L’Encyclopédie/1re édition/Tome 2
La reconnoissance & l’équité nous obligent à commencer cet Avertissement par annoncer les Savans qui ont bien voulu concourir à la composition de ce second Volume & des suivans.
Nous ne pouvons trop nous hâter de publier que M. de Buffon nous a donné pour un des Volumes qui suivront celui-ci l’article Nature ; article d’autant plus important, qu’il a pour objet un terme assez vague, souvent employé, mais bien peu défini, dont les Philosophes même n’abusent que trop, & qui demande, pour être développé & présenté sous ses différentes faces, toute la sagacité, la justesse, & l’élévation que M. de Buffon fait paroître dans les sujets qu’il traite.
M. le Chevalier de Jaucourt, que la douceur de son commerce & la variété de ses connoissances ont rendu cher à tous les gens de Lettres, & qui s’applique avec un succès distingué à la Physique & à l’Histoire Naturelle, nous a communiqué des articles nombreux, étendus, & faits avec tout le soin possible. On en trouvera plusieurs dans ce Volume, & nous avons eu soin de les désigner par le nom de leur Auteur. Ces articles sont les débris précieux d’un Ouvrage immense, qui a péri dans un naufrage, & dont il n’a pas voulu que les restes fussent inutiles à sa patrie.
M. de Mondorge, généralement estimé par la finesse de son goût, & par son amour éclairé pour les Lettres & pour les Beaux-Arts, a donné sur la Gravûre en couleur, un Mémoire important, dont on fera usage à l’article Gravure.
M. Venel, dont nous avons parlé avec éloge dans le Discours Préliminaire, & qui nous avoit déjà communiqué plusieurs éclaircissemens utiles, ne s’est pas borné à ce travail ; il a bien voulu se charger d’un grand nombre d’articles, à la fin desquels on verra son nom, & dont quelques-uns se trouvent déjà dans ce Volume.
M. l’Abbé de Sauvages, de la Société royale des Sciences de Montpellier, auteur de plusieurs excellens Mémoires, imprimés dans le recueil de l’Académie des Sciences de Paris, a fourni un morceau curieux sur les Toiles peintes, & un autre sur le Sel de marais.
Mais nous devons sur-tout beaucoup à une Personne, dont l’Allemand est la Langue maternelle, & qui est très-versée dans les matieres de Minéralogie, de Métallurgie, & de Physique ; elle nous a donné sur ces différens objets une multitude prodigieuse d’articles, dont on trouvera déjà une quantité considérable dans ce second Volume. Ces articles sont extraits des meilleurs ouvrages Allemands sur la Chimie, que la Personne dont nous parlons a bien voulu nous communiquer. On sait combien l’Allemagne est riche en ce genre ; & nous osons en conséquence assûrer que notre Ouvrage contiendra sur une si vaste matiere un grand nombre de choses intéressantes & nouvelles, qu’on chercheroit en vain dans nos livres François.
Ce Savant ne s’est pas contenté de nous rendre un si grand service. Il nous a fourni encore plusieurs articles sur d’autres matieres : mais il a exigé que son nom demeurât inconnu ; c’est ce qui nous empêche de faire connoître au Public le nom de ce Philosophe citoyen, qui cultive les Sciences sans intérêt, sans ambition, & sans bruit ; & qui, content du plaisir d’être utile, n’aspire pas même à la gloire si légitime de le paroître.
Les seules critiques auxquelles nous nous croyons obligés de répondre dans cet Ouvrage, consistent dans les plaintes de quelques personnes à qui on n’aura pas rendu justice. Nous tâcherons d’y satisfaire d’une maniere digne d’elles & de nous ; & nous commencerons aujourd’hui par M. Vaucanson. Cet illustre Académicien, célébré dans l’Encyclopédie aux articles Automate & Androide, comme les hommes supérieurs le doivent être, s’est plaint avec raison de l’article Asple, dans lequel on a fait sur un simple oui-dire une exposition infidele & peu favorable d’une très-belle machine de son invention, dont il a publié la description depuis, & dont on a paru vouloir partager la découverte, quoique sans aucune intention de la partager en effet, mais par un simple mal-entendu qu’il importe peu de détailler ici. La confiance avec laquelle M. Vaucanson a bien voulu s’adresser à nous, a été reçûe de notre part avec tous les égards que l’on doit aux vrais talens ; il nous a paru aussi satisfait de nos procédés, que nous l’avons été des siens ; & nous sommes convenus de réformer cet article, & de distribuer avec le second volume la feuille corrigée. M. Vaucanson a fait plus : il a bien voulu nous avertir de quelques erreurs où l’on est tombé dans ce même article, en suivant à la lettre le réglement de Piémont, qui passe néanmoins pour le meilleur qu’il y ait en son genre ; & ces erreurs seront rectifiées par la même occasion dans la nouvelle feuille.
On a attribué par méprise dans le Discours Préliminaire la derniere édition de Daviler à M. Blondel ; il n’est Auteur que des Planches. L’édition est d’un homme de Lettres très-connu par son goût & par ses lumieres, M. Mariette, dont le Traité des Pierres gravées a été si bien reçû du Public.
On ne doit point perdre de vûe en lisant cet Ouvrage, 1o. que chacun des Auteurs répond de ses articles, & ne répond que des siens : c’est pour cela qu’on a designé ceux de chacun par une marque distinctive ; 2o. que l’Encyclopédie, quoiqu’elle renferme certainement, & de l’aveu de tout le monde, un très-grand nombre de choses qui lui sont propres, ne peut & ne doit être néanmoins dans sa plus grande partie, qu’un recueil de ce qui se trouve ailleurs. Plusieurs de ceux qui ont travaillé à ce Dictionnaire ont cité fort exactement les sources où ils ont puisé ; les autres l’auroient dû faire sans doute : mais quand les articles empruntés sans citation, sont bien faits d’ailleurs, l’inconvénient qui résulte de cette omission par rapport à l’Ouvrage, paroît assez léger. Au reste, il sera facile, si le Public le juge à propos, de donner dans un des Volumes suivans la liste des principaux ouvrages qui ont servi à la composition de l’Encyclopédie ; on a déjà averti dans le Discours Préliminaire que tous les Dictionnaires ont été plus ou moins utiles, quoique plusieurs des Auteurs n’y ayent eu nullement recours.
Dans le Discours préliminaire, page xlj. ligne 32 & 33, au lieu de ces mots, des nouvelles vûes, lisez des vûes nouvelles. ibid. ligne 53. depuis le mot entr’autres, effacez le reste de la phrase.
A l’article Abdication, au lieu de Philippe IV. lis. Philippe V.
A l’article Adra, ligne pénultieme, au lieu de 16, lis. 61.
A l’article Acanthe, en Architecture, lig. 33, au lieu de Villapaude, lis. Villapande.
A l’article Acceptation, p. 68, col. 1, lig. 17, au lieu de par lesquelles, lis. par laquelle.
Quelques erreurs de copiste s’étant glissées dans l’impression de la Table des Accords, article Accord du volume précédent, on a cru devoir rétablir ici le commencement de cette Table.
reçûs dans l’Harmonie.

Cet accord constitue le ton, & ne se fait que sur la tonique ; sa tierce peut être majeure ou mineure, & c’est ce qui constitue le mode.

Aucun des sons de cet accord ne peut s’altérer.

La tierce, la quinte, & la septieme de cet accord peuvent s’altérer.

Aucun des sons de cet accord ne peut s’altérer.

Je joins ici par-tout le mot ajoûté, pour distinguer cet accord & ses renversés des productions semblable, de l’accord de septieme.
Ce dernier renversement qui porte le nom d’accord ajoûté de septieme, est très-bon, & pratiqué par les meilleurs Musiciens, même par tel qui le desaprouve ; mais ce n’est pas ici le lien de m’étendre sur ce sujet.
N. B. Voyez à l’article Accord le reste de la table.
A l’article Accouplement, ligne 5, au lieu de Mansard, lis. François Mansard.
Ibid. ligne 11, au lieu de Desbrosses, lis. de Brosse. C’est ainsi que se nommoit ce fameux architecte, qu’on a appellé mal-à-propos Desbrosses dans le premier volume de l’Encyclopédie.
A l’article Adrianistes, à la fin il faut Lindan, au lieu de Lidan.
A l’article Adrumete, au lieu de Bysance, lisez Bysacène.
A la fin de l’article Agir, ajoûtez : cet article est tiré du Traité des premieres vérités, dans le Cours des Sciences du P. Buffier, Jésuite.
Dans l’art. Agnus Scythicus, p. 179, col. 2, lig. 28 & 29, au lieu de Sigismond, d’Hesberetein, lis. Sigismond d’Herberstain. Ibid. page 180, col. 1, lig. 10, au lieu d’après, lis. avant.
A l’article Alastor, au lieu d’Ophnéus & Dyctéus, lis. Orphnéus & Nyctéus.
A la fin de l’article Alcove, ajoûtez : On a fait alcove masculin, quoique Despreaux ait dit une alcove enfoncée, en parlant du lit de la Mollesse ; parce qu’il semble que l’usage fait aujourd’hui alcove plus masculin que féminin. Au reste on peut lui donner quel genre on veut, cela est assez indifférent ; l’étymologie de ce mot, qui est peu connue & assez obscure, ne fournissant sur ce point aucune décision. Il n’en est pas de même d’antichambre & d’automne, dont nous avons fait le premier féminin, & le second masculin, contre l’usage qui paroît commencer à s’établir, & qui néanmoins n’a pas encore pris le dessus. Il nous paroît ridicule de faire chambre féminin, & antichambre masculin : à l’égard d’automne, tout concourt à le rendre masculin ; les trois autres saisons qui sont de ce genre en notre langue, & l’étymologie autumnus qui est du masculin. La terminaison par un e muet ne prouve rien en faveur du genre ; car verre, tonnerre, &c. & une infinité d’autres, sont masculins, quoique terminés par un e muet.
En général, c’est sur-tout où nous en voulions venir, il faut distinguer dans les langues l’usage absolument établi, de celui qui ne l’est pas encore, & qui veut, pour ainsi dire, s’établir. On doit absolument se soûmettre au premier ; à l’égard du second, on doit s’y opposer quand il n’est pas raisonnable. Si nos peres avoient suivi cette maxime, ils n’auroient pas laissé vieillir une infinité de mots & de constructions énergiques, dont nous regrettons aujourd’hui la perte.
Dans l’article Algebre, ligne 15, au lieu d’avec lis. contre. A la fin du même article, ajoûtez : Cet article traduit en partie de Chambers, mais corrigé & fort augmenté, a été tiré par cet auteur du Lexique mathématique de Harris, un des ouvrages qui ont été annoncés dans le Prospectus comme ayant servi à la composition de l’Encyclopédie.
A la fin de l’article Ame, p. 340, immédiatement avant la lettre (X) ajoûtez : Une partie de cet article a été tirée d’un Traité de M. Jacquelot sur l’existence de Dieu.
Ame, en Lutherie, est un petit morceau de bois placé droit près du chevalet, entre les deux tables des instrumens à archet. Le son de ces instrumens dépend en partie de la position de l’ame.
A la fin de l’article Amitié, ajoûtez : Voyez le Traité de la Soc. civile du P. Buffier.
A la fin de l’article An, ajoûtez : Cet article traduit de Chambers, & augmenté, a été tiré par l’auteur Anglois des élémens de Chronologie de M. Wolf.
A la fin de l’article Ana, ajoûtez :
Ana, (Littérature.) on appelle ainsi des recueils des pensées, des discours familiers, & de quelques petits opuscules d’un homme de lettres, faits de son vivant par lui-même, ou plus souvent après sa mort par ses amis. Tels sont le Menagiana, le Bolœana, &c. & une infinité d’autres. On trouve dans les Mémoires de Littérature de M. l’abbé d’Artigny, tome I. un article curieux sur les livres en ana, auquel nous renvoyons : tout ce que nous croyons à propos d’observer, c’est que la plûpart de ces ouvrages contiennent peu de bon, assez de médiocre, & beaucoup de mauvais ; que plusieurs deshonorent la mémoire des hommes célebres à qui ils semblent consacrés, & dont ils nous dévoilent les petitesses, les puérilités, & les momens foibles ; qu’en un mot, selon l’expression de M. de Voltaire, on les doit, pour la plûpart, à ces éditeurs qui vivent des sottises des morts.
Dans l’article Analogie, les deux premiers alinea & les deux derniers sont de M. du Marsais.
A la fin de l’article Anatomie, ajoûtez : La chronologie des Anatomistes qu’on trouve dans cet article, plus exacte & plus complette que celle du dictionnaire de Medecine de M. James, a été faite d’après un mémoire communiqué par l’un des plus savans & des plus respectables Medecins de l’Europe.
A l’article Antipodes, p. 513, lig. 50, après ces mots, du côté du fait, ajoûtez : Je dois avertir au reste que, selon plusieurs auteurs, ce Virgile n’étoit que prêtre, au moins dans le tems de cette affaire, & qu’il n’a été évêque de Saltzbourg que depuis ; que selon d’autres enfin, il n’a jamais été évêque ; question très-peu importante dans le cas dont il s’agit.
Je suis fort étonné, &c.
A l’article Approches, p. 558, col. 1, ligne 23, au lieu de serpe, lis. sape.
A l’article Approximation, p. 559, col. 1, ligne 22, au lieu de , lis. .
A l’article Arabes, on a écrit par mégarde en deux ou trois endroits Islamime pour l’Islamisme, qui est la même chose que le Mahométisme.
A l’article Arcade, en Jardinage, lig. 16, au lieu de fendues, lis. formées.
A l’article Architecte, p. 616, col. 2, lig. 21, au lieu de Desbrosses, lis. de Brosse.
Ibid. lig. 24, après ces mots du Val-de-Grace, ajoûtez du Palais-royal.
A l’article Architecture, p. 618, col. 1, ligne 47, au lieu de Cambray, lis. Chambray.
Dans la même page, col. 2, lig. 1, au lieu de ces mots dont nous avons un excellent traité du Jardinage, mettez qui a dessiné les planches de l’excellent traité du Jardinage de M. d’Argenville, dont il est parlé dans le Discours Préliminaire, p. xlij.
A la fin d’Aristotélisme, ajoûtez : L’auteur a cru pouvoir semer ici quelques morceaux de l’ouvrage de M. Deslandes, qui font environ la dixieme partie de ce long article ; le reste est un extrait substantiel & raisonné de l’histoire Latine de la philosophie de Brucker ; ouvrage moderne, estime des étrangers, peu connu en France, & dont on a fait beaucoup d’usage pour la partie philosophique de l’Encyclopédie, comme dans l’article Arabes, & dans un très-grand nombre d’autres.
A l’article Arithmétique universelle, page 676, col. 2, lig. 57 ; & p. 677, col. 1, lig. 12, on a mis par mégarde 40 au lieu de 60, comme la suite du discours le montre.
A l’article Arme, p. 689, lig. 11, col. 2, à compter d’en-bas, au lieu de Lerngei, lis. Langey.
A l’article Astronomie, p. 784, lig. 53, au lieu d’Achilles Statius, lis. Achilles Tatius, comme il est écrit plus bas, p. 787, col. 2, vers la fin.
A la fin de l’article Audace, ajoûtez : Nous disons avec raison qu’audace se prend toûjours en mauvaise part : en vain nous objecteroit-on qu’on dit quelquefois une noble audace ; il est évident qu’alors l’épithete noble détermine audace à être pris dans un sens favorable ; mais cela ne prouve pas que le mot audace, quand il est seul, se prenne en bonne part. Il n’est presque point de mot dans la langue, qui ne se puisse prendre en bonne part, quand on y joint une épithete convenable : ainsi Flechier a dit une prudente témérité, en parlant de M. de Turenne. Cependant un écrivain aura raison quand il dira que le terme de témérité, & une infinité d’autres, se prennent toûjours en mauvaise part. Il est évident qu’il s’agit ici de ces termes pris tout seuls, & sans aucune épithete favorable nécessaire pour changer l’idée naturelle que nous y attachons.
A la fin de l’article Augustiniens, on lit ; ce système approche fort du Thomisme, pour l’état de nature innocente, & du Molinisme, pour l’état de nature tombée : les mots Molinisme & Thomisme sont ici visiblement transposés.
N. B. Un mal entendu, qui n’aura pas lieu dans ce volume & dans les suivans, est cause que dans le premier volume la lettre de M. l’abbé Yvon se trouve aux articles Agir, Amitié, Amour, Adultere, Action, qui ont été fournis par une autre personne. Au reste les éloges qu’on a donnés dans le Discours Préliminaire aux différens auteurs de l’Encyclopédie, supposent que les articles qui portent leur nom, dont par conséquent ils répondent seuls, & qu’on a dû croire leur appartenir, soient en effet à eux. Le travail des éditeurs, comme éditeurs, consiste uniquement à réunir & à publier l’ouvrage des autres avec le leur : mais ils n’ont jamais prétendu s’engager, ni à réformer les articles faits par d’autres, ni à remonter aux sources d’où l’on a pû les tirer.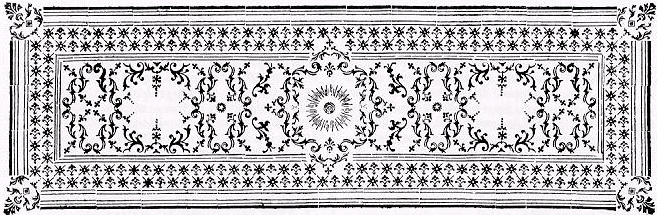
ENCYCLOPÉDIE, DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS.

B, s. m. (Gramm.) c’est la seconde lettre de l’alphabet dans la plûpart des langues, & la premiere des consonnes.
Dans l’alphabet de l’ancien Irlandois, le b est la premiere lettre, & l’a en est la dix-septieme.
Les Ethiopiens ont un plus grand nombre de lettres que nous, & n’observent pas le même ordre dans leur alphabet.
Aujourd’hui les maîtres des petites écoles, en apprenant à lire, font prononcer be, comme on le prononce dans la derniere syllabe de tom-be, il tombe : ils font dire aussi, avec un e muet, de, fe, me, pe ; ce qui donne bien plus de facilité pour assembler ces lettres avec celles qui les suivent. C’est une pratique que l’auteur de la Grammaire générale du P. R. avoit conseillée il y a cent ans, & dont il parle comme de la voie la plus naturelle pour montrer à lire facilement en toutes sortes de langues ; parce qu’on ne s’arrête point au nom particulier que l’on a donné à la lettre dans l’alphabet, mais on n’a égard qu’au son naturel de la lettre, lorsqu’elle entre en composition avec quelqu’autre.
Le b étant une consonne, il n’a de son qu’avec une voyelle : ainsi quand le b termine un mot, tels que Achab, Joab, Moab, Oreb, Job, Jacob, après avoir formé le b par l’approche des deux levres l’une contre l’autre, on ouvre la bouche & on pousse autant d’air qu’il en faut pour faire entendre un e muet, & ce n’est qu’alors qu’on entend le b. Cet e muet est beaucoup plus foible que celui qu’on entend dans syllabe, Arabe, Eusebe, globe, robbe. V. Consonne.
Les Grecs modernes, au lieu de dire alpha, beta, disent alpha, vita : mais il paroît que la prononciation qui étoit autrefois la plus autorisée & la plus générale, étoit de prononcer beta.
Il est peut-être arrivé en Grece à l’égard de cette lettre, ce qui arrive parmi nous au b : la prononciation autorisée est de dire be ; cependant nous avons des provinces où l’on dit ve Voici les principales raisons qui font voir qu’on doit prononcer beta.
Eusebe, au livre X. de la Préparation évangéiique, ch. vj. dit que l’alpha des Grecs vient de l’aleph des Hébreux, & que beta vient de beth : or il est évident qu’on ne pourroit pas dire que vita vient de beth, sur-tout étant certain que les Hébreux ont toûjours prononcé beth.
Eustathe dit que βῆ, βῆ, est un son semblable au bêlement des moutons & des agneaux, & cite ce vers d’un ancien :
Is satuus perinde ac ovis be, be dicens incedit.
Saint Augustin, au liv. II. de Doct. christ. dit que ce mot & ce son beta est le nom d’une lettre parmi les Grecs ; & que parmi les Latins, beta est le nom d’une herbe : & nous l’appellons encore aujourd’hui bete ou bete-rave.
Juvenal a aussi donné le même nom à cette lettre :
Hoc discunt omnes ante alpha & beta puella.
Belus, pere de Ninus, roi des Assyriens, qui fut adoré comme un dieu par les Babyloniens, est appellé βῆλος, & l’on dit encore la statue de Beel.
Enfin le mot alphabetum dont l’usage s’est conservé jusqu’à nous, fait bien voir que beta est la véritable prononciation de la lettre dont nous parlons.
On divise les lettres en certaines classes, selon les parties des organes de la parole qui servent le plus à les exprimer ; ainsi le b est une des cinq lettres qu’on appelle labiales, parce que les levres sont principalement employées dans la prononciation de ces cinq lettres, qui sont b, p, m, f, v.
Le b est la foible du p : en serrant un peu plus les levres, on fait p de b, & fe de ve ; ainsi il n’y a pas lieu de s’étonner si l’on trouve ces lettres l’une pour l’autre. Quintilien dit que quoique l’on écrive obtinuit, les oreilles n’entendent qu’un p dans la prononciation, optinuit : c’est ainsi que de scribo on fait scripsi.
Dans les anciennes inscriptions on trouve apsens pour absens, pleps pour plebs, poplicus pour publicus, &c.
Cujas fait venir aubaine ou aubene d’advena, étranger, par le changement de v en b : d’autres disent aubains quasi alibi nati. On trouve berna au lieu de verna.
Le changement de ces deux lettres labiales v, b, a donné lieu à quelques jeux de mots, entr’autres à ce mot d’Aurélien, au sujet de Bonose qui passoit sa vie à boire : Natus est non ut vivat, sed ut bibat. Ce Bonose étoit un capitaine originaire d’Espagne ; il se fit proclamer empereur dans les Gaules sur la fin du IIIe. siecle. L’empereur Probus le fit pendre, & l’on disoit, c’est une bouteille de vin qui est pendue.
Outre le changement du b en p ou en v, on trouve aussi le b changé en f ou en φ, parce que ce sont des lettres labiales ; ainsi de βρέμω est venu fremo, & au lieu de sibilare on a dit sisilare, d’où est venu notre mot siffler. C’est par ce changement réciproque que du grec ἄμφω les Latins ont fait ambo.
Plutarque remarque que les Lacédémoniens changeoient le φ en b ; qu’ainsi ils prononçoient Bilippe au lieu de Philippe.
On pourroit rapporter un grand nombre d’exemples pareils de ces permutations de lettres ; ce que nous venons d’en dire nous paroît suffisant pour faire voir que les réflexions que l’on fait sur l’étymologie, ont pour la plûpart un fondement plus solide qu’on ne le croit communément.
Parmi nous les villes où l’on bat monnoie, sont distinguées les unes des autres par une lettre qui est marquée au bas de l’écu de France. Le B fait connoître que la piece de monnoie a été frappée à Roüen.
On dit d’un ignorant, d’un homme sans lettres, qu’il ne sait ni a ni b. Nous pouvons rapporter ici à cette occasion, l’épitaphe que M. Menage fit d’un certain abbé :
Ci-dessous git monsieur l’abbé
Qui ne savoit ni a ni b ;
Dieu nous en doint bientôt un autre
Qui sache au moins sa patenôtre.(F)
B, chez les Grecs & chez les Romains, étoit une lettre numérale qui signifioit le nombre deux quand elle étoit figurée simplement ; & avec un accent dessous b, elle marquoit deux mille chez les Grecs.
B, dans les inscriptions, signifie quelquefois binus. On y trouve bixit pour vixit, berna pour verna ; parce que les anciens, comme on l’a dit plus haut, employoient souvent le b pour l’v consonne.
Les Egyptiens dans leurs hiéroglyphes, exprimoient le b par la figure d’une brebis, à cause de la ressemblance qu’il y a entre le bêlement de cet animal & le son de la lettre b. (G)
B, FA, SI, ou B FA, B MI, ou simplement B, est le nom d’un des sept sons de la gamme de l’Aretin, dans lequel les Italiens & les autres peuples de l’Europe repetent le b ; parce qu’ils n’ont point d’autre nom pour exprimer la note que les François appellent si. Voyez Gamme.
B MOL ou BEMOL, caractere de Musique qui a à peu-près la figure d’un b, & fait abbaisser d’un semi-ton mineur la note à laquelle il est joint.
Guy d’Arezzo ayant autrefois donné des noms à six des notes de l’octave, laissa la septieme sans autre nom que celui de la lettre b, qui lui est propre, comme le c à l’ut, le d au ré, &c. Or ce b se chantoit de deux manieres ; savoir, à un ton au-dessus du la selon l’ordre naturel de la gamme, ou seulement à un semi-ton du même la, lorsqu’on vouloit conjoindre les deux tétracordes. Dans le premier cas le si sonnant assez durement à cause des trois tons consécutifs, on jugea qu’il faisoit à l’oreille un effet semblable à celui que les corps durs & anguleux font à la main ; c’est pourquoi on l’appella b dur, ou b quarre, b quadro : dans le second cas, au contraire, on trouva que le si étoit extrèmement doux à l’oreille ; c’est pourquoi on l’appella b mol, & par la même analogie on l’auroit encore pû appeller b rond.
Il y a deux manieres d’employer le b mol : l’une accidentelle, quand dans le cours du chant on le place à la gauche d’une note ; cette note est presque toûjours la note sensible dans les tons majeurs, & quelquefois la sixieme note dans les tons mineurs, quand il n’y a pas à la clé le nombre de bémols qui doit y être. Le b mol accidentel n’altere que la note qu’il touche, ou tout au plus, celles qui dans la même mesure se trouvent sur le même degré, sans aucun signe contraire.
L’autre maniere est d’employer le b mol à la clé, & alors il agit dans toute la suite de l’air, & sur toutes les notes qui sont placées parallelement à lui sur la même ligne ou dans le même espace, à moins qu’il ne soit contrarié accidentellement par quelque dièse ou b quarre, ou que la clé ne change.
La position des b mols à la clé n’est pas arbitraire : en voici la raison. Ils sont destinés à changer le lieu des semi-tons de l’échelle : or ces deux semi-tons doivent toûjours garder entr’eux un intervalle prescrit, c’est-à-dire il faut que leurs notes homologues soient entr’elles à la distance d’une quarte d’un côté, & d’une quinte de l’autre ; ainsi la note mi inférieure de son semi-ton, fait au grave la quinte du si, qui est son homologue dans l’autre semi-ton, & à l’aigu la quarte du même si ; & la note si fait au grave la quarte du mi, & à l’aigu la quinte du même mi.
Si, par exemple, on donnoit un b mol au mi, le semi-ton changeroit de lieu, & se trouveroit descendu d’un degré entre le ré & le mi b mol. Or dans cette position il est évident que les deux semi-tons ne garderoient plus entr’eux la distance prescrite ; car le ré qui seroit la note inférieure de l’un, seroit au grave la sixte du si, son homologue dans l’autre, & à l’aigu la tierce du même si ; & ce si feroit au grave la tierce du ré, & à l’aigu la sixte du même ré : ainsi les deux semi-tons seroient trop près d’un côté, & trop éloignés de l’autre.
L’ordre des b mols ne doit donc pas commencer par mi, ni par aucune autre note de l’octave que par si, la seule qui n’a pas le même inconvénient ; car bien que le semi-ton y change de place, & cessant d’être entre le si & l’ut, descende entre le si b mol & le la, toutefois l’ordre prescrit n’est point détruit ; car le la dans ce nouvel arrangement se trouve d’un côté à la quarte, & de l’autre à la quinte de mi son homologue, & réciproquement.
La même raison qui fait placer le premier b mol sur le si, fait mettre le second sur le mi, & ainsi de suite, en montant de quarte, ou en descendant de quinte jusqu’au sol, auquel on s’arrête ; parce que le b mol de l’ut qu’on trouveroit ensuite, ne differe point du si dans la pratique. Cela fait donc une suite de cinq b mols dans cet ordre :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| si, | mi, | la, | re, | sol. |
Toûjours par la même raison, on ne sauroit employer les derniers b mols à la clé, sans employer aussi ceux qui les précedent ; ainsi le b mol du mi ne se pose qu’avec celui du si, celui du la qu’avec les deux précédens, &c.
Nous donnerons au mot Clé une formule pour trouver tout d’un coup si un ton ou un mode donné doit porter des b mols à la clé, & combien.
B QUARRE ou BÉQUARRE, signe de Musique qui s’écrit ainsi ♮, & qui placé à la gauche d’une note, marque que cette note ayant précédemment été baissée par un b mol, ou haussée par un diese, doit être remise à son élévation naturelle ou diatonique.
Le b quarre fut inventé par Guy d’Arezzo. Cet auteur qui donna des noms aux six premieres notes de l’octave, n’en laissa point d’autre que la lettre b pour exprimer le si naturel ; car chaque note avoit dès-lors sa lettre correspondante : & comme le chant diatonique de ce si est assez dur quand il monte depuis le fa, il l’appella simplement b dur ou b quarre, par une allusion dont j’ai déjà parlé au mot B mol.
Le b quarre servit dans la suite à détruire l’effet du b mol antérieur sur une note quelconque ; il suffisoit pour cela de placer le b quarre à la gauche de cette note : c’est que le b mol se plaçant plus ordinairement sur le si, le b quarre qui venoit ensuite ne produisoit en le détruisant que son effet naturel, qui étoit de représenter la note si sans altération. A la fin on s’en servit par extension & faute d’autre signe, à détruire aussi l’effet du diese ; & c’est ainsi qu’il s’employe encore aujourd ’hui. Le b quarre efface également le diese ou le b mol qui l’ont précédé.
Il y a cependant une distinction à faire. Si le diese ou le b mol sont accidentels, ils sont détruits sans retour par le b quarre dans toutes les notes qui suivent sur le même degré, jusqu’à ce qu’il s’y présente un nouveau b mol ou un nouveau diese. Mais si le b mol ou le diese sont à la clé, le b quarre ne les efface que pour la note qu’il précede, ou tout au plus pour la mesure où il se trouve ; & à chaque degré altéré à la clé, il faut sans cesse un nouveau b quarre. Tout cela est assez mal imaginé : mais tel est l’usage.
Quelques-uns donnoient un autre sens au b quarre, & lui accordant seulement le droit de rétablir les diese, ou b mols accidentels, lui ôtoient celui de rien changer à la disposition de la clé ; de sorte qu’en ce sens le b quarre sur un fa diésé, ou sur un si bémolisé à la clé, ne serviroit que pour détruire un diese accidentel sur ce si, ou un b mol sur ce fa, & signifieroit toûjours un fa diese, ou un si b mol.
D’autres enfin se servoient bien du b quarre pour effacer le b mol, même celui de la cle, mais jamais pour effacer le diese. C’est le b mol seulement qu’ils employoient dans ce dernier cas.
Le premier usage prévaut à la vérité ; ceux-ci sont plus rares & s’abolissent tous les jours : mais il est bon d’y faire attention en lisant d’anciennes musiques. (S)
* B, en Ecriture ; cette lettre considérée dans sa forme italienne, est composée de deux i l’un sur l’autre, & conjoints avec l’o : dans sa forme coulée, c’est la tête de la seconde partie de l’x, l’i & l’o : dans la ronde, c’est la quatrieme & huitieme partie de l’o, l’i, & le second demi-cercle de l’o.
La premiere partie des deux premiers b, se forme par le mouvement simple des doigts, du plié & de l’allongé : la seconde partie du même b, & le dernier b en entier, se forment par un mouvement mixte des doigts & du poignet.
* BA, (Géog. mod.) ville d’Afrique dans la Guinée, au royaume d’Arder.
BAAL ou BEL, (Hist. anc.) nom qui signifie seigneur en langue Babylonienne, & que les Assyriens donnerent à Nemrod, lorsqu’après sa mort ils l’adorerent comme un Dieu. Baal étoit le dieu de quelques peuples du pays du Chanaan. Les Grecs disent que c’étoit Mars, & d’autres que c’étoit ou Saturne ou le Soleil. L’historien Josephe appelle le dieu des Phéniciens Baal ou Bel, dont Virgile parle dans l’Enéide comme d’un roi de Tyr :
Implevitque mero pateram, quam Belus, & omnes A Belo soliti.
Godwin, fondé sur la ressemblance des noms, croit que le Baal des Phéniciens est le même que Moloch : le premier signifie seigneur, & le second, prince ou roi. Cependant d’autres pensent que ces peuples adoroient Saturne sous le nom de Moloch, & Jupiter sous celui de Baal : car ils appelloient ce dernier dieu, Baal semen, le seigneur du ciel. Quoi qu’il en soit de ces différentes opinions, le culte de Baal se répandit chez les Juifs, & fut porté à Carthage par les Tyriens ses fondateurs. On lui sacrifioit des victimes humaines, & des enfans, en mémoire de ce que se trouvant engagé dans une guerre dangereuse, il para son fils des ornemens royaux, & l’immola sur un autel qu’il avoit dressé lui-même. Jérémie reproche aux Juifs qu’ils brûloient leurs enfans en holocauste devant l’autel de Baal ; & dans un autre endroit, que dans la vallée d’Ennon ils faisoient passer leurs enfans par le feu en l’honneur de Moloch. Les Rabbins pour diminuer l’horreur de cette idolatrie, s’en sont tenus à cette seconde cérémonie. Non comburebant illos, disent-ils de leurs ancêtres, sed tantum traducebant illos per ignem. Mais si dans le culte de Baal il n’en coûtoit pas toûjours la vie à quelqu’un, ses autels au moins étoient souvent teints du sang de ses propres prêtres, comme il paroît par le fameux sacrifice où Elie les défia. Incidebant se juxta ritum suum cultris & lanceolis, donec profunderentur sanguine. Lib. III. Reg. Voyez Belus. (G)
* BAALA, (Géog. sainte.) ville de la Palestine dans la tribu de Juda, où l’arche fut en dépôt pendant vingt ans. Il y eut dans la tribu de Juda une autre ville de même nom, qui passa ensuite dans celle de Siméon.
Baala, montagne de la Palestine, qui bornoit la tribu de Juda du côté du Nord.
BAALAM, ville de la Palestine dans la demi-tribu de Manassés.
* BAAL-BERITH, (Myth.) Ce mot est composé de Baal, seigneur, & de berith, alliance, Dieu de l’alliance. C’est sous ce nom que les Carthaginois, & avant eux les Phéniciens, prenoient à témoin les dieux dans leurs alliances.
* BAAL-GAD ou BAGAD, ou BEGAD, (Hist. anc. & Myth.) idoles des Syriens ; leur nom est composé de baal, seigneur, & de gad, hasard ou fortune, dieux de la fortune ou du hasard. Le dieu du hasard est, après le dieu du tonnerre, un de ceux qui a dû avoir le premier des autels parmi les hommes.
* BAAL-HASOR, (Géog. sainte.) lieu voisin de la tribu d’Ephraim, où Absalon vengea le viol de sa sœur Thamar.
* BAAL-HERMON, (Géog. sainte.) montagne & ville au-delà du Jourdain, au nord de la tribu de Manassés.
BAALITES, s. m. pl. (Hist. anc.) secte d’impies, parmi le peuple d’Israel. Ils adoroient Baal, ou l’idole de Bel. Nous lisons dans le troisieme livre des Rois, qu’Achab & Jesabel sacrifioient tous les jours à cette idole ; & qu’Elie ayant convaincu de superstition les prêtres de ce faux dieu par un miracle qu’il fit à la vûe d’Achab & du peuple, ces sacrificateurs au nombre de quatre cens cinquante furent tous mis à mort. Ancien Testament, III. liv. des Rois, ch. xviij. Voyez Baal. (G)
* BAALMEON, (Géog. sainte.) ville de la Palestine, bâtie par la tribu de Ruben.
* BAAL-PHARASIM, (Géog. sainte.) ville des Philistins dans la tribu de Juda.
* BAAL-THAMAR, (Géog. sainte.) plaine dans la tribu de Benjamin, où toutes les tribus s’assemblerent pour venger l’outrage fait à la femme d’un Lévite de la tribu d’Ephraïm. BAAL-TSEPHON. Voyez Beelzephon.
* BAAL-PEOR, (Myth.) de Baal, seigneur, & de Peor, nom d’une montagne ; dieu que les Arabes adoroient sur la montagne de Peor : on croit que c’est le Priape des Grecs. On l’appelle encore BAAL-PHEGOR ou BEELPHEGOR, ou BELPHEGOR. Voyez Belphegor.
* BAAL-PHEGOR ou BEELPHEGOR, ou BELPHEGOR. Voyez Belphegor.
* BAALTIS, s. f. (Myth.) déesse adorée des Phéniciens : on la fait sœur d’Astarté, & femme de Saturne, dont elle n’eut que des filles. On croit que ce fut la diane des Grecs, revérée particulierement à Biblos sous le nom de Baaltis.
BAANITES, s. m. pl. (Hist. ecclés.) hérétiques, sectateurs d’un certain Baanès, qui se disoit disciple d’Epaphrodite, & semoit les erreurs des Manichéens dans le ix. siecle, vers l’an 810. Pierre de Sicile, Hist. du Manich. renaissant. Baronius, A. C. 810. (G)
* BAAR, (Géog.) comté d’Allemagne en Suabe, dans la principauté de Furstemberg, vers la source du Danube & du Neckre, proche la forêt Noire & les frontieres du Brisgaw. On appelle quelquefois les montagnes d’Abennow de son nom, montagnes de Baar.
* BAARAS, (Géog. & Hist. nat.) nom d’un lieu & d’une plante qu’on trouve sur le mont Liban en Syrie, au-dessus du chemin qui conduit à Damas. Josephe dit qu’elle ne paroît qu’en Mai, après que la neige est fondue ; qu’elle luit pendant la nuit comme un petit flambeau ; que sa lumiere s’éteint au jour ; que ses feuilles enveloppées dans un mouchoir s’échappent & disparoissent ; que ce phénomene autorise l’opinion qu’elle est obsédée des démons, qu’elle a la vertu de changer les métaux en or, & que c’est par cette raison que les Arabes l’appellent l’herbe d’or ; qu’elle tue ceux qui la cueillent sans les précautions nécessaires ; que ces précautions sont malheureusement inconnues ; qu’elle se nourrit, selon quelques Naturalistes, de bitume ; que l’odeur bitumineuse que rend sa racine, quand on l’arrache, suffoque ; que c’est ce bitume enflammé qui produit sa lumiere pendant la nuit ; que ce qu’elle perd en éclairant n’étant que le superflu de sa nourriture, il n’est pas étonnant qu’elle ne se consume point ; que sa lumiere cesse quand ce superflu est consumé ; & qu’il faut la chercher dans les endroits plantés de cedres. Combien de rêveries ! & c’est un des historiens les plus sages & les plus respectés qui nous les débite.
BAAT, s. m. (Com.) monnoie d’argent du royaume de Siam. Le baat sert aussi de poids ; sa forme est un quarré sur lequel sont empreints des caracteres assez ressemblans à ceux des Chinois : mais ils sont mal frappés. Comme on altere souvent le baat par ses angles ou côtés, il ne faut le prendre ni comme poids, ni en payement, sans en avoir fait l’examen. Son poids est de trois gros deux deniers & vingt grains, poids de marc de France ; son titre neuf deniers douze grains : il vaut deux livres neuf sols sept deniers argent de France. Cette monnoie a cours à la Chine ; on l’appelle tical. Voyez Tical.
* BABA, (Géog.) ville de la Turquie en Europe, dans la basse Bulgarie sur la mer Noire, vers les bouches du Danube, entre Prostoviza & Catu.
* BABEL, (Hist. sacr. ant.) en Hébreu confusion, nom d’une ville & d’une tour dont il est fait mention dans la Genese, chap. ij. situées dans la terre de Sennaar, depuis la Chaldée, proche l’Euphrate, que les descendans de Noé entreprirent de construire avant que de se disperser sur la surface de la terre, & qu’ils méditoient d’élever jusqu’aux cieux : mais Dieu réprima l’orgueil puérile de cette tentative que les hommes auroient bien abandonnée d’eux-mêmes. On en attribue le projet à Nemrod, petit-fils de Cham : il se proposoit d’éterniser ainsi sa mémoire, & de se préparer un asyle contre un nouveau déluge. On bâtissoit la tour de Babel l’an du monde 1802. Phaleg, le dernier des patriarches de la famille de Sem, avoit alors 14 ans ; & cette date s’accorde avec les observations célestes que Callisthene envoya de Babylone à Aristote. Ces observations étoient de 1903 ans ; & c’est précisément l’intervalle de tems qui s’étoit écoulé depuis la fondation de la tour de Babel jusqu’à l’entrée d’Alexandre dans Babylone. Le corps de la tour étoit de brique liée avec le bitume. A peine fut-elle conduite à une certaine hauteur, que les ouvriers cessant de s’entendre, furent obligés d’abandonner l’ouvrage. Quelques auteurs font remonter à cet évenement l’origine des différentes langues : d’autres ajoûtent que les payens qui en entendirent parler confusément par la suite, en imaginerent la guerre des géans contre les dieux. Casaubon croit que la diversité des langues fut l’effet & non la cause de la division des peuples ; que les ouvriers de la tour de Babel se trouvant, après avoir bâti long-tems, toûjours à la même distance des cieux, s’arrêterent comme se seroient enfin arrêtés des enfans, qui croyant prendre le ciel avec la main, auroient marché vers l’horison ; qu’ils se disperserent, & que leur langue se corrompit. On trouve à un quart de lieue de l’Euphrate, vers l’orient, des ruines qu’on imagine, sur assez peu de fondement, être celles de cette fameuse tour.
* BABEL-MANDEL, (Géog. mod.) détroit ainsi appellé de l’Arabe, bab-al-mandab, porte de deuil, parce que les Arabes prenoient le deuil pour ceux qui le passoient. Il est à 12. 40. de latit. entre une île & une montagne de même nom, & joint la mer Rouge à l’Océan.
* BABEURRE, s. f. (Œconom. rust.) espece de liqueur séreuse que laisse le lait quand il est battu, & que sa partie grasse est convertie en beurre. La babeurre prise en boisson rafraîchit & humecte.
* BABIA, s. f. (Myth.) déesse révérée en Syrie, & surtout à Damas. On y donnoit le nom de babia aux enfans ; ce qui a fait conjecturer que la babia étoit déesse de l’enfance.
BABILLER, v. n. se dit en Vénerie d’un limier qui donne de la voix : ce limier babille trop, il faut lui ôter le babil, ou le rendre secret.
* BABOLZA, (Géog. anc. & mod.) ville de la basse Hongrie dans l’Eselavonie, entre Passega & Zigeth, vers la Drave. Baudrand croit que c’a été l’ancien Mansuetinium, ou pons Mansuetinus.
BABORD. Voyez Basbord.
BABOUIN, s. m. papio (Hist. nat. Zoolog.) ; c’est ainsi que l’on appelle de gros singes qui ont des queues, & qui sont différens des Cynocéphales : on distingue les babouins à longue queue, & les babouins à courte queue. Voyez Singe. (I)
* BABUL, (Géog.) ville des Indes orientales, dans une île du fleuve Indus. Quelques-uns croyent que c’est Cambaya, & d’autres Patan.
* BABYCA, (Géog. & Hist. anc.) lieu entre lequel & le Cnacion les Lacédémoniens tenoient leurs assemblées. Aristote dit que le Cnacion est la riviere, & que le Babyca est le pont ; ce qui rend ce que l’on vient de dire des Lacédémoniens entierement inintelligible ; car entre un pont & une riviere quel espace y a-t-il où un peuple puisse s’assembler ?
* BABYLONE ou BABEL, (Géog. anc. & mod.) capitale ancienne de la Chaldée, dont il reste à peine quelques ruines. Voyez dans les historiens anciens & modernes les merveilles qu’on en raconte : ce détail est hors de notre objet. On croit que Bagdat est au lieu où étoit l’ancienne Babylone : mais ce fait n’est pas constant ; il y a sur les autres endroits où on la suppose les mêmes incertitudes ; les uns en font Felouge sur l’Euphrate, à cause de ses grandes ruines ; d’autres Il ou Elle, à cause d’un amas de Décombres qu’on appelle encore la tour de Babel.
* Babylone, (Géog. anc. & mod.) ville de l’Egypte près du Nil ; le grand Caire s’est formé de ses ruines.
Bac à naviguer, c’est en Marine un petit bâtiment dont on se sert sur les canaux & les rivieres pour porter le brai & le goudron. (Z)
Bac est encore sur les Rivieres un bateau grand, large & plat, dont on se sert pour passer hommes, bêtes & voitures.
Il y a aux environs de Paris plusieurs bacs, dans les endroits éloignés des ponts.
Bac, en Jardinage ; on appelle ainsi un petit bassin, soit quarré soit rond, placé d’espace en espace dans les quarrés d’un potager, avec un robinet pour arroser. A Versailles, à Sceaux, il y en a dans chaque petit jardin. (K)
Bac a jet trempe, en terme de Brasseur, est celui qui est posé sur les chaudieres & qui a trois trous, un de chaque côté, pour pouvoir jetter d’une chaudiere dans l’autre ; celui de devant est pour jetter les eaux chaudes des chaudieres dans la cuve matiere, par le moyen de la gouttiere à jet trempe. Voyez Brasserie & Cuve matiere.
Bac a la décharge, dans les Brasseries, est un bac qui est sur un des bords d’une des chaudieres, dans lequel on jette les métiers lorsqu’ils sont cuits pour les laisser refroidir. Voyez Brasserie & Métiers.
Bac a formes, en terme de Rafinerie de sucre, c’est une grande auge de bois très-sain, en planches de quatre pouces d’épaisseur, longues de 8 à 9, & larges de 4 à 5, dans laquelle on met les formes en trempe. Voyez Trempe & Formes.
Bac a chaux, en terme de Rafinerie de sucre, c’est un grand bassin en massif de brique & de ciment, portant 9 à 10 piés de long sur 4 à 5 de large, & 6 de profondeur, dans lequel l’on éteint la chaux dont on a besoin dans les clarifications. Voyez Clarifier.
Bac a sucre, en terme de Rafinerie de sucre, n’est autre chose que plusieurs espaces séparés par des cloisons de planches, dans lesquelles on jette les matieres triées & sorties des barils.
Bac à terre, en terme de Rafineur de sucre, c’est une auge de bois de même que le bac à formes (Voyez Bac à formes) séparé en plusieurs chambrettes où l’on délaye la terre. Voyez Terre. A chaque extrémité & au-dessus de ce bac, on voit une planche percée au milieu, & qui sert de traverse à deux bouts de chevrons qui sont attachés au plancher. C’est dans le trou de cette planche que s’emmanche un ballet dont on se sert pour passer la terre par la couleresse. Voyez Couleresse.
* BACA, (Géog. sainte.) ville de la tribu d’Aser, au pié du mont Liban.
* BACA, ou BAZA, (Géog.) ville d’Espagne, au royaume de Grenade. Long. 15. 34. lat. 37. 18.
* BAÇAIM, (Géog.) ville d’Asie, avec port, au royaume de Visapour, sur la côte de Malabar. Long. 90. 40. lat. 19.
* BACALA, (Géog.) ville de la presqu’île de Jucatan, dans l’Amérique septentrionale, près du golfe d’Honduras, entre Valladolid & Salamanque.
* BACALAOS, (Géog.) terre de l’Amérique méridionale, dont on ne nous dit rien de plus.
* BACAR, (Géog. anc. & mod.) nom d’une vallée située dans la partie septentrionale du mont Liban, que les Latins appelloient Iturea Thraconitis}}.
* BACAR, ou BAXAR, (Géog.) contrée du Mogol, sur le Gange. Becaner en est la capitale.
* BAÇA-SERAY, ou BACHA-SERAI, (Géog.) ville de la presqu’île de Crimée, dans la petite Tartarie. Long. 52. 30. lat. 45. 30.
* BACAY, (Géog.) ville de l’Inde, delà le Gange, capitale du pays de même nom, sur la riviere de Pegu.
BACCALAURÉAT, s. m. le premier des degrés qu’on acquiert dans les facultés de Théologie, de Droit, & de Médecine. Voyez Bachelier.
BACCARAT, (Géog.) ville de France, en Lorraine, sur la Meurte, entre Nanci & Estival.
BACCARACH, (Géog.) ville d’Allemagne, dans le bas Palatinat, sur le Rhin. Long. 25. 15. lat. 49. 57.
BACH, (Géog.) ville de la basse Hongrie, au comté de Toln, sur le Danube.
BACCHANALES, adj. pris subst. (Hist. anc.) fêtes religieuses en l’honneur de Bacchus, qu’on célébroit avec beaucoup de solennité chez les Athéniens, où l’on en distinguoit de diverses sortes ; d’anciennes, de nouvelles, de grandes, de petites, de printanieres, d’automnales, de nocturnes, &c. Avant les olympiades, les Athéniens marquoient le nombre des années par celui des bacchanales, autrement nommées orgies, du mot Grec ὀργὴ, fureur, à cause de l’enthousiasme ou de l’ivresse qui en accompagnoit la célébration : elles tiroient leur origine d’Egypte, & furent introduites en Grece par Melampe.
A Athenes l’Archonte régloit la forme & l’ordonnance des bacchanales, qui dans les premiers tems se passoient fort simplement : mais peu à peu on les accompagna de cérémonies ou ridicules ou infames. Les prêtresses ou bacchantes couroient de nuit, à demi-nues, couvertes seulement de peaux de tigres ou de pantheres passées en écharpe, avec une ceinture de pampre ou de lierre ; les unes échevelées & tenant en main des flambeaux allumés, les autres portant des thyrses ou bâtons entourés de lierre & de feuilles de vigne, criant & poussant des hurlemens affreux. Elles prononçoient sur-tout ces mots, Εὐοῖ Σαβοῖ, εὐοῖ Βάκχε, ou ὦ Ἴακχε, ou ἰὼ Βάκχε. A leurs cris se mêloit le son des cymbales, des tambours, & des clairons. Les hommes en habits de satyres suivoient les bacchantes, les uns à pié, d’autres montés sur des ânes, traînant après eux des boucs ornés de guirlandes pour les immoler. On pouvoit appeller ces fêtes du Paganisme le triomphe du libertinage & de la dissolution ; mais sur-tout les bacchanales nocturnes où il se passoit des choses si infames, que l’an 568 de Rome, le sénat informé qu’elles s’étoient introduites dans cette ville, défendit sous les peines les plus grieves de les célébrer. C’est avec raison que les peres de l’église ont reproché aux payens ces desordres & ces abominations. (G)
BACCHANTES, prêtresses de Bacchus, nom que l’on donna d’abord à des femmes guerrieres qui suivirent Bacchus à la conquête des Indes, portant des thyrses ou bâtons entortillés de pampres de lierre & de raisins, & faisant des acclamations pour publier les victoires de ce conquérant. Après l’apothéose de ce prince, elles célébrerent en son honneur les bacchanales. De-là les mysteres de Bacchus furent principalement confiés aux femmes ; & dans les anciennes bacchanales de l’Attique, ces prêtresses étoient au nombre de quatorze. Il est pourtant fait mention dans l’antiquité d’un grand-prêtre de Bacchus, si respecté de tout le peuple, qu’on lui donnoit la premiere place dans les spectacles. Platon bannit de sa république la danse des bacchantes, & leur cortege composé de nymphes, d’égipans, de silenes, & de satyres, qui tous ensemble imitoient les ivrognes, & presque toûjours d’après nature, sous prétexte d’accomplir certaines expiations ou purifications religieuses. Ce philosophe pense que ce genre de danse n’étant convenable ni à la guerre, ni à la paix ; & ne pouvant servir qu’à la corruption des mœurs, il doit être exclus d’un état bien policé. Tacite racontant les débauches de Messaline & de ses femmes, en fait ce portrait tout semblable aux extravagances des bacchantes. Femina pellibus accinctæ assultabant, ut sacrificantes vel insanientes bacchæ. Ipsa crine fluxo, thyrsum quatiens, juxtaque Silius hedera cinctus, gerere cothurnos, jacere caput, strepente circum procaci choro. « Les femmes de Messaline revêtues de peaux bondissoient & folâtroient comme les bacchantes dans leurs sacrifices ; elle-même les cheveux épars agitoit un thyrse ; Silius (son amant) étoit à ses côtés, couronné de lierre, chaussé d’un cothurne, jettant la tête deçà & delà, tandis que cette troupe lascive dansoit autour de lui. » (G)
BACCHE, s. m. dans la Poësie Greque & Latine, espece de pié composé de trois syllabes ; la premiere breve, & les deux autres longues, comme dans ces mots, ĕgēstās, ăvārī.
Le bacche a pris son nom de ce qu’il entroit souvent dans les hymnes composées à l’honneur de Bacchus. Les Romains le nommoient encore œnotrius, tripodius, saltans, & les Grecs παρίαμϐος. Diom. III. pag. 475. Le bacche peut terminer un vers hexametre. Voyez Pié, &c. (G)
* BACCHIONITES, s. m. pl. (Hist. anc.) c’étoient, à ce qu’on dit, des philosophes qui avoient un mépris si universel pour les choses de ce bas monde, qu’ils ne se reservoient qu’un vaisseau pour boire ; encore ajoûte-t-on qu’un d’entre eux ayant apperçu dans les champs un berger qui puisoit dans un ruisseau de l’eau avec le creux de sa main, il jetta loin de lui sa tasse, comme un meuble incommode & superflu. C’est ce qu’on raconte aussi de Diogene. S’il y a jamais eu des hommes aussi desintéressés, il faut avoüer que leur métaphysique & leur morale mériteroient bien d’être un peu plus connues. Après avoir banni d’entre eux les distinctions funestes du tien & du mien, il leur restoit peu de chose à faire pour n’avoir plus aucun sujet de querelles, & se rendre aussi heureux qu’il est permis à l’homme de l’être.
* BACCHUS, (Myth.) dieu du Paganisme. On distingue particulierement deux Bacchus : celui d’Egypte, fils d’Ammon, & le même qu’Osiris ; celui de Thebes, fils de Jupiter & de Semelé, auquel on a fait honneur de toutes les actions des autres. L’Egyptien fut nourri à Nisa, ville de l’Arabie heureuse, & ce fut lui qui fit la conquête des Indes. Orphée apporta son culte dans la Grece, & attribua par adulation les merveilles qu’il en racontoit à un Prince de la famille de Cadmus. Voyez Osiris.
Le Thébain acheva dans la cuisse de son pere le reste du tems de la grossesse de sa mere, qui mourut sur son septieme mois. Euripide dans ses Bacchantes, dit que Jupiter déposa cet enfant dans un nuage pour le dérober à la jalousie de sa femme ; & Eustathe, qu’il fut nourri sur le mont Meros, qui signifie cuisse, equivoque qui aura vraissemblablement donné lieu à la premiere fable. Bacchus alla à la conquête des Indes à la tête d’une troupe de femmes & d’hommes armés de thyrses & de tambours. Les peuples effrayés de la multitude & du bruit, le reçûrent comme un dieu ; & pourquoi se seroient-ils défendus contre lui ? il n’alloit point les charger de chaînes, mais leur apprendre la culture de la vigne. On dit qu’il fit des prodiges dans l’affaire des Géans. On le représente sous la figure d’un jeune homme, sans barbe, joufflu, couronné de lierre ou de pampre, le thyrse dans une main, & des grappes de raisin ou une coupe dans l’autre. On lui immoloit le bouc & la pie ; le bouc qui mange les bourgeons, la pie que le vin fait parler. La panthere lui étoit consacrée, parce qu’il se couvroit de sa peau. Voyez Semelé, Bimater, Dionysius, Liber, Bromius, &c.
BACHA, PASCHA, ou PACHA, subst. m. (Hist. mod.) officier en Turquie. C’est le gouverneur d’une province, d’une ville, ou d’un autre département ; nous disons le bacha de Babylone, le bacha de Natolie, le bacha de Bender, &c.
Dans les bachas sont compris les beglerbegs, & quelquefois les sangiacbegs, quoiqu’ils en soient quelquefois distingués, & que le nom de bacha se donne proprement à ceux du second ordre, c’est-à-dire à ceux devant qui l’on porte deux ou trois queues de cheval, qui sont les enseignes des Turcs ; d’où vient le titre de bacha à trois queues. Ceux-ci sont appellés beglerbegs, & les sangiacbegs ne font porter devant eux qu’une queue de cheval attachée au bout d’une lance. Voyez Beglerbeg & Sangiac.
Le titre de bacha se donne aussi par politesse aux courtisans qui environnent le grand-seigneur à Constantinople, aux officiers qui servent à l’armée, & pour ainsi dire, à tous ceux qui font quelque figure à la cour ou dans l’état.
Le grand-seigneur confie aux bachas la conduite des armées ; & pour lors on leur donne quelquefois le titre de seraskier ou de back-bog, c’est-à-dire général, parce qu’ils ont sous leurs ordres d’autres bachas. Comme on ne parvient communément au titre de bacha que par des intrigues, par la faveur du grand-visir ou des sultanes, qu’on achette par des présens considérables, il n’est point d’exactions que ces officiers ne commettent dans leurs gouvernemens, soit pour rembourser aux Juifs les sommes qu’ils en ont empruntées, soit pour amasser des trésors dont souvent ils ne joüissent pas long-tems, & qu’ils ne transmettent point à leur famille. Sur un léger mécontentement, un soupçon, ou pour s’approprier leurs biens, le grand-seigneur leur envoye demander leur tête, & leur unique réponse est d’accepter la mort. Leur titre n’étant pas plus héréditaire que leurs richesses, les enfans d’un bacha traînent quelquefois leur vie dans l’indigence & dans l’obscurité. On croit que ce nom de pascha vient du Persan pait schats, qui signifie pié de roi, comme pour marquer que le grand-seigneur a le pié dans les provinces où ses bachas le représentent. Cependant ce titre n’est en usage qu’en Turquie ; car en Perse on nommé émirs ou kams les grands seigneurs & les gouverneurs de province. (G)
* BACHARA, (Géog.) ville de la grande Tartarie en Asie, dans l’Usbech, sur une riviere qui va se jetter dans la mer Caspienne.
BACHE ou BACHOT, s. m. ce sont de petits bateaux dont on se sert sur les rivieres ; on nomme ainsi ceux dont on se sert à Lyon pour passer la Saone. (Z)
Bache, (Jardin. & Hydraul.) c’est un coffre ou une cuvette de bois qui reçoit l’eau d’une pompe aspirante à une certaine hauteur, où elle est reprise par d’autres corps de pompe foulante qui l’élevent davantage. (K)
* Bache, s. f. (Comm. & Roul.) grande couverture de grosse toile que les rouliers & voituriers étendent sur leurs voitures, pour garantir de la pluie & des autres intempéries de l’air les marchandises dont elles sont chargées. Cette couverture est bandée par des cordes qui partent de son milieu & de ses angles, & qui se rendent à différentes parties latérales de la voiture. Il y a entr’elle & les marchandises un lit de paille fort épais.
BACHELIER, s. m. (Hist. mod.) dans les écrivains du moyen âge, étoit un titre qui se donnoit, ou à ceux d’entre les chevaliers qui n’avoient pas assez de bien ou assez de vassaux pour faire porter devant eux leurs bannieres à une bataille, ou à ceux même de l’ordre des Bannerets, qui, n’ayant pas encore l’âge qu’il falloit pour déployer leur propre banniere, étoient obligés de marcher à la guerre sous la banniere d’un autre ; voyez Banneret. Camden & d’autres définissent le bachelier, une personne d’un rang moyen entre un chevalier & un écuyer, moins âgé & plus récent que celui-là, mais supérieur à celui-ci, voyez Chevalier, &c. D’autres veulent que le nom de bachelier ait été commun à tous les degrés compris entre le simple gentilhomme & le baron.
Quand l’amiral n’étoit ni comte, ni baron, il étoit nommé bachelier ; & « il est à noter que quand l’amiral va par le pays pour assembler vaisseaux de guerre, ou pour autre affaire du royaume, s’il est bachelier, il recevra par jour quatre chelins sterlins ; s’il est comte ou baron, ses gages seront à proportion de son état & rang ».
Le titre de bachelier se donnoit plus particulierement à tout jeune homme de condition qui faisoit sa premiere campagne, & qui recevoit en conséquence la ceinture militaire.
Bachelier, signifioit encore celui qui dans le premier tournois où il eut jamais combattu, avoit vaincu quelqu’un.
On disoit anciennement bacheliers au lieu de bas chevaliers, parce que les bacheliers formoient le plus bas ordre de chevaliers ; ils étoient au-dessus des bannerets, &c. Voyez Chevalier.
On appelle maintenant ceux-ci equites aurati, à cause des éperons qu’on leur met lors de leur réception.
D’abord cette dignité ne se donnoit qu’aux gens d’épée : mais dans la suite on la conféra aussi aux gens de robbe longue. La cérémonie en est extrèmement simple. L’aspirant s’étant mis à genoux, le roi le touche doucement d’une épée nue, & dit, sois chevalier au nom de Dieu ; & après, avance, chevalier. Voyez Chevalier & Noblesse.
Bachelier, est encore un terme dont on se sert dans les universités pour designer une personne qui a atteint le baccalauréat, ou le premier degré dans les Arts libéraux & dans les Sciences. Voyez Degré.
C’est dans le treizieme siecle que le degré de bachelier a commencé à être introduit par le pape Grégoire IX. mais il est encore inconnu en Italie. À Oxford, pour être reçu bachelier ès Arts, il faut y avoir étudié quatre ans, trois ans de plus pour devenir maitre ès Arts, & sept ans encore pour être bachelier en Théologie.
A Cambridge, il faut avoir étudié près de quatre ans pour être fait bachelier ès Arts, & plus de trois ans encore avant que d’être reçu maître, & encore sept ans de plus pour devenir bachelier en Théologie. Il ne faut avoir étudié que six ans en Droit pour être reçu bachelier de cette faculté.
A Paris, pour passer bachelier en Théologie, il faut avoir étudié deux ans en Philosophie, trois en Théologie, & avoir soûtenu deux examens, l’un sur la Philosophie, & l’autre sur la premiere partie de la somme de saint Thomas, qui comprend les traités de Dieu, & des divins attributs de la Trinité, & des anges. Ces deux examens doivent se faire à un mois l’un de l’autre, devant quatre docteurs de la faculté de Théologie, tirés au sort, avec droit de suffrage. Un seul mauvais billet ne laisse au candidat que la voie de l’examen public qu’il peut demander à la faculté. S’il se trouve deux suffrages defavorables, il est refusé sans retour. Lorsque les examinateurs sont unanimement contens de sa capacité, il choisit un président à qui il fait signer ses theses ; & quand le syndic les a visées, & lui a donné jour, il doit les soûtenir dans l’année à compter du jour de son second examen. Dans quelqu’une des écoles de la faculté, c’est-à-dire, des colleges ou des communautés qui sont de son corps, cette these roule sur les mêmes traités théologiques, qui ont servi de matiere à ce second examen, & on la nomme tentative. Le président, quatre bacheliers en licence, & deux bacheliers amis, y disputent contre le répondant ; dix docteurs qu’on nomme censeurs y assistent avec droit de suffrage ; les bacheliers de licence l’ont aussi, mais pour la forme, leurs voix n’étant comptées pour rien. Chaque censeur a deux billets, l’un qui porte sufficiens, & l’autre incapax. Un seul suffrage contraire suffit pour être refusé. Si le candidat répond d’une maniere satisfaisante, il va à l’assemblée du premier du mois, qu’on nomme prima mensis, se présenter à la faculté devant laquelle il prête serment. Ensuite le bedeau lui délivre ses lettres de baccalauréat, & il peut se preparer à la licence.
On distingue dans la faculté de Théologie de Paris deux sortes de bacheliers : savoir bacheliers du premier ordre, baccalaurei primi ordinis, ce sont ceux qui font leur cours de licence ; & ceux du second ordre, baccalaurei secundi ordinis, c’est-à-dire les simples bacheliers qui aspirent à faire leur licence, ou qui demeurent simplement bacheliers. L’habit des uns & des autres est la soutane, le manteau long, & la fourrure d’hermine doublée de soie noire.
Pour passer bachelier en Droit à Paris, il faut l’avoir étudié deux ans, & avoir soûtenu un acte dans les formes. Pour être bachelier en Medecine, il faut, après avoir été quatre ans maître ès Arts dans l’université, faire deux ans d’étude en Medecine & subir un examen, après quoi on est revêtu de la fourrure pour entrer en licence. Dans l’université de Paris, avant la fondation des chaires de Theologie, ceux qui avoient étudié six ans en Théologie, étoient admis à faire leurs cours, d’où ils étoient nommés baccalarii cursores : & comme il y avoit deux cours, le premier pour expliquer la bible pendant trois années consécutives ; le second, pour expliquer le maître des sentences pendant une année ; ceux qui faisoient leur cours de la bible étoient appellés baccalarii biblici ; & ceux qui étoient arrivés aux sentences, baccalarii sententiarii. Ceux enfin qui avoient achevé l’un & l’autre étoient qualifiés baccalarii formati ou bacheliers formés.
Il est fait mention encore de Bacheliers d’Église, baccalarii ecclesiæ, l’évêque avec ses chanoines & bacheliers, cum consilio & consensu omnium canonicorum suorum & baccalariorum. Il n’y a guere de mot dont l’origine soit plus disputée parmi les critiques que celui de bachelier, baccalarius ou baccalaureus : Martinius prétend qu’on a dit en latin baccalaureus, pour dire bacca laurea donatus, & cela par allusion à l’ancienne coûtume de couronner de laurier les poëtes, baccis lauri, comme le fut Petrarque à Rome en 1341. Alciat & Vivès sont encore de ce sentiment, Rhenanus aime mieux le tirer de baculus ou baccilus, un bâton, parce qu’à leur promotion, dit-il, on leur mettoit en main un bâton, pour marquer l’autorité qu’ils recevoient, qu’ils avoient achevé leurs études, & qu’ils étoient remis en liberté ; à peu près comme les anciens gladiateurs, à qui l’on mettoit à la main un bâton pour marque de leur congé ; c’est ce qu’Horace appelle rude donatus. Mais Spelman rejette cette opinion, d’autant qu’il n’y a point de preuve qu’on ait jamais pratiqué cette cérémonie de mettre un bâton à la main de ceux que l’on créoit bacheliers ; & d’ailleurs cette étymologie conviendroit plûtôt aux licentiés qu’aux bacheliers, qui sont moins censés avoir combattu qu’avoir fait un premier essai de leurs forces, comme l’insinue le nom de tentative que porte leur these.
Parmi ceux qui soûtiennent que les bacheliers militaires sont les plus anciens, on compte Cujas, qui les fait venir de buccellarii, sorte de cavalerie fort estimée autrefois ; du Cange, qui les tire de baccalaria, sorte de fiefs ou de fermes qui contenoient plusieurs pieces de terre de douze acres chacune, ou de ce que deux bœufs pouvoient labourer. Selon lui les possesseurs de ces baccalaria étoient appelles bacheliers. Enfin Caseneuve & Hauteserre font venir bacheliers de baculus ou bacillus, un bâton, à cause que les jeunes cavaliers s’exerçoient au combat avec des bâtons, ainsi que les bacheliers dans les universités s’exercent par des disputes. De toutes ces étymologies la premiere est la plus vraissemblable, puisqu’il n’y a pas encore long-tems que dans l’université de Paris la these que les aspirans à la maîtrise ès Arts étoient obligés de soûtenir, s’appelloit l’acte pro laurea artium. Ainsi de bacca lauri, qui signifie proprement le fruit ou la graine de laurier, arbre consacré de tout tems à être le symbole des récompenses accordées aux savans, on a fait dans notre langue bachelier pour exprimer un étudiant qui a déjà merité d’être couronné. (G)
Bachelier, (Commerce.) c’est un nom qu’on donne dans quelques-uns des six corps de marchands de Paris, aux anciens & à ceux qui ont passé par les charges, & qui ont droit d’être appellés par les maîtres & gardes pour être présens avec eux & les assister en quelques-unes de leurs fonctions, particulierement en ce qui regarde le chef-d’œuvre des aspirans à la maîtrise. Ainsi dans le corps des marchands Pelletiers le chef-d’œuvre doit être fait en présence des gardes, qui sont obligés d’appeller avec eux quatre bacheliers dudit état.
Le terme de bachelier est aussi en usage dans le même sens, dans la plûpart des communautés des Arts & Métiers de la ville de Paris. Voyez Communauté. (G)
* BACHER une voiture, (Commerce & Roulage.) c’est la couvrir d’une bache. Voyez Bache.
BACHIAN, (Géog. mod.) île des Indes orientales, une des Moluques, proche la ligne.
BACHOT, sub. m. sur les rivieres, c’est un petit bateau qui prend, en payant, les passans au bord d’une riviere & les met à l’autre bord ; il y en a sur la Seine en plusieurs endroits. Voyez Bachoteurs & Bachotage.
* BACHOTAGE, s. m. (Police.) c’est l’emploi de ceux qui ont le droit de voiturer sur la riviere dans des bachots, au-dessus & au-dessous de la ville. Voyez Bachoteurs.
* BACHOTEURS, sub. m. (Police.) ce sont des bateliers occupés sur les ports de Paris & en autres endroits des rives de la Seine, à voiturer le public sur l’eau & dans des bachots au-dessus & au-dessous de la ville. Ils sont obligés de se faire recevoir à la ville : ils ne peuvent commettre des garçons à leur place : leurs bachots doivent être bien conditionnés. Il leur est defendu de recevoir plus de seize personnes à la fois ; leurs salaires sont réglés ; ils doivent charger par rang ; cependant le particulier choisit tel bachoteur qu’il lui plaît. Ils sont obligés d’avoir des numeros à leurs bachots. Un officier de ville fait de quinze en quinze jours la visite des bachots ; & il est détendu aux femmes & aux enfans des bachoteurs de se trouver sur les ports. On paye par chaque personne quatre sous pour Seve & S. Cloud ; deux sous pour Chaillot & Passy ; deux sous six deniers pour Auteuil ; & ainsi à proportion de la distance, & à raison de deux sols pour chaque lieue, tant en descendant qu’en remontant. Le bachoteur convaincu d’avoir commis à sa place quelqu’homme sans expérience, ou d’avoir reçu plus de seize personnes, est condamné pour la premiere fois à cinquante livres d’amende, confiscation des bachots, trois mois de prison ; il y a punition corporelle en cas de récidive & exclusion du bachotage. C’est au lieutenant de police à veiller que les bachoteurs ne se prêtent à aucun mauvais commerce. Il leur est enjoint par ce tribunal de fermer leurs bachots avec une chaîne & un cadenat pendant la nuit.
BACHOU, s. m. (terme de Boyaudier.) c’est ainsi que ces ouvriers appellent des especes de hottes dans lesquelles les boyaux de moutons ou d’agneaux sont portés de la boucherie dans leurs atteliers.
BACILE, crithmum, (Hist. natur. botan.) genre de plante à fleurs en rose disposées en ombelle ; ces fleurs sont composées de plusieurs pétales arrangés sur un calice, qui devient dans la suite un fruit à deux semences plates légerement cannelées, qui se dépouillent ordinairement d’une enveloppe. Ajoûtez aux caracteres de ce genre, que les feuilles sont charnues, étroites, & subdivisées trois à trois. Tournefort, inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
* BACKON, (Géog.) ville de la Moldavie, sur la riviere d’Arari, proche des frontieres de la Valachie.
* BACLAGE, s. m. (terme de Comm. & de Riviere.) c’est l’arrangement sur les ports de Paris des bateaux qui y arrivent les uns après les autres, pour y faire la vente des marchandises dont ils sont chargés. Baclage se dit aussi du droit qu’on paye aux officiers de ville chargés de cet arrangement. Ils se nomment débacleurs. Voyez Débacleurs, Débacler, DÉBACLAGE.
* BACLAN, (Géographie.) pays de la Perse dans le Chorasan, près de Balche, & vers la riviere de Gihon.
BACLER les ports, (Marine.) c’est les fermer avec des chaînes & des barrieres. (Z)
* BACLER un bateau (term. de Comm. & de Riv.) c’est placer dans le port un bateau commodément & sûrement pour la charge & la décharge de ses marchandises ; ce qui s’exécute en l’attachant avec des cables & cordages à des anneaux fixés aux ponts & sur le rivage pour cet effet.
BACONISME ou PHILOSOPHIE DE BACON. Bacon, baron de Verulam & vicomte de S. Alban, naquit en Angleterre l’an 1560. Il donna dans son enfance des marques de ce qu’il devoit être un jour ; & la reine Elisabeth eut occasion plusieurs fois d’admirer la sagacité de son esprit. Il étudia la philosophie d’Aristote dans l’université de Cambridge ; & quoiqu’il n’eût pas encore seize ans, il apperçut le vuide & les absurdités de ce jargon. Il s’appliqua ensuite à l’étude de la politique & de la jurisprudence, & son mérite l’éleva à la dignité de chancelier sous le roi Jacques premier. Il fut accusé de s’être laissé corrompre par argent ; & le roi l’ayant abandonné, il fut condamné par la chambre des pairs à une amende d’environ quatre cents mille livres de notre monnoie ; il perdit sa dignité de chancelier, & fut mis en prison. Peu de tems après, le roi le rétablit dans tous ses biens & dans tous les honneurs qu’il avoit perdus : mais ses malheurs le dégoûterent des affaires, & augmenterent sa passion pour l’étude. Enfin il mourut âgé de 66 ans, & si pauvre, qu’on dit que quelques mois avant sa mort il avoit prié le roi Jacques de lui envoyer quelques secours, pour lui épargner la honte de demander l’aumône dans sa vieillesse. Il falloit qu’il eût été ou bien desintéressé ou bien prodigue, pour être tombé dans une si grande indigence.
Le chancelier Bacon est un de ceux qui ont le plus contribué à l’avancement des Sciences. Il connut très-bien l’imperfection de la Philosophie scholastique, & il enseigna les seuls moyens qu’il y eût pour y rémédier. « Il ne connoissoit pas encore la nature, dit un grand homme, mais il savoit & indiquoit tous les chemins qui menent à elle. Il avoit méprisé de bonne heure tout ce que les universités appelloient la Philosophie, & il faisoit tout ce qui dépendoit de lui, afin que les compagnies instituées pour la perfection de la raison humaine, ne continuassent pas de la gâter par leurs quiddités, leurs horreurs du vuide, leurs formes substancielles, & tous ces mots impertinens, que non-seulement l’ignorance rendoit respectables, mais qu’un mélange ridicule avec la religion avoit rendu sacrés ».
Il composa deux ouvrages pour perfectionner les Sciences. Le premier est intitulé de l’accroissement & de la dignité des Sciences : il y montre l’état où elles se trouvoient alors, & indique ce qui restoit à découvrir pour les rendre parfaites. Mais il ajoûte qu’il ne faut pas espérer qu’on avance beaucoup dans cette découverte, si on ne se sert d’autres moyens que de ceux dont on s’étoit servi jusqu’alors. Il fait voir que la Logique qu’on enseignoit dans les écoles, étoit plus propre à entretenir les disputes qu’à éclaircir la vérité, & qu’elle enseignoit plûtôt à chicaner sur les mots qu’à pénétrer dans le fond des choses. Il dit qu’Aristote, de qui nous tenons cet art, a accommodé sa physique à sa logique, au lieu de faire sa logique pour sa physique, & que renversant l’ordre naturel, il a assujetti la fin aux moyens. C’est aussi dans ce premier ouvrage qu’il propose cette célebre division des Sciences qu’on a suivie en partie dans ce Dictionnaire. Voyez le Discours préliminaire.
C’est pour remédier aux defauts de la Logique ordinaire, que Bacon composa son second ouvrage intitulé Nouvel Organe des Sciences : il y enseigne une Logique nouvelle, dont le principal but est de montrer la maniere de faire une bonne induction, comme la fin principale de la logique d’Aristote est de faire un bon syllogisme. Bacon a toûjours regardé cet ouvrage comme son chef-d’œuvre, & il fut dix-huit ans à le composer. Voici quelques-uns de ses axiomes qui feront connoître l’étendue des vûes de ce grand génie.
« 1. La cause du peu de progrès qu’on a faits jusqu’ici dans les Sciences, vient de ce que les hommes se sont contentés d’admirer les pretendus forces de leur esprit, au lieu de chercher les moyens de remédier à sa foiblesse.
2. La logique scholastique n’est pas plus propre à guider notre esprit dans les Sciences, que les sciences, dans l’état où elles sont, ne sont proprés à nous faire produire de bons ouvrages.
3. La logique scholastique n’est bonne qu’à entretenir les erreurs qui sont fondées sur les notions qu’on nous donne ordinairement : mais elle est absolument inutile pour nous faire trouver la vérité.
4. Le syllogisme est composé de propositions. Les propositions sont composées de termes, & les termes sont les signes des idées. Or si les idées, qui sont le fondement de tout, sont confuses, il n’y a rien de solide dans ce qu’on bâtit dessus. Nous n’avons donc d’espérance que dans de bonnes inductions.
5. Toutes les notions que donnent la Logique & la Physique, sont ridicules. Telles sont les notions de substance, de qualité, de pesanteur, de légereté, &c.
6. Il n’y a pas moins d’erreur dans les axiomes qu’on a formés jusqu’ici que dans les notions ; desorte que pour faire des progrès dans les Sciences, il est nécessaire de refaire tant les notions que les principes : en un mot, il faut, pour ainsi dire, refondre l’entendement.
7. Il y a deux chemins qui peuvent conduire à la vérité. Par l’un on s’éleve de l’expérience à des axiomes très-généraux, ce chemin est déjà connu : par l’autre on s’éleve de l’expérience à des axiomes qui deviennent généraux par degrés, jusqu’à ce qu’on parvienne à des choses très-générales. Ce chemin est encore en friche ; parce que les hommes se dégoûtent de l’expérience, & veulent aller tout d’un coup aux axiomes généraux, pour se reposer.
8. Ces deux chemins commencent tous les deux à l’expérience & aux choses particulieres ; mais ils sont d’ailleurs bien différens : par l’un on ne fait qu’effleurer l’expérience ; par l’autre on s’y arrête : par le premier on établit dès le second pas, des principes généraux & abstraits ; par le second, on s’éleve par degrés aux choses universelles, &c.
9. Il ne s’est encore trouvé personne, qui ait eu assez de force & de constance, pour s’imposer la loi d’effacer entierement de son esprit les théories & les notions communes qui y étoient entrées avec le tems ; de faire de son ame une table rase, s’il est permis de parler ainsi ; & de revenir sur ses pas pour examiner de nouveau toutes les connoissances particulieres qu’on croit avoir acquises. On peut dire de notre raison, qu’elle est obscurcie & comme accablée par un amas confus & indigeste de notions, que nous devons en partie à notre crédulité pour bien des choses qu’on nous a dites, au hasard qui nous en a beaucoup appris, & aux préjugés dont nous avons été imbus dans notre enfance. ...... Il faut se flatter qu’on réussira dans la découverte de la vérité, & qu’on hâtera les progrès de l’esprit, pourvû que, quittant les notions abstraites, les spéculations Métaphysiques, on ait recours à l’analyse, qu’on décompose les idées particulieres, qu’on s’aide de l’expérience, & qu’on apporte à l’étude un jugement mûr, un esprit droit & libre de tout préjugé. . . . On ne doit esperer de voir renaître les Arts & les Sciences, qu’autant qu’on refondra entierement ses premieres idées, & que l’expérience sera le flambeau qui nous guidera dans les routes obscures de la vérité. Personne jusqu’ici, que nous sachions, n’a dit que cette réforme de nos idées eût été entreprise, ou même qu’on y eût pensé ».
On voit par ces Aphorismes, que Bacon croyoit que toutes nos connoissances viennent des sens. Les Péripatéticiens avoient pris cette vérité pour fondement de leur philosophie : mais ils étoient si éloignés de la connoître, qu’aucun d’eux n’a sû la développer ; & qu’après plusieurs siecles, c’étoit encore une découverte à faire. Personne n’a donc mieux connu que Bacon la cause de nos erreurs : car il a vû que les idées qui sont l’ouvrage de l’esprit, avoient été mal faites ; & que par conséquent, pour avancer dans la recherche de la vérité, il falloit les refaire. C’est un conseil qu’il répete souvent dans son nouvel organe. « Mais pouvoit-on l’écouter, dit l’auteur de l’Essai sur l’origine des connoissances humaines ? Prévenu, comme on l’étoit, pour le jargon de l’école, & pour les idées innées, ne devoit-on pas traiter de chimérique le projet de renouveller l’entendement humain ? Bacon proposoit une méthode trop parfaite pour être l’auteur d’une révolution ; & celle de Descartes devoit réussir, parce qu’elle laissoit subsister une partie des erreurs. Ajoûtez à cela que le philosophe Anglois avoit des occupations qui ne lui permettoient pas d’exécuter entierement lui-même, ce qu’il conseilloit aux autres. Il étoit donc obligé de se borner à donner des avis qui ne pouvoient faire qu’une légere impression sur des esprits incapables d’en sentir la solidité. Descartes au contraire, livré entierement à la Philosophie, & ayant une imagination plus vive & plus féconde, n’a quelquefois substitué aux erreurs des autres que des erreurs plus séduisantes, qui, peut-être, n’ont pas peu contribué à sa réputation ».
Le soin que Bacon prenoit de toutes les Sciences en général, ne l’empêcha pas de s’appliquer à quelques-unes en particulier ; & comme il croyoit que la Philosophie naturelle est le fondement de toutes les autres Sciences, il travailla principalement à la perfectionner. Mais, il fit comme ces grands Architectes, qui ne pouvant se résoudre à travailler d’après les autres, commencent par tout abattre, & élevent ensuite leur édifice sur un dessein tout nouveau. De même, il ne s’amusa point à embellir ou à réparer ce qui avoit déjà été commencé par les autres : mais il se proposa d’établir une Physique nouvelle, sans se servir de ce qui avoit été trouvé par les anciens, dont les principes lui étoient suspects. Pour venir à bout de ce grand dessein, il avoit résolu de faire tous les mois un traité de Physique, & il commença par celui des vents. Il fit ensuite celui de la chaleur, puis celui du mouvement, & enfin celui de la vie & de la mort. Mais, comme il étoit impossible qu’un homme seul fit toute la Physique avec la même exactitude, après avoir donné ces échantillons pour servir de modele à ceux qui voudroient travailler sur ses principes, il se contenta de tracer grossierement & en peu de mots le dessein de quatre autres traités, & d’en fournir les matériaux dans le livre qu’il intitula Sylva sylvarum, où il a ramassé une infinité d’expériences, pour servir de fondement à sa nouvelle physique. En un mot personne, avant le chancelier Bacon, n’avoit connu la Philosophie expérimentale ; & de toutes les expériences physiques qu’on a faites depuis lui, il n’y en a presque pas une qui ne soit indiquée dans ses ouvrages.
Ce précurseur de la Philosophie a été aussi un écrivain élégant, un historien, un bel esprit.
Ses Essais de morale sont très-estimés, mais ils sont faits pour instruire plûtôt que pour plaire. Un esprit facile, un jugement sain, le philosophe sensé, l’homme qui refléchit y brillent tour-à-tour. C’étoit un des fruits de la retraite d’un homme qui avoit quitté le monde, aprés en avoir soûtenu long-tems les prospérités & les disgraces. Il y a aussi de très-belles choses dans le livre qu’il a fait de la Sagesse des anciens, dans lequel il a moralisé les fables, qui faisoient toute la théologie des Grecs & des Romains.
Il a fait encore l’histoire de Henri VII. roi d’Angleterre, où il y a quelquefois des traits du mauvais goût de son siecle, mais qui d’ailleurs est pleine d’esprit, & qui fait voir qu’il n’étoit pas moins grand politique que grand philosophe. (C)
BACOTI, s. f. (Histoire moderne.) nom que les peuples du Tonquin donnent à la grande Magicienne, pour laquelle ils ont une extrème vénération, & qu’ils consultent outre les deux fameux devins, le Taybou & le Tay-phouthouy. Lorsqu’une mere, après la mort de son enfant, veut savoir en quel état est l’ame du défunt ; elle va trouver cette espece de Sibylle, qui se met aussi-tôt à battre son tambour pour évoquer l’ame du mort ; elle feint que cette ame lui apparoît, & lui fait connoître si elle est bien ou mal : mais pour l’ordinaire elle annonce, à cet égard, des nouvelles consolantes. Tavernier, voyage des Indes. (G)
* BACQUET, s. m. (Arts méchaniques) on donne ordinairement le nom de bacquet à un vaisseau de bois, rond, oval ou quarré, d’un pié & demi ou même davantage de diametre, plus ou moins profond, fait de plusieurs pieces ou douves serrées par des cerceaux de fer ou de bois, & destiné à contenir de l’eau ou des matieres fluides. Le bacquet est à l’usage des Verriers, ils y rafraîchissent leurs cannes ; des Cordonniers, ils y font tremper leurs cuirs ; des Brasseurs, ils y mettent de la biere, ou y reçoivent la levure au sortir des tonneaux ; des Marchands de vin, ils y retiennent le vin qui s’échappe de la canelle des pieces en perce ; des Marchands de poisson, ils y conservent leur marchandise ; des Maçons, ils y transportent le mortier au pié de l’engin, pour être élevé de-là au haut des échaffaux ; des Carriers, ils s’en servent pour tirer le moellon & les autres pierres qu’ils ne peuvent brider avec le cable ; & d’un grand nombre d’autres ouvriers : nous allons faire mention de quelques-uns.
Bacquet, ustencile d’Imprimerie ; c’est une pierre de trois piés de long sur deux & demi de large, creusée à trois pouces de profondeur, garnie sur ses bords de bandes de fer, & percée au milieu d’une de ses extrémités ; l’Imprimeur, qui veut laver sa forme, bouche le trou avec un tampon de linge, la couche au fond du bacquet, & verse dessus une quantité suffisante de lessive pour la couvrir ; là il la brosse jusqu’à ce que l’œil de la lettre soit net, après quoi il débouche le trou pour laisser écouler la lessive, retire sa forme, & la rince avec de l’eau claire : ce bacquet doit être posé ou supporté sur une table de chêne à quatre piés bien solides.
Bacquet, chez les Marbreurs de papier, est une espece de boîte ou caisse de bois, plate, sans couvercle, quarrée, longue de la grandeur d’une feuille de papier à l’écu, & de l’épaisseur d’environ quatre doigts : elle se pose sur la table ou l’établi du Marbreur, qui y verse de l’eau gommée jusqu’à un doigt du bord ; c’est sur cette eau que l’on répand les couleurs que doit prendre le papier pour être marbré. Voyez Planche du Marbreur en F. fig. premiere.
Bacquet, chez les Relieurs & Doreurs ; c’est un demi-muid scié par le milieu, où l’on met de la cendre jusqu’à un certain degré, & par-dessus de la poussiere de charbon pour faire une chaleur douce, capable de sécher la dorure.
Bacquet, en terme de Chauderonnier, se dit en général de tous vaisseaux de cuivre imparfaits, & tels qu’ils sortent de la manufacture & de la premiere main.
BACQUETER, verb. act. en bâtiment, c’est ôter l’eau d’une tranchée avec une pelle, ou une écope. (P)
Bacqueter l’eau, en Jardinage, c’est la répandre avec une pelle de bois sur le gason d’un bassin, pour arroser le dessus des glaises. (K)
BACQUETURES, s. f. pl. terme de Marchand de vin, c’est ainsi qu’ils appellent ce qui tombe des canelles des tonneaux en perce, & des mesures quand ils vendent & versent le vin dans les bouteilles. Ils disent qu’ils envoyent ce vin au Vinaigrier, & ils le devroient faire.
* BACTRE (Géographie anc. & mod.) riviere que les modernes nomment Buschian, ou Bachora ; elle se joint à notre Gehon, ou à l’Oxus des anciens.
* BACTRES (Géographie anc. & mod.) capitale de la Bactriane, sur le fleuve Bactre ; c’est aujourd’hui Bag-dasan ou Termend : elle est voisine du mont Caucase.
* BACTREOLE, s. f. chez les Batteurs d’or, rognures de feuilles d’or ; on les employe à faire l’or en coquille. Voyez Or.
* BACTRIANE, s. f. (Géographie anc. & mod.) ancienne province de Perse, entre la Margiane, la Scythie, l’Inde & le pays des Messagetes ; c’est aujourd’hui une contrée de la Perse, formée en partie du Chorasan, & en partie du Mawaralnahar, ou plus communément Usbeck, en Tartarie.
BACTRIENS, s. m. pl. peuples de la Bactriane.
* BACU, BACHIE, BACHU, BARVIE (Géog.) ville de Perse, sur la mer Caspienne, & dans la province de Servan. Il y a près de la ville une source qui jette une liqueur noire dont on se sert par toute la Perse, au lieu d’huile à brûler. Elle donne son nom à la mer qu’on connoît sous celui de mer de Bacu, ou mer de Sala.
BACULOMETRIE, s. f. c’est l’art de mesurer avec des bâtons, ou des verges, les lignes tant accessibles qu’inaccessibles. Voyez Accessible, Arpentage, Mesure, Lever un plan, , &c. (E)
* BADACHXAN ou BADASCHIAN, ou BUSDASKAN (Géographie anc. & mod.) ville d’Asie, dans le Mawaralnahar, dont elle est la capitale : quelques Géographes prétendent que c’est l’ancienne Bactres.
* BADAI (Géographie & Histoire.) peuples de la Tartarie déserte, qui adoroient le soleil, ou un morceau de drap rouge élevé en l’air, qui en étoit apparemment la banniere ou le symbole.
* BADAJOZ (Géographie.) ville d’Espagne, capitale de l’Estramadure, sur la Guadiana. Long. 11. 27. lat. 38. 35.
* BADARA (Géographie.) petite ville des Indes, capitale de la contrée du même nom, dans la presqu’île de l’Inde, deçà le Gange, au Malabar, proche Calicut.
* BADE ou BADEN (Géographie.) ville d’Allemagne, dans le cercle de Suabe. Long. 26. 54. lat. 48. 50.
* BADE. Le margraviat de Bade est divisé en deux parties, le haut & le bas margraviat ; il est borné au septentrion par le Palatinat & l’évêché de Spire ; à l’orient, par le duché de Wirtemberg & la principauté de Furstemberg ; au midi, par le Brisgaw ; à l’occident, par le Rhin.
* BADE ou BADEN (Géographie.) ville de Suisse, dans le canton de même nom, sur le Limat. Long. 25. 55. lat. 47. 27.
* BADE ou BADEN (Géographie.) ville d’Allemagne, dans l’archiduché d’Autriche, sur le Suechat. Long. 34. 20. lat. 48.
* BADEBOU (Géographie.) petit pays d’Afrique, sur la côte de l’Océan, dans le pays des Negres, au nord de la riviere de Gambie.
BADELAIRE, s. f. vieux mot qu’on a conservé dans le Blason, & qui signifie une épée faite en sabre, c’est-à-dire, courte, large & recourbée : on croit que ce mot vient de baltearis, à cause qu’un baudrier étoit autrefois appellé baudel ; d’où vient que quelques-uns disent baudelaire. (V)
* BADENOCH (Géographie.) petit pays de l’Ecosse septentrionale, dans la province de Murray, vers les montagnes & la petite province d’Athol.
* BADENWEILER (Géographie.) ville d’Allemagne, dans le Brisgaw, proche du Rhin. Long. 25. 20. lat. 47. 55.
* BADIANE (Semence de) ou ANIS DE LA CHINE (Histoire nat. & mat. med.) c’est un fruit qui représente la figure d’une étoile ; il est composé de six, sept ou d’un plus grand nombre de capsules qui se réunissent en un centre comme des rayons ; elles sont triangulaires, longues de cinq, huit & dix lignes, larges de trois, un peu applaties & unies par la base. Ces capsules ont deux écorces, une extérieure, dure, rude, raboteuse, jaunâtre, ou de couleur de rouille de fer ; l’autre, intérieure, presqu’osseuse, lisse & luisante. Elles s’ouvrent en deux panneaux par le dos, lorsqu’elles sont seches & vieilles, & ne donnent chacune qu’un seul noyau lisse, luisant, applati, de la couleur de la graine de lin, lequel, sous une coque mince & fragile, renferme une amande blanchâtre, grasse, douce, agréable au goût, & d’une saveur qui tient de celle de l’anis & du fenouil, mais qui est plus douce. La capsule a le goût du fenouil, un peu d’acidité, & une odeur seulement un peu plus pénétrante. Ce fruit vient des Philippines, de la Tartarie & de la Chine ; l’arbre qui le porte s’appelle pansipansi ; son tronc est gros & branchu ; il s’éleve à la hauteur de deux brasses & plus. De ses branches sortent quinze feuilles alternes, rarement crenelées, pointues, longues d’un palme, & large d’un pouce & demi. Les fleurs sont, à ce qu’on dit, en grappes, grandes comme celles du poivre, & paroissent comme un amas de plusieurs chatons.
La semence de badiane donne de l’huile essentielle, limpide, subtile & plus pénétrante que celle d’anis ; elle en a les propriétés. Les Orientaux lui donnent la préférence ; elle fortifie l’estomac, chasse les vents & excite les urines. Les Chinois la mâchent après le repas ; ils l’infusent aussi, avec la racine de ninzin, dans l’eau chaude, & en boivent en forme de thé. Les Indiens en tirent aujourd’hui un esprit ardent anisé, que les Hollandois appellent anis arak, & dont on fait grand cas.
BADIGEON, s. m. en Architecture, est un enduit jaunâtre qui se fait de poudre de pierre de saint-Leu, détrempée avec de l’eau : les Maçons s’en servent pour distinguer les naissances d’avec les panneaux, sur les enduits & ravallemens. Les Sculpteurs l’employent aussi pour cacher les défauts des pierres coquillieres, & les faire paroître d’une même couleur.
BADIGEONNER, c’est colorer avec du badigeon un ravallement en plâtre, fait sur un pan de bois, ou sur un mur de moellon, de brique, &c. La plûpart des ouvriers mettent au badigeon de l’ocre pour le rendre plus jaune, mais il n’y en faut point, cette teinte devant plûtôt imiter la pierre dure d’Arcueil, qui est presque blanche, que celle de saint-Leu, qui est plus colorée. (P)
BADINANT, adj. (Manége.) on appelle ainsi un cheval qu’on mene après un carrosse attelé de six chevaux, pour le mettre à la place de quelqu’un des autres qui pourroit devenir hors d’état de servir. On l’appelle aussi le volontaire. (V)
* BADONVILLERS, (Géog.) ville de Lorraine, dans la principauté de Salmes.
* BADOULA, (Géog.) petite ville du royaume de Candie, dans l’île de Ceylan, à douze lieues du Pic d’Adam. Voyez Adams’ Pic.
* BADUKKA, (Hist. nat. bot.) nom propre du Capparis, arborescens, indica, flore tetrapetalo. Le suc de sa feuille mêlé avec la graisse de sanglier, forme un liniment pour la goutte ; la décoction des fleurs & de la feuille purge & déterge les ulceres de la bouche ; & le fruit pris dans du lait nuit à la faculté d’engendrer dans l’un & l’autre sexe.
* BADWEISS, ou BADENWEISS, ville de Bohême, cercle de Bethyn, près Muldaw.
* BAEÇA, (Géog.) ville d’Espagne, dans l’Andalousie, sur le Guadalquivir. Long. 14. 58. lat. 37. 45.
* BAEÇA, (Géog. mod.) ville du Pérou, dans la province de Los Quixos, proche la ligne.
* BÆTIQUE, (Géog. anc. & mod.) une des parties dans lesquelles les Romains avoient divisé l’Espagne. La Taraconoise, & la Lusitanie étoient les deux autres : la Bætique fut ainsi appellée du Bætis, aujourd’hui le Guadalquivir, & comprenoit l’Andalousie, avec la plus grande partie du royaume de Grenade.
* BAFFA, (Géog. anc. & mod.) ville de l’île de Chypre, bâtie sur les ruines de Paphos la nouvelle. Long. 50. lat. 34. 50.
Il y a dans la même île un cap & une petite île qui ne sont pas éloignées de Baffa, & qui portent le même nom. Le cap s’appelle aussi Capo bianco, & s’appelloit jadis Drepanum promontorium.
* BAFFETAS, s. m. (Commerce.) toile grosse de coton blanc, qui vient des Indes orientales. La meilleure est de Surate ; la piece a 13 aulnes de long, sur de large ; il y en a de moins large. On distingue les baffetas par les endroits d’où ils viennent, & par l’aunage qu’ils ont ; il y a des baffetas Orgaris, Nossaris, Gaudivis, Nerindes & Daboüis ; ils sont étroits ; ils n’ont que de large, & aune de long ; il y a des baffetas Narrow-With de 13 aunes de long, sur aune de large ; Broad-With de 14 aulnes de long, sur de large ; Broad-Brow, & Narrow-Brow, qui ne sont que des toiles écrues, les unes de 14 aunes de long, sur aune de large, & les autres de la même longueur, sur de large. Il y a un autre baffetas qui vient aussi des Indes orientales, & qu’on nomme Shaub. Voyez Shaub.
* BAFFIN’S-BAIE, ou BAIE DE BAFFIN, (Géog.) baie dans les terres arctiques : elle s’étend depuis le 70 jusqu’au 80 degré de latitude. Voyez Baie.
* BAGAIA, BAGI, VAGAI, (Géog.) ville de Numidie, en Afrique ; elle s’appelloit aussi jadis Théodorie, de Théodore épouse de l’empereur Justinien.
* BAGACE, s. f. (Sucrerie.) c’est ainsi qu’on nomme les cannes, après qu’elles ont passé au moulin. On les conserve dans des hangars qu’on appelle cases, pour être brûlées sous les poelles à sucre, quand elles seront seches. C’est l’ouvrage des négresses d’en faire des paquets au sortir des cylindres du moulin : on nourrit les chevaux, les bœufs, les cochons, avec celles qui trop brisées & réduites en trop petits fragmens, ne peuvent entrer en paquets ; trois jours de soleil suffisent pour les sécher ; au lieu de paille & de feuilles de cannes, on les met sous les premieres chaudieres dans les endroits où le bois est commun, & sous les dernieres chaudieres lorsque le bois est rare. Voyez Sucre, Sucrerie.
* BAGAGE, s. m. on donne ce nom en général à tout équipage de voyage ; & il s’applique particulierement à celui d’une armée. Voyez Armée.
* BAGAMEDER, BAGAMEDRI, BAGAMIDRI, haute Ethiopie, ou partie de l’Abyssinie, compris le Nil jusqu’à la source de la Tacaze. Cette contrée est divisée en treize petites provinces, & le Bashlo la sépare du royaume d’Amahara.
BAGAUDE, (Hist. anc.) c’est ainsi que les anciens Gaulois, sur-tout depuis le tems de Diocletien, appelloient un larron ; & de-là est venu le mot de bagauda, ou bagaudia, qui, selon Prosper en sa chronique, & Salvien, liv. V. signifie un brigandage, une émotion de peuple, une sédition, un soulevement de paysans. (G)
* BAGDAD, (Géog.) ville d’Asie, sur la rive orientale du Tigre. Long. 63. 15. lat. 37. 15.
C’est aussi une partie de la Turquie en Asie, & un de ses gouvernemens généraux.
* BAGE-LE-CHATEAU, (Géog.) ville de Bresse, du diocese de Lyon. L’archiprêtré de Bage-le-Château est composé de la paroisse de cette ville & de Pontde-Vaux, de S. Trivier, & d’autres paroisses moins considérables.
* BAGHARGAR, (Géog.) grand pays de la grande Tartarie ; il s’étend d’occident en orient ; il est borné au septentrion par les Kaimachites, au levant par le royaume de Tendu, au midi par la Chine, & au couchant par le Thibet.
* BAGIAT, (Géog.) petit pays à l’occident de la mer Rouge, compris entre l’Ethiopie & la Nubie.
* BAGNA-BEBUSSO, ou BILIBUSSA, (Géog. anc. & mod.) ville de la Turquie en Europe, sur la Stromona, dans la Macédoine, aux confins de la Romanie & de la Bulgarie : c’étoit autrefois Heraclea Sintica.
* BAGNAGAR, ou EDERABAD, ou GOLCONDE, (Géog.) ville d’Asie, au Mogol, capitale du royaume de Golconde, proche la riviere de Nerva. Long. 96. lat. 15. 30.
* BAGNARA, (Géog.) ville maritime d’Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure. Long. 33. 48. lat. 38. 15.
* BAGNAREA, (Géog.) ville d’Italie, dans le patrimoine de S. Pierre, dans la terre d’Orviette. Long. 29. 40. lat. 42. 36.
* BAGNE, s. m. c’est ainsi qu’on nomme dans quelques Verreries en bouteilles, le poinçon dans lequel on passe au tamis la terre à pot au sortir du moulin, & la terre grasse bien moulue & bien épluchée, pour faire de l’une & de l’autre la matiere des pots. Voyez Verrerie, & Pot
* BAGNERES, (Géog.) ville de France, au comté de Bigorre, en Gascogne, sur l’Adour. Long. 17. 42. lat. 43. 30.
* BAGNI D’ASINELLO, ou BAINS DE VITERBE, (Géog. anc. & mod.) ces bains sont dans le patrimoine de S. Pierre, où quelques auteurs croyent que ce fut l’ancienne ville d’Etrurie, appellée Fanum Voltumnæ.
BAGNOLOIS ou BAGNOLIENS, s. m. pl. (Hist. ecclés.) secte d’hérétiques qui parurent dans le viii. siecle, & furent ainsi nommés de Bagnols, ville du Languedoc au diocese d’Usès, où ils étoient en assez grand nombre. On les nomma aussi Concordois ou Gozocois, termes dont on ne connoît pas bien la véritable origine.
Ces Bagnolois étoient des Manichéens. Ils rejettoient l’ancien Testament & une partie du nouveau. Leurs principales erreurs étoient, que Dieu ne crée point les ames quand il les unit au corps ; qu’il n’y avoit point en lui de prescience ; que le monde est éternel, &c. On donna encore le même nom à une secte de Cathares dans le. siecle. V. Cathares. (G)
* BAGNOLS, (Géog.) petite ville de France dans le bas Languedoc, proche de la Cese. Longit. 22. 13. lat. 44. 10.
* BAGŒ, (Myth.) nymphe qui enseigna, dit-on, aux Toscans à deviner par les foudres. Quelques-uns croyent que c’est la sibylle Erythrée, connue sous le nom d’Hérophile : d’autres prétendent que Bagœ est postérieure à Hérophile, la premiere d’entre les femmes qui ait rendu des oracles.
* BAGRADE, (Géog. anc. & mod.) fleuve de l’ancienne Caramanie, connu maintenant sous le nom de Tisindon. Il a sa source dans les montagnes de cette province, passe à Pasagarde, & se jette dans l’Océan Persique.
Il y a en Afrique un fleuve du même nom ; les savans le nomment Bagrada, Bragada, Macar, Macra, Bucara, Pagrarda. Il couloit près d’Utique ; & ce fut sur ses bords qu’un serpent, dont la dépouille étoit de cent vingt piés de long, arrêta, dit-on, l’armée d’Attilius Régulus.
* BAGUE, s. f. (Hist. anc. & mod.) c’est un petit ornement circulaire d’or, d’argent, & de quelques autres matieres, qu’on porte à un des doigts. L’usage ne paroît pas en avoir été fort commun en Grece du tems d’Homere. Ce poëte, qui a mis en œuvre presque tous les objets connus de son tems, ne parle des bagues ni dans l’Iliade, ni dans l’Odyssée : mais les Egyptiens s’en servoient déjà ; car nous lisons que Pharaon donna à Joseph sa bague à cacheter. Les plus anciens Romains appelloient la bague ungulum ; & les Grecs & les Romains, symbolum. La Mythologie nous explique à sa maniere l’origine des bagues à pierre : elle dit que Jupiter instruit par Prométhée que l’enfant qu’il auroit de Thétis le déthroneroit, permit à Hercule de le détacher du Caucase, mais à condition que Prométhée porteroit toûjours au doigt une bague avec un petit morceau de rocher, afin qu’il fût vrai qu’il y étoit toûjours resté attaché, ainsi que Jupiter l’avoit juré.
On faisoit des bagues de fer, d’acier, d’or, d’argent, de bronze, &c. & on les portoit au petit doigt de la main gauche, ou au doigt que nous nommons l’annulaire. Il y en avoit de creuses & de solides. On les chargeoit de pierres précieuses. Elles servoient de sceaux ; & leur figure ne varioit pas moins que leur matiere. Nous en avons représenté quelques-unes dans nos Planches d’antiquités. Voyez Pl. 7. fig. 12.
L’usage des bagues s’est transmis jusqu’à nous. Nous en portons de fort riches. Voyez sur leur usage, tant ancien que moderne, l’article Anneau.
Bagues & Joyaux, terme de Droit, se dit des ornemens précieux des femmes, ou de l’argent même qui leur est accordé par contrat de mariage pour leur en tenir lieu.
La stipulation des bagues & joyaux est sur-tout usitée en pays de Droit écrit, où elle tient lieu de la stipulation de préciput, & fait partie des gains de survie, aussi-bien que l’augment de dot. V. Préciput, Augment de dot, & Gain de survie. (H)
Bague, c’est, en Marine, une petite corde mise en rond, dont on se sert pour faire la bordure d’un œil de pié ou œillet de voile. Voyez Œil de pié, & Œillet de voile. (Z)
Bague, s. f. (Manége.) c’est un anneau de cuivre qui pend au bout d’une espece de potence, & qui s’en détache facilement quand on est assez adroit pour l’enfiler avec une lance en courant à cheval de toute sa vîtesse ; c’est un exercice d’académie. Courir la bague, Voyez Courir. Avoir deux dedans, Voyez Dedans. (V)
Bagues ; on appelle ainsi, dans les jeux d’anches de l’Orgue, une frette ou un anneau de plomb D, (fig. 44. Pl. d’Orgue) soudé sur le corps du tuyau. Cette bague a un trou pour passer la rasette ab, au moyen de laquelle on accorde les jeux d’anches. Voyez Trompette. Lorsque le tuyau est placé dans sa boîte AB, la bague D doit porter sur la partie supérieure de cette boite, dans laquelle elle entre en partie, & doit y être ajustée de façon que l’air contenu dans cette boite, ne puisse trouver d’issue pour sortir que par l’anche du tuyau. Voyez Orgue.
BAGUENAUDIER, s. m. colutea, (Hist. nat.) genre de plante à fleur papilionacée. Il sort du calice un pistil qui devient dans la suite une capsule membraneuse, enflée comme une vessie, dans laquelle il y a des semences qui ont la forme d’un rein. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Son bois est clair, ses feuilles rondes, petites, d’un verd blanchâtre, avec des fleurs jaunes. Cet arbre se dépouille l’hyver, & se marcote ordinairement, quoiqu’il donne de la graine. Sa graine étant mûre, devient jaune. (K)
BAGUER, v. act. terme de Tailleur, de Couturiere, &c. c’est arranger les plis d’un habit, & les arrêter ensemble avec de la soie ou du fil.
* BAGUETTE, s. f. On donne communément ce nom à un petit morceau de bois de quelques lignes d’épaisseur, plus ou moins long, rond & flexible. On employe la baguette à une infinité d’usages. Le bois dont on la fait, varie selon ses usages. On en fait même de fer forgé.
Baguette divine ou divinatoire. On donne ce beau nom à un rameau fourchu de coudrier, d’aune, de hêtre ou de pommier. Il n’est fait aucune mention de cette baguette dans les auteurs qui ont vécu avant l’onzieme siecle. Depuis le tems qu’elle est connue, on lui a donné différens noms, comme caducée, verge d’Aaron, &c. Voici la maniere dont on prétend qu’on s’en doit servir. On tient d’une main l’extrémité d’une branche, sans la serrer beaucoup, ensorte que le dedans de la main regarde le ciel. On tient de l’autre main l’extrémité de l’autre branche, la tige commune étant parallele à l’horison, ou un peu plus élevée. L’on avance ainsi doucement vers l’endroit où l’on soupçonne qu’il y a de l’eau. Dès que l’on y est arrivé, la baguette tourne & s’incline vers la terre, comme une aiguille qu’on vient d’aimanter.
Supposé ce fait vrai, voici comment M. Formey croit pouvoir l’expliquer par une comparaison entre l’aiguille aimantée & la baguette. La matiere magnétique sortie du sein de la terre s’éleve, se réunit dans une extrémité de l’aiguille, où trouvant un accès facile, elle chasse l’air ou la matiere du milieu ; la matiere chassée revient sur l’extrémité de l’aiguille, & la fait pancher, lui donnant la direction de la matiere magnétique. De même à peu-près, les particules aqueuses, les vapeurs qui s’exhalent de la terre, & qui s’élevent, trouvant un accès facile dans la tige de la branche fourchue, s’y réunissent, l’appesantissent, chassent l’air ou la matiere du milieu. La matiere chassée revient sur la tige appesantie, lui donne la direction des vapeurs, & la fait pencher vers la terre, pour vous avertir qu’il y a sous vos piés une source d’eau vive.
Cet effet, continue M. Formey, vient peut-être de la même cause qui fait pencher en bas les branches des arbres plantés le long des eaux. L’eau leur envoye des parties aqueuses qui chassent l’air, pénetrent les branches, les chargent, les affaissent, joignent leur excès de pesanteur au poids de l’air supérieur, & les rendent enfin autant qu’il se peut, paralleles aux petites colonnes de vapeurs qui s’élevent. Ces mêmes vapeurs pénetrent la baguette & la font pencher. Tout cela est purement conjectural.
Une transpiration de corpuscules abondans, grossiers, sortis des mains & du corps, & poussés rapidement, peut rompre, écarter le volume, ou la colonne de vapeurs qui s’élevent de la source, ou tellement boucher les pores & les fibres de la baguette, qu’elle soit inaccessible aux vapeurs ; & sans l’action des vapeurs, la baguette ne dira rien : d’où il semble que l’épreuve de la baguette doit se faire sur-tout le matin ; parce qu’alors la vapeur n’ayant point été enlevée, elle est plus abondante. C’est peut-être aussi pour cette raison que la baguette n’a pas le même effet dans toutes les mains, ni toûjours dans la même main. Mais cette circonstance rend fort douteux tout ce qu’on raconte des vertus de la baguette.
On a attribué à la baguette la propriété de découvrit les minieres, les thrésors cachés, & qui plus est les voleurs & les meurtriers fugitifs. Pour cette derniere vertu, on peut bien dire credat Judæus Apella. Personne n’ignore la fameuse histoire de Jacques Aymar, paysan du Lyonnois, qui guidé par la baguette divinatoire, poursuivit en 1692 un meurtrier durant plus de quarante-cinq lieues sur terre, & plus de trente lieues sur mer. On fait aujourd’hui à n’en pouvoir douter, & on le croira sans peine, que ce Jacques Aymar étoit un fourbe. On peut voir le détail de son histoire dans le dictionnaire de Bayle, article Abaris. A l’égard des autres effets de la baguette, la plus grande partie des Physiciens les révoquent en doute. (O)
Baguette de Neper. Voyez Neper.
Baguette noire, (Hist. mod.) L’huissier de la baguette noire, c’est le premier huissier de la chambre du roi d’Angleterre, appellé dans le livre noir, lator virgæ nigræ & hastiarius ; & ailleurs, virgi-bajulus. Voyez Huissier. Sa charge est de porter la baguette devant le roi à la fête de S. George à Windsor. Il a aussi la garde de la porte de la chambre du chapitre, quand l’ordre de la Jarretiere est assemblé ; & dans le tems que le parlement tient, il garde la chambre des pairs. Sa marque est une baguette noire, qui a un lion d’or à l’extrémité. Cette baguette est en Angleterre une marque d’autorité, comme les masses le sont en d’autres pays. (G)
Baguette, en Architecture, est une petite moulure composée d’un demi-cercle, que la plûpart des ouvriers appellent astragale. Voyez Astragale. (P)
Baguette, chez les Arquebusiers, c’est un morceau de baleine ou de bois de chêne de la longueur d’un canon de fusil : il a par en haut le diametre du canon ; il est ferré par le bout. Son autre extrémité est menue & fort déliée ; du reste il est rond dans toute sa longueur, & sert à bourrer un fusil quand on le charge.
Baguette, chez les Artificiers. Il y en a de plusieurs sortes : les unes qu’on devroit appeller des fouloirs ou refouloirs, sont courtes, eu égard à leur grosseur, & tantôt massives, tantôt percées, suivant leur axe ; elles sont destinées à charger les cartouches des fusées de toutes especes de matieres combustibles. Les autres longues & minces, servent à diriger la course des fusées volantes, & à les tenir dans une situation verticale, & la gorge d’où sort le feu, tournée en bas. Voyez Fusée volante, & Planche I. de l’Artificier, fig. 1. R, une baguette égale dans toute sa longueur, pour rouler les cartouches. Voyez Cartouche. Fig. 2. M, une baguette avec un manche plus gros, pour les petites fusées ; & fig. 3. une baguette avec un manche plus petit, pour les grosses fusées. Voyez Artific. Pl. II. fig. 23. une baguette à charger, percée par le bout d’un trou AI, égal en largeur & profondeur à la grosseur & à la longueur de la broche qu’il doit recevoir entierement : figure 24. une baguette à charger, plus courte d’un quart, percée dans sa longueur d’un trou 26, dont l’ouverture est égale au diametre de la broche, pris au tiers de sa longueur, & profonde de la longueur du reste de la broche : fig. 25. baguette à charger, diminuée de la longueur d’un tiers plus que la précédente, & percée d’un trou 3 c, dont l’ouverture est égale au diametre de la broche pris aux deux tiers, & profonde du tiers de sa longueur : fig. 26. baguette appellée le massif, longue de deux diametres du calibre ; & massive, parce qu’elle ne sert qu’à charger la partie de la fusée qui est au-dessus de la broche. Le manche de ces baguettes doit être garni d’une virole de cuivre, & non de fer, de peur d’accident.
Baguette, chez les Ciriers. Les Ciriers ont deux sortes de baguettes : les baguettes à meches, & les baguettes à bougies ou chandelles. Ils enfilent dans les premieres leurs meches, lorsqu’elles sont coupées de longueur : ils enfilent dans les secondes leurs bougies, quand elles sont achevées. Outre ces deux sortes de baguettes, les Chandeliers en ont une troisieme, c’est une baguette à tremper : c’est celle sur laquelle les meches sont enfilées, lorsqu’ils font de la chandelle à la main, en trempant à plusieurs reprises les meches dans l’abysme. Voyez Abysme. Les baguettes à bougies & à tremper sont longues, légeres & flexibles. Celles à meches sont beaucoup plus fortes.
Baguette, terme de Courroyeur ; c’est un bâton ou perche sur laquelle ces ouvriers étendent leurs cuirs, toutes les fois qu’ils ont été foulés à l’eau, afin de les y faire sécher. Voyez Courroyer.
Baguette, outil d’Hongrieur ; c’est un morceau de bois assez long & rond, mais qui diminue de grosseur en allant du milieu aux extrémités, comme un fuseau. Il sert à ces artisans pour unir & applanir leurs cuirs, en les roulant dessus avec le pié. Voyez Hongrieur, & la figure E, Planche de l’Hongrieur.
Pour cet effet, les hongrieurs ont dans une chambre une espece d’élévation de planche, fig. 5. Planche de l’Hongrieur, a a g, sur le plancher ou le pavé, qui va un peu plus en montant du côté du mur qu’à l’extrémité opposée : deux morceaux de bois, af, de, dressés depuis le pavé jusqu’au plancher, à la distance d’environ trois piés l’un de l’autre, sont joints à la hauteur de quatre piés par un autre morceau de bois bc, qui les traverse. L’ouvrier étend son cuir F sur cette espece de parquet ; il y place sa baguette entre les plis du cuir : alors il monte dessus, & en s’appuyant avec les mains sur la traverse de bois bc, il foule le cuir en reculant, & répete la même opération jusqu’à ce que ce cuir soit rendu maniable.
Baguettes de tambour, (Luth.) ce sont deux morceaux de bois qui ont chacun un pié ou quinze pouces de longueur, sur neuf lignes ou environ de diametre par le bout qu’on tient à la main, d’où ils vont toûjours en diminuant jusqu’à l’autre bout, qui a la forme & les dimensions d’une grosse olive ; ils sont tournés au tour, d’un bois dur & pesant comme l’ébene ; & l’on s’en sert pour battre la caisse ou le tambour. Voyez Tambour. Voyez figures 16 & 17, Planche 2. de Lutherie.
Baguettes de tymballes ; ce sont deux morceaux de bois de bouis, qui sont garnis par un bout de petites courroies capables de recevoir les deux doigts du milieu, & destinées à les manier commodément, dont le fût est partout à peu près de la même grosseur, & n’a pas plus de sept à huit pouces de longueur, & qui sont terminés chacun par une espece de tête de l’épaisseur de trois à quatre lignes, du diametre de sept à huit, & de la forme d’un champignon plat & arrondi par les bords. Voyez la même Planche de Lutherie que nous venons de citer.
Baguette de Tympanon, Psaltérion, &c. ce sont deux petits morceaux de bois de bouis, de cornouiller, d’ébene, &c. recourbés par un bout, & quelquefois terminés de l’autre par un anneau ; d’une ligne & demie ou deux au plus d’épaisseur par le bout qu’on tient à la main, d’où ils vont toûjours en diminuant. Ils sont recourbés par un bout, afin que ce bout s’applique facilement sur les cordes qu’on veut, sans toucher à d’autres : ils ont un anneau pour les tenir plus commodément, en y plaçant le doigt. On prend entre les doigts celles qui n’ont point d’anneaux.
Baguettes de tambourin, soit à cordes, soit à caisse. Ces baguettes ne different guere de celles du tambour que par les dimensions. Celle du tambourin à cordes est plus courte & plus menue que celle du tambour ; celle du tambourin à caisse ou de Provence est plus menue, mais plus longue.
Baguette, bâton dont le Fauconnier se sert pour faire partir la perdrix des buissons, & pour tenir les chiens en crainte.
* BAHAMA, (Géog. mod.) île de l’Amérique septentrionale, l’une des Lucayes, qui donne le nom au canal de Bahama.
* BAHANA, (Géog.) ville d’Egypte située dans la Thébaïde inférieure, près de Fium, sur un lac formé de la décharge des eaux du Nil, & qu’on appelle mer de Joseph.
BAHAR, BAHAIRE, ou BAIRE, s. m. (Comm.) poids dont on se sert à Ternata, à Malacca, à Achem, & en plusieurs autres lieux des Indes orientales, aussi-bien qu’à la Chine.
Il y en a de deux sortes, l’une qu’on appelle grand bahar, & l’autre que l’on nomme petit bahar. Le premier revient à 481 livres 4 onces de Paris, de Strasbourg, d’Amsterdam, & de Besançon ; & le second à 401 livres 7 onces de Paris.
Le bahar de la Chine est de 300 catis, mais qui n’en font que 200 de Malaca, chaque catis de la Chine ne contenant que 16 taëls. Le taël pesant une réale & demie de huit, est de dix mas ou mases, & chaque mas de dix condorins. Voy. Condorin, Mas, Tael.
Le bahar de Moka, ville d’Arabie, est de 420 livres. (G)
* BAHEL SCHULLI, (Hist. nat. & bot.) arbrisseau épineux qu’on appelle aussi Genista spinosa indica verticillata, flore purpureo-cœruleo, qui étoit aux Indes dans les lieux aquatiques. Il y en a une espece qui vient dans les sables, dont les tiges & les feuilles sont d’un verd gai, & les fleurs sont blanches, avec une teinte d’azur.
Ray attribue à la décoction de sa racine & à ses feuilles cuites & confites dans du vinaigre, la vertu d’exciter les urines, & de remédier à leur suppression, surtout si la décoction s’est faite dans l’huile du ficus infernalis : il ajoûte que ses feuilles réduites en poudre & prises dans de l’huile tirée par expression des fleurs du ficus infernalis, résolvent les tumeurs des parties naturelles.
BAHEM. Dans le 1er livre des Machabées, il est dit, que le roi Demetrius écrivit au grand prêtre Simon, en ces termes : coronam auream & bahem quam misistis, suscepimus. Les uns croyent que ce nom bahem signifie des perles ; d’autres un habit. Le Grec, au lieu de bahem, lit baïnam, que Grotius dérive de baïs, une branche de palmier. Ce sentiment paroît le meilleur. Il étoit assez ordinaire d’envoyer ainsi des couronnes & des palmes d’or aux rois vainqueurs en forme de présens. Machab. I. c. xiij. v. 37. Syr. ad. 1. Mach. xiij. 37. (G)
BAHIR, c’est-à-dire illustre. Buxtorf a remarqué dans sa bibliotheque des Rabbins, que les Juifs ont un livre de ce nom. Il ajoûte que c’est le plus ancien de tous les livres des Rabbins ; qu’il y est traité des plus profonds mysteres de la cabale ; que ce livre n’a point été imprimé ; qu’on en voit seulement plusieurs passages dans les ouvrages des Rabbins ; que l’auteur se nommoit Rabbi Nechonia Ben Hakkana, & qu’il vivoit, selon les Juifs, en même tems que Jonathan, auteur de la paraphrase Chaldaïque, c’est-à-dire environ quarante ans avant Jesus-Christ. Le même Buxtorf s’est servi du témoignage de ce livre pour prouver l’antiquité des points voyelles, qui sont écrits au texte Hébreu de la bible : mais cette preuve est mauvaise, le bahir n’étant point un ouvrage aussi ancien qu’il a prétendu. M. Simon a mis dans le catalogue des auteurs Juifs, que l’on a depuis peu imprimé en Hollande, un petit livre intitulé Bahir : mais il dit qu’il n’y a pas d’apparence que ce soit l’ancien bahir des Juifs, qui est beaucoup plus étendu. (G)
* BAHREIN ou BAHRAIN, (Géog.) province de l’Arabie heureuse, sur le golfe Persique, avec île de même nom.
BAHU, s. m. en Architecture ; c’est le profil bombé du chaperon d’un mur, de l’appui d’un quai, d’un parapet, d’une terrasse ou d’un fossé, & d’une balustrade.
Bahu. On dit en terme de Jardinage, qu’une platebande, qu’une planche, ou qu’une couche de terre est en bahu, lorsqu’elle est bombée sur sa largeur pour faciliter l’écoulement des eaux, & mieux élever les fleurs. Les platebandes se font aujourd’hui en dos d’âne ou de carpe, c’est-à-dire en glacis à deux égoûts. (P)
* BAHURIN, (Géog. anc. & mod.) ville de la Palestine, de la tribu de Benjamin, sur une haute montagne, aux confins de la tribu de Juda ; on l’appelle aujourd’hui Bachori.
* BAHUS, (Géog.) ville de Suede, capitale du gouvernement de même nom, sur un rocher dans une île formée par la Gothelbe. Long. 29. 20. lat. 57. 52.
BAHUTIER, s. m. ouvrier dont le métier est de faire des bahus, coffres, valises, malles, &c. & autres ouvrages de cette nature, couverts de peau de veau, de vache, d’ours, &c. mais non de chagrin. Les ouvrages en chagrin sont reservés aux guaîniers. Les bahutiers sont de la communauté des coffretiers.
BAI, adj. (Manége.) poil de cheval tirant sur le rouge : ce poil a plusieurs nuances, savoir, bai clair, bai doré, bai brun, bai châtain, bai cerise, bai miroité ou à miroir, lorsqu’on distingue des taches rondes semées par tout le corps, & d’un bai plus clair que le reste du corps. (V)
BAJAMO, (le) Géog. petite contrée de l’île de Cuba, une des Antilles. Voyez Antilles.
BAIANISME. Voyez Bayanisme.
BAJARIA, (Géog. anc. & mod.) riviere de Sicile qu’on appelle encore Amirati : elle se jette dans la mer de Toscane à côté de Palerme. C’est l’Eleutherus des anciens.
BAIE, BÉE, s. f. ou JOUR, terme d’Architecture : on nomme ainsi toutes sortes d’ouvertures percées dans les murs pour éclairer les lieux, comme croisées, portes, &c. On dit baie ou bée de croisée, & baie ou bée de porte, &c. (P)
Baie, s. f. en Géographie, petit golfe ou bras de mer qui s’avance dans la terre, & dont le milieu en-dedans a plus d’étendue que l’entrée, ou ce qu’on nomme l’embouchure de la baie. Telle est la baie d’Hudson dans l’Amérique septentrionale. Voyez Golfe. (O)
Baie, s. f. bacca, (Hist. nat. bot.) fruit mou, charnu, succulent, qui renferme des pepins ou des noyaux : tels sont les fruits du laurier, du troêne, du myrte, &c. Lorsque de pareils fruits sont disposés en grappe, on leur donne le nom de grains, au lieu de celui de baie : par exemple, on dit un grain de raisin, un grain de sureau, &c. Tournefort. (I)
* Baie, (Géog. anc.) ville d’Italie dans ce que nous appellons aujourd’hui la terre de Labour, proche de Naples, à l’occident. Il n’en reste rien qu’un soûterrein appellé le Cento Camerelle, les cent petites chambres, & quelques ruines du pont que Caligula voulut construire sur le golfe qui séparoit Baie de Pouzzol. On présume que les Cento Camerelle servoient de casernes à la chiourme Romaine.
BAIGNER, v. act. (Gramm.) c’est plonger un corps nud dans l’eau, ou plus généralement dans un fluide, afin que ses parties en soient appliquées immédiatement à la peau. Voyez Bain.
Baigner, se dit en Fauconnerie de l’oiseau de proie, lorsque de lui-même il se jette dans l’eau ou qu’il se mouille à la pluie, ou qu’on le plonge dans l’eau quand on le poivre.
BAIGNEUR, s. m. (Hist. anc.) valet des bains chez les anciens. Athenée dit que ces sortes de domestiques avoient une chanson particuliere : mais s’il étoit permis aux personnes qui servoient aux bains de chanter, il n’étoit point honnête à ceux qui se baignoient d’en faire autant ; car Théophraste, ch. iv. des Caract. faisant la peinture de l’homme grossier, le représente chantant dans le bain. (G)
Baigneur, s. m. c’est celui qui tient des bains chez lui pour la commodité du public. Les Baigneurs sont appellés Etuvistes, & font corps avec les Perruquiers-Barbiers.
* BAIGNEUX, (Géog.) ville de France en Bourgogne, diocese de Dijon.
BAIGNOIRE, s. f. est une cuve de cuivre rouge de quatre piés & demi de longueur, sur deux & demi de largeur, arrondie par ses angles, & qui a environ 26 pouces de hauteur, servant à prendre le bain. Ces baignoires sont étamées en-dedans pour empêcher le verd-de-gris, & sont souvent décorées en-dehors de peintures à l’huile relatives à leur usage. Pour plus de propreté & de commodité, l’on pose dans le dedans des linges piqués, des oreillers, &c. aux deux côtés de ces baignoires, dans lesquelles on se tient assis : à leurs extrémités supérieures, sont placés deux robinets à droite & à gauche, l’un pour distribuer de l’eau chaude amenée de l’étuve, l’autre de l’eau froide amenée du réservoir. Au fond de la baignoire est pratiquée une bonde que l’on leve pour faire écouler l’eau à mesure que l’on a besoin d’en remettre de la chaude, ou de la renouveller, selon le tems qu’on veut rester au bain. Cette bonde fermée contient l’eau, & lorsqu’elle est levée elle la précipite dans un tuyau de décharge, qui l’expulse dans les basses cours ou dans les puisards pratiqués exprès.
Ces baignoires sont ordinairement placées dans des niches qui prennent le plus souvent la forme d’un de leurs grands côtés, & sont couvertes d’un baldaquin ou impérial décoré de mousseline, toile de coton, toile peinte, ou perse, comme il s’en voit au château de S. Cloud, de Sceaux, &c.
Par économie ces baignoires se font quelquefois de bois, & se portent en ville chez les particuliers, lorsqu’ils sont obligés pendant l’hyver de prendre les bains, par indisposition ou autrement. (P)
M. Burette, dans les Mém. de l’Acad. des Belles-Lettres, remarque que dans les thermes des anciens il y avoit deux sortes de baignoires ; les unes fixes, & les autres mobiles ; & que parmi ces dernieres on en trouvoit de faites exprès pour être suspendues en l’air, & dans lesquelles on joignoit le plaisir de se baigner à celui d’être balancé, & comme bercé par le mouvement qu’on imprimoit à la baignoire. (G)
Les baignoires de cuivre sont l’ouvrage des chauderonniers ; les tonneliers font & relient celles de bois.
Baignoire, chez les Hongrieurs ; c’est ainsi qu’ils appellent la poelle dans laquelle ils font chauffer l’eau d’alun & le suif qu’ils employent dans l’apprêt de leurs cuirs. Voyez la vignette, Pl. de l’Hongrieur.
* BAIGORRI, (le) Géog. petit pays de France dans la basse Navarre, entre les confins de la haute Navarre à l’occident, & le pays de Cise à l’orient.
* BAIKAL, lac de Sibérie d’où sort la riviere d’Angara. Il a en long. 125-130.
BAIL, s. m. terme de Droit, est une convention par laquelle on transfere à quelqu’un la joüissance ou l’usage d’un héritage, d’une maison, ou autre sorte de bien, ordinairement pour un tems déterminé, moyennant une rente payable à certains tems de l’année que le bailleur stipule à son profit, pour lui tenir lieu de la joüissance ou de l’usage dont il se dépouille. Il y a aussi des baux par lesquels on promet de faire certains ouvrages pour un certain prix. Voy. Louage, Location.
Le bail des choses qui produisent des fruits est ce qu’on appelle bail à ferme. Voyez Ferme.
Le bail des choses qui ne rapportent point de fruits est ce qu’on appelle bail à loyer. Voyez Loyer.
Chez les Romains les baux ne se faisoient pas pour un tems plus long que cinq années. Parmi nous ils ne passent jamais neuf ans, à moins qu’ils ne soient à vie ou emphytéotiques Voyez Emphytéotique.
Les baux se sont pardevant notaire ou sous seing privé. Ils sont également obligatoires d’une & d’autre maniere : seulement s’ils ne sont faits que sous signature privée, ils n’emportent point hypotheque sur les biens du bailleur ni du preneur. Les Anglois font aussi des baux de vive voix.
Tous ceux qui ont la libre administration de leur bien en peuvent faire des baux ; ceux même qui n’en ont que l’usufruit le peuvent aussi ; tels qu’un mari, une femme doüairiere, un tuteur, un bénéficier ; & dans l’usage commun, ceux qui entrent en joüissance après eux doivent entretenir les baux qu’ils ont faits.
L’obligation de celui qui fait le bail est de faire joüir le fermier ou locataire de la chose donnée à ferme ou à loyer, ou de lui payer des dommages & intérêts qui l’indemnisent de la perte qu’il souffre par l’inexécution du bail.
Mais il peut en demander la résiliation, pour défaut de payement ; si le locataire ou fermier dégrade l’héritage qu’il tient à bail ; si la maison tenue à bail menace ruine, & qu’il y ait nécessité de la rebâtir ; si le propriétaire d’une maison de ville veut occuper sa maison en personne ; & dans tous ces cas le propriétaire ne doit pas des dommages & intérêts au fermier ou locataire.
Celui qui succede au propriétaire n’est engagé à entretenir le bail par lui fait, que quand il lui succede à titre universel ; c’est-à-dire, à titre d’héritier, de donataire ou légataire universel ; mais non pas s’il lui succede à titre singulier, soit lucratif ou onéreux.
Le fermier ou locataire de son côté est obligé à trois choses : 1°. à joüir en bon pere de famille, à ne point faire de dégradations dans les lieux dont il a la joüissance, & même à y faire les réparations locatives ou viageres auxquelles il s’est obligé par son bail : 2°. à payer le prix du bail, si ce n’est que le fermier ait souffert des pertes considérables dans l’exploitage de sa ferme par des cas fortuits ; ce qu’on appelle en Droit vimaires, du Latin vis major, comme grêle, feu du ciel, inondations, guerre, &c. auquel cas l’équité naturelle exige qu’il soit fait une diminution au fermier : 3°. à entretenir le bail, c’est-à-dire, à continuer l’habitation ou l’exploitage jusqu’à l’expiration du bail.
Lorsque le terme du bail est expiré, si le locataire continue à occuper la maison, ou le fermier à exploiter la ferme, quoiqu’il n’y ait point de convention entre les parties, le silence du propriétaire fait présumer un consentement de sa part, & cela forme un contrat entre les parties qu’on appelle tacite réconduction. Voyez Réconduction.
Le bail à rente, suivant la définition que nous avons donnée du mot bail au commencement de cet article, est moins proprement un bail qu’une véritable aliénation, par laquelle on transfere la propriété d’un immeuble à la charge d’une certaine somme ou d’une certaine quantité de fruits que le possesseur doit payer à perpétuité tous les ans.
Le bail à rente differe de l’emphytéose en plusieurs choses, mais singulierement en ce que de sa nature il doit durer à perpétuité, moyennant la prestation de la rente par le tenancier ; au lieu que l’emphytéose finit souvent après un tems déterminé, comme de 99 ans, ou de deux ou trois générations. Voyez Emphytéose.
Bail Emphytéotique, voyez Emphytéose.
Bail a Cheptel, voyez Cheptel.
Bail judiciaire, voyez Judiciaire.
On appelle aussi bail l’expédition même du traité appellé bail, qu’on leve chez le notaire devant lequel il a été passé.
Bail est encore synonyme à ce qu’on appelle autrement baillie, ou garde-noble, ou bourgeoise. Voyez Garde.
Bail, dans les anciennes coûtumes, signifie aussi la tradition d’une chose ou d’une personne à quelqu’un : en ce sens on dit qu’il y a bail quand une fille se marie, parce qu’elle entre en la puissance de son mari ; & quand son mari meurt il y a desbail, parce qu’elle est affranchie par sa mort de la puissance maritale. Voyez Desbail & Puissance maritale. (H)
BAILE, s. m. m. terme de Palais usité particulierement en Béarn, où il se dit de certains huissiers subalternes qui ne peuvent exploiter que contre les roturiers, à la différence des veguers qui exploitent contre les gentilhommes. Voyez Veguer. (H)
Baile, s. m. (Polit. & Comm.) nom qu’on donne à Constantinople à l’ambassadeur de la république de Venise résident à la Porte.
Outre les affaires de politique & d’état dont ce ministre est chargé, il fait aussi les fonctions de consul de la nation auprès du grand Seigneur, & c’est proprement de lui que dépendent les autres consuls établis dans les échelles du levant, qui ne sont pour la plûpart que des vice-consuls. Voyez Consul. (G)
BAILLE-BOUTE, s. f. c’est parmi les Marins une moitié de tonneau en forme de baquet. Les vaisseaux de guerre ont une baille amarrée à chaque hune, pour y enfermer des grenades & autres artifices que l’on couvre de peaux fraîches, s’il est possible, pour les garantir du feu.
On met dans des bailles le breuvage que l’on distribue tous les jours aux gens de l’équipage. Il y a aussi des bailles à tremper les écouvillons dont on se sert pour rafraîchir le canon. Il y a des bailles pour mettre tremper le poisson & la viande salée.
On se sert quelquefois des bailles pour puiser l’eau qui entre dans le rum ou fond de cale. (Z)
BAILLEMENT, s. m. (Physiolog.) ouverture involontaire de la bouche, occasionnée par quelque vapeur ou ventuosité qui cherche à s’échapper, & témoignant ordinairement la fatigue, l’ennui, ou l’envie de dormir.
Le remede qu’Hippocrate prescrit contre le baillement, est de garder long-tems sa respiration. Il recommande la même chose contre le hocquet. Voyez Hocquet. Suivant l’ancien système, le bâillement n’est jamais produit sans quelque irritation qui détermine les esprits animaux à couler en trop grande abondance dans la membrane nerveuse de l’œsophage, qu’on a regardée comme le siége du bâillement. Quant à cette irritation, on la suppose occasionnée par une humeur importune qui humecte la membrane de l’œsophage, & qui vient ou des glandes répandues dans toute cette membrane, ou des vapeurs acides de l’estomac rassemblées sur les parois de l’œsophage. Par ce moyen les fibres nerveuses de la membrane du gosier étant irritées, elles dilatent le gosier, & contraignent la bouche à suivre le même mouvement.
Mais cette explication du bâillement a depuis peu donné lieu à une nouvelle plus méchanique & plus satisfaisante.
Le bâillement est produit par une expansion de la plûpart des muscles du mouvement volontaire, mais sur-tout par ceux de la respiration. Il se forme en inspirant doucement une grande quantité d’air, qu’on retient & qu’on raréfie pendant quelque tems dans les poumons, après quoi on le laisse échapper peu à peu, ce qui remet les muscles dans leur état naturel.
De-là, l’effet du bâillement est de mouvoir, d’accélérer & de distribuer toutes les humeurs du corps également dans tous les vaisseaux, & de disposer par conséquent les organes de la sensation & tous les muscles du corps, à s’acquiter chacun de leur côté de leurs fonctions respectives. Voy. Bcerhaave, Inst. méd. §. 638. (L)
Baillement, s. m. ce mot est aussi un terme de Grammaire ; on dit également hiatus : mais ce dernier est latin. Il y a bâillement toutes les fois qu’un mot terminé par une voyelle, est suivi d’un autre qui commence par une voyelle, comme dans il m’obligea à y aller ; alors la bouche demeure ouverte entre les deux voyelles, par la nécessité de donner passage à l’air qui forme l’une, puis l’autre sans aucune consonne intermédiaire ; ce concours de voyelles est plus pénible à exécuter pour celui qui parle, & par conséquent moins agréable à entendre pour celui qui écoute ; au lieu qu’une consonne faciliteroit le passage d’une voyelle à l’autre. C’est ce qui a fait que dans toutes les langues, le méchanisme de la parole a introduit ou l’élision de la voyelle du mot précédent, ou une consonne euphonique entre les deux voyelles.
L’élision se pratiquoit même en prose chez les Romains. « Il n’y a personne parmi nous, quelque grossier qu’il soit, dit Cicéron, qui ne cherche à éviter le concours des voyelles, & qui ne les réunisse dans l’occasion. » Quod quidem latina lingua sic observat, nemo ut tam rusticus sit, quin vocales nolit conjungere. Cic. Orator. n. 150. Pour nous, excepté avec quelques monosyllabes, nous ne faisons usage de l’élision que lorsque le mot suivi d’une voyelle est terminé par un e muet ; par exemple, une sincere amitié, on prononce sincer-amitié. On élide aussi l’i de si en si il, qu’on prononce s’il ; on dit aussi m’amie dans le style familier, au lieu de ma amie ou mon amie : nos peres disoient m’amour.
Pour éviter de tenir la bouche ouverte entre deux voyelles, & pour se procurer plus de facilité dans la prononciation, le méchanisme de la parole a introduit dans toutes les langues, outre l’élision, l’usage des lettres euphoniques, & comme dit Cicéron, on a sacrifié les regles de la Grammaire à la facilité de la prononciation : Consuetudini auribus indulgenti libenter obsequor...... Impetratum est à consuetudine ut peccare suavitatis causâ liceret. Cicer. Orator. n. 158. Ainsi nous disons mon ame, mon épée, plûtôt que ma ame, ma épée. Nous mettons un t euphonique dans y a-t-il, dira-t-on ; & ceux qui au lieu du tiret ou trait d’union mettent une apostrophe après le t, font une faute : l’apostrophe n’est destinée qu’à marquer la suppression d’une voyelle, or il n’y a point ici de voyelle élidée ou supprimée.
Quand nous disons si l’on au lieu de si on, l’ n’est point alors une lettre euphonique, quoiqu’en dise M. l’abbé Girard, tom. I. p. 344. On, est un abrégé de homme ; on dit l’on comme on dit l’homme. On m’a dit, c’est-à-dire, un homme, quelqu’un m’a dit. On, marque une proposition indéfinie, individuum vagum. Il est vrai que quoiqu’il soit indifférent pour le sens de dire on dit ou l’on dit, l’un doit être quelquefois préferé à l’autre, selon ce qui précede ou ce qui suit, c’est à l’oreille à le décider ; & quand elle préfere l’on au simple on, c’est souvent par la raison de l’euphonie, c’est-à-dire par la douceur qui résulte à l’oreille de la rencontre de certaines syllabes. Au reste ce mot euphonie est tout grec, εὖ bien, & φωνὴ, son.
En grec le ν, qui répond à notre n, étoit une lettre euphonique, sur-tout après l’ε & l’ι : ainsi au lieu de dire εἴχοσι ἄνδρες, viginti viri, ils disent εἴχοσιν ἄνδρες, sans mettre ce ν entre les deux mots.
Nos voyelles sont quelquefois suivies d’un son nasal, qui fait qu’on les appelle alors voyelles nasales. Ce son nasal est un son qui peut être continué, ce qui est le caractere distinctif de toute voyelle : ce son nasal laisse donc la bouche ouverte ; & quoiqu’il soit marqué dans l’écriture par un n, il est une véritable voyelle : & les poëtes doivent éviter de le faire suivre par un mot qui commence par une voyelle, à moins que ce ne soit dans les occasions où l’usage a introduit un n euphonique entre la voyelle nasale & celle du mot qui suit.
Lorsque l’adjectif qui finit par un son nasal est suivi d’un substantif qui commence par une voyelle, alors on met l’n euphonique entre les deux, du moins dans la prononciation ; par exemple, un-n-enfant, bon-nhomme, commun-n-accord, mon-n-ami. La particule on est aussi suivie de l’n euphonique, on-n-a. Mais si le substantif précede, il y a ordinairement un baillement ; un écran illuminé, un tyran odieux, un entretien honnête, une citation équivoque, un parfum incommode ; on ne dira pas un tyran-n-odieux, un entretien n-honnête, &c. On dit aussi un bassin à barbe, & non un bassin-n-à barbe. Je sai bien que ceux qui déclament des vers où le poëte n’a pas connu ces voyelles nasales, ajoûtent l’n euphonique, croyant que cette n est la consonne du mot précédent : un peu d’attention les détromperoit : car, prenez-y-garde, quand vous dites il est bon-n-homme, bon-n-ami, vous prononcez bon & ensuite-n-homme,-n-ami. Cette prononciation est encore plus desagréable avec les diphthongues nasales, comme dans ce vers d’un de nos plus beaux opera :
Ah ! j’attendrai long-tems, la nuit est loin encore ;
où l’acteur pour éviter le bâillement prononce loin-n-encore, ce qui est une prononciation normande.
Le b & le d sont aussi des lettres euphoniques. En latin ambire est composé de l’ancienne préposition am, dont on se servoit au lieu de circùm, & de ire ; or comme am étoit en latin une voyelle nasale, qui étoit même élidée dans les vers, le b a été ajoûté entre am & ire, euphonia causâ.
On dit en latin prosum, prosumus, profui ; ce verbe est composé de la préposition pro, & de sum : mais si après pro le verbe commence par une voyelle, alors le méchanisme de la parole ajoûte un d, prosum, prod-es, pro-d-est, pro-d-eram, &c. On peut faire de pareilles observations en d’autres langues ; car il ne faut jamais perdre de vûe que les hommes sont par-tout des hommes, & qu’il y a dans la nature uniformité & varieté. (F)
BAILLER, v. neut. respirer en ouvrant la bouche extraordinairement & involontairement. Bâiller d’ennui, bâiller de sommeil. V. Baillement ci-dessus. (L)
BAILLET, adj. (Manége.) cheval baillet, est celui qui a le poil roux tirant sur le blanc. (V)
* BAILLEUL ou BELLE, ville de France, au comté de France. Long. 20 25. lat. 50 45.
BAILLEUR, s. m. terme de Pratique, est celui des deux parties contractantes dans un bail, qui loue ou afferme sa propre chose. Il est opposé à preneur. Voy. Preneur. (H)
BAILLI, s. m. (Hist. mod. & Jurisprud.) on entend en général par ce mot, un officier chargé de rendre la justice dans un certain district appellé bailliage. Voyez Bailliage.
Ce mot est formé de baile, vieux terme qui signifie gouverneur, du Latin bajulus qui a la même signification.
Pasquier assûre que les baillis étoient originairement une sorte de subdélégués, que l’on envoyoit dans les provinces pour examiner si les comtes, qui alors étoient les juges ordinaires, rendoient exactement la justice. Loyseau rapporte plus vraissemblablement l’origine des baillis, à l’usurpation & à la négligence des grands seigneurs, qui s’étant emparés de l’administration de la justice, & étant trop foibles pour ce fardeau, s’en déchargerent sur des députés qu’on appella baillis. Ces baillis eurent d’abord l’inspection des armes & l’administration de la justice & des finances : mais comme ils abuserent de leur pouvoir, ils en furent insensiblement dépouillés, & la plus grande partie de leur autorité fut transferée à leurs lieutenans, qui étoient gens de robe : en France les baillis ont encore une ombre de leurs anciennes prérogatives, & sont considérés comme les chefs de leurs districts : c’est en leur nom que la justice s’administre ; c’est devant eux que se passent les contrats & les autres actes, & ce sont eux qui ont le commandement des milices.
C’est de-là que les baillis d’Angleterre ont pris leur nom & leur office : comme il y a en France huit Parlemens, qui sont des Cours suprèmes, des arrêts desquels il n’y a point d’appel ; & que dans le ressort de plusieurs parlemens, ou de différentes provinces, la justice est rendue par des baillis ou du moins par leurs lieutenans : de même il y a en Angleterre différens comtés, dans lesquels la justice est administrée par un vicomte ou sherif, qui paroit vraissemblablement avoir été appellé bailli, & son district bailliage.
Le bailli dans l’origine étoit donc un seigneur, qui avoit dans l’étendue de son bailliage, l’administration de la justice, le commandement des armes & le maniement des finances. De ces trois prérogatives, il ne leur reste plus que le commandement du ban & de l’arriere-ban. Quant à l’administration de la justice, ce ne sont plus que des juges titulaires. Les sentences & les commissions s’expédient bien en leur nom : mais ce sont leurs lieutenans de robe qui rendent la justice. Les baillis des siéges particuliers ressortissans au bailliage général, ne sont proprement que les lieutenans de ceux-là.
On distingue de ces baillis royaux, les baillis seigneuriaux par la dénomination de haut-justiciers. Quelques-uns de ceux-ci ressortissent aux bailliages royaux, lesquels ressortissent au parlement ; mais il y a des baillis haut-justiciers qui ressortissent nuement au parlement, tels sont les baillis des duchés-pairies. (H)
* Bailli (Hist. mod.) nom d’un grade ou dignité dans l’ordre de Malte. On en distingue de deux sortes, les baillis conventuels & les baillis capitulaires. Les premiers sont les huit chefs ou piliers de chaque langue. Voyez Pilier & Langue. On les appelle conventuels, parce qu’ordinairement ils résident dans le couvent de la religion à Malte.
Les baillis capitulaires, ainsi nommés, parce que dans les chapitres provinciaux, ils ont séance immédiatement après les grands-prieurs, sont des chevaliers qui possedent des bailliages de l’Ordre. La langue de France a deux bailliages, dont les titulaires sont le bailli de la Morée ou commandeur de S. Jean de Latran à Paris, & le grand trésorier ou commandeur de S. Jean en l’île proche de Corbeil. La langue de Provence a le bailliage de Manosque ; & celle d’Auvergne, le bailliage de Lyon. Il y a de même des bailliages & des baillis capitulaires dans les autres langues. Voyez Malte. (G)
BAILLIAGE, s. m. (Jurisp.) est tout le territoire où s’étend la jurisdiction d’un bailli. Un bailliage principal en contient pour l’ordinaire plusieurs autres, lesquels connoissent des mêmes matieres, & ressortissent à ce bailliage principal, lequel connoît exclusivement aux autres en dernier ressort des cas présidiaux : car ces bailliages supérieurs équivalent pour l’autorité aux présidiaux & aux sénéchaussées, dont ils ne différent que par le nom. Voyez Présidial & Bailli.
On appelle aussi bailliage l’office même du bailli. On donne aussi le même nom au lieu où il tient sa séance. (H)
Baillie, s. f. (Jurisprudence) terme de coutumes, est synonyme à garde-noble ou bourgeoise. Voyez Garde.
Baillistre, s. m. (Jurisprudence) vieux terme encore usité dans quelques coutumes, qui est synonyme à tuteur ou gardien ; & est dirivé de baillie, qui dans les mêmes coûtumes signifie tutelle ou garde. Voyez Baillie.
BAILLIVAGE, ou Balivage, s. m. (Jurisprudence) terme d’eaux & forêts, est l’étiquette ou la marque des baliveaux qui doivent rester sur pié dans les bois coupés ou à couper. Voyez Baliveau. (H)
BAILLONNÉ, adj. (terme de Blason) il se dit des animaux qui ont un bâton entre les dents, comme les lions, les ours, les chiens, &c.
Bourneus au pays de Vaux, d’argent au lion de sable baillonné de gueules à la bordure componnée d’argent & de sable. (V)
BAILLOGUES, s. f. c’est ainsi que les plumassiers nomment des plumes de couleurs mêlées ; blanches, & noires, par exemple.
BAILLOTTE, s. f. (en terme de Marine) c’est un seau.
BAINS, s. m. (terme d’Architecture) grands & somptueux bâtimens, élevés par les anciens pour l’ornement & la commodité. Il faut distinguer les bains en naturels ou en artificiels. Les bains naturels sont ou froids comme l’eau des rivieres, ou chauds comme ceux des eaux minérales, propres à la guérison de plusieurs maux. Voyez Eaux Minérales, & plus bas Bain en Médecine.
Les bains artificiels, qui étoient plûtôt pour la propreté du corps que pour la santé, étoient chez les anciens des édifices ou publics ou particuliers. Les bains publics ont été en usage en Grece & à Rome : mais les Orientaux s’en servirent auparavant. La Grece connoissoit les bains chauds dès le tems d’Homere, comme il paroît par divers endroits de l’Odyssée ; & ils étoient ordinairement joints aux gymnases ou palestres, parce qu’en sortant des exercices on prenoit le bain. Vitruve a donné une description fort détaillée de ces bains, par laquelle il paroît qu’ils étoient composés de sept pieces différentes, la plûpart détachées les unes des autres, & entremêlées de quelques pieces destinées aux exercices. Ces sept pieces étoient : 1°. le bain froid, frigida lavatio, en Grec λουτρὸν : 2°. l’elæothesium, c’est-à-dire, la chambre où l’on se frottoit d’huile ; 3°. le lieu de rafraîchissement, frigidarium ; 4°. le propnigeum, c’est-à-dire l’entrée ou le vestibule de l’hypocaustum ou du poelle ; 5°. l’étuve voutée pour faire suer, ou le bain de vapeur, appellé tepidarium ; 7°. le bain d’eau chaude, calida lavatio, auxquels il faudroit joindre l’apodyterion, ou garde-robe, si toutefois ce n’est pas la même chose que le tepidarium.
Quant aux bains détachés des palestres, il résulte de la description qu’en fait Vitruve : 1°. que ces bains étoient ordinairement doubles, les uns pour les hommes, les autres pour les femmes ; du moins chez les Romains, qui en ce point avoient plus consulté les bienséances, que les Lacédémoniens, chez qui les deux sexes se baignoient pêle-mêle : 2°. que les deux bains chauds se joignoient de fort près, afin qu’on pût échauffer par un même fourneau, les vases de l’un & de l’autre bain : 3°. que le milieu de ces bains étoit occupé par un grand bassin, qui recevoit l’eau par divers tuyaux, & dans lequel on descendoit par le moyen de quelques degrés ; ce bassin étoit environné d’une balustrade, derriere laquelle régnoit une espece de corridor, schola, assez large, pour contenir ceux qui attendoient que les premiers venus sortissent du bain : 5°. que les deux étuves, appellées laconicum & tepidarium, étoient jointes ensemble : 6°. que ces lieux étoient arrondis au compas, afin qu’ils reçussent également à leur centre la force de la vapeur chaude, qui tournoit & se répandoit dans toute leur cavité : 7°. qu’ils avoient autant de largeur que de hauteur jusqu’au commencement de la voûte, au milieu de laquelle on laissoit une ouverture pour donner du jour, & on y suspendoit avec des chaînes un bouclier d’airain, qu’on haussoit ou baissoit à volonté, pour augmenter ou diminuer la chaleur ; 8°. que le plancher de ces étuves étoit creux & suspendu pour recevoir la chaleur de l’hypocauste, qui étoit un grand fourneau maçonné dessous, que l’on avoit soin de remplir de bois & d’autres matieres combustibles, & dont l’ardeur se communiquoit aux étuves à la faveur du vuide qu’on laissoit sous leurs planchers : 9°. que ce fourneau servoit non-seulement à échauffer les deux étuves, mais aussi une autre chambre appellée vasarium, située proche de ces mêmes étuves & des bains chauds, & dans laquelle étoient trois grands vases d’airain, appellés milliaria à cause de leur capacité ; l’un pour l’eau chaude, l’autre pour la tiede, & le troisieme pour la froide. De ces vases partoient des tuyaux qui correspondant aux bains, y portoient par le moyen d’un robinet l’eau, suivant les besoins de ceux qui se baignoient.
A l’égard de l’arrangement ou disposition de ces divers appartemens des bains, voici ce qu’on en sait : on y voyoit d’abord un grand bassin ou vivier appellé en grec κολυμϐηθρὰ, en latin natatio & piscina, qui occupoit le côté du nord, & où l’on pouvoit non-seulement se baigner, mais même nager très-commodément. Les bains des particuliers avoient quelquefois de ces piscines, comme il paroît par ceux de Pline & de Ciceron. L’édifice des bains étoit ordinairement exposé au midi, & avoit une face très-étendue, dont le milieu étoit occupé par l’hypocauste, qui avoit à droite & à gauche une suite de quatre pieces semblables des deux côtés, & disposées de maniere qu’on pouvoit passer facilement des unes dans les autres. Ces pieces nommées en général balnearia, étoient celles que nous avons décrites ci-dessus. La salle du bain chaud étoit une fois plus grande que les autres, à cause du grand concours du peuple qui y abordoit, & du long séjour qu’on y faisoit d’ordinaire.
Les anciens prenoient ordinairement le bain avant souper, & il n’y avoit que les voluptueux qui se baignassent à la suite de ce repas. Au sortir du bain, ils se faisoient frotter d’huiles ou d’onguens parfumés par des valets nommés alyptæ ou unctuarii. Les bains, si on en croit Pline, ne furent en usage à Rome que du tems de Pompée ; dès lors les édiles eurent soin d’en faire construire plusieurs. Dion, dans la vie d’Auguste, rapporte que Mecene fit bâtir le premier bain public : mais Agrippa, dans l’année de son édilité, en fit construire cent soixante & dix. A son exemple, Neron, Vespasien, Tite, Domitien, Severe, Gordien, Aurelien, Diocletien, & presque tous les empereurs, qui chercherent à se rendre agréables au peuple, firent bâtir des étuves & des bains avec le marbre le plus précieux, & dans les regles de la plus belle architecture, où ils prenoient plaisir à se baigner avec le peuple : on prétend qu’il y avoit jusqu’à 800 de ces édifices répandus dans tous les quartiers de Rome.
La principale regle des bains étoit d’abord de ne les ouvrir jamais avant deux ou trois heures après midi, ensuite ni avant le soleil levé, ni après le soleil couché. Alexandre Severe permit pourtant qu’on les tint ouverts la nuit dans les grandes chaleurs de l’été, & ajoûta même la libéralité à la complaisance, en fournissant l’huile qui brûloit dans les lampes. L’heure de l’ouverture des bains étoit annoncée au son d’une espece de cloche : le prix qu’il falloit payer pour entrer aux bains étoit très-modique, ne montant qu’à la quatrieme partie d’un as, nommée quadrans ; ce qui valoit à peu près un liard de notre monnoie. Le bain gratuit étoit au nombre des largesses que les empereurs faisoient au peuple à l’occasion de quelque réjoüissance publique : mais aussi dans les calamités on avoit soin de lui retrancher cette commodité, ainsi que le plaisir des spectacles. (G)
* Tout se passoit dans les bains avec modestie : les bains des femmes étoient entierement séparés de ceux des hommes ; & ç’auroit été un crime, si l’un des sexes avoit passé dans le bain de l’autre. La pudeur y étoit gardée jusqu’à ce scrupule, que même les enfans puberes ne se baignoient jamais avec leurs peres, ni les gendres avec leurs beaux-peres. Les gens qui servoient dans chaque bain, étoient du sexe auquel le bain étoit destiné. Mais quand le luxe & la vie voluptueuse eurent banni la modestie, & que la débauche se fut glissée dans toute la ville, les bains n’en furent pas exempts. Les femmes s’y mêlerent avec les hommes, & il n’y eut plus de distinction ; plusieurs personnes de l’un & l’autre sexe n’y alloient même que pour satisfaire leur vûe, ou cacher leurs intrigues : ils y menoient des esclaves ou servantes, pour garder les habits. Les maîtres des bains affectoient même d’en avoir de plus belles, les uns que les autres, pour s’attirer un plus grand nombre de chalans.
Tout ce que les magistrats purent faire d’abord, ce fut de défendre à toutes personnes de se servir de femmes ou de filles pour garder les habits, ou pour rendre les autres services aux bains, à peine d’être notées d’infamie. Mais l’empereur Adrien défendit absolument ce mêlange d’hommes & de femmes sous de rigoureuses peines. Marc Aurele & Alexandre Severe confirmerent cette même loi ; & sous leur regne, les bains des hommes & ceux des femmes furent encore une fois séparés, & la modestie y fut rétablie.
Les ustenciles ou instrumens des bains, outre les vases propres à faire chauffer & à verser l’eau, étoient les baignoires, les étrilles. Voyez Baignoire, Etrille.
Les bains particuliers, quoique moins vastes que les bains publics, étoient de la même forme, mais souvent plus magnifiques & plus commodes, ornés de meubles précieux, de glaces, de marbres, d’or & d’argent. On pouvoit s’y baigner à toute heure ; & l’on rapporte des empereurs Commode & Galien, qu’ils prenoient le bain cinq ou six fois le jour. Mém. de l’Acad. des Belles Lettres, tome I. & III. (G)
* Parmi nous, les bains publics sur la riviere, ne sont autre chose que de grands bateaux, appellés toue, faits de sapin, & couverts d’une grosse toile, autour desquels il y a de petites échelles attachées par des cordes, pour descendre dans un endroit de la riviere où l’on trouve des pieux enfoncés d’espace en espace, qui soûtiennent ceux qui prennent le bain.
Nous appellons bains domestiques ceux que l’on pratique dans la maison des grands ou des particuliers : ils se prennent dans des baignoires de métal, dans lesquelles l’eau est amenée par des conduits de plomb qui descendent d’un réservoir un peu élevé, rempli de l’eau du ciel, ou par le secours d’une pompe. Ces tuyaux garnis de robinets, viennent, avant d’entrer dans la baignoire, se distribuer dans une cuve placée sur un fourneau, qui la tient dans un degré de chaleur convenable.
Ces bains sont composés d’un appartement distribué en plusieurs pieces : savoir, d’une anti-chambre pour tenir les domestiques pendant que le maître est au bain, d’une chambre à lit pour s’y coucher au sortir du bain, d’une salle où est placée la baignoire. d’un cabinet à soûpape ou d’une garderobe, d’un cabinet de toilette, d’une étuve pour sécher les linges & chauffer l’eau, de dégagement, &c. Il est assez d’usage de placer deux baignoires & deux lits dans ces appartemens, ces bains se prenant ordinairement de compagnie, lorsqu’on est en santé.
Ces bains doivent avoir un petit jardin particulier pour faire prendre de l’exercice, sans être vû, aux personnes qui prennent ces bains plûtôt par indisposition que par propreté.
Ces appartemens sont ordinairement décorés de lambris, de peintures, de dorure, & de glaces. C’est dans cette occasion qu’un Architecte qui a du génie, peut donner carriere à son imagination, ces sortes de pieces n’étant pas susceptibles de la sévérité des regles de l’art. Au contraire j’estime que c’est dans ces sortes de pieces seulement qu’il convient de répandre de l’élegance & de l’enjouement : dans l’ordonnance de la décoration de ces petits appartemens, les Vateaux, les Lancrets, peuvent y donner le ton, aussi-bien que les ornemens arabesques, les plans de Chinois, les magots, &c. Tout est de leur ressort, pourvû qu’il y soit ajusté avec goût & discernement. (P)
Bain de santé ou de propreté (en Medecine.) Les Medecins toûjours attentifs à chercher des secours contre les maladies, remarquerent les bons effets qu’il produisoit, & le mirent au nombre de leurs remedes.
On ordonna le bain de différentes façons, c’est-à-dire, qu’il y en eut de chauds & de froids, de généraux & de particuliers.
Dans les bains généraux, soit chauds ou froids, le corps est plongé jusqu’au-dessus des épaules ; dans les particuliers, on ne trempe que la moitié du corps, ce qui s’appelle demi-bain. Celui où on ne trempe que les piés & une partie des jambes, s’appelle pédiluve. On peut aussi rapporter aux bains particuliers les diverses especes de fomentations, & les douches. Voyez Fomentation & Douche.
Les différentes qualités de l’eau, que l’on employe pour le bain, en changent la propriété. Dans les cas où on a intention de ramollir les fibres, & de procurer quelque rélâchement dans toute l’habitude du corps, le bain chaud d’eau douce simple, ou mêlée avec des médicamens émolliens, satisfera à cette indication.
Quand il est question de resserrer la texture des fibres, de leur rendre le ressort qu’elles auront perdu, rien de plus convenable que le bain d’eau froide ; je déduirai par la suite les raisons de cette diversité.
On a encore divisé les bains en domestiques, qui sont ceux que l’on prend chez soi ou chez les Baigneurs, & que l’on compose de plusieurs façons ; il y en a de lait, de décoctions de plantes émollientes, d’eau de son, &c. en bains d’eaux minérales, qui sont ou thermales ou acidules, dont les effets sont différens, selon les principes que ces eaux contiennent : en bains d’eau de riviere, de fleuve ou de mer ; & en bains secs, tels que ceux d’esprit de vin ; ceux de vapeurs du cinabre, que l’on nomme fumigation. Voyez Fumigation : ceux de marc de raisin, de cendres, de sels, de sable, &c. auxquels on peut encore joindre l’application des boues ou bourbes sur tout le corps, qui se pratique en quelques endroits.
Pour expliquer l’action des bains, il faut d’abord poser pour principe que l’eau qui en fait la base, penetre par sa fluidité presque tous les corps, & surtout ceux dont la texture est assez lâche, pour que l’eau puisse trouver entre les fibres dont ils sont composés, des interstices que l’on appelle pores. Voyez Pore.
Le corps humain est un de ceux dans lesquels on en remarque en plus grand nombre ; la déperdition de substance à laquelle il est sujet par la transpiration, prouve assez ce que j’avance. Lorsque le corps se trouve exposé à un certain volume d’eau capable de le presser de tous les côtés, & dont chaque goutte a une pesanteur naturelle, elle s’insinue dans chacun de ses interstices, dont elle augmente la capacité par le relâchement que procure son humidité : parvenue après un certain tems jusqu’à l’intérieur du corps, elle se mêle avec le sang ; aidée d’ailleurs par les contractions réitérées du cœur, qui augmentent à proportion de la pression, elle détruit la cohésion trop forte des molécules du sang, le fait circuler avec plus de facilité, & le rend plus propre aux secrétions ; augmente celle des esprits animaux, si nécessaire pour l’entretien des forces & l’exécution de toutes les fonctions, en même tems qu’elle met le sang en état de se dépouiller des parties nuisibles que son trop grand épaississement, ou sa trop grande lenteur à circuler, y avoient amassées.
Ces principes posés, il ne sera pas difficile de déduire les raisons des phénomenes qu’on observe, selon le degré de chaleur ou de froid des eaux qu’on employe, & la différence des matieres dont elles sont imprégnées. En augmentant la chaleur de l’eau simple, on lui donne un degré d’élasticité dont elle est redevable aux parties ignées qu’elle contient, & qui la rendent plus pénétrante. Lorsqu’elle se trouve chargée de parties ferrugineuses, & chaudes en même tems, son ressort & son poids sont augmentées en raison réciproque de sa chaleur, & de la quantité de fer dont elle est chargée, & qui la rend propre à guérir plusieurs maladies qui ont pour cause l’embarras du sang dans ses couloirs. Si, au contraire, on employe l’eau froide, les effets en seront différens ; car quoique la fluidité & l’humidité soient la même, le froid loin de dilater les pores de la peau, les resserre en quelque sorte, empêche une trop grande évacuation par la transpiration, porte le calme dans la circulation du sang, lorsqu’elle est déreglée, & détruit par ce moyen les causes des maladies occasionnées par ce dérangement. Willis nous en donne un exemple dans son traité de la Phrénésie, à l’occasion d’une fille qui fut guérie de cette maladie par un seul bain froid que l’on lui fit prendre : cette malade étoit dans cet état depuis plusieurs jours ; les saignées, les délayans, les amples boissons émulsionnées, &c. n’avoient pas pû diminuer la fievre violente dont elle étoit attaquée, & la soif qui la dévoroit. Le bain d’eau simple pris dans la riviere, pendant un quart-d’heure, calma tous les accidens, lui procura un sommeil tranquille, & elle fut guérie sans avoir besoin d’autres remedes. On trouve dans la pratique plusieurs exemples de ces guérisons miraculeuses arrivées par hasard ; car souvent des gens attaqués de phrénésie se sont jettés d’eux-mêmes dans des fontaines ou bassins, & ont été guéris.
Ce que l’on peut encore assûrer, c’est que l’usage des bains de riviere, pendant les chaleurs de l’été, est un sûr préservatif contre les maladies qui regnent ordinairement dans cette saison.
Il reste à présent à chercher la raison des effets du bain de mer, que l’on regarde comme le remede le plus salutaire contre la rage, & que je tâcherai de déduire des mêmes principes : ce qui ne sera pas impossible en faisant attention d’abord, que la fluidité & l’humidité que nous trouvons dans l’eau commune, se rencontre dans l’eau de mer ; que sa pesanteur est augmentée par le sel qu’elle contient, & qui lui donne une qualité beaucoup plus pénétrante ; enfin, que la terreur du malade, née de l’appareil & du danger où il se trouve lorsqu’on le plonge, fait un contraste capable de rétablir le déreglement de l’imagination, qui est aussi dérangée dans ce cas, que dans la phrénésie la plus violente : d’ailleurs, on prend la précaution d’aller à la mer pour y être plongé, lorsque l’on a le soupçon d’être attaqué de la rage, sans en avoir de certitude. Voyez Rage.
On conçoit aisément que les bains de vapeurs pénetrent la texture de la peau, & parviennent par les pores jusques à l’intérieur, où elles occasionnent à peu près les mêmes effets que si l’on avoit appliqué les médicamens dont on les tire ; c’est ce que l’on éprouve de la part de l’esprit-de-vin, de celui de vapeurs de cinabre, qui excitent même quelquefois la salivation, effet que produisent les frictions mercurielles ; enfin celui de marc de raisin en pénétrant, soit par sa chaleur, soit par les parties spiritueuses qu’il contient, donne de nouveau aux fibres le ressort qu’elles avoient perdu, & les rétablit dans leur état naturel.
On doit prendre les précautions suivantes pour tirer quelque fruit de l’usage du bain, de quelque espece que ce soit : il faut se faire saigner & purger, le prendre le matin à jeun, ou si c’est le soir, quatre heures après le repas, afin que la digestion des alimens soit entierement finie ; se reposer, ou ne faire qu’un exercice très-moderé après que l’on est sorti du bain ; enfin ne se livrer à aucun excès pendant tout le tems que l’on le prendra, & dans quelque saison que ce soit, ne point se baigner lorsque l’on est fatigué par quelque exercice violent. V. Eau, Eaux thermales, Eaux acidules ou froides. (N)
Bain, en Chimie, se dit d’une chaleur moderée par un intermede mis entre le feu & la matiere sur laquelle on opere, & ce bain est différemment nommé, selon les différens intermedes qu’on y employe.
C’est pourquoi on dit bain de mer, ou par corruption bain-marie, lorsque le vase qui contient la matiere sur laquelle on opere, est posé dans un autre vaisseau plein d’eau, de sorte que le vase soit entouré d’eau, & que le vaisseau qui contient l’eau, soit immédiatement posé sur le feu. Voyez nos figures de Chimie. On pourroit aussi employer d’autres fluides que l’eau, comme l’huile, le mercure même, pour transmettre différentes chaleurs, ce qui feroit différentes especes de bain-marie.
On dit bain de vapeur, lorsque le vase qui contient la matiere est seulement exposé à la vapeur de l’eau qui est sur le feu. Voyez nos figures. Le bain de vapeur dans un vaisseau ouvert, ou qui laisse échapper la vapeur qui s’exhale de l’eau, est moins fort, c’est-à-dire, donne une chaleur plus douce que ne la donne le bain-marie de l’eau boüillante : mais si le vaisseau est fermé exactement, & qu’on pousse le feu dessous, il devient plus fort que le bain-marie, il tient alors de la force de la machine de Papin, ce qui fait voir qu’on peut faire un bain de vapeur très-fort, au lieu que le bain-marie ne peut avoir que les différens degrés de chaleur de l’eau tiede, de l’eau chaude, de l’eau frémissante & de l’eau bouillante. Il est vrai que la chaleur de l’eau bouillante n’est point une chaleur invariable ; elle est différente selon que l’eau est différente, & suivant la différente pesanteur de l’air. L’eau bouillante qui tient en dissolution des sels, est plus chaude qu’une eau bouillante qui seroit simple & pure. Voyez Digestoire.
La chaleur de l’eau bouillante est plus grande quand le barometre est plus élevé, c’est-à-dire, quand l’air est plus pesant ; & elle est moindre quand le barometre est plus bas, c’est-à-dire, quand l’air est plus léger. L’eau bouillante, sur le sommet d’une haute montagne, a moins de chaleur que l’eau bouillante dans un fond, parce que plus l’air est pesant, & plus il presse sur la surface de l’eau, & par conséquent plus il s’oppose à l’échappement des parties de feu qui sont en mouvement dans l’eau, & qui la traversent. C’est pourquoi la plus grande chaleur que puisse avoir l’eau, n’est pas dans le tems qu’elle bout le plus fort, c’est dans le premier instant qu’elle commence à bouillir. Ces connoissances ne sont pas inutiles : il faut y faire attention pour certaines expériences.
On dit bain de sable ou de cendre, lorsqu’au lieu d’eau, on met du sable ou de la cendre. Voyez nos figures de Chimie.
Bains vaporeux, sont termes de Medecine, qui ne signifient autre chose que ce qu’on entend en Chimie par bain de vapeur. Le bain vaporeux est une espece d’étuve qui se fait en exposant le malade à la vapeur chaude d’une eau medicinale, ou de décoctions d’herbes appropriées à la maladie qu’on veut guérir. (M)
Bain, en Chimie & à la Monnoie ; on dit qu’un métal est en bain, lorsque le feu l’a mis en état de fluidité : c’est alors qu’on le remue, ou qu’on le brasse avec des cuillieres de fer, si c’est argent ou cuivre ; pour l’or, il ne se brasse point avec le fer, mais avec une espece de quille faite de terre à creuset, & cuite. Voyez Brasser, Brassoir, Quille
Bain, est un terme générique ; il se prend chez un grand nombre d’Artistes, & pour les liqueurs, & pour les vaisseaux dans lesquels ils donnent quelques préparations à leurs ouvrages.
Bain ou Bouin, terme d’Architecture ; on dit maçonner à bain ou à bouin de mortier, lorsqu’on pose les pierres, qu’on jette les moellons, & qu’on assied les pavés en plein mortier. (P)
Bain, mettre à bain, en Maçonnerie, c’est employer à la liaison des parties d’un ouvrage, la plus grande quantité de plâtre qu’il est possible ; on se sert du mot bain, parce qu’alors les pierres ou moellons sont entierement couverts & enduits de tout côté.
Bain, c’est ainsi que les Plumassiers appellent une poelle de cuivre battu dans laquelle ils plongent ou jettent les plumes qu’ils veulent mettre en couleur. Ils donnent aussi ce nom à la matiere colorante contenue dans la poelle.
Bain, se dit chez les Teinturiers, ou de la cuve qui contient les ingrédiens dans lesquels on met les étoffes pour les colorer, ou des ingrédiens même contenus dans la cuve ; ainsi l’on dit mettre au bain, & l’on dit aussi bain d’alun, bain de cochenille, &c.
Bain (chevaliers du) (Hist. mod.) ordre militaire intitulé par Richard II. roi d’Angleterre, qui en fixa le nombre à quatre, ce qui n’empêcha pas Henri IV. son successeur de l’augmenter de quarante-deux ; leur devise étoit tres in uno, trois en un seul, pour signifier les trois vertus théologales. Leur coûtume étoit de se baigner avant que de recevoir les éperons d’or : mais cela ne s’observa que dans le commencement, & s’abolit ensuite peu à peu, quoique le bain fût l’origine du nom de ces chevaliers, & que leurs statuts portassent que c’étoit pour acquérir une pureté de cœur & avoir l’ame monde, c’est-à-dire pure. L’ordre de chevaliers du bain ne se confere presque jamais, si ce n’est au couronnement des rois, ou bien à l’installation d’un prince de Galles, ou d’un duc d’Yorck. Ils portent un ruban rouge en baudrier. Camden & d’autres écrivains disent que Henri IV. en fut l’instituteur en 1399, à cette occasion : ce prince étant dans le bain, un chevalier lui dit que deux veuves étoient venues lui demander justice ; & dans ce moment il sauta hors du bain en s’écriant que la justice envers ses sujets étoit un devoir préférable au plaisir de se baigner, & ensuite il créa un ordre des chevaliers du bain : cependant quelques auteurs soûtiennent que cet ordre existoit long-tems avant Henri IV. & le font remonter jusqu’au tems des Saxons. Ce qu’il y a de certain, c’est que le bain, dans la création des chevaliers, avoit été long-tems auparavant en usage dans le royaume de France, quoiqu’il n’y eût point d’ordre de chevaliers du bain.
L’ordre des chevaliers du bain, après avoir été comme enseveli pendant bien des années, commença de renaître sous le regne de Georges premier, qui en créa solennellement un grand nombre. (G)
BAJON, s. m. on appelle ainsi sur les rivieres la plus haute des planches ou des barres du gouvernail d’un bateau foncet. (Z)
* BAIONE. Voyez Bayone.
Baione, dite Baïona de Galizia (Géog. anc. & mod.) ville maritime d’Espagne, dans la Galice, à l’embouchure du Minho. Quelques Géographes la prennent pour les Aquæ Celinæ de Ptolomée ; d’autres veulent que ce soit Orense, sur la même riviere que Baïone : sa long. est 9. & sa lat. 41. 54.
BAJOYERS ou JOUILLIERES, s. f. pl. (Hydraul.) sont les aîles de maçonnerie qui revêtissent l’espace ou la chambre d’une écluse fermée aux deux bouts par des portes ou des vannes que l’on leve à l’aide de cables qui filent sur un treuil, que plusieurs hommes maneuvrent.
On pratique le long des bajoyers, des contreforts, des enclaves pour loger les portes quand on les ouvre, & des pertuis pour communiquer l’eau d’une écluse des deux côtés, sans être obligé d’ouvrir ses portes. (K)
* On donne aussi, sur les rivieres, le nom de bajoyers aux bords d’une riviere, près les culées d’un pont.
BAJOIRE, s. f. à la Monnoie, c’est une piece, ou médaille qui a pour effigie deux têtes de profil, qui semblent être appuyées l’une sur l’autre, telle que l’on en voit de Louis & de Carloman, de Henri IV & de Marie de Medicis.
BAJOUES s. f. pl. ou COUSSINETS, (Arts méchaniques.) ce sont des éminences ou bossages, qui tiennent aux jumelles d’une machine, telle que le tire-plomb dont les Vitriers se servent pour fondre le plomb qu’ils employent pour les vitres. Voyez Tire-plomb.
BAIRAM, s. m. (Hist. mod.) nom donné à la grande fête annuelle des Mahométans. Voyez Fête, &c. Quelques Auteurs écrivent ce mot plus conformément à l’orthographe orientale beiram ; c’est originairement un mot Turc, qui signifie à la lettre un jour de fête, ou une solennité. C’est la pâque des Turcs.
Les Mahométans ont deux bairams, le grand & le petit, que Scaliger, Erpenius, Ricaut, Hyde, Chardin, Bobovius, & d’autres écrivains Européens, prennent ordinairement l’un pour l’autre, donnant à ce que les Turcs appellent le petit bairam, le nom de grand ; & au contraire. Le petit bairam dure trois jours, pendant lesquels tout travail cesse, & l’on s’envoye des présens l’un à l’autre avec beaucoup de marques de joie. Si le lendemain du ramadhan se trouve si nébuleux & couvert qu’on ne puisse pas voir la nouvelle lune, on remet le bairam au lendemain : il commence ce jour-là, quand même la lune seroit encore cachée, & il est annoncé par des décharges de canon au sérail, & au son des tambours & des trompettes dans les places publiques. En célébrant cette fête, les Turcs font dans leurs mosquées quantité de cérémonies, ou plûtòt de simagrées bisarres, & finissent par une priere solennelle contre les infideles, dans laquelle ils demandent que les princes Chrétiens soient extirpés ; qu’ils s’arment les uns contre les autres, & qu’ils donnent ainsi occasion à la loi Mahométane de s’étendre. On se pardonne mutuellement les injures, & l’on s’embrasse en disant, Dieu te donne la bonne pâque.
Autant la rigueur du ramadham a été extrème, autant la débauche & l’intempérance regne pendant les jours du bairam : ce ne sont que festins & réjoüissances, tant dans le sérail où le Sultan admet les grands de l’empire à lui baiser la main, & marche avec eux en pompe jusqu’à la grande mosquée, que dans la ville, où tous les Turcs jusqu’aux plus pauvres, tuent des moutons, auxquels ils donnent le nom d’agneau pascal, non sur le même fondement que les Juifs, mais en mémoire du sacrifice d’Abraham, dans lequel, disent-ils, l’ange Gabriel apporta du ciel un mouton noir, qui depuis très-long-tems avoit été nourri en paradis, & qu’il mit en la place d’Isaac. Voyez Ramadhan. (G)
BAISÉ, bout baisé. On donne, dans les manufactures où l’on tire la soie, le nom de bout baisé à une portion de fils de soie, composée de deux fils ou davantage, qui se sont appliqués l’un sur l’autre, selon leur longueur pendant le tirage, & se sont collés ensemble en se sechant. Il est très-important d’éviter ce défaut. Une soie où les baisemens de fils auroient été fréquens, se devideroit avec peine. Voyez l’article Tirage de soie.
Baisé, adj. (Passement.) se dit du tissu d’un ouvrage qui a été peu frappé par le battant, & où la trame n’est pas serrée. Le baisé est positivement le contraire de frappé. Voyez Frappé.
BAISE-MAIN, s. m. (Hist. anc. & mod.) marque d’honneur ou de respect presqu’universellement répandue par toute la terre, & qui a été également partagée entre la religion & la société. Dès les tems les plus reculés, on saluoit le soleil, la lune, & les étoiles en baisant la main. Job se défend de cette superstition : si vidi solem..... aut lunam..... & osculatus sum manum meam ore meo. On rendoit le même honneur à Baal. Lucien, après avoir parlé des différentes sortes de sacrifices que les personnes riches offroient aux dieux, ajoûte que les pauvres les adoroient par de simples baise-mains. Pline de son tems mettoit cette même coûtume au nombre des usages dont on ignoroit l’origine : In adorando, dit-il, dexteram ad osculum referimus. Dans l’Eglise même, les évêques & les officians donnent leur main à baiser aux autres ministres qui les servent à l’autel.
Dans la société, l’action de baiser la main a toûjours été regardée comme un formulaire muet, pour assûrer les réconciliations, demander des graces, remercier de celles qu’on a reçûes, marquer sa vénération à ses supérieurs. Dans Homere, le vieux Priam baise les mains d’Achille, lorsqu’il le conjure de lui rendre le corps de son fils Hector. Chez les Romains les tribuns, les consuls, les dictateurs donnoient leur main à baiser à leurs inférieurs, ce que ceux-ci appelloient accedere ad manum. Sous les empereurs, cette conduite devint un devoir essentiel, même pour les grands ; car les courtisans d’un rang inférieur étoient obligés de se contenter d’adorer la pourpre en se mettant à genoux, pour toucher la robe du prince avec la main droite qu’ils portoient ensuite à leur bouche : honneur qui ne fut ensuite accordé qu’aux consuls & aux premiers officiers de l’Empire, les autres se contentant de saluer le prince de loin en portant la main à la bouche, comme on le pratiquoit en adorant les dieux.
La coûtume de baiser la main du prince, est en usage dans presque toutes les cours de l’Europe, & sur-tout en Espagne, où dans les grandes céremonies les grands sont admis à baiser la main du roi. Dapper, dans son Afrique, assûre que les Negres sont en possession de témoigner leurs respects pour leurs princes ou chefs par des baise-mains. Et Fernand Cortez trouva cette pratique établie au Mexique, où plus de mille seigneurs vinrent le saluer en touchant d’abord la terre avec leurs mains, & les portant ensuite à leur bouche. (G)
Baise-main, en Droit, signifie l’offrande qu’on donne aux curés. Les curés de Paris, dit-on en ce sens, n’ont point la dixme : ils n’ont que le baise-main. Cette expression vient de ce qu’autrefois en se présentant à l’offrande, on baisoit la main du célébrant. (H)
BAISER, terme de Géométrie. On dit que deux courbes, ou deux branches de courbes se baisent, lorsqu’elles se touchent en tournant leurs concavités vers le même côté ; c’est-à-dire, de maniere que la concavité de l’une regarde la convexité de l’autre : mais si l’une tourne sa concavité d’un côté, & l’autre d’un autre côté, ou ce qui revient au même. si les deux convexités se regardent, alors on dit simplement qu’elles se touchent. Ainsi le point baisant & le point touchant sont différens.
On employe plus particulierement le terme de baiser, pour exprimer le contact de deux courbes qui ont la même courbure au point de contact, c’est-à-dire, le même rayon de développée. Le baisement s’appelle encore alors osculation. V. Osculation, Développée, Courbure, &c. (O)
* BAISSAN, (Géog.) ville d’Afrique dans la Barbarie, à seize mille de Tripoli.
* BAISSER, abaisser, (Gramm.) Baisser se dit des objets qu’on veut placer plus bas, dont on a diminué la hauteur, & de certains mouvemens du corps. On baisse une poutre, on baisse les yeux. Abaisser se dit des choses faites pour en couvrir d’autres ; abaisser le dessus d’une cassette ; abaisser les paupieres. Exhausser, élever, sont les opposés de baisser ; lever, relever, sont les opposés d’abaisser. Baisser est quelquefois neutre ; abaisser ne l’est jamais. On baisse en diminuant ; on se baisse en se courbant ; on s’abaisse en s’humiliant ; les rivieres baissent ; les grandes personnes sont obligées de se baisser pour passer par des endroits moins élevés qu’eux ; il est quelquefois dangereux de s’abaisser. Synom. Franç.
Baisser les hanches, se dit, en Manége, du cheval. Voyez Hanches. (V)
Baisser la lance. Voyez Lance. (V)
* Baisser la vigne, (Agriculture.) c’est lier les branches taillées à l’échalas.
BAISSIERE, s. f. (Vinaigrier.) c’est ainsi qu’on appelle cette liqueur trouble & chargée, qui couvre la lie de l’épaisseur de quelques lignes, plus ou moins ; lorsqu’un tonneau d’huile ou de liqueur fermentée, quelle qu’elle soit, tire à sa fin. On dit baissiere de vin, de cidre, de bierre.
BAISSOIRS, s. m. pl. c’est le nom qu’on donne dans les Salines, aux réservoirs ou magasins d’eau. Le bâti en est de bois de chêne & de madriers fort épais, contenus par de pareilles pieces de chêne qui leur sont adossées par le milieu. La superficie de ces magasins est garnie & liée de poutres aussi de chêne, d’un pié d’épaisseur, & placées à un pié de distance les unes des autres. Les planches & madriers qui les composent, sont garnis dans leurs joints de chantouilles de fer, de mousse & d’étoupe, poussées à force avec le ciseau, & goudronnées. Le bâti est élevé au-dessus du niveau des poelles. Ce magasin d’eau est divisé en deux baissoirs, ou parties inégales, qui abreuvent à Moyenvic cinq poelles par dix conduits. Voyez la quantité d’eau & le toisé de ces baissoirs, à l’article Saline. Elles sont élevées au-dessus du niveau des poelles, & supportées par des murs d’appui, distans les uns des autres de trois piés ou environ ; ce qui en assûre la solidité. Voyez Planche 1. des Salines ; 8, 8, les auges qui conduisent les eaux aux baissoirs.
BAJULE, Bajulus, (Hist. anc.) nom d’un magistrat du bas Empire. On croit que c’étoit le nom qu’on donnoit aux personnes chargées de l’éducation du présomptif héritier de la couronne dans l’empire de Constantinople ; & l’on tire ce mot du Latin bajulare, porter ; comme pour signifier que les instituteurs de ce prince l’avoient porté entre leurs bras, & on en distinguoit de plusieurs degrés. Le précepteur portoit le titre de grand bajule, & celui de bajule simplement étoit donné aux soûprécepteurs. Si l’expression n’étoit pas noble, elle étoit du moins énergique pour insinuer que l’éducation d’un prince est un fardeau bien redoutable. (G)
Bajule, (Hist. mod.) ministre d’état chargé du poids des affaires. Notre histoire remarque que Charlemagne donna Arnoul pour bajule, c’est-à-dire pour ministre, à son fils Louis d’Aquitaine ; & les Italiens entendent par bajule d’un royaume, ce que les Anglois nomment protecteur, & ce que nous appellons régent du royaume dans une minorité. (G)
BAIVE, s. m. (Hist. mod.) faux dieu des Lapons idolatres, qu’ils adorent comme l’auteur de la lumiere & de la chaleur. On dit communément que c’est le soleil ; d’autres croyent que c’est le feu ; & quelques-uns rapportent qu’autrefois parmi ces peuples, le grand dieu Thor étoit appellé Thiermes ou Aijke, quand ils l’invoquoient pour la conservation de leur vie, & pour être défendus contre les insultes des démons ; mais qu’il étoit nommé Baive, lorsqu’ils lui demandoient de la lumiere & de la chaleur. Ces idolatres n’ont aucune figure particuliere de ce dieu, soit parce qu’il est visible de lui-même, ou plûtôt parce que selon les plus intelligens dans les mysteres de cette superstition, Thor & Baive ne sont qu’une même divinité, adorée sous différens aspects. Scheffer, hist. de Laponie. (G)
* BAKAN, (Géog.) ville de Perse dans le Chirvan, à l’extrémité du golfe de Guillan sur la mer Caspienne. Long. 89. lat. 40. 20.
* BAKINGLE, (Géog.) l’une des Philippines dans l’océan de la Chine, elle a douze ou quinze lieues de tour.
BAKISCH. Voyez Bacar.
* BALAATH ou BAALATH, (Géog. sainte.) ville de Palestine dans la tribu de Dan.
BALADIN, s. m. danseur farceur, bouffon, qui en dansant, en parlant ou en agissant, fait des postures de bas comique. Le bon goût sembloit avoir banni des spectacles de France ces sortes de caracteres, qui y étoient autrefois en usage, L’opera comique les y avoit fait revivre. La sagesse du gouvernement en abolissant ce spectacle, aussi dangereux pour les mœurs que préjudiciable au progrès & à la perfection du goût, les a sans doute bannis pour jamais. Voyez Opera comique. (B)
BALADOIRE, adj. danse baladoire, il se décline : ce sont les danses contre lesquelles les saints canons, les Peres de l’Eglise & la discipline ecclésiastique se sont élevés avec tant de force : les Payens mêmes réprouvoient ces danses licencieuses. Les danseurs & les danseuses les exécutoient avec les pas & les gestes les plus indécens. Elles étoient en usage les premiers jours de l’an & le premier jour de Mai. Voy. Danse.
Le pape Zacharie en 744 fit un decret pour les abolir, ainsi que toutes les danses qui se faisoient sous prétexte de la danse sacrée.
Il y a plusieurs ordonnances de nos Rois qui les défendent, comme tendantes à la corruption totale des mœurs. Recueil d’édits, ordonnances & déclarations des Rois de France. (B)
* BALAGANSKOI, (Géog.) ville des Moscovites dans la Sibérie, partie de la grande Tartarie : elle est sur la riviere d’Angara, au 114. degré de longit. & au 59. de lat.
* BALAGNE (la) Géog. petite contrée septentrionale de l’île de Corse : Calvi en est la capitale.
* BALAGUATE, ou BALAGATE, province d’Asie au Mogol : Aurengabad en est la capitale.
* BALAGUER, (Géog.) ville d’Espagne dans la Catalogne sur la Segre. Long. 18. 28. lat. 41. 38.
* BALAI, s. m. en general, instrument destiné principalement à ramasser des ordures éparses, & à en nettoyer les corps ou les lieux. Les balais domestiques sont faits, ou de petites branches de bouleau & de genêt attachées avec trois liens d’osier ou de châtaigner à l’extrémité d’un gros manche de bois long & rond ; ou de joncs ficellés & fixés sur le manche avec un clou ; on les poisse sur la ficelle quand ils doivent servir aux cochers & palfreniers ; ou de barbe de roseaux ; ou de plumes, ou de crins, ou poils de sangliers collés avec de la poix de Bourgogne dans une large patte de bois percée de plusieurs trous, & emmanchée d’un long bâton placé perpendiculairement au milieu de la pate. Ce sont des Bucherons qui sont les premiers, & les Vergetiers qui font les seconds. Les balais de bouleau servent à nettoyer les cours, les cuisines, les rues, & tous les endroits où il s’amasse de grosses ordures. Les balais de crin ou de poil ne s’employent que dans les appartemens frottés, où il se fait plus de poussiere que d’ordure. Les balais de plumes, selon que le manche en est court ou long, retiennent le nom de balai, ou s’appellent houssoirs. Les balais de plumes servent pour les glaces & les meubles, & ce sont aussi les Vergetiers qui les font.
Les Orfevres grossiers donnent le nom de balai à un vieux linge attaché au bout d’un bâton qui leur sert à nettoyer l’enclume.
Il y a encore d’autre sortes de balais : mais l’usage & la forme en sont si connus, qu’il seroit inutile d’en faire mention plus au long.
Balai du Ciel, en Marine, c’est le vent de nord-est, qu’on appelle ainsi à cause qu’il nettoye le ciel de nuages. (Z)
Balai, (Chirurgie.) brosses ou vergettes de l’estomac, instrument dont on peut se servir fort utilement pour repousser quelques corps étrangers arrêtés dans l’œsophage, les retirer s’il est possible, ou changer leur mauvaise détermination en une meilleure.
Cet instrument est composé d’un petit faisceau de soies de cochon, les plus molles & les plus souples, attachées à une tige de fil de fer ou de léton flexible. Voyez Plan. XXVIII. fig. 2. il a été inventé pour balayer l’estomac, & provoquer le vomissement.
Pour en faire usage, on fait avaller au malade un verre d’eau chaude, afin de délayer les mucosités glaireuses qui séjournent dans l’estomac ; on trempe le petit balai dans quelque liqueur convenable, on l’introduit dans l’œsophage, & on le conduit doucement & avec précaution jusque dans l’estomac ; on lui fait faire des mouvemens en divers sens de haut en bas & de bas en haut, comme on fait au piston d’une seringue ; puis on retire tout-à-fait l’instrument : le malade rejette la liqueur qu’il a bûe, & les humeurs que le balai a détachées des parois de l’estomac.
Les Medecins étrangers qui se servent de cet instrument, recommandent de réitérer cette opération de tems en tems : ils prétendent que ce remede, qu’ils regardent comme excellent & supérieur à tous les purgatifs, est capable seul de conduire les hommes à une extrème vieillesse, si on le répete d’abord toutes les semaines, puis tous les quinze jours, & enfin régulierement tous les mois. Ces belles promesses n’ont encore surpris la bonne foi de personne en France.
M. Houstet, membre de l’Académie royale de Chirurgie, a vû en Allemagne un homme qui se servoit de cet instrument pour gagner de quoi vivre : il se l’introduisoit dans l’estomac ; il le tournoit en diverses manieres, comme font les Cabaretiers lorsqu’ils rincent leurs bouteilles avec leur goupillon ; cet homme le retiroit ensuite, & rejettoit par le vomissement la liqueur qu’il bûvoit auparavant. (Y)
Balai, s. m. c’est ainsi qu’on nomme en Fauconnerie la queue de l’oiseau.
BALAIEURS PUBLICS, (Police.) gens établis par la police pour le nettoyement des places & des marchés. Voyez Placier.
Balaieur d’un navire, (terme de Marine.) c’est celui qui est chargé de le tenir net.
BALAIS, (Hist. nat.) rubis balais, rubinus balassius, pierre précieuse mêlée de rouge & d’orangé. On a donné à ce rubis le nom de balais, pour le distinguer des autres rubis. Voyez Rubis.
On a prétendu dériver le mot balais du nom d’un royaume où il se trouve de ces rubis, & qui est situé en terre ferme entre ceux de Pégu & de Bengale. Il y a eu encore d’autres opinions sur cette étymologie. (I)
* BALAMBUAN, ou PALAMBUAN, (Géog. mod.) ville d’Asie dans les Indes sur la côte orientale de l’île de Java, dans le pays de mêmes noms, dont elle est capitale. Longit. 133. latit. méridion. 7. 50.
BALANCE, s. f. est l’une des six puissances simples En Méchanique, servant principalement à faire connoître l’égalité ou la différence de poids dans les corps pesans, & par conséquent leur masse ou leur quantité de matiere.
Il y a deux sortes de balance, l’ancienne & la moderne.
L’ancienne ou la romaine, appellée aussi peson, consiste en un levier qui se meut sur un centre, & qui est suspendu près d’un des bouts. D’un côté du centre on applique le corps qu’on veut peser ; de l’autre côte l’on suspend un poids qui peut glisser le long du levier, & qui tient la balance en équilibre ; & la valeur du poids à peser s’estime par les divisions qui sont marquées aux différens endroits où le poids glissant est arrêté.
La balance moderne, qui est celle dont on se sert communément aujourd’hui, consiste en un levier suspendu précisément par le milieu : il y a un plat ou bassin suspendu par une corde à chacun des deux bouts du levier : dans l’un & l’autre cas le levier est appellé jugum, traversant ou fléau, dont les deux moitiés qui sont de l’un & de l’autre côté de l’axe se nomment brachia, ou les bras ; la partie par où on le tient trutina, anse ou chasse ; la ligne sur laquelle le levier tourne, ou qui en divise les bras, s’appelle l’axe, ou essieu ; & quand on la considere relativement à la longueur des bras, on ne la regarde que comme un point, & on l’appelle le centre de la balance ; les endroits où se placent les poids se nomment points de suspension, ou d’application.
Le petit style perpendiculaire au fléau, & qui fait connoître, ou que les corps sont en équilibre, ou qu’ils pesent plus l’un que l’autre, s’appelle l’aiguille, en Latin examen.
Ainsi dans la balance romaine le poids qui sert à contrebalancer ceux qu’on veut connoître, est le même, mais s’applique à différens points ; au lieu que dans la balance ordinaire le contrepoids varie, & le point d’application est toûjours le même.
Le principe sur lequel la construction de l’une & l’autre balance est fondée est le même, & se peut comprendre par ce qui suit.
Théorie de la balance. Le levier AB (Voy. Plan. de Méchan. fig. 9.) est la principale partie de la balance : c’est un levier du premier genre, & qui au lieu d’être posé sur un appui en C, centre de son mouvement, est suspendu par une verge, qui est attachée au point C ; de sorte que le méchanisme de la balance dépend du même théorème que celui du levier. Voy. Levier.
Donc comme le poids connu est à l’inconnu, ainsi la distance depuis le poids inconnu jusqu’au centre du mouvement est à la distance où doit être le poids connu, pour que les deux poids se tiennent l’un l’autre en équilibre ; & par conséquent le poids connu fait connoître la valeur du poids inconnu.
Car comme la balance est un vrai levier, sa propriété est la même que celle du levier ; savoir, que les poids qui y sont suspendus, doivent être en raison inverse de leurs distances à l’appui, pour être en équilibre. Mais cette propriété du levier que l’expérience nous manifeste, n’est peut-être pas une chose facile à démontrer en toute rigueur. Il en est à peu-près de ce principe comme de celui de l’équilibre ; on ne voit l’équilibre de deux corps avec toute la clarté possible que lorsque les deux corps sont égaux, & qu’ils tendent à se mouvoir en sens contraire avec des vîtesses égales. Car alors il n’y a point de raison pour que l’un se meuve plûtôt que l’autre ; & si l’on veut démontrer rigoureusement l’équilibre lorsque les deux corps sont inégaux, & tendent à se mouvoir en sens contraire avec des vîtesses qui soient en raison inverse de leurs masses, on est obligé de rappeller ce cas au premier, où les masses & les vîtesses sont égales. De même on ne voit bien clairement l’équilibre dans la balance que quand les bras en sont égaux & chargés de poids égaux. La meilleure maniere de démontrer l’équilibre dans les autres cas, est peut-être de les ramener à ce premier, simple & évident par lui-même. C’est ce qu’a fait M. Newton dans le premier livre de ses Principes, section premiere.
Soient, dit-il, (fig. 3. n°. 4. Méch.) OK, OL, des bras de levier inégaux, auxquels soient suspendus les poids A, P ; soit fait OD= à OL, le plus grand des bras, la difficulté se réduit à démontrer que les poids A, P, attachés au levier LOD, sont en équilibre. Il faut pour cela que le poids P soit égal à la partie du poids A qui agit suivant la ligne DC perpendiculaire à OD ; car les bras OL, OD, étant égaux, il faut que les forces qui tendent à les mouvoir, soient égales, pour qu’il y ait équilibre. Or l’action du poids A, suivant DC, est au poids A, comme DC à DA, c’est-à-dire, comme OK à OD. Donc la force du poids A suivant . Et comme cette force est égale au poids P, & que OL =OD, on aura , c’est-à-dire, que les poids A, P, doivent être en raison des bras de levier OL, OK, pour être en équilibre.
Mais en démontrant ainsi les propriétés du levier, on tombe dans un inconvénient : c’est qu’on est obligé alors de changer le levier droit en un levier recourbé & brisé en son point d’appui, comme on le peut voir dans la démonstration précédente ; de sorte qu’on ne démontre les propriétés du levier droit à bras inégaux que par celles du levier courbe, ce qui ne paroît pas être dans l’analogie naturelle. Cependant il faut avoüer que cette maniere de démontrer les propriétés du levier est peut-être la plus exacte & la plus rigoureuse de toutes celles qu’on a jamais données.
Quoi qu’il en soit, c’est une chose assez singuliere que les propriétés du levier courbe, c’est-à-dire dont les bras ne sont pas en ligne droite, soient plus faciles à démontrer rigoureusement que celles du levier droit. L’auteur du traité de Dynamique, imprimé à Paris en 1743, a réduit l’équilibre dans le levier courbe à l’équilibre de deux puissances égales & directement opposées : mais comme ces puissances égales & opposées s’évanoüissent dans le cas du levier droit, la démonstration pour ce dernier cas ne peut être tirée qu’indirectement du cas général.
On pourroit démontrer les propriétés du levier droit dont les puissances sont paralleles, en imaginant toutes ces puissances réduites à une seule, dont la direction passe par le point d’appui. C’est ainsi que M. Varignon en a usé dans sa Méchanique. Cette méthode entre plusieurs avantages, a celui de l’élégance & de l’uniformité : mais n’a-t-elle pas aussi, comme les autres, le défaut d’être indirecte, & de n’être pas tirée des vrais principes de l’équilibre ? Il faut imaginer que les directions des puissances prolongées concourent à l’infini ; les réduire ensuite à une seule par la décomposition, & démontrer que la direction de cette derniere passe par le point d’appui. Doit-on s’y prendre de cette maniere pour prouver l’équilibre de deux puissances égales appliquées suivant des directions paralleles à des bras égaux de levier ? Il semble que cet équilibre est aussi simple & aussi facile à concevoir, que celui de deux puissances opposées en ligne droite, & que nous n’avons aucun moyen direct de réduire l’un à l’autre. Or, si la méthode de M. Varignon pour démontrer l’équilibre du levier est indirecte dans un cas, elle doit aussi l’être nécessairement dans l’application au cas général.
Si l’on divise les bras d’une balance en parties égales, une once appliquée à la neuvieme division depuis le centre, tiendra en équilibre trois onces qui seront à la troisieme de l’autre côté du centre ; & deux onces à la sixieme division agissent aussi fortement que trois à la quatrieme, &c. L’action d’une puissance qui fait mouvoir une balance, est donc en raison composée de cette même puissance, & de sa distance du centre.
Il est bon de remarquer ici que le poids presse également le point de suspension, à quelque distance qu’il en soit suspendu, & tout comme s’il étoit attaché immédiatement à ce point ; car la corde qui suspend ce poids en est également tendue à quelque endroit que le poids y soit placé.
On sent bien au reste que nous faisons ici abstraction du poids de la corde, & que nous ne la regardons que comme une ligne sans épaisseur ; car le poids de la corde s’ajoûte à celui du corps qui y est attaché, & peut faire un effet très-sensible, si la corde est d’une longueur considérable.
Une balance est dite être en équilibre, quand les actions des poids sur les bras de la balance pour la mouvoir, sont égales, de maniere qu’elles se détruisent l’une l’autre. Quand une balance est en équilibre, les poids qui sont de part & d’autre sont dits équipondérans, c’est-à-dire, qui se contrebalancent. Des poids inégaux peuvent se contrebalancer aussi : mais il faut pour cela que leurs distances du centre soient en raison réciproque de ces poids ; ensorte que si l’on multiplie chaque poids par sa distance, les produits soient égaux : c’est sur quoi est fondée la construction de la balance romaine, ou peson. Voyez Romaine, ou Peson.
Par exemple, dans une balance dont les bras sont fort inégaux, un bassin étant suspendu au bras le plus court, & un autre au plus long bras divisé en parties égales : si l’on met un poids dans le bassin attaché au plus petit bras, & qu’en même tems on place un poids connu, par exemple une once, dans le bassin attaché au plus long bras, & qu’on fasse glisser ce bassin sur le plus long bras jusqu’à ce que les deux poids soient en équilibre ; le nombre des divisions entre le point d’appui & le poids d’une once, indiquera le nombre d’onces que pese le corps, & les sous-divisions marqueront le nombre de parties de l’once. C’est encore sur le même principe qu’est fondée la balance trompeuse, laquelle trompe par l’inégalité des bras ou des bassins : par exemple, prenez deux bassins de balance dont les poids soient inégaux dans la proportion de 10 à 9, & suspendez l’un & l’autre à des distances égales, alors si vous prenez des poids qui soient l’un à l’autre comme 9 à 10, & que vous mettiez le premier dans le premier bassin, & l’autre dans le second, ils pourront être en équilibre.
Plusieurs poids suspendus à différentes distances d’un côté, peuvent se tenir en équilibre avec un poids seul qui sera de l’autre côté ; pour cet effet, il faudra que le produit de ce poids par sa distance du centre, soit égal à la somme des produits de tous les autres poids multipliés chacun par sa distance du centre.
Par exemple, si on suspend trois poids d’une once chacun à la deuxieme, troisieme, & cinquieme division, ils feront équilibre avec le poids d’une once appliqué de l’autre côté du point d’appui à la distance de la dixieme division. En effet, le poids d’une once appliqué à la deuxieme division fait équilibre avec le poids d’un cinquieme d’once appliqué à la dixieme division. De même le poids d’une once appliqué à la troisieme division fait équilibre à d’once appliqués à la dixieme division, & le poids d’une once à la cinquieme division fait équilibre au poids d’une demi-once à la dixieme division ; or un cinquieme d’once avec d’once & une demi-once, font une once entiere. Donc une once entiere appliquée à la dixieme division, fait seule équilibre à 3 onces appliquées aux divisions 2, 3, & 5, de l’autre côté du point d’appui.
Donc aussi plusieurs poids appliqués des deux côtés en nombre inégal, seront en équilibre, si étant multipliés chacun par sa distance du centre, les sommes des produits de part & d’autre sont égales ; & si ces sommes sont égales, il y aura équilibre.
Pour prouver cela par l’expérience, suspendez un poids de deux onces à la cinquieme division, & deux autres chacun d’une once à la deuxieme & à la septieme ; de l’autre côté suspendez deux poids d’une once aussi chacun à la neuvieme & dixieme division. Ces deux tiendront en équilibre les trois autres ; la démonstration en est à peu près la même que de la proposition précédente.
Pour qu’une balance soit juste, il faut que les points de suspension soient exactement dans la même ligne que le centre de la balance, & qu’ils en soient également distans ; il faut aussi que les bras soient de longueur convenable, afin qu’on s’apperçoive plus aisément s’ils sont égaux, & que l’erreur qui peut résulter de leur inégalité, soit au moins fort petite ; qu’il y ait le moins de frottement qu’il est possible autour du point fixe ou centre de la balance. Quand une balance est trompeuse, soit par l’inégalité de ses bras, soit par celle de ses bassins, il est bien aisé de s’en assûrer : il n’y a qu’à changer les poids qui sont dans chaque bassin, & les mettre l’un à la place de l’autre ; ces poids qui étoient auparavant en équilibre, cesseront alors d’y être si la balance est trompeuse. Voyez Appui
Balance de M. de Roberval, est une sorte de levier, où des poids égaux sont en équilibre, quoiqu’ils paroissent situés à des extrémités de bras de leviers inégaux. Voyez Levier.
Balance Hydrostatique, est une espece de balance qu’on a imaginée, pour trouver la pesanteur spécifique des corps liquides & solides. Voyez Gravité, ou Pesanteur specifique.
Cet instrument est d’un usage considérable pour connoître les degrés d’alliage des corps de toute espece, la qualité & la richesse des métaux, mines, mineraux, &c. les proportions de quelque mêlange que ce soit, &c. la pesanteur spécifique étant le seul moyen de juger parfaitement de toutes ces choses. Voyez Poids, Métal, Or, Alliage, &c.
L’usage de la balance hydrostatique est fondé sur ce théorème d’Archimede, qu’un corps plus pesant que l’eau, pese moins dans l’eau que dans l’air, du poids d’une masse d’eau de même volume que lui. D’où il suit que si l’on retranche le poids du corps dans l’eau, de son poids dans l’air, la différence donnera le poids d’une masse d’eau égale à celle du solide proposé.
Cet instrument est représenté dans les Planches d’Hydrostatique, fig. 34. & n’a pas besoin d’une description fort ample. On pese d’abord dans l’air le poids E, qui n’est autre chose qu’un plateau garni ou couvert de différens poids, & le poids qu’on veut mesurer, lequel est suspendu à l’extrémité du bras F, ensuite on met ce dernier poids dans un fluide, & on voit par la quantité de poids qu’il faut ôter de dessus le plateau E, combien le poids dont il s’agit a perdu, & par conséquent combien pese un volume de fluide égal à celui du corps.
Pour peser un corps dans l’eau, on le met quelquefois dans le petit sceau de verre IK, & alors on ne doit pas oublier de couler le plateau R sur le petit plateau quarré H, afin que le poids de ce plateau, qui est égal à celui du volume d’eau, dont le seau occupe la place, puisse rétablir l’équilibre.
A l’égard des gravités spécifiques des fluides, on se sert pour cela d’une petite boule de verre G, de la maniere suivante.
Pour trouver la pesanteur spécifique d’un fluide, suspendez à l’extrémité d’un des bras F un petit bassin, & mettez dedans la boule G ; remplissez ensuite les deux tiers d’un vaisseau cylindrique OP, avec de l’eau commune : lorsque vous aurez mis la boule dedans, il faudra mettre sur le plateau E, de petits poids, jusqu’à ce que les bras E, F, demeurent dans une position horisontale.
Ainsi l’excès du poids de la boule sur celui d’un égal volume d’eau, se trouvera contrebalancé par les poids ajoûtés au plateau E, ce qui la fera demeurer en équilibre au milieu de l’eau. Or concevons à présent cette boule ainsi en équilibre, comme si elle étoit réellement une quantité d’eau congelée dans la même forme : si à la place de l’eau qui environne cette partie congelée, nous substituons quelqu’autre liqueur de différente pesanteur, l’équilibre ne doit plus subsister, il faudra donc pour le rétablir, mettre des poids sur celui des plateaux E, F, de la balance qui sera le plus foible.
Ces poids qu’il aura fallu ajoûter dans la balance, seront la différence en gravité de deux quantités, l’une d’eau, l’autre de la liqueur qu’on a voulu examiner, & dont le volume est égal à celui de la boule de verre. Supposons donc que le poids du volume d’eau dont la boule occupe la place, soit de 803 grains ; si nous ajoûtons à ce nombre celui des grains qu’il aura fallu ajoûter sur le plateau auquel la boule est attachée, ou si nous ôtons de 803 grains le nombre de ceux qu’il auroit fallu mettre sur le plateau opposé, le reste sera le poids du volume du fluide égal à celui de la boule, & la gravité spécifique de l’eau sera à celle de ce fluide comme 803 est à ce reste ; enfin si on divise ce même reste par 803, le quotient exprimera la gravité spécifique du fluide, l’unité exprimant celle de l’eau.
Pour rendre ceci plus sensible par un exemple, supposons qu’on veuille savoir la gravité du lait : plongeant dans cette liqueur la boule telle qu’elle est attachée à la balance, on trouve qu’il faut mettre 28 grains sur le plateau auquel elle est suspendue, pour rétablir l’équilibre : ajoûtant donc 28 grains à 803, la somme sera 831 ; & ainsi la gravité spécifique du lait sera à celle de l’eau, comme 803 à 831. On peut donc par le moyen de la balance hydrostatique : 1°. connoître la pesanteur spécifique d’une liqueur : 2°. comparer les pesanteurs spécifiques de deux liqueurs : 3°. comparer les gravités spécifiques de deux corps solides ; car si deux corps solides pesent autant l’un que l’autre dans l’air, celui qui a le plus de pesanteur spécifique, pesera davantage dans l’eau : 4°. comparer la gravité spécifique d’un corps solide avec celle d’une liqueur ; car la gravité spécifique du corps est à celle de la liqueur, comme le poids du corps dans l’air, est à ce qu’il perd de son poids dans la liqueur. Voyez aussi Aréometre.
Le Docteur Hook a imaginé une balance hydrostatique qui peut être d’une grande utilité pour examiner la pureté de l’eau, &c. Elle consiste en un ballon de verre d’environ trois pouces de diametre, lequel a un col étroit d’une demi-ligne de diametre : on charge ce ballon de minium afin de le rendre tant soit peu plus pesant qu’un pareil volume d’eau, on le trempe ensuite dans l’eau après l’avoir attaché au bras d’une exacte balance, qui a un contrepoids à l’autre bras. Cela fait, on ne sauroit ajoûter à l’eau la plus petite quantité de sel, que le col du ballon ne s’éleve au-dessus de l’eau d’un demi-pouce plus qu’il n’étoit d’abord. En effet, l’eau devenant plus pesante par l’addition du sel, le ballon qui y étoit auparavant en équilibre, doit s’élever. Transact. Philosoph. n°. 197.
Plusieurs savans se sont donné la peine de rédiger en table les pesanteurs d’un grand nombre de matieres tant solides que fluides : on doit assûrément leur savoir gré de ce travail, & l’on en sent toute la difficulté, quand on pense aux attentions scrupuleuses, & au tems qu’on est obligé de donner à ces sortes de recherches : mais leurs expériences, quelque exactes qu’elles ayent été, ne peuvent nous servir de regle que comme des à-peu-près ; car les individus de chaque espece varient entr’eux quant à la densité, & l’on ne peut pas dire que deux diamans, deux morceaux de cuivre, deux gouttes de pluie, soient parfaitement semblables. Ainsi quand il est question de savoir au juste la pesanteur spécifique de quelque corps, il faut le mettre lui-même à l’épreuve ; c’est le seul moyen d’en bien juger. Au reste on sera sans doute bien-aise de trouver ici une table dressée sur des expériences fort exactes. Il suffit de dire qu’elles sont de M. Musschembroek. Les pesanteurs specifiques de toutes les matieres énoncées dans cette table, sont comparées à celles de l’eau commune, & l’on prend pour eau commune celle de la pluie dans une température moyenne ; ainsi quand on voit dans la table, eau de pluie 1,000, or de coupelle 19,640, air 1,001 , c’est-à-dire, que la pesanteur specifique de l’or le plus fin, est à celle de l’eau, comme 19 à-peu-près à 1, & que la pesanteur de l’air n’est presque que la millieme partie de celle de l’eau.
| Acier flexible & non trempé | 7, | 738. |
| Acier trempé | 7, | 704. |
| Agate d’Angleterre | 2, | 512. |
| Air | 0, | 001 . |
| Albâtre | 1, | 872. |
| Alun | 1, | 714. |
| Ambre | 1, | 040. |
| Amiante | 2, | 913. |
| Antimoine d’Allemagne | 4, | 000. |
| Antimoine d’Hongrie | 4, | 700. |
| Ardoise bleue | 3, | 500. |
| Argent de coupelle | 11, | 091. |
| Bismuth | 9, | 700. |
| Bois de bresil | 1, | 030. |
| cedre | 0, | 613. |
| orme | 0, | 600. |
| gayac | 1, | 337. |
| ébene | 1, | 177. |
| érable | 0, | 755. |
| frêne | 0, | 845. |
| bouis | 1, | 030. |
| Borax | 1, | 720. |
| Caillou | 2, | 542. |
| Camphre | 0, | 995. |
| Charbon de terre | 1, | 240. |
| Cinabre naturel | 7, | 300. |
| artificiel | 8, | 200. |
| Cire jaune | 0, | 995. |
| rouge | 2, | 689. |
| blanche | 2, | 500. |
| Corne de bœuf | 1, | 840. |
| cerf | 1, | 875. |
| Crystal de roche | 2, | 650. |
| d’Islande | 2, | 720. |
| Cuivre de Suede | 8, | 784. |
| jetté en moule | 8, | 000. |
| Diamant | 3, | 400. |
| Ecailles d’huître | 2, | 092. |
| Encens | 1, | 071. |
| Eau commune ou de pluie | 1, | 000. |
| distillée | 0, | 993. |
| de riviere | 1, | 009. |
| Esprit-de-vin rectifié | 0, | 866. |
| de térébenthine | 0, | 874. |
| Etain pur | 7, | 320. |
| allié d’Angleterre | 7, | 471. |
| Fer | 7, | 645. |
| Gomme Arabique | 1, | 375. |
| Grenat de Boheme | 4, | 360. |
| de Suede | 3, | 978. |
| Huile de lin | 0, | 932. |
| d’olive | 0, | 913. |
| de vitriol | 1, | 700. |
| Karabé ou ambre jaune | 1, | 065. |
| Lait de vache | 1, | 030. |
| Litarge d’or | 6, | 000. |
| d’argent | 6, | 040. |
| Magnese | 3, | 530. |
| Marbre noir d’Italie | 2, | 704. |
| blanc d’Italie | 2, | 707. |
| Mercure | 13, | 593. |
| Noix de galle | 1, | 034. |
| Or d’essai ou découpé | 19, | 640. |
| de Guinée | 18, | 888. |
| Os de bœuf | 1, | 656. |
| Pierre sanguine | 4, | 360. |
| Pierre calaminaire | 5, | 000. |
| à fusil opaque | 2, | 542. |
| transparente | 2, | 641. |
| Poix | 1, | 150. |
| Sang humain | 1, | 040. |
| Sapin | 0, | 550. |
| Sel de glauber | 2, | 246. |
| ammoniac | 1, | 453. |
| gemme | 2, | 143. |
| polychreste | 2, | 148. |
| Soufre commun | 1, | 800. |
| Talc de Venise | 2, | 780. |
| Tartre | 1, | 849. |
| Turquoise | 2, | 508. |
| Verd-de-gris | 1, | 714. |
| Verre blanc | 3, | 150. |
| Verre commun | 2, | 620. |
| Vin de Bourgogne | 0, | 953. |
| Vinaigre de vin | 1, | 011. |
| Vitriol d’Angleterre | 1, | 880. |
| Yvoire | 1, | 825. |
Cet article est en partie de M. Formey. (O)
* Balance, voyez Romaine, Fleau, Peson, Porte-Balance. La balance commune n’est autre chose qu’un fléau suspendu par le milieu, & soûtenant par ses extrémités des plateaux ou bassins attachés avec des cordes. Voyez fig. 5. du Balancier, une balance qui ne differe de la commune que parce qu’elle est plus petite, & qu’elle a un porte-balance ; f, f, le fléau ou traversin ; l, la languette ; p, un des pivots ; il a son correspondant ; b, le braié ; c, la chasse ; q, q, les deux bassins ou plateaux ; s, s, s, les cordes qui les soûtiennent ; r, r, les crochets ou anneaux qui embrassent les cordes.
La balance fine ou le trebuchet, ne differe de la balance commune, que parce qu’étant destinée à peser des matieres précieuses, où la moindre quantité de trop ou de trop peu, fait une différence considérable pour le prix ; elle est fort petite, & travaillée avec la derniere précision.
Balance sourde : celle-ci a les bouts de son fleau plus bas que son clou, & sa chappe soûtenue en l’air par une guindole ou guignole ; elle est d’usage dans les monnoies.
Balance d’essai, c’est la balance de la figure 5 enfermée dans une lanterne de verre avec son porte-balance, comme on voit figure 7 ; comme on y pese l’or & l’argent, on a pris la précaution de la lanterne, contre l’agitation que l’air pourroit causer à ses bassins.
Balance de chandelier : celle-ci quand elle est petite, a les bassins en forme de seaux, on y met la chandelle debout ; & quand elle est grande, ses bassins sont presqu’entierement plats, afin qu’on y puisse coucher la chandelle. C’est du reste la même chose que la balance commune.
En général, il y a autant de différentes sortes de balances possibles, que de moyens différens possibles d’établir & de rompre l’équilibre établi entre les différentes parties d’un levier, ou d’un corps qui en fait la fonction.
Balance, Libra (Astron.) est aussi un des douze signes du zodiaque, précisément opposé au bélier : on l’appelle balance, parce que les jours & les nuits sont d’égale longueur lorsque le soleil entre dans ce signe, ce qui arrive à l’équinoxe d’automne.
Le catalogue Britannique met les étoiles de la constellation de la balance au nombre de 46. (O)
Balance, s. f. (en Mytholog.) est le symbole de l’équité. La Justice la tient à sa main. Celle que représente le septieme signe du zodiaque fut à l’usage d’Astrée ; ce fut-là qu’elle déposa cette juste balance, lorsqu’elle se retira de la terre au ciel, à l’approche du siecle de fer.
Balance de Commerce, signifie une égalité entre la valeur des marchandises achetées des étrangers, & la valeur des productions d’un pays transportées chez d’autres nations.
Il est nécessaire que cette balance soit gardée parmi les nations commerçantes ; & si elle ne peut l’être en marchandises, elle le doit être en especes.
C’est par ce moyen qu’on connoît si une nation gagne ou perd par son commerce étranger ou par quelque branche de ce commerce, & par conséquent si cette nation s’enrichit ou s’appauvrit en le continuant.
Il y a diverses méthodes pour arriver à cette connoissance.
1°. La plus reçûe est de prendre une exacte notion du produit que rapportent à proportion les marchandises exportées ou envoyées à l’étranger, & les marchandises importées, c’est-à-dire celles qu’on a tirées de lui. Si les premieres excedent les dernieres, il s’ensuit que la nation qui a fait les exportations est en chemin de gagner, dans l’hypothese que l’excédent est rapporté en argent monnoyé ou non monnoyé ; & ainsi augmente le thrésor de cette nation. Mais cette méthode est incertaine, parce qu’il est difficile d’avoir un compte véritable des marchandises, soit importées soit exportées, les registres des douanes ne pouvant pas les fournir à cause des contrebandes qui se font particulierement de marchandises belles & rares, comme points, dentelles, joyaux, rubans, soies, toiles fines, &c. qu’on peut cacher en un petit volume ; & même des vins, eaux-de-vie, thé, &c. à quoi il faut ajoûter les divers accidens qui affectent la valeur du fonds soit sorti soit rentré, comme pertes faites sur mer, par marchés, banqueroutes, saisies, &c. D’ailleurs, pour ce qui concerne les négoces particuliers, il y a divers pays où les ouvrages de nos manufactures que nous y envoyons ne sont pas en grande considération ; cependant ce que nous en rapportons est nécessaire pour pousser notre commerce en général, comme le trafic en Norvege pour du mairein & des provisions navales. D’un autre côté le commerce de la compagnie des Indes orientales est beaucoup plus avantageux, parce que les marchandises importées excedent de beaucoup les marchandises exportées, que nous vendons beaucoup des premieres aux étrangers, & que nous en consumons beaucoup dans le royaume, par exemple, des indiennes & des soies au lieu des toiles & soies des autres pays, qui nous coûteroient plus cher.
2°. La deuxieme méthode est d’observer le cours du change ; car s’il est ordinairement au-dessus de la valeur intrinseque ou de l’égalité des especes étrangeres, nous perdons non-seulement par le change, mais encore par le cours général de notre commerce. Mais cette méthode est encore imparfaite, puisque nous trafiquons dans plusieurs pays où le cours du change n’est point établi.
3°. La troisieme méthode, qui est du chevalier Jos. Child, se prend de l’accroissement ou de la diminution de notre commerce & de nos navires en général ; car si ces deux points viennent à diminuer, quelque profit que puissent faire des particuliers, la nation perd, & elle gagne dans l’hypothese contraire. Cet auteur établit comme une regle infaillible, que dans toutes les parties du monde où le commerce est grand, continue sur ce pié & augmente de jour en jour aussi-bien que le nombre des navires, par succession de tems ce commerce doit être avantageux à la nation, même dans le cas où un gros commerçant se ruine ; car quoi qu’il puisse perdre, quelle multitude de gens qui gagnent par son moyen ! le roi, les officiers des doüanes, les charpentiers de vaisseau, brasseurs, boulangers, cordiers-manufacturiers, cordiers, porteurs, charretiers, mariniers, &c.
4°. Une derniere maniere est d’observer l’augmentation & la diminution de notre argent, soit monnoyé soit en lingots : mais celle-ci est la moins sensible & la moins palpable de toutes ; car l’argent paroît aux yeux du vulgaire plus abondant lorsqu’il en a moins affaire, & plus rare selon que les occasions de l’employer sont plus fréquentes & plus avantageuses : par ce moyen il semble que nous ayons plus d’argent lorsque nous avons moins de commerce : par exemple, quand la compagnie des Indes orientales a un grand débit à faire, l’argent se trouve pour l’ordinaire plus rare à Londres, parce que l’occasion engage les particuliers à en employer quantité qu’ils avoient amassé à cette intention. Ainsi un haut prix d’intérêt fera que l’argent paroîtra plus rare, parce que chacun aussi-tôt qu’il en peut rassembler quelque somme cherche à la placer. Child, Disc. sur le comm. ch. ix. Chambers, Dictionn. (G)
Balance, en termes de teneurs de livres à parties doubles, signifie l’état final ou la solde du grand livre ou livre de raison, ou d’un compte particulier.
Balance, se dit encore de la clôture de l’inventaire d’un marchand, qui se fait en crédit & en débit, dans lequel il met d’un côté, qui est la gauche, l’argent qu’il a en caisse, ses marchandises, dettes actives, meubles & immeublés ; & en crédit du côté de la droite, ses dettes passives & ce qu’il doit payer en argent ; & quand il a défalqué ce qu’il doit d’un côté de ce qu’il a d’effets d’un autre, il connoît, tout étant compensé & balancé, ce qui doit lui rester de net & de clair, ou ce qu’il a perdu ou gagné.
On se sert quelquefois du mot de bilan au lieu de balance, mais improprement. Bilan a une autre signification plus précise. Voyez Bilan.
Balance, signifie aussi la déclaration que font les maîtres des vaisseaux, des effets & autres marchandises dont ils sont chargés. Ce terme est en usage en ce sens parmi les marchands qui trafiquent en Hollande par les rivieres du Rhin & de la Meuse. (G)
BALANCÉ, adj. terme de Danse. Le balancé est un pas qui se fait en place comme le pirouetté, mais ordinairement en présence, quoiqu’on puisse aussi le faire en tournant. Comme ce n’est que le corps qui tourne, & que cela ne change aucun mouvement, je vais décrire la maniere de le faire en présence.
Il est composé de deux demi-coupés, dont l’un se fait en-avant, & l’autre en-arriere ; savoir, en commençant vous pliez à la premiere position, & vous portez le pié à la quatrieme, en vous élevant dessus la pointe ; ensuite de quoi vous posez le talon à terre ; & la jambe qui est en l’air s’étant approchée de celle qui est devant, & sur laquelle vous vous êtes élevé, vous pliez sur celle qui a fait ce premier pas, & l’autre étant pliée se porte en-arriere à la quatrieme position, & vous vous élevez dessus, ce qui finit ce pas.
Le balancé est un pas fort gracieux que l’on place dans toutes sortes d’airs, quoique les deux pas dont il est composé soient relevés également l’un & l’autre, & de-là vient qu’il s’accommode à toutes sortes de mesures. parce que ce n’est que l’oreille qui avertit de presser les mouvemens ou de les rallentir. Voy. Position.
Il est fort usité dans les menuets figurés aussi-bien que dans les menuets ordinaires, de même qu’au passe-pié. On le fait à la place d’un pas de menuet, dont il occupe la même valeur ; c’est pourquoi il doit être plus lent, puisque ces deux pas se font dans l’étendue des quatre que le pas de menuet contient. Voyez Menuet.
BALANCEMENT, s. m. Voyez Oscillation.
BALANCER la croupe au pas ou au trot, se dit, en termes de Manége, du cheval dont la croupe dandine à ses allures ; c’est une marque de foiblesse de reins. (V)
Balancer ; se balancer dans l’air, se dit, en Fauconnerie, d’un oiseau qui reste toûjours en une place en observant la proie.
Balancer se dit aussi, en Vénerie, d’une bête, qui, chassée des chiens courans, est lassée & vacille en fuyant : on dit ce chevreuil balance.
Un levrier balance quand il ne tient pas la voie juste, ou qu’il va & vient à d’autres voies.
Balancer. On dit dans les manufactures de soie qu’une lisse balance, quand elle leve ou baisse plus d’un côté que d’un autre ; ce qui est de conséquence dans le travail des étoffes riches.
La lisse balancée ou qui ne baisse pas juste à un accompagnage, fait que la dorure est séparée ou barrée. Voyez Accompagnage, Dorure, Étoffes or et argent .
* BALANCIER, s. m. ouvrier qui fait les différens instrumens dont on se sert dans le commerce, pour peser toutes sortes de marchandises. On se doute bien que la communauté des balanciers doit être fort ancienne. Elle est soûmise à la jurisdiction de la cour des monnoies ; c’est là que les balanciers sont admis à la maîtrise ; qu’ils prêtent serment ; qu’ils font étalonner leurs poids, & qu’ils prennent les matrices de ces petites feuilles de léton à l’usage des joailliers & autres marchands de matieres, dont il importe de connoître exactement le poids. Chaque balancier a son poinçon ; l’empreinte s’en conserve sur une table de cuivre au bureau de la communauté & à la cour des monnoies. Ce poinçon composé de la premiere lettre du nom du maître, surmontée d’une couronne fleurdelisée, sert à marquer l’ouvrage. La marque des balances est au fond des bassins ; des romaines, au fleau ; & des poids, au-dessous. L’étalonnage de la cour des monnoies se connoît à une fleur de lis seule, qui s’imprime aussi avec un poinçon. D’autres poinçons de chiffres romains marquent de combien est le poids. Les feuilles de léton ne s’étalonnent point ; le balancier les forme sur la matrice, & les marque de son poinçon. Deux jurés sont chargés des affaires, des visites, & de la discipline de ce corps. Ils restent chacun deux ans en charge ; un ancien se trouve toûjours avec un nouveau. Un maître ne peut avoir qu’un apprenti ; on fait cinq ans d’apprentissage, & deux ans de service chez les maîtres. Il faut avoir fait son apprentissage chez un maître de Paris, pour travailler en compagnon dans cette ville. Les aspirans doivent chef-d’œuvre ; les fils de maître expérience. Les veuves joüissent de tous les droits de la maîtrise, excepté de celui de faire des apprentis. Les deux jurés balanciers ont été autorisés par des arrêts à accompagner les maîtres & gardes des six corps des marchands dans leurs visites pour poids & mesures ; & il seroit très-à-propos pour le bien public qu’ils fissent valoir leur privilége. Ils ont pour patron S. Michel.
Balancier, s. m. (en Méchanique) ; ce nom est donné communément à toute partie d’une machine qui a un mouvement d’oscillation, & qui sert ou à ralentir ou à régler le mouvement des autres parties. Voyez les articles suivans.
Balancier : on donne ce nom dans les grosses forges, à la partie ou anse de fer F recourbée en arc, passée dans un crochet attaché à la perche élastique GF, à l’aide de laquelle les soufflets sont baissés & relevés alternativement par le moyen des chaînes KF, KF, qui se rendent deux à deux à des anses plus petites, ou à de petits crochets arcués & suspendus aux extrémités du balancier F. V. Grosses Forges, vignette de la Planche III. On voit dans la Planche III, la même machine : F est la perche, E le balancier de la perche ; DD, les balanciers plus petits des soufflets ; cccc, chaînes des petits balanciers ou des bascules.
Balancier (terme d’Horloger) c’est un cercle d’acier ou de léton (fig. 45-71. Pl. 10. d’Horlogerie) qui dans une montre sert à regler & modérer le mouvement des roues. Voyez Échappement.
Il est composé de la zone ABC que les horlogers appellent le cercle des barettes B D, & du petit cercle T qu’ils appellent le centre.
On ignore l’auteur de cette invention, dont on s’est servi pour la mesure du tems jusqu’au dernier siecle, où la découverte du pendule en a fait abandonner l’usage dans les horloges.
On donne au balancier la forme qu’on lui voit (fig. 49-71.) afin que le mouvement qu’il acquiert ne se consume point à surmonter de trop grands frottemens sur les pivots. La force d’inertie dans les corps en mouvement, étant toûjours la masse multipliée par la vîtesse, (Voyez Inertie) la zone ABC fort distante du centre de mouvement équivaut à une masse beaucoup plus pesante. Il suit de cette considération, qu’on doit autant qu’il est possible, disposer le calibre d’une montre, de façon que le balancier soit grand, afin que par-là il ait beaucoup d’inertie. Voyez Calibre.
Voici à peu près l’histoire des différentes méthodes, dont on a fait usage dans l’application du balancier aux horloges, avant que l’addition du ressort spiral l’eût porté au degré de perfection, où il est parvenu sur la fin du dernier siecle. Toute la régularité des horloges à balancier vint d’abord de la force d’inertie de ce modérateur, & de la proportion constante qui regne entre l’action d’une force sur un corps, & la réaction de ce corps sur elle. Cet effet résultoit nécessairement de la disposition de l’échappement (Voyez Échappement. Voyez Action & Réaction. Voyez Inertie.) On attribue cette découverte à Pacisicus de Veronne. Voyez Horloge.
Tous les avantages que les mesures du tems faites sur ces principes, avoient sur celles qui étoient connues lorsqu’elles parurent, telles que les clepsydres, sabliers & autres, n’empêchoient pas que leurs irrégularités ne fussent encore fort considérables ; elles venoient principalement, de ce qu’une grande partie de la force motrice se consumant à surmonter le poids de toutes les roues, & la résistance causée par leurs frottemens ; la réaction se trouvoit toûjours inférieure à l’action, & le régulateur suivoit trop les différentes impressions qui lui étoient communiquées par le roüage qui lui opposoit toujours des obstacles supérieurs à la force qu’il en recevoit.
Voulant obvier à cet inconvenient, dans les horloges destinées à rester constamment dans une même situation, les anciens horlogers s’aviserent d’un artifice des plus ingénieux : ils disposerent le régulateur de façon, qu’il pût faire des vibrations indépendamment de la force motrice ; ils mirent en usage l’inertie du corps & sa pesanteur.
Ils poserent l’axe du balancier (voyez la fig. 27. Pl. 5. d’Horlogerie) perpendiculairement à l’horison, laisserent beaucoup de jeu à ses pivots en hauteur, passerent ensuite un fil dans une petite fente pratiquée dans le pivot supérieur au-dessus du trou dans lequel il rouloit ; ensuite de quoi ils attacherent les deux bouts de ce fil à un point fixe, tellement que le balancier suspendu ne portoit plus sur l’extrémité de son pivot inférieur. Si l’on tournoit alors le régulateur, les fils s’entortillant l’un sur l’autre, faisoient élever le balancier tant-soit-peu ; abandonné ensuite à lui-même, il descendoit par son poids & les détortilloit : or cela ne se pouvoit faire, sans qu’il acquît un mouvement circulaire. Poursuivant donc sa route de l’autre côté, il entortilloit de nouveau les fils, retomboit ensuite, & auroit toûjours continué de se mouvoir ainsi alternativement des deux côtés, si la résistance de l’air, le frottement des fils & des pivots n’eussent épuisé peu à peu tout son mouvement.
Cette méthode d’appliquer deux puissances de façon qu’elles fassent faire des vibrations au régulateur, donne à ce dernier de grands avantages. Voyez Ressort spiral.
La construction précédente auroit été bien plus avantageuse, si ces fils toûjours un peu élastiques n’eussent pas perdu peu à peu de cette élasticité ; de plus les vibrations de ce régulateur ne s’achevoient point en des tems égaux ; & les petits poids ou autrement dit régules P P qu’on mettoit à différens éloignemens du centre du régulateur, pour fixer la durée des vibrations, ne pouvoient procurer une exactitude assez grande. En cherchant donc à perfectionner encore le balancier, on parvint enfin à lui associer un ressort.
Remarque sur la matiere du balancier. Quelques Horlogers prétendent, que le balancier des montres doit être de laiton, afin de prevenir les influences que le magnétisme pourroit avoir sur lui ; ils ne font pas attention, que pour éviter un inconvénient auquel leur montre ne sera peut être jamais exposée, ils lui donnent des défauts très-réels ; parce que 1°. le laiton étant spécifiquement plus pesant que l’acier, & n’ayant point autant de corps, les balanciers de ce métal ne peuvent être aussi grands ; & comme par-là ils perdent de la force d’inertie, on est obligé de les faire plus pesans, pour que la masse compense la vîtesse ; d’où il résulte une augmentation considérable de frottement sur leurs pivots ; 2°. l’allongement du cuivre jaune par sa chaleur, étant à celui de l’acier dans le rapport de 17 à 10, les montres où l’on employe des balanciers de laiton doivent, toutes choses d’ailleurs égales, être plus susceptibles d’erreurs par les différens degrés de froid, ou de chaud auxquels elles sont exposées.
Remarque sur la forme du balancier. Comme par leur figure les balanciers présentent une grande étendue, & qu’ils ont une vitesse beaucoup plus grande que le pendule, leur mouvement doit être par conséquent plus susceptible des différences qui arrivent au milieu dans lequel ils vibrent ; ainsi après avoir disposé leurs barettes de façon que l’air leur oppose peu d’obstacles, il seroit bon encore (dans les ouvrages dont la hauteur n’est pas limitée) de leur donner la forme par laquelle ils peuvent présenter la moindre surface. Par exemple, le cercle du balancier au lieu d’être plat, comme on le fait ordinairement, devroit au contraire être une espece d’anneau cylindrique, parce que le cylindre présente moins de surface, qu’un parallelépipede de même masse que lui, & d’une hauteur égale à son diametre (T)
Balancier (en Hydraulique) est un morceau de bois freté par les deux bouts, qui sert de mouvement dans une pompe, pour faire monter les tringles des corps. (K)
Balancier, (Monnoyage.) c’est une machine avec laquelle on fait sur les flancs les empreintes qu’ils doivent porter, selon la volonté du prince.
Cette machine représentée Plan. I. du Monnoyage fig. 2. est composée du corps SRRS : il est ordinairement de bronze, & toûjours d’une seule piece. Les deux montans SS s’appellent jumelles. La partie supérieure TT qui ferme la baie ou ouverture AH, s’appelle le sommier ; elle doit avoir environ un pié d’épaisseur. La partie inférieure de la baie est de même fermée par un socle fondu avec le reste, en sorte que les jumelles, le sommier & le socle ne forment qu’un tout ; ce qui donne au corps plus de solidité & de force que si les pieces étoient assemblées.
Le socle a vers ses extrémités latérales deux éminences qui servent à l’affermir dans le plancher de l’attelier, au moyen d’un chassis de charpente qui l’entoure. Ce chassis de charpente, dont les côtés sont prolongés comme on voit en A, fig. 2. n°. 2. est fortement scellé dans le plancher, sous lequel est un massif de maçonnerie qui soûtient toute la machine.
La baie est traversée horisontalement par deux moises ou planchers H, I, ordinairement fondus de la même piece que le corps. Ces deux moises sont percées chacune d’un trou quarré dans lequel passe la boîte E E. Les trous des moises doivent répondre à celui qui est au sommier, qui est fait en écrou à deux ou trois filets ; cet écrou se fait en fondant le corps sur la vis qui doit y entrer, & qu’on enfume dans la fonte pour que le métal ne s’y attache point.
Cette vis a une partie cylindrique qui passe dans le corps de la boite EE, & y est retenue par une clavette qui traverse la boîte, & dont l’extrémité est reçûe dans une rainure pratiquée sur la surface de la partie cylindrique. C’est le même méchanisme qu’à la presse d’Imprimerie. Voy. Presse d'Imprimerie.
Si la boîte n’est point traversée par une clavette qui la retienne au cylindre qu’elle reçoit, elle est repoussée par quatre ressorts fixés sur la moise supérieure d’un bout, & appuyant de l’autre contre des éminences réservées à la partie supérieure de chaque côté de la boîte ; en sorte qu’elle est toûjours repoussée en-haut, & obligée de suivre la vis à mesure qu’elle s’éloigne.
Ce second méchanisme est défectueux ; parce que l’action du balancier, quand il presse, est diminuée de la quantité de l’action des petits ressorts employés pour relever la boîte. La partie supérieure de la vis est quarrée en A, & reçoit le grand levier ou la barre BC, qui est de fer ainsi que la vis. Cette barre a à ses extrémités des boules de plomb dont le diametre est d’environ un pié, plus ou moins, selon les especes à monnoyer. car on a ordinairement autant de balanciers que de différentes monnoies, quoiqu’on pût les monnoyer toutes avec le même. Les extrémités du levier, après avoir traversé les boules de plomb, sont terminées par des anneaux D, semblables à ceux qui terminent le pendant d’une montre, mais mobiles autour d’un boulon vertical. On attache à ces anneaux autant de cordes ou courroies de cuir nattées en rond, qu’il y a d’ouvriers qui doivent servir la machine.
La partie inférieure EE de la boîte est creuse : elle reçoit une des matrices ou coins qui porte l’empreinte d’un des côtés de la piece de monnoie. Cette matrice est retenue dans la boîte avec des vis ; l’autre matrice est assujettie dans une autre boîte H avec des vis. On pose cette boîte sur le socle ou pas de la baie : & qu’on ne soit pas étonné qu’elle ne soit que posée ; l’action de la vis étant toûjours perpendiculaire, & le poids de la matrice assemblée avec la boîte, très-considérable, il n’y a aucune raison pour que cet assemblage se déplace.
Devant le balancier est une profondeur dans laquelle le monnoyeur place ses jambes, afin d’être assis au niveau du socle, & placer commodément le flanc sur la matrice.
Tout étant dans cet état, en sorte que l’axe de la vis, celui des boîtes EEH, soient dans une même ligne perpendiculaire au plan du socle ; si on conçoit que des hommes soient appliqués aux cordons dont les extrémités du levier sont garnies, & qu’ils tirent, ensorte que la vis tourne du même sens dont elle entre dans son écrou ; la matrice dont la boîte supérieure est armée s’approchera de l’autre ; & si l’on place un flan sur celle-ci, comme on voit en H, il se trouvera pris & pressé entre les deux matrices d’une force considérable, puisqu’elle équivaudra à l’action de dix à douze hommes appliqués à l’extrémité d’un levier très-long, & chargé par ses bouts de deux poids très-lourds. Après que le flan est marqué, deux hommes tirent à eux des cordons dans un sens opposé, & font remonter la vis : le monnoyeur saisit cet instant pour chasser le flan marqué de dessus la matrice H, & y en remettre un autre. Il doit faire cette manœuvre avec adresse & promptitude ; s’il lui arrivoit de n’être pas à tems, il laisseroit le flan sur la matrice, & ce flan recevroit un second coup de balancier. Les flans ont été graissés d’huile avant que d’être mis sur la matrice.
Balancier, (terme de Papetier.) c’est un instrument de fer à l’usage de quelques manufactures de papier dans lesquelles il tient lieu de la derniere pile, appellée pile à l’ouvrier. Cet instrument est composé de trois barres de fer, qui forment comme les trois côtés d’un quarré ; savoir, deux montans & une traverse. La traverse est attachée au plancher par deux anneaux de fer, & les deux côtés paralleles descendent jusqu’à la hauteur de l’arbre de la roue. L’une des deux est terminée par une espece de crochet qui s’attache à une manivelle de fer qui est au bout de l’arbre du moulin ; l’autre branche est fort large par en-bas, & forme une espece de grille à jour. Le mouvement que la roue communique à un des montans, se communique aussi à la branche terminée en quille ; & cette branche va & vient continuellement dans une espece d’auge remplie d’eau & de pâte fine ; ce qui acheve de la délayer & de la mettre en état d’aller en sortant de-là dans la chaudiere.
Balancier, s. m. partie du Métier à bas, fixée par deux vis sur chaque extrémité des épaulieres. Il étoit composé dans les anciens métiers de deux barres paralleles 14, 14, 15, 15, assemblées, comme on voit Plan. III. fig. 1. où celle d’en-bas est terminée par deux petits crochets. On a corrigé le balancier dans les métiers nouveaux, en supprimant la barre 15, 15, avec son tenon, & en lui substituant sur la barre 14, 14, à égale distance des épaulieres, deux vis dont la tête percée & placée sous la barre 14, 14, peut recevoir deux petits crochets qui ont les mêmes fonctions que ceux de la piece qu’on a supprimée, & qui donnent encore la facilité de hausser & de baisser les crochets à discretion. Voyez à l’article Bas au Métier, à la seconde opération de la main d’œuvre, qu’on appelle le foncement de pié, l’usage du balancier. Mais observez que si cette facilité de baisser & de hausser les crochets à discrétion perfectionne la machine, en donnant lieu à un tâtonnement à l’aide duquel on obtient le point de précision qu’on cherche, on n’eût pas eu besoin de tâtonner, s’il eût été possible aux ouvriers qui construisent les métiers à bas de se conformer avec exactitude aux proportions du modele ideal qui existoit dans la tête de l’inventeur.
BALANCINES, ou VALANCINES, s. f. (Marine.) ce sont des maneuvres ou cordes qui descendent des barres de hune & des chouquets, & qui viennent former des branches sur les deux bouts de la vergue, où elles passent dans des poulies. On s’en sert pour tenir la vergue en balance lorsqu’elle est dans sa situation naturelle, ou pour la tenir haute & basse, selon qu’il est à propos. Voyez Plan. I. la situation & la forme des balancines.
Balancines de la grande vergue, Plan. I. n°. 48. Balancines de la vergue de misene, Plan. I. n°. 49. Balancines de la civadiere, Pl. I. n°. 50. Les balancines de la civadiere sont amarrées au bout du beaupré, & servent aussi pour border le perroquet. Il y a deux poulies courantes dont les cordes viennent se terminer au château d’avant, & outre cela aux deux tiers de la vergue de civadiere il y a deux poulies doubles, & de grands cordages pour tenir la vergue ferme : le tout se rendant au château d’avant, elles servent à apiquer la vergue de civadiere lorsque l’on va à la bouline. Voyez Plan. I. le beaupré en Z, & la civadiere n°. 10.
Balancines de la vergue de perroquet de misene, Pl. I. n°. 86.
Balancines de grand perroquet, Pl. I. n°. 85.
Balancines du grand hunier, voyez Pl. I. vergue du grand hunier, cot. 5.
Balancines de la vergue de perroquet de foule, Pl. I. n°. 84.
Balancines de la vergue de foule, voyez Pl. I. la vergue de foule cotée 2.
Balancines de la vergue du perroquet de beaupré, voyez Pl. I. la vergue du perroquet de beaupré cotée 11. (Z)
Balancine de chaloupe, (Marine.) c’est la maneuvre ou corde qui soûtient le gui. Voyez Gui.
* BALANÇONS, s. m. pl. (Œconom. rust.) c’est ainsi qu’on appelle en Languedoc de petites pieces de bois de sapin débitées : on les y estime à trois livres la douzaine.
* BALANÉOTE, (Géog. anc.) ville de la Cilicie sur les confins de cette province : Josephe qui en fait mention ne dit rien de plus de sa situation.
* BALANGIAR, (Géog.) ville capitale de Tartarie, au nord de la mer Caspienne.
BALANT, s. m. (Marine.) le balant d’une maneuvre est la partie qui n’est point halée : il se dit aussi de la maneuvre même lorsqu’elle n’est point employée. On dit tenir le balant d’une maneuvre, pour dire l’amarrer de telle sorte qu’elle ne balance pas. (Z)
* BALANTES, s. m. pl. (Géog.) peuples d’Afrique au pays des Negres, sur la côte de l’Océan, vers les Bissaux.
BALANUS MYREPSICA, voyez Nephriticum lignum ou ben.
* BALAOU, s. m. (Hist. nat.) poisson fort commun à la Martinique ; il se prend à la lueur des flambeaux : il est de la grandeur de la sardine, excellent au goût, & mal décrit par les auteurs.
* BALARES, s. m. pl. (Hist. anc.) nom que les habitans de l’île de Corse donnoient aux exilés, & les habitans de Carthage à ceux de leur ville ou de leur territoire, qui l’abandonnoient pour habiter les montagnes de la Sardaigne.
BALARUC, (Eaux de) voyez Eau.
BALAUSTES, s. f. (Mat. med.) Les balaustes sont les fleurs du grenadier sauvage ; on en extrait le suc de la même maniere que de l’hypociste.
Elles sont astringentes comme les cytines, d’une nature terreuse, épaississantes, rafraîchissantes, & dessiccatives : on les employe dans les flux de toute espece, comme dans la diarrhée, la dyssenterie, & pour arrêter les hémorrhagies des plaies.
On doit les choisir nouvelles, bien fleuries & d’un rouge vif : elles donnent de l’huile avec du sel essentiel, & assez de terre. (N)
* BALAUSTIER, s. m. (Jardinage.) c’est ainsi qu’on nomme le grenadier sauvage. Voyez Grenadier.
* BALASSOR, s. m. (Commerce.) étoffe faite d’écorce d’arbre que les Anglois apportent des Indes orientales : on ne nous dit point ni de quel arbre on prend l’écorce, ni comment on la travaille.
BALATS, s. m. (Marine.) c’est un amas de cailloux & de sable que l’on met à fond de cale, pour que le vaisseau entrant dans l’eau par ce poids demeure en assiette ; c’est ce qu’on appelle autrement lest. Voyez Lest. (Z)
* BALBASTRO, (Géog.) ville d’Espagne au royaume d’Aragon sur le Vero. Long. 17. 50. lat. 41. 50.
* BALBEC, (Géog. anc. & mod.) ville d’Asie dans la Syrie ; il y a de beaux restes d’antiquités. Lon. 55. lat. 33. 25.
* BALCH, (Géog. anc. & mod.) ville de Perse située dans le milieu du Chorasan, sur la riviere de Dehash. Quelques Géographes la prennent pour l’ancienne Chariaspa, ou Zariaspa, ou Bactres.
BALCON, s. m. terme d’Architect. saillie pratiquée sur la façade extérieure d’un bâtiment, portée par des colonnes ou des consoles ; on y fait un appui de pierre ou de fer qui, lorsqu’il est de maçonnerie, s’appelle balustrade ; & quand il est de serrurerie, s’appelle aussi balcon : il en est de grands, de moyens & de petits, selon l’ouverture des croisées ou avantcorps qui les reçoit. Voyez Banquette, terme de Serrurerie.
Ce mot vient de l’Italien balcone, formé du Latin palcus, ou de l’Allemand palk, une poutre. Covarruvias le fait venir de βαλλεῖν, jacere, lancer, fondé sur l’opinion que les balcons étoient de petites tourelles élevées sur les principales portes des forteresses, de dessus lesquelles on lançoit des dards, &c. sur les ennemis. (P)
Balcons, en Marine, ce sont des galeries couvertes ou découvertes, qu’on fait aux grands vaisseaux pour l’agrément ou la commodité. Voyez Galerie, (Z)
* BALDIVIA, (Géog.) port & place considérable du Chili, entre les rivieres de Callacalla & del Potrero, à leur embouchure dans la mer du Sud. Long. 306. 52. lat. mérid. 39. 58.
* BALE, (Géog.) ville de Suisse, capitale du canton de même nom. Long. 25. 15. lat. 47. 40.
* BALEARES, s. m. pl. (Géog. anc. & mod.) iles de la Méditerranée, près des côtes de Valence en Espagne, connues aujourd’hui sous le nom de Mayorque & Minorque. On donna le nom de Baleares aux habitans de ces îles, à cause de leur habileté à se servir de la fronde ; puis celui de Gymnetes, & aux iles celui de Gymnesies, par la même raison.
BALEINE, s. f. balæna, (Hist. nat.) poisson du genre des cétacées, le plus grand de tous les animaux : c’est pourquoi on a donné le nom de baleine aux plus gros poissons, quoique de différens genres.
Les baleines que l’on prend sur la côte de Bayonne & dans les Indes, ont environ trente-six coudées de longueur sur huit de hauteur ; l’ouverture de la bouche est de dix-huit piés ; il n’y a point de dents, mais il se trouve à la place des lames d’une sorte de corne noire, terminées par des poils assez semblables à des soies de cochon, qui sont plus courts en-devant qu’en arriere. On a donné le nom de fanons aux lames qui sont dans la bouche. On les fend pour les employer à différens usages ; c’est ce qu’on appelle la baleine dont on se sert pour faire des corps pour les femmes, les busques, &c. La langue est d’une substance si molle, que lorsqu’on l’a tirée hors de la bouche de l’animal, on ne peut plus l’y faire rentrer. Les yeux sont à quatre aunes de distance l’un de l’autre ; ils paroissent petits à l’extérieur : mais au-dedans ils sont plus grands que la tête d’un homme. La baleine a deux grandes nageoires aux côtés, il n’y en a point sur le dos. La queue est si grande & si forte, que lorsque l’animal l’agite il pourroit, dit-on, renverser un petit vaisseau. Le cuir de la baleine est fort dur, & de couleur noire ; il n’y a point de poils ; il s’y attache quelquefois des coquillages, tels que des lépas & des huîtres. Le membre génital est proportionné à la grosseur du corps. Rondelet.
On trouva près de l’île de Corse, en 1620, une baleine qui avoit cent piés de longueur. Son lard pesoit cent trente-cinq mille livres. Il fallut employer les forces de dix-sept hommes pour tirer du corps de l’animal le gros intestin, dont la capacité étoit si grande, qu’un homme à cheval auroit pû y entrer. L’épine du dos étoit composée de trente deux vertebres. Cette baleine étoit femelle & pleine. On retira de la matrice un fœtus qui avoit trente piés de longueur, & qui pesoit quinze cents livres.
On dit qu’on a vû des baleines qui avoient jusqu’à deux cents piés de longueur. Quelqu’énorme que cet animal soit par lui-même, je crois qu’on auroit voulu l’aggrandir encore davantage par l’amour du merveilleux. On prétend à la Chine qu’on y a vû des baleines longues de neuf cents soixante piés ; d’autres ont comparé ces grands poissons à des écueils, à des îles flottantes, &c. Quoi qu’il en soit de ces relations, on assûre que les premieres baleines qu’on a pêchées dans le Nord, étoient beaucoup plus grandes que celles qu’on y trouve à présent ; sans doute parce qu’elles étoient plus vieilles. On ne sait pas quelle est la durée de la vie de ces animaux ; il y a apparence qu’ils vivent très-long-tems.
L’estomac de la baleine est d’une grande étendue ; cependant on n’y a pas vû des choses d’un grand volume. Rondelet dit qu’on n’y trouve que de la boue, de l’eau, de l’algue puante, & qu’on en a tiré quelquefois des morceaux d’ambre. Il soupçonnoit que la baleine n’avaloit point de poissons, parce qu’on n’en avoit pas vû dans son estomac : mais Willugby fait mention d’une baleine qui avoit avalé plus de quarante merlus, dont quelques-uns étoient encore tout frais dans son estomac ; d’autres disent que ces grands poissons vivent en partie d’insectes de mer, qui sont en assez grand nombre dans les mers du Nord pour les nourrir, & qu’on a trouvé dans leur estomac dix ou douze poignées d’araignées noires, des anchois, & d’autres petits poissons blancs, mais jamais de gros. Les baleines mangent une très-grande quantité de harengs.
On dit que ces poissons s’élevent perpendiculairement sur leur queue pour s’accoupler ; que le mâle & la femelle s’approchent l’un de l’autre dans cette situation ; qu’ils s’embrassent avec leurs nageoires, & qu’ils restent accouplés pendant une demi-heure ou une heure. On prétend qu’ils vivent en société dans la suite, & qu’ils ne se quittent jamais. La femelle met bas dans l’automne. On assûre qu’il n’y a qu’un baleinon par chaque portée ; mais il est aussi gros qu’un taureau ; d’autres disent qu’il y en a quelquefois deux ; la mere l’alaite en le tenant avec ses nageoires, dont elle se sert aussi pour le conduire & pour le défendre.
M. Anderson est entré dans un détail très-satisfaisant sur les différentes especes de baleines, dans son Histoire naturelle d’Islande & du Groenland, &c. Selon cet auteur, la véritable baleine de Groenland, pour laquelle se font les expéditions de la pêche, a des barbes & le dos uni. C’est celle que Ray distingue par cette phrase : balœna vulgaris edentula, dorso non pinnato. La grosseur énorme de ce poisson fait qu’il n’approche guere des côtes d’Islande, & le retient dans des abysmes inaccessibles vers Spitzberg, & sous le pol du Nord. Il a jusqu’à soixante ou soixante & dix piés de longueur. La tête seule fait un tiers de cette masse. Les nageoires des côtés ont depuis cinq jusqu’à huit piés de long ; la gueule est horisontale, la queue un peu recourbée vers le haut aux deux extrémités : elle forme à peu-près deux demi-lunes ; elle a trois ou quatre brasses de largeur ; ses coups sont très violens, sur-tout lorsque ce poisson est couché sur le côté : c’est par le moyen de sa queue que la baleine se porte en avant ; & on est étonné de voir avec quelle vîtesse cette masse énoime se meut dans la mer. Les nageoires ne lui servent que pour aller de côté. L’épiderme de ce poisson n’est pas plus épais que du gros papier ou du parchemin. La peau est de l’épaisseur du doigt, & couvre immédiatement la graisse, qui est épaisse de huit pouces ou d’un pié ; elle est d’un beau jaune, lorsque le poisson se porte bien. La chair qui se trouve au-dessous est maigre & rouge. La mâchoire supérieure est garnie des deux côtés de barbes qui s’ajustent obliquement dans la mâchoire inférieure comme dans un fourreau, & qui embrassent, pour ainsi-dire, la langue des deux côtés. Ces barbes sont garnies du côté de leur tranchant de plusieurs appendices, & sont rangées dans la mâchoire comme des tuyaux d’orgue, les plus petites devant & derriere, & les plus grandes dans le milieu : celles-ci ont six ou huit piés & plus de longueur. La langue est adhérente presqu’en entier ; ce n’est, pour ainsi dire, qu’un morceau de graisse : mais il est si gros, qu’il suffit pour remplir plusieurs tonneaux. Les yeux ne sont pas plus grands que ceux d’un bœuf, & leur crystallin desséché n’excede pas la grosseur d’un gros pois ; ils sont placés sur le derriere de la tête, à l’endroit où elle est le plus large. Les baleines ont des paupieres & des sourcils. On ne voit dans ces poissons aucune apparence d’oreilles au dehors, cependant ils ont l’ouie très-bonne ; & si on enleve l’épiderme, on apperçoit derriere l’œil, & un peu plus bas, une tache noire, & dans ce même endroit un conduit, qui est sans doute celui de l’oreille. Les excrémens de la baleine ressemblent assez au vermillon un peu humecté ; ils n’ont aucune mauvaise odeur. Il y a des gens qui les recherchent, parce qu’ils teignent d’un joli rouge, & cette couleur est assez durable sur la toile. La baleine mâle a une verge d’environ six piés de longueur ; son diametre est de sept à huit pouces à sa racine, & l’extrémité n’a qu’environ un pouce d’épaisseur : cette verge est ordinairement renfermée dans un fourreau. Les parties naturelles de la femelle ressemblent à celles des quadrupedes : l’orifice extérieur paroît fermé pour l’ordinaire ; il y a de chaque côté une mammelle qui s’allonge de la longueur de six ou huit pouces, & qui a dix ou douze pouces de diametre, lorsque la baleine alaite ses petits. Tous les pécheurs du Groenland assûrent que l’accouplement de ces poissons se fait comme il a été dit plus haut. M. Dudley rapporte dans les Transactions philosophiques, n°. 387. article 2. que la femelle se jette sur le dos & replie sa queue, & que le mâle se pose sur elle & l’embrasse avec ses nageoires. Ce sont peut-être, dit M. Anderson, des baleines d’une autre espece que celle du Groenland, qui s’accouplent ainsi. Selon M. Dudley, l’accouplement ne se fait que tous les deux ans ; la femelle porte pendant neuf ou dix mois, & pendant ce tems elle est plus grasse, sur-tout lorsqu’elle est près de son terme. On prétend qu’un embryon de dix-sept pouces est déjà tout-à-fait formé & blanc : mais étant parvenu au terme, il est noir & a environ vingt piés de longueur. La baleine ne porte ordinairement qu’un fœtus, & rarement deux. Lorsqu’elle donne à téter à son petit, elle se jette de côté sur la surface de la mer, & le petit s’attache à la mammelle. Son lait est comme le lait de vache. Lorsqu’elle craint pour son petit, elle l’emporte entre ses nageoires.
M. Anderson décrit plusieurs autres especes de baleines, qu’il appelle le nord-caper, le gibbar, le poisson de Jupiter, le pslock-sisch, & le knoten ou knobbelfisch ; & il rapporte aussi au genre des baleines la licorne de mer ou nerwal, le cachalot, le marsouin-souffleur ou tunin, le dauphin, & l’épée de mer. Voyez Cetacée, Poisson. (I)
* Pêche de la baleine. De toutes les pêches qui se font dans l’Océan & dans la Méditerranée, la plus difficile sans contredit & la plus périlleuse est la pêche des baleines. Les Basques, & sur-tout ceux qui habitent le pays de Labour, sont les premiers qui l’ayent entreprise, malgré l’âpreté des mers du Nord & les montagnes de glace, au-travers desquelles il falloit passer. Les Basques sont encore les premiers qui ayent enhardi aux différens détails de cette pêche, les peuples maritimes de l’Europe, & principalement les Hollandois qui en font un des plus importans objets de leur commerce, & y employent trois à quatre cents navires, & environ deux à trois mille matelots : ce qui leur produit des sommes très-considérables ; car ils fournissent seuls ou presque seuls d’huile & de fanons de baleines. L’huile sert à brûler à la lampe, à faire le savon, à la préparation des laines des Drapiers, aux Courroyeurs pour adoucir les cuirs, aux Peintres pour délayer certaines couleurs, aux gens de mer pour en graisser le brai qui sert à enduire & spalmer les vaisseaux, aux Architectes & aux Sculpteurs pour une espece de détrempe avec céruse, ou chaux qui durcit, fait croute sur la pierre, & la garantit des injures du tems. A l’égard des fanons, leur usage s’étend à une infinité de choses utiles : on en fait des busques, des piquûres, des parasols, des corps & autres ouvrages.
Les Basques qui ont encouragé les autres peuples à la pêche des baleines, l’ont comme abandonnée : elle leur étoit devenue presque dommageable, parce qu’ayant préféré le détroit de Davis aux côtes de Groenland, ils ont trouvé le détroit, les trois dernieres années qu’ils y ont été, très-dépourvû de baleines.
Les Basques auparavant envoyoient à la pêche dans les tems favorables, environ trente navires de deux cents cinquante tonneaux, armés de cinquante hommes tous d’élite, avec quelques mousses ou demi-hommes. On mettoit dans chacun de ces bâtimens, des vivres pour six mois, consistans en biscuit, vin, cidre, eau, légumes & sardines salées. On y embarquoit encore cinq à six chaloupes, qui ne devoient prendre la mer que dans le lieu de la pêche, avec trois funins de cent vingt brasses chacun, au bout desquels étoit saisie & liée par une bonne épissure, la harpoire faite de fin brin de chanvre, & plus mince que le funin. A la harpoire tient le harpon de fer dont le bout est triangulaire & de la figure d’une fleche, & qui a trois piés de long, avec un manche de bois de six piés, lequel se sépare du harpon quand on a percé la baleine, afin qu’il ne puisse ressortir d’aucune maniere. Celui qui le lance se met à l’avant de la chaloupe, & court de grands risques, parce que la baleine, après avoir été blessée, donne de furieux coups de queue & de nageoires, qui tuent souvent le harponneur, & renversent la chaloupe.
On embarquoit enfin dans chaque bâtiment destiné à la pêche, trente lances ou dards de fer de quatre piés, avec des manches de bois d’environ le double de longueur ; quatre cents bariques tant vuides que pleines de vivres ; deux cents autres en bottes ; une chaudiere de cuivre contenant douze bariques & pesant huit quintaux ; dix mille briques de toutes especes pour construire le fourneau, & vingt-cinq bariques d’une terre grasse & préparée pour le même usage.
Quand le bâtiment est arrivé dans le lieu où se fait le passage des baleines, on commence par y bâtir le fourneau destiné à fondre la graisse & à la convertir en huile ; ce qui demande de l’attention. Le bâtiment se tient toûjours à la voile, & on suspend à ses côtés les chaloupes armées de leurs avirons. Un matelot attentif est en vedette au-haut du mât de hune ; & dès qu’il apperçoit une baleine, il crie en langue Basque balia, balia ; l’équipage se disperse aussi-tôt dans les chaloupes, & court la rame à la main après la baleine apperçue. Quand on l’a harponnée (l’adresse consiste à le faire dans l’endroit le plus sensible) elle prend la fuite & plonge dans la mer. On file alors les funins mis bout à bout, & la chaloupe suit. D’ordinaire la baleine revient sur l’eau pour respirer & rejetter une partie de son sang. La chaloupe s’en approche au plus vite, & on tâche de la tuer à coups de lance ou de dard, avec la précaution d’éviter sa queue & ses nageoires, qui feroient des blessures mortelles. Les autres chaloupes suivent celle qui est attachée à la baleine pour la remorquer. Le bâtiment toûjours à la voile, la suit aussi, tant afin de ne point perdre ses chaloupes de vûc, qu’afin d’être à portée de mettre à bord la baleine harponnée.
Quand elle est morte & qu’elle va par malheur au fond avant que d’être amarrée au côté du bâtiment, on coupe les funins pour empêcher qu’elle n’entraîne les chaloupes avec elle. Cette manœuvre est absolument nécessaire, quoiqu’on perde sans retour la baleine avec tout ce qui y est attaché. Pour prévenir de pareils accidens, on la suspend par des funins dès qu’on s’apperçoit qu’elle est morte, & on la conduit à un des côtés du bâtiment auquel on l’attache avec de grosses chaînes de fer pour la tenir sur l’eau. Aussitôt les charpentiers se mettent dessus avec des bottes qui ont des crampons de fer aux semelles, crainte de glisser ; & de plus ils tiennent au bâtiment par une corde qui les lie par le milieu du corps. Ils tirent leurs couteaux qui sont à manche de bois & faits exprès ; & à mesure qu’ils enlevent le lard de la baleine suspendue, on le porte dans le bâtiment, & on le réduit en petits morceaux qu’on met dans la chaudiere, afin qu’ils soient plus promptement fondus. Deux hommes les remuent sans cesse avec de longues pelles de fer qui hâtent leur dissolution. Le premier feu est de bois ; on se sert ensuite du lard même qui a rendu la plus grande partie de son huile, & qui fait un feu très-ardent. Après qu’on a tourné & retourné la baleine pour en ôter tout le lard, on en retire les barbes ou fanons cachés dans la gueule, & qui ne sont pas au-dehors comme plusieurs Naturalistes se l’imaginent.
L’équipage de chaque bâtiment a la moitié du produit de l’huile ; & le capitaine, le pilote & les charpentiers ont encore par-dessus les autres une gratification sur le produit des barbes ou fanons. Les Hollandois ne se sont pas encore hasardés à fondre dans leurs navires le lard des baleines qu’ils prennent, & cela à cause des accidens du feu, qu’ils appréhendent avec juste raison. Ils le transportent avec eux en bariques pour le fondre dans leur pays, en quoi les Basques se montrent beaucoup plus hardis : mais cette hardiesse est récompensée par le profit qu’ils font, & qui est communément triple de celui des Hollandois, trois bariques ne produisant au plus fondues, qu’une barique d’huile. Voyez le recueil de différens traités de Physique, par M. Deslandes.
C’est à un bourgeois de Cibourre, nommé François Soupite, que l’on doit la maniere de fondre & de cuire les graisses dans les vaisseaux, même à flot & en pleine mer. Il donna le dessein d’un fourneau de brique qui se bâtit sur le second pont : on met sur ce fourneau la chaudiere, & l’on tient auprès des tonneaux d’eau pour garantir du feu.
Voici maintenant la maniere dont les Hollandois fondent le lard de baleine, qu’ils apportent par petits morceaux dans des bariques. Une baleine donne aujourd’hui quarante bariques : celles qu’on prenoit autrefois en donnoient jusqu’à soixante à quatre-vingts.
On voit, fig. premiere des planches qui suivent celles de notre histoire naturelle, une coupe verticale des bacs, de la chaudiere & du fourneau à fondre le lard. On place les tonneaux AA pleins de lard qui a fermenté, sur le bord du bac B ; on vuide ces tonneaux dans ce bac ; on y remue le lard afin de le délayer, & de le disposer à se fondre. On met le feu au fourneau C, dont on voit le cendrier en E, & la grille en F ; on jette le lard du bac B dans la chaudiere G, placée dans un massif de brique & de maçonnerie, sur le fourneau C. Les bacs 1, 2, 3, qui sont tous moins élevés les uns que les autres, communiquent entr’eux par les gouttieres H ; ils sont pleins d’eau fraîche. Lorsque le lard est délayé, on le jette du bac B, dans la chaudiere G, comme on vient de dire. On l’y laisse fondre ; à mesure qu’il se fond, l’huile se forme & s’éleve à la surface. On la ramasse avec des cuillieres, & on la jette dans le bac 1 : à mesure qu’elle s’amasse dans le bac 1, elle descend dans le bac 2, & du bac 2, dans le bac 3. Au sortir du bac 3, on l’entonne dans des barriques pour être vendue.
On la fait passer successivement par ces bacs pleins d’eau, afin qu’elle se refroidisse plus promptement. Après qu’on a enlevé l’huile, il reste dans la poelle un marc, des grillons, ou, pour parler la langue de l’art, des crotons. On prend ces crotons, & on les jette sur un grillage de bois dont un des bouts porte sur le massif de la chaudiere, & l’autre bout à l’extrémité d’un long bac qui correspond à toute la longueur du grillage, & qui reçoit l’huile qui tombe des crotons qui s’égouttent sur le grillage. Voyez fig. 2.A, bac où l’on met le lard au sortir des barriques. B, fourneau. C, cendrier. D, grille. E, chaudiere. GH, grillage à égoutter le croton. IK, bac qui reçoit les égouttures. Fig. 3. plan des mêmes choses. A, bac à lard. C, chaudiere. DE, grillage. FG, bac à égouttures.
Les Basques, dans le commencement, faisoient la pêche dans la mer Glaciale, & le long des côtes de Groenland, où les baleines, qu’on appelle de grande baie, sont plus longues & plus grasses que dans les autres mers : l’huile en est aussi plus pure, & les fanons de meilleure qualité, sur-tout plus polis, mais les navires y courent de très-grands dangers, à cause des glaces qui viennent souvent s’y attacher, & les font périr sans ressource. Les Hollandois l’éprouvent tous les ans de la maniere du monde la plus triste.
Les côtes de Groenland ayant insensiblement rebuté les Basques, ils allerent faire leur pêche en pleine mer, vers l’île de Finlande, dans l’endroit nommé Sarde, & au milieu de plusieurs bas-fonds. Les baleines y sont plus petites qu’en Groenland, plus adroites, s’il est permis de parler ainsi d’un pareil animal, & plus difficiles à harponner, parce qu’elles plongent alternativement, & reviennent sur l’eau. Les Basques, encore rebutés, ont quitté ce parage, & ont établi leur pêche dans le détroit de Davis, vers l’ile d’Inseo, souvent environnée de glaces, mais peu épaisses. Ils y ont trouvé les deux especes de baleines connues sous le nom de grandes baies, & de Sarde. Voyez la péche des baleines, dans l’ouvrage de M. Deslandes, que nous avons déjà cité.
La pêche des baleines, que nous avons apprise aux Hollandois, est devenue si considérablé pour eux, qu’ils envoyent tous les ans sur nos ports sept à huit mille barrils d’huile, & du savon à proportion.
Quelqu’utile que soit cette pêche, il s’est passé des siecles sans que les hommes ayent osé la tenter. C’étoit, au tems de Job, une entreprise qu’on regardoit comme si fort au-dessus de leurs forces, que Job même se sert de cet exemple pour leur faire sentir leur foiblesse, en comparaison de la toute-puissance divine. An extrahere poteris leviathan hamo, & fune ligabis linguam ejus ? Numquid pones circulum in naribus ejus, aut armilla ; perforabis maxillam ejus ? Numquid multiplicabit ad te preces, aut loquetur tibi mollia ? Numquid saciet tecum pactum, & accipies eum servum sempiternum ? Numquid illudes ei quasi avi, aut ligabis eum ancillis tuis ? Concident eum amici ? Divident illum negociatores ? Numquid implebis sagenas pelle ejus, & gurgustium piscium capite illius ? Pone super eum manum tuam, memento belli ; nec ultra addas loqui. « Homme, enleveras-tu la baleine avec l’hameçon, & lui lieras-tu la langue avec une corde ? Lui passeras-tu un anneau dans le nez, & lui perceras-tu la mâchoire avec le fer ? La réduiras-tu à la supplication & à la priere ? Fera-t-elle un pacte avec toi, & sera-t-elle ton esclave éternel ? Te joüeras-tu d’elle comme de l’oiseau, & servira-t-elle d’amusement à ta servante ? Tes amis la couperont-ils par pieces, & tes négocians la trafiqueront-ils par morceaux ? Rempliras-tu ton filet de sa peau, & de sa tête, le réservoir des poissons ? Mets ta main sur elle ; souviens-toi de la guerre, & ne parle plus ».
En vain les incrédules voudroient-ils mettre en contradiction le discours de Job avec l’expérience d’aujourd’hui : il est évident que l’Ecriture parle ici d’après les notions populaires de ces tems-là, comme Josué quand il dit, arrête-toi Soleil. L’exemple du livre de Job est bien choisi ; montre parfaitement la hardiesse de la tentative des Basques, & prouve qu’une exactitude scrupuleuse & peu nécessaire dans des raisonnemens physiques, nuiroit souvent au sublime.
Les anciens ne disent autre chose des baleines, sinon qu’elles se jettent quelquefois d’elles-mêmes à terre pour y joüir de la chaleur du soleil qu’elles aiment, & que d’autres échoüent ou sont poussées sur les bords de la mer, par la violence de ses vagues. Si Pline rapporte que l’empereur Claude a donné le plaisir, au peuple Romain, d’une espece de pêche où l’on prit une baleine, il observe en même tems que ce monstre marin avoit échoüé au port d’Ostie ; qu’aussi-tôt qu’on l’apperçut dans le détroit, l’empereur en fit fermer l’entrée avec des cordes & des filets, & que ce prince, accompagné des archers de la garde prétorienne, en fit monter un certain nombre dans des esquifs & des brigantins, qui lancerent plusieurs dards à cet animal, dont il fut blessé à mort ; que dans le combat, il jetta une si grande quantité d’eau par son évent ou tuyau, qu’il en mit à fond l’un des esquifs : mais cette histoire est rapportée comme un fait rare & singulier ; ainsi, il demeure toûjours pour constant que l’usage de cette pêche n’étoit pas commun.
Et pourquoi l’auroit-il été ? on ne connoissoit presque pas, dans ces premiers tems, le profit qu’on en pouvoit tirer. Juba, roi de Mauritanie, écrivant au jeune prince Caïus César fils d’Auguste, lui manda qu’on avoit vû en Arabie des baleines de six cens piés de long & de trois cens soixante piés de large, qui avoient remonté de la mer dans un fleuve d’Arcadie, où elles avoient échoüé. Il ajoûte que les marchands Asiatiques recherchoient avec grand soin la graisse de ce poisson, & des autres poissons de mer ; qu’ils en frottoient leurs chameaux pour les garantir des grosses mouches appellées taons, qui craignent fort cette odeur. Voilà, selon Pline, tout l’avantage que l’on tiroit alors des baleines. Cet auteur fait ensuite mention de quarante-deux sortes d’huile, & l’on n’y trouve point celle de ce poisson : on savoit encore si peu profiter de ce poisson, sous les regnes de Vespasien, de Tite, de Domitien & de Nerva, que Plutarque rapporte que plusieurs baleines avoient échoüé en donnant de travers aux côtes de la mer, comme un vaisseau qui n’a point de gouvernail ; que lui-même en avoit vû dans l’île d’Ancire ; qu’une entre les autres, que les flots avoient jettée sur le rivage proche la ville de Bunes, avoient tellement infecté l’air, par sa putréfaction, qu’elle avoit mis la peste dans la ville & dans les environs.
Voici comment on prétend que nos Biscayens du cap-Breton près de Bayonne, & quelques autres pêcheurs, ont été engagés à la pêche des baleines. Il paroît tous les ans sur leurs côtes, vers l’hyver, de ces baleines qui n’ont point d’évent, & qui sont fort grasses : l’occasion de pêcher de ces poissons se présenta donc dans leur propre pays, & ils en profiterent. Ils se contenterent de ces baleines pendant fort long-tems : mais l’observation qu’ils firent ensuite, que ces monstrueux poissons ne paroissoient dans les mers de ce pays-là qu’en certaines saisons, & qu’en d’autres tems ils s’en éloignoient, leur fit naître le dessein de tenter la découverte de leur retraite. Quelques pêcheurs du cap-Breton s’embarquerent & firent voile vers les mers de l’Amérique, & l’on prétend que ce fût eux qui découvrirent les premiers les îles de Terre-Neuve, & la terre-ferme du Canada, environ cent ans avant les voyages de Christophle Colomb, & qu’ils donnerent le nom de cap-Breton, leur patrie, à une de ces îles, nom qu’elle porte encore. Voyez Corneil. Witfl. Ant. Mang. Ceux qui sont de ce sentiment ajoûtent que ce fut l’un de la nation de ces Biscayens qui donna avis de cette découverte à Colomb, l’an 1492, & que celui-ci s’en fit honneur : d’autres croyent que ce ne fut que l’an 1504 que ce premier voyage fut entrepris par les Basques, auquel cas il seroit postérieur à celui de Colomb. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’ils découvrirent, dans les mers qui sont au nord de l’Amérique, un grand nombre de baleines, mais en même tems, qu’ayant aussi reconnu qu’elles sont encore plus abondantes en morues, ils préférerent la pêche de ce dernier poisson, à la pêche de l’autre.
Lorsque le tems approche où les navires baleiniers doivent revenir, il y a toûjours des matelots en sentinelle dans le port de Succoa. Les premiers qui découvrent un bâtiment prêt à arriver, se hâtent d’aller à sa rencontre, & se font payer un droit de 30 sous par homme. Quelque tems qu’il fasse, ils s’embarquent sans rien appréhender, & se chargent de mouiller le bâtiment à un des endroits connus de la bonne rade. « Il est, dit M. Deslandes, aisé de voir que l’intérêt seul ne les guide point : rien, en effet, n’est plus modique, sur-tout dans les mauvais tems, & lorsque la mer brise contre une côte toute de fer, que la rétribution qu’on leur donne : mais ils seroient infiniment affligés de voir périr leurs compatriotes, & c’est un service d’humanité qu’ils se rendent mutuellement ».
* Baleine, (le blanc de) n’est autre chose qu’une préparation de cervelle de cachalots, qui se fait à Bayonne & à Saint Jean de Luz. Prenez la cervelle de cet animal ; fondez-la à petit feu ; jettez-la ensuite dans des moules comme ceux des sucreries ; laissez-la égoutter son huile & se refroidir ; refondez-la ensuite, & continuez de la faire égoutter & fondre jusqu’à ce qu’elle soit bien purifiée & bien blanche : coupez-la ensuite & la remettez en écaille de la forme de celles qu’on nous vend. Il faut choisir ces écailles belles, blanches, claires, & transparentes, d’une odeur sauvagine, & sans aucun mêlange de cire blanche, & les tenir dans des barrils ou des vaisseaux de verre bien fermés.
Je ne prétens point contredire M. Pomet sur la nature & la maniere de faire le blanc de baleine, dit M. James dans son Dictionnaire de Medecine ; j’ai pourtant vû, ajoûte-t-il, du blanc de baleine qui n’avoit essuyé aucune préparation, & qu’on s’étoit contenté de mettre dans des sacs de papier pour en absorber l’huile ; & je puis assûrer que ce n’est ni l’huile, ni le sperme de la baleine, mais une substance particuliere qu’on trouve dans la tête de ce poisson. On le trouve aussi dans d’autres endroits que la tête ; mais il y est moins bon. Voyez à l’article Cachalot, ce qu’il y a de vrai ou de faux dans ce sentiment de M. James.
Baleine, (le blanc de) Mat. med. est un remede dans plusieurs cas ; on l’employe d’ordinaire pour les meurtrissures, les contusions internes, & aprês l’accouchement ; c’est un balsamique dans plusieurs maladies de la poitrine ; il déterge & consolide : il est très-sûr & très-efficace dans les toux qui viennent d’un catarrhe opiniâtre, d’érosion, d’ulcération, aussi-bien que dans les pleurésies & les abscès internes ; c’est un consolidant, lorsque la mucosité des intestins a été emportée par l’acrimonie de la bile, comme dans les diarrhées & les dyssenteries. Il convient aussi dans les ulceres des reins & pour l’épaississement du sang ; il ramollit & relâche les fibres ; il contribue souvent à l’expulsion de la gravelle, en élargissant les passages ; on l’employe en forme d’électuaire & de bol, avec des conserves convenables & autres choses de cette espece ; & lorsqu’on a eu le soin de le mêler comme il faut, il est difficile que le malade le découvre sous cette forme : on le dissout aussi par le moyen d’un jaune d’œuf, ou bien on le réduit en émulsion ; la dose ordinaire est d’environ demi-gros.
Employé à l’extérieur il est émollient, consolidant ; il sert sur-tout dans la petite vérole, & l’on en oint les pustules lorsqu’elles commencent à se durcir, après l’avoir mêlé avec de l’huile d’amandes douces. Il n’y a pas long-tems qu’on s’en sert dans cette maladie, quoiqu’il ait été en usage du tems de Schroder, pour dissiper les crevasses que laissent la galle & les pustules.
On l’employe souvent comme un cosmétique dans le fard, & dans les pâtes avec lesquelles on se lave les mains. (N)
Baleine, (en Astronomie.) est une grande constellation de l’hémisphere méridional sous les Poissons, & proche de l’eau du Verseau. V. Constellation.
Il y a dans la baleine 22 étoiles selon le catalogue de Ptolomée ; 21, selon le catalogue de Tycho ; 22, selon Hevelius ; & 78, dans le catalogue Britannique. (O)
BALEVRES, s. f. pl. (terme d’Architecture.) du Latin bislabra, qui a deux levres ; c’est l’excédent d’une pierre sur une autre près d’un joint, dans la douille d’une voute, ou dans le parement d’un mur ; & on retaille les balevres en ragréant : c’est aussi un éclat près d’un joint occasionné dans la pierre, parce que le premier joint étoit trop serré. (P)
Balevres, (en Fonderie en grand.) on donne ce nom à ces inégalités qu’on apperçoit sur la surface des pieces fondues, & qu’il faut reparer ensuite : elles sont occasionnées dans la fonte en grand par les cires, & les jointures des assises : on a soin par cette raison que les jointures des assises tombent aux endroits de la figure les moins remarquables, afin que les balevres en soient plus faciles à reparer ; dans la fonte en petit, les balevres viennent des défauts de l’assemblage des pieces qui composent le moule & les cires. On a ainsi que dans la fonte en grand, l’attention de les écarter des parties principales, & la même peine à les reparer.
* BALI, (Géog.) ville d’Asie, capitale de l’île & du royaume de même nom, aux Indes. Long. de l’ile 133-135. lat. 9.
* Bali, (Géog.) royaume d’Afrique, dans l’Abyssinie : le fleuve Havasch le traverse.
BALISCORNE, ou BASSECONDE, s. f. on donne dans les grosses forges ce nom à une piece de fer MX, fixée sur le dessus de la caisse des soufflets par des attaches de fer NN, qui l’embrassent : le bout M en est arrondi, & c’est sur cette partie que portent les cammes de l’arbre qui fait baisser la caisse. Voyez Planche VII. fig. 1. des grosses forges.
BALISES, s. f. (termes de mer & de rivieres.) c’est une marque que l’on met sur un banc dangereux pour avertir les vaisseaux de l’éviter. Ces marques sont différentes ; quelquefois c’est un mât ou une piece de bois qu’on éleve dessus, ou aux extrémités ; d’autres fois c’est un tonneau flottant amarré avec des chaînes & des ancres sur le fond du banc : on met des balises pour indiquer un chenal ou une passe dangereuse : on se sert également du mot de bouée pour exprimer ces marques.
Balise, se dit aussi de l’espace qu’on est obligé de laisser le long des rivages des rivieres pour le halage des bateaux.
BALISER un chenal ou une passe, c’est y mettre des balises. (Z)
BALISEUR, s. m. (terme d’Eaux & Forêts.) est un officier chargé de veiller aux terres des riverains, à l’effet d’en reculer les limites du côté du bord de la riviere, à la distance prescrite. V. Riverain. (H)
BALISIER, s. m. cannacorus, (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur liliacée monopétale en forme de tuyau, divisée en six parties, dont l’une forme une sorte de languette qui semble tenir lieu de pistil, & qui a au sommet comme une étamine ; le calice est en forme de tuyau ; il embrasse la fleur, & devient dans la suite un fruit oblong ou arrondi, membraneux, divisé en trois loges, & rempli de semences presque sphériques. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
BALISTE, s. f. (Art. milit.) est une machine de guerre dont se servoient les anciens pour lancer des traits d’une longueur & d’un poids surprenant ; elle chassoit aussi des balles ou boulets de plomb égaux au poids des gros traits qu’elle lançoit.
Les écrivains de l’antiquité, au moins le plus grand nombre, sont opposés les uns & les autres à l’égard de la baliste & de la catapulte. Voyez Catapulte. Ils confondent souvent ces deux machines, qui suivant M. le Chevalier de Folard different beaucoup entr’elles dans leur usage comme dans leur construction.
Ammien Marcellin exprime la catapulte par le terme de tormentum, & quelquefois d’onagre. Voy. Onagre. Froissart se sert de celui d’engin : celui-ci est trop général ; car on peut entendre par ce terme la baliste & la catapulte. Il y a aussi des auteurs qui lui ont donné le nom de scorpion : mais le scorpion chez ceux qui paroissent les mieux instruits, n’est autre chose que la baliste. Voyez Scorpion.
« La baliste, dit M. le Chevalier de Folard, dont nous tirons la description suivante, formoit comme un arc brisé ; elle avoit deux bras, mais droits, & non pas courbes comme l’arc d’une arbalête, dont les forces agissantes sont dans les ressorts de l’arc même dans sa courbure : celles de la baliste sont dans les cercles comme celle de la catapulte : cela nous dispensera d’entrer dans une description trop détaillée de ses différentes parties. La figure en fera infiniment mieux comprendre la structure & la puissance qui la fait agir, que l’explication ne pourroit faire ». Voyez cette figure, Pl. XII. de Fortification : elle a pour titre Baliste de siége. Voici le détail de ses principales parties.
Une baliste de cette espece lançoit des traits de soixante livres, longs de trois piés neuf pouces & neuf lignes : cela veut dire, s’il faut s’en fier à Vitruve, dit le Chevalier de Folard, « que les trous des chapiteaux étoient de huit pouces neuf lignes de diametre, c’est-à-dire, le cinquieme de la longueur du trait. Elle est composée d’une base 2, des dix montans 3, 4, de quinze diametres & dix lignes de hauteur sans les tenons des deux traversans 5, 6 : leur longueur est de dix-sept diametres dix lignes ; 7, sont les deux chapiteaux du traversant ; 5, 8, les chapitaux de celui d’en-bas 6 ; ces deux traversans sont soûtenus & fortifiés des deux poteaux équarris 9 ; de cinq diametres de hauteur sans les tenons, & de deux piés de grosseur comme les montans. L’intervalle d’entre les deux poteaux 9, & les deux montans 3, 4, où sont placés les chapiteaux, est de sept diametres environ ; 10 sont les deux écheveaux de cordes de droit & de gauche ; 11 les deux bras engagés dans le centre des cheveaux : leur longueur est de dix diametres, compris les deux crochets qui sont à l’extrémité de chaque bras, où la corde, ou pour mieux dire, le gros cable est attaché comme la corde d’une arbalête. Ce cable doit être composé de plusieurs cordes de boyaux extrèmement tendu : il faut qu’il soit d’abord un peu court, parce qu’il s’allonge & se lâche dans le bandage : on l’accourcit en le tordant.
» Les bouts des bras n’ont point de cuilleron comme celui de la catapulte ; à cela près ils doivent être semblables, parfaitement égaux dans leur grosseur, dans leur longueur, dans leur poids, & il faut qu’ils ne plient point dans le plus violent effort de leur tension. Les traits 13 ne doivent pas moins être égaux en tous sens que les bras, qui seront placés sur une même ligne parallele, à même hauteur par conséquent, & au centre des deux écheveaux dans lesquels ils sont engagés.
» Les deux montans 3, 4, doivent être courbes à l’endroit 14 ou ils frappent dans la détente. Dans cette courbure on y pratiquera les coussinets 15 ; cet enfoncement fait que les bras se trouvent paralleles à l’écheveau, & qu’ils décrivent chacun un angle droit dans leur bandage, c’est-à-dire dans leur plus grande courbure. Il importe peu, à l’égard des balistes, que les deux bras frappent de leurs bouts ou de leur milieu contre les deux coussinets ; ainsi on peut, autant qu’on le juge à propos, diminuer de la largeur des deux chassis où sont placés les deux écheveaux de cordes, sans retrancher de leur hauteur.
» L’intervalle d’entre les deux poteaux 9, qui doit être au milieu des deux traversans, où l’on introduit l’arbrier 16, doit être un peu plus étroit que l’arbrier, afin de pratiquer une entaille dans l’intérieur des poteaux 9 de deux ou trois pouces des deux côtés, afin de le tenir ferme. C’est sur cet arbrier que l’on place le gros trait & que l’on pratique un canal parfaitement droit ; sa longueur se prend sur la courbure des deux bras avec la corde 12 : ainsi on connoit la longueur qu’il faut donner au canal & jusqu’à l’endroit où la noix 17 de la détente se trouve placée pour recevoir la corde de l’arc à son centre. Cette noix sert d’arrêt, & la détente est semblable à celles des arbalêtes. Il y a une chose à observer à l’égard de l’arbrier : il faut qu’il soit placé juste à la hauteur de la corde qui doit friser dessus ; car si elle étoit plus haute, elle ne prendroit pas le trait ; & si elle appuyoit trop fortement dessus, il y auroit du frottement sur le canal où le trait est étendu, ce qui diminueroit la puissance qui le chasse.
» A deux piés en-deçà de la détente est le travail 18, autour duquel se devide la corde ; & lorsqu’on veut bander la machine, on accroche la corde de l’arc à son centre par le moyen d’une main de fer 19. Cette main a deux crochets qui saisissent la corde en deux endroits pour l’amener. La distance d’un crochet à l’autre doit être plus grande que la largeur de la noix, qui doit avoir une ouverture au milieu comme celle des arbalêtes, dans laquelle on introduit le talon du trait contre la corde qui prend à la noix.
» J’ai dit que les deux montans 3, 4, étoient appuyés sur leur base à tenons & à mortoises ; ils devoient être appuyés & retenus encore par de puissantes contrefiches. Heron & Vitruve lui-même mettent une espece de table ou d’échafaudage 20, sur lequel l’arbrier est en partie soûtenu, dont la hauteur jointe à l’épaisseur de l’arbrier devoit arriver juste à la hauteur de la corde 12. Je crois, dit toûjours M. de Folard, que cette table n’étoit faite que pour aider à soûtenir l’arbrier, qui devoit être composé d’une grosse poutre de seize diametres & de deux piés de longueur, d’une de largeur & d’une d’épaisseur, conforme au trait qu’elle lançoit. Ajoûtez la force extraordinaire du bandage, capable de faire plier la plus forte poutre, si son épaisseur ne surpasse sa largeur. J’imagine toutes ces raisons, pour prouver la nécessité de cette table, parce que je n’en vois aucune autre ; car à parler franchement, cette charpente paroît un peu superflue : mais comme il faut respecter l’antiquité & l’expérience de ces sortes de machines que nous n’avons point, nous hasardons cette structure dans ce qui nous a paru inutile, qui ne l’est peut-être pas ».
Cette réflexion de M. de Folard est d’autant plus juste, que les anciens s’étant expliqués d’une maniere fort obscure sur les différentes machines de guerre qui étoient en usage de leur tems, il est bien difficile de se flatter d’avoir deviné juste tout ce qui concerne ces machines : aussi si M. de Folard, dit un habile journaliste, n’a pas toûjours donné dans le vrai à cet égard, toûjours peut-on dire qu’on lui a de grandes obligations, & qu’il en a peut-être approché plus que tous ceux qui ont travaillé avant lui sur le même sujet. Bibliotheque raisonnée des savans de l’Europe, tome V.
Au reste les anciens historiens rapportent des effets de ces machines qui nous paroissent presqu’incroyables. M. de Folard a eu soin de les rapporter dans son Traité de l’attaque des places des anciens. Voy. Catapulte. (Q)
BALISTIQUE, subst. fem. (Ord. encyclop. Entendement, Raison, Philosophie ou Science. Science de la nature. Mathématiques. Mathématiques mixtes. Méchanique. Dynamique. Dynamique proprement dite. Balistique.) c’est la science du mouvement des corps pesans jettés en l’air suivant une direction quelconque. Ce mot vient du Grec βάλλω, jacio, je jette.
On trouvera à l’article Projectile les lois de la Balistique. La théorie du jet des bombes est une partie considérable de cette science, & c’est principalement cette théorie qu’on y traite. Nous avons là-dessus plusieurs ouvrages, l’Art de jetter les bombes de M. Blondel, de l’Académie des Sciences, un des premiers qui aient paru sur cette matiere ; le Bombardier françois par M. Belidor, &c. Mais personne n’a traité cette science d’une maniere plus élegante & plus courte que M. de Maupertuis, dans un excellent mémoire imprimé parmi ceux de l’Académie des Sciences de Paris de 1732 ; ce mémoire est intitulé Balistique arithmétique, & on peut dire qu’il contient en deux pages plus de choses que les plus gros traités que nous ayons sur cette matiere. M. de Maupertuis cherche d’abord l’équation analytique de la courbe AMB (fig. 47. Méch.), que décrit un projectile A jetté suivant une direction quelconque AR ; il trouve l’équation de cette courbe entre les deux coordonnées A T, x, & T M, y, & il n’a pas de peine à faire voir que cette équation est celle d’un parabole. En faisant y=0, dans cette équation, la valeur correspondante de x lui donne la partie AB du jet ; pour avoir le cas ou la portée AB du jet est la plus grande qu’il est possible, il prend la différence de la valeur de AB, en ne faisant varier que la tangente de l’angle de projection RAB ; & il fait ensuite cette différence=0, suivant la reglé de maximis & minimis, ce qui lui donne la valeur de la tangente de l’angle de projection, pour que AB soit la plus grande qu’il est possible, & il trouve que cette tangente doit être égale au rayon, c’est-à-dire, que l’angle BAR doit être de 45 degrés. Pour avoir la hauteur tm du jet, il n’y a qu’à faire la différence de y=0, parce que tm est la plus grande de toutes les ordonnées. Pour frapper un point donné n avec une charge donnée de poudre, il substitue dans l’équation de la parabole, à la place de x, la donnée AI, & à la place de y, la donnée In, & il a une équation dans laquelle il n’y a d’inconnue que la tangente de l’angle de projection RAB, qu’il détermine par cette équation, &c. & ainsi des autres.
Au reste, la plûpart des auteurs qui ont traité jusqu’à présent de la Balislique, ou, ce qui est presque la même chose, du jet des bombes, ne l’ont fait que dans la supposition que les corps se meuvent dans un milieu non résistant ; supposition qui est assez éloignée du vrai. M. Newton a démontré dans ses principes, que la courbe décrite par un projectile dans un milieu fort résistant, s’éloigne beaucoup de la parabole ; & la résistance de l’air est assez grande pour que la différence de la courbe de projection des graves avec une parabole ne soit pas insensible. C’est au moins le sentiment de M. Robins, de la Société royale de Londres ; ce savant a donné depuis peu d’années un ouvrage Anglois, ietitulé A new principles of gunnery, nouveaux principes d’Artillerie ; dans lequel il traite du jet des bombes, & en général du mouvement des projectiles, en ayant égard à la résistance de l’air, qu’il détermine en joignant les expériences à la théorie, il n’y a point de doute que la Balistique ne se perfectionnât considérablement, si on s’appliquoit dans la suite à envisager sous ce point de vûe le mouvement des projectiles. Voyez Résistance.
Selon d’autres auteurs, qui prétendent avoir aussi l’expérience pour eux, la courbe décrite dans l’air par les projectiles est à peu-près une parabole, d’où il s’ensuit que la résistance de l’air au mouvement des projectiles est peu considérable. Cette diversité d’opinions prouve la nécessité dont il seroit de constater ce fait de nouveau par des expériences sûres & bien constatées. (O)
BALIVEAU, s. m. (terme d’Eaux & Forêts.) signifie un jeune chêne, hêtre ou châtaignier au dessous de quarante ans, reservé lors de la coupe d’un taillis. Les ordonnances enjoignent d’en laisser croître en haute-futaie seize par chaque arpent, afin de repeupler les ventes. (H)
* On peut considérer les baliveaux par rapport aux bois de haute-futaie, & par rapport aux taillis. Par rapport au premier point, M. de Reaumur prétend dans un mémoire sur l’état des bois du royaume, imprimé dans le recueil de l’Académie, Année 1721, que les baliveaux sont une mauvaise ressource pour repeupler le royaume de bois de haute-futaie, parce qu’une très-grande partie périt ; car n’ayant pas pris dans les taillis qui les couvroient toute la force nécessaire pour résister aux injures de l’air, on ne peut leur ôter cet abri sans inconvénient. Des lisieres entieres de jeunes futaies ont péri dans un hyver froid, mais non excessivement rude, après qu’on eut coupé pendant l’été d’autres lisieres qui les couvroient. Il en arrive autant aux arbres réservés au milieu de forêts abattues. Des baliveaux qui ont échappé aux injures de l’air, peu échappent à la coignée du bucheron ; il en abbat au moins une partie dans la coupe suivante du taillis : les morts lui donnent occasion d’attaquer les vifs ; & il est de notoriété que dans la plûpart des taillis, on ne trouve que des baliveaux de deux à trois coupes. Mais indépendamment de cela, dit M. de Reaumur, ces baliveaux ne seront pas des arbres d’une grande ressource ; ils ont peu de vigueur & sont tous rabougris. S’ils n’ont pas péri, ils sont restés malades ; & quelque bon qu’ait été le terrein, jamais baliveau ne parviendra peut-être & n’est parvenu à devenir un arbre propre à fournir une longue poutre, un arbre de pressoir, ni quelqu’autre semblable piece de bois. Cela est sûr au moins par rapport aux baliveaux réservés dans les taillis qu’on coupe de dix ans en dix ans au plûtôt. Ils ne sont jamais hauts de tige, & croissent toûjours en pommiers.
Ces inconvéniens des baliveaux seront d’autant moindres, que le taillis sera coupé dans un âge plus avancé ; mais à quelqu’âge qu’on le coupe, on ne peut pas espérer que les baliveaux réparent les futaies qui s’abbattent journellement.
Quant au second point, la conservation des taillis par les baliveaux ; il ne faut, dit le même auteur, que parcourir les taillis où les baliveaux ont été le mieux conservés ; on trouvera qu’au-dessous & tout autour du baliveau, sur-tout quand il est parvenu à âge d’arbre, la place est nette, & que les souches sont péries, parce qu’elles se sont trouvées trop à l’ombre : aussi, bien des particuliers qui souhaitent abattre leurs baliveaux, ne le souhaitent que pour conserver leurs taillis. Si les baliveaux donnent quelques glands aux taillis, ils les leur font donc payer cher ; d’ailleurs ces glands tombant au hasard sur la surface de la terre, & la plûpart sous l’arbre même, ne réussissent guere.
M. de Buffon s’accorde en ceci avec M. de Reaumur. « On sait, dit cet académicien, dans un mémoire sur la conservation & le rétablissement des forêts, année 1739, que le bois des baliveaux n’est pas de bonne qualité, & que d’ailleurs ces baliveaux font tort aux taillis. J’ai observé fort souvent les effets de la gelée du printems dans deux cantons voisins des bois taillis. On avoit conservé dans l’un tous les baliveaux de quatre coupes successives ; dans l’autre on n’avoit réservé que les baliveaux de la coupe actuelle. J’ai reconnu que la gelée avoit fait un si grand tort au taillis surchargé de baliveaux, que l’autre taillis l’a devancé de près de cinq ans sur douze. L’exposition étoit la même : j’ai sondé le terrein en différens endroits, il étoit semblable. Ainsi, continue M. de Buffon, j’attribue cette différence à l’ombre & à l’humidité que les baliveaux jettoient sur le taillis, & à l’obstacle qu’ils formoient au desséchement de cette humidité en interrompant l’action du vent & du soleil. Il seroit donc à propos de recourir à des moyens plus efficaces que les baliveaux, pour la restauration de nos forêts de haute-futaie, & celle de nos bois taillis ». Voyez Forêts, Taillis.
* BALKE ou BALKHE, (Géog.) ville d’Asie, au pays des Usbecs, dans la province du même nom, sur la riviere de Dilhas. Long. 85. lat. 36. 40.
* BALLADE, s. f. (Belles-Lettres.) piece de vers distribuée ordinairement en trois couplets, tous les trois de même mesure & sur les mêmes rimes masculines & féminines, assujettie à un refrein qui sert de dernier vers à chaque couplet, & terminée par un envoi ou adresse qui doit aussi finir par le refrein. Le nombre des vers du couplet n’est point limité. Ce sont ou des quatrains, ou des sixains, ou des huitains, ou des dixains, ou des douzains ; l’envoi est ordinairement de quatre ou de cinq vers, mais quelquefois tous féminins. Voilà du moins les lois auxquelles Jean Marot s’est conformé dans ses trois ballades d’amour, dont les deux dernieres sont excellentes ; elles sont de vers de dix syllabes ; c’est la mesure affectée à cette sorte d’ouvrage : il y a cependant des ballades en vers de huit syllabes. On ne fait plus guere de ballades, & je n’en suis pas trop surpris ; la ballade demande une grande naïveté dans le tour, l’esprit, le style, & la pensée, avec une extrème facilité de rimer. Il n’y a presque que la Fontaine qui, réunissant toutes ces qualités, ait su faire des ballades & des rondeaux depuis Clément Marot.
BALLE, s. f. se dit en général de tout corps à qui l’on a donné artistement la figure sphérique, ainsi on dit, une balle de paume, une balle de coton, &c.
* Balle, s. f. (Hist. anc. & gymnast.) instrument dont les anciens se servoient dans la danse appellée sphéristique. Voyez Sphéristique.
Les différens jeux de balle produisoient parmi les anciens différens effets relatifs à la conservation de la santé. Les grands mouvemens que ces jeux occasionnent, les rendent utiles lorsque l’exercice est nécessaire, & que les personnes sont en état de le supporter. Ils donnent de la vigueur, & font allonger les fibres musculeuses & nerveuses ; aussi voit-on qu’entre les jeunes gens, ceux qui y sont exercés, sont communément plus grands, plus forts, & plus alertes que les autres. Voyez Exercice, Gymnastique, Jeu.
Balle, dans l’Art milit. comprend toutes sortes de petites boules ou boulets pour les armes à feu, depuis le canon jusqu’au pistolet. Voyez Boulet, Arme à feu, Canon, &c.
Celles qui servent pour les canons sont de fer ; celles des mousquets, carabines, & pistolets, sont de plomb. On a voulu se servir de balles de fer pour ces armes : mais on a reconnu qu’outre leur légereté qui ne permet pas de tirer juste, elles ont encore le défaut de rayer le canon du fusil.
Il faut remarquer que quoiqu’on dise ordinairement un boulet de canon, on dit aussi qu’une piece de batterie porte 36, 33, ou 24 livres de balle. On dit encore charger le canon à balle, pour dire charger à boulet. (Q)
* Les balles dont on charge les petites armes à feu, se fabriquent de la même maniere que les dragées moulées, mais dans des moules plus grands. Voyez l’article Fonte de la dragée au moule. Il y en a de 26 sortes différentes, numerotées selon la quantité ou le nombre qu’il faut pour faire une livre pesant. La sorte la plus grosse est des huit à la livre ; la sorte suivante est de seize à la livre, & chaque balle pese une once. La plus petite, qui approche beaucoup de la dixieme sorte de dragée, est des 120 à la livre. Voyez la Table à l’article cité.
On appelle balles ramées, deux balles attachées ensemble par un fil de fer ; & balle de calibre, celle qui est de même grosseur que le calibre du fusil.
* Comme il importe aux chasseurs qui ont quelquefois occasion de tirer du poisson dans l’eau, de savoir si les balles y souffrent ou non de la réfraction, je vais rapporter quelques expériences que M. Carré, de l’académie royale des Sciences, a fait faire, & qu’on peut voir dans le recueil de cette académie année 1705. On tira un fusil chargé à balle deux coups dans un bassin de pierre plein d’eau, de deux piés & demi de diametre, profond de seize pouces, sous un angle de 20 degrés & sous celui de 80 : mais le grand effort de l’eau contre les parois du bassin où l’on avoit mis les ais, le dérangerent tellement qu’on ne put savoir si les balles souffroient quelque dérangement dans la direction de leur mouvement. Les expériences réitérées dans des bennes pleines d’eau ont été accompagnées du même inconvénient : elles ont été brisées sur le champ, & ce furent les cerceaux d’en-bas que l’eau fit casser.
On seroit tenté de croire que c’étoit la balle qui faisoit briser les vaisseaux en passant à travers les ais, & non le mouvement de l’eau : mais l’expérience qui suit ne laisse aucun doute que ce ne soit la derniere de ces causes. Un coup fut tiré dans une caisse quarrée d’un pié de haut, & de six pouces d’épaisseur, dont les quatre ais qui faisoient la longueur avoient chacun un pouce d’épaisseur, & les deux bouts en avoient chacun deux, afin d’y bien attacher les autres avec force clous : on avoit rempli ce vaisseau par une petite ouverture ; les ais furent percés par la balle sans en être brisés : mais l’eau s’en tourmenta de maniere qu’elle fit écarter ces ais les uns des autres, & que la caisse fut rompue.
Il fallut donc pour obtenir un résultat exact sur la réfraction, recommencer les expériences dans un bassin de pierre : on en prit un dont la longueur intérieure étoit de trois piés trois pouces, la largeur d’un pié huit pouces, & la profondeur d’un pié & un pouce ; on fit placer à son côté le plus éloigné un ais pour recevoir les balles ; un autre ais vertical & pareil à celui-là occupoit le milieu du bassin ; & au-dessus du côté le plus voisin du tireur, un carton : l’arquebuse étoit arrêtée fixe à huit piés du bassin. La balle a percé le carton : mais elle est tombée applatie, à peu près comme une piece de douze sols, entre le carton & le premier ais. Au second coup, la balle s’est divisée en trois morceaux applatis, sans avoir atteint le premier ais. On a tiré deux autres coups avec une forte charge, sans trouver de balles dans le fond du bassin ni contre les ais : ces balles avoient près de quatre lignes de diametre ; elles étoient faites exprès pour l’arquebuse, & ne pouvoient entrer dans le canon qu’en les poussant avec une baguette de fer.
On a mis dans un réservoir de 10 piés en quarré deux ais paralleles entre eux & à l’horison, & à un pié de distance l’un de l’autre : celui de dessus ne faisant qu’un même plan avec la surface de l’eau, on a tiré deux coups sur cet ais, sous un angle de 30 degrés, avec une égale charge de poudre ; le premier avec une arquebuse dont le canon avoit trois piés deux pouces six lignes de long, & la balle trois lignes de diametre ; le second avec un fusil dont le canon avoit trois piés dix pouces trois lignes de long, & la balle sept lignes de diametre : la grosse balle a percé les deux ais, & traversé par conséquent toute l’étendue de l’eau qui étoit entre eux ; au lieu que la petite n’a percé que l’ais supérieur, & s’est arrêtée applatie sur l’ais inférieur : d’où l’on a conclu que le fusil étoit plus propre pour l’expérience de la réfraction que l’arquebuse.
On a attaché au-dessus du bassin de pierre qu’on a décrit plus haut, un fusil sur deux appuis fixes, dont l’un étoit à cinq & l’autre à sept piés de distance du bassin : on l’a assûré & rendu immobile sur ces appuis : il faisoit avec l’horison, ou la surface de l’eau ou du bassin, un angle de vingt degrés ; il étoit chargé du poids de trois deniers vingt grains de poudre, avec une balle de sept lignes de diametre, qui pesoit dix-sept deniers six grains. La balle a percé le carton, le premier ais, & s’est arrêtée dans le second : on a vuidé l’eau, & les centres des trois trous se sont trouvés exactement dans la même direction.
La même expérience réitérée a donné la même chose : en augmentant la charge, on a remarqué que la balle entroit moins ; & chassée par sept deniers six grains de poudre, elle s’est applatie d’un côté, & a peu frappé l’ais du milieu.
Chassée de l’arquebuse avec la même charge, elle s’est divisée en deux parties, chacune inégalement applatie, sans avoir touché l’ais du milieu. Chassée de la même arme avec la moitié de la charge, elle n’a point atteint l’ais du milieu, & n’a perdu que peu de sa sphéricité.
Une balle de sept lignes poussée avec une forte charge dans un réservoir de 40 piés de diametre, profond de six piés, contre un linge parallelement étendu à la surface de l’eau, à deux piés de profondeur, est restée sur ce linge applatie, mais fort inégalement.
La balle de même calibre, chassée de la même arme avec un tiers de poudre de plus, s’est divisée en plusieurs petits morceaux de la grosseur d’une lentille, & diversement figurés.
La balle tirée perpendiculairement à la surface de l’eau, s’est applatie assez régulierement.
Quand on tire dans l’eau, il s’en éleve une quantité plus ou moins grande, & plus ou moins haut, selon la charge : quand la charge est forte, l’eau s’éleve jusqu’à vingt piés.
La balle de sept lignes chassée par quatre deniers de poudre ou environ, entre assez avant dans l’eau sans perdre de sa sphéricité ; chassée par huit deniers de poudre, elle en perd la moitié ; par douze deniers, elle la perd entierement ; & par seize, elle se divise en plusieurs parties.
D’où il s’ensuit 1°. que la commotion communiquée à l’eau par la balle est très-considérable ; en effet si l’on tire sur une riviere, on en sentira le rivage ébranlé sous ses piés : 2°. que plus la charge est forte, moins la balle fait de progrès dans l’eau : 3°. qu’il n’y a point de réfraction sensible : 4°. par conséquent qu’il ne faut tirer dans l’eau, ni au-dessous ni au-dessus de l’objet qu’on veut atteindre : 5°. qu’il ne faut employer qu’une petite charge.
Mais on sait qu’une balle qui passe à-travers un morceau de bois mobile sur des gonds, & fort épais, ne se défigure presque pas, & ne lui communique aucune impulsion ; tandis qu’il est constant par les expériences qui précedent, qu’elle s’applatit sur l’eau, & occasionne une grande commotion à tout le rivage. D’où vient, peut-on demander, la difference de ces phénomenes ? l’eau seroit-elle plus difficile à diviser que le bois ?
Voici comment je pense qu’on pourroit répondre à cette objection : qu’un corps mû ne communique du mouvement, au moins de translation, à un autre, qu’autant que cet autre lui résiste ou s’oppose à son mouvement. Ayez un corps, même mou, rendez-le résistant, & aussi-tôt vous lui communiquerez beaucoup de mouvement, & à tout ce qui l’environnera. Si vous enfoncez doucement un bâton dans l’eau, vous la diviserez sans peine, & presque sans l’agiter ; si vous la frappez avec impétuosité, vous donnez lieu à son élasticité, & en même tems à sa résistance ; vous lui communiquez beaucoup de mouvement, mais vous ne la divisez pas : voilà pour le corps fluide. Quant au corps solide, ce corps solide ne peut résister à la balle qui vient le frapper, que par l’adhésion de ses parties : si l’adhésion de ces parties n’est rien relativement à la vîtesse de la balle qui le vient frapper, il est évident qu’il ne peut être mû d’un mouvement de translation, parce que rien ne résiste à la balle. Qu’on suppose une porte ouverte percée d’un trou couvert d’une toile d’araignée ; si j’applique mon doigt contre les endroits solides de la porte, ces endroits résistant à son impulsion, la porte tournera sur les gonds & se fermera : mais elle restera immobile avec quelque vîtesse que je porte mon doigt contre elle, si je l’applique contre la toile d’araignée : or tout le tissu de la porte devient toile d’araignée, relativement à la vîtesse d’une balle chassée par un fusil ; & l’adhésion des parties n’est pas assez grande pour donner lieu à l’élasticité.
Mais on pourra demander encore pourquoi l’élasticité de l’eau frappée avec vîtesse a plûtôt lieu, quoique ses molécules n’ayent presqu’aucune adhérence entr’elles, que l’élasticité du bois dont les molécules tiennent les unes aux autres très-fortement. Il faut, je croi, recourir ici à la densité, à la constitution particuliere des corps ; & de ces deux causes, la derniere & la principale nous est malheureusement très-peu connue.
Balle à feu, est dans l’Artillerie, un amas d’artifice de figure ronde ou ovale de différentes grosseurs, qui se jette à la main ou avec le mortier.
Maniere la plus usitée pour faire des balles à feu. L’on se sert pour faire des balles à feu d’une livre de salpetre, d’un quarteron de fleur de soufre, deux onces de poussier broyé passé par le tamis de soie, & mêlé avec l’huile de pétrole ou huile de lin ; il faut en faire de petites boules de la grosseur d’une balle, les percer quand elles seront humides, y mettre de la corde d’amorce en travers, les passer quatre à quatre ou deux à deux, & les rouler dans le poussier vif, après quoi cela prend feu.
Autre maniere pour faire les balles à feu, qui peuvent s’exécuter dans les mortiers. Il faut avoir un porte-feu d’un pié & demi ou de deux piés de longueur, suivant la grosseur dont on voudra faire la balle, sur un pouce on un pouce & demi de diametre, lequel sera chargé d’une composition que l’on aura faite avec deux livres de salpetre, une livre de soufre,& demi-livre de poudre ; le tout bien pilé séparément, le passer dans un tamis bien fin, & après mêler le tout ensemble autant qu’il se pourra.
En cas que le feu soit trop lent, on y ajoûtera un peu de poudre pilée ; & s’il brûle trop vîte, on y ajoûtera un peu de salpetre pour le faire durer davantage. Le milieu de la balle sera un petit sac rempli de même composition. Les porte-feux seront passés au-travers de ce sac ; & par-dessus, pour couvrir la balle, on mettra de gros copeaux avec de la filasse, que l’on fera tremper dans un grand chaudron ou chaudiere, dans laquelle on mettra 6 à 7 livres d’huile de lin, & autant d’huile de térébenthine, avec 8 ou 9 livres de goudron ou poix que l’on fera chauffer doucement, & qu’on remuera bien souvent ; & lorsque le tout sera bien lié, l’on fera tremper dans la chaudiere la filasse & les copeaux, que l’on mettra à part pour les faire sécher à demi ; & après on fera tremper aussi de la vieille toile bien grossiere, qui servira pour envelopper la balle. Il faut avoir du soufre pilé sans être passé au tamis, & du salpetre, & en jetter sur la toile, comme aussi sur la filasse & les copeaux à part, pour que le feu soit plus clair. Il faut observer qu’il faut mettre de tems en tems du fil de fer autour de la matiere qu’on mettra dans la boule pour la faire tenir, & ne la pas trop presser, parce que le feu seroit trop lent. Quand la matiere est un peu mouvante, la flamme en est plus grande. Si l’on veut davantage presser le feu, il faut prendre trois livres de poudre pilée, une livre de charbon pilé, mêler le tout ensemble, & après l’étendre sur une table, & faire rouler la balle sur cette matiere lorsqu’elle sera garnie de copeaux & de filasse, & après l’on mettra la toile par-dessus ; ou si l’on ne veut pas se servir de toile pour la derniere enveloppe, l’on peut y faire une petite caisse de bois d’enveloppe léger ; le tout dépend de la conduite de l’officier qui s’en doit servir ; il peut se corriger à la premiere ou seconde balle qu’il fera joüer.
Autre maniere de composition de balles à feu qui se jettent avec le mortier, rapportée dans le Bombardier François de M. Belidor. Pour composer ces sortes de balles il faut 30 livres de poudre, 5 livres de poix blanche ou résine, 10 livres de poix noire, 2 livres de suif de mouton, 2 livres d’étoupes, 4 grenades chargées, 4 cordes pour les montans, grosses environ comme le doigt, longues chacune de 6 piés & demi ; 6 brasses de corde de la grosseur du petit doigt, & de la toile pour un sac de 11 pouces de diametre, sur 22 pouces de hauteur.
Il faut faire fondre la poix dans une chaudiere ou marmite de fer ; & lorsqu’elle sera fondue, y jetter les deux livres de suif de mouton, que l’on aura eu soin de faire bien hacher : le tout bien incorporé ensemble, on le remuera de tems en tems avec la spatule de fer, & l’on en ôtera avec l’écumoire les corps étrangers. On retire cette chaudicre de dessus le feu pour la porter la plus chaude qu’il se peut, auprès d’une autre chaudiere de fer, que l’on aura fait enterrer de façon qu’il y ait un glacis autour d’environ six pouces, pour que la composition que l’on verse doucement dans cette autre chaudiere, ne s’écarte pas. Il faudra échauffer la chaudiere enterrée avec un peu de braise, de façon qu’on la puisse toucher de la main, & la bien nettoyer avec un sac à terre pour qu’il ne reste point de feu. Ensuite on y verse la composition, sur laquelle on répand peu à peu les trente livres de poudre, en faisant remuer toûjours avec deux spatules ou pelles de fer rondes. Cette poudre bien mêlée avec la composition, on y met l’étoupe par petits morceaux, faisant toûjours remuer à force de bras pour qu’elle s’imbibe parfaitement ; après quoi on formera la balle à feu. Pour cela on noue les quatre cordes ensemble dans leur milieu, ce qui forme huit montans ; on pose le culot du sac sur le nœud ; on met dans le fond environ un tiers de la composition, sur laquelle on met encore deux grenades, que l’on couvrira d’un autre tiers de composition. On lie ensuite le sac avec une ficelle par le haut à dix huit pouces ou environ de longueur ; puis on rassemble les huit montans, qu’on lie au-dessus du sac avec une autre ficelle, observant que le sac soit toûjours bien droit & bien à-plomb sur son culot, que les montans soient également distans les uns des autres le long du sac. Ces précautions prises, on cordelle la balle à feu, fermant le culot comme celui d’un panier ; on continue jusqu’à la moitié de la hauteur de la balle, observant de bien tirer les montans à mesure que l’on monte les travers, qui doivent être distans de deux pouces les uns des autres. On lie les montans à demeure avec de la ficelle, & on continue de cordeler jusqu’en haut, serrant les montans également, afin qu’ils restent droits autant qu’il se pourra, & bien partagés.
Cette balle à feu qui doit avoir la forme d’un œuf étant faite, on fait un anneau avec le reste des montans ; on les lie avec de la ficelle pour pouvoir y passer un levier, pour la tremper dans une chaudiere où est pareille composition que celle des tourteaux, pour la goudronner de tous côtés ; après quoi on la met dans de l’eau pour la refroidir : on perce ensuite deux trous auprès de l’anneau avec une cheville de bois d’environ un pouce de diametre & de cinq à six pouces de profondeur, observant que ces deux chevilles puissent se joindre en un point. On a soin de bien graisser les chevilles qui doivent rester dans la balle jusqu’à ce que l’on veuille l’exécuter, afin qu’alors on puisse les retirer aisément. On remplit les trous qu’elles laissent, avec de la composition pareille à celle des fusées de bombe, observant de la battre avec une machine de cuivre ou de bois, crainte d’accident : mais lorsque l’on ne veut pas garder longtems la balle à feu, on charge les fusées de suite au moment qu’elle est froide, de la façon qu’il est dit ; on les coeffe avec de la cire préparée, y mettant à chacune un petit bout de ficelle pour les reconnoître au besoin. La balle à feu s’exécute dans le mortier comme la bombe. Les bombardiers mettent le feu en même tems aux fusées ; & lorsqu’on les voit bien allumées, on met le feu au mortier.
Quand on se sert de balles à feu pour découvrir les travailleurs de l’ennemi, il faut faire ensorte de pointer le canon de maniere qu’elles ne montent point fort haut, de crainte qu’elles ne s’enterrent. Elles servent aussi pour mettre le feu dans les magasins à fourage, de même que dans les maisons ; & en ce cas, on donne au mortier le degré d’élévation nécessaire pour que la balle tombe sur les toîts comme la bombe, & qu’elle les perce. On peut mettre dans la balle à feu avec les grenades, des bouts de canon de fusils, de pistolets remplis de poudre & de balles. Les grenades y sont mises pour écarter ceux qui voudroient l’éteindre.
On peut encore mettre dans la balle à feu une bombe de six pouces au lieu de grenades. On place pour cet effet environ un tiers de composition au fond du sac, sur laquelle on pose un tourteau goudronné, ensuite la bombe la fusée en bas. On peut mettre aussi dans la balle à feu quatre lits de tourteaux & de grenades avec fusées.
Composition de balles à feu qu’on jette avec la main. Il faut prendre six livres de soufre tamisé, autant de poulverin, autant de salpetre, & autant de crystal minéral, une livre & demie de camfre, trois quarterons de vif-argent, une livre & demie de colophane, trois livres d’huile de pétrole, six onces de gomme Arabique, une livre & demie de sel ammoniac, & une demi-pinte d’esprit-de-vin. On fait dissoudre le camfre dans l’esprit-de-vin, la gomme dans un peu d’eau ; après quoi on y met de l’esprit-de-vin, on mêle bien ensemble le soufre, le poulverin, le salpetre, le crystal minéral, & la colophane, humectant de tems en tems cette composition avec le camfre dissous, la gomme & l’huile de pétrole.
Après que tout a été mis en pâte & bien mêlé à force de bras, on en fait des pelotes qui pesent environ quatre livres. On partage le vif-argent en autant de parties égales qu’on a fait de pelotes. On perce chacune de ces pelotes de plusieurs petits trous avec une cheville de bois graissée ; on y met cette partie de vif-argent, puis on resserre les trous ; on enveloppe la pelote avec un peu de filasse & de l’étoupe, & du papier gris que l’on entortille avec du gros fil : on la trempe dans le goudron, ensuite on la couvre d’une grosse toile, que l’on trempe une seconde fois dans le goudron ; après quoi on la trempe dans l’eau ; on y fait un trou avec une cheville de bois graissée qui ne passe pas le centre de la pelote, & on le remplit de la composition des fusées à bombes. On se sert de ces sortes de balles à feu pour éclairer un terrein occupé par l’ennemi. S. Remy. (Q)
Balle luisante, chez les Artificiers ; on appelle ainsi une espece d’artifice semblable aux étoiles, & qui n’en differe que par la composition, la grosseur, & la couleur du feu. Voici la maniere de le faire.
Prenez six onces de soufre, deux onces d’antimoine crud ; de salpetre, de colophane, & de charbon, de chacun quatre onces : ou bien de salpetre, de colophane, de charbon, de chacun deux onces ; & d’antimoine, de soufre & de poix noire, de chacun une once.
Après avoir bien pilé ces matieres, on les fera fondre dans un vaisseau de cuivre ou de terre vernissée, dans lequel on jettera des étoupes de chanvre ou de lin autant qu’il en faudra pour absorber toute la matiere fondue ; pendant qu’elle se refroidira, on en fera des pelotons de la grosseur qu’on voudra, & on les amorcera de pâte de poudre écrasée, dans laquelle on les roulera, ou on les enveloppera de coton d’étoupille : il faut cependant prendre garde de ne pas faire ces balles si grosses qu’elles ne puissent être totalement consommées en retombant du pot d’une fusée volante, crainte qu’elles ne retombent en feu sur les spectateurs, ou sur des maisons où elles pourroient mettre le feu.
Balles d’Imprimerie ; ce sont deux morceaux de bois creusés, surmontés d’un manche aussi de bois, parfaitement ressemblant à un entonnoir. Le creaux de cet instrument se remplit de laine bien nette & bien cardée, laquelle y est maintenue par deux cuirs apprêtés & attachés avec de petits clous tout autour de la bouche de l’entonnoir ; c’est avec ces deux ustenciles que l’on empreint d’encre la forme. Voyez Planche IV. A qui représente les deux balles posées l’une sur l’autre sur les chevilles de la presse.
Balles teigneuses, terme d’Imprimerie. Lorsque les cuirs neufs refusent l’encre, faute de n’avoir pas été assez corroyés, ce qui fait paroître sur les balles des taches noires & blanches, on dit que ces balles sont teigneuses. Pour remédier à ce défaut, l’on est contraint de démonter & corroyer de nouveau les cuirs, de les saupoudrer même de cendre pour imbiber le trop d’humidité dont ils se trouvent surchargés en quelques endroits. Les balles peuvent encore devenir teigneuses si la laine de dedans sort par les bords ; car alors il se forme une espece de duvet, qui se mêle avec l’encre, & introduit sur la forme nombre d’ordures qui emplissent l’œil de la lettre.
Balle, chez les Paumiers ; c’est un corps sphérique fait de chiffons de laine couverts de drap blanc d’environ deux pouces & demi, ou trois pouces au plus de diametre, dont on se sert pour joüer à la paume : il doit être bien rond & bien ficelé. Les statuts des Paumiers ordonnent qu’il soit couvert de drap neuf, & qu’il pese en tout dix-neuf estelins. L’estelin vaut la vingtieme partie d’une once. Pour faire la balle, il faut avoir du chiffon, une masse de bois & l’instrument appellé bilboquet. On prend du chiffon, on en forme un peloton que l’on ficelle, on le bat dans le bilboquet, afin de noyer la corde dans l’étoffe dont il est fait. Quand il a la grosseur convenable, on le revêt de drap blanc : on le finit ensuite sur le bilboquet, où on le remet pour abattre la couture de son vêtement, & la balle est faite. Voyez Paumier, Bilboquet, & la figure de cet instrument dans la Planche du Paumier.
Balle, terme de Commerce ; on appelle ainsi certaine quantité de marchandises enveloppées ou empaquetées dans de la toile avec plusieurs tours de corde bien serrés par-dessus, après les avoir bien garnies de paille pour empêcher qu’elles ne se brisent ou ne se gâtent par l’injure du tems.
On dit une balle d’épicerie, de livres, de papier, de fil, &c. & l’on met sur les balles des marques & numeros, afin que les marchands à qui elles sont envoyées puissent les reconnoître.
Une balle de coton filé est ordinairement de trois ou quatre cents pesant. Une balle de soie crue pese quatre cents. Une balle de grosse toile est de trois, trois & demie ou quatre pieces.
Selon M. Chambers, une balle de laine en Angleterre est la valeur de la charge d’un cheval, & contient deux cents quarante livres de poids.
Vendre des marchandises sous cordes en balles ou en balles sous cordes, c’est les vendre en gros sans échantillon & sans les déballer.
On appelle marchandises de balle certaines quincailleries & autres ouvrages qui viennent de certains pays, particulierement de Forès, & qui sont ordinairement fabriqués par de mauvais ouvriers.
Une balle de dés est un petit paquet en papier, qui contient une ou plusieurs douzaines de dés à joüer.
On nomme porte-balles les petits merciers qui vont par la campagne, & qui portent sur leur dos des balles de menue mercerie. (G)
* Balle, (Œconomie rustiq.) c’est la pellicule qui enveloppe le grain, & que les fléaux, le van & le crible en détachent. Les laboureurs l’appellent menue paille. On la mêle avec l’avoine des chevaux ; on la donne en bûvée aux vaches ; elle peut nourrir toutes sortes de bestiaux ; elle fait mûrir les fruits & les conserve, & l’on en couvre la glace & la neige que l’on réserve pour l’été.
BALLET, s. m. danse figurée exécutée par plusieurs personnes qui représentent par leurs pas & leurs gestes une action naturelle ou merveilleuse, au son des instrumens ou de la voix.
Tout ballet suppose la danse, & le concours de deux ou de plusieurs personnes pour l’exécuter. Une personne seule, qui en dansant représenteroit une action, ne formeroit pas proprement un ballet ; ce ne seroit alors qu’une sorte de pantomime. Voyez Pantomime. Et plusieurs personnes qui représenteroient quelque action sans danse, formeroient une comédie, & jamais un ballet.
La danse, le concours de plusieurs personnes, & la représentation d’une action par les gestes, les pas, & les mouvemens du corps, sont donc ce qui constitue le ballet. Il est une espece de poësie muette qui parle, selon l’expression de Plutarque ; parce que sans rien dire, elle s’exprime par les gestes, les mouvemens & les pas. Clausis faucibus, dit Sidoine Apollinaire, & loquente gestu, nutu, crure, genu, manu, rotatu, toto in schemate, vel semel latebit. Sans danse il ne peut point exister de ballet : mais sans ballet il peut y avoir des danses. Voyez Danse.
Le ballet est un amusement très-ancien. Son origine se perd dans l’antiquité la plus reculée. On dansa dans les commencemens pour exprimer la joie ; & ces mouvemens réglés du corps, firent imaginer bientôt après un divertissement plus compliqué. Les Egyptiens firent les premiers de leurs danses des hiéroglyphes d’action, comme ils en avoient de figurés en peinture, pour exprimer tous les mysteres de leur culte. Sur une musique de caractere, ils composerent des danses sublimes, qui exprimoient & qui peignoient le mouvement reglé des astres, l’ordre immuable, & l’harmonie constante de l’univers.
Les Grecs dans leurs tragédies introduisirent des danses, & suivirent les notions des Egyptiens. Les chœurs qui servoient d’intermedes, dansoient d’abord en rond de droite à gauche, & exprimoient ainsi les mouvemens du ciel qui se font du levant au couchant. Ils appelloient cette danse strophes ou tours.
Ils se tournoient ensuite de gauche à droite pour représenter le cours des planetes, & ils nommoient ces mouvemens antistrophes ou retours ; après ces deux danses, ils s’arrêtoient pour chanter : ils nommoient ces chants épodes. Par-là ils représentoient l’immobilité de la terre qu’ils croyoient fixe. Voyez Chœur.
Thésée changea ce premier objet de la danse des Grecs ; leurs chœurs ne furent plus que l’image des évolutions & des détours du fameux labyrinthe de Crete. Cette danse inventée & exécutée par le vainqueur du Minotaure & la jeunesse de Delos, étoit composée de strophes & d’antistrophes, comme la premiere, & on la nomma la danse de la grue, parce qu’on s’y suivoit à la file, en faisant les diverses évolutions dont elle étoit composée, comme font les grues lorsqu’elles volent en troupe. Voyez Grue.
Les ballets furent constamment attachés aux tragédies & aux comédies des Grecs ; Athenée les appelle danses philosophiques ; parce que tout y étoit réglé, & qu’elles étoient des allegories ingénieuses, & des représentations d’actions, ou des choses naturelles qui renfermoient un sens moral.
Le mot ballet vient de ce qu’originairement on dansoit en joüant à la paume. Les anciens, attentifs à tout ce qui pouvoit former le corps, le rendre agile ou robuste, & donner des graces à ses mouvemens, avoient uni ces deux exercices ; ensorte que le mot ballet est venu de celui de balle : on en a fait bal, ballet, ballade, & baladin ; le ballar & ballo des Italiens, & le bailar des Espagnols, comme les Latins en avoient fait ceux de ballare, & de ballator, &c.
Deux célebres danseurs furent à Rome les inventeurs véritables des ballets, & les unirent à la tragédie & à la comédie.
Batile d’Alexandrie inventa ceux qui représentoient les actions gaies, & Pilade introduisit ceux qui représentoient les actions graves, touchantes, & pathétiques.
Leurs danses étoient un tableau fidele de tous les mouvemens du corps, & une invention ingénieuse qui servoit à les régler, comme la tragédie en représentant les passions, servoit à rectifier les mouvemens de l’ame.
Les Grecs avoient d’abord quatre especes de danseurs qu’on nommoit hylarodes, simodes, magodes, & lysiodes ; ils s’en servoient pour composer les danses de leurs intermedes. V. ces mots à leurs différ. articles.
Ces danseurs n’étoient proprement que des bouffons ; & ce fut pour purger la scene de cette indécence, que les Grecs inventerent les ballets reglés, & les chœurs graves que la tragédie reçut à sa place.
Les anciens avoient une grande quantité de ballets, dont les sujets sont rapportés dans Athenée ; mais on ne trouve point qu’ils s’en soient servis autrement que comme de simples intermedes. Voyez Intermede. Aristote, Platon, &c. en parlent avec éloge, & le premier est entré, dans sa Poëtique, dans un très-grand détail au sujet de cette brillante partie des spectacles des Grecs.
Quelques auteurs ont prétendu que c’étoit à la cruauté d’Hyeron tyran de Syracuse, que les ballets devoient leur origine. Ils disent que ce prince soupçonneux ayant défendu aux Siciliens de se parler, de peur qu’ils ne conspirassent contre lui ; la haine & la nécessité, deux sources fertiles d’invention, leur suggérerent les gestes, les mouvemens du corps & les figures, pour se faire entendre les uns aux autres : mais nous trouvons des ballets, & en grand nombre, antérieurs à cette époque ; & l’opinion la plus certaine de l’origine des danses figurées, est celle que nous avons rapportée ci-dessus.
Le ballet passa des Grecs chez les Romains, & il y servit aux mêmes usages ; les Italiens & tous les peuples de l’Europe en embellirent successivement leurs théatres, & on l’employa enfin pour célébrer dans les cours les plus galantes & les plus magnifiques, les mariages des rois, les naissances des princes, & tous les évenemens heureux qui intéressoient la gloire & le repos des nations. Il forma seul alors un très-grand spectacle, & d’une dépense immense, que dans les deux derniers siecles on a porté au plus haut point de perfection & de grandeur.
Lucien qui a fait un traité de la danse, entre dans un détail fort grand des sujets qui sont propres à ce genre de spectacle : il semble que cet auteur ait prévû l’usage qu’on en feroit un jour dans les cours les plus polies de l’Europe.
On va donner une notion exacte de ces grands ballets, aujourd’hui tout-à-fait hors de mode ; on a vû quelle a été leur origine, & leur succès ; on verra dans la suite leurs changemens, leur décadence, & le genre nouveau qu’elle a produit : des yeux philosophes trouvent par-tout ces commencemens, ces progrès, ces diminutions, ces modifications différentes, en un mot, qui sont dans la nature : mais elles se manifestent d’une maniere encore plus sensible dans l’histoire des Arts.
Comme dans son principe, le ballet est la représentation d’une chose naturelle ou merveilleuse, il n’est rien dans la nature, & l’imagination brillante des Poëtes n’a pû rien inventer, qui ne fût de son ressort.
On peut diviser ces grands ballets en historiques, fabuleux, & poëtiques.
Les sujets historiques sont les actions connues dans l’histoire, comme le siége de Troie, les victoires d’Alexandre, &c.
Les sujets fabuleux sont pris de la fable, comme le jugement de Paris, les noces de Thétis & Pelée, la naissance de Vénus, &c.
Les poëtiques, qui sont les plus ingénieux, sont de plusieurs especes, & tiennent pour la plûpart de l’histoire & de la fable.
On exprime par les uns les choses naturelles, comme les ballets de la nuit, des saisons, des tems, des âges, &c. d’autres sont des allégories qui renferment un sens moral, comme le ballet des proverbes, celui des plaisirs troublés, celui de la mode, des aveugles, de la curiosité, &c.
Il y en a eu quelques-uns de pur caprice, comme le ballet des postures, & celui de bicêtre ; quelques autres n’ont été que des expressions naïves de certains évenemens communs, ou de certaines choses ordinaires. De ce nombre étoient les ballets des cris de Paris, de la foire S. Germain, des passe-tems, du carnaval, &c. Enfin l’histoire, la fable, l’allégorie, les romans, le caprice, l’imagination, sont les sources dans lesquelles on a puisé les sujets des grands ballets. On en a vû de tous ces genres différens réussir, & faire honneur à leurs différens inventeurs.
Ce spectacle avoit des regles particulieres, & des parties essentielles & intégrantes, comme le poëme épique & dramatique.
La premiere regle est l’unité de dessein. En faveur de la difficulté infinie qu’il y avoit à s’assujettir à une contrainte pareille, dans un ouvrage de ce genre, il fut toûjours dispensé de l’unité de tems & de l’unité de lieu. L’invention ou la forme du ballet est la premiere de ses parties essentielles : les figures sont la seconde : les mouvemens la troisieme : la Musique qui comprend les chants, les ritournelles, & les symphonies, est la quatrieme : la décoration & les machines sont la cinquieme : la Poësie est la derniere ; elle n’étoit chargée que de donner par quelques récits les premieres notions de l’action qu’on représentoit.
Leur division ordinaire étoit en cinq actes, & chaque acte étoit divisé en 3, 6, 9, & quelquefois 12 entrées.
On appelle entrée une ou plusieurs quadrilles de danseurs, qui par leur danse représentent la partie de l’action dont ils sont chargés. Voyez Entrée.
On entend par quadrille, 4, 6, 8, & jusqu’à 12 danseurs vêtus uniformément, ou de caracteres différens, suivant l’exigence des cas. Voyez Quadrille. Chaque entrée étoit composée d’une ou plusieurs quadrilles, selon que l’exigeoit le sujet.
Il n’est point de genre de danse, de sorte d’instrumens, ni de caractere de symphonie, qu’on n’ait fait entrer dans les ballets. Les anciens avoient une singuliere attention à employer des instrumens différens à mesure qu’ils introduisoient sur la scene de nouveaux caracteres ; ils prenoient un soin extrème à peindre les âges, les mœurs, les passions des personnages qu’ils mettoient devant les yeux.
A leur exemple dans les grands ballets exécutés dans les différentes cours de l’Europe, on a eu l’attention de mêler dans les orchestres, les instrumens convenables aux divers caracteres qu’on a voulu peindre ; & on s’est attaché plus ou moins à cette partie, selon le plus ou le moins de goût de ceux qui en ont été les inventeurs, ou des souverains pour lesquels on les a exécutés.
On croit devoir rapporter ici en abrégé deux de ces grands ballets, l’un pour faire connoître les fonds, l’autre pour faire appercevoir la marche théatrale de ces sortes de spectacles. C’est du savant traité du P. Ménétrier Jésuite, qu’on a extrait le peu de mots qu’on va lire.
Le gris de lin étoit le sujet du premier ; c’étoit la couleur de Madame Chrétienne de France, duchesse de Savoie, à laquelle la fête étoit donnée.
Au lever de la toile l’Amour déchire son bandeau ; il appelle la lumiere, & l’engage par ses chants à se répandre sur les astres, le ciel, l’air, la terre, & l’eau, afin qu’en leur donnant par la variété des couleurs mille beautés différentes, il puisse choisir la plus agréable.
Junon entend les vœux de l’Amour, & les remplit ; Iris vole par ses ordres dans les airs, elle y étale l’éclat des plus vives couleurs. L’Amour frappé de ce brillant spectacle, après l’avoir consideré, se décide pour le gris de lin, comme la couleur la plus douce & la plus parfaite ; il veut qu’à l’avenir il soit le symbole de l’amour sans fin. Il ordonne que les campagnes en ornent les fleurs, qu’elle brille dans les pierres les plus précieuses, que les oiseaux les plus beaux en parent leur plumage, & qu’elle serve d’ornement aux habits les plus galans des mortels.
Toutes ces choses différentes animées par la danse, embellies par les plus éclatantes décorations, soûtenues d’un nombre fort considérable de machines surprenantes, formerent le fonds de ce ballet, un des plus ingénieux & des plus galans qui ayent été représentés en Europe.
On donna le second à la même cour en 1634, pour la naissance du cardinal de Savoie. Le sujet de ce ballet étoit la Verita nemica della apparenza sollevata dal tempo.
Au lever de la toile on voyoit un chœur de Faux Bruits & de Soupçons, qui précedoient l’Apparence & le Mensonge.
Le fond du théatre s’ouvrit. Sur un grand nuage porté par les vents, on vit l’Apparence vêtue d’un habit de couleurs changeantes, & parsemé de glaces de miroir, avec des aîles, & une queue de paon ; elle paroissoit comme dans une espece de nid d’où sortirent en foule les Mensonges pernicieux, les Fraudes, les Tromperies, les Mensonges agréables, les Flatteries, les Intrigues, les Mensonges bouffons, les Plaisanteries, les jolis petits Contes.
Ces personnages formerent les différentes entrées, après lesquelles le Tems parut. Il chassa l’Apparence, il fit ouvrir le nuage sur lequel elle s’étoit montrée. On vit alors une grande horloge à sable, de laquelle sortirent la Vérité, & les Heures. Ces derniers personnages, après différens récits analogues au sujet, formerent les dernieres entrées, qu’on nomme le grand ballet.
Par ce court détail, on voit que ce genre de spectacle réunissoit toutes les parties qui peuvent faire éclater la magnificence & le goût d’un souverain ; il exigeoit beaucoup de richesse dans les habits, & un grand soin pour qu’ils fussent toûjours du caractere convenable. Il falloit des décorations en grand nombre, & des machines surprenantes. Voyez Décoration, & Machine.
Les personnages d’ailleurs du chant & de la danse en étoient presque toûjours remplis par les souverains eux-mêmes, les seigneurs & les dames les plus aimables de leur cour ; & souvent à tout ce qu’on vient d’expliquer, les princes qui donnoient ces sortes de fêtes ajoûtoient des présens magnifiques pour toutes les personnes qui y représentoient des rôles ; ces présens étoient donnés d’une maniere d’autant plus galante, qu’ils paroissoient faire partie de l’action du ballet. Voyez Sapate.
En France, en Italie, en Angleterre, on a représenté une très-grande quantité de ballets de ce genre : mais la cour de Savoie semble l’avoir emporté dans ces grands spectacles sur toutes les cours de l’Europe. Elle avoit le fameux comte d’Aglié, le génie du monde le plus fécond en inventions théatrales & galantes. Le grand art des souverains en toutes choses est de savoir choisir ; la gloire d’un regne dépend presque toûjours d’un homme mis à sa place, ou d’un homme oublié.
Les ballets représentés en France jusqu’en l’année 1671, furent tous de ce grand genre. Louis XIV. en fit exécuter plusieurs pendant sa jeunesse, dans lesquels il dansa lui-même avec toute sa cour. Les plus célebres sont le ballet des Prospérités des armes de la France, dansé peu de tems après la majorité de Louis XIV. Ceux d’Hercule amoureux, exécuté pour son mariage ; d’Alcidiane, dansé le 14 Février 1658 ; des Saisons, exécuté à Fontainebleau le 23 Juillet 1661 ; des Amours déguisés, en 1664, &c.
Les ballets de l’ancienne cour furent pour la plûpart imaginés par Benserade. Il faisoit des rondeaux pour les récits ; & il avoit un art singulier pour les rendre analogues au sujet général, à la personne qui en étoit chargée, au rôle qu’elle représentoit, & à ceux à qui les récits étoient adressés. Ce poëte avoit un talent particulier pour les petites parties de ces sortes d’ouvrages ; il s’en faut bien qu’il eût autant d’art pour leur invention & pour leur conduite.
Lors de l’établissement de l’opéra en France, on conserva le fond du grand ballet : mais on en changea la forme. Quinault imagina un genre mixte, dans lequel les récits firent la plus grande partie de l’action. La danse n’y fut plus qu’en sous-ordre. Ce fut en 1671, qu’on représenta à Paris les Fêtes de Bacchus & de l’Amour, cette nouveauté plût ; & en 1681, le Roi & toute sa cour exécuterent à Saint-Germain le Triomphe de l’Amour, fait par Quinault, & mis en musique par Lully : de ce moment il ne fut plus question du grand ballet, dont on vient de parler. La danse figurée, ou la danse simple reprirent en France la place qu’elles avoient occupée sur les théatres des Grecs & des Romains ; on ne les y fit plus servir que pour les intermedes ; comme dans Psiché, le Mariage forcé, les Fâcheux, les Pygmées, le Bourgeois Gentilhomme, &c. Le grand ballet fut pour toûjours relégué dans les colléges. Voyez Ballets de Collége. A l’opéra même le chant prit le dessus. Il y avoit plus de chanteurs que de danseurs passables ; ce ne fut qu’en 1681, lors qu’on représenta à Paris le Triomphe de l’Amour, qu’on introduisit pour la premiere fois des danseuses sur ce théatre.
Quinault qui avoit créé en France l’opéra, qui en avoit apperçu les principales beautés, & qui par un trait de génie singulier avoit d’abord senti le vrai genre de ce spectacle (Voyez Opéra) n’avoit pas eu des vûes aussi justes sur le ballet. Il fut imité depuis par tous ceux qui travaillerent pour le théatre lyrique. Le propre des talens médiocres est de suivre servilement à la piste la marche des grands talens.
Après sa mort on fit des opéra coupés comme les siens, mais qui n’étoient animés, ni du charme de son style, ni des graces du sentiment qui étoit sa partie sublime. On pouvoit l’atteindre plus aisément dans le ballet, où il avoit été fort au-dessous de lui-même ; ainsi on le copia dans sa partie la plus défectueuse jusqu’en 1697, que la Mothe, en créant un genre tout neuf, acquit l’avantagé de se faire copier à son tour.
L’Europe Galante est le premier ballet dans la forme adoptée aujourd’hui sur le théatre lyrique. Ce genre appartient tout-à-fait à la France, & l’Italie n’a rien qui lui ressemble. On ne verra sans doute jamais notre opéra passer chez les autres nations : mais il est vraissemblable qu’un jour, sans changer de musique (ce qui est impossible) on changera toute la constitution de l’opéra Italien, & qu’il prendra la forme nouvelle & piquante du ballet François.
Il consiste en 3 ou 4 entrées précédées d’un prologue.
Le prologue & chacune des entrées forment des actions sèparées avec un ou deux divertissemens mêlés de chants, & de danses.
La tragédie lyrique doit avoir des divertissemens de danse & de chant, que le fonds de l’action amene. Le ballet doit être un divertissement de chant & de danse, qui amene une action, & qui lui sert de fondement, & cette action doit être galante, intéressante, badine, ou noble suivant la nature des sujets.
Tous les ballets qui sont restés au théatre sont en cette forme, & vraissemblablement il n’y en aura point qui s’y soûtiennent, s’ils en ont une différente. Le Roi Louis XV. a dansé lui-même avec sa cour, dans les ballets de ce nouveau genre, qui furent représentés aux Thuileries pendant son éducation.
Danchet, en suivant le plan donné par la Mothe, imagina des entrées comiques ; c’est à lui qu’on doit ce genre, si c’en est un. Les Fêtes Vénitiennes ont ouvert une carriere nouvelle aux Poëtes & aux Musiciens, qui auront le courage de croire, que le théatre du merveilleux est propre à rendre le comique.
Les Italiens paroissent penser que la musique n’est faite que pour peindre tout ce qui est de plus noble ou de plus bas dans la nature. Ils n’admettent point de milieu.
Ils répandent avec profusion le sublime dans leurs tragédies, & la plus basse plaisanterie dans leurs opera bouffons, & ceux-ci n’ont réussi que dans les mains de leurs musiciens les plus célebres. Peut-être dans dix ans pensera-t-on comme eux. Platée, opera bouffon de M. Rameau, qui est celui de tous ses ouvrages le plus original & le plus fort de génie, décidera sans doute la question au préjudice des Fétes Vénitiennes & des Fêtes de Thalie, peu goûtées dans leurs dernieres reprises.
Peut-être la Mothe a-t-il fait une faute en créant le ballet. Quinault avoit senti que le merveilleux étoit le fond dominant de l’opera. Voyez Opera. Pourquoi ne seroit-il pas aussi le fond du ballet ? La Mothe ne l’a point exclu : mais il ne s’en est point servi. Il est d’ailleurs fort singulier qu’il n’ait pas donné un plus grand nombre d’ouvrages d’un genre si aimable. On n’a de lui que l’Europe galante qui soit restée au théatre ; il a cru modestement sans doute que ce qu’on appelle grand opera, étoit seul digne de quelque considération. Son esprit original l’eût mieux servi cependant dans un genre tout à lui. Il n’est excellent à ce théatre que dans ceux qu’il a créés. Voyez Pastorale & Comédie-Ballet.
Il y a peut-être encore un défaut dans la forme du ballet créé par la Mothe. Les danses n’y sont que des danses simples ; nulle action relative au sujet ne les anime ; on danse dans l’Europe galante pour danser. Ce sont à la vérité des peuples différens qu’on y voit paroître : mais leurs habits plûtôt que leurs pas annoncent leurs divers caracteres ; aucune action particuliere ne lie la danse avec le reste de l’acte.
De nos jours on a hasardé le merveilleux dans le ballet, & on y a mis la danse en action : elle y est une partie nécessaire du sujet principal. Ce genre, qui a plû dans sa nouveauté, présente un plus grand nombre de ressources pour l’amusement du spectateur, des moyens plus fréquens à la poësie, à la peinture, à la musique, d’étaler leurs richesses ; & au théatre lyrique, des occasions de faire briller la grande machine, qui en est une des premieres beautés : mais il faut attendre la reprise des Fêtes de l’Hymen & de l’Amour, pour décider si ce genre est le véritable.
De tous les ouvrages du théatre lyrique, le ballet est celui qui paroît le plus agréable aux François. La variété qui y regne, le mêlange aimable du chant & de la danse, des actions courtes qui ne sauroient fatiguer l’attention, des fêtes galantes qui se succedent avec rapidité, une foule d’objets piquans qui paroissent dans ces spectacles, forment un ensemble charmant, qui plaît également à la France & aux étrangers.
Cependant parmi le grand nombre d’auteurs célebres qui se sont exercés dans ce genre, il y en a fort peu qui l’ayent fait avec succès : on a encore moins de bons ballets que de bons opera, si on en excepte les ouvrages de M. Rameau, du sort desquels on n’ose décider, & qui conserveront, ou perdront leur supériorité, selon que le goût de la nation pour la musique se fortifiera, ou s’affoiblira par la suite. Le théatre lyrique qui peut compter à peu-près sur huit ou dix tragédies dont la réussite est toujours sûre, n’a pas plus de trois ou quatre ballets d’une ressource certaine ; l’Europe galante, les Elémens, les Amours des Dieux, & peut-être les Fêtes Greques & Romaines. D’où vient donc la rareté des talens dans un pareil genre ? Est-ce le génie ou l’encouragement qui manquent ? Plutarq. Sid. Appoll. Athén. Arist. Poetique. Platon. Hist. de la danse par Bonnet. Lucien. L. P. Menestrier, Jes. Traité des Ballets, &c. (B)
Ballets de chevaux. Dans presque tous les carrousels, il y avoit autrefois des ballets de chevaux qui faisoient partie de ces magnifiques spectacles. Pluvinel, un des écuyers du roi, en fit exécuter un fort beau dans le fameux carrousel de Louis XIII. Les deux qui passent pour avoir été les plus superbes, sont ceux qui furent donnés à Florence, le premier en 1608, le dernier en 1615.
On lit dans Pline, que c’est aux Sibarites que l’on doit l’invention de la danse des chevaux : le plaisir étoit le seul objet de ce peuple voluptueux ; il étoit l’ame de tous ses mouvemens, & de tous ses exercices. Athénée, d’après Aristote, rapporte que les Crotoniates, qui faisoient la guerre à ce peuple, s’étant apperçûs du soin avec lequel on y élevoit les chevaux, firent secretement apprendre à leurs trompettes les airs de ballet que les Sibarites faisoient danser à ces animaux dociles. Au moment de la charge, lorsque leur cavalerie s’ébranla, les Crotoniates firent fonner tous ces airs différens, & dès-lors les chevaux Sibarites, au lieu de suivre les mouvemens que vouloient leur donner les cavaliers qui les montoient, se mirent à danser leurs entrées de ballet ordinaires, & les Crotoniates les taillerent en pieces.
Les Bisaltes, peuples de Macédoine, se servirent du même artifice contre les Cardiens, au rapport de Charon de Lampsaque.
Les ballets de chevaux sont composés de quatre sortes de danse ; la danse de terre-à-terre, celle des courbettes, celle des caprioles, & celle d’un pas & un saut.
La danse de terre-à-terre est formée de pas, & de mouvemens égaux, en avant, en arriere, à volte sur la droite ou sur la gauche, & à demi-volte ; on la nomme terre-à-terre, parce que le cheval ne s’y éleve point.
La danse des courbettes est composée de mouvemens à demi élevés, mais doucement, en avant, en arriere, par voltes & demi-voltes sur les côtés, faisant son mouvement courbé, ce qui donne le nom à cette espece de danse.
La danse des caprioles n’est autre chose que le saut que fait le cheval en cadence à tems dans la main, & dans les talons, se laissant soûtenir de l’un, & aider de l’autre, soit en avant en une place, sur les voltes & de côté : on n’appelle point caprioles tous les sauts ; on nomme ainsi seulement ceux qui sont hauts & élevés tout d’un tems.
La danse d’un pas & d’un saut est composée d’une capriole & d’une courbette fort basse ; on commence par une courbette, & ensuite, raffermissant l’aide des deux talons, & soûtenant ferme de la main, on fait faire une capriole, & lâchant la main & chassant en avant, on fait faire un pas : on recommence après si l’on veut, retenant la main & aidant des deux talons, pour faire faire une autre capriole.
On a donné le nom d’airs à ces différentes danses, ainsi on dit air de terre-à-terre, &c.
Dans ces ballets, on doit observer, comme dans tous les autres, l’air, le tems de l’air, & la figure.
L’air est le mouvement de la symphonie qu’on exécute, & qui doit être dansée. Le tems des airs sont les divers passages que l’on fait faire aux chevaux en avant, en arriere, à droite, à gauche : de tous ces mouvemens se forment les figures, & quand d’un seul tems sans s’arrêter, on fait aller le cheval de ces quatre manieres, on appelle cette figure faire la croix.
Ces passages, en terme de l’art, s’appellent passades.
Les trompettes sont les instrumens les plus propres pour faire danser les chevaux, parce qu’ils ont le loisir de prendre haleine lorsque les trompettes la reprennent, & que le cheval, qui est naturellement fier & généreux, en aime le son ; ce bruit martial l’excite & l’anime. On dresse les chevaux encore à danser au son des cors de chasse, & quelquefois aux violons : mais il faut de ces derniers instrumens un fort grand nombre, que les symphonies soient des airs de trompettes, & que les basses marquent fortement les cadences.
Selon la nature des airs on manie les chevaux terre-à-terre, par courbettes, ou par sauts.
Il n’est pas étonnant qu’on dresse des chevaux à la danse, puisque ce sont les animaux les plus maniables, & les plus capables de discipline ; on a fait des ballets de chiens, d’ours, de singes, d’éléphans, ce qui est bien plus extraordinaire. Voyez Danse. Elien, Martial, Athénée, Pline, Aristote, Charon de Lampsaque, &c.
Ballets aux chansons ; ce sont les premiers ballets qui ayent été faits par les anciens. Eriphanis, jeune greque, qui aimoit passionnément un chasseur nommé Menalque, composa des chansons par lesquelles elle se plaignoit tendrement de la dureté de son amant. Elle le suivit, en les chantant, sur les montagnes & dans les bois : mais cette amante malheureuse mourut à la peine. On étoit peu galant, quoi qu’en disent les Poëtes, dans ces tems reculés. L’aventure d’Eriphanis fit du bruit dans la Grece, parce qu’on y avoit appris ses chansons ; on les chantoit, & on représentoit sur ces chants les aventures, les douleurs d’Eriphanis, par des mouvemens & des gestes qui ressembloient beaucoup à la danse.
Nos branles sont des especes de ballets aux chansons. Voyez Branle. A l’opéra on peut introduire des ballets de ce genre. Il y a une sorte de pantomime noble de cette espece dans la troisieme entrée des Talens Lyriques, qui a beaucoup réussi, & qui est d’une fort agréable invention. La danse de Terpsichore, du prologue des Fêtes Greques & Romaines, doit être rangée aussi dans cette classe. Le P. Ménétrier, traité des Ballets.
Ballets de collége ; ce sont ces spectacles qu’on voit dans les colléges lors de la distribution des prix. Dans celui de Louis le Grand, il y a tous les ans la tragédie & le grand ballet, qui tient beaucoup de l’ancien, tel qu’on le représentoit autrefois dans les différentes cours de l’Europe, mais il est plus chargé de récits, & moins rempli de danses figurées.
Il sert pour l’ordinaire d’intermedes aux actes de la tragédie ; en cela il rend assez l’idée des intermedes des anciens.
Il y a plusieurs beaux ballets imprimés dans le second volume du P. le Jay Jésuite. On trouve le détail de beaucoup de ces ouvrages dans le Pere Ménétrier, qui en a fait un savant traité, & qui étoit l’homme de l’Europe le plus profond sur cette matiere. (B)
* BALLIMORE (Géog.) ville de la province de Leinster, en Irlande ; elle est entierement environnée d’un marais.
BALLIN, s. m. (Commerce.) on nomme ainsi à Bourdeaux, à Bayonne & dans les autres villes de commerce de la Guyenne, ce qu’on appelle à Paris emballage. (G)
* BALLINASLOE (Géog.) petite ville de la Connacie, en Irlande, sur la Sue, dans la province de Roscommon, à dix milles d’Athlane, sur le grand chemin de Gallowai.
* BALLINEKIL (Géog.) ville d’Irlande, dans la province de Leinster, au comté de la Reine.
* BALLON (Géog.) ville de France, au diocese du Mans, sur la rive droite de l’Orne. Long. 17. 50. lat. 48. 10.
* Ballon, s. m. on donne en général le nom de ballon à tout corps fait par art, dont la figure est sphérique ou à peu près, & qui est creux, de quelque matiere qu’il soit composé, & à quelque usage qu’on l’employe. Il ne faut pas croire que tout ce à quoi la description précedente pourra convenir s’appellera ballon, mais seulement que ce qu’on appelle ballon aum la plûpart de ces conditions.
Ballons de grenades, bombes & cailloux, sont, dans l’Artillerie, des especes de cylindres composés de chacune de ces différentes choses, lesquelles s’exécutent avec le mortier. (Q)
Ballon, terme d’Artificier ; les Artificiers appellent ainsi une espece de bombe de carton qu’on jette en l’air comme une véritable bombe, par le moyen d’un mortier. L’effet de cet artifice est de monter avec une très-petite apparence de feu, & d’en jetter subitement une grande quantité après être parvenu au sommet de son élévation, à la différence des bombes, qui ne doivent crever qu’à la fin de leur chûte. Voyez Bombe. On les divise en ballons d’air, & balions d’eau.
Comme cet artifice est fait pour être jetté en l’air, il est évident qu’il n’y a point de figure qui lui convienne mieux que la sphérique, qui présente toûjours une surface & une résistance égale au fluide de l’air de quelque côté qu’elle se tourne ; c’est pour cette raison qu’on fait les balles, boulets & bombes d’Artillerie rondes en tous sens, plûtòt que cylindriques ; cependant les Artificiers semblent préférer, pour les ballons, la figure cylindrique à la sphérique, pour leur donner plus de capacité & plus de commodité à y ranger de certaines pieces d’artifices dont on doit les remplir.
Lorsqu’on fait les ballons sphériques, il y a deux manieres de préparer les cartouches pour les remplir : l’une est de former deux hémispheres qu’on remplit chacune à part, qu’on applique ensuite l’une contre l’autre, & qu’on lie par des bandes de carton & de toiles croisées & collées ; cette maniere a des inconvéniens pour la réunion qui devient difficile à cause des évasemens inégaux qui se forment en chargeant.
L’autre est de former le cartouche avec des fuseaux, & de ne les coller premierement qu’à moitié, ou aux deux tiers de leur longueur, ensorte qu’il y reste une ouverture suffisante pour y introduire la main, si elle est nécessaire pour l’arrangement, ou seulement un trou de grandeur convenable pour y introduire les artifices & la fusée de communication, qu’on appelle le porte-feu. Lorsque tout est en place, on replie les bouts des fuseaux à mesure que le ballon se remplit, en le collant par le moyen des doubles qui croisent sur les pieces de l’intérieur ; & enfin, pour le former tout-à-fait, on colle les pointes de ces fuseaux sur le bout du porte-feu, qui sort d’environ un pouce hors du ballon, ce qui affermit très-bien toutes ces parties, & fournit le moyen d’arranger & de remplir commodément & exactement tout le vuide du ballon.
On commence par mettre au fond du ballon, une certaine quantité de relien, ou de poudre grenée, proportionnée à sa grandeur, comme une ou deux onces, mêlée d’un peu de poulverin pour servir de chasse, qui fait crever la bombe & pousse sa garniture au-dehors : comme il est à propos que cette chasse soit retenue où on l’a mise, & qu’elle ne se répande pas ailleurs lorsqu’on renverse ou qu’on remue la bombe chargée, on la couvre d’un lit de coton d’étoupille en feuille mince, c’est-à-dire, simplement étendue sans être filée ; d’autres la renferment dans un sac de papier plat, & mince, qu’on arrange de maniere qu’il occupe le fond.
On met ensuite au milieu un cartouche vuide posant sur ce sac, pour y conserver le passage du porte-feu, & l’on arrange autour de ce cartouche, la garniture du ballon, qui peut être de différentes especes d’artifices.
La premiere est celle dont l’effet produit la chevelure, laquelle est faite de cartouches de lardons, ou de tuyaux de roseaux coupés de la longueur du ballon, & remplis d’une composition lente faite de trois parties de poulverin, de deux de charbon, & d’une de soufre humecté d’un peu d’huile de prétrole, enfin amorcés par le bas de pâte de poudre écrasée dans de l’eau pure, ou de l’eau-de-vie, qu’on fera ensuite sécher ; on arrange tous ces artifices dans le cartouche autour de celui qui fait le passage du porte-feu ; & après qu’il est plein, on y introduit le porte-feu tout chargé jusqu’à ce qu’il pose sur la chasse, & comme il est lié au couvercle, on colle ce couvercle par les bords déchiquetés, sur celui du cartouche, & le ballon est fini.
La seconde espece de garniture est celle des serpenteaux, qu’on arrange comme les tuyaux de roseaux dont nous venons de parler, la gorge en bas sur la chasse.
La troisieme est composée de saucissons volans dont on peut faire tirer les coups successivement en faisant les gorges de matieres lentes, toutes inégalement longues, comme des tuyaux d’orgue ; & comme cet arrangement laisse du vuide sur les plus courts, on y peut mettre des étoiles ou des étincelles de feu.
La quatrieme espece de garniture est celle des étoiles, qu’on arrange par lits sur la poudre de la chasse, en les couvrant de poulverin mêlé d’un peu de charbon, & continuant ainsi jusqu’à ce que le ballon soit plein.
La cinquieme espece est celle des balles luisantes qu’on arrange de même par lits, comme les étoiles.
Ballon ; les artificiers appellent ainsi de gros cartouches, qu’on jette avec le mortier. On les remplit ordinairement de serpenteaux, qui sont gros comme des fusées par terre, mais non pas tout-à-fait si longs. On y met aussi deux petits saucissons de la même longueur & de la même grosseur, qui ayant pris feu par leur amorce font crever le cartouche. Celui-ci a par le bas un porte-feu, à l’embouchure duquel il y a une amorce faite avec du coton trempé dans de la poudre comme l’étoupille.
Ce cartouche se fait sur un gros rouleau de bois, autour duquel on roule des cartes fortes, que l’on colle avec de la colle forte pour les faire tenir ensemble. Après l’avoir étranglé par le bas, on y fait un trou pour le porte-feu, qui se fait comme pour les fusées par terre : sa composition est cependant plus lente, car elle est semblable à celle des fusées volantes. On remplit ensuite le cartouche de serpenteaux, & quelquefois d’étoiles, après quoi on l’étrangle par dessus. Voyez Saucisson, Fusée, Étoile, Serpenteau , &c.
Voyez Planche de l’Artificier, fig. 62. un ballon ou bombe d’artifice sphérique ; fig. 65. un mortier à ballon ; fig. 63. un ballon achevé & couvert, avec la fusée qui doit y porter le feu ; fig. 64. la coupe d’un ballon tout chargé, auquel le feu se communique par le porte-feu pratiqué au fond du ballon, qui pose sur la chasse dans le mortier ; & fig. 66. un ballon d’artifice qui en enferme un autre.
Ballon, en Chimie, est un gros vaisseau de verre dans lequel on reçoit les esprits volatils qu’on distille, c’est une espece de récipient. Lorsque le vaisseau dans lequel on reçoit ce que l’on distille est petit ou médiocre, on l’appelle récipient ; si au contraire ce vaisseau est grand, pour que les esprits sulphureux ou volatils ayent la liberté de s’y mouvoir & de se condenser en goutte contre une surface plus étendue, on l’appelle ballon, parce qu’ayant le cou très-court & la figure ronde, il ressemble à celle d’un ballon. (M)
Ballon, en Marine, c’est une espece de brigantin, dont on se sert dans le royaume de Siam ; ce sont des bâtimens fort étroits & d’une extrème longueur, qui ont le devant & le derriere fort relevés & ornés de sculpture ; il y en a de tout dorés, où l’on met jusqu’à cent vingt & même cent cinquante rameurs. Au milieu est une espece de petit dôme que les Siamois appellent chirole, qui forme une chambre couverte de riches étoffes. avec des rideaux de la même étoffe. Quelquefois cette chirole est surmontée d’une pyramide ou d’un clocher fort haut. Les bords de ces bâtimens sont à fleur d’eau, & les extrémités qui sont recourbées s’élevent fort haut, la plûpart représentant des figures de dragons, de serpens, ou d’autres animaux. Ces ballons ont pour l’ordinaire cent ou cent vingt piés de long, & n’en ont guere que six de large ; ils vont avec beaucoup de vîtesse. (Z)
Ballons, s. m. pl. c’est ainsi qu’on appelle chez les potiers de terre, les mottes de terre préparées & prêtes à être mises en œuvre ; & dans les Verreries, les mottes de terre à pot, prêtes à faire des pots. Voy. Verrerie & Pot.
BALLOT, s. m. (Comm.) petite balle ou paquet de marchandises. On le dit quelquefois des grosses balles. Voyez Balle.
Ballot ou Ballon, dans le commerce de verre de Lorraine, signifie une certaine quantité de tables de verre plus ou moins grande, selon sa qualité. Le ballot de verre blanc contient vingt-cinq liens, à raison de six tables au lien ; le ballot de verre de couleur, seulement douze liens & demi, & trois tables au lien. Voyez Lien, Table, Verre
Ballot, s’entend aussi dans le commerce des viandes boucanées que font les boucaniers de S. Domingue, d’un certain poids que chaque paquet doit avoir. Ordinairement le paquet est de 60 livres de viande nette, non compris l’emballage. Voy. Boucanier. (G)
BALLOTADE, s. f. (Manége.) c’est un saut qu’on fait faire à un cheval entre deux piliers, ou par le droit, avec justesse, soûtenu de la main & aidé du gras des jambes, ensorte qu’ayant les quatre piés en l’air, il ne montre que les fers de ceux de derriere, sans détacher la ruade & séparer. A la capriole, il rue ou noue l’aiguillette ; à la croupade, il retire les piés de derriere sous lui, au lieu de montrer ses fers comme il fait en maniant à ballotade ; c’est ce qui fait leur différence. Quand un cheval est lassé d’aller à capriole, & que son grand feu est passé, il se met de lui-même à ballotades, puis à croupades, à moins que le poinçon bien appuyé ne lui fasse noüer l’aiguillette & continuer l’air des caprioles. Faire la croix à ballotades, c’est faire ces sortes d’airs ou de sauts d’une haleine en-avant, en-arriere & sur les côtés, comme une figure de croix. La ballotade est un saut où le cheval semble vouloir ruer, mais ne le fait pourtant pas ; ce n’est qu’une demi-ruade, faisant seulement voir les fers des jambes de derriere, comme s’il avoit envie de ruer. (V)
BALLOTE, (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur monopétale labiée, dont la levre supérieure est creusée en forme de cuilliere, la levre inférieure est divisée en trois parties ; celle du milieu est la plus grande, sa figure approche de celle d’un cœur ; le pistil sort du calice, il est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & il est environné de quatre embryons, qui deviennent autant de semences oblongues, renfermées dans une capsule qui a servi de calice à la fleur, & qui est en forme de tuyau à cinq faces. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
BALLOTER, v. neut. (Hist. mod.) maniere de donner son suffrage dans les élections, &c. par le moyen de certaines petites balles de diverses couleurs ; en France on les nomme des ballotes : l’usage est de les mettre secretement dans une boîte. (G)
BALLOTER, v. act. dans les Fonderies de fer, c’est mettre la verge fendue en paquets. Pour cet effet l’ouvrier se place devant une table, telle qu’on la voit au bas de la Planche VIII. des grosses forges. Cette table est couverte de fourchettes de deux sortes ; les unes ont leur manche au milieu du crochet, d’autres l’ont à une des extrémités du crochet. C’est sur les premieres que l’ouvrier commence le ballotage ; quand le paquet ou la botte contient le nombre de verges qui convient, il la jette sur les secondes ; des secondes il passe sur les crochets fixés dans l’épaisseur de la partie antérieure de sa table ou de son établi. Là l’établi a une chaîne, elle sert à l’ouvrier pour serrer sa botte, en bien appliquer les barres les unes contre les autres, & en placer mieux & plus facilement les liens. Il la lie en trois endroits, au milieu & vers les deux bouts : ses liens sont de fer. Ainsi dans la planche que nous venons de citer, la fig. 7. est vers le haut un ouvrier qui ballote ; vers le bas est la table à balloter ; c c est cette table ; dddd sont quatre fourchettes, dont la queue est à l’extrémité du crochet : ee sont deux fourchettes placées entre les quatre précédentes, dont la queue est au milieu du crochet : ff sont deux crochets scellés dans l’épaisseur de la table : l la cisaille à couper les liens : kkk trois bottes liées : h, i deux fourchettes séparées de la table, une de chaque espece.
BALOIRES, s. f. ou principale lisse de Gabari ; ce sont, en Marine, de longues pieces de bois, qui dans la construction d’un vaisseau, déterminent la forme qu’il doit avoir ; c’est pourquoi on les appelle aussi formes de vaisseau. (Z)
BALOTIN, terme de Jardinage, espece de citronnier. Voyez Citronnier. (K)
* BALOWA, (Géog.) ville d’Asie, dans l’Indostan, au royaume de Decan.
BALSARA. Voyez BASSORA.
BALSAMINE, balsamina, s. f. (Hist. nat.) genre de plante à fleur polypétale irréguliere. Cette fleur est composée de quatre pétales ou de six : dans celle qui a quatre pétales, la supérieure forme une sorte de voûte ; l’inférieure est concave & terminée par un prolongement en forme de queue. Les deux pétales des côtés sont fort étendus & accompagnés d’une oreille : les fleurs à six pétales sont très-rares : le pétale inférieur n’a point de prolongement en forme de queue : le pistil se trouve au milieu de ces fleurs entre deux petites feuilles. Quand la fleur est passée, ce pistil devient un fruit arrondi des deux côtés dans quelques especes, & ressemblant à une silique dans quelques autres. Ce fruit a des sortes de muscles, qui le rendent élastique lorsqu’il s’ouvre. Il renferme des semences attachées à un axe ou placenta. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
On peut repiquer la balsamine sur d’autres couches pour l’avancer. On la transporte au bout de six semaines dans les parterres : on la place parmi les fleurs basses, afin de ne lui point ôter le soleil : on la met aussi dans des pots : elle veut être souvent arrosée. (K)
* Le fruit de la balsamine est de toutes ses parties celle dont on fait le plus d’usage en Medecine : il passe pour vulnéraire, rafraîchissant, & un peu dessiccatif ; il appaise les douleurs, surtout celles des hémorrhoïdes ; il est bon extérieurement pour les hernies, les brûlures, & les blessures des nerfs. Le baume tiré du fruit de cette plante trempé dans l’huile & seché au soleil, est excellent dans les blessures, les ulceres, les hémorrhoïdes, les ruptures, & les maladies de la matrice.
* BALSAMIQUES, adj. pris sub. en Medecine ; on donne ce nom à des remedes d’une nature un peu acre & chaude : cette classe comprend les céphaliques, apoplectiques, antiparalytiques, cordiaux, spiritueux, & autres. On met de ce nombre le bois d’aloès, sa résine, sa teinture, son aubier ; le santal citrin, sa teinture concentrée en baume liquide ; l’ambre gris, le liquidambar, le baume blanc, le succin, le benjoin, le stirax calamite, sa résine ; le stirax blanc, le laudanum, sa résine ; les baumes du Pérou, de Copahu, de Tolu ; l’écorce vraie de quinquina, le costus amer, la cascarille, la canelle, le girofle, la graine de paradis, les cubebes, le macis, la noix muscade, la sarriette, le thym, la rue, le serpolet, la lavande, le nard celtique, l’origan, le dictamne de Crete, la marjolaine, la mélisse, la molucque, la camomille Romaine, le marum de Syrie, le basilic, l’aurone, le stœchas, le spicanar, le jonc odorant, les feuilles de laurier & de myrte, & toutes les huiles de ces simples obtenues par la distillation. Entre ces compositions, Hoffman compte les baumes apoplectiques de Crollius, de Sherzerus, de Zeller, son baume liquide de vie, l’esprit de baume du Pérou, les esprits de succin & de mastic, l’eau apoplectique de Sennert, l’eau d’Anhalt, l’essence d’ambre, les esprits volatils huileux, faits en aromatisant ces esprits avec les huiles de canelle, de macis & de cedre.
Ces remedes augmentent la chaleur dans les solides, & donnent de la volatilité aux fluides, conséquemment hâtent le mouvement progressif du sang, divisent les humeurs, résolvent les obstructions, & entretiennent la transpiration.
On peut les employer dans les maladies de la tête, des nerfs, de l’estomac, & du cœur ; à condition que les corps ne seront pas pleins de sang & d’humeur, que le ventre sera libre, & qu’il n’y aura ni grande jeunesse, ni tempérament sensible & porté à la colere.
BALTAGIS, s. m. (Hist. mod.) sorte d’azamoglans ou valets du sérail, occupés à fendre, scier & porter le bois dans les appartemens. Leur nom vient de balta, qui en langue Turque signifie hache ou coignée. Les baltagis portent le bois partout le sérail, & jusqu’aux portes de l’appartement des femmes, où les eunuques noirs viennent le prendre, parce qu’ils ont seuls droit d’y entrer. Le visir Mehemet Kuperli sous Achmet III. avoit été baltagi ; & il en retint le nom même dans son élévation, selon la coûtume des Turcs, qui portent sans rougir le nom de leur premiere profession. Guer, Mœurs & usag. des Turcs, tom. II. (G)
* BALTEI, s. m. pl. (Hist. anc.) c’est ainsi qu’on appelloit chez les anciens les précinctions des théatres & des amphithéatres. Voyez Amphithéatres & Théatres.
* BALTEUS, en Architecture, ceinture de la volute ionique. Vitruve, p. 97.
* BALTIMORE, (Géog.) ville d’Irlande dans la province de Munster, au comté de Corck, sur la baie de même nom.
* BALTIQUE, (Mer) Géog. grand golfe entre l’Allemagne & la Pologne, qui a au midi le Danemarck, la Suede à l’occident, la Laponie au septentrion, la Bothnie, la Finlande, la Livonie, la Curlande, une partie de la Pologne à l’orient, qui communique à la mer de Danemarck par le Sund, le grand & le petit Belt.
* BALTRACAN, (Hist. nat. bot.) plante qui croît dans la Tartarie, qui a, dit-on, la feuille de la rave, qui pousse une tige plus grosse que le doigt, qui s’éleve de la longueur du bras, & qui a la graine du fenouil, seulement plus grosse, & d’une odeur forte. Le baltracan s’ouvre dans la saison ; son écorce se sépare ; il répand alors l’odeur de l’oranger. Les Tartares le mangent pour se soûtenir en voyage, sans sel ni autre assaisonnement : sa tige est un peu creuse, & son écorce d’un verd jaune. Barbaro, marchand Venitien, dont on a tiré cette description si mal arrangée, dit avoir trouvé du baltracan proche Croia dans l’Albanie.
* BALUCLAVA ou JAMBOL, (Géog. anc. & mod.) port de Crimée sur la mer Noire. Long. 52. 40. lat. 44. 50. Quelques Géographes pensent que c’est l’ancienne Pallacium.
* BALVE, (Géog.) ville de l’Allemagne dans le duché de Westphalie.
BALUSTRADE, s. f. en Architecture : on entend par ce nom la continuité d’une ou plusiéurs travées de balustres, séparés par des piédestaux construits de marbre, de pierre, de fer ou de bois, tenus de la hauteur des appuis. Voyez Appui.
Les balustrades de pierre ou de marbre servent à deux usages dans le bâtiment : l’un pour servir d’appui aux terrasses qui séparent l’inégalité de hauteur de terrein, dans un parc, dans des cours, ou dans des jardins ; l’autre pour tenir lieu de balcon ou d’appui évuidé à chaque étage d’un édifice, ou pour lui servir de couronnement lorsque les combles ne sont pas apparens, comme au palais Bourbon à Paris, au château de Versailles, & ailleurs ; cette décoration ne devant pas avoir lieu lorsque la nécessité ou l’usage exige des combles, malgré l’exemple qu’on en voit au palais du Luxembourg.
La hauteur des premieres balustrades n’a d’autre sujétion que celle d’être proportionnée à celle du coude ou hauteur d’appui : celle des secondes doit avoir en général le quart plus un 6e de l’ordre qui les soûtient ; c’est-à-dire, la hauteur de l’entablement, plus une 6e partie. Elles sont composées ordinairement de trois parties principales ; savoir, d’un socle ou retraite, d’un dez & d’une tablette ; ces trois parties comprises ensemble doivent se diviser en neuf, dont on donnera quatre à la retraite ou socle, quatre au dez, & une à la tablette : mais comme cette hauteur de balustrade tenue extérieurement du quart plus un sixieme de l’ordre, seroit souvent trop haute pour servir d’appui du côté des appartemens ou terrasses supérieurs d’un bâtiment, alors le sol des étages intérieurs peut être élevé jusqu’à la hauteur de la retraite, à 2 ou 3 pouces près.
L’on fait souvent des balustrades qui tiennent lieu d’attique ou d’amortissement aux étages supérieurs d’un édifice, & dans lesquels on n’introduit point de balustres, ne devant les employer que lorsqu’il y a des vuides dans le bâtiment ; tels que sont les croisées, les portes, les entre-colonnes : or il est quelquefois des bâtimens qui n’ont point d’ouvertures remarquables ; alors il faut soustraire les balustres dans ces balustrades, pour leur donner un caractere de solidité qui réponde au reste de l’ordonnance : mais quand on en fait usage, il faut éviter d’en mettre plus de onze dans une même travée, ou moins de cinq, malgré l’exemple du château de Clagny, où l’on n’en voit dans quelques endroits que deux, & quelquefois une ; ce qui marque un trop petit espace vuide sur une grande face de bâtiment d’une ordonnance légere ; & celui du château d’eau du Palais-royal à Paris, d’un caractere rustique, où l’on voit au contraire des travées qui en ont jusqu’à 14 ; ce qui est un défaut de convenance, qui me fait avancer pour précepte que les balustrades doivent être plus ou moins ornées, selon le caractere du bâtiment qui les reçoit ou qu’elles accompagnent ; c’est-à-dire, que leurs profils doivent se ressentir du genre rustique, solide, moyen, délicat, & composé, ainsi que les balustres. Voyez Balustre ; & ses profils suivant les cinq ordres, dans nos Planches d’Architecture. (P)
BALUSTRE, s. f. termes d’Architecture, du Latin balostrum, fait du Grec βαλόσιον, fleur du grenadier sauvage à laquelle sa tige ressemble assez, est ordinairement une petite colonne composée de trois parties principales ; savoir, le chapiteau, la tige, & le pié d’ouche. On a soin que les balustres, aussi bien que les balustrades, se ressentent du caractere de l’édifice ; c’est pour cela qu’on représente dans nos Planches à peu près les cinq manieres de les mettre en usage. Les toscanes se font volontiers quarrées par leur plan, pour plus de rusticité ; quelquefois même les doriques : mais les autres se font toûjours rondes, à l’exception des plinthes, des piés d’ouches & des chapiteaux ; malgré l’exemple de ceux du château de Sceaux, où le tout est cylindrique ; ce qu’il faut éviter. Les membres principaux des balustres peuvent être ornés de moulures au choix de l’architecte : le genre simple, élégant & orné qui est répandu dans l’ordonnance du bâtiment, doit néanmoins lui servir de regles.
Pour trouver la proportion des principales parties des balustres en général, il faut diviser toute leur hauteur en 5 ; une sera pour celle du pié d’ouche D ; les 4 parties restantes seront divisées de nouveau en 5, dont une sera pour la hauteur du chapiteau E : ensuite on divisera la distance depuis E jusqu’en F encore en 5, dont 3 seront pour la hauteur du cou F, & les deux autres pour la pance ou renflement G.
Le balustre toscan étant le plus massif, on doit donner à la largeur de sa pance les de toute sa hauteur, pendant que le corinthien, qui est le plus sevelte, n’en aura que le tiers ; la largeur des autres se trouvera entre ses deux extrèmes. Ces largeurs ainsi trouvées pour la grosseur de la pance, on les divisera chacune en 9, dont 4 formeront celle du cou, qui servira aussi pour la largeur la plus étroite du pié d’ouche, ainsi que l’exprime la ligne ponctuée N : la largeur du plinthe du pié d’ouche sera égale à celle de la pance, & celle du tailloir aura ou moins, selon le caractere du balustre ; & leur écartement d’une pance à l’autre sera tenu de la largeur d’un cou.
Il faut éviter les demi-balustres dans l’ordonnance des balustrades, ainsi que celles qui ne peuvent être que feintes : cette mutilation ou affectation est contraire au bon goût ; je leur préfere les acroteres H, qui en font l’office avec plus de vraissemblance. V. Acroteres.
Ces balustres, ainsi que les balustrades, se font de différentes matieres ; ce qui les fait nommer balustres de pierre, de marbre, de bois, de fer, de bronze, &c. Celles qu’on employe à la décoration extérieure des bâtimens, different en général très-peu des exemples que l’on a donnés dans les Planches : mais celles des dedans varient à l’infini suivant les endroits où elles sont placées, la richesse de leur matiere, & le génie de l’architecte qui en donne les desseins.
Les balustres dans les rampes d’un escalier font un assez mauvais effet, à cause de l’obliquité qu’occasionnent ces rampes, aux moulures des piés d’ouches & aux chapiteaux des balustres ; ce qui fait que quelques architectes aiment mieux faire régner ces moulures horisontales, malgré l’inclinaison des socles & des tablettes, comme on l’a pratiqué au Palais-royal : d’autres, qui regardent l’un & l’autre comme vicieux, admettent l’usage des rampes de fer, ce genre de rampe n’exigeant pas tant de sévérité. Il est cependant vrai que cette derniere espece n’a pas à beaucoup près tant de dignité, & qu’elle ne paroît tolérable que dans les escaliers des maisons des particuliers ; ceux des maisons des grands étant ordinairement susceptibles de peinture, de sculpture, & d’architecture, semblent exiger des rampes qui s’assortissent à leur magnificence. (P)
Balustre, en Serrurerie, est encore un ornement qui se pratique sous l’anneau d’une clé au haut de la tige, & qui est appellé balustre, parce qu’il en a la forme. Les clés de chef-d’œuvre ont ordinairement leur tige en balustre.
Balustre, en terme d’Orfévre, est une partie de la monture d’un chandelier qu’on voit ordinairement au milieu de cette monture. Elle est plus grosse en haut qu’en bas, & se termine à ses deux extrémités par un nœud d’une grosseur proportionnée à l’extrémité où il doit être. Voyez Nœud.
BALZANE, s. f. (Manége.) c’est la marque de poil blanc qui vient aux piés de plusieurs chevaux, depuis le boulet jusqu’au sabot, devant & derriere. Ce mot vient de l’Italien balzano. On appelle cheval balzan, celui qui a des balzanes à quelqu’un de ses piés, ou à tous les quatre. On juge de la bonté & de la nature des chevaux, selon les piés où les balzanes se rencontrent. Balzan s’applique à l’animal ; cheval balzan. Balzane, c’est la marque qui le distingue. Les termes de travat, transtravat, & chaussé trop haut, appartiennent aux balzanes. Voyez ces termes à leurs lettres. Quelques cavaliers sont assez superstitieux pour s’imaginer qu’il y a une fatalité sinistre attachée à la balzane du cheval arzel. (V)
* BAM, ville de la Caramanie Persique. Longit. 94. lat. sept. 28. 30.
* BAMBA, (Géog.) province d’Afrique au royaume de Congo.
Bamba, (Géog. anc. & mod.) village de la vieille Castille, jadis Gueritum, ville de l’Espagne Tarraconoise.
* BAMBERG, (Géog.) ville d’Allemagne dans la Franconie, au confluent du Mein & du Rednitz. Long. 28. 40. lat. 50.
Il y a en Boheme une ville du même nom. Long. 34. 20. lat. 49. 53.
* BAMBIAIE, s. m. (Hist. nat. Ornyth.) oiseau qu’on trouve dans l’île de Cuba, qui ne s’éleve presque point de terre, qu’on prend à la course, & dont la chair a bon goût. On ne nous dit rien de son plumage, de son bec, de ses pattes, de ses ailes, de sa grosseur, &c. ni des autres caracteres, que les Naturalistes doivent faire entrer dans leurs descriptions.
BAMBOCHADES, s. f. en Peinture, se dit de certains petits tableaux qui représentent des sujets champêtres & grotesques. L’étymologie de ce mot vient de Bamboche, peintre Flamand, qui s’est particuliement adonné à ce genre. Son nom de famille étoit Pierre de Laur : mais les Italiens lui donnerent celui de Bamboche, à cause de la singularité de sa taille. (R)
* BAMBOU ou BAMBUCK, (Géog.) royaume d’Afrique dans la Nigritie, borné au septentrion par les pays de Galam & de Kassan, à l’occident par la riviere de Feleme & les royaumes de Kantu & de Kombregudu, au midi par celui de Mankanna, & à l’orient par des terres inconnues.
* BAMBOUC, (Hist. nat. bot.) bois extrèmement noüeux qui croît dans plusieurs endroits des Indes Orientales. On dit que c’est une espece de canne très-grosse & très-haute, dont les bamboches ou cannes légeres que vendent nos Tabletiers, ne sont que les plus petits jets. V. Tabaxifera arundo.
* BAMBOURG, PAMBOURG, PAINBOURG, (Géog. anc. & mod.) bourg du cercle de Baviere en Allemagne, dans le gouvernement de Buchausen sur l’Achza, vers le nord du lac de Chiemzée. Quelques Géographes croyent que c’est l’ancienne Badacum ou Augusta Badacum.
* BAMBYCATIENS, s. m. pl. (Géog. anc.) peuples voisins du Tigre, peut-être les habitans de Bambyce ou Hiérapolis.
* BAMFE, (Géog.) petite ville de l’Ecosse septentrionale dans la province de même nom, à l’embouchure de la Doverne. Long. 15. 25. lat. 57. 48.
* BAMIA, (Hist. nat. bot.) on l’appelle aussi alcea indica. Elle a la fleur large, pentapétale, avec un vaisseau séminal assez considérable, divisé en cinq cellules qui contiennent des semences en forme de reins. Sa feuille est découpée, dentelée & attachée à la tige par des pédicules. Elle croît en Egypte. On se sert de sa semence : elle est d’un blanc sale ; elle répand une odeur qui tient de celle du musc. Les Egyptiens la font sécher, la broyent & en mêlent la poudre à leur caffé ; ils lui attribuent la vertu de fortifier la tête & l’estomac. On en use en fumigations.
BAN, s. m. (terme de Jurispr.) est une proclamation solennelle de quelque chose que ce soit. L’origine du mot est incertaine. Quelques-uns le tirent du Breton, ban, clameur, bruit : d’autres du Saxon, pan, une chose étendue : d’où ban ; & bande, employée pour une banniere.
Bracton fait mention de bannus regis, ban du roi, pour une proclamation de silence faite par les juges de la cour avant le choc des champions dans un combat.
Bans de mariage, sont des avertissemens solennels de promesses de futurs mariages, donnés dans l’église paroissiale avant la célébration des mariages, afin que s’il se trouve quelque opposition à faire contre l’une ou l’autre des parties, comme pour raison d’engagemens précédens, ou autre cause, il y ait lieu de les faire.
La publication des bans se fait à dessein de prévenir les mariages clandestins. Par les lois de l’Eglise, les bans doivent être publiés trois fois à trois jours différens aux lieux où les parties demeurent, à peine de nullité de mariage. Il y a peine d’excommunication contre ceux qui connoissant des empêchemens, ne les déclarent point.
Un curé ne sauroit être contraint à les publier lorsqu’il connoit dans l’un ou l’autre de ceux qui se présentent au mariage quelque incapacité ou empêchement.
Si les contractans sont majeurs, le défaut de publication de bans n’emporte pas tout seul la nullité de mariage.
Ban, en termes de Palais, est synonyme à bannissement : c’est en ce sens qu’on dit, garder son ban, rompre son ban. (H)
* Ban de vendange, c’est la publication faite au prône par les curés des paroisses de village, de la permission accordée par le juge ou le seigneur à tous les particuliers de faire vendanger leurs vignes. Le ban établi pour l’ouverture des vendanges est fondé sur deux raisons : l’une d’empêcher des gens ignorans, ou pressés par la nécessité de recueillir les raisins avant leur parfaite maturité, & d’en faire de mauvais vins ; l’autre, d’empêcher que ceux qui vendangeroient les premiers, ne découvrissent & n’exposassent au pillage les vignes de leurs voisins. Le ban de vendange se publie sur l’avis des principaux habitans des villages, & des vignerons les plus habiles. Il assujettit tous les habitans indistinctement, à moins qu’ils n’ayent acquis un titre exprès qui les en dispense. Le seigneur seul peut vendanger un jour avant l’ouverture portée par le ban. Il y a des coûtumes où les vignes enfermées de clos & de murailles sont exceptées de la loi du ban ; par-tout la contravention est punie par l’amende & la saisie des fruits.
Ban, (Hist. mod.) nom qu’on donnoit anciennement en Hongrie aux gouverneurs des provinces qui relevoient de ce royaume, telles que la Dalmatie, la Croatie, la Servie. Selon Leunclavius, on n’accordoit ce titre qu’aux princes du sang de la maison de Hongrie ; & encore aujourd’hui, la dignité de ban de Croatie est remplie par un seigneur de la premiere distinction. Le pays dans lequel est situé Temeswar, s’appelle encore aujourd’hui le banat de Temeswar, auquel sens le terme de banat équivaut à ceux de province ou de gouvernement. Le ban avoit sous lui un vice-gérent, lieutenant général, ou lieutenant de roi au gouvernement, qu’on nommoit vice-bannus. On croit que ces deux noms sont dérivés des mots ban, bando ou banno, dont on se servoit dans le bas Empire pour signifier une banniere ou un étendart ; parce que les habitans de ces provinces, en tems de guerre, étoient obligés de se ranger sous la banniere ou l’étendart de leur gouverneur. Quelques Auteurs prétendent que les Turcs ont conservé ce nom de ban, & que les gouverneurs à qui ils le donnent, ont la même autorité que les beglerbegs. Voyez Beglerbeg. (G)
Ban & Arriere-ban, (Art milit. & Hist. mod.) mandement public adressé de la part d’un souverain à ses vassaux de se trouver en armes à un rendez-vous pour servir dans l’armée, soit en personne, soit par un certain nombre de gens de pié ou de cheval qui les représentent, à proportion du revenu ou de la qualité de leurs fiefs.
Le ban se rapporte aux fiefs, & l’arriere-ban aux arriere-fiefs, selon quelques-uns : mais d’autres croyent que le ban est le service ordinaire que chaque vassal doit selon la nature de ses fiefs ; & que l’arriere-ban est un service extraordinaire que les vassaux rendent au roi ; d’autres qui font venir le mot d’arriere-ban, de heri-bannum, proclamation du maître ou seigneur, pensent qu’on ne doit mettre aucune distinction entre ban & arriere-ban.
Quoi qu’il en soit, ces assemblées de vassaux convoqués par leurs seigneurs sur les ordres ou à la réquisition du roi, ont commencé en France dès le tems des rois de la seconde race, & il en est fait mention dans les capitulaires de Charlemagne : mais elles ont été plus fréquentes sous les rois de la troisieme race. Car on trouve dans la chambre des Comptes plusieurs rôles pour le ban & l’arriere-ban, datés des années 1216, 1236, 1242, 1253, & 1272. Il paroît par le dernier, que les seigneurs fieffés cités par Philippe-le-Hardi, devoient se trouver à jour préfix à Tours, avec un certain nombre de cavaliers & de fantassins, dont les uns alloient à leurs dépens, les autres étoient défrayés ; & ceux qu’on dispensoit du service, s’en rédimoient par une somme d’argent ou une certaine quantité de fourrage. Depuis ce prince jusqu’à François I. on trouve encore plusieurs convocations & rôles du ban & de l’arriere-ban ; dans lesquels, outre les seigneurs laïques, sont aussi compris les archevêques, évêques, abbés, prieurs, chapitres, les maires, consuls & échevins des villes. Les ecclésiastiques étoient obligés d’aller ou d’envoyer au ban & arriere-ban, à cause des fiefs qu’ils possédoient. Lorsqu’ils y alloient eux-mêmes, ils combattoient en personne ; témoin ce que Monstrelet raconte de Pierre de Montaigu, archevêque de Sens, & Matthieu Paris, de Philippe de Dreux évêque de Beauvais, qui portoient la cuirasse & combattoient comme les seigneurs & barons.
Dans la suite, les ecclésiastiques ont été dispensés du ban & arriere-ban par plusieurs lettres patentes, & entre autres par un acte du 29 Avril 1636, entre Louis XIII, & le clergé de France, moyennant certaines subventions que le clergé a promis de payer au roi dans les besoins de l’état. Les rois de France ont aussi exempté de ce service les bourgeois de plusieurs villes de leur royaume, les officiers du parlement de Paris, les secrétaires du roi, & autres personnes privilégiées.
Autrefois l’assemblée du ban & de l’arriere-ban se faisoit par des seigneurs de la premiere distinction appellés missi dominici, envoyés ou députés du souverain ; ensuite par les bannerets sur les ordres du roi ou du connétable. Depuis le roi a adressé ses lettres aux sénéchaux & aux gouverneurs de province. En 1674 & en 1689, Louis XIV. ordonna à tous les nobles, barons, chevaliers, écuyers, & autres non nobles, communautés & autres vassaux, de se trouver en armes au jour & au lieu qui leur seroient désignés par le gouverneur & lieutenant général de sa majesté en leur province, pour aller joindre le corps des troupes sous la conduite du chef qui seroit choisi d’entre eux, afin de les commander suivant la forme accoûtumée. De la Roque, traité du ban & arriere-ban. Voyez Noblesse (G)
Cette milice étoit assez bonne du tems de Louis XI. parce qu’il s’en servoit souvent : elle commença à dégénerer du tems de Louis XII. & de François I. & elle tomba encore davantage sous Henri II.
On n’a point assemblé l’arriere-ban en France depuis 1674. M. de Turenne ne fut point content de cette milice qui ne se conduisoit pas avec le même ordre & la même obéissance que les troupes reglées. (Q)
BANAL, terme de coûtume, se dit d’un moulin, four, pressoir ou autre chose semblable, que le seigneur entretient pour l’usage de ses censitaires, & dont il peut les contraindre d’user. Voyez ci-dessous Banalité.
BANALITÉ, est un droit qu’a le seigneur de contraindre les habitans de son territoire, d’aller moudre leur blé à son moulin, cuire à son four, ou porter la vendange à son pressoir.
Dans la coûtume de Paris, la banalité ne peut pas s’exiger sans titre ; & ces titres ne sont pas reputés valables s’ils ne font avant vingt-cinq ans. (H)
* BANANIER, s. m. musa, (Hist. nat. bot.) Voici ses caracteres. Sa racine pousse des jets, sa tige meurt après avoir donné son fruit. Elle ressemble à un roseau ; elle n’a point de branches : mais elle jette de grandes feuilles, d’abord roulées comme au cannacorus, mais se développant dans la suite, & formant une espece de couronne à son sommet. Les fleurs & les fruits sont en grappes, & enfermés dans une gaîne comme au palmier. Les fleurs ont plusieurs pétales irréguliers & portés sur le sommet de l’ovaire. L’ovaire ressemble à celui du concombre ; il est charnu, partagé en trois loges, bon à manger, rempli de semences, & garni d’un long tuyau dont l’extrémité est arrondie. Boerhaave en distingue deux especes.
Le fruit de cet arbre est délicat ; on dit qu’il ne fait jamais de mal en quelque quantité qu’on en mange. Alpin nous assûre cependant qu’il se digere difficilement ; c’est la nourriture journaliere des Indiens. Ses feuilles sont si grandes, qu’elles peuvent servir de vêtement. La racine écrasée & bouillie dans du lait, est bonne pour abattre les vertiges ; son eau mêlée avec du sucre appaise la chaleur brûlante des reins ; la décoction du fruit adoucit la toux causée par des humeurs chaudes & acres. On s’en sert dans les inflammations de la plevre, du poumon, & des reins ; enfin elle excite la semence, & provoque l’urine. (N)
* BANARA ou BENARES, (Géog.) ville d’Asie, au Mogol, dans le royaume de Bengale. Long. 101. 30. lat. 26. 20.
BANAUÇON, s. m. en Architecture, nom du troisieme genre de machine des anciens, qui servoient à tirer des fardeaux. (P)
* BANBURY, (Géog.) ville d’Angleterre, sur la riviere de Chernel, dans la province d’Oxford. Long. 16. 10. lat. 52. 9.
* BANC, s. m. (Gramm.) ce mot se prend communément pour un long siége, à dos ou sans dos, soûtenu sur plusieurs piés ; & c’est du rapport que d’autres machines ont avec sa figure ou avec son usage, qu’elles ont pris le nom de banc.
Banc, (terme de Jurisprud.) dans le chœur est un des droits honorifiques qui appartiennent au patron d’une église, ou au seigneur haut-justicier dans la haute justice duquel elle est située. Voyez Honorifiques (droits.)
On appelle au Palais messieurs du grand banc, les présidens au mortier, parce qu’en effet le banc sur lequel ils sont assis est plus élevé que les siéges des autres conseillers.
On appelle aussi bancs au Palais des especes de bureaux où se tiennent les avocats & procureurs pour parler à leurs parties. (H)
Banc du roi, (Hist. mod. & Jurisprud.) tribunal de justice ou cour souveraine en Angleterre. On l’appelle ainsi, parce qu’autrefois le roi y présidoit en personne sur un banc élevé, les juges étant assis à ses piés sur des bancs ou siéges plus bas. C’est dans cette cour que l’on plaide les causes de la couronne entre le roi & ses sujets. Elle connoît aussi des crimes de haute trahison & des complots contre le gouvernement. Ce tribunal est composé de quatre juges, dont le premier s’appelle le lord chef de justice de la cour du banc du roi. Sa jurisdiction est générale, & s’étend par toute l’Angleterre ; il n’y en a point dans ce royaume de plus indépendante, parce que la loi suppose que le roi y préside toûjours. Il y a encore un autre tribunal nommé le banc commun ou cour des communs plaidoyers, qui est la seconde cour de justice du royaume, où l’on porte les affaires communes & ordinaires, c’est-à-dire les procès de sujet à sujet. On y juge toutes les affaires civiles, réelles, & personnelles, à la rigueur de la loi. Le premier juge de cette cour se nomme chef de la justice des communs plaidoyers ou du banc commun. On y comptoit autrefois cinq, six, sept, & jusqu’à huit juges ; leur nombre est maintenant réduit à quatre, comme celui des juges du banc du roi. (G)
Banc, (Comm.) Les banquiers avoient autrefois des bancs dans les places publiques & dans les lieux où se tenoient les foires ; & c’étoit où ils faisoient leur commerce d’argent & de lettres de change. Quand un banquier faisoit faillite, on rompoit son banc, comme pour avertir le public que celui à qui avoit appartenu le banc rompu n’étoit plus en état de continuer son négoce ; & comme cet usage étoit très-ordinaire en Italie, on prétend que le terme de banqueroute dont on se sert en France, vient des mots Italiens banco rotto, qui signifient banc rompu. V. Banqueroute. Dict. du Comm. tome I. (G)
Banc, en terme de Marine, est la hauteur du fond de la mer, qui s’éleve quelquefois jusqu’à sa surface, ou qui n’est couvert que de très-peu d’eau ; desorte que les vaisseaux ne peuvent passer dessus sans échoüer. Il y a des bancs qui restent entierement à sec, lorsque la mer est basse ; ce qui s’exprime en disant que ces bancs découvrent. Il y a des bancs sur lesquels il y a assez d’eau pour que les plus grands vaisseaux puissent y passer en tout tems, & même y mouiller, tels que le banc de Terre-neuve.
On appelle bancs de glaces, de gros glaçons flotans qu’on trouve quelquefois à la mer. (Z)
Banc de galere, de galéasse, de galiote, de brigantin, & de tout bâtiment à ramer. C’est le lieu pour asseoir ceux qui tirent à la rame, soit forçat, bonavoglie, ou matelot ; voyez Planche II. le dessein d’une galere à la rame, & les forçats assis sur le banc.
Les galeres ordinaires sont à vingt-cinq bancs ; ce qui se doit entendre de vingt-cinq de chaque côté, faisant en tout cinquante bancs pour cinquante rames, & quatre ou cinq hommes sur chaque rame.
Les galéasses ont trente-deux bancs, & six à sept hommes pour chaque rame.
De tous les bâtimens à rame, il n’y a que les gondoles de Venise qui n’ayent point de banc ; car les rameurs nagent debout.
Banc de chaloupe ; ce sont les bancs qui sont joints autour de l’arriere de la chaloupe en-dedans pour asseoir ceux qui y sont. (Z)
Banc à s’asseoir dans la chambre du capitaine. On trouve un banc qui est placé contre l’arriere du vaisseau. Il y en a encore un autre à stribord ; c’est par l’endroit qu’occupe ce banc, & qu’on ôte alors que l’on passe le gouvernail pour le monter ; on le leve aussi lorsqu’on veut culer de l’arriere ; les assuts entrent encore par-là. On y place quelquefois un tuyau d’aisement à six pouces du petit montant qui le soûtient, & à un pié du bord du vaisseau.
Banc à coucher. Il y en a aussi un dans la chambre du capitaine. (Z)
Banc d’Hippocrate, (en Chirurgie.) machine dont on se servoit autrefois pour réduire les luxations & les fractures. C’étoit une espece de bois de lit sur lequel on étendoit le malade. Il y avoit un essieu à chaque bout qui se tournoit avec une manivelle ; on attachoit des lacs aux parties luxées ou fracturées d’un côté, & aux essieux de l’autre. En tournant les essieux, les lacs qui s’entortilloient autour faisoient l’extension & la contre-extension pendant que le chirurgien réduisoit les os dans leur situation naturelle. La Chirurgie moderne a simplifié les méthodes de réduire les membres luxés ou fracturés, & ne se sert plus de cette machine dont on voit la description & la figure dans Oribase. Voy. Extension & Machine pour la réduction des luxations. (Y)
Banc, (en Architect.) c’est la hauteur des pierres parfaites dans les carrieres.
Banc de volée ; c’est le banc qui tombe après avoir soûchevé.
Banc de ciel ; c’est le premier & le plus dur qui se trouve en souillant une carriere, & qu’on laisse soûtenu sur des piliers pour lui servir de ciel ou de plafond. (P)
Banc, (Ardoise.) On entend par un banc dans les carrieres d’ardoise & autres, le long parallélépipede formé par deux foncées. Les bancs s’élevent les uns au-dessus des autres, & forment à droite & à gauche une espece d’échelle ou plûtôt d’escalier. On ne peut fixer ni la hauteur ni la largeur du banc, ou de chaque degré de cet escalier ; elles varient l’une & l’autre selon la profondeur, l’etendue & la nature de la carriere. Les bancs ou parallélépipedes d’ardoise n’ont pas la même hauteur sur toute leur longueur. Ils vont un peu en s’inclinant vers le fond de la carriere, & forment une pente aux eaux vers la cuvette qui les reçoit. La hauteur du banc est de neuf piés dans nos figures d’ardoise, & sa largeur suit la même échelle. La surface supérieure du banc s’appelle nif. Voyez les articles Foncée, Cuvette, Nif & Ardoise.
Banc de Cuve, ce sont dans les Brasseries, les planchers qui entourent les cuves. Voyez Brasserie.
Banc, en terme de Cardeur, c’est une planche d’environ un pié de large, allant en pente par un bout, & qui porte toutes les parties du roüet. Voyez Carder.
Banc a tirer, (terme & outil de Chainetier.) Il sert aux Chaînetiers pour passer à la filiere le fil de fer, de cuivre ou de laiton, qu’ils veulent employer à des chaînes, & pour le diminuer de grosseur.
Ce banc à tirer est fait comme ceux des Orfevres & autres, & est composé d’un banc, d’une piece, du moulinet, du noyau & de la filiere. Voyez Banc d'Orfevre.
Banc à couper, c’est chez les Cloutiers d’épingles, un banc de figure presque quarrée, garni de rebords plus hauts sur le derriere que sur les côtés, & le devant qui est moins élevé que tout le reste. Les cisailles sont attachées au milieu par une de leurs branches. Voyez. Cisailles, & la figure 13 du banc, Pl. II. du Cloutier d’épingles.
Banc à tirer, (en terme d’Epinglier.) est une espece d’établi adossé d’un bout sur un billot fendu à deux ou trois endroits pour y battre la filiere. Voyez Filiere. Vers le même bout ou à l’autre, selon l’emplacement, est la bobile, voyez Bobile ; plus loin, la filiere arrêtée entre trois montans. Derriere elle on voit une piece de bois plus haute que ces montans, avec un coin ; c’est-là qu’on place la filiere pour en faire l’essai : enfin vers cette extrémité on voit le tourniquet d’où devide le fil que l’on tire. Voyez la fig. Pl. des Trifileries & de l’Orfévrerie.
Banc, servant aux Fondeurs de caracteres d’Imprimerie, est une espece de table oblongue d’environ deux piés & demi, à hauteur d’appui, fermée à l’entour par un rebord, excepté vis-à-vis l’ouvrier où ce rebord finit ; ce banc sert à recevoir les lettres à mesure qu’on les fond, & de décharge pour plusieurs choses nécessaires à l’ouvrier. Voyez la vignette de la Pl. I. du Fondeur de caracteres, & la fig. 2. de la même Planche qui le représente en particulier.
Banc d’Imprimerie, est une espece de table de bois, longue environ de trois piés sur dix pouces de large, soûtenue par deux treteaux garnis de planches tout au tour, en conservant cependant une ouverture pardevant qui forme un receptacle ou bas d’armoire ; ce banc est toûjours situé à la droite de l’Imprimeur ; sur le premier bout il place le papier trempé prêt à être imprimé ; à l’autre extrémité, il pose chaque feuille au sortir de la presse : les Imprimeurs se servent de la cavité de ce banc, pour serrer la laine, les cuirs, les clous de balles, les blanchets, & autres étoffes ou ustenciles d’Imprimerie.
Banc à river, fig. 81. Pl. XVI. de l’Horlogerie, est un instrument dont les Horlogers se servent pour river certaines roues sur leur pignon. On met la partie BB de cet outil entre les mâchoires de l’étau, & on fait entrer la tige du pignon sur lequel on veut river une roue dans un trou T convenable ; on prend ensuite un poinçon à river, & on rabat la rivure à petits coups de marteau sur la roue que l’on fait tourner avec le doigt, afin que les parties de la rivure soient également rabattues de toutes parts.
Comme il est important que les balanciers soient rivés bien droit sur leurs verges, & que ces verges, vû leurs palettes, ne pourroient point tourner dans un trou comme la tige d’un pignon, on fait ordinairement au milieu des bancs à river une creusure ronde L, dâns laquelle on ajuste une petite plaque P à drageoir, de telle sorte qu’elle puisse y tourner sans beaucoup de jeu : on fait aussi au centre de cette plaque une ouverture O, propre à recevoir le corps d’une verge & une de ses palettes.
La petite plaque pouvant, comme il a été dit, tourner dans sa creusure L, lorsqu’on ajuste une verge dans sa fente pour river le balancier sur son assiette : en tournant ce balancier, on fait tourner la plaque, & on le rive sur sa verge, comme on feroit une roue sur son pignon. On a un outil de la même forme qui s’ouvre en deux pour embrasser la tige d’un pignon, sur laquelle est soudée une assiette ; cette assiette reçoit une roue que l’on y rive, en rabattant sur la roue ébiselée & entaillée, la partie de l’assiette qui l’excede. Comme la roue ou le pignon ne sauroient passer par les trous du banc, on est obligé d’en avoir un qui se sépare en deux, comme il a été dit ; ordinairement les deux pieces du banc sont assemblées ensemble à charniere, & peuvent s’ouvrir & se fermer comme un compas. (T)
Banc à cric, (en terme d’Orfévre en grosserie.) se dit d’un banc à tirer, qui ne differe du banc ordinaire, qu’en ce qu’au lieu de sangle, il est garni d’une espece de cremailliere, & d’une boîte qui renferme un arbre à chaque bout duquel on voit hors de la boîte une manivelle. Cet arbre fait tourner une roue de rencontre, qui s’engraine elle-même dans la cremailliere, qui se termine par un crochet qui retient la main. Voyez Cremailliere & Main.
Voyez Planche derniere de l’Orfevre, un banc à tirer & un banc à cric, vignet. fig. 1. 2. ouvriers qui tirent de la moulure ; a tenaille à tirer ; b moulure. Vignet. fig. 3, 4, autres ouvriers au banc à cric ; f d g g banc, ee pitons qui soûtiennent la filiere, d le cric, f la filiere. Fig. 5. ouvrier qui dresse les lames à la lime avant que de les faire passer.
Développement du banc à cric, fig. a b c b d e f g, mouvement hors de sa boîte ; bb arbre où l’on voit deux quarrés pour les manivelles ; c son pignon monté, qui fait mouvoir la roue à dent ou le hérisson d, dont le pignon ou la lanterne s’engraine dans le cric f, au bout duquel est un crochet qui tient un anneau g, où l’on met les branches de la tenaille à tirer ; mm la cage ou boîte ; nn extrémités des vis qui fixent les jumelles ; mm, oo, les jumelles ; p, étrier sur lequel glisse le cric ; q le hérisson ; r la lanterne ; h un des pitons qui soûtiennent la filiere ; i rondelle qui se met sous le banc & l’écrou.
Développement du banc à tirer, P P Q Q R R S boîte à filiere pour tirer des moulures ; pp le sommier ; QQ le chapeau ; R, R, les vis qui appuient sur les filieres, & les tiennent serrées ; T clef pour serrer les vis ; V, V, les vis ; X, X, les filieres à moulures ; YZ autre boîte à filiere peu différente de la précédente ; 1. filieres de dessus ; 2. 3. 2. filieres de dessous ; 4. 4. autre filiere ; 5. morceau tiré en rond ; 6. morceau moulé. A banc à tirer ; B, B, pitons qui soûtiennent les filieres ; C, C, aîles du moulinet ; HHGGF tambour sur lequel se roule la sangle du moulinet ; G, G, tourillons ; H, H, quarrés des moulinets ; F corps du tambour ; I, I, deux pieces quarrées qui s’ajustent aux quarrés du tambour, entre les clefs & le moulinet ; s, t, deux tambours ; u la rondelle ; M, M, deux supports du tambour ; N, O, filieres.
L’assemblage & la fonction de ces deux machines se voit si clairement dans la vignette, que ce que nous en pourrions dire n’ajoûteroit rien à ce qu’elle représente.
Banc à tirer, (terme d’Orfévre.) est une piece de bois sur laquelle les Orfévres tirent les fils d’or ou d’argent qu’ils employent. Elle peut avoir cinq, six, sept, huit, & neuf piés de long, douze à quinze pouces de large, sur quatre d’épaisseur. L’on perce sur un bout de cette piece deux trous qui servent à mettre les poupées qui tiennent l’arbre où est attachée la sangle, & où l’on met l’aîle. Voyez Poupée, Arbre, Sangle & Aile.
Les deux autres trous qui sont vis-à-vis l’un de l’autre, servent à mettre les poupées qui retiennent la filiere, & le troisieme est pour recevoir les gratures que la filiere fait à l’or ou l’argent en les tirant : elles tombent dans un tiroir qui est au-dessous. Il y a encore quatre autres trous outre ceux-ci, pour les piés qui soûtiennent le banc ; ces piés ont environ deux sur trois pouces d’équarrissage, & deux piés & demi, ou même trois piés & demi de long à deux pouces du bas : sous ces piés l’on met une planche avec un rebord de quatre ou cinq pouces de haut, pour serrer les outils qui servent au tirage. Voyez Tirage, & l’article suivant.
Banc à dégrossir, (chez les Tireurs d’or.) est un banc sur lequel le dégrosseur donne le troisieme tirage à l’or par le moyen d’une bobine sur laquelle il le devide, en le faisant passer à travers une filiere appliquée contre un faux-ras retenu dans un ajoux. Voyez Faux-ras & Ajoux.
Banc à dorer, (chez les Tireurs d’or.) est composé de deux parties, la tête & l’appui : la tête dans laquelle il y a un morceau de bois en forme de demi-cercle, tient dans un mur ; les tenailles entrent dans un trou pratiqué au milieu de ce cercle, par un bras, tandis que l’autre est retenu par des chevilles de fer fichées sur le cercle. Les tenailles sont appuyées dans une encoche à l’autre extrémité du banc, & le lingot qu’elles serrent est soûtenu par l’autre bout sur un chenet, tandis qu’on le brunit & qu’on le dore. Voyez Tireur d’or.
Banc ou Selle à ourdir, (en Passementerie.) c’est un siége destiné pour l’ourdisseur, & pour porter la manivelle qui fait tourner l’ourdissoir : cette manivelle a en bas une large poulie qui doit être parallele à celle du moulin ; sur cette poulie est passée une corde à boyau, qui après s’être croisée dans son milieu, va passer sur la poulie du moulin ; par le moyen du croisement de cette corde, le moulin tourne du même sens que la manivelle ; si la corde lâche par la secheresse du tems ou de quelqu’autre maniere, il n’y a qu’à reculer ce banc ; si le contraire arrive, on le rapproche ; il y a des ourdissoirs où l’on se passe de ce banc. Voyez Ourdissoir ; voyez aussi Pl. de Passementerie.
Bancs, (dans les manufactures de soie.) ce sont des parties de l’ourdissoir. Des bancs, les uns sont attachés au montant, les autres sont mobiles : il y a entr’eux une roue cavée sur sa circonférence en deux endroits différens ; les cavités sont environ à un pouce de distance prise sur le diametre. Il passe dans ces cavités une corde de boyau qui va envelopper la cage de l’ourdissoir, & lui donner le mouvement que la roue cavée reçoit de l’ourdisseuse. Les bancs mobiles s’éloignent & s’approchent suivant que la corde a besoin d’être lâchée ou tendue. Voyez Ourdissoir.
Banc ; on donne, dans les Verreries, ce nom à un siege sur lequel le maître s’assied pour faire l’embouchure, & poser la cordeline. Voyez Planche de Verrerie VI. fig. 17. un ouvrier au banc. Le banc n’a rien de particulier que ses deux bras qu’on fait plus longs qu’ils n’ont coûtume d’être aux autres siéges de cette nature, afin que l’ouvrier puisse y poser & mouvoir commodément sa canne, en faisant l’embouchure & la cordeline.
Banc, (en Vénerie.) c’est ainsi qu’on appelle les lits des chiens.
Banc ; on entend par ce mot, dans les Salines, un endroit clos, couvert, pratiqué au côté de la poelle, & dont la porte correspond à la pente de la chevre, qui descend par son propre poids, & se renverse sur le seuil du banc, lorsque se fait la brisée. Le sel demeure dix-huit jours dans les bancs, avant que d’être porté dans les magasins. Voyez Brisée, Chevre, & Saline ; & Planche II. des Salines. Dans la coupe de l’attelier I, I, sont deux bancs.
Bancs (controlleurs des) ; officiers de salines : il y en a deux. Leurs fonctions sont d’enregistrer par ordre de numero, & date par date, tous les billets de la délivrance journaliere ; les abattues en abregé, par colonnes & ordre de poelles ; les sels à l’entrée & à la sortie des bancs ; les bois de corde qui viennent à la saline, & d’assister à toutes les livraisons de sels des bancs & des magasins ; se trouver à la brisée ; faire porter les sels des bancs dans les magasins ; assister aux réceptions de bois & de fers ; en un mot, veiller à tout ce qui concerne le service.
Banc de jardin. Rien n’est si nécessaire dans les grands jardins, que les bancs : on en souhaiteroit à chaque bout d’allée. Ils ont des places affectées, telles que sont les renfoncemens, & les niches dans les charmilles, les extrémités des allées, les terrasses & les beaux points de vûe. Il y a des bancs simples, des bancs à dossiers, & des bancs dont le dos se renverse du côté que vous voulez. On en fait de marbre, de pierre, & de bois : ces derniers sont les plus communs ; on les peint à l’huile pour les conserver. (K)
* Banc (le grand), Géog. Banc de l’Amérique septentrionale, vers la côte orientale de Terre-neuve ; c’est le plus grand banc de sable qu’on connoisse ; il n’est pas dangereux. Les Européens y font la pêche des morues.
Banc aux baleines, aussi dans l’Amérique septentrionale, à l’occident du grand banc, & au midi du banc à vert.
Banc de l’ile de sable, dans l’Amérique septentrionale, au midi de l’île & de l’Acadie, dans la mer de la nouvelle France.
Banc des îles, à l’Amérique septentrionale, dans le grand golfe de S. Laurent, en Canada, au-devant de la baie des Chaleurs.
Banc à vert, en Amérique, près de la côte méridionale de Terre-neuve, vis-à-vis des baies de Plaisance & des Trépassés.
Banc jacquet ou le petit banc, en l’Amérique méridionale, à l’orient du grand banc.
Banc des perles, en l’Amérique méridionale, sur la côte de Carracas, entre la ville de Rio de la Gacha & le cap de la Vela.
Banc des perles, en Amérique, vers la côte de Venezuela, en allant de l’île Marguerite à celle de la Tortue.
Banc de S. Georges, en l’Amérique septentrionale, vers la nouvelle Angleterre & le cap de sable, sur la côte de l’Acadie. On l’appelle aussi banc aux Anglois.
Banc de Bimini, en l’Amérique, près de l’île Bimini, une des Lucayes, & de celle d’Abacoa, vers la Floride, sur la partie orientale de Bahama.
* BANCA (Géog.), île d’Asie, dans les Indes, entre celles de Sumatra & de Borneo, avec ville & détroit de même nom.
* BANCALIS (Géog.), ville de l’ile de Sumatra, au royaume d’Achem, vers le détroit de Malaca. Long. 118. lat. 1. 5.
* BANCHE, s. f. (Hist. nat.) pierre molle, mais dure, comparée à la glaise ; M. de Reaumur, mém. de l’Acad. année 1712, pag. 128, prétend que ce n’est autre chose que de la glaise durcie & pétrifiée par ce qu’il y a de visqueux dans l’eau de la mer, & il le prouve par la disposition de ses feuilles & sa couleur. La banche à sa surface supérieure est assez dure ; un peu au-dessous elle est un peu plus molle ; plus on la prend bas, moins elle est dure & moins elle est différente de la glaise ; en un mot, en s’approchant du lit de pure glaise, elle paroît aussi insensiblement s’approcher de la nature de cette terre, & cela par des degrés si insensibles, qu’il n’est pas possible de déterminer précisément où la banche finit, & où la glaise commence. La banche, de grise qu’elle est, devient blanche & dure lorsqu’elle n’est plus humectée par l’eau.
BANCO ou BANQUO (Commerce) ; mot Italien qui signifie banque. On s’en sert ordinairement pour exprimer celle qui est établie à Venise.
Le banco de Venise, qu’on appelle vulgairement banco del giro, est proprement un bureau du dépôt public, ou une caisse générale & perpetuelle ouverte à tous marchands & négocians, & fondée par un édit solennel de la république, que tous payemens pour marchandises en gros & de lettres de change ne se pourront faire qu’in banco ou en billets de banque ; & que tous débiteurs & créanciers seront obligés, les uns de porter leur argent à la banque, les autres d’y recevoir leur payement in banco ou en billets de banque ; de sorte que tous les payemens se font par un simple transport des uns aux autres ; celui qui étoit créancier sur le livre du banquo, devenant débiteur dès qu’il cede son droit à un autre, qui est enregistré pour créancier à sa place ; de sorte que les parties ne font que changer de nom, sans qu’il soit nécessaire pour cela de faire aucun payement réel & effectif.
Il est vrai qu’il se fait quelquefois des payemens en especes, sur-tout lorsqu’il s’agit du négoce en détail, ou que des étrangers veulent avoir de l’argent comptant pour emporter avec eux, ou que les négocians aiment mieux avoir leur fonds en monnoie courante, pour le négocier par lettres de change. La nécessité de ces payemens effectifs a donné lieu de pourvoir à un fonds d’argent comptant, qui bien loin de diminuer le capital, l’augmente plûtôt par la liberté qu’il donne à chacun de retirer son argent quand il lui plaît.
Par le moyen de cette banque la république, sans gêner la liberté du commerce & sans payer aucun intérêt, se trouve maîtresse de cinq millions de ducats à quoi le capital de la banque est limité, ce qui monte à plus de trente millions de livres monnoie de France ; elle répond du capital, & c’est pour elle en toute occasion une ressource sûre qui la dispense d’avoir recours à des impositions extraordinaires, même dans les plus pressantes nécessités. Le bon ordre qui regne dans l’administration du banco, prouve également l’utilité & la solidité de cet établissement.
Dans le banco, les écritures se tiennent en livres, sous & deniers de gros. La livre vaut dix ducats de banco, ou 240 gros, parce que le ducat est composé de 24 gros. La monnoie de change s’entend toûjours ducat de banco, qui est imaginaire, 100 desquels font 120 ducats monnoie courante. Ainsi la différence des ducats de banco & des ducats courans, est de 20 pour cent, étant défendu aux courtiers de traiter à plus haut prix.
Le banco se ferme quatre fois l’année ; savoir, le 20 Mars, le 20 Juin, le 20 Septembre, & le 20 Décembre, & chaque fois pour vingt jours : mais on n’en négocie pas moins sur la place. Il y a encore dés clôtures extraordinaires qui sont de huit à dix jours, pour le carnaval, la semaine sainte, & on le ferme encore chaque vendredi de la semaine, quand il n’y a point de fête, & cela pour faire le bilan. Voyez Bilan.
M. Savary, dans son dictionnaire, explique la maniere dont se négocient ou se payent les lettres de change au banco. Voyez le Dictionnaire du Commerce, tom. I. pag. 817. (G)
* BANCOK (Géog.), fort d’Asie, au royaume de Siam, dans les Indes. Long. 119. lat. 13. 25.
* BANDA (Géog.), sept iles d’Asie, vers le quatrieme degré de latitude méridionale.
BANDAGE, s. m. (terme de Chirurgie.) est l’application d’une ou de plusieurs bandes autour d’une partie malade. L’utilité des bandages est de contenir dans une situation naturelle les parties dérangées, de faire compression sur quelque vaisseau, de maintenir les médicamens, compresses, & autres pieces d’appareil. Un seul bandage produit quelquefois les trois effets en même tems.
Les bandages sont différens, suivant les parties sur lesquelles on applique les bandes. Voyez Bande. Par rapport à leurs usages, il y a des bandages contentifs, unissans, incarnatifs, divisifs, compressifs, expulsifs. Voyez ces mots.
La méthode de faire chaque bandage a des regles particulieres, dont le détail seroit trop long. Il ne faut pas en général que les bandages soient trop lâches ni trop serrés. Il faut avoir soin de garnir de linge mollet ou de charpie les cavités sur lesquelles on doit faire passer les bandes, afin que leur application soit plus exacte.
Pour bien appliquer une bande, on doit mettre la partie en situation, tenir le globe de la bande dans sa main, & n’en dérouler à mesure que ce qu’il en faut pour couvrir la partie.
Pour bien lever la bande, il faut mettre la partie en situation, décoller les endroits que le pus ou le sang a collés, recevoir d’une main ce que l’autre aura défait, & ne point ébranler la partie par des secousses.
On divise les bandages en simples & en composés. Le simple se divise en égal & en inégal. L’égal est appellé circulaire, parce que les tours de bande ne doivent point se déborder. L’inégal est celui dont les circonvolutions sont inégales, & plus ou moins obliques. On en fait de quatre especes, connues sous le nom de doloire, de mousse ou obtus, de renversé ; & de rampant. Voyez ces mots.
Le bandage est dit composé, lorsque plusieurs bandes sont cousues les unes aux autres en différens sens, ou qu’elles sont fendues en plusieurs chefs ; telles sont le T pour le fondement, voyez T ; le suspensoir pour les bourses, voyez Suspensoir ; la fronde pour les aisselles, le menton, &c. Voyez Fronde.
Le bandage à dix-huit chefs est un des plus composés : on s’en sert pour les fractures compliquées des extrémités. Ce sont autant de bandes courtes, qui ne font que se croiser sur la partie, & qui permettent les pansemens sans déranger la partie blessée. Voyez la figure 10. Planche XXI.
On donne aussi le nom de bandage à des instrumens faits de différentes matieres, comme fer, cuivre, cuir, &c. tels sont le bandage pour contenir les hernies ou descentes, voyez Brayer ; le bandage pour la chûte ou descente de matrice, voy. Chûte de matrice ; le bandage pour les hemorrhoïdes, voyez Hemorrhoides ; celui pour la réunion du tendon d’Achille, voyez Pantoufle.
Bandage de corps, est une serviette ou piece de linge en deux ou trois doubles, capable d’entourer le corps ; voyez fig. 1. Planche XXX. les extrémités se croisent & s’attachent l’une sur l’autre avec des épingles. Ce bandage sert à la poitrine & au bas-ventre : on le soûtient par le scapulaire. V. Scapulaire.
Bandage pour la compression de l’urethre, dont M. Foubert se sert à l’instant qu’il doit faire l’opération de la taille à sa méthode. Pl. IX. fig. 5. (Y)
Bandage (terme de Fonderie) ; les fondeurs en grand donnent ce nom à un assemblage de plusieurs bandes de fer plat, qu’on applique sur les moules des ouvrages qu’on veut jetter en fonte, pour empêcher qu’ils ne s’écrasent & ne s’éboulent par leur propre pesanteur. Voyez Fonderie & les Planches des figures de bronze.
Bandage du battant, en Passementerie, est une grosse noix de bois, plate, percée de plusieurs trous dans sa rondeur, & de quatre autres trous dans son épaisseur. Les trous de la rondeur servent à introduire, à choix & suivant le besoin, dans l’un d’eux un bâton ou bandoir, qui tient & tire à lui la corde attachée au battant. Lorsque le métier ne travaille plus, on détortille cette corde d’alentour de ce bâton, qui s’en va naturellement par sa propre force s’arrêter contre la barre d’en-haut du chassis. Les quatre trous de l’épaisseur de cette noix, sont pour passer les bouts de deux cordes qui tiennent de part & d’autre au chassis du métier. Ces cordes sont serrées fortement par les différens tours qu’on leur fait faire avec la noix, au moyen du bâton ou bandoir qu’on enfonce dans les divers trous de la rondeur, & qui mene la noix à discrétion. Deux cordes sont attachées à ce bâton, & d’autre part aux deux épées du battant, qui de cette maniere est toûjours amené du côté de la trame pour la frapper. Voyez les Planches du Passementier & leur explication.
Il y a encore le bandage du métier à frange, lequel est attaché au derriere du métier, comme il se voit dans les Planches du Passementier ; il sert par la mobilité d’une petite poulie qui est à son extrémité, à faire lever & baisser alternativement les lissettes des luisant & chaînettes qui ornent la tête des franges.
* BANDE, troupe, compagnie, (Gramm.) termes synonymes, en ce qu’ils marquent tous multitude de personnes ou d’animaux. Plusieurs personnes jointes pour aller ensemble, sont la troupe ; plusieurs personnes séparées de la troupe font la bande ; plusieurs personnes que des occupations, un intérêt, un emploi, réunissent, forment la compagnie. Il ne faut pas se séparer de sa troupe pour faire bande à part. Il faut avoir l’esprit & prendre l’intérêt de sa compagnie. On dit une troupe de comédiens, une bande de violons, & la compagnie des Indes. On dit aussi une bande d’étourneaux, des loups en troupe, deux tourterelles de compagnie.
Bande, est encore synonyme à troupe. On dit d’une troupe de soldats qui combattent sous le même étendart, que c’est une bande.
Romulus divisa les légions par cohortes, & les cohortes en manipules, du nom de l’enseigne sous laquelle elles combattoient, & qui étoit alors une poignée de foin au bout d’une pique, manipulus. Voyez Enseigne & Légion.
M. Beneton croit que le mot de ban a donné origine à celui de bande. D’abord que le ban étoit publié, dit-il, tous les militaires d’un gouvernement étant assemblés, on les partageoit en différentes bandes ou compagnies ; les unes de cavaliers ou d’hommes d’armes, les autres de soldats ou fantassins, chacune sous le commandement d’un senior, c’est-à-dire, du plus élevé ou du plus consideré d’entre tous ceux qui composoient la bande.... Du terme de ban sont venus ceux de bande & de banniere pour exprimer des hommes attroupés & des enseignes. Une bande étoit un nombre de soldats unis sous un chef, & l’enseigne qui servoit à la conduite de ces soldats, étoit aussi une bande ou une banniere. La bande enseigne donna son nom à chaque troupe assez considérable pour avoir une enseigne. Les bandes ou montres militaires d’autrefois, étoient ce que nous appellons présentement des compagnies.
Ainsi dans nos historiens, les vieilles bandes signifient les anciens régimens, les troupes aguerries. Il y est aussi parlé des bandes noires, soit que leurs enseignes fussent noires, soit qu’elles portassent des écharpes de cette couleur, comme c’étoit autrefois la mode dans les armées pour distinguer les divers partis. (G)
Bande (Hist. mod.) ordre militaire en Espagne, institué par Alphonse XI, roi de Castille, l’an 1332. Il prend son nom de banda, bande, ou ruban rouge, passé en croix au-dessus de l’épaule droite, & au-dessous au bras gauche du chevalier. Cet ordre n’étoit que pour les seuls cadets des maisons nobles. Les aînés des grands en sont exclus ; & avant que d’y être admis, il falloit nécessairement avoir servi dix ans au moins, soit à l’armée ou à la cour. Ils étoient tenus de prendre les armes pour la défense de la foi catholique contre les infideles. Le roi étoit grand maître de cet ordre, qui ne subsiste plus. (G)
Bande, s. f. (Gramm.) c’est en général un morceau de drap, de toile, de fer, de cuivre & de toute autre matiere, dont la largeur & l’épaisseur sont peu considérables relativement à la longueur.
Le mot bande présente assez ordinairement à l’esprit, l’idée d’attache & de lien ; cependant ce n’est pas là toûjours la destination de la bande.
Les termes bande, lisiere, barre, peuvent être considerés comme synonymes ; car ils désignent une idée générale qui leur est commune, beaucoup de longueur sur peu de largeur & d’épaisseur : mais ils sont différentiés par des idées accessoires. La lisiere indique longueur prise ou levée sur les extrémités d’une piece ou d’un tout ; bande, largeur prise dans la piece, avec un peu d’épaisseur ; barre, une piece ou un tout même, qui a beaucoup de longueur sur peu de largeur avec quelqu’épaisseur. Ainsi on dit la lisiere d’un drap ; une bande de toile ; une barre de fer.
Bandes de Jupiter (en Astronomie) sont deux bandes qu’on remarque sur le corps de Jupiter, & qui ressemblent à une ceinture ou baudrier. V. Jupiter.
Les bandes ou ceintures de Jupiter sont plus brillantes que le reste de son disque, & terminées par des lignes paralleles. Elles ne sont pas toûjours de la même grandeur, & elles n’occupent pas toûjours la même partie du disque.
Elles ne sont pas non plus toûjours à la même distance : il semble qu’elles augmentent & diminuent alternativement. Tantôt elles sont fort éloignées l’une de l’autre ; tantôt elles paroissent se rapprocher : mais c’est toûjours avec quelque nouveau changement. Elles sont sujettes à s’altérer de même que les taches du Soleil : une tache très-considérable que M. Cassini avoit apperçue sur Jupiter en 1665, ne s’y conserva que près de deux années. Elle parut pendant tout ce tems immobile au même endroit de la surface. On en détermina pour lors la figure, aussi bien que la situation par rapport aux bandes. Elle disparut enfin en 1667, & ne reparût que vers l’an 1672, où l’on continua de l’appercevoir pendant trois années consécutives. Enfin elle s’est montrée & cachée alternativement ; de maniere qu’en 1708, on comptoit depuis 1665 huit apparitions completes. C’est par les révolutions de cette tache observées un grand nombre de fois, qu’on a découvert le tems de la révolution de Jupiter autour de son axe.
Il est vraissemblable que la terre que nous habitons est dans un état plus tranquille & bien différent de celui de Jupiter ; puisque l’on observe dans la surface de cette planete des changemens, tels qu’il en arriveroit sur notre globe, si l’Océan par exemple changeant de lieu venoit à se répandre indifféremment sur toutes les terres, ensorte qu’il s’y formât de nouvelles mers, de nouvelles îles, & de nouveaux continens. Inst. astr. de M. le Monnier.
M. Huyghens a aussi découvert une espece de bande fort large dans la planete de Mars, qui est beaucoup plus foncée que le reste du disque, dont elle n’occupe que la moitié. (O)
Bandes (en Architecture) se dit des principaux membres des architraves, des chambranles, impostes & archivoltes, qui pour l’ordinaire ont peu de saillie & de hauteur sur une grande étendue. On les nomme aussi fasce, du latin fascia, dont Vitruve se sert pour exprimer la même chose. Voyez Plate-bande.
On donne encore, dans les édifices bâtis de brique, le nom de bande aux bandeaux de cette matiere qui sont aux pourtours, ou dans les trumeaux des croisées.
On dit aussi bande de colonne, lorsqu’on veut parler du bossage dont on orne quelquefois le nud des ordres rustiques, comme aux colonnes du Luxembourg pointillées ou vermiculées ; à celles du vieux Louvre ; aux colonnes taillées d’ornemens de peu de relief, comme aux galeries du même palais du côté de la riviere. Voyez Bossages. (P)
Bande (en terme de Marine) signifie côté.
Bande du nord, c’est-à-dire le côté du nord, ou latitude septentrionale.
Bande du sud, ou latitude méridionale.
Bande se dit encore du côté ou flanc du vaisseau : avoir son vaisseau à la bande, mettre son vaisseau à la bande, c’est le faire pancher sur un côté appuyé d’un ponton, afin qu’il présente l’autre flanc quand on veut le nettoyer, ou lui donner le radoub, le braier, & étancher quelque voie d’eau.
Tomber à la bande, c’est tomber sur le côté.
Bande de Sabords (terme de Marine) c’est toute une rangée de sabords sur le côté du vaisseau.
Bande, ou litre de toile goudronnée, qu’on met quelquefois sur les coutures d’un vaisseau.
Bande (en termes de Chirurgie) est une ligature beaucoup plus longue que large, qui sert à tenir quelque partie du corps enveloppée & serrée, pour la maintenir dans un état sain, ou le lui procurer.
La bande consiste en trois parties, le corps & les deux extrémités, que quelques-uns appellent tétes ou chefs ; & d’autres, queues. Il y a des bandes à un seul chef, c’est-à-dire, qui ne sont roulées qu’à un bout, fig. 21. Pl. II. & d’autres à double chef, fig. 22. Pl. II.
De plus, il y en a qui sont roulées également, comme celles pour les fractures & les dislocations ; d’autres qui sont divisées en plusieurs chefs, comme celles pour la tête, le menton ; d’autres sont composées de plusieurs bandelettes unies & cousues ensemble, comme celles pour les testicules. Quelques-unes sont fort larges, comme celles pour la poitrine, le ventre, &c. d’autres étroites, comme celles pour les levres, les doigts, &c. Guidon conseille de faire la bande pour l’épaule, de six doigts de large ; celle pour la cuisse, de cinq ; celle pour la jambe, de cinq ; celle pour le bras, de trois ; & celle pour le doigt, d’un.
Il a deux sortes de bandes, les unes sont remedes par elles mêmes ; telles sont celles qui servent aux fractures simples, à réunir les plaies, arrêter les hémorrhagies, &c. Les autres ne sont que contentives, c’est-à-dire qu’elles ne servent qu’à contenir les médicamens. La matiere des bandes est ordinairement du linge médiocrement fin, un peu élimé. Les bandes doivent être coupées à droit fil, & n’avoir ni ourlet ni lisiere. Voyez Bandage. (Y)
Bande, (en Commerce.) petit poids d’environ deux onces dont on se sert en quelques endroits de la côte de Guinée pour peser la poudre d’or. Dictionn. du Commerce, tom. I. p. 818. (G)
Bande, en termes de Blason, armoirie formée par deux lignes tirées diagonalement ou transversalement, c’est-à-dire, depuis le champ de l’écusson à la droite, jusqu’au bas de la gauche, en représentation d’un baudrier ou d’une écharpe passée sur l’épaule.
La bande est une des dix pieces honorables ordinaires : elle occupe la troisieme partie du champ, lorsqu’il est chargé, & la cinquieme lorsqu’il est uni. Elle est quelquefois dentelée, engrelée, &c. les héraults d’armes parlent d’une bande dextre & d’une bande fenestre : une bande se divise en bandelette, qui est la sixieme du champ ; en jarretiere, qui est la moitié d’une bande ; en valeur, qui est le quart de la bande ; & en ruban, qui est la moitié de la valeur. Bande dextre est celle qui se nomme en terme propre & absolu bande, comme elle est définie plus haut : le mot dextre lui est annexé par l’usage, pour obvier à des méprises & la distinguer de la bande fenestre, qui est ce que les héraults d’armes François appellent barre. Voy. Barre. (V)
Bande d’une selle, se dit en Manége de deux pieces de fer plates, larges de trois doigts, cloüées aux arçons pour la tenir en état. Mettre un arçon sur bande, c’est cloüer les deux bouts de chaque bande à chaque côté de l’arçon. Outre ces deux grandes bandes, l’arçon de devant en a une petite appellée bande du garot, avec un croissant pour tenir en état l’arcade du garot. L’arçon de derriere a aussi une petite bande pour le fortifier. (V)
Bande de derriere, en Bourserie, c’est une bande de cuir attachée aux deux bouts de la cartouche en-dessous, par laquelle on passe une autre bande de cuir qui sert à porter la cartouche. V. Cartouche.
Bande, chez les Imprimeurs, sont deux grandes tringles de bois de quatre piés & demi de long, sur trois pouces de large, recouvertes de lames de fer poli, ou à arrête, placées dans le milieu du berceau de la presse, & sur lesquelles roule le train. V. Berceau de presse .
Bandes de toises, dans les Salines, & particulierement à Moyenvic, ce sont des cercles de fer par lesquels le haut des poelles est ceint & terminé.
Bande de tour, terme de Pâtisserie, long morceau de pâte que les Pâtissiers nomment ainsi parce qu’il se met autour d’une tourte ou d’une autre piece, pour en contenir les parties intérieures ou supérieures.
Bande se dit encore en Pâtisserie d’un petit cordon de pâte qu’on étend en croix sur une tourte, & dont on forme plusieurs petits quarreaux qui servent d’agrémens à la piece.
Bandes de Billard, terme de Paumier ; ce sont quatre grandes tringles de bois rembourées de lisieres de drap, & recouvertes de morceaux de drap vert qui y sont attachés avec des clous de cuivre : on fixe ces bandes sur les bords de la table du billard par-dessus le tapis, avec des vis qui entrent dans la table ; ces bandes sont rembourées d’une maniere bien ferme, afin de renvoyer les billes qui viennent y frapper.
BANDÉ, adj. (en Blason.) terme qui convient à l’écusson également partagé en bandes : si les partitions sont en nombre impair, il faut d’abord nommer le champ, ensuite le nombre de bandes. Voyez Bande & Parti bandé. Miolans en Savoye, bandé d’or & de gueules. (V)
BANDEAU, s. m. (en Architecture.) plate-bande unie qui se pratique autour des croisées ou arcades d’un bâtiment où l’on veut éviter la dépense, & qui differe des chambranles en ce que ceux-ci sont ornés de moulures, & que les bandeaux n’en ont point, à l’exception quelquefois d’un quart de rond, d’un talon ou d’une feillure, que l’on introduit sur l’arrête du tableau de ces mêmes portes ou croisées. (P)
* Bandeau, s. m. c’est (en Art milit.) le nom d’une des pieces de la ferrure de l’affut du canon, appliquée sur le flasque à l’endroit de la croce dont elle imite le cintre. Elle sert à fortifier cette partie de l’affut. Voyez à l’article Canon le détail & les proportions des parties de l’affut. Dans celui d’une piece de huit livres de balles, le bandeau peut avoir 6 piés 9 pouces 6 lignes, de largeur 3 pouces 4 lignes, & d’épaisseur 3 lignes.
Bandeau, s. m. les ouvriers qui exécutent des couronnes de souverains, de quelque maniere que ce soit, entendent par le bandeau la partie de la couronne qui la termine circulairement par en-bas, & qui ceint le front de celui qui la porte : ainsi, Planche derniere de la Serrurerie en ornemens, la partie de couronne qq qu’on voit chargée de diamans, est le bandeau de la couronne.
Bandeau, en Menuiserie, est une planche mince & étroite qui est au pourtour des lambris par le haut, & qui tient lieu de corniche lorsqu’il n’y en a point.
BANDELETTE, s. f. (en Architecture.) moulure plate qui a ordinairement autant de saillie que de hauteur, comme celle qui couronne l’architrave toscan & dorique, & qui se nomme filet ou listeau, selon la place qu’elle occupe dans les corniches ou autres membres d’architecture. (P)
BANDER un arc (terme d’Architecture) ou une plate-bande, c’est en assembler les voussoirs & claveaux sur les cintres de charpente, & les fermer avec la clé.
On dit aussi bander un cable, en faisant tourner le treuil d’un gruau ou la roue d’une grue pour élever une pierre. (P)
Bander une voile ; c’est (en Marine) coudre à la voile des morceaux de toile de travers ou diagonalement, afin qu’elle dure plus long-tems. (Z)
Bander, v. act. en terme de Bijoutier, c’est redresser une moulure, par exemple, en la bandant au banc sans la tirer avec violence. Voyez Banc.
Bander, v. act. en terme de Pâtissier, c’est garnir une tourte de plusieurs petits cordons en croix.
Bander le semple, dans les Manufactures en soie & boutiques des Passementiers, c’est donner aux cordes du semple une tension telle qu’on puisse prendre librement les cordes que le lacs amene.
Bander, v. n. terme de Fauconnerie ; on dit de l’oiseau qui se tient sur les chiens faisant la cresserelle, cet oiseau bande au vent.
Bander une balle à la paume, c’est enlever une balle en mouvement ou arrêtée, & l’envoyer dans les filets.
Bander les dames au trictrac, c’est les charger ou en trop mettre sur la même fleche. Voyez Fleche.
* Bander, (Géog.) ville du Mogolistan en Asie, dans le royaume & sur le golfe de Bengale, près de Chatigan, & à l’embouchure la plus orientale du Gange.
* Bander-Abassi, ou Gomron, (Géog.) ville maritime d’Asie dans la province de Kerman en Perse, sur le golfe d’Ormus. Long. 75. lat. 27.
* Bander-Congo, (Géog.) ville maritime d’Asie en Perse, sur le golfe Persique, dans la province de Farsistan.
BANDIER, terme usité en quelques Coûtumes, dans la même signification que banal. Voyez Banal. (H)
BANDINS, s. m. pl. (en Marine.) ce sont les lieux où l’on s’appuie quand on est debout dans la poupe, & qui sortent, outre la longueur du corps, d’environ une toise pour soûtenir avec les grandes consoles une espece de banc fermé par-dehors de petits balustres, qu’ils nomment jalousie de mestre de poupe, & d’une piece figurée à jour qu’ils nomment couronnement. V. dans la Planche III. fig. 2. la lettre C qui marque les bandins. (Z)
BANDO, ou AZMER, voyez Azmer.
BANDOIR, s. m. c’est ainsi que les Passementiers appellent le bâton qui passe dans la noix du bandage du battant. Voyez Bandage.
BANDOULIERE, s. f. (Art milit.) est un large baudrier de cuir passé par-dessus l’épaule droite, & pendant en bas au-dessous du bras gauche, porté par les anciens mousquetaires, tant pour soûtenir leurs armes à feu, que pour le port de leurs cartouches ; lesquelles étant mises dans de petits étuis de bois, couverts de cuir, étoient pendues au nombre de 12 à chaque bandouliere.
Le mot est originairement François, bandouiller, formé apparemment de bandoulier, une sorte de bandits infestans particulierement les Pyrénées ; lesquels étoient autrefois distingués par cette piece de fourniture, & étoient eux-mêmes ainsi dénommés, quasi ban de voliers, un bande de voleurs.
Les cavaliers portent encore la bandouliere de même que les soldats. Ces bandoulieres sont de buffle : celles des premiers ont deux pouces de largeur, & celles des autres seulement un pouce & demi.
Les gardes du corps du Roi portent aussi la bandouliere ; & lorsqu’ils sont à cheval, ils y attachent leur mousqueton ou leur carabine. Cette bandouliere est toute unie & sans devise. Le fond est d’argent, parce que la couleur blanche a toûjours été la couleur Françoise, soit dans les drapeaux, soit dans les écharpes : c’est pourquoi la bandouliere de la compagnie Ecossoise, qui est la plus ancienne, est de blanc ou d’argent plein. Quand les autres compagnies furent instituées, on ajoûta une autre couleur à chacune pour les distinguer. La premiere & plus ancienne de ces compagnies, dont M. le duc de Villeroy est aujourd’hui capitaine, a le verd ajoûté à l’argent ; celle dont M. le duc de Luxembourg est capiraine, a le jaune avec l’argent ; & celle de M. le duc de Charost, a le bleu avec l’argent. Daniel, hist. de milice Françoise. Ce sont les Ceinturiers qui font & vendent les bandoulieres. (Q)
* BANDURA, (Hist. nat. bot.) plante Indienne qui ressemble à la gentiane par sa graine & par son fruit ; mais particulierement remarquable par une gaîne & follicule qui a la figure d’un penis, de plus d’un pié de long, & plus gros que le bras. Elle est attachée à l’arbre, & est à moitié pleine d’une liqueur agréable à boire. Sa racine est astringente ; ses feuilles rafraîchissent & humectent ; le suc qu’on en tire, pris intérieurement, peut soulager dans les fievres ardentes ; & appliqué extérieurement, guérir les érésipeles & les autres éruptions inflammatoires.
* BANÉE, (Géog. sainte.) ville de la Palestine dans la tribu de Dan sur les confins de celles de Juda & de Benjamin.
* BANGOR, (Géog.) ville d’Angleterre dans la principauté de Galles au comté de Carnarvan, sur le détroit de Menay, vis-à-vis l’île d’Anglesey. Long. 13. 4. lat. 53. 14.
* BANGUE ou chanvre des Indes, (Hist. nat. bot.) Acosta dit que cette plante ressemble beaucoup à notre chanvre ; que sa tige est haute de cinq palmes, quarrée, d’un verd clair, difficile à rompre, & moins creuse que celle du chanvre ; qu’on peut tiller, préparer & filer son écorce, & qu’elle a la feuille du chanvre.
Il ajoûte que les Indiens en mangent la graine & les feuilles pour s’exciter à l’acte vénérien.
Prise en poudre avec l’areca, l’opium & le sucre, elle endort ; avec le camfre, le macis, le girofle & la muscade, elle fait rêver agréablement ; avec l’ambre gris, le musc & le sucre en électuaire, elle réveille.
Elle croît dans l’Indostan & autres contrées des Indes orientales.
* BANIALUCH ou BAGNALUC, ville de la Turquie en Europe, capitale de la Bosnie, sur les frontieres de la Dalmatie, proche la riviere de Setina. Long. 35. 20. lat. 44. 20.
BANIANS ou BANJANS, s. m. pl. (Hist. ecclés.) secte d’idolatres répandus dans l’Inde, mais principalement dans le Mogol & dans le royaume de Cambaye. Ils croyent qu’il y a un Dieu créateur de l’univers : mais ils ne laissent pas que d’adorer le diable qui est, disent-ils, créé pour gouverner le monde & faire du mal aux hommes. Ils le représentent sous une figure effroyable dans leurs mosquées, où leur bramine ou prêtre se tient assis auprès de l’autel, & se leve de tems en tems pour faire quelques prieres, & marquer au front ceux qui ont adoré le diable. Il leur fait une marque jaune, en les frottant d’une composition faite d’eau & de bois de sandal, avec un peu de poudre de riz broyé.
Leur dogme principal est la métempsycose ; aussi ils ne mangent & même ils ne vendent point de chair des animaux, de poisson, en un mot de tout ce qui a eu vie, dans la crainte de vendre un corps dans lequel pourroit avoir passé l’ame de leur pere. Ils se font même un point de religion & un très-grand mérite de délivrer les animaux des mains de ceux qui veulent les tuer.
La purification du corps est leur cérémonie la plus essentielle : c’est pourquoi ils se lavent tous les jours jusqu’aux reins, tenant à la main un brin de paille que le bramine leur donne pour chasser le malin esprit ; & pendant cette cérémonie, le bramine les prêche. Ils regardent tous les hommes d’une religion différente de la leur comme impurs, & craignent tellement d’avoir communication avec eux, que si ceux-ci viennent à boire dans leur tasse ou simplement à la toucher, les Banians la brisent ; & qu’ils tarriroient une fontaine ou tout autre réservoir, dans lequel un Mahométan ou un Juif, &c. se seroient baignés : lors même qu’ils se touchent les uns les autres, il faut qu’ils se purifient avant que d’entrer chez eux, de manger, &c. Ils portent pendue à leur cou, une pierre nommée tamberan, percée par le milieu, & suspendue par trois cordons. Cette pierre qui est de la grosseur d’un œuf, représente, disent-ils, leur grand Dieu ; ce qui les rend fort respectables à la plûpart des Indiens. Les Banians sont divisés en quatre-vingts-trois castes ou sectes principales, sans compter les autres moins considérables qui se multiplient presqu’à l’infini ; parce qu’il n’y a presque point de famille qui n’ait ses superstitions & ses cérémonies particulieres. Les quatre premieres sectes auxquelles toutes les autres se rapportent, sont celles de Ceurawath, de Samarath, de Brinow, & de Gocghi. Voyez Ceurawath, Brinow , &c. Mandeslo, tom. II. d’Olearius. (G)
* BANISTERE, s. f. (Hist. nat. bot.) plante Américaine dont la fleur est en papillon, & fait place à une semence unie, semblable à celle de l’érable. Millet en distingue cinq especes : elles aiment les lieux chauds, les bois, & s’attachent aux arbres & aux autres plantes. Quelques-unes ont quatre à cinq piés de haut ; d’autres s’élevent à huit, dix, douze, quatorze. Si elles ne rencontrent point d’appui, elles se rompent. Les trois premieres especes sont communes dans les bois de la Jamaïque : les deux autres ont été trouvées aux Indes occidentales, proche Carthagene.
BANLIEUE, terme de Jurispr. est une lieue à l’entour de la ville, au-dedans de laquelle se peut faire le ban, c’est-à-dire, les proclamations de la ville, & jusqu’où s’étend l’échevinage & justice d’icelle. (H)
* BANNASSES, s. f. pl. c’est ainsi qu’on appelle dans les Salines, des civieres dont se servent les socqueurs pour porter les cendres du fourneau au cendrier. Voyez Planche IV. fig. 28. une bannasse. Cette machine n’a pas besoin de description.
BANNE, s. f. (Commerce.) grande toile ou couverture qui sert à couvrir quelque chose, à la garantir du soleil, de la pluie ou autres injures de l’air.
Les marchandes Lingeres appellent aussi banne une toile de cinq ou six aunes de long, & d’environ trois quarts de large, qu’elles attachent sous l’auvent de leur boutique, & qui leur sert comme de montre.
Banne, qu’on nomme aussi manne & mannette, est un grand panier d’osier fendu, plus long que large, & de peu de profondeur, qui sert à emballer certaines sortes de marchandises.
Banne se dit d’une grande toile dont on couvre les bateaux de grains ou de drcgues, d’épiceries & d’autres marchandises, pour les préserver du mauvais tems.
Banne est encore la piece de toile que les rouliers & autres voituriers par terre mettent sur les balles, ballots & caisses qu’ils voiturent, pour les conserver. (G)
Banne, s. f. voiture dont en se sert pour transporter le charbon. Elle est à deux roues : la partie antérieure de son fond s’ouvre & se ferme ; se ferme tant qu’on veut conserver la voiture pleine ; s’ouvre quand on veut la vuider. Ses côtés sont revêtus de planches, vont en s’évasant, & forment une espece de boîte oblongue, plus ouverte par le haut que par le bas, de quatre à quatre piés & demi de long sur deux piés à deux piés & demi de large par le bas, & trois piés à trois piés & demi de large par le haut, & sur environ deux piés de hauteur perpendiculaire. Voyez Pl. de charbon, la banne ABCD, & le développement de son fond & de son derriere, EFGHIKLM.
Banne. Voyez Bache.
BANNEAU, est quelquefois la même chose, ou un diminutif de la banne ; quelquefois c’est une mesure des liquides, & quelquefois un vaisseau propre à les transporter. On s’en sert de cette derniere espece pour porter la vendange ; & les Vinaigriers qui courent la campagne, ont aussi des banneaux, dont deux sont la charge d’un cheval : ceux-ci sont couverts par-dessus, & ont en bas une canelle ou robinet pour tirer le vinaigre. Banneau est aussi le nom de tinettes de bois, qu’on met des deux côtés d’un cheval de bât ou autre bête de somme, pour transporter diverses sortes de marchandises : il contient environ un minot de Paris.
BANNERETS ou CHEVALIERS BANNERETS, s. m. pl. (Hist. mod. & Art. mil.) étoient autrefois des gentilshommes puissans en terre & en vassaux, avec lesquels ils formoient des especes de compagnies à la guerre. On les appelloit bannerets, parce qu’ils avoient le droit de porter banniere.
Il falloit pour avoir cette prérogative, être non-seulement gentilhomme de nom & d’armes, mais avoir pour vassaux des gentilshommes qui suivissent la banniere à l’armée sous le commandement du banneret. Ducange cite un ancien cérémonial manuscrit, qui marque la maniere dont se faisoit le chevalier banneret, & le nombre d’hommes qu’il devoit avoir à sa suite.
« Quand un bachelier, dit ce cérémonial, a grandement servi & suivi la guerre, & que il a terre assez, & qu’il puisse avoir gentilshommes ses hommes & pour accompagner sa banniere, il peut licitement lever banniere, & non autrement ; car nul homme ne doit lever banniere en bataille, s’il n’a du moins cinquante hommes d’armes, tous ses hommes & les archiers, & les arbelestriers qui y appartiennent ; & s’il les a, il doit à la premiere bataille où il se trouvera, apporter un pennon de ses armes, & doit venir au connétable ou aux maréchaux, ou à celui qui sera lieutenant de l’ost, pour le prince requérir qu’il porte banniere ; & s’ils lui octroyent, doit sommer les hérauts pour témoignage, & doivent couper la queue du pennon, &c. » Voyez Pennon. Lors des chevaliers bannerets, le nombre de la cavalerie dans les armées s’exprimoit par celui des bannieres, comme il s’exprime aujourd’hui par celui des escadrons.
Les chevaliers bannerets, suivant le P. Daniel, ne paroissent dans notre histoire que sous Philippe-Auguste. Ils subsisterent jusqu’à la création des compagnies d’ordonnance par Charles VII. alors il n’y eut plus de bannieres, ni de chevaliers bannerets : toute la gendarmerie fut mise en compagnies reglées. Voy. Compagnies d’ordonnance & Hommes d’armes ; voyez aussi Noblesse. (Q)
BANNETON, s. m. chez les Boulangers, est une espece de panier d’osier sans ances, rond, & revêtu en-dedans d’une toile. On y met lever le pain rond. Voyez Planche du Boulanger, fig. 3.
Banneton, est une espece de cofre fermant à clé, que les pêcheurs construisent sur les rivieres pour y pouvoir garder leur poisson. Il est percé dans l’eau & sert de réservoir. On dit aussi bascule ou boutique.
BANNETTE, espece de panier, fait de menus brins de bois de chataignier, fendus en deux & entrelacés les uns dans les autres, qui sert à mettre des marchandises pour les voiturer & transporter. Souvent on se sert de deux bannettes pour les marchandises qui sont un peu de conséquence : on en met une dessous, & l’autre dessus qu’on nomme la coeffe ; quelquefois on ne se sert que d’une bannette avec une toile par-dessus.
Bannette, est encore un terme usité parmi les Boucaniers François, pour signifier un certain nombre de peaux de taureaux, bouvarts, vaches, &c. La bannette contient ou deux taureaux, ou un taureau & deux vaches, ou quatre vaches, ou trois bouvarts, autrement trois jeunes taureaux. On appelle ces cuirs bannettes, à cause de la maniere dont ils sont pliés.
BANNIE, s. f. signifie en quelques coûtumes, publication. On dit en Normandie banon dans le même sens.
Banni se dit aussi dans quelques coûtumes adjectivement, & signifie publié ou crié en justice. C’est en ce sens qu’on dit, une terre bannie, une espave bannie. (H)
* BANNIERES, s. f. (Jurispr.) registres distingués de ceux des audiences, pour l’enregistrement de toutes les ordonnances & lettres patentes adressées au Châtelet, & pour tous les autres actes dont la mémoire doit être conservée à la postérité. Ils ont été commencés en 1461 par Robert d’Etouteville, prevôt de Paris : on les a continués ; on en étoit en 1722 au treizieme volume. C’est l’une des attributions du greffier des Insinuations, qui a été créé depuis ce tems, d’en être le dépositaire & d’en délivrer des expéditions.
Banniere, s. f. terme de Marine. Voy. Pavillon. Le mot de banniere n’est en usage que dans quelques cantons de la Méditerranée, où l’on dit la banniere de France, la banniere de Venise, pour dire le pavillon de France, le pavillon de Venise. Mettre les perroquets en banniere. Voyez Perroquet. (Z)
BANNIMUS, (Hist. mod.) mot de la basse Latinité, qui exprime dans l’université d’Oxford l’expulsion d’un membre qui a mérité cette peine. On affichoit dans un carrefour ou autre endroit public, la sentence d’expulsion, à ce que nul n’en prétendît cause d’ignorance.(G)
BANNISSEMENT, s. m. (Jurisprud.) est un exil ordonné par un jugement en matiere criminelle, contre un accusé convaincu.
Le bannissement est ou perpétuel ou à tems.
Lorsqu’il est perpétuel, il équivaut à la déportation qui étoit en usage chez les Romains ; il emporte la mort civile, & conséquemment confiscation de biens.
Mais quand il n’est qu’à tems, il répond à peu près à la relégation des Romains ; il ne fait point perdre au banni les droits de citoyen, & n’emporte point la confiscation de ses biens.
La peine du banni, qui ne garde point son ban, est la condamnation aux galeres. (H)
* BANNOCHBURN ou BANNOCHRON (Géog.) petite ville d’Ecosse, à deux milles de Sterling, sur une riviere de même nom.
BANQUE, s. f. (Commerce.) nous réunirons sous ce titre plusieurs expressions & termes de commerce usités dans le trafic de la banque, comme avoir un compte en banque, avoir crédit en banque, ouvrir un compte en banque, donner crédit en banque, écrire une partie en banque, créditer quelqu’un en banque, écritures de banque.
Avoir un compte en banque, c’est y avoir des fonds & s’y faire créditer ou débiter, selon qu’on veut faire des payemens à ses créanciers en argent, ou en recevoir de ses débiteurs en argent de banque, c’est-à-dire, en billets ou écritures de banque.
Avoir crédit en banque, c’est être écrit sur les livres de la banque, comme son créancier ; & y avoir débit, c’est en être débiteur.
Ouvrir un compte en banque, c’est la premiere opération que font les teneurs de livres d’une banque, lorsque les particuliers y portent des fonds pour la premiere fois.
Donner crédit en banque ; c’est charger les livres de la banque des sommes qu’on y apporte, ensorte qu’on fait débiter sa caisse, c’est-à-dire, qu’on la rend débitrice à ceux qui y déposent leur fonds.
Ecrire une partie en banque ; c’est faire enregistrer dans les livres de la banque, le transport mutuel qui se fait par les créanciers & les débiteurs des sommes ou de portions des sommes qu’ils ont en banque, ce qu’on appelle virement de parties. Voyez Virement.
Créditer quelqu’un en banque, c’est le rendre créancier de la banque ; le débiter, c’est l’en rendre débiteur.
Ecritures de banque ; ce sont les diverses sommes pour lesquelles les particuliers, marchands, négocians & autres, se sont fait écrire en banque.
Banque d’emprunt, en Hollandois bankvanleeninge ; c’est une espece de mont de piété établi à Amsterdam, où l’on préte de l’argent aux particuliers qui en ont besoin, moyennant qu’ils y déposent des gages pour la surêté des sommes prêtées, & qu’ils payent l’intérêt reglé à tant par mois par les bourguemestres ou échevins ; c’est ce qu’on appelle plus communément la maison des lombards, ou le lombard. Voyez Lombard.
Banque (Commerce.) se dit encore de certaines sociétés, villes ou communautés, qui se chargent de l’argent des particuliers pour le leur faire valoir à gros intérêts, ou pour le mettre en sûreté.
Il y a plusieurs especes de banques etablies dans les plus grandes villes commerçantes de l’Europe, comme à Venise, Amsterdam, Rotterdam, Hambourg, Londres, Paris, &c.
On peut voir ce que nous avons dit sous le mot Banco, de celle de Venise, sur le modele de laquelle les autres ont été formées, & dans le Dictionnaire du Commerce, de Savary, les détails dans lesquels il entre sur les banques d’Amsterdam & de Hambourg, aussi-bien que sur celle qui fut érigée en France en 1716, par le sieur Law & compagnie, sous le nom de banque générale, convertie en banque royale en 1718, & dont les billets, qui avoient monté à la somme de deux milliards six cens quatre-vingts-seize millions quatre cents mille livres, furent supprimés par arrêt du conseil du 10 Octobre 1720. Nous ne parlerons ici que de la banque royale d’Angleterre & de la banque royale de Paris, sur le pié qu’elles subsistent aujourd’hui, & ce que nous en dirons est emprunté du même auteur.
Banque royale d’Angleterre ; elle a les mêmes officiers que l’échiquier. Voyez Echiquier. Le parlement en est garant ; c’est lui qui assigne les fonds nécessaires pour les emprunts qu’elle fait sur l’état.
Ceux qui veulent mettre leur argent à la banque en prennent des billets, dont les intérêts leur sont payés, jusqu’au jour du remboursement, à raison de six pour cent par an.
Les officiers de la banque royale font publier de tems en tems les payemens qu’ils doivent faire, & pour lors ceux qui ont besoin de leur argent le viennent recevoir. Il est cependant permis aux particuliers d’y laisser leurs fonds, s’ils le jugent à propos, & les intérêts leur en sont continués sur le même pié de six pour cent par an.
Comme il n’y a pas toûjours des fonds à la banque pour faire des payemens, ceux qui, dans le tems que la caisse de la banque est fermée, ont besoin de leur argent, négocient leurs billets à plus ou moins de perte, suivant le crédit que ces papiers ont dans le public, ce qui arrive ordinairement suivant les circonstances & le bon ou mauvais succès des affaires de l’état.
Banque royale de Paris est celle qui fut établie en cette ville par arrêt du conseil du 4 Décembre 1718, dont le fonds ne pouvoit passer six cens millions. On appelloit en France bureaux de la banque royale, les lieux où se faisoient les diverses opérations de cette banque, les payemens & les viremens de parties, soit en débit, soit en crédit, pour ceux qui y avoient des comptes ouverts. Les principaux de ces bureaux, après ceux de Paris, furent placés à Lyon, à la Rochelle, Tours, Orléans, & Amiens. Il y avoit deux caisses dans chaque bureau ; l’une en argent pour acquitter à vûe les billets, & l’autre en billets pour fournir de l’argent à ceux qui en demandoient.
« Dans les états qui font le commerce d’œconomie, dit l’auteur de l’esprit des Loix, on a heureusement établi des banques qui, par leur crédit, ont formé de nouveaux signes des valeurs : mais on auroit tort de les transporter dans les états qui font le commerce du luxe. Les mettre dans des pays gouvernés par un seul, c’est supposer l’argent d’un côté & de l’autre la puissance, c’est-à-dire, la faculté de tout avoir sans aucun pouvoir, & de l’autre le pouvoir sans aucune faculté ». Esprit des Loix, tom. II. pag. 7.
Les compagnies & les banques achevent d’avilir l’or & l’argent dans leur qualité de signe, en multipliant par de nouvelles fictions, les représentations des denrées.
Banque, trafic, commerce d’argent qu’on fait remettre de place en place, d’une ville à une autre, par des correspondans & commissionnaires, par le moyen des lettres de change.
Le mot banque vient de l’Italien banca, formé de l’Espagnol banco, un banc sur lequel étoient assis les changeurs, ou banquiers, dans les marchés ou places publiques, ou d’une table sur laquelle ils comptoient leur argent, & qu’on nomme aussi en Espagnol banco. Guichard fait venir le nom de banque du Latin abacus, table, buffet. Voyez Abaque.
Il n’est pas nécessaire en France, d’être marchand pour faire la banque ; elle est permise à toutes sortes de personnes, même aux étrangers. En Italie, le commerce de la banque ne déroge point à la noblesse, particulierement dans les républiques.
Un négociant qui fait la banque, & qui veut avoir de l’ordre, doit tenir deux livres principaux ; l’un, appellé livre des traites, pour écrire toutes les lettres de change qu’il tire sur ses correspondans ; & l’autre, nommé livre des acceptations, sur lequel il doit écrire par ordre de date, les lettres de change qu’il est obligé d’acquitter, en marquant le nom du tireur, la somme, le tems de l’échéance & les noms de ceux qui les lui ont présentées.
Banque, se dit aussi du lieu où les banquiers s’assemblent pour exercer leur trafic ou commerce ; on nomme ce lieu différemment, selon les pays : à Paris, c’est la place du change ; à Lyon, le change ; à Londres & à Rouen, la bourse ; à Marseille, la loge, &c. (G)
Banques à sel ; ce sont des greniers sur les frontieres de la Savoie, voisines de la France, où l’on débite du sel aux faux-sauniers François, à raison de quatre sous la livre, argent de France, poids de Geneve, qui est de dix-huit onces à la livre, pendant que les Savoyards le payent quatre sous de Piémont. La livre de Piémont n’est que de douze onces, ce qui fait neuf deniers de plus sur l’argent, & un tiers sur le poids, qui vaut un sou sept deniers, c’est-à-dire, deux sous quatre deniers sur le tout ; ainsi la différence est de plus de moitié. C’est une des suites des traités par lesquels la France s’est obligée à fournir à la Savoie jusqu’à la concurrence de 45 à 50 mille minots conduits & rendus dans les différens endroits indiqués par les traités.
La France fournit encore 5000 quintaux de sel de Peccais à la ville de Geneve, 6000 à la ville de Valais, & 1522 à la ville de Sion : mais aucun de ces pays ne fait, du bienfait du roi, un usage contraire à sa destination, & les quantités se consomment dans le pays, soit par besoin, soit par bonne-foi.
Banque, se dit chez les Imprimeurs, du payement qu’on fait du travail aux ouvriers de l’Imprimerie ; le jour de la banque est le samedi : on entend aussi par banque, la somme entiere que chaque ouvrier reçoit.
Banque, chez les Passementiers, est l’instrument propre à porter les rochets, ou bobines, pour ourdir : il y a des banques de plusieurs sortes ; les unes, outre cet usage, ont encore celui de pouvoir servir de plioir ; d’autres ressemblent assez à ces porte-vaisselles appellés dressoirs, & ont, ou peuvent avoir, double rang de broches ; les premieres auroient aussi cet avantage si on perçoit des trous paralleles dans la largeur des trois petites planchettes qui sont vûes droites dans nos planches de Passementerie, où sont représentées les deux sortes de banques dont nous venons de parler. En pratiquant ces trous paralleles, on auroit la facilité de mettre tant de rochets en banque que l’on voudroit. On a, dans les mêmes planches, une troisieme sorte de banque ; c’est une espece de poteau quarré dont la largeur n’est pas absolument déterminée, puisque si l’on vouloit y mettre deux rangs de broches, il faudroit qu’il fût plus épais que lorsqu’il n’y en auroit qu’un rang ; on fait entrer dans ce poteau le bout pointu de ces broches, de sorte qu’elles y demeurent invariables : on les place parallelement les unes aux autres ; on en peut mettre tant qu’il en pourra tenir, en laissant toutefois une distance telle que les bords des deux rochets ne se puissent toucher ; sans cette précaution ils s’empêcheroient mutuellement de se mouvoir, ou mettroient au moins les soies en danger de casser. Dans le cas où ces bords de rochets, ou bobines, se trouveroient trop hauts, & que ce frottement fût inévitable, il faudroit pour lors espacer davantage les broches les unes des autres, en laissant une place vuide entre deux, on trouveroit ainsi l’espace dont on avoit besoin : mais à quoi bon cette grande quantité de broches, dira-t-on ? lorsqu’on aura lû à l’article Ourdir, que l’on n’ourdissoit qu’avec seize rochets ; il ne faut donc, continuera-t-on, que seize broches, ou tout au plus trente-deux, ce qui n’exposera plus au frottement qu’on craignoit. Quoique la regle générale soit d’ourdir à seize rochets, ou tout au plus à trente-deux, comme le pratiquent plusieurs ouvriers qui par-là avancent plus vîte de moitié, façon de travailler qui doit être peu suivie, parce qu’il est bien plus difficile de veiller sur trente-deux rochets que sur seize, & par conséquent plus facile d’échapper un brin, ou même plusieurs qui viennent à casser : je n’en serai pas moins pour la quantité de broches à cette banque ; car au même article Ourdir, à l’endroit où il est question des rubans rayés, on voit qu’il faut, suivant le besoin, changer de couleur. En supposant qu’on eût quatre couleurs à employer, & qu’il y eut soixante-quatre broches à la banque, on auroit quatre couleurs sous la main toutes fois qu’il faudroit qu’on en changeât : d’abord deux sur la même face, ayant seize broches de chaque côté, puis en retournant la banque, encore deux autres. On voit que ces broches ne sont pas posées horisontalement, mais qu’au contraire le bout extérieur est plus élevé que l’autre, en voici la raison : si les broches étoient paralleles à l’horison, les rochets, par la vîtesse avec laquelle ils se meuvent, (car il faut qu’ils fassent bien des tours pendant que le moulin de l’ourdissoir n’en fait qu’un) seroient en danger de s’échapper des broches, inconvénient que l’on évite par l’inclinaison des broches : étant ainsi placées, il est bon d’ajuster à chacune un moule de bouton, qui, par sa convexité, empêchera que le rochet ne frotte en tant de parties contre la face platte du poteau ; la planche d’en bas, qui lui sert de base, est revêtue des quatre côtés de triangles, ce qui la rend propre à contenir les rochets, vuides ou pleins, qu’on y veut mettre.
Banque, partie du bois de métier d’étoffe de soie. C’est un plateau de noyer de deux pouces environ d’épaisseur, d’un pié de largeur, & deux piés de long, dans lequel est enclavé le pié de devant le métier ; ce plateau sert à reposer les navettes pendant que l’ouvrier cesse de travailler, & il retient le tenant de l’ensuple de devant. Voyez à l’article Velours cizelé, l’explication détaillée des pieces du métier.
Banque, (en terme de Tabletier Cornetier.) est une espece de banc triangulaire & à trois piés, sur lequel l’ouvrier en peignes travaille à califourchons, & qui a les mêmes parties, & le même usage que l’âne. Voyez Ane, machine, description & figure.
Banque, (Commerce.) c’est ainsi qu’on nomme à certains jeux, comme à celui du commerce, les cartes qui restent après qu’on en a donné à tous les joüeurs le nombre qu’exige le jeu. La banque s’appelle à d’autres jeux, talon, ou fond. Voyez Talon & Fond.
BANQUÉ, adj. (en Marine.) quelques-uns appellent ainsi un navire qui va pêcher la morue sur le grand banc.
On dit aussi qu’on est banqué, pour dire qu’on est sur le grand banc ; & debanqué, lorsqu’on a quitté le banc.
BANQUEROUTE, s. f. (Commerce.) est l’abandonnement qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers pour cause d’insolvabilité vraie ou feinte ; car il y a deux sortes de banqueroutes, la banqueroute forcée, & la frauduleuse.
La banqueroute forcée, qu’on appelle plus proprement faillite, est celle que fait nécessairement un Marchand pour raison des pertes qui l’ont rendu insolvable. Voyez Faillite.
La banqueroute volontaire ou frauduleuse, qu’on appelle aussi simplement banqueroute, est celle qui se fait avec fraude & malice ; l’insolvabilité du débiteur n’étant qu’apparente, & les effets qu’il abandonne à ses créanciers n’étant qu’une partie de son bien, dont il s’est réservé le reste.
La banqueroute frauduleuse est mise au rang des crimes : mais ce crime demeure souvent impuni, parce que les créanciers aiment mieux traiter avec le banqueroutier, & lui faire des remises, que de perdre toute leur dette ; & dès qu’ils sont d’accord, la justice ordinairement ne s’en mêle plus. Voyez la peine que les lois décernent pour la banqueroute frauduleuse au mot Banqueroutier. (H)
BANQUEROUTIER, s. m. (Commerce.) est la qualification d’un marchand, banquier, ou autre particulier qui a fait banqueroute.
Toutes les ordonnances prononcent la peine de mort contre les banqueroutiers : mais dans l’usage elles ne sont point exécutées ; on se contente pour l’ordinaire de les attacher au pilori, & de les envoyer ensuite aux galeres. (H)
BANQUET, s. m. (en termes de coûtumes.) s’est dit autrefois du repas qu’un vassal étoit obligé de fournir à son seigneur une ou plusieurs fois l’année. (H)
Banquet, on appelle ainsi (en Manege & chez les Eperonniers.) la petite partie de la branche de la bride qui est au dessous de l’œil, qui est arrondie comme une petite verge, assemble les extrémités de l’embouchure avec la branche, & est cachée sous le chaperon ou le fonceau. Voyez Chaperon, Fonceau, &c. Ligne du banquet, est une ligne imaginaire que les éperonniers en forgeant un mors tirent le long du banquet, & qu’ils prolongent de part & d’autre de haut en bas, pour déterminer la force ou la foiblesse qu’ils veulent donner à la branche pour la rendre hardie ou flasque. La branche sera hardie, si le trou du touret est au-delà de la ligne du banquet, à l’égard de l’encolure ; & elle sera flasque ou foible, si le trou du touret est au-deçà de cette ligne à l’égard de l’encolure. Voyez B. fig. 22. Pl. de l’Eperonnier. Voyez Branche, Touret, &c. (V)
BANQUETTE, s. f. (en Architecture.) est un petit chemin relevé pour les gens de pié le long d’un quai ou d’un pont, & même d’une rue, à côté du chemin des chariots & voitures, comme les banquettes du cours à Rome, & celle du pont-neuf, du pont-royal, & d’autres à Paris. Les Romains appelloient decursoria, toutes sortes de banquettes.
On appelle aussi banquettes, des appuis de pierre de 14 pouces de hauteur, pratiqués dans l’épaisseur des croisées & dans l’intérieur des appartemens ; on s’y assied, & ils reçoivent en dehors des balcons de fer, dont la hauteur réunie avec la banquette de pierre, doit être celle du coude pour s’y appuyer commodément. Voyez Appui.
Banquette est encore le balcon qui pose sur cet appui ; le nom de balcon ne se donnant qu’à ceux qui occupent toute la hauteur depuis le dessus du parquet jusques au sommet desdits balcons. (P)
Banquette, (en terme de Fortification.) est une espece de petit degré de terre que l’on construit sur le rempart des ouvrages & sur le chemin couvert au pié du côté intérieur du parapet : il sert à élever le soldat pour qu’il puisse tirer par-dessus le parapet.
La banquette a ordinairement 3 ou 4 piés de largeur, avec un talud de même étendue ; elle est élevé de 2 piés sur le terre-plein du rempart. Lorsqu’on est obligé d’élever le parapet de plus de 6 piés & demi ou 7 piés pour se garantir de l’enfilade, on construit alors deux banquettes, qui font deux especes de degrés. Le parapet a toûjours 4 piés & demi de hauteur au-dessus du terre-plein de la banquette supérieure. (Q)
Banquette, (en Hydraulique.) est un sentier construit des deux côtés de la cuvette ou rigole d’un aqueduc pour y pouvoir marcher & examiner si l’eau s’arrête ou se perd en quelque endroit : on donne ordinairement 18 pouces de large à ces sortes de banquettes. (K)
Banquette, (en Jardinage.) se dit des palissades basses à hauteur d’appui, qui ne doivent point passer ordinairement 3 ou 4 piés de haut ; elles servent dans les côtés des allées doubles, où étant ainsi ravalées, elles n’interrompent point le coup d’œil entre la tige des arbres. On y laisse quelquefois d’espace en espace des boules échappées de la banquette même. (K)
Banquette, partie du metier d’étoffes de soie ; la banquette est un morceau de bois de 6 pouces de large & d’un pouce d’épaisseur ; il sert à l’ouvrier pour s’asseoir quand il veut travailler ; il fait entrer chaque bout de sa banquette dans l’oreillon cloüé à cet effet au pié de devant le métier. Il seroit mieux que l’oreillon ou porte-banquette, ne fût point cloüé, mais qu’il fût à coulisse, pour que l’ouvrier le haussât ou baissât suivant sa taille ; il seroit encore à propos qu’il pût avancer ou reculer la banquette.
Banquette, (en Menuiserie.) est une boisure qu’on pratique aux croisées. La tablette de dessus se nomme dessus de banquette ; & la partie de devant, devant de banquette.
BANQUIER, s. m. (Commerce.) est celui qui fait la banque, c’est-à-dire, négociant, commerçant ou trafiquant en argent, qui fait des traites & remises d’argent, qui donne des lettres de change pour faire tenir de place en place ; c’est proprement un marchand d’argent. Les Anglois les appellent remitters, ceux qui font des remises. On les nommoit autrefois changeurs. Voyez Changeur & Remise.
Il y avoit autrefois des especes de banquiers chez les Romains, dont les fonctions étoient beaucoup plus étendues que celles de nos banquiers ; car ils étoient officiers publics, & tout à la fois agens de change, courtiers, commissionnaires, notaires, se mêlant d’achats & de ventes, & dressant tous les écrits & actes nécessaires pour tous ces divers objets.
La différence du profit qu’il y a à tirer par une place ou par une autre, fait l’art & l’habileté particuliere des nôtres. Voyez l’article Change. « Les banquiers sont faits pour changer de l’argent, & non pour en prêter. Si le prince ne s’en sert que pour changer son argent, comme il ne fait que de grosses affaires, le moindre profit qu’il leur donne pour leurs remises devient un objet considérable ; & si on lui demande de gros profits, il peut être sûr que c’est un défaut de l’administration : quand au contraire ils sont employés à faire des avances, leur art consiste à se procurer de gros profits de leur argent sans qu’on puisse les accuser d’usure ». Esprit des loix, tom. II. P. 71.
Les Banquiers ou Expéditionnaires en cour de Rome, (Hist. mod. & Droit canon.) sont des officiers qui font venir de Rome ou de la légation d’Avignon toutes les bulles, dispenses, provisions, & autres expéditions que le Pape s’est réservé d’accorder seul. Voyez Expéditionnaire. (H)
Banquier, (terme de Jeu.) c’est celui qui taille au pharaon, à la bassette, &c. & qui dans ces jeux a toûjours de l’avantage : les autres joüeurs s’appellent ponte. Voyez Pharaon, Bassette, Ponte. (O)
* BANSE, s. m. (en Chauderonnerie.) longue manne quarrée faite de branches d’osier ou de châtaigner à l’usage des Chauderonniers : c’est dans des banses qu’ils enferment & transportent leurs ouvrages.
* BANTAM, (Géog.) ville d’Asie aux Indes, dans l’île de Java, capitale du royaume de même nom, divisée en deux parties par une riviere. Long. 123. 3. lat. mérid. 6. 20.
* BANTON, (Géog.) île d’Asie dans l’Océan oriental : c’est une des Philippines, située vers la partie méridionale de l’île Manille.
* BANTRI, ou BANTREI, ville maritime de la province de Mommonie en Irlande, au sud-ouest : elle donne son nom à la baie.
BANVIN, s. m. terme de Coûtume ; c’est une sorte de droit de banalité qui donne pouvoir au seigneur de vendre le vin de son cru avant qu’aucun de ses vassaux commence à débiter le sien, pourvû qu’il le vende en sa maison seigneuriale, & non ailleurs. (H)
BANZA, voyez S. Salvador.
* BAOBAB, ou HAHOBAB, (Hist. nat. bot.) fruit d’Afrique de la grosseur du limon, semblable à la courge, & renfermant des semences, dures, noires, & arcuées par les bouts ; il a la pulpe de la courge, rouge, humide, & d’une acidité agréable, quand elle est récente. Il est bon à manger ; & dans l’Ethiopie on en corrige l’acidité avec le sucre ; il rafraîchit & desaltere : les Ethiopiens le prennent dans toutes les maladies de chaleur, les fievres putrides, & les affections pestilentielles ; alors ou l’on mange sa pulpe avec du sucre, ou l’on boit le suc qu’on en tire par expression, tempéré par le sucre ; ou l’on en fait un sirop dont on prend une dose convenable. Au grand Caire, où l’on ne peut l’avoir dans sa fraîcheur, on réduit sa pulpe en une poudre qui ressemble à de la terre rougeâtre, astringente, & d’un goût qui n’est pas éloigné de celui de la terre de Lemnos. On use de cette poudre dans les fievres pestilentielles, le crachement de sang, les lienteries, les dyssenteries, le flux hépatique, & l’excès des regles : on ordonne alors une dragme de cette terre dans l’eau de plantain ; d’autres la font prendre dans des décoctions ou des infusions appropriées. Prosper Alpin, qui fait mention du fruit, dit avoir vû l’arbre, & l’avoir trouvé assez ressemblant à l’oranger par la grosseur, les feuilles, & le reste de son aspect.
* BAPAUME, (Géog.) ville de France dans l’Artois. Long. 20. 30. 52. lat. 50. 6. 12.
BAPTÊME, s. m. (Théol.) sacrement par lequel on est fait enfant de Dieu & de l’Eglise, & qui a la vertu d’effacer le péché originel dans les enfans, & les péchés actuels dans les adultes.
Le mot baptême en général signifie lotion, immersion, du mot Grec βάπτω, ou βαπτίζω, je lave, je plonge ; & c’est en ce sens que les Juifs appelloient baptême certaines purifications légales qu’ils pratiquoient sur leurs prosélytes après la circoncision. On donne le même nom à celle que pratiquoit S. Jean dans le desert à l’égard des Juifs, comme une disposition de pénitence pour les préparer, soit à la venue de J. C. soit à la réception du baptême que le Messie devoit instituer, & dont le baptême de S. Jean étoit absolument différent, par sa nature, sa forme, son efficace, & sa nécessité, comme le prouvent les Théologiens, contre la prétention des Luthériens & des Calvinistes.
Le baptême de l’Eglise chrétienne est appellé dans les Peres de plusieurs noms relatifs à ses effets spirituels, comme adoption, renaissance, régénération, remission des péchés, renouvellement de l’esprit, vie éternelle, indulgence, absolution ; & par les Grecs, tantôt παλιγγενεσια ψυχῆς, régénération de l’ame, & tantôt χρῖσμα, onction ; soit à cause de celles qu’on y pratique, soit parce qu’il nous consacre à J. C. quelquefois φωτίσμα, & φωτίσμος, illumination, σφραγὶς, signe ou marque ; & par les Latins salut, mystere, sacrement. Cyprian. Augustin. Tertull. Cyrill. Justin. Chrysost. Clem. Alex. Euseb. Ambros. &c.
La définition que nous avons donnée au commencement de cet article ne convient donc au baptême, qu’entant qu’il est le premier des sacreméns de la loi nouvelle : sa matiere éloignée est l’eau naturelle, comme de riviere, de fontaine, de pluie, &c. par conséquent toute autre liqueur, soit artificielle, soit même naturelle, telle que le vin, ne peut être employée comme matiere dans ce sacrement ; & les exemples qu’on cite au contraire, ou sont apocryphes, ou partoient d’une ignorance grossiere, justement condamnée par l’Eglise. Voyez Matiere.
Sa forme dans l’Eglise Greque consiste en ces paroles : baptisatur servus vel serva Dei N in nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti ; & dans l’Eglise Latine, le prêtre en versant de l’eau naturelle sur la tête de la personne qu’il baptise, la nomme d’abord par le nom que lui ont donné ses parrein & marreine, & prononce ces mots : ego te baptiso, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus sancti, amen. Cette forme étant pleinement exprimée dans les Ecritures, Mat. ch. xxviij. vers. 19. & attestée par les écrits des plus anciens Auteurs ecclésiastiques, il s’ensuit que tout baptême conféré sans une appellation ou invocation expresse des trois personnes de la sainte Trinité, est invalide. La doctrine des conciles y est formelle, sur-tout celle du premier concile d’Arles tenu en 314 ; & l’Eglise a mis une grande distinction entre les hérétiques, qui dans leur baptême conservoient ou corrompoient cette forme ; se contentant à l’égard des premiers, lorsqu’ils revenoient dans son sein, de les recevoir par la cérémonie de l’imposition des mains, & réitérant aux autres le baptême, ou plûtôt leur donnant le sacrement qu’ils n’avoient jamais reçû. Voyez Rebaptisans.
Le baptême a été rejetté totalement par plusieurs anciens hérétiques des premiers siecles, tels que les Ascodrutes, les Marcosiens, les Valentiniens, les Quintilliens, qui pensoient tous que la grace qui est un don spirituel, ne pouvoit être communiquée ni exprimée par des signes sensibles. Les Archontiques le rejettoient comme une mauvaise invention du Dieu Sebahoth, c’est-à-dire, du Dieu des Juifs, qu’ils regardoient comme un mauvais principe. Les Seleuciens & les Hermiens ne vouloient pas qu’on le donnât avec de l’eau : mais ils y employoient le feu, sous prétexte que S. Jean-Baptiste avoit assûré que le Christ baptiseroit ses disciples dans le feu. Les Manichéens & les Pauliciens le rejettoient également, aussi bien que les Massaliens. Le nombre des hérétiques qui ont altéré ou corrompu la forme du baptême, n’est pas moindre : Menandre baptisoit en son propre nom : les Eluséens y invoquoient les démons ; les Montanistes y joignoient le nom de Montan leur chef, & de Priscille leur prophétesse, aux noms sacrés du Pere & du Fils. Les Sabelliens, les Marcosiens, les disciples de Paul de Samosate, les Eunomiens, & quelques autres hérétiques ennemis de la Trinité, ne baptisoient point au nom des trois Personnes divines ; c’est pourquoi l’Eglise rejettoit leur baptême : mais, comme nous l’avons dit, elle admettoit celui des autres hérétiques, pourvû qu’ils n’altérassent point la forme prescrite, quelles que fussent d’ailleurs leurs erreurs sur le fond des mysteres.
La discipline de l’Eglise sur la maniere d’administrer ce sacrement, n’a pas toûjours été la même : autrefois on le donnoit par une triple immersion ; & cet usage a duré jusqu’au xiie siecle. Il est vrai que dans le vie quelques Catholiques d’Espagne s’en tenoient à une seule immersion, de peur, disoient-ils, que les Ariens n’imaginassent que par la triple immersion ils divisoient la Trinité à l’exemple de ces hérétiques : mais cette raison frivole ne changea généralement rien à l’ancien usage. Celui de baptiser par infusion, ou en versant l’eau sur la tête, commença, selon quelques-uns, dans les pays septentrionaux, & s’introduisit en Angleterre vers le ixe siecle. Le concile de Calchut ou de Celchyth, tenu en 816, ordonna que le prêtre ne se contenteroit pas de verser de l’eau sur la tête de l’enfant, mais qu’il la plongeroit dans les fonts baptismaux.
Les Ecrivains ecclésiastiques parlent de plusieurs cérémonies qu’on pratiquoit au baptême, qui sont aujourd’hui abolies, ou dont il ne reste que de légeres traces ; comme de donner aux nouveaux baptisés du lait & du miel dans l’Eglise d’orient ; & dans celle d’occident, du miel & du vin, de les revêtir d’une robe blanche, &c. de ne baptiser qu’à jeûn, de donner immédiatement après le baptême la confirmation & l’eucharistie, &c.
Les Théologiens distinguent trois sortes de baptême ; le baptême d’eau, dont nous venons de parler ; le baptême de feu, c’est-à-dire, la charité parfaite jointe à un ardent desir d’être baptisé, c’est ce qu’on appelle aussi le baptême du S. Esprit, qui supplée au baptême d’eau ; & le baptême de sang, c’est-à-dire, le martyre. On ne baptisoit autrefois les catéchumenes qu’à Pâque & à la Pentecôte, excepté en cas de nécessité.
Le ministre ordinaire du baptême est l’évêque ou le prêtre : mais en cas de nécessité toutes personnes, même les femmes, peuvent baptiser.
Quelques-uns ont prétendu que dans la primitive Eglise on ne baptisoit que les adultes : mais c’est sans fondement ; car quoiqu’on n’ait point dans l’Ecriture de textes précis qui marquent que des enfans ont été baptisés, & que quelques anciens peres, comme Tertullien, fussent persuadés que de baptiser les enfans avant qu’ils eussent atteint l’âge de raison, c’étoit les exposer à violer les engagemens de leur baptême ; & qu’ainsi il étoit de la prudence & de la charité de n’admettre à ce sacrement que les adultes : il est néanmoins certain 1°. que les Apôtres ont baptisé des familles entieres, dans lesquelles il est très-probable qu’il se trouvoit des enfans : 2°. que la pratique actuelle de l’Eglise à cet égard est fondée sur la tradition des Apôtres, comme l’assûre S. Augustin, après S. Irénée & S. Cyprien. Ce dernier sur-tout consulté par l’évêque Fidus, s’il ne seroit pas à propos de fixer le tems du baptême des enfans au huitieme jour après leur naissance, comme celui de la circoncision l’étoit chez les Juifs, en conféra avec soixante-cinq autres évêques assemblés en concile à Carthage en 253, & répondit à Fidus : Quod tu putabas esse faciendum, nemo consentit : sed universi potius judicavimus, nulli hominum nato misericordiam Dei & gratiam denegandam. Quelqu’autorisée que fût cette pratique dans les premiers siecles de l’Eglise, il faut convenir qu’elle n’étoit pas généralement observée à l’égard de tous les enfans des fideles : les catéchumenes même différoient plusieurs années à recevoir le baptême. L’histoire ecclésiastique nous apprend que S. Ambroise ne fut baptisé qu’après avoir été élû évêque de Milan. On sait que l’empereur Constantin ne reçut ce sacrement qu’à l’article de la mort, & qu’il eut en cela bien des imitateurs d’un nom illustre dans l’Eglise. Plusieurs differoient ainsi leur baptême le plus long-tems qu’ils pouvoient, mais par des motifs très-différens ; les uns par un esprit d’humilité, dans la crainte de n’être pas assez bien disposés pour recevoir dignement ce premier sacrement ; les autres pour mener plus librement une vie déréglée, se flattant d’en obtenir le pardon à la mort par l’efficace du baptême. Les Peres s’éleverent avec tant de force contre les fausses raisons & le danger des délais dont on usoit pour recevoir si tard le baptême, qu’ils réussirent peu-à-peu à etablir l’usage qui subsiste aujourd’hui.
Quoique Jesus-Christ soit venu dans le monde pour ouvrir à tous les hommes la voie du salut, cependant il étoit d’usage & de regle dans la primitive Eglise de refuser le baptême à certaines personnes engagées dans des conditions ou professions notoirement criminelles, comme incompatibles avec la sainteté du Christianisme ; à moins qu’elles ne renonçassent à cette profession ou à cet état. De ce nombre étoient les sculpteurs, fondeurs, ou autres ouvriers qui faisoient des idoles ; les femmes publiques, les comédiens, les cochers, gladiateurs, musiciens, ou autres qui gagnoient leur vie à amuser le public dans le cirque ou l’amphithéatre ; les astrologues, devins, magiciens, enchanteurs, ceux qui étoient adonnés aux crimes contre nature, ceux-mêmes qui étoient tellement passionnés pour les représentations des jeux & du théatre, qu’ils refusassent de s’en abstenir dès qu’ils auroient embrassé la religion ; les concubinaires, ceux qui tenoient des lieux de débauche ; quelques-uns même ont crû qu’on n’y admettoit pas les gens de guerre : mais l’histoire ecclésiastique ne laisse aucun doute que les Chrétiens n’ont pas confondu une profession utile & honorable par elle-même, avec des arts ou des conditions réprouvées par la raison même. Bingham, orig. eccles. liv. XI. ch. v. §. 6. 7. 8. 9. 10.
On convient aujourd’hui qu’on ne doit pas baptiser les enfans des infideles, même soûmis à la domination des princes Chrétiens, malgré leurs parens, à moins que ces enfans ne soient en danger évident de mort ; parce que cette violence est contraire au droit naturel qu’ont les peres & les meres sur leurs enfans ; & que d’ailleurs elle exposeroit le sacrement à une profanation certaine, par l’apostasie à laquelle ces peres & meres engageroient leurs enfans.
Quelques-uns ont crû qu’on devoit conférer le baptême aux morts, & même qu’on pouvoit le recevoir à leur place, fondés sur ce passage de S. Paul aux Corinthiens I. epit. ch. xv. vers. 30. alioquin quid facient qui baptisantur pro mortuis, si mortui non resurgunt : ut quid & baptisantur pro illis ? passage sans doute mal entendu, & qui à la lettre ne signifie autre chose, sinon qu’on peut pratiquer en mémoire des morts des œuvres de pénitence qui leur obtiennent la rémission des péchés qu’ils n’ont pas suffisamment expiés en cette vie : car le mot de baptême, dans un sens général & usité dans l’Ecriture, signifie quelquefois la pénitence, les afflictions & les souffrances. Ainsi dans S. Luc, Jesus-Christ parlant de sa passion, l’appelle un baptême : ch. xij. vers. 50. baptismo habeo baptisari ; & dans S. Marc, ch. x. vers. 38. potestis . . . . baptismo quo ego baptisor baptisari. (G)
Bapteme du tropique ou de la ligne, (en Marine.) c’est une cérémonie ridicule, mais d’un usage ancien & inviolable parmi les gens de mer, qui la pratiquent bien régulierement sur ceux qui passent pour la premiere fois le tropique ou la ligne équinoctiale.
Chaque nation s’y prend diversement, & même les équipages d’une même nation l’exercent en différentes manieres. Voici celle qui est la plus ordinaire parmi les équipages François.
Pour préparatifs, on met une baille au pié du grand mât pleine d’eau de la mer ; le pilote pour l’ordinaire se met auprès, le visage barbouillé, le corps revêtu & tout entortillé de garcettes, dont quelques-unes lui pendent des bras. Il est accompagné de cinq ou six matelots habillés de même : il tient entre ses mains un livre de cartes marines tout ouvert ; aux environs il y a des matelots avec des seaux pleins d’eau ; il y en a sur les vergues & sur les hunes. On amene celui qui doit être baptisé en grande cérémonie ; on le fait asseoir sur une planche tenue aux deux bouts par deux matelots, & posée sur la baille pleine d’eau ; on lui fait jurer sur le livre que tient le pilote, de pratiquer sur les autres la même cérémonie, lorsque l’occasion s’en trouvera ; & dans l’instant les deux matelots renversent la planche, & font tomber l’homme dans la baille ; en même tems ceux qui sont à la hune & sur les vergues lui jettent plusieurs seaux d’eau sur le corps. Les officiers & les passagers se rachettent d’une si ridicule cérémonie, en donnant quelque argent aux équipages : mais on ne fait point de grace à ceux qui ne donnent rien. On demande cependant permission au capitaine pour faire le baptême.
Un vaisseau qui n’a point encore passé la ligne ou le tropique, y est soûmis : mais le capitaine le rachette par quelques rafraîchissemens qu’il donne aux gens de l’équipage, autrement ils couperoient l’éperon ou quelque autre partie du vaisseau : mais aujourd’hui beaucoup de capitaines abolissent cette ridicule cérémonie. (Z)
* BAPTES, (les) Hist. litt, nom d’une comédie composée par Cratinus, où ce poëte railloit d’une façon sanglante les principaux personnages du gouvernement. Lorsque Cratinus composa ses baptes ou plongeurs, la liberté de l’ancienne comédie étoit restrainte à la censure des ridicules, & surtout des poëtes, que le gouvernement n’étoit point fâché qu’on décriât ; parce que de tout tems les hommes en place ont haï les satyriques & les plaisans. Cratinus fit un effort pour rendre à la scene comique les droits dont on l’avoit dépouillée : mais il fut la victime de sa hardiesse. Il éprouva le châtiment auquel on dit que M. de Montausier, l’homme de la cour qui avoit le moins a craindre de la satyre, condamnoit tous les satyriques. Il fut jetté dans la mer, piés & mains liés.
Baptes, s. m. pl. (Myth.) prêtres de Cottytto, déesse de l’impudicité fort révérée à Athenes, où l’on célébroit sa fête pendant la nuit par des danses lascives, accompagnées de toutes sortes de débauches. Les baptes furent ainsi nommés du mot Grec βάπτειν, qui signifie laver ou tremper, parce qu’ils se plongeoient dans de l’eau tiede, selon Suidas. Juvénal en parle comme d’une troupe d’hommes si infames, que leurs déréglemens déplaisoient à Cottytto, quoiqu’elle ne fût rien moins que la déesse de la pudeur. (G)
BAPTISTE, voyez Anabaptistes, Catabaptistes, Hemero-Baptistes.
Hermites de S. Jean-Baptiste, voy. Hermites. (G)
BAPTISTERE, s. m. (Théol.) c’est le lieu ou l’édifice dans lequel on conserve l’eau pour baptiser. V. Baptême.
Les premiers Chrétiens, suivant saint Justin martyr & Tertullien, n’avoient d’autres baptisteres que les fontaines, les rivieres, les lacs, ou la mer, qui se trouvoient plus à portée de leur habitation ; & comme souvent la persécution ne leur permettoit pas de baptiser en plein jour, ils y alloient de nuit, ou donnoient le baptême dans leurs maisons.
Dès que la religion Chrétienne fut devenue celle des empereurs, outre les églises, on bâtit des édifices particuliers uniquement destinés à l’administration du baptême, & que par cette raison on nomma baptisteres.
Quelques auteurs ont prétendu que ces baptisteres étoient anciennement placés dans le vestibule intérieur des églises, comme le sont aujourd’hui nos fonts baptismaux. C’est une erreur. Les baptisteres étoient des édifices entierement séparés des basiliques, & placés à quelque distance des murs extérieurs de celles-ci. Les témoignages de saint Paulin, de saint Cyrille de Jérusalem, de saint Augustin, &c. ne permettent pas d’en douter.
Ces baptisteres ainsi séparés ont subsisté jusqu’à la fin du vi. siecle, quoique dès lors on en voye déjà quelques-uns placés dans le vestibule intérieur de l’église, tel que celui où Clovis reçut le baptême des mains de saint Remy. Cet usage est ensuite devenu général, si l’on en excepte un petit nombre d’églises qui ont retenu l’ancien, comme celle de Florence, & toutes les villes épiscopales de Toscane, la métropole de Ravenne, & l’église de saint Jean de Latran à Rome.
Ces édifices pour la plûpart étoient d’une grandeur considérable, eu égard à la discipline des premiers siecles, le baptême ne se donnant alors que par immersion, & (hors le cas de nécessité) seulement aux deux fêtes les plus solemnelles de l’année, Pâque & la Pentecôte. Le concours prodigieux de ceux qui se présentoient au baptême, la bienséance qui demandoit que les hommes fussent baptisés séparément des femmes, demandoient un emplacement d’autant plus vaste, qu’il falloit encore y ménager des autels où les néophytes reçussent la confirmation & l’eucharistie immédiatement après leur baptême. Aussi le baptistere de l’église de sainte Sophie à Constantinople étoit-il si spacieux, qu’il servit d’asyle à l’empereur Basilisque, & de sale d’assemblée à un concile fort nombreux.
Les baptisteres avoient plusieurs noms différens, tels que ceux de Piscine, lieu d’illumination, &c. tous relatifs aux différentes graces qu’on y recevoit par le sacrement.
On trouve peu de choses dans les anciens auteurs sur la forme & les ornemens des baptisteres, ou du moins ce qu’on y en lit est fort incertain. Voici ce qu’en dit M. Fleury sur la foi d’Anastase, de Grégoire de Tours, & de Durand, dans ses Notes sur le pontifical attribué au pape Damase. « Le baptistere étoit d’ordinaire bâti en rond, ayant un enfoncement où l’on descendoit par quelques marches pour entrer dans l’eau ; car c’étoit proprement un bain. Depuis on se contenta d’une grande cuve de marbre ou de porphyre, comme une baignoire ; & enfin on se réduisit à un baffin, comme sont aujourd’hui les fonts. Le baptistere étoit orné de peintures convenables à ce sacrement, & meublé de plusieurs vases d’or & d’argent pour garder les saintes huiles & pour verser l’eau. Ceux-ci étoient souvent en forme d’agneaux ou de cerfs, pour représenter l’agneau dont le sang nous lave, & pour marquer le desir des ames qui cherchent Dieu, comme un cerf altéré cherche une fontaine, suivant l’expression du pseaume 41. On y voyoit l’image de saint Jean-Baptiste & une colombe d’or ou d’argent suspendue, pour mieux représenter toute l’histoire du baptême de Jesus-Christ, & la vertu du saint-Esprit qui descend sur l’eau baptismale. Quelques-uns même disoient le jourdain pour dire les fonts ». Mœurs des Chrétiens, tit. XXXVI. Ce qu’ajoûte Durand, que les riches ornemens dont l’empereur Constantin avoit décoré le baptistere de l’église de Rome, étoient comme un mémorial de la grace qu’il avoit reçûe par les mains du pape saint Sylvestre, est visiblement faux, puisqu’il est aujourd’hui démontré que ce prince fut baptisé à Nicomédie peu de tems avant sa mort.
Il n’y eut d’abord des baptisteres que dans les villes seules épiscopales ; d’où vient qu’encore aujourd’hui le rit Ambroisien ne permet point qu’on fasse la bénédiction des fonts baptismaux les veilles de Pâque & de Pentecôte, ailleurs que dans l’église métropolitaine, d’où les églises paroissiales prennent l’eau qui a été bénite pour la mêler avec d’autre, depuis qu’on leur a permis d’avoir des baptisteres ou fonts particuliers. Dans l’église de Meaux les curés de la ville viennent baptiser les enfans depuis le samedi saint jusqu’au samedi suivant sur les fonts de l’église cathédrale. C’est un droit attaché à chaque paroisse en titre & à quelques succursales : mais non pas à toutes celles-ci, non plus qu’aux chapelles & aux monasteres, qui, s’ils en ont, ne les possedent que par privilége & par concession des évêques.
On confond aujourd’hui le baptistere avec les fonts baptismaux. Anciennement on distinguoit exactement ces deux choses, comme le tout & la partie. Par baptistere, on entendoit tout l’édifice où l’on administroit le baptême ; & les fonts n’étoient autre chose que la fontaine ou le réservoir qui contenoit les eaux dont on se servoit pour le baptême. V. Fonts. (G)
* BAQUIER, s. m. (Comm.) c’est ainsi qu’on appelle à Smyrne du coton de basse qualité, dont la valeur n’est pas considérable, & qui ne s’y fabrique pas en grande quantité.
BAR, en terme de Bâtiment, est une espece de civiere avec laquelle des hommes portent des pierres ordinairement de peu de grosseur. Les ouvriers qui portent le bar se nomment bardeurs. Voyez Bardeur.
L’action de mettre la pierre sur le bar se nomme barder. Voyez Barder. (P)
* Le bar est composé de deux longues pieces de bois équarries & assemblées parallelement par quatre ou six traverses de deux piés de long ou environ. Ces traverses n’occupent que le milieu des pieces équarries, où elles forment un fond ou une grille sur laquelle on pose les fardeaux ; le reste des pieces équarries qui demeure isolé va en diminuant, est arrondi, se termine par une tête formant une coche ou un arrêt en-dessous, & sert de manche ou bras des deux côtés de la grille ou du fond. L’arrêt de la coche retient les bretelles des bardeurs, & les empêche de s’échapper des bras. Quand les poids sont lourds, deux ou quatre maneuvres se mettent aux bras, & deux autres passent encore un levier sous la grille : ces derniers s’appellent arbalétriers.
Pour garantir les arrêtes & autres formes délicates des pierres taillées ou sculptées, de l’impression des traverses, on couvre la grille de nattes. Ces nattes s’appellent torches.
* Bar, (Géog.) ville de Pologne, dans la Podolie, sur la riviere de Kow. Long. 46. lat. 49. 15.
* Bar, (duché de) Géog. contrée de France située des deux côtés de la Meuse, entre la Lorraine & la Champagne.
* Bar-le-duc, (Géog.) capitale du duché de Bar ; il y a haute & basse ville : celle-ci est sur la petite riviere d’Orney. Long. 23. lat. 48. 35.
* Bar-sur-Aube, (Géog.) ville de France en Champagne, capitale du Vallage. Long. 22. 20. lat. 48. 14.
* Bar-sur-Seine, (Géog.) ville de France, au duché de Bourgogne. Long. 22. lat. 48. 5.
* BARABA, (Géog.) grand lac d’Asie, au royaume de Sibérie, rempli d’un sel solide, que les Moscovites coupent comme de la glace.
* BARABINSI ou BARABINSKOI, subst. m. pl. (Géog.) peuples de la Tartarie, dans la partie méridionale de la Sibérie, tributaires de la Moscovie.
* BARACAQUE, s. m. (Hist. mod.) nom de secte & de religieux Japonois, dont la priere & la méditation est l’occupation continuelle.
* BARACH, (Géog. sainte.) ville de la Palestine, dans la tribu de Dan.
* BARACI, (Géog.) ville de l’île de Sardaigne, dont il ne reste que des ruines qu’on voit proche de Sassari.
* BARACOA, (Géog.) ville de l’Amérique, dans l’île de Cuba, avec un port, sur la côte septentrionale de l’île.
* BARAD, (Géog. sainte.) ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, proche la fontaine d’Agar.
* BARADAS, s. m. c’est, en terme de Fleuriste, un œillet rouge-brun, à fleur large, grosse, feuillue, & en dôme ; ni blanc, ni carné, à panaches gros & non détachés. On ne lui laisse que quatre à cinq boutons.
* BARAICUS ou BURAICUS, (Myth.) surnom qu’Hercule prit d’une ville d’Achaie, célebre par l’oracle de ce héros : la maniere dont se rendoit cet oracle, étoit singuliere. Après qu’on avoit fait sa priere dans le temple, on prenoit quatre dez ; on les jettoit au hasard ; les faces de ces dez étoient empreintes de figures hiéroglyphiques ; on remarquoit bien les figures amenées ; & l’on alloit ensuite en chercher l’interprétation sur un tableau où elles étoient expliquées. Cette interprétation passoit pour la réponse du dieu. Voyez à l’article Dé, en combien de façons quatre dez à six faces peuvent être combinés : vous trouverez 1296 ; l’oracle auroit dû avoir au tant de réponses ; mais il en avoit bien moins & il étoit facile que la question de celui qui s’adressoit à l’oracle, fût de celles dont la réponse n’étoit pas dans les dez : mais il falloit compter jusqu’à 1296, pour sentir l’impertinence de l’oracle, & le peuple ne sait pas compter si loin, & quand il le sauroit, il s’en feroit un scrupule.
*BARALIPTON, (Log.) nom par lequel on désigne le premier mode indirect d’argument de la premiere figure. Le syllogisme en baralipton, a les deux premieres propositions universelles affirmatives, & la troisieme particuliere affirmative. Voyez Syllogisme .
BARALLOTS, s. m. pl. (Théol.) nom qu’on donna à certains hérétiques qui parurent à Bologne en Italie, & qui mettoient tous leurs biens en commun, même les femmes & les enfans. Leur extrème facilité à se livrer aux plus honteux excès de la debauche, leur fit encore donner, selon Ferdinand de Cordoue, dans son traité de Exiguis annonis, le nom d’obéissans, obedientes. (G)
* BARAMPOUR, voyez Brampour.
* BARANCA DE MELAMBO, (la) Géog. ville de l’Amérique, dans la province de Sainte-Marthe, en terre-ferme, sur la riviere de la Magdeleine. Long. 306. lat. 11.
* BARANGE, s. f. c’est ainsi qu’on appelle dans les Salines, un mur d’environ trois piés de hauteur, placé en dedans du fourneau, entre les murs sur lesquels la poelle est posée : il sert à la séparation des bois & des braises.
BARANGES, s. m. pl. (Hist. anc.) officiers qui gardoient les clefs des portes de la ville où demeuroit l’Empereur de Constantinople. On prétend que ce mot est originairement Anglois, parce que ces gardes des clefs étoient pour l’ordinaire tirés des îles Britanniques. (G)
* BARANGUELIS, (le) Géog. anc. & mod. grand étang d’Egypte, que les Latins nomment stagnum magnum, Tenesæ sinus, Sorbonis Palus, sur les frontieres de la Terre-sainte, vers la côte de la Méditerranée ; on l’appelle le golfe de Tenese, le Grand-étang, ou Stagnone. Il avoit autrefois cent vingt mille pas ; il est aujourd’hui beaucoup moindre, & l’on conjecture qu’il se remplira.
* BARANCIA, (la) Géog. grande riviere de l’Amérique septentrionale, qui a sa source au Mexique, traverse le Méchoacan, le Gadalajara, la province de Xalisco, & se jette dans la mer Pacifique, à l’entrée de la mer Vermeille. Sanson l’appelle Esquitlan.
* BARANIWAR, (Géog.) petite ville de la basse Hongrie, au comté de même nom, entre Bude & Belgrade, sur le ruisseau de Crasso. Long. 36. 20. lat. 46.
* BARANOVA, (Géog.) petite ville de Pologne, dans la haute Wolhinie, sur la riviere de Slucks.
BARAQUE, s. f. (Architecture.) lieu construit de charpente, revêtue de planches de bateau, & couverte de dosses, & pratiquée près d’un grand attelier, ou dans un grand chantier, pour servir aux ouvriers de magasin pendant l’hyver, & de retraite pendant l’été. (P)
Baraque, s. f. (en Art milit.) est une hute ou petite loge pour des soldats dans un camp. Voyez Hute.
Ce mot vient de barracas en Espagnol, petite cabane que les Pêcheurs font sur le bord de la mer.
Celles pour la cavallerie étoient autrefois appelées baraques ; & celles pour l’infanterie, huttes : mais le terme baraque est à présent usité indifféremment pour les deux.
Pour faire les baraques, on fiche quatre perches fourchues en terre, & on en met quatre autres en travers ; ensuite on éleve les murailles avec des mottes de terre, des claies, ou tout ce que le lieu fournit de propre pour cela : le dessus est couvert de chaume ou de gason, selon la commodité qu’on en a. Quand l’armée est en quartier d’hyver, les soldats font ordinairement des baraques ; en été ils se contentent de leurs tentes. (Q)
* BARASA, (Géog. sainte.) ville de la Palestine, dans la tribu de Gad.
BARAT, s. m. (Commerce.) vieux mot François & hors d’usage, qui signifioit autrefois tromperie, fourbe, mensonge. C’est de barat que vient le terme de baraterie, dont il y a un titre dans les ordonnances de la Marine. (G)
BARATHRE, s. m. (Hist. anc.) gouffre, lieu très-profond dans l’Attique, où l’on avoit coûtume de précipiter les scélérats. Il étoit revêtu de pierre de taille, en forme de puits ; & dans le mur de revêtissement, on avoit scellé d’espace en espace, des crampons de fer crochus, dont quelques-uns avoient la pointe en haut, & d’autres de côté, pour accrocher & déchirer les criminels dans leur chûte. Ce nom chez les Grecs est encore commun à toute sorte de gouffres, d’abîmes, & de concavités de la terre. (G)
BARATTE, s. f. (Œconomie rustiq.) vaisseau fait de douves, plus étroit par en-haut que par en-bas, & qui sert à battre la crême dont on fait le beurre.
L’ouverture de la baratte se couvre avec une sebille troüée qui s’y emboîte, & par le trou de laquelle passe un long bâton qui sert de manche au bat-beurre.
Le bat-beurre est un cylindre de bois épais d’environ deux pouces, percé de plusieurs trous, & emmanché de plat au bout d’un long bâton ; les trous du cylindre servent à donner passage au lait de beurre à mesure que le beurre s’avance.
Ce sont les Tonneliers qui fabriquent & vendent les barattes ; & elles sont à l’usage des habitans de la campagne.
BARATTERIE, s. f. (Commerce.) malversation, tromperie. Voyez Barat.
Barratterie de Patron, (Commerce.) en termes de commerce de mer, signifie les larcins, déguisemens, & altérations de marchandises que peuvent causer le maître & l’équipage d’un vaisseau, & généralement toutes les supercheries & malversations qu’ils mettent assez souvent en usage pour tromper le marchand chargeur & autres intéressés.
On trouve dans l’ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681, liv. II. & III. les détails des différentes baratteries que peuvent commettre les patrons ou maîtres de vaisseau, & les peines decernées contr’eux dans ces occasions. (G)
* BARBA, (Géog.) petite ville du royaume d’Alger, en Barbarie.
BARBACANNE, s. f. (en Architecture.) c’est une ouverture étroite & longue en hauteur, qu’on laisse aux murs qui soûtiennent des terres, pour y donner de l’air, ou pour en faciliter l’entrée & la sortie des eaux ; on la pratique sur-tout lorsque l’on bâtit en des lieux sujets à l’inondation ; elle se nomme aussi canonniere & ventouse, & en latin colluviarium. (P)
Barbacanne, s. f. c’est ainsi qu’on appelle en Fortification, les ouvrages avancés d’une place ou d’une citadelle ; le principal usage de la barbacanne, est d’être le boulevard des portes ou des murailles. Voyez Défense.
Ce nom rend le promurale, ante murale, murus exterior des Romains, & ce que les François nomment contre-mur. Il dénote aussi un fort à l’entrée d’un pont ou à la sortie d’une ville, avec une double muraille, comme celle que l’on voit à Roüen à l’un des bouts de son pont de bateaux. C’est pourquoi plusieurs lui donnent encore le nom de barbacanne. Il étoit d’usage aussi pour signifier une ouverture des murailles, par où l’on tire des coups de mousquet sur l’ennemi ; mais on ne s’en sert plus à présent. Voyez Créneau & Embrasure. (Q)
* BARBADE, (Géog.) ile de l’Amérique, & l’une des Antilles. Long. 318. 40. lat. 13. 20.
* BARBANÇON, (Géog.) principauté dans le Hainault.
* BARBANDA, (Géog. anc.) ville jadis considérable de la haute Egypte ; il n’en reste plus que quelques ruines entre Girgio & Asna.
* BARBARA, (Log.) terme par lequel on désigne le premier mode d’argument de la premiere figure : un syllogisme en barbara a ses trois propositions universelles affirmatives. Voyez Syllogisme.
* BARBARCA, (Hist. nat. bot.) plante qui pousse plusieurs tiges à la hauteur d’un pié & demi, branchues, creuses, plus petites que celles de la rave, & ayant quelque ressemblance à celles du cresson, vertes, noirâtres & luisantes ; ses fleurs sont petites, jaunes, à quatre feuilles disposées en croix. Il leur succede de petites gousses tendres, rondes & longues, qui contiennent des semences rougeâtres : sa racine est oblongue, mediocrement grosse, & d’un goût acre. Elle croît dans les champs, & on la cultive dans les potagers.
Elle contient du sel essentiel & de l’huile ; elle est détersive & vulnéraire ; elle excite l’urine ; elle est salutaire dans le scorbut, les maladies de la rate & la néphrétique.
BARBARES, (Philosophie.) adj. c’est le nom que les Grecs donnoient par mépris à toutes les nations, qui ne parloient pas leur langue, ou du moins qui ne la parloient pas aussi-bien qu’eux. Ils n’en exceptoient pas même les Egyptiens, chez lesquels ils confessoient pourtant que tous leurs philosophes & tous leurs législateurs avoient voyagé pour s’instruire. Sans entrer ici avec Brucker, dans les différentes étymologies de ce terme, ni sans examiner s’il est composé du bar des Arabes, qui signifie desert, ou s’il est derivé du terme par lequel les Chaldéens rendent le foris ou l’extra des Latins ; je remarquerai seulement que dans la suite des tems, les Grecs ne s’en servirent que pour marquer l’extrème opposition qui se trouvoit entr’eux & les autres nations, qui ne s’étoient point encore dépouillées de la rudesse des premiers siecles, tandis qu’eux-mêmes, plus modernes que la plûpart d’entr’elles, avoient perfectionné leur goût, & contribué beaucoup aux progrès de l’esprit humain. Ainsi toutes les nations étoient réputées barbares, parce qu’elles n’avoient ni la politesse des Grecs, ni une langue aussi pure, aussi féconde, aussi harmonieuse que celle de ces peuples. En cela ils furent imités par les Romains, qui appelloient aussi barbares tous les autres peuples, à l’exception des Grecs, qu’ils reconnoissoient pour une nation savante & policée. C’est à peu-près comme nous autres François, qui regardons comme grossier tout ce qui s’éloigne de nos usages. Les Grecs & les Romains étoient jaloux de dominer plus encore par l’esprit, que par la force des armes, ainsi que nous voulons le faire par nos modes.
Lorsque la religion Chrétienne parut, ils n’eurent pas pour elle plus de ménagement qu’ils en avoient eu pour la philosophie des autres nations. Ils la traiterent elle-même de barbare ; & sur ce pié ils oserent la mépriser. C’est ce qui engagea les premiers Chrétiens à prendre contre les Grecs & les Romains, la défense de la Philosophie barbare. C’étoit un détour adroit dont ils se servoient pour les accoûtumer peu-à-peu à respecter la religion Chrétienne, sous cette enveloppe grossiere qui leur en deroboit toute la beauté, & à lui soûmettre leur science & leur orgueil. Tatien de Syrie, & disciple de S. Justin, leur a prouvé qu’ils n’avoient rien inventé d’eux-mêmes, & qu’ils étoient redevables à ces mêmes hommes, qu’ils traitoient de barbares, de toutes les connoissances dont ils étoient si fort enorgueillis. « Quelle est, leur réprochoit-il malignement, la science parmi vous, qui ne tire son origine de quelqu’étranger ? Vous n’ignorez pas que l’art d’expliquer les songes, vient de l’Italie ; que les Cariens se sont les premiers avisés de prédire l’avenir par la diverse situation des astres ; que les Phrygiens & les Isauriens se sont servis pour cela du vol des oiseaux, & les Cypriotes, des entrailles encore fumantes des animaux égorgés. Vous n’ignorez pas que les Chaldéens ont inventé l’Astronomie ; les Perses la Magie ; les Egyptiens la Géométrie, & les Phéniciens l’art des Lettres. Cessez donc, ô Grecs, de donner pour vos decouvertes particulieres, ce que vous n’avez fait que suivre & qu’imiter ». Quoi qu’il en soit de ces reproches, il est certain qu’ils sont les premiers inventeurs de cette Philosophie systématique, qui bravant toute autorité, ne veut se laisser conduire qu’à la lueur de l’évidence dans la recherche de la vérité. La Philosophie des autres peuples, & même des Egyptiens, n’étoit, ainsi que nous l’avons remarqué à l’article de l’ame, qu’un amas de maximes, qui se transmettoient par tradition, & qui prenoient sur les esprits le même ascendant que les oracles de leurs dieux. Ce n’est qu’en Grece qu’on osoit raisonner ; & c’est aussi là le seul pays où l’esprit subtil & rafiné enfantoit des systèmes. La Philosophie des autres peuples n’étoit, à proprement parler, qu’une Théologie mystérieuse. Ainsi l’on peut dire que les Grecs ont été les premiers philosophes, dans le sens rigoureux que l’usage attache à ce terme. (X)
Barbares (Lois) Jurisprudence ; ce sont celles qui furent faites lots de la décadence de l’empire Romain, par les differens peuples qui le démembrerent, tels que les Goths, les Visigoths, les Ripuariens, les Francs-Allemands, Anglo-Saxons, &c. Voyez au mot Code.
On voit par ces lois la forme qui s’observoit dans les jugemens. Ils se rendoient dans de grandes assemblées, où toutes les personnes de distinction se trouvoient. Pour les preuves, on se servoit plus de témoins que de titres, par la raison qu’on ne faisoit presqu’aucun usage de l’écriture, sur-tout dans les commencemens. Faute de preuves on employoit le combat, ou l’on faisoit des épreuves par les élemens. Voyez Combat & Epreuve.
La principale matiere de ces lois étoient les crimes, & sur-tout ceux qui étoient les plus fréquens parmi ces peuples brutaux, tels que le vol, le meurtre, les injures, en un mot tout ce qui se commet par violence : ce qui regarde les successions & les contracts y étoit traité très-succinctement.
La qualité des peines qu’elles prononçoient est remarquable. Pour la plûpart des crimes elles n’ordonnoient que des amendes pécuniaires, ou pour ceux qui n’avoient pas de quoi payer, des coups de foüet. On ne punissoit point alors de mort les criminels, à moins qu’il ne fût question de crimes d’état. Aussi ces peines étoient-elles nommées compositions, comme n’étant qu’une taxe de dommages & intérêts, faite avec une exactitude surprenante : on y distinguoit la partie blessée ou mutilée, la profondeur, la largeur de la plaie, ou le nombre des plaies.
Ces lois sont écrites d’un style si simple & si court, qu’il seroit fort clair si tous les termes étoient latins : mais elles sont remplies de mots barbares, soit faute de mots latins qui fussent propres, soit pour leur servir de glose. (H)
BARBARICAIRE, s. m. (Peinture & Tapisserie.) Le barbaricaire est un peintre qui exécute des représentations d’hommes & d’animaux en tapisserie ou avec des soies de différentes couleurs. La tapisserie est un genre de peinture, & l’on ne doit pas être surpris que je donne le nom de peintre à ces excellens artistes, qui font avec l’aiguille des tableaux aussi beaux que tous ceux que les peintres font avec le pinceau. Voyez Lisse haute & basse
* BARBARICENS (les) s. m. pl. (Géog.), peuple de l’île de Sardaigne, dans les montagnes ; on appelle leur quartier les barbarias : il est divisé en trois parties, la Barbaria-Bervi, au quartier de Valence ; la Barbaria-Lolaï, au même quartier ; mais l’un plus à l’orient, & l’autre plus au septentrion : la Barbaria-Sevoli, dans les monts.
* BARBARIE, s. f. (Géog.) grande contrée d’Afrique, enfermée entre l’Océan Atlantique, la mer Méditerranée, l’Egypte, la Nigritie, & la Guinée. Sa longueur de l’orient à l’occident est considérable, mais sa largeur varie. Ses parties principales sont les royaumes de Tripoli, de Tunis, d’Alger, de Fez, de Maroc, de Tafilet, & le Zara ou Desert. Ces états ont un grand nombre de ports sur la Méditetranée, & les royaumes de Fez & de Maroc en ont même quelques-uns sur l’Océan : ce sont ceux de Tripoli, de la Goulette, de Tunis, d’Alger & de Salé, où l’on fait le plus de commerce. Il y a à Alger des marchands de toutes les nations ; les Juifs y ont un quartier. La marine des Algériens est très-forte. On peut tirer de-là des grains. Le commerce est le même à Couco : il se fait en grains, olives, huiles, figues, raisins secs, miel, & cire. On y trouve aussi du fer, de l’alun, & de petits bestiaux. Il y a peu de négoce à Tripoli. Il vient de Barbarie des plumes d’autruche, de l’indigo, de l’or en poudre, des dattes, des raisins de damas, des cuirs tannés & non tannés, du cuivre, de la cire, de l’étain, des laines, des peaux de chevre, du corail, qui se pêche au bastion de France ; des grains, comme blés, orges, féves, millet ; des chevaux. On charge pour ces côtes des draps, de l’écarlate, des velours, des taffetas, des mousselines, des soies apprêtées ; des épiceries, des drogues, du coton, du tabac, du sucre, du bois de campeche, du tartre, de l’alun, du soufre, de la cochenille, du papier, de l’acier, du fer, du plomb, toutes sortes de quincaillerie. Il y a beaucoup d’avantage d’aller acheter de ces voleurs, tout ce qui n’est pas à leur usage, & qu’ils revendent de leurs prises. Il n’y a en Barbarie presque que des monnoies étrangeres. Ils ont pourtant leurs burbas, leurs doublas, leurs rubics, & quelques-autres pieces. Le commerce est le même par-tout sur cette côte, excepté à Salé & au bastion de France. L’or & l’ivoire qui viennent de Salé en Europe, y sont apportés de Sudan & de Gago en Guinée par des casillas Arabes. Les plumes d’autruches viennent de Sara. Le commerce de Tamboucton, capitale de Gago, se fait singulierement, c’est un échange d’or en sel. Le marchand met son sel à terre sur des nattes de jonc & se retire : le Negre vient, il examine le tas de sel qui lui convient, il met à côté la poudre d’or qu’il en veut donner, & se retire à son tour : le marchand se rapproche ; si la quantité d’or lui convient, il prend une poignée de sel qu’il met à côté de l’or ; si elle ne lui convient pas il ne met rien ; il se retire ensuite : le Negre se rapproche & emporte son sel ou augmente la quantité d’or, ou retire son or, & tout cela se fait sans parler. Le silence est ordonné par la loi, comme le seul moyen de prevenir les querelles entre les marchands, & il s’observe rigoureusement.
Le bastion de France fait faire la pêche du corail, & en trafique particulierement. Voyez à l’article Corail cette pêche & ce commerce.
* Barbarie (mer de), Géog. c’est ainsi qu’on appelle toute la partie de la Méditerranée, qui baigne les côtes des royaumes de Tunis, d’Alger, & de Fez, & qui s’étend jusqu’aux îles de Sicile & de Sardaigne. On ne comprend quelquefois sous ce nom, que ce qui baigne les côtes d’Alger & de Fez.
* Barbarie (les seiches ou basses de), Géog. anc. & mod. ce sont les écueils du golfe de Sedra, que les anciens appelloient Syrtis magna ou major. On entend aussi par ce nom, quelquefois, le golfe de Sedra même.
BARBARIN, s. m. (Hist, nat. Zoolog.) poisson de mer, mieux connu sous le nom de surmulet. V. Surmulet.
Barbarin, poisson de riviere, petit barbeau. V. Barbeau. (I)
BARBARISME, s. m. (terme de Gramm.) le barbarisme est un des principaux vices de l’élocution.
Ce mot vient de ce que les Grecs & les Romains appelloient les autres peuples barbares, c’est-à-dire, étrangers ; par conséquent tout mot étranger mêlé dans la phrase greque ou latine étoit appellé barbarisme. Il en est de même de tout idiotisme ou façon de parler, & de toute prononciation qui a un air étranger ; par exemple, un Anglois qui diroit à Versailles, est pas le roi allé à la chasse, pour dire le roi n’est-il pas allé à la chasse ? ou je suis sec, pour dire j’ai soif, feroit autant de barbarismes par rapport au françois.
Il y a aussi une autre espece de barbarisme ; c’est lorsqu’à la vérité le mot est bien de la langue, mais qu’il est pris dans un sens qui n’est pas autorisé par l’usage de cette langue, ensorte que les naturels du pays sont étonnés de l’emploi que l’étranger fait de ce mot : par exemple, nous nous servons au figuré du mot d’entrailles, pour marquer le sentiment tendre que nous avons pour autrui ; ainsi nous disons il a de bonnes entrailles, c’est-à-dire, il est compatissant. Un étranger écrivant à M. de Fenelon, archevêque de Cambrai, lui dit : Mgr, vous avez pour moi des boyaux de pere. Boyaux ou intestins pris en ce sens, sont un barbarisme, parce que selon l’usage de notre langue nous ne prenons jamais ces mots dans le sens figuré que nous donnons à entrailles.
Ainsi il ne faut pas confondre le barbarisme avec le solécisme ; le barbarisme est une élocution étrangere, au lieu que le solécisme est une faute contre la régularité de la construction d’une langue ; faute que les naturels du pays peuvent faire par ignorance ou par inadvertance, comme quand ils se trompent dans le genre des noms ou qu’ils font quelqu’autre faute contre la syntaxe de leur langue.
Ainsi on fait un barbarisme, 1°. en disant un mot qui n’est point du dictionnaire de la langue. 2°. En prenant un mot dans un sens différent de celui qu’il a dans l’usage ordinaire, comme quand on se sert d’un adverbe comme d’une préposition ; par exemple, il arrive auparavant midi, au lieu de dire avant midi. 3°. Enfin en usant de certaines façons de parler, qui ne sont en usage que dans une autre langue.
Au lieu que le solécisme regarde les déclinaisons, les conjugaisons, & la syntaxe d’une langue, 1°. les déclinaisons, par exemple, les émails au lieu de dire les émaux : 2°. les conjugaisons, comme si l’on disoit il allit pour il alla : 3°. la syntaxe, par exemple, je n’ai point de l’argent, pour je n’ai point d’argent.
J’ajoûterai ici un passage tiré du IVe livre ad Herennium, ouvrage attribué à Cicéron : La latinité, dit l’auteur, consiste à parler purement, sans aucun vice dans l’élocution. « Il y a deux vices qui empêchent qu’une phrase ne soit latine, le solécisme & le barbarisme ; le solécisme, c’est lorsqu’un mot n’est pas bien construit avec les autres mots de la phrase ; & le barbarisme, c’est quand on trouve dans une phrase un mot qui ne devoit pas y paroître, selon l’usage reçû ». Latinitas est quæ sermonem purum conservat, ab omni vitio remotum. Vitia in sermone, quominus is latinus sit, duo possunt esse ; solecismus & barbarismus. Solecismus est, cum verbis pluribus consequens verbum superiori non accommodatur. Barbarismus est, cum verbum aliquod vitiose effertur. Rhetoricorum ad Herenn. Lib. IV. cap. xij. (F)
* BARBATA ou BARBUE, (Mytholog.) surnom qu’on donnoit à Venus ; en effet, on la représentoit quelquefois avec de la barbe & avec les deux sexes.
* BARBATH ou MARBATH (Géog. anc. & mod.), ville de l’Arabie heureuse, dans une petite province nommé Sehagt ou Hadhramuth, qui est l’Adramytene des anciens,
* BARBATO (Géog.), riviere de l’Andalousie, en Espagne, qui coule dans l’évêché de Cadis, & se jette dans l’océan Atlantique à Porto-Barbato.
* BARBATO ou PORTO-BARBATO (Géog. anc. & mod.), petite ville d’Espagne, dans l’Andalousie, sur l’Océan Atlantique, à l’embouchûre de la riviere Barbato. C’est, selon quelques Géographes, la ville Belo ou Bello des anciens ; d’autres veulent que Belo ou Bello des anciens soit Conil ou Belona.
BARBE, le poil qui croît au menton & autres parties du visage, sur-tout des mâles adultes. V. Poil.
La barbe est la premiere marque de puberté ; c’est un indice que la semence commence à se faire ; elle continue, si le sang produit la même humeur prolifique : elle cesse de pousser, ou tombe, si cette secrétion importante est empêchée. On connoît par-là pourquoi la barbe & les cheveux tombent souvent dans la vieillesse. La voix d’un garçon ressemble à celle d’une fille avant la secrétion de la semence, après quoi elle devient grave & rauque, & ce symptome paroît avant la barbe. (L)
La barbe a été assujettie à diverses coûtumes & cérémonies. Kingson nous assûre qu’une partie considérable de la religion des Tartares consiste dans le gouvernement de leur barbe ; qu’ils ont fait une longue & sanglante guerre aux Persans, & les ont déclarés infideles, quoique de leur communion à d’autres égards, précisément à cause que ceux-ci ne se faisoient point la moustache à la mode ou suivant le rit des Tartares.
Athenée remarque, d’après Chrysippe, que les Grecs avant Alexandre, avoient toûjours conservé leur barbe, & que le premier Athénien qui coupa la sienne, fut toûjours après cela dans les médailles surnommé le tondu, κόρσης. Plutarque ajoûte qu’Alexandre ordonna aux Macédoniens de se faire raser, de peur que les ennemis ne les prissent par la barbe.
Quoi qu’il en soit, nous voyons que Philippe son pere, ainsi que ses prédécesseurs Amyntas & Archelaiis, sont représentés sans barbe sur les médailles.
Pline observe que les Romains ne commencerent à se raser que l’an de Rome 454, quand P. Ticinus leur amena de Sicile une provision de barbiers ; il ajoûte que Scipion l’Africain fut le premier qui fit venir la mode de se raser chaque jour.
Ce fut encore une coûtume parmi les Romains de se faire des visites de cérémonie, à l’occasion de la premiere coupe de la barbe. Les jeunes gens commençoient à se faire couper la barbe depuis l’âgê de 21 ans, jusqu’à celui de 49 ; passé 49 ans, il n’étoit plus permis, selon Pline, de ne pas porter la barbe longue. Ils enfermoient leur premiere barbe dans une petite boîte d’or ou d’argent, qu’ils consacroient à quelque divinité, & sur-tout à Jupiter Capitolin, comme Suétone le remarque de Néron. Les 14 premiers empereurs se firent raser jusqu’au tems de l’empereur Adrien, qui retablit l’usage de porter la barbe : Plutarque dit que le motif de ce prince fut de cacher les cicatrices qu’il avoit au visage.
Tous ses successeurs l’imiterent jusqu’à Constantin. Les barbes reparurent sous Héraclius, & tous les empereurs Grecs l’ont portée depuis. Les Goths & les Francs ne portoient qu’une moustache, jusqu’à Clodion, qui ordonna aux François de laisser croître leur barbe & leurs cheveux, pour les distinguer des Romains. Les anciens philosophes & les prêtres des Juifs portoient de longues barbes. On veut que ce soit aussi l’origine du nom des Lombards, Longobardi quasi Longo-barbati. Il y a un canon du concile de Carthage, qui défend aux clercs de porter de longs cheveux & de longues barbes : clericus nec comam nutriat, nec barbam ; ce qui se concilie difficilement avec cette leçon, nec barbam tundat. Grégoire VII. dit, que le clergé d’Occident a toûjours été rasé. Aujourd’hui les Occidentaux se font raser ; & les Grecs au contraire, les Turcs & presque tous les Orientaux ont conservé la mode de porter de longues barbes.
On usoit anciennement de grandes cérémonies en bénissant la barbe, & l’on voit encore les prieres qui se disoient dans la solennité de sa consécration, lorsque l’on tonsuroit un clerc. Voyez Tonsure.
Les gens de qualité faisoient raser leurs enfans la premiere fois par des hommes aussi qualifiés qu’eux, ou plus même ; & ceux-ci devenoient par ce moyen les parreins ou les peres adoptifs des enfans. Voyez Adoption.
Il est vrai qu’anciennement, on devenoit parrein du garçon précisément en lui touchant la barbe ; aussi voit-on dans l’histoire qu’un des articles du traité entre Clovis & Alaric, fut que ce dernier lui toucheroit la barbe, afin de devenir le parrein de Clovis. Voyez Parrein.
A l’égard des ecclésiastiques, la discipline a considérablement varié sur l’article de la barbe ; on leur a quelquefois enjoint de la porter, à cause qu’il y a quelque chose d’efféminé à se la faire, & qu’une barbe longue sied bien à la gravité du clergé ; d’autres fois on l’a défendue comme suspecte de cacher de l’orgueil sous un air vénérable. L’église Greque & la Romaine ont été long-tems aux prises à ce sujet depuis leur séparation. Ceux de l’église de Rome semblent avoir encore eu plus de goût pour se raser afin de contredire les Grecs ; ils ont même fait certaines constitutions expresses de radendis barbis.
Les Grecs, de leur côté défendent la cause des grandes barbes, avec un zele ardent, & sont très scandalisés de voir dans les églises Romaines, des images de saints qui n’ont point de barbe. On trouve que par les statuts de quelques monasteres, les moines laiques devoient laisser croître leur barbe, & les prêtres se raser ; & que l’on bénissoit, avec beaucoup de cérémonies, les barbes de tous ceux qui étoient reçûs dans les couvens.
En certains pays, c’est porter le deuil que de laisser croître sa barbe, en d’autres c’en est un que de se raser. Le pere le Comte remarque l’extravagance des Chinois dans leur affectation de porter de grandes barbes, eux à qui la nature n’en a donné que de fort petites, qu’ils ont la folie de cultiver avec un grand soin, enviant beaucoup le bonheur des peuples de l’Europe à cet égard, & les considérant comme les premiers hommes du monde, à cause de leur barbe.
Les Russiens portoient encore leur barbe, il n’y a que très-peu d’années, quand le Czar Pierre I. leur ordonna de se raser : mais nonobstant son ordre, il fut contraint de tenir sur pied un bon nombre d’officiers, pour la couper de haute lutte à ceux que l’on ne pouvoit réduire autrement à s’en défaire. C’est une remarque de Saint-Chrysostome, que les rois de Perse avoient leur barbe tissue, & nattée avec un fil d’or. Quelques-uns des premiers rois de France faisoient noüer & boutonner leur barbe avec de l’or. (G)
Barbe d’une Comete (Astronom.) c’est le nom qu’on donne à ces especes de rayons qu’envoye une comete, vers la partie du ciel où son mouvement paroît la porter. Voyez Comete.
C’est en quoi la barbe de la comete est distinguée de sa queue, qui se dit des rayons poussés vers la partie d’où il semble que son mouvement l’éloigne. Voyez Queue. En un mot la barbe de la comete est une espece de chevelure lumineuse & rayonnante qui la précede, & la queue est une chevelure lumineuse & rayonnante qui la suit. La cause de la queue des cometes & de leur barbe n’est pas trop bien connue. Voyez sur ce sujet les conjectures des philosophes, au mot Comete. (O)
Barbe ou plûtôt Barbette (terme de l’Art militaire) tirer en barbe ou à barbette, c’est tirer le canon par dessus le parapet, au lieu de le tirer par les embrasures ; auquel cas le parapet ne doit avoir que trois piés & demi de hauteur, au-dessus de l’endroit où le canon est placé. On fait ordinairement de petites élévations de terre aux angles flanqués des ouvrages pour y placer du canon qu’on tire à barbette. Ces élévations sont aussi appellées barbettes. On donne ce même nom au canon, qui est tiré de ces élévations ; parce qu’on prétend que le canon en tirant de-là, par-dessus ce parapet, lui fait pour ainsi dire la barbe, en brûlant l’herbe de sa partie supérieure. (Q)
Barbe d’un vaisseau (Marine.) les barbes d’un vaisseau sont les parties du bordage de l’avant, auprès du rinjot, c’est-à-dire, vers l’endroit où l’étrave s’assemble avec la quille.
Barbe, Sainte-Barbe, gardiennerie, chambre des canonniers ; c’est ainsi que se nomme (en Marine) la chambre des canonniers, à cause qu’ils ont choisi Sainte Barbe pour patrone. La sainte-barbe est un retranchement de l’arriere du vaisseau, au-dessus de la sonte, & au-dessous de la chambre du capitaine. Le timon passe dans la sainte-barbe. Les vaisseaux de guerre y ont ordinairement deux sabords pratiqués dans l’arcasse ; on l’appelle aussi gardiennerie, à cause que le maître canonnier y met une partie de ce qui regarde les ustenciles de son artillerie. Voyez Pl. IV. fig. I. n°. 107. (Z)
Barbe (Manege) on appelle ainsi un cheval de Barbarie, qui a la taille menue & les jambes déchargées, & qui est fort estimé pour sa vigueur & sa vîtesse. Voyez Cheval.
Les barbes sont ordinairement d’une taille déliée, & ont les jambes bien écartées. C’est une maxime que les barbes meurent, mais ne vieillissent jamais ; parce qu’ils conservent leur vigueur jusqu’à la fin : c’est pourquoi on en fait des étalons. Leur feu, selon le duc de Newcastle, dure autant que leur vie.
On dit que ces chevaux étoient autrefois sauvages, & qu’ils couroient çà & là dans les forêts de l’Arabie ; & que ce ne fut qu’au tems du Cheque Ismaël qu’on commença à les dompter pour la premiere fois. On assûre qu’il y a des barbes en Afrique, qui devancent les autruches à la course, qu’on vend ordinairement dix mille livres, ou comme dit Dapper, mille ducats, ou cent chameaux. On les entretient toûjours maigres, & on les nourrit fort peu avec quelques grains & de la pâte, ou comme dit Dapper, avec du lait de chameau qu’on leur donne soir & matin. On conserve la généalogie des chevaux barbes, avec le même soin qu’on fait en Europe celle des grandes familles ; & on ne les vend jamais sans produire leurs titres de noblesse. Il y en a qu’on fait descendre en droite ligne de l’illustre cheval du grand Dalid.
La race des chevaux a fort dégénéré dans la Numidie, les Arabes ayant été découragés de la conserver par les officiers Turcs, qui étoient assûrés de s’en rendre maîtres. Les Tingitaniens & les Égyptiens ont aujourd’hui la réputation de conserver la meilleure race, tant pour la taille que pour la beauté. Les plus petits de ces derniers ont ordinairement seize palmes, & tous sont formés, suivant leur maniere de s’exprimer, comme la gazelle.
Les bonnes qualités d’un cheval de Barbarie (outre celles qu’on lui suppose de ne jamais se coucher, & de ne point bouger lorsque le cavalier vient à laisser tomber sa bride) sont d’avoir une longue allure, & de s’arrêter court, s’il le faut, en pleine course.
Le barbe n’est pas si propre à être étalon pour avoir des chevaux de manége, que pour des coureurs ; car il engendre des chevaux longs & lâches : c’est pourquoi il ne faut point avoir de sa race pour le manége, s’il n’est court de la tête à la croupe, fort, raccourci, & d’une grande vivacité ; ce qui se trouve dans peu de barbes.
Barbe, ou Sous-barbe (Manége) est la partie de la tête du cheval, qui porte la gourmette. C’est proprement le bout ou plûtôt la jonction des os de la ganache. Voyez Ganache.
Barbes, ou Barbillons, (Maréchallerie.) ce sont des petites excroissances de chair longuettes, & finissant en pointe, qui sont attachées au palais sous la langue du cheval, qui l’empêchent de manger, & qu’on ôte pour cette raison. (V)
Barbe, (en Serrurerie) est une partie du pêne ; elle a la forme de dents, qu’on voit ordinairement à sa partie inférieure, quelquefois à la supérieure, & à l’une & à l’autre. Voyez Planche III. de Serrurerie, en V & en T. La clef en tournant dans la serrure, les rencontre & fait avancer ou reculer le pêle ou pêne.
Il y a différentes sortes de barbes ; des barbes perdues, ou volantes ; ce sont celles qui sont mobiles, & qui peuvent descendre & monter. Elles ne font pas corps avec le pêne ; elles y sont seulement ajustées, & c’est par le méchanisme qu’employe l’ouvrier qu’elles paroissent ou disparoissent. On trouvera à l’article Serrure, plusieurs exemples de ces barbes. Voyez Serrure.
Barbe de bouc, tragopogon, (Hist. nat. bot.) genre de plante, dont la fleur est à demi-fleurons portés chacun sur un embryon, & soûtenus par un calice fendu en plusieurs parties sans être écailleux. Lorsque cette fleur est passée, chaque embryon devient une semence revêtue d’une membrane ou d’une enveloppe garnie d’une aigrette, & attachée sur la couche. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
* Le tragopogon pratense, luteum, majus, aime les lieux champêtres, les prés, les pâturages, & les terres grasses ; il fleurit en Mai & en Juin, & il ne tarde pas à répandre sa graine ; il redonne des fleurs en Juillet & en Août.
Sa racine échauffe & humecte ; elle est salutaire dans les maladies de poitrine ; son suc lactée agglutine les ulceres récens, pousse par les urines, & excite les graviers à sortir. Il y en a qui mangent la racine cuite, quand elle est tendre : mais ils sont en petit nombre.
Barbe de chevre, barba capræ, (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales disposés en rond ; le pistil sort d’un calice d’une seule piece, & devient dans la suite un fruit composé de plusieurs petites gaines rassemblées en forme de tête. Chaque gaîne renferme une semence ordinairement oblongue. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
* La barba capræ, floribus compactis, a la feuille d’un goût d’herbe salé & gluant, & rougissant un peu le papier bleu ; sa racine le rougit beaucoup ; elle est styptique & un peu amere. Il y a apparence que le sel de cette plante approche du sel ammoniac ; mais uni avec beaucoup de soufre & assez de terre. Elle donne par l’analyse des liqueurs acides, du sel volatil concret, beaucoup de soufre, & assez de terre ; aussi est-elle sudorifique, cordiale, & vulnéraire ; la décoction de sa racine est bonne dans les fievres malignes. Le vin où on l’a fait bouillir est salutaire dans les cours de ventre, la dyssenterie, le crachement de sang, & les blessures internes. Un gros de son extrait est sudorifique : mais il en faut continuer l’usage pendant deux ou trois jours. Il en faut prendre un gros le matin, autant l’après-midi ; & le soir, la même dose avec un grain de laudanum.
Barbe de Jupiter, barba Jovis, (Hist. nat. bot.) genre de plante dont la fleur est légumineuse ; le pistil sort du calice, & devient dans la suite une silique fort courte & presqu’ovale, qui renferme une semence arrondie. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
* On ne lui attribue aucune propriété medicinale.
Barbe renard, tragacantha, (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur légumineuse ; le pistil sort du calice, & devient dans la suite une silique divisée selon sa longueur en deux loges remplies de quelques semences qui ont ordinairement la figure d’un petit rein. Ajoûtez aux caracteres de ce genre que les feuilles naissent par paires sur une côte terminée par un piquant. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
* La tragacantha croît dans les provinces méridionales de la France & en Italie : mais elle ne donne sa gomme que dans les pays orientaux.
On tire de sa racine la gomme adragant des boutiques. Voyez Adragant.
* Barbe a plusieurs autres acceptions : voici les principales. Il se dit des petites arrêtes qu’on remarque aux poissons plats, & qui leur servent de nageoires ; voyez Poisson, Nageoires : des franges mollettes dans les plumes sont garnies depuis le haut du tuyau jusqu’à l’extrémité ; voyez Plume : des poils dont certains épis de blé sont hérissés ; voyez Blé, Épi : du poil de certaines étoffes, ou usées, ou non ébarbées ; voyez Draperie : de cette espece de duvet qui dénote la corruption & la moisissure des confitures gâtées : des petites molécules métalliques, ou grains de limaille, qui restent attachés aux arrêtes de tous les corps métalliques limés, après qu’on les a limés, & qu’on enleve ou avec le fraisoir, ou avec la lime même, ou avec la pierre, ou avec le brunissoir.
BARBÉ, adj. (en termes de Blason.) se dit des coqs & des dauphins dont la barbe est d’un autre émail que leur corps.
Boucherat, dont il y a eu un chancelier, d’azur au coq d’or bequé, membré, crêté & barbé de gueules. (V)
BARBEAU, s. m. barbus, (Hist. nat. Zoolog.) poisson de riviere, ainsi nommé parce qu’il a quatre barbillons, deux aux coins de la bouche, & deux au bout du museau, qui est allongé & pointu. Le barbeau n’a point de dents ; ses yeux sont petits ; la prunelle est noire & environnée d’un cercle doré ; la fente des ouies est petite. On a remarqué que ce poisson vit assez long-tems hors de l’eau. La ligne qui s’étend sur les côtés, depuis les oüies jusqu’à la queue est peu sensible ; le dos est d’une couleur mêlée de verd & de jaune ; le ventre est blanc. Il a une nageoire sur le dos qui tient à un fort aiguillon ; deux au bas des oüies ; deux autres sous le ventre qui sont jaunes ; & au-delà de l’anus une autre nageoire qui est rougeâtre. La chair du barbeau est blanche & molle ; il y a beaucoup d’arrêtes ; elle est d’assez bon goût, sur-tout lorsque le poisson est gros. Rondelet, Voyez Poisson. (I)
* Barbeau, (Mat. med.) il faut préférer les petits barbeaux aux grands : il faut pour être bons, qu’on les ait pêchés dans des eaux pures & loin des rives. Le barbeau nourrit : mais il est difficile à digérer ; ses parties les plus estimées sont le foie & la tête.
Le Barbeau, (Péche.) est fort avide à l’appât : mais il est rusé, à moins que l’épouvante ne le prenne ; alors il se croit fort en sûreté s’il a la tête cachée ; la pêche s’en fait de la même maniere que celle de l’anguille.
Barbeau, plante. Voyez Bluet.
* BARBECINS, (Géog.) royaume d’Afrique, dans la Guinée, vis-à-vis le cap-Verd. On dit que les filles s’y font des cicatrices, & s’agrandissent la bouche en se séparant les levres, pour se rendre plus jolies.
BARBEIER, BARBOTER, FRISER, verb. neut. on dit en Marine, la voile barbeie, lorsque le vaisseau étant trop près du vent, le vent rase la voile, & lui étant presque parallele, la bat de côté & d’autre sans la remplir. Cette agitation continue jusqu’à ce qu’elle ait pris vent, & alors elle ne barbeie ou ne frise plus. Quand on a mis le vent sur les voiles, il faut qu’elles barbeient. Il ne faut pas confondre mettre le vent, & prendre le vent. Voyez Vent. (Z)
* BARBELA, (Géog.) riviere d’Afrique, dans le Congo : elle passe à S. Salvador, & se jette dans le Zaire, un peu au-dessus de son embouchure dans l’Océan.
* BARBELIOTS, ou BARBORIENS, s. m. pl. secte de Gnostiques, qui disoient qu’un Eon immortel avoit eu commerce avec un esprit vierge appellé Barbeloth, à qui il avoit accordé successivement la prescience, l’incorruptibilité, & la vie éternelle ; que Barbeloth un jour plus gaie qu’à l’ordinaire, avoit engendré la lumiere, qui perfectionnée par l’onction de l’esprit, s’appella Christ ; que Christ desira l’intelligence & l’obtint ; que l’intelligence, la raison, l’incorruptibilité, & Christ s’unirent ; que la raison & l’intelligence engendrerent Autogene ; qu’Autogene engendra Adamas l’homme parfait, & sa femme la connoissance parfaite ; qu’Adamas & sa femme engendrerent le bois ; que le premier ange engendra le S. Esprit, la Sagesse, ou Prunic ; que Prunic ayant senti le besoin d’époux, engendra Protarchonte, ou premier prince, qui fut insolent & sot ; que Protarchonte engendra les créatures ; qu’il connut charnellement Arrogance, & qu’ils engendrerent les vices & toutes leurs branches. Pour relever encore toutes ces merveilles, les Gnostiques les débitoient en Hébreu, & leurs cérémonies n’étoient pas moins abominables, que leur doctrine étoit extravagante. Voy. Théodoret.
BARBERIE, s. f. terme qui se trouve employé dans les statuts des maîtres Perruquiers, & qui signifie l’art de raser & de faire la barbe & les cheveux. Voyez Barbier.
* BARBERINO, (Géog.) ville d’Italie, dans la Toscane, dans le Florentin, au pié de l’Apennin, sur la riviere de Siere. Long. 28. 55. lat. 44. 5.
BARBET, s. m. (Chasse.) gros chien à poil frisé, qu’on instruit à rapporter, qui va à l’eau, & qu’on dresse à la chasse du renard. On tond les barbets, & leur poil entre dans la composition des chapeaux.
* BARBETS, s. m. pl. (Géog.) habitans des vallées du Piémont, de Lucerne, d’Angrone, de Pérouse, & de S. Martin.
Barbet, poisson de riviere, mieux connu sous le nom de barbeau. Voyez Barbeau. (I)
* BARBEYRA, (Géog.) petite ville de France, dans le bas Languedoc, au diocèse de Carcassonne.
* BARBEZIEUX, (Géog.) petite ville de France, en Saintonge, avec titre de marquisat.
BARBIER, s. m. artisan qui fait la barbe. Il y a à Paris deux communautés, qui suivant leurs statuts, ont droit de tenir boutique ouverte pour faire la barbe, & d’y mettre des bassins pour enseigne.
La premiere est celle des maîtres Chirurgiens, dont les bassins de l’enseigne doivent être jaunes : la seconde est celle des Perruquiers, dont les bassins sont blancs. Voyez Chirurgie.
BARBIER, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) poisson de mer du genre appellé anthias, selon Rondelet. Voy. Anthias. Voici comme il décrit ce poisson. Le corps est de couleur rougeâtre, la tête est ronde & de différentes couleurs, le bec est mousse, les dents sont petites ; il a sur le dos, assez près de la tête, une nageoire qui s’étend jusqu’à la queue, & dont le premier aiguillon est long, fort & tranchant : on l’a comparé à un rasoir ; & c’est pourquoi on a donné à ce poisson le nom de barbier. Il a deux nageoires auprès des oüies ; deux autres sous le ventre, longues & menues ; & enfin une autre au-delà de l’anus. Toutes ces nageoires sont de couleur rousse. La queue est de la même couleur ; elle est terminée par deux nageoires. On a cru que lorsque le barbier étoit pris à la ligne, il la coupoit avec son aiguillon tranchant. Cela peut être : mais on a pretendu de plus que les autres poissons de cette espece venoient au secours de celui qui étoit pris, & le délivroient en coupant la ligne. Des poissons si intelligens pourroient bien aussi arracher l’hameçon du corps de celui qui l’auroit avalé. Leur aiguillon seroit aussi propre à cette opération qu’à la premiere. Si un de ces poissons a jamais coupé une ligne par hasard, je ne serois pas surpris qu’on leur attribuât des actions qui supposent un dessein prémedité, tant le commun des hommes est porté à croire des choses dénuées de toute vraissemblance. Voyez Poisson. (I)
BARBILLE, s. f. (à la Monnoie.) ce sont des especes de petits filamens ou pointes qui sont aux flancs, & que l’on emporte en les agitant les uns contre les autres dans un crible de fer.
BARBILLON, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) petit barbeau, poisson de riviere. Voyez Barbeau. (I)
Barbillon, (Hist. nat. Zoolog.) barbe ou pendant charnu qui fait partie du corps de certains poissons. Le nombre & la position des barbillons varient dans les différentes especes ; ils sont le plus souvent autour de la bouche, comme dans le barbeau, le surmulet, la baudroie, &c. Voyez Rondelet, liv. III. ch. xxvj. (I)
Barbillons, s. m. pl. (Fauconn.) est une maladie qui survient à la langue des oiseaux de proie, & qui leur est causée, à ce qu’on croit, par un rhûme chaud qui tombe sur les glandes de la gorge, & les fait enfler.
* BARBITON, (Hist. ancienne.) nom d’un instrument des anciens. On ne sait point ce que c’étoit. Les anciens & les modernes l’ont souvent confondu avec la lyre. M. Dacier conjecture qu’il étoit à corde ; & faisant venir barbiton de barumiton, qui signifie grosse corde de lin, il en conclut que c’étoit un instrument à grosses cordes : ce qu’il y a de certain, c’est que le lin étoit en usage pour les instrumens de musique, avant que l’on eût trouvé l’art d’employer au même usage les boyaux des bêtes. Horace l’appelle lesbien, lesboum barbiton, ode i. liv. I. & ode xxxii. même livre, Lesbio primum modulate civi : « vous, barbiton, qui avez été touché la premiere fois par un citoyen de Lesbos » ; c’étoit Alcée, à qui il attribue l’invention du barbiton.
* BARBONNE, (Géog.) petite ville de France en Champagne, généralité de Châlons.
* BARBORA, (Géog.) ville maritime d’Afrique au royaume d’Adel, sur le détroit de Babel-Mandel. Il y a une île de ce nom qu’on appelle aussi Alondi, dans la mer Rouge, à l’occident de la baie de Barbora. Lat. environ 10. 45. long. 64. 32.
BARBOT, s. m. c’est ainsi qu’on appelle sur les galeres celui qui fait le poil aux forçats.
* BARBOTE, s. f. barbota, (Hist. nat. Zoolog.) poisson qui se trouve dans des rivieres & des lacs dont les eaux sont tranquilles. Il a un barbillon au bout de la mâchoire inférieure ; ses dents sont courtes & menues ; le corps est gluant & couvert de petites écailles ; sa couleur est mêlée de roux & de brun, avec des taches noires ondoyantes. Ce poisson a deux nageoires près des oüies ; deux au-dessous ; & au-delà de l’anus une autre nageoire qui s’étend jusqu’à la queue. Il a sur le dos une pareille nageoire qui se prolonge jusqu’à la queue ; & devant cette nageoire, une autre plus petite. La barbote ressemble beaucoup à la lote ; cependant elle a le bec plus mince, la queue plus menue & plus pointue, & le ventre plus gros. Le foie de la barbote est fort grand à proportion du corps du poisson. Rondelet. Voyez Poisson. (I)
Barbote, (Mat. med.) Mustela offic. Schrod. 330. Le foie, le ventricule, & l’arrête de ce poisson, sont d’usage en Medecine. Le foie suspendu dans un vaisseau de verre, & exposé à un degré moderé de chaleur, se convertit en une liqueur jaune fort salutaire, pour dissiper les taies & éclaircir la vûe. On recommande son ventricule dans les maladies de l’utérus ; il chasse les vuidanges & appaise la colique ; son arrête pulvérisée, guérit l’épilepsie, selon Schroder. (N)
BARBOTINE, s. f. (Hist. nat. bot. & mat. Med.) semen contra, semen sanctum, ou semen sanctonicum, est une semence menue, amere, chaude & dessiccative, propre à faire mourir les vers qui s’engendrent dans le corps humain, sur-tout dans celui des petits enfans. Voyez Ver.
Cette semence est menue, brune, oblongue, amere, & d’une odeur forte & desagréable. Il faut la choisir récente, verdâtre, d’un goût amer, aromatique & desagréable. Elle croît dans la Perse, sur les frontieres de la Moscovie. On nous l’apporte d’Alep, &c.
Les Naturalistes ne sont point d’accord sur la plante qui produit cette semence, sur laquelle J. Bauhin a donné une longue dissertation. Quelques auteurs veulent que le semen contra soit la graine d’une espece d’absinthe appellée santonicum ou marinum absinthium : d’autres disent qu’elle est la graine de la tanésie ; d’autres enfin, celle de l’auronne.
Voici ce qu’en dit M. Tavernier, dans le second tome de ses Voyages. « Pour ce qui est de la semencine, ou poudre à vers, on ne peut pas la recueillir comme on fait les autres graines. C’est une herbe qui croît dans les prés, & qu’il faut laisser mûrir ; & le mal est, que lorsqu’elle approche de sa maturité, le vent en fait tomber une grande partie entre les herbes, où elle se perd : c’est ce qui la rend chere.
Comme on n’ose la toucher de la main, parce qu’elle en seroit plûtôt gâtée, & que même quand on en fait usage, on la prend dans une écuelle ; lorsqu’on veut recueillir ce qui est resté dans l’épi, on a recours à cet expédient. On a deux paniers à ance ; & en marchant dans les prés, on fait aller un des paniers de la droite à la gauche, & l’autre de la gauche à la droite, comme si l’on fauchoit l’herbe, & toute la graine tombe ainsi dans ces paniers ». V. Semen contra & Vermifuge. (N)
* BARBOUDE, (Géog.) île de l’Amérique, l’une des Antilles, au nord d’Antigoa.
BARBOUILLER, v. act. & neut. Quand il est actif, il est synonyme à salir ; quand il est neutre, il est synonyme à mal parler, mal peindre, mal écrire.
Barbouiller, terme d’Imprimeur. Lorsqu’une feuille imprimée est atteinte de noir dans les marges, ce qui ne peut arriver que par l’inattention & la mal-propreté de l’ouvrier de la presse, on dit que cet ouvrier barbouille, & que la feuille est barbouillée.
Barbouiller, en Peinture, se prend toûjours en mauvaise part : barbouiller un tableau ; il a barbouillé ce tableau, &c. à moins qu’on ne parle d’un homme dont le métier est de barbouiller une porte, des murailles, des treillages, &c. en ce cas on dit, un bar'bouilleur. Barbouiller un jeu de paume, un plancher, une menuiserie, &c. J’ai fait barbouiller ma maison depuis le haut jusqu’en bas.
BARBUE, s. f. rhombus lævis, (Hist. nat. Zoolog.) poisson de mer très-ressemblant au turbot, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à l’exception des aiguillons. La barbue n’en a aucun ni en-dessus, ni en-dessous : elle est plus large & plus mince que le turbot. Rondelet la nomme turbot sans piquans. Voyez Turbot, Poisson. (I)
BARBURES, s. f. se dit, en grande Fonderie, de toutes ces inégalités qu’on apperçoit sur une piece fondue au sortir de la fosse ou du moule, & qu’il faut reparer au ciseau. Voyez Grande fonderie & Balevre.
BARBUS, adj. pris subst. (Hist. ecclés.) c’est ainsi qu’on nommoit les freres convers de l’ordre de Grammont, parce qu’ils portoient la barbe grande. Comme ils avoient le maniement des biens temporels, ils vouloient aussi usurper le gouvernement de l’ordre, & réduire les prêtres sous leur obéissance : mais ils perdirent leur cause. Mezeray, au regne de Philippe-Auguste. (G)
* BARBUSINSKOI, (Géog.) ville d’Asie dans l’empire Russien, sur le bord oriental du lac Baikal, à l’endroit où la riviere de Barbusigga se jette dans le lac.
* BARBY, (Géog.) ville d’Allemagne dans la haute Saxe, capitale du comté de son nom sur l’Elbe.
* BARBYTHACE ou BARBYTACE, (Géog.) ancienne ville du royaume de Perse, dont Pline dit que les habitans travailloient à amasser de l’or pour l’enfoüir, non par avarice, mais par mépris, & dans le dessein de priver les hommes d’un métal si dangereux.
* BARCA, (Géog.) grande contrée d’Afrique, à l’orient du royaume de Tripoli.
BARCADE de chevaux, s. f. (Manege.) se dit d’une troupe de chevaux qu’on a achetés, & auxquels on veut faire passer la mer. (V)
* BARCELONE, (Géog.) ville d’Espagne, capitale de la Catalogne, sur la Méditerranée. Long. 19. 50. lat. 41. 26.
Barcelone, (Géog.) petite ville de France en Guienne dans l’Armagnac.
* BARCELONETTE, (Géog.) petite ville de France dans le Dauphiné, capitale de la vallée de son nom. Long. 24. 23. lat. 44. 26.
* BARCELOR, (Géog.) ville d’Asie dans les Indes, sur la côte de Malabar, entre Goa & Mangalor. Long. 92. lat. 13. 45.
* BARCELOS, (Géog.) ville de Portugal, avec titre de duché, dans la province d’entre Douro & Mino, sur la Sourille. Long. 9. 20. lat. 41. 20.
* BARCENA, (Géog. anc. & mod.) lac de l’Abyssinie en Afrique, au royaume d’Amara, sur les confins du Zanguebar, sous la Ligne. On croit que c’est le Caloë de Ptolomée.
* BARCKSHIRE, (Géog.) province d’Angleterre au midi d’Oxford : Reading en est la capitale.
* BARD, (Géog.) ville d’Allemagne dans la Poméranie citérieure, & dans la seigneurie de même nom, avec château & port sur la mer Baltique.
BARDANE, s. f. lappa, (Hist. nat. bot.) genre de plante dont la fleur est à fleurons découpés, portés chacun sur un embryon, & soûtenus par le calice. Ce calice est composé de plusieurs écailles terminées chacune par un crochet, qui attache ordinairement les têtes de cette plante aux vêtemens. Lorsque la fleur est passée, ces embryons deviennent des semences garnies d’aigrettes fort courtes. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
* Bardane (la), personata lappa major, (Mat. med.) a la feuille amere ; le papier bleu n’en est pas teint. Son pédicule est douçâtre ; sa racine a d’abord le même goût : mais ensuite on y découvre celui d’artichaut. Elle rougit un peu le papier bleu ; ce qui fait conjecturer que le sel ammoniac y est un peu plus développé que dans la feuille. On tire de cette plante par l’analyse, du sel volatil concret ; & l’on peut penser que son sel approche de l’ammoniac, & qu’il est nittreux ; puisqu’il y a détonation quand on brûle la feuille.
La bardane est diurétique, sudorifique, pectorale, hystérique, vulnéraire, fébrifuge. Sa racine & sa feuille sont salutaires dans la pleurésie. On en fait prendre l’eau à grands verres, après avoir fait prendre les germes d’une douzaine d’œufs frais, délayés dans un demi-verre de la même eau. Sa décoction purifie le sang, & soulage ceux qui ont des maux vénériens. Il faut la préférer dans la petite vérole, à la tisane de scorzonere.
Les Auteurs lui attribuent beaucoup d’autres propriétés. Voyez l’histoire des Plantes des env. de Paris.
* BARDARIOTES, s. m. pl. (Hist. anc.) soldats de la garde de l’empereur de Constantinople. Ils étoient vêtus de rouge, couverts d’un bonnet à la Persanne, appellé augurot, & bordé de drap couleur de citron, & armés de bâtons & de baguettes, pour éloigner le peuple du passage de l’empereur. Ils veilloient aux portes du palais. Ils étoient Persans d’origine. Ils avoient pris le nom de bardariotes, du fleuve Bardarius, sur lequel un des empereurs, qu’on ne nomme pas, les avoit transportés. Nicétas leur donne les noms de bardouques & de manclavites. Leur poste à l’armée étoit au septentrion de la tente impériale, où ils faisoient la garde. Ils obéissoient au primicerius, ou comite de la cour. Macri pense que les bardariotes sont les mêmes que les barbutes.
BARDE, s. f. (Hist. mod.) c’est, en vieux langage, l’armure des chevaux des anciens chevaliers & soldats qui étoient équipés de tout point ; elle étoit de fer ou de cuir, & couvroit le cou, le poitrail & les épaules du cheval ; c’est ce qu’on appelloit equi cataphracti. (G)
Barde ou Panneau (Manege & Sellier.) longue selle qui n’a ni fer, ni bois, ni arçons, & qui est faite de grosse toile piquée & bourrée. Grison & plusieurs autres auteurs Italiens, veulent qu’on se serve au manege d’une bardelle pour les poulains, & d’un caveçon à mettre sous leur nez ; c’est une invention qui ne sert qu’à perdre le tems ; on appelle en Italie ceux qui trottent les poulains en bardelle, cavalcadours ou scozzoni. (V)
* Barde (ile de) Géog. île d’Asie, sur la côte de Malabar, au nord & à peu de distance de Goa.
Bardé, adj. terme de Blason, il se dit d’un cheval caparaçonné.
Riperda, au pays de Groningue, de sable au cavalier d’or, le cheval bardé & caparaçonné d’argent. (V)
* BARDEAU, s. m. (Couvreurs.) ces ouvriers appellent ainsi de petits morceaux de mairin débité en lattes de dix à douze pouces de long sur six à sept de large ; dont ils se servent pour couvrir des bâtimens peu considérables. Si ces lattes sont faites de douves de vieilles futailles, on les appelle aussi des bardeaux.
* BARDENOCHE, s. f. (Commerce.) étoffe dont il est fait mention dans le tarif de la douanne de Lion, qui se fabrique dans le royaume, mais qu’on ne connoît point à Paris.
BARDER, verb. act. c’est, parmi les cuisiniers, couvrir une piece de viande d’une bande de lard coupée fort mince, pour ralentir l’action du feu sur cette piece, qui se secheroit trop sans cette précaution, ou même brûleroit, & pour en relever le goût.
Barder, c’est, en Architecture, l’action de charger une pierre sur un chariot, sur un bar (Voyez Bar & Chariot) pour la mener du chantier au pié du tas. (P)
Barder un cheval (Manege.) c’est lui mettre une barde. Voyez Barde. Dans les carrousels, on voit des chevaux bardés & caparaçonnés. V. Carrousels. (V)
BARDES, s. m. pl. (Hist. anc.) ministres de la religion chez les anciens Gaulois, qui habitoient dans l’Auvergne & dans la Bourgogne, où ils avoient un collége. Leur profession étoit d’écrire en vers les actions immortelles des héros de leur nation, & de les chanter au son d’un instrument qui ressembloit assez à la lyre. Voici comme en parle Lucain :
Vos quoque qui fortes animas, belloque peremptas,
Laudibus in longum vates dimiltitis œvum,
Plurima securi fudistis carmina Bardi.
Les Bardes & les Druides différoient en ce que ceux-ci étoient les prêtres & les docteurs de la nation, & que les Bardes n’étoient que poëtes ou chantres. Cependant l’autorité de ceux-ci, quoiqu’inférieure à celle des Druides, étoit si respectée des peuples, qu’on raconte qu’ils avoient fait quitter les armes à des partis prêts à se charger. Larrey, Pasquier & Bodin leur donnent le titre de prêtres & de philosophes ; & Cluvier y ajoûte celui d’orateurs, mais sans fondement. Strabon, plus voisin du tems auquel ont vécu les Bardes, compte trois sectes parmi les Gaulois ; les Druides, les Bardes, & les Evates. Les Bardes, ajoûte-t-il, sont chantres & poëtes ; les Evates, prêtres & philosophes ; & les Druides, à la philosophie naturelle, c’est-à-dire la Physique, ajoûtent la science des mœurs. Mais Hormius réduit ces sectes à deux classes, les Bardes & les Druides ; d’autres n’en font qu’un corps, sous le nom générique de Druides. Cluvier, fondé sur ce que Tacite traitant des mœurs des anciens Germains, fait mention de leurs chants & de leurs poëmes historiques, veut que ces peuples ayent eu aussi des poëtes nommés Bardes.
Bochart fait dériver ce nom de parat, chanter. Camden convient avec Festus que Barde signifie un chantre, en Celtique Bard : d’autres tirent ce nom de Bardus, ancien Druide, fils de Drys, le cinquieme roi des Celtes. (G)
BARDESANISTES, s. m. pl. (Hist. ecclés.) nom d’une secte d’hérétiques, ainsi appellés de Bardesanes Syrien, qui vivoit dans le second siecle & demeuroit à Edesse, ville de Mésopotamie. Si l’on en croit saint Epiphane, Bardesanes fut d’abord catholique, & se distingua autant par son savoir, que par sa piété, ayant écrit contre Marcion & d’autres hérétiques. Eusebe, au contraire, en parle comme d’un homme qui a toûjours été dans l’erreur. Il fut d’abord engagé dans celles de Valentin, en reconnut une partie, en retint une autre, & y en ajoûta de nouvelles de son propre fonds. Quoiqu’il admît l’ancien & le nouveau Testament, il adoptoit aussi quelque livres apocryphes ; & dans un de ses écrits intitulé du Destin, il soûtenoit que les actions des hommes étoient nécessitées, & que Dieu lui-même étoit sujet au destin. Il imagina aussi plusieurs générations d’Eons, voyez Eon, & nia la résurrection des morts. Ses sectateurs allerent plus loin, & nierent l’incarnation & la mort de Jesus-Christ, prétendant que c’étoit seulement un corps phantastique qui étoit né de la vierge Marie, & que les Juifs avoient crucifié, par où ils retomboient dans l’hérésie de Marcion, que leur maître même avoit combattue. Strumzius a écrit l’histoire des Bardesanistes. (G)
BARDEUR, s. m. pl. terme de bâtiment, on nomme ainsi les ouvriers qui chargent les pierres sur un chariot, ou qui les portent, sur une civiere ou sur un bar, du chantier au pié du tas. Voyez Bar. (P)
* BARDEWICK (Géog.) ancienne & grande ville d’Allemagne, dans la basse Saxe, maintenant bourg, sur la riviere d’Ilmeneau.
Il y a aussi un bourg de ce nom dans le comté de Hollande.
BARDIS, s. m. c’est, en Marine, un batardeau fait de planches sur le haut du bord d’un vaisseau, pour empêcher l’eau d’entrer sur le pont lorsqu’on couche ce vaisseau sur le côté pour le radouber.
Bardis, ce sont encore des séparations de planches, qu’on fait à fond de cale, pour charger des blés & d’autres grains ; les unes se font en travers, les autres en long. (Z)
* BARDIT (Hist. anc.) c’est ainsi que le chant des anciens Germains est appellé dans les auteurs Latins qui ont écrit de ces peuples. Les Germains n’ayant encore ni annales ni histoires, débitoient toutes leurs rêveries en vers : entre ces vers, il y en avoit dont le chant s’appelloit bardit, par lequel ils s’encourageoient au combat, & dont ils tiroient des augures, ainsi que de la maniere dont il s’accordoit à celui de leurs voix.
* BARDOCUCULLUS ou BARDAICUS CUCULLUS, selon Casaubon (Hist. anc.) partie du vêtement des Gaulois de Langres & de Saintes ; c’étoit une espece de cape qui avoit un capuchon commode pour ceux qui ne vouloient pas être connus dans les rues. Martial lui donne la forme d’un cornet d’épices. Il y en a, dit le savant Pere Montfaucon, qui croyent, & non sans fondement, que ce capuchon avoit une appendice, & qu’il tenoit à une cape ou à la penula. Quoi qu’il en soit, on convient que le cucullus étoit la même chose que le bardocucullus ; que cet ajustement venoit des Gaulois ; qu’on s’en servoit particulierement dans la Saintonge, & que la débauche en fit passer l’usage à Rome où on le trouva très propre pour courir la nuit, & incognito, des avantures amoureuses :
Si nocturnus adulter, Tempora santonico velas adoperta cucullo.
Je ne sai s’il reste encore en Saintonge quelque vestige de l’usage du cucullus & de la cape : mais les femmes du peuple portent encore aujourd’hui à Langres, une espece de cape qui leur est particuliere, & dont elles n’ignorent pas l’avantage.
BARDOT (Maréch. & Manege.) on appelle ainsi un petit mulet. (V)
* BARDT (Géog.) ville d’Allemagne, dans le duché de Poméranie, proche la mer Baltique. Long. 31. lat. 54. 23.
* BAREITH (Géog.) petite ville d’Allemagne, en Franconie, dans le margraviat de Culmbach. Long. 29. 20. lat. 50.
* BARENTON (Géog.) petite ville de France, dans la basse Normandie, au diocese d’Avranches, vers la source de l’Ardée.
* BARFLEUR (Géog.) ville de France, en Normandie, dans le Cotentin. Long. 16. 23. 35. lat. 49. 40. 17.
* BARFOULS, s. m. pl. (Commerce.) étoffe qui se fait à Cantor, qui sert de vêtemens aux Négres, & qu’ils échangent avec les Européens, contre du fer.
* BARGA (Géog.) petite ville de Toscane, en Italie, sur la riviere de Scorchio, dans le Florentin.
BARGE, oiseau. Voyez Petit Corlieu.
BARGE, s. f. pl (Marine.) anciennement on se servoit de ce mot pour dire une barque ou esquif : à Londres, on dit encore la barge du maire.
* BARGELACH, s. m. (Hist. nat. Ornith.) oiseau de Tartarie, qui habite les lieux deserts, où il est la proie des faucons ; il a la grosseur de la perdrix ; la forme de queue de l’hirondelle, & les piés du papeguai, avec le vol très-rapide : assemblage de caracteres qui, pouvant convenir à un grand nombre d’oiseaux, désignent assez mal le bargelach.
* BARGEMONT (Géog.) ville de France, au diocese de Fréjus.
* BARGENY (Géog.) ville de l’Ecosse méridionale, capitale de la province de Carrick. Long. 12. 38. lat. 55. 40.
* BARGUA DE REGOA (Géog. anc. & mod.) ville des Callaïques Bracariens, appellée Tantobriga ; ce n’est plus qu’un petit village au quartier de Tra-las-montes, province de Portugal, à l’occident de Bragance.
BARGUETTE, s. f. pl. sur les rivieres, espece de bateau de quarante piés de long ou environ, qui sert à passer les chevaux, & à porter des cordages pour la manœuvre de la riviere.
* BARI (Géog.) ville d’Italie, au royaume de Naples, capitale de la terre de même nom. Long. 34. 32. lat. 41. 31.
* BARI (Géog.) province d’Italie, au royaume de Naples, bornée par le golfe de Venise, la Capitanate, la Basilicate, & la terre de Lecce. Bari en est la capitale.
* BARJAC (Géog.) petite ville de France, en Languedoc, diocese d’Usès.
* BARIGA DE MORE, s. f. (Commerce.) soie que les Hollandois apportent des Indes orientales. Il y a la fine & la commune ; elles viennent l’une & l’autre sur les vaisseaux de la compagnie.
* BARJOLS (Géog.) ville de France, en Provence. Long. 23. 50. lat. 43. 35.
* BARIQUICEMETO (Géog.) contrée de la Terre-ferme, dans l’Amérique méridionale & le midi de la province de Venezuela, le long de la riviere de Bariquicemeto, qu’on nomme aussi Baria, ou Rio de S. Pietro, qui se jette dans l’Orenoque.
* BARIS (Géog.) ancienne ville de Pamphilie, dans la Pisidie, contrée de l’Asie mineure, aux environs du mont Taurus.
* BARKAN (Géog.) ville de Hongrie, proche le pont de Gran.
* BARKLEY (Géog.) ville d’Angleterre, dans la province de Glocester, sur la Saverne. Long. 15. 12. lat. 51. 43.
* BARLEMONT (Géog.) ville de Hainault dans les Pays-bas, sur la Sambre, proche Mons.
* BARLENGA (Géog. anc. & mod.) petite île de Portugal, vers la côte de l’Estramadure, vis-à-vis Santarin. Il y en a d’autres du même nom, entre lesquelles est Barlengote ; toutes s’appellent les îles de Barlenga. Barlenga étoit connu des anciens sous le nom de Londobris & d’Erythia.
* BARLETTE (Géog.) ville d’Italie, au royaume de Naples, dans la terre de Bari, sur le golfe de Venise. Long. 34. 2. lat. 41. 30.
* BARLINS. s. m. c’est dans les manufactures en soie ; le nom d’un nœud qu’on fait au commencement & à la fin des pieces pour les tordre ; noüer ou remettre. Voyez Tordre & Remettre.
BARLONG, adj. usité, en Architecture, pour signifier un plan, ou un corps dont la base a plus d’étendue à la face qu’au côté : oblong est le contraire. (P)
* BARLOVENTO (les iles de) Géog. partie septentrionale des Antilles ; on les appelle aussi insula ad ventum, parce qu’elles sont exposées au vent. On compte entre ces îles, Anguila, saint Martin, saint Barthelemi, saint Eustache, saint Christophle, Nieves ou l’île des Neiges, la Barbade, Antigoa, Montserrat, la Guadeloupe, la Desirade, la Marigalante, la Dominique, la Martinique, sainte Lucie, saint Vincent, la Barboude, Bequia, Grenadille, Grenade, & Tabago.
BARNABITES, s. m. pl. (Hist. eccl.) congrégation de clercs réguliers ainsi nommés de l’église de S. Barnabé à Milan, où ils firent leurs premiers exercices. Ils reconnoissent pour instituteurs Jacques Antoine Morigia, Barthelemi Ferrera, & François Marie Zacharie de Cremone, gentilshommes Milanois, qui jetterent les premiers fondemens de leur ordre en 1533. Ils furent alors approuvés par Clément VII. & par Paul III. en 1553. Quoiqu’ils soient vulgairement connus sous le nom de Barnabites, leur véritable titre est celui de Clercs réguliers de la congrégation de S. Paul. Ils portent l’habit noir, à peu près semblable à celui des Jésuites. Cette congrégation a produit beaucoup d’hommes distingués par leur savoir & leur piété. Les catéchismes, les missions, & l’instruction de la jeunesse dans les sciences & les lettres, sont leurs emplois ordinaires. Ils ont plusieurs colléges en Italie, en Savoie, & quelques-uns en France ; sur-tout celui de Montargis, fondé par la libéralité des ducs d’Orléans. (G)
BARNACLE, BARNAQUE, voyez Bernacle.
BARNACLES, (terme de Blason Anglois.) Voyez Bernacle.
* BARNAGASSE, (Géog.) royaume d’Afrique entre la haute Ethiopie, le Nil & la mer Rouge, le long de la côte d’Abex ; Barra en est la capitale.
* BARNEVELDT, (Géog.) ile de l’Amérique dans le détroit de Magellan, au midi de la terre de Feu. Long. 340. lat. 56. 20.
Il y a une autre île de même nom proche du Japon, lat. 34. 10.
* BARNSTABLE, (Géog.) ville d’Angleterre dans le Devonshire, sur la riviere de Taw, avec port. Long. 13. 42. lat. 51. 10.
* BAROCHE, (Géog.) ville d’Afrique dans les états du Mogol, au royaume de Gusarate, sur la riviere de Nerdaba. Lat. 21. 55.
Baroché, adj. terme de Peinture dont on se sert pour exprimer que le pinceau n’a pas tracé nettement un contour, & qu’il a éclaboussé de la couleur sur le fond ; on dit : vous barochez toûjours vos contours. Voyez Rechampir. (R)
* BAROCO, (Log.) terme qui désigne le quatrieme mode d’argument de la seconde figure. Un syllogisme en baroco a la majeure universelle affirmative, & la mineure & la conclusion particulieres négatives. Voyez Syllogisme.
BAROMETRE, s. m. (Phys.) Le barometre est un instrument qui sert à mesurer la pesanteur de l’atmosphere & ses variations, & qui marque les changemens du tems. Voyez Atmosphere & Tems.
Ce mot est composé de βάρος, poids, & de μέτρον, mesure. On confond ordinairement, quoique mal-à-propos, le barometre avec le baroscope : celui-ci cependant ne fait, suivant la signification du mot, que marquer les altérations du poids de l’atmosphere : le barometre non-seulement marque ces altérations, mais encore les mesure. Voyez Baroscope.
Le barometre & ses usages sont fondés sur l’expérience de Toricelli, ainsi nommée de Toricelli son inventeur. On prend un tuyau de verre rempli de mercure, dont un côté est fermé hermétiquement, & dont l’autre bout qui est ouvert est plongé dans une cuvette remplie de mercure : quand le poids de l’atmosphere diminue, la surface du mercure qui se trouve vers le bout inférieur, & sur laquelle l’air presse, se trouve moins comprimée : ainsi le mercure qui est dans le tuyau descend ; & au contraire si le poids de l’air augmente, le mercure monte ; car la colonne de mercure suspendue dans le tuyau est toûjours égale en pesanteur au poids de l’atmosphere qui pese dessus, comme il est démontré à l’article .
Dans cette explication nous supposons que la pression de l’air vienne uniquement de son poids, qui comprime les parties supérieures sur les inférieures. Cependant il est certain que plusieurs causes concourent à altérer la pression de l’air : en général la cause immédiate de la pression d’un fluide élastique tel que l’air, c’est la vertu élastique de ce fluide, & non son poids. On ne doit donc attribuer la suspension du mercure dans le barometre au poids de l’air, qu’autant que ce poids est la cause principale de la pression de l’air. En effet le mercure du barometre se soûtient aussi bien dans une chambre exactement fermée qu’en plein air ; parce que l’air de cette chambre, quoiqu’il ne porte pas le poids de l’atmosphere, est comprimé de la même maniere que s’il le portoit. Si l’air demeure de même poids, & que la compression de ses parties vienne à augmenter ou à diminuer par quelque cause accidentelle, alors le mercure descendra ou montera dans le barometre, quoique le poids de l’air ne soit pas augmenté. Traité des fluides, Paris 1744. p. 61.
Il y a différentes especes de barometre, dont nous allons détailler ici les principales.
Barometre commun. La construction du barometre commun est telle. On remplit de mercure un tuyau de verre, fermé hermétiquement par sa partie supérieure, ayant son diametre d’environ 1/10 de pouce, & sa longueur au moins de 31 ; on remplit ce tuyau de maniere qu’il ne reste point d’air mêlé avec le mercure, & qu’aucun autre corpuscule ne s’attache aux parois du tuyau. Pour y réussir, on peut se servir d’un entonnoir de verre terminé par un tuyau capillaire, & remplir le tube par le moycn de cet entonnoir.
On peut encore chasser les bulles d’air par deux autres méthodes : la plus ordinaire est de remplir de vif argent tout le tube, à la réserve d’un pouce environ qu’on laisse plein d’air ; on bouche avec le doigt l’orifice du tuyau, on le renverse, & en faisant promener la bulle, on lui fait entraîner avec elle toutes les petites bulles imperceptibles, après quoi on acheve de remplir le tube. Mussch. ess. de Phys.
L’autre méthode consiste à faire chauffer un tube presque plein sur un brasier couvert de cendres ; on le tourne continuellement ; & la chaleur raréfiant les petites bulles d’air, les fait sortir par l’orifice.
Quand on a ainsi rempli le tuyau jusqu’au bord, on bouche exactement avec le doigt son orifice, en sorte qu’il ne puisse s’introduire d’air entre le doigt & le mercure ; ensuite on plonge le tuyau dans un vaisseau plein de mercure, de façon cependant que le tuyau ne touche pas le fond du vase : à la distance de 28 pouces de la surface du mercure, sont attachées 2 bandes divisées en 3 pouces, & ces pouces sont subdivisés en un certain nombre de plus petites parties ; enfin on applique le tuyau sur une planche de bois, pour empêcher qu’il ne se brise : on laisse découvert le vaisseau où le tuyau est plongé, ou si l’on veut on le couvre, afin qu’il n’y entre point de poussiere, & le barometre est achevé.
Au lieu de plonger le tuyau dans un vaisseau, on se contente souvent d’en recourber l’extrémité, de sorte que le tuyau a deux branches verticales, dont l’une est beaucoup plus petite que l’autre, & se termine par une espece d’entonnoir fort large, qui se trouve rempli de mercure, sur la surface duquel l’atmosphere presse, & fait monter ou descendre le mercure du tuyau d’une maniere d’autant plus sensible, que la variation du poids de l’atmosphere est plus grande. C’est le barometre simple ou ordinaire. Voyez Planche Pneumat. fig. 1.
On a essayé plusieurs fois s’il étoit possible de rendre les variations du barometre plus sensibles, afin de pouvoir mesurer la pression de l’atmosphere avec plus de justesse ; ce qui a donné lieu à un grand nombre de barometres de différentes structures, comme le barometre à roue, le barometre diagonal, le barometre horisontal, &c.
Descartes, & ensuite Huyghens, se sont servis d’un tube AB, (fig. 2.) fermé en A, & ayant une portion CD plus grosse que le reste : la moitié de la partie CD, de même que la partie supérieure du tube, est remplie d’eau ; & l’autre moitié de CD, de même que la partie inférieure du tube, est remplie de mercure. Il est vrai que dans cette sorte de barometre la colonne suspendue étant plus grande, rendoit la variation plus sensible : mais l’air renfermé dans l’eau s’évaporant par degrés, remplissoit l’espace vuide du haut du tube, & rendoit par-là la machine défectueuse. Huyghens imagina donc qu’il valoit mieux placer dans le barometre le mercure & l’eau, de la maniere suivante : ADG (fig. 3.) est un tuyau recourbé fermé hermétiquement en A, & ouvert en G ; les vaisseaux cylindriques BC & FE, sont égaux, & distans d’environ 29 pouces l’un de l’autre ; le diametre du tuyau est d’environ une ligne ; celle de chaque vaisseau est de 15, & leur profondeur d’environ 10 : le tuyau est rempli de mercure, qui est suspendu entre le vaisseau FE & le vaisseau BC, l’espace qui reste jusqu’à A étant vuide d’air & de mercure : enfin on verse de l’eau commune mélée avec une sixieme partie d’eau régale (pour que l’eau ne se gele pas) dans le tuyau EFG, de maniere qu’elle contrebalance en partie le mercure CDF. Or quand le mercure s’éleve le long du tuyau AD, au-dessus du niveau du mercure qui est contenu en FE, ce mercure en s’élevant fait équilibre avec l’atmosphere ; si la pression de l’atmosphere augmente, la colonne de mercure s’augmentera, conséquemment l’eau descendra ; si l’atmosphere presse moins, la colonne de mercure descendra, & l’eau montera. Par là ce barometre indique beaucoup mieux les plus petites variations de l’air, que le barometre commun : car au lieu de deux pouces, le fluide pourra varier beaucoup davantage ; ce qui vient tant de la grosseur des cylindres par rapport aux tuyaux, que de la pesanteur de l’eau, qui est moindre que celle du mercure, & dont les variations doivent être par conséquent plus sensibles ; car 14 pouces d’eau équivalent à un pouce de mercure. En élargissant les diametres des cylindres, la variation sera encore plus sensible. Il y a pourtant encore cet inconvénient, que l’eau s’évaporera, & rendra les variations défectueuses ; quoiqu’on puisse en quelque façon prévenir l’évaporation en mettant une goutte d’huile d’amandes douces sur la surface de l’eau.
Mais cette goutte d’huile produit un autre inconvénient ; car elle s’attache aux parois du tuyau, & fait par conséquent que l’eau après l’avoir traversée, & quelquefois s’être débordée, rend le tuyau opaque.
Le plus grand défaut surtout est causé par le froid & le chaud, qui font que la liqueur du tuyau EFG est comme dans une boule, & un tuyau de thermometre. En effet, cette liqueur se raréfie par la chaleur, & se condense par le froid ; d’où il arrive que la hauteur de l’eau varie par la chaleur seule, & fait par conséquent varier le mercure ; de sorte que les variations de cette espece de barometre sont presqu’autant l’effet de la chaleur que de la pression de l’air.
On a tâché depuis peu de rendre ces barometres plus simples, en substituant de l’esprit-de-vin à l’eau, & des boules aux cylindres : mais l’esprit-de-vin est très-sujet à s’évaporer & à se dilater par la chaleur ; & d’ailleurs le changement des cylindres en forme de poires, empêche de faire des échelles justes. Au reste il est visible que la marche de ce barometre est contraire à celle du barometre ordinaire ; tandis que le mercure baisse dans ce dernier, l’eau & l’esprit-de-vin s’élevent dans l’autre, & réciproquement. Mussch.
Ainsi les défauts auxquels ce barometre peut être sujet, ont obligé quelques autres à avoir recours au barometre horisontal ou rectangle ABCD (fig. 4.) Ce barometre est formé de maniere que la branche BC soit verticale, & la branche CD horisontale. Il est joint par l’extrémité de sa branche perpendiculaire à un vaisseau AB, & les variations sont marquées sur la branche horisontale CD : or l’intervalle ou l’espace de variation peut être aussi étendu que l’on veut ; car plus le tuyau BCD sera petit par rapport au vase AB, plus les variations du mercure dans le tuyau AB, feront varier le mercure qui est dans la partie CD ; & par conséquent les plus petites variations seront très-sensibles. Le diametre du tuyau CD étant donné, il sera aisé de trouver le diametre du vaisseau AB, tel que les parties de l’échelle horisontale dans le tuyau DC, correspondantes aux parties de l’échelle du vaisseau AB soient aussi grandes qu’on voudra, & ayent entr’elles la même proportion que les parties de l’échelle dans le vaisseau AB, puisque le diametre du vaisseau est à celui du tuyau en raison soû-doublée réciproque des parties de leurs échelles : de même les diametres de CD & AB étant donnés, aussi bien que la hauteur du mercure dans le vaisseau, la hauteur du mercure dans le tuyau est trouvée par cette proportion ; comme le quarré du diametre du vaisseau est au quarré du diametre du tuyau, ainsi les parties de l’échelle du mercure dans le tuyau, sont aux parties correspondantes à l’échelle du mercure dans le vaisseau.
La construction de ce barometre, de même que du barometre d’Huyghens, est établie sur un théorème d’Hydrostatique ; savoir, que les fluides qui ont la même base, pesent en raison de leur hauteur perpendiculaire, & non pas de la quantité de leur matiere : ainsi la même pesanteur de l’atmosphere soûtient le vif-argent dont le tuyau ACD & le vase AB sont remplis, comme elle auroit soûtenu le mercure dans le seul tuyau ABC. Voyez Hydrostatique. Ce barometre a aussi de grands défauts.
Car, en premier lieu, l’air s’introduit quelquefois entre les particules du mercure dans le tuyau CD, & les écarte par conséquent les unes des autres lorsque le tuyau est trop large. Pour remédier à cet inconvénient, on ne donne qu’une ligne de diametre, ou même moins, la partie CD, on a soin que ce petit tuyau soit neuf & bien net, & on se sert de mercure qui soit bien purgé, à l’aide du feu, de tout l’air qu’il contient : malgré tout cela, le mercure se salit avec le tems en-dedans par l’air qui y entre, ce qui produit fort souvent quelque séparation entre les parties du mercure, lorsqu’il se meut de D vers C, ou du moins il s’en forme de petits globules, lesquels s’arrêtent çà & là dans la partie antérieure du tuyau qui se trouve vuide.
Il se présente encore un autre inconvénient bien plus considérable, qui vient du grand frottement du mercure contre le verre, & qui empêche ce barometre d’être à beaucoup près aussi sensible que le barometre ordinaire. En effet, d’habiles observateurs nous assûrent avoir remarqué souvent que si le mercure hausse ou baisse d’une demi-ligne ou d’une ligne entiere dans le barometre ordinaire, il demeure encore à sa même place dans le tuyau CD : mais si la variation augmente dans le barometre ordinaire, il se fait alors dans le tuyau CD un très-grand mouvement, ensorte que la marche de ce barometre est beaucoup moins réglée que celle du barometre ordinaire. Mussch.
Ces raisons font que plusieurs personnes préferent le barometre diagonal, dans lequel l’espace de variation est beaucoup plus grand que dans le barometre commun, & duquel ils croyent les variations plus régulieres que celles des autres. Le Chevalier Morland a imaginé pour cet effet un tuyau incliné BEC. (fig. 5.) car il est évident que le mercure s’élevant à la même hauteur dans un barometre droit, & dans un barometre recourbé, ses variations seront beaucoup plus sensibles dans le tuyau incliné BEC, que si ce tuyau étoit vertical, & d’autant plus sensibles, que le tuyau sera plus incliné, puisque le mercure, pour s’élever, par exemple, d’une ligne en hauteur perpendiculaire, aura trois ou quatre lignes ou même davantage à parcourir dans la longueur du tuyau. Cette invention est pourtant sujette à plusieurs inconvéniens ; car la surface du mercure dans le tuyau BE, n’est pas parallele à l’horison, mais elle est convexe & inclinée ; or cela posé, il est difficile de savoir à quel point on doit fixer la hauteur du mercure. De plus le coude qui est en B, rend la surface du tuyau fort raboteuse en cet endroit là, & les inégalités de la surface produisant une résistance à l’abaissement ou à l’élevation du mercure, les variations de ce barometre ne sont pas aussi promtes qu’elles le devroient être. Ce dernier inconvénient est d’autant plus grand, que le tuyau BEC fait un plus grand coude en B ; ainsi la sensibilité, pour ainsi-dire, des variations de ce barometre est alors compensée par leur lenteur. Mussch.
Barometre à roue : c’est une invention du docteur Hook, qui rend les altérations de l’air plus sensibles ; il est composé d’un barometre commun vertical, auquel on ajoûte deux poids A & B (fig. 5.) pendus à une poulie, dont l’un est en liberté à l’air, & l’autre restant sur la surface du mercure dans le tuyau, s’éleve & s’abaisse avec lui. Le poids A communique son mouvement à la poulie, & cette poulie a autour de son pivot une longue aiguille LK, qui montre sur un grand cercle gradué MNOP, les variations de la hauteur du mercure dans le barometre. De plus, le tuyau du barometre est surmonté d’un gros globe AB, & la petite boule B, qui est en liberté dans l’air, est à peu-près égale en-pesanteur à la boule A. Comme le globe AB a beaucoup de diametre par rapport à celui du tuyau, un abaissement peu considérable du mercure dans ce globe, peut faire monter le mercure dans le tuyau FA, jusqu’à la hauteur de trois pouces. Supposons maintenant que toute la circonférence de la poulie FD soit de trois pouces ; elle fera donc un tour lorsque le mercure montera ou s’abaissera de trois pouces, de sorte que l’aiguille LK fera alors un tour aussi ; & si le diametre du cercle M N OP est d’un pié, le mercure ne pourra s’abaisser ou s’élever de trois pouces, que l’aiguille ne parcoure environ trois piés. Ce barometre montre assez bien les variations considérables de la hauteur du mercure : mais aussi-tôt que le mercure vient à baisser ou à monter dans le tuyau AF, & qu’il ne fait par conséquent que commencer à devenir un peu convexe ou un peu concave, la petite boule A n’a pas assez de mouvement pour faire tourner un peu la poulie SD, parce que cette poulie est sujette à quelque frottement sur son axe : ce qui empêche d’appercevoir les variations peu considérables de la hauteur du mercure : mais lorsque la poulie commence à se mouvoir, son mouvement est plus grand qu’il ne devroit être alors. Voilà sans doute un inconvénient auquel on ne peut remédier qu’avec beaucoup de peine. Ce barometre est encore sujet à d’autres inconvéniens qu’on a eu soin de marquer dans les Transactions Philosophiques, n. 185. p. 241. aussi n’en fait-on aucun usage. Mussch.
Barometre conique : c’est une machine plûtôt curieuse qu’utile. Elle consiste en un tuyau conique verticalement placé, dont l’extrémité supérieure, & qui est la plus petite, est fermée hermétiquement. Ce barometre n’a point de vaisseau ou de bassin, sa figure conique y suppléant, pourvû que l’extrémité inférieure de ce tuyau ait un diametre fort petit : car alors le mercure se soûtient de lui-même dans ce tuyau, étant soûtenu par les particules de l’air, comme par un piston solide ou un fond. Quand ce tuyau est rempli, si le mercure s’y soûtient, son poids est équivalent au poids de l’atmosphere ; & si l’atmosphere varie, le mercure montera ou descendra. Ainsi quand le poids de l’atmosphere s’augmente, le mercure est chassé dans la partie du tuyau la plus étroite ; & par ce moyen la colonne est étendue, & son poids est augmenté. Au contraire, quand l’atmosphere décroît, le mercure s’abaisse dans la partie la plus large du tuyau ; & par ce moyen sa colonne est plus courte, & sa pression conséquemment est affoiblie.
Pour rendre ceci plus intelligible, supposons que ce barometre soit représenté par le tuyau AB (fig. 6.) qui est conique, & que ce tuyau étant renversé, se trouve rempli de trente pouces de mercure depuis A jusqu’à C ; & comme la variation da mercure dans le barometre est de trente à vingt-sept pouces, supposons que la même quantité de mercure AC dans la partie inférieure du tuyau DB, ait la hauteur DB de vingt-sept pouces ; alors il est certain que, lorsque le mercure se trouvera dans le barometre ordinaire à la hauteur de trente pouces, le mercure dans le tuyau AB occupera l’espace AC ; & quand le mercure sera dans le barometre à vingt-sept pouces, le mercure du tuyau occupera l’espace DB ; ainsi la variation du mercure dans le barometre sera depuis A jusqu’à D, qui est un espace de près de trente pouces, pendant que cette variation ne sera que de trois pouces dans le barometre ordinaire. Ce barometre est de l’invention de M. Amontons. Mussch.
L’inconvénient de ce barometre est que pour empêcher le mercure & l’air de changer de place, & de se mêler ensemble, il faut que le diametre intérieur du tuyau soit très-petit ; & cette petitesse rend le frottement de la liqueur si sensible, qu’elle peut l’empêcher d’agir librement ; ainsi cet instrument n’est guere bon que pour les Marins qui n’y regardent pas de si près, & qui s’en servent depuis trente-cinq ans, parce qu’il est fort commode. En effet, il suffit de le renverser lorsqu’on le veut garder ; & quand on veut connoître le poids de l’air, il suffit de prendre le tuyau à la main, & de le tenir dans une situation verticale. Pour empêcher que le mercure n’en sorte par en-bas, comme il pourroit arriver dans les mouvemens violens du vaisseau, on met au-dessous du tuyau, proche de B, un peu de coton à travers lequel l’air passe librement ; & s’il arrive alors par quelque accident qu’il tombe un peu de mercure de la colonne AD, il suffit de retourner le tuyau ; & ce qui est tombé se rejoint d’abord à la colonne. Il y a encore un autre barometre à l’usage des Marins. Ce barometre qui a été aussi inventé par le docteur Hook, pour pouvoir servir sur mer, où le roulis du vaisseau rendroit les autres impraticables, n’est autre chose qu’un thermometre double, ou deux tubes à demi remplis d’esprit-de-vin, dont l’un est fermé hermétiquement par les deux bouts, & renferme une certaine quantité d’air ; & l’autre est fermé par un bout, & ouvert par l’autre. Or l’air, comme l’on sait, agit sur l’esprit-de-vin, & le fait monter par deux raisons ; par sa propre gravité, comme dans le tube de Torricelli ; & par sa chaleur, comme dans le thermometre. Si donc les deux tubes sont divisés par degrés, ensorte qu’ils s’accordent l’un avec l’autre au tems où l’air y est renfermé, il s’ensuit que lorsqu’ils s’accorderont encore ensuite, la pression de l’atmosphere sera la même que dans le tems que l’air a été renfermé. Si dans le thermometre qui est ouvert à l’air, la liqueur est plus haute, en considérant en même tems combien l’autre s’éleve ou s’abaisse par l’opération de la chaleur ou du froid, on verra que l’air est plus pesant : au contraire, quand le thermometre ouvert est plus bas en comparaison de l’autre, l’air est plus léger que dans le tems que l’instrument a été divisé par degrés. Mais il faut se ressouvenir que la condensation & la raréfaction de l’air, sur quoi toute cette machine est établie, ne dépendent pas seulement du poids de l’atmosphere, mais qu’elles sont aussi causées par l’action de la chaleur & du froid. C’est pourquoi cette machine ne peut pas être nommée un barometre, mais plûtôt un instrument qui indique les altérations de l’air. Voyez Manometre.
Cependant cet instrument est regardé comme étant fort bon pour faire connoître si le tems doit être mauvais, de même que les changemens de vents, & l’approche du froid. Transact. philos. n°. 429, p. 133.
Le barometre statique, dont se sont servi Boyle, Otto de Guericke, &c. est défectueux, tant par l’action du chaud, que parce qu’il est peu précis & peu commode : il consiste en un assez grande bouteille de verre, tenue en équilibre par un poids de cuivre, dans des bassins de balance fort légers : ces deux corps étant d’égale pesanteur, mais d’inégal volume, si le milieu ou fluide dans lequel ils pesent également est changé, le changement de leur poids s’en suivra ; de sorte que si l’air devient plus pesant, le corps le plus grand deviendra plus léger en apparence, parce qu’il perdra plus de son poids que le plus petit, qui est le plus dense : mais si le milieu est plus léger, alors le corps le plus grand l’emportera sur le plus petit.
Phénomenes du barometre. Ces phénomenes sont différens, & les auteurs ne sont pas plus d’accord sur leurs causes, que sur l’usage que l’on en peut faire pour prédire les changemens de tems. Sur le haut de la montagne de Snouden en Angleterre, qui a 1240 toises de hauteur, le docteur Halley trouva le mercure de trois pouces huit dixiemes plus bas qu’au pié ; d’où il paroît que le mercure baisse d’un de pouce par trente toises. Derham a fait pareillement des expériences de la hauteur du mercure sur le haut & au pié de cette montagne, & croit qu’il faut 32 toises d’élévation perpendiculaire, pour que le mercure baisse du d’un pouce : d’où cet auteur a cru qu’on pouvoit tirer non-seulement la hauteur de l’atmosphere, mais aussi une méthode pour mesurer la hauteur des montagnes. Suivant cet auteur, si le mercure ici bas est à 30 pouces, à 1000 piés de hauteur, il sera à 28 pouces ; à 2000 piés, à 27 ; à 3000, 26 ; à 4000, 25 ; à 5000, 24 ; à un mille, 24 ; à deux milles, 20 ; à cinq milles, 11 ; à dix milles, 4 ; à quinze milles, 1 ; à vingt milles, 0 ; à trente milles, ; à quarante milles, . Mais on suppose dans ce calcul que l’atmosphere est par-tout d’une densité à peu près égale, & que si on la divise en portions d’égale hauteur, le poids de ces portions est presque le même, ce qui est bien éloigné d’être vrai ; car l’atmosphere devient continuellement moins dense à mesure qu’on s’éloigne de la terre, & ainsi une même quantité d’air occupe toûjours un volume de plus en plus grand. C’est pourquoi si on divise l’atmosphere en différentes couches toutes d’une hauteur égale, ces couches peseront d’autant moins qu’elles seront plus éloignées du centre de la terre. M. Mariotte, dans son essai sur la nature de l’air, a donné un calcul de la hauteur de l’atmosphere, fondé sur les observations du barometre faites au sommet des montagnes. Ce calcul est fondé sur ce principe, que l’air se condense en raison des poids dont il est chargé ; l’auteur trouve 15 lieues environ pour la hauteur de l’atmosphere, qui est aussi à peu près la quantité que M. de la Hire trouve par la théorie des crépuscules. M. Mariotte ajoûte aussi à son calcul un essai de méthode pour déterminer par les mêmes principes la hauteur des montagnes : mais on regarde aujourd’hui assez généralement toutes ces méthodes, comme plus curieuses que sûres & utiles. Voyez Atmosphere.
On a trouvé que la plus grande hauteur du barometre à Londres, étoit à trente pouces , & son plus grand abaissement à 28 pouces ; à l’observatoire de Paris, sa plus grande élévation est de 28 pouces , & sa moindre 26 sur la mesure du pié de Paris, qui est plus grand de que celui de Londres : ces observations s’accordent à celles qui ont été faites par M. Wolf à Hall en Saxe. A Alger le mercure s’éleve à 30 pouces ou par le vent de nord, quoique ce vent soit souvent accompagné de pluie & d’orage. Il est vrai qu’il y a une expérience dans laquelle la hauteur du mercure surpasse de beaucoup ces nombres ; le mercure étant parfaitement purifié & suspendu dans un tube, à la maniere de Torricelli, monte à la hauteur de 75 piés, quoiqu’à la moindre secousse il baisse à la hauteur ordinaire. Ce phénomene n’a pas causé peu d’embarras lorsqu’il a été question d’en découvrir la cause. Voici l’explication que M. Musschenbroek en donne dans ses Essais de Physique. Lorsqu’on a purgé le mercure de l’air qu’il contient, il devient un corps beaucoup plus dense que lorsque l’air se trouvoit placé entre ses parties : ce mercure peut aussi alors s’attacher fort étroitement à la surface du verre ; ce qui fait que ses particules y restent suspendues ; & comme ces particules s’attirent très-fortement, elles soûtiennent des particules voisines, & le mercure demeure suspendu par ce moyen à une très-grande hauteur : mais si on secoue le tuyau, alors les particules du mercure qui étoient contiguës au verre en sont détachées, & tout retombe. On peut voir dans l’ouvrage cité l’explication plus détaillée de ce phénomene singulier, & la réfutation de toutes les autres hypotheses qu’on a imaginées pour en rendre raison.
M. Boyle remarque que les phénomenes du barometre sont si variables, qu’il est extremement difficile de donner des regles générales de son élévation, ou de son abaissement. Il semble cependant que ce soit une regle assez générale, que quand les vents soufflent de bas en haut, le mercure est le plus bas : mais cela n’est pas toûjours vrai. L’illustre M. Halley nous a donné les observations suivantes. Dans un tems calme, quand il doit pleuvoir, le mercure est communément bas, & il s’éleve quand le tems doit être serein. Quand il doit faire de grands vents accompagnés de pluies, le mercure descend plus ou moins bas, selon le vent qui souffle. Toutes choses égales, la grande élévation du mercure arrive quand les vents soufflent de l’est, ou du nord-est. Après que le vent a soufflé violemment, le mercure qui pendant le tems que le vent souffloit étoit fort bas, s’éleve avec rapidité. Dans un tems calme, pendant lequel il gele, le mercure se tient haut. Dans les lieux les plus exposés au nord, le mercure souffre plus de variation que dans les lieux exposés au midi : à Naples il varie rarement de plus d’un pouce ; au lieu qu’à Upminster il varie de 2 pouces, & à Petersbourg de 3 , Transact. Phil. n°. 434, p. 402. Entre & proche les tropiques, le mercure ne varie que peu ou point du tout.
Le docteur Beal remarque, que toutes choses égales, le mercure est plus haut dans l’hyver que dans l’été, & ordinairement le matin qu’à midi ; qu’il l’est encore dans un tems serein un peu plus que devant ou après, ou que quand il pleut ; & qu’il descend ordinairement plus bas après la pluie qu’auparavant : s’il arrive qu’il s’éleve après qu’il a plû, c’est ordinairement une indice de beau tems. Il arrive cependant des changemens considérables dans l’air, sans que le barometre varie sensiblement.
Par rapport à l’usage des barometres, un habile Physicien remarque que par son secours, nous recouvrons la connoissance qui est dans les animaux, & que nous avons perdue, parce que nos corps ne sont point exposés à l’air comme les leurs : & parce que nous nous livrons à l’intempérance, & que nous corrompons la sensibilité de nos organes. Par rapport aux prédictions des barometres, M. Halley déja cité trouve que l’élévation du mercure présage le beau tems après la tempête, & que le vent soufflera de l’est ou du nord-est ; que son abaissement marque que ce seront les vents de sud ou d’ouest qui regneront avec la pluie, ou présage des vents de tempêtes, ou tous les deux ; que dans l’orage, si le mercure vient à s’élever, c’est une marque que la tempête passera bien-tôt.
M. Patrick remarque qu’en été l’abaissement du mercure annonce le tonnerre ; & que quand l’orage arrive immédiatement après la chûte du mercure, il est rarement de longue durée : la même chose s’observe du beau tems, s’il arrive immédiatement après l’élévation du mercure. Enfin Derham comparant avec ses observations celles que Scheuczer a faites à Zurich, sur les barometres, remarque que dans le cours de l’année le mercure varie plus à Zurich, quelquefois d’un & même de deux pouces ; & il conclud de-là que la situation de Zurich est de près du d’un mille d’Angleterre plus haute que celle d’Upminster. Il trouve d’ailleurs un accord remarquable entre les observations faites à Zurich & les siennes ; un des barometres suivant à peu près les mêmes variations que l’autre : cependant cet accord n’est pas si parfait que celui des barometres des endroits plus proches, comme ceux de Londres, de Paris, &c.
Causes des phénomenes du barometre. Les hypotheses par lesquelles on a voulu expliquer les phénomenes du barometre sont presque infinies. Il est vrai que le poids de l’atmosphere est généralement regardé comme la cause principale des mouvemens du barometre, & les altérations de l’air comme la cause accidentelle ; cependant cette opinion n’est pas suivie universellement. Un savant auteur, par exemple, regarde les changemens du barometre, comme étant causés par le froid & par la chaleur. Il dit avoir souvent remarqué que dans les orages, &c. quand le mercure est bas, il se divise & pousse en en-haut des particules, qu’il appelle des especes de pellicules ou d’écorchures ; & il soûtient que toutes les fois que le mercure descend, il est plus ou moins dégagé de ces pellicules : que dans ce mouvement les parties du mercure sont resserrées ensemble, & que c’est par cette raison qu’il descend ; que de plus il s’échappe alors de petites particules d’air, qui étoient renfermées dans le mercure, & qui s’élevant dans la partie supérieure du tuyau, forcent le mercure à descendre, les colonnes en étant raccourcies par la sortie de ces particules, & par leur position dans la partie supérieure du tuyau : c’est pourquoi, ajoûte-t-il, le mercure s’éleve dans le tems très-froid à la même hauteur que dans le tems très-chaud, entre les deux tropiques, parce qu’il est dans son état naturel ; & il baisse dans les degrés intermédiaires de chaud & de froid, parce qu’il est resserré, & que ses parties sont comme refoulées & comprimées ensemble. Mais ce sentiment ne rend pas de raison fort vraissemblable des phénomenes.
Les variations de l’atmosphere doivent être regardées comme la cause de celles du barometre : mais il n’est pas aisé de déterminer d’où viennent ces variations dans l’atmosphere, puisqu’il est difficile de trouver un seul principe dans la nature auquel on puisse rapporter des variations si grandes & si irrégulieres. Il est probable que les vents qui soufflent de tel ou tel endroit les occasionnent, de même que les vapeurs & les exhalaisons de la terre : les changemens d’air dans les régions voisines, & même le flux & le reflux que la lune occasionne dans l’air, peuvent y contribuer également.
Cette derniere cause doit certainement entrer parmi celles qui produisent les variations du barometre : mais son effet ne doit pas être fort considérable à cet égard ; quoique l’action de la lune éleve à une hauteur très-grande les eaux de l’Océan. Voici la raison de cette différence : supposons que l’eau s’éleve en pleine mer à la hauteur de 60 piés par l’action de la lune : qu’on mette à la place de l’Océan l’atmosphere ou tel autre fluide qu’on voudra, il est certain qu’il devra s’élever à peu près à la même hauteur ; car l’atmosphere ayant moins de parties que l’Océan, il y aura, à la vérité, une moindre masse à mouvoir, mais aussi la force qui agite cette masse en attirant chacune de ses parties, sera aussi plus petite en même raison. L’air s’élevera donc à la hauteur de 60 piés en montant, & descendra au-dessous de sa hauteur naturelle de l’espace de 60 piés, c’est-à-dire qu’il variera en hauteur de 120 piés en tout. Or le mercure étant 11000 fois plus pesant que l’air, une variation de 120 piés dans une colonne d’air, ne doit faire varier le mercure que d’environ deux lignes. C’est à peu près la quantité dont on trouve qu’il doit hausser sous l’équateur, dans la supposition que le vent d’est y fasse 8 piés par seconde. Or comme il y a une infinité d’autres causes qui font varier le barometre, il n’est pas surprenant que l’on n’ait pas distingué la petite variation que l’action du soleil & de la lune y peuvent produire en élevant ou en abaissant les colonnes de l’atmosphere. Cependant il seroit à souhaiter que les observateurs s’y rendissent attentifs dans la suite. Rech. sur les vents. Paris 1746.
Le savant Halley croit que les vents & les exhalaisons suffisent pour produire les variations du barometre ; & d’après cette opinion il en a donné une explication probable : nous allons donner la substance de son discours sur ce sujet. 1o. Ce sont, dit-il, les vents qui alterent le poids de l’air dans un pays particulier, & cela, soit en apportant ensemble & en accumulant une grande quantité d’air, & en chargeant ainsi l’atmosphere dans un endroit plus que dans l’autre, ce qui arrive lorsque deux vents soufflent en même tems de deux points opposés ; soit en enlevant une partie de l’air, & en déchargeant par-là l’atmosphere d’une partie de son poids, & lui donnant le moyen de s’étendre davantage ; soit enfin en diminuant & soûtenant, pour ainsi dire, une partie de la pression perpendiculaire de l’atmosphere, ce qui arrive toutes les fois qu’un seul vent souffle avec violence vers un seul côté ; puisqu’on a expérimenté qu’un souffle de vent violent, même artificiel, rend l’atmosphere plus légere, & conséquemment fait baisser le mercure dans le tube qui se trouve proche de l’endroit où se fait ce souffle, & même dans un tube qui en est à une certaine distance. Voyez Transactions Philosop. no. 292.
2o. Les parties nitreuses & froides, & même l’air condensé dans les pays du Nord, & chassé dans un autre endroit, chargent l’atmosphere & augmentent sa pression.
3o. Les exhalaisons seches & pesantes de la terre augmentent le poids de l’atmosphere & sa force élastique, de même que nous voyons la pesanteur spécifique des menstrues être augmentée par la dissolution des sels & des métaux.
4o. L’air étant rendu plus pesant & plus fort par les causes que nous venons de rapporter, devient plus capable de supporter des vapeurs, qui étant mêlées intimement avec lui & y surnageant, rendent le tems beau & serein ; au contraire l’air étant rendu plus léger par les causes opposées à celles que nous venons de dire, devient hors d’état de soûtenir les vapeurs dont il est chargé, lesquelles venant à se précipiter en-bas, se ramassent en nuages, qui par la suite se réunissent en gouttes de pluie. Cela étant ainsi, il paroît assez évident que les mêmes causes qui augmentent le poids de l’air, & le rendent plus propre à soûtenir le mercure dans le barometre, occasionnent pareillement le beau tems & le chaud ; & que la même cause qui rend l’air plus léger & moins capable de soûtenir le mercure, produit les nuages & la pluie : ainsi, 1°. quand l’air est très-léger & que le mercure du barometre est le plus bas, les nuées sont basses & vont fort vîte ; & quand après la pluie les nuages se dissipent & que l’air devenant calme & serein s’est purgé de ses vapeurs, il paroît extrèmement net, & on y peut voir des objets à une distance considérable.
2°. Quand l’air est plus grossier & que le mercure est haut dans le tube, le tems est calme, quoiqu’il soit en même tems quelquefois un peu couvert, parce que les vapeurs sont dispersées également : s’il paroît alors quelques nuages, ces nuages sont hauts & se meuvent lentement ; & quand l’air est très-grossier & très-lourd, la terre est ordinairement environnée de petits nuages épais, qui paroissent y être formés par les exhalaisons les plus grossieres, que l’air inférieur est encore capable de soûtenir, ce que ne peuvent plus faire les parties supérieures de l’air, qui sont trop légeres pour cela.
3°. Ainsi, ce qui est cause qu’en Angleterre, par exemple, le mercure est au plus haut degré dans le tems le plus froid quand le vent est nord ou nord-est, c’est qu’alors il y a deux vents qui soufflent en même tems, & de deux points à peu près opposés ; car il y a un vent de sud-ouest constant, qui souffle dans l’Océan atlantique à la latitude qui répond à l’Angleterre ; à quoi on peut ajoûter que le vent de nord y amene l’air froid & condensé des régions du nord.
4°. Dans les régions du nord la variation du mercure est plus sensible que dans celles du midi, les vents étant plus fréquens, plus violens, plus variables & plus opposés l’un à l’autre dans les pays septentrionaux que dans les méridionaux.
Enfin, il s’ensuit de-là qu’entre les tropiques la variation du mercure est très-peu sensible, parce que les vents y sont très-modérés, & qu’ils soufflent ordinairement dans le même sens.
Cette hypothese, quoiqu’elle paroisse propre à expliquer plusieurs mouvemens du barometre, n’est pas cependant à l’abri de toute critique ; car 1°. si le vent est le seul agent qui produise ces altérations, il ne se fera pas d’altération sensible si le vent ne l’est pas, & il n’y aura jamais de vent sensible sans variation du mercure, ce qui est contraire à l’expérience.
2°. Si le vent est le seul agent, les altérations de la hauteur du mercure doivent être en différens sens dans les différens lieux de la terre, selon que le vent y souffle ou n’y souffle pas ; ainsi, ce qu’un tube perdra à Londres, sera regagné sur un autre à Paris, ou à Zurich, &c. mais selon plusieurs Physiciens, on remarque le contraire ; car dans toutes les observations faites jusqu’à présent, les barometres de différens lieux, disent-ils, s’élevent & baissent en même tems, de sorte qu’il faut qu’il y ait une égale altération dans le poids absolu de l’atmosphere, qui occasionne ces variations. Ce fait est-il bien vrai ?
Enfin, en omettant toute autre objection, la chûte du mercure avant la pluie, & son élevation après la pluie, semblent être inexplicables dans cette hypothese ; car en supposant deux vents contraires qui chassent les colonnes d’air qui sont au-dessus de Londres, tout ce qu’ils pourront faire, sera de couper une certaine partie de l’air qui est au-dessus de Londres : en conséquence il pourra arriver que le mercure baisse, mais il n’y a pas de raison apparente pour que la pluie s’ensuive. Il est vrai que les vapeurs pourront s’abaisser, mais seulement jusqu’à ce qu’elles viennent dans un air de la même pesanteur spécifique qu’elles, & arrivées là, elles y resteront sans descendre plus bas. Leibnitz a tâché de suppléer au défaut de cette hypothese, & d’en donner une nouvelle. Il prétend donc qu’un corps plongé dans un fluide, ne pese avec ce fluide que pendant qu’il en est soûtenu ; de sorte que quand il cesse de l’être, c’est-à-dire qu’il tombe, son poids cesse de faire partie de celui du fluide, qui par ce moyen devient plus léger. Ainsi, ajoûte-t-il, les vapeurs aqueuses, pendant qu’elles sont soûtenues dans l’air, augmentent son poids : mais quand elles tombent, elles cessent de peser avec lui, & le poids de l’air est diminué ; le mercure baisse donc, & la pluie tombe. Mais le principe de Leibnitz est faux, comme il paroît par les expériences du docteur Desaguliers. D’ailleurs, en supposant que les vapeurs par leur condensation sont forcées de descendre, & cessent de peser avec l’atmosphere, elles baisseront jusqu’à ce qu’elles arrivent à la partie de l’atmosphere, qui est de la même pesanteur spécifique qu’elles, &, ainsi que nous l’avons déjà dit au sujet de M. Halley, y resteront suspendues comme auparavant. Si le mercure baisse, ce sera seulement durant le tems de cet abaissement des vapeurs ; car les vapeurs étant une fois fixées & en repos, la premiere pesanteur renaîtra, pour ainsi dire, ou si elle ne revient pas, au moins la pluie ne suivra pas la chûte du mercure.
Quelques auteurs, pour expliquer ces mêmes variations, ont imaginé l’hypothese suivante. Que l’on suppose un nombre de vésicules d’eau flottantes sur une partie de l’atmosphere, & sur une partie déterminée de la surface du globe terrestre ; par exemple, sur A B, fig. 2 1 ; si les vésicules supérieures sont condensées par le froid des régions supérieures, leur gravité spécifique s’augmentera & elles descendront ; la couche horisontale 1, par exemple, descendra à 2, 2 à 3, &c. là se rencontrant avec d’autres vésicules qui ne sont pas encore précipitées, elles s’amoncelent & se changent en vésicules plus grandes, comme il doit s’ensuivre des lois de l’attraction.
Si nous choisissons le vent pour agent, supposons qu’il souffle horisontalement ou obliquement : dans le premier cas les vésicules 8 seront chassées contre 9, celles-ci contre 10, &c. dans le second cas la vésicule 7 sera chassée contre 4, 8 contre 3, &c. par ce moyen les particules s’augmenteront & formeront de nouvelles & de plus grandes vésicules qu’auparavant ; de sorte que leur nombre, qui auparavant étoit ; si l’on veut, un million, sera alors réduit, par exemple à 100000.
Mais la même réunion par laquelle leur nombre est diminué, augmente en quelque maniere leur pesanteur spécifique ; c’est-à-dire qu’il y a plus de matieres sous d’égales surfaces : ce qui est aisément prouvé par les principes géométriques ; car dans l’augmentation de la masse des corps homogenes, celle de la surface n’est pas aussi grande que celle de la solidité : celle de la premiere est comme le quarré du diametre ; & celle de l’autre, comme son cube.
Or lorsque la même quantité de matiere se trouve sous une moindre surface, elle doit perdre moins de son poids par la résistance du milieu : car il est évident qu’un corps qui se meut dans un fluide, perd une partie de sa pesanteur par le frottement de ses parties contre celle du fluide. Or ce frottement est évidemment en raison de la surface ; c’est pourquoi la surface devenant moindre à proportion de la masse, la résistance l’est aussi : conséquemment les vésicules, dont la pesanteur, avant la jonction, étoit égale à la résistance du milieu, trouvant cette résistance diminuée, descendront avec une vîtesse proportionnelle à la diminution réelle de leur surface.
Quand elles descendent & qu’elles arrivent aux parties plus grossieres de l’atmosphere, par exemple, aux points 4, 5, &c. leur masse & leur surface sont augmentées par de nouvelles réunions ; & ainsi par de nouvelles & constantes augmentations, elles deviennent de plus en plus capables de surmonter la résistance du milieu, & de continuer leur chûte à travers toutes les couches de l’air jusqu’à ce qu’elles atteignent la terre ; leur masse étant alors excessivement grossie, & forme des gouttes de pluie.
Maintenant dans la descente des vapeurs, il faut considérer comment le barometre est affecté par cette descente. Avant qu’aucune des vésicules commence à baisser, soit par l’action du froid, ou par celle du vent, elles nagent toutes dans la partie de l’atmosphere ABDC, & pesent toutes vers le centre E. Or chacune d’elles demeurant respectivement dans une partie du milieu, qui est d’une pesanteur spécifique égale, perdra une partie de son poids égale à celle d’une partie du milieu qui auroit le même volume ; c’est-à-dire, que chacune d’elles perdra toute sa pesanteur : mais alors cette pesanteur qu’elles auront perdue, sera communiquée au milieu qui pressera sur la surface de la terre AB, avec son propre poids joint à celui de ces vésicules. Supposez alors que cette pression conjointe agisse sur le mercure élevé dans le barometre à trente pouces : par la réunion des vésicules, faite comme nous avons dit ci-dessus, leur surface, & conséquemment leur frottement, est diminué : c’est pourquoi elles communiqueront moins de leur pesanteur à l’air, c’est-à-dire une partie moindre que tout leur poids ; & conséquemment elles descendront avec une vîtesse proportionnelle à ce qui leur reste de pesanteur, ainsi que l’on vient de le dire. Or comme les vésicules ne peuvent agir sur la surface de la terre AB que par la médiation de l’air, leur action sur la terre sera diminuée en même proportion que leur action sur le milieu ; d’où il est évident que la surface de la terre AB, sera alors moins pressée qu’auparavant ; & plus les vésicules garderont de leur poids qu’elles n’auront point communiqué au milieu, plus elles accélereront leur propre descente ; c’est-à-dire, que la vîtesse de l’abaissement des vésicules ira toûjours en augmentant : en effet, quand les vésicules descendent, la masse augmente continuellement, & au contraire la résistance du milieu & la pression sur la terre diminuent, & le mercure baissera par conséquent pendant tout le tems de leur chûte. De-là il est aisé de concevoir que les vésicules qui ont une fois commencé à tomber, continuent ; que le mercure commence à tomber en même tems, & qu’il continue & cesse en même tems qu’elles.
On peut faire une objection contre ce système ; savoir, que les vésicules étant mises en mouvement, & heurtant contre les particules du milieu, rencontrent une résistance considérable dans la force d’inertie du milieu, par laquelle leur descente doit être retardée, & la pression de l’atmosphere rétablie. On peut ajoûter que la pression additionnelle sera plus grande à proportion de la vîtesse de la chûte des vésicules, une impulsion forte étant requise pour surmonter la force d’inertie des particules contigues du milieu.
Mais les partisans de l’opinion que nous rapportons, croyent pouvoir renverser cette objection par la raison & l’expérience : car, disent-ils, outre que la force d’inertie de l’air peut être très-foible à cause de son peu de densité, nous voyons que dans l’eau, qui est un milieu fort dense & non élastique, un morceau de plomb, en descendant à-travers le fluide, pese considérablement moins que quand il y est soûtenu en repos. Cependant ce fait est nié par M. Musschenbroek. Essays de Physique, §. 234.
Nous avons cru devoir rapporter assez au long cette explication qui, quoiqu’ingénieuse, n’a pas, à beaucoup près, toute la précision qu’on pourroit désirer. Mais dans une matiere si difficile, il ne nous reste presque autre chose à faire, que d’exposer ce que les philosophes ont pensé. Voyez une dissertation curieuse, de M. de Mairan, sur ce sujet, Bordeaux 1715. Voyez aussi Musschenbroek. Cet auteur regarde avec raison les prédictions du barometre, comme peu sûres.
Voici, selon M. Musschenbroek, la meilleure maniere de faire un barometre ordinaire ou commun ; ces sortes de barometres étant les meilleurs de tous, à ce qu’il prétend. Premierement, on doit prendre du mercure bien pur, & être bien assûré qu’il ne soit pas falsifié ; il faut le passer par un cuir bien net, & le verser dans un poellon neuf & verni, que l’on couvre d’un couvercle qui s’y ajuste bien. On doit mettre ce poellon couvert sur un feu de charbon bien pur, & faire bouillir le mercure : il devient alors volatil, mais on le retient à l’aide du couvercle qui est posé dessus. En faisant ainsi bouillir le mercure, on le purifie de l’eau & de l’air qui se tenoient entre ses parties. On doit avoir des tuyaux de verre nouvellement faits, dont on se sert pour les barometres ; & afin qu’ils ne soient ni sales en-dedans, ni remplis d’air, il faut avoir soin de les faire sceller hermétiquement de chaque côté dans la Verrerie, avant que de les transporter. Lorsqu’on voudra les remplir, on peut les ouvrir par un bout avec une lime, & les tenir pendant ce tems-là près d’un feu oblong, pour les rendre également chauds, & même fort chauds, afin que l’humidité & l’air qui tient aux parois, se détache & se dissipe. Si on néglige de prendre cette précaution, l’air s’y attache avec tant de force, qu’il ne peut être chassé par le mercure qu’on verse dans le tuyau, mais il reste suspendu en plusieurs endroits. Pour réussir encore mieux à purger ce tuyau d’air, on ne fera pas mal d’attacher à un fil d’archal un morceau de chamois ou de cuir, & d’en former comme un piston de pompe, que l’on fera passer dans le tuyau de haut en bas, & de bas en haut à diverses reprisés, pour détacher l’air qui y tient. Par ce moyen, le mercure qui est tout bouillant, pourra alors dissiper l’air, en le faisant sortir du tuyau chaud. On forme ensuite d’un tuyau large de barometre un petit entonnoir de verre, & en l’allongeant on le réduit en un tuyau capillaire, lequel doit être un peu plus long que le tuyau qu’on doit remplir. Il faut d’abord bien nettoyer la partie supérieure de ce petit entonnoir, & la rendre bien seche & bien chaude en l’exposant devant le feu : on l’introduit ensuite dans le tuyau du barometre, ensorte qu’il pénetre jusqu’au fond, & on verse alors le mercure tout bouillant dans ce petit entonnoir, qui doit être bien chaud, afin que la chaleur du mercure ne le fasse pas sauter en pieces. Dès qu’on verse le mercure, il se précipite en bas, remplit le tuyau, & s’éleve ensuite lentement. On doit avoir soin de verser dans l’entonnoir sans aucune interruption, afin que le mercure continue toûjours de tomber sans s’arrêter, & que l’air n’ait pas lieu de s’insinuer entre ses parties. Lorsque le tuyau se trouve plein, on retire doucement le petit entonnoir. Voilà de quelle maniere en peut remplir le tuyau aussi juste qu’il est possible, & il paroît alors dans toute sa longueur de couleur brune, & sans la moindre petite bulle d’air. Si l’on n’a point de tuyaux scellés, il faut avant que de remplir celui dont on se sert, le bien nettoyer en-dedans, en le lavant avec de l’esprit-de-vin bien rectifié, & en attachant au bas d’un fil de laiton une petite couroie en maniere de piston de pompe, que l’on pousse souvent dans le tuyau pour en détacher l’air, qui sans cela ne manquéroit pas d’y rester suspendu. Après avoir ainsi nettoyé ce tuyau, on doit le faire sécher devant le feu, & le chauffer.
Barometre portatif, est un barometre construit de maniere qu’on puisse le transporter d’une place à une autre, sans le déranger.
Il n’y a pas long-tems que le barometre portatif étoit une chose peu commune ; à présent on en fait de portatifs de toutes les sortes ; ils sont tellement construits, que le mercure peut venir tout-à-fait jusqu’à l’extrémité du tube, qui est fermée hermétiquement : cet artifice empêche le mercure de ballotter & de se répandre, & ne l’expose point au danger de casser le tube. Pour cela on attache sur le bord de la cuvette où plonge le tuyau, un cuir le plus fin que l’on peut, par le moyen duquel le mercure est contenu dans la cuvette, & on construit le barometre de maniere que sa partie supérieure se termine par un long cou étroit ; par ce moyen l’effort du mercure contre cette partie devient beaucoup moins considérable, & la partie supérieure du barometre est moins en danger de se briser. Mais un tel barometre est peu sûr.
Phosphore du barometre. M. Picard découvrit le premier en 1676 que le mercure de son barometre secoüé dans l’obscurité donnoit de la lumiere : mais quand on voulut faire l’expérience sur d’autres, il s’en trouva fort peu qui eussent ce privilége.
M. Bernoulli ayant fait l’expérience sur son barometre, trouva qu’étant secoüé fortement dans l’obscurité, il donnoit une foible lueur.
Comme l’on pouvoit soupçonner que la lumiere, ou du moins une grande lumiere, n’étoit si rare dans les barometres, que parce qu’il n’y avoit pas un vuide parfait dans le haut du tuyau, ou que le mercure n’étoit pas bien purgé d’air, il s’assûra par expérience qu’avec ces deux conditions, des barometres n’étoient encore que très-foiblement lumineux ; & par conséquent que ce n’étoit-là tout au plus que des conditions, & qu’il falloit chercher ailleurs une véritable cause. De plus son barometre n’étoit en expérience que depuis quatre semaines, lorsqu’il rendit de la lumiere ; & ainsi on ne peut pas dire que la raison pourquoi plusieurs n’en rendoient pas, est peut-être qu’il y avoit trop peu de tems qu’ils étoient en expérience.
M. Bernoulli avoit remarqué que quand on secoüoit le barometre, & que par conséquent on faisoit aller le mercure avec rapidité, tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du point d’équilibre, la lumiere ne se montroit que dans la descente du mercure, & qu’elle paroissoit comme attachée à sa surface supérieure. De-là il conjectura que quand par cette descente il se forme dans un tuyau un plus grand vuide que celui qui y étoit naturellement, il peut sortir du mercure pour remplir ce vuide en partie, une matiere très fine, qui étoit auparavant renfermée & dispersée dans les interstices très-étroits de ce minéral. D’ailleurs il peut entrer dans ce même moment par les pores du verre, plus grands apparemment que ceux du mercure, une autre matiere moins déliée, quoique beaucoup plus déliée que l’air ; & la matiere sortie du mercure & toute rassemblée au-dessus de sa surface supérieure, venant à choquer impétueusement celle qui est entrée par les pores du verre, y fait le même effet que le premier élément de Descartes sur le second, c’est-à-dire, produit la lumiere.
Mais pourquoi ce phénomene n’est-il pas commun à tous les barometres ? Pour l’expliquer M. Bernoulli imagina que le mouvement de la matiere subtile qui sort du mercure avec impétuosité, lorsqu’il descend, pouvoit être détruit, affoibli, interrompu, par quelque matiere hétérogene au mercure qui se seroit amassée sur sa surface supérieure, & y auroit été poussée par ce minéral plus pesant qu’elle ; que cette espece de pellicule ne manquoit pas de se former sur le mercure, dès qu’il n’étoit pas extrèmement pur ; que même quelque pur qu’il fût de lui-même, il contractoit en peu de tems par le seul attouchement de l’air, les saletés qui composent cette pellicule ; qu’afin qu’il les contractât en un instant, il ne falloit que le verser en l’air de haut en bas, comme l’on fait ordinairement dans la construction des barometres ; que ce mouvement lui faisoit ramasser dans l’air plus de saletés qu’il n’auroit fait durant plusieurs jours étant en repos ; qu’enfin cela supposé, une méthode sûre pour avoir un barometre lumineux, étoit de le faire d’un mercure bien pur, & qui sur-tout, quand on le feroit entrer dans son tuyau, ne traversât point l’air & ne s’y souillât point.
Le succès des expériences répondit à tout ce raisonnement de M. Bernoulli, qu’il avoit fait sans aucune expérience préalable, excepté peut-être ce qui regardoit la pellicule formée sur la surface du vif-argent.
En effet, si on expose du vif-argent dans quelque vase à l’air libre, on trouvera au bout de quelque tems sa superficie extérieure trouble & couverte d’une pellicule très-mince, laquelle étant ôtée par le moyen d’une plume nette, la surface redevient polie : mais si on le laisse encore exposé à l’air, une autre pellicule, d’abord semblable à une toile d’araignée qui s’épaissit avec le tems, s’étendra par dessus. Cette pellicule paroît au microscope fort semblable à de l’argent battu en feuille : en effet, ce n’est qu’un tissu très-fin d’une espece de mousse ou de poil tres fin, qui séparée du vif-argent par l’agitation de l’air, est repoussée à la surface ; & se mêlant-là avec les corps hétérogenes que l’air y amene, forme cette espece de pellicule. Cette pellicule paroît plus ou moins dans toutes les liqueurs exposées à l’air ; elle est formée par les corpuscules qui s’exhalent & retombent ensuite dessus. Si on laisse tomber de la hauteur d’un pié seulement une goutte de vif-argent le plus net qu’il soit possible, dans un vase où il y en ait aussi de si net, que sa superficie soit polie comme celle d’un miroir ; la goutte tombant sur cette surface polie, la ternira à l’endroit où elle tombera ; preuve que toute nette qu’elle étoit, elle avoit été infectée de l’impureté de l’air : ainsi quand on fait tomber le vif-argent goutte-à-goutte dans le barometre, ces gouttes tombant les unes sur les autres, font crever les petites pellicules, qui bientôt après remontent à la surface, & se mettent entre la surface convexe du mercure & la surface concave du verre. En effet, si le tuyau étant ainsi rempli, on le renverse pour en faire le barometre en le fermant du bout du doigt, on verra que le mercure en descendant dans le tuyau, laissera en arriere des restes de cette pellicule attachés aux parois du verre.
En supposant que cette pellicule couvre exactement les pores de la surface du vif-argent, il sera aisé de concevoir qu’elle bouche le passage à la matiere renfermée dans le mercure, de même que le vif-argent qui passe par les peaux de presque tous les animaux, n’y sauroit passer quand on n’en ôte pas cette peau fine que les Medecins appellent épiderme, ou cuticule.
Rien de si nuisible à l’apparition de cette lumiere que l’humidité ; car si l’on fait entrer de l’eau dans le tuyau, bien disposé d’ailleurs, avec le vif-argent, ou même de l’esprit-de-vin rectifié (quoique l’esprit-de-vin soit par lui-même inflammable) ces matieres se mettant dans le tuyau au haut du vif-argent, font l’effet de la petite pellicule, qui est d’empêcher la lumiere. Il faut donc que le tuyau soit bien dégraissé & net en dedans. Cela posé, voici deux manieres pour empêcher que le mercure ne contracte d’impuretés en passant dans le tuyau.
Premiere maniere. Pour cela il faut plonger un tuyau d’environ trois piés de long dans un vase d’assez petite hauteur, plein de mercure, le faire tremper dans ce mercure assez profondément, & incliner ce tuyau à la surface du mercure contenu dans le vase, le plus obliquement que le puisse permettre la hauteur du vase (M. Bernoulli faisoit faire au sien un angle de 18 degrés à peu près avec l’horison) ; ensuite sucer fortement par le bout supérieur, de façon que le tuyau s’emplisse à la fin tout entier de vif-argent. Lorsqu’il en est ainsi rempli, il faut faire boucher avec le doigt par une autre personne, le bout du tuyau qui trempe dans le mercure, & fermer ensuite soi-même aussi avec son doigt le bout supérieur du tuyau. (Il faut sucer tout de suite, de peur qu’en reprenant haleine, on ne rende le dedans du tuyau humide.) Il est évident qu’en ce cas le mercure n’a point été sali par l’air, si ce n’est peut-être la premiere goutte qui est montée, & qui a essuyé toutes ces saletés ; aussi faut-il laisser entrer un peu de mercure dans sa bouche ; auquel cas, cette premiere goutte étant ôtée, le mercure sera le plus net qu’il puisse être. Le tuyau étant ainsi fermé avec le doigt par les deux bouts, il faut le mettre tremper par son extrémité dans un autre vase plus étroit que le premier, & rempli de mercure à une hauteur plus grande que le vase dans lequel on avoit fait d’abord tremper le tuyau. Si on porte le tuyau en cet état avec le vase dans l’obscurité, le moindre balancement y produira une lueur capable d’éclairer à un pié de distance, assez pour pouvoir lire un caractere d’une grosseur médiocre.
IIe maniere. Il faut mettre perpendiculairement un tuyau fermé par un bout dans un vase plein de mercure, où il trempe par le bout ouvert, le poser avec ce vase dans la même situation, sous un récipient fait exprès pour cela, ensuite en retirer l’air qui sortira du tuyau par le vase en faisant des bulles sur la surface du mercure qui y est contenu : lorsqu’on en aura retiré le plus qu’il sera possible, il faudra le laisser rentrer ; il n’en pourra monter dans le tuyau à cause du mercure où il trempe par son bout ouvert. Cet air donc pesant sur la surface du mercure contenu dans le vase, fera monter le mercure dans le tuyau à la hauteur de 25 à 26 pouces, parce qu’on ne peut jamais tirer tout l’air du récipient, & que l’air qui dans ce cas reste dans le tuyau se condense, & augmente de force à mesure que le mercure y monte. Cet air étant très-purifié à cause de sa dilatation, le vif-argent en y passant demeurera net, & l’expérience de la lumiere réussira aussi bien que dans la premiere maniere, quoiqu’il y ait de l’air au haut du tuyau.
Quelqu’ingénieuse & vraissemblable que paroisse cette explication, néanmoins l’Académie des Sciences à qui M. Bernoulli la communiqua (voyez ann. 1701 & suiv.), remarqua pour lors que quelques barometres donnoient de la lumiere sans avoir été faits avec les précautions de M. Bernoulli, & que quelques-uns faits avec les précautions rapportées ci-dessus n’en donnoient point. C’en fut assez pour qu’elle suspendît son jugement.
Il faut, suivant le système de M. Bernoulli, 1°. que le mercure soit extrèmement pur ; 2°. que le barometre soit construit de maniere que le mercure en y tombant ne traverse point l’air ; 3°. que le vuide du haut du tuyau soit aussi parfait qu’il peut être ; car il faut que le choc des deux matieres subtiles dont parle M. Bernouilli, ne soit point affoibli par l’air, qui étant fort grossier en comparaison de ces deux matieres, feroit l’effet d’un sac de laine qui reçoit un coup de canon. La différence d’effet des expériences de Groningue & de Paris sur des barometres qui paroissoient avoir les mêmes conditions, aussi bien que le mercure qui y étoit enfermé, fit juger que le mercure de M. Bernoulli & celui des barometres lumineux de Paris, devoit avoir quelque chose de particulier, & ressembler par quelqu’accident à du mercure que l’on auroit rendu lumineux, en y mêlant, comme on fait quelquefois, du phosphore liquide. M. Bernoulli, fondé sur le succès de ses expériences, conjecture qu’il y a eu quelque faute dans celles de l’Académie. La méthode, par exemple, de remplir le tuyau avec une bourse de cuir, qu’on dit être équivalente à la sienne, a pourtant cela de différent, que c’est ici le mercure qui doit pousser l’air devant lui, lequel en faisant quelque petite résistance, peut laisser attachées aux côtés du verre quelques restes ou bulles d’air, qui suffiront pour engendrer la pellicule ; au lieu que dans la méthode de M. Bernoulli pour remplir le tuyau, l’air extérieur pousse le vif-argent en haut, & le vif-argent ne fait que suivre le mouvement de l’air intérieur, qui par sa raréfaction sort sans peine du tuyau ; peut-être aussi le tuyau de l’Académie n’étoit-il pas bien net. Les amples tuyaux sont, suivant l’expérience, les meilleurs, parce qu’outre que le mercure dans un tuyau plus large, se meut plus librement que dans un tuyau étroit, où le frottement du mercure contre le verre diminue la vîtesse de la descente ; la pellicule, s’il s’en forme, doit aussi être plus épaisse dans un tuyau étroit que dans un autre ; parce que ne pouvant s’étendre en large, elle s’épaissit en hauteur. Or le tuyau de l’Académie n’étoit pas assez large, selon M. Bernoulli, n’ayant qu’une ligne & demie de diametre.
Il est difficile de remplir le tuyau de mercure avec la bouche, sans y mêler un peu d’haleine ou de salive ; plusieurs n’y ont pû réussir. M. Bernoulli dit qu’il le faisoit aisément, pouvant d’ailleurs tirer avec la bouche, d’un petit recipient, 7/8 de l’air qu’il contient, sans se trop efforcer. Il vaut mieux faire ces expériences de nuit que de jour ; car quand on entre tout d’un coup dans l’obscurité, les yeux encore frappés de l’éclat d’une grande lumiere, ne peuvent appercevoir la foible lueur du barometre, qui paroît assez pendant la nuit obscure.
Quant aux barometres qu’on dit n’avoir pas été faits avec les mêmes précautions, & cependant donner de la lumiere, peut-être qu’en y jettant le vif-argent on a tenu le tuyau fort obliquement à l’horison, pour laisser couler doucement les gouttes de mercure comme dans un canal ; ce qui empêche l’air de l’infecter tant ; quoiqu’en ce cas il arrive souvent qu’il ne rend pas autant de lumiere que des barometres faits par la suction, ou dans la machine du vuide ; peut-être le mercure n’étoit-il pas bien purifié de toute matiere dont l’attouchement de l’air pût former une pellicule.
Cette lumiere paroît dans toute sorte de vif-argent préparé à la maniere de M. Bernoulli ; cela ne vient donc point de quelque chose de particulier dans le sien, qui enfermé dans le tuyau sans les conditions proposées, ne rend que peu ou point de lumiere.
Une des principales raisons qui fait que la pellicule du mercure empêche la lumiere, c’est peut-être qu’on secoue trop uniformément le mercure, se contentant de le balancer ; auquel cas cette pellicule, s’il y en a, ne sort point de la superficie du mercure, & y demeure toûjours attachée. Comme il est difficile d’éviter cette pellicule des barometres remplis même à la maniere de M. Bernoulli, il semble que si on pouvoit la crever, ce qui se feroit en remuant le mercure en tout sens, comme on fait l’eau d’une bouteille qu’on rince, il pourroit paroître de la lumiere. En effet, si on tire l’air d’une petite phiole pleine de mercure, en la mettant sous la machine pneumatique, par le moyen d’un robinet cimenté à son cou, & qu’on agite en tout sens le mercure qui y est contenu, on voit une lumiere bien plus vive que celle du barometre ; & cela arrive avec toute sorte de mercure, excepté lorsque l’air n’est pas assez exactement tiré de la phiole, ou qu’on y en laisse entrer un peu ; alors la lumiere est plus foible, & diminue de plus en Plus, nonobstant l’agitation réitérée de la phiole, même jusqu’à disparoître entierement ; après quoi il faut tirer l’air de nouveau de la phiole, si on veut qu’elle paroisse. On voit au jour le mercure de cette phiole dont la lumiere est affoiblie, couvert d’une pellicule épaisse, & semblable à de la pâte mêlée de poussiere ; d’où il paroît qu’un peu d’air agité salit fort le mercure, & le couvre d’une peau assez épaisse pour empêcher absolument la lumiere : car s’il n’y a point d’air, l’agitation ne fait que rendre le mercure plus pur ; par-là se délivre de tout ce qu’il pourroit contenir d’étranger, qu’il rejette à la surface du verre, qu’on voit aussi un peu trouble : ainsi le mercure est rendu de plus en plus lumineux.
Si le robinet de la phiole est d’airain, le vif-argent le corrompt : il faut donc, pour l’éviter, mettre un bouchon de liége qui bouche exactement la phiole, & de la cire par-dessus, puis percer la cire & le bouchon de liége pour faire sortir l’air de la phiole sous la machine pneumatique ; ensuite laissant le récipient dessus sans rendre l’air, faire fondre avec un verre ardent la cire d’autour du trou, qui se répandant alors sur le trou, le fermera. Voilà donc un nouveau phosphore perpétuel, & qui outre cela a l’avantage de pouvoir se transporter dans une phiole bien bouchée ; pourvû que 1°. cette phiole ait été bien nette ; 2°. qu’on n’ait pas beaucoup remué le mercure avant d’en tirer l’air ; 3°. qu’on tire le plus d’air qu’il soit possible.
M. Homberg a donné un autre raison de la lumiere des barometres. Souvent pour nettoyer le mercure on se sert de la chaux vive préférablement à de la limaille de fer ; alors le mercure qui s’élevant dans la distillation s’est criblé au travers de cette matiere, peut en avoir emporté des parties capables par leur extrème délicatesse de se loger dans ses interstices ; & comme la chaux vive retient toûjours quelques particules ignées, il est possible que ces particules agitées dans un lieu vuide d’air, où elles nagent librement & sans être étouffées par aucune autre matiere, produisent un éclat de lumiere. En effet plusieurs barometres faits de mercure ainsi nettoyé étoient lumineux : mais M. Homberg appuyoit davantage sur le peu de nécessité des conditions de M. Bernoulli.
1°. Un mercure bien net ne contracte jamais d’impuretés à l’air : l’expérience le prouve. Il y a donc lieu de croire que celui de M. Bernoulli n’étoit pas bien net.
2°. Dans les barometres lumineux anciens, le mercure étoit entré en traversant l’air.
3°. M. Homberg ayant vuidé par la seconde méthode de M. Bernoulli, un tuyau qui ne trempoit presque point dans le mercure, l’air en sortoit en soûlevant par son ressort le tuyau, & se glissant entre son bout & la surface du mercure. L’air étant raréfié jusqu’à un certain point, de façon cependant qu’on pouvoit encore en tirer assez, ne sortoit plus, parce qu’il n’avoit plus la force de soûlever le tuyau. Le vuide du barometre de M. Bernoulli n’étoit donc pas aussi parfait qu’il pouvoit l’être.
Mais M. Bernoulli, outre les réponses précédentes, ajoûte qu’il paroît que M. Homberg a trop enfoncé le tuyau dans le mercure pour en tirer l’air ; celui de M. Bernoulli étoit presqu’à fleur de mercure, qui en effet y est monté à 26 pouces, ce qui est presque la hauteur ordinaire ; outre que ce peu d’air restant dans le tuyau a notablement affoibli la lumiere, comme M. Bernoulli l’a remarqué depuis : ainsi moins il y a d’air, plus la lumiere est grande & durable.
Quand le mercure de M. Bernoulli ne seroit pas bien pur, l’air seroit toûjours la cause, sinon naturelle, du moins efficiente du défaut de lumiere, puisque ce même mercure en produit étant enfermé sans air dans le vuide. Mais M. Bernoulli a trouvé un secret de le rendre net en le lavant bien avec de l’eau : on met sur le mercure cette eau, environ à la hauteur de deux pouces ; on agite fortement le mercure qui se mêle avec l’eau, puis on le laisse reposer ; & il rejette à la surface l’eau sale & noirâtre : on réitere la lotion jusqu’à ce que l’eau ne paroisse plus ou presque point noirâtre, & alors le mercure est net. L’esprit de vin le lave plus vîte & mieux que l’eau ; il s’est même trouvé un mercure fort épais, dans lequel il y avoit apparemment quelque matiere huileuse & sulphureuse mêlée avec ses parties ; ce mercure n’est devenu assez net pour rendre de la lumiere qu’à force de lotions expressif d’esprit-de-vin. Le mercure devient si pur par ce lavement même d’eau seule, qu’il rend quelquefois de la lumiere, même dans une phiole pleine d’air : mais cette lumiere est foible.
Ce mercure ainsi bien purifié, laisse sortir de ses pores assez de matiere subtile pour vaincre la résistance de l’air.
Il faut bien sécher le mercure ainsi lavé, en le faisant passer par un linge net ; car la moindre humidité nuiroit à l’expérience.
Quelquefois le mercure même après l’agitation conserve en ses pores une matiere gluante cachée, qui en les fermant ou les rendant roides, empêche la matiere subtile de sortir, & par conséquent la lumiere de paroître. La roideur des pores peut faire cet effet ; car il faut que les pores se rétrécissent souvent pour laisser passer cette matiere : or s’ils ne sont pas flexibles ils ne pourront se retrécir. Cela étant, il paroît que le mercure qu’on dit être devenu lumineux par la distillation à travers la chaux vive, avoit cette roideur de pores causée par quelque matiere gluante qu’il a laissée dans la chaux, en s’y filtrant & s’y purifiant par-là ; & c’est à cette seule purification que M. Bernoulli en attribue la lumiere, & non pas aux particules ignées de la chaux ; de plus ces corpuscules ignées ne lui paroissent guere vraissemblables.
Ces parcelles ignées deviendroient enfin inutiles par le fréquent usage, comme on voit arriver aux autres phosphores qui sont lumineux par le moyen de ces particules ignées ; ainsi ce phosphore perdroit enfin sa vertu.
2°. Ces parcelles ignées assez petites pour se loger dans les pores du mercure, s’échapperoient quand on secoueroit la phiole, par les pores du verre bien plus larges que ceux du mercure.
3°. Cela posé, la lumiere paroîtroit également dans la descente & l’ascension du mercure.
Dans l’explication, au contraire, de M. Bernoulli, le mercure ne fait que prêter ses pores étroits à la matiere subtile ; dès que cette matiere en est sortie par l’agitation, il en revient aussi-tôt d’autres par les pores du verre. Enfin M. Bernoulli gardoit depuis un an un de ces phosphores, qui n’avoit encore souffert aucune altération. Il croit même qu’une liqueur aussi pesante que le mercure, pourroit donner de la lumiere : & cela posé, si on pouvoit rendre l’or fluide, il seroit, selon lui, le plus propre à en donner, étant le plus pesant de tous les corps, le plomb fondu même en pourroit donner s’il étoit bien pur.
Quant au mercure qu’on rend lumineux en le mêlant avec du phosphore artificiel, M. Bernoulli attribue cette lumiere au phosphore seul.
Toutes ces lumieres artificielles sont extrèmement délicates. Il n’est pas sûr qu’en maniant une phiole, la sueur de la main ne passe, quoiqu’en très-petite quantité, au-travers les jointures du bouchon, & ne nuise à la lumiere. Il faut être dans ces expériences scrupuleux, défiant, & en quelque sorte superstitieux. Voici un exemple remarquable de la délicatesse de ces phosphores. M. Bernoulli avoit une phiole qui luisoit parfaitement & également depuis six semaines ; une miette du liége qui la bouchoit s’étoit détachée & étoit tombée sur la surface du mercure où elle nageoit. M. Bernoulli brûla cette miette de liége au foyer d’un verre ardent ; & le peu de fumée qui en sortit, diminua considérablement & sans retour la vivacité du phosphore, où il n’étoit arrivé nul autre changement. Cette pureté dont la lumiere a besoin, fut souillée. M. Bernoulli a offert à l’Académie de purifier le mercure dont elle se sert, & de le lui renvoyer lumineux. La confiance apparemment qu’on avoit en sa parole, a empêché qu’on n’exécutât sa demande.
L’Accadémie en est resté là jusqu’en 1723, que M. Dufay donna son sentiment particulier, joint à l’histoire suivante des sentimens des savans sur cette matiere, & à une maniere simple & facile de rendre les barometres lumineux, qu’un Vitrier Allemand lui avoit apprise. En 1706, M. Dutal, Medecin, fit insérer dans les Nouvelles de la république des Lettres, un mémoire, où il confirme la réussite des opérations de M. Bernoulli, & croit que l’Académie ne les a pas faites assez exactement. En 1708, M. Hauksbée, après avoir décrit un phosphore consstruit avec un globe vuide d’air, qu’il faisoit tourner rapidement sur son centre, & qui par ce moyen rendoit beaucoup de lumiere lorsqu’on en approchoit la main, croit que la lumiere du barometre n’est causée que par les frictions du mercure contre les parois intérieurs du tube vuide d’air grossier.
En 1710, M. Hartsoëker combattit les expériences de M. Bernoulli, niant tout, & n’apportant d’autre raison que la pureté du mercure, & la netteté du tuyau ; ce qui, suivant l’expérience, ne suffit pas.
En 1715, Jean Frédéric Weidler combattit aussi M. Bernoulli, disant que la pellicule que contracte le mercure en passant par l’air, ne nuit en rien à la lumiere, qu’il croit ne venir d’autre chose que de la répercussion des rayons, qui quoique dans l’obscurité, conservent leur même tension & leur même effort.
En 1716, Michel Heusinger dit dans une dissertation publiée sur ce sujet, que quelques barometres où l’on remarquoit des bulles d’air étoient lumineux, quoique moins, à la vérité, que ceux qui n’avoient point d’air ; les bulles d’air même, à ce qu’il dit, donnent quelquefois de l’éclat. La pureté du mercure n’est pas encore nécessaire, puisque vingt-trois parties de mercure mêlées avec cinq de plomb, ont rendu de la lumiere. Selon lui, les particules du mercure sont spheriques, & les interstices de ces petits globes contiennent beaucoup de matiere subtile, qui s’en exprime lorsqu’on l’agite. Le mercure n’est lumineux que lorsqu’il descend, parce qu’alors il abandonne la matiere subtile contenue dans ses pores : mais en remontant il en absorbe une partie, & l’autre s’en va par les pores du verre.
En 1717, M. de Mairan attribua cette lumiere au soufre du mercure qui est en mouvement, & dit, qu’elle seroit beaucoup plus vive, s’il ne restoit dans les barometres, les plus exactement vuides d’air, une matiere différente de la matiere subtile & de l’air, qui arrête le mouvement de ce soufre & la lumiere qui en résulte, ce qui arrive sur-tout lorsque le mercure monte ; au lieu que quand il descend, il y a une partie du tuyau la plus proche de la surface du mercure qui reste, au moins pour un moment, libre de cette matiere qui ne peut pas suivre le mercure avec assez de rapidité, & qui par ce moyen donne lieu à son soufre de se développer. Diss. sur les Phosph.
Il restoit encore quelque incertitude sur la maniere de rendre les barometres lumineux. Les conditions absolument nécessaires sont :
1°. Que le tuyau soit bien sec ; on le nettoye aisément avec du coton attaché au bout d’un fil de fer ; la moindre humidité gâteroit tout : mais ce n’est, selon les observations de M. Dufay, qui a tourné de bien des sens ces expériences, que l’humidité qui seroit au haut & dans le vuide du tuyau, où la lumiere doit paroître ; hors de là, le tuyau peut être humide sans inconvénient.
2°. Que le mercure soit bien net : il faut faire passer le mercure par un cornet de papier dont l’embouchure soit fort étroite, il y dépose suffisamment ses impuretés.
3°. Que le mercure soit bien purgé d’air : versez d’abord dans le tuyau un tiers de mercure que vous devez employer, puis chauffez-le doucement & par degrés, en l’approchant petit à petit du feu ; en le remuant avec un fil de fer, vous aiderez la sortie des bulles d’air qui sont dans le mercure, & que la chaleur pousse dehors ; versez un second tiers auquel vous ferez de même, & enfin un troisieme auquel vous ne ferez rien. La purification des deux premiers tiers suffit pour le tout.
M. Dufay ne s’est point apperçû qu’un différent degré de chaleur donné au mercure, produisît de différence sensible dans la lumiere. Voyez, outre les ouvrages déjà cités, la these de M. Bernoulli, de Mercurio lucente in vacuo, soûtenue à Bâle en 1719, & imprimée dans le recueil de ses œuvres. Genev. 1743. (O)
BARON, s. m. (Hist. mod.) nom de dignité, homme qui a une baronie. Voyez Baronie. Baron est un terme dont l’origine & la premiere signification est fort contestée. Quelques-uns veulent qu’il signifie originairement ἀνὴρ, homme ; d’autres un héros, un homme brave : ceux-ci libertinus, un affranchi ; ceux-là, un grand homme, un homme riche ; d’autres, un vassal. Menage le fait venir de baro, que nous trouvons employé dans le tems de la pureté de la langue Latine pour vir, homme brave, vaillant homme. De là vint, suivant cet auteur, que ceux qui avoient leur place auprès du Roi dans les batailles, furent appellés barones, ou les plus braves de l’armée. Comme les princes récompensent ordinairement la bravoure & la fidélité de ceux qui les environnent, par quelques fiefs, ce mot fut ensuite employé pour désigner quelques hommes nobles, qui tenoient un fief immédiatement du Roi. Isidore, & après lui Cambden, regardent ce terme comme un mot qui a signifié dans son origine, un soldat mercenaire. MM. de P. R. le font venir de βάρος, poids ou autorité. Cicéron employe le mot de baro pour marquer un homme stupide, brutal. Les anciens Allemands parlent d’un baron comme nous d’un vilain ; & les Italiens momment barone, un gueux, un mendiant. M. de Marca fait venir baron du mot Allemand bar, homme, ou homme libre : d’autres en vont chercher l’étymologie dans les langues Hébraïque, Gauloise, Celtique : mais l’opinion la plus probable est qu’il vient de l’Espagnol varo, homme brave, noble. C’est de là que les femmes appellent barons leurs maris ; de même que les princes, leurs fermiers. Dans les lois Saliques, comme elles viennent des Lombards, le mot baron signifie un homme en général ; & l’ancien glossaire de Philomenes traduit baron par ἀνὴρ, homme.
Baron, est employé en Angleterre dans une signification plus particuliere, pour signifier un seigneur, un lord ou pair de la derniere classe, c’est-à-dire du degré de noblesse qui est immédiatement au-dessous des vicomtes, & au-dessus des chevaliers & des baronets. Voyez Noblesse, Pair, &c.
Les barons sont seigneurs du parlement, pairs du royaume, & joüissent de leurs priviléges ; ils ne sont pas ceints de l’épée à leur création, & n’ont eu de couronne à leurs armes que sous le regne de Charles II. qui leur accorda un cercle d’or avec six perles placées au bord.
Dans les anciennes archives, le terme de baron comprenoit toute la noblesse d’Angleterre ; tous les nobles s’appelloient barons, de quelqu’autre dignité qu’ils fussent revêtus : c’est pour cette raison que la charte du roi Edouard I. qui est une exposition de tout ce qui a rapport aux barons de la grande charte, finit par ces mots : Testibus archiepiscopis, episcopis, baronibus, &c. La grande assemblée même de la noblesse, qui est composée des ducs, des marquis, & en outre des comtes & des barons, est comprise sous le nom de l’assemblée du baronage.
On distingue les barons par leurs anciens titres, qui possédoient un territoire du roi, qui s’en réservoit toûjours le titre en chef ; & les barons par leur titre temporel, qui tenoient les seigneuries, les châteaux & places, comme chefs de leur baronie, c’est-à-dire, par la grande sergenterie : en vertu de ces titres, ils étoient anciennement convoqués au parlement : mais à présent ils ne sont seigneurs lords du parlement, que quand on les y appelle par écrit.
Après la conquête, les barons furent distingués en grands barons & en petits barons, majores & minores, & il leur fut accordé d’être convoqués au parlement ; les grands par une lettre immédiate du roi, les petits par une lettre générale du grand sherif ou échevin, sur le commandement du roi.
Les anciens distinguoient les grands barons des petits, en accordant aux premiers haute & même souveraine jurisdiction, & aux seconds une jurisdiction inférieure, & sur des matieres de peu d’importance.
Les barons de l’échiquier, sont des juges au nombre de quatre, auxquels est commise l’administration de la justice dans les causes d’entre le roi & ses sujets, sur les matieres qui concernent l’échiquier & les revenus du roi. Ils sont appellés barons, parce que les barons du royaume étoient employés dans cet office.
Leur fonction est aussi de voir les comptes royaux ; ils ont pour cette fin des auditeurs sous eux, de même que pour décider des causes qui regardent les revenus du roi, ces causes appartenant en quelque façon à l’échiquier.
Les barons de l’échiquier ont été jusque dans ces derniers tems des gens savans ès lois, des anciens maires, des personnages importans & éclairés ou censés tels, soit dans le clergé, soit à la cour ; majores & discretiores in regno, sive de clero essent, sive de curiâ.
Les barons des cinq ports sont maîtres de la chambre des communes, élûs par les cinq ports, deux pour chacun. Voyez Cinq ports. Ceux qui ont été maires du château de Corfe dans le comté de Dorset, sont nommés barons. Les principaux bourgeois de Londres avoient autrefois ce titre.
En France on entendoit anciennement par barons, tous les vassaux qui relevoient immédiatement du Roi ; ainsi ce mot comprenoit les ducs, les marquis, comtes, & autres seigneurs titrés & qualifiés, comme on le peut voir dans Aimoin & dans quelques-unes de nos vieilles chroniques, où le Roi haranguant les seigneurs de sa cour ou de son armée, les appelle mes barons. Mais maintenant on employe ce terme dans une acception beaucoup moins générale, puisqu’il ne signifie que le degré de la noblesse, qui est immédiatement au-dessous des ducs, des marquis, des comtes & des vicomtes, quoiqu’il y ait en France & en Allemagne d’anciens barons qui ne voudroient pas le céder à des nobles illustrés depuis peu de ces divers degrés de noblesse. Nos auteurs font aussi mention des barons de Bourges & d’Orléans, titres accordés à quelques-uns des principaux bourgeois de ces villes, comme à ceux de Londres, mais qui n’emportoient point avec eux de caractere de noblesse, & donnoient seulement à ces citoyens quelques prérogatives, comme de n’être pas tenus de répondre en justice sur certaines choses hors de l’enceinte des murs de leur ville. Les trois premiers barons de France dans la noblesse, étoient ceux de Bourbon, de Conty, de Beaujeu : mais ces baronies ont été depuis réunies à la couronne. Dans le clergé il y a des évêques, des abbés, & des prieurs barons ; soit qu’anciennement les rois leur ayent accordé ce titre, soit qu’ils possedent par leurs libéralités des baronies, ou qu’ils les tiennent en fief de la couronne. Voyez Noblesse. (G)
BARONET, s. m. (Hist. mod.) degré d’honneur en Angleterre, qui est immédiatement au-dessous de celui de baron, & au-dessus de celui de chevalier ; ils ont le pas sur tous les chevaliers, excepté sur ceux de la jarretiere. Voyez Chevalier, &c.
La dignité de baronet se contere par patente ; c’est le moindre degré d’honneur qui soit héréditaire. Cet ordre fut fondé par Jacques Ier en 1611. Deux cents baronets furent créés par ce prince, & fixés pour toûjours à ce nombre ; cependant on dit qu’ils sont aujourd’hui plus de huit cents.
On leur accorda plusieurs priviléges, pour être possedés par eux & par leurs héritiers mâles. Il leur fut permis de charger leur écu des armes d’Ulster, qui sont une main de gueules dans un champ d’argent, à condition qu’ils défendroient la province d’Ulster en Irlande contre les rebelles qui l’incommodoient extrèmement. Pour cet effet ils furent obligés de lever & d’entretenir à leurs dépens chacun trente soldats pendant trois ans, ou de payer à la chambre l’équivalent en argent ; cette somme, à huit sols par jour pour chaque soldat, faisoit 1095 livres. Ils sont maintenant exempts de cette obligation.
Les baronets prennent place entr’eux suivant l’ancienneté. Selon les termes de leurs patentes, il ne peut y avoir de degrés d’honneur établis entr’eux ; il en est de même entre les barons.
Le titre de sir leur est accordé par une clause particuliere ; cependant ils ne sont pas faits chevaliers : mais un baronet & son fils aîné ayant l’âge nécessaire, peuvent l’un & l’autre solliciter l’entrée dans l’ordre de chevalier. (G)
BARONIE, s. f. (Hist. mod.) seigneurie ou fief de baron, soit temporel soit spirituel. Voyez Baron. Dans ce sens baronie est la même chose que ce que l’on appelle honour en Angleterre.
Une baronie peut être considérée comme une seigneurie possedée à condition de quelque service, mais en chef par le roi : elle est ce qu’on appelle autrement grande sergenterie.
Les baronies d’Angleterre dans l’origine, étoient mouvantes du roi même, chef & seigneur de tout le royaume, & elles n’étoient pas tenues immédiatement d’un autre seigneur. Par exemple, le roi donnoit à un homme l’investiture d’une grande seigneurie dans le pays, pour que celui qu’il en investissoit en joüît, lui & ses héritiers, comme la tenant du roi & de ses successeurs. Par le service de baron, il faut entendre le service de vingt chevaliers, de quarante, de soixante, plus ou moins, suivant que le roi le déterminoit par l’investiture. Dans les tems qui suivirent de plus près la conquête, lorsqu’un grand seigneur, great lord, recevoit du roi l’investiture d’une grande seigneurie, cette seigneurie étoit appellée baronie, mais plus ordinairement un honneur, honour, comme l’honour de Gloucester, l’honour de Wallingford, l’honour de Lancaster, l’honour de Richemond, & de même des autres. Il y avoit en Angleterre des honours désignés par des noms Normands ou par d’autres noms étrangers, c’est-à-dire que quelquefois ils avoient un nom Anglois, quelquefois un nom étranger ; cela arrivoit quand la même personne étoit seigneur d’un honour en Normandie ou dans quelqu’autre province étrangere, & en même tems seigneur d’un honour en Angleterre ; par exemple, Guillaume de Forz, de Force ou de Fortibus étoit seigneur de l’honour d’Albermale en Normandie ; il étoit aussi seigneur de deux honours en Angleterre, savoir l’honour de Holderness & l’honour de Skipton en Cravene. En Angleterre on nommoit quelquefois ces honours du nom Normand, l’honour d’Albemarle ou l’honour du comte d’Albemarle. De même le comte de Bretagne étoit seigneur de l’honour de Bretagne en France, & de celui de Richemond en Angleterre. On appelloit quelquefois l’honour de Richemond du nom étranger, l’honour de Bretagne ou l’honour du comte de Bretagne, non qu’Albemarle ou la Bretagne fussent en Angleterre, mais parce que la même personne étoit respectivement seigneur de chacun de ces honours en France, & de chacun de ces honours en Angleterre. Voyez Madox, hist. des Baronies, &c.
Les baronies qui appartiennent à des évêques, & qui sont par quelques-uns dénommées regalia, parce qu’elles dépendent absolument de la pure libéralité du prince, ne consistent point en une seule baronie, mais en plusieurs ; car, tot erant baroniœ, quot majora prædia.
Suivant Bracton, une baronie est un droit indivisible ; c’est pourquoi s’il s’agit de partager un héritage entre co-héritiers, quoique l’on puisse diviser quelques maisons principales & les pieces de terre qui en dépendent : si néanmoins la maison principale est le chef-lieu d’un comté ou d’une baronie, on ne peut la morceler ; en voici la raison : le partage de ces sortes de biens anéantiroit insensiblement plusieurs droits privatifs des comtés & des baronies, ce qui tourneroit au préjudice de l’état, qui est composé de comtés & de baronies. (G)
* Baronies (les), Géog. contrée de France, dans le Dauphiné, ainsi appellée des deux baronies de Meuoillon & de Montauban, dont elle est composée.
BAROSCOPE, s. m. (Physiq.) ce mot vient de βάρος, onus, poids, & σκοπέω, video, je vois ; machine inventée pour faire connoître les changemens du poids de l’atmosphere. Voyez Barometre.
Le baroscope ne fait qu’indiquer ou faire voir les changemens du poids de l’atmosphere ; le barometre les mesure par des degrés ou divisions qui sont placés le long du tuyau ; ainsi ces degrés ou divisions font toute la difference du barometre au baroscope. Au reste il n’y a plus aujourd’hui de baroscope qui ne soit barometre, & ces deux noms désignent absolument le même instrument. (O)
BAROTINS. Voyez Barrotins.
BAROTS. Voyez Barrots.
* BARQUES, s. f. (Hist. anc. & Navig.) petits bâtimens, capables de porter sur les rivieres & même sur la mer le long des côtes, & les premiers, selon toute apparence, que les hommes ayent construits. On navigea anciennement sur des radeaux ; dans la suite on borda les radeaux de claies faites d’osier ; telles étoient les barques d’Ulysse, & celles des habitans de la Grande-Bretagne au tems de César ; ils font, dit-il, des carenes de bois léger, le reste est de claies d’osier couvertes de cuir. Les anciens ont donc eu des barques de cuir cousues ; sans cela il n’est guere possible d’entendre le cymba sutilis de Virgile : mais ce qui doit paroître beaucoup plus incroyable, c’est qu’ils en ayent eu de terre cuite. Cependant Strabon, dont la bonne foi est reconnue, dit des Egyptiens, qu’ils navigent avec tant de facilité, que quelques-uns même se servent de bateaux de terre ; & il parloit d’un fait qui se passoit de son tems. Si l’on croit aux barques de terre cuite des Egyptiens sur le témoignage de Strabon, on ne pourra guere rejetter les bateaux de terre cuite, voguant à l’aide de rames peintes, sur lesquels Juvenal lance à l’eau les Agathyrses. Mais ce n’est pas tout : les Egyptiens en ont construit avec la feuille même de cet arbre sur laquelle ils écrivoient, & le philosophe Plutarque raconte des merveilles de ces petits bâtimens ; il nous assûre, dans son traité d’Isis & d’Osiris, que les crocodiles, qui nuisoient souvent à ceux qui alloient sur de petites barques, respectoient ceux qui montoient des barques de Papyrus, en mémoire d’Isis, qui avoit une fois navigé sur un bâtiment de cette espece. Les feuilles du papyrus étoient larges & fortes, & sur la résistance qu’on leur trouve dans quelques livres anciens qui en sont faits, le P. Montfaucon a compris qu’on pouvoit, en les cousant ensemble & en les poissant, en former des barques. Plusieurs auteurs nous assûrent qu’aux Indes on en construit d’un seul roseau à nœuds & vuide en-dedans ; mais si gros, dit Héliodore, qu’en prenant la longueur d’un nœud à un autre, & le coupant en deux par le milieu des nœuds, on en formoit deux bateaux. Le témoignage d’Héliodore est un peu modifié par celui de Diodore & de Quinte-Curce, qui nous font entendre, non pas qu’on fit deux bateaux avec un morceau de canne, mais qu’on faisoit fort bien un bateau avec plusieurs morceaux de canne. Combien de faits dont le merveilleux s’évanoüiroit, si l’on étoit à portée de les vérifier ? Les Ethiopiens, à ce que dit Pline, avoient des barques pliables, qu’ils chargeoient sur leurs épaules & qu’ils portoient au bas des énormes chûtes d’eau du Nil, pour les remettre sur le fleuve & s’embarquer. Scheffer croit que c’étoient des peaux tendues par des ais circulaires, sans poupe ni proue. Les sauvages d’Amérique creusent des arbres d’une grandeur prodigieuse, sur lesquels ils s’embarquent au nombre de 30 à 40 hommes, & s’en servent, sans autre préparation, pour faire par mer des voyages de 70 à 80 lieues : voilà les premiers pas de la navigation. Bien-tôt on fit les barques de matériaux plus solides que la peau, la terre, & le jonc. Dans la suite on abattit les chênes, l’on assembla les planches & les poutres, & les mers furent couvertes de vaisseaux. Mais qu’étoient-ce encore que les vaisseaux des anciens en comparaison des nôtres ? Voy. Navigation, Vaisseau, Batiment & Canot
Barque (Marine) ; on donne particulierement ce nom à un petit bâtiment de mer, qui n’a qu’un pont & trois mâts, le grand, celui de misene, & celui d’artimon. Les plus grandes ne passent guere cent tonneaux ; les barques de la Méditerranée sont appareillées à voiles latines ou à tiers point. En général on donne le nom de barque à différens petits bâtimens qui n’ont point de hune, & qui servent à porter des munitions, & à charger & décharger un navire.
Barque d’avis ; c’est celle qu’on envoye pour porter des nouvelles d’un vaisseau à l’autre.
Barque longue ; c’est un petit bâtiment qui n’est point ponté, & plus bas de bord que les barques ordinaires, aigu par son avant, & qui va à voiles & à rames ; il a le gabarit d’une chaloupe. On l’appelle en plusieurs endroits double chaloupe.
Barque droite ; c’est un commandement qu’on fait à ceux qui sont dans une chaloupe, de se placer également, pour qu’elle aille droite sur l’eau sans pencher plus d’un côté que de l’autre.
Barque en fagot ; c’est tout le bois qu’il faut pour construire une barque, qu’on porte taillé dans un vaisseau, & qu’on peut assembler dans le lieu où l’on en a besoin.
Barque à eau ; ce sont des petits bâtimens dont on se sert en Hollande pour transporter de l’eau douce aux lieux où l’on en manque, & de l’eau de mer pour faire du sel ; ils ont un pont, & on les remplit d’eau jusqu’au pont. Voyez Bateau.
Barque de vivandier ; c’est celle qu’un vivandier promene sur l’eau le long des quais ou autour des vaisseaux, pour y vendre des vivres. (Z)
Barque, en terme de Brasserie, est une espece de bassin de bois de chêne fait avec des planches, de figure quarrée ; il sert aux Brasseurs à mettre leurs métiers lorsqu’ils les retirent des chaudieres ou des cuves.
BARQUEROLLE, BARQUETTE, s. f. (Marine.) bâtiment médiocre de voiture sans aucun mât, qui ne va qu’à la rade & de beau tems, sans jamais se hasarder en haute mer.
BARRA, (Commerce.) que l’on appelle quelquefois barro ; mesure de longueur dont on se sert en Portugal pour mesurer les draps, serges, toiles, &c. les six barras font dix cabidos ou cavidos, & chaque cabidos fait quatre septiemes d’aunes de Paris. Voy. Cabidos.
Barra est encore une mesure de longueur qui sert en quelques endroits d’Espagne à mesurer les étoffes ; c’est la même chose que la verge de Séville. Voyez Verge. (G)
* Barra, (Géog.) île de l’Océan à l’occident de l’Ecosse. Long. 10. lat. 56. 40.
Il y a un petit royaume de ce nom dans la Nigritie.
* Barra, (Géog.) ville de l’Abyssinie en Afrique, sur le lac de Zaflan, au royaume de Gorgan, entre Zaflan & Gorgan.
BARRACAN, s. m. (Commerce.) étoffe forte, dont la chaîne est de laine d’estame retorse, la trame à l’ordinaire, & qui se fabrique comme le drap ; le nombre des fils est plus considérable, proportion gardée, que dans les autres étoffes, parce que celle-ci ne va point au foulon : il faut par la même raison qu’elle soit frappée extraordinairement fort. Voyez la manufacture de drap à l’article Draperie. Elle est au sortir du métier telle qu’elle sera employée.
BARRACANIERS, s. m. ouvriers qui font le barracan. Voyez Barracan.
BARRAGE, (Commerce.) droit établi pour la réfection des ponts & passages, & particulierement du pavé. Ce droit s’appelle ainsi à cause des barres ou barrieres qui traversent le chemin aux entrées des villes & autres lieux où ce droit est établi. Il n’y a guere que les voituriers qui le payent pour leurs chariots, charrettes, & chevaux de somme. Il y a cependant des lieux où toutes les voitures en général, & même les gens de pié, ont coûtume de le payer. Il est inégal, & plus ou moins fort selon les lieux.
Les barrages, & entr’autres celui de Paris, appartenans au Roi, formoient autrefois une ferme particuliere, qui est maintenant réunie a celle des aides. Le droit de barrage se paye à Paris sur tout ce qui y entre & arrive, soit par terre soit par eau. Voyez sur cette matiere les détails dans lesquels entre M. Savary, Dictionn. du Commerce, tom. I. page 862 & 863.
BARRAGER, commis établi aux barrieres pour faire payer & recevoir les droits de barrage. Voyez Barrage. (G)
* BARRAUX, (Géog.) ville de France dans le Dauphiné, à l’entrée de la vallée de Grésivaudan, sur l’Iser.
BARRE, s. f. ce terme pris grammaticalement a plusieurs acceptions différentes, entre lesquelles les deux suivantes sont les plus générales. Il se prend ou pour un morceau de bois, de fer, ou d’autre matiere, rond, quarré, ou à pans, dont la largeur & l’épaisseur sont peu considérables par rapport à la longueur ; ou pour une ligne tracée soit sur la pierre soit sur le papier. Dans le premier cas il change quelquefois de nom, selon la matiere & la force ; & quoique l’on dise une barre de fer ou de bois, on dit un lingot d’or ou d’argent, une tringle de fer, un fil d’archal. Voyez plus bas d’autres acceptions du mot barre.
Barre, en terme de Palais, dénote une enceinte de menuiserie, haute de trois ou quatre piés, derriere laquelle les avocats sont placés pour y plaider des causes. Voyez Cour.
On l’appelle en quelques endroits barre d’audience, & dans d’autres auditoire : elle répond à ce qui étoit appellé parmi les Romains causidica. On l’appelle barre parce qu’elle est formée par une barriere, appellée aussi par des auteurs cancelli, barreaux, & caulæ, parc, par une métaphore prise d’un lieu où parquent les moutons.
La dénomination de barre ou barreau est aussi donnée aux bancs où les gens de loi ou les avocats sont assis, à cause de la barre ou barriere qui sépare les conseillers, des plaideurs, procureurs & autres.
En Angleterre les gens de loi qui sont appellés à la barre, c’est-à-dire, qui ont leur licence pour plaider, appellés licentiati, ou licentiés, sont nommés barristers. Voyez Advocat.
Barre s’est dit aussi d’une exception contre une demande ou plainte. Voyez Exception.
L’auteur des termes de pratique définit barre un moyen rapporté par le défendeur dans un procès, par lequel l’action du demandeur est détruite pour toûjours.
On distinguoit la barre en perpétuelle & temporelle.
Barre perpétuelle est celle qui éteint l’action pour toûjours.
Barre temporelle, n’est qu’une exception dilatoire. Voyez Dilatoire. (H)
* Barre-sacrée, (Hist. anc. Myth.) instrument de bois en forme de cassette, partagé par deux sceptres posés en sautoir, dont les Egyptiens se servoient dans leurs sacrifices & pour leurs divinations. Kirker, Obel. pamph. & Œdip. agypt.
Barres, (Hist. mod.) mot dont on s’est autrefois servi pour exprimer un exercice d’hommes armés & combattans ensemble avec de courtes épées, dans un espace fermé de barreaux ou barrieres qui les séparoient des spectateurs. Voyez Lice. (G)
Barres, (Jeu.) est encore le nom que les jeunes gens donnent à un jeu qui consiste à se séparer en deux troupes, à venir se provoquer réciproquement, à courir les uns contre les autres entre des limites marquées ; ensorte que si quelqu’un de l’un ou de l’autre parti est pris par ses adversaires, il demeure prisonnier jusqu’à ce que quelqu’un de son parti le délivre, en l’emmenant malgré les poursuites du parti contraire. (G)
Barres (en Musique), sont des traits tirés perpendiculairement à la fin de chaque mesure sur les lignes de la portée, pour séparer la mesure qui finit de celle qui recommence. Ainsi les notes contenues entre deux barres forment toûjours une mesure complete, égale en valeur & en durée à chacune des autres mesures comprises entre deux autres barres, tant que le mouvement ne change pas. Mais comme il y a plusieurs sortes de mesures qui different considérablement en durée, les mêmes différences se trouvent dans les valeurs contenues entre les deux barres de chacune de ces especes de mesures. Ainsi dans la mesure à 3 tems qui se marque par ce signe , & qui se bat lentement, la somme des notes comprises entre deux barres doit faire une ronde & demie ; & dans cette autre mesure à trois tems , qui se bat vîte, la même somme ne fait que trois croches : de sorte que quatre fois la valeur contenue entre deux barres de cette derniere mesure, ne font qu’une fois la valeur contenue entre deux barres de l’autre.
Le principal usage des barres est de distinguer les mesures, & d’en indiquer le frappé qui se fait toûjours sur la note qui suit immédiatement la barre. Elles servent aussi dans les partitions à montrer les mesures correspondantes dans chaque portée. Voy. Partition.
Il n’y a guere que cent ans qu’on s’est avisé de tirer des barres de mesure en mesure : auparavant la musique étoit simple ; on n’y voyoit guere que des rondes, des blanches & des noires, peu de croches, presque jamais de doubles croches, avec des divisions moins inégales ; la mesure en étoit plus aisée à suivre. Cependant j’ai vû nos meilleurs Musiciens se trouver embarrassés à bien exécuter l’ancienne musique d’Orlande & de Goudimel : ils se perdoient dans la mesure, faute des barres auxquelles ils étoient accoûtumés, & ne suivoient qu’à peine des parties chantées autrefois couramment par les Musiciens d’Henry III. (S)
Barre, en terme de Blason, dénote une piece honorable qui ressemble de près à la bande, dont elle ne differe qu’en ce qu’elle est plus étroite, & en ce que la barre peut être placée dans telle partie du champ qu’on veut ; au lieu que la fasce ou bande est confinée à un seul endroit. Voyez Fasce. (V)
Barre, en Fauconnerie, se dit des bandes noires qui traversent la queue de l’épervier.
Barre, (Commerce.) mesure de longueur dont on se sert en Espagne pour mesurer les étoffes, ainsi qu’on sait de l’aune en France.
Il y a trois sortes de barres ; celle de Valence, celle de Castille, & celle d’Arragon.
La barre de Valence contient deux piés neuf pouces sept lignes, qui sont dix treiziemes de l’aune de Paris ; de maniere que treize barres de Valence font dix aunes de Paris.
La barre de Castille contient deux piés sept pouces deux lignes & un peu plus, qui font cinq septiemes de l’aune de Paris ; ainsi sept barres de Castille font cinq aunes de Paris.
La barre d’Arragon est à quelques lignes près semblable à celles de Valence & de Castille ; en sorte que trois barres d’Arragon font deux aunes de Paris. (G)
Barre, (Marine.) c’est un amas de sable ou de vase qui se forme à l’entrée des rivieres ou des ports, & qui la bouchent de façon qu’on n’y peut arriver que de haute mer, ou quelquefois par des ouvertures & des intervalles qu’on y trouve, & qui forment des passes qu’on appelle chenal. Ces sortes d’endroits s’appellent havre de barre, riviere de barre. Voyez Havre. (Z)
Barre : ce mot, dans la Marine, se joint à plusieurs autres, & a des significations particulieres, dont on peut voir ci-dessous les principales.
Barres d’arcasse ; c’est un terme commun à la grande barre d’arcasse, ou lisse de hourdi, & aux petites barres d’arcasse, ou barres de contr’arcasse ou contrelisses ; elles sont toutes à l’arcasse du vaisseau, & le soûtiennent. La grande barre d’arcasse est la plus haute, & pose par son milieu sur le haut de l’étambord, & par ses bouts sur les estains ; c’est le dernier des bouts de l’arriere qui affermit la poupe. Voyez la position de la grande barre d’arcasse, Pl. IV. fig. 2. & la forme de cette piece, Plan. VI. fig. 39. Voyez Lisse de hourdi.
Barres d’arcasses, contrelisses, barres de contr’arcasse ; ce sont celles qui se posent au-dessous de la lisse de hourdi ; elles sont assemblées à queue d’aronde dans les estains & avec l’étambord par une entaille qu’on leur fait. Voyez leur position, Plan. IV. fig. 1. no 11.
Barre de pont ; c’est une autre barre d’arcasse sur laquelle on pose le bout du pont du vaisseau ; elle est parallele & presque semblable à la lisse de hourdi. V. la Pl. IV. fig. 1. no 10.
Barre d’arcasse de couronnement ; c’est une longue piece de bois qui lie le haut du vaisseau par son couronnement. Voyez Pl. III. fig. 1. le couronnement du vaisseau coté NN.
Barres de cabestan ; ce sont des pieces de bois quarrées qui servent à faire virer le cabestan. Voyez Cabestan.
Barres de virevaux, voyez Virevaux.
Barres d’écoutille ; ce sont des traverses de bois, ou des pieces de bois étroites qui traversent les panneaux des écoutilles par-dessous, pour en tenir les planches jointes : quelques-uns les appellent taquets de panneaux.
Barre de Gouvernail, (Marine.) c’est une longue piece de bois, qui d’un bout entre dans une mortoise qui est dans la tête du gouvernail pour le faire mouvoir, & l’autre bout est attaché avec une cheville de fer à une boucle de même métal à la barre nommée manuelle, que le timonier tient. V. Pl. IV. fig. 1. la barre du gouvernail cotée 177.
Ce terme de barre est équivoque ; on le prend quelquefois pour le timon, & quelquefois pour la manuelle ou la manivelle. V. Timon & Manivelle.
Changer la barre du gouvernail, c’est la faire tourner d’un autre côté.
Barre à bord : barre de gouvernail toute à bord, c’est-à-dire, poussée contre le côté du vaisseau, ou aussi loin qu’elle peut aller.
Pousse la barre à arriver ; c’est lorsqu’on veut ordonner au timonier de pousser la barre au vent, en sorte que le vent donne à plein dans les voiles pour arriver.
Pousse la barre à venir au vent, ou pousse la barre sous le vent ; c’est afin de faire venir le vaisseau au lof, c’est-à-dire, mettre la barre sous le vent pour virer.
Barres de hune (Marine.) barreaux, tesseaux ; ce sont quatre pieces de bois mises de travers l’une sur l’autre, qui font saillie autour de chaque mât, au-dessous de la hune, pour la soûtenir, & même pour servir de hune aux mâts qui n’en ont point. Elles sont posées en croix au-dessous du ton des mâts, & servent à soûtenir les haubans, les mâts de hune, les perroquets, les essais & diverses manœuvres & poulies. Elles sont un peu arquées, le concave en dedans ; voyez à la Planche premiere, aux articles des Mats, les chiffres 12, 13 & 14, le ton, le chouquet & la hune ; au-dessous sont placées les barres, barreaux ou tesseaux. Leur croix traverse le vaisseau par le milieu & de bord à bord ; aux angles de ces barres, il y a de petits cops de mouton, par où sont amarrés de petits haubans qui traversent aux grands haubans pour les affermir, voyez à la Planche premiere, le chiffre 14, ces petits haubans.
Les barres des perroquets servent à tenir le bâton du pavillon. On donne autant de longueur aux barres de hunes, que le fond de la hune a de largeur.
Les grandes barres de hune d’un vaisseau de cent trente-quatre piés de long de l’étrave à l’étambord, doivent avoir cinq pouces & demi d’épais, & sept pouces & demi de large ; toutes les autres sont moins larges à proportion, & aussi plus plates & plus minces ; leur longueur doit être d’environ neuf piés & demi.
Celles du mât de misene doivent avoir huit piés & demi de long.
Celles du mât d’artimon, quatre piés & demi.
Celles de beaupré, quatre piés & demi, de même que celles du grand mât de hune.
Celles du mât de hune d’avant doivent avoir trois piés & demi.
Celles du perroquet de fougue, deux piés.
Celles du grand perroquet, & du petit beaupré, deux piés.
Celles du perroquet de misene, un pié & demi au moins.
Ces mesures ne sont pas invariables ; il y a des constructeurs qui prétendent que la longueur des barres de hune, qui sont placées dans la longueur de poupe à proue, doit être du tiers de la largeur du vaisseau, que chaque six piés de leur longueur leur doit donner cinq pouces d’épaisseur de haut en bas, & que leur largeur doit être des quatre cinquiemes parties de leur épaisseur.
A l’égard de celles qui sont posées dans la largeur du vaisseau, ou qui le traversent d’un bord à l’autre ; elles doivent être un peu plus courtes, quoiqu’égales en largeur : mais en épaisseur de haut en bas, elles doivent avoit aussi un quart moins que de largeur.
Les barres de hune du mât de misene doivent être d’une sixieme partie plus courtes que celles du grand mât. Les barres du mât d’artimon à peu près la moitié de celles du grand mât, tant en longueur, largeur, qu’épaisseur. Celles de beaupré, qui doivent être posées tout-à-fait de niveau, ont les mêmes proportions que celles de l’artimon, aussi-bien que celles du grand mât de hune, & celles du mât de hune d’avant doivent être d’une dixieme partie plus petites.
Les barres de hune du grand perroquet doivent être en toutes proportions de la moitié de celles du grand mât de hune : il en doit être de même à l’égard des barres du mât de hune d’avant : celles du perroquet d’artimon doivent être un peu plus petites que celles du grand perroquet, & celles du perroquet de beaupré leur doivent être égales.
Barres de cuisine ; ce sont des barres de fer qui servent à soûtenir les chaudieres qu’on met sur le feu ; elles sont posées de long & de travers dans les cuisines des vaisseaux.
Barres ou Barrieres des ports (Marine.) ce sont de longues poutres dont on ferme les entrées des ports, mais plus souvent on se sert de chaines. (Z)
Barre, terme de riviere, piece de bois dans une écluse, qui soûtient les aiguilles.
Barre, terme de riviere, certain flot particulier à la riviere de Seine ; ce flot est haut environ de deux piés, & vient fort impétueusement avec le flux de la mer, ce qui le rend dangereux pour les batteaux mal fermés.
La barre n’est sensible que jusqu’au Pont-de-l’Arche.
Barres (Manege.) ce sont les parties les plus hautes de la gencive du cheval, où il n’y a jamais de dents ; elles sont situées entre les dents mâchelieres & les crochets de part & d’autre de la bouche ; c’est où se fait l’appui du mors de la bride, qui sert à conduire le cheval. C’est un défaut à cet animal d’avoir les barres rondes & peu sensibles ; car encore que le canon simple (voyez Canon) porte sur la langue, les barres ne laissent pas d’en ressentir l’effet au travers, tant elles sont sensibles & délicates. Il faut aux chevaux qui ont les barres rondes & peu sensibles, un mors qui en réveille le sentiment, tel qu’un mors qui tient de l’entier, c’est-à-dire, qui ne plie point dans le milieu de la liberté de la langue. Les barres tranchantes marquent une bouche extrèmement fine. On dit que la levre d’un cheval arme la barre, pour dire qu’elle la couvre.
Barre (Manege.) c’est un morceau de bois gros comme la jambe, rond & long de sept à huit piés, percé d’un trou à chaque bout, pour y arrêter deux cordes, dont l’une s’attache à la mangeoire & l’autre au poteau. V. Mangeoire, Poteau. Ce sont ces morceaux de bois qui séparent les chevaux l’un de l’autre dans une écurie : il sont ordinairement suspendus à un pié & demi de terre. Les chevaux s’embarrent quelquefois. Voyez Embarrer. (V)
Barre d’appui (Architecture.) les ouvriers l’appellent platte-bande d’appui ou plaque bande quarderonnée, parce qu’il y a deux quarts de rond aux deux côtés pour adoucir les arrêtes : c’est, dans une rampe d’escalier, ou un balcon de fer, la barre de fer applattie sur laquelle on s’appuie, & dont les arrêtes sont rabattues. (P)
* Barre de godet ; c’est une barre de fer plat en volute par sa partie saillante, & qui par l’autre bout qui porte sur les entablemens est à harpon ou à patte, & qui a, à un pié de sa partie saillante, une bride pour soûtenir les bords du godet de plomb, communément dit gouttiere.
* Barre de languettes ; c’est une barre de fer plat toute droite, qui se pose aux manteaux de cheminée, & sert à soûtenir la languette de la cheminée, ou son devant ; elle est plus en usage pour les cheminées de brique, que dans les autres ; parce que la brique ne se soûtenant pas par elle-même, comme le plâtre, elle a besoin de cet appui.
* Barre de lintot ou Lintot ; c’est une barre de fer plat, ou quarré, qui se pose au lieu de lintots de bois aux portes & aux croisées ; on en met aussi aux croisées bandées en pierre, pour en empêcher l’écartement.
* Barre de tremie ; c’est une barre de fer plat coudée à double équerre à chacune de ses extrémités, & dont l’usage est de soûtenir les plâtres des foyers des cheminées ; elle se place dans les trémies observées dans les planchers, où elle pose sur les solives d’enchevêtrure.
Barre, chez les Fontainiers ; on appelle barre de soudure une piece étendue en long, composée de plomb & d’étain, pesant environ 18 à 20 livres. V. Soudure. (K)
Barre fendue, ou fondue ; verge de barre fondue ; petite barre de dessous ; barre de derriere ; barre à aiguilles, &c. parties du métier à faire des bas. Voyez l’article Bas.
Barre, outil de Charron ; c’est une espece d’essieu de fer de la longueur de quatre piés, de trois pouces d’épaisseur, quarré au milieu, & arrondi par les deux bouts ; il sert aux Charrons à conduire deux grandes roues à la fois.
Barre (Menuiserie.) s’entend des pieces de bois qu’on met aux contrevents, aux portes, &c. pour entretenir les planches ensemble. Voyez 1. 2. Planc. IV. de Menuiserie, fig. 3.
Barres à queues (Menuiserie.) ce sont celles qui entrent dans les montans, comme celles des portes de granges, qui sont à bâtis, & dont les barres sont emmanchées à queue d’aronde dans les montans.
Barre, chez les Tonneliers, est une piece de bois que ces ouvriers appliquent en travers sur chacun des fonds d’une futaille, & qu’ils y assujettissent avec des chevilles qui appuient par un bout sur cette traverse, & de l’autre entrent dans des trous pratiqués avec le barroir, dans ce qu’on appelle le peigne du jable. La barre sert à maintenir les douves des fonds, & empêche qu’elles ne se déplacent de dedans le jable. Voyez Peigne de jable & Barroir.
Barre, terme de Tourneur, est un long morceau de bois qu’on appelle aussi appui & support, que l’ouvrier a devant lui en tournant, & sur lequel il appuie ses outils. Voyez Tour.
Barre à dégager (Verrerie.) il y a deux barres à dégager ; l’une grande, l’autre petite : elles ont l’une & l’autre le même usage. Les tiseurs s’en servent pour dégager la grille, & mettre le four en fonte. La grande a onze piés de longueur sur quatorze lignes d’épaisseur, dans la partie où elle est quarrée ; cette partie équarrie a vingt-deux pouces de long ; le reste est arrondi. La petite n’a que sept piés de long.
Barre à porter c’est ainsi qu’on appelle, dans les Verreries, un instrument, ou barre, qui sert à transporter le port de l’anse dans la tonnelle. Voyez Verrerie, Pot, Tonnelle
Barre à repasser (Verrerie.) instrument de fer ou de bois, dont on se sert dans la préparation des briques, pour la construction des fourneaux de Verrerie ou autres. Cette barre est quarrée ; elle a neuf à dix lignes d’épaisseur ; l’ouvrier la tient entre ses mains ; & quand il a placé les briques seches dans la boîte qui en détermine les dimensions, il applique la barre sur les bords de la boîte, il la tire fortement à lui en suivant toûjours les bords, & enleve dans ce mouvement l’excédant de brique.
* Barre (Géog.) petite ville de France, dans le Gévaudan, au diocese de Mende.
BARRÉ (os) Voyez Os & Hanche, & Dents barrées. Voyez Dent.
Barrés, adject. (Hist. ecclés.) ancien nom des Carmes, que l’on appelloit freres Barrés, parce qu’ils avoient des habits barrés & bigarrés de blanc & de noir, ce que l’on voit encore dans les vieilles peintures du cloître de leur grand couvent de la place Maubert à Paris. Voici quelle fut l’occasion de ces sortes d’habits des religieux Carmes : les Sarrasins, après s’être rendus maîtres de la Terre-sainte, défendirent à ceux de cet ordre de porter capuches blancs, non plus qu’aucun autre habit blanc, parce que le blanc étoit parmi eux une marque de distinction & de noblesse. Les Carmes alors furent contraints de suivre la coûtume des Orientaux, & de prendre des manteaux barriolés : étant passés en occident avec cette sorte d’habits, ils y furent appellés les freres Barrés, nom qui est demeuré à une rue du quartier saint Paul, où ils eurent leur premiere maison, jusqu’à ce qu’ils furent transportés, sous le regne de Philippe le Bel, à la place Maubert. Ils étoient venus en France sous le pontificat d’Honoré IV. environ l’an 1285 : mais dans la suite ces religieux reprirent leurs premiers habits blancs, ainsi que Tritheme le remarque de Laudibus Carmelit. l. VI. Dominicus macer. Il y a eu autrefois des gens d’église qui portoient aussi des habits bigarrés. On a vû dans le cabinet de M. Conrad, un abbé habillé partie de noir & de rouge, jusqu’au bonnet, ainsi que les consuls de plusieurs villes. Le concile de Vienne a défendu aux ecclésiastiques de tels habits, qui étoient appellés vestes virgata. (G)
Barré (en terme de Blason) se dit lorsque l’écu est divisé en forme de barres, en un nombre pair de partitions, & qu’il est composé de deux ou de plusieurs couleurs, réciproquement mêlées. Il faut dire le nombre de pieces ; par exemple, barré de tant de pieces. Si les divisions sont en nombre impair, il faut d’abord nommer le champ, & exprimer le nombre des barres. Voyez Barre.
Barré Bandé, terme d’usage, lorsque l’écusson est également divisé en barres & en bandes, par des lignes transversales, & des lignes diagonales, en variant mutuellement les couleurs dont il est formé. C’est ainsi que l’on dit, il porte barré, bandé, or, & sable. Contre-barré. Voyez Contre. Urtieres en Savoie, maison éteinte, barré, d’or & de gueules, à la bande de losanges accollées de l’un en l’autre. (V)
Barré, adj. (terme de Palais) synonyme à partagé ; ainsi lorsqu’on dit que les juges ou les avis sont barrés, c’est-à-dire qu’il y a deux sentimens ouverts par la chambre, lesquels sont tous deux appuyés d’un égal nombre de suffrages. Voyez Partage. Voyez aussi Compartiteur. (H)
BARREAU, subst. m. en terme de Palais, signifioit dans l’origine une barre de fer ou fermeture de bois à hauteur d’appui, qui séparoit l’enceinte où étoient assis les juges d’avec les parties extérieures du tribunal où étoient les avocats, & autres praticiens : mais par extension ce terme a signifié dans la suite le corps même des praticiens, avocats, procureurs, &c. C’est dans ce dernier sens qu’on dit les maximes du barreau, l’éloquence du barreau. Quelquefois même ce mot est pris dans une plus grande étendue encore, comme synonyme au forum des Latins ; & alors il s’entend collectivement de tous les officiers de justice, magistrats & praticiens ; en un mot de tout ce qu’on appelle autrement gens de robe. (H)
Barreau, s. m. (en Architecture) se dit de toute barre de fer ou de bois quarré, employée dans un bâtiment. Voyez Barre.
Barreau Montant de Costiere, c’est à une grille de fer, dans l’endroit où porte le barreau, que la porte de fer est pendue ; & le barreau montant de battement est celui où la serrure est attachée.
Barreau, se dit en particulier des barres de fer, ou de bois, qui grillent les fenêtres ou dessus de porte, ou qui sont le même office dans les grilles ou portes de fer.
Barreau à pique, ce sont dans les grilles de fer des barreaux qui passent par la traverse du haut, qui l’excedent & qui se terminent en pointe.
Barreau à flamme, ce sont dans les grilles de fer des barreaux qui passent par la traverse du haut, qui l’excedent & dont l’extrémité est terminée en pointe, & repliées en ondes.
Barreau, s. m. (partie d’une presse d’Imprimerie) c’est une barre de fer, de quatre pouces de circonférence, quarrée par le bout qui traverse la partie supérieure de l’arbre de la presse & la partie inférieure de la vis, où il est arrêté par des clavettes ; le barreau est coudé & arrondi dans le reste de sa longueur, qui est environ de trois piés ; son extrémité se termine en pointe, mais elle est garnie & revêtue d’un manche de bois tourné, poli, de la longueur d’un pié, sur six à sept pouces de circonférence, & plus gros dans sa partie supérieure. C’est de cet agent que dépend tout le jeu d’une presse ; on ne peut sans lui faire mouvoir la vis dans son écrou, ni le pivot dans sa grenouille. Voyez Pl. quatrieme de l’Imprimerie, fig. premiere & seconde B C D. D est la poignée du manche de bois.
* BARREME (Géog.) petite ville de France, dans la haute Provence, sur la riviere d’Asse.
BARRELIERE, s. f. (Hist. nat. bot.) genre de plante, dont le nom a été dérivé de celui du P. Barrelier Jacobin, dont le nom est bien connu des Botanistes. La fleur de ce genre de plante est monopétale & faite en forme de masque ; la levre supérieure est relevée & l’inférieure divisée en trois parties. Il s’éleve du fond du calice un pistil qui est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & qui devient dans la suite un fruit membraneux oblong à quatre angles, composé d’une seule capsule remplie de semences plates & arrondies. Plumier, nova plant. Amer. gen. Voyez Plante. (I)
BARRER des articles sur son livre, en terme de Commerce, signifie effacer, rayer les articles portés en crédit sur un journal ou autre registre, pour faire voir qu’on en a reçu le payement.
On barre aussi tout autre crédit, billet, obligation, quand on veut l’annuller. On appelle cette opération barrer par ce qu’on nomme barres, les lignes ou traits de plume, dont on croise ce qu’on veut qui demeure inutile dans quelqu’acte ou registre. (G)
Barrer les veines d’un cheval (Maréchal & Manége) est une opération qu’on fait sur elles pour arrêter le cours des mauvaises humeurs qui s’y jettent. On ouvre le cuir, on dégage la veine, on la lie dessus & dessous, & on la coupe entre les deux ligatures. Quoique je sois persuadé du peu d’effet de cette opération, je vais cependant la décrire, à cause qu’elle ne peut faire aucun mal, & qu’elle est par elle-même fort peu à craindre.
On barre les veines des cuisses pour les maux de jambes & des jarrets ; aux paturons pour les maux de sole ; aux larmiers & aux deux côtés du cou, pour ceux des yeux : on peut encore barrer en plusieurs endroits. Dans toutes ces parties, excepté aux larmiers, on barre les veines de la maniere que je vais enseigner, après quoi j’indiquerai la façon de pratiquer la même opération sur les larmiers.
Quand on veut barrer la veine de la cuisse, on abat le cheval (voyez Abattre) ensuite on frotte bien avec la main les endroits où l’on veut barrer, pour faire pousser la veine, c’est-à-dire, un peu au-dessus du jarret & vers le milieu de la jambe ; ce qui s’appelle barrer haut & bas : ensuite on fend la peau en long dans ces deux endroits avec le bistouri ; & ayant découvert la veine, on passe par-dessous la corne de chamois, avec laquelle on la détache doucement, en allant & venant, de toutes les petites fibres qui y sont attachées : on la lie ensuite aux deux endroits de deux nœuds, avec une soie en double, l’ayant fendue pour la faire saigner après la premiere ligature, qui est celle du jarret ; puis on la coupe en haut & en bas entre les deux ligatures : au moyen de quoi la portion de veine qui est entre deux ne recevant plus de sang par la suite, s’applatit & devient inutile. Cette opération seroit bonne, si l’humeur qui incommode la partie, n’y communiquoit que par cette branche de veine, ce qu’on ne sauroit admettre lorsqu’on sait l’Anatomie & le cours du sang ; puisqu’elle s’y rend par une infinité de rameaux.
On ne barre point lorsque la partie est enflée ; parce que l’enflure resteroit indépendamment de l’opération, & qu’on auroit quelquefois bien de la peine à trouver la veine.
Quand on barre les veines du cou, on le fait deux doigts au-dessus de l’endroit où l’on saigne : il n’y a qu’une circonstance à omettre, qui est de ne pas couper la veine entre les deux ligatures ; car s’il arrivoit que la ligature d’en haut vint à couler, ce qui peut aisément se faire par le mouvement de la mâchoire du cheval, celui-ci perdroit tout son sang. L’opération achevée, on remplit la plaie de sel.
On peut barrer les larmiers sans incision : mettez pour cet effet au cou la corde à saigner, les veines s’enfleront ; passez ensuite au-travers de la peau sous la veine, une aiguille courbe enfilée d’une soie en double ; faites-là sortir de l’autre côte : ôtez l’aiguille & noiiez la soie ferme, puis graissez la partie, elle enfle beaucoup ; mais l’enflure disparoît au bout de neuf jours. L’endroit se pourrit, la veine se consolide, l’endroit où l’on a fait la ligature tombe, & la veine se trouve bouchée.
Solleysel enseigne à arracher la veine du jarret : mais comme il avertit en même tems qu’il y a du risque à courir, de la douleur & de l’enflure à essuyer, il engage plûtôt à n’y pas songer qu’à répeter l’opération.
Le barrement de la veine est très-bon pour ôter la difformité des varices ; car comme celles-ci ne sont occasionnées que par le gonflement de la veine qui passe par le jarret, on empêche le sang d’y couler, au moyen de quoi la varice s’applanit & ne paroît plus.
Barrer les chevaux (Manége) c’est les séparer les uns des autres dans l’écurie, en mettant des barres entr’eux. Voyez Barre. (V)
Barrer se dit, en terme de Chasse, d’un chien qui balance sur les voies.
Barrer, c’est chez les Layetiers mettre des barres de bois le long des couvercles pour mieux tenir les planches dont ils sont composés.
Barrer une futaille, terme de Tonnelier ; c’est appliquer des barres en-travers sur les douves des fonds, & les y assujettir avec des chevilles. Ce mot se dit aussi des trous qu’on fait avec le barroir dans les peignes du jable. Voyez Barre.
* BARRETTE, f. f. (Hist. mod. ecclés.) bonnet que le pape donne ou envoye aux cardinaux après leur nomination. En France, le Roi donne lui-même la barrette aux cardinaux qui ont été faits à sa nomination. A Venise, ce sont les nobles qui la leur portent. La barrette étoit originairement un bonnet de toile mince, & qui s’appliquoit exactement sur les oreilles ; une espece de beguin d’enfant, qui n’étoit qu’à l’usage des papes, & qui dans la suite a été accordé aux cardinaux.
Barrette, en général veut dire, parmi les Horlogers, une petite barre : mais on donne ce nom à des choses très-différentes. C’est ainsi que l’on appelle, par exemple, une très-petite barre que l’on met dans le barrillet pour empêcher que le ressort ne s’abandonne. Voyez la fig. 49. 1 b, Pl. X. de l’Horlogerie.
Barrette d’une roue, signifie encore, parmi les Horlogers, ce que l’on appelle rayon dans une roue de carrosse. Voyez Roue. Au moyen de ces barrettes on rend la roue beaucoup plus légere, en lui conservant cependant une certaine force.
Barrette, s’entend aussi, en Horlogerie, d’une petite plaque posée sur l’une ou l’autre platine, & dans laquelle roule le pivot d’une roue, au lieu de rouler dans le trou de la platine. Voyez la fig. 43. b, Planche X. de l’Horlogerie.
Elles sont en général fort utiles, en ce que 1°. elles allongent les tiges des roues, & par là leur donnent beaucoup plus de liberté ; & 2°. qu’elles donnent moyen de faire des tigerons, chose très-essentielle pour conserver l’huile aux pivots des roues. Voyez Pivot, Tige, Tigeron, Platine, &c. Dans les montres simples bien faites, il y a ordinairement deux barrettes, l’une à la platine de dessus, & l’autre à la platine des piliers. La premiere sert pour le pivot de la roue de champ d’en haut, & l’autre pour le pivot de cette roue, & celui de la petite roue moyenne. (T)
BARRICADE, terme de guerre, est une espece de retranchement fait à la hâte avec des tonneaux ou paniers chargés de terre, d’arbres, des palissades, ou choses semblables, pour mettre une place ou un poste en état de se défendre contre l’ennemi. On fait servir ordinairement à cet usage des pieux ou des poteaux traversés de bâtons, & ferrés par le bout : on a coûtume de les planter dans les passages ou breches, pour arrêter également la cavalerie & l’infanterie. Voyez Palissade. (Q)
BARRIERE, s. f. (Gramm.) se prend ou pour un assemblage de planches destiné à fermer un passage à l’entrée d’une ville ou ailleurs ; c’est en ce sens qu’on dit, la barriere de Vaugirard, la barriere de Séve : ou pour les limites d’un état ; l’on dit les Alpes servent de barriere à l’Italie : ou en différens autres sens, qu’on peut voir ci-dessous.
Barriere virginale, {{virginale claustrum, en Anatomie ; c’est la même chose que l’hymen. Voyez Hymen. (L)
Barriere, (Traité de la) en Politique, est celui qui fut conclu en 1716 entre l’empereur Charles VI. & les Hollandois ; il contient 29 articles : en vertu de ce traité, les Hollandois ont droit de mettre des garnisons de leurs troupes dans les villes de Namur, Tournai, Menin, Furnes, Warneton, Ypres, le fort de la Knoque, & dans les villes de Dendermonde & de Ruremonde. La garnison doit être moitié Hollandoise, & moitié Autrichienne. Ces troupes ou ceux qui les commandent en leur nom, sont obligés à prêter serment de fidélité à la maison d’Autriche, avant que d’entrer dans ces garnisons.
Barriere, (Commerce.) On appelle ainsi dans les principales villes de France, particulierement à Paris, les lieux où sont établis les bureaux des entrées, & où les commis en reçoivent les droits, suivant les tarifs ou pancartes réglées au conseil du roi.
On leur a donné le nom de barrieres, parce que les passages par lesquels arrivent les voitures & les marchandises sujettes aux droits, sont traversés par une barre de bois qui roule sur un pivot, & qui s’ouvre ou se ferme à la volonté du commis.
Il y a à Paris soixante barrieres, qui sont toutes placées à la tête des fauxbourgs, & dans vingt-deux desquelles, outre les commis du barrage, il y a des commis pour la doüane qui examinent les lettres de voiture, reçoivent les principaux droits, & veillent aux intérêts des fermiers généraux. Les autres barrieres ne sont, pour ainsi dire, que des barrieres succursales, pour tenir plus libres les premieres, qui ne manqueroient pas d’être embarrassées s’il n’y avoit qu’elles qui fussent ouvertes.
C’est à ces soixante barrieres que toutes les voitures, & ceux qui sont chargés des denrées comprises dans les tarifs, doivent s’arrêter, souffrir la visite, & payer les entrées. Les commis ont même la permission de visiter les carrosses, berlines, chaises, &c. des particuliers, les porte-manteaux, valises, coffres, pour voir s’il n’y a point de marchandise de contrebande. Voyez sur cette matiere le Dictionn. du Comm. (G)
Barriere, en Architecture, est un assemblage de pieces de bois qui sert de bornes ou de chaînes au-devant, & dans les cours des hôtels & palais. (P)
Barrieres, en termes de Fortification, sont des especes de portes faites dans un passage ou un retranchement, pour pouvoir en défendre l’entrée, & en faciliter la sortie.
On les fait communément de grands poteaux d’environ quatre à cinq piés de long, & placés à la distance de dix piés les uns des autres, avec des solives en travers, afin d’empêcher les chevaux & les hommes de forcer le passage. Dans le milieu est une barre de bois qui est mobile, & que l’on ouvre & ferme à son gré. Les barrieres qui ferment les portes ou les ouvertures des lignes de circonvallation, sont à fleau tournant sur un poteau, dont le sommet taillé en pivot, est planté sur le milieu, où il partage l’ouverture en deux passages égaux. Ce fleau bat contre les deux autres poteaux plantés aux deux extrémités des passages, avec des entailles pattées, auxquelles il s’accroche & se ferme avec une cheville plate. Attaque des places, de Vauban. (Q)
Barriere, (Manége.) petit parc fermé où l’on faisoit les joûtes, les tournois, les courses de bague, &c. Sitôt qu’un cheval de bague a franchi la barriere, il court de toute sa force. (V)
Barriere, en terme de Metteur-en-œuvre, n’est autre chose qu’une bande en maniere d’ansette, dans laquelle on arrête le ruban d’un bracelet. Voyez Ansette.
BARRIL, (Commerce.) vaisseau oblong de forme sphérique, ou plûtôt cylindrique, servant à contenir diverses especes de marchandises, tant seches que liquides : il est plus petit que le tonneau. V. Mesure.
Le barril Anglois, mesure de vin, contient le huitieme d’un tonneau, le quart d’une pipe, la moitié d’un muid, ce qui fait trente-une mesures & demie de celles que l’on nomme en Angleterre gallons, & qui contiennent quatre pintes de Paris. Le barril contient trente-six gallons de bierre, & trente-deux d’aile. Voyez Pipe, Tonneau, &c.
Le barril de vinaigre, ou d’autre liqueur dont on veut faire du vinaigre, doit contenir trente-quatre de ces mesures, suivant l’étalon de la quarte d’aile, réglé par l’ordonnance de Guillaume III. c. xxj. dixieme & onzieme année de son regne.
Le barril de Florence est une mesure de liqueurs qui contient vingt bouteilles, ou le tiers d’une etoile, ou staïo. Savary l’appelle star.
Barril est encore en usage pour signifier une certaine quantité de marchandises, un certain poids qui change suivant la diversité des denrées.
Le barril de harengs doit contenir trente-deux gallons, mesure de vin, c’est-à-dire soixante-quatre pots de Paris, ce qui fait environ vingt-huit gallons, suivant l’ancienne regle, & cela va pour l’ordinaire au nombre de mille harengs laités.
Le barril de saumon doit contenir quarante-deux gallons, ou quatre-vingts-quatre pots de Paris. Et le barril d’anguilles autant.
Le barril de savon doit contenir deux cens cinquante-six livres.
Nous nous servons également en France du mot de barril pour une certaine quantité de marchandises. On dit un barril d’esturgeon, de thon, d’anchois ; un barril ou caque de poudre pour les vaisseaux, est ordinairement de cent livres : on dit encore un barril de chair salée ; un barril d’huile d’olive ; un barril de câpres, d’olives, de vinaigre, de verjus, de moutarde, pour dire un barril plein de l’une de ces choses. (G)
Barril, (Marine.) Barril de galere, c’est un barril qu’un homme peut porter plein d’eau, & dont il se sert pour en remplir les barriques, que l’on ne peut transporter ou à la fontaine ou à la riviere, où l’on va faire l’eau.
Barril de quart ; c’est le barril de galere qu’on donne plein d’eau le soir à ceux qui doivent faire le quart de la nuit.
Barrils où l’on met les viandes.
Barril de poudre ; c’est sur mer, comme on la dejà dit, cent livres de poudre mises dans un barril.
Barrils à bourse ; c’est un barril couvert de cuir, où le canonnier met de la poudre fine : on l’appelle ainsi à cause qu’il se ferme comme une bourse. (Z)
Barrils foudroyans & flamboyans, sont dans l’Artillerie, des barrils remplis d’artifices qu’on fait rouler sur l’ennemi lorsqu’il veut franchir les breches & monter à l’assaut. (Q)
Barril de trompes, terme d’Artificier, c’est un assemblage de plusieurs artifices appellés trompes, enfermés dans un barril ou fourreau de toile goudronnée, pour les faire partir de dessus l’eau, où on le fait enfoncer jusqu’au collet par le moyen d’un contre-poids.
Barril à scier, (Tonnelier.) c’est un instrument sur lequel les Tonneliers posent les douves qu’ils veulent rogner avec la scie. Il consiste en deux moitiés de barrils ajustées l’une au-dessus de l’autre par trois douves communes ; chacune de ces moitiés a deux fonds, de sorte que cet instrument peut servir à trois usages. 1°. Il leur sert d’escabeau pour scier les douves qu’ils posent dessus, en appuyant encore un genou sur la douve pour l’assujettir. 2°. Il peut leur servir de siége pour s’asseoir dans leurs boutiques : & en troisieme lieu, il peut encore leur servir comme d’un réservoir pour y serrer ce qu’ils veulent, au moyen d’un trou pratiqué au fond supérieur de chaque barril. Cer instrument a deux piés ou environ de hauteur en tout. L’espace qui est entre chaque barril est vuide, pour donner plus de légereté à la machine totale qui est ronde, & d’environ un pié de diametre. Voyez Pl. II. du Tonnelier, fig. 2.
BARRILLAGE, s. m. (Commerce.) se dit des petits barrils qui tiennent environ la huitieme partie du muid & au-dessous.
En fait de commerce de saline, barrillage s’entend de toutes sortes de tonneaux ou futailles, comme gonnes, hambourgs, barrils, demi-barrils, &c. Il y a des contrôleurs du barrillage de la saline.
L’ordonnance des Aides de 1680, tit. 4. des entrepôts & du barrillage, défend expressément de faire le barrillage, c’est-à-dire de faire arriver du vin en bouteilles, cruches ou barrils, ni vaisseaux moindres que muid, demi-muid, quart & huitiemes, à l’exception des vins de liqueur qui viennent en caisse. Il n’est pas même permis aux débitans d’avoir chez eux du vin en bouteilles, cruches & barrils. (G)
BARRILLARD, s. m. (Marine.) c’est ainsi qu’on appelle sur les galeres l’officier qui a soin du vin & de l’eau.
BARRILLATS, s. m. pl. dans les ports où il y a un arsenal de Marine, on donne ce nom aux ouvriers qui travaillent aux futailles.
BARRILLET, s. m. diminutif de barril, se dit de tout vaisseau qui a la forme du barril, & qui est plus petit. Voyez Barril.
Barrillet ou Caisse, (en Anatomie.) signifie une assez grande cavité derriere le tambour de l’oreille ; elle est doublée d’une membrane qui a plusieurs veines & arteres. On dit que dans les enfans elle est pleine d’une matiere purulente ; elle a dans sa cavité quatre petits os, qui sont le marteau, l’enclume, l’étrier, & l’orbiculaire. Voyez Oreille, & Tympan. (L)
Barrillet, s. m. (Hydraulique.) est un corps de bois arrondi en dedans & en dehors, avec un clapet posé sur le dessus. Ce corps loge dans une pompe à bras qui n’a point de corps de pompe, & sert de fond au jeu du piston, qui fait lever le clapet du barillet, & ensuite le fait refermer ; & au moyen de la filasse dont il est garni, l’eau ne peut retomber dans le puits quand la soûpape est fermée.
On appelle encore quelquefois barrillet le piston d’une pompe à bras qui n’a point de corps de pompe, mais qui joue dans un tuyau de plomb, & qui tire l’eau par aspiration d’un puits ou d’une cîterne.
Ces sortes de barrillets sont attachés à une ance de fer suspendue à une verge aussi de fer ; & ils ont sur le dessus un clapet qui s’ouvre & se ferme à chaque coup de piston. Voyez Pompe, Piston, Clapet. (K)
Barrillet, nom que les Horlogers donnent à une espece de boîte cylindrique ou tambour, qui contient le grand ressort. Voyez la figure 46, 47, 49. Planche X. de l’Horlogerie.
Il est composé de deux parties, du barillet B proprement dit, & de son couvercle C. Le barillet a dans sa partie B un rebord pour empêcher la chaîne de glisser ; & dans le dedans vers le milieu de sa hauteur, un crochet auquel s’attache l’œil d’un bout du ressort. Ce crochet est tourné en sens contraire de celui qui est à l’arbre, afin que le ressort soit attaché fixement à l’un & à l’autre : par ce moyen, on bande le ressort, en faisant tourner le barillet ; car on fait mouvoir en même tems le bout du ressort qui lui est attaché, & l’autre bout fixé à l’arbre étant immobile, cette opération doit nécessairement produire cet effet. Voyez Crochet.
On distingue dans les montres & dans les pendules les barillets par les parties auxquelles ils servent ; comme barillet du mouvement, de la sonnerie, &c. dans les pendules, sur-tout dans celles que l’on fait en France, comme il n’y a pas de fusée, le barillet est denté à sa partie inférieure, & engrene dans le pignon de la premiere roue du mouvement, ou de la sonnerie ; de façon que le ressort étant bandé, fait tourner le barillet, qui communique ainsi le mouvement à toute la machine. Voyez la fig. 10. Q, W, R. Voyez Montre, Ressort, Arbre de barillet, Pendule, Sonnerie, &c. (T)
* BARRILLIER, s. m. (Hist. mod.) nom d’un de ces anciens officiers de l’échansonnerie du roi & des princes, qui avoient soin du vin. Il en est parlé dans l’état des officiers de l’échansonnerie du tems de S. Louis, en 1261.
BARRIQUAUT, s. m. (Commerce.) se dit de certaines petites futailles ou tonneaux, dont les grandeurs ne sont point réglées : on dit un barriquaut de sucre, un barriquaut de soufre, &c. (G)
BARRIQUE, s. f. (Tonnellier.) tonneau ou futaille, fait de mairrain & cerclé de cerceaux de bois liés avec de l’osier, & propre à contenir plusieurs sortes de marchandises, & particulierement de l’eau-de-vie.
Les barriques n’ont pas de grandeur reglée partout : à Paris il faut quatre barriques pour faire trois muids.
Ce sont les Tonnelliers qui fabriquent & relient les barriques.
Les quatre barriques de vin font à Paris trois muids, à Bordeaux un tonneau six tiersons, en Anjou deux pipes. La barrique contient 210 pintes de Paris, ou vingt-six septiers un quart de septier ; ce qui revient à 360 pintes de Hollande.
La barrique se mesure encore par verges ou vettes, & varie pour le nombre de ces verges ou vettes dans presque tous les endroits.
En Angleterre la barrique de vin ou d’eau-de-vie est de soixante & trois gallons, ce qui revient à 252 pintes de Paris ; quatre de ces pintes faisant le gallon. Voy. Gallon. On met les sardines & leur huile aussi bien que celle de morue en barrique. (G)
BARROYEMENT, s. m. vieux terme de Pratique, qui signifie un délai de procédure.
BARROYER, v. neut. vieux terme de Pratique, qui signifioit à la lettre faire des procédures à la barre de la cour, & en général instruire un procès. Il ne se dit plus à présent que par dérision. (H)
BARROIR, s. m. (outil dont se servent les Tonneliers.) c’est un instrument fait en forme de longue tarriere, dont la meche est étroite & amorcée par le bout. C’est avec cet outil qu’on perce des trous au-dessus du jable, pour y faire entrer les chevilles qui tiennent les barres des futailles. Voyez Planche II. du Tonnelier, figure premiere.
BARROTÉ, adj. (en Marine.) on dit vaisseau barroté, lorsque le fond de cale est tout rempli, ou rempli jusqu’aux barrots.
Barrots, ou Baux, (Marine.) Voyez Bau. Quoiqu’on se serve indifféremment des termes de baux & de barrots, il est pourtant certain que ceux qui sont les plus exacts, ne se servent de celui de bau que pour les solives du premier pont, & qu’ils employent celui de barrot pour les solives des autres ponts. Voyez Planche VI, figure 8. la forme de cette piece de bois.
Il y a les barrots des gaillards. Voyez leur situation Planche IV. fig. prem. n°. 142.
Les barrots de la dunette, n°. 151.
Les barrots du celtis, n°. 128. (Z)
BARROTINS, (Marine.) lattes à baux ; ce sont de petits soliveaux qu’on met entre les baux & les barrots sous les ponts pour les soûtenir. Voyez Pl. VI. fig. 10, la forme de cette piece de bois.
Barrotins du premier pont. Voyez leur situation Pl. IV. fig. prem. n°. 72.
Barrotins du second pont, n°. 120.
Barrotins des gaillards, n°. 143.
Barrotins d’écoutilles, demi-baux ou demi-barrots ; ce sont en Marine des bouts de baux & de barrots, qui se terminent aux hiloires & qui sont soûtenus par des pieces de bois nommées arcboutans, mises de travers entre deux baux. Voyez la forme de cette piece Planche VI. figure 22.
Barrotins de caillebotis ; ce sont de petites pieces de bois qui servent à faire les caillebotis, & auxquelles on donne la tonture ou rondeur du pont du vaisseau en sa largeur. Voyez Caillebotis. (Z)
* BARROU, (le) Géog. riviere d’Irlande, dans la province de Leinster ; elle passe à Caterlogh & à Leighlin, reçoit la Nure & la Sheire, forme le Havre de Waterford, & se jette dans la mer d’Irlande.
BARSANIENS, ou SEMIDULITES, s. m. plur. (Hist. ecclés.) hérétiques qui s’éleverent dans le VIe. siecle. Ils soûtenoient les erreurs des Gadanaïtes, & faisoient consister leurs sacrifices à prendre du bout du doigt la fleur de farine, & à la porter à la bouche. S. Jean de Damas, des Héres. Baronius A. C. 535. n°. 74. (G)
BARTAVELLE, s. f. (oiseau.) Perdrix rouge.
* BARTHELEMI, (Saint) Géog. petite île de l’Amérique, l’une des Antilles, au midi de celle de S. Martin. lat. 17.
* BARTHELEMITES, s. m. pl. (Hist. eccles.) clercs séculiers fondés par Barthelemi Hobzauzer à Saltzbourg, le 1er Août 1640, & répandus en plusieurs endroits de l’Empire, en Pologne, & en Catalogne. Ils vivent en commun ; ils sont dirigés par un premier président, & des présidens diocésains : ils s’occupent à former des ecclésiastiques. Les présidens diocésains sont soûmis aux ordinaires ; & ils ont sous eux les doyens ruraux. Ces degrés de subordination, & quelques autres, répondent avec succès au but de leur institution : un curé Barthelemite a ordinairement un aide ; & si le revenu de sa cure ne suffit pas pour deux, il y est pourvû aux dépens des curés plus riches de la même congrégation : tous sont engagés par vœux à se secourir mutuellement de leur superflu, sans être privés cependant de la liberté d’en disposer par legs, ou d’en assister leurs parens. Ce fonds augmenté de quelques donations, suffit à l’entretien de plusieurs maisons dans quelques dioceses. Quand il y en a trois, la premiere est un séminaire commun pour les jeunes clercs, où ils étudient les humanités, la Philosophie, la Théologie, & le Droit canonique. On n’exige aucun engagement de ceux qui font leurs humanités : les philosophes promettent de vivre & de persévérer dans l’institut ; les théologiens en font serment. Ils peuvent cependant rentrer dans le monde avec la permission des supérieurs, pourvû qu’ils n’ayent pas reçû les ordres sacrés. Les curés & les bénéficiers de l’institut habitent la seconde maison ; la troisieme est proprement l’hôtel des invalides de la congrégation. Innocent XI. approuva leurs constitutions en 1680. La même année l’empereur Léopold voulut que dans ses pays héréditaires ils fussent promus de préférence aux bénéfices vacans ; & le même pape Innocent XI. approuva en 1684 les articles surajoûtés à leurs regles pour le bien de l’institut.
* BARUA, (Géog.) ville d’Afrique dans l’Abyssinie, capitale du royaume de Barnagasse, située près du fleuve de Marabu.
BARUCH, (Prophétie de) Théolog. nom d’un des livres de l’ancien Testament, qui contient en six chapitres les prophéties de Baruch, fils de Neri ou Nerias, & disciple ou secrétaire du prophete Jéremie. Nous n’avons plus l’exemplaire Hébreu de la prophétie de Baruch : mais on ne peut douter qu’il n’ait écrit en cette langue, comme les fréquens Hébraïsmes dont elle est remplie le font connoître. On en a deux versions Syriaques : mais le texte Grec paroît plus ancien. Les Juifs ne reconnoissent point ce livre pour canonique ; & on ne le trouve point dans les catalogues des livres sacrés d’Origene, de Meliton, de S. Hilaire, de S. Grégoire de Nazianze, de S. Jérome, & de Rufin. Mais dans le concile de Laodicée, dans S. Cyrille, S. Athanase, & S. Epiphane, il est joint à la prophétie de Jéremie. La prophétie de Baruch doit être aussi comprise sous le nom de ce dernier prophete, dans les catalogues des Latins ; car S. Augustin, & plusieurs autres Peres, citent les prophéties de Baruch sous le nom de Jéremie. Dupin, Dissert. prélim. sur la Bible. (G)
BARULES, s. m. pl. (Hist. eccl.) certains hérétiques dont parle Sanderus, qui soûtenoient que le fils de Dieu avoit pris un corps phantastique ; que les ames avoient toutes été créées avant la naissance du monde, & qu’elles avoient toutes péché à la fois. Sander. hœres. 149. (G)
* BARUSSES, (Géog. anc. & mod.) cinq îles de l’Océan oriental, qui, à en juger par ce que Ptolomée en dit, pourroient bien être celles que nous connoissons sous le nom de Philippines. Mercator croit que ce sont celles de Mandanao, Cailon, Sabut, & les voisines de Circium ; & Baudrand, celles de Macassar, Gilolo, Ceram, & autres connues sous le nom de Moluques.
BARUTH, (Commerce.) mesures des Indes qui contient dix-sept gantans ; c’est-à-dire cinquante à cinquante-six livres de poivre poids de Paris. Voyez Gantan. (G)
* BARUTH, (Géog.) ancienne ville de Turquie dans la Syrie, sur le bord de la mer. Long. 52. 50. lat. 33. 30.
* BARWICK, ou BERWICK, (Géog.) ville d’Angleterre dans le Northumberland, à l’embouchure de la Tweede.
* BARZOD, (Géog.) petite ville de la haute Hongrie, dans le comté de même nom, sur la riviere de Hernath. Le comté de Barzod est borné au septentrion par ceux de Sembin & de Torna ; à l’occident par ceux de Gomor & de Sag ; au midi par celui de Herwecz ; & à l’orient par celui de Chege.
* BAS, adj. terme relatif à la distance, ou la dimension en longueur considérée verticalement : haut est le corrélatif de bas. L’usage, la coûtume, les conventions, l’ordre qui regne entre les êtres, & une infinité d’autres causes, ont assigné aux objets, soit de l’art, soit de la nature, une certaine distance ou dimension en longueur considérée verticalement. Si nous trouvons que l’objet soit porté au-delà de cette distance ou dimension, nous disons qu’il est haut ; s’il reste en-deçà, nous disons qu’il est bas. Il semble que nous placions des points idéaux dans les airs, qui nous servent de termes de comparaison toutes les fois que nous employons les termes bas & haut ou élevé. Nous disons d’un clocher qu’il est bas, & d’une enseigne qu’elle est haute ; quoique de ces deux objets l’enseigne soit le moins élevé. Que signifient donc ici les mots haut & bas ? sinon que relativement à la hauteur ou à la distance verticale à laquelle on a coûtume de porter les clochers, celui-ci est bas ; & que relativement à la hauteur à laquelle on a coûtume de pendre les enseignes, celle-ci est haute. Voilà pour la distance & pour l’art ; voici pour la dimension & pour la nature. Nous disons ce chêne est bas, & cette tulipe est haute : ce qui ne signifie autre chose, sinon que relativement à la dimension verticale que le chêne & la tulipe ont coûtume de prendre, l’un peche par défaut, & l’autre par excès. C’est donc dans l’un & l’autre cas l’observation & l’expérience qui nous apprennent à faire un usage convenable de ces sortes de mots, qu’il ne faudroit peut-être pas définir, puisque l’exactitude, quand on se la propose, rend la définition plus obscure que la chose. Mais on n’écrit pas pour ses contemporains seulement.
Bas, (Marine.) les hauts & les bas du vaisseau ; les hauts du vaisseau, ce sont les parties qui sont sur le pont d’en-haut ; & les bas, celles qui sont dessous. (Z)
Bas le pavillon, mettre bas le pavillon (Marine) c’est-à-dire abaisser le pavillon pour se rendre ou pour saluer un vaisseau plus puissant à qui l’on doit cet honneur.
On dit de même avoir les mâts de hune à bas. (Z)
Bas, adj. (en Musique.) signifie la même chose que grave, & est opposé à haut ou aigu : on dit ainsi que le ton est trop bas, qu’on chante trop bas, qu’il faut renforcer les sons dans le bas. Bas signifie aussi quelquefois doucement, à demi-voix, &c. & en ce sens il est opposé à fort ; on dit parler bas, parler chanter ou psalmodier à basse voix : il chantoit ou parloit si bas qu’on ne l’entendoit point.
Coulez si lentement, & murmurez si bas,
Qu’Issé ne vous entende pas.
Bas, (Man.) mettre bas, porter bas. Voy. Porter.
Avoir les talons bas. Voyez Talon. (V)
Bas se prend en Venerie, en Chasse, pour peu élevé : on dit bas voler, ou bavoler, en parlant de la perdrix, ou autres oiseaux qui n’ont pas le vol haut.
Bas, s. m. (Bonneterie, & autres marchands, comme Peaussier, &c.) c’est la partie de notre vêtement qui sert à nous couvrir les jambes : elle se fait de laine, de peau, de toile, de drap, de fil, de filoselle, de soie ; elle se tricote à l’aiguille ou au métier. Voy. pour les bas tricotés à l’aiguille, l’article Tricoter.
Voici la description du bas au métier, & la maniere de s’en seryir. Nous avertissons avant que de commencer, que nous citerons ici deux sortes de Planches : celles du métier à bas, qui sont relatives à la machine ; & celles du bas au métier, qui ne concernent que la main d’œuvre. Ainsi la Pl. III. fig. 7. du métier à bas, n’est pas la même Planche que la Pl. III. fig. 7. du bas au métier.
Le métier à faire des bas est une des machines les plus compliquées & les plus conséquentes que nous ayons : on peut la regarder comme un seul & unique raisonnement, dont la fabrication de l’ouvrage est la conclusion ; aussi regne-t-il entre ses parties une si grande dépendance, qu’en retrancher une seule, ou altérer la forme de celles qu’on juge les moins importantes, c’est nuire à tout le méchanisme.
Elle est sortie des mains de son inventeur presque dans l’état de perfection où nous la voyons ; & comme cette circonstance doit ajoûter beaucoup à l’admiration, j’ai préféré le métier tel qu’il étoit anciennement, au métier tel que nous l’avons, observant seulement d’indiquer leurs petites différences à mesure qu’elles se présenteront.
On conçoit, après ce que je viens de dire de la liaison & de la forme des parties du métier à bas, qu’on se promettroit en vain quelque connoissance de la machine entiere, sans entrer dans le détail & la description de ces parties : mais elles sont en si grand nombre, qu’il semble que cet ouvrage doive excéder les bornes que nous nous sommes prescrites, & dans l’étendue du discours, & dans la quantité des Planches. D’ailleurs, par où entamer ce discours ? comment faire exécuter ces Planches ? La liaison des parties demanderoit qu’on dît & qu’on montrât tout à la fois ; ce qui n’est possible, ni dans le discours, où les choses se suivent nécessairement, ni dans les Planches, où les parties se couvrent les unes les autres.
Ce sont apparemment ces difficultés qui ont détourné l’utile & ingénieux auteur du Spectacle de la nature, d’insérer cette machine admirable parmi celles dont il nous a donné la description : il a senti qu’il falloit tout dire ou rien ; que ce n’étoit point ici un de ces méchanismes dont on pût donner des idées claires & nettes, sans un grand attirail de Planches & de discours ; & nous sommes restés sans aucun secours de sa part.
Que le lecteur, loin de s’étonner de la longueur de cet article, soit bien persuadé que nous n’avons rien épargné pour le rendre plus court, comme nous espérons qu’il s’en appercevra, lorsqu’il considérera que nous avons renfermé dans l’espace de quelques pages l’énumération & la description des parties, leur méchanisme, & la main d’œuvre de l’ouvrier. La main d’œuvre est fort peu de chose ; la machine fait presque tout d’elle-même : son méchanisme en est d’autant plus parfait & plus délicat. Mais il faut renoncer à l’intelligence de ce méchanisme, sans une grande connoissance des parties : or j’ose assûrer que dans un métier, tel que ceux que les ouvriers appellent un quarante-deux, on n’en compteroit pas moins de deux milles cinq cens, & par-delà, entre lesquelles on en trouveroit à la vérité beaucoup de semblables : mais si ces parties semblables sont moins embarrassantes pour l’esprit que les autres, en ce qu’elles ont le même jeu, elles sont très-incommodes pour les yeux dans les figures, où elles ne manquent jamais d’en cacher d’autres.
Pour surmonter ces obstacles, nous avons crû devoir suivre ici une espece d’analyse, qui consiste à distribuer la machine entiere en plusieurs assemblages particuliers ; représenter au-dessous de chaque assemblage les parties qu’on n’y appercevoit pas distinctement ; assembler successivement ces assemblages les uns avec les autres, & former ainsi peu-à-peu la machine entiere. On passe de cette maniere d’un assemblage simple à un composé, de celui-ci à un plus composé, & l’on arrive sans obscurité ni fatigue à la connoissance d’un tout fort compliqué.
Pour cet effet nous divisons le métier à bas en deux parties ; le fût ou les parties en bois qui soûtiennent le métier, & qui servent dans la main d’œuvre ; & le métier même, ou les parties en fer, & autres qui le composent.
Nous nous proposons de traiter chacune séparément. Mais avant que d’entrer dans ce détail, nous rapporterons le jugement que faisoit de cette machine un homme qui a très-bien senti le prix des inventions modernes. Voici comment M. Perrault s’en exprime dans un ouvrage, qui plaira d’autant plus, qu’on aura moins de préjugés. « Ceux qui ont assez de génie, non pas pour inventer de semblables choses, mais pour les comprendre, tombent dans un profond étonnement à la vûe des ressorts presqu’infinis dont la machine à bas est composée, & du grand nombre de ses divers & extraordinaires mouvemens. Quand on voit tricoter des bas, on admire la souplesse & la dextérité des mains de l’ouvrier, quoiqu’il ne fasse qu’une seule maille à la fois ; qu’est-ce donc quand on voit une machine qui forme des centaines de mailles à la fois, c’est-à-dire, qui fait en un moment tous les divers mouvemens que les mains ne font qu’en plusieurs heures ? Combien de petits ressorts tirent la soie à eux, puis la laissent aller pour la reprendre, & la faire passer d’une maille dans l’autre d’une maniere inexplicable ? & tout cela sans que l’ouvrier qui remue la machine y comprenne rien, en sache rien, & même y songe seulement : en quoi on la peut comparer à la plus excellente machine que Dieu ait faite, &c.
Il est bien fâcheux & bien injuste, ajoûte M. Perrault, qu’on ne sache point les noms de ceux qui ont imaginé des machines si merveilleuses, pendant qu’on nous force d’apprendre ceux des inventeurs de mille autres machines qui se présentent si naturellement à l’esprit, qu’il suffiroit d’être venus des premiers au monde pour les imaginer ».
Il est constant que la machine à bas a pris naissance en Angleterre, & qu’elle nous est venue par une de ces supercheries que les nations se sont permises de tout tems les unes envers les autres. On fait sur son auteur & sur son invention des contes puériles, qui amuseroient peut-être ceux qui n’étant pas en état d’entendre la machine, seroient bien aises d’en parler, mais que les autres mépriseroient avec raison.
L’auteur du Dictionnaire du Commerce dit que les Anglois se vantent en vain d’en être les inventeurs, & que c’est inutilement qu’ils en veulent ravir la gloire à la France ; que tout le monde sait maintenant qu’un François ayant trouvé ce métier si utile & si surprenant, & rencontrant des difficultés à obtenir un privilége exclusif qu’il demandoit pour s’établir à Paris, passa en Angleterre, où la machine fut admirée & l’ouvrier récompensé. Les Anglois devinrent si jaloux de cette invention, qu’il fut long-tems défendu, sous peine de la vie, de la transporter hors de l’île, ni d’en donner de modele aux étrangers : mais un François les avoit enrichis de ce présent, un François le restitua à sa patrie, par un effort de mémoire & d’imagination, qui ne se concevra bien qu’à la fin de cet article ; il fit construire à Paris, au retour d’un voyage de Londres, le premier métier, celui sur lequel on a construit ceux qui sont en France & en Hollande. Voilà ce qu’on pense parmi nous de l’invention du métier à bas. J’ajoûterai seulement au témoignage de M. de Savari, qu’on ne sait à qui l’attribuer en Angleterre, le pays du monde où les honneurs qu’on rend aux inventeurs de la nation, leur permettent le moins de rester ignorés.
DU FUST.
1. Les deux piés de devant qui soûtiennent le siége de l’ouvrier. Fig. 1. Planche I.
2. Les deux piés de derriere.
3. La traverse d’en-bas, à laquelle est attachée la patte qui arrête les marches.
4. La traverse du haut du siége.
5. La traverse allegie. On pratique ordinairement à sa surface 5, une espece de rainure assez large, sur laquelle l’ouvrier met les choses qui lui sont commodes en travaillant.
6. La traverse du contre-poids.
7. La traverse d’en-bas.
8. 8. Les deux têtes du fût. Leur partie antérieure devroit être en biseau.
9. 9. Deux pattes de fer qui tiennent le métier fixe.
10. Le siége de l’ouvrier.
11. 11. Deux goussets qui servent à soûtenir le siége.
14. Support du gousset.
15. 15. Traverses qui servent de supports aux goussets.
16. 16. Supports des montans de devant.
17. 17. Les deux montans de devant.
18. 18. Goussets des montans & des piés de derriere.
19. 19. & 19. 19. Ouvertures pratiquées à chaque tête, pour y fixer les grandes pieces du métier.
20. 20. &c. Les vis avec leurs oreilles, qui servent à tenir les parties du fût fermement assemblées.
21. Un arrêtant. Ainsi l’arrêtant est, comme on voit, un morceau de fer fendu d’une ouverture oblongue, qui lui permet d’avancer ou de reculer à discrétion sous la tête de la vis, qui le fixe au côté intérieur du montant, & terminé d’un bout par une pointe dont l’usage est d’arrêter le crochet inférieur de l’abattant, & de l’empêcher d’avancer trop en-devant ; c’est de cet usage que cette piece a pris le nom d’arrêtant. Il y a un autre arrêtant à la surface & à la hauteur correspondante de l’autre montant.
- Un petit coup. Le petit coup est une espece de
vis, dont la tête a une éminence à laquelle on porte le bout du crochet inférieur de l’abattant quand on travaille : cette éminence est coupée en plan incliné vers le fond du métier, & permet au crochet de s’échapper presque de lui-même.
23. 23. Les écrous à oreilles de l’arrêtant & du petit coup.
24. 24. Deux broches de fer, capables de recevoir chacune une bobine.
25. Une bobine dans sa broche.
26. 26. Deux passe-soies. Les passe-soies sont deux morceaux de fer recourbés, comme on voit, & percés de trous, par lesquels on fait passer la soie, qu’ils dirigent & empêchent de s’attacher aux objets circonvoisins.
27. Un rouloir avec les crochets qui le suspendent. Le rouloir est un instrument qui sert à plier l’ouvrage à mesure qu’il se fait. Il faut y distinguer plusieurs parties. La barre 1, 2, plate qui tient unis les côtés 3, 4 par leurs extrémités supérieures. La barre ronde 5, 6 qui s’ajuste dans les trous percés aux extrémités inférieures des côtés, comme nous l’allons dire. La noix 7, la gachette 8, le ressort 9, le bouton 10, la tringle 13, 14 ; la barre ronde est faite en douille par les deux bouts ; la noix & le bouton ont chacun une éminence ou espece de tourillon, par lesquels ils s’adaptent, l’un à un bout & l’autre à l’autre bout. Ces especes de tourillons sont percés d’un trou, qui ont leurs correspondans à la douille qui les reçoit. On voit ces trous 11, 12 : on place dans chacun une goupille qui traverse la douille & les tourillons, & qui fixe le bouton à l’une des extrémités de la barre ronde, & la noix à l’autre extrémité. D’où il arrive, que cette barre passée dans les ouvertures pratiquées au bas des côtés du rouloir, peut tourner dans ces ouvertures, mais ne peut s’en échapper, & que la noix est tenue appliquée au côté 3, où l’extrémité de la gachette entre dans ses dents & y reste engrainée, en vertu du ressort qui pousse son autre extrémité.
L’extrémité de la gachette peut bien s’échapper des dents de la noix, & laisser tourner la barre ronde sur elle-même, en un sens, mais non dans l’autre, c’est-à-dire que l’ouvrage peut s’envelopper sur elle, & ne peut se développer.
La tringle 13, 14 sert à diriger l’ouvrage.
1. 2. 1. Les trois marches.
3. 3. Quarrés de bois qui les séparent.
4. Quarré de bois percé par le milieu, qui écarte de la marche du milieu les deux autres.
5. 5. Extrémité de deux marches.
6. 6. Traverse de bois, sur laquelle les marches 5, 5 peuvent agir.
7. Traverse de derriere.
8. Crochet de fer qui part d’un bout de la serrure ou de l’anneau de l’extrémité de la marche du milieu, & qui embrasse de l’autre bout la partie la plus basse de la petite anse.
9. 9. Cordes qui partent de l’extrémité des marches 5, 5, passent sur le tambour de la roue 13, & la font mouvoir de gauche à droite, & de droite à gauche à discrétion.
10. 10. Cordes qui partent des extrémités de la traverse 6, 6, & la tiennent suspendue en vertu de leurs crochets 10, 10, qui s’arrêtent à ceux du balancier.
11. Patte de fer attachée à la traverse 4, qui reçoit un boulon, sur lequel sont soûtenues les marches qu’il traverse, & dont l’extrémité qu’on n’apperçoit pas est reçûe dans un piton.
12. Patte de fer qui tient la roue suspendue par une des extrémités de son axe ou arbre ; on conçoit bien que l’autre extrémité est soûtenue de la même maniere.
13. La roue avec son arbre & son tambour, dont elle ne laisse appercevoir que le quarré.
14. La tige du contre-poids ; cette tige est mobile de bas en haut dans la patte 15.
15. La patte du contre-poids.
Fig. 2. Une poulie avec son fil de soie. Cette poulie n’est autre chose qu’un fil de laiton, auquel on a fait une boucle à chaque bout ; le fil de soie passe par ces boucles, & le poids du fil de laiton l’empêche d’approcher des objets circonvoisins, & l’aide à se dévider de dessus la bobine. Quand la poulie n’est pas assez lourde pour la soie, on y attache une carte.
Voilà le fût du métier ancien, auquel on n’a presque point fait de changement depuis : on a seulement supprimé les quarrés qui séparent les marches ; on a allégi les pattes qui suspendent la roue. Au lieu de donner une patte à la tige du contre-poids, on a percé la traverse par le milieu d’un trou quarré, & l’on a fait passer la tige par ce trou, dont on a garni l’ouverture supérieure d’une plaque de fer, afin qu’elle ne fût point endommagée par la chûte du contre-poids : on en a encore amorti le coup, en attachant un morceau de cuir à la tête de la tige ou branche du contre-poids : cette tête doit être elle-même percée ; on verra dans la suite par quelle raison.
Voilà tout ce qui concerne le fût & ses parties. Nous n’avons rien dit de leur assemblage, parce qu’il n’a rien de particulier, & qu’il est tel qu’on le voit dans les figures. Passons maintenant au métier.
Pour faciliter l’intelligence de cette machine, nous allons distribuer ses parties en plusieurs assemblages, qui s’assembleront eux-mêmes les uns avec les autres, & dont on verra résulter peu à peu la machine entiere.
Les pieces entierement semblables de part & d’autre, 1, II, 2, 3 ; 1, II, 2, 3, s’appellent les grandes pieces, & ce sont en effet les plus grandes qu’il y ait dans le métier : elles forment le devant du métier par leur saillie 1, II. 1, II. & le derriere par leur hauteur d’équerre 2, 3 ; 2, 3. Leur saillie 1, 2 ; 1, 2 s’appelle avant-bras. L’avant-bras a à son extrémité 1, 1, une charniere, & à son extrémité 2, 2, une éminence oblongue & parallélogrammatique, qu’on appelle l’oreille de la grande piece. Cette oreille est percée de plusieurs trous, qui servent à fixer par des vis la grande piece sur la tête du fût.
Les pieces entierement semblables & semblablement placées 4, 5 ; 4, 5, s’appellent les épaulieres ; elles s’assemblent par leurs ouvertures quarrées avec l’arbre 6, 7, dont elles reçoivent les quarrés.
La piece 6, 7 s’appelle l’arbre ; ses deux extrémités, dont on en voit une représentée fig. 4. sont terminées l’une & l’autre par un quarré 1, & par un tourillon 2. L’ouverture 5 quarrée des épaulieres 4, 5 ; 4, 5, reçoit le quarré de l’arbre, dont le tourillon est reçu dans le nœud 3 ou 3 de la grande piece : ainsi les épaulieres sont fixées sur l’arbre, mais l’arbre tourne dans les nœuds 3, 3 des grandes pieces.
L’arbre a dans son milieu une saillie ou espece d’oreille 8, qu’on appelle le porte faix de l’arbre. On voit à chaque nœud 3, 3, des grandes pieces 1, II, 2, 3 ; 1, II, 2, 3, un bouton en vis 9, 9, qui s’enleve & permet de couler de l’huile dans le nœud 3, 3 quand il en est besoin.
La partie 10, 10 s’appelle la barre de derriere d’en-haut : elle s’attache, comme on voit ici, au derriere des grandes pieces & en-dehors.
La partie 11, 11 s’appelle la barre de derriere d’en-bas : elle s’attache, comme on voit, au derriere des grandes pieces en-dedans.
L’usage de ces deux barres est de soûtenir le porte-faix d’en-bas.
Le porte-faix d’en-bas, fig. 5. est composé de plusieurs pieces : d’une roulette 1 attachée à la piece 2, qui conserve le nom de porte-faix d’en-bas ; d’une chappe 3, qui passe sur le porte-faix, qui y est fixée, & qui soûtient la roulette ; & d’un boulon 4, qui traverse les côtés de la chappe & la roulette mobile sur ce boulon.
Ce petit assemblage se fixe, fig. 3. au milieu de la barre d’en-haut & de la barre d’en-bas, & entre ces barres, comme on le voit en 12.
La partie 13, 13 s’appelle gueule de loup : la gueule de loup est fixée au milieu de la barre d’en-bas.
Les nouveaux métiers ont deux gueules de loup, attachées à la barre d’en-bas à des distances égales des grandes pieces. Les parties par lesquelles elles sont fixées à la barre, sont ouvertes selon leur longueur, afin qu’elles puissent, comme on l’a dit de l’arrétant, glisser sous la tête des vis qui les fixent, & s’arrêter à telle hauteur qu’on desire : ce qui est très-essentiel.
La partie 14, 14, 15, 15, fixée par deux vis sur chaque extrémité des épaulieres, s’appelle le balancier. Il est composé de deux barres paralleles 14, 14, 15, 15, qui sont assemblées, comme on voit, & dont celle d’en-bas 15, 15, est terminée par deux petits crochets.
On a corrigé ce balancier dans les métiers nouveaux ; on a supprimé la barre 15, 15 avec son tenon, & on lui a substitué sur la barre 14, 14, à égale distance des épaulieres, deux vis arrêtées par des écrous à oreilles, placés sur la surface supérieure de cette barre. La tête de ces vis se trouve donc sous cette barre. Cette tête percée peut recevoir deux petits crochets ; & ces petits crochets font les mêmes fonctions que ceux de la piece 15, 15 qu’on a supprimée. D’ailleurs, à l’aide des écrous à oreilles, on peut hausser & baisser ces crochets à discrétion.
La partie 16, 16 s’appelle le grand ressort. Son extrémité 16 est terminée par un petit tourillon, qui entre dans l’enfoncement ou coup de pointe 16 du porte-faix d’en-bas ; & son extrémité 16 s’ajuste par un autre tourillon dans l’extrémité de la vis 17, qui traverse le porte-faix d’en-haut, & à l’aide de laquelle il est évident qu’on peut bander ou relâcher à discrétion le grand ressort, dont l’effort tend à relever les épaulieres avec le balancier, en faisant tourner l’arbre sur lui-même.
Voilà le premier assemblage : j’avertis qu’avant de passer au second, il faut avoir celui-ci très-familier ; sinon les pieces venant à se multiplier, & les assemblages mal-compris s’assemblant ensuite les uns avec les autres, formeront des masses confuses où l’on n’entendra rien. On en jugera par le second assemblage, qui ne differe du premier que par un tres petit nombre de pieces sur-ajoûtées, & qui commence toutefois à devenir un peu difficile à bien saisir.
Cet assemblage est formé des pieces de l’assemblage précédent, auquel on a ajoûté les pieces suivantes.
Dans les nœuds 1, 1 des grandes pieces, sont placées les pieces 17, 18, 19 ; 17, 18, 19 : ces pieces s’appellent les bras de presse ; elles sont fixées dans les nœuds 1, 1 par un boulon & par une goupille. Il faut distinguer dans le bras de presse trois parties : 17, le nœud de la charniere du bras ; ce nœud s’ajuste, comme on voit, dans la charniere de l’avant-bras de la grande piece, & s’y retient, comme nous avons dit : 18, le croissant du bras ; & 19, sa patte.
La patte du bras de presse est garnie d’une vis avec l’écrou à oreilles 20, 20 ; 20, 20 : cette vis s’appelle vis de marteau. Son extrémité inférieure vient frapper, dans le travail, sur la grande piece : mais elle ne permet au bras de presse de descendre, qu’autant qu’on le juge à propos.
La partie 21, 21, fig. 2. s’appelle la grande anse. Le lieu qu’elle occupe, & la faculté de son jeu, exigent le coude qu’on lui voit : elle se fixe, comme on voit fig. 1. sur chaque patte des bras de presse, aux lieux 21, 21.
La partie 22, 22, fig. 3. s’appelle la petite anse. Ses deux crochets se placent aux deux angles du coude de la grande anse, comme on voit fig. 1.
La partie 23, 23 s’appelle le crochet de la petite anse, fig. 2. Pl. 3. S’il y avoit eu de la place, on le verroit dans le coude de la petite anse.
La partie 24, 24 qui part de l’extrémité, fig. 1. de la branche ou tige du contre-poids, est une courroie de cuir qui vient passer sur la roulette du porte-faix d’en-bas, & s’attacher par son extrémité 24, au milieu du coude de la grande anse.
La partie 25, fig. 1. est un contre-poids attaché, comme on voit, à la branche ou tige 26 du contre-poids qu’on doit reconnoitre, & dont nous avons parlé à propos du fût.
Le crochet 23, 23, fig. 4. dont un des bouts embrasse le coude de la petite anse, tient par son autre bout à l’anneau de la marche du milieu, comme on peut voir fig. 1, Pl. II.
- Corollaire premier.
D’où il s’ensuit : 1°. qu’en appuyant du pié sur cette marche, fig. 1. Pl. II. le crochet 23, 23, fig. 1. Pl. II. sera tiré en-bas ; que la petite anse 22, 22, fig. 1. Pl. III. le suivra ; & que la petite anse fera descendre la grande anse 21, 21 : mais la grande anse 21, 21 ne peut descendre que les bras de presse 17, 18, 19 ; 17, 18, 19 ; ou plûtôt leurs vis de marteau 20, 20, ne viennent frapper sur les grandes pieces 1, II, 2, 3 ; 1, II, 2, 3 ; que la courroie 24, 24 qui passe sur la roulette du porte-faix d’en-bas, ne soit tirée en embas ; qu’elle ne fasse monter la tige ou branche 26 du contre-poids, & que cette tige n’entraine en-haut le contre-poids 25.
- Corollaire II.
D’où il s’ensuit : 2°. que si on leve le pié de dessus la marche, alors tous les mouvemens se feront en sens contraire. Rien ne retenant plus le contre-poids 25, il descendra ; sa branche 26 descendra avec lui ; la courroie 24, 24 avec la branche : mais la courroie passant sur la roulette, ne peut descendre qu’elle ne tire en-haut & ne fasse monter la grande anse 21, 21. La grande anse montera ; les bras de presse 17, 18, 19 ; 17, 18, 19 se releveront ; la petite anse 22, 22 montera ; son crochet 23, 23 la suivra ; & la marche suivra le crochet, se relevera, & tout se restituera dans l’état que représente la fig. 1. de cette Pl. III.
Ce second assemblage forme ce qu’on appelle communément la cage du métier, sa carcasse, son corps, ses parties grossieres. Nous allons passer à ce que les ouvriers appellent l’ame du métier. Les parties se multiplieront ici au point, que je ne peux trop conseiller au lecteur de se familiariser avec ce second assemblage, & avec le jeu & les noms de ses parties.
On voit dans la figure 5. de cette planche, quatre pieces assemblées. Les deux pieces semblables 27, 28, 29 ; 27, 28, 20, s’appellent porte-grilles ou chameaux de la barre fondue : la piece qu’on appelle bois de grille, & dont nous allons parler, se fixe sur leurs parties 28, 29 ; 28, 29, par des vis & des écrous à oreilles. Les extrémités des vis passent dans les ouvertures longitudinales qu’on y voit : on leur a donné cette figure, afin qu’on pût les avancer ou reculer à discrétion. La piece 30, 30 s’appelle petite barre de dessous ; & celle 31, 31, qui est fixée sur le milieu de la petite barre de dessous, est un porte-roulette garni de sa roulette, du boulon de la roulette, & de la goupille du boulon.
La figure 6. est l’assemblage des pieces précédentes, & du bois de grille garni de sa grille. On voit 32, 32 ; 32, 32, les vis qui traversent le bois de grille 33, 33, qui passent dans les ouvertures longitudinales des parties 28, 29 ; 28, 29 des chameaux, & qui fixent le bois de grille sur ces chameaux. La grosse piece 33, 33 s’appelle bois de grille. La grille est l’assemblage de deux rangées paralleles & perpendiculaires des petits ressorts plantés dans le bois de grille. Il est très-à-propos de connoître la configuration de ces petits ressorts, & d’en examiner l’arrangement. Ils sont plantés parallelement : ils laissent entre eux un petit espace ; & ceux qui forment la ligne de derriere, correspondent exactement aux intervalles que laissent entr’eux ceux qui forment la ligne de devant. L’extrémité supérieure de chacun de ces petits ressorts est renversée en-arriere, & forme une espece de plan incliné. La partie qui est immédiatement au-dessous de ce plan incliné est une cavité, qu’on peut regarder comme formée de deux autres petits plans inclinés, dont la rencontre forme un angle, & fait le fond de la petite cavité. La partie qui est immédiatement au-dessous de la petite cavité, est un quatrieme plan incliné, qui a le reste du ressort pour sa longueur.
La figure 7. est un des petits ressorts de grille détaché. La partie ab est le premier plan incliné ; la partie bc est le second ; la partie cd est le troisieme ; & la partie df est le quatrieme.
La figure 8. est ce qu’on appelle la barre fondue ou fendue : barre fondue, parce que la partie inférieure de son chassis est coulée & remplie d’étain ; barre fendue, à cause des ouvertures ou fentes que laissent entr’eux les petits quarrés de cuivre dont elle est garnie. Cette barre fondue ou fendue est composée de plusieurs pieces dont nous allons parler. 34, 34 ; 34, 34, sont deux côtés du chassis : 35, 35 ; 35, 35, sont deux pieces de commodité qui s’ajustent, comme on les voit avec les deux côtés, & qui servent à supporter la barre fondue : 36, 36 ; 36, 36, sont deux charnieres dont l’usage est de recevoir les contre-pouces ; pieces dont nous allons parler. On voit, fig. 9. une de ces charnieres : elle est percée à sa partie inférieure de deux petits trous, dans lesquels on fait passer une goupille qui traverse en même tems les deux côtés de la barre, & qui fixe la charniere entre ces côtés. Les deux quarrés de sa partie supérieure sont aussi percés dans le milieu, de même que tous les quarrés & autres parties prises entre les côtés de la barre fondue. On dira tout à l’heure l’usage de ces ouvertures. Les pieces 37, 37, sont deux autres charnieres, toutes semblables aux précédentes, & pareillement assemblées avec les côtés de la barre fondue ; mais dont l’usage est de recevoir d’autres pieces qu’on appelle tirans : 38, 38, 38, 38, &c. sont les cuivres de la barre fondue. On voit, fig. 10. la forme d’un de ces cuivres. Leur partie inférieure ou leur queue s’insere entre les côtés de la barre fondue, & le quarré de la partie supérieure demeure supporté sur ces côtés. Ces deux parties sont percées l’une & l’autre, comme on voit, & comme nous avons dit. Tous ces cuivres sont exactement semblables ; tous placés parallelement les uns aux autres, & laissant tous entr’eux le même petit intervalle. Quand on les a bien disposés, on coule de l’étain dans le dessous du chassis de la barre fondue : cet étain remplissant exactement le chassis, entre dans les trous pratiqués aux queues des cuivres, & les fixe solidement dans la disposition qu’on leur a donnée. C’est le nombre de ces cuivres qui marque la finesse d’un métier ; plus il y a de cuivres, plus un métier est fin. L’intervalle du premier au dernier cuivre est ordinairement de quinze pouces. On pourroit le prendre plus grand : mais l’expérience l’a déterminé de cette longueur. On divise cet intervalle en parties de trois pouces ; & s’il y a dans chaque intervalle de trois pouces vingt cuivres, on dit que le métier est un vingt ; s’il y en a trente, on dit que le métier est un trente ; & ainsi de suite. J’ai vû des métiers dont la barre fondue portoit jusqu’à quarante-deux cuivres, par trois pouces.
On ajuste aux extrémités de la barre fondue la piece quarrée 39, qu’on voit fig. 11. percée dans le milieu & allongée à son angle inférieur en tourillon. Cette piece est fixée à chaque extrémité de la barre fondue par une vis & son écrou. Cette vis traversant les côtés de la barre fondue avec la piece à tourillon, sert en même tems à serrer ces côtés. La piece 35 de la fig. 11. est la piece de commodité, séparée de l’assemblage de la fig. 8.
La figure 1. Pl. IV. est un assemblage des porte-grilles 27, 28, 29 ; 27, 28, 29 ; de la petite barre de dessous 30, 30, qu’on ne voit pas ; de la roulette fixée sur son milieu, que le bois cache aussi : du bois de grille, garni de sa grille 33, 33 ; de la barre fondue entiere 34, 34 ; 34, 34, avec les pieces de commodité 35, 35 ; des charnieres à contre-pouces 37, 37 ; des charnieres à tirans 36, 36 ; des cuivres 38, 38, &c. des quarrés à tourillon 39, 39.
J’observerai ici que la barre fondue n’est pas tout-à-fait la même dans les nouveaux métiers, que dans celui que je viens de décrire ; on a supprimé les pieces de commodité, & le quarré à tourillon n’a pas tout-à-fait la même figure : la barre se termine d’une façon un peu plus simple.
La piece 40 s’appelle platine à ondes, fig. 2. il faut distinguer dans cette piece plusieurs parties, qui ont toutes leurs usages, comme on verra dans la suite. a, la tête de la platine ; b, son bec ; c, le dessous du bec ; d, la gorge ; e, le ventre ; f, la queue.
On voit fig. 3, une piece qui s’appelle onde, 41. On voit que l’onde est fendue par sa partie antérieure, qu’elle a une éminence au milieu ; que cette éminence est percée, & que sa queue se termine en pointe mousse. La tête de la platine à onde s’insere, s’attache & se meut dans la fente de la tête de l’onde ; & ces deux pieces assemblées se placent entre les intervalles que laissent entr’eux les cuivres de la barre fondue, de maniere que l’ouverture de l’éminence de l’onde, réponde aux ouvertures des deux cuivres entre lesquels elle est placée, & que sa queue s’avance juste au fond de la cavité d’un ressort de grille.
- Corollaire II.
Il s’ensuit de-là qu’il faut autant de platines à ondes que d’ondes, autant d’ondes que de cuivres, autant que de ressorts de grille ; & que les queues des ondes doivent être alternativement un peu plus courtes & un peu plus longues ; plus longues en celles qui vont jusqu’au fond de la petite cavité des ressorts de grille de la seconde rangée ; plus courtes en celles qui ne vont qu’au fond de la petite cavité des ressorts de grille de la premiere rangée.
On voit, fig. 4. tous les intervalles laissés entre les cuivres remplis d’ondes garnies de leurs platines, 40, 40, 40, &c. L’usage des cuivres est maintenant évident ; on voit qu’ils servent à tenir les ondes paralleles, & à les empêcher de vaciller à droite ou à gauche.
On a représenté, fig. 5. la piece appellée un tirant, qui doit remplir la charniere de barre fondue, que nous avons appellée charniere de tirant, & que nous avons chiffrée fig. 1, 36. Le tirant 42, fig. 4, ressemble exactement à la partie antérieure d’une onde ; il fait en dessus & en dessous les mêmes coudes : il a l’éminence pareille & pareillement percée ; il est seulement plus fort ; & au lieu d’avoir l’extrémité antérieure fendue, il l’a propre à être ajustée dans le porte-tirant.
On voit, fig. 4, le tirant 42 dans sa charniere, dont la figure n’est pas inutile ; car on doit s’appercevoir que ses deux quarrés sont destinés à tenir le tirant, parallele aux ondes & non vacillant.
La piece 43, 44, 45, fig. 4, qu’on voit dans la charniere que nous avons chiffrée 37, fig. prem. s’appelle contre-pouce : sa partie antérieure 43, a la forme d’un pouce ; elle est chargée d’un contre-poids 44 : il y a en dessous une éminence comme aux tirans & aux ondes, & sa partie postérieure 45 se termine par un quarré plat & percé dans le milieu.
Les contre-pouces, les tirans, les charnieres des contre-pouces, les charnieres des tirans & toutes les ondes avec les cuivres, sont traversées par une verge ronde, qu’on appelle verge de barre fondue. On voit en 46 l’extrémité de cette verge. Les tirans, les contre-pouces & les ondes, peuvent se mouvoir librement sur elle ; & elle sert comme d’axe & de point d’appui à toutes ces parties.
On a ajusté à l’extrémité de la barre-fondue, la roulette 47 dans son tourillon, fig. 4.
La piece 48, 48, qu’on voit, fig. 4, ajustée par ses extrémités quarrées, sur les extrémités de même figure des contre-pouces, s’appelle la bascule. Il faut que le bec du contre-pouce avec le poids dont il est chargé, soit plus lourd que la partie postérieure avec la partie de bascule qu’elle soûtient ; car l’usage du contre-pouce & de son contre-poids, est de faire relever la bascule d’elle-même, quand en lâchant le pouce, on cesse de presser le contre-pouce en dessous, & d’appliquer la bascule sur la queue des ondes.
Si l’on revient à la piece de commodité de la barre fondue, fig. 1, on appercevra à l’extrémité de sa partie postérieure un petit tenon o ; c’est sur ce petit tenon qu’est soûtenue la barre à chevalet, ou la machine 49, 49, qu’on voit passée sous la queue des ondes, fig. 4. Dans les métiers nouveaux, la barre à chevalet ne porte que sur les grandes pieces.
On distingue dans le chevalet plusieurs parties ; 50, 50, s’appelle la barre à chevalet ; 51, la joue du chevalet ; 52, le corps du chevalet ; 53, l’s de la corde à chevalet ; 54, la roulette de la barre à chevalet. Les joues & le corps du chevalet tiennent ensemble : cet assemblage est mobile le long de la barre à chevalet : c’est la même corde qui part d’une des s 53, passe sur une des roulettes 49 de la barre à chevalet, va s’envelopper sous la roue du fût 13, pl. 2, fig. prem. & se rend à l’autre s 53 ; elle est cloüée sous la roue.
- Corollaire IV.
D’où il arrive qu’en appuyant sur la marche, 1, 5, qui est à gauche, fig. 1. Pl. II. cette marche faisant tourner le tambour de la roue 13, de droit à gauche, la roue 13 tourne en même sens ; le corps du chevalet, Pl. 4, fig. 4. 51, est tiré en même sens, & il va le long de la barre à chevalet 50, 50, de droite à gauche, jusqu’aux arrêts 55, 55 de la barre à chevalet : c’est le contraire, si lorsque le chevalet est aux arrêts 55 de la barre à chevalet, on vient à appuyer sur la marche qui est à droite.
- Corollaire V.
Mais le corps du chevalet faisant comble 51, & étant un peu plus élevé que la position presqu’horisontale des ondes, ou que les petites cavités des ressorts de grille où leurs queues sont placées, ne peut passer sous ces queues sans les chasser de ces cavités ; c’est ce qui produit ce cliquetis assez long qu’on entend, lorsque l’ouvrier travaille. Il est causé par l’action du comble 51 du chevalet, contre le dessous de la queue des ondes ; par la réaction des ressorts de grille, des cavités desquels les queues des ondes ne peuvent s’échapper, sans repousser ces ressorts & se trouver ensuite sur le petit plan incliné, qui forme leur extrémité & qui facilite cette réaction ; & par la chûte de la tête des ondes sur une piece dont nous parlerons, & qu’on appelle la barre à moulinet, contre laquelle les têtes des ondes viennent frapper. C’est pour que cette chûte se fasse, qu’on a pratiqué en dessous de l’onde entre sa tête & son éminence, un coude ou vuide. Moyennant ce vuide, l’onde n’est point gênée dans son mouvement par la barre fondue, qui ne laisse pas d’avoir de la largeur ; c’est par cette raison qu’on a pratiqué le même coude, ou vuide aux tirans.
La bascule sert à faire sortir les queues des ondes des cavités des ressorts de grille & à les faire descendre ; & le chevalet, à les chasser des mêmes cavites & à les faire monter.
Dans les nouveaux métiers, comme il n’y a point de pieces de commodité, la barre à chevalet porte sur les longues pieces ; elle s’y fixe à l’aide de deux chameaux, qui ont chacun une vis quarrée avec un petit tourillon, qui entre dans le dessous de la barre à chevalet.
Voilà le troisieme assemblage, ou l’ame du métier. Nous allons passer au quatrieme, qui ne sera que l’assemblage du second & du troisieme ; de même que le second n’étoit que l’assemblage du premier & de quelques autres parties.
Ce quatrieme assemblage est composé du second & du troisieme. C’est la cage du metier dans laquelle on a placé l’ame.
Nous avons donné ci-dessus un détail si exact des parties de ces deux différens assemblages & de la maniere dont elles sont assemblées, que nous pourrions nous contenter d’observer ici, que l’ame ou le troisieme assemblage est mobile dans le second ou dans la cage ; que la barre fendue ou fondue & toutes ses appartenances sont soûtenues par la gueule de loup, 13, 13, fig. 3, Pl. II. attachée à la barre de derriere d’en bas, qui est fixée aux hauteurs d’équerre des grandes pieces, & par les deux roulettes 47, 47, fig. 6, Pl. 4. placées aux extrémités de la barre fondue ; que la roulette de la petite barre de dessous du bois de grille entre & se meut dans la gueule de loup ; que les deux roulettes de l’extrémité de la barre fondue passent & se meuvent sur les grandes pieces ; & que l’assemblage entier que nous avons appellé l’ame du métier, peut s’avancer en devant & se reculer en arriere.
Mais pour faciliter au lecteur l’intelligence de la machine, nous allons lui rappeller toutes les pieces de ce quatrieme assemblage, avec leurs principales correspondances, dans l’ordre où il a vû naître cet assemblage.
1, 2, 3 ; 1, 2, 3. Les grandes pieces.
4, 5 ; 4, 5. Les épaulieres fixées dans le quarré de l’arbre, 6, 7.
6, 7. L’arbre mobile sur ses tourillons placées dans les nœuds 3, 3, des grandes pieces.
8. Le porte-faix de l’arbre.
9. Bouton pour couler de l’huile dans le nœud.
10. 10. Barre de derriere d’en-haut.
11. 11. Barre de derriere d’en-bas. Ces deux barres servent à fixer entr’elles le porte-faix d’en bas, avec sa chappe & sa roulette.
12. Porte-faix d’en bas avec sa chappe & sa roulette, fixés entre les barres de derriere.
13. Gueule de loup fixée à la barre de derriere d’en-bas, qui reçoit la roulette de la petite barre de dessous de la barre fondue.
14, 14, 15, 15. Le balancier fixé sur les épaulieres à quelque distance de leurs nœuds.
16, 16. Le grand ressort placé entre les deux porte-faix.
17, 18, 19. 17, 18, 19. Les barres de presse assemblées avec les grandes pieces.
20, 20. Vis de marteau avec son écrou, placée sur les pattes des bras de presse.
21, 21. Les extrémités de la grande anse, fixées sur les extrémités des bras de presse.
22, 22. Les deux crochets de la petite anse.
Le nœud 4 de l’épauliere droite, couvre la partie de la courroie, qui prend au milieu de la grande anse & qui passe sur la roulette du porte-faix d’en-bas ; & la barre fondue & ses parties empéchent qu’on ne voye la suite de la courroie, aller de dessus la roulette du porte-faix d’en bas, au sommet de la tige ou branche du contre-poids : on n’apperçoit qu’une partie, 26, 26, des branches de la petite ante.
27, 28, 29. Un des chameaux ou porte-grille ; l’autre est caché par les platines à ondes.
Le bois de grille cache la petite barre de dessous 30, 31. avec son porte-roulette & sa roulette que reçoit la gueule de loup ; on n’apperçoit que l’extrémité 32. de la vis qui fixe le bois de grille sur le chameau du côté droit, que l’extrémité 33. du bois de grille, & que les extrémités des petits ressorts plantés dans le bois de grille & formant la grille.
34, 34. Les extrémités des deux barres qui forment le chassis de la barre fondue.
35. Une des pieces de commodité qui soûtiennent le chevalet par un piton qui entre dans un trou pratiqué au-dessous de la barre à chevalet.
36. Un des quarrés de la charniere du tirant.
37. 37. Les quarrés des deux charnieres des contrepouces. Les ondes 42 couvrent les cuivres de la barre fondue.
38. Piece quarrée prise entre les côtes de la barre fondue, de l’angle inférieur, de laquelle part un tourillon dont on voit 47 l’extremite à travers la roulette 47 du côté droit.
39. 39. 39. Platines à ondes fixées à l’extrémité des ondes.
40. Ondes.
41. 41. 41. Partie de la surface supérieure des cuivres de la barre fondue.
42. Un tirant dans sa charniere.
43, 44, 45. Un contrepouce avec son poids, dans sa charniere.
46. L’extrémité de la verge qui traverse les contrepouces, les tirans, les cuivres & les ondes.
47. Roulettes de la barre fondue.
48. 48. La bascule fixée sur les extrémités de derriere des contre-pouces.
On voit très-bien le chevalet 49. 50. 51. 52. 53. 54. avec toutes ses parties : mais on ne voit point le tourillon de la piece de commodité qui le supporte.
Voilà le détail de ce quatrieme assemblage : j’y ai rappellé toutes les parties dont nous avons fait mention jusqu’à présent ; tant celles qu’on voit dans sa figure, que celles qu’on n’apperçoit point du tout, ou qu’on n’apperçoit qu’en partie. Nous pouvons donc passer maintenant au cinquieme assemblage, & nous tenir pour persuadés que ce sera plûtôt l’effet de l’inattention du lecteur, ou plûtôt celui de la composition de la machine, que notre faute, si l’on ne nous a pas entendus jusqu’à présent.
On voit dans la premiere figure de cette Planche ce cinquieme assemblage complet.
La piece 56, 56, figure 1 & 2, qui sert de base à toutes les autres, s’appelle corps de barre à aiguilles : ce corps de barre à aiguilles a une petite saillie ou cordon qu’on apperçoit au lieu 57. On fixe sur cette saillie la petite barre de la figure 3, qu’on ne peut appercevoir dans la figure premiere qu’on appelle queue d’aronde du corps de barre à aiguilles. La surface inférieure de cette piece est plate ; sa supérieure est un talus ou biseau un peu convexe ; ce biseau est tourné vers le fond du corps de barre à aiguilles. On en verra tout-à-l’heure l’usage.
Les pieces 58, 58, figure premiere, sont appellées par les ouvriers étochios, figure 4, 58 ; elles sont placées sur le corps de barre qu’elles traversent, par un tenon quarré qui les tient fermes & immobiles sur ce corps ; elles sont au niveau de sa saillie, & elles sont appliquées exactement contre la queue d’aronde.
Les pieces 59, 59, 59, figure premiere, &c. sont des plombs à aiguilles avec leurs aiguilles, rangés sur la queue d’aronde, entre les deux étochios. On voit, figure 5 & 6, un de ces plombs à aiguilles avec ses trois aiguilles. On a pratiqué à ce plomb, en le coulant, une petite échancrure à sa partie antérieure de dessous. La queue d’aronde a exactement la forme de cette échancrure ; ensorte qu’elle remplit les échancrures de tous les plombs à aiguilles. Il n’est pas inutile de remarquer que la partie postérieure de dessus du plomb à aiguille est en talus.
Les pieces 60, 60, figure premiere, sont des plaques de barre à aiguilles : ces pieces sont plates en dessus ; mais leur partie antérieure de dessous, imite exactement le talus de la partie postérieure de dessus du plomb à aiguille. Les plombs à aiguille sont donc fixés inébranlablement entre les plaques & la queue d’aronde ; entre les plaques qui s’appliquent exactement sur le talus de leur partie postérieure, & la queue d’aronde qui remplit les échancrures de leur partie antérieure. Ces plaques sont fixées fortement sur le corps de barre par deux vis qui les traversent chacune, & le corps de barre.
Les pieces 61, 62 ; 61, 62, s’appellent des corps de jumelles ; ces corps de jumelles sont fixés fortement par leurs pattes 62, 62, sur le corps de barre à platines. Il faut y remarquer deux choses ; leur extrémité supérieure, avec la saillie qui est au-dessous, & parallele à cette extrémité. Cette configuration a son usage, comme on verra dans la suite.
Les jumelles des nouveaux métiers sont mieux entendues ; la plaque supérieure 61 de la jumelle est percée au milieu & traversée d’une vis qu’on peut avancer ou reculer ; & au lieu d’une saillie S, S, telle qu’on la voit ici, elles ont une autre plaque parallele & semblable à celle de l’extrémité 61, percée pareillement & traversée d’une vis, dont la tête est au-dessous de la plaque, & qu’on peut aussi avancer & reculer ; ce qui met moins de difficulté dans la construction du métier, & plus de facilité dans le travail, comme on verra quand je parlerai de la main d’œuvre.
Les pieces 63, 63, placées perpendiculairement sur le corps de barre & parallelement aux jumelles, s’appellent les moulinets.
Il y a dans les moulinets plusieurs parties à distinguer : 64, 64, le corps du moulinet, qui se termine par un tenon quarré que le corps de barre reçoit dans un trou quarré ; 65, 65, le ressort du moulinet. Ce ressort est mobile dans une charniere 66, qui traverse le corps du moulinet de dehors en dedans. La queue de ce ressort porte sur un autre ressort placé plus bas qui la releve ; 67. tenon qui traverse le corps du moulinet, & qui est traversé par l’arbre du moulinet qu’il tient ferme & dirige ; 68. croisée du moulinet ; 69. roue dentée du moulinet ; 80. arbre du moulinet.
La piece 81, 81, que traverse l’extrémité en vis de l’arbre à moulinet, s’appelle boîte à moulinet : c’est en effet une boîte, ouverte par sa partie antérieure, & mobile le long du corps à moulinet, à l’aide de l’arbre à moulinet. Cette boîte reçoit une barre de fer quarrée 82, 82, appellée barre à moulinet, que le ressort courbe 83, 83, 83, fixé par ses extrémités aux côtés des deux boîtes, tient dans l’état où on la voit. Ce ressort courbe est encore attaché par son milieu à la barre à moulinet. Cette barre peut se mouvoir en devant & en arriere : mais il est évident que si quelque puissance la pousse en arriere, le ressort la repoussera en devant, & la restituera dans la situation où on la voit dans cette figure, aussi-tôt que la puissance cessera d’agir.
La barre à moulinet étant renfermée par ses extrémités dans les boîtes, son ressort étant fixé par ses extrémités au côté des boîtes, il est évident que l’arbre de moulinet faisant monter ou descendre les boîtes, fera pareillement descendre ou monter avec elles la barre & son ressort. Fin du cinquieme assemblage.
- Sixieme Assemblage.
Pour avoir le sixieme assemblage, il ne s’agit que d’assembler cet assemblage avec le quatrieme ; & c’est ce qu’on voit exécuté dans la figure 7. de la même Planche V.
Le corps de barre à aiguille 56, 56, est fixé sur les grandes piéces ; de maniere que les platines à ondes sont passées entre les aiguilles de deux en deux, & sont toutes voisines des plombs à aiguilles ; que les jumelles sont entre les bras de presse, & que l’extrémité des jumelles est appliquée sur les épaulieres, entre leurs nœuds & les extrémités du balancier.
- Corollaire VI.
On voit que sans la plaque de l’extrémité des jumelles qui contient les épaulieres, le grand ressort faisant tourner l’arbre du métier, emporteroit au derriere du métier, & les épaulieres & le balancier qui leur est attaché.
- Corollaire VII.
On voit encore qu’il est à propos que cette plaque des jumelles soit traversée d’une vis, dont l’extrémité donne sur les épaulieres ; car par ce moyen, on tiendra les épaulieres à telle hauteur qu’on voudra.
- Corollaire VIII.
On voit en troisieme lieu que la saillie de la jumelle ne servant qu’à empêcher l’épauliere de descendre trop bas quand on travaille, il vaudroit mieux substituer à cette saillie immobile telle qu’on la voit ici, une autre plaque parallele à celle du dessus de la jumelle, & traversée d’une vis, dont la tête seroit en dessous. Par le moyen de cette vis, l’épauliere ne descendroit qu’autant qu’on le jugeroit à propos ; & l’on verra, quand nous parlerons de la main d’œuvre, combien il est important de joüir de ces avantages, qu’on s’est procurés dans le nouveau métier.
Je crois qu’il est assez inutile de rentrer dans une énumération complete de toutes les parties dont ce cinquieme assemblage est formé : il nous suffira, après ce que nous avons dit jusqu’à présent, d’observer deux choses : l’une concernant cet assemblage, & l’autre concernant les différences de l’ancien métier, tel que nous le donnons ici, & du nouveau métier.
Cet assemblage est formé de trois masses importantes ; la cage avec ses appartenances, comme grande anse, petite anse, crochet de petite anse, branche de contre-poids, & contre-poids, &c.
L’ame ou la barre fondue avec ses appartenances, comme porte-grille, bois de grille, grille, platines à ondes, ondes, tirans, contre-pouces, bascule, &c.
La barre à aiguilles avec ses appartenances, comme aiguilles avec leurs plombs, jumelles, moulinets, boîtes, barre à moulinet, ressort à moulinet, &c.
Les différences de l’ancien métier & du nouveau, sont très-légeres ; elles ajoûtent à la vérité quelque chose à la perfection du métier ; mais elles ajoûtent encore davantage à l’honneur de l’inventeur : car on remarquera que si ce métier devoit être exécuté par des êtres infaillibles dans leurs mesures, & mis en œuvre par des êtres infaillibles dans leurs mouvemens, il auroit fallu le laisser tel qu’il étoit. On s’est seulement menagé par les changemens qu’on y a faits, la commodité de tâtonner, & d’atteindre dans la pratique à cette précision geométrique que la machine avoit dans l’esprit de son inventeur. Passons au septieme assemblage.
- Septieme Assemblage. Pl. VI.
La fig. premiere, Planche VI. montre ce septieme assemblage tel que nous l’allons detailler.
La piece qu’on voit 84. 84. fig. 2 & fig. 3. s’appelle barre à platine ; les grosses pieces 85. 85. auxquelles elle est fixée, fig. 2. s’appellent abattans.
La piece 86. 86. qu’on voit fig. 4. & qu’on n’apperçoit pas, fig. premiere, s’appelle le chaperon de la barre à platine ; il est placé à la partie supérieure postérieure de la barre à platine.
La piece 87. 87. qu’on voit fig. 5. mais qu’on n’apperçoit pas, fig. premiere, s’appelle queue d’aronde de la barre à platine. Cette queue d’aronde se fixe à la saillie 88. 88. ou au cordon qu’on voit à la barre à platine, fig. 3. nous parlerons de sa figure & de son usage plus bas. Il suffit de dire ici qu’elle sert à fixer les platines à plomb, & qu’elle en est couverte, de même que la queue d’aronde de la barre à aiguilles étoit couverte des plombs à aiguilles, & servoit à les fixer.
La barre à platine a pareillement ses deux étochios 89. 89. fig. 2. fixes aux extrémités de la queue d’aronde, & au niveau de la saillie, ou du cordon de la barre à platine. On voit, fig. 2. 89. 89. ces deux étochios ; ils ont la même figure & le même usage que sur la barre à aiguilles.
Les pieces qu’on voit, fig. 2. 90. 90. & fig. 6. 90. s’appellent porte-tirans ; ils ont une ouverture à la partie supérieure, par laquelle ils sont attachés, fig. 2. sermement au corps de la barre à platine, & une charniere à la partie inférieure, dont on verra l’usage.
Les pieces qu’on voit, fig. 2. 91. 91. 91. & fig. 7. 91. s’appellent platines à plombs avec leurs plombs à platines ; elles sont composées de deux parties, la supérieure qu’on voit fig. 8. & qu’on nomme plomb à platine, & l’inférieure qu’on voit fig. 9. qu’on nomme platine à plomb.
Le plomb à platine a deux fentes à sa partie large, & reçoit dans ces fentes deux platines à plomb qu’on y fixe, ensorte qu’il en résulte le tout de la fig. 7. ce tout a à sa partie postérieure un petit crochet qu’on voit fig. 8. la queue d’aronde a à sa partie postérieure une entaille en biseau, toute semblable à ce crochet, ensorte que tous les crochets des plombs à platines remplissent l’entaille ou le biseau de la queue d’aronde, à laquelle ils demeurent suspendus par leurs crochets ; ils sont appliqués du reste contre le corps de la barre à platines.
On les fixe contre le corps de la barre à platines par les plaques de barres à platines, 92. 92. & qui sont elles-mêmes fortement attachées par deux écrous & deux vis, comme on voit fig. 2.
Les pieces 93. 93. qu’on voit, fig. 2. attachées au corps de barres à platines par des éminences qui entrent dans une charniere qui tient au corps de barre à platines, & qui leur permet de se mouvoir, s’appellent pouces : on verra ci-après l’usage des pouces.
Passons aux grandes pieces 85, 85, fig. 2. on les appelle abattans ; il faut y distinguer plusieurs parties : on voit sur leur surface antérieure une piece 94, 94, qu’on appelle garde platine ; sur leur surface postérieure une piece 95, 95, qu’on appelle le crochet de dedans de l’abattant, & sous leur partie inférieure, une piece 96, 96, qu’on appelle le crochet de dessous des abattans. Il n’y a pas une de ces pieces qui n’ait son usage relatif à son lieu & à sa configuration : mais cet usage ne s’entendra bien que quand la machine entiere sera formée, & que nous traiterons de la main-d’œuvre.
La piece qu’on voit, fig. 2. 97, 97, fixée au bas des abattans par ses extrémités, & recevant sur son milieu les queues des platines à plomb, s’appelle la barre à poignée. Les parties ab, AB, sont celles que l’ouvrier tient dans ses mains, dont les doigts passent en dessous, & le pouce en dessus, de maniere qu’il puisse être appliqué contre la partie que nous avons appellée pouce ; cette barre s’appelle aussi barre à boîte, parce qu’elle forme une espece de boîte dans laquelle les queues des platines à plomb sont enfermées.
On voit, fig. 10. le dessus de cette boîte : les extrémités de ce dessus sont faites en coin, & s’appliquent dans les lieux cd, CD de la barre, fig. 2. où elles sont retenues par deux goupilles dont on voit les trous en e, E, à la barre.
Ce dessus ne gêne pas les queues des platines à plomb. Voilà toutes les parties qui forment le septieme assemblage.
Il ne s’agit plus que d’ajoûter cet assemblage au sixieme assemblage pour avoir le huitieme : c’est cette addition que nous allons considérer.
- Huitieme Assemblage. Planc. VI.}}
On voit dans cette fig. 1. le septieme assemblage joint au sixieme.
L’extrémité supérieure des abattans est ajustée dans la charniere des épaulieres ; les tirans sont pris dans la charniere des porte-tirans ; les pouces répondent au-dessous de la partie antérieure des contre-pouces ; les platines à plomb remplissent les intervalles vuides qui restoient entre les aiguilles. Il y a entre chaque aiguille une platine ; il ne s’agit plus que d’attacher en A, a, sur les bras de presse, la piece 98, 98, qu’on voit fig. 12. & qu’on appelle la presse ; que de placer toute cette machine sur le fût, ou sur le bois, & que de travailler.
Car voilà la machine entiere & complette : voilà ce qu’on appelle le métier à bas : voilà toutes ses parties, & la maniere dont elles s’assemblent ; il ne reste maintenant que d’en expliquer le jeu, ou que de traiter de la main-d’œuvre.
- Observation.
Mais avant que de passer au dernier assemblage, celui du métier avec son fût, j’observerai qu’il faut une extrème précision dans la configuration des parties du métier. Il faut que les intervalles que laissent entr’eux les cuivres, répondent bien exactement aux ressorts de grille ; que l’épaisseur des plombs à aiguilles soit bien compassée pour qu’il n’y ait pas plus de plombs à aiguilles que de platines à ondes, & que chaque platine à onde laisse toûjours entr’elle & celle qui la suit trois aiguilles ; que les plombs à platines à plomb soient bien compassés, pour que l’épaisseur d’un de ces plombs soit double de l’épaisseur d’un plomb à aiguilles ; que les deux platines que porte chacun de ces plombs, se rencontrent bien dans les deux intervalles que laissent entr’elles les trois aiguilles prises entre chaque platine à ondes, & que toutes ces parties délicates se meuvent librement les unes entre les autres.
- Corollaire IX.
J’ai dit que l’intervalle de barre fondue sur lequel sont disposés les cuivres étoit de quinze pouces : j’ai travaillé chez le sieur Barrat, le premier ouvrier dans son genre, & le dernier qu’on verra peut-être de la même habileté, sur un quarante-deux, c’est-à-dire, un métier qui portoit sur chaque trois pouces de barre fondue, quarante-deux cuivres. La barre fondue entiere avoit donc deux cens dix cuivres ; il y avoit donc deux cens dix ondes, deux cens dix platines à ondes, quatre cens vingt platines à plomb, & six cents trente aiguilles. On verra dans la suite que chaque aiguille fait sa maille, & que par conséquent l’ouvrier faisoit, ou pouvoit faire sur ce métier, six cents trente mailles à la fois.
Mais il est à propos de donner ici la représentation d’une aiguille : on en voit une dans cette planche, fig. 11. il faut y distinguer trois parties ; son bec a, sa chasse b, & sa queue c : son bec est élastique, & quand il est pressé, il se cache dans la chasse b ; la queue c est prise dans le plomb à aiguilles. Nous avons donné à l’article Aiguille, la maniere de travailler les aiguilles du métier. On a pour ce travail une machine tout-à-fait commode, & très-curieuse ; elle est de l’invention du sieur Barrat, & il y a bien de l’apparence qu’elle differe peu de celle qu’a dû imaginer l’inventeur du métier ; car ce n’étoit pas assez que d’avoir imaginé la machine ; son exécution a dû offrir des difficultés étonnantes, & elle n’a pû avoir lieu que ces difficultés ne fussent levées ; pour cet effet, il a fallu trouver les moules des plombs à platines & des plombs à aiguille ; car s’il avoit fallu égaliser ces plombs à la lime, on n’auroit jamais fini : il a fallu trouver le moyen de pratiquer en très-peu de tems des chasses à des aiguilles fines comme des cheveux. Il ne faut donc pas regarder l’inventeur de la machine à faire des bas, comme un homme qui a imaginé une chose seule, très-difficile à la vérité, & qui l’a imaginée aussi parfaite presque qu’elle le pouvoit être ; mais comme un homme qui, lui seul, a encore surmonté tous les obstacles qui s’opposoient à l’exécution de la machine ; & ces obstacles sont de nature à ajoûter beaucoup à l’honneur de celui-là seul qui les auroit surmontés. Il faut consulter pour cet effet les articles de ce Dictionnaire, Moule & Aiguille.
- Neuvieme Assemblage. Planc. VII.
Ce neuvieme assemblage est la machine entiere sur son fût.
Elle est composée 1°. de la cage, & de ses dépendances.
2°. De l’ame, & de ses dépendances.
3°. Des moulinets avec leurs dépendances.
4°. Des abattans, & de leurs dépendances.
Passons maintenant à la main-d’œuvre.
Je diviserai la main-d’œuvre en sept opérations principales. La formation des mailles est le but de ces sept opérations. La premiere consiste à cueillir ; la seconde, à foncer du pié, & à former l’ouvrage ; la troisieme, à amener sous les becs ; la quatrieme, à former aux petits coups ; la cinquieme, à presser les becs, & à faire passer la maille du derriere sur les becs ; la sixieme, à abattre ; la septieme, à crocher.
- Premiere Opération. Cueillir.
Pour rendre cette opération & les suivantes très-intelligibles, j’ai fait représenter les platines à ondes, & les platines à plomb, en grand.
Il y a une petite opération préliminaire à toute autre, c’est de noüer la soie à la premiere aiguille, comme on voit Planche I. du bas au métier, fig. 1. & fig. 2. au point 1, puis de la passer sous la seconde aiguille, & de lui faire faire un tour sur cette seconde aiguille, en la ramenant dessus ; de la conduire sous la troisieme aiguille, & de lui faire un tour sur cette aiguille, en la ramenant dessus ; de la conduire sous la quatrieme aiguille, & de lui faire faire un tour sur cette quatrieme aiguille, en la ramenant dessus, & ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’aiguilles, & placer ce commencement d’ouvrage sous la gorge des platines, comme on l’y voit fig. premiere : cela fait, voici comment on travaille.
Le premier mouvement du cueillir consiste à prendre la soie au sortir de dessous la derniere aiguille, & de l’étendre sous les becs, comme on le voit en 3, 4, fig. premiere & fig. 3. & 2.
Le second mouvement, à presser sur la premiere marche à gauche ou à droite, selon le côté où sera le corps du chevalet : s’il est à droite, comme on le suppose ici, on pressera du pié la premiere marche à gauche ; il part de l’extrémité de cette marche une corde qui passe autour du tambour de la roue ; voy. la Pl. II. fig. 1. n° 9. cette corde 8 fera tourner le tambour & la roue 13 de droite à gauche : mais il y a autour de la roue une corde qui va de-là sur les roulettes de la barre à chevalet, & de ces roulettes aux S du corps à chevalet ; Voyez Pl. IV. fig. 6. n°. 54, 54 ; le corps à chevalet 51 même fig. glissera donc le long de la barre à chevalet 50 de droite à gauche : mais comme le comble 52 du corps à chevalet est plus haut que la queue des ondes, il accrochera en passant les queues des ondes, les chassera de la petite cavité c des ressorts de grille, fig. 1. Pl. IV. & le dessous de la tête de toutes les ondes sera forcé de descendre sur la barre à moulinet, voyez Pl. 5. fig. 1. & fig. 7. & s’y tiendra comme collé, par l’action du petit plan incliné ab, qui termine les ressorts de grille. Voyez fig. 1. Pl. IV. Or la tête des ondes ne peut descendre, que les platines à ondes qui sont assemblées avec les ondes ne descendent aussi : mais en descendant, leurs becs rencontreront nécessairement la soie qu’on a étendue dessous, l’entraîneront avec eux, comme on voit Pl. I. fig. 4. & lui donneront la disposition qu’on lui voit fig. 4. 5. ou 6. c’est-à-dire, qu’elle formera des boucles entre la seconde & la troisieme aiguille, entre la cinquieme & la sixieme, entre la huitieme & la neuvieme, & ainsi de suite. Fin de la premiere opération.
Le premier mouvement de cette opération se fait du pié dont on a cueilli & des deux mains. L’ouvrier prend la barre à poignée des deux mains, de maniere que ses pouces soient appliqués contre les pieces appellées pouces. Voyez Pl. VII. fig. 1. ses mains sont en AA, & ses pouces en BB. Il fait ensuite trois actions à la fois ; il presse du pié la marche 15, fig. 1. Plan. II. dont il a cueilli ou fait marcher le corps à chevalet de droite à gauche ; il tire des mains perpendiculairement en-bas la barre à poignée A A, fig. 1. Pl. VII. & il presse avec ses pouces fortement contre les pouces B B, fig. 1. Pl. VII. voyons quel est le résultat de ces actions.
Il part des extrémités de la traverse 6, 6, fig. 1. Pl. II. qui passe sous les marches 1, 2, 3, des cordes 9, 9, avec leurs crochets 10, 10, qui vont prendre les crochets du balancier 15, 15, Pl. II. fig. 3. la marche 1, 5, même Plan. fig. 1. étant pressée, presse la traverse 6, 6 : d’ailleurs le balancier 14, 14, 15, 15, fig. 3. même Pl. est attaché sur les épaulieres, comme on voit en 14, 14 ; les épaulieres reçoivent dans leurs charnieres les abattans, Pl. VI. fig. 1. 85, 85 ; 85, 85 : la barre à platines est attachée aux abattans, même Pl. & fig. 1. n° 84, 84. L’action du pié sur la marche tend donc à faire descendre les abattans, & avec les abattans, la barre à platines, avec la barre à platines, les platines à plomb, 91, 91, 91, même Plan. fig. 2.
L’action des mains qui tirent perpendiculairement en-bas les abattans, tend aussi à faire descendre les abattans, la barre à platines, & les platines à plomb.
Les actions du pié & des mains conspirent donc ici. L’action des pouces contre les pieces appellées pouces, tend, fig. 6. Pl. IV. à lever la partie antérieure des contre-pouces 43, 43, par conséquent à faire baisser leur partie postérieure 45, & à appliquer la bascule 48, 48, sur les queues des ondes, ou à les faire baisser, ou à relever leur tête, ou à relever les platines à ondes.
Les trois actions combinées de ce mouvement tendent donc à produire deux effets contraires ; l’un d’abaisser les platines à plomb, l’autre de relever les platines à ondes.
Le second mouvement de cette opération consiste à ménager doucement ces deux effets contraires, à les combiner finement, & à faire ensorte que les platines à ondes remontent d’entre les aiguilles, à peu près de la même quantité que les platines à plomb y descendent ; en sorte que les becs des unes & des autres se trouvent tous de niveau sous les aiguilles, comme on voit Pl. I. du bas au métier fig. 7.
Il s’est donc fait dans cette seconde opération une nouvelle distribution de la soie, comme on voit fig. 7. 8. & 9. & formé une boucle entre chaque aiguille : mais les nouvelles boucles s’étant formées aux dépens des précédentes, elles sont toutes égales & toutes plus petites que les premieres formées par les seules platines à ondes.
C’étoit pour donner lieu à cette distribution de la soie entre toutes les aiguilles, au retrécissement des boucles formées par les platines à ondes, & à la formation des boucles faites par les platines à plomb aux dépens des premieres, que l’on a fait un peu relever les platines à plomb ; car si on n’eût point fait relever les platines à plomb, que seroit-il arrivé ? c’est que ces platines eussent tenu tendues sur les aiguilles les portions de soie 1, 2 ; 3, 4, fig. 5. ou 1, 2 ; 3, 4, fig. 6. Pl. I. du métier à bas, & que les platines à plomb F E, DC, &c. venant à s’appliquer sur les mêmes portions, auroient produit l’un ou l’autre de ces effets, ou enfoncé les trois aiguilles contenues sous chaque portion, ou rompu la soie : au lieu que les platines à ondes A B remontant un peu, fig. 4. & 6. même Pl. lorsque les platines à plomb C D, E F, rencontrent les portions de soie 1, 2 ; 3, 4, fig. 6. & 5. elles font descendre sans peine cette soie sous les aiguilles, & la distribuent entr’elles sans les forcer. Mais chaque boucle des platines à ondes ne perdant qu’autant de soie qu’en prend chaque platine à plomb, & ces platines cessant les unes de remonter, & les autres de descendre entre les aiguilles, lorsque leurs becs sont tous de niveau sur les aiguilles, comme on les voit Pl. I. du bas au métier, fig. 7. 8. 9. toutes les boucles sont égales, & la soie se trouve distribuée entre les aiguilles, comme on voit fig. 7. & 8. La portion 1, 2 faite à la main fig. 7. est sous les gorges des platines, & la portion 3, 4 sous les becs. Fin de la seconde opération.
- III. Opération. Amener l’ouvrage sous becs.
Cette opération s’exécute d’un seul mouvement, composé de deux actions ; l’une de laisser remonter les abattans, & l’autre de tirer la barre à poignée en-devant.
Il est évident que pour baisser les abattans, & mettre les platines à plomb de niveau avec les platines à ondes, il a fallu vaincre l’action du grand ressort ; car, Pl. VI. fig. 1. le grand ressort 16, 16, agissant par son extrémité supérieure contre le portefaix 8 de l’arbre 6, 7, tend à le faire tourner : or l’arbre ne peut tendre à tourner qu’il ne donne le même effort, la même tendance aux épaulieres 5, 85 ; 85, 5 : mais les épaulieres reçoivent dans leurs nœuds les abattans 85, 85 ; 85, 85 : le grand ressort tend donc à relever les abattans.
Ainsi pour laisser remonter les abattans, il n’est question que de lâcher des mains, ne point retenir la poignée AB, & que de laisser agir le grand ressort ; observant, tandis que le grand ressort fait remonter les abattans, de tenir les pouces BB fortement appliqués contre les contrepouces C C, Pl. VII. fig. 1. car par ce moyen les pouces BB ne cessant point d’agir contre les contrepouces CC, la partie antérieure des contrepouces ee sera levée à mesure que les abattans remonteront ; leur partie postérieure dd baissera d’autant ; la bascule ff sera toûjours appliquée sur les queues des ondes ; la tête des ondes g g suivra le mouvemement de la barre à platine h h, qui remontera avec les abattans, & les platines à ondes demeureront toûjours de niveau avec les platines à plomb.
L’autre action dont le mouvement de cette troisieme opération est composé, consiste à tirer la barre à poignée A A en devant.
Cette action se fait horisontalement : mais on ne peut tirer la barre à poignée A B, fig. 1. Pl. VI. en devant, que tout ce que nous allons dire ne s’ensuive ; voyez Pl. VI. fig. 1. la barre à platine 84, 84, est tirée en devant, car elle est attachée aux abattans ; les platines a ondes s’avancent en même tems en devant, & toûjours paralleles aux platines à plomb ; parce que la barre fondue est contrainte d’avancer, en vertu des tirans qui tiennent à elle d’un bout, & de l’autre aux porte-tirans 90, 90, même Pl. fig. 2. qui sont attachés à la barre à platines.
Par le mouvement composé de ces deux actions, les becs des platines a b s’élevent au-dessus des aiguilles, les dessous des becs sont amenés un peu au-delà de leurs têtes cd, & la soie se trouve disposée comme on la voit Pl. I. du bas au métier, fig. 10. 11. 12. mais alors la branche des crochets z de dessous des abattans est appliquée contre les petits coups x fig. 1. Pl. VII. Fin de la troisieme opération.
- IV. Opération. Former aux petits coups.
Le premier mouvement de cette opération consiste à laisser remonter l’extrémité des crochets z de dessous des abattans, aux petits coups x, Plan. VII. fig. 1. Ce mouvement se joint presqu’au premier mouvement de l’opération précédente : la surface en talus, ou le dessous du petit coup x, se trouve alors appliqué à la surface en talus pareillement de l’extrémité du crochet z. Mais comme le grand ressort 16, 16, tend toûjours à relever les abattans, il tend en même tems à séparer l’extrémité du crochet z, de l’éminence du petit coup x.
Le second mouvement consiste à empêcher cette séparation par de petites secousses, qui font un peu glisser le talus de l’extrémité du crochet z sur le talus intérieur de l’éminence du petit coup x. Ces secousses ont pour but de corrompre & corroyer la soie sous les becs d’aiguilles, & de la tenir tendue en devant, & presque de niveau avec les becs, comme on voit Pl. I. du bas au métier, fig. 10. 11. 12.
Il faut toûjours tenir les pouces de la main fortement appuyés contre les pouces de la machine, afin que les têtes des ondes demeurant toûjours appliquées à la barre à platines ; les platines à ondes & les platines à plomb demeurent toûjours de niveau ; car cela est essentiel, comme il est facile de s’en appercevoir. Fin de la quatrieme opération.
Le premier mouvement de cette opération consiste à abandonner les abattans à eux-mêmes, tenant toûjours les pouces des mains fortement contre les pouces B B de la machine, & les platines à ondes bien paralleles en tout sens aux platines à plomb. L’action du grand ressort 16, 16, fera remonter les abattans, jusqu’à ce que les épaulieres o o soient appliquées aux arrêtans de l’extrémité des jumelles p p, comme on voit Pl. VII. fig. 1.
Mais lorsque les abattans seront remontés à cette hauteur, alors le ventre n des platines correspondra ou se trouvera à la hauteur des aiguilles, comme on voit même Pl. même fig. 1. & Pl. II. bas au métier, fig. 1. a b.
Le second mouvement consiste à appuyer fortement le pié sur la marche du milieu ; & voici le résultat de ce mouvement. La marche baisse, tire à elle le crochet de la petite anse, ce crochet tire la petite anse, la petite anse tire la grande anse, la grande anse fait descendre les bras de la presse, & la presse se trouve appliquée sur les becs des aiguilles, dont elle force les pointes à se cacher dans les chasses, comme on voit fig. 1. Pl. II. du bas au métier.
Le troisieme mouvement, c’est tandis que la presse est sur les becs des aiguilles, de faire passer l’ouvrage qui est contre les ventres des platines, comme on voit Pl. II. fig. 1. au-delà des chasses des aiguilles, comme on voit fig. 4. même Pl. ce qui s’exécute en tirant la barre à poignée brusquement en devant, & horisontalement.
Le quatrieme mouvement, d’ôter le pié de dessus la marche du milieu ; d’où il s’ensuit que rien n’empêchera plus la grande anse qui est tirée en-haut par la lisiere de cuir ou la courroie, qui passe sur la roulette du porte-faix d’en-bas, & qui se rend à la branche du contre-poids, de remonter & d’entraîner avec elle & faire relever les bras de presse ; ce qui séparera la presse de-dessus les becs des aiguilles, & permettra à la pointe de ces becs de sortir de leurs chasses. Fin de la cinquieme opération.
- Sixieme Opération. Abattre l’ouvrage.
Il n’y a qu’un mouvement assez léger à cette opération, il consiste à tirer la barre à poignée, & à faire avancer les ventres des platines jusqu’entre les têtes des aiguilles ; il est évident que ces ventres placés, comme on les voit, Pl. II. du bas au métier, fig. 3. feront passer l’ouvrage, de l’état où on le voit, sur les becs des aiguilles, fig. 4. 1, 2, dans l’état où on le voit fig. 5. 3, 4, ou fig. 6. 5, 6.
Voilà la formation de la maille : la septieme opération n’y ajoûte rien ; elle restitue seulement & le métier & l’ouvrage déja fait, dans une position à pouvoir ajoûter de nouvelles mailles aux mailles qu’on voit, ou dans l’état où il étoit quand on a commencé à travailler.
- Septieme Opération. Crocher.
Cette opération n’a qu’un mouvement : mais c’est le plus considérable & le plus grand de tous.
Quand on est sur le point de crocher, le métier se trouve dans l’état suivant : les ventres des platines sont au niveau des têtes des aiguilles, & par conséquent le dessous des becs fort au-dessus des aiguilles ; les crochets de-dessous des abattans sont au-dessus des petits coups, comme on les voit Pl. VII. fig. 1. & les épaulieres sous les arrêtans des jumelles, comme on les voit même figure.
Pour crocher, on applique la branche du crochet z de-dessous des abattans, contre les arrêtans y ; on tire perpendiculairement en-bas les abattans par la barre à poignée A A ; tenant toûjours les branches des crochets appliquées à l’éminence t des arrêtans qui dirigent dans ce mouvement : on fait descendre de cette maniere les platines à ondes & les platines à plomb, jusqu’à ce que le haut de leurs gorges M, soit à la hauteur de N, ou des têtes des aiguilles : puis du même mouvement continué horisontalement, on repousse en arriere les abattans aussi loin que l’on peut ; & l’on laisse remonter le métier qui va de lui-même, s’arrêter au-dessous de la barre à aiguilles, où il rencontre un crochet prêt à recevoir celui qui est placé au derriere des abattans, & qu’on appelle crochet de-dessus des abattans.
Il est évident que dans ce mouvement le haut de la gorge M des platines a emporté avec lui l’ouvrage qui étoit sous les becs, en le faisant glisser le long des aiguilles ; que les becs des aiguilles sont vuides ; que le dessous des becs des platines à ondes & des platines à plomb, se trouve entre les aiguilles ; que l’ouvrage fait est caché pour celui qui ne voit le métier qu’en face, & qu’il le voit alors comme il est représenté Pl. II. fig. 8. du bas au métier, c’est-à-dire, prêt à travailler de nouveau, ou à faire de gauche à droite ce qu’il a exécuté de droite à gauche.
C’est maintenant qu’on doit avoir conçû comment se fait la maille, qu’il est à propos de revenir sur les parties du métier & sur leurs configurations, dont on n’étoit pas en état auparavant de bien entendre les propriétés.
Commençons par les marches ; elles sont au nombre de trois, Pl. II. fig. 1. du métier à bas ; c’est la même corde qui va de la premiere 1, 5. au tambour de la roue 17. & de ce tambour à la troisieme 1, 5. d’où il s’ensuit que si l’on presse du pié celle qui est à gauche, on fera tourner la roue de droite à gauche, & qu’en pressant du pié celle qui est à droite, la roue tournera de gauche à droite.
C’est la même corde qui passe sous la roue du fût, où elle est cloüée, & qui va se rendre d’un bout sur une des roulettes de la barre à chevalet, & de l’autre sur l’autre roulette, & s’attacher aux s qui partent du corps de ce chevalet, comme on voit Pl. IV. fig. 6. n°. 49. 49.
On conçoit actuellement ce que nous avons dit de l’arrétant, ou de cette partie yt qu’on voit Pl. VII. fig. 1. Il a fallu nécessairement se ménager la facilité de l’avancer ou de la reculer, en pratiquant à la partie appliquée & fixée au montant une ouverture longitudinale r : trop avancé en-devant, ou trop peu, le fond des gorges des platines ne pourroit plus venir chercher l’ouvrage abattu, en vuider les aiguilles, l’entraîner derriere, & donner lieu à la continuation du travail.
Au-dessous de l’arrêtant, on voit la piece appellée le petit coup x, même Planche & même figure. Sans ce petit coup, qui est ce qui regle l’ouvrier, quand il forme l’ouvrage & corrompt la soie amenée sous les becs des aiguilles ; il seroit exposé à avancer le dessous des platines trop en-avant, à casser la soie, ou à rompre les becs des aiguilles.
Voilà ce qu’il y a de plus remarquable sur le fût & ses parties. Passons au métier, & parcourons ses assemblages.
On s’est ménagé aux gueules de loup 13. la même commodité qu’aux arrêtans, celle de les hausser & baisser à discrétion, afin d’ajuster convenablement la barre fondue. Pl. II. fig. 3.
On sent de quelle importance est le grand ressort 16, 16. c’est par son moyen que les abattans sont relevés sans que l’ouvrier s’en mêle. Pl. II. fig. 3. la vis 17. qui sert à le bander ou à le relâcher, est très-bien imaginée.
Le balancier 14, 14, 15, 15, n’est pas une piece inutile ; il met à portée le pié d’aider la main ; à vaincre la résistance du grand ressort toutes les fois qu’il faut faire descendre les abattans. Or ce mouvement se faisant souvent, on n’a pû apporter trop d’attention à soulager l’ouvrier.
La patte du bras de presse 17, 18, 19, fig. 1. Pl. III. est garnie d’une vis 20, 20, dont on va sentir toute la finesse : sans cette vis, l’ouvrier, en donnant le coup de presse, seroit exposé ou à rompre toutes les aiguilles, si la presse s’appliquoit trop fortement sur elles, ou à ne pas cacher leurs becs dans leurs chasses, si elle ne s’appliquoit pas assez. Mais qui le dirigera dans cette opération ? les vis appliquées à l’extrémité des bras de presse, qui permettront à ces bras de descendre suffisamment, & à la presse de s’appliquer convenablement sur les becs d’aiguilles.
Mais ç’eût été bien du tems de perdu pour l’ouvrier, & bien de la peine réitérée, s’il eût fallu relever la presse & la soûtenir : aussi se releve-t-elle d’elle-même, à l’aide de la courroie passée de la grande anse sur la roulette du porte-faix d’en-bas, & attachée à la branche du contre-poids.
On s’est encore ménagé aux porte-grilles, Pl. III. fig. 5. le même avantage qu’aux gueules de loup, & qu’aux arrêtans. Leur ouverture longitudinale xx, permet aussi de les avancer ou reculer à discrétion.
Le porte-roulette fixé, même fig. au milieu de la petite barre de dessous, facilite avec les roulettes de l’extrémité de la barre fondue, le mouvement en-arriere ou en-devant, de tout ce qu’on appelle l’ame du métier, que l’ouvrier fait en travaillant avancer ou reculer toutes les fois qu’il tire à soi ou repousse les abattans ; ce qui lui arrive très-souvent. Aussi louai-je beaucoup ceux qui ont diminué le poids de ces parties, en ajoûtant une roulette à la petite barre, & une gueule de loup à la barre de derriere, pour recevoir la roulette ajoûtée.
Il y a plusieurs choses à considérer dans les ressorts de grille. Pl. III. fig. 6. Premierement, ils sont disposés sur deux rangées paralleles de maniere que les ressorts de la rangée de derriere répondent aux intervalles que laissent entre-eux les ressorts de la rangée de devant : c’est le seul moyen qu’il y eût peut-être de leur donner la force qui leur est nécessaire pour l’usage auquel ils sont employés. Si on les eût tous placés sur une même rangée, ils auroient été plus petits & trop foibles. Voilà pour leur arrangement.
Secondement, ils sont composés de quatre plans inclinés, disposés à-peu-près en zig-zag. Lorsque la queue de l’onde est chassée de la cavité c, figure 7. même Pl. par le corps du chevalet, elle écarte le ressort, qui revient ensuite sur elle quand elle est sortie, & qui la repousse d’autant plus vivement, qu’alors elle se trouve sur un plan incliné ab ; c’est le même effet quand elle est chassée de sa cavité en-dessous par la bascule : elle écarte pareillement le ressort qui revient ensuite sur elle, avec d’autant plus de vivacité qu’elle se trouve encore sur un plan incliné cd. La méchanique n’est pas différente, quand chassée de sa cavité, soit en-dessus, soit en-dessous, elle y est ramenée ; elle ne peut y descendre que par une espece d’échappement fort prompt, puitqu’elle y est toûjours conduite par un petit plan incliné cd, cb.
Ce n’est pas une petite affaire que de bien disposer les cuivres de la barre fondue. Leur usage est d’empêcher les ondes de vaciller dans leur mouvement de chûte. Si l’on a bien compris ce que j’ai dit jusqu’à présent, on doit s’appercevoir qu’il y a un rapport bien déterminé entre le nombre des ressorts, les intervalles qu’ils laissent entr’eux ; le nombre des cuivres, leur épaisseur ; les ondes, leur longueur, leur nombre, leur épaisseur ; les platines à ondes, leur nombre, leur épaisseur ; les platines à plomb, leur nombre, leur longueur, leur épaisseur ; les plombs à platines, leur nombre, leur épaisseur ; les aiguilles, leur nombre, leurs intervalles ; les plombs à aiguille, leur nombre, leur épaisseur : & que l’une de ces choses étant donnée, tout le reste s’ensuit. Il y a très peu d’ouvriers en état de combiner avec précision toutes ces choses, sur-tout quand il s’agit de faire un métier un peu fin ; comme un quarante, un quarante-un, un quarante-deux, &c.
La méchanique des contre-pouces 43, 44, 45, Pl. IV. fig. 4. mérite bien un coup-d’œil. Ces pieces sont chargées à leur extrémité d’un contre-poids 44, qui ne permet à la bascule d’agir sur les queues des ondes, qu’à la volonté de l’ouvrier. Il y a sur les ondes deux actions opposées pendant tout le travail, & elles ont leurs effets successivement, selon les mouvemens des abattans. Ces deux actions sont l’action de la bascule 48, 48, par le moyen des pouces & contre-pouces sur la queue des ondes, & l’action de la barre à platines sur leur tête. Lorsque l’ouvrier tire les abattans perpendiculairement en bas, alors la barre à platine, ou son chaperon, c’est-à-dire cette petite plaque qui lui est appliquée par derriere & qui fait éminence, presse fortement sur leurs têtes, les entraîne dans la même direction, & les réduit dans le parallélisme avec les platines à plomb, malgré l’action des pouces sur les contre-pouces, & celle des contre-pouces sur la bascule, & celle de la bascule sur les queues des ondes : mais lorsque l’ouvrier laisse agir le grand ressort, & que les abattans abandonnés à eux-mêmes sont relevés, alors rien ne s’oppose à l’action des pouces, des contre-pouces & de la bascule, qui subsiste pendant tout le travail ; & les ondes se relevent, & leurs queues rentrent dans leur cavité, ou descendent au-dessous, selon que l’ouvrier le veut.
Comme il falloit que dans tous les mouvemens les platines à ondes & les platines à plomb fussent toûjours exactement paralleles en tout sens les unes aux autres, quoique les platines à ondes appartinssent à la barre fondue, & que les platines à plomb appartinssent à la barre à platines, c’étoit donc nécessité que la barre fondue se prétât & suivît tous les mouvemens de la barre à platines : c’est ce qui s’exécute par le moyen des tirans qui répondent d’un bout à la barre fondue, & de l’autre à la barre à platines, & par le moyen des trois roulettes de l’ancien métier, & des quatre du métier nouveau, dont deux se meuvent dans les gueules de loup, & deux sur les grandes pieces.
Passons maintenant aux moulinets. Comme nous n’en avons rien dit jusqu’à présent, & que nous avons cependant traité de presque tout ce qui concerne la main-d’œuvre, on seroit tenté de croire au moins que ces parties & toutes celles qui leur appartiennent, comme la boite, la barre, & le ressort à moulinet, sont superflues, & qu’il n’y a pas non plus grand besoin de jumelles. On va voir combien ce soupçon est éloigné de la vérité.
Pour bien entendre ce qui suit, il faut examiner un peu la configuration d’une onde en-dessous. On voit, Pl. IV. fig. 3. que depuis a jusqu’à b elle est comme arrondie, & qu’elle est évidée depuis b jusqu’à c. La partie arrondie ab forme sa tête. Lorsque le chevalet passant sous la queue de l’onde, fait desecendre cette partie ab, elle s’applique sur la barre à moulinet 82, 82, Pl. V. fig. 1. ensorte que toutes les têtes des ondes sont rangées sur la barre à moulinet, quand le corps à chevalet a fait sa course. D’où il s’ensuit évidemment que plus cette barre sera haute, moins les têtes des ondes descendront, moins les platines à ondes attachées à ces têtes descendront entre les aiguilles ; moins les becs des platines descendront au-dessous des aiguilles dans la premiere opération de la main-d’œuvre ou le cueillement ; moins les boucles de soie formées entre les aiguilles seront grandes ; moins les mailles seront lâches : mais cette barre à moulinet étant enfermée dans des boîtes 81, 81, qui peuvent se hausser ou se baisser à l’aide des arbres à moulinet 68, 81 ; 68, 81, qui les traversent, on pourra donc hausser ou baisser cette barre à discrétion, & faire un bas plus ou moins serré. Voilà l’usage de la barre en elle-même & de sa mobilité le long des corps de moulinet ; mais ce n’est pas sans raison qu’on lui a attaché postérieurement un ressort 83, 83, 83, à l’aide duquel elle peut aller & venir dans les boîtes.
Pour sentir l’usage de ce ressort & de la mobilité de la barre dans ses boîtes, il faut relire ou se rappeller la derniere opération de la main-d’œuvre ou du crochement : il consiste à faire descendre les platines jusqu’à ce que leurs gorges soient un peu plus bas que les têtes des aiguilles, & que ces gorges puissent embrasser l’ouvrage qui remplit ces têtes, & le remporter en-arriere.
Mais pour exécuter ces mouvemens, comme il y a loin de la barre à moulinet, sur laquelle les têtes des ondes étoient placées, jusqu’aux têtes des aiguilles, il a fallu amener les têtes des ondes & les platines qui y sont attachées, en-devant ; c’est ce que l’ouvrier a fait, en tirant à lui la barre à poignée ou les abattans. Il a fallu faire descendre les platines, & par conséquent les têtes des ondes auxquelles elles sont assemblées, pour que les gorges des platines se trouvassent un peu au-dessous des têtes des aiguilles ; c’est ce qu’il a fait en tirant les abattans aussi bas qu’ils pouvoient descendre, & se laissant diriger par les arrêtans. C’est pour rendre possible ce dernier mouvement, que l’on a évidé les ondes en-dessous ; car si elles avoient été par-tout de la même largeur, elles n’auroient pû descendre ; la barre à moulinet sur laquelle elles auroient continué de porter, les en auroit empêché : mais en les évidant, elles ont cessé de porter sur la barre à moulinet, & en les évidant assez, elles n’ont rien rencontré d’ailleurs qui les gênât dans leur descente, & qui empêchât la gorge des platines de parvenir jusqu’au-dessous des becs des aiguilles.
Mais ce n’étoit pas tout ; il falloit que ces gorges remportassent l’ouvrage de dessous les becs des aiguilles en-arriere : pour cet effet, l’ouvrier tenant ces gorges entre les têtes des aiguilles, les repousse en-arriere : mais en les repoussant en-arriere, qu’arrive-t-il ? c’est que le talon de l’échancrure des ondes rencontre la barre à moulinet. Si cette barre à moulinet étoit immobile dans les boîtes, elle arrêteroit ce mouvement horisontal, & l’ouvrage ne seroit point remporté en-arriere par les gorges ; aussi l’a-t-on fait mobile : le talon de l’échancrure des ondes la fait reculer ; l’ouvrage est remporté par les gorges ; les ondes se relevent ; leurs talons cessent d’appuyer contre la barre à moulinet ; le ressort circulaire qui agit contre cette barre la restitue dans son premier état, & elle est disposée à recevoir de rechef la tête des ondes dans leur chûte, qui se fera au nouveau cueillement.
Voilà les usages de ces parties, qui paroissoient si superflues. On a dentelé la roue 69 du moulinet, figure premiere, Planche V. afin qu’on pût savoir de combien on haussoit ou baissoit la barre à moulinet, & évaluer à peu près par ce moyen, de combien on relâchoit ou resserroit les mailles, & relâcher & resserrer également de chaque côté. La partie 68, 68, qu’on appelle croisée du moulinet, sert de poignée à l’arbre, & puis c’est tout.
Il ne nous reste plus qu’un mot à dire des jumelles, 61, 61, fig. 1. Planc. V. des platines tant à ondes qu’à plomb, & des gardes-platines. On a pratiqué aux jumelles 61, 61, deux arrêtans 5, 5, l’un en-dessus 61, & l’autre en-dessous 5. L’usage de celui de dessus est de contenir à une juste hauteur les épaulieres & les abattans qui y sont assemblés, malgré l’action du grand ressort. Voyez même Planche, fig. 7. L’usage de celui de dessous est d’empêcher, dans le crochement, les mêmes épaulieres, ainsi que les abattans & par conséquent les gorges des platines, à descendre trop au-dessous des têtes des aiguilles, & de les briser & fausser toutes.
Toutes les sinuosités que l’on remarque aux platines, Pl. IV. fig. 2. ont leur raison. On peut distinguer quatre lieux principaux dans ces parties : leur bec b, qui prend la soie étendue sur les aiguilles & la fait descendre entr’elles : le dessous du bec c, qui amene la soie bouclée sous les becs & la corroie : le ventre e, qui abat l’ouvrage : la gorge d, qui le reprend & le ramene en-arriere : la queue f, qui s’emboîte dans la barre à poignée, & l’empêche de vaciller. S’il n’y avoit point de garde-platine 94, 94, Pl. VI. fig. 2. quand, dans la troisieme opération, on amene l’ouvrage sur les becs avec le ventre des platines, ce ventre viendroit frapper contre la presse qui est alors appliquée, & se défigureroit : mais le garde-platine empêche ce choc ; il permet aux ventres des platines d’approcher assez de la presse, pour que l’ouvrage soit bien amené sur les becs, mais non de la frapper, en rencontrant lui-même assez-tôt pour prevenir cet inconvénient, le bras de presse.
Il survient en travaillant plusieurs accidens, & il y a plusieurs autres choses à observer, dont je vais faire mention.
Lorsqu’il se rencontre des nœuds dans la soie ou qu’elle se casse, on ne peut continuer l’ouvrage sans faire ce que les ouvriers appellent une enture.
Pour enter, on étend bien sur les aiguilles la partie du fil de soie qui tient à l’ouvrage, & l’on couche l’autre partie, non pas bout à bout avec la premiere : mais on la passe entre la cinq, la sept, &c. avant le bout du fil qui tient à l’ouvrage ; ensorte que le fil se trouve double sur ces cinq, sept aiguilles, & l’on continue de travailler comme si le fil étoit entier.
Tout bas se commence par un ourlet, & voici comment on s’y prend pour le faire. On passe la soie dans la tête de la premiere aiguille, & on l’y arrête en la tordant ; on embrasse ensuite en-dessous les deux suivantes ; on la ramene en-dessus sur la premiere ; puis on la passe en-dessous, & on embrasse la quatrieme & la cinquieme sur lesquelles on la ramene, & sur la troisieme sous laquelle on la passe, & on embrasse la sixieme & la septieme sur lesquelles on la ramene, & sur la cinquieme sous laquelle on la passe ensuite, & on embrasse la huitieme & la neuvieme, & ainsi de suite.
Un bas n’est pas par-tout de la même venue ; on est obligé de le rétrécir de tems en tems. Supposons donc qu’on ait à rétrécir d’une maille, on prend un petit outil qu’on appelle poinçon, on s’en sert pour porter la maille de la troisieme aiguille sur la quatrieme aiguille, la maille de la seconde sur la troisieme, la maille de la premiere sur la seconde, & la premiere se trouve vuide.
On demandera peut-être pourquoi on porte la troisieme maille sur la quatrieme aiguille, & non la premiere sur la seconde tout d’un coup ; puisqu’il faut qu’il se trouve deux mailles sur une aiguille, pourquoi donner la préférence à la quatrieme ? Je répons que c’est afin que la lisiere soit plus nette ; car si la maille double se trouvoit au bord de la lisiere, elle tireroit trop. Il faut même, si l’on veut que la lisiere ne soit pas trop serrée, bien repousser l’ouvrage en-arriere, & ne pas accoller la platine avec la soie quand on la jette.
Au reste, on rétrécit d’une maille de chaque côté du métier de quatre rangées en quatre rangées, & l’on ne commence à rétrécir qu’à un pouce au-dessus de la façon, ou de cet ornement qu’on pratique au-dessus des coins.
Il arrive quelquefois, après le coup de presse, qu’un bec d’aiguille ne se releve pas, mais demeure dans sa chasse ; lors donc qu’on a cueilli & qu’on vient à abattre l’ouvrage, il y a une maille qui n’ayant pas été mise dans la tête de l’aiguille, mais ayant passé par-dessus, ne sera pas travaillée, & qu’il faudra relever ; il pourra même se trouver plusieurs mailles non-travaillées de suite ; pour les relever, voici comment on s’y prendra : on saisira la derniere qui est bien formée à l’ouvrage, avec le poinçon, & on la passera dans la tête de la tournille ou d’une aiguille emmanchée, puis on prendra avec le poinçon la bride de dessus cette maille ; on passera cette bride sur la tournille ; à mesure qu’elle avancera le long du bec, la bonne maille sortira de dessous, & bientôt la bonne maille se trouvera entierement sortie & fort loin du bec, & la bride à portée de passer dessous. On l’y fera donc passer ; puis quand elle y sera, on pressera avec le poinçon le bec de l’aiguille & l’on le tiendra dans la chasse ; cependant on tirera la tournille, ce qui fera avancer sa bride dans la tête de la tournille & passer la bonne maille par-dessus le bec, alors la maille sera relevée : on continuera de cette maniere s’il y en a plusieurs de tombées, traitant toûjours celle qui se trouvera dans la tête de la tournille comme la bonne, & la bride d’au-dessus comme la mauvaise ou comme la maille à relever ; & quand on en sera à la derniere, on la mettra dans la tête de l’aiguille. Voyez cette maneuvre, Planche III. du bas au métier, figure 2, 3. On entend par bride, la petite portion de soie, qui au lieu de passer dans la tête de l’aiguille, a passé par-dessus & n’a point été travaillée.
J’observerai pourtant qu’il faut faire cette opération en-dessous ou à l’endroit, c’est-à-dire, du côté de l’ouvrage qui ne regarde pas l’ouvrier, sans quoi les mailles relevées formeront un relief à l’envers, & par conséquent un creux à l’endroit.
Il arrive encore qu’il se forme des mailles doubles ; cet inconvénient arrive de plusieurs façons : s’il y a quelque grosseur dans la matiere, si une aiguille a le bec de travers, s’il y a quelque aiguille fatiguée qui ne presse pas, une aiguille n’aura point de maille & sa voisine en aura deux.
Dans ce cas, de deux mailles on arrête la premiere sous le bec de l’aiguille ; on fait tomber la seconde ; cette seconde tombée, formera une bride qu’on relevera & qu’on portera sur l’aiguille vuide.
Il y a encore des mailles mordues ; on entend par une maille mordue, celle qui est moitié dans la tête de l’aiguille, moitié hors, ou qui est à demi tombée. On fait entierement tomber la maille mordue, & on la releve en plein.
Les ouvriers entendent par la tige du bas, ce pouce d’ouvrage qui est au-dessus des façons & sur lequel on rétrécit.
Sur un métier de quinze pouces, on laisse du milieu d’une façon au milieu de l’autre, cinq pouces & un quart. Si le métier a moins de quinze pouces, la distance du milieu d’une façon au milieu de l’autre diminuera proportionnellement.
Quand on travaille la façon, on continue de rapetisser d’une aiguille de chaque côté de quatre en quatre rangées. Pour reconnoître les milieux des façons, on fait un peu lever les deux aiguilles qui les indiquent.
On fait usage dans les façons de deux especes de mailles, qui ne sont pas de la nature de celles dont le reste du bas est tricoté ; ce sont les mailles portées & les mailles retournées. On entend par une maille portée, celle qui, sans sortir de son aiguille, est portée dans la tête de celle qui la suit immédiatement, en allant vers la gauche de l’ouvrier ; & par une maille retournée on entend celle qu’on fait tomber & qu’on releve sur la même aiguille, de maniere qu’elle fasse relief à l’envers & creux à l’endroit du bas. Pour cet effet on n’a, comme nous l’avons dit à l’occasion des mailles tombées, qu’à la relever du côté du bas qui regarde l’ouvrier.
Les façons faites, il s’agit de partager les talons. Pour cet effet on prend la maille des aiguilles qui marquoient les milieux des façons, & on la jette sur les aiguilles voisines, en allant à la gauche de l’ouvrier ; puis on prend la maille de chacune des aiguilles voisines de ces aiguilles vuides, en allant à droite, & on la jette sur les aiguilles qui leur sont voisines, en allant aussi à droite.
On a donc en deux endroits de la largeur du bas deux aiguilles vuides, qui partagent cette largeur en trois parties.
On travaille ces trois parties avec trois fils de soie séparés, & qu’on jette chacun séparément. Jetter est synonyme à cueillir.
De ces trois parties, celle du milieu est pour le dessus du pié, & les deux autres sont les deux parties du talon. On travaille le dessus sans le rapetisser. Pour les parties du talon, on les rétrécit chacune d’une maille de six rangées en six rangées ; & cette maille on la prend à leurs extrémités ou aux côtés qui doivent se réunir pour former la couture du talon, ou sur la premiere & la derniere aiguilles pleines, ou sur l’aiguille pleine la plus à droite de l’ouvrier, & sur l’aiguille pleine la plus à gauche ; car ce n’est là que plusieurs manieres différentes de désigner les mêmes aiguilles.
On continue de rapetisser ou rétrécir les parties du talon de la maniere que nous avons dit, jusqu’à ce qu’elles n’ayent plus chacune que deux pouces & demi. Alors on forme la pointe du talon, en rétrécissant ces deux parties de la maniere suivante. Pour la partie qui est à droite de l’ouvrier, on compte les aiguilles pleines en allant de droit à gauche, & on jette la maille de la quatrieme aiguille, sur la sixieme aiguille ; la maille de la troisieme aiguille aussi sur la sixieme ; la maille de la seconde aiguille sur la cinquieme, & la maille de la premiere aiguille sur la quatrieme, qui est la seule qui reste vuide. Pour la partie du talon qui est à gauche, on compte les aiguilles pleines, en allant de gauche à droite, & on jette la maille de la quatrieme aiguille, sur la sixieme aiguille ; la maille de la troisieme aiguille pareillement sur la sixieme ; la maille de la seconde aiguille sur la cinquieme, & la maille de la premiere aiguille, sur la quatrieme qui est la seule qui reste vuide. On continue ces rapetissemens singuliers, trois, quatre, cinq fois, selon la finesse du bas, & cela de quatre en quatre rangées.
On finit les talons par une rangée lâche. Cette rangée lâche se fait en descendant les platines, comme quand on veut croiser, & en repoussant la barre à moulinet avec le talon des ondes.
On avance ensuite sous les becs, en prenant bien garde d’amener trop ; car on jetteroit le dessus du pié en bas.
On a fait cette rangée lâche, afin de pouvoir, à l’aide de la tournille, la diviser en deux & terminer le talon. Pour cet effet, on prend la premiere maille avec la tournille, & la maille suivante avec le poinçon ; à mesure que la seconde passe sur le bec de la tournille, l’autre sort de dessous la tête. Celle-ci est loin du bec, quand celle-là est à portée d’entrer dessous. On l’y fait donc entrer, & quand elle y est, on presse le bec de la tournille avec le poinçon ; on tire la tournille, & la premiere passe sur le bec & forme avec celle qui est dessous, le commencement d’une espece de chaînette, qu’on exécute exactement, comme quand on releve des mailles tombées ; avec cette différence que les mailles tombées se relevent dans une direction verticale, & que cette chaînette se forme horisontalement.
Pour arrêter la chaînette, on fait sortir la derniere maille qui est sous la tête de la tournille, en avançant la tournille ; on met le fil de soie à sa place : on presse ensuite le bec de la tournille ; on tire la tournille, & la maille passe sur le bec & par conséquent le fil de soie à travers elle. On recommence cette opération plusieurs fois ; cela fait on jette bas les talons sans aucun danger, & l’on continue le dessus du pié.
Avant que d’achever le bas, j’observerai que l’on pratique une rangée lâche, & sur cette rangée quelques autres à l’ordinaire, toutes les fois qu’on veut ôter un ouvrage de dessus le métier, sans donner lieu aux mailles de s’échapper.
Le dessus du pié s’acheve comme on l’a commencé ; quand il est achevé, on monte le talon sur le métier, non par le côté de la lisiere de derriere, mais par l’autre côté. Pour cet effet, on décroche le métier ; on tourne de son côté l’endroit de l’ouvrage ; on prend la seconde rangée de mailles après la lisiere, & on la fait passer dans les aiguilles, en tenant l’ouvrage d’une main au-dessus des aiguilles, & faisant passer chaque maille de la rangée dans chaque aiguille.
En s’y prenant ainsi, il est évident que quand après avoir croché & cueilli, comme on le dira, on abattra l’ouvrage, l’envers se trouvera vers l’ouvrier. Lorsque les mailles sont passées sur les aiguilles ; on laisse l’ouvrage sur elles, & on le repousse fort avant vers le derriere du métier, afin qu’il se trouve dans la gorge des platines, lorsqu’on crochera en dedans ; c’est-à-dire sans avancer le métier en devant, en tirant les abattans perpendiculairement : puis on pratique une enture du côté de la façon : on double la soie à cette enture, sur sept aiguilles seulement. On cueille sur elle avec la main, de peur que l’ouvrage qui est sous les gorges qui sont fort petites & qu’il remplit, ne laissassent pas tomber les platines entre les aiguilles, autant qu’il le faut pour la formation des mailles. On amene sous les becs, & l’on acheve l’ouvrage à l’ordinaire. Voilà comment on commence le coin : voici comment on le continue.
Après avoir cueilli une seconde fois, on rapetisse les coins, où l’on pratique ce que les ouvriers appellent les passemens, de la maniere suivante.
On prend la cinquieme aiguille en comptant de la pointe du coin, & l’on jette sa maille sur la quatrieme aiguille ; puis on passe la soie sur ces quatre aiguilles, & l’on forme quatre mailles avec le poinçon.
On prend ensuite la sixieme aiguille, & l’on jette sa maille sur la quatrieme ; puis on passe la soie sur ces quatre aiguilles, & l’on forme quatre autres mailles avec le poinçon. On prend ensuite la septieme aiguille, & l’on jette sa maille sur la quatrieme ; puis on passe la soie sur les quatre aiguilles, & l’on forme quatre autres mailles avec le poinçon ; ensuite on prend la huitieme aiguille, & l’on jette sa maille sur la quatrieme ; puis on passe la soie sur ces quatre aiguilles, & l’on forme quatre dernieres mailles avec le poinçon.
Cela fait, il est évident que l’on a quatre aiguilles vuides, & quatre aiguilles pleines ; on prend la quatrieme des pleines, & on la jette sur la neuvieme aiguille ; la troisieme des pleines, & on la jette sur la huitieme aiguille ou la premiere des vuides ; la seconde des pleines, & ainsi de suite. On fait là-dessus deux rangées, & l’on recommence les mêmes passemens, jusqu’à ce que le coin ait deux pouces & demi de large par le bas. On le finit par une rangée lâche, sur laquelle on fait quatre à cinq rangées à l’ordinaire, pour que la soie ne se défile pas.
Pour former la maille sur les quatre aiguilles, on passe la soie dans leurs têtes, on repousse l’ouvrage au-delà des têtes ; puis avec le poinçon on presse le bec de chaque aiguille, on retire l’ouvrage, & la maille formée à l’ouvrage passe sur les têtes, & forme de nouvelles mailles avec la soie qu’on y a mise.
Il ne reste plus que la semelle à faire : pour cet effet, on monte les coins par leur largeur bout-à-bout, ce qui forme un intervalle de cinq pouces ; c’est là-dessus qu’on travaille la semelle à laquelle on donne la longueur convenable.
Les grands bas d’hommes ont ordinairement trente-neuf pouces, depuis le bord de l’ourlet jusqu’à la pointe du talon.
Les grands bas de femmes n’ont ordinairement que vingt-neuf pouces, depuis l’ourlet jusqu’à la pointe du talon.
Les grands bas d’hommes, depuis le bord jusqu’à la façon, portent 28 pouces ; les grands bas de femmes, dix-neuf pouces.
La façon dans les grands bas d’hommes & les grands bas de femmes, est de deux pouces.
Le talon commence à la hauteur des coins, & il a jusqu’à sa pointe, neuf pouces dans les hommes, & huit pouces dans les femmes.
Les coins ont pour les hommes & pour les femmes, la même hauteur que les talons.
Les talons finis, on les met bout-à-bout & l’on travaille la semelle, de neuf pouces & demi pour les hommes, & de huit pouces & demi pour les femmes.
Après les talons finis, on continue le dessus du pié, à quatre pouces pour les femmes, & à cinq pouces pour les hommes.
Dans toutes ces dimensions, on observe les rétrécissemens que nous avons prescrits, dans l’article de la main-d’œuvre, & qu’il est inutile de répéter ici.
On voit, Planche III. du bas au métier, fig. 10. un modele de façon ; il est tracé sur un papier divisé en petits quarrés de dix en dix. La ligne AB la partage en deux parties égales ; chaque petit quarré représente une aiguille : le petit quarré A représente l’aiguille qui marque le milieu de la façon, & chaque rangée de mailles est représentée par chaque rangée de petits quarrés.
Pour exécuter la façon qu’on voit ici représentée, il faut donc faire aux mailles marquées par chaque petit quarré, quelque changement qui les distingue sur le bas : pour cet effet, on les porte, ou on les retourne ; ainsi tous les petits quarrés marqués d’un point désigneront des mailles portées ou retournées.
Nous avons déjà dit qu’une maille portée étoit celle dont la soie passoit sous deux têtes d’aiguilles, sous la tête de son aiguille propre, & sous la tête de l’aiguille voisine, en allant de droite à gauche de l’ouvrier ; & que la maille retournée étoit celle qu’on faisoit tomber, & qu’on relevoit sur l’envers de l’ouvrage, ensorte qu’elle étoit en relief sur l’envers, & par conséquent en creux sur l’endroit.
Mais les mailles ne se portent ou ne se retournent pas indistinctement partout. On voit évidemment que des mailles qu’il faut altérer pour distinguer la façon, on ne peut porter celles qui se suivent immédiatement. Quand il faut altérer la maille d’une aiguille, si celle qui lui est voisine, en allant de droite à gauche, ne doit point être altérée, on peut ou la porter ou la retourner : mais si elle doit être aussi altérée, il faut la retourner.
Ainsi dans le dessein de façon qu’on voit, toutes les mailles de masses noires doivent être retournées, & toutes les mailles des autres masses qui sont rares, & qui laissent entr’elles des mailles qu’il ne faut point altérer, peuvent être ou portées ou retournées.
Les ouvriers qui construisent des métiers à bas, se servent d’instrumens comme le rabot des verges, le moule à repasser les cuivres, le moule pour hacher les platines, la fraise, la lime à queue d’aronde, le chevalet pour les platines, le chevalet pour les cuivres, la machine à percer les aiguilles, & son détail, le moule à fondre les plombs à aiguilles & les plombs à platines, le brunissoir, les tourne-à-gauche, les becs d’âne, les clouyeres, la chasse-ronde, le pointot, la tranche, les perçoires plate & ronde, les broches, la griffe, les mandrins, le moule à bouton, le poinçon : entre ces instrumens, il y en a qui sont communs au faiseur de métier, & à celui qui s’en sert. On trouvera leurs usages aux articles de leurs noms, & leurs figures sur les planches du métier à bas.
La premiere manufacture de bas au métier fut établie en 1656, dans le château de Madrid, au bois de Boulogne. Le succès de ce premier établissement donna lieu à l’érection d’une communauté de maîtres-ouvriers en bas au métier ; & on leur donna des statuts. Par ces statuts, on régla la qualité & la préparation des soies, le nombre des brins de ces soies, la quantité des mailles vuides qu’il faut laisser aux lisieres, le nombre d’aiguilles sur lequel se doivent faire les entures, & le poids des bas.
Il fut ordonné trois ans d’apprentissage & deux ans de service chez les maîtres, pour le devenir ; la connoissance du métier, & de sa main-d’œuvre, & un chef-d’œuvre qui consiste en un bas façonné aux coins & par-derriere.
Les ouvriers en bas ne travaillerent qu’en soie jusqu’en 1684, qu’il leur fut permis d’employer des laines, le fil, le poil, le coton, à condition toutefois que la moitié des métiers d’un maître seroient occupés en soie, & les autres en matiere dont le filage seroit fin. Cette indulgence eut de mauvaises suites, & en 1700, sa Majesté ordonna à tous maîtres faiseurs de bas au métier de se conformer au reglement suivant.
I. Défense d’établir aucun métier ailleurs qu’à Paris, Dourdan, Roüen, Caën, Nantes, Oléron, Aix, Toulouse, Nismes, Usès, Romans, Lyon, Metz, Bourges, Poitiers, Orléans, Amiens & Rheims, où ils étoient déjà établis.
II. De travailler dans lesdites villes & leur banlieue sans être maîtres.
III. De faire bas, caleçons, camisolles, &c. sur autres métiers que des vingt-deux, à trois aiguilles par plomb.
IV. D’employer des soies sans être débouillies au savon, bien teintes, bien desséchées, nettes, sans bourre, doubles, adoucies, plates & nerveuses.
V. D’employer de l’huile dans ledit travail.
VI. D’employer pour le noir des soies autres que non teintes, dont les ouvrages seront envoyés faits aux Teinturiers.
VII. De travailler en soie pure, ou en poil & laine, sur un autre métier que d’un dix-huit au moins, à trois aiguilles par plomb, & de mettre moins de trois brins, deux de soie, ou poil, & un de laine.
VIII. De faire des ouvrages en laine, fil & coton sur un autre métier que de vingt-deux, à deux aiguilles par plomb.
IX. De mettre dans les ouvrages de fil, coton, laine & castor, moins de trois brins, & d’employer aucun fil d’estame, ou d’estain tiré à feu, parmi les trois fils.
X. De mettre en œuvre de mauvaise marchandise.
XI. De manœuvrer mal.
XII. De négliger les lisieres, & de n’y point laisser de maille vuide.
XIII. De faire les entures de moins que de cinq à six mailles, & de négliger de remonter les talons & les bords.
XIV. De fouler les ouvrages au métier avec autre chose que du savon blanc ou verd, à bras ou aux piés.
XV. Aux Fouleurs de se servir d’autres instrumens que de rateliers de bois ou à dents d’os, & aux Fouloniers de recevoir des bas.
XVI. De donner aux ouvrages moins de deux eaux vives, après les avoir dégraissés.
XVII. De se servir de pommelles & cardes de fer pour apprêter, appareiller.
XVIII. De débiter aucun ouvrage sans porter le plomb, qui montrera d’un côté la marque du maître, de l’autre celle de la ville.
XIX. Permission aux privilégiés de se distinguer par la fleur-de-lis jointe à l’initiale de leurs noms.
XX. Seront les articles ci-dessus exécutés à peine de confiscation des métiers, & de cent livres d’amende.
XXI. Défense aux maîtres de mettre en vente d’autres marchandises que celles qu’ils auront fabriquées, eux, leurs apprentifs ou compagnons.
XXII. Permission aux maîtres de faire peigner, carder, filer, mouliner, doubler, &c. les soies dont ils auront besoin.
XXIII. Défense de transporter hors du royaume aucun métier, sous peine de confiscation, & de mille livres d’amende.
XXIV. Défense aux maîtres de bas au métier, d’entreprendre sur ceux au tricot ; & à ceux-ci d’entreprendre rien sur les premiers.
Louis XIV. en conséquence de ces reglemens, avoit créé des charges d’inspecteurs, de contrôleurs, de visiteurs, de marqueurs, &c. Les marchands fabriquans en payerent la finance, & en acquirent les droits : mais comme la communauté étoit composée de maîtres privilégiés & d’autres, cette acquisition occasionna de la division entre les maîtres, les privilégiés se tenant exempts des droits, & les non-privilégiés prétendant les y soûmettre. Louis XV. fixa en 1720, la police de ces fabriquans, & fit cesser leurs querelles. Il voulut que les métiers dispersés dans les lieux privilégiés, comme le faubourg saint Antoine, le Temple, saint Jean de Latran, &c. payassent trente livres par métiers ; que les brevets des apprentifs fussent de cinq années. Les autres articles sont relatifs à l’acquit des dettes de la communauté, & aux autres objets semblables. Voyez le Diction. du Commerce.
Bas d’estame ; ce sont ceux qui se font avec du fil de laine très-tors, qu’on appelle fil d’estame ou d’estain. Voyez Estame.
Bas drappés ; ce sont ceux qui fabriqués avec de la laine un peu lâchement filée, qu’on appelle fil de trame, ont passé à la foule, & ont ensuite été tirés au chardon.
Bas à étrier ; ce sont des bas coupés par le pié, qui ne couvrent que la jambe : il y a encore des bas de chamois, qui sont du commerce des Peaussiers, & des bas de toile, qui sont du commerce des Lingeres. On n’exécute pas seulement des bas sur le métier, on y fait aussi des culotes, des caleçons, des mitaines, des vestes, & je ne doute pas qu’on n’y fît des habits. Il est évident, par les desseins qu’on exécute aux coins, qu’on pourroit y faire des fleurs & autres desseins, & qu’en teignant la soie, comme il convient qu’elle le soit, on imiteroit fort bien sur les ouvrages de bas au métier, & le chiné & le flambé des autres étoffes. Voyez Chiner & Flamber.
* Bas (l’ile de) Géog. petite île de la mer de Bretagne, vis-à-vis Saint-Pol-de-Léon.
Bas-bord (Marine.) vaisseau de bas-bord ; c’est un vaisseau peu élevé, & qui ne porte qu’un tillac, ou couverte, & va à voiles & à rames comme les galeres, galiotes & semblables bâtimens. Le brigantin, qui ne porte pas couverte, est un vaisseau de bas-bord.
Bas-bord ou Babord (Marine.) c’est le côté gauche du navire, c’est-à-dire, celui qui reste à la gauche lorsqu’on est à la poupe, & qu’on regarde la proue ; il est opposé à stribord, qui est le côté droit.
Bas-bord tout ; c’est un commandement que l’on fait au timonnier de pousser la barre du gouvernail à gauche tout autant qu’il est possible.
BAS-BORDES ou BAS-BORDAIS (Marine.) on appelle ainsi la partie de l’équipage qui doit faire le quart de bas-bord. Voyez Quart.
BAS-FOND, s. m. (Marine.) c’est un endroit de la mer où le fond est plus élevé, & sur lequel il n’y a pas assez d’eau pour que les vaisseaux puissent y passer sans échoüer. Voyez Banc & Basses. (Z)
BAS-JUSTICIER, s. m. (Jurisprudence.) seigneur de fief, qui a droit de basse-justice. Voyez Justice.
Quelques coûtumes lui accordent sur les denrées ou les bestiaux qui séjournent sur sa seigneurie, un droit qu’elles appellent levage, voyez Levage ; les espaves immobiliaires, voyez Espave ; le droit de banalité, & autres, voyez Banalité. (H)
BAS-MÉTIER, s. m. (Rubanier-Passementier.) c’est celui sur lequel on fait quantité de petits ouvrages ; il peut se poser sur les genoux. Voyez Agrément.
BAS-OFFICIERS, s. m. pl. (Art milit.) ce sont dans les compagnies de cavalerie & de dragons, les maréchaux des logis, & dans l’infanterie, les sergens. Ils n’ont point de lettres du roi pour avoir leur emploi, qu’ils ne tiennent que de l’autorité du colonel & de leur capitaine. (Q)
BAS-RELIEF, s. m. (en Architecture.) ouvrage de sculpture qui a peu de saillie, & qui est attaché sur un fonds ; on y représente des histoires, des ornemens, des rinceaux de feuillages, comme on en voit dans les frises, & lorsque dans les bas-reliefs il y a des parties saillantes & détachées, on les nomme demi-bosses. Voyez Sculpture. (P)
BAS-VENTRE, s. m. tout ce qui est au-dessous du diaphragme dans la cavité du ventre. Voyez Abdomen. (L)
* BASAAL, s. m. (Hist. nat. bot.) nom d’un arbre des Indes, qui croît dans les lieux sabloneux, particulierement aux environs de Cochin ; il porte des fleurs & des fruits une fois l’an, depuis la premiere fois qu’il a commencé à produire, jusqu’à sa quinzieme année.
La decoction de ses feuilles dans l’eau, avec un peu de gingembre, soulage dans les maux de gorge : on frotte le front & les tempes des phrénetiques, avec ses baies frites dans le beurre. Ses amandes tuent les vers.
* BASAN, (Géog. sainte.) ancien pays de la Judée, en Asie, entre le Jourdain, la mer de Galilée, le royaume de Galaad, & les montagnes d’Hermon, ou de Seïr ou du Liban. Moyse le conquit sur Og, & le donna à la tribu de Manassé ; il s’appella dans la suite Trachonite.
BASANNE, s. f. (Tannerie ou Megie.) c’est une peau de bélier, mouton ou brebis, passée avec le tan ou avec le redon. La basanne a différens usages suivant les différens apprêts qu’elle a reçûs : on en fait des couvertures de livres, des porte-feuilles ; on en couvre des chaises, fauteuils, banquettes, &c. on l’employe aussi à faire des tapisseries de cuir doré. Voyez Cuirs.
Il y a plusieurs sortes de basannes ; savoir les basannes tannées ou de couche, les basannes coudrées, les basannes chipées, les basannes passées en mesquis, & les basannes aludes.
Les basannes tannées ou de couche, sont celles qui ont été étendues de plat dans la fosse, pour y être tanrées comme les peaux de veaux, mais qu’on n’y a pas laissées si long-tems. On en fait des tapisseries de cuir doré.
Les basannes coudrées, celles qui après avoir été dépouillées de leur laine dans le plein, par le moyen de la chaux, ont été rougies dans l’eau chaude avec le tan. On en fait le même usage que des basannes tannées.
Les basannes chipées, celles auxquelles on a donné un apprêt particulier appellé chipage. Voyez Chipage.
Les basannes passées en mesquis, celles qui ont été apprêtées avec le redon, au lieu de tan. V. Redon.
Les basannes appellées aludes, celles qu’on teint ordinairement en jaune, verd ou violet, & qui sont fort velues d’un côté. On les appelle aludes, parce qu’on se sert d’eau d’alun dans les différens apprêts qu’on leur donne. Cette espece de basanne est tout-à-fait différente des autres : on ne l’employe d’ordinaire qu’à couvrir des livres & des porte-feuilles d’écoliers. Voyez Tannerie & Megie.
* BASARUCO, s. m. (Commerce.) petite monnoie d’étain, d’usage aux Indes : il y en a de deux sortes ; les bons sont d’un sixieme plus forts que les mauvais ; trois basarucos valent deux reys de Portugal. Voyez Rey.
* BASCAMAN, (Géog. sainte.) ville de la Palestine, de la tribu de Gad.
* BASCARA, (Géog.) ville de la partie de l’Afrique, que les Arabes appellent Ausath ou moyenne, ou le Biledulgerid.
* BASCATH, (Géog. sainte.) ville de la Palestine, dans la tribu de Juda, entre Lachis & Eglon.
BASCHI ou BACHI, s. m. (Hist. mod.) chez les Turcs, joint à un mot qui le précede, signifie le chef ou le premier d’un corps d’officiers du sérail. Ainsi bogangi bachi signifie le chef des fauconiers, & bostangi bachi, le chef des jardiniers, ou sur-intendant des jardins du grand-seigneur.
Baschi-capou-oglani, nom qu’on donne à l’eunuque qui commande aux portiers de l’appartement des sultanes ; baschi signifiant chef, capou, porte, & oglan, officier ou valet. Ricaut, de l’empire Ottoman. (G)
BASCULE, s. f. (Méchanique.) est une piece de bois qui monte, descend, se hausse, & se baisse par le moyen d’un essieu qui la traverse dans sa longueur, pour être plus ou moins en équilibre. Ce peut être encore le contre-poids d’un pont-levis, ou d’un moulin-à-vent, pour en abattre le frein : elle a son axe ou œil par où passe un boulon qui la soûtient sur un bâti de charpente. En général, bascule est proprement un levier de la premiere espece, où le point d’appui se trouve entre la puissance & la résistance. (K)
Bascule, s. f. terme de Fortification, sont deux poutres ou solives, dont une partie s’avance en-dehors de la porte, & soûtient des chaînes attachées au pont-levis ; & l’autre est en-dedans de la porte, & soûtient des contre poids qui mettent la bascule en équilibre, ensorte qu’en appuyant sur l’un des bouts, l’autre hausse. Voyez Pont-levis. (Q)
Bascule, c’est dans une grosse horloge, un levier, dont un bout donne sur la roue de cheville d’une sonnerie, & l’autre tire un fil de fer ou de cuivre, pour faire lever le marteau. Voyez l’article Horloge de clocher : voyez aussi la fig. 5. Pl. II. de l’Horlogerie. (T)
Bascule, partie du bas-au-métier ; voyez Bas-au-métier.
Bascule, terme de riviere, voyez Banneton.
Bascules du positif, ou Petit Orgue, représentées dans les Planches n°. 22. sont des regles AB de bois de chêne, de cinq ou six piés de long, plus larges dans leur milieu qu’à leurs extrémités ; ces regles sont posées de champ & par le milieu sur un dos d’âne F, qui est garni de pointes G. Ces pointes entrent dans un trou percé au milieu de la bascule. Ce trou doit être un peu plus ouvert par le haut que par le bas qui porte sur le dos d’âne ; & cela seulement dans le sens de la longueur de la bascule. A l’extrémité B de la bascule est un petit trou percé verticalement, destiné à recevoir une pointe ou épingle, qui est emmanchée à l’extrémité inférieure de la pilote EC ; les pilotes sont des baguettes de bois de chêne, de quatre ou cinq lignes de diametre ; leur partie supérieure traverse une planche D, D, D, fig. 20. percée d’autant de trous qu’il y a de pilotes, dont le nombre est égal à celui des touches du clavier, au-dessous desquelles elles doivent répondre ; ensorte que lorsque les pilotes sont passées dans les trous du guide, leurs extrémités supérieures portent contre le dessous des touches à un demi-pié près ou environ de l’extrémité antérieure des touches. L’extrémité A des bascules répond sous le sommier du positif, qui est garni en-dessous de pointes de fer, entre-deux desquelles les bascules se meuvent. Ces pointes s’appellent le guide des bascules. Elles servent en effet à les guider dans leurs mouvemens.
Lorsque l’Organiste baisse une touche du clavier, elle comprime la pilote EC, qui fait baisser l’extrémité B de la bascule, & par conséquent hausser l’extrémité A, qui foule en-haut le petit bâton qui traverse la boursette ; ce qui fait ouvrir la soupape, la soupape étant ouverte, laisse aller le vent dans la gravure du sommier. V. Sommier, Positif, Boursette, &c.
Ces bascules qui, du côté des pilotes, n’occupent que la même étendue que le clavier, sont divergentes du côté du sommier du positif, où elles occupent la même étendue que les soupapes de ce sommier. La place de ces bascules dans l’orgue, est sous le pont qui est entre le grand orgue & le positif, sur lequel le siége de l’Organiste est placé. L’extrémité qui porte les pilotes, entre dans le pié du grand orgue, & l’autre extrémité dans le positif au-dessous du sommier.
Bascules brisées de l’orgue, représentées fig. 26. Pl. d’Orgue, sont composées des deux bascules CH, HD, articulées ensemble par des entailles à moitié bois, comme on voit en H ; elles sont montées sur un chassis AB, dans lequel sont assemblées à queues d’aronde deux barres de bois E, garnies de pointes, qui entrent dans le milieu des bascules, & qui leur servent avec le dos d’âne des barres EE, de point d’appui. Au milieu du chassis, qui est l’endroit où les deux bascules se réunissent, sont deux regles ou barres HG ; l’inférieure H est garnie de chevilles de fer, entre deux desquelles les bascules peuvent se mouvoir. Cette barre avec les pointes s’appelle le guide : vis-à-vis du guide & au-dessus, est une autre barre G, dont l’usage est d’empêcher les bascules de sortir d’entre les chevilles du guide. Le contre-dos d’âne K fait la même fonction ; il sert à empêcher les bascules H D de sortir des pointes de la barre E, vis-à-vis de laquelle il est placé. Aux deux extrémités CD des bascules, on met des anneaux de fil de fer : ceux de la partie C doivent être en-dessous, pour recevoir la targette CL, qui descend de la bascule au clavier, & ceux de la partie D doivent être en-dessus, pour recevoir la targette DM, qui monte de la bascule au sommier
Les bascules brisées sont une maniere d’abregé (V. Abregé) ; car elles sont convergentes du côté des targettes du clavier, où elles n’occupent pas plus d’étendue que les touches du clavier auxquelles elles répondent perpendiculairement ; & du côté de celles du sommier elles sont divergentes, & occupent la même étendue que les soûpapes auxquelles elles communiquent par le moyen des targettes DM, & des boursettes. Voyez Boursettes & Sommier.
Lorsqu’on abaisse une touche du clavier, la targette CL qui y est attachée tire en en-bas l’extrémité C de la bascule C H, qui a son point d’appui au point E. L’extrémité C ne sauroit baisser que l’autre extrémité H ne leve : mais cette partie reçoit l’extrémité de l’autre bascule D H ; par conséquent elle doit l’élever avec elle vers la barre G ; ce qui ne se peut faire sans que la bascule H D ne descende, & n’entraîne avec elle la targette DM, qui communique par le moyen d’une boursette à la soupape correspondante du sommier qui sera ainsi ouverte. Lorsqu’on lâchera le doigt, le ressort qui renvoye la soupape contre la gravure, tirera en haut la targette MD, qui relevera l’extrémité D de la bascule, & fera par conséquent baisser l’autre extrémité H, qui parce qu’elle appuie sur l’extrémité de l’autre bascule, la fera baisser avec elle, & par conséquent lever par l’autre extrémité C, qui tirera en en-haut la targette CL, & la touche du clavier qui y est attachée.
Les bascules ont différens noms, suivant l’usage qu’on en fait.
La bascule d’un loquet est une piece de fer d’environ deux pouces de long, percée d’un trou quarré long, & posée au bout de la tige du bouton ou du lasseret de la boucle d’un loquet à bascule : cette tige excede l’épaisseur de la porte du côté où le battant doit être posé, de l’épaisseur de la bascule qui est arrêtée sur la tige par une goupille ou un écrou : on place ensuite le battant du loquet de façon que la bascule ait le plus gros de sa queue du côté où la vis arrête le battant sur la porte ; & cela afin que la tête du battant ait plus de poids pour retomber dans le mentonnet. Il faut par cette même raison poser la bascule à deux pouces de la vis qui tient la queue du battant, de sorte qu’en tournant le bouton soit à droite soit à gauche, on fasse lever le battant. Il faut remarquer qu’en tournant le bouton & la boucle dans le même sens que l’on tourne la clé d’une porte pour l’ouvrir, le battant sera plus doux à lever ; & qu’au contraire on le trouvera plus rude en tournant de l’autre sens : car la vis qui tient la queue du battant est ici le point d’appui ; & le battant pese d’autant plus que l’action de la bascule se fait sur lui dans un point plus proche de cette vis.
Bascule qui sert de fermeture aux vanteaux de porte ou d’armoire. Cette bascule est composée de deux verroux, l’un pour fermer en entrant dans la traverse du haut, & l’autre pour fermer en entrant dans la traverse d’en-bas : ils sont montés sur platines ; leurs queues viennent se joindre à la traverse du milieu des vanteaux ; elles sont coudées en croissant, l’une d’un sens, & l’autre d’un autre sens, & percées d’un trou à l’extrémité du croissant ; ces extrémités viennent se poser sur les étochios qui sont à chaque bout d’un T ; ce T est sur un étochio rivé sur une platine quarrée qui s’attache sur le vanteau de la porte ou armoire avec quatre vis ; le T est percé d’un trou dans son milieu, entre les deux étochios de l’extrémité de ses bras.
Pour ouvrir ou fermer la bascule, on prend un bouton qui est à l’extrémité de la main du T : si on meut ou leve la bascule verticalement, l’on ouvre ; si on la baisse perpendiculairement, on ferme.
Cette bascule est couverte par la gâche encloisonnée de la serrure : lorsque la bascule est posée à une porte où il n’y a point de gâche, la platine est ordinairement à panache & polie ; & l’étochio qui porte la bascule, à grand bouton plat, assez large pour couvrir le T, avec les deux bouts des croissans montés sur les étochios du bout des bras du T.
La sorte de bascule dont nous venons de parler peut être composée de deux verroux à ressort, d’un T avec sa rivure, & d’une platine : mais tout s’exécutera comme à la précédente.
Bascule à pignon ; elle ne differe de la précédente qu’en ce que les queues des verroux sont droites, & fendues de la quantité de la course des verroux, & que les côtés de ces queues qui se regardent sont à dents ou à cremailleres, & s’engrainent dans un pignon compris entr’eux. Pour ouvrir cette bascule, on prend un bouton rivé sur la queue du verrou d’en-bas, & en le levant il fait tourner le pignon, qui fait descendre le verrou d’en-haut, & monter le verrou d’en-bas.
Voyez Serrurerie, Pl. V. fig. 5. une bascule 5, 6, 7, 8, 9 ; 6 le bouton ; 6, 7, 8, le T ; 9, 9, les verroux : la fig. 1, 2, 3, 4, représente la même bascule, avec sa platine à panache, la bascule couverte.
Même Pl. fig. 1. est une bascule à pignon : H, H, le pignon ; I, K, les verroux à dents ; ED, GF, extrémités des verroux. Pl. VII. Serrur. fig. A B C D E : A B, battant du loquet ; E, bascule ; D, bouton ; CC, crampon : au lieu de bouton on a quelquefois un anneau ou une boucle, comme on voit dans la fig. F G.
BASE : la base d’une figure, en Géométrie, est proprement, & en général, la plus basse partie de son circuit. Voyez Figure.
La base dans ce sens est opposée au sommet, comme à la partie la plus élevée.
On appelle base d’un triangle, un côté quelconque de cette figure, quoiqu’à proprement parler, le mot base convienne au côté le plus bas, sur lequel le triangle est comme appuyé : ainsi la ligne AB est la base du triangle ABC (Planch. Géom. fig. 68.) ; quoiqu’en d’autres occasions les lignes AC ou BC, en puissent être la base. Dans un triangle rectangle, la base est proprement le côté opposé à l’angle droit, c’est-à-dire, l’hypothénuse. Voyez Hypothénuse. La base d’un triangle isoscele est proprement le côté inégal aux deux autres. La base d’un solide est la surface inférieure ou celle sur laquelle toute la figure est appuyée, ou peut être censée appuyée. Voyez Solide.
Ainsi le plan DFE est la base du cylindre A B DE, (Pl. Géom. fig. 56.)
La base d’une section conique est une ligne droite qui se forme dans l’hyperbole & la parabole par la commune section du plan coupant, & de la base du cone. Voyez Cone & Conique.
Base distincte, en Optique, voyez Distinct. (E)
Base, s. f. en terme de Fortifications, se dit de la largeur des différens ouvrages de fortification par le bas : ainsi l’on dit la base du rempart, celle du parapet, du revêtement, &c. Voyez Rempart, Parapet, &c. (Q)
Base du Cœur, en Anatomie, la partie supérieure & large de ce viscere, d’où partent quatre gros vaisseaux, deux arteres, l’aorte, & l’artere pulmonaire ; & deux veines, la veine cave & la veine pulmonaire. Voyez les Planch. d’Anatom. & à l’art. Anat. leurs explications. V. aussi Cœur, Aorte, &c.
On donne aussi ce nom à la partie principale de l’os hyoïde, & au grand côté de l’omoplate. Voyez os Hyoïde & Omoplate. (L)
Base des sabords, c’est en Marine le bordage qui est entre la préceinte & le bas des sabords. (Z)
* BASENTELLE, (Géog. anc.) ville d’Italie dans la Calabre, où l’empereur Othon II. fut vaincu & fait prisonnier.
* BASIEGES, (Géog.) petite ville de France, au Lauguedoc, dans le diocèse de Toulouse, entre cette ville & Carcassonne.
* BASIENTO, (Géog.) riviere du royaume de Naples qui a sa source près de Potenza, dans la Basilicate, traverse cette province, & se jette dans le golfe de Tarente.
BASILAIRE, adj. pris s. en Anatomie, épithetes de différentes parties qui sont considérées comme servant de bases : c’est dans ce sens que l’os sacrum & l’os sphénoïde ont été appellés os basilaires. Voy. Os Sacrum & Sphénoïde. (L)
Basilaire, ou Cunéiforme, apophyse de l’os occipital, qui s’articule avec l’os sphénoide. Voyez Occipital & Sphénoïde.
L’artere basilaire s’avance sous la protubérance annulaire, où elle distribue plusieurs branches ; & lorsqu’elle est parvenue à l’extrémité de cette apophyse, elle se divise en deux, & s’anastomose avec les branches postérieures de la carotide. Voyez Protubérance, Carotide, &c. (L)
BASILE (Ordre de S.) ordre religieux, & le plus ancien de tous. Il a tiré son nom, selon l’opinion la plus commune, de S. Basile, évêque de Césarée en Cappadoce, qui vivoit dans le ive siecle, & qui donna des regles aux cénobites d’orient, quoiqu’il ne fût pas l’instituteur de la vie monastique, dont long-tems avant lui l’histoire de l’Église fournit des exemples fameux, sur-tout en Egypte.
Cet ordre a toûjours fleuri en orient ; & presque tous les religieux qui y sont aujourd’hui en suivent la regle. Il passa en occident environ l’an 1057. Le pape Grégoire XIII. le réforma en 1579, & mit les religieux d’Italie, d’Espagne, & de Sicile, sous une même congrégation.
On dit que S. Basile s’étant retiré dans la province de Pont vers l’an 357, y resta jusqu’en 362 avec des solitaires, auxquels il prescrivit la maniere de vivre qu’ils devoient observer en faisant profession de la vie religieuse. Ensuite Rufin traduisit ces regles en Latin ; ce qui les fit connoître en occident, quoiqu’elles n’y ayent été suivies qu’au xie siecle. Dans le xve le cardinal Bessarion, Grec de nation, & religieux de l’ordre de S. Basile, les réduisit en abregé, & les distribua en 23 articles. Le monastere de S. Sauveur de Messine en Sicile est chef d’ordre de S. Basile en occident ; & l’on assûre qu’on y récite l’office en Grec. Le Mire, de Orig. Ordin. relig. (G)
BASILE, s. m. (Menuiserie.) est la pente ou inclinaison du fer d’un rabot, d’une varlope, & généralement de tous les outils de Menuisier qui sont montés dans des fûts, & qui servent tant à dresser le bois qu’à pousser des moulures. La pente que l’on donne à ces fers dépend de la dureté des bois ; pour les bois tendres elle forme avec le dessous du fût un angle de douze degrés, & pour les bois durs elle forme un angle de dix-huit degrés. On remarque que plus l’angle est aigu, plus il a de force ; à moins que le bois ne soit si dur, qu’il ne puisse être coupé. Dans ce cas, le fer se place perpendiculairement au fût ; & au lieu de couper, il gratte.
BASILIC, basiliscus, s. m. (Hist. nat.) animal fabuleux que les anciens mettoient au rang des serpens ou des dragons : on le croyoit de médiocre grosseur, & on prétendoit qu’il avoit sur la tête des éminences en forme de couronne. On a distingué trois especes de basilics ; les uns brûloient & enflammoient tout ce qu’ils regardoient ; les autres causoient par le même moyen la terreur & la mort ; les basilics de la troisieme espece avoient la funeste propriété de faire tomber la chair de tous les animaux qu’ils touchoient : enfin il y avoit une autre espece de basilic qui étoit produit par les œufs des vieux cocqs, &c. Toutes ces absurdités n’ont été que trop répétées par les Naturalistes : on peut juger par ce que nous en avons dit ici, que de pareils contes ne méritoient pas d’être rapportés plus au long. (I)
Basilic, ocimum, (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur monopétale labiée, dont la levre supérieure est relevée, arrondie, crenelée, & plus grande que l’inférieure, qui est ordinairement frisée ou légerement échancrée. Il sort du calice un pistil, qui est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, & environné de quatre embryons qui deviennent dans la suite autant de semences oblongues, enfermées dans une capsule qui a servi de calice à la fleur. Cette capsule se divise en deux levres, dont la supérieure est relevée & échancrée ; l’inférieure est dentelée. Tournefort, Inst. rei herb. V. Plante. (I)
On distingue, en Jardinage, quatre sortes de basilics : trois domestiques, dont l’un est appellé le grand basilic ; l’autre, le petit ; le troisieme, le panaché ; & le quatrieme est le sauvage, qui se divise encore en deux especes : tous fleurissent l’été, & viennent de graine.
Les basilics ne craignent point d’être arrosés en plein soleil : on les éleve sur couche & sous des cloches au mois de Mai. Quand ils sont en état d’être transplantés, on les porte en motte dans les parterres, & on en garnit les pots. Il faut en excepter le petit basilic, qui est trop délicat & qui veut une terre plus légere, composée de deux tiers de terreau, & l’autre de terre de potager bien criblée. On l’arrose fréquemment ; on coupe avec des ciseaux sa tête pour l’arrondir, & on le fait sécher pour les courbouillons de poisson : d’autres le mettent en poudre pour servir à plusieurs sauces. (K)
Basilic, (Artillerie.) étoit autrefois une piece de canon de quarante-huit livres de balle, qui pesoit environ sept mille deux cens livres. Il ne s’en fond plus de ce calibre en France : mais il y a encore plusieurs arsenaux dans lesquels il se trouve de ces anciennes pieces. (Q)
* BASILICATE, (la) Géog. province d’Italie au royaume de Naples, bornée par la Capitanate, la Calabre citérieure, les terres de Bari, d’Otrante, le golfe de Tarente, & les principautés. Cirenza en est la capitale.
BASILICON, (Pharmacie.) nom que les Apothicaires donnent à un onguent suppuratif. Voici comment il se prépare. Prenez résine de pin, poix navale, cire jaune, de chaque une demi-livre ; huile d’olive, une livre & demie : faites les fondre au bain-marie ; passez ensuite le tout. Cet onguent est nommé aussi tetrapharmacon : c’est un des meilleurs suppuratifs que nous possédions. Lemery ajoûte à cette formule la térébenthine de Venise.
Basilicon veut dire royal, à cause des grandes vertus de cet onguent. (N)
* BASILICUM, (Hist. anc.) espece d’ajustement ou de vêtement des anciens, dont la nature nous est encore inconnue.
BASILIDIENS, s. m. pl. (Hist. ecclés.) nom d’anciens hérétiques, sectateurs de Basilide, qui vivoit vers le commencement du 11. siecle.
Ce Basilide étoit sorti de l’école des Gnostiques, dont le chef étoit Simon le Magicien. Il croyoit avec lui que J. C. n’avoit été homme qu’en apparence, & que son corps n’étoit qu’un fantôme ; qu’il avoit donné sa figure à Simon le Cyrénéen, qui avoit été crucifié en sa place.
Nous apprenons d’Eusebe que cet imposteur avoit écrit vingt-quatre livres sur les Evangiles, & qu’il avoit feint je ne sai quels prophetes, à deux desquels il avoit donné les noms de Barcaba & de Barcoph. Nous avons encore les fragmens d’un évangile de Basilide.
Ses disciples prétendoient qu’il y avoit des vertus particulieres dans les noms, & enseignoient avec Pythagore & avec Platon, qu’ils n’avoient pas été inventés au hasard, mais qu’ils signifioient tous quelque chose de leur naturel. Basilide pour imiter Pythagore, vouloit que ses disciples gardassent le silence pendant cinq ans. Voyez Nom, Pythagoricien, &c.
Suivant la doctrine de leur maître, ils croyoient que l’ame étoit punie en cette vie des péchés qu’elle avoit commis auparavant : ils enseignoient la métempsycose, & nioient la résurrection de la chair ; parce que, disoient-ils, le salut n’avoit pas été promis au corps. Ils ajoûtoient, que dans chaque homme il y avoit autour de l’ame raisonnable plusieurs esprits qui excitoient les différentes passions ; que loin de les combattre il falloit leur obéir, & se livrer aux desirs les plus déreglés. Clément Alexandrin, Strom. liv. II. & IV. (G)
* BASILIGOROD, (Géog.) ville de l’empire Russien dans la Tartarie Moscovite, sur la rive droite du Volga au confluent de la Sura.
* BASILIMPHA, (Géog.) riviere de Diarbeck dans la Turquie en Asie ; elle se jette dans le Tigre, entre Mosul & Turit.
* BASILINDE, s. f. (Myth.) nom d’une espece de fête que les Tarentins célébroient en l’honneur de Venus. Pollux prétend, liv. IX. que c’étoit un jeu des Grecs, dans lequel celui que le sort avoit fait roi, commandoit quelque chose aux autres. Lex. Jurid. Calv.
* BASILIPOTAMO, (Géog. anc. & mod.) riviere de Grece en Morée, dans la province de Sacanie ; elle reçoit d’autres rivieres, & se jette dans la mer au golfe de Castel-Rampani. Les anciens l’ont appellée, ou Hemerus, ou Marathon, ou Eurotas.
BASILIQUE, s. f. (Hist. anc. & mod.) mot tiré du Grec βασιλεὺς, roi ; c’est-à-dire, maison royale. C’étoit à Rome un bâtiment public & magnifique, où l’on rendoit la justice à couvert ; ce qui le distinguoit du forum, place publique, où les magistrats tenoient leurs séances en plein air. Il y avoit dans ces basiliques de vastes salles voûtées, & des galeries élevées sur de riches colonnes : des deux côtés étoient des boutiques de marchands, & au milieu une grande place pour la commodité des gens d’affaires. Les tribuns & les centumvirs y rendoient la-justice ; & les jurisconsultes ou légistes gagés par la république, y répondoient aux consultations. C’est ce qu’a voulu dire Cicéron dans une épitre à Atticus, basilicam habeo, non villam, frequentiâ formianorum ; parce qu’on venoit le consulter de toutes parts à sa maison de campagne, comme s’il eût été dans une basilique. Les principales basiliques de Rome étoient Julia, Porcia Sisimini Sempronii, Caii, Lucii, ainsi nommées de leurs fondateurs, & la banque, basilica argentariorum. On en construisit d’autres moindres pour les marchands, & où les écoliers alloient faire leurs déclamations. Le nom de basilique a passé aux édifices dédiés au culte du vrai Dieu, & aux chapelles bâties sur les tombeaux des martyrs : ce nom paroît surtout leur avoir été affecté en Grece. Ainsi l’on nommoit à Constantinople la basilique des saints Apôtres, l’église où les empereurs avoient fait transporter les reliques de quelques Apôtres. Il étoit défendu d’y enterrer les morts, & les empereurs même n’avoient leur sépulture que sous les portiques extérieurs, ou le parvis de la basilique.
Le nom de Basilique signifiant maison royale, il est visible que c’est à cause de la souveraine majesté de Dieu, qui est le roi des rois, que les anciens auteurs ecclésiastiques ont donné ce nom à l’Eglise, c’est-à-dire au lieu où s’assemblent les Fideles pour célébrer l’office divin.
Ce mot est souvent employé dans ce sens par saint Ambroise, S. Augustin, S. Jérôme, Sidoine, Apollinaire, & d’autres écrivains du iv. & du v. siecle.
M. Perrault dit, que les basiliques différoient des temples en ce que les colonnes des temples étoient en-dehors, & celles des basiliques en-dedans. Voyez Temple.
Selon Bellarmin, tom. II. de ses controverses, voici la différence que les Chrétiens mettoient entre les basiliques & les temples. On appelloit basiliques les édifices dédiés au culte de Dieu & en l’honneur des saints, spécialement des martyrs. Le nom de temples étoit propre aux édifices bâtis pour y célébrer les mysteres divins, comme nous l’apprennent S. Basile, S. Grégoire de Nazianze, &c. Quelques anciens, comme Minutius Felix, dans son ouvrage intitulé Octavius, ont soûtenu que le Christianisme n’avoit point de temples, que cela n’étoit propre qu’au Judaïsme & au Paganisme : mais ils parlent des temples destinés à offrir des sacrifices sanglans, & à immoler des animaux. Il est certain que les lieux destinés à conserver & honorer les reliques des martyrs étoient proprement appellés basiliques, & non pas temples. Les Grecs font quelquefois mention des temples des martyrs ; mais ils parlent des lieux qui étoient consacrés à Dieu & dédiés au culte des martyrs. Comme consacrés à Dieu, ils étoient appellés temples ; car c’est à lui seul qu’on peut ériger des autels & offrir des sacrifices : mais comme destinés à la vénération des saints, ils avoient seulement le nom de basiliques. (G)
Basiliques, adj. pris subst. (Jurisprud.) recueil des lois Romaines, traduites en Grec par ordre des empereurs Basile & Léon, & maintenu en vigueur dans l’empire d’Orient jusqu’à sa dissolution. Voyez Droit civil.
Les basiliques comprennent les institutes, le digeste, le code & les novelles, avec quelques édits de Justinien & d’autres empereurs. Le recueil étoit de soixante livres, & s’appelloit par cette raison ἑξήκοντα, soixante. On croit que c’est principalement l’ouvrage de l’empereur Léon le philosophe, & qu’il l’intitula du nom de son pere, Basile le Macédonien, qui l’entreprit le premier. Des soixante livres il n’en reste aujourd’hui que quarante-un. Fabrolus a tiré en quelque façon le supplément des dix-neuf autres du Synopsis basilicon, &c.
Basilique, adj. pris subst. (Hist. anc.) dans l’empire Grec, dénomination qui se donnoit aux mandataires du prince, ou à ceux qui étoient chargés de porter ses ordres & ses commandemens. Voyez Mandement. (G)
Basilique, adj. pris subst. en Anatomie, nom d’une veine qui naît du rameau axillaire, qui court dans toute la longueur du bras. Voyez les Pl. d’Anat. & leur explication dans l’article Anatomie.
La basilique est une des veines que l’on a coûtume d’ouvrir en saignant au bras. Voyez Phlébotomie. (L)
Basilique ou basilica, est, en Astronomie, le nom d’une étoile fixe de la premiere grandeur dans la constellation du Lion : elle s’appelle aussi Regulus & cor Leonis, ou cœur du Lion. V. Lion. (O)
* BASILISSA, (Myth.) nom sous lequel Venus étoit honorée par les Tarentins.
* BASILUZZO, (Géog. anc. & mod.) île de la mer de Toscane, appellée jadis Herculis Insula : c’est une des îles célebres de l’Ypare.
* BASIN, s. m. (Commerce & Tisserans.) étoffe croisée, toute fil & coton ; la chaîne est fil, la trame coton. Il y a des basins unis, figurés, ras & velus ; & dans toutes ces sortes, on en distingue une infinité d’autres relativement à l’aunage & à la condition. Les manufactures principales en sont à Troies, à Roüen, & dans le Beaujolois. Ils ne se travaillent pas autrement que la toile, quand ils sont unis : ils se font à la marche, quand ils sont figurés ; le nombre de lisses & de marches est déterminé par la figure, & c’est la trame qui la fait ; parce qu’étant de coton & plus grosse que la chaîne, elle forme un relief, au lieu que la chaîne se perdroit dans la trame : les velus sont tirés au chardon.
Il est ordonné par les reglemens de donner aux basins unis ou rayés, demi-aune & un pouce de large en peigne & sur le métier ; vingt-quatre portées de quarante fils chacune, voyez Portée & Peigne ; & vingt-quatre aunes de longueur : aux basins à petites raies, cent soixante raies : aux basins à trente-six barres, demi-aune un pouce de large en peigne, vingt-deux portées de quarante fils chacune, & trois raies à chaque barre : aux basins étrois, unis & à petites raies, ou à vingt-cinq barres, demi-aune moins de large en peigne, vingt-quatre aunes de long : aux unis, vingt portées : à ceux à petites raies, cent quarante raies ; & à chacune des vingt-cinq barres, trois raies : aux basins à la mode, demi-aune un pouce de large, & vingt-quatre de long ; s’ils sont larges, demi-aune moins de large, & vingt-deux aunes de long ; s’ils sont étroits, avec un nombre de portées ou de raies convenable à la largeur & à leur degré de finesse ; & à tous, la chaîne de fils de coton filés fin, sans aucun mêlange d’étoupe, chanvre ou lin, les barres & raies de fil de coton retors.
Quoique les manufactures de France fournissent d’excellens basins, on en tire cependant de l’étranger. Il en vient de Hollande, de Bruges, & des Indes. Les basins de Hollande sont ordinairement rayés : ils sont fins & bons. Ils portent de largeur cinq huitiemes d’aune, & de longueur environ douze aunes. Ceux de Bruges sont unis, rayés à petites raies imperceptibles, à grandes raies ou barres de trois petites raies, & à poil. Les unis ou à poil ont environ cinq douze de large, & douze aunes de long ; & les rayés, un pouce de moins sur la largeur, & les deux tiers de moins sur la longueur. Il y en a de quatre sortes, qu’on distingue à la marque. Ceux qui sont marqués à deux lions rouges s’appellent basin double lion ; à un seul lion, basin simple lion ; à un B, basin B ; à un C, basin C. Voyez dans le dictionnaire de Commerce le détail de toutes ces marques.
Les basins des Indes sont blancs & sans poil ; les uns croisés & sergés ; les autres à carreaux & ouvrés. Les meilleurs se fabriquent à Bengale, Pondichery, & Belcasor.
Il n’est pas besoin d’avertir que les barres dans ce genre d’étoffe, ou plûtôt de toile, sont faites par certains fils de chaîne filés plus gros que les autres, & placés à des distances égales, & que les raies sont faites par des fils de la chaîne filés moins gros que ceux qui forment les barres, mais plus gros que les autres, placés à des distances égales sur la barre.
BASIOGLOSE, adject. pris subst. en Anatomie, nom d’une paire de muscles de la langue ; ils viennent de la base de l’os hyoide & de la partie voisine de la grande corne de ce même os, & s’inserent aux parties latérales de la racine de la langue. (L)
BASIO-PHARYNGIEN, en Anatomie, nom d’une paire de muscles du pharynx. Voyez Hyo-pharngien. (L)
* BASIRI, (Géog.) riviere de Perse qui arrose la province de Kirman, la ville de ce nom, celle de Basiri, & se jette dans le golfe d’Ormus.
* BASKIRIE, (Géog.) contrée de la Tartarie Moscovite, bornée au nord par les Tartares de Tumen, à l’orient par les Barabinskoi, & par les terres d’Ablai ; au midi, par la montagne de Sortora ; & à l’occident par le duché de Bulgare.
* BASKRON, PASCATIR, ou PASCHARTI, (Géog.) province de la Tartarie Moscovite, bornée à l’orient par les Kalmuks ; au midi par la grande Nogaia ; au couchant par la riviere de Kam, & au nord par la Permia Velchi, & par une partie de la Siberie.
BASOCHE, s. f. (Jurisprud.) est la communauté des clercs du Parlement de Paris, laquelle tient une espece de jurisdiction, où se jugent les différends qui peuvent naître entre eux. Ils s’y exercent aussi à plaider des causes sur des questions difficiles ou singulieres. La basoche a entre autres officiers un chancelier & un thrésorier de la basoche ; il y avoit même autrefois un roi de la basoche. (H)
* BASQUES (les) s. m. pl. Géog. petit pays de France, vers les Pyrenées, entre l’Adour, les frontieres d’Espagne, l’Océan, & le Bearn ; il comprend le Labour, la basse Navarre, & le pays de Soule.
* BASRACH, Voyez Bassora.
* BASS, (Géog.) petite île d’Ecosse, dans le golfe d’Edimbourg.
* BASSANO, (Géog.) petite ville d’Italie, dans l’état de Venise, au Vicentin, sur la riviere de France.
Bassano, ou Bassanello, (Géog. anc. & mod.) ville d’Italie, dans le patrimoine de S. Pierre, au confluent du Nere & du Tibre, près du lac que les anciens appelloient lacus Vadimonii.
BASSAREUS, adj. pris subst. (Myth.) surnom donné à Bacchus ; soit du Grec βαύζειν, crier, parce que dans ses mysteres les Bacchantes jettoient de grands cris ; soit d’une sorte de chaussure Lydienne nommée bassareum. On donnoit aussi aux prêtresses de ce Dieu le titre de bassarides, que l’ancien scholiaste tire d’une robe ou vêtement qui alloit jusqu’aux talons, & que les Africains & les Thraces appelloient bassyris & bassara. Mais Bochart dans son Chanaana, liv. I. c. 18. dit que ce mot vient de l’Hébreu bassar, qui signifie la même chose que le τρυγᾶν des Grecs, qui veut dire vendanger ; étymologie qui vaut bien les deux précédentes. (G)
BASSE, ou BATURE, s. f. c’est (en Marine) un fond mêlé de sable de roche ou de cailloux, qui paroît à la surface de l’eau : quand on voit la mer briser dessus, alors on nomme cet endroit bature ou brisant. (Z)
Basse, adj. fém. Voyez Bas.
Basse, adj. pris subst. est celle des parties de la Musique qui est au-dessous des autres ; la plus basse de toutes, d’où vient son nom de basse. Voyez Partition.
La basse est la plus importante des parties ; parce que c’est sur elle que s’établit le corps de l’harmonie : aussi est-ce une espece d’axiome parmi les Musiciens, que quand la basse est bonne, rarement l’harmonie est mauvaise.
Il y a plusieurs especes de basses ; basse fondamentale, dont nous ferons un article particulier.
Basse continue, ainsi appellée parce qu’elle dure pendant toute la piece : son principal usage, outre celui de régler l’harmonie, est de soûtenir les voix, & de conserver le ton. On prétend que c’est un Ludovico-Viana, dont nous en avons un traité, qui au commencement du dernier siecle la mit le premier en usage.
Basse figurée, qui au lieu de s’arrêter sur une seule note, en partage la valeur en plusieurs autres notes sous un même accord. Voyez Harmonie figurée.
Basse contrainte, dont le sujet ou le chant, borné à un petit nombre de mesures, recommence sans cesse, tandis que les parties supérieures poursuivent leur chant & leur harmonie, & les varient de différentes manieres. Cette basse appartient originairement aux couplets de la chaconne : mais on ne s’y asservit plus aujourd’hui. La basse contrainte descendant diatoniquement ou chromatiquement, & avec lenteur, de la tonique à la dominante dans les tons mineurs, est admirable pour les morceaux pathétiques : ces retours périodiques affectent insensiblement l’ame, & la disposent à la tristesse & à la langueur. On en voit de fort beaux exemples dans plusieurs scenes des opera François.
Basse chantante, est l’espece de voix qui chante la partie de la basse. Il y a des basses récitantes & des basses de chœur ; des concordans ou basses-tailles, qui tiennent le milieu entre la taille & la basse ; des basses proprement dites que l’usage fait encore appeller aujourd’hui basse-tailles ; & enfin des basse-contres, les plus graves de toutes les voix, qui chantent la basse sous la basse même, & qu’il ne faut pas confondre avec les contre-basses qui sont des instrumens. Voyez Contre-basse.
Basse fondamentale, est celle qui n’est formée que des sons fondamentaux de l’harmonie ; desorte qu’au-dessous de chaque accord, elle fait entendre le vrai son fondamental de cet accord ; par où l’on voit qu’elle ne peut avoir d’autre contexture que celle de la succession fondamentale de l’harmonie.
Pour bien entendre ceci, il faut savoir que tout accord, quoique composé de plusieurs sons, n’en a qu’un qui soit fondamental : savoir celui qui a produit cet accord, & qui lui sert de base. Or la basse qui regne au-dessous de toutes les autres parties, n’exprime pas toûjours les sons fondamentaux des accords : car entre tous les sons d’un accord, on est maître de porter à la basse celui qu’on croit préférable, eu égard à la marche de cette basse, au beau chant, ou à l’expression. Alors le vrai son fondamental, au lieu d’être à sa place naturelle, qui est la basse, se transporte dans les autres parties, ou même ne s’exprime point du tout ; & un tel accord s’appelle accord renversé. Dans le fond, un accord renversé ne differe point de l’accord direct qui l’a produit ; car ce sont toûjours les mêmes sons : mais ces sons formant des combinaisons différentes, on a long-tems pris ces combinaisons pour autant d’accords fondamentaux, & on leur a donné différens noms, qu’on peut voir au mot accord, & qui ont achevé de les distinguer ; comme si la différence des noms en produisoit réellement dans les choses. M. Rameau a fait voir dans son traité de l’Harmonie, que plusieurs de ces prétendus accords n’étoient que des renversemens d’un seul. Ainsi l’accord de sixte n’est que l’accord parfait dont la tierce est transportée à la basse : en y portant la quinte, on aura l’accord de sixte quarte. Voilà donc trois combinaisons d’un accord qui n’a que trois sons ; ceux qui en ont quatre, sont susceptibles de quatre combinaisons ; car chacun des sons peut être porté à la basse : mais en portant au-dessous de celle-ci une autre basse, qui sous toutes les combinaisons d’un même accord, présente toûjours le son fondamental, il est évident qu’on réduit au tiers le nombre des accords consonans, & au quart le nombre des dissonans. Ajoûtez à cela tous les accords par supposition, qui se réduisent encore aux mêmes fondamentaux ; vous trouverez l’harmonie simplifiée à un point qu’on n’eût jamais espéré de l’état de confusion où étoient ses regles jusqu’au tems de M. Rameau. C’est certainement, comme l’observe cet auteur, une chose très-étonnante qu’on ait pû pousser la pratique de cet Art jusqu’au point où elle est parvenue, sans en connoître le fondement, & qu’on ait trouvé exactement toutes les regles, avant que de trouver le principe qui les produit.
La marche ou le mouvement de la basse fondamentale se regle sur les lois de la succession harmonique ; de sorte que si cette basse s’écarte de l’ordre prescrit, il y a faute dans l’harmonie.
Bien moduler & observer la liaison, sont les deux plus importantes regles de la basse fondamentale. Voyez Harmonie & Modulation. Et la principale regle méchanique qui en découle, est de ne faire marcher la basse fondamentale que par intervalles consonans, si ce n’est seulement dans un acte de cadence rompue, ou après un accord de septieme diminuée, qu’elle monte diatoniquement. Quant à la descente diatonique, c’est une marche interdite à la basse fondamentale, ou tout au plus tolérée dans le cas de deux accords parfaits séparés par un repos, exprimé ou sous-entendu ; cette regle n’a point d’autre exception. Il est vrai que M. Rameau a fait descendre diatoniquement la basse fondamentale sous des accords de septieme, mais nous en dirons la raison aux mots Cadence & Dissonance.
Qu’on retourne comme on voudra une basse fondamentale ; si elle est bien faite on n’y trouvera jamais que ces deux choses : ou des accords parfaits sur les mouvemens consonans, sans lesquels ces accords n’auroient point de liaison ; ou des accords dissonans dans des actes de cadence ; en tout autre cas, la dissonance ne sauroit être ni bien placée ni bien sauvée.
Il s’ensuit de-là que la basse fondamentale ne peut jamais marcher que d’une de ces trois manieres : 1.o monter ou descendre de tierce ou de sixte ; 2.o de quarte ou de quinte ; 3.o monter diatoniquement au moyen de la dissonance qui forme la liaison, ou par licence sur un accord parfait. Toute autre marche de la basse fondamentale est mauvaise.
Quoique la basse fondamentale doive régner généralement au-dessous de la basse continue, il est pourtant des cas où celle-ci descend au-dessous de la fondamentale ; tels sont ceux des accords par supposition, ainsi appellés, parce que la basse continue suppose au-dessous de l’accord un nouveau son qui n’est point de cet accord, qui en excede les bornes, & qui ainsi se trouve au-dessous de la basse fondamentale. Voyez Supposition.
La basse fondamentale, qui n’est faite que pour servir de preuve à l’harmonie, se retranche dans l’exécution, & souvent elle y feroit un fort mauvais effet. Elle produiroit tout-au-moins une monotonie très-ennuyeuse par les retours fréquens du même accord, qu’on deguise & qu’on varie plus agréablement, en le combinant différemment sur la basse continue. (S)
En général, les regles rigoureuses de la basse fondamentale peuvent se reduire à celles-ci.
1.o Il doit toûjours y avoir au moins un son commun dans l’harmonie de deux sons fondamentaux consécutifs. Voyez Liaison.
2.o Dans toute dominante la dissonance doit être préparée, à moins que la dominante ne soit tonique.
3.o Toute dominante doit descendre de quinte, & toute sous-dominante doit monter de quinte. V. Dissonance, Dominante, Sous-dominante, Préparer, &c. On trouvera à ces articles les raisons de ces regles.
Au reste la basse fondamentale prend quelquefois des licences ; on peut mettre de ce nombre les accords de septieme diminuée, & les cadences rompues, dont on peut cependant donner la raison. Voyez Septieme diminuée & Cadence
Regles de la basse continue. La basse continue n’est qu’une basse fondamentale, renversée pour être plus chantante. Ainsi dès que la basse fondamentale est faite, on trouvera une basse continue par le renversement des accords. Voyez Accord. Par exemple, cette basse fondamentale monotone ut sol ut sol ut sol ut, peut donner cette basse continue plus chantante ut si ut ré mi fa mi. La basse continue n’est obligée de se conformer à la basse fondamentale, que lorsqu’elle approche des cadences, ou qu’elle s’y termine. La basse continue admet aussi les accords par supposition. Voyez Accord & Supposition. Toute note qui porte dans la basse continue l’accord de fausse quinte, doit monter ensuite diatoniquement ; & toute note qui porte l’accord de triton, doit descendre diatoniquement. Voyez Fausse-quinte & Triton. On trouvera les raisons de toutes ces regles à leurs différens articles.
Regles que doit observer le dessus par rapport à la basse fondamentale. Toute note du dessus qui fait dissonance avec la note qui lui répond dans la basse fondamentale, doit être préparée & sauvée. Voyez Harmonie, Dessus, Composition, Préparer, Sauver, &c.
La connoissance de la basse fondamentale, ou la regle pour trouver la basse fondamentale d’un chant donné, dépend beaucoup de celle du mode, ou de la modulation. Voyez Mode. (O)
Basse de Viole, instrument de Musique. Voyez Viole, & la table du rapport & de l’étendue des instrumens de Musique. Cet instrument a sept cordes, dont la plus grosse à vuide est à l’unisson du la du ravalement des clavecins, ou du la du 16 pié. La plus petite ou la chanterelle, est à l’unisson du ré qui suit immédiatement la clef de c sol ut.
Basse de Flûte à bec, instrument dont la figure & la tablature est entierement semblable à celle de la flûte-à-bec décrite à son article, dont la basse ne differe qu’en grandeur. Cet instrument sonne l’octave au-dessous de la flûte-à-bec, appellée taille. Son ton le plus grave est à l’unisson du fa de la clef f ut fa des clavecins, & il a une 13e d’étendue jusqu’au ré à l’octave de celui qui suit immédiatement la clé de c sol ut. Voyez la table du rapport de l’étendue des instrumens de Musique.
Basse de Flûte traversiere, représentée Pl. IX. de Lutherie, fig. 34. & suiv. est un instrument qui sonne la quinte au-dessous de la flûte traversiere, & qui lui est en tout semblable, à cela près, qu’il est plus grand, & qu’il est courbé dans la premiere partie, pour que l’embouchure a soit plus près de l’endroit où il faut poser les mains. Le coude B qui joint la piece où est l’embouchure avec le reste de l’instrument, est un tuyau de laiton qui entre par chacune de ses extrémités dans des boîtes ou noix pratiquées aux extrémités des pieces qu’il faut joindre. Les trous 1, 2, 3, 4 & 6 auxquels les doigts ne sauroient atteindre, vû la grandeur de l’instrument, se bouchent avec les clés que l’on voit vis-à-vis. Ces clés sont tellement fabriquées, que lorsqu’elles sont abandonnées à leurs ressorts, elles laissent les trous qui sont vis-à-vis, ouverts, & que lorsque l’on appuie dessus avec un doigt, ils sont fermés, la soupape de ces clés étant entre la charniere & le point où on applique le doigt ; au lieu qu’à la clef du mi b mol, c’est la charniere qui est entre la soûpape & l’endroit où on pose le doigt. Cet instrument sert de basse dans les concerts de flûte. Son ton le plus grave est à l’unisson du sol qui se trouve entre la clé de f ut fa & de c sol ut des clavecins ; ce qui est, comme on a dit ci-devant, une quinte au-dessous des flûtes ordinaires qui ont deux piés de long. Voyez Flûte traversiere, & la tablature de cet instrument, qui sert pour celui-ci, observant toutefois de commencer par le sol 5e. On façonne cet instrument qui est de bouis ou de quelqu’autre bois dur, sur le tour, comme tous les autres instrumens à vent. Voyez l’article Flûte traversiere & Tour à lunette, & la table du rapport & de l’étendue des instrumens de Musique.
Basse des Italiens, c’est le même instrument que celui que nous appellons basse de violon. Voyez Basse de Violon. Avec cette différence qu’ils l’accordent une tierce mineure plus bas, ensorte que le son le plus grave de cet instrument sonne l’unisson de l’a mi la du 16 pié. Voyez la table du rapport de l’étendue de tous les instrumens de Musique.
Basse de violon, instrument de Musique en tout semblable au violon, à l’exception des oüies, qui sont en C, au lieu qu’au violon elles sont en S, & en ce qu’il est beaucoup plus grand, & qu’on le tient entre ses jambes pour en joüer. On le construit sur le moule représenté fig. 2. Pl. XII. de Lutherie. Voyez Violon & Viole.
Cet instrument sonne l’octave au-dessous de la quinte de violon & la douzieme au-dessous du violon, & l’unisson des basses du clavecin depuis le c sol ut double octave au-dessous de celui de la clé de c sol ut ou l’unisson du huit pié ouvert. Voyez la table du rapport de l’étendue des instrumens de Musique.
Basse ou Calade, s. f. (Manége.) pente douce d’une colline, sur laquelle on accoûtume un cheval à courir au galop, pour lui apprendre à plier les jarrets. (V)
Basse-contre, s. f. acteur qui dans les chœurs de l’opéra & autres concerts chante la partie de basse-contre.
Il y a peu de basse-contres à l’opéra ; l’harmonie des
chœurs y gagneroit, s’il y en avoit un plus grand
nombre. (B)
Basse-cour, s. f. terme d’Architecture ; on appelle ainsi, dans un bâtiment construit à la ville, une cour séparée de la principale, autour de laquelle sont élevés des bâtimens destinés aux remises, aux écuries, ou bien où sont placés les cuisines, offices, communs, &c. Ces basses-cours doivent avoir des entrées de dégagement par les dehors, pour que le service de leurs bâtimens se puisse faire commodément & sans être apperçû des appartemens des maîtres & de la cour principale.
Pour l’ordinaire ces basses-cours ont des issues dans la principale cour ; mais la largeur des portes qui leur y donnent entrée s’accordant mal avec l’ordonnance d’un bâtiment régulier, il est mieux que les équipages, après avoir amené les maîtres près le vestibule, s’en retournent par les dehors pour aller à leur destination.
On appelle à la campagne basse-cour, non-seulement celles qui servent aux mêmes usages dont nous venons de parler, mais aussi celles destinées au pressoir, sellier, bûcher, ainsi que celles des bestiaux, des grains, &c. (P)
Basse-eau, ou Basse-mer (Marine) ; se dit de la mer retirée, & lorsque l’eau n’est pas plus haute qu’elle étoit avant que la mer commençât à monter, ce qui est entierement opposé à plaine mer. (Z)
Basse-enceinte, s. f. c’est la même chose que la fausse-braie, en terme de Fortification. V. Fausse-braie. (Q)
Basse-justice. (Jurisprudence.) Voyez Justice, & Fonciere. V. aussi ci-dessus Bas-justicier. (H)
Basse-taille, s. m. acteur de l’opéra ou d’un concert qui chante les rôles de basse-taille. Voy. Basse.
Ces rôles ont été les dominans ou en sous-ordre, dans les opéra, selon le plus ou le moins de goût que le public a montré pour les acteurs qui en ont été chargés.
La basse-taille étoit à la mode pendant tout le tems que Thevenard a resté au théatre : mais les compositeurs d’à present font leurs rôles les plus brillans pour la haute-contre.
Les rôles de Roland, d’Egée, d’Hidraot, d’Amadis de Grece, &c. sont des rôles de basse-taille.
On appelle Tancrede l’opéra des basse-tailles, parce qu’il n’y a point de rôles de haute-contre, & que ceux de Tancrede, d’Argant & d’Ismenor sont des rôles fort beaux de basse-taille.
Les Magiciens, les Tyrans, les Amans haïs sont pour l’ordinaire des basses-tailles ; les femmes semblent avoir décidé, on ne sait pourquoi, que la haute-contre doit être l’amant favorisé, elles disent que c’est la voix du cœur ; des sons mâles & forts allarment sans doute leur délicatesse. Le sentiment, cet être imaginaire dont on parle tant, qu’on veut placer par-tout, qu’on décompose sans cesse sans l’éprouver, sans le définir, sans le connoître, le sentiment a prononcé en faveur des hautes-contre. Lorsqu’une basse-taille nouvelle se sera mise en crédit, qu’il paroîtra un autre Thevenard, ce système s’écroulera de lui-même, & vraissemblablement on se servira encore du sentiment pour prouver que la haute-contre ne fut jamais la voix du cœur. V. Haute-contre. (B)
Basses-voiles, c’est ainsi qu’on appelle en Marine, la grande voile & celle de misene ; quelques-uns y ajoûtent l’artimon, qui ne doit pas y être compris quand on dit amarez les basses-voiles ; car l’artimon n’a point de coüets. (Z)
BASSÉE s. f. (Commerce.), mesure dont on se sert en quelques lieux d’Italie, pour mesurer les liquides. La bassée de Verone est la sixieme partie de la brinte. Voyez . (G)
* Bassée (la), Géog. ville des Pays-Bas François, au comté de Flandre, sur les confins de l’Artois, & sur un canal qui se rend dans la Deule. Longit. 20. 30. lat. 50. 53.
BASSE-LISSE. Voyez Lisse.
* BASSEMPOIN (Géog.), petite ville de France, dans la Gascogne.
* BASSENTO (Géog.), riviere de la Calabre citérieure, qui passe à Cosenze, & se joint au Grate.
* BASSESSE, abjection (Gramm.) termes synonymes, en ce qu’ils marquent l’un & l’autre l’état où l’on est : mais si on les construit ensemble, dit M. l’abbé Girard, abjection doit précéder bassesse, & la délicatesse de notre langue veut que l’on dise, état d’abjection, bassesse d’état.
L’abjection se trouve dans l’obscurité où nous nous enveloppons de notre propre mouvement, dans le peu d’estime qu’on a pour nous, dans le rebut qu’on en fait, & dans les situations humiliantes où l’on nous réduit. La bassesse, continue le même auteur, se trouve dans le peu de naissance, de mérite, de fortune & de dignité.
Observons ici combien la langue seule nous donne de préjugés, si la derniere reflexion de M. l’abbé Girard est juste. Un enfant, au moment où il reçoit dans sa mémoire le terme bassesse, le reçoit donc comme un signe qui doit réveiller pour la suite dans son entendement les idées de défaut de naissance, de mérite, de fortune, de condition, & de mépris : soit qu’il lise, soit qu’il écrive, soit qu’il médite, soit qu’il converse, il ne rencontrera jamais le terme bassesse, qu’il ne lui attache ce cortége de notions fausses ; & les signes grammaticaux ayant cela de particulier, en morale sur-tout, qu’ils indiquent non seulement les choses, mais encore l’opinion générale que les hommes qui parlent la même langue, en ont conçûe, il croira penser autrement que tout le monde & se tromper, s’il ne méprise pas quiconque manque de naissance, de dignités, de mérite & de fortune ; & s’il n’a pas la plus haute vénération pour quiconque a de la naissance, des dignités, du mérite & de la fortune ; & mourra peut-être, sans avoir conçû que toutes ces qualités étant indépendantes de nous, heureux seulement celui qui les possede ! Il ne mettra aucune distinction entre le mérite acquis & le mérite inné ; & il n’aura jamais sû qu’il n’y a proprement que le vice qu’on puisse mépriser, & que la vertu qu’on puisse loüer.
Il imaginera que la nature a placé des Êtres dans l’élévation, & d’autres dans la bassesse ; mais qu’elle ne place personne dans l’abjection ; que l’homme s’y jette de son choix, ou y est plongé par les autres ; & faute de penser que ces autres sont pour la plûpart injustes & remplis de préjugés, la différence mal-fondée que l’usage de sa langue met entre les termes bassesse & abjection, achevera de lui corrompre le cœur & l’esprit.
La piété, dit l’auteur des Synonymes, diminue les amertumes de l’état d’abjection. La stupidité empêche de sentir tous les desagrémens de la bassesse d’état. L’esprit & la grandeur d’ame font qu’on se chagrine de l’un, & qu’on rougit de l’autre.
Et je dis moi que les termes abjection, bassesse, semblent n’avoir été inventés que par quelques hommes injustes dans le sein du bonheur, d’où ils insultoient à ceux que la nature, le hasard, & d’autres causes pareilles n’avoient pas également favorisés ; que la Philosophie soûtient dans l’abjection où l’on est tombé, & ne permet pas de penser qu’on puisse naître dans la bassesse ; que le philosophe sans naissance, sans bien, sans fortune, sans place, saura bien qu’il n’est qu’un être abject pour les autres hommes, mais ne se tiendra point pour tel ; que s’il sort de l’état prétendu de bassesse qu’on a imaginé, il en sera tiré par son mérite seul ; qu’il n’épargnera rien pour ne pas tomber dans l’abjection, à cause des inconvéniens physiques & moraux qui l’accompagnent ; mais que s’il y tombe, sans avoir aucun mauvais usage de sa raison à se reprocher, il ne s’en chagrinera guere & n’en rougira point. Il y a qu’un moyen d’éviter les inconvéniens de la bassesse d’état & les humiliations de l’abjection, c’est de fuir les hommes, ou de ne voir que ses semblables. Le premier me semble le plus sûr, & c’est celui que je choisirois.
BASSETS, s. f. pl. (Chasse) ce sont des chiens pour aller en terre. Ils ont les oreilles longues, le corps long, ordinairement le poil roux, les pattes cambrées en dedans, & le nez exquis.
BASSETTE, s. f. sorte de jeu de carte qui a été autrefois fort à la mode en France ; mais il a été défendu depuis, & il n’est plus en usage aujourd’hui. En voici les principales regles.
A ce jeu, comme à celui du pharaon (Voyez Pharaon) le banquier tient un jeu entier composé de 52 cartes. Il les mêle, & chacun des autres joüeurs qu’on nomme pontes, met une certaine somme sur une carte prise à volonté. Le banquier retourne ensuite le jeu, mettant le dessus dessous ; ensorte qu’il voit la carte de dessous : ensuite il tire toutes ses cartes deux à deux jusqu’à la fin du jeu.
Dans chaque couple ou taille de cartes, la premiere est pour le banquier, la seconde pour le ponte, c’est-à-dire que si le ponte a mis par exemple sur un roi, & que la premiere carte d’une paire soit un roi, le banquier gagne tout ce que le ponte a mis d’argent sur son roi : mais si le roi vient à la seconde carte, le ponte gagne, & le banquier est obligé de donner au ponte autant d’argent, que le ponte en a mis sur sa carte.
La premiere carte, celle que le banquier voit en retournant le jeu, est pour le banquier, comme on vient de le dire : mais il ne prend pas alors tout l’argent du ponte, il n’en prend que les , cela s’appelle facer.
La derniere carte, qui devroit être pour le ponte, est nulle.
Quand le ponte veut prendre une carte dans le cours du jeu, il faut que le banquier baisse le jeu, ensorte qu’on voye la premiere carte à découvert : alors si le ponte prend une carte (qui doit être différente de cette premiere) la premiere carte que tirera le banquier sera nulle pour ce ponte ; si elle vient la seconde, elle sera facée pour le banquier ; si elle vient dans la suite, elle sera en pure gain ou en pure perte pour le banquier, selon qu’elle sera la premiere ou la seconde d’une taille.
M. Sauveur a donné dans le Journal des Sçavans 1679, six tables, par lesqu’elles on peut voir l’avantage du banquier à ce jeu. M. Jacques Bernoulli a donné dans son Ars conjectandi l’analyse de ces tables, qu’il prouve n’être pas entierement exactes. M. de Montmort, dans son Essai d’analyse sur les jeux de hasard, a aussi calculé l’avantage du banquier à ce jeu. On peut donc s’instruire à fond sur cette matiere dans les ouvrages que nous venons de citer : mais pour donner là-dessus quelque teinture à nos lecteurs, nous allons calculer l’avantage du banquier dans un cas fort simple.
Supposons que le banquier ait six cartes dans les mains, & que le ponte en prenne une qui soit une fois dans ces six cartes, c’est-à-dire dans les cinq cartes couvertes : on demande quel est l’avantage du banquier.
Il est visible (Voyez Alternation & Combinaison) que les cinq cartes étant designées par a, b, c, d, e, peuvent être combinées en 120 façons différentes, c’est-à-dire en 5 fois 24 façons. Imaginons donc que ces 120 arrangemens soient rangés sur cinq colonnes de 24 chacune, de maniere que dans la premiere de ces colonnes a se trouve à la premiere place, que dans la seconde ce soit b qui occupe la premiere place, c dans la troisieme, &c.
Supposons que a soit la carte du ponte, la colonne où la lettre a occupe la premiere place, est nulle pour le banquier & pour les pontes.
Dans chacune des quatre autres colonnes la lettre a se trouve six fois à la seconde place, six fois à la troisieme, six fois à la quatrieme & six fois à la cinquieme, c’est-à-dire qu’en supposant A la mise du ponte, il y a 24 arrangemens qui font gagner au banquier, 24 qui le font perdre, c’est-à-dire qui lui donnent -A, 24 qui le font gagner, c’est-à-dire qui lui donnent A, & 24 enfin qui sont nuls. Cela s’ensuit des regles du jeu expliquées plus haut.
Or, pour avoir l’avantage d’un joüeur dans un jeu quelconque, il faut 1.o prendre toutes les combinaisons qui peuvent le faire gagner, ou perdre, ou qui sont nulles, & dont le nombre est ici 120. 2.o Il faut multiplier ce qu’il doit gagner (en regardant les pertes comme des gains négatifs) par le nombre des cas, qui le lui feront gagner ; ajoûter ensemble ces produits, & diviser le tout par le nombre total des combinaisons : voyez Jeu, Pari ; donc l’avantage du banquier est ici ; , c’est-à-dire que si le ponte a mis par exemple un écu sur sa carte, l’avantage du banquier est de d’écu, ou de huit sous.
M. de Montmort calcule un peu différemment l’avantage du banquier : mais son calcul quoique plus long que le précédent revient au même dans le fond. Il remarque que la mise du banquier étant égale à celle du ponte, l’argent total qui est sur le jeu, avant que le sort en ait décidé, est 2 A ; dans les cas nuls, le banquier ne fait que retirer son enjeu, & le ponte, le sien, ainsi le banquier gagne A : dans le cas où il perd, son gain est 0 ; dans les cas facés, il retire ; dans les cas qui sont pur gain, il retire 2 A ; ainsi le sort total du banquier, ou ce qu’il peut espérer de retirer de la somme 2 A est & comme il a mis A au jeu ; il s’ensuit que est ce qu’il peut espérer de gagner, ou son avantage. Voyez Avantage.
M. de Montmort examine ensuite l’avantage du banquier lorsque la carte du ponte se trouve, deux, ou trois, ou quatre fois, &c. dans les cartes qu’il tient. Mais c’est un détail qu’il faut voir dans son livre même. Cette matiere est aussi traitée avec beaucoup d’exactitude dans l’ouvrage de M. Bernoulli que nous avons cité.
A ce jeu, dit M. de Montmort, comme à celui du pharaon, le plus grand avantage du banquier, est quand le ponte prend une carte qui n’a point passé, & son moindre avantage quand le ponte en prend une qui a passé deux fois. Voyez Pharaon ; son avantage est aussi plus grand, lorsque la carte du ponte a passé trois fois, que lorsqu’elle a passé seulement une fois.
M. de Montmort trouve encore que l’avantage du banquier à ce jeu est moindre qu’au pharaon ; il ajoûte que si les cartes facées ne payoient que la moitié de la mise du ponte, alors l’avantage du banquier seroit fort peu considérable ; & il dit avoir trouvé, que le banquier auroit du désavantage si les cartes facées ne payoient que le tiers. (O)
BASSICOT, s. m. c’est ainsi qu’on appelle dans les carrieres d’ardoise, une espece d’auge, dont on se sert pour sortir les morceaux d’ardoise du fond de la carriere. Voyez à l’article Ardoise, l’usage & la description de ce vaisseau.
BASSIERS, s. m. pl. (en terme de riviere) espece d’amas de sable dans une riviere, qui empêche la navigation. Il y en a un au bout du Cours-la-reine.
BASSIGNI (le) (Géog.) petit pays de France, dans la partie méridionale de la Champagne, & dans le Barrois, dans le dioc. de Langres & celui de Toul.
BASSIN, s. m. se dit en général ou d’un réservoir d’eau, ou d’un vaisseau destiné à en puiser ou à en contenir. Voy. ci-dessous des définitions & des exemples des différentes sortes de bassins.
Bassin (en Architecture), c’est dans un jardin un espace creusé en terre, de figure ronde, ovale, quarrée, à pans, &c. revêtu de pierre, de pavé, ou de plomb, & bordé de gason, de pierre ou de marbre, pour recevoir l’eau d’un jet, ou pour servir de réservoir pour arroser. Les Jardiniers appellent bac, un petit bassin avec robinet, comme il y en a dans tous les petits jardins du potager à Versailles.
Bassin de fontaine, s’entend de deux manieres, ou de celui qui est seulement à hauteur d’appui au-dessus du rez-de-chaussée d’une cour ou d’une place publique : ou de celui qui est élevé sur plusieurs degrés, avec un profil riche de moulures & de forme réguliere, comme ceux de la place Navone à Rome.
Bassin figuré, est celui dont le plan a plusieurs corps ou retours droits, circulaires ou à pans, comme ceux de la plûpart des fontaines de Rome.
Bassin à balustrade, celui dont l’enfoncement plus bas que le rez-de-chaussée, est bordé d’une balustrade de pierre, de marbre ou de bronze, comme le bassin de la fontaine des bassins d’Apollon à Versailles.
Bassin à rigole, celui dont le bord de marbre ou de caillou, a une rigole taillée, d’où sort d’espace en espace un jet ou bouillon d’eau, qui garnit la rigole, & forme une nappe à l’entour de la balustrade, comme à la fontaine du rocher de Belvéder à Rome.
Bassin en coquille, celui qui est fait en conque ou coquille, & dont l’eau tombe par nappes ou gargouilles, comme la fontaine de Palestrine à Rome.
Bassin de décharge, c’est dans le plus bas d’un jardin, une piece d’eau ou canal, dans lequel se déchargent toutes les eaux après le jeu des fontaines, & d’où elles se rendent ensuite par quelque ruisseau ou rigole dans la plus prochaine riviere.
Bassin de partage ou de distribution, c’est dans un canal fait par artifice, l’endroit où est le sommet du niveau de pente, & où les eaux se joignent pour la continuité du canal. Le repaire où se fait cette jonction est appellé point de partage. Il y en a un beau à Versailles au-dessus des réservoirs du parc au cerf, & un autre à Chambly, appellé le bassin des sources.
Bassin de port de mer, c’est un espace bordé de gros murs de maçonnerie, où l’on tient des vaisseaux à flot. Voyez plus bas Bassin (Marine.)
Bassin de bain, c’étoit dans une salle de bain chez les anciens, un enfoncement quarré long où l’on descendoit par degrés pour se baigner ; c’est ce que Vitruve appelle labrum.
Bassin à chaux, vaisseau bordé de maçonnerie, & plancheyé de dosses ou maçonné de libages, dans lequel on détrempe la chaux. Mortarium dans Vitruve, signifie autant le bassin que le mortier. (P)
Construction des bassins des Jardins. On ne sauroit apporter trop de soin à la construction des bassins & pieces d’eau ; la moindre petite fente qui augmente toûjours de plus en plus, peut devenir, par la pesanteur de l’eau, une fente considérable.
On place ordinairement les bassins à l’extrémité ou dans le milieu d’un parterre : ils ne font pas moins bien dans un potager, dans une orangerie & dans les bosquets. Leur forme ordinaire est la circulaire, il y en a cependant d’octogones, de longs, d’ovales, & de quarrés : quand ils passent une certaine grandeur, ils se nomment pieces d’eau, canaux, miroirs, viviers, étangs & réservoirs.
Pour la grandeur des bassins, on ne peut guere déterminer de juste proportion, elle dépend du terrein ; & celle qui est entre le jet & le bassin, est déterminée par la chûte & la force des eaux : leur profondeur ordinaire est de 15 à 18 pouces, ou deux piés tout au plus, & s’augmente quand ils servent de réservoirs.
On construit les bassins de quatre manieres, en glaise, en ciment, en plomb, & en terre franche : soit le bassin A (fig. 1. Jardin.) qu’on veut construire en glaise, de six toises de diametre dans œuvre ; faites ouvrir la place tracée sur le terrein, de ce qu’il convient pour les épaisseurs du pourtour & du plafond ; le mur de terre B doit avoir un pié au moins ; le mur de douve, ou d’eau C, dix-huit pouces, & le corroi de glaise entre-deux, dix-huit de large, ce qui fait en tout quatre piés, dont il faut augmenter de chaque côté le diametre pour la fouille : on a donc huit piés en tout ; on creusera aussi, pour le fond ou plat-fond du bassin, deux piés plus bas que la profondeur qu’on lui voudra donner ; ces deux piés de fouille seront pareillement occupés par le corroi de glaise de dix-huit pouces, & les autres six pouces seront pour le sable & le pavé qu’on répandra dessus la glaise ; ainsi ce bassin creuse de sept toises deux piés de diametre, & de quatre piés de bas, reviendra à six toises d’eau dans œuvre, & deux piés de creux, qui sont l’étendue & la profondeur requises. Elevez & adossez, contre les terres, le mur B d’un pié d’épaisseur depuis le bas de la fouille, jusqu’à fleur de terre ; bâtissez de moellons, libages, ou pierres de meuliere avec du mortier de terre ; faites ensuite apporter la glaise dans le fond du bassin, que vous préparerez en la rompant par morceaux, en y jettant de l’eau, & la labourant deux ou trois fois sans y souffrir aucunes ordures ; faites ensuite jetter par pelletées la glaise contre le mur, & pétrir à piés nuds, de dix-huit pouces d’épaisseur, & de sept à huit piés environ de large, tout au pourtour de ce mur, pour y poser, à dix-huit pouces de distance, le mur de douve C, qui doit porter sur une plate-forme & racinaux DD. Prenez du chevron de trois pouces d’épaisseur, ou des bouts de planches de bateau, épais de deux pouces, & larges de cinq à six ; enfoncez-les à fleur de glaise, de trois piés en trois piés, ensorte qu’ils débordent un peu le parement du mur en dedans le bassin, c’est ce que l’on nomme les racinaux ; mettez ensuite dessus de longues planches de bateau dont deux, jointes ensemble, seront de la largeur du mur, lesquelles vous cloüerez ou chevillerez sur les racinaux ; vous poserez ensuite la premiere assise du mur de douve, que vous éleverez à la hauteur de l’autre, & de dix-huit pouces d’épaisseur, bâti avec du mortier de chaux & sable. On remplira le vuide, ou l’espace entre les deux murs E, appellé le corroi, d’une glaise bien préparée, & on la pétrira jusqu’à fleur de terre.
Pour travailler au plat-fond F, on remplira de glaise toute l’étendue du bassin pour y faire un corroi de dix-huit pouces de haut, en recommençant à pétrir les glaises que l’on a d’abord étendues au-delà des racinaux, & les liant avec celles du plat-fond, qu’on couvrira ensuite de sable, de cinq à six pouces de hauteur, avec un pavé garni d’une aire GG, d’un pouce d’épaisseur de ciment, ou une blocaille de pierres plates posées de champ & à sec dans le sable pour nettoyer plus proprement le bassin, & empêcher le poisson de fouiller.
Les bassins de ciment (fig. 2.) sont construits d’une maniere bien différente. On recule la trace du bassin, d’un pié neuf pouces dans le pourtour, & autant dans le plat-fond, ce qui est suffisant pour retenir l’eau ; ainsi pour un bassin de six toises de diametre, on fouillera six toises trois piés & demi, & on creusera un pié neuf pouces plus bas que la profondeur qu’on a dessein de lui donner. Elevez & adossez contre la terre le mur de maçonnerie H, depuis le fond jusqu’au niveau de la terre, & bâti de moellons & libages, avec du mortier de chaux & sable tout autour ; ensuite commencez le massif du fond I, d’un pié d’épaisseur, & construit des mêmes matériaux & mortier ; on joindra au mur, & au plat-fond, un massif ou chemise de ciment K, de neuf pouces d’épaisseur bâti de petits cailloux de vigne mis par lits, & couverts de mortier de chaux & ciment, qu’il ne faut point épargner, de maniere que les cailloux ne se touchent point, & regorgent de mortier partout ; il faudra enduire le tout avec du mortier plus fin, c’est-à-dire, avec du ciment passé au sas avant que de le délayer avec la chaux, unir cet enduit avec la truelle, & le frotter ensuite plusieurs jours avec de l’huile.
Les bassins de plomb (fig. 3.) n’ont de singulier, dans leur construction, que les murs faits du mortier de plâtre, parce que la chaux mine le plomb ; on fera le mur de terre L, du double d’épaisseur de celui du plat-fond M, & l’on assûrera dessus ces murs les talles de plomb n, n, n, qui seront jointes ensemble avec des nœuds de soudure o, o, o.
Les bassins en terre franche sont à peu près construits comme ceux de glaise, à l’exception que les corrois seront plus larges, ayant trois & quatre piés, & les murs d’un pié & demi ou deux, seront en mortier de terre seulement, & fondés sur la masse de terre franche qui regne dans tout le terrein. Ces bassins se peuvent faire avec un seul mur du côté de l’eau, en délayant la terre franche sur le bord, & la coulant dans le corroi.
On aura soin d’entourer le pourtour des bassins, de bordures de gason, afin de préserver les corrois de l’ardeur du soleil. (K)
Bassin (Marine.) on donne ce nom, dans les ports de mer, au lieu où l’on retire les vaisseaux pour les mettre plus à l’abri, les radouber, les armer & desarmer avec plus de facilité, ou y faire les réparations nécessaires. Voyez Pl. VII. fig. 1. Mar. un bassin coté AA, & sa disposition au milieu de l’arsenal. Il y a deux sortes de bassins ; les uns qu’on peut emplir & mettre à sec à volonté, au moyen d’une écluse qui en ferme l’entrée ; & d’autres qui sont tout ouverts, & dont le fond étant de vase molle, se remplit d’eau quand la mer monte, & se vuide quand elle descend. Voyez Darse. (Z)
Bassin, en terme d’Anatomie, est la partie la plus inférieure de la cavité de l’abdomen : il est ainsi appellé de sa ressemblance à un bassin ou à une aiguiere, appellée pelvis en Latin. Voyez Abdomen.
Le bassin est toûjours plus large ou plus grand dans les femmes que dans les hommes, pour faire place à l’accroissement du fœtus. Voyez Matrice.
Cette cavité est très-bien fortifiée par les os, pour mettre à couvert des injures du dehors les parties qui y sont contenues. Le bassin est formé ou environné par les os des hanches, le coccyx, & l’os sacrum. Voyez Hanche, Coccyx.
Le bassin des reins est un grand sinus ou cellule membraneuse dans la partie concave des reins. Voy. l’article Anat. les Planch. & leur explic. Voy. Reins. Des douze mammelons des reins sortent douze canaux appellés tuyaux membraneux, fistulæ membranaceæ ; ils se réunissent ensuite en trois grosses branches, d’où enfin il en résulte une seule qui forme le bassin ; ce bassin venant encore à se contracter, se termine en un canal membraneux appellé l’urétere. Voy. Mammelon & Uretere.
L’urine étant séparée du sang par les canaux urinaires, auxquels elle a été apportée par les mammelons, les tuyaux membraneux la reprennent pour la reporter dans le bassin, d’où elle se décharge dans l’urétere, & de-là dans la vessie, &c. Voy. Urine, &c.
Bassin oculaire, instrument de Chirurgie, petite soûcoupe ovale très-commode pour laver l’œil. Sa matiere est d’argent ; sa construction consiste en une petite gondole qui a environ un pouce cinq lignes de long, sur dix ou onze lignes de diametre, plus élevé par les angles que dans le milieu, afin de s’accommoder à la figure globuleuse de l’œil : elle n’a pas plus de cinq lignes de profondeur, & est montée sur un pié artistement composé, comme on peut le voir dans la fig. 16. Pl. XXIII. ce pié a environ deux ou trois pouces de hauteur.
Pour se servir de cet instrument, il faut le remplir à moitié de la liqueur avec laquelle on veut bassiner l’œil, puis on le prend par le pié, & l’on baisse la tête, afin de faire entrer le globe de l’œil dans la soûcoupe, qui est construite de façon à occuper toute la circonférence de la cavité orbitaire : on ouvre ensuite l’œil, & la liqueur contenue dans ce bassin le mouille parfaitement.
Fabrice d’Aqua-pendente, célebre Medecin-Chirurgien, & professeur d’Anatomie à Padoue, a le premier imaginé l’application des remedes aqueux sur l’œil : il se servit d’abord de ventouses communes que l’on tenoit sur l’œil avec la main, comme le bassin oculaire dont on vient de parler ; ce qu’il remarqua être fort incommode : il en fit faire avec des anses sur chaque côté, dans lesquelles on passoit un cordon pour attacher le vase derriere la tête. Ces petits vaisseaux de crystal faits de façon à s’appliquer exactement sur la circonférence de l’orbite, lui parurent exiger encore une perfection ; car les liqueurs tiedes faisant transpirer la partie, & la matiere de cette transpiration ne trouvant aucune issue, l’œil & les parties qui l’avoisinent pouvoient se gonfler par l’usage de ces remedes. Pour prévenir les fluxions, & autres accidens qui seroient l’effet du défaut de transpiration, il fit ajoûter au-dessus de la gondole un petit tuyau percé, par lequel on pût aussi verser les liqueurs convenables au moyen d’un entonnoir, après avoir mis le vase en situation. L’auteur la nomme phiole oculaire, & assûre avoir dissipé des cataractes commençantes par l’usage des remedes convenables appliqués par le moyen de cet instrument. (Y)
Bassin (vente au) Comm. nom que l’on donne à Amsterdam aux ventes publiques qui se font par autorité de justice, & où préside un officier commis par les bourgue-mestres, qu’on nomme vendu-meester, c’est-à-dire, maître de la vente. On appelle cette vente vente au bassin, parce qu’avant que de délivrer les lots ou cavelins au plus offrant & dernier enchérisseur, on frappe ordinairement sur un bassin de cuivre, pour avertir qu’on va adjuger. Voyez Vendu-meester. (G)
Bassins d’une balance, sont deux especes de plats qu’on suspend au bout des bras d’une balance, & dans lesquels on met les poids qu’on veut peser. V. Balance. (O)
Bassin, terme de Boulanger, est une espece de casserole à queue de tole blanche, ou fer-blanc épais, dont on se sert pour puiser l’eau dans la chaudiere, & la mettre dans le pétrin en quantité convenable. Voy. Pl. du Boulanger, fig. 4.
Bassin, instrument de Chapelier, c’est une grande plaque ronde de fer ou de fonte, qui se place sur un fourneau, pour bâtir les étoffes dont on compose les chapeaux.
Les Chapeliers ont aussi des bassins à dresser les bords des chapeaux : ces bassins ont au milieu une ouverture ronde, assez grande pour y faire entrer les formes les plus larges. Ces bassins sont ordinairement de plomb, & ont par-dessus deux mains, afin que le chapelier puisse les mettre sur les bords des chapeaux, & les enlever facilement. V. Chapeau. Voyez la fig. 4. Pl. du Chapelier.
Bassin a barbe, est une espece de plat creux, rond, & quelquefois ovale, dont les Barbiers-Perruquiers se servent pour savonner le visage des personnes qu’ils rasent. Ce plat est toûjours échancré par un de ses côtés, afin de pouvoir être serré près du cou de la personne qu’on savonne, de peur que l’eau de savon qui tombe du visage ne coule le long du cou & sur les habits.
Les bassins à barbe se font de plusieurs sortes de matieres ; il y en a de fayence, de porcelaine, d’étain, de cuivre, d’argent, &c. Voyez sa fig. Plan. du Perruquier.
Bassin, s. m. (Lunetier.) les Miroitiers-Lunetiers se servent de divers bassins de cuivre, de fer ou de métal composé, les uns grands, les autres plus petis, ceux-ci plus profonds, ceux-là moins, suivant le foyer des verres qu’ils veulent travailler. Voyez les fig. 1. & 2. Pl. du Lunetier ; la premiere représente un bassin de six pouces de foyer ; B le bassin, A son profil : la seconde représente un bassin de trois pouces de foyer ; B est le bassin, & C son profil. Ces bassins sont représentés dans les figures scellées sur la table de l’établi.
C’est dans ces bassins que se font les verres convexes : les spheres, qu’on nomme autrement des boules, servent pour les verres concaves ; & le rondeau, pour les verres dont la superficie doit être plane & unie. Voyez ces deux derniers outils à leurs lettres.
On travaille les verres au bassin de deux manieres : pour l’une l’on attache le bassin à l’arbre d’un tour, & l’on y use la piece, qui tient avec du ciment à une molette de bois, en la présentant & la tenant ferme de la main droite dans la cavite du bassin, tandis qu’on lui donne avec le pié un mouvement convenable : pour l’autre, on affermit le bassin sur un billot ou sur un établi, n’y ayant que la molette garnie de son verre qui soit mobile. Les bassins pour le tour sont petits, & ne passent guere six à sept pouces de diametre : les autres sont très-grands, & ont plus de deux piés de diametre.
Pour dégrossir les verres qu’on travaille au bassin, on se sert de grès & de gros émeri : on les adoucit avec les mêmes matieres, mais plus fines, & tamisées : le tripoli & la potée servent à les polir : enfin on en acheve le poliment au papier, c’est-à-dire, sur un papier qu’on colle au fond du bassin. Quelques-uns appellent ces bassins des moules, mais improprement. Voyez Miroitier & Lunette.
La maniere la plus convenable pour faire ces bassins, est le fer & le laiton, l’un & l’autre le plus doux qu’on puisse trouver : car comme ils doivent être formés sur le tour, la matiere en doit être traitable & douce, mais pourtant assez ferme pour bien retenir sa forme dans le travail des verres. Ces deux sortes de matieres sont excellentes, & préférables à toutes les autres : le fer néanmoins est sujet à la rouille, & le laiton ou cuivre jaune à se piquer & verdir par les liqueurs acres & salées ; c’est pourquoi ces deux matieres demandent que les instrumens qui en sont faits soient proprement tenus, bien nettoyés & essuyés après qu’on s’en est servi. L’étain pur & sans alliage est moins propre pour le premier travail de verre qui est le plus rude, à cause que sa forme s’altere aisément : on peut cependant l’employer utilement après l’avoir allié avec la moitié d’étain de glace. Le métal allié, qu’on ne peut former au tour à cause de sa trop grande dureté, comme celui des cloches qui est composé d’étain & de cuivre, ne vaut rien pour les formes dont nous parlons.
On peut préparer ces deux matieres à recevoir la forme de deux manieres, suivant qu’elles sont malléables ou fusibles : elles demandent toutes deux des modeles sur lesquels elles puissent être formées, au moins grossierement d’abord, pour qu’on puisse ensuite les perfectionner au tour. La matiere malléable demande pour modele des arcs de cercle, faits de matiere solide sur les diametres des spheres desquelles on veut les former. Celle qui est fusible demande des modeles entiers de matiere aisée à former au tour ; comme de bois, d’étain, &c. pour en tirer des moules dans lesquels on puisse la jetter pour lui donner la forme la plus approchante de celle qu’on desire ; car il est ensuite fort aisé de la rendre réguliere, & de la perfectionner au tour.
Quoiqu’on puisse forger les formes de laiton ou cuivre jaune à froid au marteau, je conseille cependant de les mouler en fonte, & de leur donner même une épaisseur convenable à la grandeur de la sphere dont on veut les former, aussi bien qu’à la largeur de la superficie qu’on veut leur donner : premierement à cause qu’étant forgées & écrouïes à froid, elles feroient aisément ressort sur leur largeur, & qu’elles altéreroient par ce moyen leur forme dans l’agitation du travail ; en second lieu, pour empêcher par cette épaisseur convenable que ce métal s’échauffant sur le tour, ne se roidisse contre l’outil, comme il fait pour l’ordinaire, se rejettant dehors avec violence jusqu’à s’applanir, ou même devenir convexe de concave qu’il étoit, s’il n’a pas une épaisseur suffisante pour résister à son effort.
Pour faire les modeles qui doivent servir à faire les moules de ces platines, on ne sauroit employer de meilleure matiere que l’étain, à cause qu’on peut le fondre avec peu de feu, & le tourner nettement sans altérer sa forme. Le bois néanmoins qui est plein, comme le poirier ou le chêne, qui est gras & moins liant étant bien sec, y peut servir assez commodément : pour l’empêcher même de s’envoiler, & de se déjetter à l’humidité de la terre ou du sable qui servent à les mouler, aussi-bien que dans les changemens de tems, il convient de l’enduire & imbiber d’huile de noix, de lin, ou d’olive au défaut de ces deux premieres, laissant doucement sécher ces modeles d’eux-mêmes, dans un lieu tempéré & hors du grand air.
La meilleure maniere de mouler ces modeles, est celle où l’on employe le sable. Tout cuivre n’est pas propre pour faire ces formes : on doit choisir celui qui est jaune, & qu’on nomme laiton doux ; on peut aussi se servir d’étain pur d’Angleterre, ou de celui d’Allemagne, allié avec moitié d’étain de glace. Le fer bien doux est aussi fort propre pour faire les bassins à travailler les verres.
M. Goussier a trouvé une méthode de donner aux bassins & aux moules dans lesquels il fond les miroirs de télescopes, telle courbure qu’il peut souhaiter, soit parabolique, elliptique, hyperbolique, ou autre dont l’équation est donnée. Cette méthode sera expliquée dans un ouvrage particulier qu’il doit donner au public, sur l’art de faire de grands télescopes de réflexion, d’en mouler les miroirs, de maniere qu’ils sortent du moule presque tout achevés.
Nous allons expliquer la machine dont il se sert pour concaver les formes ou bassins concaves de courbure sphérique : cette machine est la même que celle dont il se sert pour donner aux bassins ou aux moules toute autre courbure, en y faisant seulement quelques additions dont nous donnerons l’idée à la fin de cet article.
Cette machine représentée fig. 9-15. Pl. du Lunetier, est proprement un tour en l’air, dont l’axe FH est vertical ; il passe dans deux collets F & H, fixés l’un à la table & l’autre à la traverse inférieure d’un fort établi, qui est lui-même fortement attaché au mur de l’attelier.
Le premier de ces collets F est ouvert en entonnoir, pour recevoir la partie conique de l’axe représenté en F fig. 15. le second H est seulement cylindrique.
Vers la partie inférieure de l’axe, à deux ou trois pouces du collet H, est fixée une poulie G, sur laquelle passe la corde sans fin qui vient de la roue horisontale I, que l’on met en mouvement au moyen du bras L, qui se meut librement sur les pivots de l’arbre RS. Ce bras comunique par le lien LK à la manivelle excentrique de l’axe de la roue. Cette méchanique est la même que celle du moulin des Lapidaires. Voyez Moulin.
La partie supérieure de l’axe HF est armée d’un cercle de fer exactement tourné & centré sur l’axe qui est soûtenu par trois ou quatre branches, qui partant de l’axe, vont s’attacher à sa circonférence. Il appelle cette piece main, qui est représentée séparément fig. 15. on en va voir la raison, & combien il est essentiel qu’elle soit exactement centrée.
Aux deux côtés de la main sont fixées sur l’établi deux poupées DD ; la ligne qui joint ces deux poupées doit passer le centre de l’anneau de la main : c’est sur ces deux poupées que l’on fixe la regle de fer MM, au moyen de deux vis nn, en sorte qu’une de ses arrêtes soit un diametre de la main dans laquelle on place le bassin, représenté fig. 13. & 14. cette derniere le représente en profil, aa est un rebord qui s’applique sur l’anneau de la main ; on y fait un repaire commun pour pouvoir replacer le bassin au même point où on l’a placé la premiere fois. Le bassin doit être de laiton fondu, & tourné auparavant sur le tour en l’air. Voyez Tour en l'air.
Au-dessus du bassin, dans la direction de l’axe HF, est fortement scellée dans le mur une potence de fer AB, à la surface supérieure de laquelle est un petit trou de forme conique : ce trou doit être précisément dans la direction de l’axe HF, & autant éloigné de la surface du bassin F, que l’on veut que le foyer du même bassin le soit.
Le trou dont nous venons de parler reçoit la pointe b de la vis a, fig. 10. qui traverse la partie supérieure de l’ouverture O du compas B C, fig. 9. Ce compas est formé par quatre regles de fer ou de bois, assemblées comme on voit en b, même fig. La partie inférieure C du compas BC, représentée en grand fig. 11. est quarrée, & garnie de deux frettes de fer OP, qui servent, au moyen des vis qui les traversent, à assujettir le burin ab, qui est aigu en b ; l’autre burin représenté fig. 12. est arrondi, & sert à effacer les traits que le premier peut avoir laissé sur le bassin.
Toutes choses ainsi disposées, on applique le dos du burin contre la regle de fer MM, qui est courbée en arc de cercle dont le centre est la pointe de la vis a. Pour qu’elle soit parallele à la surface du bassin, on avance ou on recule cette regle, en sorte que lorsque le dos du burin glisse contre son arrête, la pointe du burin décrive exactement un diametre du bassin.
Maintenant si on fait mouvoir l’extrémité inférieure du compas le long de la regle de fer MM, en même tems que le bassin E est mis en mouvement par le moyen de la roue I, comme il a été expliqué, on conçoit que la pointe du burin dont le compas est armé, doit emporter toutes les parties de métal du bassin qui excedent la surface sphérique concave qui a pour centre le point autour duquel le compas se meut, qui est la pointe du pivot de la vis a : mais comme la pointe de cette vis est par la construction dans la direction de l’axe de rotation HF, & que la pointe du burin décrit un arc de cercle, cela produit le même effet que si un secteur de cercle tournoit sur la ligne qui passe par le centre & le milieu de l’arc du secteur, qui, comme il est démontré en Géométrie, décrit une surface sphérique.
Après que la pointe du burin a enlevé les parties du métal qui excédoient la surface sphérique concave, on efface les traits qu’elle peut avoir laissés avec le burin arrondi représenté fig. 12. que l’on met en place du premier.
Pour décrire une surface paraboloïdale, hyperboloïdale, ou autre, il suffit, comme on voit, de trouver le moyen de faire décrire à l’extrémité du burin la parabole, l’hyperbole, ou autre courbe dont le secteur, à cause du mouvement de rotation du bassin, décrira la surface que la courbe engendreroit en tournant sur son axe : c’est ce que M. Goussier exécute par le moyen de plusieurs leviers, qui font hausser ou baisser le point de suspension a du compas, à mesure que son extrémité inférieure C avance de côté ou d’autre. Cette machine sera représentée & expliquée dans l’ouvrage annoncé dans cet article.
Bassin d’empli, en terme de rafinerie de sucre, est un vase de cuivre qui ne differe du bassin de cuite que par son embouchure qui fait le demi-cercle. Voy. Bassin de cuite. On l’appelle bassin d’empli, parce qu’il sert effectivement à faire les emplis, & à transporter la cuite du rafraîchissoir dans les formes. Voyez Forme & Rafraichissoir.
Bassin de cuite est, parmi les Rafineurs de sucre, un vase de cuivre tenant à peu près deux seaux, de figure oblongue, arrondi vers son extrémité où il est le plus profond, & angulaire vers son embouchure. Il est garni de deux poignées, & surmonté de deux hauts bords, qui diminuent jusqu’à l’embouchure où ils n’excedent plus le fond. Ce bassin sert à transporter la cuite dans le rafraîchissoir. Voyez Cuite & Rafraichissoir.
Bassin à clairée, parmi les Rafineurs de sucre, est un vase rond, & également surchargé de bords tout autour, & qui représente assez la figure d’un seau : vers son fond il y a un commencement de tuyau, qui fait même piece avec le bassin, dans lequel on emmanche la dale. Voyez Dale. Ce bassin sert à passer la clairée. Voyez Clairée & Passer.
Bassins, Bassinets, ou Boutons d’or, elychrysum, fleur basse de diverses couleurs, ordinairement jaunes, à dix feuilles assez larges, & un godet au milieu de la même couleur, & qui porte sa graine. Cette fleur demande beaucoup d’eau & de soleil, avec de la terre à potager : on la leve au bout de trois ans pour en ôter le peuple. Il y en a de plusieurs especes ; le simple à fleur jaune, le bassinet à fleur d’écarlate, le double à fleur jaune, le bassinet à feuilles frangées, & le bassinet rond. Ils fleurissent tous au printems. (K)
BASSINE, BASSIN (Gramm.) ; bassin a deux acceptions différentes, comme on peut voir par l’article précédent ; bassine n’en a qu’une. La bassine est toûjours un vaisseau de cuivre d’une profondeur peu considérable, relativement à son diametre ; ce en quoi elle differe du bassin, où le diametre & la hauteur sont plus proportionnés.
Bassine, en terme de Cirier ; c’est un instrument de cuivre de forme presque ovale, dont les deux extrémités sont applaties de maniere que la meche en passant au-dessus, ne s’éloigne pas trop du fond de la bassine. Cet ustensile ne sert proprement qu’à faire fondre la matiere propre aux petites bougies. Voyez la fig. 3. Pl. du Cirier, & la fig. 1. de la même Planche, qui fait voir l’usage de cette machine.
Bassine, en terme d’Epinglier-Aiguilletier, est une espece de poelle profonde, ressemblant à une chaudiere à confiture, dans laquelle au moyen de ses anses, on remue & on secoue les aiguilles dans de l’eau de savon bouillante. Voyez Savonner.
Bassine, ustensile d’Imprimerie. Il y a dans une Imprimerie bien montée deux sortes de bassines de cuivre : la plus grande doit contenir quelques voies d’eau ; elle sert à tremper le papier : la petite sert à ramoitir les balles, & à mettre tremper les cuirs. Au défaut d’une bassine à tremper le papier, on se sert d’une pierre creusée, ou de baquets de bois : mais ces derniers sont sujets pendant l’été à de grands inconvéniens.
BASSINER, v. act. en Chirurgie ; c’est fomenter en humectant légerement avec une liqueur tiede ou chaude. (Y)
Bassiner, (Jardinage.) c’est arroser légerement ; ce que l’on pratique aux couches de melons.
BASSINET, s. m. en Hydraulique, est un petit retranchement cintré que l’on ménage sur les bords intérieurs d’une cuvette, pour y faire entrer la quantité d’eau distribuée aux particuliers par une ou plusieurs auges de différens diametres ; ce qui s’appelle jauger.
On appelle encore de ce nom un bassin trop petit pour le lieu. (K)
Bassinet des reins, voyez Bassin.
Bassinet, terme d’Arquebusier ; c’est un morceau de fer plat en-dedans du corps de platine, où il s’attache avec deux vis à tête ronde & plate, dont les têtes n’excedent ni d’un côté, ni de l’autre. Ce bassinet sort en-dehors, & excede le corps de platine d’environ un demi-pouce. Il est de figure ronde en-dessous, & la face de dessus est plate & creusée en rond. Ce creux répond directement à la lumiere du canon de fusil, & sert pour mettre l’amorce qui y est retenue & enfermée par l’assiette de la batterie, qui vient poser sur cette face creusée du bassinet.
Bassinet, en terme d’Orfevre en grosserie, est une espece de bassin qui surmonte la branche ou le corps d’une piece, par exemple, d’un chandelier. Le bassinet est composé de quarrés, de panaches, de collets, & d’un culot. Voyez ces mots à leur article.
BASSON DE HAUTBOIS ou simplement BASSON, (Lutherie.) est un instrument de Musique à vent & à anche, représenté fig. 40. & 41. Pl. IX. de Luth.
Il est composé de quatre pieces de bois A, B, D, C, perforées dans toute leur longueur. La premiere piece Dd, qui est percée intérieurement d’un trou conique, qui va en s’élargissant de D vers d, a un épaulement ab que l’on a ménagé en tournant l’extérieur de la piece. Cet épaulement est percé de trois trous, qui communiquent au canal intérieur de la piece. Ces trous notés 1, 2, 3, suivent pour gagner le canal ou tuyau Dd, la direction des petites lignes ponctuées que l’on voit auprès des trous. Aux deux extrémités de cette piece sont deux tenons Dd garnis de filasse, pour les faire joindre exactement. Le tenon D entre dans le trou du bocal E ; comme on voit dans les figures qui représentent le basson tout monté. L’autre tenon d entre dans le trou K de la partie inférieure, qu’on appelle le cul, lequel est la seconde partie. Cette piece est percée de deux trous KC : le premier K reçoit, comme nous avons dit, la piece Dd ; & le second C, qui est plus grand, reçoit la piece Bb par le tenon b. Les deux trous KC de la piece KL vont dans toute sa longueur ; savoir, le trou K en s’élargissant de K vers L, & le trou C au contraire de L vers C : ces deux trous communiquent l’un à l’autre vers L, ensorte qu’ils forment un tuyau recourbé. On perce les trous comme ceux de tous les autres instrumens à vent. Voyez Flute. Ces deux trous KC qui traversent d’outre en outre la piece KL lorsqu’on fabrique l’instrument, sont ensuite rebouchés en L par un tampon de liége, ou autre bois garni de filasse, pour fermer exactement : or avant de reboucher le trou L, on abat un peu de la cloison qui sépare les deux trous KC ; ensorte que du côté de L ils ne forment qu’une seule ouverture ; & que la communication que laisse la breche de la cloison, lorsque la piece L est rebouchée, soit à-peu-près égale à l’ouverture des tuyaux en cet endroit, ensorte que les deux canaux KC forment un tuyau recourbé en L. On garnit de frettes de cuivre ou d’argent les deux extrémités de cette piece KL, pour qu’elle ne fende point lorsqu’on met en L le bouchon, & dans les trous KC, les pieces Dd & Bb, appellées petite & grosse pieces. Le cul est percé de six trous ; les trois marqués 4, 5, 6, communiquent au tuyau K de la petite piece, en suivant la direction des lignes ponctuées qui partent des ouvertures de ces trous. Le trou marqué 7, & qui est fermé par une clé que son ressort tient appliquée sur ce trou comme celle du mi-b de la flûte traversiere, & qui ne débouche que lorsqu’on appuie avec le petit doigt sur la patte de cette clé, communique aussi avec le tuyau K. Le trou marqué 8, au contraire, communique avec le tuyau C, & est toûjours ouvert quoiqu’il ait une clé d 8, fig. 51 & 2. Cette clé est composée de deux pieces principales ; de la bascule AC, ac, & de la soupape CD, cd. La bascule AC, ac, fait charniere dans un tenon fg, fig. 53. où elle est traversée par une goupille ou une vis h, qui lui laisse la liberté de se mouvoir. La soupape est de même articulée dans un tenon, fig. 54. par le moyen d’une vis qui traverse ses oreilles kk. Les tenons sont fixés sur le corps de l’instrument par le moyen de quelques vis qui le traversent, & vont s’implanter dans le corps de l’instrument. Ces tenons doivent être tellement éloignés les uns des autres, que le crochet de la bascule puisse prendre dans l’anneau de la soupape. Au-dessous de la patte A de la bascule, est un ressort qui la renvoye en en-haut ; ensorte que le crochet de la bascule est toûjours baissé, & par conséquent l’anneau de la soûpape, dont le cuir D est par ce moyen tenu éloigné du trou e. Voy. la fig. 52. Mais lorsqu’on tient le doigt appliqué sur la patte de la bascule, on fait hausser son crochet & l’anneau de la soupape, & par conséquent baisser cette même soupape Dd, dont le cuir s’applique & ferme exactement le trou e. Les trois clés du basson qui ferment les trous 8, 10, 12, sont construites de même ; elles ne different que par les différentes longueurs de leurs bascules.
La grosse piece Bb, comme la petite Dd, est percée dans toute sa longueur d’un trou qui va en s’élargissant de b en B, & terminée de même par deux tenons Bb. Le premier qui est garni de filasse, entre dans le trou C, & l’autre B aussi garni, reçoit le bonnet aA, qui est entouré d’une frette de cuivre ou d’argent, selon que les clés & les autres frettes en sont faites. Le bonnet est percé d’un trou dans toute sa longueur, lequel est la continuation de celui de la grosse piece. La grosse piece est percée de trois trous 10, 11, 12, qui communiquent avec le trou intérieur Bb. Ces trous marqués 10 & 12, se ferment avec les clés brisées C 10, C 12, lorsqu’on appuie le doigt sur la patte de leurs bascules.
A l’extrémité D de la petite piece, on ajuste le bocal eE, qui est un tuyau de cuivre ou d’argent courbe, comme on voit dans la figure ; on fait entrer le tenon E du bocal dans l’ouverture D de la petite piece, qui est garnie d’une frette comme toutes les parties qui en reçoivent d’autres. A l’extrémité e du bocal on ajuste l’anche eF, composée de deux lames de roseau liées sur une broche de fer de la grosseur du bocal en e : on fait entrer l’extrémité de cette partie à la place de la broche de fer qui a servi de moule à l’anche, à l’entour de laquelle on fait encore une autre ligature g, qui peut couler le long des lames dans l’espace de deux ou trois lignes. Cette ligature ou anneau, qu’on peut appeller rasette par analogie à celles de l’orgue, sert à déterminer la longueur gF des lames de l’anche qui doivent battre, & par conséquent à la mettre au ton. Voyez Anche. La longueur du basson prise d<epuis l’extrémité e de l’anche ac du bocal jusqu’à l’extrémité A du bonnet, est de huit piés, réduits à quatre à cause de la courbure en il. Les trous sont percés dans la longueur de ce tuyau qui s’élargit toûjours depuis la pointe e du bocal jusqu’à l’extrémité A du bonnet, où ce trou peut avoir deux pouces un ou de diametre, selon les distances qui conviennent aux tons que ces trous doivent rendre, lesquels sont d’autant plus graves que les trous sont plus éloignés de l’anche. L’ordre des nombres 1, 2, 3, 4, 5, &c. marqués vis-à-vis des trous du basson dans la figure, suivent l’ordre des distances, qui sont d’autant plus grandes, que le nombre qui est vis-à-vis est plus grand. Voyez la figure. Pour joüer de cet instrument, que l’on tient debout devant soi avec les deux mains, il faut d’abord tourner le côté représenté par la figure ABCD, vers soi : on accroche ensuite le ruban qui passe dans l’anneau X, qui est à la frette supérieure du cul CL, à un des boutons de l’habit qui répondent à la partie supérieure de la poitrine, ensorte que le trou 9 réponde vis-à-vis la région ombilicale. L’instrument doit pencher un peu du côté gauche, pour que l’extrémité e du bocal garnie de son anche, se présente à la bouche avec facilité : c’est pour cela que le bocal est mobile, & peut se tourner de différens sens. On porte ensuite la main gauche vers la partie moyenne de l’instrument, avec laquelle on embrasse la grosse piece ; ensorte que le pouce de cette main bouche le 11e trou, & les doigts index, medius & annulaire de cette main, les trous 1, 2, 3, fig. AD & I qui répondent à la petite piece. Le pouce de la main gauche qui sert à boucher le 11e trou, lequel répond à la grosse piece, sert aussi à toucher les deux clés brisées, avec lesquelles on ferme le 10 & le 12e trou. Ce pouce doit pouvoir tout à la fois appuyer sur les deux clés pour les fermer, & boucher le 11e trou.
A l’égard de la main droite que l’on porte vers la partie inférieure de l’instrument, le pouce doit boucher le 9e trou ; le doigt index le 4e ; le doigt medius le 5e, & le doigt annulaire de cette main le 6e. Pour le petit doigt, on s’en sert pour toucher les deux clés du 7e & 8e trou, observant que lorsqu’on touche celle du 7e trou on l’ouvre, & qu’au contraire on ferme le 8e lorsqu’on touche sa clé, à cause de la bascule qui précede la soupape.
Après avoir posé les doigts, on soufflera dans l’anche, comme il sera expliqué à l’article haut-bois, & on observera d’augmenter le vent à mesure que l’on monte sur cet instrument. Cette regle est générale pour tous les instrumens à vent. Quant à son étendue, voyez la table du rapport de l’étendue de tous les instrumens. Tous ceux qui jouent du basson ne peuvent pas faire cette étendue, soit qu’ils ne ménagent pas assez leur vent, ou que l’instrument n’y soit pas propre. Ainsi ils se contentent de descendre en ♭ fa si,, ♭ & ♮, lesquels tons se forment sans déboucher aucun trou, par la seule maniere de pousser le vent dans l’instrument. Voyez la tablature suivante, où les notes de Musique font connoître quelle partie sonne cet instrument, & les caracteres noirs & blancs qui sont dessous, quels trous il faut fermer & ouvrir pour faire le ton de la note qui est dessus.

Les agrémens se font sur le basson comme sur le haut-bois & les autres instrumens à vent, en exécutant les notes que les agrémens renferment ; & les cadences, en battant sur les trous de la note qui sert de port de voix, & qui ne sont point bouchés dans la note sur laquelle on veut faire la cadence : ainsi pour cadencer le fa premiere octave, qui se forme en débouchant les 9, 10, 11, & 12 trous, la cadence étant préparée du sol, qui a de plus le huitieme trou de débouché, on battra sur le huitieme trou qui est la différence du fa & du sol, lequel restera fermé en finissant. Voyez Haut-bois.
* BASSORA, ou BALSORA, (Géog.) grande ville d’Asie, au-dessous du Confluent du Tigre & de l’Euphrate, dans l’Irac Arabi. Long. 66. lat. 30. 20.
BASTABLES (Terres.) adj. pl. (Hist. mod.) terres contestées entre l’Angleterre & l’Ecosse : il étoit autrefois incertain auquel de ces royaumes elles appartenoient avant qu’ils fussent unis. Ce mot a toute l’énergie de litigieux, & vient de battre.
BASTAGAIRE, s. m. nom de quelques officiers des empereurs Grecs, dont la fonction étoit de veiller sur les bagages de l’empereur. On nommoit aussi dans l’église de Constantinople bastagaire, celui à qui il appartenoit de porter l’image du Saint de l’église, aux processions, & dans les fêtes solennelles. En ce sens, bastagaire revient à notre porte-baniere, ou porte-bâton de confrairie.
* BASTERNE, s. f. (Hist. anc. & mod.) voiture traînée par des bœufs, en usage sous les regnes antérieurs à celui de Charlemagne, & appellée basterne, de peuples de ce nom qui habitoient anciennement la Podolie, la Bessarabie, la Moldavie, & la Valachie. Grégoire de Tours dit que la reine Denterie, femme du roi Theodebert, craignant que ce prince ne lui préférât une fille qu’elle avoit eue d’un premier lit, la fit mettre dans une basterne, à laquelle on attacha de jeunes bœufs qui n’avoient pas encore été mis au joug, & qui la précipiterent dans la Meuse. Ces sortes de litieres étoient même plus anciennes que ce tems ; & Ennodius parle dans un de ses vers, de la basterne de la femme de Bassus. Symmaque écrivant aux enfans de Nicomaque, les prie de tenir des basternes prêtes pour leur frere. M. l’abbé de Vertot pense que nos premiers François, dans le tems qu’ils demeuroient au-delà du Rhin, avoient emprunté la basterne des Cimmeriens qui habitoient les rives du Bosphore, avant qu’ils en eussent été chassés par les Getes. Voyez le VIII. vol. des Mém. de l’Académie des Inscriptions.
BASTI, s. m. (en Architecture.) se dit de l’assemblage des montans & traversans qui renferment un ou plusieurs panneaux, en Menuiserie ou Serrurerie : c’est ce que Vitruve appelle replum. (P)
* BASTIA, (Géog.) petite ville maritime de la Turquie en Europe, dans l’Albanie, vis-à-vis l’île de Corfou, à l’embouchure de la Calamou. Long. 38. 5. lat. 39. 40.
Bastia, (Géog.) petite ville, ou bon bourg d’Italie, dans une petite île que forme le Panaro, au duché de Modene, au-dessous de cette ville.
* BASTIE, (la) Géog. anc. & mod. ville capitale de l’île de Corse. Long. 27. 12. lat. 42. 35. on croit que c’est le Mantinum, ou Mantinorum oppidum des anciens.
BASTILLE, s. f. (Fortification.) petit château à l’antique, fortifié de tourettes. Voyez Chateau & Tour. Telle est la bastille de Paris, qui semble être le seul château qui ait retenu ce nom : l’on commença de la bâtir en 1369, par ordre de Charles V. elle fut achevée en 1383 sous le regne de son successeur, & sert principalement à retenir des prisonniers d’état.
On a aussi appellé autrefois bastilles, de petits forts dont on environnoit les places dans les siéges, pour en former une espece de circonvallation. C’est ainsi que les Anglois assiégeoient Orléans, lorsque Jeanne d’Arc, autrement la pucelle d’Orléans, leur en fit lever le siége sous Charles VII. (Q)
BASTILLÉ, adj. (en termes de Blason.) se dit des pieces qui ont des creneaux renversés qui regardent la pointe de l’écu. Belot en Franche-Comté, d’argent à losanges d’azur au chef cousu d’or, bastillé de trois pieces. (V)
* BASTIMENTOS, (Géog.) petites îles de l’Amérique septentrionale, proche la Terre-ferme, à l’embouchure de la baie de Nombré de Dios.
BASTINGUE, bastingure, bastinguere, s. f.) Marine.) c’est la même chose que pavois, ou paviers, & pavesade.
On prononce la lettre s dans ce mot bastingue. C’est une bande d’étoffe ou de toile que l’on tend autour du plat-bord des vaisseaux de guerre, & qui est soûtenue par des pieces de bois mises debout, que l’on appelle pontilles ; afin de cacher ce qui se passe sur le pont pendant le combat. Voyez Pavois.
On met des bastingues aux hunes ; on les double, & on les garnit entre les deux étoffes, de façon que les balles de mousquet ne peuvent les percer.
BASTINGUER ; on dit se bastinguer, lorsque pour se préparer au combat, on tend les bastingues : on se sert aussi de Matelots pour en tenir lieu, & mettre ceux qui sont sur le pont un peu à couvert de la mousqueterie. (Z)
BASTION, s. m. (en terme de Fortification.) est une grande masse de terre ordinairement revêtue de maçonnerie ou de gason, qu’on construit sur les angles de la figure que l’on fortifie, & même quelquefois sur les côtés lorsqu’ils sont fort longs. Sa figure est à peu près celle d’un pentagone ; il est composé de deux faces qui forment un angle saillant vers la campagne, & de deux flancs qui joignent les faces à l’enceinte. Voyez Face & Flanc. Son ouverture vers la place se nomme sa gorge. Voyez Gorge & Demi-gorge.
Voyez Planche premiere de Fortification, fig. prem. le bastion FGHIL, dont GH & HI sont les faces ; GF & IL les flancs, & F K I la gorge. Voyez Gorge.
L’angle GHI formé par les faces GH & HI, est appellé l’angle flanqué du bastion ; l’angle HGF formé d’une face & d’un flanc, se nomme l’angle de l’épaule, & GFE formé d’un flanc & de la partie EF de l’enceinte, se nomme l’angle du flanc ; sa partie EF qui joint ensemble deux bastions, est appellée courtine : ainsi l’angle du flanc est formé du flanc & de la courtine.
Les parties FK & LK du prolongement des courtines EF & LM, sont appellées les demi-gorges du bastion, & l’angle FKL qu’elles font entr’elles, l’angle du centre du bastion ; la ligne KH comprise entre l’angle flanqué H, & l’angle du centre K, se nomme la capitale du bastion.
Les bastions n’ont guere commencé à être en usage que dans le tems de François premier & Charles-Quint, c’est-à-dire vers l’an 1500 ou 1520. On leur a d’abord donné le nom de boulevards, & on les a fait très-petits.
Ce qui a donné lieu à la figure du bastion, est cette maxime essentielle de la Fortification, qu’il ne doit y avoir aucune partie de l’enceinte d’une place qui ne soit vûe & défendue de quelque autre.
Les anciens pour flanquer ou défendre toutes les parties de l’enceinte des villes, élevoient de distance en distance des tours rondes ou quarrées P, P, B, B, (Planche prem. de Fortific. fig. 2.) telles qu’on en trouve encore dans les vieilles fortifications. Les parties HG, IC de ces tours flanquoient ou défendoient les parties de l’enceinte comprises entre elles. Il n’y avoit que la partie extérieure FG des tours quarrées qui n’étoit pas exactement défendue des flancs des tours opposées, (c’est le nom qu’on avoit donné aux côtés HG, & DF des tours) mais on y remédioit en faisant saillir la partie supérieure de la muraille sur celle du pié ; entre cette partie saillante ou supérieure, & l’inférieure, on pratiquoit des ouvertures par où le soldat découvroit le pié du mur. Ces sortes d’ouvertures en saillie se nommoient machicoulis ou massecoulis : on en trouve encore aujourd’hui dans les vieilles fortifications, & dans la plûpart des anciens châteaux. Voyez Redoutes à machicoulis.
Après l’invention de la poudre, & lorsqu’on eut trouvé la maniere de s’en servir pour l’attaque des places, il fallut, pour s’opposer à la violence du canon, donner plus d’épaisseur aux murs des tours & des autres parties de la fortification. Les saillies en machicoulis ne purent se conserver contre la violence de cette machine. ; & par-là le côté extérieur des tours demeuroit sans défense. Il restoit du moins une espece de petit triangle au pié de ce côté, moindre à la vérité dans les tours rondes que dans les quarrées, mais toûjours plus que suffisant pour y attacher le mineur, par où l’ennemi pouvoit, sans grand obstacle de la part de l’assiégé, se procurer l’entrée de la place. C’est ce qui engagea les ingénieurs à chercher quelqu’expédient pour remédier à ce défaut. Le plus simple fut de terminer le côté extérieur des tours par deux lignes, qui formant un angle saillant vers la campagne, renfermeroient l’espace qui n’étoit point vû des flancs. Cette correction est la véritable origine de la figure de nos bastions, qui, comme on le voit, n’est point arbitraire, mais fondée sur les maximes de la fortification ; & il en résulte la défense de toutes les parties de l’enceinte : car les flancs défendent les faces & la courtine, & ils se défendent aussi réciproquement.
La grandeur des angles & de toutes les parties du bastion a souffert différentes variations, suivant le tems & les idées particulieres des ingénieurs, ainsi qu’on peut le voir dans le précis des instructions ou systèmes qui sont à la suite du mot Fortification. On ne peut guere fixer d’une maniere absolue la valeur de toutes ces parties, parce qu’elles changent suivant les différens polygones : mais pour en donner une idée, on peut établir,
1°. Que le flanc doit avoir au moins 20 toises, & qu’il peut aller jusqu’à 30.
2°. Que la demi-gorge doit être égale aux flancs, & qu’ainsi elle peut avoir depuis 20 jusqu’à 30 toises.
3°. Que les faces doivent avoir au moins 40 toises, & au plus 60.
A l’égard des angles du bastion, l’angle flanqué peut être aigu ou obtus, pourvû que dans le premier cas il n’ait pas moins de 60 ou 70 degrés, & dans le second pas plus de 150. Sa grandeur dépend au reste de l’angle de la circonférence du polygone que l’on fortifie : lorsqu’il est un peu obtus, il donne lieu d’augmenter la gorge du bastion ; & une grande gorge est plus avantageuse qu’une petite, non seulement parce qu’elle donne plus d’espace au bastion, mais parce qu’alors on peut-y construire un retranchement plus grand & plus solide, pour disputer pié à pié à l’ennemi le terrein du bastion.
L’angle de l’épaule est celui qui mérite le moins de considération dans le bastion, parce qu’il se trouve déterminé par l’angle flanqué & celui du flanc.
Ce dernier angle exige une attention toute particuliere. S’il est aigu, comme dans le système d’Errard, le flanc ne peut défendre la face du bastion opposé : s’il est droit, il la défend trop obliquement : il doit donc être un peu obtus, pour que le soldat découvre devant lui la face & le fossé du bastion qu’il doit défendre. Voyez Défense.
L’angle du flanc ne doit pourtant pas être trop obtus, parce qu’alors le flanc pourroit être battu du bord du fossé opposé, & de la partie du fossé vis-à-vis l’épaule du bastion.
Il y a des bastions de plusieurs especes ; savoir, de simples, à flancs concaves & à orillons, de vuides, de pleins, de plats, &c.
Le bastion simple est celui dont les flancs sont en ligne droite.
Le bastion à flancs concaves & à orillons, est celui dont les flancs couverts sont disposés en ligne courbe, & dont l’épaule est arrondie. Voyez les constructions de M. de Vauban, à la suite du mot Fortification.
Les bastions vuides sont ceux dont le rempart est mené parallelement aux flancs & aux faces, de maniere qu’il reste un vuide dans le milieu du bastion : c’est dans ce vuide qu’on place ordinairement les magasins à poudre. Voyez Magasin.
Les bastions pleins sont ceux dont toute la capacité se trouve remplie par les terres du rempart. C’est sur les bastions pleins qu’on éleve des cavaliers. Voy. Cavalier.
Les bastions pleins sont bien plus favorables que les vuides pour se retrancher : le principal avantage de ces derniers est de donner plus de facilité pour aller au-devant du mineur ennemi : mais les retranchemens qu’on y construit ne peuvent être excellens ; car le peu de largeur du rempart ne permet pas de les faire assez grands pour être bien soûtenus ; & si on les place à la gorge, ils se trouvent commandés des logemens que l’assiégeant pratique sur le rempart.
Le bastion plat est un bastion construit sur une ligne droite, & dont par conséquent les deux demi-gorges ne font point d’angle. On n’employe ces sortes de bastions que lorsque les côtés des places se trouvent trop longs pour que les bastions des extrémités puissent se flanquer réciproquement. Ces bastions ont plusieurs inconvéniens : il est difficile de leur donner la même étendue qu’aux autres bastions ; & d’ailleurs l’ennemi peut enfiler leurs courtines d’une même batterie.
Outre les bastions dont on vient de parler, il y a encore les bastions détachés, les coupés, les réguliers, & les irréguliers, &c.
Le bastion détaché est un bastion qui est isolé à l’égard de l’enceinte : telles sont les contregardes des tours bastionnées de Landau & du Neuf-Brisac. L’avantage de ces bastions est de pouvoir être soûtenus jusqu’à la derniere extrémité, parce que leur prise ne donne point d’entrée dans la place : mais ils ont aussi, comme les autres dehors, le desavantage d’avoir avec la place des communications difficiles, & par lesquelles on ne peut que défiler.
Le bastion coupé est celui dont la pointe est retranchée, & qui au lieu de cette pointe a un ou deux angles rentrans : il n’est d’usage que lorsque l’angle flanqué du bastion se trouve trop aigu, c’est à-dire, au-dessous de 60 degrés ; ou lorsque quelqu’obstacle qu’on trouve dans le terrein ne permet pas de le terminer à l’ordinaire.
Le bastion régulier est celui qui a ses faces égales, ses flancs de même, & ses angles de l’epaule & du flanc égaux entr’eux : c’est celui qui se trouve dans les fortifications régulieres.
Le bastion irrégulier a de l’inégalité dans ses faces, ses flancs, ou ses demi-gorges, de même que dans ses angles du flanc & de l’épaule : c’est ce bastion qui est le plus ordinaire, parce qu’il s’employe dans les fortifications irrégulieres, qui sont bien plus communes que les régulieres. (Q)
* Bastion, se dit en Medecine, des parties qui servent d’enveloppe & comme de rempart à d’autres : tel est le thorax, par rapport au cœur & aux poumons, & le crane, qui semble fait pour défendre le cerveau.
* Bastion de France, (Géog.) place d’Afrique sur la côte de Barbarie, au royaume d’Alger, au nord-est de Bonne.
* BASTOGNACK, ou BASTOGNE, (Géog.) petite ville des Pays-bas dans le duché de Luxembourg. Lon. 23. 30. lat. 50. 10.
* BASTON, (Géog.) ville de l’Amérique septentrionale dans la nouvelle Angleterre, mieux connue sous le nom de Boston.
BASTUDE, s. f. (Pêche.) c’est une espece de filet dont on se sert pour pêcher dans les étangs salés. L’ordonnance de 1681 fait défenses aux pêcheurs qui se servent d’engins, appellés fichûres, de prendre les poissons enfermés dans les bastudes, à peine de punition corporelle. (Z)
* BASVILLE, (Géog.) ville de l’Amérique avec port, dans la Martinique.
* BASURURE, (Géog.) riviere de l’Amérique méridionale dans le pays des Caraïbes : elle se jette dans la riviere des Amazones.
BAT, BATTOLOGIE, BUTUBATA, (Gram.) En expliquant ce que c’est que battologie, nous ferons entendre les deux autres mots.
Battologie, subst. f. c’est un des vices de l’élocution ; c’est une multiplicité de paroles qui ne disent rien ; c’est une abondance stérile de mots vuides de sens, inane multiloquium. Ce mot est Grec, βαττολογία, inanis eorundem repetitio ; & βαττολογέω, verbosus sum. Au ch. vj. de S. Matthieu, v. 7. Jesus-Christ nous défend d’imiter les payens dans nos prieres, & de nous étendre en longs discours & en vaines répétitions des mêmes paroles. Le Grec porte, μὴ βαττολογήσητε, c’est-à-dire, ne tombez pas dans la battologie ; ce que la vulgate traduit par nolite multum loqui.
A l’égard de l’étymologie de ce mot, Suidas croit qu’il vient d’un certain Battus, poëte sans génie, qui répétoit toûjours les mêmes chansons.
D’autres disent que ce mot vient de Battus, roi de Libye, fondateur de la ville de Cyrene, qui avoit ; dit-on, une voix frêle & qui bégayoit : mais quel rapport y a t-il entre la battologie & le bégayement ?
On fait aussi venir ce mot d’un autre Battus, pasteur, dont il est parlé dans le II. livre des Métamorphoses d’Ovide, v. 702. qui répondit à Mercure : sub illis montibus, inquit, erant, & erant sub montibus illis. Cette réponse qui répete à-peu-près deux fois la même chose, donne lieu de croire qu’Ovide adoptoit cette étymologie. Tout cela me paroît puérile. Avant qu’il y eût des princes, des poëtes, & des pasteurs appellés Battus, & qu’ils fussent assez connus pour donner lieu à un mot tiré de quelqu’un de leurs défauts, il y avoit des diseurs de rien ; & cette maniere de parler vuide de sens, étoit connue & avoit un nom ; peut-être étoit-elle déjà appellée battologie. Quoi qu’il en soit, j’aime mieux croire que ce mot a été formé par onomatopée de bath, espece d’interjection en usage quand on veut faire connoître que ce qu’on nous dit n’est pas raisonnable, que c’est un discours déplacé, vuide de sens : par exemple, si l’on nous demande qu’a-t-il dit ? nous répondons bath, rien ; patipata. C’est ainsi que dans Plaute, ( Pseudolus, act. I. sc. 3. ) Calidore dit : quid opus est ? à quoi bon cela ? Pseudolus répond : Potin aliam rem ut cures ? vous plaît-il de ne vous point mêler de cette affaire ? ne vous en mettez point en peine, laissez-moi faire. Calidore replique at… mais….. Pseudolus l’interrompt en disant bat : comme nous dirions ba, ba, ba, discours inutile, vous ne savez ce que vous dites.
Au lieu de notre patipata, où le p peut aisément être venu du b, les Latins disoient butubata, & les Hébreux בית״ בתע bitutote, pour répoudre à une façon de parler futile. Festus dit que Nævius appelle butubata ce qu’on dit des phrases vaines qui n’ont point de sens, qui ne méritent aucune attention : butubata Noevius pro nugatoriis posuit, hoc est nullius dignationis. Scaliger croit que le mot de butubata est composé de quatre monosyllabes, qui font fort en usage parmi les enfans, les nourrices & les imbéciles ; savoir bu, tu, ba, ta : bu, quand les enfans demandent à boire ; ba ou pa, quand ils demandent à manger ; ta ou tatam, quand ils demandent leur pere, où le t se change facilement en p ou en m, maman : mots qui étoient aussi en usage chez les Latins, au témoignage de Varon & de Caton ; & pour le prouver, voici l’autorité de Nonius Marcellus au mot {{lang|la|buas. Buas, potionem positam parvulorum. Var. Cato, vel de liberis educandis. Cum cibum ac potionem buas, ac papas docent & matrem mammam, & patrem tatam. (F)
Bat, s. m. (Commerce.) petite monnoie de billon de Suisse, dont on ne peut que difficilement évaluer la valeur. Plusieurs cantons en fabriquent à différens titres & poids. Pour donner la valeur d’un bat, celui de Zuric vaut deux sous & cinq sixiemes de denier, argent de France. Il faut encore distinguer les bons bats des communs.
Bat, (Manege & Maréchallerie.) c’est une espece de selle de bois qu’on met sur les ânes, mulets & chevaux, pour y ajuster des paniers ou autres machines destinées à porter des fardeaux. Les bâts communs ne sont autre chose qu’une espece d’arçon composé de deux fûts de bois, joints avec des bandes de même matiere. Chaque fût est accompagné d’un crochet, pour tenir les cordes qui soûtiennent aux deux côtés du bât des paniers, des ballots ou des échelettes. Le dessous du bât est garni de panneaux : on y ajoûte une sangle, ou bien on fait passer un surfaix par-dessus. On attache au fût de derriere une courroie qui sert de croupiere. Voyez Panneau, Surfaix, Croupiere
Un cheval de bât est un cheval destiné à porter des fardeaux sur un bât, soit à la guerre, en route, ou dans les messageries. (V)
* Bat, s. m. chez les marchands de poisson, c’est la queue du poisson : le grand poisson, disent-ils, se mesure entre queue & bat.
* BATA, (Géog.) ville d’Afrique, capitale de la province de même nom au royaume de Congo.
BATADEUR, s. m. au jeu de Revertier, sont les dames qui font surcase sur la même fleche où il y en a déjà d’accouplées. Elles sont nommées batadeur, parce qu’elles servent à battre les dames découvertes, sans qu’on soit obligé à se découvrir soi-même.
* BATAILLE, COMBAT, ACTION, Gramm. La bataille est une action plus générale, & ordinairement précédée de préparations : le combat est une action plus particuliere, & moins prévûe. On peut dire que la bataille de Pharsalles & le combat des Horaces & des Curiaces sont des actions bien connues. Ainsi action semble le genre, & bataille & combat des especes : bataille a rapport aux dispositions, & combat à l’action : on dit l’ordre de bataille, & la chaleur du combat ; combat se prend au figuré, bataille ne s’y prend point. On ne parleroit point mal, en disant, il s’est passé en-dedans de moi un violent combat entre la crainte de l’offenser, & la honte de lui céder ; mais il seroit ridicule d’employer en ce sens le terme de bataille ; celui d’action ne convient pas davantage.
Bataille, s. f. (Ordre encycl. Entend. Raison, Philos. ou Science, Science de la nat. Mathématique, Mathématiques pures, Géométrie, Tactique.) c’est dans l’Art militaire, une action générale entre deux armées rangées en bataille, qui en viennent aux mains dans une campagne assez vaste pour que la plus grande partie puisse combattre. Les autres actions des troupes, quoique souvent plus meurtrieres que les batailles, ne doivent, selon M. de Feuquieres, se nommer que des combats.
Ainsi, suivant cet officier, l’attaque d’un poste ou d’un village retranché, ne doit point s’appeller bataille, mais un combat. Voyez Ordre de bataille & Armée.
Une bataille perdue est celle dans laquelle on abandonne le champ de bataille à l’ennemi, avec les morts & les blessés. Si l’armée se retire en bon ordre avec son artillerie & ses bagages, le fruit de la bataille se borne quelquefois à avoir essayé ses forces contre l’ennemi, & au gain du champ de bataille : mais si l’armée battue est obligée d’abandonner son canon & de se retirer en desordre, elle n’est plus en état de reparoître devant l’ennemi qu’elle n’ait réparé ses pertes ; il se trouve par là maître de la campagne, & en état d’entreprendre des siéges : c’est cette suite qui décide ordinairement du succès des batailles, dont il n’est pas rare de voir les deux partis s’attribuer l’avantage.
Un grand combat perdu, dit M. de Feuquieres, quoique plus sanglant qu’une bataille, emporte rarement la perte de toute l’artillerie, & presque jamais celle des bagages ; parce que les armées n’ayant pû s’aborder par leur front, il est certain qu’elles n’ont pû souffrir que dans la partie qui a combattu ; & que quoique pour attaquer ou pour soûtenir on ait successivement été obligé de se servir de nouvelles troupes tirées du front qui ne pouvoient combattre, l’action n’ayant pû cependant devenir générale, elle n’a pû produire qu’une plus grande ou moindre perte d’hommes, sans influer si absolument sur la suite d’une campagne & sur la décision pour la supériorité, que le peut faire une bataille rangée : elle ne peut produire ni la perte générale des bagages, ni celle de l’artillerie, mais seulement ce qui peut s’en être trouvé sur le terrein où les troupes ont combattu. Mémoires de Feuquieres.
Il suit de là qu’un général qui craint de se commettre avec un ennemi en rase campagne, doit chercher des postes de chicane, où sans faire agir toute son armée, il puisse attaquer l’ennemi sans s’exposer au hasard de perdre une bataille. Mais il faut convenir que si par ces especes de batailles on ne se met pas en danger d’être battu entierement, on ne peut non plus battre entierement l’ennemi, & l’empêcher de reparoître après le combat comme avant, pour s’opposer aux entreprises qu’on peut former.
L’histoire des batailles n’est proprement que l’histoire des défauts & des bévues des généraux : mais il est heureusement assez ordinaire que les méprises des deux généraux opposés se compensent réciproquement. L’un fait une fausse démarche ; l’autre ne s’en apperçoit pas, ou il n’en sait tirer aucun avantage : de-là il n’en résulte aucune conséquence fâcheuse.
Les Mémoires de M. de Feuquieres sur la guerre, ne sont, pour ainsi dire, qu’un récit des inadvertances & des fautes des deux partis : à peine fait-il mention d’un seul général, excepté Turenne, le grand Condé & Luxembourg, dont la conduite soit autre chose qu’un tissu continuel de fautes. Créqui & Catinat, en certaines occasions, en faisoient de grandes, selon ce même officier, mais ils savoient les compenser par une conduite judicieuse en d’autres occasions. M. le chevalier de Folard trouve aussi très-peu de généraux dont la réputation soit nette à tous égards. Le marquis de Feuquieres, dont la grande capacité dans la guerre paroît par ses Mémoires, eût été un général du premier ordre, dit M. de Folard, s’il eût plû à certaines gens, à qui son mérite faisoit ombrage, de s’empresser un peu moins à travailler à sa disgrace & à le perdre dans l’esprit du roi, après l’avoir gâté dans l’esprit du ministre ; ce qui fit perdre à ce prince un des meilleurs & des plus braves officiers généraux de ses armées, & qui le servoit mille fois mieux & avec plus de courage & d’intelligence que ses indignes ennemis.
Maniere de disposer les troupes dans une bataille rangée. Lorsqu’on a formé le dessein d’aller à l’ennemi, & qu’on est à portée de le pouvoir combattre, « il faut disposer les troupes pour arriver devant lui en bataille, sur deux lignes : l’infanterie au centre, & la cavalerie sur les ailes, si le terrein le permet ; parce qu’il y a des pays si coupés & si fourrés, qu’il faut mettre des brigades d’infanterie ou de dragons aux flancs de la droite & de la gauche, pour empêcher l’ennemi d’en approcher. Il y a d’autres situations partagées par des plaines & des buissons, où l’on place dans les intervalles d’infanterie, des escadrons pour la soûtenir & profiter du terrein que l’on veut disputer.
Quand il y a de la difficulté à pénétrer l’ennemi, & que l’on veut emporter un poste, forcer une droite, une gauche, ou le centre, on doit disposer les troupes de maniere, qu’elles se présentent également de toutes parts à l’ennemi, pendant que le plus fort de l’armée arrive en colonne sur l’endroit que l’on veut pénétrer, qu’on attaque vivement & sans relâche. Un ennemi qui n’est point prevenu de cette disposition, se trouve bien-tôt renversé par un nombre supérieur, & on le poursuit avec ordre, pour achever de le mettre en déroute.
Il y a d’autres situations qu’il faut absolument rechercher avant d’attaquer l’ennemi. S’il est posté dans des pays fourrés & coupés de haies & de fossés, où son infanterie peut avoir beaucoup d’avantage, il faut le tourner ou le déplacer, de maniere que la cavalerie sur laquelle on compte beaucoup, puisse agir & partager le mérite d’une action, qu’il vaut mieux différer quelque tems, que de s’exposer à la manquer. Lorsque le général a des troupes de confiance à la droite, & qu’il connoît que le terrein de la gauche de son champ de bataille est avantageux pour les y faire combattre, il doit les y porter, & mettre à la droite les troupes de la gauche : ce sont des dispositions qu’il faut faire quelquefois ; pour mieux s’opposer aux forces de l’ennemi, suivant l’avantage que la situation du lieu donne, & le projet que le général forme pour attaquer ; c’est de quoi le coup d’œil décide.
Il faut autant qu’il est possible, avoir un corps de reserve composé de bonnes troupes, cavalerie & infanterie. La cavalerie doit être en troisieme ligne en bataille, derriere le centre de l’infanterie de la seconde ligne, pour être en état de se porter où elle seroit utile, sans rien déplacer de la seconde ligne ; il faut dérober, s’il est possible, à l’ennemi la connoissance de cette disposition. Dans le moment que la premiere ligne s’ébranle pour combattre, on fait aussitôt passer les bataillons de la réserve par les intervalles de la cavalerie de la seconde ligne, pour se porter brusquement dans les intervalles des escadrons de la premiere, en joignant l’escadron le plus proche de la droite & de la gauche de l’infanterie de cette ligne. Suivant cette disposition, qui peut être inconnue à l’ennemi, on peut par le feu de l’infanterie, mettre un grand desordre dans sa cavalerie, lorsqu’elle vient au coup de main. Si l’infanterie reste dans la même disposition, elle favorise toûjours le retour de la cavalerie, ou elle marche pour attaquer en flanc l’infanterie ennemie de la premiere ligne qu’elle déborderoit.
Il faut observer, en mettant en bataille la premiere ligne, de laisser aux deux ailes de cavalerie des intervalles assez spacieux pour ne rien déplacer devant l’ennemi, lorsque l’infanterie de la réserve vient s’y porter. Le général doit faire reconnoître de fort près les flancs de l’armée ennemie pour les déborder, les entamer, & les replier sur le centre, rien n’est plus avantageux, & ne décide plus promptement de la victoire ; l’ennemi ne peut plus s’étendre, ni disposer du terrein dont il étoit le maître, il s’y voit resserré : les troupes n’y combattent plus qu’avec contrainte, ne se reconnoissant plus dans la mêlée, & ne cherchent qu’à se faire jour pour se sauver.
Lorsqu’on a pénétré la ligne par quelque endroit, il est très à propos de faire avancer dans le même moment des troupes de la seconde ligne, s’il n’y en a pas du corps de réserve qui soient à portée pour partager l’ennemi, & profiter de cet avantage par la supériorité, sans quoi on lui donne le tems de se rallier & de réparer les desordres où il se trouve. Il faut absolument conserver un grand ordre dans tous les avantages que l’on remporte, afin d’être plus en état de jetter la terreur dans les troupes ennemies, & empêcher leur ralliement ; la disposition doit être faite de maniere, que si la premiere ligne étoit pénétrée, la seconde puisse la secourir, observant toûjours les intervalles nécessaires pour faire agir les troupes, & les former derriere celles qui seront en ordre : on doit attaquer la bayonnette au bout du fusil, les troupes qui ont pénétré la premiere ligne, les prendre de front, & par leurs flancs, afin de les renverser, & remplir à l’instant le même terrein qu’elles occupoient ; c’est dans des coups si importans, que les officiers généraux les plus proches doivent animer par leur présence cette action, & faire couler des troupes de ce côté-là, pour les former sur plusieurs lignes, & rendre inutile l’entreprise de l’ennemi. Un général a bien lieu d’être content des officiers qui ont prévenu & arrêté ce premier desordre par leur diligence & leur valeur.
Il faut que le corps de réserve soit à portée de remplacer les troupes aux endroits où elles auront été prises, afin que l’ennemi ne voie rien de dérangé, & qu’il trouve par-tout le bon ordre & la même résistance.
Les commandans des régimens doivent avoir des officiers sur les ailes & au centre, pour contenir les soldats, & les avertir, que le premier qui se dérangera de sa troupe pour fuir ou autrement, sera tué sur le champ, afin que personne ne puisse sortir de son rang : avec cette précaution, on se présente toûjours à l’ennemi avec beaucoup d’ordre.
Dans un jour de bataille, le poste du général ne doit pas être fixé ; il est obligé de se porter dans les endroits où sa présence est utile, soit pour surprendre l’ennemi par quelques attaques, soit pour secourir une droite, une gauche ou le centre, qui commenceroient à s’ébranler ; ou faire avancer des troupes pour réparer ce qui seroit dérangé, parcourir la premiere ligne, y animer les troupes, & en même tems jetter le coup d’œil sur les forces & la situation de l’ennemi, pour en découvrir le foible, & en profiter par des détachemens que l’on fait marcher.
Tous les lieutenans généraux & maréchaux de camp doivent être aux postes marqués par l’ordre de bataille, pour conduire les troupes des ailes & du centre de l’armée ; les brigadiers à la tête de leurs brigades pour les faire mouvoir suivant les ordres qu’ils en reçoivent, ou l’occasion ; & lorsque dans l’action ils sont partagés par un mouvement brusque de l’ennemi, ils doivent prendre sur le champ le parti de se faire jour, rejoindre leurs troupes, ou de se jetter dans quelque poste, pour empêcher l’ennemi de pénétrer plus loin : par ces démarches hardies & faites à propos, on répare le desordre qui peut être arrivé.
Le major général de l’infanterie, ses aides-majors, le maréchal-de-logis de l’armée, de la cavalerie, des dragons, & le major de l’artillerie, doivent tous suivre le général pour porter ses ordres, & les faire exécuter promptement ; le capitaine des guides doit aussi l’accompagner pour conduire les troupes, & lui expliquer la situation du pays. Les colonels, lieutenans-colonels, majors de brigades, aides-majors des régimens, doivent tous avoir une grande attention de se tenir à leur troupe, & de faire observer un grand silence pour bien entendre le commandement, & le faire exécuter dans l’instant même. C’est une chose essentielle pour bien combattre l’ennemi & le prévenir dans ses démarches.
Dans le tems même que l’on fait une disposition pour combattre, tout le canon de l’armée doit se placer par brigade devant la premiere ligne, & autant qu’il est possible devant l’infanterie aux endroits les plus élevés, pour faire feu sur tout le front de l’armée ennemie. Lorsque toutes les lignes s’ébranlent pour charger, l’on peut se servir de petites pieces dans les intervalles de l’infanterie, pour faire des décharges à portée de l’ennemi, & rompre son premier rang ; après cette décharge, les officiers d’artillerie les font rentrer aussi-tôt dans l’intervalle des deux lignes, pour les faire recharger, & les avancer lorsqu’on leur ordonne.
Il est très-important que les officiers généraux expliquent à ceux qui commandent les troupes sous eux, ce qu’ils doivent faire pour attaquer l’ennemi, suivant la disposition que le général a réglée, afin que dans une affaire de cette conséquence, tout agisse & soit animé du même esprit, & qu’au cas que quelques officiers généraux fussent tués ou blessés, on fût toûjours en état de suivre le même ordre pour combattre. Il faut aussi que l’on sache, en cas de besoin, le lieu de la retraite, & l’ordre pour se rallier de nuit ; ce sont des choses trop importantes pour les oublier.
On doit observer, lorsque les troupes vont au combat, de ne pas permettre que les officiers des régimens détachent des soldats des compagnies pour la garde de leurs équipages ; on y laisse au plus les éclopés, & les valets pour en avoir soin, avec un détachement de l’armée : mais lorsqu’on prévoit une action, il faut absolument renvoyer au moins les gros bagages sous une place, pour ne pas s’affoiblir inutilement ». Observations sur l’Art de faire la guerre suivant les maximes des plus grands généraux.
Le succès des batailles ne dépend pas toûjours de l’habilité du général, & il lui est difficile de se trouver par-tout pour donner les ordres qui peuvent être nécessaires.
« Lorsque deux armées s’ébranlent pour se charger, dit M. le maréchal de Puységur, dans son livre de l’Art de la guerre, que peut faire le général ? courra-t-il le long de la ligne, ou restera-t-il en place ? il n’a pour lors d’autre avantage sur les officiers généraux inférieurs, que celui de commander par préférence les troupes qui sont sous sa main. Pendant ce tems-là on vient lui dire qu’une telle partie de son armée a battu celle de l’ennemi qu’elle avoit en tête, ou bien que sa gauche est en déroute, & que l’infanterie qui la joignoit a ployé. Je demande, dit toûjours l’illustre maréchal de Puységur, quel part ce général peut avoir alors au gain ou à la perte de la bataille ? Cependant pour marquer dans l’histoire la supériorité d’un général sur un autre, on dit qu’il l’a battu en bataille rangée, quoiqu’à dire la vérité, ce soient ces actions-là dans lesquelles le général a le moins de part. Ce sont, il est vrai, les généraux qui choisissent les postes, & qui ordonnent les dispositions pour combattre : mais l’exécution de leur ordre & l’action sont totalement l’affaire des troupes, non-seulement dans des armées également étendues ; mais même dans celles dont les forces sont fort différentes.
Aussi les généraux qui n’ont pas grande ressource dans leur savoir, préferent-ils toûjours les batailles aux autres actions de la guerre, qui donnent moins au hasard & qui demandent plus d’habileté. Au contraire ceux qui sont savans dans la guerre, cherchent par préférence les actions où ils peuvent soûtenir les troupes par leur intelligence & sans se commettre aux évenemens ; ce qu’ils ne peuvent faire que quand les armées ont peu d’étendue, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas trop nombreuses. Art de la guerre par M. le maréchal de Puységur.
M. de Folard pense sur les armées nombreuses, comme le savant maréchal que nous venons de citer. Ces armées innombrables & les évenemens prodigieux qu’elles produisent, plaisent & amusent comme les romans : mais elles instruisent peu les gens de guerre. Il y a par-tout à apprendre dans les petites guerres ; & c’est dans celles-ci uniquement que la science & l’intelligence paroissent le plus particulierement. Il faut même plus de l’une & de l’autre que dans les grandes, dont le nombre fait tout le mérite .... M. de Turenne disoit qu’une armée qui passoit cinquante mille hommes, devenoit incommode au général qui la commandoit, & aux soldats qui la composoient. Rien n’est plus vrai & plus judicieux que cette maxime. Les mauvais généraux cherchent toûjours à réparer par le nombre le défaut de leur courage & de leur intelligence. Ils n’ont jamais assez de troupes quoique l’ennemi en ait moins. Ils épuisent toutes les garnisons d’une frontiere, & les vivres en même tems pour grossir leurs armées, gagner l’avantage du nombre & l’avoir bien au-delà..... S’ils ne font rien avec des forces si supérieures, ils nous font juger que c’est à bon droit qu’ils se défient d’eux-mêmes, qu’ils se rendent justice, & que leur hardiesse n’est pas telle qu’ils la vantoient..... On voit peu de grandes armées qui réussissent lorsqu’on se défend bien : elles se dissipent d’elles-mêmes ; on voit bien-tôt la confusion & le desordre s’y introduire par la faute de paye, par la disette & les maladies : leur propre grandeur entraîne leur ruine. Comment. sur Polybe ».
Suivant la remarque d’un auteur célebre, la perte réelle soufferte dans une bataille, c’est à-dire la mort de quelques milliers d’hommes, n’est pas aussi funeste à l’état que son mal d’opinion, ou le découragement qui l’empêche d’user des forces que la fortune lui a laissées. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, par M. de Montesquieu.
M. de Turenne disoit qu’il estimoit plus un général qui conservoit un pays après une bataille perdue, que celui qui l’avoit gagnée & n’avoit pas sû en profiter. Il avoit raison. Ceux de cette derniere espece ne sont pas rares : apparuit nescire eos victoriâ uti, dit Tite-Live. Mais ceux qui poussent les avantages d’une victoire aussi loin qu’ils peuvent aller, comme M. le Prince & M. de Turenne, ne se trouvent pas partout.... Se servir de l’occasion, est une marque infaillible de l’habileté & du courage d’un général d’armée. L’occasion, dit Tacite, est la mere des grands évenemens, opportunus magnis conatibus transitus rerum. En effet, une victoire décisive & complete nous conduit à une foule d’entreprises & de grands desseins, qui résultent tous de la premiere victoire. Une armée n’est pas abysmée & anéantie pour avoir perdu & abandonné le champ de bataille, son canon, ses morts & ses blessés. Ceux qui fuient à-travers les campagnes ne sont pas morts ; ils sont dissipés aujourd’hui, ils peuvent se réunir demain, trois ou quatre jours après, quinze ou vingt, si l’on veut, se rallier, prendre de nouvelles forces, de nouvelles espérances, & revenir plus braves & plus résolus qu’auparavant, par la honte de leur défaite, ou par l’adresse des généraux. Que ne faut-il pas pour rendre une bataille décisive & complete ? elles ne le sont presque jamais : on voit l’ennemi en fuite, atterré, vaincu, foulé aux piés ; il se releve en peu de tems : on diroit que le victorieux n’a marché que sur des ressorts.
Une bataille n’est complete & décisive qu’autant qu’on en sait profiter dès l’instant que la victoire s’est déclarée sans nulle équivoque, qu’aucun corps ne reste en entier, que tout s’enfuit, que tout court à la débandade. Le général victorieux doit bien se garder alors de faire un lieu de repos du champ de bataille ; mais imiter ce que fit César dans toutes ses victoires, & particulierement dans celle de Pharsale. Il n’a pas plûtôt vaincu Pompée, que sur le champ il marche à l’attaque de son camp qu’il emporte. Ce n’est pas encore assez : il le suit sans relâche à marche forcée ; il oblige l’ennemi de s’embarquer ; il y monte aussi & avec la même promptitude, de peur qu’il ne lui échappe. Belle leçon pour les victorieux, qui ne le sont jamais qu’à demi.
On doit laisser là tous les blessés, les gros bagages, la grosse artillerie, enfin tout ce qui peut retarder la marche d’un seul moment ; camper sur les traces des vaincus, afin qu’ils n’ayent pas le tems de se reconnoître & de recourir aux ressources.
Ordinairement une armée battue cherche son salut par différentes routes & diverses retraites. On doit partager son armée en plusieurs corps dans un très-grand ordre, les envoyer aux trousses des fuyards, tâcher de les atteindre pour les accabler & ruiner le tout. Si les vaincus se réunissent & se rassemblent sous le canon de la place la plus voisine, il faut l’attaquer brusquement à la faveur de la nuit, ou dans le plein jour : on essuie un feu de passage ; mais dès qu’on est aux mains, ce feu n’a plus lieu. Enfin il faut considérer qu’il y a certaines bornes d’où l’on ne sauroit s’écarter après une victoire. Il y a un certain point jusqu’où il est permis de suivre ses avantages. Ce n’est pas connoître ses forces, ni même celles de ses ennemis, que de n’oser aller jusque-là, ou de vouloir aller plus loin, lorsque la défaite n’est pas entiere. Bien des généraux ont été battus après une victoire, faute de connoître la juste étendue qu’ils auroient pû lui donner. Commentaire sur Polybe, par M. le chevalier Folard. (Q)
Bataille navale, est une bataille donnée sur mer. Voyez Combat naval.
Bataille, (Jurispr.) s’est dit dans le même sens que combat, lorsque les duels étoient autorisés en justice. Voyez Combat. (H)
Bataille, (Peinture.) on se sert de ce mot au figuré pour signifier les représentations des batailles en peinture & en sculpture. Les batailles d’Alexandre qui sont dans les galeries du Louvre par le Brun, sont mises au nombre des morceaux de Peinture les plus achevés qui soient en-deçà des Alpes. Mais personne n’a si bien réussi dans les batailles, dont les figures soient habillées à la Françoise, que Wandermeulen, illustre peintre Flamand. Il dessinoit les chevaux mieux que qui que ce soit, & il excelloit particulierement dans les paysages & les représentations des pays plats. Il avoit été choisi pour peindre les conquêtes de Louis XIV.
On appelle Peintres de batailles, ceux qui se livrent à ce genre de représentations. (R)
Bataille, cheval de bataille, (Manege.) est un cheval fort & adroit, que l’on réserve pour les occasions où il faut combattre. (V)
Batailles, s. f. pl. c’est ainsi qu’on appelle, dans les grosses Forges, la galerie qui regne autour de la charge ou du haut de la cheminée. Ainsi Pl. V. fig. 1. des grosses Forges, l’espace FF sont les batailles.
BATAILLÉ, en terme de Blason, se dit d’une cloche dont le battant est d’un autre émail qu’elle n’est. Bellegarde, d’azur à une cloche d’argent, bataillé de sable. (V)
BATAILLON, s. m. dans l’Art militaire, est un nombre d’hommes à pié, assemblés pour agir & combattre ensemble, comme s’ils ne faisoient qu’un seul & même corps.
« La premiere chose qui se présente à examiner dans le bataillon, c’est le nombre d’hommes dont il doit être composé.
On a d’abord observé qu’une troupe formée d’un grand nombre d’hommes, ne pourroit se mouvoir avec facilité ; mais aussi, si elle en a un trop petit nombre, elle ne sera capable d’aucun effet considérable : il faut donc que le nombre des hommes du bataillon permette de le faire mouvoir avec facilité ; que ces hommes soient aussi en assez grande quantité pour faire une espece de corps solide, qui puisse attaquer avec fermeté & soûtenir les différens chocs auxquels il est exposé.
Il n’est pas aisé de fixer ce nombre d’une maniere précise & géométrique ; il dépend des coûtumes des peuples qui font la guerre, de leurs armes, de la maniere de s’en servir, & de leur façon de combattre : aussi les usages ont-ils été fort différens sur ce point. Mais à présent toutes les nations de l’Europe, hors les Turcs, suivent à-peu-près le même ordre à cet égard ; les termes mêmes de bataillons & d’escadrons sont employés dans toutes les langues.
Depuis long-tems il paroît que parmi nous le nombre des hommes du bataillon est à-peu-près fixé à sept cens : mais chez les différentes nations de l’Europe, les uns ont leurs bataillons plus forts, & les autres moins. En France, dans les deux dernieres guerres qui ont precédé la mort de Louis XIV. les bataillons étoient composés de treize compagnies de cinquante hommes chacune, ce qui faisoit six cents cinquante hommes ; ils avoient plus de quarante officiers.
Dans la guerre de 1733 ils étoient composés de seize compagnies de quarante hommes chacune, & d’une dix-septieme de quarante-cinq, ce qui faisoit six cens quatre-vingt-cinq hommes, non compris cinquante-deux officiers.
Dans la guerre de 1741 ils étoient composés de même, excepté qu’ils n’avoient que trente-quatre officiers. Le fonds des bataillons François a été autrefois plus considérable.
Il faut observer que pendant la guerre, les bataillons étant formés au commencement de la campagne sur le pié prescrit par le prince, & que ces bataillons n’étant point ordinairement recrutés pendant le cours de la campagne, il arrive par la perte que leur causent les actions de la guerre, les maladies, &c. qu’ils ne sont presque jamais complets.
Dans le nombre des hommes fixé pour le bataillon, il y a une compagnie de grenadiers attachée, laquelle est souvent employée à des usages particuliers, & qui n’agit pas toûjours avec le bataillon.
On appelle grenadiers, des soldats choisis sur tout un régiment par rapport à la valeur & à la force du corps. Ils sont destinés aux fatigues & aux emplois périlleux de la guerre. Le nom de grenadiers leur vient des grenades dont ils se servoient autrefois. Voyez Grenadier.
Les soldats sont assemblés & arrangés dans le bataillon par rang & par file. Ainsi leur nombre & leur distance constituent sa forme & l’espace qu’il occupe sur le terrein.
Du tems de Louis XIII. les bataillons étoient sur huit rangs : ils ont été ensuite réduits à six. Les dernieres ordonnances de Louis XIV. les fixent à cinq : mais l’usage, même de son tems, les a fixés à quatre. A l’égard de leur distance, les ordonnances militaires en distinguent de deux sortes ; savoir, pour paroître & pour combattre.
Les distances pour paroître sont fixées pour l’intervalle d’un rang à un autre, à la longueur de deux hallebardes, ce qui se prend pour douze piés en y comprenant la profondeur ou l’épaisseur des hommes du devant de la poitrine au dos. Les mêmes ordonnances ne prescrivent rien par rapport aux files ; & en effet leur distance est assez difficile à évaluer exactement : mais il paroît que l’usage le plus ordinaire a toûjours été de compter trois piés pour l’intervalle d’une file à une autre, en comprenant dans cette distance l’espace occupé par un homme, c’est-à-dire du milieu d’un homme au milieu de celui de la file suivante.
Lorsqu’il s’agit de combattre, les officiers s’approchent autant qu’il est possible du bataillon, & les rangs se serrent jusqu’à la pointe de l’épée, c’est-à-dire, que le second rang doit toucher le bout des épées du premier, ce qui ne donne guere que trois piés pour l’épaisseur du rang & pour son intervalle. Les files s’approchent autant qu’il est possible, en conservant la liberté du coude ; ce qui veut dire, comme on l’entend ordinairement, que la file & son intervalle doivent occuper environ deux piés. On voit par là que le bataillon occupe alors beaucoup moins d’espace qu’auparavant.
Les officiers chargés du soin de former les bataillons, ne paroissent pas s’embarrasser beaucoup à présent de la distance des rangs, parce qu’elle peut être changée fort aisément dans un instant, & surtout diminuée ; c’est pourquoi ils laissent prendre douze piés pour cette distance : mais à l’égard de celle des files, comme il faut plus de tems pour la changer, ils la fixent à deux piés pour l’épaisseur de la file & pour son intervalle, ce qui est un espace suffisant pour combattre.
Il suit de là que pour savoir l’espace que le bataillon occupe sur le terrein, il faut compter deux piés pour chaque homme dans le rang, & douze piés pour l’épaisseur du rang, jointe à son intervalle.
Ainsi supposant un bataillon de six cents cinquante hommes sans compter les officiers, & que ce bataillon soit composé de cinq rangs, on trouvera les hommes de chaque rang, en divisant six cens cinquante par cinq, ce qui donnera cent trente hommes par rang ; multipliant ensuite ce nombre par deux, on aura deux cens soixante piés, ou quarante-trois toises deux piés pour l’étendue de chaque rang.
A l’égard de la profondeur des cinq rangs, comme ils ne forment que quatre intervalles, elle est de quarante-huit piés ou de huit toises, non compris l’espace occupé par les officiers.
« Si le bataillon n’est que sur quatre rangs, il n’aura que trente-six piés de profondeur, attendu que ses rangs ne donneront que trois intervalles : mais alors son front augmentera ; car six cents cinquante divisés par quatre, donnent cent soixante-deux hommes par chaque rang : multipliant ces hommes par les deux piés qu’ils occupent sur le terrein, on aura trois cents vingt-quatre piés, ou cinquante-quatre toises pour le front du même bataillon.
Ce modele de calcul ou de supputation peut servir pour toutes sortes de bataillons dont le nombre d’hommes sera connu, de même que celui des rangs : dans tous les cas il formera toûjours un rectangle beaucoup plus étendu sur une dimension que sur l’autre ». Essai sur la Castramétation, par M. le Blond.
Bataillon quarré, est un bataillon dont les soldats sont arrangés de maniere que les rangs sont égaux aux files, en sorte que les quatre côtés qui le terminent contiennent le même nombre d’hommes. Voyez File.
Il y a deux sortes de bataillons quarrés ; savoir, à centre plein, & à centre vuide.
Le bataillon quarré à centre plein, est celui dont les hommes sont placés tout de suite, ne laissant que l’intervalle ordinaire des rangs & des files.
Le bataillon quarré à centre vuide, est celui qui laisse dans son centre un espace vuide de soldats, & qui est assez considérable eu égard au terrein occupé par le bataillon.
Le bataillon quarré à centre plein est très-aisé à former. Ceux qui ont quelque connoissance de l’extraction de la racine quarrée, n’y peuvent pas être embarrassés ; car extrayant la racine quarrée du nombre d’hommes dont le bataillon doit être composé, on trouve d’abord la quantité dont chaque côté doit être composé.
Ce bataillon est assez peu d’usage dans la Tactique moderne.
1.o Parce que le feu des ennemis, & principalement celui du canon, y peut faire un très-grand desordre.
2.o Parce que les soldats du centre ne peuvent presque pas se servir de leur feu contre l’ennemi. M. le chevalier de Folard est presque le seul qui en prescrive l’usage : sa colonne n’est autre chose que deux ou trois bataillons à centre plein placés sans intervalle les uns derriere les autres. V. Colonne.
Le bataillon à centre vuide présente, comme celui qui est à centre plein, des hommes de tous côtés. On prétend que le fameux Maurice de Nassau a été le premier qui ait trouvé l’usage de vuider le centre des bataillons.
Le bataillon à centre vuide n’a pas plus de difficulté dans sa formation que celui à centre plein : un exemple suffira pour en donner une idée.
Soit un nombre d’hommes quelconque, comme 1200, dont on veut faire un bataillon quarré à centre vuide, de maniere que le côté du quarré vuide, par exemple, ait douze hommes.
Il faut retrancher deux unités du nombre 12, parce que le côté du quarré vuide, s’il étoit rempli d’hommes, en contiendroit deux de moins que le dernier rang intérieur de la partie du quarré qui est remplie : ôtant donc 2 de 12, il reste 10 qu’il faut quarrer, & l’on aura 100, que l’on ajoûtera au nombre donné 1200. Ces deux nombres ajoûtés ensemble donneront 1300, dont on extraira la racine quarrée qu’on trouvera être 36 ; il restera quatre hommes qu’on pourra placer dans le centre du bataillon.
| Racine. | |||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 36. | |||
| 9. | |||||||
| 4 | 0 | 0. | |||||
| 6 | 6 | ||||||
| Reste | 4. |
Voyez Racine quarrée.
Présentement pour former le bataillon, je considere que s’il étoit plein, & qu’il fût de 1300, toutes les files & tous les rangs seroient de 36 hommes : mais il doit y avoir un vuide dans le milieu du bataillon de dix hommes ; donc dans cet endroit les files n’auront que 26 hommes ; c’est-à-dire, 36 moins 10 : mais ces dix hommes doivent diminuer également les demi-files du milieu ; elles n’auront donc chacune que 13 hommes ; d’où il suit qu’il n’y aura dans cet exemple que 13 rangs de 36 hommes dans le bataillon, à commencer de la tête & de la queue du bataillon, & de la droite à la gauche. Arrangeant ainsi le bataillon, il restera le vuide demandé ; & alors chaque côté du quarré intérieur sera de 12 hommes, c’est-à-dire, de deux hommes de plus à chaque côté que le côté 10 n’en a.
Pour la preuve il suffit de considérer qu’ayant ajoûté au nombre proposé, le nombre d’hommes qu’occuperoit l’espace qu’on veut laisser vuide dans le bataillon, on peut alors regarder le nombre proposé augmenté de ce dernier, comme le nombre d’hommes dont il faut extraire la racine quarrée ; laquelle racine donnera le nombre des hommes, des rangs & des files d’un tel quarré. Or retranchant vers le milieu le nombre qu’on a ajoûté à chaque file, il restera, pour le bataillon disposé en quarré, le nombre d’hommes qui avoit d’abord été proposé : cela est évident.
On peut par cette même méthode, lorsqu’un nombre d’hommes est donné, en former un bataillon quarré qui paroisse d’un bien plus grand nombre d’hommes : car si l’on a, par exemple, 1200 hommes, dont on veuille former un bataillon quarré qui paroisse 3000, on extraira la racine quarrée de ce dernier nombre, laquelle sera trouvée de 54, avec un reste 84 qu’on peut négliger ; ce nombre seroit celui des hommes de chaque rang, de chaque file d’un bataillon quarré à centre plein de 3000 : mais comme on a ajoûté 1800 hommes au nombre donné 1200, il faut retrancher du dedans de l’intérieur du bataillon l’espace qu’occuperoient ces 1800 hommes. Pour cela il faut extraire la racine quarrée de 1800, laquelle est 42 ; c’est le nombre d’hommes qu’il faut retrancher des files du milieu du bataillon plein. Ces files sont de 54, desquelles ôtant 42, il reste 12, dont la moitié 6 est le nombre des rangs de la tête & de la queue du bataillon, de même que de ceux de la droite & de la gauche. Ainsi par cette formation les 1200 hommes donnés occuperont l’espace d’un bataillon à centre plein de 3000 ; & ils seront rangés sur six de hauteur ou de file sur chaque côté du bataillon. Traité de l’Arithmétique & de la Géométrie de l’officier par M. Leblond.
Bataillon rond, est celui dont les soldats sont rangés circulairement, en formant plusieurs circonférences concentriques.
Ce bataillon a été fort en usage parmi les Romains ; c’est ce qu’ils appelloient in orbem : on en voit plusieurs exemples dans les commentaires de César. Feu M. le maréchal de Puysegur faisoit cas de ce bataillon.
Bataillon triangulaire, est un corps de troupes disposé en triangle, & dont les rangs augmentant également, forment une progression arithmétique.
Si le premier rang est un, & que les autres augmentent chacun d’une unité, le bataillon formera un triangle qui aura les trois côtés égaux ; c’est-à-dire, qu’il sera équilatéral ; autrement il formera un triangle quelconque.
Problème pour la formation du bataillon triangulaire équilatéral : un nombre d’hommes quelconque, par exemple, 400, étant donné pour en former un bataillon équilatéral, trouver le nombre des rangs dont il sera composé.
Comme dans ce bataillon le premier rang est 1, le second 2, le troisieme 3, &c. il s’ensuit que ce problème se réduit à trouver le nombre des termes d’une progression arithmétique dont le premier terme est 1, la différence aussi 1, & la somme 400. Voyez Progression arithmétique.
Solution. Soit le nombre des termes de la progression représenté par n, le dernier sera aussi n ; car il sera l’unité prise autant de fois qu’il y a de termes.
Cela posé, la somme des extrèmes de la progression sera 1 + n, laquelle multipliée par le nombre des termes n, donnera n + nn, ou nn + n, pour le double de la somme de la progression ; c’est-à-dire, que cette expression nn + n, sera égale à deux fois 400, ou à 800. Or nn est le quarré du nombre des termes de la progression, n en est la racine : donc 800 contient le quarré du nombre des termes de la progression, plus la racine de ce quarré.
Il suit delà que pour avoir la valeur de n, ou le nombre des termes de la progression, il faut extraire la racine quarrée de 800, de maniere qu’il y ait un reste égal à la racine, ou qui la contienne.
| Extrayant donc la racine quarrée de 800, on trouve 28 avec le reste 16 : mais, comme ce reste est plus petit que la racine 28, on met 7 à la place de 8.
Et achevant l’opération, on a le reste 71, qui contient la racine 27 ; ainsi 27 est le nombre des termes ou des rangs du bataillon. |
8100 | 28. | |||
| 400 | |||||
| 48 | |||||
| Reste | 16. | ||||
| 8100 | 27. | ||||
| 400 | |||||
| 47. | |||||
| Reste | 71. | ||||
Pour le prouver, il faut chercher quelle est la somme de la progression dont le premier terme est 1, le second 2, & le nombre des termes 27.
| Puisque le nombre des termes est 27 ; donc lui ajoûtant le premier 1, la somme des extrèmes sera 1 + 27 = 28, dont la moitié 14 étant multipliée par 27, nombre des termes, donnera 378 pour le nombre des hommes du bataillon proposé. Comme le nombre donné étoit 400, on voit qu’il reste 22 hommes qui ne peuvent entrer dans le bataillon, & qu’on peut employer ailleurs, & en former un peloton séparé. | ||||
| 14. | ||||
| 27. | ||||
| 98. | ||||
| 28. | ||||
| 378. | ||||
Il suit de la résolution du problème précédent, que pour former des bataillons triangulaires équilatéraux, il faut quelque nombre de soldats, que l’on ait pour cet effet, le doubler, & ensuite en extraire la racine quarrée : mais de maniere qu’il y ait un reste égal à la racine, ou qui la contienne, & qu’alors cette racine sera le nombre des rangs du bataillon, dont tous les côtés seront égaux.
| Si l’on a, par exemple, 785 hommes à disposer ainsi en bataillon triangulaire équilatéral, on commencera par les doubler, ce qui donnera 1570. On extraira la racine quarrée de ce nombre, on la trouvera de 39 avec 49 qui la contient : donc 39 est le nombre des rangs de ce bataillon. | 1570 | 39. | |||
| 9 | |||||
| 670. | |||||
| 69. | |||||
| Reste | 49. | ||||
On déterminera de la même maniere celui de tous les autres de la même espece que l’on pourra proposer.
Remarque. Si on suppose que la différence qui regne dans la progression est 2, c’est-à-dire, que le premier terme étant toûjours 1, le second est 3, le quatrieme est 5, &c. le dernier terme sera (n étant toûjours le nombre des termes) n-1 multiplié par 2, plus 1, ou 2 n - 2 + 1 ; & ajoûtant à ce terme le premier 1, la somme des extremes sera 2 n - 2 + 1 + 1 ; expression qui se réduit à 2 n, dont la moitié étant multipliée par le nombre des termes, donnera le nombre de la progression nn. Ainsi nommant S la somme de la progression, on a nn = S, c’est-à-dire, le quarré du nombre des termes égal à la somme de la progression ; & par conséquent n qui est la racine quarrée de nn, est égal à celle de S ; en sorte que .
D’où il suit que dans une progression arithmétique dont le premier terme est 1, & le second 3, le nombre des termes est égal à la racine quarrée de la somme des termes.
| Ainsi, si l’on donne 400 hommes pour former un bataillon triangulaire, dont le premier rang est 1, & le second 3, ce qui est la seconde espece des bataillons triangulaires, on trouvera le nombre des rangs de ce bataillon, en extrayant la racine quarrée de 400. Or cette racine est 20, donc ce bataillon aura vingt rangs. | ||||||
| 41 | 00 | 20. | ||||
| 4 | ||||||
| 0 | 00. | |||||
Pour le prouver, considérez que ce dernier rang sera 1 + 19 ✕ 2 ou 39, & qu’en y ajoûtant 1, on aura 40 pour la somme des extrèmes, laquelle étant multipliée par 10, moitié du nombre des termes, donnera 400 pour la somme de la progression, c’est-à-dire, le nombre proposé.
| Si l’on a de même 542 pour former un bataillon triangulaire de même espece, on extraira la racine quarrée de ce nombre, laquelle sera trouvée de 23. C’est donc le nombre des termes de cette progression. | 542 | 23. | |||
| 4 | |||||
| 142 | |||||
| 43 | |||||
| Reste | 13 | ||||
| On le prouvera comme dans l’exemple precédent, en considérant que le dernier terme sera 1 + 2 ✕ 22 = 45 : ajoûtant à ce terme le premier 1, on aura 46, qui sera la somme des extrèmes, dont la moitié 23 multipliée par le nombre des termes, donnera 529, auquel ajoûtant le reste 13, on aura le nombre proposé 542. | 23 | ||
| 23 | |||
| 69 | |||
| 46 | |||
| 529 | |||
| Reste | 13 | ||
| 542 | |||
On opérera de même pour tous les autres bataillons de même espece, quel que soit le nombre dont on voudra les former.
On voit par ce qui vient d’être enseigné sur les bataillons triangulaires, qu’ils ne sont pas plus difficiles à calculer que les bataillons quarrés. Plusieurs officiers leur donnent la préférence sur ces bataillons, parce qu’ils présentent un plus grand front, & qu’ils font également face de tous côtés. Mais comme il est difficile de faire marcher des soldats dans cet ordre, M. Bottée les croit préférables aux bataillons quarrés, seulement dans les cas où il faut combattre de pié ferme, & se donner un grand front ; ou lorsque la situation du terrein exige cette disposition. On pourra voir dans cet auteur la maniere de les former par des mouvemens réguliers. Arithmétique & Géom. de l’officier par M. Le Blond. (Q)
* BATALES, s. m. pl. (Hist. anc.) nom que les anciens donnoient aux hommes lascifs & efféminés, d’un certain Batale joueur de flûte, qui exerçoit son art avec mollesse & dissolution, & qui parut le premier sur la scene en chaussure de femme. Les ennemis de Demosthene l’appelloient batale.
* BATANOMES, s. f. (Commerce.) toiles longues de vingt-huit piés la piece, & dont la largeur varie ; elles se vendent au Caire vingt médins. Voyez Médins & Caire.
BATARD, s. m. ou ENFANT NATUREL, (Hist. anc. mod. & Jurisprud.) qui est un terme plus adouci, est celui qui est né hors d’un légitime mariage.
Il y a de deux sortes de bâtards ; les uns simples, tels que ceux qui sont nés de deux personnes libres, c’est-à-dire non engagées dans le mariage, ou dans un état qui les oblige à la continence ; mais qui pouvoient contracter mariage ensemble : les autres sont ceux qui sont nés d’autres conjonctions plus criminelles, comme les bâtards adultérins & les incestueux.
Les bâtards adultérins sont ceux dont le pere ou la mere, ou tous les deux étoient engagés dans le mariage. On appelle même adultérins les enfans des prêtres ou des religieuses.
Les bâtards incestueux sont ceux dont le pere & la mere étoient parens à un degré auquel le mariage est prohibé par les canons.
Les bâtards en général ne sont d’aucune famille, & n’ont aucuns parens ; ils ne succedent dans la plus grande partie du royaume ni à leur pere ni à leur mere, & encore moins aux parens de l’un ou de l’autre, en exceptant le Dauphiné & quelques coûtumes particulieres, où ils succedent à leur mere.
Ils ne peuvent pas même recevoir de leurs pere ou mere naturels des legs universels ou donations considérables : mais ils en peuvent recevoir de médiocres proportionnément aux facultés du pere ou de la mere. C’est à la prudence des juges de décider si elles sont modérées ou excessives.
Pour les bâtards adultérins & incestueux, ils ne peuvent recevoir que des alimens : mais aussi peuvent-ils même les exiger soit de leur pere naturel, soit de ses héritiers, s’il est mort sans y avoir pourvû ; du moins jusqu’à ce qu’ils ayent appris un métier, & qu’ils ayent été reçûs maîtres.
Comme par le droit commun les bâtards ne succedent à personne, personne non plus ne leur succede, si n’ayant point d’enfans, ils décedent sans avoir disposé de leurs biens par donation ou par testament ; en ce cas leur succession appartient aux seigneurs haut-justiciers, pourvû que les trois conditions suivantes concourent ensemble : qu’ils soient nés dans la justice du seigneur, qu’ils y soient décédés, & que leurs biens y soient ; l’une de ces trois conditions manquant, c’est au roi qu’elle appartient.
Du reste ils sont capables de toutes sortes de contrats, & entre autres de mariage ; ils peuvent disposer librement de leurs biens, soit entre-vifs, soit par testament ; ils ne sont incapables ni d’offices ni de dignités : mais ils ne peuvent avoir des bénéfices sans dispense, à moins qu’ils ne soient légitimés. Voyez Légitimation.
Chez les Athéniens, une loi de Solon excluoit du droit de bourgeoisie non-seulement les enfans nés des concubines, mais encore tous ceux qui n’étoient pas nés d’un pere & d’une mere Athéniens. Cette loi souffrit de tems en tems quelques atteintes de la part de ceux qui eurent assez de crédit pour faire aggréger leurs bâtards au corps des citoyens. Tel fut Themistocle, dont la mere étoit de Thrace. Pericles renouvella cette loi dans toute sa rigueur, & condamna cinq mille bâtards à être vendus comme esclaves : mais la peste lui ayant enlevé ses enfans légitimes, il demanda lui-même au peuple la révocation de la loi en faveur d’un bâtard qu’il avoit d’Aspasie. On la lui accorda, & cet exemple eut des suites pernicieuses : bientôt il n’y eut plus de distinction entre les enfans légitimes & les bâtards, entre les femmes Athéniennes & les étrangeres : ce qui jetta le trouble & la confusion dans toutes les familles.
En France, les bâtards ou fils naturels du roi, sont princes, lorsqu’il s’en reconnoît le pere ; ceux d’un prince ou d’un homme de qualité, sont gentilshommes : mais ceux d’un gentilhomme ne sont que roturiers ; & dans cette qualité, ils sont sujets à la taille.
Suivant le droit Romain, la mere succédoit à son enfant bâtard ; mais ce droit mettoit une grande différence entre les bâtards qu’il qualifioit nothi, ou simplement bâtards, & ceux qui étoient spurii.
La loi ne reconnoissoit point ces derniers, & leur refusoit jusqu’à la nourriture, parce qu’ils étoient les fruits d’une prostitution publique, & sans peres qui fussent bien connus pour tels de leurs meres même, par la raison que is non habet patrem, cui pater est populus. Les autres étant nés dans le concubinage, qui ressemble au mariage, héritoient de leurs meres, & pouvoient exiger des alimens de leurs peres naturels.
On les considéroit comme des créanciers domestiques, & des personnes que l’on devoit traiter avec d’autant plus d’humanité, qu’elles étoient les innocentes productions des crimes de leurs parens.
Les peres n’avoient point l’autorité paternelle sur leurs bâtards, parce que n’étant, disoit-on, peres que pour le plaisir, ce plaisir devoit être leur unique récompense.
Anciennement à Rome, les enfans naturels étoient absolument exclus de la succession de leurs peres ab intestat, mais ils pouvoient être institués héritiers.
Les Empereurs Arcadius & Honorius firent une exception en faveur des enfans naturels, & les admirent au douzieme de la succession à partager avec leur mere, quand il y avoit des enfans légitimes ; ensuite Justinien les admit à ce partage pour une moitié, & voulut qu’ils eussent un sixieme de l’hérédité ab intestat, lorsqu’il y avoit des enfans légitimes.
Les bâtards pouvoient être légitimés, soit par un mariage subséquent, ou par lettres de l’empereur. En France le roi seul a le droit de légitimer des bâtards, & de les rendre habiles à succéder. Voyez Légitimation.
En Angleterre ce droit privatif appartient au roi & au parlement.
L’empereur Anastase permit aux peres de légitimer leurs bâtards par la seule adoption : mais ce privilége fut aboli par Justin & Justinien, de peur qu’une telle condescendance n’autorisât le concubinage.
Le pape a quelquefois légitimé des bâtards, le saint-siége a même en certaines occasions, usé de dispense par des considérations spirituelles, non-seulement envers des personnes dont la naissance n’étoit pas légitime, mais encore envers des bâtards adultérins, en permettant leur promotion à l’épiscopat.
Les bâtards non légitimés peuvent disposer de leurs biens par donation entre-vifs, & par testament ; ceux qu’un mariage subséquent a légitimés, sont dans le même état, & joüissent des mêmes droits que ceux qui sont nés dans le mariage : mais les bâtards légitimés par lettres du prince, ne sont réputés ni légitimes, ni capables de succéder, qu’à l’égard des parens qui ont consenti à cette légitimation.
Le Pape Clément VII. défendit par sa bulle à un certain prêtre de résigner son bénéfice à son bâtard.
Les armes d’un bâtard doivent être croisées d’une barre, d’un filet, ou d’une traverse, de la gauche à la droite. Ils n’avoient point autrefois la permission de porter les armes de leur pere.
Les bâtards ne peuvent être présentés à des bénéfices simples, ni admis aux moindres ordres, ni posseder plus qu’un simple bénéfice, à moins qu’ils n’en ayent obtenu dispense du pape, ni être revêtus d’aucune charge sans lettres du prince.
Un bâtard, suivant le droit d’Angleterre, ne peut être héritier de son pere à l’immeuble, & ne sauroit avoir d’autre héritier que l’hoir de son corps. L’enfant engendré par celui qui dans la suite en épouse la mere, est un bâtard en droit, quoiqu’il soit réputé légitime par l’église. Si celui qui vient d’épouser une femme, décede avant la nuit sans avoir couché avec elle, & qu’ensuite elle fasse un enfant, il en est censé le pere, & l’enfant est légitime. Si un époux ou une femme se marie ailleurs, les enfans qui naissent de cette polygamie pendant la vie de l’autre conjoint, sont bâtards. Si une femme ayant quitté son mari pour suivre un adultere, a de celui-ci un enfant, tandis que son mari est dans l’enceinte des quatre mers, l’enfant est légitime, & sera son héritier à l’immeuble. Si quelqu’un fait un bâtard dans le bailliage de Middelton, dans la province de Kent, ses biens meubles & immeubles font confisqués au profit du roi. (H)
Batard de racage, c’est, en Marine, une corde qui sert à tenir & à lier un assemblage de bigots & de raques, dont le tout pris ensemble porte le nom de racage, qui sert à amarrer la vergue au mât. Voyez Racage. (Z)
* Batard, en Musique, c’est ainsi que Brossart appelle le mode hyper-éolien, qui a sa finale en b fa si, & conséquemment sa quinte fausse ou diminuée diatoniquement, ce qui le chasse du nombre des modes authentiques ; & le mode hyper-phrygien, dont la finale est en f ut fa, & la quarte superflue, ce qui l’ôte du nombre des modes plagaux.
Batard, en Jardinage, se dit de toute plante sauvage, ou qui n’est pas cultivée, & même du fruit qu’elle donne.
Batard, en Fauconerie, se dit d’un oiseau qui tient de deux especes, comme du sacre & du lanier.
BATARDE ou BASTARDELLE, s. f. en Marine ; on appelle ainsi les galeres qui ont l’extrémité de la poupe plate & élargie, pour les distinguer de celles qui ont l’extrémité de la poupe aiguë, qu’on appelle subtiles.
Batarde, Bastarde, (voile) en Marine, c’est la plus grande des voiles d’une galere ; elle ne se porte que lorsqu’il y a peu de vent, parce que de vent frais, les voiles ordinaires suffisent. (Z)
* Batarde (laine) en Bonneterie ; c’est ainsi qu’on appelle la seconde sorte parmi celles qui se levent de dessus le vigogne. Il se dit aussi des laines communes du Levant.
Batarde, (pâte) en terme de Boulanger biscuitier ; c’est celle qui, n’étant ni dure ni molle, a pris une certaine consistance qui n’est connue que de l’ouvrier, & qu’on ne peut guere expliquer aux autres.
Batarde, (largeur en Draperie.) se dit de celle des draps ou autres étoffes, qui n’est pas conforme aux ordonnances. Ainsi les draps d’une aune demi-quart, sont de largeur bâtarde & sujets à confiscation.
Batarde, seconde sorte de dragée fondue au moule ; elle est entre la petite royale & la grosse royale. Voyez l’article Fonte de la dragée au moule.
Batardes, en terme de Rafineur de sucre, sont les sucres produits des sirops qui sont émanés des matieres fines. Voici la maniere dont on les travaille : la cuite s’en fait comme celle des sucres primitifs, on transporte la cuite dans des rafraîchissoirs, en allant de l’un à l’autre, c’est-à-dire, en mettant à la ronde dans chacun d’eux le même nombre de bassins. Voyez Bassin d’empli. Avant d’être emplis, les formes bâtardes sont trempées, tapées, sondées & plantées. Voyez ces mots à leur article. Le rafraîchissoir d’où on commence à prendre la cuite, est remué sans cesse & à force de bras par un seul ouvrier, pendant que d’autres portent la cuite, & n’en versent dans chaque forme que le tiers d’un bassin. Il faut deux serviteurs pour emplir une rangée. Voyez Serviteur. Ils commencent chacun par un bout, se rejoignent au centre, vont de forme en forme regagner leur bout, d’où ils reviennent ensemble au centre, pour retourner au bout, & continuent cette maneuvre jusqu’à ce que les formes soient mises à hauteur. Voyez Mettre à hauteur. On les remplit en observant la même maneuvre, afin de mêler le sirop avec le grain qui tombe toûjours au fond du rafraîchissoir, malgré le mouvement qu’on lui donne. Ensuite quand elles sont froides, on les monte. Voyez Monter. On les met sur le pot, sans les percer ; mais après les avoir détapées, voyez Detaper, on les couvre de terre, on les change ; on les plante, mais on ne les plamote point. Les bâtardes sont rafinées avec les matieres primitives, & les sirops qu’on en a recueillis servent à faire des vergeoises. Voyez tous ces mots à leur article.
Batarde, en terme de Rafinerie de sucre ; c’est une grosse forme qui tient quelquefois jusqu’à deux cents livres de matiere : on emplit les bâtardes des sirops recuits, qui produisent une espece de sucre que l’on appelle aussi bâtardes. Voyez Batardes.
Batarde, (lime.) en terme de Bijoutier, sont celles qui sont d’un degré au-dessous des rudes, & dont on ne fait usage qu’après elles. Il y en a de toutes grandeurs & de toutes formes.
Batarde (Ecriture.) Voyez Ecriture.
Demi-Batardes, en terme de Bijoutier, sont des limes, qui ne sont ni trop rudes, ni trop douces ; mais qui tiennent le milieu entre les limes bâtardes & les douces. Il y en a de plusieurs grandeurs & de plusieurs formes.
BATARDEAU, s. m. terme de riviere & de mer, c’est une espece de digue faite d’un double rang de pieux joints par des planches, & dont l’intervalle est rempli de terre ; on s’en sert pour detourner l’eau d’une riviere.
On donne aussi le nom de batardeau à une espece d’échafaut fait de quelques planches qu’on éleve sur le bord d’un vaisseau, pour empêcher l’eau d’entrer sur le pont, lorsqu’on couche le vaisseau sur le côté pour le radouber. (Z)
Batardeau (le) est, dans la Fortification, un massif de maçonnerie qui traverse toute la largeur du fossé : on le place ordinairement vis-à-vis les angles saillans des bastions & des demi-lunes, & sur le prolongement des capitales de ces ouvrages.
On fait des bâtardeaux dans les fossés d’une place, pour en retemir l’eau & empêcher qu’elle ne s’écoule par les endroits du fossé qui se trouvent plus bas que les autres.
Pour qu’un bâtardeau soit bon & solide, il doit avoir depuis 15 piés jusqu’à 18 piés d’épaisseur. On le construit vis-à-vis les angles saillans des ouvrages de la fortification ; parce que dans tout autre endroit il pourroit servir de couvert à l’ennemi dans le passage du fossé contre le feu de la place. Sa partie supérieure forme une espece de toît en dos d’âne, & elle se nomme la cape du bâtardeau. On construit sur le milieu de la cape une petite tour d’environ 6 ou 7 piés de hauteur, & d’autant de diametre ; elle sert à empêcher qu’on marche sur la cape, & elle s’oppose ainsi à la desertion des soldats. Voyez un bâtardeau en D, Pl. IV. de Fortific. fig. 3. (Q)
BATARDIERE, s. f. (Jardinage.) est un lieu de passage ; c’est la place dans un jardin où l’on transplante des arbres tout greffés tirés de la pépiniere, & que l’on y met en réserve.
Pour les mieux lever en motte dans la suite, on les plante à 6 ou 7 piés de distance l’un de l’autre sur des alignemens tirés au cordeau.
Les fruits à noyau sont ordinairement séparés d’avec ceux à pepin.
On les leve pour être transportés trois ans après avoir été greffés dans la pépiniere.
On laboure & on taille ces arbres, qui donnent souvent de très-beaux fruits. (K)
BATARDISE, f. f. (droit de) terme de Jurispr. est le droit qu’ont les souverains en France, & en certains cas les seigneurs haut-justiciers, de s’approprier la succession des bâtards morts sans enfans & sans avoir disposé de leur bien par donation ou ordonnance de derniere volonté. Voyez Batard. (H)
BATATE, TOPINAMBOUR ou POMME DE TERRE, s. f. (Hist. nat. & Jard.) On en distingue de trois especes ; celle d’Espagne, celle de la Virginie, & celle du Canada. La premiere a passé de Newfoundland dans les jardins d’Espagne. Elles ont toutes les trois à-peu-près les mêmes propriétés médicinales.
On doit les choisir grasses, bien nourries, tendres, rougeâtres en-dehors, blanches en-dedans, & d’un goût approchant de celui de l’artichaut. Elles nourrissent, elles humectent beaucoup, elles adoucissent les acrimonies de la poitrine : mais elles engendrent des humeurs grossieres, & excitent des vents.
Ces fruits ou plûtôt ces racines sont émollientes, & bonnes pour prévenir ou dissiper les maladies qui proviennent de la rigidité des fibres ; c’est un aliment convenable à ceux qui font beaucoup d’exercice, & aux gens bilieux, & à tous ceux dont les humeurs sont trop acres & trop agitées.
Batate cathartique ou Cacamote hanaquiloni, (Med.) Les racines prises à la dose de deux onces sur le point de se mettre au lit, purgent doucement & sans danger. On dit que cette batate est douce & agréable au goût, & ne le cede en rien à nos pois. (N)
* BATAVES, s. m. pl. (les) Hist. mod. & Géog. Il est fait mention de ces peuples dans les commentaires de César, & autres écrivains anciens. Ils occupoient une partie de la Hollande méridionale, une partie du duché de Gueldre & de la seigneurie d’Utrecht. On entend aujourd’hui par Bataves les Hollandois.
* BATAVIA, (Géog.) ville d’Asie dans l’île de Java, au royaume de Bantan. Long. 124. 30. lat. mérid. 6. 10.
* Batavia, (Géog.) nom d’une riviere de la terre Australe, dans la province appellée Carpentaria, vers la mer.
BATAYOLLES, s. f. pl. (Marine.) ce sont des pieces de bois, ou gros bâtons quarrés d’environ quatre pouces, & de la hauteur de trois piés, qui sont attachées perpendiculairement par le dedans aux bacalas. Voyez la Planche II. n°. 19. (Z)
BATE, s. f. en terme de Fourbisseur, est cette partie polie & luisante d’un corps d’épée, sur laquelle on monte la moulure. Voyez Corps d'épée, & Moulure.
Bate d’une boîte de montre. Voyez Boîte de montre, & la fig. 12. Pl. XII. de l’Horlogerie.
Bate, en terme de Metteur-en-œuvre ; c’est la partie élevée perpendiculairement sur le fond de la boîte ou tabatiere, qui en fait les côtés & le contour, & qui forme la cuvette. Voyez Cuvette & Boîte.
Bates ou Rouelles, terme de Potier-d’Etain ; ce sont des plaques d’étain jettées en moule toutes plates ; elles servent à faire des pieces de rapport. Voyez Pieces de rapport.
BATEAU, BATEAUX, s. m. On nomme ainsi, en terme de Marine, diverses sortes de petits vaisseaux que l’on mene à la voile & à la rame, mais qui sont faits plus matériellement & plus forts que les chaloupes : l’on a aussi de grands bateaux portant mâts, voiles & gouvernail, & qui ne peuvent aller qu’à la voile.
Il y a différentes especes de bateaux, auxquels on donne différens noms, suivant leur forme, leur usage, & les lieux où l’on s’en sert. Ainsi on peut renfermer sous ce nom, la chaloupe, la barque, l’esquif, le canot, le paquebot, le coche-d’eau, le bac, le flibot, la patache, la gondole, le ponton, la felouque, le bateau-marnois, le bateau-foncet, le chaland, le bateau de selle, le bateau de poste, le bachot, la nacelle, le batelet, &c. & quelques autres.
Bateaux à eau, (Marine.) Les bateaux ou barques à eau sont destinés en Hollande à amener de l’eau douce dans les lieux où il n’y en a pas, comme l’on fait à Amsterdam pour les brasseurs de bierre, & quand l’eau de pluie manque : on s’en sert encore pour aller querir de l’eau de mer dont on fait du sel. Ceux qui amenent de l’eau douce sont fort plats, & enfoncent dans l’eau presque jusqu’au bord, ou du moins à un pié du bord, lorsqu’ils sont chargés : ils ont un peu de relevement à l’avant & à l’arriere, & il y a des trous dans le carreau par où s’écoule l’eau qui y tombe ou qui y entre de dehors : les coutures en sont fort bien calfatées ou goudronnées : on y fait entrer l’eau par un trou qui est dessous, qu’on bouche quand le bateau est plein.
Ceux qui amenent de l’eau salée, sont faits à la maniere des semaques, & matés en fourche. (Z)
* Bateaux maires ; c’est ainsi qu’on appelle ceux qui sont destinés au transport des sels.
* Bateaux de poste ; c’est ainsi qu’on appelle ceux qui sont établis sur la Loire & sur le Rhone. Ils sont étroits & plats, & font une très-grande diligence.
* Bateaux de selles ; c’est ainsi qu’on appelle à Paris de grands bateaux longs, plats, & garnis à leurs extrémités de deux roues à godets, qui puisent de l’eau & la jettent dans des canaux qui la conduisent sur des bancs & ailleurs où peuvent en avoir besoin les blanchisseuses, à l’usage desquelles sont ces bateaux : elles y vont laver leur linge en payant.
* Bateaux (ais de) ; ce sont ceux qui proviennent du déchirement des vieux bateaux. Les menuisiers les achetent, & s’en servent par-tout où le bois neuf n’est pas nécessaire. Le commerce en est considérable dans toutes les grandes villes où il y a des ports.
BATELÉE, s. f. (Marine.) terme dont on se sert sur les rivieres, pour dire charge entiere de bateau.
BATELIERS, s. m. pl. (Marine.) On donne ce nom à ceux qui conduisent les bateaux sur les rivieres. (Z)
* BATEMBURGIQUES, s. m. pl. (Hist. mod.) nom de coureurs, qui dans le seizieme siecle pillerent les églises, renverserent les autels, & firent beaucoup de dégâts sous la conduite d’un soldat séditieux.
* BATENBOURG, (Géog.) ville des Provinces Unies au duché de Gueldre sur la Meuse, entre Ravenstein & Megen.
BATER un cheval, un mulet, ou un âne ; (Maréch. & Manege.) c’est lui attacher le bât sur le dos : le débâter ; c’est lui ôter le bât de dessus le dos. (V)
BATH, BATHUS, ou EPHA, (Hist. anc.) mesure des Hébreux, qui contenoit la dixieme partie du chore ou gomor, c’est-à-dire vingt-neuf pintes, chopine, demi-septier, un poisson, & cette fraction de pouce, .
Quelques critiques ont imaginé qu’il y avoit chez les Hébreux deux sortes de baths ; l’un sacré, qui ne servoit qu’au temple ; & l’autre ordinaire, usité dans le commerce & plus petit que le premier. Le premier, disent-ils, contenoit un bath & demi ordinaire ; ce qu’ils essayent de prouver par ce qu’il est dit dans le III. liv. des Rois, ch. vij. v. 26. que la mer d’airain de Salomon contenoit deux mille baths ; & qu’on lit dans les Paralipomenes, liv. II. ch. iv. v. 5. qu’elle tenoit trois mille mesures ou trois mille baths. Mais on concilie aisément ces deux passages, en disant que la coupe ou cuvier de la mer d’airain contenoit deux mille baths, comme le dit le III. livre des Rois, & que le pié de ce vase qui étoit creux en contenoit encore mille, ce qui faisoit en tout trois mille, comme le portent les Paralipomenes. Calmet, Dict. de la Bible, tom. I. p. 299. Voyez Mer d’airain. (G)
* Bath, (Géog.) ville d’Angleterre en Sommersetshire, sur l’Avon. Long. 15. 10. lat. 51. 20.
Bath (eaux de). Voyez Eau.
* BATHA, (Géog. anc. & mod.) petite ville du royaume d’Alger en Barbarie, dans la province de Telensin, sur la riviere de Mina. Quelques-uns la prennent pour l’ancienne Vaga ou Vago.
* Batha, Bath, Bachia, (Géog.) ville de Hongrie, capitale du comté du même nom, sur la rive occidentale du Danube, à cinq lieues du confluent de la Drave. Long. 37. lat. 46. 40.
BATHANÉE, (Géog. sainte.) contrée de la Thraconite dans la tribu de Manassé, au-delà du Jourdain.
* BATHASECK, (Géog.) ville de la basse Hongrie dans le comté de Tolna, sur la Sarwitze. Il y en a qui prétendent que c’est la même ville que Batha. Voyez Batha.
BATH-KOL, c’est-à-dire fille de la voix, (Hist. anc.) c’est ainsi que les Juifs appellent un oracle, dont il est souvent fait mention dans leurs livres, surtout dans le Talmud. L’auteur du supplément aux cérémonies des Juifs, a remarqué qu’ils admettent différentes sortes d’inspirations, & qu’ils croyent communément que la prophétie ou inspiration divine a duré chez eux jusque vers la quarantieme année du second temple, à laquelle succéda une autre sorte d’inspiration, qu’ils nomment bath-kol. Les Rabbins, comme Buxtorf l’a observé dans son grand dictionnaire, disent qu’après la mort d’Aggée, de Zacharie, & de Malachie, le saint-Esprit se retira d’Israel ; mais que cependant ils eurent l’usage de la fille de la voix : & ils ne manquent point d’histoires pour appuyer cette rêverie. Voyez Buxtorf sur le mot bath-kol. (G)
* BATHMONSTER, (Géog.) ville de Hongrie au comté de Bath, sur la rive orientale du Danube.
BATHOS, (Géog. & Myth.) vallée de la Macédoine, près du fleuve Alpha, où l’on croyoit que les géans avoient combattu contre les dieux : on y faisoit des sacrifices au bruit d’éclairs & de tonnerres artificiels.
BATI, s. m. c’est ainsi qu’on appelle, en Menuiserie, les battans, les montans, & traverses d’une partie de lambris d’une porte ou d’un guichet de croisée assemblés, soit que les panneaux y soient ou non.
Bati, chez les Tailleurs ; c’est le gros fil qui a servi à bâtir un habit. Voyez Batir. Ainsi ils disent, ôtez le bâti de cet habit, pour ôtez le fil avec lequel on en a assemblé les morceaux.
* BATICALA, (Géog.) royaume des Indes sur la côte de Malabar, au nord du royaume de Canara. Long. 95. 50. lat. 14. 8.
* BATICALO ou MATICALO, (Géog.) ville d’Asie dans la partie orientale de l’ile de Ceylan, capitale du royaume de même nom, sur la riviere de Batecalo. Long. 99. 53. lat. 7. 55.
BATIER, s. m. ouvrier qui fait & vend des bâts de mulets & autres bêtes de somme. Les bâtiers font partie de la communauté des Selliers. V. Sellier.
BATIMENA, (Géog.) royaume de la presque île des Indes au-delà du Gange, dans le Malabar, vers les montagnes & le royaume de Cochin.
BATIMENT, s. m. (Architect.) on entend sous ce nom tous les lieux propres à la demeure des grands & des particuliers, aussi bien que les édifices sacrés, places publiques, portes de ville, arcs de triomphe, fontaines, obélisques, &c. construits tous de pierre, ou de pierre & de bois de charpente, & dans lesquels on employe le marbre, le bronze, le fer, le plomb, & autres matieres. Ces différens bâtimens passent pour réguliers ou pour irréguliers, selon la forme des plans qui les composent. Ainsi on dit qu’un bâtiment est régulier, lorsque son plan est quarré, ou de forme oblongue, pourvû que ses côtés opposés, ses avant-corps, pavillons & arriere-corps, soient égaux, & bâtis avec symmétrie : au contraire on dit qu’il est irrégulier, lorsque son plan n’est pas renfermé dans des lignes paralleles entr’elles, tel qu’est un plan triangulaire, ou celui qui n’a qu’un pavillon, qu’une aîle à l’une de ses extrémités, & qui n’en a point à ses côtés opposés.
Ces mêmes bâtimens prennent encore différens noms, eû égard à leur situation : on les appelle isolés, lorsqu’ils sont entourés de rues, de jardins, ou de grandes cours, comme est celui de l’Observatoire ; flanqués ou adossés, lorsqu’ils touchent à quelqu’autre grand édifice, tels que ceux qui sont mitoyens au Palais-royal ou au Luxembourg ; enfoncés, lorsque leur sol est plus bas que la rue, ou les maisons adjacentes, tels que ceux qui sont construits dans les rues basses du Rempart, à la porte S. Honoré, Montmartre, S. Denys, &c.
On ajoûte ordinairement au terme de bâtiment, celui de son usage en particulier : par exemple, on appelle bâtimens civils, ceux qui servent de demeures aux princes, aux ministres, aux prélats, & en général ceux qui sont relatifs à la société ; au contraire on appelle bâtimens militaires, ceux qui sont consacrés à l’art de la guerre, tels que les portes de ville, les arsenaux, casernes, bastions, guérites, &c. on appelle bâtimens hydrauliques, ceux qui sont destinés à contenir les machines pour élever les eaux, soit pour l’utilité publique, comme celui du pont Notre-Dame ; soit pour les embellissemens des maisons royales, tels que ceux de la Samaritaine & de Marly : bâtimens publics, ceux qui sont destinés à rendre la justice, ou à l’usage du public, comme le Palais à Paris, l’Hôtel-de-ville, les fontaines de Grenelle & des Innocens, ou autres de cette espece : bâtimens du commerce, ceux où les négocians s’assemblent certain jour de la semaine, pour s’y tenir en correspondance avec les étrangers ; c’est ce qu’on appelle bourse, banque, &c.
Bâtimens de Marine, sont ceux qui sont destinés à la construction des vaisseaux, dans lesquels sont compris les magasins, arsenaux, corderies, aussi bien que ceux où l’on tient ces vaisseaux en sureté, comme les ports, moles, bassins, &c. batimens rustiques & champêtres, ceux qui à la campagne sont destinés à contenir les bestiaux, les grains, les jardins potagers, vergers, légumiers, connus sous le nom de fermes ; ils sont ordinairement voisins de quelque terre considérable : enfin on appelle bâtimens particuliers, ceux qui sont destinés a la demeure des habitans d’une ville ou d’une province, qui n’ont point d’autre objet qu’une commodité relative à l’état & à la condition de leur propriétaire.
On dit aussi d’un bâtiment qu’il est triple, double, demi double, ou simple, lorsque dans sa profondeur entre cour & jardin, il est partagé par trois, deux, une & demie, ou une seule piece ; comme on dit bàtiment en aîle, lorsque l’on pratique ou ajoûte après coup à un bâtiment un ou plusieurs étages, en retour de sa façade principale.
On dit encore qu’un bâtiment est feint, lorsqu’on veut parler d’une aîle affectée contre un mur mitoyen, sans autre utilité que la symmétrie, soit que cette affectation se fasse en peinture ou en maçonnerie, comme celle que l’on a pratiquée à l’hôtel de Beauvilliers à Paris ; de même on appelle bâtiment ruiné, celui qui par vétusté ne laisse plus que quelques fragmens de son ancienne ordonnance, tels que les ruines de Tivoli, ou la plûpart des anciens châteaux aux environs de Paris, dont il ne reste plus que quelques vestiges.
Des parties essentielles qui composent la plûpart des bâtimens dont nous venons de parler, on en distingue trois de préférence, savoir, la solidité, la commodité, & l’ordonnance ; la premiere a pour objet la connoissance de l’emploi & de la qualité des matériaux, & doit être considérée comme la plus importante partie du bâtiment, connue sous le nom de construction ; la seconde consiste dans l’art de distribuer les plans selon la dignité du personnage qui fait bâtir, connue sous le nom de distribution ; la troisieme consiste dans l’art de donner de la proportion, de l’harmonie & de l’accord aux parties d’un bâtiment, pour que réunis ensemble ils concourent à faire un beau tout ; & c’est ce qu’on appelle décoration. Voyez la définition de chacun des termes dont on vient de parler à leurs différens articles. (P)
Batiment, (Marine.) on entend ordinairement par ce mot toutes sortes de navires ou vaisseaux, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, lorsqu’ils ne sont pas vaisseaux de guerre. Il y a cependant beaucoup de gens qui l’attribuent également aux vaisseaux de guerre & aux vaisseaux marchands.
Bâtiment ras, c’est un bâtiment qui n’est pas ponté.
Bâtiment délicat, c’est un navire foible de bois. (Z)
BATIR, v. a. & n. terme d’Architect. se dit & de la dépense que fait un particulier pour élever ou restaurer un bâtiment, & du travail de l’architecte chargé de la conduite des ouvrages. Aussi dit-on de quelqu’ouvrage d’importance, un tel prince a bâti tel édifice, & que tel architecte a bâti tel monument, parce qu’il en a donné les desseins.
On dit encore qu’un entrepreneur bâtit bien, lorsque ses bâtimens sont construits avec choix de bons matériaux, & avec le soin & la propreté que l’art demande. Voyez Batiment. (P)
Batir ou Bassetir, terme de Chapelier, c’est façonner le feutre sur le bassin pour en former les quatre capades : quand elles ont été bien marchées & feutrées, on les joint ensemble & on en compose un tout qui ressemble assez à une chausse à hypocras, après quoi on foule, & on dresse le chapeau sur une forme de bois avec l’avaloire, la piece, & le choque. V. Chapeau, Avaloire, Piece & Choque
Batir, terme de Tailleur, qui signifie assembler les pieces d’un habit en les cousant à grands points avec du gros fil, avant que de les coudre à demeure avec de la soie ou du fil plus fin.
BATISSOIR, s. f. instrument de Tonnelerie ; c’est un cercle de fer plus ou moins grand, selon les ouvrages, dont le tonnelier se sert pour assembler les douves d’une futaille qu’il veut construire.
* BATISTE, s. f. (Comm.) toile de lin fine & blanche qui se fabrique en Flandre & en Picardie : on en distingue de trois sortes ; il y a la batiste claire, la moins claire, & la hollandée ; les deux premieres ont deux tiers, ou trois quarts & demi de large, & se mettent par pieces de six à sept aunes ; la hollandée porte deux tiers de large, & douze à quinze aunes de long. De quelque longueur que les ouvriers fassent les batistes claires, les courtiers les réduisent à douze aunes, & ces douze aunes en deux pieces de six. Les morceaux enlevés de ces pieces se nomment coupons, s’ils sont de deux aunes juste ; s’ils ont plus ou moins de deux aunes, on les bâtit, & on les vend comme la piece. Les batistes viennent des manufactures enveloppées dans des papiers bruns battus ; chaque paquet est d’une piece entiere, ou de deux demi-pieces : on en emplit des caisses de sapin, dont les ais sont assemblés avec des chevilles au lieu de clous, ce qui est très-commode ; car en cloüant les ais, on pourroit aisément percer les pieces. L’on fait avec cette toile des fichus, des mouchoirs, des surplis, &c.
BATMAN ou BATTEMANT, s. m. (Comm.) poids de Turquie. Il y en a de deux sortes ; l’un est composé de six ocquos, chaque ocquo pesant trois livres trois quarts de Paris ; en sorte que ce premier batman est de vingt-deux livres & demie.
L’autre est pareillement composé de six ocquos ; mais chacun de ces ocquos ne pese que quinze onces, qui est trois quarts moins que le premier : ce dernier batman ne revient donc qu’à cinq livres dix onces.
Le quintal, qui est aussi un poids de Turquie, pese trente batmans. Voyez Quintal & Ocquo.
Batman est aussi un poids de Perse ; il y en a de deux sortes, ainsi qu’en Turquie ; l’une qu’on nomme batman de chahi ou cheray, & qui est le poids du roi ; & l’autre qui s’appelle batman de Tauris, du nom d’une des principales villes de Perse.
Le batman de chahi sert à peser tant les choses nécessaires à la vie, que les charges des bêtes de somme : il pese douze livres & demie de Paris.
Celui de Tauris, qu’on ne met en usage que pour les marchandises de négoce, pese moitié moins que le batman de chahi, & n’est par conséquent que de six livres un quart.
Telle est la proportion de ces poids avec les nôtres, selon Tavernier : mais Chardin y met quelque différence ; car il ne fait le batman de Tauris que de cinq livres quatorze onces de Paris, & le batman de chahi, ou le batman du roi, que de douze livres douze onces. (G)
* BATOCHINE, (Géog.) partie de l’île de Gilolo, l’une des Moluques.
* BATOCKS, ou BATOGGI, s. m. pl. (Hist. mod.) sont deux bâtons minces dont on se sert à Moscow pour battre les criminels jusqu’à la mort : lorsque quelqu’un est condamné à ce supplice, on lui ôte ses habits, & on ne lui laisse que sa chemise ; un des exécuteurs s’assied sur sa tête, & un autre sur ses jambes, tandis qu’un troisieme frappe jusqu’à ce que le patient ait reçû la dose de coups prescrite par le magistrat.
* BATON, s. m. se dit en général d’un morceau de bois rond, tourné au tour ou non tourné, & s’applique à beaucoup d’autres choses qui ont la même forme. Ainsi on dit en Tableterie, un baton d’ivoire, un bâton d’écaille, pour un morceau d’ivoire ou d’écaille rond ; chez les Marchands de bois, un bâton de coteret, pour un morceau du menu bois de chauffage, fait des petites branches des arbres ; chez les Epiciers un bâton de casse, un bâton de cire d’Espagne ; chez les Gantiers, un bâton à gant ; voyez plus bas ; un bâton de jauge, pour l’instrument qui sert à mesurer les tonneaux ; un bâton de croisure, chez les Hautelissiers, pour la baguette qui tient leurs chaines croisées ; chez les Pâtissiers & Boulangers, un bâton, pour le morceau de bois que l’on met en travers sur le pétrin, & sur lequel on meut le sas pour en tirer la farine ; chez les Fondeurs, un bâton, pour le rouleau qui leur sert à corroyer ensemble le sable & la terre qui entrent dans la façon de leurs moules. Voyez la suite de cet article.
Baton, s. m. (Hist. anc. & mod.) est un instrument dont on se sert ordinairement pour s’appuyer en marchant. Le cardinal Bona observe, dans son traité des Liturgies, qu’autrefois ceux qui se servoient de bâton dans l’église pour s’appuyer, étoient obligés de le quitter, & de se tenir debout, seuls & droits, dans le tems qu’on lisoit l’évangile, pour témoigner leur respect par cette posture, & faire voir qu’ils étoient prêts d’obéir à Jesus-Christ, & d’aller par-tout où il leur commanderoit d’aller.
On se sert souvent aussi d’un bâton comme d’une espece d’arme naturelle, offensive & défensive. Les Lacédémoniens ne portoient jamais d’épée en tems de paix, mais se contentoient de porter un bâton épais & crochu qui leur étoit particulier.
S. Evremont observe que chez les Romains les coups de bâton étoient une façon modérée de punir les esclaves, & qu’ils les recevoient par-dessus leurs habits.
Les Maîtres-d’armes, & les gens susceptibles du point d’honneur, croyent qu’il est bien plus honteux de recevoir un coup de bâton qu’un coup d’épée ; à cause que l’épée est un instrument de guerre, & le bâton un instrument d’outrage.
Les loix de France punissent bien séverement les coups de bâton. Par un reglement des Maréchaux de France fait en 1653, au sujet des satisfactions & réparations d’honneur, il est ordonné que quiconque en frappera un autre du bâton, sera puni par un an de prison, qui pourra être modéré à six mois en payant 3000 livres, applicables à l’hôpital le plus prochain : outre cela l’aggresseur doit demander pardon à genoux à l’offensé, &c. tout prêt à recevoir de lui un égal nombre de coups de bâton ; & il y a certains cas où ce dernier peut être contraint de les donner, quand même il auroit trop de générosité pour s’y résoudre de lui-même.
Par un autre reglement des Maréchaux de l’année 1679, celui qui frappe du bâton après avoir reçû des coups de poing dans la chaleur de la dispute, est condamné à deux ans de prison ; & à quatre années, s’il a commencé à frapper à coups de poing.
La loi des Frisons ne donne qu’un demi-sou de composition à celui qui a reçû des coups de baton ; & il n’y a si petite blessure pour laquelle elle n’en accorde davantage. Par la loi Salique, si un ingénu donnoit trois coups de baton à un ingénu, il payoit trois sous ; s’il avoit fait couler le sang, il étoit puni comme s’il eût blessé avec le fer, & il payoit quinze sous. La peine & l’indemnité se mesuroient sur la grandeur des blessures. La loi des Lombards établit différentes compositions pour un coup, pour deux, trois, quatre : aujourd’hui un coup en vaut mille.
La constitution de Charlemagne, insérée dans la loi des Lombards, veut que ceux à qui elle permet le duel, combattent avec le bâton ; peut-être fût-ce un ménagement pour le clergé ; ou que, comme on étendoit l’usage des combats, on voulut les rendre moins sanguinaires. Le capitulaire de Louis le Débonnaire donne le choix de combattre avec le bâton ou avec les armes : dans la suite, il n’y eût que les serfs qui combatissent avec le bâton.
Déjà je vois naître & se former les articles particuliers de notre point d’honneur, dit l’auteur de l’esprit des lois, tome II. page 202. L’accusateur commençoit par déclarer devant le juge qu’un tel avoit commis une telle action, & celui-ci répondoit qu’il en avoit menti ; sur cela le juge ordonnoit le duel : la maxime s’établit que, lorsqu’on avoit reçû un démenti, il falloit se battre.
Quand un homme avoit déclaré qu’il combattroit, il ne pouvoit plus s’en départir, sans être condamné à une peine : autre regle qui s’ensuivit ; c’est que quand un homme avoit donné sa parole, l’honneur ne lui permettoit plus de se rétracter.
Les gentilshommes se battoient entr’eux & avec leurs armes ; les villains se battoient à pié & avec le bâton. Le bâton devint donc un instrument outrageant ; parce que celui qui en avoit été frappé, avoit été traité comme un villain.
Il n’y avoit que les villains qui combatissent à visage découvert ; ainsi il n’y avoit qu’eux qui pussent recevoir des coups au visage ; de-là vint qu’un soufflet fut une injure qui devoit être lavée par le sang ; parce que celui qui l’avoit reçû, avoit été traité comme un villain.
Voilà comment par des degrés insensibles, se sont établies les lois du point d’honneur, & avant elles les différences entre les instrumens contondans. Le bâton est devenu une arme deshonorante quelquefois pour celui qui s’en sert, & toûjours pour celui avec qui l’on s’en est servi.
Baton, (Hist. mod.) est quelquefois une marque de commandement & un attribut de dignité ou d’emploi : tels sont les bâtons de maréchaux de France, de maîtres d’hôtel, de capitaines des gardes, d’exempts, &c. Celui de maréchal est fleurdelisé ; le roi l’envoye à celui qu’il éleve à ce grade militaire ; les maîtres d’hôtel, les capitaines des gardes, les exempts, &c. peuvent être méconnus pour ce qu’ils sont, s’ils s’exposent à l’exercice de leurs charges, sans leurs bâtons ; c’est-là l’usage principal du bâton :
Baton de gardes de nuit qui courent les rues de Londres, en criant l’heure qu’il est. Celui qui tient le manoir de Lambourn, dans le comté d’Essex, doit le service du bâton, c’est-à-dire, qu’il est obligé de fournir une charge de paille sur une charrette tirée à six chevaux, deux cordes, deux hommes armés de pié en cap, pour garder le bâton quand on le porte à la ville d’Aibridge, &c. Camb. tit. Essex.
Baton trainant, (Hist. mod.) ou Baton à queue ; Edouard premier, roi d’Angleterre, rendit sous ce titre un édit contre les usurpateurs des terres, lesquels pour opprimer les propriétaires véritables, transportoient ces terres usurpées à de grands seigneurs ; contre ceux qu’on loüoit pour maltraiter & outrager les autres ; contre les violateurs de la paix, ravisseurs, incendiaires, & duellistes ; contre ceux qui vendoient à faux poids & à fausses mesures, & autres malfaiteurs. Cette espece d’inquisition fut exécutée avec tant de rigueur, que les amendes qui en provinrent, apporterent au roi des thrésors immenses. On appelloit juges à bâton traînant, ceux qui étoient chargés de l’exécution de cet édit, soit par rapport à la maniere rigoureuse & sommaire dont ils faisoient leurs exécutions, soit par rapport au bâton qu’ils portoient comme une marque de leur autorité, & qu’ils tenoient à la main en jugeant les malfaiteurs. (G)
* Baton, (en Mythol.) on distingue particulierement l’augural & le pastoral : l’augural, appellé par les Latins lituus, étoit façonné en crosse par le bout ; il servoit à l’augure pour partager le ciel dans ses observations ; celui de Romulus avoit de la réputation chez les Romains : ceux d’entre eux qui ne se piquoient pas d’une certaine force d’esprit, croyoient qu’il avoit été conservé miraculeusement dans un grand incendie. Quintus tire de ce prodige & de la croyance générale qu’on lui accordoit, une grande objection contre le Pyrrhonisme de son frere Ciceron, qui n’y répond que par des principes généraux dont l’application vague seroit souvent dangereuse : Ego Philosophi non arbitror testibus uti qui aut casu veri, aut malitia falsi fictique esse possunt. Argumentis & rationibus oportet, quare quidque ita sit, docere ; non eventis, iis præsertim quibus mihi non liceat credere… omitte igitur lituum Romuli, quem maximo in incendio negas potuisse comburi… Nil debet esse in Philosophia commentitiis fabellis loci. Illud erat Philosophi, totius augurii primum naturam ipsam videre, deinde inventionem, deinde constantiam… quasi quidquam sit iam valde, quam nihil sapere vulgare ? aut quasi tibi ipsi in judicando placeat multitudo.
Ciceron a beau dire ; il y a cent mille occasions où la sorte d’examen qu’il propose ne peut avoir lieu ; où l’opinion générale, la croyance non interrompue, & la tradition constante, sont des motifs suffisans ; où le jugement de la multitude est aussi sûr que celui du philosophe : toutes les fois qu’il ne s’agira que de se servir de ses yeux, sans aucune précaution antérieure, sans le besoin d’aucune lumiere acquise, sans la nécessité d’aucune combinaison ni induction subséquente, le paysan est de niveau avec le philosophe : celui-ci ne l’emporte sur l’autre que par les précautions qu’il apporte dans l’usage de ses sens ; par les lumieres qu’il a acquises, & qui bientôt ôtent à ses yeux l’air de prodige à ce qui n’est que naturel ; ou lui montrent comme surnaturel ce qui est vraiment au-dessus des forces de la nature, qui lui sont mieux connues qu’à personne ; par l’art qu’il a de combiner les expériences, d’évaluer les témoignages, & d’estimer le degré de certitude, & par l’aptitude qu’il a de former des inductions ou de la supposition, ou de la vérité des faits.
Le baton pastoral est de deux sortes : c’est ou celui qu’on voit dans les monumens anciens à la main des Faunes, des Sylvains ; en un mot des dieux des bois & des forêts : il est long, noüeux, & terminé en crosse : ou c’est la crosse même que nos évêques portent à la main dans les jours de cérémonie ; c’est un assemblage de différentes pieces façonnées d’or & d’argent, entre lesquelles on peut distinguer le bec de corbin ou la crosse d’en-haut, les vases, les fonds de lanterne, les dômes, les douilles, & les croisillons.
Il y a encore des bâtons de chantre & de confrairie. Le bâton de confrairie, n’est autre chose qu’un long morceau de bois, tourné au tour, façonné, doré, ou argenté, à l’extrémité duquel est fichée l’image du patron de la confrairie.
Le baton de chantre en usage dans quelques cathédrales, ressemble assez au bâton pastoral, quant à la richesse, & même quant à la forme, à l’exception qu’il n’est pas terminé en haut par la crosse, mais qu’il a quelqu’autre forme relative, soit à la dignité du chantre, soit aux prérogatives de l’église.
Baton, en terme de Blason, sorte de bande qui n’a qu’un tiers de la largeur ordinaire. Voyez Bande.
Le bâton ne va pas d’un côté à l’autre de l’écusson, comme fait la bande ou l’écharpe, mais il est coupé court en forme de tronçon ; il est d’usage pour marquer la bâtardise. (V)
Batons à deux bouts ; ce sont de longs bâtons que les gardes des forêts & des parcs, &c. portent comme une marque de leur emploi, & dont ils se servent aussi comme d’une arme.
Batons ou Baculi, en Pharmacie, compositions façonnées en cylindre, ayant la figure de bâtons. C’est ainsi que l’on figure les magdaleons des emplâtres officinales.
C’est sous cette figure que l’on met les chandelles galeniques, les bougies medicamenteuses. Voyez Chandelle, Bougie.
C’est aussi sous cette forme que l’on réduit certaines préparations bechiques, ou que l’on ordonne dans la toux, comme le suc de réglisse de Blois, les tablettes ou bâtons de sucre d’orge. Voyez Tablettes, Suc de Reglisse. (N)
Baton d’Arpenteur ; voyez Equerre d’Arpenteur. (E)
Baton de Jacob, instrument dont on se sert en mer pour mesurer les hauteurs des astres. On l’appelle autrement arbalestrille. Voyez Arbalestrille. (T)
Baton à meche, (Marine.) c’est une meche qu’on entretient toûjours brûlante sur le château-d’avant.
Baton de Pavillon, ou d’Enseigne (Marine.) c’est un petit matereau, ou longue gaule de sapin, ou d’autre bois léger, qui sert à arborer le pavillon. Voyez en la figure & la position dans la Pl. I. à la lettre G.
Baton de Girouette, c’est un matereau très-petit, ou gaule, dans lequel est plantée la verge de fer qui tient la giroüette. Voyez à la Planche I. les giroüettes marquées g.
Baton de Flamme, c’est un bâton qui n’est long qu’autant que la flamme est large par le haut. C’est ce bâton qui la tient au haut du mât.
Baton de Vadel, Baton ou Manche de Guipon, (Marine.) ce sont certains bâtons où l’on attache les bouchons d’étoupe ou de penne, dont se sert le calfateur pour goudronner ou braier le vaisseau. (Z)
Batons de Neper. Voyez Neper.
Baton, en Architecture, c’est une moulure usitée dans la base des colonnes. Voyez Tore.
Baton, en Musique, est une barre épaisse qui traverse perpendiculairement une ou plusieurs lignes de la portée, & qui, selon ses différentes longueurs, selon le plus ou le moins de ces lignes qu’elle embrasse, exprime un plus grand ou moindre nombre de mesures qu’on doit compter en silence.
Anciennement, les bâtons représentoient autant de différentes valeurs de notes, depuis la ronde jusqu’à la maxime qui en valoit huit, & dont la durée en silence s’évaluoit par un bâton, qui, partant d’une ligne, traversoit trois intervalles, & alloit joindre la quatrieme ligne.
Aujourd’hui le plus grand bâton est de quatre mesures ; il faut que, partant d’une ligne, il traverse la suivante, & arrive à la troisieme ainsi :
On le répete une fois, deux fois, ou autant de fois qu’il faut pour exprimer huit mesures, ou douze, ou
tout autre multiple de quatre, & l’on ajoûteLe plus petit bâton est de deux mesures, & s’étend seulement d’une ligne à sa voisine, en cette sorte,
Les autres moindres silences comme d’une mesure, d’une demi-mesure, d’un tems, &c. s’expriment par les mots de pause, demi-pause, soupir, &c. Voyez ces mots. Il est aisé de comprendre qu’en combinant tous ces signes, on peut exprimer à sa volonté des silences d’une durée quelconque. Voyez Silence.
Il ne faut pas confondre avec les bâtons des silences, d’autres bâtons précisément de même figure, qui, sous le nom de pauses initiales, servoient dans nos anciennes musiques à déterminer le mode, c’est-à-dire, la mesure, & dont nous parlerons au mot Mode.
Baton de Mesure, est un bâton fort court, ou même un simple rouleau de papier, dont le maître de Musique se sert dans un concert pour régler le mouvement, & marquer la mesure & les tems. Voyez Battre la mesure. (S)
Batons de Chasse, ce sont ceux que l’on porte quand on va courre.
Baton à egriser, parmi les Diamantaires, est un morceau de bois tourné, composé d’une tête sur laquelle on cimente le diamant pour l’égriser ; plus bas est un collet ou espace beaucoup moins gros, qui est proprement la place du pouce & de l’index de l’ouvrier. Au-dessous de ce collet est la poignée grosse à pouvoir remplir la main. Il se termine en pointe comme le petit bout d’un fuseau. Voyez KL. Pl. I. du Diamantaire, fig. 6. qui représente une portion d’établi, sur laquelle sont montés deux égrisoirs. Voyez Egrisoir.
Baton à cimenter, terme de Lapidaire, est un morceau de bois, gros par un bout & menu par l’autre, où les Lapidaires enchâssent leurs crystaux & leurs pierres par le moyen d’un mastic. V. la fig. 15. Pl. du Lapidaire. Ce mastic n’est autre chose qu’un mêlange de ciment & de poix résine.
Baton, en terme de Formier, c’est un petit cylindre garni d’une peau de chien de mer, dont on se sert pour frotter les formes ou autres ouvrages. Voyez Frotter, voyez fig. 1. Pl. du Formier-Talonnier.
Baton à Gant, autrement Retournoir, ou Tourne-gant, est un morceau de bois fait en forme de fuseau long, dont les Gantiers se servent dans la fabrique de leurs gants. Ils sont ordinairement doubles quand on s’en sert. Voyez Gant & Tourne-gant.
Bâtonner un gant, ou réformer un gant, c’est après l’avoir fini, l’élargir sur le réformoir avec des bâtons faits exprès, & appellés bâtons à gant, afin de lui donner plus de forme.
Baton à dresser, c’est, parmi les Orfevres en grosserie, un rouleau dont on se sert pour mettre de niveau une plaque de métal mince, & qui voile au gré de l’air. Voyez Voiler. Voyez Pl. I. fig. 4.
Baton à Tourner, en Passementerie, est un simple bâton rond, de 7 à 8 pouces de long, assez menu, qui a à 3 ou 4 lignes de l’un de ses bouts, une petite rainure tout à l’entour de lui-même, pour recevoir & tenir les deux bouts d’une moyenne ficelle, qui n’est point coupée par son autre bout ; ce bout de ficelle non coupé s’introduit, se fixe dans le petit trou du bout de l’ensuple & s’enveloppe sur ce bout, jusqu’auprès du bâton à tourner, qui sert ainsi par le mouvement de la main droite, à faire tourner l’ensuple sur le ployoir, lorsque l’on ploie les pieces relevées sur le billot, au sortir de dessus l’ourdissoir.
Baton (en terme de Planneur) est un morceau de bois de tremble ou de tilleul, sur lequel les Planneurs nettoyent leurs marteaux.
Baton rompu (en Serrurerie) est un morceau de fer quarré ou rond, coudé en angle obtus ; l’angle est plus ou moins obtus, selon l’endroit où le morceau de fer doit être appliqué.
Baton de semple (partie du métier d’étoffe de soie.) Le bâton de semple est rond, il a un pié & demi de long. On y attache les cordes de semple les unes après les autres, & on les y fixe avec un nœud courant. Pour cet effet, on double les cordes & on forme une boucle double. Le baton de semple est placé au bas du métier, à l’extrémité inférieure des cordes de semple. Voyez la description du métier à l’article Velours.
Baton de rame (partie du métier d’étoffe de soie) Le bâton de rame a deux piés de long ; il est de la même forme que celui du semple, & on y attache les cordes de rame de la même maniere que celles du semple. Voyez la description du métier à l’art. Velours.
Baton de Gavassiniere, est celui auquel on arrête la gavassiniere, pour disposer la tireuse à travailler.
Baton de preuve (en terme de Rafineur de sucre) est une espece de bâton plat par un bout, allant ou s’élargissant un peu jusqu’à l’extrémité du même côté. L’autre bout qui lui sert de manche est rond, & commence un peu plus haut que la moitié du bâton. C’est sur ce bâton trempé dans sa cuite, V. cuite, que le rafineur prend la preuve & fait l’essai de la matiere. Voyez Preuve. Il sert encore à battre dans la chaudiere à cuite, voyez Chaudiere à cuite, lorsque le sucre monte avant de prendre son bouillon.
Baton de croisure (Tapissier) est un bâton rond, ordinairement de bois de saule. On en fait de diverse longueur, mais tout d’un pouce de diametre. Les Hautelissiers s’en servent pour croiser les fils de leurs chaînes. Voyez Haute-lisse.
* Baton (Isle) ou Buton (Géog.) île d’Asie, dans la mer Indienne, à l’orient de l’île de Macassar ou Célebes, entre celles de Wawani, Cœlinea, & Cabinus.
BATONNéE, s. f. BATONNÉE d’eau (en Mar.) c’est la quantité d’eau qu’on puise à la pompe, chaque fois qu’on fait joüer la brimbale. (Z)
BATONNER, v. ac. (en termes de Palais) c’est soûligner un endroit d’un acte ou d’une piece, pour avertir le juge ou autre qui la lira, de faire une singuliere attention à cet endroit. (H)
BATONNIER des Avocats (Hist. mod.) est un des anciens de sa compagnie, qui pendant une année préside aux assemblées & députations de ses confreres, comme le doyen, dans quelques autres compagnies ; il n’est que primus inter pares, & n’a aucune jurisdiction sur l’ordre. Il ne peut point faire de reglemens seul, ni agir de sa propre autorité pour faire exécuter ceux qui sont faits ; il n’a que la simple voie de représentation & de remontrances. Ce qui donne plus de considération à sa place, c’est la confection du tableau ou liste, qu’il dresse pendant son année de tous les avocats suivant le Palais, qui ont droit d’y travailler. Voyez Tableau.
On l’appelle apparemment Bâtonnier, à cause du bâton de la confrairie de Saint Nicolas, dont il est le chef, l’étant des avocats mêmes, qui tous en sont confreres nés. (H)
BATONNIERS, ou Huissiers à Baguette, commis par le maréchal du banc du roi d’Angleterre, pour accompagner les juges & porter à la main une baguette ou un bâton, dont le bout supérieur est garni d’argent : ils accompagnent aussi les prisonniers que l’on conduit aux tribunaux, ou que l’on ramene en prison.
Ce nom se donne aussi quelquefois à ceux qu’on appelle ordinairement bâtons, qui sont des gardes des officiers de la flotte du Roi, & qui se trouvent dans les cours royales, tenant à la main une baguette peinte, pour garder les prisonniers dans les prisons, & pour les accompagner en public quand ils ont la permission de sortir. Voyez Baton.
BATONNET (jeu d’enfant) : il se joue avec deux bâtons ; l’un long, assez gros, rond & long d’une aulne ou environ ; l’autre plus petit, rond, aiguisé par les deux bouts, & long de quatre à cinq pouces. On tient à la main le gros bâton ; on frappe sur une des extrémités pointues du petit qu’on appelle bâtonnet ; le bâton s’éleve en l’air ; & l’adresse du jeu consiste à le frapper, tandis qu’il est en l’air, & à l’envoyer bien loin. Si on ne l’atteint pas, ou si on ne l’envoye pas, en l’atteignant, à une certaine distance, on cede le bâtonnet à son adversaire, & l’on se succede ainsi alternativement.
* BATRACHITE, s. f. (Hist. nat.) pierre qui se trouve, dit-on, dans la grenouille. On lui attribue de grandes vertus contre les venins : mais l’existence de la pierre n’est pas encore constatée.
BATRACHOMYOMACHIE, s. m. (Belles-Let.) combat des grenouilles & des rats ; titre d’un poëme burlesque, attribué communément à Homere.
Ce mot est formé de trois autres mots grecs, βάτραχος, grenouille, μῦς, souris ou rat, & μάχη ; combat.
Le sujet de la guerre entre ces animaux est la mort de Psicarpax, jeune rat, fils de Toxaster, qui étant monté sur le dos de Physignate grenouille, pour aller visiter son palais où elle l’avoit invité de venir, fut saisi de frayeur au milieu de l’étang, chancela, lâcha sa conductrice & périt. Les rats soupçonnant Physignate de perfidie, en demandent satisfaction, déclarent la guerre, & livrent bataille aux grenouilles qu’ils auroient exterminées, si Jupiter & les autres dieux en présence desquels se donnoit le combat, n’eussent envoyé au secours des grenouilles des cancres qui arrêterent la fureur des rats.
Suidas fait honneur de ce poëme à Pigrez ou Tigrés d’Halicarnasse, frere de l’illustre Artémise, & le nom de ce Carien se lit à la tête d’un ancien manuscrit de la bibliotheque du Roi. Étienne Nunnésius & d’autres savans modernes, pensent aussi qu’Homere n’en est point l’auteur. Cependant l’antiquité dépose en faveur de ce poëte, Martial le dit expressément dans cette épigramme.
Perlege Meonio cantatas carmine ranas,
Et frontem nugis solvere disce meis.
Stace est du même sentiment ; & ce qui semble confirmer l’opinion des anciens à cet égard, c’est que dans le siecle dernier, on déterra près de Rome, dans des anciens jardins de l’empereur Claude, un bas-relief d’Archelaüs, sculpteur de Pryene, représentant un Homere avec deux rats, pour signifier qu’il étoit auteur du combat des rats.
Quoi qu’il en soit, feu M. Boivin, de l’académie Françoise & de celle des Belles-Lettres, a traduit ce petit poëme en vers François ; & sa traduction est aussi exacte qu’élégante : à cela près que pour la commodité de la rime, il a quelquefois donné aux rats & aux grenouilles, des noms différens de ceux qu’ils ont dans le texte Grec. (G)
* BATSKA (Géog.) grande contrée de la Hongrie, entre le Danube & le Théiss.
* BATTA (Géog.) province du royaume de Congo, en Afrique, une de ses six parties ; bornée au septentrion par les contrées de Sundi & de Pango ; à l’occident par celles de Pemba, & au midi par le lac d’Aquelonda. Elle est arrosée par la riviere de Barbela.
* BATTAGE des blés, (Œconomie rustique.) Laissez suer vos blés dans le tas ; tenez-les engrangés pendant trois mois, hors la quantité que vous destinez à la semaille ; celui que vous aurez fait battre quelques jours après la moisson, vaudra mieux pour cet usage : suivez la maniere de battre de votre pays. En Gascogne & en Provence, vous laisserez sécher vos gerbes sur le champ ; vous aurez un nubilaire ou un appentis, sous lequel vous puissiez mettre votre grain à couvert dans le tems de pluie. Ces appentis & cette maniere de sécher le blé, & de ne le lever du champ que pour le battre, vous dispenseront d’avoir des granges ; il ne vous faudra que des greniers. Préférez le battage au fléau. Il est aussi avantageux & plus simple que celui où les gerbes sont foulées par des chevaux, des mulets, ou des bœufs sur un aire ; ou coupées & foulées par deux grosses planches épaisses de quatre doigts, & garnies de pierres à fusil tranchantes, qui seroient traînées par des bœufs. Le premier est en usage en Gascogne, en Italie, en Provence ; & le second en Turquie. En Champagne, en Bourgogne, &c. nous nous servons du fléau ; nous battons pendant l’hyver, nous prenons des hommes de journée ; ils sont l’un à un bout de la grange, l’autre à l’autre bout ; la gerbe est entre-deux, & ils frappent alternativement sur l’épi de la gerbe, avec l’instrument appellé fléau. Voyez à l’article Fléau, la description de cet instrument. Quand le blé est battu, il faut le vanner. Voy. Vanner. Quand il est vanné on le crible. Voy. Crible & Cribler . Plus le grain est net, mieux il se garde. Quand il est criblé, on l’expose à l’air, pour que le reste de sa chaleur se dissipe.
Battage, en Draperie ; c’est une des préparations que l’on donne aux laines avant que de les employer à la fabrication des draps. Cette préparation succede au triage. Voy. Triage & Draperie. Elle consiste à les porter sur une claie de corde, & à les battre, comme on voit Pl. de Draperie. A, la claie ; BB, ouvriers battant les laines. Cette opération a deux objets ; le premier, de faire ouvrir la laine, ou de la séparer par les coups de baguette ; le second, de la purger entierement de sa poussiere. Voyez l’article Draperie.
Battage, s. m. en termes de Salpétrier, se dit du tems qu’on employe à battre la poudre dans le moulin. Les pilons sont de bois, & armés de fonte, & les mortiers de bois, creusés dans une poutre : quand ils sont de fer, il en arrive souvent des accidens. Pour faire la bonne poudre, il faut un battage de vingt-quatre heures à 3500 coups de pilons par heure, si le mortier contient 16 livres de composition. Le battage est moins rude l’été que l’hyver, à cause que l’eau est moins forte. Voyez Moulin à poudre.
BATTANS, s. m. pl. terme d’Architecture ; ce sont dans les portes & les croisées de menuiserie, les principales pieces de bois en hauteur, où s’assemblent les traverses.
On appelle aussi battans, les venteaux des portes. On dit une porte à deux battans, lorsqu’elle s’ouvre en deux parties. Les Latins appelloient ces portes bifores. (P)
Battant de pavillon, (Marine.) On entend par le battant du pavillon, sa longueur qui voltige en l’air. On appelle le guindant sa largeur ou la hauteur qui regne le long du bâton. (Z)
Battant, terme de Fondeur de cloches ; c’est une masse de fer un peu plus longue que la cloche, & d’une pesanteur proportionnée au poids de la cloche. Le battant est terminé par en-bas par une masse arrondie, & va en diminuant jusqu’en-haut, où il se termine par une espece d’anneau, dans lequel on passe le brayer pour attacher le battant à l’anse de fer qui est au cerveau de la cloche en-dedans. Voyez A O, fig. 6. Pl. de la Fonte des cloches, & l’article Fonte des cloches.
Battans, en Menuiserie ; ce sont les montans des croisées, des guichets de portes, &c. c’est-à-dire les pieces de bois dans lesquelles les traverses s’emmanchent, & qui forment la hauteur.
Battans à feuillures, dans le même métier ; ce sont ceux qui au lieu de noix ont une feuillure pour fermer sur les dormans.
Battans menau ; sont ceux dans les croisées qui portent les espagnolettes.
Battans à noix ; sont ceux qui ont une languette arrondie, qui entre dans une feuillure faite dans les dormans : c’est ce qu’on appelle croisée à noix.
Battant, partie essentielle de tous les métiers à ourdir, soit de Tisserans, de Drapiers, de Passementiers, de Manufacturiers en soie, &c. & c’est toûjours un instrument ou chassis dans la partie inférieure duquel s’ajuste le peigne : entre les dents du peigne passent les fils de la chaîne ; & ces dents par le moyen du poids du battant, qui est de cent livres dans les étoffes riches, servent à serrer la trame dans l’étoffe, à l’y faire pour ainsi dire entrer, & à la rendre plus forte. Voyez métier de Tisserans, métiers de Passementier, de Drapier, de Manufacturiers en Soie.
Il y a deux especes de battans ; le battant simple, & le battant brisé : le battant brisé ne sert qu’aux métiers de velours uni ; les deux lames ou côtés du chassis sont coupés à deux ou trois pouces au-dessous de la poignée ; & à cette partie du bois des lames enlevées, on a substitué deux courroies un peu fortes. Cette brisure est nécessaire pour faire dresser le fer du velours & le ramener sur sa canelure. Voyez Velours.
Le battant simple est celui où les lames ou côtés du chassis ne sont point coupés, & sont tout d’une piece.
Battant, en Passementerie ; c’est le chassis qui porte le peigne pour frapper la trame : dans le métier au battant, ce n’est point l’ouvrier qui frappe lui-même (comme dans l’ouvrage au moule qui se frappe avec un doigtier de cuivre) il ne fait que pousser avec la main le battant pour donner passage à la navette, le battant est ramené de lui-même par la force du bandage qui l’oblige de venir frapper la trame ; ce qui soulage beaucoup l’ouvrier.
Battant de locquet, en Serrurerie ; c’est une barre de fer où l’on distingue deux parties ; l’une appellée la tête, & l’autre la queue. La queue est percée ; & s’attache sur la porte avec une vis ou un clou ; l’autre ou tête passe dans le cramponet, & se ferme dans le mentonet.
Il y en a qui ont la tête faite en mentonet ; d’autres sont droits, selon les lieux où on les pose.
BATTE, s. f. instrument commun à un grand nombre d’ouvriers, chez qui il a la même fonction, mais non la même forme : elle varie, ainsi que sa matiere, selon les différentes matieres à battre. La batte des Plâtriers & des pileurs de ciment est une grosse masse de bois emmanchée, bandée d’un cercle de fer, & garnie de clous. Celle des Jardiniers est tantôt à-peu-près comme celle des Carreleurs, tantôt comme un battoir de lavandieres : c’est un morceau de bois d’un pied & demi de long, épais d’un pied & demi, & large de neuf pouces, emmanché d’un long bâton dans le milieu. On s’en sert pour battre les allées qui sont en recoupe ou en salpetre. Celle qui est plus courte, sert à plaquer du gason. Voyez la Planche de Jardinage. Celle des Maçons n’est qu’un long bâton, terminé comme une petite massue : celle des Carreleurs est une regle d’environ quatre piés de long, large de cinq, & d’un pouce & demi d’épais, dont ils se servent pour frapper & mettre de niveau leurs carreaux : celle des Vanniers est toute de fer, ronde par le bout, terminée par l’autre en masse, & s’employe à chasser & serrer les osiers entre les montans ; le petit bout de cette batte qui se tient à la main, a un arrêt pour qu’elle soit mieux empoignée : celle des Tapissiers n’est qu’une baguette ou deux cordes repliés, dont ils écharpissent la bourre & la laine qui ont déjà servi : celle des Potiers-de-terre est un battoir. La batte-à-beurre est faite d’un long manche, ajusté dans le milieu d’un rondin de bois de cinq pouces ou environ de diametre, sur un pouce d’épais, percé de plusieurs trous ; voyez son usage à l’article Beurre. Les Blanchisseuses ont leur batte ou battoir ; ce n’est qu’une pelle plate à manche court, dont elles frappent leur linge pour en faire sortir l’eau & la saleté. La batte-à-bœuf des Bouchers n’est qu’un bâton rond dont ils battent les gros bestiaux quand ils sont tués ou soufflés, pour en attendrir la chair. La batte à Fondeur est singuliere, sa pelle est triangulaire. Voy. à l’article Fondeur en terre son usage ; voyez aussi les articles suivans, où l’on définit plus exactement quelques-unes des battes précédentes, & quelques autres dont nous n’avons pas parlé.
Batte, (Architecture.) nom que les ouvriers de bâtiment donnent à un morceau de bois fait en forme de massue d’Hercule, avec lequel ils battent le plâtre.
Batte, autre espece d’outil qui sert à battre & à affermir les allées avant d’y mettre le sable. (P)
Batte, (Marbreur de papier.) est un bâton dont une des extremités est enfoncée dans une portion de cylindre, coupé transversalement. Les Marbreurs se servent d’une batte K pour broyer & délayer la gomme adragante dans une espece de pot à beurre L, avant que de la verser dans le baquet. Voyez la fig. K L dans le bas de la Planche du Marbreur.
Batte à recaler, sert aux Menuisiers à recaler ou dresser les onglets des cadres.
Battes, (Manége & Sellier.) Les battes sont des parties d’une selle à piquer élevées sur les arçons, sur le devant & le derriere, afin que le cavalier se tienne ferme, & que les secousses du cheval ne l’ébranlent point : ordinairement les selles n’ont point de batte de derriere. On dit chausser une batte, pour dire qu’on met le liége de la selle dans la batte, afin de tenir la batte en état. Le mot de liége vient de ce qu’autrefois cette partie de la selle étoit de liége ; car aujourd’hui elle est de bois. (V)
Batte, outil de Facteur d’orgue, est une forte regle de bois bien dressée sur le plat, dont ils se servent pour redresser les tables de plomb sur l’établi, & les ployer sur les mandrins. Voyez la fig. 65. Pl. d’Orgue, & l’article Orgue.
Batte, (Rubanier.) instrument de fer en forme de forte lime, mais uni & égal dans toute sa longueur, servant pour la fabrique des peignes. Cet instrument est emmanché dans un manche de bois : il y a de ces battes plus ou moins fortes, suivant la nécessité. Voyez Peigne.
Batte de jeu de Paume, c’est un instrument qu’on appelle plus communément battoir, ou plûtôt c’est la partie antérieure du battoir qui frappe la balle. Voyez Paumier.
Batte, terme de Potier de terre, c’est une espece de maillet plat à quatre angles, & d’une même piece avec son manche. Il sert à travailler le carreau.
Batte, en terme de Vannerie, est un morceau de fer assez lourd, & de figure quarrée, dont les Vanniers se servent pour presser leur osier façon qu’il n’y ait entre les brins qu’un très-petit intervalle, point du tout même si l’on peut.
Batte, à la Monnoie, ce sont des especes de sabres de bois quarrés par le bout, d’environ deux piés sur trois ou quatre pouces de large, & un pouce & demi d’épaisseur, avec un manche arrondi. Ces battes servent à fouler & presser les sables dont on fait les moules, & leur faire prendre la forme à force de frapper le sable.
Batte lessive, ou Batte-queue, petit oiseau mieux connu sous le nom de bergeronnette. Voyez Bergeronnette. (I)
BATTÉE, s. f. c’est le nom que les Relieurs donnent à une portion d’un livre qu’ils battent sur la pierre : on met les différentes battées dans une presse, avec un ais entre chaque battée pour les façonner.
* BATTEL, (Géog.) ville d’Angleterre dans la province de Sussex.
BATTELLEMENT, s. m. en Architecture, est le dernier rang des tuiles doubles par où un toît s’égoutte dans un chêneau ou une gouttiere. C’est le stillicidium des Latins. (P)
Battemens, s. m. pl. en Medecine, agitations & palpitations réciproques du cœur & du pouls. Voyez Pouls.
Quelques medecins distinguent quatre-vingts-un différentes sortes de battemens simples, & quinze de battemens composés : ils disent que le pouls en a soixante par minute, dans un homme d’une constitution bien tempérée : mais ils ne sont point d’accord à ce sujet avec l’expérience générale. Voyez Pouls. (N)
Battement, en Architecture, est une tringle de bois ou barre de fer plate, qui cache l’endroit où les deux venteaux d’une porte de bois ou de fer se joignent. (P)
Battemens, en Horlogerie, se dit du coup que donne à la coulisse l’étochio qui est à la circonférence du balancier lorsqu’il décrit de grands arcs. V. Renversement.
Il ne doit point y avoir de battemens dans une montre, ou s’il y en a, ils doivent être fort légers, & seulement lorsqu’elle est nouvellement nettoyée ; sans cela on aura beaucoup de peine à la régler.
Battement est aussi synonyme à vibration : mais il ne se dit que de celles du balancier des montres : dans les pendules on se sert toûjours du mot de vibration.
Le nombre des battemens qu’une montre doit donner par heure a été long-tems incertain chez les Horlogers ; tantôt ils fixoient ce nombre à quelque chose de moins que 16000 ; tantôt ils le portoient jusqu’à 18000 : enfin l’expérience a paru montrer que 17000 & quelque chose étoit le nombre le plus convenable. Dans le premier cas les montres étoient sujettes à varier par les secousses & par la chaleur ; dans le second, le balancier devenant trop léger, & les inégalités du roüage étant augmentées à cause de l’augmentation des frottemens, ces deux causes produisoient d’autres variations. Voyez Vibration. (T)
Battement d’épée, en Escrime, est une attaque qui se fait en frappant avec la lame de son épée celle de l’ennemi. Les battemens d’épée se font toûjours de pié ferme, en dégageant ou sans dégager, sur les armes ou sous les armes.
Battemens d’épée en dégageant, se font comme les battermens simples, excepté qu’on commence par dégager. Voyez Battement d’épée.
Battement d’épée de tierce, sans dégager sur les armes ou sous les armes. Il se fait en frappant d’un coup sec du fort du faux tranchant sur celui de l’épée de l’ennemi, en faisant un mouvement en avant comme quand on part ; & au même instant on allonge l’estocade de tierce ou de seconde sans quitter son épée.
Nota que dans l’instant que vous frappez sur l’épée de l’ennemi, il peut dégager ou la forcer : s’il dégageoit, alors vous ne rencontreriez pas son épée ; c’est pourquoi en pareil cas, au lieu de pousser l’estocade de tierce ou de seconde, vous allongerez une estocade de quarte ou de quarte basse ; & s’il force l’épée, vous porterez l’estocade de quarte ou de quarte basse en dégageant. Voyez Premier Dégagement forcé.
Battement d’épée de quarte, sans dégager sur les armes ou sous les armes. Il se fait en frappant un coup sec du fort du tranchant sur le fort de l’épée de l’ennemi, (on frappe ce coup en faisant un mouvement en avant comme quand on pare) & au même instant on allonge l’estocade de quarte ou de quarte basse sans quitter la lame.
Nota que dans l’instant que vous frappez sur l’épée de l’ennemi, il peut dégager ou la forcer, & alors vous ne rencontreriez pas son épée ; c’est pourquoi en pareil cas, au lieu de pousser l’estocade de quarte ou de quarte basse, vous allongerez votre estocade de tierce droite ou de seconde ; & s’il force l’épée, vous porterez l’estocade de tierce ou de seconde. Voyez Premier Dégagement serré.
Battemens, en terme de Danse, ce sont des mouvemens en l’air que l’on fait d’une jambe, pendant que le corps est posé sur l’autre, & qui rendent la danse très-brillante, sur-tout lorsqu’ils sont faits avec légereté.
La hanche & le genou forment & disposent ces mouvemens : la hanche conduit la cuisse pour s’écarter ou s’approcher ; & le genou par sa flexion forme le battement, en se croisant soit devant soit derriere l’autre jambe qui porte.
Supposé donc que vous soyez sur le pié gauche, la jambe droite en l’air & bien étendue, il faut la croiser devant la gauche, en approchant la cuisse & en pliant le genou, & l’étendre en l’ouvrant à côté ; plier du même tems le genou en croisant derriere, puis l’étendre à côté, & continuer d’en faire plusieurs de suite, tant d’une jambe que de l’autre. On mêle les battemens avec d’autres pas ; ils en rendent la danse beaucoup plus gaie.
Battemens simples. On fait, par exemple un coupé en avant du pié gauche, & la jambe droite qui est derriere vient faire un battement en frappant la jambe gauche, & se reporte du même tems en arriere à la quatrieme position. Ce battement se fait les jambes étendues, parce qu’aux demi-coupés que l’on fait en avant, on doit être élevé sur la pointe, & les jambes tendues ; c’est dans ce même tems que vous faites ce battement : alors la jambe droite se portant en arriere, le talon gauche se pose à terre, & donne la liberté au pié droit de se porter à la quatrieme position, comme on le voit à l’article des coupés. V. Coupé.
Il y a encore des battemens qui se font différemment des autres ; ce n’est que des hanches qu’ils se forment, comme les entrechats, les caprioles, & autres pas de ballet.
BATTERIE (Art milit.) on appelle ainsi dans l’Art militaire tous les endroits où l’on place du canon & des mortiers, soit pour tirer sur l’ennemi, soit pour la destruction ou l’attaque des places de guerre : ainsi une batterie de canon est une batterie qui ne contient que des canons, & une batterie de mortiers est celle qui est destinée au service des mortiers.
Dans un combat, on tire le canon à découvert sans qu’il y ait aucune élévation de terre qui couvre ceux qui le chargent, & qui le font maneuvrer. Comme il n’a pas ordinairement alors de position fixe, & qu’il en change, suivant que le général le croit nécessaire, on ne peut lui pratiquer d’épaulement. Il n’en est pas de même dans l’attaque des places ; le canon s’établit fixement dans les lieux où on le juge utile ; & il est absolument nécessaire, pour qu’on puisse le servir sûrement, qu’il soit derriere un parapet assez épais pour résister à l’effort du canon de la place.
La construction de ce parapet, qu’on appelle ordinairement épaulement, est proprement celle de la batterie. On en donnera ici le détail tel que M. de Vauban le donne dans son traité de l’attaque des places.
Il faut, autant que l’on peut, que le lit du canon, c’est-à-dire, l’endroit ou le terrein sur lequel il est placé, soit élevé de quelques piés au-dessus du niveau de la campagne.
Il faut donner au parapet trois toises d’épaisseur, & sept piés & demi de hauteur.
On construit ces parapets de terre & de fascines, ou saucissons.
On les trace avec un cordeau, ou avec de la meche, parallelement aux parties de la fortification qu’on veut détruire. Cela fait, on prend de la terre sur le devant de la batterie, en y pratiquant pour cet effet, un petit fossé. On fait alternativement un lit de terre bien foulé, & un lit de fascines mises en boutisses, c’est-à-dire couchées, selon leur longueur, dans la largeur du parapet ; on les attache bien solidement ensemble par des piquets qui les lient de maniere que tous ces différens lits ne font qu’un seul & même corps. On pose des fascines en parement, c’est-à-dire, couchées, selon leur longueur, le long de tous les côtés du parapet ; elles sont attachées fortement avec des piquets à l’intérieur du parapet.
On éleve d’abord ce parapet jusqu’à la hauteur de deux piés & demi ou trois piés, & l’on commence ensuite les embrasures du côté intérieur de la batterie. Elles se font de dix-huit piés en dix-huit piés, afin que le merlon, ou la partie de l’épaulement qui est entre les embrasures, ait assez de solidité pour résister à l’effort du canon. Ces embrasures ont trois piés d’ouverture du côté intérieur de la batterie, & neuf du côté extérieur.
Les embrasures étant ainsi tracées, on acheve d’élever le reste de l’épaulement, & l’on donne à la partie du parapet plus élevée que les embrasures, la pente ou le talud convenable pour que les merlons ne s’éboulent pas dedans.
On appelle genouilliere de la batterie, la partie du parapet depuis le niveau de la campagne, jusqu’à l’ouverture des embrasures, dont les joues sont les deux côtés de l’épaisseur de l’épaulement qui terminent l’embrasure de part & d’autre.
Le parapet, ou l’épaulement, étant achevé, on prépare les plattes-formes vis-à-vis les embrasures. (Voyez Platte-forme. ) Lorsqu’elles sont achevées, on y fait conduire le canon.
La fig. 10. de la Planche VIII. de l’Art milit. mettra au fait de tout ce qui concerne les batteries de canon.
Elle représente le plan d’une batterie avec les plattes-formes, & le canon posé dessus vis-à-vis les embrasures ; & la fig. premiere de la Planche IX. fait voir le profil d’une batterie avec une piece de canon dans son embrasure, & prête à tirer.
On ajoûtera ici, pour plus de détail, la maniere suivante de construire une batterie de canon devant une place assiégée ; elle est tirée des Mémoires d’Artillerie de M. de Saint-Remy.
Le commissaire qui doit commander la batterie, commence par reconnoître le terrein avec quelques officiers de ceux qui doivent y servir, & ensuite il fait provision de toutes les choses nécessaires, comme des outils à pionniers de toutes sortes, le double de ce qu’il y aura de travailleurs ; il doit en prendre des qualités qu’il jugera à propos, selon le terrein, c’est-à-dire, pour une terre grasse & de gason, beaucoup de bêches.
Dans du sable, beaucoup de pelles de bois ferrées.
Dans des pierres, ou dans la terre ferme, des hoyaux ou pics-hoyaux.
Des serpes, masses, haches & demoiselles, deux de chaque façon par piece ; des fascines & des piquets. Les fascines doivent être de cinq à six piés de longueur, & environ dix pouces de diametre, à chacune trois bons liens.
Les piquets doivent être de trois piés & demi de longueur, & un pouce & demi de diametre par le gros bout.
Lorsque le commissaire sera sur le terrein destiné pour la batterie, il la tracera avec de la meche & des fascines, & observera qu’elle soit parallele à ce qu’on lui aura marqué de battre. Il donnera dix-huit ou vingt piés d’épaisseur à l’épaulement, suivant les bonnes ou méchantes terres ; & supposé que la batterie soit de six pieces, il faudra prendre vingt toises de terrein ; & pour diligenter la batterie, il faudra du moins quatre-vingts travailleurs, qui seront partagés moitié d’un côté, moitié de l’autre, & environ à trois piés l’un de l’autre.
A l’égard des commissaires & officiers qui seront destinés pour la batterie, il les postera de distance en distance d’un & d’autre côté, afin de faire travailler les soldats avec diligence ; après quoi il faudra jetter la terre pour faire l’épaulement : ceux qui seront dans le dedans de la batterie tireront de la terre de loin pour ne pas s’enfoncer ; & ceux du dehors & du côté de la place feront un fossé d’environ dix piés de large & six piés de profondeur, afin de trouver beaucoup de terre, tant pour se mettre à couvert du feu de la place, que pour faire l’épaulement.
Il fera laisser entre le fossé & la fascine qui aura servi à tracer la batterie, une berme d’environ trois ou quatre piés, afin d’avoir plus de facilité à jetter la terre sur l’épaulement pour raccommoder la batterie lorsqu’elle sera éboulée par le soufle du canon de la batterie même, & par le canon de la place.
Lorsqu’on aura assez jetté de terre du fossé sur l’épaulement, ou que le jour commencera à faire voir de la place les travailleurs, alors le commissaire les fera retirer de derriere, & les fera passer devant pour toûjours jetter de la terre sur l’épaulement avec les autres, & ensuite fasciner le devant de la batterie, aussi-bien que les deux extrémités qu’il faut faire en petit épaulement ; & pour cet effet, il fera faire un petit fossé de côté & d’autre, afin d’avoir de la terre, tant pour se couvrir des pieces de la place, qui peuvent battre en roüage, que pour empêcher la communication & les passages, qui sont incommodes, des tranchées à la batterie ; & cette terre servira aussi pour emplir & fortifier les merlons des deux bouts.
Lorsque le parement de la batterie sera fasciné de trois piés de hauteur, qui doit être celle de la genouilliere, il partagera les vingt toises de terrein, qui font cent vingt piés, en treize parties.
La premiere sera de neuf piés, pour le premier merlon.
La seconde, de deux piés, pour une embrasure.
La troisieme, de dix-huit piés, pour le merlon d’entre deux pieces, & tout le reste de même.
Ce sera encore pour le dernier merlon, neuf piés.
Il donnera de l’ouverture à l’embrasure en dehors de neuf piés, après quoi il partagera les embrasures aux commissaires & aux officiers qui seront avec lui, suivant qu’il se pratique ordinairement, afin que les commissaires fassent fasciner & piqueter avec soin leurs embrasures ; on observera de mettre toûjours trois bons piquets par chacune fascine contre les liens. Il prerdra garde, de tems à autre, que les commissaires ouvrent & dégorgent les embrasures, de maniere qu’elles puissent battre en ligne directe, ce qui leur aura été marqué ; après quoi il fera toûjours fasciner & jetter de la terre à hauteur de six piés ; & en cas que la batterie soit battue de quelque cavalier ou bastion élevé, il la fera hausser de sept à huit piés, autant qu’il en sera besoin.
Quand les embrasures seront bien fascinées & dégorgées, & qu’il ne restera plus de terre que pour s’empêcher d’être vû de la place, on travaillera aux plattes-formes, & l’on commencera à mettre le terrein de niveau, ensorte qu’il n’y reste aucunes pierres, s’il se peut ; après quoi l’on doit poser le heurtoir qui sera de neuf pieds de longeur, sur neuf à dix pouces en quarré, & ensuite le premier madrier qui sera de neuf piés & de longueur, sur un pié de large & deux pouces d’épaisseur.
Le second sera de dix piés de longueur.
Le troisieme de dix piés & .
Et tous les autres en suivant jusqu’au nombre de dix-huit, & toûjours un demi-pié de plus les uns que les autres, pour rendre la platte-forme depuis les heurtoirs jusqu’au dernier madrier de recul, de dix-huit piés de long, & dix-huit piés de large au recul.
La platte-forme sera relevée depuis le heurtoir jusqu’au dernier madrier de recul de neuf à dix pouces, & bien arrêtée au recul par deux gros piquets de bois de charpente ; après quoi il pourra demander à faire marcher le canon du grand parc, qui doit être armé pour chaque piece de deux lanternes & deux refouloirs, autant d’écouvillons & de coins de mire, & de huit leviers.
Les canoniers ordonnés pour mettre le feu au canon, doivent avoir chacun deux dégorgeoirs, deux fournimens, deux boute-feux ; & pour toute la batterie, quelques tireboures du calibre des pieces.
Il faudra choisir un endroit pour un grand magasin à poudre pour toute la batterie, derriere un fossé relevé, ou redan de terre, & s’il n’y en a point, faire un épaulement à cinquante pas de la batterie. Quelques-uns même sont d’avis de porter ce magasin à cent pas, pour mettre à couvert une cinquantaine de barrils de poudre, & la sentinelle pour les garder.
Il faudra aussi avoir un petit magasin à poudre de deux pieces en deux pieces, qui puisse contenir deux tonneaux de poudre, éloigné du recul des pieces d’environ dix à douze pas, & couvert de fascines, avec un petit boyau de chaque côté pour y entrer, en cas que l’on soit vû de la place.
Il est nécessaire que le canon arrive à nuit fermante à la batterie avec toutes les munitions, & qu’il y ait au moins de quoi tirer cent coups de chaque piece. Ces munitions seront mises dans le grand magasin près la batterie, & dans les petits que l’on aura faits à dix pas des platte-formes ; & l’on ne perdra aucun temps pour faire placer les pieces, afin qu’elles puissent être logées & en état de tirer la nuit même, si le général l’ordonne, ou à l’ordinaire à la pointe du jour.
Le commissaire doit avoir soin, sur toutes choses, de visiter de temps en temps les grands & petits magasins ; afin qu’en prenant des mesures justes, il ne lui manque rien, ni poudre, ni boulets, ni fourrage. Il faut même qu’il ait toûjours des fascines & des piquets pour raccommoder le soir les épaulemens & les embrasures ; & sur tout, que les platte-formes soient bien nettes, & qu’il ne s’y répande point de poudre, non plus que dans les magasins, afin de ne point courir le risque du feu qui arrive souvent sans toutes ces précautions.
Lorsque le canon est prêt à tirer, on fait détruire le côté extérieur des embrasures qu’on a laissé exprès d’une très-petite épaisseur, & seulement pour cacher ou masquer la batterie ou les embrasures : ou bien l’on tire le canon qui détruit bientôt cette espece de petit tideau. C’est ce qu’on appelle démasquer une batterie.
Pour tout ce qui concerne le service d’une batterie de canon, voyez Charge & Canon.
La table suivante qui est aussi tirée des mémoires d’artillerie de M. de Saint-Remy, peut être fort utile pour donner une connoissance éxacte de toutes les choses nécessaires à la construction & au service des batterries de canon.
Batteries du chemin couvert, sont celles qu’on établit sur la partie supérieure du glacis pour battre en breche, lorsqu’on est maître du chemin couvert.
Ce qu’il y a d’essentiel à observer dans ces batteries, c’est d’en ouvrir les embrasures, ensorte qu’elles découvrent bien toutes les parties de la place qu’elles doivent battre, & qu’elles ayent une assez grande pente du derriere au devant pour plonger jusqu’au-bas des revêtemens que l’on veut ruiner. Comme leur construction est fort dangereuse, parce qu’elle se fait sous le feu du rempart de la place, on les masque quelquefois, c’est-à-dire, qu’on met devant les endroits où elles s’établissent, des sacs à laine, ou quelqu’autre chose qui cache les travailleurs à l’ennemi. Voyez Batterie à ricochet, voyez aussi Pl. XII. de l’Art milit. le plan des batteries du chemin couvert.
Batterie de Mortier ; c’est un lieu préparé pour tirer les mortiers sur une place assiégée. Ces batteries ne different de celles du canon, qu’en ce qu’on ne fait point d’embrasures à leur épaulement.
Les plattes-formes de ces batteries ont un pié de longueur & six de largeur : le devant se pose à deux piés de l’épaulement de la batterie.
Le magasin à poudre pour le service de la batterie, doit être derriere à quinze ou vingt pas, comme aux batteries de canon, avec un boyau de communication pour y aller en sûreté. On met des planches ou des fascines avec de la terre dessus pour le garantir du feu.
Les bombes chargées se mettent à côté du même magasin à cinq ou six pas de distance.
Pour ce qui concerne la maniere de charger le mortier & de le pointer, voyez Mortier & Bombe.
Instruction de M. Camus des Touches, pour le service d’un mortier de douze pouces, à un siége. Lorsque la batterie est construite, & que les mortiers y sont logés, on assemble tout ce qui est nécessaire pour l’exécution. Savoir : une provision de bombes chargées ; une botte de fourrage ; de la terre douce ; deux couteaux de bois ou spatules ; une bêche ; un pic-hoyau ; un balai ; quatre leviers ; une demoiselle ; un crochet ; une curette ou racloir ; un quart de cercle ; deux boute-feux ; deux coins de mire : chaque mortier doit être aussi fourni, & avoir à portée de quoi remplacer dans le besoin. Le Magasin à poudre sera dans le milieu de la batterie, vingt ou vingt-cinq pas derriere ; & s’il faut un boyau pour y communiquer sans être vû, on le tirera du milieu de la batterie, ou de quatre mortiers en quatre mortiers, si la batterie est considérable ; observant de laisser un terre-plein entre le mortier & le commencement du boyau, afin qu’on puisse se remuer dans la batterie.
Les bombes chargées seront à côté du magasin à quelques pas de distance, la fusée renversée en terre. Les armes du mortier seront couchées à droite & à gauche.
Pour servir un mortier de douze pouces, il faut un cadet bombardier, & quatrè servans. Le cadet & ces quatre servans doivent être placés comme il suit, avec ce qui sert au service du mortier.
| A la gauche du mortier. | A la droite du mortier. | |
| Deux servans. | Le cadet. | |
| Une botte de fourrage. | Deux servans. | |
| De la terre douce. | Une demoiselle. | |
| Un couteau ou spatule. | Un crochet. | |
| Une bêche. | Une curette ou racloir. | |
| Un balai. | Un couteau ou spatule. | |
| Deux leviers. | Un sac à poudre. | |
| Un picq-boyau. | ||
| Deux leviers. |
Les deux boutefeux seront mis derriere le mortier. Le cadet bombardier doit avoir un quart de cercle & un dégorgeoir. Il a soin d’aller chercher la poudre dans un sac au petit magasin. Il charge le mortier avec une mesure, après avoir mis son dégorgeoir dans la lumiere, & demande à l’officier qui commande, à combien de poudre il veut qu’on charge ; il la met dans la chambre du mortier, & l’égale bien avec la main. Le premier servant de la gauche lui fournit un bouchon de fourrage ; le premier de la droite lui donne la demoiselle : le cadet refoule un petit coup le fourrage qu’il a mis sur la poudre. Le premier soldat de la gauche lui fournit de la terre douce sur la bêche, pour mettre dans la chambre, & achever de la remplir.
Le cadet, après avoir placé cette terre, la refoule à petits coups, puis de plus fort en plus fort, jusqu’à ce que la chambre soit pleine, & fait sur la superficie un lit pour asseoir la bombe. Le premier soldat de la droite remet la demoiselle en son lieu. Le second servant de la droite, & celui de la gauche, prennent un levier & le crochet, & apportent la bombe chargée ; ils aident le cadet à la placer : le cadet pose la bombe bien droite dans l’ame du mortier. Le premier servant de la gauche lui fournit de la terre pour mettre autour de la bombe avec le couteau ou spatule, que le premier de la droite lui donne. Le cadet place la terre autour de la bombe, de maniere que son centre se trouve, s’il est possible, dans l’axe de l’ame du mortier, que les anses soient en haut & tournées suivant l’alignement des tourillons.
Lorsque la bombe est placée dans le mortier, le cadet pointe en s’alignant sur le piquet planté au haut de l’épaulement, & qui sert à s’ajuster : & pour cela les quatre servans ensemble prennent chacun un levier ; le premier de la droite & celui de la gauche, embarrent devant, & les deux autres derriere : tous ensemble poussent le mortier en batterie, suivant le commandement de l’officier ou du cadet ; ensuite les deux premiers servans lui passent un levier sous le ventre, pour le baisser & le hausser suivant les degrés de hauteur que l’officier ou le cadet veulent lui donner ; & le second servant de la gauche pousse ou retire le coin de mire pour cet effet, au commandement qu’il en reçoit. Ce deuxieme servant avec son camarade de la droite, prennent chacun un levier pour donner du flasque. Le mortier pointé, le cadet retire son dégorgeoir de la lumiere, il amorce avec de la poudre fine, & met un peu de poulverin sur le bassinet, & sur la fusée de la bombe, après avoir graté la composition avec la pointe de son dégorgeoir, afin que le feu y prenne promptement. Le premier servant de la droite prend le boutefeu, met le feu à la fusée. Le premier servant de la gauche, met le feu au mortier au commandement de l’officier ou du cadet, qui ne se donne que quand la fusée est bien allumée. Lorsque son coup n’a pas beaucoup de portée, il laisse brûler quelque tems la fusée, & ordonne le feu au mortier suivant l’estimation du tems qu’elle doit encore durer, ensorte qu’elle puisse crever au moment après qu’elle est tombée ; la longueur de la fusée se connoît en comptant 1, 2, 3, &c. également depuis son commencement jusqu’à sa fin. Le cadet ou l’officier, en donnant le commandement, se tiennent à portée de pouvoir observer leur coup, pour se corriger, & mieux ajuster dans la suite. Quand la bombe est partie, le premier servant de la droite nettoye le mortier avec la curette ou racloir, & un bouchon de fourrage, que celui de sa gauche lui donne. Le second servant de la gauche, a le soin de balayer toûjours pendant qu’on sert la piece, afin qu’il ne reste point de poudre qui puisse mettre le feu à la batterie. Les deux seconds servans prennent chacun un levier, les placent sous le ventre du mortier pour le mettre debout, & en état d’être rechargé. Le cadet va à la poudre avec un sac, charge le mortier avec la mesure, &c. chacun reprend le même poste & ses mêmes fonctions enseignées ci-dessus. Pour charger les bombes, on les emplit de poudre avec un entonnoir, on fait ensuite entrer la fusée par le petit bout dans la lumiere de la bombe, & on l’enfonce avec un repoussoir de bois à coups de maillet de bois, & jamais de fer.
Les petits mortiers se servent à proportion comme celui de douze pouces. Ceux à grenades sont servis par un seul homme ; à l’égard du pierrier, il ne faut que trois hommes. La différence qu’il y a de son service à celui du mortier, est qu’au lieu de la bombe, on met des pierres dans l’ame, sous lesquelles on place un plateau ou une pierre platte, lesquels couvrent la chambre. Ces pierres sont arrangées jusqu’à la bouche ; quelquefois on les met dans un panier. Il faut faire un amas de pierres à portée de la batterie, & dans la batterie même, & sur-tout en avoir quelques-unes de larges pour mettre au fond du pierrier : ces pierres tiennent lieu de plateaux, il faut aussi que chaque pierrier soit muni d’une bonne civiere pour aller chercher les pierres.
Le pierrier se met en batterie, & se pointe comme un mortier : le principal Bombardier a soin de bien arranger les pierres ; & soit qu’on se serve du panier ou qu’on ne s’en serve pas, il faut qu’il y ait de la terre autour pour ajuster la charge, ainsi qu’on en use autour de la bombe. Chacun de messieurs les commandans de l’école peuvent réduire l’exercice du mortier à la voix ou au tambour : mais il faut observer que chacune des fonctions soit dans l’ordre de la présente instruction.
Les soldats servans qui se trouveront le plus d’intelligence, seront quelquefois employés aux fonctions de cadets ; on les changera de place de tems en tems, afin qu’ils sachent servir également dans les postes de droite ou de gauche, de premier ou de second servant. Les officiers & les sergens tiendront chacun dans leur devoir, & surtout veilleront à la propreté de la batterie ; ensorte qu’il n’y ait point de poudre à terre, ou sur la plate-forme qui puisse causer aucun danger ; le feu est bien plus à craindre dans une batterie de mortiers, à cause des bombes chargées qui s’y trouvent : les plus exactes précautions y sont nécessaires.
Il est à remarquer qu’une platte-forme de mortiers ne peut avoir trop de solidité : de-là dépend la justesse du mortier ; il faut que les lambourdes ayent au moins six pouces en quarré.
Recapitulation des différentes fonctions des cadets bombardiers & soldats, dans l’exécution du mortier de douze pouces.
Le cadet va chercher la poudre ; met le dégorgeoir dans la lumiere ; charge le mortier ; met le fourrage sur la poudre, refoule avec la demoiselle sur le fourrage ; refoule la terre douce ; pose la bombe, & met de la terre à l’entour ; s’aligne sur ce qu’il veut battre ; donne l’élévation avec le quart de cerclz ; retire le dégorgeoir de la lumiere ; amorce & gratte la composition de la fusée ; ordonne le feu au mortier ; observe le coup.
Premier servant de la gauche : donne le fourrage au cadet, fournit la terre douce pour la chambre, donne la terre pour mettre autour de la bombe, embarre sur le devant de l’affut pour l’alignement du mortier sur le piquet, passe un levier sous le ventre du mortier pour l’élevation, met le feu au mortier, donne du fourrage à son camarade pour nettoyer.
Premier servant de la gauche : donne la demoiselle au cadet, la remet en sa place, donne le couteau ou spatule, embarre au-devant de l’affut pour l’alignement sur le piquet, passe un levier sous le ventre du mortier pour l’élevation, prend le boute-feu, & met le feu à la fusée, nettoye le mortier avec la curette.
Deuxieme servant à la gauche : va chercher la bombe chargée, aide au cadet à la placer, embarre au derriere de l’affut pour l’alignement, pousse ou retire le coin derriere pour l’élevation, prend un levier & met le mortier debout.
Deuxieme servant de la droite : va chercher la bombe chargée, aide au cadet à la placer, embarre au derriere de l’affut pour l’alignement, prend un levier, & met le mortier debout, balaye la batterie. Mém. d’Artillerie de S. Remy, troisieme édition.
Batterie à ricochet, c’est celle qui est destinée à tirer le canon à ricochet.
On dit qu’on tire le canon à ricochet, lorsqu’on le charge d’une quantité de poudre capable seulement de chasser ou porter le boulet vers le commencement des faces des pieces attaquées. Il faut pour cela que le canon soit posté dans le prolongement de ces faces. Le boulet tiré de cette maniere va en roulant & en bondissant, & il tue ou estropie tous ceux qu’il rencontre dans le cours de son mouvement. Il fait bien plus de desordre en allant ainsi mollement, que s’il étoit chassé avec force ou roideur.
Les batteries à ricochet ont été inventées par M. le maréchal de Vauban : il commença à les employer au siege d’Ath en 1697. Voici ce qu’il prescrit touchant ces batteries, dans son traité de l’Attaque des places.
Pour tirer à ricochet il faut mettre les pieces sur la semelle, c’est-à-dire à toute volée, & charger avec des mesures remplies & raclées avec exactitude, versant la charge dans la lanterne, & la conduisant doucement au fond de la piece, sur laquelle on coule la bourre, appuyant dessus avec le refouloir sans battre. La piece étant chargée de la sorte, pointée & posée sur la semelle, comme il est dit ci-dessus, il n’y aura plus que le trop ou le trop peu de charge qui puisse empêcher le coup d’aller où l’on veut. Mais on a bien-tôt trouvé la véritable charge qu’il lui faut ; car en chargeant toûjours de même poudre & de mesure, on l’augmente ou diminue jusqu’à ce qu’on voie le boulet entrer dans l’ouvrage, effleurant le sommet du parapet, ce qui se voit aisément, parce qu’on conduit le boulet à l’œil. Quand on a une fois trouvé la vraie charge, il n’y a qu’à continuer : comme la piece ne recule pas, au moins sensiblement, à cause de cette charge qui est beaucoup plus petite que la charge ordinaire, tant que la même poudre dure, le boulet se porte toûjours où il doit aller.
Observez aussi que quand on change de poudre, il faut prendre garde au ricochet, & le régler de nouveau ; & quand il est trop fort, c’est-à-dire quand il éleve considérablement, il sera bon de l’abaisser & d’employer pour cet effet le coin de mire, & augmenter la charge afin de le roidir un peu davantage ; il en devient plus dangereux : mais il faut prendre garde à deux choses ; l’une, de ne pas trop roidir, parce qu’il pourroit passer sans plonger ; & l’autre, qu’il rase toûjours les paniers dont les soldats assiégés se couvrent ; & quand il en abat quelqu’un, il n’est que meilleur ; car c’est la perfection de bien tirer que de raser toûjours le sommet du parapet le plus près qu’il est possible, sans le toucher ; un peu d’expérience & d’attention l’ont bientôt reglé.
Il faut encore bien prendre garde à une chose, c’est que le ricochet ne doit pas faire bond sur le parapet des faces prolongées, mais sur le rempart qui est derriere ; c’est pourquoi il faut toûjours laisser quatre toises ou environ, depuis le devant des pieces que l’on bat jusqu’à l’endroit où l’on pointe. Quand il y a lieu de changer d’objet & de battre en revers sur le chemin couvert, ou dans le fossé ou sur l’arriere des bastions, il n’y a qu’à donner un peu de flasque à la piece, la repointer, & toûjours l’abattre sur la semelle, & remonter ensuite le ricochet jusqu’à ce qu’on soit ajusté, après quoi il n’est plus nécessaire d’y retoucher. Quand les pieces sont dirigées sur ce qu’on veut battre, comme elles ne reculent point, on peut les affermir pour la nuit & le jour, & quand même il faudroit les contenir par des tringles cloüées sur les plattes-formes pour mieux s’en assûrer, cela n’en seroit que mieux.
Le nombre des pieces aux batteries à ricochets doit être depuis cinq jusqu’à huit ou dix ; si l’on en mettoit moins, le ricochet seroit trop lent, & laisseroit du tems à l’ennemi, dont il pourroit se prévaloir pour travailler à ses retranchemens.
Par cette raison on ne doit jamais permettre de tirer en salve, mais toûjours un coup après l’autre par intervalles égaux.
On ne doit jamais non plus tirer à ricochet qu’on ne charge avec des mesures, c’est de quoi on doit être abondamment fourni.
Les mesures nécessaires doivent être de fer-blanc, comme celles dont on mesure le sel ; savoir, d’une once, de deux, de trois, de quatre, de huit qui font la demi-livre, & de seize onces qui font la livre.
Cette quantité par chaque piece doit suffire, & même on pourroit se contenter de moins ; car s’il s’agit de charger d’une once, vous en aurez la mesure, si de deux, vous l’avez aussi ; si de trois, de même ; si de quatre, vous l’avez encore ; si de cinq, ajoûtez un à quatre ; si de six, ajoûtez deux à quatre ; si de sept, ajoûtez trois à quatre ; la huitieme fait la demi-livre, qui repetée deux fois fait la livre ; trois fois fait la livre & demie ; quatre fois font deux livres.
Il vaut mieux néanmoins avoir quelques mesures de plus pour ne point tâtonner, & les faire toutes numéroter avec bien de l’exactitude. On est bientôt accoûtumé au ricochet, qui est la meilleure & la plus excellente maniere d’employer utilement le canon dans les siéges.
Les propriétés de ces batteries dans les commencemens d’un siége, sont,
1°. De démonter promptement les barbettes & toutes les autres pieces montées le long des faces des bastions & demi-lunes, qui peuvent incommoder la tranchée, en battant à pleine charge.
2°. De plonger les fossés, y couper les communications de la place aux demi-lunes, principalement s’ils sont pleins d’eau.
3°. De chasser l’ennemi des défenses de la place opposées aux attaques, en battant à ricochet.
4°. De chasser l’ennemi des chemins couverts, & de l’y tourmenter tellement par la rupture des pallissades, en les plongeant d’un bout à l’autre, qu’il soit obligé de les abandonner.
5°. De prendre le derriere des flancs & des courtines qui peuvent s’opposer aux passages des fossés, & les rendre inutiles.
6°. D’être d’une grande œconomie, en ce qu’elles peuvent servir tant que le siége dure, sans qu’on soit obligé de changer les batteries.
7°. De consommer sept ou huit fois moins de poudre, & de ne tirer jamais inutilement.
8°. De tirer plus juste & plus promptement, & bien plus efficacement que par toutes les autres manieres de battre.
Après les batteries à ricochet, il n’en faut pas d’autres que celles du chemin couvert ; car pour ce qui est de rompre les défenses, outre qu’elles sont de longue discussion, c’est une erreur, on ne le fait jamais ; & il n’arrive point qu’un parapet à l’épreuve soit assez rasé pour que l’on ne s’en puisse plus servir. D’ailleurs cela est inutile quand le ricochet est bien placé & qu’il fait son devoir : ainsi toutes les autres batteries nécessaires doivent s’établir sur le haut du parapet du chemin couvert, & se doivent border ; elles sont toutes de même espece, mais elles ont différens usages.
Les premieres en ordre doivent être les deux d, d, (Planche XVII. de l’Art milit. fig. 1.) quatre pieces chacune destinées à l’ouverture de la demi-lune C ; on les place de part & d’autre de son angle, à peu près dans les endroits marqués d, d ; & quand la demi-lune est prise, on les peut changer de place, en les mettant un peu à droite & un peu à gauche, pour enfiler son fossé, afin de pouvoir battre en breche les épaules des bastions, comme on le voit en e, e.
Après que les breches sont faites, soit à la demi-lune, soit aux bastions, & bien éboulées, on tient ces batteries en leur premier état, toûjours prêtes à battre le haut jusqu’à ce qu’on en soit le maître ; on biaise même les embrasures pour aggrandir les breches, observant que pour faire breche avec le canon, il faut toûjours battre en salve, & le plus bas qu’on peut, mais jamais le plus haut, parce que cela attire des ruines au pié qui rompent l’effet du canon. Pour bien faire, il ne faut pas que la sape ait plus de six à sept piés de haut. On ne doit jamais quitter le trou qu’on bat, qu’on ne l’ait enfoncé de 8 à 10 piés au moins, après quoi on leur fait élargir la breche, comme on l’a dit ci-dessus, ce qui est une affaire de vingt-quatre heures au plus : on peut donc dire que les batteries des demi-lunes ont trois usages :
Le premier, est celui d’ouvrir la piece attaquée.
Le second, de battre le haut de la breche.
Et le troisieme, d’ouvrir le corps de la place par des orillons.
Les secondes batteries en ordre sont celles marquées h, h, (Planche XVII. de l’Art milit. fig. 1.), qui s’établissent sur le haut du chemin couvert, devant les faces des bastions AB qu’on veut ouvrir.
Les bombes peuvent aussi se tirer à ricochet. M M. les commandans de l’école d’artillerie de Strasbourg ont fait en 1723 des expériences à ce sujet, rapportées de cette maniere dans le Bombardier François. « Pour tirer les bombes à ricochet, on se sert de mortiers de huit pouces montés sur des affuts de canon. Les batteries que l’on fait pour cela, se placent sur le prolongement des branches du chemin couvert, ou de tout autre ouvrage, mais principalement du chemin couvert, parce que les bombes y font un si grand ravage, qu’il n’est presque pas possible de pouvoir y tenir. Elles rompent les pallissades, les tambours & réduits que l’on fait dans des places d’armes rentrantes, & causent bien plus de desordre que les boulets ; car non-seulement elles sont plus grosses & plus pesantes, mais après avoir fait plusieurs bonds, elles crevent à l’endroit où elles viennent se terminer & ne s’enterrent point. Leurs éclats sont toûjours meurtriers ; d’autre part ces mortiers peuvent être servis avec beaucoup plus de célérité que les canons ; car il n’est question que de mettre la poudre dans sa chambre, la bombe dessus, & tirer ; & comme cela peut se faire en 3 ou 4 minutes, une batterie de deux mortiers servie de cette façon, pourra jetter trente ou quarante bombes par heure. Je laisse à penser, ajoûte M. Belidor, si un chemin couvert étoit croisé par de semblables batteries, quelle est la garnison qui pourroit s’y maintenir, l’avantage qu’on auroit de l’attaquer de vive force, & combien on auroit de facilité pour avancer les travaux.
Comme il faut éviter que les bombes ne s’enterrent en tombant, parce qu’elles ne feroient point le ricochet, les mortiers ne doivent jamais être pointés au-dessus de 12 degrés : mais on peut se servir de tous les angles que le mortier peut faire avec l’horison entre 8 & 12 degrés, & choisir le plus convenable à la charge dont on se servira, relativement à la distance dont on sera de l’endroit où les bombes doivent commencer à bondir. Les épreuves faites à Strasbourg peuvent servir de regle à ce sujet. Voici en quoi elles consistent.
On a construit une batterie à 70 toises de l’angle saillant du chemin couvert de la demi-lune du polygone de cette école : un mortier pointé à 9 degrés au-dessus de la ligne horisontale, & chargé de 13 quarterons de poudre, a jetté les bombes sur le glacis, à 2, 4, 6, 8 toises du parapet du chemin couvert, d’où elles se relevoient & alloient plonger dans la branche entre les deux traverses, & de-là dans la place d’armes rentrante contre un petit réduit qu’on y avoit fait.
L’on a pointé ensuite à 10 degrés avec la même charge, & après 5 ou 6 coups répétés de cette maniere, l’on a observé que les bombes tomboient dans la place d’armes saillante, d’où elles se relevoient & alloient plonger, comme les précédentes, dans la branche entre les deux traverses, & de-là dans la place d’armes rentrante. Enfin on a pointé le mortier à 11 degrés toûjours avec la même charge, & après 5 ou 6 coups réitérés, on a observé que les bombes tomboient encore dans la branche, entre les deux traverses ; d’où elles se relevoient & alloient passer par-dessus le reste du chemin couvert : ce qui a fait conclurre que la maniere la plus avantageuse & la plus convenable de faire agir ce ricochet, étoit de ménager la direction du mortier ; de sorte que les bombes pûssent tomber sur la crête du chemin couvert, ou dans la place d’armes saillante, moyennant quoi elles faisoient toûjours un grand effet.
On a éprouvé si la fusée ne s’éteindroit point, soit par la chûte des bombes, ou par le frottement du ricochet en roulant ; & pour cela on en a fait tirer plusieurs avec des fusées allumées, qui ont toutes réussi, ayant été entierement consumées. »
Batteries en rouage, sont celles qu’on destine à démonter les pieces de l’ennemi.
Batteries enterrées, sont celles dont les plattes-formes sont enfoncées dans le terrein de la campagne ; de maniere que ce terrein sert de parapet ou d’épaulement à la batterie, & qu’on peut y pratiquer des embrasures.
Batteries directes, sont celles qui battent à peu près perpendiculairement les côtes des ouvrages devant lesquels elles sont placées.
Batterie meurtriere. Voyez Batteries de revers.
Batteries de revers, sont celles qui battent le derriere d’un ouvrage, & qui voyent le dos de ceux qui le défendent. Elles sont aussi appellées batteries meurtrieres, à cause qu’elles sont les plus dangereuses, & qu’il est fort difficile de se parer ou mettre à couvert de leur canon.
Batteries en écharpe, sont celles dont les tirs font un angle au plus de 20 degrés avec les faces, ou les côtés des pieces qu’elles battent. On les appelle aussi quelquefois batteries de bricole ; parce que le boulet ne faisant, pour ainsi dire, qu’effleurer la partie sur laquelle il est tiré, se réfléchit dans les environs, à peu près comme le fait une balle de billard, qui a frappé la bande obliquement.
Batterie d’enfilade, est celle qui découvre toute la longueur de quelque partie d’un ouvrage de fortification ; ensorte que le boulet peut prendre par le flanc ou le côté, tous ceux qui sont placés sur ce côté, & qui font face au parapet.
Batteries en croix, ou Batteries croisées, ou encore en chapelet, sont dans l’Art militaire des batteries qui se croisent pour battre la même face ; ensorte que l’une acheve ce que l’autre a commencé d’ébranler. (Q)
Batteries (Marine.) c’est une quantité de canons placés des deux côtés du vaisseau, à son avant & à son arriere.
Les gros vaisseaux de guerre ont trois batteries ; la premiere qui est la plus basse, porte les canons du plus fort calibre. La seconde est au-dessus de la premiere, c’est-à-dire au second pont, & porte des canons d’un moindre calibre. La troisieme est sur le dernier pont, ou pont d’en-haut ; chaque rang étant ordinairement de quinze sabords, sans y comprendre ceux de la sainte barbe, & les batteries qui sont sur les châteaux. La premiere batterie, qui est la plus basse, doit être pratiquée assez haut, pour que dans le gros tems elle ne soit pas noyée, c’est-à-dire qu’elle ne se trouve pas sous l’eau, ce qui la rendroit inutile.
Voyez à la Pl. I. Mar. la maniere dont les batteries sont disposées dans un vaisseau du premier rang.
Batterie trop basse ou Batterie noyée, se dit d’un vaisseau qui a son premier pont, & ses sabords trop près de l’eau.
Batterie basse, se dit de la batterie du premier pont.
Batterie haute, se dit de la batterie du pont d’en-haut.
Batterie entre deux ponts ou seconde Batterie.
Mettez la batterie dehors, c’est-à-dire, mettez les canons aux sabords.
Mettez la batterie dedans, c’est-à-dire, ôtez les canons des sabords pour les remettre dans le vaisseau. (Z)
Batterie (terme d’Arquebusier) c’est un morceau de fer large d’un bon pouce, qui est reployé en équerre plate, dont les faces extérieures sont un peu arrondies ; les intérieures sont exactement plates : la face de dessous sert pour couvrir le bassinet & empêcher l’amorce de sortir : celle qui la surmonte sert pour faire sortir du feu de la pierre & allumer l’amorce. La partie qui couvre le bassinet a une petite oreille plate, qui est percée d’un trou ou se place une vis qui assujettit la batterie au corps de platine, & qui ne l’empêche point de se mouvoir en tournant dessus la vis. Le bout de cette oreille forme un petit talon qui est fait en rond, & qui pese sur le ressort de la batterie.
Batterie (en Boissellerie) c’est le pié, ou le dessous, ou fond du tamis. On l’appelle peut-être ainsi, parce que l’on remue le tamis en le battant par en bas sur une table, &c. pour mieux faire passer ce qui est dedans.
Batterie (terme de Chapelier) qui signifie l’endroit où on foule les chapeaux, & où sont établis le fourneau, la chaudiere & les fouloirs. On dit une batterie à deux, à quatre, à huit, &c. pour désigner une foulerie où deux, quatre, huit, &c. ouvriers peuvent travailler à la fois. Voyez Foulerie. Voyez aussi Chapeau.
Batterie, se dit dans les Manufactures à papier, à poudre, & autres, de la chûte des pilons dans les mortiers. Ainsi arrêter la batterie, c’est empêcher les pilons de tomber dans les mortiers. Voyez Moulin à Papier, Moulin à Poudre.
Batterie (chez les Chapeliers & Bonnetiers) est synonyme à soulerie. Voyez Chapelerie & Bonneterie.
BATTEURS D’ESTRADE, (Art militaire.) sont des cavaliers que le général envoye pour reconnoître les environs du camp qu’il occupe, & les avenues ou chemins par où l’ennemi pourroit s’avancer pour l’attaquer. Ces troupes doivent se porter en-avant avec beaucoup de circonspection, afin qu’elles ne soient pas coupées par l’ennemi, qui pourroit ensuite tomber sur le camp & le surprendre. Elles doivent aussi fouiller exactement les bois & tous les endroits fourrés des lieux où elles passent, pour s’assûrer qu’il n’y a point d’ennemis cachés. Voyez Reconnoître. (Q)
Batteur, s. m. nom commun dans les Arts méchaniques, à un grand nombre d’ouvriers dont l’emploi est d’écraser, de pulvériser, ou d’étendre : & pour les distinguer les uns des autres, on ajoûte au terme batteur celui de la matiere, & l’on dit batteur de plâtre, de soude, d’étain, d’or, &c.
Le batteur de plâtre, est celui qui écrase le plâtre après qu’il est cuit : pour cet effet il en étend à terre une certaine quantité, qu’il frappe avec sa batte jusqu’à ce qu’il soit assez menu pour être gaché.
Le batteur de soude, est celui qui chez les Epiciers pile la soude dans un mortier de fer avec un pilon de même matiere.
Le batteur d’étain, est celui qui chez les Miroitiers étend sur un marbre l’étain qui doit être appliqué en feuilles très-minces derriere les glaces.
Le batteur d’or, est celui qui réduit sur le marbre l’or dans ces feuilles très-minces qu’on vend par livrets, & qui servent à dorer la plûpart des ouvrages qui se font en argent, en cuivre, en bois, &c. On trouvera à l’article une description étendue du métier du batteur d’or.
Les Batteurs-d’or à Paris sont un corps de maîtres-marchands, ayant des statuts, priviléges & reglemens, suivant lesquels ils se conduisent dans leur communauté : ils ne sont pas plus de trente environ, dont les uns ne battent que de l’or uniquement, & les autres l’argent ; ayant néanmoins le choix de l’un ou de l’autre commerce, & pouvant même les faire tous deux à la fois.
* Batteur en grange ; c’est à la campagne l’ouvrier ou l’homme de journée qui frappe le blé avec un fléau, pour faire sortir le grain de l’épi. V. Blé.
BATTITURES, s. f. (Mat. med.) écailles des métaux qui s’en séparent en les battant : elles ont les mêmes usages en Medecine que les métaux dont on les tire. (N)
BATTOIR, s. m. (Arts méchaniq.) instrument de bois plat, large & quarré, qui est plus ou moins épais, selon les différens usages auxquels il doit être appliqué, & qu’on tient à la main par le moyen d’un manche rond & tout d’une piece, avec l’autre partie que j’appelle la pelle. Les Blanchisseuses & autres ouvriers ont leurs battoirs. Voyez Batte.
Battoir, terme de Paume, est un instrument rond ou quarré par un bout, garni d’un long manche, le tout couvert d’un parchemin fort dur : on s’en sert à la longue paume pour chasser les balles.
Battorie, s. f. (Comm.) nom que les villes Anséatiques donnent aux comptoirs ou magasins qu’elles ont hors de chez elles. Les principales de ces batteries sont celles d’Archangel, de Novogrod, de Berghen, de Lisbonne, de Venise & d’Anvers. Elles en avoient aussi une à Londres : mais il y a déjà du tems qu’elles s’en sont retirées à cause des impositions excessives qu’on mettoit sur leurs marchandises. (G)
* BATTRE, frapper, (Gramm.) Battre marque plusieurs coups ; c’est avoir frappé que d’en avoir donné un. On n’est point battu qu’on ne soit frappé ; on est quelquefois frappé sans être battu. Battre suppose toûjours de l’intention ; on peut frapper sans le vouloir. Le plus violent frappe le premier ; le plus foible doit être battu. Frapper est toûjours un verbe actif ; battre devient neutre dans se battre : car se battre ne signifie point se frapper soi-même de coups redoublés, mais seulement combattre quelqu’un. La loi du prince défend de se battre en duel ; celle de Jesus-Christ défend même de frapper.
Battre, en termes de l’Art militaire, signifie attaquer une place, un ouvrage, &c. avec beaucoup d’artillerie. Voyez Batterie.
Battre en breche ; c’est ruiner avec le canon le revêtement ou le rempart de quelque ouvrage que ce soit, pour y faire une ouverture par laquelle on puisse y entrer.
Battre par camarade, est quand plusieurs pieces de canon tirent tout à la fois sur un même ouvrage, soit d’une même batterie, soit de plusieurs.
Battre en salve ; c’est tirer toutes à la fois les différentes pieces d’une batterie, avec lesquelles on bat un ouvrage en breche.
Battre en écharpe ; c’est battre un ouvrage sous un angle au plus de 20 degrés.
Battre de bricole ; c’est battre un ouvrage par réflexion, c’est-à-dire faire frapper le boulet à une partie du revêtement, ensorte qu’il puisse se refléchir, & se porter à celle qu’on veut détruire ou incommoder.
Battre en sappe ; c’est battre un ouvrage par le pié de son revêtement. (Q)
Battre la chamade. Voyez Chamade.
Battre la mesure, en Musique ; c’est en marquer les tems par des mouvemens de la main ou du pié, qui en reglent la durée, & qui rendent toutes les mesures semblables parfaitement égales en tems.
Il y a des mesures qui ne se battent qu’à un tems, d’autres à deux, à trois, & à quatre, qui est le plus grand nombre de tems que puisse renfermer une mesure : encore cette derniere espece peut-elle toûjours se résoudre en deux mesures à deux tems. Dans toutes ces différentes mesures, le tems frappé est toûjours sur la note qui suit la barre immédiatement ; celui qui la précede est toûjours levé, à moins que la mesure ne soit à un seul tems.
Le degré de lenteur ou de vîtesse qu’on donne à la mesure, dépend 1.o de la valeur des notes qui la composent ; on voit bien qu’une mesure qui contient une ronde, doit se battre plus posément & durer davantage que celle qui ne contient que deux croches : 2.o du caractere du mouvement énoncé par le mot François ou Italien, qu’on trouve ordinairement à la tête de l’air. Gravement, gai, vite, lent, &c. sont autant d’avertissemens sur les manieres de modifier le mouvement d’une espece de mesure.
Les musiciens François battent la mesure un peu différemment des Italiens : ceux-ci dans la mesure à quatre tems, frappent successivement les deux premiers tems, & levent les deux autres ; ils frappent aussi les deux premiers dans la mesure à trois tems, & levent le troisieme. Les François ne frappent jamais que le premier tems, & marquent les autres par différens mouvemens de la main à droite & à gauche : cependant la Musique Françoise auroit beaucoup plus besoin que l’Italienne d’une mesure bien marquée ; car elle ne porte point sa cadence par elle-même ; le mouvement n’en a aucune précision naturelle ; on le presse, on le ralentit au gré du chanteur. Tout le monde est choqué à l’opéra de Paris du bruit desagréable & continuel que fait avec son bâton celui qui bat la mesure. Sans ce bruit personne ne la sentiroit : la Musique par elle-même ne la marque point ; aussi les étrangers n’apperçoivent-ils presque jamais la mesure dans les mouvemens de nos airs. Si l’on y réfléchit bien, on trouvera que c’est ici la différence spécifique de la Musique Françoise & de l’Italienne. En Italie, la mesure est l’ame de la Musique ; c’est elle qui gouverne le musicien dans l’exécution : en France, c’est le musicien qui gouverne la mesure, & le bon goût consiste à ne la pas même laisser sentir.
Les anciens, dit M. Burette, battoient la mesure en plusieurs façons : la plus ordinaire consistoit dans le mouvement du pié, qui s’élevoit de terre & la frappoit alternativement, selon la mesure des deux tems egaux ou inégaux (Voyez Rythme) : c’étoit ordinairement la fonction du maître de Musique appellé Coryphée, Κορυφαῖος ; parce qu’il étoit placé au milieu du chœur des musiciens, & dans une situation élevée, pour être vû & entendu plus facilement de toute la troupe. Ces batteurs de mesure se nommoient en Grec ποδοκτύπος & ποδοψόφος, à cause du bruit de leurs piés ; συντονάριος, à cause de l’uniformité, & si l’on peut parler ainsi, de la monotonie du rythme qu’ils battoient toûjours à deux tems. Ils s’appelloient en Latin pedarii, podarii, pedicularii. Ils garnissoient ordinairement leurs piés de certaines chaussures ou sandales de bois ou de fer, destinées à rendre la percussion rythmique plus éclatante, & nommées en Grec κρουπέζια, κρούπαλα, κρούπετα ; & en Latin pedicula, scabella ou scabilla, à cause qu’ils ressembloient à de petits marche-piés, ou de petites escabelles.
Ils battoient la mesure non-seulement du pié, mais aussi de la main droite, dont ils réunissoient tous les doigts pour frapper dans le creux de la main gauche ; & celui qui marquoit ainsi le rythme s’appelloit manuductor. Outre ce claquement de main & le bruit de sandales, les anciens avoient encore pour battre la mesure, celui des coquilles, des écailles d’huîtres, & des ossemens d’animaux, qu’on frappoit l’un contre l’autre, comme on fait aujourd’hui les castagnettes, le triangle, & autres pareils instrumens. (S)
Battre, a plusieurs sens dans le Manege, où l’on dit qu’un cheval bat à la main ou bégaye, pour marquer un cheval qui n’a pas la tête ferme, qui leve le nez, qui branle & secoue la tête à tout moment en secoüant sa bride. Les chevaux turcs & les cravates sont sujets à battre à la main. Un cheval bat à la main, parce qu’ayant les barres trop tranchantes, il ne peut souffrir la sujétion du mors, quelque doux qu’il soit. Pour lui ôter l’envie de battre à la main, & lui affermir la tête, il n’y a qu’à mettre sous sa muserole une petite bande de fer plate & tournée en arc, qui réponde à une martingale. Cet expédient au reste ne fait que suspendre l’habitude ; car la martingale n’est pas plûtôt ôtée, que le cheval retombe dans son vice. Voyez Martingale. On dit aussi, qu’un cheval bat la poudre ou la poussiere, lorsqu’il trépigne, qu’il fait un pas trop court, & avance peu : ce qui se dit de tous ses tems & mouvemens. Un cheval bat la poudre au terre-à-terre, lorsqu’il n’embrasse pas assez de terrein avec les épaules, & qu’il fait tous ses tems trop courts, comme s’il les faisoit dans une place. Il bat la poudre aux courbettes, lorsqu’il les hâte trop & les fait trop basses. Il bat la poudre au pas, lorsqu’il va un pas trop court, & qu’il avance peu, soit qu’il aille au pas par le droit, ou sur un rond, ou qu’il passege. On dit enfin qu’un cheval bat du flanc, quand il commence à être poussif. Le battement des flancs du cheval est une marque de plusieurs maladies. Battre des flancs, c’est les agiter avec violence. (V)
Battre l’eau, terme de Chasse ; quand une bête est dans l’eau, alors on dit aux chiens, il bat l’eau.
Se faire battre ; c’est se faire chasser long-tems dans un même canton : on dit, ce chevreuil s’est fait battre long-tems.
* Battre, dans les Arts méchaniques, a différentes acceptions : tantôt il se prend pour forger, comme chez presque tous les ouvriers en métaux ; tantôt pour écraser, comme chez presque tous les ouvriers qui employent la pierre, les minéraux, les fossiles. On bat le beurre ; voyez Beurre. On bat le tan ; voy. Tan. On bat en grange ; voyez Battage. On bat des pieux pour les enfoncer ; voyez Mouton. On bat le papier, l’or, l’argent, les livres, &c. voyez ci-dessous quelques autres significations du même terme, ou quelques-unes des précédentes plus détaillées.
* Battre l’or, l’argent, le cuivre (Ordre encyc. Entend. Mém. Hist. Hist. de la Nat. employée, Arts Méchan. Art de battre l’or.) ; c’est l’action de réduire ces métaux en feuilles extrèmement minces, mais plus ou moins cependant, selon le prix qu’on se propose de les vendre : cette action s’appelle batte, & l’ouvrier batteur.
Les opérations principales sont la fonte, la forge, le tirage au moulin, & la batte. On peut appliquer ce que nous allons dire de l’or aux autres métaux ductiles.
L’or qu’on employe est au plus haut titre, & il est difficile d’en employer d’autre : l’alliage aigrit l’or, le rend moins ductile ; & l’ouvrier qui l’allieroit s’exposeroit à perdre plus par l’inutilité de son travail, qu’il ne gagneroit par le bas alloi de la matiere. Les Batteurs d’or le prennent en chaux chez l’affineur de la monnoie, à vingt-quatre carats moins un quart, ou à cent trois livres l’once. Il y en a qui préferent à cet or les piastres, & autres anciennes pieces d’Espagne : ils prétendent que même en alliant l’or de ces monnoies, il se bat mieux & plus facilement que celui qu’ils sont obligés d’acheter à cent trois livres l’once. Il y a trois sortes d’or en feuille ou battu, l’or pâle, l’or fin ou verd, & l’or commun. On employe l’or dans toute sa pureté, & comme il vient de l’affinage dans l’or fin battu : il y a quatre gros de blanc ou d’argent sur l’once d’or, dans l’or pâle ou verd ; & jusqu’à douze grains de rouge, ou de cuivre de rosette, & six grains de blanc ou d’argent dans l’or commun.
On fond l’or dans le creuset avec le borax, comme on voit Pl. du Batteur d’or fig. 1. & quand il a acquis le degré de fusion convenable, on le jette dans la lingotiere a, qu’on a eu grand soin de faire chauffer auparavant pour en ôter l’humidité, & de frotter de suif.
Ces précautions sont nécessaires ; elles garantissent de deux inconvéniens également nuisibles ; l’un en ce que les parties de la matiere fondue qui toucheroient l’endroit humide pourroient rejaillir sur l’ouvrier ; l’autre en ce que les particules d’air qui s’insinueroient dans l’effervescence causée par l’humidité entre les particules de la matiere, y produiroient de petites loges vuides ou soufflures, ce qui rendroit l’ouvrage défectueux. Après la fonte on le fait recuire au feu pour l’adoucir, & en ôter la graisse de la lingotiere.
Quand la matiere ou le lingot est refroidi, on le tire de la lingotiere pour le forger. On le forge sur une enclume b qui a environ trois pouces de large, sur quatre de long, avec un marteau c qu’on appelle marteau à forger : il est à tête & à panne ; il pese environ trois livres ; sa panne peut avoir un pouce & demi en quarré, & son manche six pouces de long. Si l’ouvrier juge que ce marteau ait rendu sa matiere écroüie, il la fait encore recuire : d est le bloc de l’enclume.
Ou l’on destine la matiere forgée & étirée au marteau à passer au moulin, ou non : si l’on se sert du moulin, il suffira de l’avoir réduite sur l’enclume à l’épaisseur d’environ une ligne & demie, ou deux lignes, au plus. Le moulin est composé d’un banc très-solide, vers le milieu duquel se fixe avec de fortes vis le chassis du moulin : ce chassis est fait de deux jumelles de fer d’un demi-pouce d’épaisseur, sur deux pouces & demi de largeur, & quatorze pouces de hauteur. Ces jumelles sont surmontées d’un couronnement, qui avec la traverse inférieure servent à consolider le tout. Le couronnement & les jumelles sont unis par de longues & fortes vis. Dans les deux jumelles sont enarbrés deux cylindres d’acier, polis, de deux pouces de diametre, sur deux pouces & demi de longueur ; le supérieur traverse des pieces à coulisses, qui à l’aide d’une vis placée de chaque côté, l’approchent ou l’écartent plus ou moins de l’inférieure, selon que le cas le requiert : l’axe du cylindre inférieur est prolongé de part & d’autre du chassis ; à ses deux extrémités équarries s’adaptent deux manivelles d’un pié & demi de rayon, qui mettent les cylindres en mouvement. Les cylindres mobiles sur leur axe étendent en tournant la matiere serrée entre leurs surfaces, & la contraignent de glisser par le mouvement qu’ils ont en sens contraires.
L’artiste se propose deux choses dans le tirage ; la premiere d’adoucir les coups de marteau qui avoient rendu la surface du métal inégale & raboteuse ; la seconde d’étendre en peu de tems le métal très-également. Les ouvriers suppléoient autrefois au moulin par le marteau ; & quelques-uns suivent encore aujourd’hui l’ancienne méthode.
Ceux qui se servent du moulin obtiennent par le moyen de cette machine un long ruban, qu’ils roulent sur une petite latte ; ils le pressent fortement sur la latte, afin qu’il prenne un pli aux deux côtés de la latte, qu’ils retirent ensuite ; & afin que le ruban ne se détortille pas, qu’il conserve son pli aux endroits où il l’a pris, & que les surfaces de ses tours restent bien exactement appliquées les unes sur les autres, ils font deux ligatures qui les contiennent dans cet état, l’une à un bout, & l’autre à l’autre : ces ligatures sont de petites lanieres de peau d’anguille. Cela fait, avec le même marteau qui a servi à forger ils élargissent la portion du ruban comprise entre les deux ligatures, en chassant la matiere avec la panne vers les bords, d’abord d’un des côtés du ruban, puis de l’autre ; ensuite ils frappent sur le milieu pour égaliser l’épaisseur, & augmenter encore la largeur.
Lorsque la portion comprise entre les ligatures est forgée, ils ôtent les ligatures, ils inserent leurs doigts au milieu des plis, & amenent vers le milieu les portions qui étoient d’un & d’autre côté au-delà des ligatures ; de maniere que quand les ligatures sont remises, ce qui est précisément au-delà des ligatures, est la partie forgée qui étoit auparavant comprise entr’elles ; & que ce qui a été amené entr’elles, est la partie qui n’a pû être forgée, qui formoit le pli, & qui étoit au-delà des ligatures. Il est évident que cette portion doit former une espece de croissant : on forge cette portion comme la précédente, en commençant par les bords, & s’avançant vers le milieu d’un & d’autre côté, puis forgeant le milieu, jusqu’à ce que le ruban se trouve également épais & large dans toute sa longueur : cette épaisseur est alors à peu près d’une demi-ligne, ou même davantage.
Si l’on ne se sert point du moulin, on forge jusqu’à ce que la matiere ait à peu près l’épaisseur d’une forte demi-ligne, puis on la coupe tout de suite en parties qui ont un pouce & demi de long, sur un pouce de large ; ce qu’on ne fait qu’après le tirage au moulin, quand on s’en sert. Ces portions d’un pouce & demi de long sur un pouce de large, & une demi-ligne & davantage d’épais, s’appellent quartiers : on coupe ordinairement cinquante-six quartiers ; l’ouvrier prend entre ses doigts un nombre de ces quartiers, capable de former l’épaisseur d’un pouce ou environ, il les applique exactement les uns sur les autres, & il leur donne la forme quarrée sur l’enclume & avec la panne du marteau, commençant à étendre la matiere vers les bords, s’avançant ensuite vers le milieu, en faisant autant à l’autre côté, forgeant ensuite le milieu, & réduisant par cette maniere de forger réitérée tous les quartiers du même paquet, & tous à la fois, à l’épaisseur d’une feuille de papier gris, & à la dimension d’un quarré dont le côté auroit deux pouces.
Lorsque l’or est dans cet état, on prend des feuillets de vélin, on en place deux entre chaque quartier ; ainsi pour cela seul les cinquante-six quartiers exigent cent douze feuillets de velin : mais il en faut encore d’autres qu’on met à vuide en-dessus & en-dessous ; & sur ces feuillets vuides, tant en-dessus qu’en-dessous, on met encore deux feuillets de parchemin. Cet assemblage s’appelle le premier caucher ; & les feuillets vuides, avec les feuillets de parchemin ou sans eux, s’appellent emplures. Ainsi voici donc la disposition & l’ordre du premier caucher ; deux feuillets de parchemin, une vingtaine plus ou moins de feuillets de vélin vuides ; un quartier, deux feuillets de vélin ; un quartier, deux feuillets de velin ; & ainsi de suite jusqu’à la concurrence de cinquante-six quartiers, une vingtaine de feuillets de vélin vuides, & deux feuillets de parchemin. L’usage des emplures est d’amortir l’action des coups de marteau sur les premiers quartiers, & de garantir les outils. Les Batteurs d’or entendent par les outils l’assemblage des feuillets de velin. Le caucher se couvre de deux fourreaux ; le fourreau est une enveloppe de plusieurs feuillets de parchemin appliqués les uns sur les autres, & collés par les deux bouts, de maniere qu’ils forment une espece de sac ouvert. On a deux fourreaux ; quand on a mis le caucher dans un, on fait entrer le caucher & ce premier fourreau dans le second, mais en sens contraire : d’où il arrive que quoique les fourreaux soient tous les deux ouverts, cependant ils couvrent par-tout le caucher. Voy. fig. 6. un caucher, & fig. 7. & 8. les fourreaux. Mettre les fourreaux au caucher, cela s’appelle enfourrer. Les feuillets de vélin & de parchemin sont des quarrés dont le côté a quatre pouces.
Le caucher ainsi arrangé, on le bat sur un marbre, comme on voit fig. 2. ce marbre est noir ; il a un pié en quarré, & un pié & demi de haut. On ajuste à sa partie supérieure une espece de boîte F, ouverte du côté de l’ouvrier : cette boîte s’appelle la caisse ; elle est faite de sapin, & revêtue en-dedans de parchemin collé : le parchemin collé qui s’étend jusque sur le marbre, n’en laisse appercevoir au milieu de la caisse que la portion e. La caisse est embrassée du côté de l’ouvrier par une peau h que l’ouvrier releve sur lui, & dont il se fait un tablier. Quand il travaille, cette peau ou tablier reçoit les lavures. On entend par les lavures, les parties de matiere qui se détachent d’elles mêmes, ou qu’on détache des cauchers.
Comme l’action continuelle d’un marteau de douze à quinze livres sur une masse de pierre d’un poids énorme, ne manqueroit pas d’ébranler à la longue les voûtes d’une cave, s’il s’en trouvoit une immédiatement dessous ; dans ce cas, il est prudent de l’étayer, soit par une forte piece de bois, soit par un massif de pierre, placé sous l’endroit qui correspond au marbre du batteur d’or.
Il faut que la surface du marbre & du marteau soit fort unie, sans quoi les cauchers ou outils, & les feuilles d’or seroient maculées. On bat le premier caucher pendant une demi-heure, en chassant du centre à la circonférence, le retournant de tems en tems, & appliquant au marbre la surface sur laquelle >on frappoit, & frappant sur l’autre. Le marteau dont on se sert dans cette opération s’appelle marteau plat, ou à dégrossir : il pese quatorze à quinze livres ; sa tête est ronde, & tant soit peu convexe : il a six pouces de haut, & va depuis sa tête jusqu’à son autre extrémité un peu en diminuant, ce qui le fait paroître cone tronqué : sa tête a cinq pouces de diametre ou environ. L’ouvrier a l’attention de défourrer de tems en tems son cancher, & d’examiner en quel état sont les quartiers. Il ne faut pas espérer qu’ils s’étendent tous également ; il en trouvera qui n’occuperont qu’une partie de l’étendue du feuillet de vélin ; d’autres qui l’occuperont toute entiere ; d’autres qui déborderont : il pourra, s’il le veut, ôter les avant-derniers, & il fera bien d’ôter les derniers : il est évident qu’après cette soustraction le caucher sera moins épais. Mais on empêchera les fourreaux d’être lâches, en insérant de petits morceaux de bois dans les côtés, entr’eux & le caucher.
On continuera de battre jusqu’à ce qu’on ait amené les quartiers restant à l’étendue ou environ des feuillets de vélin qui les séparent cela fait, la premiere opération de la batte sera finie. Si on laissoit desafleurer les quartiers au-delà des outils, ceux-ci pourroient en être gâtés.
Au sortir du premier caucher les quartiers sont partagés en quatre parties égales avec le ciseau. On a donc deux cents vingt-quatre nouveaux quartiers, dont on forme un second caucher de la maniere suivante : on met deux feuillets de parchemin, une douzaine de feuillets de vélin vuides ou d’emplures ; un quartier, un feuillet de vélin ; un quartier, un feuillet de vélin ; & ainsi de suite jusqu’à cent douze inclusivement : une douzaine d’emplures, deux feuillets de parchemin ; deux autres feuillets de parchemins, une douzaine d’emplures ; un quartier, un feuillet de vélin ; un quartier, un feuillet de vélin ; & ainsi de suite jusqu’à cent douze inclusivement, douze emplures & deux feuillets de velin.
D’où l’on voit que le second caucher est double du premier, & qu’il est séparé par le milieu en deux parts distinguées par quatre feuillets de parchemin, dont deux finissent la premiere part, & lui appartiennent, & deux appartiennent à la seconde part, & la commencent : en un mot il y a dans le milieu du second caucher quatre feuillets de parchemin entre vingt-quatre emplures de vélin, douze d’un côté & douze de l’autre. Au reste il n’y a pas d’autre différence entre le premier caucher & le second : il a ses deux fourreaux aussi, il ne s’enfourre pas différemment, & les feuillets de vélin sont de la même forme & de la même grandeur.
Ce second caucher enfourré comme le premier, on le bat de la même maniere, avec le même marteau, & pendant le même tems que le premier : observant non-seulement d’opposer tantôt une des faces, tantôt l’autre au marteau & au marbre : au marbre celle qui vient d’être opposée au marteau ; au marteau celle qui vient d’être opposée au marbre : mais encore de défourrer de tems en tems, de séparer les deux parts du caucher, afin de mettre en dedans la face de l’une & de l’autre part qui étoit en-dehors, & en-dehors celle qui étoit en-dedans ; & d’examiner attentivement quand les quartiers desafleurent les outils : lorsque les quartiers desafleurent les outils ; alors la seconde opération sera finie.
On desemplit le second caucher ; pour cet effet, on a à côté de soi le caucher même : on écarte les deux parchemins & les emplures ; on prend la premiere feuille d’or que l’on rencontre, & on l’étend sur un coussin ; on enleve le second feuillet de vélin, & l’on prend la seconde feuille d’or qu’on pose sur la premiere ; mais de maniere que la seconde soit plus reculée vers la gauche que la premiere : on ôte un autre feuillet de vélin, & l’on prend une troisieme feuille d’or que l’on étend sur la seconde, de maniere que cette troisieme soit plus avancée vers la droite que la seconde : en un mot, on range les feuilles en échelle ; on fait ensorte qu’elles ne se débordent point en-haut, mais qu’elles se débordent toutes à droite & à gauche d’un demi-pouce ou environ ; puis avec un coûteau d’acier, émoussé par le bout, & à l’aide d’une pince de bois léger qu’on voit fig. 10. on les prend toutes quatre à quatre, & on les coupe en quatre parties égales ; ce qui donne huit cents quatre-vingts-seize feuilles.
Quand cette division est faite, voici comment on arrange ces huit cents quatre-vingt-seize feuilles : on laisse-là les feuillets de vélin ; on en prend d’une autre matiere qu’on appelle baudruche, & dont nous parlerons plus bas ; on met deux feuillets de parchemin, quinze emplures de baudruche, une feuille d’or, un feuillet de baudruche ; une feuille d’or, un feuillet de baudruche, & ainsi de suite jusqu’à quatre cents quarante-huit inclusivement ; puis quinze emplures, puis deux feuillets de parchemin ; puis encore deux feuillets de parchemin, puis quinze emplures, puis une feuille d’or, puis un feuillet de baudruche, puis une feuille d’or, puis un feuillet de baudruche, & ainsi de suite, jusqu’à quatre cents quarante-huit inclusivement, puis quinze emplures de baudruche, & enfin deux feuillets de parchemin : cet assemblage s’appelle chaudret.
D’où l’on voit que le chaudret, ainsi que le second caucher, est divisé en deux parts au milieu, dans l’endroit où il se rencontre quatre feuillets de parchemin, dont deux appartiennent à la premiere part du chaudret, & la finissent, & deux à la seconde part, & la commencent.
Le feuillet du chaudret a environ cinq pouces en quarré ; il est de baudruche, matiere bien plus déliée & bien plus fine que le vélin ; c’est une pellicule que les Bouchers ou les Boyaudiers enlevent de dessus le boyau du bœuf : deux de ces pellicules minces collées l’une sur l’autre, forment ce qu’on appelle le feuillet de baudruche ; & ces feuillets de baudruche & de parchemin disposés comme nous venons de le prescrire, forment le chaudret ; le chaudret s’enfourre comme les cauchers.
On bat environ deux heures le chaudret : le marteau est le même que celui des cauchers ; on observe en le battant tout ce qu’on a observé en battant le second caucher ; je veux dire de défourrer de tems en tems, d’examiner si les feuilles d’or desafleurent ou non ; de mettre en-dedans les faces des deux parts qui sont en-dehors, & celles qui sont en-dehors, de les mettre en-dedans ; de battre selon l’art, en chassant du centre à la circonférence, &c. Lorsqu’on s’apperçoit que toutes les feuilles desafleurent, la troisieme opération est finie.
Alors on prend le chaudret défourré avec une tenaille abc, qu’on voit fig. 9. on serre le chaudret par un de ses angles, entre les extrémités a de la tenaille, on empêche la tenaille de se desserrer, en contraignant une de ses branches c, d’entrer dans un des trous de la plaque x, attachée à l’autre branche b ; on a à côté de soi un coussin d’un pié de large, sur deux piés & demi à trois piés de long, couvert de peau de veau, comme on le voit en 1, 2, fig. 3 ; on leve les feuillets de baudruche de la main gauche ; & de la droite, on enleve avec une pince de bois qu’on voit fig. 10, les feuilles d’or ; on les rogne avec un coûteau d’acier, & on les range par échelle sur le coussin ; on les divise en quatre parties égales ; ce qui donne quatre fois huit cents quatre-vingt-seize feuilles d’or ; on divise ce nombre de quatre fois huit cents quatre-vingt-seize feuilles en quatre portions d’environ huit cents feuilles chacune, & l’on arrange ces huit cents feuilles d’or de la maniere suivante, afin de continuer le travail.
On prend deux feuillets de parchemin, vingt-cinq emplures de baudruche, une feuille d’or, un feuillet de baudruche ; une feuille d’or, un feuillet de baudruche, & ainsi de suite, jusqu’à huit cents inclusivement, puis vingt-cinq emplures, & enfin deux feuilles de parchemin. Cet assemblage forme ce qu’on appelle une moule ; les divisions du chaudret en quatre donnent de quoi former quatre moules qui se travaillent l’une après l’autre, & séparément.
La feuille de la moule a six pouces en quarré, comme disent les ouvriers très-improprement, c’est-à-dire a la forme d’un quarré, dont le côté a six pouces ; on l’enfourre, & on la bat plus ou moins de tems ; cela dépend de plusieurs causes ; de la disposition des outils, de la température de l’air, & de la diligence de l’ouvrier : il y a des ouvriers qui battent jusqu’à deux moules par jour. Chaque moule ne contient que huit cents feuilles d’or ; quoiqu’il dût y en avoir quatre fois huit cents quatre-vingt-seize pour les quatre ; ce qui fait plus de huit cents pour chacune : mais partie de cet excédent s’est brisé dans la batte, quand il est arrivé que la matiere étoit aigre, ou qu’elle n’étoit pas assez épaisse pour fournir à l’extension ; partie a été employée à étouper les autres. On appelle étouper une feuille, appliquer une piece à l’endroit foible où elle manque d’étoffe.
C’est ici le lieu d’observer qu’il importoit assez peu que les cinquante-six premiers quartiers qui ont fourni un si grand nombre de feuilles, fussent un peu plus forts ou un peu plus foibles les uns que les autres ; la batte les réduit nécessairement à la même épaisseur : la seule différence qu’il y ait, c’est que dans le cours des opérations, les forts desafleurent beaucoup plus que les foibles.
On commence à battre la moule avec le marteau rond qui pese six à sept livres, qui porte quatre pouces de diametre à la tête, & qui est un peu plus convexe qu’aucun de ceux dont on s’est servi pour les cauchers & le chaudret ; il s’appelle marteau à commencer ; on s’en sert pendant quatre heures ; on lui fait succéder un second marteau qui pese quatre à cinq livres, qui porte deux pouces de diametre à la tête, & qui est encore plus convexe que les précédens ; on l’appelle marteau à chasser, & l’on s’en sert pendant une demi-heure ; on reprend ensuite le marteau à commencer ; on revient au marteau à chasser, dont on se sert pendant encore une demi-heure, & l’on passe enfin au marteau à achever. Le marteau à achever porte quatre pouces de diametre à la tête, est plus convexe qu’aucun des précédens, & pese douze à treize livres. On a eu raison de l’appeller marteau à achever ; car c’est en effet par lui que finit la batte.
On observe aussi pendant la batte de la moule, de la frapper tantôt sur une face, tantôt sur une autre ; de défourrer de tems en tems, & d’examiner si les feuilles desafleurent : quand elles desafleurent toutes, la batte est finie. Il ne s’agit plus que de tirer l’or battu d’entre les feuillets de la moule, & c’est ce que fait la fig. 3. & de les placer dans les quarterons.
Pour cet effet, on se sert de la tenaille de la fig. 9. on serre avec elle la moule par l’angle, & l’on en sort les feuilles battues les unes après les autres, à l’aide de la pince de bois de la fig. 10. on les pose sur le coussin ; on souffle dessus pour les étendre ; on prend le coûteau de la fig. 11. fait d’un morceau de roseau 5 ; on coupe un morceau de la feuille en ligne droite ; ce côté de la feuille qui est coupé en ligne droite, se met exactement au fond du livret & du quarteron, que la feuille déborde de tous les autres côtés ; on continue de remplir ainsi le quarteron ; quand il est plein, on en prend un autre, & ainsi de suite. Lorsque la moule est vuide, on prend un coûteau, & l’on enleve tout l’excédent des feuilles d’or qui paroît hors des quarterons ou livrets ; & l’on emporte ce que le coûteau a laissé, avec un morceau de linge qu’on appelle frottoir.
Les quarterons dont on voit un, fig. 5. sont des livrets de vingt-cinq feuillets quarrés ; il y en a de deux sortes : les uns, dont le côté est de quatre pouces ; d’autres, dont le côté n’est que de trois pouces & demi. Un livret d’or dont le côté est de quatre pouces, se vend quarante sous ; un livret pareil d’argent, se vend six sous.
Quatre onces d’or donnent les cinquante-six quartiers avec lesquels on a commencé le travail. Il y a eu dans le cours du travail, tant en lavures qu’en rognures ou autrement, dix-sept gros de déchet. Ainsi quatre onces moins dix-sept gros, pourroient fournir trois mille deux cents feuilles quarrées, de chacune trente-six pouces de surface : mais elles ne les donnent que de 16 pouces en quarré ; car les feuilles qui sortent de la moule de 36 pouces en quarré, s’enferment dans un quarteron de 16 pouces en quarré. Ainsi l’on ne couvriroit qu’une surface de 41200 pouces quarrés, avec quatre onces d’or, moins dix-sept gros, ou deux onces un gros : mais on en pourroit couvrir une de 115200 pouces quarrés.
Pour avoir de bons cauchers, il faut choisir le meilleur vélin, le plus fin, le plus serré & le plus uni. Il n’y a pas d’autre préparation à lui donner, que de le bien laver dans de l’eau froide, que de le laisser sécher à l’air, & que de le passer au brun ; on verra plus bas ce que c’est que le brun.
Quant à la baudruche, ou à cette pellicule qui se leve de dessus le boyau de bœuf, c’est autre chose : elle vient d’abord pleine d’inégalités & couverte de graisse ; on enleve les inégalités en passant légerement sur sa surface le tranchant mousse d’un couteau. Pour cet effet, on la colle sur les montans verticaux d’une espece de chevalet ; le même instrument emporte aussi la graisse. Quand elle est bien égale & bien degraissée, on l’humecte avec un peu d’eau ; & l’on applique l’une sur l’autre deux peaux de baudruche humides. L’humidité suffit pour les unir indivisiblement. Le batteur d’or paye soixante-quinze livres les huit cents feuilles ; cela est cher, mais elles durent : quatre mois, six mois, huit mois de travail continu les fatiguent, mais ne les usent point.
Avant que de les employer, le Batteur d’or leur donne deux préparations principales : l’une s’appelle le fond, & l’autre consiste à les faire suer. Il commence par celle-ci ; elle consiste à en exprimer ce qui peut y rester de graisse. Pour cet effet, il met chaque feuille de baudruche entre deux feuillets de papier blanc ; il en fait un assemblage considérable qu’il bat à grands coups de marteau. L’effort du marteau en fait sortir la graisse, dont le papier se charge à l’instant. Donner le fond aux feuillets de baudruche, c’est les humecter avec une éponge, d’une infusion de canelle, de muscade, & autres ingrédiens chauds & aromatiques ; l’effet de ce fond est de les consolider, & d’en resserrer les parties. Quand on leur a donné le fond une premiere fois, on les laisse sécher à l’air, & on le leur donne une seconde fois ; quand elles sont seches, on les met à la presse & on les employe.
Les Batteurs donnent en général le nom d’outils aux assemblages, soit de vélin, soit de baudruche ; & quand ces assemblages ont beaucoup travaillé, ils disent qu’ils sont las ; alors ils cessent de s’en servir. Ils ont de grandes feuilles de papier blanc qu’ils humectent, les uns de vinaigre, les autres de vin blanc. Ils prennent les feuillets de baudruche las ; ils les mettent feuillets à feuillets entre les feuilles de papier blanc préparées ; ils les y laissent pendant trois ou quatre heures : quand ils s’apperçoivent qu’ils ont assez pris de l’humidité des papiers blancs, ils les en retirent, & les distribuent dans un outil de parchemin, dont chaque feuillet est un quarré, dont le côté a douze pouces. Ils appellent cet outil plane ; Pour faire sécher les feuillets de baudruche enfermés entre ceux de la plane, ils battent avec le marteau la plane pendant un jour. Puis ils les brunissent, ou donnent le brun ; c’est-à-dire, qu’ils prennent du gypse ou de ce fossile qu’on appelle miroir d’âne, qu’on tire des carrieres de plâtre ; qu’ils le font calciner, qu’ils le broyent bien menu, & qu’avec une patte de lievre, ils en répandent sur les feuillets de baudruche, d’un & d’autre côté.
Le brun se donne aussi aux outils de vélin.
Il faut que les outils de baudruche soient pressés & séchés toutes les fois qu’on s’en sert ; sans quoi l’humidité de l’air qu’ils pompent avec une extrème facilité, rendroit le travail pénible. Il ne faut pourtant pas les faire trop sécher ; la baudruche trop seche est perdue.
On a pour presser & sécher en même tems la baudruche, un instrument tel qu’on le voit fig. 4. La partie MNOP peut contenir du feu. C’est une espece de vaisseau de fer ; le fond q est une plaque de fer. Ce vaisseau & sa plaque peuvent se baisser & se hausser en vertu de la vis tu ; la bride abc est fixe sur la plaque inférieure qrs ; on insere entre ces plaques les outils enfermés entre deux voliches ; on serre la presse ; on met du feu dans le vaisseau supérieur, dont la plaque mnop fait le fond ; & l’on pose la plaque inférieure qrs, sur une poele pleine de charbons ardens : les outils se trouvent par ce moyen entre deux feux.
Quant aux outils de vélin, quand ils sont très-humides, on les répand sur un tambour ; c’est une boîte faite comme celle où l’on enfermeroit une chaufrette, avec cette différence qu’elle est beaucoup plus grande & plus haute ; & qu’au lieu d’une planche percée, sa partie supérieure est grillée avec du fil d’archal ; on étend les feuillets de vélin sur cette grille, & l’on met du feu dans le tambour.
Il paroît que les Romains ont possédé l’art d’étendre l’or : mais il n’est pas aussi certain qu’ils l’ayent poussé jusqu’au point où nous le possédons. Pline rapporte que dans Rome on ne commença à dorer les planchers des maisons, qu’après la ruine de Carthage, lorsque Lucius Mummius étoit censeur ; que les lambris du capitole furent les premiers qu’on dora ; mais que dans la suite le luxe prit de si grands accroissemens, que les particuliers firent dorer les plat-fonds & les murs de leurs appartemens.
Le même auteur nous apprend qu’ils ne tiroient d’une once d’or, que cinq à six cents feuilles de quatre doigts en quarré ; que les plus épaisses s’appelloient bracteæ Pranestinæ, parce qu’il y avoit à Preneste une statue de la Fortune, qui étoit dorée de ces feuilles épaisses ; & que les feuilles de moindre épaisseur se nommoient bracteæ quæstoriæ. Il ajoûte qu’on pouvoit tirer un plus grand nombre de feuilles que celui qu’il a désigné.
Il étoit difficile d’assujettir les batteurs d’or à la marque. La nature de leur ouvrage ne permet pas de prendre cette précaution contre l’envie qu’ils pourroient avoir de tromper, en chargeant l’or qu’ils employent, de beaucoup d’alliage : mais heureusement l’art même y a pourvû ; car l’or se travaillant avec d’autant plus de facilité, & ayant d’autant plus de ductilité, qu’il est plus pur, ils perdent du côté du tems & de la quantité d’ouvrage, ce qu’ils peuvent gagner sur la matiere, & peut-être même perdent-ils davantage. Leur communauté paye mille écus à la monnoie pour ce droit de marque.
Quoiqu’il ne s’agisse que de battre, cette opération n’est pas aussi facile qu’elle le paroît ; & il y a peu d’arts où le savoir-faire soit si sensible ; tel habile ouvrier fait plus d’ouvrage & plus de bon ouvrage en un jour, qu’un autre ouvrier n’en fait de mauvais en un jour & demi.
Cependant le meilleur ouvrier peut avoir contre lui la température de l’air ; dans les tems pluvieux, humides, pendant les hyvers nébuleux, les vélins & les baudruches s’humectent, deviennent molles, & rendent le travail très-pénible. C’est à la Physique à chercher un remede à cet inconvénient.
Il ne me reste plus qu’une observation à faire, c’est sur la découverte de la baudruche. Comment les hommes se sont-ils avisés d’aller chercher sur le boyau du bœuf cette pellicule déliée, sans laquelle ils auroient eu bien de la peine à étendre l’or ? Ce ne sont sûrement pas des considérations philosophiques qui les ont conduits là. La baudruche étoit-elle trouvée avant qu’on l’employât à cet usage ; ou bien est-ce le besoin qu’on en avoit qui l’a fait chercher ?
Battre, en terme de Cardeur de laine, c’est préparer la laine pour être huilée, en la secoüant sur une claie avec des baguettes, pour en ôter la poussiere.
Battre, en terme de Filassier, c’est écraser & adoucir la filasse à coups de maillet de bois.
Battre une allée, c’est après qu’elle est régalée, en affermir la terre avec la batte, pour la recouvrir ensuite de sable.
Battre la chaude, terme d’ancien monnoyage ; avant la decouverte du laminoir, on battoit les lingots d’or, d’argent, &c. sur l’enclume à grands coups de marteau, après avoir été retirés du moule ; ensuite on les donnoit aux ouvriers afin de recevoir les préparations nécessaires pour être empreints.
Battre, en terme de Potier ; c’est étendre à la main un creuset, par exemple, sur son moule. Voyez Moule.
Battre du Papier, terme de Papetier, signifie l’applatir, & le rendre uni en le battant sur la pierre avec un marteau pesant, dont le manche est court & la masse large. Voyez Papier.
Dans les manufactures de papier, on se sert pour battre le papier & le lisser, d’un marteau, ou plûtôt d’une grosse masse de bois B fort pesante, emmanchée d’un long manche C aussi de bois, auquel l’arbre de la roue du moulin à papier, donne le mouvement par le moyen de plusieurs leviers ou morceaux de bois, qui sortent de cet arbre, & qui appuient sur l’extrémité du manche du marteau ; l’ouvrier A est assis dans un creux, afin d’avoir les mains de niveau à la pierre D, sur laquelle il change le papier continuellement de place, pour le faire battre également partout : il a autour de lui différentes piles de papier GGG, desquelles les unes sont le papier qu’il a retiré de dessous le marteau ; & les autres celui qu’il doit y mettre.
Battre les livres pour les relier : le batteur doit tenir de la main droite un marteau pesant environ neuf à dix livres, & de la main gauche une partie du livre, que l’on nomme une battée, tel que Pl. I. du Relieur, figure A. Son ouvrage est d’applatir les feuilles du livre avec art, pour que le livre soit facile à s’ouvrir. Il y a des papiers fort difficiles à unir.
Battre les cartons ; on bat sur la pierre à battre les cartons quand ils sont attachés au volume, pour en applanir toutes les inégalités.
Battre les ficelles ; lorsque les ficelles sont passées dans les cartons, on en applatit les bouts avec le marteau à endosser sur la pierre à parer, pour éviter qu’elles fassent de l’élevation sous la couverture. On dit aussi rabbaisser les ficelles.
Battre les plats ; lorsque le livre est marbré sur le plat & que la couleur est seche, on bat le plat sur la pierre à battre avec le marteau à battre pour mieux effacer toutes les inégalités, s’il en est resté, & pour renforcir la couverture.
Battre devant, se dit chez les ouvriers qui s’occupent à battre un morceau de fer sur l’enclume, de ceux qui aident le forgeron avec de gros marteaux, & qui sont placés devant lui ou à ses côtés.
Battre du tan ; terme de Taneur, qui signifie concasser de l’écorce de chêne dans des mortiers, ou la faire reduire en poudre sous les pilons d’un moulin. Voyez Tan.
Battre une dame au jeu du revertier, c’est mettre une dame sur la même fleche où étoit placée celle de son adversaire. Quand toutes les dames sont battues hors du jeu, on ne peut plus joüer, à moins qu’on ne les ait toutes rentrées.
* Battre au tric-trac, c’est en comptant de la droite à la gauche les points amenés par les dés, tomber de la fleche la plus voisine d’une de ses dames, sur une fleche de son adversaire où il n’y ait qu’une dame, cette dame découverte est battue, si le dernier point d’un des dés ou de tous les deux tombe sur elle.
On peut battre de trois façons ; d’un dé, de l’autre, & des deux ensemble.
On bat par doublets, lorsqu’on a amené le même point des deux dés, comme deux quatre, deux cinq, &c.
On bat à faux, lorsqu’en comptant les points amenés par les deux dés, le dernier point de l’un & de l’autre des dés tombe sur une fleche de l’adversaire couverte de deux dames.
On gagne sur une dame battue simplement & d’une façon, dans le grand jan, deux points ; de deux façons, quatre ; de trois façons, six.
On gagne sur une dame battue par doublets dans le grand jan, quatre points ; six dans le petit jan.
Quand on bat à faux, on perd ce qu’on eût gagné en battant bien.
On bat le coin comme une dame, quand on a le sien & que l’adversaire ne l’a pas.
On bat les deux coins quand on n’a que deux dames abattues, & que les points amenés par l’un & l’autre dés tombent tous les deux sur le coin.
On gagne quatre points quand on bat le coin ou les deux coins simplement ; six quand on les bat par doublets.
On en perd autant si on bat le coin à faux ; ce qui arrive quand on n’a que deux dames abattues, & que l’adversaire a son coin.
Il y a encore d’autres manieres de battre. Voyez Trictrac, Dame, Fleche, &c.
BATTU, adj. (Marine.) vaisseau battu de la tempête, se dit d’un vaisseau qui ayant essuyé des coups de vent, se trouve tourmenté ou maltraité par la mer. (Z)
Battu, adj. se dit, dans les manufactures de soie, des ouvrages où il est entré beaucoup d’or & d’argent : on dit ce brocard est tout battu d’or.
Battu, adj. pris subst. se dit chez les Tireurs d’or, du trait d’or ou d’argent quand il est écaché. Voyez Trait & Tireur d'or.
Battu, Pas battu. Voyez Pas.
* BATTUE (faire la), dans les endroits où l’on tire la soie. Voyez les articles Soie & Tirage. C’est l’opération qui succede au tirage, & à la séparation des cocons. Elle consiste à foüetter avec un balai les cocons dans la bassine pleine d’eau chaude, & placée devant la machine à tirer la soie, afin d’en séparer & démêler des brins ou fils, & en commencer ou continuer le tirage. Voyez Soie.
* Battue, s. f. (Chass.) maniere de chasser le loup ; c’est la plus dangereuse pour les chasseurs & pour les loups ; pour les chasseurs, parce que si celui qui conduit cette chasse les dispose mal, ils sont exposés à s’entretuer ; pour les loups, parce que les loups effarouchés par une multitude d’enfans & de femmes de tout âge, qui sont armés de bâtons & qui traquent toute une forêt, sont tous chassés & forcés de passer devant les tireurs.
Battue (Pêche) ; le poisson s’enfonce dans la boue pendant l’hyver ; on reconnoît sa grosseur par le creux qu’il y fait. On appelle ce creux la battue du poisson.
* BATUECAS ou LOS BATUECAS (Géog.), peuples d’Espagne, dans le royaume de Léon, au diocese de Coria, dans une vallée qu’on appelle le val de Batuecas, couverte par des montagnes presqu’inaccessibles, entre Salamanque au septentrion, Coria au midi, la riviere de Tormes au levant, & la roche de France au couchant. Il n’y a pas plus de 150 ans qu’ils ont été découverts par le duc d’Albe. On conjecture que ce sont des restes des anciens Goths, qui s’étoient refugiés dans cette vallée entre des montagnes fort hautes, où ils avoient échappé aux Maures. D’autres disent au contraire que ce fut là que se retirerent plusieurs anciens Espagnols ou Iberes dans le tems de l’invasion des Goths, & où eux & leurs descendans vécurent separés du commerce du reste des humains, jusqu’à ce que le hasard les fit découvrir par un fugitif, sous le regne de Philippe II. qui leur envoya des ecclésiastiques pour leur prêcher le Christianisme & leur faire changer de mœurs. Ils sont cependant encore aujourd’hui peu policés, & si grossiers, que les Espagnols disent d’un homme rustre qu’il vient des vallées de Batuecas.
BATTURE, s. f. (Marine.) c’est un endroit où le fond s’éleve & que la mer couvre, mais où il n’y a pas assez d’eau pour qu’on y puisse passer sans danger. Voyez Basse. (Z)
Batture, composition qu’on met sur les ouvrages de Peinture à plat ou de bossage, comme la sculpture, & sur laquelle on applique de l’or ou du cuivre en feuilles.
Cette composition s’employe chaude, & se fait avec la colle de Flandre & du miel jaune, autant de l’un que de l’autre : on y ajoûte du vinaigre dans la quantité qu’on juge nécessaire pour la faire couler. (R)
BATURIN, (Géog.) ville de l’Ukraine, sur la Desne, autrefois résidence du général des Cosaques.
* BATUSABER, (Géog.) ville d’Asie, dans les Indes, dans la partie méridionale de la presqu’île de Malaca.
* BATZEN, (Commerce.) monnoie d’Allemagne, qui est en usage sur les bords du Rhin & en Suabe. 22 batzen valent un florin & demi d’Empire, ce qui revient environ à 3 livres 15 sols argent de France ; ainsi un batzen fait quelque chose de plus que trois sous de notre monnoie.
BAU, BAUX, BARROTS, c’est, en Marine ou construction de vaisseaux, une solive qui est mise avec plusieurs autres semblables par la largeur ou par le travers du vaisseau, d’un flanc à l’autre, pour affermir les bordages & soûtenir les tillacs. Voyez Pl. V. fig. 1. dans la coupe transversale d’un vaisseau, les baux no 69 & 119, & dans la Planc. IV. fig. 1. dans la coupe longitudinale d’un vaisseau sous les no 119 & 69, la situation de ces baux & leur nombre.
Le bout de chaque bau porte sur des pieces de charpente appellées courbâtons ou courbes, qui sont d’une figure triangulaire, & qui entretiennent les baux ou barrots avec les vaigres, voyez dans la Pl. V. fig. 1. les courbâtons no 70, & les vaigres no 32 ; & dans la Planche IV. fig. 1. no 70 les courbes ou courbâtons du premier pont.
De part & d’autre des écoutilles il y a des barotins ou demi-baux, qui se terminent aux hiloires, & qui sont soûtenus par des arcboutans ou pieces de bois mises de travers entre deux baux. Voyez Planche IV. fig. 1. no 73, les arcboutans du premier pont, & n° 77 les hiloires du premier pont.
Il faut remarquer qu’on ne se sert ordinairement du mot bau, que pour le premier pont, & de celui de barrot pour les autres ponts. Voyez Barrot.
Pour donner l’épaisseur & la largeur aux baux du premier pont, la plûpart des constructeurs mettent un pouce & la huitieme partie d’un pouce pour chaque dix piés de la longueur du vaisseau, prise de l’étrave à l’étambord, chaque dix piés de long leur donne un pouce de tonture. Il y a aussi plusieurs constructeurs qui ont pour regle de donner aux baux l’épaisseur de l’étrave prise en-dedans.
Il y a d’autres charpentiers qui proportionnent les baux par la largeur du vaisseau. Ils donnent à ceux du premier pont, par chaque cinq piés de largeur, deux pouces d’épaisseur de haut en-bas : mais ils leur donnent un peu plus de largeur si le bois le permet ; & comme ceux qui sont à l’avant & à l’arriere n’ont pas tant de largeur que les autres, on peut les tenir un peu moins épais si l’on veut. Ces mêmes charpentiers veulent qu’on leur donne six à sept pouces de rondeur, & qu’on fasse le faux pont sur ce même modele ; ils veulent que les baux ou barrots du haut pont soient un tiers moins larges & moins épais que ces premiers, mais ils leur donnent un peu plus de rondeur ; ils posent les baux à trois ou quatre piés l’un de l’autre, hormis ceux qui sont aux côtés des écoutilles des vaisseaux marchands, qui chargent toutes sortes de marchandises & de gros balots ; ceux-là se posent à sept piés de distance l’un de l’autre.
Les bouts des baux surmontent de cinq pouces ou cinq pouces & demi les serre-banquieres, & sont assemblés à queue d’aronde. Voyez la Planche V. fig. 1. au no 68 & 69, le bau & le serre-banquiere du premier pont.
Au devant & au derriere des baux de dale & de lof, on pose des courbes à l’équerre, & il y en a une autre au-dessus du bau de dale, qui est posée le long de la serre-gouttiere & le long de la barre d’arcasse. La serre-gouttiere fente dans le jarlot qu’on fait dans cette courbe.
Maitre bau, (Marine.) c’est celui qui étant le plus long des baux, donne par sa longueur la plus grande largeur au vaisseau ; il est posé à l’embelle ou au gros du vaisseau, sur le premier gabarit.
Faux bau, (Marine.) ce sont des pieces de bois pareilles aux baux, qui sont mises de six piés en six piés, sous le premier tillac des grands vaisseaux, pour fortifier le fond du bâtiment & former le faux pont. Voyez la Pl. V. fig. prem. les faux-baux cotés 38, & dans la Pl. IV. fig. prem. sous la même cote 38.
On pose le plus souvent les faux-baux à trois piés & demi au-dessous des baux du premier pont, c’est-à-dire dans un vaisseau de 134 piés, pris de l’étrave à l’étambord ; & par conséquent de 13 piés ou 13 piés de creux depuis le premier pont, & l’on suit à peu près cette proportion dans de plus grands vaisseaux. C’est sur ces faux-baux qu’on fait souvent un faux pont, dans lequel on pratique un retranchement derriere le grand mât, où le faux pont a le plus de hauteur ; les soldats y couchent.
Bau de dale, (Marine.) c’est celui qui est le dernier vers l’arriere.
Bau de Lof, c’est celui qui est le dernier vers l’avant sur l’extrémité. (Z)
BAVAROIS, (les) s. m. plur. (Géog.) peuples d’Espagne, connus anciennement sous le nom de Boiens ou Boiares. Ce sont les premiers des anciens Germains qui ayent passé les Alpes, pénetré dans la Grece, & qui ayent paru en armes sur les rives du Tibre & du Thermodon. En 493, ils occupoient la partie du Norique, qui étoit le long du Danube, ou ce que nous appellons la haute & moyenne Autriche, avec la seconde Rhetie, contrée située entre l’Œin & le Lech. Ces peuples ont eu & conservé de tout tems une haute réputation de bravoure. Leurs ancêtres vainquirent les peuples du midi, & leurs descendans arrêterent les courses des peuples du Nord.
* BAUBIS, chiens (Chasse.) c’est ainsi qu’on appelle des chiens dressés au lievre, au renard, & au sanglier. On leur coupe presque toute la queue. Ils sont plus bas de terre & plus longs que les autres, de gorge effroyable. Ils heurlent sur la voie. Ils ont le nez dur, & le poil demi-barbets.
* BAUCIS & PHILEMON (Myth.) Il y eut autrefois dans une cabane de la Phrygie un mari & une femme qui s’aimoient. C’étoient Philémon & Baucis. Jupiter & Mercure parcourant la terre en habit de pélerins, arriverent dans la contrée de nos époux : il étoit tard ; & les dieux auroient passé la nuit exposés aux injures de l’air, si Philemon & Baucis n’avoient pas été plus humains que le reste des habitans. Jupiter touché de la piété de Philemon & de Baucis, & irrité de la dureté de leurs voisins, conduisit les époux sur le sommet d’une montagne, d’où ils virent le pays submergé, à l’exception de leur cabane qui devenoit un temple. Jupiter leur ordonna de faire un souhait, & leur jura qu’il seroit accompli sur le champ. Nous voudrions, dirent Philemon & Baucis, servir les dieux dans ce temple, nous aimer toûjours, & mourir en même tems. Ces souhaits méritoient bien d’être écoutés ; aussi le furent-ils. Philemon & Baucis servirent long-tems les dieux dans le temple ; ils s’aimerent jusque dans l’extrème vieillesse ; & un jour qu’ils s’entretenoient à la porte du temple, ils furent métamorphosés en arbre. La Fontaine, Prior, & le docteur Swift, ont mis en vers cette fable : la Fontaine a célébré Philemon & Baucis, d’un style simple & naif, sans presque rien changer au sujet. Prior & Swift en ont fait l’un & l’autre un poeme burlesque & satyrique ; la Fontaine s’est proposé de montrer, que la piété envers les dieux étoit toûjours récompensée : Prior, que nous n’étions pas assez éclairés pour faire un bon souhait ; & Swift, qu’il y a peut-être plus d’inconvénient à changer une cabane en un temple, qu’un temple en une cabane. Que d’instructions dans cette fable ! L’amour conjugal, la tranquillité, & le bonheur, refugiés dans une cabane ; la sensibilité que les indigens & les malheureux ne trouvent que chez les petits ; la cabane changée en temple, parce que les deux époux y rendoient par leur union le culte le plus pur aux dieux ; la simplicité de leurs souhaits, qui montre que le bonheur est dans la médiocrité & dans l’obscurité, & combien les hommes sont insensés de le chercher si loin d’eux-mêmes.
* BAUD, s. m. chasse, race de chiens-courans qui viennent de Barbarie. Ils chassent le cerf. Ils sont ordinairement tout blancs : on les appelle aussi chiens muets, parce qu’ils cessent d’aboyer, quand le cerf vient au change.
* BAUDEQUIN, s. m. (Comm.) petite monnoie, de la valeur de six deniers ou environ, ainsi appellée, à ce qu’on conjecture, d’un baldaquin ou dais sous lequel le roi y étoit représenté. Elle étoit en usage au commencement du quatorzieme siecle.
* BAUDET, s. m. c’est ainsi que les scieurs de planches appellent les treteaux ou chevalets, sur lesquels ils placent leurs pieces élevées pour travailler.
* Baudir les Chiens (chasse) c’est les exciter du cor & de la voix. On baudit aussi les oiseaux.
* BAUDOSE, s. f. espece d’instrument de Musique à plusieurs cordes, dont Aimery du Peyrat, abbé de Moisac, fait mention dans une vie de Charlemagne, manuscrite. Voyez n°. 1343, de la bibliotheque du Roi, quidam baudosam concordabant.
BAUDRIER, s. m. c’est chez les Ceinturiers, une bande de cuir large de quatre ou cinq doigts, le plus souvent enjolivée, qui prend depuis l’épaule droite & se vient rendre au côté gauche, & qui est composée de la bande & de deux pendans, au-travers desquels on passe l’épée.
Le Baudrier (Hist. anc.) est une partie de l’habillement des gens de guerre qui, sert à porter leur épée. Les militaires qui étoient admis aux festins de l’empereur ou des généraux d’armées, avoient coûtume de quitter leurs baudriers ou ceinturons avant que de se mettre à table. Trebellius Pollion rapporte, que dans un repas que l’empereur Gallien donnoit à plusieurs officiers, le jeune Salonin, fils de ce prince, leur enleva leurs baudriers dorés & constellés, auratos constellatosque balteos. M. Baudelot dans les Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres, croit que ces baudriers constellés étoient des ceinturons chargés de pierres précieuses & de lames d’or & d’argent, sur lesquelles étoient gravées quelques figures mystérieuses de signes célestes, suivant les idées superstitieuses de la théologie payenne, ou qui avoient été fabriquées sous l’aspect de quelques constellations. Tertullien en décrivant quelques ceintures semble vouloir parler de ces talismans, latent in cingulis smaragdi. Or Pline & Marcellus Empiricus attribuent beaucoup de vertus aux figures d’aigles & de scarabées qu’on gravoit sur ces pierres, smaragdi. Les gens de guerre aussi superstitieux que d’autres, pouvoient avoir d’autant plus de foi à ces pierres constellées, dont leurs baudriers étoient enrichis, qu’on croyoit communément que c’étoit par la vertu d’un semblable amulete que Milon de Crotone avoit été invincible dans les combats ; & que l’hématite autre espece de pierre précieuse, n’étoit pas moins salutaire pour repousser les ennemis & les vaincre ; recherches que cet académicien appuie des témoignages de plusieurs anciens auteurs. Sans prétendre diminuer le mérite de toutes ces découvertes ingénieuses, j’hasarderai que comme dans le passage de Trebellius Pollion, auratos balteos signifie des baudriers ornés ou enrichis de dorure ; constellatos y signifie tout simplement qu’ils étoient parsemés d’étoiles en broderie, & qu’apparemment Casaubon qui n’y a point entendu de mystere, a crû que ce sens se présentoit de lui-même & n’avoit pas besoin d’explication. (G)
BAUDROIE, rana piscatrix, s. f. (Hist. nat. Zoolog.) poisson de mer ainsi nommé ; parce que sa bouche est si grande qu’on l’a comparée à un baudrier : on lui a donné le nom de rana, parce qu’il ressemble au tétard ; & on a ajoûté celui de piscatrix, parce qu’il est bon pêcheur. La baudroie est plate & de couleur brune ou enfumée ; sa tête est grosse, ronde, applatie & garnie de plusieurs aiguillons ; l’ouverture de la bouche est au-devant de la tête & non pas en dessous ; la mâchoire inférieure & la langue sont plus longues que la mâchoire supérieure, c’est pourquoi la bouche est toûjours ouverte : chaque mâchoire a des dents longues, pointues & recourbées en dedans ; il s’en trouve sur le palais & sur la langue. Les yeux sont placés sur le dessus de la tête, dirigés de côté, & environnés d’aiguillons. Il y a au-devant des yeux deux barbillons, qui sont fort menus à leur naissance & plus gros à leur extrémité ; on prétend que par le moyen de ces barbillons, la baudroie est avertie de l’approche des petits poissons lorsqu’elle est dans le sable ou dans l’eau trouble. Elle a deux nageoires au milieu du corps, une de chaque côté, & une ouverture pour les ouies aussi de chaque côté, recouverte par une peau. La queue est épaisse, charnue, & terminée par une seule nageoire ; il s’en trouve une autre sur le dessus de la queue. Il y a de petits prolongemens charnus, qui pendent des deux côtés de la tête & de la queue, & qui sont placés à quelque distance les uns des autres. Ce poisson fait des œufs ; sa chair est de mauvais goût & de mauvaise odeur. Lorsqu’on a tiré les entrailles par la bouche & qu’on a étendu le corps, on voit le jour au-travers ; & si on met une chandelle au dedans, il paroît fort hideux : c’est pourquoi les Italiens l’ont nommée diavolo di mare. Rondelet. Voyez Poisson. (I)
BAUDROYER, v. act. vieux terme synonyme à courroyer ou préparer les cuirs, colorés seulement.
BAUDROYEUR, s. m. ouvrier qui courroyoit les cuirs de couleur. La communauté des Baudroyeurs est unie à celle des Courroyeurs, qui se qualifient maîtres Baudroyeurs-Courroyeurs.
BAUDRUCHE, s. m. en terme de Batteur d’or ; c’est une pellicule d’un boyau de bœuf apprêtée, dont ils font les feuillets de leurs outils. Voyez Battre l’or.
BAVER, v. neut. (Jardinage.) se dit d’une eau qui vient en décharge, ou d’un jet qui ne s’éleve pas haut. (K)
BAVETTE, s. f. chez les Boyaudiers, est un ustencile qui dépend en quelque façon du tablier, quoiqu’il en soit séparé ; c’est une espece de plastron composé de vieux chiffons que ces ouvriers mettent devant eux pour garantir leur poitrine, & empêcher que leurs habits ne soient gâtés. Les Boyaudiers suspendent la bavette à leur cou, & se l’attachent derriere eux avec des cordons.
Bavette, terme de Plombier ; c’est ainsi qu’on appelle une sorte de plate-bande de plomb qui couvre les bords des cheneaux.
Bavette, se dit aussi des plaques de plomb, qui se mettent au-dessous des bourseaux qui servent d’ornement sur les couvertures d’ardoises.
BAVEUSE, bavosa, s. f. (Hist. nat. Zoolog.) poisson de mer ainsi appellé à Antibes, parce qu’il est toûjours couvert d’une bave gluante : il n’a point d’écailles ; il est lisse & moucheté, le dos est brun & le ventre de couleur blanchâtre. Il a deux nageoires près des oüies, & deux au-dessous, une sur le dos, qui s’étend depuis la tête jusqu’à la queue, & une autre qui va depuis l’anus jusqu’à la queue. Ce poisson ressemble beaucoup à celui que l’on nomme percepierre & coquillade. Rondelet. Voyez Percepierre , Coquillade, Poisson . (I)
* BAVEY (Géog.) petite ville de France, dans le Haynault.
* BAUGE, s. f. (Commerce.) espece de droguet d’une demi-aune de large au sortir du foulon, qui se fabrique en Bourgogne, sur des rats ou peignes de trois quarts, avec de la laine grossiere, & du fil filé gros.
* Bauge, s. f. (Œconomie rustique.) c’est de la terre franche mêlée avec de la paille & du foin hachés. On pétrit ce mêlange, on le corroie, & l’on s’en sert où le plâtre & la pierre sont rares. Les murs sont ou de bauge, ou de cailloux liés de bauge. Ces derniers ne s’en appellent pas moins murs de bauge. La plûpart des chaumieres ne sont pas construites d’autre chose. Quand la bauge est soûtenue par de la charpente, comme dans les granges, les étables & d’autres bâtimens, cela s’appelle torchis ; parce que cette charpente n’étant pour l’ordinaire qu’un assemblage de perches & de pieux lattés, pour remplir & consolider cette espece de grillage, on se sert de bâtons fourchus & de branches d’arbres qu’on enduit de bauge, & qui ressemblent assez alors à une torche ; on insere ces torches dans les entailles & ouvertures de la charpente : quand le mur est plein, on le crépit du haut en bas avec de la bauge pure & bien corroyée ; on l’unit avec la truelle, & l’on blanchit le tout, si l’on veut, avec du lait de chaux ; ce cloisonnage est de peu de dépense, & il est d’autant plus solide que les palissons ou palats, c’est ainsi qu’on appelle les bâtons ou rameaux qu’on enduit de bauge, sont plus courts, & par conséquent les perches & pieux qui forment la charpente plus serrés : il ne faut point employer de bois verd dans cette maniere de bâtir ; car il se déjette, & donne lieu à des crevasses & à la chûte des murs. Que les palissons ou palats soient de chênes ; que la terre soit bien délayée, & qu’elle soit en une pâte ni molle ni dure : voila les conditions principales à observer dans la maniere de faire & d’employer la bauge.
* Bauge s. f. (Chasse.) c’est le lieu où la bête noire, comme le sanglier, se couche tout le jour : c’est ordinairement un endroit bourbeux & touffu de la forêt.
* BAUGÉ (Géog.) ville de France, en Anjou, sur le Coesnon, à quatre lieues de la Fleche.
Baugé (Géog.) ville de France, dans la Bresse, dont elle étoit autrefois la capitale, à une lieue de Mâcon.
* BAUGENCI (Géog.) ville de France, dans l’Orléanois proprement dit, avec titre de comté.
BAUHINE, bauhinia, genre de plante dont le nom a été dérivé de celui de Jean & Gaspar Bauhin ; la fleur des plantes de ce genre est polypétale irréguliere, composée pour l’ordinaire de cinq pétales tous rangés du même côté ; il s’éleve du fond du calice un pistil recourbé & entouré d’étamines aussi recourbées ; il devient dans la suite une silique remplie de semences qui ont la forme d’un rein. Plumier, nova plant. Americ. gen. Voyez Plante. (I)
* BAVIERE, (Géog.) état considérable d’Allemagne, avec titre de duché, borné au septentrion par la Boheme & le haut Palatinat ; à l’orient par l’Autriche, l’archevêché de Saltzbourg, & l’évêché de Passau ; au midi par l’évêché de Brixen & le Tirol ; à l’occident par le Lech. Il a environ 50 lieues d’occident en orient, & 35 du midi au septentrion : ses principales rivieres sont le Danube, l’Inn, l’Iser, & le Lech. La Baviere se divise en haute, où est la régence de Munich, capitale de Baviere ; & en basse, où sont les trois régences de Burckhausen, Landshut, & Straubingen.
Baviere, (Cercle de) partie de l’Allemagne beaucoup plus étendue que la Baviere ; comprenant outre la Baviere, le haut Palatinat, l’archevêché de Saltzbourg, les évêchés de Frizingue, de Passaw, & de Ratisbonne, avec le duché de Neubourg. Elle est bornée à l’orient & au midi par le cercle d’Autriche, & à l’occident & au septentrion par les cercles de Franconie & de Suabe, & par la Bohème.
Baviere, (Palatinat de) partie du Nortgaw, dont la capitale est Amberg.
Il ne faut pas confondre, comme on voit, la Baviere, soit avec le cercle, soit avec le Palatinat de même nom.
* BAUMANN, (Caverne de) ; elle est proche de Goslar, dans le comté de Blanckenburg, sous un rocher. On dit qu’on y trouve des pierres auxquelles la nature a donné la figure d’os d’animaux, & d’autres formes bisarres ; il y a six grottes qui communiquent les unes aux autres, & s’étendent sous terre à une très-grande profondeur ; on ajoûte sur ces grottes beaucoup de choses fabuleuses, qu’il est inutile de rapporter ici.
* BAUMARIS, (Géog.) ville située dans l’île d’Anglescey.
BAUME, plante. Voyez Mente. (I)
Baume, proprement dénote une substance huileuse, résineuse, odoriférente, provenant des incisions de certaines plantes, d’une vertu souveraine pour la cure des plaies & de divers autres maux.
Nous l’appellons quelquefois par maniere de distinction, baume naturel. Nous disons baume de la Méque, baume du Pérou, de Tolu, de Copahu, d’ambre liquide, à quoi peut être ajoûté le baume de Carpathie.
Baume de Giléad, est des plus estimés, quoiqu’il y ait des auteurs qui veulent que celui du Pérou ne lui soit point inférieur en vertu. On le tire par incision d’un arbre du même nom, qui croît en Egypte & dans la Judée, mais principalement dans l’Arabie Heureuse, & qui est d’une si grande valeur, qu’il fait partie du revenu particulier du grand-seigneur, sans la permission duquel il n’est point permis d’en planter ou cultiver aucun. L’incision par laquelle cet admirable suc coule, se fait pendant la canicule. Théophraste dit qu’elle doit être faite avec des clous de fer ; Pline avec du verre ; parce que, dit-il, le fer fait mourir la plante. Tacite nous dit que lorsque les branches sont pleines de seve, leurs veines semblent appréhender le fer, & s’arrêter quand une incision est faite avec ce métal, mais couler librement lorsqu’elles sont ouvertes avec une pierre, ou un têt de cruche cassée, Enfin, Marmol dit que les veines doivent être ouvertes avec de l’ivoire ou du verre. Le suc est d’abord d’une couleur sombre ; il devient ensuite blanc, enfin vert, & peu à peu d’une couleur d’or, & quand il est vieux, de la couleur de miel : il est de la consistance de la térébenthine ; son odeur est agréable & très-vive ; son goût amer, piquant, & astringent : il se dissout aisément dans la bouche, & ne laisse point de tache sur le drap.
Il est à remarquer que le suc qui nous est apporté pour du baume, n’est pas proprement la gomme, ou pleurs de l’arbre, extraites par incision, parce qu’il n’en rend que peu de cette façon ; mais est préparé du bois & des branches vertes de l’arbre distillées ; & toutefois il se trouve même souvent sophistiqué avec de la térébenthine de Chypre & d’autres résines & huiles, ainsi qu’avec du miel, de la cire, &c. Outre cela, il y a pareillement une liqueur extraite de la semence de la plante, qu’on fait passer souvent pour le véritable baume, quoique son odeur soit beaucoup plus foible, & son goût beaucoup plus amer.
Le baumier est à peu près de la hauteur du grenadier ; ses feuilles semblables à celles de rue, toûjours vertes ; ses fleurs blanches, & en forme d’étoiles, d’où sortent de petites cosses pointues, renfermant un fruit semblable à l’amande, appellé carpo-balsamum, comme le bois est appellé xylo-balsamum, & le suc opo-balsamum. Voyez Opo-balsamum, &c.
Le carpo-balsamum entre dans la composition de la thériaque de Venise, & n’a guere d’autre usage dans la Medecine : on doit le choisir d’un goût aromatique, & d’agréable odeur. Voyez Carpo-balsamum. Le xylo-balsamum, qui comme les autres productions du baumier, est apporté du Caire, entre dans la composition des trochisques hedychrois ; il est apporté en petits fagots, ayant l’écorce rouge, le bois blanc, resineux & aromatique. Voyez Xylobalsamum.
Il y a pareillement un baume de la Meque, qui est une gomme seche & blanche, ressemblante à la couperose, sur-tout quand elle est vieille. Elle est apportée de la Meque, au retour des caravanes de pélerins & marchands Mahométans, qui vont là par dévotion au lieu de la naissance de leur prophete. Elle a toutes les vertus du baume de Giléad, ou de la Judée, & est probablement le même baume, qui est seulement endurci, & dont la couleur est altérée.
Baume du Pérou, est de trois especes, ou plûtôt un même baume à trois différens noms : savoir, baume d’incision, qui est une résine blanche & glutineuse provenant d’une incision faite dans l’arbre, & ensuite épaissie & endurcie. Il est excellent pour les plaies récentes, fraîches, & ressemble beaucoup à l’opo-balsamum, à l’odeur près qui le distingue. Baume sec, qui se distille des bouts de branches coupées, auxquelles sont attachés de petits vaisseaux pour recevoir la liqueur, qui est d’abord semblable à du lait, mais rougit étant exposée au soleil. Son usage principal est dans la composition du lait virginal, qui se fait beaucoup mieux avec ce baume, qu’avec le storax ou le benjoin. Enfin le baume de lotion, qui est noirâtre, est tiré de l’écorce, des racines, & feuilles de l’arbre hachées & bouillies ensemble : on s’en sert pour les plaies comme du baume blanc, & il est fort en usage chez les Parfumeurs, à cause de son odeur.
Baume de Copahu, ou de Copaiba, vient du Brésil, dans des bouteilles de terre : il y en a de deux sortes ; l’un est clair & liquide ; l’autre est d’une couleur plus sombre & épais : le premier est blanc, d’une odeur résineuse ; l’autre tire un peu plus sur le jaune ; tous deux sont admirables pour les plaies ; les Juifs s’en servent après la circoncision pour étancher le sang.
Baume de Tolu, est une résine liquide, qui à mesure qu’elle vieillit, devient de la couleur & de la consistance de la colle de Flandre. Elle se tire par incision de quelques arbres qui croissent dans la Nouvelle Espagne, où les habitans la reçoivent dans de petits vaisseaux de cire noire : elle ressemble au baume de Giléad pour le goût & pour l’odeur, selon qu’elle devient vieille ; elle prend la consistance d’un baume sec.
Baume d’ambre liquide, est une résine claire & rouge, produite par un arbre de la nouvelle Espagne, appellé par les naturels du pays ososol ; il ressemble à l’ambre gris, sur-tout par l’odeur, d’où vient son nom. Le nouveau baume est liquide, & est nommé huile d’ambre liquide : mais quand il est vieux, on l’appelle baume d’ambre liquide ; il vient des deux Espagnes en barrils, & est très-rare parmi nous.
On le trouve souverain pour les plaies, particulierement pour les fistules à l’anus : il ressemble au baume de Tolu par l’odeur & la couleur, & est exprimé de la même maniere que l’huile de laurier, d’un fruit rouge qui croît dans l’île de Saint-Domingue.
Baume, est aussi appliqué à de certaines compositions faites par les Chimistes & Apothicaires, principalement lorsqu’il y entre des ingrédiens balsamiques & consolidans, en imitation des baumes naturels.
Ceux-ci sont appellés par maniere de distinction, baumes factices ou artificiels. Nous avons deux différentes compositions de baumes, en imitation du baume véritable d’Egypte ; l’un par Matthiole, l’autre par Furicus Cordus. Pomet a aussi donné une méthode d’imiter le baume naturel.
Baume de Saturne, est un sel ou sucre de plomb dissout dans l’huile ou esprit de térébenthine, genievre ou semblables, digéré jusqu’à ce que la matiere ait acquis une teinture rouge. On dit qu’il résiste à la putréfaction des humeurs, & qu’il est propre à nettoyer & cicatriser les ulceres. (N)
Baume de soufre ; c’est une dissolution du soufre par une liqueur huileuse. On peut employer pour cette opération toute sorte d’huile : mais de toutes les huiles, l’huile de térébenthine est la plus conveble pour tirer une teinture du soufre.
Le baume de soufre térébenthiné est le plus en usage. Pour le faire, on met dans un petit matras deux onces de fleurs de soufre, on verse dessus huit onces d’huile de térébenthine, on place le matras sur un feu de sable, & on fait un feu de digestion cinq ou six heures ; & après avoir laissé refroidir le tout, on sépare le baume d’avec le reste du soufre qui ne s’est point dissous, en versant à clair la liqueur qui a une couleur de rubis.
Le baume de soufre est en usage lorsqu’il y a ulcere aux poumons après une fluxion de poitrine, une pleurésie, une péripneumonie, après l’empyeme & la vomique, en général lorsqu’on soupçonne un abcès dans l’intérieur, & qu’on juge que la matiere peut prendre la route des urines ou celle de la transpiration. Il faut donner tous les matins, & quelquefois tous les après-midi, du baume de soufre dans de la conserve de violette, de rose, ou de fleurs de pié-de-chat, depuis une goutte jusqu’à dix.
Les femmes peuvent user de ce remede dans le tems même de leurs regles ; il ne les arrête pas, au contraire : mais il faut avoir l’attention de ne le pas
- donner lorsqu’il y a de la fievre ; & quand même il
n’y auroit pas de fievre, il seroit contraire s’il y avoit de la secheresse : dans ce cas la térébenthine sans soufre convient mieux. Ou bien on fait le baume de soufre avec l’huile d’amandes douces : mais pour peu qu’il y ait disposition à la fievre, autre que la fievre lente, ces remedes ne conviennent point.
Il est bon de remarquer que les baumes de soufre mettent le sang en mouvement, & qu’ils sont pernicieux lorsqu’il y a érésipele ou disposition à l’érésipele.
Lorsque pour faire le baume de soufre on se sert de l’huile d’anis, on le nomme baume de soufre anisé. Ce baume est bon dans les maladies d’estomac & des intestins : il est moins desagréable que les autres. Lorsqu’on fait le baume de soufre avec l’huile de succin, on le nomme baume de soufre succiné : on l’employe lorsqu’il y a complication par maladies de nerfs.
On fait aujourd’hui un grand usage du baume blanc de Canada ; mais les baumes de soufre m’ont paru beaucoup plus efficaces, dans la pratique de la Medecine, pour les ulceres du poumon, & pour ceux des reins. Lorsqu’on destine le baume de soufre pour être employé dans les maladies des reins, de la vessie & de la matrice, on le prépare avec l’huile de genievre.
On fait peu d’usage extérieurement du baume de soufre, quoiqu’il y fût fort utilement employé dans plusieurs occasions : il est vulnéraire & détersif en vuidant les extrémités des vaisseaux rompus ; il divise les humeurs visqueuses & purulentes, & les fait couler ; ce qui s’appelle déterger.
On peut faire un baume de soufre pour l’usage externe : on prend pour cela une once de fleurs de soufre ; on verse dessus de l’huile de lin, ou de l’huile de noix six onces, des huiles de milpertuis, de jusquiame & de pavot blanc, de chaque deux gros ; & on fait digérer le tout ensemble pour faire la dissolution du soufre. Malouin, Traité de Chimie. (M)
Baume du Pérou artificiel : prenez huile d’olive une livre & demie, santal rouge une demi-once : faites bouillir jusqu’à ce que l’huile soit d’un rouge foncé : dissolvez-y cire jaune une livre, térébenthine fine une livre & demie, baume du Pérou une once.
Ces baumes tiennent lieu des naturels, & sont en grand usage pour l’extérieur. La plûpart des pharmacopées sont remplies de ces especes de baumes. Voici la description de ceux dont on se sert le plus ordinairement.
Baume d’Arceus : prenez suif de bouc deux livres ; térébenthine de Venise, gomme élemi, de chaque une livre & demie ; graisse de porc une livre : faites fondre le tout ensemble, passez, & vous aurez le baume : c’est un très-bon digestif, & le plus en usage dans la cure des plaies.
Baume du Commandeur : prenez racine d’angélique de Bohème, sechée & coupée par petits morceaux, une demi-once ; fleurs de milpertuis séchées, une once ; esprit-de-vin rectifié, deux livres quatre onces : faites-les digérer au soleil ou au bain-marie dans un vaisseau fermé, en remuant de tems à autre le mêlange, jusqu’à ce que la teinture soit parfaitement tirée : passez ensuite ; & dans la colature ajoûtez myrrhe, oliban, de chaque demi-once : faites digérer comme auparavant ; & ensuite prenez styrax calamite deux onces, benjoin choisi trois onces, baume de Tolu une once, aloès succotrin demi-once : ajoûtez, si vous le jugez à propos, ambre gris six grains : mettez en poudre ces drogues, & les jettez ensuite dans la teinture ci-dessus énoncée ; faites-les encore digérer pendant quarante jours au soleil ; filtrez, & conservez la colature pour l’usage.
Ce baume est un grand vulnéraire, détersif & incarnatif, appliqué à l’extérieur ; & pris à l’intérieur dans du vin ou dans quelqu’autre liqueur, il est excellent contre les coliques, les dévoiemens, les vomissemens ; il est propre pour exciter les regles : enfin on lui attribue, comme à tous les nouveaux remedes, de grandes vertus, qui sont toûjours relatives aux indications qui se présentent dans les maladies : on peut en faire un alexitaire, un stomachique, & enfin un diaphorétique.
Baume ou Onguent de genievre : prenez huile d’olive trois livres, eau rose une livre, cire neuve demi-livre, térébenthine une livre, santal rouge en poudre deux onces : faites bouillir le tout dans un pot de terre neuf, avec trois demi-septiers de vin rouge ; étant refroidi, on séparera le baume du vin. Voyez Mémoires de l’Académie 1702.
Baume de Lucatelli : prenez de la meilleure huile d’olive que vous pourrez trouver, deux livres ; vin de Canarie, deux livres ; sang de dragon pulvérisé, une once : faites bouillir ces drogues jusqu’à consomption du vin : ajoûtez-y cire jaune une livre, térébenthine de Venise une livre & demie, santal rouge en poudre deux onces, baume du Pérou deux onces ; mêlez-les & faites-les fondre ensemble, & ne mettez le baume qu’après avoir retiré le mêlange du feu.
Ce baume est un excellent vulnéraire employé dans les ulceres internes & externes, dans les tubercules, & dans les ulceres & les hémorrhagies internes. On l’applique sur les plaies & les contusions.
Baume odorisérant : prenez pommade sans odeur une once ; faites-la fondre à petit feu dans une tasse de porcelaine, & ajoûtez-y peu-à-peu cire blanche un gros ; le tout étant bien mêlé, retirez le vaisseau : lorsque le mêlange commencera à s’épaissir, versez-y huile essentielle de citron un gros : remuez la matiere, pour que le mêlange soit plus parfait : mettez le vaisseau dans l’eau froide, pour qu’il se refroidisse plûtôt ; & le baume étant tout-à-fait froid, serrez-le dans de petites boîtes, où il soit bien bouché.
Il se garde plusieurs années sans se corrompre : on peut au lieu de pommade & de cire, employer l’huile exprimée de noix muscade, après l’avoir lavée si long-tems dans l’eau qu’elle devienne blanche. Ce baume est propre à ranimer ; c’est un grand cordial : on en peut faire un pareil avec toutes les especes d’huile essentielle.
Baume pectoral : prenez benjoin, myrrhe, baume du Pérou, safran, muscade, teinture de sel de tartre, gomme ammoniaque, de chaque deux gros ; huile d’anis, de macis, de fenouil, de chaque dix gouttes. Cette composition peut se donner liquide, en l’étendant davantage avec l’esprit-de-vin.
Baume polychreste : prenez esprit-de-vin quatre livres ; faites-y infuser à petit feu en remuant, gomme de gaiac douze onces ; ajoûtez-y ensuite baume du Pérou, térébenthine, de chaque deux onces.
Baume préparé par la décoction des bois résineux balsamiques : prenez râpures de santal, de bois de rose, de genevrier, de sassafras, de bois de vie, racine de salsepareille, de chaque une once ; racine de pimprenelle, d’angélique, canelle, clous de girofle, râpures de bois d’aloès, de chaque deux gros ; mêlez ces drogues, & faites-les bouillir avec du vin rouge dans un vaisseau fermé. Cette décoction peut être d’usage comme les baumes.
Baume solide & astringent : prenez baume de Copahu, de Tolu, succin, mastic, oliban, cachou, terre sigillée, antimoine diaphorétique, corail préparé, de chaque un gros ; huile de sassafras dix gouttes : préparez ces drogues selon l’art ; il produit des effets admirables dans la gonorrhée.
Baume verd de Mets ou de Mademoiselle Feuillet : prenez huile de lin par expression, d’olive, de chaque une livre, de laurier une once, térébenthine de Venise deux onces ; liquéfiez le tout à petit feu ; & quand elles seront refroidies, ajoûtez-y huile distillée de baies de genievre une once & demie, verd de gris trois gros, aloès succotrin en poudre deux gros, vitriol blanc pulvérisé un gros & demi, huile de girofle un gros ; faites-en un baume selon l’art. Il est propre pour mondifier les plaies & les ulceres, pour les incarner & les cicatriser, contre la morsure des bêtes venimeuses : on en fait chauffer, & on en met dans la plaie avec la barbe d’une plume.
Ce baume a été inventé en premier lieu par M. Duclos, Medecin de Mets ; Mademoiselle Feuillet l’a fait appeller de son nom, l’ayant mis en vogue à Paris. Lemery, Pharmacop. univers.
Baume vulnéraire : prenez essence de myrrhe, succin, gomme élémi, santal rouge, baume du Pérou, de Tolu, huile d’armoise, sommités de mille-feuilles, d’hypericum, de chaque une once : on mêle ces drogues avec cinq quarterons d’huile & de vin, & on en fait un baume excellent en les digérant sur un feu modéré. Hoffmann les distille & en tire un esprit qu’il préfere au baume de Lucatelli.
Ce baume est un excellent vulnéraire & stomachique ; on en peut user intérieurement comme extérieurement.
On n’auroit jamais fait, si on vouloit détailler tous les baumes artificiels qui ont été découverts par les auteurs qui nous ont laissé des dispensaires. Lemery en compte soixante-treize especes différentes dans sa Pharmacopée universelle, en y comprenant quelques-uns de ceux dont nous avons parlé plus haut. On en trouve un grand nombre d’autres dans les dispensaires étrangers. (N)
* Baume (la sainte), grotte sur une montagne de France en Provence, entre Aix, Marseille & Toulon. Ce lieu est très-fréquenté, parce que les peuples sont imbus du préjugé que la Magdeleine y est morte.
* Baume les nones, (Géogr.) ville de Franche-Comté en France, sur le Doux.
* Baunach, (Géog.) riviere de Franconie.
BAVOIS, s. m. ancien terme de Monnoie, étoit la feuille de compte où l’on marquoit l’évaluation des droits de seigneuriage, foiblage, brassage, &c. selon le prix courant que le prince par ses ordonnances, avoit prescrit pour l’or, pour l’argent, & pour le billon en œuvre ou hors d’œuvre.
BAVOLET, s. m. (terme de Marchande de mode.) c’est la seconde piece d’une coeffure, mais qui n’a point de barbe, & qui forme seulement le dessus de tête ; au reste ce bavolet est garni & plissé comme la piece de dessous ; c’est aussi sur lui que l’on monte le fer qui forme le gros pli du milieu.
* BAUSK (Géog.) ville importante de Curlande, sur les frontieres de Pologne au nord, sur la riviere de Musza. Long. 42. 14. lat. 56. 30.
* BAUTZEN ou BUDISSEN (Géog.), ville d’Allemagne, capitale de la haute Lusace, sur la Sprée. Long. 32. 13. lat. 51. 10.
* BAXANA, plante Indienne, ainsi caractérisée dans les auteurs, baxana, arbor fructu venenato, radice venenorum antidoto.
Baxana, arbre à fruit vénéneux, & à racine anti-vénéneuse ; en le trouve à Queyonne, proche Ormuz. On dit que son fruit suffoque, en quelque petite quantité qu’on en prenne, & que son ombre est mortelle si l’on s’y tient pendant un quart d’heure : mais Ray traite ces effets de fables, sur ce que dans d’autres contrées on attribue à la racine, aux feuilles & au fruit du même arbre, des propriétés salutaires. Au reste que cet arbre soit ou aussi pernicieux ou aussi utile qu’on le dit, il n’est pas moins constant qu’il en faudroit une autre description que la précédente, & que tant qu’une plante, étrangere sur-tout, ne nous sera pas mieux connue que par une phrase, telle que la précédente, c’est précisément comme si elle n’existoit pas.
* BAXEA (Hist. anc. & Antiq.), espece de chaussure ancienne, du nombre de celles qui s’attachant sur le pié avec des bandes, ne le couvroient pas entierement. Plaute en a fait mention : mais on croit que le baxea de Plaute étoit une sorte de sandale à l’usage des philosophes. Arnobe parle de baxées faites de feuilles de palmier.
* BAYA ou BAJA (Géog.), ville de la basse Hongrie, dans le comté de Bath, près du Danube. Long. 37. lat. 46. 25.
BAYANISME ou BAIANISME, s. m. (Hist. ecclés. & Théol.) erreur de Baïus & de ses disciples.
Michel Baïus ou de Bay, né en 1513 à Melin, dans le territoire d’Ath en Haynault, après avoir étudié à Louvain & passé successivement par tous les grades de cette université, y reçut le bonnet de docteur en 1550, & fut nommé l’année suivante, par Charles V. pour y remplir une chaire d’Écriture sainte, avec Jean Hessels, son compagnon d’étude & son ami. Il enseigna dans ses écrits & fit imprimer diverses erreurs sur la grace, le libre arbitre, le péché originel, la charité, la mort de Jesus-Christ, &c. Elles sont contenues dans 76 propositions, condamnées d’abord en 1567 par le pape Pie V.
On peut rapporter toutes les propositions de Baïus à trois chefs principaux. Les unes regardent l’état d’innocence ; les autres l’état de nature tombée ou corrompue par le péché ; & les autres enfin l’état de nature réparée par le fils de Dieu fait homme & mort en croix.
1o. Les anges & les hommes sont sortis des mains de Dieu justes & innocens : mais Baïus & ses disciples ont prétendu que la destination des anges & du premier homme à la béatitude céleste, que les graces qui les menoient de proche en proche à cette derniere fin, que les mérites qui résultoient de ces graces, & la récompense qui étoit attachée à ces mérites, n’étoient pas proprement des bienfaits non dûs ou des dons gratuits ; que ces dons étoient inséparables de la condition des anges & du premier homme, & que Dieu ne les leur devoit pas moins qu’il devoit à ce dernier la vûe, l’oüie, & les autres facultés naturelles. Tout cela est appuyé sur ce principe fondamental de Baïus, que ce n’est point par une destination accidentelle & arbitraire que la vision ou joüissance intuitive de Dieu a été préparée aux anges & au premier homme, mais en vertu du droit de leur création dans l’état d’innocence, & par une suite de leur condition naturelle : qu’une créature raisonnable & sans tache ne peut avoir d’autre fin que la vision intuitive de son Créateur ; que par conséquent Dieu n’a pû, sans être lui-même l’auteur du péché, créer les anges & le premier homme que dans un état exclusif de tout crime, ni par conséquent les destiner qu’a la béatitude céleste : que cette destination étoit à la vérité un don de Dieu, mais un don que Dieu ne pouvoit leur refuser sans déroger à sa bonté, à sa sainteté, à sa justice. Telle est la doctrine de Baïus dans son livre de primâ hominis justitiâ, sur-tout chap. viij. & elle est exprimée dans les propositions 21, 23, 24, 26, 27, 55, 71, & 72, condamnées par la bulle de Pie V. 2o. Si Dieu n’a pû créer les anges & l’homme dans ce premier état, sans cette destination essentielle, il est évident qu’il a été dans l’obligation indispensable de leur départir les moyens nécessaires pour arriver à leur fin ; d’où il résulte que toutes les graces, soit actuelles soit habituelles, qu’ils ont reçûes dans l’état d’innocence, leur étoient dûes comme une suite naturelle de leur création. 3o. Que les mérites des vertus & des bonnes actions étoient de même espece, c’est-à-dire, naturels, ou ce qui revient au même, le fruit de la premiere création. 4o. Que la félicité éternelle attachée à ces mérites étoit de même ordre, c’est-à-dire une pure rétribution, où la libéralité gratuite de Dieu n’entroit pour rien ; en un mot qu’elle étoit une récompense & non pas une grace. Dans ce système, les dons divins gratuits n’avoient donc point de lieu dans l’économie du salut des anges & du premier homme, puisque tout y étoit dû & un apanage nécessaire de la nature innocente. 5°. Enfin, par rapport à cet état Baïus & ses disciples ont erré sur ce qui concerne la connoissance des devoirs, l’exemption des souffrances, & l’immortalité, en soûtenant que l’homme innocent étoit à l’abri de l’ignorance, des peines & de la mort en vertu de sa création, & que l’exemption de tous ces maux étoit une dette que Dieu payoit à l’état d’innocence ou un ordre établi par la loi naturelle toujours invariable, parce qu’elle a pour objet ce qui est essentiellement bon & juste. C’est la doctrine expresse des propositions 53, 69, 70, & 75 de Baïus. Voyez le P. Duchesne, hist. du Baïanisme, liv. II. pag. 177. 180. & liv. IV. pag. 356. & 361. & le traité historique & dogmatique sur la doctrine de Baïus, par l’abbé de la Chambre, tom. I. chap. ij. pag. 49. & suiv.
II°. Quant à l’état de nature tombée, voici les erreurs de Baïus & de ses sectateurs sur la nature du péché originel, sa transfusion, & ses suites. 1°. Dans leur système le peché originel n’est autre chose que la concupiscence habituelle dominante. 2°. Cette idée supposée, la transfusion du péché d’Adam n’est plus un mystere qui révolte la raison ; ce n’est plus l’effet du violement d’une loi de Dieu qui ait attaché le sort des hommes à la fidélité de leur premier pere. Ce péché se transmet de la même maniere que l’aveuglement, la goutte, & les autres mauvaises qualités physiques de ceux dont on tient la naissance : cette communication se fait indépendamment de tout arrangement arbitraire de la part de Dieu ; tout péché par sa nature ayant la force d’infecter le transgresseur & toute sa postérité, comme a fait le péché originel, prop. 50. & cependant ce dernier est en nous sans aucun rapport à la volonté du premier pere, prop. 46. Sur les suites du péché originel Baïus dit, 1°. que le libre arbitre sans la grace n’a de forces que pour pécher, prop. 28. 2°. qu’il ne peut éviter aucun péché, prop. 29. que tout ce qui en sort, même l’infidélité négative, est un péché ; que l’esclave du péché obéit toûjours à la cupidité dominante ; que jusqu’à ce qu’il agisse par l’impression de la charité, toutes ses actions partent de la cupidité & sont des péchés. Prop. 34. 36. 64. 68. &c. 3°. qu’il ne peut y avoir en lui aucun amour légitime dans l’ordre naturel, pas même de Dieu, aucun acte de justice, aucun bon usage du libre arbitre, ce qui paroît dans les infideles, dont toutes les actions sont des péchés, comme les vertus des philosophes sont des vices. Prop. 25. & 26. Ainsi, selon Baïus, la nature tombée & destituée de la grace est dans une impuissance générale à tout bien, & toûjours déterminée au mal que sa cupidité dominante lui propose. Il ne lui reste ni liberté de contrariété, ni liberté de contradiction exempte de nécessité : incapable d’aucun bien, elle ne peut produire d’action qui ne soit un péché ; & nécessitée au mal, elle s’y porte au gré du penchant qui la domine, & n’en est ni moins criminelle ni moins punissable devant Dieu. Voyez le P. Duchesne, hist. du Baïanisme, liv. II pag. 180. 182. & liv. IV. pag. 361. & 367. & le traité historique & dogmatique déjà cité, pag. 54. & suiv.
III°. Les erreurs de Baïus, d’Hessels, & de leurs sectateurs, ne sont pas moins frappantes quant à l’état de nature réparée par le rédempteur : ils disent formellement, que la rétribution de la vie éternelle s’accorde aux bonnes actions, sans avoir égard aux mérites de Jesus-Christ ; qu’elle n’est pas même, à proprement parler, une grace de Dieu, mais l’effet & la suite de la loi naturelle, par laquelle il a été établi par un juste jugement de Dieu, dès la premiere institution du genre humain, que le royaume céleste seroit le salaire de l’obéissance à la loi ; que toute bonne œuvre est de sa nature méritoire du ciel, comme toute mauvaise est de sa nature méritoire de la damnation ; que les bonnes œuvres ne tirent pas leur mérite de la grace d’adoption, mais uniquement de leur conformité à la loi ; que le mérite ne se prend pas de l’état de grace, mais seulement de l’obéissance à la loi ; que les bonnes actions des catéchumenes, qui précedent la remission de leurs péchés, comme la foi & la penitence, méritent la vie éternelle. Prop. 11. 12. 13. 18. 69.
La justification des adultes, selon Baïus, de justif. cap. viij. & de justit. cap. iij. & iv. consiste dans la pratique des bonnes œuvres & la rémission des péchés. La rémission des péchés peut s’entendre de la coulpe & de la peine éternelle ou temporelle : l’obéissance à la loi justifie sans remettre la peine éternelle ; pour la coulpe, elle passe avec la peine du péché. En conséquence les Baiamstes ont avancé, que le pécheur pénitent n’est point vivifié par le ministere du prêtre qui l’absout, & qu’il n’en reçoit que la remission de la peine ; que les sacremens de baptême & de pénitence ne remettent point la coulpe, mais la peine seulement ; qu’ils ne conferent point la grace sanctifiante ; qu’il peut y avoir dans les pénitens & les catéchumenes une charité parfaite, sans que leurs péchés leur soient remis ; que la charité, qui est la plénitude de la loi, n’est pas toûjours jointe avec la rémission des péchés ; que le catéchumene vit dans la justice avant que d’avoir obtenu la rémission de ses péchés ; qu’un homme en péché mortel peut avoir une charité même parfaite, sans cesser d’être sujet à la damnation éternelle ; parce que la contrition, meme parfaite, jointe à la charité & au desir du sacrement, ne remet point la dette de la peine éternelle, hors le cas de nécessité ou de martyre, sans la réception actuelle du sacrement. Prop. 31. 54. 55. 67. 68. &c.
Comme dans le système de Baïus on est formellement justifié par l’obéissance à la loi, ce docteur & ses disciples disent qu’ils ne reconnoissent d’autre obéissance à la loi que celle qui coute de l’esprit de charité ; Prop. 6. point d’amour légitime dans la créature raisonnable, que cette loüable charité que le S. Esprit répand dans le cœur, & par laquelle on aime Dieu ; & que tout autre amour est cette cupidité vicieuse qui attache au monde, & que S. Jean réprouve. Prop. 38.
Enfin leur doctrine n’est pas moins erronée sur le mérite & la valeur des bonnes œuvres, puisqu’ils avancent d’un côté que dans l’état de la nature réparée il n’y a point de vrais mérites qui ne soient gratuitement conférés à des indignes ; & que de l’autre ils prétendent que les bonnes œuvres des fideles qui les justifient, ne peuvent pas satisfaire à la justice de Dieu pour les peines temporelles qui restent à expier après la remission des péchés, ni les expier ex condigno : ces peines, selon eux, ne pouvant pas être rachetées, même par les souffrances des Saints. Prop. 8. 57. 74. Voyez les auteurs cités ci-dessus : voyez aussi l’abrégé du Trait. de la grace de Tournely par M. Montagne, doct. de Sorb. de la maison de S. Sulpice.
Ce système, comme le remarque solidement ce dernier théologien, est un composé bisarre & monstrueux de Pélagianisnme, quant à ce qui regarde l’état de nature innocente, & de Luthéranisme & de Calvinisme pour ce qui concerne l’état de nature tombée. Quant à l’état de nature réparée, tous les sentimens de Baïus, sur-tout sur la justification, l’efficace des sacremens, & le mérite des bonnes œuvres, sont si directement opposés à la doctrine du concile de Trente, qu’ils ne pouvoient éviter les différentes censures qu’ils ont essuyées.
En effet, dès 1552 Ricard Tapper, Josse Ravestein, Richtou, Cuner, & d’autres docteurs de Louvain, s’éleverent contre Baïus & Hessels, qui répandoient les premieres semences de leurs opinions. En 1560, deux gardiens des Cordeliers de Flandre en déférerent 18 articles à la faculté de Théologie de Paris, qui les condamna par sa censure du 27 Juin de la même année. En 1567 parut la bulle de Pie V. du premier Octobre, portant condamnation de 76 propositions qu’elle censuroit in globo, mais sans nommer Baïus. Le cardinal de Granvelle, chargé de l’exécution de ce decret, l’envoya à Morillon son vicaire général, qui le présenta à l’université de Louvain le 29 Décembre 1567. La bulle fut reçûe avec respect, & Baïus même parut d’abord s’y soûmettre : mais ensuite il écrivit une longue apologie de sa doctrine qu’il adressa au pape, avec une lettre du 8 Janvier 1569. Pie V. après un mûr examen, confirma le 13 Mai suivant son premier jugement, & écrivit un bref à Baïus pour l’engager à se soûmettre sans tergiversation. Baïus hésita quelque tems, & se soûmit enfin en donnant à Morillon une révocation des propositions condamnées. Mais après la mort de Josse Ravestein, arrivée en 1570, Baïus & ses disciples remuerent de nouveau : Grégoire XIII. pour mettre fin à ces troubles, donna une bulle le 29 Janvier 1579, en confirmation de celle de Pie V. son prédécesseur, & choisit pour la faire accepter par l’université de Louvain, François Tolet Jésuite, & depuis cardinal. Baïus rétracta alors ses propositions, & de vive voix, & par un écrit signé de sa main, & daté du 24 Mars 1580. Dans les huit années suivantes qui s’écoulerent jusqu’à la mort de Baïus, les contestations se réveillerent, & ne furent enfin assoupies que par un corps de doctrine dressé par les Théologiens de Louvain, & adopté par ceux de Douai. Jacques Janson, professeur de Théologie à Louvain, voulut ressusciter les opinions de Baïus, & en chargea le fameux Cornélius Jansénius, son éleve, qui dans son ouvrage intitulé Augustinus, a renouvellé les principes & la plûpart des erreurs de Baïus. Voyez l’histoire du Baianisme par le P. Duchesne, qui rapporte tous ces évenemens dans un détail que la nature de cet ouvrage ne nous permet pas d’imiter. Voy. Jansénisme. (G)
BAYART, s. m. terme de Riviere, instrument qui sert à deux hommes pour porter différens fardeaux.
BAYE ou BAIE, s. f. (Marine.) c’est un bras de mer qui se jette entre deux terres, & qui s’y termine en cul-de-sac, par un ventre ou enfoncement plus grand que celui de l’ance, & plus petit que celui du golphe. Voyez Baie. (Z)
Bayes, s. f. (Marine.) bayes d’un vaisseau, ce sont les ouvertures qui se sont dans sa charpente, comme celles des écoutilles, les trous par où les mâts passent, &c. (Z)
* Baye de tous les saints, (Géog.) grande baie sur la côte méridionale du Brésil, proche Saint-Salvador.
* BAYELTE, s. f. (Commerce.) espece de flanelle grossiere & fort large dont on fabrique en plusieurs endroits de France : elle est faite de laine non croisée, fort lâche, & tirée à poil d’un côté.
* BAYEUX, (Géog.) ville de France dans la Normandie, capitale du Bessin, sur la riviere d’Aure. Long. 16. 57. 9. lat. 49. 16. 30.
* BAYON, (Géog.) ville de Lorraine sur la Moselle, à cinq lieues de Nancy.
* BAYONNE, voyez Baionne.
BAYONNETTE, s. f. (Art milit.) dague courte, large, façonnée en forme de lancette, ayant au lieu de poignée un manche creux de fer, pour la fixer au bout d’un mousquet, de sorte qu’elle n’empeche ni de tirer ni de charger.
Les bayonnettes sont d’un grand usage aux dragons & aux fusiliers, lorsqu’ils ont consommé leurs provisions de poudre & de balles.
On dit que la bayonnette a été inventée à Bayonne. Les troupes françoises sont très-redoutables, la bayonnette au bout du fusil.
On se sert du même instrument à la chasse du sanglier : mais on le fait plus grand pour cet exercice que pour le service militaire. (Q)
* BAZ, (Géog.) petite île à l’occident de l’Irlande, vis-à-vis le comté de Desmond en Mommonie, au nord de la baie de Dingle. Les Irlandois la nomment Blasquo.
* BAZA ou BASA, (Géog.) ville d’Espagne au royaume de Grenade près du Guadalentin, sur les limites de la Murcie & de la Castille.
* BAZAC, s. m. (Commerce.) coton filé très-beau & très-fin qui vient de Jérusalem, ce qui l’a fait appeller coton de Jérusalem : il y a le demi & le moyen bazac, qui sont d’une qualité fort inférieure au bazac simple ou de la premiere sorte.
* BAZADOIS, (le) Géog. province de France qui fait partie de la basse Gascogne, entre la Guienne propre, l’Agénois, & le Condomois. Bazas en est la capitale.
BAZAR ou BAZARI, (Commerce.) lieu destiné au commerce parmi les Orientaux, particulierement chez les Persans. Les uns sont découverts, comme les marchés d’Europe, & servent aux mêmes usages, mais seulement pour y vendre les marchandises les moins précieuses & de plus grand volume ; les autres sont couverts de voûtes fort élevées, & percées par des especes de dômes qui y donnent du jour : c’est dans ces derniers où les marchands de pierreries, de riches étoffes, d’orfévrerie, & d’autres semblables marchandises, ont leurs boutiques : quelquefois même les esclaves s’y vendent, quoique ce barbare commerce se fasse aussi dans les bazars découverts. Furetiere dit que ce terme est purement Arabe, & signifie achat & échange de marchandise, & se dit par extension des lieux où se fait le trafic.
Le bazar ou maidan d’Ispaham est une des plus belles places de toute la Perse, & surpasse même toutes celles qu’on voit en Europe : mais nonobstant sa grande magnificence, il faut avoüer que le bazar de Tauris est la place la plus vaste que l’on connoisse : on y a plusieurs fois rangé trente mille hommes en bataille. Il contient plus de quinze mille boutiques, & passe sans contredit pour le plus superbe de la Perse. On appelle dans cette derniere ville le bazar des pierreries, kaiserié, c’est-à-dire, marché royal. V. Maidan . (G)
* BAZARIE, (Hist. anc. & Géog.) province des Scythes dont les habitans formoient des parcs de bêtes fauves & d’autres animaux : ils choisissoient pour cet effet de grandes forêts arrosées d’eau, ils les fermoient de murailles, & les garnissoient de tours où les chasseurs se retiroient. Alexandre le grand entra dans un de ces parcs où l’on n’avoit point chassé depuis quatre cents ans, & y fut attaqué par un lion qu’il eut le bonheur de tuer.
* BAZAS, (Géog.) ville de France, capitale du Bazadois en Gascogne, sur un rocher. Lon. 17. 20. lat. 44. 20.
* BAZAT, s. m. coton qui vient de Leyde : il y a le bazat de la premiere sorte, l’ordinaire & le moyen. Le premier est le plus beau.
* BAZIOTHIA, (Géog. sainte.) ville de la Palestine dans la tribu de Juda. Samson croit que c’est la même que Bethsabée.
* BAZUNA, (Géog.) ville maritime de l’Océan éthiopique ou oriental, située entre les Cafres & le Zanguebar. On dit que ses habitans ne se nourrissent que de serpens & de grenouilles.
BAZZARUCO, voyez Basaruco.
BAZZO, s. m. (Commerce.) petite monnoie de billon qui a cours en Allemagne : elle a differentes empreintes, selon les différens états. Elle vaut un sou six deniers quatre cinquiemes argent de France.
BDELLIUM, (mat. Med.) gomme aromatique apportée du levant, & d’usage en Medecine. On croit que ce mot est formé de l’Hébreu bedollach, que les traducteurs ont rendu par bdellium. On écrit aussi bedellium, bedella, ptellium, petalium, megalium, & telinum.
Ce nom se trouve dans les anciens Naturalistes & dans l’Ecriture : mais y est-il pris dans le même sens que dans nos langues ? cela est fort douteux. Moyse dit que la manne est de la couleur du bdellium ; & Josephe expliquant ce passage, prétend que c’est la gomme d’un arbre semblable à l’olivier, & que la manne dont furent nourris les Juifs dans le desert lui ressembloit. Mais Scaliger & d’autres auteurs rejettent cette conjecture, & avoüent qu’ils ignorent ce que c’est que le bdellium dont il est fait mention dans l’Ecriture. (N)
* Dioscoride en distingue de trois sortes ; l’un en larmes, transparent, semblable à la colle de taureau, gras en-dedans, facile à fondre, sans bois & sans ordure, amer au goût, odorant quand on le brûle, de la couleur de l’ongle, & produit par un arbre du pays des Sarrasins : l’autre en masses grasses, noires, sordides, de la couleur de l’aspalathe, & apporté des Indes : le troisieme, sec, résineux, livide, & tiré de la ville de Petra. Galien reconnoît deux bdellium ; l’Arabique, & le Scythique. Pline dit qu’il y a dans la Bactriane un arbre noir, de la grandeur de l’olivier, avec la feuille du chêne, & la forme & le fruit du figuier sauvage, appellé bdellium, & donnant une gomme transparente semblable à la cire, odorante, grasse au toucher, amere au goût, mais sans acreté : il ajoûte qu’il y avoit aussi de cette gomme dans l’Arabie, aux Indes, dans la Médie, & à Babylone.
Si l’histoire du bdellium est très-obscure dans les anciens, elle n’est pas plus claire dans les modernes : il y en a qui le confondent avec la myrrhe, d’autres avec la gomme animé ; il y en a même qui font signifier au mot bdellium, escarboucle, ou crystal.
G. Bauhin en compte six especes différentes. Dale le décrit ou comme une substance gemmeuse & résineuse, grasse, ténace, gluante, noirâtre, & ressemblant à la myrrhe, dont elle imite la couleur & le goût, & il fait venir ce bdellium de l’Arabie, de la Medie & des Indes : ou comme une substance résineuse, un peu dure, noirâtre, friable, en gouttes durcies, de la même odeur & du même goût que la précédente ; & il le fait venir de Ganea. Pomet prétend qu’on a dans les boutiques sous le nom de bdellium des résines d’especes différentes : mais M. Geoffroi dit que le bdellium des boutiques est la même chose que la premiere espece de Dale, & qu’il n’y a rien de certain sur l’arbre qui le porte.
* BEALT, (Géog.) petite ville d’Angleterre dans la principauté de Galles, sur la riviere de Vye.
* BEAN, (Géog. sainte) ville de la tribu de Gad, dont les habitans tourmenterent cruellement les Juifs dans le tems des guerres des Macédoniens. Elle fut détruite par Judas Machabée.
* BEAT, (S.) Géog. petite ville de France au comté de Comminges, au confluent de la Garonne & de la Pique : toutes les maisons y sont bâties de marbre. Long. 18. 16. lat. 42. 50.
BEATIFICATION, s. f. (Théol.) acte par lequel le pape déclare qu’une personne, dont la vie a été sainte, accompagnée de quelques miracles, &c. joüit après sa mort du bonheur éternel. La béatification differe de la canonisation en ce que dans la premiere le pape n’agit pas comme juge, en déterminant l’état du béatifié, mais seulement en ce qu’il accorde à certaines personnes, comme à un ordre religieux, à une communauté, &c. le privilége de rendre au béatifié un culte particulier, qu’on ne peut regarder comme superstitieux, dès qu’il est muni de sceau de l’autorité pontificale ; au lieu que dans la canonisation, le pape parle comme juge, & détermine ex cathedrâ l’état du nouveau saint.
La cérémonie de la béatification a été introduite lorsqu’on a pensé qu’il étoit à propos de permettre à un ordre ou une communauté, de rendre un culte particulier au sujet proposé pour être canonisé, avant que d’avoir une pleine connoissance de la vérité des faits, & à cause de la longueur des procédures qu’on observe dans la canonisation. V. Canonisation. (G)
* BEATITUDE, BONHEUR, FELICITÉ, (Gramm.) termes relatifs à la condition d’un être qui pense & qui sent. Le bonheur marque un homme riche des biens de la fortune ; la félicité, un homme content de ce qu’il en a ; la béatitude, l’état d’une ame que la présence immédiate de son Dieu remplit dans ce monde-ci ou dans l’autre ; état qui seroit au-dessus de toute expression sans doute, si nous le connoissions. Le bonheur excite l’envie ; la félicité se fait sentir à nous seuls ; la béatitude nous attend dans une autre vie. La joüissance des biens fait la félicité ; leur possession le bonheur ; la béatitude réveille une idée d’extase & de ravissement, qu’on n’éprouve ni dans le bonheur, ni dans la félicité de ce monde. C’est aux autres à faire notre bonheur ; notre félicité dépend davantage de nous ; il n’y a que Dieu qui puisse nous conduire à la béatitude. Le bonheur est pour les riches, dit M. l’abbé Girard dans ses Synonymes ; la félicité pour les sages ; & la béatitude pour les pauvres d’esprit.
* BEAU, adj. (Métaphysique.) Avant que d’entrer dans la recherche difficile de l’origine du beau, je remarquerai d’abord, avec tous les auteurs qui en ont écrit, que par une sorte de fatalité, les choses dont on parle le plus parmi les hommes, sont assez ordinairement celles qu’on connoît le moins ; & que telle est, entre beaucoup d’autres, la nature du beau. Tout le monde raisonne du beau : on l’admire dans les ouvrages de la nature : on l’exige dans les productions des Arts : on accorde ou l’on refuse cette qualité à tout moment ; cependant si l’on demande aux hommes du goût le plus sûr & le plus exquis, quelle est son origine, sa nature, sa notion précise, sa véritable idée, son exacte définition ; si c’est quelque chose d’absolu ou de relatif ; s’il y a un beau essentiel, éternel, immuable, regle & modele du beau subalterne ; ou s’il en est de la beauté comme des modes : on voit aussitôt les sentimens partagés ; & les uns avoüent
leur ignorance, les autres se jettent dans le scepticisme.
Comment se fait-il que presque tous les hommes soient d’acord qu’il y a un beau ; qu’il y en ait tant entr’eux qui le sentent vivement où il est, & que si peu sachent ce que c’est ?
Pour parvenir, s’il est possible, à la solution de ces difficultés, nous commencerons par exposer les différens sentimens des auteurs qui ont écrit le mieux sur le beau ; nous proposerons ensuite nos idées sur le même sujet, & nous finirons cet article par des observations générales sur l’entendement humain & ses opérations relatives à la question dont il s’agit.
Platon a écrit deux dialogues du beau, le Phedre & le grand Hippias : dans celui-ci il enseigne plûtôt ce que le beau n’est pas, que ce qu’il est ; & dans l’autre, il parle moins du beau que de l’amour naturel qu’on a pour lui. Il ne s’agit dans le grand Hippias que de confondre la vanité d’un sophiste ; & dans le Phedre, que de passer quelques momens agréables avec un ami dans un lieu délicieux.
S. Augustin avoit composé un traité sur le beau : mais cet ouvrage est perdu, & il ne nous reste de S. Augustin sur cet objet important, que quelques idées éparses dans ses écrits, par lesquelles on voit que ce rapport exact des parties d’un tout entr’elles, qui le constitue un, étoit, selon lui, le caractere distinctif de la beauté. Si je demande à un architecte, dit ce grand homme, pourquoi ayant élevé une arcade à une des ailes de son bâtiment, il en fait autant à l’autre : il me répondra sans doute, que c’est afin que les membres de son architecture symmétrisent bien ensemble. Mais pourquoi cette symmétrie vous paroît-elle nécessaire ? Par la raison qu’elle plaît. Mais qui êtes-vous pour vous ériger en arbitre de ce qui doit plaire ou ne pas plaire aux hommes ? & d’où savez-vous que la symmétrie nous plaît ? J’en suis sûr, parce que les choses ainsi disposées ont de la décence, de la justesse, de la grace ; en un mot parce que cela est beau. Fort bien : mais dites-moi, cela est-il beau parce qu’il plaît ? ou cela plaît-il parce qu’il est beau ? Sans difficulté cela plait, parce qu’il est beau. Je le crois comme vous : mais je vous demande encore pourquoi cela est-il beau ? & si ma question vous embarrasse, parce qu’en effet les maîtres de votre art ne vont guere jusque là, vous conviendrez du moins sans peine que la similitude, l’égalité, la convenance des parties de votre bâtiment, réduit tout à une espece d’unité qui contente la raison. C’est ce que je voulois dire. Oui : mais prenez-y garde, il n’y a point de vraie unité dans les corps, puisqu’ils sont tous composés d’un nombre innombrable de parties, dont chacune est encore composée d’une infinité d’autres. Où la voyez-vous donc cette unité qui vous dirige dans la construction de votre dessein ; cette unité que vous regardez dans votre art comme une loi inviolable ; cette unité que votre édifice doit imiter pour être beau, mais que rien sur la terre ne peut imiter parfaitement, puisque rien sur la terre ne peut être parfaitement un. Or, de là que s’ensuit-il ? ne faut-il pas reconnoître qu’il y a au-dessus de nos esprits une certaine unité originale, souveraine, éternelle, parfaite, qui est la regle essentielle du beau, & que vous cherchez dans la pratique de votre art ? D’où S. Augustin conclut, dans un autre ouvrage, que c’est l’unité qui constitue, pour ainsi dire, la forme & l’essence du beau en tout genre. Omnis porro pulchritudinis forma, unitas est.
M. Wolf dit, dans sa Psychologie, qu’il y a des choses qui nous plaisent, d’autres qui nous déplaisent ; & que cette différence est ce qui constitue le beau & le laid : que ce qui nous plaît s’appelle beau, & que ce qui nous déplaît est laid.
Il ajoûte, que la beauté consiste dans la perfection ; de maniere que par la force de cette perfection, la chose qui en est revêtue est propre à produire en nous du plaisir.
Il distingue ensuite deux sortes de beautés, la vraie & l’apparente : la vraie est celle qui naît d’une perfection réelle ; & l’apparente, celle qui naît d’une perfection apparente.
Il est évident que S. Augustin avoit été beaucoup plus loin dans la recherche du beau que le philosophe Lebnitien : celui-ci semble prétendre d’abord qu’une chose est belle, parce qu’elle nous plait ; au lieu qu’elle ne nous plaît que parce qu’elle est belle ; comme Platon & S. Augustin l’ont très-bien remarqué. Il est vrai qu’il fait ensuite entrer la perfection dans l’idée de la beauté : mais qu’est-ce que la perfection ? le parfait est-il plus clair & plus intelligible que le beau.
Tous ceux qui se piquant de ne pas parler simplement par coûtume & sans réflexion, dit M. Crouzas, voudront descendre dans eux-mêmes, & faire attention à ce qui s’y passe, à la maniere dont ils pensent, & à ce qu’ils sentent lorsqu’ils s’écrient cela est beau, s’appercevront qu’ils expriment par ce terme un certain rapport d’un objet, avec des sentimens agréables ou avec des idées d’approbation, & tomberont d’accord que dire cela est beau, c’est dire, j’apperçois quelque chose que j’approuve ou qui me fait plaisir.
On voit que cette définition de M. Crouzas n’est point prise de la nature du beau, mais de l’effet seulement qu’on éprouve à sa présence : elle a le même défaut que celle de M. Wolf. C’est ce que M. Crouzas a bien senti ; aussi s’occupe-t-il ensuite à fixer les caracteres du beau : il en compte cinq, la variété, l’unité, la régularité, l’ordre, la proportion.
D’où il s’ensuit, ou que la définition de S. Augustin est incomplete, ou que celle de M. Crouzas est redondante. Si l’idée d’unité ne renferme pas les idées de variété, de régularité, d’ordre & de proportion, & si ces qualités sont essentielles au beau, S. Augustin n’a pas dû les omettre : si l’idée d’unité les renferme, M. Crouzas n’a pas dû les ajoûter.
M. Crouzas ne définit point ce qu’il entend par variété ; il semble entendre par unité, la relation de toutes les parties à un seul but ; il fait consister la régularité dans la position semblable des parties entr’elles ; il désigne par ordre une certaine dégradation de parties, qu’il faut observer dans le passage des unes aux autres ; & il définit la proportion, l’unité assaisonnée de variété, de régularité & d’ordre dans chaque partie.
Je n’attaquerai point cette définition du beau par les choses vagues qu’elle contient ; je me contenterai seulement d’observer ici qu’elle est particuliere, & qu’elle n’est applicable qu’à l’Architecture, ou tout au plus à de grands touts dans les autres genres, à une piece d’éloquence, à un drame, &c. mais non pas à un mot, à une pensée, à une portion d’objet.
M. Hutcheson, célebre professeur de Philosophie morale dans l’université de Glascou, s’est fait un système particulier : il se réduit à penser qu’il ne faut pas plus demander qu’est-ce que le beau, que demander qu’est-ce que le visible. On entend par visible, ce qui est fait pour être apperçû par l’œil ; & M. Hutcheson entend par beau, ce qui est fait pour être saisi par le sens interne du beau. Son sens interne du beau, est une faculté par laquelle nous distinguons les belles choses, comme le sens de la vûe est une faculté par laquelle nous recevons la notion des couleurs & des figures. Cet auteur & ses sectateurs mettent tout en œuvre pour démontrer la réalité & la nécessité de ce sixieme sens ; & voici comment ils s’y prennent.
1°. Notre ame, disent-ils, est passive dans le plaisir & dans le déplaisir. Les objets ne nous affectent pas précisément comme nous le souhaiterions ; les uns font sur notre ame une impression nécessaire de plaisir ; d’autres nous déplaisent nécessairement : tout le pouvoir de notre volonté se réduit à rechercher la premiere sorte d’objet, & à fuir l’autre : c’est la constitution même de notre nature, quelquefois individuelle, qui nous rend les uns agréables & les autres desagréables. Voyez Peine & Plaisir.
2°. Il n’est peut-être aucun objet qui puisse affecter notre ame, sans lui être plus ou moins une occasion nécessaire de plaisir ou de déplaisir. Une figure, un ouvrage d’architecture ou de peinture, une composition de musique, une action, un sentiment, un caractere, une expression, un discours ; toutes ces choses nous plaisent ou nous déplaisent de quelque maniere. Nous sentons que le plaisir ou le déplaisir s’excite nécessairement par la contemplation de l’idée qui se présente alors à notre esprit avec toutes ses circonstances. Cette impression se fait, quoiqu’il n’y ait rien dans quelques-unes de ces idées de ce qu’on appelle ordinairement perceptions sensibles ; & dans celles qui viennent des sens, le plaisir ou le déplaisir qui les accompagne, naît de l’ordre ou du desordre, de l’arrangement ou défaut de symmétrie, de l’imitation ou de la bisarrerie qu’on remarque dans les objets ; & non des idées simples de la couleur, du son, & de l’étendue, considérées solitairement. V. Goût.
3°. Cela posé, j’appelle, dit M. Hutcheson, du nom de sens internes, ces déterminations de l’ame à se plaire ou à se déplaire à certaines formes ou à certaines idées, quand elle les considere : & pour distinguer les sens internes des facultés corporelles connues sous ce nom, j’appelle sens interne du beau, la faculté qui discerne le beau dans la régularité, l’ordre & l’harmonie ; & sens interne du bon, celle qui approuve les affections, les actions, les caracteres des agens raisonnables & vertueux. Voyez Bon.
4°. Comme les déterminations de l’ame à se plaire ou à se déplaire à certaines formes ou à certaines idées, quand elle les considere, s’observent dans tous les hommes, à moins qu’ils ne soient stupides ; sans rechercher encore ce que c’est que le beau, il est constant qu’il y a dans tous les hommes un sens naturel & propre pour cet objet ; qu’ils s’accordent à trouver de la beauté dans les figures, aussi généralement qu’à éprouver de la douleur à l’approche d’un trop grand feu, ou du plaisir à manger quand ils sont pressés par l’appetit, quoiqu’il y ait entr’eux une diversité de goûts infinie.
5°. Aussi-tôt que nous naissons, nos sens externes commencent à s’exercer & à nous transmettre des perceptions des objets sensibles ; & c’est là sans doute ce qui nous persuade qu’ils sont naturels. Mais les objets de ce que j’appelle des sens internes, ou les sens du beau & du bon, ne se présentent pas si-tôt à notre esprit. Il se passe du tems avant que les enfans refléchissent, ou du moins qu’ils donnent des indices de reflexion sur les proportions, ressemblances & symmétries, sur les affections & les caracteres : ils ne connoissent qu’un peu tard les choses qui excitent le goût ou la repugnance intérieure ; & c’est-là ce qui fait imaginer que ces facultés que j’appelle les sens internes du beau & du bon, viennent uniquement de l’instruction & de l’éducation. Mais quelque notion qu’on ait de la vertu & de la beauté, un objet vertueux ou bon est une occasion d’approbation & de plaisir, aussi naturellement que des mets sont les objets de notre appétit. Et qu’importe que les premiers objets se soient présentés tôt ou tard ? si les sens ne se développoient en nous que peu-à-peu & les uns après les autres, en seroient-ils moins des sens & des facultés ? & serions-nous bien venus à prétendre, qu’il n’y a vraiement dans les objets visibles, ni couleurs, ni figures, parce que nous aurions eu besoin de tems & d’instruction pour les-y appercevoir, & qu’il n’y auroit pas entre nous tous, deux persornes qui les y appercevroient de la même maniere ? Voyez Sens.
6°. On appelle sensations, les perceptions qui s’excitent dans notre ame à la présence des objets extérieurs, & par l’impression qu’ils font sur nos organes. Voyez Sensation. Et lorsque deux perceptions different entierement l’une de l’autre, & qu’elles n’ont de commun que le nom générique de sensation, les facultés par lesquelles nous recevons ces différentes perceptions, s’appellent des sens différens. La vûe & l’oüie, par exemple, désignent des facultés différentes, dont l’une nous donne les idées de couleur, & l’autre les idées de son : mais quelque différence que les sons ayent entr’eux, & les couleurs entr’elles, on rapporte à un même sens toutes les couleurs, & à un autre sens tous les sons ; & il paroît que nos sens ont chacun leur organe. Or si vous appliquez l’observation précédente au bon & au beau, vous verrez qu’ils sont exactement dans ce cas. Voyez Bon.
7°. Les défenseurs du sens interne entendent par beau, l’idée que certains objets excitent dans notre ame, & par le sens interne du beau, la faculté que nous avons de recevoir cette idée ; & ils observent que les animaux ont des facultés semblables à nos sens extérieurs, & qu’ils les ont même quelquefois dans un degré supérieur à nous ; mais qu’il n’y en a pas un qui donne un signe de ce qu’on entend ici par sens interne. Un être, continuent-ils, peut donc avoir en entier la même sensation extérieure que nous éprouvons, sans observer entre les objets, les ressemblances & les rapports ; il peut même discerner ces ressemblances & ces rapports sans en ressentir beaucoup de plaisir ; d’ailleurs les idées seules de la figure & des formes, &c. sont quelque chose de distinct du plaisir. Le plaisir peut se trouver où les proportions ne sont ni considérées ni connues ; il peut manquer, malgré toute l’attention qu’on donne à l’ordre & aux proportions. Comment nommerons-nous donc cette faculté qui agit en nous sans que nous sachions bien pourquoi ? sens interne.
8°. Cette dénomination est fondée sur le rapport de la faculté qu’elle désigne avec les autres facultés. Ce rapport consiste principalement en ce que le plaisir que le sens interne nous fait éprouver, est différent de la connoissance des principes. La connoissance des principes peut l’accroître ou le diminuer : mais cette connoissance n’est pas lui ni sa cause. Ce sens a des plaisirs nécessaires, car la beauté & la laideur d’un objet est toûjours la même pour nous, quelque dessein que nous puissions former d’en juger autrement. Un objet desagréable, pour être utile, ne nous en paroît pas plus beau ; un bel objet, pour être nuisible, ne nous paroît pas plus laid. Proposez-nous le monde entier, pour nous contraindre par la récompense à trouver belle la laideur, & laide la beauté ; ajoûtez à ce prix les plus terribles menaces, vous n’apporterez aucun changement à nos perceptions & au jugement du sens interne : notre bouche loüera ou blâmera à votre gré, mais le sens interne restera incorruptible.
9°. Il paroît de-là, continuent les mêmes systématiques, que certains objets sont immédiatement & par eux-mêmes, les occasions du plaisir que donne la beauté ; que nous avons un sens propre à le goûter ; que ce plaisir est individuel, & qu’il n’a rien de commun avec l’intérêt. En effet, n’arrive-t-il pas en cent occasions qu’on abandonne l’utile pour le beau ? cette généreuse préférence ne se remarque-t-elle pas quelquefois dans les conditions les plus méprisées ? Un honnête artisan se livrera à la satisfaction de faire un chef-d’œuvre qui le ruine, plûtôt qu’à l’avantage de faire un mauvais ouvrage qui l’enrichiroit.
10°. Si on ne joignoit pas à la considération de l’utile, quelque sentiment particulier, quelqu’effet subtil d’une faculté différente de l’entendement & de la volonté, on n’estimeroit une maison que pour son utilité, un jardin que pour sa fertilité, un habillement que pour sa commodité. Or cette estimation étroite des choses n’existe pas même dans les enfans & dans les sauvages. Abandonnez la nature à elle-même, & le sens interne exercera son empire : peut-être se trompera-t-il dans son objet, mais la sensation de plaisir n’en sera pas moins réelle. Une philosophie austere, ennemie du luxe, brisera les statues, renversera les obélisques, transformera nos palais en cabanes, & nos jardins en forêts : mais elle n’en sentira pas moins la beauté réelle de ces objets ; le sens interne se révoltera contr’elle, & elle sera réduite à se faire un merite de son courage.
C’est ainsi, dis-je, que Hutcheson & ses sectateurs s’efforcent d’établir la nécessité du sens interne du beau : mais ils ne parviennent qu’à démontrer qu’il y a quelque chose d’obscur & d’impénétrable dans le plaisir que le beau nous cause ; que ce plaisir semble indépendant de la connoissance des rapports & des perceptions ; que la vûe de l’utile n’y entre pour rien, & qu’il fait des enthousiastes que ni les récompenses ni les menaces ne peuvent ébranler.
Du reste, ces philosophes distinguent dans les êtres corporels un beau absolu & un beau relatif. Ils n’entendent point par un beau absolu, une qualité tellement inhérente dans l’objet, qu’elle le rende beau par lui-même, sans aucun rapport à l’ame qui le voit & qui en juge. Le terme beau, semblable aux autres noms des idées sensibles, désigne proprement, selon eux, la perception d’un esprit ; comme le froid & le chaud, le doux & l’amer, sont des sensations de notre ame, quoique sans doute il n’y ait rien qui ressemble à ces sensations dans les objets qui les excitent, malgré la prévention populaire qui en juge autrement. On ne voit pas, disent-ils, comment les objets pourroient être appellés beaux, s’il n’y avoit pas un esprit doüé du sens de la beauté pour leur rendre hommage. Ainsi par le beau absolu, ils n’entendent que celui qu’on reconnoît en quelques objets, sans les comparer à aucune chose extérieure dont ces objets soient l’imitation & la peinture. Telle est, disent-ils, la beauté que nous appercevons dans les ouvrages de la nature, dans certaines formes artificielles, & dans les figures, les solides, les surfaces ; & par beau relatif, ils entendent celui qu’on apperçoit dans des objets considérés communément comme des imitations & des images de quelques autres. Ainsi leur division a plûtôt son fondement dans les différentes sources du plaisir que le beau nous cause, que dans les objets ; car il est constant que le beau absolu a, pour ainsi dire, un beau relatif, & le beau relatif un beau absolu.
Du beau absolu, selon Hutcheson & ses sectateurs. Nous avons fait sentir, disent-ils, la nécessité d’un sens propre qui nous avertit par le plaisir de la présence du beau ; voyons maintenant quelles doivent être les qualités d’un objet pour émouvoir ce sens. Il ne faut pas oublier, ajoûtent-ils, qu’il ne s’agit ici de ces qualités que relativement à l’homme ; car il y a certainement bien des objets qui font sur eux l’impression de beauté, & qui déplaisent à d’autres animaux. Ceux-ci ayant des sens & des organes autrement conformés que les nôtres, s’ils étoient juges du beau, en attacheroient des idées à des formes toutes différentes. L’ours peut trouver sa caverne commode : mais il ne la trouve ni belle ni laide ; peut-être s’il avoit le sens interne du beau la regarderoit-il comme une retraite délicieuse. Remarquez en passant, qu’un être bien malheureux, ce seroit celui qui auroit le sens interne du beau, & qui ne reconnoîtroit jamais le beau que dans des objets qui lui seroient nuisibles : la providence y a pourvû par rapport à nous ; & une chose vraiement belle, est assez ordinairement une chose bonne.
Pour découvrir l’occasion générale des idées du beau parmi les hommes, les sectateurs d’Hutcheson examinent les êtres les plus simples, par exemple, les figures ; & ils trouvent qu’entre les figures, celles que nous nommons belles, offrent à nos sens l’uniformité dans la variété. Ils assûrent qu’un triangle équilatéral est moins beau qu’un quarré ; un pentagone moins beau qu’un exagone, & ainsi de suite, parce que les objets également uniformes sont d’autant plus beaux, qu’ils sont plus variés ; & ils sont d’autant plus variés, qu’ils ont plus de côtés comparables. Il est vrai, disent-ils, qu’en augmentant beaucoup le nombre des côtés, on perd de vûe les rapports qu’ils ont entr’eux & avec le rayon ; d’où il s’ensuit que la beauté de ces figures n’augmente pas toûjours comme le nombre des côtés. Ils se font cette objection, mais ils ne se soucient guere d’y répondre. Ils remarquent seulement que le défaut de parallélisme dans les côtés des eptagones & des autres polygones impairs en diminue la beauté : mais ils soûtiennent toûjours que, tout étant égal d’ailleurs, une figure réguliere à vingt côtés surpasse en beauté celle qui n’en a que douze ; que celle-ci l’emporte sur celle qui n’en a que huit, & cette derniere sur le quarré. Ils font le même raisonnement sur les surfaces & sur les solides. De tous les solides réguliers, celui qui a le plus grand nombre de surfaces est pour eux le plus beau, & ils pensent que la beauté de ces corps va toûjours en décroissant jusqu’à la pyramide réguliere.
Mais si entre les objets également uniformes, les plus variés sont les plus beaux ; selon eux, réciproquement entre les objets également variés, les plus beaux seront les plus uniformes : ainsi le triangle équilatéral ou même isoscele est plus beau que le scalene ; le quarré plus beau que le rhombe ou losange. C’est le même raisonnement pour les corps solides réguliers, & en général pour tous ceux qui ont quelque uniformité, comme les cylindres, les prismes, les obélisques, &c. & il faut convenir avec eux, que ces corps plaisent certainement plus à la vûe que des figures grossieres où l’on n’apperçoit ni uniformité, ni symmétrie, ni unité.
Pour avoir des raisons composées du rapport de l’uniformité & de la variété, ils comparent les cercles & les spheres avec les ellipses & les sphéroïdes peu excentriques ; & ils prétendent que la parfaite uniformité des uns est compensée par la variété des autres, & que leur beauté est à peu près égale.
Le beau, dans les ouvrages de la nature, a le même fondement selon eux. Soit que vous envisagiez, disent-ils, les formes des corps célestes, leurs révolutions, leurs aspects ; soit que vous descendiez des cieux sur la terre, & que vous considériez les plantes qui la couvrent, les couleurs dont les fleurs sont peintes, la structure des animaux, leurs especes, leurs mouvemens, la proportion de leurs parties, le rapport de leur méchanisme à leur bien être ; soit que vous vous élanciez dans les airs & que vous examiniez les oiseaux & les météores ; ou que vous vous plongiez dans les eaux & que vous compariez entre eux les poissons, vous rencontrerez par-tout l’uniformité dans la variété, par-tout vous verrez ces qualités compensées dans les êtres également beaux, & la raison composée des deux, inégale dans les êtres de beauté inégale ; en un mot, s’il est permis de parler encore la langue des Géometres, vous verrez dans les entrailles de la terre, au fond des mers, au haut de l’atmosphere, dans la nature entiere & dans chacune de ses parties, l’uniformité dans la variété, & la beauté toûjours en raison composée de ces deux qualités.
Ils traitent ensuite de la beauté des Arts, dont on ne peut regarder les productions comme une véritable imitation, telle que l’Architecture, les Arts méchaniques, & l’harmonie naturelle ; ils font tous leurs efforts pour les assujettir à leur loi de l’uniformité dans la variété ; & si leur preuve peche, ce n’est pas par le défaut de l’énumération, ils descendent depuis le palais le plus magnifique jusqu’au plus petit édifice, depuis l’ouvrage le plus prétieux jusqu’aux bagatelles, montrant le caprice par-tout où manque l’uniformité, & l’insipidité où manque la variété.
Mais il est une classe d’êtres fort différens des précédens, dont les sectateurs d’Hutcheson sont fort embarrassés ; car on y reconnoît de la beauté, & cependant la regle de l’uniformité dans la variété ne leur est pas applicable ; ce sont les démonstrations des vérités abstraites & universelles. Si un théorème contient une infinité de vérités particulieres qui n’en sont que le développement, ce théoreme n’est proprement que le corollaire d’un axiome d’où découle une infinité d’autres théoremes ; cependant on dit voilà un beau théorème, & l’on ne dit pas voilà un bel axiome.
Nous donnerons plus bas la solution de cette difficulté dans d’autres principes. Passons à l’examen du beau relatif, de ce beau qu’on apperçoit dans un objet considéré comme l’imitation d’un original, selon, ceux de Hutcheson & de ses sectateurs.
Cette partie de son système n’a rien de particulier. Selon cet auteur, & selon tout le monde, ce beau ne peut consister que dans la conformité qui se trouve entre le modele & la copie.
D’où il s’ensuit que pour le beau relatif, il n’est pas nécessaire qu’il y ait aucune beauté dans l’original. Les forêts, les montagnes, les précipices, le cahos, les rides de la vieillesse, la pâleur de la mort, les effets de la maladie, plaisent en peinture ; ils plaisent aussi en Poësie : ce qu’Aristote appelle un caractere moral, n’est point celui d’un homme vertueux ; & ce qu’on entend par fabula bene morata, n’est autre chose qu’un poëme épique ou dramatique, où les actions, les sentimens, & les discours sont d’accord avec les caracteres bons ou mauvais.
Cependant on ne peut nier que la peinture d’un objet qui aura quelque beauté absolue, ne plaise ordinairement davantage que celle d’un objet qui n’aura point ce beau. La seule exception qu’il y ait peut-être à cette regle, c’est le cas où la conformité de la peinture avec l’état du spectateur gagnant tout ce qu’on ôte à la beauté absolue du modele, la peinture en devient d’autant plus intéressante ; cet intérêt qui naît de l’imperfection, est la raison pour laquelle on a voulu que le héros d’un poëme épique ou héroïque ne fût point sans défaut.
La plûpart des autres beautés de la poesie & de l’éloquence suivent la loi du beau relatif. La conformité avec le vrai rend les comparaisons, les métaphores, & les allégories belles, lors même qu’il n’y a aucune beauté absolue dans les objets qu’elles représentent.
Hutcheson insiste ici sur le penchant que nous avons à la comparaison. Voici selon lui quel en est l’origine. Les passions produisent presque toûjours dans les animaux les mêmes mouvemens qu’en nous ; & les objets inanimés de la nature, ont souvent des positions qui ressemblent aux attitudes du corps humain, dans certains états de l’ame ; il n’en a pas fallu davantage, ajoûte l’auteur que nous analysons, pour rendre le lion symbole de la fureur, le tigre celui de la cruauté ; un chêne droit, & dont la cime orgueilleuse s’éleve jusques dans la nue, l’emblème de l’audace ; les mouvemens d’une mer agitée, la peinture des agitations de la colere ; & la mollesse de la tige d’un pavot, dont quelques gouttes de pluie on fait pencher la tête, l’image d’un moribond.
Tel est le système de Hutcheson, qui paroîtra sans doute plus singulier que vrai. Nous ne pouvons cependant trop recommander la lecture de son ouvrage, sur-tout dans l’original ; on y trouvera un grand nombre d’observations délicates sur la maniere d’atteindre la perfection dans la pratique des beaux Arts. Nous allons maintenant exposer les idées du pere André Jésuite. Son essai sur le beau est le système le plus suivi, le plus étendu, & le mieux lié que je connoisse. J’oserois assûrer qu’il est dans son genre ce que le traité des beaux Arts réduits à un seul principe est dans le sien. Ce sont deux bons ouvrages auxquels il n’a manqué qu’un chapitre pour être excellens ; & il en faut savoir d’autant plus mauvais gré à ces deux auteurs de l’avoir omis. M. l’abbé Batteux rappelle tous les principes des beaux Arts à l’imitation de la belle nature : mais il ne nous apprend point ce que c’est que la belle nature. Le pere André distribue avec beaucoup de sagacité & de philosophie le beau en général dans ses différentes especes ; il les définit toutes avec précision : mais on ne trouve la définition du genre, celle du beau en général, dans aucun endroit de son livre, à moins qu’il ne le fasse consister dans l’unité comme S. Augustin. Il parle sans cesse d’ordre, de proportion, d’harmonie, &c. mais il ne dit pas un mot de l’origine de ces idées.
Le pere André distingue les notions générales de l’esprit pur, qui nous donnent les regles éternelles du beau ; les jugemens naturels de l’ame où le sentiment se mêle avec les idées purement spirituelles, mais sans les détruire ; & les préjugés de l’éducation & de la coûtume, qui semblent quelquefois les renverser les uns & les autres. Il distribue son ouvrage en quatre chapitres. Le premier est du beau visible ; le second, du beau dans les mœurs ; le troisieme, du beau dans les ouvrages d’esprit, & le quatrieme, du beau musical.
Il agite trois questions sur chacun de ces objets ; il prétend qu’on y découvre un beau essentiel, absolu, indépendant de toute institution, même divine ; un beau naturel dépendant de l’institution du Créateur, mais indépendant de nos opinions & de nos goûts ; un beau artificiel & en quelque sorte arbitraire, mais toûjours avec quelque dépendance des loix éternelles.
Il fait consister le beau essentiel, dans la régularité, l’ordre, la proportion, la symmétrie en général ; le beau naturel, dans la régularité, l’ordre, les proportions, la symmétrie, observés dans les êtres de la nature ; le beau artificiel, dans la régularité, l’ordre, la symmétrie, les proportions observées dans nos productions méchaniques, nos parures, nos bâtimens, nos jardins. Il remarque que ce dernier beau est mêlé d’arbitraire & d’absolu. En Architecture par exemple, il apperçoit deux sortes de regles, les unes qui découlent de la notion indépendante de nous, du beau original & essentiel, & qui exigent indispensablement la perpendicularité des colonnes, le parallélisme des étages, la symmétrie des membres, le dégagement & l’élégance du dessein, & l’unité dans le tout. Les autres qui sont fondées sur des observations particulieres, que les maîtres ont faites en divers tems, & par lesquelles ils ont déterminé les proportions des parties dans les cinq ordres d’Architecture : c’est en conséquence de ces regles, que dans le toscan la hauteur de la colonne contient sept fois le diametre de sa base, dans le dorique huit fois, neuf dans l’ionique, dix dans le corinthien, & dans le composite autant ; que les colonnes ont un renflement, depuis leur naissance jusqu’au tiers du fût ; que dans les deux autres tiers, elles diminuent peu à peu en fuyant le chapiteau ; que les entre-colonnemens sont au plus de huit modules, & au moins de trois ; que la hauteur des portiques, des arcades, des portes & des fenêtres est double de leur largeur. Ces regles n’étant fondées que sur des observations à l’œil & sur des exemples équivoques, sont toûjours un peu incertaines & ne sont pas tout-à-fait indispensables. Aussi voyons nous quelquefois que les grands Architectes se mettent au-dessus d’elles, y ajoûtent, en rabattent, & en imaginent de nouvelles selon les circonstances.
Voilà donc dans les productions des Arts, un beau essentiel, un beau de création humaine, & un beau de système : un beau essentiel, qui consiste dans l’ordre ; un beau de création humaine, qui consiste dans l’application libre & dépendante de l’artiste des lois de l’ordre, ou pour parler plus clairement, dans le choix de tel ordre ; & un beau de système, qui naît des observations, & qui donne des varietés même entre les plus savans artistes ; mais jamais au préjudice du beau essentiel, qui est une barriere qu’on ne doit jamais franchir. Hic murus aheneus esto. S’il est arrivé quelquefois aux grands maîtres de se laisser emporter par leur génie au-delà de cette barriere, c’est dans les occasions rares où ils ont prévû que cet écart ajoûteroit plus à la beauté qu’il ne lui ôteroit : mais ils n’en ont pas moins fait une faute qu’on peut leur reprocher.
Le beau arbitraire se sous-divise selon le même auteur en un beau de génie, un beau de goût, & un beau de pur caprice : un beau de génie fondé sur la connoissance du beau essentiel, qui donne les regles inviolables ; un beau de goût, fondé sur la connoissance des ouvrages de la nature & des productions des grands maîtres, qui dirige dans l’application & l’emploi du beau essentiel ; un beau de caprice, qui n’étant fondé sur rien, ne doit être admis nulle part.
Que devient le système de Lucrece & des Pyrrhoniens, dans le système du pere André ? que reste-t-il d’abandonné à l’arbitraire ? presque rien : aussi pour toute réponse à l’objection de ceux qui prétendent que la beauté est d’éducation & de préjugé, il se contente de développer la source de leur erreur. Voici, dit-il, comment ils ont raisonné : ils ont cherché dans les meilleurs ouvrages des exemples de beau de caprice, & ils n’ont pas eu de peine à y en rencontrer, & à démontrer que le beau qu’on y reconnoissoit étoit de caprice : ils ont pris des exemples du beau de goût, & ils ont très-bien démontré qu’il y avoit aussi de l’arbitraire dans ce beau ; & sans aller plus loin, ni s’appercevoir que leur énumération étoit incomplete, ils ont conclu que tout ce qu’on appelle beau, étoit arbitraire & de caprice ; mais on conçoit aisément que leur conclusion n’étoit juste que par rapport à la troisieme branche du beau artificiel, & que leur raisonnement n’attaquoit ni les deux autres branches de ce beau, ni le beau naturel, ni le beau essentiel.
Le pere André passe ensuite à l’application de ses principes aux mœurs, aux ouvrages d’esprit & à la Musique ; & il démontre qu’il y a dans ces trois objets du beau, un beau essentiel, absolu & indépendant de toute institution, même divine, qui fait qu’une chose est une ; un beau naturel dépendant de l’institution du créateur, mais indépendant de nous ; un beau arbitraire, dépendant de nous, mais sans préjudice du beau essentiel.
Un beau essentiel dans les mœurs, dans les ouvrages d’esprit & dans la Musique, fondé sur l’ordonnance, la régularité, la proportion, la justesse, la décence, l’accord, qui se remarquent dans une belle action, une bonne piece, un beau concert, & qui font que les productions morales, intellectuelles & harmoniques sont unes.
Un beau naturel, qui n’est autre chose dans les mœurs, que l’observation du beau essentiel dans notre conduite, relative à ce que nous sommes entre les êtres de la nature ; dans les ouvrages d’esprit, que l’imitation & la peinture fidele des productions de la nature en tout genre ; dans l’harmonie, qu’une soumission aux lois que la nature a introduite dans les corps sonores, leur résonnance & la conformation de l’oreille.
Un beau artificiel, qui consiste dans les mœurs à se conformer aux usages de sa nation, au génie de ses concitoyens, à leurs lois ; dans les ouvrages d’esprit, à respecter les regles du discours, à connoître la langue, & à suivre le goût dominant ; dans la Musique, à insérer à propos la dissonance, à conformer ses productions aux mouvemens & aux intervalles reçûs.
D’où il s’ensuit que, selon le P. André, le beau essentiel & la vérité ne se montrent nulle part avec tant de profusion que dans l’univers ; le beau moral, que dans le philosophe chrétien ; & le beau intellectuel, que dans une tragédie accompagnée de musique & de décorations.
L’auteur qui nous a donné l’essai sur le mérite & la vertu, rejette toutes ces distinctions du beau, & prétend, avec beaucoup d’autres, qu’il n’y a qu’un beau, dont l’utile est le fondement : ainsi tout ce qui est ordonné de maniere à produire le plus parfaitement l’effet qu’on se propose, est supremement beau. Si vous lui demandez qu’est-ce qu’un bel homme, il vous répondra que c’est celui dont les membres bien proportionnés conspirent de la façon la plus avantageuse à l’accomplissement des fonctions animales de l’homme. Voy. Essai sur le mérite & la vertu, pag. 48. L’homme, la femme, le cheval, & les autres animaux, continuera-t-il, occupent un rang dans la nature : or dans la nature ce rang détermine les devoirs à remplir ; les devoirs déterminent l’organisation ; & l’organisation est plus ou moins parfaite ou belle, selon le plus ou le moins de facilité que l’animal en reçoit pour vaquer à ses fonctions. Mais cette facilité n’est pas arbitraire, ni par conséquent les formes qui la constituent, ni la beauté qui dépend de ces formes. Puis descendant de-là aux objets les plus communs, aux chaises, aux tables, aux portes, &c. il tâchera de vous prouver que la forme de ces objets ne nous plaît qu’à proportion de ce qu’elle convient mieux à l’usage auquel on les destine ; & si nous changeons si souvent de mode, c’est-à-dire, si nous sommes si peu constans dans le goût pour les formes que nous leur donnons, c’est, dira-t-il, que cette conformation la plus parfaite relativement à l’usage, est très-difficile à rencontrer ; c’est qu’il y a là une espece de maximum qui échappe à toutes les finesses de la Géométrie naturelle & artificielle, & autour duquel nous tournons sans cesse : nous nous appercevons à merveille quand nous en approchons & quand nous l’avons passé, mais nous ne sommes jamais sûrs de l’avoir atteint. De-là cette révolution perpétuelle dans les formes : ou nous les abandonnons pour d’autres, ou nous disputons sans fin sur celles que nous conservons. D’ailleurs ce point n’est pas partout au même endroit ; ce maximum a dans mille occasions des limites plus étendues ou plus étroites : quelques exemples suffiront pour éclaircir sa pensée. Tous les hommes, ajoûtera-t-il, ne sont pas capables de la même attention, n’ont pas la même force d’esprit ; ils sont tous plus ou moins patiens, plus ou moins instruits, &c. Que produira cette diversité ? c’est qu’un spectacle composé d’Académiciens trouvera l’intrigue d’Héraclius admirable, & que le peuple la traitera d’embrouillée ; c’est que les uns restraindront l’étendue d’une comédie à trois actes, & les autres prétendront qu’on peut l’étendre à sept ; & ainsi du reste. Avec quelque vraissemblance que ce système soit exposé, il ne m’est pas possible de l’admettre.
Je conviens avec l’auteur qu’il se mêle dans tous nos jugemens un coup d’œil délicat sur ce que nous sommes, un retour imperceptible vers nous-mêmes, & qu’il y a mille occasions où nous croyons n’être enchantés que par les belles formes, & où elles sont en effet la cause principale, mais non la seule, de notre admiration ; je conviens que cette admiration n’est pas toûjours aussi pure que nous l’imaginons : mais comme il ne faut qu’un fait pour renverser un système, nous sommes contraints d’abandonner celui de l’auteur que nous venons de citer, quelqu’attachement que nous ayons eu jadis pour ses idées ; & voici nos raisons.
Il n’est personne qui n’ait éprouvé que notre attention se porte principalement sur la similitude des parties, dans les choses mêmes où cette similitude ne contribue point à l’utilité : pourvû que les piés d’une chaise soient égaux & solides, qu’importe qu’ils ayent la même figure ? ils peuvent différer en ce point, sans en être moins utiles. L’un pourra donc être droit, & l’autre en pié de biche ; l’un courbe en-dehors, & l’autre en-dedans. Si l’on fait une porte en forme de bierre, sa forme paroîtra peut-être mieux assortie à la figure de l’homme qu’aucune des formes qu’on suit. De quelle utilité sont en Architecture les imitations de la nature & de ses productions ? A quelle fin placer une colonne & des guirlandes où il ne faudroit qu’un poteau de bois, ou qu’un massif de pierre ? A quoi bon ces cariatides ? Une colonne est-elle destinée à faire la fonction d’un homme, ou un homme a-t-il jamais été destiné à faire l’office d’une colonne dans l’angle d’un vestibule ? Pourquoi imite-t-on dans les entablemens, des objets naturels ? qu’importe que dans cette imitation les proportions soient bien ou mal observées ? Si l’utilité est le seul fondement de la beauté, les bas-reliefs, les cannelures, les vases, & en général tous les ornemens, deviennent ridicules & superflus.
Mais le goût de l’imitation se fait sentir dans les choses dont le but unique est de plaire ; & nous admirons souvent des formes, sans que la notion de l’utile nous y porte. Quand le propriétaire d’un cheval ne le trouveroit jamais beau que quand il compare la forme de cet animal au service qu’il prétend en tirer ; il n’en est pas de même du passant à qui il n’appartient pas. Enfin on discerne tous les jours de la beauté dans des fleurs, des plantes, & mille ouvrages de la nature dont l’usage nous est inconnu.
Je sai qu’il n’y a aucune des difficultés que je viens de proposer contre le système que je combats, à laquelle on ne puisse répondre : mais je pense que ces réponses seroient plus subtiles que solides.
Il suit de ce qui précede, que Platon s’étant moins proposé d’enseigner la vérité à ses disciples, que de desabuser ses concitoyens sur le compte des sophistes, nous offre dans ses ouvrages à chaque ligne des exemples du beau, nous montre très-bien ce que ce n’est point, mais ne nous dit rien de ce que c’est.
Que S. Augustin a réduit toute beauté à l’unité ou au rapport exact des parties d’un tout entr’elles, & au rapport exact des parties d’une partie considérée comme tout, & ainsi à l’infini ; ce qui me semble constituer plûtôt l’essence du parfait que du beau.
Que M. Wolf a confondu le beau avec le plaisir qu’il occasionne, & avec la perfection ; quoiqu’il y ait des êtres qui plaisent sans être beaux, d’autres qui sont beaux sans plaire ; que tout être soit susceptible de la derniere perfection, & qu’il y en ait qui ne sont pas suceptibles de la moindre beauté : teis sont tous les objets de l’odorat & du goût, considérés relativement à ces sens.
Que M. Crouzas en chargeant sa définition du beau, ne s’est pas apperçû que plus il multiplioit les caracteres du beau, plus il le particularisoit ; & que s’étant proposé de traiter du beau en général, il a commencé par en donner une notion, qui n’est applicable qu’à quelques especes de beaux particuliers.
Que Hutcheson qui s’est proposé deux objets, le premier d’expliquer l’origine du plaisir que nous éprouvons à la présence du beau ; & le second, de rechercher les qualités que doit avoir un être pour occasionner en nous ce plaisir individuel, & par conséquent nous paroître beau ; a moins prouvé la réalité de son sixieme sens, que fait sentir la difficulté de développer sans ce secours la source du plaisir que nous donne le beau ; & que son principe de l’uniformité dans la variété n’est pas général ; qu’il en fait aux figures de la Géométrie une application plus subtile que vraie, & que ce principe ne s’applique point du tout à une autre sorte de beau, celui des démonstrations des vérités abstraites & universelles.
Que le système proposé dans l’essai sur le mérite & sur la vertu, où l’on prend l’utile pour le seul & unique fondement du beau, est plus défectueux encore qu’aucun des précédens.
Enfin que le pere André Jésuite, ou l’auteur de l’essai sur le beau, est celui qui jusqu’à présent a le mieux approfondi cette matiere, en a le mieux connu l’étendue & la difficulté, en a posé les principes les plus vrais & les plus solides, & mérite le plus d’être lû.
La seule chose qu’on pût desirer peut-être dans son ouvrage, c’étoit de déveloper l’origine des notions qui se trouvent en nous de rapport, d’ordre, de symmétrie : car du ton sublime dont il parle de ces notions, on ne sait s’il les croit acquises & factices, ou s’il les croit innées : mais il faut ajoûter en sa faveur que la maniere de son ouvrage, plus oratoire encore que philosophique, l’éloignoit de cette discussion, dans laquelle nous allons entrer.
Nous naissons avec la faculté de sentir & de penser : le premier pas de la faculté de penser, c’est d’examiner ses perceptions, de les unir, de les comparer, de les combiner, d’appercevoir entr’elles des rapports de convenance & disconvenance, &c. Nous naissons avec des besoins qui nous contraignent de recourir à différens expédiens, entre lesquels nous avons souvent été convaincus par l’effet que nous en attendions, & par celui qu’ils produisoient, qu’il y en a de bons, de mauvais, de prompts, de courts, de complets, d’incomplets, &c. la plûpart de ces expédiens étoient un outil, une machine, ou quelqu’autre invention de ce genre : mais toute machine suppose combinaison, arrangement de parties tendantes à un même but, &c. Voilà donc nos besoins, & l’exercice le plus immédiat de nos facultés, qui conspirent aussi-tôt que nous naissons à nous donner des idées d’ordre, d’arrangement, de symmétrie, de méchanisme, de proportion, d’unité : toutes ces idées viennent des sens, & sont factices ; & nous avons passé de la notion d’une multitude d’êtres artificiels & naturels, arrangés, proportionnés, combinés, symmétrisés, à la notion positive & abstraite d’ordre, d’arrangement, de proportion, de combinaison, de rapports, de symmétrie, & à la notion abstraite & négative de disproportion, de desordre & de cahos.
Ces notions sont expérimentales comme toutes les autres : elles nous sont aussi venues par les sens ; il n’y auroit point de Dieu, que nous ne les aurions pas moins : elles ont précédé de long-tems en nous celle de son existence : elles sont aussi positives, aussi distinctes, aussi nettes, aussi réelles, que celles de longueur, largeur, profondeur, quantité, nombre : comme elles ont leur origine dans nos besoins & l’exercice de nos facultés, y eût-il sur la surface de la terre quelque peuple dans la langue duquel ces idées n’auroient point de nom, elles n’en existeroient pas moins dans les esprits d’une maniere plus ou moins étendue, plus ou moins développée, fondée sur un plus ou moins grand nombre d’expériences, appliquée à un plus ou moins grand nombre d’êtres ; car voilà toute la différence qu’il peut y avoir entre un peuple & un autre peuple, entre un homme & un autre homme chez le même peuple ; & quelles que soient les expressions sublimes dont on se serve pour désigner les notions abstraites d’ordre, de proportion, de rapports, d’harmonie ; qu’on les appelle, si l’on veut, éternelles, originales, souveraines, regles essentielles du beau ; elles ont passé par nos sens pour arriver dans notre entendement, de même que les notions les plus viles ; & ce ne sont que des abstractions de notre esprit.
Mais à peine l’exercice de nos facultés intellectuelles, & la nécessité de pourvoir à nos besoins par des inventions, des machines, &c. eurent-ils ébauché dans notre entendement les notions d’ordre, de rapports, de proportion, de liaison, d’arrangement, de symmétrie, que nous nous trouvâmes environnés d’êtres où les mêmes notions étoient, pour ainsi dire, répétées à l’infini ; nous ne pûmes faire un pas dans l’univers sans que quelque production ne les réveillât ; elles entrerent dans notre ame à tout instant & de tous côtés ; tout ce qui se passoit en nous, tout ce qui existoit hors de nous, tout ce qui subsistoit des siecles écoulés, tout ce que l’industrie, la réflexion, les découvertes de nos contemporains, produisoient sous nos yeux, continuoit de nous inculquer les notions d’ordre, de rapports, d’arrangement, de symmétrie, de convenance, de disconvenance, &c. & il n’y a pas une notion, si ce n’est peut-être celle d’existence, qui ait pû devenir aussi familiere aux hommes, que celle dont il s’agit.
S’il n’entre donc dans la notion du beau soit absolu, soit relatif, soit général, soit particulier, que les notions d’ordre, de rapports, de proportions, d’arrangement, de symmétrie, de convenance, de disconvenance ; ces notions ne découlant pas d’une autre source que celles d’existence, de nombre, de longueur, largeur, profondeur, & une infinité d’autres, sur lesquelles on ne conteste point, on peut, ce me semble, employer les premieres dans une définition du beau, sans être accusé de substituer un terme à la place d’un autre, & de tourner dans un cercle vicieux.
Beau est un terme que nous appliquons à une infinité d’êtres : mais quelque différence qu’il y ait entre ces êtres, il faut ou que nous fassions une fausse application du terme beau, ou qu’il y ait dans tous ces êtres une qualité dont le terme beau soit le signe.
Cette qualité ne peut être du nombre de celles qui constituent leur différence spécifique ; car ou il n’y auroit qu’un seul être beau, ou tout au plus qu’une seule belle espece d’êtres.
Mais entre les qualités communes à tous les êtres que nous appellons beaux, laquelle choisirons-nous pour la chose dont le terme beau est le signe ? Laquelle ? il est évident, ce me semble, que ce ne peut être que celle dont la présence les rend tous beaux ; dont la fréquence ou la rareté, si elle est susceptible de fréquence & de rareté, les rend plus ou moins beaux ; dont l’absence les fait cesser d’être beaux ; qui ne peut changer de nature, sans faire changer le beau d’espece, & dont la qualité contraire rendroit les plus beaux desagréables & laids ; celle en un mot par qui la beauté commence, augmente, varie à l’infini, décline, & disparoît : or il n’y a que la notion de rapports capable de ces effets.
J’appelle donc beau hors de moi, tout ce qui contient en soi de quoi réveiller dans mon entendement l’idée de rapports ; & beau par rapport à moi, tout ce qui réveille cette idée.
Quand je dis tout, j’en excepte pourtant les qualités relatives au goût & à l’odorat ; quoique ces qualités puissent réveiller en nous l’idée de rapports, on n’appelle point beaux les objets en qui elles résident, quand on ne les considere que relativement à ces qualités. On dit un mets excellent, une odeur délicieuse ; mais non un beau mets, une belle odeur. Lors donc qu’on dit, voilà un beau turbot, voilà une belle rose, on considere d’autres qualités dans la rose & dans le turbot que celles qui sont relatives aux sens du goût & de l’odorat.
Quand je dis tout ce qui contient en soi de quoi réveiller dans mon entendement l’idée de rapport, ou tout ce qui réveille cette idée, c’est qu’il faut bien distinguer les formes qui sont dans les objets, & la notion que j’en ai. Mon entendement ne met rien dans les choses, & n’en ôte rien. Que je pense ou ne pense point à la façade du Louvre, toutes les parties qui la composent n’en ont pas moins telle ou telle forme, & tel & tel arrangement entr’elles : qu’il y eût des hommes ou qu’il n’y en eût point, elle n’en seroit pas moins belle ; mais seulement pour des êtres possibles constitués de corps & d’esprit comme nous ; car pour d’autres, elle pourroit n’être ni belle ni laide, ou même être laide. D’où il s’ensuit que, quoiqu’il n’y ait point de beau absolu, il y a deux sortes de beau par rapport à nous, un beau réel, & un beau apperçû.
Quand je dis, tout ce qui réveille en nous l’idée de rapports, je n’entens pas que pour appeller un être beau, il faille apprétier quelle est la sorte de rapports qui y regne ; je n’exige pas que celui qui voit un morceau d’Architecture soit en état d’assûrer ce que l’Architecte même peut ignorer, que cette partie est à celle-là comme tel nombre est à tel nombre ; ou que celui qui entend un concert, sache plus quelquefois que ne sait le Musicien, que tel son est à tel son dans le rapport de 2 à 4, ou de 4 à 5. Il suffit qu’il apperçoive & sente que les membres de cette architecture, & que les sons de cette piece de musique ont des rapports, soit entr’eux, soit avec d’autres objets. C’est l’indétermination de ces rapports, la facilité de les saisir, & le plaisir qui accompagne leur perception, qui a fait imaginer que le beau étoit plûtôt une affaire de sentiment que de raison. J’ose assûrer que toutes les fois qu’un principe nous sera connu dès la plus tendre enfance, & que nous en ferons par l’habitude une application facile & subite aux objets placés hors de nous, nous croirons en juger par sentiment : mais nous serons contraints d’avoüer notre erreur dans toutes les occasions où la complication des rapports & la nouveauté de l’objet suspendront l’application du principe : alors le plaisir attendra pour se faire sentir, que l’entendement ait prononcé que l’objet est beau. D’ailleurs le jugement en pareil cas est presque toûjours du beau relatif, & non du beau réel.
Ou l’on considere les rapports dans les mœurs, & l’on a le beau moral, ou on les considere dans les ouvrages de Littérature, & on a le beau littéraire ; ou on les considere dans les pieces de Musique, & l’on a le beau musical ; ou on les considere dans les ouvrages de la nature, & l’on a le beau naturel ; ou on les considere dans les ouvrages méchaniques des hommes, & on a le beau artificiel ; ou on les considere dans les représentations des ouvrages de l’art ou de la nature, & l’on a le beau d’imitation : dans quelqu’objet, & sous quelque aspect que vous considériez les rapports dans un même objet, le beau prendra différens noms.
Mais un même objet, quel qu’il soit, peut être considéré solitairement & en lui-même, ou relativement à d’autres. Quand je prononce d’une fleur qu’elle est belle, ou d’un poisson qu’il est beau, qu’entens-je ? Si je considere cette fleur ou ce poisson solitairement ; je n’entends pas autre chose, sinon que j’apperçois entre les parties dont ils sont composés, de l’ordre, de l’arrangement, de la symmétrie, des rapports (car tous ces mots ne désignent que différentes manieres d’envisager les rapports mêmes) : en ce sens toute fleur est belle, tout poisson est beau ; mais de quel beau ? de celui que j’appelle beau réel.
Si je considere la fleur & le poisson relativement à d’autres fleurs & d’autres poissons ; quand je dis qu’ils sont beaux, cela signifie qu’entre les êtres de leur genre, qu’entre les fleurs celle-ci, qu’entre les poissons celui-là, réveillent en moi le plus d’idées de rapports, & le plus de certains rapports ; car je ne tarderai pas à faire voir que tous les rapports n’étant pas de la même nature, ils contribuent plus ou moins les uns que les autres à la beauté. Mais je puis assûrer que sous cette nouvelle façon de considérer les objets, il y a beau & laid : mais quel beau, quel laid ? celui qu’on appelle relatif.
Si au lieu de prendre une fleur ou un poisson, on généralise, & qu’on prenne une plante ou un animal ; si on particularise & qu’on prenne une rose & un turbot, on en tirera toûjours la distinction du beau relatif, & du beau réel.
D’où l’on voit qu’il y a plusieurs beaux relatifs, & qu’une tulipe peut être belle ou laide entre les tulipes, belle ou laide entre les fleurs, belle ou laide entre les plantes, belle ou laide entre les productions de la nature.
Mais on conçoit qu’il faut avoir vû bien des roses & bien des turbots, pour prononcer que ceux-ci sont beaux ou laids entre les roses & les turbots ; bien des plantes & bien des poissons, pour prononcer que la rose & le turbot sont beaux ou laids entre les plantes & les poissons ; & qu’il faut avoir une grande connoissance de la nature, pour prononcer qu’ils sont beaux ou laids entre les productions de la nature.
Qu’est-ce donc qu’on entend, quand on dit à un artiste, imitez la belle nature ? Ou l’on ne sait ce qu’on commande, ou on lui dit : si vous avez à peindre une fleur, & qu’il vous soit d’ailleurs indifférent laquelle peindre, prenez la plus belle d’entre les fleurs ; si vous avez à peindre une plante, & que votre sujet ne demande point que ce soit un chêne ou un ormeau sec, rompu, brisé, ébranché, prenez la plus belle d’entre les plantes ; si vous avez à peindre un objet de la nature, & qu’il vous soit indifférent lequel choisir, prenez le plus beau.
D’où il s’ensuit, 1°. que le principe de l’imitation de la belle nature demande l’étude la plus profonde & la plus étendue de ses productions en tout genre.
2°. Que quand on auroit la connoissance la plus parfaite de la nature, & des limites qu’elle s’est prescrites dans la production de chaque être, il n’en seroit pas moins vrai que le nombre des occasions où le plus beau pourroit être employé dans les Arts d’imitation, seroit à celui où il faut préférer le moins beau, comme l’unité est à l’infini.
3°. Que quoiqu’il y ait en effet un maximum de beauté dans chaque ouvrage de la nature, considéré en lui-même ; ou, pour me servir d’un exemple, que quoique la plus belle rose qu’elle produise, n’ait jamais ni la hauteur, ni l’étendue d’un chêne, cependant il n’y a ni beau, ni laid dans ses productions, considérées relativement à l’emploi qu’on en peut faire dans les Arts d’imitation.
Selon la nature d’un être, selon qu’il excite en nous la perception d’un plus grand nombre de rapports, & selon la nature des rapports qu’il excite, il est joli, beau, plus beau, très-beau ou laid ; bas, petit, grand, élevé, sublime, outré, burlesque ou plaisant ; & ce seroit faire un très-grand ouvrage, & non pas un article de dictionnaire, que d’entrer dans tous ces détails : il nous suffit d’avoir montré les principes ; nous abandonnons au lecteur le soin des conséquences & des applications. Mais nous pouvons lui assûrer, que soit qu’il prenne ses exemples dans la nature, ou qu’il les emprunte de la Peinture, de la Morale, de l’Architecture, de la Musique, il trouvera toûjours qu’il donne le nom de beau réel à tout ce qui contient en soi dequoi réveiller l’idée de rapports ; & le nom de beau relatif, à tout ce qui réveille des rapports convenables avec les choses, auxquelles il en faut faire la comparaison.
Je me contenterai d’en apporter un exemple, pris de la Littérature. Tout le monde sçait le mot sublime de la tragédie des Horaces, qu’il mourût. Je demande à quelqu’un qui ne connoît point la piece de Corneille, & qui n’a aucune idée de la réponse du vieil Horace, ce qu’il pense de ce trait qu’il mourût. Il est évident que celui que j’interroge ne sachant ce que c’est que ce qu’il mourût ; ne pouvant deviner si c’est une phrase complete ou un fragment, & appercevant à peine entre ces trois termes quelque rapport grammatical, me répondra que cela ne lui paroît ni beau ni laid. Mais si je lui dis que c’est la réponse d’un homme consulté sur ce qu’un autre doit faire dans un combat, il commence à appercevoir dans le répondant une sorte de courage, qui ne lui permet pas de croire qu’il soit toûjours meilleur de vivre que de mourir ; & le qu’il mourût commence à l’intéresser. Si j’ajoûte qu’il s’agit dans ce combat de l’honneur de la patrie ; que le combattant est fils de celui qu’on interroge ; que c’est le seul qui lui reste ; que le jeune homme avoit à faire à trois ennemis, qui avoient déjà ôté la vie à deux de ses freres ; que le vieillard parle à sa fille ; que c’est un Romain : alors la réponse qu’il mourût, qui n’étoit ni belle, ni laide, s’embellit à mesure que je développe ses rapports avec les circonstances, & finit par être sublime.
Changez les circonstances & les rapports, & faites passer le qu’il mourut du théatre François sur la scene Italienne, & de la bouche du vieil Horace dans celle de Scapin, le qu’il mourût deviendra burlesque.
Changez encore les circonstances, & supposez que Scapin soit au service d’un maitre dur, avare & bourru, & qu’ils soient attaqués sur un grand chemin par trois ou quatre brigands. Scapin s’enfuit ; son maître se défend : mais pressé par le nombre, il est obligé de s’enfuir aussi ; & l’on vient apprendre à Scapin que son maître a échappé au danger. Comment, dira Scapin trompé dans son attente ; il s’est donc enfui : ah le lâche ! Mais lui répondra-t-on, seul contre trois que voulois-tu qu’il fit ? qu’il mourût, répondra-t-il ; & ce qu’il mourût deviendra plaisant. Il est donc constant que la beauté commence, s’accroît, varie, décline & disparoît avec les rapports, ainsi que nous l’avons dit plus haut.
Mais qu’entendez-vous par un rapport, me demandera-t-on ? n’est-ce pas changer l’acception des termes, que de donner le nom de beau à ce qu’on n’a jamais regardé comme tel ? Il semble que dans notre langue l’idée ce beau soit toûjours jointe à celle de grandeur, & que ce ne soit pas définir le beau que de placer sa différence spécifique dans une qualité qui convient à une infinité d’êtres, qui n’ont ni grandeur, ni sublimité. M. Crouzas a péché, sans doute, lorsqu’il a chargé sa définition du beau d’un si grand nombre de caracteres, qu’elle s’est trouvée restreinte à un très-petit nombre d’êtres : mais n’est-ce pas tomber dans le défaut contraire, que de la rendre si générale, qu’elle semble les embrasser tous, sans en excepter un amas de pierres informes, jettées au hasard sur le bord d’une carriere ? Tous les objets, ajoûtera-t-on, sont susceptibles de rapports entre eux, entre leurs parties, & avec d’autres êtres ; il n’y en a point qui ne puissent être arrangés, ordonnés, symmétrisés. La perfection est une qualité qui peut convenir à tous : mais il n’en est pas de même de la beauté ; elle est d’un petit nombre d’objets.
Voilà, ce me semble, sinon la seule, du moins la plus forte objection qu’on puisse me faire, & je vais tâcher d’y répondre.
Le rapport en général est une opération de l’entendement, qui considere soit un être, soit une qualité, en tant que cet être ou cette qualité suppose l’existence d’un autre être ou d’une autre qualité. Exemple : quand je dis que Pierre est un bon pere, je considere en lui une qualité qui suppose l’existence d’une autre, celle de fils ; & ainsi des autres rapports, tels qu’ils puissent être. D’où il s’ensuit que, quoique le rapport ne soit que dans notre entendement, quant à la perception, il n’en a pas moins son fondement dans les choses ; & je dirai qu’une chose contient en elle des rapports réels, toutes les fois qu’elle sera revêtue de qualités qu’un être constitué de corps & d’esprit comme moi, ne pourroit considérer sans supposer l’existence ou d’autres êtres, ou d’autres qualités, soit dans la chose même, soit hors d’elle ; & je distribuerai les rapports en réels & en apperçus. Mais il y a une troisieme sorte de rapports ; ce sont les rapports intellectuels ou fictifs ; ceux que l’entendement humain semble mettre dans les choses. Un statuaire jette l’œil sur un bloc de marbre ; son imagination plus prompte que son ciseau, en enleve toutes les parties superflues, & y discerne une figure : mais cette figure est proprement imaginaire & fictive ; il pourroit faire sur une portion d’espace terminée par des lignes intellectuelles, ce qu’il vient d’exécuter d’imagination dans un bloc informe de marbre. Un philosophe jette l’œil sur un amas de pierres jettées au hasard ; il anéantit par la pensée toutes les parties de cet amas qui produisent l’irrégularité, & il parvient à en faire sortir un globe, un cube, une figure réguliere. Qu’est-ce que cela signifie ? Que quoique la main de l’artiste ne puisse tracer un dessein que sur des surfaces résistantes, il en peut transporter l’image par la pensée sur tout corps ; que dis-je, sur tout corps ? dans l’espace & le vuide. L’image, ou transportée par la pensée dans les airs, ou extraite par imagination des corps les plus informes, peut être belle ou laide : mais non la toile idéale à laquelle on l’a attachée, ou le corps informe dont on l’a fait sortir.
Quand je dis donc qu’un être est beau par les rapports qu’on y remarque, je ne parle point des rapports intellectuels ou fictifs que notre imagination y transporte, mais des rapports réels qui y sont, & que notre entendement y remarque par le secours de nos sens.
En revanche, je prétens que quels que soient les rapports, ce sont eux qui constitueront la beauté, non dans ce sens étroit où le joli est l’opposé du beau, mais dans un sens, j’ose le dire, plus philosophique & plus conforme à la notion du beau en général, & à la nature des langues & des choses.
Si quelqu’un a la patience de rassembler tous les êtres auxquels nous donnons le nom de beau, il s’appercevra bientôt que dans cette foule il y en a une infinité où l’on n’a nul égard à la petitesse ou la grandeur : la petitesse & la grandeur sont comptées pour rien toutes les fois que l’être est solitaire, ou qu’étant individu d’une espece nombreuse, on le considere solitairement. Quand on prononça de la premiere horloge ou de la premiere montre qu’elle étoit belle, faisoit-on attention à autre chose qu’à son méchanisme, ou au rapport de ses parties entre-elles ? Quand on prononce aujourd’hui que la montre est belle, fait-on attention à autre chose qu’à son usage & à son méchanisme. Si donc la définition générale du beau doit convenir à tous les êtres auxquels on donne cette épithete, l’idée de grandeur en est exclue. Je me suis attaché à écarter de la notion du beau, la notion de grandeur ; parce qu’il m’a semblé que c’étoit celle qu’on lui attachoit plus ordinairement. En Mathématique, on entend par un beau problème, un problème difficile à résoudre ; par une belle solution, la solution simple & facile d’un problème difficile & compliqué. La notion de grand, de sublime, d’élevé, n’a aucun lieu dans ces occasions où on ne laisse pas d’employer le nom de beau. Qu’on parcourre de cette maniere tous les êtres qu’on nomme beaux : l’un exclura la grandeur, l’autre exclura l’utilité ; un troisieme la symmétrie ; quelques-uns même l’apparence marquée d’ordre & de symmétrie ; telle seroit la peinture d’un orage, d’une tempête, d’un cahos : & l’on sera forcé de convenir, que la seule qualité commune, selon laquelle ces êtres conviennent tous, est la notion de rapports.
Mais quand on demande que la notion générale de beau convienne à tous les êtres qu’on nomme tels, ne parle-t-on que de sa langue, ou parle-t-on de toutes les langues ? Faut-il que cette définition convienne seulement aux êtres que nous appellons beaux en François, ou à tous les êtres qu’on appelleroit beaux en Hébreu, en Syriaque, en Arabe, en Chaldéen, en Grec, en Latin, en Anglois, en Italien, & dans toutes les langues qui ont existé, qui existent, ou qui existeront ? & pour prouver que la notion de rapports est la seule qui resteroit après l’emploi d’une regle d’exclusion aussi étendue, le philosophe sera-t-il forcé de les apprendre toutes ? ne lui suffit-il pas d’avoir examiné que l’acception du terme beau varie dans toutes les langues ; qu’on le trouve appliqué là à une sorte d’êtres, à laquelle il ne s’applique point ici, mais qu’en quelque idiome qu’on en fasse usage, il suppose perception de rapports ? Les Anglois disent a fine flavour, a fine woman, une belle femme, une belle odeur. Où en seroit un philosophe Anglois, si ayant à traiter du beau, il vouloit avoir égard à cette bisarrerie de sa langue ? C’est le peuple qui a fait les langues ; c’est au philosophe à découvrir l’origine des choses ; & il seroit assez surprenant que les principes de l’un ne se trouvassent pas souvent en contradiction avec les usages de l’autre. Mais le principe de la perception des rapports, appliqué à la nature du beau, n’a pas même ici ce desavantage ; & il est si général, qu’il est difficile que quelque chose lui échappe.
Chez tous les peuples, dans tous les lieux de la terre, & dans tous les tems, on a eu un nom pour la couleur en général, & d’autres noms pour les couleurs en particulier, & pour leurs nuances. Qu’auroit à faire un philosophe à qui l’on proposeroit d’expliquer ce que c’est qu’une belle couleur ? sinon d’indiquer l’origine de l’application du terme beau à une couleur en général, quelle qu’elle soit, & ensuite d’indiquer les causes qui ont pû faire préférer telle nuance à telle autre. De même c’est la perception des rapports qui a donné lieu à l’invention du terme beau ; & selon que les rapports & l’esprit des hommes ont varié, on a fait les noms joli, beau, charmant, grand, sublime, divin, & une infinité d’autres, tant relatifs au physique qu’au moral. Voilà les nuances du beau : mais j’étens cette pensée, & je dis :
Quand on exige que la notion générale de beau convienne à tous les êtres beaux, parle-t-on seulement de ceux qui portent cette épithete ici & aujourd’hui, ou de ceux qu’on a nommés beaux à la naissance du monde, qu’on appelloit beaux il y a cinq mille ans, à trois mille lieues, & qu’on appellera tels dans les siecles à venir ; de ceux que nous avons regardés comme tels dans l’enfance, dans l’âge mûr, & dans la vieillesse ; de ceux qui font l’admiration des peuples policés, & de ceux qui charment les sauvages. La vérité de cette définition sera-t-elle locale, particuliere, & momentanée ? ou s’étendra-t-elle à tous les êtres, à tous les tems, à tous les hommes, & à tous les lieux ? Si l’on prend le dernier parti, on se rapprochera beaucoup de mon principe, & l’on ne trouvera guere d’autre moyen de concilier entr’eux les jugemens de l’enfant & de l’homme fait : de l’enfant, à qui il ne faut qu’un vestige de symmétrie & d’imitation pour admirer & pour être recréé ; de l’homme fait, à qui il faut des palais & des ouvrages d’une étendue immense pour être frappé : du sauvage & de l’homme policé ; du sauvage, qui est enchanté à la vûe d’une pendeloque de verre, d’une bague de laiton, ou d’un brasselet de quincaille ; & de l’homme policé, qui n’accorde son attention qu’aux ouvrages les plus parfaits : des premiers hommes, qui prodiguoient les noms de beaux, de magnifiques, &c. à des cabanes, des chaumieres, & des granges ; & des hommes d’aujourd’hui, qui ont restreint ces dénominations aux derniers efforts de la capacité de l’homme.
Placez la beauté dans la perception des rapports, & vous aurez l’histoire de ses progrès depuis la naissance du monde jusqu’aujourd’hui : choisissez pour caractere différentiel du beau en général, telle autre qualité qu’il vous plaira, & votre notion se trouvera tout-à-coup concentrée dans un point de l’espace & du tems.
La perception des rapports est donc le fondement du beau ; c’est donc la perception des rapports qu’on a désignée dans les langues sous une infinité de noms différens, qui tous n’indiquent que différentes sortes de beau.
Mais dans la nôtre, & dans presque toutes les autres, le terme beau se prend souvent par opposition à joli ; & sous ce nouvel aspect, il semble que la question du beau ne soit plus qu’une affaire de Grammaire, & qu’il ne s’agisse plus que de spécifier exactement les idées qu’on attache à ce terme. Voyez à l’article suivant Beau opposé à Joli.
Après avoir tenté d’exposer en quoi consiste l’origine du beau, il ne nous reste plus qu’à rechercher celle des opinions différentes que les hommes ont de la beauté : cette recherche achevera de donner de la certitude à nos principes ; car nous démontrerons que toutes ces différences résultent de la diversité des rapports apperçûs ou introduits, tant dans les productions de la nature, que dans celles des arts.
Le beau qui résulte de la perception d’un seul rapport, est moindre ordinairement que celui qui résulte de la perception de plusieurs rapports. La vûe d’un beau visage ou d’un beau tableau, affecte plus que celle d’une seule couleur ; un ciel étoilé, qu’un rideau d’asur ; un paysage, qu’une campagne ouverte ; un édifice, qu’un terrein uni ; une piece de musique, qu’un son. Cependant il ne faut pas multiplier le nombre des rapports à l’infini ; & la beauté ne suit pas cette progression : nous n’admettons de rapport dans les belles choses, que ce qu’un bon esprit en peut saisir nettement & facilement. Mais qu’est-ce qu’un bon esprit ? où est ce point dans les ouvrages en-deçà duquel, faute de rapports, ils sont trop unis, & au-delà duquel ils en sont chargés par excès ? Premiere source de diversité dans les jugemens. Ici commencent les contestations. Tous conviennent qu’il y a un beau, qu’il est le résultat des rapports apperçûs : mais selon qu’on a plus ou moins de connoissance, d’expérience, d’habitude de juger, de mediter, de voir, plus d’étendue naturelle dans l’esprit, on dit qu’un objet est pauvre ou riche, confus ou rempli, mesquin ou chargé.
Mais combien de compositions où l’artiste est contraint d’employer plus de rapports que le grand nombre n’en peut saisir, & où il n’y a guere que ceux de son art, c’est-à-dire, les hommes les moins disposés à lui rendre justice, qui connoissent tout le mérite de ses productions ? Que devient alors le beau ? Ou il est présenté à une troupe d’ignorans qui ne sont pas en état de le sentir, ou il est senti par quelques envieux qui se taisent ; c’est-là souvent tout l’effet d’un grand morceau de Musique. M. d’Alembert a dit dans le Discours préliminaire de cet Ouvrage, Discours qui mérite bien d’être cité dans cet article, qu’après avoir fait un art d’apprendre la Musique, on en devroit bien faire un de l’écouter : & j’ajoûte qu’après avoir fait un art de la Poësie & de la Peinture, c’est en vain qu’on en a fait un de lire & de voir ; & qu’il régnera toûjours dans les jugemens de certains ouvrages une uniformité apparente, moins injurieuse à la vérité pour l’artiste que le partage des sentimens, mais toûjours fort affligeante.
Entre les rapports on en peut distinguer une infinité de sortes : il y en a qui se fortifient, s’affoiblissent, & se temperent mutuellement. Quelle différence dans ce qu’on pensera de la beauté d’un objet, si on les saisit tous, ou si l’on n’en saisit qu’une partie ! Seconde source de diversité dans les jugemens. Il y en a d’indéterminés & de déterminés : nous nous contentons des premiers pour accorder le nom de beau, toutes les fois qu’il n’est pas de l’objet immédiat & unique de la science ou de l’art de les déterminer. Mais si cette détermination est l’objet immédiat & unique d’une science ou d’un art, nous exigeons non-seulement les rapports, mais encore leur valeur : voilà la raison pour laquelle nous disons un beau théorème, & que nous ne disons pas un bel axiome ; quoiqu’on ne puisse pas nier que l’axiome exprimant un rapport, n’ait aussi sa beauté réelle. Quand je dis, en Mathématiques, que le tout est plus grand que sa partie, j’énonce assûrément une infinité de propositions particulieres, sur la quantité partagée : mais je ne détermine rien sur l’excès juste du tout sur ses portions ; c’est presque comme si je disois : le cylindre est plus grand que la sphere inscrite, & la sphere plus grande que le cone inscrit. Mais l’objet propre & immédiat des Mathématiques est de déterminer de combien l’un de ces corps est plus grand ou plus petit que l’autre ; & celui qui démontrera qu’ils sont toûjours entr’eux comme les nombres 3, 2, 1, aura fait un théorème admirable. La beauté qui consiste toûjours dans les rapports, sera dans cette occasion en raison composée du nombre des rapports, & de la difficulté qu’il y avoit à les appercevoir ; & le théoreme qui énoncera que toute ligne qui tombe du sommet d’un triangle isoscele sur le milieu de sa base, partage l’angle en deux angles égaux, ne sera pas merveilleux : mais celui qui dira que les asymptotes d’une courbe s’en approchent sans cesse sans jamais la rencontrer, & que les espaces formés par une portion de l’axe, une portion de la courbe, l’asymptote, & le prolongement de l’ordonnée, sont entr’eux comme tel nombre à tel nombre, sera beau. Une circonstance qui n’est pas indifférente à la beauté, dans cette occasion & dans beaucoup d’autres, c’est l’action combinée de la surprise & des rapports, qui a lieu toutes les fois que le théorème dont on a démontré la vérité passoit auparavant pour une proposition fausse.
Il y a des rapports que nous jugeons plus ou moins essentiels ; tel est celui de la grandeur relativement à l’homme, à la femme, & à l’enfant : nous disons d’un enfant qu’il est beau, quoiqu’il soit petit ; il faut absolument qu’un bel homme soit grand ; nous exigeons moins cette qualité dans une femme ; & il est plus permis à une petite femme d’être belle, qu’à un petit homme d’être beau. Il me semble que nous considérons alors les êtres, non-seulement en eux-mêmes, mais encore relativement aux lieux qu’ils occupent dans la nature, dans le grand tout ; & selon que ce grand tout est plus ou moins connu, l’échelle qu’on se forme de la grandeur des êtres est plus ou moins exacte : mais nous ne savons jamais bien quand elle est juste. Troisieme source de diversité de goûts & de jugemens dans les arts d’imitation. Les grands maîtres ont mieux aimé que leur échelle fût un peu trop grande que trop petite : mais aucun d’eux n’a la même échelle, ni peut-être celle de la nature.
L’intérêt, les passions, l’ignorance, les préjugés, les usages, les mœurs, les climats, les coûtumes, les gouvernemens, les cultes, les évenemens, empêchent les êtres qui nous environnent, ou les rendent capables de réveiller ou de ne point réveiller en nous plusieurs idées, anéantissent en eux des rapports très-naturels, & y en établissent de capricieux & d’accidentels. Quatrieme source de diversité dans les jugemens.
On rapporte tout à son art & à ses connoissances : nous faisons tous plus ou moins le rôle du critique d’Apelle ; & quoique nous ne connoissions que la chaussure, nous jugeons aussi de la jambe ; ou quoique nous ne connoissions que la jambe, nous descendons aussi à la chaussure : mais nous ne portons pas seulement ou cette témérité ou cette ostentation de détail dans le jugement des productions de l’art ; celles de la nature n’en sont pas exemptes. Entre les tulipes d’un jardin, la plus belle pour un curieux sera celle où il remarquera une étendue, des couleurs, une feuille, des variétés peu communes : mais le Peintre occupé d’effets de lumiere, de teintes, de clair obscur, de formes relatives à son art, négligera tous les caracteres que le fleuriste admire, & prendra pour modele la fleur même méprisée par le curieux. Diversité de talens & de connoissances, cinquieme source de diversité dans les jugemens.
L’ame a le pouvoir d’unir ensemble les idées qu’elle a reçûes séparément, de comparer les objets par le moyen des idées qu’elle en a, d’observer les rapports qu’elles ont entr’elles, d’étendre ou de resserrer ses idées à son gré, de considérer séparément chacune des idées simples qui peuvent s’être trouvées réunies dans la sensation qu’elle en a reçûes. Cette derniere opération de l’ame s’appelle abstraction. V. Abstraction. Les idées des substances corporelles sont composées de diverses idées simples, qui ont fait ensemble leurs impressions lorsque les substances corporelles se sont présentées à nos sens : ce n’est qu’en spécifiant en détail ces idées sensibles, qu’on peut définir les substances. Voyez Substance. Ces sortes de définitions peuvent exciter une idée assez claire d’une substance dans un homme qui ne l’a jamais immédiament apperçûe, pourvû qu’il ait autrefois reçû séparément, par le moyen des sens, toutes les idées simples qui entrent dans la composition de l’idée complexe de la substance définie : mais s’il lui manque la notion de quelqu’une des idées simples dont cette substance est composée, & s’il est privé du sens nécessaire pour les appercevoir, ou si ce sens est dépravé sans retour, il n’est aucune définition qui puisse exciter en lui l’idée dont il n’auroit pas eû précédemment une perception sensible. Voyez Définition. Sixieme source de diversité dans les jugemens que les hommes porteront de la beauté d’une description ; car combien entr’eux de notions fausses, combien de demi-notions du même objet !
Mais ils ne doivent pas s’accorder davantage sur les êtres intellectuels : ils sont tous représentés par des signes ; & il n’y a presqu’aucun de ces signes qui soit assez exactement défini, pour que l’acception n’en soit pas plus étendue ou plus resserrée dans un homme que dans un autre. La Logique & la Métaphysique seroient bien voisines de la perfection, si le Dictionnaire de la langue étoit bien fait : mais c’est encore un ouvrage à desirer ; & comme les mots sont les couleurs dont la Poësie & l’Eloquence se servent, quelle conformité peut-on attendre dans les jugemens du tableau, tant qu’on ne saura seulement pas à quoi s’en tenir sur les couleurs & sur les nuances ? Septieme source de diversité dans les jugemens.
Quel que soit l’être dont nous jugeons ; les goûts & les dégoûts excités par l’instruction, par l’éducation, par le préjugé, ou par un certain ordre factice dans nos idées, sont tous fondés sur l’opinion où nous sommes que ces objets ont quelque perfection ou quelque défaut dans des qualités, pour la perception desquelles nous avons des sens ou des facultés convenables. Huitieme source de diversité.
On peut assûrer que les idées simples qu’un même objet excite en différentes personnes, sont aussi differentes que les goûts & les dégoûts qu’on leur remarque. C’est même une vérité de sentiment ; & il n’est pas plus difficile que plusieurs personnes different entr’elles dans un même instant, relativement aux idées simples, que le même homme ne differe de lui-même dans des instans différens. Nos sens sont dans un état de vicissitude continuelle : un jour on n’a point d’yeux, un autre jour on entend mal ; & d’un jour à l’autre, on voit, on sent, on entend diversement. Neuvieme source de diversité dans les jugemens des hommes d’un même âge, & d’un même homme en différens âges.
Il se joint par accident à l’objet le plus beau des idées desagréables : si l’on aime le vin d’Espagne, il ne faut qu’en prendre avec de l’émétique pour le détester ; il ne nous est pas libre d’éprouver ou non des nausées à son aspect : le vin d’Espagne est toûjours bon, mais notre condition n’est pas la même par rapport à lui. De même, ce vestibule est toûjours magnifique, mais mon ami y a perdu la vie. Ce théatre n’a pas cessé d’être beau, depuis qu’on m’y a sifflé : mais je ne peux plus le voir, sans que mes oreilles ne soient encore frappées du bruit des sifflets. Je ne vois sous ce vestibule, que mon ami expirant ; je ne sens plus sa beauté. Dixieme source d’une diversité dans les jugemens, occasionnée par ce cortege d’idées accidentelles, qu’il ne nous est pas libre d’écarter de l’idée principale. Post equitem sedet atra cura.
Lorsqu’il s’agit d’objets composés, & qui présentent en même tems des formes naturelles & des formes artificielles, comme dans l’Architecture, les jardins, les ajustemens, &c. notre goût est fondé sur une autre association d’idées moitié raisonnables, moitié capricieuses : quelque foible analogie avec la démarche, le cri, la forme, la couleur d’un objet malfaisant, l’opinion de notre pays, les conventions de nos compatriotes, &c. tout influe dans nos jugemens. Ces causes tendent-elles à nous faire regarder les couleurs éclatantes & vives, comme une marque de vanité ou de quelqu’autre mauvaise disposition de cœur ou d’esprit : certaines formes sont-elles en usage parmi les paysans, ou des gens dont la profession, les emplois, le caractere nous sont odieux ou méprisables ; ces idées accessoires reviendront malgré nous, avec celles de la couleur & de la forme ; & nous prononcerons contre cette couleur & ces formes, quoiqu’elles n’ayent rien en elles-mêmes de desagréable. Onzieme source de diversité.
Quel sera donc l’objet dans la nature sur la beauté, duquel les hommes seront parfaitement d’accord ? La structure des végétaux ? Le méchanisme des animaux ? Le monde ? Mais ceux qui sont le plus frappés des rapports, de l’ordre, des symmétries, des liaisons, qui regnent entre les parties de ce grand tout, ignorant le but que le créateur s’est proposé en le formant, ne sont-ils pas entraînés à prononcer qu’il est parfaitement beau, par les idées qu’ils ont de la divinité ? & ne regardent-ils pas cet ouvrage, comme un chef-d’œuvre, principalement parce qu’il n’a manqué à l’auteur ni la puissance ni la volonté pour le former tel ? Voyez Optimisme. Mais combien d’occasions où nous n’avons pas le même droit d’inférer la perfection de l’ouvrage, du nom seul de l’ouvrier, & où nous ne laissons pas que d’admirer ? Ce tableau est de Raphael, cela suffit. Douzieme source, sinon de diversité, du moins d’erreur dans les jugemens.
Les êtres purement imaginaires, tels que le sphynx, la syrene, le faune, le minotaure, l’homme idéal, &c. sont ceux sur la beauté desquels on semble moins partagé, & cela n’est pas surprenant : ces êtres imaginaires sont à la vérité formés d’après les rapports que nous voyons observés dans les êtres réels ; mais le modele auquel ils doivent ressembler, épars entre toutes les productions de la nature, est proprement par tout & nulle part.
Quoi qu’il en soit de toutes ces causes de diversité dans nos jugemens, ce n’est point une raison de penser que le beau réel, celui qui consiste dans la perception des rapports, soit une chimere ; l’application de ce principe peut varier à l’infini, & ses modifications accidentelles occasionner des dissertations & des guerres littéraires : mais le principe n’en est pas moins constant. Il n’y a peut-être pas deux hommes sur toute la terre, qui apperçoivent exactement les mêmes rapports dans un même objet, & qui le jugent beau au même degré : mais s’il y en avoit un seul qui ne fût affecté des rapports dans aucun genre, ce seroit un stupide parfait ; & s’il y étoit insensible seulement dans quelques genres, ce phénomene décéleroit en lui un défaut d’œconomie animale, & nous serions toûjours éloignés du scepticisme, par la condition générale du reste de l’espece.
Le beau n’est pas toûjours l’ouvrage d’une cause intelligente : le mouvement établit souvent, soit dans un être considéré solitairement, soit entre plusieurs êtres comparés entr’eux, une multitude prodigieuse de rapports surprenans. Les cabinets d’histoire naturelle en offrent un grand nombre d’exemples. Les rapports sont alors des résultats de combinaisons fortuites, du moins par rapport à nous. La nature imite, en se joüant, dans cent occasions, les productions de l’art ; & l’on pourroit demander, je ne dis pas si ce philosophe qui fut jetté par une tempête sur les bords d’une ile inconnue, avoit raison de s’écrier, à la vûe de quelques figures de Géométrie : courage, mes amis, voici des pas d’hommes ; mais combien il faudroit remarquer de rapports dans un être, pour avoir une certitude complete qu’il est l’ouvrage d’un artiste ; en quelle occasion un seul défaut de symmétrie prouveroit plus que toute somme donnée de rapports ; comment sont entr’eux le tems de l’action de la cause tortuite, & les rapports observés dans les effets produits ; & si, à l’exception des œuvres du Tout-puissant, il y a des cas où le nombre des rapports ne puisse jamais être compensé par celui des jets.
* Blau, Joli, (Gramm.) le beau opposé à joli, est grand, noble & régulier ; on l’admire : le joli est fin, délicat ; il plait. Le beau dans les ouvrages d’esprit, suppose de la vérité dans le sujet, de l’élévation dans les pensées, de la justesse dans l’expression, de la nouveauté dans le tour, & de la régularité dans la conduite : l’éclat & la singularité suffisent pour les rendre jolis. Il y a des choses qui peuvent être jolies ou belles, telle est la comédie ; il y en a d’autres qui ne peuvent être que belles, telle est la tragédie. Il y a quelquefois plus de mérite à avoir trouvé une jolie chose qu’une belle ; dans ces occasions, une chose ne mérite le nom de belle, que par l’importance de son objet ; & une chose n’est appellée jolie, que par le peu de conséquence du sien. On ne fait attention alors qu’aux avantages, & l’on perd de vûe la difficulté de l’invention. Il est si vrai que le beau emporte souvent une idée de grand, que le même objet que nous avons appellé beau, ne nous paroîtroit plus que joli, s’il étoit exécuté en petit. L’esprit est un faiseur de jolies choses ; mais c’est l’ame qui produit les grandes. Les traits ingénieux ne sont ordinairement que jolis ; il y a de la beauté par-tout où l’on remarque du sentiment. Un homme qui dit d’une belle chose qu’elle est belle, ne donne pas une grande preuve de discernement ; celui qui dit qu’elle est jolie, est un sot, ou ne s’entend pas. C’est l’impertinent de Boileau, qui dit que le Corneille est joli quelquefois.
* BEAUX, adj. pris subst. (Hist. mod.) Les Anglois ont fait un substantif de cet adjectif François ; & c’est ainsi qu’ils appellent les hommes occupés de toutes les minuties qui semblent être du seul ressort des femmes, comme les habillemens recherchés, le goût des modes & de la parure ; ceux, en un mot, à qui le soin important de l’extérieur fait oublier tout le reste. Les beaux sont en Angleterre, ce que nos petits-maîtres sont ici ; mais les petits maîtres de France possedent l’esprit de frivolité, & l’art des bagatelles & des jolis riens, dans un degré bien supérieur aux beaux de l’Angleterre. Pour corriger un petit-maître Anglois, il n’y auroit peut-être qu’à lui montrer un petit-maître François : quant à nos petits-maîtres François, je ne crois pas que tout le phlegme de l’Angleterre puisse en venir à bout.
* BEAUCAIRE, (Géog.) ville du bas Languedoc, sur le bord du Rhone. Long. 22. 18. lat. 43. 43.
* BEAUCE, (Géog.) province de France entre le Perche, l’île de France, le Blésois & l’Orléanois.
BEAU-CHASSEUR, en Vénerie, se dit d’un chien qui crie bien dans la voie, & qui a toûjours en chassant la queue retournée sur les reins.
* BEAUCOUP, PLUSIEURS, (Gramm.) termes relatifs à la quantité : beaucoup a rapport à la quantité qui se mesure ; & plusieurs à celle qui se compte. Beaucoup d’eau ; plusieurs hommes. L’opposé de beaucoup est peu ; l’opposé de plusieurs est un. Pour qu’un état soit bien gouverné, nous disons qu’il ne faut qu’un seul chef, plusieurs ministres, beaucoup de lumiere & d’équité.
BEAU-FILS ou BELLE-FILLE, (Jurispr.) nom d’affinité, qui se dit du fils ou de la fille de quelqu’un qui se remarie en secondes nôces, par rapport à celui ou celle qui épouse le veuf ou la veuve.
Beau-fils & belle-fille se disent aussi quelquefois du gendre & de la bru. Voyez Gendre & Bru.
BEAU-FRERE ou BELLE-SOEUR, autre nom d’affinité, dont on se sert pour exprimer l’alliance de l’un des conjoints avec le frere ou la sœur de l’autre.
BEAU-PERE ou BELLE-MERE, est le terme qui correspond à ceux de beau-fils ou belle-fille, dans les deux sens exprimés ci-dessus au mot Beau-fils. (H)
* BEAUFORT, (Géog.) petite ville d’Anjou. Lon. 17. 26. lat. 47. 26.
* Beaufort, (Géog.) ville de Savoie, sur la riviere d’Oron. Long. 24. 18. lat. 45. 40.
* Beaufort, (Géog.) petite ville de France en Champagne, avec titre de duché. Elle porte maintenant le nom de Montmorenci.
BEAUJEU, (Géog.) ville de France dans le Beaujolois sur l’Ardiere. Long. 22. 10. lat. 46. 9.
* BEAUJOLOIS, (Géog.) petit pays de France entre la Saone & la Loire, le Lyonnois & la Bourgogne. Ville-franche en est la capitale.
* BEAULIE, (Géog.) petite ville d’Ecosse, dans le comté de Ross.
BEAU-LIEU, (Manege.) on dit qu’un cheval porte en beau-lieu, lorsqu’il porte bien sa tête.
* Beau-lieu, (Géog.) nom de deux petites villes de France, l’une en Touraine sur l’Indre, l’autre dans la vicomté de Turenne, sur la Dordogne.
Beau ou beau-parer ou beau-partir, porter beau ou en beau lieu. Voyez Parer, Partir.
BEAU PAS, voyez Pas.
BEAUX-JARRETS, voyez Jarret.
BEAUX MOUVEMENS, voyez Mouvement.
* BEAUMARCHÈS, (Géog.) petite ville de France dans la généralité d’Ausch, élection de Riviere-Verdun.
* BEAUMARIS, (Géog.) ville d’Angleterre, capitale de l’ile d’Anglesey, sur le détroit de Menay. Long. 13. 4. lat. 53. 20.
* BEAUMONT, (Géog.) petite ville des Pays-Bas dans le Hainaut, entre la Sambe & la Meuse, avec titre de comté. Long. 21. 51. lat. 50. 12.
Beaumont-le-Roger, (Géog.) ville de haute Normandie. Long. 18. 26. lat. 49. 2.
Beaumont-le-Vicomte, (Géog.) ville du Maine, sur la Sarte. Long. 17. 40. lat. 48. 12.
Beaumont-sur-l’Oise, ville de l’île de France, sur la pente d’une montagne : avec titre de comté. Long. 19. 58. 57. lat. 59. 8. 38.
Il y a encore en France une petite ville de même nom, dans le Périgord, avec titre de comté.
* BEAUNE, (Géog.) ville de France en Bourgogne. Long. 22. 20. lat. 47. 2.
* BEAUPORT, (Géog.) petite baie d’Afrique, en Cafrerie. Les Porugais l’appellent la bay a hermosa.
Beauport, (Géog.) port de l’Amérique, sur la côte méridionale de l’île Espagnole ; on l’appelle dans le pays el puerto hermoso.
BEAUPRÉ, s. m. (Marine.) c’est un mât qui est couché sur l’éperon à la proue des vaisseaux ; son pié est enchâssé sur le premier pont, au-dessous du château d’avant, avec une grande boucle de fer & deux chevilles aussi de fer, qui sortent entre deux ponts. Voyez la position de ce mât & ses dépendances, Pl. I. en Z. Voyez aussi la Pl. IV. fig. premiere, no 201. Ces figures donneront une idée plus claire de ce mot & de ce qui le concerne, qu’un discours plus étendu.
Le beaupré s’avance au-delà de la proue ; il est couché sur l’étambraie, & passe au-delà de l’éperon autant qu’il est nécessaire pour donner du jeu à la voile, afin qu’elle ne s’embarrasse point avec l’éperon ; il est appuyé sur l’étrave ou accotté sur un coussin, & couché sur l’étambraie. (Pl. IV. fig. I. no 210.) Quelquefois il passe entre les bittes, & son pié est contre le mât de misene, s’affermissant ainsi l’un & l’autre ; car sans cela on pourroit ne pas entrer le beaupré si avant dans le vaisseau. Il y a au mât de misene un gros taquet, qui entre dans les petits blocs avec une entaille, & qui vient finir sur ce beaupré. Il a 12 pouces de large, & 4 pouces d’épais, avec un collier de fer sur le bout.
Pour affermir encore le beaupré, on le surlie, & on couvre d’une peau de mouton cette liure ou saisine, afin de la conserver. Cette liure ou saisine tient le beaupré avec l’aiguille de l’éperon.
Beaupré sur poupe, terme de Marine, pour dire qu’un vaisseau se met le plus près qu’il peut de l’arriere d’un autre.
Passer sur le beaupré d’un autre vaisseau. Voyez Passer.
Petit beaupré, perroquet de beaupré, tourmentin ; c’est le mât qui est arboré sur la hune de beaupré.
Voile de beaupré, voyez Civadiere. (Z)
BEAU-REVOIR, s. m. se dit, en terme de Chasse, de l’action du limier, lorsqu’étant sur les voies il bande fort sur la bête & sur le trait.
* BEAUTÉ, s. f. terme relatif ; c’est la puissance ou faculté d’exciter en nous la perception de rapports agréables. J’ai dit agréables, pour me conformer à l’acception générale & commune du terme beauté : mais je crois que, philosophiquement parlant, tout ce qui peut exciter en nous la perception de rapports, est beau. Voyez l’article Beau. La beauté n’est pas l’objet de tous les sens. Il n’y a ni beau ni laid pour l’odorat & le goût. Le P. André, Jésuite, dans son Essai sur le beau, joint même à ces deux sens celui du toucher : mais je crois que son système peut être contredit en ce point. Il me semble qu’un aveugle a des idées de rapports, d’ordre, de symmétrie, & que ces notions sont entrées dans son entendement par le toucher, comme dans le nôtre par la vûe, moins parfaites peut-être & moins exactes : mais cela prouve tout au plus que les aveugles sont moins affectés du beau, que nous autres clair-voyans. Voyez l’article Aveugle. En un mot, il me paroît bien hardi de prononcer que l’aveugle statuaire qui faisoit des bustes ressemblans, n’avoit cependant aucune idée de beauté.
* BEAUVAIS, (Géog.) ville de France, capitale du Beauvoisis, dans le gouvernement de l’île de France, sur le Therain. Lon. 19. 44. 42. lat. 46. 26. 2.
* BEAUVOIR-SUR-MER, (Géog.) petite ville maritime de France en Poitou, avec titre de marquisat.
* BEAUVOISIS ou BEAUVAISIS, (Géog.) petit pays de France, dont Beauvais est la capitale.
* BEAWDLEY, (Géog.) ville d’Angleterre, dans la province de Worcester.
* BEBRE ou CHABRE, (Géog.) riviere du Bourbonnois en France, qui a sa source vers Montmorillon, reçoit le Val & le Teiche, passe à la Palisse & à Jaligne, & se jette dans la Loire.
* BEBRIACUM, (Géog. anc. & mod.) ville voisine de Crémone, dont Plutarque a fait mention dans la vie d’Othon. Les uns prétendent que c’est nôtre Bina, d’autres veulent que ce soit Canetto.
BEC, s. m. (Hist. nat. Ornitholog.) partie de la tête des oiseaux, qui leur tient lieu de dents. Il y a des oiseaux dont le bec est dentelé à peu près comme une scie : mais ces sortes de dents sont bien différentes de celles des quadrupedes, qui sont logées dans des alvéoles. Non-seulement le bec sert aux oiseaux pour prendre leur nourriture ; mais c’est aussi pour eux une arme offensive : de plus ils arrangent leurs plumes avec leur bec, & il y en a quelques-uns qui s’en aident comme d’un crochet pour élever leurs corps, & qui se laissent tomber sur cette partie dure lorsqu’ils veulent descendre à une petite distance ; tels sont les perroquets.
Les becs des oiseaux sont fort différens les uns des autres par la grandeur, la figure, &c. & ces différences sont si sensibles, qu’on en a fait des caracteres distinctifs dans les divisions méthodiques des oiseaux. Voyez Oiseau, & la Plan. VIII. où les principales figures des becs des oiseaux sont exposées, selon la méthode de M. Barrere, dans son Ornithologie. (I)
* Bec, s. m. ce terme transporté par métaphore de la partie de la tête des oiseaux, qui porte ce nom, à une infinité d’autres productions naturelles & artificielles, se dit ordinairement de parties solides, antérieures & pointues.
Bec a ciseaux, oiseau, Voyez Bec croisé.
Bec courbe, oiseau mieux connu sous le nom d’avoceta. Voyez Avoceta.
Bec croisé, s. m. loxia, (Hist. nat. Ornithol.) oiseau qui ne differe guere du verdier ; il pese une once & demie : il a environ six pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu’à l’extrémité de la queue : le bec est noir, dur, épais, & fort ; il est crochu en-dessus & en-dessous ; cette figure est particuliere à cet oiseau à l’exclusion de tout autre. Voyez la Planche VIII. fig. 10. les deux pieces du bec sont courbées à leur extrémité en sens contraire l’une de l’autre ; de sorte que l’extrémité de la piece inférieure est recourbée en-haut, & celle de la piece supérieure l’est en-bas. La situation de ces pieces n’est pas toûjours la même dans tous les oiseaux de cette espece : il y en a dont la piece supérieure passe à droite en se croisant avec la piece inférieure, & dans d’autres elle se trouve à gauche ; c’est à cause de cette conformation qu’on a donné à ces oiseaux les noms de bec croisé & de bec à ciseaux. La mâchoire inférieure & la langue sont semblables à la mâchoire & à la langue du pinson ; les ouvertures des narines sont rondes, les trous des oreilles sont grands, l’iris des yeux est de couleur de noisette, les pattes sont brunes, les ongles noirs ; le doigt extérieur tient au doigt du milieu à sa naissance. Le milieu des plumes de la tête & du dos est noir, & les bords sont verds ; il y a aussi sur la tête une légere teinte de couleur cendrée ; le croupion est verd, le menton cendré, la poitrine verte, & le ventre blanc ; mais les plumes qui se trouvent sous la queue, sont en partie noires ou brunes. Il y a dix-huit grandes plumes dans chaque aile ; elles sont noirâtres à l’exception des bords extérieurs des premieres plumes qui sont verdâtres ; la queue a environ deux pouces de longueur ; elle est composée de douze plumes noires, dont les bords sont verdâtres.
On dit que cet oiseau change trois fois de couleur par an ; qu’il est verd en automne, jaune en hyver, & rouge au printems. Gesner rapporte que les plumes de la poitrine, du cou, & du ventre, prennent d’abord une couleur rouge, qui devient ensuite jaune, & que leur couleur varie principalement en hyver. D’autres assûrent que ces oiseaux changent tous les ans de couleur ; qu’ils sont tantôt jaunes, tantôt verds, tantôt rouges ou cendrés. Ce qu’il y a de plus vraissemblable, c’est que ce changement de couleur dépend de l’âge de l’oiseau, ou des saisons de l’année. Au rapport d’Aldrovande, le bec-croisé est fort vorace ; il aime beaucoup le chénevi ; il mange aussi des semences de sapin, il niche sur cet arbre aux mois de Janvier & de Fevrier ; il ne chante que quand il gele ou qu’il fait très-froid, tandis que les autres oiseaux gardent le silence ; au lieu qu’il se taît en été, tandis que tous les autres chantent, &c. Ces derniers faits mériteroient d’être observés avec attention. On dit que d’un ou de deux coups de bec, ces oiseaux fendent par le milieu les pommes de sapin, & qu’ensuite ils en mangent les semences, ce qui cause un grand dommage dans les jardins. Le chant du bec-croisé est assez agréable : on trouve ces oiseaux en grande quantité, & pendant toute l’année en Allemagne, en Baviere, en Suede, en Norwege, & il en vient quelquefois beaucoup sur la côte occidentale de l’Angleterre, où ils font un grand dégât dans les vergers. Willughby, ornit. Voyez Oiseau. (I)
Gros-bec, s. m. Coccothrostes, (Hist. nat. Ornith.) oiseau ainsi nommé pour la grosseur de son bec relativement à celle du corps. Il est d’un tiers plus grand que le pinson ; son corps est court ; il pese environ une once trois quarts : il a sept pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu’au bout des ongles, & un pié d’envergure : la tête est grosse en comparaison du corps ; le bec est gros, dur, large à la base, & très-pointu à l’extrémité ; sa longueur est d’environ trois quarts de pouce ; il est de couleur de chair, ou de couleur blanchâtre ; la pointe est noirâtre, l’iris des yeux est de couleur cendrée ; la langue semble avoir été coupée à l’extrémité comme celle du pinson : les pattes sont d’une couleur rouge-pâle ; les ongles sont longs, sur-tout celui du doigt du milieu ; le doigt extérieur tient à sa naissance au doigt du milieu : les plumes qui se trouvent auprès de la base du bec, sont de couleur orangée ; celles qui occupent l’espace qui est entre le bec & les yeux sont noires ; la même couleur est dans les mâles sur les plumes qui sont autour de la mâchoire inférieure ; la tête est d’une couleur jaune roussâtre ; le cou de couleur cendrée ; le dos roux, à l’exception du milieu de chaque plume qui est blanchâtre : le croupion est de couleur jaune cendrée ; la poitrine, & principalement les côtés, sont d’une couleur cendrée, légerement teinte de rouge ; les plumes sont blanchâtres sous la queue & sous le milieu du ventre. Il y a dix-huit grandes plumes dans les ailes, dont les neuf ou dix premieres sont blanches dans le milieu seulement sur les barbes intérieures : dans les suivantes la couleur blanche de ces barbes ne s’étend pas jusqu’au tuyau ; les trois dernieres plumes sont rousses ; la pointe des plumes depuis la seconde jusqu’à la dixieme, est de couleur de gorge de pigeon ; les six ou sept plumes qui suivent, ont le bord extérieur de couleur cendrée. Tout le reste de ces dix-huit grandes plumes est de couleur brune ; la queue est courte ; elle n’a qu’environ deux pouces de longueur ; elle est composée de douze plumes ; les barbes intérieures de la partie supérieure de chaque plume sont blanches ; les barbes extérieures sont noires dans les premieres plumes de chaque côté de la queue, & roussâtres dans celles du milieu.
Ces oiseaux sont fort communs en Italie, en France, en Allemagne ; ils restent en été dans les bois & sur les montagnes ; en hyver ils descendent dans les plaines ; ils cassent avec beaucoup de facilité les noyaux de cerises & d’olives ; ils vivent pour l’ordinaire de semence de chénevi, de panis, &c. ils mangent aussi les boutons des arbres. On dit que c’est sur leur sommet que ces oiseaux font leurs nids, & que les femelles y déposent 5 ou 6 œufs.
Il y a une espece de gros-bec dans les Indes, surtout en Virginie ; il est à peu près de la grosseur du merle ; son bec est un peu plus court que celui du nôtre ; il a une belle crête sur la tête. Cet oiseau est d’une belle couleur écarlate, qui est moins foncée sur la tête & sur la queue que sur le reste du corps ; son chant est fort agréable, Willughby, Ornit. Voyez Oiseau. (I)
Bec de Grue, Geranium, (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur en rose, composée de plusieurs pétales disposés en rond ; il s’éleve du calice un pistil qui devient dans la suite un fruit en forme d’aiguille, dont le noyau a cinq rainures sur sa longueur ; dans chacune de ces rainures est attachée une capsule terminée par une longue queue. Ces capsules se détachent ordinairement de la base du fruit vers la pointe, & se recoquillent en-dehors : chacune renferme une semence ordinairement oblongue. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Bec d’oie, nom que l’on a donné au dauphin, à cause de la ressemblance de son bec, ou plûtôt de ses mâchoires avec le bec d’une oie. Voy. Dauphin. (I)
Bec ou Tuyau de l’entonnoir, en Anatomie, c’est une production très-mince de la substance des parois de la cavité que l’on appelle entonnoir, qui s’épanoüit autour de la glande pituitaire où elle se termine. V. Pituitaire. (L)
Bec (Blason) on appelle becs en termes de Blason, les pendans du lambel. Voyez Lambel. Ils étoient autrefois faits en pointes ou en rateaux, & ils ont aujourd’hui la figure des goûtes qui sont au-dessous des triglyphes dans l’ordre dorique. Voyez Ordre dorique. (V)
Bec, s. m. (Géog.) nom que nous donnons à plusieurs pointes de terre, où deux rivieres se joignent ; ainsi nous disons le bec d’ambes, de l’endroit où la Garonne & la Dordogne se rencontrent.
Bec (en terme de Bijoutiers, & autres artistes) c’est une petite avance, telle qu’on la voit aux tabatieres, ou de même matiere que la tabatiere, & soudée sur le devant du dessus, par laquelle on ouvre la boîte en y appuyant le doigt ; ou de matiere différente & attachée au même endroit. On donne le nom de bec à un grand nombre d’autres parties accessoires dans les ouvrages des artistes.
Double Bec, sorte de cuilliere à l’usage des Ciriers. Voyez Pl. du Cirier, fig. 13.
Bec (en Ecriture) se dit de la partie fendue de la plume, qui sert à tracer des caracteres sur le papier. Il y a quatre sortes de becs : la premiere, où les deux parties du bec sont coupées d’égale longueur, & parallelement ; la seconde, où elles sont coupées en angle ; la troisieme, où l’angle est plus considérable ; la quatrieme, où le bec est très-menu & coupé inégalement. La 1ere est pour l’expédition ; la 2de pour le style aisé ; la troisieme pour le style régulier, & la derniere pour les traits d’ornement.
Bec (en terme d’Epinglier fabriquant d’aiguilles pour les bonnetiers) se dit de l’extrémité pliée & recourbée, qui entre dans la châsse de l’aiguille ; c’est proprement la pointe, où le crochet de l’aiguille. Voyez Bas au métier.
Faire le bec (en terme d’Epinglier-Aiguilletier) c’est avec une tenaille arcuer le bec d’une aiguille en forme de demi cercle, dont la concavité est en dehors, & la convexité en dedans, ou regarde le corps de l’aiguille & la châsse.
Bec d’Ane (chez les Serruriers) c’est une espece de burin à deux biseaux, qui forme le coin, mais dont les côtes supérieures vont en s’arrondissant & en s’évasant. Sa largeur est ordinairement de trois à quatre lignes au plus. Son usage est pour commencer à ébaucher les cannelures & mortoises qu’on pratique aux grosses barres ; le bec d’âne résistant mieux en pareil cas que les autres burins. Il sert aussi à refendre les clés : mais alors il est très-petit & très-menu.
Bec d’Ane (chez les Arquebusiers) c’est un petit outil d’acier dont la figure n’est guere différente du bec d’âne des Menuisiers : ils s’en servent pour former des mortoises dans le bois ; & ils en ont de toutes grosseurs, depuis celle du bec d’âne des Menuisiers, jusqu’à la moindre grosseur.
Bec d’Ane (chez les Menuisiers & les Charpentiers) est un outil d’acier, de la même forme que les précédens, & qu’ils employent au même usage. Voyez Menuisier. Pl. I. fig. 7.
Ce sont les Taillandiers qui font les becs d’âne. Voyez Pl. II du Taillandier, fig. prem. un bec d’âne. K K est sa queue, I sa tige.
Les Tonneliers ont aussi des becs d’âne, & cet outil est commun à presque tous les ouvriers en bois.
Les Tourneurs en ont de deux sortes, de droits & de ronds, terminés l’un & l’autre par une espece particuliere de biseau, qui ne différe que par l’arrête du tranchant, qui est perpendiculaire à la longueur de l’outil dans le droit, & qui est arrondie en demi-cercle dans le rond. Voyez Biseau, & les fig. Pl. I. du tour.
Bec de Canne (terme de Cloutier) c’est une espece de clou à crochet qu’on nomme aussi clou à pigeon. Le crochet en est plat & ressemble à un bec de canne. Ces clous servent à attacher les paniers à pigeons dans les volets. Voyez Pl. du Cloutier, fig. 17.
Bec de Canne, outil qui sert aux Menuisiers à dégager le derriere des moulures ; il ne differe du bec d’âne qu’en ce qu’il est plus foible de tige, & plus étroit & plus allongé par le bec. Voyez Pl. I. Menuis. figure 8.
Bec de Corbin, ou les Gentilshommes au bec de corbin (Hist. mod.) officiers de la maison du roi, institués pour la garde de la personne de sa Majesté. Ils n’étoient que cent au commencement : mais quoiqu’on en ait depuis doublé le nombre, on les a toûjours appellés les cent gentilshommes. Ils marchent deux à deux devant le roi aux jours de cérémonie, portant le bec de corbin ou le faucon à la main ; & dans un jour de bataille, ils doivent se tenir auprès du roi : chaque compagnie a son capitaine, son lieutenant, & d’autres officiers[1]. (G)
Bec de corbin : on donne en général, ce nom dans les Arts, à tout ce qui est recourbé & terminé en pointe. Cette expression est tirée du bec du corbeau ; ainsi quand on dit, cela est fait en bec de corbin, c’est comme si l’on disoit, cela imite la forme du bec du corbeau.
Bec de Corbin (Marine) c’est un instrument de fer, fait en crochet, avec lequel un calfat tire la vieille étoupe d’une couture, ou d’entre les joints de deux bordages. (Z)
Bec de Corbin, Bec de Canne, Bec de Lésard, sont des instrumens de Chirurgie en forme de pincettes, qui ne different pas essentiellement du bec de grue, dont on donnera plus bas la description. Leur usage est le même, & on ne leur a donné tous ces différens noms qu’à raison de la différente longueur ou largeur des branches antérieures. On ne trouve plus ces instrumens que dans les anciens arsenaux de Chirurgie. Les bornes qui sont prescrites pour chaque matiere, ne permettent pas de donner des descriptions de ces instrumens ; on peut les voir dans le Traité d’Opérations de M. Dionis, à l’article de l’extraction des corps étrangers. Voyez Pl. XXX. de Chirurgie, fig. 2. 3. & 4. la construction de quelques-unes de ces pincettes. Voyez Tire-balle. (Y)
Bec de Corbin, (Jardinage) figure faite en crochet ou en bec d’oiseau, qui entre dans la composition des parterres de broderie. V. Parterre. (K)
Bec de Corbin, (outil d’Arquebusier) c’est un ciseau emmanché, comme le bec d’âne, &c. dont le fer est recourbé par en bas, comme un bec de corbeau. Le bout du bec est plat & très-tranchant. Les Arquebusiers s’en servent pour nettoyer une mortaise, & sculpter des ornemens sur un bois de fusil.
Bec de Corbin, (terme de Chapelier) c’est une espece de crochet de bois, qui fait partie de l’arçon des Chapeliers : le bec de corbin soûtient par un bout la corde de l’arçon, & sert à arçonner ou faire voler l’étoffe sur la claie. Voyez la fig. 16. Pl. du Chap.
Bec de Gorcin, (Manege) est un petit morceau, de fer de la largeur d’un pouce, & qui en a 3 ou 4 de long, que l’on soude à un des fers de derriere, pour empêcher un cheval boiteux de marcher sur l’autre fer de derriere. (Z)
Bec de Grue Musqué. Voyez Herbe à Robert.
Bec de Grue, c’est un instrument dont se servent les Chirurgiens dans leurs opérations, particulierement pour tirer des balles de plomb & autres corps étrangers hors des plaies. Voyez Tire-balle. Le bec de grue est une pincette composée de deux branches unies ensemble par jonction passée. Voyez Pl. III. fig. 3. La branche qui reçoit se nomme branche femelle, & on appelle branche male celle qui est reçûe. La jonction de ces deux pieces forme le corps de l’instrument, qui paroît au-dehors d’une figure quarrée ; les surfaces supérieure & inférieure de ce quarré ont environ cinq lignes de longueur, & les latérales excedent cette mesure d’une ligne : le corps de l’instrument se divise en parties antérieures & parties postérieures.
Les parties postérieures sont regardées comme le manche de l’instrument, elles sont différemment contournées ; la branche mâle est toute droite, & la femelle est doucement courbée dans toute sa longueur ; ce qui l’éloigne de deux pouces ou environ de la branche mâle, lorsque la pincette est fermée, & augmente considérablement la force de l’instrument. Ces branches sont plattes, pour présenter plus de surface à la main & aux doigts qui doivent les empoigner. Leurs faces intérieures sont planes : mais l’extérieure est légerement arrondie pour s’accommoder à la figure creuse de la main. La longueur de ces branches est de cinq à six pouces ; leur épaisseur près du corps est de trois lignes, & leur largeur est de cinq : mais en s’approchant de l’extrémité, elles diminuent d’épaisseur & augmentent de quelques lignes en largeur.
Ces pincettes sont naturellement écartées par un simple ressort très-élastique ; c’est une languette d’acier battue à froid, afin d’en resserrer les pores & lui donner par-là beaucoup d’élasticité. Ce ressort est percé d’un trou à son talon, pour y passer un clou qui traverse aussi la branche mâle de la pincette, & qui est si exactement rivé & limé sur la surface supérieure qu’il n’y paroît point.
Il nous reste à examiner la partie antérieure ou le bec de l’instrument. Il commence à la partie antérieure du corps au-delà de la jonction, par une tête arrondie sur ses faces supérieure & inférieure, mais applattie sur les côtés. Cette tête est formée par deux demi-cercles, dont le plus grand se trouve à la partie supérieure ou branche femelle, & l’autre à l’inférieure ; ces deux cercles mis ensemble, font un trou horisontal qu’on appelle l’œil de la pincette : mais lorsque l’instrument est ouvert, ils ressemblent avec le bec à une gueule béante.
Le reste du bec est deux branches pyramidales, dont le commencement a environ deux lignes & demie d’épaisseur & cinq lignes de large ; elles sont exactement planes en dedans, arrondies en dehors, & vont un peu en diminuant dans l’espace de trois pouces pour se terminer par une pointe mousse & très arrondie. Ces deux lames qui forment le bec sont légerement courbées en dedans ; ce qui fait que l’instrument étant fermé, on voit un espace entre ces deux lames ou branches, qui devient moins considérable à mesure qu’il approche de l’extrémité du bec ; ce qui fait que ces branches se touchant par leur extrémité, pincent avec plus d’exactitude. Cette description est extraite du traité d’Instrumens de M. de Garengeot, Chirurgien de Paris. (Y)
Bec-de-Lievre, (terme de Chirurgie.) est une difformité dans laquelle la levre supérieure est fendue comme celle des lievres. Cette division qui arrive aussi quelquefois à la levre inférieure, vient d’un vice de conformation avant la naissance, ou par accident, comme chûte, coup, incision, &c. Le bec-de-lievre accidentel est ancien ou récent : l’ancien est celui dans lequel les bords de la plaie n’ayant point été réunis, se sont cicatrisés à part sans se joindre : le récent est celui dont les bords sont encore sanglans. Celui-ci se guérit par le bandage unissant, si la plaie est en long, ou par la suture entre-coupée, si elle a une autre direction. Ces deux moyens de réunion n’ont lieu que lorsqu’il n’y a point de déperdition de substance ; & dans ces cas le traitement du bec-de-lievre accidentel & récent ne differe point de celui qui convient à une plaie simple. Voyez Plaie.
Le bec-de-lievre de naissance, celui qui est accidentel & ancien, & celui qui est accidentel récent, & dans lequel il se trouve perte de substance, exigent la suture entortillée, parce que dans les deux premiers cas il faut rafraîchir les bords de la division, avant de procéder à la réunion ; & que la suture entre-coupée n’est point capable d’assujettir les deux levres de la plaie, lorsqu’il y a déperdition de substance.
Pour rafraîchir les levres de la division d’un bec-de-lievre de naissance ou accidentel ancien, on se sert des ciseaux ou du bistouri : on approche ensuite les deux plaies récentes, ayant soin de les mettre bien au niveau l’une de l’autre : un aide les soûtient dans cette situation, en avançant avec ses mains les deux joues vers la division. La peau prête assez pour cette approximation, quelque déperdition de substance qu’il y ait. Les levres de la plaie étant bien rapprochées, le chirurgien pose l’extrémité du pouce & du doigt indicateur de la main gauche, au côté droit de la division : il prend avec le pouce & le doigt indicateur de la main droite, une aiguille convenable, (Voyez Aiguille) qu’il fait entrer dans le côté gauche, à quelques lignes de la division, pour traverser la plaie, en approchant le plus qu’on peut de la membrane interne de la levre, afin de procurer également la réunion de toute l’épaisseur de cette partie. La pointe de l’aiguille doit sortir entre les deux doigts de la main gauche, qui appuient légerement sur la peau, & qui la tendent au côté droit de la division : la sortie de l’aiguille doit être à la même distance du bord droit de la plaie, que son entrée l’est du bord gauche. Pour réunir un bec-de-lievre, il suffit ordinairement de mettre deux aiguilles : la premiere doit se passer un peu au-dessus du bord rouge de la levre, & l’autre près de l’angle supérieur de la plaie. Lorsque les aiguilles sont placées, on prend un fil ciré, qu’on fait tourner simplement deux ou trois fois autour de la premiere aiguille qu’on a mise, en le faisant passer alternativement sous sa tête & sous sa pointe. Le même fil sert à faire pareillement deux ou trois tours sous les extrémités de l’aiguille supérieure ; on arrête les deux bouts du fil par une rosette à côté de l’angle supérieur de la plaie : on met une petite compresse ou une petite boule de cire, sous la pointe de chaque aiguille, pour empêcher qu’elle ne blesse ; & on en met autant sous les têtes pour leur servir d’appui.
On couvre la division avec un petit lambeau de toile, imbibé de baume vulnéraire, & on maintient le tout avec une petite bandelette à quatre chefs, dont le plein pose sur l’appareil, & dont les extrémités s’appliquent au bonnet, en se croisant de chaque côté, de façon que le chef supérieur croise l’inférieur, & aille s’attacher latéralement au bonnet, au-dessous de celui ci. On appelle ce bandage une fronde, il est simplement contentif. Quelques praticiens le préferent à l’unissant, parce qu’il est moins sujet à se déranger. Je crois cependant qu’il faudroit préférer un bandage, qui, en tendant à rapprocher les joues vers les levres, soulageroit beaucoup les points de suture. Voyez Fronde.
Pendant l’opération qui vient d’être décrite, le malade doit être assis sur une chaise, & avoir la tête appuyée sur la poitrine de l’aide Chirurgien, dont les mains rapprochent les joues, & les poussent l’une contre l’autre vers la division.
Quelques heures après l’opération & l’application de l’appareil, on fait saigner le malade pour prévenir l’inflammation. On lui défend exactement de parler ; on tâche d’éloigner de sa vûe tout ce qui pourroit le déterminer à cette action ou à rire ; on ne lui donne du bouillon que rarement, & dans un biberon ou cuilliere couverte, parce que l’action des levres nuiroit beaucoup à la réunion. L’éternuement peut occasionner beaucoup de desordre après l’opération du bec-de-lievre. Si un enfant se trouve dans le cas de cette opération, on conseille de l’empêcher de dormir une nuit, & on opere le lendemain au matin. Par ce moyen il pourra rester tranquille après l’opération ; ce stratagème paroît pouvoir assûrer la réunion : elle est ordinairement faite au bout de 24 ou 36 heures ; on ôte alors les aiguilles, & on continue le bandage unissant ; on pourroit même contenir les levres de la plaie avec des languettes de toile couvertes d’emplâtre agglutinatif. On peut lire dans le premier volume des Mémoires de l’Académie royale de Chirurgie, des observations singulieres de M. de la Faye, & de plusieurs autres Académiciens, sur les becs-de-lievre venus de naissance, & sur différentes méthodes de corriger ces difformités : on y trouvera des moyens de remédier au dechirement qui survient lorsque les points d’aiguille manquent, & qu’il n’est plus possible de pratiquer la suture entortillée par le défaut de solidité des parties qui devoient la soûtenir. (Y)
BECASSE, s. f. scolopax, (Hist. nat. Ornith.) oiseau qui est moins gros que la perdrix. Toute sa partie supérieure est bigarrée de trois couleurs, qui sont le roux, le noir & le cendré. Depuis le bec jusqu’au milieu de la tête, les plumes sont presque toutes de couleur rousse mêlée de noir ; la poitrine & le ventre sont de couleur cendrée, & il y a des lignes transversales d’un brun obscur ; le dessous de la queue est un peu jaune ; le menton est de couleur blanchâtre mêlée de jaune : il y a une ligne noire depuis les yeux jusqu’au bec : le derriere de la tête est presqu’entierement noir, avec deux ou trois bandes transversales de couleur de terre cuite. Il y a vingt-trois grandes plumes dans les ailes, elles sont noires, & ont des taches transversales de couleur rousse ; les petites plumes qui sont sous les ailes, ont des bandes transversales de deux couleurs, qui sont le cendré & le roux. La queue a environ trois pouces trois lignes de longueur, elle est composée de douze plumes, dont les pointes sont blanches sur la face inférieure, & de couleur cendrée sur la face supérieure ; les bords semblent avoir des entailles ou des dents de couleur rousse, le reste est noir.
Le bec a trois pouces de longueur ; il est d’un brun obscur à son extrémité, mais auprés de la tête cette couleur est moins foncée, & tire sur la couleur de chair ; la partie supérieure du bec est un peu plus longue que la partie inférieure ; la langue est tendineuse ; le palais est tuberculeux ; les oreilles sont grandes & bien ouvertes, les yeux sont placés plus haut, & plus en arriere que dans les autres oiseaux ; c’est pourquoi la becasse ne les blesse pas lorsqu’elle fouille dans la terre avec son bec : les jambes, les pattes, les doigts sont d’un brun pâle, les ongles sont noirs ; le doigt de derriere est fort court, & son ongle est le plus petit de tous.
Au printems cet oiseau quitte notre pays : mais il s’accouple auparavant. Le mâle & la femelle se suivent par tout : ils vivent dans les forêts humides, le long des petits ruisseaux & des haies. On dit que dans les jours nébuleux, ils ne cessent d’aller & de venir en volant : leurs œufs sont longs, de couleur rougeâtre, pâles & bigarrés d’ondes & de taches bien foncées.
La femelle est un peu plus grande, & pese plus que le mâle, & sa couleur est plus foncée. Ils ont environ treize pouces de longueur depuis la pointe du bec, jusqu’à l’extrémité de la queue ; l’envergure est de deux piés : la chair de la bécasse est excellente, la cuisse est le meilleur morceau. Willughby, Ornithologie. Voyez Oiseau. (I)
* On prend les bécasses à la pentiere ; si vous avez des bois taillis, & proche de-là une haute futaie, coupez-en quelques arbres dans le milieu ; faites-y une clairiere ou passée de sept à huit toises ; & fermez votre passée par la pentiere, comme vous la voyez dans la figure de nos planches de chasse. Ebranchez deux arbres AB ; ajoûtez-y deux perches C D, C D ; ayez des boucles de verre, comme elles sont no 3. ces boucles serviront à suspendre votre filet aux lieux D, D ; attachez les extrémités EE de votre filet, aux piés des arbres A, B, par deux cordes lâches ; liez des cordes F, F, les deux autres extrémités G, G ; faites passer ces cordes dans vos boucles de verre ; qu’elles se rendent l’une & l’autre en un même lieu R, à sept ou huit toises de la pentiere ; faites-là une loge, avec cinq ou six branches d’arbres ; que cette loge soit ouverte vers le filet. Quand une bécasse se viendra jetter dans la pentiere, le chasseur caché lâchera les extrémités R des cordes ; alors le filet tombera, & la bécasse n’aura pas le tems de s’en debarrasser. Les bécasses ne volent presque jamais de jour ; elles restent dans les bois, pour n’en sortir que le soir à l’approche de la nuit.
On peut aussi les prendre aux lacets dans les bois, ou le long des ruisseaux ; ces lacets n’ont rien de particulier.
Les bécasses se mangent roties, sans être vuidées : quand on en veut faire un ragoût, on ne les laisse cuire à la broche qu’à moitié ; on les dépece ; on les met dans une casserole avec du vin, des capres, des champignons, du sel & du poivre, & on les laisse bouillir jusqu’à ce que la cuisson soit achevée. Le salmi se fait presque de la même maniere ; on ajoûte seulement des trufes & des anchois, & on lie la sausse avec le foie & les entrailles de la bécasse.
La bécasse considérée comme aliment, passe pour être nourrissante, restaurante & fortifiante : mais elle ne se digere pas si aisément que les oiseaux dont la chair est blanche ; ses sels sont fort exaltés par son exercice continuel, ce qui fait que sa chair fait du bien à ceux qui regorgent d’acides. Ses cendres passent pour lithontriptiques. La bécassine se digere moins bien, elle a au reste les mêmes propriétés que la précédente. Voyez Bécassine. (N)
Bécasse de mer, hæmatopus, (Hist. nat. Ornith.) oiseau de la grosseur de la pie ou de la corneille ; cette ressemblance de grosseur jointe à celle des couleurs, a fait donner à cet oiseau le nom de pie de mer. Il pese dix-huit onces, il a dix-huit pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu’à l’extrémité de la queue ou des pattes.
Le bec est droit, long de trois pouces, applati sur les côtés, terminé en pointe, & de couleur rouge : dans une autre bécasse de mer, qui étoit peut-être plus jeune que celle qui a servi à cette description, le bec étoit noirâtre depuis la pointe jusqu’au milieu de sa longueur. La partie supérieure du bec est un peu plus longue que l’inférieure ; l’iris des yeux & les tarses des paupieres sont d’un beau rouge ; dans un autre ils étoient de couleur de noisette : les piés sont rouges, cet oiseau n’a point de doigts de derriere, & le doigt extérieur tient au doigt du milieu par une membrane. On a vû des oiseaux de cette espece, qui avoient les pattes d’un brun pâle, peut-être étoient-ils jeunes. Les ongles sont noirs, de même que la tête, le cou, la gorge, jusqu’au milieu de la poitrine, & le dos. Le reste de la poitrine, le ventre & le croupion sont blancs. Il y avoit dans une autre bécasse de mer, une grande tache blanche sous le menton, & une autre petite sous les yeux : la queue est en partie noire & en partie blanche : la premiere des grandes plumes de l’aile est noire, à l’exception du bord intérieur qui est blanc : dans les autres plumes, l’espace qu’occupe le blanc, augmente de plus en plus jusqu’à la vingtieme qui est entierement blanche, de même que les trois suivantes ; mais depuis la vingt-troisieme, la couleur noire reparoît sur les plumes qui suivent. Les petites plumes de l’aile qui recouvrent les grandes du milieu, sont blanches, ce qui forme un trait blanc transversal sur l’aile.
On trouve dans l’estomac de la bécasse de mer des patelles entieres, ce qui prouve qu’elle fait sa principale nourriture de ce coquillage. On voit fréquemment cet oiseau sur les côtes occidentales de l’Angleterre ; sa chair est noire & dure. Willughby, Ornit. Voyez Oiseau. (I)
Bécasse, scolopax, (Hist. nat. Ichthiolog.) poisson de mer. Il a été ainsi nommé, parce que son bec est long comme celui de l’oiseau appellé bécasse. On lui a aussi donné le nom d’éléphant, par une comparaison plus éloignée que l’on a faite du bec de ce poisson avec la trompe de l’éléphant. Ce poisson a le corps rond, de couleur rouge, couvert d’écailles rondes : il y a auprès de la queue un grand aiguillon garni de dents comme une scie, du côté de la queue qui est menue. Ce poisson est petit. Rondelet. Voyez Poisson & Becune. (I)
Bécasse, est un instrument dont les Vanniers se servent pour renverger leurs ouvrages de clôture. Voyez Renverger. Cet outil n’est autre chose qu’une verge de fer courbée en arc de cercle, dont le bout seroit un peu prolongé en ligne droite : l’autre bout sert de tige à la partie coudée, & se termine par une queue qui s’emmanche dans un morceau de bois. Voyez la Planche du Vannier.
BÉCASSINE, s. f. gallinago minor, (Hist. nat. Ornith.) oiseau qui pese environ quatre onces : il a un pié de longueur depuis la pointe du bec jusqu’à l’extrémité des pattes, & seulement onze pouces, si on ne prend la longueur que jusqu’au bout de la queue ; l’envergure est de sept pouces.
Une bande blanche mêlée de roux, occupe le milieu de la tête, & de chaque côté on voit une tache de couleur mêlée de brun & de roux. Il y a au-dessus des yeux une autre bande, de la même couleur que celle du milieu de la tête, & une autre entre les yeux & le bec, qui est de couleur brune. La couleur des plumes qui sont au-dessous du bec est blanche ; le cou est de couleur brune mêlée de roux ; la poitrine & le ventre sont presque entierement blancs ; les grandes plumes qui sortent de l’épaule, s’étendent presque jusqu’à la queue ; leurs barbes intérieures sont noires & un peu luisantes ; la pointe de ces plumes est de couleur rousse, & les barbes extérieures sont d’un roux pâle, ce qui forme alternativement des bandes de différentes couleurs. Les plumes qui couvrent le dos sont de couleur brune ; elles ont des lignes transversales de couleur blanchâtre. Les plumes qui couvrent la queue sont rousses, avec des lignes noires transversales. Les plus grandes des plumes qui recouvrent les ailes sont de couleur brune, à l’exception de la pointe qui est blanche ; & les petites sont panachées de noir & de roux pâle. Il y a dans chaque aile vingt-quatre grandes plumes ; le bord extérieur de la premiere est blanc presque jusqu’à la pointe ; l’extrémité de celles qui suivent est un peu blanchâtre, mais cette couleur est beaucoup plus claire sur les plumes qui se trouvent depuis la onzieme jusqu’à la vingt-unieme ; au reste toutes ces plumes font rousses : enfin les dernieres ont des lignes transversales, dont les unes sont noires, & les autres de couleur blanche mêlée de roux.
La queue est composée de douze plumes : elle paroît très-courte, parce qu’elle est recouverte presqu’en entier par les plumes qui l’environnent. La pointe de ses plumes extérieures est blanche, & le reste est traversé par des bandes de couleur brune, & des bandes de couleur pâle posées alternativement ; leur bord extérieur est d’un blanc plus clair ; les plumes qui suivent de chaque côté jusqu’à celles du milieu sont presque de la même couleur, excepté que la pointe est moins blanche, que le brun approche plus du noir, & que la bande blanche du haut est un peu rougeâtre. La pointe des plumes du milieu est blanchâtre ; au-dessus du blanc il y a une bande brune qui est suivie d’une tache rougeâtre avec des taches brunes dans le milieu : le reste de la plume est presque entierement noir, à l’exception d’une ou deux taches rougeâtres qui sont sur les bords extérieurs. Le bec de la bécassine a près de trois pouces de longueur ; il est noir à la pointe ; il est un peu applati & parsemé de petits grains. La langue est pointue. L’iris des yeux est couleur de noisette. Les pattes sont d’un verd pâle. Les ongles sont noirs. Les doigts sont longs & séparés dès leur naissance ; celui de derriere est très-petit.
Ces oiseaux sont passagers, au moins pour la plûpart. Ils nichent dans les marais. La femelle fait d’une seule ponte quatre ou cinq œufs. La bécassine vit dans les lieux marécageux & le long des petits ruisseaux. Sa chair est très-tendre & d’un goût excellent. Willughby, Ornit. Voyez Oiseau. (I)
* On apprête les bécassines comme les bécasses, quand on les veut manger roties : mais pour les mettre en ragoût, on les fend en deux sans les vuider ; on les passe à la poelle au lard fondu, avec poivre & ciboule : on y fait ensuite distiller du jus de champignon, avec un peu de celui de citron ; & le ragoût est fait, quand les bécassines sont achevées de cuire ; car il faut observer qu’elles doivent être à moitié roties avant que d’être fendues en deux.
* BECCABUNGA, (Hist. nat. bot.) Il y a deux plantes de ce nom ; le grand & le petit beccabunga. Le grand a la racine fibreuse, blanche & rampante ; la tige couchée à terre, cylindrique, fongueuse, rougeâtre & branchue ; & la feuille rangée par paires opposées sur les nœuds, arrondie, longue d’un pouce & plus, lisse, luisante, épaisse, crenelée, & d’un verd foncé. De l’aisselle de la feuille il sort des pédicules longs d’un palme ou d’un palme & demi, chargés de fleurs disposées en épi, d’une seule piece, en rosette bleue, partagée en quatre parties percées dans le centre, à deux étamines surmontées d’un sommet bleuâtre, avec un pistil qui se change en un fruit membraneux de la forme de cœur applati, long de trois lignes, divisé en loges qui contiennent plusieurs petites graines applaties.
Le petit beccabunga ne differe du grand qu’en ce que sa tige, sa feuille & sa fleur sont plus petites.
On les trouve, par l’analyse chimique, composés d’un sel essentiel salé, vitriolique, doux & tempéré, peu différent du sel admirable de Glauber, délayé dans beaucoup de phlegme, & enveloppé d’une assez grande portion d’huile.
On leur attribue la vertu d’échauffer, d’exciter les urines & les regles, de briser le calcul, & de hâter la sortie du fœtus : on s’en sert encore pour le scorbut ; mais on ne l’ordonne qu’aux malades d’un tempérament sec & chaud.
BECCADE, s. f. (Fauconnerie.) Les fauconniers disent faire prendre la beccade à l’oiseau, pour dire lui donner à manger.
BEC-FIGUE, s. m. ficedula, (Hist. nat. Ornith.) beccafigo à Florence ; très-petit oiseau qui est à peine de la grosseur de la linote ordinaire. Le corps est court. La tête, le dos, les ailes & la queue, sont de couleur cendrée ou de feuille morte mêlée de verd ; & dans quelques-uns de ces oiseaux, elle est d’un brun verdâtre. Les grandes plumes des ailes sont de couleur brune ou gris de souris ; leurs tuyaux sont noirs ; les bords extérieurs sont verdâtres. La queue a environ deux pouces de longueur ; elle est brune. Le ventre est blanc ou de couleur argentée ; celle de la poitrine est un peu plus foncée, avec quelque teinte de jaune. Le bec est court ; la piece supérieure est noire, & l’inférieure bleuâtre. Le dedans de la bouche est rouge. Les pattes sont courtes, de couleur bleuâtre, & quelquefois plombée.
Il est assez difficile de distinguer cet oiseau par le moyen de la description, parce qu’il n’y a rien de tranché dans ses couleurs : aussi y a t-il plusieurs sortes d’oiseaux que l’on rapporte aux mêmes noms de bec-figue & de ficedula. Willughby, Ornit. Voy. Tête noire. Le bec-figue est excellent à manger : il se nourrit de figues, de raisin, &c. Voyez Oiseau. (I)
* Pour l’apprêter, on le plume ; on lui coupe la tête & les piés ; on le rotit à la broche : à mesure qu’il cuit on le saupoudre de croûte de pain rapée & mêlée de sel, & on le mange au verjus de grain & au poivre blanc.
BECHARU, oiseau. Voyez Flamand. (I)
BECHE, insecte. Voyez Lisette. (I)
Beche, s. f. (Jard.) est un outil de fer tranchant, large, applati, d’environ un pié de long sur huit à neuf pouces de large, & emmanché d’un bâton de trois piés de long. Il est à l’usage des Jardiniers, qui s’en servent pour labourer la terre… (K) Voyez Pl. du Jardinier.
Les Artilleurs ont aussi leur beche ; elle leur sert à préparer les endroits où des batteries doivent être placées. Voyez Art milit. Pl. XVII. (Q)
Ce sont les Taillandiers qui les font. Il y en a de rondes & de quarrées. Les rondes entrent plus facilement dans la terre ; les quarrées séparent des morceaux de terre plus étendus. Pour s’en servir, on les tient à la main ; on les place dans l’endroit qu’on veut cultiver, & on les fait entrer en poussant avec le manche, & en aidant cette action avec le pié qu’on appuie à la partie supérieure de la beche, à côté de la douille où le manche est reçû. Voyez Pl. VII. du Taillandier, en B & en D, une beche ronde & une beche quarrée.
* Beche, (Géog.) riviere de Hongrie, qui se jette dans le Danube près de Belgrade.
BECHET, espece de chameau. V. Chameau. (I)
* BECHIN, (Géog.) petite ville de Boheme, du cercle de même nom. Long. 32. 35. lat. 49. 14.
* BECHIQUES, adj. nom qu’on donne, en Medecine, à tous les remedes indiqués dans la toux : il vient de βηξ, toux.
Quincy donne, dans sa Pharmacopée, la préparation du trochisque suivant, que M. James dit préférable à tout autre, & salutaire dans toutes sortes de toux. Prenez des quatre grandes semences froides écossées, de chacune deux onces ; graine de pavot blanc, une once ; mettez le tout dans un mortier de marbre ; versez dessus une quantité suffisante de jus de réglisse délayé dans de l’eau-rose, & de la consistance d’un sirop : faites une pulpe douce ; passez cette pulpe par un tamis, après y avoir ajoûté quatre ou cinq onces de pulpe de reglisse : ajoûtez ensuite storax dissous & passé, une once ; poudre d’iris, trois onces ; graine d’anis, une once ; fenouil, une once ; sucre fin, deux livres & demie : mettez le tout en une pâte, & faites-en des tablettes, dont vous pourrez user à discrétion.
* BECHIRES, s. m. pl. (Géog.) peuples de Scythie, dont Pline a fait mention.
BECK, (Commerce.) c’est un poids d’usage en Angleterre pour peser des marchandises seches. Le beck tient deux gallons ou seize livres d’Angleterre. Voyez Gallon.
* BECKEN ou BECKUM, (Géog.) petite ville de l’evêché de Munster en Westphalie.
* BECKENRIEDT, (Géog.) ville de Suisse dans le canton d’Underwaldt.
BECQUÉ, adj. en termes de Blason, se dit des oiseaux dont le bec est d’un autre émail que le corps.
Guiffray Vachat en Bugey, d’asur au griffon d’or, becqué d’argent. (V)
BECQUILLON, s. m. en Fauconnerie, se dit du bec des oiseaux de proie, lorsqu’ils sont encore jeunes. Cet oiseau n’a encore que le becquillon.
* BECSANGIL, (Géog.) province d’Asie, qui fait partie de la Natolie, bornée au septentrion par la mer Noire, à l’occident par la mer de Marmora & l’Archipel, au midi par la Natolie propre, & à l’occident par la province de Bolli.
BECTACHIS, s. m. pl. (Hist. mod.) espece de religieux chez les Turcs, ainsi nommés de Haji Bectak leur fondateur, fameux par de prétendus miracles & des prophéties. Il vivoit sous le regne d’Amurat I. qui lui envoya, dit-on, la nouvelle milice qu’il vouloit former d’enfans enlevés aux Chrétiens, afin qu’il la désignât par un nom ; & il nomma ces soldats Janissaires : soit en mémoire de cet évenement, soit parce que les Bectachis ne sont pas fort réguliers sur l’heure de la priere, les Janissaires trouvent leur dévotion fort commode, & sont très-attachés à leur secte.
Les Bectachis sont habillés de blanc, & portent des turbans de laine, dont la lesse est tortillée comme une corde. Ils croyent honorer singulierement l’unité de Dieu en crian hû, c’est-à-dire qu’il vive. Ces moines se marient, demeurent dans les villes & dans les bourgs : mais par leur institut ils sont obligés de voyager dans les pays éloignés. Ils doivent à tous ceux qu’ils rencontrent le gazel, espece de chant affectueux qui par allégorie est appliqué à l’amour divin ; & l’elma, qui est une invocation d’un des noms de Dieu qui sont chez eux au nombre de mille & un. Guer, mœurs des Turcs, tom. I.
Ricaut, dans son ouvrage de l’empire Ottoman, fait mention d’une autre secte Mahométane, suivie par quelques Janissaires, & nommée Bectaschistes de Bectas, aga des Janissaires, au commencement du regne de Mahomet IV. On les nomme autrement Zératites, & le vulgaire les appelle Mun sconduren, c’est-à-dire ceux qui éteignent la chandelle ; parce qu’on les accuse d’avoir indifféremment commerce avec toutes sortes de personnes dans leurs assemblées, & d’y permettre l’inceste à la faveur de l’obscurité. Au reste ils observent la loi de Mahomet pour ce qui regarde le culte divin : mais ils pensent qu’il n’est pas permis de donner des attributs à Dieu, ni de dire qu’il est grand, qu’il est juste ; parce qu’il est un être très-simple, & que nos idées n’approchent point de la simplicité de son essence. Ce mêlange monstrueux de spiritualité rafinée & de libertinage, fait que cette secte est très-peu suivie. (G)
* BECUIBA NUX, noix de Becuiba, (Hist. nat. bot.) espece de noix brune, commune au Brésil, de la grosseur d’une noix muscade, pleine d’une amande huileuse, couverte d’une coque ligneuse. On met cette amande au rang des balsamiques.
BECUNE ou BEKUNE, s. f. (Hist. nat. Ichthiol.) poisson de mer auquel on a aussi donné le nom de brochet de mer, parce qu’il ressemble à notre brochet, & que sa chair en a le goût. Il y a des bécunes que l’on appelle bécasses de mer, parce qu’elles ont le bec allongé. On pêche la bécune sur la côte d’Or en Guinée, sur les rivages avec de grands filets, dans les mois d’Octobre & de Novembre. Celle que l’on nomme bécasse de mer se trouve sur les côtes de l’Amérique ; elle a jusqu’à huit piés de longueur. Ce poisson est fort dangereux par sa morsure sur-tout, parce qu’il mord hardiment sans s’épouvanter du bruit, ni des mouvemens que l’on peut faire pour l’écarter. On dit que sa chair est souvent un poison aussi dangereux que l’arsenic, & on prétend que c’est lorsque la bécune s’est nourrie de mançeuille sur les côtes des îles de l’Amérique. (I)
* BECZAU, (Géog.) ville de Boheme sur la riviere de Topel.
BECZKA, s. f. (Commerce.) mesure dont on se sert en Pologne pour les marchandises seches & humides. La beczka de Vilna tient 350 livres de grain, & celle de Smolensko 325 livres.
BEDA, (Métallurg.) on nomme ainsi au Potosi une mine d’or ou d’argent, lorsqu’elle est mêlée de fer. Voyez Mine. (M)
BECHOTTER, (Jardinage.) Voyez Bequiller.
* BEDARIEUX, (Géog.) ou BEC D’ARIEUX, ville de France, dans le Languedoc, au diocese de Beziers, sur la riviere d’Obe. Long. 20. 54. lat. 43. 39.
* BEDAS, (Géog. & Hist. mod.) peuples d’Asie, dans l’île de Ceylan. Ils habitent une grande forêt auprès de la mer, au nord-est de l’île. Ce sont des sauvages blancs, fort adroits à tiret de l’arc. Ils apprêtent leur viande avec du miel ; ils la mettent avec cet assaisonnement dans un trou d’arbre, bouché d’un tampon, où ils la laissent pendant un an ; après quoi, ils l’en retirent & la mangent. Il y a beaucoup d’abeilles dans leurs forêts ; ils n’ont aucune demeure fixe ; ils errent, habitant tantôt un lieu, tantôt un autre.
* BEDBUR, (Géog.) petite ville du duché de Juliers.
BEDEAU, s. m. (Hist. mod.) bas officier, sergent, qui somme les personnes de paroître ou de repondre.
Bedeau, se dit encore d’un officier subalterne dans les universités, dont la fonction est de marcher devant le recteur & les autres principaux, avec une masse, dans toutes les cérémonies publiques.
Les uns disent que bedelli vient par corruption de pedelli, parce que les bedeaux servent & courent à pié ; les autres font dériver ce nom de pedo seu baculo, parce qu’ils portent une baguette ; ils forment pedellus de pedum, espèce de baguette, qui est leur symbole ; & de pedellus, ils font le nom bedellus. Il en est qui s’imaginent en avoir trouvé l’étymologie dans l’Hébreu bedal, ordonner, ranger, disposer. Spelman, Vossius, & Somner, dérivent bedeau du Saxon bidel, crieur public ; c’est dans le même sens que certains anciens manuscrits Saxons, nomment les évêques bedeaux de Dieu, Dei bedalli.
Le traducteur du nouveau Testament Saxon rend exactor, par bydele ; & ce mot est employé dans les lois d’Ecosse, pour signifier la même chose.
Dans les églises & paroisses, on nomme bedeaux de bas officiers laïcs, vêtus de longues robes de drap rouge ou bleu, portans sur la manche gauche une plaque d’argent ou un chifre en broderie, qui représente l’image où le nom du patron de cette église ; ils ont à la main droite une verge ou baleine garnie de viroles & de plaques d’argent, précedent le clergé dans les cérémonies, & servent à maintenir le bon ordre pendant l’office, en chassant les mendians, les chiens, &c. (G)
* BEDEGUAR, (Hist. nat. & mat. med.) nom que quelques auteurs qui ont écrit de la matiere médicale, ont donné aux excroissances spongieuses du laurier sauvage. On dit que les cendres du bedeguar sont bonnes dans la gravelle & dans la dysurie, & qu’elles font dormir, si on en tient sous l’oreiller.
* BEDER, (Géog) ville d’Asie, dans les états du Mogol, capitale des Talingas. Long. 95. 10. lat. 16. 50.
* BEDESE ou Romo, (Géog.) riviere d’Italie, qui a sa source dans la Toscane, entre la Romagne, arrose Forli, prend le nom d’Acquedatto, & se jette dans le golfe de Venise, au-dessus de Ravenne.
* BEDFORD, (Géog.) ville d’Angleterre, dans la province de même nom, avec titre de duché sur l’Ouse. Long. 17. lat. 52. 8.
* BEDFORDSHIRE, (Géog.) petite province d’Angleterre, dont Bedford est la capitale.
* BEDIZ-VELEZ, ou BELZ, (Géog. anc. & mod.) ville d’Afrique, au royaume de Fez, sur la côte de la Méditerranée, avec port & château. On la prend pour l’ancienne Acrath.
* BEDOUINS, s. m. pl. (Géog. & Hist. mod.) peuples d’Arabie, qui vivent toûjours dans les deserts & sous des tentes. Ils ne sont soûmis qu’aux émirs leurs princes, ou aux cheiks, autres seigneurs subalternes. Ils se prétendent descendus d’Ismaël. Celui d’entre leurs souverains, qui a le plus d’autorité, habite le desert, qui est entre le mont Sinaï & la Mecque. Les Turcs lui payent un tribut annuel, pour la sûreté des caravanes. Il y a des Bedouins, dans la Syrie, la Palestine, l’Egypte & les autres contrées d’Asie & d’Afrique. Ils sont Mahométans, ils n’en traitent pas plus mal les Chrétiens. Ils sont naturellement graves, sérieux, & modestes. Ils font bon accueil à l’étranger ; ils parlent peu, ne médisent point, & ne rient jamais ; ils vivent en grande union. Mais si un homme en tue un autre, l’amitié est rompue entre les familles, & la haine est irréconciliable. La barbe est en grande vénération parmi eux ; c’est une infamie que de la raser : ils n’ont point de gens de justice. L’émir, le cheik, ou le premier venu termine leur différend : ils ont des chevaux & des esclaves. Ils font assez peu de cas de leur généalogie ; pour celle de leurs chevaux, c’est toute autre chose. Ils en ont de trois especes ; des nobles, des mésalliés & des roturiers. Ils n’ont ni medecins, ni apothicaires. Ils ont tant d’aversion pour les lavemens, qu’ils aimeroient mieux mourir que d’user de ce remede. Ils sont secs, robustes & infatigables. Leurs femmes sont belles, bien faites & fort blanches. Voyez le Dictionn. géog. de M. de Vosgien. A juger de ces peuples sur ce qu’on nous en raconte, il est à présumer que n’ayant ni medecins, ni jurisconsultes, ils n’ont guere d’autres lois que celles de l’équité naturelle, & guere d’autres maladies que la vieillesse.
BEEL-PHEGOR ou BEL-PEHOR, s. m. (Myth.) fausse divinité que les Israélites adoroient à l’imitation des Moabites, selon le récit que Moyse en fait au ch. xxv des nombres. Selden croit que c’étoit un faux dieu des Moabites & des Madianites, & le même qui est seulement nommé peor au chapitre qui vient d’être cité, & au xxxj du même livre, comme encore au xxij de Josué. Une lettre hébraïque ע, dont la pronontiation est difficile, & qui se change souvent en g dans les autres langues, a fait aussi qu’on l’a nommé phegor. Origene, Homel. xx sur le livre des nombres, dit qu’il n’a rien pû trouver dans les écrits des Hébreux, touchant cette idole de saleté & d’ordure. Beel-phegor, dit-il, est le nom d’une idole qui est adorée dans le pays de Madian, principalement par les femmes. Le peuple d’Israel se dévoüa à son service, & fut initié dans ses mysteres. Origene ajoûte, que Beel-phegor marque une espece de turpitude & de vilainie. Le rabbin Salomon de Lunel, autrement Jarchi, dans son commentaire sur le xxv des nombres, croit que ce nom signifie faire ses ordures devant quelqu’un, & que les idolatres faisoient cette salle action devant Beel-phegor. Le célebre Moyse, fils de Maimon, approche de son sentiment, & l’explique un peu plus au long dans son livre intitulé More Neuochim, partie 3. ch. xlvj. que Buxtorf le fils a traduit en Latin. On a encore allégué d’autres raisons du nom de cette idole. Quelques-uns croyent qu’elle s’appelloit ainsi, à cause qu’elle avoit la bouche ouverte. Philon juif est de cette opinion ; & il semble, qu’au lieu de Beel-phegor, il avoit lû Baal-piaghor, ce qui peut signifier la bouche ou l’ouverture supérieure de la peau. Saint Jérôme sur le 4 & le 9 du prophete Osée, & au I. livre contre Jovinien, chapitre xij. croit que le beel-phegor des Moabites & des Madianites est le même que le Priape des Grecs & des Latins. Isidore est de cette opinion au VIII. livre des origines ; & Rufin au III. livre sur Osée. Ces auteurs prouvent par les endroits de l’écriture sainte, où il est parlé des fornications des Moabites & des Hébreux, que ces deux idoles, Beel-phegor & Priape, étoient honorées avec d’infames cérémonies. Ils alleguent aussi le chapitre ix. du prophete Osée, où ceux qui servoient Beel-phegor sont accusés de commettre des impudicités, & de faire des choses abominables. Le pere Kircher suit aussi le sentiment de S. Jérôme, & dit que cette infame idolatrie étoit venue d’Egypte, où les Hébreux avoient vû les détestables cérémonies d’Osiris. Scaliger conjecture que le nom de phegor fut donné en dérision au dieu des Moabites, qui s’appelloit Baal-kéem, le dieu du tonnerre, que les Hébreux appellerent par mépris le dieu du pet, comme ils changerent le nom du dieu d’Accaron, Beelzebub, qui signifie le dieu des mouches, en celui de beelzebul, dieu des excrémens ; & comme ils donnerent à Bethel, où étoient les veaux d’or de Jéroboam, le nom de beth-aven, maison d’iniquité. Vossius, après S. Jérôme, croit que phegor est le dieu Priape ; d’autres se persuadent que cette idole reçut son nom de quelque prince qui fut mis au nombre des dieux, ou de quelque montagne de même nom, car il y avoit dans le pays de Moab une montagne qui s’appelloit phegor ; & l’on croit que baal y avoit un temple, où on lui offroit des sacrifices. Balac, dit Moyse, nomb. chap. xxiij. verset 28, conduisit Balaam au sommet de Phegor, qui regarde vis-à-vis du desert de Jesimon. Theodoret, sur le pseaume cv, fait venir de-là le nom de beel-phegor, & Suidas en donne l’étymologie en ces termes : Beel, c’est Saturne ; Phegor le lieu où il étoit adoré ; & de ces deux noms, a été formé celui de Beel-phegor : car, comme Jupiter a été appellé Olympien & Mercure Cyllenien, à cause des montagnes de Thessalie & d’Arcadie, où ils étoient adorés, il y a apparence que Baal étoit appellée Baal-phegor, à cause du mont Phegor, où on lui sacrifioit. Il est fait mention au ch. xxxjv du Deuteronome de la maison de phegor, ou de beeth-phegor, qui étoit dans le pays de Moab, auprès de la vallée dans laquelle Moyse fut enseveli. Les noms de beth dagon, de beth-shemesh, &c. semblent être des preuves que Beel-phegor se peut prendre là pour la montagne où étoit le temple de l’idole ; car les Hébreux appellent un temple beth, c’est-à-dire, maison. Les Moabites offroient les sacrifices à Beel-phegor, dont il est parlé dans les Nombres, chap. xxv. verset 2. Les filles de Moab inviterent les Israélites à leurs sacrifices, ils mangerent, & adorerent leurs dieux, & Israel fut invité aux mysteres de Beel-phegor. Et dans le pseaume cv. ils furent initiés à Beel-phegor, & ils mangerent les sacrifices des morts. Par ces sacrifices des morts, quelques-uns entendent les sacrifices offerts à Beel-phegor, qui étoit un dieu mort. D’autres entendent par-là les cérémonies des funérailles, & les offrandes que les Moabites faisoient aux morts. Selden prétend que Peel-phegor étoit le dieu des morts, ou le Pluton des Grecs ; & que les offrandes que l’on faisoit aux manes pour les appaiser, sont ces sacrifices des morts, dont il est parlé en cet endroït. Le pere dom Augustin Calmet conjecture que Phegor est peut-être le même qu’Adonis, ou Isiris, dont on célébroit les fêtes comme des funérailles des morts, avec des lamentations & des pleurs & d’autres cérémonies lugubres ; & il prétend que la défense que Moyse fait aux Hébreux, Lévit. xix. de se raser, & de se faire des incisions dans la chair pour les morts, a rapport au culte de Beel-phegor. Cela paroît assez vraissemblable, & il est certain que l’on honoroit ainsi Adonis : mais il se peut faire que deux différens dieux ayent eu le même culte dans deux diverses habitations, & il paroît que les Hébreux n’appelloient pas Adonis Phegor, mais Thammus. Le même Bénédictin donne encore une autre conjecture sur le dieu Phegor, en prétendant que c’est l’Orus des Egyptiens, fils d’Isis. Mais toutes ces conjectures n’ont rien de certain. Consultez Vossius, de l’idolatrie des payens, livre II. chap. vij. Voyez Baal. Selden, de Diis Syris. Dom Augustin Calmet, Dissertation sur les Nombres. (G)
BEELZEBUB, (Myth.) c’est-à-dire, dieu mouche, ou dieu de la mouche, étoit le nom d’un célebre dieu des Accaronites, dont il est parlé au IV. liv. des Rois ch. j. Quelques auteurs ont crû que les Juifs lui avoient donné ce nom par dérision, parce que dans le temple de Jérusalem on ne voyoit point de mouches sur les victimes. Scaliger est de cette opinion. Mais il est bien plus probable que les Accaronites avoient eux-mêmes donné ce nom à leur dieu ; ce qu’on peut prouver par les paroles d’Ochosias, qui envoya consulter ce dieu beelzebub ; il n’y a aucune apparence qu’il eût voulu consulter un dieu dont il se moquoit. Maldonat est de ce dernier sentiment dans son commentaire sur le ch. x. de S.Matt. Cette idole étoit donc appellée le dieu mouche, ou de la mouche, parce qu’on l’invoquoit contre les mouches. Ceux d’Arcadie sacrifioient tous les ans à un dieu semblable appellé Myagros. Les Juifs par l’horreur qu’ils avoient pour cette idole, appellerent le diable beelzebub ; on lit néanmoins dans la plûpart des exemplaires Grecs du nouveau Testament, beelzebul, qui signifie un dieu d’excrément : ce que les Juifs auroient pû faire du mot beelzebub, par mépris pour cette idole, comme on la dit dans l’article précédent. Au reste on pourroit croire qu’il faut aussi bien lire beelzebub dans le nouveau Testament comme dans l’ancien ; & que beelzebub est une ancienne erreur des copistes Grecs. Voyez Baal. (G)
BEELZEPHON, ou BAAL-TSEPHON, (Myth.) idole des Egyptiens. Ce mot est composé de beel, seigneur ou dieu, & de tsephon, caché, ou le septentrion, comme qui diroit le dieu caché, ou le dieu du nord. On donna aussi ce nom au lieu où cette idole étoit placée, sur les confins de l’Egypte vers la mer Rouge. Rabi Aben-Ezra dit que c’étoit un talisman d’airain que les magiciens de Pharaon avoient fait pour empêcher que les Israélites ne sortissent de l’Egypte. D’autres disent que les Egyptiens dressoient de ces talismans en tous les endroits par où les ennemis pouvoient aisément faire irruption dans l’Egypte, afin que leurs efforts fussent arrêtés par la force magique de ces idoles. Il y en a qui croyent que cette idole de beelzephon avoit la figure d’un chien, & qu’elle aboyoit lorsque quelqu’Israélite passoit par ce lieu pour s’enfuir. Kircher, Œdipus Ægiptiacus, tome I. (G)
* BEEMSTER, (Géog.) c’est une petite étendue de pays dans la Hollande septentrionale, vulgairement appellée Noort-Hollande : c’étoit autrefois un lac que l’on est parvenu à dessécher, & dont l’industrie des habitans a fait un des plus rians séjours de l’univers.
* BEENEL, (Hist. nat. bot.) arbrisseau toûjours verd qui croît dans le Malabar : on lui attribue quelques propriétés medicinales, sur lesquelles il ne faut pas compter tant qu’on n’aura pas de la plante une meilleure description.
* BEER-RAMATH, (Géog. sainte.) ville de Palestine dans la tribu de Siméon.
* BEESHA, (Hist. nat. bot.) espece de bambu qui croît au Malabar : on dit des merveilles de sa décoction pour l’érosion des gencives, les maux de dents, & la suppression des regles.
* BEFORT, (Géog.) ville de France capitale du Sundgaw, au haut d’une montagne. Lon. 24. 32. 30. lat. 47. 38. 18.
BEFROY, s. m. (Art. milit.) c’est dans les villes de guerre ou dans les places à portée de l’ennemi, une tour, clocher, ou autre lieu élevé, où il y a une cloche qui sonne lorsqu’on apperçoit l’ennemi, ou qu’on veut assembler les troupes. Dans les villes de guerre on sonne la cloche du béfroi à la pointe du jour pour l’ouverture des portes. Voy. Ouverture des Portes. (Q)
Befroy, (Charpenterie.) est la charpente d’une tour ou d’un clocher dans laquelle les cloches sont suspendues. Voy. la fig. 7. Pl. de la Fonderie des cloches, & l’art. Fonte des cloches.
BEGAYER, v. n. (Manége.) c’est la même chose que battre à la main par l’incommodité de la bride. Voyez Battre à la main. (V)
* BEG-ERI, (Géog. anc. & mod.) petite île d’Irlande près de Wexford, dans un petit golfe formé par la riviere de Slany, à son embouchure. Les Géographes sont partagés entre Beg-Eri & Bardesei, & ils ne savent laquelle des deux fut l’ancienne Andros, Edros, ou Hedros.
BEGGHARDS ou BEGGUARDS, BEGUINS & BEGUINES, (Hist. eccl.) sous tous ces noms on comprend une secte d’hérétiques qui s’éleverent en Allemagne sur la fin du xiiie siecle, & auxquels quelques auteurs donnent pour chef Dulcin ou Doucin : mais il ne faut pas les confondre avec les Dulcinistes. Voyez Dulcinistes.
Les principales erreurs des Begghars, Béguins, & Béguines, étoient que l’homme peut acquérir en cette vie un tel degré de perfection, qu’il deviendra entierement impeccable, & ne pourra plus avancer dans la grace ; parce que si quelqu’un y croissoit toûjours, il pourroit être plus parfait que J. C ; que quand on est arrivé à ce degré de perfection on ne doit plus prier ni jeûner, mais qu’alors la sensualité est tellement soûmise à l’esprit & à la raison, qu’on peut librement accorder à son corps tout ce qu’on veut : que ceux qui sont en ce degré de perfection, & qui ont l’esprit de liberté, ne sont point soûmis à l’autorité des hommes, ni obligés aux commandemens de l’Église ; parce que là où est l’esprit du Seigneur, là est la liberté : qu’on peut obtenir en cette vie la béatitude finale, comme on l’obtiendra dans l’autre : que toute nature intellectuelle est heureuse en soi, & que l’ame n’a pas besoin de lumiere de gloire pour voir Dieu & joüir de lui : que c’est être imparfait que de s’exercer à la pratique des vertus, l’ame parfaite les ayant exclues : qu’a l’élevation du corps de J. C. les parfaits ne doivent ni se lever ni lui rendre aucune marque de respect, parce que ce seroit une imperfection que de descendre de la pureté & de la hauteur de leur contemplation pour penser à l’eucharistie, à la passion ou à l’humanité de J. C.
Le pape Clément V. condamna ces fanatiques dans le concile général de Vienne tenu en 1311. Comme ils portoient l’habit religieux, sans garder ni le célibat ni aucune observance monastique, on les a quelquefois confondus avec ceux dont nous allons parler dans l’article suivant.
Begghards, Beguins, & Beguines, sont aussi les noms qu’on a donnés aux religieux du tiers ordre de S. François. On les appelle encore à présent dans les Pays-bas, Begghards, parce que long-tems avant qu’ils eussent reçû la regle du tiers ordre de S. François, & qu’ils fussent érigés en communauté réguliere, ils en formoient cependant dans plusieurs villes, vivans du travail de leurs mains, & ayant pris pour patrone sainte Begghe, fille de Pepin le vieux, & mere de Pepin de Herstal, laquelle fonda le monastere d’Andenne, s’y retira, & y mourut, selon Sigebert, en 692. A Toulouse on les nomma Béguins, parce qu’un nommé Barthelemi Bechin leur avoit donné sa maison pour les établir en cette ville. De cette conformité de nom le peuple ayant pris occasion de leur imputer les erreurs des Begghards & des Béguins, condamnés au concile de Vienne, les papes Clément V. & Benoit XII. déclarerent par des bulles expresses que ces religieux du tiers ordre n’étoient nullement l’objet des anathèmes lancés contre les Begghards & les Béguins répandus en Allemagne. Il y a encore aujourd’hui dans plusieurs villes de Flandre des communautés de filles qu’on nomme Béguines, & leurs maisons sont appellées béguinages. Voyez Beguines. (G)
* BEGIE ou BEGGIE, (Géog.) ville d’Afrique au royaume de Tunis, sur la pente d’une montagne. Long. 27. lat. 37.
BEGLERBEG, s. m. (Hist. mod.) nom qu’on donne en Turquie au gouverneur général d’une grande étendue de pays. Ce mot se trouve écrit diversement dans les auteurs : Beglerbeg, Beylery, & Begheler-Beghi ; il signifie seigneur des seigneurs.
Les Beglerbegs sont autant de vicerois qui commandent à tout un royaume ; leur autorité s’étend également sur la guerre, sur la justice, & sur la police : ils ont au-dessous d’eux d’autres gouverneurs particuliers, soit d’une province, soit d’une grosse ville, qu’on nomme sanjacs ou sanjiacs. Après le grand-visir, les Beglerbegs seuls ont le pouvoir de publier dans leurs départemens les ordonnances impériales, & d’y tenir la main. Par tout l’empire, hors de l’enceinte de Constantinople, ils peuvent faire décapiter, ou punir de tel autre genre de mort ou châtiment que bon leur semble, les coupables qu’on leur amene, sans que le bacha du lieu puisse s’y opposer ; il a seulement la liberté de se plaindre à la Porte s’ils abusent de leur autorité.
Autrefois il n’y avoit que deux Beglerbegs dans tout l’empire ; celui d’Europe ou de Romelie, & celui de Natolie en Asie : mais l’empire s’étant accru, le nombre des Beglerbegs s’est aussi augmenté en Asie ; celui de Romelie est resté seul en Europe, & semble représenter l’empereur Grec. Il est le plus éminent de tous les Beglerbegs ; car quoique tous les visirs à trois queues joüissent de ce titre, il sert cependant à caractériser plus particulierement le Beglerbeg de Romelie, gouverneur général de toutes les provinces Européennes dépendantes du grand-Seigneur ; le Beglerbeg de Natolie & celui de Syrie, qui fait sa résidence à Damas. Le gouverneur de Bude & celui de l’Arabie Pétrée portoient autrefois ce titre ; & si quelques bachas le prennent aujourd’hui, c’est sans l’aveu de la cour qui ne les traite que de plénipotentiaires. Guer. mœur. & usag. des Turcs, tome II. (G)
BEGONE, s. f. begonia, (Hist. nat. bot.) genre de plante dont le nom a été dérivé de celui de M. Bégon, & qui a été observée par le pere Plumier. Les fleurs des plantes de ce genre sont de deux sortes : l’une est stérile, & composée de quatre pétales grands & étroits ; l’autre est en rose, composée de plusieurs pétales disposés en rond sur un calice garni de feuilles, qui devient dans la suite un fruit à trois angles, ailé, divisé en trois loges, & rempli de petites semences. Tournefort, Inst. rei herb. app. Voyez Plante. (I)
BEGUILL, (Hist. nat. bot.) fruit de la grosseur d’une pomme, & couvert d’une écorce rude & noüeuse, sous laquelle il y a une pulpe semblable au fruit de l’arbousier.
BEGUINES, s. f. (Hist. mod.) c’est le nom qu’on donne dans le Pays-bas à des filles ou veuves, qui sans faire de vœux se rassemblent pour mener une vie dévote & réglée. Pour être aggregée au nombre des béguines, il ne faut qu’apporter suffisamment de quoi vivre. Le lieu où vivent les béguines s’appelle béguinage ; celles qui l’habitent peuvent y tenir leur ménage en particulier, ou elles peuvent s’associer plusieurs ensemble. Elles portent un habillement noir, assez semblable à celui des autres religieuses. Elles suivent de certaines regles générales, & sont leurs prieres en commun aux heures marquées ; le reste du tems est employé à travailler à des ouvrages d’aiguille, à faire de la dentelle, de la broderie, &c. & à soigner les malades. Il leur est libre de se retirer du béguinage, & de se marier quand il leur plaît. C’est ordinairement un ecclésiastique qui leur est préposé, & qui remplit les fonctions de curé du béguinage. Elles ont aussi une supérieure, qui a droit de les commander, & à qui elles sont tenues d’obéir tant qu’elles demeurent dans l’état de béguines.
Il y a dans plusieurs villes des Pays-bas des béguinages si vastes & si grands, qu’on les prendroit pour de petites villes. A Gand en Flandre il y en a deux, le grand & le petit, dont le premier peut contenir jusqu’à 800 béguines.
Il ne faut pas confondre ces béguines avec certaines femmes qui étoient tombées dans les excès des Béguins & des Begguards, qui furent condamnés comme hérétiques par le pape Jean XII. & dont il ne reste plus aucun vestige. Voyez Begghards.
BEGU, adj. (Manege.) Un cheval begu est celui qui, depuis l’âge de cinq ans jusqu’à sa vieillesse, marque naturellement & sans artifice à toutes les dents de devant : il s’y conserve un petit creux & une marque noire, qu’on appelle germe de féve, qui aux autres chevaux s’efface vers les six ans. Les chevaux begus ont les dents plus dures que les autres chevaux, ce qui fait que quand ils ont une fois marqué, ils marquent toûjours également aux pinces, aux dents moyennes, & aux coins. Les jumens sont plus sujettes à être beguës que les chevaux ; & parmi les chevaux Polonois, Hongrois, & Cravates, on trouve force chevaux begus. Les maquignons nient qu’il y ait des chevaux begus. Pour distinguer les begus des jeunes chevaux, on examine s’ils ont les dents courtes, nettes, & blanches ; c’est alors un signe de jeunesse. S’ils ont les dents longues, jaunes, crasseuses & décharnées, quoiqu’ils marquent encore à toutes les dents de devant, c’est un signe que ces chevaux sont vieux & bégus. (V)
BEHEMOTH, s. m. ce mot signifie en général bête de somme, & toute autre sorte de bétail : il se prend, selon les rabbins, dans Job, pour un bœuf d’une grandeur extraordinaire. Les docteurs talmudistes & les auteurs allégoriques des Juifs, & entr’autres R. Eliezer dans ses chapitres, disent que Dieu créa ce grand animal, appellé behemoth, le sixieme jour, & qu’il paît sur mille montagnes pendant le jour, que l’herbe de ces mille montagnes repousse pendant la nuit, & que les eaux du Jourdain lui servent pour boire. Ils ajoûtent que ce behemoth a été destiné pour faire un grand banquet aux justes à la fin du monde. Les Juifs les plus sensés savent bien à quoi s’en tenir sur ce conte : mais ils disent que c’est une allégorie qui désigne la joie des justes, figurée par ce festin. Cette théologie symbolique tient quelque chose du style des anciens prophetes : nous en voyons même des exemples dans le Nouveau-Testament. Mais les rabbins proposent trop cruement leurs allégories, & y ajoûtent certaines circonstances qui les rendent le plus souvent ridicules. Samuel Bochart a montré dans la seconde partie de son Hieroz. liv. V. chap. xv. que le behemoth de Job est l’hippopotame. Rab. Eliezer, Job, Ludolf, hist. de l’Abyssinie. (G)
* Behemoth, (Hist. nat.) c’est le nom que l’on a donné à l’animal, auquel on prétend qu’ont appartenu les os qui se trouvent en Russie & d’autres contrées, sur-tout du Nord ; ses dents sont d’un ivoire plus beau que celui qui vient des Indes. Les Turcs & les Persans en font des manches de poignards & des poignées de sabre, qu’ils estiment autant que si elles étoient d’argent. Voyez Élephant.
BEHEN, (en Pharmacie.) racine médicinale, en grande estime, sur-tout chez les Arabes, à cause de ses vertus cardiaques, aromatiques, & aléxitériales.
Il y a deux especes de behen ; savoir, le behen album ou blanc, qui est insipide, faisant peu d’impression sur la langue, ou celle d’une petite amertume seulement qu’il laisse après lui. Les botanistes modernes prétendent que c’est la même chose que notre lychnis terrestris ; d’autres veulent que ce soit proprement le papaver spumeum. Le behen rouge, behen rubrum, a des fibres, est brun par-dehors & rouge en-dedans : on présume qu’il n’est point différent de notre lemonium maritimum majus, ou lavande marine. L’un & l’autre viennent du Levant ; ils ont les mêmes vertus : on les substitue réciproquement ; il faut les choisir secs, & d’un goût aromatique astringent. (N)
* Le behen blanc est la racine d’une plante qui s’appelle jacea orientalis, patula, carthami facie, flore luteo magno ; elle est longue, noüeuse, sans chevelure ; elle s’étend de côté & d’autre comme la réglisse, à laquelle elle ressemble par sa figure & par sa grosseur, mais elle est plûtôt blanche que jaune. De la racine s’éleve une tige unique, de la hauteur d’une coudée, à la partie inférieure de laquelle naissent de grandes feuilles, longues, épaisses, semblables à celles de la patience, soûtenues par de longues queues. Les feuilles ont vers leur base quatre découpures, deux de chaque côté : mais les feuilles qui naissent de la partie supérieure de la tige l’embrassent sans queue, comme dans la perce-feuille ordinaire & le mouron de Crete. Le sommet de cette tige se partage en plusieurs rameaux garnis de petites feuilles, qui portent chacun une fleur composée de plusieurs fleurons, profondément découpés, jaunes, posés sur un embryon, & renfermés dans un calice écailleux, sans épines, jaune. Cet embryon se change dans la suite en une semence en aigrette.
On ne sait rien sur l’origine du behen rouge ; au sentiment des Arabes, l’un & l’autre fortifie, engraisse, forme la semence, est utile dans le tremblement, produit encore d’autres effets salutaires.
* BEHER, (Géog.) ville du Semigalle, en Courlande.
BEHIMA, (Hist. nat. bot.) herbe qui croît dans la province de Tremecen, en Afrique ; elle engraisse fort promptement les chevaux & le bétail, à qui on n’en laisse manger que jusqu’à ce qu’elle soit en épi ; car alors elle les étrangleroit.
BEHOURD ou BEHOURT ou BOHOURT, s. m. (Hist. mod.) mot dont l’origine & la racine sont assez obscures, mais qu’on rencontre fréquemment dans nos anciens romans, pour signifier un combat que l’on faisoit à cheval la lance au poing, ou une course de lances dans les réjoüissances publiques. Dans la basse Latinité on l’a appellé behordium, en vieux Gaulois behourt & tournoy, & l’on disoit behorder, behourder, & border, pour marquer les exercices où la jeune noblesse combattoit avec des lances & des boucliers. Les Espagnols en ont retenu quelque chose dans le jeu qu’ils nomment cannas. On appelloit aussi dies de behourdeis, ce que d’autres auteurs ont nommé en bonne Latinité dies hastiludii. Parmi les gens de la campagne & la bourgeoisie des petites villes, le behourd étoit un jour assigné pour joûter avec des cannes & de longs bâtons non ferrés, ce qui se pratique encore en Angleterre à certains jours de l’année ; & Monet assûre que le même usage avoit autrefois lieu en France le premier & le second Dimanche de carême ; & d’autres ajoûtent, que pour exprimer un exercice à peu près semblable, les Florentins se servent du terme bagordare. (G)
* BEJA ou BEJER, (Géog.) contrée de Barbarie, dans le royaume de Tunis.
* Beja, (Géog.) ville de Portugal, dans l’Alentejo, près du lac de même nom ; long. 10. 10. lat. 37. 58. On dit qu’il y a dans ce lac une espece de poisson bon à manger, qui présage la pluie & la tempête, & l’annonce par des mugissemens semblables à ceux du taureau ; d’autres attribuent ces mugissemens & le bruit, précurseurs des mauvais tems, à l’agitation des eaux du lac.
BÉJAUNE, sub. m. se dit, en Fauconnerie, des oiseaux niais & tout jeunes, qui ne savent encore rien faire ; béjaune ou bec-jaune signifie ignorance. Ce terme, béjaune, vient des petits oiseaux qui, avant d’être en état de sortir du nid, ont le bec jaune.
* BÉjaune ou Becjaune, (Hist. mod.) c’est ainsi qu’on nomme communément le régal qu’un officier donne à ses camarades en entrant dans un régiment : on dit payer son béjaune.
* BEICHLINGEN, (Géog.) ville d’Allemagne, au comté de même nom, dans le cercle de haute Saxe. Long. 29. 20. lat. 51. 20.
* BEID-EL-OSSAR ou BEID-EL-SSAR, plante Égyptienne, dont on trouvera la description & les propriétés dans Prosper Alpin & dans Veslingius. Elle croît aux environs d’Alexandrie ; ses feuilles coupées rendent un suc laiteux : on s’en sert pour dépouiller les peaux de leur poil ; pour cet effet on les laisse macérer dans ce suc.
Le fruit de la plante est environné d’un duvet ou coton fort doux, dont on fait des lits, des coussins, & des meches. Les abeilles se reposent volontiers sur le beid-el-ossar.
* BEIDHAH, (Géographie.) ville de la province de Perse proprement dite, proche Schiraz.
* BEIGE, s. f. (Commerce.) serge noire, grise ou tannée, que l’on fabrique en Poitou avec la laine, telle qu’on l’enleve de dessus le mouton, tant à la chaîne qu’à la trame. Elle doit avoir trente-huit à trente-neuf portées, & chaque portée vingt fils.
* BEILE ou BEIE, (Géog. anc. & mod.) ville d’Afrique, au royaume de Tunis, entre Constantine & Tunis. On croit que c’est la Bulla regia des anciens.
* BEILSTEIM, (Géog.) petite ville d’Allemagne, dans la Veteravie, avec titre de comté, entre Marpourg, Nassau, & Coblentz.
* BEIRA, (Géog.) province de Portugal, bornée au septentrion par les provinces entre Minho & Douro, & Tra-los-Montes ; au midi par l’Estramadure Portugaise ; à l’orient par l’Estramadure Espagnole ; à l’occident par la mer. Elle a environ 30 lieues en long, sur autant en large : sa capitale est Coimbre.
* BEIRE, (Géog.) petite ville de France, en Bourgogne, au bailliage de Dijon.
BEISTY, ou BISTI, subst. m. (Commerce.) petite monnoie d’argent billoné, à très-bas titre, que beaucoup d’auteurs ont traitée de monnoie de compte. Le beisty est rond, frappé de quelques caracteres bisarres & sans ordre ; il vaut argent de France un sou cinq deniers deux neuviemes.
BEIZA, ou BEIZATH, (Hist. anc.) mot Hébreu qui signifie un œuf, & aussi une certaine mesure usitée parmi les Juifs. Ils disent que l’œuf contient la sixieme partie du log, & par conséquent trois pouces cubes, & cette fraction de pouces Voyez Log. Le beizath est aussi une monnoie d’or usitée parmi les Perses, & qui pese quarante dragmes. Le P. Calmet prétend que c’est de ce mot, & non de la ville de Bysance, qu’est dérivé le mot besam ou besan, nom d’une autre monnoie d’or aussi en usage, du moins autrefois en orient ; un besam valoit deux dinars, & chaque dinar vingt ou vingt-cinq dragmes. Voyez Bezant, Dinar, Dragme. (G)
* BEKAVA, ou BEKAWA, (Géog.) petite ville de Pologne, dans le Palatinat de Lublin.
* BEKIA, (Géog.) ile de l’Amérique septentrionale, une des Antilles, qui n’est guere fréquentée que par quelques Caraïbes de S. Vincent qui y font la pêche, & y cultivent de petits jardins ; elle manque d’eau-douce, & abonde en viperes dangereuses. Lat. 12. 24.
* BELA, (Géog.) petite ville de Hongrie.
* BELALCAZAR, (Géog.) petite ville du royaume d’Andalousie.
BELANDRE, ou BELANDE, s. m. (Marine.) c’est un petit bâtiment fort plat de Varangue, qui a son appareil de mâts & de voiles semblable à l’appareil d’un heu : son tillac ou pont s’éleve de poupe à proue d’un demi-pié plus que le plat-bord. Outre qu’entre le plat-bord & le tillac, il y a un espace d’environ un pié & demi qui regne en-bas, tant à stribord qu’à babord. Les plus grands belandres sont de 80 tonneaux, & se conduisent par 3 ou 4 hommes pour le transport des marchandises ; ils ont des semelles pour aller à la bouline comme le heu. Voyez Heu. (Z)
BELATUCADRUS, s. m. (Myth.) nom d’une fausse divinité honorée autrefois en Angleterre, dont il est fait mention dans une inscription trouvée sur une vieille pierre dans la maison du sieur Th. Dikes, dans le comté de Cumberland, qui porte : Deo sancto Belatucadro Aurelius Diatova aram ex voto posuit. L. L. M. M. On trouve encore sur une autre pierre cette inscription au même Belatucadrus : Belatucadro Jul. Civilis Opt. V. S. L. M. & sur une troisieme qui a échappé au recueil des inscriptions de Gruter, & que Cambden a communiquée. On lit dans cette derniere : Deo Belatucadro lib. votum fecit Jolus. Selden dans son ouvrage de Diis Syris, croit que ce Belatucadrus est le même que Belenus & Abellion, nom que les Payens donnoient au soleil qu’ils adoroient particulierement. Gerard Jean Vossius est du même sentiment dans son livre de Origine & progressu Idololatr. lib. II. c. 17. Voyez Belenus. (G)
* BELBAIS, (Géog. anc. & mod.) ville d’Egypte, à l’une des embouchures du Nil ; c’étoit autrefois Peluse.
* BELBINE, ou BELENTINE, (Géog. anc.) ville située à l’entrée de la Laconie, vers le nord, près de l’Eurotas. Plutarque en fait mention dans la vie de Cléomenes.
* BELBO, (Géog.) riviere du duché de Milan.
* BELBUCH, & ZEOMBUCH, (Myth.) divinités des Vandales. C’étoient leur bon & leur mauvais génie : Belbuch étoit le dieu blanc, & Zeombuch le dieu noir : on leur rendoit à l’un & à l’autre les honneurs divins. Le Manichéisme est un système dont on trouve des traces dans les siecles les plus reculés, & chez les nations les plus sauvages ; il a la même origine que la Métempsycose, les desordres apparens qui regnent dans l’ordre moral & dans l’ordre physique, que les uns ont attribués à un mauvais génie, & que ceux qui n’admettoient qu’un seul génie, ont regardés comme la preuve d’un état à venir, où les choses morales seroient dans une position renversée de celle qu’elles ont. Mais ces deux opinions ont leurs difficultés.
Admettre deux dieux, c’est proprement n’en admettre aucun. Voyez Manichéisme. Dire que l’ordre des choses subsistant est mauvais en lui-même, c’est donner des soupçons sur l’ordre des choses à venir ; car qui a pû permettre le desordre une fois, pourroit bien le permettre deux. Il n’y a que la révélation qui puisse nous rassûrer ; & il n’y a que le Christianisme qui joüisse de cette grande prérogative. Voyez Immortalité & Ame.
* BELCASTRO, (Géog. anc. & mod.) ville d’Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, sur une montagne. Long. 34. 45. lat. 39. 6.
On la prend pour la Chonia des anciens : mais il y a peu d’apparence qu’elle ait été bâtie sur les ruines de la Petilia, dont il est parlé dans Strabon, Pline, Ptolomée, & Pomponius Méla.
* BELCHITE, (Géog.) petite ville d’Espagne, au royaume d’Arragon, sur la riviere d’Almonazir. Long. 17. lat. 41. 19.
* BELEDIN, s. m. (Commerce.) coton filé, d’une médiocre qualité & de peu de débit.
* BELELACS, s. m. pl. (Commerce.) especes de taffetas qui se fabriquent au Bengale : leur aunage est de quarante cobres de longueur, deux de large.
BÉLEMNITE. Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ici l’article de M. Formey, secrétaire de l’académie royale des Sciences & Belles-Lettres de Prusse, sur la bélemnite, qui nous a été remis manuscrit.
« Bélemnite (Hist. nat.) ce nom vient de la ressemblance de cette pierre avec le fer d’une fleche. Elle porte aussi celui de dactylus idæus, à cause de sa conformité avec un doigt de la main, & du mont Ida, où Pline dit qu’on la trouve ; & celui de lapis lyncis, ou lyncusius pris de la fabuleuse origine que les anciens lui donnoient ; parce qu’ils pensoient bonnement que c’étoit de l’urine de lynx changée en pierre. D’autres lui ont donné avec aussi peu de fondement le nom de pierre de tonnerre, pensant qu’elle tomboit du ciel. On trouve la bélemnite dans toutes sortes de lits de terre, de sable, de marne & de pierre, presque toûjours accompagnée de coquillages ou d’autres dépouilles de l’Océan, & souvent un peu applaties, à demi cassées, ou autrement défigurées par les mouvemens violens des couches de pierre ou de terre qui les ont comprimées, comme il est arrivé à un grand nombre de coquillages, & à d’autres productions marines.
» Il y a des bélemnites qui sont chargées de petites huîtres & de petits tuyaux de vers marins, dont la nature est d’être nécessairement attachés aux corps, où ils naissent, vivent & meurent sans changer de place ; d’autres ont été rongés par de petits insectes, comme cela arrive souvent aux huîtres & aux autres coquilles de mer. Les bélemnites sont en général d’une figure fort réguliere ; elles different néanmoins en trois manieres entr’elles. Il y en a de parfaitement coniques, d’autres presque cylindriques, dont la pointe paroît au haut après une espece d’arrondissement, qui les fait ressembler à un doigt de la main ; les dernieres ont un renflement à peu près comme les fuseaux. Leur longueur est depuis environ deux pouces jusqu’à huit & davantage, & leur grosseur depuis celle d’une plume médiocre jusqu’à trois & quatre pouces de circonférence ; leur couleur bien que différente ne peut point servir à les distinguer, puisqu’elle dépend uniquement des lieux où on les trouve. Elles ont toutes une cannelure plus ou moins marquée, qui regne depuis la base jusqu’à la pointe, mais dont l’enfoncement va toûjours en diminuant ; & c’est cette cannelure qui fait qu’elles se rendent facilement en long. Toutes celles qui sont entieres, ont à leur base une cavité de figure conique, qui differe en largeur & en longueur, selon que ces pierres sont plus grosses & plus longues. Cette cavité est souvent vuide & quelquefois pleine de sable, de crystaux & d’autres matieres. Il y en a aussi qui renferment une alvéole fort curieuse, composée de plusieurs petites coupes semblables aux verres des montres de poche, enchâssées l’une dans l’autre, & qui toutes ensemble forment un cone parfaitement convenable au vuide de la pierre ; ce qui fait que quoique ces alvéoles soient de differentes matieres, tous les auteurs qui en ont parlé croyent qu’ils appartiennent véritablement à la bélemnite, & qu’ils se sont formés dans sa cavité.
» Leur structure inférieure est toûjours absolument la même. Elles sont toutes composées de plusieurs couches très-régulierement rangées, comme les aubiers des arbres, & si minces qu’il faut une loupe pour les distinguer avec quelque exactitude. Leur matiere forme par ses filets presque imperceptibles des rayons qui vont du centre à la circonférence. Ces rayons partent d’un très-petit tuyau, qui occupe toute la largeur de la pierre, & qui n’est bien visible que dans les plus transparentes ; d’horisontaux qu’ils sont d’abord, ils s’élevent ensuite peu à peu vers la circonférence, surtout en approchant de la pointe. C’est-là la raison pourquoi la partie de la pierre du côté de la base paroît creuse, & l’autre paroît convexe, quand on l’a coupée en travers. Le demi-diametre de la bélemnite qui regarde la cannelure, est toûjours plus court que celui qui lui est opposé ; & l’on remarque par intervalles des lignes longitudinales, qui se terminent en cone autour du petit tuyau. On peut facilement séparer les couches de ces pierres en les mettant sur un charbon allumé, ou à la flamme d’une chandelle. Elles sont en dedans & en dehors d’un parfait poli, & deviennent blanches lorsqu’elles sont exposées au feu. Il en sort une mauvaise odeur, comme de corne brûlée, ou d’urine de chat, quand on les frotte l’une contre l’autre ; mais sur-tout quand on les brûle.
» On agite la question ; si ces pierres sont de vrais minéraux, ou si elles appartiennent à quelque animal, & en ce cas à quelle de ses parties on doit les rapporter. Il faut lire là-dessus les Lettres philosophiques sur la formation des sels & des crystaux, &c. par M. Bourguet. Ce savant de Neuf-châtel y établit d’une maniere qui me paroît démonstrative, que les bélemnites n’appartiennent point au regne minéral, vû que les corps les plus réguliers que ce regne fournisse ne gardent point une symmétrie aussi parfaite dans leur structure. Il compare la bélemnite à la stalactite, qui est de toutes les pierres celle qui en approche le plus ; & il fait voir qu’il reste encore une énorme différence entr’elles. Cela le conduit à conjecturer que c’est une dent d’animal ; & quoiqu’on ne puisse pas encore indiquer l’animal auquel elles ont appartenu, la grande conformité qu’a la bélemnite avec les dents d’autres animaux, & particulierement avec les dents droites du crocodile, met cette conjecture dans une fort grande vraissemblance. La cavité de figure conique que les bélemnites entieres ont à leur base, est en effet semblable à celle qu’on voit aux dents du crocodile & du physeter, aux défenses de l’éléphant, & du poisson nahrwal. La cannelure de la même pierre a beaucoup de rapport avec celles des dents de la scie du spadon, qui sont enchâssées dans cette longue défense, comme dans une mâchoire. Enfin ses petits filets sont de même nature que ceux de la structure intérieure de l’émail des dents de presque tous les autres animaux. Quant à l’alvéole, ses coupes répondent aux couches de la bélemnite par le moyen des lignes longitudinales, qui forment d’espace en espace de petits cones qui marquent peut-être les divers tems de son accroissement. M. Bourguet répond ensuite aux difficultés de M. Scheuchzer, & de quelques autres Physiciens. Enfin il explique la formation & le méchanisme organique de la bélemnite d’une maniere fort plausible. Comme les animaux auxquels ces dents appartiennent, croissent pendant toute leur vie, il n’est pas étonnant qu’il y ait des bélemnites si différentes en grosseur & en longueur ».
Nous ajoûterons seulement à cet article l’opinion de M. Woodward & celle de M. le Monnier le Medecin, de l’académie royale des Sciences. M. Woodward rapporte dans sa lettre sur l’Origine, la nature & la constitution de la bélemnite, que M. Lhwyd prétendoit qu’elle se forme dans le pinceau de mer ou dans le coquillage appellé dentale. Notre auteur réfute ce sentiment par la raison qu’on ne voit jamais aucunes traces du moule dans lequel la bélemnite se seroit formée, comme on voit celle du moule des autres pétrifications ; que le prétendu moule de la bélemnite devroit être bien apparent autour de celles qui ont près de deux piés de longueur, & environ deux pouces de diametre à l’endroit le plus gros ; & que cependant il n’en a apperçû aucun vestige dans des bélemnites de cette grandeur qu’il a observées.
M. Woodward répond ensuite à ceux qui croyent que les bélemnites sont des cornes d’animaux ou des dents de poissons : il soûtient que ce ne sont pas des cornes, parce que la plûpart n’en ont pas la figure ; & pour le prouver, il fait mention des trois principales especes de bélemnites, qui sont la bélemnite conoïde, qui est la plus commune ; la bélemnite en forme de fuseau, & la bélemnite cylindrique terminée en pointe par les deux bouts ; & il conclut que si toutes ces bélemnites ressemblent à des cornes, il n’y a rien qui ne puisse y ressembler. Le même auteur ne croit pas qu’il soit à présumer que la bélemnite soit une corne, parce qu’on la trouve dans la terre avec des coquilles, des dents & d’autres parties d’animaux ; puisqu’il s’y trouve aussi bien d’autres choses qui ne sont certainement pas des cornes. Il nie que toutes les bélemnites ayent une odeur de corne brûlée, c’est-à-dire une odeur animale : il assûre que les bélemnites d’Angleterre n’ont ordinairement aucune odeur, & que toutes celles qu’il a trouvées dans la craie n’en ont point du tout ; & il croit que les bélemnites n’ont que l’odeur qui leur a été communiquée par des matieres salines, sulphureuses ou bitumineuses avec lesquelles elles ont séjourné. Enfin M. Woodward soûtient que les bélemnites ne sont ni des cornes ni des dents, parce que leur pesanteur spécifique est différente de celle des cornes & des dents : les raisons qu’il en donne sont tirées de ses principes sur l’Histoire naturelle de la terre.
C’est en conséquence de ces mêmes principes que M. Woodward met la bélemnite dans la classe des corps talqueux, parce que sa pesanteur est égale à celle de ces corps. La couleur jaune de certaines bélemnites est semblable à celle de quelques talcs, spars, & autres productions minérales.
La substance de la bélemnite, dit M. Woodward, n’est pas coriace & ténace comme celle des animaux, mais friable & cassante comme celle du talc, &c. à la vûe elle paroît minérale ; & on en est convaincu par les épreuves chimiques : sa tissure, ajoûte le même auteur, est directement contraire à celle des dents, & des autres parties solides des animaux ; ses fibres coupent diamétralement son axe, au lieu que celles des dents, des os, des cornes, &c. sont paralleles à leur axe. Le talc fibreux ou cannelé, le gypse strié, le spar talqueux, l’amiante, l’alun de plume, &c. ont leurs fibres transversales comme celles des bélemnites. L’auteur cite un exemple remarquable de cette tissure, qu’il a observée dans quelques stalactites composées d’un spar talqueux, qui sont suspendues dans des grottes soûterreines ; il en a vû plusieurs qui étoient cannelées.
De tout ceci M. Woodward conclut affirmativement que les bélemnites ne peuvent venir d’un animal. Quand on lui objecte qu’elles ont été altérées comme d’autres pétrifications, il répond que cela n’est pas possible, parce qu’il en seroit resté au moins quelqu’une sans altération, comme il y a tant de coquilles fossiles qui ne sont pas pétrifiées.
Les tuyaux vermiculaires, & les coquilles d’huîtres qui sont attachées sur quelques bélemnites, ne prouvent rien pour leur origine ; puisque l’on trouve les mêmes choses sur des cailloux, des pyrites, &c. D’ailleurs si la bélemnite étoit une dent de poisson, on trouveroit au moins quelques vestiges de cette dent, ou quelques marques de son adhérence à une mâchoire. On aura beau dire que cette dent aura été séparée de la mâchoire, M. Woodward ne conçoit pas que cela puisse être pour toutes les bélemnites qui sont si nombreuses, tandis que toutes les vraies dents fossiles sont reconnoissables à ces mêmes marques qui manquent aux bélemnites. Géographie, Physique, &c. page 363.
M. Le Monnier n’est point opposé au sentiment de M. Woodward, pour l’origine de la bélemnite ; il la croit appartenante au regne minéral. Il en a vû dans le Berri qui étoient entierement solides, & d’autres qui étoient creuses en-dedans : celles-ci avoient une cavité conique comme la surface extérieure de la bélemnite ; l’axe du cone extérieur étoit double de celui du cone intérieur ; de sorte que la pointe de la bélemnite étoit entierement solide, & cette solidité alloit toûjours en diminuant jusqu’aux bords de la base, qui n’étoit qu’une lame transparente, & mince comme une feuille de papier ; cette cavité étoit remplie d’une terre très-fine, jaune, grasse & humide, qui paroissoit être, pour ainsi dire, la matrice des bélemnites. M. Le Monnier n’a pas vû d’apparence que ces bélemnites fussent des tuyaux, des pointes d’hérisson de mer, non plus que des dents du souffleur ; il lui a semblé au contraire que ce sont des productions de la terre, comme des stalactites ou des pyrites. M. le Monnier appuie cette conjecture sur ce que les bélemnites incrustées dans la pierre & dans la craie, & qui n’ont pour ainsi dire plus de vie, ne renferment point de cette terre jaune & humide ; que cette même terre se trouve par-tout où il y a des bélemnites en certaine quantité ; & que le feuillet mince, transparent & fragile qui termine la bélemnite, peut être regardé comme un ouvrage en train, auquel la nature n’a pas encore mis la derniere main. M. le Monnier sait parfaitement que l’on trouve avec les bélemnites des cornes d’ammon, & d’autres coquilles, telles que les gryphytes, les petoncles, les cames, &c. mais il fait remarquer qu’on rencontre aussi dans les mêmes endroits du gypse & des pyrites. Mérid. de l’Observ. de Paris, &c. Observ. d’Hist. nat. p. 125. & suiv.
On voit par cet exposé, que les Naturalistes ne sont point d’accord sur l’origine & la nature de la bélemnite : on n’a pas encore prouvé d’une maniere décisive que ce soit un minéral ou une pétrification originaire du regne animal. (I)
Belemnite, ou Pierre de Lynx, (Mat. med.) Les Allemands la croyent bonne contre le cochemar & le calcul des reins ; ils en ordonnent la poudre depuis un gros jusqu’à un gros & demi. (N)
* BELINGELA, (Hist. nat. bot.) c’est un fruit qui se trouve en Afrique & en Amérique : ses racines sont grosses & courtes, ses feuilles grandes, d’un verd obscur, & remplies de veines brunes tirant sur le pourpre. Elle porte deux ou trois fleurs blanches mouchetées de rouge : le fruit à l’extérieur est rond, uni & brillant comme une pomme ; le dedans est plein de chair, & contient beaucoup de semences. Les habitans du Bresil en font un très-grand cas. Il n’est pas sain de le manger crud : mais en le faisant cuire, & l’assaisonnant avec du poivre & de l’huile, il prend un goût aigrelet & agréable, qui a quelque rapport avec celui du citron.
BELENOIDE, apophyse bélenoïde, voyez Styloïde. (L)
BELENOS ou BELENUS, (Myth.) nom que les Gaulois donnoient au soleil, qu’ils appelloient aussi Mithra. On croit que c’est le même que le baal de l’Ecriture, & le Belus des Assyriens. Elias Schedius persuadé que le nom de Belenus étoit mystérieux, jusque dans les lettres qui le composent, les a considérées selon leur valeur dans les nombres (à la maniere des anciens Grecs, dont les caracteres étoient, dit-on, en usage parmi les Druides), & a trouvé qu’elles faisoient trois cens soixante-cinq jours ; tems de la révolution du soleil autour de la terre.
| Β | η | λ | ε | ν | ο | ς |
| 2 | 8 | 30 | 5 | 50 | 70 | 200 |
L’on voit plusieurs inscriptions rapportées par Gruter & par d’autres antiquaires, qui prouvent que Belenus étoit la même divinité que le soleil ou Apollon ; entr’autres celle-ci :
Apollini Beleno. C. Aquileiens. felix. (G)
* BELER, (Géog.) riviere de Catalogne qui se jette dans la Méditerranée proche de Barcelone.
* BELERAN, (Géog.) île de la mer Méditerranée, proche d’Yvica.
* BELESME, (Géog.) ville de France assez ancienne, dans le Perche. Lon. 17. 14. 15. lat. 48. 22. 32.
BELETTE, s. f. mustela domestica, (Hist. nat. Zoolog.) petit animal quadrupede dont on a donné le nom à un genre entier de quadrupedes, genus mustelinum. Les animaux de ce genre sont carnassiers : mais ils different des autres animaux carnassiers, en ce qu’ils sont plus petits, qu’ils ont le corps plus mince & plus long, la tête plus petite & plus allongée, & les pattes plus courtes ; de sorte qu’ils semblent être faits pour se glisser & s’insinuer à travers les plus petites ouvertures ; & en effet ils penetrent dans des endroits dont l’entrée est si étroite, qu’on ne croiroit pas qu’il leur fût possible d’y entrer.
La belette est plus petite que le putois ; le dos & les côtés du corps sont de couleur rousse, la gorge & le ventre sont blancs ; & cette couleur s’étend depuis le bout de la mâchoire inférieure, jusqu’à l’extrémité des pattes de derriere sur leur côté intérieur ; car le côté extérieur, & presque tout le reste du corps est roux : le museau ressemble à celui du chien, de sorte que la mâchoire supérieure est plus avancée que l’inférieure. La belette a des soies en forme de moustache. Ses dents sont au nombre de trente-deux ; six incisives, deux canines, & huit molaires dans chaque mâchoire ; les canines sont longues & fortes : les yeux sont petits & noirs ; les oreilles courtes & larges, arrondies, couvertes de petit poil fort épais : ce qu’il y a de singulier, c’est que la partie postérieure de la conque est double, c’est-à-dire, composée de deux panneaux qui forment une sorte de poche dont l’entrée est au bord de la conque. La queue est assez semblable à celle d’un rat, quoique beaucoup plus courte : les piés sont larges à proportion de la grosseur de l’animal ; il y a cinq doigts à chaque pié, & un petit ongle à chaque doigt. La belette est un animal fort vif & fort agile ; elle habite dans les greniers, dans les vieux murs, dans les étables, & surtout dans les trous en terre : elle cherche avec avidité les œufs des pigeons, des poules, &c. pour les manger. Elle se nourrit le plus souvent de rats, de serpens, de taupes ; elle les surprend dans leurs trous, parce qu’elle est faite de façon qu’elle y pénetre aisément ; & elle est assez courageuse pour attaquer des animaux plus gros qu’elle, comme sont les gros rats, car on prétend qu’elle leur donne la chasse de quelque espece qu’ils soient. L’agilité de la belette & la finesse de son instinct, lui donnent aussi de l’avantage sur les chauvesouris & sur d’autres oiseaux, dont on prétend qu’elle suce le sang après qu’elle les a tués. Ray. Aldrovande. V. Fouine, Putois, Quadrupede. (I)
La belette est d’usage. Après en avoir ôté les boyaux, l’avoir salée & fait sécher à l’ombre, deux gros de cet animal préparé comme on vient de dire, passent pour un remede efficace contre le venin du serpent, & contre toute sorte de poison. Son ventricule rempli de semence de coriandre, & gardé pendant un tems convenable, est salutaire contre l’épilepsie & la morsure des serpens.
La belette calcinée dans un pot de terre, est utile contre les douleurs de la goutte ; son sang diminue les tumeurs scrophuleuses lorsqu’on l’applique dessus ; ses cendres mêlées avec du vinaigre ont la même vertu. Dioscoride. (N)
* BELEZO, (Géog.) ville & palatinat de la Pologne.
* BELFAST, (Géog.) ville d’Irlande au comté d’Antrim, avec château & port.
* BELFORTE, (Géog. anc. & mod.) village du royaume de naples dans la Calabre ultérieure, près de la riviere de Metramno, au midi de Mileto. On y voit encore les ruines de l’ancienne Subcinum ou Subsicinum des Brutiens.
* BELGARD ou BELGRAD, (Géog.) ville du duché de Poméranie, sur le Persante.
* BELGES ou BELGIQUE, (Géog & Hist. anc.) peuples qui habitoient une des trois parties de la Gaule, qu’on appella Belgique. La Belgique fut soûdivisée dans la suite en Belgique premiere, Belgique seconde, Germanie inférieure, & Germanie supérieure. César la place entre le Rhin, l’Océan, & les rivieres de Seine & de Marne. On donne aujourd’hui le nom de Belgique à la basse Allemagne, qui comprend les 17 provinces des Pays-bas.
* BELGRADE, (Géog. anc. & mod.) ville de la Turquie Européenne, capitale de la Servie, au confluent du Danube & de la Save. Long. 38. 30. lat. 45. Quelques-uns croyent que c’est le Taurinum des anciens.
* Belgrade, (Géog.) petite ville de la Turquie Européenne dans la Romanie, sur le Bosphore de Thrace. Lon. 40. 30. lat. 41. 22.
* BELGRADO, (Géog.) petite ville d’Italie dans le Frioul & l’état de Venise. Lon. 30. 35. lat. 46.
* Belgrado, (Géog.) petite riviere de la Romanie en Turquie.
* BELI, voyez Covalam ; c’est un grand arbre fruitier qui ressemble assez au coignassier, qu’on appelle aussi serifole Bengalensium.
BELIAL, s. m. (Myth.) nom d’une idole des Sidoniens. S. Paul donne ce nom à Satan ou au démon. S. Jérôme dit que par les enfans de bélial, on doit entendre les enfans du démon, c’est-à-dire les méchans. C’est en ce sens que les deux fils d’Heli, Ophni & Phinées, sont appellés filii belial. Reg. I. c. ij. v. 12. Parmi les imprécations que Semeï fait à David fuyant devant Absalon, il l’appelle homme de sang, homme de belial, vir belial ; c’est-à-dire, cruel & méchant. II. Reg. c. xvj. vers. 7. Aquila explique ce mot par celui d’apostat : il renferme, selon d’autres, une espece d’injure qui répond à nos mots François de fainéant & de vaurien. Gregorii lexic. sanct. (G)
BELIC, s. m. terme de Blason qu’on employe quelquefois au lieu de gueules, pour signifier couleur rouge. On dit aussi belif. Voyez Gueule. (V)
BELIER, s. m. aries, (Hist nat. Zoolog.) animal quadrupede qui est le mâle de la brebis, qui porte le nom d’agneau dans les premiers tems de sa vie, & qui prend celui de mouton lorsqu’il a été coupé. L’agneau, le bélier, la brebis & le mouton, appartiennent donc à un seul genre que les Naturalistes appellent ovinum genus, ovillum pecus, le genre des brebis. Ce genre porte le nom de la femelle & non pas celui du mâle, sans doute parce qu’on éleve bien plus de femelles & de mâles coupés, que de mâles entiers. Car il y a des troupeaux de moutons & des troupeaux de brebis : mais jamais on n’a vû des troupeaux de béliers ; on n’en garde qu’autant qu’il en faut pour féconder les femelles.
Quoi qu’il en soit de la dénomination du genre, je crois que sa description doit être à l’article du bélier, ne fût-ce que parce que les cornes sont un des caracteres génériques. Les animaux du genre dont il s’agit ici font partie du bétail : ils sont couverts de laine au lieu de poil ; leurs cornes sont creuses, ridées, recourbées, & quelquefois contournées en spirale. La femelle a deux mammelles. Ces animaux n’ont pas le quart de la grosseur du bœuf ; ils sont lâches & timides : cependant les béliers montrent du courage, surtout lorsque leurs cornes commencent à paroître : ils se battent les uns contre les autres à coups de tête & de cornes ; & ils sont quelquefois assez hardis pour attaquer des hommes, sur-tout lorsqu’ils courrent les femelles. Ils en peuvent féconder dès l’âge d’un an : mais les agneaux qui en viennent ne sont pas aussi bien conditionnés que ceux qui ont été produits par un bélier de trois ans. Quoique les brebis n’entrent en chaleur que vers le commencement de Novembre, cependant les béliers s’accouplent avec elles, & les fécondent en tout tems, lorsqu’on leur en donne la liberté. Ils sont très-propres aux femelles depuis l’âge de trois ans jusqu’à huit ; & un seul peut suffire à trente & même à cinquante brebis, & quelquefois jusqu’à soixante, & plus. On ne doit les laisser ensemble qu’autant de tems qu’il en faut pour l’accouplement, afin de ménager les forces du mâle & des femelles.
Les meilleurs béliers sont ceux qui ont la tête grosse, le nez camus, le front large, les yeux noirs & gros, les oreilles grandes, le corps long & élevé, l’encolure & le rable large, le ventre grand, les testicules gros, & la queue longue. Ils doivent avoir beaucoup de laine, même dans les endroits où il y en a ordinairement le moins ; c’est-à-dire, sur le ventre, la queue & les oreilles, & sur la tête jusqu’autour des yeux. Quoique la toison du bélier soit entierement blanche, on prétend qu’il ne produit que des agneaux tachetés, s’il a la moindre tache à la langue ou au palais. Les béliers qui ont des cornes passent pour être plus ardens & plus propres à féconder les brebis, que ceux qui n’en ont point ; & on croit que cette différence est fort sensible dans les pays froids, & même dans les climats tempérés : mais les béliers cornus sont plus incommodes & plus dangereux dans le troupeau que les autres, parce qu’ils se battent plus souvent, non-seulement contre les autres mâles, mais aussi contre les brebis, & qu’ils les blessent. Pour arrêter leur fureur, & les empêcher de doguer, on leur perce les cornes avec une tarriere près des oreilles, à l’endroit où elles se courbent. Il y a encore un autre moyen, qui est de poser sur leur front & d’attacher à la racine des cornes, un morceau de planche garni de pointes de fer tournées du côté du front, qui piquent l’animal toutes les fois qu’il donne un coup de tête.
Lorsque les béliers ont passé huit ans, & qu’ils ne sont plus propres à la multiplication de leur espece, on les fait tourner, & on les engraisse : mais leur chair a toûjours de l’odeur & du goût de celle du bouc, & elle n’est jamais aussi bonne que celle du mouton, ni même que celle de la brebis. Voyez Aldrovande & la Maison rustique. V. Agneau, Mouton, Brebis, Quadupede. (I)
Belier, aries, (Astron.) le bélier est le premier des 12 signes du zodiaque ; il donne son nom à la douzieme partie de ce cercle. V. Signe. Les étoiles qui forment cette constellation, sont dans le catalogue de Ptolomée au nombre de 18, dans celui de Ticho au nombre de 21, & dans le catalogue Britannique au nombre de 65. Voyez Printems, Equinoxe. (O)
Belier, s. m. (Art milit.) machine dont les anciens se servoient pour battre les murailles des ouvrages qu’ils attaquoient. Aries, arietaria machina.
Le belier étoit une grosse poutre ferrée par le bout en forme de tête de bélier. On s’en servoit pour battre les murailles, en le poussant à force de bras, par le moyen de cables ou de chaînes, avec lesquels il étoit suspendu. On faisoit joüer le bélier sous une galerie, à laquelle on donnoit le nom de tortue, ou dans une tour de bois destinée à cet effet. Voyez cette tour Pl. XI. de l’art militaire. Il y avoit des béliers suspendus, & d’autres qui ne l’étoient pas. Voici la description du belier suspendu, suivant M. le chevalier de Folard.
Le bélier suspendu étoit composé d’un seul brin de bois de chêne 2, Pl. XII. assez semblable à un mât de navire, d’une longueur & d’une grosseur prodigieuse, dont le bout étoit armé d’une tête de fer fondu 3, proportionnée au reste, & de la figure d’une tête de bélier, ce qui lui fit donner ce nom, à cause qu’elle heurte les murailles comme le bélier fait de sa tête tout ce qu’il rencontre. Tous ceux que l’on voit sur les monumens Grecs & Romains paroissent sous cette forme. La tête du bélier, dit Vitruve, portoit quatre bandes de fer longues environ de quatre piés, par lesquelles elle étoit attachée au bois. A l’extrémité de chacune de ces bandes 4, il y avoit une chaîne 5 de même métal, dont un des bouts étoit attaché au crochet 6, & à l’autre extrémité des quatre chaînes il y avoit un cable, dont un des bouts de chacun étoit fortement amarré au dernier chaînon ; ces cables étoient allongés le long de la poutre béliere jusqu’à l’arriere 7 le long de la poutre, liés serrément tous les quatre ensemble par une petite corde, qui les contenoit fermes & bandés autant qu’il étoit possible, ainsi qu’on le pratique ordinairement sous les brancards d’une chaise de poste, pour leur donner plus de force.
A l’extrémité de ces cables, il devoit y en avoir un autre, & un trelingage 8 au bout, c’est-à-dire, un cordage qui finit par plusieurs branches, à chacune desquelles il y avoit plusieurs hommes pour balancer la machine. Pour fortifier davantage le bélier, on faisoit une liure de plusieurs tours de corde 9 à la distance d’environ deux piés d’une liure à l’autre ; les tours de chaque cordage liés aussi serrément & près à près qu’il étoit possible, & sans déborder. Ce bélier ou poutre béliere, devoit être d’une grosseur conforme à sa longueur ; Vitruve lui donne quatre mille talens de pesanteur, c’est-à-dire, quatre cents quatre-vingts mille liv. ce qui n’est pas exorbitant. Cette terrible machine, comme Josephe l’appelle, étoit balancée en équilibre comme la branche d’une balance, avec une chaîne ou de gros cables 10 qui la tenoient suspendue. Cette chaîne ou ces cables doubles étoient amarrés au milieu d’une puissante poutre de travers 11, pour tenir suspendue & comme en l’air une masse si prodigieuse. On faisoit pour soûtenir la poutre traversante une base 12, non pas telle que Josephe & Vitruve la représentent, mais en quarré long de trente ou quarante piés, & quelquefois davantage, sur plus ou moins de largeur selon la longueur de la poutre. Les auteurs varient sur ces proportions comme dans tout le reste ; car il ne faut point chercher l’uniformité dans ceux qui ont écrit des machines de guerre ; on ne manque jamais de trouver les auteurs en contradiction entr’eux sur les mêmes choses ; parce que la plûpart ont écrit sans expérience, & d’autres, après les changemens qui ont été faits dans ces machines.
Sur les deux côtés de cette base on élevoit dix gros poteaux de 25 à 30 piés de haut, sans les tenons, dont quatre faisoient les encognures ; ces poteaux étoient joints en-haut par quatre sablieres pour recevoir les bouts des poteaux, de même qu’ils l’étoient par en-bas, avec les poutres qui faisoient le premier chassis ou la base ; sur cet assemblage de montans & de traversans, & les sablieres qui alloient de chacun des poteaux à l’autre opposé, on passoit la poutre de travers dont j’ai déja parlé, posée entre deux coins de bois de chaque côté, traversées de fortes chevilles de fer, & de puissantes équerres, qui servoient à resserrer & tenir ferme les deux bouts de la poutre traversante qui soûtenoit la béliere.
Toute cette charpente, qui prenoit quelquefois le nom de tortue béliere à comble plat, & le plus souvent à comble aigu, étoit couverte de maniere différente selon les forces des assiégés. On l’enveloppoit quelquefois d’un tissu d’osier verd enduit de terre grasse, & recouvert d’un rideau de peaux fraîchement écorchées, que l’on doubloit d’autres peaux où l’on mettoit entre deux de l’herbe marine piquée comme nos matelas, ou de la mousse, le tout trempé dans du vinaigre, afin que cette couverture fût à l’épreuve des pierres & des dards, dont les assiégés n’étoient pas chiches : car ces rideaux matelassés étant suspendus à un pié de la charpente, rompoient la force des coups des machines ; & lorsque la place en étoit abondamment fournie, on garnissoit les côtés de charpente de forts madriers, indépendamment des mantelets.
Comme le comble souffroit le plus par les masses affreuses chassées par les grosses catapultes, qui faisoient autant de desordre que nos mortiers, on le couvroit de madriers revêtus de claies enduites de mortier ou d’argille, pétrie avec du crin & de la bourre. Traité de l’attaque des places des anciens, par M. le chevalier Folard. Voy. Pl. XII. de l’art militaire, une tour avec son pont & son bélier renfermé dedans. Voyez aussi Helepole. (Q).
BELIERES, subst. f. pl. en terme de Metteur en œuvre, se dit de certains petits anneaux d’or ou d’argent auxquels on suspend une pendeloque ou un pendant. On nomme beliere du talon celle qui reçoit l’une ou l’autre de ces choses ; & beliere du cliquet, celle qui passe sous le tendon de l’oreille, & retient toûjours la boucle du même côté V. Cliquet & Talon.
* BELILLA, (Hist. nat. bot.) arbrisseau Indien qui porte des baies, & sur le compte duquel on ne tarit point : on lui attribue une foule de propriétés médicinales qu’on peut voir dans le dictionnaire de Médecine ; nous ne les rapporterons point ici, parce que nous n’ajoûtons pas beaucoup de foi aux propriétés des choses qui nous paroissent aussi peu connues que le belilla, dont on n’a qu’une phrase botanique.
BELIN, (Marine) Voyez Blin.
* BELINGE, s. f. (Commerce) tiretaine grossiere, fil & laine, qui se fabrique à Beauchamp le vieil, en Picardie.
* BELINZONA, (Géog.) ville de la Suisse, sur le Tesin, aux frontieres du Milanois.
* BELITZ (Géog.) petite ville de la Marche de Brandebourg, sur l’Ada.
* BELIZANA (Myth.) nom sous lequel les Gaulois adoroient Minerve, inventrice des Arts. Elle étoit représentée, sans lance & sans égide, revêtue d’une tunique sans manches ; les piés croisés, & la tête appuyée sur sa main droite, comme une femme qui médite. On auroit pû lui ôter encore son casque & son aigrette.
* BELLAC (Géog.) petite ville de France, dans la Marche, sur la petite riviere d’Unicon. Long. 18. 48. lat. 46. 4.
BELLADONE, s. f. belladona (Hist. nat. bot.) genre de plante à fleur monopétale en forme de cloche découpée sur ses bords. Il s’éleve du calice un pistil, qui est attaché comme un clou à la partie postérieure de la fleur, dont la base devient dans la suite un fruit presque rond, mou, partagé en deux loges par une cloison mitoyenne. Ce fruit renferme plusieurs semences attachées à un placenta. Tournefort, Inst. rei herb. Voyez Plante. (I)
Belladone ou Solanum, lethale offic. solanum maniacum multis, seu belladona. J. B. 3 611. Les fruits & les feuilles aussi bien que les tiges de cette plante sont assoupissans, & très-dangereux : leur usage intérieur est très-équivoque. On lit dans les Mémoires de l’Académie 1703, que des enfans ayant mangé de ces fruits eurent une fievre violente avec des convulsions & des battemens de cœur terribles ; ils perdirent la connoissance & les sens, & tomberent dans une aliénation d’esprit. Un petit garçon de quatre ans mourut le lendemain ; on lui trouva trois plaies dans l’estomac avec des grains de solanum écrasés, & des pépins enfermés dans les plaies, le cœur livide, nulle sérosité dans le péricarde : ces faits furent attestés par M. Boulduc.
Le remede à ces maux est le vomissement, procuré en bûvant de l’eau miellée, ou du vinaigre en grande quantité.
Les feuilles & les fruits sont bons appliqués extérieurement, sont adoucissans & résolutifs ; on s’en sert sur les hémorrhoides & sur le cancer : on les fait bouillir avec le saindoux, & on en compose une pommade pour les ulceres carcinomateux, & pour les durillons des mammelles. Ces avis sont de Mrs. Ray & Tournefort.
Les peintres en mignature font macérer le fruit, & en préparent un beau vert. (N)
* BELLAGINES ou BILAGINES, sub. f. pl. (Jurisprudence.) c’est le recueil des loix municipales des Goths, ainsi appellé par Diceneus des mots Saxons by, qui signifie habitation, bourg ou ville, & lagen, loi.
BELLA MORESKOY-LEPORIE. V. Leporie.
* BELLANO (Géog.) ville sur le lac de Come, dans le Milanois.
* BELLA-POLA (Géog.) île située dans le golphe de Napoli, en Morée.
BELLE, EMBELLE, s. f. (Marine.) c’est la partie du pont d’en-haut, qui regne entre les haubans de misene & les grands haubans ; & qui ayant son bordage & son plat-bord moins élevé que le reste de l’avant & de l’arriere, laisse cet endroit du pont presque à découvert par les flancs. Pendant un combat on met des pavois & des garde-corps pour fermer ou boucher la belle. C’est ordinairement par la belle qu’on vient à l’abordage. Voyez Herpe & Embelle.
La belle est presque toûjours au tiers du vaisseau ou à l’endroit où l’on prend le gros du vaisseau. Voy. Pl. I. L’espace entre les lettres L & K est la belle.
Aborder en belle ; voyez Aborder. (Z)
Belle, terme de riviere, sorte de perche de frêne dont on se sert sur les bateaux pour soûtenir les bannes ou toiles.
Belle de nuit, (Hist. nat. bot.) plante qui doit se rapporter au genre appellé jalap. V. Jalap. (I)
Cette plante est fort commune dans les jardins, où elle orne les parterres & les boulingrins. On l’appelle quelquefois merveille du Pérou. Elle s’eleve de deux piés, est assez garnie de feuilles pointues & d’un beau verd ; ses fleurs de couleur rouge ou de jaune & de blanc, forment un tuyau évasé en entonnoir à cinq parties qui sont jointes ensemble avec deux calices, dont le premier lui sert d’enveloppe, & le second d’un appui, qui devient un fruit rempli de semence. La belle de nuit ne fleurit qu’en automne, & ne s’épanoüit que le soir, d’où elle a pris son nom. On la transplante dans les parterres parmi les plantes de la grande espece, à l’ombre si l’on peut : on la met encore dans des pots. Elle se seme sur couche à claire voie, & demande à être arrosée. (K)
* BELLEGARDE, (Géog.) ville de France en Bourgogne sur la Sône, avec titre de duché.
Bellegarde, (Géog.) ville de France dans le Roussillon, au-dessus du col de Pertuis sur la frontiere de Catalogne, entre Ceret & Jonquieres. Long. 20. 30. lat. 42. 20.
* BELLE-ISLE, (Géog.) île de France à six lieues de la côte de Bretagne, dans l’évêché de Vannes, d’environ six lieues de long sur deux de large.
BELLE-FACE, (Manege.) Voyez Chanfrein.
BELLERIES, (Medecine.) espece de myrobolans. Voyez Myrobolans.
* BELLEVILLE, (Géog.) petite ville de France dans le Beaujolois, près de la Sône. Long. 22. 16. lat. 45. 5.
* BELLEY ou BELLAY, (Géog.) ville de France, capitale du Bugey, proche le Rhone. Long. 23. 20. lat. 45. 43.
* BELLICULE, s. f. (Hist. nat.) c’est une espece de limaçon de mer ou poisson à coquille umbilicaire, blanche avec des taches jaunes, ou jaune avec des raies noires.
BELLID ASTRUM, (Hist. nat. bot.) genre de plante qui ne differe de la paquerette que parce que ses semences sont garnies d’aigrettes, & que la couche de la fleur n’est pas faite en pyramide. Nova plantarum genera, &c. par M. Micheli. Voyez Plante. (I)
* BELLIGAMME, (Géog.) contrée du royaume de Jafnapatman, dans l’île de Ceylan.
* BELLINUS, (Myth.) c’est le même que Belenus. Voyez Belenus. De tous les pays de la Gaule où Bellinus avoit des autels, il n’y en avoit aucun où il fût plus révéré qu’en Auvergne.
BELLIS ou MARGUERITE, leucanthemum. Voy. Marguerite.
* BELLOC, (Géog.) petite ville de France en Béarn, sur le gave de Pau.
BELLON, s. m. (Medecine.) maladie extrèmement commune en Derbyshire, à laquelle les animaux, la volaille & les hommes sont sujets ; en général elle regne dans toutes les contrées infectées de
- l’odeur de la mine de plomb : c’est pourquoi on distingue
un certain espace autour des lieux où l’on travaille la mine de plomb, que l’on appele la sphere du bellon. Il est très-dangereux pour tout animal de paître dans cet intervalle. Les symptomes concomitans de cette maladie sont la langueur, la foiblesse, des douleurs insupportables, des tiraillemens dans le ventre, & généralement la constipation. Elle est ordinairement mortelle. La méthode de la guérir la plus heureuse, est d’ordonner aux malades la crême ou les crystaux de tartre en petite dose, mais fréquemment réitérés ; par exemple, deux ou trois fois par jour. Il faut remarquer que le sucre de saturne pris avec excès, produit la même maladie : elle a été occasionnée dans des personnes à qui on l’avoit ordonné, pris en remede contre les fleurs blanches. Voyez Plomb. (N)
BELLONAIRES, (Hist. anc.) prêtres de Bellone, la déesse des combats. Lorsqu’on les admettoit au sacerdoce, ils se faisoient des incisions à la cuisse ou au bras ; & recevant dans la paume de la main le sang qui sortoit de cette blessure, ils en faisoient un sacrifice à leur déesse. Cette cérémonie violente ne fut plus que simulée dans la suite. Ces prêtres étoient des fanatiques, qui dans leurs enthousiasmes prédisoient la prise des villes, la défaite des ennemis, & n’annonçoient que meurtre & que carnage. (G)
BELLONE, s. f. bellonia, (Hist. nat. bot.) genre de plante dont le nom a été dérivé de celui de Pierre Bellon, medecin de Caen, qui a écrit sur les arbres coniferes, & sur d’autres parties d’histoire naturelle. La fleur des plantes de ce genre est monopétale, rayonnée & découpée : il s’éleve du fond du calice un pistil, qui est attaché comme un clou au milieu de la fleur. Le calice devient dans la suite un fruit dur d’une figure ovoide pointue, rempli de petites semences. Plumier, Nova plant. Amer. gen. Voyez Plante. (I)
Bellone, (Myth.) déesse de la guerre, qu’on représentoit armée d’un casque & d’une cuirasse, les cheveux épars & en desordre, avec une pique à la main & un flambeau, ou une espece de fouet ensanglanté. Communément ses temples étoient hors des villes, parce qu’on la regardoit comme une divinité turbulente : Arnobe même l’a mise au nombre des divinités infernales. Elle en avoit un à Rome près de la porte Carmentale, où le sénat donnoit audience publique aux ambassadeurs qu’il ne jugeoit pas à propos de recevoir dans la ville. Il y avoit dans ce temple une petite colonne nommée bellica, sur laquelle on mettoit une pique lorsqu’on étoit prêt de déclarer la guerre à quelque ennemi ; ou, comme d’autres prétendent, par-dessus laquelle les consuls ou les féciaux lançoient un javelot le plus loin qu’ils pouvoient, comme s’ils l’eussent jetté dans le pays ennemi, pour déclarer la guerre. (G)
BELLONS, (Hist. mod.) c’est une espece de lampe usitée en Espagne, que l’on place sur un pié d’argent ou d’autre métal fort évasé. Chaque lampe a huit ou dix tuyaux par où l’on fait passer la meche ; ce qui fait que ces lampes éclairent parfaitement ; & pour augmenter encore la lumiere, on place derriere une plaque d’argent bien polie, qui la refléchit. On y brûle ordinairement de l’huile très-pure.
* BELLUNO, (Géog.) ville d’Italie, capitale du Bellunois dans la Marche-Trévisane, sur la Piave. Long. 29. 45. lat. 46. 9.
* BELMONT, (Géog.) petite ville de France dans le Quercy, généralité de Montauban.
* BELNAUX, s. m. pl. (Œconom. rust.) ce sont des especes de tombereaux qui servent à la campagne au transport des fumiers dans les terres. Comme ils sont lourds, on leur préfere les charettes.
* BELOÉRE, (Hist. nat. bot.) plante Indienne, toûjours verte. Nous ne dirons rien de ses propriétés, parce qu’on ne nous en apprend pas assez pour la connoître.
BELOMANTIE, s. f. (Divination.) espece de divination qui se faisoit avec des fleches ; du Grec βέλος, arme de jet, dard, fleche, &c. & μαντεία, divination. Elle étoit fort en usage chez les Orientaux pour prendre les augures, surtout avant que de commencer les expéditions militaires. « Le roi de Babylone, dit Ezéchiel en parlant de Nabuchodonosor, s’est arrêté à la tête des deux chemins ; il a mêlé des fleches dans un carquois pour en tirer un augure de la marche qu’il doit prendre. Le sort est tombé sur Jerusalem, & lui a fait prendre la droite ». D’où il s’ensuit que la belomantie se pratiquoit de cette sorte. Celui qui vouloit tirer un augure sur son entreprise prenoit plusieurs fleches, sur chacune desquelles il écrivoit un mot relatif à son dessein & pour ou contre ; il brouilloit ensuite & confondoit ces fleches dans un carquois ; & la premiere qu’il tiroit le décidoit, suivant ce qu’elle portoit écrit. Le nombre des fleches n’étoit pas determiné ; quelques-uns le font monter à onze : mais Pocockius, dans son Essai sur l’histoire des Arabes, remarque que ces peuples, dans une espece de divination semblable à la belomantie, & qu’ils nomment alazalam, n’employent que trois fleches ; l’une sur laquelle ils ecrivent ces mots : le Seigneur m’a commandé ; sur la seconde ceux-ci : le Seigneur m’a empêché ; & ne marquent rien sur la troisieme. Si du vase où ils ont mis ces trois fleches ils tirent du premier coup la premiere ou la seconde, ç’en est assez pour leur faire exécuter le dessein qu’ils ont projetté, ou pour les en détourner. Mais si la troisieme leur tombe d’abord sous la main, ils la remettent dans le vase jusqu’à ce qu’ils en ayent tiré une des deux autres, afin d’être absolument décidés. Voy. Divination.
Il est encore mention dans le prophete Osée, ch. vj. d’une espece de divination qu’on faisoit avec des baguettes, & qui a plus de rapport à la rhabdomantie qu’à la belomantie. Voyez Rhabdomantie. Grotius & S. Jérôme confondent ces deux sortes de divinations, & prouvent que la belomantie eut lieu chez les Mages, les Chaldéens, les Scythes ; que ceux-ci la transmirent aux Sclavons, de qui les Germains la reçurent. (G)
BELOUSES, s. f. pl. (Paumier.) ce sont des trous pratiqués sur la table d’un billard, dans lesquels on tâche de faire entrer les billes en les frappant avec d’autres billes. Il y a ordinairement six belouses sur une table de billard, savoir une à chaque coin, & deux autres dans le milieu de la longueur des deux grands côtés.
BEL-OUTIL, s. m. chez les Orfevres & les Bijoutiers, c’est une espece de petite enclume très-étroite, fort longue, un peu convexe & portative, à deux cornes longues, l’une ronde & l’autre quarrée : c’est de là que plusieurs artistes l’appellent aussi bigorne ou bigorneau. Elle sert au même usage que la bigorne ; mais à des ouvrages concaves qui ont beaucoup de longueur, & dont l’entrée doit être fort étroite. Les deux bigornes ou cornes longues sont séparées par un petit quarré oblong. Il y a des outils d’Orfevre qui portent le même nom de bel-outil, & qui n’ont qu’une corne ; le reste depuis l’origine de la corne, est un quarré oblong & étroit, d’une forme un peu convexe, & qui va en s’allongeant & en conservant la même forme. Voyez Orfevre, Planche I. & II.
BELT, (Géog.) nom de deux detroits de Danemarck, dont l’un est appellé le grand Belt, & l’autre le petit Belt.
* BELTZ ou BELTZKO, (Géog.) ville de Pologne, dans le palatinat de même nom. Long. 42. 44. lat. 50. 30.
BELVEDERE, s. m. (Architecture.) mot italien qui signifie belle vûe ; c’est ordinairement un petit bâtiment situé à l’extrémité d’un jardin ou d’un parc pour y prendre le frais, s’y mettre à l’abri de l’ardeur du soleil ou des injures du tems. Les belvederes ne sont composés, pour la plûpart, que d’un salon percé à jour, ainsi qu’il s’en voit dans plusieurs de nos maisons royales ; ou bien d’une seule piece à pans, elliptique ou circulaire, fermée de portes & croisées, comme est celui de Sceaux, nommé le pavillon de l’aurore ; ou enfin ils sont composés de plusieurs pieces, savoir de vestibules, salons, cabinets, chambres à coucher, garde-robbes, tels qu’on l’a pratiqué à la ménagerie de Sceaux, nommée ainsi parce que ce bâtiment est situé au milieu du jardin potager, dans lequel sont distribuées les basses-cours de la ménagerie.
Lorsqu’un bel aspect, une campagne fertile, des prés, des valons, étalent avec éclat les dons de la nature, & que ces points de vûe, qui font les délices de la campagne, se trouvent éloignés du château d’une distance assez considérable, alors on distribue plusieurs appartemens dans ces belvederes pour s’y rassembler par choix & sans tumulte : mais dans ce cas on nomme ces bâtimens trianons. V. Trianon.
La décoration extérieure d’un belvedere doit être tenue simple & rustique ; & leur intérieur, au lieu de lambris, doit être revêtu de marbre ou de pierre de liais, à moins que ces pavillons par leur proximité ne soient assez près du château, pour être souvent visités dans les différentes saisons par les maîtres ou par les étrangers. (P)
On appelle aussi très-souvent belvedere, en jardinage, un simple berceau élevé sur quelque montagne ou terrasse ; ce peut être aussi une éminence ou platte-forme élevée & soûtenue par des talus de gason, pour joüir de la belle vûe dont le belvedere a pris son nom. On voit un fort beau belvedere en forme de palais, dans les jardins de Bagnolet, & dans ceux de Meudon, de S. Cloud, & de Marly : on en trouve tout de gason. (K)
Belvedere, s. f. (Hist. nat. bot.) plante qui doit être rapportée au genre nommé patte d’oye. Voyez Patte d’oye. (I)
La belvedere, linaria, (Jardinage.) est une plante que les Latins appellent linaria, qui jette plusieurs tiges à la hauteur de deux piés, garnies de feuilles semblables à celles du lin. Ses fleurs sont jaunes, fermées en-devant par deux levres en forme de mâchoires. Il s’éleve du calice un pistil qui se change en un fruit à deux baies remplies de semences.
Cette plante se multiplie par la graine que l’on seme en pleine terre pour la replanter. On la trouve dans les lieux incultes, & on la met sur une platte-bande ou dans des pots : elle aime assez l’ombre & forme un buisson. (K)
* Belvedere (Géog.), ville de Grece, capitale de la province de même nom, dans la Morée. La province est située sur la côte occidentale de la mer.
* BELUS (Myth.), c’étoit la grande divinité des Babyloniens. S’il est vrai que la tour de Babel lui ait servi de temple, le Paganisme n’a point eu d’autels plus anciens que ceux de Belus. Les rois de Babylone y amasserent successivement des thresors immenses, que Xercès pilla au retour de son expédition de Grece. Ce fut alors que le temple fut démoli : il en reste une belle description dans le premier livre d’Herodote. Les prêtres de Belus avoient persuadé aux habitans de Babylone, que le dieu honoroit de sa présence toute vierge Babylonienne, qui se rendoit dans un lit magnifique qu’on avoit dressé dans le lieu du temple le plus élevé ; & toutes les nuits Belus avoit une compagne nouvelle. Ce Belus, qui accueilloit si bien les filles de Babylone, étoit le soleil pendant le jour, ou la nature elle-même qu’on adoroit sous son nom. Dans la suite, le premier roi des Assyriens, qui porta le nom de Belus, ayant été mis au rang des dieux, on confondit ce Belus avec la grande divinité des Assyriens. Il y eut beaucoup d’autres princes de ce nom ; & Cicéron appelle du nom de Belus, le cinquieme de ses Hercules.
* BELUTES (les) s. m. plur. (Géog.) peuple de voleurs & de vagabonds, qui vivent sous des tentes, & se tiennent aux environs de Candahar, entre les frontieres de Perse & de l’empire du Mogol.
* BELUTTA TSJAMPACAM, (Hist. nat. bot.) c’est le nom d’un grand arbre qui croit au Malabar. Voyez dans le dictionnaire de Medecine ses propriétés merveilleuses contre les serpens, les humeurs pituiteuses du cerveau, la difficulté de transpirer, la toux, la constipation, les douleurs des membres, &c.
* BELZELINGEN, (Géog.) ville de Suisse, dans le canton d’Uri.
* BELZIC, (Géog.) petite ville de Pologne, dans le palatinat de Lublin.
* BELZIEH, (Géog.) ville de l’électorat de Saxe.
* BEME, s. m. (Hist. mod.) autel des Manichéens ou jour de fête qu’ils célébroient en mémoire de la mort de Manés leur fondateur. Beme en général signifie aussi sanctuaire. De tous les laïcs, il n’y avoit chez les Grecs que l’empereur qui pût entrer dans le beme.
* BEMILUCIUS, (Mythol.) surnom d’un Jupiter jeune & sans barbe, qui avoit ses autels dans la province que nous nommons la Bourgogne, aux environs de l’endroit où est maintenant l’abbaye de Flavigny.
BEMOL, en Musique. Voyez B. mol. (S)
* BEN, subst. m. (Hist. nat. bot.) petite noix de la grosseur d’une aveline, de figure tantôt oblongue, tantôt arrondie, triangulaire, couverte d’une coque blanchâtre, médiocrement épaisse, fragile, contenant une amande assez grosse, couverte d’une pellicule fongueuse, blanche, de la consistance d’une aveline. On estime celle qui est récente, pleine, blanche, & se sépare aisément de sa coque : on l’apporte d’Egypte.
C’est le fruit d’un arbre appellé glans unguentaria, qui a deux sortes de feuilles, l’une simple, & l’autre branchue. La branchue, prise depuis l’endroit où elle tient à la tige, est composée d’une côte molle, pliante, cylindrique, grêle, semblable au petit jonc ou à un rameau de genêt, mais une fois plus menue ; de cette côte sortent des queues ou petites côtes d’un palme & plus de longueur, fort écartées les unes des autres, mais toûjours rangées deux à deux, garnies chacune de quatre ou de cinq conjugaisons de feuilles, qui se terminent aussi en une pointe fort menue. Le tout ensemble forme la feuille branchue : mais ces rameaux de feuilles en portent d’autres petites à leurs nœuds, toûjours posées deux à deux, de figure & de grandeur différentes ; car les premieres sont à pointes mousses, comme les feuilles du tournesol ; celles qui sont au milieu sont plus pointues & semblables à celles du myrte ; & celles qui sont à l’extremité sont plus petites & plus étroites, & approchent de celles de la renoüée. Elles tombent toutes en hyver ; d’abord les petites feuilles, puis toute la feuille branchue ; c’est pourquoi Aldinus l’appelle feuille. Si c’étoit une branche, dit cet auteur, elle ne tomberoit pas. La racine de cette plante est épaisse, semblable en quelque façon à celle du navet, noire en-dedans, & peu branchue. Le fruit, selon Bauhin, est une gousse longue d’un palme, composée de deux cosses, cylindrique, grêle, partagée intérieurement en deux loges, renflée depuis son pédicule jusqu’à son milieu, contenant une noisette dans chaque loge. Cette gousse est pointue ou en forme de stylet, recourbée en bec à son extrémité, roussâtre en-dedans, brune ou cendrée en-dehors, cannelée & ridée dans toute sa longueur, coriace, flexible, de la nature des écorces, insipide, un peu astringente & sans suc. Chaque loge contient une noisette de médiocre grosseur, triangulaire, laquelle renferme sous une coque & sous une pellicule blanche & fongueuse une amande triangulaire, grasse, blanchâtre, un peu acre, amere, huileuse, & qui provoque le vomissement.
On trouve par l’analyse, que la noix de ben contient beaucoup d’huile épaisse, une certaine huile essentielle, acre & brûlante, en petite quantité à la vérité, mais unie à un sel ammoniacal : c’est cette huile subtile & acre qui purge & fait vomir.
La noix de ben est contraire à l’estomac, trouble les visceres, purge avec peine & lentement, & a quelque causticité. Les parfumeurs vantent son huile, parce qu’elle se rancit difficilement, & qu’étant sans odeur, elle ne gâte point celle des fleurs.
Voici comment on tire les odeurs des fleurs par le moyen de cette huile : on prend un vaisseau de verre ou de terre, large en-haut, étroit par bas ; on y met de petits tamis de crin par étage ; on arrange sur ces tamis des fleurs par lits, avec du coton cardé bien menu & imbibé d’huile de ben : on laisse le tout dans cet état pendant quatre heures, puis on jette les fleurs. On en remet d’autres avec le même coton, & l’on réitere jusqu’à ce que l’huile soit suffisamment imprégnée de l’odeur des fleurs : on finit par exprimer l’huile du coton.
Il y a une autre espece de noix de ben, appellée mouringou ; elle croit sur un arbre haut d’environ 25 piés, & gros d’environ 5 piés. Voyez sa description a l’article Mouringou.
* BENA ou BECCABENA, royaume de Nigritie.
* BENA ou BENE, (Géog.) petite ville du Piémont, avec titre de comté. L. 25. 30. lat. 44. 29.
* BENACHUS, (Géog. anc. & mod.) un des plus grands lacs de l’Italie, dans l’état de Venise. Nous l’appellons aujourd’hui lac de Garde.
* BENADKY, (Géog.) petite ville de Boheme.
* BENARES, (Géog.) ville de l’Indostan, sur le Gange ; c’est où les bramines tiennent leurs écoles.
BENARI, oiseau. Voyez Ortolan. (I)
BENATAGE, s. m. c’est ainsi qu’on nomme dans les salines la fonction des benatiers. V. Bénatiers & Benate.
BENATE, s. f. (terme de Saline.) c’est une espece de caisse d’osier, capable de contenir douze pains de sel. On donne aussi le nom de benate à la quantité de sel qui entre dans la benate. Voyez Benatiers.
BENATH, s. f. (Medecine.) nom que les Arabes donnent à de petites pustules qui s’élevent sur le corps pendant la nuit après la sueur. (N)
BENATIERS, s. m. pl. ouvriers occupés dans les salines de Moyenvic, au nombre de dix-huit, à assembler des bâtons de bois avec des osiers & de la ficelle, & à en former des especes de paniers capables de contenir douze pains de sel, ce qu’on appelle une benate. Voyez Benate.
* BENAVARRI, (Géographie) ville d’Espagne, au royaume d’Aragon. Long. 18. 10. lat. 41. 55.
* BENAVENTE, (Géog.) ville d’Espagne, au royaume de Léon, dans la tierra de Campos, avec titre de duché, sur la riviere d’Ezla. Long. 12. 30. lat. 42. 4.
* BENAUGE, (Géog.) petite contrée de la Guienne, province de France, le long de la Garonne, au midi de Bordeaux, en allant vers l’orient.
* BENDA, (Géog.) ville de la Macédoine, appartenante aux Turcs.
* BENDARMARSSEN ou BENJARMASEN, (Géog.) ville d’Asie, capitale du royaume de même nom, dans l’île de Borneo, sur la riviere de Benjarmasse. Long. 131. 20. lat. mérid. 2. 40.
* BENDER ou TEKIN, (Géog.) ville de la Turquie Européenne, dans la Bessarabie, sur le Niester.
* BENDERICK, (Géog.) ville & port sur le golfe Persique.
* BENDIDIES, adj. pris subst. (Mythol.) fêtes qui se célébroient à Athenes, dans le Pyrée, en l’honneur de Diane bendis ; elles y furent apportées par des marchands qui fréquentoient les côtes de la Thrace. Voyez Bendis.
* BENDIMIR, (Géographie) fleuve de Perse, qui tombe dans le golfe de Bengale.
* BENDIS, (Mythol.) nom que les peuples de Thrace donnoient à Diane. Les uns prétendent qu’ils entendoient par ce mot la terre ; d’autres la lune. Les fêtes qu’on célébroit en son honneur différoient peu des bacchanales ; elles précédoient de quelques jours les panathénées, & elles se faisoient dans le Pyrée.
BENEDICTINS, s. m. pl. (Hist. ecclés.) moines ainsi nommés de S. Benoît, Benedictus, dont ils suivent la regle.
C’est aux Bénédictins proprement que convient le nom de moines, monachi ; & les plus éclairés d’entre eux, tels que les PP. Mabillon, Martenne, Ruinard, &c. s’en sont fait honneur à la tête de leurs ouvrages ; celui de religieux convenant plus particulierement aux autres ordres & congrégations. V. Moines & Religieux.
Dans le droit canon les Bénédictins sont appellés moines noirs à cause de la couleur de leur habit, par opposition à celle des ordres blancs. Ils n’étoient connus autrefois en Angleterre que sous ce nom. Cet habit est composé d’une robbe & d’un scapulaire noirs, avec un petit capuce de même couleur, qu’ils portent dans l’intérieur de leur maison & en voyage. Au chœur & lorsqu’ils vont en ville, ils mettent par-dessus une ample chappe de serge noire à grandes manches, avec un capuchon qui se termine en pointe.
L’ordre de Saint-Benoit a été florissant dès sa naissance. Il subsiste depuis plus de treize cens ans avec un éclat qui a été rarement obscurci ; également distingué par les sciences & par la piété, il a été l’asyle des lettres dans les siecles où il sembloit qu’elles n’en dussent avoir aucun, & a donné à l’Eglise un très grand nombre de saints, de souverains pontifes, de cardinaux, patriarches, archevêques, évêques, &c.
Les réformes qu’y ont introduit en divers tems plusieurs personnages éminens en sainteté, l’ont partagé en plusieurs branches ou congrégations. Saint Odon, abbé de Cluny, commença la réforme de cet ordre vers l’an 940, & de là est venu l’ordre ou la congrégation de Cluny. Celle de Sainte Justine de Padoue & du Mont-Cassin, s’est établie en Italie en 1408, & s’est renouvellée en 1504. Celle de Saint Maur en France a commencé en 1621, & s’est depuis soûtenue avec beaucoup de gloire : elle a produit ces hommes dont les noms ne périront jamais dans la république des lettres, qui nous ont donné d’excellentes éditions de presque tous les PP. de l’Eglise, & beaucoup d’autres qui se distinguent encore par leur vertu & leurs lumieres. La réforme de Saint Vanne & de Saint Hydulphe, établie en Lorraine en 1600, s’est aussi rendue célebre par les savans ouvrages qui en sont sortis ; tels que ceux de dom Calmet & de dom Remi Ceillier.
L’ordre de Saint-Benoît a été la tige de plusieurs autres, dont les plus considérables sont ceux de Camaldoli, de Valombreuse, des Chartreux, de Cîteaux, de Grammont, des Célestins, &c. qui ont rendu de grands services à la religion, ou par leur doctrine, ou par l’édification de leur vie, & qui suivent tous pour le fond la regle de S. Benoit. Voyez Camaldules, Chartreux, Cîteaux, &c.
Il y a aussi des religieuses appellées Bénédictines, dont on attribue l’institution à sainte Scholastique, sœur de S. Benoît : elles suivent la regle de ce patriarche des moines d’Occident. (G)
BÉNÉDICTION, s. f. (Théol.) l’action de bénir, c’est-à-dire de souhaiter quelque chose d’heureux, soit par des signes, soit par des paroles. Cette cérémonie a été en usage de toute antiquité, tant parmi les Juifs que parmi les Chrétiens.
Les Hébreux entendent souvent sous ce nom les présens que se font les amis ; apparemment parce qu’ils sont d’ordinaire accompagnés de bénédictions & de complimens de la part de ceux qui les donnent, & de ceux qui les reçoivent. Voyez, Gen. xxxiij. 2. Josué, xv. 19. I. Reg. xxv. 27. xxx. 26. IV. Reg. v. 15. &c. les bénédictions solennelles que les prêtres donnoient au peuple dans certaines cérémonies. Par exemple, Moyse dit au grand-prêtre Aaron : Quand vous bénirez les enfans d’Israël, vous direz : que le Seigneur vous bénisse & vous conserve ; que le Seigneur fasse briller sur vous la lumiere de son visage ; qu’il ait pitié de vous, qu’il tourne sa face sur vous, & qu’il vous donne sa paix. Il prononçoit ces paroles debout à voix haute, & les mains étendues & élevées. Les prophetes & les hommes inspirés, donnoient aussi souvent des bénédictions aux serviteurs de Dieu & au peuple du Seigneur. Les pseaumes sont pleins de pareilles bénédictions. Les patriarches au lit de la mort, bénissoient leurs enfans & leur famille. Le Seigneur ordonne que le peuple d’Israel étant arrivé dans la terre promise, on assemble toute la multitude entre les montagnes d’Hébal & de Garizim, & que l’on fasse publier des bénédictions pour ceux qui observent les lois du Seigneur sur la montagne de Garizim, & des malédictions contre les violateurs de ces lois sur la montagne d’Hébal. C’est ce que Josué exécuta après qu’il eut fait la conquête d’une partie de la terre de Chanaan. Voyez l’article Hébal, Num. vj. 24. Genes. xxvij. xlix. Tob. vij. 7. Deut. xj. Josué, &c.
Bénédiction signifie aussi abondance. Celui qui seme avec épargne moissonnera peu ; & celui qui seme avec bénédiction, moissonnera avec bénédiction, avec abondance. Et encore : Je les ai priés de passer chez vous, afin que cette bénédiction que vous avez promise soit toute préte, & qu’elle soit, comme elle est véritablement, une bénédiction, & non un don d’avarice ; & Jacob souhaite à son fils Joseph, les bénédictions du ciel, ou la pluie & la rosée en abondance ; les bénédictions de l’abysme, l’eau des sources ; les bénédictions des entrailles & des mammelles, la fécondité des femmes & des animaux. Et le Psalmiste : vous remplirez tout animal de bénédiction, de l’abondance de vos biens. Cor. ix. 6. 5. Gen. xlix. 15. Ps. cxliv. 16. D. Calmet, Dict. de la bibl. tom. I. pag. 309. (G)
* BÉNEFICE, GAIN, PROFIT, LUCRE, ÉMOLUMENT, (Grammaire.) Le gain semble dépendre beaucoup du hasard ; le profit paroît plus sûr ; le lucre est plus général, & à plus de rapport à la passion ; l’émolument est affecté aux emplois ; le bénéfice semble dépendre de la bienveillance des autres. Le gain est pour les joüeurs ; le profit pour les marchands ; le lucre pour les hommes intéressés ; l’émolument pour certaines gens de robe & de finance ; & le bénéfice pour celui qui revend sur le champ. Le joüeur dira, j ai peu gagné ; le marchand, je n’ai pas fait grand profit ; l’employé, les émolumens de mon emploi sont petits ; le revendeur, accordez-moi un petit bénéfice : & l’on peut dire d’un homme intéressé, qu’il aime le lucre.
Bénéfice, s. m. (Droit canoniq.) office ecclésiastique auquel est joint un certain revenu qui n’en peut être séparé. Ce nom vient de ce qu’au commencement les évêques donnoient quelquefois aux ecclésiastiques qui avoient long-tems servi, quelque portion des biens de l’Eglise pour en joüir pendant un tems, après lequel ce fonds revenoit à l’Eglise ; ce qui ressembloit aux récompenses que les empereurs accordoient aux soldats Romains en considération de leurs services ; d’où l’on appelloit ces soldats, milites beneficiarii ; & d’où quelques auteurs tirent l’origine de nos fiefs. Ce nom a passé ensuite aux ecclésiastiques, à qui on a donné de semblables fonds pour subsister. Leur véritable origine ne paroît pas avoir précédé le viii. siecle, où l’on fit le partage des biens d’Eglise. On ne laisse pourtant pas que de trouver quelques vestiges des bénéfices dès l’an 500, sous le pape Symmaque : on voit qu’alors on donna à un clerc qui avoit bien servi l’Eglise, un champ en fonds qu’il posséda, & dont il tira sa subsistance. On trouve de plus dans un canon du premier concile d’Orange, tenu en 441, quelques traces de la fondation des bénéfices & du droit de patronage, tant ecclésiastique que laïque : mais ce n’étoit pas l’ordinaire avant le viii. siecle ; communément les ecclésiastiques subsistoient des revenus des biens des églises & des oblations des fideles que l’évêque distribuoit entre eux. Du tems de Charlemagne, les curés & les autres ministres de l’Eglise joüissoient de revenus fixes & certains, & percevoient des dixmes ; & cette coûtume s’établit dans tout l’Occident. Ce fut alors que ces titres ecclésiastiques furent appellés bénéfices, & que chaque clerc eut un revenu attaché à son titre.
Les bénéfices sont ou séculiers ou réguliers. Les séculiers sont l’évêché, les dignités des chapitres ; savoir, la prevôté, le doyenné, l’archidiaconné, la chancellerie, la chantrerie ; les charges d’écolâtre ou capricol, ou théologal, de thrésorier, de chefcier, & les canonicats, qui sont des places de chanoines, ou sans prébende, ou avec prébende, ou avec semi-prébende. Les autres bénéfices séculiers, les plus ordinaires, sont les simples cures, les prieurés-cures, les vicaireries perpétuelles, les prieurés simples, & les chapelles.
Les bénéfices réguliers sont l’abbaye en titre ; les offices claustraux qui ont un revenu affecté, comme le prieuré conventuel en titre, les offices de chambrier, aumônier, hospitalier, sacristain, célérier & autres semblables. Les places de moines anciens & non-réformés, sont regardées presque comme des bénéfices. On ne donne pourtant proprement ce nom qu’aux offices dont on prend des provisions.
On divise encore les bénéfices en bénéfices sacerdotaux, bénéfices à charge d’ames, & bénéfices simples. Les bénéfices sacerdotaux sont des bénéfices ou dignités ecclésiastiques, qu’on ne peut posséder sans être prêtre, ou en âge de l’être du moins dans l’année. Les bénéfices à charge d’ames sont ceux dont le pourvû a jurisdiction sur une certaine portion de peuple, dont l’instruction est confiée à ses soins ; tels sont les évêchés & les cures. Enfin les bénéfices simples sont ceux qui n’ont ni charge d’ames, ni obligation d’aller au chœur, & qui par conséquent n’obligent point à résidence ; telles sont les abbayes ou prieurés en commende, & les chapelles chargées seulement de quelques messes, que l’on peut faire célébrer par d’autres.
Il y a des irrégularités qui empêchent de posséder des bénéfices ; telles que la bâtardise, la bigamie, la mutilation, le crime public pour lequel on peut être repris de justice, & le crime ecclésiastique, comme l’hérésie, la simonie, la confidence, &c. qui emportent privation du bénéfice. Les casuistes disputent sur la pluralité des bénéfices : quelques-uns la croyent illégitime ; le plus grand nombre la croit permise, & l’Eglise la tolere. En Angleterre, la plûpart des bénéfices ont été supprimés du tems de la réformation, parce qu’alors les biens ecclésiastiques ont passé dans les mains des laïques. Fleury, Instit. au Droit ecclés. tom. I. part. II. ch. xiv. xix. & xxviij.
Bénéfices consistoriaux, grands bénéfices, comme les évêchés, abbayes & autres dignités, ainsi appellés, parce que le pape en donne les provisions aprés une délibération faite dans le consistoire des cardinaux. On donne ce nom en France aux dignités ecclésiastiques dont le Roi a la nomination, suivant le concordat fait entre le pape Léon X. & François I. mais ce concordat n’a fait que renouveller un droit que les rois de France avoient possédé des le commencement de la monarchie. Grégoire de Tours, Aimoin, & nos anciens historiens, sont pleins d’exemples qui prouvent que nos rois de la premiere race disposoient des évêchés. Ils en parlent en ces termes : talis episcopus ordinatus est jussu regis, ou assensu regis, ou decreto regis. Cet usage continua sous la seconde race. Loup, abbé de Ferrieres, rapporte que le roi Pepin obtint le consentement du pape pour nommer aux grandes dignités ecclésiastiques ceux qu’il en jugeroit les plus capables pour le bien de son état. Hincmar, archevéque de Rheims, & Flodoard, parlent aussi de ces nominations. C’est ce qu’on voit encore dans le second concile d’Aix-la-Chapelle, tenu sous Louis le Debonnaire. Les rois successeurs d’Hugues Capet, en userent ainsi, comme le témoigne, en plusieurs endroits de ses épitres, Fulbert, éveque de Chartres, qui vivoit dans le xi siecle, du tems du roi Robert. Il est vrai que dans le xii, les papes disposerent de plusieurs de ces bénéfices : mais vers le commencement du xiii, sous Philippe Auguste, les élections eurent lieu, de sorte néanmoins que le roi les autorisoit, & l’évêque élû ne pouvoit être consacré sans le consentement du prince. Le concordat n’a donc fait que rendre au roi le droit de nomination aux grands bénéfices, que quelques-uns disent appartenir au roi de France en qualité de Roi ; parce que le choix des prélats est une chose importante pour la conservation de l’état, & que ce monarque est le premier patron & protecteur des églises de son royaume. Les autres rois & princes souverains joüissent d’un pareil droit ; & cette nomination a eu lieu en Hongrie, en Espagne, dans les Pays-Bas, à Venise & en Savoie. Elle étoit aussi en usage en Angleterre & en Ecosse avant la réformation, & le roi y nomme encore aux archevêchés & évêchés : mais on ne peut plus appeller ces dignités bénéfices consistoriaux, depuis que le pape n’en donne plus la confirmation. Pithou, Traité des Libert. de l’Egl. Gallic. (G)
Bénéfice, en terme de Droit civil, signifie en général une exception favorable accordée par la loi ou par le prince, qui rend l’impétrant habile à une fonction ou une qualité dont il étoit incapable à la rigueur. Tels sont le bénéfice d’age, voyez Age ; le bénéfice de cession, voyez Cession ; de division, voyez Division ; de discussion, voyez Discussion ; d’inventaire, voyez Inventaire ; &c.
Bénéfice se prend aussi quelquefois pour un simple privilége ou droit favorable. C’est en ce sens qu’on dit, que le bénéfice du vendeur sert à l’acheteur. (H)
Bénéfice, (Commerce.) signifie avantage, gain, profit. On dit qu’un marchand a du bénéfice sur le marché ou la vente de certaines marchandises.
Quand on dit qu’un banquier fait tenir de l’argent d’une place à l’autre avec bénéfice, cela doit s’entendre qu’au lieu de demander quelque chose pour l’échange, il donne du profit. Quand le change est au pair, il n’y a ni bénéfice ni perte.
On nomme bénéfice d’aunage, le profit qui se rencontre sur l’aunage des étoffes, des toiles, &c. Il y a des endroits où, quoique l’aune soit égale à celle de Paris, on ne laisse pas de trouver un bénéfice considérable sur l’aunage, par la bonne mesure que donnent les fabriquans pour attirer les marchands. Ainsi, par exemple, à Roüen on donne vingt-quatre aunes de toile pour vingt aunes, ce qui est quatre aunes de bon ou de bénéfice sur chaque fois vingt aunes. Voyez Aunage. (G)
Bénéfices, s. m. (Hist. anc.) terme dont les anciens se servoient pour signifier les fonds de terre qu’on donnoit aux vieux soldats ou vétérans, pour récompense de leurs services ; & c’est de là qu’on appelloit ces soldats beneficiarii milites. Les Turcs en usent encore aujourd’hui de même à l’egard de leurs spahis ou timariots. Voyez Spahi & Timariot. (G)
BÉNEFICIABLE, adj. (Chimie.) profitable ; il se dit ordinairement d’une mine. On dit qu’une mine est benéficiable, lorsqu’on veut dire qu’elle peut être exploitée avec profit ; qu’on en peut tirer du bénéfice. Pour rendre une mine bénéficiable, il faut en séparer ce qui détruiroit le métal, ou ce qui l’empécheroit de se séparer de sa mine. (M)
BÉNÉFICIAIRE, adj. pris subst. terme de Droit, qui ne se dit qu’en un seul cas, à savoir en parlant de l’héritier qui a pris des lettres de bénéfice d’inventaire. Voyez Inventaire.
En pays coûtumier, l’héritier pur & simple on ligne collatérale exclut le bénéficiaire ; secus en ligne directe : mais en pays de Droit écrit, l’héritier pur & simple n’exclut pas le bénéficiaire, même en collatérale.
L’héritier bénéficiaire a l’administration de tous les biens de la succession, dont il doit un compte aux creanciers & légataires, pour le reliqua duquel, s’il se trouve redevable, ils ont hypotheque sur ses propres biens, du jour qu’il a été déclaré héritier bénéficiaire. (H)
* Bénéficiaires, s. m. pl. (Hist. anc.) c’est ainsi qu’on appelloit dans les troupes Romaines ceux qui servoient volontairement, soit pour obtenir les bonnes graces & la faveur des consuls, soit pour obtenir quelque récompense des chefs. Ils étoient rangés sous les drapeaux dans les cohortes ; ils ne montoient point la garde ; ils étoient dispensés de travailler aux fortifications & aux campemens. Ils faisoient l’office de centurions, en cas de besoin, & portoient comme eux la branche de vigne. Le terme benéficiaire se prend en différens sens, & tout ce que nous venons de dire de leurs fonctions a été sujet à bien des changemens.
BÉNÉFICIAL, qui concerne les bénéfices. Cet adjectif ne se trouve employé qu’au féminin, ainsi l’on dit des causes, des matieres bénéficiales : mais on ne diroit pas des codes bénéficiaux. (H)
BÉNÉFICIATURES, s. f. plur. (terme de Droit ecclésiastiq. ) sortes de bénéfices amovibles, qui ne peuvent se résigner, & peuvent vaquer par l’absence, comme les bénéfices de chantres ou vicaires, choristes, chapelains. Les bénéficiatures ne peuvent être appellées qu’improprement bénéfices ; ce sont plûtôt des places destinées à des prêtres chargés pour ce de rendre un service actuel à l’église, & que le chapitre peut destituer, s’ils y manquent pendant deux mois de suite, sans qu’il soit nécessaire de faire précéder aucune monition canonique ; monitions sans lesquelles, suivant le droit commun, on ne pourroit pas priver de son bénéfice un véritable bénéficier.
On appelle aussi les bénéficiatures, bénéfices serfs. Voyez Bénéfice. (H)
BÉNÉFICIER, v. neut. en Chimie, c’est exploiter les mines avec bénéfice, avec profit. (M)
* BENESCHAU, (Géog.) il y a deux villes de ce nom ; l’une dans le royaume de Boheme, & l’autre en Silesie.
* BENEVENT, (Géog.) ville d’Italie, au royaume de Naples, près du confluent du Sabato & du Calore. Long. 32. 27. lat. 41. 6.
* Benevent, (Géog.) petite ville de France, dans le Limosin.
BÉNÉVOL, adj. (terme de Droit ecclésiastique.) est un acte par lequel un supérieur octroye une place monacale dans sa maison, à un religieux d’un autre ordre, qui est dans le dessein de se faire transférer dans le sien. Il doit avoir ce bénévol, pour être en état d’obtenir le bref de translation, de peur qu’il ne se Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/208 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/209 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/210 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/211 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/212 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/213 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/214 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/215 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/216 Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/217 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/218 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/219 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/220 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/221 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/222 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/223 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/224 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/225 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/226 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/227 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/228 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/229 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/230 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/231 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/232 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/233 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/234 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/235 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/236 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/237 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/238 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/239 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/240 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/241 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/242 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/243 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/244 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/245 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/246 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/247 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/248 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/249 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/250 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/251 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/252 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/253 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/254 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/255 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/256 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/257 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/258 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/259 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/260 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/261 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/262 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/263 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/264 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/265 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/266 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/267 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/268 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/269 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/270 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/271 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/272 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/273 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/274 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/275 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/276 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/277 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/278 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/279 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/280 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/281 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/282 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/283 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/284 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/285 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/286 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/287 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/288 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/289 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/290 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/291 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/292 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/293 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/294 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/295 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/296 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/297 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/298 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/299 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/300 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/301 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/302 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/303 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/304 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/305 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/306 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/307 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/308 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/309 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/310 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/311 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/312 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/313 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/314 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/315 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/316 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/317 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/318 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/319 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/320 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/321 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/322 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/323 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/324 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/325 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/326 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/327 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/328 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/329 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/330 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/331 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/332 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/333 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/334 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/335 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/336 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/337 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/338 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/339 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/340 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/341 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/342 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/343 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/344 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/345 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/346 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/347 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/348 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/349 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/350 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/351 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/352 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/353 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/354 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/355 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/356 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/357 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/358 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/359 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/360 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/361 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/362 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/363 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/364 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/365 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/366 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/367 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/368 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/369 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/370 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/371 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/372 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/373 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/374 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/375 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/376 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/377 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/378 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/379 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/380 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/381 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/382 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/383 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/384 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/385 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/386 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/387 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/388 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/389 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/390 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/391 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/392 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/393 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/394 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/395 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/396 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/397 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/398 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/399 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/400 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/401 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/402 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/403 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/404 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/405 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/406 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/407 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/408 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/409 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/410 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/411 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/412 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/413 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/414 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/415 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/416 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/417 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/418 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/419 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/420 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/421 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/422 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/423 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/424 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/425 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/426 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/427 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/428 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/429 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/430 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/431 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/432 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/433 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/434 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/435 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/436 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/437 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/438 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/439 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/440 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/441 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/442 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/443 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/444 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/445 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/446 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/447 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/448 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/449 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/450 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/451 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/452 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/453 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/454 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/455 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/456 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/457 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/458 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/459 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/460 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/461 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/462 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/463 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/464 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/465 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/466 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/467 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/468 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/469 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/470 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/471 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/472 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/473 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/474 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/475 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/476 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/477 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/478 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/479 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/480 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/481 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/482 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/483 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/484 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/485 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/486 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/487 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/488 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/489 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/490 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/491 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/492 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/493 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/494 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/495 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/496 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/497 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/498 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/499 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/500 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/501 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/502 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/503 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/504 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/505 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/506 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/507 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/508 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/509 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/510 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/511 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/512 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/513 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/514 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/515 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/516 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/517 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/518 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/519 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/520 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/521 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/522 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/523 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/524 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/525 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/526 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/527 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/528 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/529 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/530 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/531 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/532 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/533 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/534 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/535 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/536 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/537 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/538 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/539 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/540 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/541 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/542 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/543 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/544 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/545 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/546 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/547 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/548 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/549 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/550 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/551 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/552 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/553 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/554 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/555 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/556 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/557 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/558 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/559 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/560 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/561 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/562 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/563 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/564 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/565 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/566 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/567 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/568 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/569 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/570 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/571 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/572 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/573 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/574 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/575 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/576 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/577 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/578 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/579 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/580 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/581 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/582 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/583 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/584 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/585 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/586 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/587 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/588 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/589 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/590 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/591 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/592 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/593 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/594 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/595 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/596 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/597 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/598 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/599 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/600 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/601 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/602 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/603 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/604 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/605 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/606 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/607 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/608 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/609 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/610 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/611 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/612 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/613 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/614 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/615 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/616 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/617 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/618 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/619 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/620 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/621 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/622 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/623 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/624 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/625 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/626 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/627 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/628 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/629 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/630 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/631 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/632 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/633 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/634 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/635 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/636 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/637 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/638 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/639 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/640 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/641 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/642 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/643 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/644 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/645 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/646 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/647 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/648 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/649 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/650 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/651 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/652 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/653 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/654 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/655 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/656 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/657 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/658 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/659 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/660 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/661 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/662 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/663 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/664 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/665 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/666 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/667 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/668 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/669 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/670 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/671 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/672 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/673 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/674 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/675 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/676 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/677 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/678 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/679 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/680 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/681 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/682 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/683 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/684 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/685 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/686 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/687 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/688 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/689 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/690 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/691 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/692 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/693 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/694 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/695 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/696 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/697 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/698 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/699 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/700 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/701 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/702 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/703 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/704 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/705 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/706 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/707 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/708 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/709 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/710 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/711 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/712 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/713 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/714 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/715 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/716 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/717 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/718 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/719 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/720 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/721 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/722 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/723 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/724 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/725 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/726 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/727 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/728 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/729 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/730 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/731 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/732 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/733 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/734 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/735 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/736 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/737 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/738 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/739 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/740 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/741 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/742 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/743 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/744 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/745 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/746 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/747 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/748 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/749 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/750 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/751 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/752 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/753 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/754 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/755 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/756 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/757 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/758 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/759 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/760 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/761 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/762 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/763 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/764 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/765 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/766 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/767 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/768 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/769 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/770 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/771 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/772 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/773 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/774 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/775 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/776 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/777 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/778 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/779 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/780 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/781 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/782 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/783 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/784 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/785 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/786 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/787 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/788 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/789 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/790 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/791 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/792 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/793 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/794 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/795 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/796 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/797 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/798 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/799 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/800 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/801 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/802 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/803 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/804 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/805 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/806 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/807 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/808 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/809 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/810 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/811 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/812 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/813 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/814 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/815 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/816 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/817 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/818 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/819 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/820 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/821 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/822 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/823 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/824 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/825 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/826 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/827 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/828 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/829 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/830 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/831 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/832 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/833 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/834 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/835 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/836 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/837 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/838 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/839 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/840 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/841 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/842 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/843 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/844 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/845 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/846 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/847 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/848 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/849 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/850 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/851 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/852 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/853 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/854 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/855 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/856 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/857 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/858 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/859 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/860 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/861 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/862 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/863 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/864 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/865 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/866 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/867 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/868 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/869 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/870 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/871 MediaWiki:Proofreadpage pagenum templatePage:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 2.djvu/872
- ↑ Voir erratum, tome II, p. 872.
- ↑ Voir erratum, tome II, p. 872.
- ↑ Note wikisource : Les calculs sont faux. En remontant à la source de Diderot (J. Craig, Modèle:Lang, paru en 1699 dans les Modèle:Lang de la Royal Society. Cf. [1]), on voit qu’il faut lire douzième au lieu de soixante-dixième pour le rapport de et que le dernier calcul mentionné concerne le rapport de , et non .





















































