Dictionnaire infernal/6e éd., 1863/Texte entier p3
Mais Michel Schramm, en songeant qu’il avait vendu son âme, perdit tout repos. Il eut l’heureux | courage ou plutôt la grâce de retourner à Dieu. Il se rendit chez les jésuites de Molsheim, abjura sa lâcheté et fut délivré au bout de trois semaines, le démon, contraint par les exorcismes, ayantrendu son pacte. Ce qui eut lieu le 13 janvier 1613[1].
Schroettelis, les esprits montagnards ou gnomes en Suisse.
Schroter (Ulrich). En 1552, à Willissaw, dans le canton de Lucerne, un joueur de profession, nommé Ulrich Schroter, se voyant malheureux au jeu, proférait des blasphèmes qui ne rendaient pas ses parties meilleures. Il jura que, s’il ne gagnait pas, dans la chance qui allait tourner, il jetterait sa dague contre un crucifix qui était sur la cheminée. Les menaces d’Ulrich n’épouvantèrent point celui dont il outrageait l’image ; Ulrich perdit encore. Furieux, il se lève, lance sa dague, qui n’atteignit pas son but sacrilège, et aussitôt, disent les chroniques du temps, une troupe de démons tombe sur lui et l’étouffe, avec un bruit si épouvantable, que toute la ville* en fut ébranlée[2].
Sciamancie, divination qui consiste à évoquer les ombres des morts, pour apprendre les choses futures. Elle différait de la nécromancie et de la psychomancie en ce que c’était, non l’âme ni le corps du défunt qui paraissait, mais seulement un simulacre.
Sciences. Les musulmans attribuent la diffusion des sciences dans le monde à Édris, qui n’est autre qu’Énoch. Ce nom Édris vient d’un mot arabe qui signifie méditation, étude. Édris, disent-ils, fut l’un des plus anciens prophètes. Dieu lui envoya trente volumes qui renfermaient les principes de toutes les sciences et de toutes les connaissances humaines. Il fit la guerre aux infidèles descendus de Caïn, et réduisit le premier en esclavage ses prisonniers de guerre ; il inventa la plume et l’aiguille, l’arithmétique et l’astronomie. Édris vécut 375 ans et fut enlevé au ciel.
Sciences occultes ou Sciences secrètes. On donne ce nom à la magie, à la théurgie, au plus grand nombre des divinations, à la jurisprudence des pactes, à l’art notoire, à l’art des talismans, aux pratiques des grimoires, aux secrets et aux combinaisons des sorciers, aux procédés qui évoquent, dirigent ou renvoient les démons et les esprits, etc., etc., etc.
Scimasar, une des douze espèces d’augures que Michel Scot distingue dans son Traité de la physionomie. Il l’appelle Scimasar nova. Lorsque vous voyez, dit-il, un homme ou un oiseau derrière vous, qui vous joint ou vous passe, s’il passe à votre droite, c’est bon augure, et mauvais s’il passe à votre gauche.
Sciopodes, peuples fabuleux de l’Éthiopie, dont parle Pline, lesquels, n’ayant qu’un pied, s’en servaient pour se mettre à l’ombre du soleil, en se couchant par terre et levant leur pied en l’air.
Scopelisme, sorte de maléfice qu’on donnait par le moyen de quelques pierres charmées. On jetait une ou plusieurs pierres ensorcelées dans un jardin ou dans un champ : la personne, qui les découvrait ou y trébuchait en recevait le maléfice, qui faisait parfois mourir.
Scorpion. Les Persans croient que, par le moyen de certaines pierres merveilleuses, on peut ôter le venin aux scorpions, qui se trouvent chez eux en grand nombre.
Frey assure qu’il n’y a jamais eu ni de serpents ni de scorpions dans la ville de Hamps, à cause de la figure d’un scorpion gravée sur un talisman dans les murailles de cette ville.
Scot, magicien. Voy. Sibylles, à la fin.
Scotopètes. Voy. Circoncellions.
Scott (Michel), magicien écossais, que Dante a mis dans son enfer. Il vivait au treizième siècle.
Scott (Réginald) a publié en Angleterre une description et statistique du gouvernement des démons. Il n’est pas d’accord avec Wierus.
Scott (Walter). Voy. Walter Scott.
Scouminkes, esprits familiers allemands, qui s’attachent surtout aux maisons nobles.
Scox ou Chax, duc et grand marquis des

Scylla, nymphe dont Glaucus fut épris. N’ayant pu la rendre sensible, il eut recours à Circé, qui mit un charme dans la fontaine où Scylla avait coutume de se baigner. À peine y fut-elle entrée, qu’elle se vit changée en un monstre qui avait douze griffes, six gueules et six têtes ; une meute de chiens lui sortait de la ceinture. Effrayée d’elle-même, Scylla se jeta dans la mer à l’endroit où est le détroit qui porte son nom.
Sébhil ou Sébhaël, génie qui, selon les musulmans, tient les livres où sont écrites les bonnes et les mauvaises actions des hommes.
Secrétain (Françoise), sorcière qui fut brûlée à Saint-Claude, en Franche-Comté, sous Boguet. Elle avoua qu’elle avait vu le diable, tantôt en forme de chien, tantôt en forme de chat, tantôt en forme de poule[4]. Elle le vit aussi sous les traits peu agréables d’un grand cadavre…
Secrets merveilleux. Faites tremper une graine quelconque dans la lie de vin, puis jetez-la aux oiseaux ; ceux qui en tâteront s’enivreront et se laisseront prendre à la main. Mangez à jeun quatre branches de rue, neuf grains de genièvre, une noix, une figue sèche et un peu de sel, pilés ensemble, vous vous maintiendrez en parfaite santé, dit le Petit Albert. Qu’on pile et qu’on prenne dans du vin une pierre qui se trouve dans la tête de quelques poissons, Avicenne dit qu’on guérira de la pierre. Mizaldus prétend que les grains d’aubépine, pris avec du vin blanc, guérissent de la gravelle. La grenouille des buissons, coupée et mise sur les reins, fait tellement uriner, si l’on en croit Cardan, que les hydropiques en sont souvent guéris.
Qu’on plume, qu’on brûle et qu’on réduise en poudre la tête d’un milan, qu’on en avale dans de l’eau autant qu’on peut en prendre avec trois doigts, Mizaldus promet qu’on guérira de la goutte. Cardan assure encore qu’une décoction de l’écorce du peuplier blanc, appliquée sur les membres souffrants, guérit la goutte sciatique. Wecker déclare qu’une tasse de thé guérit les morsures des vipères.
On voit dans Thiers qu’on fait sortir les ordures des yeux en crachant trois fois.
Ce ne sont là que des secrets de santé. Leloyer dit que, pour se garantir des enchantements, il faut cracher sur le soulier du pied droit, et qu’on se préserve des maléfices en crachant trois fois sur les cheveux qu’on s’arrache en se peignant, avant de les jeter à terre.
Un ancien assure qu’une vierge arrête la grêle en en mettant trois grains dans son sein. Nous entrons là dans les secrets plus mystérieux. On empêche un mari de dormir en mettant dans son lit un œuf d’hirondelle.
Mettez un œuf dans le vin : s’il descend de suite au fond, le vin est trempé ; s’il surnage, le vin est pur. Qu’on mêle l’herbe centaurée avec le sang d’une huppe femelle, et qu’on en mette dans une lampe avec de l’huile, tous ceux qui se trouveront présents se verront les pieds en l’air et la tête en bas. Si on en met au nez de quelqu’un, il s’enfuira et courra de toutes ses forces. Celui-ci est d’Albert le Grand, ou du moins du livre de secrets merveilleux qu’on lui attribue. Qu’on mette pourrir la sauge dans une fiole, sous du fumier, il s’en formera un ver qu’on brûlera. En jetant sa cendre au feu, elle produira un coup de tonnerre. Le même livre ajoute que, si on en mêle à l’huile de la lampe, toute la chambre semblera pleine de serpents.
La poudre admirable que les charlatans appellent poudre de perlimpinpin, et qui opère tant de prodiges, se fait avec un chat écorché, un crapaud, un lézard et un aspic, qu’on met sous de bonne braise jusqu’à ce que le tout soit pulvérisé[5]. On pourrait citer une foule de secrets pareils, car nous en avons de toutes les couleurs ; mais ceux qu’on vient de lire donnent une idée de la totalité. Voy. Charmes, Enchantements, Maléfices, Prières, Superstitions, etc.
Pline assure qu’un certain Babilius fit en six jours la traversée de la Sicile à Alexandrie, par la vertu d’une herbe dont il ne dit pas le nom. On cite d’autres voyageurs qui ont fait en un jour cent lieues à pied au moyen de la jarretière du bon voyageur. Voy. Jarretière.
Il y a des livres très-gros, uniquement consacrés aux formules des secrets dits naturels et des secrets dits magiques. Nous devons donner une idée textuelle de cette partie de l’encyclopédie infernale.
« Composition de mort, ou la pierre philosophale. — Prenez un pot de terre neuf, mettez-y une livre de cuivre rouge avec une demi-chopine d’eau-forte que vous ferez bouillir pendant une demi-heure : après quoi vous y mettrez trois onces de vert-de-gris que vous ferez bouillir une heure ; puis vous mettrez deux onces et demie d’arsenic que vous ferez bouillir une heure ; vous y mettrez trois onces d’écorce de chêne, bien pulvérisée, que vous laisserez bouillir une demi-heure, une potée d’eau rose bouillie douze minutes, trois onces de noir de fumée que vous laisserez bouillir jusqu’à ce que la composition soit bonne. Pour voir si elle est assez cuite, il faut y tremper un clou : si elle y prend, ôtez-la ; elle vous procurera une livre et demie de bon or ; et si elle ne prend point, c’est une preuve qu’elle n’est pas assez cuite ; la liqueur peut servir quatre fois.

» Pour faire la baguette divinatoire et la faire tourner. — Dès le moment que le soleil paraît sur l’horizon, vous prenez de la main gauche une baguette vierge de noisetier sauvage et la coupez de la droite en trois coups, en disant : Je te ramasse au nom d’Eloïm, Matrathon, Adonai et Semiphoras, afin que tu aies la vertu de la verge de Moïse et de Jacob, pour découvrir tout ce que je voudrai savoir. Et pour la faire tourner, il faut dire, la tenant serrée dans ses mains par les deux bouts qui font la fourche : Je te recommande au nom d’Eloïm, Matrathon, Adonài et Semiphoras, de me relever…
» Pour gagner toutes les fois qu’on met aux loteries. — Il faut, avant de se coucher, réciter trois fois cette oraison, après quoi vous la mettrez sous l’oreiller, écrite sur du parchemin vierge, sur lequel vous aurez fait dire une messe du Saint-Esprit…, et pendant le sommeil le génie de votre planète vient vous dire l’heure où vous devez prendre votre billet : Domine Jesu Christe, qui dixisti ego sum, via, veritas et vita, ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi, adhuc quæ révélés in hac nocte sicut ita revelatum fuit parvulis solis, incognita et ventura unaque alia me doceas, ut possim omnia cognoscere, si et si sit ; ita monstra mihi montem ornatum omni vino bono, pulclirum et gratum pomarium, aut quamdam rem gratam, sin autem ministra mihi ignem ardentem, vel aquarum currentem, vel aliam quamcunque rem quæ Domino placeat, et vel Angeli Ariel, Rubiel et Barachiel sitis mihi multum amatores et factores ad opus istud obtinendum quod cupio scire, videre, cognoscere et prævidere per ilium Deum qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. Amen. Vous direz trois Pater et trois Ave Maria pour les âmes du purgatoire…
» Pour charmer les armes à feu. — Il faut dire : — Dieu y ait part et le diable la sortie, — et lorsqu’on met en joue, il faut dire en croisant la jambe gauche sur la droite : — Non tradas Dominum nostrum Jesum Christum. Mathon. Amen…
» Pour parler aux esprits la veille de la Saint-Jean-Baptiste. — Il faut se transporter, de onze heures à minuit, près d’un pied de fougère, et dire : — Je prie Dieu que les esprits à qui je souhaite parler apparaissent à minuit précis. — Et aux trois quarts vous direz neuf fois ces cinq paroles : Bar, Kirabar, Alli, Alla-Tetragramaton.
» Pour se rendre invisible. — Vous volerez un chat noir, et vous achèterez un pot neuf, un miroir, un briquet, un pierre d’agate, du charbon et de l’amadou, observant d’aller prendre de l’eau au coup de minuit à une fontaine ; après quoi, allumez votre feu, mettez le chat dans le pot, et tenez le couvert de la main gauche sans bouger ni regarder derrière vous, quelque bruit que vous entendiez ; et, après l’avoir fait bouillir vingt-quatre heures, vous le mettez dans un plat neuf ; prenez la viande et la jetez par-dessus l’épaule gauche, en disant ces paroles : Accipe quod tibi do, et nihil amplius[6] ; puis vous mettrez les os un à un sous les dents du côté gauche, en vous regardant dans le miroir ; et si ce n’est pas le bon os, vous le jetterez de même, en disant les mêmes paroles jusqu’à ce que vous l’ayez trouvé, et sitôt que vous ne vous verrez plus dans le miroir, retirez-vous à reculons en disant : Pater, in manus tuas commendo spiriturn meum…
» Pour faire la jarretière de sept lieues par heure. — Vous achèterez un jeune loup au-dessous d’un an, que vous égorgerez avec un couteau neuf à l’heure de Mars, en prononçant ces paroles : Adhumalis cados ambulavit infortitudine cibi illius ; puis vous couperez sa peau en jarretières larges d’un pouce, et y écrirez dessus les mêmes paroles que vous avez dites en l’égorgeant, savoir, la première lettre de votre sang, la seconde de celui du loup, et immédiatement de même jusqu’à la fin de la phrase. Après qu’elle est écrite et sèche, il faut la doubler avec un padoue de fil blanc, et attacher deux rubans violets aux deux bouts pour la nouer du dessus au-dessous du genou ; il faut prendre garde qu’aucune femme ou fille ne la voie ; comme aussi la quitter avant de passer une rivière, sans quoi elle ne serait plus assez forte.
» Composition de l’emplâtre pour faire dix lieues par heure. — Prenez deux onces de graisse humaine, une once d’huile de cerf, une once d’huile de laurier, une once de graisse de cerf, une once de momie naturelle, une demi-chopine d’esprit-de-vin et sept feuilles de verveine. Vous ferez bouillir 16 tout dans un pot neuf jusqu’à demi-réduction ; puis vous en formez les emplâtres sur de la peau neuve, et, lorsque vous les appliquez sur la rate, vous allez comme le vent. Pour n’être point malade quand vous le quittez, il faut prendre trois gouttes de sang dans un verre de vin blanc.
» Composition de l’encre pour écrire les pactes. — Les pactes ne doivent point être écrits avec l’encre ordinaire. Chaque fois qu’on fait une appellation à l’esprit, on doit en changer. Mettez dans un pot de terre verpissé neuf de l’eau de rivière et la poudre décrite ci-après. Alors prenez des branches de fougère cueillie la veille de la Saint-Jean, du sarment coupé en pleine lune de mars ; allumez ce bois avec du papier vierge, et dès que votre eau bouillira, votre encre sera faite. Observez bien d’en changer à chaque nouvelle écriture que vous aurez à faire. Prenez dix onces de noix de galle et trois onces de vitriol romain, ou couperose verte ; d’alun de roche ou de gomme arabique, deux onces de chacun ; mettez le tout en poudre impalpable, dont, lorsque vous voudrez faire de l’encre, vous préparerez comme il est dit ci-dessus.
» Encre pour noter les sommes qu’on prendra dans les trésors cachés et pour en demander de plus fortes à Lucifuge[7] dans les nouveaux besoins. — Prenez des noyaux de pêche sans en ôter les amandes, mettez-les dans le feu pour les réduire en charbons bien brûlés ; alors retirez-les, et, lorsqu’ils sont bien noirs, prenez-en une partie, que vous mêlerez avec autant de noir de fumée ; ajoutez-y deux parties de noix de galle concassées ; faites dans l’huile desséchée de gomme arabique quatre parties ; que le tout soit mis en poudre très-fine et passée par le tamis. Mettez cette poudre dans de l’eau de rivière. Il est inutile de faire remarquer que tous les objets décrits ci-dessus doivent être absolument neufs.
» Lecteur bénévole, dit pour sa conclusion l’auteur de ces recettes, dont nous ne donnons que le bouquet, pénétre-toi bien de tout ce que le grand Salomon vient de t’enseigner par mon organe. Sois sage comme lui, si tu veux que toutes les richesses que je viens de mettre en ton pouvoir puissent faire ta félicité. Sois humain envers tes semblables, soulage les malheureux ; vis content. Adieu. »
Il est triste de savoir que de tels livres se vendent en grand nombre dans nos campagnes. Les voltairiens se plaignent de l’innocente diffusion de quelques petites brochures pieuses qui prêchent la paix ; ils ne disent rien des Grimoires et des Clavicules.
Segjin, septième partie de l’enfer chez les mahométans. On y jette les âmes des impies, sous un arbre noir et ténébreux, où l’on ne voit jamais aucune lumière ; ce qui n’est pas gai.
Seidur, magie noire chez les Islandais. V. Nid.
Seings. Divination à l’aide des seings, adressée par Mélampus au roi Ptolémée. — Un seing ou grain de beauté, au front de l’homme ou de la femme, promet des richesses. Un seing auprès des sourcils d’une femme la rend à la fois bonne et belle ; auprès des sourcils d’un homme, un seing le rend riche et beau. Un seing dans les sourcils promet à l’homme cinq femmes et à la femme cinq maris. Celui qui porte un seing à la joue deviendra opulent. Un seing à la langue promet le bonheur en ménage. Un seing aux lèvres indique la gourmandise. Un seing au menton annonce des trésors. Un seing aux oreilles donne une bonne réputation. Un seing au cou promet une grande fortune ; mais pourtant celui qui porte un seing derrière le cou pourrait bien être décapité. Un seing aux reins caractérise un pauvre gueux. Un seing aux épaules annonce une captivité. Un seing à la poitrine ne donne pas de grandes richesses. Celui qui porte un seing sur le cœur est quelquefois méchant ; celui qui porte un seing au ventre aime la bonne chère. Ceux qui ont un seing aux mains auront beaucoup d’enfants. Voy. Chiromancie.
Sel. Le sel, dit Boguet, est un antidote souverain contre la puissance de l’enfer. Le diable a tellement le sel en haine qu’on ne mange rien de salé au sabbat. Un Italien, se trouvant par hasard à cette assemblée pendable, demanda du sel avec tant d’importunité, que le diable fut contraint d’en faire servir. Sur quoi l’Italien s’écria : — Dieu soit béni, puisqu’il m’envoie ce sel ! et tout délogea à l’instant. Quand du sel se répand sur la table, mauvais présage, que l’on conjure en prenant une pincée du sel répandu et le jetant derrière soi avec la main droite par-dessus l’épaule gauche. Les Écossais attribuent une vertus extraordinaire à l’eau saturée de sel ; les habitants des Hébrides et des Orcades n’oublient jamais de placer un vase rempli d’eau et de sel sur la poitrine des morts, afin, disent-ils de chasser les esprits infernaux. Le sel est le symbole de l’éternité et de la sagesse, parce qu’il ne se corrompt point. Voy. Salière.
Sépar. Voy. Vépar.
Séphirioths (les) sont dans la cabale des êtres supérieurs mal définis.
Sépulture. Quelques philosophes qui voyageaient en Perse, ayant trouvé un cadavre abandonné sur le sable, l’ensevelirent et le mirent en terre. La nuit suivante, un spectre apparut à l’un de ces philosophes et lui dit que ce mort était le corps d’un infâme qui avait commis un inceste, et que la terre lui refusait son sein. Les philosophes se rendirent le lendemain au même lieu pour déterrer le cadavre ; mais ils trouvèrent la besogne faite, et continuèrent la route sans plus s’en occuper. Voy. Mort et Funérailles.
Nous pouvons ajouter un trait de plus aux bizarreries des usages funèbres.
Jonas, l’un des rois comans, mourut subitement avant d’être baptisé ; pour cette raison, on l’enterra comme païen hors des murs de Constantinople. On permit à ses officiers de faire ses funérailles selon leurs pratiques barbares. Son monument fut dressé sur une éminence, et dans la fosse, autour de son cadavre, on pendit à sa droite et à sa gauche plusieurs de ses écuyers qui s’offrirent volontairement à aller servir leur maître dans l’autre monde.; on y pendit aussi, pour le même usage, vingt-six chevaux vivants.
Sermons. Le diable, qui affecte de singer tous les usages de l’Église, fait faire au sabbat des sermons auxquels doivent assister tous les

Serosch, génie de la terre chez les Parsis. Il préserve l’homme des embûches du diable.
Serpent. C’est sous cette figure redoutée que Satan fit sa première tentation. Le serpent noir de Pensylvanie a le pouvoir de charmer ou de fasciner les oiseaux et les écureuils : s’il est couché sous un arbre et qu’il fixe ses regards sur l’oiseau ou l’écureuil qui se trouve au-dessus de lui, il le force à descendre et à se jeter directement dans sa gueule. Cette opinion est justement très-accréditée, et ceux qui la nient parce qu’elle tient du merveilleux ne connaissent pas les effets de la fascination naturelle. Il y a dans les royaumes de Juida et d’Ardra, en Afrique, des serpents très-doux, très-familiers, et qui n’ont aucun venin ; ils font une guerre continuelle aux serpents venimeux : voilà sans doute l’origine du culte qu’on commença et qu’on a continué de leur rendre dans ces contrées. Un marchand anglais, ayant trouvé un de ces serpents dans son magasin, le tua, et, n’imaginant pas avoir commis une action abominable, le jeta devant sa porte. Quelques femmes passèrent, poussèrent des cris affreux, et coururent répandre dans le canton la nouvelle de ce sacrilège. Une grande fureur s’empara des esprits : on massacra les Anglais ; on mit le feu à leurs comptoirs, et leurs marchandises furent consumées par les flammes.

Des chimistes ont soutenu que le serpent, en muant et en se dépouillant de sa peau, rajeunit, croît, acquiert de nouvelles forces, et qu’il ne meurt que par des accidents et jamais de mort naturelle. On ne peut pas prouver par des expériences la fausseté de cette opinion ; car si l’on nourrissait un serpent et qu’il vînt à mourir, les partisans de son espèce d’immortalité diraient qu’il est mort de chagrin de n’avoir pas sa liberté, ou parce que la nourriture qu’on lui donnait ne convenait point à son tempérament.
On dit qu’Ajax, roi des Locriens, avait apprivoisé un serpent de quinze pieds de long, qui le suivait comme un chien et venait manger à table. Voy. Alexandre de Paphlagonie, Âne, Harold, Haridi, etc.
Serpent de mer (Le grand). On se rappelle le bruit que fit en 1837 la découverte du grand serpent de mer vu par le navire le Havre à la hauteur des Açores. Tous les journaux s’en sont occupés ; et, après s’en être montrée stupéfaite, la presse, faisant volte-face, a présenté ensuite le grand serpent marin comme un être imaginaire. M. B. de Xivrey a publié à ce propos, dans le Journal des Débats, des recherches curieuses que nous reproduisons en partie :
« Les mers du Nord, dit-il, paraissent être aujourd’hui la demeure habituelle du grand serpent de mer, et son existence est en Norvège un fait de notoriété vulgaire. Ce pays a vu souvent échouer sur ses côtes des cadavres de ces animaux, sans que l’idée lui soit venue de mettre de l’importance à constater ces faits. Les souvenirs s’en sont mieux conservés lorsqu’il s’y sorciers quelque autre incident plus grave, comme la corruption de l’air causée quelquefois par la putréfaction de ces corps. Pontoppidan en a cité des exemples, mais jamais on n’avait pensé à rédiger, à l’occasion de pareils faits, un procès-verbal. Celui qui fut rédigé à Stronza offre les notions les plus précises que l’on possède sur la figure du serpent de mer. Nous y voyons notamment ce signe remarquable de la crinière, dont les observateurs plus anciens et les récits des Norvégiens s’accordent à faire mention. Nous le trouvons dans une lettre datée de Bergen, 21 février 1751, où le capitaine Laurent Ferry termine ainsi sa description du serpent de mer qu’il rencontra : « Sa tête, qui s’élevait au-dessus des vagues les plus hautes, ressemblait à celle d’on cheval ; il était de couleur grise, avec la bouche très-brune, les yeux noirs et une longue crinière qui flottait sur son cou. Outre la tête de ce reptile, nous pûmes distinguer sept ou huit de ses replis, qui étaient très-gros et renaissaient à une toise l’un de l’autre. Ayant raconté cette aventure devant une personne qui désira une relation authentique, je la rédigeai et la lui remis avec la signature des deux matelots, témoins oculaires, Nicolas Peterson Kopper et Nicolas Nicolson Angleweven, qui sont prêts à attester sous serment l’a description que j’en ai faite. »
» C’est probablement cette crinière que Paul Égède compare à des oreilles ou à des ailes dans sa description du serpent marin qu’il vit à son second voyage au Groenland : « Le 6 juillet, nous aperçûmes un monstre qui se dressa si haut sur les vagues, que sa tête atteignait la voile du grand mât. Au lieu de nageoires, il avait de grandes oreilles pendantes comme des ailes ; des écailles lui couvraient tout le corps, qui se terminait comme celui d’un serpent. Lorsqu’il se reployait dans l’eau, il s’y jetait en arrière et, dans cette sorte de culbute, il relevait sa queue de toute la longueur du navire. »
» Olaüs Magnus, archevêque d’Upsal au milieu du seizième siècle, fait une mention formelle de cette crinière, dans le portrait du serpent de deux cents pieds de long et de vingt de circonférence, dont il parle comme témoin oculaire : « Ce serpent a une crinière de deux pieds de long ; il est couvert d’écailles et ses yeux brillent comme deux flammes ; il attaque quelquefois un navire, dressant sa tête comme un mât et saisissant les matelots sur le tillac. » Les mêmes caractères, qui se reproduisent dans d’autres récits dont la réunion serait trop longue, se retrouvent dans les descriptions des poètes Scandinaves. Avec une tête de cheval, avec une crinière blanche et des joues noires, ils attribuent au serpent marin six cents pieds de long. Ils ajoutent qu’il se dresse tout à coup comme un mât de vaisseau de ligne, et pousse des sifflements qui effrayent comme le cri d’une tempête. Ici nous apercevons bien les effets de l’exagération poétique, mais nous n’avons pas les données suffisantes pour marquer le point précis où elle abandonne la réalité.
» En comparant ces notions[8] avec ce que peuvent nous offrir d’analogue les traditions du moyen âge et de l’antiquité, je trouve des similitudes frappantes dans la description qu’Albert le Grand nous a laissée du grand serpent de l’Inde : « Avicenne en vit un, dit-il, dont le cou était garni dans toute sa longueur de poils longs et gros comme la crinière d’un cheval. » Albert ajoute que ces serpents ont à chaque mâchoire trois dents longues et proéminentes. Cette dernière circonstance paraît une vague réminiscence de ce que Ctésias, dans ses Indiques, et d’après lui Élien, dans ses Propriétés des animaux, ont rapporté du ver du Gange. Pour la dimension, ce ver est sans doute inférieur à la grandeur que peut atteindre le serpent marin, puisque ces auteurs grecs lui donnent sept coudées de long et une circonférence telle qu’un enfant de dix ans aurait de la peine à l’embrasser. Les deux dents dont ils le disent pourvu, une à chaque mâchoire, lui servent à saisir les bœufs, les chevaux ou les chameaux qu’il trouve sur la rive du fleuve, où il les entraîne et les dévore. Il est à propos de remarquer ici qu’un grand nombre de traits d’Hérodote et même de Ctésias, rejetés d’abord comme des contes ridicules, ont été plus tard repris pour ainsi dire en sous-œuvre par la science, qui souvent y a découvert des faits vrais et même peu altérés. Malte-Brun a plusieurs fois envisagé Ctésias sous ce point de vue.
» Nous arrivons naturellement à l’épouvantable animal appelé odontotyrannus, dans les récits romanesques des merveilles qu’Alexandre rencontra dans l’Inde. Tous les romans dû moyen âge sur ce conquérant, provenant des textes grecs désignés sous le nom du Pseudo-Callisthène, sont unanimes sur l’odontotyrannus, dont parlent aussi plusieurs auteurs byzantins. Tous en font un animal amphibie, vivant dans le Gange et sur ses bords, d’une taille dont la grandeur dépasse toute vraisemblance, « telle, dit Palladius, qu’il peut avaler un éléphant tout entier ». Quelque ridicule que paraisse cette dernière circonstance, on pourrait y voir mie allusion hyperbolique à la manière dont les plus gros serpents terrestres dévorent les grands quadrupèdes, comme les chevaux et les bœufs ; ils les avalent en effet sans les diviser, mais après les avoir broyés, allongés en une sorte de rouleau informe, par les puissantes étreintes et les secousses terribles de leurs replis. Il est vrai que M. Grœfe, par une docte dissertation insérée dans les Mémoires de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, a prétendu que l’odontotyrannus des traditions du moyen âge devait être un souvenir du mammouth. Le savant russe ne peut guère fonder cette singulière interprétation que sur les versions latines du roman d’Alexandre, dont monsignor Mai a publié un texte en 1818, sous le nom de Julius Valérius. Il est dit que l’odontotyrannus foula aux pieds (conculcavit) un certain nombre de soldats macédoniens. Le même récit se trouve dans une prétendue lettre d’Alexandre à Aristote, et dans un petit Traité des monstres et des bêtes extraordinaires, récemment publié. Mais dans les auteurs grecs que je viens d’indiquer, c’est-à-dire les divers textes grecs inédits du Pseudo-Callis-thène et Palladius, Cédrénus, Glycas, Hamarto-lus, on n’ajoute aucun détail figuratif à l’expression d’une grandeur énorme et d’une nature amphibie.
» Pour la qualité d’amphibie, qui n’appartient certainement pas au mammouth, peut-elle s’appliquer au grand serpent de mer ? Sir Everard Home, en proposant de placer parmi les squales celui qui avait échoué sur la place de Stronza, a prouvé par là qu’il le regardait comme un véritable poisson. Mais si l’on en fait un reptile, on lui supposera par cela même une nature amphibie, avec la faculté de rester indéfiniment dans l’eau, et l’on pourra en même temps rapporter au même animal les exemples de serpents énormes vus sur terre et consignés de loin en loin dans la mémoire des hommes. Le serpent de mer dont Olaüs Magnus a conservé une description était, au rapport du même prélat, un serpent amphibie qui vivait de son temps dans les rochers aux environs de Bergen, dévorait les bestiaux du voisinage et se nourrissait aussi de crabes. Un siècle plus tard, Nicolas Grammius, ministre de l’Évangile à Londen en Norvège, citait un gros serpent d’eau qui des rivières Mios et Banz, s’était rendu à la mer le 6 janvier 1656. « On le vit s’avancer tel qu’un long mât de navire, renversant tout sur son passage, même les arbres et les cabanes. Ses sifflements, ou plutôt ses hurlements, faisaient frissonner tous ceux qui les entendaient. Sa tête était aussi grosse qu’un tonneau, et son corps, taillé en proportion, s’élevait au-dessus des ondes à une hauteur considérable. »

» En des temps plus anciens, nous citerons le serpent de l’île de Rhodes, dont triompha au quatorzième siècle le chevalier Gozon, qui, par suite de cet exploit, trop légèrement traité de fable, devint grand maître de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; au seizième siècle, celui que Grégoire de Tours rapporte avoir été vu à Rome dans une inondation du Tibre, et qu’il représente grand comme une forte poutre : in modum trahis validæ. Le mot draco, dont se sert là notre vieil historien, est le terme de la bonne latinité, où il signifie seulement un grand serpent. Dans l’antiquité proprement dite, Suétone nous apprend qu’Auguste publia aux comices, c’est-à-dire annonça officiellement, la découverte faite en Étrurie d’un serpent long de soixante-quinze pieds. Dion Cassius dit que, sous le même prince, on vit dans la même contrée un serpent de quatre-vingt-cinq pieds de long, qui causa de grands ravages et fut frappé de la foudre. Le plus célèbre de tous ceux dont ont parlé les auteurs anciens est celui qu’eut à combattre l’armée romaine près de Carthage, sur les bords du lac Bagrada, pendant le second consulat de Régulus, l’an de Rome 498, qui répond à l’année 256 avant Jésus-Christ. Ce

» Philostorge parle de peaux de serpents de soixante-huit pieds de long, qu’il avait vues à Rome. Diodore rapporte qu’un serpent de quarante-cinq pieds de long fut pris dans le Nil et envoyé vivant à Ptolémée-Philadelphe à Alexandrie. Strabon, qui, d’après Agatharchides, parle d’autres serpents de la même grandeur, cite ailleurs Posidonius, qui vit dans la Cœlésyrie un serpent mort de cent vingt pieds de long et d’une circonférence telle que deux cavaliers séparés par son corps ne se voyaient pas.
» Alléguerons-nous que le même Strabon rapporte, d’après Onésicrite, que, dans une contrée de l’Inde appelée Aposisares, on avait nourri deux serpents, l’un de cent vingt pieds, l’autre de deux cent dix, et qu’on désirait beaucoup les faire voir à Alexandre ? Si nous ajoutions le serpent que Maxime de Tyr prétend avoir été montré par Taxile au même conquérant, et qui avait cinq cents pieds de long, nous arriverions dans les traditions de l’Orient, presque au même degré d’extension où nous avons vu les traditions Scandinaves, qui donnent six cents pieds à leur serpent de mer. Mais on peut juger par ces rapprochements que l’existence de cet animal, bien qu’entourée souvent de traits suspects, est loin d’être nouvelle ; qu’elle a été observée de bien des manières et depuis bien longtemps. Ce n’est pas, comme on le disait, un danger de plus pour les navigateurs ; car ce terrible monstre est déjà indiqué dans la Bible sous le nom de Léviathan, que l’Écriture applique à diverses bêtes énormes, ainsi que le remarque Bochart. Le prophète Isaïe l’applique ainsi : Léviathan, ce serpent immense ; Léviathan, serpent à divers plis et replis[9].
» Dans ce siècle, la présence du serpent de mer a été signalée en 1808, en 1815, en 1817 et en 1837. Il n’est pas présumable qu’on le rencontre plus fréquemment à l’avenir que par le passé ; du moins l’attention publique, appelée sur ce phénomène par les organes de la presse, portera à la publicité des faits du même genre qui pourraient survenir encore, et qui sans cela auraient passé inaperçus. L’auteur anglais qui le premier a publié ceux qu’il avait recueillis, et à qui nous devons toutes nos citations des témoignages modernes, fait aussi connaître le moyen que les pêcheurs norvégiens emploient pour se garantir du serpent de mer. Lorsqu’ils l’aperçoivent tout près d’eux, ils évitent surtout les vides que laisse sur l’eau l’alternative de ses plis et replis. Si le soleil brille, ils rament dans la direction de cet astre qui éblouit le serpent. Mais lorsqu’ils l’aperçoivent à distance, ils font toujours force de rames pour l’éviter. S’ils ne peuvent espérer d’y parvenir, ils se dirigent droit sur sa tête, après avoir arrosé le pont d’essence de musc. On a observé l’antipathie de cet animal pour ce parfum violent ; aussi les pêcheurs norvégiens en son t toujours pourvus quand ils se mettent en mer pendant les mois calmes et chauds de l’été. Dans la rencontre faite en 1837, les personnes qui étaient à bord du Havre ont aperçu seulement les ondulations du corps de l’immense reptile, et ont évalué approximativement sa longueur à plusieurs fois celle du navire. »
Sérug, esprit malin. Voy. Chassen.
Servants, lutins familiers dans les Alpes. Ils bêchent et entretiennent le jardin si on a pour eux des égards, ils le bouleversent si on les irrite. On les apaise en leur jetant de la main gauche une cuillerée de lait sous la table.

Servius-Tullius. Leloyer et d’autres prétendent que le roi de Rome Servius était fils d’un démon. Les cabalistes soutiennent de leur côté qu’il fut fils d’un salamandre.
Sethiens ou Sethites, hérétiques du deuxième siècle qui honoraient particulièrement le patriarche Seth, fils d’Adam. Ils disaient que deux anges avaient créé Caïn et Abel et débitaient beaucoup d’autres rêveries. Selon ces hérétiques, Jésus-Christ n’était autre que Seth, venu au monde une seconde fois. Ils forgèrent des livres sous le nom de Seth et des autres patriarches.
Séthus. Il y avait à la suite de l’empereur Manuel un magicien, nommé Séthus, qui rendit une fille éprise de lui par le moyen d’une pêche qu’il lui donna, à ce que conte Nicétas.
Sévère (Septime). Des historiens rapportent qu’à la sortie d’Antioche l’ombre de l’empereur Sévère apparut à Caracalla, et lui dit pendant son sommeil : « Je te tuerai comme tu as tué ton frère. »
Sexe. On prétend aussi reconnaître d’avance, à certains symptômes, le sexe d’un enfant qui n’est pas né. Si la mère est gaie dans sa grossesse, elle aura un garçon ; si elle est pesante du côté droit, elle aura un garçon. Si elle se sent lourde du côté gauche, elle aura une fille. Si elle est pâle et pensive, elle aura une fille. Albert le Grand donne à entendre qu’il naît des garçons dans un ménage où l’on mange du lièvre, et des filles dans une maison où l’on fait cas de la fressure de porc. Voici autre chose : Ems possède deux sources, la Bubenquelle et la Maegdenquelle, qui, selon les gens du pays, ont une vertu merveilleuse : en buvant de la première, on est sûr d’avoir des garçons, et en buvant de l’autre, d’avoir des filles. Croyez cela et buvez… du johannisberg ou du champagne[10].
Shamavedam, l’un des quatre livres sacrés des Indiens. C’est celui qui contient la science des augures et des divinations.
Shelo. Voy. Southcote.
Shoupeltins. Les habitants des îles Schetland appelaient ainsi des tritons ou hommes marins, dont les anciennes traditions et la superstition populaire ont peuplé les mers du Nord.
Sibylles. Les sibylles étaient chez les anciens des femmes enthousiastes qui ont laissé une

1° La sibylle de Perse. Elle se nommait Sam-bethe ; on la dit bru de Noé dans des vers sibyllins apocryphes.
2° La sibylle libyenne. Elle voyagea à Samos, à Delphes, à Claros et dans plusieurs autres pays. On lui attribue des vers contre l’idolâtrie : elle reproche aux hommes la sottise qu’ils font de placer leur espoir de salut dans un dieu de pierre ou d’airain, et d’adorer les ouvrages de leurs mains.
3° La sibylle de Delphes. Elle était fille du devin Tirésias. Après la seconde prise de Thèbes, elle fut consacrée au temple de Delphes par les Épigones, descendants des guerriers qui avaient pris Thèbes la première fois. Ce fut elle, selon Diodore, qui porta la première le nom de sibylle. Elle a célébré dans ses vers la grandeur divine ; et des savants prétendent qu’Homère a tiré parti de quelques-unes de ses pensées.
4° La sibylle d’Érythrée. Elle a prédit la guerre de Troie, dans le temps où les Grecs s’embarquaient pour cette expédition. Elle a prévu aussi qu’Homère chanterait cette guerre longue et cruelle. Si l’on en croit Eusèbe et saint Augustin, elle connaissait les livres de Moïse ; elle a parlé en effet de l’attente de Jésus-Christ. On lui attribue même des vers dont les premières lettres expriment, par acrostiche, Jésus-Christ, fils de Dieu. On l’a quelquefois représentée avec un petit Jésus et deux anges à ses pieds.
5° La sibylle cimmérienne a parlé de la sainte Vierge plus clairement encore que celle d’Érythrée, puisque, selon Suidas, elle la nomme par son propre nom.
6° La sibylle de Samos a prédit que les Juifs crucifieraient un juste qui serait le vrai Dieu.
7° La sibylle de Cumes, la plus célèbre de toutes, faisait sa résidence ordinaire à Cumes, en Italie. On l’appelait Déiphobe ; elle était fille de Glaucus et prêtresse d’Apollon. Elle rendait ses oracles au fond d’un antre qui avait cent portes, d’où sortaient autant de voix qui faisaient entendre ses réponses. Ce fut elle qui offrit à Tarquin le Superbe un recueil de vers sibyllins, dont on sait qu’il ne reçut que la quatrième partie : ces vers furent soigneusement conservés dans les archives de l’empire, au Capitole. Cet édifice ayant été brûlé du temps de Sylla, Auguste fit ramasser tout ce qu’il put de fragments détachés des vers sibyllins et les fit mettre dans des coffres d’or au pied de la statue d’Apollon Palatin[11], où l’on allait les consulter. Petit, dans son traité De sibylla, prétend qu’il n’y a jamais eu qu’une sibylle, celle de Cumes, dont on a partagé les actions et les voyages. Ce qui a donné lieu, selon lui, à cette multiplicité, c’est que cette fille mystérieuse a prophétisé en divers pays, mais c’est là une idée de savant à système.
8° La sibylle hellespontine. Elle naquit à Marpèse, dans la Troade : elle prophétisa du temps de Solon et de Crésus. On lui attribue aussi des prophéties sur la naissance de Notre-Seigneur.
9° La sibylle phrygienne. Elle rendait ses oracles à Ancyre, en Galatie. Elle a prédit l’annonciation et la naissance du Sauveur.
10° La sibylle tiburtine ou Albunée, qui fut honorée à Tibur comme une femme divine. Elle prédit que Jésus-Christ naîtrait d’une vierge à Bethléem et régnerait sur le monde.
11° La sibylle d’Épire. Elle a aussi prédit la naissance du Sauveur.
12° La sibylle égyptienne, a chanté également les mystères de la Passion et la trahison de Judas. Saint Jérôme pense que les sibylles avaient reçu du ciel le don de lire dans l’avenir en récompense de leur chasteté. Mais il paraît que les huit livres sibyllins que nous avons aujourd’hui sont en effet douteux. Bergier, dans son savant Dictionnaire de théologie, les croit supposés et les attribue dans ce cas aux gnostiques du deuxième siècle.
Sibylles modernes. Il y a eu succession, peu connue à la vérité, dans les sibylles. Pierre Crespet, dans ses deux livres De la haine des démons pour les hommes, en cite quelques faits. La grotte de Nursie, au pays de Naples, s’appelle encore la grotte de la Sibylle, et une sibylle y florissait dans le moyen âge et dans les premiers temps de la réforme. Dominique Mirabelli, dont nous ignorons l’origine, arrêté pour magie, car il portait avec lui des livres de magie, confessa, dans son interrogatoire, qu’il avait visité la sibylle de Nursie, avec quelques compagnons ; que Scot, l’un d’eux, avait reçu d’elle un livre mystérieux, avec un démon renfermé dans un anneau ; qu’il avait fait alors des choses prodigieuses devant plusieurs princes ; qu’à l’aide du livre et de l’anneau il pouvait se transporter où il voulait, toutes les fois qu’il n’avait pas les vents contraires. Il ajouta que l’autorité religieuse avait établi des surveillants à la porte de la grotte ; mais que ceux qui étaient initiés à la magie y entraient en se rendant invisibles. Il dépeignait la sibylle : « Sa taille était petite ; elle était assise sur un siège peu élevé, et ses cheveux flottaient jusqu’à terre. » Pendant que le visiteur s’entretenait avec elle, les éclairs et le tonnerre désolaient les environs de la grotte. Mirabelli, son ami Scot et ses autres compagnons furent emmenés à Paris. Nous ne savons pas ce qu’il advint d’eux. Mais ces faits ont du avoir lieu aux temps où les Français avaient le pouvoir à Naples.
Enfin nous avons eu dans mademoiselle Le-normand, dans mademoiselle Ledoux et dans d’autres femmes, des sibylles contemporaines. Il y en a une que nous ne nommons pas, car elle vit peut-être encore, en retraite sans doute ; elle faisait des horoscopes longuement écrits, et les débitait à bon marché en 1829.

Sicidites. Leloyer conte que ce magicien, appuyé sur les fenêtres de l’empereur Manuel Gomnène, avec les courtisans, regardait le port de Constantinople. Il arriva une petite chaloupe chargée de pots de terre. Sicidites offrit à ceux qui l’entouraient de leur faire voir le potier cassant ses pots ; ce qu’il effectua à l’instant au grand divertissement des courtisans qui se pâmaient de rire ; mais ce rire se changea en compassion quand ils aperçurent ce pauvre homme qui se lamentait, en s’arrachant la barbe, à la vue de tous ses pots cassés. Et comme on lui demandait pourquoi il les avait brisés de la sorte, il répondit qu’il avait vu un serpent à crête rouge et étincelante, entortillé autour de ses pots, qui le regardait la gueule ouverte et la tête levée comme s’il eût voulu les dévorer, et qu’il n’avait disparu qu’après tous les pots cassés. Un autre jour, pour se venger de quelques gens qui l’insultaient dans un bain, Sicidites se retira dans une chambre prochaine pour reprendre ses habits. Dès qu’il fut sorti, tous ceux qui étaient dans le bain détalèrent avec précipilation, parce que du fond de la cuve du bain il sortit des hommes noirs qui les chassaient à coups de pied.
Sidéromancie, divination qui se pratiquait avec un fer rouge, sur lequel on plaçait avec art un certain nombre de petites paillettes qu’on brûlait et qui jetaient des reflets comme les étoiles.
Sidragasum, démon qui a le pouvoir de faire danser les femmes mondaines.
Siffler le vent. « Cette coutume de siffler pour appeler le vent est une de nos superstitions nautiques, qui, malgré son absurdité, s’empare insensiblement, aux heures de calme, des esprits les plus forts et les plus incrédules ; autant vaudrait raisonner avec la brise capricieuse elle-même que d’essayer de convaincre le matelot anglais que, le vent soufflant où il lui plaît et quand il lui plaît, il ne sert à rien de l’invoquer. En dépit de la marche des intelligences, lorsque l’air manque à la voile, toujours le matelot sifflera[12]. »
Sifflet magique. La ville d’Hameln, en 1284, fut délivrée des rats qui l’infestaient en nombre immense par un magicien, lequel les attirait au son de sa flûte et les entraîna dans le Wéser, où ils se noyèrent. Mais les magistrats de la cité, ayant refusé de payer le prix convenu pour ce service, le même magicien, sifflant un autre air, entraîna tous les enfants d’Hameln, que leur parents ne revirent plus. Cet événement est constaté par plusieurs monuments très-graves[13].
Sigéani, esprit qui, dans le royaume d’Ava, préside à l’ordre des éléments et lance la foudre et les éclairs.
Signe de croix. Un Juif qui se rendait à Fondi, dans le royaume de Naples, fut surpris par la nuit et ne trouva pas d’autre gîte qu’un temple d’idoles, où il se décida, faute de mieux, à attendre le matin. Il s’accommoda comme il put dans un coin, s’enveloppa dans son manteau et se disposa à dormir. Au moment où il allait fermer l’œil, il vit plusieurs démons tomber de la voûte dans le temple et se disposer en cercle autour d’un autel. Le roi de l’enfer descendit aussi, se plaça sur un trône et ordonna à tous les diables subalternes de lui rendre compte de leur conduite. Chacun fit valoir les services qu’il avait rendus à la chose publique ; chacun fit l’exposé de ses bonnes actions. Le Juif, qui ne jugeait pas comme le prince des démons et qui trouvait leurs bonnes actions un peu mauvaises, fut si effrayé de la mine des démons et de leurs discours qu’il se hâta de dire les prières et de faire les cérémonies que la synagogue met en usage pour chasser les esprits malins. Mais inutilement : les démons ne s’aperçurent pas qu’ils étaient vus par un homme. Ne sachant plus à quoi recourir, le juif s’avisa d’employer le signe de la croix. On lui avait dit que ce signe était formidable aux démons ; il en eut la preuve, dit le légendaire, car les démons cessèrent de parler, aussitôt qu’il commença de se signer. Après avoir regardé autour de lui, le roi de l’enfer aperçut l’enfant d’Israël.
— Allez voir qui est là, dit-il à un de ses gens. Le démon obéit ; lorsqu’il eut examiné le voyageur, il retourna vers son maître. — C’est un vase de réprobation, dit-il ; mais il vient de s’appuyer du signe de la croix.
Sortons, reprit le diable. Nous ne pourrons bientôt plus être tranquilles dans nos temples. — En disant ces paroles, le prince des démons s’envola ; tous ses gens disparurent et le Juif se fit chrétien.
Silènes. On donnait ce nom aux satyres lorsqu’ils étaient vieux. On entendait aussi quelquefois par sylènes des génies familiers tels que celui dont Socrate se vantait d’être accompagné.
Simagorad. Grimoire. Voy. Charles vi.
Simle, partie du paradis Scandinave, d’un agrément assez médiocre.
Simon le magicien. Ce Simon, connu pour avoir voulu acheter aux apôtres le don de faire des miracles et pour avoir donné son nom maudit à la simonie, n’ayant pu traiter avec les saints, traita avec les démons. Il en avait un à sa porte sous la forme d’un gros dogue, et dès lors il fit des miracles ou plutôt des prestiges. Il disait que si on lui coupait la tête, il ressusciterait trois jours après. L’empereur le fit décapiter ; par ses artifices, il supposa la tête d’un mouton à la place de la sienne et se remontra le troisième jour. Il commandait à une faux de faucher d’elle-même, et elle faisait autant d’ouvrage que le plus habile faucheur. Sous le règne de l’empereur Néron, il parut un jour en l’air comme un oiseau. Mais saint Pierre, plus puissant que lui, le fit tomber, et il se cassa les jambes. Cet imposteur eut des disciples ; et on le croit le premier chef des gnostiques. Il attribuait la création aux Éons ou esprits ; il affirmait que les plus parfaits des divins Éons résidaient dans sa personne ; qu’un autre Éon, très-distingué, quoique du sexe féminin, habitait dans sa maîtresse Sélène, dont il contait des choses prodigieuses ; que lui, Simon, était envoyé de Dieu sur la terre pour détruire l’empire des esprits qui ont créé le monde matériel, et surtout pour délivrer Sélène de leur puissance. Il est certain que Simon, après sa mort, fut honoré comme un dieu par les Romains, et qu’il eut une statue[14].
Simon de Pharès, auteur d’un recueil d’histoires de quelques célèbres astrologues et hommes doctes, qu’il dédia au roi Charles VIII. Il ne paraît pas que ce livre ait été imprimé[15].
Simonide. Un jour qu’il soupait chez un de ses amis, on vint l’avertir que deux jeunes gens étaient à la porte, qui voulaient lui parler d’une importante affaire. Il sort aussitôt, ne trouve personne ; et, dans l’instant qu’il veut rentrer à la maison, elle s’écroule et écrase les convives sous ses ruines. Il dut son salut à un hasard si singulier, qu’on le regarda, parmi le peuple, comme un trait de bienveillance de Castor et Pollux, qu’il avait chantés dans un de ses poèmes.
Simorgue, oiseau fabuleux que les. Arabes nomment Anka, les rabbins Jukhneh, et que les Perses disent habiter dans les montagnes de Kaf. Il est si grand qu’il consomme pour sa subsistance tout ce qui croît sur plusieurs montagnes. Il parle ; il a de la raison ; en un mot, c’est une fée qui a la figure d’un oiseau immense. Étant un jour interrogée sur son âge, la Simorgue répondit :
— Ce monde s’est trouvé sept fois rempli de créatures, et sept fois entièrement vide d’animaux. Le cycle d’Adam, dans lequel nous sommes, doit durer sept mille ans, qui font un grand cycle d’années : j’ai déjà vu douze de ces cycles, sans que je sache combien il m’en reste à voir. — La Simorgue joue un grand rôle dans les légendes de Salomon.
Singes. Ces animaux étaient vénérés en Égypte.

Sirath. C’est le nom que donnent les musulmans au pont que les âmes passent après leur mort, et au-dessous duquel est un feu* éternel. Il est aussi mince que le tranchant d’un sabre ; les justes doivent le franchir avec la rapidité de l’éclair, pour entrer dans le paradis.
Sirchade, démon qui a tout pouvoir sur les animaux.
Sistre, plante qui, selon Aristote, se trouvait dans le Scamandre, ressemblait au pois chiche et avait la vertu de mettre à l’abri de la crainte des spectres et des fantômes ceux qui la tenaient à la main.
Sittim, démon indien, qui habite les bois sous la forme humaine.
Skalda. Voy. Nornes.
Skinkraftigans, conjurateurs qui, chez les Anglo-Saxons, opposaient aux chrétiens de faux miracles par des moyens magiques.
Smaël, le même que Samaël.
Smyrne. On dit qu’antérieurement aux temps historiques, une amazone fonda la ville de Smyrne et lui donna son nom, qu’elle n’a jamais perdu.
Socrate. Les anciens, qui trouvaient les grandes qualités surhumaines, ne les croyaient pas étrangères à l’essence des démons. Il est vrai que les démons chez eux n’étaient pas pris tous en mauvaise part. Aussi disaient-ils que Socrate avait un démon familier ; et Proclus soutient qu’il lui dut toute sa sagesse[16]. Peut-être les hommes trouvaient-ils leur compte à cet arrangement. Ils se consolaient d’être moins vertueux que Socrate en songeant qu’ils n’avaient pas un appui comme le sien.
Soleil. Voy. Danse du soleil.
Solèves, esprits de la montagne, légers comme des sylphes, dans les Alpes.
Soliman. C’est le nom de Salomon chez les musulmans. Ils entendent par ce nom quelque chose de très-grand ; et ils assurent qu’il y a eu quarante solimans ou monarques universels de la terre, qui ont régné successivement pendant le cours d’un très-grand nombre de siècles avant la création d’Adam. Tous ces monarques prétendus commandaient chacun à des créatures de leur espèce, différentes de l’espèce humaine actuelle, quoique raisonnables comme les hommes ; ce sont les génies.
Sommeil. Van der Viel rapporte qu’en 1684 un potier de terre de Londres dormit quinze jours de suite sans avoir été affaibli par le défaut de nourriture ; il lui semblait n’avoir dormi qu’un jour. Épiménide, philosophe de Crète, étant entré dans une caverne, y dormit, selon Diogène Laërce, cinquante-sept ans ; selon Plutarque cinquante, selon d’autres vingt-sept. On prétend qu’au sortir de là il ne reconnaissait plus personne. Voy. Dormants.
Somnambules. Des gens d’une imagination vive, d’un sang trop bouillant, font souvent en dormant ce que les plus hardis n’osent entreprendre éveillés. Bardai parle d’un professeur qui répétait la nuit les leçons qu’il avait données le jour, et qui grondait si haut qu’il réveillait tous ses voisins. Johnston rapporte, dans sa Thaumatographia naturalis, qu’un jeune homme sortait toutes les nuits de son lit, vêtu seulement de sa chemise ; puis montant sur la fenêtre de sa chambre, il sautait à cheval sur le mur et le talonnait pour accélérer la course qu’il croyait faire. Un autre descendit dans un puits et s’éveilla aussitôt que son pied eut touché l’eau, qui était très-froide. Un autre monta sur une tour, enleva un nid d’oiseaux et se glissa à terre par une corde, sans s’éveiller. Un Parisien, de même endormi, se leva, prit son épée, traversa la Seine à la nage, tua un homme que, la veille, il s’était proposé d’assassiner ; et, après qu’il eut consommé son crime, il repassa la rivière, retourna à sa maison et se mit au lit sans s’éveiller.
Le Courrier de la Gironde rapportait, il y a quelques années, le petit fait suivant :
Il existe dans une commune près de Bordeaux une famille citée de père en fils comme somnambule. Le chef actuel de la famille vient de donner la preuve qu’il n’avait pas dégénéré. Après la veillée, il était allé se reposer des fatigues de la journée ; sa femme et ses enfants l’avaient bientôt imité. À minuit, le laboureur ouvre l’œil, bâille, étend les bras comme un homme qui secoue le sommeil et descend de sa couche. Il passe son pantalon et sa veste de travail, noue sa cravate de coton autour de son cou, chausse ses sabots, tire la chevillette de sa porte, et sort. Notre laboureur va droit à son étable, saisit l’aiguillon, et, un juron aidant, il réveille ses bœufs pour le travail. Ces bons animaux, tout animaux qu’ils sont, comprennent que l’heure d’aller aux champs n’est pas encore venue, font la sourde oreille, se roulent un instant encore sur la litière, puis enfin se décident à se lever. Les voilà partis pour la vigne, traînant le soc au clair de la lune. Le laboureur suit par derrière, la gourde à la main et l’aiguillon sur l’épaule. On arrive aux champs, les instruments de travail sont disposés ; la charrue est emmanchée, et voilà la glèbe qui se retourne et le sillon qui se creuse droit et profond. Il était six heures environ, et le jour commençait à poindre quand la besogne fut achevée. Le laboureur tourna la rége, attacha le cordon de sa gourde vide au bouton de son gilet, remit l’aiguillon sur l’épaule et ramena ses bœufs à l’écurie.
Il était temps qu’il arrivât, car la maison était dans un désordre indescriptible. La femme se lamentait et les enfants couraient le village, cherchant les bœufs et la charrue qui avaient disparu pendant la nuit. Tout le quartier était soulevé. Cette scène de désolation se changea soudain en un immense éclat de rire, quand on vit entrer dans la cour les grands bœufs roux, suant et fumant comme s’ils sortaient d’un bain à la vapeur, et précédés du laboureur nocturne, lequel, secouant enfin le sommeil magnétique, s’aperçut à sa grande surprise qu’il avait gagné sa journée quand les autres l’avaient à peine commencée.
On peut expliquer le somnambulisme comme une activité partielle de la vie animale, disent les philosophes. L’organe actif transmet ainsi l’incitation sur les organes voisins, et ceux-ci commencent également, par l’effet de leurs relations avec la représentation qui a été excitée, à devenir actifs et à coopérer. Par là l’idée de l’action représentée devient si animée que, même les instruments corporels nécessaires pour son opération, sont mis en activité par les nerfs qui agissent sur eux. Le somnambule commence même à agir corporellement, et remplit l’objet qu’il s’est proposé avec la même exactitude que s’il était éveillé, avec cette différence néanmoins qu’il n’en a pas le sentiment général, parce que les autres organes de la vie animale qui n’ont pas participé à l’activité reposent, et que, par conséquent, le sentiment n’y a pas été réveillé. Gall a connu un prédicateur somnambule qui, très-souvent, ayant un sermon à faire, se levait la nuit en dormant, écrivait son texte ou en faisait la division, en travaillait des morceaux entiers, rayait ou corrigeait quelques passages, en un mot, qui se conduisait comme s’il eût été éveillé, et qui cependant en s’éveillant n’avait aucun sentiment de ce qu’il venait de faire. La Fontaine a composé, dit-on, sa fable des deux Pigeons en dormant ; anecdote contestée.
Suivant le rapport de Fritsh, qui le tenait du père Delrio, un maître d’école, nommé Gondisalve, allait enseigner pendant la journée le catéchisme à des enfants et venait coucher le soir dans un monastère, où la nuit, en dormant, il recommençait ses leçons, reprenait les enfants et entonnait le chant de son école. Un moine, dans la chambre duquel il couchait, le menaça de l’étriller s’il ne restait pas tranquille. Le maître d’école se coucha sur cette menace et s’endormit. Dans la nuit, il se lève, prend de grands ciseaux et va au lit du moine, qui par bonheur, étant éveillé, le vit venir à la faveur du clair de lune ; sur quoi il prit le parti de se glisser hors du lit et de se cacher dans la ruelle. Le maître d’école, arrivé au lit, hache le traversin de coups de ciseaux et va se recoucher. Le lendemain, quand on lui présenta le traversin en lambeaux, il dit que tout ce qu’il se rappelait c’était que, le moine l’ayant voulu rosser, il s’était défendu avec des ciseaux.
Il y a un grand nombre d’histoires de somnambules. Le remords a souvent produit cette crise, et, depuis la femme de Macbeth, la série des coupables qui se sont trahis dans leur sommeil serait longue.
Somnambulisme magnétique. Nous devons parler aussi de celui-là. Une personne magnétisée s’endort profondément et parle aussitôt pour révéler les choses secrètes et lire dans les cœurs, par un prodige jusqu’ici inexplicable. Le fait dans tous les cas est constant. Nous ne l’apprécierons ni ne le jugerons, nous contentant de citer des passages curieux de divers observateurs sur un sujet si mystérieux. Voici d’abord un article digne d’attention, publié, il y a une trentaine d’années, par la Revue britannique et répété dans plusieurs journaux ; il contredit les dénégations systématiques de certaines académies. Nous mentionnerons après cela le jugement de la cour de Rome sur certains usages du somnambulisme, que dans sa profonde sagesse elle ne condamne pas en fait, mais dont elle réprouve les abus et les procédés au moins dangereux.
« A différentes époques, dit l’auteur anglais, le magnétisme a donné lieu à des discussions si vives et si animées, que des deux côtés on arriva promptement aux extrêmes ; c’est presque dire à l’erreur. Les partisans du magnétisme prétendirent que l’homme possède, dans cet état, des facultés jusqu’alors inconnues. Pour quelques-uns d’entre eux, l’espace disparaissait devant les prodiges de leurs sujets magnétisés ; il n’en coûtait que le simple effort de la volonté pour la nature des choses les plus différentes, pour métamorphoser une tonne d’eau de la Tamise en vin de Champagne, ou pour répandre sur une population affamée les bienfaits d’une nourriture agréable et abondante. Pour eux, les sciences les plus problématiques, celles qui exigent les études les plus profondes et les plus sévères, s’apprennent en quelques instants. La femme nerveuse, qu’une pensée sérieuse de quelques minutes fatigue, devient, entre les mains des habiles du parti, plus savante et plus heureuse dans ses prescriptions qu’aucun de nos praticiens les plus expérimentés.
» De leur côté, les antagonistes du magnétisme ne veulent admettre aucun phénomène insolite, aucune exception aux règles ordinaires de la nature : pour eux, tout l’échafaudage du magnétisme ne repose que sur l’erreur des sens de quelques personnes et sur la fourberie de quelques autres. Le fait suivant, exemple remarquable de somnambulisme naturel, ne permet pas de douter que, dans cet état, l’homme ne possède quelquefois des facultés qui sont à peine appréciables dans l’état de veille. Au reste, ces phénomènes, quoique très-curieux, n’ont rien de surnaturel ; et il est facile d’expliquer ce qu’ils ont de surprenant par la concentration de toutes les forces de l’intelligence sur un seul objet et par l’exercice de quelques sens dans des circonstances particulières. Les faits rapportés dans la brochure américaine dont nous allons donner l’analyse, et sur la véracité desquels aucun praticien des États-Unis n’a élevé de doute v présentent un haut degré d’intérêt, surtout si on les rapproche de ceux du même genre qui ont été offerts par l’infortuné Gaspard Hauser, quoique dans des circonstances différentes.
» Jeanne Rider, âgée de dix-sept ans, est fille de Vermont, artisan. Son éducation a été supérieure à celle que reçoivent ordinairement les personnes des classes moyennes de la société. Elle aime beaucoup la lecture et fait surtout ses délices de celle des poètes. Bien que son extérieur annonce une bonne santé, cependant elle a toujours été sujette à de fréquents maux de tête ; il lui est arrivé plusieurs fois de se lever du lit au milieu de son sommeil ; mais il n’y avait rien là qui ressemblât aux phénomènes remarquables que depuis elle a éprouvés.
» Cette singulière affection a débuté chez elle subitement. D’abord ses parents firent tous leurs efforts pour l’empêcher de se lever ; les secours de l’art furent même invoqués sans un grand succès, car au bout d’un mois elle fut prise d’un nouveau paroxysme, pendant lequel on résolut de ne la soumettre à aucune contrainte et de se contenter d’observer ses mouvements. Aussitôt qu’elle se sentit libre, elle s’habilla, descendit et fit tous les préparatifs du déjeuner. Elle mit la table, disposa avec la plus grande exactitude les divers objets dont elle devait être couverte, entra dans une chambre obscure, et de là dans un petit cabinet encore plus reculé, où elle prit les tasses à café, les plaça sur un plateau qu’elle déposa sur la table, après beaucoup de précautions pour ne pas le heurter en l’apportant. Elle alla ensuite dans la laiterie, dont les contrevents étaient fermés, et poussa la porte derrière elle ; après avoir écrémé le lait, elle versa la crème dans une coupe et le lait dans une autre sans en épancher une seule goutte. Elle coupa ensuite le pain, qu’elle plaça sur la table ; enfin, quoique les yeux fermés, elle fit tous les préparatifs du déjeuner avec la même précision qu’elle eût pu y mettre en plein jour. Pendant tout ce temps, elle sembla ne faire aucune attention à ceux qui l’entouraient, à moins qu’ils ne se missent sur sa route ou qu’ils ne plaçassent des chaises ou d’autres obstacles devant elle ; alors elle les évitait, mais en témoignant un léger sentiment d’impatience.
» Enfin, elle retourna d’elle-même au lit ; et lorsque le lendemain, en se levant, elle trouva la table toute préparée pour le déjeuner, elle demanda pourquoi on l’avait laissée dormir pendant qu’une autre avait fait son travail. Aucune des actions de la nuit précédente n’avait laissé la plus légère impression dans son esprit. Un sentiment de fatigue fut le seul indice qu’elle reconnut à l’appui de ce qu’on lui rapportait.
» Les paroxysmes devinrent de plus en plus fréquents ; la malade ne passait pas de semaine sans en éprouver deux ou trois, mais avec des circonstances très-variées. Quelquefois elle ne sortait pas de sa chambre, et s’amusait à examiner ses robes et les autres effets d’habillement renfermés dans sa malle. Il lui arrivait aussi de placer divers objets dans des endroits où elle n’allait plus les chercher éveillée, mais dont le souvenir lui revenait pendant le paroxysme. Ainsi, elle avait tellement caché son étui qu’elle ne put le trouver pendant le jour, et l’on fut étonné de la voir la nuit suivante occupée avec une aiguille qu’elle avait dû certainement y prendre. Non-seulement elle cousait dans l’obscurité, mais encore elle enfilait son aiguille les yeux fermés. Les idées de Jeanne Rider relatives au temps étaient ordinairement inexactes ; constamment elle supposait qu’il était jour. Aussi, quand on lui répétait qu’il était temps d’aller se coucher : — Quoi ! disait-elle, aller au lit en plein jour ! Voyant une fois une lampe brûler dans l’appartement où elle était occupée à préparer le dîner, elle l’éteignit en disant qu’elle ne concevait pas pourquoi on voulait avoir une lampe pendant la journée. Elle avait le plus souvent les yeux fermés ; quelquefois cependant elle les tenait grands ouverts, et alors la pupille offrait une dilatation considérable. Au reste, que l’œil fût ouvert ou fermé, il n’en résultait aucune différence dans la force de la vue. On lui présentait des écritures très-fines, des monnaies presque effacées ; elle les lisait très-facilement dans l’obscurité et les yeux fermés.
» Si les idées de la somnambule, par rapport au temps, étaient ordinairement erronées, il n’en était pas de même de celles qui étaient relatives aux lieux ; tous ses mouvements étaient toujours réglés par ses sens, dont les rapports étaient le plus souvent exacts, et non par des notions préconçues. Sa chambre était contiguë à une allée à l’extrémité de laquelle se trouvait l’escalier. Au haut de ce dernier était une porte qu’on laissait ordinairement ouverte, mais que l’on ferma un jour avec intention après qu’elle fut couchée, et que l’on assura en plaçant la lame d’un couteau au-dessus du loquet. À peine levée, dans son accès de somnambulisme, elle sort avec rapidité de sa chambre, et, sans s’arrêter, elle tend la main d’avance pour enlever le couteau, qu’elle jette avec indignation en demandant pourquoi on veut l’enfermer.
» On fit diverses tentatives pour l’éveiller, mais elles furent toutes également infructueuses ; elle entendait, sentait et voyait tout ce qui se passait autour d’elle ; mais les impressions qu’elle recevait par les sens étaient insuffisantes pour la tirer de cet état. Un jour qu’on jeta sur elle un sceau d’eau froide, elle s’écria : — Pourquoi voulez-vous me noyer ? Elle alla aussitôt dans sa chambre changer de vêtement et redescendit de nouveau. On lui donnait quelquefois de fortes doses de laudanum pour diminuer la douleur de tête dont elle se plaignait habituellement, et alors elle ne tardait pas à s’éveiller. Les excitations de toute espèce, et surtout les expériences que l’on faisait pour constater les phénomènes du somnambulisme, prolongeaient invariablement les accès, et aggravaient habituellement sa douleur de tête.
» Les paroxysmes du somnambulisme étaient précédés tantôt d’un sentiment désagréable de pesanteur à la tête, tantôt d’une véritable douleur, d’un tintement dans les oreilles, d’un sentiment de froid aux extrémités et d’une propension irrésistible à l’assoupissement. Ces paroxysmes, au commencement, ne venaient que la nuit et quelques instants seulement après qu’elle s’était mise au lit ; mais à mesure que la maladie fit des progrès, ils commencèrent plus tôt. À une époque plus avancée, les attaques la prirent à toute heure de la journée, et quelquefois elle en eut jusqu’à deux dans le même jour. Lorsqu’elle en pressentait l’approche, elle pouvait les retarder de quelques heures en prenant un exercice violent. Le grand air surtout était le meilleur moyen qu’elle pût employer pour obtenir ce répit ; mais aussitôt qu’elle se relâchait de cette précaution, ou même quelquefois au milieu de l’occupation la plus active, elle éprouvait une sensation qu’elle comparait à quelque chose qui lui aurait monté vers la tête, et perdait aussitôt le mouvement et la parole. Si alors on la transportait immédiatement en plein air, l’attaque était souvent arrêtée ; mais si l’on attendait trop longtemps, on ne pouvait plus se mettre en rapport avec elle, et il était tout à fait impossible de la tirer de cet état. On aurait cru qu’elle venait de s’endormir tranquillement ; ses yeux étaient fermés, la respiration était longue et bruyante, et son attitude, ainsi que les mouvements de sa tête, ressemblaient à ceux d’une personne plongée dans un profond sommeil.
» Pendant les accès qui avaient lieu durant le jour, elle prit toujours le soin de se couvrir les yeux avec un mouchoir, et ne permettait jamais qu’on l’enlevât, à moins que la pièce où elle se trouvait ne fût très-obscure, et cependant elle lisait à travers ce bandeau des pages entières, distinguait l’heure de la montre ; elle jouissait enfin d’une vision aussi parfaite que si elle eût eu les yeux libres et ouverts. Dans quelques expériences qui furent faites par le docteur Beiden, on appliqua sur ses yeux un double mouchoir, et l’on garnit le vide qu’il laissait de chaque côté du nez avec de la ouate. Toutes ces précautions ne diminuèrent en rien la force de sa vue ; mais un fait important, bien qu’il n’explique pas ce phénomène curieux, c’est que, de tout temps, elle a eu les yeux si sensibles à la lumière qu’elle n’a pu jamais s’exposer au grand jour sans son voile. Cette sensibilité était encore bien plus vive pendant le somnambulisme, comme le docteur Beiden le constata.
» Cependant toutes ces expériences fatiguaient considérablement la pauvre fille, dont l’état, au lieu de s’améliorer, allait au contraire en empirant. Cette circonstance et l’insuccès de tous les moyens employés jusqu’alors firent prendre la résolution de l’envoyer à l’hôpital de Worcester, où elle entra le 5 décembre 1833. Les accès s’y répétèrent avec la même fréquence et la même intensité ; mais on remarqua bientôt des changements importants dans les paroxysmes. D’abord la malade commença à rester les yeux ouverts, disant qu’elle n’y voyait pas clair lorsqu’ils étaient fermés ; ensuite les accès se dessinèrent moins bien. Elle conservait dans le somnambulisme quelque souvenir de ce qui lui était arrivé dans l’état de veille, et on avait de la peine à distinguer le moment exact où finissait l’accès de celui où elle était éveillée. Peu à peu, ces accès eux-mêmes se sont éloignés, et, d’après le dernier rapport du docteur Woodward, médecin de l’hôpital de Worcester, on avait tout lieu d’espérer une guérison complète. »
On rapporte un fait de magnétisme tout récent et qui semblera extraordinaire. « M. Ferrand, marchand quincaillier à Antibes, ayant trouvé dernièrement, dans sa propriété, une pièce de monnaie en argent frappée du temps des Romains, l’envoya à ses correspondants de Paris, MM. Deneux et Gronnet aîné, 18, rue du Grand-Chantier, en les priant d’aller avec cette pièce chez le magnétiseur Marcillet, pour consulter Alexis à ce sujet. Ce dernier, dans l’état de somnambulisme, leur dit qu’il voyait chez M. Ferrand, à Antibes, une petite urne enfouie à quelques pieds en terre… renfermant une assez grande quantité de ces mêmes pièces… mais qu’il lui faudrait le plan de la propriété, afin de mieux désigner le lieu où ce petit trésor avait été enterré. Le plan ayant été envoyé par M. Ferrand à ses correspondants, puis communiqué ensuite par eux à Alexis, il leur indiqua, en faisant une marque au crayon, l’endroit où l’on devait creuser. Les instructions du somnambule ayant été suivies, l’urne indiquée par lui fut trouvée… Elle contenait trois kilogrammes cinq cents grammes de pièces de monnaie en argent, semblables à celle qui lui avait été remise précédemment. »
Magnétisme dans ses rapports avec la religion. — La sacrée pénitencerie à Rome a été saisie, en 1841, de la question de savoir si le somnambulisme obtenu par les pratiques magnétiques, dans les maladies, était chose convenable et permise. À l’exposé rapide des procédés employés pour obtenir l’état du somnambulisme, ainsi que des résultats extraordinaires produits par les somnambules, la sacrée pénitencerie a répondu expressément que l’application du magnétisme animal, dans les termes de l’exposé en question, n’était pas chose licite. Voici la traduction de la consultation envoyée à Rome et du jugement laconique du saint-siège :
« Éminentissime Seigneur, vu l’insuffisance des réponses données jusqu’à ce jour sur le magnétisme animal, et comme il est grandement à désirer que l’on puisse décider plus sûrement et plus uniformément les cas qui se présentent assez souvent, le soussigné expose ce qui suit à Votre Éminence. Une personne magnétisée (on la choisit d’ordinaire dans le sexe féminin) entre dans un tel état de sommeil ou d’assoupissement, appelé somnambulisme magnétique, que ni le plus grand bruit fait à ses oreilles, ni la violence du fer ou du feu ne sauraient l’en tirer. Le magnétiseur seul, qui a obtenu son consentement (car le consentement est nécessaire), la fait tomber dans cette espèce d’extase, soit par des attouchements et des gesticulations en divers sens, s’il est auprès d’elle, soit par un simple commandement intérieur, s’il en est éloigné, même de plusieurs lieues.
» Alors, interrogée de vive voix ou mentalement sur sa maladie et sur celles de personnes absentes, qui lui sont absolument inconnues, cette magnétisée, notoirement ignorante, se trouve à l’instant douée d’une science bien supérieure à celle des médecins : elle donne des descriptions anatomiques d’une parfaite exactitude ; elle indique le siège, la cause, la nature des maladies internes du corps humain, les plus difficiles à connaître et à caractériser ; elle en détaille les progrès, les variations et les complications, le tout dans les termes propres ; souvent elle en prédit la durée précise et en prescrit les remèdes les plus simples et les plus efficaces.
» Si la personne pour laquelle on consulte la magnétisée est présente, le magnétiseur la met en rapport avec celle-ci par le contact. Est-elle absente ? une boucle de ses cheveux la remplace et suffit. Aussitôt que cette boucle de cheveux est seulement approchée contre la main de la magnétisée, celle-ci dit ce que c’est, sans y regarder, de qui sont ces cheveux, où est actuellement la personne de qui ils viennent, ce qu’elle fait. Sur sa maladie, elle donne tous les renseignements énoncés ci-dessus, et cela avec autant d’exactitude que si elle faisait l’autopsie du corps.
» Enfin la magnétisée ne voit pas par les yeux. On peut les lui bander, elle lira quoi que ce soit, même sans savoir lire, un livre ou un manuscrit qu’on aura placé ouvert ou fermé, soit sur sa tête, soit sur son ventre. C’est aussi de cette région que semblent sortir ses paroles. Tirée de cet état, soit par un commandement même intérieur du magnétiseur, soit comme spontanément à l’instant annoncé par elle, elle paraît complètement ignorer tout ce qui lui est arrivé pendant l’accès, quelque long qu’il ait été : ce qu’on lui a demandé, ce qu’elle a répondu, ce qu’elle a souffert, rien de tout cela n’a laissé aucune idée dans son intelligence, ni dans sa mémoire la moindre trace.
» C’est pourquoi l’exposant, voyant de si fortes raisons de douter que de tels effets, produits par une cause occasionnelle manifestement si peu proportionnée, soient purement naturels, supplie très-instamment Votre Éminence de vouloir bien, dans sa sagesse, décider, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le plus grand avantage des âmes si chèrement rachetées par Notre-Seigneur Jésus-Christ, si, supposé la vérité des faits énoncés, un confesseur ou un curé peut sans danger permettre à ses pénitents ou à ses paroissiens : 1° d’exercer le magnétisme animal ainsi caractérisé, comme s’il était un art auxiliaire et supplémentaire de la médecine ; 2° de consentir à être plongés dans cet état de somnambulisme magnétique ; 3° de consulter, soit pour eux-mêmes, soit pour d’autres, les personnes ainsi magnétisées ; 4° de faire l’une de ces trois choses, avec la précaution préalable de renoncer formellement dans leur cœur à tout pacte diabolique, explicite ou implicite, et même à toute intervention satanique, vu que nonobstant cela quelques personnes ont obtenu du magnétisme ou les mêmes effets ou du moins quelques-uns.
| » | Eminentissime Seigneur, de Votre Excellence, par ordre du révérendissime évêque de Lausanne et Genève, le très-humble et très-obéissant serviteur, |
| » Jac.-Xavier Fontana, |
| » chancelier de la chancellerie épiscopale. |
| » | Fribourg en Suisse, palais épiscopal, le 19 mai 1841.» |
» La sacrée pénitencerie, après une mûre délibération, se croit en droit de répondre que l’usage du magnétisme, dans les cas mentionnés par la présente consultation, n’est pas chose licite.
| » | À Rome, dans la sacrée pénitencerie, le 4er juillet 1841. |
| » C. Castracane, M. P. — Ph. Pomella, |
| » secrétaire de la sacrée pénitencerie. » |
« Pour les catholiques dévoués, ajoute l’écrivain distingué à qui nous empruntons ces réflexions, l’arrêt de la sacrée pénitencerie est un jugement sans appel, qui n’a nul besoin d’explications ni de commentaires. »
» Mesmer ne connaissait pas ou n’a pas mentionné le somnambulisme magnétique. Ses pratiques ordinaires se réduisaient à traiter les maladies au moyen de crises accompagnées fréquemment de convulsions. Rien de plus prestigieux que les opérations de Mesmer. C’était autour d’un baquet, dans un appartement éclairé d’un demi-jour, que les malades allaient se soumettre aux influences magnétiques. Le baquet consistait dans une petite cuve de diverses figures, fermée par un couvercle à deux pièces ; au fond se plaçaient des bouteilles en rayons convergents, le goulot dirigé vers le centre de la cuve ; d’autres bouteilles, disposées sur celles-ci, mais en rayons divergents, étaient remplies d’eau comme les premières, bouchées et magnétisées également. La cuve recevait de l’eau de manière à recouvrir les lits de bouteilles ; on y mêlait quelquefois diverses substances, telles que du verre pilé, de la limaille de fer, etc.; d’autres fois, Mesmer ne se servait que de baquets à sec. Le couvercle du baquet livrait passage à des baguettes de fer mobiles et d’une longueur suffisante pour être dirigées vers diverses régions du corps des malades. De l’une de ces tiges, ou d’un anneau scellé au couvercle du baquet, partait en outre une corde très-longue, destinée à toucher les parties souffrantes ou à entourer le corps des malades sans la nouer. Les malades se formaient en cercle, en tenant chacun cette corde, et en appuyant le pouce droit sur le pouce gauche de son voisin. Il fallait de plus que tous les individus composant la chaîne se rapprochassent les uns des autres, au point de se toucher avec les pieds et les genoux. Au milieu de cet appareil apparaissait Mesmer, vêtu d’un habit de ; soie d’une couleur agréable, tenant en main une baguette qu’il promenait d’un air d’autorité au-dessus de la tête des magnétisés. Nous tenions à reproduire, au moins en abrégé, les traits principaux du spectacle magnétique dont le premier magnétiseur avoué avait soin de s’environner, afin de mettre le lecteur en mesure de juger qui avait plus de part aux effets tant vantés du magnétisme animal de la fin du dix-huitième siècle, ou des jongleries de Mesmer, ou de l’imagination des malades irritables, ou de la sotte crédulité des mesméristes bien intentionnés. Les jongleries de Mesmer couvraient pourtant une puissance réelle ; car il est certain, — et on l’a expliqué ailleurs, — que son regard, ses gestes, ses paroles, ses attouchements obtenaient maintes fois des résultats surprenants et des cures vraiment prodigieuses.
» Le somnambulisme magnétique ne fut découvert que par le marquis de Puységur. Lui seul commença à se servir de cet état pour traiter les maladies, soit chez les somnambules mêmes, soit chez les autres personnes. Alors s’ouvrit une nouvelle source de fraudes que la foi des magnétiseurs était incapable de dévoiler, et qui en imposait, à plus forte raison, à la masse du public. Beaucoup de magnétisés feignaient de succomber au sommeil magnétique, tout en restant très-éveillés, voyaient à leur aise, en apparence les yeux fermés, répondaient aux questions qui leur étaient adressées, obéissaient, en un mot, au moindre mouvement du magnétiseur abusé. C’était bien autre chose, ce qui ne manquait pas d’arriver, quand le magnétiseur et le somnambule, aidés de quelques compères avisés, se concertaient derrière les coulisses et s’appliquaient de leur mieux, par cupidité ou par une vanité puérile, à mystifier les spectateurs. »
Soneillon, démon qui se trouve cité dans les phases de la possession de Louviers.
Songes. Le cerveau est le siège de la pensée, du mouvement et du sentiment. Si le cerveau n’est pas troublé par une trop grande abondance de vapeurs crues, si le travail ne lui a pas ôté toutes ses forces, il engendre dans le sommeil des songes, excités ou par les images dont il s’est vivement frappé durant la veille, ou par des impressions toutes nouvelles, que produisent les affections naturelles ou accidentelles des nerfs ou la nature du tempérament. C’est aussi limpide que ce qu’on a lu sur le somnambulisme. Les songes naturels viennent des émotions de la journée et du tempérament. Les personnes d’un tempérament sanguin songent les festins, les danses, les divertissements, les plaisirs, les jardins et les fleurs. Les tempéraments bilieux songent les disputes, les querelles, les combats, les incendies, les couleurs jaunes, etc. Les mélancoliques songent l’obscurité, les ténèbres, la fumée, les promenades nocturnes, les spectres et les choses tristes. Les tempéraments pituiteux ou flegmatiques songent la mer, les rivières, les bains, les navigations, les naufrages, les fardeaux pesants, etc. Les tempéraments mêlés, comme les sanguins-mélancoliques, les sanguins-flegmatiques, les bilieux-mélancoliques, etc., ont des songes qui tiennent des deux tempéraments : ainsi le dit Peucer.
Les anciens attachaient beaucoup d’importance aux rêves ; et l’antre de Trophonius était célèbre pour cette sorte de divination. Pausanias nous a laissé, d’après sa propre expérience, la description des cérémonies qui s’y observaient. « Le chercheur passait d’abord plusieurs jours dans le temple de la bonne Fortune. Là il faisait ses expiations, observant d’aller deux fois par jour se laver. Quand les prêtres le déclaraient purifié, il immolait au dieu des victimes ; cette cérémonie finissait ordinairement par le sacrifice d’un bélier noir. Alors le curieux était frotté d’huile par deux enfants et conduit à la source du fleuve ; on lui présentait là une coupe d’eau du Léthé, qui bannissait de son esprit toute idée profane, et une coupe d’eau de Mnémosyne, qui disposait sa mémoire à conserver le souvenir de ce qui allait se passer. Les prêtres découvraient ensuite la statue de Trophonius, devant laquelle il fallait s’incliner et prier ; enfin, couvert d’une tunique de lin et le front ceint de bandelettes, on allait à l’oracle. Il était placé sur une montagne, au milieu d’une enceinte de pierres qui cachait une profonde caverne, où l’on ne pouvait descendre que par une étroite ouverture. Quand, après beaucoup d’efforts et à l’aide de quelques échelles, on avait eu le bonheur de descendre par là sans se rompre le cou, il fallait passer encore de la même manière dans une seconde caverne, très-petite et très-obscure. Là on se couchait à terre, et on n’oubliait pas de prendre dans ses mains une espèce de pâte faite avec de la farine, du lait et du miel. On présentait les pieds à un trou qui était au milieu de la caverne : au même instant, on se sentait rapidement emporté dans l’antre ; on s’y trouvait couché sur des peaux de victimes récemment sacrifiées, enduites de certaines drogues dont les agents du dieu connaissaient seuls la vertu ; on ne tardait pas à s’endormir profondément ; et c’était alors qu’on avait d’admirables visions et que les temps à venir découvraient tous leurs secrets. »
Hippocrate dit que, pour se soustraire à la malignité des songes, quand on voit en rêvant pâlir les étoiles, on doit courir en rond ; quand on voit pâlir la lune, on doit courir en long ; quand on voit pâlir le soleil, on doit courir tant en long qu’en rond… On rêve feu et flammes quand on a une bile jaune ; on rêve fumée et ténèbres quand on a une bile noire ; on rêve eau et humidité quand on a des glaires et des pituites, à ce que dit Galien. C’est le sentiment de Peucer. Songer à la mort, annonce mariage, selon Artémidore ; songer des fleurs, prospérité ; songer des trésors, peines et soucis ; songer qu’on devient aveugle, perte d’enfants… Ces secrets peuvent donner une idée de l’Onéirocritique d’Artémidore, ou explication des rêves. Songer des bonbons et des crèmes, dit un autre savant, annonce des chagrins et des amertumes ; songer des pleurs, annonce de la joie ; songer des laitues, annonce une maladie ; songer or et richesses, annonce la misère… Il y a eu des hommes assez superstitieux pour faire leur testament parce qu’ils avaient vu un médecin en songe. Ils croyaient que c’était un présage de mort.
Songes (explication des), suivant les livres les plus consultés :
Aigle. Si on voit en songe voler un aigle, bon

Bain dans l’eau claire, bonne santé ; bain dans l’eau trouble, mort de parents et d’amis. Belette. Si on voit une belette en songe, signe qu’on aura ou qu’on a une méchante femme. Boire de l’eau fraîche, grandes richesses ; boire de l’eau chaude, maladie ; boire de l’eau trouble, chagrins. Bois. Être peint sur bois dénote longue vie. Boudin. Faire du boudin, présage de peines ; manger du boudin, visite inattendue. Brigands. On est sûr de perdre quelques parents ou une partie de sa fortune si on songe qu’on est attaqué par des brigands.
Cervelas. Manger des cervelas, bonne santé. Champignons, signe d’une vie longue, par contraste, sans doute. Chanter. Un homme qui chante, espérance ; une femme qui chante, pleurs et gémissements. Charbons éteints, mort ; charbons allumés, embûches ; manger des charbons, pertes et revers. Chat-huant, funérailles. Cheveux arrachés, pertes d’amis. Corbeau qui vole, péril de mort. Couronne. Une couronne d’or sur la tête, présage des honneurs ; une couronne d’argent, bonne santé ; une couronne de verdure, dignités ; une couronne d’os de morts annonce la mort. Cygnes noirs, tracas de ménage.
Déménagements. Annonce d’un mariage ou d’une succession.

Dents. Chute de dents, présage de mort. Dindon. Voir ou posséder des dindons, folie de parents ou d’amis.
Enterrement. Si quelqu’un rêve qu’on l’enterre vivant, il peut s’attendre à une longue misère. Aller à l’enterrement de quelqu’un, heureux mariage. Étoiles. Voir des étoiles tomber du ciel, chutes, déplaisirs et revers.
Fantôme blanc, joie et honneurs ; fantôme noir, peines et chagrins. Femme. Voir une femme, infirmité ; une femme blanche, heureux événement ; une femme noire, maladie ; plusieurs femmes, caquets. Fèves. Manger des fèves, querelles et procès. Filets. Voir des filets, présage de pluie. Flambeau allumé, récompense ; flambeau éteint, emprisonnement. Fricassées, caquets de voisins.
Gibet. Songer qu’on est condamné à être pendu, heureux succès. Grenouilles, indiscrétions et babils.
Hannetons, importunités. Homme vêtu de blanc, bonheur ; vêtu de noir, malheur ; homme assassiné, sûreté.
Insensé. Si quelqu’un songe qu’il est devenu insensé, il recevra des bienfaits de son prince.
Jeu. Gain au jeu, perte d’amis.
Lait. Boire du lait, amitié. Lapins blancs, succès ; lapins noirs, revers ; manger du lapin, bonne santé ; tuer un lapin, tromperie et perte. Lard. Manger du lard, victoire. Limaçon, charges honorables. Linge blanc, mariage ; linge sale, mort. Lune. Voir la lune, retard dans les affaires ; la lune pâle, peines ; la lune obscure, tourments.
Manger à terre, emportements. Médecine. Prendre médecine, misère ; donner médecine à quelqu’un, profit. Meurtre. Voir un meurtre, sûreté. Miroir, trahison. Moustaches. Songer qu’on a de grandes moustaches, augmentation de richesses.
Navets, vaines espérances. Nuées, discorde.
Œufs blancs, bonheur ; œufs cassés, malheur. Oies. Qui voit des oies en songe peut s’attendre à être honoré des princes. Ossements, traverses et peines inévitables.
Palmiers, palmes, succès et honneurs. Paon. L’homme qui voit un paon aura de beaux enfants. Perroquet, indiscrétion, secret révélé.
Quenouille, pauvreté.
Rats, ennemis cachés. Roses, bonheur etplaisirs.
Sauter dans l’eau, persécutions. Scorpions, lézards, chenilles, scolopendres, etc., malheurs et trahisons. Soufflet donné, paix et union entre le mari et la femme. Soufre, présage d’empoisonnement. Spectre. Signe d’une surprise.

Tempête, outrage et grand péril. Tête blanche, joie ; tête tondue, tromperie ; tête chevelue, dignité ; tête coupée, infirmité ; tête coiffée d’un agneau, heureux présage. Tourterelles, accord des gens mariés, mariage pour les célibataires.
Vendanger, santé et richesses. Violette, succès. Violon. Entendre jouer du violon et des autres instruments de musique, concorde et bonne intelligence entre le mari et la femme, etc., etc.
Telles sont les extravagances que débitent, avec étendue et complaisance, les interprètes des songes ; et l’on sait combien ils trouvent de gens qui les croient ! Le monde fourmille de petits esprits qui, pour avoir entendu dire que les grands hommes étaient au-dessus de la superstition croient se mettre à leur niveau en refusant à l’âme son immortalité et à Dieu son pouvoir, et qui n’en sont pas moins les serviles esclaves des plus absurdes préjugés. On voit tous les jours d’ignorants esprits forts, de petits sophistes populaires, qui ne parlent que d’un ton railleur des saintes Écritures, et qui passent les premières heures du jour à chercher l’explication d’un songe insignifiant, comme ils passent les moments du soir à interroger les cartes sur leurs plus minces projets[17].
Il y a des songes qui ont embarrassé ceux qui veulent expliquer tout. Nous ne pouvons passer sous silence le fameux songe des deux Arcadiens. Il est rapporté par Valère-Maxime et par Cicéron. Deux Arcadiens, voyageant ensemble, arrivèrent à Mégare. L’un se rendit chez un ami qu’il avait en cette ville, l’autre alla loger à l’auberge. Après que le premier fut couché, il vit en songe son compagnon, qui le suppliait de venir le tirer des mains de l’aubergiste, par qui ses jours étaient menacés. Cette vision l’éveille en sursaut ; il s’habille à la hâte, sort et se dirige vers l’auberge où était son ami. Chemin faisant, il réfléchit sur sa démarche, la trouve ridicule, condamne sa légèreté à agir ainsi sur la foi d’un songe ; et après un moment d’incertitude, il retourne sur ses pas et se remet au lit. Mais à peine a-t-il de nouveau fermé l’œil, que son ami se présente de nouveau à son imagination, non tel qu’il l’avait vu d’abord, mais mourant, mais souillé de sang, couvert de blessures, et lui adressant ce discours : « Ami ingrat, puisque tu as négligé de me secourir vivant, ne refuse pas au moins de venger ma mort. J’ai succombé sous les coups du perfide aubergiste ; et pour cacher les traces de son crime, il a enseveli mon corps, coupé en morceaux, dans un tombereau plein de fumier, qu’il conduit à la porte de la ville. » Le songeur, troublé de cette nouvelle vision, plus effrayante que la première, épouvanté par le discours de son ami, se lève derechef, vole à la porte de la ville et y trouve le tombereau désigné, dans lequel il reconnaît les tristes restes de son compagnon de voyage. Il arrête aussitôt l’assassin et le livre à la justice.
Cette aventure, on l’explique. Les deux amis étaient fort liés et naturellement inquiets l’un pour l’autre ; l’auberge pouvait avoir un mauvais renom : dès lors, le premier songe n’a rien d’ extraordinaire Le second en est la conséquence ! dans l’imagination agitée du premier des deux voyageurs. Les détails du tombereau sont plus forts ; il peut seiaire qu’ils soient un effet des pressentiments ou d’une anecdote du temps, ou une rencontre du hasard. Mais il y a des choses qui sont plus inexplicables et qu’on ne peut pourtant contester.
Un célèbre médecin irlandais, le docteur Abercombie, raconte, dans ses Études de psychologie, deux songes de deux de ses malades qui peuvent appuyer le récit qu’on vient de lire. « Un ministre, venu d’un village voisin à Édimbourg, y passait la nuit dans une auberge ; là, pendant son sommeil, il songea que le feu prenait à sa maison et que ses enfants y couraient danger de mort. Aussitôt il se lève et se hâte de quitter la ville ; à peine hors des murs, il aperçoit sa maison en feu ; il y court et arrive assez à temps pour sauver un de ses fils en bas âge que, dans le désordre causé par l’incendie, on avait laissé au milieu des flammes. » — Voici le second fait : « Un bourgeois d’Édimhourg était affecté d’un anévrysme de l’artère crurale. Deux chirurgiens distingués qui le soignaient devaient faire l’opération dans quelques jours. La femme du patient songea que le mal avait disparu et que l’opération projetée devenait inutile. En effet, le malade, en examinant le matin le siège de son affection, fut surpris de voir qu’elle n’avait pas laissé la moindre trace. » Il est important d’ajouter, dit le compte rendu, que ces sortes de guérisons sont extrêmement rares et qu’il est presque inconnu que cette maladie se soit résolue ainsi sans le secours de l’art.
Alexander ab Alexandro raconte, chap, xi du premier livre de ses Jours Géniaux, qu’un sien fidèle serviteur, homme sincère et vertueux, couché dans son lit, dormant profondément, commença à se plaindre, soupirer et se lamenter si fort, qu’il éveilla tous ceux de la maison. Son maître, après l’avoir éveillé, lui demanda la cause de son cri. Le serviteur répondit : « Ces plaintes que vous avez entendues ne sont point vaines ; car lorsque je m’agitais ainsi, il me semblait que je voyais le corps mort de ma mère passer devant mes yeux, par des gens qui la portaient en terre. » On fit attention à l’heure, au jour, à la saison où cette vision était advenue, pour savoir si elle annoncerait quelque désastre au garçon : et l’on fut tout étonné d’apprendre la mort de cette femme quelques jours après. S’étant informé des jour et heure, on trouva qu’elle était morte le même jour et à la même heure qu’elle s’était présentée morte à son fils. Voy. Rambouillet.
Saint Augustin, sur la Genèse, raconte l’histoire d’un frénétique qui revient un peu à ce songe. Quelques gens étant dans la maison de ce frénétique entrèrent en propos d’une femme I qu’ils connaissaient, laquelle était vivante et faisait bonne chère, sans aucune appréhension de mal. Le frénétique leur dit : « Comment parlez-vous de cette femme ? Elle est morte ; je l’ai vue passer comme on la portait en terre. » Et un ou deux jours après, la prédiction fut confirmée[18]. Voy. Cassius, Hymera, Amilcar, Décius, etc.
Un certain Égyptien, joueur de luth, songea une nuit qu’il jouait de son luth aux oreilles d’un âne. Il ne fit pas d’abord grandes réflexions sur un tel songe ; mais quelque temps après, Antiochus, roi de Syrie, étant venu à Memphis pour voir son neveu Ptolomée, ce prince fit venir le joueur de luth pour amuser Antiochus. Le roi de Syrie n’aimait pas la musique ; il écouta d’un air distrait et ordonna au musicien de se retirer. L’artiste alors se rappela le songe qu’il avait fait, et ne put s’empêcher de dire en sortant ; « J’avais bien rêvé que je jouerais devant un âne. » Antiochus l’entendit par malheur, commanda qu’on le liât, et lui fit donner les étrivières. Depuis ce moment, le musicien perdit l’habitude de rêver, ou du moins de se vanter de ses rêves.
On raconte sur la mort de l’acteur Champmeslé une anecdote plus extraordinaire. Il avait perdu sa femme et sa mère. Frappé d’un songe où il avait vu sa mère et sa femme lui faire signe du doigt de venir les trouver, il était allé chez les Cordeliers demander deux messes des morts, l’une pour sa mère, l’autre pour sa femme. L’honoraire de ces messes était alors de dix sous. Champmeslé ayant donné au sacristain une pièce de trente sous, le religieux était embarrassé pour lui rendre les dix sous restants. « Gardez tout, dit l’acteur et faites dire sur-le-champ une troisième messe des morts ; elle sera pour moi. » En effet, il mourut subitement le même jour, au moment où le cordelier venait le voir.

Terminons par un petit fait récent, consigné dans l’Indicateur de Champagne :
Un jeune homme de vingt-cinq ans, M. Baptiste Renard, cultivateur demeurant chez ses parents, au hameau dit les Tourneurs, commune de Fontenelle, rêve, la nuit en dormant, qu’il était monté sur un arbre, que la branche sur laquelle il était se rompait sous lui et qu’il se brisait les membres en tombant.
Ce jeune homme, le lendemain, eut la fatale pensée d’aller grimper sur l’arbre qu’il avait vu en songe, comme pour prouver qu’il n’ajoutait aucune foi aux rêves. Il était sur l’arbre, et racontait en riant à l’un de ses camarades son rêve de la nuit précédente, lorsque tout à coup la branche qui le portait rompt sous le poids de son corps ; M. Renard tombe, et dans sa chute il se casse un bras et une jambe ; il est relevé dans un état tel, que trois jours après il expira au milieu des plus cruelles souffrances.
Sonhardibel, prêtre apostat des Basses-Pyrénées, qui disait au sabbat la messe du diable avec une hostie noire en triangle. Il était quelquefois assez longtemps enlevé en l’air, la tête en bas. Fin du seizième siècle. Nous n’en savons pas plus.
Sorciers, gens qui, avec le secours des puissances infernales, peuvent opérer des choses surnaturelles, en conséquence d’un pacte fait avec le diable. Ce n’étaient en général que des imposteurs, des charlatans, des fourbes, des maniaques, des fous, des hypocondres ou des vauriens qui, désespérant de se donner quelque importance par leur propre mérite, se rendaient remarquables par les terreurs qu’ils inspiraient. Chez tous les peuples, on trouve des sorciers : on les appelle magiciens lorsqu’ils opèrent des prodiges, et devins lorsqu’ils devinent les choses cachées. Il y avait à Paris, du temps de Charles IX, trente mille sorciers qu’on chassa de la ville. On en comptait plus de cent mille en France sous le roi Henri III. Chaque ville, chaque bourg, chaque village, chaque hameau, avait les siens ; et de nos jours en France, où la partie la plus malsaine et la plus répandue de la presse combat les choses religieuses au lieu d’éclairer les esprits grossiers, il y a encore les deux tiers des villages où l’on croit aux sorciers. On les poursuivit sous Henri IV et sous Louis XIII; le nombre de ces misérables ne commença à diminuer que sous Louis XIV. L’Angleterre n’en était pas moins infestée. Le roi Jacques Ier, qui leur faisait la chasse très-durement, écrivit contre eux un gros livre, sans éclairer la question.
Un fait constant, c’est que la plupart des sorciers et de ceux qui se disent tels sont des bandits qui prennent un masque diabolique pour faire le mal ; c’est que la plupart de leurs sortilèges sont des empoisonnements, et leurs sabbats d’affreuses orgies. Ces sorciers étaient encore des restes de bandes hérétiques, conduits d’aberrations en aberrations au culte tout cru du démon.
Les sorciers sont coupables de quinze crimes, dit Bodin : 1° ils renient Dieu ; 2° ils le blasphèment ; 3° ils adorent le diable ; 4° ils lui vouent leurs enfants ; 5° ils les lui sacrifient souvent, avant qu’ils soient baptisés[19] ; 6° ils les consacrent à Satan, dès le ventre de leur mère ; 1° ils lui


On s’est moqué de ce passage de Bodin ; il est pourtant vrai presque en tout. Sandoval, dans son Histoire de Charles-Quint, raconte que deux jeunes filles, l’une de onze ans et l’autre de neuf, s’accusèrent elles-mêmes comme sorcières devant les membres du conseil royal de Navarre ; elles avouèrent qu’elles s’étaient fait recevoir dans la secte des sorciers, et s’engagèrent à découvrir toutes les femmes qui en étaient, si on consentait à leur faire grâce. Les juges l’ayant promis, ces deux enfants déclarèrent qu’en voyant l’œil gauche d’une personne elles pourraient dire si elle était sorcière ou non ; elles indiquèrent l’endroit où l’on devait trouver un grand nombre de ces femmes, et où elles tenaient leurs assemblées. Le conseil chargea un commissaire de se transporter sur les lieux avec les deux enfants, escortés de cinquante cavaliers. En arrivant dans chaque bourg ou village, il devait enfermer les deux jeunes filles dans deux maisons séparées, et faire conduire devant elles les femmes suspectes de magie, afin d’éprouver le moyen qu’elles avaient indiqué. Il résulta de l’expérience que celles de ces femmes qui avaient été signalées par les deux filles comme sorcières l’étaient réellement. Lorsqu’elles se virent en prison, elles déclarèrent qu’elles étaient plus de cent cinquante ; que, quand une femme se présentait pour être reçue dans leur société, on lui faisait renier Jésus-Christ et sa religion. Le jour où cette cérémonie avait lieu, on voyait paraître au milieu d’un cercle un bouc noir qui en faisait plusieurs fois le tour. À peine avait-il fait entendre sa voix rauque, que toutes les sorcières accouraient et se mettaient à danser ; après cela, elles venaient toutes baiser le bouc au derrière, et faisaient ensuite un repas avec du pain, du vin et du fromage.
Aussitôt que le festin était fini, chaque sorcière s’envolait dans les airs, pour se rendre aux lieux où elle voulait faire du mal. D’après leur propre confession, elles avaient empoisonné trois ou quatre personnes, pour obéir aux ordres de Satan, qui les introduisait dans les maisons, en leur en ouvrant les portes et les fenêtres. Il avait soin de les refermer quand le maléfice avait eu son effet. Toutes les nuits qui précédaient les grandes fêtes de l’année, elles avaient des assemblées générales, où elles faisaient des abominations et des impiétés. Lorsqu’elles assistaient à la messe, elles voyaient l’hostie noire ; mais si elles avaient déjà formé le propos de renoncer à leurs pratiques diaboliques, elles la voyaient blanche. Sandoval ajoute que le commissaire, voulant s’assurer de la vérité des faits par sa propre expérience, fit prendre une vieille sorcière, et lui promit sa grâce, à condition qu’elle ferait devant lui toutes ses opérations de sorcellerie. La vieille, ayant accepté la proposition, demanda la boîte d’onguent qu’on avait trouvée sur elle, et monta dans une tour avec le commissaire et un grand nombre de personnes. Elle se plaça devant une fenêtre, et se frotta d’onguent la paume de la main gauche, le poignet, le nœud du coude, le dessous du bras, l’aine et le côté gauche ; ensuite elle cria d’une voix forte : Es-tu là ? Tous les spectateurs entendirent dans les airs une-voix qui répondit : Oui, me voici. La sorcière se mit alors à descendre le long de la tour, la tête en bas, se servant de ses pieds et de ses mains à la manière des lézards. Arrivée au milieu de la hauteur, elle prit son vol dans les airs devant les assistants, qui ne cessèrent de la voir que lorsqu’elle eut dépassé l’horizon. Dans l’étonnement où ce prodige avait plongé tout le monde, le commissaire fit publier qu’il donnerait une somme d’argent considérable à quiconque lui ramènerait la sorcière. On la lui présenta au bout de deux jours, qu’elle fut arrêtée par des bergers. Le commissaire lui demanda pourquoi elle n’avait pas volé assez loin pour échapper à ceux qui la cherchaient. À quoi elle répondit que son maître n’avait voulu la transporter qu’à la distance de trois lieues, et qu’il l’avait laissée dans le champ où les bergers l’avaient rencontrée.
Ce récit singulier, dû pourtant à un écrivain grave, n’est pas facile à expliquer. Le juge ordinaire ayant prononcé sur l’affaire des cent cinquante sorcières, ni l’onguent ni le diable ne purent leur donner des ailes pour éviter le châtiment de deux cents coups de fouet et de plusieurs années de prison qu’on leur fit subir.
Notre siècle, comme nous l’avons remarqué, n’est pas encore exempt de sorciers. Il y en a dans tous les villages. On en trouve à Paris même, où le magicien Moreau faisait merveilles il y a quarante ans. Mais souvent on a pris pour sorciers des gens qui ne l’étaient pas. Mademoiselle Lorimier, à qui les arts doivent quelques tableaux remarquables, se trouvant à Saint-Flour en 1811 avec une autre dame artiste, prenait, de la plaine, l’aspect de la ville, située sur un rocher. Elle dessinait et faisait des gestes d’aplomb avec son crayon. Les paysans, qui voient encore partout la sorcellerie, jetèrent des pierres aux deux dames, les arrêtèrent et les conduisirent chez le maire, les prenant pour des sorcières qui faisaient des sorts et des charmes. Vers 1778, les Auvergnats prirent pour des sorciers les ingénieurs qui levaient le plan de la province, et les accablèrent de pierres. Le tribunal correctionnel de Marseille eut à prononcer, en 1820, sur une cause de sorcellerie. Une demoiselle, abandonnée par un homme qui devait l’épouser, recourut à un docteur qui passait pour sorcier, lui demandant s’il aurait un secret pour ramener un infidèle et nuire à une rivale. Le nécromancien commença par se faire donner de l’argent, puis une poule noire, puis un cœur de bœuf, puis des clous. Il fallait que la poule, le cœur et les clous fussent volés ; pour l’argent, il pouvait être légitimement acquis, le sorcier se chargeait du reste. Mais il arriva que, n’ayant pu rendre à la plaignante le cœur de son amant, celle-ci voulut au moins que son argent lui fût restitué ; de là le procès, dont le dénoûment a été ce qu’il devait être : le sorcier a été condamné à l’amende et à deux mois de prison comme escroc.
Voici encore ce qu’on écrivait de Valognes en On jugera des sorciers passés par les sorciers présents, sous le rapport de l’intérêt qu’ils sont dignes d’inspirer : « Notre tribunal correctionnel vient d’avoir à juger des sorciers de Brix. Les prévenus, au nombre de sept, se trouvent rangés dans l’ordre suivant : Anne-Marie, femme de Leblond, dit le Marquis, âgée de soixante-quinze ans (figure d’Atropos ou d’une sorcière de Macbeth); Leblond, son mari, âgé de soixante-onze ans ; Charles Lemonnier, maçon, âgé de vingt-six ans ; Drouet, maçon, âgé de quarante-quatre ans ; Thérèse Leblond, dite la Marquise, âgée de quarante-huit ans (teint fiévreux ou animé par la colère) ; Jeanne Leblond, sa sœur, également surnommé la Marquise, âgée de trente-quatre ans, femme de Lemonnier, et Lemonnier, mari de la précédente, équarrisseur, âgé de trente-trois ans, né à Amfreville, tous demeurant à Brix. Divers délits d’escroquerie à l’aide de manœuvres frauduleuses leur sont imputés ; les témoins, dont bon nombre figurent parmi les dupes qu’ils ont faites, comparaissent successivement et reçoivent une ovation particulière à chaque aveu de leur crédulité. Les époux Halley, dit Morbois, et leur frère et beau-frère Jacques Legouche, des Moitiers-en-Bauptois, se croyaient ensorcelés. Or il n’était bruit à dix lieues à la ronde que des Marquis de Brix. On alla donc les supplier d’user de leur pouvoir en faveur de braves gens dont la maison, remplie de myriades de sorciers, n’était plus habitable. Le vieux Marquis se met aussitôt en route avec sa fille Thérèse et commande des tisanes. Mais il en faut bientôt de plus actives, et la société, composée de ses deux filles et des frères Lemonnier, qui se sont entremis dans la guérison, apporte des bouteilles tellement puissantes que toute la famille les a vues danser dans le panier qui les contenait. Il faut en effet de bien grands remèdes pour lever le sort que le curé, le vicaire et le bedeau de la paroisse ont jeté sur eux, au dire des Marquises. Il faut en outre du temps et de l’argent. Deux ans se passent en opérations, et avec le temps s’écoule l’argent. Mais enfin une si longue attente, de si nombreux sacrifices auront un terme, et ce terme, c’est la nuit de Pâques fleuries, dans laquelle le grand maître sorcier viendra débarrasser les époux Halley des maléfices qu’ils endurent. Ce qui avait été promis a lieu ; non pas précisément la guérison, mais l’arrivée de plusieurs membres de la compagnie de Brix. Que s’est-il passé dans la maison ? c’est ce que des voisins assignés ne peuvent nous dire, parce qu’ils n’ont osé ni regarder ni entendre. Un seul rapporte avoir ouï, lorsque les sorciers sont repartis, une voix s’écrier : — Il faut qu’ils soient plus bêtes que le cheval qui nous traîne ! D’autres racontent la ruine de cette maison, qui date des fréquents voyages de la compagnie. Les Halley et les Legouche étaient dans une parfaite aisance avant qu’il fût question de les désensorceler. Leurs meubles, leurs bestiaux, leur jardin, leur peu de terre, ils ont tout vendu ; leurs bardes, parce qu’elles étaient ensorcelées comme-leurs personnes, ils les ont données ; ils ont arraché jusqu’à leur plant de pommiers pour en faire un peu d’argent et rassasier l’hydre insatiable qui les dévorait ; 2,000 fr., tel est peut-être le chiffre des sommes que l’accusation reproche aux prévenus d’avoir escroquées à ces pauvres gens. Cependant ceux-ci avouent à peine 250 fr. qu’ils auraient pu remettre pour prix de médicaments qui les ont, disent-ils, radicalement guéris. Ils ne confessent aucuns détails, n’accusent personne. Ils rendent grâces au contraire du bien qu’on leur a fait. Les malheureux tremblent encore en présence de ceux qu’ils ont appelés auprès d’eux, et dont le regard semble toujours les fasciner ! Un nommé Henri Lejuez, de Flottemanville-Hague (arrondissement de Cherbourg), vient ensuite raconter avec la même bonne foi et le même air de simplicité les tours subtils de magie dont il a été victime. Chevaux et porcs, chez lui tout mourait ; ce n’était point naturel ; mais aux grands maux les grands remèdes. Il se mit donc en quête pour les trouver. Un jour, dit-il, que j’étais à l’assemblée de Vasteville, je trouvai un homme qui me dit que je ferais bien d’aller à Brix, chez un nommé le Marquis. J’y allai ; or, quand je lui eus dit mon affaire, et qu’il eut lu deux pages dans un livre que sa femme alla lui chercher dans l’armoire, il me répondit : — Ce sont des jaloux ; mais je vais vous butter ça ; baillez-moi 5 fr. 50 c. pour deux bouteilles de drogues, et je ferai mourir le malfaiteur. — Nenni, que je lui dis, je n’en demande pas tant ; domptez-le seulement de façon qu’il ne me fasse plus de mal, c’en est assez. Quinze jours après, j’y retournai, et j’apportai vingt-cinq kilogrammes de farine, deux pièces de 5 fr., et environ deux kilogrammes de filasse que sa bonne femme m’avait demandés. Il n’y avait point d’amendement chez mes avers, et je lui dis en le priant de travailler comme il faut l’homme qui m’en voulait. Enfin, après un autre voyage que je fis encore, il fut convenu que sa fille Thérèse viendrait à la maison. Elle y vint donc et fit sa magie avec une poule qu’on happa sans lui ôter une plume du corps. Sur le coup elle la saignit, et quand elle eut ramassé son sang dans un petit pot avec le cœur, elle le fit porter à la porte de l’homme que nous soupçonnions. Pendant que le sang s’égoutterait, notre homme devait dessécher, à ce qu’elle disait. Après cela elle nous demanda vingt-cinq aiguilles neuves qu’elle mit dans une assiette et sur laquelle elle versa de l’eau. Autant il y en aurait qui s’affourcheraient les unes sur les autres, autant il y aurait d’ennemis qui nous en voudraient. Il s’en trouva trois. Tout cela fait, elle emporta la poule et revint quelques jours après avec Jeanne sa sœur. Mais il se trouva qu’il leur manqua quelque chose pour arriver à leur définition : c’étaient des drogues qu’avec 25 fr. que je leur donnai, et que j’empruntai en partie, elles allèrent quérir à Cherbourg, et qu’elles devaient rapporter le soir, avec deux mouchoirs que ma femme leur prêta ; mais elles ne revinrent plus. Pour lors j’eus l’idée qu’elles n’étaient pas aussi savantes qu’on le disait. Pour m’en assurer, j’allai consulter une batteuse de cartes du Limousin, et je l’amenai chez Thérèse. Là-dessus les deux femelles se prirent de langue : la Limousine traita la Marquise d’agrippeuse et le Marquis d’agrippeur. Ça fit une brouille, et les affaires en restèrent là. À quelque temps de là cependant, ma femme la revit dans une boutique à la Pierre-Butée, avec Charles Lemonnier, qu’elle appelait son homme. Elle lui parla de ce qu’elle lui avait donné, de trois chemises que j’oubliais, de deux draps de lits, d’un canard et d’une poule que je lui avais portés moi-même ; elle lui demanda aussi ce qu’était devenue la poule qu’elle avait saignée pour sa magie. Sur-le-champ, Thérèse répondit qu’après l’avoir fait rôtir elle s’était dressée sur table et avait chanté trois fois comme un coq. — C’est vrai, reprit Charles Lemonnier, car quand je l’ai vue, ça m’a fait un effet que je n’ai pas osé en manger.
» Les Marquis et compagnie n’appliquaient pas seulement leurs talents à la levée des sorts ; mais tels sont les principaux faits qui amènent les différents prévenus devant le tribunal, et auxquels on pourrait ajouter le vol de deux pièces de fil et de deux livres de piété, imputé à la même Thérèse, lors de sa visite, au préjudice de la femme Heiland, et le fait d’escroquerie reproché au vieux sorcier Marquis, à raison de ses sortilèges sur la fille d’un nommé Yves Adam, de Brix. M. le substitut Desmortiers rappelle les fâcheux antécédents, d’abord de Thérèse, condamnée par un premier jugement, pour vol, à un an et un jour d’emprisonnement ; par un second jugement de la cour d’assises de la Manche, en sept années de travaux forcés ; de sa sœur ensuite, condamnée pareillement en six années de la même peine ; de Leblond père, dit le Marquis, qui a subi deux condamnations correctionnelles dont la durée de l’une a été de neuf ans ; de Drouet enfin, condamné à un an et un jour de prison.
» Le tribunal, après avoir renvoyé de l’action la vieille femme Leblond, prononce son jugement, qui condamne aux peines qui suivent les coprévenus : Thérèse Leblond, dix années d’emprisonnement ; Jeanne Leblond, femme Lemonnier, six ans ; Jacques Leblond, dit le Marquis, cinq ans ; Charles Lemonnier, un an et un jour ; Pierre-Amable Drouet, six mois ; Pierre Lemonnier, un mois ; les condamne chacun, en outre, en 50 fr. d’amende, et solidairement aux dépens, et dit qu’à l’expiration de leur peine ils resteront pendant dix ans sous la surveillance de la haute police. » Voy. Sicidites, Agrippa, Faust et une foule de petits articles sur divers sorciers.
On trouve des sorciers dans les plus vieux récits. Les annales mythologiques vous diront qu’à Jalysié, ville située dans l’île de Rhodes, il y avait six hommes qui étaient si malfaisants que leurs seuls regards ensorcelaient les objets de leur haine. Ils faisaient pleuvoir, neiger et grêler sur les héritages de ceux auxquels ils en voulaient. On dit que, pour cet effet, ils arrosaient la terre avec de l’eau du Styx, d’où provenaient les pestes, les famines et les autres calamités. Jupiter les changea en écueils.
Le voyageur Beaulieu conte qu’il rencontra un de ces sorciers ou escrocs, qu’on a aussi appelés grecs, à la cour du roi d’Achem. C’était un jeune Portugais nommé Dom Francisco Carnero ; il passait pour un joueur habile et si heureux qu’il semblait avoir enchaîné la fortune. On découvrit néanmoins que la mauvaise foi n’avait pas moins de part que le bonheur et l’habileté aux avantages qu’il remportait continuellement. Après avoir gagné de grosses sommes à un ministre de cette cour, qui se dédommageait de ses pertes par les vexations qu’il exerçait sur les marchands, il jouait un jour contre une dame indienne, à laquelle il avait gagné une somme considérable, lorsqu’en frappant du poing sur la table, pour marquer son étonnement d’un coup extraordinaire, il rencontra un de ses dés qu’il brisa, et dont il sortit quelques gouttes de vif argent. Elles disparurent aussitôt, parce que la table avait quelque pente. Les Indiens, d’autant plus étonnés de cette aventure, que le Portugais se saisit promptement des pièces du dé, et qu’il refusa de les montrer, jugèrent qu’il y avait de l’enchantement. On publia qu’il en était sorti un esprit, que tout le monde avait vu sous une forme sensible, et qui s’était évanoui sans nuire à personne. Beaulieu pénétra facilement la vérité. Mais il laissa les Indiens dans leur erreur ; et, loin de rendre aucun mauvais office à Carnero, il l’exhorta fortement à renoncer au jeu dont il ne pouvait plus espérer les mêmes avantages à la cour d’Achem[20].
Sous le règne de Jacques Ier, roi d’Angleterre, le nommé Lily fut accusé d’user de sortilège devant un juge peu éclairé, qui le condamna au feu. Lily n’était rien moins que sorcier ; son crime consistait à abuser de l’ignorance superstitieuse de ses concitoyens. Il osa s’adresser au souverain et lui présenter un placet écrit en grec. L’étude des langues était alors fort négligée en Angleterre. Un semblable placet parut un phénomène au monarque. — Non, dit-il, cet homme ne sera pas exécuté, je le jure, fût-il encore plus sorcier qu’on ne l’accuse de l’être. Ce que je vois, c’est qu’il est plus sorcier dans la langue grecque que tous mes prélats anglicans.
Un officier, d’un génie très-médiocre, envieux de la gloire d’un capitaine qui avait fait une belle action, écrivit à M. de Louvois que ce capitaine était sorcier. Le ministre lui répondit : « Monsieur, j’ai fait part au roi de l’avis que vous m’avez donné de la sorcellerie du capitaine en question. Sa Majesté m’a répondu qu’elle ignorait s’il était sorcier, mais qu’elle savait parfaitement que vous ne l’étiez pas. »
Il y eut à Salem, dans l’Amérique du Nord, en 1692, de singuliers symptômes qui tiennent à l’histoire de la sorcellerie. Beaucoup d’hypocondriaques voyaient des spectres, d’autres subissaient des convulsions rebelles aux médecins ; on attribua tout à la nécromancie, et Godwin, dans son Histoire des nécromanciens, donne sur ces faits étranges des détails étendus. Plusieurs femmes furent pendues comme accusées et convaincues d’avoir donné des convulsions ou fait apparaître des fantômes, « On voit constamment, dit Godwin, les accusations de ce genre suivre la marche d’une épidémie. Les vertiges et les convulsions se communiquent d’un sujet à un autre. Une apparition surnaturelle est un thème à l’usage de l’ignorance et de la vanité. L’amour de la renommée est une passion universelle. Quoique ordinairement placée hors de l’atteinte des hommes ordinaires, elle se trouve, dans certaines occasions, mise d’une manière inattendue à la portée des esprits les plus communs, et alors ils savent s’en servir avec une avidité proportionnée au peu de chances qu’ils avaient d’y parvenir. Quand les diables et les esprits de l’enfer sont devenus les sujets ordinaires de la conversation ; quand les récits d’apparition sont aux nouvelles du jour, et que telle ou telle personne, entièrement ignorée jusqu’alors, devient tout à coup l’objet de la surprise générale, les imaginations sont vivement frappées, on en rêve, et tout le monde, jeunes et vieux, devient sujet à des visions.
» Dans une ville comme Salem, la seconde en importance de la colonie, de semblables accusations se répandirent avec une merveilleuse rapidité. Beaucoup d’individus furent frappés de vertiges ; leurs visages et leurs membres furent contractés par d’effroyables contorsions, et ils devinrent un spectacle d’horreur pour ceux qui les approchaient. On leur demandait d’indiquer la cause de leurs souffrances ; et leurs soupçons ou leurs prétendus soupçons se portaient sur quelque voisin, déjà malheureux et abandonné, et pour cette cause en butte aux mauvais traitements des habitants de la ville. Bientôt les personnes favorisées de l’apparition surnaturelle formèrent une classe à part, et furent envoyées, aux dépens du public, à la recherche des coupables, qu’eux seuls pouvaient découvrir. Les prisons se remplirent des individus accusés. On s’entretint avec horreur d’une calamité qui n’avait jamais régné avec un tel degré d’intensité dans cette partie du monde, et, par une coïncidence malheureuse, il arriva qu’à cette époque beaucoup d’exemplaires de l’ouvrage de Baxter intitulé Certitude du monde des esprits parvinrent dans la Nouvelle-Angleterre. Des hommes honorables donnèrent crédit à cette ridicule superstition et entretinrent même la violence populaire par la solennité et l’importance qu’ils donnèrent aux accusations, et par le zèle et l’ardeur qu’ils déployèrent dans les poursuites. On observa dans cette occasion toutes les formes de la justice ; on ne manqua ni de juges, ni de jurés, grands ou petits, ni d’exécuteurs, encore moins de persécuteurs et de témoins. Du 10 juin au 22 septembre 1692, dix-neuf accusés furent pendus ; bien des gens avouèrent qu’ils pratiquaient la sorcellerie, car cet aveu paraissait la seule voie ouverte de salut. On vit des maris et des enfants supplier à genoux leur femme et leur mère de confesser qu’elles étaient coupables. On mit à la torture plusieurs de ces malheureuses en leur attachant les pieds au cou jusqu’à ce qu’elles eussent avoué tout ce qu’on leur suggérait.
» Dans cette douloureuse histoire, l’affaire la plus intéressante fut celle de Gilles Gory et de sa femme. Celle-ci fut jugée le 9 septembre et pendue le 22 ; dans cet intervalle on mit aussi le mari en jugement. Il affirma qu’il n’était point coupable. Quand on lui demanda comment il voulait être jugé, il refusa de répondre, selon la formule ordinaire, par Dieu et mon pays. Il observa qu’aucun de ceux qui avaient été précédemment jugés n’ayant été proclamé innocent, le même mode de procédure rendrait sa condamnation également certaine ; il refusa donc obstinément de s’y conformer. Le juge ordonna que, selon l’usage barbare prescrit en Angleterre, il fût couché sur le dos et mis à mort au moyen de poids graduellement accumulés sur toute la surface de son corps, moyen qu’on n’avait point encore mis en pratique dans l’Amérique du Nord. Gilles Gory persista dans sa résolution et demeura muet pendant toute la durée de son supplice. Tout s’enchaîna par un lien étroit dans cette horrible tragédie. Pendant fort longtemps les visionnaires n’étendirent leurs accusations que sur les gens mal famés ou qui ne tenaient qu’aux rangs inférieurs de la communauté. Bientôt cependant, perdant toute retenue, ils ne craignirent pas de portèr leurs accusations de sorcellerie sur quelques personnes appartenant aux premières familles et du caractère le moins suspect. Dès lors tout changea de face. Les principaux habitants reconnurent combien il serait imprudent de mettre leur honneur et leur vie à la merci de si misérables accusateurs. De cinquante-six actes d’accusation qui furent soumis au grand jury le 3 janvier 1693, on n’en trouva que vingt-six qui eussent quelque fondement, et on en écarta trente. Sur les vingt-six accusations auxquelles on donna suite, on ne trouva que trois coupables, et le gouvernement leur fit grâce. On ouvrit les prisons : deux cent cinquante personnes, tant de celles qui avaient fait des aveux que de celles qui étaient simplement accusées, furent mises en liberté, et on n’entendit plus parler d’accusations de ce genre. Les affligés, c’est ainsi qu’on nommait les visionnaires, furent rendus à la santé. Les apparitions de spectres disparurent complètement, et l’on ne s’étonna plus que d’une chose, ce fut d’avoir été victime d’une si horrible illusion. — Ces phénomènes de démence infernale en pays hostile à l’Église demanderaient une étude.
Sort. On appelle sort ou sortilège certaines paroles, caractères, drogues, etc., par lesquels les esprits crédules s’imaginent qu’on peut produire des effets extraordinaires, en vertu d’un pacte supposé fait avec le diable : ce qu’ils appellent jeter un sort. La superstition populaire attribuait surtout cette faculté nuisible aux bergers ; et cette opinion était sinon fondée, au moins excusée par la solitude et l’inaction où vivent ces sortes de gens. Voy. Maléfices, Charmes, Scopélisme, etc.
Les hommes ont de tout temps consulté le sort ou, si l’on veut, le hasard. Cet usage n’a rien de ridicule lorsqu’il s’agit de déterminer un partage, de fixer un choix douteux, etc. Mais les anciens consultaient le sort comme un oracle, et quelques modernes se sont montrés aussi insensés. Toutes les divinations donnent les prétendus moyens de consulter le sort.
Sortilèges. Voy. Sort.
Sotray, nom que les Solognots et les Poitevins donnent à un lutin qui tresse les crinières des chevaux.
Souad, goutte noire, germe de péché, inhérente depuis la chute originelle au cœur de l’homme, selon les musulmans, et dont Mahomet se vantait d’avoir été délivré par l’ange Gabriel, il dit aussi, dans le Koran, que Jésus et Marie sont les seuls êtres humains qui n’aient pas eu le Souad.
Sougai-Toyon, dieu du tonnerre chez les Yakouts ; il est mis par eux au rang des esprits malfaisants. C’est le ministre des vengeances d’Oulon-Toyon, chef des esprits.
Soulié (Frédéric). Dans les Mémoires du Diable, l’auteur a déployé un très-beau talent à faire malheureusement un mauvais livre en morale.
Souris. Le cri d’une souris était chez les anciens de si mauvais augure qu’il rompait les auspices. Voy. Rats.

Dans plusieurs contrées, les laboureurs cherchent à préserver leurs granges des souris par un procédé superstitieux que voici :
Ils prennent quatre œufs, qui doivent avoir été pondus le vendredi saint ; ils les placent aux quatre coins de la grange et aspergent ces quatre coins d’eau bénite du samedi saint et du samedi veille de la Pentecôte. Après cela, ils mettent en croix les deux premières gerbes de la moisson qui rentre et font le tas avec croyance que les souris ne pourront manger que ces deux gerbes mises en croix.
Souterrains (démons), démons dont parle Psellus, qui, du vent de leur haleine, rendent aux hommes le visage bouffi, de manière qu’ils sont méconnaissables.
« En Norvège, comme dans d’autres pays, on croit à des génies qui habitent sous terre. Voici, dit un écrivain anglais, ce qui me fut raconté très-sérieusement sur ces êtres surnaturels par la maîtresse de la maison où je logeais : « J’avais, me dit-elle, un oncle que l’on destinait à la profession des armes. Un jour, dans sa jeunesse, allant aux champs avec son père, il laissa tomber un couteau avant de sortir du logis, et, malgré les recherches les plus exactes, il ne put le retrouver. Peu de temps après, il partit pour les pays étrangers. Au bout de quinze ans, il revint en Norvège. Un soir qu’il se rapprochait de chez lui, se trouvant encore à dix lieues de la maison de son père, il se sentit fatigué, et entra dans une cabane peu éloignée du chemin, qui, en cet endroit, traversait une forêt. Il n’y avait dans l’habitation qu’une vieille femme, qui l’accueillit bien ; il était assis depuis peu d’instants lorsqu’il aperçut sur la table un couteau absolument semblable à celui qu’il avait perdu quinze ans auparavant. Il raconta le fait à la vieille et lui dit : « Si cette maison n’était pas aussi éloignée de la mienne, je croirais que ce couteau est le mien. — En effet, repartit la vieille, c’est lui : lorsque vous l’avez laissé tomber, il coupa la jambe de ma fille, qui, dans ce moment, sous la forme d’une taupe, courait sous la terre ; je vous empêchai alors de le retrouver en le changeant en un ver de terre que ma fille emporta. »
» Mon oncle s’aperçut qu’il était dans la compagnie d’un être souterrain qui, dans cette occasion, avait pris la figure humaine. Quand il voulut partir pour continuer sa route, la petite femme insista pour qu’il restât jusqu’au lendemain matin, l’assurant que ce retard ne lui ferait pas perdre une minute, parce que, s’il voulait lui promettre sa vache rousse avec les belles clochettes qu’elle portait à son collier, elle le transporterait chez lui sans qu’il bougeât de place. « Mais, reprit mon oncle, voilà quinze ans que je suis absent, et j’ignore s’il y a chez nous des vaches. — Il y en a sept, mon digne monsieur. — Je ne puis rien vous promettre, puisque s’il y a des vaches, elles ne m’appartiennent pas ; cependant je consens à passer la nuit ici. » Le lendemain, pendant qu’il déjeunait avec la vieille, on entendit le tintement d’une clochette. « Oh ! s’écria mon oncle en se levant de surprise, cette clochette me rappelle les jours de mon enfance ; c’est celle de la vache rousse dont vous parliez hier. — C’est fort possible, car je lui ai ordonné de venir ici ce matin. »
» Le déjeuner fini, mon oncle dit adieu à la vieille ; et en sortant de la cabane, il se trouva tout près du jardin de son père.
» On dit que ces êtres surnaturels n’ont pas le pouvoir de transformer un animal en un autre ; ils peuvent seulement diminuer la taille des animaux, afin de les emporter plus facilement sous terre. Je me contenterai de raconter à ce sujet une histoire à laquelle on ajoute généralement foi en Norvège, et qui même y a donné naissance au proverbe : « Souvenez-vous du bétail de l’évêque de Dronlheim. » On l’emploie souvent pour rappeler qu’il faut veiller attentivement sur ce qu’on possède. En voici l’origine.
» Il y a bien longtemps qu’un jour d’été un évêque de Drontheim envoya ses bestiaux pâturer dans la montagne ; c’étaient les plus beaux de toute la Norvège. À leur départ, le prélat recommanda expressément aux gardiens d’avoir constamment l’œil sur les animaux et de ne pas les perdre de vue, attendu que beaucoup d’êtres souterrains habitaient dans l’intérieur des montagnes de Rœraas. L’injonction de ne pas les perdre de vue se rapportait à la croyance qu’aussi longtemps que les yeux d’un homme sont fixés sur un animal les génies souterrains n’ont aucun pouvoir sur lui. Un jour, pendant que les bestiaux paissaient dans les montagnes, et que les pasteurs, assis dans différents endroits, n’en détournaient pas leurs regards, un élan d’une taille extraordinaire passa. Aussitôt les yeux des trois pasteurs se portèrent du bétail sur l’élan, et se tinrent un moment fixés sur lui ; quand ils retombèrent sur le troupeau, ils aperçurent les bestiaux réduits à la dimension de petites souris. Ces animaux, au nombre de trois cents, descendaient la montagne en courant, et avant que leurs gardiens pussent les atteindre, ils les virent tous entrer par une petite fente dans la terre, où ils disparurent. Ainsi, l’évêque de Drontheim perdit son bétail. »
Southcott (Jeanne), visionnaire anglaise du dernier siècle, qui se fit une secte avec des cérémonies bizarres. De temps à autre on entend encore parler de cette fanatique. Une centaine de sectaires se sont réunis dans un bois, il y a une trentaine d’années, auprès de Sydenham, et ont commencé leur culte superstitieux par le sacrifice d’un petit cochon noir, qu’ils ont brûlé pour répandre ses cendres sur leurs têtes. Ces fous disent et croient que Jeanne Southcott, qu’ils appellent la fille de Sion, est montée au ciel, et qu’elle reviendra avec le Messie. Elle avait annoncé qu’elle accoucherait d’un nouveau Messie ; mais elle est morte sans avoir rempli sa promesse ; ce qui n’empêche pas ses crédules disciples d’attendre sa résurrection, qui sera suivie de l’accouchement tant désiré. Les sectateurs de cette prétendue prophétesse portent, dans leurs processions, des cocardes blanches et des étoles en ruban jaune sur la poitrine. Le ruban jaune est, selon eux, la couleur de Dieu ; leur Messie se nommera le Shelo.
Souvigny. Une tradition populaire attribue aux fées la construction de l’église de Souvigny. Au milieu de la délicieuse vallée qu’arrose la petite rivière appelée la Queune, une laitière vit surgir cette église d’un brouillard du matin, avec ses aiguilles dentelées, ses galeries festonnées, et son portail à jour, à une place où la veille encore s’élevaient de beaux arbres et coulait une fontaine. Frappée de stupeur, la pauvre femme devint pierre ; on montre encore sa tête placée à l’angle d’une des tours. Il y a bien, en effet, quelque chose de féerique dans l’église de Souvigny. Un jour qu’il allait s’y livrer à ses études, M. Achille Allier y découvrit un curieux support de nervure ogivique ; c’était une femme d’une délicatesse de formes presque grecque, qui se tordait et jouait avec une chimère ; il lui sembla voir l’intelligence de l’artiste créateur de ce temple fantastique aux prises avec son caprice[21].
Sovas-Munusins (empoisonneurs et suceurs de sang), espèce de vampires, chez les Quojas ; esprits ou revenants qui se plaisent à sucer le sang des hommes ou des animaux. Ce sont les broucolaques de l’Afrique.
Spectres, sorte de substance sans corps, qui se présente sensiblement aux hommes, contre l’ordre de la nature, et leur cause des frayeurs. La croyance aux spectres et aux revenants, aussi ancienne que les sociétés d’hommes, est une preuve de l’immortalité de l’âme, et en même temps un monument de la faiblesse de l’esprit humain, abandonné à lui-même. Olaüs Magnus assure que, sur les confins de la mer Glaciale, il y a des peuples, appelés Pylapiens, qui boivent, mangent et conversent familièrement avec les spectres. Ælien raconte qu’un vigneron, ayant tué d’un coup de bêche un aspic fort long, était suivi en tous lieux par le spectre de sa victime !
Suétone dit que le spectre de Galba poursuivait sans relâche Othon, son meurtrier, le tiraillait hors du lit, l’épouvantait et lui causait mille tourments. Voy. Apparitions, Fantômes, Flaxbinder, Philinnion, Polycrite, Revenants, Vampires, etc.
Spectriana, recueil mal fait d’histoires et d’aventures surprenantes, merveilleuses et remarquables de spectres, revenants, esprits, fantômes, diables et démons ; manuscrit trouvé dans les catacombes. Paris, 1817; 1 vol. in-18.
Spéculaires, nom que l’antiquité donnait aux magiciens ou devins qui faisaient voir dans un miroir les personnes ou les choses qu’on désirait connaître.
Spée. Leibniz remarque que le P. Spée, jésuite allemand, auteur du livre intitulé Cautio criminalis circa processus contra sagas, déclarait qu’il avait accompagné au supplice beaucoup de condamnés comme sorciers et sorcières ; mais

Sper, en patois de Liège, revenant ou plutôt esprit ; de spiritus.
Sphinx, monstre fabuleux, auquel les anciens donnaient ordinairement un visage de femme avec un corps de lion couché. Il devinait les énigmes.
Spina (Alphonse), religieux franciscain, auteur du livre intitulé Fortalitium fidei, in-4o, imprimé à Nuremberg en 1494, et ailleurs. Il cite des femmes de la Gascogne et du Dauphiné qui se réunissaient la nuit dans des lieux déserts pour adorer le bouc (le diable) qui recevait ce culte entouré de flambeaux. Spina était un juif converti au milieu du quinzième siècle.
Spinello, peintre, né à Arezzo, dans la Toscane, au quatorzième siècle. À l’âge de soixante-dix-sept ans, il s’avisa de peindre la chute des mauvais anges. Il représenta Lucifer sous la forme d’un monstre tellement horrible, qu’il en fut lui-même frappé. Une nuit, dans un songe, il crut apercevoir le diable tel qu’il était dans son tableau, qui lui demanda d’une voix menaçante où il l’avait vu, pour le peindre si effroyable. Spinello, interdit et tremblant, pensa mourir de frayeur ; il eut toujours, depuis ce rêve, l’esprit troublé, la vue égarée ; et il se crut jusqu’à sa mort poursuivi par Lucifer.
Spirinx (Jean), astrologue belge du quinzième siècle, qui prédit à Charles le Téméraire que, s’il marchait contre les Suisses, il lui en arriverait mal ; à quoi le duc répondit que la force de son épée vaincrait les influences des astres : ce que lui, son épée et toute sa puissance ne purent pas faire, puisqu’il s’ensuivit sa défaite et sa mort.
Spiritisme. C’est la découverte que l’on croit récente des communications avec les esprits. On a publié là-dessus beaucoup d’ouvrages. De la plupart, il est sage de se défier. Nous nous bornerons à citer ici des emprunts à quelques journaux transatlantiques, reproduits dans plusieurs feuilles françaises. Un ou deux de ces fragments suffiront au lecteur pour comprendre.
Remontons aux premiers bruits que fit aux États-Unis le spiritisme. On lisait le 4 décembre 1850, dans la Voix de la Vérité :
Une société de magnétiseurs illuminés, établie à New-York, prétend avoir avec Swedenborg des relations suivies. Nous allons, grâce à un correspondant américain du Journal du magnétisme, les initier aux révélations ultramondaines qui se sont manifestées à quelques croyants de l’état de New-York en 1846.
Chez un M. John Fox, qui habitait à cette époque un petit village, des coups très-légers, comme si quelqu’un frappait sur le parquet, se faisaient entendre assez souvent la nuit, à ce point qu’il n’y eut plus moyen de dormir dans la maison. Pendant longtemps il fut impossible de découvrir la cause de ces coups mystérieux, lorsque, dans la nuit du 31 mars 1847, les jeunes filles de M. Fox, tenues en éveil par ces coups, se mettent, pour se distraire, à les imiter en faisant claquer leurs doigts. À leur grand étonnement, les coups répondent à chaque claquement. Alors la plus jeune se met à vérifier ce fait surprenant ; elle fait un claquement, on entend un coup ; deux, trois, etc.; toujours l’être invisible rend le même nombre de coups. Une des autres filles dit en badinant : « Maintenant, faites ce que je fais ; comptez un, deux, trois, quatre, cinq, six, etc., » en frappant chaque fois dans sa main le nombre indiqué. Les coups la suivirent avec la même précision ; mais, ce signe d’intelligence alarmant la jeune fille, elle cessa bientôt son expérience. Alors ce fut madame Fox qui dit : « Comptez dix. » Et sur-le-champ dix coups se font entendre. Elle ajoute ; « Voulez-vous me dire l’âge de Catherine ? (une de ses filles) ; » et les coups frappent précisément le nombre d’années qu’avait cette enfant.
Madame Fox demanda ensuite si c’était un être humain qui frappait ces coups ? Point de réponse. Puis elle dit ; « Si vous êtes un esprit, je vous prie de frapper deux coups, » et deux coups se font entendre. Elle ajoute : « Si vous êtes un esprit auquel on a fait du mal, répondez-moi de la même façon, et les coups répondent de suite. De cette manière on lia conversation, pour ainsi dire, et bientôt madame Fox parvint à savoir que c’était l’esprit d’un homme ; qu’il avait été tué dans cette maison plusieurs années auparavant ; qu’il était marchand colporteur, et que le locataire qui habitait la maison à cette époque l’avait tué pour s’emparer de son argent.
On pense bien que cette affaire n’en resta pas là. On accourut de toutes parts pour causer avec les coups, qui, à ce qu’il paraît, se firent entendre dans d’autres localités. On imagina de se servir de l’alphabet, et un coup se faisait entendre à la lettre voulue. On fit tout si bien, enfin, qu’on en vint à des expériences publiques, dans lesquelles les incrédules usèrent de tous les moyens pour s’assurer qu’il n’y avait là nulle supercherie.
Un jour que plusieurs personnes étaient réunies pour entendre les coups, les voilà qui demandent l’alphabet, et qui disent à l’assemblée ; « Vous avez tous un devoir à remplir. Nous voudrions que vous donnassiez plus de retentissement aux faits que vous examinez. » Cette demande étant très-inattendue, on se mit à en discuter les difficultés, le ridicule, l’incrédulité qu’il faudrait braver en attirant l’attention du public sur ce sujet bizarre. « Tant mieux, répondent les coups, votre triomphe n’en sera que plus éclatant. » Après avoir reçu de longues communications de cet interlocuteur invisible, une foule d’indications quant à ce qu’il fallait faire, et les assurances les plus positives que les coups se feraient entendre à toute l’audience, et que tout irait au mieux, ces personnes se décidèrent enfin à louer une grande salle déjà désignée par les coups, pour y faire entendre ces phénomènes au public, les coups insistant sur la nécessité d’une pareille manifestation, qui devait préparer les esprits à l’établissement d’un nouvel ordre de rapports entre les deux mondes, lequel aurait lieu à une époque prochaine.
Quelques magnétiseurs, entre autres un M. Capron, qui depuis a publié un livre sur la matière, donnèrent à ces faits un grand retentissement. On se passionna pour et contre. On consulta les somnambules sur le degré de confiance qu’on pouvait accorder aux révélations des coups, et, à ce qu’il paraît, aucune rivalité haineuse ne s’établit entre ces concurrents d’une nouvelle espèce. On demanda entre autres à un jeune garçon clairvoyant s’il pouvait voir ce qui faisait ces bruits. Il dit que oui. « Quelle est l’apparence de ces êtres ? — Ils ressemblent à la lumière, ils sont comme de la gaze ; je vois tout à travers leur corps. — Eh bien ! comment s’y prennent-ils pour faire ces bruits ; est-ce qu’ils frappent ? — Non, ils ne frappent pas du tout. » Puis, ayant paru regarder avec une grande attention pendant quelques instants, il ajoute : « Ils veulent ces bruits, et ces bruits se font partout où ils les désirent. »
Enfin, le 26 février 1850, le Rochester Daily Magnet publia sur ces faits le récit surprenant d’une entrevue qu’aurait eue la famille Fox avec l’esprit de Benjamin Franklin, qui désigna, dans une première conversation au moyen des coups, quelles personnes il fallait convoquer pour une séance solennelle, fixée au 20 février. À l’heure convenue (nous traduisons le récit du journal américain), on se réunit chez M. Draper ; mais quelques-uns se firent un peu attendre. On demanda d’abord les instructions de Benjamin Franklin, qui répondit : « Hâtez-vous ; faites tout de suite magnétiser madame Draper. » M. Draper la magnétisa, et elle ne fut pas plutôt endormie, qu’elle nous dit : « Il nous reproche d’être en retard ; il nous pardonne pour cette fois, mais il faut que nous soyons plus exacts à l’avenir. »
Alors la société se divise en deux groupes. MM. Jervis et Jones, mesdames Fox, Brown et mademoiselle Catherine s’installèrent dans une pièce éloignée, ayant deux portes fermées entre eux et le salon, où restaient mesdames Draper et Jervis, MM. Draper et Willet, et mademoiselle Margaretta. Bientôt des bruits télégraphiques se firent entendre dans les deux pièces, mais cette fois si forts, que mademoiselle Fox, tout effrayée, demande à la voyante : « Mais que veut dire tout ceci ? » Madame Draper, la figure radieuse d’animation, répond : « Il essaye les batteries. » Bientôt le signal demande l’alphabet, et on nous dit : « Maintenant, mes amis, je suis prêt. Il y aura de grands changements dans le cours du dix-neuvième siècle. Les choses qui vous paraissent maintenant obscures et mystérieuses rieuses deviendront claires à vos regards. Des merveilles vont être révélées. Le monde sera illuminé. Je signe : Benjamin Franklin.
» N’allez pas dans l’autre pièce. »
Nous attendions depuis quelques instants, lorsque M. Jervis se présenta dans le salon, et nous dit que les coups lui avaient ordonné de s’y rendre pour comparer ses notes avec les nôtres. Alors il lut ces notes, qui étaient comme il suit :
Nous demandons : « Est-ce tout comme vous le voulez ? — Oui. » Nous entendons le signal pour faire réciter l’alphabet, et on nous dit : « Il y aura de grands changements dans le cours du dix-neuvième siècle. Des choses qui vous paraissent maintenant obscures et mystérieuses deviendront claires à vos regards. Des merveilles vont être révélées. Le monde sera illuminé. Je signe : Benjamin Franklin.
» Allez dans le salon, et comparez vos notes avec celles des autres. »
Cette comparaison faite, M. Jervis retourne à son groupe, et alors, par l’alphabet, on leur dit : « Maintenant, allez tous dans le salon. » Ce qui fut fait ; et enfin la lecture générale des notes fut faite en présence de tous.
Après cette lecture, nous demandâmes : « Le docteur Franklin a-t-il encore quelque chose à nous dire ? — Il me semble que je vous ai donné bien assez de preuves pour aujourd’hui. — Ne faut-il pas garder le secret sur cette expérience ? — Non, il faut en mettre le récit dans les journaux. — Dans quels journaux ? — Dans le Democrat ou le Magnet. — Qui doit rédiger ce compte rendu ? — George Willet. »
Alors on nous fixa l’heure et le lieu d’un prochain rendez-vous, en nous indiquant encore deux autres individus qui devaient y assister avec nous.
On sait que les esprits ont causé avec les humains, au moyen des tables tournantes. Ensuite sont venus les mediums, personnages favorisés par les esprits qui font d’eux leurs organes. Nos journaux reproduisaient en janvier 1862 plusieurs nouvelles du spiritisme, venues aussi des relations américaines. En voici une :
« Le général Scott avait pour principal conseiller un beau guéridon en palissandre. D’après le Journal de Mayfield, ce n’est plus une table que consulte Beauregard, mais un medium en chair et en os, une jeune Hindoustani, nommée Elzur Bahoor.
» Cette fille de Brahma a commencé, dit-on, par être bayadère au service du fameux Nana-Sahib. Après le massacre de Gawnpore, elle resta dans cette ville assiégée par les Anglais, et tomba aux mains du général Havelock, qui l’envoya à Londres. Là elle fut douée de la faveur spirite, devint medium, connut M. Home et partit avec un riche planteur pour la Nouvelle-Orléans. Elle y émerveilla Beauregard, qui se l’attacha et s’abandonna entièrement à ses avis. Ce n’est que sur ses conseils qu’il a bombardé Sumter. Il lui doit la bataille de Bull-Run. Elle lui a prédit qu’il entrerait un jour vainqueur dans Washington. Sa puissance comme medium est si grande qu’elle évoque qui elle veut, vivant ou mort. On prétend même qu’elle a fait apparaître M. Lincoln à Jefferson Davis, abusant d’un moment où le président, abdiquant sa volonté, était endormi à la Maison-Blanche. On raconte que M. Lincoln a révélé tous ses secrets à son adversaire, a fait trois fois le tour de la chambre en voltigeant, puis s’est évanoui par la cheminée. On conçoit qu’après de pareilles preuves de puissance, Beau-regard ait confiance dans Elzur Bahoor. »
En tout cela, nous ne jugeons pas ; c’est l’affaire de l’Église. Le P. Matignon, dans un admirable petit livre[22], éclaire les âmes prudentes sur ces faits du spiritisme. Il voit Paris conserver à ce propos des séances hebdomadaires où l’on est reçu dès qu’on est sympathique aux esprits ; il voit, dans la plupart de nos grands centres, des réunions d’hommes influents évoquer les morts et ne recevoir des esprits trompeurs qui leur répondent que des illusions ou des fourberies. Dieu a condamné les évocations des morts ; les esprits qui se donnent des noms ne sont donc que ces puissances de l’air qui nous circonviennent pour nous entraîner. Voy. Tables.
Spodomantie ou Spodanomancie, divination par les cendres des sacrifices, chez les anciens. Il en reste quelques vestiges en Allemagne. On écrit du bout du doigt, sur la cendre exposée à l’air, ce que l’on veut savoir ; on laisse la cendre ainsi chargée de lettres à l’air de la nuit, et le lendemain matin, on examine les caractères qui sont restés lisibles, et on en tire des oracles. Quelquefois le diable vient écrire la réponse. Voy. Cendres.
Spranger (Barthélemi), peintre d’Anvers qui se rendit célèbre au seizième siècle par un tableau connu sous le nom de tableau des sorciers.
Sprenger (Jacques), dominicain qui, avec son confrère Henri Institor, écrivit, d’après leurs propres expériences dans les affaires de sorcellerie, un livre qui a fait assez de bruit, sous le titre de Malleus maleficarum, Lyon, 1484, réimprimé plusieurs fois en divers formats et dans diverses collections, à Cologne, à Nuremberg, à Francfort, etc.
Spunkie, démon qui protège en Écosse les maraudeurs et les bandits. Il est errant et assez redouté[23].
Spurina. Suétone assure que l’astrologue Spurina prédit à César que les ides de mars lui seraient funestes. César se moqua de lui et fut assassiné dans la journée.
Squelette. Un chirurgien qui était au service du czar Pierre le Grand avait un squelette qu’il pendait dans sa chambre auprès de sa fenêtre.

Stadius, chiromancien qui, du temps de Henri III, exerçait son art en public. Ayant un jour été conduit devant le roi, il dit au prince que tous les pendus avaient une raie au pouce comme la marque d’une bague. Le roi voulut s’en assurer, et ordonna qu’on visitât la main d’un malheureux qui allait être exécuté ; n’ayant trouvé aucune marque, le sorcier fut regardé comme un imposteur et logé en prison[24].
Staffirs, spectres dangereux qui se montrent en formes de femmes blanches dans la Moldavie et la Valachie.
Stagirus, moine hérétique qui était souvent possédé. On rapporte que le diable, qui occupait son corps, apparaissait sous la forme d’un pourceau couvert d’ordure et fort puant[25].
Stalkers, lutin méchant qui hante les pays flamands.
Stanoska, jeune fille de Hongrie dont on raconte ainsi l’histoire. Un défunt nommé Millo était devenu vampire ; il reparaissait les nuits et suçait les gens. La pauvre Stanoska, qui s’était couchée en bonne santé, se réveilla au milieu de la nuit en s’écriant que Millo, mort depuis neuf

Stauffenberger, famille allemande qui compte parmi ses grand’mères une ondine, ou esprit des eaux, laquelle s’allia au treizième siècle à un Stauffenberger.
Stéganographie ou Sténographie, art d’écrire en chiffres ou abréviations d’une manière qui ne puisse être devinée que par ceux qui en ont la clef. Trithème a fait un traité de sténographie, que Charles de Bouelles prit pour un livre de magie et l’auteur pour un nécromancien. On attribuait autrefois à la magie tous les caractères qu’on ne pouvait comprendre ; et beaucoup de gens, à cause de son livre, ont mis le bon abbé Trithème au nombre des sorciers.
Steiner (Véronique). Nous extrairons l’histoire de cette pauvre fille du chapitre xiii du livre VII de la Mystique de Görres : « Elle demeurait au château de Starenberg en Autriche, chez les seigneurs de Taxis, lorsqu’en 1574 on la reconnut évidemment possédée de plusieurs démons. On la soumit aux exorcismes. Quatre de ces esprits sortirent d’abord en exhalant une telle puanteur que quelques personnes présentes tombèrent en défaillance. Mais elle n’était pas délivrée. Les exorcistes ordonnèrent aux démons d’éteindre chacun une lumière, à mesure qu’ils sortiraient. On entendit alors un bruit inexplicable dans le corps de la jeune fille. Son visage, sa poitrine et son cou s’enflèrent énormément ; son corps se ramassa en pelote, et trente démons sortirent, en éteignant tous les cierges, l’un après l’autre. La possédée resta quelque temps comme morte ; mais elle se releva délivrée.
Steinlin (Jean). Le 9 septembre 1625, Jean Steinlin mourut à Altheim, dans le diocèse de Constance. C’était un conseiller de la ville. Quelques jours après sa mort, il se fit voir pendant la nuit à un tailleur nommé Simon Bauh, sous la forme d’un homme environné de flammes de soufre, allant et venant dans la maison, mais sans parler. Bauh, que ce spectacle inquiétait, lui demanda ce qu’on pouvait faire pour son service ; et le 17 novembre suivant, comme il se reposait la nuit dans son poêle, un peu après onze heures du soir, il vit entrer le spectre par la fenêtre, lequel dit d’une voix rauque : — Ne me promettez rien, si vous n’êtes pas résolu d’exécuter vos promesses. — Je les exécuterai, si elles ne passent pas mon pouvoir, répondit le tailleur. — Je souhaite donc, reprit l’esprit, que vous fassiez dire une messe à la chapelle de la Vierge de Botembourg ; je l’ai vouée pendant ma vie, et ne l’ai pas fait acquitter ; de plus, vous ferez dire deux messes à Altheim, l’une des défunts et l’autre de la sainte Vierge ; et comme je n’ai pas toujours exactement payé mes domestiques, je souhaite qu’on distribue aux pauvres un quarteron de blé.
Le tailleur promit de satisfaire à tout. L’esprit lui tendit la main, comme pour s’assurer de sa parole, mais Simon, craignant qu’il ne lui arrivât quelque chose, présenta le banc où il était assis, et le spectre, l’ayant touché, y imprima sa main, avec les cinq doigts et les jointures, comme si le feu y avait passé et y eût laissé une impression profonde. Après cela, il s’évanouit avec un si grand bruit qu’on l’entendit à trois maisons plus loin. Ce fait est rapporté dans plusieurs recueils.
Sternomancie, divination parle ventre. Ainsi on savait les choses futures lorsque l’on contraignait un démon ou un esprit à parler dans le corps d’un possédé, pourvu qu’on entendît distinctement. C’était ordinairement de la ventriloquie.
Stiffels. Nous empruntons cette anecdote à une publication anonyme, que les petits journaux, d’ordinaire plus spirituels que les grands, ont mise en lumière :
« Il y avait, en 1544, un prédicant rauque et bourru, nommé Stiffels, fou de cabale et croyant à la divination par la magie, qui se fourra dans la cervelle que le monde n’avait plus que pour un an à demeurer sur le globe, dont nous ne sommes après tout que les locataires. Il consulta les nombres, les étoiles, et les virgules de la Bible ; les astres et les chiffres s’entendirent pour le mystifier.
» Il monta donc en chaire et prêcha. Il

» Alors toutes les passions éclatèrent à la fois. L’expectative de l’absolution, que les ministres protestants donnaient avec facilité, encouragea le désordre. Les villages de la Saxe devinrent une véritable kermesse, où l’on but au jugement dernier, au grand branlebas de l’univers, à l’espoir de se retrouver frais et vermeils dans le paradis.
» Les laboureurs brisèrent les charrues ; les vignerons se chauffèrent avec les échalas ; on avait assez de blé pour vivre jusque-là, assez de vin pour se griser au jour le jour. La propriété devint une chimère. Il n’y avait plus qu’à s’en donner jusque par-dessus les oreilles, sauf à se faire habilement absoudre au moment préfix. On s’en donna ferme.
» Cependant le jour arriva. On fit alors un feu de joie de ses meubles, on lâcha les bestiaux dans les plaines ; et, sur la fin de cette dernière orgie, qui devait être suivie de ce qu’on appela depuis lors le grand quart d’heure de Rabelais, on se précipita dans le temple, où Stiffels distribuait des bénédictions en masse.
» Au coup de midi, voilà de grands nuages qui se rassemblent de tous les points de l’horizon, sillonnés de pâles éclairs et de roulements sinistres. Le jour s’efface, les ténèbres gagnent. Il fait nuit. Une immobilité menaçante se répand sur tous les objets, ciel, terre, arbres ; le vent tombe et se tait. L’air est allumé par des exhalaisons ardentes et souterraines qui se dégagent des entrailles du sol, comme des âmes échappées de la tombe. Pas une feuille ne bouge, pas un oiseau ne bat de l’aile, pas un souffle ne ride les eaux ; tout est noir et tout est lumineux à la fois, car bientôt le firmament s’affaisse lui-même, comme une voûte que le reflet d’une étincelle embrase. Une psalmodie commence à la lueur des cierges qui flambent avec timidité. Stiffels seul a le courage d’élever la voix. À cette voix, des commotions effroyables répondent ; c’est la foudre qui tonne de concert avec le glas des clochers qui tremblent et qui sonnent le tocsin sans que l’on y touche. Le vitrail de l’église, assiégé par la grêle, plie et se brise avec fracas : des tourbillons de feuilles, de grêlons et de poussière éteignent les cierges, aveuglent les pécheurs épouvantés ; leur foule tombe à genoux sous le vitrail que l’ouragan éparpille à travers le parvis, au milieu des femmes et des enfants qui se répandent en cris affreux. Le monde est à l’agonie !…
» Trois minutes après, il faisait un temps magnifique. Un arc-en-ciel immense se dressa sur l’orage dont la colère parcourait la Saxe. À ce signe de la miséricorde céleste, les premiers paysans qui revinrent de leur frayeur, en reprenant leur incrédulité, demandèrent à Stiffels ce que cette mauvaise plaisanterie voulait dire. Le prédicateur essaya de leur démontrer que la cabale était formelle, le pronostic d’une certitude mathématique ; mais après avoir écouté en hochant la tête, furieux d’avoir gaspillé leur patrimoine, et de s’en être donné de façon à se trouver dans la misère la plus profonde, ils se mirent à vouloir pendre le démonstrateur qui ne voulait pas en avoir le démenti. Stiffels épouvanté se sauva de son mieux à Vittemberg, non sans gourmades, il raconta l’histoire à Luther.
» — Ah ! lui dit Luther, s’il y avait quelque chose de certain, je ne serais pas fâché de l’apprendre moi-même. Prédire est bon, mais il faut prédire sans se compromettre. Pourquoi, d’avance, ne pas vous être porté fort d’essayer de désarmer la colère du ciel ? Vous avez gâté le métier, mon ami. Apprenez la fin du métier avant de vous mêler de prédire la fin du monde. — Stiffels trouva juste le raisonnement de l’hérétique et mourut fou à l’hôpital » (à Iéna en 1567). Il avait 58 ans.
Stoffler, mathématicien et astrologue allemand, qui florissait vers la fin du quinzième siècle. Il annonça qu’il y aurait un déluge universel au mois de février 1524 ; Saturne, Jupiter, Mars et les Poissons devaient être en conjonction. Cette nouvelle porta l’alarme dans l’Europe : tous les charpentiers furent requis pour construire ga-liotes, nacelles et bateaux ; chacun se munissait de provisions, lorsque le mois de février 1524 arriva. Il ne tomba pas une goutte d’eau ; jamais il n’y avait eu de mois plus sec. On se moqua de Stoffler ; mais on n’en fut pas plus raisonnable : on continua de croire aux charlatans, et Stoffler continua de prophétiser[26]. Il précédait Stiffels.
Stoïchéomancie, divination qui se pratiquait en ouvrant les livres d’Homère ou de Virgile, et prenant oracle du premier vers qui se présentait. C’est une branche de la rhapsodomancie.

Stolas, grand prince des enfers, qui apparaît sous la forme d’un hibou ; lorsqu’il prend celle d’un homme et qu’il se montre devant l’exorciste, il enseigne l’astronomie, ainsi que les propriétés des plantes et la valeur des pierres précieuses. Vingt-six légions le reconnaissent pour général[27].
Stolisomancie, divination par la manière de s’habiller. Auguste se persuada qu’une sédition militaire lui avait été prédite le matin, par la faute de son valet, qui lui avait chaussé le soulier gauche au pied droit.
Stollenwurms, énormes serpents noirs qui ont deux, quatre ou six pattes, une tête de griffon, avec crête couleur de feu. Personne ne les a jamais vus. Mais l’on vous dira, dans l’Oberland bernois, qu’ils viennent la nuit teter les vaches dans les prairies, et que la présence d’un coq blanc les écarte.
Strasite, pierre fabuleuse à laquelle on attribuait la vertu de faciliter la digestion.
Stratagèmes. On lit dans les Récréations mathématiques et philosophiques d’Ozanam (tome IV, page 177) un trait qui prouve que l’usage du phosphore naturel ne fut pas entièrement inconnu aux anciens. Kenneth, deuxième roi d’Écosse, monta, en 833, sur le trône de son père Alpin, tué indignement par les Pietés révoltés.
Voulant soumettre ces montagnards farouches, ennemis de toute domination, il proposa à toute sa noblesse et à son armée de les combattre. La cruauté des Pietés et leurs succès dans la dernière guerre épouvantaient les Écossais ; ils refusèrent de marcher contre eux. Pour parvenir à les résoudre, il fallut que Kenneth recourût à la ruse. Il fait inviter à des fêtes, qui devaient durer plusieurs jours, les principaux gentilshommes du royaume et les chefs de l’armée. Il les reçoit avec la plus grande bienveillance, les comble de caresses, leur prodigue les festins et les jeux, l’abondance et la délicatesse.
Un soir que la fête avait été plus brillante et le festin plus somptueux, le roi, par son exemple, invite ses convives aux douceurs du sommeil, après l’excès des vins les plus généreux. Déjà le silence régnait par tout le palais ; tous dormaient profondément, quand des hurlements épouvantables retentissent. Étourdis parle vin, par le sommeil et par un bruit si étrange, tous sautent en bas du lit et chacun court à sa porte. Ils aperçoivent le long des corridors des spectres imposants, affreux, tout en feu, armés de bâtons enflammés et soufflant dans une grande corne de bœuf, pour pousser des beuglements terribles et pour faire entendre ces paroles : Vengez sur les Pietés la mort du roi Alpin ; nous sommes envoyés du ciel pour vous annoncer que sa justice est prête à punir leurs crimes.
Comme il ne fut pas difficile d’en imposer à des gens assoupis par le sommeil et par le vin, épouvantés par un spectacle d’autant plus effrayant qu’il se présentait à des hommes qui n’étaient rien moins que physiciens, le stratagème eut tout l’effet que le roi s’en était promis. Le lendemain, dans le conseil, ces seigneurs se rendent compte de leur vision ; et, le roi assurant avoir entendu et vu la même chose, on convient d’une voix unanime d’obéir au ciel, de marcher contre les Pietés, qui, vaincus en effet trois fois de suite, sont passés au fil de l’épée : l’assurance de la victoire que l’on avait en marchant au combat eut beaucoup de part à ces succès. Ainsi Kenneth sut mettre à profit la connaissance qu’on lui avait donnée des phosphores naturels. Tout ce manège consistait à avoir choisi de grands hommes couverts de peaux de grands poissons dont les écailles luisent extraordinairement la nuit, et à les avoir munis de grands bâtons de bois pourri, appelé communément bois mort, lequel est resplendissant au milieu des ténèbres.
Strauss, écrivain allemand qui voit des mythes dans les faits de l’histoire les plus solidement établis. Un savant du même pays et du même nom (est-ce le même ?) prétend, au moyen d’aliments et de condiments spéciaux, faire penser les ours, parler les chiens, chanter les poissons ; en un mot, spiritualiser (c’est son mot) ces pauvres êtres en qui Descartes ne voyait que des machines. Les amis de cet homme, ont publié son portrait que nous donnons page 637, en faisant observer que le nom de Strauss, en vieil allemand, signifie menteur.
Stryges. C’étaient de vieilles femmes chez les anciens. Chez les Francs, nos ancêtres, c’étaient des sorcières ou des spectres qui mangeaient les vivants. Il y a même dans la loi salique un article contre ces monstres : « Si une stryge a mangé un homme et qu’elle en soit convaincue, elle payera une amende de huit mille deniers, qui font deux cents sous d’or. » Il paraît que les stryges étaient communes au cinquième siècle, puisqu’un autre article de la même loi condamne à cent quatre-vingt-sept sous et demi celui qui appellera une femme libre stryge ou prostituée. Comme ces stryges sont punissables d’amende, on croit généralement que ce nom devait s’appliquer, non à des spectres insaisissables, mais exclusivement à des magiciennes. Il y eut, sous prétexte de poursuites contre les stryges, des excès qui frappèrent Charlemagne. Dans les Capitulaires qu’il composa pour les Saxons, ses sujets de conquête, il condamne à la peine de mort ceux qui auront fait brûler des hommes ou des femmes accusés d’être stryges. Le texte se sert des mots stryga vel masca ; et l’on croit que ce dernier terme signifie, comme larva, un spectre, un fantôme, peut-être un loup-garou. On peut remarquer, dans ce passage des Capitulaires[28], que c’était une opinion reçue chez les Saxons qu’il y avait des sorcières et des spectres (dans ce cas des vampires) qui mangeaient ou suçaient les hommes vivants ; qu’on les brûlait, et que, pour se préserver désormais de leur voracité, on mangeait la chair de ces stryges ou vampires. Quelque chose de semblable s’est vu dans le traitement du vampirisme au dix-huitième siècle. Ce qui doit prouver encore que les stryges des anciens étaient quelquefois des vampires, c’est que, chez les Russes, et dans quelques contrées de la Grèce moderne où le vampirisme a exercé ses ravages, on a conservé aux vampires le nom de stryges. Voy. Vampires.

Stuffe (Frédéric). Sous Rodolphe de Habsbourg, il y eut en Allemagne un magicien qui voulut se faire passer pour le prince Frédéric Stuffe. Avec le secours des diables, il avait tellement gagné les soldats que les troupes le suivaient au moindre signal, et il s’était fait aimer en leur fascinant les yeux. On ne doutait plus que ce ne fût le vrai Frédéric, lorsque Rodolphe, fatigué des brigandages que ce sorcier exerçait, lui fit la guerre. Le sorcier avait pris la ville de Cologne ; mais, ayant été contraint de se réfugier à Wetzlar, il y fut assiégé ; et comme les choses étaient aux dernières extrémités, Rodolphe fit déclarer qu’on eût à lui livrer le faux prince pieds et poings liés, et qu’il accorderait la paix. La proposition fut acceptée : l’imposteur fut conduit devant Rodolphe, qui le condamna à être brûlé comme un sorcier[29].
Stumf (Pierre), misérable qui, uni vingt ans à un démon succube, en avait obtenu une ceinture au moyen de laquelle il prenait tout à fait la forme d’un loup. Il avait, sous cette forme, égorgé quinze enfants, mangé leur cervelle, et il allait manger deux de ses belles-filles lorsqu’il fut exécuté à Bibourg, en Bavière[30].
Styx, fontaine célèbre dans les enfers des païens.
Succor-Bénoth, chef des eunuques de Belzébuth, démon de la jalousie.
Succubes, démons qui prennent des figures de femmes. On trouve dans quelques écrits, dit le rabbin Élias, que, pendant cent trente ans, Adam fut visité par des diablesses, qui accouchèrent de démons, d’esprits, de lamies, de spectres, de lémures et de fantômes. Sous le règne de Roger, roi de Sicile, un jeune homme, se baignant au clair de la lune avec plusieurs autres personnes, crut voir quelqu’un qui se noyait, courut à son secours, et ayant retiré de l’eau une femme, en devint épris, l’épousa et en eut un enfant. Dans la suite, elle disparut avec son enfant, sans qu’on en ait depuis entendu parler, ce qui a fait croire que cette femme était un démon succube. Hector de Boëce, dans son histoire d’Écosse, rapporte qu’un jeune homme d’une extrême beauté était poursuivi par une jeune démone, qui passait à travers sa porte fermée et venait lui offrir de l’épouser. Il s’en plaignit à son évêque, qui le fit jeûner, prier et se confesser, et la beauté d’enfer cessa de lui rendre visite. Delancre dit qu’en Égypte, un honnête maréchal ferrant étant occupé à forger pendant la nuit, il lui apparut un diable sous la forme d’une belle femme. Il jeta un fer chaud à la face du démon, qui s’enfuit.
Les cabalistes ne voient dans les démons succubes que des esprits élémentaires. Voy. Incubes, Abrahel, etc.
Sucre. Les Grecs ont, à la vérité, connu le sucre, mais seulement comme un article rare et précieux, et Théophraste, le premier, en fait mention. On l’appelait le sel indien. Cependant les Chinois connaissaient déjà l’art de le raffiner. De la Chine, le sucre fut porté vers l’Inde occidentale, où il reçut le nom qu’il porte encore aujourd’hui, succar. Parmi les peuples européens du moyen âge, ce furent les Portugais qui connurent les premiers le sucre dans les ports de l’Inde.
Les Indiens racontaient des merveilles de la vertu du sucre ; ils cherchèrent à induire les Portugais en erreur sur son origine. Mille contes fabuleux avaient couru à ce propos en Europe. Les savants l’appelaient miel de l’Orient. Cependant on objectait qu’on le découvrait dans le miel ordinaire. Les théoriciens répondaient qu’il ne fallait pas s’en laisser imposer par les praticiens, et que ce miel était une espèce de manne qui tombe du ciel en Inde. Il n’y avait rien à opposer à cet argument : la blancheur, la pureté, la suavité extraordinaire de ce remarquable produit, semblaient donner de l’appui à cette assertion.
La chimie s’occupa de l’analyse de la nouvelle manne, et conclut que c’était la résine qui s’écoule d’un tronc d’arbre à la manière de la résine du cerisier. C’est ainsi qu’on extravaguait sur l’origine du sucre ; le vulgaire ne manquait pas d’y ajouter du romanesque ; il regardait le sucre comme un ouvrage des sorcières indiennes, qui le tiraient des cornes de la lune pendant son premier quartier. Enfin Marco Polo vint étonner le monde européen lorsque, de retour de ses voyages, il entra dans Venise la canne à sucre en main, et expliqua le secret de préparer le sucre.
La culture de la canne à sucre fut introduite en Arabie ; de là, comme le café, on la transplanta dans les régions méridionales, en Égypte, en Sicile, à Madère, à Hispaniola, au Brésil, etc.
Suceurs (démons). Quoique immortels, dit Görres, les démons sont appauvris dans leur être et cherchent ailleurs ce qui leur manque. Ils le trouvent en partie dans l’homme ; or celui-ci ne peut perdre malgré lui ce qu’il a reçu comme portion de son être. Mais si les démons parviennent à obtenir son consentement, ils exercent un empire absolu sur le domaine qu’il leur a cédé, et le froid de la mort se réveille à la chaleur de la vie. Or la vie est dans le sang. C’est donc en suçant le sang de l’homme que les démons se nourrissent de la vie[31]. Ils apparaissent quelquefois en vampires ; et si on lit Homère, on voit, dans les sacrifices d’Ulysse aux enfers, combien les ombres et les dieux infernaux étaient avides de sang.
Sueur. On dit qu’un morceau de pain placé sous l’aisselle d’une personne qui transpire devient un poison mortel, et que, si on le donne à manger à un chien, il devient aussitôt enragé. C’est une erreur. La sueur de l’homme ne tue pas plus que sa salive.
Summanus, souverain des mânes dans l’ancienne mythologie.
Sunnyass, fanatiques de l’Inde. Voyez Superstitions.
Supercherie. Henri Estienne raconte que de son temps un curé de village répandit pendant la nuit dans le cimetière des écrevisses sur le dos desquelles il avait attaché de petites bougies. À la vue de ces lumières errantes, tout le village fut effrayé et courut chez le pasteur. Il fit entendre que c’étaient sans doute les âmes du purgatoire qui demandaient des prières. Mais malheureusement on trouva le lendemain une des écrevisses que l’on avait oublié de retirer, et l’imposture fut découverte.
Ce petit conte de Henri Estienne est une de ces inventions calomnieuses que les protestants ont prodiguées en si grand nombre.
Superstitions. Saint Thomas définit la superstition : un vice opposé par excès à la religion, un écart qui rend un honneur divin à qui il n’est pas dû ou d’une manière qui n’est pas licite. Une chose est superstitieuse 1o lorsqu’elle est accompagnée de circonstances que l’on sait n’avoir aucune vertu naturelle pour produire les effets qu’on en espère ; 2o lorsque ces effets ne peuvent être raisonnablement attribués ni à Dieu ni à la nature ; 3o lorsqu’elle n’a été instituée ni de Dieu ni de l’Église ; b° lorsqu’elle se fait en vertu d’un pacte avec le diable. La superstition s’étend si loin que cette définition, qui est du curé Thiers, est très-incomplète. Il y a des gens qui jettent la crémaillère hors du logis pour avoir du beau temps ; d’autres mettent une épée nue sur le mât d’un vaisseau pour apaiser la tempête ; les uns ne mangent point de têtes d’animaux, pour n’avoir jamais mal à la tête ; les autres touchent avec les dents une dent de pendu ou un os de mort, ou mettent du fer entre leurs dents, pendant qu’on sonne les cloches le samedi saint, pour guérir le mal de dents. Il en est qui portent contre la crampe un anneau fait pendant qu’on chante la Passion ; ceux-ci se mettent au cou deux noyaux d’avelines joints ensemble contre la dislocation des membres ; ceux-là mettent du fil filé par une vierge ou du plomb fondu dans l’eau sur un enfant tourmenté par les vers. On en voit qui découvrent le toit de la maison d’une personne malade lorsqu’elle ne meurt pas assez facilement, que son agonie est trop longue et qu’on désire sa mort ; d’autres enfin chassent les mouches lorsqu’une femme est en travail d’enfant, de crainte qu’elle n’accouche d’une fille. Certains juifs allaient à une rivière et s’y baignaient en disant quelques prières ; ils étaient persuadés que si l’âme de leur père ou de leur frère était en purgatoire, ce bain la rafraîchirait.
Voici diverses opinions superstitieuses. Malheureux qui chausse le pied droit le premier. Un couteau donné coupe l’amitié. Il ne faut pas mettre les couteaux en croix ni marcher sur des fétus croisés. Semblablement, les fourchettes croisées sont d’un sinistre présage. Grand malheur encore qu’un miroir cassé une salière répandue, un pain retourné, un tison dérangé !… Certaines gens trempent un balai dans l’eau pour faire pleuvoir.
La cendre de la fiente de vache est très-sacrée chez les Indiens ; ils s’en mettent tous les matins au front et à la poitrine ; ils croient qu’elle purifie l’âme.
Quand, chez nous, une femme est en travail d’enfant, on vous dira, dans quelques provinces, qu’elle accouchera sans douleur si elle met la culotte de son mari. — Pour empêcher que les renards ne viennent manger les poules d’une métairie, il faut faire, dans les environs, une aspersion de bouillon d’andouille le jour du carnaval. — Quand on travaille à l’aiguille les jeudis et samedis après midi, on fait souffrir Jésus-Christ et pleurer la sainte Vierge. Les chemises qu’on fait le vendredi attirent les poux… Le fil filé le jour du carnaval est mangé des souris.

On ne doit pas manger de choux le jour de saint Étienne, parce qu’il s’était caché dans des choux. Les loups ne peuvent faire aucun mal aux brebis et aux porcs, si le berger porte le nom de saint Basile écrit sur un billet et attaché au haut de sa houlette. À Madagascar, on remarque, comme on le faisait à Rome, les jours heureux et les jours malheureux. Une femme de Madagascar croirait avoir commis un crime impardonnable si, ayant eu le malheur d’accoucher dans un temps déclaré sinistre, elle avait négligé de faire dévorer son enfant par les bêtes féroces, ou de l’enterrer vivant, ou tout au moins de l’étouffer.
On peut boire comme un trou, sans crainte de s’enivrer, quand on a récité ce vers :
Presque tous les articles de ce livre mentionnent quelque croyance superstitieuse. Nous citerons encore, avec un peu de désordre, plusieurs petits faits. Voici des notes de M. Marinier sur la Suède :
« Quand on enterre un mort, on répand sur le sentier qui va de sa demeure au cimetière des feuilles d’arbre et des rameaux de sapin. C’est l’idée de résurrection exprimée par un symbole. C’est le chrétien qui pare la route du tombeau. Quand vient le mois de mai, on plante à la porte des maisons des arbres ornés de rubans et de couronnes de fleurs, comme pour saluer le retour du printemps et le réveil de la nature. Quand vient Noël, on pose sur toutes les tables des sapins chargés d’œufs et de fruits, et entourés de lumières : image sans doute de cette lumière céleste qui est venue éclairer le monde. Cette fête dure quinze jours, et porte encore le nom de jul. Le jul était l’une des grandes solennités de la religion Scandinave. À cette fête, toutes les habitations champêtres sont en mouvement. Les amis vont visiter leurs amis, et les parents leurs parents. Les traîneaux circulent sur les chemins. Les femmes se font des présents ; les hommes s’assoient à la même table et boivent la bière préparée exprès pour la fête. Les enfants contemplent les étrennes qu’ils ont reçues. Tout le monde rit, chante et se réjouit, comme dans la nuit où les anges dirent aux bergers : Réjouissez-vous, il vous est né un sauveur. Alors aussi, on suspend une gerbe de blé en haut de la maison. C’est pour les petits oiseaux des champs qui ne trouvent plus de fruits sur les arbres, plus de graines dans les champs, Il y a une idée touchante à se souvenir, dans un temps de fête, des pauvres animaux privés de pâture, âne pas vouloir se réjouir sans que tous les êtres qui souffrent se réjouissent aussi.
» Dans plusieurs provinces de la Suède, on croit encore aux elfes qui dansent le soir sur les collines. Dans quelques autres, on a une coutume singulière. Lorsque deux jeunes gens se fiancent, on les lie l’un à l’autre avec la corde des cloches, et on croit que cette cérémonie rend les mariages indissolubles. »
Un nouveau voyage dans l’Inde nous fournit sur les superstitions de ces contrées de nombreux passages ; nous n’en citerons que quelques-uns.
« Lorsqu’un Indien touche à ses derniers moments, on le transporte au bord du Gange ; étendu sur la berge, les pieds dans l’eau, on lui remplit de limon la bouche et les narines ; le malheureux ne tarde pas à être suffoqué et à rendre le dernier soupir. Alors, ses parents, qui l’environnent, se livrent au plus frénétique désespoir ; l’air retentit de leurs cris ; ils s’arrachent les cheveux, déchirent leurs vêtements et poussent dans le fleuve ce cadavre encore chaud et presque palpitant, qui surnage à la surface jusqu’à ce qu’il devienne la proie des vautours et des chacals…
» Après avoir traversé plusieurs villes et villages, me voici devant Bénarès, la ville sainte des Hindous, le chef-lieu de leurs superstitions, où plusieurs princes ont des maisons habitées par leurs représentants, chargés défaire au nom de leurs maîtres des ablutions et les sacrifices prescrits par leur croyance.
» Le soleil n’est pas encore levé que les degrés du large et magnifique escalier en pierre de taille qui se prolonge jusqu’à l’eau, et qui à lui seul est un monument remarquable, sont chargés d’Hindous qui viennent prier et se baigner dans le Gange. Tous sont chargés de fleurs ; à chaque strophe de leurs prières, ils en jettent dans l’eau, dont la surface, au bout de quelques moments, est couverte de camellias, de roses, de mongris ; hommage que tous les sectateurs de Brahma rendent chaque jour au roi des fleuves.
» En parcourant les rues, qui sont toutes fort étroites, je vis une foule nombreuse se diriger vers une large avenue de manguiers, qui aboutissait à l’une des Payades. C’était un jour de grande solennité. Je parvins avec peine près de ce temple, où les plus étranges scènes s’offrirent à mes regards. Je me crus un moment entouré de malfaiteurs subissant la peine de leurs crimes, ou bien certainement de fous furieux ; les uns, véritables squelettes vivants, étaient depuis vingt années renfermés dans des cages de fer d’où ils n’étaient jamais sortis ; d’autres, insensés, suspendus par les bras, avaient fait vœu de rester dans cette position jusqu’à ce que ces membres, privés de sentiment, eussent perdu leur jeu d’articulation. Un de ces fanatiques me frappa par son regard sombre et farouche, qui décelait l’horrible angoisse qu’il éprouvait en tenant son poing constamment fermé, pour que ses ongles, en croissant, entrassent dans les chairs et finissent par lui percer la main. Chez ce peuple idolâtre, il existe des préjugés, des superstitions plus affreuses encore, entre autres l’horrible et barbare sacrifice des femmes sur le bûcher de leur mari défunt. Les lois sévères et l’influence morale des Anglais, à qui appartient une grande partie de cette immense contrée, ne diminuent pas vite ces coutumes absurdes et révoltantes. Mais ces sacrifices odieux ont encore lieu en secret, et le préjugé est tel que la malheureuse victime qui s’arrache au bûcher est rejetée de sa caste, maudite de sa famille, et traîne les jours qu’elle a voulu sauver dans l’ignominie, la misère et l’abandon.
» Chez tous les peuples qui n’ont pas reçu la lumière de l’Évangile et parmi les Indiens plus que partout ailleurs, une femme est regardée pour si peu de chose que les plus durs traitements, les travaux les plus pénibles lui sont réservés. Aussi s’habituent-ils difficilement à voir les femmes européennes entourées d’hommages et de respect.
» Bénarès, comme toutes les villes indiennes, offre le singulier mélange de toutes les superstitions des divers peuples de l’Orient. À leurs traits beaux et réguliers, à leurs membres musculeux, à leurs turbans blancs et à leurs larges pantalons, on reconnaît les sectateurs d’Ali et de Mahomet. On distingue les brahmes, adorateurs de Vichnou, à leur démarche grave et hautaine, à leur tête nue, aux lignes blanches, jaunes et rouges qu’ils portent sur le front, et qu’ils renouvellent tous les matins à jeun ; à leurs vêtements blancs drapés avec art sur leurs épaules ; enfin, à la marque la plus distinctive de leurs fonctions de brahmes, le cordon en écharpe qu’ils portent de gauche à droite, et qui se compose d’un nombre déterminé de fils, que l’on observe scrupuleusement. Il est filé sans quenouille, et de la main même des brahmes. Le cordon des nouveaux initiés a trois brins avec un nœud ; à l’âge de douze ans, on leur confère le pouvoir de remplir leurs fonctions ; ils reçoivent alors le cordon composé de six brins avec deux nœuds.
» Les Hindous sont divisés en quatre castes : la première est celle des brahmes ou prêtres ; la seconde celle des guerriers ; la troisième celle des agriculteurs ; la quatrième celle des artisans. Ces castes ne peuvent manger ni s’allier ensemble. Vient ensuite la caste la plus basse, la plus méprisée, la plus en horreur à tous les Hindous : c’est celle des parias, qui sont regardés comme des infâmes, parce qu’ils ont été chassés il y a des siècles peut-être des castes auxquelles ils appartenaient. Cette infamie se transmet de père en fils, de siècle en siècle. Quand un Hindou de caste permet à un paria de lui parler, celui-ci est obligé de tenir une main devant sa bouche, pour que son haleine ne souille pas le fier et orgueilleux Bengali.
» Le nombre des parias est si considérable que s’ils voulaient sortir de l’opprobre où on les tient, ils pourraient devenir oppresseurs à leur tour.
» Vers le milieu de la journée, dit ailleurs l’écrivain que nous transcrivons, nous arrivâmes près d’une vaste plaine, où se trouvaient réunis un grand nombre d’Hindous. Au centre s’élevait un mât ayant à son sommet une longue perche transversale fixée par le milieu. Quelques hommes, pesant sur l’un des bouts de la perche, la tenaient près du sol, tandis que l’autre extrémité s’élevait en proportion contraire. Un corps humain y était suspendu ; il paraissait nager dans l’air. Nous nous approchâmes du cercle formé par les spectateurs, et je vis avec le plus grand étonnement que ce malheureux n’était retenu dans sa position que par deux crocs en fer.
» Cet homme ayant été descendu et décroché, il fut remplacé par un autre sunnyass ; c’est sous ce nom qu’on désigne cette sorte de fanatiques. Loin de donner des signes de terreur, il s’avança gaiement et avec assurance au lieu du supplice. Un brahme s’approcha de lui, marqua la place où il fallait enfoncer les pointes de fer ; un autre, après avoir frappé le dos de la victime, avait introduit les crocs avec adresse, juste au-dessous de l’omoplate. Le sunnyass ne parut point en ressentir de douleur. Il plana bientôt au-dessus des têtes, prit dans sa ceinture des poignées de fleurs qu’il jeta à la foule en la saluant de gestes animés et de cris joyeux.
» Le fanatique paraissait heureux de sa position ; il fit trois tours dans l’espace de cinq minutes. Après quoi on le descendit, et les cordes ayant été déliées, il fut ramené à la pagode au bruit des tam-tams et aux acclamations du peuple.
» Que penser d’une religion qui veut de tels sacrifices ? Quels préjugés ! quel aveuglement ! On éprouve un sentiment douloureux au milieu de ce peuple privé de ces vérités consolantes, de ces pratiques si douces et si sublimes de la religion du Christ. Hâtons de nos vœux le moment où celui qui a dit au soleil : « Sortez du néant et présidez au jour, » commandera à sa divine lumière d’éclairer ces peuples assis à l’ombre de la mort.
» Tous les riches habitants de Madras possèdent de charmantes maisons de campagne entourées de jardins d’une immense étendue ; c’est un véritable inconvénient pour les visiteurs, qui sont souvent obligés de parcourir un espace de trois milles pour aller d’une maison à l’autre. En revenant un soir d’une de ces délicieuses propriétés fort éloignée de la ville, j’entendis des cris déchirants partir d’une habitation indienne devant laquelle je passais ; ils furent bientôt couverts par une musique assourdissante : le son si triste du tam-tam prévalait sur tout ce tumulte. Je sortis de mon palanquin, et montant sur une petite éminence qui se trouvait à quelques pas de la maison, je pus jouir tout à mon aise de l’étrange spectacle qui s’offrit à ma vue.
» Je vis sortir de cette habitation des musiciens deux à deux, et, dans le même ordre, suivaient une trentaine d’Indiens, tous coiffés d’un mouchoir en signe de deuil ; ils déroulèrent dans toute sa longueur une pièce d’étoffe blanche d’environ trente pieds, qu’ils étendirent avec soin sur le milieu de la route. Puis venait un groupe d’hommes paraissant chargés d’un lourd et précieux fardeau qu’ils portaient sur leurs épaules ; ils marchaient sur le tapis jonché de fleurs, que de jeunes filles jetaient à mesure qu’ils approchaient. Le fardeau était une jeune fille morte, richement parée, que l’on conduisait à sa dernière demeure. Le voyageur eut le bonheur d’entendre les chants de l’Église sur la fosse ; car on rendait à la terre les restes d’une chrétienne malabare.
On voit dans le même chapitre comment sont enterrés les Indiens sans honneur. Tippoo-Sahïb dut sa perte surtout à la perfidie. Son premier ministre, soupçonné d’avoir trahi sa cause, fut massacré par les soldats et enterré sous des babouches (souliers); ce qui, dans l’Orient, est la plus grande marque de mépris.
Sureau. Quand on a reçu quelque maléfice de la part d’un sorcier qu’on ne connaît point, qu’on pende son habit à une cheville, et qu’on frappe dessus avec un bâton de sureau : tous les coups retomberont sur l’échine du sorcier coupable, qui sera forcé de venir, en toute hâte, ôter le maléfice.
Surtur, génie qui doit, selon les Celtes, revenir, à la fin du monde, à la tête des génies du feu, précédé et suivi de tourbillons enflammés ; il pénétrera par une ouverture du ciel, brisera le pont Bifrost, et, armé d’une épée plus étincelante que le soleil, combattra les dieux, lancera des feux sur toute la terre, et consumera le monde entier. Il aura pour antagoniste le dieu Frey, qui succombera. Voy. Bifrost.
Sustrugiel, démon qui, selon les Clavicules de Salomon, enseigne l’art magique et donne des esprits familiers.
Suttée. C’est le nom qu’on donne dans l’Inde au sacrifice d’une veuve par le feu. Ces sacrifices sont rarement volontaires. Un voyageur anglais écrivait en 1836 :
« Une tentative de suttée a eu lieu le mois dernier (avril) hors des murs de Jeypore. J’en ai été averti à temps, et je vis un grand concours de peuple qui se portait de la ville à Murda-Haida. J’appris que ces gens allaient voir une suttée. La femme était sur le bûcher. Dès que les flammes l’y gagnèrent, elle s’en élança et y fut rejetée. Elle s’en arracha une seconde fois. On la replongea de nouveau dans le feu, elle s’en sauva une troisième fois. La police de Jeypore intervint alors, et renvoya l’affaire au Rawul, qui ordonna de ne plus employer la force. La veuve fut sauvée en conséquence, et puis se réfugia dans un de nos hôpitaux ; sans quoi elle eût été chassée du district. C’est, entre beaucoup d’autres preuves, une preuve nouvelle que le sacrifice est, dans un grand nombre de circonstances, un meurtre prémédité de la part des parents de la victime… »
Swedenborg (Emmanuel), célèbre visionnaire suédois.
« Nous ne savons guère, en France, qu’une chose de Swedenbord, dit M. Émile Souvestre, c’est que, dînant un jour de bon appétit dans une taverne de Londres, il entendit la voix d’un ange qui lui criait : « Ne mange pas tant ! » et qu’à partir de cet instant il eut des extases qui l’emportèrent régulièrement au ciel plusieurs fois par semaine. Selon quelques auteurs, l’illuminé suédois fut un des savants les plus distingués des temps modernes, et celui qui, après Descartes, remua le plus d’idées nouvelles. Ce fut Swedenborg qui, dans un ouvrage intitulé Opera philosophica et mineralia, publié en 1737, entrevit le premier la science à laquelle nous avons donné depuis le nom de géologie. La seconde partie de son livre contient un système complet de métallurgie, auquel l’Académie des sciences a emprunté tout ce qui a rapport au fer et à l’acier dans son Histoire des arts et métiers. Il composa aussi plusieurs ouvrages sur l’anatomie (ce qui est un nouveau trait de ressemblance entre lui et Descartes), et sembla même indiquer, dans un chapitre sur la pathologie du cerveau, le système phrénologique auquel le docteur Gall dut plus tard sa célébrité. Il publia enfin, sous le titre de Dædalus hyperboreus, des essais de mathématiques et de physique qui fixèrent l’attention de ses contemporains.

» Il parlait les langues anciennes, plusieurs langues modernes, les langues orientales, et passait pour le plus grand mécanicien de son siècle. Ce fut lui qui fit amener par terre, au siège de Frédérick-Hall, en se servant de machines de son invention, la grosse artillerie qui n’avait pu être transportée par les moyens ordinaires.
» Loin d’être écrits dans un langage mystique, comme on le croit communément, la plupart des traités religieux de Swedenborg se recommandent parla méthode, l’ordre et la sobriété. Ils peuvent se partager en quatre classes, que l’on n’aurait jamais dû confondre : la première renferme les livres d’enseignement et de doctrine ; la seconde, les preuves tirées de l’Écriture sainte ; la troisième, les arguments empruntés à la métaphysique et à la morale religieuse ; enfin, la quatrième, les révélations extatiques de l’auteur. Les ouvrages compris dans cette dernière catégorie sont les seuls qui affectent la forme apocalyptique, et dont l’extravagance puisse choquer. »
Swedenborg fit toutefois, dans sa mysticité, une religion, comme en font tous les illuminés. De même qu’il avait devancé les savants dans quelques découvertes mathématiques, il a été aussi le précurseur des philosophes d’aujourd’hui. Il a prétendu « réunir toutes les communions en un vaste catholicisme où toutes elles trouveront satisfaction ». D’après lui, « le principe de tout bien est dans un premier détachement de soi-même et du monde. Cet état constitue le bonheur présent et futur, c’est le ciel. L’amour exclusif de soi-même et du monde constitue au contraire la damnation, c’est l’enfer. »
Il annonce une nouvelle révélation de l’Esprit, et se pose le Christ d’un christianisme régénéré, comme font présentement quelques professeurs de philosophie. En même temps, Swedenborg se disait en communication avec des intelligences supérieures et avec les âmes de certains morts de ses amis. Ceux qui le copient aujourd’hui ont-ils les mêmes avantages ?
Sycomancie, divination par les feuilles de figuier. On écrivait sur ces feuilles les questions ou propositions sur lesquelles on voulait être éclairci : la feuille séchait-elle après la demande faite au devin par les curieux, c’était un mauvais présage ; et un heureux augure si elle tardait à sécher.
Sydonay. Voy. Asmodée.
Sylla. Comme il entrait à main armée en Italie, on vit dans l’air, en plein jour, deux grands boucs noirs qui se battaient, et qui, après s’être élevés bien haut, s’abaissèrent à quelques pieds de terre, et disparurent en fumée. L’armée de Sylla s’épouvantait de ce prodige, quand on lui fit remarquer que ces prétendus boucs n’étaient que des nuages épais formés par les exhalaisons de la terre. Ces nuages avaient une forme qu’on s’avisa de trouver semblable à celle du bouc, et qu’on aurait pu comparer également à celle de tout autre animal. On dit encore que Sylla avait une figure d’Apollon à laquelle il parlait en public pour savoir les choses futures.
Sylphes, esprits élémentaires, composés des plus purs atomes de l’air, qu’ils habitent.
L’air est plein d’une innombrable multitude de peuples, de figure humaine, un peu fiers en apparence, dit le comte de Gabalis, mais dociles en effet, grands amateurs des sciences, subtils, officieux aux sages, ennemis des sots et des ignorants. Leurs femmes et leurs filles sont des beautés mâles, telles qu’on dépeint les Amazones. Ces peuples sont les sylphes. On trouve sur eux beaucoup de contes. Voy. Cabale.
Sylvestre II. Gerbert, élevé sur la chaire de saint Pierre, sous le nom de Sylvestre, en 999, fut l’un des plus grands papes. Ses connaissances l’avaient mis si fort au-dessus de son siècle, que des hérétiques, ne pouvant nier sa grandeur, attribuèrent l’étendue de son savoir à quelque pacte avec le diable. Il faisait sa principale étude, après les sciences sacrées, des sciences mathématiques : les lignes et triangles dont on le voyait occupé parurent à des yeux ignorants une espèce de grimoire et contribuèrent à le faire passer pour un nécromancien. Ce ne fut pas seulement le peuple qui donna dans cette idée absurde. Un auteur des vies des papes a dit sérieusement que Sylvestre, possédé du désir d’être pape, avait eu recours au diable, et avait consenti à lui appartenir après sa mort, pourvu qu’il lui fit obtenir cette dignité ; ce qui est un mensonge infâme. Lorsque, par cette voie détestable, ajoute le même auteur stupide, il se vit élevé sur le trône apostolique, il demanda au diable combien de temps il jouirait de sa dignité ; le diable lui répondit par cette équivoque digne de l’ennemi du genre humain : « Vous en jouirez tant que vous ne mettrez pas le pied dans Jérusalem. » La prédiction s’accomplit. Ce pape, après avoir occupé quatre ans le trône apostolique, au commencement de la cinquième année de son pontificat, célébra les divins mystères dans la basilique de Sainte-Croix, dite en Jérusalem, et se sentit attaqué aussitôt après d’un mal qu’il reconnut être mortel. Alors il avoua aux assistants le commerce qu’il avait eu avec le diable et la prédiction qui lui avait été faite, les avertissant de profiter de son exemple et de ne pas se laisser séduire par les artifices de cet esprit malin. Nous n’avons pas besoin de faire observer que nous rapportons des contes impudemment menteurs, jusque dans leurs moindres circonstances. Puis il demanda, poursuivent les calomniateurs niais de ce grand pape, qu’après sa mort son corps fût coupé en quartiers, mis sur un chariot à deux chevaux, et inhumé dans l’endroit que les chevaux désigneraient en s’arrêtant d’eux-mêmes. Ses dernières volontés furent ponctuellement exécutées. Sylvestre fut inhumé dans la basilique de Latran, parce que ce fut devant cette église que les chevaux s’arrêtèrent…
Martinus Polonus a conté encore que Sylvestre II avait un dragon qui tuait tous les jours six mille personnes… D’autres ajoutent qu’autre-fois son tombeau prédisait la mort des papes par un bruit des os en dedans, et par une grande sueur et humidité de la pierre au dehors. On voit, par tous ces contes ridicules, qu’autrefois comme de nos jours, l’Église et ses plus illustres pontifes ont été en butte aux plus sottes calomnies.
Symandius, roi d’Égypte, qui, possesseur du grand œuvre, au dire des philosophes hermétiques, avait fait environner son monument d’un cercle d’or massif, dont la circonférence était de trois cent soixante-cinq coudées. Chaque coudée était un cube d’or. Sur un des côtés du péristyle d’un palais qui était proche du monument, on voyait Symandius offrir aux dieux l’or et l’argent qu’il faisait tous les ans. La somme en était marquée, et elle montait à 131,200,000,000 de mines[32].
Sympathie. Les astrologues, qui rapportent tout, aux astres, regardent la sympathie et l’accord parfait de deux personnes comme un effet produit par la ressemblance des horoscopes. Alors tous ceux qui naissent à la même heure sympathiseraient entre eux ; ce qui ne se voit point. Les gens superstitieux voient dans la sympathie un prodige dont on ne peut définir la cause. Les physionomistes attribuent ce rapprochement mutuel à un attrait réciproque des physionomies. Il y a des visages qui s’attirent les uns les autres, dit Lavater, tout comme il y en a qui se repoussent. La sympathie n’est pourtant quelquefois qu’un enfant de l’imagination. Telle personne vous plaît au premier coup d’œil, parce qu’elle a des traits que votre cœur a rêvés. Quoique les physionomistes ne conseillent pas aux visages longs de s’allier avec les visages arrondis, s’ils veulent éviter les malheurs qu’entraîne à sa suite la sympathie blessée, on voit pourtant tous les jours des unions de cette sorte aussi peu discordantes que les alliances les plus sympathiques en fait de physionomie.
Les philosophes sympathistes disent qu’il émane sans cesse des corpuscules de tous les corps, et que ces corpuscules, en frappant nos organes, font dans le cerveau des impressions plus ou moins sympathiques ou plus ou moins antipathiques.
Le mariage du prince de Condé avec Marie de Clèves se célébra au Louvre le 13 août 1572. Marie de Clèves, âgée de seize ans, de la figure la plus charmante, après avoir dansé assez longtemps et se trouvant un peu incommodée de la chaleur du bal, passa dans une garde-robe, où une des femmes de la reine mère, voyant sa chemise toute trempée, lui en fit prendre une autre. Un moment après, le duc d’Anjou (depuis Henri III), qui avait aussi beaucoup dansé, y entra pour raccommoder sa chevelure, et s’essuya le visage avec le premier linge qu’il trouva : c’était la chemise qu’elle venait de quitter. En rentrant dans le bal, il jeta les yeux sur Marie de Clèves, la regarda avec autant de surprise que s’il ne l’eût jamais vue ; son émotion, son trouble, ses transports, et tous les empressements qu’il commença de lui marquer étaient d’autant plus étonnants, que, depuis six mois qu’elle était à la cour, il avait paru assez indifférent pour ces mêmes charmes qui dans ce moment faisaient sur son âme une impression si vive et qui dura si longtemps. Depuis ce jour, il devint insensible à tout ce qui n’avait pas de rapport à sa passion. Son élection à la couronne de Pologne, loin de le flatter, lui parut un exil ; et quand il fut dans ce royaume, l’absence, au lieu de diminuer son amour, semblait l’augmenter ; il se piquait un doigt toutes les fois qu’il écrivait à cette princesse, et ne lui écrivait jamais que de son sang. Le jour même qu’il apprit la nouvelle de la mort de Charles IX, il lui dépêcha un courrier pour l’assurer qu’elle serait bientôt reine de France ; et lorsqu’il y fut de retour, il lui confirma cette promesse et ne pensa plus qu’à l’exécuter ; mais, peu de temps après, cette princesse fut attaquée d’un mal violent qui l’emporta. Le désespoir de Henri III ne se peut exprimer ; il passa plusieurs jours dans les pleurs et les gémissements, et il ne se montra en public que dans le plus grand deuil. Il y avait plus de quatre mois que la princesse de Condé était morte et enterrée à l’abbaye de Saint-Germain des Prés, lorsque Henri III, en entrant dans cette abbaye, où le cardinal de Bourbon l’avait convié à un grand souper, se sentit des saisissements de cœur si violents, qu’on fut obligé de transporter ailleurs le corps de cette princesse. Enfin il ne cessa de l’aimer, quelques efforts qu’il fît pour étouffer cette passion malheureuse[33]. Quelques-uns virent là un sortilège.
On raconte qu’un roi et une reine d’Arracan (dans l’Asie, au delà du Gange) s’aimaient éperdument ; qu’il n’y avait que six mois qu’ils étaient mariés, lorsque ce roi vint à mourir ; qu’on brûla son corps, qu’on en mit les cendres dans une urne, et que toutes les fois que la reine allait pleurer sur cette urne, ces cendres devenaient tièdes…
Il y a des sympathies d’un autre genre : ainsi Alexandre sympathisait avec Bucéphale ; Auguste chérissait les perroquets ; Néron, les étourneaux ; Virgile, les papillons ; Commode sympathisait merveilleusement avec son singe ; Héliogabale, avec un moineau ; Honorius, avec une poule[34], etc. Voy. Antipathie, Clef d’or, etc.
Syrènes. Vous ne croyez peut-être pas plus aux syrènes qu’aux géants, qu’aux dragons. Cependant il est prouvé aujourd’hui qu’il y a eu des dragons et des géants ; et dans un appendice très-attachant qui suit la légende de saint Oran (sixième siècle) dans le recueil de M. Amédée Pichot, intitulé le Perroquet de Walter Scott, l’auteur prouve, par une multitude de faits et de monuments, qu’il y a eu des syrènes en Bretagne.

Dans ce pays on les appelle les chanteuses des mers. Les marins disent avoir entendu le sifflement de la syrène : ce mot, chez eux, indique cette faculté de la nature par laquelle l’air pressé rend un son ; elle existe dans le ciel, sur la terre, dans les mers ; elle produit l’harmonie des sphères, le sifflement des vents, le bruit des mers sur le rivage. Le peuple se représente la faculté dont il s’agit comme une espèce de génie auquel il applique la forme d’une femme, d’une cantatrice habitante des airs, de la terre et des mers. De là les syrènes des anciens ; ils leur donnaient la figure d’une femme, et le corps d’un oiseau ou d’un poisson. Zoroastre appelait l’âme syrène, mot qui en hébreu signifie chanteuse[35].
Syrrochite, pierre précieuse dont, au rapport de Pline, les nécromanciens se servaient pour retenir les ombres évoquées.
Sytry ou Bitru, grand prince aux enfers ; il apparaît sous la forme d’un léopard, avec des ailes de griffon. Mais lorsqu’il prend la forme humaine, il est d’une grande beauté. C’est lui qui enflamme les passions. Il découvre, quand on le lui commande, les secrets des femmes, qu’il tourne volontiers en ridicule. Soixante-dix légions lui obéissent[36].
T
Taaora est, dans les traditions de Tahiti, le créateur de toutes choses. C’est lui qui fixa la terre, qui en appela les éléments, qui arrangea les mers et qui produisit les premières créatures humaines à sa ressemblance…
Tabac. Nicot, ambassadeur à Lisbonne, est le premier qui ait fait connaître le tabac en France ; le cardinal de Sainte-Croix l’introduisit en Italie ; le capitaine Drack en Angleterre. Jamais la nature n’a produit de végétaux dont l’usage se soit répandu aussi rapidement ; mais il a eu ses adversaires. Un empereur turc, un czar de Russie, un roi de Perse, le défendirent à leurs sujets, sous peine de perdre le nez ou même la vie. Il ne fut pas permis dans l’origine d’en prendre à l’église ; de même, à cause des éternuments qu’il provoque, on ne le prenait pas dans les réunions sérieuses de la cour. Jacques Ier, roi d’Angleterre, composa un gros livre pour en faire connaître les dangers. La faculté de médecine de Paris fit soutenir une thèse sur les mauvais effets de cette plante, prise en poudre ou en fumée ; mais le docteur qui présidait ne cessa de prendre du tabac pendant toute la séance.
Les habitants de l’île de Saint-Vincent croient, dit-on, que le tabac était le fruit défendu du paradis terrestre.
Tables tournantes. De même que le magnétisme il y a cent ans et le somnambulisme au commencement de ce siècle, la divination par les tables tournantes et les esprits frappeurs occupe aujourd’hui bien des têtes, et fait, depuis quelques années, le mystérieux entretien des
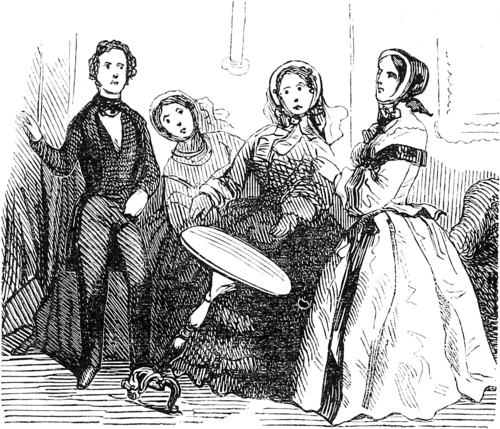
causeries. Cette évocation toute magique n’est pourtant pas nouvelle. Toutes les époques philosophiques ont fini par là. À ceux qui repoussent Dieu, athées ou panthéistes, pour exalter la matière, Dieu laisse aller le diable et ses légions ; et dès lors il n’est plus possible de ne pas s’incliner devant ce que dit saint Paul, que nous devons lutter contre les puissances invisibles qui circulent dans notre atmosphère. Tertullien parle des tables tournantes que l’on consultait de son temps ; mais il y avait alors d’autres tables divinatoires L’auteur du savant livre Des esprits, M. de Mirville, cite, du livre XXIX d’Ammien Marcellin, un passage que nous reproduisons ici :
« Patricius et Hilarius, traduits devant un tribunal romain pour crime de magie, se défendirent ainsi :
» Hilaire parla le premier : Nous avons fait, dit-il, avec des morceaux de laurier, à Limitation du trépied de Delphes, la petite table (mensulam) que vous voyez ici. Puis, l’ayant consacrée, suivant l’usage…, nous nous en sommes servis… Nous la posons au milieu de la maison, et plaçons proprement dessus un bassin rond fait de plusieurs métaux. Alors un homme vêtu de lin récite une formule de chant et fait un sacrifice au dieu de la divination, puis il tient suspendu au-dessus du bassin un anneau en fil de lin très-fin et consacré par des moyens mystérieux. Cet anneau saute successivement, mais sans confusion, sur plusieurs des lettres gravées et s’arrête sur chacune ; il forme aussi des vers parfaitement réguliers…, et ces vers sont les réponses aux questions qu’on a faites. Nous demandions un jour qui serait le successeur de l’empereur actuel…, l’anneau sauta et donna les deux syllabes Théo… Nous ne poussâmes pas plus loin, nous trouvant suffisamment avertis que ce serait Théodore. Les faits démentirent plus tard les magiciens, mais non la prédiction, car ce fut Théodose. »
Voilà bien, vous en conviendrez, tout ce qui se passe aujourd’hui. C’est la mensula qui joue le premier rôle ; c’est elle qui est consacrée ; le prêtre remplace notre medium (intermédiaire entre l’esprit évoqué et le curieux) ; et l’anneau tient lieu du crayon ; puis au-dessus de ces trois organes plane le dieu de la divination…
Le secret des tables divinatoires ne s’est jamais perdu. On lisait, il n’y a pas longtemps, dans l’Abeille de Saint-Pétersbourg, que les lamas, prêtres de la religion de Bouddha dans l’Inde, se servaient de tables pour deviner depuis un temps immémorial Voici un extrait de cet article, signé Alexis de Valdemar :
« Une personne vient-elle s’adresser au lama et lui porter sa plainte avec prière de lui découvrir l’objet qui lui a été volé, il est rare que le lama consente sur-le-champ à acquiescer à la demande. Il la renvoie à quelques jours, sous prétexte de préparations à son acte de divination.
» Quand arrive le jour et l’heure indiqués, il s’assied par terre devant une petite table carrée, place sa main dessus, et commence à voix basse la lecture d’un ouvrage thibétain. Une demi-heure après, le prêtre se soulève, détache sa main de la table, élève son bras, tout en lui conservant, par rapport à son corps, la position qu’il avait en se reposant sur la table ; celle-ci s’élève aussi suivant la direction de la main. Le lama se place alors debout, élève sa main au-dessus de sa tête, et la table se retrouve au niveau de ses yeux.
» L’enchanteur fait un mouvement en avant, la table exécute le même mouvement ; il court, la table le précède avec une rapidité telle que le lama a peine à la suivre. Après avoir suivi diverses directions, elle oscille un peu dans l’air et finit par tomber.
» De toutes les directions qu’elle a suivies, il en est une plus marquée, c’est de ce côté que l’on doit chercher les objets volés.
» Si l’on prêtait foi aux récits des gens du pays, on les retrouverait à l’endroit où tombe la petite table.
» Le jour où j’assistai à cette expérience, après avoir parcouru dans l’air un trajet de plus de 80 pieds, elle est tombée dans un endroit où le vol n’a pas été découvert. Toutefois, je dois avouer, en toute humilité, que le même jour un paysan russe, demeurant dans la direction indiquée, s’est suicidé. Ce suicide a éveillé des soupçons ; on s’est rendu à son domicile, et on y a trouvé tous les objets volés.
» Par trois différentes fois cette expérience échoua en ma présence, et le lama déclara que les objets ne pouvaient être retrouvés. Mais en y assistant pour la quatrième fois, j’ai été témoin du fait que je viens de vous rapporter. Cela se passait aux environs du bourg Élane, dans la province actuelle de Zabaïkal.
» N’osant pas me fier aveuglément à mes yeux, je m’expliquais ce fait par un tour d’adresse employé par le lama prestidigitateur. Je l’accusais de soulever la table au moyen d’un fil invisible aux yeux des spectateurs. Mais après un examen plus minutieux, je n’ai trouvé aucune trace de supercherie quelconque. De plus, la table mouvante était en bois de pin et pesait une livre et demie.
» À l’heure qu’il est, je suis persuadé que ce phénomène se produisait en vertu des mêmes principes qui font mouvoir les tables, les chapeaux, les clefs, etc. »
Nous avons rapporté, à l’article Spiritisme, l’origine et les progrès de la divination par les esprits, au moyen surtout des tables tournantes. Cette nouveauté éclata comme une contagion. Au bout de deux ans, on comptait aux États-Unis cinq cent mille personnes en communication avec les esprits. Il se publia là-dessus des livres ; et des journaux furent consacrés à cette science, qui ouvrait aux curieux des voies nouvelles. Les tables tournantes furent bientôt interrogées en Europe, et, depuis 1850, on s’en est occupé partout. Nous pourrions citer des faits incontestables. Des hommes sérieux les ont étudiés et n’ont vu en résumé, dans ces esprits, que les démons dont saint Paul nous rappelle que nous vivons entourés.
Et cependant, les savants de nos académies se refusent à l’évidence, dès qu’elle gêne et contrarie tant soit peu leur doctrine, comme le dit M. de Mirville. Il ajoute : « On aura peine à comprendre un jour le degré d’acharnement manifesté par les docteurs en sciences médicales contre toute idée surnaturelle ; on dirait vraiment qu’ils n’ont pas d’autres ennemis, pas d’autres maladies à combattre.
» Vous entendez, par exemple, M. le docteur Leuret s’écrier que : « Tout homme qui s’avise de croire à un esprit doit être immédiatement renfermé à Charenton. » — « Dans nos temps modernes, dit à son tour le docteur Lelut, sous peine d’être pris pour un fou halluciné, on ne saurait plus se prétendre en communication avec aucun agent surnaturel, quel qu’il soit… »
» Le docteur Parchappe est encore moins poli pour les simples qu’il attaque : « Graduellement affaibli de siècle en siècle, le surnaturalisme, dit-il, a été définitivement chassé du domaine de la science, dès la fin du siècle dernier, et c’est à peine aujourd’hui s’il se trouve encore accrédité chez un petit nombre d’individus appartenant aux classes les plus infimes et les plus ignorantes de nos sociétés civilisées…[37] »
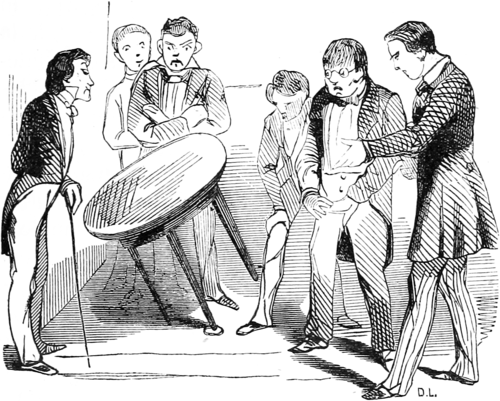
Nous ne répondrons pas impolitesses ; pour grossièretés. Nous ne dirons pas (ce serait ici superflu) qu’il y a, chez les savants surtout, des hommes qui ont des yeux pour ne pas voir et une intelligence pour ne pas comprendre ; nous ne les enfermerons pas à Charenton, comme ils nous y poussent. En renvoyant le lecteur à M. de Mirville, à M. Des Mousseaux, à la Table parlante, nous reviendrons aux coups frappés et aux esprits frappeurs.
Au moyen de ces coups, et à l’aide de la récitation de l’alphabet, les êtres invisibles qui les produisent sont parvenus à faire des signes affirmatifs et négatifs, à compter, à écrire des phrases et des pages entières. Mais c’est loin d’être tout. Non-seulement ils battent des marches, suivent le rhythme des airs qu’on leur indique ou que l’on chante avec eux, et imitent toutes sortes de bruits, tels que celui de la scie-, du rabot, d’une navette, de la pluie, de la mer, du tonnerre ; mais on les a entendus, dans certains cas, jouer des airs sur des violons ou guitares, sonner des cloches, et même exécuter, sans qu’aucun instrument soit présent, de magnifiques morceaux de musique militaire.
D’autres fois, et c’est là le genre de phénomènes qui a le plus de rapport avec ce qui se passe en ce moment, on voit, sans cause connue, ou sur la simple demande des assistants et sans que personne les touche, des meubles ou autres objets de toute nature et de toute dimension se mettre en mouvement, tandis que d’autres, au contraire, prennent une telle adhérence au plancher, que plusieurs hommes ne peuvent les ébranler. D’énormes tables parcourent les appartements avec une rapidité effrayante, bien qu’elles soient chargées de plusieurs centaines de livres ; d’autres s’agitent et s’inclinent de plus de 45 degrés, sans que les menus objets qui les couvrent se renversent ; d’autres sautent sur un pied et exécutent une véritable danse, malgré le poids de plusieurs personnes qu’elles entraînent. Des hommes eux-mêmes sont transportés tout d’un coup d’un bout d’une chambre à un autre, ou bien sont élevés en l’air et y demeurent quelques instants suspendus. Là, des mains sans corps se laissent voir et sentir, ou bien elles apposent, sans qu’on les voie, des signatures appartenant à des personnes décédées, ou d’autres caractères sur des papiers dont nul ne s’est approché. Ici, on aperçoit des formes humaines diaphanes, dont on entend même quelquefois la voix. Dans d’autres endroits, des porcelaines se brisent d’elles-mêmes, des étoffes se déchirent, des vases se renversent, des bougies s’éteignent et se rallument, des appartements s’illuminent et rentrent tout à coup dans l’obscurité, des fenêtres sont brisées à coups de pierres, des femmes sont décoiffées.. Enfin, on n’en finirait pas si l’on voulait énumérer tous les faits étranges, fantastiques et souvent grotesques qui sont très-sérieusement rapportés dans les relations américaines.
Sans doute, parmi tous ces faits, il doit y en avoir un certain nombre d’inexacts, de faux ou même de controuvés ; mais dans une pareille matière la critique est inhabile à faire un choix, et dès l’instant où l’on entre dans le champ du surnaturel, la raison n’a plus le droit de s’arrêter à un point plutôt qu’à un autre. Ce qu’il y a de certain, c’est que beaucoup des faits que nous avons indiqués, et les plus importants, sont établis d’une manière si positive et si authentique qu’il est impossible de les révoquer en doute, sans attaquer le caractère et la bonne foi des nombreux témoins qui les attestent, et parmi lesquels se trouvent des hommes honorables et éclairés, tels que des magistrats, des médecins, des professeurs.
Quelles sont les conditions nécessaires pour le développement de ces manifestations ?… La seule dont on ait pu jusqu’à présent se rendre compte, mais qui paraît indispensable, est la présence de certaines personnes, qui sont des intermédiaires obligés entre les hommes et les auteurs de ces phénomènes, et que, pour cette raison, on désigne sous le nom de médium. Mais du reste ces médium ne peuvent être reconnus d’avance par aucun caractère physique ou moral. Ils se révèlent d’eux-mêmes ou sont indiqués par les médium déjà développés, et il s’en rencontre au moment où on s’y attend le moins parmi les personnes de tout sexe, de tout âge, de toute condition, croyants ou incrédules. Ainsi, dans les trente à quarante mille médium que l’on prétendait exister aux États-Unis au commencement de cette année (1854), on voit des hommes graves, instruits, entourés de l’estime et de la considération publique, parmi lesquels on compte un juge de la cour suprême et plusieurs ministres de différentes sectes, des femmes distinguées appartenant à la classe supérieure de la société, et à côté d’eux des gens du peuple tout à fait illettrés, des sauvages, et même des individus d’un caractère notoirement immoral et dépravé.
On ne sait pas encore si les médium se rencontrent plus fréquemment parmi les sujets magnétiques que parmi les autres, et, bien que cela paraisse probable, on trouve à cet égard des opinions contradictoires dans les différents ouvrages qui traitent de ces questions.

Certains médium très-développés, étant en rapports constants avec les esprits, obtiennent presque toujours, partout où ils se trouvent, qu’ils se manifestent à leur volonté. Mais la méthode suivie habituellement pour provoquer ces manifestations consiste à former des cercles spirituels qui, au dire des esprits, servent singulièrement à faciliter leurs rapports avec les vivants. Pour cela, quelques personnes ayant, autant que faire se peut, la même manière de voir sur ces questions, et bien disposées, c’est-à-dire prêtes à servir aux esprits d’instruments passifs, se réunissent autour d’une table, de préférence en compagnie d’un ou de plusieurs médium, s’il s’en trouve dans la localité : là elles attendent, en se tenant ou non par la main, et en fixant leur pensée commune sur ces questions, par des lectures ou des chants, ou simplement en gardant le silence, que les esprits manifestent leur présence de façon ou d’autre. Souvent ce n’est qu’après plusieurs séances, de plusieurs heures chacune, que de très-légers coups, qui se font entendre sur la table ou ailleurs, annoncent que leur désir est exaucé. Quelquefois aussi, et cela paraît dépendre surtout de l’état physique ou moral des personnes qui composent le cercle, ou même simplement de celles qui sont présentes, aucune manifestation ne s’obtient, quelque temps que l’on prolonge les séances ; et l’on voit fréquemment les esprits refuser de rien faire ou dire jusqu’à ce qu’une personne qui leur déplaît soit sortie de l’appartement. Dans d’autres cas, au contraire, la présence des esprits s’est, à la grande frayeur des assistants, manifestée subitement par des coups terribles, dans des cercles formés par des incrédules et par façon de plaisanterie.
Mais depuis que ces manifestations se sont multipliées, les esprits ont adopté différents autres modes de communication beaucoup plus simples, pour lesquels les médium eux-mêmes leur servent d’instrument direct.
Indépendamment des rapping médium, c’est-à-dire de ceux en présence desquels des coups se font entendre, on en voit qui, sous l’influence des esprits, tombent subitement dans des états nerveux tout à fait semblables à ceux que produit souvent le magnétisme, et qui deviennent alors de véritables automates, des membres et des organes desquels les esprits disposent à volonté. Dans cet état, les médium répondent aux questions verbales ou même mentales adressées aux esprits par des mouvements spasmodiques et involontaires, soit en frappant des coups avec la main, soit en faisant des signes de tête ou de corps, soit en indiquant du doigt sur un alphabet des lettres successives avec une rapidité telle qu’il est souvent difficile de les suivre.
D’autres, les writing médium, sentent tout à coup leur bras saisi d’une roideur tétanique, et armés d’une plume ou d’un crayon, ils servent aux esprits d’instruments passifs pour écrire ou dessiner les choses qu’ils veulent faire connaître, et parfois des volumes entiers, sans que la plupart du temps leur intelligence soit en jeu.
Il est des esprits qui, par l’intermédiaire de leurs médium, décrivent les maladies, en prévoient les crises, en indiquent le traitement et en opèrent la guérison par l’imposition des mains, ou par des passes magnétiques, comme le font les somnambules clairvoyants.
D’autres ont donné, sur des faits anciens et oubliés, ou sur des faits récents ignorés de toutes les personnes présentes, ou encore sur des choses qui se passaient à des distances telles qu’ils ne pouvaient pas en avoir naturellement connaissance, des détails suivis et circonstanciés qui parfois se sont trouvés d’une exactitude incroyable.
Mais c’en est assez sur ces redoutables matières, qui ont donné lieu à beaucoup d’ouvrages et même à une revue spéciale : la Table parlante[38] ; terminons en rappelant aux chrétiens que l’Église a formellement condamné et rigoureusement interdit ce dangereux commerce avec les démons, seuls meneurs de ces tours.
Taciturnité. Le diable jette souvent sur ses suppôts un sort que l’on appelle le sort de taciturnité. Les sorciers qui en sont frappés ne peuvent répondre aux demandes qu’on leur fait dans leur procès. Ainsi Boullé garda le silence sur ce qu’on cherchait à savoir de lui, et il passa pour avoir reçu le sort de taciturnité[39].
Tacouins, espèce de fées chez les mahométans ; leurs fonctions répondent quelquefois à celles des Parques chez les anciens. Elles secourent plus habituellement les hommes contre les démons et leur révèlent l’avenir. Les romans orientaux leur donnent une grande beauté, avec des ailes comme celles des anges.
Taillepied (Noël), mort en 1589. On lui doit un Traité de Vapparition des esprits, à savoir, des âmes séparées, fantômes, etc., in-12, souvent réimprimé. Il admet dans ce livre beaucoup de contes de revenants. Il a laissé de plus les Vies de Luther et de Carlostadt, Paris, 1577, in-8o; un Abrégé de la philosophie l’Aristote, 1583, in-8o; une Histoire de l’État et la république des druides, eubages, saronides, bardes, depuis le déluge jusqu’à Notre-Seigneur Jésus-Christ, 1585, in-8o, livre plein de fables et d’idées singulières.
Tailletroux (Jeanne), femme de Pierre Bonnevault, sorcière que l’on accusa, à Montmorillon en Poitou (année 1599), d’avoir été au sabbat. Elle avoua dans son interrogatoire que, son mari l’ayant contrainte de se rendre à l’assemblée infernale, elle y fut et continua d’y aller pendant vingt-cinq ans ; que la première fois qu’elle vit le diable, il était en forme d’homme noir ; qu’il lui dit en présence de l’assemblée : Saute ! saute ! qu’alors elle se mit à danser ; que le diable lui demanda un lopin de sa robe et une poule, etc. Convaincue par témoins d’avoir, au moyen de charmes, maléficié et fait mourir des personnes et des bestiaux, elle fut condamnée à mort, ainsi que son mari.
Taingairi, esprits aériens chez les Kalmouks. Ils animent les étoiles, qui passent pour autant de petits globes de verre. Ils sont des deux sexes.
Talapoins, magiciens qui servent de prêtres aux habitants du royaume de Lao, en Asie, et qui sont très-puissants.
Les Langiens (peuples de Lao) sont fort entêtés pour la magie et les sortilèges. Ils croient que le moyen le plus sûr de se rendre invincible est de se frotter la tête d’une certaine liqueur composée de vin et de bile humaine. Ils en mouillent aussi les tempes et le front de leurs éléphants. Pour se procurer cette drogue, ils achètent des talapoins la permission de tuer. Puis ils chargent de cette commission des mercenaires qui en font leur métier. Ceux-ci se postent au coin d’un bois et tuent le premier qu’ils rencontrent, homme ou femme, lui fendent le ventre et en arrachent le fiel. Si l’assassin ne rencontre personne dans sa chasse, il est obligé de se tuer lui-même, ou sa femme, ou son enfant, afin que celui qui l’a payé ait de la bile humaine pour son argent.
Les talapoins profitent avec adresse de la crainte qu’on a de leurs sortilèges, qu’ils donnent et qu’ils ôtent à volonté, suivant les sommes qu’on leur offre.
On lit dans Marini beaucoup d’autres détails, mais la plupart imaginaires, l’auteur ayant voulu faire quelquefois assez méchamment, sous le manteau des talapoins, des allusions misérables aux moines chrétiens.
Talismans. Un talisman ordinaire est le sceau, la figure, le caractère ou l’image d’un signe céleste ou autre, faite, gravée ou ciselée sur une pierre, par un ouvrier qui ait l’esprit arrêté et attaché à l’ouvrage, sans être distrait ou dissipé par des pensées étrangères, au jour et à l’heure de la planète, en un lieu fortuné, par un temps beau et serein et quand le ciel est en bonne disposition, afin d’attirer les influences.
Le talisman portant la figure ou le sceau du soleil doit être composé d’or pur sous l’influence de cet astre, qui domine sur l’or. Le talisman de la lune doit être composé d’argent pur, avec les mêmes circonstances. Le talisman de Mars doit être composé d’acier fin. Le talisman de Jupiter doit être composé du plus pur étain. Le talisman de Vénus doit être composé de cuivre poli et bien purifié. Le talisman de Saturne doit être composé de plomb raffiné. Le talisman de Mercure doit être composé de vif-argent fixé. Quant aux pierres, l’hyacinthe et la pierre d’aigle sont de nature solaire. L’émeraude est lunaire. L’aimant et l’améthyste sont propres à Mars. Le béryl est propre à Jupiter, la cornaline à Vénus, la chalcédoine et le jaspe à Saturne, la topaze et le porphyre à Mercure.
Les talismans furent imaginés, dit-on, par les Égyptiens, et les espèces en sont innombrables. Le plus célèbre de tous les talismans est le fameux anneau de Salomon, sur lequel était gravé le grand nom de Dieu. Rien n’était impossible à l’heureux possesseur de cet anneau, qui dominait sur tous les génies.
Apollonius de Tyane mit à Constantinople la figure d’une cigogne qui en éloignait tous les oiseaux de cette espèce par une propriété magique. En Égypte, une figure talismanique représentait Vénus couchée, et servait à détourner la grêle.
On faisait des talismans de toutes les matières ; les plus communs sont les talismans cabalistiques, qui sont aussi les plus faciles, puisqu’on n’a pas besoin pour les fabriquer de recourir au diable ; ce qui demande quelques réflexions.
Les talismans du soleil, portés avec confiance et révérence, donnent les faveurs et la bienveillance des princes, les honneurs, les richesses et l’estime générale. Les talismans de la lune garantissent des maladies populaires : ils devraient aussi garantir des superstitions. Ils préservent les voyageurs de tout péril. Les talismans de Mars ont la propriété de rendre invulnérables ceux qui les portent avec révérence. Ils leur donnent une force et une vigueur extraordinaires. Les talismans de Jupiter dissipent les chagrins, les terreurs paniques, et donnent le bonheur dans le commerce et dans toutes les entreprises. Les talismans de Vénus éteignent les haines et donnent des dispositions à la musique. Les talismans de Saturne font accoucher sans douleur ; ce qui a été éprouvé avec un heureux succès, disent les écrivains spéciaux, par des personnes de qualité qui étaient sujettes à faire de mauvaises couches. Ils multiplient les choses avec lesquelles on les met. Si un cavalier est botté et qu’il porte un de ces talismans dans sa botte gauche, son cheval ne pourra être blessé. Les talismans de Mercure rendent éloquents et discrets ceux qui les portent révéremment. Ils donnent la science et la mémoire ; ils peuvent guérir toutes sortes de fièvres, et, si on les met sous le chevet de son lit, ils procurent des songes véritables dans lesquels on voit ce que l’on souhaite de savoir : agrément qui n’est pas à dédaigner[40]. Voy. Talys, Theraphim, Thomas d’Aquin, Crocodiles, Pantacles, etc.
Talissons, prêtres des Prussiens aux siècles de l’idolâtrie. Ils faisaient l’oraison funèbre du mort, puis, regardant au ciel, ils criaient qu’ils voyaient le mort voler en l’air à cheval, revêtu d’armes brillantes, et passer en l’autre monde avec une grande suite.
Talmud. Voy. Thalmud.
Talys, talismans employés dans les mariages chez les Indiens. Dans quelques castes, c’est une petite plaque d’or ronde, sans empreinte ni figure ; dans d’autres, c’est une dent de tigre ; il y en a qui sont des pièces d’orfèvrerie matérielles et informes.
Tambour magique. C’est le principal instrument de la magie chez les Lapons. Ce tambour est ordinairement fait d’un tronc creusé de pin ou de bouleau. La peau tendue sur ce tambour est couverte de figures symboliques que les Lapons y tracent avec du rouge. Voy. Lapons.
Tamaracunga, jeune Péruvien qui, à la suite de l’entrée des Espagnols dans le Pérou, voulut recevoir le baptême. Il fut à ce sujet cruellement harcelé par les démons, qui jusqu’alors avaient régné dans cette contrée. Mais il eut la grâce de triompher d’eux. Ses luttes contre l’ennemi sont racontées avec de curieux détails dans l’histoire du Pérou de Pierre Ciéca de Léon, ouvrage estimé[41]. On y voit que les démons, moitié furieux, moitié baladins, ne négligeaient rien pour conserver leur proie.
Tamis (divination par le). Voy. Cosquinomancie.
Tamous, enfer général des Kalmouks. Des diables à tête de chèvre y tourmentent les damnés, qui sont sans cesse coupés par morceaux, sciés, brisés sous des meules de moulin, puis rendus à la vie pour subir le même supplice. Les bêtes de somme y expient leurs fautes sous les plus pesants fardeaux, les animaux féroces se déchirent entre eux sans cesse, etc.
Tanaquil, femme de Tarquin l’Ancien. Elle était habile dans la science des augures ; on conservait à Rome sa ceinture, à laquelle on attribuait de grandes vertus.
Tanchelm ou Tanchelin. De 1105 à 1123, cet hérétique dissolu fut en si grande vénération à Anvers et dans les contrées voisines, qu’on recherchait ses excréments comme des préservatifs, charmes et phylactères[42].
Taniwoa, le Neptune des naturels de la Nouvelle-Zélande.
Tanner. Le cardinal Sfrondrate raconte que le P. Tanner, pieux et savant jésuite, allant de Prague à Inspruck pour rétablir sa santé à l’air natal, mourut en chemin dans un village dont on ne dit pas le nom. Comme la justice du lieu faisait l’inventaire de son bagage, on y trouva une petite boite que sa structure extraordinaire fit d’abord regarder comme suspecte, car elle était noire et composée de bois et de verre. Mais on fut bien plus surpris lorsque le premier qui regarda par le verre d’en haut se recula en disant qu’il y avait vu le diable. Tous ceux qui regardèrent après lui en firent autant. Effectivement ils voyaient dans cette boîte un être animé, de grande taille, noir, affreux, armé de cornes. Un jeune homme qui achevait son cours de philosophie fit observer à l’assemblée que la bête renfermée dans la boîte, étant infiniment plus grosse que la boîte elle-même, ne pouvait être un être matériel, mais bien un esprit comprimé sous la forme d’un animal. On concluait que celui qui portait la boîte avec lui ne pouvait être qu’un sorcier et un magicien. Un événement si diabolique fit grand bruit. Le juge qui présidait à l’inventaire condamna le mort à être privé de la sépulture ecclésiastique, et enjoignit au curé d’exorciser la boîte pour en faire sortir le démon. La multitude, sachant que le défunt était jésuite, décida de plus que tout jésuite commerçait avec le diable ; ce qui est la manière de juger des masses ignorantes. Pendant qu’on procédait en conséquence, un philosophe prussien, passant par ce village, entendit parler d’un jésuite sorcier et du diable enfermé dans une boîte. Il en rit beaucoup, alla voir le phénomène et reconnut que c’était un microscope, que les villa-

Tap ou Gaap, grand président et grand prince aux enfers. Il se montre à midi lorsqu’il prend la forme humaine. Il commande à quatre des principaux rois de l’empire infernal. Il est aussi puissant que Byleth. Il y eut autrefois des nécromanciens qui lui offrirent des libations et des holocaustes ; ils l’évoquaient au moyen d’artifices magiques qu’ils disaient composés par le très-sage roi Salomon ; ce qui est faux, car ce fut Cham, fils de Noé, qui le premier commença à évoquer les esprits malins. Il se lit servir par Byleth et composa un art en son nom, et un livre qui est apprécié de beaucoup de mathématiciens. On cite un autre livre attribué aux prophètes Élie et Élisée, par lequel on conjure Gaap en vertu des saints noms de Dieu renfermés dans les Clavicules de Salomon.

Si quelque exorciste connaît l’art de Byleth, Gaap ou Tap ne pourra supporter la présence dudit exorciste. Gaap ou Tap excite à l’amour, à la haine. Il a l’empire sur les démons soumis à la puissance d’Amaymon. Il transporte trèspromptement les hommes dans les différentes contrées qu’ils veulent parcourir. Il commande à soixante légions[44].
Tarentule. On prétend qu’une seule piqûre de la tarentule suffit pour faire danser. Un coq et une guêpe piqués de cette sorte d’araignée ont dansé, dit-on, au son du violon et ont battu la mesure. Si l’on en croit certains naturalistes, non-seulement la tarentule fait danser, mais elle danse elle-même assez élégamment. Le docteur Saint-André certifie qu’il a traité un soldat napolitain qui dansait tous les ans quatre ou cinq jours de suite, parce qu’une tarentule l’avait piqué. Ces merveilles ne sont pas encore bien expliquées.
Tarni, formules d’exorcisme usitées chez les Kalmouks. Écrites sur du parchemin et suspendues au cou d’un malade, elles passent pour avoir la vertu de lui rendre la santé.
Taroataihetomeo, Dieu suprême des indigènes d’Otahiti ; sans doute le même que Taaroa et aussi qu’Éatua.
Tarots ou Cartes tarotées. C’est le nom qu’on donne aux cartes égyptiennes, italiennes et allemandes ; le jeu se compose de soixante-dix-huit cartes, avec lesquelles on dit la bonne aventure d’une manière plus étendue que par nos cartes ordinaires. Il y a dans ce jeu vingt-deux tarots proprement dits. Dans les cartes italiennes, les tarots sont les quatre éléments (vieux style), l’Évangile, la mort, le jugement dernier, la prison, le feu, Judas Iscariote, etc. ; dans les cartes allemandes, les tarots sont le fou, le magicien, l’ours, le loup, le renard, la licorne, etc. Il y a ensuite cinquante-six cartes, savoir : quatre rois, quatre dames, quatre cavaliers, quatre valets ; dix cartes depuis l’as jusqu’au dix pour les bâtons (ou trèfles) ; dix pour les épées (ou piques) ; dix pour les coupes (ou carreaux) ; dix pour les pièces d’argent (ou cœurs).
Il serait trop long de détailler ici l’explication de toutes ces cartes. Elle ressemble beaucoup à la cartomancie ordinaire. Cependant elle donne infiniment plus d’oracles.
Tartara ! C’est le cri que poussaient les prophètes du Dauphiné en allant à la bataille. Ce cri devait, disaient-ils, leur assurer la victoire et mettre leurs ennemis en déroute. Le contraire arriva[45].
Tartare, enfer des anciens. Ils le plaçaient sous la terre, qu’ils croyaient plate, à une telle profondeur, dit Homère, qu’il est aussi éloigné de la terre que la terre l’est du ciel. Virgile le dépeint vaste, fortifié de trois enceintes de murailles et entouré du Phlégéton. Une haute tour en défend l’entrée. Les portes en sont aussi dures que le diamant ; tous les efforts des mortels et toute la puissance des dieux ne pourraient les briser… Tisiphone veille toujours à leur garde et empêche que personne ne sorte, tandis que Rhadamanthe livre les criminels aux furies. L’opinion commune était qu’il n’y avait plus de retour pour ceux qui se trouvaient une fois précipités dans le Tartare. Platon est d’un autre avis : selon lui, après qu’ils y ont passé une année, un flot les en retire et les ramène dans un lieu moins douloureux.
Tartini. Le célèbre musicien Tartini se couche ayant la tête échauffée d’idées musicales. Dans son sommeil lui apparaît le diable jouant une sonate sur le violon. Il lui dit : « Tartini, joues-tu comme moi ? » Le musicien, enchanté de cette délicieuse harmonie, se réveille, court à son piano et compose sa plus belle sonate, celle du diable.
Tasso (Torquato). Il croyait à l’astrologie judiciaire. « J’ai fait considérer ma naissance par trois astrologues, dit-il dans l’une de ses lettres, et, sans savoir qui j’étais, ils m’ont représenté d’une seule voix comme un grand homme dans les lettres, me promettant très-longue vie et très-haute fortune ; et ils ont si bien deviné les qualités et les défauts que je me connais à moi-même, soit dans ma complexion, soit dans mes habitudes, que je commence à tenir pour certain que je deviendrai un grand homme. » Il écrivait cela en 1576. On sait quelle fut sa haute fortune et sa très-longue vie ! Il mourut en 1595, âgé de cinquante-deux ans. Il se disait doté d’un esprit familier.
Tatien, hérétique du deuxième siècle, chef des encratites, qui attribuaient au démon la plantation de la vigne et l’institution du mariage.
Taupe. Elle jouait autrefois un rôle important dans la divination. Pline a dit que ses entrailles étaient consultées avec plus de confiance que celles d’aucun autre animal. Le vulgaire attribue encore à la taupe certaines vertus. Les plus merveilleuses sont celles de la main taupée, c’est-à-dire qui a serré une taupe vivante jusqu’à ce qu’elle soit étouffée. Le simple attouchement de cette main encore chaude guérit les douleurs de dents et même la colique. Si on enveloppe un des pieds de la taupe dans une feuille de laurier et qu’on la mette dans la bouche d’un cheval, il prendra aussitôt la fuite, saisi de peur. Si on la met dans le nid de quelque oiseau, les œufs deviennent stériles.
De plus, si on frotte un cheval noir avec de l’eau où aura cuit une taupe, il deviendra blanc[46]…
Tauses. En pays allemands, les tauses sont des esprits malins qui donnent le cauchemar en s’appuyant sur les bonnes gens pendant le sommeil.
Tavides, caractères que les insulaires des Maldives regardent comme propres à les garantir des maladies. Ils s’en servent aussi comme des philtres, et prétendent, par leur moyen, inspirer de l’amour.
Taymural, roi de Perse qui, dans les temps fabuleux, relégua les génies dans le Ginnistan. Voy. Génies.
Tée, génie protecteur, que chaque famille otahitienne adore, et qui passe pour un des aïeux ou des parents défunts. On attribue à ces esprits le pouvoir de donner ou de guérir les maladies.
Tehuptehuh, génie auquel les Boutaniens attribuent la construction d’un pont de chaînes de fer qui se trouve dans les montagnes du Boutan.
Tell. Dans une des montagnes sauvages de la Suisse, auprès du lac Waldstœtten, il y a une grotte où les habitants croient que reposent les trois sauveurs de la Suisse, qu’ils appellent les trois Tell. Ils portent encore les anciens vêtements, et reviendront une seconde fois au secours de leur pays quand il en sera temps. L’entrée de leur grotte est très-difficile à trouver. Un jeune berger racontait à un voyageur qu’un jour son père, en cherchant à travers les rochers une chèvre qu’il avait perdue, était descendu par hasard dans cette grotte, et avait vu là dormir les trois hommes, qu’il savait être les trois Tell. L’un d’eux, se levant tout à coup pendant qu’il le regardait, lui demanda : « À quelle époque en êtes-vous dans le monde ? » Le berger, tout effrayé, lui répondit, sans savoir ce qu’il disait : « Il est midi. — Eh bien ! s’écria Tell, il n’est pas temps encore que nous reparaissions. » Et il se rendormit.
Plus tard, lorsque la Suisse se trouva engagée dans des guerres assez périlleuses, le vieux berger voulut aller réveiller les trois Tell ; mais il ne put jamais retrouver la grotte.
Tellez (Gabriel), plus connu sous le nom de Tirso de Molina, auteur du Diable prédicateur, drame dans le génie espagnol. À cinquante ans, ce poète dramatique renonça au théâtre et se fit religieux de l’ordre de la Merci. Nous faisons cette remarque parce qu’à propos de quelques plaisanteries un peu libres semées dans ses pièces, les critiques philosophes l’ont traité de moine licencieux, oubliant qu’il n’était pas moine quand il écrivait pour la scène.
Température. Les Grecs avaient des prêtres appelés Calazophylaces, dont les foliotions consistaient à observer les grêles et les orages, pour les détourner par le sacrifice d’un agneau ou d’un poulet. Au défaut de ces animaux, ou s’ils n’en tiraient pas un augure favorable, ils se découpaient le doigt avec un canif ou un poinçon, et croyaient ainsi apaiser les dieux par l’effusion de leur propre sang. Les Éthiopiens ont, dit-on, de semblables charlatans, qui se déchiquètent le corps à coups de couteau ou de rasoir pour obtenir la pluie ou le beau temps. Nous avons des almanachs qui prédisent la température pour tous les jours de l’année ; prenez toutefois un manteau quand Matthieu Laensberg annonce plein soleil.
Tempêtes. On croit, sur les bords de la Baltique, qu’il y a des sorciers qui, par la force de leurs enchantements, attirent la tempête, soulèvent les flots et font chavirer la barque du pêcheur. Voy. Éric, Finnes, Jacques Ier, etc.
Templiers. Vers l’an 1118, quelques pieux chevaliers se réunirent à Jérusalem pour la défense du saint sépulcre et pour la protection des pèlerins. Le roi Baudouin II leur donna une maison, bâtie aux lieux que l’on croyait avoir été occupés par le temple de Salomon ; ils prirent de là le nom de templiers et appelèrent temple toute maison de leur ordre.
Dans l’origine, ils ne vivaient que d’aumônes, et on les nommait aussi les pauvres de la sainte cité ; mais ils rendaient tant de services que les rois et les grands s’empressèrent de leur donner des biens considérables. Ils firent les trois vœux de religion. En 1128, au concile de Troyes, saint Bernard leur donna une règle[47]. En 1146, le pape Eugène détermina leur habit, sur lequel ils portaient une croix.
Cet ordre se multiplia rapidement, fit de très-grandes choses, et s’enrichit à tel point qu’à l’aurore du quatorzième siècle il possédait, en Europe seulement, neuf mille seigneuries. L’opulence avait amené la corruption ; les templiers s’étaient laissés entraîner dans l’hérésie albigeoise et leurs mœurs faisaient scandale. Il s’éleva bientôt contre eux cinq griefs : on les accusait d’hérésie, de blasphèmes, de mépris de la foi chrétienne, de reniement de Jésus-Christ et d’impuretés contre nature. On leur reprochait en même temps la magie, l’idolâtrie, l’adoration du diable, qui présidait à leurs réunions secrètes sous la forme d’une tête dorée montée sur quatre pieds et connue sous le nom de tête de Bophomet[48].
Philippe le Bel, qui les redoutait et qui, selon quelques opinions, voulait s’emparer de leurs richesses, les fit arrêter tous en France dans l’année 1307 et les mit en jugement. Le pape s’opposa à cette procédure comme revenant au Saint-Siège, attendu que ces chevaliers étaient un ordre religieux. Cent quarante templiers avaient, à Paris, confessé les crimes qu’on leur imputait. Le pape (c’était Clément V) en interrogea à Poitiers soixante-douze ; ils avouèrent pareillement. Un concile fut donc convoqué à Vienne pour juger cette affaire. L’ordre des templiers y fut aboli et proscrit.
Cependant Clément V avait absous le grand maître et ceux des chevaliers qui s’étaient confessés avec repentir ; mais Philippe voulut que Jacques de Molay, le grand maître, fît sa confession publique avec amende honorable devant les portes de Notre-Dame ; et comme il s’y refusa, il y fut brûlé avec un autre des hauts chevaliers le 18 mars 1314.
Il n’est pas vrai que Jacques de Molay ait ajourné le roi et le pape, comme on l’a dit, pour produire un effet de théâtre. Lui et ses compagnons infortunés se bornèrent à invoquer vainement une vengeance mystérieuse contre leurs juges.
Telle est la vérité sur les templiers.
Il reste dans la maçonnerie symbolique un ordre dit des templiers, qui prétendent remonter à l’ordre condamné.
Temzarpouliet, lutin domestique en Bretagne. Toujours malicieux, il se présente sous diverses formes, de chien et d’autres bêtes. À Morlaix, on voit, au carrefour de la Dame de la Fontaine, une croix que l’on dit avoir été plantée là pour écarter le temzarpouliet.
 Supplice du grand maître des Templiers.
|
Ténare, soupirail des enfers chez les anciens ; il était gardé par Cerbère.
Ténèbres. On appelle les démons puissances des ténèbres, parce qu’ils ne souffrent pas la lumière. On comprend aussi pourquoi les enfers sont nommés le séjour ténébreux.
Tentations. Voy. Démons, Pactes, Dévouement, etc. — Voici sur ce sujet un passage emprunté à l’Esprit de Nicole et composé d’extraits textuels de ses divers écrits :
« Les démons sont des anges qui ont été créés, comme les bons, dans la vérité, mais qui, n’y ayant pas demeuré fermes, sont tombés par orgueil et ont été précipités dans l’enfer ; et quoique Dieu, par un secret jugement, permette qu’avant le jugement dernier ils n’y soient pas entièrement attachés et qu’ils en sortent pour tenter les hornmqs, ils portent néanmoins leur enfer partout. Quoique toujours disposés à nuire aux hommes, ils n’en ont néanmoins aucun pouvoir, à moins que Dieu ne le leur donne, et alors c’est ou pour punir les hommes, ou pour les éprouver, ou pour les couronner.
» Les méchants sont proprement les esclaves du diable ; ils les tient assujettis à sa volonté ; ils sont dans les pièges du diable, qui les tient captifs pour en faire ce qu’il lui plaît. Dieu règle néanmoins le pouvoir du démon, et ne lui permet pas d’en user toujours à sa volonté ; mais il y a cette différence entre les méchants et les bons, qu’à l’égard des méchants il faut que Dieu borne le pouvoir que le diable a de lui-même sur eux, pour l’empêcher de les porter à toutes sortes d’excès ; au lieu qu’à l’égard des bons il faut, afin que le diable puisse les tourmenter, que Dieu même lui en donne la puissance, qu’il n’aurait pas sans cela.
» Tout le monde est rempli de démons qui, comme des lions invisibles, rôdent à l’entour de nous et ne cherchent qu’à nous dévorer. Les hommes sont si vains dans leur aveuglement, qu’ils se font un honneur de ne pas les craindre et presque de ne pas y croire.
» C’est une faiblesse d’esprit, selon plusieurs, d’attribuer aux démons quelque effet, comme s’ils étaient dans le monde pour n’y rien faire, et qu’il y eut quelque apparence que Dieu, les ayant autrefois laissés agir, il les ait maintenant réduits à une entière impuissance. Mais cette incrédulité est beaucoup plus supportable quand il ne s’agit que des effets extérieurs. Le plus grand mal est qu’il y a peu de personnes qui croient sérieusement que le diable les tente, leur dresse des pièges, et rôde à l’entour d’eux pour les perdre, quoique ce soit ce qu’il y a de plus certain. Si on ne le croyait, on agirait autrement ; on ne laisserait pas au démon toutes les portes de son âme ouvertes par la négligence et les distractions d’une vie relâchée, et l’on prendrait les voies nécessaires pour lui résister.
» Il est bien rare de trouver des gens frappés de la crainte des démons, et qui aient quelque soin de se garantir des pièges qu’ils leur tendent. C’est la chose du monde à quoi on tient le moins. Toute cette république invisible d’esprits mêlés parmi nous, qui nous voient et que nous ne voyons point, et qui sont toujours à nous tenter, en excitant ou en enflammant nos passions, ne fait pas plus d’impression sur l’esprit de la plupart des chrétiens que si c’était un conte et une chimère. Notre âme, plongée dans les sens, n’est touchée que par les choses sensibles. Ainsi elle ne craint point ce qu’elle ne voit point ; mais ces ennemis n’en sont pas moins à craindre pour n’être pas craints. Ils le sont, au contraire, beaucoup plus, parce que cette fausse sécurité fait leur force et favorise leurs desseins. C’est déjà pour eux avoir fait de grands progrès que d’avoir mis les hommes dans cette disposition. Comme ce sont des esprits de ténèbres, leur propre effet est de remplir l’âme de ténèbres et de s’y cacher. Hors les âmes qui vivent de l’esprit de Jésus-Christ, les démons possèdent toutes les autres.
» Le démon ne parle pas par lui-même, mais il parle par tous les hommes qu’il possède et à qui il inspire les sentiments qu’il voudrait faire passer dans notre cœur. Il nous parle par tous les objets du monde, qui ne frappent pas seulement nos sens, mais qui sont présentés à notre esprit sous une fausse image de grands biens et d’objets capables de nous rendre heureux. Il nous parle par nos propres sentiments et par ces mouvements qu’il excite dans notre âme, qui la portent à vouloir jouir de ces biens sensibles et à y chercher son bonheur. Ainsi nous sommes dans une épreuve continuelle de ces impressions des démons sur nous.
» Le démon, ne pouvant parler immédiatement au cœur et ne devant pas se manifester à nous, emprunte le langage des créatures et celui de notre chair et de nos passions, et il nous fait entendre par là tout ce qu’il désire. Il nous dit, par les discours d’un vindicatif, qu’il est bon de se venger ; par ceux d’un ambitieux, qu’il est bon de s’élever ; par ceux d’un avare, qu’il est bon de s’enrichir ; par ceux d’un voluptueux, qu’il est bon de jouir du monde. Il les fait parler en agissant sur leur imagination et en y excitant les idées qu’ils expriment par leurs paroles, et il joint en même temps à cette instruction extérieure le langage de nos désirs qu’il excite. Celui des exemples des personnes déréglées lui sert encore plus que celui de leurs paroles. Et enfin, la seule vue muette des objets du monde qu’il nous présente lui sert encore d’un langage pour nous dire que le monde est aimable et qu’il est digne d’être recherché.
» La malice et l’artifice du démon ont bien plus pour but en cette vie de rendre les hommes criminels que de les accabler de misères et de maux. Il espère bien se dédommager en l’autre vie de tous les ménagements dont il use en celle-ci. Mais comme il sait qu’il n’a de force et d’empire sur eux qu’à proportion qu’ils sont coupables, il tâche de les rendre plus coupables, afin de pouvoir les dominer et tourmenter plus cruellement et plus à son aise. Il prend donc pour l’ordinaire, dans cette vie, le parti d’exciter et de féconder les passions. Il tâche de procurer aux siens des richesses et des plaisirs, et de les faire réussir dans leurs injustes desseins. Il s’applique particulièrement à empêcher qu’ils ne lui échappent, et à éloigner d’eux tout ce qui pourrait les réveiller de leur assoupissement. Il emploie toutes sortes d’adresses et d’artifices pour les retenir dans ses liens. Il les environne de gens qui les louent et qui les autorisent dans leurs dérèglements, qui leur en ôtent le scrupule en leur proposant une infinité de mauvais exemples, qui les y confirment. Il les amuse et les entretient d’espérances trompeuses. Il les accable d’emplois, d’occupations, de desseins, de divertissements qui les empêchent de penser à eux ; et comme, selon les diverses personnes et dans les diverses circonstances, il a besoin de divers moyens, il se sert aussi quelquefois des calamités et des maux de la vie pour les accabler de tristesse, les réduire au désespoir et les empêcher, par la multitude de leurs maux, d’avoir le temps de penser à se convertir ; enfin, tout lui est bon pour se conserver l’empire de ceux qu’il tient en sa possession, se réservant en l’autre vie de leur faire sentir la dureté de son joug. »
Tephramancie, divination pour laquelle on se servait de la cendre du feu qui, dans les sacrifices, avait consumé les victimes.
Tératoscopie, divination qui tire des présages de l’apparition de quelques spectres vus dans les airs, tels que des armées de cavaliers et autres prodiges dont parlent les chroniqueurs.
Terragon. Dans un pamphlet contre Henri III, qui parut en 1589 sous le titre de Remontrances à Henri de Valois sur les choses horribles envoyées par un enfant de Paris, on lisait ce qui suit : « Henri, lorsque vous donnâtes liberté à tous sorciers et enchanteurs et autres divinateurs de tenir libres écoles aux chambres de votre Louvre et même dans votre cabinet, à chacun d’iceux une heure le jour, pour mieux vous instruire, vous savez qu’ils vous ont donné un esprit familier, nommé Terragon. Vous savez qu’aussitôt que vous vîtes Terragon, vous l’appelâtes votre frère en l’accolant… » On ajoutait sur ce démon familier des choses détestables. « Vous savez, Henri, que Terragon vous donna un anneau, et que dans la pierre de cet anneau votre âme était figurée… »
Ces singularités ne viennent que d’un pamphlet. Mais toutefois Henri III était fort superstitieux et s’occupait de magie. Voy. Henri III.
Terre. Félix Nogaret a exploité une opinion bizarre de quelques philosophes dans un petit ouvrage intitulé La terre est un animal, in-16. Versailles, an III. Lyon possède un astronome qui met en avant une autre théorie. Il prétend que la terre est une éponge qui se soulève et qui s’abaisse chaque jour au-dessus et au-dessous du soleil, de manière à former les jours et les nuits. Les éclipses sont impossibles, d’après son système, puisque les astres sont immobiles. Nous oublions de dire que, selon lui, la terre respire à la manière des éléphants : les volcans sont ses narines. Par le temps de professions de foi qui court, disait l’Union catholique[49], il ne serait peut-être pas déplacé que l’illustre auteur de cette belle découverte formulât son système de la terre-éponge.
Les Orientaux disent que l’herbe est la chevelure de la terre et le zéphyr le peigne qui la démêle.
Terrestres ou souterrains, espèce de démons que les Chaldéens regardaient comme menteurs, parce qu’ils étaient les plus éloignés de la connaissance des choses divines. Voy. Souterrains.
Terreurs paniques. Un cavalier pariait qu’il irait, la nuit, donner la main à un pendu. Son camarade y court avant lui, pour s’en assurer. Le cavalier arrive bientôt, tremble, hésite ; puis, s’encourageant, prend la main du pendu et le salue. L’autre, désespéré de perdre la gageure, lui donne un grand soufflet, tellement que celui-ci, se croyant frappé du pendu, tombe à la renverse et meurt sur la place. Voy. Retz, Frayeur, Revenants, etc.
Terrier, démon invoqué dans les litanies du sabbat.
Tervagant, démon fameux au moyen âge, comme protecteur des Sarasins.
Tervilles, démons qui habitent la Norvège avec les drolles. Ils sont méchants, fourbes, indiscrets et font les prophétiseurs[50].
Tespesion, enchanteur qui, pour montrer qu’il pouvait enchanter les arbres, commanda à un orme de saluer Apollonius de Tyane ; ce que l’orme fit d’une voix grêle[51].
Tête. M. Salgues cite Phlégon, qui rapporte que, un poète, nommé Publius, ayant été dévoré par un loup, qui ne lui laissa que la tête, cette tête, saisie d’un noble enthousiasme, articula vingt vers qui prédisaient la ruine de l’empire romain. Il ci te encore Aristote, qui atteste que, un prêtre de Jupiter ayant été tué, sa tête, séparée de son corps, nomma son meurtrier, lequel fut arrêté, jugé et condamné sur ce témoignage. Voy. Polycrite.
Tête de Bophomet. M. de Hammer a publié, en 1818, une découverte intéressante pour l’histoire des sociétés secrètes. Il a trouvé, dans le cabinet des antiquités du Muséum impérial de Vienne, quelques-unes de ces idoles nommées têtes de Bophomet que les templiers adoraient. Ces têtes représentent la divinité des gnostiques, nommée Mêté ou la Sagesse. On y trouve la croix tronquée ou la clef égyptienne de la vie et de la mort, le serpent, le soleil, la lune, l’étoile du sceau, le tablier, le flambeau à sept branches et d’autres hiéroglyphes de la franc-maçonnerie. M. de Hammer prouve que les templiers, dans les hauts grades de leur ordre, abjuraient le christianisme et se livraient à des superstitions abominables. Les templiers et les francs-maçons remontent, selon lui, jnsqu’au gnosticisme, ou du moins certains usages ont été transmis par les gnostiques aux templiers, et par ceux-ci aux francs-maçons.
On garda longtemps à Marseille une de ces têtes dorées, saisie dans un retrait de templiers lorsqu’on fit leur procès.
Tête de mort. Un roi chrétien, voulant connaître le moment et le genre de sa mort, fit venir un nécromancien, qui, après avoir dit la messe du diable, fit couper la tête d’un jeune enfant de dix ans, préparé pour cet effet ; ensuite il mit cette tête sur l’hostie noire, et, après certaines conjurations, il lui commanda de répondre à la demande du prince ; mais la tête ne prononça que ces mots : Le ciel me vengera[52]… Et aussitôt le roi entra en furie, criant sans cesse : Ôtez-moi cette tête ! Peu après il mourut enragé[53].
Tête de saint Jean. Un devin s’était rendu fameux dans le dix-septième siècle par la manière dont il rendait ses oracles. On entrait dans une chambre éclairée par quelques flambeaux. On voyait sur une table une représentation qui figurait la tête de saint Jean-Baptiste dans un plat. Le devin affectait quelques cérémonies magiques ; il conjurait ensuite cette tête de répondre sur ce qu’on voulait savoir, et la tête répondait d’une voix intelligible, quelquefois avec une certaine exactitude. Or, voici la clef de ce mystère : la table, qui se trouvait au milieu de la chambre, était soutenue de cinq colonnes, une à chaque coin et une dans le milieu. Celle du milieu était un tuyau de bois ; la prétendue tête de saint Jean était de carton peint au naturel, avec la bouche ouverte, et correspondait, par un trou pratiqué dans le plat et dans la table, à la cavité de la colonne creuse. Dans la chambre qui se trouvait au-dessous, une personne, parlant par un porte-voix dans cette cavité, se faisait entendre très-distinctement : la bouche de la tête avait l’air de rendre ses réponses.
Têtes de serpent. Passant par Hambourg, Linné, encore fort jeune, donna une preuve de sa sagacité en découvrant qu’un fameux serpent à sept têtes, qui appartenait au bourgmestre Spukelsen, et qu’on regardait comme un prodige, n’était qu’une pure supposition. À la première inspection, le docte naturaliste s’aperçut que six de ces têtes, malgré l’art avec lequel on les avait réunies, étaient des museaux de belettes, couverts d’une peau de serpent.
Tetragrammaton, mot mystérieux employé dans la plupart des conjurations qui évoquent le diable.
Teula, sorte de mirage qui a lieu en Écosse, où la personne qui en est frappée croit voir passer un convoi funèbre ou ce qu’ils appellent un enterrement. Elle se dérange pour ne pas en être froissée.
Teusarpouliet ou Temzarpouliet. Voy. ce mot.
Teuss, génie bienfaisant révéré dans le Finistère ; il est vêtu de blanc et d’une taille gigantesque, qui croît quand on l’approche. On ne le voit que dans les carrefours, de minuit à deux heures. Quand vous avez besoin de son secours contre les esprits malfaisants, il vous sauve sous son manteau. Souvent, quand il vous tient enveloppé, vous entendez passer avec un bruit affreux le chariot du diable, qui fuit à sa vue, qui s’éloigne en poussant des hurlements épouvantables, en sillonnant d’un long trait de lumière l’air, la surface de la mer, en s’abîmant dans le sein de la terre ou dans les ondes[54].
Teutatès, le Pluton des Gaulois. On l’adorait dans les forêts. Le peuple n’entrait dans ces forêts mystérieuses qu’avec un sentiment de terreur, fermement persuadé que les habitants de l’enfer s’y montraient, et que la seule présence d’un druide pouvait les empêcher de punir la profanation de leur demeure. Lorsqu’un Gaulois tombait à terre, dans une enceinte consacrée au culte, il devait se hâter d’en sortir, mais sans se relever et en se traînant à genoux, pour apaiser les êtres surnaturels qu’il croyait avoir irrités[55].
Thalmud, livre qui contient la doctrine, les contes merveilleux, la morale et les traditions des Juifs modernes. Environ cent vingt ans après la destruction du temple, le rabbin Juda-Haccadosch, que les juifs appelaient notre saint maître, homme fort riche et fort estimé de l’empereur Antonin le Pieux, voyant avec douleur que les Juifs dispersés commençaient à perdre la mémoire de la loi qu’on nomme orale ou de tradition, pour la distinguer de la loi écrite, composa un livre où il renferma les sentiments, les constitutions, les traditions de tous les rabbins qui avaient fleuri jusqu’à son temps. Ce recueil forme un volume in-folio ; on l’appelle spécialement la Mischna ou seconde loi. Cent rabbins y ont joint des commentaires, dont la collection se nomme Gémare. Le tout embrasse douze volumes in-folio.
Les Juifs mettent tellement le Thalmud audessus de la Bible qu’ils disent que Dieu étudie trois heures par jour dans la Bible, mais qu’il en étudie neuf dans le Thalmud.
Thamus, pilote qui annonça la mort du grand Pan. Voy. Pan.
Thamuz, démon du second ordre, inventeur de l’artillerie. Ses domaines sont les flammes, les grils, les bûchers. Quelques démonomanes lui attribuent l’invention des bracelets que les dames portent.
Théagènes. Voy. Oracles.
Théantis, femme mystérieuse. Voy. Oféreit.
Thème céleste. Ce terme d’astrologie se dit de la figure que dressent les astrologues lorsqu’ils tirent l’horoscope. Il représente l’état du ciel à un point fixe, c’est-à-dire le lieu où sont en ce moment les étoiles et les planètes. Il est composé de douze triangles enfermés entre deux carrés ; on les appelle les douze maisons du soleil. Voy. Astrologie.
Thémura, l’une des trois divisions de la cabale rabbinique. Elle consiste : 1° dans la transposition et le changement des lettres ; 2° dans un changement de lettres que l’on fait en certaines combinaisons équivalentes.
Théoclimène, devin qui descendait en ligne directe de Mélampus de Pylos, et qui devinait à Ithaque en l’absence d’Ulysse.
Théodat. Voy. Onomancie.
Théodoric, roi des Goths. Sous son règne, les deux plus illustres sénateurs, Symmaque et Boëce, son gendre, furent accusés de crimes d’État et mis en prison. Boëce était chrétien. Il fut mis à mort l’an 524, et son beau-père eut le même sort l’année suivante. Un jour, les offi-

Théodose. Voy. Alectryomancie.
Théomancie, partie de la cabale des Juifs qui étudie les mystères de la divine majesté et recherche les noms sacrés. Celui qui possède cette science sait l’avenir, commande à la nature, a plein pouvoir sur les anges et les diables, et peut faire des prodiges. Des rabbins ont prétendu que c’est par ce moyen que Moïse a tant opéré de merveilles ; que Josué a pu arrêter le soleil ; qu’Élie a fait tomber le feu du ciel et ressuscité un mort ; que Daniel a fermé la gueule des lions ; que les trois enfants n’ont pas été consumés dans la fournaise, etc. Cependant, quoique très-experts aussi dans les noms divins, les rabbins juifs ne font plus rien des choses opérées chez leurs pères.
Théophile, économe de l’église d’Adana, en Cilicie, au sixième siècle. Il marchait dans les voies de la justice et de la charité, lorsque, sur les rapports calomnieux de rivaux jaloux, son évêque le renvoya de ses fonctions. L’orgueil, qui jusque-là dormait en lui, s’éveilla au point de le dominer bientôt. Pour se venger, il se vendit au démon. Son pacte, célèbre dans tout l’Orient, est exposé avec ses suites dans un poëme latin de la pieuse et illustre Rosvitha. Il eut le bonheur de se repentir et de rentrer en grâce, à force de prières et de constance. Voy. cette histoire (qui n’a jamais pu être contestée) dans les Légendes infernales.
Théraphim. Selon rabbi Aben-Esra, les idoles que les Hébreux appelaient théraphim étaient des talismans d’airain, en forme de cadran solaire, qui faisaient connaître les heures propres à la divination. Pour les faire, on tuait le premier-né de la maison, on lui arrachait la tête, qu’on salait de sel mêlé d’huile ; puis on écrivait sur une lame d’or le nom de quelques mauvais esprits ; on mettait cette lame sous la langue de l’enfant ; on attachait la tête coupée à la muraille, et, après avoir allumé des flambeaux devant elle, on lui rendait à genoux de grands respects. Cette figure répondait aux questions qu’on avait à lui faire ; on suivait ses avis, et on traçait sur ses indications les figures du théraphim. Selon d’autres rabbins, les théraphim étaient des mandragores.
Thermomètre. L’abbé Chappe, né à Mauriac en Auvergne, en 1722, de l’Académie des sciences, s’est immortalisé par ses deux voyages, l’un à Tobolsk, dans la Sibérie, en 1761, l’autre en 1769, en Californie, où il est mort. Dans le premier de ces voyages, il arriva un jour qu’après s’être livré au sommeil, auquel la fatigue l’avait fait succomber, il se trouva, en s’éveillant au milieu de la nuit, abandonné par ses gens, seul dans son traîneau, au milieu d’un désert de glaces, sans vivres et loin de toute espèce d’habitation. Il ne perd point courage ; il marche au hasard, s’abîme dans un trou rempli de neige, s’en tire par miracle, aperçoit dans le lointain une faible lumière, la suit, arrive, retrouve ses gens, les réveille, leur pardonne et poursuit sa route. Il approche enfin de Tobolsk ; il ne restait que trois rivières à passer : mais tout annonçait le dégel ; on voyait l’eau partout. Les postillons refusent le service. Il les enivre d’eau-de-vie, et traverse les deux premières.
À la dernière, il n’éprouve que des refus insurmontables. Indigné, il entre chez le maître de poste en tenant à la main son thermomètre, que la chaleur du poêle fait monter, au grand étonnement des spectateurs. L’abbé, qui s’en aperçoit, saisit la circonstance. Il leur fait dire par son interprète qu’il est un grand magicien, que l’instrument qu’il porte l’avertit de tous les dangers ; que si le dégel était à craindre, l’animal qu’il renferme, étant exposé au grand air, ne descendrait pas ; mais que si la glace était encore forte, il descendrait au-dessous d’une ligne qu’il marque avec le doigt. Il sort alors : tous le suivent en foule, et le thermomètre de descendre. Pleins de surprise et d’admiration, les postillons se hâtent d’obéir, et la rivière est traversée malgré la glace fléchissant sous le poids du traîneau, et menaçant à chaque instant de se rompre et de l’engloutir avec les voyageurs.
Thespésius, citoyen de Cilicie, connu de Plutarque. C’était un mauvais sujet qui exerçait toutes sortes de friponneries, et se ruinait de jour en jour de fortune et de réputation. L’oracle lui avait prédit que ses affaires n’iraient bien qu’après sa mort. En conséquence, il tomba du haut de sa maison, se cassa le cou et mourut. Trois jours après, lorsqu’on allait faire ses funérailles, il revint à la vie, et fut dès lors le plus juste, le plus pieux et le plus homme de bien de la Cilicie. Comme on lui demandait la raison d’un tel changement, il disait qu’au moment de sa chute son âme s’était élevée jusqu’aux étoiles, dont il avait admiré la grandeur immense et l’éclat surprenant ; qu’il avait vu dans l’air un

Thessaliennes. La Thessalie possédait un si grand nombre de sorciers, et surtout de sorcières, que les noms de sorcière et de Thessalienne étaient synonymes.
Théurgie, art de parvenir à des connaissances surnaturelles et d’opérer des miracles par le secours des esprits ou génies que les païens nommaient des dieux et que les Pères de l’Église ont appelés avec raison des démons. Cet art imaginaire a été recherché et pratiqué par un grand nombre de philosophes. Mais ceux des troisième et quatrième siècles, qui prirent le nom d’éclectiques ou de nouveaux platoniciens, tels que Porphyre, Julien, Jamblique, Maxime, en furent principalement entêtés. Ils se persuadaient que, par des formules d’invocation, par certaines pratiques, on pouvait avoir un commerce familier avec les esprits, leur commander, connaître et opérer par leur secours des choses supérieures aux forces de la nature. Ce n’était, dans le fond, rien autre chose que la magie, quoique ces philosophes en distinguassent deux espèces, savoir : la magie noire et malfaisante, qu’ils nommaient goétie, et dont ils attribuaient les effets aux mauvais démons, et la magie bienfaisante, qu’ils appelaient théurgie, c’est-à-dire opération divine par laquelle on invoquait les bons esprits.
Comment savait-on, ajoute Bergier, que telles paroles ou telles pratiques avaient la vertu de subjuguer ces prétendus esprits et de les rendre obéissants ? Les théurgistes supposaient que les mêmes esprits avaient révélé ce secret aux hommes. Plusieurs de ces pratiques étaient des crimes, tels que les sacrifices de sang humain ; et il est établi que les théurgistes en offraient. Voy. Julien, Magie, Art notoire.
Thiers (Jean-Baptiste), savant bachelier de Sorbonne, professeur de l’Université de Paris, et ensuite curé de Vibraye, dans le diocèse du Mans ; né à Chartres en 1638, mort à Vibraye en 1703; auteur un peu janséniste de plusieurs ouvrages curieux, parmi lesquels on recherche toujours le Traité des superstitions, 4 vol. in-12. Il y rapporte une foule de petits faits singuliers.
Thomas (Saint). On lit dans les démonomanes que saint Thomas d’Aquin se trouvait incommodé dans ses études par le grand bruit des chevaux qui passaient tous les jours sous ses fenêtres pour aller boire. Comme il était habile à faire des talismans, il fit une petite figure de cheval qu’il enterra dans la rue ; et depuis, les palefreniers furent contraints de chercher un autre chemin, ne pouvant plus à toute force faire passer aucun cheval dans cette rue enchantée.
C’est un conte comme un autre. Voy. Albert le Grand.
Thomas. On lit dans plusieurs conteurs ce qui suit ; « Un moine nommé Thomas, à la suite d’une querelle qu’il eut avec les religieux d’un monastère de Lucques, se retira tout troublé dans un bois, où il rencontra un homme qui avait la face horrible, le regard sinistre, la barbe noire et le vêtement long. Cet homme vint au moine et lui demanda pourquoi il allait seul dans ces lieux détournés. Le moine répondit qu’il avait perdu son cheval et qu’il le cherchait. « Je vous aiderai, » dit l’inconnu. — Comme ils allaient ensemble à la poursuite du prétendu cheval égaré, ils arrivèrent au bord d’un ruisseau entouré de précipices. L’inconnu invita le moine, qui déjà se déchaussait, à monter sur ses épaules, disant qu’il lui était plus facile de passer à lui qui était plus grand. Thomas, fasciné par son compagnon, quoiqu’il en eut peur, y consentit. Mais lorsqu’il fut sur le dos de l’inconnu, il s’aperçut qu’il avait les pieds difformes d’un démon. Il commença à trembler et à se recommander à Dieu de tout son cœur. Le diable aussitôt se mit à murmurer, et s’échappa avec un bruit affreux en brisant un grand chêne qu’il arracha de terre. Quant au moine, il demeura étendu au bord du précipice, et remercia son bon ange de l’avoir ainsi tiré des griffes de Satan[57]. »
Thor, dieu de la foudre chez les anciennes races germaniques, qui l’armaient d’un marteau.
Thou. Il arriva en 1598 une aventure assez singulière au président de Thou. Il se trouvait depuis peu de temps dans la ville de Saumur. Une nuit qu’il était profondément endormi, il fut réveillé tout à Coup par le poids d’une masse énorme qu’il sentit se poser sur ses pieds. Il secoua fortement ce poids et le fit tomber dans la chambre… Le président ne savait encore s’il était bien éveillé, quand il entendit marcher tout auprès de lui. Il ouvrit les rideaux de son lit, et comme les volets de ses fenêtres n’étaient pas fermés et qu’il faisait clair de lune, il vit distinctement une grande figure blanche qui se promenait dans l’appartement… Il aperçut en même temps des hardes éparses sur des chaises auprès de la cheminée. Il s’imagina que des voleurs étaient entrés dans sa chambre ; et voyant la figure blanche se rapprocher de son lit, il lui demanda d’une voix forte : « Qui êtes-vous ? — Je suis la reine du ciel, » répondit le fantôme d’un ton solennel.
Le président, reconnaissant la voix d’une femme, se leva aussitôt ; et, ayant appelé ses domestiques, il leur dit de la faire sortir, et se recoucha sans demander d’éclaircissement. Le lendemain, il apprit que la femme qui lui avait rendu une visite nocturne était une folle, qui, n’étant pas renfermée, courait çà et là et servait de jouet au peuple. Elle était entrée dans la maison, qu’elle connaissait déjà, en cherchant un asile pour la nuit. Personne ne l’avait aperçue, et elle s’était glissée dans la chambre du président, dont elle avait trouvé la porte ouverte. Elle s’était déshabillée auprès du feu et avait étalé ses habits sur des chaises. Cette folle était connue dans la ville sous le nom de la Reine du ciel, qu’elle se donnait elle-même.
Thuggisme. C’est le nom qu’on donne dans l’Inde à l’assassinat ou au meurtre qui se commet par un principe dit religieux, c’est-à-dire pour plaire à l’une des affreuses divinités de l’Hindoustan, à Devi, appelée aussi la Noire, la Dévorante, la Mangeuse d’hommes, etc. Celui qui assassine en ce sens se cache sur le chemin du voyageur, lui jette un lacet et l’étrangle. Il croit par là mériter. Ces assassins, que nous nommons étrangleurs, s’appellent dans l’Inde les thugs.
Thurifumie, divination par la fumée de l’encens.
Thymiamata, parfums d’encens qu’on employait chez les anciens pour délivrer ceux qui étaient possédés de quelque mauvais esprit.
Thyrée (Pierre), jésuite, auteur d’un livre sur les démoniaques, les maisons infestées et les frayeurs nocturnes[58].
Tibalang, fantômes que les naturels des Philippines croient voir sur la cime de certains vieux arbres, dans lesquels ils sont persuadés que les âmes de leurs ancêtres ont leur résidence. Ils se les figurent d’une taille gigantesque ; de longs cheveux, de petits pieds, des ailes très-étendues et le corps peint.
Tibère. Cet empereur romain voyait clair dans les ténèbres, selon Cardan, qui avait la même propriété. Voy. Trasulle.
Ticho-Brahé, astronome suédois. Il croyait que sa journée serait malheureuse et s’en retournait promptement si, en sortant de son logis, la première personne qu’il rencontrait était une vieille ou si un lièvre traversait son chemin.
Tieck (Louis), auteur allemand d’un livre qui, sous forme de roman, donne dans un esprit hostile à l’Église l’histoire de la vauderie en Artois au quinzième siècle. Il a été traduit en français sous ce titre : le Sabbat des sorcières ; in-8o.
Tigre (Le grand). Voy. Lièvre.
Tintement. Lorsque nous sentons une chaleur à la joue, dit Brown, ou que l’oreille nous tinte, nous disons ordinairement que quelqu’un parle de nous. Ce tintement d’oreille passait chez nos pères pour un très-mauvais augure.
Tiphaine. Nos anciennes chroniques soupçonnaient de féerie ou de commerce avec les fées toutes les femmes dans l’histoire desquelles ils trouvaient du merveilleux. La Pucelle d’Orléans fut accusée d’avoir eu commerce avec les fées auprès d’une fontaine de son pays, que l’on appelle encore la fontaine des Fées ou des Dames. L’ancienne chronique de Duguesclin dit que dame Tiphaine, femme de ce héros, était regardée comme une fée, parce qu’elle était fort adroite et qu’elle prédisait à son mari tout ce qui devait lui arriver.
Tiromancie, divination par le fromage. On la pratiquait de diverses manières que nous ne connaissons pas.
Titania, reine des fées. Voy. Oberon.
Titus. On trouve raconté dans un vieux recueil de traditions juives que Titus prétendit avoir vaincu le Dieu des Juifs à Jérusalem. Alors une voix terrible se fit entendre, qui dit : « Malheureux, c’est la plus petite de mes créatures qui triomphera de toi. » En effet, un moucheron se glissa dans le nez de l’empereur et parvint jusqu’à son cerveau. Là pendant sept années, il se nourrit de cervelle d’empereur, sans qu’aucun médecin pût le déloger. Titus mourut après d’horribles souffrances. On ouvrit sa tête pour voir quel était ce mal contre lequel avaient échoué tous les efforts de la médecine, et on trouva le moucheron, mais fort engraissé. Il était devenu de la taille d’un pigeon. Il avait des pattes de fer et une bouche de cuivre[59].
Toia, nom sous lequel les habitants de la Floride adorent le diable, c’est-à-dire l’auteur du mal.
Tombeaux. Chez plusieurs nations idolâtres de l’antiquité, l’usage était d’aller dormir sur les tombeaux, afin d’avoir des rêves de la part des morts, de les évoquer en quelque sorte et de les interroger. Voy. Morts.
Tomtegobbe, le vieux du grenier, lutin suédois de la famille des Gobelins.
Tondal. Un soldat nommé Tondal, à la suite d’une vision, raconte qu’il avait été conduit par un ange dans les enfers. Il avait vu et senti les tourments qu’on y éprouve. L’ange l’avait conduit dans les diverses contrées de cet abîme ; et après lui avoir fait subir les horreurs du froid et la puanteur du soufre, expier le vol d’une vache qu’il se reprochait et comprendre les dangers d’une vie mal réglée, il lui fit entrevoir le paradis avec ses splendeurs, et le ramena ensuite dans son lit. Dès lors il se leva pour mener désormais une vie toute chrétienne[60].
Tonnerre. Le tonnerre a été adoré en qualité de dieu. Les Égyptiens le regardaient comme le symbole de la voix éloignée, parce que de tous les bruits c’est celui qui se fait entendre le plus loin. Lorsqu’il tonne, les Chingulais se persuadent que le ciel veut leur infliger un châtiment, et que les âmes des méchants sont chargées de diriger les coups pour les tourmenter et les punir de leurs péchés. En Bretagne on a l’usage, quand il tonne, de mettre un morceau de fer dans le nid des poules qui couvent[61], comme préservatif du tonnerre. Voy. Cloches, Évangile de saint Jean, etc.
Topielnitsys, malins esprits qui dansent sur les eaux en Russie et en Pologne.
Toqui. Le grand Toqui est le dieu suprême des Araucaniens. Il a pour ennemi Guécuba, qui est le démon.
Torngarsuk. Les Groënlandais ne font ni prières ni sacrifices et ne pratiquent aucun rite ; ils croient pourtant à l’existence de certains êtres surnaturels. Le chef et le plus puissant-de ces êtres est Torngarsuk, qui est invoqué surtout par les pêcheurs, et qu’ils représentent tantôt sous la

C’est auprès de cette divinité que les anguekkoks sont obligés de se rendre pour lui demander conseil, quand un Groënlandais tombe malade. Indépendamment de ce bon génie, qui est invisible à tout le monde, excepté à l’anguekkok, il en est d’autres qui, par l’entremise de l’anguekkok, enseignent ce qu’on doit faire ou ce qu’on doit éviter pour être heureux. Chaque anguekkok a en outre son esprit familier, qu’il évoque et qu’il consulte comme un oracle.
Torquemada (Antoine de), auteur espagnol de l’Hexameron ou six journées, contenant plusieurs doctes discours, etc.; avec maintes histoires notables et non encore ouïes, mises en français par Gabriel Chappuys, Tourangeau ; Lyon, 1582, in-8o ; ouvrage plein de choses prodigieuses et d’aventures de spectres et de fantômes.
Torreblanca (François), jurisconsulte de Cordoue, auteur d’un livre curieux sur les crimes des sorciers[62].
Torture. Quand on employait la torture contre les sorciers et que les tourments ne les faisaient pas avouer, on disait que le diable les rendait insensibles à la douleur.
Totam, esprit qui garde chaque sauvage de l’Amérique septentrionale. Ils se le représentent sous la forme de quelque bête, et, en conséquence, jamais ils ne tuent, ni ne chassent, ni ne mangent l’animal dont ils pensent que leur totam a pris la figure.
Toupan, esprit malin qui préside au tonnerre chez les naturels brésiliens.
Tour de force. Delrio rapporte cette histoire plaisante. Deux troupes de magiciens s’étaient réunies en Allemagne pour célébrer le mariage d’un grand prince. Les chefs de ces troupes étaient rivaux et voulaient chacun jouir sans partage de l’honneur d’amuser la cour. C’était le cas de combattre avec toutes les ressources de la sorcellerie. Que fit l’un des deux magiciens ? Il avala son confrère, le garda quelque temps dans son estomac, et le rendit ensuite par où vous savez. Cette espièglerie lui assura la victoire. Son rival, honteux et confus, décampa avec sa troupe et alla plus loin prendre un bain et se parfumer.
Tour de Montpellier. Il y a sans doute en-

Tour des Rats. Voy. Hatton II.
Tour de Wigla, tour maudite de la Norvège, où le roi païen Vermund fit brûler les mamelles de sainte Ethelrède avec du bois de la vraie croix, apportée à Copenhague par Olaüs III. On dit que depuis on a essayé inutilement de faire une chapelle de cette tour maudite ; toutes les croix qu’on y a placées successivement ont été consumées par le feu du ciel[63].
Tourterelle. Si on porte le cœur de cet oiseau dans une peau de loup, il éteindra tous les sentiments. Si on pend ses pieds à un arbre, l’arbre ne portera jamais de fruit. Si on frotte de son sang, mêlé avec de l’eau dans laquelle on aura fait cuire une taupe, un endroit couvert de poils, tous les poils noirs tomberont[64].
Traditions populaires. « C’est sur la fatalité et l’antagonisme du bien et du mal, dit un habile écrivain, dans le Quarterly Magazine, que se fonde la philosophie des traditions du peuple. Cette base se retrouve dans le conte le plus trivial où l’on introduit un pouvoir surnaturel ; et la nourrice qui fait son récit au coin de la cheminée rustique a la même science que les hiérophantes de la Grèce et les mages de la Perse. Le principe destructeur étant le plus actif dans ce bas monde, il reparaît dans toutes les croyances superstitieuses sous une variété infinie de formes, les unes sombres, les autres brillantes ; on retrouve partout les mêmes personnifications d’Oromase et d’Arimane et l’hérésie des manichéens. La vague crédulité du villageois ignorant s’accorde avec la science mythologique des anciens sages. Des peuples que l’Océan sépare sont rapprochés par leurs fables ; les hamadryades de la Grèce et les lutins de la Scandinavie dansent une ronde fraternelle avec les fantômes évoqués par le sorcier moderne ; celui-ci compose ses philtres, comme Canidie, avec la mandragore, la ciguë, les langues de vipères et les autres ingrédients décrits par Virgile et Horace. À la voix des sorciers modernes, comme à celle des magiciens de Thessalie, on entend encore le hibou crier, le corbeau croasser, le serpent siffler, et les ailes noires des scarabées s’agiter. Toutefois, le Satan des légendes n’est jamais revêtu de la sombre dignité de l’ange déchu ; c’est le diable, l’ennemi, méchant par essence, de temps immémorial. Sa rage est souvent impuissante, à moins qu’il n’ait recours à la ruse : il inspire la peur encore plus que la crainte. De là vient cette continuelle succession de caprices bizarres et de malices grotesques qui le caractérise ; de là cette familiarité qui diminue la terreur causée par son nom. Les mêmes éléments entrent dans la composition de toutes les combinaisons variées du mauvais principe qui engendra la race nombreuse des lutins sortis de l’enfer. Si le rire n’est pas toujours méchant et perfide, il exprime, assez bien du moins, la malice et la perfidie. C’est de l’alliance du rire et de la malice que sont nés tous ces moqueurs placés par les mythologues au rang des divinités. Tels sont le Momus des Grecs et le Loki des Scandinaves, l’un bouffon de l’Olympe, l’autre bouffon des banquets du Valhalla. » Les traditions populaires se conservent sous mille formes, Voy. Superstitions et tous les articles des esprits et démons.
Mais voici une tradition du Pas-de-Calais que nous communique un savant de la contrée.
« Dans les environs de Béthune, près de Beuvry, aux rives des marais qui avoisinent cette commune, était une fontaine assez remarquable. Ses eaux tourbillonnaient sans cesse et offraient à leur centre un vaste entonnoir qui engouffrait, pour ne jamais le laisser reparaître, tout ce qui était atteint par les rayons de ce tourbillonnement. Vainement on a cherché la profondeur du gouffre, la sonde n’a jamais pu en atteindre le fond ; et les habitants prétendaient que cette fontaine était traversée par un fleuve souterrain, dont les flots emportaient le plomb de la sonde et déterminaient le tourbillonnement des eaux « Dans les environs de Béthune, près de Beuvry, aux rives des marais qui avoisinent cette commune, était une fontaine assez remarquable. Ses eaux tourbillonnaient sans cesse et offraient à leur centre un vaste entonnoir qui engouffrait, pour ne jamais le laisser reparaître, tout ce qui était atteint par les rayons de ce tourbillonnement. Vainement on a cherché la profondeur du gouffre, la sonde n’a jamais pu en atteindre le fond ; et les habitants prétendaient que cette fontaine était traversée par un fleuve souterrain, dont les flots emportaient le plomb de la sonde et déterminaient le tourbillonnement des eaux à leur surface. Les vieillards, dit M. Félix Lequien, conservent, sur cette fontaine, de nombreuses légendes. Nous citerons la plus répandue :
» Dans des temps que bien des siècles séparent de nous, au milieu des marais de Beuvry, alors appelé Beury, était un castel. Ses noires murailles dominaient la vaste plaine d’eau qui les entourait. Une étroite chaussée, coupée de distance en distance par des ponts mobiles, formait le seul accès de cette habitation.
» Quel motif avait déterminé le châtelain qui s’était retiré là à choisir pour demeure un séjour si sauvage ? Personne ne le savait. Nul n’avait pu même l’entrevoir, depuis vingt ans qu’il s’y tenait renfermé ; nul n’avait pénétré dans ce château ni aux bâtiments extérieurs, où, nuit et jour, veillaient des étrangers dont on ne comprenait pas le langage et qui n’entendaient pas plus celui du pays.

» Une crainte superstitieuse en éloignait d’ailleurs chacun. Le château et son châtelain avaient été l’objet des conjectures de tous ; mais la disparition subite de ceux qui avaient trop hautement émis leur opinion là-dessus faisait qu’on n’osait plus, dans l’intimité même des veillées, parler du mystérieux manoir. Chacun supposait là des intelligences avec les esprits infernaux ; et il est certain que, tous les ans, dans la nuit qui précède le saint jour de Noël, il se passait dans le château des choses extraordinaires. De la plupart des maisons de Beuvry, une oreille attentive pouvait saisir les derniers sons, affaiblis par la distance, de mille voix confuses, proférant des cris et des gémissements mêlés d’éclats de rire. À minuit, tout rentrait dans le calme ordinaire ; le lendemain, pas un seul de ceux que les événements avaient effrayés n’aurait osé dire qu’il avait entendu le moindre bruit ; et vainement se serait-on préoccupé de pénétrer ce mystère. Parmi ceux [qui, dans les combats, avaient bravé la mort, nul n’aurait été assez hardi pour s’approcher des marais de Beuvry dans la nuit de la veille de Noël.
» Cet état de choses durait depuis vingt ans, quand, à l’aube de ce jour dont la nuit venait d’être troublée d’une manière encore plus extraordinaire que les années précédentes, ceux qui se hasardèrent à jeter un coup d’œil furtif et inquiet sur le château ne le découvrirent plus. Ce fut aussi vainement que des yeux ils cherchèrent une seconde, une troisième fois, cette masse de bâtiments au milieu des eaux qui, la veille encore, faisaient contraster sa sombre couleur avec la blancheur de l’onde et l’azur des cieux. Au plein jour seulement, quand le castel et ses accessoires n’apparurent pas davantage sur l’horizon, on osa se communiquer cet étrange événement. Chacun n’y voulut croire qu’après s’en être assuré par ses yeux. Rien n’apparaissait au milieu de la vaste plaine d’eau… pas le moindre vestige. L’étroite chaussée seule était restée intacte, comme pour rendre plus apparente la disparition des bâtiments auxquels elle avait abouti. Cependant on se hasarda, mais ce ne fut que plus d’un mois après, à s’avancer dans le marais ; on risqua quelques pas sur la chaussée. On parvint à son extrémité, et, à la place du castel, on trouva cette effroyable fontaine avec ses eaux tourbillonnantes et sa bouche incessamment béante. Elle reçut et conserva le nom que sa première vue inspira : on l’appela et on l’appelle encore la Fontaine hideuse.
» Ce qu’était, ce que devint le châtelain avec ses serviteurs, nul ne put jamais le savoir. La justice céleste avait puni de grands forfaits, disait-on ; mais on le conjecturait. Ce qu’on savait dans le pays, ce qu’on y croit encore, c’est que chaque année, dans la nuit de la veille de Noël, vers la douzième heure, on entend toujours sortir du fond de cette fontaine des cris, des gémissements et de sinistres éclats de rire. »
Traire par charmes. Voy. Blokula.
Trajan, empereur romain qui, selon Dion Cassius, se trouvant à Antioche lors de ce terrible tremblement de terre qui renversa presque toute la ville, fut sauvé par un démon, lequel se présenta subitement devant lui, le prit entre ses bras, sortit avec lui par une fenêtre et Remporta j hors de la ville.
On a écrit que Trajan ne rebâtit pas la ville d’Italica, où ses ancêtres étaient nés, parce qu’un mathématicien devin lui avait prédit qu’autant cette ville croîtrait en maisons, autant son empire décroîtrait en provinces.
Transmigration des âmes. Plusieurs anciens philosophes, comme Empédocle, Pythagore et Platon, avaient imaginé que les âmes, après la mort, passaient du corps qu’elles venaient de quitter dans un autre corps, afin d’y être purifiées avant de parvenir à l’état de béatitude. Les uns pensaient que ce passage se faisait seulement d’un corps humain dans un autre de même espèce. D’autres soutenaient que certaines âmes entraient dans les corps des animaux et même dans ceux des plantes. Cette transmigration était nommée par les Grecs métempsycose et métensomatose. C’est encore aujourd’hui un des principaux articles de la croyance des Indiens. Ce dogme absurde, enfanté par le panthéisme, leur fait considérer les maux de cette vie, non comme une épreuve utile à la vertu, mais comme la punition des crimes commis dans un autre corps. N’ayant aucun souvenir de ces crimes, leur croyance ne peut servir à leur en faire éviter aucun. Elle leur inspire de l’horreur pour la caste des parias, parce qu’ils supposent que ce sont des hommes qui ont commis des forfaits affreux dans une vie précédente. Elle leur donne plus de charité pour les animaux même nuisibles que pour les hommes, et une aversion invincible pour les Européens, parce qu’ils tuent les animaux. Enfin, la multitude des transmigrations leur fait envisager les récompenses de la vertu dans un si grand éloignement qu’ils n’ont plus le courage de les mériter[65].
Transport des sorcières. Quelques-unes se transportent au sabbat enlevées par les airs, comme Simon le magicien et sans monture ; mais, en France surtout, les sorcières considérables, lorsqu’elles emportaient au sabbat quelque enfant, étaient transportées et ramenées à domicile par un bouc qui voyageait dans le vide comme un oiseau.

Trasulle. Tibère, étant à Rhodes, voulut satisfaire sa curiosité relativement à l’astrologie judiciaire. Il fit venir l’un après l’autre tous ceux qui se mêlaient de prédire l’avenir ; il les attendait sur une terrasse élevée de sa maison au bord de la mer. Un de ses affranchis, d’une taille haute et d’une force extraordinaire, les lui amenait là à travers les précipices ; et si Tibère reconnaissait que l’astrologue n’était qu’un fourbe, l’affranchi ne manquait pas, à un signal convenu, de le précipiter dans la mer.
Il y avait alors à Rhodes un certain Trasulle, homme habile dans l’astrologie, disait-on, mais incontestablement d’un esprit très-adroit. Il fut conduit comme les autres à ce lieu écarté, assura à Tibère qu’il, serait empereur et lui prédit beaucoup de choses futures. Tibère lui demanda ensuite s’il connaissait ses propres destinées et s’il avait tiré son propre horoscope. Trasulle, qui avait eu quelques soupçons, car il n’avait vu revenir aucun de ses confrères, et qui sentit redoubler ses craintes en considérant le visage de Tibère, l’homme qui l’avait amené et qui ne le quittait point, le lieu élevé où il se trouvait, le précipice qui était à ses pieds, regarda le ciel comme pour lire dans les astres ; bientôt il s’étonna, pâlit et s’écria épouvanté qu’il était menacé d’une mort instante. Tibère, ravi d’admiration, attribua à l’astrologie ce qui n’était que de la présence d’esprit et de l’adresse, rassura Trasulle en l’embrassant, et le regarda comme un oracle.
Trazégnies, famille belge illustre à de justes et nombreux titres. Un conte populaire se rattache à cette noble maison. On dit que son chef fut père, d’une seule couche de sa femme, de treize fils ; qu’il voulut reconnaître l’aîné à son retour d’une course, mais que la mère, qui les aimait tous, les avait si bien mêlés dans treize berceaux

Trazgos, lutins espagnols, de l’espèce des Gobelins et des Kobolds.
Trèfle à quatre feuilles. Herbe qui croît sous les gibets, arrosée du sang des pendus. Un joueur qui la cueille après minuit le premier jour de la lune, et la porte sur soi avec révérence, est sûr de gagner à tous les jeux.
Trégitourie. Les nécromanciens du moyen âge devaient surtout leur renom d’habileté en magie à la faculté qu’ils possédaient de produire des illusions d’optique, faculté connue alors sous le nom de trégitourie. Godwin, dans son Histoire des nécromanciens, donne de curieux exemples des effets merveilleux produits à l’aide de la trégitourie par Agrippa, le docteur Faust et d’autres hommes célèbres. La lanterne magique, devenue si triviale, était leur grand instrument, et elle a conservé le nom qui la faisait regarder autrefois comme quelque chose de surhumain.
Treize. Nos anciens regardaient le nombre treize comme un nombre fatal, ayant remarqué que de treize personnes réunies à la même table, il en meurt une dans l’année ; ce qui n’arrive jamais quand on est quatorze…
Un premier président du parlement de Rouen, ne pouvant se résoudre à se mettre à table parce qu’il se trouvait le treizième, il fallut adhérer à sa superstition et faire venir une autre personne, afin qu’on fût quatorze. Alors il soupa tranquillement ; mais à peine sorti de table, il fut frappé d’une attaque d’apoplexie dont il mourut sur-le-champ.
Tremblements de terre. Les Indiens des montagnes des Andes croient, quand la terre tremble, que Dieu quitte le ciel pour passer tous les mortels en revue. Dans cette persuasion, à peine sentent-ils la secousse la plus légère qu’ils sortent tous de leurs huttes, courent, sautent et frappent du pied en s’écriant : Nous voici ! nous voici[66].
Certains docteurs musulmans prétendent que la terre est portée sur les cornes d’un grand bœuf ; quand il baisse la tête, disent-ils, il cause les tremblements de terre[67].
Les lamas de Tartarie croient que Dieu, après avoir formé la terre, l’a posée sur le dos d’une immense grenouille jaune, et que toutes les fois que cet animal prodigieux secoue la tête ou allonge les pattes, il fait trembler la partie de la terre qui est dessus[68].
Trésors. On croit dans l’Écosse qu’il y a sous les montagnes des trésors souterrains gardés par des géants et des fées ; en Bretagne, on croit qu’ils sont gardés par un vieillard, par une vieille, par un serpent, par un chien noir ou par de petits démons, hauts d’un pied. Pour se saisir de ces trésors, il faut, après quelques prières, faire un grand trou sans dire un mot. Le tonnerre gronde, l’éclair brille, des charrettes de feu s’élèvent dans les airs, un bruit de chaînes se fait entendre ; bientôt on trouve une tonne d’or. Parvient-on à l’élever au bord du trou, un mot qui vous échappe la précipite dans l’abîme à mille pieds de profondeur. — Les Bretons ajoutent qu’au moment où l’on chante l’évangile des Rameaux, les démons sont forcés d’étaler leurs trésors eh les déguisant sous des formes de pierres, de charbons, de feuillages. Celui qui peut jeter sur eux des objets consacrés les rend à leur première forme et s’en empare[69]. Voy. Argent.
Tribunal secret. C’est un de nos princes qui a fondé ce tribunal célèbre des francs-juges (des frey graves), qui retentit si puissamment dans tout le moyen âge, qui plane, si imposant et si mystérieux, sur la Germanie et le nord de la vieille Gaule et dont l’institution, le but, les actes ont été appréciés jusqu’à présent d’une manière si incomplète et souvent si fausse.
Il est possible qu’on s’étonne du point de vue sous lequel nous considérons la cour vehmique ; mais c’est après de mûres recherches que nous croyons avoir rencontré la vérité ; et nous pensons que notre façon de voir jettera sur l’histoire un jour nouveau, sur cette histoire des siècles écoulés qui est tout entière à refaire, non plus avec les vaines théories de ces hommes qui parlent et ne savent pas faire autre chose, tristes eunuques de sérail dont nous sommes assaillis, mais avec l’étude profonde des faits à reproduire, si animés, si vivants, si variés, si dramatiques.
Le nom de tribunal secret se comprend ; celui de cour vehmique est plus obscur : il vient du mot saxon vehmen, qui veut dire condamnateur, et non de væ mihi, comme l’ont dit ceux qu’on appelle les doctes. Jamais une cour de justice ne s’est donné un nom injurieux ou absurde. L’histoire, cette muse si pauvre et tant abusée, ne nous a conservé, sur le tribunal secret de Westphalie, que des notions peu satisfaisantes, parce que les francs-juges qui le composaient s’engageaient par un serment terrible au silence le plus absolu, qu’on osait à peine prononcer le nom de ce tribunal redouté, et que les écrivains se contentaient, plus qu’aujourd’hui, de saisir les superficies.
On lit dans le tome III, page 624, du Recueil des historiens de Brunswick, publié par Leibniz, que Charlemagne, vainqueur pour la dixième fois, en 779, des Saxons, peuples indomptables, qui n’avaient leur plaisir que dans le sang, leur richesse que dans le pillage, et qui honoraient leurs dieux avec des victimes humaines, envoya un ambassadeur au pape Léon III (qui ne régnait pas alors) pour lui demander ce qu’il devait faire de ces rebelles qu’il ne pouvait soumettre, et que pourtant il ne voulait pas exterminer. Le saint-père, ayant entendu le sujet de l’ambassade, se leva sans répondre un mot et alla dans son jardin, où ayant ramassé des ronces et de mauvaises herbes, il les suspendit à un gibet qu’il venait de former avec des bâtons. L’ambassadeur à son retour raconta à Charlemagne ce qu’il avait vu ; et le roi, car il n’était pas encore empereur, institua le tribunal secret, pour contraindre les païens du Nord à embrasser le Christianisme. Tous les historiens ont répété ce récit altéré. Bientôt, poursuivent-ils, toute la Germanie se remplit de délateurs, d’espions et d’exécuteurs. Le tribunal secret connut de tous les grands crimes, et son autorité s’étendit sur tous les ordres de l’État ; les électeurs, les princes, les évêques mêmes y furent soumis, et ne pouvaient être relevés de cette juridiction, dans certains cas, que par le pape ou par l’empereur. Néanmoins, dès le treizième siècle, les ecclésiastiques et les femmes n’étaient plus recherchés par la cour vehmique.
Les francs-juges, c’est le nom qu’on donnait généralement aux membres du tribunal secret, étaient ordinairement inconnus. Ils avaient des usages particuliers et des formalités cachées pour juger les malfaiteurs, et jamais, dit Æneas Sylvins, il ne s’est trouvé personne parmi eux à qui la crainte ou l’argent ait fait révéler le secret. Ils parcouraient les provinces pour connaître les criminels, dont ils prenaient les noms ; ils les accusaient ensuite devant le tribunal invisible ; on les citait ; on les condamnait ; on les inscrivait sur un livre de mort ; et les plus jeunes étaient chargés d’exécuter la sentence. Tous les membres faisaient cause commune ; lors même qu’ils ne s’étaient jamais vus, ils avaient pour se reconnaître un moyen qui est encore pour nous un mystère. C’étaient des mots d’ordre en saxon : stock, stein, grass, grein, et quelques autres qui peuvent bien n’être que des conjectures. Du reste le secret sè gardait si étroitement, que l’empereur lui-même ne savait pas, dit Mœser, pour quels motifs le tribunal secret vehmique faisait mourir un coupable.
Pour l’ordinaire, quand la cour vehmique avait proscrit un accusé, tous les francs-juges avaient ordre de le poursuivre ; et celui qui le rencontrait devait le tuer. S’il était trop faible pour ce métier de bourreau, ses confrères, en vertu de leurs serments, étaient tenus de lui prêter secours. Nous suivons toujours la masse des historiens, qui dans ces détails au moins sont exacts. Parfois, foulant aux pieds toutes les formes judiciaires, le tribunal secret condamnait un accusé sans le citer, sans l’entendre, sans le convaincre. Mais d’ordinaire on le sommait de comparaître, par quatre citations. Ceux qui étaient chargés de citer l’accusé épiaient, dans les ténèbres, le mo-

La personne citée se rendait à un carrefour où aboutissaient quatre chemins. Un franc-juge, masqué et couvert d’un manteau noir, s’approchait lentement en prononçant le nom du coupable qu’il cherchait, il l’emmenait en silence et lui jetait sur le visage un voile épais, pour l’empêcher de reconnaître le chemin qu’il parcourait. Les sentences se rendaient toujours à l’heure de minuit. Il n’était point de lieu qui ne pût servir aux séances du tribunal secret, tout caché qu’il était et à l’abri de toute surprise : c’était souvent une caverne. L’accusé y descendait, et on lui découvrait le visage ; il voyait alors ces justiciers qui étaient partout et nulle part, et dont les bras s’étendaient partout, comme la présence de l’Éternel. Mais tous ces juges étaient masqués, ils ne s’exprimaient que par signes, à la lueur des torches. Quand l’accusé avait parlé pour sa défense, et que l’heure du jugement était venue, on sonnait une cloche ; de vives lumières éclairaient l’assemblée, le prévenu se voyait au milieu d’un cercle nombreux de juges noirs. La cour qui condamna ainsi Conrad de Langen était composée de trois cents francs-juges, et un jour que l’empereur Sigismond, de la maison de Luxembourg, présidait le tribunal secret, mille juges siégeaient autour de lui.
Pour les crimes avérés, pour les longs brigandages, on ne citait point, parce que le coupable, dès qu’il savait que la cour vehmique avait les yeux sur lui, se hâtait de fuir devant les poignards de cette justice inévitable ; il abandonnait pour jamais la terre rouge ; c’est le nom que les invisibles donnaient à la Westphalie, siège de leurs séances, centre de leurs pouvoirs.
Quand les juges chargés d’exécuter les sentences du tribunal secret avaient trouvé et saisi le condamné, ils le pendaient, avec une corde faite de branches d’osier tordues et tressées, au premier arbre qui se rencontrait sur le grand chemin. S’ils le poignardaient, selon la teneur du jugement, ils attachaient le cadavre à un tronc d’arbre et laissaient dans la plaie le poignard, au manche duquel était attachée la sentence, afin que l’on sût que ce n’était pas là un meurtre, ni un assassinat, mais une justice des francs-juges.
On ne pouvait rien objecter aux sentences de ce tribunal ; il fallait sur-le-champ les exécuter avec la plus parfaite obéissance. Chaque juge s’était obligé, par d’épouvantables serments, à révéler tous les crimes qui viendraient à sa connaissance, dût-il dénoncer son père ou sa mère, son frère ou sa sœur, son ami ou ses parents sans exception. Il avait juré aussi de donner la mort à ce qu’il avait de plus cher, dès qu’il en recevrait l’ordre.
On cite ce mot du duc Guillaume de Brunswick, qui était initié au tribunal secret : « Il faudra bien, dit-il un jour tristement, que je fasse pendre le duc Adolphe de Sleswig, s’il vient me voir, puisque autrement mes confrères me feront pendre moi-même. »
Un prince de la même famille, le duc Frédéric de Brunswick, qui fut élu empereur un instant, ayant été condamné par les invisibles, ne marchait plus qu’entouré d’une garde nombreuse. Mais un jour qu’une nécessité le força à s’éloigner de quelques pas de sa suite, le chef de ses gardes, le voyant tarder à reparaître, l’alla joindre à l’entrée du petit bois où il s’était arrêté, le trouva assassiné, avec sa sentence pendue au poignard ; il vit le meurtrier qui se retirait gravement et n’osa pas le poursuivre.
C’était en l’année 1400. Il y avait alors cent mille francs-juges en Allemagne, et le tribunal vehmique était devenu si puissant, que tous les princes étaient contraints à s’y affilier. Sigismond, comme nous l’avons dit, le présida quelquefois. L’empereur Charles IV, pareillement de la maison de Luxembourg, trouva dans l’assistance des francs-juges une partie de sa force. Sans eux, l’odieux Wenceslas n’eût pu être déposé ; et de graves chroniques leur attribuent la mort de Charles le Téméraire.
Nous avons rapporté sommairement tout ce qui peut donner une idée de la vieille cour vehmique, en nous conformant aux récits de tous les historiens. Il paraît certain que cette institution est due à Charlemagne, mais non pas pour opprimer par la terreur, pour protéger au contraire le faible contre le fort. Lorsqu’il fonda ce tribunal tout-puissant, il établit à côté un refuge : la sentence était signifiée ; et tout criminel condamné par les frey graves, si c’était pour un délit religieux ou politique, pouvait, en vertu d’une loi formelle, éviter la mort en s’exilant. Le pays ainsi était délivré du coupable.
Dans la suite, toujours fidèles à leur mission de protéger la faiblesse et l’innocence, les francs-juges ne furent l’effroi que des hommes puissants. Un seigneur féodal qui tuait ou pillait ses sujets tombait bientôt sous le poignard des francs-juges. Un brigand s’arrêtait devant le sentier du crime, parce qu’il savait qu’en le parcourant il trouverait le tribunal des secrets vengeurs de l’Éternel. Les souverains, qui n’étaient pas exempts de la même crainte, repoussaient en tremblant les tentations de la tyrannie. Et, remarquez-le, dans les pays où le tribunal secret s’est étendu, les iniquités féodales sont bien plus rares. Vous ne trouverez ni en Allemagne, ni dans le nord des Gaules, les sanglantes horreurs qui rendent l’histoire d’Angleterre si épouvantable au moyen âge. L’affreux despotisme seigneurial, qui pesait sur la France du milieu, fut généralement léger au Nord. Les communes se formèrent, le commerce s’établit parce qu’il y avait une puissance occulte qui protégeait le peuple et qui atteignait les nobles voleurs de grand chemin.
Pour frapper vivement les grossières imaginations des temps barbares, il fallait bien que cette puissance fût mystérieuse et terrible. Un baron guerroyeur n’eût pas craint une petite armée ; il pâlissait au seul nom des francs-juges. Il savait qu’on n’évitait pas aisément leur sentence.
Quelquefois il arriva qu’un franc-juge, rencontrant un de ses amis condamné par le tribunal secret, l’avertit du danger qu’il courait, en lui disant : On mange ailleurs aussi bon pain qu’ici ; mais dès lors les francs-juges, ses confrères, étaient tenus, par leurs serments, de pendre le traître sept pieds plus haut que tout autre criminel condamné au même supplice. C’est qu’il fallait, nous le répétons, que cette justice fût inévitable. Les foudres de Rome étaient le seul frein des hommes qui pensaient ; le tribunal secret, la seule terreur des hommes matériels.
À la fin du quinzième siècle, les francs-juges devinrent moins nécessaires. Alors donc ce tribunal, dont la vaste étendue occupée par cent mille juges faisait ombrage aux souverains, car il pouvait être dangereux, attira leur attention. Ils cherchèrent à le supprimer. Celui qui seul y parvint fut l’époux de Marie de Bourgogne. Maximilien, élevé à l’empire, abolit à jamais, en 1512, le tribunal vehmique. Charles-Quint, son petit-fils et son successeur, maintint cette abolition, dont il ne resta que quelques vestiges impuissants.
Nous avons voulu, dans les notes qu’on vient de lire, mettre les savants sur une voie nouvelle relativement à la cour vehmique. Peut-être un investigateur plus habile montrera-t-il dans l’histoire les services immenses qu’elle a rendus.
Trithème (Jean), savant abbé de l’ordre de Saint-Benoît, qui chercha à perfectionner la stéganographie ou l’art d’écrire en chiffres. On prit ses livres pour des ouvrages magiques ; et Frédéric II, électeur palatin, fit brûler publiquement les manuscrits originaux qui se trouvaient dans sa bibliothèque. Mort en 1516.
M. Audin, à qui l’histoire vraie doit de si beaux, de si consciencieux et de si savants travaux, a publié, dans ses études sur les couvents, une étude très-remarquable de Trithème, regardé dans le Rhingau comme un magicien de l’espèce de Faust, évoquant les morts et faisant des prodiges.
Trodds, petits lutins danois, qui sont toujours habillés de gris et coiffés d’un chapeau rouge.
Troian, roi de Servie, dans les temps obscurs. Sa légende a été célébrée dans un klechd ou chant populaire de la Servie, que la Revue du Nord a publié[70]. Ce roi ne pouvait supporter le soleil et ne se sentait vivre que la nuit. Il allait la nuit à ses rendez-vous et avait grand soin de rentrer avant le jour dans son palais, sans lumière. Mais un matin, oubliant l’approche de l’aurore, il prolongea sa visite malgré l’appel réitéré de son fidèle serviteur. Lorsqu’il se remit en route, l’aurore s’emparait du ciel ; il eut beau presser son cheval pour regagner sa demeure avant les premiers rayons du soleil, il en fut atteint à mi-chemin, sauta à bas de son cheval, s’étendit sur la terre humide et ordonna à son serviteur de le couvrir d’un épais manteau. Le fidèle varlet obéit, et courut expliquer au palais la cause de l’absence du maître. Pendant ce temps, des pâtres qui menaient leurs troupeaux aux prairies arrivent au manteau ; ils l’enlèvent, et Troian crie : « Couvrez-moi du manteau ; gardez-moi du soleil. » Mais ses prières sont inutiles ; les rayons du so-

Trois. Les anciens crachaient trois fois dans leur sein pour détourner les enchantements. En Bretagne, un bruit qui se fait entendre trois fois annonce un malheur. On sait aussi que trois flambeaux allumés dans la même chambre sont un mauvais présage.
Trois-Échelles, sorcier de Charles IX, qui le fit brûler à la fin pour avoir joint aux sortilèges les empoisonnements et les meurtres. Il avoua dans son interrogatoire que le nombre de ceux de son temps qui s’occupaient de magie passait dix-huit mille. Bodin raconte le tour suivant de ce sorcier : En présence du duc d’Anjou, depuis Henri III, il attira les chaînons d’une chaîne d’or d’assez loin, et les fit venir dans sa main ; après quoi la chaîne se trouva entière. Naudé parle de Trois-Échelles, dans le chapitre ni de son Apologie des grands personnages soupçonnés de magie. Il reconnaît que c’était un charlatan, un escamoteur et un fripon.
Trois-Rieux. Voy. Macrodor.
Troldman, magicien chez les Scandinaves. Voy. Harold.
Trollen, esprits follets qui, selon Leloyer, se louent comme domestiques dans le Nord, en habits de femme ou d’homme, et s’emploient aux services les plus honnêtes de la maison. Ce sont les mêmes que les drolles.
Tronc d’arbre. Le diable prend quelquefois cette forme au sabbat.
Trophonius. Voy. Songes.
Trou du château de Carnoët. J’ai visité, dit Cambry dans son Voyage du Finistère, les ruines massives de l’antique château de Carnoët, sur la rive droite du Laïta (c’est le nom que l’isole et l’Ellé prennent après leur réunion) ; les pans de murs, couverts de grands arbres, de ronces, d’épines, de plantes de toute nature, ne laissent apercevoir que leur grandeur ; des fossés remplis d’une eau vive l’entouraient, des tours le protégeaient. C’était sans doute un objet de terreur pour le voisinage ; il y paraît par les contes qu’on nous en rapporte.
Un de ses anciens propriétaires, type de la Barbe-Bleue, égorgeait ses femmes dès qu’elles étaient grosses. La sœur d’un saint devint son épouse. Convaincue, quand elle s’aperçut de son état, qu’il fallait cesser d’être, elle s’enfuit ; son barbare époux la poursuit, l’atteint, lui tranche la tête et retourne dans son château. Le saint, son frère, instruit de cette barbarie, la ressuscite et s’approche de Carnoët : on lui refuse d’en baisser les ponts-levis. À la troisième supplication sans succès, il prend une poignée de poussière, la lance en l’air ; le château tombe avec le prince, il s’abîme dans les enfers. Le trou par lequel il passa subsiste encore. Jamais, disent les bonnes gens, on n’essaya d’y pénétrer sans devenir la proie d’un énorme dragon.
Troupe furieuse. En Allemagne la superstition a fait donner ce nom à certains chasseurs mystérieux qui sont censés peupler les forêts. Voy. Monsieur de la Forêt, Veneur, etc.
Troupeaux. Garde des troupeaux. — Les bergers superstitieux donnent le nom de gardes à certaines oraisons incompréhensibles accompagnées de formules. Ce qui va suivre nous fera comprendre. Le tout est textuellement transcrit des grimoires et autres mauvais livres de noirs mystères. Nous pensons que la stupidité de ces procédés les combat suffisamment. Les recueils ténébreux donnent ces gardes comme capables

Le château de Belle, garde pour les chevaux. — Prenez du sel sur une assiette ; puis, ayant le dos tourné au lever du soleil et les animaux devant vous, prononcez, la tête nue, ce qui suit : « Sel qui es fait et formé au château de Belle, je te conjure au nom de Gloria, d’Orianté et de Galliane, sa sœur ; sel, je te conjure que tu aies à me tenir mes vifs chevaux de bêtes cavalines que voici présents sains et nets, bien buvant, bien mangeant, gros et gras ; qu’ils soient à ma volonté ; sel dont sel, je te conjure par la puissance de gloire et par la vertu de gloire, et en toute mon intention toujours de gloire. » Ceci prononcé au coin du soleil levant, vous gagnez l’autre coin, suivant le cours de cet astre, vous y prononcez ce que dessus. Vous en faites de même aux autres coins ; et étant de retour où vous avez commencé, vous y prononcez de nouveau les mêmes paroles. Observez, pendant toute la cérémonie, que les animaux soient toujours devant vous, parce que ceux qui traverseront sont autant de bêtes folles. Faites ensuite trois tours autour de vos chevaux, faisant des jets de votre sel sur les animaux, disant : « Sel, je te jette de la main que Dieu m’a donnée ; Grapin, je te prends, à toi je m’attends. » Dans le restant de votre sel, vous saignerez l’animal sur qui on monte, disant : « Bête cavaline, je te saigne de la main que Dieu m’a donnée ; Grapin, je te prends, à toi je m’attends. » On doit saigner avec un morceau de bois dur, comme du buis ou poirier ; on tire le sang de quelle partie on veut, quoi qu’en disent quelques capricieux qui affectent des vertus particulières à certaines parties de l’animal. Nous recommandons seulement, quand on tire le sang, que l’animal ait le cul derrière vous. Si c’est par exemple un mouton, vous lui tiendrez la tête dans vos jambes. Enfin, après avoir saigné l’animal, vous faites une levée de corne du pied droit, c’est-à-dire que vous lui coupez un petit morceau de corne du pied droit avec un couteau ; vous le partagez en deux et en faites une croix. Vous mettez cette croisette dans un morceau de toile neuve, puis vous la couvrez de votre sel ; vous prenez ensuite de la laine, si vous agissez sur les moutons ; autrement vous prenez du crin, vous en faites ainsi une croisette que vous mettez dans votre toile sur le sel, vous mettez sur cette laine ou crin une seconde couche de sel ; vous faites encore une autre croisette de cire vierge pascale ou chandelle bénite, puis vous mettez le restant de votre sel dessus, et nouez le tout en pelote avec une ficelle ; frottez avec cette pelote les animaux au sortir de l’écurie, si ce sont des chevaux. Si ce sont des moutons, on les frottera au sortir de la bergerie ou du parc, prononçant les paroles qu’on aura employées pour le jet ; on continue à frotter pendant un, deux, trois, sept, neuf ou onze jours de suite. Ceci dépend de la force et de la vigueur des animaux. Notez que vous ne devez faire vos jets qu’au dernier mot ; quand vous opérez sur les chevaux, prononcez vivement ; quand il s’agira de moutons, plus vous serez long à prononcer, mieux vous ferez.
Toutes les gardes se commencent le matin du vendredi, au croissant de la lune ; et, en cas pressant, on passe par-dessus ces observations. Il faut avoir soin que vos pelotes ne prennent pas d’humidité, parce que les animaux périraient. On les porte ordinairement dans un gousset ; mais, sans vous charger de ce soin inutile, faites ce que font les praticiens experts : placez-les chez vous en quelque lieu sec, et ne craignez rien. Nous avons dit ci-dessus de ne prendre de la corne que du pied droit pour faire la pelote ; la plupart en prennent des quatre pieds, et en font conséquemment deux croisettes, puisqu’ils en ont quatre morceaux. Cela est superflu et ne produit rien de plus. Si vous faites toutes les cérémonies des quatre coins au seul coin du soleil levant, le troupeau sera moins dispersé. Remarquez qu’un berger mauvais, qui en veut à celui qui le remplace, peut lui causer bien des peines et même faire périr le troupeau : premièrement par le moyen de la pelote qu’il coupe en morceaux et qu’il disperse sur une table ou ailleurs ; ensuite par le moyen d’une taupe ou d’une belette ; enfin par le moyen d’une grenouille ou raine verte, ou queue de morue qu’il met dans une fourmilière, disant : Maudition, perdition. Il l’y laisse durant neuf jours, après lesquels il la relève avec les mêmes paroles, la mettant en poudre et en semant où doit paître le troupeau. Il se sert encore de trois cailloux pris en différents cimetières, et, par le moyen de certaines paroles que nous ne voulons pas révéler, il donne des courantes, cause la gale et fait mourir autant d’animaux qu’il souhaite.
Autre garde. — « Astarin, Astarot qui est Bahol, je te donne mon troupeau à ta charge et à ta garde ; et pour ton salaire je te donnerai bête blanche ou noire, telle qu’il me plaira. Je te conjure, Astarin, que tu me les garde partout dans ces jardins, en disant hurlupapin. » Vous agirez suivant ce que nous avons dit au château de Belle, et ferez le jet, prononçant ce qui suit : « Gupin férant a failli le grand, c’est Caïn qui te fait chat. » (Vous les frotterez, avec les mêmes paroles.)
Autre garde. — « Bête à laine, je prie Dieu que la saignerie que je vais faire prenne et profite à ma volonté. Je conjure que tu casses et brises tous sorts et enchantements qui pourraient être passés dessus le corps de mon vif troupeau de bêtes à laine que voici présent devant Dieu et devant moi, qui sont à ma charge et à ma garde. » Voyez ci-dessus ce que nous avons dit pour opérer au château de Belle, et vous servez pour le jet et frottement des paroles qui suivent :
« Passe flori, tirlipipi. »
Garde contre la gale, rogne et clavelée. — « Ce fut par un lundi au matin que le Sauveur du monde passa, la sainte Vierge après lui, monsieur saint Jean, son pastoureau, son ami, qui cherche son divin troupeau. Mon troupeau sera sain et joli, qui est sujet à moi. Je prie madame sainte Geneviève qu’elle m’y puisse servir d’amie, dans ce malin claviau ici. Claviau banni de Dieu, je te commande que tu aies à sortir d’ici, et que tu aies à fondre et à confondre devant Dieu et devant moi, comme fond la rosée devant le soleil. O sel ! je te conjure de la part du grand Dieu vivant que tu me puisses servir à ce que je prétends, que tu me puisses préserver et garder mon troupeau de rogne, gale, pousse, de pousset, de gobes et de mauvaises eaux. » Avant toutes choses, à cette garde (rédigée, ainsi que les autres, par quelque paysan), ayez recours au château de Belle et faites le jet et les frottements, prononçant quelques formules.
Garde contre la gale. — « Quand Notre-Seigneur monta au ciel, sa sainte vertu en terre laissa. Pasle, Collet et Herve ; tout ce que Dieu a dit a été bien dit. Bête rousse, blanche ou noire, de quelque couleur que tu sois, s’il y a quelque gale ou rogne sur toi, fût-elle mise et faite à neuf pieds dans terre, il est vrai qu’elle s’en ira et mortira. » Vous vous servirez pour le jet et pour les frottements des mots suivants, et aurez recours à ce que nous avons dit au château de Belle : « Sel, je te jette de la main que Dieu m’a donnée. Volo et vono Baplista Sancta Aca latum est. »
Garde pour empêcher les loups d’entrer sur le terrain où sont les moutons. — Placez-vous au coin du soleil levant et prononcez cinq fois ce qui va suivre. Si vous ne le souhaitez prononcer qu’une fois, vous en ferez autant cinq jours de suite. « Viens, bête à laine, je te garde. Va droit, bête grise, à gris agripeuse ; va chercher ta proie, loups et louves et louveteaux ; tu n’as point à venir à cette viande qui est ici. » Ceci prononcé au coin que nous avons dit, on continue de faire de même aux autres coins ; et, de retour où l’on a commencé, on le répète de nouveau. Voyez pour le reste le château de Belle, puis faites le jet avec les paroles qui suivent : Vanus vanes, attaquez sel soli.
Garde pour les chevaux. — « Sel, qui es fait et formé de l’écume de mer, je te conjure que tu fasses mon bonheur et le profit de mon maître ; je te conjure au nom de Grouay, Rou et Rouvayet ; viens ici, je te prends pour mon valet (en jetant le sel). (Gardez-vous de direRouvaye.) Ce que tu feras, je le trouverai bien fait. » Cette garde est forte et quelquefois pénible, dit l’auteur. Voy. Oraison du loup. (Une variante.)
Trows, esprits qui, dans l’opinion des habitants des îles Shetland, résident dans les cavernes intérieures des collines. Ils sont habiles ouvriers en fer et en toutes sortes de métaux précieux. Voy. Mineurs, Montagnards, etc.
Truie. Les juges laïques de la prévôté de Paris, qui étaient très-ardents, firent brûler en 1466 Gillet-Soulart et sa truie, pauvre charlatan qui avait simplement appris à sa pauvre truie l’art de se redresser et de tenir une quenouille. On l’appelait la truie qui file, et une enseigne a conservé son souvenir. On voyait là une œuvre du diable. Mais il fallait qu’il y eût encore là-dessous quelque horreur.
« Rien de plus simple, dit alors M. Victor Hugo (Notre-Dame de Paris), qu’un procès de sorcellerie intenté à un animal. On trouve dans les comptes de la prévôté pour 1466 un curieux détail des frais du procès de Gillet-Soulart et de sa truie, exécutés pour leur démérites à Corbeil. Tout y est : le coût des fosses pour mettre la truie, les cinq cotrets pris sur le port de Morsang, les trois pintes de vin et le pain, dernier repas du patient, fraternellement partagé par le bourreau, jusqu’aux onze jours de garde et de nourriture de la truie, à huit deniers parisis chacun. »
La truie a ses fastes dans l’antiquité. Les Grundules étaient des espèces de dieux lares établis par Romulus en l’honneur d’une truie qui avait porté trente petits. Voyez Porcs.
Tschouwasches. L’irich ou jerich est un faisceau sacré devant lequel les Tschouwasches, peuplade de Sibérie, font leurs prières. Ce faisceau est composé de jets choisis du rosier sauvage, au nombre de quinze, d’égale grosseur, et longs d’environ quatre pieds, qu’on lie par le milieu avec une bande d’écorce, à laquelle on pend un petit morceau d’étain. Chaque maison en a un pareil à soi. Il n’est permis à personne de le toucher jusqu’en automne. Alors, lorsque toutes les feuilles sont tombées, on va en cueillir un nouveau et jeter dévotement l’ancien dans une eau courante.
Tullie. Vers le milieu du seizième siècle, on découvrit un tombeau près de la voie Appienne. On y trouva le corps d’une jeune fille nageant dans une liqueur inconnue. Elle avait les cheveux blonds, attachés avec une boucle d’or ; elle était aussi fraîche que si elle n’eût été qu’endormie. Au pied de ce corps, il y avait une lampe qui brûlait et qui s’éteignit dès que l’air s’y fut introduit. On reconnut à quelques inscriptions que ce cadavre était là depuis quinze cents ans, et on conjectura que c’était le corps de Tullie, fille de Cicéron. On le transporta à Rome ; on l’exposa au Capitole, où tout le monde courut en foule pour le voir. Comme le peuple imbécile commençait à rendre à ces restes les honneurs dus aux saints, on le fit jeter dans le Tibre. Voy. Lampes merveilleuses.
Turlupins, secte de libertins qui allaient tout nus, et qui renouvelaient en France, en Allemagne et dans les Pays-Bas, au quatorzième siècle, les grossièretés des anciens cyniques. Ils disaient que la modestie et les mœurs étaient des marques de corruption, et que tous ceux qui avaient de la pudeur étaient possédés du diable.
Turpin, archevêque de Reims, mêlé dans toutes les chroniques de Charlemagne à la vie ou plutôt aux légendes de ce grand homme. On a conservé sous son nom une vision qu’il aurait eue, étant à Vienne, en Dauphiné, d’une troupe de démons qui s’en allaient vivement se saisir de l’âme de Charlemagne ou qui du moins se flattaient de cet espoir. Mais, peu après il les vit s’en revenant l’oreille basse de n’avoir pas réussi[71].
Tvardowski, magicien polonais qui semble un type du Faust allemand.
Tybilenus, nom du mauvais génie chez les Saxons.
Tylwyth-Teg (la belle famille). On donne ce nom dans le pays de Galles à une peuplade de petites fées qui viennent la nuit dans les fermes et rendent de bons offices aux ménages où il y a de l’ordre et de la propreté. Elles ont pour opposés les Ellyllons, lutins malicieux qui font des tours aux maisons mal tenues et aux mauvais serviteurs.
Tympanites, variété des vampires. Voyez Huet.
Tympanon, peau de bouc dont les sorciers font des outres où ils conservent leur bouillon. Voy. Sabbat.
Tyre, sorte d’instrument dont les Lapons se servent pour leurs opérations magiques. Scheffer nous en fournit la description : Cette tyre n’est autre chose qu’une boule ronde, de la grosseur d’une noix ou d’une petite pomme, faite du plus tendre duvet, polie partout y et si légère qu’elle semble creuse. Elle est d’une couleur mêlée de jaune, de vert et de gris ; le jaune y domine. On assure que les Lapons vendent cette tyre, qu’elle est comme animée, qu’elle a du mouvement ; en sorte que celui qui l’a achetée la peut envoyer en qualité de maléfices sur qui il lui plaît. La tyre va comme un tourbillon. S’il se rencontre en son chemin quelque chose d’animé, cette chose reçoit le mal qui était préparé pour une autre.
U
Ukobach, démon d’un ordre inférieur. Il se montre, toujours avec un corps enflammé ; on le

dit inventeur des fritures et des feux d’artifice. Il est chargé par Belzébuth d’entretenir l’huile dans les chaudières infernales.
Universités occultes. « Il existait un homme à qui Catherine de Médicis tenait autant qu’à ses enfants : cet homme était Cosme Ruggieri, qu’elle logeait à son hôtel de Soissons et dont elle avait fait un conseiller suprême, chargé de lui dire si les astres, ratifiaient les avis et le bon sens de ses conseillers ordinaires. De curieux antécédents justifiaient l’empire que ce Ruggieri conserva sur sa maîtresse jusqu’au dernier moment. Un des plus savants hommes du seizième siècle fut certes le médecin de Laurent de Médicis, duc d’Urbin, père de Catherine. Ce médecin fut appelé Ruggieri le vieux (vecchio Ruggier, et Roger l’Ancien chez les auteurs français qui se sont occupés d’alchimie), pour le distinguer de ses deux fils, Laurent Ruggieri, nommé le grand par les auteurs cabalistiques, et Cosme Ruggieri, l’astrologue de Catherine, également nommé Roger par plusieurs historiens français. Ruggieri le vieux était si considéré dans la maison de Médecis que les deux ducs, Cosme et Laurent, furent les parrains de ses deux enfants. Il dressa, de concert avec le fameux mathématicien Bazile, le thème de nativité de Catherine, en sa qualité de mathématicien, d’astrologue et de médecin de la maison de Médecis ; trois qualités qui se confondaient souvent.
» À cette époque, les sciences occultes se cultivaient avec une ardeur qui peut surprendre les esprits incrédules de notre siècle si souverainement analyseur ; mais peut-être verront-ils poindre dans ce croquis historique le germe des sciences positives, épanouies au dix-neuvième siècle, sans la poétique grandeur qu’y portaient les audacieux chercheurs du seizième siècle ; lesquels, au lieu de faire de l’industrie, agrandissaient l’art et fertilisaient la pensée. L’universelle protection accordée à ces sciences par les souverains de ce temps était d’ailleurs justifiée par les admirables, créations de tous les inventeurs, qui partaient de la recherche du grand œuvre pour arriver a des résultats étonnants. Aussi jamais les souverains ne furent-ils plus avides de ces mystères. Les Fugger, en qui les Lucullus modernes reconnaîtront leurs princes, en qui les banquiers reconnaîtrait leurs maîtres, étaient certes des calculateurs difficiles a surprendre ; eh bien, ces hommes si positifs, qui prêtaient les capitaux de l’Europe aux souverains du seizième siècle endettés aussi bien que ceux d’aujourd’hui, ces illustres hôtes de Charles-Quint, commanditèrent les fourneaux de Paracelse.
» Au commencement du seizième siècle, Ruggieri le vieux fut le chef de cette université secrète d’où sortirent les Nostradamus et les Agrippa qui, tour à tour furent médecins des Valois, enfin tous les astronomes y les astrologues, les alchimistes qui entourèrent a cette époque les princes de la chrétienté, et qui furent plus particulièrement accueillis et protégés en France par Catherine de Médicis. Dans le thème de nativité que dressèrent Bazile et Ruggieri le vieux, les principaux événements de la vie de Catherine furent prédits avec une exactitude désespérante pour ceux qui nient les sciences occultes. Cet horoscope annonçait les malheurs qui, pendant le siège de Florence, signalèrent le commencement de sa vie, son mariage avec un fils de France, l’avènement inespéré de ce fils an trône, la naissance de ses enfants et leur nombre. Trois de ses Ris devaient être rois chacun à son tour, deux filles devaient être reines ; tous devaient mourir sans postérité.
» Ce thème se réalisa si bien, que beaucoup d’historiens font cru fait après coup. Mais chacun sait que Nostradamus produisit, au château de Chaumont, où Catherine se trouvait lors de la conspiration de la Renaudie, un homme qui possédait le don de lire dans l’avenir. Or, sous le règne de François II, quand la reine voyait ses quatre fils en bas âge et bien portants, avant le mariage d’Élisabeth de Valois avec Philippe II, roi d’Espagne, avant celui de Marguerite de Valois avec Henri de Bourbon, roi de Navarre, Nostradamus et son ami confirmèrent toutes les circonstances du fameux thème. Cet homme, doué sans doute de seconde vue, et qui appartenait à la grande école des infatigables chercheurs du grand œuvre, mais dont la vie secrète a échappé a l’histoire, affirma que ce dernier enfant couronné mourrait assassiné.
» Après avoir placé la reine devant un miroir magique où se réfléchissait un fouet sur une des pointes duquel se dessina la figure de chaque enfant, l’astrologue imprimait un mouvement au rouet, et la reine comptait le nombre de tours qu’il faisait ; chaque tour était pour un enfant une année de règne. Henri IV, mis sur le rouet, fit vingt-deux tours. L’astrologue dit a la reine effrayée que Henri de Bourbon serait en effet roi de France et régnerait tout ce temps ; la reine Catherine lui voua une haine mortelle en apprenant qu’il succéderait au dernier dés Valois assassiné.
» Curieuse de connaître son genre de mort, il lui fut dit de se défier de Saint-Germain. Dès ce jour, pensant qu’elle serait renfermée ou violentée au château de Saint-Germain, elle n’y mit jamais le pied quoique ce château fût infiniment plus convenable à ses desseins, par sa proximité de Paris, que tous ceux où elle alla se réfugier avec le roi durant les troubles. Quand elle tomba malade, quelques jours après l’assassinat du duc de Cuise aux états de Blois, elle demanda le nom du prélat qui vint l’assister ; ont lui dit qu’il se nommait Saint-Germain : Je suis morte ! s’écriat-elle. Elle mourut le lendemain, ayant ; d’ailleurs accompli le nombre d’années que lui accordaient tous ses horoscopes. Cette scène, connue du Cardinal de Lorraine, qui la traita de sorcellerie, se réalisait peu à peu. François II n’avait régné que ses tours de rouet ; Charles IX accomplissait en ce moment son dernier. Si Catherine a dit ces singulières paroles à son fils Henri partant pour la Pologne : — Vous reviendrez bientôt ! il faut les attribuer à sa foi dans les sciences occultes et non à son dessein d’empoisonner le roi Marguerite de France était reine de Navarre, Élisabeth, reine d’Espagne, le duc d’Anjou était roi de Pologne.
» Beaucoup d’autres circonstances corroborèrent la foi de Catherine dans les sciences occultes. La veille du tournoi où Henri II fut blessé
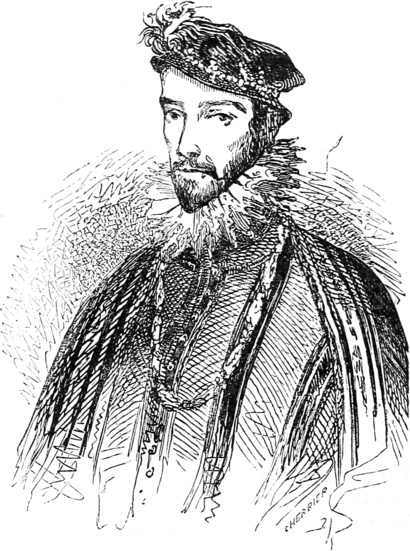
» Les mémoires du temps rapportent un autre fait non moins étrange. Le courrier qui annonçait la victoire de Moncontour arriva la nuit, après être venu si rapidement qu’il avait crevé trois chevaux. On éveilla la reine mère, qui dit : Je le savais. En effet, la veille, dit Brantôme, elle avait raconté le triomphe de son fils et quelques circonstances de la bataille. L’astrologue de la maison de Bourbon déclara que le cadet de tant de princes issus de saint Louis, que le fils d’Antoine de Bourbon serait roi de France. Cette prédiction, rapportée par Sully, fut accomplie dans les termes mêmes de l’horoscope, ce qui fit dire à Henri IV qu’à force de mensonges ces gens rencontraient le vrai. Quoi qu’il en soit, si la plupart des têtes fortes de ce temps croyaient à la vaste science appelée magisme par les maîtres de l’astrologie judiciaire et sorcellerie par le public, ils étaient autorisés par le succès des horoscopes. Ce fut pour Cosme Ruggieri, son mathématicien, son astronome, son astrologue, son sorcier, si l’on veut, que Catherine fit élever la colonne adossée à la halle au blé, seul débris qui reste de l’hôtel de Boissons. Cosme Ruggieri possédait, comme les confesseurs, une mystérieuse influence dont il se contentait comme eux ; d’ailleurs, il nourrissait une ambitieuse pensée supérieure à l’ambition vulgaire. Cet homme, que les romanciers ou les dramaturges dépeignent comme un bateleur, possédait la riche abbaye de Saint-Mahé en basse Bretagne, et avait refusé de hautes dignités ecclésiastiques ; l’or, que les pas sions superstitieuses çLe cette époque lui appor taient abondamment, suffisait à sa secrète entre prise, et la main de la reine, étendue sur sa tête, en préservait le moindre cheveu de tout mal[72]. »
Uphir, démon chimiste, très-versé dans la connaissance des simples. Il est responsable aux enfers de la santé de Belzébuth et des grands de sa cour. Les médecins matériels l’ont pris pour leur patron depuis le discrédit d’Esculape.
Upiers. Voy. Vampires.
Urda. Voy. Nornes.
Urgande, bonne fée des temps chevaleresques. Elle avait pour ennemie Mélye la Mauvaise. Voici une de ses aventures : La fée Urgande, qui protégeait si généreusement Amadis, avait donné au jeûne Esplandian, fils de ce héros, une épée enchantée qui devait rompre tous les charmes. Un jour qu’Esplandian et les chevaliers chrétiens se battaient en Galatie, aidés de la fée Urgande, ils aperçurent la fée Mélye, leur ennemie implacable, sous la figure la plus hideuse. Elle était assise à la pointe d’un rocher, d’où elle protégeait les armes dès Sarasins. Esplandian courut à elle pour purger la terre de cette furie (car, bien qu’immortelles de leur nature jusqu’au jugement dernier, les fées n’étaient pas à l’épreuve d’un bon coup d’épée, et pouvaient comme d’autres recevoir la mort, pourvu qu’elle fût violente). Mélye évita le coup en changeant de place avec la plus grande agilité ; et comme elle servit pressée, elle parut s’abîmer dans un antre qui vomit aussitôt des flammes. Urgande reconnut Mélye au portrait que les chevaliers lui en firent ; elle voulut la voir ; elle conduisit donc Esplandian et quelques chevaliers dans une prairie, au bout de laquelle ils trouvèrent Mélye assise sur ses talons et absorbée dans une profonde rêverie. Cette fée possédait un livre magique dont Urgande désirait depuis longtemps la possession. Mélye, apercevant Urgande composa son visage, accueillit la fée, sa rivale, avec aménité, et la fit entrer dans sa grotte. Mais à peine y avait-elle pénétré, que, s’élançant sur elle, la méchante fée la renversa par terre en lui serrant la gorge avec violence. Les chevaliers, les entendant se débattre, entrèrent dans la grotte : le pouvoir des enchantements les fit tomber sans connaissance ; le seul Esplandian, que son épée charmée garantissait de tous les pièges magiques, courut sur Mélye et retira Urgande de ses mains. Au même instant Mélye prit celui de ses livres qui portait le nom de Médée, et forma une conjuration ; le ciel s’obscurcit aussitôt : il sortit d’un nuage noir un chariot attelé de deux dragons qui vomissaient des flammes. Enlevant lestement Urgande, Mélye la plaça dans le chariot et disparut avec elle. Elle l’emmena dans Thésyphante et l’enferma dans une grosse tour, d’où Esplandian parvint à la tirer quelque temps après.
Urine. L’urine a aussi des vertus admirables. Elle guérit la teigne et les ulcères des oreilles, pourvu qu’on la prenne en bonne santé. Elle guérit aussi de la piqûre des serpents, des aspics et autres reptiles venimeux. Il paraît que les sorcières s’en servent pour faire tomber la pluie. Delrio conte que, dans le diocèse de Trèves, un paysan qui plantait des choux dans son jardin avec sa fille, âgée de huit ans, donnait des éloges à cette enfant sur son adresse à s’acquitter de sa petite fonction. « Oh ! répondit l’enfant, j’en sais bien d’autres. Retirez-vous un peu, et je ferai descendre la pluie sur telle partie du jardin que vous désignerez. — Fais, reprend le paysan surpris, je vais me retirer. » Alors la petite fille creuse un trou dans la terre, y répand son urine, la mêle avec la terre, prononce quelques mots, et la pluie tombe par torrents sur le jardin.
« Qui t’a donc appris cela ? s’écrie le paysan étourdi. — C’est ma mère, qui est très-habile dans cette science. » Le paysan effrayé fit monter sa fille et sa femme sur sa charrette, les mena à la ville, et les livrât toutes deux à la justice.
Nous ne parlerons de la médecine des urines que pour remarquer qu’elle est un peu moins incertaine que les autres spécialités de la même science, Des railleurs présentaient une fiole d’urine de cheval à un docteur de ce genre qu’ils voulaient mystifier ; il l’inspecta et la rendit en disant : « Donnez de l’avoine et du foin au malade. »
Les Égyptiens disaient qu’Hermès Trismégiste avait divisé le jour en douze heures et la nuit pareillement, sur l’observation d’un animal consacré à Sérapis, le Cynocéphale, qui jetait son urine douze fois par jour, et autant la nuit, à des intervalles égaux.
Urotopégnie, chevillement. Delancre dit qu’il y a un livre de ce nom dans lequel on voit que les moulins, les tonneaux, les fours, etc., peuvent être liés ainsi que les hommes. Voy. Ligatures.
Uterpen. Voy. Merlin.
Utéseture, espèce de magie pratiquée chez les Islandais ; on en fait remonter l’usagé jusqu’à Odin. Ceux qui se trouvent la nuit hors de leur logis s’imaginent converser avec des esprits, qui communément leur conseillent de faire le mal.
V
Vaccine. Quand l’inoculation s’introduisit à Londres, un ministre anglican la traita en chaire d’innovation infernale, de suggestion diabolique, et soutint que la maladie de Job n’était que la petite vérole que lui avait inoculée le malin[73].
D’autres pasteurs anglais ont traité pareillement la vaccine ; des médecins français ont écrit que la vaccine donnerait aux vaccinés quelque chose de la race bovine, que les femmes soumises à ce préservatif s’exposaient à devenir des vaches comme Io. Voy. les écrits des docteurs Vaume, Moulet, Chapon, etc.
Vache. Cet animal est si respecté dans l’Hindoustan, que tout ce qui passe par son corps a, pour les Hindous, une vertu sanctifiante et

médicinale. Les brahmes donnent du riz aux vaches, puis ils en cherchent les grains entiers dans leurs excréments, et font avaler ces grains aux malades, persuadés qu’ils sont propres à guérir le corps et à purifier l’âme. Ils ont une vénération singulière pour les cendres de bouse de vache. Les souverains ont à leur cour des officiers qui n’ont point d’autre fonction que de présenter le matin à ceux qui viennent saluer le prince un plat de ces cendres détrempées dans un peu d’eau. Le courtisan plonge le bout du doigt dans ce mortier, et se fait sur différentes parties du corps une onction qu’il regarde comme très-salutaire. Voy. Vaïcarani.
Chez les Hébreux, on sacrifiait une vache rousse, pour faire de ses cendres une eau d’expiation destinée à purifier ceux qui s’étaient souillés par l’attouchement d’un mort. C’est de là sans doute que vient, dans le Midi, l’opinion qu’une vache rousse est mauvaise.
Vade. La légende de Vade ou Wade et de son fils Véland le Forgeron est célèbre dans la littérature Scandinave. La voici telle que MM. Depping et Francisque Michel, guidés par les monuments de la Suède et de l’Islande, l’ont exposée dans leur Dissertation sur une tradition du moyen âge, publiée à Paris en 1833 :
« Le roi danois Wilkin, ayant rencontré dans une forêt, au bord de la mer, une belle femme, qui était une haffru ou femme de mer, espèce d’êtres marins qui, sur terre, prennent la forme d’une femme, s’unit avec elle, et le fruit de cette union fut un fils géant, qui fut appelé Vade. Wilkin lui donna douze terres en Seeiande. Vade eut à son tour un fils appelé Veland ou Vanlund. Quand ce dernier eut atteint Page de neuf ans, son père le conduisit chez un habile forgeron du Hunaland, appelé Mimer, pour qu’il apprît à forger, tremper et façonner le fer. Après l’avoir laissé trois hivers dans le Hunaland, le géant Vade se rendit avec lui à une montagne appelée Kallova, dont l’intérieur était habité par deux nains qui passaient pour savoir mieux forger le fer que les autres nains et que les hommes ordinaires. Ils fabriquaient des épées, des casques et des cuirasses ; ils savaient aussi travailler l’or et l’argent, et en faire toute sorte de bijoux. Pour un marc d’or, ils rendirent Veland le plus habile forgeron de la terre. Néanmoins ce dernier tua ses maîtres, qui voulaient profiter d’une tempête dans laquelle Vade avait péri pour mettre à mort leur élève. Veland s’empara alors des outils, chargea un cheval d’autant d’or et d’argent qu’il pouvait en porter, et reprit le chemin du Danemark, il arriva près d’un fleuve, nommé Visara ou Viser-Aa ; il s’arrêta sur la rive, y abattit un arbre, le creusa, y déposa ses trésors et ses vivres, et s’y pratiqua une demeure tellement fermée que l’eau ne pouvait y pénétrer. Après y être entré, il se laissa flotter vers la mer.
» Un jour, un roi de Jutland, nommé Nidung, pêchait avec sa cour, quand les pêcheurs retirèrent de leur filet un gros tronc d’arbre singulièrement taillé. Pour savoir ce qu’il pouvait contenir, on voulut le mettre en pièces ; mais tout à coup une voix, sortant du tronc, ordonna aux ouvriers de cesser. À cette voix, tous les assistants prirent là fuite, croyant qu’un sorcier était caché dans l’arbre. Veland en sortit ; il dit au roi qu’il n’était pas magicien, et que, si on voulait lui laisser la vie et ses trésors, il rendrait de grands services. Le roi lui promit. Veland cacha ses trésors en terre et entra au service de Nidung. Sa charge fut de prendre soin de trois couteaux que l’on mettait devant le roi à table. Le roi, ayant découvert l’habileté de Veland dans l’art de fabriquer des armes, consentit à ce qu’il luttât avec son forgeron ordinaire. Celui-ci fit une armure qu’il croyait impénétrable, mais que Veland fendit en deux d’un seul coup de l’épée d’or qu’il avait fabriquée en peu d’heures. Depuis lors, Veland fut en grande faveur auprès du roi ; mais ayant été mal récompensé d’un message pénible et dangereux, il ne songea plus qu’à se venger. Il tenta d’empoisonner le roi, qui s’en aperçut et lui fit couper les jarrets. Furieux de cette injure, Veland feignit du repentir ; et le roi consentit à lui laisser une forge et les outils nécessaires pour composer de belles armures et des bijoux précieux. Alors le vindicatif artisan sut attirer chez lui les deux fils du roi ; il les tua, et offrit à leur père deux coupes faites avec le crâne de ses enfants. Après quoi il se composa des ailes, s’envola sur la tour la plus élevée, et cria de toutes ses forces pour que le roi vînt et lui parlât. En entendant sa voix, le roi sortit. « Veland, dit-il, est-ce que tu es devenu oiseau ?
» — Seigneur, répondit le forgeron, je suis maintenant oiseau et homme à la fois ; je pars, et tu ne me verras plus. Cependant, avant de partir, je veux t’apprendre quelques secrets. Tu m’as fait couper les jarrets pour m’empêcher de m’en aller : je m’en suis vengé ; je t’ai privé de tes fils, que j’ai égorgés de ma main ; mais tu trouveras leurs ossements dans les vases garnis d’or et d’argent dont j’ai orné ta table. »
» Ayant dit ces mots, Veland disparut dans les airs.
» Ce récit est la forme la plus complète qu’ait reçue la légende de Vade et de son fils dans les monuments de la littérature Scandinave. Le chant de l’Edda, qui nous fait connaître Veland, diffère dans plusieurs de ses circonstances. Là, Veland est le troisième fils d’un roi alfe, c’est-à-dire d’espèce surnaturelle. Ces trois princes avaient épousé trois valkiries ou fées qu’ils avaient rencontrées au bord d’un lac, où, après avoir déposé leur robe de cygne, elles s’amusaient à filer du lin. Au bout de sept années de mariage, les valkiries disparurent, et les deux frères de Veland allèrent à la recherche de leurs femmes ; mais Veland resta seul dans sa cabane, et s’appliqua à forger les métaux. Le roi Niduth, ayant entendu parler des beaux ouvrages d’or que Veland faisait, s’empara du forgeron pendant qu’il dormait ; et, comme il faisait peur à la reine, celle-ci ordonna qu’on lui coupât les jarrets. Veland, pour se venger, accomplit les actions différentes que nous avons rapportées. »
Cette histoire de Wade et de son fils a été souvent imitée par les anciens poëtes allemands et anglo-saxons. Les trouvères français ont parlé plusieurs fois de Veland, de son habileté à forger des armures. Ils se plaisaient à dire que l’épée du héros qu’ils chantaient avait été trempée par Veland.
Vafthrudnis, génie des Scandinaves renommé pour sa science profonde. Odin alla le défier dans son palais, et le vainquit par la supériorité de ses connaissances.
Vagnoste, géant, père d’Agaberte. Voy. ce mot.
Vaïcarani, fleuve de feu que les âmes doivent traverser avant d’arriver aux enfers, selon la doctrine des Indiens. Si un malade tient en main la queue d’une vache au moment de sa mort, il passera sans danger le fleuve Vaïcarani, parce que la vache dont il a tenu la queue se présentera à lui sur le bord du fleuve ; il prendra sa queue et fera doucement le trajet par ce moyen.
Vaisseau-fantôme. Voy. Voltigeur hollandais.
Valafar ou Malafar, grand et puissant duc de l’empire infernal. Il paraît sous la forme d’un ange, quelquefois sous celle d’un lion avec la tête et les pattes d’une oie et une queue de lièvre. Il connaît le passé et l’avenir, donne du génie et de l’audace aux hommes, et commande trente-six légions[74].
Valens, empereur arien. « Curieux de savoir le nom de son successeur, il eut recours aux voies extraordinaires et défendues ; et comme le démon l’eut informé[75] qu’il le connaîtrait aux lettres théod, il fit mourir Théodore, Théodule, etc., sans penser à Théodose, qui lui succéda.
» Cette histoire, ajoute Chevreau, est peut-être plus connue que la suivante. Pierre-Louis, duc de Parme, étant averti par Lucas Gauric d’une conspiration contre lui, se mit en tête de savoir le nom des conjurés par l’évocation des esprits. Le démon lui répondit, se voyant pressé, que s’il prenait garde à sa monnaie, il trouverait ce qu’il demandait. Comme la réponse était obscure, et que pour l’entendre il fallait être aussi diable que le diable même, il s’en moqua, quoiqu’elle fût trouvée véritable par l’événement, puisque la légende de la vieille monnaie de Farnèse était p. alois, parm. et plac. dux. Par ces quatre lettres plac., qui signifient Placentiæ, il lui découvrait le lieu et le nom des conjurés. Chaque lettre des quatre marquait la première du nom des quatre familles qui exécutèrent leur entreprise : P, Pallavicini ; L, Landi ; A, Anguiscioli ; C, Confalonieri. »
Valentin, hérésiarque, originaire d’Égypte, qui enseigna sa doctrine peu de temps après la mort du dernier des apôtres. Il admettait un séjour éternel de lumière, qu’il nommait pléroma ou plénitude, dans lequel habitait la Divinité. Il y plaçait des Éons ou intelligences immortelles, au nombre de trente, les uns mâles, les autres femelles ; il les distribuait en trois ordres, les supposait nés les uns des autres, leur donnait des noms et faisait leur généalogie. Le premier était Bythos, la profondeur, qu’il appelait aussi le premier père, propator. Il lui donnait pour femme Ennoïa, l’intelligence, qu’il appelait encore le silence, Sigé. Jésus-Christ et le Saint-Esprit étaient les derniers nés de ces Éons.
On a peine à concevoir que Valentin ait eu de nombreux disciples et que plusieurs sectes soient nées de sa doctrine ; mais l’esprit humain fourvoyé a aussi ses prodiges.
Valentin (Basile). Voy. Basile-Valentin.
Valère-Maxime, écrivain qui florissait sous Tibère. Le premier livre de son Recueil des actions et des paroles mémorables roule principalement sur les prodiges et les songes merveilleux.
Valkiries. Voy. Walkiries.
Vampires. Ce qu’il y a de plus remarquable dans l’histoire des vampires, c’est qu’ils ont partagé avec les philosophes, ces autres démons, l’honneur d’étonner et de troubler le dix-huitième siècle ; c’est qu’ils ont épouvanté la Lorraine, la Prusse, la Silésie, la Pologne, la Moravie, l’Autriche, la Russie, la Bohême et tout le nord de l’Europe, pendant que les démolisseurs de l’Angleterre et de la France renversaient les croyances en se donnant le ton de n’attaquer que les erreurs populaires.
Chaque siècle, il est vrai, a eu ses modes ; chaque pays, comme l’observe D. Calmet, a eu ses préventions et ses maladies. Mais les vampires n’ont point paru avec tout leur éclat dans les siècles barbares et chez les peuples sauvages : ils se sont montrés au siècle des Diderot et des Voltaire, dans l’Europe, qui se disait déjà civilisée.
On a donné le nom d’upiers oupires, et plus généralement vampires en Occident, de broucolaques (vroucolacas) en Morée, de katakhanès à Ceylan, — à des hommes morts et enterrés depuis plusieurs années, ou du moins depuis plusieurs jours, qui revenaient en corps et en âme, parlaient, marchaient, infestaient les villages, maltraitaient les hommes et les animaux ; et surtout qui suçaient le sang de leurs proches, les épuisaient, leur causaient la mort[76]. On ne se délivrait de leurs dangereuses visites et de leurs infestations qu’en les exhumant, les empalant, leur coupant la tête, leur arrachant le cœur, ou les brûlant.
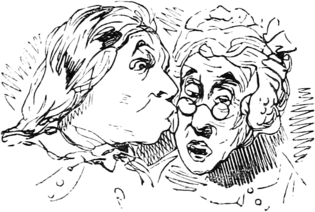
Ceux qui mouraient sucés devenaient habituellement vampires à leur tour. Les journaux publics de la France et de la Hollande parlent, en 1693 et 1694, des vampires qui se montraient en Pologne et surtout en Russie. On voit dans le Mercure galant de ces deux années que c’était alors une opinion répandue chez ces peuples que les vampires apparaissaient depuis midi jusqu’à minuit ; qu’ils suçaient le sang des hommes et des animaux vivants avec tant d’avidité, que souvent ce sang leur sortait par la bouche, par les narines, par les oreilles. Quelquefois, ce qui est plus fort encore, leurs cadavres nageaient dans le sang au fond de leurs cercueils.

On disait que ces vampires, ayant continuellement grand appétit, mangeaient aussi les linges qui se trouvaient autour d’eux. On ajoutait que, sortant de leurs tombeaux, ils allaient la nuit embrasser violemment leurs parents ou leurs amis, à qui ils suçaient le sang en leur pressant la gorge pour les empêcher de crier. Ceux qui étaient sucés s’affaiblissaient tellement qu’ils mouraient presque aussitôt. Ces persécutions ne s’arrêtaient pas à une personne seulement : elles s’étendaient jusqu’au dernier de la famille ou du village (car le vampirisme ne s’est guère exercé dans les villes), à moins qu’on n’en interrompît le cours en coupant la tête ou en perçant le cœur du vampire, dont on trouvait le cadavre mou, flexible, mais frais, quoique mort depuis très-longtemps. Comme il sortait de ces corps une grande quantité de sang, quelques-uns le mêlaient avec de la farine pour en faire du pain : ils prétendaient qu’en mangeant ce pain ils se garantissaient des atteintes du vampire.
Voici quelques histoires de vampires.
M. de Vassimont, envoyé en Moravie par le duc de Lorraine Léopold Ier, assurait, dit D. Calmet, que ces sortes de spectres apparaissaient fréquemment et depuis longtemps chez les Moraves, et qu’il était assez ordinaire dans ce pays-là de voir des hommes morts depuis quelques semaines se présenter dans les compagnies, se mettre à table sans rien dire avec les gens de leur connaissance, et faire un signe de tête à quelqu’un des assistants, lequel mourait infailliblement quelques jours après.
Un vieux curé confirma ce fait à M. de Vassimont et lui en cita même plusieurs exemples, qui s’étaient, disait-il, passés sous ses yeux.
Les évêques et les prêtres du pays avaient consulté Rome sur ces matières embarrassantes ; mais le saint-siége ne fit point de réponse, parce qu’il regardait tout cela comme des visions. Dès lors on s’avisa de déterrer les corps de ceux qui revenaient ainsi, de les brûler ou de les consumer en quelque autre manière, et ce fut par ce moyen qu’on se délivra de ces vampires, qui devinrent de jour en jour moins fréquents. Toutefois ces apparitions donnèrent lieu à un petit ouvrage composé par Ferdinand de Schertz, et imprimé à Olmutz, en 1706, sous le titre de Magia posthuma. L’auteur raconte qu’en un certain village, une femme, étant morte munie des sacrements, fut enterrée dans le cimetière à la manière ordinaire. On voit que ce n’était point une excommuniée, mais peut-être une sacrilège. Quatre jours après son décès, les habitants du village entendirent un grand bruit et virent un spectre qui paraissait tantôt sous la forme d’un chien, tantôt sous celle d’un homme, non à une personne seulement, mais à plusieurs. Ce spectre serrait la gorge de ceux à qui il s’adressait, leur comprimait l’estomac jusqu’à les suffoquer, leur brisait presque tout le corps et les réduisait à une faiblesse extrême ; en sorte qu’on les voyait pâles, maigres et exténués. Les animaux mêmes n’étaient pas à l’abri de sa malice : il attachait les vaches l’une à l’autre par la queue, fatiguait les chevaux et tourmentait tellement le bétail de toute sorte, qu’on n’entendait partout que mugissements et cris de douleur. Ces calamités durèrent plusieurs mois : on ne s’en délivra qu’en brûlant le corps de la femme vampire.
L’auteur de la Magia posthuma raconte une autre anecdote plus singulière encore. Un pâtre du village de Blow, près la ville de Kadam en Bohême, apparut quelque temps après sa mort avec les symptômes qui annoncent le vampirisme. Le fantôme appelait par leur nom certaines personnes, qui ne manquaient pas de mourir dans la huitaine. Il tourmentait ses anciens voisins, et causait tant d’effroi que les paysans de Blow déterrèrent son corps et le fichèrent en terre avec un pieu qu’ils lui passèrent à travers le cœur. Ce spectre, qui parlait quoiqu’il fût mort, et qui du moins n’aurait plus dû le faire dans une situation pareille, se moquait néanmoins de ceux qui lui faisaient souffrir ce traitement.
« Vous avez bonne grâce, leur disait-il, en ouvrant sa grande bouche de vampire, de me donner ainsi un bâton pour me défendre contre les chiens ? » On ne fit pas attention à ce qu’il put dire, et on le laissa. La nuit suivante, il brisa son pieu, se releva, épouvanta plusieurs personnes et en suffoqua plus qu’il n’avait fait jusqu’alors. On le livra au bourreau, qui le mit sur une charrette pour le transporter hors de la ville et l’y brûler. Le cadavre remuait les pieds et les mains, roulait des yeux ardents et hurlait comme un furieux. Lorsqu’on le perça de nouveau avec des pieux, il jeta de grands cris et rendit du sang très-vermeil ; mais quand on l’eut bien brûlé, il ne se montra plus…
On en usait de même, dans le dix-septième siècle, contre les revenants de ce genre ; et dans plusieurs endroits, quand on les tirait de terre, on les trouvait pareillement frais et vermeils, les membres souples et maniables, sans vers et sans pourriture, mais non sans une très-grande puanteur.
L’auteur que nous avons cité assure que de son temps on voyait souvent des vampires dans les montagnes de Silésie et de Moravie. Ils apparaissaient en plein jour, comme au milieu de la nuit, et l’on s’apercevait que les choses qui leur avait appartenu se remuaient et changeaient de place sans que personne parût les toucher. Le seul remède contre ces apparitions était de couper la tête et de brûler le corps du vampire.
Vers l’an 1725, un soldat qui était en garnison chez un paysan des frontières de la Hongrie vit entrer, au moment du souper, un inconnu qui se mit à table auprès du maître de la maison. Celui-ci en fut très-effrayé, de même que le reste de la compagnie. Le soldat ne savait qu’en juger et craignait d’être indiscret en faisant des questions, parce qu’il ignorait de quoi il s’agissait. Mais le maître du logis étant mort le lendemain, il chercha à connaître le sujet qui avait produit cet accident et mis toute la maison dans le trouble. On lui dit que l’inconnu qu’il avait vu entrer et se mettre à table, au grand effroi de la famille, était le père du maître de la maison ; qu’il était mort et enterré depuis dix ans, et qu’en venant ainsi s’asseoir auprès de son fils, il lui avait apporté la mort. Le soldat raconta ces choses à son régiment. On en avertit les officiers généraux, qui donnèrent commission au comte de Cabreras, capitaine d’infanterie, de faire information de ce fait. Cabréras s’étant transporté sur les lieux avec d’autres officiers, un chirurgien et un auditeur, ils entendirent les dépositions de tous les gens de la maison, qui attestèrent que le revenant n’était autre que le père du maître du logis, et que tout ce que le soldat avait rapporté était exact : ce qui fut aussi affirmé par la plupart des habitants du village. En conséquence, on fit tirer de terre le corps de ce spectre. Son sang était fluide et ses chairs aussi fraîches que celles d’un homme qui vient d’expirer. On lui coupa la tête, après quoi on le remit dans son tombeau. On exhuma ensuite, après d’amples informations, un homme mort depuis plus de trente ans, qui était revenu trois fois dans sa maison à l’heure du repas, et qui avait sucé au cou, la première fois, son propre frère ; la seconde, un de ses fils ; la troisième, un valet de la maison. Tous trois en étaient morts presque sur-le-champ. Quand ce vieux vampire fut déterré, on le trouva, comme le premier, ayant le sang fluide et le corps frais. On lui planta un grand clou dans la tête, et ensuite on le remit dans son tombeau. Le comte de Cabréras fit brûler un troisième vampire, qui était enterré depuis seize ans, et qui avait sucé le sang et causé la mort à deux de ses fils. — Alors enfin le pays fut tranquille[77].
On a vu, dans tout ce qui précède, que généralement, lorsqu’on exhume les vampires, leurs corps paraissent vermeils, souples, bien conservés. Cependant, malgré tous ces indices de vampirisme, on ne procédait pas contre eux sans formes judiciaires. On citait et on entendait les témoins, on examinait les raisons des plaignants, on considérait avec attention les cadavres : si tout annonçait un vampire, on le livrait au bourreau, qui le brûlait. Il arrivait quelquefois que ces spectres paraissaient encore pendant trois ou quatre jours après leur exécution ; cependant leur corps avait été réduit en cendres. Assez souvent on différait d’enterrer pendant six ou sept semaines les corps de certaines personnes suspectes. Lorsqu’ils ne pourrissaient point et que leurs membres demeuraient souples, leur sang fluide, alors on les brûlait. On assurait que les habits de ces défunts se remuaient et changeaient de place sans qu’aucune personne les touchât. L’auteur de la Magia posthuma raconte que l’on voyait à Olmutz, à la fin du dix-septième siècle, un de ces vampires qui, n’étant pas enterré, jetait des pierres aux voisins et molestait extrêmement les habitants.
Dom Calmet rapporte, comme une circonstance particulière, que, dans les villages où l’on est infesté du vampirisme, on va au cimetière, on visite les fosses, on en trouve qui ont deux ou trois, ou plusieurs trous de la grosseur du doigt ; alors on fouille dans ces fosses, et l’on ne manque pas d’y trouver un corps souple et vermeil. Si on coupe la tête de ce cadavre, il sort de ses veines et de ses artères un sang fluide, frais et abondant. Le savant bénédictin demande ensuite si ces trous qu’on remarquait dans la terre qui couvrait les vampires pouvaient contribuer à leur conserver une espèce de vie, de respiration, de végétation, et rendre plus croyable leur retour parmi les vivants ; il pense avec raison que ce sentiment, fondé d’ailleurs sur des faits qui n’ont rien de réellement constaté, n’est ni probable ni digne d’attention.
Le même écrivain cite ailleurs, sur les vampires de Hongrie, une lettre de M. de l’Isle de Saint-Michel, qui demeura longtemps dans les pays infestés, et qui devait en savoir quelque chose. Voici comment M. de l’Isle s’explique là-dessus :
« Une personne se trouve attaquée de langueur, perd l’appétit, maigrit à vue d’œil et, au bout de huit ou dix jours, quelquefois quinze, meurt sans fièvre et sans aucun autre symptôme de maladie que la maigreur et le dessèchement. On dit, en Hongrie, que c’est un vampire qui s’attache à cette personne et lui suce le sang. De ceux qui sont attaqués de cette mélancolie noire, la plupart, ayant l’esprit troublé, croient voir un spectre blanc qui les suit partout, comme l’ombre fait le corps.
» Lorsque nous étions en quartiers d’hiver chez les Valaques, deux cavaliers de la compagnie dont j’étais cornette moururent de cette maladie, et plusieurs autres, qui en étaient attaqués, seraient probablement morts de même, si un caporal de notre compagnie n’avaient guéri les imaginations en exécutant le remède que les gens du pays emploient pour cela. Quoique assez singulier, je ne l’ai jamais lu nulle part. Le voici :
» On choisit un jeune garçon, on le fait monter à poil sur un cheval entier, absolument noir ; on conduit le jeune homme et le cheval au cimetière ; ils se promènent sur toutes les fosses. Celle où l’animal refuse de passer, malgré les coups de cravache qu’on lui délivre, est regardée comme renfermant un vampire. On ouvre cette fosse, et on y trouve un cadavre aussi beau et aussi frais que si c’était un homme tranquillement endormi. On coupe, d’un coup de bêche, le cou de ce cadavre ; il en sort abondamment un sang, des plus beaux et des plus vermeils, du moins on croit le voir ainsi. Cela fait, on remet le vampire dans sa fosse, on la comble et on peut compter que dès lors la maladie cesse et que tous ceux qui en étaient attaqués recouvrent leurs forces peu à peu, comme des gens qui échappent d’une longue maladie d’épuisement… »
Les Grecs appellent leurs vampires broucolaques ; ils sont persuadés que la plupart des spectres d’excommuniés sont vampires, qu’ils ne peuvent pourrir dans leurs tombeaux, qu’ils apparaissent le jour comme la nuit, et qu’il est très-dangereux de les rencontrer.
Léon Allatius, qui écrivait au seizième siècle, entre là-dessus dans de grands détails ; il assure que dans l’île de Chio les habitants ne répondent que lorsqu’on les appelle deux fois, car ils sont persuadés que les broucolaques ne les peuvent appeler qu’une fois seulement. Ils croient encore que quand un broucolaque appelle une personne vivante, si cette personne répond, le spectre disparaît ; mais celui qui a répondu meurt au bout de quelques jours. On raconte la même chose des vampires de Bohême et de Moravie.
Pour se garantir de la funeste influence des broucolaques, les Grecs déterrent le corps du spectre et le brûlent, après avoir récité sur lui des prières. Alors ce corps, réduit en cendres, ne paraît plus.
Ricaut, qui voyagea dans le Levant au dix-septième siècle, ajoute que la peur des broucolaques est générale aux Turcs comme aux Grecs. Il raconte un fait qu’il tenait d’un caloyer candiote, lequel lui avait assuré la chose avec serment.
Un homme, étant mort excommunié pour une faute qu’il avait commise dans la Morée, fut enterré sans cérémonie dans un lieu écarté et non en terre sainte. Les habitants furent bientôt effrayés par d’horribles apparitions qu’ils attribuèrent à ce malheureux. On ouvrît son tombeau au bout de quelques années, on y trouva son corps enflé, mais sain et bien dispos ; ses veines étaient gonflées du sang qu’il avait sucé : on reconnut en lui un broucolaque. Après qu’on eut délibéré sur ce qu’il y avait à faire, les caloyers furent d’avis de démembrer le corps, de le mettre en pièces et de le faire bouillir dans le vin ; car c’est ainsi qu’ils en usent, de temps très-ancien, envers les broucolaques. Mais les parents obtinrent, à force de prières, qu’on différât cette exécution ; ils envoyèrent en diligence à Constantinople, pour solliciter du patriarche l’absolution dont le défunt avait besoin. En attendant, le corps fut mis dans l’église, où l’on disait tous les jours des prières pour son repos. Un matin que le caloyer faisait le service divin, on entendit tout d’un coup une espèce de détonation dans le cercueil : on l’ouvrit, et l’on trouva le corps dissous, comme doit l’être celui d’un mort enterré depuis sept ans. On remarqua le moment où le bruit s’était fait entendre ; c’était précisément l’heure où l’absolution accordée par le patriarche avait été signée…

Les Grecs et les Turcs s’imaginent, que les cadavres des broucolaques mangent pendant la nuit, se promènent, font la digestion de ce qu’ils ont mangé, et se nourrissent réellement (V. Mastication). Ils content qu’en déterrant ces vampires, on en a trouvé qui étaient d’un coloris vermeil, et dont les veines étaient tendues par la quantité de sang qu’ils avaient sucé ; que, lorsqu’on leur ouvre le corps, il en sort des ruisseaux de sang aussi frais, que celui d’un jeune homme d’un tempérament sanguin. Cette opinion populaire est si généralement répandue que tout le monde en raconte des histoires circonstanciées.
L’usage de brûler les corps des vampires est très-ancien dans plusieurs autres pays, Guillaume de Neubrige, qui vivait au douzième siècle, raconte[78] que, de son temps, on vit en Angleterre, dans le territoire de Buckingham, un spectre qui apparaissait en corps et en âme, et qui vint épouvanter sa femme et ses parents. On ne se défendait de sa méchanceté qu’en faisant grand bruit lorsqu’il approchait. Il se montra même à certaines personnes en plein jour. L’évêque de Lincoln assembla sur cela son conseil, qui lui dit que pareilles choses étaient souvent arrivées en Angleterre, et que le seul remède que l’on connût à ce mal était de brûler le corps du spectre. L’évêque ne put goûter cet avis, qui lui parut cruel. Il écrivit une cédule d’absolution ; elle fut mise sur le corps du défunt, que l’on trouva aussi frais que le jour de son enterrement, et depuis lors le fantôme ne se montra plus. Le même auteur ajoute que les apparitions de ce genre étaient alors en effet très-fréquentes en Angleterre.
Quant à l’opinion répandue dans le Levant que les spectres se nourrissent, on la trouve établie depuis plusieurs siècles dans d’autres contrées. Il y a longtemps que les, Allemands sont persuadés que les morts mâchent comme des porcs dans leurs tombeaux, et qu’il est facile de les entendre grogner en broyant ce qu’ils dévorent[79]. Philippe Rherius, au dix-septième siècle, et Michel Raufft, au commencement du dix-huitième, ont même publié des traités sur les morts qui mangent dans leurs sépulcres[80].
Après avoir parlé de la persuasion où sont les Allemands qu’il y a des morts qui dévorent les linges et tout ce qui est à leur portée, même leur propre chair, ces écrivains remarquent qu’en quelques endroits de l’Allemagne, pour empêcher les morts de mâcher, on leur met dans le cercueil une motte de terre sous le menton ; qu’ailleurs on leur fourre dans la bouche une petite pièce d’argent et une pierre, et que d’autres leur serrent fortement la gorge, avec un mouchoir. Ils citent des morts qui se sont dévorés eux-mêmes dans leur sépulcre.
On doit s’étonner de voir des savants trouver quelque chose de prodigieux dans des faits aussi naturels. Pendant la nuit qui suivit les funérailles du comte Henri de Salm, on entendit dans l’église de l’abbaye de Haute-Seille, où il était enterré, des cris sourds que les Allemands auraient sans doute pris pour le grognement d’une personne, qui mâche ; et le lendemain, le tombeau du comte ayant été ouvert, on le trouva mort, mais renversé et le visage en bas, au lieu qu’il avait été inhumé sur le dos. On l’avait enterré vivant. On doit attribuer à une cause semblable l’histoire rapportée par Raufft d’une femme de Bohême qui, en 1345, mangea dans sa fosse la moitié de son linceul sépulcral.
Dans le dernier, siècle, un pauvre homme ayant été inhumé précipitamment dans le cimetière, on entendit pendant la nuit du bruit dans son tombeau ; on l’ouvrit le lendemain, et on trouva qu’il s’était mangé les chairs des bras. Cet homme, ayant bu de l’eau-de-vie avec excès, avait été enterré vivant.
Une demoiselle d’Ausbourg tomba dans une telle léthargie qu’on la crut morte ; son corps fut mis dans un caveau profond, sans être couvert de terre ; on entendit bientôt quelque bruit dans le tombeau, mais on m’y fit point attention. Deux ou trois ans après, quelqu’un de la même famille mourut ; on ouvrit le caveau, et l’on trouva le corps de la demoiselle auprès de la pierre qui en fermait l’entrée ; elle avait en vain tenté de déranger cette pierre, et elle n’avait plus de doigt à la main droite, qu’elle s’était dévorée de désespoir.
Tournefort raconte, dans le tome Ier de son Voyage au Levant, la manière dont il vit exhumer un broucolaque de l’île de Mycone, où il se trouvait en 1701.
« C’était un paysan d’un naturel chagrin et querelleur, circonstance qu’il faut remarquer dans de pareils sujets ; il fut tué à la campagne, on ne sait ni par qui, ni comment. Deux jours après qu’on l’eut inhumé dans une chapelle de la ville, le bruit courut qu’on le voyait la nuit se promener à grands pas, et qu’il venait dans les maisons renverser les meubles, éteindre les lampes, embrasser les gens par derrière et faire mille tours d’espiègle. On ne lit qu’en rire d’abord. Mais, l’affaire devint sérieuse lorsque les plus honnêtes gens commencèrent à se plaindre. Les papas (prêtres grecs) convenaient eux-mêmes du fait, et sans doute ils avaient leurs raisons. Cependant le spectre continuait la même vie. On décida enfin, dans une assemblée des principaux de la ville, des prêtres et des religieux, qu’on attendrait, selon je ne sais quel ancien cérémonial, les neuf jours après l’enterrement. Le dixième jour, on dit une messe dans la chapelle où était le corps, afin de chasser le démon que l’on croyait s’y être renfermé. La messe-dite, on déterra le corps et on se mit en devoir de lui ôter le cœur ; ce qui excita les applaudissements de toute l’assemblée. Le corps sentait si mauvais, que l’on fut obligé de brûler de l’encens ; mais la fumée, confondue avec la mauvaise odeur, ne fit que l’augmenter et commença d’échauffer la cervelle de ces pauvres gens : leur imagination se remplit de visions. On s’avisa de dire qu’il sortait une épaisse fumée de ce corps. Nous n’osions pas assurer, dit Tournefort, que c’était celle de l’encens. Oh ne criait que Vroucolacas dans la chapelle et dans la place. Le bruit se répandait dans les rues comme par mugissements, et ce nom semblait fait pour tout ébranler. Plusieurs assistants assuraient que le sang était encore tout vermeil ; d’autres juraient qu’il était encore tout chaud ; d’où l’on concluait que le mort avait grand tort de n’être pas mort, ou, pour mieux dire, de s’être laissé ranimer par le diable. C’est là précisément l’idée qu’on a d’un broucolaque ou vroucolaque. Les gens qui l’avaient mis en terre prétendirent qu’ils s’étaient bien aperçus qu’il n’était pas roide, lorsqu’on le transportait de la campagne à l’église pour l’enterrer, et que, par conséquent, c’était un vrai broucolaque. C’était le refrain. Enfin, on fut d’avis de brûler le cœur du mort, qui, après cette exécution, ne fut pas plus docile qu’auparavant. On l’accusa encore de battre les gens la nuit, d’enfoncer les portes, de déchirer les habits et de vider les cruches et les bouteilles. C’était un mort bien altéré. Je crois, ajoute Tournefort, qu’il n’épargna que la maison du consul chez qui nous logions. Mais tout le monde avait l’imagination renversée ; c’était une vraie maladie, de cerveau, aussi dangereuse que la manie et la rage. On voyait des familles entières abandonner leurs maisons, portant leurs grabats à la place, pour y passer la nuit. Les plus sensés se retiraient à la campagne. Les citoyens un peu zélés pour le bien public assuraient qu’on avait manqué au point le plus essentiel de la cérémonie. Il ne fallait, disaient-ils, célébrer la messe qu’après avoir ôté le cœur du défunt. Ils prétendaient qu’avec cette précaution on n’aurait pas manqué de surprendre le diable, et sans doute il n’aurait pas eu l’audace d’y revenir ; au lieu qu’ayant commencé par la messe, il avait eu le temps de rentrer, après s’être d’abord enfui. On fit cependant des processions dans toute la ville pendant trois jours et trois nuits ; on obligea les papas de jeûner ; on se détermina à faire le guet pendant la nuit, et on arrêta quelques vagabonds qui assurément avaient part à tout ce désordre. Mais on les relâcha trop tôt, et deux jours après, pour se dédommager du jeûne qu’ils avaient fait en prison, ils recommencèrent à vider les cruches de vin de ceux qui avaient quitté leur maison la nuit. On fut donc obligé de recourir de nouveau aux prières.
» Un matin que l’on récitait certaines oraisons, après avoir planté quantité d’épées nues sur la fosse du cadavre, que l’on déterrait trois ou quatre fois par jour, suivant le caprice du premier venu, un Albanais qui se trouvait à Mycone s’avisa de dire, d’un ton de docteur, qu’il était ridicule de se servir, en pareil cas, des épées des chrétiens. Ne voyez-vous pas, pauvres gens, ajouta-t-il, que la garde de ces épées, faisant une croix avec la poignée, empêche le diable de sortir de ce corps ? Que ne vous servez-vous plutôt des sabres des Turcs ? L’avis ne servit de rien ; le broucolaque ne fut pas plus traitable, et on ne savait plus à quel saint se vouer, lorsqu’on résolut, d’une voix unanime, de brûler le corps, tout entier : après cela ils défiaient bien le diable de s’y nicher. On prépara donc un bûcher avec du goudron, à l’extrémité de l’île de Saint-Georges, et les débris du corps furent consumés le 1er janvier 1701. Dès lors on n’entendit plus parler du broucolaque. On se contenta de dire que le diable avait été bien attrapé cette fois-là, et l’on fit des chansons pour le tourner en ridicule.
» Dans tout l’Archipel, dit encore Tournefort, on est bien persuadé qu’il n’y a que les Grecs du rite grec dont le diable ranime les cadavres. Les habitants de l’île de Santonine appréhendent fort ces sortes de spectres. Ceux de Mycone, après que leurs visions furent dissipées, craignaient également les poursuites des Turcs et celles de l’évêque de Tine. Aucun prêtre, ne voulut se trouver à Saint-Georges quand on brûla le corps, de peur que l’évêque n’exigeât une somme d’argent pour avoir fait déterrer et brûler le mort sans sa permission. Pour les Turcs, il est certain qu’à la première visite ils ne manquèrent pas de faire payer à la communauté de Mycone le sang de ce pauvre revenant, qui fut, en toute manière, l’abomination et l’horreur de son pays. »
On a publié, en 1773, un petit ouvrage intitulé[81] Pensées philosophiques et chrétiennes sur les vampires, par Jean-Christophe Herenberg. L’auteur parle, en passant, d’un spectre qui lui apparut à lui-même en plein midi : il soutient en même temps que les vampires ne font pas mourir les vivants, et que tout ce qu’on en débite ne doit être attribué qu’au trouble de l’imagination des malades. Il prouve par diverses expériences que l’imagination est capable de causer, de très-grands dérangements dans le corps et dans les humeurs. Il rappelle qu’en Esclavonie on empalait les meurtriers, et qu’on y perçait le cœur du coupable avec un pieu qu’on lui enfonçait dans la poitrine. Si l’on a employé le même châtiment contre les vampires, c’est parce qu’on les suppose auteurs de la mort de ceux dont on dit qu’ils sucent le sang.
Christophe Herenberg donne quelques exemples de ce supplice exercé contre les vampires, l’un dès l’an 1337, un autre en l’année 1347, etc. ; il parle de l’opinion de ceux qui croient que les morts mâchent dans leurs tombeaux, opinion dont il tâche de prouver l’antiquité par des citations de Tertullien, au commencement de son livre de la Résurrection, et de saint Augustin, livre VIII de la Cité de Dieu.
Quant à ces cadavres qu’on a trouvés, dit-on, pleins d’un sang fluide, et dont la barbe, les cheveux et les ongles se sont renouvelés, avec beaucoup de surveillance on peut rabattre les trois quarts de ces prodiges ; et encore faut-il être complaisant pour en admettre une partie. Tous ceux qui raisonnent connaissent assez comme le crédule vulgaire et même certains historiens sont portés à grossir les choses qui paraissent extraordinaires. Cependant il n’est pas impossible d’en expliquer physiquement la cause. On sait qu’il y a certains terrains qui sont propres à conserver les corps dans toute leur fraîcheur : les raisons en ont été si souvent expliquées qu’il n’est pas nécessaire de s’y arrêter.
On montre encore à Toulouse, dans une église, un caveau où les corps restent si parfaitement dans leur entier, qu’il s’en trouvait, en 1789, qui étaient là depuis près de deux siècles, et qui paraissaient vivants. On les avait rangés debout contre la muraille, et ils portaient les vêtements avec lesquels on les avait enterrés.
Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que les corps qu’on met de l’autre côté de ce même caveau deviennent, deux ou trois jours après, la pâture des vers. Quant à l’accroissement des ongles, des cheveux et de la barbe, on l’aperçoit très-souvent dans plusieurs cadavres. Tandis qu’il reste encore beaucoup d’humidité dans les corps, il n’y a rien de surprenant que pendant un certain temps on voie quelque augmentation dans des parties qui n’exigent pas l’influence des esprits vitaux. Pour le cri que les vampires font entendre lorsqu’on leur enfonce le pieu dans le cœur, rien n’est plus naturel. L’air qui se trouve renfermé dans le cadavre, et que l’on en fait sortir avec violence, produit nécessairement ce bruit en passant par la gorge : souvent même les corps morts produisent des sons sans qu’on les touche.
Voici encore une anecdote qui peut expliquer quelques-uns des traits du vampirisme, que nous ne prétendons pourtant pas nier ou expliquer sans réserve. Le lecteur en tirera les conséquences qui en dérivent naturellement. Cette anecdote a été rapportée dans plusieurs journaux anglais, et particulièrement dans le Sun du 22 mai 1802.
Au commencement d’avril de la même année, le nommé Alexandre Anderson, se rendant d’Elgin à Glascow, éprouva un certain malaise, et entra dans une ferme qui se trouvait sur sa route, pour y prendre un peu de repos. Soit qu’il fût ivre, soit qu’il craignît de se rendre importun, il alla se coucher sous une remise, ou il se couvrit de paille, de manière à n’être pas aperçu. Malheureusement, après qu’il fut endormi, les gens de la ferme eurent occasion d’ajouter une grande quantité de paille à celle où cet homme s’était enseveli. Ce ne fut qu’au bout de cinq semaines qu’on le découvrit dans cette singulière situation. Son corps n’était plus qu’un squelette hideux et décharné ; son esprit était si fort aliéné, qu’il ne donnait plus aucun signe d’entendement : il ne pouvait plus faire usage de ses jambes. La paille qui avait environné son corps était réduite en poussière, et celle qui avait avoisiné sa tête paraissait avoir été mâchée. Lorsqu’on le retira de cette espèce de tombeau, il avait le pouls presque éteint, quoique ses battements fussent très-rapides, la peau moite et froide, les yeux immobiles, très-ouverts, et le regard étonné. — Après qu’on lui eut fait avaler un peu de vin, il recouvra suffisamment l’usage de ses facultés physiques et intellectuelles pour dire à une des personnes qui l’interrogeaient que la dernière circonstance qu’il se rappelait était celle où il avait senti qu’on lui jetait de la paille sur le corps ; mais il paraît que, depuis cette époque, il n’avait eu aucune connaissance de sa situation. On supposa qu’il était constamment resté dans un état de délire, occasionné par l’interception de l’air et par l’odeur de la paille, pendant les cinq semaines qu’il avait ainsi passées, sinon sans respirer, du moins en respirant difficilement, et sans prendre de nourriture que le peu de substance qu’il put extraire de la paille qui l’environnait et qu’il eut l’instinct de mâcher.
« Cet homme vit peut-être encore. Si sa résurrection eût eu lieu chez des peuples infectés d’idées de vampirisme, en considérant ses grands yeux, son air égaré et toutes les circonstances de sa position, on l’eût brûlé avant de lui donner le temps de se reconnaître ; et ce serait un vampire de plus. » Voy. Paul, Harpe, Plogojowits, Polycrite, Katakhanès, Gholes, Huet, etc.
Van-Dale (Antoine), médecin hollandais, mort en 1708. Il a publié une Histoire des oracles, très-inexacte, qui a été abrégée par Fontenelle.
Vanlund. Voy. Vade.
Vapeurs. Les Knistenaux, peuplade sauvage du Canada, croient que les vapeurs qui s’élèvent et restent suspendues au-dessus des marais sont les âmes des personnes nouvellement mortes[82]. Les vapeurs sont prises chez nous, lorsqu’elles, s’enflamment, pour des esprits follets.
Vapula, grand et puissant duc de l’enfer ; il paraît sous la forme d’un lion, avec des ailes de griffon. Il rend l’homme très-adroit dans la mécanique et la philosophie, et donne l’intelligence aux savants. Trente-six légions lui obéissent[83].
Varonnin, dieu de la lumière chez les Indiens. C’est le soleil. Il est monté sur un crocodile et armé d’un fouet d’argent.
Vaudois, hérétiques, sectateurs de Pierre Valdo, qui, égarés par une fausse humilité, se séparèrent de l’Église et allèrent bien vite très-loin. Ils niaient le purgatoire et l’efficacité des prières pour les morts ; mais ils évoquaient les démons et faisaient de la magie. Naturellement, ils rejetèrent la messe, saccagèrent les églises et les couvents, troublèrent la société par le fanatisme en se mêlant aux Albigeois, et sont comptés parmi les précurseurs de la prétendue réforme.
Vaulx (Jean de), de Stavelot, dans le pays de Liège, sorcier renommé

Vauvert. Saint Louis, ayant fait venir des chartreux à Paris, leur donna une habitation au faubourg Saint-Jacques, dans le voisinage du château de Vauvert, vieux manoir bâti par le roi Robert, mais depuis longtemps inhabité, parce qu’il était infesté de démons (qui étaient peut-être des faux monnayeurs). On y entendait des hurlements affreux ; on y voyait des spectres traînant des chaînes, et entre autres un monstre vert, avec une grande barbe, blanche, moitié homme, et moitié serpent, armé d’une grosse massue, et qui semblait toujours prêt à s’élancer, la nuit, sur les passants. Il parcourait même, disait-on, la rue où se trouvait le château, sur un chariot enflammé, et tordait le cou aux téméraires qui se trouvaient sur son passage. Le peuple, l’appelait le diable de Vauvert. Les chartreux ne s’en effrayèrent point et demandèrent le manoir à saint Louis ; il le leur donna avec toutes ses appartenances et dépendances, et les revenants ni le diable de Vauvert n’y revinrent plus. Le nom d’Enfer resta seulement à la rue, en mémoire de tout le tapage, que les diables y avaient fait[84].
Veau d’or. Le rabbin Salomon prétend que le veau d’or des Israélites était vivant et animé. Le Koran dit qu’il mugissait. Plusieurs rabbins pensent qu’il fut fabriqué par des magiciens qui s’étaient mêlés aux Israélites à la sortie d’Égypte, Hur avait refusé de le faire ; et on voit dans les vieilles légendes que les Hébreux, irrités de ce refus, crachèrent si fort contre lui qu’ils l’étouffèrent sous ce singulier projectile[85].
Veau marin. Si l’on prend, du sang de ce poisson avec un peu de son cœur, et qu’on le mette dans de l’eau, on verra à l’entour une multitude de poissons ; et celui qui prendra un morceau de son cœur et le placera sous ses aisselles surpassera tout le monde en jugement et en esprit. Enfin, le criminel qui l’aura rendra son juge doux et favorable[86]. Voy. Mérovée.
Veland le Forgeron. Voy. Vade.
Velleda, druidesse qui vivait du temps de Vespasien, chez les Germains, au rapport de Tacite, et qui, moitié fée, moitié prophétesse, du haut d’une tour où elle siégeait, exerçait au loin une puissance égale ou supérieure à celle des rois. Les plus illustres guerriers n’entreprenaient rien sans son aveu et lui consacraient une partie du butin.
Vendredi. Ce jour, comme celui du mercredi, est consacré, par les sorcières du sabbat, à la représentation de leurs mystères. Il est regardé par les superstitieux comme funeste, quoique l’esprit de la religion chrétienne nous apprenne le contraire[87]. Ils oublient tous les malheurs qui leur arrivent les autres jours, pour se frapper l’imagination de ceux qu’ils éprouvent le vendredi. Néanmoins, ce jour tant calomnié a eu d’illustres partisans. François Ier assurait que tout lui réussissait le vendredi. Henri iv aimait ce jour-là de préférence. Sixte-Quint préférait aussi le vendredi à tous les autres jours de la semaine, parce que c’était le jour de sa naissance, le jour de sa promotion au cardinalat, de son élection à la papauté et de son couronnement.
Le peuple est persuadé que le vendredi est un jour sinistre, parce que rien ne réussit ce jour-là. Mais si un homme fait une perte, un autre fait un gain ; et si le vendredi est malheureux pour l’un, il est heureux pour un autre, comme tous les autres jours.
Cette superstition est très-enracinée aux États-Unis. À New-York, on voulut la combattre il y a quelques années ; on commanda un navire qui fut commencé un vendredi ; on en posa la première pièce un vendredi ; on le nomma un vendredi ; on le lança à la mer un vendredi ; on le fit partir un vendredi, avec un équipage qu’on avait éclairé. Il ne revint jamais… Et la crainte du vendredi est à New-York plus forte que jamais.
Les chemises qu’on fait le vendredi attirent les poux[88] dans certaines provinces.
Veneur. L’historien Mathieu raconte que le roi Henri iv, chassant dans la forêt de Fontainebleau entendit, à une demi-lieue de lui, des jappements de chiens, des cris et des cors de chasseurs ; et qu’en un instant tout ce bruit, qui semblait-fort éloigné, s’approcha à vingt pas de ses oreilles, tellement que, tout étonné, il commanda au comte de Soissons de voir ce que c’était. Le comte s’avance ; un homme noir se présente dans l’épaisseur des broussailles, et disparaît en criant d’une voix terrible : M’entendez-vous ?
Les paysans et les bergers des environs dirent que c’était un démon, qu’ils appelaient le grand veneur de la forêt de Fontainebleau, et qui chassait souvent dans cette forêt. D’autres prétendaient que c’était la chasse de Saint-Hubert, chasse mystérieuse de fantômes d’hommes et de fantômes de chiens, qu’on entendait aussi en d’autres lieux. Quelques-uns, moins amis du merveilleux, disaient que ce n’était qu’un compère qui chassait impunément les bêtes du roi sous le masque protecteur d’un démon ; mais voici sans doute la vérité du fait :
Il y avait à Paris, en 1596, deux gueux qui dans leur oisiveté s’étaient si bien exercés à contrefaire le son des cors de chasse et la voix dés chiens, qu’à trente pas on croyait entendre une meute et des piqueurs. On devait y être encore plus trompé dans des lieux où les rochers renvoient et multiplient les moindres cris. Il y a toute apparence qu’on s’était servi de ces deux hommes pour l’aventure de la forêt de Fontainebleau, qui fut regardée comme l’apparition véritable d’un fantôme.
Un écrivain anglais, dans un remarquable travail sur les traditions populaires, publié par le Quarterly Magazine, cite ce fait avec des accessoires qu’il n’est pas inutile de reproduire :
« Henri, dit-il, ordonna au comte de Soissons d’aller à la découverte ; le comte de Soissons obéit en tremblant, ne pouvant s’empêcher de reconnaître qu’il se passait dans l’air quelque chose de surnaturel : quand il revint auprès de son maître : — Sire, lui dit-il, je n’ai rien pu voir, mais j’entends, comme vous, la voix des chiens et le son du cor.
» — Ce n’est donc qu’une illusion ! dit le roi.
» Mais alors une sombre figure se montra à travers les arbres et cria au Béarnais :
» — Vous voulez me voir, me voici ! »
Cette histoire est remarquable pour plusieurs raisons : Mathieu la rapporte dans son Histoire de France et des choses mémorables advenues pendant sept années de paix du règne de Henri IV, ouvrage publié du temps de ce monarque à qui il est dédié. Mathieu était connu personnellement de Henri IV, qui lui donna lui-même plusieurs renseignements sur sa vie.
On a supposé que ce spectre était un assassin déguisé, et que le poignard de Ravaillac aurait été devancé par l’inconnu de Fontainebleau, si le roi avait fait un pas de plus du côté de l’apparition.

Quel que soit le secret de cette histoire, il est clair que Henri IV ne la fit nullement démentir. « Il ne manque pas de gens, dit Mathieu, qui auraient volontiers relégué cette aventure avec les fables de Merlin et d’Urgande, si la vérité n’avait été certifiée par tant de témoins oculaires et auriculaires. Les bergers du voisinage prétendent que c’est un démon qu’ils appellent le grand veneur, et qui chasse dans cette forêt ; mais on croit aussi que ce pouvait bien être la chasse de Saint-Hubert, prodige qui a lieu dans d’autres provinces.
» Démon, esprit, ou tout ce qu’on voudra, il fut réellement aperçu par Henri IV, non loin de la ville et dans un carrefour qui a conservé la désignation de « la Croix du Grand Veneur ! » À côté de cette anecdote, nous rappellerons seulement l’apparition semblable qui avait frappé de terreur le roi Charles VI, et qui le priva même de sa raison.
Ventriloques, gens qui parlent par le ventre, et qu’on a pris autrefois pour des démoniaques ou des magiciens. Voy. Cécile, etc.
Vents. Les anciens donnaient à Éole plein pouvoir sur les vents ; la mythologie moderne a imité cette fable en donnant une pareille prérogative à certains sorciers. Voy. Finnes, Éric, etc.
Il y avait dans le royaume de Congo un petit despote qui tirait des vents un parti plus lucratif. Lorsqu’il voulait imposer un nouveau tribut à son peuple, il sortait dans la campagne par un temps orageux, le bonnet sur l’oreille, et obligeait à payer l’impôt du vent ceux de ses sujets sur les terres desquels tombait le bonnet.
Le vent violent est, chez les Slaves, un méchant esprit qui habite les ruines et cherche à en faire. Il s’attaque aux cheminées et les secoue. Il se montre quelquefois sous la forme d’un hibou.
À Quimper, en Bretagne, les femmes qui ont leur mari en mer vont balayer la chapelle la plus voisine et en jeter la poussière en l’air, dans l’espérance que cette cérémonie procurera un vent favorable à leur retour[89]. Dans le même pays, une femme ne souffre pas qu’on lui passe son enfant par-dessus la table ; si dans ce passage un mauvais vent venait à le frapper, il ne pourrait en guérir de la vie[90].
Vépar ou Sépar, puissant et redoutable duc du sombre empire. Il se montre sous la forme d’une syrène, conduit les vaisseaux marchands et afflige les hommes de blessures venimeuses, qu’on ne guérit que par l’exorcisme. Il commande vingt-neuf légions.
Vérandi. Voy. Nornes.
Verdelet, démon du second ordre, maître des cérémonies de la cour infernale. Il est chargé du transport des sorcières au sabbat. « Verdelet prend aussi le nom de Jolibois, ou de Vert-Joli, ou de Saute-Buisson, ou de Maître Persil, pour allécher les femmes et les faire tomber dans ses pièges, dit Boguet, par ces noms agréables et tout à fait plaisants. »
Verdung (Michel), sorcier de la Franche-Comté, pris en 1521 avec Pierre Burgot et le Gros-Pierre. Wierus a rapporté les faits qui donnèrent lieu au supplice des trois frénétiques[91]. Tous trois confessèrent s’être donnés au diable. Michel Verdung, qui se vantait d’avoir un esprit nommé Guillemin, avait mené Burgot près du Château-Charlon, où chacun, ayant à la main une chandelle de cire verte qui faisait la flamme bleue, avait offert des sacrifices et dansé en l’honneur du diable. Après s’être frotté de graisse, ils s’étaient vus changés en loups. Dans cet état, ils vivaient absolument comme des loups, dirent-ils.
Burgot avoua qu’il avait tué un jeune garçon avec ses pattes et dents de loup, et qu’il l’eût mangé, si les paysans ne lui eussent donné la chasse. Michel Verdung confessa qu’il avait tué une jeune fille occupée à cueillir des pois dans un jardin, et que lui et Burgot avaient tué et mangé quatre autres jeunes filles. Ils désignaient le temps, le lieu et l’âge des enfants qu’ils avaient dérobés. Il ajouta qu’ils se servaient d’une poudre qui faisait mourir les personnes. Ces trois loups-garoux furent condamnés à être brûlés vifs. Les circonstances de ce fait étaient peintes en un tableau qu’on voyait dans une église de Poligny. Chacun de ces loups-garoux avait la patte droite armée d’un couteau[92].
Verge. On donne quelquefois témérairement le nom de verge de Moïse à la baguette divinatoire. Voy. Baguette.
Sans doute aussi le lecteur a entendu parler de la verge foudroyante, avec laquelle les sorciers faisaient tant de prodiges. Pour la faire, il faut acheter un chevreau, le premier jour de la lune, l’orner trois jours après d’une guirlande de verveine, le porter dans un carrefour, l’égorger avec un couteau neuf, le brûler dans un feu de bois blanc, en conservant la peau, aller ensuite chercher une baguette fourchue de noisetier sauvage, qui n’ait jamais porté fruit, ne la toucher ce jour-là que des yeux, et la couper le lendemain matin, positivement au lever du soleil, avec la même lame d’acier qui a servi à égorger la victime, et dont on n’a pas essuyé le sang. Il faut que cette baguette ait dix-neuf pouces et demi de longueur, ancienne mesure du Rhin, qui fait à peu près un demi-mètre. Après qu’on l’a coupée, on l’emporte, on la ferre par les deux extrémités de la fourche avec la lame du couteau ; on l’aimante ; on fait un cercle avec la peau du chevreau qu’on cloue à terre au moyen de quatre clous qui aient servi à la bière d’un enfant mort. On trace avec une pierre ématite un triangle au milieu de la peau ; on se place dans le triangle, puis on fait les conjurations, tenant la baguette à la main, et ayant soin de n’avoir sur soi d’autre métal que de l’or et de l’argent. Alors les esprits paraissent, et on commande… Ainsi le disent du moins les grimoires.
Verge d’Aaron. Quelques esprits pointus, à propos de ces paroles du chapitre viii de l’Exode, où l’on voit qu’Aaron ayant étendu sa verge sur les fleuves, les rivières, et les étangs, toute l’Égypte fut remplie de grenouilles, en ont conclu que cette verge avait une puissance suprême, divine ou magique, et qu’elle était la cause de ces prodiges. Mais Benjamin Binet leur a répondu non : Aaron était le ministre et sa verge le symbole que Dieu employait.
Verre d’eau. On prédit encore l’avenir dans un verre d’eau, et cette divination était surtout en vogue sous la régence du duc d’Orléans. Voici comment on s’y prend : on se tourne vers l’orient, on prononce Abraxa per nostrum ; après quoi on voit dans le vase plein d’eau tout ce qu’on veut : on choisit d’ordinaire pour cette opération des enfants qui doivent avoir les cheveux longs.
À côté de la divination par le verre d’eau, par la coupe, qui était usitée en Égypte du temps de Joseph, et qui se pratique encore avec diverses cérémonies, par la carafe, comme l’exerçait Cagliostro, on pourrait placer d’autres divinations qui ont pour élément un corps liquide. M. Léon de Laborde donne le détail de scènes produites au Caire[93] par un Algérien réputé sorcier, lequel prenait l’enfant qu’on lui présentait, le magnétisait par des incantations, lui traçait dans la main certaines figures, plaçait sur celle main un pâté d’encre en prononçant de mystérieuses paroles puis lui faisait voir dans ce pâté d’encre tout ce qui pouvait piquer la curiosité des assistants. Les vivants et les morts y paraissaient. Shakespeare y vint et plusieurs autres. L’auteur d’un vol tout récent fut même découvert ainsi. S’il est vrai, comme l’assure M. Léon de Laborde, que ce récit soit sérieux, c’est fort singulier. Voy. Cagliostro, Oomancie, Harvis, Hydromancie, etc.
Verrues. On peut se délivrer des verrues, dit le Petit Albert, en enveloppant dans un linge autant de pois qu’on a de verrues, et en les jetant dans un chemin, afin que celui qui les ramassera prenne les verrues et que celui qui les a en soit délivré. Cependant voici un remède plus admirable pour le même objet : c’est de couper la tête d’une anguille vivante, de frotter les verrues et les porreaux du sang qui en découle ; puis on enterrera la tête de l’anguille, et, quand elle sera pourrie, toutes les verrues qu’on a disparaîtront.
Les physiognomonistes, Lavater même, voient dans les verrues du visage une signification et un pronostic. On ne trouve guère, dit Lavater, au menton d’un homme vraiment sage, d’un caractère noble et calme, une de ces verrues larges et brunes que l’on voit si souvent aux hommes d’une imbécillité décidée. Mais si par hasard vous en trouviez une pareille à un homme d’esprit, vous découvririez bientôt que cet homme a de fréquentes absences, des moments d’une stupidité complète, d’une faiblesse incroyable. Des hommes aimables et de beaucoup d’esprit peuvent avoir, au front ou entre les sourcils, des verrues qui, n’étant ni fort brunes, ni fort grandes, n’ont rien de choquant, n’indiquent rien de fâcheux ; mais si vous trouvez une verrue forte, foncée, velue, à la lèvre supérieure d’un homme, soyez sûr qu’il manquera de quelque qualité très-essentielle, qu’il se distinguera au moins par quelque défaut capital.
Les Anglais du commun prétendent au contraire que c’est un signe heureux d’avoir une verrue au visage. Ils attachent beaucoup d’importance à la conservation des poils qui naissent ordinairement sur ces sortes d’excroissances.
Vers. On voit dans le livre des Admirables secrets d’Albert le Grand que les vers de terre, broyés et appliqués sur des nerfs rompus ou coupés, les rejoignent en peu de temps.
Vert. Dans les îles Britanniques, on croit que le vert est la couleur que les fées affectionnent le plus.
Vert-Joli. Voy. Verdelet.
Verveine, herbe sacrée dont on se servait pour balayer les autels de Jupiter. Pour chasser des maisons les malins esprits, on faisait des aspersions d’eau lustrale avec de la verveine. Les druides surtout ne l’employaient qu’avec beaucoup de superstitions : ils la cueillaient à la canicule, à la pointe du jour, avant que le soleil fût levé. Nos sorciers ont suivi le même usage, et les démonographes croient qu’il faut être couronné de verveine pour évoquer les démons.
Vespasien. On raconte qu’étant en Achaïe avec Néron, il vit en songe un inconnu qui lui prédit que sa bonne fortune ne commencerait que lorsqu’on aurait ôté une dent à Néron. Quand Vespasien se fut réveillé, le premier homme qu’il rencontra fut un chirurgien, qui lui annonça qu’il venait d’arracher une dent à l’empereur. Peu de temps après, ce tyran mourut ; mais Vespasien ne fut pourtant couronné qu’après Galba, Othon et Vitellius.
Vesta, déesse du feu chez les païens. Les cabalistes la font femme de Noé. Voy. Zoroastre.
Vêtements des morts. Ménasseh-ben-Israël dit que Dieu les conserve. Il assure que Samuel apparut à Saül dans ses habits de prophète ; qu’ils n’étaient point gâtés, et que cela ne doit point surprendre, puisque Dieu conserve les vêtements aussi bien que les corps, et qu’autrefois tous ceux qui en avaient les moyens se faisaient ensevelir en robe de soie, pour être bien vêtus le jour de la résurrection.
Vétin. Un moine du neuvième siècle nommé Vétin, étant tombé malade, vit entrer dans sa cellule une multitude de démons horribles, portant des instruments propres à bâtir un tombeau. Il aperçut ensuite des personnages sérieux et graves, vêtus d’habits religieux, qui firent sortir ces démons ; puis il vit un ange environné de lumière qui vint se présenter au pied de son lit, le prit par la main et le conduisit par un chemin agréable sur le bord d’un large fleuve, où gémissaient un grand nombre d’âmes en peine, livrées à des tourments divers, suivant la quantité et l’énormité de leurs crimes. Il y trouva plusieurs personnes de sa connaissance, entre autres un moine qui avait possédé de l’argent en propre, et qui devait expier sa faute dans un cercueil de plomb jusqu’au jour du jugement. Il remarqua des chefs, des princes et même l’empereur Charlemagne qui se purgeaient par le feu, mais qui devaient être délivrés dans un certain temps. Il visita ensuite le séjour des bienheureux qui sont dans le ciel, chacun à sa place selon ses mérites. Quand Vétin fut éveillé, il raconta au long toute cette vision, qu’on écrivit aussitôt. Il prédit en même temps qu’il n’avait plus que deux jours à vivre ; il se recommanda aux prières des religieux, et mourut en paix le matin du troisième jour. Cette mort arriva, le 31 octobre 824, à Aigue-la-Riche[94], et la vision de ce bon moine a fourni des matériaux à ceux qui ont décrit les enfers.
Veu-Pacha, enfer des Péruviens.
Viaram, espèce d’augure qui était en vogue dans le moyen âge. Lorsqu’on rencontrait en chemin un homme ou un oiseau qui venait par la droite et passait à la gauche, on en concluait mauvais présage, et au sens contraire passable augure[95].
Vidal de la Porte, sorcier du seizième siècle que les juges de Riom condamnèrent à être pendu, étranglé et brûlé pour ses maléfices, tant sur les hommes que sur les chiens, chats et autres animaux.
Vid-Blain, le plus haut des elfs.
Vieille. Bien des gens superstitieux croient encore que dans certaines familles une vieille apparaît et annonce la mort de quelqu’un de la

Villain (l’abbé), auteur de l’Histoire critique de Nicolas Flamel et de Pernelle, sa femme, in-12. Paris, 1761, livre assez recherché.
Villars (l’abbé de), littérateur de Limoux, assassiné, en 1673, sur la route de Lyon. Il était, dit-on, de l’ordre, secret, des Rose-Croix. Il a beaucoup écrit sur la cabale, et de manière qu’on ne sait pas très-bien découvrir s’il y croyait ou s’il s’en moquait. On a de lui : le Comte, de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrètes, in-12, Londres, 1742 ; les Génies assistants, in-12, même année, suite du Comte de Gabalis ; le Gnome irréconciliable, autre suite du même ouvrage ; les Nouveaux Entretiens sur les sciences secrètes, troisième suite du Comte de Gabalis. Nous avons cité souvent ces opuscules, aujourd’hui peu recherchés. Voy. Cabale, etc.
Villiers (Florent de), grand astrologue, qui dit a son père qu’il ne fallait pas qu’il lui bâtît une maison, parce qu’il saurait habiter en divers lieux et toujours chez autrui. En effet, il alla à Beaugency, de là à Orléans, puis à Paris, en Angleterre, en Écosse, en Irlande ; il étudia la médecine à Montpellier ; de là il fut à Rome, à Venise, au Caire, à Alexandrie, et revint auprès du duc Jean de Bourbon. Le roi Louis XI le prit à son service ; il suivit ce prince en Savoie pour étudier les herbes des montagnes et les pierres médicinales. Il apprit à les tailler et à les graver en talismans. Il se retira à Genève, puis à Saint-Maurice en Chablais, à Berne en Suisse, et vint résider à Lyon ; il y fit bâtir une étude, où il y avait-deux cents volumes de livrés singuliers qu’il consacra au public, il se maria, eut des enfants, tint ouverte une école d’astrologie, où le roi Charles VII se rendit pour écouter ses jugements. On l’accusa d’avoir un esprit familier, parce qu’il répondait promptement à toutes questions.
Vine, grand roi et comte de la cour infernale. Il se montre furieux comme un lion ; un cheval noir lui sert de monture. Il tient une vipère à la main, bâtit des maisons v enfle les rivières et connaît Impasse. Dix-neuf légions lui obéissent[96].
Vipère. On trouve sans doute encore en Espagne et en Italie de prétendus parents de saint Paul qui se vantent de charmer les serpents et de guérir les morsures de vipère. Voy. Salive.
Virgile. Les hommes qui réfléchissent s’étonnent encore de la légende des faits merveilleux de Virgile, tradition du moyen âge, que tous les vieux chroniqueurs ont ornée à l’envi, et qui nous présente comme un grand magicien celui qui ne fut qu’un grand poète. Est-ce à cause de l’admiration qu’il inspira ? Est-ce à cause de la quatrième églogue, qui route sur une prophétie de la naissance de Jésus-Christ ? N’est-ce pas pour l’aventure d’Aristée et les descriptions magiques du sixième livre de l’Énéide ? Des savants l’ont pensé. Mais Gervais de Tilbury, Vincent de Beauvais, le poëte Adenès, Alexandre Neeckam, Gratian du Pont, Gauthier de Metz et cent autres racontent de lui de prodigieuses aventures, qui semblent une page arrachée aux récits surprenants des Mille et une Nuits.
Il attrape le diable, après lui avoir escamoté tous les secrets de la magie, et cela à peine sorti des écoles. Il a appris qu’on a dépouillé sa mère de ses domaines ; il en fait enlever toutes les récoltes par des esprits qui sont à ses ordres, et il les fait apporter chez lui. Il se fait bâtir un château immense, où il a une armée de domestiques qui ne sont que des démons ; mais il les domine. L’empereur de Rome vient pour le prendre dans son château ; Virgile l’a entouré d’un brouillard où personne ne peut se reconnaître, et les soldats de l’empereur, sous l’empire d’une fascination prodigieuse, se croient les pieds dans l’eau.
L’empereur a ses magiciens, qui essayent vainement de lutter contre Virgile. Il rend tous ceux qui cherchent à l’investir immobiles comme des statues, et force l’empereur à capituler.
Devenu alors le favori de l’empereur, il lui fait des statués enchantées, au. moyen desquelles il sera informé de tout mouvement d’insurrection jusque dans les provinces les plus éloignées de Rome ; puis l’enchanteur opère d’autres merveilles. Il aime la ville de Naples ; il la protège donc contre les mouches qui l’infestent. Elles ne pourront plus y entrer, arrêtées par une grosse mouche d’airain qu’il a placée sur une des portes. Il construit pour l’empereur des bains merveilleux où toute maladie quelconque trouve sa guérison immédiate. Il délivre les eaux de Rome du fléau des sangsues, en plaçant dans un de ses puits une sangsue d’or dont il a fait un talisman. Il allume au milieu de Rome un fanal qui brûlera trois cents ans et qui éclairera la grande cité jusque, dans ses moindres carrefours.
Pourtant il paraît que ces merveilles ne sont pas l’œuvre du grand poëte, que c’est a tort qu’on les lui attribue ; que le vrai magicien Virgile était un chevalier des Ardennes, plus ancien que l’auteur de l’Enéide, et que son histoire excentrique a sa source dans un vieux roman chevaleresque du moyen âge[97].
Virgile, évêque de Salzbourg. Voy. Antipodes.
Visions. Il y a plusieurs sortes de visions, qui la plupart ont leur siège dans l’imagination ébranlée. Aristote parle d’un fou qui demeurait tout le jour au théâtre, quoiqu’il n’y eût personne, et que là il frappait des mains et riait de tout son cœur, comme s’il avait vu jouer la comédie la plus divertissante.
Un jeune homme, d’une innocence et d’une pureté de vie extraordinaires, étant venu a mourir à l’âge de vingt-deux ans, une vertueuse veuve vit en songe plusieurs serviteurs de Dieu qui ornaient un palais magnifique. Elle demanda pour qui on le préparait ; on lui dit que c’était pour le jeune homme qui était mort la veille. Elle vit ensuite dans ce palais un vieillard vêtu de blanc, qui ordonna à deux de ses gens de tirer ce jeune homme du tombeau et de l’amener au ciel. Trois jours après la mort du jeune homme, son père, qui se nommait Armène, s’étant retiré dans un monastère, le fils apparut à l’un des moines et lui dit que Dieu l’avait reçu au nombre des bienheureux, et qu’il l’envoyait chercher son père. Armène mourut le quatrième jour[98].
Voici des traits d’un autre genre. Torquemada conte qu’un grand seigneur espagnol, sorti un jour pour aller à la chasse sur une de ses terres, fut fort étonné lorsque, se croyant seul, il s’entendit appeler par son nom. La voix ne lui était pas inconnue ; mais comme il ne paraissait pas empressé, il fut appelé une seconde fois et reconnut distinctement l’organe de son père, décédé depuis peu. Malgré sa peur, il ne laissa pas d’avancer. Quel fut son étonnement de voir une grande caverne ou espèce d’abîme dans laquelle était une longue échelle ! Le spectre de son père se montra sur les premiers échelons, et lui dit que Dieu avait permis qu’il lui apparût, afin de l’instruire de ce qu’il devait faire pour son propre salut et pour la délivrance de celui qui lui parlait, aussi bien que pour celle de son grande père, qui était quelques échelons plus bas ; que la justice divine, les punissait et les retiendrait jusqu’à ce qu’on eût restitué un héritage usurpé par ses aïeux ; qu’if eût à le faire incessamment, qu’autrement sa place était déjà marquée dans ce lieu de souffrance. À peine ce discours eut-il été prononcé que le spectre et l’échelle disparurent, et l’ouverture de la caverne se referma. Alors la frayeur l’emporta sur l’imagination du chasseur ; il retourna chez lui, rendit l’héritage, laissa à son fils ses autres biens et se retira dans un monastère, où il passa le reste de sa vie.
Il y a des visions qui tiennent un peu à ce que les Écossais appellent la seconde vue. Boaistuau raconte ce qui suit :
« Une femme enchanteresse, qui vivait à Pavie du temps du règne de Léonicettus, avait cet avantage qu’il ne se pouvait rien faire de mal à Pavie sans qu’elle je découvrît par son artifice, en sorte que la renommée des merveilles qu’elle faisait par l’art des diables lui attirait tous les seigneurs et philosophes de l’Italie. Il y avait en ce temps un philosophe à qui, l’on ne pouvait persuader d’aller voir cette femme, lorsque, vaincu par les sollicitations de quelques magistrats de la ville, il s’y rendit. Arrivé devant cet organe de Satan, afin de ne demeurer muet et pour la sonder au vif, il la pria de lui dire, à son avis, lequel de tous les vers de Virgile était le meilleur. La vieille, sans rêver, lui répondit aussitôt :
Discite juslitiam moniti et non temnero divos.
» Voilà, ajouta-t-elle, le plus digne vers que Virgile ait fait. Va-t’en, et ne reviens plus pour me tenter. Ce pauvre philosophe et ceux qui l’accompagnaient s’en retournèrent sans aucune réplique et ne furent en leur vie plus étonnés d’une si docte réponse, attendu qu’ils savaient tous qu’elle n’avait en sa vie appris ni à lire ni à écrire…
» Il y a encore, dit le même auteur, quelques visions qui proviennent d’avoir mangé du venin ou poison, comme Pline et Edouardus enseignent de ceux qui mangent la cervelle d’un ours, laquelle dévorée, on se droit transformée en ours. Ce qui est advenu à un gentilhomme espagnol de notre temps à qui on en fit manger, et il errait dans les montagnes, pensant être changé en ours.
» Il reste, pour mettre ici toutes espèces de visions, de traiter des visions artificielles, lesquelles, ordonnées et bâties par certains secrets et mystères des hommes, engendrent la terreur en ceux qui les contemplent. Il s’en est trouvé qui ont mis des chandelles dans des têtes de morts pour épouvanter le peuple, et d’autres qui ont attaché des chandelles de cire allumées sur des coques de tortues et limaces, puis les mettaient dans les cimetières la nuit, afin que le vulgaire, voyant ces animaux se mouvoir de loin avec leurs flammes, fut induit à croire que c’étaient les esprits dès morts. Il y a encore certaines visions diaboliques qui se sont faites de nos jours avec des chandelles composées de suif humain ; et pendant qu’elles étaient allumées de nuit, les pauvres gens demeuraient si bien charmés, qu’on dérobait leur bien devant eux sans qu’ils sussent se mouvoir de leurs lits ; ce qui a été pratiqué en Italie de notre temps, Mais Dieu, qui ne laissé rien impuni, a permis que ces voleurs fussent appréhendés ; et, convaincus, ils ont depuis terminé leurs vies misérablement au gibet. » Voy. Main de gloire.
Nous reproduirons maintenant quelques pièces curieuses et rares :
« Un gentilhomme de Silésie, ayant convié quelques amis, et, à l’heure du festin venue, se voyant frustré par l’excuse des conviés, entre en grande colère, et commence à dire que, puisque nul homme ne daignait être chez lui, tous les diables y vinssent ! Cela dit, il sort de sa maison et entre à l’église, ou le curé prêchait, lequel il écoute attentivement. Comme il était là, voici entrer dans la cour du logis des hommes à cheval, de haute stature et tout noirs, qui commandèrent aux valets du gentilhomme d’aller dire à leur maître que les conviés étaient venus. Un des valets court à l’église avertir son maître, qui, bien étonné, demande avis au curé, celui, finissant son sermon, conseille qu’on fasse sortir toute la famille hors du logis. Aussitôt dit, aussitôt fait ; mais de hâte que les gens eurent de déloger, ils laissèrent dans la maison un petit enfant dormant au berceau. Ces hôtes, ou, pour mieux dire, ces diables (c’est le sentiment du narrateur) commencèrent bientôt à remuer les tables, à hurler, à regarder par les fenêtres, en forme d’ours, de loups, de chais, d’hommes terribles, tenant à la main ou dans leurs pattes des verres pleins de vin, des poissons, de la chair bouillie et rôtie. Comme les voisins, le gentilhomme, le curé et autres contemplaient avec frayeur un tel spectacle, le pauvre père se mit à crier : « Hélas ! ou est mon pauvre enfant ? »
» Il avait encore le dernier mot à la bouche, quand un de ces hommes noirs apporta l’enfant aux fenêtres et le montra à tous ceux qui étaient dans la rue. Le gentilhomme demanda à un de ses serviteurs auquel il se fiait le mieux : a Mon ami, que ferai-je ? — Monsieur, répond le serviteur, je recommanderai ma vie à Dieu ; après quoi j’entrerai dans la maison, d’où, moyennant son secours, je vous rapporterai reniant. — À la bonne heure ! dit le maître ; Dieu t’accompagne, l’assiste et te fortifié ! »
» Le serviteur, ayant reçu la bénédiction de son maître, du curé et des autres gens de bien, entra au logis, et, approchant du poêle où étaient ces hôtes ténébreux, se prosterne à genoux, se recommande à Dieu et ouvre la porte. Voilà les diables en horribles formes, les uns assis, les autres debout, aucuns se promenant, autres rampant sur le plancher, qui tous accoururent contre lui, criant ensemble : « Hui ! hui ! que viens-tu faire céans ? » Le serviteur, suant de détresse et néanmoins fortifié de Dieu, s’adresse au malin qui tenait l’enfant et lui dit : « Ça, baillez-moi cet enfant. — Non, répond l’autre, il est mien ; va dire à ton maître qu’il vienne le recevoir. »
» Le serviteur insiste et dit : « Je fais la charge que Dieu m’a commandée, et sais que-tout ce que je fais selon icelle lui est agréable ; partant, à l’égard de mon office, en vertu de Jésus-Christ, je t’arrache et saisis cet enfant, lequel je rapporte à soir père. » Ce disant, il empoigne l’enfant, puis le serre entre ses bras. Les hôtes noirs ne répondent que par des cris effroyables et par ces mots : « Hui ! hui ! méchant ; hui ! garnement ! laisse, laisse cet enfant ; autrement nous te dépiécerons. » Mais lui, méprisant ces menaces, sortit sain et sauf et rendit l’enfant au gentilhomme son père ; et quelques jours après tous ces hommes s’évanouirent, et le gentilhomme, devenu sage et bon chrétien, retourna en sa maison. »
« Samedi, premier jour de février 1620, il arriva un grand malheur et désastre en la ville de Quimper-Corentin. Une belle et haute pyramide couverte de plomb, étant sur la nef de la grande église, fut brûlée par la foudre et feu du ciel depuis le haut jusqu’à ladite nef, sans que l’on pût y apporter aucun remède. Le même jour, sur les sept heures et demie, tendant à huit du matin, se fit un coup de tonnerre et d’éclair terrible. À l’instant fut visiblement vu un démon horrible, au milieu d’une grande ondée de grêle, se saisir de ladite pyramide par le haut et au-dessous de la croix, étant ce démon de couleur verte, avec une longue queue. Aucun feu ni fumée n’apparut sur la pyramide que vers une heure après midi, que la fumée commença à sortir du haut d’icelle et dura un quart d’heure ; et du même endroit commença le feu à paraître peu à peu, en augmentant toujours ainsi qu’il dévalait du haut en bas ; tellement qu’il se fit si grand et si épouvantable que l’on craignait que toute l’église ne fût brûlée, et non seulement l’église, mais toute la ville. Les trésors de ladite église furent tirés hors, les processions allèrent à l’entour, et finalement on fit mettre des reliques saintes Sur la nef de l’église, au-devant du feu. Messieurs du chapitre commencèrent à conjurer ce méchant démon que chacun voyait dans le feu, tantôt bleu, vert ou jaune. Ils jetèrent des agnus Dei dans icelui et près de cent cinquante barriques d’eau, quarante ou cinquante charretées de fumier, et néanmoins le feu continuait. Pour, dernière ressource, on fit jeter un pain de seigle de quatre sous, puis on prit de l’eau béni le avec du lait d’une, femme nourrice de bonne vie, et tout cela jeté dedans le feu, tout aussitôt le démon fut contraint de quitter la flamme, et avant de sortir il fit un si grand remue-ménage, que l’on semblait être tous brûlés et qu’il devait emporter l’église et-tout avec lui ; il ne s’en alla qu’à six heures et demie du soir, sans avoir fait autre mal, Dieu merci, que la totale ruine de ladite pyramide, qui est de douze mille écus au moins. Ce méchant étant hors, on eut raison du feu, et peu de temps après on trouva encore ledit pain de seigle en essence, sans être endommagé, hors que la croûte était un peu noire ; et sur les huit ou neuf heures et demie, après que tout le feu fut éteint, la cloche sonna pour amasser le peuple, afin de rendre grâces à Dieu. Messieurs du chapitre, avec les choristes et musiciens, chantèrent un Te Deum et un Stabat Mater dans la chapelle de la Trinité, à neuf heures du soir. Grâces à Dieu, il n’est mort personne ; mais il n’est pas possible de voir chose plus horrible et épouvantable qu’était ce dit feu. »
« La nuit du mercredi 22 juillet, apparurent entre le château de Lusignan et la Fare, sur la rivière, deux hommes de feu extrêmement puissants, armés de toutes pièces, dont le harnais était enflammé, avec un glaive en feu dans une main et une lance flambante dans l’autre, de laquelle dégouttait du sang. Ils se rencontrèrent et se combattirent longtemps, tellement qu’un des deux fui blessé, et en tombant fit un si horrible cri qu’il réveilla plusieurs habitants de la haute et basse ville et étonna la garnison. Après ce combat, parut comme une souche de feu qui passa la rivière et s’en alla dans le parc, suivie de plusieurs monstres de feu semblant des singes. Des gens qui étaient allés chercher du bois dans la forêt rencontrèrent ce prodige, dont ils pensèrent mourir, entre autres un pauvre ouvrier du bois de Galoche, qui fut si effrayé qu’il eut une fièvre qui ne le quitta point. Comme les soldats de la garnison s’en allaient sur les murs de la ville, il passa sur eux une troupe innombrable d’oiseaux, les uns noirs, les autres blancs, tous criant d’une voix épouvantable. Il y avait des flambeaux qui les précédaient et. Une figure d’homme qui les suivait faisant le hibou. Ils furent effrayés d’une telle vision, et il leur tardait fort qu’il fût jour pour la raconter aux habitants. — Voici (ajoute le narrateur) l’histoire, que j’avais à vous présenter, et vous me remercierez et serez contents de ce que je vous donne pour vous, avertir de ce que vous pouvez voir quand vous allez la nuit dans les, champs. »
« Guicciardin écrit en son histoire italique que sur la venue du petit roi Charles VIII à Naples, outre les prédictions du frère Hiérôme Savonarole, tant prêchées au peuple que révélées au roi même, apparurent en la Pouille, de nuit, trois soleils au milieu du ciel, offusqués de nuages à l’entour, avec force tonnerres et éclairs ; et vers Arezzo furent vues en l’air de grandes troupes de gens armés à cheval, passant par là avec grand bruit et son des tambours et trompettes ; et en plusieurs parties de l’Italie, maintes images et statues suèrent, et divers monstres d’hommes et d’animaux naquirent, de quoi le pays fut épouvanté. On vit depuis la guerre qui advint au royaume de Naples, que les Français conquirent et puis perdirent. — En la ville d’Altorff, au pays de Wurtemberg, en Allemagne, à une lieue de la ville de Tubingue et aux environs, on a vu, le cinquième jour de décembre 1577, environ sept heures du matin, que le soleil commençant à se lever n’apparaissait pas en sa clarté et splendeur naturelle, mais montrait une couleur jaune, ainsi qu’on voit la lune quand elle est pleine, ressemblait au rond d’un gros tonneau, et reluisait, si peu qu’on le pouvait regarder sans s’éblouir les yeux. Bientôt après il s’est montré à l’entour aillant d’obscurité que s’il s’en fût suivi une éclipse, et le soleil s’est couvert d’une couleur plus rouge que du sang, tellement qu’on ne savait pas si c’était le soleil ou non. Incontinent après, on a vu deux soleils, l’un rouge, l’autre jaune, qui se sont heurtés et battus : cela a duré quelque peu de temps, où l’un des soleils s’est évanoui, et on n’a plus vu que le soleil jaune. Peu après s’est apparue une nuée noire de la forme d’une boule, laquelle a tiré tout droit contre le soleil et l’a couvert au milieu, de sorte qu’on n’a vu qu’un grand cercle jaune à l’entour. Le soleil ainsi couvert, est apparue une autre nuée noire, laquelle a combattu avec lui, et l’un a couvert l’autre plusieurs fois, tant que le soleil est retourné à ladite première couleur jaunâtre. Un peu après est apparue derechef une nuée longue comme un bras, venant du côté du soleil couchant, laquelle S’est arrêtée près dudit soleil. De cette nuée est sorti un grand nombre de gens habillés de noir et armés comme gens de guerre, à pied et à cheval, marchant en rang, lesquels ont passé tout bellement par dedans ce soleil vers l’Orient, et cette troupe a été suivie derrière d’un grand et puissant homme beaucoup plus haut que les autres. Après que cette troupe a été passée, le soleil s’est un peu obscurci, mais a gardé sa clarté naturelle et a été couvert de sang, en sorte que le ciel et la terre se sont montrés tout rouges, parce que sont sorties du ciel plusieurs nuées sanglantes et s’en sont retournées par-dessus, et ont tiré du côté de l’Orient, tout ainsi qu’avait fait avant la gendarmerie. Beaucoup de nuées noires se sont montrées autour du soleil, comme c’est coutume quand il y a grande tempête, et bientôt après sont sorties du soleil d’autres nuées sanglantes et ardentes ou jaunes comme du safran. De ces nuées sont parties des réverbérations semblables à de grands chapeaux hauts et larges, et s’est montrée toute la terre, jaune et sanglante, couverte de grands chapeaux, lesquels avaient diverses couleurs, rouge, bleu, vert, et la plupart noirs ; ensuite il a fait un brouillard et comme une pluie de sang, dont non-seulement le ciel, mais encore la terre et tous les habillements d’hommes se sont montrés sanglants et jaunâtres. Cela a duré jusqu’à ce que le soleil eut repris sa clarté naturelle, ce qui n’est arrivé qu’à dix heures du matin.
» Il est aisé de penser ce que signifie ce prodige : ceci n’est autre chose que menaces, » dit l’auteur. — Quant à nous, comme il n’y a dans le pays d’Altorff aucun témoignage qui appuie ce merveilleux récit, nous n’y verrons qu’un puff du dix-septième siècle.
« Il n’y a personne qui, ayant été vers la ville de Bellac, en Limousin, n’ait passé par une grande et très-spacieuse plaine nullement habitée. Or en icelle, quantité de gens dignes de foi et croyance, même le sieur Jacques Rondeau, marchand tanneur de la ville de Montmorillon, le curé d’Isgre, Pierre Ribonneau, Mathurin Cognac, marchand de bois, demeurant en la ville de Chanvigné, étant tous de même compagnie, m’ont assuré avoir vu ce que je vous écris : 1° trois hommes vêtus de noir, inconnus de tous les regardants, tenant chacun une croix à la main ; 2° après eux marchait une troupe de jeunes filles, vêtues de longs manteaux de toile blanche, ayant les pieds et les jambes nus, portant des chapeaux de fleurs, desquels pendaient jusques aux talons de grandes bandes de toile d’argent, tenant en leur main gauche quelques rameaux et de la droite un vase de faïence d’où sortait de la fumée ; 3° marchait après celles-ci une dame accoutrée en deuil, vêtue d’une longue robe noire qui traînait fort longue sur la terre, laquelle robe était semée de cœurs percés de flèches, de larmes et de flammes de satin blanc, et ses cheveux épars sur ses vêtements ; elle tenait en sa main comme une branche de cèdre, et ainsi vêtue cheminait toute triste ; 4° ensuite marchaient six petits enfants couverts de longues robes de taffetas vert, tout semé de flammes de Satin rouge et de gros flambeaux allumés, et leurs têtes couvertes de chapeaux de fleurs. Ceci n’est rien encore, il marchait après une foule de peuples vêtus de blanc et de noir, qui cheminaient deux à deux, ayant des bâtons blancs à la main. Au milieu de la troupe était comme une déesse, vêtue richement, portant une grande couronne de fleurs sur la tête, les bras retroussés, tenant en sa main une belle branche de cyprès, remplie de petits cristaux qui pendaient de tous côtés. À l’entour d’elle, il y avait comme des joueurs d’instruments, lesquels toutefois ne formaient aucune mélodie. À la suite de cette procession étaient huit grands hommes nus jusqu’à la ceinture, ayant le corps fort garni de poil, la barbe jusqu’à mi-corps et le reste couvert de peaux de chèvres, tenant en leurs mains de grosses masses ; et, comme tout furieux, suivaient la troupe de loin. La course de cette procession s’étendait tout le long de l’île, jusqu’à une autre île voisine, où tous ensemble s’évanouissaient lorsqu’on voulait en approcher pour les contempler Je vous prie, à quoi tend cette vision merveilleuse, vous autres qui savez ce que valent les choses ?… »
Nous transcrivons le naïf écrivain. Nous ajouterons que la mascarade qu’il raconte eut lieu à l’époque du roman de l’Astrée, et que c’était une société qui se divertissait à la manière des héros de Don Quichotte.
« Le troisième jour de décembre, environ neuf heures du matin, faisant un temps doux et un beau soleil, l’on vil en l’air une figure d’un homme de la hauteur d’environ neuf lances, qui dit trois fois : « Peuples, peuples, peuples, amendez-vous, ou vous êtes à la fin de vos jours. » El ce advint un jour de marché, devant plus de dix mille personnes, et, après ces paroles, la dite figure s’en alla en une nue, comme se-retirant droit au ciel. Une heure après, le temps s’obscurcit tellement, qu’à vingt lieues autour de la ville on ne voyait plus ni ciel ni terre. Il y eut beaucoup de personnes qui moururent ; le pauvre monde se mit à prier Dieu et à faire des processions. Enfin, au bout de trois jours, vint un beau temps comme auparavant, et un vent le plus cruel que l’on ne saurait voir, qui dura environ une heure et demie, et une telle abondance d’eau, qu’il semblait qu’on la jetait à pipes, avec un merveilleux tremblement de terre, tellement que la ville fondit, comprenant quatorze lieues de long et six de large, et n’est demeuré qu’un château, un clocher et trois maisons tout au milieu. On les voit en un rondeau de terre assises comme par devant ; on voit quelques portions des murs de la ville, et dans le clocher et le château, du côté d’un village appelé des Guetz, on voit comme des enseignes et étendards qui pavolent ; et n’y saurait-on aller. Pareillement on, ne sait ce que cela signifie, et n’y a homme qui regarde cela à qui les cheveux ne dressent sur la tête ; car c’est une chose merveilleuse et épouvantable. »
Sans être très-crédule, l’auteur de ce petit ouvrage admet les apparitions et reconnaît que les unes viennent du démon, les autres de Dieu. Mais il en attribue beaucoup à l’imagination. Il raconte l’histoire d’un malade qui vit longtemps dans sa chambre un spectre habillé en ermite avec une longue barbe, deux cornes sur la tête et une figure horrible. Cette vision, qui épouvantait le malade sans qu’on pût le rassurer, n’était, dit le professeur, que l’effet du cerveau dérangé. Voyez Hallucinations.
Il croit que les morts peuvent revenir, à cause de l’apparition de Samuel ; et il dit que les âmes dit purgatoire ont une figure intéressante et se contentent en se montrant de gémir et de prier, tandis que les mauvais esprits laissent toujours entrevoir quelque supercherie et quelque malice. Voy. Apparitions.
Terminons les visions par le fait suivant, qu’on lit dans divers recueils d’anecdotes.
Un capitaine anglais, ruiné par des folies de jeunesse, n’avait plus d’autre asile que la maison d’un ancien ami. Celui-ci, obligé d’aller passer quelques mois à la campagne, et ne pouvant y conduire le capitaine, parce qu’il était malade, le confia aux soins d’une vieille domestique, qu’il chargeait de la garde de sa maison quand il s’absentait. La bonne femme vint un matin voir de très-bonne heure son malade, parce qu’elle avait rêvé qu’il était mort dans la nuit ; rassurée en le trouvant dans le même état que la veille, elle le quitta pour aller soigner ses affaires et oublia de fermer la porte après elle.
Les ramoneurs, à Londres, ont coutume de se glisser dans les maisons qui-ne sont point habitées, pour s’emparer de la suie, dont ils font un petit commerce. Deux d’entre eux avaient su l’absence du maître de la maison ; ils épiaient le moment de s’introduire chez lui. Ils virent sortir la vieille, entrèrent dès qu’elle fut éloignée, trouvèrent la chambre du capitaine ouverte, et, sans prendre garde à lui, grimpèrent tous les deux dans la cheminée. Le capitaine était en ce moment assis sur son séant. Le jour était sombre ; la vue de deux créatures aussi noires lui causa une frayeur inexprimable ; il retomba dans ses draps, n’osant faire aucun mouvement. Le docteur arriva un instant après ; il entra avec sa gravité ordinaire et appela le capitaine en s’approchant du lit. Le malade reconnut la voix, souleva ses couvertures et regarda d’un œil égaré, sans avoir la force de parler. Le docteur lui prit la main et lui demanda comment il se trouvait. — Mal, répondit-il ; je suis perdu : les diables se préparent à m’emporter, ils sont dans ma cheminée… Le docteur, qui était un esprit fort, secoua la tête, tâta le pouls et dit gravement : — Vos idées sont coagulées ; vous avez un lucidum caput, capitaine… — Cessez votre galimatias, docteur : il n’est plus temps de plaisanter, il y a deux diables ici… — Vos idées sont incohérentes ; je vais vous le démontrer. Le diable n’est pas ici : votre effroi est donc…
Dans ce moment, les ramoneurs, ayant rempli leur sac, le laissèrent tomber au bas de la cheminée et le suivirent bientôt. Leur apparition rendit le docteur muet ; le capitaine se renfonça dans sa couverture, et, se coulant aux pieds de son lit, se glissa dessous sans bruit, priant les diables de se contenter d’emporter son ami. Le docteur, immobile d’effroi, cherchait à se ressouvenir des prières qu’il avait apprises dans sa jeunesse. Se tournant vers son ami pour lui demander son aide, il fut épouvanté de ne plus le voir dans son lit. Il aperçut dans ce moment un des ramoneurs qui se chargeait du sac de suie ; il ne douta pas que le capitaine ne fût dans le sac. Tremblant de remplir l’autre, il ne fit qu’un saut jusqu’à la porte de la chambre, et de là au bas de l’escalier. Arrivé dans la rue, il se mit à crier de toutes ses forces : — Au secours ! le diable emporte mon ami ! La populace accourt à ses cris ; il montre du doigt la maison, on se précipite en foule vers la porte, mais personne ne veut entrer le premier… Le docteur, un peu rassuré par le nombre, excite tout le monde. Les ramoneurs, en entendant le bruit qu’on faisait dans la rue, posent leur sac dans l’escalier, et, de crainte d’être surpris, remontent quelques étages. Le capitaine, mal à son aise sous son lit, ne voyant plus les diables, se hâte de sortir de la maison. Sa peur et sa précipitation ne lui permettent pas de voir le sac, il le heurte, tombe dessus, se couvre de suie, se relève et descend avec-rapidité ; l’effroi de la populace augmente à sa vue : elle recule et lui ouvre un passage ; le docteur reconnaît son ami et se cache dans la foule pour l’éviter. Enfin un ministre, qu’on était allé chercher pour conjurer l’esprit malin, parcourt la maison, trouva les ramoneurs, les force à descendre, et montre les prétendus diables au peuple assemblé. Le docteur et le capitaine se rendirent enfin à l’évidence ; mais le docteur, honteux d’avpir, par sa sotte frayeur, démenti le caractère d’intrépidité qu’il avait toujours affecté, voulait rosser ces coquins qui, disait-il, avaient fait une si grande peur à son ami.
Vocératrices. Lorsqu’un homme est mort, en Corse, particulièrement lorsqu’il a été assassiné, on place son corps sur une table ; et les femmes de sa famille, à leur défaut des amies ou même des femmes étrangères connues par leur talent poétique, improvisent devant un auditoire nombreux des complaintes en vers, dans le dialecte du pays. On nomme ces femmes voceratrici, ou, suivant la prononciation corse, bucerairici, et la complainte s’appelle vocero, buceru, buceratu, sur la côte orientale ; ballata sur la côte opposée. Le mot vocero, ainsi que ses dérivés vocerar, voceratrice, vient du latin vociferare. Quelquefois plusieurs femmes improvisent tour à tour, et fréquemment la femme ou la fille du mort chante elle-même la complainte funèbre[99].
Voile. Chez les Juifs modernes, c’est une tradition qu’un voile qu’on se met sur le visage empêche que le fantôme ne reconnaisse celui qui a peur. Mais si Dieu juge qu’il l’ait mérité par ses péchés, il lui fait tomber le masque, afin que l’ombre puisse le voir et le mordre.
Voisin (la), devineresse qui tirait les cartes, faisait voir tout ce qu’on voulait dans un bocal plein d’eau et forçait le diable à paraître à sa volonté. Il y avait un grand concours de monde chez elle. Un jeune époux, remarquant que sa femme sortait aussitôt qu’il quittait la maison, résolut de savoir qui pouvait ainsi la déranger. Il la suit donc un jour et la voit entrer dans une sombre allée ; il s’y glisse, l’entend frapper à une porte qui s’ouvre, et, content de savoir ou il peut la surprendre, il regarde par le trou de la serrure et entend ces mots : — Allons, il faut vous déshabiller ; ne faites pas l’enfant, ma chère amie, hâtons-nous… La femme se déshabillait ; le mari frappe à la porte à coups rédoublés. La Voisin ouvre, et le curieux voit sa femme, une baguette magique à la main, prête à évoquer le diable… Une autre fois, une dame très-riche était venue la trouver pour qu’elle lui tirât les cartes. La Voisin, qui à sa qualité de sorcière joignait les talents de voleuse, lui persuade qu’elle fera bien de voir le diable, qui ne lui fera d’ailleurs aucun mal ; la dame y consent. La bohémienne lui dit d’ôter ses vêtements et ses bijoux. La dame obéit et se trouve bientôt seule, n’ayant qu’une vieille paillasse, un bocal et un jeu de cartes. Cette dame était venue dans son équipage ; le cocher, après avoir attendu très-longtemps sa maîtresse, se décide enfin a monter, monte et la trouve au désespoir. La Voisin avait disparu avec ses hardes ; on l’avait dépouillée. Il lui met son manteau sur les épaules et la reconduit chez elle.
On cite beaucoup d’anecdotes pareilles. Voici quelques détails sur son procès, tirés des relations contemporaines.
Vers l’an 1677, la fameuse Voisin s’unit à la femme Vigoureux et à un ecclésiastique apostat nommé Lesage, pour trafiquer des poisons d’un Italien nommé Exili, qui avait fait en ce genre d’horribles découvertes. Plusieurs morts Subites firent soupçonner des crimes secrets. On établit à l’Arsenal, en 1680, la chambre des poisons, qu’on appela la chambre ardente. Plusieurs personnes de distinction furent citées à cette chambre, entre autres deux nièces du cardinal Mazarin, la duchesse de Bouillon, la comtesse de Soissons, mère du prince Eugène, et enfin le célèbre maréchal de Luxembourg.
La Voisin, la Vigoureux et Lesage s’étaient fait un revenu de la curiosité des ignorants, qui étaient en très-grand nombre ; ils prédisaient l’avenir ; ils faisaient voir le diable. S’ils s’en étaient tenus là, il n’y aurait eu que du ridicule et de la friponnerie chez eux, et la chambre ardente n’était pas nécessaire.
La Reynie, l’un des présidents de cette chambre, demanda à la duchesse de Bouillon si elle avait vu le diable. Elle répondit : — Je le vois dans ce moment ; il est déguisé en conseiller d’État, fort laid et fort vilain.
Ce procès dura quatorze mois, pendant lesquels la comtesse de Soissons se sauva en Flandre. Le maréchal de Luxembourg fut acquitté, comme tous les personnages de condition impliqués dans cette affaire[100]. La Voisin et ses deux complices furent condamnés par jugement de la Chambre ardente à être brûlés en place de Grève.
On lit ailleurs que la Voisin, par ses relations avec le diable, sut son arrêt, chose assez extraordinaire, quatre jours avant son supplice. Cela ne l’empêcha pas de boire, de manger et de faire débauche. Le lundi, à minuit, elle demanda du vin et se mit à chanter des chansons indécentes. Le mardi, elle eut la question ordinaire et extraordinaire ; elle avait bien dîné et dormi huit heures. Elle soupa le soir et recommença, toute brisée qu’elle était, à faire débauche de table. On lui en fit honte ; on lui dit qu’elle ferait bien mieux de penser à Dieu et de chanter un Ave maris stella ou un Salve. Elle chanta l’un et l’autre en plaisantant et dormit ensuite. Le mercredi se passa de même en débauche et en chansons ; elle refusa de voir un confesseur. Enfin le jeudi on ne voulut lui donner qu’un bouillon ; elle en gronda, disant qu’elle n’aurait pas la force de parler à ces messieurs…
Elдe vint en carrosse de Vincennes à Paris. On la voulut faire confesser ; il n’y eut pas moyen d’y parvenir. À cinq heures on la lia, et avec une torche à la main elle parut dans le tombereau, habillée de blanc ; on voyait qu’elle repoussait le confesseur et le crucifix avec violence.
À Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l’amende honorable ; à la Grève, elle se défendit autant qu’elle put de sortir du tombereau. On l’en tira de force ; on l’a mit sur le bûcher, assise et liée avec des chaînes ; on la couvrit de paille. Là elle jura beaucoup, repoussa la paille cinq ou six fois ; mais enfin le feu monta et on la perdit de vue.
Voiture du diable. On vit pendant plusieurs nuits, dans un faubourg de Paris, au commencement du dix-septième siècle, une voiture noire, traînée par des chevaux noirs, conduite par un cocher également noir, qui passait au galop des chevaux, sans faire le moindre bruit. La voiture paraissait sortir tous les soirs de la maison d’un seigneur mort depuis peu. Le peuple se persuada que ce ne pouvait être que la voiture du diable qui emportait le corps. On reconnut par la suite que celle jonglerie était l’ouvrage d’un fripon, qui voulait avoir à bon compte la maison du gentilhomme. Il avait attache des feutres autour des roues de la voiture et sous les pieds des chevaux, pour donner à sa promenade nocturne l’apparence d’une œuvre magique.
Voix. Boguet assure qu’on reconnaît un possédé à la qualité de sa voix. Si elle est sourde et enrouée, nul doute, dit-il, qu’il ne faille aussitôt procéder aux exorcismes.
Sous le règne de Tibère, vers le temps de la mort de Notre-Seigneur, le pilote Thamus, côtoyant les îles de la mer Egée, entendit un soir, aussi bien que tous ceux qui se trouvaient sur son vaisseau, une grande voix qui l’appela plusieurs fois par son nom. Lorsqu’il eut répondu, la voix lui commanda de crier, en un certain lieu, que le grand Pan était mort. À peine eut-il prononcé ces paroles dans le lieu désigné, qu’on entendit de tous côtés des plaintes et des gémissements, comme d’une multitude de personnes affligées par cette nouvelle[101]. L’empereur Tibère assembla des savants pour interpréter ces paroles. On les appliqua à Pan, fils de Pénélope, qui vivait plus de mille ans auparavant ; mais, selon les versions les plus accréditées, il faut entendre par le grand Pan le maître des démons, dont l’empire était détruit parla mort de Jésus-Christ.
Les douteurs attribuent aux échos les gémissements qui se firent entendre au pilote Thamus ; mais on n’explique pas la voix.
Cette grande voix, dit le comte de Gabalis, était produite par les peuples de l’air, qui donnaient avis aux peuples des eaux que le premier et le plus âgé des sylphes venait de mourir. Et comme il s’ensuivrait de là que les esprits élémentaires étaient les faux dieux des païens, il confirme cette conséquence en ajoutant que les démons sont trop malheureux et trop faibles pour avoir jamais eu le pouvoir de se faire adorer ; mais qu’ils ont pu persuader aux hôtes des éléments de se montrer aux hommes et de se luire dresser des temples ; et que, par la domination naturelle que chacun d’eux a sur l’élément qu’il habite, ils troublaient l’air et la mer, ébranlaient la terre et dispensaient les feux du ciel à leur fantaisie : de sorte qu’ils n’avaient pas grand-peine à être pris pour des divinités.
Le comte Arigo bel Missere (Henri le bel Missere) mourut vers l’an 1000. Il avait combattu les Maures qui envahissaient la Corse. Une tradition prétend qu’à sa mort une voix s’entendit dans l’air, qui chantait ces paroles prophétiques :
È morto il conte Arigo bel Missere,
E Corsica sarà di maie in peggio[102].
Saint Clément d’Alexandrie raconte qu’en Perse, vers la région des mages, on voyait trois montagnes, plantées au milieu d’une large campagne, distantes également l’une de l’autre. En approchant de la première, on entendait comme des voix confuses de plusieurs personnes qui se battaient ; près de la seconde, le bruit était plus grand ; et à la troisième, c’étaient des fracas d’allégresse, comme d’un grand nombre de gens qui se réjouissaient. Le même auteur dit avoir appris d’anciens historiens que, dans la Grande-Bretagne, on entend au pied d’une montagne des sons de cymbales et de cloches qui carillonnent en mesure.
Il y a, dit-on, en Afrique, dans certaines familles, des sorcières qui ensorcellent par la voix et la langue, et font périr les blés, les animaux et les hommes dont elles parlent, même pour en dire du bien. — En Bretagne, le mugissement lointain de la trier, le sifflement des vents, entendu dans la nuit, sont la voix d’un noyé qui demande un tombeau[103].
Volac, grand président aux enfers ; il apparaît sous la forme d’un enfant avec des ailes
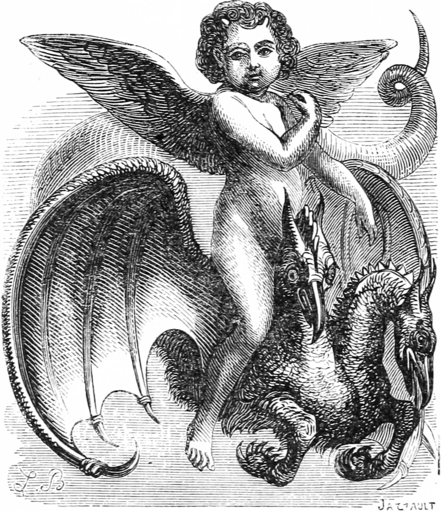
Volet (Marie). Vers l’année 1691, une jeune fille, de la paroisse de Pouillat en Bresse, auprès de Bourg, se prétendit possédée. Elle poussait des cris que l’on prit pour de l’hébreu. L’aspect des reliques, l’eau bénite, la vue d’un prêtre, la faisaient tomber en convulsions. Un Chanoine de Lyon consulta un médecin sur ce qu’il y avait à faire. Le médecin visita la possédée ; il prétendit qu’elle avait un levain corrompu dans l’estomac, que les humeurs cacochymes de la masse du sang et l’exaltation d’un acide violent sur les autres parties qui le composent étaient l’explication naturelle de l’état de maladie de cette fille. Marie Volet fui envoyée aux eaux minérales ; le grand air, la défense de lui parler du diable et de l’enfer, et sans doute le retour de quelque paix dans sa conscience troublée, calmèrent ses agitations ; bientôt elle fut en état de reprendre ses travaux ordinaires[105].
Vols ou Voust, de vultus, figure, effigie. On appelait ainsi autrefois une image de cire, au moyen de laquelle on se proposait de faire périr ceux qu’on haïssait ; ce qui s’appelait envoûter. La principale formalité de l’envoûtement consistait à modeler, soit en cire, soit en argile, l’effigie de ceux à qui On voulait mal. Si l’on perçait la figurine, l’envoûté qu’elle représentait était lésé dans la partie correspondante de sa personne. Si on la faisait dessécher ou fondre au feu, il dépérissait et ne tardait pas à mourir.
Enguerrand de Marigny fut accusé d’avoir voulu envoûter Louis X. L’un des griefs de Léonora Galigaï fut qu’elle gardait de petites figures de cire dans de petits cercueils. En envoûtant, on prononçait des paroles et on pratiquait des cérémonies qui ont varié. Ce sortilège remonte à une haute antiquité. Platon le mentionne dans ses Lois : « Il est inutile, dit-il, d’entreprendre de prouvera certains esprits fortement prévenus qu’ils ne doivent point s’inquiéter des petites figures de cire qu’on aurait mises ou à leur porte, ou dans les carrefours, ou sur le tombeau de leurs ancêtres, et de les exhorter à les mépriser, parce qu’ils ont une foi confuse à la vérité de ces maléfices. — Celui qui se sert de charmes, d’enchantements et de tous autres maléfices de cette nature, à dessein de nuire par de tels prestiges, s’il est devin ou versé dans l’art d’observer les prodiges, qu’il meure ! Si, n’ayant aucune connaissance de ces arts, il est convaincu d’avoir usé de maléfices, le tribunal décidera ce qu’il doit souffrir dans sa personne ou dans ses biens. » (Traduction de M. Cousin.)
Ce qui est curieux, c’est qu’on a retrouvé la même superstition chez les naturels du nouveau monde. Le père Charlevoix raconte que les Illinois font de petits marmousets pour représenter ceux dont ils veulent abréger les jours, et qu’ils les percent au cœur. Voy. Envoûtement.
Volta. C’est une ancienne tradition de l’Étrurie que les campagnes furent désolées par un monstre appelé Voila. Porsenna fit tomber la foudre sur lui. Lucius Pison, l’un des plus braves auteurs de l’antiquité, assure qu’avant lui Nu ma avait fait usage du même moyen, et que Tullus Hostilius, l’ayant imité sans être suffisamment instruit, fut frappé de ladite foudre[106]…
Voltaire. L’abbé Fiard, Thomas, madame de Staël et d’autres têtes sensées le mettent au nombre des démons incarnés.
Voltigeur hollandais. Les marins de toutes les nations croient à l’existence d’un bâtiment hollandais dont l’équipage est condamné par la justice divine, pour crime de pirateries et de cruautés abominables, à errer sur les mers jusqu’à la fin des siècles. On considère sa rencontre comme un funeste présage. Un écrivain de nos jours, à fort bien décrit cette croyance dans une scène maritime que nous transcrivons :
« Mon vieux père m’a souvent raconté, lorsque, tout petit, il me berçait dans ses bras, pour m’accoutumer au roulis, et il jurait que c’était la pure vérité, qu’étant un jour ou plutôt une nuit dans les parages du cap de Bonne-Espérance, un malavisé de mousse jeta par-dessus bord un chat, vivant qu’il avait pris en grippé, et qu’aussitôt, comme cela ne pouvait manquer d’arriver, un affreux coup de vent assaillit le navire, lequel, ne pouvant supporter une seule aune de toile, fut obligé de fuir à sec devant la bourrasque, avec la vitesse d’au moins douze nœuds.

» Ils étaient dans cette position, lorsque, vers minuit, ils virent tout à coup, à leur grand étonnement, un bâtiment de construction étrangère courir droit dans le lit du vent, qui était cependant alors dans sa plus grande violence. Pendant qu’ils examinaient ce singulier navire, dont les voiles pendaient en lambeaux, et dont les œuvres mortes étaient recouvertes d’une épaisse couche de coquillages et d’herbes marines, comme s’il n’eût pas été nettoyé depuis de longues
» — Au nom de Dieu tout-puissant, je l’ordonne de qui Lier mon bord ! s’écria enfin le capitaine, en s’adressant au spectre. À peine ces mots eurent-ils été prononcés, qu’un cri long et aigu, tel que mille voix humaines n’auraient pu en produire un semblable, domina le bruit de la tempête, qu’un horrible coup de tonnerre ébranla le bâtiment jusqu’à sa quille… »
Le navire eut le bonheur d’échapper ; ce qui est rare.
On dit encore que ceux qui ont reçu les lettres que les matelots-fantômes du navire appelé le Voltigeur hollandais envoyaient à leurs parents et amis ont vu qu’elles étaient adressées à des personnes qui n’existent plus depuis des siècles.
Vondel, poëte hollandais célèbre, auteur du drame de Lucifer.
Vouivre. Voy. Wivre.
Voyages des sorcières. Si elles vont au sabbat portées par un bouc ou par un mouton noir ou par un démon, dans leurs autres excursions elles ne voyagent généralement qu’à cheval sur un manche à balais.
Vroucolacas ou Broucolaques. V. Vampires.
Vue. Il y a des sorcières qui tuent par leur regard ; mais, en Écosse, beaucoup de femmes ont ce qu’on appelle la seconde vue, c’est-à-dire le don de prévoir l’avenir et de l’expliquer, et de connaître par une mystérieuse intuition ce qui se passe au loin. Voy. Yeux.
W
Waeter-Elves (fées des eaux). On les trouve dans les récits des marins, qui croient se les rendre favorables en leur sifflant des airs monotones.
Wakeman (Rhoda), illuminée qui a fait grand bruit à New-Haven, il y a quelques années. Elle se disait envoyée de Dieu sur la terre pour annoncer la venue prochaine du Christ, et y ouvrir le Millenium. Elle se vantait de recevoir quelquefois la visite du Saint-Esprit, et d’être honorée de temps en temps des révélations de Dieu, Ces prétentions, disent les journaux qui nous guident, ne lui ont encore attiré, quoiqu’elle prêche en Amérique, que dix à douze disciples, mais quels disciples !… Suivons maintenant les feuilles publiques :

« La petite congrégation a l’habitude de se réunir pour prier et pour divaguer chez la prophétesse Wakeman. Mathews était un des adeptes les plus fervents de cette église ; toutefois, on avait remarqué que, depuis quelque temps, il était moins assidu aux réunions, et la femme Wakeman lui avait persuadé qu’il était possédé de l’esprit malin, du vieil homme dont parle l’Écriture. Cet esprit, disait-elle, agissait aussi sur elle-même, la tourmentait, lui faisait éprouver de vives douleurs, et il était en même temps un obstacle au commencement immédiat du Millenium. Il était à craindre qu’il la fît mourir…, ce qui amènerait de suite le jugement dernier, sans aucune espèce de Millenium !
» Voilà la folie ; voici comment elle a pu s’exalter jusqu’au crime.
» On est parvenu à persuader à Mathews qu’il fallait, par tous les moyens possibles, faire sortir, ce malin esprit de son corps. Il se rendit donc un dimanche soir chez la vieille Wakeman, afin de se soumettre à tout ce que pourraient tenter les adeptes de cette singulière croyance. Il y arriva vers onze heures et y trouva, qui attendaient son arrivée, d’abord la vieille prophétesse, puis les époux Sanford, qui sont son beau-frère et sa sœur ; Julia Davis, sœur de Sanford ; Abigail-Sables ; un homme de couleur nommé Josiah Jackson, Hersey, Wooding et Samuel Sly, frère utérin de la femme Wakeman. Ils étaient tous en prières quand il arriva.
» Sa sœur, la femme Sanford, vint au-devant de lui et le conduisit dans une autre chambre dans laquelle on avait préparé du feu pour le recevoir. Il s’assit, ôta ses bottes pour se chauffer, et une longue conversation s’engagea entre lui et sa sœur sur l’objet de sa visite ; il exprima un ardent désir d’être débarrasse de l’esprit malin qui l’obsédait et qui agissait sur les autres, et notamment sur la digne mistress Wakeman. Il se laissa bander les yeux avec un mouchoir, et attacher les mains derrière le dos avec une petite corde. Cette double opération fut faite par sa sœur, qui lui dit que c’était afin d’avoir plus de pouvoir sur l’esprit et d’empêcher Mathews d’opérer des enchantements par les yeux. On le laissa dans cette situation jusque vers deux heures du matin, et pendant ce temps il reçut la visite de plusieurs de ses coreligionnaires, qui venaient le supplier de faire déguerpir l’esprit malin.
» De temps en temps on lui criait de la chambre du haut, ou se tenait le cénacle, que l’esprit obsédait la femme Wakeman, qu’il la frappait, et que, s’il ne le chassait pas, l’esprit allait la tuer. On lui disait aussi qu’il vaudrait mieux qu’il mourut, si l’on ne pouvait en venir à bout d’une autre manière, et s’il n’y avait que ce moyen de conjurer la mort de la femme Wakeman et la venue immédiate du jugement dernier. Quelques témoins ont déclaré que Mathews aurait dit qu’il consentait volontiers à faire le sacrifice de sa vie.
» Les prières se continuèrent encore pendant une heure. Sanford et sa femme visitèrent encore une fois Mathews ; Wooding et Sly étaient avec eux. À ce moment, Jackson cria du haut de l’escalier que si l’on n’emmenait pas Mathews l’esprit malin allait certainement tuer la femme Wakeman. Les quatre visiteurs quittèrent aussitôt la chambre, Sanford et sa femme remontant l’escalier pour prendre leurs effets, dans l’intention de redescendre pour ramener Mathews chez lui, Wooding et Sly entrant dans une chambre contiguë à celle où était resté Mathews.
» Il s’était à peine écoulé quelques minutes, quand on entendit en haut des cris et le bruit d’une lutte partant de la chambre du bas. Sanford, sa femme et mistress Davis se précipitèrent vers cette chambre, dont ils trouvèrent la porte fermée à l’intérieur ; ils tentèrent de l’enfoncer et ne purent y réussir. À ce moment Wooding et Sly ne furent vus par personne en dehors de cette chambre.
» Sanford partit de suite pour Hamden, résidence de la famille Mathews, et il revint le matin avec le fils de ce malheureux fanatique. Ils pénétrèrent dans la chambre, sans difficulté cette fois, ils y trouvèrent Mathews étendu, sur le parquet, le cou horriblement coupé, déchiqueté par cinq ou six blessures béantes, et le ventre percé de douze autres blessures qui paraissaient avoir été faites avec une fourchette qu’on retrouva sur la table. Une large mare de sang couvrait le milieu de la chambre, dont la porte principale était encore fermée à l’aide de coins de bois placés dans le loquet.
» La police fut immédiatement avertie, et tous les habitants de cette funeste maison furent arrêtés.
» Voici le résumé des aveux qui ont été faits par Sly devant le jury d’enquête.
» Il a commencé par déclarer qu’il était seul coupable du meurtre de Mathews. Cependant, vers la fin de ses déclarations, il a semblé désigner Jackson et miss Hersey comme l’ayant assisté et s’étant rendus ses complices.
» Il raconte que sa sœur, la femme Wakeman, souffrait tellement de l’esprit ou du pouvoir qui était en Mathews, qu’il a pensé, lui, qu’il y avait quelque chose à faire pour l’en délivrer. À cet égard, il s’est consulté avec Jackson sur l’effet probable que produirait sur Mathews, un bâton de coudrier, et il s’en était procuré un depuis quelques jours, dans la prévision qu’une opération de ce genre deviendrait nécessaire. Il pensait dissiper l’enchantement en combinant ce moyen avec une infusion d’écorce de coudrier et d’aune dans du thé. Le bâton qu’il s’est procuré a un pouce de diamètre et un pied et demi de longueur. Il l’avait placé dans la chambre voisine de celle où était Mathews. Jackson et miss Hersey étaient là quand il est venu prendre cette arme.
» Quand il a compris que Sanford et sa femme se disposaient à emmener Mathews, il est rentré dans la chambre, dont il a fermé la porte. Il s’est approché de Mathews, qui avait toujours les yeux bandés et les mains liées, et lui a porté sur la tempe droite un coup de bâton si violent qu’il l’a renversé de sa chaise sur le parquet. Il a continué à le frapper ; puis, tirant son couteau de sa poche, il lui a fait les blessures du cou. Mathews a crié, mais il n’a pas prononcé une parole après le premier coup porté. Sly, prenant alors la fourchette dont il a été parlé, lui a fait ensuite les blessures constatées au ventre. Il dit qu’il n’avait d’abord l’intention d’user que de son bâton, mais qu’ensuite il a été poussé par une influence qu’il ignore à se servir de son couteau et de la fourchette.
» Il est resté là, renfermé pendant une demi-heure, après laquelle il est rentré dans l’autre chambre, où était miss Hersey ; il tenait d’une main son bâton sanglant, et une lumière de l’autre main. C’est devant elle qu’il a lavé ses mains et qu’il a arraché et brûlé les manches de sa chemise, qui étaient ensanglantées. Il a ensuite brisé en trois morceaux le bâton dont il s’était servi et il a jeté ces morceaux, avec son couteau, dans les lieux d’aisances. »
Nous ne savons pas quel jugement a couronné cette procédure.
Walhalla, Paradis des guerriers chez les anciens Scandinaves. Pour y entrer, il fallait être mort en combattant. On y buvait de la bière forte dans une coupe qui ne se vidait jamais. On y mangeait des grillades d’un sanglier vivant, qui se prêtait à la chose et qui était toujours entier.
Walkiries, fées des Scandinaves. Elles ont, comme la mythologie dont elles dépendent, un caractère très-sauvage. Voy. Vade.
Wall, grand et puissant duc du sombre empire ; il a la forme d’un dromadaire haut et terrible ; s’il prend figure humaine, il parle Égyptien ; il connaît le présent, le passé et l’avenir ; il était de l’ordre des puissances. Trente-six légions sont sous ses ordres.
Walter. Jacques Ier, roi d’Écosse, fut massacré de nuit, dans son lit, par son oncle Walter, que les historiens français ont appelé Gauthier, et qui voulait monter sur le trône. Mais ce traître reçut à Édimbourg le prix de son crime ; car il fut exposé sur un pilier, et là, devant tout le monde, on lui mit sur la tête une couronne de fer qu’on avait fait rougir dans un grand feu, avec cette inscription : Le roi des traîtres. Un astrologue lui avait promis qu’il serait couronné publiquement, dans une grande assemblée de peuple…
Walter-Scott. L’illustre romancier a publié sur la démonologie et les sorciers un recueil de lettres qui expliquent et qui éclaircissent certaines particularités mystérieuses, croyances et traditions populaires dont il a fait usage si souvent et si heureusement dans ses romans célèbres. Il est fâcheux que les opinions religieuses de l’auteur anticatholique aient déteint dans son esprit un peu trop de scepticisme. Il est trop enclin à ne voir dans les matières qui font le sujet de ses lettres que les aspects poétiques ; et s’il est agréable de le suivre dans des recherches piquantes, il faut recommander de le lire, avec toute réserve ; car il est là, comme dans ses romans, opposé en toute occasion à l’Église romaine.

Dans la première lettre, il établit que le dogme incontestable d’une âme immatérielle a suffi pour accréditer la croyance aux apparitions.
Dans la deuxième, il s’arrête à la tradition du péché originel ; il y trouve la source des communications de l’homme avec les esprits. Il reconnaît que les sorciers et magiciens, condamnés par la loi de Moïse, méritaient la mort, comme imposteurs, comme empoisonneurs, comme apostats ; et il remarque avec raison qu’on ne voyait pas chez les Juifs et chez les anciens, dans ce qu’on appelait un magicien ou un devin, ce que nous voyons dans les sorciers du moyen âge, sur lesquels, au reste, nous ne sommes encore qu’à demi éclairés.
La troisième lettre est consacrée à l’étude de la démonologie et des sorciers chez les Romains, chez les Celtes et chez les différents peuples du Nord. Les superstitions des anciens Celtes subsistent encore en divers lieux, dit l’auteur, et les campagnards les observent sans songer à leur origine.
La quatrième et la cinquième lettre sont consacrées aux fées.
La sixième lettre traite principalement des esprits familiers, dont le plus illustre était le célèbre Puck ou Robin Goodfellow, qui chez les sylphes jouait en quelque sorte le rôle de fou ou de bouffon de la compagnie. Ses plaisanteries étaient du comique à la fois le plus simple et le plus saugrenu : égarer un paysan qui se rendait chez lui, prendre la forme d’un singe afin de faire tomber une vieille commère sur son derrière, lorsqu’elle croyait s’asseoir sur une chaise, étaient ses principales jouissances. S’il se prêtait à faire quelque travail pour les gens de la maison pendant leur sommeil, c’était à condition qu’on lui donnerait un déjeuner délicat.
La septième, la huitième et la neuvième lettre s’occupent des sorciers et de la sorcellerie. La dernière est consacrée aux devins et aux revenants. Tout ce dictionnaire est parsemé de faits et de documents pour lesquels nous avons puisé et cité en leur lieu tout ce qui, dans ce livre de démonologie, peut intéresser le lecteur.
Wattier (Pierre). Il a publié, au dix-septième siècle, la Doctrine et interprétation des songes, comme traduite de l’arabe de Gabdorrhaman, fils de Nosar ; in-12, Paris, 1664.
Wechselbalg. La wechselbalg est, dans l’île de Man, une fée ou un lutin qui mange tout ce qui se trouve sous sa main dans les maisons qu’il ou qu’elle hante.
Welz (André), bourgeois de Dottingen, dont la maison, en 1689, fut hantée par un esprit frappeur. Il se montra une fois en oiseau gris, une autre fois en vieille femme laide, une autre fois en chat et fit divers tours.
Wenham (Jane), Anglaise qui se tuait à se faire passer pour sorcière au commencement du dix-huitième siècle. On l’amena au juge Powel, qui était un homme éclairé. Des témoins étaient là qui juraient l’avoir vue voler en l’air. Jeanne se gardait bien de les démentir. Le juge lui demanda s’il était vrai qu’elle eût ce pouvoir, et la pauvre femme en convint naïvement. — Eh bien, dit Powel, je ne vois rien dans la loi qui vous empêche de vous donner ce plaisir. Allez-vous-en à vos affaires ; et Jeanne Wenham se retira triste de voir tomber sa réputation de sorcière.
Wesley, fondateur de la secte des méthodistes. Sa maison fut visitée aussi par un esprit frappeur. Il se montra un jour sous la forme d’un basset, un autre jour sous celle d’un petit lapin, qui disparut lorsqu’on voulut le toucher avec des pincettes.
Wiclef. On croit qu’il fut étranglé par le diable.
Wierus ou Wier (Jean), célèbre démonographe brabançon, élève d’Agrippa, qu’il a défendu dans ses écrits. On lui doit les cinq livres Des prestiges des démons, traduits en français sous ce titre : Cinq livres de l’imposture et tromperie des diables, des enchantements et sorcelleries, pris du latin de Jean Wier, médecin du duc de Clèves, et faits français par Jacques Grevin, de Clermont. Paris, in-8o, 1569.
L’ouvrage de Wierus est plein de crédulité, d’idées bizarres, de contes populaires, d’imaginations, et riche de connaissances. C’est ce même écrivain qui a publié un traité curieux des lamies et l’inventaire de la fausse monarchie de Satan (Pseudomonarchia Dæmonum), où nous avons trouvé de bonnes désignations sur presque tous les esprits de ténèbres cités dans ce dictionnaire.
Wilis. Dans quelques contrées de l’Allemagne, toute fiancée qui meurt avant le mariage, « pour peu que de son vivant elle ait un peu trop aimé la danse, devient après sa mort une wili, c’est-à-dire un fantôme blanc et diaphane, qui s’abandonne chaque nuit à la danse d’outre-tombe.

Wiulmeroz (Guillaume), sorcier en Franche-Comté, vers l’an 1600. Son fils, âgé de douze ans, lui reprocha d’avoir été au sabbat et de l’y avoir mené. Le père, indigné, s’écria : « Tu nous perds tous les deux !… » Il protesta qu’il n’avait jamais été au sabbat. Néanmoins, on prononça son arrêt, parce qu’il y avait cinq personnes qui le chargeaient ; que d’ailleurs sa mère avait été suspecte, ainsi que son frère, et que beaucoup de méfaits avaient été commis par lui.
Comme il fut démontré que l’enfant ne participait pas à la sorcellerie, il fut élargi[107].
Wivre, monstre du moyen âge, à qui on a donné des formes fantastiques.
« Sur le plateau de Haute-Pierre, dans la Franche-Comté, on a vu quelquefois passer une autre Mélusine, un être moitié femme et moitié serpent. C’est la wivre ; elle n’a point d’yeux, mais elle porte au front une escarboucle qui la guide comme un rayon lumineux le jour et la nuit. Lorsqu’elle va se baigner dans les rivières, elle est obligée de déposer cette escarboucle à terre, et si l’on pouvait s’en emparer, on commanderait à tous les génies ; on pourrait se faire apporter tous les trésors enfouis dans les flancs des montagnes. Mais il n’est pas prudent de tenter l’aventure ; car, au moindre bruit, la wivre s’élance au dehors de la rivière, et malheur à celui qu’elle rencontre ! Un pauvre homme de Moustier, qui l’avait suivie un jour de très-loin, et qui l’avait vue déposer son escarboucle au bord de la Loue et plonger ses écailles de serpent dans la rivière, s’approcha avec précaution du bienheureux talisman ; mais à l’instant où il étendait déjà la main pour le saisir, la wivre, qui l’avait entendu, s’élance sur lui, le jette par terre, lui déchire le sein avec ses ongles, lui serre la gorge pour l’étouffer ; et si ce n’était que le malheureux avait reçu le matin même la communion à l’église de Lods, il serait infailliblement mort, sous les coups de cette méchante wivre ; mais il rentra chez lui le visage et le corps tout meurtris, se promettant bien de ne plus courir après l’escarboucle[108]. »
Woden, dieu suprême des anciens Germains, le même qu’Odin. On laissait dans les moissons des épis pour ses chevaux, et dans les bois du gibier pour sa chasse. Les chercheurs ont trouvé que Woden, dont les races germaniques ont fait God, en se convertissant au christianisme, a de l’analogie avec le Bouddha des Indiens[109].
Wolotys, monstres épouvantables qui, selon le récit de Lomonosoff, étaient chez les Slavons comme les géants chez les Grecs.
Woodward. Un médecin empirique, James Woodward, surnommé le Docteur noir à cause de son teint, est mort en 1844 à Cincinnati, laissant une fortune considérable. On a été surpris de trouver chez lui, dans une grande armoire vitrée, une immense quantité de petites fioles de diverses dimensions, les unes pleines et les autres vides, et portant sur leurs étiquettes les noms et demeures de personnages-habitant les différents États de l’Union. Il y en avait aussi du Canada, des Antilles et du Mexique. Voici quel en était l’usage : le Docteur noir se vantail de découvrir le diagnostic de toutes les maladies par des émanations des consultants, à quelque distance qu’ils fussent de lui. Le malade devait tremper son doigt pendant une heure dans Une fiole remplie de l’eau la plus pure, et lui envoyer ensuite cette fiole soigneusement bouchée. L’eau, se trouvant ainsi imprégnée des sueurs du malade, était soumise à une analyse chimique. Le Docteur noir, sans autre indication, répondait au malade qu’il était attaqué ou menacé de phthisie, de péripneumonie, de goutte, de rhumatisme, etc., et il faisait ses prescriptions en conséquence. Quand il rencontrait juste, on était émerveillé de sa science profonde, et l’on demandait une consultation nouvelle, payée plus cher que la première. Les registres du docteur ont constaté-qu’il avait répondu avec les plus grands détails à un grand nombre de ses malades, sans prendre la peine d’analyser leurs émanations, car les fioles étaient encore hermétiquement fermées.
Wortigern, roi d’Angleterre. Voy. Merlin.
Wulson de la Colombière (Marc). On lui doit le Palais des curieux, où, entre autres sujets, il est question des songes, avec un traité de la physionomie. Orléans, 1660.
X
Xacca, philosophe indien, né à Sica, mille ans avant notre ère, et regardé par les Japonais comme leur législateur. Il leur persuada que, pour gagner le ciel, il suffisait de prononcer souvent ces mots : nama, mio, foren, qui, quio. Jusqu’ici, aucun interprète n’a pu deviner le sens de ces paroles. Ce fut Xacca qui introduisit au Japon le culte d’Amidas[110].
Xaphan, démon du second ordre. Quand Satan et ses anges se révoltèrent contre Dieu, Xaphan se joignit aux mécontents, et il en fut bien reçu, car il avait l’esprit inventif. Il proposa aux rebelles de mettre le feu dans le ciel ; mais il fut précipité avec les autres au fond de l’abîme, où il est continuellement occupé à souffler la braise des fourneaux avec sa bouche et ses mains. Il a pour emblème un soufflet.
Xeirscopie. Voici sur ce sujet de charmants extraits d’un spirituel écrit de M. Munier des Closeaux :
« Xeirscopie, de xeir, main, et scopeô, j’examine. Les lecteurs sont priés de supposer que les deux mots xeir et scopeô sont écrits en langue grecque, ainsi qu’ils ont droit de l’être ; nous avons mille raisons pour les écrire en lettres ordinaires ; la première et la meilleure de ces mille raisons, c’est celle qui fait qu’on ne tire pas le canon dans les villes qui n’ont pas de canons.
» La signification positive de xeirscopie est donc examen de la main ; mais il en est du mot xeirscopie comme du mot cranioscopie, qui signifie proprement examen, inspection du crâne, et qui, par extension, veut dire aussi art de reconnaître le développement des parties du cerveau, des organes particuliers, ou des conditions matérielles de l’intelligence, d’après la configuration extérieure du crâne. Xeirscopie ne veut pas dire seulement examen, inspection de la main ; il signifie encore l’art de connaître le caractère des hommes d’après la conformation de leur main.
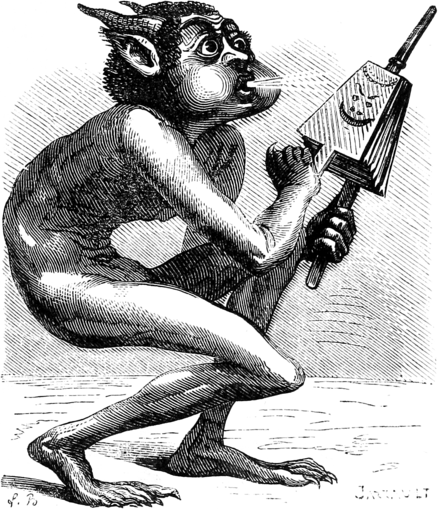
» La xeirscopie est donc un système de physiognomie à ajouter au système de Lavater et à celui de Gall.
» Au premier coup d’œil, nous avons considéré la xeirscopie comme une plaisanterie ; il a dû en être de même des doctrines de Lavater et de Gall à leur origine. On en a ri beaucoup avant de les élever à l’état de science ou de quasi-science ; mais un examen attentif nous a prouvé que l’inventeur de la nouvelle doctrine prend la chose au sérieux ; c’est très-sérieusement qu’il prétend trouver dans les différentes parties dont se compose une main des indications aussi nombreuses, aussi variées, aussi certaines que peut en fournir la configuration d’un crâne plus ou moins bossue.
» L’inventeur de la nouvelle doctrine a des titres qui doivent inspirer la confiance, les voici avec ses noms et prénoms : W.-F. Sargenkœnig, docteur en médecine de l’université de Wurtzbourg, conseiller et professeur de physiognomonique à l’université d’Iéna, membre de toutes les académies d’Allemagne et de plusieurs autres sociétés savantes. Après cela, croyez si vous voulez. Au fait, nous ne voyons pas pourquoi des passions qui se trahissent sur la boîte osseuse qui leur sert de domicile ne viendraient pas aussi révéler leur existence par quelques modifications dans la conformation de l’organe qui leur sert d’agent principal et plus habituel.

» Dans notre siècle de lumières, on ne croit plus aux sorciers ; on traite de fables ridicules les prédictions faites par des sorciers d’une autre époque, au moyen d’un examen attentif de la paume de la main. Il est prouvé pourtant, à en croire les almanachs, que beaucoup de prédictions de ce genre se sont réalisées.
» Ainsi, la mulâtresse qui, après avoir examiné la main de la belle et gracieuse créole de la Martinique, lui prédit qu’elle serait un jour plus que reine, c’est-à-dire impératrice des Français, reine d’Italie, et, par alliance, protectrice de la confédération du Rhin et médiatrice de la confédération suisse, n’était pas, comme on l’a toujours dit, une vieille sorcière tannée, mais bien une xeirscope naturelle, possédant la xeirscopie par intuition. Au train dont vont les choses, bien d’autres mystères seront certainement éclaircis. On ne s’est pas arrêté à Lavater, Gall est venu à son tour ; on ne s’est pas arrêté à la phrénologie ; voici venir le savant docteur W.-F. Sargenkœnig ; on ne s’arrêtera pas à la xeirscopie. Un petit os de quelques lignes suffisait à Cuvier pour recomposer un animal antédiluvien ; un jour peut-être il suffira d’un fragment d’os pour faire, en ce qui concerne l’homme et sous le rapport moral, ce que Cuvier n’a jamais prétendu faire que pour les animaux, et seulement au physique. Quel siècle que notre siècle !
» Le docteur Sargenkœnig prend pour point de départ une passion bien commune, presque générale ; la colère ; en latin ira ou furor brevis. Qu’est-ce que la colère ? C’est une passion violente dont les caractères les plus saillants sont l’accélération du cours du sang et de la respiration, une coloration très-vive de la face, avec des yeux étincelants joints à l’expression menaçante de la voix et des gestes (n’oublions pas et des gestes) ; ou bien, pâleur de visage, tremblement involontaire, altération de la voix, etc., etc. Tous ces phénomènes sont l’effet de l’état d’excitation violente dans lequel est entré le cerveau, à l’occasion d’une cause quelconque. Cette définition de la colère est toute médicale. Suivant les crânioscopes, l’état d’excitation violente dans lequel entre le cerveau, s’il se prolonge ou s’il se renouvelle fréquemment, produira à la longue une bosse au crâne. Quelle bosse ? Nous n’en savons vraiment rien, mais enfin nous acceptons la bosse. Mais dans la colère, il y a expression menaçante de la voix et du geste ; quel est l’organe principal du geste ? n’est-ce pas la main ? Dans la colère, la main ne se crispe-t-elle pas ? L’homme en colère ne ferme-t-il pas la main, ne roidit-il pas le poing comme s’il voulait frapper quelqu’un ou quelque chose ? Ces données admises, et elles ne peuvent pas ne pas l’être, l’homme qui aura fait une étude particulière de la main ne pourra-t-il pas découvrir dans la conformation de cet organe chez une personne si elle se met habituellement en colère ? En ce qui concerne la colère, il saute aux yeux de tout le monde que la xeirscopie offre des indications bien autrement certaines, bien autrement saisissables que la crânioscopie.

» Maintenant et pour l’utilité d’application, le docteur Sargenkœnig prouve sans peine que la xeirscopie laisse bien loin derrière elle son aînée. Jadis, avant de se lier avec une personne, on prenait la peine d’étudier son caractère, ses mœurs, ses habitudes ; tout cela est maintenant inutile ; la nature a pris soin de nous tout révéler ; si nous sommes trompés, c’est que nous le voulons bien. Et pourtant on ne peut guère dire à une personne avec laquelle on veut former une liaison : Je me sens disposé à vous aimer ; vous avez, suivant Lavater, une physionomie fort heureuse ; mais pour être plus sûr de mon fait, permettez que je vous tâte le crâne ; si vous n’avez aucune protubérance fâcheuse, je vous accorderai mon estime et vous demanderai votre amitié. Avec la xeirscopie, il suffit d’une poignée de main artistement donnée.
» Vous voulez vous marier. En pareil cas, de part et d’autre, on dissimule le plus habilement possible ses défauts ; le jeune homme est prévenant, affectueux ; la demoiselle fait patte de velours avec infiniment de grâce. Dans une pareille circonstance, impossible encore de tâter mutuellement le crâne ; mais il est toujours permis au fiancé de prendre la main de sa fiancée ; il peut, sans manquer aux règles de la décence, explorer doucement la face palmaire, l’éminence thénar et l’éminence hypothénar, la face dorsale, etc., etc. Il y a tel signe auquel on peut infailliblement reconnaître que l’un des deux époux sera égratigné avant la fin de la lune de miel.

» Les préjugés ne sont pas tous menteurs. On croit généralement que dans la cérémonie du mariage, si la jeune ou vieille épouse, au moment où le marié lui passe l’anneau au doigt annulaire, ou au quatrième des prolongements de l’extrémité du membre pectoral, parvient à fermer le doigt assez tôt pour que l’anneau ne franchisse pas la dernière phalange, elle sera maîtresse de la maison. Ce préjugé n’en est pas un. Ce mouvement instinctif du fléchisseur du quatrième prolongement de l’extrémité du membre pectoral est très-clairement expliqué comme effet physique d’une cause morale dans le traité de xeirscopie du docteur Sargenkœnig. En huit pages, le docte professeur démontre que cette action rapide du fléchisseur particulier du quatrième doigt prouve une grande fermeté de caractère et beaucoup d’énergie et d’obstination dans la volonté.
» Comme étude, la crânioscopie est auprès de la xeirscopie un enfantillage. On peut devenir crânioscope sans connaître le moins du monde l’anatomie ; la besogne d’ailleurs est toute mâchée : avec une tête de carton verni sur laquelle sont indiquées des cases soigneusement marquées par des numéros, on peut tout apprendre. Il n’en est pas de même en xeirscopie ; c’est une étude longue, patiente, qui nécessite des connaissances préliminaires. Dans la pratique, il faut de l’aptitude et beaucoup de tact. En s’intitulant phrénologues, les crânioscopes ont quelque peu étendu leur domaine, mais en définitive tout chez eux se réduit à des bosses plus ou moins prononcées. Les coryphées de la science, les docteurs, les professeurs ont pu éprouver le besoin de pénétrer plus avant dans les mystères, d’assigner une place distincte à chaque passion, à chaque penchant, à chaque sensation ; mais cette besogne primordiale terminée, la science s’est trouvée créée tout entière ; elle a été livrée sans réserve à la pratique. Quelle différence en ce, qui concerne la main ! là, pas de bosses, pas de cavernes, mais des détails infinis à étudier. C’est à ce point que nous sommes contraint d’avouer qu’en lisant l’ouvrage, trop savant selon nous, du docteur Sargenkœnig, nous nous sommes perdu cent fois au milieu de ses descriptions anatomiques. Les crânioscopes auront beau faire, ils auront beau prendre des crânes monstrueux et en multiplier les divisions, ils n’arriveront jamais à y placer toutes les opérations, bonnes ou mauvaises, de l’intelligence humaine. Dans une main, au contraire, il y a place pour tout.
» Prenez la paume de la main, ou, pour parler correctement, la face palmaire. Cette partie de la main qui se termine à son extrémité supérieure à l’attache des premières phalanges, à son extrémité inférieure à l’articulation corpo-brachiale, d’un côté à l’éminence thénar, de l’autre à l’éminence hypothénar, n’a pas, chez les hommes les plus herculéennement constitués, plus de trois pouces carrés d’étendue, et elle contient un monde de passions, de désirs, de penchants vertueux ou criminels. L’éminence thénar seule, c’est-à-dire cette grosseur qui a le pouce pour prolongement, compte douze muscles au moins qui viennent s’y rattacher et s’y confondre. Un de ces muscles, par une saillie imperceptible à l’œil, mais reconnaissable au toucher d’une main exercée, révèle chez celui qui peut offrir cet heureux indice le don de l’éloquence au plus haut degré. Comment l’éloquence va-t-elle se nicher là ? Pour vous l’expliquer, il faudrait vous conduire à travers un labyrinthe inextricable, dans lequel nous nous sommes perdu le premier : nous aimons mieux vous engager à croire le docteur Sargenkœnig sur sa parole. D’ailleurs, des planches sont jointes au texte du livre ; et quand vous aurez vu l’éminence thénar de Pitt mise à nu, et que vous l’aurez comparée à celle d’un homme ordinaire, il vous sera loisible, comme à nous, de croire sans comprendre.
» Le docteur Sargenkœnig a enrichi, à ce qu’il paraît, le musée de l’université d’Iéna d’une nombreuse collection xeirscopique ; il a fourni des mains prises dans toutes les conditions sociales ; nous regrettons que celle de Napoléon manque ; nous aurions aimé à voir expliquer par le professeur comment cette main si blanche, si douce, aux muscles si peu accusés, pouvait indiquer une aussi grande puissance de volonté, tant de génie, tout ce que les phrénologues enfin ont trouvé dans la tête du grand homme. Le docteur s’en serait tiré, nous n’en doutons pas, car il se tire de tout à sa satisfaction. Mais il n’hésite pas à le déclarer, les mains reproduites en plâtre ne lui fournissent que des indications fort incertaines. La xeirscopie ne s’exerce avec avantage que sur la main naturelle et vivante ; pour elle, les secrets de la nature doivent être pris sur le fait ; elle laisse à la crânioscopie les bosses permanentes.
» On comprend que dans un pareil livre les exemples invoqués doivent être nombreux. Les exemples prouvent beaucoup, mais c’est quand ils sont eux-mêmes prouvés, et pour ajouter foi à ce que le docteur fournit à l’appui de son système, il faut être déjà prédisposé à croire. Un jour, par exemple, le docteur reçoit la visite d’un individu qui se présentait à lui avec une lettre d’introduction. C’était, lui disait-on, un savant distingué qui désirait se perfectionner auprès de lui. M. Sargenkœnig tend la main à son visiteur qui la lui serre avec effusion. Tout à coup le docteur retire sa main comme si un fer rouge l’eût brûlée. Fuyez, malheureux, lui dit-il, ma maison ne peut pas servir d’asile à un meurtrier. L’individu se trouble, pâlit, tombe aux genoux du professeur et avoue son crime. On rencontre vingt ou trente événements de ce genre dans le Traité de xeirscopie. Nous sommes trop poli et nous savons trop bien ce que nous devons à un savant étranger pour révoquer sa sincérité en doute, mais tout le monde pensera avec nous qu’il faudra encore bien des exemples, et des exemples bien authentiques, pour que l’on se décide à substituer la xeirscopie à l’épreuve de la cour d’assises.
» Nous avons cherché avec soin dans le livre du professeur allemand quelques indications propres à établir que certains proverbes relatifs à la main, et nous professons un grand respect pour les proverbes, sont fondés en raison. Ainsi on dit ordinairement des personnes dont les veines de la main sont saillantes et très-visibles : qui voit ses veines voit ses peines. Nous n’avons rien trouvé. Cette particularité s’explique tout naturellement et sans le secours d’aucune influence morale. Les veines sont saillantes chez les sujets pléthoriques, elles sont visibles chez les sujets à peau délicate, chez ceux dont le chorion manque de densité. Le chorion est la partie la plus épaisse du tissu de la peau.
» On prétend que les Normands ont les doigts crochus. Généralement les Normands ont le caractère processif et quelque peu rapace. Autrefois, dit-on encore, quand un enfant normand venait au monde, on le lançait contre un mur ; s’il parvenait à s’y accrocher, il était déclaré bon Normand et digne enfant de la famille ; s’il tombait, on le laissait, sans pitié, se casser la tête. Nous avons demandé au livre du docteur Sargenkœnig quels sont les indices d’un caractère processif et d’un penchant à la rapacité. Nous avons trouvé que les individus dont les phalanges dépassent le volume ordinaire sont naturellement difficultueux ; difficultueux peut bien être accepté comme synonyme de processif. Quant à la rapacité, elle est signalée par une grande élasticité des fléchisseurs. Les doigts crochus ne signifient donc absolument rien.
» Dans l’impossibilité où nous nous trouvons de suivre le docteur allemand dans le développement de sa théorie, et cela, comme nous l’avons dit déjà, faute de connaissances préliminaires suffisantes, nous nous bornerons à ces principes généraux et d’application usuelle.
» Une main potelée, douce, molle, avec les doigts effilés et leur surface dorsale un peu saillante, dénote un caractère facile, timide et faible. Une main large, d’une largeur qui n’est pas en proportion avec la Constitution physique de l’individu, si la surface palmaire ne forme pas cavité, si, en d’autres termes, la main ouverte et renversée ne laisse qu’à peine apercevoir les deux éminences, annonce un caractère absolu, tranchant et de la sécheresse de cœur. La rigidité des extenseurs externes est généralement une indication fâcheuse ; c’est la preuve d’un caractère qui manque de franchise ; c’est aussi le signe de l’avarice.
» Il y a ici quelque chose qui semble se rapporter à une locution assez usitée. On dit : avoir le cœur sur la main. Quand on prononce cette phrase, il semble que l’on voie une main toute grande ouverte, la main d’une personne qui ne sait rien refuser. La rigidité des extenseurs s’oppose à ce que la main s’ouvre avec facilité. L’aisance dans les fléchisseurs, au contraire, est un indice de générosité. Le volume disproportionné de l’éminence thénar, si la face dorsale de la main est potelée, révèle des passions généreuses. S’il arrive, ce qui est peu ordinaire, que l’éminence hypothénar l’emporte en volume sur l’autre éminence, c’est la plus déplorable de toutes les indications. L’individu colère a l’attache des premières phalanges très-marquée. La surface dorsale des doigts grasse et couverte d’un léger duvet dénote un individu voluptueux. La main sèche et plate, avec les doigts carrés à leur extrémité, est l’indication d’un cerveau propre à l’étude des sciences exactes.
» La xeirscopie est une science à l’état d’enfance. On se moquera probablement du docteur Sargenkœnig, comme on s’est moqué de Gall lorsqu’il a mis son système en avant. Qui sait pourtant si la xeirscopie n’est pas destinée à faire son chemin comme la crânioscopie a fait le sien ? Au surplus, comme nous l’avons dit, on ne s’arrêtera pas là. Nous connaissons déjà un homme très-sérieux, employé supérieur au ministère de la guerre en France, qui ne demande que deux lignes de l’écriture d’une personne pour reconnaître si elle a eu, ou si elle aura des garçons ou des filles. Auprès de ces sorciers-là, les crânioscopes et les xeirscopes, si le docteur Sargenkœnig n’est pas le seul de sa bande, font certainement triste figure. »
Xerxès. Ayant cédé aux remontrances de son oncle Artaban, qui le dissuadait de porter la guerre en Grèce, il vit dans son sommeil un jeune homme d’une beauté extraordinaire qui lui dit : — Tu renonces donc au projet de faire la guerre aux Grecs, après avoir mis tes armées en campagne ?… Crois-moi, reprends au plus tôt cette expédition, ou tu seras dans peu aussi bas que tu te vois élevé aujourd’hui. Cette vision se répéta la nuit suivante. Le roi étonné envoya chercher Artaban, le fit revêtir de ses ornements royaux, en lui contant la double apparition qui l’inquiétait, et lui ordonna de se coucher dans son lit, pour éprouver s’il ne se laissait point abuser par l’illusion d’un songe. Artaban, quoiqu’il craignît d’offenser les dieux en les mettant ainsi à l’épreuve, fit ce que le roi voulut, et lorsqu’il fut endormi, le jeune homme, lui apparut et lui dit :
« J’ai déjà déclaré au roi ce qu’il doit craindre, s’il ne se hâte d’obéir à mes ordres ; cesse donc de t’opposer à ce qui est arrêté par les destins. » En même temps il sembla à Artaban que le fantôme voulait lui brûler les yeux avec un fer ardent. Il se jeta au bas du lit, raconta à Xerxès ce qu’il venait de voir et d’entendre et se rangea de son avis, bien persuadé que les dieux destinaient la victoire aux Perses ; mais les suites funestes de cette guerre démentirent les promesses du fantôme.
Xezbeth, démon des prodiges imaginaires, des contes merveilleux et du mensonge. Il serait impossible de compter ses disciples.
Xitragupten. Les Indiens appellent ainsi le secrétaire du dieu des enfers ; il est chargé de tenir un registre exact des actions de chaque homme pendant sa vie.
Lorsqu’un défunt est présenté au tribunal du juge infernal, le secrétaire lui met en main le mémoire qui contient toute la vie de cet homme ; c’est sur ce mémoire que le dieu des enfers règle son arrêt.
Xylomancie, divination par le bois. On la pratiquait particulièrement en Esclavonie.
C’était l’art de tirer des présages de la position des morceaux de bois sec qu’on trouvait dans son chemin. On faisait aussi des conjectures non moins certaines pour les choses à venir sur l’arrangement des bûches dans le foyer, sur la manière dont elles brûlaient, etc. C’est peut-être un reste de cette divination qui fait dire aux bonnes gens, lorsqu’un tison se dérange, qu’ils vont avoir une visite.
Y
Yaga-Baba, monstre décrit dans les vieux contes russes sous les traits d’une femme : horrible à voir, d’une grandeur démesurée, de la forme d’un squelette, avec des pieds décharnés, tenant en main une massue de fer, avec laquelle elle fait rouler la machine qui la porte (espèce de vélocipède). Elle paraît remplir l’emploi de Bellone ou de quelque autre divinité infernale.
Yakouts. Voy. Mangtaar.
Yan-gant-y-tan, espèce de démon qui circule la nuit dans le Finistère, il porte cinq chan-

delles sur ses cinq doigts, et les tourne avec la rapidité d’un dévidoir. Sa rencontre est d’un mauvais, augure pour les Bretons.
Yasdh. Le même que Yesdhoon.
Ychain-bonawgs, bœufs monstres qui hantent les montagnes de l’Ecosse, que l’on ne voit jamais et qui sont assez forts pour fendre au besoin leur montagne et la déplacer. Leurs mugissements, qu’on entend quelquefois, sont épouvantables et font trembler les vitres à dix lieues.
Yen-vang, roi de l’enfer chez les Chinois. Il exerce des châtiments terribles sur ceux qui n’ont rien à lui offrir.
Yesdhoon. Le missionnaire hébraïsant Wolff s’entretint, à Ispahan, avec des adorateurs du feu, sectateurs de Zoroastre ; nous leur donnons le nom de Guèbres, ils s’appellent entre eux Bedhin. Ils adorent un dieu unique qu’ils désignent par le mot d’Yesdoon-Urmuzd (Ormusd) et auquel ils attribuent, mille et un noms (ce nombre de 1,001 a toujours passé en Orient comme doué d’une vertu mystique) ; ils rendent de plus un culte à trois anges qui protègent l’un le feu, l’autre l’eau, le troisième les arbres et les moissons. Ils entretiennent, avec du bois d’aloès et de santal, un feu constamment allumé et dont ils n’approchent qu’avec une extrême vénération. Une de leurs légendes raconte que Zoroastre, entra dans un brasier ardent, s’y promena tout à son aise, y coucha, y dormit, en sortit frais comme un homme qui vient de se plonger dans les flots limpides d’un torrent.
Ces sectaires prétendent être en possession, du livre Yashd, dont voici la propriété : celui qui se sert de ce livre pour faire ses prières meurt, il est vrai, tout comme un autre, mais, après son trépas, son cadavre répand un parfum délicieux. Les exemplaires du livre Yashd sont d’une rareté insigne. Les Bedhin croient que le monde doit finir par être réduit en cendres ; ils avouent ne pas savoir quand, mais ils n’ignorent point que dès qu’il aura été détruit, Dieu en refera un autre et que cette création nouvelle se reproduira dix-huit mille fois de suite. Un Bedhin reçoit à l’âge de sept ans une ceinture qu’il ne doit jamais quitter une seule minute ; cette ceinture est garnie de quatre boutons ; c’est un emblème des quatre prières à faire par jour. Si sa maison devient la proie d’un incendie, il se garde bien de faire quoi que ce soit pour essayer d’éteindre le feu ; il se prosterne et regarde brûler[111].
Yermoloff, général russe contemporain, savant très-spirituel. Il a placé dans ses Mélanges, qui sont charmants, un récit très-curieux d’une maison hantée. Cette maison est à Moscou.
Yeux. Boguet assure que les sorcières ont deux prunelles dans un œil. Les sorcières illyriennes avaient la même singularité dans les deux yeux. Elles ensorcelaient mortellement ceux qu’elles regardaient et tuaient ceux qu’elles fixaient longtemps.
Il y avait dans le Pont des sorcières qui avaient deux prunelles dans un œil et la figure d’un cheval dans l’autre. Il y avait en Italie des sorcières qui, d’un seul regard, mangeaient le cœur des hommes et le dedans des concombres… On redoute beaucoup, dans quelques contrées de l’Espagne, certains enchanteurs qui empoisonnent par les yeux. Un Espagnol avait l’œil si malin qu’en regardant fixement les fenêtres d’une maison, il en cassait toutes les vitres. Un autre, sans même y songer, tuait tous ceux sur qui sa vue s’arrêtait. Le roi, qui en fut informé, fit venir cet enchanteur et lui ordonna de regarder quelques criminels condamnés au dernier supplice. L’empoisonneur obéit ; les criminels expiraient à mesure qu’il les fixait. Un troisième faisait assembler dans un champ toutes les poules des environs, et sitôt qu’il avait fixé celle qu’on lui désignait, elle n’était plus[112].
Les Écossais redoutent beaucoup, dans ce sens, ce qu’ils appellent le mauvais œil, Parmi leurs superstitions les plus vulgaires, celle qui attribue au regard de certaines personnes la faculté de produire de fâcheux effets est la plus généralement répandue. Dalyel raconte qu’il y a peu d’années, un domestique de sa famille étant mort de la petite vérole, la mère de ce dernier soutint qu’il avait péri victime d’un mauvais œil. Il ajoute que, maintenant encore, il existe dans les plaines une femme dont le regard, au dire de ses voisins, suffit pour aigrir le lait, rendre les chèvres stériles et quelquefois même pour faire périr les troupeaux. Une cheville de fer rouillée peut seule détourner le maléfice. Les Irlandais ont des sorcières qui, par des contre-charmes, paralysent l’effet du mauvais œil.
Dans le Péloponnèse, à peine le nouveau-né a-t-il vu le jour, que la sage-femme le couvre d’un voile et lui étend sur le front un peu de boue prise au fond d’un vase où l’eau a longtemps séjourné. Elle espère ainsi éloigner de lui l’esprit malin, autrement dit mauvais œil, dont les Grecques croient voir partout la funeste influence.
Un soldat, dans l’expédition du maréchal Maison, faisait des sauts de force, mangeait des étoupes et rendait de la fumée par la bouche. On le prit pour le mauvais-œil ou esprit malin[113].
On a prétendu que l’on devenait aveugle lorsqu’on regardait le basilic. Voy. ce mot.
À Plouédern, près de Landerneau, dans la Bretagne, si l’œil gauche d’un mort ne se ferme pas, un des plus proches parents est menacé de cesser d’être[114].
Le mauvais œil est un des maléfices les plus reprochés aux gitanos ou bohémiens. Le docteur Géronimo d’Alcala en parle comme il suit :
« Dans la langue des gitanos, querelar nazula signifie jeter le mauvais œil, c’est-à-dire rendre quelqu’un malade par la simple influence du regard. Les enfants sont surtout exposés à cette influence perfide. Une corne de cerf est regardée comme un préservatif. On rencontre encore en Andalousie plus d’un enfant au cou duquel pend une petite corne montée en argent et attachée à un cordon fait avec les crins d’une jument blanche. Heureusement, si les gitanos peuvent, de leur propre aveu, jeter le mauvais œil, ils ont aussi dans leur pharmacie le remède du mal qu’ils font : quant à moi, je n’y aurais pas grande confiance ; ce remède, à ma connaissance, étant la même poudre qu’ils administrent aux chevaux malades de la morve.
» La superstition du mauvais œil se retrouve en Italie et en Allemagne ; mais elle vient originairement d’Orient ; les rabbins en parlent dans le Thalmud. Si vous vous trouvez avec des juifs ou des mahométans, évitez de fixer trop longtemps vos regards sur leurs enfants ; ils croiraient que vous voulez leur jeter le mauvais œil. L’effet du mauvais œil est d’altérer d’abord les organes de la vision par lesquels il se communique au cerveau. On prétend aussi que le mauvais œil jeté par une femme est plus funeste que celui que vous jette, un homme. Voici comment cette maladie, est traitée chez les juifs de Barbarie :
» Dès qu’ils se sentent frappés, ils envoient chercher le médecin le plus renommé pour cette espèce de cas. En arrivant, le docteur prend son mouchoir ou sa ceinture, fait un nœud à chaque bout, mesure trois palmes avec sa main gauche, fait un nœud à chaque mesure, et se ceint trois fois la tête de la ceinture ou du mouchoir, en prononçant beraka ou bénédiction : Ben porat Josef, ben porat ali ain (Joseph est un rameau fécond, un rameau près d’une source) ; puis il se remet à mesurer la ceinture ou le mouchoir, et s’il trouve trois palmes et demie au lieu de trois qu’il a mesurées auparavant, il pourra vous nommer la personne qui a jeté le mauvais œil. La personne étant connue, la mère, la femme ou la sœur du patient sort en prononçant à haute voix le nom du coupable ; elle ramasse un peu de terre devant la porte de sa maison et un peu encore devant celle de sa chambre à coucher ; on lui demande ensuite de sa salive le matin avant son déjeuner ; on va chercher au four sept charbons ardents qu’on éteint dans l’eau du bain des femmes. Ces quatre ingrédients, la terre, la salive, les charbons, l’eau, étant malaxés dans un plat, le patient en avale trois gorgées, et le reste est enterré par quelqu’un qui fait trois pas à reculons en s’écriant : « Puisse le mauvais œil être enseveli sous terre ! » Voilà comment on procède si le coupable est connu ; mais dans le cas contraire on prend un verre, on se tient sur la porte, et l’on force tous les passants de jeter dans ce verre un peu de salive. Le mélange avec le charbon et l’eau du bain a lieu ensuite, et l’on applique la mixtion à l’œil du patient, qui a soin de s’endormir sur le côté gauche : le lendemain matin il se réveille guéri.
» Peut-être cette superstition comme beaucoup d’autres est-elle fondée sur une réalité physique. J’ai observé que l’on croit surtout au mauvais œil dans les pays chauds où la lune et le soleil ont un rayonnement très-éclatant. Que dit l’Écriture, ce livre merveilleux, où l’on trouve à éclaircir tous les mystères ? « Ni le soleil ne te frappera le jour, ni la lune la nuit. » (Ps. cxxxi, 6.) Que ceux qui veulent éviter le mauvais œil, au lieu de se fier aux amulettes, aux charmes et aux antidotes des gitanos, se gardent du soleil, car il a un mauvais œil qui produit des fièvres cérébrales ; qu’ils ne dorment pas la tête découverte sous les caressants rayons de la lune, car elle a aussi un regard empoisonné qui altère la vision et frappe même de cécité. »
Yffrotte, roi de Gothie et de Suède, qui mourut sur le bord de la mer où il se promenait, frappé des cornes d’une vache que l’on pensa être certainement une sorcière convertie en icelle, laquelle se voulait venger de cette manière de ce roi pour quelque tort qu’elle avait reçu de lui[115].
Yormoungandour, serpent monstrueux des mythologies scandinaves, tellement grand qu’il peut entourer la terre de ses replis.
Youf (Marie-Anne), grosse paysanne qui se fit traiter il y a quelques années par un sorcier, avec les circonstances que voici, qui se sont exposées devant le tribunal correctionnel de Saint-Lô.
Elle avait mal au genou ; les médecins n’y faisant rien, elle apprend qu’elle peut être guérie par un sorcier d’Écrammeville nommé Lebrun. Elle va trouver Marie Ledezert, qui est l’intermédiaire habituelle de cet homme, lui donne de l’argent, des denrées de toute espèce, et la supplie d’aller consulter ce grand docteur, ce savant sorcier qui guérit tous les maux. Marie Ledezert se laisse toucher ; accompagnée de mademoiselle Lamare, que ses trente-six ans auraient dû rendre plus sage, on va consulter le devin. La justice, jalouse de ses succès, le tenait alors sous les verrous, dans la prison de Coutances, comme prévenu d’avoir causé la mort d’une fille en lui administrant des drogues pernicieuses. On se rend à Coutances, on régale le sorcier dans sa geôle ; on en revient avec une précieuse consultation qui doit, avant trois mois, désanchiloser le malheureux genou. Le remède du reste n’était pas difficile à composer : de l’if, du lierre terrestre, de la fumeterre, quelque peu d’arsenic, et… quelqu’autre chose que nous ne pouvons désigner qu’en nous servant de l’expression des témoins, de la boue de blé ; le tout était bien et dûment pilé dans un mortier emprunté chez un pâtissier, qui entendait énumérer à l’audience, au milieu du rire général, les curieux ingrédients dont on aime à croire que sa pâtisserie n’a rien emprunté.
Tout ceci semble bien vulgaire, mais l’efficacité du remède consistait dans ce qui suit. Avant le lever du soleil, il fallait qu’une branche de sureau fût coupée par une jeune fille vierge ; on en mettait ensuite un morceau sur chaque croisée et sous chaque porte ; tous les gens de la famille portaient au cou un petit sachet rempli de sel bénit, avec une conjuration et le nom de celui que l’on soupçonnait du maléfice ; puis, en médicamentant le malade, on lui faisait tenir un cierge, et Marie Ledezert récitait à haute voix la conjuration suivante (nous respectons l’orthographe et le style) :
« Ô Dieu de la mystérieuse cabale, gouverneur des astres, présidant au premier mouvement de tes disciples ! quel mal a fait Marie-Anne Youf, pour la retenir sous ton pouvoir diabolique ? Père de tous les astres, si saint et si pur, mets, ô grand Dieu, Marie-Anne Youf dans les renforts, afin que ses ennemis ne peuvent jamais l’atteindre, Agla, Ada, Manisite, Jofi et Jofil ; couvre Marie-Anne Youf de tes boucliers.
» Gresus, que le mal qu’on veut faire à Marie-Anne Youf retombe sur celui ou celle qui ont des intentions perMes et illicites. Je me dévoue à jamais au désir de faire le bien. Secourez, Seigneur, la plus honnête et la plus soumise de vos servantes. Tabat tabac tabat Sabaoth ! que ses ennemis soient confondus et renversés pour l’éternité par la vertu du grand Jéova ; je te conjure de quitter le corps de Marie-Anne Youf au nom d’Abra et d’Anayaa et d’Adoni.
» Alla machrome arpayon alamare, bourgosi serabani veniat a lagarote. »
On joignit à cela des sangsues et d’excellents déjeuners, suivis de dîners semblables. Les témoins ont dit que Marie Ledezert était traitée comme une princesse, et encore qu’elle n’était pas contente ; mais le mal était, plus opiniâtre que le remède, et comme la bourse baissait et que la guérison n’avançait pas, la confiance diminua et finit par s’éteindre non pas tout à fait dans le sorcier, mais dans son émissaire. Marie Ledezert n’ayant pas eu l’esprit de se taire, des reproches en étant venue aux injures, le procureur du roi, qui paraît ne pas aimer les sorciers, finit par provoquer une instruction ; et une citation en police correctionnelle amena Marie Ledezert à se justifier d’une accusation d’escroquerie. La prévention a été soutenue avec force par M. Lecampion, substitut. Le tribunal, reconnaissant sans doute la nécessité de combattre par une condamnation exemplaire le préjugé qui fait croire aux sorciers, a prononcé six mois d’emprisonnement.
Mais il faut remarquer bien haut que les sorciers vont, comme les vampires, avec les philosophes ; et que les misérables qui consultent les sorciers ne fréquentent pas les sacrements et ne vont guère à la messe.
Youma. Dans le gouvernement de Cazan, les Tchérémisses adorent un Dieu suprême, auquel ils donnent le nom de Youma et qu’ils supposent présent partout. C’est ainsi probablement que tous les peuples d’origine finnoise appelaient jadis le Dieu le plus puissant de leur Olympe ; du moins voit-on que les Finnois des rives de la mer Baltique invoquent encore aujourd’hui le Dieu des chrétiens sous le nom de Youmala emprunté à leur ancien culte. Le pouvoir du Youma des Tchérémisses n’est pas illimité, il le partage avec son épouse, Youman-Ava, et avec une foule d’autres divinités, enfants de ce couple, qui n’ont ni les mêmes noms ni les mêmes attributs dans toutes les communes. Différant sous ce rapport de presque tous les autres païens, les Tchérémisses n’ont point d’images, ni de leurs dieux, ni du génie du mal qui, d’après leur mythologie, habite au fond des eaux, et qui est puissant et dangereux surtout à midi, au moment où le soleil est à son apogée. Du reste, ce peuple, bien que fort attaché à sa religion, n’a cependant que très-rarement recours à ses dieux, et à l’exception des grandes fêtes célébrées de temps en temps, quelquefois après plusieurs années d’intervalle, ce n’est guère que dans les cas d’une grande calamité qu’on songe à apaiser leur courroux, ou à se les rendre propices.
Dans ces cas, lorsqu’une épidémie qui ravage le pays, ou une sécheresse prolongée qui menace de détruire les moissons, réveille en eux la crainte de leurs dieux, plusieurs familles, quelquefois tous les habitants d’un village, se réunissent pour préparer un sacrifice. Tout homme qui veut prendre part à la prière est obligé de présenter quelque victime, quelque offrande propre, d’après leurs idées, à être présentée aux dieux ; que ce soit un poulain, une vache, un mouton, un canard, une poule, ou bien une certaine mesure de miel ou de bière ; même quelques gâteaux sont jugés nécessaires. Tout étant ainsi préparé, on se rend au bois sacré, au pied de quelque vieux chêne, autour duquel on a eu soin d’égaliser le terrain en le débarrassant des broussailles et des pierres qui pouvaient s’y trouver jusqu’à une distance assez considérable. Un vieillard, auquel on donne le titre de youmlane, est chargé des rites ; chacun de ceux qui y assistent apporte un bâton fait d’une branche de noisetier, au bout duquel il a attaché un cierge. Au moment où la cérémonie commence, on fixe ces bâtons dans la terre de manière à former un cercle autour du chêne ; en même temps, le youmlane orne le tronc de l’arbre sacré de rubans d’écorce de tilleul ; il suspend à une de ses branches un petit morceau d’étain muni à cet effet d’une anse ; quatre petites branches de sapin et deux de tilleul réunies en faisceau et auxquelles le youmlane a fait un nombre d’entailles égal à celui des personnes qui ont contribué au sacrifice, sont également attachées à l’arbre sacré. Au. moment où le youmlane immole une des victimes, on éteint les cierges pour les allumer de nouveau lorsque l’animal frappé par lui a expiré, pendant que le prêtre frotte du sang du poulain ou de la vache qu’il vient de tuer les rubans d’écorce dont il a décoré le chêne. Ensuite, on fait bouillir la chair des victimes immolées dans des chaudières suspendues à des espèces de chevalets autour de l’arbre ; les cierges, éteints pendant ce temps, sont derechef allumés lorsque le festin commence ; on jette dans un grand feu allumé à cet effet au pied du chêne le premier morceau tiré de chaque chaudière, ainsi que les os ; le reste est partagé entre les convives, et chaque fois qu’on rallume les cierges, le youmlane prononce des prières, dans lesquelles il a soin de faire expressément mention du motif qui amène les suppliants dans la forêt consacrée aux dieux. Le repas fini, chacun s’éloigne ; les bâtons fixés dans la terre autour de l’arbre ainsi que le lingot d’étain et les rubans d’écorce restent à leurs places ; on n’emporte que les restes des cierges.
Les grandes fêtes célébrées, tantôt à un an, tantôt a deux, trois et même quatre années d’intervalle, sont désignées sous le nom de Youman-Bairam, et les prêtres ont toutes sortes de moyens de deviner l’époque à laquelle il convient d’offrir un pareil hommage aux dieux. Une des manières les plus usitées de consulter le sort est de jeter des fèves par terre, et les prêtres jugent, d’après la manière dont elles tombent, si le moment est favorable ou non. Les rites du Youman-Bairam diffèrent de ceux des sacrifices expiatoires que nous venons de décrire, surtout en ce qu’on allume alors dans la forêt sacrée jusqu’à sept feux, dont le premier est consacré à Youma, le second à Youman-Ava, et les autres aux divinités inférieures. Chacun de ces feux est placé sous la garde d’un kort, d’un mouschane ou d’un oudsché : noms sous lesquels sont désignés les prêtres de différents degrés.
Quelquefois aussi, surtout lorsque quelqu’un de la famille est dangereusement malade, on se réunit pour apaiser le Schaïtane, le génie du mal, par un sacrifice. En conduisant à la forêt la victime qu’on a choisie, et qui est toujours un poulain, on se fait un devoir de le battre, de le maltraiter de toutes les manières, et aussitôt qu’on arrive sur les lieux consacrés à cet usage, on enferme le poulain dans une espèce de petite caisse quadrangulaire qu’on couvre de bois, de broussailles et de paille, et, après y avoir mis le feu de tous les côtés à la fois, tout le monde s’enfuit en poussant des cris. Quelque temps après on revient pour arracher du corps de la victime étouffée ainsi trois côtes et le foie qu’on donne à manger au malade. Le reste est enterré sous les cendres. Nous ajouterons encore que le nom de kérémet, que les Tchérémisses donnent aux forêts sacrées, a pour eux quelque chose de terrible ; prêts à jurer par leurs dieux, ils ne peuvent jamais se résoudre à jurer par le kérémet.
Z
Zabulon, démon qui possédait une sœur laie de Loudun.
Zacharie. Revenant prétendu. Voy. Bietka.
Zacoum, arbre de l’enfer des mahométans, dont les fruits sont des têtes de diables.
Zaebos, grand comte des enfers. Il a la figure

Zagam, grand roi et président, de l’enfer. Il a l’apparence d’un taureau aux ailes de griffon. Il change l’eau en vin, le sang en huile, l’insensé en homme sage, le plomb en argent et le cuivre en or. Trente légions lui obéissent[116].
Zahuris ou Zahories. Les Français qui sont allés en Espagne racontent des faits très-singuliers sur les zahuris, espèces de gens qui ont la vue si subtile qu’ils voient sous la terre les veines d’eau, les métaux, les trésors et les corps privés de vie. On a cherché à expliquer ce phénomène par des moyens naturels. On dit que ces hommes reconnaissaient les lieux où il y avait des sources par les vapeurs qui s’en exhalaient, et qu’ils suivaient la trace des mines d’or et d’argent ou de cuivre par les herbes qui croissaient sur la terre dont elles étaient recouvertes. Mais ces raisons n’ont point satisfait le peuple espagnol ; il a persisté à croire que les zahuris étaient doués de qualités surhumaines, qu’ils avaient des rapports avec les démons, et que, s’ils le voulaient, ils sauraient bien, indépendamment des choses matérielles, découvrir les secrets et les pensées qui n’ont rien de palpable pour les grossiers et vulgaires mortels. Au reste les zahuris ont les yeux ronges, et, pour être zahuri, il faut être né le vendredi saint.
Zairagie (Zairagiah), divination en usage parmi les Arabes ; elle se pratique au moyen de plusieurs cercles ou roues parallèles correspondantes aux deux des planètes, placés les uns avec les autres, et marqués de lettres que l’on fait rencontrer ensemble par le mouvement qu’on leur donne selon certaines règles.
Zapan est, dans Wierus, l’un des rois de l’enfer.
Zariatnatmik, personnage inconnu, mais très-puissant. Voy. Verge.
Zazarraguan, enfer des îles Mariannes, où sont logés ceux qui meurent de mort violente, tandis que ceux qui meurent naturellement vont jouir des fruits délicieux du paradis.
Zédéchias. Quoiqu’on fût crédule sous le règne de Pépin le Bref, on refusait de croire à l’existence des êtres élémentaires. Le cabaliste Zédéchias se mit dans l’esprit d’en convaincre le monde ; il commanda donc aux sylphes de se montrer à tous les mortels. S’il faut en croire l’abbé de Villars, ils le firent avec magnificence. On voyait dans les airs ces créatures admirables, en forme humaine, tantôt rangées en bataille, marchant en bon ordre, ou se tenant sous les armes, ou campées sous des pavillons superbes ; tantôt sur des navires aériens d’une structure merveilleuse, dont la flotte volante voguait au gré des zéphirs. Mais ce siècle ignorant ne pouvait raisonner sur la nature de ces spectacles étranges ; le peuple crut d’abord que c’étaient des sorciers qui s’étaient emparés de l’air pour y exciter des orages et pour faire grêler sur les moissons. Les savants et les jurisconsultes furent bientôt de l’avis du peuple ; les empereurs le crurent aussi, et cette ridicule chimère alla si loin que le sage Charlemagne et après lui Louis le Débonnaire imposèrent de graves peines à ces prétendus tyrans de l’air… Mais nous ne connaissons qu’un coin de la superficie de ces faits.
Zeernébooch, dieu noir, dieu de l’empire des morts chez les anciens Germains.
Zépar, grand-duc de l’empire infernal, qui pourrait bien être le même que Vépar ou Sépar. Néanmoins, sous ce nom de Zépar, il a la forme d’un guerrier. Il pousse les hommes aux passions infâmes. Vingt-huit légions lui obéissent.
Ziganis. Voy. Zincalis.
Zigheuners. On rencontre souvent en Allemagne, tantôt marchant par bandes avec leurs charrettes disloquées et leurs haridelles boiteuses, tantôt bivouaquant en dehors des villages, des familles de gens déguenillés, au teint de cuivre, au regard sauvage, et dont le physique vulturien, encadré de longs cheveux noirs, contraste autant que leur saleté sordide avec cette population germanique si propre, si blonde et à physionomie si cordialement ouverte.
Ces voyageurs, que l’on nomme zigheuners (vagabonds) dans le pays, sont des bohémiens dont les hideuses caravanes parcourent encore l’Europe orientale et pénètrent même quelquefois jusqu’en France par les parties boisées de nos frontières ; mais elles ne tardent pas alors à être obligées de rebrousser chemin. Ces tribus errantes, que l’on nomme dans le Levant nids de bohémiens, paraissent descendre des sudders ou parias de l’Inde, qui, dans les premières années du quinzième siècle, ont quitté leur patrie pour échapper à la férocité des Tartares de Timour-Beg, et cette opinion semble être confirmée par le caractère de leur physionomie, leurs mœurs, et surtout par leur préférence marquée pour la viande des bêtes mortes de maladie. « La viande d’un animal que Dieu a fait mourir, disent-ils, doit être meilleure que celle d’un animal tué par la main de l’homme. »
Depuis plus de quatre siècles donc, ces peuplades n’ont jamais pu s’accoutumer à la vie sédentaire ; l’hiver, néanmoins, les bohémiens se bâtissent des cabanes où ils gîtent tant que dure la saison rigoureuse ; mais dès que les grenouilles commencent à coasser, ils se mettent à jeter bas ces huttes et reprennent gaiement leur volée.
Les zigheuners exercent tous le métier de forgerons et de rétameurs ambulants. « Cinquante bohémiens, cinquante forgerons, » dit un proverbe hongrois. Leurs femmes disent la bonne aventure et leurs enfants vont mendier. Mais le vol est aussi une de leurs ressources, et il leur arrive même quelquefois de commettre ce crime à main armée ; toutefois il faut que l’aubaine soit bonne et l’occasion facile, car la bravoure n’est pas leur fait, comme on peut en juger par ce dicton transylvain : « On peut chasser devant soi cinquante bohémiens sans avoir d’autre arme qu’un torchon mouillé. »
Les Hongrois et les Allemands leur attribuent le pouvoir de jeter des sorts, l’art de guérir les animaux malades, et surtout la science divinatoire : aussi n’est-il merveille que l’on ne raconte là-dessus ; mais la naïveté de ceux qui les consultent nous semble bien plus merveilleuse encore que la science prophétique de ces éternels voyageurs. Une femme veuve, qui faisait valoir avec son fils une petite ferme aux environs de Troppau, dans la Silésie autrichienne, étant allée un matin pour traire sa vache, fut grandement surprise de ne plus la trouver à l’étable. Aussitôt la paysanne et son fils de chercher partout, mais nulle part la moindre trace de la bête fugitive. Enfin, après avoir inutilement battu les environs, la fermière se décide à aller consulter des bohémiens qui avaient pris leurs quartiers d’hiver à quelques kilomètres de là, et la bonne femme fut vraiment au comble de la joie lorsque, ayant demandé le signalement de sa bête, celui à qui elle s’était adressée lui promit que, moyennant dix florins payables après réussite, elle trouverait le lendemain matin sa vache attachée au loquet de sa porte.
Le lendemain, en effet, dès le petit jour, l’animal était à l’endroit désigné, et quelques heures plus tard, le devin s’étant présenté pour toucher la somme convenue, la veuve allait s’empresser de la lui remettre, quand son fils l’en empêche et dit d’un air goguenard : « Puisque vous êtes sorcier, mon cher, vous devez aussi connaître le larron : allez donc le trouver de ma part et dites-lui de vous remettre les dix florins. — Oh ! Hanz, reprend la paysanne mécontente, cela n’est pas juste : toute peine mérite salaire, et qui sait si cet homme pourra rattraper le voleur ? — Sois donc tranquille, réplique le fils, le voleur n’est pas si loin que tu penses, n’est-ce pas mon bonhomme ? » Et le bohémien de s’en aller sans demander son reste, bien que le payement n’eut pas l’air d’être tout à fait de son goût.
Zincalis. C’est le nom qu’on donne aux bohémiens en Orient. Les auteurs de la Revue Britannique, qui nous ont enrichis de tant de renseignements précieux, ont traduit dans leur recueil, en juin 1841, des fragments étendus d’un livre spécial, composé par Georges Barrow, sur les zincalis. Georges Barrow a passé cinq années en Espagne, distribuant des Bibles. Il déclare

» J’ai vécu dans l’intimité avec les gypsys, je les ai vus en divers pays, et je suis arrivé à cette conclusion que partout où ils se trouvent, ce sont toujours les mêmes mœurs et les mêmes coutumes, quoique modifiées par les circonstances ; partout c’est le même langage qu’ils parlent entre eux, avec certaines variantes plus ou moins nombreuses, et enfin partout encore leur physionomie a le même caractère, le même air de famille, et leur teint, plus ou moins brun, suivant la température du climat, est invariablement plus foncé, en Europe du moins, que celui des indigènes des contrées qu’ils habitent, par exemple, en Angleterre et en Russie, en Allemagne et en Espagne.
» Les noms sous lesquels on les désigne diffèrent dans les divers pays. Ainsi on les appelle ziganis en Russie, zingarri en Turquie et en Perse, Zigheuners en Allemagne ; dénominations qui semblent découler de la même étymologie, et qu’on peut, selon toute vraisemblance, supposer être une prononciation locale de zincali, terme par lequel, en beaucoup de lieux, ils se désignent eux-mêmes quelquefois, et qu’on croit signifier les hommes noirs de Zind ou de l’Inde. En Angleterre et en Espagne on les connaît généralement sous le nom de gypsys et de gitanos, d’après la supposition générale qu’ils sont venus d’Égypte ; en France, sous le nom de bohémiens, parce que la Bohême fut le premier pays de l’Europe civilisée où ils parurent, quoiqu’ils eussent antérieurement erré assez longtemps parmi les régions lointaines de la Slavonie, comme le prouve le nombre de mots d’origine slave dont abonde leur langage.
» Mais plus généralement ils se nomment rommany : ce mot est d’origine sanscrite et signifie les maris, ou tout ce qui appartient à l’homme marié, expression peut-être plus applicable que toute autre à une secte ou caste qui n’a d’autre affection que celle de sa race, qui est capable de faire de grands sacrifices pour les siens, mais qui, détestée et méprisée par toutes les autres races, leur rend avec usure haine pour haine, mépris pour mépris, et fait volontiers sa proie du reste de l’espèce humaine.
» On trouve les ziganis dans toutes les parties de la Russie, à l’exception du gouvernement de Saint-Pétersbourg, d’où ils ont été bannis. Dans la plupart des villes provinciales, ils vivent en un état de demi-civilisation ; ils ne sont pas tout à fait sans argent, sachant en soutirer de la crédulité des moujiks ou paysans, et ne faisant aucun scrupule de s’en approprier par le vol et le brigandage, à défaut de bêtes à guérir et de gens curieux de se faire dire la bonne aventure.
» La race des rommanys est naturellement belle ; mais autant ils sont beaux dans l’enfance, autant leur laideur est horrible dans un âge avancé. S’il faut un ange pour faire un démon, ils vérifient parfaitement cet adage. Je vivrais cent ans que je n’oublierais jamais l’aspect d’un vieil attaman ziganskie ou capitaine de ziganis, et de son petit-fils, qui m’abordèrent sur la prairie de Novogorod, où était le campement d’une horde nombreuse. L’enfant eût été en tout un ravissant modèle pour représenter Astyanax ; mais le vieillard m’apparut comme l’affreuse image que Milton n’a osé peindre qu’à moitié ; il ne lui manquait que le javelot et la couronne pour être une personnification du monstre qui arrêta la marche de Lucifer aux limites de son infernal domaine.
» Les chinganys sont les Égyptiens hongrois.
» Il n’est que deux classes en Hongrie qui soient libres de faire tout ce qu’elles veulent, les nobles et les Égyptiens ; ceux-là sont au-dessus de la loi ; ceux-ci en dessous. Par exemple, un péage est exigé au pont de Pesth de tout ouvrier ou paysan qui veut traverser la rivière ; mais le seigneur aux beaux habits passe sans qu’on lui demande rien ; le chingany de même, qui se présente à moitié nu avec une heureuse insouciance et riant de la soumission tremblante de l’homme du peuple. Partout l’Égyptien est un être incompréhensible, mais nulle part plus incompréhensible qu’en Hongrie, où il est libre au milieu des esclaves et quoique moins bien partagé en apparence que le pauvre serf. La vie habituelle des Égyptiens de Hongrie est d’une abjection abominable ; ils demeurent dans des taudis où l’on respire l’air infect de la misère ; ils sont vêtus de haillons ; ils se nourrissent fréquemment des plus viles charognes, et de pire encore quelquefois, si l’on en croit la rumeur populaire. Eh bien, ces hommes à demi nus, misérables, sales et disputant aux oiseaux de proie leur nourriture, sont toujours gais, chantants et dansants. Les chinganys sont fous de la musique, il en est qui jouent du violon avec un vrai talent d’artiste.
» Comme tous les enfants de la race égyptienne, les chinganys s’occupent des maladies des chevaux ; ils sont chaudronniers et maréchaux par occasion ; les femmes disent aussi la bonne aventure ; hommes et femmes sont très-pillards. Dans une contrée où la surveillance de la police parque les autres habitants, les chinganys vont et viennent comme il leur plaît. Leur vie vagabonde leur fait souvent franchir les frontières, et ils reviennent de leurs excursions riches de leurs rapines ; riches, mais pour dissiper bientôt cette richesse en fêtes, en danses et en repas. Ils se partagent volontiers en bandes de dix à douze, et se rendent ainsi jusqu’en France et jusqu’à Rome. S’ils ont eu jamais une religion à eux, ils l’ont certainement oubliée ; ils se conforment généralement aux cérémonies religieuses du pays, de la ville ou du village où ils s’établissent, sans trop s’occuper de la doctrine…
» L’impératrice Marie-Thérèse et Joseph II firent quelques efforts inutiles pour civiliser les chinganys. On en comptait en Hongrie cinquante mille, d’après le recensement qui eut lieu en 1782. On dit que ce nombre a diminué depuis.
» Il y a trois siècles environ que les gypsys arrivèrent en Angleterre, et ils furent accueillis par une persécution qui ne tendait à rien moins qu’à les exterminer complètement. Être un gypsy était un crime digne de mort ; les gibets anglais gémirent et craquèrent maintes fois sous le poids des cadavres de ces proscrits, et les survivants furent à la lettre obligés de se glisser sous la terre pour sauver leur vie. Ce temps-là passa. Leurs persécuteurs se lassèrent enfin ; les gypsys montrèrent de nouveau la tête, et, sortant des trous et des cavernes où ils s’étaient cachés, ils reparurent plus nombreux ; chaque tribu ou famille choisit un canton, et ils se partagèrent bravement le sol pour l’exploiter selon leur industrie. Dans la Grande-Bretagne aussi les gypsys du sexe mâle sont tout d’abord des maquignons, des vétérinaires, etc. Quelquefois aussi ils emploient leurs loisirs à raccommoder les ustensiles de cuivre et d’étain des paysans. Les femmes disent la bonne aventure. Généralement ils dressent leurs tentes à l’ombre des arbres ou des haies, dans les environs d’un village ou d’une petite ville sur la route. La persécution qui fit autrefois une si rude guerre aux gypsys se fondait sur diverses accusations : on leur reprochait entre autres crimes le vol, la sorcellerie et l’empoisonnement dés bestiaux. Étaient-ils innocents de ces crimes ? Il serait difficile de les justifier d’une manière absolue. Quant à la sorcellerie, il suffisait de croire aux sorciers pour condamner les gypsys ; car ils se donnaient eux-mêmes pour tels. Ce ne sont pas seulement les gypsys anglais, mais tous les Égyptiens, qui ont toujours prétendu à cette science ; ils n’avaient donc qu’à s’en prendre à eux-mêmes s’ils étaient poursuivis pour ce crime.
» C’est la femme gypsy qui exploite généralement cette partie des arts traditionnels de la race. Encore aujourd’hui elle prédit l’avenir, elle prépare les philtres, elle a le secret d’inspirer l’amour ou l’aversion. Telle est la crédulité de toute la race humaine, que, dans les pays les plus éclairés des lumières de la civilisation, une devineresse fait encore de grands bénéfices.
» On accusait autrefois les gypsys de causer la maladie et la mort des bestiaux. Cette accusation était certes fondée, lorsque nous voyons encore dans le dix-neuvième siècle les rommanys, en Angleterre et ailleurs, empoisonner réellement des animaux, dans le double but de se faire payer pour les guérir ou de profiter de leurs cadavres. On en a surpris jetant des poudres pendant la nuit dans les mangeoires des étables. Ils ont aussi des drogues à l’usage des porcs et les leur font avaler, tantôt pour les faire mourir subitement, tantôt pour les endormir : ils arrivent ensuite à la ferme et achètent les restes de l’animal, dont ils se nourrissent sans scrupule, sachant bien que leur poison n’a affecté que la tête et ne s’est nullement infiltré dans le sang et les chairs.
» Les zingarris ou Égyptiens d’Orient gagnent leur vie comme les autres, à soigner les chevaux, à faire les sorciers, à chanter et danser. C’est en Turquie qu’on les trouve en plus grand nombre, surtout à Constantinople, où les femmes pénètrent souvent dans les harems, prétendant guérir les enfants du mauvais œil et interpréter les rêves des odalisques. Parmi les zingarris, il en est qui font à la fois le commerce des pierres précieuses et des poisons : j’en ai connu un qui exerçait ce double trafic, et qui était l’individu le plus remarquable que j’aie rencontré parmi les zincalis d’Europe ou d’Orient. Il était né à Constantinople et avait visité presque toutes les contrées du monde, entre autres presque toute l’Inde ; il parlait les dialectes malais ; il comprenait celui de Java, cette île plus fertile en substances vénéneuses que l’Iolkos et l’Espagne. Il m’apprit qu’on lui achetait bien plus volontiers ses drogues que ses pierreries, quoiqu’il m’assurât qu’il n’était peut-être pas un bey ou un pacha de la Perse et de la Turquie auquel il n’eût vendu des deux. J’ai rencontré cet illustre nomade en bien des pays, car il traverse le monde comme l’ombre d’un nuage. La dernière fois, ce fut à Grenade, où il était venu après, avoir rendu visite à ses frères égyptiens des présides (galères) de Ceuta.
» Il est peu d’auteurs orientaux qui aient parlé des zingarris, quoiqu’ils soient connus en Orient depuis des siècles. Aucun n’en a rien dit de plus curieux que Arabschah, dans un chapitre de sa Vie de Timour ou Tamerlan, un des trois ouvrages classiques de la littérature arabe. Je vais traduire ce passage : « Il existe à Samarcande de nombreuses familles de zingarris, les uns lutteurs, les autres gladiateurs, d’autres redoutables au pugilat, ces hommes avaient de fréquentes discussions, et il en résultait de fréquentes batailles. Chaque bande avait son chef et ses officiers subalternes. La puissance de Timour les remplit de terreur, car ils savaient qu’il était instruit de leurs crimes et de leurs désordres. Or, c’était la coutume de Timour, avant de partir pour ses expéditions, de laisser un vice-roi à Samarcande ; mais à peine avait-il quitté la ville, que les bandes de zingarris marchaient en armes, livraient bataille au vice-roi, le déposaient et prenaient possession du gouvernement ; de sorte qu’à son retour, Timour trouvait l’ordre troublé, la confusion partout et son trône renversé. Il n’avait donc pas peu à faire pour rétablir les choses et punir ou pardonner les coupables. Mais dès qu’il partait de nouveau pour ses guerres ou pour ses autres affaires, les zingarris se livraient aux mêmes excès. Voilà ce qu’ils firent et recommencèrent trois fois, jusqu’à ce qu’enfin Timour arrêta un plan pour les exterminer. Il bâtit des remparts et appela dans leur enceinte tous les habitants grands et petits, distribua à chacun sa place, à chaque ouvrier son devoir, et il réunit les zingarris dans un quartier isolé ; puis il convoqua les chefs du peuple, et remplissant une coupe, il les fit boire et leur donna un riche vêtement. Quand vint le tour des zingarris, il leur versa aussi à boire et leur fit le même présent ; mais à mesure que chacun d’eux avait bu, il l’envoyait porter un message dans un lieu où il avait fait camper une troupe de soldats. Ceux-ci, qui avaient leurs ordres, entouraient le zingarri, le dépouillaient de son habit et le poignardaient, jusqu’à ce que le dernier de tous eut ainsi répandu l’or liquide de son cœur dans le vase de la destruction. Ce fut par cette ruse que Timour frappa un grand coup contre cette race, et depuis ce temps-là il n’y eut plus de rébellions à Samarcande. »
» Que faut-il croire de cette histoire ou de ce conte d’Arabschah ? Comment le mettre d’accord avec ceux qui veulent que les Égyptiens actuels soient les descendants des familles hindoues qui s’exilèrent de l’Inde pour fuir les cruautés de Timour ? Si c’est un conte, toutes les autres traditions peuvent lui survivre ; mais si ce récit est fondé lui-même sur une tradition historique plus ou moins vraie, nous y voyons les zingarris à l’état de peuple, établis dans Samarcande à une époque de la vie de Timour où il n’avait pas encore envahi l’Inde. D’un autre côté, si les zingarris réunis en Occident étaient les débris fugitifs du peuple égorgé à Samarcande, comment ont-ils eux-mêmes laissé ignorer ce malheur de leur race, au lieu de s’en servir pour exciter la sympathie ? En dernière analyse, il est plus facile de prouver qu’ils viennent de l’Inde que de Samarcande.
» Les zincalis ne sont pas seulement appelés, en Espagne, gitanos ou Égyptiens, on les appelle encore Nouveaux Castillans, Allemands, Flamands, termes à peu près synonymes dans la langue populaire, quant aux derniers du moins, et devenus également méprisants, quoiqu’ils aient pu servir primitivement à désigner leur origine, sans aucune intention outrageante.
» Entre eux, les gitanes se nomment zincalis, et abréviativement cales et chai.
» Ce ne fut guère que dans le quinzième siècle que les zincalis se montrèrent en France. On lit dans un auteur français, cité par Pasquier : « Le 17 avril 1427, on vit à Paris douze pénitents d’Égypte, chassés par les Sarasins. Ils amenaient avec eux cent vingt personnes, et se logèrent dans le village de la Chapelle, où l’on allait en foule les visiter. Ils avaient les oreilles percées et portaient des anneaux d’argent. Leurs cheveux étaient noirs et crépus. Leurs femmes étaient horriblement sales et disaient la bonne aventure en vraies sorcières. » Ces hommes, après avoir traversé la France et franchi les Pyrénées, se répandirent par bandes dans les plaines de l’Espagne. Partout où ils avaient passé, leur présence avait été regardée comme un fléau, et non sans motif. Ne voulant ou ne pouvant s’imposer aucune occupation, encore moins aucun métier fixe, ils venaient comme des essaims de frelons s’abattre sur les fruits du travail d’autrui, et bientôt une ligue générale se forma contre eux. Armés de lois terribles, les agents de la justice se mirent à leur poursuite ; le peuple irrité, secondant de lui-même la sévérité de la législation, ou la devançant, leur courait sus et les pendait au premier arbre, sans autre forme de procès.
» Parfois donc, quand ces sauterelles humaines avaient dévasté un canton, la vengeance des habitants suppléait a la connivence des agents de la justice ; mais souvent les gitanos n’attendaient pas que cette vengeance vînt les surprendre, et ils levaient leur camp sans tambour ni trompette. Leurs ânes, chargés des femmes et des enfants, marchaient les premiers, et à l’avant-garde les plus hardis de la troupe, armés d’escopettes, tenaient en respect la police rurale qui osait les poursuivre. Malheur alors au voyageur qui tombait au milieu de cette bande en retraite ! Les gitanos ne se contentaient pas toujours de sa bourse, ils laissaient maintes fois un cadavre sanglant sur les limites du canton qu’on les forçait de quitter en ennemis déclarés.
» Chaque bande ou famille de gitanos avait son capitaine, ou, comme on le désignait généralement, son comte. Don Juan de Quinones, qui, dans son volume publié en 1632, a donné quelques détails sur leur genre de vie, dit : « Pour remplir les fonctions de leur chef ou comte, les gitanos choisissent celui d’entre eux qui est à la fois le plus fort et le plus brave. Il doit joindre à ces qualités la ruse et l’intelligence, pour être propre à les gouverner. C’est lui qui règle leurs différends, même là où existe une justice régulière ; c’est lui qui les guide la nuit, lorsqu’ils vont voler les troupeaux ou détrousser les voyageurs sur la grande route : le butin se partage entre eux, après avoir prélevé pour le comte un tiers du tout. »
» Ces comtes, étant élus pour faire le bien de la troupe ou de la famille, étaient exposés à être dégradés s’ils ne contentaient pas leurs sujets. L’emploi n’était pas héréditaire, et, quels que fussent ses avantages et ses privilèges, il avait ses inconvénients et ses périls. Au comte le soin de préparer une expédition et de la l’aire réussir. Si elle échouait, s’il ne parvenait pas à rendre la liberté à ceux des siens qui restaient prisonniers, si surtout il les laissait périr, sur lui retombait tout le blâme, et il se voyait nommer un nouveau chef qui succédait à tous ses droits. Le seigneur comte des gitanos avait une sorte de privilège féodal : c’était celui de la chasse au chien et au faucon. Naturellement il en jouissait à ses risques ; car on pense bien qu’il ne chassait que sur la terre d’autrui : or le seigneur gitano pouvait fort bien rencontrer le vrai seigneur du domaine. Une ballade traditionnelle nous apprend l’histoire d’un comte Pépé qui, ayant voulu s’opposer au droit de chasse d’un chef gitano, n’y parvint qu’en le tuant. La veuve du mort, en franche Égyptienne, dérobe alors le fils du vainqueur et l’élève parmi les gitanos. Avec le temps, le fils du comte Pépé, nommé comte, veut, comme son père putatif, chasser sur les terres de son véritable père, et tue celui-ci sur la place même qui avait vu tomber le chef, vengé ainsi par un parricide.
» Voici ce qu’on lit dans les Disquisitions magiques de Martin del Rio ; « Lorsqu’en l’année 1581 je traversais l’Espagne avec mon régiment, une multitude de gitanos infestait les campagnes. Il arriva que la veille de la Fête-Dieu, ils demandèrent a être admis dans la ville pour y danser en l’honneur de la fête, selon un antique usage. Ils l’obtinrent ; mais la moitié du jour ne s’était pas écoulée, qu’un grand tumulte éclata à cause du grand nombre de vols commis par les femmes de ces misérables ; là-dessus, ils sortirent par les faubourgs et se rassemblèrent près de Saint-Marc, magnifique hôpital des chevaliers de Saint-Jacques, où les agents de la justice, ayant voulu les arrêter, se virent repousser par la force des armes. Cependant, je ne sais comment cela se fit, mais tout à coup tout s’apaisa. Ils avaient, à cette époque, pour comte un gitano qui parlait l’espagnol aussi purement qu’un natif de Tolède ; ce comte connaissait tous les ports de l’Espagne, tous les chemins et passages des provinces, la force des villes, le nombre des habitants, leurs propriétés à chacun ; bref, il n’ignorait rien de ce qui concernait le secret de l’État, et il s’en vantait publiquement. » Évidemment, aux yeux de del Rio, ce gitano était une espèce de sorcier ; car, à cette époque, tous les gitanos étaient considérés comme des étrangers, et il ne lui paraissait pas naturel qu’ils fussent capables de parler purement l’idiome castillan.
» Je trouve encore, dans les Didascalia de Francesco de Cordova, une anecdote qui prouve que les gitanos ne craignirent pas d’empoisonner, pendant la nuit, toutes les fontaines de Logrono. Cette horrible machination fut découverte par un libraire qui avait autrefois vécu avec eux, et qui la dénonça au curé de la ville. Déjà une épidémie pestilentielle régnait parmi les habitants ; mais il leur resta assez de force pour massacrer les gitanos, lorsqu’ils venaient piller leurs maisons sans attendre qu’ils fussent tous morts.
« Il semblerait, dit un auteur espagnol, que les gitanos et les gitanas n’ont été envoyés dans ce monde que pour y être voleurs ; ils naissent voleurs ; ils sont élevés parmi les voleurs ; ils apprennent à être voleurs, et ils finissent par être voleurs, allant et venant pour faire des dupes. L’amour du vol et la pratique de la volerie sont en eux des maladies constitutionnelles qui ne les quittent plus jusqu’au jour de leur mort. » Tel est l’exorde de la Gitanilla ou la fille égyptienne, nouvelle de Cervantes, qui introduit ensuite son héroïne en ces termes : « Une vieille sorcière de cette nation, qui avait certainement pris ses grades dans la science de Cacus, élevait une jeune fille dont elle se disait la grand’mère et qu’elle appelait Preciosa, etc. »
» Parmi les nombreuses anecdotes qui se rattachent à la vie et aux ouvrages de Cervantes, on raconte que, sous le règne de Philippe III, il parut dans la rue de Madrid une fille égyptienne qui y brilla comme un météore : elle dansait et chantait en compagnie d’autres gitanas, mais si supérieure à toutes par sa beauté, sa grâce et sa voix, que la foule se pressait partout autour d’elle. Une pluie d’or et d’argent exprimait l’enthousiasme des spectateurs. Le roi lui-même fut curieux de la voir ; les meilleurs poètes du temps lui adressaient des vers, trop heureux si elle daignait les chanter ; plusieurs seigneurs devinrent épris d’elle, et enfin un jeune homme de la cour, abandonnant sa famille, se fit gitano pour lui plaire. On découvrit plus tard que cet astre de beauté était la fille d’un noble corrégidor, volée à son père, dans son enfance, par la vieille sorcière qui se disait sa grand’mère. Elle épousa son fidèle adorateur. Telle est l’anecdote, et c’est aussi le sujet de la nouvelle de Cervantes, qui n’est pas la meilleure de ses œuvres, malgré sa popularité. Il n’y a pas que son héros et son héroïne qui ne sont pas de la vraie race égyptienne : tous ses autres gitanos sont des busnis (chrétiens) déguisés, parlant comme jamais gitano véritable n’aurait parlé, alors même qu’ils décrivent assez exactement la vie nomade de leur race. Cervantes connaissait mieux les posadas et les ventas de l’Espagne que les camps des gitanos.
» Mais il existe dans la langue espagnole un roman intitulé Alonso, le valet de plusieurs maîtres, composé par le docteur Geronimo de Alcala, natif de Ségovie, qui écrivait au commencement du dix-septième siècle. Cet Alonso sert toutes sortes de maîtres, depuis le sacristain d’un obscur village de la vieille Castille jusqu’au fier hidalgo de Lisbonne, et tous ces maîtres le congédient à cause de son caractère bavard et de son incorrigible manie de critiquer leurs faiblesses. Enfin, il tombe entre les mains des gitanos. Je suis tenté de croire que l’auteur lui-même avait vécu parmi cette race, tant la description qu’il en donne est vivante et colorée. En voici quelques extraits :
« Je cheminais depuis plus d’une heure à travers ces bois, lorsque, à peu de distance de l’endroit où j’étais, je vis s’élever une grosse fumée : concluant, en vrai philosophe, qu’il n’y a pas de fumée sans feu, et que s’il y avait du feu il devait y avoir des gens pour l’allumer, je me mis à diriger mes pas de ce côté, car il commençait à faire nuit et il régnait un air assez froid. Je n’avais pas marché beaucoup, lorsque je me sentis saisir par les épaules, et tournant la tête, je me vis accosté de deux hommes, pas tout à fait aussi beaux que des Flamands ou des Anglais, vrai teint de mulâtre, mal vêtus et de mauvaise mine.

» Curieux de savoir quel sort m’était réservé, je me trouvai bientôt entouré d’une bande de quarante hommes et femmes, sans parler d’enfants de tout âge qui couraient au milieu d’eux, nus comme dans l’état de nature. Ils me menèrent devant le señor comte, personnage qu’ils respectent tous et qui était le juge et le gouverneur de cette république désordonnée. Le señor comte m’accueillit avec complaisance et me fit dépouiller jusqu’à ma chemise, me laissant comme lorsque j’étais sorti du sein de ma mère. Mes habits furent partagés entre les garçons nus et mon petit pécule entre eux tous… J’aurais voulu garder au moins un peu du manteau usé dont je me garnissais l’estomac quand je me sentais malade ; mais une vieille me l’arracha en me disant : « Voyons, voyons, ce sera pour abriter le ventre du petit Antonio qui se meurt de froid… » Maudite gitana, qui avait lu peut-être cet apophthegme d’Avicenne : Etiam in vilibus summa virtus inest, et qui voulait soigner l’estomac de son marmot aux dépens du mien… À la voix du chef parut Isabel, avec une moitié de chèvre (l’autre moitié, comme je l’appris plus tard, ayant été mangée le matin), volée, selon l’habitude, à des bergers du voisinage. Sans que personne s’avisât de demander de quelle mort elle était morte, ou si elle était tendre, les gitanos la traversèrent d’un bâton en guise de broche, et tous, aidant à apporter du bois, dont il y avait abondance, ils firent un grand feu. La chèvre fut bientôt rôtie ; on ne s’inquiéta pas d’y ajouter des sauces savoureuses, mais ceux qui découpaient servirent à chacun sa portion dans des plats de bois ; alors la troupe s’assit autour d’un drap de lit étalé par terre et servant de nappe. Quoique la nuit fût noire, point n’était besoin de lumière, la flamme du feu suffisant bien pour éclairer trois fois plus de monde. Voyant qu’on soupait, j’allai me montrer à un coin pour ne pas forcer les convives à m’inviter, et là-dessus une gitana, prenant une ou deux côtes, m’appela en disant : « Prends ce morceau de viande et ce morceau de pain, afin que tu ne nous dises pas : Grand mal vous fasse ! » Je fus reconnaissant de ce régal, car, à vrai dire, à mesure que je me réchauffais au voisinage du feu, l’appétit commençait à m’agacer et la faim, à m’incommoder. Je m’escrimai donc sur mes côtes ; mais, quoique j’eusse de bonnes dents, je ne pus y mordre, et le meilleur lévrier d’Irlande n’aurait pu les entamer, tant elles étaient dures. Quant à mes compagnons, sans faire plus de façon, ils mangeaient leur part de chèvre ou de bouc comme si c’eût été le plus gras et le plus tendre chapon, avalant de temps en temps quelques gorgées d’eau, car le vin n’était pas en usage dans cette troupe, qui le trouvait trop cher. Je levai les yeux au ciel et remerciai le Seigneur, en voyant que ce que je ne pouvais manger était si savoureux pour ces misérables : qu’importait que leur viande fût charogne, que le repas arrivât tard, qu’au lieu de vin ils n’eussent qu’une eau dure et saumâtre, capable de faire crever le plus robuste animal ! Tous ces gens-là, jeunes et vieux, femmes et enfants, étaient vigoureux et d’un excellent teint, comme si leur santé avait toujours été soignée avec une sollicitude particulière… Il était déjà plus de minuit lorsque les gitanos pensèrent à dormir, les uns s’adossant aux pins du bois, les autres s’étendant sur le peu de vêtements qu’ils pouvaient avoir. Pour moi, assiégé de maintes et diverses imaginations, je servis de sentinelle, entretenant le feu de peur qu’il ne vînt à s’éteindre, car, sans sa bienfaisante chaleur, je me serais bientôt senti mourir. Je m’occupai ainsi pendant plus de cinq heures, jusqu’à ce que le jour parut, et sa lumière sembla bien paresseuse à mon attente. Je me réjouis de voir s’en aller la nuit, et le ciel se colorer des teintes de l’aube : cherchant alors quelque chose pour couvrir ma pauvre chair, je trouvai, grâce à Dieu, quelques peaux de mouton, dont je m’entourai le corps, la laine en dedans, de manière à être pris pour un anachorète.
» Déjà le soleil rayonnait sur les plus basses montagnes lorsque ces barbares se réveillèrent. Providence divine ! il avait plu pendant près de onze heures, ils n’avaient rien pour se protéger contre l’inclémence de l’air, et cependant ils avaient dormi comme sur de bons matelas ; tant il est vrai que l’habitude devient une seconde nature. Les enlever à cette vie eût été leur donner la mort. Voyant que je m’étais accoutré comme un autre saint Jean-Baptiste, n’ayant plus que les bras et les jambes à découvert, ils rirent de bon cœur et louèrent mon industrie ; mais tous ces compliments sur mon talent à m’accommoder aux circonstances me servirent de peu, car une des gitanas poussant des cris et m’accablant d’injures me commanda de quitter mon nouveau costume, qui était le lit sur lequel elle dormait. Je vis que je m’étais emparé du bien d’autrui, et me dépouillant pour l’acquit de ma conscience, je me retrouvai nu comme tout à l’heure. Ainsi restai-je deux jours pleins, et je serais resté bien davantage encore sans la mort d’un gitano, infirme et vieux, qui ne put se dispenser de payer sa dette à la nature, le premier peut-être de sa race qui mourût ainsi naturellement, tant il est d’usage que ces gens-là meurent à la potence. Deux gitanos creusèrent une fosse où ils déposèrent le défunt, le corps découvert, ensevelissant avec lui deux pains et quelques pièces de monnaie, comme s’il en avait eu besoin pour le voyage de l’autre monde. Alors s’approchèrent les gitanas, toutes échevelées et s’égratignant le visage à qui mieux mieux ; venaient ensuite les hommes invoquant les saints et surtout le grand saint Jean-Baptiste, pour lequel ils ont une dévotion particulière, lui criant comme à un sourd de les écouter et d’obtenir pour le mort le pardon de ses péchés. Quand ils se furent enroués à crier, ils allaient rejeter la terre dans la fosse, mais je les priai d’attendre que j’eusse dit deux mots ; on m’accorda ma requête, et moi, du ton le plus humble, je dis à peu près : « Votre compagnon est déjà allé jouir de la vue de Dieu, car il faut bien l’espérer de sa bonne vie et de sa bonne mort. Vous avez rempli vos obligations en le recommandant au Seigneur et en lui donnant la sépulture ; mais qu’il soit enterré vêtu ou nu, peu lui importe à lui, tandis qu’il peut m’être à moi d’un grand secours de profiter de ses habits. Si vous voulez donc bien permettre que je m’en empare et m’en vêtisse, je me souviendrai toujours, dans mes oraisons, de ce bienfait accordé à ma misère et à ma nudité. » Ce discours parut fort raisonnable ; et j’eus le bonheur de ne pas être contredit. Ils me dirent de faire ce que je désirais. J’obéis, et me voilà cette fois vêtu en vrai gitano, sans en avoir encore l’esprit et les mœurs. Je rendis le corps du mort à sa sépulture, et l’ayant recouvert de terre, je le laissai là jusqu’au jour du jugement, où il reparaîtra, comme nous tous, pour rendre ses comptes. »
Voici d’autres anecdotes :
« Charles-Quint, en venant prendre possession du trône d’Espagne, amena à sa suite une cour d’étrangers, Flamands la plupart, qui révoltèrent bientôt l’orgueil castillan. Charles lui-même, jeune, mais tourmenté d’une vaste ambition et rêvant déjà l’empire d’Allemagne, semblait trouver ses sujets de la Péninsule trop heureux de lui payer les frais de son élection. Il s’étonna beaucoup de l’opposition des cortès quand il fut question de voter les impôts ; mais pressé de se rendre auprès des électeurs germaniques, il partit pour Worms, laissant à ses ministres le soin de résister aux comuneros. Cette ligue comprenait l’alliance de tous les intérêts castillans : elle voulait une souveraineté nationale et imposait à Charles de choisir entre la couronne d’Espagne et celle d’Allemagne.
» On voit dans l’histoire les luttes de Juan de Padilla et de sa vaillante épouse, dona Maria de Pacheco ; mais le mystère de cette ligue ne s’explique que par les traditions des gitanos. On avait prédit à dona Maria qu’elle serait reine. Dans ses épîtres familières, Guevarra lui écrivait : « On sait, madame, que vous avez auprès de vous une sorcière qui vous a promis qu’en peu de jours vous seriez appelée haute et puissante dame et votre mari altesse. » Cette sorcière était une gitana. Dans une des ballades traditionnelles des gitanos, on trouve ces mots : « Je donnerai un de ses fromages magiques à Maria Padilla et aux siens. » Disons d’abord qu’il ne peut être ici question de la première Maria Padilla, femme du roi don Pedro, puisque les gitanos n’étaient pas encore en Espagne sous le règne de ce prince. Il paraît que dona Maria Pacheco ou Padilla, car elle est désignée tantôt par un de ces noms, tantôt par l’autre, s’échappa de Tolède avec sa sorcière, déguisée elle-même en gitana. Cette sorcière était attachée à sa personne depuis longtemps et l’abusait par les apparences, sans doute aussi par les flatteries de son affection perfide ; elle lui persuada que les gitanos de sa tribu la transporteraient en Portugal avec son plus jeune fils, son or et ses bijoux. Les gitanos l’attendaient en effet dans la montagne ; mais, pour s’emparer de cet or et de ces bijoux, ces misérables assassinèrent la mère et l’enfant.
» Si cette tradition espagnole est vraie, jamais action plus odieuse n’a été commise par les gitanos. Los gitanos son muy malos : Les gitanos sont de bien méchantes gens. Cette phrase proverbiale est de bien vieille date en Espagne. Selon les Espagnols, les gitanos ont toujours été des escrocs, des voleurs, des sorciers ; et ils ajoutent, chose plus difficile à prouver, heureusement : Les gitanos mangent de la chair humaine. Mais il est un autre crime qu’il est impossible de nier : Los gitanos son muy malos ; llevan niños hurtados a Berbería : Les gitanos sont très-méchants ; ils transportent les enfants volés en Barbarie… afin de les vendre aux Maures. Il paraît évident que les gitanos ne cessèrent jamais d’entretenir des relations avec les Maures d’Afrique depuis leur expulsion d’Espagne. Les gitanos, n’ayant pas plus de sympathie pour un peuple que pour l’autre, devaient vendre des enfants espagnols aux Barbaresques, comme ils auraient vendu des enfants barbaresques aux Espagnols, si ceux-ci en eussent voulu acheter. Bien mieux, par leurs rapporte avec les pirates, ils leur devaient souvent servir d’espions lorsque ceux-ci méditaient quelque invasion sur les côtes d’Espagne. Voilà comment ils ont pu paraître plus Maures que chrétiens. Aussi ne démentirai-je pas l’anecdote de Quiñones qui raconte que, lors du siège de Mamora, deux galères espagnoles ayant échoué sur un récif de la côte d’Afrique, les Maures firent esclaves les chrétiens des équipages, délivrèrent les Maures enchaînés à la rame et traitèrent également comme une race amie tous les gitanos à bord des deux bâtiments. » Voy. Bohémiens.
Ziton. Pendant les noces de Venceslas, fils de l’empereur Charles IV, avec la princesse Sophie de Bavière, le beau-père, qui savait que son gendre prenait plaisir à des spectacles ridicules et à des enchantements, fit amener de Prague une charretée de magiciens. Le magicien de Venceslas, nommé Ziton, se présente pour faire assaut avec eux. Ayant la bouche fendue de part et d’autre jusqu’aux oreilles, il l’ouvre et dévore tout d’un coup le bouffon du duc de Bavière, avec tous ses habits, excepté ses souliers, qui étaient sales et qu’il cracha loin de lui. Ensuite, ne pouvant digérer un telle viande, il va se décharger dans une grande cuve pleine d’eau, rend son homme par le bas et défie ses rivaux de l’imiter.
Nos vieilles chroniques et nos contes de fées offrent encore des traits semblables. Ce même Ziton changeait quelquefois, dans des festins, les mains des conviés en pieds de bœuf, afin qu’ils ne pussent rien toucher des mets qu’on leur servait, de sorte qu’il avait loisir de prendre pour lui la meilleure part. Voyant un jour des gens à des fenêtres, attentifs à regarder un spectacle qui excitait leur curiosité, il leur fit venir au front de larges cornes de cerf, pour les empêcher de se retirer de ces fenêtres quand ils le voudraient.
Ziwick, dieu des Polonais avant leur conversion. Il présidait à la vie et à la mort.
Zizis. C’est le nom que donnent les juifs modernes à leurs phylactères.
Zoaphité. Voy. Monstres, à la fin.
Zodiaque. Les douze signes du zodiaque ont une influence diverse sur les horoscopes. Voy. Horoscopes et Astrologie.

Les influences du firmament se trouvaient très-favorables, disent les astrologues, à la naissance de Louis XIV ; nous en avons le système généthliaque dans l’une des médailles qui appuient l’histoire de son fastueux règne ; l’Académie royale des inscriptions y a marqué (sans rien donner aux incertitudes de l’astrologie) la position précise des planètes au moment où Dieu accorda à la France ce monarque que ses grandes actions ont rendu si célèbre.
On voit autour de cette curieuse médaille les douze signes du zodiaque formant les douze maisons de ce système ; les sept planètes y paraissent dans les positions qu’elles occupaient alors ; le soleil occupe le milieu du ciel ; Mars, seigneur de l’ascendant, se trouve en réception avec Jupiter, le protecteur de la vie, et ce qu’on nomme la fortune majeure. Saturne, qui est hostile, se voit là placé dans les dignités (en argot d’astrologue), ce qui le rend moins maléfique ; la lune est en conjonction avec Vénus, et Mercure, dans son domicile de prédilection, à dix degrés du soleil, hors de combustion, éclairé par ses rayons, ce qui donne une supériorité de génie dans les plus difficiles et les plus importantes entreprises ; son carré avec Mars n’est pas capable de l’abaisser.
La naissance du roi était figurée dans le milieu de la médaille par un soleil levant, et le roi est placé dans le char de l’astre, avec cette légende : Ortus sotis gallici ; le lever du soleil de la France. L’exergue contient ces autres paroles : Septembris quinto, minutis 38, ante meridiem, 1638.
Ajoutons ici une remarque curieuse, c’est que les objets sur lesquels les augures exerçaient leur science se réduisaient à douze chefs, en l’honneur des douze signes du zodiaque : 1o l’entrée dans une maison des animaux domestiques ou sauvages ; 2o la rencontre subite de quelque animal sur le chemin ; 3o la foudre, l’incendie d’une maison ou de quelque autre objet ; 4o un rat qui rongeait des meubles, un loup qui emportait une brebis, un renard qui mangeait une poule, et tout événement de cette espèce ; 5o un bruit qu’on entendait dans la maison et que l’on croyait produit par quelque esprit follet ; 6o un oiseau qui tombait sur le chemin et se laissait prendre, un hibou qui chantait, une corneille qui criait, toutes circonstances qui étaient du ressort de l’augure ; 7o un chat qui, contre la coutume, entrait dans la chambre par un trou ; dans ce cas, il était pris pour un mauvais génie, dans ce cas, il était pris pour un mauvais génie, ainsi que tout autre animal qui se présentait de la même manière ; 8o une chandelle ou un flambeau qui s’éteignait de lui-même, ce que l’on croyait un fait de quelque démon ; 9o le feu qui pétillait ; les anciens croyaient là entendre parler Vulcain ; 10° le feu qui étincelait extraordinairement ; 11° le feu qui bondissait d’une manière singulière ; les anciens s’imaginaient que les lares l’agitaient ; 12° enfin, une tristesse subite et tout événement fâcheux que l’on apprenait contre toute attente.
Et maintenant dans ce livre, où nous démasquons toutes les erreurs, autant que le permettent nos humbles lumières, ne dirons-nous rien des querelles singulières qui se sont élevées à propos du zodiaque de Denderah et de quelques autres zodiaques égyptiens ? Les philosophes, qui ont enfanté tous les égarements de l’esprit humain, comme il ne serait pas difficile de le démontrer, ont reçu de nos jours bien des échecs ; ils en recevront encore jusqu’à ce qu’ils reconnaissent, si c’est possible, dans les conditions de leur pauvre orgueil, qu’on ne trouve guère la vérité hors des enseignements de l’Église. Les luttes contre le Pentateuque n’ont laissé dans ses adversaires que des vaincus. Les plus fiers combattants étaient deux astronomes, gens dont la science est moins fixée peut-être que le magnétisme, aux bases si incertaines. Ces astronomes, Bailly et Dupuis, comme les Titans qui s’étaient promis d’escalader le ciel, ont entassé paradoxes sur systèmes, conjectures sur présomptions, suppositions sur bévues, inductions sur fantômes, aberrations sur mauvais vouloirs pour asseoir un piédestal à une antiquité du monde qui pût contredire les livres divins.
Bailly crut démontrer que le zodiaque de Denderah était antérieur au déluge ; Dupuis, plus acharné, car ce n’était là ni la hardiesse ni l’intérêt de la science, Dupuis s’épuisa en longues veilles, en travaux ardus, qui lui ont coulé assurément bien des sueurs, pour établir que le zodiaque égyptien était antérieur de treize mille ans à Jésus-Christ. Pauvre homme qui se frottait les mains d’un tel triomphe !
Mais les savants sérieux sont venus bientôt, les savants sans passion, les savants qui recherchent la vérité. Les Visconti, les Testa, les Champollion, les Letronne ont ramené la question aux faits réels ; ils ont prouvé de la manière la plus incontestable que les Égyptiens ni les Indiens n’avaient inventé le zodiaque, qu’ils l’avaient reçu des Grecs, lesquels le tenaient des Hébreux ; que le zodiaque de Denderah était un ouvrage du règne de Néron, et que les interprétations astronomiques au moyen desquelles Dupuis, dans le fatras indigeste et infâme qu’il a intitulé Origine de tous les cultes, a voulu démolir nos dogmes, n’ont pas le moins du monde l’antiquité qu’il leur prête, n’ayant été imaginées que par Macrobe et ses contemporains, lorsque le paganisme, honteux, devant les premiers chrétiens, de sa grossière théogonie, chercha à la colorer de ce vernis pour en rougir un peu moins[118].
Zodiaque de Jacob. Un jeune savant anglais, Arthur Lumley Davids, trop tôt enlevé aux sciences et aux lettres, nous a légué une observation ingénieuse sur les connaissances astronomiques des anciens Hébreux. Le songe de Joseph et la bénédiction de Jacob, dit-il, ne laissent aucun doute de la connaissance du zodiaque parmi les anciens Hébreux. Le songe de Joseph est exprimé par les images du soleil, de la lune et des onze constellations qui s’inclinent devant lui, la douzième. Ces constellations ainsi réunies ne peuvent signifier que les signes du zodiaque dans les limites desquelles se retrouvent toujours le soleil et la lune. L’historien sacré nous dit qu’après le récit de son fils, Jacob en garda le souvenir, et rien ne le prouve mieux que les dernières paroles du saint patriarche à ses fils.
Les images dont Jacob s’est servi pour exprimer les destinées diverses de sa postérité sont prises de ces mêmes signes du zodiaque auxquels Joseph avait fait allusion, avec cette seule différence qu’ici les signes eux-mêmes sont nommés et décrits. Ruben comparé à l’eau inconstante est le Verseau ; Siméon et Lévi sont réunis ensemble avec l’observation qu’ils sont frères, et figurent les Gémeaux ; Judas est le Lion ; Zabulon, qui habite les ports de mer, en représente la production : le Cancer ; Issachar est probablement le Taureau, les Septante l’ont même traduit par Aner Georgos, le cultivateur du sol. Les signes appliqués à Dan montrent évidemment l’identité de nos signes du zodiaque avec ceux des anciens Hébreux ; les trois signes dans lesquels Dan est représenté se suivent dans la même position que dans nos zodiaques. La Balance est l’attribut de Dan, en sa qualité de juge, puis comme Scorpion : « Il mord le talon du cheval et le cavalier est renversé. » C’est exactement la position de notre Scorpion à l’égard du Centaure, qui représente le Sagittaire. Gad l’archer est le Sagittaire. Asher, aux mets succulents, représente les Poissons ; Nephthali est le Bélier ; Joseph, la vigne féconde, est la Vierge ; Benjamin enfin est comparé au loup qui dans l’antiquité occupait la place du Capricorne ; même dans des temps plus récents on voit à ce signe un Pan avec une tête de loup. Les Hébreux auraient ainsi connu la sphère plus de deux mille ans avant l’ère chrétienne. Il y a peu de doute que le zodiaque hébreu ne soit le Massanoh dont parle Job dans son allusion astronomique aux constellations célestes. (Archives israelites.)
Zoroastre, le premier et le plus ancien des magiciens. Sextus Sinensis reconnaît deux enchanteurs de ce nom : l’un roi de Perse et auteur de la magie naturelle ; l’autre roi des Bactriens et inventeur de la magie noire ou diabolique. Justin dit que Zoroastre régnait dans la Bactriane longtemps avant la guerre de Troie ; qu’il fut le premier magicien et qu’il infecta le genre humain des erreurs de la magie.
Voici, dit Voltaire, ce que l’Anglais Hyde rapporte sur Zoroastre, d’après un historien arabe :
« Le prophète. Zoroastre étant venu du paradis prêcher sa religion chez le roi de Perse Gustaph, le roi dit au prophète : « Donnez-moi un signe. » Aussitôt le prophète fit croître devant la porte du palais un cèdre si gros et si haut, que nulle corde ne pouvait l’entourer ni atteindre sa cime. Il mit au haut du cèdre un beau, cabinet où nul homme ne pouvait monter. Frappé de ce miracle, Gustaph crut à Zoroastre ; Quatre mages ou quatre sages (c’est la même chose), gens jaloux et méchants, empruntèrent du portier royal la clef de la chambre du prophète pendant son absence et jetèrent parmi ses livres des os de chiens et de chats, des ongles et des cheveux de mort, toutes drogues avec les quelles les magiciens ont opéré de tout temps. Puis ils allèrent accuser le prophète d’être un sorcier et un empoisonneur. Le roi se fit ouvrir la chambre par son portier. On y trouva les maléfices, et voilà Zoroastre condamné à être pendu.
» Comme on allait pendre Zoroastre, le plus beau cheval du roi tombe malade ; ses quatre jambes rentrent, dans son corps, tellement qu’on ne les voit plus. Zoroastre l’apprend ; il promet qu’il guérira le cheval, pourvu qu’on ne le pende pas. L’accord étant fait, il fait sortir une jambe du ventre et dit au roi : « Sire, je ne vous rendrai pas la seconde jambe que vous n’ayez embrassé ma religion.
» — Soit, dit le monarque. » Le prophète, après avoir fait paraître la seconde jambe, voulut que les fils du roi se fissent zoroastriens ; et les autres jambes firent des prosélytes de toute la cour. On pendit les quatre malins sages au lieu du prophète, et toute la Perse reçut sa foi.
» Bundari, historien arabe, conte que Zoroastre était Juif, et qu’il avait été valet de Jérémie ; qu’il mentit à son maître ; que Jérémie, pour le punir, lui donna la lèpre ; que le valet, pour se décrasser, alla prêcher une nouvelle religion en Perse et fit adorer le soleil.
» Le voyageur français qui a écrit la vie de Zoroastre, après avoir observé que son enfance ne pouvait manquer d’être miraculeuse, dit qu’il se mit à rire dès qu’il fut né, du moins à ce que disent Pline et Solin. Il y avait alors un grand nombre de magiciens très-puissants ; ils savaient qu’un jour Zoroastre en saurait plus qu’eux et qu’il triompherait de leur magie. Le prince des magiciens fit amener l’enfant et voulut le couper en deux ; mais sa main se sécha sur-le-champ. On le jeta dans le feu, qui se convertit pour lui en bain d’eau rose. On voulut le faire briser sous les pieds des taureaux sauvages, mais un taureau plus puissant prit sa défense. On le jeta parmi les loups ; ces loups allèrent incontinent chercher deux brebis qui lui donnèrent à téter toute la nuit. Enfin, il fut rendu à sa mère, Dogdo, ou Dodo, ou Dodu. » Bérose prétend que Zoroastre n’est autre que Cham, fils de Noé. Les cabalistes ont de Zoroastre une opinion toute différente ; mais, si les démonomanes le confondent avec Cham, les cabalistes le confondent avec Japhet. Ainsi, les uns et les autres s’accordent à le faire fils de Noé. « Zoroastre » autrement nommé Japhet, dit le comte de Gabalis, était fils de Vesta, femme de Noé. Il vécut douze cents ans, le plus sage monarque du monde ; après quoi il fut enlevé. Cette Vesta, étant morte, fut le génie tutélaire de Rome ; et le feu sacré, que des vierges conservaient avec tant de soin sur un autel, brûlait en son honneur. Outre Zoroastre, il naquit d’elle une fille d’une rare beauté et d’une grande-sagesse, la divine Égérie, de qui Numa Pompilius reçut toutes ses lois. Ce fut elle qui engagea Numa à bâtir un temple en l’honneur de Vesta, sa mère. Les livres secrets de l’ancienne cabale nous apprennent qu’elle fut conçue en l’espace de temps que Noé passa sur les flots, réfugié dans l’arche cabalistique. »
Zoubdadeyer. En l’an 408, le roi de Perse Cabadès apprit, dit Théophanes, qu’il y avait aux frontières de ses États un vieux château appelé Zoubdadeyer, plein de richesses gardées par des démons. Il résolut de s’en emparer, mais les magiciens juifs qu’il employa pour mettre en fuite les bandes infernales n’y réussirent pas. Un évêque chrétien put seul dissiper les prestiges du château ensorcelé.
Zoureg, serpent mystérieux, long d’un pied, que les Arabes disent habiter le désert, ou il est doué d’une puissance qui lui permet, dans ses courses, de traverser, sans se détourner les plus rudes obstacles, un rocher, un mur, un arbre, un homme. L’homme que le zoureg traverse en passant meurt aussitôt. On ne peut tuer ce petit serpent qu’en lui coupant la tête pendant qu’il dort.
Zozo, démon qui, accompagné de Mimi et de Crapoulet, posséda en 1816 une jeune fille du bourg de Teilly en Picardie. Voy. Possédés.
Zundel, capitaine des bohémiens. Voy. Bohémiens.
Zwingle, était curé de Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln, lorsque Luther donna le signal de cette révolte effroyable qu’on a appelée la Réforme.
Il voulut comme lui se rendre indépendant. Mais comme il n’avait pas entièrement perdu la foi, ces mots si précis de la consécration : Ceci est mon corps ! l’embarrassaient.
Un démon, peut-être celui qui avait enseigné Luther, vint à lui et lui dit : « Lâche, que ne réponds-tu à ce propos ce qui est écrit dans l’Exode :
— L’agneau est la Pâque, pour dire qu’il en est le signe ? »
Ce trait de lumière venu d’en bas suffit à Zwingle, qui apostasia, et qui, quelque temps après, le 11 octobre 1531, à l’une des batailles qui ont été les fruits amers de la Réforme, y fut tué misérablement combattant contre l’Église.
Dans ce dédale immense d’erreurs, d’illusions et d’égarements, dont nous venons de rassembler les croquis monstrueux ou grotesques, on ne perdra pas de vue ce grand fait, — que tout ce qui est faux et coupable est dans tous les temps le fruit des insurrections de l’esprit humain, et que ces écarts et ces rebellions n’ont pu être produits que par les hardiesses d’une fausse philosophie qui a constamment répandu ses rêves sous des masques divers ; mais il est une lumière, la seule vraie, qui brille au milieu de ces ténèbres, quoique le grand nombre ferme les yeux pour ne la point voir : — Lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehenderunt. — Cette vraie lumière n’est nulle part entière que dans l’Église romaine, centre unique de la liberté et de la Vérité, — ou Dieu nous maintienne !

- ↑ Gloria posthuma S. Ignatii, cité par Görres, Mystique, liv. VI, ch. xvi.
- ↑ Bodin, Démonomanie, liv. III, ch. i, après Job-Fincel et André-Muscul. Voyez les preuves de ce fait dans les Légendes des saintes images.
- ↑ Wierus, in Pseudomon. dæm.
- ↑ Boguet, Discours des exécrables sorciers.
- ↑ Kivasseau.
- ↑ On disait à Belphégor :
Accipe quod tibi do, stercus in ore tuo.
- ↑ Pour Lucifage (qui fait la lumière), voyez Pactes.
- ↑ Fournies par l’auteur anglais d’un article de la Retrospective Review, traduit en 1835 dans la Revue britannique.
- ↑ Isaïe, ch. xxvi, verset 4, traduct. de Sacy.
- ↑ Jacquemin, Fragments d’un voyage en Allemagne.
- ↑ On appelait quindécemvirs les quinze magistrats préposés pour consulter les livres des sibylles. Mais ces livres, où l’on croyait contenues les destinées du peuple romain, ayant été brûlés, l’an de Rome 670, avec le Capitole où ils étaient gardés, on envoya de tous côtés des ambassadeurs faire la recherche des oracles des sibylles, et les quindécemvirs en composèrent d’autres livres qu’Auguste fit cacher sous le piédestal de la statue d’Apollon Palatin. Ils avaient été d’abord établis par Tarquin au nombre de deux, puis furent portés à dix, et enfin jusqu’à quinze par Sylla. On les créait de la même manière que les pontifes. (Le Livre unique, n° 15.)
- ↑ Le capitaine Bazil Hall.
- ↑ Voyez cette histoire dans les Légendes des commandements de Dieu. Gustave de Nierilz a fait de ce sujet un pur roman que M. J.-B. de Champagnac a traduit en français et qui est intitulé le Sifflet magique ou les Enfants d’Hameln.
- ↑ Voyez sa vie dans les Légendes infernales.
- ↑ Singularités historiques et littéraires de D. Liron, t. I, p. 313.
- ↑ Proclus, De anima et dæmone. Naudé, Apologie.
- ↑ Il y a des gens qui ne croient à rien et qui mettent à la loterie sur la signification des songes. Mais qui peut leur envoyer des songes, s’il n’y a pas de Dieu ?… Comment songent-ils quand leur corps est assoupi, s’ils n’ont point d’âme ? Deux savetiers s’entretenaient, sous l’Empire, de matières de religion. L’un prétendait qu’on avait eu raison de rétablir le culte ; l’autre, au contraire, qu’on avait eu tort. — Mais, dit le premier, je vois bien que tu n’es pas foncé dans la politique ; ce n’est pas pour moi qu’on a remis Dieu dans ses fonctions, ce n’est pas pour toi non plus ; c’est pour le peuple. — Ces deux savetiers, avec tout leur esprit, se faisaient tirer les cartes et se racontaient leurs songes.
- ↑ Boistuau, Visions prodigieuses.
- ↑ Spranger fit condamner à mort une sorcière qui avait fait mourir quarante et un petits enfants.
- ↑ Histoire générale des voyages.
- ↑ Jules Duvernay, Excursion d’artiste en 1841.
- ↑ Les morts et les vivants, entretiens sur les communications d’outre-tombe, petit in-12.
- ↑ Voyez la légende du Spunkie dans les Légendes des esprits et démons.
- ↑ Delancre, Tableau de l’inconst. des démons, etc., liv. III, p. 187.
- ↑ Saint Jean Chrysostome.
- ↑ M. Salgues, Des erreurs et des préjugés, etc., t. I, p. 88.
- ↑ Wierus, in Pseudom. dæmon.
- ↑ Capitul. Caroli Mag. pro partibus Saxoniæ, cap. vi.
- ↑ Leloyer, Histoire des spectres ou apparitions des esprits, p. 303.
- ↑ Delrio, Disquisitionum magicarum lib. II, p. 190. Édition de Mayence, 1612.
- ↑ Mystique, liv. VIII, ch. xxx.
- ↑ Charlatans célèbres, de M. Gouriet, t. I, p. 195.
- ↑ Saint.-Foix, Essais.
- ↑ Les antipathies ne sont pas moins singulières en certains cas que les sympathies. On a vu à Calais un homme qui entrait en fureur malgré lui lorsqu’il entendait crier des canards. Il les poursuivait l’épée à la main. Cependant il en mangeait avec plaisir : c’était son mets favori.
Helvétius raconte ce petit trait :
« Le duc de Lorraine donnait un grand repas à toute sa cour. On avait servi dans le vestibule, et le vestibule donnait sur un parterre. Au milieu du souper, une femme croit voir une araignée. La peur la saisit ; elle pousse un cri, quitte la table, fuit dans le jardin et tombe sur le gazon. Au moment de sa chute, elle entend quelqu’un rouler à ses côtés ; c’était le premier ministre du duc. — Ah ! monsieur, que vous me rassurez et que j’ai de grâces à vous rendre ! Je craignais d’avoir fait une impertinence. — Hé ! madame, qui pourrait y tenir ? Mais, dites-moi, était-elle bien grosse ? — Ah ! monsieur, elle était affreuse. — Volait-elle près de moi ? — Que voulez-vous dire ? Une araignée voler ? — Hé quoi ! reprend le ministre, pour une araignée vous faites ce train-là ! Allez, madame, vous êtes folle ; je croyais, moi, que c’était une chauve-souris. »
- ↑ Cambry, Voyage dans le Finistère.
- ↑ Wierus, in Pseudom. dæm.
- ↑ Il est fait mention de coups semblables dans une foule d’histoires de revenants, de maisons hantées, de faux monnayeurs supposés, de Klopf et de Poltergeister, etc.
On se rappelle aussi cette prière que l’Église répétait dans les exorcismes qui précédaient la bénédiction des édifices : « Mettez en fuite, Seigneur, tous les Esprits malins, tous les fantômes, et tout Esprit qui frappe (Spiritum percutientem). » Quel jour jeté sur la question !
- ↑ Réunie en un volume in-8o, chez Henri Plon, à Paris. Voyez aussi Bortisme.
- ↑ M. Jules Garinet, Hist. de la magie en France, p. 245.
- ↑ Le Petit Albert.
- ↑ Imprimé à Séville en 1555, in-folio.
- ↑ Voyez son histoire dans les Légendes des péchés capitaux.
- ↑ Le P. Bonaventure Giraudeau. Paraboles.
- ↑ Wierus, in Pseudom. dæm., p. 823.
- ↑ Voyez les prophètes du Dauphiné, dans les Légendes infernales.
- ↑ Les admirables secrets d’Albert le Grand, p. 114.
- ↑ Cette règle consistait en soixante-douze articles, qui disaient en substance que ces religieux militaires porteraient l’habit blanc ; qu’ils entendraient tous les jours l’office divin ; que lorsque le service militaire les en empêcherait, ils seraient tenus d’y suppléer par d’autres prières spécifiées dans les constitutions ; qu’ils feraient maigre quatre jours par semaine, et que l’exercice de la chasse leur serait absolument interdit.
- ↑ Des aveux établirent que, dans un des chapitres de l’ordre tenu à Montpellier, et de nuit, suivant l’usage, on avait exposé une tête (Voy. Tête de Bophomet); qu’aussitôt le diable avait paru sous la figure d’un chat ; que ce chat, tandis qu’on l’adorait, avait parlé et répondu avec bonté aux uns et aux autres ; qu’ensuite plusieurs démons étaient venus, etc.
- ↑ 16 juillet 1842.
- ↑ Leloyer, Histoire des spectres ou apparitions, etc., liv. VI, p. 329.
- ↑ Jacques d’Autun, l’Incrédulité savante.
- ↑ L’original porte : Vim patior.
- ↑ Bodin, Démonomanie des sorciers.
- ↑ Cambry, Voyage dans le Finistère.
- ↑ M. Garinet, Histoire de la magie en France, p. 3.
- ↑ Voyez ce récit tout entier dans les Légendes de l’autre monde.
- ↑ Wierus, De præst., etc.
- ↑ Dæmoniaci, cum locis infestis et terriculamentis nocturnis.
- ↑ Vieille tradition rapportée par Alph. Karr, Voyage autour de mon jardin, lettre xie.
- ↑ Dionysii Carthusiani, art. 49. — Hæc prolixius describuntur in libello qui Visio Tondali nuncupatur. Voyez les Voyages de Tondal, dans les Légendes de l’autre monde.
- ↑ Cambry, Voyage dans le Finistère, t. II, p. 16.
- ↑ Epitome delictorum, sive de Magia, in qua aperta vel occulta invocatio dæmonis intervenit, etc., editio novissima. Lugduni, 1679, in-4o.
- ↑ Victor Hugo, Han d’Islande, ch. xii.
- ↑ Les admirables secrets d’Albert le Grand, p. 113.
- ↑ Bergier, Dictionnaire de théologie.
- ↑ Voyages au Pérou faits en 1794, 1794, par les PP. Manuel Sobre, Viela et Barcelo.
- ↑ Voyages à Constantinople, 1800.
- ↑ Voyage de J. Bell d’Antermoni, etc.
- ↑ Cambry, Voyage au Finistère, t. II, p. 15.
- ↑ Livraison de mai 1837.
- ↑ Voyez cette vision dans les Légendes de l’autre monde.
- ↑ M. de Balzac, Le secret des Ruggieri.
- ↑ M. Salues, Des erreurs et des préjugés, etc., t. III, p. 84.
- ↑ Wierus, in Pseudomonarch. dæmon.
- ↑ Par l’alectryomancie. Voy. ce mot.
- ↑ C’est la définition que donne le R. P. D. Calmet.
- ↑ D. Calmet déclare qu’il tient ces faits d’un homme grave, qui les tenait de M. le comte de Cabréras.
- ↑ Wilhelm. Neubrig., Berum. anglicarum lib. V, cap. xxii.
- ↑ Les anciens croyaient aussi que les morts mangeaient. On ne dit pas s’ils les entendaient mâcher ; mais il est certain qu’il faut attribuer à l’idée qui conservait aux morts la faculté de manger d’habitude des repas funèbres qu’on servait, de temps immémorial et chez tous les peuples, sur la tombe des défunts.
- ↑ De masticatione mortuorum in tumulis.
- ↑ Philosophicæ et christianæ cogitationes de vampiriis, a Joanne Christophoro Herenbergio.
- ↑ Mackensie, Voyage dans l’Amérique septentrionale, 1802.
- ↑ Wierus, in Pseudom. dæm.
- ↑ Saint-Foix, Essais sur Paris.
- ↑ Bayle, Dictionnaire critique ; Aaron, note A.
- ↑ Admirables secrets d’Albert le Grand, p. 110.
- ↑ La mort de Notre-Seigneur, la rédemption du genre humain, la chute du pouvoir infernal, doivent au contraire sanctifier le vendredi.
- ↑ Thiers, Traité des superstitions.
- ↑ Cambry, Voyage dans le Finistère, t. III, p. 35.
- ↑ Cambry, Voyage dans le Finistère, t. III, p. 48.
- ↑ Liv. VI, ch. xiii.
- ↑ Boguet, p. 364.
- ↑ Revue des Deux Mondes, août 1833.
- ↑ Lenglet-Dufresnoy.
- ↑ Michel Scott, De physiogn., ch. lvi.
- ↑ Wierus, Pseudom. dæm.
- ↑ Voyez cette grande légende dans les Légendes infernales.
- ↑ Lettre de l’évêque Evode a saint Augustin.
- ↑ Prosper Mérimée, Colomba.
- ↑ Les grands personnages, dans ce procès, où ils se trouvaient mêlés à une canaille infâme, y allaient toutefois d’un ton fort dégagé. Madame de Bouillon, assignée pour répondre par-devant les commissaires de la chambre des poisons (en 1680), s’y rendit accompagnée de neuf carrosses de princes ou ducs ; M. de Vendôme la menait. M. de Bezons lui demanda d’abord si elle n’était pas venue pour répondre aux interrogations qu’on lui ferait. Elle dit que oui ; mais qu’avant d’entrer en matière elle lui déclarait que tout ce qu’elle allait dire ne pourrait préjudicier au rang qu’elle tenait, ni à tous ses privilèges. Elle m voulut rien dire ni écouter davantage que le greffier n’eût écrit cette déclaration préliminaire. M. de Bezons la questionna sur ce qu’elle avait demandé à la Voisin. Elle répondit « qu’elle l’avait priée de lui faire voir des sibylles » ; et après huit ou dix autres questions d’aussi peu d’importance, sur lesquelles elle répondit toujours en se moquant, M. de Bezons lui dit qu’elle pouvait s’en aller. M. de Vendôme lui donnait la main, sur le seuil de la porte de celle chambre, elle s’écria « qu’elle n’avait jamais ouï dire tant de sottises d’un ton si grave ».
- ↑ Eusèbe, après Plutarque.
- ↑ Prosper Mérimée, Colomba.
- ↑ Cambry, Voyage dans le Finistère.
- ↑ Wierus, in Pseudom. dæm.
- ↑ M. Garinet, Histoire de la magie en France, p. 255.
- ↑ Pline, liv. II, ch. xxxiii.
- ↑ M. Garinet, Histoire de la magie en France, p. 464.
- ↑ Xavier Marmier, Souvenirs de voyages et traditions populaires, p. 72.
- ↑ Voyez M. Ozanam, Recherches sur l’établissement du christianisme en Allemagne.
- ↑ Il paraît, d’après la description que les disciples d’Amidas, idole japonaise, font de ce dieu, que c’est l’Être suprême ; car dans leur idée c’est une substance indivisible, incorporelle, immuable, distincte de tous les éléments. Il existait avant la nature ; il est la source et le fondement de tout bien, sans commencement et sans fin, infini, immense, et créateur de l’univers. Il est représenté sur un autel, montant un cheval à sept têtes, hiéroglyphe de sept mille ans, avec une tête de chien, et tenant dans ses mains un anneau en cercle d’or qu’il mord. Cet emblème a beaucoup d’analogie avec le cercle égyptien, que l’on regarde comme un emblème du temps.
- ↑ Mémoires et correspondance de Wolff, analysés dans le Quotidienne.
- ↑ Voyage de Dumont, liv. III.
- ↑ Mangeart, Souvenirs de la Morée, 1830.
- ↑ Cambry, Voyage dans le Finistère, t. I, p. 470. Il y a encore des gens qui, à l’heure qu’il est, et tout près de Paris, croient au mauvais œil, aux donneurs de sort, etc. Nous empruntons ce récit à un journal parisien : la nommée X…, fille d’un cultivateur des environs, en est un exemple ; seulement cette pauvre fille se croit le don fatal de porter malheur à ceux qu’elle affectionne, et voici pourquoi : Il y a trois ans, la jeune paysanne était sur le point de se marier avec un de ses cousins. Accordailles, dispenses, publications de bans, tout était fini, lorsque son fiancé est atteint de la fièvre typhoïde, et meurt en trois jours : premier deuil et en même temps premier doute sur la mauvaise chance attachée à sa personne. Un an après, un autre prétendu se présente, sa demande est accordée, les préparatifs se font de nouveau, mais quatre jours avant celui fixé pour le mariage, il est frappé tout à coup d’aliénation mentale, on est obligé de l’enfermer, et six mois plus tard il était mort. « Décidément, se dit-on dans le pays, Marianne n’a pas de chance avec ses marieux ! » et il n’y eut désormais que les moins poltrons pour oser la faire danser. Pourtant, comme Marianne est très-jolie, il finit par se présenter un troisième prétendant, dont la demande est encore acceptée, et cette demande était faite il y a trois mois. Cette fois encore ont lieu tous les préparatifs nécessaires ; époque est prise pour un jour du mois d’avril ; et le jeune homme part pour son pays, afin d’en ramener certains parents qu’il désire avoir à sa noce ; mais, la veille de ce jour tant désiré, le père de Marianne reçoit une lettre qui lui annonce la mort de son futur gendre : le malheureux jeune homme était allé tirer quelques lapins qu’il voulait rapporter, son fusil était parti à l’improviste et l’avait atteint dans le côté gauche ; il était mort presque sur le coup.
- ↑ Torquemada, Hexameron, p. 428.
- ↑ Wierus, Pseudomonarchia dæmon.
- ↑ C’est le nom qu’on donne en Espagne aux bohémiens.
- ↑ Voyez M. Letronne, Sur l’origine grecque des prétendus zodiaques égyptiens. Voyez aussi la brochure de M. Testa sur les zodiaques.


