En famille (Hector Malot)/Texte entier
EN FAMILLE


EN FAMILLE
I
Comme cela arrive souvent le samedi vers trois heures, les abords de la porte de Bercy étaient encombrés, et sur le quai, en quatre files, les voitures s’entassaient à la queue leu leu : haquets chargés de fûts, tombereaux de charbon ou de matériaux, charrettes de foin ou de paille, qui tous, sous un clair et chaud soleil de juin, attendaient la visite de l’octroi, pressés d’entrer dans Paris à la veille du dimanche.
Parmi ces voitures, et assez loin de la barrière, on en voyait une d’aspect bizarre avec quelque chose de misérablement comique, sorte de roulotte de forains mais plus simple encore, formée d’un léger châssis tendu d’une grosse toile, avec un toit en carton bitumé, le tout porté sur quatre roues basses.
Autrefois la toile avait dû être bleue, mais elle était si déteinte, salie, usée, qu’on ne pouvait s’en tenir qu’à des probabilités à cet égard, de même qu’il fallait se contenter d’à peu près si l’on voulait déchiffrer les inscriptions effacées qui couvraient ses quatre faces : l’une, en caractères grecs, ne laissait plus deviner qu’un commencement de mot : φωτογ ; celle au-dessous semblait être de l’allemand : ; une autre de l’italien fia ; enfin, la plus fraîche et française, celle-là : photographie, était évidemment la traduction de toutes les autres, indiquant ainsi, comme une feuille de route, les divers pays par lesquels la pauvre guimbarde avait roulé avant d’entrer en France et d’arriver enfin aux portes de Paris.
Était-il possible que l’âne qui y était attelé l’eût amenée de si loin jusque-là ?
Au premier coup d’œil on pouvait en douter, tant il était maigre, épuisé, vidé ; mais, à le regarder de plus près, on voyait que cet épuisement n’était que le résultat des fatigues longuement endurées dans la misère. En réalité, c’était un animal robuste, d’assez grande taille, plus haute que celle de notre âne d’Europe, élancé, au poil gris cendré avec le ventre clair malgré les poussières des routes qui le salissaient ; des lignes noires transversales marquaient ses jambes fines aux pieds rayés, et, si fatigué qu’il fût, il n’en tenait pas moins sa tête haute d’un air volontaire, résolu et coquin. Son harnais se montrait digne de la voiture, rafistolé avec des ficelles de diverses couleurs, les unes grosses, les autres petites au hasard des trouvailles, mais qui disparaissaient sous les branches fleuries et les roseaux, coupés le long du chemin, dont on l’avait couvert pour le défendre du soleil et des mouches.
Près de lui, assise sur la bordure du trottoir, se tenait une petite fille de onze à douze ans qui le surveillait.
Son type était singulier : d’une certaine incohérence, mais sans rien de brutal dans un très apparent mélange de race. Au contraire de l’inattendu de la chevelure pâle et de la carnation ambrée, le visage prenait une douceur fine qu’accentuait l’œil noir, long, futé et grave. La bouche aussi était sérieuse. Dans l’affaissement du repos le corps s’était abandonné ; il avait les mêmes grâces que la tête à la fois délicates et nerveuses ; les épaules étaient souples d’une ligne menue et fuyante dans une pauvre veste carrée de couleur indéfinissable, noire autrefois probablement ; les jambes volontaires et fermes dans une pauvre jupe large en loques ; mais la misère de l’existence n’enlevait cependant rien à la fierté de l’attitude de celle qui la portait.
Comme l’âne se trouvait placé derrière une haute et large voiture de foin, la surveillance en eût été facile si de temps en temps, il ne s’était pas amusé à happer une goulée d’herbe, qu’il tirait discrètement avec précaution, en animal intelligent qui sait très bien qu’il est en faute.
« Palikare, veux-tu finir ! »
Aussitôt il baissait la tête comme un coupable repentant, mais dès qu’il avait mangé son foin en clignant de l’œil et en agitant ses oreilles, il recommençait avec un empressement qui disait sa faim.
À un certain moment comme elle venait de le gronder pour la quatrième ou cinquième fois, une voix sortit de la voiture appelant :
« Perrine. »
Aussitôt sur pied, elle souleva un rideau et entra dans la voiture où une femme était couchée sur un matelas si mince qu’il semblait collé au plancher.
« As-tu besoin de moi, maman ?
— Que fait donc Palikare ?
— Il mange le foin de la voiture qui nous précède.
— Il faut l’en empêcher.
— Il a faim.
— La faim ne nous permet pas de prendre ce qui ne nous appartient pas ; que répondrais-tu au charretier de cette voiture s’il se fâchait ?
— Je vais le tenir de plus près.
— Est-ce que nous n’entrons pas bientôt dans Paris ?
— Il faut attendre pour l’octroi.
— Longtemps encore ?
— Tu souffres davantage ?
— Ne t’inquiète pas ; l’étouffement du renfermé ; ce n’est rien, » dit-elle d’une voix haletante, sifflée plutôt qu’articulée.
C’étaient là les paroles d’une mère qui veut rassurer sa fille ; en réalité elle se trouvait dans un état pitoyable, sans respiration, sans force, sans vie, et, bien que n’ayant pas dépassé vingt-six ou vingt-sept ans, au dernier degré de la cachexie ; avec cela des restes de beauté admirables, la tête d’un pur ovale, des yeux doux et profonds, ceux même de sa fille, mais avivés par le souffle de la maladie.
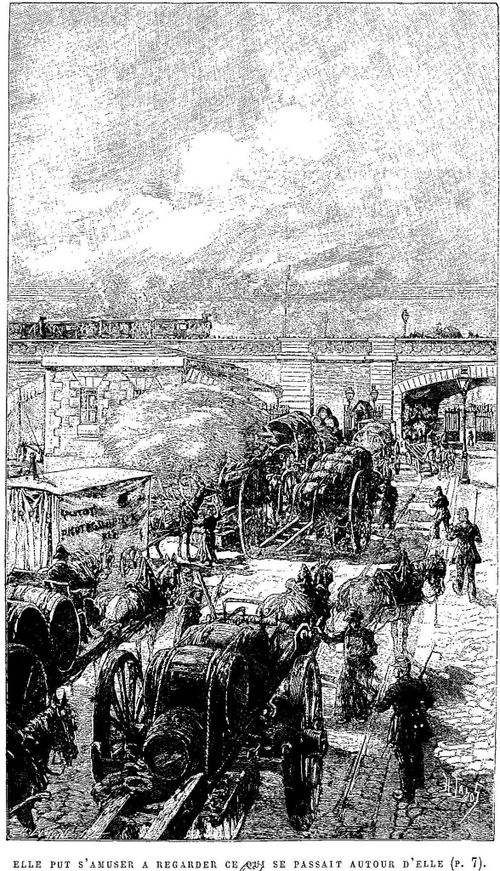
« Veux-tu que je te donne quelque chose ? demanda Perrine.
— Quoi ?
— Il y a des boutiques, je peux t’acheter un citron ; je reviendrais tout de suite.
— Non. Gardons notre argent. Nous en avons si peu. Retourne près de Palikare, et fais en sorte de l’empêcher de voler ce foin.
— Cela n’est pas facile.
— Enfin veille sur lui. »
Elle revint à la tête de l’âne, et comme un mouvement se produisait, elle le retint de façon qu’il restât assez éloigné de la voiture de foin pour ne pas pouvoir l’atteindre.
Tout d’abord il se révolta, et voulut avancer quand même, mais elle lui parla doucement, le flatta, l’embrassa sur le nez ; alors il abaissa ses longues oreilles avec une satisfaction manifeste et voulut bien se tenir tranquille.
N’ayant plus à s’occuper de lui, elle put s’amuser à regarder ce qui se passait autour d’elle : le va-et-vient des bateaux-mouches et des remorqueurs sur la rivière ; le déchargement des péniches au moyen des grues tournantes qui allongeaient leurs grands bras de fer au-dessus d’elles et prenaient, comme à la main, leur cargaison pour la verser dans des wagons quand c’étaient des pierres, du sable ou du charbon, ou les aligner le long du quai quand c’étaient des barriques ; le mouvement des trains sur le pont du chemin de fer de ceinture dont les arches barraient la vue de Paris qu’on devinait dans une brume noire plutôt qu’on ne le voyait ; enfin près d’elle, sous ses yeux, le travail des employés de l’octroi qui passaient de longues lances à travers les voitures de paille, ou escaladaient les fûts chargés sur les haquets, les perçaient d’un fort coup de foret, recueillaient dans une petite tasse d’argent le vin qui en jaillissait, en dégustaient quelques gouttes qu’ils crachaient aussitôt.
Comme tout cela était curieux, nouveau, et elle s’y intéressait si bien, que le temps passait, sans qu’elle en eût conscience.
Déjà un gamin d’une douzaine d’années qui avait tout l’air d’un clown, et appartenait sûrement à une caravane de forains dont les roulottes avaient pris la queue, tournait autour d’elle depuis dix longues minutes, sans qu’elle eût fait attention à lui, lorsqu’il se décida à l’interpeller :
« V’là un bel âne ! »
Elle ne dit rien.
« Est-ce que c’est un âne de notre pays ? Ça m’étonnerait joliment. »
Elle l’avait regardé, et voyant qu’après tout il avait l’air bon garçon, elle voulut bien répondre :
« Il vient de Grèce.
— De Grèce !
— C’est pour cela qu’il s’appelle Palikare.
— Ah ! c’est pour cela ! »
Mais malgré son sourire entendu, il n’était pas du tout certain qu’il eût très bien compris pourquoi un âne qui venait de Grèce pouvait s’appeler Palikare.
« C’est loin la Grèce ? demanda-t-il.
— Très loin.
— Plus loin que… la Chine ?
— Non, mais loin, loin.
— Alors vous venez de la Grèce ?
— De plus loin encore.
— De la Chine ?
— Non ; c’est Palikare qui vient de la Grèce.
— Est-ce que vous allez à la fête des Invalides ?
— Non.
— Ousque vous allez ?
— À Paris.
— Ousque vous remiserez votre roulotte ?
— On nous a dit à Auxerre qu’il y avait des places libres sur les boulevards des fortifications. »
Il se donna deux fortes claques sur les cuisses en plongeant de la tête.
« Les boulevards des fortifications, oh là là là !
— Il n’y a pas de places ?
— Si.
— Eh bien ?
— Pas pour vous. C’est voyou les fortifications. Avez-vous des hommes dans votre roulotte, des hommes solides qui n’aient pas peur d’un coup de couteau ? J’entends d’en donner et d’en recevoir.
— Nous ne sommes que ma mère et moi, et ma mère est malade.
— Vous tenez à votre âne ?
— Bien sûr.
— Eh bien demain votre âne vous sera volé ; v’là pour commencer, vous verrez le reste ; et ça ne sera pas beau ; c’est Gras Double qui vous le dit.
— C’est vrai cela ?
— Pardi, si c’est vrai ; vous n’êtes jamais venue à Paris ?
— Jamais.
— Ça se voit ; c’est donc des moules ceux d’Auxerre qui vous ont dit que vous pouviez remiser là ? pourquoi que vous n’allez pas chez Grain de Sel ?
— Je ne connais pas Grain de Sel.
— Le propriétaire du Champ Guillot, quoi ! c’est clos de palissades fermées la nuit ; vous n’auriez rien à craindre, on sait que Grain de Sel aurait vite fichu un coup de fusil à ceux qui voudraient entrer la nuit.
— C’est cher ?
— L’hiver oui, quand tout le monde rapplique à Paris, mais en ce moment je suis sûr qu’il ne vous ferait pas payer plus de quarante sous la semaine, et votre âne trouverait sa nourriture dans le clos, surtout s’il aime les chardons.
— Je crois bien qu’il les aime.
— Il sera à son affaire ; et puis Grain de Sel n’est pas un mauvais homme.
— C’est son nom Grain de Sel ?
— On l’appelle comme ça parce qu’il a toujours soif. C’est un ancien biffin qui a gagné gros dans le chiffon, qu’il n’a quitté que quand il s’est fait écraser un bras, parce qu’un seul bras n’est pas commode pour courir les poubelles ; alors il s’est mis à louer son terrain, l’hiver pour remiser les roulottes, l’été à qui il trouve ; avec ça, il a d’autres commerces : il vend des petits chiens de lait.
— C’est loin : d’ici le Champ Guillot ?
— Non, à Charonne ; mais je parie que vous ne connaissez seulement pas Charonne ?
— Je ne suis jamais venue à Paris.
— Eh bien, c’est là. »
Il étendit le bras devant lui dans la direction du nord.
« Une fois que vous avez passé la barrière, vous tournez tout de suite à droite, et vous suivez le boulevard le long des fortifications pendant une petite demi-heure ; quand vous avez traversé le cours de Vincennes, qui est une large avenue, vous prenez sur la gauche et vous demandez ; tout le monde connaît le Champ Guillot.
— Je vous remercie ; je vais en parler à maman ; et même, si vous vouliez rester auprès de Palikare deux minutes, je lui en parlerais tout de suite.
— Je veux bien ; je vas lui demander de m’apprendre le grec.
— Empêchez-le, je vous prie, de prendre du foin. »
Perrine entra dans la voiture et répéta à sa mère, ce que le jeune clown venait de lui dire.
« S’il en est ainsi il n’y a pas à hésiter, il faut aller à Charonne ; mais trouveras-tu ton chemin ? Pense que nous serons dans Paris.
— Il paraît que c’est très facile. »
Au moment de sortir elle revint près de sa mère et se pencha vers elle :
« Il y a plusieurs voitures qui ont des bâches, on lit dessus : « Usines de Maraucourt », et au-dessous le nom : « Vulfran Paindavoine » ; sur les toiles qui couvrent les pièces de vin alignées le long du quai on lit aussi la même inscription.
— Cela n’a rien d’étonnant.
— Ce qui est étonnant c’est de voir ces noms si souvent répétés. »


II
Quand Perrine revint prendre sa place auprès de son âne, il s’était enfoncé le nez dans la voiture de foin, et il mangeait tranquillement comme s’il avait été devant un râtelier.
« Vous le laissez manger ? s’écria-t-elle.
— J’vous crois.
— Et si le charretier se fâche ?
— Faudrait pas avec moi. »
Il se mit en posture d’invectiver un adversaire, les poings sur les hanches, la tête renversée.
« Ohé, croquant ! »
Mais son concours ne fut pas nécessaire pour défendre Palikare ; c’était au tour de la voiture de foin d’être sondée à coups de lance par les employés de l’octroi, et elle allait passer la barrière.
« Maintenant ça va être à vous ; je vous quitte. Au revoir, mam’zelle ; si vous voulez jamais avoir de mes nouvelles, demandez Gras Double, tout le monde vous répondra. »
Les employés qui gardent les barrières de Paris sont habitués à voir bien des choses bizarres, cependant celui qui monta dans la voiture photographique eut un mouvement de surprise en trouvant cette jeune femme couchée ; et surtout en jetant les yeux çà et là d’un rapide coup d’œil qui ne rencontrait partout que la misère.
« Vous n’avez rien à déclarer ? demanda-t-il en continuant son examen.
— Rien.
— Pas de vin, pas de provisions ?
— Rien. »
Ce mot deux fois répété était d’une exactitude rigoureuse : en dehors du matelas, de deux chaises de paille, d’une petite table, d’un fourneau en terre, d’un appareil et de quelques ustensiles photographiques, il n’y avait rien dans cette voiture : ni malles, ni paniers, ni vêtements.
« C’est bien, vous pouvez entrer. »
La barrière passée, Perrine tourna tout de suite à droite, comme Gras Double lui avait recommandé conduisant Palikare par la bride. Le boulevard qu’elle suivait longeait le talus des fortifications, et dans l’herbe roussie, poussiéreuse, usée par plaques, des gens étaient couchés qui dormaient sur le dos ou sur le ventre, selon qu’ils étaient plus ou moins aguerris contre le soleil, tandis que d’autres s’étiraient les bras, leur sommeil interrompu, en attendant de le reprendre. Ce qu’elle vit de la physionomie de ceux-là, de leurs têtes ravagées, culottées, hirsutes, de leurs guenilles, et de la façon dont ils les portaient, lui fit comprendre que cette population des fortifications ne devait pas, en effet, être très rassurante la nuit, et que les coups de couteau devaient s’échanger là facilement.
Elle ne s’arrêta pas à cet examen, maintenant sans intérêt pour elle, puisqu’elle ne se trouverait pas mêlée à ces gens, et elle regarda de l’autre côté, c’est-à-dire vers Paris.
Hé quoi ! ces vilaines maisons, ces hangars, ces cours sales, ces terrains vagues où s’élevaient des tas d’immondices, c’était Paris, le Paris dont elle avait si souvent entendu parler par son père, dont elle rêvait depuis longtemps, et avec des imaginations enfantines, d’autant plus féeriques que le chiffre des kilomètres diminuait à mesure qu’elle s’en rapprochait ; de même, de l’autre côté du boulevard, sur les talus, vautrés dans l’herbe, comme des bestiaux, ces hommes et ces femmes, aux faces patibulaires, étaient des Parisiens.
Elle reconnut le cours de Vincennes à sa largeur et, après l’avoir dépassé, tournant à gauche, elle demanda le Champ Guillot. Si tout le monde le connaissait, tout le monde n’était pas d’accord sur le chemin à prendre pour y arriver, et elle se perdit plus d’une fois dans les noms de rues qu’elle devait suivre. À la fin cependant, elle se trouva devant une palissade formée de planches, les unes en sapin, les autres en bois non écorcé, celles-ci peintes, celles-là goudronnées, et quand, par la barrière ouverte à deux battants, elle aperçut dans le terrain un vieil omnibus sans roues et un wagon de chemin de fer sans roues aussi, posés sur le sol, elle comprit, bien que les bicoques environnantes ne fussent guère en meilleur état, que c’était là le Champ Guillot. Eût-elle eu besoin d’une confirmation de cette impression, qu’une douzaine de petits chiens tout ronds, qui boulaient dans l’herbe, la lui eût donnée.
Laissant Palikare dans la rue, elle entra, et aussitôt les chiens se jetèrent sur ses jambes, les mordillant avec de petits aboiements.
« Qu’est-ce qu’il y a » ? cria une voix.
Elle regarda d’où venait cet appel, et, sur sa gauche, elle aperçut un long bâtiment qui était peut-être une maison, mais qui pouvait bien être aussi tout autre chose ; les murs étaient en carreaux de plâtre, en pavés de grès et de bois, en boîtes de fer-blanc, le toit en carton et en toile goudronnée, les fenêtres garnies de vitres en papier, en bois, en feuilles de zinc et même en verre, mais le tout construit et disposé avec un art naïf qui faisait penser qu’un Robinson en avait été l’architecte, avec des Vendredis pour ouvriers. Sous un appentis, un homme à la barbe broussailleuse était occupé à trier des chiffons qu’il jetait dans des paniers disposés autour de lui.
« N’écrasez pas mes chiens, cria-t-il, approchez. »
Elle fit ce qu’il commandait.
« Qu’est-ce que vous voulez ? demanda-t-il lorsqu’elle fut près de lui.
— C’est vous qui êtes le propriétaire du Champ Guillot ?
— On le dit. »
Elle expliqua en quelques mots ce qu’elle voulait, tandis que, pour ne pas perdre son temps en l’écoutant, il se versait, d’un litre qu’il avait à sa portée, un verre de vin à rouges bords et se le jetait dans le gosier.

« C’est possible, si l’on paye d’avance, dit-il en l’examinant.
— Combien ?
— Quarante-deux sous par semaine pour la voiture, vingt et un sous pour l’âne.
— C’est bien cher.
— C’est mon prix.
— Votre prix d’été ?
— Mon prix d’été.
— Il pourra manger les chardons ?
— Et l’herbe aussi, s’il a les dents assez solides.
— Nous ne pouvons pas payer à la semaine, puisque nous ne resterons pas une semaine, mais au jour seulement ; nous passons par Paris pour aller à Amiens, et nous voulons nous reposer.
— Alors, ça va tout de même ; six sous par jour pour la roulotte, trois sous pour l’âne. »
Elle fouilla dans sa jupe, et, un à un, elle en tira neuf sous :
« Voilà la première journée.
— Tu peux dire à tes parents d’entrer. Combien sont-ils ? Si c’est une troupe, c’est deux sous en plus par personne.
— Je n’ai que ma mère.
— Bon. Mais pourquoi ta mère n’est-elle pas venue faire sa location ?
— Elle est malade, dans la voiture.
— Malade. Ce n’est pas un hôpital ici. »
Elle eut peur qu’on ne voulût pas recevoir une malade.
« C’est-à-dire qu’elle est fatiguée. Vous comprenez, nous venons de loin.
— Je ne demande jamais aux gens d’où ils viennent. »
Il étendit le bras vers un coin de son champ :
« Tu mettras ta roulotte là-bas, et puis tu attacheras ton âne ; s’il m’écrase un chien, tu me le payeras cent sous. »
Comme elle allait s’éloigner, il l’appela :
« Prends un verre de vin.
— Je vous remercie, je ne bois pas de vin.
— Bon, je vas le boire pour toi. »
Il se jeta dans le gosier le verre qu’il avait versé, et se remit au tri de ses chiffons, autrement dit à son « triquage ».
Aussitôt qu’elle eut installé Palikare à la place qui lui avait été assignée, ce qui ne se fit pas sans certaines secousses, malgré le soin qu’elle prenait de les éviter, elle monta dans la roulotte :
« À la fin, pauvre maman, nous voilà arrivées.
— Ne plus remuer, ne plus rouler ! Tant et tant de kilomètres ! Mon Dieu, que la terre est grande !
— Maintenant que nous avons le repos, je vais te faire à dîner. Qu’est-ce que tu veux ?
— Avant tout, détèle ce pauvre Palikare, qui, lui aussi, doit être bien las ; donne-lui à manger, à boire ; soigne-le.
— Justement, je n’ai jamais vu autant de chardons ; de plus, il y a un puits. Je reviens tout de suite. »
En effet, elle ne tarda pas à revenir et se mit à chercher çà et là dans la voiture d’où elle sortit le fourneau en terre, quelques morceaux de charbon et une vieille casserole, puis elle alluma le feu avec des brindilles et le souffla, en s’agenouillant devant, à pleins poumons.
Quand il commença à prendre, elle remonta dans la voiture :
« C’est du riz que tu veux, n’est-ce pas ?
— J’ai si peu faim.
— Aurais-tu faim pour autre chose ? J’irai chercher ce que tu voudras. Veux-tu ?…
— Je veux bien du riz. »
Elle versa une poignée de riz dans la casserole où elle avait mis un peu d’eau, et, quand l’ébullition commença, elle remua le riz avec deux baguettes blanches dépouillées de leur écorce, ne quittant la cuisine que pour aller rapidement voir comment se trouvait Palikare et lui dire quelques mots d’encouragement qui, à vrai dire, n’étaient pas indispensables, car il mangeait ses chardons avec une satisfaction, dont ses oreilles dressées traduisaient l’intensité.
Quand le riz fut cuit à point, à peine crevé et non réduit en bouillie, comme le servent bien souvent les cuisinières parisiennes, elle le dressa sur une écuelle en une pyramide à large base, et le porta dans la voiture.
Déjà elle avait été emplir une petite cruche au puits et l’avait placée auprès du lit de sa mère avec deux verres, deux assiettes, deux fourchettes : elle posa son écuelle de riz à côté et s’assit sur le plancher, les jambes repliées sous elle, sa jupe étalée.
« Maintenant, dit-elle, comme une petite fille qui joue à la poupée, nous allons faire la dînette, je vais te servir. »
Malgré le ton enjoué qu’elle avait pris, c’était d’un regard inquiet qu’elle examinait sa mère, assise sur son matelas, enveloppée d’un mauvais fichu de laine qui avait dû être autrefois une étoffe de prix, mais qui maintenant n’était plus qu’une guenille, usée, décolorée.
« Tu as faim, toi ? demanda la mère.
— Je crois bien, il y a longtemps.
— Pourquoi n’as-tu pas mangé un morceau de pain ?
— J’en ai mangé deux, mais j’ai encore une belle faim : tu vas voir ; si ça met en appétit de regarder manger les autres, la platée sera trop petite. »
La mère avait porté une fourchette de riz à sa bouche, mais elle la tourna et retourna longuement sans pouvoir l’avaler.
— Ça ne passe pas très bien, dit-elle en réponse au regard de sa fille.
— Il faut te forcer : la seconde bouchée passera mieux, la troisième mieux encore. »
Mais elle n’alla pas jusque-là, et après la seconde elle reposa sa fourchette sur son assiette :
« Le cœur me tourne, il vaut mieux ne pas persister.
— Oh ! maman !
— Ne t’inquiète pas, ma chérie, ce n’est rien ; on vit très bien sans manger quand on n’a pas d’efforts à faire ; avec le repos l’appétit reviendra. »
Elle défit son fichu et s’allongea sur son matelas haletante, mais si faible qu’elle fût elle ne perdit pas la pensée de sa fille, et en la voyant les yeux gonflés de larmes elle s’efforça de la distraire :
« Ton riz est très bon, mange-le ; puisque tu travailles tu dois te soutenir ; il faut que tu sois forte pour me soigner ; mange, ma chérie, mange.
— Oui maman, je mange ; tu vois, je mange. »
À la vérité elle devait faire effort pour avaler, mais peu à peu sous l’impression des douces paroles de sa mère sa gorge se desserra, et elle se mit à manger réellement, alors l’écuelle de riz disparut vite, tandis que sa mère la regardait avec un tendre et triste sourire :
« Tu vois qu’il faut se forcer.
— Si j’osais, maman !
— Tu peux oser.
— Je te répondrais que ce que tu me dis, c’était cela même que je te disais.
— Moi, je suis malade.
— C’est pour cela que si tu voulais j’irais chercher un médecin ; nous sommes à Paris, et à Paris il y a de bons médecins.
— Les bons médecins ne se dérangent pas sans qu’on les paie.
— Nous le paierions.
— Avec quoi ?
— Avec notre argent ; tu dois avoir sept francs dans ta robe et en plus un florin que nous pouvons changer ici ; moi j’ai dix-sept sous. Regarde dans ta robe. »
Cette robe noire, aussi misérable que la jupe de Perrine, mais moins poudreuse, car elle avait été battue, était posée sur le matelas et servait de couverture ; sa poche explorée donna bien les sept francs annoncés et le florin d’Autriche.
« Combien cela fait-il en tout ? demanda Perrine, je connais si mal l’argent français.
— Je ne le connais guère mieux que toi. »
Elles firent le compte, et en estimant le florin à deux francs elles trouvèrent neuf francs quatre-vingt-cinq centimes.
« Tu vois que nous avons plus qu’il ne faut pour le médecin, continua Perrine.
— Il ne me guérirait pas par des paroles, il ordonnerait des médicaments, comment les payer ?
— J’ai mon idée. Tu penses bien que quand je marche à côté de Palikare, je ne passe pas tout mon temps à lui parler quoiqu’il aimerait cela, je réfléchis aussi à toi, à nous, surtout à toi, pauvre maman, depuis que tu es malade, à notre voyage, à notre arrivée à Maraucourt. Est-ce que tu crois que nous pouvons nous y montrer dans notre roulotte, qui, si souvent, sur notre passage a fait rire ? Cela nous vaudrait-il un bon accueil ?
— Il est certain que même pour des parents qui n’auraient pas de fierté, cette entrée serait humiliante.
— Il vaut donc mieux qu’elle n’ait pas lieu ; et puisque nous n’avons plus besoin de la roulotte nous pouvons la vendre. D’ailleurs à quoi nous sert-elle maintenant ? Depuis que tu es malade, personne n’a voulu se laisser photographier par moi ; et quand même je trouverais des gens assez braves pour se fier à moi, nous n’avons plus de produits. Ce n’est pas avec ce qui nous reste d’argent, que nous pouvons dépenser trois francs pour un paquet de développement, trois francs pour un virage d’or et d’acétate, deux francs pour une douzaine de glaces. Il faut la vendre.
— Et combien la vendrons-nous ?
— Nous la vendrons toujours quelque chose : l’objectif est en bon état ; et puis il y a le matelas…
— Tout, alors ?
— Cela te fait de la peine ?
— Il y a plus d’un an que nous vivons dans cette roulotte, ton père y est mort, cela fait que si misérable qu’elle soit la pensée de m’en séparer m’est douloureuse ; de lui c’est tout ce qui nous reste, et il n’est pas une seule de ces pauvres choses à laquelle son souvenir ne soit attaché. »
Sa parole haletante s’arrêta tout à fait, et sur son visage décharné des larmes coulèrent sans qu’elle pût les retenir.
« Oh ! maman, s’écria Perrine, pardonne-moi de t’avoir parlé de cela.
— Je n’ai rien à te pardonner, ma chérie ; c’est le malheur de notre situation, que nous ne puissions ni toi, ni moi aborder certains sujets sans nous attrister réciproquement, comme c’est la fatalité de mon état que je n’aie aucune force pour résister, pour penser, pour vouloir, plus enfant que tu ne l’es toi-même. N’est-ce pas moi qui aurais dû te parler comme tu viens de le faire, prévoir ce que tu as prévu, que nous ne pouvions pas arriver à Maraucourt dans cette roulotte, ni nous montrer dans ces guenilles, cette jupe pour toi, cette robe pour moi ? Mais en même temps qu’il fallait prévoir cela, il fallait aussi combiner des moyens pour trouver des ressources, et ma tête si faible ne m’offrait que des chimères, surtout l’attente du lendemain, comme si ce lendemain devait accomplir des miracles pour nous : je serais guérie, nous ferions une grosse recette ; les illusions des désespérés qui ne vivent plus que de leurs rêves. C’était folie, la raison a parlé par ta bouche : je ne serai pas guérie demain, nous ne ferons pas une grosse, ni une petite recette, il faut donc vendre la voiture et ce qu’elle contient. Mais ce n’est pas tout encore ; il faut aussi que nous nous décidions à vendre… »
Il y eut une hésitation et un moment de silence pénible.
« Palikare, dit Perrine.
— Tu y avais pensé ?
— Si j’y avais pensé ! Mais je n’osais pas le dire, et depuis que l’idée me tourmentait que nous serions forcées un jour ou l’autre de le vendre, je n’osais même pas le regarder, de peur qu’il ne devine que nous pouvions nous séparer de lui, au lieu de le conduire à Maraucourt où il aurait été si heureux, après tant de fatigues.
— Savons-nous seulement, si nous-mêmes, nous serons reçues à Maraucourt ! Mais enfin, comme nous n’avons que cela à espérer, et que si nous sommes repoussées, il ne nous restera plus qu’à mourir dans un fossé de la route, il faut coûte que coûte que nous allions à Maraucourt, et que nous nous y présentions, de façon à ne pas nous faire fermer les portes devant nous…
— Est-ce que c’est possible ? cela maman. Est-ce que le souvenir de papa ne nous protégerait pas ? lui qui était si bon ? Est-ce qu’on reste fâché contre les morts ?
— Je te parle d’après les idées de ton père, auxquelles nous devons obéir. Nous vendrons donc et la voiture et Palikare. Avec l’argent que nous en tirerons, nous appellerons un médecin ; qu’il me rende des forces pour quelques jours, c’est tout ce que je demande. Si elles reviennent, nous achèterons une robe décente pour toi une pour moi, et nous prendrons le chemin de fer pour Maraucourt, si nous avons assez d’argent pour aller jusque-là ; sinon nous irons jusqu’où nous pourrons, et nous ferons le reste du chemin à pied.
— Palikare est un bel âne ; le garçon qui m’a parlé à la barrière, me le disait tantôt. Il est dans un cirque, il s’y connaît ; et c’est parce qu’il trouvait Palikare beau, qu’il m’a parlé.
— Nous ne savons pas la valeur des ânes à Paris, et encore moins celle que peut avoir un âne d’Orient. Enfin, nous verrons, et puisque notre parti est arrêté, ne parlons plus de cela : c’est un sujet trop triste, et puis je suis fatiguée. »
En effet, elle paraissait épuisée, et plus d’une fois, elle avait dû faire de longues pauses pour arriver à bout de ce qu’elle voulait dire.
« As-tu besoin de dormir ?
— J’ai besoin de m’abandonner, de m’engourdir dans la tranquillité du parti pris et l’espoir d’un lendemain.
— Alors, je vais te laisser pour ne pas te déranger, et comme il y a encore deux heures de jour, je vais en profiter pour laver notre linge. Est-ce que ça ne te paraîtra pas bon d’avoir demain une chemise fraîche ?
— Ne te fatigue pas.
— Tu sais bien que je ne suis jamais fatiguée. »
Après avoir embrassé sa mère, elle alla de-ci de-là dans la roulotte, vivement, légèrement ; prit un paquet de linge dans un petit coffre où il était enfermé, le plaça dans une terrine ; atteignit sur une planche un petit morceau de savon tout usé, et sortit emportant le tout. Comme après que le riz avait été cuit, elle avait empli d’eau sa casserole, elle trouva cette eau chaude et put la verser sur son linge. Alors, s’agenouillant dans l’herbe, après avoir ôté sa veste, elle commença à savonner, à frotter, et sa lessive ne se composant en réalité que de deux chemises, de trois mouchoirs, de deux paires de bas, il ne lui fallait pas deux heures pour que tout fût lavé, rincé et étendu sur des ficelles entre la roulotte et la palissade.
Pendant qu’elle travaillait, Palikare attaché, à une courte distance d’elle, l’avait plusieurs fois regardée comme pour la surveiller, mais sans rien de plus. Quand il vit qu’elle avait fini, il allongea le cou vers elle et poussa cinq ou six braiments qui étaient des appels impérieux.
« Crois-tu que je t’oublie ? » dit-elle.
Elle alla à lui, le changea de place et lui apporta à boire dans sa terrine qu’elle avait soigneusement rincée, car s’il se contentait de toutes les nourritures qu’on lui donnait ou qu’il trouvait lui-même, il était au contraire très difficile pour sa boisson, et n’acceptait que l’eau pure dans des vases propres ou le bon vin qu’il aimait par-dessus tout.
Mais cela fait, au lieu de le quitter, elle se mit à le flatter de la main en lui disant des paroles de tendresse comme une nourrice à son enfant, et l’âne qui tout de suite s’était jeté sur l’herbe nouvelle, s’arrêta de manger pour poser sa tête contre l’épaule de sa petite maîtresse et se faire mieux caresser : de temps en temps il inclinait vers elle ses longues oreilles et les relevait avec des frémissements qui disaient sa béatitude.
Le silence s’était fait dans l’enclos maintenant fermé, ainsi que dans les rues désertes du quartier, et on n’entendait plus, au loin, qu’un sourd mugissement sans bruits distincts, profond, puissant, mystérieux comme celui de la mer, la respiration et la vie de Paris qui continuaient actives et fiévreuses malgré la nuit tombante.
Alors dans la mélancolie du soir, l’impression de ce qui venait de se dire étreignit Perrine plus fort, et, appuyant sa tête à celle de son âne, elle laissa couler les larmes qui depuis si longtemps l’étouffaient, tandis qu’il lui léchait les mains.


III
La nuit de la malade fut mauvaise ; plusieurs fois, Perrine couchée près d’elle, tout habillée sur la planche, avec un fichu roulé qui lui servait d’oreiller, dut se lever pour lui donner de l’eau qu’elle allait chercher au puits afin de l’avoir plus fraîche : elle étouffait et souffrait de la chaleur. Au contraire, à l’aube, le froid du matin, toujours vif sous le climat de Paris, la fit grelotter et Perrine dut l’envelopper dans son fichu, la seule couverture un peu chaude qui leur restât.
Malgré son désir d’aller chercher le médecin aussitôt que possible, elle dut attendre que Grain de Sel fût levé, car à qui demander le nom et l’adresse d’un bon médecin, si ce n’était à lui ?
Bien sûr qu’il connaissait un bon médecin, et un fameux qui faisait ses visites en voiture, non à pied comme les médecins de rien du tout : M. Cendrier, rue Riblette, près l’église ; pour trouver la rue Riblette il n’y avait qu’à suivre le chemin de fer jusqu’à la gare.
En entendant parler d’un médecin fameux qui faisait les visites en voiture, elle eut peur de n’avoir pas assez d’argent pour le payer, et timidement, avec confusion, elle questionna Grain de Sel en tournant autour de ce qu’elle n’osait pas dire. À la fin il comprit :
« Ce que tu auras à payer ? dit-il. Dame, c’est cher. Pas moins de quarante sous. Et pour être sûre qu’il vienne, tu feras bien de les lui remettre d’avance. »
En suivant les indications qui lui avaient été données, elle trouva assez facilement la rue Riblette, mais le médecin n’était point encore levé, elle dut attendre, assise sur une borne dans la rue, à la porte d’une remise derrière laquelle on était en train d’atteler un cheval : comme cela elle le saisirait au passage, et en lui remettant ses quarante sous, elle le déciderait à venir, ce qu’il ne ferait pas, elle en avait le pressentiment, si on lui demandait simplement une visite pour un des habitants du Champ Guillot.
Le temps fut éternel à passer, son angoisse se doublant de celle de sa mère qui ne devait rien comprendre à son retard ; s’il ne la guérissait point instantanément, au moins allait-il l’empêcher de souffrir. Déjà elle avait vu un médecin entrer dans leur roulotte, lorsque son père avait été malade. Mais c’était, en pleine montagne, dans un pays sauvage, et le médecin que sa mère avait appelé sans avoir le temps de gagner une ville, était plutôt un barbier avec une tournure de sorcier qu’un vrai médecin comme on en trouve à Paris, savant, maître de la maladie et de la mort, comme devait l’être celui-là, puisqu’on le disait fameux.
Enfin la porte de la remise s’ouvrit, et un cabriolet de forme ancienne, à caisse jaune, auquel était attelé un gros cheval de labour vint se ranger devant la maison et presque aussitôt le médecin parut, grand, gros, gras, le visage rougeaud encadré d’une barbe grise qui lui donnait l’air d’un patriarche campagnard.
Avant qu’il fût monté en voiture, elle était près de lui et lui exposait sa demande.
« Le Champ Guillot, dit-il, il y a eu de la batterie.
— Non, monsieur, c’est ma mère qui est malade, très malade.
— Qu’est-ce que c’est, ta mère ?
— Nous sommes photographes. »
Il mit le pied sur le marchepied.
Vivement elle tendit sa pièce de quarante sous.
« Nous pouvons vous payer.
— Alors, c’est trois francs. »
Elle ajouta vingt sous à la pièce ; il prit le tout et le fourra dans la poche de son gilet.
« Je serai près de ta mère d’ici un quart d’heure. »
Elle fit en courant le chemin du retour, joyeuse d’apporter la bonne nouvelle :
« Il va te guérir, maman, c’est un vrai médecin celui-là. »
Et vivement elle s’occupa de sa mère, lui lava le visage, les mains, lui arrangea les cheveux qui étaient admirables, noirs et soyeux, puis elle mit de l’ordre dans la roulotte ; ce qui n’eut d’autre résultat que de la rendre plus vide et par là plus misérable encore.
Elles n’eurent pas une trop longue attente à endurer : un roulement de voiture annonça l’arrivée du médecin et Perrine courut au-devant de lui.
Comme en entrant il voulait se diriger vers la maison, elle lui montra la roulotte.
« C’est dans notre voiture que nous habitons », dit-elle.
Bien que cette voiture n’eût rien d’une habitation, il ne laissa paraître aucune surprise, étant habitué à toutes les misères avec sa clientèle ; mais Perrine qui l’observait remarqua sur son visage comme un nuage lorsqu’il vit la malade couchée sur son matelas, dans cet intérieur dénudé.
« Tirez la langue, donnez-moi la main. »
Ceux qui payent quarante ou cent francs la visite de leur médecin n’ont aucune idée de la rapidité avec laquelle s’établit un diagnostic auprès des pauvres gens ; en moins d’une minute son examen fut fait.
« Il faut entrer à l’hôpital », dit-il.
La mère et la fille poussèrent un même cri d’effroi et de douleur.
« Petite, laisse-moi seul avec ta maman », dit le médecin d’un ton de commandement.
Perrine hésita une seconde ; mais, sur un signe de sa mère, elle quitta la roulotte, dont elle ne s’éloigna pas.
« Je suis perdue ? dit la mère à mi-voix.
— Qu’est-ce qui parle de ça : vous avez besoin de soins que vous ne pouvez pas recevoir ici.
— Est-ce qu’à l’hôpital j’aurais ma fille ?

— Elle vous verrait le jeudi et le dimanche.
— Nous séparer ! Que deviendrait-elle sans moi, seule à Paris ? que deviendrai-je sans elle ? Si je dois mourir, il faut que ce soit sa main dans la mienne.
— En tout cas on ne peut pas vous laisser dans cette voiture où le froid des nuits vous est mortel. Il faut prendre une chambre ; le pouvez-vous ?
— Si ce n’est pas pour longtemps, oui peut-être.
— Grain de Sel en loue qu’il ne vous fera pas payer cher. Mais la chambre n’est pas tout, il faut des médicaments, une bonne nourriture, des soins : ce que vous auriez à l’hôpital.
— Monsieur, c’est impossible, je ne peux pas me séparer de ma fille. Que deviendrait-elle ?
— Comme vous voudrez, c’est votre affaire ; je vous ai dit ce que je devais. »
Il appela :
« Petite. »
Puis, tirant un carnet de sa poche, il écrivit au crayon quelques lignes sur une feuille blanche, qu’il détacha :
« Porte cela chez le pharmacien, dit-il, celui qui est auprès de l’église, pas un autre. Tu donneras à ta mère le paquet no 1 ; tu lui feras boire d’heure en heure la potion no 2 ; le vin de quinquina en mangeant, car il faut qu’elle mange ; ce qu’elle voudra, surtout des œufs. Je reviendrai ce soir. »
Elle voulut l’accompagner pour le questionner :
« Maman est bien malade ?
— Tâche de la décider à entrer à l’hôpital.
— Est-ce que vous ne pouvez pas la guérir ?
— Sans doute, je l’espère ; mais je ne peux pas lui donner ce qu’elle trouverait à l’hôpital. C’est folie de n’y pas aller ; c’est pour ne pas se séparer de toi qu’elle refuse : tu ne serais pas perdue, car tu as l’air d’une fille avisée et délurée. »
Marchant à grands pas, il était arrivé à sa voiture ; Perrine eût voulu le retenir, le faire parler, mais il monta et partit.
Alors elle revint à la roulotte.
« Qu’a dit le médecin ? demanda la mère.
— Qu’il te guérirait.
— Va donc vite chez le pharmacien, et rapporte aussi deux œufs ; prends tout l’argent. »
Mais tout l’argent ne fut pas suffisant ; quand le pharmacien eut lu l’ordonnance, il regarda Perrine en la toisant :
« Vous avez de quoi payer ? » dit-il.
Elle ouvrit la main.
« C’est sept francs cinquante », dit le pharmacien qui avait fait son calcul.
Elle compta ce qu’elle avait dans la main et trouva six francs quatre-vingt-cinq centimes en estimant le florin d’Autriche à deux francs ; il lui manquait donc treize sous.
« Je n’ai que six francs quatre-vingt-cinq centimes, dont un florin d’Autriche, dit-elle ; le voulez-vous, le florin ?
— Ah ! non, par exemple. »
Que faire ? Elle restait au milieu de la boutique la main ouverte, désespérée, anéantie.
« Si vous vouliez prendre le florin, il ne me manquerait que treize sous, dit-elle enfin ; je vous les apporterais tantôt. »
Mais le pharmacien ne voulut d’aucune de ces combinaisons, ni faire crédit de treize sous, ni accepter le florin :
« Comme il n’y a pas urgence pour le vin de quinquina, dit-il, vous viendrez le chercher tantôt ; je vais tout de suite vous préparer les paquets et la potion qui ne vous coûteront que trois francs cinquante. »
Sur l’argent qui lui restait elle acheta des œufs, un petit pain viennois, qui devait provoquer l’appétit de sa mère, et revint toujours courant au Champ Guillot.
« Les œufs sont frais, dit-elle, je les ai mirés ; regarde le pain comme il est bien cuit ; tu vas manger, n’est-ce pas ? maman.
— Oui, ma chérie. »
Toutes deux étaient pleines d’espérance et Perrine d’une foi absolue : puisque le médecin avait promis de guérir sa mère, il allait accomplir ce miracle : pourquoi l’aurait-il trompée ? quand on demande la vérité à un médecin, il doit la dire.
C’est un merveilleux apéritif que l’espoir ; la malade, qui depuis deux jours n’avait pu rien prendre, mangea un œuf et la moitié du petit pain.
« Tu vois, maman, disait Perrine.
— Cela va aller. »
En tout cas, son irritabilité nerveuse s’émoussa ; elle éprouva un peu de calme, et Perrine en profita pour aller consulter Grain de Sel sur la question de savoir comment elle devait s’y prendre pour vendre la voiture et Palikare.
Pour la roulotte, rien de plus facile, Grain de Sel pouvait l’acheter comme il achetait toutes choses : meubles, habits, outils, instruments de musique, étoffes, matériaux, le neuf, le vieux ; mais, pour Palikare, il n’en était pas de même, parce qu’il n’achetait pas de bêtes, excepté les petits chiens, et son avis était qu’on devait attendre au mercredi pour le vendre au Marché aux chevaux.
Le mercredi c’était bien loin, car, dans sa surexcitation d’espérance, Perrine s’imaginait qu’avant ce jour-là, sa mère aurait repris assez de forces pour pouvoir partir ; mais, à attendre ainsi, il y avait au moins cela de bon, qu’elles pourraient avec le produit de la vente de la roulotte s’arranger des robes pour voyager en chemin de fer, et aussi cela de meilleur encore, qu’on pourrait peut-être ne pas vendre Palikare, si le prix payé par Grain de Sel était assez élevé ; Palikare resterait au Champ Guillot, et quand elles seraient arrivées à Maraucourt, elles le feraient venir. Comme elle serait heureuse de ne pas le perdre, cet ami qu’elle aimait tant ! et comme il serait heureux de vivre, désormais dans le bien-être, logé dans une belle écurie, se promenant toute la journée à travers de grasses prairies avec ses deux maîtresses auprès de lui !
Mais il fallut en rabattre des visions qui en quelques secondes avaient traversé son esprit, car, au lieu de la somme qu’elle imaginait sans la préciser, Grain de Sel n’offrit que quinze francs de la roulotte et de tout ce qu’elle contenait, après l’avoir longuement examinée.
« Quinze francs !
— Et encore c’est pour vous obliger ; qu’est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? »
Et du crochet qui lui tenait lieu de bras, il frappait les diverses pièces de la roulotte, les roues, les brancards, en haussant les épaules d’un air de pitié méprisante.
Tout ce qu’elle put obtenir après beaucoup de paroles, ce fut une augmentation de deux francs cinquante sur le prix offert, et l’engagement que la roulotte ne serait dépecée qu’après leur départ, de façon à pouvoir jusque-là l’habiter pendant la journée, ce qui, imaginait-elle, vaudrait mieux pour sa mère que de rester enfermée dans la maison.
Quand, sous la direction de Grain de Sel elle visita les chambres qu’il pouvait leur louer, elle vit combien la roulotte leur serait précieuse, car, malgré l’orgueil avec lequel il parlait de ses appartements, et qui n’avait d’égal que son mépris pour la roulotte, elle était si misérable, si puante cette maison, qu’il fallait leur détresse pour l’accepter.
À la vérité, elle avait un toit et des murs qui n’étaient pas en toile, mais sans aucune autre supériorité sur la roulotte : tout à l’entour se trouvaient amoncelées les matières dont Grain de Sel faisait commerce et qui pouvaient supporter les intempéries : verres cassés, os, ferrailles ; tandis qu’à l’intérieur le couloir et des pièces sombres, où les yeux se perdaient, contenaient celles qui avaient besoin d’un abri : vieux papiers, chiffons, bouchons, croûtes de pain, bottes, savates, ces choses innombrables, détritus de toutes sortes, qui constituent les ordures de Paris ; et de ces divers tas s’exhalaient d’âcres odeurs qui prenaient à la gorge.
Comme elle restait hésitante se demandant si sa mère ne serait pas empoisonnée par ces odeurs, Grain de Sel la pressa :
« Dépêchez-vous, dit-il, les biffins vont rentrer ; il faut que je sois là pour recevoir et « triquer » ce qu’ils apportent.
— Est-ce que le médecin connaît ces chambres ? demanda-t-elle.
— Bien sûr qu’il les connaît ; il est venu plus d’une fois à côté quand il a soigné la Marquise. »
Ce mot la décida : puisque le médecin connaissait ces chambres, il savait ce qu’il disait en conseillant d’en prendre une ; et puisqu’une marquise habitait l’une d’elles, sa mère pouvait bien en habiter une autre.
« Cela vous coûtera huit sous par jour, dit Grain de Sel, ajoutés aux trois sous pour l’âne et aux six sous pour la roulotte.
— Vous l’avez achetée ?
— Oui, mais puisque vous vous en servez, il est juste de la payer. »
Elle ne trouva rien à répondre ; ce n’était pas la première fois qu’elle se voyait ainsi écorchée ; bien souvent elle l’avait été plus durement encore dans leur long voyage, et elle finissait par croire que c’est la loi de nature pour ceux qui ont, au détriment de ceux qui n’ont pas.


IV
Perrine employa une bonne partie de la journée à nettoyer la chambre où elles allaient s’installer, à laver le plancher, à frotter les cloisons, le plafond, la fenêtre qui depuis que la maison était construite n’avait jamais été bien certainement à pareille fête.
Pendant les nombreux voyages qu’elle fit de la maison au puits où elle tirait de l’eau pour laver, elle remarqua qu’il ne poussait pas seulement de l’herbe et des chardons dans l’enclos ; des jardins environnants le vent ou les oiseaux avaient apporté des graines ; par-dessus le palis, les voisins avaient jeté des plants de fleurs dont-ils ne voulaient plus ; de sorte que quelques-unes de ces graines, quelques-uns de ces plants, tombant sur un terrain qui leur convenait, avaient germé ou poussé, et maintenant fleurissaient tant bien que mal. Sans doute leur végétation ne ressemblait en rien à celle qu’on obtient dans un jardin, avec des soins de tous les instants, des engrais, des arrosages ; mais pour sauvage qu’elle fût, elle n’en avait pas moins son charme de couleur et de parfum.
Cela lui donna l’idée de cueillir quelques-unes de ces fleurs, des giroflées rouges et violettes, des œillets, et d’en faire des bouquets qu’elle placerait dans leur chambre d’où ils chasseraient la mauvaise odeur en même temps qu’ils l’égayeraient. Il semblait que ces fleurs n’appartenaient à personne, puisque Palikare pouvait les brouter si le cœur lui en disait ; cependant elle n’osa pas en cueillir le plus petit rameau, sans le demander à Grain de Sel.
« Est-ce pour les vendre ? répondit celui-ci.
— C’est pour en mettre quelques branches dans notre chambre.
— Comme ça, tant que tu voudras ; parce que si c’était pour les vendre, je commencerais par te les vendre moi-même. Puisque c’est pour toi, ne te gêne pas, la petite : tu aimes l’odeur des fleurs, moi j’aime mieux celle du vin, même il n’y a que celle-là que je sente. »
Le tas des verres plus ou moins cassés étant considérable, elle y trouva facilement des vases ébréchés dans lesquels elle disposa ses bouquets, et comme ces fleurs avaient été cueillies au soleil, la chambre se remplit bientôt du parfum des giroflées et des œillets, ce qui neutralisa les mauvaises odeurs de la maison, en même temps que leurs fraîches couleurs éclairaient ses murs noirs.
Tout en travaillant ainsi, elle fit la connaissance des voisins qui habitaient de chaque côté de leur chambre : une vieille femme qui sur ses cheveux gris portait un bonnet orné de rubans tricolores aux couleurs du drapeau français ; et un grand bonhomme courbé en deux, enveloppé dans un tablier de cuir si long et si large qu’il semblait constituer son unique vêtement. La femme aux rubans tricolores était une chanteuse des rues, lui dit le bonhomme au tablier, et rien moins que la Marquise dont avait parlé Grain de Sel ; tous les jours elle quittait le Champ Guillot avec un parapluie rouge et une grosse canne dans laquelle elle le plantait aux carrefours des rues ou aux bouts des ponts, pour chanter et vendre à l’abri le répertoire de ses chansons. Quant au bonhomme au tablier, c’était, lui apprit la Marquise, un démolisseur de vieilles chaussures, et du matin au soir il travaillait muet comme un poisson, ce qui lui avait valu le nom de Père la Carpe, sous lequel on le connaissait ; mais pour ne pas parler il n’en faisait pas moins un tapage assourdissant avec son marteau.
Au coucher du soleil son emménagement fut achevé, et elle put alors amener sa mère qui, en apercevant les fleurs, eut un moment de douce surprise :
« Comme tu es bonne pour ta maman, chère fille ! dit-elle.
— Mais c’est pour moi que je suis bonne, ça me rend si heureuse de te faire plaisir ! »
Avant la nuit il fallut mettre les fleurs dehors, et alors l’odeur de la vieille maison se fit sentir terriblement, mais sans que la malade osât s’en plaindre ; à quoi cela eût-il servi, puisqu’elles ne pouvaient pas quitter le Champ Guillot pour aller autre part ? Son sommeil fut mauvais, fiévreux, troublé, agité, halluciné, et quand le médecin vint le lendemain matin il la trouva plus mal, ce qui lui fit changer le traitement et obligea Perrine à retourner chez le pharmacien, qui cette fois lui demanda cinq francs. Elle ne broncha pas et paya bravement ; mais en revenant elle ne respirait plus. Si les dépenses continuaient ainsi, comment gagneraient-elles le mercredi qui leur mettrait aux mains le produit de la vente du pauvre Palikare ? Si le lendemain le médecin prescrivait une nouvelle ordonnance coûtant cinq francs, ou plus, où trouverait-elle cette somme ?
Au temps où avec ses parents elle parcourait les montagnes, ils avaient plus d’une fois été exposés à la famine, et plus d’une fois aussi, depuis qu’ils avaient quitté la Grèce pour venir en France, ils avaient manqué de pain. Mais ce n’était pas du tout la même chose. Pour la famine dans les montagnes, ils avaient toujours l’espérance, qui se réalisait souvent, de trouver quelques fruits, des légumes, un gibier qui leur apporteraient un bon repas. Pour le manque de pain en Europe, ils avaient aussi celle de rencontrer des paysans grecs, bosniaques, styriens, tyroliens, qui consentiraient à se faire photographier moyennant quelques sous. Tandis qu’à Paris il n’y a rien à attendre pour ceux qui n’ont pas d’argent en poche, et le leur tirait à sa fin. Alors, que feraient-elles ? Et le terrible, c’est qu’elle devait répondre à cette question, elle ne sachant rien, ne pouvant rien ; l’effroyable, c’est qu’elle devait prendre la responsabilité de tout, puisque la maladie rendait sa mère incapable de s’ingénier, et qu’elle se trouvait ainsi la vraie mère, quand elle ne se sentait qu’une enfant.
Si encore un peu de mieux se présentait, elle en serait encouragée et fortifiée ; mais il n’en était pas ainsi, et bien que sa mère ne se plaignît jamais, répétant toujours, au contraire, son mot habituel : « Cela va aller », elle voyait qu’en réalité « cela n’allait pas » : pas de sommeil, pas d’appétit, la fièvre, un affaiblissement, une oppression qui lui paraissaient progresser, si sa tendresse, sa faiblesse, son ignorance, sa lâcheté ne l’abusaient point.
Le mardi matin, à la visite du médecin, ce qu’elle craignait pour l’ordonnance se réalisa : après un rapide examen de la malade, le docteur Cendrier tira de sa poche son carnet, ce terrible carnet cause de tant d’angoisses pour Perrine, et se prépara à écrire ; mais au moment où il posait le crayon sur le papier, elle eut le courage de l’arrêter.
« Monsieur, si les médicaments que vous allez ordonner ne sont pas d’égale importance, voulez-vous bien n’inscrire aujourd’hui que ceux qui pressent ?
— Qu’est-ce que vous voulez dire ? » demanda-t-il d’un ton fâché.
Elle tremblait, mais cependant elle osa aller jusqu’au bout.
« Je veux dire que nous n’avons pas beaucoup d’argent aujourd’hui et que nous n’en recevrons que demain ; alors… »
Il la regarda, puis après avoir jeté un coup d’œil rapide çà et là, comme s’il voyait pour la première fois leur misère, il remit son carnet dans sa poche :
« Nous ne changerons le traitement que demain, dit-il ; rien ne presse, celui d’hier peut être encore continué aujourd’hui. »
« Rien ne presse », fut le mot que Perrine retint et se répéta :
Si rien ne pressait, c’était que sa mère ne se trouvait pas aussi mal qu’elle l’avait craint ; on pouvait donc encore espérer et attendre.
Le mercredi était le jour qu’elle attendait, mais son impatience de le voir arriver était traversée par l’émotion douloureuse avec laquelle elle le redoutait, car s’il devait les sauver par l’argent qu’il allait leur apporter, d’un autre côté il devait la séparer de Palikare. Aussi, chaque fois qu’elle pouvait quitter sa mère, courait-elle dans l’enclos pour dire un mot à son ami qui, n’ayant plus à travailler, ni à peiner, et trouvant à manger autant qu’il voulait après tant de privations, ne s’était jamais montré si joyeux. Dès qu’il la voyait venir, il poussait quatre ou cinq braiments à ébranler les vitres des cahutes du Champ Guillot, et, au bout de sa corde, il lançait quelques ruades jusqu’à ce qu’elle fût près de lui ; mais aussitôt qu’elle lui avait mis la main sur le dos, il se calmait et, allongeant le cou, il lui posait la tête sur l’épaule sans plus bouger. Alors, ils restaient ainsi, elle le flattant, lui remuant les oreilles et clignant des yeux avec des mouvements rythmés qui étaient tout un discours.
« Si tu savais ! » murmurait-elle doucement.
Mais lui ne savait point, ne prévoyait point, et, tout aux satisfactions du moment présent, le repos, la bonne nourriture, les caresses de sa maîtresse, il se trouvait le plus heureux âne du monde. D’ailleurs, il s’était fait un ami de Grain de Sel, de qui il recevait des marques d’amitié qui flattaient sa gourmandise. Le lundi, dans la matinée, ayant trouvé le moyen de se détacher, il s’était approché de Grain de Sel occupé à triquer les ordures qui arrivaient, et curieusement il était resté là. C’était une habitude religieusement pratiquée par Grain de Sel d’avoir toujours un litre de vin et un verre à portée de sa main, de façon à n’être point obligé de se lever lorsque l’envie de boire un coup le prenait, et elle le prenait souvent. Ce matin-là, tout à sa besogne, il ne pensait pas à regarder autour de lui, mais précisément parce qu’il s’y appliquait et s’y échauffait, la soif, cette soif qui lui avait valu son surnom, n’avait pas tardé à se faire sentir. Au moment où, s’interrompant, il allait prendre sa bouteille, il vit Palikare les yeux attachés sur lui, le cou tendu.
« Qu’est-ce que tu fais là, toi ? »
Comme le ton n’était pas grondeur, l’âne n’avait pas bougé.
« Tu veux boire un verre de vin ? » demanda Grain de Sel dont toutes les idées tournaient toujours autour du mot boire.
Et au lieu de porter à sa bouche le verre qu’il emplissait, il l’avait par plaisanterie tendu à Palikare ; alors celui-ci considérant l’invitation comme sérieuse avait fait deux pas de plus en avant, et, allongeant ses lèvres de manière qu’elles fussent aussi minces, aussi allongées que possible, il avait aspiré une bonne moitié du verre, plein jusqu’au bord.
« Oh ! la ! la ! la ! », s’écria Grain de Sel en riant aux éclats.
Et il se mit à appeler :
« La Marquise ! la Carpe ! »
À ses cris ils arrivèrent, ainsi qu’un chiffonnier chargé de sa hotte pleine, qui rentrait dans le clos, et le locataire du wagon dont la profession était d’être marchand de pâte de guimauve et de parcourir les fêtes et les marchés en suspendant à un crochet tournant des tas de sucre fondu, dont il tirait des tortillons jaunes, bleus, rouges, comme l’eût fait une fileuse de sa quenouille.
« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda la Marquise.
— Vous allez voir ; mais préparez-vous à vous faire du bon sang. »
De nouveau il emplit son verre et le tendit à Palikare qui, comme la première fois, le vida à moitié au milieu des rires et des exclamations des gens qui le regardaient.
« J’avais entendu raconter que les ânes aimaient le vin, dit l’un, mais je ne le croyais pas.
— C’est un poivrot ! dit un autre.
— Vous devriez l’acheter, dit la Marquise en s’adressant à Grain de Sel, il vous tiendrait joliment compagnie.
— Ça ferait la paire. »
Grain de Sel ne l’acheta point, mais il se prit d’affection pour lui et proposa à Perrine de l’accompagner le mercredi au Marché aux chevaux. Et cela fut un grand soulagement pour elle, car elle n’imaginait pas du tout comment elle trouverait le Marché aux chevaux dans Paris, pas plus qu’elle ne voyait comment elle s’y prendrait pour vendre un âne, discuter son prix, le recevoir sans se faire voler ; elle avait bien des fois entendu raconter des histoires de voleurs parisiens et se sentait tout à fait incapable de se défendre contre eux si, d’aventure, ils avaient l’idée de s’attaquer à elle.
Le mercredi matin elle s’occupa donc de faire la toilette de Palikare, et ce fut une occasion pour elle de le caresser et de l’embrasser. Mais hélas ! combien tristement ! Elle ne le verrait plus. Dans quelles mains allait-il passer ? le pauvre ami ! et elle ne pouvait s’arrêter à cette pensée sans revoir les ânes misérables ou martyrs que dans sa vie sur les grands chemins, elle avait rencontrés en tous lieux, comme si, sur la terre entière, l’âne n’existait que pour souffrir. Certainement, depuis que Palikare leur appartenait, il avait supporté

bien des fatigues et des misères, celles des longues routes, du froid, du chaud, de la pluie, de la neige, du verglas, des privations, mais au moins n’était-il jamais battu, et se sentait-il l’ami de ceux dont il partageait le sort malheureux ; tandis que maintenant elle ne pouvait que trembler en se demandant quels allaient être ses maîtres ; elle en avait tant rencontré de cruels, qui n’avaient
même pas conscience de leur cruauté.
Quand Palikare vit qu’au lieu de l’atteler à la roulotte, on lui passait un licol, il montra de la surprise, et plus encore quand Grain de Sel, qui ne voulait pas faire à pied la longue route de Charonne au Marché aux chevaux, lui monta sur le dos en se servant d’une chaise ; mais comme Perrine le tenait par la tête et lui parlait cette surprise n’alla pas jusqu’à la résistance : Grain de Sel d’ailleurs n’était-il pas un ami ?
Ils partirent ainsi, Palikare marchant gravement, conduit par Perrine et à travers des rues, où il n’y avait que peu de voitures et de passants, ils arrivèrent à un pont très large, aboutissant à un grand jardin.
« C’est le Jardin des Plantes, dit Grain de Sel, je suis sûr qu’ils n’ont pas un âne comme le tien.
— Alors on pourrait peut-être le leur vendre », dit Perrine pensant que dans un jardin zoologique les bêtes n’ont qu’à se promener.
Mais Grain de Sel n’accueillit pas cette idée :
« Des affaires avec le gouvernement, dit-il, il n’en faut pas… parce que le gouvernement… »
Il n’avait pas la confiance de Grain de Sel, le gouvernement.
Maintenant la circulation des voitures et des tramways était si active que Perrine avait besoin de toute son attention pour se diriger au milieu de leur encombrement, aussi n’avait-elle d’yeux ni d’oreilles pour rien autre chose, ni pour les monuments devant lesquels ils passaient, ni pour les plaisanteries que les charretiers et les cochers leur adressaient, mis en gaieté et en esprit par l’attitude de Grain de Sel sur l’âne. Mais lui, qui n’avait pas les mêmes préoccupations, n’était pas embarrassé pour leur répondre joyeusement, et cela faisait sur leur parcours un concert de cris et de rires, auquel les passants des trottoirs mêlaient leur mot.
Enfin, après une légère montée, ils arrivèrent devant une grande grille au delà de laquelle s’étendait un vaste espace que des lisses séparaient en divers compartiments dans lesquels se trouvaient des chevaux ; alors Grain de Sel mit pied à terre.
Mais pendant qu’il descendait, Palikare avait eu le temps de regarder devant lui, et, quand Perrine voulut lui faire franchir la grille, il refusa d’avancer. Avait-il deviné que c’était un marché où l’on vendait les chevaux et les ânes ? Avait-il peur ? Toujours est-il que malgré les paroles que Perrine lui adressait sur le ton du commandement ou de l’affection, il persista dans sa résistance. Grain de Sel crut qu’en le poussant par derrière il le ferait avancer, mais Palikare, qui ne devina pas quelle main se permettait cette familiarité sur sa croupe, se mit à ruer en reculant et en entraînant Perrine.
Quelques curieux s’étaient aussitôt arrêtés et faisaient cercle autour d’eux ; le premier rang étant comme toujours occupé par des porteurs de dépêches et des pâtissiers ; chacun disait son mot et donnait son conseil sur les moyens à employer pour l’obliger à passer la porte.
« V’là un âne qui donnera de l’agrément à l’imbécile qui l’achètera », dit une voix.
C’était là un propos dangereux qui pouvait nuire à la vente ; aussi Grain de Sel qui l’avait entendu, crut-il devoir protester.
« C’est un malin, dit-il, comme il a deviné qu’on va le vendre, il fait toutes ces grimaces pour ne pas quitter ses maîtres.
— Êtes-vous sûr de ça, Grain de Sel ? demanda la voix qui avait fait l’observation.
— Tiens, qu’est-ce qui sait mon nom ici ?
— Vous ne reconnaissez pas La Rouquerie ?
— C’est ma foi vrai. »
Et ils se donnèrent la main.
« C’est à vous l’âne ?
— Non, c’est à cette petite.
— Vous le connaissez ?
Nous avons bu plus d’un verre ensemble : si vous avez besoin d’un bon âne, je vous le recommande.
— J’en ai besoin, sans en avoir besoin.
— Alors allons prendre quelque chose. Ce n’est pas la peine de payer un droit là dedans.
— D’autant mieux qu’il paraît décidé à ne pas entrer.
— Je vous dis que c’est un malin.
— Si je l’achète ce n’est pas pour faire des malices, ni pour boire des verres, mais pour travailler.
— Dur à la peine ; il vient de Grèce, sans s’arrêter.
— De Grèce !… »
Grain de Sel avait fait un signe à Perrine, qui les suivait n’entendant que quelques mots de leur conversation, et, docile, maintenant qu’il n’avait plus à entrer dans le marché, Palikare venait derrière elle, sans même qu’elle eût à tirer sur le licol.
Qu’était cet acquéreur ? Un homme ? Une femme ? Par la démarche et le visage non barbu, une femme de cinquante ans environ. Par le costume composé d’une blouse et d’un pantalon, d’un chapeau en cuir comme ceux des cochers d’omnibus, et aussi par une courte pipe noire qui ne quittait pas sa bouche, un homme. Mais c’était son air qui était intéressant pour les inquiétudes de Perrine, et il n’avait rien de dur ni de méchant.
Après avoir pris une petite rue, Grain de Sel et La Rouquerie s’étaient arrêtés devant la boutique d’un marchand de vin, et, sur une table du trottoir on leur avait apporté une bouteille avec deux verres, tandis que Perrine restait dans la rue devant eux, tenant toujours son âne.
« Vous allez voir s’il est malin », dit Grain de Sel en avançant son verre plein.
Tout de suite Palikare allongea le cou et de ses lèvres pincées aspira la moitié du verre, sans que Perrine osât l’en empêcher.
« Hein ! » dit Grain de Sel triomphant.
Mais La Rouquerie ne partagea pas cette satisfaction :
« Ce n’est pas pour boire mon vin que j’en ai besoin, mais pour traîner ma charrette et mes peaux de lapin.
— Puisque je vous dis qu’il vient de Grèce attelé à une roulotte.
— Ça, c’est autre chose. »
Et l’examen de Palikare commença en détail et avec attention ; quand il fut terminé, La Rouquerie demanda à Perrine combien elle voulait le vendre. Le prix qu’elle avait arrêté à l’avance avec Grain de Sel était de cent francs ; ce fut celui qu’elle dit.
Mais La Rouquerie poussa les hauts cris : « cent francs, un âne vendu sans garantie ! C’était se moquer du monde. » Et le malheureux Palikare eut à subir une démolition en règle, du bout du nez aux sabots. « Vingt francs, c’était tout ce qu’il valait ; et encore…
— C’est bon, dit Grain de Sel après une longue discussion, nous allons le conduire au marché. »
Perrine respira, car la pensée de n’obtenir que vingt francs l’avait anéantie ; que seraient vingt francs dans leur détresse ; alors que cent ne devaient même pas suffire à leurs besoins les plus pressants ?
« Savoir s’il voudra entrer cette fois plutôt que la première », dit La Rouquerie.
Jusqu’à la grille du marché, il suivit sa maîtresse docilement, mais arrivé là il s’arrêta, et comme elle insistait en lui parlant et en le tirant, il se coucha au beau milieu de la rue.
« Palikare, je t’en prie, s’écria Perrine éplorée, Palikare ! »
Mais il fit le mort sans vouloir rien entendre.
De nouveau on s’était rassemblé autour d’eux et l’on plaisantait.
« Mettez-lui le feu à la queue, dit une voix.
— Ça sera fameux pour le faire vendre, répondit une autre.
— Tapez dessus. »
Grain de Sel était furieux, Perrine désespérée.
« Vous voyez bien qu’il n’entrera pas, dit La Rouquerie, j’en donne trente francs parce que sa malice prouve que c’est un bon garçon ; mais, dépêchez-vous de les prendre ou j’en achète un autre. »
Grain de Sel consulta Perrine d’un coup d’œil, lui faisant en même temps signe qu’elle devait accepter. Cependant elle restait paralysée par la déception, sans pouvoir se décider, quand un sergent de ville vint lui dire rudement de débarrasser la rue :
« Avancez ou reculez, ne restez pas là. »
Comme elle ne pouvait pas avancer puisque Palikare ne le voulait pas, il fallait bien reculer ; aussitôt qu’il comprit qu’elle renonçait à entrer, il se releva et la suivit avec une parfaite docilité en remuant les oreilles d’un air de contentement.
« Maintenant, dit La Rouquerie après avoir mis trente francs en pièces de cent sous dans la main de Perrine, il faut me conduire ce bonhomme-là chez moi, car je commence à le connaître, il serait bien capable de ne pas vouloir me suivre ; la rue du Château-des-Rentiers n’est pas si loin. »
Mais Grain de Sel n’accepta pas cet arrangement, la course serait trop longue pour lui.
« Va avec madame, dit-il à Perrine, et ne te désole pas trop, ton âne ne sera pas malheureux avec elle, c’est une bonne femme.
— Et comment retrouver Charonne ? dit-elle, se voyant perdue dans ce Paris, dont pour la première fois elle venait de pressentir l’immensité.
— Tu suivras les fortifications, rien de plus facile. »
En effet, la rue du Château-des-Rentiers n’est pas bien loin du Marché aux chevaux, et il ne leur fallut pas longtemps pour arriver devant un amas de bicoques qui ressemblaient à celles du Champ Guillot.
Le moment de la séparation était venu, et ce fut en lui mouillant la tête de ses larmes qu’elle l’embrassa après l’avoir attaché dans une petite écurie.
« Il ne sera pas malheureux, je te le promets, dit La Rouquerie.
— Nous nous aimions tant ! »


V
« Qu’allaient-elles faire de trente francs, quand c’était sur cent qu’elles avaient établi leurs calculs ? »
Elle agita cette question en suivant tristement les fortifications depuis la Maison-Blanche jusqu’à Charonne, mais sans lui trouver de réponses acceptables ; aussi, quand elle remit entre les mains de sa mère l’argent de La Rouquerie, ne savait-elle pas du tout à quoi et comment il allait être employé.
Ce fut sa mère qui en décida :
« Il faut partir, dit-elle, partir tout de suite pour Maraucourt.
— Es-tu assez bien ?
— Il faut que je le sois. Nous n’avons que trop attendu, en espérant un rétablissement qui ne viendra pas… ici. Et en attendant nos ressources se sont épuisées, comme s’épuiseraient celles que la vente de notre pauvre Palikare nous procure. J’aurais voulu aussi ne pas nous présenter dans cet état de misère ; mais peut-être que plus cette misère sera lamentable plus elle fera pitié. Il faut, il faut partir.
— Aujourd’hui ?
— Aujourd’hui il est trop tard, nous arriverions en pleine nuit sans savoir où aller, mais demain matin. Ce soir tâche d’apprendre les heures du train et le prix des places : le chemin de fer est celui du Nord ; la gare d’arrivée, Picquigny. »
Perrine, embarrassée, consulta Grain de Sel qui lui dit, qu’en cherchant dans les tas de papiers, elle trouverait certainement un indicateur des chemins de fer, ce qui serait plus commode, et moins fatigant que d’aller à la gare du Nord, qui est bien loin de Charonne. Cet indicateur lui apprit qu’il y avait deux trains le matin : l’un à six heures, l’autre à dix heures, et que la place pour Picquigny en troisièmes classes coûtait neuf francs vingt-cinq.
« Nous partirons à dix heures, dit la mère, et nous prendrons une voiture, car je ne pourrais certainement pas aller à pied à la gare puisqu’elle est éloignée. J’aurai bien des forces jusqu’au fiacre. »
Cependant elle n’en eut pas jusque-là, et quand, à neuf heures, elle voulut, en s’appuyant sur l’épaule de sa fille, gagner la voiture que Perrine avait été chercher, elle ne put pas y arriver, bien que la distance ne fût pas longue de leur chambre à la rue : le cœur lui manqua, et si Perrine ne l’avait pas soutenue elle serait tombée.
« Je vais me remettre, dit-elle faiblement, ne t’inquiète pas, cela va aller. »
Mais cela n’alla pas, et il fallut que la Marquise qui les regardait partir apportât une chaise ; c’était un effort désespéré qui l’avait soutenue. Assise, elle eut une syncope, la respiration s’arrêta, la voix lui manqua.
« Il faudrait l’allonger, dit la Marquise, la frictionner ; ce ne sera rien, ma fille, n’aie pas peur ; va chercher La Carpe ; à nous deux nous la porterons dans votre chambre ; vous ne pouvez pas partir… tout de suite. »
C’était une femme d’expérience que la Marquise ; presque aussitôt que la malade eut été allongée, le cœur reprit ses mouvements, et la respiration se rétablit ; mais au bout d’un certain temps, comme elle voulut s’asseoir, une nouvelle défaillance se produisit.
« Vous voyez qu’il faut rester couchée, dit la Marquise sur le ton du commandement, vous partirez demain, et tout de suite vous prendrez une tasse de bouillon que je vais demander à La Carpe ; car c’est son vice à ce muet-là que le bouillon, comme le vin est celui de monsieur notre propriétaire ; hiver comme été, il se lève à cinq heures pour mettre son pot-au-feu, et fameux qu’il le fait ! il n’y a pas beaucoup de bourgeois qui en mangent d’aussi bon. »
Sans attendre une réponse, elle entra chez leur voisin qui s’était remis au travail.
« Voulez-vous me donner une tasse de bouillon pour notre malade ? » demanda-t-elle.
Ce fut par un sourire qu’il répondit, et tout de suite il ôta le couvercle de son pot en terre qui bouillottait dans la cheminée devant un petit feu de bois ; alors comme le fumet du bouillon se répandait dans la pièce il regarda la Marquise, les yeux écarquillés, les narines dilatées avec une expression de béatitude en même temps que de fierté.
« Oui ça sent bon, dit-elle, et si ça pouvait sauver la pauvre femme, ça la sauverait : mais, — elle baissa la voix, — vous savez elle est bien mal ; ça ne peut pas durer longtemps. »
La Carpe leva les bras au ciel.
« C’est bien triste pour cette petite. »
La Carpe inclina la tête et étendit les bras par un geste qui disait :
« Qu’y pouvons-nous ? »
Et de fait, ce qu’ils pouvaient, ils le faisaient l’un et l’autre, mais le malheur est chose si habituelle aux malheureux qu’ils ne s’en étonnent pas, pas plus qu’ils ne s’en révoltent. Qui d’eux n’a pas à souffrir en ce monde ? Toi aujourd’hui, moi demain.
Quand le bol fut rempli, la Marquise l’emporta en trottinant pour ne pas perdre une goutte de bouillon.
« Prenez ça, ma chère dame, dit-elle en s’agenouillant auprès du matelas, et surtout ne bougez pas, entr’ouvrez seulement les lèvres. »
Délicatement, une cuillerée de bouillon lui fut versée dans la bouche ; mais, au lieu de passer, elle provoqua des nausées

et une nouvelle syncope qui se prolongea plus que les deux premières.
Décidément le bouillon n’était pas ce qui convenait, la Marquise le reconnut et, pour qu’il ne fût pas perdu, elle obligea Perrine à le boire.
« Vous aurez besoin de forces, ma petite, il faut vous soutenir. »
N’ayant pas, avec son bouillon, qui pour elle était le remède à tous les maux, obtenu le résultat qu’elle attendait, la Marquise se trouva à bout d’expédients, et n’imagina rien de mieux que d’aller chercher le médecin : peut-être ferait-il quelque chose.
Mais, bien qu’il eût formulé une ordonnance, il déclara franchement à la Marquise, en partant, qu’il ne pouvait rien pour la malade :
« C’est une femme épuisée par le mal, la misère, les fatigues et le chagrin ; elle partait, qu’elle serait morte en wagon ; ce n’est plus qu’une affaire d’heures qu’une syncope réglera probablement. »
C’en fut une de jours, car la vie, si prompte à s’éteindre dans la vieillesse, est plus résistante dans la jeunesse : sans aller mieux, la malade n’allait pas plus mal, et bien qu’elle ne pût rien avaler, ni bouillon ni remèdes, elle durait étendue sur son matelas, sans mouvements, presque sans respiration, engourdie dans la somnolence.
Aussi Perrine se reprenait-elle à espérer : l’idée de la mort, qui obsède les gens âgés et la leur montre partout, tout près, alors même qu’elle reste loin encore, est si répulsive pour les jeunes, qu’ils se refusent à la voir, même quand elle est là menaçante. Pourquoi sa mère ne guérirait-elle point ? Pourquoi mourrait-elle ? C’est à cinquante ans, à soixante ans qu’on meurt, et elle n’en avait pas trente ! Qu’avait-elle fait pour être condamnée à une mort précoce, elle, la plus douce des femmes, la plus tendre des mères, qui n’avait jamais été que bonne pour les siens et pour tous ? Cela n’était pas possible. Au contraire, la guérison l’était. Et elle trouvait les meilleures raisons pour se le prouver, même dans cette somnolence qu’elle se disait n’être qu’un repos tout naturel après tant de fatigues et de privations. Quand, malgré tout, le doute l’étreignait trop cruellement, elle demandait conseil à la Marquise, et celle-ci la confirmait dans son espérance :
« Puisqu’elle n’est pas morte dans sa première syncope, c’est qu’elle ne doit pas mourir.
— N’est-ce pas ?
— C’est ce que pensent aussi Grain de Sel et La Carpe. »
Maintenant, sa plus grande inquiétude, puisque du côté de sa mère on la rassurait comme elle se rassurait elle-même, était de se demander combien dureraient les trente francs de La Rouquerie, car, si minimes que fussent leurs dépenses, ils filaient cependant terriblement vite, tantôt pour une chose, tantôt pour une autre, surtout pour l’imprévu. Quand le dernier sou serait dépensé, où iraient-elles ? Où trouveraient-elles une ressource, si faible qu’elle fût, puisqu’il ne leur restait plus rien, rien, rien que les guenilles de leur vêtement ? Comment iraient-elles à Maraucourt ?
Quand elle suivait ces pensées, près de sa mère, il y avait des moments où, dans son angoisse, ses nerfs se tendaient avec une intensité si poignante, qu’elle se demandait, baignée de sueur, si elle aussi n’allait pas succomber dans une syncope. Un soir qu’elle se trouvait dans cet état d’appréhension et d’anéantissement, elle sentit que la main de sa mère, qu’elle tenait dans les siennes, la serrait.
« Tu veux quelque chose ? demanda-t-elle vivement, ramenée par cette pression dans la réalité.
— Te parler, car l’heure est venue des dernières et suprêmes paroles.
— Oh ! maman…
— Ne m’interromps pas, ma fille chérie, et tâche de contenir ton émotion comme je tâcherai de ne pas céder au désespoir. J’aurais voulu ne pas t’effrayer, et c’est pour cela que jusqu’à présent je me suis tue, pour ménager ta douleur, mais ce que j’ai à dire doit être dit, si cruel que cela soit pour nous deux. Je serais une mauvaise mère, faible et lâche, au moins je serais imprudente de reculer encore. »
Elle fit une pause, autant pour respirer que pour affermir ses idées vacillantes.
« Il faut nous séparer… »
Perrine eut un sanglot que malgré ses efforts elle ne put contenir.
« Oui, c’est affreux, chère enfant, et pourtant j’en suis à me demander si après tout il ne vaut pas mieux pour toi que tu sois orpheline, que d’être présentée par une mère qu’on repousserait. Enfin Dieu le veut, tu vas rester seule,… dans quelques heures, demain peut-être. »
L’émotion lui coupa la parole, et elle ne put la reprendre qu’après un certain temps.
« Quand je… ne serai plus, tu auras des formalités à accomplir ; pour cela tu prendras dans ma poche un papier enveloppé dans une double soie et tu le donneras à ceux qui te le demanderont : c’est mon acte de mariage, et l’on y trouvera mes noms et ceux de ton père. Tu exigeras qu’on te le rende, car il doit t’être utile plus tard pour établir ta naissance. Tu le garderas donc avec grand soin. Cependant comme tu peux le perdre, tu l’apprendras par cœur de façon à ne l’oublier jamais : le jour où tu aurais besoin de le montrer, tu en demanderais un autre. Tu m’entends bien ; tu retiens tout ce que je te dis ?
— Oui, maman, oui.
— Tu seras bien malheureuse, bien anéantie, mais il ne faut pas t’abandonner… quand tu n’auras plus rien à faire à Paris et que tu seras seule, toute seule. Alors tu dois partir immédiatement pour Maraucourt : par le chemin de fer, si tu as assez d’argent pour payer ta place ; à pied, si tu n’en as pas ; mieux vaut encore coucher dans le fossé de la route et ne pas manger que rester à Paris. Tu me le promets ?
— Je te le promets…
— Si grande est l’horreur de notre situation que ce m’est presque un soulagement de penser qu’il en sera ainsi. »
Cependant ce soulagement ne fut pas assez fort pour la défendre contre une nouvelle faiblesse, et pendant un temps assez long elle resta sans respiration, sans voix, sans mouvement.
— Maman, dit Perrine penchée sur elle, toute tremblante d’anxiété, éperdue de désespoir, maman ! »
Cet appel la ranima :
« Tout à l’heure, dit-elle si faiblement que ses paroles ne furent qu’un murmure entrecoupé d’arrêts, j’ai encore des recommandations à te faire, il faut que je te les fasse ; mais je ne sais plus ce que je t’ai déjà dit, attends. »
Après un moment, elle reprit :
« C’est cela, oui c’est cela : tu arrives à Maraucourt ; ne brusque rien ; tu n’as le droit de rien réclamer, ce que tu obtiendras ce sera par toi-même, par toi seule, en étant bonne, en te faisant aimer… Te faire aimer,… pour toi, tout est là… Mais j’ai espoir,… tu te feras aimer ;… il est impossible qu’on ne t’aime pas… Alors les malheurs seront finis. »
Elle joignit les mains et son regard prit une expression d’extase :
« Je te vois,… oui je te vois heureuse… Ah que je meure avec cette pensée, et l’espérance de vivre à jamais dans ton cœur. »
Cela fut dit avec l’exaltation d’une prière qu’elle jetait vers le ciel ; puis aussitôt, comme si elle s’était épuisée dans cet effort, elle retomba sur son matelas, à bout, inerte, mais non syncopée cependant, ainsi que le prouvait sa respiration pantelante.
Perrine attendit quelques instants, puis, voyant que sa mère restait dans cet état, elle sortit. À peine fut-elle dans l’enclos qu’elle éclata en sanglots et se laissa tomber sur l’herbe : le cœur, la tête, les jambes lui manquaient pour s’être trop longtemps contenue.
Pendant quelques minutes elle resta là brisée, suffoquée, puis comme malgré son anéantissement la conscience persistait en elle qu’elle ne devait pas laisser sa mère seule, elle se leva pour tâcher de se calmer un peu, au moins à la surface, en arrêtant ses larmes et ses spasmes de désespoir.
Et par le clos qui s’emplissait d’ombres elle allait sans savoir où, droit devant elle ou tournant sur elle-même, ne contenant ses sanglots que pour les laisser éclater plus violents.
Comme elle passait ainsi devant le wagon pour la dixième fois peut-être, le marchand de sucre qui l’avait observée sortit de chez lui, deux bâtons de guimauve à la main et s’approchant d’elle :
« Tu as du chagrin ma fille, dit-il d’une voix apitoyée.
— Oh ! monsieur.
— Eh bien, tiens, prends ça — il tendit ses bâtons de sucre, — les douceurs c’est bon pour la peine. »


VI
L’aumônier des dernières prières venait de se retirer, et Perrine restait devant la fosse, quand la Marquise, qui ne l’avait pas quittée, passa son bras sous le sien :
« Il faut venir, dit-elle.
— Oh ! Madame…
— Allons, il faut venir, » répéta-t-elle avec autorité.
Et lui serrant le bras, elle l’entraîna.
Elles marchèrent ainsi pendant quelques instants, sans que Perrine eût conscience de ce qui se passait autour d’elle et comprît où l’on pouvait la conduire : sa pensée, son esprit, son cœur, sa vie étaient restés avec sa mère.
Enfin on s’arrêta dans une allée déserte et elle vit autour d’elle la Marquise qui l’avait lâchée, Grain de Sel, La Carpe, et le marchand de sucre, mais ce fut vaguement qu’elle les reconnut : la Marquise avait des rubans noirs à son bonnet, Grain de Sel était habillé en monsieur et coiffé d’un chapeau à haute forme, La Carpe avait remplacé son éternel tablier de cuir par une redingote noisette qui lui descendait jusqu’aux pieds, et le marchand de sucre sa veste de coutil blanc par un veston de drap, car tous en vrais Parisiens qui pratiquent le culte de la Mort, avaient tenu à se mettre en grande tenue pour honorer celle qu’ils venaient d’enterrer.
« C’est pour te dire, petite, commença Grain de Sel, qui crut pouvoir prendre le premier la parole comme étant le personnage le plus important de la compagnie, c’est pour te dire que tu peux loger au Champ Guillot tant que tu voudras, sans payer.
— Si tu veux chanter avec moi, continua la Marquise, tu gagneras ta vie : c’est un joli métier.
— Si tu aimes mieux la confiserie, dit le marchand de sucre de guimauve, je te prendrai : c’est aussi un joli métier, et un vrai. »
La Carpe ne dit rien, mais avec un sourire de sa bouche close et un geste de sa main qui semblait présenter quelque chose, il exprima clairement l’offre qu’il faisait à son tour : à savoir que toutes les fois qu’elle aurait besoin d’une tasse de bouillon, elle en trouverait une chez lui, et du fameux.
Ces propositions s’enchaînant ainsi emplirent de larmes les yeux de Perrine, et la douceur de celles-là lava l’âcreté de celles qui depuis deux jours la brûlaient.
« Comme vous êtes bons pour moi ! murmura-t-elle.
— On fait ce qu’on peut, dit Grain de Sel.
— On ne doit pas laisser une brave fille comme toi sur le pavé de Paris, répondit la Marquise.
— Je ne dois pas rester à Paris, répondit Perrine, il faut que je parte tout de suite pour aller chez des parents.
— T’as des parents ? interrompit Grain de Sel en regardant les autres d’un air qui signifiait que ces parents-là ne valaient pas cher ; où sont-ils tes parents ?
— Au delà d’Amiens.
— Et comment veux-tu aller à Amiens ? Tu as de l’argent ?
— Pas assez pour prendre le chemin de fer ; c’est pourquoi j’irai à pied.
— Tu sais la route ?
— J’ai une carte dans ma poche.
— Ta carte te donne-t-elle ton chemin dans Paris pour trouver la route d’Amiens ?
— Non ; mais si vous voulez me l’indiquer. »
Chacun s’empressa de lui donner cette indication, et ce fut une confusion d’explications contradictoires, auxquelles Grain de Sel coupa court.
« Si tu veux te perdre dans Paris, dit-il, tu n’as qu’à les écouter. V’là ce que tu dois faire : prendre le chemin de fer de ceinture jusqu’à la Chapelle-Nord ; là tu trouveras la route d’Amiens, que tu n’auras plus qu’à suivre tout droit ; ça te coûtera six sous. Quand veux-tu partir ?
— Tout de suite ; je l’ai promis à maman de partir tout de suite.
— Il faut obéir à ta mère, dit la Marquise, Pars donc, mais pas avant que je t’embrasse ; tu es une brave fille. »
Les hommes lui donnèrent une poignée de main.
Elle n’avait plus qu’à sortir du cimetière, cependant elle hésita et se retourna vers la fosse qu’elle venait de quitter ; alors la Marquise, devinant sa pensée, intervint :
« Puisqu’il faut que tu partes, pars tout de suite, c’est le mieux.
— Oui pars », dit Grain de Sel.
Elle leur adressa à tous un salut de la tête et des deux mains dans lequel elle mit toute sa reconnaissance, puis elle s’éloigna à pas pressés, le dos tendu comme si elle se sauvait.
« J’offre un verre, dit Grain de Sel.
— Ça ne fera pas de mal », répondit la Marquise.
Pour la première fois La Carpe lâcha une parole et dit :
« Pauvre petite. »
Quand Perrine fut montée dans le chemin de fer de ceinture, elle tira de sa poche une vieille carte routière de France qu’elle avait consultée bien des fois depuis leur sortie d’Italie, et dont elle savait se servir. De Paris à Amiens sa route était facile, il n’y avait qu’à prendre celle de Calais que suivaient autrefois les malles-poste et qu’un petit trait noir indiquait sur sa carte par Saint-Denis, Écouen, Luzarches, Chantilly, Clermont et Breteuil ; à Amiens elle la quitterait pour celle de Boulogne ; et, comme elle savait aussi évaluer les distances, elle calcula que jusqu’à Maraucourt cela devait donner environ cent cinquante kilomètres ; si elle faisait trente kilomètres par jour régulièrement, il lui faudrait donc six jours pour son voyage.
Mais pourrait-elle faire ces trente kilomètres régulièrement et les recommencer le lendemain ?
Justement parce qu’elle avait l’habitude de la marche pour avoir cheminé pendant des lieues et des lieues à côté de Palikare, elle savait que ce n’est pas du tout la même chose de faire trente kilomètres par hasard, que de les répéter jour après jour ; les pieds s’endolorissent, les genoux deviennent raides. Et puis que serait le temps pendant ces six journées de voyage ? Sa sérénité durerait-elle ? Sous le soleil elle pouvait marcher, si chaud qu’il fût. Mais que ferait-elle sous la pluie, n’ayant pour se couvrir que des guenilles ? Par une belle nuit d’été elle pouvait très bien coucher en plein air, à l’abri d’un arbre ou d’une cépée. Mais le toit de feuilles qui reçoit la rosée, laisse passer la pluie et n’en rend ses gouttes que plus grosses. Mouillée elle l’avait été bien souvent, et une ondée, une averse même ne lui faisaient pas peur ; mais pourrait-elle rester mouillée pendant six jours, du matin au soir et du soir au matin ?
Quand elle avait répondu à Grain de Sel qu’elle n’avait pas assez d’argent pour prendre le chemin de fer, elle laissait entendre comme elle l’entendait elle-même, qu’elle en aurait assez pour son voyage à pied ; seulement c’était à condition que ce voyage ne se prolongerait pas.
En réalité, elle avait cinq francs trente-cinq centimes en quittant le Champ Guillot, et comme elle venait de payer sa place six sous, il lui restait une pièce de cinq francs et un sou qu’elle entendait sonner dans la poche de sa jupe, quand elle remuait trop brusquement.
Il fallait donc qu’elle fît durer cet argent autant que son voyage, et même plus longtemps, de façon à pouvoir vivre quelques jours à Maraucourt.
Cela lui serait-il possible ?
Elle n’avait pas résolu cette question et toutes celles qui s’y rattachaient, quand elle entendit appeler la station de La Chapelle, alors elle descendit, et tout de suite prit la route de Saint-Denis.
Maintenant il n’y avait qu’à aller droit devant soi et comme le soleil resterait encore au ciel deux ou trois heures, elle espérait se trouver, quand il disparaîtrait, assez loin de Paris pour pouvoir coucher en pleine campagne, ce qui était le mieux pour elle.
Cependant, contre son attente, les maisons succédaient aux maisons, les usines aux usines sans interruption, et aussi loin que ses yeux pouvaient aller, elle ne voyait dans cette plaine plate que des toits et des hautes cheminées qui jetaient des tourbillons de fumée noire ; de ces usines, des hangars, des chantiers sortaient des bruits formidables, des mugissements, des ronflements de machines, des sifflements aigus ou rauques, des échappements de vapeur, tandis que sur la route même dans un épais nuage de poussière rousse, voitures, charrettes, tramways se suivaient, ou se croisaient en files serrées ; et sur celles de ces charrettes qui avaient des bâches ou des prélarts l’inscription qui l’avait déjà frappée à la barrière de Bercy se répétait : « usines de Maraucourt, Vulfran Paindavoine ».
Paris ne finirait donc jamais ! Elle n’en sortirait donc pas ! Et ce n’était pas de la solitude des champs qu’elle avait peur, du silence de la nuit, des mystères de l’ombre, c’était de Paris, de ses maisons, de sa foule, de ses lumières.
Une plaque bleue fixée à l’angle d’une maison lui apprit

qu’elle entrait dans Saint-Denis alors qu’elle se croyait toujours à Paris, et cela lui donna bon espoir : après Saint-Denis commencerait certainement la campagne.
Avant d’en sortir, bien qu’elle ne se sentît aucun appétit, l’idée lui vint d’acheter un morceau de pain qu’elle mangerait avant de s’endormir et elle entra chez un boulanger :
« Voulez-vous me vendre une livre de pain ?
— Tu as de l’argent ? » demanda la boulangère à qui sa tenue n’inspirait pas confiance.
Elle mit sur le comptoir derrière lequel la boulangère était assise, sa pièce de cinq francs.
« Voici cinq francs ; je vous prie de me rendre la monnaie. »
Avant de couper la livre de pain qu’on lui demandait, la boulangère prit la pièce de cinq francs et l’examina.
« Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda-t-elle en la faisant sonner sur le marbre du comptoir.
— Vous voyez bien c’est cinq francs.
— Qu’est-ce qui t’a dit d’essayer de me passer cette pièce ?
— Personne ; je vous demande une livre de pain pour mon dîner.
— Eh bien tu n’en auras pas de pain, et je t’engage à filer au plus vite si tu ne veux pas que je te fasse arrêter. »
Perrine n’était point en situation de tenir tête :
« Pourquoi m’arrêter ? balbutia-t-elle.
— Parce que tu es une voleuse…
— Oh ! madame.
— … Qui veut me passer une pièce fausse. Vas-tu te sauver, voleuse, vagabonde. Attends un peu que j’appelle un sergent de ville. »
Perrine avait conscience de n’être pas une voleuse, bien qu’elle ne sût pas si sa pièce était bonne ou fausse ; mais vagabonde elle l’était puisqu’elle n’avait ni domicile ni parents. Que répondrait-elle au sergent de ville ? Comment se défendrait-elle, si on l’arrêtait ? Que ferait-on d’elle ?
Toutes ces questions lui traversèrent l’esprit avec la rapidité de l’éclair, cependant telle était sa détresse qu’avant d’obéir à la peur qui commençait à la serrer à la gorge, elle pensa à sa pièce :
« Si vous ne voulez pas me donner du pain, au moins rendez-moi ma pièce, dit-elle en étendant la main.
— Pour que tu la passes ailleurs n’est-ce pas ? Je la garde ta pièce. Si tu la veux, va chercher un sergent de ville, nous l’examinerons ensemble. En attendant fiche-moi le camp et plus vite que ça, voleuse. »
Les cris de la boulangère qui s’entendaient de la rue avaient arrêté trois ou quatre passants et des propos s’échangeaient entre eux curieusement :
« Qu’est-ce que c’est ?
— C’te fille qui a voulu forcer le tiroir de la boulangère.
— Elle marque mal.
— N’y a donc jamais de police quand on en a besoin. »
Affolée Perrine se demandait si elle pourrait sortir ; cependant on la laissa passer, mais en l’accompagnant d’injures et de huées, sans qu’elle osât se sauver à toutes jambes comme elle en avait envie, ni se retourner pour voir si on ne la poursuivait point.
Enfin après quelques minutes, qui pour elle furent des heures, elle se trouva dans la campagne, et malgré tout elle respira : pas arrêtée ! plus d’injures !
Il est vrai qu’elle pouvait se dire aussi : pas de pain, plus d’argent ; mais cela c’était l’avenir ; et ceux qui, aux trois quarts noyés, remontent à la surface de l’eau, n’ont pas pour première pensée de se demander comment ils souperont le soir et dîneront le lendemain.
Cependant après les premiers moments donnés au soulagement de la délivrance cette pensée du dîner s’imposa brutalement, sinon pour le soir même, en tout cas pour le lendemain et les jours suivants. Elle n’était pas assez enfant pour imaginer que la fièvre du chagrin la nourrirait toujours, et savait qu’on ne marche pas sans manger. En combinant son voyage elle n’avait compté pour rien les fatigues de la route, le froid des nuits et la chaleur du jour, tandis qu’elle comptait pour tout la nourriture que sa pièce de cinq francs lui assurait ; mais maintenant qu’on venait de lui prendre ses cinq francs et qu’il ne lui restait plus qu’un sou, comment achèterait-elle la livre de pain qu’il lui fallait chaque jour ? Que mangerait-elle ?
Instinctivement elle jeta un regard, de chaque côté de la route où dans les champs sous la lumière rasante du soleil couchant s’étalaient des cultures : des blés qui commençaient à fleurir, des betteraves qui verdoyaient, des oignons, des choux, des luzernes, des trèfles ; mais rien de tout cela ne se mangeait, et d’ailleurs alors même que ces champs eussent été plantés de melons mûrs ou de fraisiers chargés de fruits, à quoi cela lui eût-il servi ? elle ne pouvait pas plus étendre la main pour cueillir melons et fraises, qu’elle ne pouvait la tendre pour implorer la charité des passants ; ni voleuse, ni mendiante, vagabonde.
Ah ! comme elle eût voulu en rencontrer une aussi misérable qu’elle, pour lui demander de quoi vivent les vagabonds le long des chemins qui traversent les pays civilisés.
Mais y avait-il au monde aussi misérable, aussi malheureuse qu’elle, seule, sans pain, sans toit, sans personne pour la soutenir, accablée, écrasée, le cœur étranglé, le corps enfiévré par le chagrin ?
Et cependant il fallait qu’elle marchât, sans savoir si au but une porte s’ouvrirait devant elle.
Comment pourrait-elle arriver à ce but ?
Tous nous avons dans notre vie quotidienne des heures de vaillance ou d’abattement pendant lesquelles le fardeau que nous avons à traîner se fait ou plus lourd ou plus léger ; pour elle c’était le soir qui l’attristait toujours, même sans raison ; mais combien plus pesamment quand, à l’inconscient, s’ajoutait le poids des douleurs personnelles et immédiates qu’elle avait en ce moment à supporter.
Jamais elle n’avait éprouvé pareil embarras à réfléchir, pareille difficulté à prendre parti, et il lui semblait qu’elle était vacillante, comme une chandelle qui va s’éteindre sous le souffle d’un grand vent, s’abattant sans résistance possible tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, folle.
Combien mélancolique était-elle cette belle et radieuse soirée d’été, sans nuages au ciel, sans souffle d’air, d’autant plus triste pour elle qu’elle était plus douce et plus gaie aux autres, aux villageois assis sur le pas de leur porte avec l’expression heureuse de la journée finie ; aux travailleurs qui revenaient des champs et respiraient déjà la bonne odeur de la soupe du soir ; même aux chevaux qui se hâtaient parce qu’ils sentaient l’écurie où ils allaient se reposer devant leur râtelier garni.
Lorsqu’elle sortit de ce village, elle se trouva à la croisée de deux grandes routes qui toutes deux conduisaient à Calais, l’une par Moisselles, l’autre par Écouen, disait le poteau posé à leur intersection ; ce fut celle-là qu’elle prit.


VII
Bien qu’elle commençât à avoir les jambes lasses et les pieds endoloris, elle eût voulu marcher encore, car à faire la route dans la fraîcheur du soir et la solitude, sans que personne s’inquiétât d’elle, elle eût trouvé une tranquillité que le jour ne lui donnait pas. Mais, si elle prenait ce parti, elle devrait s’arrêter quand elle serait trop fatiguée, et alors, ne pouvant pas se choisir une bonne place dans l’obscurité de la nuit, elle n’aurait pour se coucher que le fossé du chemin ou le champ voisin, ce qui n’était pas rassurant. Dans ces conditions, le mieux était donc qu’elle sacrifiât son bien-être à sa sécurité et profitât des dernières clartés du soir pour chercher un endroit où, cachée et abritée, elle pourrait dormir en repos. Si les oiseaux se couchent de bonne heure, quand il fait encore clair, n’est-ce pas pour mieux choisir leur gîte : les bêtes maintenant devaient lui servir d’exemple, puisqu’elle vivait de leur vie.
Elle n’eut pas loin à aller pour en rencontrer un qui lui parut réunir toutes les garanties qu’elle pouvait souhaiter. Comme elle passait le long d’un champ d’artichauts, elle vit un paysan occupé avec une femme à en cueillir les têtes qu’ils plaçaient dans des paniers ; aussitôt remplis, ils chargeaient ces paniers dans une voiture restée sur la route. Machinalement elle s’arrêta pour regarder ce travail, et à ce moment arriva une autre charrette que conduisait, assise sur le limon, une fillette rentrant au village.
« Vous avez cueillé vos artichauts, cria-t-elle ?
— C’est pas trop tôt, répondit le paysan ; pas drôle de coucher là toutes les nuits pour veiller aux galvaudeux, au moins je vas dormir dans mon lit.
— Et la pièce à Monneau ?
— Monneau, il fait le malin ; il dit que les autres la gardent ; cette nuit ce ne sera toujours pas mé ; ce que c’ serait drôle si demain il se trouvait nettoyé ! »
Tous les trois partirent d’un gros rire qui disait qu’ils ne s’intéressaient pas précisément à la prospérité de ce Monneau qui exploitait la surveillance de ses voisins pour dormir tranquille lui-même.
« Ce que c’serait drôle !
— Attends, minute, nous rentrons ; nous avons fini. »
En effet, au bout de peu d’instants, les deux charrettes s’éloignèrent du côté du village.
Alors, de la route déserte Perrine put voir dans le crépuscule la différence qu’offraient les deux champs qui se touchaient, l’un complètement dépouillé de ses fruits, l’autre encore tout chargé de grosses têtes bonnes à couper ; sur leur limite se dressait une petite cabane en branchages dans laquelle le paysan avait passé les nuits qu’il regrettait tant à garder sa récolte et du même coup celle de son voisin. Combien heureuse eût-elle été d’avoir une pareille chambre à coucher !
À peine cette idée eut-elle traversé son esprit qu’elle se demanda pourquoi elle ne la prendrait pas cette chambre. Quel mal à cela puisqu’elle était abandonnée ? D’autre part, elle n’avait pas à craindre d’y être dérangée, puisque, le champ étant dépouillé maintenant, personne n’y viendrait. Enfin, un four à briques brûlant à une assez courte distance, il lui semblait qu’elle serait moins seule, et que ses flammes rouges qui tourbillonnaient dans l’air tranquille du soir lui tiendraient compagnie au milieu de ces champs déserts, comme le phare au marin sur la mer.
Cependant elle n’osa pas tout de suite aller prendre possession de cette cabane, car, un espace découvert assez grand s’étendant entre elle et la route, il valait mieux pour le traverser que l’obscurité se fût épaissie. Elle s’assit donc sur l’herbe du fossé et attendit en pensant à la bonne nuit qu’elle allait passer là, alors qu’elle en avait craint une si mauvaise. Enfin quand elle ne distingua plus que confusément les choses environnantes, choisissant un moment où elle n’entendait aucun bruit sur la route, elle se glissa en rampant à travers les artichauts et gagna la cabane qu’elle trouva encore mieux meublée qu’elle n’avait imaginé puisqu’une bonne couche de paille couvrait le sol, et qu’une botte de roseaux pouvait servir d’oreiller.
Depuis Saint-Denis, il en avait été d’elle comme d’une bête traquée, et plus d’une fois elle avait tourné la tête pour voir si les gendarmes à ses trousses n’allaient pas l’arrêter, afin d’éclaircir l’histoire de sa pièce fausse ; dans la cabane, ses nerfs crispés se détendirent, et, du toit qu’elle avait sur la tête, descendit en elle un apaisement avec un sentiment de sécurité mêlé de confiance qui la releva ; tout n’était donc pas perdu, tout n’était pas fini.
Mais en même temps elle fut surprise de s’apercevoir qu’elle avait faim, alors que, tandis qu’elle marchait, il lui semblait qu’elle n’aurait jamais plus besoin de manger ni de boire.
C’était là désormais l’inquiétant et le dangereux de sa situation : comment avec le sou qui lui restait vivrait-elle pendant cinq ou six jours ? Le moment présent n’était rien, mais que serait le lendemain, le surlendemain ?
Cependant si grave que fût la question, elle ne voulut pas la laisser l’envahir et l’abattre ; au contraire il fallait se secouer, se raidir, en se disant que, puisqu’elle avait trouvé une si bonne chambre quand elle admettait qu’elle n’aurait pas mieux que le grand chemin pour se coucher, ou un tronc d’arbre pour s’adosser, elle trouverait bien aussi le lendemain quelque chose à manger. Quoi ? Elle ne l’imaginait pas. Mais cette ignorance présente ne devait pas l’empêcher de s’endormir dans l’espérance.

Elle s’était allongée sur la paille, la botte de roseaux sous sa tête, ayant en face d’elle, par une des ouvertures de la cabane, les feux du four à briques qui, dans la nuit, voltigeaient en lueurs fantastiques, et le bien-être du repos, au milieu d’une tranquillité qui ne devait pas être troublée, l’emportait sur les tiraillements de son estomac.
Elle ferma les yeux et avant de s’endormir, comme tous les soirs depuis la mort de son père, elle évoqua son image ; mais ce soir-là à l’image du père se joignit celle de la maman qu’elle venait de conduire au cimetière en ce jour terrible, et ce fut en les voyant l’un et l’autre penchés sur elle pour l’embrasser comme toujours ils le faisaient vivants que, dans un sanglot, brisée par la fatigue et plus encore par les émotions, elle trouva le sommeil.
Si lourde que fût cette fatigue, elle ne dormit pas cependant solidement ; de temps en temps le roulement d’une voiture sur le pavé l’éveillait, ou le passage d’un train, ou quelque bruit mystérieux qui dans le silence et le recueillement de la nuit lui faisait battre le cœur, mais aussitôt elle se rendormait. À un certain moment, elle crut qu’une voiture venait de s’arrêter près d’elle sur la route, et cette fois elle écouta. Elle ne s’était pas trompée, elle entendit un murmure de voix étouffées mêlé à un bruit de chutes légères. Vivement elle s’agenouilla pour regarder par un des trous percés dans la cabane ; une voiture était bien arrêtée au bout du champ, et il lui sembla, autant qu’elle pouvait juger à la pâle clarté des étoiles, qu’une ombre, homme ou femme, en jetait des paniers que deux autres ombres prenaient et portaient dans la pièce à côté, celle à Monneau. Que signifiait cela à pareille heure ?
Avant qu’elle eût trouvé une réponse à cette question, la voiture s’éloigna, et les deux ombres entrèrent dans le champ d’artichauts ; aussitôt elle entendit des petits coups secs et rapides comme si l’on coupait là quelque chose.
Alors elle comprit : c’étaient des voleurs, « des galvaudeux », qui « nettoyaient la pièce à Monneau » ; vivement ils coupaient les artichauts et les entassaient dans les paniers que la charrette avait apportés et que, sans doute, elle allait venir reprendre la récolte achevée, afin de ne pas rester sur la route pendant cette opération et d’appeler l’attention des passants s’il en survenait.
Mais au lieu de se dire, comme les paysans, « que c’était drôle », Perrine fut épouvantée, car instantanément elle comprit les dangers auxquels elle pouvait se trouver exposée.
Que feraient-ils d’elle s’ils la découvraient. Souvent elle avait entendu raconter des histoires de voleurs, et savait que c’est quand on les surprend ou les dérange qu’ils tuent ceux qui porteraient un témoignage contre eux.
Il est vrai qu’elle avait bien des chances pour n’être pas découverte par eux, puisque c’était parce qu’ils savaient certainement cette cabane abandonnée qu’ils volaient cette nuit-là les artichauts du champ Monneau ; mais si on les surprenait, si on les arrêtait, ne pouvait-elle pas être prise avec eux ; comment se défendrait-elle et prouverait-elle qu’elle n’était pas leur complice ?
À cette pensée, elle se sentit inondée de sueur, et ses yeux se troublèrent au point qu’elle ne distingua plus rien autour d’elle, bien qu’elle entendît toujours les coups secs des serpettes qui coupaient les artichauts ; et le seul soulagement à son angoisse fut de se dire qu’ils travaillaient avec une telle ardeur qu’ils auraient bientôt dépouillé tout le champ.
Mais ils furent dérangés ; au loin, on entendit le roulement d’une charrette sur le pavé, et quand elle approcha ils se blottirent entre les tiges des artichauts, si bien rasés qu’elle ne les voyait plus.
La charrette passée, ils reprirent leur besogne avec une activité que le repos avait renouvelée.
Cependant, si furieux que fût leur travail, elle se disait qu’il ne finirait jamais ; d’un instant à l’autre on allait venir les arrêter, et sûrement elle avec eux.
Si elle pouvait se sauver ! Elle chercha le moyen de sortir de la cabane, ce qui, à vrai dire, n’était pas difficile ; mais où irait-elle sans être exposée à faire du bruit et à révéler ainsi sa présence qui, si elle ne bougeait pas, devait rester ignorée ?
Alors elle se recoucha et feignit de dormir, car puisqu’il lui était impossible de sortir sans s’exposer à être arrêtée au premier pas, le mieux encore était qu’elle parût n’avoir rien vu, si les voleurs entraient dans la cabane.
Pendant un certain temps encore ils continuèrent leur récolte, puis, après un coup de sifflet qu’ils lancèrent, un bruit de roues se fit entendre sur la route et bientôt leur voiture s’arrêta au bout du champ ; en quelques minutes elle fut chargée et au grand trot elle s’éloigna du côté de Paris.
Si elle avait su l’heure, elle aurait pu se rendormir jusqu’à l’aube, mais, n’ayant pas conscience du temps qu’elle avait passé là, elle jugea qu’il était prudent à elle de se remettre en route : aux champs on est matineux ; si au jour levant un paysan la voyait sortir de cette pièce dépouillée, ou même s’il l’apercevait aux environs, il la soupçonnerait d’être de la compagnie des voleurs et l’arrêterait.
Elle se glissa donc hors de la cabane, et rampant comme
les voleurs pour sortir du champ, l’oreille aux écoutes, l’œil aux aguets, elle arriva sans accident sur la grande route où elle reprit sa marche à pas pressés ; les étoiles qui criblaient le ciel sans nuages avaient pâli, et du côté de l’orient une faible lueur éclairait les profondeurs de la nuit, annonçant
l’approche du jour.


VIII
Elle n’eut pas à marcher longtemps sans apercevoir devant elle une masse noire confuse qui profilait d’un côté ses toits, ses cheminées et son clocher sur la blancheur du ciel, tandis que de l’autre tout restait noyé dans l’ombre.
En arrivant aux premières maisons, instinctivement elle étouffa le bruit de ses pas, mais c’était une précaution inutile ; à l’exception des chats, qui flânaient sur la route, tout dormait et son passage n’éveilla que quelques chiens qui aboyaient derrière les portes closes ; il semblait que ce fût un village de morts.
Quand elle l’eut traversé elle se calma et ralentit sa course, car maintenant qu’elle se trouvait assez éloignée du champ volé pour qu’on ne pût pas l’accuser d’avoir fait partie des voleurs. Elle sentait qu’elle ne pourrait pas continuer toujours à cette allure ; déjà elle éprouvait une lassitude qu’elle ne connaissait pas, et malgré le refroidissement du matin il lui montait à la tête des bouffées de chaleur qui la rendaient vacillante.
Mais ni le ralentissement de sa marche, ni la fraîcheur de plus en plus vive, ni la rosée qui la mouillait ne calmèrent ces troubles, pas plus qu’ils ne lui donnèrent de la vigueur, et il fallut qu’elle reconnût que c’était la faim qui l’affaiblissait en attendant qu’elle l’abattît tout à fait défaillante.
Que deviendrait-elle si elle n’avait plus ni sentiment ni volonté ?
Pour que cela n’arrivât pas, elle crut que le mieux était de s’arrêter un instant ; et comme elle passait en ce moment devant une luzerne nouvellement fauchée, dont la moisson mise en petites meules, faisait des tas noirs sur la terre rase, elle franchit le fossé de la route, et se creusant un abri dans une de ces meules, elle s’y coucha enveloppée d’une douce chaleur parfumée de l’odeur du foin. La campagne déserte, sans mouvement, sans bruit, dormait encore, et sous la lumière qui jaillissait de l’orient elle paraissait immense. Le repos, la chaleur, et aussi le parfum de ces herbes séchées calmèrent ses nausées et elle ne tarda pas à s’endormir.
Quand elle s’éveilla le soleil déjà haut à l’horizon couvrait la campagne de ses chauds rayons, et dans la plaine des hommes, des femmes, des chevaux travaillaient çà et là ; près d’elle une escouade d’ouvriers échardonnaient un champ d’avoine ; ce voisinage l’inquiéta tout d’abord un peu, mais à la façon dont ils faisaient leur ouvrage, elle comprit, ou qu’ils ne soupçonnaient pas sa présence, ou qu’elle ne les intéressait pas, et, après avoir attendu un certain temps qui leur permit de s’éloigner, elle put revenir à la route.
Ce bon sommeil l’avait reposée ; et elle fit quelques kilomètres assez gaillardement, quoique la faim maintenant lui serrât l’estomac et lui rendît la tête vide, avec des vertiges, des crampes, des bâillements, et qu’elle eût les tempes serrées comme dans un étau. Aussi quand du haut d’une côte qu’elle venait de monter, elle aperçut sur la pente opposée les maisons d’un gros village que dominaient les combles élevés d’un grand château émergeant d’un bois, se décida-t-elle à acheter un morceau de pain.
Puisqu’elle avait un sou en poche, pourquoi ne pas l’employer, au lieu de souffrir la faim volontairement ? à la vérité quand elle l’aurait dépensé il ne lui resterait plus rien ; mais qui pouvait savoir si un heureux hasard ne lui viendrait pas en aide ? il y a des gens qui trouvent des pièces d’argent sur les grands chemins, et elle pouvait avoir cette bonne chance ; n’en avait-elle pas eu assez de mauvaises, sans compter les malheurs qui l’avaient écrasée ?
Elle examina donc son sou attentivement pour voir s’il était bon ; malheureusement elle ne savait pas très bien comment les vrais sous français se distinguent des mauvais ; aussi était-elle émue lorsqu’elle se décida à entrer chez le premier boulanger qu’elle vit, tremblant que l’aventure de Saint-Denis se reproduisît.
« Est-ce que vous voulez bien me couper pour un sou de pain ? » dit-elle.
Sans répondre, le boulanger lui tendit un petit pain d’un sou qu’il prit sur son comptoir, mais au lieu d’allonger la main elle resta hésitante :
« Si vous vouliez m’en couper ? dit-elle, je ne tiens pas à ce qu’il soit frais.
— Alors tiens. »
Et il lui donna sans le peser un morceau de pain qui traînait là depuis deux ou trois jours.
Mais il importait peu qu’il fût plus ou moins rassis, la grande affaire était qu’il fût plus gros qu’un petit pain d’un sou, et en réalité il en valait au moins deux.
Aussitôt qu’elle l’eût entre les mains, sa bouche se remplit d’eau ; cependant quelque envie qu’elle en eût, elle ne voulut pas l’entamer avant d’être sortie du village. Cela fut vivement fait. Aussitôt qu’elle eut dépassé les dernières maisons, tirant son couteau de sa poche, elle dessina une croix sur sa miche de manière à la diviser en quatre morceaux égaux, et elle en coupa un qui devait faire son unique repas de cette journée ; les trois autres réservés pour les jours suivants, la conduiraient, calculait-elle, jusqu’aux environs d’Amiens, si petits qu’ils fussent.
C’était en traversant le village qu’elle avait fait ce calcul qui lui semblait d’une exécution aussi simple que facile, mais à peine eut-elle avalé une bouchée de son petit morceau de pain qu’elle sentit que les raisonnements les plus forts du monde n’ont aucune puissance sur la faim, pas plus que ce n’est sur ce qui doit ou ne doit pas se faire que se règlent nos besoins : elle avait faim, il fallait qu’elle mangeât, et ce fut gloutonnement qu’elle dévora son premier morceau en se disant qu’elle ne mangerait le second qu’à petites bouchées pour le faire durer ; mais celui-là fut englouti avec la même avidité, et le troisième suivit le second sans qu’elle pût se retenir, malgré tout ce qu’elle se disait pour s’arrêter. Jamais elle n’avait éprouvé pareil anéantissement de volonté, pareille impulsion bestiale. Elle avait honte de ce qu’elle faisait. Elle se disait que c’était bête et misérable ; mais paroles et raisonnements restaient impuissants contre la force qui l’entraînait. Sa seule excuse, si elle en avait une, se trouvait dans la petitesse de ces morceaux qui réunis ne pesaient pas une demi-livre, quand une livre entière n’eût pas suffi à rassasier cette faim gloutonne qui ne se manifestait si intense sans doute que parce qu’elle n’avait rien mangé la veille, et que parce que les jours précédents elle n’avait pris que le bouillon que La Carpe lui donnait.
Cette explication qui était une excuse, et en réalité la meilleure de toutes, fut cause que le quatrième morceau eut le sort des trois premiers ; seulement pour celui-là elle se dit qu’elle ne pouvait pas faire autrement et que dès lors il n’y avait de sa part ni faute, ni responsabilité.
Mais ce plaidoyer perdit sa force dès qu’elle se remit en marche, et elle n’avait pas fait cinq cents mètres sur la route poudreuse, qu’elle se demandait ce que serait sa matinée du lendemain, quand l’accès de faim qui venait de la prendre se produirait de nouveau, si d’ici là le miracle auquel elle avait pensé ne se réalisait pas.
Ce qui se produisit avant la faim, ce fut la soif avec une sensation d’ardeur et d’aridité de la gorge : la matinée était brûlante et, depuis peu, soufflait un fort vent du sud qui l’inondait de sueur et la desséchait ; on respirait un air embrasé, et le long des talus de la route, dans les fossés, les cornets roses des liserons et les fleurs bleues des chicorées pendaient flétris sur leurs tiges amollies.
Tout d’abord elle ne s’inquiéta pas de cette soif ; l’eau est à tout le monde et il n’est pas besoin d’entrer dans une boutique pour en acheter : quand elle rencontrerait une rivière ou une fontaine, elle n’aurait qu’à se mettre à quatre pattes ou se pencher pour boire tant qu’elle voudrait.
Mais justement elle se trouvait à ce moment sur ce plateau de l’Île-de-France, qui du Rouillon à la Thève ne présente aucune rivière, et n’a que quelques rus qui s’emplissent d’eau l’hiver, mais restent l’été entièrement à sec ; des champs de blé ou d’avoine, de larges perspectives, une plaine plate sans arbres d’où émerge çà et là une colline, couronnée d’un clocher et de maisons blanches ; nulle part une ligne de peupliers indiquant une vallée au fond de laquelle coulerait un ruisseau.
Dans le petit village où elle arriva après Écouen, elle eut beau regarder de chaque côté de la rue qui le traverse, nulle part elle n’aperçut la fontaine bienheureuse sur laquelle elle comptait, car ils sont rares les villages où l’on a pensé au vagabond du chemin qui passe assoiffé ; on a son puits, ou celui du voisin, cela suffit.
Elle parvint ainsi aux dernières maisons, et alors elle n’osa pas revenir sur ses pas pour entrer dans une maison et demander un verre d’eau. Elle avait remarqué que les gens la regardaient déjà d’une façon peu encourageante à son premier passage, et il lui avait semblé que les chiens eux-mêmes montraient les dents à la déguenillée inquiétante qu’elle était ; ne l’arrêterait-on pas quand on la verrait passer une seconde fois devant les maisons ? Elle aurait un sac sur le dos, elle vendrait, elle achèterait quelque chose qu’on la laisserait circuler ; mais, comme elle allait les bras ballants, elle devait être une voleuse qui cherche un bon coup pour elle ou pour sa troupe.
Il fallait marcher.

Cependant par cette chaleur, dans ce brasier, sur cette route blanche, sans arbres, où le vent brûlant soulevait à chaque instant des tourbillons de poussière qui l’enveloppaient, la soif lui devenait de plus en plus pénible ; depuis longtemps elle n’avait plus de salive ; sa langue sèche la gênait comme si elle eût été un corps étranger dans sa bouche ; il lui semblait que son palais se durcissait semblable à de la corne qui se recroquevillerait, et cette sensation insupportable la forçait, pour ne pas étouffer, à rester les lèvres entr’ouvertes, ce qui rendait sa langue plus sèche encore et son palais plus dur.
À bout de forces, elle eut l’idée de se mettre dans la bouche des petits cailloux, les plus polis qu’elle put trouver sur la route, et ils rendirent un peu d’humidité à sa langue qui s’assouplit ; sa salive devint moins visqueuse.
Le courage lui revint, et aussi l’espérance ; la France, elle le savait par les pays qu’elle avait traversés depuis la frontière, n’est pas un désert sans eau ; en persévérant elle finirait bien par trouver quelque rivière, une mare, une fontaine. Et puis, bien que la chaleur fût toujours aussi suffocante et que le vent soufflât toujours comme s’il sortait d’une fournaise, le soleil depuis un certain temps déjà s’était voilé, et quand elle se retournait du côté de Paris, elle voyait monter au ciel un immense nuage noir qui emplissait tout l’horizon, aussi loin qu’elle pouvait le sonder. C’était un orage qui arrivait, et sans doute il apporterait avec lui la pluie qui ferait des flaques et des ruisseaux où elle pourrait boire tant qu’elle voudrait.
Une trombe passa, aplatissant les moissons, tordant les buissons, arrachant les cailloux de la route, entraînant avec elle des tourbillons de poussière, de feuilles vertes, de paille, de foin, puis, quand son fracas se calma, on entendit dans le sud des détonations lointaines, qui s’enchaînaient, vomies sans relâche d’un bout à l’autre de l’horizon noir.
Incapable de résister à cette formidable poussée, Perrine s’était couchée dans le fossé, à plat ventre, les mains sur ses yeux et sur sa bouche ; ces détonations la relevèrent. Si tout d’abord, affolée par la soif, elle n’avait pensé qu’à la pluie, le tonnerre en la secouant lui rappelait qu’il n’y a pas que de la pluie dans un orage ; mais aussi des éclairs aveuglants, des torrents d’eau, de la grêle, des coups de foudre.
Où s’abriterait-elle dans cette vaste plaine nue ? Et si sa robe était traversée, comment la ferait-elle sécher ?
Dans les derniers tourbillons de poussière qu’emportait la trombe, elle aperçut devant elle à deux kilomètres environ la lisière d’un bois à travers lequel s’enfonçait la route, et elle se dit que là peut-être elle trouverait un refuge, une carrière, un trou où elle se terrerait.
Elle n’avait pas de temps à perdre : l’obscurité s’épaississait, et les roulements du tonnerre se prolongeaient maintenant indéfiniment, dominés à des intervalles irréguliers par un éclat plus formidable que les autres, qui suspendait sur la plaine et dans le ciel, tout mouvement, tout bruit, comme s’il venait d’anéantir la vie de la terre.
Arriverait-elle au bois avant l’orage ? Tout en marchant aussi vite que sa respiration haletante le permettait, elle tournait parfois la tête en arrière, et le voyait fondre sur elle au galop furieux de ses nuages noirs ; et de ses détonations, il la poursuivait en l’enveloppant d’un immense cercle de feu.
Dans les montagnes, en voyage, elle avait plus d’une fois été exposée à de terribles orages, mais alors elle avait son père, sa mère qui la couvraient de leur protection, tandis que maintenant elle se trouvait seule, au milieu de cette campagne déserte, pauvre oiseau voyageur surpris par la tempête.
Elle eût dû marcher contre elle qu’elle n’eût certainement pas pu avancer, mais par bonheur le vent la poussait, et si fort, que par instants il la forçait à courir.
Pourquoi ne garderait-elle pas cette allure ? La foudre n’était pas encore au-dessus d’elle.
Les coudes serrés à la taille, le corps penché en avant, elle se mit à courir, en se ménageant cependant pour ne pas tomber à bout de souffle ; mais si vite qu’elle courût, l’orage courait encore plus vite qu’elle, et sa voix formidable lui criait dans le dos qu’il la gagnait.
Si elle avait été dans son état ordinaire elle aurait lutté plus énergiquement, mais fatiguée, affaiblie, la tête chancelante, la bouche sèche, elle ne pouvait pas soutenir un effort désespéré, et par moment le cœur lui manquait.
Heureusement le bois se rapprochait, et maintenant elle distinguait nettement ses grands arbres que des abatis récents avaient clairsemés.
Encore quelques minutes, elle arrivait ; au moins elle touchait sa lisière, qui pouvait lui donner un abri que la plaine certainement ne lui offrirait pas ; et il suffisait que cette espérance présentât une chance de réalisation, si faible qu’elle fût, pour que son courage ne l’abandonnât pas : que de fois son père lui avait-il répété que dans le danger les chances de se sauver sont à ceux qui luttent jusqu’au bout.
Et elle luttait soutenue par cette pensée, comme si la main de son père tenait encore la sienne et l’entraînait.
Un coup plus sec, plus violent que les autres la cloua au sol couvert de flammes ; cette fois le tonnerre ne la poursuivait plus, il l’avait rejointe, il était sur elle ; il fallait qu’elle ralentît sa course, car mieux valait encore s’exposer à être inondée que foudroyée.
Elle n’avait pas fait vingt pas que quelques gouttes de pluie larges et épaisses s’abattirent, et elle crut que c’était l’averse qui commençait ; mais elle ne dura point, emportée par le vent, coupée par les commotions du tonnerre qui la refoulaient.
Enfin elle entrait dans le bois, mais l’obscurité s’était faite si noire que ses yeux ne pouvaient pas le sonder bien loin, cependant à la lueur d’un coup de foudre elle crut apercevoir, à une courte distance, une cabane à laquelle conduisait un mauvais chemin creusé de profondes ornières, elle se jeta dedans, au hasard.
De nouveaux éclairs lui montrèrent qu’elle ne s’était pas trompée : c’était bien un abri que des bûcherons avaient construit en fagots, pour travailler sous son toit fait de bourrées, à l’abri du soleil et de la pluie. Encore cinquante pas, encore dix et elle échappait à la pluie. Elle les franchit, et, à bout de forces, épuisée par sa course, étouffée par son émoi, elle s’affaissa sur le lit de copeaux qui couvrait le sol.
Elle n’avait pas repris sa respiration qu’un fracas effroyable emplit la forêt, avec des craquements à croire qu’elle allait être emportée ; les grands arbres que la coupe du sous-bois avait isolés, se courbaient, leurs tiges se tordaient, et des branches mortes tombaient partout avec des bruits sourds, écrasant les jeunes cépées.
La cabane pourrait-elle résister à cette trombe, ou dans un balancement plus fort que les autres n’allait-elle pas s’effondrer ? Elle n’eut pas le temps de réfléchir, une grande flamme accompagnée d’une terrible poussée la jeta à la renverse, aveuglée et abasourdie en la couvrant de branches. Quand elle revint à elle, tout en se tâtant pour voir si elle était encore en vie, elle aperçut à une courte distance, tout blanc dans l’obscurité, un chêne que le tonnerre venait de frapper, en le dépouillant du haut en bas de son écorce, projetée à l’entour, et qui, en tombant sur la cabane, l’avait bombardée de ses éclats ; le long de son tronc nu deux de ses maîtresses branches pendaient tordues à la base ; secouées par le vent, elles se balançaient avec des gémissements sinistres.
Comme elle regardait effarée, tremblante, épouvantée à la pensée de la mort qui venait de passer sur elle, et si près que son souffle terrible l’avait couchée sur le sol, elle vit le fond du bois se brouiller, en même temps qu’elle entendit un roulement extraordinaire plus puissant que ne le serait celui d’un train rapide, — c’était la pluie et la grêle qui s’abattaient sur la forêt ; la cabane craqua du haut en bas, son toit ondula sous la bourrasque, mais elle ne s’effondra pas.
L’eau ne tarda pas à rouler en cascades sur la pente que les bûcherons avaient inclinée au nord, et sans se faire mouiller, Perrine n’eut qu’à étendre le bras pour boire à sa soif dans le creux de sa main.
Maintenant elle n’avait qu’à attendre que l’orage fût passé ; puisque la hutte avait résisté à ces deux assauts furieux, elle supporterait bien les autres, et aucune maison, si solide qu’elle fût, ne vaudrait pour elle cette cabane de branchages dont elle était maîtresse. Cette pensée la remplit d’un doux bien-être qui, succédant aux efforts qu’elle venait de faire, à ses angoisses, à ses affres, l’engourdit ; et malgré le tonnerre qui continuait ses coups de foudre et ses roulements, malgré la pluie qui tombait à flots, malgré le vent et son fracas à travers les arbres, malgré la tempête déchaînée dans les airs et sur la terre, s’allongeant au milieu des copeaux qui lui servaient d’oreiller, elle s’endormit avec un sentiment de
soulagement et de confiance qu’elle ne connaissait plus
depuis longtemps : c’était donc bien vrai, que se sauvent ceux qui ont le courage de lutter jusqu’au bout.


IX
Le tonnerre ne grondait plus quand elle s’éveilla, mais comme la pluie tombait encore fine, et continue, brouillant tout dans la forêt ruisselante, elle ne pouvait pas songer à se remettre en route ; il fallait attendre.
Cela n’était ni pour l’inquiéter, ni pour lui déplaire ; la forêt avec sa solitude et son silence ne l’effrayait pas, et elle aimait déjà cette cabane qui l’avait si bien protégée, et où elle venait de trouver un si bon sommeil ; si elle devait passer la nuit là, peut-être même y serait-elle mieux qu’ailleurs, puisqu’elle aurait un toit sur la tête et un lit sec.
Comme la pluie cachait le ciel, et qu’elle avait dormi sans garder conscience du temps écoulé, elle n’avait aucune idée de l’heure qu’il pouvait être ; mais, au fond, cela importait peu, quand le soir viendrait, elle le verrait bien.
Depuis son départ de Paris, elle n’avait eu ni le loisir ni l’occasion de faire sa toilette, et cependant, le sable de la route, fouetté par le vent d’orage, l’avait couverte de la tête aux pieds, d’une épaisse couche de poussière, qui lui brûlait la peau. Puisqu’elle était seule, puisque l’eau coulait dans la rigole creusée autour de la hutte, c’était le moment de profiter de l’occasion qui lui avait manqué ; par cette pluie persistante, personne ne la dérangerait.
La poche de sa jupe contenait en plus de sa carte et de l’acte de mariage de sa mère, un petit paquet serré dans un chiffon, composé d’un morceau de savon, d’un peigne court, d’un dé et d’une pelote de fil avec deux aiguilles piquées dedans. Elle le développa et, après avoir ôté sa veste, ses souliers et ses bas, penchée au-dessus de la rigole qui coulait claire, elle se savonna le visage, les épaules et les pieds. Pour s’essuyer, elle n’avait que le chiffon qui enveloppait son paquet, et il n’était guère grand ni épais, mais encore valait-il mieux que rien.
Cette toilette la délassa presque autant que son bon sommeil, et alors elle se peigna lentement en nattant ses cheveux en deux grosses tresses blondes qu’elle laissa pendre sur ses épaules. N’était la faim qui recommençait à tirailler son estomac, et aussi quelques morsures de ses souliers qui, à certains endroits, lui avaient mis les pieds à vif, elle eût été tout à fait à l’aise : l’esprit calme, le corps dispos.
Contre la faim, elle ne pouvait rien, car, si cette cabane était un abri, elle n’offrirait jamais la moindre nourriture. Mais pour les écorchures de ses pieds, elle pensa que si elle bouchait les trous que les frottements de la marche avaient faits dans ses bas, elle souffrirait moins de la dureté de ses souliers, et, tout de suite, elle se mit à l’ouvrage. Il fut long autant que difficile, car c’était du coton qu’il lui aurait fallu pour un reprisage à peu près complet, et elle n’avait que du fil.
Ce travail avait encore cela de bon, qu’en l’occupant, il l’empêchait de penser à la faim, mais il ne pouvait pas durer toujours. Quand il fut achevé, la pluie continuait à tomber plus ou moins fine, plus ou moins serrée, et l’estomac continuait aussi ses réclamations de plus en plus exigeantes.
Puisqu’il semblait bien maintenant qu’elle ne pourrait quitter son abri que le lendemain, et comme d’autre part, il était certain qu’un miracle ne se ferait pas pour lui apporter à souper, la faim, plus impérieuse, qui ne lui laissait plus guère d’autres idées que celles de nourriture, lui suggéra la pensée de couper, pour les manger, des tiges de bouleau qui se mêlaient au toit de la hutte, et qu’elle pouvait facilement atteindre en grimpant sur les fagots. Quand elle voyageait avec son père, elle avait vu des pays où l’écorce du bouleau servait à fabriquer des boissons ; donc, ce n’était pas un arbre vénéneux qui l’empoisonnerait ; mais la nourrirait-il ?
C’était une expérience à tenter. Avec son couteau, elle coupa quelques branches feuillues, et les divisant en petits morceaux très courts, elle commença à en mâcher un.
Bien dur elle le trouva, quoique ses dents fussent solides, bien âpre, bien amer ; mais ce n’était pas comme friandise qu’elle le mangeait ; si mauvais qu’il fût, elle ne se plaindrait pas pourvu qu’il apaisât sa faim et la nourrît. Cependant, elle n’en put avaler que quelques morceaux, et encore cracha-t-elle presque tout le bois, après l’avoir tourné et retourné inutilement dans sa bouche ; les feuilles passèrent moins difficilement.
Pendant qu’elle faisait sa toilette, raccommodait ses bas, et tâchait de souper avec les branches du bouleau, les heures avaient marché, et quoique le ciel, toujours troublé de pluie, ne permît pas de suivre la baisse du soleil, il semblait à l’obscurité qui, depuis un certain temps, emplissait la forêt, que la nuit devait approcher. En effet, elle ne tarda pas à venir, et elle se fit sombre comme dans les journées sans crépuscule ; la pluie cessa de tomber, un brouillard blanc s’éleva aussitôt, et, en quelques minutes, Perrine se trouva plongée dans l’ombre et le silence : à dix pas, elle ne voyait pas devant elle, et, à l’entour, comme au loin, elle n’entendait plus d’autre bruit que celui des gouttes d’eau qui tombaient des branches sur son toit ou dans les flaques voisines.
Quoique préparée à l’idée de coucher là, elle n’en éprouva pas moins un serrement de cœur en se trouvant ainsi isolée, et perdue dans cette forêt, en plein noir. Sans doute, elle venait de passer, à cette même place, une partie de la journée, sans courir d’autre danger que celui d’être foudroyée, mais, la forêt le jour, n’est pas la forêt la nuit, avec son silence solennel et ses ombres mystérieuses, qui disent et laissent voir tant de choses troublantes.
Aussi ne put-elle pas s’endormir tout de suite, comme elle l’aurait voulu, agitée par les tiraillements de son estomac, effarée par les fantômes de son imagination.
Quelles bêtes peuplaient cette forêt ? Des loups peut-être ?
Cette pensée la tira de sa somnolence, et s’étant relevée, elle prit un solide bâton, qu’elle aiguisa d’un bout avec son couteau, puis elle se fit un entourage de fagots. Au moins si un loup l’attaquait, elle pourrait, de derrière son rempart, se défendre ; certainement, elle en aurait le courage. Cela la rassura, et quand elle se fut recouchée dans son lit de copeaux, en tenant son épieu à deux mains, elle ne tarda pas à s’endormir.
Ce fut un chant d’oiseau qui l’éveilla, grave et triste, aux notes pleines et flûtées, qu’elle reconnut tout de suite pour celui du merle. Elle ouvrit les yeux, et vit qu’au-dessus de ses fagots, une faible lueur blanche perçait l’obscurité de la forêt, dont les arbres et les cépées se détachaient en noir sur le fond pâle de l’aube : c’était le matin.
La pluie avait cessé, pas un souffle de vent n’agitait les feuilles lourdes, et dans toute la forêt régnait un silence profond que déchirait seulement ce chant d’oiseau, qui s’élevait au-dessus de sa tête, et auquel répondaient au loin d’autres chants, comme un appel matinal, se répétant, se prolongeant de canton en canton.
Elle écoutait, en se demandant si elle devait se lever déjà et reprendre son chemin, quand un frisson la secoua, et en passant sa main sur sa veste, elle la sentit mouillée comme après une averse ; c’était l’humidité des bois qui l’avait pénétrée, et maintenant, dans le refroidissement du jour naissant, la glaçait. Elle ne devait pas hésiter plus longtemps ; tout de suite elle se mit sur ses jambes et se secoua fortement comme un cheval qui s’ébroue : en marchant, elle se réchaufferait.
Cependant, après réflexion, elle ne voulut pas encore partir, car il ne faisait pas assez clair pour qu’elle se rendît compte de l’état du ciel, et avant de quitter cette cabane, il était prudent de voir si la pluie n’allait pas reprendre.
Pour passer le temps, et plus encore pour se donner du mouvement, elle remit en place les fagots qu’elle avait dérangés la veille, puis elle peigna ses cheveux, et fit sa toilette au bord d’un fossé plein d’eau.
Quand elle eut fini, le soleil levant avait remplacé l’aube, et maintenant, à travers les branches des arbres, le ciel se montrait d’un bleu pâle, sans le plus léger nuage : certainement la matinée serait belle, et probablement la journée aussi ; il fallait partir.
Malgré les reprises qu’elle avait faites à ses bas, la mise en marche fut cruelle, tant ses pieds étaient endoloris, mais elle ne tarda pas à s’aguerrir, et bientôt elle fila d’un bon pas régulier sur la route dont la pluie avait amolli la dureté ; le soleil qui la frappait dans le dos, de ses rayons obliques, la réchauffait, en même temps qu’il projetait sur le gravier une ombre allongée marchant à côté d’elle ; et cette ombre, quand elle la regardait, la rassurait : car si elle ne donnait pas l’image d’une jeune fille bien habillée, au moins ne donnait-elle plus celle de la pauvre diablesse de la veille, aux cheveux embroussaillés et au visage terreux ; les chiens ne la poursuivraient peut-être plus de leurs aboiements, ni les gens de leurs regards défiants.

Le temps aussi était à souhait pour lui mettre au cœur des pensées d’espérance : jamais elle n’avait vu matinée si belle, si riante, l’orage en lavant les chemins et la campagne avait donné à tout, aux plantes, comme aux arbres, une vie nouvelle qui semblait éclose de la nuit même ; le ciel réchauffé, s’était peuplé de centaines d’alouettes qui piquaient droit dans l’azur limpide en lançant des chansons joyeuses ; et de toute la plaine qui bordait la forêt s’exhalait une odeur fortifiante d’herbes, de fleurs et de moissons.
Au milieu de cette joie universelle était-il possible qu’elle restât seule désespérée ? Le malheur la poursuivrait-il toujours ? Pourquoi n’aurait-elle pas une bonne chance ? C’en était déjà une grande de s’être abritée dans la forêt ; elle pouvait bien en rencontrer d’autres.
Et tout en marchant son imagination s’envolait sur les ailes de cette idée, à laquelle elle revenait toujours, que quelquefois on perd de l’argent sur les grands chemins, qu’une poche trouée laisse tomber ; ce n’était donc pas folie de se répéter encore qu’elle pouvait trouver ainsi, non une grosse bourse qu’elle devrait rendre, mais un simple sou, et même une pièce de dix sous qu’elle aurait le droit de garder sans causer de préjudice à personne, et qui la sauveraient.
De même il lui semblait qu’il n’était pas extravagant non plus, de penser qu’elle pourrait rencontrer une bonne occasion de s’employer à un travail quelconque, ou de rendre un service qui lui feraient gagner quelques sous.
Elle avait besoin de si peu pour vivre trois ou quatre jours.
Et elle allait ainsi les yeux attachés sur le gravier lavé, mais sans apercevoir le gros sou ou la petite pièce blanche tombés d’une mauvaise poche, pas plus qu’elle ne rencontrait les occasions de travail que l’imagination représentait si faciles, et que la réalité n’offrait nulle part.
Cependant il y avait urgence à ce que l’une ou l’autre de ces bonnes chances s’accomplît au plus tôt, car les malaises qu’elle avait ressentis la veille, se répétaient si intenses par moments, qu’elle commençait à craindre de ne pas pouvoir continuer son chemin : maux de cœur, nausées, étourdissements, bouffées de sueurs qui lui cassaient bras et jambes.
Elle n’avait pas à chercher la cause de ces troubles, son estomac la lui criait douloureusement, et comme elle ne pouvait pas répéter l’expérience de la veille avec les branches de bouleau, qui lui avait si mal réussi, elle se demandait ce qui adviendrait, après qu’un étourdissement plus fort que les autres l’aurait forcée à s’asseoir sur l’un des bas côtés de la route.
Pourrait-elle se relever ?
Et si elle ne le pouvait pas, devrait-elle mourir là sans que personne lui tendît la main ?
La veille si on lui avait dit, quand par un effort désespéré elle avait gagné la cabane de la forêt, qu’à un moment donné elle accepterait sans révolte cette idée d’une mort possible par faiblesse et abandon de soi, elle se serait révoltée : ne se sauvent-ils pas ceux qui luttent jusqu’au bout ?
Mais la veille ne ressemblait pas au jour présent : la veille elle avait un reste de force qui maintenant lui manquait, sa tête était solide, maintenant elle vacillait.
Elle crut qu’elle devait se ménager, et chaque fois qu’une faiblesse la prit elle s’assit sur l’herbe pour se reposer quelques instants. Comme elle s’était arrêtée devant un champ de pois, elle vit quatre jeunes filles à peu près du même âge qu’elle, entrer dans ce champ sous la direction d’une paysanne et en commencer la cueillette. Alors ramassant tout son courage, elle franchit le fossé de la route et se dirigea vers la paysanne ; mais celle-ci ne la laissa pas venir :
« Qué que tu veux ? dit-elle.
— Vous demander si vous voulez que je vous aide.
— Je n’avons besoin de personne.
— Vous me donnerez ce que vous voudrez.
— D’où que t’es ?
— De Paris. »
Une des jeunes filles leva la tête et lui jetant un mauvais regard, elle cria :
« C’te galvaudeuse qui vient de Paris pour prendre l’ouvrage du monde.
— On te dit qu’on n’a besoin de personne, » continua la paysanne.
Il n’y avait qu’à repasser le fossé et à se remettre en marche, ce qu’elle fit, le cœur gros et les jambes cassées.
« V’là les gendarmes, cria une autre, sauve-toi. »
Elle retourna vivement la tête et toutes partirent d’un éclat de rire, s’amusant de leur plaisanterie.
Elle n’alla pas loin et bientôt elle dut s’arrêter, ne voyant plus son chemin tant les yeux étaient pleins de larmes ; que leur avait-elle fait pour qu’elles fussent si dures !
Décidément, pour les vagabonds le travail est aussi difficile à trouver que les gros sous. La preuve était faite. Aussi n’osa-t-elle pas la répéter, et continua-t-elle son chemin, triste, n’ayant pas plus d’énergie dans le cœur que dans les jambes.
Le soleil de midi acheva de l’accabler ; maintenant elle se traînait plutôt qu’elle ne marchait, ne pressant un peu le pas que dans la traversée des villages pour échapper aux regards, qui, s’imaginait-elle, la poursuivaient, le ralentissant au contraire quand une voiture venant derrière elle, allait la dépasser ; à chaque instant, quand elle se voyait seule, elle s’arrêtait pour se reposer et respirer.
Mais alors c’était sa tête qui se mettait en travail, et les pensées qui la traversaient de plus en plus inquiétantes, ne faisaient qu’accroître sa prostration.
À quoi bon persévérer, puisqu’il était certain qu’elle ne pourrait pas aller jusqu’au bout ?
Elle arriva ainsi dans une forêt à travers laquelle la route droite s’enfonçait à perte de vue, et la chaleur déjà lourde et brûlante dans la plaine, s’y trouva étouffante : un soleil de feu, pas un souffle d’air, et des sous-bois comme des bas côtés du chemin montaient des bouffées de vapeur humide qui la suffoquaient.
Elle ne tarda pas à se sentir épuisée, et, baignée de sueur, le cœur défaillant, elle se laissa tomber sur l’herbe, incapable de mouvement comme de pensée.
À ce moment une charrette qui venait derrière elle, passa :
« Fait-y donc chaud, dit le paysan qui la conduisait, assis sur un des limons, faut mouri. »
Dans son hallucination, elle prit cette parole pour la confirmation d’une condamnation portée contre elle.
C’était donc vrai qu’elle devait mourir ; elle se l’était déjà dit plus d’une fois, et voilà que ce messager de la Mort le lui répétait.
Hé bien, elle mourrait ; il n’y avait pas à se révolter, ni à lutter plus longtemps ; elle le voudrait, qu’elle ne le pourrait plus ; son père était mort, sa mère était morte, maintenant c’était son tour.
Et de ces idées qui traversaient sa tête vide, la plus cruelle était de penser qu’elle eût été moins malheureuse de mourir avec eux, plutôt que dans ce fossé comme une pauvre bête.
Alors elle voulut faire un dernier effort, entrer sous bois et y choisir une place où elle se coucherait pour son dernier sommeil, à l’abri des regards curieux. Un chemin de traverse s’ouvrait à une courte distance, elle le prit et à une cinquantaine de mètres de la route, elle trouva une petite clairière herbée, dont la lisière était fleurie de belles digitales violettes. Elle s’assit à l’ombre d’une cépée de châtaignier, et s’allongeant, elle posa sa tête sur son bras, comme elle faisait chaque soir pour s’endormir.


X
Une sensation chaude sur le visage la réveilla en sursaut, elle ouvrit les yeux, effrayée, et vit vaguement une grosse tête velue penchée sur elle.
Elle voulut se jeter de côté, mais un grand coup de langue appliquée en pleine figure la retint sur le gazon.
Si rapidement que cela se fût passé, elle avait eu cependant le temps de se reconnaître : cette grosse tête velue était celle d’un âne ; et, au milieu des grands coups de langue qu’il continuait à lui donner sur le visage et sur ses deux mains mises en avant, elle avait pu le regarder.
« Palikare ! »
Elle lui jeta les bras autour du cou et l’embrassa en fondant en larmes :
« Palikare, mon bon Palikare. »
En entendant son nom il s’arrêta de la lécher, et relevant la tête il poussa cinq ou six braiments de joie triomphante, puis après ceux-là qui ne suffisaient pas pour crier son contentement, encore cinq ou six autres non moins formidables.
Elle vit alors qu’il était sans harnais, sans licol et les jambes entravées.
Comme elle s’était soulevée pour lui prendre le cou et poser sa tête contre la sienne en le caressant de la main, tandis que de son côté il abaissait vers elle ses longues oreilles, elle entendit une voix enrouée qui criait :
« Qué que t’as, vieux coquin ? Attends un peu, j’y vas, j’y vas, mon garçon. »
En effet un bruit de pas pressés résonna bientôt sur les cailloux du chemin, et Perrine vit paraître un homme vêtu d’une blouse et coiffé d’un chapeau en cuir qui arrivait la pipe à la bouche.
« Hé ! gamine, qué tu fais à mon âne ? » cria-t-il sans retirer sa pipe de ses lèvres.
Tout de suite Perrine reconnut La Rouquerie, la chiffonnière habillée en homme à qui elle avait vendu Palikare au Marché aux chevaux, mais la chiffonnière ne la reconnut pas et ce fut seulement après un certain temps qu’elle la regarda avec étonnement :
« Je t’ai vue quelque part ? dit-elle.
— Quand je vous ai vendu Palikare.
— Comment, c’est toi, fillette, que fais-tu ici ? »
Perrine n’eut pas à répondre ; une faiblesse la prit qui la força à s’asseoir, et sa pâleur ainsi que ses yeux noyés parlèrent pour elle.
« Qué que t’as, demanda La Rouquerie, t’es malade ? »
Mais Perrine remua les lèvres sans articuler aucun son, et s’appuyant sur son coude s’allongea tout de son long, décolorée, tremblante, abattue par l’émotion autant que par la faiblesse.
« Hé ! ben, hé ben, cria La Rouquerie, ne peux-tu pas dire ce que t’as ? »
Précisément elle ne pouvait pas dire ce qu’elle avait, bien qu’elle gardât conscience de ce qui se passait autour d’elle.
Mais La Rouquerie était une femme d’expérience qui connaissait toutes les misères :
« Elle est bien capable de crever de faim », murmura-t-elle.
Et sans plus, abandonnant la clairière, elle se dirigea vers la route où se trouvait une petite charrette dételée dont les ridelles étaient garnies de peaux de lapin accrochées çà et là ; vivement elle ouvrit un coffre d’où elle tira une miche de pain, un morceau de fromage, une bouteille, et rapporta le tout en courant.
Perrine était toujours dans le même état.
« Attends, ma fillette, attends, » dit La Rouquerie.
S’agenouillant près d’elle elle lui introduisit le goulot de la bouteille entre les lèvres.
« Bois un bon coup, ça te soutiendra. »
En effet le bon coup ramena le sang au visage pâli de Perrine et lui rendit le mouvement.
« Tu avais faim ?
— Oui.
— Eh bien maintenant il faut manger, mais en douceur ; attends un peu. »
Elle coupa un morceau à la miche ainsi qu’au fromage et les lui tendit.
« En douceur, surtout, ou plutôt je vas manger avec toi, ça te modérera. »
La précaution était sage car déjà Perrine avait mordu à même le pain et il semblait qu’elle ne se conformerait pas à la recommandation de La Rouquerie.
Jusque-là Palikare était resté immobile regardant ce qui se passait de ses grands yeux doux ; quand il vit La Rouquerie assise sur l’herbe à côté de Perrine il s’agenouilla près de celle-ci.
« Le coquin voudrait bien un morceau de pain, dit La Rouquerie.
— Vous permettez que je lui en donne un ?
— Un, deux, ce que tu voudras, quand il n’y en aura plus, il y en aura encore ; ne te gêne pas, fillette, il est si content de te retrouver, le bon garçon, car tu sais c’est un bon garçon.
— N’est-ce pas ?
— Quand tu auras mangé ton morceau, tu me diras comment tu es dans cette forêt à moitié morte de faim, car ça serait vraiment pitié de te couper le sifflet. »
Malgré les recommandations de La Rouquerie il fut vite dévoré le morceau :
« Tu en voudrais bien un autre ? dit-elle quand il eut disparu.
— C’est vrai.
— Hé bien tu ne l’auras qu’après m’avoir raconté ton histoire ; pendant le temps qu’elle te prendra, ce que tu as déjà mangé se tassera. »
Perrine fit le récit qui lui était demandé en commençant à la mort de sa mère ; quand elle arriva à l’aventure de Saint-Denis,

La Rouquerie qui avait allumé sa pipe la retira de sa bouche et lança une bordée d’injures à l’adresse de la boulangère :
« Tu sais que c’est une voleuse, s’écria-t-elle, je n’en donne à personne des pièces fausses, attendu que je ne m’en laisse fourrer par personne. Sois tranquille, il faudra qu’elle me la rende quand je repasserai par Saint-Denis ou bien j’ameute le quartier contre elle ; j’en ai des amis à Saint-Denis, nous mettrons le feu à sa boutique. »
Perrine continua son récit et l’acheva.
« Comme ça tu étais en train de mourir, dit La Rouquerie ; quel effet cela te faisait-il ?
— Ça a commencé par être très douloureux, et j’ai dû crier à un moment comme on crie la nuit quand on étouffe, et puis j’ai rêvé du paradis et de la bonne nourriture que j’allais y manger ; maman qui m’attendait me faisait du chocolat au lait, je le sentais.
— C’est curieux que le coup de chaleur qui devait te tuer te sauve précisément, car sans lui je ne me serais pas arrêtée dans ce bois pour laisser reposer Palikare et il ne t’aurait pas trouvée. Maintenant qu’est-ce que tu veux faire ?
— Continuer mon chemin.
— Et demain comment mangeras-tu ? Il faut avoir ton âge pour aller comme ça à l’aventure.
— Que voulez-vous que je fasse ? »
La Rouquerie tira deux ou trois bouffées de sa pipe gravement, en réfléchissant, puis elle répondit :
« Voilà. Je vas jusqu’à Creil, pas plus loin, en achetant mes marchandises dans les villages et les villes qui se trouvent sur ma route ou à peu près, Chantilly, Senlis ; tu viendras avec moi, crie un peu, si tu en as la force : « Peaux de lapin, chiffons, ferraille à vendre ».
Perrine fit ce qui lui était demandé.
« Bon, la voix est claire ; comme j’ai mal à la gorge tu crieras pour moi et gagneras ton pain. À Creil je connais un coquetier qui va jusqu’aux environs d’Amiens pour ramasser des œufs, je lui demanderai de t’emmener avec lui dans sa voiture. Quand tu seras près d’Amiens tu prendras le chemin de fer pour aller jusqu’au pays de tes parents.
— Avec quoi ?
— Avec cent sous que je t’avancerai en remplacement de la pièce que la boulangère t’a volée et que je me ferai rendre, tu peux en être sûre. »


XI
Les choses s’arrangèrent comme La Rouquerie les avait disposées.
Pendant huit jours Perrine parcourut tous les villages qui se trouvent de chaque côté de la forêt de Chantilly : Gouvieux, Saint-Maximin, Saint-Firmin, Mont-l’Évêque, Chamant, et, quand elle arriva à Creil, La Rouquerie lui proposa de la garder avec elle :
« Tu as une voix fameuse pour le commerce du chiffon, tu me rendrais service et ne serais pas malheureuse ; on gagne bien sa vie.
— Je vous remercie, mais ce n’est pas possible. »
Voyant que cet argument n’était pas suffisant, elle en mit un autre en avant :
« Tu ne quitterais pas Palikare. »
Il troubla en effet Perrine qui laissa voir son émotion, mais elle se raidit.
« Je dois aller près de mes parents.
— Tes parents t’ont-ils sauvé la vie comme lui ?
— Je n’obéirais pas à maman si je n’y allais pas.
— Vas-y donc ; mais si un jour tu regrettes l’occasion que je t’offre, tu ne t’en prendras qu’à toi.
— Soyez sûre que je garderai votre souvenir dans mon cœur. »
La Rouquerie ne se fâcha pas de ce refus au point de ne pas arranger avec son ami le coquetier le voyage en voiture jusqu’aux environs d’Amiens, et pendant toute une journée Perrine eut la satisfaction de rouler au trot de deux bons chevaux, couchée dans la paille, sous une bâche au lieu de peiner à pied sur cette longue route, que la comparaison de son bien-être présent avec les fatigues passées lui faisait paraître plus longue encore. À Essentaux, elle coucha dans une grange, et le lendemain, qui était un dimanche, elle donna au guichet de la gare d’Ailly sa pièce de cent sous qui, cette fois, ne fut ni refusée, ni confisquée, et sur laquelle on lui rendit deux francs soixante-quinze avec un billet pour Picquigny, où elle arriva à onze heures par une matinée radieuse et chaude, mais d’une chaleur douce qui ne ressemblait pas plus à celle de la forêt de Chantilly, qu’elle ne ressemblait elle-même à la misérable qu’elle était à ce moment.
Pendant les quelques jours qu’elle avait passés avec La Rouquerie, elle avait pu repriser et rapiécer sa jupe et sa veste, se tailler un fichu dans des chiffons, laver son linge, cirer

ses souliers ; à Ailly, en attendant le départ du train, elle avait fait dans le courant de la rivière une toilette minutieuse ; et maintenant, elle débarquait propre, fraîche et dispose.
Mais ce qui, mieux que la propreté, mieux même que les cinquante-cinq sous qui sonnaient dans sa poche, la relevait, c’était un sentiment de confiance qui lui venait de ses épreuves passées. Puisqu’en ne s’abandonnant pas et en persévérant jusqu’au bout, elle en avait triomphé, n’avait-elle pas le droit d’espérer et de croire qu’elle triompherait maintenant des difficultés qui lui restaient à vaincre ? Si le plus dur n’était pas accompli, au moins y avait-il quelque chose de fait, et précisément le plus pénible, le plus dangereux.
À la sortie de la gare, elle avait passé sur le pont d’une écluse, et maintenant elle marchait allègre, à travers de vertes prairies plantées de peupliers et de saules qu’interrompaient de temps en temps des marais, dans lesquelles on apercevait à chaque pas des pêcheurs à la ligne penchés sur leur bouchon et entourés d’un attirail qui les faisait reconnaître tout de suite pour des amateurs endimanchés échappés de la ville. Aux marais succédaient des tourbières, et sur l’herbe, roussie, s’alignaient des rangées de petits cubes noirs entassés géométriquement et marqués de lettres blanches ou de numéros qui étaient des tas de tourbe disposés pour sécher.
Que de fois son père lui avait-il parlé de ces tourbières et de leurs entailles, c’est-à-dire des grands étangs que l’eau a remplis après que la tourbe a été enlevée, qui sont l’originalité de la vallée de la Somme. De même, elle connaissait ces pêcheurs enragés que rien ne rebute, ni le chaud, ni le froid, si bien que ce n’était pas un pays nouveau qu’elle traversait, mais au contraire connu et aimé, bien que ses yeux ne l’eussent pas encore vu : connues ces collines nues et écrasées qui bordent la vallée ; connus les moulins à vent qui les couronnent et tournent même par les temps calmes, sous l’impulsion de la brise de mer qui se fait sentir jusque-là.
Le premier village, aux tuiles rouges, où elle arriva, elle le reconnut aussi, c’était Saint-Pipoy, où se trouvaient les tissages et les corderies dépendant des usines de Maraucourt, et avant de l’atteindre, elle traversa par un passage à niveau un chemin de fer qui, après avoir réuni les différents villages : Hercheux, Bacourt, Flexelles, Saint-Pipoy et Maraucourt qui sont les centres des fabriques de Vulfran Paindavoine, va se souder à la grande ligne de Boulogne : au hasard des vues qu’offraient ou cachaient les peupliers de la vallée, elle voyait les clochers en ardoise de ces villages et les hautes cheminées en brique des usines, en cette journée du dimanche, sans leur panache de fumée.
Quand elle passa devant l’église on sortait de la grand’messe, et en écoutant les propos des gens qu’elle croisait, elle reconnut encore le lent parler picard aux mots traînés et chantés que son père imitait pour l’amuser.
De Saint-Pipoy à Maraucourt le chemin bordé de saules se contourne au milieu des tourbières, cherchant pour passer un sol qui ne soit pas trop mouvant plutôt que la ligne droite. Ceux qui le suivent ne voient donc qu’à quelques pas, en avant comme en arrière. Ce fut ainsi qu’elle arriva sur une jeune fille qui marchait lentement, écrasée par un lourd panier passé à son bras.
Enhardie par la confiance qui lui était revenue, Perrine osa lui adresser la parole.
« C’est bien le chemin de Maraucourt, n’est-ce pas ?
— Oui, tout dret.
— Oh ! tout dret, dit Perrine en souriant ; il n’est pas si dret que ça.
— S’il vous emberluque, j’y vas à Maraucourt, nous pouvons faire le k’min ensemble.
— Avec plaisir, si vous voulez que je vous aide à porter votre panier.
— C’est pas de refus, y pèse rud’ment. »
Disant cela elle le mit à terre en poussant un ouf de soulagement.
« C’est-y que vous êtes de Maraucourt ? demanda-t-elle.
— Non : et vous ?
— Bien sûr que j’en suis.
— Est-ce que vous travaillez aux usines ?
— Bien sûr, comme tout le monde donc ; je travaille aux cannetières.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Tiens, vous ne connaissez pas les cannetières, les épouloirs quoi ! d’où que vous venez donc ?
— De Paris.
— À Paris ils ne connaissent pas les cannetières, c’est drôle ; enfin, c’est des machines à préparer le fil pour les navettes.
— On gagne de bonnes journées ?
— Dix sous.
— C’est difficile ?
— Pas trop ; mais il faut avoir l’œil et ne pas perdre son temps. C’est-y que vous voudriez être embauchée ?
— Oui ; si l’on voulait de moi.
— Bien sûr qu’on voudra de vous ; on prend tout le monde ; sans ça ousqu’on trouverait les sept mille ouvriers qui travaillent dans les ateliers ; vous n’aurez qu’à vous présenter demain matin à six heures à la grille des shèdes. Mais assez causé, il ne faut pas que je sois en retard. »
Elle prit l’anse du panier d’un côté, Perrine la prit de l’autre et elles se mirent en marche d’un même pas, au milieu du chemin.
L’occasion qui s’offrait à Perrine d’apprendre ce qu’elle avait intérêt à savoir était trop favorable pour qu’elle ne la saisît pas ; mais comme elle ne pouvait pas interroger franchement cette jeune fille, il fallait que ses questions fussent adroites et que tout en ayant l’air de bavarder au hasard, elle ne demandât rien qui n’eût un but assez bien enveloppé pour qu’on ne pût pas le deviner.
« Est-ce que vous êtes née à Maraucourt ?
— Bien sûr que j’en suis native, et ma mère l’était aussi ; mon père était de Picquigny.
— Vous les avez perdus ?
— Oui, je vis avec ma grand’mère qui tient un débit et une épicerie : Mme Françoise.
— Ah ! Mme Françoise !
— Vous la connaissez-t’y ?
— Non… je dis ah ! Mme Françoise.
— C’est qu’elle est bien connue dans le pays, pour son débit, et puis aussi parce que comme elle a été la nourrice de M. Edmond Paindavoine, quand les gens veulent demander quelque chose à M. Vulfran Paindavoine, ils s’adressent à elle.
— Elle obtient ce qu’ils désirent ?
— Des fois oui, des fois non ; pas toujours commode M. Vulfran.
— Puisqu’elle a été la nourrice de M. Edmond Paindavoine, pourquoi ne s’adresse-t-elle pas à lui ?
— M. Edmond Paindavoine ! il a quitté le pays avant que je sois née ; on ne l’a jamais revu ; fâché avec son père, pour des affaires, quand il a été envoyé dans l’Inde où il devait acheter le jute… Mais si vous ne savez pas ce que c’est qu’une cannetière, vous ne devez pas connaître le jute ?
— Une herbe ?
— Un chanvre, un grand chanvre qu’on récolte aux Indes et qu’on file, qu’on tisse, qu’on teint dans les usines de Maraucourt ; c’est le jute qui a fait la fortune de M. Vulfran Paindavoine. Vous savez il n’a pas toujours été riche M. Vulfran : il a commencé par conduire lui-même sa charrette dans laquelle il portait le fil et rapportait les pièces de toile que tissaient les gens du pays chez eux, sur leurs métiers. Je vous dis ça, parce qu’il ne s’en cache pas. »
Elle s’interrompit :
« Voulez-vous que nous changions de bras ?
— Si vous voulez, mademoiselle… Comment vous appelez-vous ?
— Rosalie.
— Si vous voulez, mademoiselle Rosalie.
— Et vous, comment que vous vous nommez ? »
Perrine ne voulut pas dire son vrai nom, et elle en prit un au hasard :
« Aurélie.
— Changeons donc de bras, mademoiselle Aurélie. »
Quand, après un court repos, elles reprirent leur marche cadencée, Perrine revint tout de suite à ce qui l’intéressait :
— Vous disiez que M. Edmond Paindavoine était parti fâché avec son père.
— Et quand il a été dans l’Inde ils se sont fâchés bien plus fort encore, parce que M. Edmond se serait marié là-bas avec une fille du pays par un mariage qui ne compte pas, tandis qu’ici M. Vulfran voulait lui faire épouser une demoiselle qui était de la plus grande famille de toute la Picardie ; c’est pour ce mariage, pour établir son fils et sa bru, que M. Vulfran a construit son château qui a coûté des millions et des millions. Malgré tout, M. Edmond n’a pas voulu se séparer de sa femme de là-bas pour prendre la demoiselle d’ici et ils se sont fâchés tout à fait, si bien que maintenant on ne sait seulement pas si M. Edmond est vivant ou s’il est mort. Il y en a qui disent d’un sens, d’autres qui disent le contraire ; mais on ne sait rien puisqu’on est sans nouvelles de lui depuis des années et des années… à ce qu’on raconte, car M. Vulfran n’en parle à personne et ses neveux n’en parlent pas non plus.
— Il a des neveux M. Vulfran ?
— M. Théodore Paindavoine, le fils de son frère, et M. Casimir Bretoneux, le fils de sa sœur qu’il a pris avec lui pour

l’aider. Si M. Edmond ne revient pas, la fortune et toutes les usines de M. Vulfran seront pour eux.
— C’est curieux cela.
— Vous pouvez dire que si M. Edmond ne revenait pas ce serait triste.
— Pour son père ?
— Et aussi pour le pays, parce qu’avec les neveux on ne sait pas comment iraient les usines qui font vivre tant de monde. On parle de ça ; et le dimanche, quand je sers au débit, j’en entends de toutes sortes.
— Sur les neveux ?
— Oui, sur les neveux et sur d’autres aussi ; mais ça n’est pas nos affaires, à nous autres.
— Assurément. »
Et comme Perrine ne voulut pas montrer de l’insistance, elle marcha pendant quelques minutes sans rien dire, pensant bien que Rosalie, qui semblait avoir la langue alerte, ne tarderait pas à reprendre la parole ; ce fut ce qui arriva :
« Et vos parents, ils vont venir aussi à Maraucourt ? dit-elle.
— Je n’ai plus de parents.
— Ni votre père, ni votre mère ?
— Ni mon père, ni ma mère.
— Vous êtes comme moi, mais j’ai ma grand’mère qui est bonne, et qui serait encore meilleure s’il n’y avait pas mes oncles et mes tantes qu’elle ne veut pas fâcher ; sans eux je ne travaillerais pas aux usines, je resterais au débit ; mais elle ne fait pas ce qu’elle veut. Alors vous êtes toute seule ?
— Toute seule.
— Et c’est de votre idée que vous êtes venue de Paris à Maraucourt ?
— On m’a dit que je trouverais peut-être du travail à Maraucourt, et au lieu de continuer ma route pour aller au pays des parents qui me restent, j’ai voulu voir Maraucourt, parce que les parents, tant qu’on ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils vous recevront.
— C’est bien vrai ; s’il y en a de bons, il y en a de mauvais.
— Voilà.
— Eh bien, ne vous élugez point, vous trouverez du travail aux usines ; ce n’est pas une grosse journée dix sous, mais c’est tout de même quelque chose, et puis vous pourrez arriver jusqu’à vingt-deux sous. Je vais vous demander quelque chose ; vous répondrez si vous voulez ; si vous ne voulez pas vous ne répondrez pas ; avez-vous de l’argent ?
— Un peu.
— Eh bien, si ça vous convient de loger chez mère Françoise, ça vous coûtera vingt-huit sous par semaine en payant d’avance.
— Je peux payer vingt-huit sous.
— Vous savez, je ne vous promets pas une belle chambre pour vous toute seule à ce prix-là ; vous serez six dans la même, mais enfin vous aurez un lit, des draps, une couverture ; tout le monde n’en a pas.
— J’accepte en vous remerciant.
— Il n’y a pas que des gens à vingt-huit sous la semaine qui logent chez ma grand’mère ; nous avons aussi, mais dans notre maison neuve, de belles chambres pour nos pensionnaires qui sont employés à l’usine : M. Fabry, l’ingénieur des constructions ; M. Mombleux, le chef comptable ; M. Bendit, le commis pour la correspondance étrangère. Si vous parlez jamais à celui-là, ne manquez pas de l’appeler M. Benndite ; c’est un Anglais qui se fâche quand on prononce Bandit, parce qu’il croit qu’on veut l’insulter comme si on disait « Voleur ».
— Je n’y manquerai pas ; d’ailleurs je sais l’anglais.
— Vous savez l’anglais, vous ?
— Ma mère était Anglaise.
— C’est donc ça. Ah bien, il sera joliment content de causer avec vous, M. Bendit, et il le serait encore bien plus si vous saviez toutes les langues, parce que sa grande récréation le dimanche c’est de lire le Pater dans un livre où il est imprimé en vingt-cinq langues ; quand il a fini, il recommence, et puis après il recommence encore ; et toujours comme ça chaque dimanche ; c’est tout de même un brave homme.


XII
Entre le double rideau de grands arbres qui de chaque côté encadre la route, depuis déjà quelques instants se montraient pour disparaître aussitôt, à droite sur la pente de la colline, un clocher en ardoises, à gauche des grands combles dentelés d’ouvrages en plomb, et un peu plus loin plusieurs hautes cheminées en briques.
« Nous approchons de Maraucourt, dit Rosalie, bientôt vous allez apercevoir le château de M. Vulfran, puis ensuite les usines ; les maisons du village sont cachées dans les arbres, nous ne les verrons que quand nous serons dessus ; vis-à-vis de l’autre côté de la rivière, se trouve l’église avec le cimetière. »
En effet, en arrivant à un endroit où les saules avaient été coupés en têtards, le château surgit tout entier dans son ordonnance grandiose avec ses trois corps de bâtiment aux façades de pierres blanches et de briques rouges, ses hauts toits, ses cheminées élancées au milieu de vastes pelouses plantées de bouquets d’arbres, qui descendaient jusqu’aux prairies où elles se prolongeaient au loin avec des accidents de terrain selon les mouvements de la colline.
Perrine surprise avait ralenti sa marche, tandis que Rosalie continuait la sienne, cela produisit un heurt qui leur fit poser le panier à terre.
« Vous le trouvez beau hein ! dit Rosalie.
— Très beau.
— Eh bien M. Vulfran demeure tout seul là dedans avec une douzaine de domestiques pour le servir, sans compter les jardiniers, et les gens de l’écurie qui sont dans les communs que vous apercevez là-bas à l’extrémité du parc, à l’entrée du village où il y a deux cheminées moins hautes et moins grosses que celles des usines ; ce sont celles des machines électriques pour éclairer le château, et des chaudières à vapeur pour le chauffer ainsi que les serres. Et ce que c’est beau là dedans ; il y a de l’or partout. On dit que Messieurs les neveux voudraient bien habiter là avec M. Vulfran, mais que lui ne veut pas d’eux et qu’il aime mieux vivre tout seul, manger tout seul. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il les a logés, un dans son ancienne maison qui est à la sortie des ateliers et l’autre à côté ; comme ça ils sont plus près pour arriver aux bureaux ; ce qui n’empêche pas qu’ils ne soient quelquefois en retard tandis que leur oncle qui est le maître, qui a soixante-cinq ans, qui pourrait se reposer, est toujours là, été comme hiver, beau temps comme mauvais temps, excepté le dimanche, parce que le dimanche on ne travaille jamais, ni lui ni personne, c’est pour cela que vous ne voyez pas les cheminées fumer. »
Après avoir repris le panier elles ne tardèrent pas à avoir une vue d’ensemble sur les ateliers ; mais Perrine n’aperçut qu’une confusion de bâtiments, les uns neufs, les autres vieux, dont les toits en tuiles ou en ardoises se groupaient autour d’une énorme cheminée qui écrasait les autres de sa masse grise dans presque toute sa hauteur, noire au sommet.
D’ailleurs elles atteignaient les premières maisons éparses dans des cours plantées de pommiers malingres et l’attention de Perrine était sollicitée par ce qu’elle voyait autour d’elle : ce village dont elle avait si souvent entendu parler.
Ce qui la frappa surtout, ce fut le grouillement des gens : hommes, femmes, enfants endimanchés autour de chaque maison, ou dans des salles basses dont les fenêtres ouvertes laissaient voir ce qui se passait à l’intérieur : dans une ville l’agglomération n’eût pas été plus tassée ; dehors on causait les bras ballants, d’un air vide, désorienté ; dedans on buvait des boissons variées qu’à la couleur on reconnaissait pour du cidre, du café ou de l’eau-de-vie, et l’on tapait les verres ou les tasses sur les tables avec des éclats de voix qui ressemblaient à des disputes.
« Que de gens qui boivent ! dit Perrine.
— Ce serait bien autre chose si nous étions un dimanche qui suit la paye de quinzaine ; vous verriez combien il y en a qui, dès midi, ne peuvent plus boire. »
Ce qu’il y avait de caractéristique dans la plupart des maisons devant lesquelles elles passaient, c’était que presque toutes si vieilles, si usées, si mal construites qu’elles fussent, en terre ou en bois hourdé d’argile, affectaient un aspect de coquetterie au moins dans la peinture des portes et des fenêtres qui tirait l’œil comme une enseigne. Et en effet c’en était une ; dans ces maisons on louait des chambres aux ouvriers, et cette peinture, à défaut d’autres réparations, donnait des promesses de propreté, qu’un simple regard jeté dans les intérieurs démentait aussitôt.
« Nous arrivons, dit Rosalie en montrant de sa main libre une petite maison en briques qui barrait le chemin dont une haie tondue aux ciseaux la séparait ; au fond de la cour et derrière se trouvent les bâtiments qu’on loue aux ouvriers : la maison, c’est pour le débit, la mercerie ; et au premier étage sont les chambres des pensionnaires. »
Dans la haie, une barrière en bois s’ouvrait sur une petite cour, plantée de pommiers, au milieu de laquelle une allée empierrée d’un gravier grossier conduisait à la maison. À peine avaient-elles fait quelques pas dans cette allée, qu’une femme, jeune encore, parut sur le seuil et cria :
« Dépêche té donc, caleuse, en v’là eine affaire pour aller à Picquigny, tu t’auras assez câliné.
— C’est ma tante Zénobie, dit Rosalie à mi-voix, elle n’est pas toujours commode.
— Qué que tu chuchottes ?
— Je dis que si on ne m’avait pas aidé à porter le panier, je ne serais pas arrivée.
— Tu ferais mieux ed’ d’te taire, arkanseuse. »
Comme ces paroles étaient jetées sur un ton criard, une grosse femme se montra dans le corridor.
« Qu’est-ce que vos avé core à argouiller ? demanda-t-elle.
— C’est tante Zénobie qui me reproche d’être en retard grand’mère ; il est lourd le panier.
— C’est bon, c’est bon, dit la grand’mère placidement, pose là ton panier, et va prendre ton fricot sur le potager, tu le trouveras chaud.
— Attendez-moi dans la cour, dit Rosalie à Perrine, je reviens tout de suite, nous dînerons ensemble ; allez acheter votre pain ; le boulanger est dans la troisième maison à gauche ; dépêchez-vous. »
Quand Perrine revint, elle trouva Rosalie assise devant une table installée à l’ombre d’un pommier, et sur laquelle étaient posées deux assiettes pleines d’un ragoût aux pommes de terre.
« Asseyez-vous, dit Rosalie, nous allons partager mon fricot.
— Mais…
— Vous pouvez accepter ; j’ai demandé à mère Françoise, elle veut bien. »
Puisqu’il en était ainsi, Perrine crut qu’elle ne devait pas se faire prier, et elle prit place à la table.
« J’ai aussi parlé pour votre logement, c’est arrangé : vous n’aurez qu’à donner vos vingt-huit sous à mère Françoise ; v’là où vous habiterez. »
Du doigt elle montra un bâtiment aux murs d’argile dont on n’apercevait qu’une partie au fond de la cour, le reste étant masqué par la maison en briques, et ce qu’on en voyait paraissait si usé, si cassé qu’on se demandait comment il tenait encore debout.
« C’était là que mère Françoise demeurait avant de faire construire notre maison avec l’argent qu’elle a gagné comme nourrice de M. Edmond. Vous n’y serez pas aussi bien que dans la maison ; mais les ouvriers ne peuvent pas être logés comme les bourgeois, n’est-ce pas ? »
À une autre table placée à une certaine distance de la leur, un homme de quarante ans environ, grave, raide dans un veston boutonné, coiffé d’un chapeau à haute forme, lisait avec une profonde attention un petit livre relié.
« C’est M. Bendit, il lit son Pater, » dit Rosalie à voix basse.
Puis tout de suite, sans respecter l’application de l’employé, elle s’adressa à lui :
« M. Bendit, voilà une jeune fille qui parle anglais.
— Ah ! » dit-il sans lever les yeux.
Et ce ne fut qu’après deux minutes au moins qu’il tourna les yeux vers elles.
« Are you an English girl ? demanda-t-il.
— No sir, but my mother was. »
Sans un mot de plus il se replongea dans sa lecture passionnante.
Elles achevaient leur repas quand le roulement d’une voiture légère se fit entendre sur la route, et presque aussitôt ralentit devant la haie.

« On dirait le phaéton de M. Vulfran, » s’écria Rosalie en se levant vivement.
La voiture fit encore quelques pas et s’arrêta devant l’entrée.
« C’est lui, » dit Rosalie en courant vers la rue.
Perrine n’osa pas quitter sa place, mais elle regarda.
Deux personnes se trouvaient dans la voiture à roues basses : un jeune homme qui conduisait, et un vieillard à cheveux blancs, au visage pâle coupé de veinules rouges sur les joues, qui se tenait immobile, la tête coiffée d’un chapeau de paille, et paraissait de grande taille bien qu’assis : M. Vulfran Paindavoine.
Rosalie s’était approchée du phaéton.
« Voici quelqu’un, dit le jeune homme qui se préparait à descendre.
— Qui est-ce ? » demanda M. Vulfran Paindavoine.
Ce fut Rosalie qui répondit à cette question :
« Moi, Rosalie.
— Dis à ta grand’mère de venir me parler. »
Rosalie courut à la maison, et revint bientôt amenant sa grand’mère qui se hâtait :
« Bien le bonjour, monsieur Vulfran.
— Bonjour, Françoise.
— Qu’est-ce que je peux pour votre service, M. Vulfran ?
— C’est de votre frère Omer qu’il s’agit. Je viens de chez lui, je n’ai trouvé que son ivrogne de femme incapable de rien comprendre.
— Omer est à Amiens ; il rentre ce soir.
— Vous lui direz que j’ai appris qu’il a loué sa salle de bal pour une réunion publique à des coquins, et que je ne veux pas que cette réunion ait lieu.
— S’il est engagé ?
— Il se dégagera, ou dès le lendemain de la réunion je le mets à la porte ; c’est une des conditions de notre location, je l’exécuterai rigoureusement : je ne veux pas de réunions de ce genre ici.
— Il y en a eu à Flexelles.
— Flexelles n’est pas Maraucourt ; je ne veux pas que les gens de mon pays deviennent ce que sont ceux de Flexelles, c’est mon devoir de veiller sur eux ; vous n’êtes pas des nomades de l’Anjou ou de l’Artois, vous autres, restez ce que vous êtes. C’est ma volonté. Faites-la connaître à Omer. Adieu, Françoise.
— Adieu, monsieur Vulfran. »
Il fouilla dans la poche de son gilet :
« Où est Rosalie ?
— Me voilà, monsieur Vulfran. »
Il tendit sa main dans laquelle brillait une pièce de dix sous.
« Voilà pour toi.
— Oh ! merci, monsieur Vulfran. »
La voiture partit.
Perrine n’avait pas perdu un mot de ce qui s’était dit, mais ce qui l’avait plus fortement frappée que les paroles mêmes de M. Vulfran, c’était son air d’autorité et l’accent qu’il donnait à l’expression de sa volonté : « Je ne veux pas que cette réunion ait lieu… C’est ma volonté. » Jamais elle n’avait entendu parler sur ce ton, qui seul disait combien cette volonté était ferme et implacable, car le geste incertain et hésitant était en désaccord avec les paroles.
Rosalie ne tarda pas à revenir d’un air joyeux et triomphant.
« M. Vulfran m’a donné dix sous, dit-elle en montrant la pièce.
— J’ai bien vu.
— Pourvu que tante Zénobie ne le sache pas, elle me les prendrait pour me les garder.
— J’ai cru qu’il ne vous connaissait pas.
— Comment ! il ne me connaît pas ; il est mon parrain !
— Il a demandé : « où est Rosalie ? » quand vous étiez près de lui.
— Dame, puisqu’il n’y voit pas.
— Il n’y voit pas !
— Vous ne savez pas qu’il est aveugle ?
— Aveugle ! »
Tout bas elle répéta le mot deux ou trois fois.
« Il y a longtemps qu’il est aveugle ? dit-elle.
— Il y a longtemps que sa vue faiblissait, mais on n’y faisait pas attention, on pensait que c’était le chagrin de l’absence de son fils. Sa santé, qui avait été bonne, devint mauvaise : il eut des fluxions de poitrine, et il resta avec la toux ; et puis, un jour il ne vit plus ni pour lire, ni pour se conduire. Pensez quelle inquiétude dans le pays, s’il était obligé de vendre ou d’abandonner les usines ! Ah ! bien oui, il n’a rien abandonné du tout, et a continué de travailler comme s’il avait ses bons yeux. Ceux qui avaient compté sur sa maladie pour faire les maîtres, ont été remis à leur place, — elle baissa la voix, — les neveux et M. Talouel le directeur. »
Zénobie, sur le seuil, cria :
« Rosalie, vas-tu venir, fichue caleuse ?
— Je finis d’ manger.
— Y a du monde à servir.
— Il faut que je vous quitte.
— Ne vous gênez pas pour moi.
— À ce soir. »
Et d’un pas lent, à regret, elle se dirigea vers la maison.


XIII
Après son départ, Perrine fût volontiers restée assise à sa table comme si elle était là chez elle. Mais justement elle n’était pas chez elle, puisque cette cour était réservée aux pensionnaires, non aux ouvriers qui n’avaient droit qu’à la petite cour du fond où il n’y avait ni bancs, ni chaises, ni table. Elle quitta donc son banc, et s’en alla au hasard, d’un pas de flânerie par les rues qui se présentaient devant elle.
Mais si doucement qu’elle marchât, elle les eut bientôt parcourues toutes, et comme elle se sentait suivie par des regards curieux qui l’empêchaient de s’arrêter lorsqu’elle en avait envie, elle n’osa pas revenir sur ses pas et tourner indéfiniment dans le même cercle. Au haut de la côte, à l’opposé des usines, elle avait aperçu un bois dont la masse verte se détachait sur le ciel : là peut-être elle trouverait la solitude en cette journée du dimanche, et pourrait s’asseoir sans que personne fît attention à elle.
En effet il était désert, comme déserts aussi étaient les champs qui le bordaient, de sorte qu’à sa lisière, elle put s’allonger librement sur la mousse, ayant devant elle la vallée et tout le village qui en occupait le centre. Quoiqu’elle le connût bien par ce que son père lui en avait raconté, elle s’était un peu perdue dans le dédale des rues tournantes ; mais maintenant qu’elle le dominait, elle le retrouvait tel qu’elle se le représentait en le décrivant à sa mère pendant leurs longues routes, et aussi tel qu’elle le voyait dans les hallucinations de la faim comme une terre promise, en se demandant désespérément si elle pourrait jamais l’atteindre.
Et voilà qu’elle y était arrivée ; qu’elle l’avait étalé devant ses yeux ; que du doigt elle pouvait mettre chaque rue, chaque maison à sa place précise.
Quelle joie ! c’était vrai ; c’était vrai, ce Maraucourt dont elle avait tant de fois prononcé le nom comme une obsession, et que depuis son entrée en France elle avait cherché sur les bâches des voitures qui passaient ou celles des wagons arrêtés dans les gares, comme si elle avait besoin de le voir pour y croire ; ce n’était plus le pays du rêve, extravagant, vague ou insaisissable, mais celui de la réalité.
Droit devant elle, de l’autre côté du village, sur la pente opposée à celle où elle était assise se dressaient les bâtiments de l’usine, et à la couleur de leurs toits elle pouvait suivre

l’histoire de leur développement comme si un habitant du pays la lui racontait.
Au centre et au bord de la rivière, une vieille construction en briques, et en tuiles noircies, que flanquait une haute et grêle cheminée rongée par le vent de mer, les pluies et la fumée était l’ancienne filature de lin, longtemps abandonnée, que trente-cinq ans auparavant le petit fabricant de toiles Vulfran Paindavoine avait louée pour s’y ruiner, disaient les fortes têtes de la contrée, pleines de mépris pour sa folie. Mais au lieu de la ruine, la fortune était arrivée petite d’abord, sou à sou, bientôt millions à millions. Rapidement autour de cette mère Gigogne les enfants avaient pullulé. Les aînés mal bâtis, mal habillés, chétifs comme leur mère, ainsi qu’il arrive souvent à ceux qui ont souffert de la misère. Les autres, au contraire, et surtout les plus jeunes, superbes, forts, plus forts qu’il n’est besoin, parés avec des revêtements de décorations polychromes qui n’avaient rien du misérable hourdis de mortier ou d’argile des grands frères usés avant l’âge, semblaient, avec leurs fermes en fer et leurs façades roses ou blanches en briques vernies, défier les fatigues du travail et des années. Alors que les premiers bâtiments se tassaient sur un terrain étroitement mesuré autour de la vieille fabrique, les nouveaux s’étaient largement espacés dans les prairies environnantes, reliés entre eux par des rails de chemin de fer, des arbres de transmission et tout un réseau de fils électriques, qui couvraient l’usine entière d’un immense filet.
Longtemps elle resta perdue dans le dédale de ces rues, allant des puissantes cheminées, hautes et larges, aux paratonnerres qui hérissaient les toits, aux mâts électriques, aux wagons de chemin de fer, aux dépôts de charbon, tâchant de se représenter par l’imagination ce que pouvait être la vie de cette petite ville morte en ce moment, lorsque tout cela chauffait, fumait, marchait, tournait, ronflait avec ces bruits formidables qu’elle avait entendus dans la plaine Saint-Denis, en quittant Paris.
Puis ses yeux descendant au village, elle vit qu’il avait suivi le même développement que l’usine : les vieux toits couverts de sedum en fleurs qui leur faisaient des chappes d’or, s’étaient tassés autour de l’église ; les nouveaux qui gardaient encore la teinte rouge de la tuile sortie depuis peu du four, s’étaient éparpillés dans la vallée au milieu des prairies et des arbres en suivant le cours de la rivière ; mais, contrairement à ce qui se voyait dans l’usine, c’était les vieilles maisons qui faisaient bonne figure, avec l’apparence de la solidité, et les neuves qui paraissaient misérables, comme si les paysans qui habitaient autrefois le village agricole de Maraucourt, étaient alors plus à leur aise que ne l’étaient maintenant ceux de l’industrie.
Parmi ces anciennes maisons une dominait les autres par son importance, et s’en distinguait encore par le jardin planté de grands arbres qui l’entourait, descendant en deux terrasses garnies d’espaliers jusqu’à la rivière où il aboutissait à un lavoir. Celle-là, elle la reconnut : c’était celle que M. Vulfran avait occupée en s’établissant à Maraucourt, et qu’il n’avait quittée que pour habiter son château. Que d’heures, son père, enfant, avait passées sous ce lavoir aux jours des lessives, et dont il avait gardé le souvenir pour avoir entendu là, dans le caquetage des lavandières, les longs récits des légendes du pays, qu’il avait plus tard racontés à sa fille : la Fée des tourbières, l’Enlisage des Anglais, le Leuwarou d’Hangest, et dix autres qu’elle se rappelait comme si elle les avait entendus la veille.
Le soleil, en tournant, l’obligea à changer de place, mais elle n’eut que quelques pas à faire, pour en trouver une valant celle qu’elle abandonnait, où l’herbe était aussi douce, aussi parfumée, avec une aussi belle vue sur le village et toute la vallée, si bien que, jusqu’au soir, elle put rester là dans un état de béatitude tel qu’elle n’en avait pas goûté depuis longtemps.
Certainement elle n’était pas assez imprévoyante pour s’abandonner aux douceurs de son repos, et s’imaginer que c’en était fini de ses épreuves. Parce qu’elle avait assurés le travail, le pain et le coucher, tout n’était pas dit, et ce qui lui restait à acquérir pour réaliser les espérances de sa mère paraissait si difficile qu’elle ne pouvait y penser qu’en tremblant ; mais enfin, c’était un si grand résultat que de se trouver dans ce Maraucourt, où elle avait tant de chances contre elle pour n’arriver jamais, qu’elle devait maintenant ne désespérer de rien, si long que fût le temps à attendre, si dures que fussent les luttes à soutenir. Un toit sur la tête, dix sous par jour, n’était-ce pas la fortune pour la misérable fille qui n’avait pour dormir que la grand’route, et pour manger, rien autre chose que l’écorce des bouleaux ?
Il lui semblait qu’il serait sage de se tracer un plan de conduite, en arrêtant ce qu’elle devait faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, au milieu de la vie nouvelle qui allait commencer pour elle dès le lendemain ; mais cela présentait une telle difficulté dans l’ignorance de tout où elle se trouvait, qu’elle comprit bientôt que c’était une tâche de beaucoup au-dessus de ses forces : sa mère, si elle avait pu arriver à Maraucourt, aurait sans doute su ce qu’il convenait de faire ; mais elle n’avait ni l’expérience, ni l’intelligence, ni la prudence, ni la finesse, ni aucune des qualités de cette pauvre mère, n’étant qu’une enfant, sans personne pour la guider, sans appuis, sans conseils.
Cette pensée et plus encore l’évocation de sa mère amenèrent dans ses yeux un flot de larmes ; elle se mit alors à pleurer sans pouvoir se retenir, en répétant le mot que tant de fois elle avait dit depuis son départ du cimetière comme s’il avait le pouvoir magique de la sauver :
« Maman, chère maman ! »
De fait, ne l’avait-il pas secourue, fortifiée, relevée quand elle s’abandonnait dans l’accablement de la fatigue, et du désespoir ? eût-elle soutenu la lutte jusqu’au bout, si elle ne s’était pas répété les dernières paroles de la mourante : « Je te vois,… oui, je te vois heureuse ? » N’est-il pas vrai que ceux qui vont mourir, et dont l’âme flotte déjà entre la terre et le ciel, savent bien des choses mystérieuses qui ne se révèlent pas aux vivants ?
Cette crise, au lieu de l’affaiblir, lui fit du bien, et elle en sortit le cœur plus fort d’espoir, exalté de confiance, s’imaginant que la brise, qui de temps en temps passait dans l’air calme du soir, apportait une caresse de sa mère sur ses joues mouillées, et lui soufflait ses dernières paroles : « Je te vois heureuse. »
Et pourquoi non ? Pourquoi sa mère ne serait-elle pas près d’elle, en ce moment penchée sur elle comme son ange gardien ?
Alors l’idée lui vint de s’entretenir avec elle et de lui demander de répéter le pronostic qu’elle lui avait fait à Paris. Mais quel que fût son état d’exaltation elle n’imagina pas qu’elle pouvait lui parler comme à une vivante, avec nos mots ordinaires, pas plus qu’elle n’imagina que sa mère pouvait répondre avec ces mêmes mots, puisque les ombres ne parlent pas comme les vivants, bien qu’elles parlent, cela est certain, pour qui sait comprendre leur mystérieux langage.
Assez longtemps elle resta absorbée dans sa recherche, penchée sur cet insondable inconnu qui l’attirait en la troublant jusqu’à l’affoler ; puis machinalement ses yeux s’attachèrent sur un groupe de grandes marguerites qui dominaient de leurs larges corolles blanches l’herbe de la lisière dans laquelle elle était couchée, et alors, se levant vivement, elle alla en cueillir quelques-unes, qu’elle prit en fermant les yeux pour ne pas les choisir.
Cela fait, elle revint à sa place et s’assit avec un recueillement grave ; puis, d’une main que l’émotion rendait tremblante, elle commença à effeuiller une corolle :
« Je réussirai, un peu, beaucoup, tout à fait, pas du tout ; je réussirai, un peu, beaucoup, tout à fait, pas du tout. »
Et ainsi de suite, scrupuleusement jusqu’à ce qu’il ne restât plus que quelques pétales.
Combien ? Elle ne voulut pas les compter, car leur chiffre eût dit leur réponse ; mais vivement, quoique son cœur fût terriblement serré, elle les effeuilla : « Je réussirai,… un peu,… beaucoup,… tout à fait. »
En même temps un souffle tiède lui passa dans les cheveux, et sur les lèvres : la réponse de sa mère, dans un baiser, le plus tendre qu’elle lui eût donné.


XIV
Enfin elle se décida à quitter sa place ; la nuit tombait, et déjà dans l’étroite vallée comme plus loin dans celle de la Somme, montaient des vapeurs blanches qui flottaient légères autour des cimes confuses des grands arbres ; des petites lumières piquaient çà et là l’obscurité s’allumant derrière les vitres des maisons, et des rumeurs vagues passaient dans l’air tranquille mêlées à des bribes de chansons.
Elle était assez aguerrie pour n’avoir pas peur de s’attarder dans un bois ou sur la grand’route ; mais, à quoi bon ! Elle possédait maintenant ce qui lui avait si misérablement manqué : un toit et un lit ; d’ailleurs, puisqu’elle devait se lever le lendemain tôt pour aller au travail, mieux valait se coucher de bonne heure.
Quand elle entra dans le village, elle vit que les rumeurs, et les chants qu’elle avait entendus partaient des cabarets aussi pleins de buveurs attablés que lorsqu’elle était arrivée, et d’où s’exhalaient par les portes ouvertes des odeurs de café, d’alcool chauffé et de tabac qui emplissaient la rue comme si elle eût été un vaste estaminet. Et toujours ces cabarets se succédaient, sans interruption, porte à porte quelquefois, si bien que sur trois maisons il y en avait au moins une qu’occupait un débit de boissons. Dans ses voyages sur les grands chemins et par tous les pays, elle avait passé devant bien des assemblées de buveurs, mais nulle part elle n’avait entendu tapage de paroles, claires et criardes, comme celui qui sortait confusément de ces salles basses.
En arrivant à la cour de mère Françoise, elle aperçut, à la table où elle l’avait déjà vu, Bendit qui lisait toujours, une chandelle entourée d’un morceau de journal pour protéger sa flamme, posée devant lui sur la table, autour de laquelle des papillons de nuit et des moustiques voltigeaient, sans qu’il parût en prendre souci, absorbé dans sa lecture.
Cependant quand elle passa près de lui, il leva la tête et la reconnut ; alors, pour le plaisir de parler sa langue, il lui dit :
« A good night’s rest to you. »
À quoi elle répondit :
« Good evening, sir.
— Où avez-vous été ? continua-t-il en anglais.
— Me promener dans les bois, répondit-elle en se servant de la même langue.
— Toute seule ?
— Toute seule, je ne connais personne à Maraucourt.
— Alors pourquoi n’êtes-vous pas restée à lire ? Il n’y a rien de meilleur, le dimanche, que la lecture.
— Je n’ai pas de livres.
— Êtes-vous catholique ?
— Oui, monsieur.
— Je vous en prêterai tout de même quelques-uns : farewell.
— Good-bye, sir. »
Sur le seuil de la maison, Rosalie était assise, adossée au chambranle, se reposant, à respirer le frais.
« Voulez-vous vous coucher ? dit-elle.
— Je voudrais bien.
— Je vas vous conduire, mais avant il faut vous entendre avec mère Françoise ; entrons dans le débit. »
L’affaire, ayant été arrangée entre la grand’mère et sa petite-fille, fut vivement réglée par le payement des vingt-huit sous que Perrine allongea sur le comptoir, plus deux sous pour l’éclairage pendant la semaine.
« Pour lors vous voulez vous établir dans notre pays, ma petite ? dit mère Françoise d’un air placide et bienveillant.
— Si c’est possible.
— Ça sera possible si vous voulez travailler.
— Je ne demande que cela.
— Eh bien ça ira ; vous ne resterez pas toujours à cinquante centimes, vous arriverez à un franc, même à deux ; si plus tard, vous épousez un bon ouvrier qui en gagne trois, ça vous fera cent sous par jour ; avec ça on est riche… quand on ne boit pas, seulement il faut ne pas boire. C’est bien heureux que M. Vulfran ait donné du travail au pays ; c’est vrai qu’il y a la terre, mais la terre ne peut pas nourrir tous ceux qui lui demandent à manger. »
Pendant que la vieille nourrice débitait cette leçon avec l’importance et l’autorité d’une femme habituée à ce qu’on respecte sa parole, Rosalie atteignait un paquet de linge dans une armoire et Perrine, qui tout en écoutant, la suivait de l’œil, remarquait que les draps qu’on lui préparait étaient en grosse toile d’emballage jaune ; mais depuis si longtemps elle ne couchait plus dans des draps, qu’elle devait encore s’estimer heureuse d’avoir ceux-là, si durs qu’ils fussent. Déshabillée ! La Rouquerie qui durant ses voyages ne faisait jamais la dépense d’un lit, n’avait même pas eu l’idée de lui offrir ce plaisir, et longtemps avant leur arrivée en France les draps de la roulotte, excepté ceux qui servaient à la mère, avaient été vendus, ou s’en étaient allés en lambeaux.
Elle prit la moitié du paquet et suivant Rosalie elles traversèrent la cour où une vingtaine d’ouvriers, hommes, femmes, enfants étaient assis sur des billots de bois, des blocs de pierre, attendant l’heure du coucher en causant et en fumant. Comment tout ce monde pouvait-il loger dans la vieille maison qui n’était pas grande ?
La vue de son grenier, quand Rosalie eut allumé une petite chandelle placée derrière un treillis en fil de fer, répondit à cette question. Dans un espace de six mètres de long sur un peu plus de trois de large, six lits étaient alignés le long des cloisons, et le passage qui restait entre eux au milieu avait à peine un mètre. Six personnes devaient donc passer la nuit là où il y avait à peine place pour deux ; aussi, bien qu’une petite fenêtre fût ouverte dans le mur opposé à l’entrée, respirait-on dès la porte une odeur âcre et chaude qui suffoqua Perrine. Mais elle ne se permit pas une observation, et comme Rosalie disait en riant :
« Ça, vous paraît peut-être un peu petiot ! »
Elle se contenta de répondre :
« Un peu.
— Quatre sous, ce n’est pas cent sous.
— Bien sûr. »
Après tout, mieux encore valait pour elle cette chambre trop petite que les bois et les champs : puisqu’elle avait supporté l’odeur de la baraque de Grain de Sel, elle supporterait bien celle-là sans doute.
« V’là votre lit », dit Rosalie en lui désignant celui qui était placé devant la fenêtre.
Ce qu’elle appelait un lit était une paillasse posée sur quatre pieds réunis par deux planches et des traverses ; un sac tenait lieu d’oreiller.
« Vous savez, la fougère est fraîche, dit Rosalie, on ne mettrait pas quelqu’un qui arrive, coucher sur de la vieille fougère ; ce n’est pas à faire quoiqu’on raconte que dans les hôtels, les vrais, on ne se gêne pas. »
S’il y avait trop de lits dans cette petite chambre, par contre on n’y voyait pas une seule chaise.
« Il y a des clous aux murs, dit Rosalie répondant à la muette interrogation de Perrine, c’est très commode pour accrocher les vêtements. »
Il y avait aussi quelques boîtes et des paniers sous les lits dans lesquels les locataires qui avaient du linge pouvaient le serrer, mais comme ce n’était pas le cas de Perrine, le clou planté aux pieds de son lit lui suffisait de reste.
« Vous serez avec des braves gens, dit Rosalie ; si la Noyelle cause dans la nuit, c’est qu’elle aura trop bu, il ne faudra pas y faire attention : elle est un peu bavarde. Demain, levez-vous avec les autres ; je vous dirai ce que vous devrez faire pour être embauchée. Bonsoir.
— Bonsoir et merci.
— Pour vous servir. »
Perrine se hâta de se déshabiller, heureuse d’être seule et de n’avoir pas à subir la curiosité de la chambrée. Mais en se mettant entre ses draps elle n’éprouva pas la sensation de bien-être sur laquelle elle comptait tant ils étaient rudes : tissés avec des copeaux, ils n’eussent pas été plus raides, mais cela était insignifiant, la terre aussi était dure la première fois qu’elle avait couché dessus, et, bien vite, elle s’y était habituée.
La porte ne tarda pas à s’ouvrir et une jeune fille d’une quinzaine d’années étant entrée dans la chambre commença à se déshabiller, en regardant de temps en temps du côté de Perrine, mais sans rien dire. Comme elle était endimanchée, sa toilette fut longue, car elle dut ranger dans une petite caisse ses vêtements des jours de fête, et accrocher à un clou pour le lendemain ceux du travail.
Une autre arriva, puis une troisième, une quatrième ; alors, ce fut un caquetage assourdissant ; toutes parlant en même temps, chacune racontait sa journée ; dans l’espace ménagé entre les lits elles tiraient et repoussaient leurs boîtes ou leurs paniers qui s’enchevêtraient les uns dans les autres, et cela provoquait des mouvements d’impatience ou des paroles de
 colère qui toutes se tournaient contre la propriétaire du grenier.
colère qui toutes se tournaient contre la propriétaire du grenier.
« Queu taudis !
— El’mettra bentôt d’autres lits au mitan.
— Por sûr, j’ne resterai point la d’ans.
— Où qu’ t’iras ; c’est y mieux cheux l’zautres. »
Et les exclamations se croisaient ; à la fin cependant, quand les deux premières arrivées se furent couchées, un peu d’ordre s’établit, et bientôt tous les lits furent occupés, un seul excepté.
Mais pour cela les conversations ne cessèrent point, seulement elles tournèrent ; après s’être dit ce qu’il y avait eu d’intéressant dans la journée écoulée, on passa à celle du lendemain, au travail des ateliers, aux griefs, aux plaintes, aux querelles de chacune, aux potins de l’usine entière, avec un mot de ses chefs : M. Vulfran, ses neveux qu’on appelait les « jeunes », le directeur, Talouel qu’on ne nomma qu’une fois, mais qu’on désigna par des qualificatifs qui disaient mieux que des phrases la façon dont on le jugeait : la Fouine, l’Mince, Judas.
Alors Perrine éprouva un sentiment bizarre dont les contradictions l’étonnèrent : elle voulait être tout oreilles, sentant de quelle importance pouvaient être pour elle les renseignements qu’elle entendait ; et d’autre part elle était gênée, comme honteuse d’écouter ces propos.
Cependant ils allaient leur train, mais si vagues bien souvent, ou si personnels qu’il fallait connaître ceux à qui ils s’appliquaient pour les comprendre ; ainsi elle fut longtemps sans deviner que la Fouine, l’Mince et Judas ne faisaient qu’un avec Talouel qui était la bête noire des ouvriers, détesté de tous autant que craint, mais avec des réticences, des réserves, des précautions, des hypocrisies qui disaient quelle peur on avait de lui. Toutes les observations se terminaient par le même mot, ou à peu près :
« N’empêche que ce soit ein ben brav’ homme !
— Et juste donc !
— Oh ! pour ça ! »
Mais tout de suite une autre ajoutait :
« N’empêche aussi… »
Alors les preuves étaient données de façon à montrer cette bonté et cette justice.
« S’il ne fallait point gagner son pain ! »
Peu à peu les langues se ralentirent.
« Si on dormait, dit une voix alanguie.
— Qui t’en empêche ?
— La Noyelle n’est pas rentrée.
— Je viens de la voir.
— Ça y est-il ?
— En plein.
— Assez pour qu’elle ne puisse pas monter l’escalier ?
— Ça je ne sais pas.
— Si on fermait la porte à la cheville ?
— Et le tapage qu’elle ferait.
— Ça va recommencer comme l’autre dimanche.
— Peut-être pire encore. »
À ce moment on entendit un bruit de pas lourds et hésitants dans l’escalier.
« La voilà. »
Mais les pas s’arrêtèrent et il y eut une chute suivie de gémissements.
« Elle est tombée.
— Si elle pouvait ne pas se relever.
— Elle dormirait aussi ben dans l’escalier qu’ici.
— Et nous dormirions mieux. »
Les gémissements continuaient mêlés d’appels.
« Viens donc, Laïde : un p’tit coup de main, m’n’éfant.
— Plus souvent que je vas y aller.
— Ohé Laïde, Laïde ! »
Mais Laïde n’ayant pas bougé, au bout d’un certain temps les appels cessèrent.
« Elle s’endort.
— Quelle chance. »
Elle ne s’endormait pas du tout ; au contraire elle essayait à nouveau de monter l’escalier, et elle criait :
« Laïde, viens me donner la main, m’n’éfant, Laïde, Laïde. »
Elle n’avançait pas évidemment, car les appels partaient toujours du bas de l’escalier de plus en plus pressants à chaque cri, si bien qu’ils finirent par s’accompagner de larmes :
« Ma p’tite Laïde, ma p’tite Laïde, p’tite, p’tite ; l’escalier s’enfonce, oh ! la ! la ! »
Un éclat de rire courut de lit en lit.
« C’est-y que t’es pas rentrée, Laïde, dis, dis Laïde, dis ; je vas aller te qu’ri.
— Nous v’là tranquilles, dit une voix.
— Mais non, elle va chercher Laïde qu’elle ne trouvera pas, et quand elle reviendra dans une heure ça recommencera.
— On ne dormira donc jamais !
— Va lui donner la main, Laïde.
— Vas-y té.
— C’est té qu’é veut. »
Laïde se décida, passa un jupon et descendit.
« Oh ! m’n’éfant, m’n’éfant », cria la voix émue de la Noyelle.
Il semblait qu’elles n’avaient qu’à monter l’escalier qui ne s’enfoncerait plus, mais la joie de voir Laïde chassa cette idée :
« Viens avec mé, je vas te payer un p’tiot pot. »
Laïde ne se laissa pas tenter par cette proposition.
« Allons nous coucher, dit-elle.
— Non, viens avec mé, ma p’tite Laïde. »
La discussion se prolongea, car la Noyelle qui s’était obstinée dans sa nouvelle idée, répétait son mot, toujours le même :
« Un p’tiot pot.
— Ça ne finira jamais, dit une voix.
— J’voudrais pourtant dormir, mé.
— Faut s’lever demain.
— Et c’est comme ça tous les dimanches. »
Et Perrine qui avait cru que quand elle aurait un toit sur la tête, elle trouverait le sommeil le plus paisible ! Comme celui en plein champ, avec les effarements de l’ombre et les hasards du temps, valait mieux cependant que cet entassement dans cette chambrée, avec ses promiscuités, son tapage et l’odeur nauséeuse qui commençait à la suffoquer d’une façon si gênante qu’elle se demandait comment elle pourrait la supporter après quelques heures.
Au dehors, la discussion durait toujours et l’on entendait la voix de la Noyelle qui répétait : « Un p’tiot pot », à laquelle celle de Laïde répondait : « Demain ».
« Je vas aller aider Laïde, dit une des femmes, ou ça durera jusqu’à demain. »
En effet elle se leva et descendit ; alors dans l’escalier se produisit un grand brouhaha de voix, mêlé à des bruits de pas lourds, à des coups sourds, et aux cris des habitants du rez-de-chaussée furieux de ce tapage : toute la maison semblait ameutée.
À la fin la Noyelle fut traînée dans la chambre, pleurant avec des exclamations désespérées :
« Qu’est-ce que je vos ai fait ? »
Sans écouter ses plaintes, on la déshabilla et on la coucha ; mais pour cela elle ne s’endormit point et continua de pleurer en gémissant.
« Qu’est que je vos ai fait pour que vous me brutalisiez ? Je suis-t’y malheureuse ! Je suis-t’y une voleuse qu’on ne veut pas boire avec mé ? Laïde, j’ai sef. »
Plus elle se plaignait, plus l’exaspération contre elle montait dans la chambrée, chacune criant son mot plus ou moins fâché.
Mais elle continuait toujours :
« Salut, turlututu, chapeau pointu, fil écru, t’es rabattu. »
Quand elle eut épuisé tous les mots en u qui amusaient son oreille, elle passa à d’autres qui n’avaient pas plus de sens.
« Le café à la vapeur, n’a pas peur, meilleur pour le cœur ; va donc, balayeur ; et ta sœur ? Bonjour, monsieur le brocanteur. Ah ! vous êtes buveur ? ça fait mon bonheur, peut-être votre malheur. Ça donne la jaunisse ; faut aller à l’hospice ; voyez la directrice ; mangez de la réglisse ; mon père en vendait et l’en régalait, aussi ça m’allait. Ce que j’ai sef, monsieur le chef, sef, sef, sef ! »
De temps en temps la voix se ralentissait et faiblissait comme si le sommeil allait bientôt se produire ; mais tout de suite elle repartait plus hâtée, plus criarde, et alors celles qui avaient commencé à s’endormir se réveillaient en sursaut en poussant des cris furieux qui épouvantaient la Noyelle, mais ne la faisaient pas taire :
« Pourquoi que vous me brutalisez ? Écoutez, pardonnez, c’est assez.
— Vous avez eu une belle idée de la monter !
— C’est té qu’as voulu.
— Si on la redescendait ?
— On ne dormira jamais. »
C’était bien le sentiment de Perrine qui se demandait si c’était vraiment ainsi tous les dimanches, et comment les camarades de la Noyelle pouvaient supporter son voisinage : n’existait-il pas à Maraucourt d’autres logements où l’on pouvait dormir tranquillement ?
Il n’y avait pas que le tapage qui fût exaspérant dans cette chambrée, l’air aussi qu’on y respirait commençait à n’être plus supportable pour elle : lourd, chaud, étouffant, chargé de mauvaises odeurs dont le mélange soulevait le cœur ou le noyait.
À la fin cependant le moulin à paroles de la Noyelle se ralentit, elle ne lança que des mots à demi formés, puis ce ne fut plus qu’un ronflement qui sortit de sa bouche.
Mais bien que le silence se fût maintenant établi dans la chambre, Perrine ne put pas s’endormir : elle était oppressée, des coups sourds lui battaient dans le front, la sueur l’inondait de la tête aux pieds.
Il n’y avait pas à chercher la cause de ce malaise : elle étouffait parce que l’air lui manquait, et si ses camarades de chambrée n’étouffaient pas comme elle, c’est qu’elles étaient habituées à vivre dans cette atmosphère, suffocante pour qui couchait ordinairement en plein champ.
Mais puisque ces femmes, des paysannes, s’étaient bien habituées à cette atmosphère, il semblait qu’elle le pourrait comme elles : sans doute il fallait du courage et de la persévérance ; mais si elle n’était pas paysanne, elle avait mené une existence aussi dure que la leur pouvait l’être, même pour les plus misérables, et dès lors elle ne voyait pas de raisons pour qu’elle ne supportât pas ce qu’elles supportaient.
Il n’y avait donc qu’à ne pas respirer, qu’à ne pas sentir, alors viendrait le sommeil, et elle savait bien que pendant qu’on dort l’odorat ne fonctionne plus.
Malheureusement, on ne respire pas quand on veut, ni comme on veut : elle eut beau fermer la bouche, se serrer le nez, il fallut bientôt ouvrir les lèvres, les narines et faire une aspiration d’autant plus profonde qu’elle n’avait plus d’air dans les poumons ; et le terrible fut que, malgré tout, elle dut répéter plusieurs fois cette aspiration.
Alors quoi ? Qu’allait-il se produire ? Si elle ne respirait pas, elle étouffait ; si elle respirait, elle était malade.
Comme elle se débattait, sa main frôla le papier qui remplaçait une des vitres de la fenêtre, contre laquelle sa couchette était posée.
Un papier n’est pas une feuille de verre, il se crève sans bruit et, crevé, il laissait entrer l’air du dehors. Quel mal y avait-il à ce qu’elle le crevât ? Pour être habituées à cette atmosphère viciée, elles n’en souffraient pas moins certainement. Donc à condition de n’éveiller personne, elle pouvait très bien déchirer ce papier.
Mais elle n’eut pas besoin d’en venir à cette extrémité qui laisserait des traces ; comme elle le tâtait, elle sentit qu’il n’était pas bien tendu, et de l’ongle elle put avec précaution en détacher un côté. Alors se collant la bouche à cette ouverture, elle put respirer, et ce fut dans cette position que le sommeil la prit.


XV
Quand elle se réveilla une lueur blanchissait les vitres, mais si pâle qu’elle n’éclairait pas la chambre ; au dehors des coqs chantaient, par l’ouverture du papier pénétrait un air froid ; c’était le jour qui pointait.
Malgré ce léger souffle qui venait du dehors, la mauvaise odeur de la chambrée n’avait pas disparu ; s’il était entré un peu d’air pur, l’air vicié n’était pas du tout sorti, et en s’accumulant, en s’épaississant, en s’échauffant, il avait produit une moiteur asphyxiante.
Cependant tout le monde dormait d’un sommeil sans mouvements que coupaient seulement de temps en temps quelques plaintes étouffées.
Comme elle essayait d’agrandir l’ouverture du papier, elle donna maladroitement un coup de coude contre une vitre, assez fort pour que la fenêtre mal ajustée dans son cadre résonnât avec des vibrations qui se prolongèrent. Non seulement personne ne s’éveilla, comme elle le craignait, mais encore il ne parut pas que ce bruit insolite eût troublé une seule des dormeuses.
Alors son parti fut pris. Tout doucement elle décrocha ses vêtements, les passa lentement, sans bruit, et prenant ses souliers à la main, les pieds nus elle se dirigea vers la porte, dont l’aube lui indiquait la direction. Fermée simplement par une clenche, cette porte s’ouvrit silencieusement et Perrine se trouva sur le palier, sans que personne se fût aperçu de sa sortie. Alors elle s’assit sur la première marche de l’escalier et, s’étant chaussée, descendit.
Ah ! le bon air ! la délicieuse fraîcheur ! jamais elle n’avait respiré avec pareille béatitude ; et par la petite cour elle allait la bouche ouverte, les narines palpitantes, battant des bras, secouant la tête : le bruit de ses pas éveilla un chien du voisinage qui se mit à aboyer, et aussitôt d’autres chiens lui répondirent furieux.
Mais que lui importait : elle n’était plus la vagabonde contre laquelle les chiens avaient toutes les libertés, et puisqu’il lui plaisait de quitter son lit, elle en avait bien le droit sans doute, — un droit payé de son argent.
Comme la cour était trop petite pour son besoin de mouvement, elle sortit dans la rue par la barrière ouverte, et se mit à marcher au hasard, droit devant elle, sans se demander où elle allait. L’ombre de la nuit emplissait encore le chemin, mais au-dessus de sa tête elle voyait l’aube blanchir déjà la cime des arbres et le faîte des maisons ; dans quelques instants il ferait jour. À ce moment une sonnerie éclata au milieu du profond silence : c’était l’horloge de l’usine qui, en frappant trois coups, lui disait qu’elle avait encore trois heures avant l’entrée aux ateliers.
Qu’allait-elle faire de ce temps ? Ne voulant pas se fatiguer avant de se mettre au travail, elle ne pouvait pas marcher jusqu’à ce moment, et dès lors le mieux était qu’elle s’assît quelque part où elle pourrait attendre.
De minute en minute, le ciel s’était éclairci, et les choses autour d’elle avaient pris, sous la lumière rasante qui les frappait, des formes assez distinctes pour qu’elle reconnût où elle était.
Précisément au bord d’une entaille qui commençait là, et paraissait prolonger sa nappe d’eau, pour la réunir à d’autres étangs et se continuer ainsi d’entailles en entailles les unes grandes, les autres petites, au hasard de l’exploitation de la tourbe, jusqu’à la grande rivière. N’était-ce pas quelque chose comme ce qu’elle avait vu en quittant Picquigny, mais plus retiré, semblait-il, plus désert, et aussi plus couvert d’arbres dont les files s’enchevêtraient en lignes confuses ?
Elle resta là un moment, puis la place ne lui paraissant pas bonne pour s’asseoir, elle continua son chemin qui, quittant le bord de l’entaille, s’élevait sur la pente d’un petit coteau boisé ; dans ce taillis sans doute elle trouverait ce qu’elle cherchait.
Mais comme elle allait y arriver, elle aperçut au bord de l’entaille qu’elle dominait une de ces huttes en branchages et en roseaux qu’on appelle dans le pays des aumuches et qui servent l’hiver pour la chasse aux oiseaux de passage. Alors l’idée lui vint que si elle pouvait gagner cette hutte, elle s’y trouverait bien cachée, sans que personne pût se demander ce qu’elle faisait dans les prairies à cette heure matinale, et aussi sans continuer à recevoir les grosses gouttes de rosée qui ruisselaient des branches formant couvert au-dessus du chemin et la mouillaient comme une vraie pluie.
Elle redescendit et, en cherchant, elle finit par trouver dans une oseraie un petit sentier à peine tracé, qui semblait conduire à l’aumuche ; elle le prit. Mais s’il y conduisait bien, il ne conduisait pas jusque dedans car elle était construite sur un tout petit îlot planté de trois saules qui lui servaient de charpente, et un fossé plein d’eau la séparait de l’oseraie. Heureusement un tronc d’arbre était jeté sur ce fossé, bien qu’il fût assez étroit, bien qu’il fût aussi mouillé par la rosée qui le rendait glissant, cela n’était pas pour arrêter Perrine. Elle le franchit et se trouva devant une porte en roseaux liés avec de l’osier qu’elle n’eut qu’à tirer pour qu’elle s’ouvrît.
L’aumuche était de forme carrée et toute tapissée jusqu’au toit d’un épais revêtement de roseaux et de grandes herbes : aux quatre faces étaient percées des petites ouvertures invisibles du dehors, mais qui donnaient des vues sur les entours et laissaient aussi pénétrer la lumière ; sur le sol était étendue une épaisse couche de fougères ; dans un coin un billot fait d’un tronc d’arbre servait de chaise.
Ah ! le joli nid ! qu’il ressemblait peu à la chambre qu’elle venait de quitter. Comme elle eût été mieux là pour dormir,

en bon air, tranquille, couchée dans la fougère, sans autres bruits que ceux du feuillage et des eaux, plutôt qu’entre les draps si durs de Mme Françoise, au milieu des cris de la Noyelle, et de ses camarades, dans cette atmosphère horrible dont l’odeur toujours persistante la poursuivait en lui soulevant le cœur.
Elle s’allongea sur la fougère, et se tassa dans un coin contre la moelleuse paroi des roseaux en fermant les yeux. Mais comme elle ne tarda pas à se sentir gagnée par un doux engourdissement, elle se remit sur ses jambes, car il ne lui était pas permis de s’endormir tout à fait, de peur de ne pas s’éveiller avant l’entrée aux ateliers.
Maintenant le soleil était levé, et par l’ouverture exposée à l’orient, un rayon d’or entrait dans l’aumuche qu’il illuminait ; au dehors les oiseaux chantaient, et autour de l’îlot, sur l’étang, dans les roseaux, sur les branches des saules se faisait entendre une confusion de bruits, de murmures, de sifflements, de cris qui annonçaient l’éveil à la vie de toutes les bêtes de la tourbière.
Elle mit la tête à une ouverture et vit ces bêtes s’ébattre autour de l’aumuche en pleine sécurité : dans les roseaux, des libellules voletaient de çà et de là ; le long des rives, des oiseaux piquaient de leurs becs la terre humide pour saisir des vers, et sur l’étang couvert d’une buée légère, une sarcelle d’un brun cendré, plus mignonne que les canes domestiques, nageait entourée de ses petits qu’elle tâchait de maintenir près d’elle par des appels incessants, mais sans y parvenir, car ils lui échappaient pour s’élancer à travers les nénuphars fleuris où ils s’empêtraient, à la poursuite de tous les insectes qui passaient à leur portée. Tout à coup un rayon bleu rapide comme un éclair l’éblouit, et ce fut seulement après qu’il eut disparu qu’elle comprit que c’était un martin-pêcheur qui venait de traverser l’étang.
Longtemps, sans un mouvement qui, en trahissant sa présence, aurait fait envoler tout ce monde de la prairie, elle resta à sa fenêtre à le regarder. Comme tout cela était joli dans cette fraîche lumière, gai, vivant, amusant, nouveau à ses yeux, assez féerique pour qu’elle se demandât si cette île avec sa hutte n’était point une petite arche de Noé.
À un certain moment elle vit l’étang se couvrir d’une ombre noire qui passait capricieusement, agrandie, rapetissée sans cause apparente, et cela lui parut d’autant plus inexplicable que le soleil qui s’était élevé au-dessus de l’horizon continuait de briller radieux dans le ciel sans nuage. D’où pouvait venir cette ombre ? Les étroites fenêtres de l’aumuche ne lui permettant pas de s’en rendre compte, elle ouvrit la porte et vit qu’elle était produite par des tourbillons de fumée qui passaient avec la brise, et venaient des hautes cheminées de l’usine où déjà des feux étaient allumés pour que la vapeur fût en pression à l’entrée des ouvriers.
Le travail allait donc bientôt commencer, et il était temps qu’elle quittât l’aumuche pour se rapprocher des ateliers. Cependant avant de sortir, elle ramassa un journal posé sur le billot qu’elle n’avait pas aperçu, mais que la pleine lumière qui sortait par la porte ouverte lui montra, et machinalement elle jeta les yeux sur son titre : c’était le Journal d’Amiens du 25 février précédent, et alors elle fit cette réflexion que de la place qu’occupait ce journal sur le seul siège où l’on pouvait s’asseoir, aussi bien que de sa date, il résultait la preuve que depuis le 25 février l’aumuche était abandonnée, et que personne n’avait passé sa porte.


XVI
Au moment où sortant de l’oseraie elle arrivait dans le chemin, un gros sifflet fit entendre sa voix rauque et puissante au-dessus de l’usine, et presque aussitôt d’autres sifflets lui répondirent à des distances plus ou moins éloignées, par des coups également rythmés.
Elle comprit que c’était le signal d’appel des ouvriers qui partait de Maraucourt, et se répétait de villages en villages, Saint-Pipoy, Hercheux, Bacourt, Flexelles dans toutes les usines Paindavoine, annonçant à leur maître que partout en même temps on était prêt pour le travail.
Alors, craignant d’être en retard, elle hâta le pas, et en entrant dans le village elle trouva toutes les maisons ouvertes ; sur les seuils, des ouvriers mangeaient leur soupe, debout, accotés au chambranle de la porte ; dans les cabarets d’autres buvaient, dans les cours, d’autres se débarbouillaient à la pompe ; mais personne ne se dirigeait vers l’usine, ce qui signifiait assurément qu’il n’était pas encore l’heure d’entrer aux ateliers, et que, par conséquent, elle n’avait pas à se presser.
Mais trois petits coups qui sonnèrent à l’horloge, et qui furent aussitôt suivis d’un sifflement plus fort, plus bruyant que les précédents firent instantanément succéder le mouvement à cette tranquillité : des maisons, des cours, des cabarets, de partout sortit une foule compacte qui emplit la rue comme l’eût fait une fourmilière, et cette troupe d’hommes, de femmes, d’enfants se dirigea vers l’usine ; les uns fumant leur pipe à toute vapeur ; les autres mâchant une croûte hâtivement en s’étouffant ; le plus grand nombre bavardant bruyamment : à chaque instant des groupes débouchaient des ruelles latérales et se mêlaient à ce flot noir qu’ils grossissaient sans le ralentir.
Dans une poussée de nouveaux arrivants Perrine aperçut Rosalie en compagnie de la Noyelle, et en se faufilant elle les rejoignit :
« Où donc que vous étiez ? demanda Rosalie surprise.
— Je me suis levée de bonne heure, pour me promener un peu.
— Ah ! bon. Je vous ai cherchée.
— Je vous remercie bien ; mais il ne faut jamais me chercher, je suis matineuse. »
On arrivait à l’entrée des ateliers, et le flot s’engouffrait dans l’usine sous l’œil d’un homme grand, maigre, qui se tenait à une certaine distance de la grille, les mains dans les poches de son veston, le chapeau de paille rejeté en arrière, mais la tête un peu penchée en avant, le regard attentif,

de façon que personne ne défilât devant lui sans qu’il le vît.
« Le Mince », dit Rosalie d’une voix sifflée.
Mais Perrine n’avait pas besoin de ce mot ; avant qu’il lui fût jeté, elle avait deviné dans cet homme le directeur Talouel.
« Est-ce qu’il faut que j’entre avec vous ? demanda Perrine.
— Bien sûr. »
Pour elle, le moment était décisif, mais elle se raidit contre son émotion : pourquoi ne voudrait-il pas d’elle puisqu’on acceptait tout le monde ?
Quand elles arrivèrent devant lui, Rosalie dit à Perrine de la suivre et, sortant de la foule, elle s’approcha sans paraître intimidée :
« M’sieu le directeur, dit-elle, c’est une camarade qui voudrait travailler. »
Talouel jeta un rapide coup d’œil sur cette camarade :
« Dans un moment nous verrons », répondit-il.
Et Rosalie, qui savait ce qu’il convenait de faire, se plaça à l’écart avec Perrine.
À ce moment un brouhaha se produisit à la grille et les ouvriers s’écartèrent avec empressement, laissant le passage libre au phaéton de M. Vulfran, conduit par le même jeune homme que la veille : bien que tout le monde sût qu’il ne pouvait pas voir, toutes les têtes d’hommes se découvrirent devant lui, tandis que les femmes saluaient d’une courte révérence.
« Vous voyez qu’il n’arrive pas le dernier », dit Rosalie.
Le directeur fit quelques pas pressés au-devant du phaéton :
« Monsieur Vulfran, je vous présente mon respect, dit-il le chapeau à la main.
— Bonjour, Talouel. »
Perrine suivit des yeux la voiture qui continuait son chemin, et quand elle les ramena sur la grille, elle vit successivement passer les employés qu’elle connaissait déjà : Fabry l’ingénieur, Bendit, Mombleux et d’autres que Rosalie lui nomma.
Cependant la cohue s’était éclaircie, et maintenant ceux qui arrivaient couraient, car l’heure allait sonner.
« Je crois bien que les jeunes vont être en retard », dit Rosalie à mi-voix.
L’horloge sonna, il y eut une dernière poussée, puis quelques retardataires parurent à la queue leu leu, essoufflés, et la rue se trouva vide ; cependant Talouel ne quitta pas sa place et, les mains dans les poches, il continua à regarder au loin, la tête haute.
Quelques minutes s’écoulèrent, puis apparut un grand jeune homme qui n’était pas un ouvrier, mais bien un monsieur, beaucoup plus monsieur même par ses manières et sa tenue soignée que l’ingénieur et les employés ; tout en marchant à pas hâtés il nouait sa cravate, ce qu’il n’avait pas eu le temps de faire évidemment.
Quand il arriva devant le directeur, celui-ci ôta son chapeau comme il l’avait fait pour M. Vulfran, mais Perrine remarqua que les deux saluts ne se ressemblaient en rien.
« Monsieur Théodore, je vous présente mon respect », dit Talouel.
Mais bien que cette phrase fût formée des mêmes mots que celle qu’il avait adressée à M. Vulfran, elle ne disait pas du tout la même chose, cela était évident aussi.
« Bonjour, Talouel. Est-ce que mon oncle est arrivé ?
— Mon Dieu oui, monsieur Théodore, il y a bien cinq minutes.
— Ah !
— Vous n’êtes pas le dernier ; c’est M. Casimir qui aujourd’hui est en retard, bien que comme vous il n’ait pas été à Paris ; mais je l’aperçois là-bas. »
Tandis que Théodore se dirigeait vers les bureaux, Casimir avançait rapidement.
Celui-là ne ressemblait en rien à son cousin, pas plus dans sa personne que dans sa tenue ; petit, raide, sec ; quand il passa devant le directeur, cette raideur se précisa dans la courte inclinaison de tête qu’il lui adressa sans un seul mot.
Les mains toujours dans les poches de son veston, Talouel lui présenta aussi son respect, et ce fut seulement quand il eut disparu qu’il se tourna vers Rosalie :
« Qu’est-ce qu’elle sait faire ta camarade ? »
Perrine répondit elle-même à cette question :
« Je n’ai pas encore travaillé dans les usines », dit-elle d’une voix qu’elle s’efforça d’affermir.
Talouel l’enveloppa d’un rapide coup d’œil, puis s’adressant à Rosalie :
« Dis de ma part à Oneux de la mettre aux wagonets, et ouste ! plus vite que ça.
— Qu’est-ce que c’est que les wagonets ? » demanda Perrine en suivant Rosalie à travers les vastes cours qui séparaient les ateliers les uns des autres. Serait-elle en état d’accomplir ce travail, en aurait-elle la force, l’intelligence ? fallait-il un apprentissage ? toutes questions terribles pour elle, et qui l’angoissaient d’autant plus que maintenant qu’elle se voyait admise dans l’usine, elle sentait qu’il dépendait d’elle de s’y maintenir.
« N’ayez donc pas peur, répondit Rosalie qui avait compris son émotion ; rien n’est plus facile. »
Perrine devina le sens de ces paroles plutôt qu’elle ne les entendit ; car, depuis quelques instants déjà, les machines, les métiers s’étaient mis en marche dans l’usine, morte lorsqu’elle y était entrée, et maintenant un formidable mugissement, dans lequel se confondaient mille bruits divers, emplissait les cours ; aux ateliers, les métiers à tisser battaient, les navettes couraient, les broches, les bobines tournaient, tandis que dehors, les arbres de transmission, les roues, les courroies, les volants, ajoutaient le vertige des oreilles à celui des yeux.
« Voulez-vous parler plus fort ? dit Perrine, je ne vous entends pas.
— L’habitude vous viendra, cria Rosalie, je vous disais que ce n’est pas difficile ; il n’y a qu’à charger les cannettes sur les wagonets ; savez-vous ce que c’est qu’un wagonet ?
— Un petit wagon, je pense.
— Justement, et quand le wagonet est plein, à le pousser jusqu’au tissage où on le décharge ; un bon coup au départ, et ça roule tout seul.
— Et une cannette, qu’est-ce que c’est au juste ?
— Vous ne savez pas ce que c’est qu’une cannette ? oh ! Puisque je vous ai dit hier que les cannetières étaient des machines à préparer le fil pour les navettes ; vous devez bien voir ce que c’est.
— Pas trop. »
Rosalie la regarda, se demandant évidemment si elle était stupide ; puis elle continua :
« Enfin, c’est des broches enfoncées dans des godets, sur lesquelles s’enroule le fil ; quand elles sont pleines, on les retire du godet, on en charge les wagonets qui roulent sur un petit chemin de fer, et on les mène aux ateliers de tissage ; ça fait une promenade ; j’ai commencé par là ; maintenant je suis aux cannettes. »
Elles avaient traversé un dédale de cours, sans que Perrine, attentive à ces paroles, pour elles si pleines d’intérêt, pût arrêter ses yeux sur ce qu’elle voyait autour d’elle, quand Rosalie lui désigna de la main une ligne de bâtiments neufs, à un étage, sans fenêtres, mais éclairés à l’exposition du nord par des châssis vitrés qui formaient la moitié du toit.
« C’est là », dit-elle.
Et aussitôt ayant ouvert une porte, elle introduisit Perrine dans une longue salle, où la valse vertigineuse de milliers de broches en mouvement produisait un vacarme assourdissant.
Cependant, malgré le tapage, elles entendirent une voix d’homme qui criait :
« Te voilà, rôdeuse !
— Qui, rôdeuse ? qui rôdeuse ? s’écria Rosalie, ce n’est pas moi, entendez-vous, père la Quille ?
— D’où viens-tu ?
— C’est l’Mince qui m’a dit de vous amener cette jeune fille pour que vous la mettiez aux wagonets. »
Celui qui leur avait adressé cet aimable salut était un vieil ouvrier à jambe de bois, estropié une dizaine d’années auparavant dans l’usine, d’où son nom de la Quille. Pour ses invalides, on l’avait mis surveillant aux cannetières, et il faisait marcher les enfants placés sous ses ordres, rondement, rudement, toujours grondant, bougonnant, criant, jurant, car le travail de ces machines est assez pénible, demandant autant d’attention de l’œil que de prestesse de la main pour enlever les cannettes pleines, les remplacer par d’autres vides, rattacher les fils cassés, et il était convaincu que s’il ne jurait pas et ne criait pas continuellement, en appuyant chaque juron d’un vigoureux coup du pilon de sa jambe de bois appliqué sur le plancher, il verrait ses broches arrêtées, ce qui pour lui était intolérable. Mais comme, au fond, il était bon homme, on ne l’écoutait guère, et, d’ailleurs, une partie de ses paroles se perdait dans le tapage des machines.
« Avec tout ça, tes broches sont arrêtées ! cria-t-il à Rosalie en la menaçant du poing.
— C’est-y ma faute ?
— Mets-toi au travail pus vite que ça. »
Puis, s’adressant à Perrine :
« Comment t’appelles-tu ? »
Comme elle ne voulait pas donner son nom, cette demande qu’elle aurait dû prévoir, puisque la veille Rosalie la lui avait posée, la surprit, et elle resta interloquée.
Il crut qu’elle n’avait pas entendu et, se penchant vers elle, il cria en frappant un coup de pilon sur le plancher :
« Je te demande ton nom. »
Elle avait eu le temps de se remettre et de se rappeler celui qu’elle avait déjà donné :
« Aurélie, dit-elle.
— Aurélie qui ?
— C’est tout.
— Bon ; viens avec moi. »
Il la conduisit devant un wagonet garé dans un coin, et lui répéta les explications de Rosalie, s’arrêtant à chaque mot pour crier :
« Comprends-tu ? »
À quoi elle répondait d’un signe de tête affirmatif.
Et de fait son travail était si simple qu’il eût fallu qu’elle fût stupide pour ne pas pouvoir s’en acquitter ; et, comme elle y apportait toute son attention, tout son bon vouloir, le père la Quille, jusqu’à la sortie, ne cria pas plus d’une douzaine de fois après elle, et encore plutôt pour l’avertir que pour la gronder :
« Ne t’amuse pas en chemin. »
S’amuser, elle n’y pensait pas, mais au moins, tout en poussant son wagonet d’un bon pas régulier, sans s’arrêter, pouvait-elle regarder ce qui se passait dans les différents quartiers qu’elle traversait, et voir ce qui lui avait échappé pendant qu’elle écoutait les explications de Rosalie ? Un coup d’épaule pour mettre son chariot en marche, un coup de reins pour le retenir lorsque se présentait un encombrement, et c’était tout ; ses yeux, comme ses idées, avaient pleine liberté de courir comme elle voulait.
À la sortie, tandis que chacun se hâtait pour rentrer chez soi, elle alla chez le boulanger et se fit couper une demi-livre de pain qu’elle mangea en flânant par les rues, et en humant la bonne odeur de soupe qui sortait des portes ouvertes devant lesquelles elle passait, lentement quand c’était une soupe qu’elle aimait, plus vite quand c’en était une qui la laissait indifférente. Pour sa faim, une demi-livre de pain était mince, aussi disparut-elle vite ; mais peu importait, depuis le temps qu’elle était habituée à imposer silence à son appétit, elle ne s’en portait pas plus mal : il n’y a que les gens habitués à trop manger qui s’imaginent qu’on ne peut pas rester sur sa faim ; de même, il n’y a que ceux qui ont toujours eu leurs aises, pour croire qu’on ne peut pas boire à sa soif, dans le creux de sa main, au courant d’une claire rivière.


XVII
Bien avant l’heure de la rentrée aux ateliers, elle se trouva à la grille des shèdes, et à l’ombre d’un pilier, assise sur une borne, elle attendit le sifflet d’appel, en regardant des garçons et des filles de son âge arrivés comme elle en avance, jouer à courir ou à sauter, mais sans oser se mêler à leurs jeux, malgré l’envie qu’elle en avait.
Quand Rosalie arriva elle rentra avec elle et reprit son travail, activé comme dans la matinée par les cris et les coups de pilon de la Quille, mais mieux justifiés que dans la matinée, car à la longue la fatigue, à mesure que la journée avançait, se faisait plus lourdement sentir. Se baisser, se relever pour charger et décharger le wagonet, lui donner un coup d’épaule pour le démarrer, un coup de reins pour le retenir, le pousser, l’arrêter qui n’était qu’un jeu en commençant ; répété, continué sans relâche, devenait un travail, et avec les heures, les dernières surtout, une lassitude qu’elle n’avait jamais connue, même dans ses plus dures journées de marche, avait pesé sur elle.
« Ne lambine donc pas comme ça ! » criait la Quille.
Secouée par le coup de pilon qui accompagnait ce rappel, elle allongeait le pas comme un cheval sous un coup de fouet, mais pour le ralentir aussitôt qu’elle se voyait hors de sa portée. Et maintenant tout à sa besogne, qui l’engourdissait, elle n’avait plus de curiosité et d’attention que pour compter les sonneries de l’horloge, les quarts, la demie, l’heure, se demandant quand la journée finirait et si elle pourrait aller jusqu’au bout.
Quand cette question l’angoissait, elle s’indignait et se dépitait de sa faiblesse. Ne pouvait-elle pas faire ce que faisaient les autres qui n’étant ni plus âgées, ni plus fortes qu’elle, s’acquittaient de leur travail sans paraître en souffrir ; et cependant elle se rendait bien compte que ce travail était plus dur que le sien, demandait plus d’application d’esprit, plus de dépense d’agilité. Que fût-elle devenue si, au lieu de la mettre aux wagonets, on l’avait tout de suite employée aux cannettes ? Elle ne se rassurait qu’en se disant que c’était l’habitude qui lui manquait, et qu’avec du courage, de la volonté, de la persévérance, cette accoutumance lui viendrait ; pour cela comme pour tout, il n’y avait qu’à

vouloir, et elle voulait, elle voudrait. Qu’elle ne faiblît pas tout à fait ce premier jour, et le second serait moins pénible, moins le troisième que le second.
Elle raisonnait ainsi en poussant ou en chargeant son wagonet, et aussi en regardant ses camarades travailler avec cette agilité qu’elle leur enviait, lorsque tout à coup elle vit Rosalie qui rattachait un fil, tomber à côté de sa voisine : un grand cri éclata, en même temps tout s’arrêta ; et au tapage des machines, aux ronflements, aux vibrations, aux trépidations du sol, des murs et du vitrage succéda un silence de mort, coupé d’une plainte enfantine :
« Oh ! la ! la ! »
Garçons, filles, tout le monde s’était précipité ; elle fit comme les autres malgré les cris de la Quille qui hurlait :
« Tonnerre ! mes broches arrêtées. »
Déjà Rosalie avait été relevée ; on s’empressait autour d’elle, l’étouffant.
« Qu’est-ce qu’elle a ? »
Elle-même répondit :
« La main écrasée. »
Son visage était pâle, ses lèvres décolorées tremblaient, et des gouttes de sang tombaient de sa main blessée sur le plancher.
Mais, vérification faite, il se trouva qu’elle n’avait que deux doigts blessés, et peut-être même un seul écrasé ou fortement meurtri.
Alors la Quille, qui avait eu un premier mouvement de compassion, entra en fureur et bouscula les camarades qui entouraient Rosalie.
« Allez-vous me fiche le camp ? V’là-t-il pas une affaire !
— C’était peut-être pas une affaire quand vous avez eu la quille écrasée », murmura une voix.
Il chercha qui avait osé lâcher cette réflexion irrespectueuse, mais il lui fut impossible de trouver une certitude dans le tas. Alors il n’en cria que plus fort :
« Fichez-moi le camp ! »
Lentement on se sépara, et Perrine comme les autres allait retourner à son wagonet quand la Quille l’appela :
« Hé, la nouvelle arrivée, viens ici, toi, plus vite que ça. »
Elle revint craintivement, se demandant en quoi elle était plus coupable que toutes celles qui avaient abandonné leur travail ; mais il ne s’agissait pas de la punir.
« Tu vas conduire cette bête-là chez le directeur, dit-il.
— Pourquoi que vous m’appelez bête ? cria Rosalie, car déjà le tapage des machines avait recommencé.
— Pour t’être fait prendre la patte, donc.
— C’est-y ma faute ?
— Bien sûr que c’est ta faute, maladroite, feignante. »
Cependant il s’adoucit :
« As-tu mal ?
— Pas trop.
— Alors file. »
Elles sortirent toutes les deux, Rosalie tenant sa main blessée, la gauche, dans sa main droite.
« Voulez-vous vous appuyer sur moi ? demanda Perrine.
— Merci bien ; ce n’est pas la peine, je peux marcher.
— Alors cela ne sera rien, n’est-ce pas ?
— On ne sait pas ; ce n’est jamais le premier jour qu’on souffre, c’est plus tard.
— Comment cela vous est-il arrivé ?
— Je n’y comprends rien ; j’ai glissé.
— Vous étiez peut-être fatiguée, dit Perrine pensant à elle-même.
— C’est toujours quand on est fatigué qu’on s’estropie ; le matin on est plus souple et on fait attention. Qu’est-ce que va dire tante Zénobie ?
— Puisque ce n’est pas votre faute.
— Mère Françoise croira bien que ce n’est pas ma faute, mais tante Zénobie dira que c’est pour ne pas travailler.
— Vous la laisserez dire.
— Si vous croyez que c’est amusant d’entendre dire. »
Sur leur chemin les ouvriers qui les rencontraient les arrêtaient pour les interroger : les uns plaignaient Rosalie ; le plus grand nombre l’écoutait indifféremment, en gens qui sont habitués à ces sortes de choses et se disent que ça a toujours été ainsi ; on est blessé comme on est malade, on a de la chance ou on n’en a pas ; chacun son tour, toi aujourd’hui, moi demain ; d’autres se fâchaient :
« Quand ils nous auront tous estropiés !
— Aimes-tu mieux crever de faim ? »
Elles arrivèrent au bureau du directeur qui se trouvait au centre de l’usine, englobé dans un grand bâtiment en briques vernissées bleues et roses, où tous les autres bureaux étaient réunis ; mais tandis que ceux-là, même celui de M. Vulfran, n’avaient rien de caractéristique, celui du directeur se signalait à l’attention par une vérandah vitrée à laquelle on arrivait par un perron à double révolution.
Quand elles entrèrent sous cette vérandah, elles furent reçues par Talouel qui se promenait en long et en large comme un capitaine sur sa passerelle, les mains dans ses poches, son chapeau sur la tête.
Il paraissait furieux :
« Qu’est-ce qu’elle a encore celle-là ? » cria-t-il.
Rosalie montra sa main ensanglantée.
« Enveloppe-la donc de ton mouchoir, ta patte ! » cria-t-il.
Pendant qu’elle tirait difficilement son mouchoir, il arpentait la vérandah à grands pas ; quand elle l’eut tortillé autour de sa main, il revint se camper devant elle :
« Vide ta poche. »
Elle le regarda sans comprendre.
« Je te dis de tirer tout ce qui se trouve dans ta poche. »
Elle fit ce qu’il commandait et tira de sa poche un attirail de choses bizarres : un sifflet fait dans une noisette, des osselets, un dé, un morceau de jus de réglisse, trois sous et un petit miroir en zinc.
Il le saisit aussitôt :
« J’en étais sûr, s’écria-t-il, pendant que tu te regardais dans ton miroir un fil aura cassé, ta cannette s’est arrêtée, tu as voulu rattraper le temps perdu, et voilà.
— Je me suis pas regardée dans ma glace, dit-elle.
— Vous êtes toutes les mêmes ; avec ça que je ne vous connais pas. Et maintenant qu’est-ce que tu as ?
— Je ne sais pas ; les doigts écrasés.
— Qu’est-ce que tu veux que j’y fasse ?
— C’est le père la Quille qui m’envoie à vous. »
Il s’était retourné vers Perrine.
« Et toi, qu’est-ce que tu as ?
— Moi je n’ai rien, répondit-elle décontenancée par cette dureté.
— Alors ?…
— C’est la Quille qui lui a dit de m’amener à vous, acheva Rosalie.
— Ah ! il faut qu’on t’amène ; eh bien alors qu’elle te conduise chez le Dr Ruchon ; mais tu sais ! je vais faire une enquête, et si tu as fauté, gare à toi ! »
Il parlait avec des éclats de voix qui faisaient résonner les vitres de la vérandah, et qui devaient s’entendre dans tous les bureaux.
Comme elles allaient sortir elles virent arriver M. Vulfran qui marchait avec précaution en ne quittant pas de la main le mur du vestibule :
« Qu’est-ce qu’il y a, Talouel ?
— Rien, monsieur, une fille des cannetières qui s’est fait prendre la main.
— Où est-elle ?
— Me voici, monsieur Vulfran, dit Rosalie en revenant vers lui.
— N’est-ce pas la voix de la petite fille de Françoise ? dit-il.
— Oui, monsieur Vulfran, c’est moi, c’est moi Rosalie. »
Et elle se mit à pleurer, car les paroles dures lui avaient jusque-là serré le cœur et l’accent de compassion avec lequel ces quelques mots lui étaient adressés le détendait.
« Qu’est-ce que tu as, ma pauvre fille ?
— En voulant rattacher un fil j’ai glissé, je ne sais comment, ma main s’est trouvée prise, j’ai deux doigts écrasés… il me semble.
— Tu souffres beaucoup ?
— Pas trop.
— Alors pourquoi pleures-tu ?
— Parce que vous ne me bousculez pas. »
Talouel haussa les épaules.
« Tu peux marcher ? demanda M. Vulfran.
— Oh ! oui monsieur Vulfran.
— Rentre vite chez toi ; on va t’envoyer M. Ruchon. »
Et s’adressant à Talouel :
« Écrivez une fiche à M. Ruchon pour lui dire de passer tout de suite chez Françoise ; soulignez « tout de suite », ajoutez « blessure urgente. »
Il revint à Rosalie :
« Veux-tu quelqu’un pour te conduire ?
— Je vous remercie, monsieur Vulfran, j’ai une camarade.
— Va, ma fille ; dis à ta grand’mère que tu seras payée. »
C’était Perrine maintenant qui avait envie de pleurer ; mais sous le regard de Talouel elle se raidit ; ce fut seulement quand elles traversèrent les cours pour gagner la sortie qu’elle trahit son émotion :
« Il est bon M. Vulfran.
— Il le serait ben tout seul ; mais avec le Mince, il ne peut pas ; et puis il n’a pas le temps, il a d’autres affaires dans la tête.
— Enfin il a été bon pour vous. »
Rosalie se redressa :
« Oh ! moi, vous savez, je le fais penser à son fils ; alors vous comprenez, ma mère était la sœur de lait de M. Edmond.
— Il pense à son fils ?
— Il ne pense qu’à ça. »
On se mettait sur les portes pour les voir passer, le mouchoir teint de sang dont la main de Rosalie était enveloppée provoquant la curiosité ; quelques voix aussi les interrogeaient :
« T’es blessée ?
— Les doigts écrasés.
— Ah ! malheur. »
Il y avait autant de compassion que de colère dans ce cri, car ceux qui le proféraient pensaient que ce qui venait d’arriver à cette fille pouvait les frapper le lendemain ou à l’instant même dans les leurs, mari, père, enfants : tout le monde à Maraucourt ne vivait-il pas de l’usine ?
Malgré ces arrêts, elles approchaient de la maison de mère Françoise, dont déjà la barrière grise se montrait au bout du chemin.
« Vous allez entrer avec moi, dit Rosalie.
— Je veux bien.
— Ça retiendra peut-être tante Zénobie. »
Mais la présence de Perrine ne retint pas du tout la terrible tante qui, en voyant Rosalie arriver à une heure insolite, et en apercevant sa main enveloppée, poussa les hauts cris :
« Te v’là blessée, coquine ! Je parie que tu l’as fait exprès.
— Je serai payée, répliqua Rosalie rageusement.
— Tu crois ça ?
— M. Vulfran me l’a dit. »
Mais cela ne calma pas tante Zénobie qui continua de crier si fort, que mère Françoise, quittant son comptoir, vint sur le seuil ; mais ce ne fut pas par des paroles de colère qu’elle accueillit sa petite-fille : courant à elle, elle la prit dans ses bras :
« Tu es blessée ? s’écria-t-elle.
— Un peu, grand’maman, aux doigts ; ce n’est rien.
— Il faut aller chercher M. Ruchon.
— M. Vulfran l’a fait prévenir. »
Perrine se disposait à les suivre dans la maison, mais tante Zénobie se retournant sur elle l’arrêta :
« Croyez-vous que nous avons besoin de vous pour la soigner ?
— Merci », cria Rosalie.
Perrine n’avait plus qu’à retourner à l’atelier, ce qu’elle fit ; mais au moment où elle allait arriver à la grille des shèdes, un long coup de sifflet annonça la sortie.


XVIII
Dix fois, vingt fois pendant la journée, elle s’était demandé comment elle pourrait bien ne pas coucher dans la chambrée où elle avait failli étouffer et où elle avait si peu dormi.
Certainement elle y étoufferait tout autant la nuit suivante et elle ne dormirait pas mieux. Alors, si elle ne trouvait pas dans un bon repos à réparer l’épuisement de la fatigue du jour, qu’arriverait-il ?
C’était une question terrible dont elle pesait toutes les conséquences ; qu’elle n’eût pas la force de travailler, on la renvoyait et c’en était fini de ses espérances ; qu’elle devînt malade, on la renvoyait encore mieux, et elle n’avait personne à qui demander soins et secours : le pied d’un arbre dans un bois, c’était ce qui l’attendait, cela et rien autre chose.
Il est vrai qu’elle avait bien le droit de ne plus occuper le lit payé par elle ; mais alors où en trouverait-elle un autre, et surtout que dirait-elle à Rosalie pour expliquer d’une façon acceptable que ce qui était bon pour les autres ne l’était pas pour elle ? Comment les autres, quand elles connaîtraient ses dégoûts, la traiteraient-elles ? N’y aurait-il pas là une cause d’animosité qui pouvait la contraindre à quitter l’usine ? Ce n’était pas seulement bonne ouvrière qu’elle devait être, c’était encore ouvrière comme les autres ouvrières.
Et la journée s’était écoulée sans qu’elle osât se résoudre à prendre un parti.
Mais la blessure de Rosalie changeait la situation : maintenant que la pauvre fille allait rester au lit pendant plusieurs jours sans doute, elle ne saurait pas ce qui se passerait à la chambrée, qui y coucherait ou n’y coucherait point, et par conséquent ses questions ne seraient pas à craindre. D’autre part, comme aucune de celles qui occupaient la chambrée ne savait qui avait été leur voisine pour une nuit, elles ne s’occuperaient pas non plus de cette inconnue, qui pouvait très bien avoir pris un logement ailleurs.
Cela établi, et ce raisonnement fut vite fait, il ne restait qu’à trouver où elle irait coucher si elle abandonnait la chambrée.
Mais elle n’avait pas à chercher. Combien souvent n’avait-elle pas pensé à l’aumuche avec une convoitise ravie ! comme on serait bien là pour dormir si c’était possible ! rien à craindre de personne puisqu’elle n’était fréquentée que pendant la saison de la chasse, ainsi que le numéro du Journal d’Amiens le prouvait : un toit sur la tête, des murs chauds, une porte, et pour lit une bonne couche de fougères sèches ; sans compter le plaisir d’habiter dans une maison à soi, la réalité dans le rêve.
Et voilà que ce qui semblait irréalisable devenait tout à coup possible et facile.
Elle n’eut pas une seconde d’hésitation, et après avoir été chez le boulanger acheter la demi-livre de pain de son souper, au lieu de retourner chez mère Françoise, elle reprit le chemin qu’elle avait parcouru le matin pour venir aux ateliers.
Mais en ce moment des ouvriers qui demeuraient aux environs de Maraucourt suivaient ce chemin pour rentrer chez eux, et comme elle ne voulait point qu’ils la vissent se glisser dans le sentier de l’oseraie, elle alla s’asseoir dans le taillis qui dominait la prairie ; quand elle serait seule, elle gagnerait l’aumuche, et là bien tranquille, la porte ouverte sur l’étang, en face du soleil couchant, assurée que personne ne viendrait la déranger, elle souperait sans se presser, ce qui serait autrement agréable que d’avaler les morceaux en marchant, comme elle avait fait pour son déjeuner.
Elle était si ravie de cet arrangement qu’elle avait hâte de le mettre à exécution ; mais elle dut attendre assez longtemps, car après un passant, il en arrivait un autre, et après celui-là d’autres encore ; alors l’idée lui vint de préparer son emménagement dans l’aumuche, qui sans doute était propre et confortable, mais pouvait le devenir plus encore avec quelques soins.
Le taillis où elle était assise se trouvait en grande partie formé de maigres bouleaux sous lesquels avaient poussé des fougères ; qu’elle se fît un balai avec des brindilles de bouleau, et elle pourrait balayer son appartement ; qu’elle coupât une botte de fougères sèches et elle pourrait se faire un bon lit doux et chaud.
Oubliant la fatigue qui, pendant les dernières heures de son travail, avait si lourdement pesé sur elle, elle se mit tout de suite à l’ouvrage : promptement le balai fut réuni, lié avec un brin d’osier, emmanché d’un bâton ; non moins vite la botte de fougère fut coupée et serrée dans une hart de saule de façon à pouvoir être facilement transportée dans l’aumuche.
Pendant ce temps les derniers retardataires avaient passé dans le chemin, maintenant désert aussi loin qu’elle pouvait voir et silencieux ; le moment était donc venu de se rapprocher du sentier de l’oseraie. Ayant chargé la botte de fougère sur son dos et pris son balai à la main, elle descendit du taillis en courant, et en courant aussi traversa le chemin. Mais dans le sentier, il fallut qu’elle ralentît cette allure, car la botte de fougère s’accrochait aux branches et elle ne pouvait la faire passer qu’en se baissant à quatre pattes.
Arrivée dans l’îlot, elle commença par sortir ce qui se trouvait dans l’aumuche, c’est-à-dire le billot et la fougère, puis elle se mit à tout balayer, le plafond, les parois, le sol ; et alors, sur l’étang comme dans les roseaux, s’élevèrent des vols bruyants, des piaillements, des cris de toutes les bêtes que ce remue-ménage troublait dans leur tranquille possession de ces eaux et de ces rives où depuis longtemps ils étaient maîtres.
L’espace était si étroit qu’elle eut vite achevé son nettoyage, si consciencieusement qu’elle le fît, et elle n’eut plus qu’à rentrer le billot ainsi que la vieille fougère en la recouvrant de la sienne qui gardait encore la chaleur du soleil, ainsi que le parfum des herbes fleuries au milieu desquelles elle avait poussé.
Maintenant il était temps de souper et son estomac criait famine presque aussi fort que sur la route d’Écouen à Chantilly. Heureusement ces mauvais jours étaient passés,

et établie dans cette jolie petite île, son coucher assuré, n’ayant rien à craindre de personne, ni de la pluie, ni de l’orage, ni de quoi que ce fût, un bon morceau de pain dans sa poche, par cette belle et douce soirée, elle ne devait se rappeler ses misères que pour les comparer à l’heure présente et se fortifier dans l’espérance du lendemain.
Comme en mangeant lentement son pain, qu’elle coupait par petits morceaux de peur de l’émietter, elle ne faisait plus de bruit, la population de l’étang, rassurée, revenait à son nid pour la nuit, et à chaque instant c’étaient des vols qui rayaient l’or du couchant, ou des apparitions d’oiseaux aquatiques qui sortaient avec précaution des roseaux et nageaient doucement, le cou allongé, la tête aux écoutes pour reconnaître la position. Et comme leur réveil l’avait amusée le matin, leur coucher maintenant la charmait.
Quand elle eut achevé son pain, qui tourna court, bien qu’elle fît, à mesure qu’il diminuait, les morceaux de plus en plus petits, les eaux de l’étang, quelques instants auparavant brillantes comme un miroir, étaient devenues sombres, et le ciel avait éteint son éblouissant incendie ; dans quelques minutes la nuit descendrait sur la terre, l’heure du coucher avait sonné.
Mais avant de fermer sa porte et de s’étendre sur son lit de fougère, elle voulut prendre une dernière précaution, qui était d’enlever le pont jeté sur le fossé. Assurément elle se croyait en pleine sécurité dans l’aumuche ; personne ne viendrait la déranger, de cela elle était sûre ; et, en tout cas, on ne pourrait pas en approcher sans que les habitants de l’étang, qui avaient l’oreille fine, lui donnassent l’éveil par leurs cris ; mais enfin, tout cela n’empêchait pas que l’enlèvement du pont, s’il était possible, ne fût une bonne chose.
Et puis il n’y avait pas que la question de sécurité dans cet enlèvement, il y avait aussi celle du plaisir : est-ce que ce ne serait pas amusant de se dire qu’elle était sans aucune communication avec la terre, dans une vraie île dont elle prenait possession ? quel malheur de ne pas pouvoir hisser un drapeau sur le toit comme cela se voit dans les récits de voyages, et de tirer un coup de canon.
Vivement elle se mit à l’ouvrage, et ayant avec son manche à balai dégagé la terre qui à chaque bout entourait le tronc de saule servant de pont, elle put le tirer sur son bord.
Maintenant elle était bien chez elle, maîtresse dans son royaume, reine de son île qu’elle s’empressa de baptiser, comme font les grands voyageurs ; et pour le nom elle n’eut pas une seconde d’embarras ou d’hésitation : que pouvait-elle trouver de mieux que celui qui répondait à sa situation présente :
— Good hope.
Il y avait bien déjà le cap de Bonne-Espérance ; mais on ne peut pas confondre un cap avec une île.


XIX
C’est très amusant d’être reine, surtout quand on n’a ni sujets, ni voisins, mais encore faut-il n’avoir rien autre chose à faire que de se promener de fêtes en fêtes à travers ses États.
Et justement elle n’en était pas encore à l’heureuse période des fêtes et des promenades. Aussi quand le lendemain, au jour levant, la population volatile de l’étang la réveilla par son aubade, et qu’un rayon de soleil passant par une des ouvertures de l’aumuche, se joua sur son visage, pensa-t-elle tout de suite que ce n’était plus à poings fermés qu’elle pouvait dormir, mais assez légèrement au contraire pour se réveiller lorsque le premier coup de sifflet ferait entendre son appel.
Mais le sommeil le plus solide n’est pas toujours le meilleur, c’est bien plutôt celui qui s’interrompt, reprend, s’interrompt encore et donne ainsi la conscience de la rêverie qui se suit et s’enchaîne ; et sa rêverie n’avait rien que d’agréable et de riant : en dormant, sa fatigue de la veille avait si bien disparu qu’elle ne s’en souvenait même plus ; son lit était doux, chaud, parfumé ; l’air qu’elle respirait embaumait le foin fané ; les oiseaux la berçaient de leurs chansons joyeuses, et les gouttes de rosée condensée sur les feuilles de saules qui tombaient dans l’eau faisaient une musique cristalline.
Quand le sifflet déchira le silence de la campagne elle fut vite sur ses pieds, et après une toilette soignée au bord de l’étang, elle se prépara à partir. Mais sortir de son île en remettant le pont en place lui parut un moyen qui, en plus de sa vulgarité, présentait ce danger d’offrir le passage à ceux qui pourraient vouloir entrer dans l’aumuche, si tant était que quelqu’un eût avant l’hiver cette idée invraisemblable. Elle restait devant le fossé, se demandant si elle pourrait le franchir d’un bond quand elle aperçut une longue branche qui étayait l’aumuche du côté où les saules manquaient, et la prenant, elle s’en servit pour sauter le fossé à la perche, ce qui pour elle, habituée à cet exercice qu’elle avait pratiqué bien souvent, fut un jeu. Peut-être était-ce là une façon peu noble de sortir de son royaume, mais comme personne ne l’avait vue, au fond cela importait peu ; d’ailleurs les jeunes reines doivent pouvoir se permettre des choses qui sont interdites aux vieilles.
Après avoir caché sa perche dans l’herbe de l’oseraie pour la retrouver quand elle voudrait rentrer le soir, elle partit et arriva à l’usine une des premières. Alors en attendant, elle vit des groupes se former et discuter avec une animation qu’elle n’avait pas remarquée la veille. Que se passait-il donc ?
Quelques mots qu’elle entendit au hasard le lui apprirent :
« Pove fille !
— On y a copé le dé.
— L’pétiot dé ?
— L’pétiot.
— Et l’ote ?
— On y a pas copé.
— All’ a criai ?
— C’tait des beuglements à faire pleurer ceux qui l’y entendaient. »
Perrine n’avait pas besoin de demander à qui on avait coupé le doigt ; et après le premier saisissement de la surprise, son cœur se serra : sans doute elle ne la connaissait que depuis deux jours, mais celle qui l’avait accueillie à son arrivée, qui l’avait guidée, l’avait traitée en camarade, c’était cette pauvre fille qui venait de si cruellement souffrir et qui allait rester estropiée.
Elle réfléchissait désolée, quand, en levant les yeux machinalement, elle vit venir Bendit ; alors, se levant, elle alla à lui, sans bien savoir ce qu’elle faisait et sans se rendre compte de la liberté qu’elle prenait, dans son humble position, d’adresser la parole à un personnage de cette importance, qui de plus était Anglais.
« Monsieur, dit-elle en anglais, voulez-vous me permettre de vous demander, si vous le savez, comment va Rosalie ? »
Chose extraordinaire, il daigna abaisser les yeux sur elle et lui répondre :
« J’ai vu sa grand’mère, ce matin, qui m’a dit qu’elle avait bien dormi.
— Ah ! monsieur, je vous remercie. »
Mais Bendit, qui de sa vie n’avait jamais remercié personne, ne sentit pas tout ce qu’il y avait d’émotion et de cordiale reconnaissance dans l’accent de ces quelques mots.
« Je suis bien aise », dit-il, en continuant son chemin.
Pendant toute la matinée elle ne pensa qu’à Rosalie, et elle put d’autant plus librement suivre sa vision que déjà elle était faite à son travail qui n’exigeait plus l’attention.
À la sortie elle courut à la maison de mère Françoise, mais comme elle eut la mauvaise chance de tomber sur la tante, elle n’alla pas plus loin que le seuil de la porte.
« Voir Rosalie, pour quoi faire ? Le médecin a dit qu’il ne fallait pas l’éluger. Quand elle se lèvera, elle vous racontera comment elle s’est fait estropier, l’imbécile ! »
La façon dont elle avait été accueillie le matin l’empêcha de revenir le soir ; puisque certainement elle ne serait pas mieux reçue, elle n’avait qu’à rentrer dans son île qu’elle avait hâte de revoir. Elle la retrouva telle qu’elle l’avait quittée, et ce jour-là n’ayant pas de ménage à faire, elle put souper tout de suite.
Elle s’était promis de prolonger ce souper ; mais si petits qu’elle coupât ses morceaux de pain, elle ne put pas les multiplier indéfiniment, et quand il ne lui en resta plus, le soleil était encore haut à l’horizon ; alors s’asseyant au fond de l’aumuche sur le billot, la porte ouverte, ayant devant elle l’étang et au loin les prairies coupées de rideaux d’arbres, elle rêva au plan de vie qu’elle devait se tracer.
Pour son existence matérielle trois points principaux d’une importance capitale se présentaient : le logement, la nourriture, l’habillement.
Le logement grâce à la découverte qu’elle avait eu l’heureuse chance de faire de cette île, se trouvait assuré au moins jusqu’en octobre, sans qu’elle eût rien à dépenser.
Mais la question de nourriture et d’habillement ne se résolvait pas avec cette facilité.
Était-il possible que pendant des mois et des mois, une livre de pain par jour fût un aliment suffisant pour entretenir les forces qu’elle dépensait dans son travail ? Elle n’en savait rien, puisque jusqu’à ce moment elle n’avait pas travaillé sérieusement ; la peine, la fatigue, les privations, oui, elle les connaissait, seulement c’était par accident, pour quelques jours malheureux suivis d’autres qui effaçaient tout ; tandis que le travail répété, continu, elle n’avait aucune idée de ce qu’il pouvait être, pas plus que des dépenses qu’il exigeait à la longue. Sans doute, elle trouvait que depuis deux jours ses repas tournaient court ; mais ce n’était là, en somme, qu’un ennui pour qui avait connu comme elle le supplice de la faim ; qu’elle restât sur son appétit n’était rien, si elle conservait la santé et la force. D’ailleurs, elle pourrait bientôt augmenter sa ration, et aussi mettre sur son pain un peu de beurre, un morceau de fromage ; elle n’avait donc qu’à attendre, et quelques jours de plus ou de moins, des semaines même n’étaient rien.
Au contraire l’habillement, au moins pour plusieurs de ses parties, était dans un état de délabrement qui l’obligeait à agir au plus vite, car les raccommodages faits pendant ses quelques journées de séjour auprès de La Rouquerie, ne tenaient plus.
Ses souliers particulièrement s’étaient si bien amincis que la semelle fléchissait sous le doigt quand elle la tâtait : il n’était pas difficile de calculer le moment où elle se détacherait de l’empeigne, et cela se produirait d’autant plus vite que, pour conduire son wagonet, elle devait passer par des chemins empierrés depuis peu, où l’usure était rapide. Quand cela arriverait comment ferait-elle ? Évidemment elle devrait acheter de nouvelles chaussures ; mais devoir et pouvoir sont deux ; où trouverait-elle l’argent de cette dépense ?
La première chose à faire, celle qui pressait le plus, était de se fabriquer des chaussures, et cela présentait pour elle des difficultés qui tout d’abord, quand elle en envisagea l’exécution, la découragèrent. Jamais elle n’avait eu l’idée de se demander ce qu’était un soulier ; mais quand elle en eut retiré un de son pied pour l’examiner, et qu’elle vit comment l’empeigne était cousue à la semelle, le quartier réuni à l’empeigne et le talon ajouté au tout, elle comprit que c’était un travail au-dessus de ses forces et de sa volonté, qui ne pouvait lui inspirer que du respect pour l’art du cordonnier. Fait d’une seule pièce et dans un morceau de bois, un sabot était par cela même plus facile ; mais comment le creuser quand pour tout outil elle n’avait que son couteau ?

Elle réfléchissait tristement à ces impossibilités, quand ses yeux errant vaguement sur l’étang et ses rives, rencontrèrent une touffe de roseaux qui les arrêta : les tiges de ces roseaux étaient vigoureuses, hautes, épaisses, et parmi celles poussées au printemps, il y en avait de l’année précédente, tombées dans l’eau, qui ne paraissaient pas encore pourries. Voyant cela, une idée s’éveilla dans son esprit : on ne se chausse pas qu’avec des souliers de cuir et des sabots de bois ; il y a aussi des espadrilles dont la semelle se fait en roseaux tressés et le dessus en toile. Pourquoi n’essayerait-elle pas de se tresser des semelles avec ces roseaux qui semblaient poussés là exprès pour qu’elle les employât, si elle en avait l’intelligence ?
Aussitôt elle sortit de son île et, suivant la rive, elle arriva à la touffe de roseaux, où elle vit qu’elle n’avait qu’à prendre à brassée parmi les meilleures tiges, c’est-à-dire celles qui, déjà desséchées, étaient cependant flexibles encore et résistantes.
Elle en coupa rapidement une grosse botte qu’elle rapporta dans l’aumuche où aussitôt elle se mit à l’ouvrage.
Mais après avoir fait un bout de tresse d’un mètre de long à peu près, elle comprit que cette semelle, trop légère parce qu’elle était trop creuse, n’aurait aucune solidité, et qu’avant de tresser les roseaux, il fallait qu’ils subissent une préparation qui, en écrasant leurs fibres, les transformerait en grosse filasse.
Cela ne pouvait l’arrêter ni l’embarrasser : elle avait un billot pour battre dessus les roseaux ; il ne lui manquait qu’un maillet ou un marteau ; une pierre arrondie qu’elle alla choisir sur la route, lui en tint lieu ; et tout de suite elle commença à battre les roseaux, mais sans les mêler. L’ombre de la nuit la surprit dans son travail ; et elle se coucha en rêvant aux belles espadrilles à rubans bleus qu’elle chausserait bientôt, car elle ne doutait pas de réussir, sinon la première fois, au moins la seconde, la troisième, la dixième.
Mais elle n’alla pas jusque-là : le lendemain soir elle avait assez de tresses pour commencer ses semelles, et le surlendemain ayant acheté une alène courbe, qui lui coûta un sou, une pelote de fil un sou aussi, un bout de ruban de coton bleu du même prix, vingt centimètres de gros coutil moyennant quatre sous, en tout sept sous, qui étaient tout ce qu’elle pouvait dépenser, si elle ne voulait pas se passer de pain le samedi, elle essaya de façonner une semelle à l’imitation de celle de son soulier : la première se trouva à peu près ronde, ce qui n’est pas précisément la forme du pied ; la deuxième, plus étudiée, ne ressembla à rien ; la troisième ne fut guère mieux réussie ; mais enfin la quatrième, bien serrée au milieu, élargie aux doigts, rapetissée au talon, pouvait être acceptée pour une semelle.
Quelle joie ! Une fois de plus la preuve était faite qu’avec de la volonté, de la persévérance, on réussit ce qu’on veut fermement, même ce qui d’abord paraît impossible, et qu’on n’a pour tout aide qu’un peu d’ingéniosité, sans argent, sans outils, sans rien.
L’outil qui lui manquait pour achever ses espadrilles, c’était des ciseaux. Mais leur achat entraînerait une telle dépense, qu’elle devait s’en passer. Heureusement elle avait son couteau ; et au moyen d’une pierre à aiguiser qu’elle alla chercher dans le lit de la rivière, elle put le rendre assez coupant pour tailler le coutil appliqué à plat sur le billot. La couture de ces pièces d’étoffe n’alla pas non plus sans tâtonnements, et recommencements ; mais enfin, elle en vint à bout, et le samedi matin elle eut la satisfaction de partir chaussée de belles espadrilles grises qu’un ruban bleu croisé sur ses bas retenait bien à la jambe.
Pendant ce travail, qui lui avait pris quatre soirées et trois matinées commencées dès le jour levant, elle s’était demandé ce qu’elle ferait de ses souliers, alors qu’elle quitterait sa cabane. Sans doute, elle n’avait pas à craindre qu’ils fussent volés par des gens qui les trouveraient dans l’aumuche, puisque personne n’y entrait. Mais ne pourraient-ils pas être rongés par des rats ? Si cela se produisait, quel désastre ! Pour aller au-devant de ce danger, il fallait donc qu’elle les serrât dans un endroit où les rats, qui pénètrent partout, ne pourraient pas les atteindre ; et ce qu’elle trouva de mieux, puisqu’elle n’avait ni armoire, ni boîte, ni rien qui fermât, ce fut de les suspendre à son plafond par un brin d’osier.


XX
Si elle était fière de ses chaussures, elle avait d’autre part cependant des inquiétudes sur la façon dont elles allaient se comporter en travaillant : la semelle ne s’élargirait-elle pas, le coutil ne se distendrait-il pas au point de ne conserver aucune forme ?
Aussi, tout en chargeant son wagonet ou en le poussant, regardait-elle souvent à ses pieds. Tout d’abord elles avaient résisté ; mais cela continuerait-il ?
Ce mouvement, sans doute, provoqua l’attention d’une de ses camarades qui, ayant regardé les espadrilles, les trouva à son goût, et en fit compliment à Perrine.
« Où qu’c’est que vo avez acheté ces chaussons ? demanda-t-elle.
— Ce ne sont pas des chaussons, ce sont des espadrilles.
— C’est joli tout de même ; ça coûte-t-y cher ?
— Je les ai faites moi-même avec des roseaux tressés et quatre sous de coutil.
— C’est joli. »
Ce succès la décida à entreprendre un autre travail, beaucoup plus délicat, auquel elle avait bien souvent pensé, mais en l’écartant toujours, autant parce qu’il entraînait une trop grosse dépense, que parce qu’il se présentait entouré de difficultés de toutes sortes. Ce travail c’était de se tailler et de se coudre une chemise pour remplacer la seule qu’elle possédât maintenant et qu’elle portait sur le dos, sans pouvoir l’ôter pour la laver. Combien coûteraient deux mètres de calicot, qui lui étaient nécessaires ? Elle n’en savait rien. Comment les couperait-elle lorsqu’elle les aurait ? Elle ne le savait pas davantage. Et il y avait là une série d’interrogations qui lui donnaient à réfléchir ; sans compter qu’elle se demandait s’il ne serait pas plus sage de commencer par se faire un caraco, et une jupe en indienne pour remplacer sa veste et son jupon, qui se fatiguaient d’autant plus qu’elle était obligée de coucher avec. Le moment où ils l’abandonneraient tout à fait n’était pas difficile à calculer. Alors comment sortirait-elle ? Et pour sa vie, pour son pain quotidien, aussi bien que pour le succès de ses projets, il fallait qu’elle continuât à être admise à l’usine.
Cependant quand, le samedi soir, elle eut entre les mains les trois francs qu’elle venait de gagner dans sa semaine, elle ne put pas résister à la tentation de la chemise. Assurément le caraco et la jupe n’avaient rien perdu de leur utilité à ses yeux ; mais la chemise aussi était indispensable, et, de plus, elle se présentait avec tout un entourage d’autres considérations : habitudes de propreté dans lesquelles elle avait été élevée, respect de soi-même, qui finirent par l’emporter. La veste, le jupon elle les raccommoderait encore, et comme leur étoffe était de fabrication solide, ils porteraient bien sans doute quelques nouvelles reprises.
Tous les jours, quand à l’heure du déjeuner elle allait de l’usine à la maison de mère Françoise pour demander des nouvelles de Rosalie, qu’on lui donnait ou qu’on ne lui donnait point, selon que c’était la grand’mère ou la tante qui lui répondaient, elle s’arrêtait, depuis que l’envie de la chemise la tenait, devant une petite boutique dont la montre se divisait en deux étalages, l’un de journaux, d’images, de chansons, l’autre de toile, de calicot, d’indienne, de mercerie ; se plaçant au milieu, elle avait l’air de regarder les journaux ou d’apprendre les chansons, mais en réalité elle admirait les étoffes. Comme elles étaient heureuses, celles qui pouvaient franchir le seuil de cette boutique tentatrice et se faire couper autant de ces étoffes qu’elles voulaient ! Pendant ses longues stations, elle avait vu souvent des ouvrières de l’usine entrer dans ce magasin, et en ressortir avec des paquets soigneusement enveloppés de papier, qu’elles serraient sur leur cœur, et elle s’était dit que ces joies n’étaient pas pour elle… au moins présentement.
Mais maintenant elle pouvait franchir ce seuil si elle voulait, puisque trois pièces blanches sonnaient dans sa main, et très émue, elle le franchit.
« Vous désirez, mademoiselle ? » demanda une petite vieille d’une voix polie, avec un sourire affable.
Comme il y avait longtemps qu’on ne lui avait parlé avec cette douceur ; elle s’affermit.
« Voulez-vous bien me dire, demanda-t-elle, combien vous vendez votre calicot… le moins cher ?
— J’en ai à quarante centimes le mètre. »
Perrine eut un soupir de soulagement.
« Voulez-vous m’en couper deux mètres ?
— C’est qu’il n’est pas fameux à l’user, tandis que celui à soixante centimes…
— Celui à quarante centimes me suffit.
— Comme vous voudrez ; ce que j’en disais c’était pour vous renseigner ; je n’aime pas les reproches.
— Je ne vous en ferai pas, madame. »
La marchande avait pris la pièce du calicot à quarante centimes, et Perrine remarqua qu’il n’était ni blanc, ni lustré comme celui qu’elle avait admiré dans la montre.
« Et avec ça ? demanda la marchande quand elle eut déchiré le calicot avec un claquement sec.
— Je voudrais du fil.
— En pelote, en écheveau, en bobine… ?
— Le moins cher.
— Voilà une pelote de dix centimes ; ce qui nous fait en tout dix-huit sous. »
À son tour Perrine éprouva la joie de sortir de cette boutique en serrant contre elle ses deux mètres de calicot enveloppés dans un vieux journal invendu : elle n’avait sur ses trois francs dépensé que dix-huit sous, il lui en restait donc quarante-deux jusqu’au samedi suivant, c’est-à-dire qu’après avoir prélevé les vingt-huit sous qu’il lui fallait pour le pain de sa semaine, elle se voyait pour l’imprévu ou l’économie un capital de sept sous, n’ayant plus de loyer à payer.

Elle fit en courant le chemin qui la séparait de son île, où elle arriva essoufflée, mais cela ne l’empêcha pas de se mettre tout de suite à l’ouvrage, car la forme qu’elle donnerait à sa chemise ayant été longuement débattue dans sa tête, elle n’avait pas à y revenir : elle serait à coulisse ; d’abord parce que c’était la plus simple, et la moins difficile à exécuter pour elle qui n’avait jamais taillé des chemises, et manquait de ciseaux, et puis parce qu’elle pourrait faire servir à la nouvelle le cordon de l’ancienne.
Tant qu’il ne s’agit que de couture, les choses marchèrent à souhait, sinon de façon à s’admirer dans son travail, au moins assez bien pour ne pas le recommencer. Mais où les difficultés et les responsabilités se présentèrent, ce fut au moment de tailler les ouvertures pour la tête et les bras, ce qui, avec son couteau et le billot pour seuls outils, lui paraissait si grave, que ce ne fut pas sans trembler un peu qu’elle se risqua à entamer l’étoffe. Enfin, elle en vint à bout, et le mardi matin elle put s’en aller à l’atelier habillée d’une chemise gagnée par son travail, taillée et cousue de ses mains.
Ce jour-là, quand elle se présenta chez mère Françoise, ce fut Rosalie qui vint au-devant d’elle le bras en écharpe.
« Guérie !
— Non, seulement on me permet de me lever et de sortir dans la cour. »
Tout à la joie de la voir, Perrine continua de la questionner, mais Rosalie ne répondait que d’une façon contrainte.
Qu’avait-elle donc ?
À la fin elle lâcha une question qui éclaira Perrine :
« Où donc logez-vous maintenant ? »
N’osant pas répondre, Perrine se jeta à côté :
« C’était trop cher pour moi, il ne me restait rien pour ma nourriture et mon entretien.
— Est-ce que vous avez trouvé à meilleur prix autre part ?
— Je ne paye pas.
— Ah ! »
Elle resta un moment arrêtée, puis la curiosité l’emporta.
« Chez qui ? »
Cette fois Perrine ne put pas se dérober à cette question directe :
« Je vous dirai cela plus tard.
— Quand vous voudrez ; seulement vous savez, lorsqu’en passant vous verrez tante Zénobie dans la cour ou sur la porte, il vaudra mieux ne pas entrer : elle vous en veut ; venez le soir plutôt, à cette heure-là elle est occupée. »
Perrine rentra à l’atelier attristée de cet accueil ; en quoi donc était-elle coupable de ne pas pouvoir continuer à habiter la chambrée de mère Françoise ?
Toute la journée elle resta sous cette impression, qui revint plus forte quand le soir elle se trouva seule dans l’aumuche, n’ayant rien à faire pour la première fois depuis huit jours. Alors, afin de la secouer, elle eut l’idée de se promener dans les prairies qui entouraient son île, ce qu’elle n’avait pas encore eu le temps de faire. La soirée était d’une beauté radieuse, non pas éblouissante comme elle se rappelait celles de ses années d’enfance dans son pays natal, ni brûlante sous un ciel d’indigo, mais tiède, et d’une clarté tamisée qui montrait les cimes des arbres baignées dans une vapeur d’or pâle : les foins, qui n’étaient pas encore mûrs, mais dont les plantes défleurissaient déjà, versaient dans l’air mille parfums qui se concentraient en une senteur troublante.
Sortie de son île, elle suivit la rive de l’entaille, marchant dans les herbes hautes qui depuis leur pousse printanière n’avaient été foulées par personne, et de temps en temps se retournant, elle regardait à travers les roseaux de la berge son aumuche qui se confondait si bien avec le tronc et les branches des saules, que les bêtes sauvages ne devaient certainement pas soupçonner qu’elle était un travail d’homme, derrière lequel l’homme pouvait s’embusquer avec un fusil.
Au moment où, après un de ces arrêts qui l’avait fait descendre dans les roseaux et les joncs, elle allait remonter sur la berge, un bruit se produisit à ses pieds qui l’effara, et une sarcelle se jeta à l’eau en se sauvant effrayée. Alors regardant d’où elle était partie, elle aperçut un nid fait de brins d’herbe et de plumes, dans lequel se trouvaient dix œufs d’un blanc sale avec de petites taches de couleur noisette : au lieu d’être posé sur la terre et dans les herbes, ce nid flottait sur l’eau ; elle l’examina pendant quelques minutes, mais sans le toucher, et remarqua qu’il était construit de façon à s’élever ou s’abaisser selon la crue des eaux, et si bien entouré de roseaux que ni le courant, si une crue en produisait un, ni le vent ne pouvaient l’entraîner.
De peur d’inquiéter la mère, elle alla se placer à une certaine distance, et resta là immobile. Cachée dans les hautes herbes où elle avait disparu en s’asseyant, elle attendit pour voir si la sarcelle reviendrait à son nid ; mais comme celle-ci ne reparut pas, elle en conclut qu’elle ne couvait pas encore, et que ces œufs étaient nouvellement pondus ; alors elle reprit sa promenade, et de nouveau au frôlement de sa jupe dans les herbes sèches elle vit partir d’autres oiseaux effrayés, — des poules d’eau si légères dans leur fuite qu’elles couraient sur les feuilles flottantes des nénuphars sans les enfoncer ; des râles au bec rouge ; des bergeronnettes sautillantes ; des troupes de moineaux qui, dérangés au moment de leur coucher, la poursuivaient du cri auquel ils doivent leur nom dans le pays « cra-cra ».
Allant ainsi à la découverte, elle ne tarda pas à arriver au bout de son entaille, et reconnut qu’elle se réunissait à une autre plus large et plus longue, mais par cela même beaucoup moins boisée ; aussi, après avoir suivi dans la prairie une de ses rives pendant un certain temps, s’expliqua-t-elle que les oiseaux y fussent moins nombreux.
C’était son étang avec ses arbres touffus, ses grands roseaux foisonnants, ses plantes aquatiques qui recouvraient les eaux d’un tapis de verdure mouvante que ce monde ailé avait choisi parce qu’il y trouvait sa nourriture aussi bien que sa sécurité ; et quand, une heure après, en revenant sur ses pas, elle le revit à demi noyé dans l’ombre du soir, si tranquille, si vert, si joli, elle se dit qu’elle avait eu autant d’intelligence que ces bêtes de le prendre elle aussi pour nid.


XXI
Chez Perrine, c’étaient bien souvent les événements du jour écoulé qui faisaient les rêves de sa nuit, de sorte que les derniers mois de sa vie ayant été remplis par la tristesse, il en avait été de ses rêves comme de sa vie. Que de fois depuis que le malheur avait commencé à la frapper, s’était-elle éveillée baignée de sueur, étouffée par des cauchemars qui prolongeaient dans le sommeil les misères de la réalité. À la vérité, après son arrivée à Maraucourt, sous l’influence des pensées d’espoir qui renaissaient en elle, comme aussi sous celle du travail, ces cauchemars moins fréquents étaient devenus moins douloureux, leur poids avait pesé moins lourdement sur elle, leurs doigts de fer l’avaient serrée moins fort à la gorge.
Maintenant lorsqu’elle s’endormait, c’était au lendemain qu’elle pensait, à un lendemain assuré, ou bien à l’atelier, ou bien à son île ; ou bien encore à ce qu’elle avait entrepris ou voulait entreprendre pour améliorer sa situation, ses espadrilles, sa chemise, son caraco, sa jupe. Et alors son rêve, comme s’il obéissait à une suggestion mystérieuse, mettait en scène le sujet qu’elle avait tâché d’imposer à son esprit : tantôt un atelier dans lequel la baguette d’une fée remplaçant le pilon de La Quille, donnait le mouvement aux mécaniques, sans que les enfants qui les conduisaient eussent aucune peine à prendre ; tantôt un lendemain radieux, tout plein de joies pour tous ; une autre fois il faisait surgir une nouvelle île d’une beauté surnaturelle avec des paysages et des bêtes aux formes fantastiques qui n’ont de vie que dans les rêves ; ou bien encore plus terre à terre son imagination lui donnait à coudre des bottines merveilleuses qui remplaçaient ses espadrilles, ou des robes extraordinaires tissées par des génies dans des cavernes de diamants et de rubis, lesquelles robes remplaceraient à un moment donné le caraco et la jupe en indienne qu’elle se promettait.
Sans doute ce moyen de suggestion n’était pas infaillible, et son imagination inconsciente ne lui obéissait ni assez fidèlement, ni assez régulièrement pour avoir la certitude, en fermant les yeux, que les pensées de sa nuit continueraient celles de sa journée, ou celles qu’elle suivait quand le sommeil la prenait, mais enfin cette continuation s’enchaînait quelquefois, et alors ces bonnes nuits lui apportaient un soulagement moral aussi bien que physique qui la relevait.
Ce soir-là lorsqu’elle s’endormit dans sa hutte close, la dernière image qui passa devant ses yeux à demi noyés par le sommeil, aussi bien que la dernière idée qui flotta dans sa pensée engourdie, continuèrent son voyage d’exploration aux abords de son île. Cependant ce ne fut pas précisément de ce voyage qu’elle rêva, mais plutôt de festins : dans une cuisine haute et grande comme une cathédrale, une armée de petits marmitons blancs, de tournure diabolique, s’empressait autour de tables immenses et d’un brasier infernal : les uns cassaient des œufs que d’autres battaient et qui montaient, montaient en mousse neigeuse ; et de tous ces œufs, ceux-ci gros comme des melons, ceux-là à peine gros comme des pois, ils confectionnaient des plats extraordinaires, si bien qu’ils semblaient avoir pour but d’arranger ces œufs de toutes les manières connues, sans en oublier une seule : à la coque, au fromage, au beurre noir, aux tomates, brouillés, pochés, à la crème, au gratin, en omelettes variées, au jambon, au lard, aux pommes de terre, aux rognons, aux confitures, au rhum qui flambait avec des lueurs d’éclairs ; et à côté de ceux-là d’autres plus importants, et qui incontestablement étaient des chefs, mélangeaient d’autres œufs à des pâtes pour en faire des pâtisseries, des soufflés, des pièces montées. Et chaque fois qu’elle se réveillait à moitié, elle se secouait pour chasser ce rêve bête, mais toujours il reprenait et les marmitons qui ne la lâchaient point continuaient leur travail fantastique, si bien que quand le sifflet de l’usine la réveilla, elle en était encore à suivre la préparation d’une crème au chocolat dont elle retrouva le goût et le parfum sur ses lèvres.
Et alors, quand la lucidité commença à se faire dans son esprit qui s’ouvrait, elle comprit que ce qui surtout l’avait frappée dans son voyage, ce n’était ni le charme, ni la beauté, ni la tranquillité de son île, mais tout simplement les œufs de sarcelle qui avaient dit à son estomac que depuis quinze jours bientôt, elle ne lui donnait que du pain sec et de l’eau : et c’étaient ces œufs qui avaient guidé son rêve en lui montrant ces marmitons et toutes ces cuisines fantastiques ; il avait faim de ces bonnes choses cet estomac et il le disait à sa manière en provoquant ces visions, qui en réalité n’étaient que des protestations.
Pourquoi n’avait-elle pas pris ces œufs, ou quelques-uns de ces œufs qui n’appartenaient à personne, puisque la sarcelle qui les avait pondus était une bête sauvage ? Assurément, n’ayant à sa disposition ni casserole, ni poêle, ni ustensile d’aucune sorte, elle ne pouvait se préparer aucun des plats qui venaient de défiler devant ses yeux, tous plus alléchants, plus savants les uns que les autres ; mais c’est là le mérite des œufs précisément qu’ils n’ont pas besoin de préparations savantes : une allumette pour mettre le feu à un petit tas de bois sec ramassé dans les taillis ; et sous la cendre il lui était facile de les faire cuire comme elle voulait, à la coque ou durs, en attendant qu’elle pût se payer une casserole ou un plat. Pour ne pas ressembler au festin que son rêve avait inventé, ce serait un régal qui aurait son prix.
Plus d’une fois pendant son travail ce pourquoi lui revint à l’esprit, et si ce ne fut pas avec le caractère d’une obsession comme son rêve, il fut cependant assez pressant pour qu’à la sortie elle se trouvât décidée à acheter une boîte d’allumettes et un sou de sel ; puis ces acquisitions faites elle partit en courant pour revenir à son entaille.
Elle avait trop bien retenu la place du nid pour ne pas le retrouver tout de suite, mais ce soir-là la mère ne l’occupait

pas ; seulement elle y était venue à un moment quelconque de la journée, puisque maintenant au lieu de dix œufs il y en avait onze ; ce qui prouvait que n’ayant pas fini de pondre, elle ne couvait pas encore.
C’était là une bonne chance, d’abord parce que les œufs seraient frais, et puis parce qu’en en prenant seulement cinq ou six la sarcelle, qui ne savait pas compter, ne s’apercevrait de rien.
Autrefois Perrine n’eût pas eu de ces scrupules et elle eût vidé complètement le nid, sans aucun souci, mais les chagrins qu’elle avait éprouvés lui avaient mis au cœur une compassion attendrie pour les chagrins des autres, de même que son affection pour Palikare lui avait inspiré pour toutes les bêtes une sympathie qu’elle ne connaissait pas en son enfance. Cette sarcelle n’était-elle pas une camarade pour elle ? Ou plutôt en continuant son jeu, une sujette ? Si les rois ont le droit d’exploiter leurs sujets et d’en vivre, encore doivent-ils garder avec eux certains ménagements.
Quand elle avait décidé cette chasse, elle avait en même temps arrêté la manière de la faire cuire ; bien entendu ce ne serait pas dans l’aumuche, car le plus léger flocon de fumée qui s’en échapperait pourrait donner l’éveil à ceux qui le verraient, mais simplement dans une carrière du taillis où campaient les nomades qui traversaient le village, et où par conséquent ni un feu, ni de la fumée ne devaient attirer l’attention de personne. Promptement elle ramassa une brassée de bois mort et bientôt elle eut un brasier dans les cendres duquel elle fit cuire un de ses œufs, tandis qu’entre deux silex bien propres et bien polis elle égrugeait une pincée de sel pour qu’il fondît mieux. À la vérité il lui manquait un coquetier ; mais c’est là un ustensile qui n’est indispensable qu’à qui dispose du superflu. Un petit trou fait dans son morceau de pain lui en tint lieu. Et bientôt elle eut la satisfaction de tremper une mouillette dans son œuf cuit à point ; à la première bouchée, il lui sembla qu’elle n’en avait jamais mangé d’aussi bon, et elle se dit qu’alors même que les marmitons de son rêve existeraient réellement ils ne pourraient certainement pas faire quelque chose qui approchât de cet œuf de sarcelle à la coque, cuit sous les cendres.
Réduite la veille à son seul pain sec, et n’imaginant pas qu’elle pût y rien ajouter avant plusieurs semaines, des mois, peut-être, ce souper aurait dû satisfaire son appétit et les tentations de son estomac. Cependant il n’en fut pas ainsi ; et elle n’avait pas fini son œuf qu’elle se demandait si elle ne pourrait pas accommoder d’une autre façon ceux qui lui restaient, aussi bien que ceux qu’elle se promettait de se procurer par de nouvelles trouvailles. Bon, très bon l’œuf à la coque ; mais bonne aussi une soupe chaude liée avec un jaune d’œuf. Et cette idée de soupe lui avait trotté par la tête avec le très vif regret d’être obligée de renoncer à sa réalisation. Sans doute la confection de ses espadrilles et de sa chemise lui avait inspiré une certaine confiance, en lui démontrant ce qu’on peut obtenir avec de la persévérance. Mais cette confiance n’allait pas jusqu’à croire qu’elle pourrait jamais se fabriquer une casserole en terre ou en fer-blanc pour faire sa soupe, pas plus qu’une cuiller en métal quelconque ou simplement en bois pour la manger. Il y avait là des impossibilités contre lesquelles elle se casserait la tête ; et, en attendant qu’elle eût gagné l’argent nécessaire pour l’acquisition de ces deux ustensiles, elle devrait, en fait de soupe, se contenter du fumet qu’elle respirait en passant devant les maisons, et du bruit des cuillers qui lui arrivait.
C’était ce qu’elle se disait un matin en se rendant à son travail, lorsqu’un peu avant d’entrer dans le village, à la porte d’une maison d’où l’on avait déménagé la veille, elle vit un tas de vieille paille jeté sur le bas côté du chemin avec des débris de toutes sortes, et parmi ces débris elle aperçut des boîtes en fer-blanc qui avaient contenu des conserves de viande, de poisson, de légumes ; il y en avait de différentes formes, grandes, petites, hautes, plates.
En recevant l’éclair que leur surface polie lui envoyait, elle s’était arrêtée machinalement ; mais elle n’eut pas une seconde d’hésitation : les casseroles, les plats, les cuillers, les fourchettes qui lui manquaient, venaient de lui sauter aux yeux ; pour que sa batterie de cuisine fût aussi complète qu’elle la pouvait désirer, elle n’avait qu’à tirer parti de ces vieilles boîtes. D’un saut elle traversa le chemin, et à la hâte fit choix de quatre boîtes qu’elle emporta en courant pour aller les cacher au pied d’une haie, sous un tas de feuilles sèches : au retour le soir, elle les retrouverait là et alors avec un peu d’industrie, tous les menus qu’elle inventait, pourraient être mis à exécution.
Mais les retrouverait-elle ? Ce fut la question qui pendant toute la journée la préoccupa. Si on les lui prenait, elle n’aurait donc arrangé toutes ses combinaisons de travail que pour les voir lui échapper au moment même où elle croyait pouvoir les réaliser.
Heureusement aucun de ceux qui passèrent par là ne s’avisa de les enlever, et quand la journée finie elle revint à la haie, après avoir laissé passer le flot des ouvriers qui suivaient ce chemin, elles étaient à la place même où elle les avait cachées.
Comme elle ne pouvait pas plus faire du bruit dans son île que de la fumée, ce fut dans la carrière qu’elle s’établit, espérant trouver là les outils qui lui étaient nécessaires, c’est-à-dire des pierres dont elle ferait des marteaux pour battre le fer-blanc ; d’autres plates lui serviraient d’enclumes, ou rondes de mandrins ; d’autres seraient des ciseaux avec lesquels elle le couperait.
Ce fut ce travail qui lui donna le plus de peine, et il ne lui fallut pas moins de trois jours pour façonner une cuiller ; encore n’était-il pas du tout prouvé que si elle l’avait montrée à quelqu’un, on eût deviné que c’était une cuiller ; mais comme c’en était une qu’elle avait voulu fabriquer, cela suffisait, et d’autre part comme elle mangeait seule, elle n’avait pas à s’inquiéter des jugements qu’on pouvait porter sur ses ustensiles de table.
Maintenant pour faire la soupe dont elle avait si grande envie, il ne lui manquait plus que du beurre et de l’oseille.
Pour le beurre, il en était comme du pain et du sel ; ne pouvant pas le faire de ses propres mains, puisqu’elle n’avait pas de lait, elle devait l’acheter.
Mais pour l’oseille elle économiserait cette dépense par une recherche dans les prairies où non seulement elle trouverait de l’oseille sauvage, mais aussi des carottes, des salsifis qui tout en n’ayant ni la beauté, ni la grosseur des légumes cultivés, seraient encore très bons pour elle.
Et puis il n’y avait pas que des œufs et des légumes dont elle pouvait composer le menu de son dîner ; maintenant qu’elle s’était fabriqué des vases pour les cuire, une cuiller en fer-blanc et une fourchette en bois pour les manger, il y avait aussi les poissons de l’étang, si elle était assez adroite
pour les prendre. Que fallait-il pour cela ? Des lignes qu’elle amorcerait avec des vers qu’elle chercherait dans la vase. De la ficelle qu’elle avait achetée pour ses espadrilles, il restait
un bon bout ; elle n’eut qu’à dépenser un sou pour des hameçons : et avec des crins de cheval qu’elle ramassa devant la forge, ses lignes furent suffisantes pour pêcher plusieurs sortes de poissons, sinon les plus beaux de l’entaille qu’elle
voyait, dans l’eau claire, passer dédaigneux devant ses amorces trop simples, au moins quelques-uns des petits, moins difficiles, et qui pour elle étaient d’une grosseur bien suffisante.


XXII
Très occupée par ces divers travaux qui lui prenaient toutes ses soirées, elle resta plus d’une semaine sans aller voir Rosalie ; et comme par une de leurs camarades aux cannetières qui logeait chez mère Françoise elle eut de ses nouvelles ; d’autre part comme elle craignait d’être reçue par la terrible tante Zénobie, elle laissa les jours s’ajouter aux jours ; mais à la fin, un soir elle se décida à ne pas rentrer tout de suite chez elle, où d’ailleurs elle n’avait pas à faire son dîner composé d’un poisson froid pris et cuit la veille.
Justement Rosalie était seule dans la cour, assise sous un pommier ; en apercevant Perrine elle vint à la barrière d’un air à moitié fâché et à moitié content :
« Je croyais que vous vouliez ne plus venir ?
— J’ai été occupée.
— À quoi donc ? »
Perrine ne pouvait pas ne pas répondre : elle montra ses espadrilles, puis elle raconta comment elle avait confectionné sa chemise.
« Vous ne pouviez pas emprunter des ciseaux aux gens de votre maison ? dit Rosalie étonnée.
— Il n’y a pas de gens qui puissent me prêter des ciseaux dans ma maison.
— Tout le monde a des ciseaux. »
Perrine se demanda si elle devait continuer à garder le secret sur son installation, mais pensant qu’elle ne pourrait le faire que par des réticences qui fâcheraient Rosalie, elle se décida à parler.
« Personne ne demeure dans ma maison, dit-elle en souriant.
— Pas possible.
— C’est pourtant vrai, et voilà pourquoi ne pouvant pas non plus me procurer une casserole pour me faire de la soupe et une cuiller pour la manger, j’ai dû les fabriquer, et je vous assure que pour la cuiller ç’a été plus difficile que pour les espadrilles.
— Vous voulez rire.
— Mais non, je vous assure. »
Et sans rien dissimuler, elle raconta son installation dans l’aumuche, ainsi que ses travaux pour fabriquer ses ustensiles, ses chasses aux œufs, ses pêches dans l’entaille, ses cuisines dans la carrière.
À chaque instant Rosalie poussait des exclamations de joie comme si elle entendait une histoire tout à fait extraordinaire :
« Ce que vous devez vous amuser ! s’écria-t-elle quand Perrine expliqua comment elle avait fait sa première soupe à l’oseille.
— Quand ça réussit, oui ; mais quand ça ne marche pas ! J’ai travaillé trois jours pour ma cuiller ; je ne pouvais pas arriver à creuser la palette : j’ai gâché deux morceaux de fer-blanc ; il ne m’en restait plus qu’un seul ; pensez à ce que je me suis donné de coups de caillou sur les doigts.
— Je pense à votre soupe.
— C’est vrai qu’elle était bonne…
— Je vous crois.
— Pour moi qui n’en mange jamais, et ne mange non plus rien de chaud.
— Moi j’en mange tous les jours, mais ce n’est pas la même chose : est-ce drôle qu’il y ait de l’oseille dans les prairies, et des carottes, et des salsifis !
— Et aussi du cresson, de la ciboulette, des mâches, des panais, des navets, des raiponces, des bettes et bien d’autres plantes bonnes à manger.
— Il faut savoir.
— Mon père m’avait appris à les connaître. »
Rosalie garda le silence un moment d’un air réfléchi ; à la fin elle se décida :
« Voulez-vous que j’aille vous voir ?
— Avec plaisir si vous me promettez de ne dire à personne où je demeure.
— Je vous le promets.
— Alors quand voulez-vous venir ?
— J’irai dimanche chez une de mes tantes à Saint-Pipoy ; en revenant dans l’après-midi je peux m’arrêter. »
À son tour Perrine eut un moment d’hésitation, puis d’un air affable :
« Faites mieux, dînez avec moi. »
En vraie paysanne qu’elle était, Rosalie s’enferma dans des réponses cérémonieuses, sans dire ni oui ni non ; mais il était facile de voir qu’elle avait une envie très vive d’accepter.
Perrine insista :
« Je vous assure que vous me ferez plaisir, je suis si isolée.
— C’est tout de même vrai.
— Alors c’est entendu ; mais apportez votre cuiller, car je n’aurai ni le temps, ni le fer-blanc pour en fabriquer une seconde.
— J’apporterai aussi mon pain, n’est-ce pas ?
— Je veux bien. Je vous attendrai dans la carrière ; vous me trouverez occupée à ma cuisine. »
Perrine était sincère en disant qu’elle aurait plaisir à recevoir Rosalie, et à l’avance elle s’en fit fête : une invitée à traiter, un menu à composer, ses provisions à trouver, quelle affaire ! et son importance devint quelque chose de sensible pour elle-même : qui lui eût dit quelques jours plus tôt qu’elle pourrait donner à dîner à une amie ?
Ce qu’il y avait de grave, c’étaient la chasse et la pêche, car si elle ne dénichait pas des œufs, et ne pêchait pas du poisson, ce dîner serait réduit à une soupe à l’oseille, ce qui serait vraiment par trop maigre. Dès le vendredi elle employa sa soirée à parcourir les entailles voisines, où elle eut la chance de découvrir un nid de poule d’eau ; il est vrai que les œufs des poules d’eau sont plus petits que ceux des sarcelles, mais elle n’avait pas le droit d’être trop difficile. D’ailleurs sa pêche fut meilleure, et elle eut l’adresse de prendre avec sa ligne

amorcée d’un ver rouge une jolie perche, qui devait suffire à son appétit et à celui de Rosalie. Elle voulut cependant avoir en plus du dessert, et ce fut un groseillier à maquereau poussé sous un têtard de saule qui le lui fournit ; peut-être les groseilles
n’étaient-elles pas parfaitement mûres, mais c’est une
des qualités de ce fruit de pouvoir se manger vert.
Quand à la fin de l’après-midi du dimanche Rosalie arriva dans la carrière, elle trouva Perrine assise devant son feu sur lequel la soupe bouillait :
« Je vous ai attendue pour mêler le jaune d’œuf à la soupe, dit Perrine, vous n’aurez qu’à tourner avec votre bonne main pendant que je verserai doucement le bouillon ; le pain est taillé. »
Bien que Rosalie eût fait toilette pour ce dîner, elle ne craignit pas de se prêter à ce travail qui était un jeu, et des plus amusants pour elle encore.
Bientôt la soupe fut achevée, et il n’y eut plus qu’à la porter dans l’île, ce que fit Perrine.
Pour recevoir sa camarade qui tenait encore sa main en écharpe, elle avait rétabli la planche servant de pont :
« Moi, c’est à la perche que j’entre et sors, dit-elle, mais cela n’eût pas été commode pour vous, à cause de votre main. »
La porte de l’aumuche ouverte, Rosalie ayant aperçu dressées dans les quatre coins des gerbes de fleurs variées, l’une de massettes, l’autre de butomes rosés, celle-ci d’iris jaunes, celle-là d’aconit aux clochettes bleues, et à terre le couvert mis, poussa une exclamation qui paya Perrine de ses peines.
« Que c’est joli ! »
Sur un lit de fougère fraîche deux grandes feuilles de patience se faisaient vis-à-vis en guise d’assiettes et sur une feuille de berce beaucoup plus grande, comme il convient pour un plat, la perche était dressée entourée de cresson ; c’était une feuille aussi, mais plus petite, qui servait de salière, comme c’en était une autre qui remplaçait le compotier pour les groseilles à maquereau ; entre chaque plat était piquée une fleur de nénuphar qui sur cette fraîche verdure jetait sa blancheur éblouissante.
« Si vous voulez vous asseoir », dit Perrine en lui tendant la main.
Et quand elles eurent pris place en face l’une de l’autre, le dîner commença.
« Comme j’aurais été fâchée de n’être pas venue, dit Rosalie, parlant la bouche pleine, c’est si joli et si bon.
— Pourquoi donc ne seriez-vous pas venue ?
— Parce qu’on voulait m’envoyer à Picquigny pour M. Bendit qui est malade.
— Qu’est-ce qu’il a, M. Bendit ?
— La fièvre typhoïde ; il est très malade, à preuve que depuis hier il ne sait pas ce qu’il dit, et ne reconnaît plus personne ; c’est pour cela qu’hier justement j’ai été pour venir vous chercher.
— Moi ! Et pourquoi faire ?
— Ah ! voilà une idée que j’ai eue.
— Si je peux quelque chose pour M. Bendit, je suis prête : il a été bon pour moi ; mais que peut une pauvre fille ? Je ne comprends pas.
— Donnez-moi encore un peu de poisson, avec du cresson, et je vais vous l’expliquer. Vous savez que M. Bendit est l’employé chargé de la correspondance étrangère, c’est lui qui traduit les lettres anglaises et allemandes. Comme maintenant il n’a plus sa tête, il ne peut plus rien traduire. On voulait faire venir un autre employé pour le remplacer ; mais comme celui-là pourrait bien garder la place quand M. Bendit sera guéri, s’il guérit, M. Fabry et M. Mombleux ont proposé de se charger de son travail, afin qu’il retrouve sa place plus tard. Mais voilà qu’hier M. Fabry a été envoyé en Écosse, et M. Mombleux est resté embarrassé, parce que s’il lit assez bien l’allemand, et s’il peut faire les traductions de l’anglais avec M. Fabry, qui a passé plusieurs années en Angleterre, quand il est tout seul, ça ne va plus aussi bien, surtout quand il s’agit de lettres en anglais dont il faut deviner l’écriture. Il expliquait ça à table où je le servais, et il disait qu’il avait peur d’être obligé de renoncer à remplacer M. Bendit ; alors j’ai eu idée de lui dire que vous parliez l’anglais comme le français…
— Je parlais français avec mon père, anglais avec ma mère, et quand nous nous entretenions tous les trois ensemble, nous employions tantôt une langue, tantôt l’autre, indifféremment, sans y faire attention.
— Pourtant je n’ai pas osé ; mais maintenant, est-ce que je peux lui dire cela ?
— Certainement, si vous croyez qu’il peut avoir besoin d’une pauvre fille comme moi.
— Il ne s’agit pas d’une pauvre fille ou d’une demoiselle, il s’agit de savoir si vous parlez l’anglais.
— Je le parle, mais traduire une lettre d’affaires, c’est autre chose.
— Pas avec M. Mombleux qui connaît les affaires.
— Peut-être. Alors s’il en est ainsi, dites à M. Mombleux que je serais bien heureuse de pouvoir faire quelque chose pour M. Bendit.
— Je le lui dirai. »
La perche, malgré sa grosseur, avait été dévorée et le cresson avait aussi disparu. On arrivait au dessert, Perrine se leva et remplaça les feuilles de berce sur lesquelles le poisson avait été servi par des feuilles de nénuphar en forme de coupe, veinées et vernissées comme eût pu l’être le plus beau des émaux : puis elle offrit ses groseilles à maquereau :
« Acceptez donc, dit-elle en riant comme si elle avait joué à la poupée, quelques fruits de mon jardin.
— Où est-il votre jardin ?
— Sur notre tête : un groseillier a poussé dans les branches d’un des saules qui sert de pilier à la maison.
— Savez-vous que vous n’allez pas pouvoir l’occuper longtemps encore votre maison ?
— Jusqu’à l’hiver, je pense.
— Jusqu’à l’hiver ! Et la chasse au marais qui va ouvrir ; à ce moment l’aumuche servira pour sûr.
— Ah ! mon Dieu. »
La journée qui avait si bien commencé finit sur cette terrible menace, et cette nuit-là fut certainement la plus mauvaise que Perrine eut passée dans son île depuis qu’elle l’occupait.
Où irait-elle ?
Et tous ses ustensiles, qu’elle avait eu tant de peine à réunir, qu’en ferait-elle ?


XXIII
Si Rosalie n’avait parlé que de la prochaine ouverture de la chasse au marais, Perrine serait restée sous le coup de ce danger gros de menaces pour elle, mais ce qu’elle avait dit de la maladie de Bendit et des traductions de Mombleux apportait une diversion à cette impression.
Oui, elle était charmante son île, et ce serait un vrai désastre que de la quitter ; mais en ne la quittant point, elle ne se rapprochait pas et même il semblait qu’elle ne se rapprocherait jamais du but que sa mère lui avait fixé et qu’elle devait poursuivre. Tandis que si une occasion se présentait pour elle d’être utile à Bendit et à Mombleux, elle se créait ainsi des relations qui lui entr’ouvriraient peut-être des portes par lesquelles elle pourrait passer plus tard ; et c’était là une considération qui devait l’emporter sur toutes les autres, même sur le chagrin d’être dépossédée de son royaume : ce n’était pas pour jouer à ce jeu si amusant qu’il fût, pour dénicher des nids, pêcher des poissons, cueillir des fleurs, écouter le chant des oiseaux ; donner des dînettes, qu’elle avait supporté les fatigues et les misères de son douloureux voyage.
Le lundi, comme cela avait été convenu avec Rosalie, elle passa devant la maison de mère Françoise à la sortie de midi, afin de se mettre à la disposition de Mombleux, si celui-ci avait besoin d’elle ; mais Rosalie vint lui dire que, comme il n’arrivait pas de lettres de l’Angleterre le lundi, il n’y avait pas eu de traductions à faire le matin ; peut-être serait-ce pour le lendemain.
Et Perrine rentrée à l’atelier avait repris son travail, quand quelques minutes après deux heures, La Quille la happa au passage :
« Va vite au bureau.
— Pour quoi faire ?
— Est-ce que ça me regarde ? on me dit de t’envoyer au bureau, vas-y. »
Elle n’en demanda pas davantage, d’abord parce qu’il était inutile de questionner La Quille, ensuite parce qu’elle se doutait de ce qu’on voulait d’elle ; cependant, elle ne comprenait pas très bien que s’il s’agissait de travailler avec Mombleux à une traduction difficile, on la fit venir dans le bureau où tout le monde pourrait la voir et, par conséquent, apprendre qu’il avait besoin d’elle.
Du haut de son perron, Talouel qui la regardait venir l’appela :
« Viens ici. »
Elle monta vivement les marches du perron.
« C’est bien toi qui parles anglais ? demanda-t-il, réponds-moi sans mentir.
— Ma mère était Anglaise.
— Et le français ? Tu n’as pas d’accent.
— Mon père était Français.
— Tu parles donc les deux langues ?
— Oui, monsieur.
— Bon. Tu vas aller à Saint-Pipoy, où M. Vulfran a besoin de toi. »
En entendant ce nom, elle laissa paraître une surprise qui fâcha le directeur.
« Es-tu stupide ? »
Elle avait déjà eu le temps de se remettre et de trouver une réponse pour expliquer sa surprise.
« Je ne sais pas où est Saint-Pipoy.
— On va t’y conduire en voiture, tu ne te perdras donc pas. »
Et du haut du perron, il appela :
« Guillaume ! »
La voiture de M. Vulfran qu’elle avait vue rangée, à l’ombre, le long des bureaux, s’approcha :
« Voilà la fille, dit Talouel, vous pouvez la conduire à M. Vulfran, et promptement, n’est-ce pas. » Déjà Perrine avait descendu le perron, et allait monter à côté de Guillaume, mais il l’arrêta d’un signe de main :
« Pas par là, dit-il, derrière. »
En effet, un petit siège pour une seule personne se trouvait derrière ; elle y monta et la voiture partit grand train.
Quand ils furent sortis du village, Guillaume, sans ralentir l’allure de son cheval, se tourna vers Perrine.
« C’est vrai que vous savez l’anglais ? demanda-t-il.
— Oui.
— Vous allez avoir la chance de faire plaisir au patron »
Elle s’enhardit à poser une question :
« Comment cela ?
— Parce qu’il est avec des mécaniciens anglais qui viennent d’arriver pour monter une machine et qu’il ne peut pas se faire comprendre. Il a amené avec lui M. Mombleux, qui parle anglais à ce qu’il dit ; mais l’anglais de M. Mombleux n’est pas celui des mécaniciens, si bien qu’ils se disputent sans se comprendre, et le patron est furieux ; c’était à mourir de rire. À la fin, M. Mombleux n’en pouvant plus, et espérant calmer le patron, a dit qu’il y avait aux cannettes une jeune fille appelée Aurélie qui parlait l’anglais, et le patron m’a envoyé vous chercher. »
Il y eut un moment de silence ; puis, de nouveau, il se tourna vers elle.
« Vous savez que si vous parlez l’anglais comme M. Mombleux, vous feriez peut-être mieux de descendre tout de suite. »
Il prit un air gouailleur :
« Faut-il arrêter ?
— Vous pouvez continuer.

— Ce que j’en dis, c’est pour vous.
— Je vous remercie. »
Cependant, malgré la fermeté de sa réponse elle n’était pas sans éprouver une angoisse qui lui étreignait le cœur, car si elle était sûre de son anglais, elle ignorait quel était celui de ces mécaniciens, qui n’était pas celui de M. Mombleux, comme disait Guillaume en se moquant ; puis elle savait que chaque métier a sa langue ou tout au moins ses mots techniques, et elle n’avait jamais parlé la langue de la mécanique. Qu’elle ne comprit pas, qu’elle hésitât et M. Vulfran n’allait-il pas être furieux contre elle, comme il l’avait été contre Mombleux ?
Déjà ils approchaient des usines de Saint-Pipoy, dont on apercevait les hautes cheminées fumantes, au-dessus des cimes des peupliers ; elle savait qu’à Saint-Pipoy on faisait la filature et le tissage comme à Maraucourt, et que, de plus, on y fabriquait des cordages et des ficelles ; seulement, qu’elle sût cela ou l’ignorât, ce qu’elle allait avoir à entendre et à dire ne s’en trouvait pas éclairci.
Quand elle put, au tournant du chemin, embrasser d’un coup d’œil l’ensemble des bâtiments épars dans la prairie, il lui sembla que pour être moins importants que ceux de Maraucourt, ils étaient considérables cependant ; mais déjà la voiture franchissait la grille d’entrée, presque aussitôt elle s’arrêta devant les bureaux.
« Venez avec moi », dit Guillaume.
Et il la conduisit dans une pièce où se trouvait M. Vulfran, ayant près de lui le directeur de Saint-Pipoy avec qui il s’entretenait.
« Voilà la fille, dit Guillaume son chapeau à la main.
— C’est bien, laisse-nous. »
Sans s’adresser à Perrine, M. Vulfran fit signe au directeur de se pencher vers lui, et il lui parla à voix basse ; le directeur répondit de la même manière, mais Perrine avait l’ouïe fine, elle comprit plutôt qu’elle n’entendit que M. Vulfran demandait qui elle était, et que le directeur répondait : « Une jeune fille de douze à treize ans qui n’a pas l’air bête du tout. »
« Approche, mon enfant », dit M. Vulfran d’un ton qu’elle lui avait déjà entendu prendre pour parler à Rosalie et qui ne ressemblait en rien à celui qu’il avait avec ses employés.
Elle s’en trouva encouragée et put se raidir contre l’émotion qui la troublait.
« Comment t’appelles-tu ? demanda M. Vulfran.
— Aurélie.
— Qui sont tes parents ?
— Je les ai perdus.
— Depuis combien de temps travailles-tu chez moi ?
— Depuis trois semaines.
— D’où es-tu ?
— Je viens de Paris.
— Tu parles anglais ?
— Ma mère était Anglaise.
— Alors, tu sais l’anglais ?
— Je parle l’anglais de la conversation et le comprends, mais…
— Il n’y a pas de mais, tu le sais ou tu ne le sais pas ?
— Je ne sais pas celui des divers métiers qui emploient des mots que je ne connais pas.
— Vous voyez, Benoist, que ce que cette petite dit là n’est pas sot, fit M. Vulfran en s’adressant à son directeur.
— Je vous assure qu’elle n’a pas l’air bête du tout.
— Alors, nous allons peut-être en tirer quelque chose. »
Il se leva en s’appuyant sur une canne et prit le bras du directeur.
« Suis-nous, mon enfant. »
Ordinairement les yeux de Perrine savaient voir et retenir ce qu’ils rencontraient, mais dans le trajet qu’elle fit derrière M. Vulfran, ce fut en dedans qu’elle regarda : qu’allait-il advenir de cet entretien avec les mécaniciens anglais ?
En arrivant devant un grand bâtiment neuf construit en briques blanches et bleues émaillées, elle aperçut Mombleux qui se promenait en long et en large d’un air ennuyé, et elle crut voir qu’il lui lançait un mauvais regard.
On entra et l’on monta au premier étage, où au milieu d’une vaste salle se trouvaient sur le plancher des grandes caisses en bois blanc, bariolées d’inscriptions de diverses couleurs avec les noms Matter et Platte, Manchester, répétés partout ; sur une de ces caisses, les mécaniciens anglais étaient assis, et Perrine remarqua que pour le costume au moins ils avaient la tournure de gentlemen ; complet de drap, épingle d’argent à la cravate, et cela lui donna à espérer qu’elle pourrait mieux les comprendre que s’ils étaient des ouvriers grossiers. À l’arrivée de M. Vulfran ils s’étaient levés ; alors celui-ci se tourna vers Perrine :
« Dis-leur que tu parles anglais et qu’ils peuvent s’expliquer avec toi. »
Elle fit ce qui lui était commandé, et aux premiers mots elle eut la satisfaction de voir la physionomie renfrognée des ouvriers s’éclairer ; il est vrai que ce n’était là qu’une phrase de conversation courante, mais leur demi-sourire était de bonne augure.
« Ils ont parfaitement compris, dit le directeur.
— Alors maintenant, dit M. Vulfran, demande-leur pourquoi ils viennent huit jours avant la date fixée pour leur arrivée ; cela fait que l’ingénieur qui devait les diriger et qui parle anglais est absent. »
Elle traduisit cette phrase fidèlement, et tout de suite la réponse que l’un d’eux lui fit :
« Ils disent qu’ayant achevé à Cambrai le montage de machines plus tôt qu’ils ne pensaient, ils sont venus ici directement au lieu de repasser par l’Angleterre.
— Chez qui ont-ils monté ces machines à Cambrai ? demanda M. Vulfran.
— Chez MM. Aveline frères.
— Quelles sont ces machines ? »
La question posée et la réponse reçue en anglais, Perrine hésita.
« Pourquoi hésites-tu ? demanda vivement M. Vulfran d’un ton impatient.
— Parce que c’est un mot de métier que je ne connais pas.
— Dis ce mot en anglais.
— Hydraulic mangle.
— C’est bien cela. »
Il répéta le mot en anglais, mais avec un tout autre accent que les ouvriers, ce qui expliquait qu’il n’eut pas compris ceux-ci lorsqu’ils l’avaient prononcé ; puis s’adressant au directeur :
« Vous voyez que les Aveline nous ont devancés ; nous n’avons donc pas de temps à perdre ; je vais télégraphier à Fabry de revenir au plus vite ; mais en attendant, il nous faut décider ces gaillards-là à se mettre au travail. Demande-leur, petite, pourquoi ils se croisent les bras. »
Elle traduisit la question, à laquelle celui qui paraissait le chef fit une longue réponse.
« Eh bien ? demanda M. Vulfran.
— Ils répondent des choses très compliquées pour moi.
— Tâche cependant de me les expliquer.
— Ils disent que le plancher de fer n’est pas assez solide pour porter leur machine qui pèse cent vingt mille livres… »
Elle s’interrompit pour interroger les ouvriers en anglais :
« One hundred and twenty ?
— Yes.
— C’est bien cent vingt mille livres, et que ce poids crèverait le plancher, la machine travaillant.
— Les poutres ont soixante centimètres de hauteur. »
Elle transmit l’objection, écouta la réponse des ouvriers, et continua :
« Ils disent qu’ils ont vérifié l’horizontalité du plancher et qu’il a fléchi. Ils demandent qu’on fasse le calcul de résistance ; ou qu’on place des étais sous le plancher.
— Le calcul, Fabry le fera à son retour ; les étais, on va les placer tout de suite. Dis-leur cela. Qu’ils se mettent donc au travail sans perdre une minute. On leur donnera tous les ouvriers dont ils peuvent avoir besoin : charpentiers, maçons. Ils n’auront qu’à demander en s’adressant à toi qui seras à leur disposition, n’ayant qu’à transmettre leurs demandes à M. Benoist. »
Elle traduisit ces instructions aux ouvriers qui parurent satisfaits quand elle dit qu’elle serait leur interprète.
« Tu vas donc rester ici, continua M. Vulfran ; on te donnera une fiche pour ta nourriture et ton logement à l’auberge, où tu n’auras rien à payer. Si on est content de toi, tu recevras une gratification au retour de M. Fabry. »


XXIV
Interprète, le métier valait mieux que celui de rouleuse ; ce fut en cette qualité que la journée finie, elle conduisit les monteurs à l’auberge du village, où elle arrêta un logement pour eux et pour elle, non dans une misérable chambrée, mais dans une chambre où chacun serait chez soi. Comme ils ne comprenaient pas et ne disaient pas un seul mot de français, ils voulurent qu’elle mangeât avec eux, ce qui leur permit de commander un dîner qui eût suffi à nourrir dix Picards, et qui par l’abondance des viandes ne ressemblait en rien au festin cependant si plantureux que, la veille, Perrine offrait à Rosalie.
Cette nuit-là ce fut dans un vrai lit qu’elle s’étendit et dans de vrais draps qu’elle s’enveloppa, cependant le sommeil fut long, très long à venir ; encore lorsqu’il finit par fermer ses paupières, fut-il si agité qu’elle se réveilla cent fois. Alors elle s’efforçait de se calmer en se disant qu’elle devait suivre la marche des événements sans chercher à les deviner heureux ou malheureux ; qu’il n’y avait que cela de raisonnable ; que ce n’était pas quand les choses semblaient prendre une direction si favorable qu’elle pouvait se tourmenter ; enfin qu’il fallait attendre ; mais les plus beaux discours, quand on se les adresse à soi-même, n’ont jamais fait dormir personne, et même plus ils sont beaux plus ils ont chance de nous tenir éveillés.
Le lendemain matin quand le sifflet de l’usine se fit entendre, elle alla frapper aux portes des deux monteurs pour leur annoncer qu’il était l’heure de se lever ; mais des ouvriers anglais n’obéissent pas plus au sifflet qu’à la sonnette, sur le continent au moins, et ce ne fut qu’après avoir fait une toilette que ne connaissent pas les Picards, et après avoir absorbé de nombreuses tasses de thé, avec de copieuses rôties bien beurrées, qu’ils se rendirent à leur travail, suivis de Perrine qui les avait discrètement attendus devant la porte, en se demandant s’ils en finiraient jamais, et si M. Vulfran ne serait pas à l’usine avant eux.
Ce fut seulement dans l’après-midi qu’il vint accompagné d’un de ses neveux, le plus jeune, M. Casimir, car ne pouvant pas voir avec ses yeux voilés, il avait besoin qu’on vît pour lui.
Mais ce fut un regard dédaigneux, que Casimir jeta sur le travail des monteurs, qui, à dire vrai, ne consistait encore qu’en préparation :
« Il est probable que ces garçons-là ne feront pas grand’chose tant que Fabry ne sera pas de retour, dit-il ; au reste il n’y a pas à s’en étonner avec le surveillant que vous leur avez donné. »
Il prononça ces derniers mots d’un ton sec et moqueur ; mais M. Vulfran au lieu de s’associer à cette raillerie, la prit par le mauvais côté :
« Si tu avais été en état de remplir cette surveillance, je n’aurais pas été obligé de prendre cette petite aux cannetières. »
Perrine le vit se cabrer d’un air rageur sous cette observation faite d’une voix sévère, mais Casimir se contint pour répondre presque légèrement :
« Il est certain que si j’avais pu prévoir qu’on me ferait un jour quitter l’administration, pour l’industrie, j’aurais appris l’anglais plutôt que l’allemand.
— Il n’est jamais trop tard pour apprendre », répliqua M. Vulfran de façon à clore cette discussion où de chaque côté les paroles étaient parties si vite.
Perrine s’était faite toute petite, sans oser bouger, mais Casimir ne tourna pas les yeux vers elle, et presque aussitôt il sortit donnant le bras à son oncle ; alors elle fut libre de suivre ses réflexions : il était vraiment dur avec son neveu M. Vulfran, mais combien le neveu était-il rogue, sec et déplaisant ; s’ils avaient de l’affection l’un pour l’autre, certes il n’y paraissait guère ! Pourquoi cela ? Pourquoi le jeune homme n’était-il pas affectueux pour le vieillard accablé par le chagrin et la maladie ? Pourquoi le vieillard était-il si sévère avec l’un de ceux qui remplaçaient son fils auprès de lui ?
Comme elle tournait ces questions, M. Vulfran rentra dans l’atelier, amené cette fois par le directeur, qui, l’ayant fait asseoir sur une caisse d’emballage, lui expliqua où en était le travail des monteurs.
Après un certain temps, elle entendit le directeur appeler à deux reprises :
« Aurélie, Aurélie. »
Mais elle ne bougea pas ayant oublié qu’Aurélie était le nom qu’elle s’était donné.
Une troisième fois il cria :
« Aurélie. »
Alors comme si elle s’éveillait en sursaut, elle courut à eux :
« Est-ce que tu es sourde ? demanda Benoist.
— Non, monsieur ; j’écoutais les monteurs.
— Vous pouvez me laisser » dit M. Vulfran, au directeur.
Puis quand celui-ci fut parti, s’adressant à Perrine restée debout devant lui :
« Tu sais lire, mon enfant ?
— Oui, monsieur.
— Lire l’anglais ?
— Comme le français ; l’un ou l’autre, cela m’est égal.
— Mais sais-tu en lisant l’anglais le mettre en français ?
— Quand ce ne sont pas des belles phrases, oui, monsieur.
— Des nouvelles dans un journal ?
— Je n’ai jamais essayé, parce que si je lisais un journal anglais je n’avais pas besoin de me le traduire à moi-même, puisque je comprends ce qu’il dit.
— Si tu comprends, tu peux traduire.
— Je crois que oui, monsieur, cependant je n’en suis pas sûre

— Eh bien nous allons essayer ; pendant que les monteurs travaillent, mais après les avoir prévenus que tu restes à leur disposition et qu’ils peuvent t’appeler s’ils ont besoin de toi, tu vas tâcher de me traduire dans ce journal les articles que je t’indiquerai. Va les prévenir et reviens t’asseoir près de moi. »
Quand sa commission faite, elle se fut assise, à une distance respectueuse de M. Vulfran, il lui tendit son journal : le Dundee News.
« Que dois-je lire ? demanda-t-elle en le dépliant.
— Cherche la partie commerciale. »
Elle se perdit dans les longues colonnes noires qui se succédaient indéfiniment, anxieuse, se demandant comment elle allait se tirer de ce travail nouveau pour elle, et si M. Vulfran ne s’impatienterait pas de sa lenteur, ou ne se fâcherait pas de sa maladresse.
Mais au lieu de la bousculer il la rassura, car avec sa finesse d’oreille si subtile chez les aveugles, il avait deviné son émotion au tremblement du papier :
« Ne te presse pas, nous avons le temps ; d’ailleurs tu n’as peut-être jamais lu un journal commercial.
— Il est vrai, monsieur. »
Elle continua ses recherches et tout à coup elle laissa échapper un petit cri.
« Tu as trouvé ?
— Je crois.
— Maintenant cherche la rubrique : Linen, hemp, jute, sacks, twine.
— Mais, monsieur, vous savez l’anglais, s’écria-t-elle involontairement.
— Cinq ou six mots de mon métier, et c’est tout malheureusement. »
Quand elle eut trouvé, elle commença sa traduction qui fut d’une lenteur désespérante pour elle, avec des hésitations, des ânonnements qui lui faisaient perler la sueur sur les mains, bien que M. Vulfran de temps en temps la soutînt :
« C’est suffisant, je comprends, va toujours. »
Et elle reprenait, élevant la voix quand les mécaniciens menaçaient de l’étouffer dans leurs coups de marteau.
Enfin elle arriva au bout.
« Maintenant, vois s’il y a des nouvelles de Calcutta ? »
Elle chercha.
« Oui voilà : « De notre correspondant spécial. »
— C’est cela ; lis.
— « Les nouvelles que nous recevons de Dakka… »
Elle prononça ce nom avec un tremblement de voix qui frappa M. Vulfran.
« Pourquoi trembles-tu ? demanda-t-il.
— Je ne sais pas si j’ai tremblé ; sans doute c’est l’émotion.
— Je t’ai dit de ne pas te troubler ; ce que tu donnes est beaucoup plus que ce que j’attendais. »
Elle lut la traduction de la correspondance de Dakka qui traitait de la récolte du jute sur les rives du Brahmapoutra ; puis quand elle eut fini, il lui dit de chercher aux nouvelles de mer si elle trouvait une dépêche de Sainte-Hélène.
« Saint Helena est le mot anglais, » dit-il.
Elle recommença à descendre et à monter les colonnes noires ; enfin le nom de Saint Helena lui sauta aux yeux :
« Passé le 23, navire anglais Alma de Calcutta pour Dundee ; le 24, navire norwégien Grundloven de Naraïngaudj pour Boulogne. »
Il parut satisfait :
« C’est très bien, dit-il, je suis content de toi. »
Elle eût voulu répondre, mais de peur que sa voix trahît son trouble de joie, elle garda le silence.
Il continua :
« Je vois qu’en attendant que ce pauvre Bendit soit guéri je pourrai me servir de toi. »
Après s’être fait rendre compte du travail accompli par les monteurs, et avoir répété à ceux-ci ses recommandations de se hâter autant qu’ils pourraient, il dit à Perrine de le conduire au bureau du directeur.
« Est-ce que je dois vous donner la main ? demanda-t-elle timidement.
— Mais certainement, mon enfant, comment me guiderais-tu sans cela ; avertis-moi aussi quand nous trouverons un obstacle sur notre chemin ; surtout ne sois pas distraite.
— Oh ! je vous assure, monsieur, que vous pouvez avoir confiance en moi !
— Tu vois bien que je l’ai cette confiance. »
Respectueusement elle lui prit la main gauche, tandis que de la droite il tâtait l’espace devant lui du bout de sa canne.
À peine sortis de l’atelier ils trouvèrent devant eux la voie du chemin de fer avec ses rails en saillie, et elle crut devoir l’en avertir.
« Pour cela c’est inutile, dit-il, j’ai le terrain de toutes mes usines dans la tête et dans les jambes, mais ce que je ne connais pas, ce sont les obstacles imprévus que nous pouvons rencontrer ; c’est ceux-là qu’il faut me signaler ou me faire éviter. »
Ce n’était pas seulement le terrain de ses usines qu’il avait dans la tête, c’était aussi son personnel ; quand il passait dans les cours les ouvriers le saluaient, non seulement en se découvrant comme s’il eût pu les voir, mais encore en prononçant son nom :
« Bonjour, monsieur Vulfran. »
Et pour un grand nombre, au moins pour les anciens, il répondait de la même manière : « Bonjour, Jacques », ou bonjour, Pascal », sans que son oreille eût oublié leur voix. Quand il y avait hésitation dans sa mémoire, ce qui était rare, car il les connaissait presque tous, il s’arrêtait :
« Est-ce que ce n’est pas toi ? » disait-il en le nommant.
S’il s’était trompé, il expliquait pourquoi.
Marchant ainsi lentement, le trajet fut long des ateliers au bureau ; quand elle l’eut conduit à son fauteuil, il la congédia :
« À demain », dit-il.


XXV
En effet, le lendemain à la même heure que la veille M. Vulfran entra dans l’atelier, amené par le directeur, mais Perrine ne put pas aller au-devant de lui, comme elle l’aurait voulu, car elle était à ce moment occupée à transmettre les instructions du chef monteur aux ouvriers qu’il avait réunis : maçons, charpentiers, forgerons, mécaniciens, et nettement, sans hésitations, sans répétitions elle traduisait à chacun les indications qui lui étaient données, en même temps qu’elle répétait au chef monteur les questions ou les objections que les ouvriers français lui adressaient.
Lentement, M. Vulfran s’était approché, et les voix s’interrompant, de sa canne il avait fait signe de continuer comme s’il n’était pas là.
Et pendant que Perrine obéissante se conformait à cet ordre, il se penchait vers le directeur :
« Savez-vous que cette petite ferait un excellent ingénieur, dit-il à mi-voix, mais pas assez bas cependant pour que Perrine ne l’entendît point.
— Positivement elle est étonnante pour la décision.
— Et pour bien d’autres choses encore, je crois ; elle m’a traduit hier le Dundee News plus intelligemment que Bendit ; et c’était la première fois qu’elle lisait la partie commerciale d’un journal.
— Sait-on ce qu’étaient ses parents ?
— Peut-être Talouel le sait-il, moi je l’ignore.
— En tout cas elle paraît être dans une misère pitoyable.
— Je lui ai donné cinq francs pour sa nourriture et son logement.
— Je veux parler de sa tenue : sa veste est une dentelle ; je n’ai jamais vu jupe pareille à la sienne que sur le corps des bohémiennes ; certainement elle a dû fabriquer elle-même les espadrilles dont elle est chaussée.
— Et la physionomie, qu’est-elle, Benoist ?
— Intelligente, très intelligente.
— Vicieuse ?
— Non, pas du tout ; honnête au contraire, franche et résolue ; ses yeux perceraient une muraille et cependant ils ont une grande douceur, avec de la méfiance.
— D’où diable nous vient-elle ?
— Pas de chez nous assurément.
— Elle m’a dit que sa mère était Anglaise.
— Je ne trouve pas qu’il y ait en elle rien des Anglais que j’ai connus ; c’est autre chose, tout autre chose ; avec cela jolie, et d’autant plus que son costume réellement misérable fait ressortir sa beauté. Il faut vraiment qu’il y ait en elle une sympathie ou une autorité native pour qu’avec une pareille tenue, nos ouvriers veuillent bien l’écouter. »
Et comme Benoist était de caractère à ne pas laisser passer une occasion d’adresser une flatterie au patron qui tenait la liste des gratifications, il ajouta :
« Sans la voir vous avez deviné tout cela.
— Son accent m’a frappé. »
Bien que n’entendant pas tout ce discours, Perrine en avait saisi quelques mots qui l’avaient jetée dans une agitation violente contre laquelle elle s’était efforcée de réagir ; car ce n’était pas ce qui se disait derrière elle, qu’elle devait écouter, si intéressant que cela pût être, mais bien les paroles que lui adressaient le monteur et les ouvriers : que penserait M. Vulfran si dans ses explications en français elle lâchait quelque ineptie qui prouverait son inattention ?
Elle eut la chance d’arriver au bout de ses explications, et, alors, M. Vulfran l’appela près de lui :
« Aurélie. »
Cette fois elle n’eut garde de ne pas répondre à ce nom qui désormais devait être le sien.
Comme la veille il la fit asseoir près de lui en lui remettant un papier pour qu’elle le traduisît, mais au lieu d’être le Dundee News ce fut la circulaire de la Dundee trades report association, qui est en quelque sorte le bulletin officiel du commerce du jute ; aussi sans avoir à chercher de-ci, de-là, dut-elle la traduire d’un bout à l’autre.
Comme la veille aussi lorsque la séance de traduction fut terminée, il se fit conduire par elle à travers les cours de l’usine ; mais cette fois ce fut en la questionnant :
« Tu m’as dit que tu avais perdu ta mère ; combien y a-t-il de temps ?
— Cinq semaines.
— À Paris ?
— À Paris.
— Et ton père ?
— Je l’ai perdu il y a six mois. »
Lui tenant la main dans la sienne, il sentit à la contraction qui la rétracta combien était douloureuse l’émotion que ses souvenirs évoquaient ; aussi sans abandonner son sujet, passa-t-il les questions qui nécessairement découlaient de celles auxquelles elle venait de répondre.
« Que faisaient tes parents ?
— Nous avions une voiture et nous vendions.
— Aux environs de Paris ?
— Tantôt dans un pays, tantôt dans un autre ; nous voyagions.
— Et ta mère morte, tu as quitté Paris ?
— Oui, monsieur.
— Pourquoi ?
— Parce que maman m’avait fait promettre de ne pas rester à Paris, quand elle ne serait plus là, et d’aller dans le Nord, auprès de la famille de mon père.
— Alors pourquoi es-tu venue ici ?
— Quand ma pauvre maman est morte, il nous avait fallu vendre notre voiture, notre âne, le peu que nous avions, et cet argent avait été épuisé par la maladie ; en sortant du

cimetière il me restait cinq francs trente-cinq centimes, qui ne me permettaient pas de prendre le chemin de fer. Alors je me décidai à faire la route à pied. »
M. Vulfran eut un mouvement dans les doigts dont elle ne comprit pas la cause :
« Pardonnez-moi si je vous ennuie, monsieur, je dis sans doute des choses inutiles.
— Tu ne m’ennuies pas ; au contraire, je suis content de voir que tu es une brave fille ; j’aime les gens de volonté, de courage, de décision, qui ne s’abandonnent pas ; et si j’ai plaisir à rencontrer ces qualités chez des hommes, j’en ai un plus grand encore à les trouver chez une enfant de ton âge. Te voilà donc partie avec cent sept sous dans ta poche…
— Un couteau, un morceau de savon, un dé, deux aiguilles, du fil, une carte routière ; c’est tout.
— Tu sais te servir d’une carte ?
— Il faut bien quand on roule par les grands chemins ; c’était tout ce que j’avais sauvé du mobilier de notre voiture. »
Il l’interrompit :
« Nous avons un grand arbre sur notre gauche, n’est-ce pas ?
— Avec un banc autour, oui, monsieur.
— Allons-y ; nous serons mieux sur ce banc. »
Quand ils furent assis, elle continua son récit, qu’elle n’eut plus souci d’abréger, car elle voyait qu’il intéressait M. Vulfran.
« Tu n’as pas eu l’idée de tendre la main ? demanda-t-il, quand elle en fut à sa sortie de la forêt où l’orage avait fondu sur elle.
— Non, monsieur, jamais.
— Mais sur quoi as-tu compté quand tu as vu que tu ne trouvais pas d’ouvrage ?
— Sur rien ; j’ai espéré qu’en allant tant que j’aurais des forces, je pouvais me sauver ; c’est quand j’ai été à bout, que je me suis abandonnée, parce que je ne pouvais plus ; si j’avais faibli une heure plus tôt j’étais perdue. »
Elle raconta alors comment elle était sortie de son évanouissement sous les léchades de son âne, et comment elle avait été secourue par la marchande de chiffons ; puis passant vite sur le temps pendant lequel elle était restée avec La Rouquerie, elle en vint à la rencontre qu’elle avait faite de Rosalie.
« En causant, dit-elle, j’appris que dans vos usines on donne du travail à tous ceux qui en demandent, et je me décidai à me présenter ; on voulut bien m’envoyer aux cannetières.
— Quand vas-tu te remettre en route ? »
Elle ne s’attendait pas à cette question qui l’interloqua :
« Mais je ne pense pas à me remettre en route, répondit-elle après un moment de réflexion.
— Et tes parents ?
— Je ne les connais pas ; je ne sais pas s’ils sont disposés à me faire bon accueil, car ils étaient fâchés avec mon père. J’allais près d’eux, parce que je n’ai personne à qui demander protection, mais sans savoir s’ils voudraient m’accueillir. Puisque je trouve à travailler ici, il me semble que le mieux pour moi est de rester ici. Que deviendrais-je si on me repoussait ? Assurée de ne pas mourir de faim, j’ai très peur de courir de nouvelles aventures. Je ne m’y exposerais que si j’avais des chances de mon côté.
— Ces parents se sont-ils jamais occupés de toi ?
— Jamais.
— Alors ta prudence peut être avisée ; cependant si tu ne veux pas courir l’aventure d’aller frapper à une porte qui reste fermée et te laisse dehors, pourquoi n’écrirais-tu pas, soit à tes parents, soit au maire ou au curé de ton village ? Ils peuvent n’être pas en état de te recevoir ; et alors tu restes ici où ta vie est assurée. Mais ils peuvent aussi être heureux de te recevoir à bras ouverts ; alors tu trouves près d’eux une affection, des soins, un soutien qui te manqueront si tu restes ici ; et il faut que tu saches que la vie est difficile pour une fille de ton âge qui est seule au monde,… triste aussi.
— Oui, monsieur, bien triste, je le sais, je le sens tous les jours, et je vous assure que si je trouvais des bras ouverts, je m’y jetterais avec bonheur ; mais s’ils restent aussi fermés pour moi qu’ils l’ont été pour mon père…
— Tes parents avaient-ils des griefs sérieux contre ton père, je veux dire légitimes par suite de fautes graves ?
— Je ne peux pas penser que mon père que j’ai connu si bon pour tous, si brave, si généreux, si tendre, si affectueux pour ma mère et pour moi, ait jamais rien fait de mal ; mais enfin ses parents ne se sont pas fâchés contre lui et avec lui sans raisons sérieuses, il me semble.
— Évidemment ; mais les griefs qu’ils pouvaient avoir contre lui, ils ne les ont pas contre toi ; les fautes des pères ne retombent pas sur les enfants.
— Si cela pouvait être vrai ! »
Elle jeta ces quelques mots avec un accent si ému, que M. Vulfran en fut frappé.
« Tu vois comme au fond du cœur, tu souhaites d’être accueillie par eux.
— Mais il n’est rien que je redoute tant que d’être repoussée.
— Et pourquoi le serais-tu ? Tes grands parents avaient-ils d’autres enfants que ton père ?
— Non.
— Pourquoi ne seraient-ils pas heureux que tu leur tiennes lieu du fils perdu ? Tu ne sais pas ce que c’est que d’être seul au monde.
— Mais justement je ne le sais que trop.
— La jeunesse isolée qui a l’avenir devant elle, n’est pas du tout dans la même situation que la vieillesse, qui n’a que la mort. »
S’il ne pouvait pas la voir, elle de son côté ne le quittait pas des yeux, tâchant de lire en lui les sentiments que ses paroles trahissaient : après cette allusion à la vieillesse, elle s’oublia à chercher sur sa physionomie la pensée du fond de son cœur.
« Eh bien, dit-il après un moment d’attente, que décides-tu ?
— N’allez pas imaginer, monsieur, que je balance ; c’est l’émotion qui m’empêche de répondre ; ah ! si je pouvais croire que ce serait une fille qu’on recevrait, non une étrangère qu’on repousserait !
— Tu ne connais rien de la vie, pauvre petite ; mais sache bien que la vieillesse ne peut pas plus être seule que l’enfance.
— Est-ce que tous les vieillards pensent ainsi, monsieur ?
— S’ils ne le pensent pas, ils le sentent.
— Vous croyez ? », dit-elle les yeux attachés sur lui, frémissante.
Il ne lui répondit pas directement, mais parlant à mi-voix comme s’il s’entretenait avec lui-même :
« Oui, dit-il, oui, ils le sentent. »
Puis se levant brusquement comme pour échapper à des idées qui lui seraient douloureuses, il dit d’un ton de commandement :
« Au bureau. »


XXVI
Quand l’ingénieur Fabry reviendrait-il ?
C’était la question que Perrine se posait avec inquiétude, puisque ce jour-là son rôle d’interprète auprès des monteurs anglais serait fini.
Celui de traductrice des journaux de Dundee pour M. Vulfran continuerait-il jusqu’à la guérison de Bendit ? en était une autre plus anxieuse encore.
Ce fut le jeudi, en arrivant le matin avec les monteurs, qu’elle trouva Fabry dans l’atelier, occupé à inspecter les travaux qui avaient été faits ; discrètement elle se tint à une distance respectueuse et se garda bien de se mêler aux explications qui s’échangèrent, mais le chef monteur la fit quand même intervenir :
« Sans cette petite, dit-il, nous n’aurions eu qu’à nous croiser les bras. »
Alors Fabry la regarda, mais sans lui rien dire, tandis que de son côté elle n’osait lui demander ce qu’elle devait faire, c’est-à-dire si elle devait rester à Saint-Pipoy ou retourner à Maraucourt.
Dans le doute elle resta, pensant que puisque c’était M. Vulfran qui l’avait fait venir, c’était lui qui devait la garder ou la renvoyer.
Il n’arriva qu’à son heure ordinaire amené par le directeur qui lui rendit compte des instructions que l’ingénieur avait données et des observations qu’il avait faites ; mais il se trouva qu’elles ne lui donnèrent pas entière satisfaction :
« Il est fâcheux que cette petite ne soit pas là, dit-il, mécontent.
— Mais elle est là, répondit le directeur, qui fit signe à Perrine d’approcher.
— Pourquoi n’es-tu pas retournée à Maraucourt ? demanda M. Vulfran.
— J’ai cru que je ne devais partir d’ici que quand vous me le commanderiez, répondit-elle.
— Tu as eu raison, dit-il, tu dois être ici à ma disposition quand je viens… »
Il s’arrêta, pour reprendre presque aussitôt :
« Et même j’aurai besoin de toi aussi à Maraucourt ; tu vas donc rentrer ce soir, et demain matin tu te présenteras au bureau ; je te dirai ce que tu as à faire. »
Quand elle eut traduit les ordres qu’il voulait donner aux monteurs, il partit, et ce jour-là il ne fut pas question de lire des journaux.
Mais qu’importait ; ce n’était pas quand le lendemain semblait assuré, qu’elle allait prendre souci d’une déception pour le jour présent.
« J’aurai besoin de toi aussi à Maraucourt. »
Ce fut la parole qu’elle se répéta dans le chemin qu’en venant à Saint-Pipoy, elle avait fait à côté de Guillaume. À quoi allait-elle être employée ? Son esprit s’envola, mais sans pouvoir s’accrocher à rien de solide. Une seule chose était certaine : elle ne retournait point aux cannetières. Pour le reste il fallait attendre ; mais non plus dans la fièvre de l’angoisse, car ce qu’elle avait obtenu lui permettait de tout espérer, si elle avait la sagesse de suivre la ligne que sa mère lui avait tracée avant de mourir, lentement, prudemment, sans rien brusquer, sans rien compromettre : maintenant elle tenait entre ses mains sa vie qui serait ce qu’elle la ferait ; voilà ce qu’elle devait se dire chaque fois qu’elle aurait une parole à prononcer, chaque fois qu’elle aurait une résolution à prendre, chaque fois qu’elle risquerait un pas en avant ; et cela sans pouvoir demander conseil à personne.
Elle s’en revint à Maraucourt en réfléchissant ainsi, marchant lentement, s’arrêtant lorsqu’elle voulait cueillir une fleur dans le pied d’une haie, ou bien lorsque par-dessus une barrière une jolie échappée de vue s’offrait à elle sur les prairies et les entailles : un bouillonnement intérieur, une sorte de fièvre la poussaient à hâter le pas, mais volontairement elle le ralentissait ; à quoi bon se presser ? C’était une habitude qu’elle devait prendre, une règle qu’elle devait s’imposer de ne jamais céder à des impulsions instinctives.
Elle retrouva son île dans l’état où elle l’avait laissée, avec chaque chose à sa place ; les oiseaux avaient même respecté les groseilles du saule qui ayant mûri pendant son absence, composèrent pour son souper un plat, sur lequel elle ne comptait pas du tout.
Comme elle était rentrée de meilleure heure que lorsqu’elle sortait de l’atelier, elle ne voulut pas se coucher aussitôt son souper fini, et en attendant la tombée de la nuit, elle passa la soirée en dehors de l’aumuche, assise dans les roseaux à l’endroit où la vue courait librement sur l’entaille et ses rives. Alors elle eut conscience que si courte qu’eût été son absence, le temps avait marché et amené des changements pour elle menaçants. Dans les prairies ne régnait plus le silence solennel des soirs, qui l’avait si fortement frappée aux premiers jours de son installation dans l’île, quand dans toute la vallée on n’entendait sur les eaux, au milieu des hautes herbes, comme sous le feuillage des arbres que les frôlements mystérieux des oiseaux qui rentraient pour la nuit. Maintenant la vallée était troublée au loin par toutes sortes de bruits : des battements de faux, des grincements d’essieu, des claquements de fouet, des murmures de voix. C’est qu’en effet, comme elle l’avait remarqué en revenant de Saint-Pipoy, la fenaison était commencée dans les prairies les mieux exposées, où l’herbe avait mûri plus vite ; et bientôt les faucheurs arriveraient à celles de son entaille qu’un ombrage plus épais avait retardées.
Alors sans aucun doute elle devrait quitter son nid, qui pour elle ne serait plus habitable ; mais que ce fût par la fenaison ou par la chasse, le résultat ne devait-il pas être le même, à quelques jours près ?
Bien qu’elle fût déjà habituée aux bons draps, ainsi qu’aux

fenêtres et aux portes closes, elle dormit sur son lit de fougères comme si elle le retrouvait sans l’avoir jamais quitté, et ce fut seulement le soleil levant qui l’éveilla.
À l’ouverture des grilles, elle était devant l’entrée des Shèdes, mais au lieu de suivre ses camarades pour aller aux cannetières, elle se dirigea vers les bureaux, se demandant ce qu’elle devait faire : entrer, attendre ?
Ce fut à ce dernier parti qu’elle s’arrêta : puisqu’elle se tenait devant la porte, on la trouverait, si on la faisait appeler.
Cette attente dura près d’une heure ; à la fin elle vit venir Talouel qui durement lui demanda ce qu’elle faisait là.
« M. Vulfran m’a dit de me présenter ce matin au bureau.
— La cour n’est pas le bureau.
— J’attends qu’on m’appelle.
— Monte. »
Elle le suivit ; arrivé sous la véranda, il alla s’asseoir à califourchon sur une chaise, et d’un signe de main appela Perrine devant lui.
« Qu’est-ce que tu as fait à Saint-Pipoy ? »
Elle dit à quoi M. Vulfran l’avait employée.
« M. Fabry avait donc ordonné des bêtises ?
— Je ne sais pas.
— Comment tu ne sais pas ; tu n’es donc pas intelligente ?
— Sans doute je ne le suis pas.
— Tu l’es parfaitement, et si tu ne réponds pas c’est parce que tu ne veux pas répondre ; n’oublie pas à qui tu parles. Qu’est-ce que je suis ici ?
— Le directeur.
— C’est-à-dire le maître, et puisque comme maître, tout me passe par les mains, je dois tout savoir ; celles qui ne m’obéissent pas, je les mets dehors, ne l’oublie pas. »
C’était bien l’homme dont les ouvrières avaient parlé dans la chambrée, le maître dur, le tyran qui voulait être tout dans les usines, non seulement à Maraucourt, mais encore à Saint-Pipoy, à Bacourt, à Flexelles, partout, et à qui tous les moyens étaient bons pour étendre et maintenir son autorité, à côté, au-dessus même de celle de M. Vulfran.
« Je te demande quelle bêtise a faite M. Fabry, reprit-il, en baissant la voix.
— Je ne peux pas vous le dire puisque je ne le sais pas ; mais je peux vous répéter les observations que M. Vulfran m’a fait traduire pour les monteurs. »
Elle répéta ces observations sans en omettre un seul mot.
« C’est bien tout ?
— C’est tout.
— M. Vulfran t’a-t-il fait traduire des lettres ?
— Non, monsieur ; j’ai seulement traduit des passages du Dundee News, et en entier la Dundee trades report association.
— Tu sais que si tu ne me dis pas la vérité, toute la vérité, je l’apprendrai bien vite, et alors, ouste ! »
Un geste souligna ce dernier mot, déjà si précis, dans sa brutalité.
« Pourquoi ne dirais-je pas la vérité ?
— C’est un avertissement que je te donne.
— Je m’en souviendrai, monsieur, je vous le promets.
— Bon. Maintenant va t’asseoir sur le banc là-bas ; si M. Vulfran a besoin de toi, il se rappellera qu’il t’a dit de venir. »
Elle resta près de deux heures sur son banc, n’osant pas bouger tant que Talouel était là, n’osant même pas réfléchir, ne se reprenant que lorsqu’il sortait, mais s’inquiétant, au lieu de se rassurer, car il eût fallu, pour croire qu’elle n’avait rien à craindre de ce terrible homme, une confiance audacieuse qui n’était pas dans son caractère. Ce qu’il exigeait d’elle ne se devinait que trop : qu’elle fût son espion auprès de M. Vulfran, tout simplement, de façon à lui rapporter ce qui se trouverait dans les lettres qu’elle aurait à traduire.
Si c’était là une perspective bien faite pour l’épouvanter, cependant elle avait cela de bon de donner à croire que Talouel savait ou tout au moins supposait qu’elle aurait des lettres à traduire, c’est-à-dire que M. Vulfran la prendrait près de lui tant que Bendit serait malade.
Cinq ou six fois en voyant paraître Guillaume, qui, lorsqu’il ne remplissait pas les fonctions de cocher, était attaché au service personnel de M. Vulfran, elle avait cru qu’il venait la chercher, mais toujours il avait passé sans lui adresser la parole, pressé, affairé, sortant dans la cour, rentrant. À un certain moment il revint ramenant trois ouvriers qu’il conduisit dans le bureau de M. Vulfran, où Talouel les suivit. Et un temps assez long s’écoula, coupé quelquefois par des éclats de voix qui lui arrivaient quand la porte du vestibule s’ouvrait. Évidemment M. Vulfran avait autre chose à faire que de s’occuper d’elle et même de se souvenir qu’elle était là.
À la fin les ouvriers reparurent accompagnés de Talouel : quand ils étaient passés la première fois ils avaient la démarche résolue de gens qui vont de l’avant et sont décidés ; maintenant ils avaient des attitudes mécontentes, embarrassées, hésitantes. Au moment où ils allaient sortir, Talouel les retint d’un geste de main :
« Le patron vous a-t-il dit autre chose que ce que je vous avais déjà dit moi-même ? Non, n’est-ce pas. Seulement il vous l’a dit moins doucement que moi, et il a eu raison.
— Raison ! Ah ! malheur.
— Vo n’direz point ça.
— Si, je le dirai parce que c’est la vérité. Moi, je suis toujours pour la vérité et la justice. Placé entre le patron et vous, je ne suis pas plus de son côté que du vôtre, je suis du mien qui est le milieu. Quand vous avez raison, je le reconnais ; quand vous avez tort, je vous le dis. Et aujourd’hui vous avez tort. Ça ne tient pas debout vos réclamations. On vous pousse, et vous ne voyez pas où l’on vous mène. Vous dites que le patron vous exploite, mais ceux qui se servent de vous, vous exploitent encore bien mieux ; au moins le patron vous fait vivre, eux vous feront crever de faim, vous, vos femmes, vos enfants. Maintenant il en sera ce que vous voudrez, c’est votre affaire bien plus que la mienne. Moi je m’en tirerai avec de nouvelles machines qui marcheront avant huit jours et feront votre ouvrage mieux que vous, plus vite, plus économiquement, et sans qu’on ait à perdre son temps à discuter avec elles — ce qui est quelque chose, n’est-ce pas ? Quand vous aurez bien tiré la langue, et que vous reviendrez en couchant les pouces, votre place sera prise, on n’aura plus besoin de vous. L’argent que j’aurai dépensé pour mes nouvelles machines, je le rattraperai bien vite. Voilà. Assez causé.
— Mais…
— Si vous n’avez pas compris, c’est bête, je ne vais pas perdre mon temps à vous écouter. »
Ainsi congédiés, les trois ouvriers s’en allèrent la tête basse, et Perrine reprit son attente jusqu’à ce que Guillaume vint la chercher pour l’introduire dans un vaste bureau où elle trouva M. Vulfran assis devant une grande table couverte de dossiers qu’appuyaient des presse-papiers marqués d’une lettre en relief, pour que la main les reconnût à défaut des yeux, et dont l’un des bouts était occupé par des appareils électriques et téléphoniques.
Sans l’annoncer, Guillaume avait refermé la porte derrière elle. Après un moment d’attente, elle crut qu’elle devait avertir M. Vulfran de sa présence :
« C’est moi Aurélie, dit-elle.
— J’ai reconnu ton pas ; approche et écoute-moi. Ce que tu m’as raconté de tes malheurs, et aussi l’énergie que tu as montrée m’ont intéressé à ton sort. D’autre part, dans ton rôle d’interprète avec les monteurs, dans les traductions que je t’ai fait faire, enfin dans nos entretiens j’ai rencontré en toi une intelligence qui m’a plu. Depuis que la maladie m’a rendu aveugle, j’ai besoin de quelqu’un qui voie pour moi, et qui sache regarder ce que je lui indique aussi bien que m’expliquer ce qui le frappe. J’avais espéré trouver cela dans Guillaume qui lui aussi est intelligent, mais par malheur la boisson l’a si bien abêti qu’il n’est plus bon qu’à faire un cocher, et encore à condition d’être indulgent. Veux-tu remplir auprès de moi la place que Guillaume n’a pas su prendre ? Pour commencer tu auras quatre-vingt-dix francs par mois, et des gratifications si, comme je l’espère, je suis content de toi. »
Suffoquée par la joie, Perrine resta sans répondre.
« Tu ne dis rien ?
— Je cherche des mots pour vous remercier, mais je suis si émue, si troublée que je n’en trouve pas ; ne croyez pas… »
Il l’interrompit :
« Je crois que tu es émue en effet, ta voix me le dit, et j’en suis bien aise, c’est une promesse que tu feras ce que tu pourras pour me satisfaire. Maintenant autre chose : as-tu écrit à tes parents ?
— Non, monsieur ; je n’ai pas pu, je n’ai pas de papier…
— Bon, bon ; tu vas pouvoir le faire, et tu trouveras dans le bureau de M. Bendit, que tu occuperas en attendant sa guérison, tout ce qui te sera nécessaire. En écrivant, tu devras dire à tes parents la position que tu occupes dans ma maison ; s’ils ont mieux à t’offrir, ils te feront venir ; sinon, ils te laisseront ici.
— Certainement, je resterai ici.
— Je le pense, et je crois que c’est le meilleur pour toi maintenant. Comme tu vas vivre dans les bureaux où tu seras en relation avec les employés, à qui tu porteras mes ordres, comme d’autre part tu sortiras avec moi, tu ne peux pas garder tes vêtements d’ouvrière, qui, m’a dit Benoist, sont fatigués…
— Des guenilles ; mais je vous assure, monsieur, que ce n’est ni par paresse, ni par incurie, hélas !
— Ne te défends pas. Mais enfin comme cela doit changer, tu vas aller à la caisse où l’on te remettra une fiche pour que tu prennes, chez Mme Lachaise, ce qu’il te faut en vêtements, linge de corps, chapeau, chaussures. »
Perrine écoutait comme si au lieu d’un vieillard aveugle à la figure grave, c’était une belle fée qui parlait, la baguette au-dessus d’elle.
M. Vulfran la rappela à la réalité :
« Tu es libre de choisir ce que tu voudras, mais n’oublie pas que ce choix me fixera sur ton caractère. Occupe-toi de cela. Pour aujourd’hui je n’aurai pas besoin de toi. À demain. »


XXVII
Quand à la caisse on lui remit, après l’avoir examinée des pieds à la tête, la fiche annoncée par M. Vulfran, elle sortit de l’usine en se demandant où demeurait cette Mme Lachaise.
Elle eût voulu que ce fût la propriétaire du magasin où elle avait acheté son calicot, parce que la connaissant déjà, elle eût été moins gênée pour la consulter sur ce qu’elle devait prendre.
Question terrible qu’aggravait encore le dernier mot de M. Vulfran : « ton choix me fixera sur ton caractère ». Sans doute elle n’avait pas besoin de cet avertissement pour ne pas se jeter sur une toilette extravagante ; mais encore ce qui serait raisonnable pour elle, le serait-il pour M. Vulfran ? Dans son enfance elle avait connu les belles robes, et elle en avait porté, dans lesquelles elle était fière de se pavaner ; évidemment ce n’étaient point des robes de ce genre qui convenaient présentement ; mais les plus simples qu’elle pourrait trouver conviendraient-elles mieux ?
On lui eût dit la veille, alors qu’elle souffrait tant de sa misère, qu’on allait lui donner des vêtements et du linge, qu’elle n’eût certes pas imaginé que ce cadeau inespéré ne la remplirait pas de joie, et cependant l’embarras et la crainte l’emportaient de beaucoup en elle sur tout autre sentiment.
C’était place de l’Église que Mme Lachaise avait son magasin, incontestablement le plus beau, le plus coquet de Maraucourt, avec une montre d’étoffes, de rubans, de lingerie, de chapeaux, de bijoux, de parfumerie qui éveillait les désirs, allumait les convoitises des coquettes du pays, et leur faisait dépenser là leurs gains, comme les pères et les maris dépensaient les leurs au cabaret.
Cette montre augmenta encore la timidité de Perrine, et comme l’entrée d’une déguenillée ne provoquait les prévenances ni de la maîtresse de maison, ni des ouvrières qui travaillaient derrière un comptoir, elle resta un moment indécise au milieu du magasin, ne sachant à qui s’adresser. À la fin elle se décida à élever l’enveloppe qu’elle tenait dans sa main.
« Qu’est-ce que c’est, petite ? » demanda Mme Lachaise.
Elle tendit l’enveloppe qui à l’un de ses coins portait imprimée la rubrique : « Usines de Maraucourt, Vulfran Paindavoine ».
La marchande n’avait pas lu la fiche entière que sa physionomie s’éclaira du sourire le plus engageant :
« Et que désirez-vous, mademoiselle ? » demanda-t-elle en quittant son comptoir pour avancer une chaise.
Perrine répondit qu’elle avait besoin de vêtements, de linge, de chaussures, d’un chapeau.
« Nous avons tout cela et de premier choix ; voulez-vous que nous commencions par la robe ? Oui, n’est-ce pas. Je vais vous montrer des étoffes ; vous allez voir. »
Mais ce n’était point des étoffes qu’elle voulait voir, c’était une robe toute faite qu’elle pût revêtir immédiatement ou tout au moins le soir même, afin de pouvoir sortir le lendemain avec M. Vulfran.
« Ah ! vous devez sortir avec M. Vulfran », dit vivement la marchande dont la curiosité se trouvait surexcitée par cet étrange propos qui la faisait se demander ce que le tout-puissant maître de Maraucourt pouvait bien avoir à faire avec cette bohémienne.
Mais au lieu de répondre à cette interrogation, Perrine continua ses explications pour dire que la robe dont elle avait besoin devait être noire, parce qu’elle était en deuil.
« C’est pour aller à l’enterrement, cette robe ?
— Non.
— Vous comprenez, mademoiselle, que l’usage auquel vous devez employer votre robe, dit ce qu’elle doit être, sa forme, son étoffe, son prix.
— La forme, la plus simple ; l’étoffe, solide et légère ; le prix, le plus bas.
— C’est bien, c’est bien, répondit la marchande, on va vous montrer. Virginie, occupez-vous de mademoiselle. »
Comme le ton avait changé, les manières changèrent aussi ; dignement Mme Lachaise reprit sa place à la caisse, dédaignant de s’occuper elle-même d’une acheteuse qui montrait de pareilles dispositions : quelque fille de domestique sans doute, à qui M. Vulfran faisait l’aumône d’un deuil, et encore quel domestique.
Cependant comme Virginie apportait sur le comptoir une robe en cachemire, garnie de passementerie et de jais, elle intervint :
« Cela n’est pas dans les prix, dit-elle, montrez la jupe avec blouse en indienne noire à pois ; la jupe sera un peu longue, la blouse un peu large, mais avec un rempli et des pinces, le tout ira à merveille ; au reste nous n’avons pas autre chose. »
C’était là une raison qui dispensait des autres ; d’ailleurs malgré leur taille, Perrine trouva cette jupe et cette blouse très jolies, et puisqu’on lui assurait qu’avec quelques retouches, elles iraient à merveille, elle devait le croire.
Pour les bas et les chemises, le choix était plus facile puisqu’elle voulait ce qu’il y avait de moins cher ; mais quand elle déclara qu’elle ne prenait que deux paires de bas et deux chemises, Mlle Virginie se montra aussi méprisante que sa patronne, et ce fut par grâce qu’elle daigna montrer les chaussures et le chapeau de paille noire qui complétaient l’habillement de cette petite niaise : avait-on idée d’une sottise pareille, deux paires de bas ! deux chemises ! Et quand Perrine demanda des mouchoirs de poche, qui depuis longtemps étaient l’objet de ses désirs, ce nouvel achat limité d’ailleurs à trois mouchoirs, ne changea ni le sentiment de la patronne, ni celui de la demoiselle de magasin :
« Moins que rien cette petite.
— Et maintenant, est-ce qu’il faudra vous envoyer ça ? demanda Mme Lachaise.
— Je vous remercie, madame, je viendrai le chercher ce soir.
— Pas avant huit heures, pas après neuf. »
Perrine avait cette bonne raison pour ne pas vouloir qu’on lui envoyât ses vêtements, qu’elle ne savait pas où elle coucherait le soir. Dans son île, il n’y fallait pas songer. Qui n’a rien se passe de portes et de serrures, mais la richesse, — car malgré le dédain de cette marchande, ce qu’elle venait d’acheter constituait pour elle de la richesse, — a besoin d’être gardée ; il fallait donc que la nuit suivante, elle eût un logement, et tout naturellement elle pensa à le prendre chez la grand’mère de Rosalie, et en sortant de chez Mme Lachaise elle se dirigea vers la maison de mère Françoise, pour voir si elle trouverait là ce qu’elle désirait, c’est-à-dire un cabinet ou une toute petite chambre, qui ne coûtât pas cher.
Comme elle allait arriver à la barrière, elle vit Rosalie sortir d’une allure légère.
« Vous partez !
— Et vous, vous êtes donc libre ! »
En quelques mots précipités elles s’expliquèrent :
Rosalie qui allait à Picquigny pour une commission pressée ne pouvait pas rentrer chez sa grand’mère immédiatement comme elle l’aurait voulu, de façon à arranger pour le mieux la location du cabinet ; mais puisque Perrine n’avait rien à faire de la journée, pourquoi ne l’accompagnerait-elle pas à Picquigny, elles reviendraient ensemble ; ce serait une partie de plaisir.
Rapide à l’aller, cette partie de plaisir, une fois la commission faite, s’agrémenta si bien au retour de bavardages, de flâneries, de courses dans les prairies, de repos à l’ombre qu’elles ne rentrèrent que le soir à Maraucourt ; mais ce fut seulement en passant la barrière de sa grand’mère que Rosalie eut conscience de l’heure.
« Qu’est-ce que va dire tante Zénobie ?
— Dame !
— Ma foi tant pis ; je me suis bien amusée. Et vous ?
— Si vous vous êtes amusée, vous qui avez avec qui vous entretenir toute la journée, pensez ce qu’a été notre promenade pour moi qui n’ai personne.
— C’est vrai tout de même. »
Heureusement la tante Zénobie était occupée à servir les pensionnaires, de sorte que l’arrangement se fit avec mère Françoise, ce qui permit qu’il se conclut assez promptement sans être trop dur : cinquante francs par mois pour deux repas par jour, douze francs pour un cabinet orné d’une petite glace avec une fenêtre et une table de toilette.
À huit heures Perrine dînait seule à sa table dans la salle commune une serviette sur ses genoux ; à huit heures et demie elle allait chercher ses vêtements qui se trouvaient prêts ; et à neuf heures, dans son cabinet dont elle fermait la porte à clef, elle se couchait, un peu troublée, un peu grisée, la tête vacillante, mais au fond pleine d’espoir.
Maintenant on allait voir.
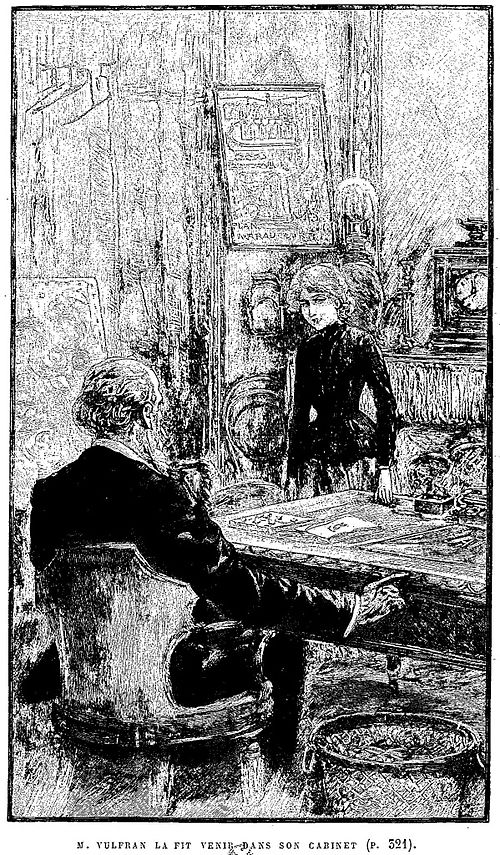
Ce qu’elle vit le lendemain matin, lorsqu’après avoir donné ses ordres à ses chefs de service qu’il appelait par une sonnerie aux coups numérotés dans le tableau électrique du vestibule, M. Vulfran la fit venir dans son cabinet, ce fut un visage sévère qui la déconcerta, car bien que les yeux qui se tournèrent vers elle à son entrée, fussent sans regards, elle ne put pas se méprendre sur l’expression de cette physionomie qu’elle connaissait pour l’avoir longuement observée.
Assurément ce n’était pas la bienveillance qu’exprimait cette physionomie, mais plutôt le mécontentement et la colère.
Qu’avait-elle donc fait de mal qu’on pût lui reprocher ?
À cette question qu’elle se posa, elle ne trouva qu’une réponse : ses achats, chez Mme Lachaise, étaient exagérés. D’après eux M. Vulfran jugeait son caractère. Et elle qui s’était si bien appliquée à la modération et à la discrétion. Que fallait-il donc qu’elle achetât, ou plutôt n’achetât point ?
Mais elle n’eut pas le temps de chercher, M. Vulfran lui adressait la parole d’un ton dur :
« Pourquoi ne m’as-tu pas dit la vérité ?
— À propos de quoi, ne vous aurais-je pas dit la vérité ? demanda-t-elle effrayée.
— À propos de ta conduite depuis ton arrivée ici ?
— Mais je vous affirme, monsieur, je vous jure que je vous ai dit la vérité.
— Tu m’as dit que tu avais logé chez Françoise. Et en partant de chez elle où as-tu été ? Je te préviens que Zénobie la fille de Françoise, interrogée hier par quelqu’un qui voulait avoir des renseignements sur toi, a dit que tu n’as passé qu’une nuit chez sa mère, et que tu as disparu sans que personne sache ce que tu as fait depuis ce temps-là. »
Perrine avait écouté le commencement de cet interrogatoire avec émoi, mais à mesure qu’il avançait elle s’était affermie.
« Il y a quelqu’un qui sait ce que j’ai fait depuis que j’ai quitté la chambrée de mère Françoise.
— Qui ?
— Rosalie, sa petite fille qui peut vous confirmer ce que je vais vous dire, si vous trouvez que ce que j’ai pu faire depuis ce jour mérite d’être connu de vous.
— La place que je te destine auprès de moi, exige que je sache ce que tu es.
— Eh bien, monsieur, je vais vous le dire. Quand vous le saurez, vous ferez venir Rosalie, vous l’interrogerez sans que je l’aie vue, et vous aurez la preuve que je ne vous ai pas trompé.
— Cela peut en effet se faire ainsi, dit-il d’une voix adoucie, raconte donc. »
Elle fit ce récit en insistant sur l’horreur de sa nuit, dans la chambrée, son dégoût, ses malaises, ses nausées, ses suffocations.
« Ne pouvais-tu supporter ce que les autres acceptent ?
— Les autres n’ont sans doute pas vécu comme moi en plein air, car je vous assure que je ne suis difficile en rien, ni sur rien et que la misère m’a appris à tout endurer ; je serais morte ; et je ne pense pas que ce soit une lâcheté d’essayer d’échapper à la mort.
— La chambrée de Françoise est-elle donc si malsaine ?
— Ah ! Monsieur, si vous pouviez la voir, vous ne permettriez pas que vos ouvrières vivent là.
— Continue. »
Elle passa à sa découverte de l’île, et à son idée de s’installer dans l’aumuche.
« Tu n’as pas eu peur ?
— Je suis habituée à n’avoir pas peur.
— Tu parles de l’entaille qui se trouve la dernière sur la route de Saint-Pipoy, à gauche ?
— Oui, monsieur.
— Cette aumuche m’appartient et elle sert à mes neveux. C’est donc là que tu as dormi ?
— Non seulement dormi, mais travaillé, mangé, même donné à dîner à Rosalie, qui pourra vous le raconter ; je ne l’ai quittée que pour Saint-Pipoy quand vous m’avez dit de rester à la disposition des monteurs, et cette nuit pour loger chez mère Françoise, où je peux maintenant me payer un cabinet pour moi seule.
— Tu es donc riche que tu peux donner à dîner à ta camarade ?
— Si j’osais vous dire.
— Tu dois tout me dire.
— Est-il permis de prendre votre temps pour des histoires de petites filles.
— Ce n’est pas trop court qu’est le temps pour moi, depuis que je ne peux plus l’employer comme je voudrais, c’est long, bien long… et vide. »
Elle vit passer sur le visage de M. Vulfran un nuage sombre qui accusait les tristesses d’une existence que l’on croyait si heureuse et que tant de gens enviaient, et à la façon dont il prononça le mot « vide » elle eut le cœur attendri. Elle aussi depuis qu’elle avait perdu et son père et sa mère, pour rester seule, savait ce que sont les journées longues et vides, que rien ne remplit si ce n’est les soucis, les fatigues, les misères de l’heure présente, sans personne avec qui les partager, qui vous soutienne ou vous égaie. Lui ne connaissait ni fatigues, ni privations, ni misères. Mais sont-elles tout au monde, et n’est-il pas d’autres souffrances, d’autres douleurs ! C’étaient celles-là que traduisaient ces quelques mots, leur accent, et aussi cette tête penchée, ces lèvres, ces joues affaissées, cette physionomie allongée par l’évocation sans doute de souvenirs pénibles.
Si elle essayait de le distraire ? sans doute cela était bien hardi à elle qui le connaissait si peu. Mais pourquoi ne risquerait-elle point puisque lui-même demandait qu’elle parlât, d’égayer ce sombre visage et de le faire sourire ? Elle pouvait l’examiner, elle verrait bien si elle l’amusait ou l’ennuyait.
Et tout de suite d’une voix enjouée, qui avait l’entrain d’une chanson, elle commença :
« Ce qui est plus drôle que notre dîner, c’est la façon dont je me suis procuré les ustensiles de cuisine pour le faire cuire, et aussi comment, sans rien dépenser, ce qui m’eût été impossible, j’ai réuni les mets de notre menu. C’est cela que je vais vous dire, en commençant par le commencement qui expliquera comment j’ai vécu dans l’aumuche depuis que je m’y suis installée. »
Pendant son récit elle ne quitta pas M. Vulfran des yeux, prête à couper court, si elle voyait se produire des signes d’ennui, qui certainement ne lui échapperaient pas.
Mais ce ne fut pas de l’ennui qui se manifesta, au contraire ce fut de la curiosité et de l’intérêt.
« Tu as fait cela ! » interrompit-il plusieurs fois.
Alors il l’interrogea pour qu’elle précisât ce que, par crainte de le fatiguer, elle avait abrégé, et lui posa des questions qui montraient qu’il voulait se rendre un compte exact non seulement de son travail, mais surtout des moyens qu’elle avait employés pour remplacer ce qui lui manquait :
« Tu as fait cela ! »
Quand elle fut arrivée au bout de son histoire il lui posa la main sur les cheveux :
« Allons tu es une brave fille, dit-il, et je vois avec plaisir qu’on pourra faire quelque chose de toi. Maintenant va dans ton bureau et occupe ton temps comme tu voudras ; à trois heures nous sortirons. »


XXVIII
Son bureau, ou plutôt celui de Bendit, n’avait rien pour les dimensions ni l’ameublement du cabinet de M. Vulfran, qui avec ses trois fenêtres, ses tables, ses cartonniers, ses grands fauteuils en cuir vert, les plans des différentes usines accrochés aux murs dans des cadres en bois doré, était très imposant et bien fait pour donner une idée de l’importance des affaires qui s’y décidaient.
Tout petit au contraire était le bureau de Bendit, meublé d’une seule table avec deux chaises, des casiers en bois noirci, et une card of the world sur laquelle des pavillons de diverses couleurs désignaient les principales lignes de navigation ; mais cependant avec son parquet de pitchpin bien ciré, sa fenêtre au midi tendue d’un store en jute à dessins rouges, il paraissait gai à Perrine, non seulement en lui-même, mais encore parce qu’en laissant sa porte ouverte, elle pouvait voir et quelquefois entendre ce qui se passait dans les bureaux voisins : à droite et à gauche du cabinet de M. Vulfran, ceux des neveux, M. Edmond et M. Casimir, ensuite ceux de la comptabilité et de la caisse, enfin vis-à-vis celui de Fabry, dans lequel des commis dessinaient debout devant de hautes tables inclinées.
N’ayant rien à faire et n’osant occuper la place de Bendit, Perrine s’assit à côté de cette porte, et, pour passer le temps, elle lut des dictionnaires qui étaient les seuls livres composant la bibliothèque de ce bureau. À vrai dire, elle en eût mieux aimé d’autres, mais il fallut bien qu’elle se contentât de ceux-là qui lui firent paraître les heures longues.
Enfin la cloche sonna le déjeuner, et elle fut une des premières à sortir ; mais en chemin, elle fut rejointe par Fabry et Mombleux, qui, comme elle, se rendaient chez mère Françoise.
« Eh bien, mademoiselle, vous voilà donc notre camarade, » dit Mombleux, qui n’avait pas oublié son humiliation de Saint-Pipoy et voulait la faire payer à celle qui la lui avait infligée.
Elle fut un moment déconcertée par ces paroles dont elle sentit l’ironie, mais elle se remit vite :
« La vôtre non, monsieur, dit-elle doucement, mais celle de Guillaume. »
Le ton de cette réplique plut sans doute à l’ingénieur, car se tournant vers Perrine, il lui adressa un sourire qui était un encouragement en même temps qu’une approbation.
« Puisque vous remplacez Bendit, continua Mombleux, qui pour l’obstination n’était pas à moitié Picard.
— Dites que mademoiselle tient sa place, reprit Fabry.
— C’est la même chose.
— Pas du tout, car dans une dizaine, une quinzaine de jours, quand M. Bendit sera rétabli, il la reprendra cette place, ce qui ne serait pas arrivé, si mademoiselle ne s’était pas trouvée là pour la lui garder.
— Il me semble que vous de votre côté, moi du mien, nous avons contribué à la lui garder.
— Comme mademoiselle du sien ; ce qui fait que M. Bendit nous devra une chandelle à tous les trois, si tant est qu’un Anglais ait jamais employé les chandelles autrement que pour son propre usage. »
Si Perrine avait pu se méprendre sur le sens vrai des paroles de Mombleux, la façon dont on agit avec elle chez mère Françoise, la renseigna, car ce ne fut pas à la table des pensionnaires qu’elle trouva son couvert mis, comme on eût fait pour une camarade, mais sur une petite table à part, qui, pour être dans leur salle, ne s’en trouvait pas moins reléguée dans un coin, et ce fut là qu’on la servit après eux, ne lui passant les plats qu’en dernier.
Mais il n’y avait là rien pour la blesser ; que lui importait d’être servie la première ou la dernière, et que les bons morceaux eussent disparu ? Ce qui l’intéressait, c’était d’être placée assez près d’eux pour entendre leur conversation, et par ce qu’ils diraient de tâcher de se tracer une ligne de conduite au milieu des difficultés qu’elle allait affronter. Ils connaissaient les habitudes de la maison ; ils connaissaient M. Vulfran, les neveux, Talouel de qui elle avait si grande peur ; un mot d’eux pouvait éclairer son ignorance et en lui montrant des dangers qu’elle ne soupçonnait même pas, lui permettre de les éviter. Elle ne les espionnerait pas ; elle n’écouterait pas aux portes ; quand ils parleraient, ils sauraient qu’ils n’étaient pas seuls ; elle pouvait donc sans scrupule profiter de leurs observations.
Malheureusement, ce matin-là, ils ne dirent rien d’intéressant pour elle ; leur conversation roula tout le temps du déjeuner sur des sujets insignifiants : la politique, la chasse, un accident de chemin de fer ; et elle n’eut pas besoin de se donner un air indifférent pour ne pas paraître prêter attention à leur discours.
D’ailleurs, elle était forcée de se hâter ce matin-là, car elle voulait interroger Rosalie pour tâcher de savoir comment M. Vulfran avait appris qu’elle n’avait couché qu’une fois chez mère Françoise.
« C’est le Mince qui est venu pendant que nous étions à Picquigny ; il a fait causer tante Zénobie sur vous et vous savez, ça n’est pas difficile de faire causer tante Zénobie, surtout quand elle suppose que ça ne vaudra pas une gratification à ceux dont elle parle ; c’est donc elle qui a dit que vous n’aviez passé qu’une nuit ici, et toutes sortes d’autres choses avec.
— Quelles autres choses ?
— Je ne sais pas, puisque je n’y étais pas, mais vous pouvez imaginer le pire ; heureusement, ça n’a pas mal tourné pour vous.
— Au contraire ça a bien tourné puisqu’avec mon histoire j’ai amusé M. Vulfran.
— Je vais la raconter à tante Zénobie ; ce que ça la fera rager.
— Ne l’excitez pas contre moi.
— L’exciter contre vous ! maintenant, il n’y a pas de danger ; quand elle saura la place que M. Vulfran vous donne, vous n’aurez pas de meilleure amie… de semblant ; vous verrez demain ; seulement si vous ne voulez pas que le Mince apprenne vos affaires, ne les lui dites pas à elle.
— Soyez tranquille.
— C’est qu’elle est maline.
— Mais me voilà avertie. »
À trois heures, comme il l’en avait prévenue, M. Vulfran sonna Perrine, et ils partirent, en voiture, pour faire la tournée habituelle des usines, car il ne laissait pas passer un seul jour sans visiter les différents établissements, les uns après les autres, sinon pour tout voir, au moins pour se faire voir, en donnant ses ordres à ses directeurs, après avoir entendu leurs observations ; et encore y avait-il bien des choses dont il se rendait compte lui-même, comme s’il n’avait point été aveugle, par toutes sortes de moyens qui suppléaient ses yeux voilés.
Ce jour-là ils commencèrent la visite par Flexelles qui est un gros village, où sont établis les ateliers du peignage du lin et du chanvre ; et en arrivant dans l’usine, M. Vulfran, au lieu de se faire conduire au bureau du directeur, voulut entrer, appuyé sur l’épaule de Perrine, dans un immense hangar où l’on était en train d’emmagasiner des ballots de chanvre qu’on déchargeait des wagons qui les avaient apportés.
C’était la règle que partout où il allait, on ne devait pas se déranger pour le recevoir, ni jamais lui adresser la parole, à moins que ce ne fût pour lui répondre. Le travail continua donc comme s’il n’était pas là, un peu plus hâté seulement dans une régularité générale.
« Écoute bien ce que je vais t’expliquer, dit-il à Perrine car je veux pour la première fois tenter l’expérience de voir par tes yeux en examinant quelques-uns de ces ballots qu’on décharge. Tu sais ce que c’est que la couleur argentine, n’est-ce pas ? »
Elle hésita.
« Ou plutôt la couleur gris-perle ?
— Gris-perle, oui, monsieur.
— Bon. Tu sais aussi distinguer les différentes nuances du vert : le vert foncé, le vert clair, le gris-brunâtre, le rouge ?
— Oui, monsieur, au moins à peu près.
— À peu près suffit ; prends donc une petite poignée de chanvre à la première balle venue et regarde-la bien de manière à me dire quelle est sa nuance. »
Elle fit ce qui lui était commandé, et, après avoir bien examiné le chanvre, elle dit timidement :
« Rouge ; est-ce bien rouge ?
— Donne-moi ta poignée. »
Il la porta à ses narines et la flaira :
« Tu ne t’es pas trompée, dit-il, ce chanvre doit être rouge en effet. »
Elle le regarda surprise ; et, comme s’il devinait son étonnement, il continua :
« Sens ce chanvre ; tu lui trouves, n’est-ce pas, l’odeur de caramel ?
— Précisément, monsieur.
— Eh bien, cette odeur veut dire qu’il a été séché au four où il a été brûlé, ce que traduit aussi sa couleur rouge ; donc odeur et couleur, se contrôlant et se confirmant, me donnent la preuve que tu as bien vu et me font espérer que je peux avoir confiance en toi. Allons à un autre wagon et prends une autre poignée de chanvre. »
Cette fois elle trouva que la couleur était verte.
« Il y a vingt espèces de vert ; à quelle plante rapportes-tu le vert dont tu parles ?
— À un chou, il me semble, et, de plus, il y a par places des taches brunes et noires
— Donne ta poignée. »
Au lieu de la porter à son nez, il l’étira des deux mains et les brins se rompirent.
« Ce chanvre a été cueilli trop vert, dit-il, et de plus il a été mouillé en balle : cette fois encore ton examen est juste. Je suis content de toi ; c’est un bon début. »
Ils continuèrent leur visite par les autres villages, Bacourt, Hercheux, pour la terminer par Saint-Pipoy, et celle-là fut de beaucoup la plus longue à cause de l’inspection du travail des ouvriers anglais.
Comme toujours, la voiture, une fois que M. Vulfran en était descendu, avait été conduite à l’ombre d’un gros tremble ; et au lieu de rester auprès du cheval pour le garder, Guillaume l’avait attaché à un banc pour aller se promener dans le village, comptant bien être de retour avant son maître, qui ne saurait rien de sa fugue. Mais, au lieu d’une rapide promenade, il était entré dans un cabaret avec un camarade qui lui avait fait oublier l’heure, si bien que lorsque M. Vulfran était revenu pour monter en voiture, il n’avait trouvé personne.
« Faites chercher Guillaume », dit-il au directeur qui les accompagnait.
Guillaume avait été long à trouver, à la grande colère de M. Vulfran qui n’admettait pas qu’on lui fit perdre une minute de son temps.
À la fin, Perrine avait vu Guillaume accourir d’une allure tout à fait étrange : la tête haute, le cou et le buste raides, les jambes fléchissantes, et il les levait de telle sorte en les jetant en avant, qu’à chaque pas il semblait vouloir sauter un obstacle.
« Voilà une singulière manière de marcher, dit M. Vulfran, qui avait entendu ces pas inégaux ; l’animal est gris, n’est-ce pas, Benoist ?
— On ne peut rien vous cacher.
— Je ne suis pas sourd, Dieu merci. »
Puis s’adressant à Guillaume, qui s’arrêtait :
« D’où viens-tu ?
— Monsieur… je vais… vous dire…
— Ton haleine parle pour toi, tu viens du cabaret ; et tu es ivre, le bruit de tes pas me le prouve.
— Monsieur… je vais… vous dire… »
Tout en parlant, Guillaume avait détaché le cheval, et en remettant les guides dans la voiture, fait tomber le fouet ; il voulut se baisser pour le ramasser, et trois fois il sauta par-dessus sans pouvoir le saisir.
« Je crois qu’il vaut mieux que je vous reconduise à Maraucourt, dit le directeur.
— Pourquoi ça ? répliqua insolemment Guillaume qui avait entendu.
— Tais-toi, commanda M. Vulfran d’un ton qui n’admettait

pas la réplique ; à partir de l’heure présente tu n’es plus à mon service.
— Monsieur… je vais… vous dire… »
Mais, sans l’écouter, M. Vulfran s’adressa à son directeur :
« Je vous remercie, Benoist, la petite va remplacer cet ivrogne.
— Sait-elle conduire ?
Ses parents étaient des marchands ambulants, elle a conduit leur voiture bien souvent ; n’est-ce pas, petite ?
— Certainement, monsieur.
— D’ailleurs, Coco est un mouton ; si on ne le jette pas dans un fossé, il n’ira pas de lui-même. »
Il monta en voiture, et Perrine prit place près de lui, attentive, sérieuse, avec la conscience bien évidente de la responsabilité dont elle se chargeait.
« Pas trop vite, dit M. Vulfran, quand elle toucha Coco du bout de son fouet légèrement.
— Je ne tiens pas du tout à aller vite, je vous assure, monsieur.
— C’est déjà quelque chose. »
Quelle surprise quand, dans les rues de Maraucourt, on vit le phaéton de M. Vulfran conduit par une petite fille coiffée d’un chapeau de paille noire, vêtue de deuil, qui conduisait sagement le vieux Coco, au lieu de le mener du train désordonné que Guillaume obligeait la vieille bête à prendre bien malgré elle ! Que se passait-il donc ? Quelle était cette petite fille ? Et l’on se mettait sur les portes pour s’adresser ces questions, car les gens étaient rares dans le village qui la connaissaient, et plus rares encore ceux qui savaient quelle place M. Vulfran venait de lui donner auprès de lui. Devant la maison de mère Françoise, la tante Zénobie causait appuyée sur sa barrière avec deux commères ; quand elle aperçut Perrine, elle leva les deux bras au ciel dans un mouvement de stupéfaction, mais aussitôt elle lui adressa son salut le plus avenant accompagné de son meilleur sourire, celui d’une amie véritable.
« Bonjour, monsieur Vulfran ; bonjour, mademoiselle Aurélie. »
Et aussitôt que la voiture eût dépassé la barrière, elle raconta à ses voisines comment elle avait procuré à cette jeune personne, qui était leur pensionnaire, la bonne place qu’elle occupait auprès de M. Vulfran, par les renseignements qu’elle avait donnés au Mince :
« Mais c’est une gentille fille, elle n’oubliera pas ce qu’elle me doit, car elle nous doit tout. »
Quels renseignements avait-elle pu donner ?
Là-dessus elle avait enfilé une histoire, en prenant pour point de départ les récits de Rosalie, qui, colportée dans Maraucourt avec les enjolivements que chacun y mettait selon son caractère, son goût ou le hasard, avait fait à Perrine une légende, ou plus justement cent légendes devenues rapidement le fond de conversations d’autant plus passionnées que personne ne s’expliquait cette fortune subite ; ce qui permettait toutes les suppositions, toutes les explications avec de nouvelles histoires à côté.
Si le village avait été surpris de voir passer M. Vulfran avec Perrine pour conductrice, Talouel en le voyant arriver fut absolument stupéfait.
« Où donc est Guillaume ? s’écria-t-il en se précipitant au bas de l’escalier de sa véranda pour recevoir le patron.
— Débarqué pour cause d’ivrognerie invétérée, répondit M. Vulfran en souriant.
— Je suppose que depuis longtemps vous aviez l’intention de prendre cette résolution, dit Talouel.
— Parfaitement. »
Ce mot « je suppose » était celui qui avait commencé la fortune de Talouel dans la maison et établi son pouvoir. Son habileté en effet avait été de persuader à M. Vulfran qu’il n’était qu’une main, aussi docile que dévouée qui n’exécutait jamais que ce que le patron ordonnait ou pensait.
« Si j’ai une qualité, disait-il, c’est de deviner ce que veut le patron, et en me pénétrant de ses intérêts, de lire en lui. »
Aussi commençait-il presque toutes ses phrases par son mot :
« Je suppose que vous voulez… »
Et comme sa subtilité de paysan toujours aux aguets s’appuyait sur un espionnage qui ne reculait devant aucun moyen pour se renseigner, il était rare que M. Vulfran eût à faire une autre réponse que celle qui se trouvait presque toujours sur ses lèvres :
« Parfaitement. »
« Je suppose, aussi, dit-il en aidant M. Vulfran à descendre, que celle que vous avez prise pour remplacer cet ivrogne, s’est montrée digne de votre confiance ?
— Parfaitement.
— Cela ne m’étonne pas ; du jour où elle est entrée ici amenée par la petite Rosalie, j’ai pensé qu’on en ferait quelque chose et que vous la découvririez. »
En parlant ainsi il regardait Perrine, et d’un coup d’œil qui lui disait en insistant :
« Tu vois ce que je fais pour toi ; ne l’oublie pas et tiens-toi prête à me le rendre. »
Une demande de payement de ce marché ne se fit pas attendre ; un peu avant la sortie il s’arrêta devant le bureau de Perrine et, sans entrer, à mi-voix de façon à n’être entendu que d’elle :
« Que s’est-il donc passé à Saint-Pipoy avec Guillaume ? »
Comme cette question n’entraînait pas la révélation de choses graves, elle crut pouvoir répondre, et faire le récit qu’il demandait.
« Bon, dit-il, tu peux être tranquille, quand Guillaume
viendra demander à rentrer, il aura affaire à moi. »


XXIX
Le soir au souper, cette question : « Que s’est-il passé à Saint-Pipoy avec Guillaume ? » lui fut de nouveau posée par Fabry et par Mombleux, car il n’était personne de la maison qui ne sût qu’elle avait ramené M. Vulfran, et elle recommença le récit qu’elle avait déjà fait à Talouel ; alors ils déclarèrent que l’ivrogne n’avait que ce qu’il méritait.
« C’est miracle qu’il n’ait pas versé dix fois le patron, dit Fabry, car il conduisait comme un fou…
— Prononcez plutôt comme un saoul, répondit Mombleux en riant.
— Il y a longtemps qu’il aurait dû être congédié.
— Et qu’il l’aurait été en effet sans certains appuis… »
Elle devint tout oreilles, mais en s’efforçant de ne pas laisser paraître l’attention qu’elle prêtait à ces paroles.
« Il le payait cet appui.
— Pouvait-il faire autrement ?
— Il l’aurait pu s’il n’avait pas donné barre sur lui : on est fort pour résister à toutes les pressions d’où qu’elles viennent, quand on marche droit.
— C’était là le diable pour lui de marcher droit.
— Êtes-vous sûr qu’on ne l’a pas encouragé dans son vice, au lieu de le prévenir qu’un jour ou l’autre il se ferait renvoyer ?
— Je pense qu’on a dû faire une drôle de mine quand on ne l’a pas vu revenir : j’aurais voulu être là.
— On s’arrangera pour le remplacer par un autre qui espionne et rapporte aussi bien.
— C’est tout de même étonnant que celui qui est victime de cet espionnage ne le devine pas et ne comprenne pas que ce merveilleux accord d’idées dont on se vante, que cette intuition extraordinaire ne sont que le résultat de savantes préparations : qu’on me rapporte que vous avez ce matin exprimé l’opinion que le foie de veau aux carottes était une bonne chose, et je n’aurai pas grand mérite à vous dire ce soir que je suppose que vous aimez le veau aux carottes. »
Ils se mirent à rire en se regardant d’un air goguenard.
Si Perrine avait eu besoin d’une clé pour deviner les noms qu’ils ne prononçaient pas, ce mot « je suppose » la lui eût mise aux mains ; mais tout de suite elle avait compris que le « on » qui organisait l’espionnage était Talouel, et celui qui le subissait, M. Vulfran.
« Enfin quel plaisir peut-il trouver à toutes ces histoires ? demanda Mombleux.
— Comment quel plaisir ! On est envieux, ou on ne l’est pas ; de même on est, ou l’on n’est pas ambitieux. Eh bien, il se rencontre qu’on est envieux et encore plus ambitieux. Parti de rien, c’est-à-dire d’ouvrier, on est devenu le second dans une maison qui à la tête de l’industrie française, fait plus de douze millions de bénéfices par an, et l’ambition vous est venue de passer du second rang au premier ; est-ce que cela ne s’est pas déjà produit, et n’a-t-on pas vu de simples commis remplacer des fondateurs de maisons considérables ? Quand on a vu que les circonstances, les malheurs de famille, la maladie pouvaient un jour ou l’autre mettre le chef dans l’impossibilité de continuer à la diriger, on s’est arrangé pour se rendre indispensable, et s’imposer comme le seul qui fût de taille à porter ce fardeau écrasant. La meilleure méthode pour en arriver là n’était-elle pas de faire la conquête de celui qu’on espérait remplacer, en lui prouvant du matin au soir qu’on était d’une capacité, d’une force d’intelligence, d’une aptitude aux affaires au delà de l’ordinaire ? De là le besoin de savoir à l’avance ce qu’a dit le chef, ce qu’il a fait, ce qu’il pense, de manière à être toujours en accord parfait avec lui, et même de paraître le devancer : si bien que quand on dit : « Je suppose que vous voudriez bien manger du veau aux carottes », la réponse obligée soit : « Parfaitement. »
De nouveau ils se mirent à rire, et pendant que Zénobie changeait les assiettes pour le dessert ils gardèrent un silence prudent ; mais lorsqu’elle fut sortie, ils reprirent leur entretien comme s’ils n’admettaient pas que cette petite qui mangeait silencieusement dans son coin, pût en deviner les dessous qu’ils brouillaient à dessein.
« Et si le disparu reparaissait ? dit Mombleux.
— C’est ce que tout le monde doit souhaiter. Mais s’il ne reparaît pas, c’est qu’il a de bonnes raisons pour ça, comme d’être mort probablement.
— C’est égal, une pareille ambition chez ce bonhomme est raide tout de même, quand on sait ce qu’il est, et aussi ce qu’est la maison qu’il voudrait faire sienne.
— Si l’ambitieux se rendait un juste compte de la distance qui le sépare du but visé, le plus souvent il ne se mettrait pas en route. En tout cas, ne vous trompez pas sur notre bonhomme qui est beaucoup plus fort que vous ne croyez, si on compare son point de départ à son point d’arrivée.
— Ce n’est pas lui qui a amené la disparition de celui dont il compte prendre la place.
— Qui sait s’il n’a pas contribué à provoquer cette disparition ou à la faire durer ?
— Vous croyez ?
— Nous n’étions ici, ni l’un ni l’autre à ce moment, nous ne pouvons donc pas savoir ce qui s’est passé ; mais étant donné le caractère du personnage, il est vraisemblable d’admettre qu’un événement de cette gravité n’a pas dû se produire, sans qu’il ait travaillé à envenimer les choses, de façon à les incliner du côté de son intérêt.
— Je n’avais pas pensé à cela, tiens, tiens.
— Pensez-y, et rendez-vous compte du rôle, je ne dis pas qu’il a joué, mais qu’il a pu jouer en voyant l’importance que cette disparition lui permettait de prendre.
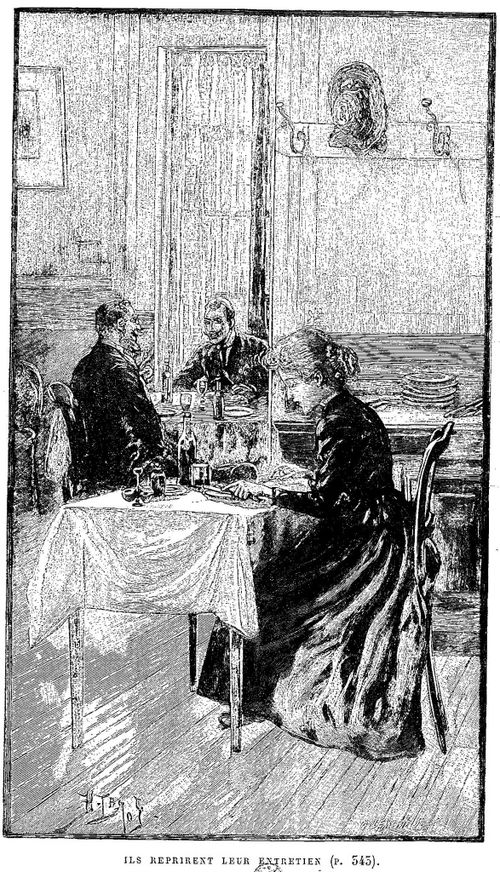
— Il est certain qu’à ce moment il pouvait ne pas prévoir que d’autres hériteraient de la place du disparu ; mais maintenant que cette place est occupée, quelles espérances peut-il garder ?
— Quand ce ne serait que celle que cette occupation n’est pas aussi solide qu’elle en a l’air. Et de fait est-elle si solide que ça ?
— Vous croyez…
— J’ai cru en arrivant ici qu’elle l’était ; mais depuis j’ai vu par bien des petites choses, que vous avez pu remarquer vous-même, qu’il se fait un travail souterrain à propos de tout, comme à propos de rien, qu’on devine, plutôt qu’on ne le suit, dont le but certainement est de rendre cette occupation intolérable. Y parviendra-t-on ? D’un côté arrivera-t-on à leur rendre la vie tellement insupportable qu’ils préfèrent, de guerre lasse, se retirer ? De l’autre trouvera-t-on moyen de les faire renvoyer ? Je n’en sais rien.
— Renvoyer ! Vous n’y pensez pas.
— Évidemment s’ils ne donnent pas prise à des attaques sérieuses, ce sera impossible. Mais si dans la confiance que leur inspire leur situation ils ne se gardent pas ; s’ils ne se tiennent pas toujours sur la défensive ; s’ils commettent des fautes, et qui n’en commet pas ? alors surtout qu’on est tout-puissant et qu’on a lieu de croire l’avenir assuré, je ne dis pas que nous n’assisterons pas à des révolutions intéressantes.
— Pas intéressantes pour moi les révolutions, vous savez.
— Je ne crois pas que j’aurais plus que vous à y gagner ; mais que pouvons-nous contre leur marche ? Prendre parti pour celui-ci. Prendre parti pour celui-là. Ma foi non. D’autant mieux qu’en réalité mes sympathies sont pour celui dont on vise l’héritage, en escomptant une maladie qui doit, semble-t-il aux uns et aux autres, le faire disparaître bientôt ; ce qui, pour moi, n’est pas du tout prouvé.
— Ni pour moi.
— D’ailleurs on ne m’a jamais demandé nettement mon concours, et je ne suis pas homme à l’offrir.
— Ni moi non plus.
— Je m’en tiens au rôle de spectateur, et quand je vois un des personnages de la pièce qui se joue sous nos yeux entreprendre une lutte qui semble impossible aussi bien que folle, n’ayant pour lui que son audace, son énergie…
— Sa canaillerie.
— Si vous voulez je le dirai avec vous, cela m’intéresse, bien que je n’ignore pas que dans cette lutte des coups seront donnés qui pourront m’atteindre. Voilà pourquoi j’étudie ce personnage, qui n’a pas que des côtés tragiques, mais qui en a aussi de comiques, comme il convient d’ailleurs dans un drame bien fait.
— Moi je ne le trouve pas comique du tout.
— Comment vous ne trouvez pas personnage comique un homme qui à vingt ans savait à peine lire et signer son nom, et qui a assez courageusement travaillé pour acquérir une calligraphie et une orthographe impeccables, qui lui permettent de reprendre tout le monde ni plus ni moins qu’un maître d’école ?
— Ma foi, je trouve ça remarquable.
— Moi aussi je trouve ça remarquable, mais le comique c’est que l’éducation n’a pas marché parallèlement avec cette instruction primaire, que le bonhomme s’imagine être tout dans le monde, si bien que malgré sa belle écriture et son orthographe féroce, je ne peux pas m’empêcher de rire quand je l’entends faire usage de son langage distingué dans lequel les haricots sont « des flageolets » et les citrouilles « des potirons » ; nous nous contentons de soupe, lui ne mange que « du potage » ; quand je veux savoir si vous avez été vous promener, je vous demande : « Avez-vous été vous promener ? » lui vous dit : « Allâtes-vous à la promenade ? Qu’éprouvâtes-vous ? Nous voyageâmes ». Et quand je vois qu’avec ces beaux mots il se croit supérieur à tout le monde, je me dis que s’il devient maître des usines qu’il convoite, ce qui est possible, sénateur, administrateur de grandes compagnies, il voudra sans doute se faire nommer de l’Académie française, et ne comprendra pas qu’on ne l’accueille point. »
À ce moment Rosalie entra dans la salle et demanda à Perrine si elle ne voulait pas faire une course dans le village. Comment refuser ? Il y avait longtemps déjà qu’elle avait fini de dîner, et rester à sa place eût pu éveiller des suppositions qu’elle devait éviter de faire naître, si elle voulait qu’on continuât de parler librement devant elle.
La soirée étant douce et les gens restant assis dans la rue en bavardant de porte en porte, Rosalie aurait voulu flâner et transformer sa course en promenade ; mais Perrine ne se prêta pas à cette fantaisie, et elle prétexta la fatigue pour rentrer.
En réalité ce qu’elle voulait c’était réfléchir, non dormir, et dans la tranquillité de sa petite chambre, la porte close, se rendre compte de sa situation, et de la conduite qu’elle allait avoir à tenir.
Déjà pendant la soirée où elle avait entendu ses camarades de chambrée parler de Talouel, elle avait pu se le représenter comme un homme redoutable ; depuis, quand il s’était adressé à elle pour qu’elle lui dît « toute la vérité sur les bêtises de Fabry », en ajoutant qu’il était le maître et qu’en cette qualité il devait tout savoir, elle avait vu comment cet homme redoutable établissait sa puissance, et quels moyens il employait ; cependant tout cela n’était rien à côté de ce que révélait l’entretien qu’elle venait d’entendre.
Qu’il voulût avoir l’autorité d’un tyran à côté, au-dessus même de M. Vulfran, cela elle le savait ; mais qu’il espérât remplacer un jour le tout-puissant maître des usines de Maraucourt, et que depuis longtemps il travaillât dans ce but, cela elle ne l’avait pas imaginé.
Et pourtant c’était ce qui résultait de la conversation de l’ingénieur et de Mombleux, en situation de savoir mieux que personne ce qui se passait, de juger les choses et les hommes et d’en parler.
Ainsi le on qu’ils n’avaient pas autrement désigné, devait s’arranger pour remplacer par un autre l’espion qu’il venait de perdre ; mais cet autre c’était elle-même qui prenait la place de Guillaume.
Comment allait-elle se défendre ?
Sa situation n’était-elle pas effrayante ? Et elle n’était qu’une enfant, sans expérience, comme sans appui.
Cette question elle se l’était déjà posée, mais non dans les mêmes conditions que maintenant.
Et assise sur son lit, car il lui était impossible de rester couchée, tant son angoisse était énervante, elle se répétait mot à mot ce qu’elle avait entendu :
« Qui sait s’il n’a pas contribué à provoquer l’absence du disparu, et à la faire durer. »
« La place qu’ont prise ceux qui doivent remplacer ce disparu, est-elle aussi solidement occupée qu’on croit, et ne se fait-il pas un travail souterrain pour les obliger à l’abandonner, soit en les forçant à se retirer, soit en les faisant renvoyer ? »
S’il avait cette puissance de faire renvoyer ceux qui semblaient désignés pour remplacer le maître, que ne pourrait-il pas contre elle qui n’était rien, si elle essayait de lui résister, et se refusait à devenir l’espionne qu’il voulait qu’elle fût !
Comment ne donnerait-elle pas barre sur elle ?
Elle passa une partie de la nuit à agiter ces questions, mais quand à la fin la fatigue la coucha sur son oreiller, elle n’en avait vu que les difficultés sans leur trouver une seule réponse rassurante.


XXX
La première occupation de M. Vulfran en arrivant le matin à ses bureaux, était d’ouvrir son courrier, qu’un garçon allait chercher à la poste et disposait sur la table en deux tas, celui de la France et celui de l’étranger. Autrefois il décachetait lui-même toute sa correspondance française, et dictait à un employé les annotations que chaque lettre comportait, pour les réponses à faire ou les ordres à donner ; mais depuis qu’il était aveugle il se faisait assister dans ce travail par ses neveux et par Talouel qui lisaient les lettres à haute voix, et les annotaient ; pour les lettres étrangères, depuis la maladie de Bendit, après les avoir ouvertes on les transmettait à Fabry si elles étaient anglaises, allemandes à Mombleux.
Le matin qui suivit l’entretien entre Fabry et Mombleux qui avait ému Perrine si violemment, M. Vulfran, Théodore, Casimir et Talouel étaient occupés à ce travail de la correspondance, quand Théodore qui ouvrait les lettres étrangères, en annonçant le lieu d’où elles étaient écrites, dit :
« Une lettre de Dakka, 29 mai.
— En français ? demanda M. Vulfran.
— Non, en anglais.
— La signature ?
— Pas très lisible, quelque chose comme Feldes, Faldes, Fildes, précédé d’un mot que je ne peux pas lire ; quatre pages ; votre nom revient plusieurs fois ; à transmettre à M. Fabry n’est-ce pas ?
— Non ; me la donner. »
En même temps Théodore et Talouel regardèrent M. Vulfran, mais en voyant qu’ils avaient l’un et l’autre surpris le mouvement qui venait de leur échapper, et trahissait une même curiosité, ils prirent un air indifférent.
« Je mets la lettre sur votre table, dit Théodore.
— Non, donne-la-moi. »
Bientôt le travail prit fin, et le commis se retira en emportant la correspondance annotée ; Théodore et Talouel voulurent alors demander à M. Vulfran ses instructions sur plusieurs sujets, mais il les renvoya, et aussitôt qu’ils furent partis il sonna Perrine.
Instantanément elle arriva.
« Qu’est-ce que c’est que cette lettre ? » demanda M. Vulfran.
Elle prit la lettre qu’il lui tendait et jeta les yeux dessus ; s’il avait pu la voir il aurait constaté qu’elle pâlissait et que ses mains tremblaient.
« C’est une lettre en anglais datée de Dakka du 29 mai.
— Sa signature ? »
Elle la retourna :
« Le père Fildes.
— Tu en es certaine ?
— Oui, monsieur, le père Fildes.
— Que dit-elle ?
— Voulez-vous me permettre d’en lire quelques lignes avant de répondre ?
— Sans doute, mais vite. »
Elle eût voulu obéir à cet ordre, cependant son émotion, au lieu de se calmer, s’était accrue, les mots dansaient devant ses yeux troubles.
« Eh bien ? demanda M. Vulfran d’une voix impatiente.
— Monsieur, cela est difficile à lire, et difficile aussi à comprendre : les phrases sont longues.
— Ne traduis pas, analyse simplement ; de quoi s’agit-il ? »
Un certain temps s’écoula encore avant qu’elle répondît ; enfin elle dit :
« Le père Fildes explique que le père Leclerc à qui vous aviez écrit est mort, et que lui-même chargé par le père Leclerc de vous répondre, en a été empêché par une absence, et aussi par la difficulté de réunir les renseignements que vous demandez ; il s’excuse de vous écrire en anglais, mais il ne possède qu’imparfaitement votre belle langue.
— Ces renseignements, s’écria M. Vulfran.
— Mais, monsieur, je n’en suis pas encore là. »
Bien que cette réponse eût été faite sur le ton d’une extrême douceur, il sentit qu’il ne gagnerait rien à la bousculer.
« Tu as raison, dit-il, ce n’est pas une lettre française que tu lis ; il faut que tu la comprennes avant de me l’expliquer. Voilà ce que tu vas faire : tu vas prendre cette lettre et aller dans le bureau de Bendit ; où tu la traduiras aussi fidèlement que possible, en écrivant ta traduction que tu me liras. Ne perds pas une minute. J’ai hâte, tu le vois, de savoir ce qu’elle contient. »
Elle s’éloignait, il la retint :
« Écoute bien. Il s’agit, dans cette lettre, d’affaires personnelles qui ne doivent être connues de personne ; tu entends, de personne ; quoi qu’on te demande, s’il se trouve quelqu’un qui ose t’interroger, tu ne dois donc rien dire, non seulement ne rien dire, mais même ne laisser rien deviner. Tu vois la confiance que je mets en toi ; je compte que tu t’en montreras digne ; si tu me sers fidèlement, sois certaine que tu t’en trouveras bien.
— Je vous promets, monsieur, de tout faire pour mériter cette confiance.
— Va vite et fais vite. »
Malgré cette recommandation, elle ne se mit pas tout de suite à écrire sa traduction, mais elle lut la lettre d’un bout à l’autre, la relut, et ce fut seulement après cela qu’elle prit une grande feuille de papier et commença.
« J’ai le vif chagrin de vous apprendre que nous avons eu la douleur de perdre notre révérend père Leclerc à qui vous aviez bien voulu demander certains renseignements, auxquels vous paraissez attacher une importance qui me décide à vous répondre à sa place, en m’excusant de n’avoir pas pu le faire plus tôt, empêché que j’ai été par des voyages dans l’intérieur, et retardé d’autre part par les difficultés, qu’après plus de douze ans écoulés, j’ai éprouvées à réunir ces renseignements
d’une façon un peu précise ; je fais donc appel à toute votre bienveillance, pour qu’elle me pardonne ce retard involontaire, et aussi de vous écrire en anglais ; la connaissance imparfaite de votre belle langue en est seule la cause. »
Après avoir écrit cette phrase qui était véritablement longue, comme elle l’avait dit à M. Vulfran, et qui par cela seul présentait de réelles difficultés pour être mise au net, elle s’arrêta pour la relire et la corriger. Elle s’y appliquait de toutes les forces de son attention quand la porte de son bureau, qu’elle avait fermée, s’ouvrit devant Théodore Paindavoine qui entra et lui demanda un dictionnaire anglais-français.
Justement elle avait ce dictionnaire ouvert devant elle ; elle le ferma et le tendit à Théodore.
« Ne vous en serviez-vous pas ? dit celui-ci en venant près d’elle.
— Oui, mais je peux m’en passer.
— Comment cela ?
— J’en ai plus besoin pour l’orthographe des mots français que pour le sens des mots anglais, un dictionnaire français le remplacera très bien. »
Elle le sentait sur son dos, et bien qu’elle ne pût pas voir ses yeux n’osant pas se retourner, elle devinait qu’ils lisaient par-dessus son épaule.
« C’est la lettre de Dakka que vous traduisez ? »
Elle fut surprise qu’il connût cette lettre qui devait rester si rigoureusement secrète. Mais tout de suite elle réfléchit que c’était peut-être pour la connaître qu’il l’interrogeait, et cela paraissait d’autant plus probable que le dictionnaire semblait être un prétexte : pourquoi aurait-il besoin d’un dictionnaire anglais-français puisqu’il ne savait pas un mot d’anglais ?
« Oui, monsieur, dit-elle.
— Et cela va bien cette traduction ? »
Elle sentit qu’il se penchait sur elle, car il avait la vue basse ; alors vivement elle tourna son papier de façon à ce qu’il ne le vît que de côté.
« Oh ! je vous en prie, monsieur, ne lisez pas, cela ne va pas du tout, je cherche,… c’est un brouillon.
— Cela ne fait rien.
— Si, monsieur, cela fait beaucoup, j’aurais honte. »
Il voulut prendre la feuille de papier, elle mit la main dessus ; si elle avait commencé à se défendre par un moyen détourné, maintenant elle était résolue à faire tête, même à l’un des chefs de la maison.
Il avait jusque-là parlé sur le ton de la plaisanterie, il continua :
« Donnez donc ce brouillon, est-ce que vous me croyez homme à faire le maître d’école avec une jolie jeune fille comme vous ?
— Non, monsieur, c’est impossible.
— Allons donc. »
Et il voulut le prendre en riant ; mais elle résista.
« Non, monsieur, non, je ne vous le laisserai pas prendre.
— C’est une plaisanterie.
— Pas pour moi, rien n’est plus sérieux : M. Vulfran m’a défendu de laisser voir cette lettre par personne, j’obéis à M. Vulfran.
— C’est moi qui l’ai ouverte.
— La lettre en anglais n’est pas la traduction.
— Mon oncle va me la montrer tout à l’heure cette fameuse traduction.
— Si monsieur votre oncle vous la montre, ce ne sera pas moi ; il m’a donné ses ordres, j’obéis, pardonnez-le-moi. »
Il y avait tant de résolution dans son accent et dans son attitude que bien certainement pour avoir cette feuille de papier, il faudrait la lui prendre de force ; et alors ne crierait-elle point ?
Théodore n’osa pas aller jusque-là :
« Je suis enchanté de voir, dit-il, la fidélité que vous montrez pour les ordres de mon oncle, même dans les choses insignifiantes. »
Lorsqu’il eut refermé la porte, Perrine voulut se remettre au travail, mais elle était si bouleversée que cela lui fut impossible. Qu’allait-il advenir de cette résistance, dont il se disait enchanté quand au contraire il en était furieux ? S’il voulait la lui faire payer, comment lutterait-elle, misérable sans défense, contre un ennemi qui était tout-puissant ? Au premier coup qu’il lui porterait, elle serait brisée. Et alors il faudrait qu’elle quittât cette maison, où elle n’aurait que passé.
À ce moment sa porte s’ouvrit de nouveau, doucement poussée, et Talouel entra à pas glissés, les yeux fixés sur le pupitre où la lettre et son commencement de traduction se trouvaient étalés.
« Eh bien, cette traduction de la lettre de Dakka, ça marche-t-il ?
— Je ne fais que commencer.
— M. Théodore t’a dérangée. Qu’est-ce qu’il voulait ?
— Un dictionnaire anglais-français.
— Pourquoi faire ? il ne sait pas l’anglais.
— Il ne me l’a pas dit.
— Il ne t’a pas demandé ce qu’il y a dans cette lettre ?
— Je n’en suis qu’à la première phrase.
— Tu ne vas pas me faire croire que tu ne l’as pas lue.
— Je ne l’ai pas encore traduite.
— Tu ne l’as pas écrite en français, mais tu l’as lue. »
Elle ne répondit pas.
« Je te demande si tu l’as lue ; tu me répondras peut-être.
— Je ne peux pas répondre.
— Parce que ?
— Parce que M. Vulfran m’a défendu de parler de cette lettre.
— Tu sais bien que M. Vulfran et moi nous ne faisons qu’un. Tous les ordres que M. Vulfran donne ici passent par moi, toutes les faveurs qu’il accorde passent par moi, je dois donc connaître ce qui le concerne.
— Même ses affaires personnelles ?
— C’est donc d’affaires personnelles qu’il s’agit dans cette lettre ? »

Elle comprit qu’elle s’était laissé surprendre.
« Je n’ai pas dit cela ; mais je vous ai demandé si dans le cas d’affaires personnelles, je devrais vous faire connaître le contenu de cette lettre.
— C’est surtout s’il s’agit d’affaires personnelles que je dois les connaître, et cela dans l’intérêt même de M. Vulfran. Ne sais-tu pas qu’il est devenu malade à la suite de chagrins qui ont failli le tuer ? Que tout à coup il apprenne une nouvelle qui lui apporte un nouveau chagrin ou lui cause une grande joie, et cette nouvelle trop brusquement annoncée, sans préparation, peut lui être mortelle. Voilà pourquoi je dois savoir à l’avance ce qui le touche, pour le préparer ; ce qui n’aurait pas lieu, si tu lui lisais ta traduction tout simplement. »
Il avait débité ce petit discours d’un ton doux, insinuant, qui ne ressemblait en rien à ses manières ordinaires si raides et si hargneuses.
Comme elle restait muette le regardant avec une émotion qui la faisait toute pâle, il continua :
« J’espère que tu es assez intelligente pour comprendre ce que je t’explique là, et aussi de quelle importance il est pour tous, pour nous, pour le pays entier qui vit par M. Vulfran, pour toi-même qui viens de trouver auprès de lui une bonne place qui ne peut que devenir meilleure avec le temps, que sa santé ne soit pas ébranlée par des coups violents auxquels elle ne résisterait pas. Il a l’air solide encore, mais il ne l’est pas autant qu’il le paraît ; ses chagrins le minent, et d’autre part la perte de sa vue le désespère. Voilà pourquoi nous devons tous ici travailler à lui adoucir la vie, et moi le premier, puisque je suis celui en qui il a mis sa confiance. »
Perrine n’eût rien su de Talouel, qu’elle se fût sans doute laissé prendre à ces paroles habilement arrangées pour la troubler et la toucher ; mais après ce qu’elle avait entendu, et des femmes de la chambrée qui à la vérité n’étaient que de pauvres ouvrières, et de Fabry et de Mombleux qui eux étaient des hommes capables de savoir les choses aussi bien que de juger les gens, elle ne pouvait pas plus ajouter foi à la sincérité de ce discours, qu’avoir confiance dans le dévouement du directeur : il voulait la faire parler, voilà tout, et pour en arriver là tous les moyens lui étaient bons : le mensonge, la tromperie, l’hypocrisie. Elle eût pu avoir des doutes à ce sujet, que la tentative de Théodore auprès d’elle devait l’empêcher de les admettre : pas plus que le neveu, le directeur n’était sincère, l’un et l’autre voulaient savoir ce que disait la lettre de Dakka et ne voulaient que cela ; c’était donc contre eux que M. Vulfran prenait ses précautions quand il lui disait : « S’il se trouve quelqu’un qui ose t’interroger, tu dois non seulement ne rien dire, mais même ne laisser rien deviner ; » et c’était à M. Vulfran, qui certainement avait prévu ces tentatives, à lui seul qu’elle devait obéir, sans prendre autrement souci des colères et des haines qu’elle allait accumuler contre elle.
Il était debout devant elle, appuyé sur son bureau, penché vers elle, la tenant dans ses yeux, l’enveloppant, la dominant ; elle fit appel à tout son courage, et d’une voix un peu rauque qui trahissait son émotion, mais qui ne tremblait pas cependant, elle dit :
« M. Vulfran m’a défendu de parler de cette lettre à personne. »
Il se redressa furieux de cette résistance, mais presque aussitôt, se penchant de nouveau vers elle en se faisant caressant dans les manières comme dans l’accent :
« Justement je ne suis personne, puisque je suis son second, un autre lui-même.
Elle ne répondit pas.
« Tu es donc stupide ? s’écria-t-il d’une voix étouffée.
— Sans doute, je le suis.
— Alors, tâche de comprendre qu’il faut être intelligent pour occuper la place que M. Vulfran t’a donnée auprès de lui, et que puisque cette intelligence te manque, tu ne peux pas garder cette place, et qu’au lieu de te soutenir comme je l’aurais voulu, mon devoir est de te faire renvoyer. Comprends-tu cela ?
— Oui, monsieur.
— Eh bien, réfléchis-y, pense à ce qu’est ta situation aujourd’hui, représente-toi ce qu’elle sera demain dans la rue, et prends une résolution que tu me feras connaître ce soir. »
Là-dessus, après avoir attendu un moment sans qu’elle faiblît, il sortit à pas glissés comme il était entré.


XXXI
« Réfléchis. »
Elle eût voulu réfléchir ; mais comment, alors que M. Vulfran attendait.
Elle se remit donc à sa traduction, se disant que pendant qu’elle travaillerait, son émotion se calmerait peut-être, et qu’alors elle serait sans doute mieux en état d’examiner sa situation et de décider ce qu’elle avait à faire.
« La principale difficulté que j’ai, comme je vous le dis, rencontrée dans mes recherches, a été celle du temps qui s’est écoulé depuis le mariage de M. Edmond Paindavoine, votre très cher fils. Tout d’abord je vous avoue que privé des lumières de notre révérend père Leclerc qui avait béni cette union, j’ai été complètement désorienté ; et que j’ai dû chercher de différents côtés avant de pouvoir recueillir les éléments d’une réponse qui pût vous satisfaire.
« De ces éléments il résulte que celle qui est devenue la femme de M. Edmond Paindavoine était une jeune personne douée des plus charmantes qualités : l’intelligence, la bonté, la douceur, la tendresse de l’âme, la droiture du caractère, sans parler de ces charmes personnels qui, pour être éphémères,
n’en ont pas moins une importance souvent décisive
pour ceux qui laissent leur cœur se prendre par les vanités de ce monde. »
Quatre fois elle recommença la traduction de cette phrase, la plus entortillée à coup sûr de cette lettre, mais elle s’acharna à la rendre avec toute l’exactitude qu’elle pouvait mettre dans ce travail, et si elle n’arriva pas à se satisfaire elle-même, au moins eut-elle la conscience d’avoir fait ce qu’elle pouvait.
« Le temps n’est plus où tout le savoir des femmes hindoues consistait dans la science de l’étiquette, dans l’art de se lever ou de s’asseoir, et où toute instruction, en dehors de ces points essentiels, était considérée comme une déchéance ; aujourd’hui un grand nombre, même parmi celles des hautes castes, ont l’esprit cultivé et se rappellent que dans l’Inde ancienne, l’étude était placée sous l’invocation de la déesse Sarasvati. Celle dont je parle appartenait à cette catégorie, et son père ainsi que sa mère qui étaient de famille brahmane, c’est-à-dire deux fois nés, selon l’expression hindoue, avaient eu le bonheur d’être convertis à notre sainte religion catholique, apostolique et romaine par notre révérend père Leclerc pendant les premières années de sa mission. Par malheur pour la propagation de notre foi dans le Hind l’influence de la caste est toute-puissante, de sorte que qui perd sa foi perd sa caste, c’est-à-dire son rang, ses relations, sa vie sociale. Ce fut le cas de cette famille, qui par cela seul qu’elle se faisait chrétienne, se faisait en quelque sorte paria.
« Il vous paraîtra donc tout naturel que rejetée du monde hindou, elle se soit tournée du côté de la société européenne, si bien qu’une association d’affaires et d’amitié l’a unie à une famille française pour la fondation et l’exploitation d’une fabrique importante de mousseline sous la raison sociale Doressany (l’Hindou) et Bercher (le Français).
« Ce fut dans la maison de Mme Bercher que M. Edmond Paindavoine fit la connaissance de Mlle Marie Doressany et s’éprit d’elle ; ce qui s’explique par cette raison principale qu’elle était bien réellement la jeune fille que je viens de vous dépeindre, tous les témoignages que j’ai réunis concordent entre eux pour l’affirmer, mais je ne peux pas en parler moi-même puisque je ne l’ai pas connue et ne suis arrivé à Dakka qu’après son départ.
« Pourquoi s’éleva-t-il des empêchements au mariage qu’ils voulaient contracter ? C’est une question que je n’ai pas à traiter.
« Quoiqu’il en ait été, le mariage fut célébré, et dans notre chapelle le révérend père Leclerc donna la bénédiction nuptiale à M. Edmond Paindavoine et à Mlle Marie Doressany ; l’acte de ce mariage est inscrit à sa date sur nos registres, et il pourra vous en être délivré une copie si vous en faites la demande.
« Pendant quatre ans M. Edmond Paindavoine vécut dans la maison des parents de sa femme où une enfant, une petite fille leur fut accordée par le Seigneur Tout-Puissant. Les souvenirs qu’ont gardés d’eux, ceux qui à Dakka les ont alors connus, sont des meilleurs, et les représentent comme le modèle des époux, se laissant peut-être emporter par les plaisirs mondains ; mais cela n’était-il pas de leur âge, et l’indulgence ne doit-elle pas être accordée à la jeunesse ?
« Longtemps prospère, la maison Doressany et Bercher éprouva coup sur coup des pertes considérables qui amenèrent une ruine complète : M. et Mme Doressany moururent en quelques mois d’intervalle, la famille Bercher rentra en France, et M. Edmond Paindavoine entreprit un voyage d’exploration en Dalhousie comme collecteur de plantes et de curiosités de toutes sortes pour des maisons anglaises : avec lui il avait emmené sa jeune femme et sa petite fille alors âgée de trois ans environ.
« Depuis il n’est pas revenu à Dakka, mais j’ai su par un de ses amis à qui il a écrit plusieurs fois, et aussi par un de nos pères qui tenait ces renseignements du révérend père Leclerc, resté en correspondance avec Mme Edmond Paindavoine, qu’il a habité pendant plusieurs années la ville de Dehra, choisie par lui comme centre d’exploration, sur la frontière thibétaine et dans l’Himalaya, qui, dit cet ami, ont été très fructueuses.
« Je ne connais pas Dehra, mais nous avons une mission dans cette ville, et si vous pensez que cela peut vous être utile dans vos recherches, je me ferai un plaisir de vous envoyer une lettre pour un de nos pères dont le concours pourrait peut-être les faciliter. »
Enfin elle était terminée, la terrible lettre, et tout de suite après le dernier mot écrit, sans même traduire la formule de politesse de la fin, elle ramassa les feuillets et se rendit vivement auprès de M. Vulfran qu’elle trouva marchant d’un bout à l’autre de son cabinet en comptant les pas, autant pour ne pas aller donner contre la muraille que pour tromper son impatience.
« Tu as été bien lente, dit-il.
— La lettre est longue et difficile.
— N’as-tu pas été dérangée aussi ? J’ai entendu la porte de ton bureau s’ouvrir et se fermer deux fois. »
Puisqu’il l’interrogeait, elle crut qu’elle devait répondre sincèrement : peut-être était-ce la seule solution honnête et juste aux questions qu’elle avait agitées sans leur trouver de réponses satisfaisantes :
« M. Théodore et M. Talouel sont venus dans mon bureau.
— Ah ! »
Il parut vouloir s’engager sur ce point, mais s’arrêtant, il reprit :
« La lettre d’abord ; nous verrons cela ensuite ; assieds-toi près de moi, et lis lentement, distinctement, sans hausser la voix. »
Elle fit sa lecture comme il lui était commandé, et d’une voix plutôt faible que forte.
De temps en temps M. Vulfran l’interrompit, mais sans s’adresser à elle, en suivant sa pensée :
… Modèle des époux,
… Plaisirs mondains,
… Maisons anglaises, quelles maisons ?
… Un de ses amis ; quel ami ?
… De quelle époque datent ces renseignements ?
Et quand elle fut arrivée à la fin de la lettre, résumant ses impressions, il dit :
« Des phrases. Pas un fait. Pas un nom. Pas une date. Que ces gens-là ont donc l’esprit vague ! »
Comme ces observations ne lui étaient pas faites directement, Perrine n’avait garde de répondre ; alors un silence s’établit que M. Vulfran ne rompit qu’après un temps de réflexion assez long :
« Peux-tu traduire du français en anglais comme tu viens de traduire de l’anglais en français ?
— Si ce ne sont pas des phrases trop difficiles, oui.
— Une dépêche ?
— Oui, je crois.
— Eh bien, assieds-toi à la petite table et écris. »
Il dicta :
« Père Fildes
« Remerciements pour lettre.
« Prière envoyer par dépêche, réponse payée vingt mots, nom de l’ami qui a reçu nouvelles, dernière date de celles-ci. Envoyer aussi nom du père de Dehra. Lui écrire pour le prévenir que je m’adresse à lui directement.
« Traduis cela en anglais, et fais plutôt plus court que plus long, à 1 fr. 60 le mot, il ne faut pas les prodiguer ; écris très lisiblement. »
La traduction fut assez vivement achevée et elle la lut à haute voix.
« Combien de mots ? demanda-t-il.
— En anglais quarante-cinq. »
Alors il calcula tout haut :
« Cela fait 72 francs pour la dépêche, 32 pour la réponse ; 104 francs en tout que je vais te donner ; tu la porteras toi-même au télégraphe et la liras à la receveuse, pour qu’elle ne commette pas d’erreur. »
En traversant la vérandah elle y trouva Talouel qui les mains dans les poches, se promenait là, de manière à surveiller tout ce qui se passait dans les cours aussi bien que dans les bureaux.
« Où vas-tu ? demanda-t-il.
— Au télégraphe porter une dépêche. »
Elle la tenait d’une main et l’argent de l’autre ; il la lui prit en la tirant si fort que si elle ne l’avait pas lâchée, il l’aurait déchirée, et tout de suite il l’ouvrit. Mais en voyant qu’elle était en anglais, il eut un mouvement de colère.
« Tu sais que tu as à me parler tantôt, dit-il.
— Oui, monsieur. »
Ce fut seulement à trois heures qu’elle revit M. Vulfran, quand il la sonna pour partir. Plus d’une fois elle s’était demandé qui remplacerait Guillaume ; sa surprise fut grande quand M. Vulfran lui dit de prendre place à ses côtés, après avoir renvoyé le cocher qui avait amené Coco.
« Puisque tu as bien conduit hier, il n’y a pas de raisons pour que tu ne conduises pas bien aujourd’hui. D’ailleurs nous avons à parler, et il vaut mieux pour cela que nous soyons seuls. »
Ce fut seulement après être sortis du village où sur leur passage se manifesta la même curiosité que la veille, et quand ils roulèrent doucement à travers les prairies où la fenaison était dans son plein, que M. Vulfran, jusque-là silencieux, prit la parole, au grand émoi de Perrine qui eût bien voulu retarder encore le moment de cette explication si grosse de dangers pour elle, semblait-il.
« Tu m’as dit que M. Théodore et M. Talouel étaient venus dans ton bureau.
— Oui, monsieur.
— Que te voulaient-ils ? »
Elle hésita, le cœur serré.
« Pourquoi hésites-tu ? Ne dois-tu pas tout me dire ?
— Oui, monsieur, je le dois, mais cela n’empêche pas que j’hésite.
— On ne doit jamais hésiter à faire son devoir ; si tu crois que tu dois te taire, tais-toi ; si tu crois que tu dois répondre à ma question, car je te questionne, réponds.
— Je crois que je dois répondre.
— Je t’écoute. »
Elle raconta exactement ce qui s’était passé entre Théodore et elle, sans un mot de plus, sans un de moins.
« C’est bien tout ? demanda M. Vulfran lorsqu’elle fut arrivée au bout.
— Oui, monsieur, tout.

— Et Talouel ? »
Elle recommença pour le directeur ce qu’elle avait fait pour le neveu, aussi fidèlement, en arrangeant seulement un peu ce qui avait rapport à la maladie de M. Vulfran, de façon à ne pas répéter « qu’une mauvaise nouvelle trop brusquement annoncée, sans préparation, pouvait le tuer ». Puis après la première tentative de Talouel, elle dit ce qui s’était passé pour la dépêche, sans cacher le rendez-vous qui lui était assigné à la fin de la journée.
Tout à son récit, elle avait laissé Coco prendre le pas, et le vieux cheval abusant de cette liberté se dandinait tranquillement, humant la bonne odeur du foin séché que la brise tiède lui soufflait aux naseaux, en même temps qu’elle apportait les coups de marteau du battement des faux qui lui rappelaient les premières années de sa vie, quand, n’ayant pas encore travaillé, il galopait à travers les prairies avec les juments et ses camarades les poulains, sans se douter alors qu’ils auraient à traîner un jour des voitures sur les routes poussiéreuses, à peiner, à souffrir les coups de fouet et les brutalités.
Quand elle se tut, M. Vulfran resta assez longtemps silencieux, et comme elle pouvait l’examiner sans qu’il sût qu’elle tenait les yeux attachés sur lui, elle vit que son visage trahissait une préoccupation douloureuse faite, semblait-il, d’autant de mécontentement que de tristesse ; enfin, il dit :
« Avant tout, je dois te rassurer ; sois certaine qu’il ne t’arrivera rien de mal pour tes paroles qui ne seront pas répétées, et que si jamais quelqu’un voulait se venger de la résistance que tu as honnêtement opposée à ces tentatives, je saurais te défendre. Au reste, je suis responsable de ce qui arrive. Je les pressentais ces tentatives quand je t’ai recommandé de ne pas parler de cette lettre qui devait éveiller certaines curiosités, et, dès lors, je n’aurais pas dû t’y exposer. À l’avenir, il n’en sera plus ainsi. À partir de demain, tu abandonneras le bureau de Bendit, où on peut aller te trouver, et tu occuperas, dans mon cabinet, la petite table sur laquelle tu as écrit ce matin la dépêche ; devant moi, on ne te questionnera pas, je pense. Mais comme on pourrait le tenter en dehors des bureaux, chez Françoise, à partir de ce soir, tu auras une chambre au château, et tu mangeras avec moi. Je prévois que je vais entretenir avec les Indes un échange de lettres et de dépêches que tu seras seule à connaître. Il faut que je prenne mes précautions pour qu’on ne cherche pas à t’arracher de force, ou à te tirer adroitement des renseignements qui doivent rester secrets. Près de moi, tu seras défendue. De plus, ce sera ma réponse à ceux qui ont voulu te faire parler, aussi bien que ce sera un avertissement à ceux qui voudraient le tenter encore. Enfin, ce sera une récompense pour toi. »
Perrine, qui avait commencé par trembler, s’était bien vite rassurée ; maintenant, elle était si violemment secouée par la joie qu’elle ne trouva pas un mot à répondre.
« Ma confiance en toi m’est venue du courage que tu as montré dans ta lutte contre la misère ; quand on est brave comme tu l’as été, on est honnête ; tu viens de me prouver que je ne me suis pas trompé, et que je peux me fier à toi, comme si je te connaissais depuis dix ans. Depuis que tu es ici tu as dû entendre parler de moi avec envie : être à la place de M. Vulfran, être M. Vulfran, quel bonheur ! La vérité est que la vie m’est dure, très dure, plus pénible, plus difficile que pour le plus misérable de mes ouvriers. Qu’est la fortune sans la santé qui permet d’en jouir ? le plus lourd des fardeaux. Et celui qui charge mes épaules m’écrase. Tous les matins, je me dis que sept mille ouvriers vivent par moi, vivent de moi, pour qui je dois penser, travailler et que si je leur manquais ce serait un désastre, pour tous la misère, pour un grand nombre la faim, la mort peut-être. Il faut que je marche pour eux, pour l’honneur de cette maison que j’ai créée, qui est ma joie, ma gloire, — et je suis aveugle ! »
Une pause s’établit et l’âpreté de cette plainte emplit de larmes les yeux de Perrine ; mais bientôt M. Vulfran reprit :
« Tu devais savoir par les conversations du village, et tu sais par la lettre que tu as traduite, que j’ai un fils ; mais entre ce fils et moi, il y a eu, pour toutes sortes de raisons dont je ne veux pas parler, des dissentiments graves qui nous ont séparés et qui, après son mariage conclu malgré mon opposition, ont amené une rupture complète, mais n’ont pas éteint mon affection pour lui, car je l’aime, après tant d’années d’absence, comme s’il était encore l’enfant que j’ai élevé, et quand je pense à lui, c’est-à-dire le jour et la nuit si longs pour moi, c’est le petit enfant que je vois de mes yeux sans regard. À son père, mon fils a préféré la femme qu’il aimait et qu’il avait épousée par un mariage nul. Au lieu de revenir près de moi, il a accepté de vivre près d’elle, parce que je ne pouvais ni ne devais la recevoir. J’ai espéré qu’il céderait ; il a dû croire que je céderais moi-même. Mais nous avons le même caractère : nous n’avons cédé ni l’un ni l’autre. Je n’ai plus eu de ses nouvelles. Après ma maladie qu’il a certainement connue, car j’ai tout lieu de penser qu’on le tenait au courant de ce qui se passe ici, j’ai cru qu’il reviendrait. Il n’est pas revenu, retenu évidemment par cette femme maudite qui, non contente de me l’avoir pris, me le garde, la misérable !… »
Perrine écoutait, suspendue aux lèvres de M. Vulfran, ne respirant pas ; à ce mot, elle interrompit :
« La lettre du père Fildes dit : « Une jeune personne douée des plus charmantes qualités : l’intelligence, la bonté, la douceur, la tendresse de l’âme, la droiture du caractère », on ne parle pas ainsi d’une misérable.
— Ce que dit la lettre peut-il aller contre les faits ? et le fait capital qui m’a inspiré contre elle l’exaspération et la haine, c’est qu’elle me garde mon fils, au lieu de s’effacer comme il convient à une créature de son espèce, pour qu’il puisse retrouver et reprendre ici la vie qui doit être la sienne. Enfin par elle nous sommes séparés, et tu vois que, malgré les recherches que j’ai fait entreprendre, je ne sais même pas où il est ; comme moi, tu vois les difficultés qui s’opposent à ces recherches. Ce qui complique ces difficultés, c’est une situation particulière que je dois t’expliquer, bien qu’elle soit sans doute peu claire pour une enfant de ton âge ; mais, enfin, il faut que tu t’en rendes à peu près compte, puisque par la confiance que je mets en toi, tu vas m’aider dans ma tâche. La longue absence, la disparition de mon fils, notre rupture, le long temps qui s’est écoulé depuis les dernières nouvelles qu’on a reçues de lui, ont fatalement éveillé certaines espérances. Si mon fils n’était plus là pour prendre ma place quand je serai tout à fait incapable d’en porter les charges, et pour hériter de ma fortune quand je mourrai, qui occuperait cette place ? À qui cette fortune reviendrait-elle ? Comprends-tu les espérances embusquées derrière ces questions ?
— À peu près, monsieur.
— Cela suffit, et même j’aime autant que tu ne les comprennes pas tout à fait. Il y a donc près de moi, parmi ceux qui devraient me soutenir et m’aider, des personnes qui ont intérêt à ce que mon fils ne revienne pas, et qui par cela seul que cet intérêt trouble leur esprit, peuvent s’imaginer qu’il est mort. Mort, mon fils ! Est-ce que cela est possible ! Est-ce que Dieu m’aurait frappé d’un si effroyable malheur ! Eux peuvent le croire, moi je ne peux pas. Que ferais-je en ce monde si Edmond était mort ? C’est la loi de nature que les enfants perdent leurs parents, non que les parents perdent leurs enfants. Enfin, j’ai cent raisons meilleures les unes que les autres qui prouvent l’insanité de ces espérances. Si Edmond avait péri dans un accident, je l’aurais su ; sa femme eût été la première à m’en avertir. Donc Edmond n’est pas, ne peut pas être mort ; je serais un père sans foi d’admettre le contraire. »
Perrine ne tenait plus ses yeux attachés sur M. Vulfran, mais elle les avait détournés pour cacher son visage, comme s’il pouvait le voir.
« Les autres, qui n’ont pas cette foi, peuvent croire à cette mort, et cela t’explique leur curiosité en même temps que les précautions que je prends pour que tout ce qui se rapporte à mes recherches reste secret. Je te le dis franchement. D’abord pour que tu voies la tâche à laquelle je t’associe : rendre un fils à son père ; et je suis certain que tu as assez de cœur pour t’y employer fidèlement. Et puis je t’en parle encore, parce que ç’a toujours été ma règle de vie d’aller droit à mon but, en disant franchement où je vais ; quelquefois les malins n’ont pas voulu me croire et ont supposé que je jouais au fin ; ils en ont toujours été punis. On a déjà tenté de te circonvenir ; on le tentera encore, cela est probable, et de différents côtés ; te voilà prévenue, c’est tout ce que je devais faire. »
Ils étaient arrivés en vue des cheminées de l’usine de Hercheux, de toutes la plus éloignée de Maraucourt ; encore quelques tours de roues, ils entraient dans le village.
Perrine, bouleversée, frémissante, cherchait des paroles pour répondre et ne trouvait rien, l’esprit paralysé par l’émotion, la gorge serrée, les lèvres sèches :
« Et moi, s’écria-t-elle enfin, je dois vous dire que je suis à vous, monsieur, de tout cœur. »


XXXII
Le soir, la tournée des usines achevée, au lieu de revenir aux bureaux comme c’était la coutume, M. Vulfran dit à Perrine de le conduire directement au château ; et pour la première fois elle franchit la magnifique grille dorée, chef-d’œuvre de serrurerie, qu’un roi n’avait pas pu se donner à l’une des dernières expositions, racontait-on, mais que le riche industriel n’avait pas trouvé trop cher pour sa maison de campagne.
« Suis la grande allée circulaire », dit M. Vulfran.
Pour la première fois aussi elle vit de près les massifs de fleurs que jusque-là elle n’avait aperçus que de loin, formant des taches rouges ou roses sur le velours foncé des gazons tondus ras. Habitué à faire ce chemin, Coco le montait d’un pas tranquille et, sans avoir besoin de le conduire, elle pouvait poser ses regards à droite et à gauche, sur les corbeilles, ou les plantes et les arbustes que leur beauté rendait dignes d’être isolés en belle vue ; car bien que leur maître ne pût plus les admirer comme naguère, rien n’avait été changé dans l’ordonnance des jardins, aussi soigneusement entretenus, aussi dispendieusement ornés qu’au temps où, chaque matin et chaque soir, il les passait en revue avec fierté.
De lui-même, Coco s’arrêta devant le large perron, où un vieux domestique, prévenu par le coup de cloche du concierge, attendait.
« Bastien, tu es là ? demanda M. Vulfran sans descendre.
— Oui, monsieur.
— Tu vas conduire cette jeune personne à la chambre des papillons qui sera la sienne, et tu veilleras à ce qu’on lui donne tout ce qui peut lui être nécessaire pour sa toilette ; tu mettras son couvert vis-à-vis le mien ; en passant, envoie-moi Félix qu’il me conduise aux bureaux. »
Perrine se demandait si elle était éveillée.
« Nous dînerons à huit heures, dit M. Vulfran, jusque-là tu es libre. »
Elle descendit et suivit le vieux valet de chambre, marchant éblouie, comme si elle était transportée dans un palais enchanté.
Et réellement, le hall monumental, d’où partait un escalier majestueux aux marches en marbre blanc, sur lesquelles un tapis traçait un chemin rouge, n’avait-il pas quelque chose d’un palais : à chaque palier, de belles fleurs étaient groupées avec des plantes à feuillage dans de vastes jardinières et leur parfum embaumait l’air renfermé.
Bastien la conduisit au second étage, et, sans entrer, lui ouvrit une porte :
« Je vais vous envoyer la femme de chambre », dit-il en se retirant.

Après avoir traversé une petite entrée sombre, elle se trouva dans une grande chambre très claire, tendue d’étoffe de couleur ivoire, semée de papillons aux nuances vives qui voletaient légèrement ; les meubles étaient en érable moucheté et sur le tapis gris s’enlevaient vigoureusement des gerbes de fleurs des champs : pâquerettes, coquelicots, bleuets, boutons d’or.
Que cela était frais et joli !
Elle n’était pas revenue de son émerveillement, et s’amusait encore à enfoncer, son pied dans le tapis moelleux qui le repoussait, quand la femme de chambre entra :
« Bastien m’a dit de me mettre à la disposition de mademoiselle. »
Une femme de chambre en toilette claire, coiffée d’un bonnet de tulle, aux ordres de celle qui quelques jours avant couchait dans une hutte, sur un lit de roseaux, au milieu d’un marais, avec les rats et les grenouilles : il lui fallut un certain temps pour se reconnaître.
« Je vous remercie, dit-elle enfin, mais je n’ai besoin de rien… il me semble.
— Si mademoiselle veut bien, je vais toujours lui montrer son appartement. »
Ce qu’elle appelait « montrer l’appartement », c’était ouvrir les portes d’une armoire à glace et d’un placard, ainsi que les tiroirs d’une table de toilette, tout remplis de brosses, de ciseaux, de savons et de flacons ; cela fait, elle mit la main sur un bouton posé dans la tenture :
« Celui-ci, dit-elle, est pour la sonnerie d’appel ; celui-là pour l’éclairage. »
Instantanément la chambre, l’entrée et le cabinet de toilette s’éclairèrent d’une lumière éblouissante qui, instantanément aussi, s’éteignit ; et il sembla à Perrine qu’elle était encore dans les plaines des environs de Paris, quand l’orage l’avait assaillie et que les éclairs fulgurants du ciel entr’ouvert lui montraient son chemin ou le noyaient d’ombres.
« Quand mademoiselle aura besoin de moi, elle voudra bien me sonner : un coup pour Bastien, deux coups pour moi. »
Mais ce dont « mademoiselle avait besoin », c’était d’être seule, autant pour passer la visite de sa chambre que pour se ressaisir, ayant été jetée hors d’elle-même par tout ce qui lui était arrivé depuis le matin.
Que d’événements, que de surprises en quelques heures, et qui lui eût dit le matin, quand sous les menaces de Théodore et de Talouel, elle se voyait en si grand danger, que le vent, au contraire, allait si favorablement tourner pour elle ? N’y avait-il pas de quoi rire de penser que c’était leur hostilité même qui faisait sa fortune ?
Mais combien plus encore eût-elle ri si elle avait pu voir la tête du directeur en recevant M. Vulfran au bas de l’escalier des bureaux.
« Je suppose que cette jeune personne a fait quelque sottise ? dit Talouel.
— Mais non.
— Pourtant, vous vous faites ramener par Félix ?
— C’est qu’en passant je l’ai déposée au château, afin qu’elle ait le temps de se préparer pour le dîner.
— Dîner ! Je suppose… »
Il était tellement suffoqué qu’il ne trouva pas tout de suite ce qu’il devait supposer.
« Je suppose moi, dit M. Vulfran, que vous ne savez que supposer.
— … Je suppose que vous la faites dîner avec vous.
— Parfaitement. Depuis longtemps je voulais avoir près de moi quelqu’un d’intelligent, de discret, de fidèle en qui je pourrais avoir confiance. Justement cette petite fille me paraît réunir ces qualités : intelligente elle l’est, j’en suis sûr ; discrète et fidèle elle l’est aussi, j’en ai la preuve. »
Cela fut dit sans appuyer, mais cependant de façon que Talouel ne pût se méprendre sur le sens de ses paroles.
« Je la prends donc ; et comme je ne veux pas qu’elle reste exposée à certains dangers, — non pour elle, car j’ai la certitude qu’elle n’y succomberait pas, mais pour les autres, ce qui m’obligerait à me séparer de ces autres… »
Il appuya sur ce mot :
« … Quels qu’ils fussent, elle ne me quittera plus ; ici elle travaillera dans mon cabinet ; pendant le jour elle m’accompagnera, elle mangera à ma table, ce qui rendra moins tristes mes repas qu’elle égayera de son babil, et elle habitera le château. »
Talouel avait eu le temps de retrouver son calme, et comme il n’était ni dans son caractère, ni dans sa ligne de conduite de faire formellement la plus légère opposition aux idées du patron, il dit :
« Je suppose qu’elle vous donnera toutes les satisfactions, que très justement, il me semble, vous pouvez attendre d’elle.
— Je le suppose aussi. »
Pendant ce temps, Perrine, accoudée au balcon de sa fenêtre, rêvait en regardant la vue qui se déroulait devant elle : les pelouses fleuries du jardin, les usines, le village avec ses maisons et l’église, les prairies, les entailles dont l’eau argentée miroitait sous les rayons obliques du soleil qui s’abaissait et vis-à-vis de l’autre côté, le bouquet de bois où elle s’était assise, le jour de son arrivée, et où dans la brise du soir elle avait entendu passer la douce voix de sa mère qui murmurait : « Je te vois heureuse ».
Elle avait pressenti l’avenir la chère maman, et les grandes marguerites traduisant l’oracle qu’elle leur dictait, avaient aussi dit vrai : heureuse, elle commençait à l’être ; et si elle n’avait pas encore réussi tout à fait, ni même beaucoup, au moins devait-elle reconnaître qu’elle était en passe de réussir plus qu’un peu ; qu’elle fût patiente, qu’elle sût attendre, et le reste viendrait à son heure. Qui la pressait maintenant ? Ni la misère, ni le besoin dans ce château où elle était entrée si vite.
Quand le sifflet des usines annonça la sortie, elle était encore à son balcon planant dans sa rêverie, et ce furent ses coups stridents qui la ramenèrent de l’avenir dans la réalité présente. Alors du haut de l’observatoire d’où elle dominait les rues du village et les routes blanches à travers les prairies vertes et les champs jaunes, elle vit se répandre la fourmilière noire des ouvriers, qui grouillant d’abord en un gros amas compact, ne tarda pas à se diviser en plusieurs courants, à se morceler à l’infini, et à ne former bientôt plus que des petits groupes qui eux-mêmes s’évanouirent promptement ; la cloche du concierge sonna et la voiture de M. Vulfran monta l’allée circulaire au pas tranquille du vieux Coco.
Cependant elle ne quitta pas encore sa chambre, mais comme il le lui avait recommandé, elle fit sa toilette, en se livrant à une véritable débauche d’eau de Cologne aussi bien que de savon, — d’un bon savon onctueux, mousseux, tout parfumé de fines odeurs ; — et ce fut seulement quand la pendule placée sur sa cheminée sonna huit heures qu’elle descendit.
Elle se demandait comment elle trouverait la salle à manger, mais elle n’eut pas à la chercher, un domestique en habit noir, qui se tenait dans le hall, la conduisit. Presque aussitôt M. Vulfran entra ; personne ne le conduisait ; elle remarqua qu’il suivait un chemin en coutil posé sur le tapis, ce qui permettait à ses pieds de le guider et de remplacer ses yeux : une corbeille d’orchidées, au parfum suave, occupait le milieu de la table, couverte d’une lourde argenterie ciselée et de cristaux taillés dont les facettes reflétaient les éclairs de la lumière électrique qui tombait du lustre.
Un moment elle se tint debout derrière sa chaise, ne sachant trop ce qu’elle devait faire ; heureusement M. Vulfran lui vint en aide :
« Assieds-toi. »
Aussitôt le service commença, et le domestique qui l’avait amenée posa une assiette de potage devant elle, tandis que Bastien en apportait une autre à son maître, celle-là pleine jusqu’au bord.
Elle eût dîné seule avec M. Vulfran qu’elle se fût trouvée à son aise ; mais sous les regards curieux, quoique dignes, des deux valets de chambre qu’elle sentait ramassés sur elle, pour voir sans doute comment mangeait une petite bête de son espèce, elle se sentait intimidée, et cet examen n’était pas sans la gêner un peu dans ses mouvements.
Cependant elle eut la chance de ne pas commettre de maladresse.
« Depuis ma maladie, dit M. Vulfran, j’ai l’habitude de manger deux soupes, ce qui est plus commode pour moi, mais tu n’es pas tenue, toi qui vois clair, d’en faire autant.
— J’ai été si longtemps privée de soupe, que j’en mangerais bien deux fois aussi. »
Mais ce ne fut pas une assiette du même potage qu’on leur servit, ce fut une nouvelle soupe, aux choux celle-là, avec des carottes et des pommes de terre, aussi simple que celle d’un paysan.
Au reste, le dîner garda en tout, excepté pour le dessert, cette simplicité, se composant d’un gigot avec des petits pois et d’une salade ; mais pour le dessert il comprenait quatre assiettes à pied avec des gâteaux et quatre compotiers chargés de fruits admirables, dignes par leur grosseur et leur beauté, des fleurs du surtout.
« Demain tu iras, si tu le veux, visiter les serres qui ont produit ces fruits, » dit M. Vulfran.
Elle avait commencé par se servir discrètement quelques cerises, mais M. Vulfran voulut qu’elle prît aussi des abricots, des pêches et du raisin.
« À ton âge, j’aurais mangé tous les fruits qui sont sur la table… si on me les avait offerts. »
Alors Bastien, bien disposé par cette parole, voulut mettre sur l’assiette « de cette petite bête », comme il l’eût fait pour un singe savant, un abricot et une pêche qu’il choisit avec la compétence d’un connaisseur, quittant pour cela la place qu’il occupait derrière la chaise de M. Vulfran.
Malgré les fruits, Perrine fut bien aise de voir le dîner prendre fin ; plus l’épreuve serait courte, mieux cela vaudrait, le lendemain la curiosité satisfaite des domestiques la laisserait tranquille sans doute.
« Maintenant tu es libre jusqu’à demain matin, dit M. Vulfran en se levant de table, tu peux te promener dans le jardin au clair de la lune, lire dans la bibliothèque ou emporter un livre dans ta chambre. »
Elle était embarrassée, se demandant si elle ne devait pas proposer à M. Vulfran de se tenir à sa disposition. Comme elle restait hésitante, elle vit Bastien lui faire des signes silencieux que tout d’abord elle ne comprit pas : de la main gauche il paraissait tenir un livre qu’il feuilletait de la droite, puis, s’interrompant, il montrait M. Vulfran en remuant les lèvres avec une physionomie animée. Tout à coup elle crut qu’il lui expliquait qu’elle devait demander à M. Vulfran de lui faire la lecture ; mais comme elle avait déjà eu cette idée, elle eut peur de traduire la sienne plutôt que celle de Bastien ; cependant elle se risqua :
« Mais n’avez-vous pas besoin de moi, monsieur ? Ne voulez-vous pas que je vous fasse la lecture ? »
Elle eut la satisfaction de voir Bastien l’applaudir par de grands mouvements de tête : elle avait deviné, c’était bien cela qu’elle devait dire.
« Il convient que quand on travaille, on ait ses heures de liberté, répondit M. Vulfran.
— Je vous assure que je ne suis pas fatiguée du tout.
— Alors, dit-il, suis-moi dans mon cabinet. »
C’était une vaste pièce sombre, qu’un vestibule séparait de la salle à manger, et à laquelle conduisait un chemin en toile qui permettait à M. Vulfran de marcher franchement, puisqu’il ne pouvait s’égarer et qu’il avait dans la tête comme dans les jambes le juste sentiment des distances.
Perrine s’était plus d’une fois demandé à quoi M. Vulfran passait son temps lorsqu’il était seul, puisqu’il ne pouvait pas lire ; mais cette pièce, lorsqu’il eut pressé un bouton d’éclairage, ne répondit rien à cette question ; pour meubles, une grande table chargée de papiers, des cartonniers, des sièges, et c’était tout ; devant une fenêtre un grand fauteuil voltaire, mais sans rien autour. Cependant l’usure de la tapisserie qui le recouvrait, semblait indiquer que M. Vulfran devait y rester assis pendant de longues heures, en face du ciel dont il ne voyait même pas les nuages.
« Que me lirais-tu bien ? » demanda-t-il.
Des journaux étaient sur la table enveloppés de leurs bandes multicolores.
« Un journal, si vous voulez.
— Moins on donne de temps aux journaux, mieux cela vaut. »
Elle n’avait rien à répondre, n’ayant dit cela que pour proposer quelque chose.
« Aimes-tu les livres de voyage ? demanda-t-il.
— Oui, monsieur.
— Moi aussi ; ils amusent l’esprit en le faisant travailler. »
Puis, comme s’il se parlait à lui-même, sans qu’elle fût là pour l’entendre :
« Sortir de soi, vivre d’autres vies que la sienne. »
Mais après un moment de silence, revenant à elle :
« Allons dans la bibliothèque, » dit-il.
Elle communiquait avec le cabinet, il n’eut qu’une porte à ouvrir et, pour l’éclairer, qu’un bouton à pousser ; mais comme une seule lampe s’alluma, la grande salle aux armoires de bois noir resta dans l’ombre.
« Connais-tu le Tour du Monde ? demanda-t-il.
— Non, monsieur.
— Eh bien, nous trouverons dans la table alphabétique des indications qui nous guideront. »
Il la conduisit à l’armoire qui contenait cette table, et lui dit de la chercher, ce qui demanda un certain temps ; à la fin cependant elle mit la main dessus.
« Que dois-je chercher ? dit-elle.
— À l’I, le mot Inde. »
Ainsi il suivait toujours sa pensée, et n’avait nullement l’idée de vivre la vie des autres comme il avait semblé en exprimer le désir, car ce qu’il voulait certainement, c’était vivre celle de son fils, en lisant la description des pays où il le faisait rechercher.
« Que vois-tu ? dis.
— L’Inde des Rajahs, voyage dans les royaumes de l’Inde centrale et dans la présidence du Bengale, 1871², 209 à 288.
— Cela veut dire que dans le deuxième volume de 1871 à la page 209, nous trouverons le commencement de ce voyage ; prends ce volume et rentrons dans mon cabinet. »
Mais quand elle eut atteint ce volume sur une planche basse, au lieu de se relever, elle resta à regarder un portrait placé au-dessus de la cheminée, que ses yeux qui peu à peu étaient habitués à la demi-obscurité, venaient d’apercevoir.
« Qu’as-tu ? » demanda-t-il.
Franchement elle répondit, mais d’une voix émue.
« Je regarde le portrait placé au-dessus de la cheminée.
— C’est celui de mon fils à vingt ans, mais tu dois bien mal le voir, je vais l’éclairer. »
Allant à la boiserie, il pressa un bouton, et un foyer de petites lampes placé au haut du cadre et en avant du portrait l’inonda de lumière.
Perrine qui s’était relevée pour se rapprocher de quelques pas, poussa un cri et laissa tomber le volume du Tour du monde.
« Qu’as-tu donc ? » dit-il.
Mais elle ne pensa pas à répondre, et resta les yeux attachés sur le jeune homme blond, vêtu d’un costume de chasse en velours vert, coiffé d’une casquette haute à large visière, appuyé d’une main sur un fusil et de l’autre flattant la tête d’un épagneul noir, qui venait de jaillir du mur comme une apparition vivante. Elle était frémissante de la tête aux pieds, et un flot de larmes coulait sur son visage, sans qu’elle eût l’idée de les retenir, emportée, abîmée dans sa contemplation.
Ce furent ses larmes qui, dans le silence qu’elle gardait, trahirent son émoi.
« Pourquoi pleures-tu ? »
Il fallait qu’elle répondît ; par un effort suprême elle tâcha de se rendre maîtresse de ses paroles, mais en les entendant elle sentit toute leur incohérence :
« C’est ce portrait… votre fils… vous son père… »
Il resta un moment ne comprenant pas, attendant, puis avec un accent que la compassion attendrissait :
« Et tu as pensé au tien ?
— Oui, monsieur…, oui, monsieur.
— Pauvre petite ! »


XXXIII
Quelle surprise le lendemain matin, quand en entrant dans le cabinet de leur oncle pour le dépouillement du courrier, les deux neveux toujours en retard, virent Perrine installée à sa table comme si elle ne devait pas en démarrer.
Talouel s’était bien gardé de les prévenir, mais il s’était arrangé de façon à se trouver là quand ils arriveraient, et à se « payer leur tête ».
Elle fut tout à fait drôle, et par là réjouissante pour lui ; car s’il était furieux de l’intrusion de cette mendiante, qui du jour au lendemain, sans protection, sans rien pour elle, s’imposait à la faiblesse sénile d’un vieillard, au moins était-ce une compensation de voir que les neveux éprouvaient une fureur égale à la sienne. Qu’ils étaient donc amusants en jetant sur elle des regards impatients dans lesquels il y avait autant de colère que de surprise. Évidemment ils ne comprenaient rien à sa présence dans ce cabinet sacré, où eux-mêmes ne restaient que juste le temps nécessaire pour écouter les explications que leur oncle avait à leur donner, ou pour rapporter les affaires dont ils étaient chargés. Et les coups d’œil qu’ils échangeaient en se consultant sans oser prendre un parti, sans même oser risquer une observation ou une question le faisaient rire sans qu’il prît la peine de leur cacher sa satisfaction et sa moquerie, car si une guerre ouverte n’était pas déclarée entre eux, il y avait beaux jours qu’ils savaient à quoi s’en tenir les uns et les autres, sur leurs sentiments réciproques nés des secrètes espérances que chacun nourrissait de son côté : Talouel contre les neveux ; les neveux contre Talouel ; ceux-ci l’un contre l’autre.
Ordinairement Talouel se contentait de leur marquer son hostilité par des sourires ironiques ou des silences méprisants sous une forme de politesse humble, mais ce jour-là il ne put pas résister à l’envie de leur jouer une comédie de sa façon qui lui donnerait quelques instants d’agrément : ah ! ils le prenaient de haut avec lui parce qu’ils se croyaient tous les droits en vertu de leur naissance, — neveux bien au-dessus de directeur ; l’un parce qu’il était fils d’un frère, l’autre fils d’une sœur du patron, tandis que lui qui n’était que fils de ses œuvres, avait de toutes ses forces travaillé au succès de la glorieuse maison qui pour une part, une grosse part, était sienne, eh bien ! ils allaient voir. Ah ! ah !
Il sortit avec eux, et bien qu’ils parussent pressés de rentrer dans leurs bureaux pour se communiquer leurs impressions et sans doute voir ce qu’ils avaient à faire contre l’intruse d’un signe auquel ils obéirent, — ce qui était déjà un triomphe, — il les emmena sous sa vérandah d’où le bruit des voix contenues ne pouvait pas arriver jusqu’au bureau de M. Vulfran.
« Vous avez été étonnés de voir cette… petite installée dans le bureau du patron », dit-il.
Ils ne crurent pas devoir répondre, ne pouvant pas plus reconnaître leur étonnement que le nier.
« Je l’ai bien vu, dit-il en appuyant ; si vous n’étiez pas arrivés en retard ce matin, j’aurais pu vous prévenir pour que vous vous tinssiez mieux. »
Ainsi il leur donnait une double leçon : — la première, en constatant qu’ils étaient en retard ; la seconde, en leur disant, lui qui n’avait passé ni par l’École polytechnique, ni par les collèges, que leur tenue avait manqué de correction. Peut-être la leçon était-elle un peu grossière, mais son éducation l’autorisait à n’en pas chercher une plus fine. D’ailleurs les circonstances lui permettaient de ne pas se gêner avec eux : quoi qu’il dît ils l’écouteraient ; et il en usait.
Il continua :
« Hier M. Vulfran m’a averti qu’il installait cette petite au château, et que désormais elle travaillerait dans son cabinet.
— Mais quelle est cette petite ?
— Je vous le demande. Moi je ne sais pas ; M. Vulfran non plus, je crois bien.
— Alors ?
— Alors il m’a expliqué que depuis longtemps il voulait avoir près de lui quelqu’un d’intelligent, de discret, de fidèle, en qui il pourrait avoir pleine confiance.
— Ne nous a-t-il pas ? interrompit Casimir.
— C’est justement ce que je lui ai dit : N’avez-vous pas M. Casimir, M. Théodore ? M. Casimir, un élève de l’École polytechnique, où il a tout appris, en théorie s’entend, qui pour l’X ne craint personne, enfin qui vous est si attaché ; M. Théodore qui connaît la vie et le commerce pour avoir passé ses premières années auprès de ses parents, dans des difficultés qui pour sûr l’ont formé, et qui d’autre part a pour vous tant d’affection. Est-ce que tous deux ne sont pas intelligents, discrets, fidèles, et ne pouvez-vous pas avoir toute confiance en eux ? Est-ce qu’ils pensent à autre chose qu’à vous soulager, vous aider, vous débarrasser du tracas des affaires en bons neveux, bien affectueux, bien reconnaissants qu’ils sont, et bien unis, unis comme de vrais frères qui n’ont qu’un même cœur, parce qu’ils n’ont qu’un même but. »
Malgré l’envie qu’il en avait, il n’appuyait pas sur chaque mot caractéristique, mais au moins en soulignait-il l’ironie par un sourire gouailleur, qu’il adressait à Théodore quand il parlait de la supériorité de Casimir dans la science de l’X, et à Casimir quand il glissait sur les difficultés commerciales de la famille de Théodore ; à tous les deux, quand il insistait sur leur fraternité de cœur qui n’avait qu’un même but.
« Savez-vous ce qu’il me répondit ? » continua-t-il.
Il eût bien voulu faire une pause, mais de peur qu’ils ne lui tournassent le dos avant qu’il eût tout dit, vivement il continua :
« Il me répondit : « Ah ! mes neveux ! » Qu’est-ce que cela voulait dire ? Vous pensez bien que je ne me suis pas permis de le chercher : je vous le répète simplement. Et tout de suite j’ajoute ce qu’il me dit encore, pour expliquer sa détermination de la prendre au château et de l’installer dans son bureau, que c’était parce qu’il ne voulait pas qu’elle restât exposée à certains dangers, — non pour elle, car il avait la certitude qu’elle n’y succomberait pas ; mais pour les autres, ce qui l’obligerait à se séparer de ces autres, quels qu’ils fussent. Je vous donne ma parole que je vous répète ce qu’il m’a dit mot pour mot. Maintenant, quels sont ces autres, je vous le demande. »
Comme ils ne répondaient pas, il insista :
« À qui a-t-il voulu faire allusion ? Où voit-il des autres qui pourraient faire courir des dangers à cette petite ? Quels dangers ? Toutes questions incompréhensibles, mais que justement pour cela j’ai cru devoir vous soumettre, à vous, messieurs qui, en l’absence de M. Edmond, vous trouvez placés, par votre naissance, à la tête de cette maison. »
Il avait assez joué avec eux comme le chat avec la souris, pourtant il crut pouvoir une fois encore les faire sauter en l’air d’un vigoureux coup de patte :
« Il est vrai que M. Edmond peut revenir d’un moment à l’autre, demain peut-être, au moins si l’on s’en rapporte à toutes les recherches que M. Vulfran fait faire, fiévreusement, comme s’il brûlait sur une bonne piste.
— Savez-vous donc quelque chose ? » demanda Théodore qui n’eut pas la dignité de retenir sa curiosité.
« Rien autre chose que ce que je vois ; c’est-à-dire que M. Vulfran ne prend cette petite que pour lui traduire les lettres et les dépêches qu’il reçoit des Indes. »
Puis avec une bonhomie affectée :
« C’est tout de même malheureux que vous, M. Casimir, qui avez tout appris vous ne sachiez pas l’anglais. Ça vous tiendrait au courant de ce qui se passe. Sans compter que ça vous débarrasserait de cette petite, qui est en train de prendre au château une place à laquelle elle n’a pas droit. Il est vrai que vous trouverez peut-être un autre moyen, et meilleur que celui-ci pour en arriver là ; et si je peux vous aider, vous savez que vous pouvez compter sur moi… sans paraître en rien bien entendu. »
Tout en parlant il jetait de temps en temps et à la dérobée un rapide coup-d’œil dans les cours, plutôt par force d’habitude que par besoin immédiat ; à ce moment, il vit venir le facteur du télégraphe qui, sans se presser, musait à droite et à gauche.
« Justement, dit-il, voilà qu’arrive une dépêche qui est peut-être la réponse à celle qui a été envoyée à Dakka. C’est tout de même ennuyeux pour vous, que vous ne puissiez pas savoir ce qu’elle contient, de façon à être les premiers à annoncer au patron le retour de son fils. Quelle joie, hein ? Moi, mes lampions sont prêts pour illuminer. Mais voilà, vous ne savez pas l’anglais, et cette petite le sait, elle. »
Quelque regret qu’il eût à mettre un pas devant l’autre, le porteur de dépêches était enfin arrivé au bas de l’escalier ; vivement Talouel alla au-devant de lui :
« Eh bien, tu sais, toi, tu ne t’amènes pas trop vite, dit-il.
— Faut-il s’en faire mourir ? »
Sans répondre, Talouel prit la dépêche, et la porta à M. Vulfran avec un empressement bruyant.
« Voulez-vous que je l’ouvre ? demanda-t-il.
— Parfaitement. »
Mais il n’eut pas déchiré le papier dans la ligne pointillée, qu’il s’écria :
« Elle est en anglais.
— Alors c’est l’affaire d’Aurélie », dit M. Vulfran avec un geste auquel le directeur ne pouvait pas ne pas obéir.
Aussitôt que la porte fut refermée, elle traduisit la dépêche :
« L’ami, Leserre, négociant français, dernières nouvelles cinq ans ; Dehra, révérend père Mackerness, lui écris selon votre désir. »
— Cinq ans, s’écria M. Vulfran, qui tout d’abord ne fut sensible qu’à cette indication ; que s’est-il passé depuis cette époque, et comment suivre une piste après cinq années écoulées ? »
Mais il n’était pas homme à se perdre dans des plaintes inutiles ; ce fut ce qu’il expliqua, lui-même :
« Les regrets n’ont jamais changé les faits accomplis ; tirons parti plutôt de ce que nous avons ; tu vas tout de suite faire une dépêche en français pour ce M. Leserre puisqu’il est Français, et une en anglais pour le père Mackerness. »
Elle écrivit couramment la dépêche qu’elle devait traduire en anglais, mais pour celle qui devait être déposée en français au télégraphe elle s’arrêta dès la première ligne, et demanda la permission d’aller chercher un dictionnaire dans le bureau de Bendit.
« Tu n’es pas sûre de ton orthographe ?
— Oh ! pas du tout sûre, monsieur, et je voudrais bien qu’au bureau on ne pût pas se moquer d’une dépêche envoyée par vous.
— Alors tu n’es pas en état d’écrire une lettre sans fautes ?
— Je suis sûre de l’écrire avec beaucoup de fautes ; le commencement des mots va à peu près, mais pas la fin, quand il y a des accords, et puis les doubles lettres ne vont pas du tout non plus, et beaucoup d’autres choses encore ; bien plus facile à écrire l’anglais que le français. J’aime mieux vous avouer cela tout de suite, franchement.
— Tu n’as jamais été à l’école ?
— Jamais. Je ne sais que ce que mon père et ma mère m’ont appris, au hasard des routes, quand on avait le temps de s’asseoir, ou qu’on restait au repos dans un pays ; alors ils me faisaient travailler ; mais pour dire vrai, je n’ai jamais beaucoup travaillé.
— Tu es une bonne fille de me parler franchement ; nous verrons à remédier à cela ; pour le moment occupons-nous de ce que nous avons à faire. »
Ce fut seulement dans l’après-midi, en voiture, quand ils firent la visite des usines, que M. Vulfran revint à la question de l’orthographe.
« As-tu écrit à tes parents ?
— Non, monsieur.
— Pourquoi ?
— Parce que je ne désire rien tant que rester ici à jamais, près de vous qui me traitez avec tant de bonté, et me faites une vie si heureuse.
— Alors tu désires ne pas me quitter ?
— Je voudrais vous prouver chaque jour, pour tout, dans tout, ce qu’il y a de reconnaissance dans mon cœur,… et aussi d’autres sentiments respectueux que je n’ose exprimer.
— Puisqu’il en est ainsi, le mieux est peut-être, en effet, que tu n’écrives pas, au moins pour le moment ; nous verrons plus tard. Mais afin que tu puisses m’être utile, il faut que tu travailles, et te mettes en état de me servir de secrétaire pour beaucoup d’affaires, dans lesquelles tu dois écrire convenablement, puisque tu écris en mon nom. D’autre part il est convenable aussi pour toi, il est bon que tu t’instruises. Le veux-tu ?
— Je suis prête à tout ce que vous voudrez, et je vous assure que je n’ai pas peur de travailler.
— S’il en est ainsi, les choses peuvent s’arranger sans que je me prive de tes services. Nous avons ici une excellente institutrice, en rentrant je lui demanderai de te donner des leçons quand sa classe est finie, de six à huit heures, au moment où je n’ai plus besoin de toi. C’est une très bonne personne qui n’a que deux défauts : sa taille, elle est plus grande que moi, et plus large d’épaules, — plus massive bien qu’elle n’ait pas quarante ans, — et son nom, Mlle Belhomme, qui crie d’une façon fâcheuse, ce qu’elle est réellement : un bel homme sans barbe, et encore n’est-il pas certain qu’on ne lui en trouverait point en regardant bien. Pourvue d’une instruction supérieure, elle a commencé par des éducations particulières, mais sa prestance d’ogre faisait peur aux petites filles, tandis que son nom faisait rire les mamans et les grandes sœurs. Alors elle a renoncé au monde des villes, et bravement elle est entrée dans l’instruction primaire où elle a beaucoup réussi ; ses classes tiennent la tête parmi celles de notre département ; ses chefs la considèrent comme une institutrice modèle. Je ne ferais pas venir d’Amiens une meilleure maîtresse pour toi ! »
La tournée des usines terminée, la voiture s’arrêta devant l’école primaire des filles, et Mlle Belhomme accourut auprès de M. Vulfran, mais il tint à descendre et à entrer chez elle pour lui exposer sa demande. Alors Perrine qui les suivit, put l’examiner : c’était bien la femme géante dont M. Vulfran avait parlé, imposante, mais avec un mélange de dignité et de bonté qui n’aurait nullement donné envie de se moquer d’elle, si elle n’avait pas eu un air craintif en désaccord avec sa prestance.
Bien entendu, elle n’avait rien à refuser au tout-puissant maître de Maraucourt, mais eût-elle eu des empêchements qu’elle s’en serait dégagée, car elle avait la passion de l’enseignement qui, à vrai dire, était son seul plaisir dans la vie, et puis d’autre part cette petite aux yeux profonds lui plaisait :
« Nous en ferons une fille instruite, dit-elle, cela est certain, savez-vous qu’elle a des yeux de gazelle ? Il est vrai que je n’ai jamais vu des gazelles, et pourtant je suis sûre qu’elles ont ces yeux-là. »
Mais ce fut bien autre chose le surlendemain quand après deux jours de leçons, elle put se rendre compte de ce qu’était la gazelle, et que M. Vulfran en rentrant au château au moment du dîner, lui demanda ce qu’elle en pensait.
« Quelle catastrophe c’eût été, — Mlle Belhomme employait volontiers des mots grands et forts comme elle, — quelle catastrophe c’eût été que cette jeune fille restât sans culture.
— Intelligente, n’est-ce pas ?
— Intelligente ! Dites intelligentissime, si j’ose m’exprimer ainsi.
— L’écriture ? demanda M. Vulfran qui dirigeait son interrogatoire d’après les besoins qu’il avait de Perrine.
— Pas brillante, mais elle se formera.
— L’orthographe ?
— Faible.
— Alors ?
— J’aurais pu, pour la juger, lui faire faire une dictée qui m’aurait montré précisément son écriture et son orthographe ; mais cela seulement. J’ai voulu prendre d’elle une meilleure opinion, et je lui ai demandé une petite narration sur Maraucourt ; en vingt lignes, ou cent lignes, me dire ce qu’était le pays, comment elle le voyait. En moins d’une heure, au courant de la plume, sans chercher ses mots elle m’a écrit quatre grandes pages vraiment extraordinaires : tout s’y trouve réuni, le village lui-même, les usines, le paysage général, l’ensemble aussi bien que le détail ; il y a une page sur les entailles avec leur végétation, leurs oiseaux et leurs poissons, leur aspect dans les vapeurs du matin et l’air pur du soir, que j’aurais cru copiée dans un bon auteur, si je ne l’avais vu écrire. Par malheur la calligraphie et l’orthographe sont ce que je vous ai dit, mais qu’importe, c’est une affaire de quelques mois de leçons, tandis que toutes les leçons du monde ne lui apprendraient pas à écrire, si elle n’avait pas reçu le don de voir et de sentir, et aussi de rendre ce qu’elle voit et ce qu’elle sent. Si vous en avez le loisir, faites-vous lire cette page sur les entailles, elle vous prouvera que je n’exagère pas. »
Alors, M. Vulfran que cette appréciation avait mis en belle humeur, car elle calmait les objections qui lui étaient venues sur son prompt engouement pour cette petite, raconta à Mlle Belhomme comment Perrine avait habité une aumuche dans l’une de ces entailles, et comment avec rien, si ce n’est ce qu’elle trouvait sous sa main, elle avait su se fabriquer des espadrilles, et toute une batterie de cuisine dans laquelle elle avait préparé un dîner complet, fourni par l’entaille elle-même, ses oiseaux, ses poissons, ses fleurs, ses herbes, ses fruits.
Le large visage de Mlle Belhomme s’était épanoui pendant ce récit, qui sans aucun doute l’intéressait, puis quand M. Vulfran avait cessé de parler, elle avait gardé elle-même le silence, réfléchissant :
« Ne trouvez-vous pas, dit-elle enfin, que savoir créer ce qui est nécessaire à ses besoins est une qualité maîtresse, enviable entre toutes ?
— Assurément, et c’est cela même qui m’a tout d’abord frappé chez cette jeune fille, cela et la volonté ; dites-lui de vous conter son histoire, vous verrez ce qu’il lui a fallu d’énergie pour arriver jusqu’ici.
— Elle a reçu sa récompense, puisqu’elle vous a intéressé cette jeune fille.
— Intéressé, et même attaché, car je n’estime rien tant dans la vie que la volonté à qui je dois d’être ce que je suis. C’est pourquoi je vous demande de la fortifier chez elle par vos leçons, car si l’on dit avec raison qu’on peut ce qu’on veut, au moins est-ce à condition de savoir vouloir, ce qui n’est pas donné à tout le monde, et ce qu’on devrait bien

commencer par enseigner, si toutefois il est des méthodes pour cela ; mais en fait d’instruction, on ne s’occupe que de l’esprit, comme si le caractère ne devait point passer avant. Enfin, puisque vous avez une élève douée de ce côté, je vous prie de vous appliquer à le développer. »
Mlle Belhomme était aussi incapable de dire une chose par flatterie, que de la taire par timidité ou embarras :
« L’exemple fait plus que les leçons, dit-elle, c’est pourquoi elle apprendra à votre école mieux qu’à la mienne, et en voyant que malgré la maladie, les années, la fortune, vous ne vous relâchez pas une minute dans ce que vous considérez comme l’accomplissement d’un devoir, son caractère se développera dans le sens que vous désirez : en tout cas je ne manquerais pas de m’y employer, si elle passait insensible ou indifférente, — ce qui m’étonnerait bien, — à côté de ce qui doit la frapper. »
Et comme elle était femme de parole, elle ne manqua pas en effet une occasion de citer M. Vulfran, ce qui l’amenait à parler de lui-même pour ce qui n’était pas rigoureusement indispensable à sa leçon, entraînée bien souvent, sans s’en apercevoir, par les adroites questions de Perrine.
Assurément elle s’appliquait à écouter Mlle Belhomme sans distraction, même quand il fallait la suivre dans l’explication des règles de « l’accord des adjectifs considérés dans leurs rapports avec les substantifs », ou celle « du participe passé dans les verbes actifs, passifs, neutres, pronominaux, soit essentiels, soit accidentels, et dans les verbes impersonnels » ; mais combien plus encore ses yeux de gazelle trahissaient-ils d’intérêt, quand elle pouvait amener l’entretien sur M. Vulfran, et particulièrement sur certains points inconnus d’elle, ou mal connus par les histoires de Rosalie qui n’étaient jamais très précises, ou par les propos de Fabry et de Mombleux, énigmatiques à dessein, avec les lacunes, les sous-entendus de gens qui parlent pour eux, non pour ceux qui peuvent les écouter, et même avec le souci que ceux-là ne les comprennent point.
Plusieurs fois elle avait demandé à Rosalie ce qu’avait été la maladie de M. Vulfran, et comment il était devenu aveugle, mais sans jamais en tirer que des réponses vagues ; au contraire avec Mlle Belhomme elle eut tous les détails qu’elle pouvait désirer sur la maladie elle-même, et sur la cécité qui, disait-on, pouvait n’être pas incurable, mais qui ne serait guérie, si on la guérissait, que dans certaines conditions particulières qui assureraient le succès de l’opération.
Comme tout le monde à Maraucourt, Mlle Belhomme s’était préoccupée de la santé de M. Vulfran, et elle en avait assez souvent parlé avec le docteur Ruchon pour être en état de satisfaire la curiosité de Perrine d’une façon autrement compétente que Rosalie.
C’était d’une cataracte double que M. Vulfran était atteint. Mais cette cataracte ne paraissait pas incurable, et la vue pouvait être recouvrée par une opération. Si cette opération n’avait pas encore été tentée, c’était parce que sa santé générale ne l’avait pas permis. En effet, il souffrait d’une bronchite invétérée qui se compliquait de congestions pulmonaires répétées, et qu’accompagnaient des étouffements, des palpitations, des mauvaises digestions, un sommeil agité. Pour que l’opération devînt possible, il fallait commencer par guérir la bronchite, et d’autre part il fallait que tous les autres accidents disparussent. Or, M. Vulfran était un détestable malade qui commettait imprudence sur imprudence, et se refusait à suivre exactement les prescriptions du médecin. À la vérité cela ne lui était pas toujours facile : comment pouvait-il rester calme, ainsi que le recommandait M. Ruchon, quand la disparition de son fils et les recherches qu’il faisait faire à ce sujet, le jetaient à chaque instant dans des accès d’inquiétude ou de colère, qui engendraient une fièvre constante dont il ne se guérissait que par le travail ? Tant qu’il ne serait pas fixé sur le sort de son fils, il n’y aurait pas de chance pour l’opération, et on la différerait. Plus tard deviendrait-elle possible ? On n’en savait rien, et on resterait dans cette incertitude tant que par des bons soins l’état de M. Vulfran ne serait pas assez assuré pour décider les oculistes.
Mettre Mlle Belhomme sur le compte de M. Vulfran et la faire parler était en somme assez facile pour Perrine, mais il n’en avait pas été de même lorsqu’elle avait voulu compléter ce que la conversation de Fabry et de Mombleux lui avait appris sur les secrètes espérances des neveux, aussi bien que sur celles de Talouel. Ce n’était point une sotte que l’institutrice, il s’en fallait de tout, et elle ne se laisserait interroger ni directement ni indirectement sur un pareil sujet.
Que Perrine fût curieuse de savoir ce qu’était la maladie de M. Vulfran, dans quelles conditions elle s’était produite, et quelles chances il y avait pour qu’il recouvrât la vue un jour ou ne la recouvrât point, il n’y avait rien que de naturel et même de légitime à ce qu’elle se préoccupât de la santé de son bienfaiteur.
Mais qu’elle montrât la même curiosité pour les intrigues des neveux et celles de Talouel, dont on parlait dans le village, voilà qui certainement ne serait pas admissible. Est-ce que ces choses-là regardent les petites filles ? Est-ce un sujet de conversation entre une maîtresse et son élève ? Est-ce avec des histoires et des bavardages de ce genre qu’on forme le caractère d’une enfant ?
Elle aurait donc dû renoncer à tirer quoi que ce fût de l’institutrice à cet égard, si une visite à Maraucourt de Mme Bretoneux, la mère de Casimir, n’était venue ouvrir les lèvres de Mlle Belhomme, qui seraient certainement restées closes.
Avertie de cette visite par M. Vulfran, Perrine en fit part à Mlle Belhomme en lui disant que la leçon du lendemain serait peut-être dérangée, et, du moment où elle eut reçu cette nouvelle l’institutrice montra une préoccupation tout à fait extraordinaire chez elle, car c’était une de ses qualités de ne se laisser distraire par rien, et de tenir son élève constamment en main comme le cavalier qui doit faire franchir à sa monture un passage périlleux tout plein de dangers.
Qu’avait-elle donc ? Ce fut seulement peu de temps avant son départ, que Perrine eut une réponse à cette question qui vingt fois s’était posée à son esprit.
« Ma chère enfant, dit Mlle Belhomme en baissant la voix, je dois vous donner le conseil de vous montrer discrète et réservée demain avec la dame dont la visite vous est annoncée.
— Discrète, à propos de quoi ? réservée en quoi et comment ?
— Ce n’est pas seulement de votre instruction que je suis chargée par M. Vulfran, c’est aussi de votre éducation, voilà pourquoi je vous adresse ce conseil, dans votre intérêt, comme dans l’intérêt de tous.
— Je vous en prie, mademoiselle, expliquez-moi ce que je dois faire, car je vous assure que je ne comprends pas du tout ce qu’exige le conseil que vous me donnez, et tel qu’il est, il m’effraie.
— Bien que vous ne soyez que depuis peu à Maraucourt, vous devez savoir que la maladie de M. Vulfran et la disparition de M. Edmond sont une cause d’inquiétude pour tout le pays.
— Oui, mademoiselle, j’ai entendu parler de cela.
— Que deviendraient les usines dont vivent sept mille ouvriers, sans compter ceux qui vivent eux-mêmes de ces ouvriers, si M. Vulfran mourait et si M. Edmond ne revenait pas ? Vous devez sentir que ces questions ne se sont pas posées sans éveiller des convoitises. M. Vulfran en léguerait-il la
direction à ses deux neveux ; ou bien à un seul qui lui inspirerait plus de confiance que l’autre ; ou bien encore à celui qui depuis vingt ans a été son bras droit et qui ayant dirigé avec lui cette immense machine, est peut-être plus que personne
en situation et en état de ne pas la laisser péricliter ? Quand M. Vulfran a fait venir son neveu M. Théodore, on a cru qu’il désignait ainsi celui-ci pour son successeur. Mais quand l’année dernière il a appelé près de lui M. Casimir au moment où celui-ci sortait de l’École des ponts et chaussées,
on a compris qu’on s’était trompé, et que le choix de M. Vulfran ne s’était encore fixé sur personne par cette raison décisive qu’il ne veut pour successeur que son fils, car malgré les querelles qui les ont séparés depuis plus de douze ans, c’est son fils seul qu’il aime d’un amour et d’un orgueil de père,
et il l’attend. M. Edmond reviendra-t-il, on n’en sait rien puisqu’on ignore s’il est vivant ou mort. Une seule personne recevait probablement de ses nouvelles, comme M. Edmond en recevait de cette personne qui n’était autre que notre ancien curé M. l’abbé Poiret ; mais M. l’abbé Poiret est mort depuis deux ans, et aujourd’hui il paraît à peu près certain qu’il est impossible de savoir à quoi s’en tenir. Pour M. Vulfran il croit, il est sûr que son fils arrivera un jour ou l’autre. Pour les personnes qui ont intérêt à ce que M. Edmond soit mort, elles croient non moins fermement, elles sont non moins sûres qu’il est mort réellement et elles manœuvrent de façon à se trouver maîtresses de la situation le jour où la nouvelle de cette mort arrivera à M. Vulfran, qu’elle pourra bien tuer d’ailleurs. Maintenant, ma chère enfant, comprenez-vous l’intérêt que vous avez, vous qui vivez dans l’intimité de M. Vulfran, à vous montrer discrète et réservée avec la mère de M. Casimir qui, de toutes les manières, travaille pour son fils aussi bien que contre ceux qui menacent celui-ci ? Si vous étiez trop bien avec elle, vous seriez mal avec la mère de
M. Théodore. De même que si vous étiez trop bien avec celle-ci quand elle viendra, ce qui certainement ne tardera pas, vous auriez pour adversaire Mme Bretoneux. Sans compter que si vous gagniez les bonnes grâces des deux, vous vous attireriez peut-être l’hostilité de celui qui a tout à redouter d’elles. Voilà pourquoi je vous recommande la plus grande circonspection.
Parlez aussi peu que possible. Et toutes les fois que vous serez interrogée de façon à ce que vous deviez malgré tout répondre, ne dites que des choses insignifiantes ou vagues ; dans la vie bien souvent on a plus d’intérêt à s’effacer qu’à briller, et à se faire prendre pour une fille un peu bête plutôt que pour une trop intelligente : c’est votre cas et moins vous paraîtrez intelligente, plus vous le serez. »


XXXIV
Ces conseils, donnés avec une bienveillance amicale, n’étaient pas pour rassurer Perrine déjà inquiète de la venue de Mme Bretoneux.
Et cependant, si sincères qu’ils fussent, ils atténuaient la vérité plutôt qu’ils ne l’exagéraient, car précisément parce que Mlle Belhomme était physiquement d’une exagération malheureuse, moralement elle était d’une réserve excessive, ne se mettant jamais en avant, ne disant que la moitié des choses, les indiquant, ne les appuyant pas, pratiquant en tout les préceptes qu’elle venait de donner à Perrine et qui étaient les siens mêmes.
En réalité la situation était encore beaucoup plus difficile que ne le disait Mlle Belhomme, et cela aussi bien par suite des convoitises qui s’agitaient autour de M. Vulfran, que par le fait des caractères des deux mères qui avaient engagé la lutte pour que leur fils héritât seul, un jour ou l’autre, des usines de Maraucourt, et d’une fortune qui s’élevait, disait-on, à plus de cent millions.
L’une, Mme Stanislas Paindavoine, femme du frère aîné de M. Vulfran, avait vécu dévorée d’envie, en attendant que son mari, grand marchand de toile de la rue du Sentier, lui gagnât l’existence brillante à laquelle ses goûts mondains lui donnaient droit, croyait-elle. Et comme ni ce mari, ni la chance n’avaient réalisé son ambition, elle continuait à se dévorer en attendant maintenant que, par son oncle, Théodore obtînt ce qui lui avait manqué à elle, et prît dans le monde parisien la situation qu’elle avait ratée.
L’autre, Mme Bretoneux, sœur de M. Vulfran, mariée à un négociant de Boulogne, qui cumulait toutes sortes de professions sans qu’elles l’eussent enrichi : agence en douane, agence et assurance maritimes, marchand de ciment et de charbons, armateur, commissionnaire-expéditeur, roulage, transports maritimes, — voulait la fortune de son frère autant pour l’amour même de la richesse, que pour l’enlever à sa belle-sœur qu’elle détestait.
Tant que M. Vulfran et son fils avaient vécu en bons rapports, elles avaient dû se contenter de tirer de leur frère ce qu’elles en pouvaient obtenir en prêts d’argent qu’on ne remboursait pas, en garanties commerciales, en influences, en tout ce qu’un parent riche est forcé d’accorder.
Mais le jour où, à la suite de prodigalités excessives et de dépenses exagérées, Edmond avait été envoyé dans l’Inde, ostensiblement comme acheteur de jute pour la maison paternelle, en réalité comme fils puni, les deux belles-sœurs avaient pensé à tirer parti de cette situation ; et quand ce fils en révolte s’était marié malgré la défense de son père, elles avaient commencé, chacune de son côté, à se préparer pour que leur fils pût, à un moment donné, prendre la place de l’exilé.
À cette époque Théodore n’avait pas vingt ans, et il ne paraissait pas, par ce qu’il s’était montré jusque-là, qu’il pût être jamais propre au travail et aux affaires commerciales : choyé, gâté par sa mère qui lui avait donné ses goûts et ses idées, il ne vivait que pour les théâtres, les courses et les plaisirs que Paris offre aux fils de famille dont la bourse se remplit aussi facilement qu’elle se vide. Quelle chute quand il lui avait fallu s’enfermer dans un village, sous la férule d’un maître qui ne comprenait que le travail, et se montrait aussi rigoureux pour son neveu que pour le dernier de ses employés. Cette existence exaspérante, il ne l’avait supportée que le mépris au cœur pour ce qu’elle lui imposait d’ennuis, de fatigues et de dégoûts. Dix fois par jour il décidait de l’abandonner, et s’il ne le faisait point, c’était dans l’espérance d’être bientôt maître, seul maître de cette affaire considérable, et de pouvoir alors la mettre en actions, de façon à la diriger de haut et de loin, surtout de loin, c’est-à-dire de Paris, où il se rattraperait enfin de ses misères.
Quand Théodore avait commencé à travailler avec son oncle, Casimir n’avait que onze ou douze ans, et était par conséquent trop jeune pour prendre une place à côté de son cousin. Mais pour cela sa mère n’avait pas désespéré qu’il pût l’occuper un jour en regagnant le temps perdu : ingénieur, Casimir du haut de l’X dominerait M. Vulfran, en même temps qu’il écraserait de sa supériorité officielle son cousin qui n’était rien. C’était donc pour l’École polytechnique qu’il avait été chauffé, ne travaillant que les matières exigées pour les examens de l’École, et cela en proportion de leur coefficient : 58 les mathématiques, 10 la physique, 5 la chimie, 6 le français. Et alors il s’était produit ce résultat fâcheux pour lui, que, comme à Maraucourt, les vulgaires connaissances usuelles étaient plus utiles que l’X, l’ingénieur n’avait pas plus dominé l’oncle qu’il n’avait écrasé le cousin. Et même celui-ci avait gardé l’avance que dix années de vie commerciale lui donnaient, car s’il n’était pas savant, il en convenait, au moins il était pratique, prétendait-il, sachant bien que cette qualité était la première de toutes pour son oncle.
« Que diable peut-on bien leur apprendre d’utile, disait Théodore, puisqu’ils ne sont pas seulement en état d’écrire clairement une lettre d’affaires avec une orthographe décente ?
— Quel malheur, expliquait Casimir, que mon beau cousin s’imagine qu’on ne peut pas vivre ailleurs qu’à Paris, quels services, sans cela, il rendrait à mon oncle ; mais qu’attendre de bon d’un monomane qui, dès le jeudi, ne pense qu’à filer le samedi soir à Paris, disposant tout, dérangeant tout dans ce but unique, et qui, du lundi matin au jeudi, reste engourdi dans les souvenirs de la journée du dimanche passée à Paris. »
Les mères ne faisaient que développer ces deux thèmes en les enjolivant ; mais, au lieu de convaincre M. Vulfran, celle-ci que Théodore seul pouvait être son second, celle-là que Casimir seul était un vrai fils pour lui, elles l’avaient plutôt disposé à croire, de Théodore, ce que disait la mère de Casimir, et de Casimir ce que disait celle de Théodore, c’est-à-dire qu’en réalité, il ne pouvait pas plus compter sur l’un que sur l’autre, ni pour le présent ni pour l’avenir.
De là, chez lui, des dispositions à leur égard, qui étaient précisément tout autres que celles que chacune d’elles avait si âprement poursuivies : ses neveux, rien que ses neveux ; nullement et à aucun point de vue des fils.
Et même, dans ses procédés à leur égard, on pouvait facilement voir qu’il avait tenu à ce que cette distinction fût évidente pour tous, car, malgré les sollicitations de tout genre, directes et détournées, dont on l’avait enveloppé, il n’avait jamais consenti à les loger au château où cependant les appartements ne manquaient pas, ni à leur permettre de partager sa vie intime, si triste et si solitaire qu’elle fût.
« Je ne veux ni querelles ni jalousies autour de moi », avait-il toujours répondu.
Et, partant de là, il avait donné à Théodore la maison qu’il habitait lui-même avant de faire construire son château, et à Casimir celle de l’ancien chef de la comptabilité que Mombleux remplaçait.
Aussi leur surprise avait-elle été vive et leur indignation exaspérée, quand une étrangère, une gamine, une bohémienne s’était installée dans ce château où ils n’entraient que comme invités.
Que signifiait cela ?
Qu’était cette petite fille ?
Que devait-on craindre d’elle ?
C’était ce que Mme Bretoneux avait demandé à son fils, mais ses réponses ne l’ayant pas satisfaite, elle avait voulu faire elle-même une enquête qui l’éclairât.
Arrivée assez inquiète, il ne lui fallut que peu de temps pour se rassurer, tant Perrine joua bien le rôle que Mlle Belhomme lui avait soufflé.
Si M. Vulfran ne voulait pas avoir ses neveux à demeure chez lui, il n’en était pas moins hospitalier, et même largement, fastueusement hospitalier pour sa famille, lorsque sa sœur et sa belle-sœur, son frère et son beau-frère venaient le voir à Maraucourt. Dans ces occasions, le château prenait un air de fête qui ne lui était pas habituel : les fourneaux chauffaient au tirage forcé ; les domestiques arboraient leurs livrées ; les voitures et les chevaux sortaient des remises et des écuries avec leurs harnais de gala ; et le soir, dans l’obscurité, les habitants du village voyaient flamboyer le château depuis le rez-de-chaussée jusqu’aux fenêtres des combles et de Picquigny à Amiens, d’Amiens à Picquigny, circulaient le cuisinier et le maître d’hôtel chargés des approvisionnements.
Pour recevoir Mme Bretoneux, on s’était donc conformé à l’usage établi et en débarquant à la gare de Picquigny, elle avait trouvé le landau avec cocher et valet de pied pour l’amener à Maraucourt, comme en descendant de voiture elle avait trouvé Bastien pour la conduire à l’appartement, toujours le même, qui lui était réservé au premier étage.
Mais malgré cela, la vie de travail de M. Vulfran et de ses neveux, même celle de Casimir, n’avait été modifiée en rien : il verrait sa sœur aux heures des repas, il passerait la soirée avec elle, rien de plus, les affaires avant tout ; quant au fils et au neveu, il en serait de même pour eux, ils déjeuneraient et dîneraient au château, où ils resteraient le soir aussi tard qu’ils voudraient, mais ce serait tout : sacrées les heures de bureau.
Sacrées pour les neveux, elles l’étaient aussi pour M. Vulfran et par conséquent pour Perrine, de sorte que Mme Bretoneux n’avait pas pu organiser et poursuivre son enquête sur « la bohémienne » comme elle l’aurait voulu.
Interroger Bastien et les femmes de chambre, aller chez Françoise pour la questionner adroitement, ainsi que Zénobie et Rosalie, était simple et, de ce côté, elle avait obtenu tous les renseignements qu’on pouvait lui donner, au moins ceux qui se rapportaient à l’arrivée dans le pays de « la bohémienne », à la façon dont elle avait vécu depuis ce moment ; enfin à son installation auprès de M. Vulfran, due exclusivement, semblait-il, à sa connaissance de l’anglais ; mais examiner Perrine elle-même qui ne quittait pas M. Vulfran, la faire parler, voir ce qu’elle était et ce qu’il y avait en elle, chercher ainsi les causes de son succès subit, ne se présentait pas dans des conditions faciles à combiner.
À table, Perrine ne disait absolument rien ; le matin, elle partait avec M. Vulfran ; après le déjeuner, elle montait tout de suite à sa chambre : au retour de la tournée des usines, elle travaillait avec Mlle Belhomme ; le soir en sortant de table, elle montait de nouveau à sa chambre ; alors, quand ou comment la prendre pour l’avoir seule et librement la retourner ?
De guerre lasse, Mme Bretoneux, la veille de son départ, se décida à l’aller trouver dans sa chambre, où Perrine, qui se croyait débarrassée d’elle, dormait tranquillement.
Quelques coups frappés à sa porte, l’éveillèrent ; elle écouta, on frappa de nouveau.
Elle se leva et alla à la porte à tâtons :
« Qui est là ?
— Ouvrez, c’est moi.
— Mme Bretoneux ?
— Oui. »
Perrine tira le verrou, et vivement Mme Bretoneux se glissa dans la chambre, tandis que Perrine pressait le bouton de la lumière électrique.
« Couchez-vous, dit Mme Bretoneux, nous serons mieux pour causer. »
Et, prenant une chaise, elle s’assit au pied du lit de façon à avoir Perrine devant elle ; puis tout de suite elle commença :
« C’est de mon frère que j’ai à vous parler, à propos de certaines recommandations que je veux vous adresser. Puisque vous remplacez Guillaume auprès de lui, vous pouvez prendre des précautions utiles à sa santé et dont Guillaume, malgré tous ses défauts, l’entourait. Vous paraissez intelligente, bonne petite fille, il est donc certain que, si vous le voulez, vous pouvez nous rendre les mêmes services que Guillaume ; je vous promets que nous saurons le reconnaître. »
Aux premiers mots, Perrine s’était rassurée : puisqu’on voulait lui parler de M. Vulfran, elle n’avait rien à craindre ; mais quand elle entendit Mme Bretoneux lui dire qu’elle paraissait intelligente, sa défiance se réveilla, car il était impossible que Mme Bretoneux qui, elle, était vraiment intelligente et fine, pût être sincère en parlant ainsi ; or, si elle n’était pas sincère, il importait de se tenir sur ses gardes.
« Je vous remercie, madame, dit-elle en exagérant son sourire

niais, bien sûr que je ne demande qu’à vous rendre les mêmes services que Guillaume. »
Elle souligna ces derniers mots de façon à laisser entendre qu’on pouvait tout lui demander.
« Je disais bien que vous étiez intelligente, reprit Mme Bretoneux, et je crois que nous pouvons compter sur vous.
— Vous n’avez qu’à commander, madame.
— Tout d’abord, ce qu’il faut, c’est que vous soyez attentive à veiller sur la santé de mon frère et à prendre toutes les précautions possibles pour qu’il ne gagne pas un coup de froid qui peut être mortel, en lui donnant une de ces congestions pulmonaires, auxquelles il est sujet, ou qui aggrave sa bronchite. Savez-vous que si cette bronchite se guérissait, on pourrait l’opérer et lui rendre la vue ? Songez quelle joie ce serait pour nous tous. »
Cette fois, Perrine répondit franchement :
« Moi aussi, je serais bien heureuse.
— Cette parole prouve vos bons sentiments, mais vous, si reconnaissante que vous soyez de ce qu’on fait pour vous, vous n’êtes pas de la famille. »
Elle reprit son air niais.
« Bien sûr, mais ça n’empêche pas que je sois attachée à M. Vulfran, vous pouvez me croire.
— Justement, vous pouvez nous prouver votre attachement par ces soins de tout instant que je vous indiquais, mais encore bien mieux. Mon frère n’a pas besoin seulement d’être préservé du froid, il a besoin aussi d’être défendu contre les émotions brusques qui, en le surprenant, pourraient le tuer. Ainsi, ces messieurs me disaient qu’en ce moment il faisait faire recherches sur recherches dans les Indes pour obtenir des nouvelles de son fils, notre cher Edmond. »
Elle fit une pause, mais inutilement, car Perrine ne répondit pas à cette ouverture, bien certaine que « ces messieurs », c’est-à-dire les deux cousins, n’avaient pas pu parler de ces recherches à Mme Bretoneux ; que Casimir en eût parlé, il n’y avait là rien que de vraisemblable, puisqu’il avait appelé sa mère à son secours ; mais Théodore, cela n’était pas possible.
« Ils m’ont dit que lettres et dépêches passaient par vos mains et que vous les traduisiez à mon frère. Eh bien ! il serait très important, au cas où ces nouvelles deviendraient mauvaises, comme nous ne le prévoyons que trop, hélas ! que mon fils en fût averti le premier ; il m’enverrait une dépêche, et, comme la distance d’ici à Boulogne n’est pas très grande, j’accourrais soutenir mon pauvre frère : une sœur, surtout une sœur aînée, trouve d’autres consolations dans son cœur qu’une belle-sœur. Vous comprenez ?
— Oh ! bien sûr, madame, que je comprends ; il me semble au moins.
— Alors, nous pouvons compter sur vous ? »
Perrine hésita un moment, mais elle ne pouvait pas ne pas répondre.
« Je ferai tout ce que je pourrai pour M. Vulfran.
— Et ce que vous ferez pour lui, vous le ferez pour nous, comme ce que vous ferez pour nous vous le ferez pour lui. Tout de suite je vais vous prouver que, quant à nous, nous ne serons pas ingrats. Qu’est-ce que vous diriez d’une robe qu’on vous donnerait ? »
Perrine ne voulut rien dire, mais comme elle devait une réponse à cette offre, elle la mit dans un sourire.
« Une belle robe avec une petite traîne, continua Mme Bretoneux.
— Je suis en deuil.
— Mais le deuil n’empêche pas de porter une robe à traîne. Vous n’êtes pas assez habillée pour dîner à la table de mon frère et même vous êtes très mal habillée, fagotée comme un chien savant. »
Perrine savait qu’elle n’était pas bien habillée, cependant elle fut humiliée d’être comparée à un chien savant, et surtout de la façon dont cette comparaison était faite, avec l’intention manifeste de la rabaisser.
— J’ai pris ce que j’ai trouvé chez Mme Lachaise.
— Mme Lachaise était bonne pour vous habiller quand vous n’étiez qu’une vagabonde, mais maintenant qu’il a plu à mon frère de vous admettre à sa table, il ne faut pas que nous ayons à rougir de vous ; ce qui, nous pouvons le dire entre nous, a lieu en ce moment. »
Sous ce coup, Perrine perdit la conscience du rôle qu’elle jouait :
« Ah ! dit-elle tristement.
— Ce que vous êtes drôle avec votre blouse, vous n’en avez pas idée. »
Et l’évocation de ce souvenir fit rire Mme Bretoneux comme si elle avait cette fameuse blouse devant les yeux.
« Mais cela est facile à réparer, et quand vous serez belle comme je veux que vous le soyez, avec une robe habillée pour la salle à manger, et un joli costume pour la voiture, vous vous rappellerez à qui vous les devez. C’est comme pour votre lingerie, je me doute qu’elle vaut la robe. Voyons un peu. »
Disant cela, d’un air d’autorité, elle ouvrit les uns après les autres les tiroirs de la commode, et méprisante, elle les referma d’un mouvement brusque en haussant les épaules avec pitié.
« Je m’en doutais, reprit-elle, c’est misérable, indigne de vous. »
Perrine suffoquée ne répondit rien.
« Vous avez de la chance, continua Mme Bretoneux, que je sois venue à Maraucourt, et que je me charge de vous. »
Le mot qui monta aux lèvres de Perrine fut un refus : elle n’avait pas besoin qu’on se chargeât d’elle, surtout avec de pareils procédés ; mais elle eut la force de le refouler : elle avait un rôle à remplir, rien ne devait le lui faire oublier ; après tout, c’étaient les paroles de Mme Bretoneux qui étaient mauvaises et dures, ses intentions, au contraire, s’annonçaient bonnes et généreuses.
« Je vais dire à mon frère, reprit Mme Bretoneux, qu’il doit vous commander chez une couturière d’Amiens dont je lui donnerai l’adresse, la robe et le costume, qui vous sont indispensables, et de plus, chez une bonne lingère un trousseau complet. Fiez-vous-en à moi, vous aurez quelque chose de joli, qui à chaque instant, je l’espère au moins, me rappellera à votre souvenir. Là-dessus dormez bien, et n’oubliez rien de ce que je vous ai dit. »


XXXV
« Faire tout ce qu’elle pourrait pour M. Vulfran » ne signifiait pas du tout, aux yeux de Perrine, ce que Mme Bretoneux avait cru comprendre ; aussi se garda-t-elle de jamais dire un mot à Casimir des recherches qui se poursuivaient aux Indes et en Angleterre.
Et cependant, quand il la rencontrait seule, Casimir avait une façon de la regarder qui aurait dû provoquer les confidences.
Mais quelles confidences eût-elle pu faire, alors même qu’elle se fût décidée à rompre le silence que M. Vulfran lui avait commandé ?
Elles étaient aussi vagues que contradictoires, les nouvelles qui arrivaient de Dakka, de Dehra et de Londres, surtout elles étaient incomplètes, avec des trous qui paraissaient difficiles à combler, surtout pour les trois dernières années. Mais cela ne désespérait pas M. Vulfran et n’ébranlait pas sa foi. « Nous avons fait le plus difficile, disait-il quelquefois, puisque nous avons éclairé les temps les plus éloignés ; comment la lumière ne se ferait-elle pas sur ceux qui sont près de nous ? un jour ou l’autre le fil se rattachera et alors il n’y aura plus qu’à le suivre. »
Si de ce côté Mme Bretoneux n’avait guère réussi, au moins n’en avait-il pas été de même pour les soins qu’elle avait recommandé à Perrine de donner à M. Vulfran. Jusque-là Perrine ne se serait pas permis, les jours de pluie, de relever la capote du phaéton, ni les jours de froid ou de brouillard, de rappeler à M. Vulfran qu’il était prudent à lui d’endosser un pardessus, ou de nouer un foulard autour de son cou, pas plus qu’elle n’aurait osé, quand les soirées étaient fraîches, fermer les fenêtres du cabinet ; mais du moment qu’elle avait été avertie par Mme Bretoneux que le froid, l’humidité, le brouillard, la pluie pouvaient aggraver la maladie de M. Vulfran, elle ne s’était plus laissé arrêter par ces scrupules et ces timidités.
Maintenant, elle ne montait plus en voiture, quel que fût le temps, sans veiller à ce que le pardessus se trouvât à sa place habituelle avec un foulard dans la poche, et au moindre coup de vent frais, elle le posait elle-même sur les épaules de M. Vulfran, ou le lui faisait endosser. Qu’une goutte de pluie vînt à tomber, elle arrêtait aussitôt, et relevait la capote. Que la soirée ne fût pas tiède après le dîner, et elle refusait de sortir. Au commencement, quand ils faisaient une course à pied, elle allait de son pas ordinaire, et il la suivait sans se plaindre, car la plainte était précisément ce qu’il avait le plus en horreur, pour lui-même, aussi bien que pour les autres ; mais maintenant qu’elle savait que la marche un peu vive lui était une souffrance accompagnée de toux, d’étouffement, de palpitations, elle trouvait toujours des raisons, sans donner la vraie, pour qu’il ne pût pas se fatiguer, et ne fit qu’un exercice modéré, celui précisément qui lui était utile, non nuisible.
Une après-midi qu’ils traversaient ainsi à pied le village, ils rencontrèrent Mlle Belhomme qui ne voulut point passer sans saluer M. Vulfran, et après quelques paroles de politesse le quitta en disant :
« Je vous laisse sous la garde de votre Antigone. »
Que voulait dire cela ? Perrine n’en savait rien et M. Vulfran qu’elle interrogea ne le savait pas davantage. Alors le soir elle questionna l’institutrice qui lui expliqua ce qu’était cette Antigone, en lui faisant lire avec un commentaire approprié à sa jeune intelligence, ignorante des choses de l’antiquité, l’Œdipe à Colone de Sophocle ; et les jours suivants abandonnant le Tour du Monde, Perrine recommença cette lecture pour M. Vulfran qui s’en montra ému, sensible surtout à ce qui s’appliquait à sa propre situation.
« C’est vrai, dit-il, que tu es une Antigone pour moi, et même plus, puisque Antigone, fille du malheureux Œdipe, devait ses soins et sa tendresse à son père. »
Par là, Perrine vit quel chemin elle avait fait dans l’affection de M. Vulfran qui n’avait pas pour habitude de se répandre en effusion. Elle en fut si bouleversée que lui prenant la main, elle la lui baisa.
« Oui, dit-il, tu es une bonne fille. »
Et lui mettant la main sur la tête, il ajouta :
« Même quand mon fils sera de retour, tu ne nous quitteras pas, il saura reconnaître ce que tu as été pour moi.
— Je suis si peu et je voudrais être tant.
— Je lui dirai ce que tu as été, et d’ailleurs il le verra bien, car c’est un homme de cœur que mon fils. »
Bien souvent il s’était exprimé dans ces termes ou d’autres du même genre sur ce fils, et toujours elle avait eu la pensée de lui demander comment, avec ces sentiments, il avait pu se montrer si sévère, mais chaque fois, les paroles s’étaient arrêtées dans sa gorge serrée par l’émotion : c’était chose si grave pour elle d’aborder un pareil sujet.
Cependant ce soir-là, encouragée par ce qui venait de se passer, elle se sentit plus forte ; jamais occasion s’était-elle présentée plus favorable : elle était seule avec M. Vulfran, dans son cabinet où jamais personne n’entrait sans être appelé, assise près de lui, sous la lumière de la lampe, devait-elle hésiter plus longtemps ?
Elle ne le crut pas :
« Voulez-vous me permettre, dit-elle, le cœur angoissé et la voix frémissante, de vous demander une chose que je ne comprends pas, et à laquelle je pense à chaque instant sans oser en parler ?
— Dis.
— Ce que je ne comprends pas, c’est qu’aimant votre fils comme vous l’aimez, vous ayez pu vous séparer de lui.
— C’est qu’à ton âge on ne comprend, on ne sent que ce qui est affection, sans avoir conscience du devoir : or mon devoir de père me faisait une loi d’imposer à mon fils, coupable de fautes qui pouvaient l’entraîner loin, une punition qui serait une leçon. Il fallait qu’il eût la preuve que ma volonté était au-dessus de la sienne ; c’est pourquoi je l’envoyai aux Indes, où j’avais l’intention de ne le tenir que peu de temps, et où je lui donnais une situation qui ménageait sa dignité, puisqu’il était le représentant de ma maison. Pouvais-je prévoir qu’il s’éprendrait de cette misérable créature, et se laisserait entraîner dans un mariage fou, absolument fou ?
— Mais le père Fildes dit que celle qu’il a épousée n’était point une misérable créature.
— Elle en était une, puisqu’elle a accepté un mariage nul en France, et dès lors je ne pouvais pas la reconnaître pour ma fille, pas plus que je ne pouvais rappeler mon fils près de moi, tant qu’il ne se serait pas séparé d’elle ; c’eût été manquer à mon devoir de père, en même temps qu’abdiquer ma volonté, et un homme comme moi ne peut pas en arriver là ; je veux ce que je dois, et ne transige pas plus sur la volonté que sur le devoir. »
Il dit cela avec une fermeté d’accent qui glaça Perrine ; puis, tout de suite il poursuivit :
« Maintenant, tu peux te demander comment, n’ayant pas voulu recevoir mon fils après son mariage, je veux présentement le rappeler près de moi. C’est que les conditions ne sont plus aujourd’hui ce qu’elles étaient à cette époque. Après treize années de ce prétendu mariage, mon fils doit être aussi las de cette créature que de la vie misérable qu’elle lui a fait mener près d’elle. D’autre part, les conditions pour moi sont changées aussi : ma santé est loin d’être restée ce qu’elle était, je suis malade, je suis aveugle, et je ne peux recouvrer la vue que par une opération qu’on ne risquera que si je suis dans un état de calme lui assurant des chances sérieuses de réussite. Quand mon fils saura cela, crois-tu qu’il hésitera à quitter cette femme, à laquelle d’ailleurs j’assurerai la vie la plus large ainsi qu’à sa fille ? Si je l’aime, il m’aime aussi ; que de fois a-t-il tourné ses regards vers Maraucourt, que de regrets n’a-t-il pas éprouvés ; qu’il apprenne la vérité, tu le verras accourir.
— Il devrait donc quitter sa femme et sa fille ?
— Il n’a pas de femme, il n’a pas de fille.
— Le père Fildes dit qu’il a été marié dans la chapelle de la mission par le père Leclerc.
— Ce mariage est nul en France pour avoir été contracté contrairement à la loi.
— Mais aux Indes, est-il nul aussi ?
— Je le ferai casser à Rome.
— Mais sa fille ?
— La loi ne reconnaît pas cette fille.
— La loi est-elle tout ?
— Que veux-tu dire ?
— Que ce n’est pas la loi qui fait qu’on aime ou qu’on n’aime pas ses enfants, ses parents. Ce n’était pas en vertu de la loi que j’aimais mon pauvre papa, mais parce qu’il était bon, tendre, affectueux, attentif pour moi, parce que j’étais heureuse quand il m’embrassait, joyeuse quand il me disait de douces paroles ou qu’il me regardait avec un sourire ; et parce que je n’imaginais pas qu’il y eût rien de meilleur que d’être avec lui-même, quand il ne me parlait point et s’occupait de ses affaires. Et lui, il m’aimait parce qu’il m’avait élevée, parce qu’il me donnait ses soins, son affection, et plus encore je crois bien, parce qu’il sentait que je l’aimais de tout mon cœur. La loi n’avait rien à voir là dedans ; je ne me demandais pas si c’était la loi qui le faisait mon père, car j’étais bien certaine que c’était l’affection que nous avions l’un pour l’autre.
— Où veux-tu en venir ?
— Pardonnez-moi si je dis des paroles qui vous paraissent déraisonnables, mais je parle tout haut, comme je pense, comme je sens.
— Et c’est pour cela que je t’écoute, parce que tes paroles, pour peu expérimentées qu’elles soient, sont au moins celles d’une bonne fille.
— Eh bien, monsieur, j’en veux venir à ceci, c’est que si vous aimez votre fils et voulez l’avoir près de vous, lui de son côté il doit aimer sa fille et veut l’avoir près de lui.
— Entre son père et sa fille, il n’hésitera pas ; d’ailleurs le mariage annulé, elle ne sera plus rien pour lui. Les filles de l’Inde sont précoces ; il pourra bientôt la marier, ce qui, avec la dot que je lui assurerai, sera facile ; il ne sera donc pas assez peu sensé pour ne pas se séparer d’une fille qui, elle, n’hésiterait pas à se séparer bientôt de lui pour suivre son mari. D’ailleurs, notre vie n’est pas faite que de sentiment, elle l’est aussi d’autres choses qui pèsent d’un lourd poids sur nos déterminations : quand Edmond est parti pour les Indes, ma fortune n’était pas ce qu’elle est maintenant ; quand il verra, et je la lui montrerai, la situation qu’elle lui assure à la tête de l’industrie de son pays, l’avenir qu’elle lui promet, avec toutes les satisfactions des richesses et des honneurs, ce ne sera pas une petite moricaude qui l’arrêtera.
— Mais cette petite moricaude n’est peut-être pas aussi horrible que vous l’imaginez.
— Une Hindoue.
— Les livres que je vous lisais disent que les Hindous sont en moyenne plus beaux que les Européens.
— Exagérations de voyageurs.
— Qu’ils ont les membres souples, le visage d’un ovale pur, les yeux profonds avec un regard fier, la bouche discrète, la physionomie douce ; qu’ils sont adroits, gracieux dans leurs mouvements ; qu’ils sont sobres, patients, courageux au travail ; qu’ils sont appliqués à l’étude…
— Tu as de la mémoire.
— Ne doit-on pas retenir ce qu’on lit ? Enfin il résulte de ces livres qu’une Hindoue n’est pas forcément une horreur comme vous êtes disposé à le croire.
— Que m’importe, puisque je ne la connaîtrai pas.
— Mais si vous la connaissiez, vous pourriez peut-être vous intéresser à elle, vous attacher à elle…
— Jamais ; rien qu’en pensant à elle et à sa mère, je suis pris d’indignation.
— Si vous la connaissiez… cette colère s’apaiserait peut-être. »
Il serra les poings dans un mouvement de fureur qui troubla Perrine, mais qui cependant ne lui coupa pas la parole :
« J’entends si elle n’était pas du tout ce que vous supposez ; car elle peut, n’est-ce pas, être le contraire de ce que votre colère imagine : le père Fildes dit que sa mère était douée des plus charmantes qualités, intelligente, bonne, douce…

— Le père Fildes est un brave prêtre qui voit la vie et les gens avec trop d’indulgence ; d’ailleurs, il ne l’a pas connue, cette femme dont il parle.
— Il dit qu’il parle d’après les témoignages de tous ceux qui l’ont connue ; ces témoignages de tous n’ont-ils pas plus d’importance que l’opinion d’un seul ? Enfin, si vous la receviez dans votre maison, n’aurait-elle pas, elle, votre petite-fille, des soins plus intelligents que ceux que je peux avoir, moi ?
— Ne parle pas contre toi.
— Je ne parle ni pour ni contre moi, mais pour ce qui est la justice…
— La justice !
— Telle que je la sens ; ou si vous voulez, pour ce que, dans mon ignorance, je crois être la justice. Précisément parce que sa naissance est menacée et contestée, cette jeune fille en se voyant accueillie, ne pourrait pas ne pas être émue d’une profonde reconnaissance. Pour cela seul, en dehors de toutes les autres raisons qui la pousseraient, elle vous aimerait de tout son cœur. »
Elle joignit les mains en le regardant comme s’il pouvait la voir, et avec un élan qui donnait à sa voix un accent vibrant :
« Ah ! monsieur, ne voulez-vous pas être aimé par votre fille ? »
Il se leva d’un mouvement impatient :
« Je t’ai dit qu’elle ne serait jamais ma fille. Je la hais, comme je hais sa mère ; elles qui m’ont pris mon fils, qui me le gardent. Est-ce que, si elles ne l’avaient pas ensorcelé, il ne serait pas près de moi depuis longtemps ? Est-ce qu’elles n’ont pas été tout pour lui, quand moi son père, je n’étais rien ? »
Il parlait avec véhémence en marchant à pas saccadés par son cabinet, emporté, secoué par un accès de colère qu’elle n’avait pas encore vu.
Tout à coup il s’arrêta devant elle :
« Monte à ta chambre, dit-il, et plus jamais, tu entends, plus jamais, ne te permets de me parler de ces misérables ; car enfin de quoi te mêles-tu ? Qui t’a chargé de me tenir un pareil discours ? »
Un moment interdite, elle se remit :
« Oh ! personne, monsieur, je vous jure ; j’ai traduit, moi fille sans parents, ce que mon cœur me disait, me mettant à la place de votre petite-fille. »
Il se radoucit, mais ce fut encore d’un ton menaçant qu’il ajouta :
« Si tu ne veux pas que nous nous fâchions, désormais n’aborde jamais ce sujet, qui m’est, tu le vois, douloureux ; tu ne dois pas m’exaspérer.
— Pardonnez-moi, dit-elle la voix brisée par les larmes qui l’étouffaient, certainement j’aurais dû me taire.
— Tu l’aurais dû d’autant mieux que ce que tu as dit était inutile. »


XXXVI
Pour suppléer aux nouvelles que ses correspondants ne lui donnaient point, sur la vie de son fils, pendant les trois dernières années, M. Vulfran faisait paraître dans les principaux journaux de Calcutta, de Dakka, de Dehra, de Bombay, de Londres, une annonce répétée chaque semaine, promettant quarante livres de récompense à qui pourrait fournir un renseignement, si mince qu’il fût, mais certain cependant sur Edmond Paindavoine ; et comme une des lettres qu’il avait reçues de Londres parlait d’un projet d’Edmond de passer en Égypte et peut-être en Turquie, il avait étendu ses insertions au Caire, à Alexandrie, à Constantinople : rien ne devait être négligé, même l’impossible, même l’improbable ; d’ailleurs n’était-ce pas l’improbable qui devenait le vraisemblable dans cette existence cahotée ?
Ne voulant pas donner son adresse, ce qui eût pu l’exposer à toutes sortes de sollicitations plus ou moins malhonnêtes, c’était celle de son banquier à Amiens que M. Vulfran avait indiquée ; c’était donc celui-ci qui recevait les lettres que l’offre des mille francs provoquait, et qui les transmettait à Maraucourt.
Mais de ces lettres assez nombreuses, pas une seule n’était sérieuse ; la plupart provenaient d’agents d’affaires, qui s’engageaient à faire des recherches dont ils garantissaient le succès, si on voulait bien leur envoyer une provision indispensable aux premières démarches ; quelques-unes étaient de simples romans qui se lançaient dans une fantaisie vague promettant tout et ne donnant rien ; d’autres enfin racontaient des faits remontant à cinq, dix, douze ans ; aucune ne se renfermait dans les trois dernières années fixées par l’annonce, pas plus qu’elle ne fournissait l’indication précise demandée.
C’était Perrine qui lisait ces lettres ou les traduisait, et si nulles qu’elles fussent généralement, elles ne décourageaient pas M. Vulfran et n’ébranlaient pas sa foi :
« Il n’y a que l’annonce répétée qui produise de l’effet », disait-il toujours.
Et sans se lasser, il répétait les siennes.
Un jour enfin une lettre datée de Serajevo en Bosnie apporta une offre qui paraissait pouvoir être prise en considération : elle était en mauvais anglais, et disait que si on voulait déposer les quarante livres promises par l’insertion du Times, chez un banquier de Serajevo, on s’engageait à fournir des nouvelles authentiques de M. Edmond Paindavoine remontant au mois de novembre de la précédente année : au cas où l’on accepterait cette proposition, on devait répondre poste restante à Serajevo sous le no 917.
« Eh bien, tu vois si j’avais raison, s’écria M. Vulfran, c’est près de nous le mois de novembre. »
Et il montra une joie qui était un aveu de ses craintes : c’était maintenant qu’il pouvait affirmer l’existence d’Edmond avec preuves à l’appui et non plus seulement en vertu de sa foi paternelle.
Pour la première fois depuis que ses recherches se poursuivaient, il parla de son fils à ses neveux et à Talouel.
« J’ai la grande joie de vous annoncer que j’ai des nouvelles d’Edmond ; il était en Bosnie au mois de novembre. »
L’émoi fut grand quand ce bruit se répandit dans le pays. Comme toujours en pareille circonstance on l’amplifia :
« M. Edmond va arriver !
— Est-ce possible ?
— Si vous voulez en avoir la certitude regardez la mine des neveux et de Talouel. »
En réalité, elle était curieuse cette mine : préoccupée chez Théodore autant que chez Casimir, avec quelque chose de contraint ; au contraire épanouie chez Talouel, qui depuis longtemps avait pris l’habitude de faire exprimer à sa physionomie comme à ses paroles, précisément le contraire de ce qu’il pensait.
Cependant il y avait des gens qui ne voulaient pas croire à ce retour :
« Le vieux a été trop dur ; le fils n’avait pas mérité que, pour quelques dettes, on l’envoyât aux Indes ; mis en dehors de sa famille, il s’en est créé une autre là-bas.
— Et puis, être en Bosnie, en Turquie, quelque part par là, cela ne veut pas dire qu’on est en route pour Maraucourt : est-ce que la route des Indes en France passe par la Bosnie ? »
Cette réflexion était de Bendit qui, avec son sang-froid anglais, jugeait les choses au seul point de vue pratique, sans y mêler aucune considération sentimentale.
« Comme vous je désire le retour du fils, disait-il, cela donnerait à la maison une solidité qui lui manque, mais il ne suffit pas que je désire une chose pour que j’y croie ; c’est Français cela, ce n’est pas Anglais, et moi, vous savez : « I am an Englishman. »
Justement parce que ces réflexions étaient d’un Anglais, elles faisaient hausser les épaules : si le patron parlait du retour de son fils, on pouvait avoir foi en lui ; il n’était pas homme à s’emballer, le patron.
« En affaires, oui ; mais en sentiment, ce n’est pas l’industriel qui parle, c’est le père. »
À chaque instant M. Vulfran s’entretenait avec Perrine de ses espérances :
« Ce n’est plus qu’une affaire de temps : la Bosnie, ce n’est pas l’Inde, une mer dans laquelle on disparaît ; si nous avons des nouvelles certaines pour le mois de novembre, elles nous mettront sur une piste qu’il sera facile de suivre. »
Et il avait voulu que Perrine prît dans la bibliothèque les livres qui parlaient de la Bosnie, cherchant en eux, sans y trouver une explication satisfaisante, ce que son fils était venu faire dans ce pays sauvage, au climat rude, où il n’y a ni commerce, ni industrie.
« Peut-être s’y trouvait-il simplement en passant, dit Perrine.
— Sans doute, et c’est un indice de plus pour prouver son prochain retour ; de plus s’il était là de passage, il semble vraisemblable qu’il n’était pas accompagné de sa femme et de sa fille, car la Bosnie n’est pas un pays pour les touristes ; donc il y aurait séparation entre eux. »
Comme elle ne répondait rien malgré l’envie qu’elle en avait, il s’en fâcha :
« Tu ne dis rien.
— C’est que je n’ose pas ne pas être d’accord avec vous.
— Tu sais bien que je veux que tu me dises tout ce que tu penses.
— Vous le voulez pour certaines choses, vous ne le voulez pas pour d’autres. Ne m’avez-vous pas défendu d’aborder jamais ce qui se rapporte à… cette jeune fille ? Je ne veux pas m’exposer à vous fâcher.
— Tu ne me fâcheras pas en disant les raisons pour lesquelles tu admets qu’elles ont pu venir en Bosnie.
— D’abord parce que la Bosnie n’est pas un pays inabordable pour des femmes, surtout quand ces femmes ont voyagé dans les montagnes de l’Inde qui ne ressemblent en rien pour les fatigues et les dangers à celles des Balkans. Et puis d’un autre côté, si M. Edmond ne faisait que traverser la Bosnie, je ne vois pas pourquoi sa femme et sa fille ne l’auraient pas accompagné, puisque les lettres que vous avez reçues des différentes contrées de l’Inde disent que partout elles étaient avec lui. Enfin il y a encore une autre considération que je n’ose pas vous dire, précisément parce qu’elle n’est pas d’accord avec vos espérances.
— Dis-la quand même.
— Je la dirai, mais à l’avance je vous demande de ne voir dans mes paroles que le souci de votre santé, qui serait atteinte au cas où votre attente serait déçue ; ce qui est possible n’est-ce pas ?
— Explique-toi clairement.
— De ce que M. Edmond était à Serajevo au mois de novembre, vous concluez qu’il doit être de retour ici… bientôt.
— Évidemment.
— Et cependant on peut ne pas le retrouver.
— Je n’admets pas cela.
— Une raison ou une autre peut l’empêcher de revenir… N’est-il pas possible qu’il ait disparu ?
— Disparu ?
— S’il était retourné aux Indes… ou ailleurs ; s’il était parti pour l’Amérique ?
— Les si entassés les uns par-dessus les autres conduisent à l’absurde.
— Sans doute, monsieur, mais en choisissant ceux qu’on désire et en repoussant les autres on s’expose…
— À quoi ?
— Quand ce ne serait qu’à l’impatience. Voyez dans quel état agité vous êtes depuis que vous avez reçu cette nouvelle de Serajevo ; et cependant les délais ne sont pas écoulés pour que la réponse vous soit parvenue. Vous ne toussiez presque plus ; vous avez maintenant plusieurs accès par jour et aussi des palpitations, de l’essoufflement ; votre visage rougit à chaque instant ; les veines de votre front se gonflent. Que se passera-t-il si cette réponse se fait encore attendre, et surtout si… elle n’est pas ce que vous espérez, ce que vous voulez ? Vous vous êtes si bien habitué à dire : Cela est ainsi, et non autrement, que je ne peux pas ne pas m’…inquiéter. Cela est si terrible d’être frappé par le pire, quand c’est au meilleur qu’on croit, et si j’en parle ainsi, c’est que cela m’est arrivé : après avoir tout craint pour mon père, nous étions sûres de son prompt rétablissement le jour même où nous l’avons perdu ; nous avons été folles, maman et moi ; et certainement c’est la violence de ce coup inattendu qui a tué ma pauvre maman ; elle n’a pas pu se relever ; six mois après, elle est morte à son tour. Alors pensant à cela, je me dis… »
Mais elle n’acheva pas, les sanglots étranglèrent les paroles dans sa gorge, et comme elle voulait les contenir, car elle comprenait qu’ils ne s’expliquaient pas, ils la suffoquèrent.
« N’évoque pas ces souvenirs, pauvre petite, dit M. Vulfran, et parce que tu as été cruellement éprouvée, n’imagine pas qu’il n’y a que malheurs en ce monde ; cela serait mauvais pour toi ; de plus cela serait injuste. »
Évidemment tout ce qu’elle dirait, ce qu’elle ferait n’ébranlerait pas cette confiance, qui ne voulait croire possible que ce qui s’accordait avec son désir : elle ne pouvait donc qu’attendre en se demandant, pleine d’angoisses, ce qui se passerait lorsqu’arriverait la lettre du banquier d’Amiens apportant la réponse de Serajevo.
Mais ce ne fut pas une lettre qui arriva, ce fut le banquier lui-même.
Un matin que Talouel comme à son ordinaire se promenait sur son banc de quart les mains dans ses poches, surveillant de son regard, qui ne laissait rien échapper, les cours de l’usine, il vit le banquier qu’il connaissait bien descendre de voiture à la grille des Shèdes, et se diriger vers les bureaux d’un pas grave, avec une attitude compassée.
Précipitamment il dégringola l’escalier de sa vérandah et courut au-devant de lui : en approchant, il constata que la mine était d’accord avec la démarche et l’attitude.
Incapable de se contenir il s’écria :
« Je suppose que les nouvelles sont mauvaises, cher monsieur ?
— Mauvaises. »
La réponse se renferma dans ce seul mot.
Talouel insista :
« Mais…
— Mauvaises. »
Puis changeant tout de suite de sujet :
« M. Vulfran est dans ses bureaux ?
— Sans doute.
— Je dois l’entretenir tout d’abord.
— Cependant…
— Vous comprenez. »
Si le banquier qui, dans son attitude embarrassée, fixait ses regards à terre, avait eu des yeux pour voir, il aurait deviné qu’au cas où Talouel deviendrait un jour le maître des usines de Maraucourt, il lui ferait payer cher cette discrétion.
Autant Talouel s’était montré obséquieux quand il avait espéré obtenir ce qu’il voulait savoir, autant il afficha de brutalité quand il vit ses avances repoussées :
« Vous trouverez M. Vulfran dans son cabinet », dit-il en s’éloignant les mains dans ses poches.
Comme ce n’était pas la première fois que le banquier venait à Maraucourt, il n’eut pas de peine à trouver le cabinet de M. Vulfran, et arrivé à sa porte, il s’arrêta un moment pour se préparer.
Il n’avait pas encore frappé qu’une voix, celle de M. Vulfran, cria :
« Entrez. »
Il n’y avait plus à différer, il entra en s’annonçant :
« Bonjour, monsieur Vulfran.
— Comment c’est vous ; à Maraucourt !
— Oui, j’avais affaire ce matin à Picquigny ; alors j’ai poussé jusqu’ici pour vous apporter des nouvelles de Serajevo. »
Perrine assise à sa table n’avait pas besoin que ce nom fût prononcé pour savoir qui venait d’entrer : elle resta pétrifiée.
« Eh bien ? demanda M. Vulfran d’une voix impatiente.
— Elles ne sont pas ce que vous deviez espérer, ce que nous espérions tous.
— Notre homme a voulu nous escroquer les quarante livres ?
— Il semble que ce soit un honnête homme.
— Il ne sait rien ?
— Ses renseignements ne sont que trop authentiques… malheureusement.
— Malheureusement ! »
C’était la première parole de doute que M. Vulfran prononçait.
Il s’établit un silence, et sur la physionomie de M. Vulfran qui s’assombrissait, il fut facile de voir par quels sentiments il passait : la surprise, l’inquiétude.
« Alors on n’a plus de nouvelles d’Edmond depuis le mois de novembre ? dit-il.
— On n’en a plus.
— Mais quelles nouvelles a-t-on eues à cette époque ? quel caractère de certitude, d’authenticité présentent-elles ?
— Nous avons des pièces officielles, visées par le consul de France à Serajevo.
— Mais parlez donc, rapportez ces nouvelles mêmes.
— En novembre, M. Edmond est arrivé à Serajevo comme… photographe.
— Allons donc ; vous voulez dire avec des appareils de photographie ?
— Avec une voiture de photographe ambulant, dans laquelle il voyageait en famille, accompagné de sa femme et de sa fille. Pendant quelques jours il a fait des portraits sur une place de la ville… »
Il chercha dans les papiers qu’il avait dépliés sur un coin du bureau de M. Vulfran.
« Puisque vous avez des pièces, lisez-les, dit M. Vulfran, ce sera plus vite fait.
— Je vais vous les lire ; je vous disais qu’il avait travaillé comme photographe sur une place publique, la place Philippovitch. Au commencement de novembre il quitta Serajevo pour… »
Il consulta de nouveau ses papiers :

« … pour Travnik, et tomba… ou arriva malade à un village situé entre ces deux villes…
— Mon Dieu, s’écria M. Vulfran, mon Dieu, mon Dieu ! »
Et il joignit les mains, le visage décomposé, tremblant de la tête aux pieds, comme si la vision de son fils se dressait devant lui.
« Vous êtes un homme de grande force…
— Il n’y a pas de force contre la mort. Mon fils…
— Eh bien oui, il faut que vous connaissiez l’affreuse vérité : le sept novembre… M. Edmond… est mort à Bousovatcha d’une congestion pulmonaire.
— C’est impossible !
— Hélas ! monsieur, moi aussi j’ai dit : c’est impossible en recevant ces pièces, bien que leur traduction soit visée par le consul de France ; mais cet acte de décès d’Edmond-Vulfran Paindavoine, né à Maraucourt (Somme), âgé de trente-quatre ans, n’emprunte-t-il pas un caractère d’authenticité à ces renseignements mêmes si précis ? Cependant voulant douter malgré tout, j’ai, en recevant ces pièces hier, télégraphié à notre consul à Serajevo ; voici sa réponse : « Pièces authentiques, mort certaine. »
Mais M. Vulfran paraissait ne pas écouter : affaissé dans son fauteuil, écroulé sur lui-même, la tête penchée en avant reposant sur sa poitrine, il ne donnait aucun signe de vie, et Perrine affolée, éperdue, suffoquée, se demandait s’il était mort.
Tout à coup, il redressa son visage ruisselant de larmes qui jaillissaient de ses yeux sans regard, et tendant la main il pressa le bouton des sonneries électriques qui correspondaient dans les bureaux de Talouel, de Théodore et de Casimir.
Cet appel était si violent qu’ils accoururent aussitôt tous les trois.
« Vous êtes là, dit-il, Talouel, Théodore, Casimir ? »
Tous trois répondirent en même temps.
« J’apprends la mort de mon fils. Elle est certaine. Talouel, arrêtez partout et immédiatement le travail ; téléphonez qu’on affiche qu’il reprendra après demain, et que demain un service sera célébré dans les églises de Maraucourt, Saint-Pipoy, Hercheux, Bacourt et Flexelles.
— Mon oncle ! » s’écrièrent d’une même voix les deux neveux.
Mais il les arrêta :
« J’ai besoin d’être seul ; laissez-moi. »
Tout le monde sortit, Perrine seule resta.
« Aurélie, tu es là ? demanda M. Vulfran.
Elle répondit dans un sanglot.
« Rentrons au château. »
Comme toujours il avait posé sa main sur l’épaule de Perrine, et ce fut ainsi qu’ils sortirent au milieu du premier flot des ouvriers qui quittaient les ateliers : ils traversèrent ainsi le village où déjà la nouvelle courait de porte en porte, et chacun en les voyant passer se demandait s’il survivrait à cet écrasement ; comme il était déjà courbé, lui qui d’ordinaire marchait si solide, couché en avant comme un arbre que la tempête a brisé par le milieu de son tronc.
Mais cette question, Perrine se la posait avec plus d’angoisse encore, car aux secousses que de sa main il lui imprimait à l’épaule, elle sentait, sans qu’il prononçât une seule parole, combien profondément il était atteint.
Quand elle l’eut conduit dans son cabinet, il la renvoya :
« Explique pourquoi je veux être seul, dit-il, que personne n’entre, que personne ne me parle. »
Comme elle allait sortir :
« Et je me refusais à te croire.
— Si vous vouliez me permettre…
— Laisse-moi », dit-il rudement.


XXXVII
Toute la nuit le château fut plein de mouvement et de bruit, car successivement arrivèrent : de Paris, M. et Mme Stanislas Paindavoine, prévenus par Théodore ; de Boulogne, M. et Mme Bretoneux, avertis par Casimir ; enfin de Dunkerque et de Rouen, les deux filles de Mme Bretoneux avec leurs maris et leurs enfants. Personne n’aurait manqué au service de ce pauvre Edmond. D’ailleurs ne fallait-il pas être là pour prendre position et se surveiller ? Maintenant que la place était vide, et bien vide à jamais, qui allait s’en emparer ? C’était l’heure des manœuvres habiles où chacun devait s’employer entièrement, avec toute son énergie, toute son intelligence, toute son intrigue. Quel désastre si cette industrie qui était une des forces du pays, tombait aux mains d’un incapable comme Théodore ! Quel malheur si un esprit borné comme Casimir en prenait la direction ! Et aucune des deux familles n’avait la pensée d’admettre qu’une association fût possible, qu’un partage pût se faire entre les deux cousins : on voulait tout pour soi ; l’autre n’aurait rien : quels droits d’ailleurs avait-il à faire valoir cet autre ?
Perrine s’attendait à la visite matinale de Mme Bretoneux, et aussi à celle de Mme Paindavoine ; mais elle ne reçut ni l’une ni l’autre, ce qui lui fit comprendre qu’on ne croyait plus avoir besoin d’elle, au moins pour le moment. Qu’était-elle en effet dans cette maison ? Maintenant c’était le frère de M. Vulfran, sa sœur, ses neveux, ses nièces, ses héritiers enfin, qui y étaient les maîtres.
Elle s’attendait aussi à ce que M. Vulfran l’appellerait pour qu’elle le conduisît à l’église, comme elle le faisait tous les dimanches depuis qu’elle avait remplacé Guillaume ; mais il n’en fut rien, et quand les cloches, qui depuis la veille sonnaient des glas de quart d’heure en quart d’heure, annoncèrent la messe, elle le vit monter en landau appuyé sur le bras de son frère, accompagné de sa sœur et de sa belle-sœur, tandis que les membres de la famille prenaient place dans les autres voitures.
Alors n’ayant pas de temps à perdre, elle qui devait faire à pied le trajet du château à l’église, elle partit au plus vite.
Elle quittait une maison sur laquelle la Mort avait étendu son linceul ; elle fut surprise en traversant à la hâte les rues du village, de remarquer qu’elles avaient leur air des dimanches, c’est-à-dire que les cabarets étaient pleins d’ouvriers qui buvaient en bavardant avec un tapage assourdissant, tandis que le long des maisons, assises sur des chaises, ou sur le pas de leur porte, les femmes causaient et que les enfants jouaient dans les cours. Personne n’assisterait-il donc au service ?
En entrant dans l’église où elle avait eu peur de ne pas pouvoir entrer, elle la vit à moitié vide : dans le chœur était rangée la famille ; çà et là se montraient les autorités du village, les fournisseurs, le haut personnel des usines, mais rares, très rares étaient les ouvriers, hommes, femmes, enfants qui, en cette journée dont les conséquences pouvaient être si graves pour eux cependant, avaient eu la pensée de venir joindre leurs prières à celles de leur patron.
Le dimanche sa place était à côté de M. Vulfran, mais comme elle n’avait pas qualité pour l’occuper, elle prit une chaise à côté de Rosalie qui accompagnait sa grand’mère en grand deuil.
« Hélas ! mon pauvre petit Edmond, murmura la vieille nourrice qui pleurait, quel malheur ! Qu’est-ce que dit M. Vulfran ? »
Mais l’office qui commençait dispensa Perrine de répondre, et ni Rosalie, ni Françoise ne lui adressèrent plus la parole, voyant combien elle était bouleversée.
À la sortie, elle fut arrêtée par Mlle Belhomme qui, comme Françoise, voulut l’interroger sur M. Vulfran, et à qui elle dut répondre qu’elle ne l’avait pas vu depuis la veille.
« Vous rentrez à pied ? demanda l’institutrice.
— Mais oui.
— Eh bien, nous ferons route ensemble jusqu’aux écoles. »
Perrine eût voulu être seule, mais elle ne pouvait pas refuser et elle dut suivre la conversation de l’institutrice.
« Savez-vous à quoi je pensais en regardant M. Vulfran se lever, s’asseoir, s’agenouiller pendant l’office, si brisé, si accablé qu’il semblait toujours qu’il ne pourrait pas se redresser ? C’est que pour la première fois aujourd’hui, il a peut-être été bon pour lui d’être aveugle.
— Pourquoi ?
— Parce qu’il n’a pas vu combien l’église était peu remplie. C’eût été une douleur de plus que cette indifférence de ses ouvriers à son malheur.
— Ils n’étaient pas nombreux, cela est vrai.
— Au moins il ne l’a pas vu.
— Mais êtes-vous sûre qu’il ne s’en soit pas rendu compte par le silence vide de l’église en même temps que par le brouhaha des cabarets quand il a traversé les rues du village ; avec les oreilles il reconstitue bien des choses.
— Cela serait un chagrin de plus pour lui, dont il n’a pas besoin, le pauvre homme ; et cependant… »
Elle fit une pause pour retenir ce qu’elle allait dire ; mais comme elle n’avait pas l’habitude de jamais cacher ce qu’elle pensait, elle ajouta :
« Et cependant ce serait une leçon, une grande leçon, car voyez-vous, mon enfant, nous ne pouvons demander aux autres de s’associer à nos douleurs, que lorsque nous nous associons nous-mêmes à celles qu’ils éprouvent, ou à leur souffrance ; et on peut le dire, parce que c’est l’expression de la stricte vérité… »
Elle baissa la voix :
« … Ce n’a jamais été le cas de M. Vulfran : homme juste avec les ouvriers, leur accordant ce qu’il leur croit dû, mais c’est tout ; et la seule justice, comme règle de ce monde, ce n’est pas assez : n’être que juste, c’est être injuste. Comme il est regrettable que M. Vulfran n’ait jamais eu l’idée qu’il pouvait être un père pour ses ouvriers ; mais entraîné, absorbé par ses grandes affaires, il n’a appliqué son esprit supérieur qu’aux seules affaires. Quel bien il eût pu faire cependant, non seulement ici même, ce qui serait déjà considérable, mais partout par l’exemple donné. Qu’il en eût été ainsi et vous pouvez être certaine que nous n’aurions pas vu aujourd’hui… ce que nous voyons. »
Cela pouvait être vrai, mais Perrine n’était pas en situation d’apprécier la morale de ces paroles, qui la blessaient par ce qu’elles disaient, autant que parce qu’elle les entendait de la bouche de Mlle Belhomme, pour qui elle s’était vite prise d’une affection respectueuse. Qu’une autre eût exprimé ces idées, il lui semblait que cela l’eût laissée indifférente, mais elle souffrait de ce qu’elles étaient celles d’une femme en qui elle avait mis une grande confiance.
En arrivant devant les écoles elle se hâta donc de la quitter.
« Pourquoi n’entrez-vous pas, nous déjeunerions ensemble, dit Mlle Belhomme qui avait deviné que son élève ne devait pas prendre place à la table de la famille.
— Je vous remercie : M. Vulfran peut avoir besoin de moi.
— Alors rentrez. »
Mais en arrivant au château elle vit que M. Vulfran n’avait pas besoin d’elle, et même qu’il ne pensait pas du tout à elle ; car Bastien qu’elle rencontra dans l’escalier lui dit qu’en descendant de voiture, M. Vulfran s’était enfermé dans son cabinet où personne ne devait entrer :
« En un jour comme aujourd’hui, il ne veut même pas déjeuner avec la famille.
— Elle reste, la famille ?
— Vous pensez bien que non ; après le déjeuner, tout le monde part ; je crois qu’il ne voudra même pas recevoir les adieux de ses parents. Ah ! il est bien accablé. Qu’est-ce que nous allons devenir, mon Dieu ! Il faudra nous aider.
— Que puis-je ?
— Vous pouvez beaucoup : M. Vulfran a confiance en vous, et il vous aime bien.
— Il m’aime !
— Je sais ce que je dis, et c’est gros cela. »
Comme Bastien l’avait annoncé, toute la famille partit après le déjeuner ; mais jusqu’au soir Perrine resta dans sa chambre sans que M. Vulfran la fît appeler ; ce fut seulement un peu avant le coucher que Bastien vint lui dire que le patron la prévenait de se tenir prête à l’accompagner le lendemain matin à l’heure habituelle.
« Il veut se remettre au travail, mais le pourra-t-il ? Ce serait le mieux : le travail c’est sa vie. »
Le lendemain à l’heure fixée, comme tous les matins elle se trouva dans le hall, attendant M. Vulfran, et bientôt elle le vit paraître, marchant courbé, conduit par Bastien, qui silencieusement fit un signe attristé pour dire que la nuit avait été mauvaise.
« Aurélie est-elle là ? » demanda-t-il d’une voix altérée, dolente et faible comme celle d’un enfant malade.

Elle s’avança vivement :
« Me voilà, monsieur.
— Montons en voiture. »
Elle eût voulu l’interroger, mais elle n’osa pas ; une fois assis en voiture, il s’affaissa et la tête inclinée en avant, il ne prononça pas un mot.
Au bas du perron des bureaux, Talouel se tenait prêt à le recevoir et à l’aider à descendre ; ce qu’il fit obséquieusement :
« Je suppose que vous vous êtes senti assez fort pour venir, dit-il d’une voix compatissante qui contrastait avec l’éclat de ses yeux.
— Je ne me suis pas senti fort du tout ; mais je suis venu parce que je devais venir.
— C’est ce que je voulais dire… »
M. Vulfran lui coupa la parole en appelant Perrine, et en se faisant conduire par elle à son cabinet.
Bientôt commença le dépouillement de la correspondance qui était volumineuse, comprenant les lettres de deux jours ; il le laissa se faire, sans une seule observation, un seul ordre, comme s’il était sourd ou endormi.
Ensuite venait la réunion des chefs de services, dans laquelle devait ce jour-là se décider une grosse question, qui engageait sérieusement les intérêts de la maison : devait-on vendre les grandes provisions de jute qu’on avait aux Indes et en Angleterre, en ne gardant que ce qui était indispensable à la fabrication courante des usines pendant un certain temps, ou bien devait-on faire de nouveaux achats ? en un mot se mettre à la hausse ou à la baisse ?
Habituellement les affaires de ce genre se traitaient avec une méthode rigoureuse, dont personne ne s’écartait : chacun à tour de rôle, en commençant par le plus jeune, donnait son avis et développait ses raisons ; M. Vulfran écoutait, et à la fin, faisait connaître la résolution qu’il se proposait de suivre ; — ce qui ne voulait pas dire qu’il la suivrait, car plus d’une fois, on apprenait six mois ou un an après, qu’il avait fait précisément le contraire de ce qu’il avait dit ; mais en tout cas, il se prononçait avec une netteté qui émerveillait ses employés, et toujours la discussion aboutissait.
Ce matin-là la délibération suivit sa marche ordinaire, chacun expliqua ses raisons pour vendre ou pour acheter ; mais quand vint le tour de parole de Talouel, ce ne fut pas une affirmation que celui-ci produisit, ce fut un doute :
« Je n’ai jamais été si embarrassé ; il y a de bien bonnes raisons pour, mais il y en a de bien fortes contre. »
Il était sincère, en confessant cet embarras, car c’était une règle chez lui de suivre la discussion sur la physionomie du maître, bien plus que sur les lèvres de celui qui parlait, et de se décider d’après ce que disait cette physionomie, qu’il avait appris à connaître par une longue pratique, sans s’inquiéter de ce qu’il pouvait penser lui-même : que pouvait d’ailleurs peser son opinion dans la balance où de l’autre côté ce qu’il mettait était une flatterie au patron, dont il devait toujours et en tout devancer le sentiment. Or, ce matin-là, cette physionomie n’avait absolument rien exprimé, qu’un vague exaspérant. Voulait-il acheter ? Voulait-il vendre ? À vrai dire il semblait ne pas prendre souci plus de l’un que de l’autre ; absent, envolé, perdu dans un autre monde que celui des affaires.
Après Talouel, deux conclusions furent encore émises, puis ce fut au patron de rendre son arrêt ; et comme toujours, même plus complet que toujours s’établit un respectueux silence, tandis que les yeux restaient attachés sur lui.
On attendait, et comme il ne disait rien on s’interrogeait du regard : avait-il donc perdu l’intelligence ou le sentiment de la réalité ?
Enfin il leva le bras, et dit :
« Je vous avoue que je ne sais que décider. »
Quelle stupéfaction ! Eh quoi, il en était là !
Pour la première fois depuis qu’on le connaissait, il se montrait indécis, lui toujours si résolu, si bien maître de sa volonté.
Et les regards, qui tout à l’heure se cherchaient, évitaient maintenant de se rencontrer : les uns par compassion ; les autres, particulièrement ceux de Talouel et des neveux, de peur de se trahir.
Il dit encore :
« Nous verrons plus tard. »
Alors chacun se retira, sans dire un mot, et en s’en allant, sans échanger ses réflexions.
Resté seul avec Perrine, assise à la petite table d’où elle n’avait pas bougé, il ne parut pas faire attention au départ de ses employés, et garda son attitude accablée.
Le temps s’écoula, il ne bougea point. Souvent elle l’avait vu rester, immobile devant sa fenêtre ouverte, plongé dans ses pensées ou ses rêves, et cette attitude s’expliquait de même que son inaction et son mutisme, puisqu’il ne pouvait ni lire, ni écrire ; mais alors elle ne ressemblait en rien à celle de maintenant, et à le regarder, l’oreille attentive, on pouvait voir sur sa physionomie mobile, que par les bruits de l’usine, il suivait son travail comme s’il le surveillait de ses yeux, dans chaque atelier ou chaque cour : le battement des métiers, les échappements de la vapeur, les ronflements des cannetières, les lamentables gémissements de la valseuse, le décrochage et l’accrochage des wagons, le roulement des wagonets, les coups de sifflet des locomotives, les commandements de manœuvres, même le sabotage des ouvriers quand ils traversaient d’un pas traîné un chemin pavé, rien ne se confondait pour lui, et de tout il se rendait un compte exact, qui lui permettait de savoir ce qui se faisait, et avec quelle activité ou quelle nonchalance cela se faisait.
Mais maintenant oreille, visage, physionomie, mouvements, tout paraissait pétrifié, momifié comme l’eût été une statue. Cela était si saisissant que Perrine, dans ce silence, se sentait envahie par une sorte de terreur qui l’anéantissait.
Tout à coup, il mit ses deux mains sur son visage, et d’une voix forte, avec la conscience d’être seul, ou plutôt sans conscience de l’endroit où il était et de ceux qui pouvaient l’entendre, il dit :
« Mon Dieu, mon Dieu, vous vous êtes retiré de moi. Qu’ai-je fait pour que vous m’abandonniez ? »
Puis le silence reprit plus écrasant, plus lugubre pour Perrine, que ce cri avait bouleversée, bien qu’elle ne pût pas mesurer toute l’étendue et la profondeur du désespoir qu’il accusait.
C’est qu’en effet, M. Vulfran, par la grande fortune qu’il avait faite et la situation qu’il occupait, en était arrivé à croire qu’il était un être privilégié, en quelque sorte un élu, dont la Providence se servait pour conduire le monde. Parti de si bas, comment serait-il parvenu si haut, s’il n’avait été servi que par sa seule intelligence ? Une main toute-puissante l’avait donc tiré de la foule pour de grandes choses, et plus tard guidé si sûrement, que ses idées avaient toujours obéi à une inspiration supérieure, de même que ses actes à une direction infaillible ; ce qu’il désirait, avait toujours réussi ; dans ses batailles, il avait toujours triomphé, et toujours ses adversaires avaient succombé. Mais voilà que tout à coup ce qu’il voulait le plus ardemment, ce qu’il se croyait sûr d’obtenir, pour la première fois ne se réalisait pas : il attendait son fils, il savait qu’il allait le voir arriver, toute sa vie était désormais arrangée pour cette réunion ; et son fils était mort.
Alors quoi ?
Il ne comprenait pas, — ni le présent, ni le passé.
Qu’avait-il été ?
Qu’était-il ?
Et si vraiment il avait été ce que pendant quarante ans il avait cru être, pourquoi ne l’était-il plus ?


XXXVIII
Cet anéantissement se prolongea, et il s’y joignit des accidents de santé : la bronchite, les palpitations s’aggravèrent, il se produisit même une congestion pulmonaire, qui pendant une semaine retint M. Vulfran à la chambre, et donna l’entière direction des usines à Talouel triomphant.
Cependant ces accidents s’amendèrent, mais la prostration morale ne s’améliora pas, et au bout de quelques jours, il n’y eut plus qu’elle qui inquiéta le médecin.
Plusieurs fois Perrine avait essayé de l’interroger ; mais il lui avait à peine répondu, le docteur Ruchon n’étant pas homme à s’intéresser à la curiosité des gamines ; heureusement il avait été moins rébarbatif avec Bastien et Mlle Belhomme qu’il rencontrait souvent à sa visite du soir, si bien que par le vieux valet de chambre et par l’institutrice, son anxiété était tant bien que mal renseignée.
« Il n’y a pas de danger pour la vie, disait Bastien, mais M. Ruchon voudrait voir monsieur se remettre au travail. »
Mlle Belhomme était moins brève, et quand en venant au château donner sa leçon, elle avait bavardé avec le médecin, elle répétait volontiers à son élève ce que celui-ci avait dit, ce qui d’ailleurs se résumait en un mot toujours le même :
« Il faudrait une secousse, quelque chose qui remontât la mécanique morale arrêtée ; mais dont le grand ressort ne paraît cependant pas cassé. »
Pendant longtemps on l’avait redoutée cette secousse, et c’était même la crainte qu’elle se produisît inopinément qui, plusieurs fois, avait retardé l’opération de la cataracte, que l’état général semblait permettre. Mais maintenant on la désirait. Qu’elle se produisît, que M. Vulfran sous son impression reprît intérêt à ses affaires, au travail, à tout ce qui était sa vie, et dans un avenir, prochain peut-être, on pourrait sans doute la tenter avec des chances de réussite, alors surtout qu’on n’aurait pas à redouter les violentes émotions d’un retour ou d’une mort, qu’au point de vue spécial de l’opération on pouvait également redouter.
Mais comment la provoquer ?
C’était ce qu’on se demandait sans trouver de réponse à cette question, tant il semblait détaché de tout, au point de ne vouloir recevoir ni Talouel, ni ses neveux pendant qu’il avait gardé la chambre, et d’avoir toujours fait répondre par Bastien, à Talouel, qui respectueusement venait à l’ordre deux fois par jour, le matin et le soir :
« Décidez pour le mieux. »
Et quand quittant le lit, il était revenu aux bureaux, à peine s’était-il fait rendre compte de ce qu’avait décidé Talouel trop habile, trop adroit et trop prudent d’ailleurs, pour prendre aucune mesure que le patron n’eût pas prise lui-même.
Cette apathie n’empêchait pas cependant que chaque jour Perrine le conduisît comme naguère dans les diverses usines ; mais le chemin se faisait silencieusement, sans qu’il répondît le plus souvent aux observations qu’elle lui adressait de temps en temps, et arrivé aux usines, c’était à peine s’il écoutait le rapport des directeurs.
« Pour le mieux, répétait-il, entendez-vous avec Talouel. »
Combien de temps cela durerait-il ?
Une après-midi qu’ils revenaient de la tournée des usines, et qu’ils approchaient de Maraucourt, au trot endormi du vieux cheval, une sonnerie de clairon passa dans la brise.
« Arrête, dit M. Vulfran, il semble qu’on sonne au feu. »
La voiture arrêtée, la sonnerie s’entendit distinctement.
« C’est le feu, dit M. Vulfran, vois-tu quelque chose ?
— Un tourbillon de fumée noire.
— De quel côté ?
— À travers le rideau des peupliers, je ne peux pas me reconnaître.
— À droite, ou à gauche ?
— Plutôt à gauche. »
À gauche, c’était vers l’usine.
« Faut-il mettre Coco au galop ? demanda-t-elle.
— Non, seulement va vite. »
En approchant, la sonnerie leur arrivait plus claire, mais comme ils tournaient selon le caprice des entailles bordées de peupliers, Perrine ne pouvait fixer l’endroit précis d’où s’élevait la fumée, il semblait que c’était du centre du village, et non de l’usine.
Elle fit cette observation à M. Vulfran, qui ne répondit rien.
Ce qui la confirma dans cette idée, ce fut que la sonnerie se faisait entendre maintenant tout à gauche, c’est-à-dire aux environs de l’usine.
« On ne sonne pas là où est le feu, dit-elle.
— Voilà qui est bien raisonné », répliqua M. Vulfran.
Mais il fit cette réponse d’un ton presque indifférent, comme s’il n’y avait pas intérêt pour lui à savoir où était le feu.
Ce fut seulement en entrant dans le village, qu’ils furent fixés ;
« Ne vous pressez pas, monsieur Vulfran, cria un paysan, le feu n’est pas chez vous, c’est la maison à la Tiburce qui brûle. »
La Tiburce était une vieille ivrogne qui gardait les enfants trop petits pour être admis à l’asile, et habitait une misérable chaumière, usée, à moitié effondrée, située au fond d’une cour, aux environs des écoles.
« Allons-y », dit M. Vulfran.
Il n’y avait qu’à suivre les gens qui couraient ; maintenant on voyait la fumée et les flammes s’élever en tourbillons au-dessus des maisons, et l’on respirait une odeur de brûlé. Avant d’arriver, ils durent arrêter sous peine d’écraser les curieux, qui pour rien au monde ne se seraient dérangés. Alors M. Vulfran descendit de voiture, et guidé par Perrine traversa les groupes. Comme ils approchaient de l’entrée de la maison, Fabry, le casque en tête, car il commandait les pompiers de l’usine, vint à eux :
« Nous sommes maîtres du feu, dit-il, mais la maison est

entièrement brûlée, et ce qui est plus grave, plusieurs enfants, cinq ou six peut-être ont péri ; un est enseveli sous les décombres, deux ont été asphyxiés ; les trois autres, on ne sait pas.
— Comment le feu a-t-il pris ?
— La Tiburce était endormie ivre, — elle l’est encore, — les enfants les plus grands ont joué avec des allumettes ; quand tout a commencé à flamber, ils se sont sauvés, la Tiburce épouvantée en a fait autant, oubliant ceux au berceau. »
Une clameur sortait de la cour accompagnée de cris, M. Vulfran voulut se diriger de ce côté.
« N’allez pas par là, dit Fabry, ce sont les deux mères des enfants asphyxiés qui les pleurent.
— Qui sont-elles ?
— Des ouvrières des usines.
— Il faut que je leur parle. »
Il appuya sa main sur l’épaule de Perrine, pour dire qu’elle devait le conduire.
Précédés de Fabry, qui leur fit faire place, ils entrèrent dans la cour, où les pompiers noyaient les décombres de la maison effondrée entre ses quatre murs restés debout, et sous les jets d’eau des tourbillons de flammes jaillissaient de ce foyer avec des crépitements.
D’un coin opposé encombré de femmes, partaient les cris qu’ils avaient entendus. Fabry écarta les groupes, et M. Vulfran, précédé de Perrine, s’avança vers les deux mères qui tenaient leurs enfants sur leurs genoux. Au milieu de ses larmes, l’une d’elles, qui croyait peut-être à un secours suprême, le vit paraître ; alors reconnaissant que ce n’était que le patron, elle étendit vers lui un bras menaçant :
« Venez donc ver ce qu’on fait d’nos éfants, pendant qu’on s’extermine pour vous, c’est y vo qu’allez li rendre la vie ? Oh mon pauvre petit ! »
Et se penchant sur son enfant, elle éclata en cris et en sanglots.
Un moment M. Vulfran resta indécis, puis il dit à Fabry :
« Vous aviez raison ; allons-nous-en. »
Ils rentrèrent aux bureaux, et il ne fut plus question de l’incendie, jusqu’au moment où Talouel vint annoncer à M. Vulfran que sur les six enfants qu’on croyait morts, trois avaient été retrouvés en bonne santé chez des voisins, où on les avait portés dans le premier moment d’affolement : il n’y avait donc réellement que trois victimes, dont l’enterrement venait d’être fixé au lendemain.
Quand Talouel fut parti, Perrine, qui depuis le retour à l’usine était restée plongée dans une réflexion profonde, se décida à adresser la parole à M. Vulfran :
« N’irez-vous pas à cet enterrement ? demanda-t-elle avec un frémissement de voix, qui trahissait son émotion.
— Pourquoi irais-je ?
— Parce que ce serait votre réponse — la plus digne que vous puissiez faire — aux accusations de cette pauvre femme.
— Mes ouvriers sont-ils venus au service célébré pour mon fils ?
— Ils ne se sont pas associés à votre douleur : vous vous associez à celles qui les atteignent, c’est une réponse aussi cela, et qui serait comprise.
— Tu ne sais pas combien l’ouvrier est ingrat.
— Ingrat pourquoi ? Pour l’argent reçu ? C’est possible ; et cela vient peut-être de ce qu’il ne considère pas l’argent reçu au même point de vue que celui qui le donne ; n’a-t-il pas des droits sur cet argent qu’il a gagné lui-même ? Cette ingratitude-là existe peut-être telle que vous dites. Mais l’ingratitude pour une marque d’intérêt, pour une aide amicale, croyez-vous qu’elle soit la même ? C’est l’amitié qui fait naître l’amitié. On aime ceux dont on se sent aimé ; et il me semble que si nous nous faisons l’ami des autres, nous faisons des autres nos amis. C’est beaucoup de soulager la misère des malheureux ; mais comme c’est plus encore de soulager leur douleur… en la partageant. »
Elle avait encore bien des choses à dire dans ce sens, lui semblait-il ; mais M. Vulfran ne répondant rien, et ne paraissant même pas l’écouter, elle n’osa pas continuer : plus tard elle reprendrait ce sujet.
Quand ils passèrent devant la vérandah de Talouel pour rentrer au château, M. Vulfran s’arrêta :
« Prévenez M. le curé, dit-il, que je prends à ma charge les frais de l’enterrement des enfants ; qu’il ordonne un service convenable ; j’y assisterai. »
Talouel eut un haut-le-corps.
« Faites afficher, continua M. Vulfran, que tous ceux qui voudront se rendre demain à l’église en auront la liberté : c’est un grand malheur que cet incendie.
— Nous n’en sommes pas responsables.
— Directement, non. »
Ce ne fut pas la seule surprise de Perrine ; le lendemain matin, après le dépouillement de la correspondance et la conférence avec les chefs de service, M. Vulfran retint Fabry :
« Vous n’avez rien de pressé en train, je pense ?
— Non, monsieur.
— Eh bien, partez pour Rouen. J’ai appris qu’on avait construit là une crèche modèle, dans laquelle on a appliqué ce qui s’est fait de mieux ailleurs ; non la Ville, il y aurait eu concours et par suite routine, mais un particulier qui a cherché dans le bien à faire un hommage à des mémoires chères. Vous étudierez cette crèche dans tous ses détails : construction, chauffage, ventilation, prix de revient, et dépense d’entretien. Puis vous demanderez à son constructeur de quelles crèches il s’est inspiré. Vous irez les étudier aussi, et vous reviendrez aussi vite qu’il vous sera possible. Il faut qu’avant trois mois nous ayons ouvert une crèche à la porte de toutes mes usines : je ne veux pas qu’un malheur comme celui qui est arrivé avant-hier se renouvelle. Je compte sur vous. N’ayons pas la charge d’une pareille responsabilité. »
Le soir, la leçon que Mlle Belhomme donnait à Perrine qui avait raconté cette grande nouvelle à l’institutrice enthousiasmée, fut interrompue par l’entrée de M. Vulfran dans la bibliothèque :
« Mademoiselle, dit-il, je viens vous demander un service en mon nom et au nom des populations de ce pays, service considérable, d’une importance capitale par les résultats qu’il peut produire, mais qui, je le reconnais, exige de votre part un sacrifice considérable aussi : voici ce dont il s’agit. »
Ce dont il s’agissait, c’était qu’elle donnât sa démission pour prendre la direction des cinq crèches qu’il allait fonder ; après avoir cherché, il ne trouvait qu’elle qui fût la femme d’intelligence, d’énergie et de cœur capable de mener à bien une tâche aussi lourde. Les crèches ouvertes, il les offrirait aux communes de Maraucourt, Saint-Pipoy, Hercheux, Bacourt, Flexelles, avec un capital suffisant pour subvenir à leur entretien à perpétuité, et il ne mettrait pour condition à sa donation que l’obligation de maintenir à leur tête celle en qui il avait toute confiance pour assurer le succès et la durée de son œuvre.
Ainsi présentée, la demande ne pouvait pas ne pas être accueillie, mais ce ne fut pas sans déchirements, car le sacrifice, comme l’avait dit M. Vulfran, était considérable pour l’institutrice :
« Ah ! monsieur, s’écria-t-elle, vous ne savez pas ce que c’est que l’enseignement.
— Donner le savoir aux enfants, c’est beaucoup, je le sais, mais leur donner la vie, la santé, c’est quelque chose aussi, et ce sera vôtre tâche ; elle est assez grande pour que vous ne la refusiez pas.
— Et je ne serais pas digne de votre choix si j’écoutais mes convenances personnelles… Après tout je me prendrai moi-même pour élève, et j’aurai tant à apprendre, que mon besoin d’enseignement trouvera à s’employer largement. Je suis à vous de tout cœur, et ce cœur est plus ému qu’il ne saurait l’exprimer, pénétré de gratitude, d’admiration…
— Si vous voulez parler de gratitude, ce n’est pas à moi qu’il faut en adresser l’expression, mais à votre élève ; mademoiselle, car c’est elle qui par ses paroles, par ses suggestions, a éveillé dans mon cœur des idées auxquelles j’étais jusqu’alors resté étranger, et m’a mis dans une voie où je n’ai encore fait que quelques pas, qui ne sont rien à côté de la route à parcourir.
— Ah ! monsieur, s’écria Perrine enhardie de joie et de fierté, si vous vouliez encore en faire un.
— Pour aller où ?
— Quelque part où je vous conduirais ce soir.
— Alors, tu ne doutes de rien.
— Ah ! si je ne doutais de rien !
— Est-ce de moi que tu doutes ?
— Non, monsieur, de moi, de moi seule. Mais cela n’a aucun rapport avec ce que je vous demande en vous proposant de vous conduire quelque part ce soir.
— Mais où veux-tu me conduire ce soir ?
— En un endroit où votre présence pendant quelques minutes seulement peut produire des résultats extraordinaires.
— Encore ne peux-tu me dire quel est cet endroit mystérieux ?
— Si je vous le disais, l’effet que j’attends de notre visite serait manqué. Il fera beau et chaud ce soir, vous n’aurez pas à craindre de gagner froid, laissez-vous décider.
— Il semble qu’on peut avoir confiance en elle, dit Mlle Belhomme, bien que cette proposition se présente sous une forme un peu… bizarre et enfantine.
— Allons, qu’il soit fait comme tu veux, je t’accompagnerai ce soir. À quelle heure fixes-tu notre expédition ?
— Plus il sera tard, mieux cela vaudra. »
Dans la soirée, il parla plusieurs fois de cette expédition, mais sans décider Perrine à s’expliquer.
« Sais-tu que tu en es arrivée à piquer ma curiosité ?
— Quand je n’aurais obtenu que cela, est-ce que ce ne serait pas déjà quelque chose ? Ne vaut-il pas mieux pour vous rêver à ce qui peut se produire tantôt ou demain, que vous anéantir dans les regrets de ce que vous espériez hier ?
— Cela vaudrait mieux si demain existait maintenant pour moi ; mais à quel avenir veux-tu que je rêve ? il est plus triste encore que le passé, puisqu’il est vide.
— Mais non, monsieur, il n’est pas vide, si vous songez à celui des autres. Quand on est enfant… et pas heureux, on pense souvent, n’est-ce pas, à tout ce qu’on demanderait à un magicien tout-puissant, à un enchanteur si on le rencontrait et qui n’a qu’à vouloir pour réaliser tous les souhaits ; mais quand on est soi-même cet enchanteur, est-ce qu’on ne pense pas quelquefois à ce qu’on peut faire pour rendre heureux ceux qui ne le sont pas, qu’ils soient enfants ou non ; puisqu’on a aux mains le pouvoir, n’est-ce pas amusant de s’en servir ? Je dis amusant parce que nous sommes dans une féerie, mais dans la réalité il y a un autre mot que celui-là. »
La soirée s’écoula dans ces propos ; plusieurs fois M. Vulfran demanda si le moment n’était pas venu de partir, mais elle le retarda tant qu’elle put.
Enfin elle annonça qu’ils pouvaient se mettre en route : la nuit était chaude comme elle l’avait prévu, sans vent, sans brouillard, mais avec des éclairs de chaleur qui fréquemment embrasaient le ciel noir. Quand ils arrivèrent dans le village ils le trouvèrent endormi, pas une seule lumière ne brillait aux fenêtres closes, pas de bruit d’aucune sorte, excepté celui de l’eau qui tombait des barrages de la rivière.
Comme tous les aveugles, M. Vulfran savait se reconnaître la nuit, et depuis leur sortie du château, il avait suivi son chemin comme avec ses yeux.
« Nous voilà devant Françoise, dit-il, à un certain moment.
— C’est justement chez elle que nous allons. Maintenant si vous le voulez bien, nous ne parlerons pas : par la main je vous guiderai. Je vous préviens cependant que nous aurons un escalier à monter, il est facile et droit ; au haut de cet escalier j’ouvrirai une porte et nous entrerons ; nous ne resterons là que ce que vous voudrez rester, une minute ou deux.
— Que veux-tu que je voie, puisque je ne voie pas ?
— Vous n’avez pas besoin de voir.
— Alors pourquoi venir ?
— Pour être venu. J’oubliais de vous dire qu’il importe peu que nous fassions du bruit en marchant. »
Les choses s’arrangèrent comme elle avait dit, et en arrivant dans la cour intérieure, un éclair lui montra l’entrée de l’escalier. Ils montèrent, et Perrine ouvrant la porte dont elle avait parlé, attira doucement M. Vulfran et referma la porte.
Alors ils se trouvèrent enveloppés d’un air chaud, âcre, suffoquant.
Une voix empâtée dit :
« Qu’est-ce qui est là ? »
Une pression de main avertit M. Vulfran de ne pas répondre.
La même voix continua :
« Couche-té don la Noyelle. »
Cette fois ce fut la main de M. Vulfran qui dit à Perrine qu’il voulait sortir.
Elle rouvrit la porte, et ils redescendirent, tandis qu’un murmure de voix les accompagnait.
Ce fut seulement dans la rue que M. Vulfran prit la parole :
« Tu as voulu me faire connaître la chambrée dans laquelle tu as couché la première nuit de ton arrivée ici ?
— J’ai voulu que vous connaissiez une des nombreuses chambrées de Maraucourt, et des autres villages où couche tout un monde de vos ouvriers : hommes, femmes, enfants, pensant que quand vous auriez respiré leur air empoisonné pendant une minute seulement, vous voudriez faire rechercher combien de pauvres gens il tue. »


XXXIX
Il y avait treize mois jour pour jour, qu’un dimanche par un temps radieux Perrine était arrivée à Maraucourt, misérable et désespérée, se demandant ce qui allait advenir d’elle.
Le temps était aussi radieux, mais Perrine et le village ne ressemblaient en rien à ce qu’ils étaient l’année précédente.
À la place où elle avait passé la fin de sa journée, assise tristement à la lisière du petit bois qui couronne la colline, tâchant de se rendre compte de ce qu’étaient le village et les usines étalés au-dessous d’elle dans la vallée, se trouvent maintenant des bâtiments en construction ; un hôpital en bon air, en belle vue, qui dominera tout le pays et recevra les ouvriers des usines de M. Vulfran, qu’ils habitent ou n’habitent pas Maraucourt.
C’est de là qu’on peut le mieux suivre les transformations de la contrée, et elles sont extraordinaires, eu égard surtout au peu de temps qui s’est écoulé.
Aux usines elles-mêmes il n’a pas été apporté de changements bien sensibles : ce qu’elles étaient, elles le sont toujours, comme si, arrivées à leur complet développement, elles n’avaient qu’à continuer la marche régulière de tout ce qui est rigoureusement réglé.
Mais à une courte distance de leur entrée principale, là où autrefois s’effondraient de pauvres bicoques occupées par deux garderies d’enfants du genre de celle de la Tiburce brûlée quelques mois auparavant, se montrent le toit flambant rouge et la façade mi-partie rose, mi-partie bleue de la crèche que M. Vulfran a fait construire en achetant pour les raser ces vieilles masures croulantes.
Sa façon de procéder avec leurs propriétaires a été aussi nette que franche : il les a fait venir et leur a expliqué que comme il ne pouvait pas tolérer plus longtemps que les enfants de ses ouvriers et de ses ouvrières fussent exposés à être brûlés ou tués par toutes sortes de maladies résultant des mauvais soins qu’ils trouvaient chez celles qui les gardaient, il allait faire construire une crèche dans laquelle ces enfants seraient reçus, nourris, élevés gratuitement jusqu’à l’âge de trois ans. Entre sa crèche et leurs garderies il n’y avait pas de lutte possible. S’ils voulaient vendre leurs maisons, il les achèterait moyennant une somme fixe et une rente viagère. S’ils ne voulaient pas, ils n’avaient qu’à les garder ; le terrain ne lui manquerait pas. Ils avaient jusqu’au lendemain matin onze heures pour se décider ; à midi il serait trop tard.
Au centre du village se dressent d’autres toits rouges beaucoup plus hauts, plus longs, plus imposants : ce sont ceux d’un groupe de bâtiments à peine achevés dans lesquels sont établis des logements séparés, des réfectoires, des restaurants, des cantines, des magasins d’approvisionnement pour les ouvriers célibataires, hommes et femmes ; et pour ces bâtiments M. Vulfran a employé le même procédé d’expropriation que pour la crèche.
Précédemment se trouvaient là plusieurs vieilles maisons appropriées tant bien que mal, en réalité aussi mal que possible, au logement en chambrées des ouvriers et en cabinets. Il a fait appeler les propriétaires de ces maisons, et leur a tenu un langage à peu près analogue à celui dont il s’est déjà servi :
« Depuis longtemps on se plaint violemment des chambrées dans lesquelles vous couchez mes ouvriers, et c’est aux mauvaises conditions dans lesquelles sont établis ces logements qu’on attribue les maladies de poitrine et la fièvre typhoïde qui tuent tant de monde. Je ne peux pas tolérer cela plus longtemps. J’ai donc résolu de faire construire deux hôtels dans lesquels j’offrirai aux ouvriers célibataires, hommes et femmes, une chambre séparée et exclusive pour trois francs par mois. En même temps j’aménagerai les rez-de-chaussée en réfectoires et en restaurants où je donnerai un dîner composé de soupe, de ragoût ou de rôti, de pain et de cidre pour soixante-dix centimes. Si vous voulez me vendre vos maisons, j’élèverai mes hôtels sur leur emplacement. Si vous ne voulez pas, gardez-les. Ma combinaison est dans votre intérêt, car j’ai ailleurs des terrains où mes constructions me coûteront beaucoup moins cher. Vous avez jusqu’à onze heures demain pour réfléchir ; à midi il serait trop tard. »
Sur ces terrains éparpillés un peu partout, on aperçoit d’autres toits en tuiles neuves, tout petits ceux-là, et qui par leur propreté et leur éclat rouge contrastent avec les anciennes toitures couvertes de mousses et de sedum : ce sont ceux des maisons ouvrières dont la construction est commencée depuis peu, et qui toutes sont ou seront isolées au milieu d’un jardinet, dans lequel pourront se récolter les légumes nécessaires à l’alimentation de la famille qui, pour cent francs par an de loyer, aura le bien-être matériel et la dignité du chez soi.
Mais la transformation qui à coup sûr eût frappé le plus vivement, surpris et même stupéfié celui qui serait resté un an absent de Maraucourt, était celle qui avait bouleversé le parc même de M. Vulfran, dans des pelouses qui, en le prolongeant, descendaient jusqu’aux entailles avec lesquelles elles se confondaient. Cette partie basse restée jusque-là presque à l’état naturel, avait été retranchée du parc par un saut de loup, et maintenant s’élevait à son centre un grand chalet en bois, flanqué d’autres cottages ou de kiosques construits à la légère, qui donnaient à l’ensemble une apparence de jardin public que précisaient encore toutes sortes de jeux, des manèges de chevaux de bois, des balançoires, des appareils de gymnastique, des jeux de boules, de quilles, des tirs à l’arc, à l’arbalète, à la carabine et au fusil de guerre, des mâts de cocagne, des terrains pour la paume, des pistes pour vélocipèdes, un théâtre de marionnettes, une estrade pour des musiciens.
C’est qu’en réalité c’était bien un jardin public, celui qui servait aux jeux des ouvriers de toutes les usines ; car si pour chacun des autres villages : Hercheux, Saint-Pipoy, Bacourt, Flexelles, M. Vulfran avait décidé de faire les mêmes constructions qu’à Maraucourt, il avait voulu qu’il n’y eût pour tous qu’un seul lieu de réunion et de récréation où pourraient s’établir des relations générales, qui deviendraient un lien entre eux. Et la simple bibliothèque qu’il avait eu tout d’abord l’intention d’établir, s’était transformée, sans qu’il sût trop sous quelle influence, en ce vaste jardin où autour des salles de lecture et de conférence qui occupent le grand chalet central, se sont groupés ces jeux divers, dont le développement a exigé une partie même de son parc, de sorte que maintenant le cercle ouvrier protège le château et le fait pardonner.
Si rapidement que ces changements eussent été conçus et réalisés, ils n’ont pas été sans produire un vif émoi dans la contrée et même une sorte d’agitation.
Les plus hostiles ont été les logeurs, les cabaretiers, les boutiquiers qui ont crié à la ruine et à l’oppression : n’était-ce pas une injustice, un crime social qu’on vînt leur faire concurrence et les empêcher de continuer leur commerce dans les mêmes conditions qu’ils l’avaient toujours pratiqué, au mieux de leurs intérêts, comme il convient à des hommes libres ? Et de même que lors de la création des usines, les fermiers s’étaient insurgés contre ces fabriques qui leur prenaient les ouvriers de la terre, ou les obligeaient à hausser les salaires, les petits commerçants avaient joint leurs plaintes à celles des cultivateurs ; et c’était tout juste si quand M. Vulfran passait par les rues des villages en compagnie de Perrine, on ne les poursuivait pas de huées comme des malfaiteurs : il n’était donc pas encore assez riche, le vieil aveugle, qu’il voulait ruiner le pauvre monde ! la mort de son fils ne lui avait donc pas mis un peu de bonté, un peu de pitié au cœur ! les ouvriers étaient donc imbéciles de ne pas comprendre que tout cela n’avait d’autre but que de les enchaîner plus étroitement encore, et de leur reprendre d’une main ce qu’on semblait leur donner de l’autre. Des réunions s’étaient tenues où l’on avait discuté ce qu’il y avait à faire, et dans lesquelles plus d’un ouvrier avait prouvé qu’il n’était pas un imbécile comme tant d’autres de ses camarades.
Dans l’intimité même de M. Vulfran, ou plutôt dans sa famille, ces réformes avaient provoqué autant d’inquiétudes que de critiques. Devenait-il fou ? Allait-il se ruiner, c’est-à-dire les ruiner ? Ne serait-il pas prudent de le faire interdire ? Évidemment sa faiblesse pour cette petite fille, qui faisait de lui ce qu’elle voulait, était une preuve de démence sénile, que les tribunaux ne pourraient pas ne pas peser. Et toutes les inimitiés s’étaient concentrées sur cette dangereuse gamine qui ne savait pas ce qu’elle faisait : qu’importait à cette fille l’argent follement gaspillé, ce n’était pas le sien.
Heureusement pour la fille elle se sentait soutenue contre cette colère, dont elle recevait des coups directs ou indirects à chaque instant, par des amitiés qui l’encourageaient et la réconfortaient.
Comme toujours Talouel, courtisan du succès, s’était rangé de son côté : elle réussissait ce qu’elle entreprenait, elle faisait faire à M. Vulfran tout ce qu’elle voulait, elle était en butte à l’hostilité des neveux, c’était plus qu’il n’en fallait pour qu’il se montrât ouvertement son ami ; au fond, que lui importait que M. Vulfran dépensât des sommes considérables qui en réalité augmentaient la fortune des établissements ; cet argent ce n’était pas à lui Talouel qu’on le prenait, tandis que bien vraisemblablement les établissements seraient à lui un jour ou l’autre ; aussi quand il avait pu deviner qu’une amélioration nouvelle était à l’étude, n’avait-il pas raté les occasions de « supposer » avec M. Vulfran que le moment était propice pour la réaliser.
Mais d’autres amitiés qui plus que celle-là plaisaient à Perrine, c’était celles du docteur Ruchon, de Mlle Belhomme, de Fabry et des ouvriers que M. Vulfran avait fait élire pour composer le conseil de surveillance de ses différentes fondations.
En voyant comment « la gamine » avait rendu à M. Vulfran l’énergie morale et intellectuelle, le médecin avait changé de manières à son égard, et maintenant c’était avec une affection paternelle qu’il la traitait, presque avec déférence, en tout cas comme une personne qui compte : « Cette petite a plus fait que la médecine, disait-il, sans elle je ne sais vraiment pas ce que M. Vulfran serait devenu. »
Mlle Belhomme n’avait pas eu à changer de manières, mais elle était fière d’elle, et chaque jour dans sa leçon, il y avait quelques minutes où franchement elle laissait paraître ses vrais sentiments, bien qu’elle s’avouât que leur expression n’en fût peut-être pas très correcte, « de maîtresse à élève ».
Quant à Fabry, il était associé de trop près à tout ce qui se faisait, pour n’être pas en accord avec cette jeune fille, à laquelle il n’avait pas tout d’abord prêté attention, mais qui bien vite avait pris une si grande importance dans la maison, qu’il n’était plus qu’un instrument entre ses mains.
« Monsieur Fabry, vous allez aller à Noisiel étudier les maisons ouvrières.
— Monsieur Fabry, vous allez aller en Angleterre étudier le Working men’s club Union.
— Monsieur Fabry, vous allez aller en Belgique étudier les cercles ouvriers. »
Et Fabry partait, étudiait ce qu’on lui avait indiqué tout en ne négligeant rien de ce qu’il trouvait intéressant, puis au retour, après de longues discussions avec M. Vulfran, étaient arrêtés les plans qu’exécutaient sous sa direction l’architecte et les conducteurs de travaux, adjoints à son bureau, devenu depuis peu le plus important de la maison. Jamais elle ne prenait part à ces discussions, jamais elle n’y mêlait son mot, mais elle y assistait, et il eût fallu une stupidité réelle pour ne pas comprendre qu’elle les préparait, les inspirait, et qu’en somme c’était la semence qu’elle avait jetée dans l’esprit ou dans le cœur du maître, qui germait et portait ses fruits.
Pas plus que Fabry, les ouvriers élus par leurs camarades ne méconnaissaient le rôle de Perrine, et bien que dans leurs conseils, elle ne se fût jamais permis ni un mot, ni un signe, ils savaient très justement peser l’influence qu’elle exerçait, et ce n’était pas pour eux un mince sujet de confiance et de fierté qu’elle fût des leurs :
« Vous savez, elle a travaillé aux cannetières.
— Est-ce que si elle ne sortait pas du travail, elle serait ce qu’elle est ? »
Il n’eût pas fait bon que devant ceux-là, on parlât de la huer quand elle traversait les rues des villages ; les huées commencées auraient été vivement et violemment refoulées dans les gosiers.
Ce dimanche-là, justement Fabry, parti depuis plusieurs jours pour une enquête dont M. Vulfran n’avait pas parlé à Perrine, et qu’il avait même paru vouloir tenir secrète, était attendu ; le matin il avait envoyé de Paris une dépêche ne contenant que ces quelques mots :
« Renseignements complets, pièces officielles, arriverai midi ».
Il était midi et demi, et il n’arrivait pas, ce qui contrairement à l’habitude avait provoqué l’impatience de M. Vulfran d’ordinaire plus calme.
Son déjeuner achevé plus promptement que de coutume, il était rentré dans son cabinet avec Perrine, et à chaque instant il allait à la fenêtre ouverte sur les jardins pour écouter.
« Il est étrange que Fabry n’arrive pas.
— Le train aura eu du retard. »
Mais il ne se rendait pas à cette raison et restait à la fenêtre d’où elle eût voulu l’arracher, car il se passait dans les jardins et dans le parc des choses dont elle ne voulait pas qu’il eût connaissance ; avec une activité plus qu’ordinaire les jardiniers achevaient d’entourer de treillages les corbeilles de fleurs, tandis que d’autres emportaient les plantes rares disséminées sur les pelouses ; les grilles d’entrée étaient grandes ouvertes et au delà du saut de loup, le Cercle des ouvriers était pavoisé de drapeaux et d’oriflammes, qui claquaient dans la brise de mer.
Tout à coup il pressa le bouton d’appel pour son valet de chambre, et quand celui-ci parut, il lui dit que si quelqu’un venait, il ne recevrait personne.
Cet ordre surprit d’autant plus Perrine que le dimanche habituellement il recevait tous ceux qui voulaient l’entretenir, petits ou grands car très avare en semaine de paroles qui font perdre un temps appréciable en argent, il était au contraire volontiers bavard le dimanche, quand son temps et celui des autres n’avaient plus la même valeur.
Enfin un roulement de voiture se fit entendre dans le chemin des entailles, c’est-à-dire celui qui vient de Picquigny :
« Voilà Fabry, » dit-il d’une voix qui parut altérée, anxieuse et heureuse à la fois.
En effet, c’était bien Fabry, qui entra vivement dans le cabinet : lui aussi paraissait être dans un état extraordinaire, et le regard qu’il jeta tout d’abord à Perrine, la troubla sans qu’elle sût pourquoi :
« Un accident de machine est cause de mon retard, dit-il.
— Vous arrivez, c’est l’essentiel.
— Ma dépêche vous a prévenu.
— Votre dépêche trop courte et trop vague, m’a donné des espérances ; ce sont des certitudes qu’il me faut.
— Elles sont aussi complètes que vous pouvez les désirer.
— Alors parlez, parlez vite.
— Le dois-je devant mademoiselle ?
— Oui, si elles sont ce que vous dites. »
C’était la première fois que Fabry, rendant compte d’une mission, demandait s’il pouvait parler devant Perrine ; et dans l’état de trouble où elle se trouvait déjà, cette précaution ne pouvait que rendre plus violent encore l’émoi que les

paroles de M. Vulfran, et de Fabry, leur agitation à l’un et à l’autre, le frémissement de leurs voix avaient provoqué en elle.
— Comme l’avait bien prévu l’agent que vous aviez chargé de faire des recherches, dit Fabry qui parlait sans regarder Perrine, la personne dont il avait perdu la trace plusieurs fois était venue à Paris ; là, en compulsant les actes de décès, on a trouvé au mois de juin de l’année dernière un acte au nom de Marie Doressany, veuve de Edmond Vulfran Paindavoine. Voici une expédition de l’acte.
Il la remit entre les mains tremblantes de M. Vulfran.
« Voulez-vous que je vous la lise ?
— Avez-vous vérifié les noms ?
— Assurément.
— Alors ne lisez pas ; nous verrons plus tard, continuez.
— Je ne m’en suis pas tenu à cet acte, poursuivit Fabry, j’ai voulu interroger le propriétaire de la maison dans laquelle elle est morte, qui se nomme Grain de Sel, j’ai vu aussi ceux qui ont assisté à la mort de la pauvre jeune femme, une chanteuse des rues appelée la Marquise, et la Carpe, un vieux cordonnier ; c’est à la fatigue, à l’épuisement, à la misère qu’elle a succombé ; de même j’ai vu le médecin qui l’a soignée, le docteur Cendrier qui demeure à Charonne, rue Riblette ; il avait voulu l’envoyer à l’hôpital, mais elle a refusé de se séparer de sa fille. Enfin pour compléter mon enquête ils m’ont envoyé rue du Château-des-Rentiers chez une marchande de chiffons appelée La Rouquerie, que j’ai rencontrée hier seulement au moment où elle rentrait de la campagne. »
Fabry fit une pause, et, pour la première fois, se tournant vers Perrine qu’il salua respectueusement :
« J’ai vu Palikare, mademoiselle, il va bien. »
Depuis un moment déjà Perrine s’était levée, et elle regardait, elle écoutait éperdue, un flot de larmes jaillit de ses yeux.
Fabry continua :
« Fixé sur l’identité de la mère, il me restait à savoir ce qu’était devenue la fille, c’est ce que m’a appris La Rouquerie en me racontant la rencontre qu’elle avait faite dans les bois de Chantilly d’une pauvre enfant mourant de faim, retrouvée par son âne.
« Et toi, s’écria M. Vulfran se tournant vers Perrine qui tremblait de la tête aux pieds, ne me diras-tu pas pourquoi cette enfant ne s’est pas fait connaître, ne me l’expliqueras-tu pas toi qui peux descendre dans le cœur d’une jeune fille… ? »
Elle fit quelques pas vers lui.
Il continua :
« Pourquoi elle ne vient pas dans mes bras ouverts… ?
— Mon Dieu !
— Ceux de son grand’père. »


XL
Fabry s’était retiré, laissant en tête-à-tête le grand-père et la petite-fille.
Mais ils étaient si émus qu’ils restaient les mains dans les mains sans parler, n’échangeant que des mots de tendresse :
« Ma fille, ma chère petite-fille !
— Grand-papa. »
Enfin quand ils se remirent un peu du trouble qui les bouleversait, il l’interrogea :
« Pourquoi ne t’es-tu pas fait connaître ? demanda-t-il.
— Ne l’ai-je pas tenté plusieurs fois ? rappelez-vous ce que vous m’avez dit un jour, le dernier où j’ai fait allusion à maman et à moi : « plus jamais, tu entends, plus jamais, ne me parle de ces misérables ».
— Pouvais-je soupçonner que tu étais ma fille ?
— Si cette fille s’était présentée franchement devant vous ne l’auriez-vous pas chassée sans vouloir l’entendre ?
— Qui sait ce que j’aurais fait !
— C’est alors que j’ai décidé de ne me faire connaître que le jour où, selon la recommandation de maman, je me serais fait aimer.
— Et tu as attendu si longtemps ! n’avais-tu pas à chaque instant des preuves de mon affection ?
— Était-elle celle d’un père ? je n’osais le croire.
— Et il a fallu que, mes soupçons s’étant précisés après des luttes cruelles, des hésitations, des espérances aussi bien que des doutes que tu m’aurais épargnés en parlant plus tôt, j’emploie Fabry pour t’obliger à te jeter dans mes bras.
— La joie de l’heure présente ne prouve-t-elle pas qu’il était bon qu’il en fût ainsi ?
— Enfin c’est bien, laissons cela, et dis-moi ce que tu m’as caché, me laissant poursuivre des recherches que d’un mot tu pouvais satisfaire…
— En me découvrant.
— Parle-moi de ton père ; comment êtes-vous arrivés à Serajevo ? Comment était-il photographe ?
— Ce qu’a été notre vie dans l’Inde vous pouvez… »
Il l’interrompit :
« Dis-moi tu ; c’est à ton grand-père que tu parles, non plus à M. Vulfran.
— Par les lettres que tu as reçues tu sais à peu près ce qu’a été cette vie ; je te la raconterai plus tard, avec nos chasses aux plantes, nos chasses aux bêtes, tu verras ce qu’était le courage de papa, la vaillance de maman, car je ne peux pas te parler de lui sans te parler d’elle…
— Ne crois pas que ce que Fabry vient de m’apprendre d’elle, en me disant son refus d’entrer à l’hôpital où elle aurait peut-être été sauvée, et cela pour ne pas t’abandonner, ne m’a pas ému.
— Tu l’aimeras, tu l’aimeras.
— Tu me parleras d’elle.
— … Je te la ferai connaître, je te la ferai aimer. Je passe donc là-dessus. Nous avions quitté l’Inde pour revenir en France, quand, arrivé à Suez, papa perdit l’argent qu’il avait emporté. Il lui fut volé par des gens d’affaires. Je ne sais comment. »
M. Vulfran eut un geste qui semblait dire que lui savait ce comment.
« N’ayant plus d’argent, au lieu de venir en France, nous partîmes pour la Grèce, ce qui coûtait moins cher de voyage. À Athènes, papa, qui avait des instruments pour la photographie, fit des portraits dont nous vécûmes. Puis il acheta une roulotte, un âne, Palikare qui m’a sauvé la vie, et il voulut revenir en France par terre, en faisant des portraits le long de la route. Mais qu’on en faisait peu hélas ! et que la route était dure dans les montagnes, où le plus souvent il n’y avait que de mauvais sentiers dans lesquels Palikare aurait dû se tuer vingt fois par jour. Je t’ai dit comment papa était tombé malade à Bousovatcha. Je te demande à ne pas te raconter sa mort aujourd’hui, je ne pourrais pas. Quand il ne fut plus avec nous, il fallut continuer notre route. Si nous gagnions peu, quand il pouvait inspirer confiance aux gens et les décider à se faire photographier, combien moins encore y gagnâmes-nous quand nous fûmes seules. Plus tard aussi je te raconterai ces étapes de misère, qui durèrent de novembre à mai, en plein hiver, jusqu’à Paris. Par M. Fabry tu viens d’apprendre comment maman est morte chez Grain de Sel, et cette mort je te la dirai plus tard aussi avec les dernières recommandations de maman pour venir ici. »
Pendant que Perrine parlait, des rumeurs vagues venant des jardins passaient dans l’air.
« Qu’est-ce que cela ? » demanda M. Vulfran.
Perrine alla à la fenêtre : les pelouses et les allées étaient noires d’ouvriers endimanchés, d’hommes, de femmes, d’enfants au-dessus desquels flottaient des drapeaux, des bannières ; et de cette foule de six à sept mille personnes entassées, et dont les masses se continuaient en dehors du parc dans le jardin du Cercle, la route, les prairies, s’élevait cette rumeur qui avait surpris M. Vulfran et détourné son attention du récit de Perrine, si grande qu’en fut l’intérêt.
« Qu’est-ce donc ? répéta-t-il.
— C’est aujourd’hui ton anniversaire, dit-elle, et les ouvriers de toutes les usines ont décidé de le célébrer en te remerciant ainsi de ce que tu as fait pour eux.
— Ah ! vraiment, ah ! vraiment ! »
Il vint à la fenêtre comme s’il pouvait les voir, mais il fut reconnu, et aussitôt courut de groupe en groupe une clameur qui en se propageant devint formidable.
« Mon Dieu ! qu’ils pourraient être terribles s’ils étaient contre nous, murmura-t-il, sentant pour la première fois la force de ces masses qu’il commandait.
— Oui, mais ils sont avec nous parce que nous sommes avec eux.
— Et c’est à toi que cela est dû, petite-fille ; qu’il y a loin d’aujourd’hui au service célébré à la mémoire de ton père dans notre église vide.
— Voici l’ordre de la cérémonie qui a été adopté par le conseil : je te conduirai sur le perron à deux heures précises ; de là tu domineras la foule et tout le monde te verra ; un ouvrier de chacun des villages où sont les usines, montera sur le perron et, au nom de tous, le vieux père Gathoye t’adressera un petit discours. »
À ce moment deux heures sonnèrent à la pendule.
« Veux-tu me donner la main ? » dit-elle.
Ils arrivèrent sur le perron et une immense acclamation retentit ; alors comme cela avait été réglé les délégués montèrent sur le perron, et le père Gathoye qui était un vieux peigneur de chanvre s’avança seul à quelques pas de ses camarades pour débiter sa harangue qu’on lui avait fait répéter dix fois depuis le matin :
« Monsieur Vulfran, c’est pour vous féliciter que… c’est pour vous féliciter que… »
Mais il resta court en faisant de grands bras, et la foule qui voyait ses gestes éloquents crut qu’il débitait son discours.
Après quelques secondes d’efforts pendant lesquelles il s’arracha plusieurs poignées de cheveux gris, en tirant dessus comme s’il peignait son chanvre, il dit :
« Voilà la chose : j’avais un discours à vous dire, mais je peux pas en retrouver un mot, ce que ça m’ennuie pour vous ; enfin c’est pour vous féliciter, vous remercier au nom de tous, et de bon cœur. »
Il leva la main solennellement :
« Je le jure, foi de Gathoye. »
Pour être incohérent ce discours n’en remua pas moins M. Vulfran qui était dans un état d’âme où l’on ne s’arrête pas aux paroles ; la main toujours appuyée sur l’épaule de Perrine il s’avança jusqu’à la balustrade du perron et se trouva là comme dans une tribune où la foule le voyait :
« Mes amis, dit-il d’une voix forte, vos compliments d’amitié me causent une joie d’autant plus grande que vous me les apportez dans la journée la plus heureuse de ma vie, celle où je viens de retrouver ma petite-fille, la fille du fils que j’ai perdu ; vous la connaissez, vous l’avez vue à l’œuvre, soyez sûrs qu’elle continuera et développera ce que nous avons fait ensemble, et dites-vous que votre avenir, celui de vos enfants est entre de bonnes mains. »
Disant cela, il se pencha vers Perrine, et sans qu’elle pût s’en défendre la prenant dans ses bras encore vigoureux, il la souleva, et, la présentant à la foule, il l’embrassa.
Alors il s’éleva une acclamation poussée et répétée pendant plusieurs minutes par des milliers de bouches d’hommes, de femmes, d’enfants ; puis comme l’ordre de la fête avait été bien réglé, aussitôt le défilé commença et chacun en passant devant le vieux patron et sa petite-fille salua ou fit la révérence.
« Si tu voyais les bonnes figures, » dit Perrine.
Cependant il y en eut qui ne furent pas précisément radieuses : celles des neveux, quand la cérémonie terminée, ils vinrent féliciter leur « cousine ».
« Pour moi, dit Talouel qui avait voulu se donner le plaisir de se joindre à eux, et qui d’autre part tenait à ne pas perdre

de temps pour faire sa cour à l’héritière des usines, je l’avais toujours supposé. »
Des émotions de ce genre ne pouvaient pas être bonnes pour la santé de M. Vulfran ; la veille de son anniversaire il se trouvait mieux qu’il ne l’avait été depuis longtemps, ne toussant plus, n’étouffant plus, mangeant et dormant bien ; le lendemain, au contraire, la toux et les étouffements avaient si bien repris que tout ce qui avait été si péniblement gagné, paraissait perdu de nouveau.
Aussitôt le docteur Ruchon fut appelé :
« Vous devez comprendre, dit M. Vulfran, que j’ai envie de voir ma petite-fille, il faut donc que vous me mettiez au plus vite en état de supporter l’opération.
— Ne sortez pas, mettez-vous au régime lacté, soyez calme, parlez peu, et je vous garantis qu’avec le beau temps dont nous jouissons, l’oppression, les palpitations, la toux disparaîtront, et l’opération pourra se faire avec toutes chances de succès. »
Le pronostic du docteur Ruchon se réalisa, et un mois après l’anniversaire, deux médecins appelés de Paris constatèrent un état général assez bon pour autoriser l’opération qui, si elle n’avait point toutes les chances pour elle, en avait cependant de sérieuses et de nombreuses : en l’examinant dans une chambre obscure, on constatait que M. Vulfran avait conservé de la sensibilité rétinienne, ce qui était la condition indispensable pour permettre l’opération, et on décidait de la pratiquer avec iridectomie, c’est-à-dire excision d’une partie de l’iris.
Comme on voulait l’endormir, il s’y refusa ;
« Non, dit-il, mais je demande à ma petite-fille d’avoir le courage de me tenir la main ; vous verrez que cela me rendra solide. Est-ce très douloureux ?
— La cocaïne atténuera la douleur. »
L’opération faite, le patient ne recouvra pas la vue instantanément, et cinq ou six jours s’écoulèrent avant que ne commençât la coaptation de la plaie de son œil recouvert d’un bandeau compressif.
Combien furent-elles longues pour le père et la fille, ces journées d’attente, malgré les assurances favorables de l’oculiste resté au château pour pratiquer lui-même les pansements nécessaires ; mais l’oculiste n’était pas tout : que se passerait-il si une reprise de la bronchite se produisait ? Une crise de toux, un éternuement ne pouvaient-ils pas tout compromettre ?
Et de nouveau Perrine éprouva les angoisses qui l’avaient accablée pendant la maladie de son père et de sa mère. N’aurait-elle donc retrouvé son grand-père que pour le perdre, et une fois encore rester seule au monde ?
Le temps s’écoula sans complications fâcheuses, et M. Vulfran fut autorisé à se servir, dans une chambre aux volets clos, et aux rideaux fermés, de son œil opéré.
« Ah ! si j’avais eu des yeux, s’écria-t-il après l’avoir contemplée, est-ce que mon premier regard ne t’aurait pas reconnu pour ma fille ? Ils sont donc imbéciles ici de n’avoir pas retrouvé la ressemblance avec ton père ? Talouel serait donc sincère en disant qu’il l’avait « supposé ».
Mais on ne le laissa pas prolonger ses épanchements : il ne fallait pas qu’il éprouvât des émotions, ni qu’il toussât, ni qu’il eût des palpitations.
« Plus tard. »
Le quinzième jour le bandeau compressif fut remplacé par un bandeau flottant ; le vingtième les pansements cessèrent ; mais ce fut seulement le trente-cinquième que l’oculiste revint de Paris pour décider un choix de verres convexes qui permettraient la lecture et la vision à distance : avec un malade ordinaire les choses eussent sans doute marché moins lentement, mais avec le riche M. Vulfran c’eût été naïveté de ne pas pousser les soins à l’extrême, et de ne pas multiplier les voyages.
Ce que M. Vulfran désirait le plus, maintenant qu’il avait vu sa petite-fille, c’était de sortir pour visiter ses travaux ; mais cela demanda de nouvelles précautions, et imposa de nouveaux retards, car il ne voulait pas s’enfermer dans un landau aux glaces closes, mais se servir de son vieux phaéton, pour être conduit par Perrine, et se montrer à tous avec elle : pour cela il importait de choisir une journée sans soleil, aussi bien que sans vent et sans froid.
Enfin il s’en présenta une à souhait, douce et vaporeuse, avec un ciel bleu tendre, comme on en rencontre assez souvent en ce pays, et après le déjeuner Perrine donna l’ordre à Bastien de faire atteler Coco au phaéton.
« Tout de suite, mademoiselle. »
Elle fut surprise du ton de cette réponse, et du sourire de Bastien, mais elle n’y prêta pas autrement attention, occupée qu’elle était à habiller son grand-père de façon qu’il ne fût exposé à n’avoir ni froid, ni chaud.
Bientôt Bastien revint annoncer que la voiture était avancée, et ils se rendirent sur le perron ; Perrine qui ne quittait pas des yeux son grand-père, marchant seul, arrivait à la dernière marche, quand un formidable braiment lui fit tourner la tête.
Était-ce possible ! Un âne était attelé au phaéton, et cet âne ressemblait à Palikare, mais Palikare lustré, peigné, les sabots brillants, habillé d’un beau harnais jaune avec des houpettes bleues, qui continuait de braire le cou tendu, et voulait venir vers Perrine malgré le groom qui le retenait.
« Palikare ! »
Et elle lui sauta à la tête en l’embrassant.
« Ah ! grand-papa, quelle bonne surprise.
— Ce n’est pas à moi que tu la dois, c’est à Fabry qui l’a racheté à La Rouquerie ; le personnel des bureaux a voulu faire ce cadeau à leur ancienne camarade.
— M. Fabry est un bon cœur.
— Mais oui, mais oui, il a eu une idée qui n’est pas venue à tes cousins. Il m’en est venu une aussi à moi, qui a été de commander à Paris une jolie charrette pour Palikare ; elle arrivera dans quelques jours, et ne sera traînée que par lui, car ce phaéton n’est pas son affaire. »
Ils montèrent en voiture, et Perrine prit les guides :
« Par où commençons-nous ?
— Comment par où ? Mais par l’aumuche donc. Crois-tu que je n’ai pas envie de voir le nid où tu as vécu, et d’où tu es partie ? »
Elle était telle que Perrine l’avait quittée l’année précédente, avec son fouillis de végétation vierge, sans que personne y eût touché, respectée même par le temps qui n’avait fait qu’ajouter à son caractère.
« Est-ce curieux, dit M. Vulfran, qu’à deux pas d’un grand centre ouvrier, en pleine civilisation tu aies pu vivre là de la vie sauvage !
— Aux Indes, en pleine vie sauvage tout nous appartenait ; ici dans la vie civilisée, je n’avais droit à rien ; j’ai souvent pensé à cela. »
Après l’aumuche, M. Vulfran voulut que sa première visite fût pour la crèche de Maraucourt.
Il croyait la bien connaître pour en avoir longuement discuté et arrêté les plans avec Fabry, mais quand il se trouva dans l’entrée, et qu’il vit d’un coup d’œil toutes les autres salles : le dortoir où sont couchés les enfants au maillot dans des berceaux roses ou bleus, selon le sexe de l’enfant ; le pouponnat où jouent ceux qui marchent seuls ; la cuisine, le lavabo, il fut surpris et charmé de reconnaître que par une habile distribution et l’emploi de larges portes vitrées, l’architecte avait réalisé le difficile idéal à lui imposé, qui était que la crèche fût une véritable maison de verre où les mères vissent de la première salle, tout ce qui se passait dans celles où elles ne devaient pas entrer.
Quand du dortoir ils vinrent dans le pouponnat, les enfants se précipitèrent sur Perrine en lui présentant le jouet qu’ils avaient aux mains, une trompette, une crécelle, un cheval de bois, une poule, une poupée.
« Je vois que tu es connue ici, dit M. Vulfran.
— Connue ! reprit Mlle Belhomme qui les accompagnait, dites aimée, adorée ; elle est une petite mère pour eux : personne comme elle qui sache si bien les faire jouer.
— Vous souvenez-vous, répondit M. Vulfran, que vous me disiez que c’était une qualité maîtresse de savoir créer ce qui est nécessaire à nos besoins ; il me semble qu’il en est une autre plus belle encore, c’est de savoir créer ce qui est nécessaire aux besoins des autres, et cela précisément ma petite-fille l’a fait. Mais nous ne sommes qu’au commencement, ma chère demoiselle : bâtir des crèches, des maisons ouvrières, des cercles, c’est l’a b c d de la question sociale, et ce n’est pas avec cela qu’on la résout ; j’espère que nous pourrons aller plus loin, plus à fond ; nous ne sommes qu’à notre point de départ : vous verrez, vous verrez. »
Quand ils revinrent dans la salle d’entrée, une femme finissait d’allaiter son enfant ; vivement elle le redressa, et le présenta à M. Vulfran :
« Regardez-le, monsieur Vulfran, c’est-y un bel éfant ?
— Mais… oui, c’est un bel enfant.
— Eh ben, il est ben à vous.
— Vraiment ?
— J’en ai déjà eu trois, que j’ai perdus ; à qui doit-il de vivre celui-là ? Vous voyez s’il est à vous ; Dieu vous bénisse, vous et votre chère fille. »
Après la crèche ce fut le tour d’une maison ouvrière, puis de l’hôtel, du restaurant, du cercle, et en quittant Maraucourt ils allèrent à Saint-Pipoy, à Flexelles, à Bacourt, à Hercheux, et sur la route Palikare trottait joyeux, fier d’être conduit par sa petite maîtresse dont la main était plus douce que celle de La Rouquerie, et qui ne remontait jamais en voiture sans l’embrasser, — caresse à laquelle il répondait par des mouvements d’oreilles tout à fait éloquents pour qui savait les traduire.
Dans ces villages les constructions n’étaient pas aussi avancées qu’à Maraucourt, mais déjà cependant pour la plupart on pouvait fixer l’époque de leur achèvement.
La journée avait été bien remplie, ils revinrent lentement avant l’approche de la nuit ; alors comme ils passaient d’une colline à l’autre, ils se trouvèrent dominer la contrée où partout se montraient des toits neufs à l’entour des hautes cheminées qui vomissaient des tourbillons de fumée ; M. Vulfran étendit la main :
« Voilà ton ouvrage, dit-il, ces créations auxquelles entraîné par la fièvre des affaires, je n’avais pas eu le temps de penser. Mais pour que cela dure et se développe, il te faut un mari digne de toi, qui travaille pour nous et pour tous. Nous ne lui demanderons pas autre chose. Et j’ai idée que nous pourrons rencontrer l’homme de bon cœur qu’il nous faut. Alors nous vivrons heureux… en famille. »

En famille
