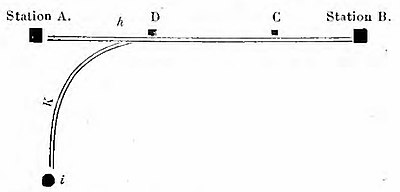La Double Vie de Théophraste Longuet/Texte entier

TABLE DES MATIÈRES
PRÉFACE HISTORIQUE
Certain soir de l’an dernier, je remarquai dans le salon d’attente du journal le Matin un homme tout de noir vêtu, sur la figure duquel je m’arrêtai à lire le plus sombre désespoir. Il ne pleurait plus. Ses yeux desséchés et morts recevaient l’image des objets extérieurs, comme des glaces immobiles.
Il était assis et avait déposé sur ses genoux un coffret en bois des îles tout orné de ferrures. Ses deux mains étaient croisées sur le coffret. Un garçon de service me dit qu’il attendait là, depuis trois longues heures, mon arrivée sans un mouvement, sans le bruit d’un soupir.
Je priai cet homme en deuil de franchir le seuil de mon cabinet.
Je lui montrai un siège, mais il ne s’assit point. Il vint droit à mon bureau et y déposa le coffret en bois des îles tout orné de ferrures.
— Monsieur, me dit-il d’une voix éteinte et lointaine, ce coffret vous appartient. Mon ami, M. Théophraste Longuet, m’a donné la mission de vous l’apporter. Recevez-le, monsieur, et croyez-moi votre serviteur.
L’homme me salua et regagna la porte. Je l’arrêtai :
— Eh quoi ! lui dis-je, ne partez pas ainsi. Je ne puis recevoir ce coffret sans savoir ce qu’il contient.
Il me répondit :
— Monsieur, je ne sais pas ce qu’il contient. Ce coffret est fermé à clef. La clef de ce coffret n’existe plus. Vous devez briser le coffret pour savoir ce qu’il contient.
Je repris :
— Je voudrais au moins savoir le nom de celui qui me l’apporte.
— Mon ami, M. Théophraste Longuet, m’appelait : Adolphe, répliqua cet homme désespéré, d’une voix de plus en plus éteinte.
— M. Théophraste Longuet, s’il m’eût apporté lui-même ce coffret, m’eût dit certainement ce qu’il renferme. Je regrette que M. Théophraste Longuet…
— Moi aussi, monsieur, fit l’homme. Mais M. Théophraste Longuet est mort, et je suis son exécuteur testamentaire.
Ayant dit ces mots, il ouvrit la porte et s’en alla. Je regardai le coffret, la porte, je courus à l’homme, mais il avait disparu.
Je fis ouvrir le coffret et y trouvai une liasse de papiers, que je considérai d’abord avec ennui et que j’examinai ensuite, par le menu, avec intérêt.
Au fur et à mesure que je pénétrai dans ces documents posthumes, l’aventure qui s’y révélait était si inattendue que je n’y voulus point croire ; cependant, comme il y avait là des preuves, je dus, après enquête, me rendre à sa réalité.
Tout d’abord, il importe de dire que le de cujus, M. Théophraste Longuet, bourgeois de Paris, me faisait héritier du coffret, de son contenu et des secrets qui s’y trouvaient renfermés.
Quels étaient ces secrets ?
Les papiers du défunt, fort nombreux, et qui relataient dans les plus grands détails les derniers événements d’une existence devenue exceptionnellement dramatique, m’apprenaient que M. Théophraste Longuet, par la découverte d’un document vieux de deux siècles, avait acquis la preuve que Louis-Dominique Cartouche et lui, Théophraste Longuet, venu au monde deux siècles plus tard, ne faisaient qu’UN.
Ce document l’avait mis également sur la trace des trésors du fameux Cartouche.
Un trépas précoce et certaines terribles histoires qui seront narrées tout au long dans cette œuvre extraordinaire n’avaient pas permis au défunt de les retrouver. Il me les léguait ainsi que tous les détails et tout le secret de son incroyable vie ; et cela, quoiqu’il ne me connût point, mais tout simplement parce que j’écrivais dans un journal qui avait été « son organe favori ». Enfin, s’il m’avait choisi parmi tant de rédacteurs de ce journal, c’est qu’il me trouvait, non pas plus d’esprit — ce qui m’eût empli de confusion — mais une intelligence plus solide que celle des autres.
J’appris par la suite et vous apprendrez ce qu’il entendait par le mot : solide.
Très perplexe, j’allai porter tout ce fatras à mon directeur qui, lui, eut cette imagination de le faire servir, non seulement à la joie des lecteurs de son journal mais encore à leur intérêt. Il n’hésita pas à trouver les trésors de Cartouche tout de suite, dans sa caisse. Vous savez de quelle sorte pratique et tout à fait curieuse vingt-cinq mille francs, somme divisée en sept trésors, furent cachés à Paris et en province, et comment l’auteur de ces lignes fut chargé de glisser, dans l’histoire trouvée dans le coffret en bois des îles, histoire qui parut en feuilleton au mois d’octobre de l’an 1903[1], certaines indications qui devaient conduire à la découverte des trésors du Matin.
Aujourd’hui que les trésors du Matin sont trouvés, il ne s’agira donc plus en cette œuvre que des trésors de Cartouche qui ne sont, du reste, que le moindre incident de cette prodigieuse aventure.
J’ai cru de mon devoir vis-à-vis du lecteur et aussi de la mémoire de Théophraste Longuet de publier en volume l’histoire vraie, l’histoire authentique de la réincarnation de Cartouche, écrite uniquement avec les documents trouvés dans le coffret en bois des îles, et débarrassée par conséquent de tout ce que, moi, pauvre journaliste, j’y avais ajouté avec tant de plaisir du reste, pour la fortune des lecteurs de mon journal.
Le lecteur du livre, lui, ne trouvera ici qu’un trésor, mais il est considérable : c’est une pure œuvre littéraire d’une valeur inestimable si l’on songe à tout ce que nous prouvent les documents enfermés dans le coffret en bois des îles.
Certes, quelques esprits avancés se doutaient bien de quelque chose, mais eussent-ils jamais osé soupçonner la réelle aventure de Théophraste Longuet ? osé la soupçonner et la comprendre ?
Le coffret en bois des îles contenait le secret de la tombe.
Il contenait aussi l’Histoire du peuple Talpa due à la plume autorisée de M. le commissaire de police Mifroid qui fut retenu trois semaines avec M. Théophraste Longuet chez ces monstres souterrains aux groins roses. Disons tout de suite que cette dernière infernale déambulation eut certainement rencontré des incrédules si le récit n’en avait été fait par le plus curieux, le plus noble, le plus charmant esprit — musicien, peintre, sculpteur, poète — des commissariats modernes, par ce Protée auquel on ne pourrait comparer que Léonard de Vinci si Léonard de Vinci avait été commissaire de police.
Enfin, je ne terminerai pas cette préface sans avertir le lecteur qu’il doit s’attendre à tout et qu’il est absolument dangereux, pour sa santé intellectuelle et physique, d’aborder le secret de la vie de Théophraste, s’il n’a, selon l’expression de Théophraste lui-même, la tête solide.
I
M. THÉOPHRASTE LONGUET VEUT S’INSTRUIRE ET VISITE LES MONUMENTS HISTORIQUES
L’étrange aventure de M. Théophraste Longuet qui devait se terminer d’une façon si tragique eut son origine dans une visite que cet homme de bien fit à la prison de la Conciergerie, le vingt-huitième jour de juin 1899. Ainsi l’histoire est d’hier, mais l’auteur de ces lignes, après avoir feuilleté, compulsé, interrogé, avec une grande conscience, tous les papiers, cahiers, mémoires et testaments du sieur Théophraste Longuet, ose dire qu’elle n’en est pas moins fantastique.
M. Théophraste Longuet, quand il sonna à la porte de la Conciergerie, n’était point seul ; il était accompagné de sa femme, Marceline, qui était une fort belle femme, blonde et mûre, la « majestueuse enfant » dont parle le poète. Marceline balançait son col « avec d’étranges grâces » ; et, vraiment, je ne trouve rien de mieux à vous dire sur cette aimable personne, pour vous donner la sensation un peu vague mais réelle de son aspect général, que les deux vers de Baudelaire :
Quand tu vas, balayant l’air de ta jupe large,
Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large.
M. Théophraste Longuet était donc accompagné de sa femme et aussi de M. Adolphe Lecamus, son meilleur ami.
La porte de fer trouée d’un petit judas grillagé tourna sur ses gonds avec pesanteur, comme il sied à une porte de prison, et un gardien, secoueur de clefs, demanda à Théophraste sa « permission ». Celui-ci était allé la chercher le matin même à la préfecture de police ; il la tendit avec satisfaction et, confiant dans son droit, regarda son ami Adolphe.
Il admirait Adolphe presque autant que sa femme. Ce n’était point qu’Adolphe fût absolument beau, mais il avait une figure énergique et il n’y avait rien au monde que Théophraste, l’homme le plus timide de Paris, prisât tant que l’énergie. Ce front large et bombé, — tandis que le sien était court et perpendiculaire — ces sourcils horizontaux et bien fournis, qui se relevaient d’ordinaire avec harmonie pour exprimer le dédain des autres et la confiance en soi, ce regard aigu — tandis que ses yeux pâles, à lui, clignaient sous des lunettes de myope, — ce nez droit, l’arc orgueilleux de cette lèvre, surmonté de la moustache brune en volute, le dessin carré du menton, bref, toute cette vivante antithèse de sa figure falote aux joues blettes était l’objet continuel de sa tacite admiration. De plus, Adolphe avait été employé supérieur des postes en Tunisie. Il avait donc « traversé la mer ».
Théophraste, lui, n’avait jamais rien traversé du tout. Certainement il avait traversé la Seine, il avait traversé Paris, mais on ne saurait prétendre sérieusement que ce sont là des traversées.
— Pourtant, disait-il, pourtant, on court quelquefois de plus grands risques en se promenant dans les rues de Paris qu’en naviguant sur les grands steamers (il prononçait : sté-a-mairs). Il peut vous tomber, sur la tête, un pot de fleurs !
Ainsi il aimait, par des imaginations inoffensives, introduire dans son existence monotone et exempte de tout danger apparent la perspective troublante des plus inattendues catastrophes.
Le gardien-portier remit la petite troupe à la disposition du gardien-chef qui passait.
Marceline était très impressionnée. Elle s’appuyait au bras d’Adolphe. Elle pensait au cachot de Marie-Antoinette et au musée Grévin.
Le gardien-chef dit :
— Vous êtes Français ?
Théophraste s’arrêta au milieu de la cour.
— Est-ce que nous ressemblons à des Anglais ? fit-il.
Et, en posant cette question, il souriait avec audace, car il était bien sûr d’être Français.
— C’est bien la première fois, expliqua le gardien-chef, que je vois des Français demander à visiter la Conciergerie. Les Français, à l’ordinaire, ne visitent rien.
— Ils ont tort, monsieur, répliqua Théophraste en essuyant les verres de ses lunettes. Ils ont tort. Les monuments du passé sont le livre de l’histoire.
Il s’arrêta et regarda Adolphe et sa femme. Évidemment, il trouvait la phrase belle. Mais Adolphe et Marceline ne l’avaient pas entendue. Il continua, en suivant l’homme porte-clefs :
— Moi, je suis un vieux Parisien, et si j’ai attendu ce jour pour visiter les monuments du passé, c’est que mon état — je fabriquais la semaine dernière encore, monsieur, des timbres en caoutchouc — ne m’a point laissé de loisir jusqu’à l’heure de la retraite. Cette heure a sonné, monsieur, je vais m’instruire.
Et il frappa avec autorité le pavé séculaire du bout de son ombrelle verte. Puis ils franchirent tous une petite porte et un grand guichet. Ils descendirent quelques marches et furent dans la salle des Gardes.
Et la première chose qui arrêta leurs regards fit sourire Adolphe, rougir Marceline, s’insurger Théophraste. C’était, au chapiteau d’une de ces sveltes colonnes gothiques qui sont le suprême orgueil de l’architecture au treizième siècle, l’histoire en pierre et symbolique d’Héloïse et d’Abailard. Abailard s’appuyait fort tristement à la protégée du chanoine Fulbert, cependant que celle-ci recueillait, d’une main attendrie, la cause de tous leurs malheurs.
— Il est étrange, fit M. Longuet en entraînant précipitamment sa femme et son ami, il est étrange que, sous prétexte d’art gothique, le gouvernement tolère de pareilles obscénités. Ce chapiteau déshonore la Conciergerie et il est incroyable que saint Louis, qui rendait la justice sous un chêne, ait pu en supporter la vue.
M. Lecamus n’était point de cet avis. Il disait : L’art sauve tout.
Mais bientôt ils ne parlèrent plus et furent uniquement à leurs réflexions. Ils faisaient « tout leur possible » pour que ces vieux murs qui évoquaient une si prodigieuse histoire leur laissassent une impression durable. Ils n’étaient pas des brutes. Pendant que le gardien-chef les conduisait dans la tour de César, ou dans la tour d’Argent, ou dans la tour Bon Bec, ils se disaient vaguement qu’il y avait eu là depuis plus de mille ans des prisonniers illustres dont ils avaient oublié les noms. Marceline continuait à penser à Marie-Antoinette, à madame Élisabeth et au petit Dauphin, et aussi aux gendarmes de cire qui veillent dans les musées, sur la famille royale. Ainsi, elle visitait la Conciergerie, tandis qu’en esprit elle était au Temple. Mais elle ne s’en doutait pas.
Comme ils descendaient de la tour d’Argent, où ils avaient trouvé pour tout souvenir moyenâgeux un vieux monsieur sur un rond-de-cuir, derrière un bureau modern-style, classant des papiers relatifs aux derniers internés politiques de la troisième République, ils retombèrent dans la salle des Gardes, se dirigeant vers la tour Bon Bec.
Théophraste, qui avait son idée, demanda au gardien-chef :
— N’est-ce pas ici, monsieur, que s’est passé le dernier repas des Girondins ?
Et il fut heureux d’ajouter, car il mettait quelque amour-propre à paraître renseigné :
— Vous devriez bien nous dire exactement où se trouvait la table, et aussi la place qu’occupait Camille Desmoulins.
Le gardien répondit que les Girondins avaient dîné dans la chapelle et qu’on la visiterait bientôt.
— Si je tiens à connaître la place de Camille Desmoulins, dit Théophraste, c’est que Camille Desmoulins est mon ami.
— À moi aussi, fit Marceline, avec un regard d’une grande douceur vers M. Adolphe Lecamus, regard qui signifiait — on peut le jurer — « Pas autant que toi, Adolphe ».
Mais Adolphe se moqua d’eux. Il prétendit que Camille n’était pas un Girondin. Théophraste fut vexé et un peu aussi Marceline. Quand Adolphe eut affirmé que c’était un cordelier, un ami de Danton, un septembriseur, Marceline nia :
— Jamais, dit-elle, s’il en eût été ainsi, jamais Lucie ne l’eût épousé.
M. Adolphe Lecamus n’insista pas, mais comme on était arrivé tour Bon Bec, dans la salle de la Torture, il feignit, par condescendance, de s’intéresser aux étiquettes qui annonçaient, sur les tiroirs garnissant les murs, du houblon, de la cannelle, du séné.
Le gardien dit :
— Ceci est la salle de la question. On en a fait la pharmacie.
— On a bien fait, répliqua Théophraste ; c’est plus humain.
— Sans doute, ajouta Adolphe, mais c’est moins impressionnant.
Marceline, du coup, fut de son avis. On n’était pas impressionné du tout. Ah ! ils attendaient autre chose. Quand on passe sur le quai de l’Horloge, l’aspect formidable de ces tours féodales, « dernier vestige » du palais de la vieille monarchie franque, porte un trouble momentané dans l’esprit du plus ignorant. Cette prison millénaire a entendu tant de râles magnifiques et caché de si lointaines et légendaires misères, qu’il semble bien que l’on n’a qu’à y pénétrer pour trouver assise en quelque coin sombre, humide et funeste, l’Histoire tragique de Paris, immortelle comme ces murs. Or, voici que dans ces tours, avec un peu de plâtre, de parquet, de peinture, on a fait le cabinet de M. le directeur, le bureau du greffier ; on a mis le potard là où autrefois se tenait le bourreau. Comme dit Théophraste, c’est plus humain.
Mais, tout de même, comme c’est moins impressionnant ainsi que l’affirme M. Adolphe, cette visite du vingt-huitième jour de juin 1899 menaçait de ne laisser chez nos trois personnages que le souvenir passager d’une complète désillusion, quand survint un événement inouï et si curieusement fantastique que j’ai cru de toute nécessité, après avoir lu la relation qui en a été faite par Théophraste Longuet lui-même dans ses mémoires, d’aller interroger le gardien-chef, qui me confirma la scène en ces termes.
— Monsieur, la chose s’était passée comme à l’ordinaire et je venais de faire visiter à ces messieurs et dame les cuisines de saint Louis, qui sont maintenant un dépôt de plâtres. Nous nous dirigions vers le cachot de Marie-Antoinette, qui est maintenant une petite chapelle. Le Christ devant lequel elle a prié avant de monter dans la charrette est aujourd’hui dans le cabinet de M. le directeur.
— Passez ! passez ! interrompis-je, et au fait.
— Mais nous y sommes. Je racontais à l’homme à l’ombrelle verte que nous nous étions vus forcés de placer dans le cabinet de M. le directeur le fauteuil de la reine, parce que les Anglais emportaient tout le crin de ce fauteuil dans leurs porte-monnaie.
— Eh ! passez ! m’exclamai-je, impatienté.
— Monsieur, il faut bien que je vous répète ce que je racontais à l’homme à l’ombrelle verte, quand il m’interrompit sur un ton tellement étrange que l’autre monsieur et la dame remarquèrent tout haut « qu’ils ne reconnaissaient plus sa voix ».
— Ah ! ah ! Et que vous disait-il ?
— Nous étions arrivés exactement à l’extrémité de la rue de Paris. (Vous savez ce que c’est que la rue de Paris à la Conciergerie ?)
— Oui, oui, continuez.
— Nous touchions à cet affreux couloir noir où se trouve une grille derrière laquelle on coupait les cheveux des femmes avant de les exécuter. Vous savez que c’est toujours la même grille ?
— Oui, oui, continuez.
— C’est un couloir, monsieur, où jamais ne pénètre un rayon de soleil. Vous savez que Marie-Antoinette, monsieur, a suivi ce couloir le jour de sa mort ?
— Oui, oui, continuez.
— C’est là, monsieur, la vieille Conciergerie dans toute son horreur… Alors, l’homme à l’ombrelle verte me dit : « Parbleu ! c’est l’allée des Pailleux ! »
— Il vous dit cela ? Rappelez-vous ; il vous dit bien : « Parbleu ! »
— Oui, monsieur.
— Ce n’est pas extraordinairement étonnant qu’il vous ait dit : « Parbleu ! c’est l’allée des Pailleux ! »
— Attendez ! Attendez ! Je lui répondis qu’il se trompait, que l’allée des Pailleux devait être cette allée que nous appelons aujourd’hui la rue de Paris. Il me répliqua avec cette même voix étrange : « Parbleu ! vous n’allez pas me l’apprendre ! J’y ai couché sur la paille, comme les autres ! »
» Je lui fis remarquer en souriant, non sans crainte, qu’on n’avait pas couché sur la paille, dans l’allée des Pailleux, depuis plus de deux cents ans.
— Et que vous répondit-il ? fis-je au gardien.
— Il allait me répondre quand sa femme intervint : « Qu’est-ce que tu racontes, Théophraste ? dit-elle. Tu veux apprendre son métier à monsieur et tu n’es jamais venu à la Conciergerie. » Alors il dit, mais avec sa voix naturelle, la voix que je lui connaissais au commencement : « C’est vrai, je ne suis jamais venu à la Conciergerie. »
— Et que fîtes-vous alors ?
— Je ne m’expliquais point cet incident et je le croyais terminé quand il se passa quelque chose de plus étrange encore.
— Ah ! ah !
— Nous avions visité le cachot de la reine et celui de Robespierre, et la chapelle des Girondins, et cette petite porte qui n’a point changé depuis que les malheureux prisonniers de septembre la franchirent pour se faire massacrer dans la cour ; nous étions revenus dans la rue de Paris. Il y a là sur la gauche un petit escalier que nous ne descendons jamais, car il conduit aux caves et il n’y a rien à voir dans les caves, que la nuit qui y règne éternellement. La porte qui est au bas de ce petit escalier est fermée par une grille qui a peut-être mille ans et même davantage. Le monsieur que l’on appelle Adolphe se dirigeait, avec la dame, vers la porte de sortie de la salle des Gardes quand, sans rien dire, l’homme à l’ombrelle verte descendit le petit escalier. Quand il fut à la grille, il cria, avec la voix étrange dont je vous ai parlé tout à l’heure :
» — Eh bien ! Où allez-vous ? C’est par ici !
» Le monsieur, la dame et moi, nous nous arrêtâmes comme pétrifiés. Il faut vous dire, monsieur, que sa voix était tout à fait terrible et que rien dans l’aspect de l’homme à l’ombrelle verte ne préparait à entendre une voix pareille. Je courus comme malgré moi au haut du petit escalier. L’homme me lança un regard foudroyant. Vrai, j’étais comme foudroyé, pétrifié et foudroyé, oui, monsieur, et quand il m’ordonna : « Ouvrez cette grille ! » je ne sais comment j’ai trouvé encore la force de descendre précipitamment les degrés et de lui ouvrir la porte, ainsi qu’il me le demandait d’une façon si exceptionnellement énergique. Alors…
— Alors ?
— Alors, quand la grille fut ouverte, il s’enfonça dans la nuit des caves. Où allait-il ? Comment trouvait-il son chemin ! Ces bas-fonds de la Conciergerie sont plongés dans d’effrayantes ténèbres que rien ne vient troubler depuis les siècles des siècles.
— Vous n’avez pas tenté de l’arrêter ?
— Il était déjà trop loin et ce n’était pas en mon pouvoir. L’homme à l’ombrelle verte me commandait. Je restai ainsi un quart d’heure environ, à l’entrée de cette nuit opaque. Soudain, j’entendis sa voix, pas la première mais la seconde voix. J’en fus tellement saisi que je m’accrochai aux barreaux de la porte. Il criait :
» — C’est toi, Simon l’Auvergnat ?
» Je ne répondis rien. Il passa près de moi et il me sembla qu’il mettait un chiffon de papier dans la poche de sa jaquette : il franchit d’un bond l’escalier et rejoignit l’autre monsieur et la dame. Il ne leur donna aucune explication. Moi, je courus leur ouvrir la porte de la prison. J’avais hâte de les voir dehors. Quand le guichet fut ouvert et que l’homme à l’ombrelle verte se trouva sur le seuil, devant le quai, il prononça, sans raison apparente, cette phrase :
» — Il faut éviter la roue !
» Je dis, monsieur : sans raison apparente, car il ne passait pas de voiture.
II
OÙ L’ON POURRAIT CROIRE QUE M. THÉOPHRASTE LONGUET EST FOU ; OÙ L’ON NE SAURAIT L’AFFIRMER
Que s’était-il passé ? Je reproduis textuellement ce que M. Théophraste Longuet a bien voulu me confier de cette exceptionnelle aventure dans ses mémoires au jour le jour.
« Je suis un homme sain de corps et d’esprit, confesse Théophraste. Je suis un bon citoyen, c’est-à-dire que je ne me suis jamais élevé contre la règle. Il faut des lois. Je les ai toujours observées. Du moins, je le crois.
» J’ai toujours eu la haine de l’imagination ; par là, j’entends que, dans toutes les circonstances de la vie, soit qu’il s’agit de placer mon amitié, soit que j’eusse à déterminer une ligne de conduite, j’ai pris soin de me rapprocher du bon sens. Le plus simple me semblait le meilleur.
» J’ai beaucoup souffert, par exemple, lorsque je découvris que mon ami Adolphe Lecamus, un ancien camarade de collège, un labadens, se livrait à l’étude du spiritisme.
» Qui dit spiritisme dit folie. Vouloir interroger les esprits par le truchement des tables tournantes est une chose éminemment grotesque. Du reste, j’ai assisté à quelques séances que cet excellent Adolphe nous donna à Marceline et à moi. J’y pris même une certaine part, désireux de lui prouver l’absurdité de ses théories. Des heures, nous restâmes, Adolphe, ma femme et moi, les mains sur un petit guéridon qui jamais ne se décida à tourner. Je me moquai fort de lui. Ma femme m’en voulut un peu, parce que les femmes sont toujours prêtes à ajouter foi à l’impossible et à croire au mystérieux.
» Adolphe lui apportait des livres, qu’elle lisait avec avidité, et s’amusait quelquefois à vouloir l’endormir, à lui faire des passes avec les mains et à lui souffler dans les yeux. C’était bête comme tout. Jamais je n’aurais supporté cela d’un autre, mais j’ai toujours eu du penchant pour Adolphe. Il a une figure énergique et il a beaucoup voyagé.
» Marceline et Adolphe disaient de moi que j’étais un « sceptique ». Je leur répondais que je n’étais point un sceptique, attendu qu’un sceptique est celui qui ne croit à rien ou qui doute de tout ; or, moi, je crois à tout ce qu’il faut croire ; je crois, par exemple, au progrès. Je ne suis pas un sceptique, je suis un sage.
» Pendant ses voyages, Adolphe a beaucoup lu ; moi, pendant ce temps-là, je fabriquais des timbres en caoutchouc. J’étais, je suis encore ce que l’on a coutume d’appeler un esprit « terre à terre ». Je ne m’en vante pas ; je constate, simplement.
» J’ai cru utile de donner ce léger aperçu de mon caractère pour qu’il fût bien entendu que ce qui m’est arrivé avant-hier n’est point de ma faute. Je visitais une prison, comme je serais allé acheter une cravate au Louvre. Je voulais m’instruire, voilà tout. J’ai maintenant des loisirs, puisque nous avons vendu notre fonds. Je me suis dit : « Faisons comme les Anglais, visitons Paris. » Et le hasard voulut que nous débutâmes par la Conciergerie.
» Je le regrette bien.
» Est-ce que je le regrette vraiment ? Je ne sais. Je ne sais plus rien. Je ne me rends plus compte de rien. En ce moment, je suis très calme. Et je vais vous raconter ce dont je me souviens, comme si la chose était arrivée à un autre. Tout de même, quelle histoire !
» Tant que nous fûmes dans les tours, il ne se passa rien qui vaille la peine d’être rapporté ici. Je me rappelle que, me trouvant dans la tour Bon Bec, je me disais : « Eh quoi ! c’est ici, dans cette petite salle qui a l’air d’une épicerie, qu’il y eut tant de douleurs et que furent martyrisées tant d’illustres victimes ! » J’essayai honnêtement de me représenter l’horreur de ces lieux quand le bourreau et ses aides s’approchaient des prisonniers avec leurs monstrueux engins, dans le dessein de leur faire avouer des crimes intéressant l’État. Mais, à cause justement des petites étiquettes des tiroirs sur lesquelles on lisait : « séné, houblon », je n’y parvenais pas.
» La tour Bon Bec ! On l’appelait aussi la « Bavarde », à cause des cris horribles qui s’en échappaient et qui allaient troubler sur le quai le passant inoffensif qui hâtait le pas, tout frissonnant encore d’avoir entendu la justice du roi.
» Maintenant, elle était bien paisible et toute silencieuse, la tour Bon Bec. Je ne m’en plaindrai point : c’est le progrès.
» Mais quand nous pénétrâmes dans cette partie de la Conciergerie qui n’a guère changé depuis des siècles, quand nous glissâmes entre ces pierres nues que n’ont recouvertes aucun enduit nouveau, aucun plâtre profane, une fièvre inexplicable s’empara de mes sens, et quand nous fûmes dans le noir du bout de l’allée des Pailleux, je criai : « Parbleu ! c’est l’allée des Pailleux ! »
» Aussitôt, je me retournai, pour savoir qui avait crié cela. Mais ils me regardaient tous et je vis bien que c’était moi qui avais crié cela. J’en avais la gorge encore toute frémissante.
» Cet imbécile de gardien prétendait que nous avions dépassé l’allée des Pailleux. Je lui dis son fait et il ne répliqua pas. J’en étais sûr, vous entendez bien, j’en étais sûr que c’était l’allée des Pailleux. Pourquoi en étais-je sûr ? Je lui répondis que j’y avais couché sur la paille, mais c’est absurde. Comment voulez-vous que j’aie couché sur la paille dans l’allée des Pailleux, puisque c’est la première fois que je vais à la Conciergerie ? Alors, en étais-je sûr ? Voilà ce qui m’épouvante. J’avais un mal de tête atroce.
» Mon front brûlait, ce pendant que je le sentais balayé par un grand courant d’air froid. Enfin, j’essaie de m’expliquer : j’avais froid au dehors, j’étais une fournaise au dedans.
» Qu’est-ce que nous avons fait ? Je me suis, un moment, promené bien tranquillement dans la chapelle des Girondins, et, ma foi, pendant que le gardien nous expliquait l’histoire, je jouais avec mon ombrelle verte. Je n’avais conservé aucun ennui de m’être montré si bizarre tout à l’heure. J’étais naturel. Mais, du reste, je n’ai jamais cessé d’être naturel.
» Ce qui m’est arrivé par la suite et que je vais vous conter était naturel, puisque cela n’était le résultat d’aucun effort. Ce qui n’aurait pas été naturel, c’est que ça ne m’arrivât pas.
» Je me souviens que je me suis trouvé, au bas d’un escalier, debout devant une grille. J’étais doué d’une force surhumaine ; je secouai la grille et je criai : « Par ici ! » Les autres, qui ne savaient pas, tardaient à venir et se trompaient de chemin. Je ne sais pas ce que j’aurais fait de la grille, si le gardien ne me l’avait ouverte ; je ne sais pas non plus ce que j’aurais fait du gardien. J’étais fou. Non, je n’ai pas le droit de dire cela. Je n’étais pas fou ; et c’est un grand malheur. C’est pire que si j’eusse été fou.
» Certes, j’étais dans une grande surexcitation nerveuse, mais je jouissais d’une entière lucidité. Je crois que je n’ai jamais vu aussi clair, et cependant j’étais dans les ténèbres ; je crois que je ne me suis jamais mieux souvenu, et cependant j’étais dans des lieux que je ne connaissais pas. Mon Dieu ! je ne les connaissais pas et je les reconnaissais ! Je n’hésitais pas sur mon chemin ; mes mains tâtonnantes retrouvaient des pierres qu’elles allaient chercher dans la nuit et mes pieds foulaient un sol qui ne pouvait m’être étranger.
» Qui pourra jamais dire l’antiquité de ce sol ; qui pourra vous apprendre l’âge de ces pierres ? Moi-même je ne le sais pas. On parle de l’origine du Palais ? Qu’est-ce que l’origine du vieux palais des Francs ? On pourrait peut-être dire quand ces pierres finiront, mais nul ne dira jamais quand elles ont commencé. Et elles sont oubliées, ces pierres, dans la nuit millénaire des Caves. L’étrange est que je m’en sois ressouvenu.
» Je glissais le long des parois humides, comme si ce chemin m’était coutumier ; j’attendais certaines aspérités de la muraille et elles venaient au bout de mes ongles ; je comptais les joints des pierres et je savais qu’au bout de ce compte je n’aurais qu’à me retourner pour apercevoir au lointain d’une galerie un rayon que le soleil y a oublié depuis le commencement de l’Histoire de France. Je me retournai et je vis le rayon, et je sentis, à grands coup, battre mon cœur du fond des siècles. »
Ici, dans le manuscrit, le récit est momentanément interrompu. M. Longuet explique qu’il se passe en lui, quand il revit cette heure inouïe de la Conciergerie, des choses qui l’agitent, qui le font souffrir. Difficilement, il reste maître de sa pensée. Il a une peine très grande à la suivre. Elle court devant lui comme un cheval emballé dont il aurait lâché les rênes. Elle le dépasse, bondit, s’enfuit en laissant sur le papier des traces de son passage qui sont des mots tellement profonds, dit-il, que « lorsqu’il regarde dedans il a le vertige. »
Et il ajoute, non sans épouvante :
« Il faut s’arrêter au bord de ces mots, comme on s’arrête au bord d’un précipice. »
Et il reprend la plume d’une main fiévreuse, continuant à s’enfoncer dans les galeries souterraines :
« Et la Bavarde, la voilà ! Voilà les murs qui ont entendu. Ce n’est point là-haut, dans le grand soleil, que la Bavarde parlait, c’est ici, dans cette nuit de la terre ! Voilà des anneaux aux murs. Est-ce l’anneau de Ravaillac ? Je ne me rappelle plus.
» Mais vers le rayon, vers l’unique rayon éternel et immobile comme ces immobiles murailles, vers le rayon blême et carré qui, depuis le commencement des âges, a pris et gardé la forme du soupirail, je m’avance, je m’avance avec une hâte certaine, pendant que la fièvre me consume, flambe et enivre mon cerveau. Mes pieds soudain s’arrêtent, mais si brutalement que l’on pourrait les croire tirés par des mains invisibles qui eussent surgi du sol, et mes doigts courent, glissent le long de la muraille, pétrissent cet endroit de la muraille. Qu’est-ce que veulent mes doigts ? Quelle est la pensée de mes doigts ? J’avais un canif, voyez-vous, dans ma poche. Et tout à coup j’ai laissé choir de dessous mon bras mon ombrelle verte pour prendre dans ma poche mon petit couteau. Et, entre deux pierres, sûrement, j’ai gratté. J’ai fait tomber avec mon couteau, entre deux pierres, de la poussière et de la poudre de ciment. Puis mon couteau a piqué quelque chose entre les deux pierres et a ramené cette chose.
» Voici pourquoi je suis sûr de n’être point fou. Cette chose est sous mes yeux. Dans mes heures les plus paisibles, moi, Théophraste Longuet, je la puis contempler, sur mon bureau, entre mes derniers modèles de timbres en caoutchouc. Ce n’est pas moi qui suis fou, c’est cette chose qui est folle. C’est un morceau de papier déchiré, maculé… un document dont on pourrait dire l’âge et qui a tout ce qu’il faut pour plonger dans une consternation prodigieuse un honnête marchand de timbres en caoutchouc. Le papier est, vous pensez bien, terriblement moisi. L’humidité a mangé la moitié des mots, qui semblent, à cause de leur teinte rousse, avoir été écrits avec du sang.
» Mais dans ces mots que voici, dans ce document qui avait certainement quelques siècles d’existence, et que je faisais passer dans le rayon carré du soupirail, et que je considérais, le poil hérissé d’horreur, JE RECONNAISSAIS MON ÉCRITURE ! »
Voici, traduit au clair, ce précieux et combien mystérieux document :
Mo rt en fui
mes trésors après trahison
du 1er avril
Va prendre l’air
aux Chopinettes
regarde le Four
Regarde le Coq
Fouille espace et tu
seras riche.
III
QUI SE TERMINE PAR UNE CHANSON
M. Adolphe Lecamus et Marceline étaient trop occupés de leur côté, comme nous le verrons au cours de cette histoire, pour avoir attaché une grande importance aux faits et gestes de Théophraste. Du reste celui-ci dissimula son émoi et prétendit que sa visite aux caves de la Conciergerie était l’événement le plus naturel du monde. Il avait contenté là une légitime curiosité, n’étant point de ceux qui voient les choses superficiellement.
Le jour qui suivit, Théophraste, sous prétexte de mettre de l’ordre dans ses affaires, s’enferma dans son bureau, dont les fenêtres donnaient sur le carré de verdure du petit square d’Anvers. Appuyé à la balustrade, il contempla la vérité de ce décor prosaïque, reconnut les bonnes du quartier qui poussaient paresseusement devant elles les petites voitures où s’agitaient les nouveau-nés. Des professeurs, une serviette sous le bras, se dirigeaient sans hâte vers le collège Rollin. L’avenue Trudaine retentissait des cris et des poursuites bruyantes de quelques adolescents, arrivés là avant l’heure des cours.
La pensée de Théophraste était d’une grande simplicité et d’une grande unité. Elle tenait tout entière dans cette phrase : « Le monde n’a pas changé. »
Non, le monde n’avait pas changé. Aujourd’hui comme hier, comme avant-hier, la rue Gérando voyait passer les mêmes gens se rendant aux mêmes besognes et accomplissant les mêmes gestes. Et, comme il allait être deux heures, l’épouse de M. Petito, le professeur d’italien qui occupait l’étage au-dessus de son appartement, se mit à jouer au piano le Carnaval de Venise.
Non, rien au monde n’était changé, et cependant, en se retournant, il pouvait voir entre les derniers modèles de ses timbres en caoutchouc, sur le pupitre de son bureau d’acajou, une feuille…
Cette feuille existait-elle réellement ? Il avait passé une nuit délirante à la suite de laquelle il avait mis son étrange aventure de la veille sur le compte d’un mauvais songe. Mais il avait retrouvé la feuille au fond du tiroir…
Encore maintenant, il se disait : « Tout à l’heure, je vais me retourner, et il n’y aura sur mon bureau pas plus de feuille que sur ma main. » Il se retourna. Le chiffon de papier était là avec son écriture !
Théophraste se passa la main droite sur le front en sueur, poussa un soupir d’enfant qui a un gros chagrin, sembla prendre une résolution définitive et mit avec soin le papier mystérieux dans son portefeuille. Il venait de se rappeler que M. Petito, le professeur d’italien du dessus, passait pour fort expert en écriture et pour s’occuper sérieusement de graphologie. Son ami Adolphe Lecamus, lui aussi, s’occupait de graphologie, mais à la façon des spirites. Aussi Théophraste ne songea même pas à parler de son affaire à Adolphe. Il trouvait qu’il y avait déjà trop de mystère en tout ceci pour y mêler encore l’imagination débordante d’un médium qui se disait élève de Papus.
Il ne connaissait M. Petito que pour l’avoir salué dans l’escalier ; il préférait cela. Il éviterait ainsi bien des questions.
Il se fit annoncer. On l’introduisit.
Il se trouva en face d’un homme d’âge moyen, dont les caractéristiques étaient des cheveux frisés en abondance, un regard perçant et des oreilles énormes. Après les politesses d’usage, Théophraste aborda l’objet de sa visite. Il tira de son portefeuille le papier de la Conciergerie et une lettre non signée qu’il avait écrite lui-même huit jours auparavant, mais qu’il n’avait pas expédiée pour des raisons de commerce que nous n’avons pas à apprécier ici.
— Monsieur Petito, commença-t-il, je sais que l’on vous dit grand expert en écritures. Je vous serais reconnaissant d’examiner cette lettre et ce document et de me confier ensuite le résultat de vos observations. Je prétends, moi, qu’il n’y a aucun rapport…
Il s’arrêta, plus rouge que pivoine. Théophraste n’avait pas l’habitude de mentir. Mais M. Petito considérait déjà d’un œil savant le chiffon et la lettre. Il souriait en montrant ses dents, qu’il avait fort blanches.
— Monsieur Longuet, dit-il, je ne vous ferai pas attendre ma réponse. Ce document est en bien mauvais état, mais les morceaux d’écriture qu’on y peut lire encore sont en tout point semblables à l’écriture de la lettre. Devant les tribunaux, monsieur Longuet, devant Dieu et devant les hommes, ces deux écritures ont été tracées par la même main !
Et il entra dans quelques détails. Un enfant, affirmait-il, ne s’y tromperait pas. Il pontifiait maintenant :
— Cette double écriture est identiquement anguleuse. Nous appelons anguleuse, monsieur, une écriture dont les déliés qui relient les jambages des lettres et les lettres les unes aux autres sont à angle aigu comme le plein des lettres. Vous comprenez ? (Silence de brute de Théophraste.) Comparez, voyez ce crochet, et cet autre, et ce délié, et toutes ces lettres qui augmentent progressivement dans une mesure égale. Mais quelle écriture aiguë, monsieur ! Je n’ai jamais vu d’écriture aussi aiguë que celle-là… Aiguë comme un coup de couteau.
Théophraste, à ces derniers mots, devint d’une telle pâleur que M Pelito crut qu’il allait se trouver mal.
Néanmoins, il se leva, ramassa son document, sa lettre, remercia et sortit.
Il erra dans les rues, longtemps. Il se retrouva place Saint-André-des-Arts, s’orienta et alla soulever le loquet d’une vieille porte, rue Suger.
Il était dans un couloir obscur et sale. Un homme vint au-devant de lui et, le reconnaissant, lui marqua aussitôt de l’amitié. Cet homme avait un bonnet carré de papier sur la tête et s’habillait d’une blouse noire qui lui descendait aux pieds.
— Bonjour, Théophraste ! Quel bon vent !…
— Bonjour, Ambroise !…
Comme il y avait deux ans qu’ils ne s’étaient vus, ils se dirent d’abord des niaiseries. Ambroise, de son métier, gravait des cartes de visite. Il avait été imprimeur en province, mais, ayant mis tout son avoir dans l’invention d’un nouveau papier, il n’avait pas tardé à faire faillite. C’était un cousin éloigné de Marceline. Théophraste, qui était un brave homme, lui était venu en aide au moment de ses plus gros ennuis.
Théophraste s’assit sur une chaise de paille, dans une petite pièce qui servait d’atelier et qu’éclairait une grande vitre poussiéreuse au plafond.
Théophraste dit :
— Ambroise, tu es un savant.
Ambroise protesta.
— Oui, oui, tu es un savant. Personne ne t’en remontrerait sur le papier.
— Ça, c’est vrai ; le papier, ça me connaît.
— Tu connais tous les papiers ?
— Tous.
— Si on te présentait un papier, tu pourrais dire l’âge qu’il a ?
— Oui, fit Ambroise ; j’ai publié une étude sur les filigranes des papiers employés en France au dix-septième et au dix-huitième siècle. Cette étude a été couronnée par l’Académie.
— Je le sais, et j’ai confiance dans ta science du papier.
— Tu le peux. Du reste, la chose est simple. Les plus vieux papiers ont d’abord présenté, dès leur jeunesse, une surface plane et lisse ; mais bientôt y apparurent des vergures, coupées à intervalles réguliers par des lignes perpendiculaires, les unes et les autres reproduisant l’empreinte du treillis métallique sur lequel la pâte avait été étalée. Dès le quatorzième siècle, on eut l’idée d’utiliser cette reproduction en lui faisant une marque de provenance ou de fabrique. Dans ce but, sur le treillis des formes, on broda en fil de laiton, des initiales, des mots, des emblèmes de toutes sortes : ce sont les filigranes. Toute feuille de papier filigranée porte en elle-même son acte de naissance ; mais le difficile est de le déchiffrer. Il faut un peu d’habitude : le pot, l’aigle, la cloche…
Théophraste ouvrit son portefeuille et tendit en tremblant son document :
— Pourrais tu me dire l’âge exact de ce papier ?
Ambroise mit des lunettes et approcha le papier du jour de la vitre.
— Il y a là, dit-il, une date : 172… Le dernier chiffre manque, ce serait donc un papier du dix-huitième siècle… À neuf ans près, notre tâche devient très facile.
— Oh ! fit Théophraste, j’ai bien vu la date, mais est-ce que vraiment le papier est du dix-huitième siècle, est-ce que la date n’est pas menteuse ? Voilà ce que je voudrais savoir.
Ambroise montra le centre du papier :
— Vois !
Théophraste ne voyait rien. Alors, Ambroise alluma une petite lampe et éclaira le document. En mettant le document entre l’œil et la lampe, on distinguait dans l’épaisseur du papier une sorte de couronne.
— Théophraste, fit Ambroise avec émotion, ce papier est excessivement rare. Cette marque est presque inconnue, car il a été très peu tiré de cette marque dite « à la couronne d’épines ». Ce papier, mon cher Théophraste, est exactement de l’année 1721.
— Tu es sûr ?
— Oui. Mais dis-moi, s’écria tout à coup Ambroise, qui ne put dissimuler sa surprise, comment se fait-il que ce document, qui date de 1721, soit, dans toutes ses parties visibles, de ton écriture ?
Théophraste se leva, remit son document dans son portefeuille et sortit, en titubant, sans répondre.
Je reprends, parmi tout un fatras de papiers, ce coin des mémoires de Théophraste :
« Ainsi maintenant, écrit Théophraste, j’avais la preuve, je ne pouvais plus douter, je n’en avais plus le droit. Ce papier qui datait du commencement du dix-huitième siècle, du temps du Régent, cette feuille que j’avais trouvée ou plutôt que j’étais allé chercher dans une prison, portait bien mon écriture. J’avais écrit sur cette feuille, moi Théophraste Longuet, ex-marchand de timbres en caoutchouc, qui venais de prendre ma retraite la semaine passée, à l’âge de quarante et un ans, j’avais écrit sur cette feuille les mots encore incompréhensibles que j’y lisais, en 1721 ! Du reste, je n’avais pas besoin de M. Petito ni d’Ambroise pour en être sûr. Je le savais ! Tout en moi me criait : « C’est ton papier ! c’est ton papier ! »
» Ainsi, avant d’être Théophraste Longuet, fils de Jean Longuet, maître jardinier à la Ferté-sous-Jouarre, j’avais été, dans les temps passés, quelqu’un que je ne savais pas, mais qui renaissait en moi. Oui, oui, par instants, j’étais « tout écumant » de me ressouvenir d’avoir vécu il y a deux cents ans.
» Qui étais-je ? Comment me nommais-je alors ? Dans quel corps mon âme immortelle avait-elle momentanément élu domicile ? J’avais la certitude que toutes ces questions ne resteraient point longtemps sans réponse. Est-ce que déjà des choses que mon existence présente ignorait ne surgissaient pas de mon existence passée ? Que voulaient dire certaines phrases prononcées à la Conciergerie ? Qui donc était ce Simon l’Auvergnat dont le nom était revenu par deux fois sur mes lèvres brûlantes ?
» Oui, oui, le nom d’autrefois, le mien, surgirait, lui aussi, de mon cerveau réveillé et, sachant qui j’étais, je me rappellerais toute la vie revivante d’autrefois, et je lirais alors dans mon ardente mémoire tout le document d’un trait. »
M. Théophraste Longuet, il faut que je le dise, n’était pas parvenu à préciser ainsi, en quelques mots, sa situation exceptionnelle sans l’avoir, dans des lignes incohérentes, fait précéder de quelques divagations. Mais, vraiment, convient-il de s’en étonner ?
Ce qui lui arrivait n’était pas ordinaire. Songez que c’était un esprit simple, un peu lourd, un peu « suffisant », qui n’avait jamais cru qu’aux timbres en caoutchouc. C’était un aimable bourgeois honnête, strictement, et borné, et têtu. Il n’avait point de religion, la trouvant bonne seulement pour les femmes, et, sans affirmer son athéisme, il avait accoutumé de dire que « lorsqu’on était mort, c’était pour longtemps ».
Or, il venait de découvrir de façon certaine, palpable qu’on n’était jamais mort !
C’était un coup. Il faut avouer que d’autres, même parmi ceux qui font métier, dans les sciences occultes, de fréquenter quotidiennement les esprits, ne l’auraient peut-être pas aussi bien supporté.
Car, en fin de compte, Théophraste Longuet en prit vite son parti. Et même, du moment qu’il se rappelait avoir vécu vers la fin du dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième, il regretta que la période fût aussi rapprochée. Tant qu’à faire, il aurait voulu remonter à deux mille ans.
Voilà bien le bourgeois de Paris ; il est plein de bon sens, mais quand il exagère, rien ne lui coûte.
Dans l’incertitude de son esprit, touchant une existence antérieure qui n’était plus niable, mais dont il ignorait tout encore, il ne pouvait se rattacher qu’à un chiffre : 1721, et à une chose : la Conciergerie.
Et voici ce que, dès lors, il croyait pouvoir affirmer : c’est que, en 1721, il se trouvait dans la prison de la Conciergerie, probablement comme prisonnier d’État, car il n’admettait pas une seconde qu’il eût pu être enfermé, même sous Louis XV, lui, Théophraste, pour un crime de droit commun.
Dans un moment solennel, peut-être avant de marcher au supplice, il avait rédigé le document qui était, à cette heure, en sa possession. Il avait caché le papier entre deux pierres de son cachot et, repassant par là, deux siècles plus tard, il l’y avait retrouvé. C’était simple. Ceci ne résultait point de quelque divagation surnaturelle, mais des faits eux-mêmes, qui ne pouvaient s’expliquer logiquement que de cette sorte et aussi de l’aspect du papier qui portait l’empreinte de son écriture.
Théophraste se remit, en secret, en face du document.
Certains mots du document prenaient dans son esprit une importance toute naturelle. C’étaient les mots : trésors et trahison du 1er avril.
Et il ne désespérait point avec ces mots de reconstituer sa personnalité. D’abord, il avait été riche et puissant. Les mots enf ui trésors signifiaient bien que l’homme qui avait écrit ces lignes avait été riche, puisqu’il avait enfoui des trésors. Il avait été puissant, puisqu’il avait été trahi. Dans son esprit même, cette trahison devait être une trahison mémorable, peut-être une trahison historique, trahison du 1er avril.
Oui, oui, toutes les bizarreries et tous les mystères de ce papier laissaient au moins entrevoir avec certitude ceci : qu’il avait été un grand personnage et qu’il avait enfoui des trésors.
Après les avoir enfouis très mystérieusement, plus mystérieusement encore il en révélait l’existence au prix de quelle astuce ! Peut-être au prix de son sang. Car enfin ces mots de teinte roussâtre avaient sans doute été écrits avec son sang. Plus tard, il se proposait de consulter là-dessus un chimiste distingué.
« Pourvu, mon Dieu, pensait-il, encore, qu’on n’y ait pas touché ! Ces trésors m’appartiennent, puisque c’est moi qui les ai enfouis. Si besoin est, avec ce document qui est de mon écriture, j’établirai mes droits de propriété. »
Théophraste Longuet n’était pas riche. Il se retirait du commerce avec une honnête petite aisance : la maison de campagne, le jardinet, la pièce d’eau, la boule. C’était peu, avec les goûts quelquefois somptueux de Marceline. Décidément, les trésors arrivaient bien.
Et Théophraste se replongeait en l’étude de son papier.
Il faut dire tout de suite à sa louange, qu’il était beaucoup plus intrigué par le mystère de sa personnalité que par le mystère des trésors ; aussi, il se résolut à interrompre momentanément ses recherches jusqu’au jour où il pourrait enfin donner un nom au personnage qu’avait été Théophraste Longuet en 1721. Cette découverte, qui l’intéressait au plus haut point, devait être, dans son esprit, la clef de toutes les autres.
Ce qui l’étonnait un peu, c’était la disparition soudaine de ce qu’il appelait « son instinct historique », instinct qui lui avait fait défaut toute sa vie, mais qui s’était révélé à lui avec la promptitude et la force d’un coup de tonnerre, dans les bas-fonds de la Conciergerie. Un moment, l’Autre, comme il disait en s’entretenant du grand personnage du dix-huitième siècle qu’il avait été, l’Autre l’avait possédé. L’Autre était alors si bien entré en maître chez Théophraste qu’il avait agi avec ses mains et parlé avec sa bouche. C’était l’Autre qui avait trouvé le document, c’était l’Autre qui avait crié : « Parbleu ! c’est l’allée des Pailleux ! », c’était l’Autre qui avait appelé Simon l’Auvergnat. Et depuis, l’Autre avait disparu. Théophraste ne savait plus ce qu’il était devenu. Il le cherchait en vain. Il se tâtait. Il descendait en lui-même. Rien !
Théophraste n’entendait point que les choses se passassent de la sorte. Théophraste, avant cette aventure, n’avait aucune curiosité malsaine de savoir ce qui était au commencement des choses, ce qui devait être à la fin ; il n’avait point perdu son temps à sonder des mystères philosophiques, dont la vanité lui avait toujours fait hausser les épaules. C’était un bourgeois tranquille qui savait que deux et deux font quatre et qui n’aurait jamais imaginé qu’un même homme pût fabriquer des timbres en caoutchouc en l’an 1899 et avoir été enfermé dans un cachot, après avoir enfoui des trésors, en 1721. Mais puisque la révélation d’un fait aussi prodigieusement exceptionnel était venue, sans qu’il la demandât, habiter son esprit, avec des preuves, il s’était juré d’aller « jusqu’au bout ». Il saurait. Il saurait tout.
Son instinct pouvait l’abandonner momentanément ; il irait chercher dans les livres. Et il finirait bien par découvrir qui était ce personnage puissant et riche qui avait été enfermé dans un cachot en 1721, après avoir été trahi le 1er avril. Quel 1er avril ? Ceci restait à déterminer.
Il courut dès lors les bibliothèques et poursuivit son personnage. Il fit défiler devant lui les premiers du royaume. « Pendant qu’il y était, il ne trouvait rien de trop beau. » Des ducs et pairs, des généraux illustres, de grands financiers, des princes du sang. Il s’arrêta un instant à Law, mais il lui trouva l’esprit trop dissipé ; à Maurice de Saxe, « qui devait gagner la bataille de Fontenoy » ; au comte Du Barry, qui avait eu les plus belles maîtresses de Paris ; il eut la terreur, un moment, d’avoir été le comte de Charolais, « qui se distinguait par ses débauches et tuait à coups de carabine les couvreurs sur les toits ». Il fut, pendant quarante-huit heures, le cardinal de Polignac, qui le dégoûta quand il apprit qu’il avait les faveurs de la duchesse du Maine. Certes, il finissait bien par trouver en quelque coin de l’Histoire une figure sympathique que les écrivains de l’époque paraient des plus engageantes couleurs et gratifiaient des plus solides vertus, mais il se voyait bientôt obligé de délaisser cette figure comme il avait fait des précédentes, car à toutes il manquait ces deux choses principales : d’avoir été enfermées à la Conciergerie en 1721 et d’avoir été trahies le 1er avril.
Cependant, il venait de découvrir, dans le Journal de Barbier, un bâtard du Régent qui allait peut-être faire son affaire, quand il se produisit des événements qui le précipitèrent dans une stupeur voisine de la consternation.
Il nous faut un instant quitter Paris et nous rendre avec M. Théophraste Longuet dans cette petite propriété des bords de la Marne qu’il commençait d’occuper aux premiers rayons du soleil de juillet. Il s’y était fait, cette année, précéder de Marceline et de son ami Adolphe, qui avaient mission de tout aménager pour la définitive villégiature. Aussi, ces jours derniers, avait-il pu en toute sécurité et en toute paix, seul à Paris, vaquer aux occupations inaccoutumées que lui donnait son nouvel État dans le Monde.
Nous prendrons le train à la gare de l’Est avec Théophraste et n’aurons garde d’user de notre droit d’historiographe pour pénétrer avant lui dans la « Villa Flots d’Azur » qui dressait ses murs blancs et ses tuiles rouges sur le coteau vert d’Esbly. Nous n’aurons garde, disons-nous, de franchir ce seuil sans nous être fait annoncer, car on apprend toujours trop tôt l’infortune domestique d’un brave homme.
Il ne faut point pour cela que M. Adolphe Lecamus nous en apparaisse moins sympathique, car nous devons à la vérité de dire que Théophraste avait tout fait pour réaliser cette catastrophe domestique. Mais il ne s’en doutait pas.
Pourquoi cette villa s’appelait-elle « Villa Flots d’Azur » ? Parce que Théophraste l’avait voulu. En vain Adolphe lui avait-il remontré que c’était là un nom pour villa des bords de la mer ; il avait répondu avec une grande logique qu’il était allé souvent au Tréport et qu’il y avait toujours vu la mer verte ; qu’il pêchait le goujon dans la Marne et que, par les beaux ciels d’été, il avait vu la rivière bleue. Ne disait-on pas aussi : « Le beau Danube bleu » ? Du moment que l’océan n’avait pas le monopole des flots bleus, il ne voyait pas pourquoi il se priverait d’appeler sa villa des bords de la Marne « Villa Flots d’Azur ».
Ce jour-là était le jour anniversaire du mariage de Théophraste.
Théophraste embrassa, sur le seuil de la villa, sa femme avec une émotion annuelle. Certes, il l’aimait bien toute l’année, mais, le jour anniversaire de son mariage, il croyait de son devoir d’honnête mari de l’aimer davantage.
Marceline aimait aussi beaucoup Théophraste ; ce n’était point une raison parce qu’elle aimait également beaucoup Adolphe pour que Théophraste eût à en souffrir. Elle n’aurait pas trouvé cela juste ; or, c’était une nature adultère, mais droite.
De son côté, Adolphe adorait Marceline et se serait fait tuer pour Théophraste.
Quand on réfléchit à cette merveilleuse union de trois cœurs qui s’estiment, on se prend à regretter, tout de même, que la « Villa Flots d’Azur » ne se soit pas appelée « Villa Flots d’Amour ».
Théophraste serra avec effusion la main d’Adolphe, qui se tenait derrière Marceline. Il fit compliment à sa femme de sa belle mine, et cela sur un petit ton gaillard qui sentait son bâtard du Régent.
Il avait, ce jour-là encore, son ombrelle verte, mais il l’agitait de façon désinvolte, en faisant son compliment, comme il pensait qu’on en usait des cannes au commencement du dix-huitième siècle.
Vous savez que Théophraste n’était point un esprit vaniteux ; mais on n’apprend pas, par une sorte de miracle scientifique, qu’on a été un grand homme il y a deux cents ans, sans qu’il vous en reste quelque chose dans les manières, dans la façon d’être avec les gens et avec les choses.
Quelques amis étaient venus des environs avec leurs femmes pour fêter, comme ils en avaient coutume, l’anniversaire de l’heureux ménage. Théophraste sut trouver le mot qu’il fallait pour chacun et une flatterie délicate pour chacune. Sa femme et Adolphe le regardaient, un peu étonnés, et le trouvaient, ce jour-là, à son avantage.
On se mit à table dans le jardin, sous la tente. La conversation roula tout d’abord sur les derniers événements de la pêche à la ligne, dont l’ouverture était encore récente.
M. Lopard avait pêché un gros « bétet » de trois livres ; la vieille Mlle Taburet, qui trempait son fil dans l’eau le dimanche, se plaignait qu’on fût venu, pendant la semaine, pêcher « sur son coup ». Un troisième déclarait qu’on donnait trop à manger au poisson, qu’on le gavait et que l’amorce finissait par nuire à l’appât. Une discussion s’engagea sur le mode d’appât qu’il convenait d’employer en cette partie de l’année. Enfin, tout le monde fut d’accord pour constater que le poisson diminuait « dans des proportions effrayantes ».
Théophraste ne disait rien. Il trouvait ces bonnes gens trop bourgeois. Il eût voulu relever le niveau de la conversation. Il eût voulu aussi que cette conversation répondît aux préoccupations brûlantes de son esprit.
Il sut, par un habile artifice, comme le soir tombait et que le dîner touchait à sa fin, amener son ami Adolphe à émettre quelques aphorismes sur les revenants ; des revenants, on s’en fut vers le peresprit. Une dame du voisinage, qui connaissait une somnambule, rapporta des faits étranges qui eurent le don de captiver l’imagination de la compagnie. Adolphe, là-dessus, expliqua, à la mode spirite, les phénomènes du somnambulisme et cita Allan Kardec. Adolphe n’était jamais embarrassé pour expliquer ces phénomènes. Enfin, on en arriva à ce point désiré par Théophraste : à la transmigration des âmes et à la métempsycose.
— Est-il possible, demanda Marceline, qu’une âme revienne habiter un corps ? Vous me l’avez souvent affirmé, Adolphe, mon ami, mais il me semble que notre raison repousse avec force une pareille hypothèse.
— Rien ne se perd dans la nature, répondit Adolphe avec autorité, ni les âmes ni les corps. Tout se transforme, les âmes comme des corps. La réincarnation des âmes dans le but d’une purification nécessaire est un dogme qui remonte à la plus haute antiquité et que les sages de tous les temps se gardent de nier.
— Si on revenait dans un corps, dit Marceline, on le saurait.
— Pas toujours, fit Adolphe, mais quelquefois.
— Ah ! quelquefois ? demanda Théophraste, qui sentait son cœur battre avec un grand tumulte.
— Oui, il y a des exemples. Ainsi Ptolémée Césarion, fils de César et de Cléopâtre, qui était roi d’Égypte trente ans avant Jésus-Christ, se rappelait fort bien avoir été Pythagore, un philosophe grec qui avait vécu six cents ans auparavant.
— Pas possible ! s’écrièrent les dames, cependant que les messieurs souriaient.
— Il ne faut pas rire, messieurs. Il est impossible de parler de choses plus sérieuses, fit Adolphe sévèrement.
Il reprit :
— Notre transformisme actuel, qui est le dernier mot de la science, est en plein accord avec la théorie de la réincarnation. Qu’est-ce que le transformisme, sinon l’idée d’après laquelle les êtres vivants se transforment progressivement les uns dans les autres ? La Nature se présente à nous sous l’aspect d’une étincelle élaboratrice perfectionnant sans cesse les types créés pour atteindre un idéal qui sera le couronnement définitif de la Loi du Progrès ! Comme la fin de la nature est unique, ce que la nature fait pour les corps, elle le fait aussi pour les âmes. Je puis vous l’affirmer, répéta Adolphe, car j’ai beaucoup étudié cette question, qui est à l’origine de toute science qui se respecte.
M. Adolphe n’était point compris de la compagnie, ce dont il s’enorgueillissait intérieurement ; il n’en était pas moins écouté avec extase et il se plaisait à voir que Théophraste, qui était d’ordinaire rebelle à ce genre de conversation, semblait y prendre un plaisir extrême. Il se lança dans des considérations que je veux abréger ici, mais dont je donnerai tout de même un léger aperçu pour que les mauvais esprits, qui pourraient s’imaginer que cette histoire extraordinaire de Théophraste Longuet est le fruit d’une imagination en délire, soient enfin persuadés qu’elle repose sur les bases scientifiques les plus sérieuses.
— La transmigration des âmes était enseignée dans l’Inde, dit Adolphe, berceau du genre humain ; puis elle le fut en Égypte, puis en Grèce. On la chantait dans les mystères, au nom d’Orphée. Cependant, Pythagore, qui continua cet enseignement, n’admettait pas, avec les philosophes du bord du Gange, que l’âme dût parcourir le cycle de toutes les existences animales. Il ne la faisait jamais habiter, par exemple, dans un cochon.
— Il y a pourtant des hommes, dit Mme Bache, la receveuse des postes de Villiers-sur-Morin, qui ont des âmes de cochon.
— Sans doute, fit Adolphe avec un sourire ; mais on ne saurait conclure de là qu’il y a des cochons qui ont des âmes d’homme. Voilà ce que voulait dire Pythagore, Platon a adopté la doctrine de Pythagore. C’est le premier qui a donné, dans le Phédon, les preuves que les âmes ne s’exilent pas pour toujours et qu’elles reviennent animer de nouveaux corps.
— Oh ! si nous pouvions avoir des preuves d’une affaire pareille ! s’écria Mme Sampic, la femme du percepteur de Pont-aux-Dames, en regardant Mme Bache.
— Ça ne me ferait plus rien de mourir, déclara la vieille Mlle Taburet, qui vivait dans la terreur de trépasser.
— Voici les preuves, continua Adolphe. Elles sont au nombre de deux. L’une est tirée de l’ordre général de la nature ; l’autre de la conscience humaine. 1o « La nature, dit Platon, est gouvernée par la loi des contraires. Par cela seul donc que nous voyons dans son sein la mort succéder à la vie, nous sommes obligés de croire que la vie succédera à la mort. » Est-ce clair ?
— Oui, oui, lui fut-il répondu de toutes parts.
— D’ailleurs, continue Platon, rien ne pouvant naître de rien, si les êtres que nous voyons mourir ne devaient jamais revenir à la vie, tout finirait par s’absorber dans la mort, et la nature deviendrait un jour semblable à Endymion ! Vous avez compris la première preuve ?
— La seconde ! réclamèrent les convives, qui n’avaient rien compris du tout et qui oncques n’avaient entendu parler d’Endymion, lequel, pour avoir trop apprécié les charmes de Junon, dormait, aux grottes de Latmos, son éternel sommeil.
— Deuxièmement, obtempéra Adolphe, si après avoir consulté les lois générales de l’univers, nous descendons au fond de notre âme, nous y trouverons le même dogme attesté par le fait de la réminiscence ! « Apprendre, crie Platon à l’univers, apprendre, ce n’est pas autre chose que se souvenir. » Puisque notre âme apprend, c’est qu’elle se souvient ; elle se souvient de quoi, sinon d’avoir vécu ? Et d’avoir vécu dans un autre corps ? Pourquoi ne croirions-nous pas qu’en quittant le corps qu’elle anime à cette heure, elle en pourra animer successivement plusieurs autres ? Et je cite textuellement Platon ! remarqua encore Adolphe.
Théophraste, qui se sentait depuis quelques moments une étrange chaleur au cœur et à la cervelle, crut devoir ajouter :
— Et vous savez, messieurs et mesdames, Platon, c’était quelqu’un !
Adolphe regarda Marceline en souriant de la réflexion inutile de Théophraste. Puis il passa de Platon à un auteur plus moderne.
— Charles Fourier a dit : « Où est le vieillard qui ne voulût être sûr de renaître et de rapporter dans une autre vie l’expérience qu’il a acquise dans celle-ci ? Prétendre que ce désir doit rester sans réalisation, c’est admettre que Dieu puisse nous tromper. Il faut donc reconnaître que nous avons vécu déjà avant d’être ce que nous sommes, et plusieurs autres vies nous attendent. Toutes ces vies — ajoute Fourier avec une précision dont on ne saurait trop lui savoir gré, — au nombre de huit cent dix, sont distribuées entre cinq périodes d’inégale étendue et embrassent une durée de quatre-vingt-un mille ans. »
— Mâtin ! Quatre-vingt-un mille ans ! interrompit M. Lopard ; ce n’est pas de la crotte de bique !
— Nous en passerons, expliqua Adolphe, vingt-sept mille sur notre planète et cinquante-quatre mille ailleurs.
— Au bout de combien de temps revient-on dans un autre corps ? demanda Mme Bache.
— Il faut compter environ deux ou trois mille ans au minimum, s’il faut en croire Allan Kardec. À moins que nous ne soyons décédés de mort violente. Alors, surtout si on a succombé au dernier supplice, on peut être réincarné au bout de deux cents ans.
Théophraste pensait :
— C’est bien cela. Ils m’auront pendu, ou si je ne suis pas passé par le gibet, ils se seront débarrassés de moi par quelque autre supplice plus en rapport avec ma première naissance. Tout de même, songeait-il avec un juste orgueil, si tous ces gens qui m’entourent savaient à qui ils ont affaire — à un prince du sang peut-être, à un bâtard du Régent, je n’ose encore l’affirmer — ils seraient bien étonnés et frappés de respect. Mais non, ils se disent : « C’est Théophraste Longuet, fabricant de timbres en caoutchouc », et cela leur suffit.
On venait d’apporter le champagne. Le premier bouchon fit entendre son explosion joyeuse. Adolphe s’était tu. Tout le monde était encore sous l’impression de ses discours. Cependant, on ne demandait qu’à s’amuser.
C’est alors que Marceline se tourna vers Théophraste et le pria de chanter cette chanson qu’il avait coutume de faire entendre au dessert, à chaque anniversaire de leur mariage. Il l’avait chantée le jour même des noces et elle avait eu, à cause de sa grâce et de sa fraîcheur, un succès général. C’était la Lisette de Béranger.
Mais quelle fut la stupéfaction de Marceline et de tous les convives, quand ils virent Théophraste se lever, jeter sa serviette sur la table et dire à la maîtresse de céans :
— Comme tu voudras, Marie-Antoinette ! Je n’ai rien à te refuser.
— Oh ! mon Dieu ! s’écria Marceline. Il m’appelle Marie-Antoinette, et voilà que sa voix le reprend !
Mais les convives n’étaient pas revenus de cette légère algarade que Théophraste, d’une voix éclatante, d’une voix que les autres ne lui connaissaient pas, de sa voix de la Conciergerie, chantait…
Et quelle chanson ! Pour se rendre compte de l’effet qu’elle produisit, il faut se représenter qu’il y avait ce soir-là, chez Théophraste, la société la plus choisie de Crécy-en-Brie à Lagny-Thorigny-Pomponne.
Il la chanta sur un vieil air français :
Ton joli, belle meunière,
Ton joli moulin.
IV
LA CHANSON
M. et Mme Sampic, M. Lopard, Mme Bache, la vieille Mlle Taburet, M. et Mme Troude « et leur demoiselle », toute cette aimable société qui, depuis quatre années que M. Théophraste Longuet et son épouse villégiaturaient à Esbly, avaient coutume d’entendre au dessert de ce matrimonial anniversaire la Lisette de Béranger, reçurent avec une stupéfaction que j’essayerais en vain de décrire la chanson suivante :
J’ai dit que l’air en était :
Théophraste, l’œil allumé, le verre en main, beuglait :
Fanandels, en cette piole,
On vit chenument.
Arton, pivois et criolle
On a gourdement.
Pitanchons, faisons riolle
Jusqu’au jugement.
Cette chanson, comme vous pouvez en juger, était d’argot, et comme l’argot ne s’apprend pas à l’école, je crois de mon devoir envers le lecteur de la traduire :
Fanandels, en cette piole,
(frères) (maison)
On vit chenument.
(grassement)
Arton, pivois et criolle
(pain) (vin) (viande)
On a gourdement.
(beaucoup)
Pitanchons, faisons riolle
(buvons) (bonne chère)
Jusqu’au jugement.
Malgré la richesse de la rime, ce couplet ne fut suivi d’aucun applaudissement. Ces dames ne firent point retentir le cristal des verres du choc de leurs couteaux ; elles regardaient Marceline fort curieusement et semblaient demander une explication.
Qu’est-ce que Marceline eût expliqué ? Adolphe lui-même considérait Théophraste avec désespoir ; mais Théophraste, comme possédé d’un démon, continuait :
Second couplet
Icicaille est le théâtre
(ici)
Du petit Dardant.
(l’Amour)
Fonçons à ce mion folâtre
(petit garçon)
Notre palpitant ;
(cœur)
Pitanchons pivois chenâtre
(buvons) (vin) (excellent)
Jusques au luisant !
(jour)
Théophraste, triomphalement, reprit ces deux derniers vers et prolongea sa dernière note en regardant le soleil qui disparaissait, dans une gloire, à l’horizon restreint des coteaux. Le chanteur, d’une main, tenait son « palpitant » ; de l’autre, il « embrassait la nature ».
Pitanchons pivois chenâtre
Jusques au luisant !
Il se rassit, content de lui, en disant à Marceline :
— Qu’est-ce que tu penses de ça, Marie-Antoinette ?
Au milieu du silence de mort de tous les assistants, Marceline demanda, toute tremblante :
— Pourquoi m’appelles-tu Marie-Antoinette ?
— Parce que tu es la plus belle de toutes, s’écria Théophraste dans une grande exaltation. J’en appelle à Mme la maréchale de Boufflers qui a du goût ! J’en appelle à vous tous ! Et il n’y en a pas un, par la gorge du pape, qui me démentira, ni le Gros-Picard, ni le Bourbonnais, ni le Bourguignon, ni la Tête-de-Mouton, ni le Craqueur, ni le Parisien, ni le Provincial, ni le Petit-Breton, ni la Plûme, ni Patapon, ni la Canette, ni la Porte-Saint-Jacques, ni Gâtelard, ni Bras-de-Fer, ni Gueule-Noire, ni même Bel-à-Voir !
Comme Théophraste avait à sa droite la vieille Mlle Taburet, il lui pinça le genou, ce qui fit que cette honorable personne crut qu’elle allait s’évanouir.
Personne n’osait bouger, car le regard ardent de Théophraste épouvantait la société. Et celui-ci, penché amoureusement vers Mlle Taburet, lui disait, en fixant Marceline qui se prit à pleurer :
— Voyons, mademoiselle Taburet, n’ai-je pas raison ? Qui pourrait-on lui comparer ? Est-ce la Belle-Laitière, ou la Petite-Mion ? ou même la Blanche, cette anquilleuse ? ou la Belle-Hélène qui tient le cabaret de la Harpe ?
Il se tourna vers Adolphe :
— Allons, toi, Va-de-Bon-Cœur, dit-il avec une énergie effrayante, tu vas me dire ton avis. Regarde un peu Marie-Antoinette ! Par le Veau-qui-tette, elle les met toutes dans un sac : et Jeanneton-Vénus, la bouquetière du Palais-Royal ; et Marie Leroy, et la femme Salomon, la belle limonadière du Temple ; et Jeanne Bonnefoy, qui vient de se marier à Veunier, qui tient le café du Pont-Marie. À toutes, à toutes : la Tapedru, Manon de Versailles, la Grosse-Poulaillière, la Platine, la Vache-à-Paniers, et la Bastille !…
Théophraste, d’un bond, fut sur la table et la vaisselle se brisa en mille éclats. Il tenait une coupe, il cria : « Je bois à la reine des nymphes ! à Marie-Antoinette Néron ! » Puis il broya le verre entre ses mains qui furent ensanglantées et salua la société.
Mais celle-ci s’était enfuie…
Un esprit superficiel pourrait juger, d’après les événements que nous venons de relater, que Théophraste était subitement devenu fou. Voici quelque chose qui est bientôt dit : « Cet homme est fou ! » Avec cette phrase rapide, on explique tout ce qui ne tombe point sous le sens commun ; cependant, le sens commun n’est pas tout le sens. Nous y reviendrons, mais dans le cas qui nous occupe, nous ajoutons qu’il n’est point besoin d’un sens exceptionnel pour affirmer que Théophraste n’était pas fou.
Ce n’est pas parce qu’on devient subitement fou qu’on peut chanter une chanson que l’on n’a pas apprise et parler couramment une langue que l’on ne connaît pas.
C’était bien le cas de Théophraste et l’expérience scientifique moderne établit avec des exemples indiscutables que ce cas est loin d’être unique. On a vu des sujets, des sujets frustes, ne sachant ni lire ni écrire, n’étant jamais sortis de leur village, répondre le plus correctement du monde au médium qui les interrogeait, dans une langue morte. Comment expliquer cela qui s’est passé devant des professeurs de nos facultés et non devant des charlatans ? On ne sait encore. Nous sommes toujours sur le seuil du grand mystère ; nous n’avons encore fait qu’en pousser la porte, en tremblant. Les uns expliquent que c’est un Esprit savant qui parle par cette bouche ignorante. D’autres ont émis timidement — et combien comprenons-nous cette timidité — qu’un tel phénomène ne peut s’expliquer que par la réminiscence d’une vie antérieure. Jusqu’à plus ample informé, j’imagine que ce que Théophraste raconte sans savoir, c’est l’Autre qui le sait, celui qui par instants revit en lui. Toutes les phrases, donc, qu’on ne peut comprendre avec Théophraste, on les comprendrait avec l’Autre si l’on savait qui est l’autre.
Je reprends les mémoires de Théophraste, à la suite de la scène de la chanson :
« Je me trouvai sur la table, au milieu des éclats de la vaisselle, cependant que toute la société s’était enfuie. Cette façon brutale que mes convives avaient de prendre congé de ma personne m’avait quelque peu étourdi. Je voulus descendre, mais par un phénomène singulier, j’eus autant de difficulté à me retrouver sur le sol que j’avais montré d’adresse à monter sur la table. Je me mis à genoux et, prenant de grandes précautions pour ne point choir, j’arrivai cependant à mes fins. J’appelai Marceline qui ne me répondit pas et que je retrouvai, toute tremblante d’effroi, dans notre chambre. J’en fermai soigneusement la porte et me disposai à lui donner quelques explications. Ses grands yeux étonnés et pleins de larmes m’en demandaient et je crus qu’il était de mon devoir de mari de ne point lui celer plus longtemps la grande et surprenante préoccupation de mon esprit. Je l’engageai à se déshabiller et à se mettre au lit. Me voyant tout à fait redevenu calme — et je l’étais en effet — elle ne fit aucune difficulté pour m’obéir. Je la rejoignais bientôt. J’avais laissé la fenêtre de la chambre ouverte. La nuit était idéale et comme j’entendais Adolphe marcher dans le jardin, je lui criai que l’heure du repos avait sonné.
» Bientôt je n’entendis plus dans toute la maison que le bruit du cœur de Marceline.
» — Ma chère femme, lui dis-je, tu dois ne rien comprendre à ce qui m’est arrivé ce soir. Rassure-toi : moi non plus. Mais en unissant nos deux intelligences, nos deux amours, je ne désespère point d’arriver à un résultat appréciable.
» Je lui contai alors tous les détails de ma visite dans les caves de la Conciergerie, ne lui celant quoi que ce fût et lui traçant une image fidèle des sentiments extraordinaires qui m’agitaient et de la force inconnue qui paraissait me commander. Tout d’abord, elle ne dit rien, se contentant de se retirer doucement vers la ruelle, comme si elle avait peur de moi ; mais quand j’en arrivai au document qui révélait l’existence des trésors, elle demanda à le voir tout de suite. Je jugeai par là de l’intérêt qu’elle portait à mon aventure, et je lui en fus aussitôt reconnaissant. Je me levai et lui montrai le papier à la lueur de la lune qui était dans son plein. Comme moi, comme tous ceux qui en avaient déjà eu connaissance, elle reconnut immédiatement mon écriture ; et elle fit le signe de la croix. Avait-elle peur de quelque diablerie ? Marceline n’est point une sotte, mais elle m’expliqua que ce geste avait été « plus fort qu’elle ». Du reste, elle eut tôt fait de se remettre et elle trouva l’occasion de faire l’éloge d’Adolphe qui, malgré mon mauvais vouloir, avait su l’initier aux éléments du spiritisme, science, me disait-elle, qui, dans mon état, ne manquerait point de me rendre quelques services. Je m’étais recouché. Nous avions le papier sur notre lit, dans le rai de lune, et, en face de ce témoin irrécusable, elle dut bientôt avouer que j’étais un esprit réincarné datant de deux cents ans. Comme je me demandais une fois de plus qui j’avais bien pu être, elle me causa la première peine depuis notre mariage ; elle dit :
» — Mon pauvre Théophraste, tu as dû être « un pas grand’chose ».
» — Et pourquoi ? fis-je, très humilié.
» — Parce que, mon ami, tu as, ce soir, chanté en argot, et que les dames dont tu as cité les noms n’appartiennent pas à l’aristocratie. Quand on fréquente la Tapedru, la Platine et Manon de Versailles, je répète qu’on est « un pas grand’chose ».
» Elle disait ceci avec un léger accent de dépit que j’attribuai à la jalousie.
» — Mais j’ai cité aussi la maréchale de Boufflers, répliquai-je, et tu dois savoir que les mœurs étaient si dissolues sous la régence du duc d’Orléans que la mode à la cour, pour les dames, était de se donner des noms de catins. Je crois, bien au contraire, avoir été quelqu’un de considérable. Que dirais-tu d’un bâtard du Régent ?
» Pour toute réponse, elle m’embrassa avec transport et moi-même, me souvenant, comme il était de mon devoir, de la date que nous fêtions ce jour-là, je lui prouvai que si Théophraste était plus vieux de deux cents ans, son amour était toujours resté jeune et galant. »
V
M. LECAMUS DIT DES CHOSES DÉSAGRÉABLES À M. LONGUET
« Il pouvait être deux heures du matin, continue à nous narrer Théophraste dans ses mémoires, quand ma chère Marceline sut me persuader qu’il était de toute nécessité de faire à M. Adolphe Lecamus mes confidences. La grande expérience d’Adolphe, sa science certaine de la métaphysique, disait-elle, devaient être d’un grand secours à un homme qui avait enfoui des trésors deux cents ans auparavant et qui voulait les retrouver.
» — Tu verras, mon ami, ajouta-t-elle, tu verras que c’est lui qui te dira comment tu t’appelles.
» Elle était si gentille que je finis par céder à ses instances. Et, dès la matinée, j’entrepris Adolphe sur l’événement de la veille. C’est ainsi que de fil en aiguille, je veux dire de chanson en document et de document en Conciergerie, je lui contai tout, en épiant sur son visage l’effet qu’une telle révélation pouvait lui produire. Je constatai que je l’avais complètement ahuri. Ceci me parut même étrange au plus haut point qu’un homme qui faisait profession de spiritisme s’étonnât ainsi de se trouver en face d’un bourgeois sain de corps et d’esprit, lequel prétendait avoir eu une existence certaine deux cents ans avant de renaître. Il me répondit que ma conduite au repas de la veille et les phrases incompréhensibles que j’avais prononcées devant lui depuis notre visite à la Conciergerie étaient bien faites pour le préparer à une aussi exceptionnelle confidence, mais enfin qu’il ne s’y attendait pas, que je l’en voyais tout interloqué et qu’il serait heureux de toucher du doigt les preuves d’un tel phénomène.
» Je sortis mon document. Il ne put en nier l’authenticité et reconnut mon écriture. Cette dernière constatation lui tira une exclamation dont je voulus connaître toute la raison. Il me répondit que mon écriture sur un document datant de deux siècles lui expliquait bien des choses. Quoi encore ? fis-je. Il m’avoua alors avec une grande loyauté que, jusqu’à ce jour, il n’avait rien compris à mon écriture et qu’il lui aurait été impossible d’établir un rapport quelconque entre cette écriture et le caractère qu’il me connaissait.
» — Vraiment, interrompis-je, et quel caractère me connaissez-vous, Adolphe ?
» — Me permettez-vous de vous le dire et me promettez-vous de ne m’en point vouloir ?
» — Je vous le promets.
» Il me fit, sur cette promesse, une peinture de mon caractère : qu’il était celui d’un brave bourgeois, d’un honnête marchand, d’un excellent mari, mais d’un homme incapable de montrer de la fermeté, de la volonté, de l’énergie. Il me dit encore que ma timidité était excessive et que cette bonté qu’il me reconnaissait tout à l’heure était toujours prête à dégénérer en faiblesse.
» Le portrait n’était guère flatté, et je ne me cachai point pour en rougir.
» — Et maintenant, fis-je, que vous m’avez dit ce que vous pensez de mon caractère, me direz-vous ce que vous pensez de mon écriture ?
» — Oui, répondit-il, puisqu’aujourd’hui c’est nécessaire.
» Alors, il me fit, sur mon écriture, des observations qui n’auraient point manqué de me fâcher tout à fait si je ne m’étais souvenu que M. Petito, le professeur d’italien, m’en avait servi de concordantes. Il me dit :
» — Votre écriture exprime tous les sentiments contraires à la nature que je vous connais, et je n’imagine rien de plus antithétique que votre écriture et votre caractère. C’est donc que vous n’avez pas l’écriture de votre caractère actuel, mais l’écriture de l’Autre.
» — Oh ! oh ! m’écriai-je, c’est fort intéressant ! L’Autre était donc énergique ?
» Et je pensai à part moi que l’Autre avait dû être quelque grand capitaine. Voici ce qu’Adolphe ajouta, et que je me rappellerai toute ma vie, tant j’en conçus de peine :
» — Tout marque, dans ces jambages et dans la façon aiguë qu’ils ont de se rejoindre, et dans la manière qu’ils ont de grandir, de monter, de se dépasser les uns les autres : de l’énergie, de la fermeté, de l’entêtement, de la dureté, de l’ardeur, de l’activité, de l’ambition… pour le mal ! J’étais consterné, mais je m’écriai dans une lueur de génie :
» — Où est le mal ? Où est le bien ? Si Attila avait su écrire, il eût peut être eu l’écriture de Napoléon !
» — On a appelé Attila « le fléau de Dieu ! », dit-il.
» — Et Napoléon a été le fléau des hommes ! répliquai-je du tac au tac.
» Je contenais difficilement mon courroux et je lui boutai que Théophraste Longuet ne pouvait être qu’un honnête homme avant sa vie, pendant sa vie, et après sa mort.
» Marceline, ma chère femme, m’approuva, et Adolphe, qui vit qu’il était allé trop loin, me demanda pardon. »
VI
THÉOPHRASTE A SA PLUME NOIRE
Je vous laisse à penser si, à dater de ce jour, les conversations entre M. et Mme Longuet et M. Lecamus manquèrent d’intérêt. Elles se passaient du reste de témoins et c’était fort mystérieusement qu’ils s’entretenaient de coq, de four, de chopinettes et de trahison du 1er avril.
Ils quittèrent la villa « Flots d’Azur » pour regagner Paris, dans le dessein de fouiller les bibliothèques.
Ainsi faisaient-ils depuis trois jours et se désolaient-ils déjà de leurs vains travaux. M. Lecamus était le plus patient. Il disait :
— Que nous ferait de trouver l’espace approximatif où sont enfouis tes trésors si tu n’as pas ta plume noire ?
Théophraste et Marceline réclamèrent une explication nécessaire.
— Remontons vers le Rond-Point, proposa Adolphe ; car nos amis se promenaient ce jour-là, qui était dimanche, aux Champs-Élysées. Et je vais vous dire ce que j’entends par la plume noire de Théophraste.
Quand ils furent sous les arbres, parmi les promeneurs nonchalants, Adolphe commença :
— Vous avez entendu parler des chercheurs de sources ?
— Certes ! répondirent-ils.
— Par un phénomène qu’on n’a pas encore expliqué, ces chercheurs, armés de petites baguettes qu’ils dirigent vers la terre, voient à travers les diverses couches de terrain la source qu’il faut faire jaillir et indiquent l’endroit à creuser. Je ne désespère point d’amener Théophraste à faire pour ses trésors ce que les chercheurs de sources font pour les sources. Je le conduirai sur le terrain désigné par le document et il dira : « C’est là, c’est là qu’il faut creuser pour trouver les trésors. »
— Mais tout ceci ne m’explique point ce que vous entendez par « ma plume noire », interrompit Théophraste.
— J’y arrive. Je vous amènerai sur cet espace, vous, le chercheur de trésors, comme on amène sur les espaces où l’on soupçonne la présence de l’eau les chercheurs de sources. Je vous y amènerai quand vous aurez votre plume noire.
Adolphe fit une pause et reprit :
— Je suis obligé de vous parler de Darwin : rassurez-vous, ce ne sera pas long. Vous allez comprendre tout de suite. Vous savez que Darwin se livra à plusieurs expériences célèbres, dont la plus connue est celle des pigeons. Désireux de se rendre compte des phénomènes de l’hérédité et de la valeur qu’il y faut attacher, il étudia de près la reproduction des pigeons, qui est suffisamment rapide pour qu’il ait pu tirer des conclusions sur un chiffre appréciable de générations successives. Au bout d’un nombre X de générations, il retrouva le même pigeon. Vous entendez, le même, avec les mêmes tares, les mêmes qualités, la même forme, le même dessin, la même plume noire, là où le premier pigeon avait une plume noire. Eh bien ! moi, Adolphe Lecamus, je prétends, et je vous le prouverai, qu’il en est des âmes comme il en fut des corps aux yeux avertis de Darwin. Au bout d’un nombre X de générations, on retrouve la même âme, telle qu’elle exista, avec les mêmes défauts et les mêmes qualités, avec la plume noire originelle. Comprenez-vous ?
— À peu près, fit Théophraste.
— Je me mets pourtant à votre portée, reprit Adolphe. Mais il faut distinguer entre l’âme qui reparaît ainsi héréditairement et celle qui revient par réincarnation.
— Voyons cela.
— Une âme héréditaire qui revit l’ancêtre a toujours sa plume noire, attendu qu’elle est le résultat d’une combinaison unique que rien ne vient contrarier, puisqu’elle vit dans un fourreau, le corps, qui est héréditaire au même degré. Est-ce clair ?
— J’ai remarqué, mon ami, fit Marceline fort humblement, que chaque fois que vous dites : « Est-ce clair ? » on n’y comprend plus goutte.
— Tandis qu’une âme qui revient par réincarnation, continua Adolphe en se pinçant les lèvres, se trouve dans un corps que rien n’a préparé à la recevoir. Les agrégats matériels de ce corps sont originaires — je prends l’exemple de Théophraste — de plusieurs générations de maraîchers à la Ferté-sous-Jouarre…
— De jardiniers, de maîtres-jardiniers, interrompit Théophraste.
— Les agrégats matériels de ce corps, dis-je, pourront momentanément imposer silence à cette âme, peut-être originaire, elle — je prends toujours l’exemple de Théophraste — de la première lignée de France, mais il arrive un moment où cette âme est la plus forte, où elle parle, où elle se montre tout entière, telle qu’elle fut avec sa plume noire !
— Je comprends ! Je comprends tout ! s’écria Théophraste.
— Alors, quand cette âme parle en vous, dit Adolphe avec une chaleur touchante, vous n’êtes plus vous ! Théophraste Longuet a disparu. C’est l’Autre qui est là ! L’Autre qui a le geste, l’allure, l’action, la plume noire de l’Autre ! C’est l’Autre qui se rappellera exactement le mystère des trésors ! C’est l’Autre qui se souvient de l’Autre !…
— Oh ! ceci est admirable, proclama Théophraste qui avait envie de pleurer, et je saisis maintenant ce que vous voulez dire avec ma plume noire. J’aurai ma plume noire lorsque je serai l’Autre !
— Et nous vous y aiderons, mon ami, affirma Adolphe avec conviction. Mais jusqu’à ce que nous ayons dégagé l’Inconnu qui est caché dans Théophraste Longuet, jusqu’à ce qu’il vive à nos yeux avec assez de force, d’audace et de liberté, jusqu’à ce qu’il soit ressuscité, en un mot, jusqu’à ce qu’il nous apparaisse avec sa plume noire, livrons-nous avec calme à l’étude de cet intéressant document que vous nous rapportâtes de la Conciergerie. Faisons-nous un jeu d’en pénétrer le mystère, précisons les limites de cet espace où les trésors furent enfouis. Mais attendons pour fouiller le sein de la terre que l’Autre qui dort en vous nous dise : « C’est là ! »
— Mon ami, mon ami, fit Marceline qui débordait d’admiration, vous parlez comme un livre et j’admire que vous ayez toujours prêt pour notre ignorance quelque petit discours qui me la fait chérir. Mais n’avons-nous pas à craindre les bouleversements de la terre pour l’objet de nos recherches ? Depuis deux cents ans…
— Femme de peu de foi, répondit Adolphe. Depuis plus de deux mille ans qu’on remue la terre sacrée du Forum comme jamais ne fut remuée cette terre franque depuis deux siècles, ce n’est qu’hier qu’ont réapparu sous le ciel latin ces rostres illustres qui connurent Caïus et Tibérius… Mais je vois s’approcher mon ami le commissaire de police, M. Mifroid, un charmant homme que je veux vous présenter.
Le commissaire de police Mifroid, qui doit jouer un rôle prépondérant dans cette histoire, un homme d’une quarantaine d’années, mis avec une grande élégance et ganté de beurre frais, une boucle argentée sur un front pur, s’avança, sourit, salua : « Monsieur, madame. »
Et il serra la main d’Adolphe qui dit :
— Mon excellent ami, M. le commissaire de police Mifroid ; M. et Mme Théophraste Longuet.
À la façon dont M. Mifroid regarda la belle Marceline, celle ci jugea tout de suite que c’était un amateur. Elle rougit un peu.
— Notre ami Adolphe, dit-elle, nous a souvent parlé de vous, monsieur Mifroid.
— Oh ! madame, je vous connais depuis longtemps, répliqua M. Mifroid. Chaque fois que je rencontre M. Lecamus, il me parle de ses amis de la rue Gérando, et dans des termes tels que mon plus grand désir était le bonheur qui m’arrive aujourd’hui : celui de vous être présenté.
— Il paraît que vous êtes très fort sur le violon ? demanda Marceline, conquise par tant de façons galantes.
— Oh ! madame, si l’on peut dire !… Je fais aussi un peu de sculpture et je m’occupe également de philosophie. Je dois ce dernier goût à mon ami Adolphe. Tout à l’heure, je vous ai croisés et j’ai entendu que vous disputiez sur l’immortalité de l’âme.
— Monsieur, fit Théophraste, qui n’avait encore rien dit, mon ami Adolphe et moi, nous aimons à nous entretenir de choses sérieuses. Il est vrai que nous parlions, pas plus tard que tout à l’heure, de l’âme et du corps et des différentes manières que l’âme a de se comporter avec le corps.
— Eh ! en seriez-vous encore, cher monsieur, fit M. Mifroid, qui avait le plus grand désir de briller devant Marceline, à distinguer entre la matière et l’esprit ? La matière et l’esprit sont même chose aux yeux de la science, c’est-à-dire qu’ils constituent une même unité dans une même Force, à la fois produit et phénomène, cause et effet, tendant à un but unique : la montée progressive de l’Être. Vous êtes les seuls, messieurs, à faire encore cette antique démarcation de la matière et de l’esprit.
Théophraste n’était point content. Il dit :
— Nous faisons, monsieur, ce que nous pouvons.
Le groupe était revenu à la place de la Concorde. À l’entrée de la rue Royale, il y avait une grande agglomération de populaire, gesticulante et tumultueuse.
Théophraste, en vieux Parisien, voulut immédiatement savoir ce qui se passait et se jeta dans la foule.
— Prends garde aux pickpockets ! lui cria Marceline.
— Oh ! madame, fit le commissaire de police Mifroid, il n’y a pas de pickpockets quand on est avec le commissaire de police Mifroid.
— C’est vrai, monsieur, fit Marceline avec un aimable sourire, vous êtes là et nous ne courons aucun danger.
— Je n’en sais rien, dit Adolphe en regardant Mifroid. Mon ami Mifroid me paraît plus dangereux que tous les pickpockets de la terre.
Mifroid éclata de rire :
— Ah ! ah ! le gaillard !
Théophraste se fit attendre dix minutes. Il avait l’œil fort allumé quand il revint :
— C’est un cocher, dit-il, qui a accroché une automobile.
— Et alors ?
— Et alors, voilà. Il ne peut pas la décrocher, c’est tout !
— La foule est-elle bête ? fit Marceline.
Là-dessus, sur un coup d’œil d’Adolphe, elle invita M. Mifroid à dîner. Celui-ci se défendit, mais peu.
Transportons-nous maintenant rue Gérando. Il est neuf heures. Le dîner touche à sa fin, dans la salle à manger de Théophraste. M. Mifroid et Adolphe, pendant le repas, ont dit mille choses ingénieuses et plaisantes. Mais M. Mifroid est inquiet. Il a plongé ses mains dans toutes ses poches, y cherchant vainement son mouchoir. Après une dernière et inutile enquête dans la poche de côté de sa redingote, il se passe désespérément l’index sous la moustache et aspire avec force. À ce moment, Théophraste se mouche. Marceline lui demande où il a trouvé ce joli mouchoir. M. Mifroid reconnaît le sien, estime que la plaisanterie est charmante, prend le mouchoir des mains de Théophraste et le replace dans sa poche. Théophraste ne comprend pas. Soudain, Mifroid pâlit. Il se tâte le côté gauche. Il dit tout haut :
— Mon Dieu ! qu’est-ce que j’ai fait de mon portefeuille ?
C’est bien simple, on a volé, dans sa poche, le portefeuille du commissaire. Il y avait cinq cents francs dedans. M. Mifroid ne regrette pas les cinq cents francs, mais il se trouve ridicule. Marceline se moque gentiment de lui, tout en le plaignant. Intérieurement, il est furieux.
— Monsieur Mifroid, dit Théophraste, si vous avez besoin d’argent pour ce soir, je puis vous en prêter.
Et il tire de sa poche un portefeuille. M. Mifroid pousse un cri : c’est le sien ! Théophraste devient écarlate. M. Mifroid le regarde, lui retire des mains le portefeuille, comme il a fait du mouchoir, reconquiert ses cinq cents francs, excipe de ses nombreuses occupations pour prendre congé et dit, avant de dégringoler l’escalier, à son ami Adolphe qui le poursuit :
— À quelle sorte de gens m’as-tu donc présenté là ?
Quand Adolphe rentre dans la salle à manger, Théophraste est en train de vider ses poches ; il y a sur la table : trois montres, six mouchoirs, quatre portefeuilles contenant des sommes importantes et dix-huit porte-monnaie !
VII
LE PORTRAIT
L’événement capital de cette histoire et son héros nous ont à ce point occupé que nous n’avions point trouvé le temps de présenter comme il faut M. Adolphe Lecamus. Le peu que nous en savons n’est point pour le rendre sympathique. La place qu’il occupe dans le ménage Longuet et qui est éminemment immorale, le cynisme avec lequel il trompe une âme simple, le peu de danger qu’il semble courir en accomplissant un larcin qui est honteusement puni par le code Napoléon, voilà bien des raisons pour que nous nous éloignions de lui en marquant quelque mépris. Ce serait, disons-le tout de suite, le juger hâtivement. Il sied, avant de le condamner, de plaider les circonstances atténuantes. La principale, et qui vaut bien qu’on s’y arrête, est qu’il aime Théophraste par-dessus tout. Il l’aime dans ses défauts, dans ses faiblesses, dans sa naïveté, dans la confiance qu’il a en lui, et surtout dans l’admiration qu’il a de lui, Adolphe. Il n’est point de sacrifice qu’il ne soit prêt à consentir pour Théophraste, et je dis que si Théophraste avait des ennuis d’argent, qui sont les seuls véritables ennuis qui comptent ici-bas, Adolphe Lecamus ouvrirait sa bourse et lui dirait : Prends !
Adolphe aime Théophraste par-dessus tout, c’est-à-dire qu’il l’aime par-dessus Marceline. Je ne prétends point faire ici de la psychologie, mais je me trouve en face d’un cas qui est beaucoup moins ordinaire qu’on ne serait porté à le croire. Adolphe aime bien Marceline, puisqu’il en a fait sa maîtresse, et cependant il aime Théophraste plus que sa maîtresse, qui est la femme de Théophraste. Je m’explique. S’il avait su, par un avertissement surnaturel de l’Avenir, que Théophraste aurait un jour le chagrin d’apprendre qu’il était cocu, Anatole aurait respecté Marceline. Mais Anatole s’était dit : « Théophraste ne saura jamais rien ; malheur caché n’existe pas. » Et voilà dans quel sentiment il était devenu l’amant de la femme de son meilleur ami.
Ces lignes étaient nécessaires pour que le lecteur comprît bien que la fourberie de l’amant — si tant est qu’il y eût fourberie en la circonstance — ne pouvait contredire en rien le dévouement de l’ami.
Adolphe était dévoué à Théophraste. Aussi, après le départ du commissaire, se prit-il à considérer avec un réel désespoir, sur la table de la salle à manger, les trois montres, les six mouchoirs, les quatre portefeuilles et les dix-huit porte-monnaie. (Il est beaucoup plus facile de s’emparer de dix-huit porte-monnaie dans la poche d’un pantalon que de voler quatre portefeuilles dans la poche intérieure d’une redingote qui peut être boutonnée.)
Marceline, Adolphe et Théophraste se taisaient devant l’étalage inattendu de ces objets disparates.
Théophraste était d’une tristesse effrayante à voir. Il rompit le premier le silence. Il dit :
— Je n’ai plus rien dans mes poches…
— Oh ! mon ami ! fit Marceline, dans un soupir de reproche.
— Mon pauvre ami ! accentua Adolphe, qui craignait de laisser pénétrer sa pensée.
— Je crois bien, murmura Théophraste, qui épongeait la sueur froide de son front avec un mouchoir dont il ignorait la provenance, je crois bien que j’ai eu ma plume noire ?…
Marceline et Adolphe, atterrés, se taisaient encore.
Théophraste les regarda, essuya les verres de ses lunettes ; il sourit et dit :
— Après tout, dans ce temps-là, c’était peut-être un jeu de société !
Et il se fourra l’index de la main droite dans la bouche, geste familier qui indiquait chez Théophraste une préoccupation excessive. Ni Marceline, ni Adolphe, ni Théophraste n’osaient toucher un seul de ces objets inconnus qui surchargeaient la table.
— Mon ami, reprit Marceline, retire ton doigt de ta bouche et dis-nous comment tu as fait pour avoir sur toi trois montres, six mouchoirs, quatre portefeuilles et dix-huit porte-monnaie, sans compter le mouchoir et le portefeuille de M. le commissaire Mifroid. J’ai retourné ce matin toutes tes poches, en nettoyant tes effets, et je n’y ai trouvé, comme à l’ordinaire, que quelques grains de tabac.
— Il y avait, place de la Concorde, fit Théophraste, une agglomération ; je suis entré dedans et j’en suis sorti avec tout cela ; c’est bien simple.
— Qu’est-ce que nous allons en faire ? demanda Adolphe d’une voix grave.
— Et qu’est-ce que tu veux que j’en fasse ? répliqua Théophraste, qui se remettait peu à peu. Tu ne penses pas que je vais le garder ? Est-ce que j’ai l’habitude de garder ce qui ne m’appartient pas ? Je suis un honnête homme et je n’ai jamais fait de tort à personne. Tu vas prendre tout cela et le porter chez ton ami le commissaire de police Mifroid. Il lui sera facile de retrouver les propriétaires.
— Et qu’est-ce que je lui dirai ?
— Ce que tu voudras ! éclata Théophraste qui commençait à s’impatienter. Est-ce que l’honnête cocher qui trouve une serviette et cinquante mille francs dans sa voiture, et qui les porte au commissariat, se préoccupe de ce qu’il dira ? Il dit : J’ai trouvé ceci dans ma voiture ! et cela suffit. On lui donne même une récompense. Toi, tu diras : mon ami Longuet me charge de vous rapporter ces objets qu’il a trouvés dans ses poches et il ne demande pas de récompense !
Depuis un instant, Marceline avait placé sous la table son pied sur le pied d’Adolphe. Du reste, c’était là, le plus souvent, quand il y avait table entre eux, que l’on pouvait trouver le pied de Marceline. Il ne faut point l’en blâmer. Songez que sa tendresse pour son mari pouvait librement s’exprimer ; il lui était loisible, devant tout le monde, de l’embrasser, de le caresser, de l’appeler « mon Théo ! » et de l’entourer de ces mille petites attentions qui, venant d’une femme, surtout de la sienne, flattent infiniment le cœur et la vanité si naturelle d’un époux. Mais si quelque démonstration de sympathie un peu osée lui eût échappé en public à l’adresse d’Adolphe Lecamus, on n’eût point manqué de dire que Théophraste était trompé par son meilleur ami.
Elle, Marceline, eût été compromise, Théophraste eût été ridicule et Adolphe Lecamus eût passé pour un vilain monsieur.
Comme Marceline était une femme intelligente, elle avait résolu d’éviter cette inutile et triple catastrophe en réservant toutes ses caresses visibles à son mari et en gardant les cachées pour son amant. Il se rencontre beaucoup de femmes mariées qui n’ont point cette discrétion, et elles s’en trouvent, les premières, châtiées par les désagréments que tant de bénévole audace leur attire. La caresse du pied était celle que Marceline prodiguait le plus souvent à M. Lecamus ; c’était aussi, il faut l’avouer, parmi toutes les autres, la caresse la plus inoffensive. Mais elle s’y complaisait. Puisqu’il leur était interdit, à Adolphe et à elle, de s’attarder en de longues songeries, la main dans la main, comme on le voit faire aux amants dans les tableaux des peintres mélancoliques, ils s’oubliaient ainsi, le pied sur le pied. Et même, par un juste équilibre de toutes les facultés, pendant des heures quelquefois, quand il y avait une table entre eux trois, Marceline et Théophraste restaient la main dans la main au-dessus de cette table, cependant que Marceline et Adolphe, au-dessous, restaient le pied sur le pied. Et Marceline, qui avait, comme on dit, de la santé, était aussi heureuse au-dessus de la table qu’au-dessous.
Le jeu de pied, ce soir-là, n’était point simplement une caresse ; il signifiait : « Adolphe ! Adolphe ! où allons-nous ? Il me semble que Théophraste déménage. Viens à mon secours ! Viens au secours de Théophraste ! »
Adolphe avait compris : il fronçait les sourcils et se grattait le bout du nez. Il jugeait la minute importante. Il regarda encore Théophraste, il regarda les porte-monnaie. Il toussa. Il dit :
— Théophraste, ce qui vient de se passer n’est pas naturel. Il faut tâcher à nous expliquer. Il faut nous efforcer de comprendre. Il ne faut point fermer les yeux, mon ami. Il faut les ouvrir ! les ouvrir tout grands à ton malheur, si malheur il y a, afin de le combattre.
— De quel malheur parles-tu ? demanda Théophraste, redevenu timide, et prenant, dans sa détresse, la main de Marceline.
— C’est toujours un malheur d’avoir dans ses poches des choses qui ne vous appartiennent pas.
— Il n’y a que cela dans les poches des prestidigitateurs ! s’écria Théophraste avec force. Et les prestidigitateurs sont d’honnêtes gens. Et Théophraste Longuet est un honnête homme, par les tripes de Mme de Phalaris !
Ayant dit ces choses, il retomba, exténué, sur sa chaise, et entre eux trois, il y eut un grand silence.
Quand Théophraste sortit de sa torpeur, ses yeux étaient pleins de larmes. Il fit signe à son ami et à sa femme d’approcher tout près de lui et, quand ils furent à ses côtés, il marqua une émotion pitoyable.
— Je sens, dit-il, qu’Adolphe a raison. Un grand malheur me menace… Je ne sais lequel ! Je ne sais lequel ! Mon Dieu ! mon Dieu ! je ne sais lequel !
Et il pleura… Adolphe et Marceline tentèrent de le consoler, mais il pleura encore, et ils eurent, eux aussi, la douceur de pleurer. Ils s’étreignirent tous les trois. Théophraste les tenait embrassés.
— Jurez-moi, disait ce brave et honnête homme, jurez-moi de ne m’abandonner jamais, quoi qu’il arrive !
Ils le jurèrent, de bonne foi. Alors Adolphe exigea qu’il lui apportât le document. Il alla le lui chercher. Ils se rassirent, après s’être mouchés bruyamment. Adolphe avait étalé le document devant lui. Il y eut un pesant silence. Adolphe hochait la tête et puis, délibérément, il la releva.
— Théophraste, ordonna-t-il, il faut tout me dire. Rêvez-vous quelquefois ?
— Si je rêve ? répéta notre ami, si je rêve ? C’est bien possible ; mais comme mes digestions sont excellentes, je ne me rappelle guère avoir rêvé.
— Jamais ? insista Adolphe.
— Oh ! jamais, c’est trop dire. Ainsi, il me souvient d’avoir rêvé quatre ou cinq fois dans ma vie, en effet. Il m’en souvient peut-être parce que je me réveillais chaque fois au milieu de mon rêve et que c’était toujours le même rêve. Mais de quel intérêt cela peut-il être dans le cas qui nous occupe, mon cher ami ?
Adolphe continua :
— Les rêves n’ont jamais été expliqués par la science ; celle-ci croit avoir tout dit en les attribuant à un effet de l’imagination, mais elle ne nous donne pas la raison de ces visions si claires et si nettes qui nous apparaissent quelquefois. Ainsi explique-t-elle une chose qui n’est pas connue par une autre qui ne l’est pas davantage. La question reste donc tout entière. C’est, dit-on, les souvenirs des préoccupations de la veille que nous rêvons ; mais en admettant même cette solution qui n’en est pas une, il resterait encore à savoir quel est ce miroir magique qui conserve ainsi l’empreinte des choses ? En outre, comment expliquer les visions des choses réelles que l’on n’a jamais vues à l’état de veille et auxquelles même on n’a jamais pensé ! Qui pourrait affirmer que ce ne sont point là des visions rétrospectives des événements passés avant la vie ?
— En vérité, mon cher Adolphe, répliqua Théophraste avec une grande douceur, je dois vous avouer que les choses que j’ai rêvées — et je les ai rêvées trois fois, je l’affirme maintenant — sont peut-être réelles, dans le passé ou dans l’avenir, mais que je ne les ai jamais vues, à l’état de veille, dans le présent[2].
— Vous me comprenez, congratula Adolphe. Racontez-moi donc ces choses que vous avez rêvées et que vous n’avez jamais vues.
— Oh ! ce ne sera pas long, mais c’est tant mieux, parce que ce n’est pas gai. Je rêvais que j’étais marié à une femme que j’appelais Marie-Antoinette et qui me trompait, et alors…
— Et alors ? interrogea Adolphe qui ne quittait plus des yeux le document.
— Et alors, je la découpais en morceaux !
— Oh ! l’horreur ! s’écria Marceline.
— C’est horrible, en effet, continua Théophraste en hochant la tête, et alors…
— Et alors ?
— Je mettais les morceaux dans une hotte et j’allais la décharger dans la Seine, au petit pont de l’Hôtel-Dieu. Ensuite je me réveillais, et je dois vous dire que je n’en étais pas fâché.
Adolphe donna un grand coup de poing sur la table.
— C’est épouvantable ! s’écria-t-il d’une voix rauque, en regardant Théophraste.
— N’est-ce pas ? fit Marceline, toute frissonnante.
— Je viens de lire entièrement la première ligne du document et voilà ce qui est épouvantable ! continua-t-il à gémir. Hélas ! hélas ! je comprends maintenant !
— Et que comprends-tu ? fit Théophraste, effrayé, lui aussi, en suivant, du doigt d’Adolphe, les deux premières lignes du document.
— Ceci veut dire, affirma M. Lecamus : Moi, rt !… j’ai enfoui trésors. Vous entendez ! Moi, rt !… Et vous ne savez pas qui c’est, rt ? Eh bien ! je ne veux pas vous le dire avant d’en être tout à fait sûr. Et j’en serai sûr demain. Demain, Théophraste, soyez à deux heures à l’angle de la rue Guénégaud et de la rue Mazarine !… J’emporte ces objets chez mon ami Mifroid, qui les restituera, ajouta-t-il, et à qui il sera prouvé qu’il y a encore des pickpockets, même « avec » le commissaire. Adieu, mon ami ! Adieu ! Et du courage ! surtout du courage !
Et Adolphe serra la main de Théophraste comme on serre la main d’un parent de mort.
Théophraste ne dormit pas, cette nuit-là. Pendant que Marceline reposait paisiblement à ses côtés, il avait, lui, les yeux grands ouverts dans les ténèbres. Sa respiration était irrégulière et pleine de soupirs profonds. Une lourde anxiété s’était assise sur son cœur.
Le jour se leva sur la ville, un jour d’une tristesse blême et sale qui enveloppa sinistrement les choses. En vain le soleil d’été voulut-il pénétrer cette atmosphère fuligineuse et opaque. Midi qui voyait ordinairement son triomphe montra un globe épais roulant sans gloire dans une lumière sulfureuse. Telle était exactement la « peinture » du ciel, ce jour-là. Si je m’y suis attardé en trois phrases, c’est qu’elle nous est nécessaire.
Théophraste, dès la première heure, sauta du lit et soudain réveilla Marceline par un accès d’hilarité insensée. Marceline lui demanda la cause d’une joie aussi étrange et il répondit que la nature ne lui avait pas fait la bouche assez large pour contenir le rire qui s’emparait de lui à la pensée de la tête de M. le commissaire de police Mifroid, qui ne croyait pas aux pickpockets, devant le déballage de ces objets dont il avait gonflé les poches de son ami Adolphe, pour qu’il les restituât.
Il dit :
— Ma chère, Marceline, c’est l’enfance de l’art de prendre un porte-monnaie dans une poche. Si vous n’y pouvez mettre la main, glissez-y une paille enduite de glu. Ce dernier système est excellent dans le travail à la presse.
Marceline se leva sur son séant et fixa avec effroi Théophraste qui n’avait jamais eu l’air plus naturel. Théophraste mettait son caleçon.
— Il manque un bouton à la patte, dit-il.
— Théophraste, tu m’épouvantes, avoua Marceline.
— Il y a de quoi ! répondit son époux en se mettant à quatre pattes pour chercher ses bretelles qui s’étaient enfuies sous le lit. Mais on ne fait de bon travail, ajouta-t-il, qu’avec une bonne femme. Et il n’y a rien à faire avec toi. Tu ne seras jamais une bonne anquilleuse.
— Une… quoi ?
— Une bonne anquilleuse. La prochaine fois que tu iras à la Maison-Dorée, tu m’achèteras une paire de bretelles ; celles-ci ne pourraient même plus servir à réjouir le bourgeois. Tu ne sais même pas ce qu’est une anquilleuse. C’est honteux, à ton âge. Une anquilleuse est une personne de ton sexe, qui sait avec habileté cacher les objets dérobés entre ses jambes. Je n’ai jamais eu de meilleure anquilleuse que la Vache-à-Paniers.
— Mon pauvre enfant ! gémit Marceline.
Théophraste fut pris d’une colère terrible. Il se précipita vers sa femme et la menaça du tire-bouton.
— Tu sais bien ! tu sais bien que je ne veux plus qu’on m’appelle l’Enfant ! depuis la mort de Jeanneton-Vénus.
Marceline jura qu’elle ne recommencerait plus. Et elle se mit à regretter du plus profond de son âme l’heure funeste qui l’avait rendue propriétaire avec son époux d’un document qui lui promettait des trésors, mais qui lui apportait tout de suite, dans son ménage, le trouble, la peur, l’intolérance, la folie et l’inexplicable. Après Marie-Antoinette, Jeanneton-Vénus surgissait. Elle ne connaissait ni l’une ni l’autre, et ne les devait point connaître. Mais son mari avait une façon familière de s’exprimer sur le compte de ces dames qui pouvait faire croire qu’il était très bien renseigné. Enfin, les phrases inattendues dans la bouche de Théophraste, tout en lui faisant redouter le Théophraste incompréhensible d’il y a deux cents ans, lui faisaient surtout regretter le Théophraste si facile à comprendre de l’avant-veille. Elle se prenait à d’amères réflexions sur la théorie de la réincarnation.
Théophraste avait fini de s’habiller. Il se plaignit encore qu’on n’eût point fait une reprise nécessaire à la boutonnière de son gilet à fleurs. Puis il annonça qu’il ne déjeunerait pas à la maison, qu’il avait rendez-vous avec son ami Va-de-Bon-Cœur, au coin de la rue Mazarine et de la rue Guénégaud, pour faire un bon tour à un monsieur de Traneuse, officier ingénieur qui le dégoûtait fort. Mais, comme ce rendez-vous était après déjeuner, il se promettait d’aller prendre l’air au Moulin des Chopinettes.
Marceline, sous sa chemisette de nuit, tremblait à faire pitié. Elle regrettait l’absence d’Adolphe. Elle eut la force de dire, à tout hasard :
— Il fait bien mauvais pour aller prendre l’air au Moulin des Chopinettes.
— Bah ! répondit Théophraste fort logiquement, je laisserai ici mon ombrelle verte et je prendrai ma plume noire.
Là-dessus, il s’en fut, en mettant la dernière main à sa cravate.
Sur le palier, il rencontra M. Petito, le professeur d’italien, qui descendait l’escalier, lui aussi. M. Petito salua très bas M. Longuet, se plaignit de l’état de la température et lui fit mille compliments de sa bonne mine. Théophraste répondit sur un ton peu aimable, et comme M. Petito, sur le trottoir, semblait ne devoir point quitter Théophraste, celui-ci lui demanda si Mme Petito ne se résoudrait pas bientôt à apprendre sur le piano un autre air que le Carnaval de Venise ; mais M. Petito répondit en souriant qu’elle étudiait justement Une étoile d’amour, et qu’elle étudierait à l’avenir tous les morceaux qui pourraient convenir à M. Théophraste Longuet.
Et M. Petito demanda :
— De quel côté allez-vous, monsieur Longuet ?
— J’allais faire un tour au Moulin des Chopinettes, mais décidément le temps est trop gâté et je descends aux Porcherons.
— Aux Porcherons ?… (M. Petito allait demander : « Qu’est-ce que c’est que les Porcherons ? » Mais il se ravisa.) Moi aussi, fit-il.
— Ah ! ah ! répliqua Théophraste en jetant sur M. Petito un singulier coup d’œil, vous aussi, vous allez aux Porcherons ?
— Aller là ou ailleurs… dit M. Petito en plaisantant.
Et il suivit Théophraste. Il y eut un petit silence, au bout de quoi M, Petito osa formuler cette question :
— Et où en sont vos trésors, monsieur Théophraste Longuet ?
Théophraste fit brusquement un demi-tour.
— Eh mais ! s’écria-t-il, qu’est-ce que ça peut vous f… ?
— Vous vous rappelez que vous m’avez apporté, un jour, pour quelques remarques sur l’écriture…
— Je me le rappelle, et vous, vous avez tort de vous en souvenir ! fit Théophraste d’un ton sec, en ouvrant son parapluie, car il commençait à pleuvoir.
M. Petito, nullement découragé, se mit à l’abri sous le parapluie de Théophraste.
— Oh ! monsieur, je ne dis point cela pour vous désobliger…
Ils étaient arrivés au coin de l’avenue Trudaine et de la rue des Martyrs. Ils descendirent. Théophraste était de fort méchante humeur.
— Monsieur, dit-il, j’ai rendez-vous au cabaret du Veau qui tette, à côté de la chapelle des Porcherons que voici…
— Mais c’est la chapelle Notre-Dame-de-Lorette et nullement celle des Porcherons.
— Je n’aime point qu’on se paie ma tête, affirma Théophraste.
M. Petito protesta.
— Je sais bien qu’elle vaut cher, ma tête, continua Théophraste en regardant M. Petito de façon de plus en plus étrange. Savez-vous combien elle vaut, monsieur Petito, la tête de l’Enfant ? Non ?… Eh bien, je vais vous le dire, puisque l’occasion s’en présente. Et, du même coup, je vous conterai une petite histoire dont vous pourrez faire votre profit. Arrêtons-nous ici. C’est le cabaret du Veau qui tette.
— Mais, monsieur, interrompit M. Petito qui commençait à s’effrayer, c’est la brasserie Bousset.
— Il y a du brouillard, répliqua Théophraste, et c’est votre excuse. Vous avez perdu votre chemin, parmi tous ces champs de culture ! Ah ! ah ! monsieur Petito, vous avez voulu me nuire ! Tant pis, monsieur Petito, tant pis ! Que prenez-vous ! Un verre de ratafia ? La patronne de céans, cette excellente Mme Taconet[3], m’a mis de côté une bouteille qui vous embaumera les boyaux.
Et comme un garçon, orné d’un tablier blanc, s’approchait, Théophraste, sans sourciller, commanda :
— Deux bocks bien tirés, sans faux-col !
Ainsi, sans préparation aucune, sans même s’en rendre compte, il reliait fort naturellement son existence d’autrefois à son existence d’aujourd’hui. Il reprit, cependant que M. Petito regrettait intimement son insistance à accompagner jusqu’à la brasserie Bousset un homme qui prétendait être admis au cabaret du Veau qui tette :
— Ma tête vaut 20.000 livres, monsieur ! Et vous le savez bien !
Ce « Et vous le savez bien ! » fut prononcé avec un tel ton et accompagné d’un tel coup de poing sur la table de bois, qui supportait les deux bocks, que M. Petito recula instinctivement.
— N’ayez pas peur, monsieur Petito, la bière, ça détache. Vous savez donc que ma tête vaut 20.000 livres ; eh bien ! mon petit monsieur, il faut faire comme si vous ne le saviez pas ! Ou il pourrait vous arriver du désagrément. Je vous ai promis un conte. Le voici[4] :
Je me promenais, il a quelque deux cents ans de cela, rue de Vaugirard, les mains dans les poches, sans armes, sans même une épée, et le plus honnêtement du monde, quand un homme m’aborda au coin de cette rue de Vaugirard et de l’« Enfant Jésus ». Il me salua jusqu’à terre et me dit que ma figure lui revenait beaucoup (comme vous fîtes, comme vous dîtes, monsieur Petito !) et qu’on l’appelait le bonhomme Bidel, et qu’il avait un secret à me confier. Je l’encourageai d’une petite tape amicale sur l’épaule. (Ici M. Théophraste Longuet décharge une telle petite tape sur l’épaule de M. Petito, que M. Petito pousse un gémissement et sort sa monnaie, dans le désir qui l’étreint d’aller voir dehors si le brouillard s’est dissipé.) Rentrez donc votre monnaie, monsieur Petito ! C’est moi qui régale. Je disais donc que le bon homme Bidel, encouragé par une petite tape amicale sur l’épaule (M. Petito glisse sur la banquette), me confia son secret. Il me dit, dans le tuyau de l’oreille, que le Régent avait promis 20.000 livres à qui ferait arrêter l’Enfant et qu’il savait, lui, où se cachait l’Enfant, que je lui étais apparu comme un homme de courage, et qu’il se faisait fort, avec mon aide, de gagner les 20.000 livres. On partagerait. Le bonhomme Bidel était bien mal tombé, monsieur Petito, car, moi aussi, je savais où se trouvait l’Enfant, puisque l’Enfant, c’était moi ! (M. Petito n’en veut rien croire. Il estime, à part lui, que depuis de longs mois M. Longuet n’est plus un enfant. Mais il n’ose le dire.) Je répondis au bonhomme Bidel que c’était là une bonne aubaine et que je remerciais le ciel de l’avoir mis sur mon chemin, et je le priai de me conduire à l’endroit où se trouvait l’Enfant. Il me dit : « Ce soir, l’Enfant couche aux Capucins, dans une petite auberge qui est à l’enseigne de la Croix de la Sainte-Hostie. » C’était vrai, monsieur Petito. Le bonhomme Bidel était bien renseigné. Je l’en félicitai. Nous passâmes alors devant une boutique de coutellerie et j’achetai, sous le regard étonné de Bidel, un petit couteau d’un sou. (Les yeux de Théophraste lancent des éclairs, les paupières de M. Petito battent de terreur.) Le bonhomme Bidel me demanda, dans la rue, ce que je comptais faire avec un petit couteau d’un sou. Je lui répondis : Avec un petit couteau d’un sou (M. Longuet se rapproche de M. Petito ; M. Petito s’éloigne de M. Longuet), on peut toujours tuer une mouche ! Et je le lui plongeai dans le cœur. Il s’affaissa en faisant des moulinets avec ses bras, Il était mort ! (M. Petito, qui avait d’abord glissé sur la banquette, glisse dessous, et, de dessous de banquettes en dessous de banquettes, gagne la porte et recouvre la liberté.)
M. Théophraste Longuet vide son bock, se lève et va à la caisse de la brasserie Boustes, où Mme Berthet compte des jetons. Il lui dit :
— Madame Taconet (Mme Berthet se demande pourquoi M. Théophraste l’appelle Mme Taconet ; cette demande informulée reste sans réponse), si vous recevez ici le chevalier Petito, vous lui direz de ma part que la première fois que je le retrouverai sur mon chemin, je lui couperai les oreilles !
Ce disant, Théophraste caresse le manche de son parapluie comme on caresse le manche d’un poignard. Il n’y a pas de doute, Théophraste a sa plume noire. Il est tout à fait devenu l’Autre. Et il s’en va, sans payer.
Le brouillard était encore épais. Il ne songea pas à déjeuner. Il marchait dans cette buée sulfureuse comme en un rêve. Il traversa tout l’ancien quartier d’Antin et ce qui fut autrefois la Ville-l’Évêque. Quand il aperçut l’ombre des tours de la Trinité, il dit : « Ah ! ah ! le Château du Coq ! » Il était à la gare Saint-Lazare quand il croyait être « à la Petite Pologne. » Mais, peu à peu, le brouillard s’étant dissipé, son rêve, avec lui, s’envola. Il eut une notion plus exacte des choses. Quand il traversa la Seine, au Pont-Royal, il était redevenu un honnête Théophraste, et quand il mit le pied sur la rive gauche, il n’avait plus qu’un vague souvenir de ce qui venait de se passer sur la rive droite.
Mais il avait ce souvenir. En effet, quand il s’interrogeait bien, maintenant qu’il commençait à avoir l’expérience de ses différents états d’âme, Théophraste découvrait en lui trois états d’âme : 1o celui qui résultait de son existence actuelle d’honnête marchand de timbres en caoutchouc ; 2o celui qui résultait de la Résurrection soudaine et momentanée de l’Autre ; 3o celui qui résultait du Souvenir. Ce souvenir était en lui comme un troisième Théophraste qui eût raconté au premier ce qu’il savait du second. Autant la Résurrection en Théophraste était un événement terrible (nous l’avons vu et nous le verrons encore avec M. Petito), autant le souvenir était chose douce, mélancolique et propre à faire naître en un cœur endolori le sentiment d’une tristesse toujours aimable et d’une pitié philosophique.
— Pourquoi, se disait-il maintenant, en se dirigeant vers la rue Guénégaud, pourquoi Adolphe m’a-t-il donné rendez-vous au coin de la rue Guénégaud et de la rue Mazarine ?
Il s’y achemina. Il ne voulut point passer par le coin de la rue Mazarine qui longe le palais de l’Institut, autrefois des Quatre-Nations. Il ne savait pas pourquoi. Il fit le tour par l’hôtel de la Monnaie et ainsi arriva-t-il rue Guénéguaud. Adolphe était là qui le prit par le bras.
— N’auriez-vous point entendu parler, mon cher Adolphe, lui dit-il, d’un nommé l’Enfant ?
— Oui, oui, dit Adolphe, j’en ai entendu parler. Je sais même son véritable nom, son nom de famille.
— Ah ! et quel est-il ? demanda anxieusement Théophraste.
Adolphe, pour toute réponse, poussa Théophraste dans la petite allée d’une vieille maison de la rue Guénégaud, à quelques pas de l’hôtel de la Monnaie. Ils montèrent un escalier branlant et entrèrent dans une chambre dont les rideaux étaient tirés. On avait fait la nuit dans cette chambre. Mais sur une petite table, dans un coin, la flamme tremblante d’une bougie éclairait uniquement un portrait.
C’était l’image d’un homme d’une trentaine d’années, à la figure énergique, au regard « flamboyant ». Il avait le front haut, le nez fort, le menton ras, la bouche grande, la moustache hirsute ; le cheveu nombreux était coiffé d’une toque de laine ou de feutre grossier, et l’habit paraissait d’un prisonnier. Sur le torse s’entr’ouvrait une chemise de grosse toile.
— Tiens ! fit Théophraste sans hausser le ton, comment mon portrait se trouve-t-il dans cette maison ?
— Votre portrait ! s’écria Adolphe. En êtes-vous bien sûr ?
— Qui donc peut en être plus sûr que moi ? fit encore Théophraste sans s’émouvoir.
— Eh bien ! ce portrait, se décida à avouer M. Lecamus avec une émotion que nous n’essaierons pas de décrire… ce portrait, qui est votre portrait, est le portrait de Cartouche !!!
Quand M. Lecamus se retourna pour juger de l’effet qu’il avait produit sur son ami, il vit Théophraste étendu sur le parquet, évanoui. Longtemps, il lui tapa dans les mains, après avoir soufflé la bougie et ouvert la fenêtre. Quand Théophraste revint à lui, les premiers mots qu’il prononça furent ceux-ci :
— Adolphe, surtout ne le dites pas à ma femme !
VIII
OÙ THÉOPHRASTE MANQUE UN BROCHET DE QUATRE LIVRES ET APPREND, SUR SON COMPTE, DES HISTOIRES QU’IL NE SOUPÇONNAIT PAS.
Le lendemain de ce jour, Théophraste et Marceline regagnaient les joies calmes de la villa « Flots d’Azur ». Théophraste ne disait mot et Marceline n’avait garde de l’interroger. Marceline ne savait rien encore de l’épouvantable malheur. Une consternation parfaite était répandue sur les traits de Théophraste ; quelquefois, des larmes emplissaient ses bons yeux sans qu’il donnât à son épouse la raison de cet apitoiement humide.
Adolphe devait les venir rejoindre dans les quarante-huit heures. Deux jours se passèrent, fort tristes, à la villa. Marceline vaquait aux soins du ménage et Théophraste préparait en silence ses engins de pêche ; mais, comme un soleil joyeux se leva sur la troisième journée, Théophraste, qui avait passé une bonne nuit, montra un visage reposé, un regard moins inquiet et un commencement de sourire. Par le train de onze heures quarante-six, M. Adolphe Lecamus descendait à la gare d’Esbly. Il fut reçu avec transports et l’on se mit à table. On en sortit (de cette table) à deux heures seulement. Marceline, profitant de ce que l’on était « entre soi », avait dégagé un peu sa chemisette, exhibant, sans contrainte, un commencement de gorge houleuse et rose. Théophraste faisait prévoir, avec une grande abondance de détails, à son ami Adolphe, les joies d’un après-midi de pêche passionnée. M. Lecamus ne disait rien, mais prenait pour la troisième fois d’un certain curaçao qu’il appréciait au-dessus de sa valeur. Théophraste se chargea des lignes, gaules, amorces, boulettes d’argile et de sang de porc qui s’arrondissaient au fond d’un seau d’étain. Adolphe prit l’épuisette et la boîte d’asticots. Ils embrassèrent Marceline et descendirent doucement vers la Marne.
— J’ai préparé ton coup, disait Théophraste ; tu m’en diras des nouvelles. Moi, pendant que tu pêcheras, je t’écouterai en m’amusant avec mes vérons. J’en ai une pleine boutique qui dort là-bas sous les herbes et les nénuphars. Je taquinerai la perchette : c’est tout ce que je peux faire aujourd’hui, en t’écoutant.
Adolphe était redevenu muet.
Quand ils furent sur la rive, Théophraste déposa tous ses engins, et pendant que son ami examinait un hameçon, il lui dit :
— Eh bien ?…
— Eh bien, répondit Adolphe, il y a du bon et du mauvais. Mais je dois te dire qu’il y a plus de mauvais que de bon ; sans doute, on a inventé bien des histoires sur ton compte, mais la vérité vraie n’est point tout à fait ragoûtante.
— T’es-tu bien renseigné ?
(Théophraste depuis la scène de la rue Guénégaud tutoyait Adolphe. Le formidable secret les avait encore rapprochés.)
— Je suis allé aux sources. J’ai vu les pièces authentiques. Je vais te dire ce que je sais. Si je me trompe, tu m’avertiras.
Théophraste jeta la boulette de glaise dans la Marne et dit :
— Va toujours. Il faut bien que je me fasse une raison.
— D’abord, fit Adolphe, tu es né au mois d’octobre 1693 et tu t’appelles Louis-Dominique Cartouche.
— C’est inutile, interrompit Théophraste, en tirant à lui sa « boutique » pleine de vérons, c’est inutile de crier que je m’appelle Cartouche. Personne n’a besoin de le savoir. Dans le pays, tu les connais, ils en feraient des gorges chaudes. Appelle-moi l’Enfant ; j’aime mieux cela et nul ne comprendra.
— Tu sais que Cartouche est ton vrai nom ; ce n’est pas un nom de guerre, insista Adolphe.
— Passons, passons ! C’est un vilain nom.
— On a raconté que tu as fait de solides études au collège de Clermont et que tu fus le condisciple de Voltaire. Mais c’est une légende, attendu que si tu sus lire par la suite, grâce à des Bohémiens qui t’enseignèrent la lecture, tu ne sus jamais écrire.
— Eh bien ! Elle est raide ! s’écria Théophraste.
— Tu savais écrire ?
— Parbleu ! si je n’avais pas su écrire, comment aurais-je rédigé le document dans le cachot de la Conciergerie ?
— C’est vrai. Lors de ton procès…
— J’ai donc eu un procès ?
— Et un fameux. Lors de ton procès, tu as déclaré ne pas savoir écrire. Tu signais tes dépositions d’une croix, et tu n’as jamais écrit une ligne à qui que ce fût.
— « Parce qu’il ne faut jamais écrire », répondit Théophraste. Dans ma situation, je devais redouter de me compromettre. Mais le document est là.
— Évidemment. Revenons à tes onze ans. Un jour, tu vas avec des camarades à la foire Saint-Laurent.
— Dis donc, Adolphe, tu ne pourrais pas t’exprimer autrement ? Tu me dis : « Tu vas avec des camarades à la foire Saint-Laurent… Tu es né en 1693… tu étais un mauvais garnement… après tout, je veux bien avoir été Car… (il se rattrapa) l’Enfant… mais je suis aussi Théophraste Longuet, et je sais bien que Théophraste Longuet n’est qu’à moitié flatté de tout ce que tu lui racontes sur Car… l’Enfant. À chacun sa part. Je te serai reconnaissant de dire : L’Enfant s’en alla avec des camarades à la foire Saint-Laurent.
— C’est trop juste. À la foire Saint-Laurent, le petit Cartouche, donc…
— L’Enfant.
— Tu ne t’appelais pas encore l’Enfant ; on ne t’a appelé l’Enfant que lorsque tu as été un homme.
— Eh bien ! dis : le petit Louis-Dominique…
— Louis-Dominique tomba dans une troupe de bohémiens.
— Ce qui prouve, fit Théophraste, que les parents ont toujours tort de laisser aller à la foire les enfants tout seuls.
— Les bohémiens l’emmenèrent. Ils le volèrent.
— Le petit Louis-Dominique était à plaindre, s’apitoya Théophraste. Est ce qu’on le plaint dans les livres ?
— On dit qu’il se laissa voler de bonne grâce.
— Et qu’est-ce qu’ils en savent ! s’écria Théophraste.
— Les bohémiens lui apprirent le jeu du bâton et de l’épée, à tirer au pistolet, à sauter sur les toits, à escamoter, à faire la roue, à faire le saut périlleux en avant et en arrière…
— Toutes choses utiles…
— À vider les poches des bourgeois et gentilshommes sans que ceux-ci s’en aperçussent. À douze ans, c’était un gentil garçon. Il n’avait pas son pareil pour rapporter mouchoirs, tabatières, montres et, nœuds d’épée…
— Ça ! dit Théophraste, ça ! ça n’est pas bien !…
— S’il n’y avait que ça ! s’écria Adolphe !…
— Quoi donc encore ?
— Attends ! Prends patience ! courage et patience ! Il t’en faudra. La troupe de bohémiens se trouvait à Rouen quand le petit Louis-Dominique tomba malade.
— Le pauvre petit ! Il n’était pas fait pour une pareille existence.
— Il entra à l’hôpital de Rouen. C’est là que son oncle, un frère de son père, le découvrit. Il le reconnut, il poussa un cri de joie, l’embrassa, jura de le ramener à ses parents.
— Le brave homme d’oncle ! Louis-Dominique était sauvé !…
Impatienté, M. Lecamus se tourna vers Théophraste et le pria de cesser ses interruptions continuelles, affirmant qu’il mettrait bien dix ans à lui raconter l’histoire de Cartouche s’il ne voulait se résoudre à écouter en silence.
— Tu es bon, toi ! fit Théophraste. Je voudrais bien te voir à ma place… Enfin, je te promets de faire ce que tu voudras ; mais, avant tout autre détail, dis-moi si ce Cartouche était aussi redoutable qu’on l’a raconté. Était-ce un chef de brigands ?
— Oui.
— De beaucoup de brigands ?
— À Paris seulement, tu commandais à trois mille hommes.
— Trois mille ! Diable ! C’est un chiffre
— Tu avais plus de cinquante lieutenants. Il y avait toujours, de par la ville, vingt hommes vêtus exactement comme toi en habit cannelle, doublé de soie amarante, exhibant un morceau de taffetas noir au-dessus de l’œil gauche, pour dépister la police.
— Oh !! oh !! oh !! s’exclama Théophraste avec un accent d’orgueil dont il ne fut pas le maître, c’était une maison importante !
— On a relevé contre toi plus de cent cinquante assassinats personnels !…
Je dois faire remarquer que Théophraste pêchait la perchette, au véron, depuis plus d’une heure, sans que rien n’eût pu, jusqu’alors, lui faire soupçonner l’existence, dans les eaux de la Marne, d’un poisson quelconque amateur de son vivant appât. Soudain, le bouchon que le véron promenait parmi les cœurs verts des nénuphars, sans hâte, bien qu’avec inquiétude, sembla frappé de vertige. Il fit un saut sur l’eau et plongea. Mais il plongea avec une telle rapidité inattendue, il disparut dans le gouffre humide avec une précipitation si définitive, qu’il entraîna avec lui tout le fil qui le reliait à la gaule qui le reliait à la main de Théophraste. Et le malheur fut que, après avoir entraîné à sa suite tout le fil, il entraîna toute la gaule, de telle sorte qu’il ne fut plus relié du tout à la main restée entr’ouverte de Théophraste. Dans la circonstance, il ne pouvait plus être question de perchette ni même de perche. Un tel exploit contre le pêcheur devait être mis sur le compte d’un « bêtet » exceptionnel, comme par exemple, d’un brochet, et encore fallait-il que ce brochet fût de forte taille.
Cet événement se produisit dans le moment que M. Lecamus apprenait à M. Longuet qu’on avait relevé contre lui, lors du procès qui lui fut intenté, il y a de cela deux siècles à peu près, plus de cent cinquante assassinats personnels.
Théophraste eut aussitôt un geste de désespoir et s’écria :
— Ah ! le cochon !…
De telle sorte qu’il eut été bien difficile de dire si cette injure, exceptionnelle dans la bouche de Théophraste, s’adressait à l’assassin de jadis ou au bêtet d’aujourd’hui.
Cependant, Théophraste ajouta :
— Il devait bien peser quatre livres !
Et, en vérité, il avait des larmes dans les yeux. Tout compte fait, Théophraste semblait regretter davantage son brochet que ses cent cinquante assassinats.
IX
LE MASQUE DE CIRE
Adolphe et Théophraste n’attendirent point le déclin du jour pour regagner la villa « Flots d’Azur ». Brinquebalant leur maigre butin dans le filet où luisaient les écailles humides de deux gardons, d’un chevesne et d’un petit hottu, balançant d’un bras dolent leur boutique et l’une de leurs quatre épaules chargée du dernier roseau flexible qui leur restait, ils quittèrent la rive et s’en furent vers le coteau.
Avant d’y atteindre, ils résolurent de retremper leur cœur en un sérieux apéritif, à la porte de l’aubergiste Lopard, ce pendant que la diligence de Crécy arrêterait à leurs pieds le balancement tumultueux de son antique ferraille.
Le sucre détrempé savamment fondait à travers la pelle d’acier et se mêlait en gouttes onctueuses à la liqueur verte, quand Adolphe reprit l’histoire de l’Enfant au point où il l’avait laissée.
— Ce bon oncle, dit-il, avait le sentiment de la famille. Il arracha le petit Cartouche à son misérable sort, lui fit quitter l’hôpital de Rouen et le rendit à ses parents. Il y eut fête, rue du Pont-aux-Choux. C’est là, en effet, au n°9 de la rue du Pont-aux-Choux, qu’était né Cartouche et que son père exerçait son métier de tonnelier. Louis-Dominique, instruit par ses jeunes malheurs, jura qu’il n’y aurait désormais dans Paris fils plus respectueux, apprenti plus ardent au travail. Il aida son bonhomme de père à fabriquer ses tonneaux, et c’était plaisir de le voir manœuvrer dès l’aurore le marteau et la doloire. Il semblait prendre à tâche de faire oublier sa triste équipée. Les quelques mois qu’il avait passés dans la compagnie des bohémiens lui avaient été utiles en ce qu’ils lui avaient donné la science de quelques arts d’agrément. À l’heure du goûter, il amusait ses compagnons par de jolis tours de passe-passe, et quand venaient les jours de fête c’était à qui inviterait pour le dîner ou pour le souper la famille du petit Cartouche, car on se promettait la réjouissance de l’adresse, des facéties, des singeries et grimaces de Louis-Dominique. Il eut un grand succès dans le quartier et sa renommée naissante lui donna de l’orgueil. Sur ces entrefaites, il atteignit cet âge heureux où le moins sensible des humains sent battre son cœur et s’éveiller en lui les sentiments les plus tendres. Louis-Dominique aima. L’objet de ses amours était charmant. C’était une lingère de la rue Portefoin, aux yeux bleus, aux cheveux dorés, à la taille fine et, ma foi, fort coquette.
— Mais tout ceci est très bien, interrompit Théophraste, et ne dénote point une méchante nature. Il est incompréhensible qu’il ait si mal tourné.
— J’ai dit, continua Adolphe, que cette lingère était coquette. Elle aimait la toilette, les bijoux, les dentelles. Elle voulait « éclipser » ses compagnes. Bientôt, le gain modeste de Louis-Dominique ne suffit plus à payer les fantaisies de la petite lingère de la rue Portefoin. Alors, Cartouche vola son père.
— Oh ! les femmes ! s’exclama Théophraste en fermant les poings.
— Tu oublies, mon ami, fit observer Adolphe, que tu possèdes, toi, une femme qui ne t’a donné que de la joie et de l’orgueil.
— C’est vrai ! Pardonne-moi, Adolphe, mais tu sais que je m’intéresse aux aventures de l’Enfant, comme si elles étaient les miennes, et je ne puis que regretter de le voir si gravement se compromettre pour une lingère de la rue Portefoin.
— Il vola donc son père et celui-ci ne tarda pas à s’en apercevoir. Le père de Cartouche prit une grande résolution. Il obtint un ordre du roi, qui était une lettre de cachet, par lequel il pouvait faire entrer son fils dans le couvent des lazaristes du faubourg Saint-Denis, maison de correction.
— Voilà bien les parents ! fit Théophraste. Au lieu de combattre par la douceur les mauvais penchants de leurs enfants, ils les désespèrent par des incarcérations funestes où ils ne rencontrent que mauvais exemples et où le sentiment de la révolte fermente, grandit, bouillonne, étouffe tout autre sentiment dans leur âme neuve et primesautière. Je parie que si on n’avait pas mis Louis-Dominique dans une maison de correction, tout cela ne serait pas arrivé !…
— Rassure-toi, Théophraste, Cartouche ne fut pas enfermé au couvent des lazaristes.
— Comment cela ?
— Voici. Son père ne lui avait pas fait part de la découverte qu’il venait de faire de sa rapine. Louis-Dominique n’avait donc aucun soupçon. Un dimanche matin, Cartouche père dit à Cartouche fils de venir faire avec lui un petit tour de promenade. Dominique, charmé, le suivit. Il était de bien belle humeur, avait revêtu ses plus beaux habits et escomptait déjà en son esprit ardent les joies de la soirée qu’il devait passer non loin de la rue Portefoin.
— Où allons-nous, mon père ? dit-il.
— Eh bien ! mais nous promener, mon fils.
— Où ça ?
— N’importe où ; du côté du faubourg Saint-Denis…
Louis-Dominique commença à dresser l’oreille. Il savait qu’au bout du faubourg Saint-Denis il y avait les lazaristes, et il savait aussi qu’aux lazaristes les pères, quelquefois, y conduisaient leurs enfants. Il ne marqua aucune méchante humeur, mais il se défia, car il n’avait point la conscience tranquille. Quand ils arrivèrent au coin de la rue du Faubourg-Saint-Denis et de la rue de Paradis et que se dressèrent devant eux les bâtiments de Saint-Lazare, il sembla à Louis-Dominique que son père avait un air qui manquait de naturel, et le quartier lui déplut instantanément. Il dit donc à son père de continuer son chemin doucement, sans se presser, car il était, lui, dans la nécessité de s’arrêter au coin d’un mur (ce coin existe toujours) « pour faire pipi ».
Quand le père se retourna, l’enfant avait disparu. Il ne devait plus le revoir.
Théophraste avala une gorgée de son apéritif, claqua des lèvres, les essuya de son mouchoir et dit :
— C’est bien fait ! À sa place, j’en aurais fait autant !
— Malheureux ! s’écria Adolphe, mais tu y étais à sa place !
— C’est vrai, il ne faut pas l’oublier, soupira Théophraste.
Il y eut un grand remue-ménage dans la rue d’Esbly. La diligence, ayant pris les voyageurs à la gare, s’arrêtait devant l’auberge de M. Lopard. Poulain faisait claquer son fouet à assourdir ses chevaux. Sur l’impériale, Théophraste reconnut M. Bache, M. et Mme Troude. Il leur fit des signes auxquels ils ne répondirent point ; il les appela par leur nom, et ils restèrent muets. Théophraste en fut atterré. « Ils ne me connaissent plus, pensait-il. Est-ce qu’ils se douteraient de quelque chose ? » Poulain cria : « Hue ! » fit encore claquer son fouet, et la diligence, zigzaguant au travers de la route et soulevant la poussière, prit le chemin de Condé.
— As-tu vu ? Ils ne nous ont même pas salués.
— Cela ne m’étonne point. C’est depuis le dîner de l’autre jour. Je me demande ce qu’ils ont bien pu penser, dit Adolphe.
— Qu’est-ce qu’il s’est donc passé de si extraordinaire ? demanda innocemment Théophraste.
— Tu es monté sur la table pour chanter une chanson en argot, et il y avait là des demoiselles, la petite Mlle Troude et la vieille Mlle Taburet.
— Les sales bourgeois ! C’est bien borné, tout de même ! Maintenant, je comprends l’attitude de Mme Bache, qui a fait celle qui ne me connaissait pas, avant-hier, chez Pâris, le pharmacien de Crécy, à qui elle était venue demander « de la térébenthine en capsules pour chien qui n’urine pas. » Mais je suis au-dessus de ces gens-là. Continue, Adolphe. Quand j’eus quitté mon père, qu’arriva-t-il de moi ?
— Tu t’en fus dans une maison borgne « de l’autre côté de l’eau ». Ta gentille mine te fit bien voir des clients des Trois-Entonnoirs, au coin de la rue des Rats et de la rue de la Bucherie. Mais comme on ne te fit pas longtemps crédit, il fallut bien que tu songeasses à te garnir d’argent.
— Et ma lingère de la rue Portefoin ?
— Tu n’y pensais même plus. Elle pleura ta disparition au moins quinze jours, et toi tu la remplaças bientôt dans les circonstances que voici. La nécessité t’y poussant, tu te rappelas tes anciens talents et tu te mis à soulager les basques des passants de tout ce qui s’y trouvait renfermé : tabatières, bourses et mouchoirs, bonbonnières et boîtes à mouches. Tu opérais si adroitement que tu encourus l’admiration d’un grand escogriffe qui s’appelait Galichon et qui, t’ayant vu travailler, t’arrêta au coin de la rue Galande en te demandant « la bourse ou la vie ».
— Tu n’auras ma bourse que lorsque tu auras pris ma vie, lui répondis-tu, et tu mis l’épée à la main, une petite épée que tu avais volée la veille à un garde-française qui contait fleurette à une bouquetière de la rue Poupée. Le grand escogriffe te félicita de ton courage et puis de ton adresse, et il te pria de le suivre chez lui, rue du Bout-du-Monde, aujourd’hui rue Saint-Sauveur. Il te conta en chemin qu’il cherchait un associé et que tu ferais son affaire. Il te dit encore qu’il avait femme et que cette femme avait une sœur fort avenante, et que cette sœur brûlerait de t’épouser quand elle te connaîtrait. Tu te laissas faire. La cérémonie se passa comme elle avait été prévue. On ne fit venir ni notaire ni prêtre. Cette liaison ne dura pas six mois, attendu que Galichon, sa femme et sa belle-sœur prenaient le chemin des galères.
— Et moi ?
— Oh ! toi, tu les avais déjà lâchés. Tu trichais dans les académies !
— Quelle conduite ! fit Théophraste navré.
— Mais bientôt tu fus « brûlé » dans les académies et réduit à servir, de tes expédients, les sergents recruteurs. Tu sais de quelle façon on recrutait les soldats à cette époque ? C’était simple : les sergents recruteurs auxquels on amenait de bons jeunes gens sans malice ou d’affreux garnements sans foi, ni dieu, ni lieu, les sergents recruteurs, dis-je, enivraient tout le monde. Le lendemain matin, quand on se réveillait, dégrisé, on avait signé, et il avait fallu partir pour la guerre. Tu fournissais les sergents recruteurs et tu rabattais pour eux. Mais tu en fus puni. Ayant un jour amené deux jeunes gens à tes sergents, au cabaret des Amoureux de Montreuil, et ayant fait, la fête avec eux, tu te réveillas, le lendemain, ayant signé toi aussi. Tu étais le recruteur recruté !
— Je ne m’en plains pas. J’ai toujours eu du goût pour l’armée, dit Théophraste, et si j’ai signé mon engagement, ceci prouve encore que je savais écrire. Tu diras cela à mes historiens de ma part.
Mais il était sept heures. Adolphe interrompit là le cours de son récit. Ils reprirent le chemin de la ville, après une solide poignée de main à M. Lopard.
Ils gravirent le coteau. Avant d’en atteindre le faîte, Théophraste demanda ;
— Dis-moi, Adolphe, je suis curieux de savoir comment j’étais fait. J’étais un bel homme, n’est-ce pas ? Un grand, fort bel homme ?
— Ainsi te représente-t-on au théâtre, dans la pièce de M. d’Ennery ; mais, au contraire, tu étais, selon le poète Granval, un homme qui t’a bien connu et qui a chanté ta gloire…
— Oui da !
— Ta gloire sanglante. Tu étais :
Brun, sec, maigre, petit, mais grand par le courage,
Entreprenant, hardi, robuste, alerte, adroit.
— Tu ne m’as point dit comment tu as eu ce portrait de la rue Guénégaud ?
— C’est la copie d’une photographie de Nadar.
Théophraste ne dissimula pas son étonnement :
— Nadar m’a donc photographié ?
— Parfaitement. Il a photographié un masque de cire qui devait te ressembler, puisque cette cire t’a été appliquée, par ordre du régent, sur le visage, Nadar a photographié cette cire le 17 janvier 1859.
— Et où se trouvait ce masque de cire ?
— Au château de Saint-Germain.
— Je veux le voir, s’écria Théophraste, je veux le voir, le toucher ! Nous irons demain à Saint-Germain !
À ce moment, Marceline, en galant déshabillé, leur ouvrit avec un sourire les portes de la villa « Flots d’Azur ».
Je publie ici un passage intégral des mémoires de Théophraste :
« Mon désir était grand, écrit Théophraste, de voir, de toucher cette cire que l’on avait appliquée sur ma peau. Ce désir grandit encore si possible quand Adolphe fut entré dans certains détails. Il me dit que c’était depuis le 25 avril 1849 que le château de Saint-Germain-en-Laye possédait le portrait de cire du fameux Cartouche. Il paraît que ce portrait fut donné par un abbé Niallier, héritier sous bénéfice d’inventaire d’un M. Richot, ancien officier de la maison du roi Louis XVI. M. Richot, décédé à Saint-Germain, possédait depuis de longues années ce portrait, d’autant plus précieux qu’il avait appartenu à la famille royale.
» Ce buste en cire aurait donc été, d’ordre du régent, moulé par un artiste florentin sur ma figure, quelques jours avant mon supplice. Il est coiffé, m’affirmait M. Lecamus, d’une toque de laine ou de feutre grossier, vêtu d’une chemise de grosse toile recouverte de suie, d’un gilet, d’une veste et d’un pourpoint de camelot noir. Mais ce que M. Lecamus affirmait encore et qui était plus extraordinaire, c’est que les cheveux et la moustache auraient été coupés sur mon cadavre et recollés sur ma cire ! Le tout devait être renfermé dans un cadre en bois doré, large et profond, d’un fort joli travail. Une glace de Venise protège le portrait et on remarquerait encore sur le cadre la trace de l’écusson aux armes de France.
» Je demandai à Adolphe d’où il tenait des détails aussi précis ; il me répondit que c’était là, depuis deux jours, le résultat de ses recherches dans les rayons les plus oubliés des plus illustres bibliothèques.
» Mes cheveux ! ma moustache ! mes habits ! Tout moi d’il y a deux cents ans ! Malgré l’horreur qu’auraient dû m’inspirer les reliques d’un homme qui avait commis autant de crimes, je ne me tenais point d’impatience de les voir, de les toucher. Ô mystère de la nature ! Abîme profond des âmes ! Précipice vertigineux des cœurs ! Moi, Théophraste Longuet, dont le nom est synonyme d’honneur, moi qui eus toujours peur du sang répandu, je chérissais déjà dans ma pensée les restes maudits du plus grand brigand de la terre.
» Quand j’eus reconquis, après la scène du portrait de la rue Guénégaud, l’empire de mes sens, et que j’examinai ce qui se passait au fond de moi, vis-à-vis de Cartouche, je fus d’abord tout étonné de ne point y trouver un désespoir assez certain pour qu’il me dégoûtât de la vie et me reportât pour la seconde fois, dans la tombe. Non, je ne songeai point à supprimer cette enveloppe à face d’honnête homme qui était étiquetée, fin dix-neuvième siècle : Théophraste Longuet, et qui enfermait et qui promenait l’âme de Cartouche ! Certes, dans le premier moment d’une telle révélation, je ne pus que m’évanouir, et c’est du reste ce que je fis. Ensuite, je suppliai Adolphe de ne rien dire à ma femme. Je connais Marceline ; elle a une telle peur des voleurs, surtout la nuit, qu’elle n’aurait plus voulu coucher avec moi.
» Donc, je ne trouvai point au fond de moi un sentiment de désespoir absolu, mais une grande pitié, une vraie pitié attendrie, qui non seulement était capable de me faire pleurer sur le sort de moi, Théophraste, mais qui me portait aussi à plaindre Cartouche. Je me demandais, en effet, lequel était le plus à la noce de l’honnête Théophraste traînant dedans lui le brigand Cartouche ou du brigand Cartouche enfermé dedans l’honnête Théophraste.
» — Il faut tâcher de s’entendre ! dis-je tout haut.
» Je n’avais pas plutôt prononcé cette phrase, qui peut paraître bizarre mais qui traduisait bien la double et cependant unique préoccupation de mon âme, que je ne pus retenir un cri. Une grande lumière se faisait en moi, en même temps que je me rappelais la théorie de la réincarnation que m’avait exposée M. Lecamus.
» Il rattachait la réincarnation à l’évolution nécessaire des choses et des individus, ce qui n’est rien autre que le transformisme cher à la science officielle, et ne disait-il point que l’âme se réincarne pour évoluer, selon la règle, vers le meilleur ? C’est la montée progressive de l’Être, dont nous avait parlé avec une emphase si charmante M. le commissaire Mifroid. Eh bien ! la Loi naturelle que certains appellent Dieu n’avait trouvé sur la terre rien de plus honnête que le corps de Théophraste Longuet pour faire évoluer vers le meilleur l’âme criminelle de Cartouche. J’avouerai que lorsque cette idée se fut ancrée en moi, au lieu du désespoir primitif qui me conduisit à l’évanouissement, je me sentis pénétré d’un sentiment qui ressemblait presque à de l’orgueil. J’étais chargé par le Destin du Monde, moi, l’humble mais honnête Théophraste, de régénérer en idéale splendeur l’âme de ténèbres et de sang de Louis-Dominique Cartouche, dit l’Enfant. J’acceptai de bonne volonté, puisque je ne pouvais faire autrement, cette tâche inattendue et je me mis tout de suite sur mes gardes. Ainsi, je ne répétai point cette phrase qui s’adressait aux deux êtres qui habitaient en moi : « Il va falloir s’entendre ! » Mais j’ordonnai tout de suite à Cartouche d’obéir à Théophraste, et je me promettais de lui mener la vie si dure que je ne pus m’empêcher de dire en souriant : « Ce pauvre Cartouche ! »
» J’avais chargé M. Lecamus de se documenter à fond sur Louis-Dominique, de telle sorte que je n’ignorasse rien de ce qu’on pouvait savoir de son existence. Avec ce que ma plume noire et mon souvenir m’en apprendraient moi-même, je pensai justement que je ressusciterais tout à fait, en esprit, l’Autre, ce qui me permettrait d’agir en conséquence.
» Je fis part de mes réflexions à Adolphe qui les approuva, tout en me mettant en garde contre la tendance que j’avais à séparer Théophraste de Cartouche. « Il ne faut pas oublier qu’ils ne font qu’Un, me disait-il. Tu as les instincts de Théophraste, c’est-à-dire des maraîchers (des jardiniers, des maîtres-jardiniers) de la Ferté-sous-Jouarre. Ces instincts sont bons, mais tu as l’âme de Cartouche, qui est détestable. Prends garde ! la guerre est déclarée. Il s’agit de savoir qui vaincra de l’âme d’autrefois ou des instincts d’aujourd’hui ? »
» Je lui demandai si vraiment l’âme de Cartouche était tout à fait détestable, ce qui me peinait, et je fus heureux d’apprendre qu’elle avait quelques bons côtés :
» — Cartouche, me dit-il, avait expressément défendu à ses hommes de tuer ou même de blesser les passants sans raison. Quand il opérait dans Paris avec quelqu’une de ses troupes et que ses gens lui amenaient les victimes, il leur parlait avec beaucoup de politesse et de douceur, leur faisant toujours rendre une partie du butin. Quelquefois, les choses se bornaient à un simple échange d’habits. Quand il se rencontrait dans les poches de l’habit ainsi échangé des lettres ou des portraits, il courait après leur ex-propriétaire pour les leur rendre, leur souhaitant une bonne nuit et leur donnant un mot de passe. C’était une maxime de cet homme extraordinaire qu’un individu ne devait pas être volé deux fois dans la même nuit, ni trop durement traité, pour ne pas dégoûter les Parisiens de sortir le soir.
» Ainsi, il ne voulait point qu’on assassinât sans raison. Cet homme n’était donc point foncièrement méchant. Il y a de belles crapules, aujourd’hui, qui tuent uniquement pour le plaisir, sur les boulevards extérieurs. Je regrette cependant que, pour son propre compte, Cartouche ait eu, dans sa vie, cent cinquante raisons d’assassiner ses contemporains.
» Mais revenons au masque de cire. Nous venions de descendre, mon ami Adolphe et moi, en gare de Saint-Germain-en-Laye, quand je crus apercevoir dans un groupe de voyageurs une figure qui ne m’était pas inconnue. Mû par un sentiment dont je ne fus point tout à fait le maître, je me précipitai vers ce groupe, mais la figure avait disparu. Où donc ai-je vu cette figure-là ? pensai-je ; elle m’est essentiellement antipathique. Adolphe me demanda la raison de mon agitation et je me souvins tout à coup :
» Eh mais ! je jurerais, m’écriai-je, que c’est M. Petito, le professeur d’italien du dessus ! Qu’est-ce que M. Petito vient faire à Saint-Germain ? Je lui souhaite de ne point se jeter dans mes jambes.
» — Que t’a-t-il donc fait ? demanda Adolphe.
» — Oh ! rien. Seulement, s’il se jette dans mes jambes, je te jure que je lui coupe les oreilles !
» Et vous savez, je l’aurais fait comme je le disais.
» Nous allâmes donc, sans plus penser à M. Petito, au château. C’est un merveilleux château, que l’on rebâtit tel qu’il fut sous François Ier. Nous entrâmes dans le musée, et alors je regrettai que ce château qui sait toute l’histoire de France, où se déroula la longue et merveilleuse aventure de nos rois, je regrettai que ces murs, qui eussent dû servir de cadre à notre passé, même si on n’avait mis rien dedans, servissent aujourd’hui de bazar pour plâtres romains, armes préhistoriques, dents d’éléphants et bas-reliefs de l’arc de Constantin. Ma colère devint de la rage quand j’appris que le masque de cire de Cartouche ne s’y trouvait pas. Je venais d’enfoncer traîtreusement le bout de mon ombrelle verte dans l’œil, que je crevais, d’un légionnaire de plâtre, lorsqu’un vieux gardien vint à nous et nous dit qu’il croyait bien savoir qu’il y avait un masque de cire de Cartouche à Saint-Germain, qu’il se trouvait, pensait-il, dans la bibliothèque, mais que celle-ci était fermée depuis huit jours pour cause de réparation.
» Je donnai dix sous à ce brave homme et nous nous en fûmes vers la terrasse, nous promettant de revenir en temps utile, car plus le masque de cire s’éloignait, plus je brûlais de le toucher.
» Il faisait beau. Nous nous enfonçâmes dans la forêt, Une allée magnifique nous conduisit aux bâtiments des Loges, qui furent construits, en face le château de Saint-Germain, sur le désir de la reine Anne d’Autriche.
» Comme nous atteignions l’angle gauche de la muraille, il me sembla reconnaître encore, se glissant dans un fourré, la silhouette abominable et la figure repoussante de M. Petito. Adolphe prétendit que je m’étais trompé.
X
M. LONGUET NOUS EN RACONTE « UNE BIEN BONNE » SUR MONSEIGNEUR LE DUC D’ORLÉANS, RÉGENT DE FRANCE, SUR M. LAW, CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, ET SUR LA COURTISANE ÉMILIE.
« Était-ce parce que je foulais cette vieille terre que j’avais cornue, parce que je me retrouvais dans cette forêt amie, parmi des feuillages familiers, était-ce l’effet d’une longue conversation suggestive sur le vieux monde et sur les vieilles gens ? Tout à coup, je sentis naître en moi le souvenir, mais un souvenir très doux comme vous revient l’attendrissant souvenir de jeunes années que l’on croit à jamais perdues, ensevelies dans la Mémoire. Et alors, je vis bien que j’étais la même âme, car je me souvenais de Cartouche, comme si nous n’étions pas séparés par deux cents ans de mort.
» Oui, j’avais une même âme, une longue même âme. À un bout il y avait Cartouche et à l’autre Théophraste.
» Je me souvenais donc. Ceci me prit tout à fait quand nous eûmes dépassé le mur à gauche, vers le Nord, en nous enfonçant toujours davantage dans la forêt.
» Nous nous assîmes à un prochain carrefour, au pied d’un gros arbre fourchu, sur l’herbe verte. Mes yeux brillaient du feu extraordinaire de la jeunesse, en regardant ces lieux, et je commençai en ces termes :
» — Adolphe, mon ami, il faut que je te dise qu’à cette époque ma fortune était complète. J’étais redouté et aimé de tous. J’étais même, Adolphe, aimé de mes victimes. Je les dépouillais si galamment qu’elles s’en allaient ensuite, par la Ville, chanter mes louanges. Je n’étais pas encore entrepris par cet épouvantable instinct sanguinaire qui devait, quelques mois plus tard, me faire commettre les plus grandes atrocités. Tout me réussissant, tous me craignant et tous m’aimant, j’étais heureux, enjoué, d’une magnifique audace, somptueux en amour, du meilleur caractère du monde et le maître de Paris. On a dit que j’étais le maître de tous les voleurs, ce n’était qu’à moitié vrai, car il me fallait partager cette souveraineté avec M. Law, contrôleur général des finances. Notre gloire fut à son apogée dans le même temps. Je n’en étais point trop jaloux, car souvent il me payait tribut, lui et ses gens. Mais il imagina d’exciter le régent contre moi, un soir que j’avais volé chez lui, dans son hôtel, sur les indications d’un laquais, à lord Dermott, qui y était venu pour traiter d’affaires, un million trois cent mille livres d’actions du Mississipi, de la Ferme des tabacs et de la Compagnie des Indes.
» Le régent fit venir M. d’Argenson, garde des sceaux, et lui dit qu’il avait huit jours pour me faire arrêter. M. d’Argenson promit tout ce qu’on voulut, pourvu qu’on lui laissât reprendre le chemin du couvent de la Madeleine du Trainel, où venait de se réfugier sa maitresse, Mlle Husson. Huit jours plus tard, M. d’Argenson était encore au couvent, non plus avec Mlle Husson, mais avec la supérieure, de qui il disait qu’il y avait, « dans une seule cuisse de la supérieure de la Madeleine du Trainel, deux demoiselles Husson ».
» Moi, mon cher Adolphe, pendant ce temps, je vaquais à mes petites affaires et je commandais sans souci à mes trois mille hommes. Nous étions au mois de septembre ; les nuits étaient belles, et nous profitâmes de l’une d’elles pour pénétrer chez l’ambassadeur d’Espagne, qui habitait, rue de Tournon, l’ancien hôtel du maréchal d’Ancre, celui-là même qui fut occupé depuis par la garde de Paris. Nous nous introduisîmes dans la chambre à coucher de sa femme, nous emparant de toutes les robes, d’une boucle ornée de vingt-sept gros diamants (on dirait, mon cher Adolphe, que tout ceci s’est passé hier), d’un collier de perles fines, de six assiettes, de six couverts, de six couteaux et de dix gobelets en vermeil. (Quelle chose, mon cher Adolphe, quelle chose incompréhensible que le phénomène de la mémoire !) Nous roulâmes le tout dans une nappe et nous nous en fûmes souper chez la Belle Hélène, qui tenait, tu te le rappelles, le « cabaret de la Harpe », rue de la Harpe.
» Vraiment, vraiment, vraiment ! je ne puis comprendre pourquoi je t’ai dit : tu te le rappelles, à moins que, dans mon esprit, tu ne me représentes un ami que j’avais et qui était aussi bon que toi, et que j’aimais comme toi, et qui s’appelait Va-de-Bon-Cœur. Avec Magdeleine, dit Beaulieu, c’était mon favori. Ah ! par les tripes de Mme de Phalaris ! c’était un beau et brave jeune homme ! Il était sergent aux gardes-françaises et lieutenant chez moi ; car il faut te dire, mon cher Adolphe, que je commandais à un nombre considérable de gardes-françaises. Lors de mon arrestation, à laquelle devait procéder M. Jean de Courtade, sergent d’affaires de la Compagnie de M. de Chabannes, aidé de quarante hommes, on vit aussitôt cent cinquante sous-officiers et soldats aux gardes-françaises s’enfuir et passer aux colonies[5]. Ils craignaient des révélations ; ils redoutaient que je ne les vendisse ; ils avaient tort, car la torture ne m’a pas fait parler !
» Mais fuyons ces moments funestes pour revenir aux belles nuits de septembre, où nous procédions en gaieté au déménagement des Parisiens. Le régent montra plus de colère encore contre moi et contre M. d’Argenson quand il sut la triste aventure de l’ambassadeur d’Espagne. Songe maintenant à sa furie quand je lui jouai, à lui, le tour suivant : Va-de-Bon Cœur, étant de garde au Palais-Royal, emporta deux flambeaux de vermeil auxquels le duc d’Orléans tenait beaucoup. Rage de Monseigneur. Depuis quelque temps, on volait au Palais-Royal tout ce qui pouvait présenter quelque valeur. Le régent résolut de substituer sans rien dire à l’orfèvrerie d’argent celle en acier ciselé, et particulièrement pour les boucles et les poignées d’épée. Or, le premier jour qu’il en porta une de cette espèce, qu’il avait fait venir de Londres et qui lui coûtait tout de même quinze cents livres, à cause de la beauté merveilleuse du travail, moi Cartouche, je la lui volai à la sortie de l’Opéra. Le lendemain, je lui renvoyai cette poignée d’acier en morceaux, avec un petit billet (tu vois, Adolphe, que je savais écrire) charmant dans lequel je le plaisantais sur son avarice prétendue et lui reprochais à lui, le plus grand Voleur de France, de vouloir empêcher de vivre de malheureux confrères[6]. Il me répondit publiquement en proclamant qu’il était fort curieux de me connaître et qu’il donnerait de sa poche vingt mille livres à qui lui amènerait Cartouche. Le lendemain, comme il était venu en promenade à Saint-Germain et qu’il déjeunait au château, il trouvait sous sa serviette un mot dont voici à peu près les termes, mais dont voici sûrement le sens : « Monseigneur, vous pouvez me voir pour rien. Soyez cette nuit, à minuit, derrière le mur d’Anne d’Autriche, dans la forêt, au lieu dit : Saint-Joseph. Cartouche vous y attendra. Vous êtes brave ; venez seul. Si vous venez accompagné, vous courrez danger de mort. »
» À minuit, j’attendis le régent, et le douzième coup sonnait encore aux Loges que le régent apparut. Il faisait un clair de lune de féerie, comme on en voit au théâtre. La forêt semblait dégager de toutes ses branches, de tous ses feuillages, de tous ses buissons une merveilleuse clarté bleue. « Me voici, Cartouche, dit le prince ; je viens à toi armé de ma seule épée, comme tu l’as voulu. Je cours peut-être les plus grands dangers, ajouta-t-il d’un clair accent railleur, mais que ne risquerait-on pas pour voir de près, à minuit, au cœur d’une forêt, la figure de Cartouche, quand ça ne coûte rien ! » Oh ! Adolphe, mon ami, j’aurais voulu que tu fusses là pour m’entendre répondre au régent de France. Certes, je ne suis que le fils d’un pauvre tonnelier de la rue du Pont-aux-Choux, mais quel Condé, quel Montmorency se serait incliné avec plus de grâce, balayant l’herbe humide de la plume de son chapeau ? Le duc de Richelieu lui-même n’aurait pas plus élégamment mis un genou en terre comme je le fis aussitôt, ni présenté de façon plus gracieuse à Monseigneur la bourse que je venais de lui prendre dans sa poche. « Je suis de Monseigneur, dis-je, le plus humble serviteur et je le prie de reprendre à Cartouche cette bourse qu’il n’eut l’audace de dérober avec tant d’adresse que pour bien prouver à Monseigneur que Monseigneur se trouve bien en face de Cartouche. »
» Le Régent me pria de conserver cette bourse pour l’amour de lui. Il eut le tort de raconter par la suite cette anecdote, car le bruit courut depuis qu’il faisait partie de ma bande. Je croyais qu’il allait s’en aller, quand il me prit sous le bras et m’entraîna jusqu’à l’endroit même où nous sommes assis aujourd’hui. »
XI
SUITE DE L’HISTOIRE DE CARTOUCHE, DE MONSEIGNEUR LE DUC D’ORLÉANS, RÉGENT DE FRANCE, DE M. LAW, CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DES FINANCES, ET DE LA COURTISANE ÉMILIE
« Donc, le régent m’avait fait l’honneur de prendre, par-dessous, mon bras et je vis bien qu’il avait quelque chose de secret à me confier. Il ne tarda point à m’avouer qu’il comptait sur mon ingéniosité pour le venger d’une offense que M. le contrôleur général lui infligeait. Il me dit qu’il était tout à fait amoureux de la courtisane Émilie, qu’elle était sa maîtresse depuis quinze jours et qu’il avait appris par La Fillon que M. Law avait la promesse de ses faveurs pour la nuit prochaine, contre le présent d’un collier de dix mille louis qu’il lui ferait. Il en était sûr, car La Fillon ne l’avait jamais trompé. N’était-ce point par elle qu’il avait eu vent de la conspiration de Cellamare ? Tous les mauvais sujets de Paris connaissent la Fillon.
» La Fillon est une femme de cinq pieds dix pouces, qui eut des formes admirables, une figure ravissante. Dès l’âge de quinze ans, cette beauté modèle pensa que la nature ne l’avait pas pourvue de si rares trésors pour les enfouir ; elle les prodigua. Le duc d’Orléans, longtemps avant la Régence, l’aima ; il en demeura coiffé pendant plus d’un an. C’est pour elle qu’il fit construire dans une partie retirée des jardins de Saint-Cloud une sorte de grotte, éclairée mystérieusement par quelques rayons dirigés sur un lit de nattes sur lequel s’étendait sa maîtresse, tout habillée de ses cheveux blonds. Il les montra à tous ceux qui passaient par là et il se fit ainsi de nombreux amis. Mais il y a beau temps que les quinze ans de La Fillon se sont envolés. Maintenant elle n’a plus que la joie de l’intrigue dont elle a fait deux parts : la galanterie et l’observation. Ainsi fournit-elle des renseignements précieux à la police et à M. d’Argenson, garde des sceaux, et des sujets remarquables pour les amours du régent. C’est elle qui lui procura Émilie, qui est bien la plus jolie fille de Paris.
» Tout le monde veut la lui voler. Law, qui est le plus riche, a juré d’y réussir. Il lui demandait une heure de complaisance et lui donnait un collier de dix mille louis dont elle raffolait. C’était marché conclu pour la nuit prochaine.
» — Cartouche, me dit le régent, après m’avoir expliqué ses petites affaires, tu es un brave homme. Je te donne le collier.
» Et il s’en alla, sous le clair de lune, en me faisant un petit signe de la main. Cette sorte de mission que je recevais de contrarier les amours de M. le surintendant et de venger celles du duc d’Orléans m’emplit d’un juste orgueil. Étant rentré à Paris, j’appris dès le matin, par ma police, qui était la mieux faite de l’époque, que la courtisane Émilie habitait un petit hôtel, dans le Marais, au coin de la rue Barbette et des Trois-Pavillons, et que le régent montrait plus d’attachement pour elle qu’il n’en eut jamais pour la duchesse de Berry dont il était dégoûté depuis longtemps, pour la Parabère, ou même pour sa seconde fille, Mlle d’Orléans, qui venait de s’enfermer au couvent de Chelles, moins à cause de son amour pour Dieu que de son penchant pour les belles religieuses (Quelles mœurs ! mon cher Adolphe, quelles mœurs !) et qu’il se consolait avec elle des mépris plus récents de Mlle de Valois, uniquement occupée du duc de Richelieu. Cette courtisane Émilie n’était pourtant qu’une fille d’opéra, mais sa beauté, comme je te l’ai dit, dépassait tout ce qui peut s’imaginer. Je ne fus pas longtemps à en juger par moi-même.
» Vingt-quatre heures après l’entrevue de Saint-Germain, c’est-à-dire le minuit suivant, je sortis d’un placard qui faisait justement l’angle de la rue des Trois-Pavillons et de la rue Barbette. J’avais, comme par hasard, un pistolet de chaque main, ce qui fit qu’il me fut impossible de saluer décemment Mlle Émilie, qui se trouvait pour l’heure dans le plus galant déshabillé, et M. le surintendant, qui lui présentait un écrin dans lequel brillaient les feux d’un collier qui valait pour le moins dix mille louis. Je m’excusai de la nécessité où j’étais de garder mon chapeau sur la tête et je priai M. le surintendant, vu l’encombrement de mes mains, de refermer l’écrin sur le collier et de mettre le tout dans la poche de mon habit cannelle, lui promettant ma reconnaissance de ce léger service.
» Comme il hésitait, je procédai à ma présentation, et quand il sut que je me nommais Cartouche, il n’est point de gentillesses dont il ne m’accablât. Je suppliai Mlle Émilie de se rassurer, lui affirmant qu’elle ne courait aucun danger, ce dont elle fut convaincue, car elle se prit à rire, avec de grands éclats, de la déconfiture de M. Law. Je riais aussi. Je dis à M. Law que son collier valait dix mille louis, mais que, s’il voulait envoyer le lendemain, vers cinq heures de relevée, un homme de confiance au coin de la rue de Vaugirard et de la rue des Fossés-Monsieur-le-Prince, avec cinq mille louis, on lui remettrait le collier, parole d’honneur de Cartouche ! Il me répondit que c’était marché conclu et nous prîmes congé les uns des autres.
» Deux jours après, on raconta l’aventure au régent, qui fut dans la joie d’abord, mais qui changea de visage quand il sut la fin de l’événement. L’homme de Law avait donné les cinq mille louis, comme il avait été entendu, à l’homme de Cartouche, et il attendait l’écrin, quand l’autre lui répondit que Cartouche s’était déjà chargé de le porter lui-même à Mlle Émilie. Law courut chez la courtisane, vit le collier et en demanda le prix. « C’est déjà touché », répliqua Émilie en lui tournant le dos. « Et par qui ? » s’écria M. le surintendant. « Mais évidemment par celui qui m’a apporté le collier, par Cartouche, qui sort d’ici ! Ne devais-je pas payer contre réception du collier ? Et tout de suite ! Je n’ai point de crédit, moi, ajouta-t-elle en s’esclaffant sur la mine déconfite de l’homme de la rue Quincampoix, et je ne pouvais lui donner d’actions de mon Missipipi !… »
» Au Palais-Royal, le mot, mon cher Adolphe, eut le succès que tu devines. Il n’empêche que le régent trouva que j’avais dépassé ses instructions et fit revenir encore M. d’Argenson de sa Madeleine du Trainel pour l’entretenir de la méchante humeur où il était à mon endroit. De fait, mon cher Adolphe, j’étais très porté sur les femmes et elles contribuèrent pour beaucoup à ma perte. À ce propos, toi qui me connais, et qui sais la sagesse de mes mœurs et de mon amour exclusif de Marceline, tu dois te dire : « Comme deux cents ans vous changent un homme ! »
Enchanté de sa petite narration, M. Longuet se mit à rire de l’inoffensive plaisanterie qui la terminait. « Comme deux cents ans vous changent un homme ! » Il plaisantait. Il plaisantait, vraiment, sincèrement. Ah ! ah ! il blaguait. Ainsi en va-t-il du bourgeois parisien d’aujourd’hui qui commence par s’épouvanter d’un rien et qui finit par rire de tout. M. Longuet en était arrivé à rire de lui-même. L’antithèse surnaturelle et terrifiante entre Cartouche et Longuet, qui l’avait plongé d’abord dans le plus sombre effroi, l’incitait, quelques jours passés, à « faire des mots ! » Le malheureux ! Il insultait au Destin ! Il riait au tonnerre ! Il blaguait la face de Dieu ! Son excuse est qu’il n’y voyait pas d’importance.
Il finissait par trouver son cas un peu bizarre. Il s’en amusait avec Adolphe. Il résolut même, à part lui, de ne point celer plus longtemps sa vraie personnalité à sa chère Marceline. Elle était intelligente, elle comprendrait. Il s’était imaginé que cette personnalité pourrait présenter des dangers pour lui-même et pour l’ordre social, mais voilà qu’elle n’existait plus à l’état réel, mais à l’unique état de souvenir, de doux souvenir !… Il n’aurait pas à combattre Cartouche comme il l’avait redouté ; il n’aurait qu’à lui demander, de temps en temps, quelque anecdote un peu salée, qui procurerait du succès à M. Longuet, dans les conversations. Cette histoire du régent, de Law et de la courtisane Émilie n’était-elle point la preuve de cet état d’âme ? Comme elle avait coulé de sa mémoire sans effort, avec gentillesse et galanterie ! Quel mal donc y avait-il à cela ? Après tout, s’il avait été Cartouche, il n’y allait point de sa faute et il serait bien bête de s’en faire de la bile !
Il se frotta les mains et sa jubilation était telle qu’il ne cessa de plaisanter sur tout, même sur les Chopinettes, sur le Coq et sur le Four, qui, cependant, semblaient, dans le document, marquer les trois points d’un triangle qui renfermait une fortune. Mais il plaisantait la fortune. Au crépuscule ils reprirent le chemin de Paris.
Comme ils arrivaient à la gare Saint-Lazare, M. Adolphe Lecamus lui posa la question suivante :
— Mon ami, quand tu es Cartouche, que tu te promènes dans Paris et que tu vis de la vie de Paris, dis-moi ce qui t’étonne le plus. Est-ce le téléphone, le chemin de fer, le Métro, la tour Eiffel ?
Il répondit :
— Non, non ! Ce qui m’étonne le plus, quand je suis Cartouche, c’est les sergents de ville !
XII
ÉTRANGE ATTITUDE D’UN PETIT CHAT VIOLET
Il semble que le Destin qui commande aux hommes prend un détestable plaisir à faire précéder les pires catastrophes des joies les plus sereines. Ainsi, la tempête n’est-elle souvent annoncée que par le calme sournois des éléments. Voyez ces trois êtres, l’homme, la femme et l’amant, arrêtez votre regard et votre pensée sur ce charmant tableau de « fin de dessert ». Ils ont dîné au restaurant, en cabinet particulier. L’homme allume un cigare, la femme allume une cigarette russe, et l’amant, de son regard langoureux et de ses discours suaves aux termes choisis par l’amour, allume la femme, mais d’une flamme tellement douce, d’un feu si discret, que rien ne semble devoir troubler jamais la paix de leurs triples et aimables digestions. Dites-moi si ces êtres ne sont pas heureux, non seulement du bonheur présent, mais de tout celui à venir ? N’est-ce pas ? N’est-ce pas qu’il est de toute harmonie que cela continue ? N’est-ce pas que la nuit est pure ? N’est-ce pas que la brise qui agite les stores légers est odorante ? N’est-ce pas qu’il y a des milliards d’étoiles et que la vie est éternellement bonne ? N’est-ce pas que Théophraste, sans le savoir, sera éternellement cocu ?
Mensonge de la terre et du ciel ! Mensonge de la vie, mensonge du bonheur ! Le bonheur ! Il cache un gouffre plus profond que celui qui se dissimule derrière le sourire en fête des vagues. Il renferme des ouragans plus chargés de foudre que le « grain » qui monte au radieux horizon des mers de Cochinchine ! (Tout le monde sait que les tempêtes les plus épouvantables sont celles des mers de Cochinchine. On les appelle typhons.)
Oui, un petit « grain » de rien du tout annonce et précède les perturbations les plus regrettables de l’atmosphère. Ainsi, au commencement des véritablement grands malheurs de Théophraste, de Marceline et d’Adolphe, il y eut — quelque chose qui n’a pas grande importance en soi — l’étrange attitude d’un petit chat violet.
Je n’ai point encore décrit par le menu l’appartement qu’occupait le ménage Longuet, rue Gérando. La chose devient nécessaire. C’était un petit appartement de douze cents francs de loyer. On entrait par une porte à deux battants dans un vestibule aux dimensions restreintes, comme vous pensez bien. Un bahut de chêne ciré l’encombrait encore. Outre la porte d’entrée, quatre portes ouvraient sur ce vestibule ; c’étaient la porte de la cuisine et la porte de la salle à manger à gauche, la porte du salon et celle de la chambre à coucher à droite. Le salon et la chambre à coucher étaient sur la rue. La cuisine et la salle à manger étaient sur la cour. Sur la rue encore donnait la fenêtre d’un petit cabinet dont M. Longuet avait fait son « bureau ». On pénétrait dans ce petit cabinet à la fois par une porte qui ouvrait sur la chambre à coucher et par une porte qui ouvrait sur la salle à manger. Que ceci soit entendu une fois pour toutes !
Je n’ai point à vous donner le détail de l’ameublement de cet honnête appartement. Il me suffit de vous dire — ce qui est beaucoup plus important tout de même que vous ne pourriez l’imaginer — que dans le petit cabinet il y avait un bureau (puisque c’était à cause de ce bureau que le cabinet s’appelait dans le langage courant du ménage : le bureau), que ce bureau était appuyé contre le mur, qu’il avait des tiroirs au-dessus de la table de travail et sous la table de travail, que cette table de travail se refermait sur elle-même et présentait alors un ventre harmonieusement arrondi, que ce ventre était percé à l’endroit du nombril d’une serrure et que lorsque cette serrure était fermée toutes les serrures de tous les tiroirs se trouvaient par le fait fermées ; à l’ordinaire, quand le bureau était ainsi fermé, M. Théophraste Longuet, à l’endroit de la serrure, autant pour cacher cette serrure-nombril qu’en manière d’ornement, déposait un petit chat violet.
Ce petit chat violet, qui avait des yeux de verre, n’était autre chose qu’une ingénieuse pelote soyeuse destinée à essuyer l’encre des plumes et à recevoir la piqûre des épingles, objet nécessaire à tout individu qui travaille de tête. Il ne faut pas oublier non plus que dans le bureau se trouvait encore une table à thé.
Ceci expliqué, nous n’avons plus qu’à reprendre nos trois personnages où nous les avons quittés. L’addition payée, Adolphe offre son bras à Marceline ; Théophraste suit avec son ombrelle verte. Une heure de marche lente (pour faire la digestion) les conduit à la porte de la rue Gérando. On prie Adolphe de monter. Marceline insiste. Adolphe les accompagne dans l’escalier. Il pénètre avec eux dans le vestibule. Il engage ses amis à se coucher tout de suite, car le lendemain on doit se lever de bonne heure. Il embrasse Marceline (il a pris depuis peu l’habitude d’embrasser Marceline le soir, avant d’aller se coucher, parce que Théophraste l’a exigé absolument), il serre avec une démonstration sincère d’amitié fervente la main de Théophraste : il est déjà sur le palier. Et, pendant qu’il descend l’escalier, Théophraste « lui tient la lampe ». (Cette petite lampe était sur le bahut ; Théophraste n’a eu qu’à l’allumer en entrant.) « À demain ! » murmure Adolphe dans la nuit de la cage. Et puis on entend le grand coup sourd de la porte qui se referme. Adolphe est parti pour la rue des Francs-Bourgeois, qu’il habite et où il va passer une excellente nuit. Théophraste a refermé la porte de l’appartement, à clef, avec le plus grand soin. Il a fait « deux tours », ainsi que le lui demande Marceline. C’est même imprudent de ne pas avoir de verrou de sûreté, « mais il n’est jamais rien arrivé dans la maison ». Il n’importe ; maintenant qu’on est très souvent à la campagne, « il faut faire faire un verrou de sûreté ». Théophraste et Marceline ont visité minutieusement l’appartement ; ils sont allés dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon, dans le bureau et même dans les water-closets avant de se retrouver dans leur chambre à coucher. Ils ont constaté qu’en leur absence il ne s’est rien passé d’anormal. Ils se déshabillent. Je crois bien que c’est la troisième fois, depuis que nous avons entrepris le récit de l’aventure de Théophraste, que nous nous trouvons dans la chambre à coucher du ménage ; c’est la faute des événements, et je n’y puis rien.
Ils sont couchés. Ils ont soufflé la bougie, posée sur la table de nuit. Selon sa coutume, Théophraste est « dans le coin ». Théophraste n’est pas brave : il ne s’en défend pas. Marceline non plus. Cependant, elle s’endort en pensant à Adolphe, mais elle a dans sa main la main de Théophraste. Celui-ci, vaguement, songe aux drames mystérieux qui sont enfermés dans les ténèbres ; il se dit que Cartouche, lui, n’avait pas peur, et il envie le courage de Cartouche.
… Il s’amuse encore à fermer les yeux avec force, et à rouvrir ses paupières dans la nuit, ce qui fait qu’il aperçoit une grande quantité de cercles bleus, verts, violets qui s’agrandissent, s’éloignent, s’arrêtent soudain et s’envolent rapidement, et d’autres cercles multicolores apparaissent encore, pour s’évanouir à nouveau. Puis, ce ne sont plus des cercles, ce sont, — bel et bien — des figures, avec des yeux, des nez, des bouches et des bonnets de coton… Il voudrait fermer les yeux pour ne plus voir ces figures, ces visages fantastiques, mais il s’aperçoit que ses yeux sont fermés. C’est drôle ! oh ! tout à fait incroyablement drôle ! Pour voir des figures dans la nuit, il faut fermer les yeux… Il dort. Il ronfle.
La nuit. Pas une voiture dans la rue. Silence. Le ronflement de Théophraste a cessé. Est-ce que M. Longuet dort toujours ? Non, il ne dort plus. Il a la gorge sèche ; il ouvre, dans les ténèbres, des yeux d’effroi ; il appuie sa main froide, sa main que glace la peur, sur la cuisse chaude de son épouse. Il la réveille et il dit, mais si bas, si bas qu’il est le seul à savoir qu’il parle :
— Entends-tu ?
Marceline ne respire plus. Ils se serrent la main sous le drap, sans le remuer. Ils « tendent l’oreille ». En effet, on entend quelque chose… dans l’appartement.
Vraiment, vraiment, il ne faut pas rire. Celui qui rit du bruit inexpliqué, la nuit, dans l’appartement, celui-là n’est pas encore né ! Oh ! il y a des gens très braves, tout à fait extrêmement braves, et que rien n’arrête, et qui passeraient partout, partout, le soir, dans les rues les plus désertes, dans les quartiers les plus mal famés, et qui n’hésiteraient pas à s’aventurer, pour leur plaisir, dans des culs-de-sac sans réverbères ; mais moi je vous dis, parce que c’est la vérité, parce que vous savez que c’est la vérité : celui qui rit du bruit inexpliqué, la nuit, dans l’appartement, celui-là n’est pas encore né !
Nous avons assisté déjà à l’insomnie de Théophraste, la nuit de la révélation, et alors, à cause du grand, du formidable secret jailli des pierres de la Conciergerie, l’anxiété s’était assise sur son cœur. Eh bien ! cette anxiété, qui avait cependant sa terrible raison d’être, n’était rien, mais rien du tout, comparée à celle qui l’étranglait parce qu’il y avait, la nuit, dans l’appartement, un bruit inexpliqué.
C’était un drôle de bruit, certainement, mais tout à fait réel, sans aucun doute, sans aucun doute. Ce bruit faisait ron ron ron ron ron ron ron ron. Et ce bruit faisait cela, derrière le mur, « dans la pièce à côté ».
Vous savez qu’il n’y a rien de plus effrayant, la nuit, dans l’appartement, qu’un bruit inexpliqué, si ce n’est le bruit d’un craquement de meuble, qui est un bruit expliqué, mais plus effrayant encore. Alors, oh ! alors, vous entendez votre cœur qui bat contre votre poitrine, comme on frappe à une porte avant de l’ouvrir, et il y a des gens, des gens pourtant braves, qui mettent précipitamment leurs mains contre leur cœur, parce qu’ils savent très bien que s’ils oubliaient cette précaution leur poitrine s’ouvrirait et que leur cœur roulerait sur la descente de lit. Eh bien ! je le dis, le bruit que Théophraste et Marceline écoutaient, dégouttants de sueur, était bien autrement plein d’épouvante qu’un craquement de meuble, parce que cela faisait, derrière le mur : ron ron ron ron ron, que cela était le ronron d’un chat, et que ce ronron — ils le reconnaissaient bien — était le ronron du chat violet.
Marceline laissa glisser entre ses lèvres :
— C’est le ronron du chat violet. Va voir ce qu’il a, Adolphe !
Elle était tellement émue qu’elle appelait Théophraste : Adolphe. Mais Théophraste ne s’en apercevait même pas. Théophraste ne bougeait pas. Il aurait donné cent mille timbres en caoutchouc pour être en train de se promener, à midi, sur le boulevard.
— Ce n’est pas naturel qu’il ronronne ainsi, ajouta-t-elle. Va voir ce qu’il a ! Il le faut, Théophraste ; prends dans le tiroir de la table de nuit le revolver.
— Tu sais bien, eut la force de dire Théophraste, qu’il n’est pas chargé (Il n’était pas chargé parce que M. Longuet ne savait pas comment on charge un revolver, encore moins comment on le décharge, et qu’il n’avait pas osé avouer son ignorance à l’armurier.)
Ils écoutèrent encore. Le ronron s’était tu. Marceline eut cette espérance qu’ils s’étaient peut-être trompés… Alors, Théophraste poussa un petit soupir lamentable, sortit du lit, prit le revolver et, tout doucement, ouvrit la porte donnant sur son bureau. La nuit était claire, la lune entrait dans la pièce en grande nappe bleue. Et ce que vit Théophraste le fit reculer aussitôt, cependant qu’il laissait échapper un gémissement sourd et qu’il repoussait la porte, en s’appuyant le dos dessus, comme pour empêcher ce qu’il avait vu d’entrer dans la chambre à coucher.
— Quoi ? demanda Marceline soulevée sur les oreillers.
Théophraste, claquant des dents, dit :
— Il ne ronronne plus, mais il a bougé !
— Où est-il ?
— Il est sur la table à thé !…
— Le chat violet est sur la table à thé ?
— Oui…
— Es-tu bien sûr qu’il était hier soir à sa place ?…
— Tout à fait sûr. Je lui ai piqué dans la tête l’épingle de ma cravate. Il était sur le bureau, comme toujours.
— Tu auras cru, tu auras cru, fit Marceline. Si je faisais de la lumière ?…
— Non, non. On peut s’échapper dans l’obscurité… Si j’allais ouvrir la porte du palier ? On pourrait appeler la concierge !
— Ne t’épouvante donc pas, fit Marceline qui reprenait peu à peu ses sens depuis qu’elle n’entendait plus le chat violet. C’est une illusion que nous avons eue. Tu l’as changé de place hier soir et il n’a pas ronronné !
— Après tout, c’est bien possible, dit Théophraste qui ne demandait qu’à se recoucher.
— Remets-le à sa place, insista Marceline.
Théophraste s’y décida. Il alla dans le bureau et, d’une main hâtive et tremblante, prit le chat sur la table à thé, le replaça sur le bureau et revint s’étendre dans la douce chaleur du lit. Le chat violet n’était pas plus tôt sur le bureau qu’il se reprit à ronronner : ron ron ron ron. Mais cette fois, bien qu’ils l’entendissent parfaitement, ni Théophraste ni Marceline ne s’effrayèrent. Ils sourirent même dans les ténèbres de la peur qu’ils avaient eue. Cependant, ils ne se rendormirent point tout de suite, même après que le deuxième ronron eut cessé. Un quart d’heure venait de s’écouler, quand une seconde épouvante les redressa à nouveau sur leur séant. Un troisième ronron se faisait entendre. Si le premier ronron les avait comblés d’effroi, si le second ronron les avait fait sourire, le troisième ronron (suivez bien la succession des ronrons, car je vous jure que ce n’est pas risible) les enivra de terreur.
— Oh ! ce n’est pas possible, murmura Marceline, nous sommes victimes d’une hallucination. Du reste, cela n’a rien d’étonnant, depuis ce qui nous est arrivé à la Conciergerie.
Le ronron s’était encore tu. Ce fut Marceline, cette fois, qui se leva ; elle poussa la porte du cabinet et se retourna aussitôt vers Théophraste. Elle dit, mais avec quelle pauvre voix, quelle mourante voix :
— Tu n’as donc pas remis le chat violet sur le bureau ?
— Mais si ! geignit Théophraste.
— Eh bien ! il est retourné sur la table à thé !
— Mon Dieu ! fit le pauvre homme en se cachant la tête sous les couvertures…
Le chat violet ne ronronnait plus. Marceline fut persuadée que son mari, dans le désordre de son esprit, avait laissé le chat sur la table à thé. Elle alla l’y prendre et le replaça sur le bureau, en retenant sa respiration. Le chat violet fit entendre son ronron pour la quatrième fois, mais Marceline ni Théophraste n’y virent cette fois, pas plus que la seconde, d’inconvénient. Marceline se recoucha. Le quatrième ronron s’était tu.
Un nouveau quart d’heure s’écoula, au bout duquel un cinquième ronron… Alors, chose incroyable, Théophraste bondit comme un tigre, et s’écria :
— Ah ! c’est trop fort, à la fin !… Par les tripes de Mme de Phalaris ! qu’est-ce qui m’a f… un pareil chat violet !
XIII
EXPLICATION DE L’ÉTRANGE ATTITUDE D’UN PETIT CHAT VIOLET, SUIVIE DE L’ÉPOUVANTABLE HISTOIRE DES OREILLES DE M. PETITO.
Il nous faut tout d’abord monter à l’étage du dessus, dans l’appartement occupé par M. et Mme Petito. Nous pénétrâmes déjà dans cet appartement, le jour que Théophraste s’en vint demander au professeur d’italien quelques renseignements nécessaires sur l’écriture du document. Il croyait bien alors ne commettre aucune imprudence. Quelle imprudence peut-il y avoir à présenter à un expert en écritures un document si déchiré, si maculé, si effacé qu’il est tout à fait impossible, à première vue, de lui trouver un sens ni de lui donner une signification ?
Or, par un hasard excessivement mystérieux, mais qu’on finirait bien par expliquer à la longue, cette nuit-là, M. et Mme Petito s’entretenaient justement du document sur lequel le professeur avait eu à émettre un avis si rapide.
La chose se passait dans le petit salon de Mme Petito, à côté du piano où elle jouait plusieurs fois par jour le Carnaval de Venise ; mais en ce moment ni M. ni Mme Petito ne songeaient à faire de la musique.
Mme Petito disait :
— Je n’y comprends rien. La conduite de M. Longuet aujourd’hui à Saint-Germain, d’après ce que tu me dis, ne nous instruit guère, mais tu dois ne pas te souvenir des termes, de tous les termes. « Va prendre l’air aux Chopinettes, regarde le Coq, regarde le Four… » c’est vague, et qu’est-ce que ça veut dire ?
— Ça veut dire d’abord, répondit M. Petito, que le trésor doit se trouver aux environs de Paris, du Paris de l’époque : Va prendre l’air… Mon avis est qu’il faut chercher ou du côté de Montrouge ou du côté de Montmartre. Les Chopinettes devaient être un endroit où l’on se régalait en parties fines, certainement un endroit champêtre. Je penche pour Montmartre, à cause du Coq. Il y avait un château du Coq aux Porcherons… Regarde ce plan du vieux Paris…
Ils regardèrent le plan sur un petit guéridon.
— C’est encore bien vague, ajouta après un silence M. Petito. Moi, je crois qu’il faut surtout s’attacher à ces mots : le Four.
— Mon cher ami, c’est de plus en plus vague alors, car il y avait beaucoup de fours autour de Paris, de fours à plâtre, de fours à chaux, de fours à briques…
— Mon idée, fit M. Petito, est que le Four ne veut pas dire le Four, car je me souviens (et tu sais de quelle prodigieuse mémoire je suis doué !) qu’il y avait un certain espace entre le mot le et le mot Four, et après le mot Four il y avait encore un grand espace sur le papier. Passe-moi le dictionnaire.
Mme Petito se leva avec les plus grandes précautions et, sans bruit, apporta un petit lexique. Ils suivirent et inscrivirent tous les mots substantifs qui commençaient par la syllabe Four. Ils trouvèrent : Fourche, Fourchette, Fourchure, Fourgon, Fourmi, Fourmilière, Fournaise, Fourneau, Fournil, Fourrage, Fourrière, Fourrure.
À cause du mot le, ils furent d’avis de ne prêter point d’attention à la Fourche, ni à aucun des substantifs féminins. Il restait Fourgon, Fourneau, Fournil, Fourrage, qui ne leur apprenaient rien.
C’est alors que la pendule, sur la cheminée, sonna minuit. Mme Petito, très pâle, se leva et fit un signe. Plus pâle encore, M. Petito était debout.
— Voilà le moment ! dit Mme Petito. Tu trouveras des renseignements utiles en bas.
On ne peut pas t’entendre, ajouta-t-elle, avec tes chaussons de corde ; je veillerai derrière notre porte, en haut de l’escalier. Tu sais qu’il n’y a aucun danger ; ils sont à Esbly.
Une ombre, deux minutes plus tard, glissait sur le palier de M. Longuet, introduisait une clef dans la serrure de la porte de M. Longuet et pénétrait dans le vestibule de M. Longuet. L’appartement de M. Longuet avait exactement la même disposition que celui de M. Petito. Celui-ci trouva facilement son chemin dans la salle à manger ; il agissait avec d’autant plus de présence d’esprit qu’il croyait l’appartement inhabité. Il poussa la porte du cabinet et vit le chat violet sur le bureau. Comme c’était évidemment à la serrure du bureau qu’il en voulait, M. Petito retira le chat violet, qui le gênait sur le bureau, et le plaça sur la table à thé ; puis il quitta la pièce tout de suite et se précipita sans bruit dans la salle à manger, de là dans le vestibule, car il lui avait semblé entendre des voix dans l’escalier.
Il s’était sans doute trompé. Quand il revint dans le cabinet, il retrouva le chat violet sur le bureau et ronronnant. Bien que les cheveux de M. Petito fussent frisés, ils se dressèrent sur sa tête. L’horreur qui s’était emparée de lui n’était comparable qu’à l’autre horreur, de l’autre côté du mur.
M. Petito resta immobile, dans la lune bleue, même après qu’il n’entendit plus ronronner le petit chat violet. Et puis il se décida et, sur ses savates de corde, il fit quelques pas. D’une main timide, il se saisit du petit chat violet et le mouvement qu’ainsi il lui imprima fit que le ronron recommença. Il se rendit compte alors que, dans le ventre en carton du chat, il y avait une petite bille et que le balancement de cette petite bille dans ce ventre de carton simulait fort ingénieusement un ronron naturel. Comme il avait eu très peur, il se traita d’imbécile. Tout s’expliquait. N’avait-il point, avant de retourner dans le vestibule, remué le chat ? Au lieu de l’avoir posé sur la table à thé, comme il le croyait, il l’avait reposé sur le bureau : c’était simple. Là-dessus, il fit bien attention à mettre le chat violet ronronnant sur la table à thé.
Il ne faut pas oublier que le ronron qui n’épouvantait plus M. Petito recommençait à épouvanter Théophraste et sa femme, tandis que le second ronron qui avait défrisé de terreur les cheveux de M. Petito avait, au contraire, laissé le ménage Longuet indiffèrent.
Il y eut un nouveau bruit dans l’escalier. (C’était Mme Petito qui, surprise par un courant d’air, fort mal à propos, éternuait.) M. Petito se reprécipita dans le vestibule, en silence. Quand, rassuré, il revint dans le cabinet, le chat violet ronronnant était retourné sur le bureau.
Il crut qu’il allait mourir d’effroi. Il pensa qu’une intervention miraculeuse l’arrêtait sur le bord du crime, et il fit une prière rapide dans laquelle il promit au ciel qu’il ne recommencerait plus. Cependant, un quart d’heure passé encore, comme il n’entendait plus rien, il attribua ces événements surprenants au trouble qu’apportait dans ses sens son exceptionnelle besogne, et il reprit le chat violet qui rerereronronna.
Mais alors la porte de la chambre s’ouvrit avec violence et M. Petito, anéanti, tombait dans les bras de M. Longuet qui n’exprima aucun étonnement.
M. Longuet rejeta avec mépris M. Petito sur le parquet et courut au chat violet dont il s’empara : puis, ayant ouvert la fenêtre, il jeta le chat violet dans la rue, après avoir préalablement retiré de la tête du chat l’épingle de cravate qu’il y avait mise et à laquelle il tenait beaucoup, parce que Marceline la lui avait offerte pour sa fête.
— Sale chat ! dit-il dans une colère inexprimable, tu ne nous empêcheras plus de dormir !
Pendant ce temps, M. Petito, qui s’était relevé, ne savait plus quelle contenance tenir, d’autant que Mme Longuet, en chemise, le visait assidûment d’un gros revolver au brillant nickel. Il ne trouvait que cette phrase :
— Je vous demande pardon ! Je vous croyais à la campagne !
Mais M. Longuet vint à lui et lui prenant entre le pouce et l’index l’une de ses oreilles, qu’il avait fort longues, il lui dit :
— Maintenant, mon cher monsieur Petito, nous allons causer !
Marceline abaissa le canon de son revolver et, lui voyant tant de courage, considéra son mari avec une admiration extatique. Théophraste continuait :
— Vous voyez, mon cher monsieur Petito, que je suis calme. Oh ! tout à l’heure j’étais fort en colère, mais c’était contre ce satané chat qui nous empêchait de dormir ! Aussi, je l’ai jeté par la fenêtre. Rassurez-vous, mon cher monsieur Petito, je ne vous jetterai pas par la fenêtre. Je suis juste. Vous ne vous avez pas empêchés de dormir, vous ! Vous avez pris la précaution de chausser des pantoufles à semelles de corde ! Tous mes remerciements. Pourquoi donc, mon cher monsieur Petito, faites-vous cette insupportable grimace ? C’est à cause sans doute de votre oreille. J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer et qui vous mettra à l’aise, rapport à votre oreille : Vos oreilles ne vous feront plus souffrir ! mon cher monsieur Petito.
Ayant parlé de la sorte, Théophraste pria sa femme de passer un peignoir et M. Petito de passer dans la cuisine.
— Ne vous étonnez point, lui dit-il, de ce que je vous reçois dans la cuisine. Je tiens beaucoup à mes carpettes et vous devez saigner comme un cochon.
M. Longuet tira à lui une table de bois blanc placée contre le mur et la disposa au milieu de la cuisine ; il pria Marceline de dérouler sur cette table une toile cirée, de se procurer la grande jatte et d’aller chercher dans le tiroir de la desserte de la salle à manger le couvert à découper.
Marceline essaya d’articuler une demande d’explications, mais son mari lui montra un regard si étrangement glacé qu’elle ne put qu’obéir en frissonnant. Il y a des peurs qui donnent chaud, il en est qui donnent froid. Ainsi, M. Petito grelottait, et c’est bien en grelottant qu’il tenta de gagner la porte de cette cuisine dans laquelle il se disait mentalement qu’il n’avait que faire. Malheureusement, M. Longuet se refusa absolument à laisser partir son voisin. Il le pria de s’asseoir, il s’assit lui-même.
— Monsieur Petito, lui dit-il sur le ton de la plus excessive politesse, vous avez une figure qui me déplaît. Ce n’est point de votre faute, mais ce n’est point de la mienne non plus. Certes, vous êtes bien le plus lâche et le plus méprisable des petits bandits, mais qu’importe ? Ceci n’est point mon affaire, mais celle de quelque honnête bourreau du roy qui vous invitera, la saison prochaine, à vendanger à l’Eschelle ou, certain jour qu’il fera chaud, vous mettra gentiment à la bise, à seule fin que vous gardiez, comme un brave homme, ses moutons à la lune ! Ne souriez pas, monsieur Petito ! (Il est absolument évident que M. Petito ne souriait pas.) Vous avez des oreilles ridicules, et je suis certain qu’avec de pareilles oreilles vous n’osez pas passer au carrefour Guilleri ![7]
M. Petito joignit les mains et bredouilla :
— Ma femme m’attend !
— Qu’est-ce que tu fais, Marceline ? cria Théophraste impatienté. Tu vois bien que M. Petito est pressé ; sa femme l’attend !… As-tu le couvert à découper ?
— Je ne trouve pas la fourchette ! répondit la voix tremblante de Marceline.
La vérité était que Marceline ne savait plus ce qu’elle répondait. Elle croyait son mari devenu complètement fou. Entre M. Petito cambrioleur, et Théophraste fou, elle n’était nullement portée à plaisanter. Elle s’était cachée instinctivement derrière la porte d’un placard, et son trouble était si extrême qu’en se retournant un peu brusquement, dans le moment que Théophraste lui lançait une bordée d’injures, elle renversa la desserte et le vase de Sarreguemines qui en faisait le principal ornement. Il en résulta un grand bruit et une confusion complète. Théophraste s’en prit encore aux tripes de Mme de Phalaris et appela si vigoureusement Marceline auprès de lui qu’elle accourut malgré elle. Le spectacle qui l’attendait dans la cuisine était atroce :
Les yeux de M. Petito semblaient sortir des orbites. Était-ce l’effroi ? L’effroi devait y être pour quelque chose, mais aussi l’étouffement qui résultait du mouchoir que Théophraste lui avait enfoncé dans la bouche. M. Petito lui-même était couché sur la table en bois blanc. Théophraste avait eu le temps et la force invincible de lui lier les poings et les chevilles avec des ficelles. La tête de M. Petito pendait un peu au delà de la table. À côté de la table et sous la tête de M. Petito, il y avait une jatte que M. Longuet avait placée là pour ne rien salir. Celui-ci, les narines palpitantes (c’est ce que Marceline remarqua surtout dans la figure formidable de son mari), avait pris M. Petito par les cheveux, de la main gauche. Dans la main droite, il serrait le manche d’un couteau de cuisine ébréché, qui ne servait guère qu’à ouvrir les huîtres et les boîtes de sardines. Les dents de Théophraste grinçaient. Il dit :
— Amène les pavillons !…
Et il entama l’oreille droite. Le cartilage résistait. On entendait, à travers le mouchoir, le hurlement lointain et tout à fait sourd de M. Petito. Comme M. Longuet était resté en chemise, il semblait, par derrière, quand on ne voyait pas son visage terrible, un interne penché sur une opération difficile. Marceline, sans force, tomba à genoux. M. Petito tenta un mouvement suprême et le sang de son oreille jaillit à travers la cuisine. Théophraste lâcha les cheveux et lui administra une gifle.
— Fais donc attention, disait-il, tu éclabousses partout[8] !
Comme le cartilage résistait encore, il prit de la main gauche l’oreille droite et, d’un grand coup du couteau ébréché, acheva de l’arracher. Il mit cette oreille dans une soucoupe qu’il avait préalablement déposée sur l’évier. Et il ouvrit le robinet d’eau dont le jet (dirigé mathématiquement par le brise-jet) alla laver l’oreille de tout le sang dont elle était maculée. Puis il revint à la seconde oreille. Comme Marceline gémissait trop fort, il la fit taire d’un coup d’œil. La seconde oreille fut coupée beaucoup plus vite, sans comparaison, et vraiment, quant à moi, j’en suis bien aise, car le découpage de la première oreille est une chose affreuse. Il était temps. M. Petito avait avalé la moitié du mouchoir. Il étouffait. Théophraste retira de la bouche de M. Petito son mouchoir et le jeta dans le panier au linge sale, qui était là, par hasard. Il délia ensuite les chevilles et les poignets du lamentable expert en écriture, et il lui conseilla dans le tuyau de l’oreille, puisque l’oreille elle-même avait disparu, de quitter le plus tôt possible son appartement, s’il ne voulait pas qu’il le fît arrêter comme cambrioleur. Il eut encore la précaution de lui envelopper la tête dans un torchon « pour que son sang ne tachât point l’escalier du concierge » ; enfin, comme M. Petito, agonisant, se disposait à regagner ses pénates, Théophraste lui mit ses oreilles lavées dans la poche de son veston.
— Vous oubliez tout en route, lui dit-il. Que penserait Mme Petito si vous rentriez sans vos oreilles !
Il referma la porte et, regardant Marceline qui, toujours à genoux, se mourait d’horreur, il essuya le couteau sanglant sur sa manche.
XIV
M. THÉOPHRASTE LONGUET PRÉTEND QU’IL N’EST PAS MORT SUR LA PLACE DE GRÈVE.
M. Longuet, dans les notes qu’il consigna le lendemain de cette nuit funeste sur son carnet des Mémoires, ne paraît pas avoir attaché autrement d’importance à l’essorillement de M. Petito.
« La nature des femmes, dit-il, est tout à fait délicate ; j’en jugeai par l’émoi de ma chère Marceline. Elle ne pouvait admettre que j’eusse coupé les oreilles de M. Petito. Sa manière de raisonner était incroyable et combien incompréhensible, mais je la lui pardonnai à cause de sa sensibilité excessive. Elle disait que je n’avais pas besoin de couper les oreilles de M. Petito. Je lui répondis qu’évidemment on n’avait jamais besoin de couper les oreilles d’un homme, pas plus qu’on n’a besoin de le tuer ; et, cependant quatre-vingt-dix-neuf hommes sur cent, affirmai-je (et nul ne me contredira), auraient tué chez eux, la nuit, M. Petito. Elle-même, qui n’était après tout qu’une femme, si le revolver eût été chargé, aurait fait tout ce qu’il faut pour tuer M. Petito. Elle ne le nia pas. Eh bien ! en lui coupant les oreilles, n’avais-je pas prouvé qu’il n’y avait aucun besoin de le tuer ?
» Un homme préfère vivre sans oreilles que trépasser avec ses oreilles, et M. Petito se trouvait aussi dégoûté de ses promenades nocturnes dans les appartements des autres que s’il était mort.
« — J’ai agi pour le mieux, avec une grande retenue et une inconcevable humanité.
» La logique de ces paroles la calma un peu, et ce qui restait de la nuit se serait passé convenablement si je ne m’étais avisé de lui dévoiler tout le mystère de ma personnalité. Ce fut sa faute. Elle insistait pour connaître le pourquoi de mon courage subit, ce qui était assez naturel, attendu que jusqu’à ce jour je n’étais guère brave. Ce n’est pas en vendant des timbres en caoutchouc que l’on apprend à voir couler le sang. Alors, je lui dis, tout de go, que j’étais Cartouche et, par une sorte de forfanterie qui m’étonna moi-même, je me vantai de mes cent cinquante assassinats personnels. Elle s’enfuit du lit, ainsi que je l’avais prévu, et jura que rien au monde ne la ferait coucher avec Cartouche. Elle montrait les signes de la plus grande terreur et s’était réfugiée derrière le canapé. De plus, elle m’annonça qu’elle allait demander le divorce. Je ne pus m’empêcher, à cette nouvelle, de m’attendrir sur mon malheur, et je me pris à pleurer. Elle voulut bien alors se rapprocher de moi, me fit comprendre avec beaucoup de précaution combien sa situation devenait difficile, qu’elle avait cru épouser un honnête homme, qu’elle découvrait tout à coup qu’elle partageait la couche du plus affreux des brigands, et qu’il n’y aurait plus désormais pour elle de repos possible. J’avais séché mes pleurs, je compatissais à sa peine, et nous ne nous consolâmes d’une telle catastrophe que lorsque j’eus trouvé la solution : « Nous dirons à Adolphe, fis-je, de venir coucher avec nous. » Elle acquiesça tout de suite à cette proposition, et il fut entendu qu’Adolphe aurait toujours son lit fait chez nous, comme il avait son couvert mis.
» Justement, Adolphe survint à la première heure. Marceline et lui s’enfermèrent dans le salon et ils eurent là un entretien d’une longueur inusitée. Je m’étais retiré par discrétion dans mon cabinet.
» Quand ils vinrent me retrouver, ils semblaient sortir d’une conversation grandement animée. Adolphe me regarda avec tristesse et me pria de l’accompagner dans quelques courses qu’il avait à faire le matin même. Marceline insista pour que je fisse tout ce qu’Adolphe me demanderait, et je le promis sans difficulté. Adolphe et moi, nous descendîmes donc dans Paris. Je demandai à mon ami si l’étude du document lui avait révélé quelque fait nouveau intéressant nos trésors, il me répondit que tout cela n’était guère pressé, qu’il fallait avant tout songer à ma santé, et que nous prendrions tous trois, le soir même, le train pour la villa « Flots d’Azur ».
» Je remis la conversation sur le terrain de Cartouche, qui ne m’avait jamais autant préoccupé ; mais il semblait éviter de me répondre et fuyait ce sujet. Enfin, je fus tellement pressant que, me voyant sur le point d’être tout à fait exaspéré, il voulut bien me donner sur moi-même quelques renseignements dont j’estimais avoir le plus grand besoin. Et puis, il s’échauffa à mon histoire et je sus bientôt tout ce que je voulais savoir.
» Je lui dis que, dans la narration qu’il avait entreprise de ma vie d’autrefois, il m’avait laissé partir pour la guerre et que je serais curieux de savoir comment de soldat je devins le plus grand bandit du monde, car mes propres souvenirs étaient fantasques ; ils me revenaient à leur caprice et je ne connaissais encore ma vie que par lambeaux. Il me répondit que ceci ne s’était pas fait d’un coup ; qu’après la guerre, on avait, comme de coutume, licencié la majeure partie des troupes et que je m’étais trouvé avec quelques camarades à Paris, sans ressources autres que celles qui pouvaient me venir de mon ingéniosité particulière et de mes talents spéciaux. J’en usai avec un tel bonheur et une audace si remarquable que mes camarades n’hésitèrent point à me prendre pour chef. Notre troupe se grossit avec rapidité de tous les mauvais garçons que nous trouvâmes dans les rues quand les honnêtes gens sont couchés.
» Justement, à cette époque, la police de Paris était si mal faite que je résolus de m’en occuper. Mon dessein était que chacun, bourgeois, gentilhomme ou curé, pût se promener à toute heure, en toute tranquillité, dans sa bonne ville de Paris. Je partageai mes troupes fort habilement, leur donnai à chacune un quartier à garder et un chef intelligent qui restait toujours mon lieutenant docile. Quand un quidam sortait après le couvre-feu, et même quelquefois avant, il était abordé fort poliment par une petite escouade de mes gens qui l’invitait à verser une certaine somme, ou s’il n’avait pas d’argent sur lui, à se défaire de son habit, moyennant quoi on lui donnait le mot de passe et il pouvait dès lors se promener dans Paris, toute la nuit, s’il lui plaisait, dans une sécurité parfaite. Il n’avait plus rien à craindre, car j’étais devenu le chef de tous les voleurs.
» Je serais indigne du nom d’homme, moi, Théophraste Longuet, si je n’osais avouer ici, à ma honte, que je m’admirais d’avoir su monter une aussi prodigieusement criminelle entreprise. Tout à fait criminelle, hélas ! car mon intention de police pouvait être en soi une conception admirable, mais l’exécution de cette conception nous incita, par la suite, à de tels débordements, à de si nombreux attentats que l’honnêteté première de l’affaire ne saurait être, à mes yeux, une excuse. Le bourgeois ne comprit pas. Il résista trop souvent, et il en résulta des malheurs. Nous n’avions point, cependant, le clergé contre nous, parce que nous respections les églises. Un prêtre défroqué que nous appelions le Ratichon nous rendit même quelques services qui le conduisirent bientôt à donner la bénédiction par les pieds « communi patibulo ».
» Ici j’arrêtai Adolphe pour une explication, à cause des mots latins ; il me répliqua que si j’avais réellement fait mes études au collège de Clermont, avec Voltaire, je saurais le latin et que communi patibulo veut dire : au gibet commun, et que : donner la bénédiction par les pieds « communi patibulo » signifiait, dans le langage du temps, être pendu aux Fourches Patibulaires, comme on appelait encore le gibet.
» — Oh ! je sais ! répondis-je ; nous passions quelquefois devant, quand nous allions faire ripaille et gourgandiner au Moulin des Chopinettes.
» — Oh ! il y avait beaucoup de gibets, me répondit Adolphe en me jetant un regard dont je ne saisis pas tout le sens. Gibets, échelles et piloris ne manquaient pas à la bonne ville. Et même, ici…
» Il me fixa encore d’une façon bizarre. Je vis que nous étions arrivés place de l’Hôtel-de-Ville. Il me dit :
» — Veux-tu que nous traversions la place de l’Hôtel-de-Ville ?
» — Si cela peut te servir, je la traverserai.
» — Tu as traversé souvent la place de l’Hôtel-de-Ville ?
» — Oh ! très souvent !
» — Et il ne s’est rien passé d’anormal, tu n’as rien ressenti ?… Tu ne l’es souvenu de rien ?
» — … De rien !
» — Se trouve-t-il des endroits, dans Paris, que tu n’as pas pu traverser ?
» J’estimai cette question tellement, mais tellement stupide, que je haussai les épaules avec un dédain écrasant.
» — Et qu’est-ce qui pourrait m’empêcher de traverser l’endroit que je veux traverser ? Tu deviens bête, Adolphe.
» Je ne l’avais jamais traité si familièrement. Mais, cette fois, il ne pouvait s’en plaindre. Sa question ne signifiait rien du tout. Cependant, son regard insistait. Son regard me parlait, m’ordonnait de réfléchir. Je me rappelai alors quelques attitudes inexpliquées que j’avais eues avec moi-même. C’est ainsi que, plusieurs fois, devant me rendre place de l’Odéon et me trouvant devant l’Institut, j’étais entré dans la rue Mazarine. Mais je n’y avais pas plutôt mis le pied que je retournais sur mes pas et que je prenais un tout autre chemin. Je me rendais compte vaguement de ma contremarche, surtout après, et je m’accusais de distraction. Mais plus j’y songe et moins je crois vraiment que c’était là une distraction. En effet, je me suis trouvé plus de vingt fois à cet endroit, et plus de vingt fois j’ai rebroussé chemin. Jamais, jamais, je ne suis passé dans cette partie de la rue Mazarine qui commence à l’Institut et qui va jusqu’au coin de la rue Guénégaud et jusqu’au passage du Pont-Neuf. Jamais ! De même, quand je descendais la rue Mazarine, pour gagner les quais, je m’arrêtais à la rue Guénégaud et je prenais la rue Guénégaud avec plaisir. Je dis tout cela à Adolphe. Il me demanda :
» — Est-ce qu’il y a encore d’autres endroits que tu n’as pas pu traverser ?
» En effet, en y réfléchissant bien — c’est tout à fait inouï et on a bien tort, vraiment, de ne pas réfléchir — je n’ai jamais pris le Pont-Neuf — oh ! jamais ! — ni le Petit-Pont ; et il y a, au coin de la rue Vieille-du-Temple, une maison avec des grilles aux fenêtres et un soleil d’or devant laquelle j’ai toujours reculé !
» — Et pourquoi, me demanda encore Adolphe, ne peux-tu passer dans ces endroits, sur ces ponts, devant cette maison de la rue Vieille-du-Temple ?
» Je me rappelai alors exactement pourquoi et, certes, la raison en est bien la plus naturelle du monde. Je croyais ne pas savoir pourquoi, mais évidemment je le savais, puisque c’était à cause des pavés.
» — À cause des pavés ?
» — Oui, à cause de la couleur des pavés, à cause que ces pavés sont rouges. Il m’est absolument impossible de supporter la couleur rouge des pavés. Cette couleur ne me produit pas le même effet sur la brique et sur la tuile.
» — Et alors, reprit Adolphe qui m’écoutait, penché sur moi comme un médecin qui écoute battre l’artère d’un malade, et alors, le sol de cette place que tu traverses, ce sol n’est pas rouge ?
» — Me crois-tu atteint de daltonisme ?
» — Sais-tu bien que cette place, fit-il brusquement, était la place de Grève ?
» — Parbleu ! c’était là qu’était le pilori, là l’échelle, là la plateforme, l’échafaud où se dressaient la roue et la croix, les jours d’exécution, en face la rue de la Vannerie. Enfin, là se trouvait le vieux port à charbon. Je ne passais jamais sur cette place sans prononcer cette phrase : Il faut éviter la roue ! C’était un conseil que je donnais aux camarades, à Bourguignon, à Bel-à-Voir, à Gatelard et à la Tète-de-Mouton. Aucun, du reste, je le parierais, n’en a profité.
» — Ni toi non plus ! me fit Adolphe. Malheureux ! c’est là que tu as subi le dernier supplice ! C’est là que tu as été roué ! C’est là que tu as expiré dans les tourments de la roue !
» Il était très animé en disant cela, mais je lui éclatai de rire au nez !
» — Qui est-ce qui t’a raconté cette farce-là ? m’écriai-je.
» — Tous les historiens sont d’accord…
» — Ce sont de foutues bêtes ! Je sais peut-être bien que je suis mort au gibet de Montfaucon !
» — Toi ! tu es mort au gibet de Montfaucon ? Qu’est-ce qui m’a fichu un âne pareil ? s’écria Adolphe qui ne se possédait plus. Tu es mort en 1721 au gibet de Montfaucon ? Mais il y avait beau temps qu’on n’y pendait plus !
» Mais je criai beaucoup plus fort que lui, et nous devînmes le centre d’un rassemblement.
» — Je ne te dis pas que je suis mort pendu ! Je te dis que je suis mort au gibet de Montfaucon !
» Disant cela, ou plutôt criant cela, je semblais prendre à témoin les quarante personnes que notre altercation semblait intéresser et à laquelle, du reste, ils ne comprenaient rien, à l’exception d’un monsieur intelligent qui, lui, avait saisi, car il s’adressa à Adolphe et lui dit d’une voix incomparablement calme, en me montrant :
» — Vous n’allez peut être pas apprendre à monsieur comment il est mort !
» Adolphe baissa la tête en s’avouant vaincu, et nous nous dirigeâmes, réconciliés, bras dessus, bras dessous, vers la rue du Petit-Pont.
» Cependant, j’avais besoin d’explications et je voulais savoir comment les historiens racontent ma mort. Adolphe, pour son excuse, m’avoua la fable qui court aujourd’hui les ouvrages les plus autorisés, et qui semble du reste étayée sur les pièces les plus authentiques. Et j’appris comment on avait déshonoré ma mort !
XV
M. ÉLIPHAS DE SAINT-ELME DE TAILLEBOURG DE LA NOX
Parmi tous les papiers que j’ai trouvés dans le coffret en bois des îles, ceux qui ont rapport à la mort de Cartouche sont certainement les plus curieux et présentent un intérêt hautement historique, en ce que, justement, ils contredisent l’histoire. Ils la nient. Mais ils la nient avec une telle force de persuasion et une telle indéniable logique qu’on se demande comment des hommes d’une haute valeur comme Barbier, qui était cependant le mieux placé de tous pour n’être la dupe de personne, puisqu’il vivait à l’époque, ont pu être victimes de la plus pauvre et de la plus indéniable comédie, comment enfin les générations qui se sont succédé depuis l’an 1721 n’ont pas soupçonné la vérité.
L’histoire donc, et l’histoire sérieuse — il ne saurait s’agir en tout ceci de la légende, qui est encore plus méprisable que l’histoire — nous apprend que Cartouche, après avoir subi la question dans sa forme la plus cruelle, pendant laquelle il n’avoua rien, ni un nom ni un fait, Cartouche, qui n’avait plus qu’à mourir et qui n’avait à espérer, par ses aveux, nul adoucissement à ses derniers moments, Cartouche fut amené pour le supplice sur la place de Grève, et que là il se décida à parler ; qu’on le conduisit à l’Hôtel de Ville et qu’il livra ses principaux complices ; après quoi il fut roué et attaché à la croix où il expira. Immédiatement, trois cent soixante personnes, parmi lesquelles des personnages, furent arrêtées, et il en résulta des procès et des massacres judiciaires pendant plus de deux ans[9].
Or, les papiers de Théophraste Longuet nous font toucher du doigt la supercherie. Cartouche était, en même temps qu’un objet de terreur, un objet d’admiration. Son courage ne connaissait pas de limite, et il le prouva lors de la torture. Du moment que les souffrances du brodequin ne l’avaient point fait parler, il était impossible moralement qu’il parlât. Pourquoi eût-il parlé ? Il n’avait plus, comme on l’a dit plus tard, qu’à mourir « en beauté ». Les plus grandes dames de la Cour et de la ville avaient loué loges et fenêtres. Pourquoi leur montrer sur l’échafaud la figure inutile du plus lâche en place et lieu du plus brave des bandits ? Enfin M. Longuet combat justement l’histoire avec ses propres armes. Il est de vérité historique que, parmi les trois cent soixante personnes qui furent dénoncées et arrêtées, il s’en trouvait que Cartouche aimait comme des frères et d’autres comme les plus tendres des maîtresses et les plus fidèles, certaines étant revenues de province à Paris, méprisant tous les dangers, dans cette espérance que l’Enfant aurait la consolation de les voir une dernière fois. Le procès-verbal est évidemment truqué, qui montre ces femmes se jetant, après la dénonciation, dans les bras de l’Enfant, à l’Hôtel de Ville même.
Je ne reproduirai point ici toutes les protestations de M. Longuet contre la mort déshonorante qu’on attribue à Cartouche, mais les quelques lignes qui précèdent semblent bien à mes yeux prouver à priori qu’il a raison.
Quelle fut donc la mort réelle de Cartouche ? Montrons un peu de patience. Nous allons en être informés avant qu’il soit longtemps, car le déroulement de cette aventure va nous faire assister à la mort de Cartouche, à sa vraie mort, sans qu’il soit possible d’en douter.
Du reste, comment pourrions-nous anticiper ? En ce moment, M. Théophraste Longuet sait qu’il est mort sur la butte, au gibet de Montfaucon, où il n’a pas été pendu, mais c’est encore tout ce qu’il sait.
C’est en s’entretenant de cette grave question que Théophraste et son ami arrivèrent rue du Petit-Pont, sans être passés sur le Petit-Pont. Théophraste ne regarda même pas du côté du Petit-Pont. Qu’est-ce qu’ils allaient faire rue du Petit-Pont ? Théophraste n’en savait absolument rien, mais Adolphe était fixé, lui.
— Mon cher ami, dit Théophraste qui était dans un état moitié de souvenir, moitié de possession, regarde cette maison, à côté de cet hôtel qui porte pour enseigne : « Au rendez-vous des Maraîchers », et dis-moi ce que tu y trouves de remarquable.
Ils étaient alors en face d’une vieille petite maison basse, étroite et sale ; cette maison était un hôtel : au rez-de-chaussée s’ouvrait la porte d’un débit de boissons. Au-dessus de la porte, on lisait : « Au rendez-vous des maraîchers. »
L’hôtel était appuyé ou plutôt semblait se soutenir en s’appuyant contre une vaste bâtisse du dix-huitième siècle que Théophraste désignait de son ombrelle verte. Cette bâtisse avait un balcon ventru en fer forgé, aux dessins solides et délicats.
Adolphe répondit :
— Je remarque un balcon superbe.
— Et encore ?
— Le carquois du dieu Amour, sculpté sur la porte.
— Et encore !
— Je ne remarque plus rien.
— Tu ne remarques pas les fortes grilles aux fenêtres !
— Évidemment.
— Il fut un temps, mon cher Adolphe, où l’on tenait beaucoup à ce que les fenêtres fussent grillées. Jamais on ne vit autant de grilles aux fenêtres de Paris qu’en l’an 1720, et je jurerais que celles-ci furent posées le lendemain de l’affaire des Petits-Augustins. Les Parisiens en garnirent d’abord tous leurs rez-de-chaussée. Cette précaution ne nous troubla en rien, car nous avions Simon l’Auvergnat.
Adolphe crut le moment opportun de lui demander ce qu’était au juste ce Simon l’Auvergnat qui apparaissait souvent, sans raison appréciable, dans leurs conversations.
Théophraste répondit :
— C’était un objet bien utile. C’était ma base de colonne.
— Qu’est-ce que c’est que ça, ta base de colonne ?
— Tu ne comprends pas ? Attends, tu vas comprendre. Imagine-toi que tu es Simon l’Auvergnat.
Adolphe voulut bien, mais « pas pour longtemps ».
— Attends ! Attends ! Mets-toi comme cela !…
Et Théophraste, entraînant Adolphe contre la muraille du « Rendez-vous des maraîchers », lui indiqua la position qu’il devait prendre : écarter les jambes et s’appuyer, en baissant la tête et en levant les bras recourbés, contre cette muraille.
— Je te place ici, dit-il, à cause de la petite corniche qui est à gauche. Je me rappelle qu’elle est très commode.
— Et puis après ? dit Adolphe.
— Après, puisque tu es ma base de colonne, je monte sur cette base et alors…
Avant, mais bien avant que M. Lecamus ait eu le temps d’imaginer un mouvement, Théophraste avait grimpé sur ses épaules, sauté sur la corniche et, passant d’un bond de la corniche de l’hôtel Notre-Dame au balcon de l’hôtel d’à côté, pénétré dans une chambre dont la fenêtre était restée entr’ouverte.
M. Lecamus, stupéfait et consterné, regardait en l’air et se demandait, bouche bée, par où avait bien pu s’évanouir son ami Théophraste, quand des cris perçants commencèrent à emplir la rue. Une voix désespérée hurlait : « Au secours ! Au voleur ! À l’assassin ! »
— J’aurais dû m’en douter ! s’écria M. Lecamus, et, craignant déjà quelque catastrophe, il se précipita dans l’hôtel d’où partaient les appels, cependant que, dans la rue, les passants s’arrêtaient ou accouraient en grande hâte.
Il franchit un vaste escalier avec une vélocité de jeune homme et arriva au premier étage dans le moment qu’une porte s’ouvrait et qu’apparaissait Théophraste, son chapeau à la main. Il saluait très bas une vieille dame dont les dents claquaient d’effroi et dont la figure était tout emmêlée de papillotes. Il lui disait :
— Chère madame, si j’avais cru un instant vous causer une aussi désagréable surprise en pénétrant dans votre salon par la fenêtre, je serais resté bien tranquillement dans la rue. Je ne suis, chère madame, ni un voleur ni un assassin ; je suis un honnête marchand de timbres en caoutchouc.
Adolphe lui avait déjà saisi le bras et l’entraînait dans l’escalier, mais Théophraste continuait :
— Tout ceci est de la faute d’Adolphe, chère madame, qui a voulu que je lui montre comment Simon l’Auvergnat pouvait me servir de base de colonne !
Adolphe, derrière Théophraste, faisait des signes à la dame aux papillotes, tendant à lui faire comprendre que son ami était toqué. Là-dessus, la dame tomba sans connaissance dans les bras d’une femme de chambre qui accourait. L’escalier était envahi. Adolphe en profita pour emmener Théophraste. Ils passèrent au travers de la foule sans difficulté et Théophraste disait à Adolphe :
— Ce qu’il y a de tout à fait surprenant, mon cher ami, c’est que ce Simon l’Auvergnat, qui nous servit de base de colonne pendant plus de deux ans, ne s’est jamais douté de rien. Il croyait livrer ses fortes épaules à une bande de jeunes seigneurs qui s’amusaient[10] !
Adolphe n’écoutait plus Théophraste ; d’une main, il l’entraînait à grands pas vers la rue de la Huchette, et, de l’autre, il essuyait la sueur qui lui coulait du front.
— Ah ! il est temps ! murmurait-il, il est temps ! Qu’est-ce que j’ai fait ?
— Où me mènes-tu ? demanda Théophraste.
— Chez un de mes amis.
Rue de la Huchette, ils pénétrèrent sous un porche rouge, dans une maison dont certainement il eût été impossible de dire l’âge. Adolphe semblait connaître les êtres, car il n’hésita pas sur le chemin à suivre. Il fit gravir à Théophraste une demi-douzaine de marches de pierre dont l’usure était extrême et poussa, au fond de la cour, une porte épaisse.
Ils se trouvèrent dans une sorte de vestibule qui était éclairé par une grande lampe en forme de boule, que des chaînes de fer suspendaient au plafond de pierre.
— Attends-moi ici, dit Adolphe, après avoir refermé la porte par laquelle ils étaient entrés, d’une certaine façon.
Il promit de ne pas être longtemps et il disparut.
Théophraste s’assit dans un vaste fauteuil de paille et regarda autour de lui. Ce qu’il vit sur les murs, particulièrement, précipita son esprit dans un ahurissement profond.
D’abord, il y avait une quantité incroyable de mots peints en lettres noires. Ces mots grimpaient sans ordre au long des murs, comme des mouches.
Il en épela quelques-uns : Iris, Thabethnah, Jakin, Bohaz, Theba, Pic de la Mirandole, Paracelse, Jacque Molay, Nephesch-Ruach-Neschamah, Ézéchiel, Aïsha, Puységur, Gagliostro, Wronski, Fabre d’Olivet, Louis Lucas, Hiram, Élie, Plotin, Origène, Gutman, Swedenborg, Giorgius, Apollonius de Tyane, Cassiodore, Éliphas Levi, Cardan, Allan-Kardec, Olympicodore, Spinosa, etc., etc., et, répété une centaine de fois, ce mot : ihôah.
En se retournant vers l’autre mur, contre lequel il s’appuyait, il vit un sphinx et des pyramides, une immense rosace au centre de laquelle le Christ étendait les bras dans un cercle de flammes. Et ces mots, sur la rosace : Amphitheatrum sapientiæ æternæ solius veræ. C’était la rosace de la Rose-Croix.
Au-dessous, ces deux vers :
À quoi servent flambeaux et torches et besicles,
Pour qui ferme les yeux afin de ne point voir ?
— Je ne ferme point les yeux, dit Théophraste, et j’ai des besicles, et du diable si je sais où je suis !
Il tomba sur cette inscription en lettres d’or :
« Dès que vous avez un fait, un seul fait, appliquez-y tout ce que vous avez d’intelligence, cherchez-y les côtés saillants, voyez ce qui est en lumière, laissez-vous aller aux hypothèses, courez au-devant s’il le faut. » (Introduction à la clinique de l’Hôtel-Dieu. Professeur Trousseau.)
Il vit encore des éperviers, des vautours, des chacals, des hommes à tête d’oiseau, plusieurs scarabées, un dieu à tête d’âne, puis un sceptre, un âne et un œil, qui sont l’emblème d’Osiris.
Enfin, il lut ces mots, en lettres bleues :
« Plus l’âme se sera enracinée en ses instincts, plus elle se sera oubliée dans sa chair, moins elle aura conscience de sa vie immortelle et plus elle restera prisonnière des cadavres vivants. »
Impatienté de l’absence de son ami et un peu effrayé, il voulut soulever la draperie derrière laquelle Adolphe avait disparu. Mais comme il montait sur une marche, il heurta du front deux pieds qui se balançaient en l’air et qui rendirent un bruit cliquetant d’osselets. Il regarda : c’était un squelette.
Nous avons dit que M. Lecamus s’occupait de sciences occultes et pratiquait le spiritisme. Ce que nous connaissons aujourd’hui du caractère et de la science de M. Lecamus nous permet d’affirmer que c’était le plus vulgaire et le moins renseigné des amateurs. M. Lecamus avait désiré pratiquer le spiritisme par genre, par snobisme, pour étonner les salons où il fréquentait. Tout d’abord sceptique, il faisait tourner les tables comme il faisait tourner les cœurs ; je veux dire qu’il ne croyait pas plus alors au spiritisme qu’il ne croyait à l’amour. Un jour vint cependant où son cœur devait succomber, où son esprit devait s’humilier ; c’est le jour unique qui lui fit connaître Marceline et M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox.
Il rencontra Marceline dans un salon où l’on faisait surtout « du péresprit ». Ce salon reconnaissait pour grand maître, pour chef, pour dieu, M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox.
On voyait rarement, du reste, M. de Saint-Elme de la Nox, qui menait la vie la plus retirée, la plus mystérieuse au fond de sa rue de la Huchette. Aussi ses apparitions dans le salon des Pneumatiques, chez la belle Mme de Bithynie, annoncées à l’avance, étaient-elles considérées par les initiés comme des sortes de fêtes religieuses auxquelles ils s’empressaient d’assister fort dévotement.
Comment Marceline avait-elle pénétré dans ce milieu ? De par la volonté de M. Longuet qui, ayant entendu parler d’un salon des Pneumatiques, n’avait eu de cesse que sa femme s’y fît présenter. Il pensait, dans sa belle âme, que c’était là une espèce de cercle mondain qui réunissait les trafiquants en caoutchouc les plus en vue de la capitale. Or, chacun sait que la pneumatologie étant cette partie de la métaphysique qui traite des esprits (de pneuma, souffle, âme), les Pneumatiques sont les initiés à cette science, qui n’a rien à faire avec la substance élastique et résistante extraite par incision de l’arbre appelé dans les Indes occidentales cahuchu.
Les Pneumatiques s’appellent encore Gnostiques ; ce sont, bien entendu, ceux des Pneumatiques qui s’attachent plus particulièrement à l’étude de la Gnose, qui n’est rien moins que l’ensemble des connaissances acquises par des voies mystérieuses échappant généralement aux procédés scientifiques connus.
Le jour où Marceline fit son entrée dans le salon de Mme de Bithynie, M. de Saint-Elme de la Nox devait faire une conférence sur la Gnose. Mme Longuet se trouva, par un hasard providentiel, à côté de M. Lecamus. Et comme ils furent un peu pressés l’un contre l’autre, à cause de la foule des fidèles, et que M. de Saint-Elme de la Nox parla ce jour-là avec la plus suave et la plus pénétrante éloquence, M. Lecamus et Marceline se sentirent, avant la fin de la séance, embrasés l’un et l’autre d’un double feu, le feu de l’amour et le feu de la Gnose.
C’est ainsi que M. Lecamus, qui s’était trouvé — hasard toujours providentiel — l’ancien camarade de collège de M. Longuet, entra dans le ménage, après quelques autres séances chez les Pneumatiques. Marceline avait trouvé inutile de donner à son mari, alors plongé jusqu’au cou dans les affaires, des explications embrouillées sur la différence qu’il y a entre la Pneumatologie et les timbres en caoutchouc.
Ce préambule était nécessaire pour nous préparer à la présence de M. Lecamus et de Marceline dans la salle d’expériences de M. de Saint-Elme de la Nox, au fond de la maison de la rue de la Huchette, cependant que Théophraste, las d’attendre dans le vestibule, bousculait un squelette.
Cette visite à M. de la Nox était le résultat de la conversation animée, mais honnête, qui s’était tenue le matin même entre M. Lecamus et Mme Longuet, portes closes. Mme Longuet n’avait rien caché de son épouvante à M. Lecamus, à la suite des événements de la nuit, et l’histoire des oreilles de M. Petito prouva à l’ami de Théophraste qu’il était grand temps de prendre ses précautions contre Cartouche. Au fond de son cœur, M. Lecamus se sentait coupable dans une certaine mesure des extravagances sanglantes de Théophraste ; il se demandait déjà avec terreur jusqu’où celui-ci pourrait aller dans la voie rouge où sa propre inexpérience l’avait précipité.
Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que M. Lecamus s’était conduit comme un novice en face de l’âme réincarnée de M. Longuet. Vraiment — on ne saurait trop le dire — on ne se conduit pas ainsi avec une âme réincarnée, quelle qu’elle soit ! C’est peut-être le mécanisme humain le plus compliqué, le plus délicat et certainement le plus difficile à manœuvrer ! Ce n’est certainement pas un Pneumatique de deux jours qui pourrait manœuvrer une pareille âme, et, notre parole d’honneur, M. Lecamus avait agi comme un Pneumatique de deux jours ! Il y a, par exemple, un principe absolu qui préside à la manœuvre des âmes réincarnées, et qui est celui-ci : ne point s’occuper de la mise en mouvement avant d’être sûr de son cran d’arrêt.
On peut se demander — il le faut — si M. Lecamus connaissait ce principe. En tout cas, il a agi comme s’il l’ignorait totalement. Il ne fut pas plutôt assuré qu’il avait entre les mains une âme réincarnée qu’il la lançait à toute vitesse. N’était-ce pas ce qu’il avait fait exactement en mettant, sans précaution aucune, sans vitesse intermédiaire, l’âme réincarnée de M. Longuet en face de son portrait !
Et, maintenant, il ne savait pas comment il pourrait arrêter ce mécanisme qu’il avait mis en mouvement sans le connaître ! Que vous dirai-je de plus que ceci : d’une façon générale, M. Lecamus ne savait pas comment on arrête une âme réincarnée !
Je ne saurais mieux comparer M. Lecamus, dans ce cas regrettable, qu’à un enfant qui serait monté dans une automobile, et qui, ayant remué quelque chose, la verrait partir. Il a, à côté de lui et autour de lui, des pédales, un levier, une roue, mais il n’en connaît pas l’usage. Quand et comment l’automobile s’arrêtera-t-elle ! En attendant, il court, il vole, il écrase, il laisse du sang sur sa route, il coupe les oreilles de M. Petito, il entre par les fenêtres chez les honnêtes gens !
Or, M. Lecamus, et Mme Longuet, de son côté, étaient venus ce matin-là supplier M. de Saint-Elme de la Nox de monter dans l’automobile. Il n’y avait pas à Paris un plus habile conducteur d’âmes réincarnées.
Cependant, Théophraste avait heurté du front le squelette. Il le considéra avec une entière et douce commisération :
— Tu serais bien plus tranquille, lui dit-il, à la butte Saint-Chaumont.
Et il passa en souriant tristement.
Le corridor dans lequel il marchait au hasard n’avait aucune fenêtre ; une lueur rouge grenat l’éclairait d’un bout à l’autre, sans que Théophraste pût d’abord en deviner l’origine. Et puis il s’aperçut qu’il marchait sur cette lueur rouge. Elle venait de caveaux et pénétrait dans le corridor à travers d’épais pavés de verre. Qu’est-ce que faisaient, en bas, ces flammes écarlates, dans la lueur desquelles il se promenait ?
Il n’en savait rien. Il ne se le demandait même pas. Il ne se demandait même pas pourquoi, lui, Théophraste, se trouvait dans cette lueur. Il avait fini de se demander : « Ah ! ça ! pourquoi suis-je dans cette maison de la rue de la Huchette ? » Il avait fini de se le demander, parce que personne ne lui répondait.
Emmanuel, Noun, Samech, Haïn… Sabaoth… Adonaï…
Encore des noms sur les murs de pierre.
Le seul ornement de ces murs, sur lesquels couraient des noms, était, à hauteur d’homme, une théorie sans fin d’étoiles formées par les deux triangles du sceau de Salomon. Entre chaque étoile ou sceau, on lisait ce mot peint en vert : NIRVANA.
Ce corridor ne fuyait pas en ligne droite. Il avait des courbes et des angles. Bientôt même, il eut un carrefour. Théophraste s’arrêta prudemment. Mais il s’impatienta encore et s’enfonça dans l’un des deux corridors qui aboutissaient au premier corridor. Cinq minutes après, sans qu’il pût y rien comprendre, il se retrouvait au même carrefour. Alors, il remonta le premier corridor, refaisant le chemin qu’il avait suivi en sortant du vestibule ; mais, fait véritablement surprenant, il ne retrouva pas le vestibule. Il se disposait à hurler de détresse, quand il vit Adolphe devant lui. Celui-ci avait ses yeux rouges comme des yeux qui ont pleuré. M. Lecamus lui dit avec une grande tristesse :
— Viens ! Marceline est là. Nous allons te présenter à un bon ami.
Et Théophraste se trouva, sans savoir comment, dans une vaste pièce sombre, où son regard fut attiré par une lueur merveilleuse qui tombait sur la plus noble, la plus douce et plus belle figure d’homme qu’il eût jamais vue. Chose étrange, cette figure ne semblait pas recevoir de la lumière ; elle paraissait en dégager. De fait, quand cette figure remuait, elle entraînait la lumière avec elle. Elle était figure et flambeau. Devant ce flambeau, une femme, dans la plus humble des attitudes et les mains jointes, se tenait, recueillant sur elle quelques reflets de cet être harmonieux et divin.
Alors, Théophraste entendit une voix amie, une voix mâle, mais plus douce que la plus douce des voix de femmes, qui lui disait :
— Venez à moi sans crainte.
Ce qui étonnait par-dessus tout M. Longuet depuis qu’il avait pénétré dans cette étonnante maison de la rue de la Huchette, c’était cette sorte de lumière astrale, de fluide miraculeux que dégageaient les nobles traits de M. Éliphas de la Nox, et telle que le peintre James Tissot a pu la reproduire en une gravure d’une beauté ineffable, d’après une apparition médianimique photographiée, communiquée au congrès spirite de 1889 par Donald Nac-Nab. Sur cette gravure, à côté de la matérialisation d’une apparition de jeune fille, on voit M. Éliphas de la Nox, médium, et sa lumière.
La personne de M. Éliphas de la Nox était d’une divine élégance, comme peut être élégant un Christ du Tiepolo. Il avait été divinement élégant au sortir de l’adolescence en mangeant trois millions avec les pauvres.
Non point, vous m’entendez bien, qu’il eût constitué quelques donations, aussi sérieuses que perpétuelles, destinées à soulager de rares malheurs et à nourrir de nombreux et intéressants employés d’une Assistance publique ou privée, mais il avait « fait la noce » avec les pauvres. Il invita les plus misérables en des villégiatures d’une incomparable magnificence, où, des mois, ils menaient vie de princes, tout en conservant leurs loques, car Éliphas, qui leur offrait entre autres exceptionnels luxes, celui de la chasse à courre, prétendait n’être point assez riche pour leur payer des pantalons.
Théophraste ayant contemplé en silence le rayonnant visage de M. Éliphas de la Nox (car il faut renoncer à lui donner, chaque fois, tous ses noms), Théophraste, disons-nous, fut au comble de l’étonnement. Mais, comme il ressentait une sympathie immédiate pour cet homme qui lui apparaissait en des circonstances si imprévues et dans un cadre quelque peu démoniaque (pensait-il), il résolut de lui demander bravement la raison de tout ce qu’il voyait.
— Je ne sais où je suis, dit Théophraste. Ce qui me rassure un peu, c’est de voir à côté de vous, monsieur, mon ami Adolphe et ma femme Marceline. Cependant, avant tout, je voudrais savoir votre nom.
— Mon ami, dit la voix harmonieuse, je m’appelle Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox.
— Vous vous appelez vraiment comme ça ? demanda Théophraste qui, peu à peu, retrouvait ses esprits.
L’homme de lumière fit un signe affirmatif de la tête en souriant.
— Après tout, reprit Théophraste, il n’y a rien d’étonnant à cela. Je m’appelle bien, moi, de mon vrai nom, de mon nom de famille, Cartouche[11], et l’on a cru longtemps que ce nom m’avait été donné en sobriquet.
— Vous ne vous appelez pas Cartouche, fit doucement Éliphas ; vous vous appelez Théophraste Longuet.
— L’un n’empêche pas l’autre ! dit fort logiquement Théophraste, qui, mieux que personne, savait à quoi s’en tenir.
— Pardon ! répliqua plus doucement encore Éliphas, il ne faut pas qu’il y ait dans votre esprit de confusion. Vous vous êtes appelé autrefois Cartouche, et maintenant, vous êtes Théophraste Longuet.
Il répéta :
— Sachez cela : vous êtes Théophraste Longuet. Mon ami, mon ami, écoutez-moi bien, comme on écoute un médecin qui va vous guérir, car vous êtes malade, mon ami, très malade, à cause justement que vous croyez être Cartouche, mais vous êtes Théophraste Longuet. Je vais faire appel à toute la simplicité de votre esprit.
— Tant mieux ! dit Théophraste ; moi, j’aime les choses simples ; ainsi je n’aime pas du tout, mais pas du tout, cette façon que l’on a d’entrer chez vous, à travers un labyrinthe de corridors où sont pendus des squelettes. Qu’est-ce qu’il fait chez vous, ce squelette, au lieu d’être bien tranquillement à la Butte Saint-Chaumont ? Je l’ai reconnu ! On le traînait au charnier des Fourches Patibulaires de Montfaucon, le jour où, avec Beaulieu et Va-de-Bon-Cœur, nous fêtions aux Chopinettes mes fiançailles avec ma chère femme Marie-Antoinette Néron ! À cette époque, cher monsieur d’Éliphas de Taille-à-rebours…
— Éliphas de Taillebourg, corrigea M. Lecamus.
— … Cher monsieur Éliphas de Taillebourg, à cette époque — mon ami Adolphe, qui est sérieux comme un âne, vous le dira — on ne pendait plus aux Fourches Patibulaires de Montfaucon, mais on allait jeter dans le charnier de ces Fourches la dépouille de ceux qu’on avait pendus ailleurs. C’est ainsi que ce pauvre Gâtelard, dont j’ai reconnu le squelette tout à l’heure, fut traîné à la voirie après avoir été pendu place de Grève. Gâtelard, cher monsieur Feu-Saint-Elme…
— De Saint-Elme, recorrigea M. Lecamus.
— Cher monsieur de Saint-Elme, Gâtelard était un homme de néant, un pauvre hère plein d’imagination qui, s’étant un jour déguisé en exempt du roi, réclama son épée à un gentilhomme auquel il montra, par la même occasion, une lettre de cachet. Le gentilhomme crut qu’on l’arrêtait et tendit son épée, dont la poignée était en or et la plus belle qui se pût imaginer. Cette histoire se termina pour Gâtelard au bout d’une corde. Mais du diable ! mon cher monsieur de l’Équinoxe !…
— De la Nox ! insista M. Lecamus.
— … De la Noce, cher monsieur de la Noce, du diable ! si je me doutais alors que je retrouverais un jour son squelette dans une maison de la rue de la Huchette !…
Éliphas, immobile, considérait avec une attention que rien ne pouvait troubler Théophraste et ses discours.
Celui-ci continuait :
— Je n’ai jamais tant ri qu’à la butte Saint-Chaumont, entre le moulin des Chopinettes et le moulin du Coq. Là se trouvait le cabaret des Chopinettes, qui avait pris la suite de l’auberge chère à François Villon, où depuis des siècles venaient en grande liesse ripailler les mauvais garçons et gourgandines, les jours de pendaison aux Fourches. C’est entre le moulin des Chopinettes, le moulin du Coq et les Fourches de Montfaucon, sans que je puisse dire exactement où aujourd’hui (excusez-moi, le terrain a été si bouleversé !) que j’ai enfoui une partie de la dot de Marie-Antoinette Néron, si généreusement consentie par un jeune seigneur ami du Bourguignon et de la Vache-à-Paniers, et qui n’avait rien à nous refuser ce soir-là, sous peine de mort. Si vous aviez un vieux plan de Paris, mon cher monsieur d’Éliphas de Taille-à-rebours de Feu Saint-Elme de la Noce…
Théophraste n’avait pas fini de prononcer cette dernière phrase que, par un phénomène insoupçonné, les demi-ténèbres qui l’enveloppaient se dissipaient tout à coup, et que la pièce, ainsi que les personnages qui s’y trouvaient, apparaissaient dans la splendide clarté du jour.
Il regarda autour de lui avec une satisfaction évidente, d’abord sa femme, Marceline, qui semblait marmotter une prière, ensuite son ami Lecamus, dont les yeux étaient pleins de larmes ; enfin, M. Éliphas de la Nox, qui lui souriait d’un doux sourire compatissant. Éliphas avait perdu tout aspect surnaturel ; son manteau astral avait disparu, et, si ses traits avaient toujours leur pâleur sublime et inoubliable, il semblait néanmoins « un homme comme tout le monde ».
— J’aime mieux cela, fit Théophraste en soupirant.
Éliphas se leva :
— Non, je ne vous donnerai point à consulter un plan du vieux Paris, dit-il, bien que j’en aie ici de tous les âges. Il ne faut plus, monsieur Théophraste, songer au vieux Paris. Vous n’avez plus rien à faire dans le vieux Paris. Vous êtes Théophraste, et nous sommes en l’an de grâce 1899.
— Possible, répondit Théophraste qui s’entêtait, mais il s’agit de mon trésor, de mon trésor qui m’appartient, monsieur, et c’est bien mon droit de regarder sur un plan du vieux Paris l’endroit où je l’ai enfoui autrefois, pour que je puisse ensuite, sur un plan du nouveau Paris, voir où j’aurai à le chercher aujourd’hui. C’est clair !…
Éliphas dit, parlant à M. Lecamus :
— J’ai vu souvent ici des crises de karma, mais jamais il ne m’a été donné d’en étudier de cette force.
— Oh ! mais vous n’avez encore rien vu ! insista Théophraste.
Éliphas réfléchit, puis, conduisant Théophraste à un endroit de la muraille où se trouvait un plan de Paris actuel, il dit :
— Voici ! Voici le point exact où se trouvaient les Fourches de Montfaucon ; quant aux moulins du Coq et des Chopinettes, qui sont marqués sur les plans de Paris de 1721, ils étaient à ces deux points de la butte Saint-Chaumont. Les fourches se trouvaient sur une petite éminence, à côté de la butte principale, non loin de l’endroit où s’élève aujourd’hui le temple protestant de la rue de Crimée. Pour retrouver votre trésor, il faudrait donc, mon ami, faire des recherches dans ce triangle…
» Ces buttes ont été, comme vous le disiez, remaniées de fond en comble, continua Éliphas, et je doute fort que votre trésor s’y trouve encore[12]. Je vous ai précisé l’espace ancien sur un plan moderne, pour vous en débarrasser l’esprit. Mon ami, mon ami, il faut vous débarrasser l’esprit. Ne soyez plus à vos trésors. Il ne faut pas vivre dans le passé ! C’est un crime ! Il faut vivre dans le présent, c’est-à-dire pour l’Avenir. Mon ami, mon ami, il va falloir chasser Cartouche, parce que Cartouche n’est plus. C’est Théophraste Longuet qui est !
Éliphas prononça ces derniers mots avec une grande force.
XVI
JE TE DOIS MON DOIGT !
— Monsieur, répondit tristement Théophraste, je vous remercie de l’intérêt que vous me portez, et je ne vous cacherai pas que vous m’êtes extraordinairement sympathique, malgré vos squelettes et les mots bizarres qui sont écrits sur vos murs. Vous devez être très savant, si j’en crois tous les livres qui vous entourent. (La pièce où ils se trouvaient, en effet, semblait uniquement tapissée, décorée, meublée de livres, de grands et de petits, de très vieux livres.) Vous devez être aussi très bon, c’est ce qui fait que je vous aime comme le plus tendre et le plus compatissant de mes frères humains, mais je vous le dis bien tristement, bien tristement, vous ne pouvez rien pour moi ; car, hélas ! monsieur, vous me croyez malade, et je ne suis pas malade. Si j’étais malade, vous me guéririez, je le jure, mais on ne guérit pas un homme qui n’est pas malade ! Vous me dites : « Il va falloir chasser Cartouche ! » C’est une parole très belle, tout à fait magnifique, une grande parole que j’admire, mais à laquelle je ne crois pas, mon cher monsieur d’Éliphas de Brandebourg de Feu-Saint-Elme de la Boxe !
Cependant que Marceline et Adolphe étaient atterrés de cette extraordinaire façon qu’avait Théophraste de comprendre les noms d’Éliphas, celui-ci dit, en lui serrant encore la main avec une inconcevable amitié :
— Et cependant, il va falloir chasser Cartouche, car si nous ne parvenions pas à le chasser, il nous faudrait le tuer, et je ne vous cacherai pas, mon cher monsieur Théophraste Longuet, que c’est une opération délicate !
« Quand l’Homme de Lumière, dit Théophraste dans ses mémoires, entreprit de chasser de mon être l’obsession de Cartouche, qui ne s’y trouvait point, hélas ! en imagination, mais bien en réalité, je ne pus que sourire de pitié et me gausser d’un si formidable orgueil ; mais quand je sus qu’il voulait le chasser par le seul miracle de la raison, je pensai qu’il était temps de servir cet homme tout chaud à Charenton.
» Or, il faut que l’on sache cela, parce que vraiment cela en vaut la peine, il n’avait pas prononcé trois phrases que déjà j’étais avec lui, que je le comprenais, que je jugeais nécessaire de servir le dessein qu’il avait de chasser Cartouche de moi par le seul miracle de la raison. Enfin, dans la suite de son discours, il se rendit si bien maître de ma pensée que je ne pouvais comprendre comment j’avais pu rester de si longues années sans même soupçonner la vérité évidente qu’il m’enseignait. Il me serait absolument impossible de répéter ici les mots magnifiques qui rendaient la vérité plus éblouissante encore, mais comme ses arguments sont les plus simples qui puissent se présenter à l’esprit des hommes, je ne désespère pas de produire chez ceux qui me liront, en les leur apportant tout sèchement, une impression efficace. Je pus ainsi mesurer tout d’abord l’abîme qui séparait l’Homme de Lumière de mon ami Adolphe, et qui séparera toujours l’Homme de Raison du Singe Savant.
» Avant tout, il me dit qu’il croyait que j’avais été Cartouche. Il en était sûr. Et il m’affirma que c’était une chose toute naturelle. Il me confia qu’il avait « grondé » sévèrement M. Lecamus de m’avoir présenté mon cas comme possible mais exceptionnel, attendu que mon cas est celui de tout le monde. Certes ! tout le monde n’a pas été Cartouche, mais tout le monde a été, avant d’être, quelques-uns parmi lesquels il a pu se trouver des hommes qui valaient bien Cartouche.
» Vous entendez l’Homme de Lumière ? Mon cas était ordinaire. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a vécu avant de vivre et revivra. « C’est, me dit-il, la Loi du Karma. Mon esprit pouvait être en paix. » Il m’expliqua en quelques mots inouïs de clarté la Loi du Karma, et vraiment, quand je l’eus comprise — ce qui est aussi facile que d’additionner de tête deux chiffres — je me demandai comment j’avais pu être assez niais pour m’imaginer qu’on pouvait commencer à naître ou finir de naître. On naît tout le temps, on ne meurt jamais ! Et quand on meurt, c’est qu’on renaît, et ainsi de suite depuis le commencement du commencement des commencements !
» Le véritable but, m’a-t-il dit, de cette effrayante évolution des âmes à travers les corps, est de les développer pour les rendre aptes à goûter le bonheur absolu qui sera finalement la part de tous les heureux qui entreront dans le Royaume des Cieux, qu’il appelle Nirvana.
» Ne trouvez-vous point la sagesse de cette religion admirable, et n’en aimez-vous pas la clarté qui touche au sublime ? Il est entendu qu’à chaque naissance la personnalité diffère de la précédente et de la suivante, mais ce n’est qu’une modification du véritable Moi divin et spirituel ; ces diverses personnalités ne sont, en quelque sorte, que les différents anneaux de la chaîne infinie de la vie qui constitue à travers les âges notre Individualité immortelle !
» Et alors l’Homme de Lumière me dit que lorsqu’on est persuadé de cette Vérité immense, on ne saurait s’étonner que quelques événements du Maintenant rappellent quelques événements de l’Autrefois ! Mais, pour vivre selon la loi de sagesse, il faut vivre le Maintenant et ne plus regarder en arrière. J’avais trop regardé en arrière ; mon esprit, mal dirigé par M. Lecamus, ne s’était plus occupé, depuis quelques semaines, que de mon Autrefois et, certainement, pour peu que cela eût continué, j’aurais été réduit à un état voisin de la folie. Je ne devais pas plus m’étonner d’avoir été un autre état d’âme, il y a deux cents ans, que je ne devais m’étonner d’avoir été un autre état d’âme, il y a vingt ans. Est-ce que le Théophraste de vingt ans avait quelque chose à faire avec le Théophraste d’aujourd’hui ? Non. Le Théophraste d’aujourd’hui ignorait ce jeune homme : même il le haïssait. N’aurais-je pas été stupide de rassembler tout l’effort de ma mémoire pour revivre aujourd’hui le jeune Théophraste de la vingtième année ? Ainsi, ma faute terrible avait été de ne plus vivre que pour Cartouche, parce que, par hasard, je m’étais souvenu d’avoir été Cartouche !
» La parole de M. Éliphraste de la Boxe, vous dis-je, coulait en moi comme un rafraîchissement et me faisait un bien infini.
» Il me dit encore des choses qui ne sortiront jamais de ma mémoire, pendant cent mille ans. Il me dit que ce qu’on appelait des vocations chez les hommes d’aujourd’hui n’était qu’une révélation latente du passé, et qu’elles ne pouvaient s’expliquer que de cette sorte. Il me dit que ce qu’on appelait « facilité » chez les hommes d’aujourd’hui n’était autre chose que de la sympathie rétrospective pour des objets qu’ils connaissaient mieux que tous les autres pour les avoir mieux étudiés avant la vie actuelle, et que ceci ne pouvait encore s’expliquer que de cette sorte. Il me dit que chacun de nous faisait, presque toujours, sans s’en douter, les gestes du passé ; et qu’il avait vu, lui, de ses propres yeux vu, le soir de la bataille du Bourget, tomber à ses côtés deux jeunes gens, beaux comme des demi-dieux, braves comme Castor et Pollux, et qui succombèrent avec la grâce que les héros mettaient à mourir à Salamine, à Marathon et à Platées !
» L’Homme de Lumière me pressa alors sur son cœur comme un père embrasse son petit enfant ; il souffla sur mon front et sur mes yeux son souffle divin et il me demanda si j’étais bien persuadé maintenant de sa Vérité et que, pour être heureux, il fallait que nous cherchions à nous rendre compte de notre condition de changement perpétuel, et qu’ainsi nous apprendrions à vivre le Maintenant et à comprendre que le temps nous appartient tout entier. Ne sommes-nous pas les enfants de l’Éternel, aux yeux de qui « mille ans sont comme un jour et un jour comme mille ans » ?
» Je lui répondis en pleurant de joie — et ma chère femme aussi pleurait de joie, et mon cher Adolphe aussi pleurait de joie — que je croyais, que je voyais, que je ne m’étonnais plus du tout d’avoir été Cartouche, que je le regrettais un peu, mais que la chose, après tout, était si naturelle que jamais plus mon esprit ne s’y arrêterait. Je lui dis : « Soyez tranquille, soyons heureux, vivons le Maintenant, Cartouche est chassé ! »
» Là-dessus Marceline demanda l’heure qu’il était et Adolphe lui répondit qu’il était onze heures ; moi, je tirai mon oignon et je vis qu’il était onze heures et demie ; or, comme ma montre ne s’était jamais dérangée, j’affirmai qu’il était onze heures et demie.
» — Non, fit Adolphe, je te demande pardon, il est onze heures.
» — Et moi ! m’écriai-je, car j’étais bien sûr de ma montre, je te donne mon doigt à couper qu’il est onze heures et demie.
» Mais l’Homme de Lumière consulta son chronomètre et dit qu’il était onze heures. C’était mon ami Adolphe qui avait raison. Je le regrettai à cause de mon doigt. Je suis un homme juste et un honnête commerçant. J’ai toujours tenu ma parole et j’ai toujours fait honneur à ma signature. Je n’hésitai pas. Pouvais-je faire autrement ? « C’est bien, dis-je à Lecamus, je te dois mon doigt ! Le voilà ! » Et, saisissant une petite hachette que l’Homme de Lumière avait sur son bureau et qui lui servait de presse-papiers, je la fis tourner en l’air et l’abattis sur mon petit doigt de la main gauche que j’avais mis bien en évidence sur le bout de la table du bureau. (C’était mon droit de ne donner à Adolphe que le petit doigt de ma main gauche. Je lui avais dit en effet : « Je te donne mon doigt à couper », mais je n’avais pas stipulé lequel, et j’avais choisi celui dont l’absence devait le moins me gêner.) Mon petit doigt allait être infailliblement tranché, quand l’Homme de Lumière saisit au passage mon poignet avec une adresse et une force incroyables. Il me dit de lâcher ma hachette ; je lui répondis que je ne lâcherais ma hachette que lorsqu’elle aurait tranché mon doigt, qui appartenait à Adolphe. Adolphe s’écria qu’il n’avait que faire de mon doigt et que je pouvais le garder. Marceline se joignit à Adolphe, me priant d’accepter mon doigt, qu’Adolphe m’en faisait cadeau, mais je répondis au premier qu’il n’y avait aucune raison pour me faire des cadeaux à cette époque de l’année, et à la seconde qu’elle n’entendait rien aux affaires. C’est alors que M. d’Éliphraste de l’Équinoxe me fit observer que je ne suivais pas les conditions du contrat. J’avais dit : « Je te donne mon doigt à couper », par conséquent c’était à Adolphe qu’il appartenait de me couper le doigt. J’admirai cette profonde logique, dont il ne se départissait jamais, et je lui remis ma hachette.
» J’eus tort de lâcher ma hachette dans cette maison de la rue de la Huchette. Ils se précipitèrent sur moi, et j’entendis l’Homme de Lumière qui disait : « Allons, il est trop tard, il n’y a plus qu’à le tuer ! »
XVII
OÙ L’ON ESSAIE DE TUER CARTOUCHE EN LAISSANT LA VIE
À M. THÉOPHRASTE LONGUET, OPÉRATION BEAUCOUP PLUS DÉLICATE QU’ON NE LE CROIRAIT AU PREMIER ABORD.
J’ai trouvé dans le coffret en bois des îles, tout orné de ferrures, beaucoup de papiers et documents autres que les mémoires propres à M. Longuet, ce qui m’a permis de suivre dans ses plus grands détails la terrible aventure. Parmi ces papiers, recueillis sur son cas si étrange par M. Longuet lui-même, j’ai distingué une relation des plus importantes, signée de M. Lecamus, de l’épouvantable opération que M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox crut de son devoir d’effectuer sur la personne de notre ami Théophraste. Je laisse donc la parole à M. Lecamus :
« La scène sauvage et si rapide à laquelle nous venions d’assister, raconte Adolphe, et qui se serait terminée par l’amputation du petit doigt de la main gauche de M. Longuet, sans la présence d’esprit de M. de la Nox, nous prouva que l’imagination sanglante de Cartouche avait envahi si complètement le cerveau de cet honnête homme, que je considère comme le meilleur et le plus sûr des amis, qu’il nous sembla que l’unique remède à tant de malheurs était la mort de Cartouche.
» M. de la Nox n’hésita pas. En vain avait-il usé de la Raison, que nous avions pu croire un moment victorieuse ; l’opération s’indiquait. Mme Longuet fit bien quelques observations auxquelles nous ne répondîmes même point. Quant à Théophraste, il était inutile de lui demander son avis. Du reste, M. de la Nox avait déjà son regard sur lui, et nul n’a jamais résisté au regard de M. de la Nox.
» Théophraste poussa quelques soupirs, se prit à trembler affreusement ; mais quand M. de la Nox lui cria : « Cartouche je t’ordonne de dormir ! » il tomba d’un seul coup sur le fauteuil qui se trouvait derrière lui et ne fit plus aucun mouvement. Sa respiration était si muette que nous eussions pu douter qu’il vivait encore.
» L’opération de la mort de Cartouche allait commencer. Je savais, par quelques exemples illustres, que c’était une opération difficile, car on risque toujours, quand on veut tuer une âme réincarnée, c’est-à-dire rejeter vers le néant passé cette partie de l’Individualité, cette manifestation passagère de notre Moi éternel qui a été quelqu’un auparavant et qui nous poursuit de telle sorte qu’il nous empêche de vivre en toute sagesse notre maintenant, — on risque toujours, dis-je, de tuer avec cette âme réincarnée (pour parler le langage du vulgaire) le corps même dans lequel elle s’est réincarnée. Ni plus ni moins, nous allions essayer de tuer Cartouche sans tuer Théophraste, mais on pouvait tuer Théophraste. De là notre émotion.
» Il fallait toute l’autorité, toute la science et toute la paix d’âme de M. de la Nox pour me tranquilliser à peu près dans l’extrémité où nous nous trouvions. Mais M. de la Nox, qui est bien l’esprit le plus complet et le plus divin de notre époque (voyez ses travaux sur le Sepher de Moïse et sur l’origine des langues, où ses déductions, tirées d’une triple étude hébraïque du Besaeschit, chinoise du Kinh, sanscrite du Véda, laissent loin derrière elles les hésitations de Fabre d’Olivet, renouvelées des premières propositions de Court de Gébelin.)
» M. de la Nox, dis-je, est encore la volonté la plus absolue et la plus dominatrice qu’ait connue le monde depuis Jacques Molay, auquel il a succédé dans la direction suprême de l’Ordre actuel et secret des Templiers.
» Aussi, je me rappelais les démonstrations catégoriques de son dernier traité de Chirurgie psychique et les enseignements mathématiques de son opuscule sur le Scalpel astral. Si j’énumère toutes les raisons que j’avais de croire en M. de la Nox, c’est que je veux réfuter par avance le reproche que l’on pourrait me faire d’avoir laissé M. de la Nox traiter mon meilleur ami avec la dernière rigueur. Enfin, les excentricités criminelles de M. Longuet, dont avaient été les premières victimes les oreilles de M. Petito, me faisaient redouter les plus irrémédiables catastrophes, et c’est ainsi que je fus porté à considérer l’opération de la mort de Cartouche comme un bienfait non seulement possible mais réalisable, sans un trop grand risque.
» Quant à Mme Longuet, sa foi était si complète en M. de la Nox qu’elle ne fit d’abord quelques remarques timides que pour dégager moralement une responsabilité qu’à tout prendre elle ne croyait pas engagée. Et puis (pourquoi ne pas le dire ?), la terreur où elle était de coucher avec Cartouche — terreur que j’avais prévue et qui avait été une des raisons pour lesquelles je lui avait celé l’ancienne personnalité criminelle de son époux — lui faisait, par-dessus tout, désirer sa mort.
» M. de la Nox me signifia de prendre Théophraste endormi par les pieds, ce que je fis ; il le saisit, lui, sous les aisselles, et, Mme Longuet nous suivant, nous le transportâmes dans le sous-sol, où se trouve le laboratoire qu’éclairent nuit et jour des becs d’un gaz aux larges flammes rouges et sifflantes dont j’ignore encore la nature.
» Nous déposâmes Théophraste sur un lit de sangle et, dans une immobilité miraculeuse, M. de la Nox le considéra plus d’un quart d’heure. Nous nous taisions.
» Enfin, une admirable mélodie se fit entendre. C’était la voix de M. de la Nox qui priait. De quelle musique des anges, de quelles vibrations supraterrestres, de quelles syllabes de gloire céleste et de triomphant amour était faite cette prière ? Qui la redira jamais ? Qui la réunira jamais ? Connaissez-vous le musicien maître de l’Art et du Son qui réunira, une fois passés, les éléments de cette brise parfumée de printemps qui chante, pour la première fois, sous les feuilles premières, sa chanson tremblante d’espoir et d’éternelle vie, au seuil renouvelé des saisons[13] ?
» Je sais seulement que cette prière commençait à peu près ainsi : « Au commencement, tu étais le Silence, Éon éternel, source des Éons ! Silencieuse comme toi était Eunoïa et vous vous contempliez dans un inexprimable embrassement, Éon, source des Éons, Eunoïa, source d’amour, germe fécond par qui l’Abîme allait engendrer ! Au commencement, tu étais le Silence, source des Éons ! »
» Quand la prière fut terminée, M. de la Nox prit la main de Théophraste et commanda. Mais comme les lèvres de M. de la Nox ne remuaient pas, comme il commandait sans parler, comme il interrogeait Théophraste par le seul truchement de son esprit dominateur, je ne pus d’abord savoir ce qu’il commandait ou ce qu’il demandait que par la réponse que faisait Théophraste endormi.
» Théophraste dit sans effort et sans souffrance :
» — Oui, je vois… Oui, je suis…
» — · · · · · · · · · · · · · · ·
» — Je suis Théophraste Longuet…
» — · · · · · · · · · · · · · · ·
» — Dans un appartement de la rue Gérando…
» M. de la Nox se tourna vers nous.
» — L’opération se présente mal, dit-il à voix basse ; j’ai endormi Cartouche et c’est Théophraste qui me répond. Il est endormi dans le maintenant. Il ne faut rien brusquer, cela pourrait être dangereux. Je vais le promener, pour ne point l’effrayer dans le maintenant.
» Théophraste reprit la parole[14] :
» — Je suis rue Gérando, dans l’appartement au-dessus du mien. Et je vois, étendu sur un lit, un homme sans oreilles. En face de lui, une femme, une femme brune… Elle est jolie… elle est jeune… Elle s’appelle Régina…
» Cette femme jeune et jolie, qui s’appelle Régina, dit à l’homme sans oreilles :
» — Monsieur Petito, aussi vrai que je m’appelle Régina, que je suis brune, jeune et jolie, et que vous n’avez plus d’oreilles, vous aurez cessé de me voir dans quarante-huit heures et d’entendre le Carnaval de Venise, si vous n’avez trouvé le moyen de me donner la petite aisance à laquelle j’estime avoir droit. Quand je me suis mariée avec vous, monsieur Petito, vous m’avez indignement trompée sur le chiffre de votre fortune et sur le volume de votre intelligence. Eh quoi ! monsieur Petito, votre fortune — je le sais trop maintenant, puisque nous sommes en retard de deux termes et que nous serions dans l’obligation de fuir l’huissier, si nous n’avions résolu de quitter à jamais cet appartement à la suite de la déconfiture de vos oreilles — votre fortune, dis-je, ne reposait que sur des espérances qui ne se sont point réalisées, et votre intelligence, comme votre fortune, n’a rien tenu de ce qu’elle promettait. À mon âge, monsieur Petito, quand on est brune, jeune et jolie, et qu’on s’appelle Régina, on ne saurait se résoudre à la misère. Je ne puis aller toute nue par les rues, monsieur Petito, et cependant il me semble que vous vouliez me réduire à cette extrémité indécente, puisque depuis un mois je n’ai pas donné un sol à ma couturière. Monsieur Petito, je vous parle sérieusement et j’attends de vous une réponse sérieuse. Qu’allez-vous faire, monsieur Petito ?
» M. Petito répond :
» — Ma chère Régina, vous me cassez la tête ! Laissez-moi en paix chercher la trace de ces trésors que l’imbécile du dessous est incapable d’arracher au sein profond de la terre.
» — L’imbécile, fit entendre dans son sommeil Théophraste, c’est Cartouche !
» M. de la Nox se tourna vers nous,
» — J’attendais ce mot, nous dit-il, pour lui faire quitter le maintenant ! Priez, madame ; priez, mon ami ; l’heure est venue ! Je vais tenter Dieu.
» Et alors, il parla, il commanda, et il était impossible, oh ! tout à fait, tout à fait impossible de ne pas obéira sa voix.
» — Cartouche, fit-il en étendant sa main au-dessus du lit de sangle avec une majesté supérieure, Cartouche, que faisais-tu, à dix heures du soir, dans la nuit du 1er avril 1721 ?
» — Le 1er avril 1721, à dix heures du soir, répond sans hésiter Théophraste, je frappe deux petits coups secs, un en haut de la porte, un autre en bas, dans le dessein de faire ouvrir le cabaret de la « Reine Margot »… Après l’algarade, jamais je n’aurais cru que je pourrais atteindre aussi facilement la rue de la Ferronnerie… Mais j’avais crevé le cheval du garde française ou plutôt il avait culbuté près de la pompe Notre-Dame. Mais j’avais dépisté ceux qui me poursuivaient… À la « Reine Margot », je trouve Patapon, la Porte-Saint-Jacques, Gâtelard et Gueule-Noire… La Belle-Laitière est avec eux… Je leur raconte l’histoire en vidant une bouteille de ratafia… J’avais confiance en eux et je leur dis que je soupçonne Va-de-Bon-Cœur et peut-être bien Marie-Antoinette d’avoir soufflé quelque chose aux mouches. Ils se récrient. Mais je crie plus fort qu’eux. Ils se taisent. Je leur annonce que je suis décidé à faire proprement l’affaire de tous ceux qui me donneront motif à soupçon… Et j’entre dans une belle colère… La Belle-Laitière me dit que je ne suis plus vivable… C’est vrai que je ne suis plus vivable… Mais est-ce de ma faute ?… Tout le monde me trahit. Je ne puis coucher deux nuits de suite dans le même endroit… Où donc est-il ce temps où j’avais tout Paris avec moi ? Où donc est-il le jour de mes noces avec Marie-Antoinette Néron, quand, à l’enseigne du Petit Sceau, chez le cabaretier Bigot de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, nous chantions tous en chœur sur l’air de
la chanson chère à mon lieutenant Camus :
Nous mangeâmes ce jour-là de la perdrix — on n’en
mangeait pas chez le roi — nous bûmes du champagne.
Ma belle Marie m’aimait. J’avais là mon oncle et ma
tante Tanton, qui vendaient de la chandelle rue de Bretagne.
Eh quoi ! Tant de bonheur datait du 15 mai de
l’année passée, et maintenant !… maintenant, où est-il
mon oncle Tauton ? Enfermé au Châtelet. Et son fils ?
J’ai dû le tuer le mois dernier pour qu’il ne me dénonçât
pas !… La chose fut vite faite… Un bon coup de pistolet à Montparnasse et son cadavre sous un tas
de fumier… J’étais sûr de son silence… Mais combien
à tuer encore ?… Combien à tuer pour être sûr du silence
de tous ?… Par les tripes de Mme de Phalaris ! j’ai
dû tuer l’archer Pépin et l’exempt Huron qui s’acharnaient
un soir après mon habit cannelle, et cinq archers
encore que j’ai massacrés, les pauvres, rue Mazarine… Je vois encore leurs cinq cadavres… Et, cependant,
je ne suis pas méchant ! Je voudrais ne faire de
mal à personne… Je ne demande qu’une chose, c’est
qu’on me laisse tranquillement faire la police dans
Paris, pour la sécurité de tout le monde… Mon grand conseil lui-même murmure. Il ne me pardonne pas
d’avoir exécuté Jacques Lefebvre[15]. Certes, non, je ne
suis plus vivable, mais c’est parce que je veux vivre !
» Après ce qui vient de se passer, continua Théophraste dans son sommeil hypnotique, et la façon miraculeuse dont j’ai pu m’échapper, malgré la trahison et les précautions prises par les mouches, je ne dissimule pas à Gâtelard et à Gueule-Noire que je suis décidé à tout… Je le répète, parce que la Belle-Laitière ne cache rien de mes intentions à Duplessis, ni même à Duchâtelet… Je les quitte là-dessus, j’ouvre la porte de la « Reine Margot » ; personne dans la rue de la Ferronnerie ; je me sauve. Je ne dis pas même où je vais coucher à Magdeleine, que je rencontre le long des murs du cimetière des Innocents… La vérité est que je vais passer la nuit comme un voleur, dans mon trou de la rue Amelot[16]. Il pleut à verse. »
M. Adolphe Lecamus, à qui nous devons cette narration, fait remarquer dans ses notes qu’il s’est efforcé de retracer le plus fidèlement possible les phrases échappées à Théophraste dans l’état de sommeil hypnotique. Ce qu’il ne peut pas rendre, nous dit-il, c’est la modulation de ces phrases, leur ton étrange, leurs arrêts, leurs stations, leurs départs précipités, et quelquefois leurs arrivées douloureuses. Enfin, ce qu’il renonce tout à fait à peindre, c’est la physionomie de Théophraste. Par moments, elle exprimait la colère, par moments le mépris, quelquefois l’audace la plus inouïe, quelquefois la terreur. M. Lecamus, qui avait vu le portrait de Cartouche, rapporte que, dans certaines minutes étranges, Théophraste ressemblait à Cartouche. Il lui ressembla pour la première fois, dit-il, dans la minute que voici… Théophraste venait de faire assister ceux qui l’écoutaient dormir à son départ de la rue de la Ferronnerie pour la rue Amelot. Il passe près du cimetière des Innocents, il vient de rencontrer Magdeleine (dit Beaulieu). La pluie tombe à verse, la nuit est lugubre, la rue est sinistre. Soudain, sur son lit de sangle, la figure de Théophraste exprime un sentiment inouï qu’on ne saurait qualifier, car cette expression est à la fois celle de la joie la plus sauvage et du plus magnifique désespoir.
M. de la Nox, penché sur le lit, lui demande :
— Que se passe-t-il, Cartouche ?
Théophraste répond dans un râle :
— Je viens de tuer un passant[17] !
L’opération continue, nous explique M. Lecamus, ou plutôt les préliminaires de l’opération, car ce n’est que peu à peu que M. de la Nox veut amener Cartouche à l’heure de sa mort. Avant de lui faire vivre sa mort, il est nécessaire de lui faire vivre un peu de sa vie. C’est là la raison qui avait poussé M. de la Nox à rejeter Théophraste dans Cartouche au mois d’avril 1721.
Les minutes qui suivirent furent affreuses pour nous, avoue M. Lecamus, et bien tristes aussi pour Cartouche, qui a repassé la fin de sa carrière, laquelle fut gâtée par la trahison sans cesse renaissante de son lieutenant et l’acharnement incroyable de la police.
La relation de M. Lecamus ne présente rien avant la scène de la torture, qui puisse nous occuper, car elle ne nous apprend quoi que ce soit de nouveau, et elle ne fait en somme que corroborer l’histoire. Il n’est pas utile, en effet, de descendre dans le laboratoire de M. de la Nox pour connaître tous les détails de la sensationnelle arrestation et de l’emprisonnement au Grand-Châtelet. J’en rappellerai quelques-uns. Nous trouvons au Registre des ordres du roi (lettres de cachet) : « Du 16 may 1721, ordre du Roy de saisir et arrêter le nommé Cartouche, qui a assassiné le sieur Huron, lieutenant de robe courte, et le nommé Tanton ; et aussi Cartouche Cadet, dit Louison ; Le Chevalier, dit le Craqueur, et Fortier, dit de Mouchy, pour complicité d’assassinat. » En marge, en regard du nom de Cartouche, ce seul mot : « Rompu. »
La chose était plus facile à dire qu’à faire. Ce n’est que le 14 octobre 1721 que la trahison porta ses fruits et que nous pouvons lire le rapport de Jean de Coustade, sergent d’affaires de la compagnie de Chabannes, quarante-sept ans, vingt-sept ans de services.
M. de Coustade prit avec lui quarante hommes et quatre sergents désignés par Duchâtelet (le lieutenant de Cartouche qui le trahissait, lui-même sergent aux gardes françaises. On lui avait promis la vie sauve). Cette petite armée prit des habits bourgeois, dissimulant ses armes, et cerna fort mystérieusement la maison désignée par Duchâtelet. Il pouvait être un peu plus de neuf heures du soir quand ils arrivèrent en vue du cabaret Au Pistolet, tenu par Germain Savard et sa femme, à la Courtille, près la haute Borne (rue des Trois-Bornes). Savard fumait sa pipe sur le pas de sa porte. Duchâtelet demanda :
— Y a-t-il quelqu’un là-haut ?
— Non.
Duchâtelet dit alors :
— Ces quatre dames y sont-elles ?
Savard, qui attendait cette phrase, dit :
— Montez !
Quand il eut dit : « Montez ! », Savard se rangea de côté et la petite troupe se précipita. Elle se ruait à l’assaut de Cartouche comme une armée se rue à l’assaut d’une place forte.
« Quand nous arrivâmes dans la chambre haute, dit M. Jean de Coustade dans son rapport, nous trouvâmes Balagny et Limousin buvant du vin devant la cheminée. Gaillard était dans les draps et Cartouche assis sur le lit, raccommodant sa culotte. Nous nous jetâmes sur lui. Le coup était pour lui si inattendu qu’il n’eut point le temps de nous faire résistance. On l’attacha avec de fortes cordes et nous le menâmes d’abord chez M. le secrétaire d’État de la guerre et ensuite à pied au Grand-Châtelet, dès que l’ordre nous en eut été donné. »
Au fait, les choses ne se passèrent point tout à fait aussi simplement que M. de Coustade le raconte, mais aboutirent au même résultat. Cartouche était d’une force exceptionnelle, malgré sa petite taille, et on ne vainquit sa résistance qu’en l’attachant à un pilier, ce qui nécessita une bataille ardente. Enfin, quand toutes les précautions furent prises, on fit avancer un carrosse dans lequel on déposa Cartouche. Celui-ci était en chemise (il n’avait pas eu le temps de remettre le pantalon qu’il raccommodait). Comme on le bousculait fort, il dit : « Prenez garde, camarades, vous me chiffonnez ! » Il avait gardé tout son sang-froid et félicita le lieutenant qui l’avait trahi de la toilette qu’il avait ce jour-là. Duchâtelet, en effet, avait sorti de magnifiques vêtements d’un noir tout neuf, à cause du deuil de Mme la grande duchesse Marguerite d’Orléans, décédée quinze jours auparavant. Enfin, comme le carrosse faillit écraser quelque pauvre sire, il prononça encore cette phrase qu’il semblait affectionner : « Il faut prendre garde à la roue ! »
De chez M. le secrétaire d’État de la guerre au Grand-Châtelet, il alla à pied, au centre d’une pompeuse escorte. Tout le peuple de Paris accourait sur son passage et criait : « C’est Cartouche ! » sans beaucoup y croire. Il avait été tant de fois trompé ! Mais il le reconnut à ce qu’un officier de l’escorte ayant donné au prisonnier un coup de canne, celui-ci se retourna fort paisiblement et lui envoya dans le visage une ruade de son pied gauche qui fit disparaître, avec un grand fracas, l’officier dans une bouche d’égout qui, par malheur, se trouvait près de là. Le peuple applaudit, car il aime beaucoup les voleurs quand ils sont pris.
Dans sa prison du Grand-Châtelet, en attendant son procès, Cartouche reçut les plus belles visites du monde. Le régent se dérangea pour lui exprimer tout le regret qu’il prenait personnellement à cette triste aventure, mais la conduite du royaume, disait-il, lui imposait des devoirs. La courtisane Émilie et Mme la maréchale de Boufflers se succédèrent dans les petits soins à donner au prisonnier. Mme de Phalaris vint se plaindre à lui de ce que Mme de Boufflers ne lui avait pas rendu son anneau, et Cartouche promit d’en dire un mot à Mme de Boufflers, s’il en avait le temps. On ne lui refusait rien. Il avait droit à trois chopines de vin par jour. Il ne fut jamais plus à la mode. On monta, sans tarder, une pièce intitulée Cartouche. Legrand, qui en était l’auteur, et Quinault, qui en remplissait le principal rôle, vinrent lui demander quelques indications sur la mise en scène. Enfin, quand Cartouche se fut bien amusé, il songea à s’évader. Malgré une surveillance de tous les instants, il allait y parvenir, après être sorti de son cachot et être retombé, grâce à des cordes de paille tressée, dans une boutique, quand on le rejoignit au moment où il poussait le dernier verrou d’une porte qui le séparait de la rue. On trouva que le Grand-Châtelet n’était pas assez sûr pour un homme aussi ingénieux, et il fut, en secret, déposé, chargé de chaînes, à la Conciergerie, dans le coin le plus formidable de la tour de Montgommery[18].
XVIII
M. THÉOPHRASTE LONGUET SUBIT LA TORTURE SANS AUCUN COURAGE, MAIS EN POUSSANT DE CURIEUX HURLEMENTS.
L’auteur de ces lignes a toujours estimé qu’il appartenait seulement à une littérature de décadence de s’attacher à peindre, sans utilité, des objets d’horreur. Ne dirait-on point vraiment qu’il n’est de joie, pour certains auteurs, que dans la description minutieuse, ardente, palpitante, satanique des pires tableaux de la perversité des hommes ou de la cruauté des choses ! Ils recueillent avec un soin jaloux tout ce que peut inventer le Malheur ; ils ne laissent se perdre aucun gémissement ; au besoin, ils apprendraient à la Douleur à enfanter.
Ceci vraiment — ne le pensez-vous pas ? — devrait être défendu par les lois qui ont la garde de la raison sociale. Que ferons-nous et que deviendra le monde — je vous le demande — le jour où la raison sociale fera faillite ? La société, c’est tout à fait certain, ne peut vivre sans la Raison. Il serait grand temps qu’on préserve celle-ci des coups regrettables qu’on lui porte.
Quant à l’auteur de ces lignes, que la nature a doué d’un esprit sain et pondéré — du moins, il le croit — il ne saurait prendre la moindre jouissance à tremper sa plume dans le sang des blessures aux lèvres fraîches. Il le dit bien haut avant de s’engager dans le récit des plus affreuses tortures morales et physiques qu’il ait été donné à une créature de Dieu de supporter. Mais ce qui ne saurait manquer de le soutenir dans cette tâche difficile, c’est qu’il sait que le récit des malheurs de Théophraste, plongé dans le sommeil de l’hypnose, est destiné à jeter un jour extraordinairement étourdissant sur les problèmes restés les plus obscurs de la chirurgie psychique.
Tout d’abord, on ne saurait trop engager le lecteur à se rendre un compte tout à fait exact des éléments de l’opération si monstrueusement singulière que va oser, dans son laboratoire de la rue de la Huchette, M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox. Si osée, notre parole, que cet homme de lumière a dit : « Je vais tenter Dieu ! » Il n’exagérait pas.
Tuer Cartouche sans tuer Longuet ! Voilà ! C’est simple ! c’est aussi simple que de dire : Que le monde soit ! C’est aussi simple que cela quand on est Dieu ; mais quand on est M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox, ce qui est cependant déjà quelque chose, on risque de tuer Longuet sans tuer Cartouche ! C’est une responsabilité des plus graves. Il est absolument inutile de tuer M. Longuet si Cartouche, dont l’âme n’aura pas été régénérée, doit réapparaître sur le globe en quelque nouvelle réincarnation ! Un autre qu’Éliphas eût certainement reculé.
Mais lui, nous l’avons dit, avait l’habitude des opérations psychiques les plus compliquées, et la délicatesse de son scalpel astral était universellement reconnue, même au Thibet. Il savait promener, sans hâte et sans fièvre, l’esprit à tuer autour de sa mort. Il le préparait ainsi au trépas. Il l’y amenait. Il lui faisait vivre sa mort jusqu’au moment où il lui faisait mourir sa mort. Alors, à ce moment juste, il fallait, oui, certainement, il fallait le geste d’un Dieu, le geste double qui précipitait à la mort l’esprit mort et ramenait à la vie l’esprit vivant.
Maintenant que nous avons parfaitement compris les données de l’opération et que nous avons assisté aux préliminaires de cette opération, qui ont consisté à faire vivre à Théophraste les derniers mois de la vie de Cartouche, descendons dans le laboratoire où gémit Théophraste sur son lit de sangle, dans le laboratoire qu’éclairent les flammes écarlates et sifflantes ; asseyons-nous aux côtés de M. Lecamus et de cette pauvre Mme Longuet, et qu’une anxiété charitable habite notre cœur.
Nous n’allons plus entendre que la voix impérative de M. de la Nox et la voix douloureuse de Théophraste. Aussi, pour que la moindre petite réflexion étrangère à une scène aussi sublime et aussi criminelle ne vienne nous troubler, nous allons la présenter sous forme d’interrogatoire. Le D. est M. de la Nox, l’R. c’est Théophraste. De cette manière aussi, l’auteur de ces lignes dégage sa responsabilité. Enfin, il ne saurait trop répéter que cet interrogatoire et les incidents qui l’entourent sont purement reproduits d’après la narration qu’en a laissée M. Lecamus.
D. Où te conduit-on, Cartouche ?
R. Dans la salle de la « question ». Mon procès est terminé, je suis condamné à mourir par la roue. Avant le supplice, ils veulent mes aveux, les noms de mes complices, de mes amis, de mes maîtresses. Je me ferais plutôt rouer deux fois ! Ils n’auront rien !…
D. Et maintenant, où es-tu, Cartouche ?
R. Je descends un petit escalier au bout de l’allée des Pailleux. On ouvre une grille… Je suis dans les ténèbres des caves… Ces caves ne me font pas peur… Je les connais bien, ah ! ah ! J’ai été enfermé dans ces caves sous Philippe-le-Bel !
D. (Avec une terrible autorité.) Cartouche ! Tu es Cartouche ! Tu es dans ces caves par ordre du régent ! (Il répète dans le fond de lui-même : Philippe-le-Bel ! Où allons-nous, mon Dieu ! où allons-nous ! Ne nous égarons pas !) Et maintenant, où es-tu, Cartouche ?
R. J’avance dans la nuit des caves. Il y a autour de moi tant de gardes qui marchent dans la nuit des caves que je ne pourrais en dire le nombre. Je vois là-bas, tout là-bas, un rayon que je connais bien. C’est un rayon carré que le soleil a oublié là depuis le commencement de l’histoire de France. Mes gardes ne sont pas des gardes françaises. On se méfie de tous les gardes françaises. Mes gardes sont commandés par le lieutenant de robe courte du Châtelet !
D. Et maintenant, où es-tu, Cartouche ?
R. Je suis dans la chambre de la torture. J’ai devant moi des hommes vêtus de longues robes, mais je ne distingue pas leurs visages. Ce sont mes commissaires qui ont été commis pour les recollements, suivant l’usage, paraît-il. Mais pourquoi appelle t-on cela recollements ? Cette pensée me fait sourire. (Théophraste sourit, en effet.)
D. Et maintenant, que fais-tu, Cartouche ?
R. On me pose sur la sellette. Le bourreau et ses aides placent mes jambes dans les brodequins. Ils serrent fortement les planchettes autour de mes jambes avec des cordes d’une dureté incroyable. Je crois bien que les gaillards vont me faire souffrir tout mon saoul et que la journée sera rude, mais j’ai le cœur serré de courage. Ils ne l’entameront pas !…
Ici, M. Théophraste Longuet, sur son lit de sangle, pousse un cri effroyable.
La bouche de Théophraste est grande ouverte et le hurlement s’en échappe toujours. Adolphe et Marceline sont penchés sur ; lui et se demandent avec horreur quand ce hurlement cessera et quand cette bouche se refermera…
Quant à M. Éliphas de la Nox, il dit :
— C’est la torture qui commence. Mais s’il se met à hurler comme cela au premier coup de maillet !… Ça ne va pas être drôle…
M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox ne s’attendait point à ces hurlements. Il calma l’émotion de M. Lecamus et de Mme Longuet d’un geste suprême et il voulut ordonner quelque chose à Théophraste, quelque chose qu’on ne sut jamais, car le hurlement, qui continuait, empêcha que l’on entendît ce quelque chose.
Enfin le hurlement devint gémissement et le gémissement lui-même se tut. La figure de Théophraste était redevenue relativement placide…
D. Qu’as-tu donc à crier de la sorte, Cartouche ?
R. Je crie parce que c’est un supplice terrible que de ne pouvoir dénoncer mes complices. Je les ai sur le bout de la langue ! Ils ne voient donc pas que si je ne les dénonce point, c’est que je ne puis remuer le bout de la langue ? Pourquoi Cartouche n’a-t-il pas remué le bout de la langue ? Moi, je ne peux pas ! je ne peux pas ! je ne peux pas ! Et ils vont encore venir avec leur maillet ! Et ils vont encore m’enfoncer des morceaux de bois dans les jambes ! C’est injuste ! Je ne peux pas remuer le bout de la langue !…
C. Et maintenant, qu’est-ce qu’on te fait, Cartouche ?
R. Le médecin et le chirurgien se penchent sur moi et me tâtent les poignets. Ils se félicitent d’avoir choisi ce genre de torture qui est, disent-ils aux commissaires, le moins dangereux pour la vie et le moins susceptible d’accidents. « Il n’y a rien au-dessus, proclament-ils, que la question des brodequins pour prolonger et pour rendre plus sensibles les douleurs, sans hasarder que le condamné succombe sous leur violence ou qu’il perde la connaissance et le sentiment[19]. »
D. Et maintenant, qu’est-ce qu’on te fait, Cartouche ?
R. Mais on ne me fait rien. Et je le regrette ! car on a décidé de ne m’enfoncer le second coin qu’une demi-heure après le premier, pour laisser passer l’engourdissement que produit ordinairement la ligature et pour que la sensibilité fût tout entière. Je regarde mes juges, ils ont des gueules noires ! J’aime mieux la figure du bourreau. Ça ne l’amuse pas plus que moi. Il voudrait être ailleurs et moi aussi. Mais le voilà qui revient avec le second coin. Ils sont tous autour de moi, ils sont sur moi…
… Aaaaaaaaaaaaaah !
« Jamais, raconte M. Lecamus, jamais la bouche de Théophraste ne m’avait paru aussi grande Dans son visage, il n’y avait plus qu’une bouche, une bouche qui ne remuait pas le bout de la langue, et cet abîme tumultueux qu’était cette bouche débordait avec fracas de ce « aaaaaaaaah ! » qui, telle une lave bouillonnante, en brûlait les bords ! En effet, nous pûmes constater que les lèvres éclataient ! C’était là, hélas ! un des moindres phénomènes que nous étions appelés à constater relativement à la douleur que Théophraste ressentait de la torture de Cartouche. Ce furent là de bien affreuses minutes Je regardais M. Éliphas de la Nox qui, lorsque ce second sinistre hurlement se fut tu, dit encore :
D. Pourquoi cries-tu ainsi, Cartouche ?
R. Je vous répète que c’est à cause que ces imbéciles ne me prennent point les noms que j’ai sur le bout de la langue ! Ce n’est pas de ma faute si Cartouche n’a pas dénoncé !
D. Mais Cartouche n’a pas crié ; pourquoi cries-tu, Cartouche ?
R. C’est Cartouche que l’on torture et c’est Théophraste Longuet qui crie !
M. de la Nox semble foudroyé par cette dernière réponse. Il se tourne vers M. Lecamus et Mme Longuet. Il dit d’une voix basse et tremblante :
— Alors, alors, alors, c’est lui qui souffre.
Et c’était la vérité. « On ne pouvait, dit M. Lecamus, en douter à l’expression effroyable du visage dans le moment que le bourreau enfonçait le coin. C’était Cartouche que l’on torturait et c’était Théophraste qui souffrait. Ceci prouvait l’identité de l’âme ; mais que la douleur n’eût pas cessé d’être effective, après deux cents ans, voilà ce qui consternait M. Éliphas de la Nox. C’était la première fois qu’un cas semblable se présentait sous son scalpel astral. La douleur de Cartouche criait, à travers deux siècles, et ce cri de la douleur qui n’était pas sorti de la bouche de Cartouche avait attendu, pour sortir, la bouche de Théophraste. »
M. Éliphas de la Nox se mit la tête dans les mains, sa lumineuse tête, et il pria, dit M. Lecamus. Il pria ardemment. Puis il se retourna encore vers nous :
— Nous n’en sommes, dit-il, qu’au second coin. Et il y en eut sept !…
— Il en reste encore cinq, fit Marceline, qui avait reçu du ciel le don des mathématiques. Je me demande si mon pauvre mari aura la force de les supporter.
M. Éliphas de la Nox se pencha sur le cœur de Théophraste et l’ausculta comme avaient fait le chirurgien et le médecin de Cartouche sur Cartouche, dans la salle de la torture, dix minutes auparavant.
— L’homme est solide, fit-il. Je crois que nous n’avons, à ce point de vue, presque rien à craindre. Il enterrera Cartouche.
« On me consulta, fait remarquer M. Lecamus, et je fus de cet avis, les larmes aux yeux, que puisqu’on avait tant fait, il eût été regrettable de « reculer », pour la sécurité future et pour le bonheur définitif de M. Longuet.
— C’est un mauvais moment à passer, fis-je.
Mme Longuet, avec un soupir où elle avait mis sa tendresse, qui est grande, pour son mari, dit :
— Certes ! c’est un mauvais moment à passer pour tout le monde ; mais il faut tuer Cartouche ! M. Longuet nous en remerciera après. Et puisque vous nous dites que l’homme est solide, faites, monsieur de la Nox, faites vite !
M. de la Nox reprit donc le cours de son interrogatoire :
D. Et maintenant, que fait-on de toi, Cartouche ?
R Ils m’interrogent. Je ne peux pas répondre. Depuis quelques minutes, je me demande ce que cet homme, dans le coin du cachot qui est à ma droite, peut bien faire. Je n’ai pas encore vu son visage ; il me tourne le dos et il masque un bruit de ferraille. Le bourreau, en ce moment, est bien tranquille. Il est appuyé contre la muraille et il bâille. Il y a une lampe sur la table qui éclaire deux hommes qui ne cessent d’écrire. Je viens d’apercevoir une petite lueur rouge derrière l’homme qui a devant lui un bruit de ferraille. L’aide du bourreau a desserré un peu le nœud des cordes, et cela me procure un soulagement dont je lui suis infiniment reconnaissant. Mais… Mais… Mais l’autre aide, de l’autre côté, tire, tire, tire… S’il continue à tirer ainsi sur les cordes, les cordes vont me couper les jambes. Je lui en fais l’observation, et les docteurs viennent me donner le crucifix à baiser. Derrière l’homme qui me tourne le dos, dans le coin de droite, et autour du bruit de ferraille, j’entends comme un grésillement de braise, et il y a des petites flammes rouges qui lèchent la pierre des murs. Entre les deux hommes qui écrivent, il y a un homme qui fait un signe. Le bourreau a une bonne figure. Je lui demande à boire. Certainement, j’aurais moins mal aux jambes si j’avais moins soif. Jésus ! Le bourreau ramasse son maillet. Mais je jure que je ne peux pas remuer les noms qui sont sur le bout de ma langue et qui sont si lourds qu’ils m’empêchent encore de parler. Enlevez-moi ces noms ! Enlevez-moi ces noms ! Vous ne les voyez donc pas ? Aaaaaaaaaaaaaaah !…
« Cette fois, raconte M. Lecamus, la bouche est fermée. Mais les lèvres découvrent les dents de telle sorte qu’on ne croirait plus qu’il y a des lèvres autour de ces dents. Ces dents sont serrées, serrées, tout à fait soudées, sans espoir qu’aucun levier les sépare jamais. On dirait les dents d’un mort qui serait mort en serrant les dents, et ce sont là des dents serrées pour l’éternité. Derrière ces dents gronde le cri démoniaque de la douleur. Le cri roule dans la bouche sans trouver d’issue, se heurtant à ces dents, mais on l’entend tout de même qui mugit de rage de ne pouvoir s’échapper librement, à cause de ces dents fermées. Puis, nous entendons un grincement aigu qui est bien le plus insupportable à l’oreille comme le bruit de l’ongle ou d’une pierre dans de la craie qui égratigne le tableau noir. Ce sont les dents de M. Longuet qui se brisent, qui éclatent sous la poussée du cri de la douleur. Des petits morceaux de ces dents ont été projetés autour de nous. À cet horrible spectacle, M. de la Nox, qui avait l’air ennuyé, nous avoua qu’il n’avait jamais assisté ni soupçonné que l’on pût assister à une souffrance aussi effective, et que cela tenait peut-être à ce qu’il n’avait, jusqu’à ce jour, opéré que des âmes réincarnées d’au moins cinq cents ans, et encore étaient-elles fort rares, celles de deux mille ans fournissant la majeure partie de sa clientèle. Je vis bien que, malgré toute sa science et toute son expérience, l’illustre auteur de la Chirurgie psychique était sensiblement désemparé. Comme il avait été un peu dur pour moi et qu’il m’avait traité tout à fait en amateur, j’en aurais pu concevoir quelque intime réjouissance, mais le supplice que supportait, sur l’heure, mon meilleur ami m’empêcha de tirer de cet incident toute la consolation morale qu’il m’apportait. M. de la Nox, qui ne tâchait même plus à dissimuler son trouble, aurait peut-être arrêté là l’opération s’il en avait eu le temps. Mais on enfonçait déjà le quatrième coin dans les jambes de mon pauvre ami, et les trois derniers autres coins se succédèrent avec une rapidité qui ne permit même point à M. de la Nox d’interroger M. Longuet. Pendant ces quatre coins, la bouche de M. Longuet, édentée, s’était rouverte, et ce qui s’en échappait n’avait plus rien qui ressemblât au cri des hommes.
» Ce cri était si inconnu et si curieux dans la bouche d’un homme que nous nous penchâmes sur la bouche, tremblants de terreur, pour voir comment un pareil cri pouvait se faire dans une bouche humaine. Nous nous penchâmes sur cette bouche, en nous enfonçant les doigts dans les oreilles, et nous vîmes le fond d’une gorge écarlate et vibrante où roulaient pêle-mêle le rugissement du lion, le hi-han de l’âne, l’aboiement du chien, le miaou du chat, le sifflement du reptile, le barrissement de l’éléphant et le piouïtt de la perdrix.
» Mme Longuet voulut s’enfuir, mais elle était si épouvantée qu’elle s’empêtra dans les plis de sa robe et s’étala de tout son long sur le carreau. Quand elle se releva — je l’y aidai — le cri avait à nouveau cessé, et M. de la Nox lui ordonna de se tenir tranquille et de rester à sa place, lui rappelant, d’un front sévère, qu’elle avait sa part de responsabilité dans l’opération. M. de la Nox nous avoua que « le pire était fait », ce dont nous fûmes tout à fait aises. Nous étions débarrassés, du moins le pensions-nous, de cette grosse histoire de la torture.
» Maintenant Théophraste reposait paisiblement sur son matelas de sangle. C’était une chose à considérer que cet apaisement immédiat suivant l’horreur de la souffrance. Il ne souffrait donc que pendant qu’on le faisait souffrir. Il n’en conservait, après, aucune douleur appréciable. Il n’y avait pas de suite dans la douleur ; c’est ainsi que nous nous expliquions que, dans les intervalles de la torture, il répondait à M. de la Nox, de la façon la plus naturelle, sans émotion physique. M. de la Nox reprit l’interrogatoire :
D. Et maintenant où es-tu, Cartouche ?
R. Je suis toujours dans la salle de la torture. Ah ! ils me tiennent ! Ils me tiennent bien. Mais on ne sait jamais. Je vous dis, je vous répète qu’ils croyaient bien me tenir le 1er avril dernier !… Ah ! ah ! voilà qu’ils me prennent les bras. Qu’est-ce qu’ils vont en faire ? Je crois bien, par les tripes de Mme de Phalaris ! que mes juges rigolent ! L’homme du milieu de la table dit : « Ordre du régent ; il nous faut des noms : tant pis s’il en meurt ! Les tenailles sont-elles prêtes ? Commencez par les mamelles !… » Ah ! ah ! l’homme à genoux devant le bruit des ferrailles et le grésillement des braises se lève, il passe au bourreau des tenailles rougies ! L’aide me découvre le sein droit… Ah ! ah ! par les tripes de Mme…
Aaaiiiauuuumaahuurrroihammamohuuuah !…
XIX
OÙ L’ON DÉCOUVRE QUE CE PAUVRE THÉOPHRASTE EST ENCORE PLUS À PLAINDRE QUE LES ÉVÉNEMENTS DU DERNIER CHAPITRE N’ONT PU LE FAIRE SUPPOSER.
« Nous n’étions pas au bout de nos peines, » écrit M. Lecamus, qui décidément m’apparaît comme un affreux égoïste. Cette phrase peint tout à fait l’état de son cœur, moins troublé par la douleur excessive qu’entraînait pour son ami la terrible opération que par les cris inharmoniques jaillis de sa bouche édentée.
C’est dans de pareils moments, à des heures aussi exceptionnelles, quand des événements imprévus dérangent la quiétude coutumière des amis que l’on pourrait croire les meilleurs, qu’il faut juger les gens. Voyez M. Lecamus. Il aimait Théophraste, puisqu’il lui eût donné sa bourse, mais il ne lui aurait pas sacrifié son repos. Il lui eût donné sa bourse parce que, jouissant d’une belle aisance, ce geste ne l’eût point dérangé, tandis que cela dérangeait les oreilles de M. Lecamus que Théophraste, pendant son opération, criât si fort. Je me sens, quant à moi, beaucoup moins d’estime pour M. Lecamus depuis qu’il a écrit en face de ce pauvre Théophraste, torturé sur son lit de sangle : « Nous n’étions pas au bout de nos peines. »
Enfin, s’il fallait m’en dégoûter tout à fait, je crois bien que je n’aurais qu’à analyser subtilement, mais sûrement, la façon dont il nous rapporte « le phénomène des cheveux ». À un moment de l’opération, pendant la torture, qui durait beaucoup plus que l’histoire officielle de Cartouche n’eût pu le faire supposer, ce qui prouve, entre parenthèses, qu’il ne faut ajouter qu’une foi médiocre aux histoires officielles, Théophraste ne criait plus. Et cependant on le torturait avec plus de cruauté que jamais, puisque quelques mots qui lui échappaient apprenaient à ceux qui l’entouraient qu’après lui avoir tenaillé aux fers rougis les mamelles et le gras des bras, le bourreau versait dans les blessures vives du plomb fondu et de la poix-résine[20]. Théophraste alors ne criait plus, mais on vit ses cheveux blanchir.
Eh bien ! si M. Lecamus a rapporté avec méchante humeur les cris insupportables poussés par Théophraste, il s’est quasi-complu à décrire le blanchissement des cheveux. À le lire, on voit bien que ce blanchissement le dérange beaucoup moins que les cris, et cependant il ne devait rester rien des cris après l’opération, tandis que les cheveux de M. Longuet étaient devenus blancs pour toujours. « Ils ont commencé à blanchir par les tempes, dit M. Lecamus, ce qui est naturel, mais nous ne nous en aperçûmes que lorsque la moitié de la chevelure était déjà blanche. Ce phénomène capillaire est certainement le plus curieux auquel j’aie jamais assisté. Certes, on est toujours un peu étonné de trouver le lendemain matin une chevelure dorée sur la tête d’une femme que l’on a quittée brune la veille au soir, mais, dans ce cas, on se doute un peu de ce qui s’est passé, tandis que nous ne pouvions nous expliquer la transformation mystérieuse et visible de la couleur des cheveux de M. Longuet que par sa douleur, que nous ne voyions pas et que nous n’entendions plus. Cette ondulation blanche s’avançait avec la même certitude et la même aisance que la vague à l’heure de la marée. Tous les cheveux mirent cinq minutes à peu près à devenir blancs, à l’exception d’une mèche qui garda sa couleur châtain sur le front de M. Longuet, ce qui n’était point d’un aspect déplaisant[21]. »
Et voulez-vous que je vous donne encore « le phénomène du ventre », d’après M. Lecamus ? Vous y chercherez également en vain le moindre sentiment de pitié. C’est tout à fait incroyable ; je n’aurais jamais cru à autant de sécheresse d’âme chez M. Lecamus.
Voici « le phénomène du ventre » :
« Le bourreau venait de couler de l’eau bouillante dans les oreilles de M. Longuet et nous pensions que cette fois la torture que l’on faisait souffrir au malheureux touchait à sa fin, quand Mme Longuet, qui depuis quelques instants ne cessait de pleurer, nous montra le ventre de son mari. Ce ventre se gonflait « à vue d’œil », comme avaient blanchi les cheveux. Cependant Théophraste ne faisait entendre le moindre cri. Bientôt, il fut nécessaire de déboutonner le gilet et le haut du pantalon, car tout le vêtement eût éclaté. Sous sa chemise, le ventre de M. Longuet dessinait un ballon qui, après avoir remué, resta immobile ; enfin, peu à peu, il diminua, et quand il fut revenu à un volume normal, M. de la Nox demanda au patient pourquoi son ventre avait pris cette forme insolite, et pourquoi il avait, lui, Théophraste, pendant le gonflement de ce ventre, conservé le plus parfait silence. Mon ami répondit qu’il aurait été bien embarrassé de parler, attendu qu’on lui avait mis un entonnoir dans la bouche, et que si son ventre avait ainsi gonflé, c’est qu’on avait versé dans cet entonnoir plusieurs seaux pleins d’eau ; enfin, qu’il avait rendu cette eau sans plus de dommage. »
M. de la Nox, un instant, se pencha si précipitamment sur le cœur de Théophraste que Mme Longuet crut à quelque issue fatale ; mais il résulta de la demande qui fut posée que Cartouche alors faisait le mort. Ses bourreaux et ses juges, et même les médecins, y furent trompés ; on le laissa seul une heure, et il en profita pour glisser dans une fente de la muraille contre laquelle il était appuyé un billet qu’il avait écrit de son sang avec une aiguille de bois, le matin même, dans son cachot de la tour Montgommery. C’était ce billet qui était le Document, et, sur une question que fit poser encore à ce propos M. Lecamus, on apprit que le Document révélait bien l’existence de très réels et importants trésors. Je ferai encore remarquer au lecteur combien l’attitude de M. Lecamus en cette occurrence était indécente. La vie de Théophraste était en danger et c’étaient encore les trésors qui le préoccupaient. Voulant même profiter de l’état de douloureuse hypnose dans lequel se trouvait M. Longuet, il tenta d’obtenir des renseignements complémentaires à cet égard. Mais M. de la Nox et Marceline elle-même mirent fin à cette scène regrettable, et M. Lecamus en fut pour sa rougeur et sa courte honte.
M. Lecamus, dans la relation de ces sensationnels événements, n’est point tendre pour M. de la Nox. Après l’avoir porté aux nues et nous l’avoir présenté comme le roi des théosophes, à seule fin de dégager sa responsabilité, il prend un malin plaisir à faire état de son trouble, de ses hésitations et de ses stupéfactions devant les phénomènes exceptionnels qui firent de cette opération psychique une opération historique, semée des enseignements les plus hardis dans le domaine scientifique occulte. Tout ceci prouve bien que M. Lecamus était un âne prétentieux. Le charlatanisme lui en eût imposé, mais la simplicité et la sincérité de l’attitude de M. de la Nox lui répugnaient. Il pensait aussi que le rôle de cet homme extraordinaire se bornait à dire sur une certaine modalité de ton : « Et maintenant, que fais-tu, Cartouche ? » Et il n’était pas éloigné de croire qu’il eût pu l’accomplir, tant il l’estimait banal. L’insensé ! M. Longuet serait mort entre ses bras dès la première minute et Cartouche se promènerait encore dans le maintenant ! Tout le travail astral de M. de la Nox échappait à M. Lecamus. Comment aurait-il pu, lui, dont les yeux étaient de chair, voir ce miracle psychique par lequel M. de la Nox rejetait Cartouche vers l’abîme et retenait Théophraste dans la vie !
Au début du récit de l’opération, je m’étais promis de n’interrompre cet illustre et divin interrogatoire d’aucune réflexion personnelle ; mais, vraiment, je suis sûr que tout le monde ici m’excusera et me pardonnera, car il est des moments où la bêtise et l’ignorance, irrésistiblement, nous arrachent des cris d’indignation.
Ceci dit, je reviens vite, et avec quelle émotion attendrie, à ce pauvre Théophraste sur son lit de sangle, car ce qui lui est arrivé ne saurait compter au regard des malheurs qui l’attendent.
XX
LA DERNIÈRE POIGNÉE DE MAIN DE CARTOUCHE
Le récit qui suit est la reproduction intégrale de ce qui est sorti de la bouche de Théophraste, toujours plongé dans le sommeil de l’hypnose, depuis le moment qu’il a subi la torture et qu’il a fait le mort. Cette pièce est de la plus haute importance, non seulement pour la science expérimentale spirite, mais encore pour l’histoire, car elle détruit la légende de la roue et nous expose de façon indiscutable la véritable mort de Cartouche. J’ai trouvé cette pièce non point dans le coffret en bois des îles, mais dans les papiers et rapports qui ont été lus au congrès spirite de 1889. Il est tout entier de la main de M. de la Nox, et je lui ai donné la préférence sur la narration in fine de M. Lecamus, qui est à chaque instant émaillée des réflexions les plus stupides.
Théophraste ou plutôt Cartouche, en puissance de M. de la Nox, dit :
— Je ne sais au juste ce qui m’est arrivé. J’ai fait le mort, j’ai caché le Document et je n’ai plus revu personne. Quand je rouvre les yeux (je les avais donc fermés et j’étais sans doute tombé, en les fermant, en quelque faiblesse semblable à la mort), je ne reconnais d’abord aucun des objets qui m’entourent, et j’ignore le lieu dans lequel on m’a transporté. Certainement, je ne suis plus dans la salle de la torture, ni dans mon cachot de la tour de Montgommery. Suis-je seulement encore dans la Conciergerie ? Je sais que non. Où m’a-t-on enfermé ? Après la torture, en attendant mon supplice dernier, en quelle prison nouvelle m’a-t-on jeté ? La première chose que je distingue est une lueur bleuâtre qui filtre en face de moi, au travers des barreaux épais et rapprochés d’une grille. La lune vient me visiter. Elle descend deux ou trois marches. Je tente de faire un mouvement, mais je ne puis. Je suis une chose inerte. Ma volonté ne commande plus à mes membres, ni à aucun de mes muscles. C’est comme s’ils avaient coupé toute relation entre ma volonté et ma chair. Mon cerveau n’est plus maître que de voir et de comprendre ; il n’est plus maître d’agir. Mes pauvres membres ! Je les sens épars autour de moi. J’ai dû atteindre à un degré de souffrance tel que je m’explique ainsi que je ne souffre plus. Mais où suis-je ?… La lune a descendu encore deux marches, et puis deux marches encore… Ah ! ah ! qu’est-ce qu’elle éclaire, la lune ? Elle éclaire un œil, un grand œil. C’est un œil énorme et profond dans lequel un corbeau, après l’avoir vidé d’un coup de bec, pourrait déposer son œuf. Mais l’œil est vide ; mais le grand œil est vide, et l’autre œil, à côté, qui est aussi éclairé maintenant, est encore recouvert de sa paupière verte. Je vois toute la tête. Elle n’a plus de peau sur les joues, mais elle a de la barbe au menton. La lune avance avec précaution ; elle s’arrête tout doucement dans des trous de nez. Il y a trois trous de nez. À un trou de nez par tête, cela fait trois têtes !… Ils m’ont donc jeté dans une fosse commune !… La lune vient jusqu’à moi : j’ai deux jambes de cadavre au travers du ventre. Je reconnais maintenant ces marches, et cette fosse, et cette lune… Je suis dans le charnier de Montfaucon !… j’ai peur !!!…
» Quand, les jours de ripailles, je montais aux Chopinettes par la rue des Morts, j’ai regardé ce charnier à travers les grilles ; je l’ai regardé avec curiosité, parce que j’y voyais déjà ma charogne ; mais jamais il ne m’était venu à l’idée que lorsqu’une charogne serait là, elle pourrait regarder de l’autre côté des grilles ! Et maintenant, ma charogne voit ! Ils m’ont jeté là parce qu’ils m’ont cru expiré, et je suis enterré vivant avec les corps de pendus ! Mon sort est tout à fait misérable et dépasse tout ce que l’imagination des hommes pourrait inventer. Les plus tristes réflexions viennent m’assaillir, et si je me demande d’abord par quel artifice du sort j’en suis réduit à une pareille extrémité, je me vois obligé de m’avouer que le sort n’est pour rien dans mon affaire, mais bien exclusivement mon orgueil. J’aurais pu continuer tranquillement à être « le chef de tous les voleurs » si j’étais resté vivable. Mais la Belle-Laitière avait raison quand, au cabaret de la « Reine-Margot », elle me disait que je n’étais plus vivable. Je n’admettais plus une observation et, quand je convoquais mon grand conseil, je ne tenais aucun compte des résolutions où il s’était arrêté. Je me plaisais à jouer au potentat et j’avais fini par prendre cette manie de découper en morceaux tous ceux que je soupçonnais. Mes lieutenants couraient plus de danger en me servant qu’en me desservant. Ils m’ont trahi et c’était logique. Le commencement de ma mauvaise fortune fut l’affaire du Luxembourg[22]. Elle aurait dû m’ouvrir l’œil, mais mon orgueil m’empêchait de voir clair. Il est bien temps de faire toutes ces réflexions, maintenant que je suis dans le charnier !
» Je suis vivant dans le charnier, avec les morts, et, pour la première fois de ma vie, j’ai peur ! Mais je n’ai pas peur des morts, j’ai peur des vivants, car il y a un vivant autour de moi ! Je sais qu’il remue. Il est étrange comme à cette minute, où je suis sur la limite de la vie et de la mort, mes sens perçoivent des choses qu’ils avaient ignorées dans la bonne santé, et cependant mes oreilles n’entendent plus, à cause de l’eau bouillante dont elles furent pleines. Ne serais-je donc point le seul à vivre dans ce domaine de la putréfaction ? Je me souviens que la Vache-à-Paniers m’a raconté que le comte de Charolais avait fait enfermer vivantes dans de petites fosses, sur la butte de Montfaucon, des femmes qui lui avaient résisté. Mais moi, Cartouche, je n’ai point voulu croire à un crime pareil. Je sais bien qu’il se baigne dans le sang des petites vierges qu’il fait tuer, pour se guérir de l’affreuse maladie qui lui dévore les chairs ; mais enfermer des femmes vivantes dans des fosses, ça, je ne le crois pas[23]. Et cependant, il y a, sur ma gauche, à côté de moi une femme qui remue dans une fosse !… Je ne l’entends pas, je la sens. La lune a allongé son rayon jusqu’à moi. Son rayon est divisé en trois par les barreaux de la grille. Cela fait trois bandes bleues dans lesquelles je vois d’abord le trou de l’œil et les trois trous de nez, et puis une bouche épouvantable qui me tire la langue. Après, il y a trois corps sans tête. Dans le flanc gauche du troisième corps, je distingue très bien la plaie putréfiée dans laquelle s’enfonça l’un des crocs de fer par lesquels fut pendu ce décapité. On ne pouvait le pendre par la tête, puisqu’il n’avait plus de tête. Comme je ne sens plus remuer la femme dans la fosse à côté, je me remets un peu et je m’occupe à dénombrer les corps qui emplissent le charnier. Je commence même à apercevoir ceux qui sont tout à fait dans les ténèbres. Il y en a ! Il y en a ! Parbleu ! On apporte ici tous les suppliciés de la ville[24]. Il y en a de frais, il y en a de pourris, il y en a de bien conservés et tout secs ; mais d’autres ne sont pas présentables : ils tombent en ruine. Je serai bientôt une ruine comme eux. Cependant, cependant, tout n’est pas dit, tout n’est pas fini ; puisque je suis, l’espérance n’est pas morte. On retrouve l’espérance même au fond d’un charnier. Ah ! si je pouvais remuer ? Les morts remuent ; je finirai bien aussi par remuer. J’ai tourné les yeux le plus qu’il m’était possible dans le coin droit de l’orbite et j’ai vu que le mort qui est sur mon ventre et qui remue n’a pas de tête. Il glisse sur mon ventre. Je recommence à avoir peur, non pas parce que le mort remue, car les charniers appartiennent aux morts, qui y font ce qu’ils veulent, mais parce que l’on tire ce mort par les jambes. J’ai retourné mes yeux dans l’autre coin, dans le coin gauche de l’orbite, et j’ai vu une jambe du mort en l’air. Cette jambe doit être tenue par quelque chose, tirée par quelque chose. La lune monte le long du mur avec la jambe jusqu’à un trou. Et mes yeux regardent tellement à gauche qu’ils voient une main vivante. La main vivante, qui sort du trou, tire le pied mort. Je sens, je sais qu’il y a dans la fosse à côté une femme qui mange[25]…
» Et maintenant, mes yeux ne quittent plus le trou, dans la terreur de voir revenir la main vivante, de voir s’allonger vers moi la main vivante… Mais j’espère, j’espère sur mon salut, que la main ne sera pas assez longue… La lune soudain cesse d’éclairer le trou, et mes yeux se tournent vers la grille par où la lune est entrée. Alors, je vois, entre la lune et moi, sur les marches du charnier, un homme ! Un homme vivant ! Je suis peut-être sauvé ! Je voudrais crier de joie et j’aurais peut-être crié, si l’horreur de ce que je sens tout à coup, de ce que je sais, ne m’avait soudain bouché la gorge. Je sens, je sais que cet homme est venu là, pour me voler mes os !… à cause de la courtisane Émilie !… Le régent s’est souvenu du duc d’Orléans et de Jean sans Peur[26] !…
» La courtisane Émilie ne veut plus le voir… Un os de Cartouche, qui en fut aimé, entre sa peau et sa chemise, pourrait, le diable s’en mêlant, la ramener dans son lit… Je sais cela… Mon regard a lu cela dans le cœur de l’homme qui descend les marches du charnier. Il vient là pour me prendre mes os !… Il allume une lanterne. Il va droit à mon cadavre. Il ne voit donc pas que les yeux de mon cadavre remuent !… Il tire de sous son manteau une lame d’acier aiguë et toute rouge dans le rayon de la lanterne… Il dépose sa lanterne… Il me prend par les épaules et me dresse à demi contre la muraille, au-dessous du trou. Il me prend la main gauche avec sa main gauche, et de la main droite m’enfonce la lame d’acier dans le poignet. Je ne sens pas la lame dans mon poignet, mais je la vois. Elle tourne autour de mon poignet… Elle va le trancher ; déjà elle le détache. Mais je commence à sentir la lame ! La vie renaît dans mon poignet ! Ah ! si mon poignet !… Ah ! si mon poignet !… Un dernier coup de sa lame et ma main gauche va lui rester dans sa main gauche !… Ah ! si mon poignet !… Ah ! si mon poignet !… Oui ! oui ! oui !!! La vie ! la vie ! la vie d’un nerf !… Je vous dis qu’il suffit de la vie d’un nerf !… Ah ! ah ! ah !!! L’homme hurle et casse d’un coup de pied sa lanterne… Ma main est partie dans la main de l’homme, mais par un dernier miracle de la vie dernière de mon poignet, ma main au moment où elle quittait mon bras a saisi la main de l’homme ! Et l’homme ne peut plus se défaire de ma main, qui s’est crispée en mourant et qui le tient ! et qui le tient ! et qui le tient ! Ah ! il agite, il secoue, il hurle, il secoue ma main qui le tient ! qui le tient ! Il tire avec sa main droite ma main qui est dans sa main gauche, mais on ne se débarrasse pas ainsi de la poignée de main d’un mort !… Je le vois qui s’enfuit du charnier en hurlant et qui bondit sur les marches, en agitant dans la lune, comme un fou, comme un fou, ma poignée de main…
» À ce moment, au-dessus de ma tête, une main que je ne vois pas, mais que je sens, sort du mur et me prend par les cheveux ! Elle me tire, me tire la tête ! Ah ! crier ! crier ! crier ! Mais comment crier avec ces dents vivantes qui me défoncent la gorge ! »
D. Et maintenant, Cartouche, où es-tu ?
R. J’entre dans les ténèbres rayonnantes de la mort !
XXI
DES INCONVÉNIENTS DE LA CHIRURGIE PSYCHIQUE
Ici, je reprends le rapport de M. Lecamus :
« Aussitôt que Théophraste eut prononcé ces mots : « J’entre dans les ténèbres rayonnantes de la mort », M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox fit un geste immense de son bras droit, se pencha sur le visage de mon ami et lui souffla impétueusement sur les paupières. Il lui dit :
» — Réveille-toi, Théophraste Longuet.
» Théophraste ne s’éveilla pas. Ses paupières restaient closes et son immobilité nous parut plus immobile encore. Et maintenant que sa bouche, sa pauvre bouche édentée ne parlait plus, maintenant que ses lèvres étaient aussi closes que ses paupières, il nous parut avec terreur avoir suivi Cartouche dans les ténèbres rayonnantes de la mort. Sa pâleur de cadavre, qui nous sembla — était-ce un effet de notre imagination ? — déjà tournée au vert, ses cheveux devenus subitement blancs, nous le montraient, en réalité, atrocement vieux mais de la vieillesse si hâtivement acquise au fond des tombeaux, où quelques minutes de pourriture vieillissent davantage que cent ans de vie. Était-il déjà mort ? Se décomposait-il déjà[27] ? M. de la Nox répétait ses grands gestes de fou sublime et un peu ridicule et lui ressoufflait sur les yeux à lui faire voler les cils, et recommençait à crier :
» — Théophraste Longuet ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Théophraste Longuet !…
» Dans le moment que nous croyions bien que Théophraste Longuet ne se réveillerait jamais plus, il se réveilla. Il tourna ses yeux vers nous en poussant un effrayant soupir, et nous dit simplement :
» — Bonzour ! Cartouce est mort !
» M. de la Nox nous dit :
» — Remercions Dieu : l’opération a réussi, et il recommença sa prière :
» — Au commencement tu étais le Silence ! Éon ! source des Éons !…
» Mme Longuet et moi nous nous étions précipités sur Théophraste en remerciant Dieu du fond du cœur. Certes ! l’opération avait été rude et, cependant, nous nous félicitions que Théophraste s’en tirât, en somme, avec un pot de teinture pour ses cheveux et un râtelier. Ce n’était pas acheter trop cher la mort de Cartouche. Nous lui dîmes de se lever et de nous suivre. Nous avions hâte de fuir cette maison de la rue de la Huchette, où il me semblait que nous étions depuis plus de deux cents ans. Mme Longuet embrassa son mari et lui dit doucement, en le prenant sous le bras :
» — Allons ! mon ami !…
» — Parlez plus fort, fit Théophraste, ze ne sais ce que z’ai dans les oreilles, ze suis quasi-sourd et puis ze ne puis plus remuer !
» — C’est que tu dois être un peu engourdi, mon chéri ! Depuis le temps que tu es étendu sans bouger sur ce lit de sangle, quoi d’étonnant à cela ? Mais, fais un effort, mon petit chat !
» — Parlez plus fort, vous dis-ze ! Ze remue encore les bras, mais ze n’ai plus aucun moyen de remuer les zambes. Ze veux les remuer et elles ne bouzent pas ! Et puis, z’ai des picotements dans les pieds !
» — C’est des fourmis ! mon petit ange. Secoue-toi, secoue-toi vite ! que nous rentrions chez nous. Nous n’avons rien mangé depuis ce matin et j’ai l’estomac dans les talons !
» — Moi, fit Théophraste tristement, ze ne sais ce que z’ai dans mes talons. Ze ne sais plus si z’ai des talons ; ils sont peut-être dans mon estomac !…
« Ensuite, Théophraste porta la main à sa bouche et dit :
» — Tiens ! le dentiste est venu ! Vous m’avez endormi pour m’arranger mes dents. Qu’est-ce que vous avez fait de mes dents ?…
» Chose curieuse, fait observer M. Lecamus, Théophraste réveillé zézayait et il n’avait pas zézayé dans son sommeil, après le départ précipité de ses dents. C’est, sans doute, que rien ne pouvait faire zézayer Cartouche, ni la douleur, ni même l’absence des dents de Théophraste. Je répétai :
» — Il faut partir !…
» Il répondit :
» — Évidemment, mais emportez-moi, car z’ai les zambes dans un état…
» M. de la Nox, que nous regardions, ne put retenir un sourd gémissement. Il eut enlevé le pantalon et les bottines de Théophraste en un tour de main : le caleçon fut ouvert avec des ciseaux et les chaussettes elles-mêmes jonchèrent le carreau. Alors ! Oh ! alors !… quel spectacle affreux ! et quelle douleur nous étreignit à la vue des malheureux membres de mon ami ! Les jambes et les pieds de Théophraste étaient en bouillie. La chair était arrachée par endroits et, en d’autres, horriblement meurtrie. Les mains tremblantes de M. de la Nox écartaient les vêtements qui recouvraient le thorax de ce pauvre Théophraste et, là aussi, nous vîmes, aux seins, deux sanguinolentes taches noires. Les biceps, que nous examinâmes, portaient également les marques fraîches de l’épouvantable torture[28]. Théophraste considérait ses jambes et ses bras et ses seins avec curiosité. Mme Longuet s’abattit sur sa poitrine en sanglotant ; quant à moi, je fis un geste qui menaçait le Destin et je courus chercher une voiture.
» Quand je revins, Mme Longuet pleurait toujours, Théophraste n’avait pas cessé de se plaindre de picotements aux jambes et demandait ce qui lui était arrivé pour qu’il lui fût impossible de les remuer et qu’elles lui apparussent en un état aussi sanguinolent. M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox, au lieu de répondre, était prosterné, le front dans la plus grande des humiliations. Ses mains étaient jointes, ses coudes étaient sur le carreau. Il disait, d’une voix lamentable qu’entrecoupait un immense sanglot : « Mon Bien-Aimé ! Mon Bien-Aimé, j’ai cru que j’étais ton fils, ô mon Bien Aimé ! J’ai pris mon Ombre pour ta Lumière ! Mon Bien-Aimé ! Tu as précipité mon orgueil ; je ne suis qu’un peu de nuit, au fond de l’Abîme obscur, moi, l’Homme de lumière. Et la nuit ne veut pas ! Et j’ai voulu, Moi : la nuit ! Je ne suis qu’un fils ténébreux du Silence, Éon, source des Éons ! Et j’ai voulu parler ! Ah ! la Vie ! la Vie ! Connaître la Vie ! Posséder la Vie ! Égaler la Vie !… Tentation ! Vertige de l’éternel Abîme ! Mystère du Ternaire ! Trois ! Oui, les trois Mondes sont Un ! et le Monde est trois ! C’était la vérité à Tyr, à Memphis ! à Babylone ! Un ! Deux ! Trois ! Actif, Passif et Réactif ! Un et un font deux ! Deux est neutre ! Mais ! mais ! mais, ô mon Bien-Aimé ! 1 et 2 font 12. 1 est Dieu ! 2 est la matière ! Mettez la matière à côté de Dieu ! Pythagore l’a dit et vous avez 12, c’est-à-dire l’Union !… C’est-à-dire ? C’est-à-dire ? Qui donc ici-bas a osé prononcer ces mots : c’est-à-dire ? »
» Puis il sanglota encore à fendre l’âme, cependant que Théophraste, sur son lit de sangle, disait :
» — Ze voudrais pourtant bien m’en aller d’ici. »
XXII
OÙ THÉOPHRASTE LONGUET REPREND GOÛT À LA VIE ET AUX TIMBRES EN CAOUTCHOUC. IL SE DISTRAIT DANS LA FRÉQUENTATION D’UN BOUCHER QUI TUE UN VEAU TOUS LES JOURS.
Les os n’étaient pas brisés et c’était tout juste. Quant aux plaies, elles exigèrent six semaines seulement pour se cicatriser. Théophraste ne souffrait pas, mais il dut garder le lit jusqu’au moment où il reconquit l’usage de ses jambes, ce qui n’arriva qu’à la fin du deuxième mois. Cependant ses oreilles le tracassaient toujours un peu, et l’eau bouillante qui y avait été versée avait cet effet de le rendre par moments tout à fait sourd. Pendant tout ce temps, il ne fit aucune allusion au Passé ; je ne parle point de ce misérable passé, qui se borne, dans l’esprit de tous, à ces quelques années qui se sont écoulées depuis notre dernière naissance terrestre, mais à l’autre passé, à celui dont la réapparition avait jeté un trouble si absolu dans la vie de cet homme ; et, pour M. Lecamus comme pour Mme Longuet, comme pour M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox, lequel était venu à son chevet, rue Gérando, presque tous les jours, Cartouche était mort, bien mort ! L’opération avait été extrêmement douloureuse, tellement qu’on avait pu redouter que Théophraste ne restât estropié jusqu’à la fin des derniers jours de sa vie actuelle, mais, à tout prendre, elle avait merveilleusement réussi. M. de la Nox ne cessait d’en remercier l’Éon, source des Éons.
Théophraste, à qui on avait posé les dents nécessaires, ne zézayait plus. Enfin, il songeait à se remettre « dans les affaires ». Il avait quitté bien jeune ses timbres en caoutchouc. À quarante et un ans, il avait pris sa retraite, à la suite de la découverte qu’il venait de faire d’un nouveau timbre en caoutchouc, qui marquait non seulement l’année, le mois, le jour, l’heure, la minute, la seconde, mais encore « le temps qu’il faisait », ce qui, paraît-il, était de la dernière importance pour certaines industries. Son esprit était à nouveau occupé par une innovation incroyable, qui devait bouleverser toutes les idées qu’on s’était faites jusqu’à ce jour sur les timbres en caoutchouc. Cette innovation était basée sur les derniers progrès de la cinématographie.
Que vous dirai-je de plus ? Quand il put marcher, il était redevenu si naturel, que Mme Longuet et M. Lecamus purent croire que leurs malheurs à tous trois avaient fatigué le Destin. Ce que c’est que le cœur des hommes !
Le moindre nuage qui passe à l’horizon les précipite à un désespoir hâtif et ils ne croient plus au jour ! La moindre lueur qui monte dans le ciel obscurci est une lueur d’espoir, et ils ne croient plus à la nuit.
Théophraste se levait de bonne heure et, après avoir déjeuné d’une tasse de chocolat et de rôties beurrées, allait faire un petit tour sur les boulevards extérieurs. Il essayait ses jambes. Il retrouvait leur ancienne élasticité.
Il s’arrêtait aux boutiques, regardait en détail le spectacle de la rue. Adolphe, dans les commencements, de loin, le suivait. Il ne remarquait rien d’anormal dans la façon d’être de Théophraste et, dans son rapport à M. de la Nox, se contenta de lui signaler ce fait, vraiment sans importance, d’une station un peu prolongée devant l’étal d’un boucher. Si cette station n’avait pas été quotidienne, elle eût passé inaperçue, même aux yeux avertis d’Adolphe. Théophraste, ses mains jouant derrière lui avec son ombrelle verte, regardait la viande saignante. Il avait aussi quelque petite conversation avec le boucher, un fort gaillard, carré des épaules, et qui avait toujours le mot pour rire. Un jour que M. Lecamus estimait que Théophraste avait passé beaucoup de son temps à l’étal du boucher, il le rejoignit, « comme par hasard », et le trouva, avec le patron, occupé à décorer de papillotes de papier frisé la viande toute fraîche. C’était bien inoffensif. Ainsi en jugea du reste M. de la Nox qui écrivit en marge du rapport de M. Lecamus : « Il peut regarder la viande saignante à l’étal du boucher. Il est bon de le laisser « voir rouge » de temps en temps. C’est la fin de la crise et ça ne fait de mal à personne. »
Cette boucherie était une petite boucherie qui avait sa spécialité. Il y a, à Paris, des boucheries où l’on ne vend que du cheval. M. Houdry vendait surtout, entre autres viandes communes, une exceptionnelle viande de veau. Ah ! quelle viande de veau ! Où M. Houdry faisait-il nourrir ses veaux ? Quel régime les veaux de M. Houdry suivaient-ils avant que de se montrer dans tous leurs avantages à son étal ? D’où venaient les veaux de M. Houdry ? Autant de mystères impénétrables qui faisaient la renommée et la petite fortune de M. Houdry. Quant à moi, je crois bien que l’excellence de la viande de veau de M. Houdry tenait moins au traitement que subissaient les veaux vivants qu’à la façon dont il les faisait trépasser. Tous les bouchers à Paris reçoivent leur viande des abattoirs. M. Houdry, lui, recevait son veau vivant, et tuait lui-même à sa manière. Je dis qu’il recevait « son veau ». Car, c’était un veau que M. Houdry tuait tous les jours que Dieu fait. Il ne tenait pas à vendre en grande quantité mais il vendait cher et il avait raison, car son mode de tuer ou plutôt « d’énerver » la viande faisait que celle-ci était tout de suite, et à ne s’y jamais tromper, appréciée des amateurs. Il ne se contentait pas de ne point assommer son veau ainsi qu’on le fait aux abattoirs, il le saignait à la mode juive avec un grand coutelas qu’il appelait « le saigneur », sans s’y reprendre jamais à deux fois, c’est-à-dire qu’il lui coupait la gorge sans revenir dans la blessure. En outre, il ne manquait point de rejeter un veau dès qu’il était « trèfle », c’est-à-dire dès qu’il avait quelque petite maladie de la fressure. Enfin, il y avait la façon dans tout cela.
M. Houdry avait, dans le plus grand mystère, expliqué son cas de sa viande de veau à M. Théophraste Longuet qui y avait pris un évident plaisir. Si bien que Théophraste, après avoir prêté l’oreille à la théorie, devant l’étal, avait manifesté le désir d’assister à une leçon de pratique. Dans une petite cour adjacente à l’étal, M. Houdry avait un abattoir clandestin. Certain matin, Théophraste, qui était survenu de meilleure heure que de coutume, trouva son homme à l’abattoir avec son veau. Le boucher pria Théophraste d’entrer et les portes se refermèrent sur eux.
— Je m’enferme tous les jours ainsi avec un veau vivant, dit M. Houdry, et quand les portes de l’abattoir se rouvrent, le veau est mort. Je ne perds pas mon temps. J’ai opéré en vingt-cinq minutes.
Théophraste le félicita. Il lui demanda quelques explications, s’intéressa à tous les objets qui frappèrent son regard. Le soufflet avec ses grands bras attira son attention. Il demanda comment cet instrument s’appelait, et on lui répondit que c’était un soufflet. Il vit aussi le treuil. Il apprit que cette forte barre de chêne munie de chevilles qui était suspendue au treuil s’appelait « tinet ». Il admira la solidité de ce brancard, également de chêne, qui a nom « étout ». Une hachette qui traînait fut appelée « feuille ». Mais ce qui l’intéressa davantage, ce fut, suspendue, au mur, la « boutique ». Dans cette boutique, qui était une sorte de sacoche pour coutelas, il vit d’abord le « saigneur » et se complut à passer tout doucement son index sur la lame longue, forte et affilée. Et puis ce fut le couteau, plus petit, dénommé « moutonnier », occupé d’ordinaire à dépecer le mouton, comme son nom l’indique, mais qui servait là pour certaines parties du veau. Puis, d’autres petites lames, dont la « lancette », pour « fleurer » le veau. « Fleurer » le veau consiste à faire de légers dessins artistiques, du bout de la lame, sur la peau du veau, une fois qu’il est « blanchi ».
Ce jour-là, comme je vous le dis, l’instruction de M. Théophraste Longuet porta sur les outils. Mais il fut dans la nécessité soudaine d’interrompre cette leçon, à cause de ses oreilles qui, une fois de plus, n’entendaient plus. Cette petite infirmité passagère était bien désagréable. Mais les jours suivants, ayant recouvré toute sa faculté auditive, il assista à toute l’opération, dans les détails de laquelle il entra sans trop de répugnance.
Il se contentait de dire tous les jours, en s’en allant, en manière de plaisanterie :
— Vous tuez tous les jours un veau ; vous devriez vous méfier, mon cher monsieur Houdry, vous verrez que ça finira par se savoir chez les veaux !
Théophraste n’était pas paresseux. Un jour que le jeune néophyte qui aidait M. Houdry à attacher le veau s’était attardé à quelque flânerie, il attacha lui-même la patte de derrière du veau, cependant qu’avec ses longes M. Houdry attachait les deux pattes de devant au même étout. Une patte restait libre ; c’était la manière. M. Houdry s’approcha de la gorge du veau avec le « saigneur ».
— Dire, fit-il avec mépris, dire qu’il y en a qui les assomment ? Ça marque toujours la tête.
— Évidemment ! confirma Théophraste. Quand on assomme, ça doit marquer la tête.
— Il se forme un dépôt de sang ! C’est un crime !…
— Oui, oui ! c’est un crime ! On ne tue pas une bête en lui fichant un dépôt de sang !…
— Tenez ! avec le « saigneur », il ne faut qu’un coup et un cou ! Ah ! ah ! un coup et un cou ! Ah ! ah ! comme cela !…
— Ah ! ah ! comme cela ! Ah ! ah !
— Le rabbin ne ferait pas mieux. On dirait que j’ai été boucher chez les juifs !… Ah ! ah !
— Ah ! ah !… Ah ! ah !… le sang pisse ! Regardez les yeux du veau pendant que le sang pisse ! dit Théophraste.
— Qu’est-ce qu’ils ont, les yeux du veau ? demanda M. Houdry ; c’est des yeux comme tout le monde.
— Regardez les yeux du veau qui vous regardent !
— Ses yeux sont morts !
— Ils sont morts, mais ils vous regardent !
— Eh bien ?
— Eh bien ? Vous n’avez pas peur des yeux d’un veau mort qui vous regardent ? Félicitations !… monsieur Houdry !… Félicitations !
— Ah ! ah !… Vous voulez rire !
— Ah ! non ! Permettez ! C’est vous qui riez ! Moi, je me garde à carreau. Le veau le voit bien. Tant pis, monsieur Houdry ! Tant pis ! Rira bien qui rira le dernier !…
Mais déjà M. Houdry, « qui n’avait pas de temps à perdre », « brochait » le veau avec son « fusil », près du nombril, et enfonçait dans l’incision le bout de son soufflet et soufflait.
— Regardez comme il gonfle bien ; il ne sera pas difficile à « blanchir ». Moi, je le souffle toujours ; sans ça, j’estime que c’est du mauvais travail. Du côté d’Orléans, on ne le soufflait pas autrefois ! Mais ils y sont revenus.
— Il faut toujours reconnaître ses erreurs, dit Théophraste.
M. Houdry finit de décoller la tête et coupa les quatre pieds aux joints. Puis d’un grand coup de son couteau, il pourfendit l’animal de haut en bas, et en croix d’un jarret à l’autre. Puis il « le blanchit », c’est-à-dire qu’il enleva le cuir de dessus le ventre et dessina sur la peau de petites choses aimables avec sa lancette. Puis quand le veau fut « fleuri », M. Houdry lui ouvrit le ventre complètement, lui trancha le quartier de derrière et dit :
— C’est le cul de veau !
— Pas mauvais, à la casserole, avec des carottes ! fit Théophraste.
Et Théophraste aida M. Houdry à attacher les pattes de derrière au « tinet », qui fut hissé à l’aide du treuil. Le veau était suspendu. Le boucher le vida de ses boyaux, de la fressure, du ris. Il souffla la fressure, ayant mis « le cornet » dans sa bouche. Les poumons étaient roses et volumineux ; Théophraste félicita M. Houdry sur « l’excellente santé du veau ». Il examina également le cœur et la rate, et dit :
— Bonne constitution ! Bonne constitution !… Il était fait pour vivre cent ans. C’est un pauvre malheureux veau !
Pendant que M. Houdry dépouillait le veau de ce qui lui restait de cuir dans le dos et l’habillait d’une belle nappe blanche pour l’étal, Théophraste avait fait « friser » la fraise dans l’eau bouillante, puis il demanda à son ami le boucher de lui laisser la toilette de la tête et des quatre pieds. Il y avait près de là de l’eau très chaude dans une chaudière. Il y jeta la tête et les quatre pieds. Puis il reprit la tête et, au-dessus de la chaudière, en gratta avec force le poil, l’échauda, la raffina, et prit tout son temps pour lui nettoyer les oreilles.
— Les oreilles, fit-il avec une joie d’ange, les oreilles, ça me connaît !…
Et, tout de suite, il acheta la tête de veau tout entière.
M. Houdry voulut la lui faire porter à domicile, mais il refusa et il la disposa avec soin au fond de son ombrelle verte, retournée, qui lui servit de panier.
— Au revoir, monsieur Houdry, dit-il, au revoir ! J’emporte ma tête de veau, mais je vous ai laissé les yeux. Je n’aime pas que des yeux de veau me regardent comme ces yeux-là vous ont regardé tout à l’heure ! Les yeux de veau mort, c’est méchant ! Vous riez, monsieur Houdry ! C’est votre affaire !… Félicitations, monsieur Houdry, félicitations !… Mais ça finira par se savoir chez les veaux !
Et il rentra chez lui.
Quand il se montra avec son ombrelle verte et sa tête de veau, Adolphe et Marceline se sourirent.
— Il s’amuse, dit Marceline.
— Ce sont des jeux innocents ! ajouta Adolphe.
XXIII
LA PARTIE DE DOMINOS. — LA LECTURE DES JOURNAUX APRÈS DÎNER.
Dans le cabinet où naguère encore ronronnait le petit chat violet, on avait fait le lit de M. Lecamus. M. Longuet occupait seul la chambre conjugale. Marceline habitait un petit lit de fer volant dans le salon. Ce petit lit n’était pas un embarras dans la journée, mais un ornement, car, replié et recouvert d’une housse à fleurs, il supportait la corbeille de Sarreguemines raccommodée depuis la nuit funeste où elle tomba en même temps que les oreilles de M. Petito. Après le dîner, on faisait une partie de dominos devant les tasses de café bouillant ; M. Lecamus, qui était Normand, s’amusait à des termes de terroir. Quand il posait le double-six, il s’écriait : « V’là l’ doub’ nègre ! » Quand il posait un cinq, il s’écriait : « Un quint ! (un chien) Ça mord ! » Quand il posait un as, il s’écriait : « L’asticot ? Amorce ! » Le trois l’incitait à cette phrase : « Si t’as du cœur, pose une queue d’cochon ! » (Le numéro 3 a, en effet, la forme enroulée d’une petite queue de cochon.) Il appelait le deux : « le gueux ! » Le quatre était flétri par lui de ce mot : « Ah ! la cateau ! » Enfin, il n’aurait pu poser un « blanc » sans annoncer : « la blanchisseuse ! »
Marceline s’amusait beaucoup de ces exclamations patoises, et elle était toujours prête à jouer aux dominos. Théophraste perdait souvent, non point qu’il ignorât le jeu, mais comme le pied de Marceline, sous la table, indiquait au pied d’Adolphe par des pressions réitérées le point qu’il fallait jouer pour gagner, le sort s’en trouvait tout désemparé. Mais c’était un plaisir que de voir perdre Théophraste, attendu qu’il avait au jeu le plus désagréable caractère du monde. Quand il avait perdu, il boudait.
Le soir qui nous occupe, Théophraste venait, ainsi que presque tous les autres soirs, de perdre et, le front méchant, s’était plongé en la lecture des gazettes. Il affectionnait par-dessus tout les « filets » politiques. Il avait des opinions arrêtées. Les barrières qui arrêtaient ses opinions étaient, au nord, « le despotisme des tyrans » et, au sud, « l’utopie socialiste ». Entre l’utopie socialiste et le despotisme des tyrans, il comprenait tout, disait-il, excepté cependant que l’on touchât à l’armée. Il répétait souvent : « Il ne faut pas toucher à l’armée. » C’était un brave homme.
Il lut donc le filet politique, sans le commenter tout haut cependant parce qu’il boudait. Et puis ses yeux furent attirés par ce titre : Cartouche n’est donc pas mort ?
Il ne put s’empêcher de sourire, tant il trouvait cette hypothèse absurde. Et puis il parcourut les premières lignes de l’article et laissa échapper ce mot : « Étrange !… » et cet autre : « Bizarre !… » et cet autre : « Surprenant !… » mais sans émotion particulière. Il jugea qu’il était temps de finir de bouder et il dit :
— Mon cher Adolphe, tu n’as pas lu cet article intitulé : Cartouche n’est donc pas mort ? C’est un étrange, bizarre et surprenant article.
Adolphe et Marceline ne purent retenir un mouvement et se regardèrent avec inquiétude. Théophraste lut :
« Cartouche n’est donc pas mort ? Depuis quelques jours, les agents de la Sûreté, dans le plus grand mystère, que nous avons du reste pénétré, ne s’occupent plus que d’une série de crimes bizarres dont on s’est efforcé de cacher les côtés les plus curieux au public. Ces crimes et la façon dont leur auteur échappe aux agents dans le moment qu’ils croient le tenir rappellent point par point la manière de faire du célèbre Cartouche ! S’il ne s’agissait d’une chose aussi répréhensible qu’une série de crimes, on pourrait même admirer l’art parfait avec lequel le modèle est imité. Comme nous disait hier un fonctionnaire supérieur du service de la Sûreté que nous ne nommerons pas, car il nous a recommandé le secret : « C’est Cartouche tout craché ! » Si bien que les agents eux-mêmes n’appellent plus le mystérieux bandit, sur la piste duquel ils se sont trouvés quelquefois, que Cartouche ! Du reste, l’administration, fort mystérieusement mais fort intelligemment — pour une fois nous ne ferons aucune difficulté de le constater — a fait remettre à trois d’entre eux un précis de l’histoire de Cartouche rédigé par MM. les bibliothécaires de la Nationale. Elle a pensé subtilement que l’histoire de Cartouche leur serait utile non seulement dans la tâche précise qui consiste aujourd’hui pour eux à prévenir les excentricités criminelles du nouveau Cartouche et à arrêter le nouveau Cartouche lui-même, mais encore il lui a semblé que l’histoire de Cartouche doit faire partie de l’ « instruction générale de tous les agents de police ou de sûreté ». Enfin, le bruit nous est venu que M. Lépine, préfet de police, de son côté, a ordonné que l’on consacrerait quelques cours du soir, à la préfecture, à l’histoire authentique de l’illustre bandit. »
Que dites-vous de cela ? demanda Théophraste avec une grande béatitude amusée. La farce est joyeuse, et les journalistes sont d’aimables cocos de nous sortir de pareilles bourdes !
Adolphe ni Marceline ne souriaient. Marceline avait un léger tremblement dans la voix quand elle pria Théophraste de « continuer ». Il reprit paisiblement le cours de sa lecture.
« Le premier crime du nouveau Cartouche, celui du moins dont la Sûreté eut tout d’abord à s’occuper, ne présente point cette horreur que nous retrouvons dans quelques autres. C’est un crime galant. Disons tout de suite que tous les crimes dont nous avons connaissance et que l’on attribue au nouveau Cartouche ont été accomplis depuis quinze jours au plus, et toujours de onze heures du soir à quatre heures du matin ! »
Mme Longuet s’était levée toute pâle ; M. Lecamus la fit se rasseoir assez brutalement et un serrement furtif de sa main lui commanda de se taire.
Théophraste dit :
— Qu’est-ce qu’ils veulent dire avec leur nouveau Cartouche ! Moi, je ne connais que l’ancien ! Enfin, voyons le crime galant !…
Et il lut, toujours de plus en plus calme :
« Une femme, une jolie femme, très connue à Paris, où son salon littéraire est couru de tous ceux qui s’occupent avec élégance des choses du spiritisme — nous croyons ainsi l’avoir suffisamment désignée sans cependant la compromettre — une femme, une jolie femme procédait, vers une heure du matin, à sa toilette de nuit et s’apprêtait à prendre un repos bien gagné, à la suite des fatigues qui lui étaient échues ce soir-là, avec les tracas d’une conférence à domicile par le plus illustre de nos Pneumatiques, quand soudain la porte-fenêtre de son balcon s’ouvrit avec impétuosité et un homme, d’une taille un peu au-dessus de la moyenne, jeune encore et extrêmement vigoureux (ce dernier détail est dans le rapport de la police), mais la chevelure entièrement blanche, se précipita à ses pieds. Il avait dans la main un revolver au brillant nickel.
» — Madame, dit-il à cette femme épouvantée, remettez vos esprits. Je ne vous veux point de mal. Considérez le plus humble de vos serviteurs. Je m’appelle Louis-Dominique Cartouche et je n’ai d’autre ambition que de souper à vos côtés. Par les tripes de Mme de Phalaris ! j’ai une faim de tous les diables. Et il se prit à rire.
» Mme de B… (appelons-la Mme de B…) crut avoir affaire à un fou, mais ce n’était qu’un homme déterminé à souper avec Mme de B…, dont il disait apprécier depuis longtemps la grâce particulière. Et cet homme était beaucoup plus dangereux qu’un fou, car il fallait lui céder, à cause du revolver au brillant nickel.
» — Vous allez, dit l’homme, appeler vos gens et leur commander de vous apporter ici un excellent souper. Ne leur donnez aucune explication qui pourrait me causer quelque désagrément, car alors vous êtes une femme morte.
» Mme de B… prit son parti, car elle est brave et d’un esprit assez élevé pour faire face aux plus inattendues aventures. Elle sonna sa femme de chambre et, un quart d’heure plus tard, l’homme aux cheveux blancs et Mme de B… étaient assis devant un en-cas fort convenable et les meilleurs amis du monde. Le souper se prolongea et l’homme, paraît-il (car nous ne voulons rien affirmer quant à ce point si intéressant, mais un peu scabreux de cette véridique histoire), l’homme ne redescendit par le chemin du balcon qu’aux seconds feux de l’aurore. La belle Mme de B… n’en est point à un souper près et, certes, elle ne se fût point plainte de ce souper forcé, qu’elle avait fini par partager de bonne grâce, si elle n’avait été dans la nécessité de conter son aventure au commissaire de police. Et voici dans quelles circonstances. Le commissaire se fit, quelques jours plus tard, annoncer chez Mme de B… Il lui dit que l’anneau qu’elle portait au doigt et sur lequel brillait un diamant magnifique, était la propriété de Mlle Émilienne de Besançon ; qu’elle en ignorait sans doute, elle, Mme de B…, la provenance ; qu’on lui en avait fait cadeau bien certainement. Mais Mlle Émilienne de Besançon, qui avait aperçu la veille, dans une vente de charité, ce diamant au doigt de Mme de B…, le reconnaissait formellement comme sien. Elle en avait fourni, du reste, toutes preuves, et ce diamant avait une monture tout à fait unique qui ne pouvait laisser de doute. Mme de B… se troubla infiniment et dut conter l’aventure qui lui était survenue. Elle parla de l’inconnu, du balcon, du souper et du reste, c’est-à-dire de la reconnaissance que cet inconnu lui avait montrée de son souper, en lui passant au doigt ce diamant magnifique qu’il tenait, dit-il, d’une femme qu’il avait beaucoup aimée, mais qui était morte depuis quelque temps, de Mme de Phalaris. Mme de B… ne pouvait être soupçonnée. Elle fournit une preuve : le revolver au brillant nickel, que l’inconnu avait laissé sur la table de nuit. Enfin, elle pria également le commissaire de police de faire reprendre chez elle cent bouteilles de champagne de premier choix que l’inconnu lui avait expédiées dès le lendemain de cette exceptionnelle nuit, sous le prétexte que son souper avait été exquis, mais que le champagne seul avait « laissé à désirer ». Elle craignait que, comme l’anneau, le champagne n’eût été volé. Le commissaire quitta la belle Mme de Bithynie tout rêveur. (Le nom nous échappe en toutes lettres ; nous ne le rattrapons point. Rien n’eût pu faire que demain il ne fût dans toutes les bouches, car tout le monde va s’occuper désormais du nouveau Cartouche.)
» Cette petite aventure, qui est la moindre de celles que nous avons à conter, est la reproduction quasi-fidèle de ce qui s’est passé, dans la nuit du 13 juillet 1721, chez Mme la maréchale de Boufflers. Elle procédait, elle aussi, à sa toilette. Le jeune homme qui survint par le balcon n’avait pas dans la main de revolver au brillant nickel, mais il portait à la ceinture six pistolets anglais, il demanda à souper, après s’être présenté comme Louis-Dominique Cartouche. Et la veuve de Louis-François duc de Boufflers, pair et maréchal de France, héros de Lille et de Malplaquet, soupa avec Cartouche et, ma foi, fort avant dans la nuit.
» Cartouche ne se plaignit que du champagne et Mme de Boufflers en reçut cent bouteilles le lendemain ; il les avait fait prendre par son sommelier Patapon dans les caves d’un gros financier.
» À quelque temps de là, une des bandes de Cartouche arrêtait, la nuit, dans une rue de Paris, un équipage. Cartouche se pencha dans la voiture pour reconnaître les visages. C’était Mme la maréchale de Boufflers. Il se retourna vers ses gens.
» — Laissez passer librement, aujourd’hui et toujours, Mme la maréchale de Boufflers ! ordonna-t-il d’une voix retentissante.
» Et il salua la maréchale fort bas, après lui avoir glissé au doigt un diamant magnifique qu’il avait préalablement volé à Mme de Phalaris. Mme de Phalaris ne le revit jamais !
» Et maintenant, passons au crime de la rue du Bac.
XXIV
MADAME THÉOPHRASTE LONGUET DEMANDE À M. LONGUET CE QU’EST DEVENU SON REVOLVER AU BRILLANT NICKEL, ET M. LONGUET RÉPOND QU’IL N’EN SAIT RIEN. M. LONGUET CONTINUE SA LECTURE.
Marceline s’était levée, autant pour cacher son émotion que pour constater que le revolver au brillant nickel ne se trouvait plus dans le tiroir de la table de nuit. Quand elle fut de retour dans la salle à manger, M. Longuet lui demanda la raison de son trouble. Marceline répondit que le revolver n’était plus dans le tiroir de la table de nuit. Théophraste lui conseilla de se calmer et déclara, sur un ton sans réplique, que puisque le revolver n’était pas dans le tiroir de la table de nuit, il devait être ailleurs et que cela n’avait aucune importance.
— Nous allons donc nous entretenir, dit-il, avec ce monsieur le journaliste, du crime de la rue du Bac. L’histoire de Mme de Bithynie n’est point faite pour nous décourager. C’est un homme renseigné qui a écrit cela. Cependant, j’aurai à relever dans sa narration quelques petites inexactitudes et quelques omissions qui sont, après tout, excusables. Ainsi Mme de Bithynie, d’après ce monsieur le journaliste, aurait été victime, après le souper, des exigences amoureuses de l’homme aux cheveux blancs. C’est là une erreur que je ne saurais laisser se propager. Ma réputation en souffrirait. Quand je me présentai à Mme la maréchale de Boufflers, le 13 juillet 1721, je n’avais d’autre intention que de souper. Ces messieurs les historiens racontent que je fis subir les derniers outrages à Mme la maréchale de Boufflers. Ces messieurs les historiens sont des sots. J’ai beaucoup aimé Mme la maréchale à cause de son esprit, et nous eûmes ainsi le commerce le plus galant, mais aussi le plus honnête. Que messieurs les historiens réfléchissent un peu et qu’ils étudient les dates. Ils apprendront que Mme la maréchale avait, en 1721, dépassé la soixantaine, et vraiment j’ose dire que Cartouche avait d’autres morceaux à se mettre sous la dent. J’admets cependant que Mme la maréchale, malgré sa soixantaine, était d’un esprit si éveillé que nous passâmes en conversation la nuit la plus chaude du monde. Après ! Le diable n’y eût pas trouvé son compte. Quant à Mme de Bithynie, c’est une autre affaire. Mme de Bithynie est jeune et son ardeur est telle qu’il est bien difficile de lui résister. Mais je n’y suis pour rien ! Moi, je ne lui demandais qu’à souper ; le reste ne me regarde pas.
Théophraste, disant ceci, agitait l’index de la main droite avec autorité, et ce n’est ni Marceline ni Adolphe qui eussent osé le contredire. Marceline et Adolphe, oubliant toute prudence, se serraient les mains avec une émotion communicative.
Théophraste reprit le journal :
« L’histoire de la rue du Bac est beaucoup plus simple et plus rapide. Le préfet de police avait reçu un billet ainsi conçu : « Si tu l’oses, viens me trouver ! Je suis toujours chez Bernard, au cabaret de la rue du Bac. » C’était signé : Cartouche. La chose se présentait après l’histoire de Mme de Bithynie. Le préfet de police dressa l’oreille et ses plans. Le soir même, à minuit moins un quart, une demi-douzaine de policiers envahissaient le cabaret de la rue du Bac. Ils furent reçus à coups de chaise par un homme d’une force merveilleuse, encore jeune, dont les cheveux étaient tout blancs. Trois hommes restèrent étourdis sur le carreau et les trois autres n’eurent que le temps de tirer dans la rue les trois corps endoloris de leurs camarades, pour qu’ils ne fussent point consumés par un incendie qu’avait allumé au premier étage l’homme aux cheveux blancs. L’homme se sauva par les toits, en sautant d’un toit à l’autre, au-dessus d’une courette étroite, mais formant une sorte de puits de plus de dix mètres de hauteur[29]. Il y avait de quoi se rompre dix fois le cou. »
— Ah ! ah ! s’interrompit Théophraste. Voilà qui me plaît. Trois hommes sur le carreau ! J’ai été moins heureux, rue du Bac, l’autre siècle. Car je laissai là neuf de mes lieutenants, qui furent arrêtés, malgré le massacre des troupes policières. Je crus tout perdu, mais il ne faut jamais désespérer de la Providence !
« Le nouveau Cartouche — continua-t-il après avoir repris son journal, parmi le silence effaré de M. Lecamus et de Mme Longuet — le nouveau Cartouche (sont-ils assez stupides de l’appeler le nouveau Cartouche), a fait des siennes rue Guénégaud. Il y a là une sorte de voûte-passage que traverse une planche. On a trouvé sous cette planche, il y a quelques jours, le corps d’un jeune polytechnicien (il s’agit ici de la mort de M. de Bardinoldi, dont le mystère a si fort intrigué la presse). Ce que la police n’a confié à personne, c’est que sur la tunique de ce polytechnicien était épinglée une petite carte où l’on avait écrit au crayon : « Nous nous reverrons dans l’autre monde, monsieur de Traneuse. » Ceci est encore à n’en point douter, un crime du nouveau Cartouche, car l’ancien (il faut être bête, s’écria Théophraste, comme un journaliste, pour s’imaginer qu’il y a deux Cartouche), car l’ancien a, en effet, à cette place, assassiné un officier ingénieur nommé M. de Traneuse. Cartouche l’avait assommé d’un coup de canne derrière la tête, et le polytechnicien a eu le crâne fracassé, par derrière, avec un objet contondant. »
Théophraste se livra à quelques commentaires.
— Ils disent aujourd’hui : objet contondant. Objet contondant ! cela sonne bien ! Objet contondant me plaît… Vous faites une drôle de tête, dit-il à Marceline et à Adolphe, et vous voilà serrés l’un contre l’autre comme si vous redoutiez une même catastrophe ! Vous avez bien tort de vous faire de la bile pour quelques méchantes plaisanteries. Je profite de l’occasion, mon cher Adolphe, pour t’expliquer la joie que j’ai à fréquenter la rue Guénégaud. Cette histoire de M. de Traneuse fut pour moi l’origine d’une des plus jolies farces que je jouai aux mouches de M. d’Argenson. À la suite de cette exécution de M. de Traneuse, qui s’était permis sur mon compte des propos fort déplacés, je fus poursuivi par deux patrouilles du guet qui m’enveloppèrent et rendirent toute résistance impossible. Mais ils ignoraient que j’étais Cartouche et se contentèrent de me conduire au Fort-l’Évèque, qui était la prison la moins sévère de Paris, où l’on enfermait les dettiers, les comédiens incivils et les gens qui n’avaient pas payé l’amende. Ils surent seulement qu’ils avaient pris Cartouche le 10 janvier ; mais le 9, au soir, Cartouche s’était évadé et reprenait la direction de sa police. Il était temps, car tout allait de travers dans les rues de Paris. Ma chère Marceline, mon cher Adolphe, vous avez des mines d’enterrement. Cet article ne manque cependant point d’un certain sel. J’ai cru tout d’abord à une facétie de folliculaire, mais je vois bien que c’est très sérieux, croyez-moi ! et attendez l’histoire du veau ! Ah ! ah ! nous n’en sommes encore qu’à l’affaire des Petits-Augustins !… Écoutez !
Théophraste, qui avait ramassé son journal, assujettit ses besicles d’or et reprit :
« Ce qu’il y a de plus extraordinaire dans cette incroyable aventure, c’est que plusieurs fois, depuis huit jours, on a été sur le point de prendre le Cartouche moderne et qu’il s’est toujours évadé, ainsi que l’autre, par les cheminées. C’est ainsi que l’histoire nous apprend que le vrai Cartouche, le 11 juin 1721, eut le dessein de mettre à sac l’hôtel Desmarets, rue des Petits-Augustins. C’est un de ses hommes, le Ratichon, qui lui avait indiqué le coup à faire. Mais Cartouche et le Ratichon avaient été « mis dedans » par la police. Sitôt que Cartouche fut dans la maison, les archers accoururent et la place fut investie. Lui, tranquillement, fit fermer les portes des salons et éteindre les lumières, se déshabilla, grimpa dans la cheminée, descendit par une autre cheminée dans la cuisine, où il trouva un marmiton, tua le marmiton, se déguisa avec les habits du mort, sortit enfin de l’hôtel, mettant à mal, de deux coups de pistolet, deux archers qui lui demandaient des nouvelles de Cartouche. Eh bien ! que direz-vous quand vous saurez que notre Cartouche, traqué avant-hier dans une pâtisserie du quartier des Augustins, s’est échappé par la cheminée, après avoir revêtu, par-dessus ses effets, qu’il désirait sans doute ne point salir, une blouse de pâtissier qui a été retrouvée sur les toits, ainsi que le pantalon du même pâtissier. Quant au pâtissier, on l’a retrouvé à moitié fondu dans son four !… Mais avant de l’y mettre, précaution humanitaire, le Cartouche moderne l’avait préalablement assassiné ! »
Ici, Théophraste s’interrompit encore.
— Préalablement ! s’écria-t-il, préalablement ! Ces journalistes sont épatants !… Je l’avais préalablement assassiné !… Mais pourquoi fuyez-vous ainsi dans les coins ? Est-ce que je vous fais peur ? Voyons, mon cher Adolphe, ma chère Marceline, un peu de sang-froid. Vous en aurez besoin pour l’histoire du veau !
XXV
LA REVANCHE DU VEAU.
« Jamais, dit Théophraste dans ses mémoires qui, dès cette époque, commencent à être empreints d’une immense mélancolie, jamais ma femme ni M. Lecamus ne m’avaient présenté figures pareilles à la lecture d’un article de journal. S’il faut s’effrayer de tout ce que racontent les journaux, nous avons de la terreur sur la planche ! Ces petits faits diversiers, particulièrement, se plaisent à nous retracer les événements avec une imagination surprenante pour le crime. Il leur faut leur sang quotidien. C’est même risible : un coup de couteau de plus ou de moins ne leur coûte rien, et à moi ça me fait hausser les épaules. Oui, vraiment, les coups de couteau de MM. les journalistes ne sauraient troubler la parfaite sérénité de mes digestions et, je le répète, je hausse les épaules.
» Ma femme, quand je fus arrivé à cet endroit de l’article où Cartouche a déposé le mitron dans le four, laissa échapper un gémissement, comme si ce mitron était son frère, et, abandonnant sa chaise, recula peu à peu jusque derrière la desserte, dans le coin de gauche de la salle à manger quand on entre par le vestibule. M. Lecamus avait une attitude au moins aussi ridicule, mais lui, il fit retraite vers le coin de droite, toujours quand on entre par le vestibule. Ils me regardaient avec insistance et, ma foi ! on leur eût présenté à la foire quelque phénomène, comme un mangeur de lapins vivants, qu’ils ne l’eussent point considéré d’autre sorte ; c’en était déplaisant. Je ne leur cachai point que toute cette comédie était indigne de deux êtres de raison et les engageai à reprendre leurs places à mes côtés ; mais ils n’en firent rien. Alors, j’entamai l’histoire de la « Revanche du Veau. »
» Je lus :
» M. Houdry est boucher sur les boulevards extérieurs. Sa spécialité est la viande de veau. On vient lui acheter du veau à la ronde. Cette renommée s’explique par un fait si exceptionnel que nous n’avons voulu y croire que sur l’affirmation réitérée de M. le commissaire de police Mifroid, lequel a procédé à la première enquête. On sait que tous les bouchers de Paris reçoivent leur viande des abattoirs. Il leur est défendu de tuer chez eux. Or, M. Houdry tuait tous les jours un veau à domicile.
» — C’est exact, interrompis-je c’est absolument exact ; M. Houdry me l’a expliqué plusieurs fois, et la confiance qu’il me marqua en me mettant dans la confidence de son mystérieux abattoir m’étonna quelque peu. Pourquoi me révéla-t-il à moi un fait qui n’était connu que de sa femme, de son petit commis, enfant trouvé qu’il considérait comme de la famille, et de son beau-frère qui, toutes les nuits, lui apportait le veau ? Pourquoi ? Ah ! on ne sait pas ! C’était peut-être plus fort que lui ! Vous savez bien qu’on n’échappe pas à sa destinée. Moi, je lui disais : « Prenez garde ! ça finira par se savoir chez les veaux ! »
» Je repris ma lecture :
» Ce veau lui était apporté en silence chaque nuit par un sien beau-frère, et comme la petite cour où se trouve son abattoir donne par derrière, sur des terrains vagues, nul ne vit jamais chez M. Houdry un veau vivant.
» D’où venait ce veau vivant ? L’enquête nous l’apprendra bientôt, car M. le commissaire de police Mifroid est bien décidé à pénétrer tout le mystère de cette épouvantable histoire de veau, qui se rattache, hélas ! comme on le verra plus loin, à l’histoire vraiment miraculeuse des hauts méfaits du nouveau Cartouche. (Allons, bon ! interrompis-je, c’est encore Cartouche qui va trinquer dans cette affaire. Pauvre Cartouche !) Si M. Houdry tenait tant à tuer lui-même son veau, c’est qu’il avait sa manière, une manière qui donnait toute sa qualité à la viande de veau. (Oui, interrompis-je, il n’assomme pas, parce que quand on assomme ça marque la tête.) Il coupe la gorge du veau d’un seul coup (il la coupe, interrompis-je, avec le « saigneur »), il énerve la viande… (Au fait, interrompis-je, il faut que je vous explique ce que c’est que « le saigneur », et après avoir remué les couverts dans le tiroir de la desserte, je pris le couteau à découper et leur dis que « le saigneur » — ainsi nommé parce que c’était avec lui que l’on saignait — était au moins deux fois grand comme le couteau à découper ; je le fis passer sur le nez de M. Lecamus en lui imprimant un double mouvement pour leur faire comprendre que c’était là le mouvement à éviter : « On ne doit point revenir dans la blessure » ; même je voulus mettre le couteau dans la main de M. Lecamus, mais celui-ci recula encore, tout à fait dans le coin de droite de la salle à manger, quand on entre par le vestibule, et il s’enveloppa dans les rideaux de la fenêtre ; il faisait l’enfant.)
» … Hier, de grand matin, M. Houdry s’enferma dans son abattoir, comme tous les jours, avec son veau. Il s’était fait aider de son petit commis pour attacher le veau sur l’étout, sorte de brancard qui est de toute utilité pour ce genre d’opération ; le veau attaché, le petit commis s’occupa à rincer des barriques dans la cour, devant la double porte de l’abattoir que le boucher tient toujours close.
» Ordinairement, M. Houdry met de vingt à trente minutes pour tuer son veau, le vider, le blanchir (le blanchir, interrompis-je, c’est lui décoller le cuir du ventre), l’habiller pour l’étal. Trente-cinq minutes s’écoulèrent et la double porte de l’abattoir ne se rouvrait pas ; le petit commis, qui avait fini de rincer ses barriques, en marqua tout haut quelque étonnement. Souvent, M. Houdry lui criait de venir échauder la tête, gratter les poils et nettoyer les oreilles. Ce jour-là le patron ne l’appelait pas. Sur ces entrefaites, Mme Houdry, la femme du boucher, se montra sur le seuil de la cour. « Qu’est-ce qu’il fait donc ? dit-elle ; il n’en finit pas aujourd’hui ». — « C’est vrai, madame, il est bien longtemps. » Alors elle appela : « Houdry ! Houdry ! » Pas de réponse ; elle traversa la cour et entr’ouvrit la porte de l’abattoir. Le veau aussitôt s’en échappa et se prit à sauter avec grâce autour d’elle. (Ah ! mon Dieu ! interrompis-je ; ah ! mon Dieu ! je redoute un grand malheur !) Elle regarda d’abord le veau avec émotion, car, à cette heure, le veau devait être mort, puis elle poussa d’un seul coup la double porte et appela encore son mari qui ne lui répondit point. Elle se tourna vers le commis :
» — Houdry n’est point là, dit-elle. Tu es sûr qu’il n’est pas sorti ?
» — Oh ! madame ! j’en suis tout à fait sûr ; il n’est pas sorti et personne n’est entré ! Je n’ai pas quitté la cour, répliqua le commis en sautant à la tête du veau qui continuait à cabrioler avec grâce. Bien sûr il est là. Il se cache pour vous faire peur ! Il ferait mieux de cacher le veau !
» — Houdry ! Houdry ! réponds-moi, Houdry ! Tu te caches pour me faire peur !…
» Le petit commis, d’un tour de longe, avait attaché le veau[30]. Il fut aux côtés de Mme Houdry et poussa un point d’exclamation… Puis il ajouta :
» — Oh ! celle-là ! elle est raide ! quand nous sommes entrés, il n’y avait qu’un veau, un seul veau, madame, un veau que j’ai attaché sur l’étout et qui gambade maintenant dans la cour, et il y a un autre veau au tinet. (Le tinet, interrompis-je, est une barre de chêne à laquelle on suspend le veau et que l’on hisse à l’aide du treuil.) Oui ! oui ! il y a un autre veau au tinet !
» — Je le vois bien ! fit Mme Houdry. Un tout petit veau. Quel petit veau ! Mais, tu es fou, commis, il devait y avoir deux veaux !
« — Jamais ! madame ! Jamais !
» — Eh bien ! tu vois pourtant bien le veau du tinet ? (Moi, interrompis-je, moi, je redoute, oh ! combien je redoute un grand malheur !)
» Le petit commis et Mme Houdry s’approchèrent du tinet qui était dans l’ombre et ne dirent rien tant ils étaient étonnés de voir la sorte de viande blanche qui était suspendue à ce tinet. Ils n’avaient jamais vu une pareille viande blanche et si cette viande était tout à fait arrangée comme un veau, ils se rendirent enfin compte que ce n’était pas de la viande de veau. (Moi, interrompis-je encore, moi, je redoute un grand malheur !)
» — Quel drôle de petit veau ! ne cessait de répéter le petit commis.
» — Ce n’est pas un petit veau ! fit Mme Houdry !… Non ! non !
» — On lui a tout de même « fleuri » la peau du ventre avec la lancette ; voyez, madame, les jolis dessins !… Il y a des cœurs, des flèches, des fleurs… Ah ! les belles fleurs !… (Il faut avoir, interrompis-je, un certain tour de main pour fleurir le veau avec la lancette. On peut dessiner de très belles fleurs avec un crayon sur un morceau de papier et être tout à fait — oh ! tout, à fait ! — incapable d’user de la lancette pour dessiner sur un morceau de ventre. Mettez une lancette dans la main de M. Bouguereau, et peut-être trouvera-t-il qu’il n’a jamais éprouvé tant de difficulté à dessiner des veaux !)
» Le petit commis souleva la fressure, c’est-à-dire les poumons, auxquels pendait le cœur.
» — C’est une belle fressure, dit-il, et elle n’est pas trèfle !… (Elle n’est pas trèfle, interrompis-je, c’est-à-dire qu’elle n’est pas malade. Non ! non ! c’étaient de beaux poumons ; ils étaient coches !… Coche, expliquai-je, c’est le contraire de trèfle. Une viande est coche quand elle est bonne !…)
» Le petit commis ajouta :
» — Le cœur est bon.
» — Oui ! il avait un bon cœur ! gémit Mme Houdry, qui fut tout à coup épouvantée de ce qu’elle venait de dire. (En effet, interrompis-je, pourquoi cette imprudente femme dit-elle : Il avait un bon cœur ? Il ne l’avait donc plus, son cœur ?… Oh ! les femmes sont tout à fait imprudentes…)
» Là-dessus, le petit commis, qui s’était pris, sans savoir au juste pourquoi, à pleurer comme un veau, trempa ses mains dans le seau d’eau froide qui est placé à côté de la chaudière et, les ayant ainsi refroidies, les plongea dans la chaudière, cherchant la tête du veau ou plutôt la tête de l’animal à la viande si blanche qui pendait au tinet, et il tira une tête, en effet.
» Mais quand elle vit cette tête, Mme Houdry s’évanouit, car elle avait reconnu la tête de son mari. (Je l’avais bien dit ! interrompis-je. Et mes pressentiments ne me trompent point ! Je redoutais un grand malheur ! Et le voilà ! Je répétais tous les jours à M. Houdry de se méfier ; qu’on ne tue pas tant de veaux sans que ça se sache chez les veaux. Mais il riait, il se moquait de moi ! — Félicitations, monsieur Houdry ! félicitations ! — Le calcul des probabilités est là, n’est-ce pas ? Rien n’y faisait ! ni le regard du veau : ni le calcul des probabilités ! Je lui disais : « Mon cher monsieur Houdry, si un boucher peut tuer plus de mille veaux à Paris, quand c’est défendu, il se trouvera bien un veau pour tuer un boucher ! Et le boucher n’aura rien à dire, car ce sera le droit du veau. » Et voilà ! Et voilà ! Le veau a découpé le boucher ! Enfin ! ça n’est la faute de personne !… Mais continuons cette intéressante lecture) :
« Si Mme Houdry avait tout de suite reconnu la tête de son mari, le petit commis, lui, dut l’examiner de plus près pour être sûr que c’était là la tête de son patron. C’était une tête bien coupée, bien raffinée, bien échaudée, bien épilée. La moustache et les cheveux avaient été rasés comme il faut, les oreilles bien nettoyées, et, pour quelqu’un qui n’eût pas été prévenu, cette tête de boucher eût pu, au besoin, passer pour une tête de veau. À son tour, le petit commis s’évanouit et laissa rouler la tête de M. Houdry. (Ce pauvre M. Houdry, interrompis-je, était un brave homme ! Mais il aimait trop à couper les têtes des veaux avec le saigneur ! Tout ça devait mal finir ! C’est bien triste !…)
» Quelques minutes plus tard, « le drame était découvert ». On juge de l’émotion dans le quartier !… (Il y a de quoi, interrompis-je ; il y a de quoi ! Et maintenant, il faut juger le veau ! Il aura du succès en cour d’assises. C’est un étrange, fantastique, impitoyable et courageux veau !)
» Le journaliste, dit Théophraste, n’était point de cet avis que le veau eût découpé le boucher, et il mettait encore en avant le nom de Cartouche. (Ce pauvre Cartouche !) Je haussai une fois de plus les épaules ; puis, ayant levé les yeux de dessus mon journal, je cherchai en vain dans les deux coins de la salle à manger — où ils s’étaient réfugiés « pour faire l’enfant » — ma femme et M. Lecamus. Ils avaient disparu. Je les appelai avec force, et ils ne me répondirent point. Je fouillai l’appartement, et ne les trouvai point. Je voulus ouvrir la porte du palier, et elle ne s’ouvrit point. Ils m’avaient enfermé, ce qui ne me gêna point. Quand je suis enfermé, je sors par les cheminées si elles sont assez larges et, si elles sont trop étroites, je disparais par les fenêtres. Mais la cheminée de mon salon est une cheminée monumentale comme il ne s’en trouve point deux dans la rue Gérando, et je l’escaladai avec la même facilité que j’avais descendu la cheminée où commençait à chauffer la chaudière de M. Houdry, le matin même, quand le veau découpa si proprement cet excellent malheureux homme !… J’arrivai bientôt sur les toits, par un temps froid et pluvieux qui m’incita à une grande tristesse. »
XXVI
ÉTRANGE ATTITUDE D’UN TRAIN QUI FAIT DU CENT DIX À L’HEURE.
Cette dernière promenade sur les toits de la rue Gérando, par un temps froid et pluvieux, devait avoir sur Théophraste une influence physique et morale que nous essaierons d’analyser en quelques lignes. D’abord, je parlerai de l’influence physique qui est, comme on le verra par la suite, de la plus grande importance. Théophraste, mélancolique, s’étant assis, les jambes pendantes, au rebord d’une gouttière, et s’étant attardé à quelque rêverie, s’enrhuma. Au point de vue moral, je ne saurais trop insister sur cette considération que Théophraste qui, pendant toute la lecture de l’article du journal relatant les crimes dont le nouveau Cartouche épouvantait Paris, avait montré une large désinvolture inconsciente, Théophraste, dis-je, qui semblait n’être sorti par la cheminée que « pour rentrer en lui-même », commença enfin à se rendre compte de sa terrible responsabilité, et, en ce qui concerne spécialement le découpage du boucher Houdry, cessa d’accuser le veau. Il se rappela maintes sorties nocturnes, par la route qu’il venait de suivre ; et quelques crimes sanglants, apparus à sa mémoire enfin dégourdie, lui firent monter aux yeux les larmes trop tardives d’un inutile remords. Ainsi, malgré toutes les souffrances passées, en dépit des invocations de M. de la Nox et de la torture qu’on lui avait imposée, Cartouche n’était pas mort ! Et ce soir-là, comme tant d’autres criminels soirs, il promenait son âme damnée sur les toits de Paris. Il pleura. Il maudit cette force mystérieuse et irrésistible qui, du fond des siècles, lui ordonnait de tuer. Il maudit le geste qui tue. Il songea à sa femme, à Adolphe. Il regretta amèrement les heures de bonheur passées entre ces deux êtres si chers. Il les excusa de s’être enfuis, il leur pardonna leur terreur. Il résolut de ne plus, désormais, troubler de ses rouges divagations la paix de leurs jours. « Disparaissons ! se dit-il ; cachons notre honte et notre tare originelle au fond des déserts ! Ils m’oublieront !… Je m’oublierai moi-même. Profitons de ces minutes logiques où mon cerveau, dégagé momentanément de l’Autrefois, discute, pèse, déduit, conclut et voit dans le maintenant. Ce n’est plus Cartouche qui parle ! C’est aujourd’hui Théophraste qui veut ! Théophraste qui crie à Cartouche : Fuyons ! fuyons ! puisque j’aime Marceline ! Fuyons ! puisque j’aime Adolphe ! Un jour, ils seront heureux sans toi ; il n’y a plus de bonheur avec toi !… Adieu ! adieu ! Marceline, femme adorée, épouse fidèle ! Adieu ! Adolphe, ami précieux et consolateur !… Adieu ! Théophraste vous dit : Adieu !… »
Il pleura ! Il pleura !… Puis tout haut il dit :
— Viens, Cartouche !…
Et il s’enfonça dans la nuit, allant de gouttière en gouttière, grimpant de toit en toit, glissant du haut des murs avec une sûreté, une aisance, un équilibre de somnambule…
Et maintenant, quel est cet homme qui, le front bas et le dos courbé, les mains dans les poches, erre comme un malheureux dans le vent qui passe, sous la pluie qui tombe, le long, tout le long de la voie ? Il suit la route qui longe la voie du chemin de fer ; c’est une route droite, bordée de petits arbres malingres, plumeaux naturels et chétifs, tristes ornements de la route départementale, le long de la voie du chemin de fer. D’où vient cet homme qui a les mains dans les poches, ou plutôt cette ombre d’homme, cette triste ombre d’homme ? La plaine s’étend à droite et à gauche, sans une ondulation, sans le renflement d’une colline, sans le creux d’une rivière. Il est de toute utilité, pour ce qui va suivre, de se rappeler les détails du paysage. Ces détails, du reste, sont visibles, car ceci n’est point une scène de nuit, mais bien une scène de plein jour. Sur la voie, toute droite, à côté de la route, passent de temps à autre des trains, des trains omnibus, des trains rapides, des trains de marchandises. Pendant qu’ils passent la voie ronfle, puis elle se tait et l’on entend alors, dans le vent, le ting-ting-ting-ting de la sonnette des disques de la petite gare prochaine. Mais quelle petite gare ? Il y en a une en avant ; il y en a une en arrière. Les deux petites gares sont espacées de cinq kilomètres — et encore, il faudrait mesurer. Entre les deux petites gares, il y a la voie droite, la double voie, bien entendu, pour les trains qui montent et pour les trains qui descendent. Ces deux gares sont rejointes donc par un quadruple trait de rails posés sur la plaine. Entre les deux gares, il n’y a aucun travail d’art, aucun viaduc, aucun tunnel, aucun pont, pas même un passage à niveau. Mon Dieu ! j’insiste. Oui, c’est à cause de l’étrange attitude d’un train qui fait du cent dix à l’heure. Si je n’avais pas insisté sur tous les détails de l’étrange attitude d’un petit chat violet, on eût pu me dire que je me plaisais à créer du fantastique. Or, je hais le fantastique, et si je me suis résolu à publier les papiers, mémoires et documents qui se trouvaient dans le coffret en bois des îles, c’est bien après avoir acquis cette certitude que tout le fantastique apparent de l’aventure de Théophraste s’expliquait naturellement avec un peu d’intelligence et de flair.
J’ai dit : « D’où venait la triste ombre d’homme ? » Je ne m’appesantirai point sur des effets littéraires, surtout maintenant que nous connaissons la route et la voie toute droite, posée sur la plaine, du chemin de fer… Un ballast d’une régularité incomparable…
La triste ombre d’homme, c’est Théophraste. Il a résolu de fuir, de fuir n’importe où — loin de sa femme — le pauvre cher malheureux héroïque homme ! — Après une nuit passée de gouttière en gouttière, ne sachant où diriger sa course, ne le voulant du reste pas, il est entré dans une gare — quelle gare ? le saura-t-on jamais ? — et, sans billet, est monté dans un train et, sans billet, quelque part, est descendu du train et est sorti d’une autre gare. Il arrive, certes ! combien de fois que le contrôle des gares est mal fait, à cause du grand nombre des voyageurs ou pour toute autre cause…
Le voilà donc sur la route… à l’entrée d’un village, sur la route qui suit la voie du chemin de fer…
Qui aperçoit-il sur le seuil d’une petite maison à l’entrée du village ?… Mme Petito elle-même ! C’était la première fois que Mme Petito revoyait M. Longuet depuis que celui-ci avait dû couper les oreilles de M. Petito. Mme Petito fut prise d’une grande colère. Elle fit un grand discours. On ne saurait arrêter une femme en colère. Si M. Petito avait entendu Régina, il l’aurait giflée à cause de son imprudence ridicule. Après toutes sortes d’imprécations, résultat de la barbarie de Théophraste, Mme Petito apprit à Théophraste que M. Petito avait trouvé les trésors des Chopinettes, qu’il les avait mis en lieu sûr et que ces trésors étaient les plus riches trésors de la terre, des trésors qui valaient plus que deux oreilles, fussent-elles aussi vastes que les oreilles de M. Petito. « Ils étaient quittes ! »
Théophraste, au cours de ce discours, trouva difficilement le moyen de placer quelques paroles, mais il n’en fut pas autrement marri ; il remercia même la colère de Mme Petito de lui avoir fourni des renseignements aussi précieux et il laissa tomber ces mots : « Je retrouverai mes trésors, car je retrouverai M. Petito ! »
Mme Petito éclata d’un rire satanique.
— M. Petito ! s’écria-belle. Il est dans le train !
— Dans quel train ?
— Dans le train qui va vous passer sous le nez.
— Quel est le train qui va me passer sous le nez ?
— Celui qui emporte mon mari par delà la frontière ! Montez dedans ! cher monsieur ! Montez dedans si vous voulez parler à M. Petito. Mais dépêchez-vous, car il va passer dans une heure et ce n’est pas à la station prochaine que l’on distribue des billets !…
Et elle eut un rire plus satanique encore, si satanique que Théophraste regretta les moments où il était sourd. Il la salua et s’éloigna rapidement sur la route, au bas de la voie du chemin de fer. Quand il fut seul, entre les petits arbres et les poteaux du télégraphe, il dit :
— Allons ! allons ! Il faut que j’aille demander des nouvelles de mes trésors à M. Petito lui-même… Mais comment ? Il est dans le train qui va me passer sous le nez !
Ici, il est nécessaire de publier un plan.
Mais vraiment, je crois absolument inutile de publier les noms des stations A et B. Ce qui va arriver est mathématique, si j’ose dire, et les noms de ces stations ne sauraient rien empêcher. Du reste, il vaut mieux réduire les données du problème de cette épouvantable catastrophe à deux points A et B et à une ligne AB. Ce sera plus clair.
Allons à la station A. Le sémaphoriste de la station A entend le ting ! qui annonce que le rapide attendu vient de passer la station B et de s’engager dans la section du bloc-système qui commence à la station A et finit à la station B. Mais le train va de B à A. Il est sur la ligne BA, c’est clair. Le sémaphore, en A, annonce le train avec son petit bras jaune, avec son ting ! Et le sémaphoriste trompe pour avertir le chef de service.
Le sémaphoriste de la station A attend le train, attend le train, attend le train ! Il devrait être là, le train. C’est un train qui fait « du 90 » à l’heure, et, comme il est en retard, il fait même « du 110 » et « du 115 et du 120 ! » Il y a peut-être 4 ou 5 kilomètres au maximum entre la station A et la station B. Le sémaphoriste, mort d’effroi de ne pas voir apparaître le train, crie au chef de service qui vient vers lui que le train devrait être passé ! Le chef de service, qui est le chef de gare, se précipite à son télégraphe et télégraphie à la station B : « Train signalé pas arrivé ! » La station B répond : « Farceur ! » La station A : « C’est sérieux. Que faire ? Horrible anxiété. » La station B : « Va raconter ça à Dache. » La station A : « Devons redouter catastrophe ; courons sur les lieux, venez au-devant de nous. » La station B : « Que peut-il être arrivé ? Courons aussi. »
Alors les chefs de gare, les facteurs enregistrants et hommes d’équipe des stations A et B courent, courent, les hommes de la station À allant sur la station B et ceux de la station B allant sur la station A ; ils courent, en plein jour, au milieu de la plaine unie, de la plaine sans rivière, sans coteau, sans vallon (ce ne serait plus une plaine) ; ils courent le long de la ligne du chemin de fer et se rencontrent entre A et B… Mais ils ne rencontrent pas le train !
Le chef de gare de la station A (je dis bien de la station A), qui avait une maladie de cœur, en tombe raide mort.
XXVII
UN HOMME SANS OREILLES AVAIT LA TÊTE À LA PORTIÈRE.
En somme, toute cette géométrie résume cet événement bien simple : Un train rapide doit brûler deux petites stations distantes de quatre à cinq kilomètres. Il est annoncé à la seconde quand il passe à la première, et cependant on l’attend vainement à la seconde ! On court de part et d’autre au-devant d’une catastrophe : or, on ne retrouve plus le train, un train rapide dans lequel il y a peut-être une centaine de voyageurs ?
Que le chef de gare de la station A soit mort sur le coup que lui porta cette disparition inouïe, stupéfiante, ahurissante, ridicule, infernale et cependant combien simple du train (nous le verrons par la suite), il ne faut point s’en étonner outre mesure. Les esprits avaient été fort secoués par l’événement. Le chef de gare de la station B ne valait guère mieux que son collègue. Enfin, toutes les personnes présentes poussaient des cris incohérents. Ils appelaient le train, comme si le train pouvait leur répondre ! Ils ne l’entendaient pas et, sur la plaine unie, ils ne le voyaient pas ! Le facteur enregistrant de la station A était penché sur le corps de son chef et prononça ces mots : « Je crois bien qu’il est mort ! » Tous alors se groupèrent autour du mort et, sur deux branches d’arbre arrachées au bord de la route, couchèrent son cadavre. Ils revinrent ainsi, accompagnant le cadavre porté par deux d’entre eux, vers la station A. N’oublions pas que le train avait passé à la station B et que nul ne l’avait vu à la station A.
Or, ils n’étaient pas arrivés à la station A, que sur la voie, sur la voie qu’ils venaient cependant de parcourir, ils aperçurent un wagon, ou plutôt deux wagons, c’est-à-dire un wagon et le fourgon de queue ! Ces gens poussèrent encore des cris de fou. D’où venait cette queue de train et qu’était devenu le commencement de ce train, c’est-à-dire la locomotive, le tender et trois wagons à couloir ?
Consultez le plan.
C marque le point où, sur la ligne, se sont rencontrées les deux équipes A et B quand elles allaient à la recherche du train, et c’est encore le point où est mort le chef de gare de la station A. Les deux groupes, réunis en un seul, rapportèrent donc le corps vers A, quand sur le point D, point sur lequel ils venaient quelques minutes auparavant de passer et où ils n’avaient rien vu, ils trouvent un wagon et le fourgon de queue.
Je dis que ces gens poussaient des clameurs de fou quand ils aperçurent une tête bizarre qui remuait à la portière. Cette tête n’avait pas d’oreilles et l’homme sans oreilles avait la tête à la portière. Ils le hélèrent. Du plus loin qu’ils le virent, ils lui demandèrent ce qui était arrivé. Mais l’homme ne répondit pas. Chose bizarre, la tête remuait, comme si elle était poussée de droite et de gauche par le vent qui soufflait alors avec une force appréciable. C’était une tête aux cheveux crépus. Elle baissait le nez ; la cravate, autour du faux-col d’une blancheur éblouissante, était dénouée et flottait au vent. En approchant davantage, les hommes aperçurent de la peinture rouge sur le panneau de la portière.
Enfin, enfin, quand ils furent tout près (ils n’allaient qu’assez lentement, à cause du cadavre du chef de gare), ils eurent la vision de l’effroyable réalité. Cette peinture était du sang, et si l’homme avait la tête à la portière, c’est qu’il avait la tête prise dans la portière. Elle ne tenait plus que par un lambeau. Cet homme, ce malheureux homme avait dû ouvrir en cours de route la portière, pencher la tête au dehors, et la portière s’était brutalement refermée sur son cou, le décapitant, ou presque ! Les deux équipes, voyant cela, hurlèrent encore, déposèrent le cadavre du chef de gare, firent le tour du fourgon, dans lequel il n’y avait personne, et, ouvrant une autre portière du wagon, constatèrent que ce wagon était vide, sauf l’homme qui avait la tête prise dans la portière et dont le corps, à l’intérieur du wagon, c’est-à-dire dans le couloir, était tout nu !
La nouvelle de tant de fantastiques horreurs se répandit immédiatement dans les villages à la ronde. Et une foule énorme, toute la journée, encombra les quais de la petite station A. Des chefs vinrent de Paris. Non seulement on ne put s’expliquer, ce jour-là ni les jours suivants, la mort de l’homme tout nu qui avait la tête à la portière, mais encore on ne retrouva ni le train ni les voyageurs. On ne parla que de cette étrange affaire aux obsèques du chef de la station A, qui furent tout à fait solennelles ; et même dans toute l’Europe ; aussi en Amérique.
XXVIII
OÙ LA CATASTROPHE, QUI SEMBLAIT DEVOIR S’EXPLIQUER, DEVIENT PLUS INEXPLICABLE ENCORE.
Je n’ai fait que publier un plan sommaire de la ligne, pour ne pas compliquer les choses. Ce plan n’est pas tout à fait complet. Car si cette ligne était unique, reliant dans une plaine les deux stations A et B, il se trouvait, adjacente à cette ligne, une courte ligne de garage hi, qui conduisait à une carrière récemment abandonnée de sable pour verrerie. La verrerie ayant fait faillite, on n’exploitait plus la carrière et la ligne était en quelque sorte abandonnée. Voici le plan complet :
Je sens bien que dans l’esprit du lecteur, cette voie de garage hi conduisant à une carrière de sable va jouer un rôle explicatif, trop facilement explicatif. Mais, vraiment, si l’affaire était aussi simple que la voie de garage hi semble devoir le faire croire, pensez-vous que l’auteur de ces lignes aurait attendu pour parler de cette voie de garage ? Et de cette carrière de sable ? Il aurait dit tout de suite : « Par suite de circonstances qui restent à déterminer, le rapide, au lieu de continuer à suivre la voie BA, s’est sans doute engagé sur la ligne hi de garage et s’est jeté dans le monticule de sable qui se trouve en i. Le train, marchant à plus de cent dix kilomètres à l’heure, a défoncé le monticule de sable i qui l’a recouvert, et telle est la cause stupide mais réelle, ou apparemment réelle, de la disparition du rapide. » Outre que ceci n’expliquerait pas la présence en D du dernier fourgon et du wagon où M. Petito avait la tête à la portière, cette démonstration n’aurait pas manqué de frapper l’intelligence si déliée de MM. les ingénieurs de la compagnie ; or, il y avait bien un aiguillage en h, mais cet aiguillage en h était, selon les règles, cadenassé et la clef avait été enlevé du cadenas.
Mais, moi, je vais plus loin que les ingénieurs de la compagnie. Je n’attache point d’importance à ce que le cadenas soit fermé ; je me dis : le cadenas avait peut-être sa clef que l’on y avait oubliée en h, ce qui était vrai, et Théophraste Longuet, qui avait intérêt à arrêter le train pour rejoindre M. Petito, a profité de la présence de cette clef pour faire jouer l’aiguillage, c’est-à-dire pour tourner la lentille de l’aiguille de l’autre côté, ce qui explique que le train n’a pas été vu par le sémaphoriste placé en A, puisque le train, au lieu de continuer sur A, s’est engagé sur hi vers la carrière… Je me dis, ou plutôt je me suis dit cela ; et si cela avait pu expliquer quelque chose, je ne suis pas un homme à avoir fait languir le lecteur et je lui aurais démontré l’affaire sans ambage, et je n’aurais pas hésité à publier comme premier plan la ligne AB et la petite ligne hi.
Si je ne l’ai pas fait, c’est que cette petite ligne de garage hi n’explique rien. Moi aussi, j’ai cru qu’elle allait nous faire comprendre la disparition du train, mais elle complique la catastrophe, au lieu de l’expliquer, car voici l’histoire, l’histoire vraie qui continue à ne rien expliquer du tout.
Errant le long de la route qui suivait la voie du chemin de fer, Théophraste avait remarqué la petite ligne de garage, et il avait vu que la clef avait été laissée dans le cadenas de l’aiguille. Ceci, qui n’avait aucune importance avant son entrevue avec Mme Petito, en prit une énorme quand il résolut de rejoindre coûte que coûte M. Petito qui était dans le train qui allait lui passer sous le nez. M. Longuet se dit : je ne puis monter normalement dans le rapide qui brûle les deux gares A et B. Mais il y a une petite voie de garage hi ; la clef est sur le cadenas de l’aiguille ; je n’ai qu’à retourner la lentille et le rapide s’engagera sur la ligne hi. Le mécanicien, puisqu’on est en plein jour, s’en apercevra, arrêtera le train et moi je profiterai de cet arrêt pour sauter dans le train.
N’est-ce-pas ? C’est excessivement simple. Théophraste fit comme il le pensait. Il retourna la lentille et, montant le long de la voie hi, il attendit le rapide.
M. Théophraste Longuet, caché derrière un arbre, pour n’être aperçu ni du chauffeur, ni du mécanicien, attendit le rapide au point K, c’est-à-dire avant la carrière i. Il attendit le rapide venant de h, les yeux sur la voie. Si, comme tous les lecteurs, depuis que j’ai parlé de la carrière, l’ont pensé, le train s’était précipité, venant de h, dans la carrière i, M. Théophraste Longuet, qui était en K, entre h et i, eût vu ce train !
Or, M. Longuet attendit, attendit, attendit le rapide ! Il l’attendit comme le sémaphoriste placé en A l’avait attendu et, pas plus que le sémaphoriste, pas plus que tous les agents de la gare A, il ne vit de rapide !
Le rapide avait disparu pour M. Longuet comme pour tout le monde.
Si bien que, las d’attendre, M. Longuet descendit, pour voir ce qui se passait, jusqu’en h, et là il vit l’équipe A qui s’en allait vers C à la recherche du train. Mélancolique et se demandant, sans pouvoir se répondre, ce que le rapide était devenu, il remonta la ligne hi et, arrivé en K qu’il venait de quitter, il trouva le fourgon vide et le wagon que, quelques minutes plus tard, les deux équipes devaient retrouver en B ! Il jura encore par les tripes de Mme de Phalaris et se prit le front à deux mains, se demandant comment ce wagon et ce fourgon étaient là, puisque le rapide n’était pas venu. Il n’était pas venu, puisque lui, Théophraste, n’avait pas quitté la voie.
Soudain, il vit la tête d’un homme à la portière du wagon. Le vent faisait remuer cette tête comme une loque et, comme cette tête n’avait pas d’oreilles, il reconnut M. Petito.
Il monta dans le wagon et déshabilla en lui laissant la tête prise dans la portière, M. Petito. Il le mit tout nu. Il se déshabilla lui-même et revêtit les habits de M. Petito. Il fit un sac avec les siens. Évidemment, Théophraste, qui se savait traqué par la police et en qui renaissait l’astuce de Cartouche, se déguisait. Quand M. Petito fut tout nu et que lui, Théophraste, fut dans les habits de M. Petito il descendit de wagon, fouilla dans la poche de M. Petito, en retira le portefeuille et, s’étant assis sur le talus, se plongea dans les paperasses de M. Petito, y cherchant les traces de ses trésors, mais M. Petito avait emporté le secret des trésors des Chopinettes dans la tombe et jamais plus on ne devait réentendre parler ni du Four, ni du Coq, ni des Chopinettes, ni des trésors, d’autant mieux que Mme Petito qui, quelques minutes plus tard, devait apprendre l’incroyable trépas de son mari, devint folle et le resta jusqu’à la fin de ses jours.
Nous ne nous occuperons plus que du malheur de Théophraste qui dépasse tous les malheurs et qui devient si incroyable qu’il nous faudra tout le secours de la science pour y ajouter une entière foi. L’auteur de ces lignes ose dire au lecteur qu’il ne le croit pas d’esprit si bas, ni d’imagination si pauvre qu’il ne puisse s’intéresser qu’à une aventure de trésors ; la véritable aventure, c’est l’âme de Théophraste. Or, ce qui est arrivé jusqu’à ce jour à l’âme de Théophraste — et à son corps — n’est rien, absolument rien, mais rien du tout à côté de ce que le ciel lui a réservé par la suite et que j’ai noté fort scrupuleusement dans la dernière partie de cette honnête compilation.
Donc, Théophraste poussa un soupir en ne trouvant rien d’intéressant dans les papiers de M. Petito, mais quand il releva le nez le fourgon et le wagon et M. Petito avaient disparu.
XXIX
UN OUVRIER QUI CHANTE L’« INTERNATIONALE » ACCOMPLIT CETTE ŒUVRE SYMBOLIQUE D’ENTERRER UN VOLEUR ET UN COMMISSAIRE DE POLICE.
M. Longuet, bien que décidé à ne plus s’étonner de rien, s’étonna tout de même de la disparition du wagon à l’une des portières duquel on pouvait voir la tête sans oreilles de M. Petito. Mélancoliquement, il descendit au long de la petite voie de garage, se demandant s’il lui fallait s’étonner davantage de la disparition du wagon que de son apparition ; enfin, la suppression du rapide l’avait jeté dans une prostration que nos lecteurs comprendront sans doute.
Il me semble que je n’ai point le droit, moi qui ai eu le secret du coffret en bois des îles, de donner l’explication de cette suppression et de tout ce qui s’ensuivit avant l’heure. M. Théophraste Longuet apprendra comment le rapide fut supprimé, c’est-à-dire comment il disparut avec ses voyageurs ; et toute cette fantasmagorie du rapide et des wagons tiendra dans une courte phrase naturelle, prononcée par M. le commissaire de police Mifroid, lequel, depuis le lycée, n’a cessé, entre autres sciences, d’étudier assidûment cette partie si importante de la philosophie qui s’appelle logique. Il est bon, à ce propos, de faire cette remarque ici que nous avons dès maintenant toutes les données de cet étrange problème et que nous n’avons plus rien à ajouter au dernier plan.
Théophraste, donc, prostré, descend la voie de garage, arrive à la bifurcation, considère la lentille de l’aiguille, retourne cette lentille qu’il avait détournée, referme le cadenas et en emporte définitivement la clef qui y avait été, quelques jours auparavant, si imprudemment laissée. Il accomplit ce geste parce qu’il le trouve juste, et il remet l’aiguille en place parce qu’il sent bien que sa raison ne résisterait pas à une nouvelle disparition de train.
Toujours mélancolique, il arrive à la station A, désertée. Toute l’équipe est, en effet, à la recherche du train et, seul, le sémaphoriste veille. Théophraste interroge le sémaphoriste qui ne peut que lui dire, en lui montrant le petit bras jaune de son sémaphore :
— Le rapide est annoncé et il ne vient pas !
Théophraste insiste.
— On vous a bien annoncé le rapide à la station précédente ?
— Oui, monsieur, et le chef de gare et tous les hommes d’équipe de la station précédente ont vu passer le rapide et nous l’ont télégraphié. Enfin, voyez, monsieur, mon petit bras jaune ! Voyez mon petit bras jaune ! Il n’y a pas de catastrophe possible entre la précédente station et celle-ci ; il n’y a, monsieur, aucun pont, aucun viaduc, point de travaux d’art ! Enfin, que vous dirai-je ? Je suis monté tout à l’heure à l’échelle que vous voyez, appliquée contre cette grosse cuve. De là, on aperçoit toute la ligne jusqu’à l’autre station. J’ai vu nos gens qui gesticulaient sur la ligne, mais je n’ai pas vu de train !
— Étrange ! étrange !
— Oh ! tout à fait étrange. Croyez-en mon petit bras jaune !
— Inexplicable !
— C’est-à-dire qu’il n’y a rien de plus inexplicable.
— Si ! Il y a quelque chose de plus inexplicable qu’un rapide qui disparaît avec sa locomotive, sans qu’on puisse savoir ce qu’il est devenu.
— Quoi donc ?
— Mais un wagon sans locomotive qui apparaît sans qu’on puisse dire d’où il vient.
— Oh ! ça…
— Et qui disparaît comme il est apparu… Vous n’avez pas vu passer par là un wagon avec un homme à la portière ?
— Monsieur, fit le sémaphoriste en se fâchant, vous vous moquez de moi. Vous exagérez ! Parce que vous ne croyez pas à l’histoire du rapide annoncé qui ne vient pas ! Mais regardez, monsieur, regardez mon petit bras jaune !
M. Longuet réplique au sémaphoriste :
— Si vous n’avez pas vu le rapide, moi non plus !
Ce « moi non plus », qui ne dit rien à l’esprit du sémaphoriste, répond aux préoccupations intimes de M. Longuet, qui s’éloigne, dans les habits de M. Petito.
M. Longuet a son idée : son malheur est si extrême et si inguérissable qu’il a résolu de mourir… pour les autres.
Avec un peu d’astuce, la chose est possible. Puisqu’il a revêtu les habits de M. Petito, rien ne l’empêche de laisser les siens au bord de la première rivière qu’il rencontrera ; cet acte si simple constituera un acte de suicide en règle. Voilà Adolphe et Marceline bien tranquilles. Pensée émue de M. Longuet à l’adresse de Marceline et d’Adolphe.
Au bord de quelle rivière M. Longuet déposa-t-il ses habits ? Comment M. Longuet rentra-t-il à Paris ? Ceci n’a point d’importance ; il n’y a qu’une chose qui soit vraiment importante, c’est l’explication de la disparition du train. Cette explication fut donnée à Théophraste par M. Mifroid dans les circonstances que voici et qui valent d’être rapportées en détail.
Au crépuscule, un ouvrier chantait sur une place de Paris du côté de l’ancien quartier d’Enfer, l’hymne qui, quelques mois plus tard, devait devenir si populaire : j’ai nommé l’Internationale.
Cet ouvrier terrassier travaillait avec quelques compagnons à la « réfection de la voie ». Celle-ci, en effet, avait subi certains dommages à la suite de la construction d’un nouvel égout.
La voie, en certains endroits, avait fléchi. Même, une maison de la place, une lourde récente maison à sept étages, s’était inclinée. Les ingénieurs de la Ville voulurent bien s’intéresser à ce menaçant état de choses. On n’ignorait pas que, surtout dans ce quartier, les catacombes avançaient leurs tunnels innombrables, leurs couloirs millénaires, et que certaines bâtisses, qui dressent avec audace leurs épaisses murailles immobiles, ont une vie architecturale aussi précaire que celle d’un château de cartes, car elles reposent sur les voûtes branlantes des antiques carrières gallo-romaines.
Donc, on se résolut à des travaux restreints qui devaient donner une sécurité immédiate. Le jour qui nous occupe voyait la fin de ces travaux. L’ouvrier qui chantait l’Internationale finissait, avec ses camarades, de boucher un trou de la voûte souterraine que l’on avait préalablement consolidée, par en-dessous, de très puissants piliers, voûte sur laquelle allait reposer, quelques mètres plus haut, après remblai, le pavé de la place. En somme, cet ouvrier qui chantait l’Internationale finissait de boucher ce trou, à l’heure du crépuscule…
À la même heure, quelques pas plus loin, sur le trottoir de la place, à la devanture d’un magasin de lampes électriques, M. le commissaire de police Mifroid marchandait pour ses hommes une demi-douzaine de ces lampes. Ce sont des lampes portatives grandes comme un étui à cigarettes. On appuie sur un bouton et on a dans sa poche pour quarante-huit heures d’électricité. M. le commissaire de police Mifroid avait fait son prix ; il avait même payé ; il emportait le petit paquet de six lampes électriques, petit paquet qu’il commençait de balancer avec grâce au bout d’une ficelle rouge, quand il vit, à la devanture du magasin qu’il se disposait à quitter, un homme jeune encore, mais aux cheveux tout blancs, qui, lui, faisait disparaître dans ses poches, sans les avoir payés, quelques spécimens de ces lampes électriques, lesquelles devaient présenter des avantages aussi appréciables pour un voleur que pour un commissaire de police. M. Mifroid, toujours courageux, bondit vers l’homme et cria :
— C’est Cartouche !
(Il l’avait reconnu, car depuis la revanche du veau, tous les commissaires de police avaient le portrait du nouveau Cartouche dans leur poche. Nous devons ajouter, hélas ! que Mme Longuet elle-même et M. Lecamus, à la suite de la lecture relative au veau, n’avaient enfermé M. Longuet que dans le dessein d’aller faire une communication urgente, quoique tardive, au plus proche commissariat, sur l’état mental bicentenaire du malheureux marchand de timbres en caoutchouc.)
Donc, M. le commissaire de police Mifroid, qui avait connu notre héros à l’état de Théophraste, puisqu’il avait dîné chez lui, et qui le reconnaissait à l’état de Cartouche, s’écria en bondissant vers lui :
— C’est Cartouche !
Théophraste, depuis quelques nuits, savait ce que lui voulait la police. Quand il vit M. Mifroid et quand il entendit ces mots : « C’est Cartouche ! » il se dit : « Il est temps que je me trotte ! » et il détala…
Le commissaire, derrière lui, courut…
Revenons à l’ouvrier. Il chantait toujours l’Internationale. Ses camarades venaient de le quitter, à cause d’une tournée chez le marchand de vin. Il en était au refrain. C’était la soixante-dix-septième fois que, depuis deux heures de l’après-midi, l’ouvrier en était au refrain, mais tout le monde sait que lorsqu’on a une chanson dans la tête…
L’ouvrier disait :
Cellalutte finale
Groupppons-nous etddemain…
Ayant tourné la tête, il ne vit pas deux ombres qui dégringolaient dans son trou ; c’étaient les deux ombres de Théophraste et du commissaire de police Mifroid, celle-ci poursuivant celle-là, à l’heure du crépuscule, ombres qui, dans leur précipitation imprudente, venaient de choir dans les travaux de réfection de la voie.
L’ouvrier retourna la tête et gueula, dans un vaste enthousiasme :
L’Interrrnatiônâââleu
Sera le genrrhummain !…
Et il finit de boucher son trou.
Avant de passer à d’autres chapitres, l’auteur de ces lignes tient à s’excuser auprès du lecteur de la rapidité des derniers événements. Certainement, l’incident du train qui disparaît, la figure, agitée par le vent, de M. Petito à la portière du wagon fantôme, et plus récemment encore, l’enterrement vraiment symbolique d’un voleur et d’un commissaire de police par un brave ouvrier qui chante l’Internationale, tout cela eût gagné à être narré posément, avec tous les détails, à tête reposée. Mais il ne l’a pas voulu ; il ne l’a pas voulu pour une seule raison, qui est que les papiers qu’il a trouvés dans le coffret en bois des îles relatent les événements en question avec une sécheresse mathématique, et que cela aurait été, selon lui, faillir à cette aventure que de la dénaturer par des enjolivements littéraires qui ne sauraient être de mise pour des faits aussi graves. Ces événements tout secs, certes ! sont plus difficiles à lire et demandent une grande contention d’esprit ; mais tels quels, il leur trouve encore leur beauté !
Dans les chapitres qui vont suivre, nous prendrons notre temps pour faire de la littérature. N’avons-nous point la relation toute fleurie de l’aimable commissaire de police Mifroid, dont le titre est si plein de grâce et le sous-titre si plein de mystère ? Voici le premier titre : Promenade de M. le commissaire de police Mifroid et de l’âme réincarnée de Cartouche à l’envers de Paris, et voici le sous-titre : Trois semaimes chez les Talpa.
XXX
PREMIÈRES RÉFLEXIONS DE M. LE COMMISSAIRE DE POLICE MIFROID QUAND IL SE RÉVEILLA AU FOND DES CATACOMBES. — IL REDOUTE AVANT TOUT D’ÊTRE « VIEUX JEU ». — IL APPREND À M. THÉOPHRASTE LONGUET À « TENIR SA RAISON PAR LE BON BOUT ».
« Quand on se réveille au fond des catacombes, dit M. le commissaire de police Mifroid dans l’admirable rapport qu’il rédigea à l’issue de ce surprenant voyage, la première pensée qui vous envahit l’esprit est une pensée de crainte : la crainte d’être « vieux jeu » ; j’entends par là l’anxiété subite où l’on se trouve de reproduire tous ces gestes ridicules que les romanciers et dramaturges ne manquent point de faire accomplir aux tristes héros qu’ils égarent dans des souterrains, grottes, excavations, cavernes et tombeaux.
» Dans le moment même de ma chute, alors que déjà je parcourais si rapidement l’espace qui me séparait du sol des catacombes, ma présence d’esprit ne m’avait pas abandonné, et je savais que je tombais au fond de ces carrières vieilles de mille ans qui croisent, innombrables, leurs capricieux méandres au-dessous du Paris moderne. Je retrouvai ce sentiment, je dirai même cette sensation, accompagnée d’un léger engourdissement douloureux, au réveil qui suivit l’évanouissement où j’avais été plongé par le choc inévitable. J’étais donc dans les catacombes ! Je me dis tout de suite : « Surtout, ne soyons pas vieux jeu ! »
» Il eût été, par exemple, vieux jeu de pousser des cris désespérés, de faire appel à la providence, de se frapper le front contre les parois du souterrain ; il eût été vieux jeu de retrouver au fond de sa poche une tablette de chocolat qui aurait été immédiatement séparée en huit et qui aurait ainsi représenté huit jours de nourriture assurée ; il eût été vieux jeu de découvrir également dans ses poches un bout de bougie et cinq ou six allumettes, et, ainsi, de créer un problème d’une anxiété touchante, où la question de savoir si l’on doit laisser brûler la bougie une fois allumée ou la souffler ensuite, quitte à perdre une allumette, aurait troublé plus d’une digestion autour des tables de famille.
» Moi, je n’avais rien dans mes poches ! Rien ! Rien ! Rien ! Je le constatai tout d’abord avec une évidente satisfaction et, dans les ténèbres des catacombes, je me frappai la poche en répétant : « Rien ! Rien ! Rien ! »
» Je pensai aussitôt qu’il serait « nouveau jeu », pour un homme dans ma situation, d’éclairer sans plus tarder cette nuit opaque qui me pesait si lourdement sur les paupières et qui me fatiguait si singulièrement les yeux ; d’éclairer, dis-je, cette nuit d’une subite et radieuse et victorieuse étoile électrique. N’avais-je point, avant que de tomber dans ce trou, acheté une demi-douzaine de lampes électriques que je balançais en paquet au bout d’une ficelle rouge, quand je reconnus Cartouche ? Il eût été incroyable que ce paquet ne m’eût point accompagné dans ma chute. Sans me lever, car un mouvement imprudent pouvait me faire perdre la connaissance de l’endroit exact où j’étais tombé, je tendis les mains autour de moi et fus assez heureux pour ramener mon paquet. Je redoutai que ces lampes ne fussent brisées, mais je sentis bientôt qu’il n’en était rien et, ayant défait le paquet, je pris l’une d’elles et appuyai sur le bouton. Le souterrain s’éclaira d’une lueur féerique et je ne pus m’empêcher de sourire en pensant au malheureux qui, enfermé dans quelque caverne, se traîne généralement, en retenant son souffle, derrière un lumignon chétif qui a hâte de s’éteindre :
» Je me levai alors et j’examinai la voûte. J’étais au courant des travaux de réfection de la voie ; je savais qu’ils touchaient à leur fin, et quand je constatai que le trou par lequel j’étais descendu était bouché définitivement, je n’en conçus aucun étonnement. Maintenant, quelques mètres de terre me séparaient des vivants, sans qu’il me fût possible d’atteindre à cette terre même, tant la voûte était haute. Je fis du reste ces observations sans effroi, et ayant dirigé mon étoile électrique sur le sol, j’aperçus un corps.
» C’était le corps de M. Théophraste Longuet, le corps du nouveau Cartouche. Je l’examinai et je remarquai qu’il ne portait aucune trace de blessures graves. L’homme devait être étourdi, ainsi que je l’avais été moi-même, et sans doute il ne tarderait point à sortir de cet évanouissement. Je me rappelai que M. Lecamus m’avait présenté, un jour, son ami aux Champs-Élysées, et voilà que j’allais avoir affaire à lui comme au pire des assassins.
» Sur ces entrefaites, M. Longuet poussa un soupir, étendit le bras, se plaignit de quelques douleurs, me salua et me demanda où nous étions, je le renseignai. Il n’en parut point entièrement désolé, mais, tirant de sa poche un portefeuille, il traça quelques lignes qui pouvaient ressembler à un plan, me les montra, et dit :
» — Monsieur le commissaire, nous sommes au fond des catacombes. C’est un événement extraordinaire. Comment allons-nous sortir de là ? Je n’en sais rien. Or, ce qui me préoccupe l’esprit, à cette heure, est beaucoup plus intéressant, croyez-moi, qu’une chute dans les catacombes. Veuillez jeter, je vous prie, un coup d’œil sur ce petit plan.
» Et il me tendit la feuille, sur laquelle je vis ceci :
» Puis il éternua deux fois.
» — Oh ! remarquai-je en prenant le papier, vous êtes enrhumé.
» — Cela me tient, répondit-il, depuis une promenade un peu prolongée que je fis, par un temps de pluie et de fraîcheur, sur les toits de la rue Gérando.
» Je lui conseillai de se soigner. Je dois dire que cette conversation si naturelle entre deux hommes au fond des catacombes, quelques minutes à peine après leur réveil d’une chute aussi inattendue, me plut infiniment. Ayant considéré le papier et les lignes qui s’y trouvaient tracées, je demandai des explications. M. Longuet me raconta l’histoire d’une disparition de train et d’une réapparition de wagon qui est bien la plus fantastique que j’aie jamais entendue. Cet homme avait voulu faire disparaître un train entre A et B, en le lançant, par le moyen d’un faux aiguillage, sur la voie du garage hi, et il l’avait attendu en K ; or, le train n’était venu ni en A ni en K, c’est-à-dire ni pour lui ni pour personne. Ensuite, un wagon lui était apparu en K ; après quoi, ce wagon lui-même avait disparu. J’aurais pu croire que cet homme, vu son passé (le passé de Cartouche !) et ce qu’il me racontait présentement, était fou, s’il ne s’était exprimé avec la plus grande logique et s’il ne m’avait donné les détails matériels les plus certains sur l’aiguillage et sur tous les faits de la cause.
» Enfin, il est d’expérience qu’un fou comprend toujours. Or, lui demandait à comprendre. Je le priai de répéter cette histoire. Il se tut. Deux fois, je réitérai cette prière, et il continua de se taire. J’allais m’impatienter, quand, se rendant compte que je l’avais prié de quelque chose, il me confia que, par instants, il était sourd. Cette infirmité passagère lui venait de ce que, m’a-t-il dit, un M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox lui avait, pendant son sommeil, versé de l’eau chaude dans les oreilles.
» Bientôt, ses oreilles ayant repris leur service accoutumé, nous revînmes au problème du train. M. Longuet me dit qu’il préférait mourir dix fois au fond des catacombes plutôt que d’en sortir une seule, s’il en sortait sans savoir ce qu’était devenu son train. « Je ne veux pas, ajouta-t-il, perdre ce qu’il y a de plus précieux au monde : la Raison. »
» — Et quand cela vous est-il arrivé, dis-je, car enfin, moi, je n’ai pas entendu parler de cette disparition de train ! Et ça devrait se savoir.
» — Cela doit se savoir maintenant, me répondit-il avec une grande mélancolie. La chose est arrivée quelques heures seulement avant notre chute dans les catacombes.
» J’examinai encore le papier, pendant cinq minutes, je réfléchis profondément, demandai quelque complément d’instruction et éclatai de rire, bien qu’il n’y eût point à rire, car la catastrophe était vraiment épouvantable. Ce qui me faisait rire c’était la difficulté apparente du problème et aussi la joie de l’avoir, après cinq minutes, résolu.
» — Vous vous croyez raisonnable, m’écriai-je, parce que vous avez une Raison, mais vous êtes comme cent mille, vous ne savez pas vous en servir ! Ah ! ah ! on dit : « La Raison ! » Mais qu’est-ce que la Raison dans un cerveau qui ne sait par où la prendre ? C’est un merveilleux instrument à la portée d’un manchot ! Monsieur Longuet, ne détournez point ainsi la tête d’un air boudeur ; je vous le dis : Vous ne savez par quel bout prendre votre raison ! Voyons, monsieur Longuet, voyons, raisonnez avec ce papier à la main !
» Il essaya, le malheureux. Il dit : « Il y avait cinq hommes en A, cinq hommes en B. Les cinq hommes de B ont vu passer le train ; les cinq hommes de A ne l’ont point vu. Moi, j’étais en K ; je suis sûr qu’il n’est pas passé en K… par conséquent… »
» — Par conséquent ?… Par conséquent, il n’y a plus de train ? Par conséquent, votre train s’est évanoui ? Volatilisé ? Envolé ? Psst ! Train disparaissez ! Vous croyez peut-être que le train est dans la manche de Dieu ! Vous voyez bien, monsieur Longuet, que si vous avez une raison, vous ne savez pas vous en servir ! Permettez-moi de vous dire que vous avez pris votre raison par le mauvais bout ! Le mauvais bout est celui qui commence par : « Nous n’avons pas vu le train », et qui finit par : « Donc, il n’y a plus de train ! » Or, moi, je vais vous donner à tenir le bon bout de votre raison. C’est celui-ci : la vérité est que le train existe et qu’il existe entre les point B où on l’a vu passer, A où on ne l’a pas vu passer et i où il aurait pu aller. Puisque nous sommes dans une plaine, votre train est entre A B et i. C’est sûr…
» — Mais !
» — Chut ! Taisez-vous ! Et puisque nous sommes dans une plaine et que dans cette plaine il n’y a qu’un monticule de sable, le seul endroit où le train aurait pu disparaître, en i, le train est dans le monticule de sable c’est la vérité éternelle !…
» — Ça, je jure que non ! J’étais en K, attendant le train, et je n’ai pas quitté la voie hi.
» — Par les chefs-d’œuvre immortels de la Renaissance italienne ! je vous ordonne de ne point lâcher le bon bout de votre raison que je vous ai donné à tenir. Nous discutons en ce moment ce qui est, nous n’en sommes pas encore au comment. C’est parce que vous avez commencé par le comment que vous n’avez pu aboutir à ce qui est. Le train est dans i, puisqu’il ne peut être autre part. Si je suis sûr que cinq hommes n’auraient pas pu le voir passer en B comme ils l’affirment, alors qu’il ne serait pas passé, je suis aussi certain que cinq hommes n’ont pas pu ne pas le voir en A, alors qu’il serait passé ; et puisque la ligne AB, examinée, était vide de train, c’est qu’il s’est engagé sur la ligne hi. Nous voilà donc, avec le train sur la ligne hi.
» — Mais moi aussi j’y suis, s’écrie Théophraste, et je vous jure qu’il n’y est pas !
» — Ah ! le malheureux qui lâche encore le bout de sa raison ! Vous êtes en K ; le train passe en K ; il faut qu’il passe en K et il faut qu’il aille se jeter en i, puisqu’il ne peut pas être autre part. Par un hasard nécessaire, pendant que le commencement du train s’engouffre dans le monticule de sable qui l’engloutit (j’imagine avec certitude que la ligne hi est trop courte pour que le mécanicien, s’étant aperçu par exemple, de son erreur à mi-route, ait eu le temps de parer la catastrophe), la chaîne d’attelage du dernier wagon est brisée, et le wagon ainsi que le fourgon de queue se mettent à descendre jusqu’en K la voie qui était un peu montante, puisqu’elle allait à un monticule. Là, après être descendu en h et remonté en K, vous avez vu le wagon et M. Petito à la portière. (Votre M. Petito a ouvert la portière, peut-être pour se jeter sur la voie, au moment où il s’est rendu compte de la catastrophe imminente, et comme celle-ci s’est produite, un choc a refermé la portière sur la tête de votre M. Petito.)
» — Ça, je le comprends ! Mais ce que je ne comprends pas…
» — Voyons d’abord tout ce que nous comprenons. C’est le bon bout de la raison. Nous verrons ensuite ce que nous ne comprenons pas. On n’a retrouvé personne dans le fourgon. La secousse a certainement projeté le garde-frein dans le sable. Tout cela est certain. Maintenant, après avoir dépouillé M. Petito de ses habits, vous vous asseyez sur un talus et vous lisez les papiers de votre M. Petito. Quand vous levez la tête, le wagon n’est plus là ! Parbleu ! puisqu’il y a pente et puisqu’il y a du vent, un vent qui, à la portière, agitait la tête de M. Petito comme un pavillon ! Le wagon, après avoir glissé jusqu’en h, s’est retrouvé sur la ligne AB, un peu plus loin que h, du côté de B, où les hommes d’équipe l’ont certainement retrouvé ! Comprenez-vous, maintenant ? Comprenez-vous tout, excepté que vous n’avez pas vu le train passer en K ? Puisque tout s’explique ainsi, il faut que la chose se soit passée ainsi ; et alors seulement je recherche comment vous n’avez pas vu le train passer en K. Ce qui est impossible à expliquer pour cinq personnes en A ou en B doit l’être pour une en K.
» — J’attends ! dit Théophraste.
» Je continuai en ricanant, et vraiment vous allez voir qu’il y avait de quoi ricaner :
» — Il y a des moments où vous êtes sourd, monsieur Longuet ?
» — J’ai déjà eu l’honneur de vous le dire.
» — Imaginez que vous étiez sourd au moment où vous attendiez le train en K, vous ne l’avez donc pas entendu ?
» — Oui, mais je l’aurais vu.
» — Déjà, vous ne l’avez pas entendu ! C’est beaucoup cela ! Dieu vous bénisse ! monsieur Longuet ! Dieu vous bénisse ! (M. Longuet éternuait.)
» M. Longuet me remercia de ce que je priais Dieu de le bénir et, comme il éternuait encore, je tirai ma montre de sa poche (il me l’avait déjà prise) et je lui dis :
» — Savez-vous, monsieur Longuet, combien dure un seul de vos éternuements ? c’est-à-dire combien vous restez de temps la tête basse pendant que vous éternuez ?… Trois secondes !… C’est-à-dire une seconde 30 centièmes de plus qu’il ne faut pour ne pas voir passer devant soi un train de quatre wagons qui, étant en retard, fait du cent vingt à l’heure. Monsieur Longuet, le train a disparu ou plutôt a semblé disparaître, parce que vous étiez sourd et enrhumé !
» M. Longuet leva des bras démesurés vers les voûtes des catacombes.
XXXI
OÙ M. LE COMMISSAIRE DE POLICE MIFROID TROUVE QU’IL A TROP DE LUMIÈRE
» Quand M. Longuet fut remis de l’émotion que lui avait causée mon explication de la disparition du train, il m’embrassa et me passa un revolver qu’il avait trouvé dans la poche de son M. Petito. Il ne voulait pas le conserver sur lui. Il désirait que je pusse me défendre, au besoin, contre des fantaisies dont il redoutait, avec une sagesse due, hélas ! à une trop réelle expérience, le dangereux retour. Pour la même raison, il me confia un grand couteau qui venait toujours de la poche de M. Petito.
» Nous rîmes et nous nous occupâmes sérieusement de notre situation. M. Longuet continuait à vider ses poches, et ainsi il sortit sept petites lampes électriques, semblables à celles dont j’avais fait l’acquisition avant que de choir en ce trou. Il se félicita, disant que son instinct avait du bon, qui l’avait poussé à les dérober, car, en comptant mes six lampes, nous avions maintenant treize lampes, ce qui, à quarante-huit heures au minimum d’électricité pour chacune, nous donnait cinq cent vingt heures de lumière consécutive. Il ajouta que, comme il fallait considérer qu’au préalable nous pouvions rester dix heures par jour sans lumière, à cause du sommeil et du repos de midi (M. Longuet avait l’habitude de la sieste), son calcul lui donnait donc, à quatorze heures de lumière par jour, trente-sept jours plus deux heures de lumière pour le trente-huitième jour.
» Je dis à M. Longuet :
» — Monsieur Longuet, vous êtes tout à fait vieux jeu. Cartouche, enfermé dans les catacombes, n’en eût pas agi autrement avec des lampes électriques. Mais moi, monsieur Longuet, moi, je prends vos sept lampes et j’y joins trois des miennes, et voilà ce que je fais de ces dix lampes !…
» Et je les jetai négligemment loin de nous. J’ajoutai :
» — Nous n’avons que faire de trimballer ces impedimenta. Avez-vous faim, monsieur Longuet ?
» — Oh ! très faim, monsieur Mifroid.
» — Combien de temps pensez-vous pouvoir avoir faim ?
» Comme M. Longuet semblait ne pas comprendre, je lui expliquai que j’entendais par là lui demander combien, selon lui, il pouvait rester de temps à avoir faim sans manger.
» — Je crois bien, assura-t-il, que s’il me fallait rester quarante-huit heures avec cette faim-là…
» — Mettons, interrompis-je, que vous restiez sept jours avec cette faim-là ; trois lampes nous suffisent donc, car au bout de ces trois lampes nous n’aurons plus besoin de lumière !…
» Il avait compris ! Mais bien qu’il eût compris, il ramassa encore deux lampes. Je me moquai et nous nous mîmes en route.
» — Où allez-vous ? me demanda-t-il.
» — N’importe où, fis-je, mais il faut aller partout, plutôt que de rester là, puisque là il n’y a aucun espoir. Nous réfléchirons en marchant. La marche est notre seul salut ; mais en marchant sept jours sans prendre de point de repère, nous risquerons tout de même d’arriver quelque part.
» — Pourquoi sans prendre de point de repère ? me demanda-t-il.
» — Parce que, répliquai-je, j’ai remarqué que dans toutes les histoires de catacombes, ce sont toujours les points de repère qui ont perdu les malheureux égarés. Ils mêlaient leurs points de repère, n’y comprenaient plus rien et s’affalaient désespérés. Il faut éviter, dans notre situation, toute cause de désespoir. Vous n’êtes pas désespéré, monsieur Théophraste Longuet ?
» — Oh ! nullement, monsieur le commissaire de police Mifroid. J’ajouterai même que si j’avais moins faim, votre aimable société aidant, je ne regretterais nullement les toits de la rue Gérando. Pour tromper ma faim, monsieur le commissaire, vous devriez bien me raconter des histoires sur les catacombes.
» — Mais certainement, mon ami.
» — Vous en connaissez de fort belles ?
» — De tout à fait belles. Il y a l’histoire du « Concierge » et l’histoire des « Quatre soldats ».
» — Par laquelle allez-vous commencer ?
» — Je vais d’abord vous entretenir, si vous le permettez, mon ami, des catacombes en général ; ceci vous fera mieux comprendre pourquoi il est absolument nécessaire de marcher longtemps pour en sortir.
» Ici, M. Longuet m’interrompit et me demanda pourquoi, en terminant mes phrases, j’avais toujours ce geste du pouce de la main droite dont je ne puis me défaire « depuis le buste de César ».
» — Serait-ce, monsieur le commissaire, que ce geste du pouce vous vient de l’habitude de mettre les « poucettes ? »
» Je lui répondis que non, mais que je le tenais de ce que, ami des beaux-arts, je me livrais souvent à celui de la sculpture. C’est, lui expliquai-je, le geste du modelage. J’enfonce mon pouce dans mon discours comme dans ma glaise…
» Il me remercia en s’étonnant qu’un commissaire de police s’occupât de sculpture. Je lui répondis que c’était le nouveau jeu.
» Et maintenant que je connais les événements, je puis dire avec un certain orgueil que si je n’avais pas été sculpteur, nous ne serions jamais sortis des catacombes !
» Ayant remonté ma montre dans le moment que M. Longuet éternuait, raconte M. Mifroid, nous étions fixés sur l’écoulement des jours et des nuits. Je laissai ma montre dans la poche de M. Longuet, ce dont il me remercia en me disant que : « d’avoir ma montre dans sa poche, cela le soulagerait beaucoup. »
» Qu’est-ce que cela, au fond, pouvait me faire, qu’il eût ma montre, puisque je savais où était l’heure ?
» Je n’eusse jamais pensé cette dernière phrase hors des catacombes, et, maintenant, je la jugeais sans importance. Or, cette phrase renferme une révolution, auprès de laquelle les bouleversements sociaux de 1793 sont de petits jouets de peuple en enfance. Je devais m’en rendre compte à quelque temps de là.
» Le chemin que nous suivions était une galerie assez vaste, de quatre à cinq mètres de haut. Les parois en étaient fort sèches, et la lumière électrique dont nous l’éclairions nous faisait voir une pierre dure, exempte de toute végétation parasite, exempte même de moisissure. Cette constatation n’était point pour réjouir M. Longuet, car s’il commençait à avoir grand’faim, il claquait déjà de la langue avec une ostentation qui attestait son désir de se désaltérer. Je savais qu’il y avait dans les catacombes des filets d’eau courante. Je remerciai le ciel de ne nous avoir point mis sur la trace d’un de ces filets-là, car nous n’eussions point manqué de perdre un temps précieux à nous y abreuver. De plus, comme nous ne pouvions emporter d’eau, ce liquide n’aurait servi qu’à nous donner soif.
» M. Longuet se faisant difficilement à cette idée que nous marchions sans vouloir savoir où, je résolus de le mettre à même de comprendre la nécessité de vouloir marcher au hasard, en lui racontant, ce qui était la vérité, que, lors des dernières réfections de la voie, les ingénieurs, étant descendus dans le trou des catacombes, avaient en vain cherché à s’orienter et à trouver une issue ; ils avaient dû y renoncer, faire construire les trois piliers de soutènement et maçonner la voûte avec des matériaux descendus directement dans le trou et retirés par ce trou avant sa clôture définitive qui, malheureusement, s’était faite sur nos têtes.
» Pour ne point le décourager, j’appris à M. Longuet qu’à ma connaissance nous pouvions compter sur au moins cinq cents kilomètres de catacombes[31], mais qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il n’y en eût pas davantage. Évidemment, si je ne l’avais averti tout de suite de la difficulté de sortir de là, il eût manifesté son désespoir le deuxième jour de marche.
» — Songez donc, lui dis-je, qu’on a creusé ce sol du troisième au dix-septième siècle ! Oui, pendant quatorze cents ans, l’homme a enlevé sous ce sol les matériaux qui lui étaient nécessaires pour construire dessus ! Si bien que de temps à autre, comme il y a trop de choses dessus et qu’il n’y en a plus du tout dessous, le dessus retourne au dessous, d’où il est sorti.
Et puisque nous nous trouvions encore sous l’ancien quartier d’Enfer, je lui rappelai qu’en 1777 une maison de la rue d’Enfer fut engloutie de la sorte « par le dessous ». Elle fut précipitée à vingt-huit mètres au-dessous du sol de sa cour. Quelques mois plus tard, en 1778, sept personnes trouvaient la mort dans un éboulement semblable, du côté de Ménilmontant. Je lui citai encore quelques exemples plus rapprochés, insistant sur les accidents de personnes. Il comprit et me dit :
» — En somme, il est souvent plus dangereux de se promener dessus que dessous.
» Je le tenais, et le voyant, ma foi, tout ragaillardi, ne me parlant plus de sa faim, oubliant sa soif, j’en profitai pour lui faire allonger le pas et j’entonnai le refrain le plus entraînant qui me vint à la mémoire. Il le reprit, et nous chantâmes en chœur :
Au pas, camarade, au pas,
La route est belle !
Y’aura du frichti là-bas
Dans la gamelle !
» C’est ça qui vous fait marcher au pas !
» Quand nous fûmes fatigués de chanter (on se fatigue très vite de chanter dans les catacombes parce que la voix ne porte pas), M. Longuet me fit encore cent questions. Il me demanda combien nous avions de mètres sur la tête, et je lui répondis que cela pouvait varier, d’après les derniers rapports, entre 5 m. 82 et 79 mètres.
» — Quelquefois, lui dis-je, la croûte terrestre est si peu épaisse qu’il faut prolonger les fondations des monuments jusqu’au fond des catacombes. C’est ainsi qu’au cours de nos pérégrinations nous risquons de rencontrer les piliers de Saint-Sulpice, de Saint-Étienne-du-Mont, du Panthéon, du Val-de-Grâce, de l’Odéon… Ces monuments s’élèvent en quelque sorte sur des pilotis souterrains…
» — Pilotis souterrains ! fit-il, pilotis souterrains ; vraiment, au cours de nos pérégrinations, nous risquons de rencontrer des pilotis souterrains…
» Mais il avait son idée fixe :
» — Et, au cours de nos pérégrinations, est-ce que nous risquons de rencontrer une sortie ? Y a-t-il beaucoup de sorties des catacombes ?
» — Ce n’est point, lui répondis-je, ce qui manque. D’abord, nous avons des sorties dans le quartier…
» — Tant mieux ! interrompit-il.
» — Et d’autres que l’on ne connaît pas, des sorties par lesquelles on n’« entre » jamais, mais qui n’en existent pas moins : dans les caves du Panthéon, dans celles du collège Henri IV, de l’Observatoire, du séminaire Saint-Sulpice, de l’hôpital du Midi, de quelques maisons de la rue d’Enfer, de Vaugirard, de la Tombe-Issoire ; à Passy, à Chaillot, à Saint-Maur, à Charenton, à Gentilly… plus de soixante…
» — Y a du bon !
» — Il y avait du meilleur, répliquai-je, avant Colbert.
» — Ah ! ah !
» — Ne faites pas : « Ah ! ah !… » Si Colbert, le 11 juillet 1678…
» — Épatant ! interrompit M. Longuet, vous avez autant de mémoire que M. Lecamus.
» — Ne vous étonnez point, monsieur Longuet. J’ai été secrétaire du commissaire, autrefois, dans le quartier, et il m’a plu de m’intéresser aux catacombes, comme il m’a plu depuis de faire du violon et de la sculpture. Vous en êtes resté au commissaire de police vieux jeu, permettez-moi de vous le dire en passant, mon cher monsieur Théophraste Longuet !
» Pan ! dans l’œil ! Il ne répliqua point.
» — Vous disiez donc que Colbert, le 11 juillet 1678 ?
» — … Pour mettre un frein à la cupidité des entrepreneurs, fit rendre une ordonnance qui bouchait les issues des catacombes… L’ordonnance de Colbert, mon cher monsieur Longuet, nous a quasi murés.
» À ce moment, nous frôlâmes un pilier énorme. J’en examinai la structure et je dis, sans m’arrêter :
» — Voici un pilier qui a été bâti par les architectes de Louis XVI en 1778, lors des consolidations !
» — Ce pauvre Louis XVI ! dit M. Longuet : il eût mieux fait de consolider la royauté.
» — C’eût été, répliquai-je avec à-propos, consolider une catacombe ! (Cependant je crois que catacombes ne s’emploient qu’au pluriel.)
» M. Longuet m’avait pris la lampe électrique des mains et ne cessait d’en diriger les rayons à droite et à gauche, comme s’il cherchait quelque chose ; je lui demandai la raison de ce geste qui finissait par me fatiguer les yeux.
» — Je cherche, dit-il, des cadavres.
» — Des cadavres ?
» — Des squelettes. On m’avait dit que les murs des catacombes étaient « tapissés » de squelettes.
» — Oh ! mon ami, cette tapisserie macabre (je l’appelais déjà mon ami, tant sa sérénité, en une aussi grave occurrence, était faite pour me ravir), cette tapisserie macabre n’est guère plus longue qu’un kilomètre. Ce kilomètre, justement, s’appelle l’ossuaire, à cause des crânes, radius, cubitus, tibias, fémurs, phalanges, thorax et autres osselets qui en font l’unique ornement. Mais quel ornement ! C’est un ornement de trois millions cinquante mille squelettes qu’on a tirés des cimetières et nécropoles de Saint-Médard, Cluny, Saint-Landry, des Carmélites, des Bénédictins et des Innocents ! Tous os, osselets bien triés, arrangés, coordonnés, classés, étiquetés, qui font sur les murs et dans les carrefours, des rosaces, parallélipipèdes, triangles, rectangles, volutes, corniches et maintes autres figures d’une régularité merveilleuse. Souhaitons, mon ami, d’arriver dans ce domaine de la mort. Ce sera la vie ! Car je ne connais pas à Paris d’endroit plus agréablement fréquenté ! On n’y rencontre que des fiancés, des jeunes mariés en pleine lune de miel, les amants et généralement tous les gens heureux. Mais nous n’y sommes pas ! Qu’est-ce qu’un kilomètre d’ossements sur cinq cents !
» — Évidemment ! Combien estimez-vous, monsieur Mifroid, que nous ayons fait de kilomètres ?
» — Mettons neuf.
» — Qu’est-ce que neuf kilomètres sur cinq cents ?
» J’engageai M. Longuet à ne point faire de ces calculs inutiles et il me pria de lui raconter l’histoire du « Concierge » et celle des « Quatre soldats. »
» Cela faisait deux histoires qui n’étaient guère longues à narrer. Elles nous firent passer tout de même un kilomètre. La première tient en quelques mots. Il y avait une fois un concierge des catacombes qui s’égara dans les catacombes : on retrouva huit jours plus tard son cadavre. La seconde se rapporte à quatre soldats du Val-de-Grâce qui descendirent, à l’aide d’une corde, dans un puits de quatre-vingts mètres. Ils étaient dans les catacombes. Comme ils ne reparaissaient pas, on fit descendre des tambours qui firent le plus de bruit qu’ils purent avec leurs peaux d’âne. Mais, dans les catacombes, comme la voix ne porte pas, nul ne répondit au roulement. On fit des recherches. Au bout de quarante heures, on les trouva mourants dans un cul-de-sac.
» — Ils n’avaient pas de résistance morale, dit Théophraste.
» — C’étaient des imbéciles, ajoutai-je. Quand on est assez bête pour s’égarer dans les catacombes, on ne mérite aucune pitié, je dirai même aucun intérêt.
» Là-dessus, Théophraste me demanda comment je ferais, moi, pour ne pas m’égarer dans les catacombes. Comme nous arrivions à un carrefour, je pus lui répondre sans tarder.
» Je lui dis :
« — Voici deux galeries ; laquelle allez-vous prendre ?
» L’une s’éloignait presque directement de notre point de départ ; l’autre y revenait presque sûrement ; comme notre dessein à nous était de nous éloigner de notre point de départ, M. Longuet me montra la première galerie.
» — J’en étais sûr ! m’exclamai-je. Mais vous ignorez donc tout de la méthode expérimentale ? La méthode expérimentale, au fond des catacombes, a démontré, depuis des siècles, que tout individu qui croit revenir à son point de départ (à l’entrée des catacombes) s’en éloigne : donc, il est de toute logique que, pour s’éloigner de son point de départ, il faut prendre le chemin qui paraît y ramener !
» Et nous nous engageâmes dans la galerie qui semblait nous ramener sur nos pas. Comme cela, nous étions sûrs de n’avoir pas fait un inutile chemin !
« Ce système était excellent, car il nous conduisit dans une certaine contrée des catacombes que personne n’avait visitée avant nous depuis le quatorzième siècle ; autrement, on le saurait.
XXXII
OÙ M. LE COMMISSAIRE DE POLICE MIFROID, QUI A EU L’OCCASION DE VISITER LE LABORATOIRE DE MILNE-EDWARDS, RACONTE À M. THÉOPHRASTE LONGUET DES « HISTOIRES NATURELLES » QUI LE RASSURENT UN PEU QUANT À SA FAIM FUTURE, SANS LUI ENLEVER TOUTE PRÉOCCUPATION QUANT À SA FAIM PRÉSENTE.
« M. Théophraste Longuet, raconte M. Mifroid, ne cessait, depuis quelques heures, de me fatiguer de ses réflexions inutiles sur l’état de son estomac. Il n’y avait pas un jour et demi que nous nous trouvions dans les catacombes et déjà ce pauvre homme se plaignait de la nécessité où nous nous trouvions de marcher sans manger. « Manger » : ce mot prenait dans la bouche de Théophraste une importance considérable. Il semblait, à l’entendre, que nous ne devions penser qu’à cette chose : « manger ». À quoi cela nous eût-il servi de « manger » ? Je vous le demande. J’ai toujours eu le sourire quand, dans les histoires de naufrages, l’« auteur » apporte au malheureux qui se noie une bouée qui, sur la mer immense et démontée, ne pourra servir qu’à prolonger l’agonie de celui-ci et les phrases de celui-là. Certes, je n’aurais pas, étant doué autant que quiconque de l’esprit pratique, négligé, en état de naufrage, le secours d’une bouée au milieu de la Seine ou encore dans le détroit du Pas-de-Calais, entre Douvres et le cap Gris-Nez, mais, sur une mer immense et démontée, j’eusse repoussé la bouée, l’inutile bouée, et me serais résolu à une mort immédiate dans l’abîme plutôt qu’à danser sans espoir à la crête écumante des vagues. Ainsi j’aurais estimé perdre mon temps en gestes vains et inutiles si, obéissant à l’instigation de Théophraste, qui voulait « manger », j’avais accroché mon espoir à quelques maigres végétations cryptogamiques que mon regard attentif venait de découvrir à la paroi humide des galeries que nous parcourions alors.
« Ah ! si nous avions pu interrompre notre course d’un bon repas qui nous eût donné des jambes pour continuer notre route, j’aurais été le premier à dire à Théophraste : « Mangeons, ami, la table est servie ! » Mais, pour quelques champignons, peut-être vénéneux, arrêter notre marche eût été le fait de sots et peu intéressants personnages…
» M. Théophraste Longuet n’est pas raisonnable… Puisqu’il a faim et qu’il n’est pas près de sortir des catacombes, il veut que je lui dise ce qu’il pourrait manger pour ne pas mourir de faim, s’il devait rester dans les catacombes. C’est un enfant. Heureusement, j’ai visité le laboratoire des catacombes de M. Milne-Edwards, et je pus l’entretenir de la faune et de la flore obscuricoles et cavernicoles, dont, au besoin, il se pourra repaître…
» Du reste, ce genre de conversation — en vain m’efforcerais-je de le dissimuler — me plaît. Oui, il me plaît de parler des choses qui se mangent. C’est, sans doute, que ne voulant pas m’avouer que j’ai faim, j’ai faim tout de même. Il y a des moments où, malgré soi, on est vieux jeu.
» — Mon cher ami, dis-je à Théophraste, il se peut, même si vous ne sortez des catacombes, que vous ne mouriez pas de faim.
» — Pourrais-je mourir de soif ? interrompit-il.
» — Je crois bien que si vous mourez de soif, vous mourrez de faim… Mais si vous ne mourez pas de soif, vous ne mourrez pas de faim.
» — Quel mystère est-ce là ? Expliquez-vous, monsieur le commissaire.
» — Voici. La flore obscuricole, la végétation cryptogamique, les champignons des catacombes, pour tout dire, ne parviendront jamais, je le crains, à calmer les transports d’une faim qui, si j’en crois vos jeux de physionomie, augmente dans des proportions inquiétantes pour tout être vivant ! (Disant cela, je faisais une allusion évidente au danger que je courais d’être mangé d’ici quarante-huit heures par le sanguinaire et impitoyable Théophraste, ce qui eût été parfaitement ridicule, mais dans l’ordre. Lisez, à ce sujet, tous les radeaux de la Méduse et tous les Arthur Gordon Pym de l’univers.) Mais nous pouvons rencontrer de l’eau ! Et alors, vous pourrez manger !
» — Boire ! fit-il.
» — Manger et boire. Vous vous ferez ichtyophage.
» — Qu’est-ce que c’est que ça ?
» — Les ichtyophages sont les mangeurs de poissons.
» — Ah ! ah ! s’exclama-t-il avec une immense satisfaction ; il y a de l’eau dans les catacombes, et, dans cette eau, il y a des poissons ? Sont-ce de gros poissons ?…
» — Ce ne sont point de gros poissons, mais certaines eaux courantes en contiennent des quantités incalculables.
» — Vraiment ? Incalculables ?… Incalculables ?… Comment sont-ils gros ?
» — Oh ! il en est de différentes tailles… généralement ils sont petits. Mais ils ne sont point désagréables au goût…
» — Vous en avez mangé ?
» — Non, mais on me l’a affirmé quand je suis descendu dans l’ossuaire et que je visitai la fontaine de la Samaritaine, qui est une très belle et très confortable fontaine.
» — Elle est loin d’ici ?
» — En ce moment, je ne pourrais vous dire. Tout ce que je sais, c’est que cette fontaine fut construite en 1810, par M. Héricourt de Thury, ingénieur des carrières souterraines. Actuellement, cette fontaine est occupée par les copépodes (cyclops fimbriatus) ! !…
» — Ah ! ah ! les copépodes ? C’est des poissons ?
» — Oui, ils présentent des modifications de tissus, de coloration, tout à fait particulières… Ils ont un bel œil rouge.
» — Comment ? Un œil ?
» — Oui ! C’est pour cela qu’on les appelle cyclops. De ce que ce poisson n’ait qu’un œil, il ne faut point vous étonner, car l’asellus aquaticus, qui vit également dans les eaux courantes des catacombes, est un petit Isopode aquatique, comme son nom l’indique, qui souvent n’a pas d’yeux du tout. Beaucoup d’exemplaires ne présentent plus à la place de l’œil qu’une petite pigmentation rougeâtre. D’autres, enfin, n’en ont nulle trace.
» — Pas possible ! s’écria Théophraste. Alors, comment voient-ils clair ?
» — Ils n’ont pas besoin de voir clair, puisqu’ils vivent dans l’obscurité. La nature est parfaite ! crus-je devoir alors m’écrier, et jamais je ne m’élèverai avec assez de colère contre ceux qui nient cette perfection ! Il est parfait que la nature donne des yeux à ceux qui en ont besoin ! Il est parfait que la nature les ôte à ceux à qui ils ne sont plus nécessaires !
» Théophraste fut frappé de mes paroles.
» — Alors, me dit-il, nous, si nous continuions à vivre dans les catacombes, nous finirions par ne plus avoir d’yeux ?
» — Évidemment ! Nous, nous commencerions à perdre l’usage du regard et le regard lui-même. Nos enfants perdraient bientôt les yeux !
» — Nos enfants !… s’écria-t-il.
» Nous rimes beaucoup de ce léger lapsus.
» Puis, comme il insistait encore à ce que je l’entretinsse des poissons que nous pouvions trouver dans les catacombes et que nous pourrions peut-être manger, je fus ainsi amené à lui faire une sorte de cours sur les modifications des organes, leur développement excessif ou leur atrophie, suivant les milieux fréquentés par les individus.
» — Si les poissons dont je vous parle n’ont plus d’yeux… fis-je.
» — Oh ! ça m’est égal, je ne mange jamais la tête…
» — … En revanche, leurs organes sensoriels présentent de profondes modifications. Ainsi, l’asellus aquaticus, dans l’espèce normale même, est armé de petits organes aplatis, ovulaires, terminés par un pore, que l’on considère comme des organes olfactifs. Ce sont de véritables bâtonnets olfactifs. En outre, différents poils, les uns ramifiés, les autres droits, sont, à n’en point douter, des poils tactiles… des poils qui tâtent l’espace. Et ces bêtes qui ne voient pas, grâce à ces organes olfactifs et tactiles, si entièrement développés, connaissent l’espace autour d’eux aussi bien et peut-être mieux que s’ils voyaient dans la lumière[32] ! Oui, mon cher Théophraste, il y a des circonstances dans la vie des animaux où le nez remplace l’œil. Et ce nez peut acquérir ainsi des dimensions tout à fait incroyables. Dans le puits de Padirac, qui est dans le Lot, M. Armand Viré, qui est un savant, a trouvé un asellide à cent cinquante mètres de profondeur et à près d’un kilomètre de l’entrée du gouffre, qui possède des bâtonnets olfactifs d’une longueur tout à fait surprenante !
» — Est-ce qu’il n’y a, dans les eaux courantes des catacombes, que cet asellus aquaticus ? demanda Théophraste.
» — Que non point ! Il s’y trouve encore maintes autres sortes de poissons cavernicoles, tel par exemple le niphargus puteanus, et ce dernier en grande abondance.
» — Tant mieux ! s’écria Théophraste, tant mieux !
» — Les organes oculaires du niphargus puteanus sont également atrophiés…
» — Ceci m’est égal, fit encore M. Longuet, qui avait son idée. Savez-vous seulement comment on le pêche ?
» — Je ne saurais affirmer que les catacombes, fis-je, qui contiennent tant de centaines de mille d’ossements, puissent nous présenter, en cette occurrence, le secours d’un asticot.
» — Il n’importe ! s’écria Théophraste, un pêcheur à la ligne a plus d’un tour dans sa boutique, et le nommé puteanus n’a qu’à bien se tenir !
» Ici, nous prîmes quelque repos. Nous nous endormîmes en songeant aux eaux courantes fréquentées par l’asellus aquaticus et par le niphargus puteanus. Nos rêves furent magnifiques, mais de beaucoup dépassés par la surprise inexprimable de notre réveil.
XXXIII
OÙ MM. MIFROID ET LONGUET FONT, POUR LA PREMIÈRE FOIS, CONNAISSANCE AVEC GENTILLE DAME JANE DE MONTFORT ET DAMOISELLE DE COUCY, DANS QUEL ÉQUIPAGE, ET CE QUI S’EN SUIVIT AU FOND DES CATACOMBES.
« Nous nous étions endormis sur un sol mou, quasi-humide, sur une terre presque végétale. J’avais tiré de cette remarque le meilleur augure pour un prochain avenir. En somme, notre voyage, jusqu’à cette heure, n’avait présenté de remarquable que quelques bribes de conversation entre Théophraste et votre serviteur. Les galeries souterraines que les feux de notre lampe électrique illuminaient, tantôt vastes, tantôt étroites, tantôt arrondies comme des nefs de cathédrale, tantôt carrées et angulaires et si mesquines qu’il nous fallait nous traîner à genoux, ne nous présentaient point un spectacle d’une grande variété. Quand nous avions dit : « Tiens, de la pierre ! Tiens, de l’argile ! Tiens, du sable ! » nous avions tout dit, parce que nous avions tout vu !…
» Ceci ne pouvait durer. Depuis quarante-huit heures que nous marchions sans avoir rencontré d’eau, nous commencions, suivant moi, à avoir les plus grandes chances de tomber sur quelque filet d’eau courante. Mon espoir, comme vous voyez, était bien modeste. De combien fut-il dépassé ! Je vous laisse à en juger quand vous aurez appris de quelle merveille, dix minutes plus tard, nos yeux furent éblouis.
» — En route ! avais-je fait, et Théophraste, debout, ayant serré de deux crans sa ceinture, fut prêt à reprendre sa route, sans m’entretenir cette fois de sa faim ni de sa soif. Le brave homme devait penser sans doute que mon estomac n’était pas plus à la noce que le sien. Nous nous remîmes à marcher, notre veston sur le bras, tant il faisait chaud. Jusqu’à la veille à quatre heures de l’après-midi, j’avais estimé que notre température était d’environ dix degrés centigrades, puis cette température n’avait fait qu’augmenter, au fur et à mesure que nous avancions dans la basse galerie que nous ne devions plus quitter que pour aboutir à ce que je vais vous dire tout à l’heure. Maintenant, je pensai qu’il faisait plus de vingt degrés centigrades, et la sueur coulait de nos fronts en abondance. Nous nous promenions dans un brûlant été. À quoi devions-nous attribuer cette hausse subite de la température ? Étions-nous plus bas dans la terre ? ou avions-nous simplement plus de terre au-dessus de nous ? Certaines galeries, je le savais, s’enfonçaient à plus de soixante-dix-neuf mètres au-dessous de la surface du sol de Paris. Qui eut pu dire à quelle distance du sol nous nous trouvions alors ?
» Notre lampe électrique répandant son éclat autour de nous, nous avancions toujours, discutant déjà sur le feu central, quand, les parois de la galerie s’écartant tout à coup, nous nous trouvâmes dans une excavation si vaste, dans un si immense cirque, que notre lumière, si brillante fût-elle, ne pouvait nous en montrer les extrémités. Enfin, quelle ne fut pas notre joie et aussi notre stupéfaction quand, ayant regardé à nos pieds, nous nous aperçûmes que nous étions sur la berge, fleurie d’un épais tapis de mousse, d’un lac aux eaux d’une transparence cristalline, dans laquelle nous voyions s’ébattre des poissons merveilleux aux écailles incolores, sans yeux, nullement sauvages, et que nous eûmes pu saisir, nous semblait-il, en nous penchant un peu, avec la main. Enfin, nageant sur les eaux enchantées de ce lac, une troupe de canards ! Une troupe de quinze canards !
» — Quinze canards ! s’écriait tout bas Théophraste, car il avait peur de les faire fuir. Il y en a quinze ! Je les ai comptés ! Et dans sa barbe il ajouta, en pleurant de joie : « Coin ! Coin ! Coin !… »
» Puis, perdant toute espèce de respect, Théophraste me frappa sur le ventre et me dit :
» — Eh ben, mon vieux ! qu’est-ce que tu dis de ça ? C’est autre chose que tes aselides, asellus, asionus, aquaticus, masticus, mastica, masticum, puteanus ! Coin ! Coin ! Coin !
» J’avoue que j’étais un peu humilié de ne pas avoir su prévoir… Mais je reconquis bientôt tous mes avantages dans l’esprit de Théophraste, lorsque, l’ayant fait asseoir à mes côtés sur la berge, pour qu’il n’effrayât point les canards, je lui eus expliqué, avec preuves à l’appui, que ce que nous voyions là était tout à fait naturel. Il me remercia avec effusion, me disant qu’il ne se serait jamais consolé qu’un si beau lac, que de si beaux canards, en un pareil moment, n’eussent pas été naturels !
» Je ne perdis point notre temps à lui faire un cours sur le rôle que chaque genre de terrain, pouvait jouer dans un pareil phénomène ; je n’eus garde de lui obscurcir l’entendement de la théorie des couches sablonneuses reposant sur des couches imperméables. Tout de même, il fallut bien qu’il comprît que, dans les couches perméables, les eaux pouvaient former des nappes liquides continues se mouvant avec une certaine vitesse. Ces eaux courantes, entraînant peu à peu les roches et les sables environnants, des rivières souterraines prennent ainsi la place du massif originaire et opèrent de grands vides là où primitivement tout se touchait.
» Ce qui le frappa par-dessus tout, c’est le récit que je lui fis de mon voyage en Carniole. Il y a là un lac, le lac de Zirknitz, qui a environ deux lieues de long sur une lieue de large. Vers le milieu de l’été, si la saison est sèche, son niveau baisse rapidement et, en peu de semaines, il est complètement à sec. Alors, on aperçoit distinctement les ouvertures par lesquelles les eaux se sont retirées sous le sol, ici verticalement, ailleurs dans une direction latérale, sous les cavernes dont sont criblées les montagnes environnantes. Quand les eaux réapparaissent, venant du lac souterrain qui est évidemment adjoint naturellement au lac visible avec ces eaux apparaissent des poissons plus ou moins gros, sans yeux. Enfin, par une sorte de caverne sortent quelques canards du lac souterrain. « Ces canards, au moment où le flux liquide les fait ainsi jaillir à la surface de la terre, nagent bien. Ils sont complètement aveugles et presque entièrement nus, c’est-à-dire sans plumes. La faculté de voir leur revient en peu de temps, mais ce n’est guère qu’au bout de deux ou trois semaines que leurs plumes, toutes noires, ont assez poussé pour qu’ils pussent s’envoler. Vœlvesor visita le lac de Zirknitz en 1687, ajoutai-je pour qu’aucun doute ne restât dans l’esprit de M. Longuet sur le phénomène naturel des canards, et il y prit lui-même un grand nombre de ces canards ; il pêcha des anguilles sans yeux et des tanches et des brochets sans yeux qui avaient un poids énorme. Certains de ces brochets pesaient quarante livres ! Il y a donc à Zirknitz, non seulement une immense nappe souterraine, mais un lac véritable, avec les poissons et les canards qui peuplent les lacs de la surface[33].
» M. Théophraste Longuet, qui ne lâchait point des yeux les canards, ne cessait de répéter :
» — Vous avez raison, monsieur le commissaire. Ce sont des canards naturels !
» J’ajoutai qu’en France il y avait aussi des lacs de Zirknitz. Près de Sablé, en Anjou, il y a un gouffre de six à huit mètres de diamètre dont on n’a pu déterminer la profondeur ; ce gouffre, connu dans le pays sous le nom de « Fontaine-sans-fond », déborde quelquefois, et alors il en sort une quantité prodigieuse de poissons, et surtout de brochets truités d’une espèce particulière…
» — Ils n’ont point d’yeux ! interrompit Théophraste, je le sais, monsieur le commissaire ; mais puisque ces poissons et ces canards n’ont point d’yeux, ils doivent être faciles à prendre pour ceux qui en ont envie !…
» Théophraste ne parlait de rien moins que de se jeter à l’eau pour aller pêcher un canard, quand ma main s’appesantit sur son épaule ; il se tut, et il nous eût été impossible, dès lors, de formuler un son, tant ce que nous vîmes nous cloua la langue !
» Notre étoile électrique venait de découvrir, assez loin devant nous, mais assez près pour que nous ne perdions aucun détail de cette inoubliable scène, un corps de femme ! Ce corps, debout sur la berge de mousse, était absolument nu. Il nous tournait le dos.
» Je jure que, de ma vie, moi, un artiste, je n’ai jamais vu pareil corps de femme ! Cette première vision, du reste, ne dura qu’un instant, car le corps nu de cette femme se jeta à l’eau et se mit à nager avec la grâce et l’aisance d’une jeune otarie.
» Cette apparition nous avait fait oublier les canards ; ce qui prouve une fois de plus que l’art immortel peut faire oublier bien des choses. Théophraste ni moi ne songions plus à la faim qui nous serrait les entrailles. Nous n’avions plus qu’une crainte, c’est que l’apparition ne s’évanouît, qu’un espoir, c’est que notre présence, évidemment inattendue, sur la berge fleurie de mousse, continuât à être insoupçonnée !
» Après quelques brasses, le corps de la belle inconnue, secouant les perles fines du lac aux eaux dormantes, se dressa encore dans sa glorieuse nudité, et cette fois, à quelques pas de nous, mais toujours de dos.
» De quoi était faite la blancheur, je veux dire la pâleur de cette chair ? Quelle carrière de Carrare ou du Pentélique donna jamais au Monde agenouillé un marbre plus précieux et plus pur ? Par quel miracle des divins enfers où le sort venait de nous précipiter pouvions-nous contempler ces lignes de définitive beauté ?
» C’étaient les hanches de la Vénus de Médicis, la taille de la Vénus de Cnide, le cou de la Vénus de Praxitèle et les bras de la Vénus de Milo ! (C’est-à-dire que l’on pouvait souhaiter à la Vénus de Milo elle-même de retrouver des bras pareils.) C’était le cou de la Diane à la biche, les épaules d’Ariane, le port de tête de Melpomène, les fossettes de la Vénus d’Arles, le mouvement de jambe de la Pallas de Velletri, la cheville de la Diane de Gabies, le pied de la Minerve pacifique et la cuisse de la Vénus Génitrix ! Enfin, si, dans les jeux de son bain, cette exquise enfant montrait les grâces d’une jeune otarie, sur la berge, l’allure de sa marche et l’unité incomparable de ses mouvements rappelaient ces grandes Panathénées qui viennent offrir le peplum à Minerve sur la frise de notre grand Phidias !
» Je souhaitai ardemment que ce chef-d’œuvre se retournât, pour m’écrier enfin dans une allégresse qui commençait à me brûler les reins : Comme elle est belle et grande et noble, cette Vénus ! Quel vague et divin sourire sur ses lèvres à demi-entr’ouvertes ; quel regard surhumain… etc., etc… Oh ! Théophile ! si tu avais été là !! (Théophile Gautier.)
» Comme si un dieu malin veillait à ce que fût accompli sur le champ mon vœu le plus brûlant, la Vénus se détourna et nous ne pûmes, Théophraste ni moi, retenir un cri d’horreur, ce qui fit que la Vénus replongea avec un grand clapotis.
» Notre Vénus n’avait pas d’yeux ! Vous entendez bien, pas les moindres traces d’yeux. Il n’y avait rien à la place des yeux ! Rien ! Rien ! Rien ! Ses oreilles, que nous avait cachées l’opulence de sa chevelure, étaient énormes et relevées en cornet, comme on le voit à certains animaux qui habitent la terre. Mais, ce qui nous effraya le plus, ce fut le nez. Était-ce un nez ? Un museau ? Je dirai le mot : un groin ? Hélas ! Hélas ! cela ressemblait davantage à un groin qu’à un nez ! Un joli petit groin rose !
» Nous n’étions pas encore revenus de notre surprise qu’une autre jeune personne, habillée celle-là d’une tunique légère mais opaque, survint sur la berge, tenant en ses bras un peignoir et tournant vers nous un identique groin rose.
» La Vénus vint vers sa compagne à la rive et sa compagne dit :
» — Ils se taisent tous cois ni nul ne sonne mot.
» La Vénus paraissait courroucée. Elle dit :
» — Ha ! saincte Marie ! n’auront nul pardon ! Véez !
» — Oïl !
» — C’est fol outrage !
» — Oïl !
» — Finablement ! Bien véaient ! sont traitours !… Je vous cuidais encore en ma compagnie. Ha ! saincte Marie !… De nos gens savez-vous nulles nouvelles ? Allez voir que c’est ni quelle chose ils font ! Je le veuil !
» Depuis que le sort m’avait précipité en le trou des catacombes, je m’étais efforcé de ne m’étonner de rien et de me préparer à tout. Qu’un lac se fût présenté à mes regards, quand j’espérais un mince filet d’eau, que des canards se fussent ébattus à portée de ma main quand je n’osais entrevoir pour le contentement de ma faim que le repas un peu maigre des chétifs asellides ; qu’une femme, plus belle de dos que toutes les femmes imaginées par le rêve des sculpteurs, se fût dressée pour mon éblouissement, sur la rive moussue d’une pièce d’eau des catacombes, à l’heure de son bain ; que cette femme, s’étant retournée, au lieu de m’exhiber le visage humain, me montrât un groin rose dépourvu d’yeux, mon Dieu ! tout cela, tout cela pouvait s’expliquer, mais que cette femme, avec son groin rose, parlât le plus pur français, la plus pure langue d’oïl du commencement du quatorzième siècle, oh ! cela ! cela était tout à fait extraordinairement étourdissant !
» Comme je pensais que Théophraste ne s’étonnait pas assez, j’allais entrer en quelque dissertation touchant la langue d’oïl, lorsque nous fûmes tout à coup entourés par une trentaine de personnages qui sortaient de je ne sais où et qui agitaient autour de nous des mains où je fus assez surpris de compter dix doigts (avec les doigts de pied, cela faisait quarante doigts par personne). Ils avaient tous des groins roses sans yeux. C’étaient des hommes, à n’en pas douter, des hommes du plus pur quatorzième siècle, pour peu qu’on prêtât l’oreille à leurs conversations tenues sur un diapason des plus bas, chose que je m’expliquai par le développement excessif de leurs organes auditifs. Beaucoup d’entre eux, tout en gesticulant d’une main, se pinçaient leur groin rose de l’autre main, c’est-à-dire de leurs dix doigts de la main gauche. Ils se pinçaient leur groin au fur et mesure qu’ils entraient dans le rayon de notre lumière. Et j’eus bientôt cette certitude que notre lumière leur procurait la sensation d’une odeur désagréable.
» Ils parlaient tous à la fois en citant à chaque instant ces noms : « Dame Jane de Montfort, demoiselle de Coucy » et nous vîmes bien qu’il s’agissait là de ces dames que nous avions dérangées à l’heure du bain. Ils ne nous effrayaient pas, mais ils nous ennuyaient avec leurs vingt doigts chacun, qu’ils ne cessaient de promener, très légèrement du reste et fort poliment, avec mille belles excuses, sur notre visage.
» Ils exprimaient sans circonlocution l’étonnement où les plongeait l’inesthétisme de nos faces et nous plaignaient hautement. Notre petit nez, notre pauvre petit nez de rien du tout leur faisait hausser les épaules avec joie. Ils tâtaient aussi nos oreilles ; enfin, ils nous enfonçaient leurs vingt doigts dans les yeux et ne pouvaient comprendre à quoi ces petits trous pouvaient servir. Je voulus le leur faire entendre, mais en vain, ils avaient perdu le sens de la signification du mot : œil… Cependant, ils se servaient du mot voir, mais c’était dans la signification de : sentir.
» Sur ce, dame Jane de Montfort et damoiselle de Coucy, qui s’était revêtue, nous furent présentées. Nous demandâmes de grands pardons. Damoiselle de Coucy les accueillit avec agrément et passa son bras sous celui de Théophraste. Dame Jane de Montfort me prit le mien, et, escortés de tous ces groins roses sans yeux qui faisaient grand bruit autour de nous, nous quittâmes les berges fleuries de mousse de l’étang et nous acheminâmes vers la Cité.
» Il me paraît superflu de vous analyser mes sensations, de vous disséquer mes étonnements. Depuis quarante-huit heures nous n’avions mangé, et cependant ni Théophraste ni moi ne fîmes, dans ce sens, aucun appel. Nos gens nous questionnaient tout le long de la route, mais leurs demandes étaient si multiples et embrouillées que nous n’avions point le temps de leur répondre. À peine pouvions-nous nous garer des doigts qui se promenaient sur notre visage.
» Où allâmes-nous ? Où entrâmes-nous ? Notre trouble était si extrême que difficilement nous nous en rendions compte. Du reste, ces dames s’étaient emparées de nos lampes sous prétexte d’être incommodées par l’odeur, et les ténèbres les plus opaques nous entouraient. Cependant, autour de nous, nous sentions grouiller des centaines, des milliers de groins roses. Dame Jane de Montfort, qui ne cessait de me pincer amicalement le bras des dix doigts de sa main droite chargés de bagues, m’apprit que nous allions au concert. Il y avait ce jour-là, paraît-il, matinée classique.
» Moi, je pensais : Pourquoi ont-ils un groin rose ?
Quand on a jeté des dorades dans la fontaine de la Samaritaine, les dorades ont perdu leurs couleurs. Ça n’est donc pas naturel qu’ils aient un groin rose. Je parvins à chiper à ma compagne une de nos lampes, et, rapidement, j’appuyai sur le bouton électrique. Je vis alors que nous étions arrivés sur une place publique. La foule des groins autour de nous était tout fait incalculable. Quelle attitude, quels profils, quels gestes ! Et cependant les groins étaient roses et parlaient la plus pure langue d’oïl du commencement du quatorzième siècle ! Ce qui n’empêchait pas les uns d’avoir la démarche des ours du Tonkin (on dirait qu’ils marchent avec les épaules), ou encore des ours de Sibérie (quand ils remuent la tête comme ça, comme ça, comme ça, sans que ça finisse jamais ; ceux-là étaient les vieillards) ; d’autres avaient le nez si long, qu’on eût juré des pélicans d’Australie, d’autres enfin avaient quelque chose du Févier d’Amérique (mais quelle chose, je ne sais plus au juste).
» Enfin, on nous avertit que nous étions à la porte du concert.
» Théophraste dit :
» — C’est bien ennuyeux ! Je n’ai pas de gants !
XXXIV
OÙ, APRÈS QUELQUES INCIDENTS D’UNE BANALITÉ COURANTE, LA NATION « TALPA » ÉTONNE VRAIMENT M. LE COMMISSAIRE MIFROID ET M. THÉOPHRASTE LONGUET.
« Évidemment, nous ne pouvions nous attendre à tomber ainsi, à l’un des innombrables détours des catacombes, dans une cité de vingt mille âmes. Tout de même, en y réfléchissant — et il faut y réfléchir — on peut se demander pourquoi l’homme, desservi par certaines circonstances, ne serait point susceptible de passer par les mêmes aventures naturelles que l’animal. Quand Arago nous raconte qu’il a vu sortir des cavernes du lac souterrain de Zirknitz des familles de canards aveugles, vous le croyez et vous êtes dans la nécessité de supposer — avec certitude — que ces canards aveugles sont fils ou petits-fils de canards qui y voyaient clair, lesquels canards se sont autrefois trouvés enfermés par un âpre destin dans les entrailles de la terre, au sein des obscures eaux. Moi, je ne suis pas Arago ; mais si le ciel vous a doué de quelque logique, vous devez raisonner pour mon phénomène, comme vous avez raisonné pour le phénomène d’Arago.
» Vous devez imaginer — avec certitude — qu’une famille, dans les premières années du quatorzième siècle, s’est trouvée enfermée dans les catacombes, à la suite d’une catastrophe qui n’a pour nous aucune importance, qu’elle a pu y vivre, qu’elle y a vécu, en effet, et qu’elle a engendré. Pouvant y vivre (nous verrons qu’on se nourrit très bien dans les catacombes), pourquoi n’aurait-elle pas engendré ? Au bout de trois générations, ces gens ne se souviennent même plus du dessus de la terre. D’autant plus qu’ils ont peut-être intérêt à en perdre la mémoire. Ce qui se passait alors sur la terre n’était point si ragoûtant, et nous comprenons, quant à nous, tout à fait bien que, lorsqu’on a cessé de contempler, par le plus heureux des hasards, les horreurs du moyen âge, on ne soit point pressé de revoir la lumière du jour. Bien entendu, on continue toujours à parler la langue et, comme aucun élément étranger ne s’y vient mêler, elle se conserve dans toute sa pureté à travers les siècles. Tout ceci est si simple que je suis étonné d’avoir mis au moins vingt lignes à vous l’expliquer, mais je ne le regrette pas, car avant tout je ne voudrais que quiconque m’accusât de lui faire prendre des vessies pour des lanternes.
» Enfin, en ce qui concerne les quarante doigts de ces gens (vingt en haut et vingt en bas), nous avons les études probantes de Milne-Edwards, comme j’eus déjà l’honneur de l’exposer, sur l’asellus aquaticus, dont les poils tactiles sont si développés. De même pour le museau, pour le nez en nez monstrueux de taupe, mais qui, comme il était rose, pouvait passer pour un groin de cochon, nous avons encore et toujours les bâtonnets olfactifs du néphargus puteanus. Même raisonnement pour les oreilles. Tout le monde voudra comprendre qu’on ne peut perdre les yeux sans que les autres sens se développent et, quand ce développement date de plusieurs siècles, il devient monstrueux pour nous, magnifique pour les indigènes. C’est ainsi que damoiselle de Coucy était réputée comme la plus belle de la ville, parce qu’elle avait le plus gros nez. Il ne reste plus à expliquer que le groin rose. En effet, l’obscurité décolore. Mais je sus par la suite — dès le premier baiser de dame de Montfort — que cette couleur rose était artificielle et tenait à l’application d’un certain fard. Encore une fois, je m’excuse de tous ces considérants, mais chacun n’a pas lu la notice sur les puits artésiens d’Arago ni visité le laboratoire des catacombes de Milne-Edwards. Enfin, tant pis pour les autres, moi, j’ai la science avec moi !
» Que nous soyons arrivés à l’heure du concert (matinée classique), ceci, maintenant que nous avons la science avec nous, ne saurait nous arrêter un instant comme un événement excessif. Il fallait bien arriver à une heure quelconque, dans la cité des Talpa (au nominatif pluriel, talpa fait talpæ — voyez Rosa, la Rose, mais en fait les Talpa disaient : « Nous sommes les Talpa »). Ce qui nous gênait tout à fait dans cette histoire de concert, c’est que nous ne pouvions appuyer sur le bouton d’une lampe électrique sans exciter les murmures des spectateurs. Il paraît que notre lampe répandait une odeur de lumière insupportable. Nous nous résolûmes momentanément aux ténèbres et, comme il y avait un grand brouhaha autour de nous, à cause de nous, je m’efforçai de démêler quelques bribes de conversations. Ces gens s’interpellaient par des noms qui sont les plus illustres de l’histoire de France, aux environs de la bataille de Crécy. Mais ils s’interpellaient avec une voix d’une douceur ineffable, et tant de brouhaha n’était que le résultat de mille murmures enchanteurs. Moi qui, dans un éclat de mon étoile électrique, avais vu leurs groins roses, je ne pouvais me faire à cette idée que de pareils groins pussent laisser couler de si douces et mielleuses paroles. J’écoutai, cependant que dame de Montfort, dans le fauteuil d’orchestre, à côté de moi, m’enfonçait les doigts dans les oreilles, en manière de gentillesse, et s’extasiait sur leur petitesse. Mon Dieu ! quelle belle langue que la langue du quatorzième siècle : écoutez ! Un beau sire derrière moi bouscule tout le monde et je l’entends qui dit : « Or, veux-je retourner à dame de Montfort, qui bien a courage d’homme et cœur de lion. » Un autre sire répond au premier sire que, dans le moment, dame de Montfort a une attitude dont il est dolent et courroucé. (Elle me promenait alors ses deux index de la main droite dans l’œil gauche.) Mais elle ne s’occupait de personne que de moi et répétait aux gens : « Ha ! seigneurs ! ne vous ébahissez mie ! Ainsi je le vueuil réconforter ! » Et elle me réconfortait en fourrant ses doigts partout, avec une grande décence certainement, mais avec plus de curiosité encore. Cette dame avait les vingt doigts les plus curieux du monde.
» Enfin, il y eut un grand silence. C’était sans doute le concert qui commençait ; durant quelques minutes, nous n’entendîmes plus rien, mais absolument plus rien. « Ils se tenaient tous cois et nul ne sonnait mot[34]. »
» Mais bientôt des protestations troublèrent cette grande pause. Elles montaient autour d’un ronflement que je reconnus pour être celui de Théophraste. Je me levai et lui secouai le bras. Il me pria de présenter ses excuses.
» — Chaque fois, me dit-il, que je vais au théâtre, ça ne rate pas.
» Beaucoup de paroles encore autour de nous. « Tant fut proposé et parlementé », m’avoua ma voisine, qu’on avait déterminé de nous faire descendre sur la scène. J’eus ainsi la raison pour laquelle on nous avait entraînés avec cette précipitation dans la salle de spectacle de la ville et à la matinée classique de concert ; c’est qu’on voulait exhiber « notre phénomène » !… dans un entr’acte !… On nous réservait pour l’entr’acte !… Je fus étonné de voir avec quelle facilité Théophraste supportait cette humiliation, mais il était décidé à tout depuis que sa compagne lui avait promis qu’il y aurait du canard au sang au dîner, plus un brochet à la mode du cuisinier Jean Phébus et grand’foison de champignons de Béarn. Il fallut nous exécuter. Nous descendîmes donc sur la scène, dans un véritable trou, comme à l’orchestre de Bayreuth[35]. On pouvait nous voir, ce qui n’avait pas d’importance, mais je craignais qu’ils ne pussent m’entendre, car on me demanda de chanter. J’eus le bon goût de ne point me faire prier plus de cinq minutes. Ma voix n’est point déplaisante. Ces braves gens, selon moi, n’auraient certainement rien compris aux dernières chansons rosses de Montmartre. Le ciel me préserve de leur en faire un crime ! Moi aussi, j’en suis resté à la vieille et bonne et saine chanson de nos pères. Je susurrai le premier couplet de cette aimable romance : « Élisa, viens à moi ! » Je dis : susurrai, pour des raisons que vous comprendrez à l’instant. Je n’entonnai point, je susurrai :
Élisa, viens à moi ! Abandonne la ville…
D’un amour partagé viens goûter le bonheur.
J’aurais, pour t’enlever, ma cavale docile ;
Dans mes bras amoureux, sens tressaillir mon cœur !
» Je n’avais point fini le premier couplet que toute la salle criait : « Plus bas ! plus bas ! » « Chante donc plus bas ! » me fit Théophraste.
» Je chantai plus bas :
Viens ! J’ornerai ton front des perles les plus fines,
Et des bracelets d’or te pareront les bras !
Je me voudrais à toi au penchant des collines
(hiatus charmant).
Sur la peau du lion d’or, la nuit tu dormiras !
» Je comptais, comme toujours, sur le gros effet de la peau du lion d’or, quand les voix crièrent encore : « Plus bas ! plus bas ! » « Chante donc plus bas ! » fit encore Théophraste…
» Alors, je chantai le troisième couplet si bas, si bas, que l’on eût dit de ma voix le murmure étouffé de quelque lointaine et cristalline source :
J’habite le désert, au bord d’une fontaine,
Cet asile si pur où m’attend le bonheur.
Je quitterai ma tente et tu seras ma reine…
» Il me fut impossible de terminer. Je disais encore : « Je quitterai ma tante et tu seras marraine », que les cris reprenaient : « Plus bas ! Plus bas ! »
» Je regagnai alors ma place, suivi de Théophraste qui me suppliait de me calmer, car, dame ! je n’étais pas content. Eh bien ! j’avais tort. Ceci n’était pas un incident personnel. J’en pus juger par la suite du concert. Ce fut un concert de silence. De temps à autre, ils applaudissaient le silence. Ces gens ont un système auditif si développé qu’il ne comprennent la musique que dans le silence. Ils ont, m’a-t-on affirmé, des chanteurs silencieux de premier ordre ! Pour être applaudi, moi, j’aurais dû me taire.
XXXV
OÙ NOUS COMMENÇONS À ENTRER DANS LE FANTASTIQUE, SI L’ON ENTEND PAR FANTASTIQUE TOUT CE QUI NE SE PASSE PAS À LA SURFACE DE LA TERRE.
« Après le concert, nous fîmes un dîner à nous cogner partout. Je ne m’y appesantirai point. Les choses de la chair m’ont toujours laissé dans une vaste indifférence. Et cependant je veux avouer que je ne sus, après le dîner qui suivit ce concert, me défendre des entreprises, comme mon honneur du dessus de la terre eût dû m’y inviter, ni résister aux agaceries de la dame de Montfort. Les ténèbres, il ne faut pas l’oublier, furent, pour beaucoup dans cette faillite de mes plus honnêtes instincts, je dirai de ma naturelle vertu. Quoi ce fut ? Ne vous dirai-je. N’en attends nul pardon. Mais aussi dame de Montfort m’énervait avecques ses vingt doigts de main et aussi avecques ses vingt doigts de pied. J’avais combattu vaillamment. Je jurai de n’en parler oncques, mais ma dame dit qu’elle n’était point repentie de ce qu’elle avait mis la chose si avant, et finablement, elle s’étant endormie, je me partis de sa chambre et ouvris l’huis…
» … Certainement, je serais resté huit jours de plus en la ville (nous y restâmes trois semaines, et nous y serions encore si je n’avais été sculpteur) que je n’aurais pu désormais me servir d’une autre langue que celle du commencement du quatorzième siècle, qui est la plus belle du monde. Mais il faut savoir se reprendre, ou alors on n’est qu’un pauvre sire, triste jouet du destin.
» L’événement était, en somme, si exceptionnel que je brûlais du désir de l’approfondir. Nous n’avions eu encore le temps de rien voir de la ville, tant ils avaient mis de hâte à nous entourer, nous exhiber, nous gaver et nous mettre en notre couche. Théophraste s’était conduit de telle sorte, pendant le repas, mangeant de tout avec excès, qu’on avait dû l’emporter, ce qui avait été fait selon les ordres et desseins de la damoiselle de Coucy, laquelle, je le crains bien, n’aura point fait pour lors ses frais de galanterie.
» L’électricité, toujours à cause de cette insupportable odeur de lumière, nous ayant été interdite en public, je fus bien aise de me trouver à cette heure, tout seul, dans les rues, ayant fui la couche de volupté pour juger des choses posément, après les avoir éclaircies.
» Ce qui me frappa d’abord, ce fut que les maisons n’avaient point de porte et que toutes les boutiques étaient ouvertes au passant. Les objets les plus précieux et aussi les plus ordinaires se trouvaient à portée du premier voleur venu, d’autant plus que je n’aperçus nul gardien dans ma promenade. Je me dis : « Voilà une ville où la police est tout à fait mal faite. Mon passage en ce lieu sera peut-être de quelque utilité. »
» Puis, l’artiste reprenant le dessus sur le commissaire, je m’attardai bientôt avec ma lampe électrique à des merveilles d’architecture.
» Mes yeux restaient éblouis par la profusion des colonnades, des cannelures, des chapiteaux, par le travail tout à fait incroyablement fouillé des frises, des bas-reliefs, des socles et généralement des assises des monuments. Les chapiteaux aux feuilles si extravagantes, aux volutes si contournées, détournées, retournées, étaient toujours à hauteur d’homme. La main pouvait les atteindre. Je vis bientôt qu’au-dessus de la hauteur d’homme l’architecture devenait ce qu’elle pouvait ; elle se perdait, sans intérêt, dans la voûte des catacombes, mais tout ce que pouvaient toucher les doigts n’était comparable à rien, si ce n’est cependant — de loin — à ce que je sais des merveilles d’Angkor et du vieux Delhi. Oui, peut-être, la pierre mille fois travaillée par les artistes de l’Inde et du Cambodge, pendant mille ans, pourrait faire prévoir — peut-être, oh ! peut-être — cette floraison souterraine et sublime de l’architecture talpa ! jusqu’à hauteur d’homme ! Non, non, après tout, ni le bouddhisme, ni le brahmanisme, ni l’islamisme, ni les Aryas, ni les Dravidiens, ni les Arabes, ni les Mongols, ni les Afghans (après tout !), ni les Perses, oui, certainement, ni même les Perses — pas plus l’Inde avec le palais de Taujoré, et les tombes légères et poétiques de Haïder-Ali, d’Aureng-Ceyb, de Schah-Djihan et aussi (après tout) les kiosques funèbres d’Haïderabad et de Golconde (de Golconde, je dis de Golconde !) pas plus cela dans les Indes que ceci chez les Perses, c’est-à-dire : ce qui reste (oh ! mon Dieu combien peu !) du Tak-Kesra (c’était le palais de Chosroës Nouschirvan) ou des ruines (ce qui reste des ruines) de Ctésiphore Silencie (et je sais bien toutefois que l’art des Sassanides paraît avoir été tributaire de Byzance — mais ce n’est pas tout à fait sûr) rien, vous entendez, rien de tout ceci ou de tout cela, rien du tout de tout en architecture du dessus de la terre n’approche — à hauteur d’homme — de l’architecture talpa !
» Et cependant je ne rencontrerai point de monuments publics. En vain me mis-je en quête du temple ou, par exemple, d’une mairie. Je ne vis ni temple ni mairie. Le peuple Talpa semblait n’avoir ni Dieu ni maire. Cependant, damoiselle de Coucy disait toujours : « Ha ! Sainte-Marie !… » Mais je vis bien que cette exclamation n’avait pas plus d’importance dans son charmant petit énorme groin rose que, chez nous : « Nom d’un petit bonhomme !… »
» Le seul monument, vraiment monument public, que j’eus à admirer était justement la bâtisse des Concerts classiques. Elle était certainement plus admirable que tout le reste encore. Je n’y puis comparer — pour en donner une idée — que ce que nous pouvons voir encore du temple de Chillambaron, en y ajoutant les cent temples de Civa à Bhuvanemera et les quatre-vingt-seize colonnes du Madapam de Condjevesam, et les sept pagodes (monolithes !) d’Engles-Hill (je ne les ai pas encore vues, mais je me suis promis de ne point mourir sans les avoir vues).
» En dehors de ce monument, toutes ces merveilles architecturales, donc, s’appliquaient aux bâtisses privées. La plus mesquine ouverture, la plus humble porte, la fenêtre de la cuisine — que vous dirai-je ? — étaient de véritables petits bijoux, comme on dit. Et, d’après ce que je vous ai narré plus haut de cette architecture, vous voyez qu’il ne faut évoquer en aucune façon ni l’art léger mais nu des Hellènes, ni l’art épais de l’Égypte (de l’antique Égypte), ni le composite — trop peu composite encore — romain, et les fenêtres et portes ne rappelaient en rien le cintre lourd du roman où l’ogive du gothique qui oncques n’eut assez rayonné ou flamboyé, mais plutôt le fer à cheval de Cordoue — toujours l’art arabe, oh ! ces Arabes ! — oui, le fer à cheval avec ses mille incrustations et ses cent mille ornements, chef-d’œuvre de la pierre fouillée et trifouillée ! Oui, maintenant j’y suis. Il se peut que les Arabes et aussi les Mongols, avec leurs dix doigts de main chacun, aient fouillé la pierre…
» Mais le peuple de Talpa, avec ses vingt doigts de main chacun, l’a trifouillée ! C’est admirable !… Et la trifouille sans cesse pour en jouir, ce qui rend l’œuvre plus admirable encore, sans qu’elle soit jamais terminée…
» Sur les places publiques, je ne vis point de statues. Le sculpteur le regretta ; le philosophe dit : « Voici un peuple qui n’a ni dieux, ni maire, ni grands hommes… C’est un pauvre peuple, il n’ira pas loin ! »
« Ainsi, le front lourd, je supportais mes pensées, quand je rencontrai une troupe de jeunes gens talpa armés d’arbalètes. Je me dis : « Ah ! voici enfin les archers du guet ! » Mais je fus vite détrompé, car, comme ils m’avaient senti à l’odeur de ma lumière, ils vinrent à moi, me firent cent compliments sur ma bonne mine et me confièrent qu’ils partaient pour la chasse. Mon Dieu oui ! C’était la saison des chasses. Cette saison coïncidait tous les ans avec une forte crue de leur lac intérieur, et certaines régions du pays talpa se trouvaient envahies « par des passages de rats ». Ils en tuaient des quantités innombrables, qu’ils accommodaient en mille sortes de nourritures, pâtés et conserves : enfin, ils usaient de la fourrure fort artificieusement pour l’habillement des personnes et la tapisserie des maisons.
» Je leur souhaitai : bonne chasse ! et ces jeunes gens partirent pleins de gaieté, c’est-à-dire moult réjouis. Ils se contaient leurs exploits passés ; et il y en avait grand’multitude et grand’foison.
» Grâce à quelques indications qu’ils me voulurent bien donner, je retrouvai la demeure de dame de Montfort, qui m’attendait à la fenêtre et, du plus loin qu’elle me vit, agita son mouchoir de peau de rat. Je la rejoignis, et nous commençâmes à parler moult sagement. Je lui demandai si elle était mariée ; elle se mit à rire, et je vis que je n’avais rien à craindre du mari. Elle me demanda ce que je faisais sur le dessus de la terre « de mes vingt doigts ». — De mes dix doigts ! répliquai-je, ce que je fais de mes dix doigts ? Je suis commissaire de police !
» Elle ouvrit, à ces mots, de grandes oreilles et me demanda ce que faisait mon ami ; je lui répondis que sur le dessus de la terre, c’était un voleur…
» Elle ne savait ce que c’était qu’un commissaire de police ni qu’un voleur !
Le bruit bientôt se répandit par la ville que nous avions des métiers inconnus, et une grande foule survint qui nous suppliait ne leur montrer comment nous faisions sur le dessus de la terre.
J’envoyai quérir Théophraste.
XXXVI
LE PEUPLE TALPA EST UN PEUPLE COMME IL N’EN EXISTE PAS SUR LA TERRE. M. MIFROID ET M. LONGUET, L’UN COMME COMMISSAIRE ET L’AUTRE COMME VOLEUR, SONT PARFAITEMENT RIDICULES.
« On m’amena Théophraste dans le plus triste état, raconte M. Mifroid. Incapable de refréner ses passions, il s’était laissé aller à la pire débauche. Je n’en fis point mes compliments à demoiselle de Coucy, et j’en fus d’autant plus navré que nous étions dans le moment où il fallait montrer à ces gens ce qu’était un commissaire de police. Or, j’avais besoin d’un voleur, et Théophraste était incapable de faire mon affaire. Ces gens sont si ignorants que je ne pouvais espérer leur donner un aperçu de mes officielles fonctions qu’avec une leçon de choses. Ne comprenant point ce qu’est un commissaire de police, n’ayant aucune idée de ce qu’est un voleur, peut-être, par le complément de l’un et de l’autre, serais-je arrivé à un résultat. Ainsi pensais-je, mais sans conviction, à cause du laisser-aller de Théophraste.
» Cependant la foule augmentait. D’autorité, j’avais fait la lumière. Ils se bouchaient le nez et attendaient.
» En quelques phrases bien senties, je priai Théophraste de « se tenir devant le monde » et dame de Montfort, à côté de moi, me suppliant de « commencer » parce que le peuple finissait par s’énerver, je conduisis Théophraste dans une boutique de chapelier qui, comme toutes les autres boutiques, était ouverte au passant. Je lui dis, sur un ton sans réplique :
» — Fais le voleur !
» Chacun nous suivit, et ces gens se massèrent devant la boutique comme chez nous on se précipite à la devanture d’un pharmacien, après un accident.
» Il y avait là beaucoup de casquettes en peau de rat, et de chapeaux en peau de poisson. Quelques-uns s’ornaient de plumes de canard. Théophraste me sourit de façon si insipide que je l’aurais giflé. Enfin, il se décida et son instinct du fond des siècles réapparaissant, il s’empara prestement de six casquettes qu’il dissimula fort habilement sous sa redingote, et de trois chapeaux de formats différents, qu’il mit, sans avoir l’air de rien, les uns dans les autres sur sa tête. Et puis il essaya de s’éloigner naturellement, en regardant de droite et de gauche ce qui se passait dans la rue et sifflant un petit air.
» Nos gens, autour de nous, ne bronchaient pas. Ils étaient muets comme carpes et regardaient de toutes leurs oreilles. Quelques groins roses seulement se prirent à sourire en faisant cette réflexion que ce beau sire faisait des provisions de chapeaux pour plusieurs années.
» C’est alors que je m’annonçai et que je dis de ma voix officielle, en mettant ma main droite sur l’épaule de Théophraste :
» — Au nom de la loi, je vous arrête !
» Cette fois, je crus bien qu’ils avaient compris et que je n’aurais plus à leur expliquer ce qu’est un commissaire de police et un voleur. Mais ils conservaient, qui leur mutisme imbécile, qui leur sourire stupéfiant. Damoiselle de Coucy m’ayant demandé ce que c’était que : au nom de la loi ! je lui parlai de la loi avec un commencement de colère, mais il me fut impossible de me faire entendre ; d’après elle — fallait-il la croire ? — le peuple talpa n’avait ni loi, ni voleur, ni commissaire de police ! »
» Elle précisa devant tout le monde sa question et me demanda à quoi pouvait servir un commissaire de police. Je lui répondis : « Vous l’avez vu ! À arrêter les voleurs ! » Et elle me demanda à quoi pouvaient servir les voleurs ! Je lui répondis : « À se faire arrêter par les commissaires de police. »
» Elle précisa davantage et demanda la définition de la police.
» Je lui dis :
» — La police est une institution qui a pour but de protéger les citoyens paisibles et honnêtes dans leurs personnes et leurs propriétés !
» Ils se taisaient encore comme si je leur avais dit de l’hébreu.
» Je m’écriai :
» — Le commissaire de police est le gardien des lois !… Ainsi, il y a une loi qui empêche de prendre des chapeaux dans une boutique !…
» Ils m’interrompirent tous en s’écriant :
» — Nennil !
» — Comment, nennil ! Vous n’avez pas de loi ?
» — Nennil !
» — Ni de gardien des lois !
» — Nennil !
» — Enfin, fis-je, furieux de cette mauvaise plaisanterie, il y a un État !
» — Nennil !
» — Vous, vous êtes l’État ?
» — Nennil ?
» — Vous avez des chefs qui sont l’État ?
» — Nennil !
» Je me pris la tête dans mes deux mains. Et je résolus de revenir à l’exemple palpable :
» — Mon ami n’a pas le droit de prendre ces chapeaux dans la boutique de ce chapelier.
» — Oïl !
» — Comment ! Il a le droit de prendre ces chapeaux ?
» — Oïl !
» — Ces chapeaux ne lui appartiennent pas !…
» — Oïl !
» — Alors, il peut prendre tous ces chapeaux ?
» — Oïl !
» J’étais cramoisi. Dame de Montfort se pencha vers moi et me confia que tous ces gens me demandaient ce que mon ami comptait faire de tous ses chapeaux ! Je lui dis qu’il comptait les vendre. Elle me répondit que, dans les livres sacrés, c’est-à-dire dans les vieilles légendes de son pays, on avait conservé la trace de ce que pouvait être autrefois l’achat et la vente, mais que, seules, les personnes très savantes comme elle pouvaient en avoir une idée. Chez les Talpa, me fit-elle, on ne vend pas, parce qu’on n’achète pas. Chacun prend ce qu’il a besoin de prendre. Et comme il n’a pas besoin de prendre dix chapeaux pour les mettre à la fois sur sa tête, mon ami passait pour un fol, pour un pauvre malheureux triste fol.
» — Cette plaisanterie a trop duré, fis-je, croyez-en un commissaire de police qui a pu se rendre compte souvent, par lui-même, de la nécessité des lois.
Dame de Montfort me demanda à quoi servent les lois. Je lui répondis :
» — À trois choses : il y a les lois qui protègent l’État ; il y a les lois qui protègent la propriété ; il y a les lois qui protègent l’individu !
« Dame de Montfort me répondit qu’il n’y avait pas besoin de lois chez eux pour protéger l’État, puisqu’il n’y avait pas d’État, ni pour protéger la propriété, puisqu’il n’y avait pas de propriété ! Je l’attendais aux individus.
» — Oui, mais vous avez des individus ?
» — Oïl ! répondirent-ils tous.
» Mais, dame de Montfort me fit entendre, dès que je lui eus parlé des conflits entre les individus, que ces conflits, d’après ce que je lui avais dit, naissant de la propriété, du moment qu’il n’y avait plus de propriété, les conflits n’existaient plus. Pourquoi avoir des lois qui auraient protégé des individus qui n’ont pas de conflits, puisqu’il n’y a pas de propriétés ?
» J’étais tellement abruti que je répondis :
» — Oïl !
» Quant à Théophraste, il était là, planté devant moi avec ses chapeaux. Lui, il avait compris. Il déposa les chapeaux où il les avait pris et dit :
» — Pour sûr, ce n’est pas la peine de voler puisque je peux repasser demain.
» Je me sauvai dans la chambre de dame de Montfort, car je sentais ma cervelle fuir de toutes parts. Ma petite amie m’y rejoignit et me pria de ne point me frapper, comme nous disons chez nous. Je crus cependant devoir lui faire observer qu’un pareil système d’existence de peuple ne pouvait servir que les fainéants ; mais elle me répondit qu’il n’y avait rien de plus fatigant au monde que de ne rien faire, ni de plus intéressant que de travailler pour se distraire, et que tout le monde, dans le pays, se distrayait à faire des chapeaux, des bottines, des haut-de-chausses, des cors de chasse, des maisons, des ponts, des boîtes de conserves, de la littérature. Oui, oui, de beaux livres d’histoires pour les étrennes et des poèmes immortels qu’ils lisaient passionnément avec leurs vingt doigts. Certainement, me fit-elle comprendre, avec ce système, il n’y a pas de surproduction, mais nul ne s’en plaignait. Je n’osai lui avouer qu’avec notre système à nous et notre manie de louer l’activité à propos de tout et à propos de rien, la surproduction était un fléau.
» Je lui demandai encore, pour en avoir le cœur net, pourquoi, avec son système, tout le monde n’était pas faiseur de livres, ce qui — je me l’imaginais — était plus agréable que d’être faiseur de bottes. Elle me répondit en me demandant si, chez nous, il y avait une loi qui me forçait à être commissaire de police. Je répliquai que non. Alors, elle me demanda le pourquoi de l’état où j’étais de commissaire de police. Je ne sus que dire. Aussitôt, elle me traita d’enfant et me prit le crâne entre ses vingt doigts. Me l’ayant palpé, elle me fit comprendre que, d’après ce que je lui avais raconté du métier de commissaire, j’avais été dans la nécessité de songer, dès mon plus jeune âge, à être commissaire, à cause de la conformation de mon cerveau. J’ai, paraît-il, une proéminence bombée à trois centimètres de l’arcade sourcilière ; cette proéminence, qu’elle reconnut immédiatement, bien qu’elle ne fût pas accoutumée au point de repère des sourcils, est celle de la ruse et de la finesse. Elle me dit aussi que je devais avoir le sens des arts, à cause d’une circonvolution roulée en spirale, placée sous la région temporale. Enfin, elle me confia encore avec un gentil sourire de son groin rose, que j’avais l’instinct de la propagation de l’espèce, à cause du développement excessif de mon cervelet (Elle était d’accord, je dois l’avouer, avec Lavater et Gall)
» Je saisis, d’après son discours, que nous devions nous étonner autant, dans notre société, qu’il se trouvât tous les bouchers et tous les tailleurs et tous les artistes qu’il fallait et tous les bottiers, si nous devions nous étonner de cela dans la société sans lois des Talpas, puisque nos lois n’étaient pour rien dans la distribution des états, professions et métiers. Pourquoi ne m’étonnerais-je point, conclut-elle, qu’il y a tous les mâles et toutes les femelles qu’il faut ? La nature fait des bottiers, des littérateurs, des charcutiers de rats, comme elle fait des mâles et des femelles, le tout dans une quantité harmonieuse.
» Ma cervelle continuait à fuir de toutes parts. Je crus avoir un argument décisif et je m’écriai :
» — Pas de loi pour l’État, puisqu’il n’y a pas d’État, pas de loi pour la propriété, puisqu’il n’y a pas de propriété, pas de loi pour les conflits entre individus, résultant de la propriété ; mais pour les conflits résultant des passions ! Si vous avez supprimé l’État et la propriété, vous n’avez pas supprimé les passions !
» Elle me demanda si nous, nous avions des lois qui les suppriment. Je lui répondis :
» — Oïl !
» Il fallut que j’expliquasse ce que c’était que nos lois concernant les passions. Par exemple, un mari est trompé par sa femme qu’il adore. Il la tue et il passe, de par les lois, devant un tribunal de douze citoyens.
» Elle eut la curiosité de me demander encore ce que les douze citoyens, en l’occurrence, faisaient du mari. Je lui répondis qu’ils l’acquittaient.
» — Voilà donc, me fit-elle entendre, des lois inutiles quant aux passions.
» — Oïl !
» J’étais enterré ! Tout à coup, j’entendis sous la fenêtre un prodigieux éclat de rire. C’était la nation talpa qui riait de l’idée qu’avaient eue les nations du dessus d’inventer les voleurs et les commissaires de police. Ils riaient, les groins roses, les vingt mille groins roses (excepté ceux qui étaient partis pour la chasse) ; ils riaient à en faire éclater la Terre !
XXXVII
PAR QUEL SUBTERFUGE M. MIFROID ET M. LONGUET PARVIENNENT À S’ÉCHAPPER DES CATACOMBES.
« Je n’ai rien caché au lecteur et il a sans doute deviné de quelle liberté de mœurs jouissait le peuple talpa. Le mariage était chez eux une institution préhistorique dont ils ne parlaient qu’en souriant et qui, du reste, leur apparaissait tellement monstrueuse et indigne de l’état humain, qu’ils n’y croyaient qu’à moitié, comme à une sorte de légende inscrite dans les livres sacrés. À l’encontre des autres peuples qui ne parlent des livres sacrés qu’avec le plus grand respect, car ces livres sont à l’origine des lois et des mœurs comme des sources sont à l’origine des fleuves, le peuple talpa n’invoquait ces antiques tablettes que pour s’en gausser comme d’un conte de la mère l’Oie ; mais tout en s’en gaussant, il les avait toujours présentes à la mémoire, de telle sorte qu’il n’oubliât jamais de faire le contraire de ce qui s’y trouvait ordonné.
» Pour en revenir au mariage, il n’y avait donc pas de mariage, mais l’union la plus libre qui se pût imaginer. Cependant, il n’était pas rare de voir ces unions se perpétuer depuis l’adolescence jusqu’à la mort. À côté du spectacle réconfortant de ces unions que scellait la fidélité la plus inconnue sur le dessus de la terre, je vous donne ma parole qu’un quasi-vertueux commissaire de police avait quelque occasion de s’étonner de la rapidité inconcevable et de la variété stupéfiante avec lesquelles s’échangeaient les baisers les plus définitifs. Mais le quasi-vertueux commissaire était le seul à s’étonner de ces choses. M. Théophraste Longuet lui-même semblait avoir oublié les derniers liens qui le rattachaient au-dessus de la terre, et alors que je ne m’étais abandonné aux fantaisies un peu excessives, quoique originales, de dame de Montfort, qu’à mon corps défendant, Théophraste s’était vautré dans la débauche, sans retenue et sans honte. Quand je le voyais venir à moi, dans ses moments lucides, les yeux creusés par l’insomnie et les joues flasques, se tapant sur les cuisses en disant : « Ils sont épatants, dans les catacombes ! » il me dégoûtait. Vraiment, je ne trouve pas d’autre vocable pour traduire mon écœurement ; il me dégoûtait[36] !
» Ce qui me dépasse tout à fait, c’est qu’il n’y eût aucune différence à établir ou à constater entre les plus vertueuses des femmes talpa et les plus légères. Elles vivaient toutes sur le même pied et jouissaient de la même considération. Les premières ne s’étonnaient point plus de la frivolité amoureuse des secondes que les secondes ne s’extasiaient sur la vertu des premières. Les choses se passaient suivant les goûts et les tempéraments, et nul n’y prenait garde. C’est ainsi que je m’expliquai que chez ce peuple, les conflits de passions fussent réduits à leur strict minimum. Comme me le fit entendre dame de Montfort, personne n’étant la propriété de personne, personne n’avait même l’idée d’avoir des droits sur personne. L’idée du mariage étant issue de l’idée de propriété, cette idée de propriété conjugale a inspiré fatalement l’idée de propriété même dans l’amour libre, dans nos sociétés ; mais chez un peuple qui, comme celui des Talpa, ignore la propriété — celle des personnes comme celle des choses — personne ne devant rien à personne, pas plus « sa personne » que le reste, l’existence du « vol d’amour » qui, chez nous est la cause première de tous les conflits de passions, est aussi insoupçonnée, je dirai même aussi impossible que tous les autres vols.
» Est-il nécessaire de vous dire combien de pareilles théories révoltaient en moi l’honnêteté sociale du commissaire de police, et combien la vision d’une désorganisation aussi radicale me chavirait l’intelligence ?
» — Mais enfin, m’écriai-je, il y a les enfants ! Puisqu’ils n’ont pas de parents reconnus, qui est-ce qui les élève ? Ça n’est pas l’État puisqu’il n’y a pas d’État ! Votre ville doit être grouillante de petits enfants abandonnés, à moins qu’on ne les jette dans le lac comme chez les Chinois !
« Elle me répondit qu’ils n’avaient pas assez d’enfants, qu’on s’inscrivait ci l’avance pour en avoir ; que les enfants, c’était une grande distraction et que les personnes qui n’en avaient pas suppliaient les personnes qui en avaient trop de leur en passer un ou deux. Quand une femme était grosse, c’était à qui la soignerait, dans l’espérance qu’elle aurait deux jumeaux.
» Je lui demandai encore quelle instruction ils recevaient ; elle me répondit que chez eux, l’instruction n’était pas obligatoire et qu’on ne donnait guère que de l’instruction de métier. Seuls, les jeunes gens qui se sentaient beaucoup d’imagination recevaient une instruction générale qui leur était donnée par d’illustres rêveurs qu’on rencontre tous les jours au coin des bornes publiques, ce qui permettait à ces jeunes gens de faire, par la suite, des vers immortels ; mais l’immense majorité des enfants s’amusaient à apprendre à être bottiers, ou maçons, ou tailleurs, et alors ils faisaient avec orgueil des chefs-d’œuvre de maisons, ou d’habits, ou de bottes.
» Tant de stupidité sociale me donnait des nausées. — Vous avez de la veine, dis-je, de n’être que vingt mille, car si vous étiez seulement trente millions, vous verriez ce qui resterait de votre désorganisation ! Vous seriez organisés au bout de huit jours !
» Elle me répondit qu’ils pouvaient être, au lieu de vingt mille Talpa, trois cent quatre-vingt-dix mille millions trois cent soixante-quatre Talpa, et même davantage, que cela ne modifierait en rien leur désorganisation ; qu’ils étaient désorganisés en îlots de quatre cents Talpa, et que chaque îlot avait une place publique où se traitaient les affaires publiques de l’îlot. Un îlot de plus ou de moins leur était parfaitement indifférent, quant à leur désorganisation. Et puis, elle ajouta que ces places publiques ne servaient à rien, en réalité, quant à la discussion des affaires publiques, parce que, en dehors de la question d’un pont à construire ou d’un égout (ce qui arrivait tous les deux cents ans), il n’y avait pas d’affaires publiques.
» Cette dernière parole me suffoqua à un point que je ne saurais exprimer et, Théophraste survenant sur ces entrefaites, j’en profitai pour lui dire toute la répugnance que j’avais à rester au sein d’un peuple qui n’avait pas d’affaires publiques.
» Il me répliqua qu’il n’avait jamais été aussi heureux, lui, Théophraste, et qu’il passait son temps à jouer les plus joyeux tours à Cartouche dont l’âme inutile lui laissait enfin la grande paix inconnue à la terre.
» Quinze jours s’étaient écoulés depuis notre arrivée chez les Talpa. Je commençais à en avoir assez de leurs groins roses, de leur charcuterie de rat et de leurs concerts de silence. Je songeai sérieusement à les quitter et je me proposais d’exécuter mon dessein, quand j’appris par damoiselle de Coucy (dame de Montfort m’avait quitté pour Théophraste) que les places publiques avaient décidé de ne nous laisser partir que lorsque les vingt mille Talpa nous auraient passé les doigts sur le visage, pour que le peuple talpa fût dégoûté à jamais de tenter de retourner sur le dessus de la terre dont il est parlé dans les livres sacrés.
» Chacun de nos deux visages était livré à dix Talpa par jour, ce qui faisait vingt Talpa par jour. D’où cinquante jours pour mille Talpa, d’où mille jours pour vingt mille Talpa (les chiffres sont exacts). La perspective de trois années passées ainsi au fond des catacombes n’avait rien d’attrayant, bien que les Talpa eussent tous les mains propres et les ongles fort soignés.
» Théophraste, lui, trouvait que trois années, « c’était bien court », et il ne parlait de rien moins que de se crever les yeux « pour être comme tout le monde »
» Nous n’étions jamais longtemps seuls. Dans le moment que l’on s’y attendait le moins, des doigts nous entraient dans le nez ou dans les oreilles.
» C’est alors que j’eus l’idée miraculeuse d’utiliser mes talents de sculpteur pour fabriquer deux masques de terre glaise à l’image des groins de Talpa. Cette terre glaise fut recouverte de peaux de rats fraîches. Je m’appliquai l’un de ces masques ; puis, sous couleur de flatter la manie de Théophraste qui ne rêvait que devenir Talpa, je lui en collai un à travers le visage. Il rit beaucoup, surtout quand, en cours de route, nous rencontrâmes des Talpa qui, malgré la promenade des doigts, ne nous reconnurent point.
» Quand il eut fini de rire, il n’y avait plus de Talpa. Mon âme reconnaissante remerciait l’Être suprême. Nous avions enfin retrouvé la grande solitude des catacombes. J’avais eu la précaution d’emporter quelques boîtes de conserves de végétation cryptogamique, ce qui nous permit de marcher pendant cinq jours, au bout desquels nous tombâmes, au milieu de l’ossuaire, dans une fête de nuit donnée par les civilisés du dessus de la terre. Nous étions sauvés !
XXXVIII
UN JOYEUX OSSUAIRE
« Dès que j’eus reconnu les premiers ossements, je les saluai avec gratitude. Je montrai ces tibias, ces péronés et quelques cubitus à Théophraste qui ne se dérida pas. Depuis que nous avions quitté les Talpa, il ne cessait de me reprocher notre fuite avec amertume et ses yeux souvent étaient pleins de larmes. Pauvre et cher Théophraste ! Il était calme maintenant et le plus doux des hommes. Son séjour dans les catacombes semblait lui avoir fait le plus grand bien, avoir chassé de son esprit toute extravagance sanguinaire et j’en étais très heureux, car malgré ses défauts et surtout l’incroyable relâchement de ses mœurs chez les Talpa, je l’avais pris en amitié.
» Bientôt un crâne s’étant présenté à nous avec une chandelle allumée dans l’œil gauche, j’en conclus que nous entrions enfin dans l’empire des vivants. Des chandelles, des chandelles dans les crânes, des girandoles de chandelles clignotantes. La galerie descend, le sol se fait humide, nous pataugeons dans la boue. Des gouttes pleuvent sur nous, des parois supérieures. Nous marchons dix minutes encore, un quart d’heure. Je reconnais mes ossements. Voici ceux du cimetière de Saint-Laurent, déposés le 7 novembre 1804, et ceux de Saint-Esprit, et ceux des milliers et des milliers de morts qui s’enfoncent à droite, à gauche, dans les ténèbres. Toujours les petites chandelles. Les ossements sont bien alignés, bien rabotés, jolis. On dirait d’interminables et vastes haies de buis où viennent de passer les ciseaux du tondeur. Et des inscriptions : « Ossa arida, audite verbum Domini. » Ils entendront autre chose que la parole du Seigneur, cette nuit, les os arides.
» Des voix, des papotages féminins, quelques rires, nous annoncent que nous touchons au terme de notre voyage. « Stimulus autem mortis peccatum est. » Oui, l’aiguillon de la mort, c’est le péché. Le péché est là ce soir, et les pécheresses aussi, des dames qui ont des bandeaux plats.
» Les premières paroles du dix-neuvième siècle que nous entendons sont celles-ci :
» — Eh bien, mon vieux ! c’est pas gai, c’t affaire-là. J’aime mieux Bullier…
» — Dix-huit ans. J’suis pas près de remplacer les tibias qui sont ici.
» Nous arrivons sur une sorte de place publique des morts, où se prépare la fête. On ne fait nulle attention à nous, on nous prend pour des invités.
» Au long des murs funèbres, on a rangé des chaises. Le luminaire se fait plus nombreux, les chandelles se dressent aux chandeliers des crânes. Au bout de cette galerie, une rotonde où s’alignent, en cercles, régulièrement, les pupitres à musique. Pas encore de musiciens. Ils arriveront tout à l’heure, après les dernières mesures à l’Académie nationale, nous dit-on.
» Le public s’empare des chaises, se les dispute, échange des plaisanteries sur la physionomie des « macchabées », attend.
» Il est une heure et demie du matin. Les musiciens arrivent, avec les boîtes lourdes des instruments.
» Oh ! alors.
» Tous les cabarets du néant, toutes les scènes artistico-mystico-macabres où l’on vient bafouer la vie et se gausser de la mort, toutes les boîtes de la Butte où les crânes ricanent aux murs, où les squelettes « chahutent » sur les planches, tout le carnaval funéraire de Montmartre est dépassé.
» Nous avons devant nous cinquante musiciens des orchestres de l’Opéra, de Lamoureux et de Colonne qui sont descendus au royaume des morts pour donner l’aubade aux trépassés. Et sous les voûtes des catacombes, parmi les avenues et les carrefours où s’alignent les murs tragiques des crânes, des tibias et des fémurs, la marche funèbre de Chopin fait entendre sa plainte, devant un public d’esthètes, de « petits ventres affamés », d’artistes, de bulgares, de moldo-valaques, de quelques habitués des premières, de M. le commissaire Mifroid et de M. Théophraste Longuet, qui redort sur une chaise (quand il est au théâtre, ça ne rate pas).
» — Parfait, le premier violon, parfait ! fis-je à mi-voix (je suis un amateur). Ce qui me transporta complètement, ce fut la façon dont ces messieurs exécutèrent l’adagio de la troisième symphonie de Beethoven. Enfin, nous eûmes « la danse macabre » de Saint-Saëns. Après quoi je frappai sur l’épaule de Théophraste et lui dis qu’il était très tard, qu’il fallait rentrer chez nous. Théophraste faisait tout ce que je voulais. Nous pressâmes le pas et dix minutes plus tard, nous nous retrouvions sur le dessus de la terre. Je soupirai avec satisfaction. Vraiment, cette promenade de trois semaines à l’envers de Paris n’avait pas été vieux jeu du tout. Oh ! ces catacombes ! ce peuple de Talpa ! Ces canards aveugles ! Ces aselli aquatici ! Ces concerts de silence et enfin ces concerts de musique !…
» — Je vous avais bien dit, fis-je à Théophraste, que nous en sortirions ! Mme Mifroid va être bien contente de me revoir !…
» — Tant mieux, monsieur Mifroid, tant mieux pour vous et pour elle !…
» Théophraste était bien triste, bien triste.
» Je lui dis :
» — Jamais je n’aurais cru qu’il se passât tant de choses dans les catacombes[37].
» Il me répondit :
» — Ni moi non plus.
» Nous marchions depuis une demi-heure sans mot dire quand M. Longuet me demanda :
» — Qu’attendez-vous, monsieur Mifroid ?
» — Comment ? Mais je n’attends rien ni personne. C’est moi certainement qu’on attend. Et je suis persuadé que Mme Mifroid est dans une terrible anxiété. À propos, cher ami (crus-je devoir ajouter), si jamais vous rencontrez Mme Mifroid, et que la conversation roule sur le sous-terrain des catacombes, vous serez bien aimable de glisser sur la liberté des mœurs du peuple talpa… Mon avis est que le dessous de la terre ne regarde pas le dessus !…
» — Voulez-vous être tout à fait tranquille, monsieur Mifroid ? Eh bien, arrêtez-moi ! Quand je vous demande : ce que vous attendez…, c’est ce que vous attendez pour m’arrêter !…
» — Non, monsieur Longuet, non, je ne vous arrêterai pas !… J’avais mission d’arrêter Cartouche, mais Cartouche n’est plus ! Il n’y a plus que M. Longuet, et M. Longuet est mon ami !…
» Théophraste avait les larmes aux yeux.
» — Je crois bien, en effet, dit-il, que suis guéri… Ah ! si j’en étais sûr !
» — Qu’est-ce que vous feriez ?
» — Si j’étais sûr que les Talpa m’aient tout à fait guéri de Cartouche !…
» — Eh bien !
» — Eh bien ! j’irais retrouver ma femme, ma chère Marceline…
» — Il faut aller retrouver votre femme, monsieur Longuet. Il le faut.
» — Vous me le conseillez ?
» — N’en doutez point.
» — Dans ces conditions, fit Théophraste qui pleurait à chaudes larmes à l’idée qu’il allait retrouver sa chère Marceline, dans ces conditions, je vous prierais, monsieur le commissaire, de me rendre le même service que vous m’avez demandé relativement à l’ignorance où je dois laisser Mme Mifroid des succès que vous remportâtes auprès de ces dames talpa…
» — Comptez sur moi, mon cher Théophraste. Si jamais je rencontre Mme Longuet, je serai discret… Mais elle vous attend, Mme Longuet ?
» — Non, monsieur le commissaire, non. Elle ne m’attend plus. Avant de tomber dans le trou de la place Denfert, j’avais pris soin délaisser mes effets au bord d’une rivière ; elle me croit mort ! Noyé ! Elle doit être plongée dans le plus profond désespoir. Une chose me rassure un peu, c’est que cet excellent M. Lecamus, que vous connaissez, ne l’aura pas abandonnée dans un état si extrême, et je suis sûr qu’il ne lui a ménagé, le cher homme, aucune consolation…
XXXIX
COMMENT M. LE COMMISSAIRE DE POLICE MIFROID PRIT CONGÉ DE M. THÉOPHRASTE LONGUET
« On eût dit que nous avions la plus grande peine de nous quitter, tant nous traînions la jambe en devisant de la sorte et en nous faisant les derniers compliments. Nous nous trouvâmes ainsi au carrefour Buci.
» — Mes hommages à Mme Mifroid.
» — Mes amitiés respectueuses à Mme Longuet. Rappelez-moi, je vous prie, à l’excellent souvenir de M. Lecamus.
» — Enchanté des trois semaines que nous avons passées ensemble…
» — Croyez que je n’oublierai jamais…
» Nous nous secouions les mains avec la dernière énergie pour dissimuler notre trouble, notre émotion, notre…
» Tout à coup, Théophraste Longuet se frappa le front et me dit :
» — Il faut que je vous raconte un souvenir de votre jeunesse.
» Cet homme, en une pareille heure, après trois pareilles semaines, alors que Mme Mifroid devait être si inquiète, m’eût dit : « Il faut que je vous raconte un souvenir de ma jeunesse », que j’eusse trouvé le joint nécessaire pour prendre congé, mais il me disait : « Il faut que je vous raconte un souvenir de votre jeunesse. » C’était bien curieux ; je restai et j’écoutai, et voici ce qu’il me narra :
» — La chose se passait, fit M. Longuet, dans l’endroit où nous sommes, au carrefour Buci.
» — Étais-je bien jeune ? demandai-je en souriant.
» — Heu ! heu ! vous pouviez avoir de cinquante à cinquante-cinq ans !
» Je fis un léger bond sur le trottoir. Je me vois dans la nécessité d’avouer que je vais atteindre bientôt (Pourquoi ne ferais-je point cette confession ? Quelle honte à cacher son âge ?)… la quarantaine. Vous jugez de mon émoi quand M. Longuet me parla d’un souvenir de ma jeunesse, au temps où j’avais « de cinquante à cinquante-cinq ans. » Mais il ne prit pas garde à mon geste de protestation et continua son dire :
» — À cette époque, vous aviez une barbe grisonnante, taillée en deux pointes larges et longues qui vous descendaient bellement jusqu’au ceinturon, et vous montiez — je le vois encore — un superbe cheval isabelle.
» — Vraiment, je montais un cheval isabelle ? (Je ne suis jamais monté qu’à bicyclette.),
» — Un cheval isabelle que vous donnâtes à garder à l’un de vos archers…
» — Ah ! ah ! je commandais à des archers !…
» — Oui, monsieur le commissaire, à vingt archers à cheval et à soixante archers à pied… Toute cette troupe venait du Palais de Justice et, arrivé carrefour Buci, vous, le chef, mîtes pied à terre, parce que vous aviez soif et qu’avant la cérémonie vous vouliez vous désaltérer d’une pinte au cabaret tenu par la Tapedru…
» — Et quelle était cette cérémonie pour laquelle je venais du Palais de Justice, avec mes vingt archers à cheval et mes soixante archers à pied ?… (Je ne voulais point contrarier cet homme ; je ne demandais qu’à aller me coucher.)
» — Il s’agissait, monsieur le commissaire, de m’assigner par cri public, à quinzaine franche, pour l’assassinat de l’ouvrier Mondelot. Donc, en ce jour du 28 mars 1721, les huissiers, trompes, tambours, archers à pied et à cheval, en un cortège des plus imposants, sortirent du Palais de Justice, après avoir crié une première fois dans la cour de May, où tout s’était passé fort convenablement. Puis ils s’en furent tout d’une traite place de la Croix-Rouge, où le cri fut crié sans encombre ni maléfices, et revinrent ici, au carrefour Buci. Vous aviez avalé votre pinte, monsieur le commissaire, et vous vous disposiez à remonter sur votre cheval isabelle, quand survint cet événement mémorable. L’huissier, bien solennellement, lisait : « Au nom du roy, de par nos seigneurs du Parlement, il est ordonné au nommé Louis-Dominique Cartouche… » quand une voix retentit : « Présent ! Voilà Cartouche ! Qui est-ce qui demande Cartouche ? »… Sitôt, huissiers, archers à pied et à cheval, tambours et trompettes, tout le cortège se débande et fuit de toutes parts…
» Et M. Longuet ajouta :
» — Oui, il ne resta personne au carrefour Buci, personne que moi et le cheval isabelle, quand j’eus crié :
» — Je suis Cartouche !
» Phénomène plus curieux que tous les curieux phénomènes que j’avais eu l’occasion d’étudier au fond des catacombes, raconte M. Mifroid… M. Longuet n’avait pas plutôt dit :
» — Je suis Cartouche !…
» … que je me mettais à fuir le carrefour Buci de toute la vélocité de mes jambes, comme si la terreur de Cartouche habitait toujours les jarrets de la police, depuis près de deux cents ans, carrefour Buci. »
XL
OÙ LE LECTEUR RETROUVE UNE ANCIENNE CONNAISSANCE
Nous voici forcé de laisser là le mémoire de M. le commissaire de police Mifroid, quoique les considérations philosophiques, réflexions et déductions qui le terminent, présentent le plus haut et le plus pressant intérêt pour l’humanité. Non seulement son mode de juger la désorganisation sociale des Talpa et les leçons qui, selon lui, en découlent pour un peuple sévèrement policé, mais encore les quelques observations psychiques qu’il fut à même de faire sur la personne double et une de M. Longuet, dans les couloirs des catacombes, nous eussent procuré de longues heures de lecture instructive et originale. Mais quoi ! Pouvions-nous abandonner M. Longuet au carrefour Buci ? Je ne le pense pas. Hélas ! M. Longuet n’a plus de longues heures à vivre, et il est utile de ne point le perdre de vue, jusqu’à son dernier souffle.
M. Longuet, quand le bruit de la fuite de M. Mifroid ne retentit plus sur les trottoirs, se sentit envahi de la plus définitive tristesse. Voyez le pauvre homme dans la clarté vacillante du réverbère. Il secoue la tête. Ah ! comme il secoue lamentablement sa misérable douloureuse tête. À quoi songe-t-il, le triste homme, pour ainsi, à plusieurs reprises, secouer, secouer la tête ? Sans doute, cette idée qu’il eut d’aller troubler le repos de sa chère Marceline ne lui paraît point, à cette heure, une idée raisonnable, et il la repousse, en effet, car son pas pesant et languissant ne le conduit point vers les hauteurs de la rue Gérando…
Quelques minutes plus tard, il se trouve place Saint-André-des-Arts, puis il s’enfonce dans le boyau obscur de la rue Suger. Il sonne à une porte. La porte s’ouvre. Dans l’allée, un homme en blouse, un bonnet de papier sur la tête, une lanterne à la main, demande « ce qu’on veut ».
— Bonsoir, Ambroise, dit Théophraste. Tu veilles encore à cette heure ? C’est moi ! Il m’en est arrivé des histoires depuis la dernière fois que je t’ai vu !…
C’était vrai. Il était arrivé à M. Longuet beaucoup d’histoires depuis qu’il avait vu Ambroise, car il ne l’avait pas revu depuis que celui-ci lui avait donné son avis sur le filigrane trouvé dans les caves de la Conciergerie. Et le lecteur se souviendra peut-être que ceci survint tout au début de cette histoire.
— Entre, dit Ambroise. Tu es chez toi.
— Je te raconterai tout ça demain, dit Théophraste ; ce soir, je voudrais bien dormir.
Ambroise montra son lit à Théophraste, qui s’y étendit et dormit aussitôt du pur sommeil du petit enfant…
Les jours suivants Ambroise voulut faire parler Théophraste, mais chose singulière, celui-ci conserva le plus absolu mutisme. Il passait son temps à compulser des notes et papiers qui remplissaient ses poches. Et puis, deux nuits de suite, toujours sans dire un mot, il écrivit.
Un matin, il s’apprêtait à sortir.
— Où vas-tu ? lui demanda Ambroise.
— Demander une copie de ses notes à M. le commissaire Mifroid sur un voyage que nous avons fait ensemble et dont tu connaîtras tous les détails après ma mort.
— Tu vas te tuer ?
— Oh ! non ! ça ne sert à rien… Je mourrai bien tout seul, cette fois-ci… Mais je viendrai mourir chez toi, mon bon Ambroise.
— Tu me consoles ! fit Ambroise avec un sourire d’une pitoyable navrance. (Nous avons dit qu’Ambroise avait un bon cœur.)
— En sortant de chez Mifroid, j’irai voir ma femme.
— Je n’osais pas t’en parler… Ta tristesse, ton attitude qui m’est encore inexpliquée, tout me faisait craindre des peines de ménage…
— Oh ! elle m’adore toujours !
Malheureusement ! Jamais on ne le dira, en une si cruelle et fatale occurrence, jamais on ne le dira assez : malheureusement !…
Malheureusement, Ambroise eut l’idée de faire changer de linge à Théophraste. Oui, malheureusement, pour qu’il pût se présenter décemment devant sa femme, il lui prêta une de ses chemises ! Ah ! ah ! combien malheureusement ! Mais qui est-ce qui se serait douté que de mettre une chemise propre et revenue le matin même du blanchissage, cela pouvait avoir une telle importance ? Ce n’est ni la faute d’Ambroise ni de personne.
Ambroise avait pensé :
— Au moins, sa femme verra qu’il a une chemise propre !
Théophraste mit la chemise.
— C’est pour être propre, dit-il ; c’est pour moi, c’est pour le respect que je dois avoir de moi-même. Car ma femme ne verra pas cette chemise. Ma femme ne me verra pas. Mais moi, je veux la voir, de loin, la voir pour savoir si elle est heureuse !
XLI
LE DERNIER GESTE ET LA DERNIÈRE PAROLE DE THÉOPHRASTE
Nous voici arrivés au dernier chapitre de cette surprenante et véridique histoire. Ce n’est point sans une certaine émotion que l’auteur de ces lignes prend aujourd’hui la plume pour retracer le dernier geste et répéter la parole dernière de M. Théophraste Longuet. Il s’est attaché à son héros et, malgré qu’il ait eu à passer en sa compagnie des heures funestes, comme celles qui virent la revanche du veau, il eût désiré que les documents renfermés dans le coffret en bois des îles lui permissent de prolonger de quelques jours l’existence d’un homme si sympathique en dépit de ses crimes. Mais l’histoire est là. L’histoire finit là. Il lui faut donc finir avec l’histoire. Encore, il eût désiré que le dernier geste de M. Théophraste Longuet fut moins tragique ; il l’eût souhaité pour lui, auteur, qui ne prend aucune joie à tremper, comme il en fit déjà proclamation, sa plume dans le sang des blessures aux lèvres fraîches, et ensuite pour cette malheureuse Mme Longuet qui fut vraiment trop punie de ses faiblesses à l’endroit de M. Lecamus…
… Pauvre Théophraste ! Pauvre Marceline ! Voilà donc, ô homme, comme tu devais traiter la femme qui fut si longtemps l’orgueil et la joie de ton foyer ! Voilà donc, ô femme ! à quel trépas lamentable devait te conduire ta nature adultère mais droite ! Mais M. Lecamus me dégoûte.
Il est neuf heures du soir, la saison est avancée, la nuit est opaque. M. Longuet monte le long, tout le long du coteau où se dressent les murs de la villa « Flots d’Azur ». La main tremblante, il pousse avec combien de précautions la petite porte de derrière du jardin. Il traverse le jardin, tout doucement, en s’arrêtant à chaque pas, comme un voleur. Ah ! Théophraste, comme tu es abattu, Théophraste. Comme je te plains ; ô toi qui retiens de la main gauche ton cœur plus bondissant que dans cette nuit où ronronna le petit chat violet. Ton bon cœur, ton immense cœur, tout chargé d’amour encore pour cette femme que tu veux voir heureuse ! et qui ne peut plus l’être avec toi… Une lumière dans le salon… La fenêtre est entr’ouverte… Tu avances à petits pas, Théophraste, et puis tu allonges, tu allonges la tête… Ah ! qu’as-tu vu dans le salon… Pourquoi ce gémissement lugubre s’échappe-t-il de tes lèvres ? Pourquoi te prends-tu le front entre tes mains fiévreuses, tes mains qui arrachent les mèches blanches de ton front ?… Qu’as-tu vu ?… Après tout, qu’importe ce que tu as vu, puisque tu es mort ? Tu as voulu la voir heureuse, ta femme ? Sans doute que tu sais maintenant à n’en pouvoir douter jamais, pendant cent mille ans, qu’elle est heureuse ? Pitoyable cocu, éloigne-toi… que ferais-tu plus longtemps dans ce jardin ? Si tu as vu ton ami, M. Lecamus, déposer un brûlant baiser sur les lèvres amoureuses de Marceline, quoi d’étonnant à cela ?… Puisqu’on te croit mort ?… M. Lecamus console Marceline de ta mort et ta mort est une chose si douloureuse, au cœur de Marceline, qu’il faudra bien des baisers encore, très brûlants, pour que Marceline t’oublie… Vas-tu point en vouloir à M. Lecamus de ce qu’il se dévoue à cette tâche du bonheur de Marceline ?…
… Là, tu pleures… tu es assis par terre, dans le jardin… et tu pleures, tu pleures… Va-t’en ! oh ! va-t’en !…
Malheureux, après avoir vu, tu veux entendre ! Et tu t’es relevé et tu as encore allongé la tête et tu as écouté. Tu as entendu M. Lecamus qui disait :
— Moi je le regrette !
Et tu as dit alors merci de bon cœur à ton ami fidèle, jusqu’au moment où il a achevé sa phrase :
— … Je le regrette parce que tu étais plus gentille de son temps !
… À travers champs, maintenant, Théophraste fuit, fuit, fuit… il fuit le crime qui l’appelle.
Et peut-être aurait-il fui si loin, si loin qu’il aurait été trop tard pour le crime, mais sa chemise se mit tout à coup à lui brûler les chairs, et la souffrance horrible que lui procurait cette chemise le précipita dans la certitude qu’il ne pourrait se débarrasser de cette souffrance qu’en se débarrassant du crime. Et il court au crime !
Le grand malheur est qu’il n’eût point songé alors à se débarrasser de sa chemise.
Dans un état d’exaltation sanguinaire comparable à rien dans l’histoire des crimes — même si l’on se donne la peine de remonter aux crimes de la mythologie qui furent cependant de bien beaux crimes — il revint donc sur ses pas, se retrouva dans le jardin, bondit dans le salon, joignit M. Lecamus et Mme Longuet dans le vestibule.
À sa vue, Adolphe et Marceline poussèrent des cris terribles qui ne furent pas entendus de la bonne, laquelle venait de s’absenter justement pour aller acheter du brillant belge.
Une corde était là, provenant de quelque récent déballage. M. Longuet s’en empara et, avant que M. Lecamus ait eu le temps d’opposer la moindre résistance, il était ficelé comme andouille au lampadaire de l’escalier.
Puis, il se précipita sur une panoplie, en détacha un grand sabre recourbé et aussitôt Marceline cria à M. Lecamus :
— Prends garde à tes oreilles !
La généreuse femme, elle, ne pensait, en cette heure tragique, qu’aux oreilles de M. Lecamus[38]. Elle eût mieux fait, hélas ! de songer à sa tête.
Deux secondes plus tard, M. Longuet la lui coupait comme on coupe une tête de veau, sans revenir dans la blessure.
Et, prenant cette tête par les cheveux, il la présenta à M. Lecamus « qui était au comble de l’horreur ».
— Hâte-toi, lui dit-il, de baiser ces lèvres, pendant qu’elles sont encore chaudes !…
Que pouvait faire M. Lecamus, ficelé comme il l’était ? Il n’avait qu’à obéir. Aussi, se hâta-t-il de baiser les lèvres qui, aussitôt après, se mirent à refroidir.
Théophraste grimpa au grenier et en descendit une malle. Il ne fut pas plus de vingt-cinq minutes (le boucher Houdry n’avait pas besoin de plus de vingt-cinq minutes pour découper un veau ; Théophraste n’avait pas eu besoin de plus de vingt-cinq minutes pour découper le boucher Houdry)… il ne fut pas, dis-je, plus de vingt-cinq minutes à découper Mme Longuet. Il la découpa, du reste, en pleurant, mais il la découpa.
Les morceaux en furent proprement déposés dans la malle. Théophraste ferma la malle à clef et la chargea sur ses épaules. Il dit adieu à M. Lecamus, toujours en pleurant. M. Lecamus ne lui répondit pas. Il suffoquait. Théophraste et la malle s’enfoncèrent dans la nuit…
Cette nuit même, on aurait pu voir un homme qui, sur la berge de la Seine, au Petit-Pont, déchargeait dans le fleuve le contenu d’une malle. On eût pu même l’entendre murmurer : « Ma pauvre Marceline ! Ma pauvre Marceline !… Une si belle femme !… Ah ! elle n’était pas trèfle, bien sûr !… »
À l’aurore, Théophraste frappait à l’huis de ce bon Ambroise. Ambroise vit qu’il avait pleuré et lui demanda très affectueusement ce qui lui était encore arrivé.
— D’abord, fit Théophraste… Je veux te rendre ta chemise. Et ne me la redonne jamais ; elle brûle !
— Comment ! ma chemise brûle ! répliqua Ambroise interloqué. Que me racontes-tu là ? C’est une honnête chemise. Elle a été lavée, comme toutes mes autres chemises, au lavoir de la rue du Pont-aux-Choux !
Théophraste pâlit :
— Oh ! c’est donc cela ! murmura-t-il, et il se coucha tout de suite « pour ne plus se relever. »
Oui, c’était donc cela ! Car, enfin, le lecteur doit bien penser tout de même qu’on ne découpe pas ainsi une femme en morceaux — même la sienne — qu’on ne va pas jeter ces morceaux à la berge du Petit-Pont, sans une raison sérieuse !
Théophraste avait eu une raison sérieuse de découper. Elle lui était venue du fond des siècles. Telle la tunique de Déjanire dévorant Hercule, la chemise d’Ambroise l’avait brûlé d’un criminel feu. Il avait revêtu en même temps qu’elle l’âme de Cartouche. Il avait senti passer en ses veines la flamme séculaire du meurtre, car cette chemise avait été lavé au lavoir de la rue du Pont-aux-Choux ! Ce lavoir s’élève à l’endroit même où naquit Cartouche !
Oui, le geste de tuer lui était revenu du fond des siècles, le même geste qui lui avait fait découper deux cents ans auparavant sa femme infidèle, Marie-Antoinette Néron, et pour en jeter les morceaux au Petit-Pont de l’Hôtel-Dieu !
Je vous dis, moi, qu’il ne faut point sourire de cette explication exorbitante. Que MM. les juges y songent ! Bien des crimes qu’ils ne comprennent point, mais qu’ils condamnent tout de même, apparaîtraient moins obscurs si l’on faisait comparaître sur les bancs de la cour d’assises ce complice qui se cache au fond des siècles !
Théophraste était le plus doux et le plus tendre des hommes, et cependant il tuait ! Mais il en avait bien du regret après. Ne disait-il point à Ambroise qui le soignait à son lit de mort : « Plains-moi, mon ami, plains-moi de tout ton cœur, car j’ai été un peu vif avec ma femme !… »
Non, non, il ne s’expliquait point une si rude vivacité, et il en avait un remords qui le conduisit en quelques semaines à la tombe. C’était le remords de l’acte d’un autre, cependant… Pourquoi, ah ! pourquoi, la nature nous fait-elle expier les crimes d’il y a deux cents ans ?
Pauvre Théophraste ! À cette heure où tu vas retourner au fond des siècles, permets-moi de m’agenouiller pieusement, ô martyr de la tare héréditaire, sur l’humble descente de lit qu’arrose de ses larmes le bon Ambroise…
— Je pardonne à M. Lecamus, dis-tu dans le plus funèbre des sourires. Quand je serai mort, tu l’iras chercher et tu lui apprendras que je l’ai nommé mon exécuteur testamentaire. Ce sera mon châtiment. Je lui lègue tous mes biens. Il saura ce qu’il doit faire de ce coffret en bois des îles que tu vois à mon chevet, et où j’ai renfermé le formidable secret des derniers mois de ma triste vie.
Ayant dit ces mots, Théophraste se souleva sur ses oreillers, car l’oppression le gagnait et il savait qu’il allait mourir… Son regard n’était plus de ce monde… Son regard semblait considérer des choses, à travers les murs, et sa voix douloureuse dit encore :
— J’ai vu… je vois… Je retourne vers le rayon carré que le soleil a oublié dans les caves de la Conciergerie depuis le commencement de l’Histoire de France.
Et il expira…
Ambroise pleure, pleure, car il ne sait pas que cet homme, qui vient d’expirer, n’est pas mort !…
Certes, il est des gens, très bien renseignés, paraît-il, qui disent que lorsqu’on est mort, on est mort ! Ils en sont sûrs !… Félicitations ! Félicitations ! Je ne les contredirai pas aujourd’hui, parce que je suis très fatigué… Mais nous en reparlerons demain au fond des tombeaux !
- ↑ Cette date est très importante, car elle établit que mon histoire authentique de Cartouche a paru avant le livre de M. Frank Brentano et que nos deux ouvrages ont vu le jour après celui de M. Maurice Bernard.
- ↑ À propos de ces choses que l’on rêve, qui sont réelles et qu’on n’a jamais vues, l’auteur de ces lignes, c’est-à-dire celui qui, modestement, compulse les papiers de Théophraste, peut citer un exemple personnel : depuis sa plus tendre enfance, il lui arrivait au moins une fois chaque mois de rêver qu’il traversait une forêt de Pologne (il savait dans son rêve que c’était une forêt de Pologne). Il y avait dans cette forêt, sur la droite d’une allée boueuse et défoncée par les pluies, trois chênes décapités, et puis : une petite cabane avec un tuyau de poêle, sur le toit, qui fumait, et un chien jaune, à la porte, qui ouvrait la gueule, comme s’il aboyait, mais qui n’aboyait pas parce qu’il était muet.
Il rêvait cette chose qu’il n’avait jamais vue et cependant elle était réelle, puisqu’un jour, il y a cinq ans, traversant la Pologne, à quelques lieues de la frontière de Russie, il reconnut la forêt, l’allée humide et triste, les trois chênes découronnés par un récent orage, la cabane au tuyau de poêle et le chien jaune qui aboyait en silence. C’est en vain qu’il voulut, à coups de canne, le faire parler. Oui, qui donc expliquera jamais ces choses ?
- ↑ Tous ces détails sont historiques. Mme Taconet tenait, il y a deux cents ans, à cet endroit, le cabaret du Veau qui tette, non loin de la chapelle des Porcherons, qui fut démolie en 1800 et sur l’emplacement de laquelle on construisit en 1802 une autre chapelle qui fut celle de Notre-Dame-de-Lorette, rue Coquenard. Tout cet espace situé au nord-ouest du boulevard des Italiens était anciennement rempli par des champs en culture, des marais, des jardins et des maisons de campagne, et par le village des Porcherons, par une ferme nommée Grange-Batelière, par le château du Coq, une voirie, le cimetière de Saint-Eustache. L’ensemble était traversé par un chemin qui partait de la porte Gaillon, s’avançait en formant des sinuosités, coupait la rue Saint-Lazare et allait aboutir au village des Porcherons et à celui de Clichy. Le cabaret du Veau qui tette avait une réputation terrible. Sa propriétaire, la veuve Taconet, l’amie de l’Enfant, donnait asile chez elle à tous les bandits de la capitale. Les caves du Veau qui tette ouvraient sur des carrières célèbres, véritables repaires, où les compagnons de l’Enfant n’avaient rien à craindre de la police du roy.
- ↑ Historique. Du reste, tout ce que nous aurons l’occasion de raconter relativement à la vie de l’Enfant est de la plus grande exactitude. Nous avons eu soin de nous éloigner toujours de la légende qui est de beaucoup moins extraordinaire que la réalité. Nous avons contrôlé les papiers de Théophraste, nous avons vérifié ses assertions, grâce à la parfaite complaisance de MM. les bibliothécaires de la Nationale, de Carnavalet et de l’Arsenal. Nous avons vu les pièces du procès de l’Enfant qui est le plus formidable procès criminel des temps modernes. Enfin, comment pourrions-nous douter des dires du principal intéressé, j’ai nommé Théophraste ? Qui, mieux que lui, connaîtra son histoire ?
- ↑ Historique.
- ↑ Historique. — Du reste, il faut que ce soit entendu, une fois pour toutes, c’est une histoire historique. — G. L.
- ↑ Au carrefour Guilleri se trouvaient une échelle et un pilori. C’était là que l’on pratiquait l’essorillement au détriment des voleurs. On laissait quelquefois l’oreille droite, mais on coupait toujours l’oreille gauche à cause d’une veine correspondante avec les organes de la génération. On espérait ainsi que les voleurs n’auraient pas de petits.
- ↑ Il ne faut pas s’étonner une seconde de l’extrême férocité de Théophraste. L’histoire, par la suite, nous apprendra que Cartouche a accompli des crimes au-dessus de l’humanité.
- ↑ Procès de Cartouche.
- ↑ Authentique. Lors du procès des complices de Cartouche, la bonne foi de Simon l’Auvergnat fut démontrée et il eut la vie sauve.
- ↑ Cartouche était le vrai nom de Cartouche.
- ↑ Les Fourches de Montfaucon sont désignées dans le document par ces mots tronqués : Le Four… En remplissant les blancs, nous avons : Les Fourches, c’est-à-dire les Fourches Patibulaires. Ce n’est qu’en 1766 que le charnier de Montfaucon fut transféré aux environs de la rue Secrétan. Ce dernier charnier fut découvert dernièrement ; on fit des fouilles et l’on n’y retrouva qu’un pot à moutarde de l’époque.
- ↑ Je tiens absolument à faire remarquer que je cite textuellement M. Lecamus et que je ne suis pour rien dans le déroulement harmonieux de ces phrases un peu excessives mais qu’excuse en somme l’enthousiasme de M. Lecamus pour M. Éliphas de Saint-Elme de Taillebourg de la Nox.
- ↑ Il est inutile de faire observer au lecteur que cette première expérience, qui consiste pour M. de la Nox à promener l’esprit endormi et dominé de Théophraste dans la vie actuelle, qui est le Maintenant, est la plus commune des expériences ; mais je le fais observer tout de même.
- ↑ Journal de Barbier : « Il a été fait, il y a deux ou trois jours, un meurtre effroyable derrière les Chartreux. On a trouvé un homme le nez coupé dans sa bouche, le cou coupé et le ventre ouvert dont les entrailles sortaient. Il est depuis ce temps à la Morgue (salle basse, à l’entrée du Petit-Châtelet). On a trouvé sur lui une carte très bien écrite : « Ci-gît Jean Rebaty (en argot le tué, l’assassiné) qui a eu le traitement qu’il méritait ; ceux qui en feraient autant que lui peuvent attendre la même mort. » M. Moreau, procureur du roy, écrivit à M. Pacôme, aide-major du régiment des gardes : « Je suis persuadé que vous sentirez comme moi combien il est important que de pareils crimes ne demeurent pas impunis. »
- ↑ En 1823, à une époque où l’on procéda au nettoiement du grand égout de la rue Amelot, il existait près de la bouche principale un renfoncement, une grotte de quatre mètres carrés qu’on appelait encore dans le rapport administratif : « La chambre à coucher de Cartouche », parce que le bandit avait été souvent obligé d’y passer la nuit. Combien nous voilà loin de la légende qui représente Cartouche vivant dans « le meilleur monde » et arrêté au moment où il allait épouser la fille d’un riche gentilhomme !
- ↑ Les dernières expériences des professeurs de l’école de Nancy (se rappeler leurs déclarations au moment du procès Eyraud et Gabrielle Bompard) ont ouvert un champ immense aux hypothèses relatives aux suggestions criminelles de l’hypnose. On peut tuer dans le rêve hypnotique. Ici, M. Théophraste Longuet tue, dans son rêve deux fois centenaire, un passant non loin de l’ancien cimetière des Innocents, un passant d’il y a deux cents ans, du moins c’est ce que M. Lecamus et même M. de la Nox croient ; car M. Lecamus, dans sa narration, ne fait suivre d’aucun commentaire ce meurtre d’un homme auquel il n’attache point d’importance, puisqu’il est déjà mort depuis deux cents ans. Mais, vraiment, je crois qu’il s’est passé encore autre chose que cela. Oserai-je le dire ? Il le faut. Il le faut, car c’est avec des faits semblables jusqu’alors négligés comme impossibles que l’école de Nancy est destinée à étonner le monde. Je signale donc le fait suivant à l’école de Nancy, fait qui pourrait peut-être s’expliquer par l’étrange et complet amalgame du Maintenant et de l’Autrefois chez M. Longuet. Le jour où M. de la Nox opérait M. Longuet de Cartouche, rue de la Huchette, ce jour-là était le 13 juillet 1899. Et si nous calculons l’heure d’après l’incident de la montre (Je te dois mon doigt !) il pouvait être midi ou midi et demi au plus quand, dans son rêve hypnotique, M. Longuet prononçait ces paroles : « Je viens de tuer un passant ! » Il disait cela, alors que dans son rêve, toujours, il se trouvait près du cimetière des Innocents. Or, je reproduis ici ces lignes que publiaient quelques jours plus tard, et que j’ai trouvées dans le coffret en bois des îles, les journaux, à la rubrique « faits-divers » : « M. Jacques Mathomersuil, habitant la ville d’Eu, 6, rue de la Petite-Mouillette, et de passage à Paris, où il est descendu chez M. Noël, épicier, son parent, rue de la Tour-d’Auvergne, se trouvait le 13 de ce mois à midi et quart devant la Fontaine des Innocents, examinant curieusement l’œuvre de Jean Goujon, quand il s’affaissa sans pousser un cri. On le crut pris d’un soudain malaise et on le transporta dans une pharmacie voisine. Là, on s’aperçut qu’il avait reçu un coup de poignard en plein cœur. Pourtant, les témoins ne se rappellent pas avoir vu quiconque l’approcher. Une enquête est ouverte. Va-t-on se mettre maintenant à assassiner en plein Paris et en plein midi ? »… Coïncidence étrange, infernale, sur laquelle je n’ose insister. Il y a des moments où le mystère attire, il en est d’autres où il épouvante.
- ↑ Cette tour a disparu aujourd’hui.
- ↑ Phrase historique.
- ↑ Trente-six ans plus tard, en 1757, on fit subir absolument le même supplice à Damiens (Procès de Damiens) qui, de plus, fut écartelé.
- ↑ Cartouche avait cette mèche-là.
- ↑ Le 1er avril 1721, un mois après son évasion du Fort-Lévêque, Cartouche fut vendu par des mouches. Ils avaient averti la police que Cartouche devait traverser le Luxembourg pour se rendre dans une carrière près de Montrouge. Quand il fut dans le jardin, toutes les portes furent fermées à l’exception de celle par laquelle il était entré, qui était la porte de la rue de Vaugirard, en face de la rue Férou. Cette porte était gardés par cinquante archers qui devaient l’emmener en prison. Ayant jugé du traquenard, Cartouche prend vite sa résolution, comme toujours. Il revient en face de la rue Férou. Là, un pistolet de chaque main, il se précipite, bondit sur un cheval qu’un garde française tenait par la bride, et disparaît par la rue de Tournon sans avoir même eu besoin de faire feu (Maurice Bernard).
- ↑ Plusieurs historiens accusent, en effet, le comte de Charolais d’avoir pris des bains de sang humain. C’était un bruit certain qui courait à l’époque et qui était des plus vraisemblables vu le personnage. Il est historique que le comte de Charolais, pour se faire la main, décrochait à coups de carabine les couvreurs sur les toits. À la suite de l’un de ces derniers crimes, qui avait ému même le garde des sceaux, Louis XV dit à ce monstre, prince du sang : « Je viens de signer votre grâce, mais voici, en blanc, la grâce de celui qui vous tuera. »
- ↑ Les corps des individus qu’on avait décapités ou fait bouillir sur une des places de Paris étaient suspendus par les aisselles et exposés, accrochés à une chaîne. Les Fourches Patibulaires de Montfaucon, nous dit Sauval, étaient, au temps de la Ligue, une masse de pierres surmontée de seize piliers, on y arrivait par une rampe faite de pierres assez larges et que fermait une porte solide. Cette masse avait la forme d’un parallélogramme : elle était haute de deux à trois toises, longue de six à sept, large de cinq à six, et composée de dix ou douze assises de gros quartiers de pierres bien liées et bien cimentées. Les piliers étaient gros, carrés, chacun avait trente-deux ou trente-trois pieds de hauteur. Pour joindre ensemble ces piliers et y attacher les corps des suppliciés, on avait enclavé dans leurs chaperons, à moitié de leur hauteur et à leur sommet, de grosses poutres de bois qui traversaient de l’un à l’autre et supportaient des chaînes de fer d’un mètre cinquante de longueur. Contre les piliers étaient toujours dressées de longues échelles destinées à monter le patient au gibet. Au milieu de la masse sur laquelle se trouvaient les piliers était une cave destinée à recevoir les corps des suppliciés qui devaient y rester jusqu’à destruction entière des squelettes. C’est dans ce charnier que les magiciens venaient chercher les cadavres dont ils avaient besoin (Sauval). Le cadavre de Coligny fut pendu à Montfaucon par les cuisses avec des chaînes de fer, puis on y pendit encore son mannequin de paille avec un cure-dent à la bouche.
On continua à exposer ainsi les corps jusqu’en 1630. Y furent exposés encore tous ceux qui moururent en duel malgré les édits. Vingt années plus tard, du temps de Sauval (1650), le gibet lui-même était délaissé, mais le charnier continua longtemps encore à être en honneur. Ce n’est qu’en 1760 quarante années après les événements qui nous occupent, que le gibet fut détruit et la fosse comblée, et la grande justice du roy transportée, comme nous l’avons dit, à un nouveau Montfaucon, près la rue actuelle Secrétan.
- ↑ On enterrait aussi sous le gibet de Montfaucon des personnes toutes vives. Quelques-unes de ces sinistres exécutions sont restées historiques. Jeannette la Bonne Valette et Marion Bonnecoste, Ermine Valancienne et Louise Chaussier subirent ce supplice pour leurs « démérites » et furent enfouies dans une fosse de sept pieds de long. L’une des plus célèbres de ces malheureuses, Perrette Mauger, voleuse et recéleuse de profession, fut condamnée par Robert d’Estouville, prévôt de Paris, « à souffrir mort et à être enfouye toute vive devant le gibet. Elle dit qu’elle était grosse. Fut visitée par ventrières et matrones qui rapportèrent à la justice qu’elle n’était point grosse. Elle fut alors enfouye comme avait été dict. » (Sauval.)
- ↑ Au commencement du dix-huitième siècle, comme au quatorzième, comme encore maintenant, on pratiquait l’envoûtement qui vient d’apparaître comme une chose moins inoffensive qu’on ne l’avait cru, depuis les expériences de M. de Rochas sur l’extériorisation de la sensibilité. L’envoûtement primitif consistait dans la fabrication d’une image en limon, quelquefois en cire, fabriquée à la ressemblance de la personne à qui l’on voulait nuire. Avec l’accompagnement de quelques prières, sacrements, invocations et formules magiques, un stylet était enfoncé dans cette figure, et la personne à laquelle elle ressemblait pouvait en mourir. Depuis le douzième siècle, les monuments historiques offrent des exemples assez nombreux de cette pratique. L’envoûtement ne consistait point seulement à tuer, mais à détourner l’esprit de la personne visée dans le sens désiré par l’envoûteur. Au cours du procès qui suivit l’assassinat du duc d’Orléans, dans lequel fut si fort compromis le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, celui-ci fit déposer que le duc d’Orléans se livrait à ces pratiques. En 1407, est-il écrit dans ce procès, un moine, à l’instigation du duc d’Orléans, alla, après avoir fait invocation au diable, dépendre un homme tout frais à Montfaucon, lui mit l’anneau du duc à la bouche, lui fendit le ventre, lui arracha l’os de l’épaule, lequel fut remis au duc d’Orléans qui porta cet os de pendu entre sa peau et sa chemise. Grâce à l’anneau et à l’os, le duc d’Orléans savait fasciner et faire condescendre toutes les femmes à ses désirs. (Extrait de la justification de Jean sans Peur de l’assassinat du duc d’Orléans.)
- ↑ Il est évident que M. Lecamus, qui a de l’imagination et de la lecture, se laisse aller à l’une et aux souvenirs de l’autre. Il est hanté là par « le cas de M. Valdemar », et il a tort, car l’auteur de ces lignes, qui a pu interroger dernièrement M. de La Nox, a su que Théophraste n’a jamais, à aucun moment de cette opération, tourné au vert.
- ↑ L’expérience suivante a été faite souvent à la clinique du docteur Charcot. On endormait un sujet : on lui appliquait sur la peau du ventre un cercle de papier et on lui suggérait l’idée que ce cercle était un vésicatoire. Immédiatement, tous les effets du vésicatoire se produisaient. La peau rougissait et se soulevait en forme de cloches remplies d’eau. Ainsi, pour Théophraste, endormi du sommeil de l’hypnose, et vivant la torture de Cartouche, tous les effets extérieurs de la torture se produisent et les chairs apparaissent, en réalité, meurtries. Et c’est le Rêve qui a meurtri la Réalité ! Ceci ne prouve-t-il point qu’il n’y a qu’une chose qui est : Le Rêve, c’est-à-dire l’Idée ? À rapprocher de ce fait les stigmates apparus aux mains, aux pieds et au flanc des saints et des martyrs.
- ↑ Cartouche était le plus habile homme de son temps pour sauter sur les toits, gouttières et corniches. Il usait des cheminées avec une science de ramoneur. Bondir d’un toit à l’autre, au-dessus des cours et même des rues, fut longtemps un plaisir nocturne de gentilhomme. Les rois s’y essayèrent. Charles IX n’avait pas son pareil dans la partie.
- ↑ Tous ces détails étaient dans l’article. La mode à cette époque était déjà aux faits-divers dramatisés, et celui-ci est dramatisé à souhait. Au fond, on eût pu le raconter en cinq lignes. Mais c’est la nouvelle presse.
- ↑ C’est le chiffre de kilomètres connus.
- ↑ Tout ceci a été démontré directement par les travaux de M. Milne-Edwards, dans son laboratoire des catacombes.
- ↑ Notice d’Arago sur les Puits artésiens.
- ↑ J’ai tenu à mettre en lettres italiques tout ce qui est de la langue du quatorzième siècle, de telle sorte que les pédants pussent vérifier et avoir ainsi la certitude que, dans cette histoire, je n’ai rien inventé. (Note de M. le commissaire Mifroid.)
- ↑ Tout ce qui est en italique n’est pas nécessairement dans la langue du quatorzième siècle. (Seconde note de M. le commissaire de police Mifroid.)
- ↑ Ne nous étonnons point du succès que remportaient auprès du beau sexe ces deux monstres qu’étaient pour le peuple talpa MM. Mifroid et Longuet. Récemment, nous avons vu un chimpanzé beau parleur, dans un music-hall, recueillir, s’il faut en croire la chronique galante, les suffrages les plus difficiles des plus inaccessibles beautés de la capitale. Et il en est mort !
- ↑ L’auteur de ces lignes, après avoir compulsé les différents
mémoires qui ont été publiés sur le laboratoire des catacombes
et sur les travaux de Milne-Edwards, après avoir constaté que
M. Mifroid ne se moquait de personne avec ses canards aveugles,
et ses groins et ses Talpa et racontait l’exacte vérité possible, à moins de refuser toute autorité à Arago lui-même, fut un peu
étonné de se trouver en face de cette partie du mémoire de M. Mifroid
où il est question du concert donné par les musiciens de
l’Opéra ossuaire. Ceci dépassait de beaucoup en fantastique tout
ce que M. Mifroid avait raconté jusqu’alors, car les catacombes
sont propriété de la Ville de Paris, et les portes en sont rigoureusement closes ; elles ne s’ouvrent qu’une fois le mois aux visiteurs munis du laisser-passer de la préfecture, et le viol nocturne de l’immense fosse par les rires alcooliques des cocottes du quartier et les violoneux d’opéra lui semblait impossible.
Ayant rencontré dernièrement un haut fonctionnaire de la police, il l’entretint de la question et lui demanda si, en son âme et conscience, il pensait que M. le commissaire de police Mifroid était capable de raconter un événement impossible. Le haut fonctionnaire lui répondit en son âme et conscience qu’il ne le croyait pas, et il demanda à son tour de quel événement il s’agissait. « D’un concert dans les catacombes », fit l’auteur de ces lignes. « — Monsieur, répondit le haut fonctionnaire, c’est si peu impossible que le journal Le Matin a rendu compte d’un concert semblable à la date du 3 avril 1897 ! » (Quelle mémoire des dates avait ce haut fonctionnaire…)
En effet, à cette date, il est rendu compte, dans le Matin, d’un concert qui fut donné à deux heures du matin dans les catacombes. Le reporter dit : « Nous avions cru à quelque poisson d’avril d’actualité, à quelque farce sinistre. L’invitation qui nous fut adressée était ainsi libellée : « Vous êtes prié d’assister au concert spirituel et profane qui se fera le vendredi 2 avril 1897, en l’ossuaire des catacombes de Paris, par le concours d’artistes musicaux très éminents. Notes précieuses. L’entrée sera rue Dareau, 92, près la rue Hallé, dès onze heures du soir. Pour éviter le rassemblement de curieux et de gêneurs, prière de ne pas ordonner l’arrêt de voitures devant la porte d’entrée. »
Le reporter s’était rendu naturellement à cette invitation et racontait ses impressions qui étaient, à s’y tromper, celles de M. Mifroid. Il est vrai qu’en somme un concert dans les catacombes, c’est toujours un concert dans les catacombes, et la note ne saurait varier (il faut mettre hors de cause les concerts de silence, où la note varie toujours.)
Le reporter avait interviewé l’un des organisateurs de cette petite fête macabre.
« — L’idée nous en est venue un soir, raconte l’organisateur, chez un de nos amis, un étudiant en médecine, M. Doubrolle. Nous avons pensé que ce ne serait point banal, cette note d’art : du Chopin dans les catacombes. Et comme un ami, M. Daille, nous fit entendre que la chose était possible, nous nous sommes immédiatement organisés, MM. Alla, littérateur ; Jouano, musicien ; Prenet, compositeur ; Lassalle, littérateur ; Dogno, artiste, et nos efforts ont abouti. Nous n’avons pas besoin de vous dire que nous sommes ici subrepticement, et que nous n’avons nullement l’autorisation de la préfecture. L’ingénieur de la Ville, M. Pellet, ignore le concert qui se donne ce soir aux catacombes. »
Le reporter ajoute :
« — Ces jeunes gens disaient vrai. Deux ouvriers qui ont pris sur eux de les introduire et qui, nous les croyons sans peine, ont par cela même « risqué leur place », nous confirment les paroles de l’« organisateur ».
- ↑ Ce qui était tout naturel, car elle ne pouvait avoir oublié l’affreux spectacle de l’essorillement de M. Petito.