Phèdre (trad. Robin)/Notice
NOTICE
I
LE PHÈDRE
Le Banquet et le Phèdre.
Entre le Banquet et le Phèdre la relation est une de celles qui nous sont le plus familières : dans tous les deux en effet il est parlé de l’amour et ce sont eux qu’on utilise pour définir la conception que s’en fait Platon. Toutefois, ainsi comprise, la relation n’est peut-être qu’extérieure et superficielle. Sans doute n’est-il pas faux de dire que l’amour est le sujet du Banquet ; mais c’est une question, comme on le verra (section III), de savoir s’il en est pareillement du Phèdre. Bien plus, même à propos du premier, on avait pu se demander (Notice p. xcii, n. 1) s’il ne s’y cachait pas une autre intention, celle d’opposer, sur ce thème, le point de vue de la Philosophie à celui des Sophistes et des Rhéteurs. Cette intention se dévoile et prend corps dans le second dialogue, où décidément le problème de l’amour semble bien n’être pour Platon qu’une occasion de dire comment il conçoit la culture et l’enseignement, d’une façon qui contraste vivement avec l’idée qu’on s’en faisait dans les écoles de rhétorique. Il en résulte d’ailleurs, ainsi qu’on essaiera de le montrer plus tard (Notice, p. cxxxv sqq.), un approfondissement et un élargissement de la conception même de l’amour par la nécessité, ouvertement reconnue, d’y introduire une théorie de l’âme. Il est possible aussi que, dans le Banquet, cette nécessité fût déjà entrevue, si vraiment la connaissance de l’âme humaine est, comme je l’ai pensé (p. 92, n. 1 et Notice, p. vii), la condition qui permettrait au même homme d’exceller également dans l’art tragique et l’art comique. En tout cas ce qui, d’après le Phèdre, fait l’infirmité de l’art de la parole, en général et tel qu’il est présentement constitué, c’est justement l’ignorance où il est du rapport de ses moyens d’action avec la nature vraie des âmes humaines.
Authenticité et date de la composition.
L’authenticité du Phèdre n’a pas plus besoin d’être discutée que celle du Banquet. Elle est garantie, d’abord par plusieurs références aristotéliciennes, soit avec le titre seul, soit avec le nom seul de Platon[1], ensuite par la tradition unanime de l’Antiquité. La question délicate, c’est de savoir à quelle époque Platon l’a écrit. Il y a dans ce dialogue une telle allégresse de vie, une si grande fraîcheur de jeunesse qu’on a pendant longtemps ajouté foi à une allégation rapportée par quelques écrivains anciens d’époque tardive[2], que le Phèdre serait le premier ouvrage de Platon, antérieur même, disent certains, à la mort de Socrate et datant de sa vingt-cinquième année environ. Cette opinion, à la vérité, avait rencontré des adversaires ; mais ce sont les travaux des Stylisticiens qui l’ont le plus fortement ébranlée. On ne peut dire cependant qu’ils lui aient porté le coup de grâce et qu’il y ait rien d’entièrement décisif dans les résultats auxquels a conduit la comparaison de la langue du Phèdre avec celle de dialogues que leur parenté stylistique avec les Lois a fait reconnaître eux-mêmes comme tardifs : une statistique brutale des particularités verbales risque en effet de méconnaître les altérations apportées dans la prose du second discours de Socrate par le seul parti-pris poétique qui le domine d’un bout à l’autre. Encore moins déterminantes pour renoncer à voir dans le Phèdre une œuvre de jeunesse seraient d’ailleurs les raisons tirées des rapports personnels entre Platon et Isocrate : on verra plus tard combien elles sont fragiles (p. clxxii, sqq.). Une discussion sur ce point entraînerait donc fort loin[3] : aussi me contenterai-je de quelques indications sur la position que me semble avoir le Phèdre dans l’œuvre de Platon. Tout compte fait, la prétendue objectivité sur des matières historiquement si obscures n’est, je crois, qu’une chimère : aux vraisemblances qu’on a pu obtenir s’en opposent d’autres, et l’attirail de dates dont chacun étaie sa conviction est un trompe-l’œil. Aussi m’appuierai-je uniquement sur l’analyse interne et sur des considérations relatives au contenu : subjectivité pour subjectivité, celle-ci se reconnaît au moins pour telle.
En premier lieu, je crois le Phèdre postérieur au Banquet. Si c’était l’inverse, on comprendrait mal que, dans un dialogue spécialement consacré à l’amour, Platon en eût dépouillé la théorie de développements qui, sans la modifier, lui donnent cependant toute sa portée. D’autre part, à supposer que Platon eût déjà écrit cet entretien de Socrate avec Phèdre sur l’amour et à propos d’un Érôticos de Lysias, aurait-il présenté dans le Banquet comme il l’a fait (177 a sqq.) les plaintes de Phèdre sur la négligence des auteurs à l’égard d’un tel sujet ? On pensera bien plutôt que, en donnant ici pour interlocuteur à Socrate Phèdre, et non pas un autre, il s’est souvenu des plaintes dont il s’agit : il y aurait donc là un renvoi implicite au Banquet. Il y en a d’ailleurs d’autres et qui sont plus manifestes : Phèdre est celui des hommes de son temps, exception faite pour Simmias le Thébain, qui a fait se produire le plus de discours (242 ab) et, à ce titre, il mérite d’être appelé « le père de beaux enfants » (261 a)[4]. Enfin nombre de passages du Phèdre ne prennent, je crois, tout leur sens que si on les rapproche du Banquet[5].
Mais une deuxième question se pose aussitôt : le Phèdre est-il immédiatement consécutif au Banquet ? C’est ce que suppose le plan de cette édition de l’œuvre de Platon (vol. I, p. 13), en mettant le Phèdre entre le Banquet et la République. Mais on a eu soin d’ajouter que la chronologie sur laquelle se fonde ce plan est conjecturale : sur une question aussi controversée que celle de la place du Phèdre la sagesse était donc de prendre un parti moyen et, d’autre part, de ne pas le séparer d’un dialogue dont le sujet est voisin. Il n’en reste pas moins que l’antériorité du Phèdre par rapport à la République n’est nullement hors de question. Mon sentiment personnel est qu’au contraire il lui est postérieur. D’abord il est psychologiquement peu vraisemblable que, aussitôt après le Banquet, Platon ait senti le besoin d’en élargir la doctrine pour tracer une image, inégalement poussée sans doute, de la culture philosophique dans son ensemble et pour l’opposer à la culture rhétorique : un temps de méditation semble nécessaire. Cet intervalle assurément pourrait avoir été vide de tout écrit. Si en revanche il existe un ouvrage sans lequel le Phèdre serait souvent inintelligible, c’est dans l’intervalle qu’il faudra placer celui-là. Or, c’est ce que je voudrais maintenant établir, la République satisfait justement à cette condition et, par conséquent, le livre I étant supposé déjà écrit depuis longtemps, la composition de ce grand dialogue, en un seul ou en plusieurs moments, me paraît avoir assez abondamment rempli cet intervalle pour donner à l’élargissement dont je parlais le temps de se préparer. Ceci se vérifiera peu à peu par la suite. Dès à présent je dirai que le mythe de l’attelage ailé serait difficilement intelligible si la tripartition de l’âme, au livre IV de la République, ne permettait de l’interpréter ; admet-on que le mythe a précédé l’explication ? On devra nier alors le caractère de nouveauté que, selon moi, Platon a incontestablement attribué à cette explication (cf. p. cxvii, sqq.). Sur le problème de l’immortalité de l’âme, il y a dans la République des témoignages visibles d’embarras (cf. p. cxxv) ; ne seraient-ils pas fort étranges après la démonstration du Phèdre, puisque celle-ci est conservée par Platon à la fin de sa carrière, quand il achève les Lois (X 894 e-895 c, 896 ab) ? L’eschatologie du Phèdre serait, sur certains points, bien énigmatique sans l’eschatologie similaire du livre X de la République, notamment la combinaison du choix avec le tirage au sort pour les âmes qui vont commencer une nouvelle existence terrestre (249 b) ; de même, dans la hiérarchie des prédestinations, la place du tyran au neuvième et dernier rang de l’échelle (248 e ; cf. p. xc). Enfin il ne me paraît pas douteux que le « lieu supra-céleste » du Phèdre ne soit rien d’autre qu’un doublet mythique du « lieu intelligible » de la République (VI 508 bc, 509 d ; VII 517 b), et il n’y a[6] d’autre différence, de la République au Phèdre, pour la situation dans laquelle est ce lieu par rapport au ciel astronomique, qu’une plus grande précision et une affinité plus marquée avec la psycho-astrologie du Timée et des Lois.
C’est qu’en effet le Phèdre présente de remarquables ressemblances avec les dialogues de la dernière période. Je laisse de côté le point de vue stylistique et je reconnais à quel point ils diffèrent dans la forme littéraire ; mais il y a des ressemblances de fond sur lesquelles il est impossible de fermer les yeux. N’est-ce pas tout d’abord un fait significatif que l’aspect, vraiment nouveau en dépit de certaines anticipations de la République, que prend dans le Phèdre la dialectique avec l’importance prépondérante de la méthode de division, soit précisément celui que développent avec prédilection le Sophiste et le Politique, celui sur le sens profond duquel le Philèbe (16 c-e) insiste avec tant de force (cf. p. cliv sqq.) ? En affirmant la supériorité de la dialectique, sous le rapport de l’exactitude, sur tous ceux des autres arts où il y a le plus d’exactitude, ce dernier dialogue précise d’ailleurs, non sans solennité, que la rhétorique est à cet égard complètement hors de cause (58 a-d). Bien plus, c’est de cette méthode même du Phèdre que les Lois (XII 966 a et cf. p. clvii) exigent une parfaite possession chez les magistrats du Conseil Nocturne. On aura dans la suite plusieurs occasions particulières de rapprocher Phèdre et Philèbe (p. 59, n. 1, p. 61, n. 2, p. 87, n. 1). De son côté le Politique éclairera, lui aussi, certains points obscurs (p. cxv) : tout ce qui y est dit des caractères de l’art (283 c-287 b) développe des indications, encore imprécises, du Phèdre sur le même sujet. Quant au Timée, il est difficile d’en exposer la doctrine sur l’âme sans se référer constamment au Phèdre, et la réciproque, on le verra, n’est pas moins vraie. Au surplus, quand le Phèdre affirme solennellement (269 e-270 c) qu’il n’y a pas de vraie rhétorique capable d’agir sur les âmes, non plus que de vraie médecine capable d’agir sur les corps, sans la connaissance de la relation qui unit au Tout l’âme aussi bien que le corps, n’y a-t-il pas là comme une annonce du Timée ? Le dialecticien philosophe qui à la rhétorique empirique veut en substituer une autre, telle qu’elle soit un art éducateur fondé sur la science, devra donc préalablement connaître la Nature ; or cette exigence est celle à laquelle répond le Timée. Enfin nous avons vu tout à l’heure comment le livre X des Lois ne retient qu’une seule preuve de l’immortalité, qui est justement celle du Phèdre. Tant de points de contact entre notre dialogue et ceux de la vieillesse conduisent donc à penser que, postérieur au Banquet et à la République, c’est de ceux-là d’autre part qu’il est le plus voisin[7].
Schleiermacher avait cru trouver dans le Phèdre le programme de toute la philosophie de Platon, programme tracé dans l’enthousiasme d’une jeunesse inspirée ; chaque dialogue venait à son tour développer un des points de ce programme. L’invraisemblance psychologique d’une telle conception suffirait à la condamner. Cependant il n’était pas faux de regarder le Phèdre comme un raccourci de l’ensemble : c’est qu’en effet le dialogue retient beaucoup du passé, notamment du Phédon, du Banquet et de la République, et qu’en même temps il présage et définit l’avenir. L’erreur de Schleiermacher a été de s’imaginer une telle anticipation figeant, pour cinquante ans au moins, la pensée de Platon dans un moule préfiguré. Or les développements méthodologiques ou doctrinaux que le Phèdre anticipe sont au contraire tout proches, et le programme ou le plan qu’il en trace est pour être réalisé dans la dizaine d’années qui suit. En plaçant ainsi le Phèdre après le Banquet et la République, je suis amené à le rapprocher du Théétète : ce sont des dialogues du même type et qui semblent devoir se situer à peu près de même, tant par rapport aux dialogues de la maturité qu’à ceux de la vieillesse.
Le Théétète est d’un charme exquis dans le mouvement du dialogue et dans la façon dont il s’engage ; s’il est, comme on le pense assez généralement, un peu postérieur à 369, il atteste chez un homme qui ainsi toucherait à la vieillesse une merveilleuse intensité de vie, un irrésistible entrain de la pensée ; à côté d’une polémique serrée, pressante non sans causticité, on y trouve une méditation, vibrante d’enthousiasme, sur ce modèle divin qu’il faut s’efforcer d’imiter, une imprécation vengeresse contre le modèle humain loin duquel on doit s’écarter. Du Phèdre ou du Théétète, lequel placera-t-on le premier ? En faveur de l’une ou l’autre solution on ne présumerait rien que de fragile. Ce qui importe surtout d’ailleurs, c’est de souligner la signification du rapprochement conjecturé. Dans le Théétète, Platon suppose la rencontre de Socrate jeune avec le vieux Parménide et avec Zénon (183 e) : fiction sur laquelle est construit le Parménide. Que celui-ci soit ou non antérieur au Théétète, à tout le moins y a-t-il dans ce dernier (180 d-181 b, 184 a) une intention déclarée de disjoindre l’Éléatisme de toutes les autres doctrines philosophiques pour en faire l’objet d’un examen spécial ; il y a même l’annonce d’un essai de synthèse, qui se fera autant aux dépens de l’Éléatisme que de ce qui s’y oppose. Or c’est ce qui sera réalisé par le Sophiste et, pour autant qu’il définit les rapports de l’Un et du Multiple, par le Philèbe. De plus, en distinguant comme il le fait sensation et science, le Théétète détermine, au moins négativement, à quelles conditions il peut exister un vrai savoir concernant les phénomènes de la nature, objets de la sensation ; ainsi il serait comme une préface épistémologique au Timée. Enfin, si les difficultés du problème de l’erreur sont mises en pleine lumière par le Théétète, c’est au Sophiste qu’il appartiendra de fournir la solution. — De son côté, en montrant que l’amour est dans l’âme le lien du sensible avec l’intelligible, que ce ne sont pas là deux mondes qui se nient mutuellement, le Phèdre prend une position antagoniste de celle des Éléates ; ainsi en effet il réconcilie le non-être de la sensibilité avec l’être de l’Idée. Ce savoir secret dont le Théétète nous dit que chaque âme est grosse a pour pendant le pouvoir latent de s’élever que, d’après le Phèdre, gardent toujours les ailes de celle-ci, desséchées et durcies par son union à un corps de terre : double expression mythique, par conséquent, d’une idée à laquelle le Sophiste donnera sa forme dialectique. De plus, la méthodologie du Phèdre semble complémentaire de l’épistémologie du Théétète. Enfin, tandis que ce dernier envisageait l’affection sensible, le πάθος, sous son aspect de sensation, d’état individuel et momentané qui, sans l’acte synthétique du jugement, n’est à aucun degré une connaissance, l’autre la considère sous l’aspect d’une jouissance, qui n’est pas le véritable amour ou qui n’en est qu’une dégradation. D’autre part, en un passage (258 e et p. 59, n. 1) qui rappelle une analyse de la République, il prélude au développement que cette analyse doit recevoir dans le Philèbe.
En somme ce seraient là deux dialogues en quelque mesure parallèles, et pareillement liminaires. Avant d’entrer dans des voies qui, préparées de longue date, n’en sont pas moins nouvelles, il semble que Platon ait voulu régler ses comptes : dans le Théétète, c’est avec certaines écoles philosophiques, hormis toutefois celle sous la pression de laquelle il s’engageait justement dans ces chemins nouveaux ; dans le Phèdre, c’est avec les écoles des rhéteurs. Les deux dialogues se placeraient donc dans la période qui précède le départ de Platon, au printemps de 366, pour son deuxième voyage en Sicile. Toute tentative pour préciser davantage serait arbitraire. Mais, si la République a, comme je le crois, précédé le Phèdre ; si le Banquet est de 385 ou de 380 environ, écho plus ou moins attardé de la fondation de l’Académie (cf. Banquet, Notice p. ix, n. 2 et p. xci sq.) ; si l’on réfléchit aux tâches absorbantes que sa fonction de Chef d’École dut imposer à Platon, on pensera qu’entre le Banquet et le Phèdre il a dû s’écouler un intervalle qui ne peut être inférieur à une dizaine d’années au moins. Notre dialogue suppose en effet une conscience précise des besoins de l’enseignement, des expériences faites sur les procédés les plus féconds de la dialectique, bref toute une organisation méthodique de la culture. Or cela n’apparaissait pas dans le Banquet ; d’autre part, l’éducation des philosophes telle que la décrit le livre VII de la République, ne dessinait que des fondations ou les plus grandes lignes de ce qui doit être le couronnement de toute éducation libérale. Mais peut-être aussi, et pour les mêmes raisons, le Phèdre atteste-t-il chez Platon une soif de délassement, la joie qui suit l’achèvement d’une longue tâche et qui est impatiente de se déployer en un mouvement aisé et libre de la pensée ; bref tout ce qui a déterminé Wilamowitz à intituler : « Un heureux jour d’été » le chapitre de son Platon qui est consacré à notre dialogue[8].
II
QUESTIONS D’HISTOIRE
L’époque de la scène
Peut-être n’est-il pas très nécessaire de chercher à dater la scène du Phèdre : ne suffit-il pas, tenant compte de l’allusion qui y est faite au rôle de Phèdre dans la scène du Banquet, de dire que Platon a voulu qu’on la supposât postérieure à celle-ci ? Or celle-ci se place vraisemblablement en 416. Mais, pour assigner à l’autre la date précise de 410[9], on manque de base : Lysias, dit-on, serait revenu d’Italie à Athènes en 412, il y aurait fait bientôt figure d’homme de lettres et il en aurait donné une preuve en composant un Erôticos. Or rien de tout cela, on le verra bientôt (p. xiv, sqq.), n’est assuré. En quoi cela servirait-il d’ailleurs à dater la scène ? La seule chose qu’il y ait sans doute à dire, c’est que dans le Phèdre il n’est pas du tout question, comme dans d’autres dialogues, des inimitiés que Socrate a suscitées contre lui, encore moins de poursuites judiciaires, possibles, imminentes, ou déjà engagées. C’est donc, si l’on tient à toute force à situer dans l’histoire sociale et politique une scène qui est, en elle-même, en dehors de toute histoire, que Platon a voulu nous reporter à une époque éloignée du procès. La scène n’a besoin d’être située que dans la série de ces petits drames fictifs dont Socrate est l’ordinaire protagoniste : c’est un cas analogue à celui de la Comédie humaine de Balzac.
Topographie.
Ce qui, par une singularité remarquable, mérite en revanche plus d’attention, c’est le lieu même de cette scène. Il ne semble pas en effet qu’il soit imaginaire, puisque les indications topographiques données par Platon nous permettent, avec le secours des découvertes archéologiques, de le retrouver sur le terrain[10]. Relevons dans leur ordre toutes ces indications. Phèdre va pour faire une promenade hors des Murs et sur la grand’route (227 a) : c’est donc qu’au moment de sa rencontre avec Socrate il est encore en dedans, et l’expression, malgré ce qu’un peu plus bas (228 b) elle a d’ambigu, n’y peut avoir un autre sens. De l’endroit où ils se sont rencontrés on voit, Phèdre la montre, la maison de Morychus et, tout contre, on aperçoit aussi le temple de Zeus Olympien. Phèdre invite Socrate à marcher avec lui, tout en devisant (b, l. 8). Si longue que puisse être la promenade projetée par Phèdre, Socrate est prêt à le suivre en partant des Murs jusqu’à Mégare, et même à faire deux fois ce chemin aller et retour, selon le précepte d’Hérodicus (227 d). Toutefois, puisqu’aussi bien il faudra s’asseoir quelque part pour lire le discours, il propose à un moment de se détourner de la grand’route pour suivre le cours de l’Ilissus (229 a) jusqu’où il fera bon de s’arrêter. Chemin faisant, on discute de l’endroit où Borée enleva la Nymphe Orithye : ce n’est pas ici où les rives, étant plates, semblent à Phèdre propices aux ébats des jouvencelles, mais en contre-bas, à deux ou trois stades environ, au point où on passe la rivière quand on va vers le sanctuaire d’Agra, car il y a là des rochers qui en dominent le lit (229 c).
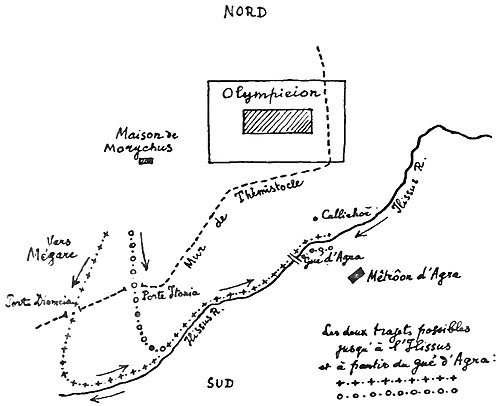 Sans s’interrompre de parler, ils continuent à avancer. C’est ainsi qu’ils se trouvent tout à coup devant ce haut platane vers lequel ils se dirigeaient (230 a ; cf. 229 a).
Sans s’interrompre de parler, ils continuent à avancer. C’est ainsi qu’ils se trouvent tout à coup devant ce haut platane vers lequel ils se dirigeaient (230 a ; cf. 229 a).
Ces données, il faut maintenant les interpréter. D’abord, si la rencontre a lieu à proximité du Mur, du moins est-ce, comme déjà cela semblait probable, à l’intérieur de la ville ; sans quoi on ne pourrait voir la Morychienne et l’Olympieïon lequel se trouvait en dedans du rempart de Thémistocle. D’autre part, Socrate ne penserait pas que Phèdre pût avoir idée de faire sa promenade vers Mégare si l’on n’était du côté d’une porte ouvrant sur la route qui y mène, c’est-à-dire près de la porte Dioméïa ou, ce qui est moins probable, d’une porte voisine, l’Itonia. Dans ce dernier cas, le point où les deux promeneurs, ayant quitté la route, rejoignent l’Ilissus est plus rapproché de celui d’où ils sont partis ; plus court est alors le trajet dans le lit de la rivière jusqu’au gué d’Agra : deux stades, soit un peu plus de 300 mètres. Dans l’autre hypothèse, le trajet serait plus long, puisqu’ils auraient atteint la rivière plus en aval : trois stades, ou un peu plus de 500 mètres. Les deux évaluations sont données par Platon, mais comme si la première lui avait semblé trop modérée : ce qui est en faveur de la sortie par la porte Dioméïa, sur la route même de Mégare. Quant au sanctuaire dont il est parlé, ce n’est pas à Artémis Agrotéra ou Agraïa, la Chasseresse, ici tout à fait hors de question, qu’il est consacré ; c’est un sanctuaire de Démêter, un Mètrôon que possédait le dème d’Agra et qui, au siècle dernier[11], se voyait encore sur les pentes rocheuses qui surplombent la rivière. Ils en remontent le cours et peut-être passent-ils sur la rive gauche[12] à l’endroit du gué. Peut-être le lieu où ils vont faire halte est-il, de ce côté, celui où l’on a découvert un relief de Pan, au-dessous de l’emplacement où jaillissait, sur la rive droite, la source Callirhoè. Aujourd’hui la source est obstruée, il n’y a plus d’ombrages, le lit de l’Ilissus n’est plus sillonné des filets d’une eau transparente, mais on a plaisir à faire avec le philosophe cette promenade dans un paysage dont il a si délicatement traduit la poésie.
Les interlocuteurs.
Le Phèdre est un dialogue à deux personnages et qui sont vraiment, selon le mot de Phèdre (236 d déb.), « seul à seul ». De Socrate il n’y a rien à dire. Quant à Phèdre j’en ai esquissé déjà le portrait dans la Notice du Banquet (p. xxxvi, sqq.) et d’après les trois dialogues où il figure : ce dernier, le nôtre et le Protagoras. On a eu raison[13] de réagir contre la tradition qui fait ici de Phèdre un tout jeune homme. C’est ainsi en effet qu’il apparaît dans le Protagoras, dont l’action se passe vers 433/2. Mais alors, seize ans plus tard, à l’époque du banquet d’Agathon il doit être environ dans sa trente-cinquième année. Si donc le Phèdre suppose le Banquet, il faut enfin qu’ici il soit encore plus âgé. Toutefois, à vouloir préciser davantage, ne trahirait-on pas l’esprit de Platon, peu soucieux de ces scrupules chronologiques (cf. Banquet, Notice p. xx, n. 1) et qui s’accommode de vraisemblances psychologiques générales ? De ce qu’au cours du Phèdre il ait voulu rappeler le Banquet, s’ensuit-il que l’action du premier doive être tenue pour postérieure à celle du second ? Il n’y aurait alors anachronisme que par rapport à nos conjectures sur la relation chronologique des deux dialogues. C’est donc assez, je crois, d’observer simplement que, quelle que puisse être la différence des âges, Socrate se croit du moins autorisé par la naïveté des enthousiasmes de son ami à l’égard de la rhétorique, de la mythologie, de l’érudition, des livres des Maîtres, etc., à le traiter d’une façon un peu cavalière et, en vérité, comme « un grand enfant[14] ». Quant à savoir ce qu’ensuite devient Phèdre et quelle est l’époque de sa mort, cela peut avoir son intérêt. Mais c’est ruiner toute vraisemblance interne que de conjecturer cette époque en s’appuyant sur le fait que, si la mort de Phèdre n’avait pas précédé celle de Socrate, il aurait certainement été du nombre des fidèles qui assistèrent Socrate à ses derniers moments[15]. Conjecture gratuite : le Phédon ne dit-il pas (59 b fin) que tous ceux des Attiques qui étaient présents n’ont pas été nommés ? Conjecture arbitraire et que dément le portrait psychologique du Phèdre platonicien : son honnête sincérité lui vaut d’être traité avec une sympathie un peu condescendante et railleuse ; mais toujours il apparaît comme un fervent partisan des Sophistes, totalement incapable par là même de communier avec la pensée de Socrate[16].
Deux célébrités principales en cause.
Mais il y a dans le Phèdre, derrière les deux interlocuteurs, deux autres personnages dont la muette présence y est capitale ; ils en sont les deux pôles ; Lysias, dès le commencement, Isocrate, seulement à la fin[17]. Pour des raisons que je dirai plus tard (p. clxxiii sq.), la figure prépondérante me paraît être cependant la seconde. Pour le moment, nous pouvons les mettre toutes deux sur le même plan et réunir ici à leur sujet quelques données historiques et littéraires indispensables.
Lysias.
Lysias nous est présenté dans le Phèdre sous un double aspect : c’est un maître de rhétorique et qui compose des discours épidictiques, modèles sur lesquels on faisait étudier aux élèves la technique de la composition ; c’est aussi un logographe, qui écrit des plaidoyers que les parties, demanderesses ou défenderesses, récitent devant le tribunal[18]. L’auteur de la Vie des dix orateurs, faussement attribuée à Plutarque, est surtout abondant et précis, ainsi qu’il arrive souvent, à propos de ce qu’il sait sans doute le moins bien, c’est-à-dire de l’activité de Lysias en tant que rhéteur : « Il a composé aussi, dit-il (836 b), des Arts de la parole, des Discours politiques, des Lettres, des Éloges (Encômia), des Oraisons funèbres, des Discours sur l’amour, une Apologie de Socrate… » Or on peut présumer que les « philologues » de l’Antiquité n’étaient riches là-dessus que de conjectures : celui-ci, au surplus, n’avoue-t-il pas (836 a) que la moitié à peu près de toute l’œuvre attribuée à Lysias est inauthentique ? Au reste, c’est une question que nous retrouverons à propos du discours de Lysias dans le Phèdre (p. lx sqq.). Notons seulement ici que toute cette production rhétorique, vraie ou fausse, de Lysias est en majeure partie perdue : des Discours politiques il ne subsiste que l’exorde et un sommaire de l’Olympique dans Denys d’Halicarnasse ; d’autre part, l’Oraison funèbre des Athéniens morts en défendant Corinthe est loin d’être incontestablement authentique.
En outre on ne s’accorde pas sur la place que cette forme de son activité aurait occupée dans la vie de Lysias. Pour les uns elle serait du début de sa carrière à Athènes. C’est ce que semble avoir pensé Cicéron (Brutus 48) : il fait en effet de lui, sur ce terrain, un concurrent de Théodore de Byzance, et sa logographie ne serait qu’une extension ultérieure de sa profession primitive[19]. L’hypothèse est assez vraisemblable. C’est en effet très probablement en 412 que Lysias revient s’établir à Athènes. Fils de Céphale, ce grand négociant syracusain qui sur les conseils, dit-on, de Périclès, avait fondé au Pirée une fabrique d’armes (cf. p. 1, n. 1), il avait suivi son frère aîné Polémarque dans un exode d’émigrants allant occuper les lots de terre qui leur avaient été assignés (clérouquie) sur le territoire de Thourii, dans l’Italie méridionale. C’était une cité de création récente (444/3) : Hippodame de Milet en aurait été l’architecte et Protagoras, le législateur ; Hérodote, comme on sait, la visita et il en devint citoyen. Or Tisias, le maître syracusain qui passe pour être l’inventeur de la rhétorique, y était venu fonder une école dont Lysias fut l’élève. Y a-t-il lui-même professé ? C’est fort possible[20]. Après le désastre d’Athènes en Sicile (413), il y avait peu de sécurité pour lui à rester à Thourii ; on dit même qu’il en fut banni par le parti anti-athénien. Si donc Tisias était surtout, comme il semble, un professeur et que Lysias l’ait été, lui aussi, avant son retour à Athènes, il est permis de croire qu’une fois revenu c’est sous cette forme qu’il commença d’exercer son activité.
Toutefois certaines autres données peuvent suggérer de la vie de Lysias une représentation différente. Il est remarquable tout d’abord que Cicéron, qui nous donnait à penser que Lysias avait commencé par s’illustrer comme rhéteur, ne connaît cependant en lui, comme nous-mêmes, que le causidicus, l’avocat (Orator 30). Il est donc possible que ce soit en appliquant à la composition de plaidoyers les connaissances techniques acquises en Italie, qu’il a fondé sa réputation. Un tel début expliquerait en outre ses ambitions ultérieures. Huit ans après son retour à Athènes, quand après la prise de la ville par Lysandre s’y fut établi le gouvernement des Trente Tyrans, Lysias se trouva dans une situation périlleuse. Sans doute sa qualité d’isotèle, c’est-à-dire de métèque privilégié, admis sans être citoyen au droit de posséder, était peu faite pour le rendre sympathique à une aristocratie en majorité nationaliste, prête d’ailleurs à toutes les rigueurs contre ses propres concitoyens du parti adverse. Mais peut-être des rancunes contre l’avocat intervenaient-elles aussi, plus vraisemblables qu’à l’égard d’un rhéteur. Toujours est-il que son frère Polémarque fut, sur l’ordre des Trente, arrêté par l’un d’eux, Ératosthène, pour être conduit à la prison où il devait bientôt périr. Il ne dut lui-même son salut qu’à une fuite précipitée. On sait comment les bannis et les fugitifs se groupèrent sous le commandement du démocrate Thrasybule. Mais ils manquaient d’armes, il leur fallait recruter des mercenaires : Lysias se fit leur bailleur de fonds. Enfin, une fois abattue la tyrannie des Trente, il se crut alors près de monter sur la scène politique pour laquelle, avocat rompu aux affaires, il devait se sentir mieux préparé que s’il n’avait été jusque-là que théoricien et professeur. Pour reconnaître en effet les services rendus, Thrasybule fit voter un décret qui, conférant le droit de cité à tous les non-Athéniens qui avaient soutenu l’armée des bannis, allait faire de lui un Athénien de premier plan. La mesure était d’ailleurs conforme à la politique traditionnelle des démocrates radicaux qui, ayant toujours eu l’appui des étrangers domiciliés en Attique, cherchaient à grossir leur majorité civique. Mais le parti démocratique comptait des conservateurs, assez proches de cette aristocratie modérée dont Théramène avait été, dans le gouvernement des Trente, le représentant malheureux. On attaqua donc le décret de Thrasybule : il était illégal, n’ayant pas reçu l’approbation préalable du Conseil (la Boulê). Le décret fut cassé[21], et Lysias dut rester dans l’isotélie. Déçu dans ses espérances, il n’abandonne pas son lucratif métier d’avocat, mais il s’occupe surtout de causes politiques ; il plaide même en personne, dans cette année 403 qui avait failli voir son triomphe, contre Ératosthène, qui avait fait périr son frère. Or, ce serait justement à partir de 403 que Lysias aurait cherché à se faire une réputation d’homme de lettres et de professeur de composition littéraire. À cette période appartient en effet son Discours Olympique, prononcé en 388[22] et c’est ainsi que, par l’éloquence d’apparat, il se serait consolé de n’avoir pu devenir un orateur politique. Il y jetait feu et flamme contre les tyrans, engageant les Grecs à se réconcilier contre eux ; non plus, il est vrai, contre l’ennemi héréditaire, contre la Perse, mais bien contre une puissance redoutable du pays d’où il était originaire, contre Denys, le prince syracusain qu’une ambassade somptueuse représentait précisément à la Fête. À la détresse des Grecs il opposait les immenses richesses dont ils avaient sous les yeux le témoignage insolent. Bref, son éloquence échauffa si bien les esprits que, à la suite de manifestations hostiles, l’ambassade se retira. Lysias provoquait ainsi un incident qui devait être fatal à la renaissance athénienne. La colère poussa en effet Denys à appuyer énergiquement l’hostilité de Sparte et de la Perse, et la dureté des conditions imposées par la paix d’Antalcidas (387) en fut probablement encore aggravée. C’est de la même époque que seraient aussi l’Apologie de Socrate, qui vraisemblablement répondait au pamphlet de Polycrate (Banquet, Notice, p. x, sq.), et enfin, comme si avec l’âge les sujets proprement sophistiques tentaient davantage un Lysias apaisé, ces discours ou lettres Sur l’Amour dont le Phèdre nous aurait conservé un échantillon ; ceux-ci seraient de la sorte assez voisins de sa mort survenue en 379[23].
L’extrême imprécision de nos connaissances ne semble pas permettre de choisir entre ces deux façons de « romancer » quelques pauvres données de l’histoire, ou d’une tradition érudite qui n’est peut-être elle-même qu’un autre roman plus ancien. Ce sur quoi, par contre, il faut s’arrêter c’est sur l’étrange désaccord qu’il semble y avoir entre la façon dont l’art de Lysias est apprécié par Platon et dont il l’a été par Cicéron, par Quintilien et aussi par la critique moderne. Pour Platon en effet Lysias, qui passe aux yeux de Phèdre et de tous les fervents de l’écriture artiste pour « le plus habile des écrivains actuels » (228 a), est au contraire un mauvais écrivain, qui manque à la fois d’invention et de méthode, qui n’a ni spontanéité ni logique, aussi vague qu’il est diffus (cf. p. lxiv, sq.). Or Cicéron par exemple, s’il reproche à Lysias une maigreur passablement décharnée, loue la façon dont il va droit au fait, sa finesse élégante et spirituelle, sa pénétration, le naturel de ses peintures et même, parfois, la vigueur nerveuse de son talent[24]. Nous n’en jugeons guère autrement : nous louons chez Lysias la sobriété, une simplicité de ton qui dissimule à merveille une technique savante, l’art de faire vivre ses personnages et de les faire parler selon leur caractère et leur situation, enfin, à l’occasion, de la force ou de l’émotion, mais sans rien de déclamatoire ni de forcé. Sans doute dira-t-on, pour atténuer le contraste brutal de ces jugements, que Platon n’a pas eu en vue les mêmes écrits de Lysias que Cicéron ou que les critiques d’aujourd’hui. Est-il croyable cependant que Lysias fût à ce point différent dans ses plaidoyers de ce qu’il était dans ses discours épidictiques ? Pourquoi, si cette différence existait en effet, Platon ne l’a-t-il pas notée et ne tient-il aucun compte de ce qu’il y a de meilleur chez Lysias ? On en est d’autant plus surpris qu’en lui il a envisagé aussi l’auteur de plaidoyers, le logographe (257 c sqq.) ; or il n’a jugé utile d’introduire à ce propos ni distinction ni réserve, se bornant à mettre hors de cause le fait même d’être logographe, pourvu qu’on le soit comme il faut (cf. 258 cd ; 277 ab, d). Il semble donc qu’on doive taxer Platon d’injustice notoire envers Lysias. Mais, son appréciation fût-elle même de tout point justifiée, il resterait encore à se demander pourquoi, entre tant de rhéteurs, il a spécialement choisi Lysias pour victime expiatoire de tous les péchés de la rhétorique.
Une première raison pourrait être que, au moment de la composition du Phèdre. Lysias devait déjà être mort[25] : autrement, on concevrait à peine que Platon eût pu ouvertement lancer contre un contemporain vivant une diatribe à ce point injurieuse ; un ouvrage littéraire, émanant du chef d’une grande école, n’excluait-il pas l’emploi de procédés que la comédie même avait cessé d’admettre ? Certes le fait de viser un disparu ne diminuerait pas l’injustice de l’attaque ; pour notre conscience elle en serait seulement plus déplacée. Quoi qu’il en soit, tous les autres motifs qui se présentent le plus spontanément à l’esprit pour expliquer une telle attitude de la part de Platon semblent ne pouvoir être, en l’espèce, d’aucun poids. Ce n’est pas en effet le métèque que Platon peut exécrer en Lysias : aurait-il, dans sa République, traité avec tant de faveur Céphale et Polémarque ? aurait-il, ici même (257 b), opposé ce dernier à Lysias en ceci seulement, qu’il s’est tourné vers la philosophie et que l’autre s’en tient à l’écart ? Pas davantage, le démocrate en tant que tel (cf. p. 2, n. 2), ni l’homme suspect au gouvernement des Trente et qu’on aurait voulu supprimer comme on le fit de Polémarque, ni celui qui a contribué à abattre la tyrannie : un des hommes les plus passionnément dévoués à Socrate, Chéréphon, n’était-il pas justement de ceux-là et fervent démocrate (Apologie 20 e sq.) ? Socrate lui-même n’avait-il pas été menacé par les Tyrans ? Il faut donc supposer une animosité personnelle et essayer d’en deviner les raisons cachées.
Un passage de la VIIe Lettre (325 bc) me paraît, dans une phrase il est vrai assez mystérieuse, propre à bien poser le le problème[26] : « Ceux qui rentrèrent alors, y lit-on, usèrent assurément d’une très grande modération. Mais voici ce qui arrive : ce Socrate, au cercle duquel nous appartenions, est traduit en justice par certains hommes qui avaient du pouvoir… » Or l’expression ne convient ni au principal accusateur, Mélètus, ni à l’un de ceux qui avaient appuyé l’accusation, Lycon : ce n’étaient pas des hommes puissants ; très tôt ils étaient déjà des inconnus. Le seul, dans l’affaire, qui eût du pouvoir, c’est celui qui avait mis sa signature à côté de celle de Lycon, savoir Anytus. Il était une des têtes du parti démocrate et, dans la révolution de 403, son rôle avait été de premier plan[27]. Mais, si le pluriel de la Lettre a une signification, on peut alors supposer que, derrière l’accusateur en titre et à côté d’Anytus, il y a d’autres hommes puissants. Peut-être l’Apologie nous mettrait-elle sur la voie. De toutes les haines qui se sont conjurées contre moi, y dit Socrate (23 e sq.), Mélètus représente celle des poètes, Anytus celle des gens de métier et des hommes politiques, Lycon celle des orateurs. Ordinairement on comprend : des orateurs politiques, parce qu’on se réfère au passage de Diogène Laërce (II 38) où, peut-être d’après Hermippe, Lycon est appelé δημαγωγός, orateur du parti populaire. Mais, si le renseignement est exact, comment se fait-il que, dans l’histoire de ces temps, nous ne trouvions pas trace d’un politicien de ce nom ? De plus, l’acception du mot orateur (ῥήτωρ) est habituellement déterminée chez Platon par le contexte ou spécifiée avec précision[28] ; or, rien de tel ici. Il est donc permis de supposer que Lycon n’était qu’un rhéteur. Si sa médiocrité professionnelle a été ensevelie dans l’oubli où n’a pas réussi à sombrer complètement celle de Mélètus, c’est que, grâce à l’enregistrement officiel des pièces présentées au concours, les poètes avaient un privilège spécial. Ainsi, dans l’accusation, Lycon aurait été le porte-parole des rhéteurs. Et maintenant, quand on se demande qui, dans ce camp, avait pu sournoisement pousser Lycon, quel est le rhéteur démocrate dont l’influence personnelle était comparable en puissance à celle d’Anytus, et qui, par intérêt ou par vengeance, pouvait souhaiter l’éloignement ou la perte de Socrate, c’est à Lysias que l’on peut penser. Si avant la révolution il était déjà, comme l’insinue Cicéron (cf. p. xv), maître de rhétorique, il devait redouter l’action de Socrate sur la jeunesse riche. D’autre part, en tant que démocrate et en tant qu’étranger, il devait partager l’opinion qui faisait de Socrate le maître, non seulement de Critias, le chef cruel des Trente, l’ennemi juré des métèques et l’instigateur probable de la mort de Polémarque, mais le maître encore de Charmide, l’oncle de Platon ; or Charmide avait été l’un des Dix, qui représentaient au Pirée, à l’égard d’une population de métèques et d’Athéniens interdits de séjour, l’implacable autorité des Tyrans. Sans doute Lysias était-il, comme son patron Thrasybule, un démocrate plutôt radical, tandis qu’Anytus appartenait à la fraction modérée du parti. Mais, puisqu’il s’agissait d’anéantir une propagande aussi agissante que celle de Socrate, subversive de toutes les valeurs sociales et politiques admises, bien plus, antipatriotique dans la mesure où elle affichait des sympathies lacédémoniennes, une action concertante d’hommes appartenant à des fractions opposées pouvait être très légitimement envisagée et acceptée.
Ainsi la sévérité, incroyablement partiale, dont Platon a fait preuve envers Lysias pourrait s’expliquer en partie par la rancune qu’il lui aurait gardée de sa participation, dans la coulisse, à la conjuration ourdie contre Socrate en 399. S’il en est bien ainsi, loin d’apaiser cette rancune, la composition d’une Apologie de Socrate, exercice rhétorique destiné à rivaliser avec l’exercice contraire de Polycrate, était une indécence, avivant encore la blessure. L’animosité de Platon contre Lysias serait donc comparable à celle qu’il ressent à l’égard d’Aristophane, auquel, en dépit des illusions que peut suggérer le Banquet (cf. la Notice, p. lvii-lix), il n’a jamais pardonné ; avec cette différence toutefois que le génie d’Aristophane a pu lui paraître digne d’un acte de justice que ne méritait pas l’adresse sans scrupule du rhéteur. Ce n’est pas tout : il est possible aussi, à supposer le Phèdre écrit entre 370 et 366, que Platon ait souhaité ménager, soit Denys encore vivant en 368, soit plus généralement la cour de Syracuse. Après l’algarade de Lysias aux Jeux Olympiques de 388, il pouvait sentir le besoin de marquer avec force, et son désaveu de l’insulte et son antipathie pour l’insulteur : n’était-ce pas sur cette puissance des princes siciliens que comptait Platon pour réaliser son État modèle ?
Isocrate.
Ainsi Lysias aurait été délibérément élu entre tous les rhéteurs pour que son nom détesté portât, à lui seul, le poids des fautes de la rhétorique. Pourquoi Isocrate est-il au contraire exclu de cette sphère empestée et élu par Platon pour recevoir, tout à la fin du dialogue, des louanges qui contrastent singulièrement avec la façon dont Lysias a été constamment traité ? La question est délicate. Sans doute serait-il assez facile d’y répondre si l’on connaissait vraiment l’histoire des relations personnelles d’Isocrate avec Platon. Il ne manque certes pas à ce sujet de conjectures, analogues à celles qui viennent d’être proposées pour le cas de Lysias. Mais, cette fois, nous avons au moins des données positives d’une autre sorte ; ce sont les vues d’Isocrate sur la nature et la destination d’un art de parler, et nous pouvons les confronter avec celles que Platon expose dans le Phèdre. La question devra donc être reprise quand on abordera la conception de la rhétorique (p. clxiv, sqq.). Pour le moment, on se bornera à situer le personnage d’Isocrate et à noter les principales étapes de sa carrière jusqu’aux environs de l’époque au-dessous de laquelle on peut difficilement reculer la composition du Phèdre.
Né en 436, plus âgé par conséquent que Platon d’à peu près huit ans et, de toute façon, notablement plus jeune que Lysias, Isocrate était le fils d’un Athénien à qui sa fabrique de flûtes avait valu une belle fortune. Il n’est pas impossible qu’il ait été l’élève de Prodicus et fréquenté Socrate. En tout cas la situation de son père lui assurait la meilleure éducation ; elle lui permit même, vers sa vingtième année, de se rendre en Thessalie à l’école de Gorgias qui, dit-on, vendait fort cher son enseignement. Combien de temps y resta-t-il ? à quelle époque rentra-t-il à Athènes ? Nous l’ignorons : à l’époque où nous retrouvons sa trace il est ruiné et, pour vivre, contraint d’utiliser sa culture rhétorique à faire métier de logographe. Les plus anciens plaidoyers que nous possédions de lui semblent être contemporains, ou peu s’en faut, de la restauration démocratique de 403[29]. Mais cela ne prouve pas qu’il n’eût point déjà plaidé, et d’un autre côté la publication, totale ou partielle, paraît en avoir été faite bien plus tard, par ses soins, pour montrer aux élèves de son école comment il faut traiter tel genre d’affaire, comment on doit employer tel moyen rhétorique. Il y en a, comme le Trapézitique et l’Éginétique, qui traitent de délicates questions d’intérêt ; le dernier avait même ceci de particulier qu’il concernait un problème de droit international privé, puisque c’était à Égine que se jugeait le procès et que le client d’Isocrate était d’ailleurs. Dans d’autres, c’est la politique d’Athènes qui est évoquée ; ainsi dans le discours Sur l’attelage, écrit vers 395 pour le fils d’Alcibiade, et qui est un éloge de ce dernier en même temps qu’un raccourci, assez partial bien entendu, des faits auxquels Alcibiade avait été mêlé. Quelque fructueux que fût le métier, Isocrate n’y trouvait pas cependant la satisfaction de traiter de grands sujets, ni celle de parler en son propre nom (Antidosis 46-48). Peut-être alors eût-il aimé se consacrer activement à la politique de son pays ; mais il manquait des dons naturels indispensables : la force et la souplesse de la voix, l’assurance et même la hardiesse (Antid. 189 sq.). Il se tourna donc vers le professorat et, vers 393, il ouvrait une école de rhétorique.
Dès lors ses écrits seront des discours épidictiques. Celui qui s’intitule Contre les Sophistes (vers 390) est un programme de son enseignement, en opposition à ce qu’on faisait dans d’autres écoles concurrentes. L’Hélène et le Busiris sont des « modèles » du genre « éloge », proposés à l’imitation de ses élèves et à l’admiration découragée de ses rivaux. Enfin Isocrate aperçoit, dans cette même voie, un moyen de satisfaire ses ambitions déçues : il va devenir un écrivain politique ou, comme on dit parfois, un publiciste. Il s’attaque d’abord au thème, déjà traité par Gorgias et par Lysias[30], de la concorde entre les Grecs ; il le développe avec éclat en 380 dans son Panégyrique d’Athènes : si Lacédémone voulait faire sincèrement sa paix avec Athènes, l’union de ces deux États ferait celle de toute la Grèce contre l’ennemi naturel, le Barbare d’Orient, dont la faiblesse avérée garantit à l’entreprise les meilleures chances de succès. Puis, Lacédémone persévérant dans sa politique hargneuse et despotique, ce n’est plus contre le Grand Roi, c’est contre elle qu’il veut réaliser l’union ; le résultat peut avoir été, en 377, la formation de cette nouvelle Confédération athénienne qu’animait une pensée, non d’hégémonie, mais de justice. Désormais Isocrate suit les événements plutôt qu’il ne les dirige, mentor qui, devant le démenti des faits, ne sait que remplacer ses illusions passées par des illusions nouvelles. Quand il voit en effet grandir la puissance de Thèbes et que la destruction de Platées lui révèle la menace, contre Athènes, de l’unité béotienne en voie de se réaliser, alors il écrit son Discours plataïque : c’est maintenant contre Thèbes qu’il faut organiser le front commun. Et le voici qui cherche un homme dont l’autorité personnelle soit assez grande pour imposer l’union : c’est d’abord le fils de Conon, le stratège athénien Timothée qui avait été l’un de ses plus chers élèves (Antid. 101-139) ; ce sont ensuite des princes étrangers : Jason et Alexandre de Phères, Denys l’Ancien, le roi de Sparte Archidame, fils d’Agésilas, le roi de Chypre Nicoclès, fils d’Évagoras ; plus tard encore ce sera Philippe de Macédoine. À tous il écrit des lettres qui, encore et toujours, sont des morceaux d’éloquence épidictique. Il n’y a pas lieu de suivre cette évolution de la pensée politique d’Isocrate jusqu’à sa mort en 338, une dizaine d’années après celle de Platon : cela n’a rien à voir en effet avec le problème à propos duquel il figure dans le Phèdre, le problème de la rhétorique. Rien d’autre part ne prouve que, à l’époque où il écrivait le Phèdre et si tardive qu’on la suppose, Platon ait eu connaissance des lettres à Jason ou de la lettre à Denys, nécessairement antérieure à la mort de ce prince en 367 : la publication peut avoir suivi d’assez loin la composition.
On observera seulement, pour terminer, quelle différence il y a sous ce rapport même entre le point de vue d’Isocrate et celui de Platon. Tous deux, en vue de réaliser leurs plans, se sont tournés vers des tyrans, investis d’un pouvoir absolu. Mais le plan d’Isocrate vise uniquement le Panhellénisme ; celui de Platon, sans se désintéresser, loin de là, de cette question de politique extérieure, est surtout un plan de réforme sociale et de politique intérieure, applicable à tout État, présent ou futur, quel qu’il soit. Isocrate est toujours en quête d’accommodements, il accepte les variations, les renoncements même, s’ils doivent servir l’idée dont il est obsédé. Platon, lui, a la hantise du gouvernement par une science qui est une et immuable, qui n’admet point les coups de pouce ni les retouches ; il n’a jamais, à bien considérer les choses, varié dans sa conviction, mais seulement dans la possibilité d’en réaliser intégralement l’objet. Ce sont deux esprits et deux caractères entièrement différents : l’un se meut dans le plan du relatif et du contingent, l’autre dans celui de l’éternel et de l’absolu.
III
LA STRUCTURE DU DIALOGUE ET SON UNITÉ
Le problème.
Dans un texte rebattu du Phèdre (264 c), Platon affirme la nécessité pour tout discours, autrement dit pour toute œuvre littéraire de la pensée, d’ « être constitué à la façon d’un être animé », d’avoir un corps qui ait une partie centrale, une tête, des membres, bref des éléments qui soient solidaires les uns des autres et du tout, se convenant entre eux et au tout. Là-dessus maint critique s’étonne que Platon ait si mal appliqué un précepte si bien formulé : comment se fait-il que, dans une première partie, le Phèdre traite de l’amour et de la beauté, puis dans une seconde, de la rhétorique opposée à la dialectique ? Certains en prennent bravement leur parti[31] : Platon était vieux quand il écrivit le Phèdre, et son art avait perdu de sa souplesse. La plupart font des efforts désespérés pour découvrir une cohésion à laquelle ils ne croient guère ; ils cherchent surtout à subordonner à l’autre une des deux parties[32], espérant ainsi trouver dans la partie dominante le principe d’unité de l’ensemble. Aussi est-il indispensable, si l’on veut savoir à quoi s’en tenir sur une question si controversée, de déterminer le plus précisément qu’on pourra les articulations essentielles de la structure du Phèdre[33].
L’objet immédiat du dialogue :
la rhétorique.
Dès le début, nous sommes mis en face de Lysias et introduits dans l’école d’un maître de rhétorique : Lysias a lu devant son auditoire un discours de sa composition sur le thème de l’amour, et ce qui fait l’intérêt de cette composition aux yeux de Phèdre, c’est qu’il a pris, si l’on peut dire, le thème à rebrousse-poil et qu’il a parlé d’un amour d’où l’amour est absent (227 c) ; ce qui est le comble de l’originalité dans l’invention. Quoique la lecture ait lieu dans une maison particulière (ibid. b), il s’agit bien d’une leçon d’école et l’auditoire est un auditoire d’élèves : Phèdre se plaint en effet d’être resté assis depuis le petit matin (ibid. a et 228 b), et l’on sait que les classes à Athènes ouvraient en effet avec le jour. N’est-ce pas d’autre part l’image d’une classe qui nous est donnée par Socrate, quand il se représente Phèdre empressé à se faire analyser par le Maître chacun des passages qui ont excité son intérêt, demandant à emporter le texte du modèle pour étudier celui-ci plus à loisir, se hâtant, avant de le rendre, de l’avoir en secret appris par cœur (228 ab)[34] ? Si enfin Phèdre se dit capable de donner, point par point, un sommaire du discours, il est possible que ce sommaire soit le moyen dont il a usé pour aider sa mémoire, mais possible aussi que ce soit le fruit du commentaire même du Maître sur le discours qu’il vient de lire. Enfin ce Socrate que Platon peint ailleurs comme un homme passionné d’entretiens où questionneur et répondant cherchent en commun la vérité, ce Socrate que l’éloquence de longue haleine décourage (p. ex. Protagoras 328 de, 335 bc ; Apologie 33 b), est représenté ici comme follement avide d’y goûter et de se prêter à ses redoutables enchantements (cf. p. 17, n. 3). Ironie sans doute, mais qui rappelle celle qu’on trouve au début d’un dialogue dont l’objet est justement l’art oratoire, le Ménexéne. Une chose apparaît donc dès ces premières pages : c’est que Platon n’a pas attendu d’être plus qu’au milieu de son dialogue pour signifier que l’enseignement de la rhétorique en est l’objet immédiat.
Préambule sur la fonction des mythes.
Puisque Phèdre a sur lui le texte même du discours, il en devra donner lecture à Isocrate. On cherche pour cela un coin où faire halte et, tandis qu’on y va, la conversation des deux promeneurs tombe sur l’enlèvement par Borée de la Nymphe Orithye : prétexte pour Platon à définir son attitude en face des interprétations physiques des mythes traditionnels. L’effort qu’elles supposent détourne, dit-il, du véritable objet de la pensée, la réflexion de celle-ci sur elle-même et la connaissance de soi ; ainsi on se lance dans une recherche qui est sans fin comme sans base, on se croit très savant et l’on n’est qu’un rustaud (229 c-230 a). Mais, si ce n’est pas là ce qu’il faut chercher sous l’affabulation d’un mythe, celui-ci ne serait-il donc qu’un conte amusant ? Encore aurions-nous à lui demander, comme le dit Platon dans un morceau fameux de la République (II 376 e sqq.), de ne pas servir à dépraver l’esprit. La vérité est du reste qu’il est possible au philosophe d’utiliser les mythes existants ou d’en créer lui-même de façon à faire deviner, sous la séduction du vêtement, un corps de vérité substantielle. C’est de quoi le Phèdre nous fournira trois remarquables exemples. Bien plus, le plus important d’entre eux, celui où est enfermée la doctrine de l’âme et de l’amour, représente l’expiation qui doit purifier d’une souillure religieuse, du péché de mythologie (243 a) ; or ce péché consiste justement à traiter les mythes comme des fables avec lesquelles on peut en prendre à son aise, faute d’y voir une occasion de réfléchir sur soi-même. Peut-être est-il donc permis, en résumé, de penser que cet apparent hors-d’œuvre mythologique du début est secrètement motivé par la signification qu’il doit recevoir de la suite même du dialogue.
Comment s’explique la place faite à l’amour.
L’amour est le sujet du discours de Lysias, que Phèdre lit à Socrate. Serait-ce pour cette raison, tout extérieure, que l’œuvre fait à l’amour une grande place ? S’il en était ainsi, tout ce qui y est dit plus tard sur la question et qui est une pièce de la philosophie de Platon, de sa théorie de l’âme en particulier, aurait alors le caractère d’un accident : ce serait quelque chose d’extrinsèque et de déterminé par le dehors. Dans cette hypothèse, la rhétorique deviendrait le sujet principal. Ne peut-on cependant se demander alors pourquoi Platon a choisi un discours sur l’amour plutôt que sur tout autre sujet ? Sans doute allèguera-t-on l’existence réelle de ce discours de Lysias. Supposons pour l’instant qu’il soit en effet de lui. Le choix n’en subsiste pas moins : entre tous les thèmes que Lysias, rhéteur, pouvait avoir traités dans des discours épidictiques, il a préféré celui-ci. Or un choix suppose un dessein. C’est donc que, dans ce dessein, au problème de la valeur d’un enseignement de la rhétorique se trouvait uni le problème de l’amour. Au surplus, si le premier de ces problèmes était le vrai et le seul sujet, tandis que le second ne serait qu’une matière de fait, accidentellement fournie à Platon, certaines particularités de structure s’expliqueraient fort mal. Pourquoi n’a-t-il pas suffi à Socrate de refaire le discours de Lysias, puis de le critiquer et, enfin, de joindre à cette critique ses propres vues sur l’art de parler ? Pourquoi la critique est-elle ainsi coupée en deux tronçons (234 e-236 a, 262 c-265 c) ? Et surtout, pourquoi y a-t-il, au centre de l’œuvre, cette « palinodie » dans laquelle ce n’est plus seulement la forme qui est corrigée, mais bien le fond même et où est instituée une doctrine ? Mais si, d’un autre côté, on arguait de ce qu’elle est le point culminant d’un effort en vue de déterminer la fonction de l’amour, pour prétendre inversement que la rhétorique est le sujet accessoire et l’amour le sujet principal, c’est alors une autre question qui se poserait : pourquoi le mythe des Cigales (259 b sqq.) ? Or on voit au contraire qu’il est destiné à nous rappeler qu’avec la doctrine de l’amour, exposée dans la palinodie, le sujet n’est pas épuisé et qu’on serait coupable de ne pas le conduire à son terme. Une conclusion semble donc s’imposer à nous : c’est que, conformément à ce qu’exige aux yeux de Platon tout discours, il y a dans le Phèdre une solidarité organique entre l’élément « amour » et l’élément « rhétorique », qu’aucun des deux ne peut être rendu indépendant de l’autre, mais que tous deux concourent à la vie de l’ensemble.
La première partie du dialogue.
Tout à l’heure j’étudierai (IV), à la fois en eux-mêmes et dans leur rapport, le discours de Lysias et le premier discours de Socrate. Puisque, en apparence au moins, le thème en est identique, on doit les considérer, je crois, comme les deux sections, entre lesquelles il n’y a différence que de forme et de méthode, d’une première partie. C’est ce que me paraît marquer très nettement cette observation de Socrate : mon attention, dit-il (234 e sq.), s’est portée tout entière, tandis que j’écoutais le discours de Lysias, sur les caractères rhétoriques du morceau et sur le style, attendu que le fond semblait être en effet complètement indifférent à l’auteur. Plus loin (235 e sq.) une autre remarque parle dans le même sens : asservir d’avance l’orateur à une donnée fictive et arbitraire (p. 18, n. 2), c’est lui interdire toute liberté dans la recherche et dans l’invention de la vérité, c’est l’astreindre à ne développer que les points nécessairement impliqués par la donnée : dès lors, sa tâche est limitée à l’ordonnance des développements, et c’est en effet à cette tâche toute formelle que se bornera Socrate en reprenant, sur l’injonction de Phèdre, la donnée de Lysias. Reste, il est vrai, un passage assez embarrassant : celui où Socrate (235 b-d), invoquant une tradition de l’antiquité que représentent des femmes comme des hommes, nomme Sapho et Anacréon. Il y faut reconnaître, semble-t-il, un procédé familier d’exposition[35], qui sert à dissimuler sous le voile de mystérieuses autorités le caractère original et personnel de certaines opinions ; c’est une des exigences du motif socratique de l’inscience, qui du reste est rappelé ici même à trois reprises (234 d, e fin, 235 a fin). Toujours est-il que Socrate déclare qu’à ces sources étrangères son cœur s’est empli, il ne sait comment[36]. Il me semble impossible qu’une déclaration si solennelle puisse se rapporter au discours que Socrate va prononcer sur le thème sophistique de l’amour sans amour : pourquoi parlerait-il de sources étrangères, si elles ne l’étaient en effet à l’inspiration même du thème en question et, par conséquent, impropres à donner, fût-ce sous une forme plus épurée, une eau dont la nature n’aurait point changé ? C’est donc que Socrate sent déjà vaguement qu’il serait en état, puisant à ces sources étrangères, d’opposer au discours de Lysias un autre discours, dont le fond cette fois serait différent. Tel est, je crois, le sens de ce qu’il affirme en se disant prêt à soutenir, sans infériorité, le parallèle (235 c mil.). Il y a donc dans ce passage l’annonce du second discours.
Mais Phèdre n’a pas compris[37] : c’est la rhétorique seule qui l’intéresse, et il croit que Socrate s’engage à changer la forme sans toucher au fond (235 d, 236 a-c) : le malentendu roule tout entier sur les mots autre et différent, qui dans son esprit ne doivent concerner que le vocabulaire et le style. C’est de quoi justement le raille Socrate quand il lui donne à entendre (235 e sq.) que, à moins de changer la donnée, il n’y a pas réellement de nouveauté possible. Mais la violence exercée sur lui par Phèdre le contraint de garder la donnée de Lysias. En dépit du comique de la scène et qui d’ailleurs est surtout dans le rôle de Phèdre, sa défense n’est pas feinte ; pas davantage la honte qu’il ressent d’avoir à parler contre la vérité, et le geste de se voiler la face en est l’expression visible (236 b-237 a). Enfin, nouvel indice de cette annonce implicite, que j’ai cru apercevoir, d’une nouvelle position à prendre sur la question, il observe une fois de plus avec force (237 b) que la position actuelle est purement conventionnelle et qu’elle ne répond à aucune réalité. Concluons : si l’amour était le sujet de Phèdre, le second discours, déjà près d’éclore, viendrait maintenant ; ce ne serait pas une « palinodie », une rétractation à l’égard de soi-même, mais la réfutation d’un autre. Et d’un autre côté, si la rhétorique était le sujet, il n’y aurait lieu ni à rétractation ni à réfutation : le premier discours suffirait, avec le progrès rhétorique qu’il marque à l’égard du discours de Lysias. Ainsi s’affirme de nouveau la solidarité des deux sujets entre lesquels on a voulu écarteler le Phèdre. La vérité est donc qu’il n’y a qu’un seul sujet.
Au moment où, dans son premier discours, Socrate en vient à parler de l’amour en tant que forme particulière de la sensualité (238 bc), il s’interrompt pour noter que son éloquence a perdu sa froideur méthodique, qu’elle touche presque au ton du dithyrambe, qu’elle semble enfin procéder de quelque inspiration divine. Quelle inspiration ? Serait-ce ce mystérieux influx dont il se sentait tout à l’heure envahi (235 cd) et qui se manifestait à lui par l’éveil imprévu dans sa mémoire d’une tradition vénérable de l’Antiquité ? De fait il n’en est plus question, et ce qu’il allègue maintenant, ce sont des influences presque physiques, une magie inhérente au lieu où ils sont et attestée par les consécrations religieuses dont il porte le témoignage : c’est Pan, divinité des champs et des troupeaux, ce sont les Nymphes, divinités des bois et des fontaines, c’est le dieu fluvial, Achéloüs, leur père (cf. 263 d) ; il y a aussi les cigales chanteuses, servantes des Muses (230 c, 259 cd, 262 d) ; il y a ces Muses mêmes, à la voix claire, qu’il a invoquées en commençant son discours et dont l’inspiration n’est pas sans risques. Or, quand ils résultent de telles influences, l’enthousiasme et la possession, la présence intérieure de quelque divinité, ne sont pas les plus belles formes de ces délires dont il sera plus tard question. Sur cette pente, Socrate est donc en danger d’en venir aux égarements de la nympholepsie (238 d déb.)[38]. Et c’est autre chose encore que ce délire corybantique où Phèdre est jeté par l’éloquence, autre chose que cette bacchanale dans laquelle il a entraîné Socrate (228 bc, 234 d), au point que le véritable auteur du premier discours de celui-ci, c’est Phèdre lui-même (242 de, 244 a) ! Sans doute cela n’est-il pas, et Socrate en fait à Phèdre le reproche, sans avoir contribué à le mener où il en est ; ce n’est pourtant encore qu’une sorte de vertige, dont il est légitime de parler avec ironie. Mais voici que l’apparition inattendue, sur ses lèvres, d’un hexamètre (241 d déb.) révèle à Socrate que, tout en parlant, il s’est à son insu élevé du ton du dithyrambe à celui de l’épopée : à quel diapason va-t-il donc monter, s’il continue ? Aussi se gardera-t-il bien de donner à Phèdre ce qu’attendait celui-ci : après le réquisitoire contre l’homme passionné d’amour, l’éloge de celui qui n’aime pas. Déjà c’était à sa honte et contre son gré qu’il avait repris le thème de Lysias : plutôt que de trahir, plus honteusement encore, les nobles enseignements dont il avait eu le bonheur de se souvenir, il aime mieux tout de suite s’en aller !
La voix du Démon :
deuxième partie.
C’est alors que, au moment où dans cette intention il allait passer de l’autre côté de l’eau, il a entendu la voix de son démon, l’avertissant de n’en rien faire. Il avait eu auparavant, tandis qu’il parlait, la vague divination d’une faute personnelle, il s’était senti troublé et décontenancé, il avait obscurément senti que l’éloge dont les hommes honoreraient son langage pourrait bien signifier un péché contre les dieux (242 b-d) : l’amour dont les deux discours ont parlé est en effet un amour de gens sans noblesse, et non pas d’hommes libres (243 c)[39]. Mais c’est l’admonition démonique qui a vraiment permis à Socrate de prendre enfin pleine conscience de son péché. Il est donc difficile de ne pas voir là une coupe significative dans le développement du dialogue : à une inspiration qui venait d’en bas s’en substitue désormais une autre, qui vient d’en haut. Car un démon, selon la doctrine du Banquet (202 e sq.), est un médiateur : c’est grâce à lui que l’homme est capable de cette divination de l’âme dont Socrate s’était tout à l’heure jugé investi, et les divinités dont il lui porte le verbe sont des divinités vraiment souveraines. C’est donc, je crois, une erreur de considérer la discussion sur la rhétorique comme inaugurant la deuxième partie du dialogue : dès le début, la rhétorique était son cadre et nous ne sortons pas de ce cadre. Mais ce qui a complètement changé, c’est le rapport à ce cadre de son contenu : celui-ci était jusqu’à présent une image sans vérité, dont on n’a fait que rectifier le dessin sans en corriger l’inconvenance foncière ; c’est la réalité même de l’amour qu’enfermera désormais le cadre. La deuxième partie du Phèdre, comme partie distincte dans l’ensemble, me paraît donc être constituée par le second discours de Socrate.
Dans ce second discours, ce que Phèdre a surtout admiré, c’est la beauté de la forme (257 c). Or il s’était promis, avant de l’avoir entendu, d’obliger Lysias à entrer en compétition avec Socrate, en composant à son tour un éloge de l’amour (243 de). Il craint maintenant que cette compétition ne tourne pas à l’avantage de son héros, sans penser, bien entendu, à autre chose qu’à la difficulté pour Lysias de réaliser dans la forme une pareille élévation. Aussi bat-il prudemment en retraite et allègue-t-il, par anticipation, un prétexte pour excuser Lysias s’il garde le silence : déjà suspect aux politiques en crédit parce qu’il compose des discours et qu’il est un logographe (p. 56, n. 2), ne risquera-t-il pas ainsi de surexciter encore leur hostilité ? Un homme public redoute en effet d’être appelé « sophiste » : cela reviendrait à dire qu’il est en dehors de la vie publique, travaillant en effet dans la coulisse pour ceux qui y participent[40]. N’y a-t-il pas toutefois, observe Socrate, quelque chose de déconcertant dans ce grief comme dans cette crainte (cf. 258 c) ? Tout homme politique, qu’il soit comme Darius monarque absolu d’un grand royaume, ou bien comme Lycurgue et Solon orateur dans un État grec, n’est-il pas un logographe ? Ses lois sont des écrits et qui sont destinés à d’autres, principalement à la postérité sur laquelle régneront ces lois. L’illustration que se sont acquise de tels « écrivains » prouve donc qu’il n’y a pas de mal, en soi et absolument, à se faire écrivain, et aussi bien dans des productions qui ne concernent pas le public, en prose tout comme en vers. La question est autre : c’est de savoir par quels caractères un mauvais écrit se distingue d’un bon. A-t-on besoin d’examiner cette question de valeur relative ? N’en aurait-on pas besoin, ce ne serait pas une raison pour ne pas goûter un vif plaisir à faire un tel examen[41]. En tout cas, que ce soit ou non un besoin, que ce doive être un plaisir ou non, ce n’est pas le loisir qui manque à Socrate et à Phèdre.
Le mythe des Cigales.
C’est en effet justement l’heure de la sieste : vont-ils l’employer à dormir, au lieu de discuter la question qui s’offre à leur examen ? Ils ne doivent pas, pareils à des esclaves ou à des bêtes, se laisser vaincre par la chaleur ; le chant ensorceleur des cigales ne les captivera pas, pour leur perte, comme dans l’Odyssée celui des Sirènes. Ils peuvent espérer au contraire que, d’avoir résisté à leurs enchantements en employant le temps à philosopher, cela leur vaudra l’avantage d’être signalés par ces déléguées et ces interprètes des Muses à celles d’entre ces dernières qui ont le plus noble rang. Elles sont nommées : c’est Calliope, l’aînée, et sa cadette, Uranie. Or la première est, d’après la tradition la plus ordinaire, muse de l’épopée et de l’éloquence, la seconde, de l’astronomie ; leur commune musique est la plus belle de toutes (p. 29 n. 1 et p. 60 n. 1). Je crois apercevoir là un ensemble significatif de notations. Il y a d’abord l’idée d’une hiérarchie parmi les Muses et dans l’ordre de leurs fonctions. Socrate leur avait demandé, à toutes indistinctement, l’inspiration de son premier discours, et on se rappelle où cela le conduisit. Or c’est quand il était parvenu au ton de l’épopée qu’il s’est refusé à continuer par peur d’un pire danger et qu’il a entendu l’avertissement de son Démon. Mais voici maintenant qu’il distingue entre les Muses et que, conformément d’ailleurs à la tradition, il donne à Calliope la première place. Est-ce au titre seulement de l’épopée et de l’éloquence ? La subordination d’Uranie, muse des choses du ciel, à l’égard de Calliope, suggère l’idée que la double fonction de celle-ci relève en effet de quelque principe commun, qui ne peut être que la philosophie[42]. Il y aurait donc là, au moins pour ce qui regarde l’éloquence, une sorte de présage de l’existence d’une rhétorique philosophique et de sa relation nécessaire avec l’étude du ciel et de la nature entière (269 d sqq., surtout e-270 c). Au surplus ce qui est dit de l’incomparable valeur de « la musique » de ces deux Muses est tout à fait dans le sens de ce qu’on lit dans le Timée (47 de), où les mouvements de notre âme, leur harmonie et leur rythme, sont manifestement liés, à la fois à la musique proprement dite et à l’astronomie, dont on connaît d’autre part l’étroite correspondance. En second lieu, ce sont les cigales elles-mêmes qui sont en quelque sorte promues en dignité. Elles se rattachaient tout à l’heure à cet ensemble d’influences locales qui ont inspiré à Socrate une éloquence mensongère (cf. 262 d). Maintenant encore ce sont des sorcières, dont l’inlassable claquette travaille à endormir la pensée du philosophe. Ces sorcières toutefois récompensent celui qui résiste à leurs maléfices : si Phèdre et Socrate ne trahissent pas la philosophie au profit d’un repos animal, s’ils persévèrent dans leur enquête sur la rhétorique, ce sont elles qui devant Calliope et Uranie en porteront témoignage.
Ainsi le mythe des Cigales serait autre chose qu’un intermède. Il est comparable à ce qu’est dans le Phédon (84 e-85 b) le mythe des Cygnes, les oiseaux d’Apollon, qui rappelle le thème apollinien du début (60 e-61 b) pour en faire repartir ensuite le dialogue. De même, le mythe des Cigales est comme le pivot du Phèdre. Le second discours de Socrate nous a fait monter jusqu’au plan le plus élevé dans la conception de l’amour. Mais nous n’en avions pas fini avec la rhétorique et il nous faut revenir à notre point de départ. Ce sera pourtant dans d’autres conditions, et l’objet de cet intermède apparent est de le faire sentir. Un nouvel exemplaire de discours s’est en effet ajouté à ceux qui remplissaient la première partie. Du point de vue supérieur jusqu’où il nous a élevés, nous recommencerons notre enquête, mais avec de plus vastes horizons, non pas seulement sur la rhétorique, mais sur le rapport qui l’unit à l’amour et au-dedans de l’âme. Nous voici donc au seuil d’une troisième partie ; elle se lie aux deux autres de la façon la plus intime et elle en fait comprendre la destination. C’est un nouveau motif de reconnaître combien est solide, et même particulièrement serrée, la texture du dialogue.
La troisième partie.
Cette troisième partie peut à son tour se subdiviser en trois sections. Dans la première, après avoir déterminé les conditions les plus générales auxquelles doit satisfaire toute œuvre d’un art quelconque, on s’interroge sur les œuvres que produit l’usage de la rhétorique ; et d’autre part, en expérimentant sur des exemples, on cherche dans quel cas l’usage ne satisfait pas du tout à ces conditions générales, ou bien y satisfait d’une façon incomplète, ou enfin totalement. Une seconde section envisage l’enseignement de la rhétorique, et dans ce qu’il comporte, et par rapport à la contribution historique des Maîtres à la constitution de l’art enseigné sous ce nom. Enfin, dans la dernière section, à cette rhétorique de fait Platon oppose ce qu’on pourrait appeler une rhétorique de droit, rhétorique philosophique qui n’est autre chose qu’une mise en œuvre pratique de sa dialectique[43].
Quels sont les droits de la rhétorique à se dire un art ?
I — A. La question à examiner en premier lieu (259 e sqq.) est celle qui a été posée tout à l’heure (258 d) : comment et pourquoi parler et écrire, actes qui en eux-mêmes n’ont rien de repréhensible, ni, ajouterions-nous, de spécifiquement méritoire, peuvent-ils être tantôt quelque chose de mauvais et tantôt quelque chose de bon ? Ce dernier résultat, Socrate en a la certitude, ne sera obtenu qu’à une condition : connaître ce qui est la vérité sur le sujet dont on traite. Ce n’est pas là pourtant ce que Phèdre a appris à l’école de la rhétorique : si le but à atteindre est de persuader des auditeurs (ou des lecteurs), ce n’est pas le vrai qu’il importe de savoir, sur la justice par exemple, mais uniquement, puisque ce sont eux qui doivent juger et décider, quelle est là-dessus leur opinion, de façon à utiliser cette opinion pour produire en eux telle conviction qu’on veut obtenir. Soit ! réplique Socrate, appliquons donc ceci à un exemple : je ne sais pas ce qu’est un cheval ; je sais uniquement que, dans l’opinion de Phèdre, c’est entre les animaux domestiques celui dont les oreilles sont les plus longues ; la rhétorique m’autorisera-t-elle à lui persuader, en conformité avec cette opinion, qu’il fera bien, ayant besoin d’un cheval pour la guerre, d’acheter cet animal aux longues oreilles ? Il n’y a qu’à transporter cet exemple au cas de la distinction du bien et du mal, pour se rendre compte de ce que peut valoir en ses fruits une rhétorique ainsi conçue. Peut-être y a-t-il cependant, dans l’expression d’un tel grief, une simplicité quelque peu brutale. La rhétorique, par la voix d’un de ses suppôts (Notice, p. clxviii sqq.), répondra que la connaissance de la vérité est préliminaire sans doute, mais insuffisante pour savoir persuader et que, si le but du discours est de persuader, on ne saurait se passer de la rhétorique, l’art qui en enseigne le moyen. — Ainsi une sorte de procès est engagé, où la rhétorique est défenderesse. Le demandeur lui refuse le droit, telle qu’en fait elle se comporte, de se dire un art, une discipline capable d’être transmise par l’enseignement ; il soutient qu’elle n’est au contraire qu’une grossière routine. Il procède donc, selon l’usage, à l’interrogatoire de la partie adverse (p. 62, n. 3).
La rhétorique comme « psychagogie » de l’illusion.
B. Le but de la rhétorique, demandera-t-il, n’est-ce pas de « diriger les âmes » par la parole, d’être une psychagogie[44], comme il existe une pédagogie dont le but est de diriger l’enfance ? Est-elle cela dans toutes les circonstances possibles, soit publiques, devant l’Assemblée du Peuple ou au Tribunal, soit privées, et quelle que soit d’ailleurs l’importance du sujet ou l’étendue du discours ? C’est seulement, répond la rhétorique, dans les deux premiers cas, ce qui implique que le sujet est important et que le discours sera étendu. Mais, riposte le demandeur, dans l’Assemblée ou au Tribunal n’est-ce pas une controverse qui s’engage, une antilogie, où s’affrontent deux parties dont chacune cherche à faire croire aux mêmes gens que la même chose est juste ou injuste, bonne ou mauvaise ? Or n’est-ce pas ce qui se passe aussi dans des discussions en petit cercle et portant sur de petits intérêts, ainsi l’argumentation de Zénon d’Élée sur la pluralité et le mouvement ? C’est donc que le domaine de la rhétorique est bien plus vaste qu’elle ne le croit, mais que, d’autre part, son caractère essentiel est de s’appliquer, autant que faire se peut et à l’égard de gens capables de s’y laisser prendre[45], à assimiler ceci à cela qui en diffère et à seule fin de créer une illusion, ou bien au contraire à déjouer dans le discours d’autrui de telles assimilations illusoires. Or, comment pourra-t-on pratiquer contre autrui cet art d’illusion, ou bien éviter d’en être dupe soi-même, si l’on n’est pas capable de distinguer des choses qui se ressemblent ? Car le terrain privilégié d’un tel illusionnisme est celui sur lequel on peut insensiblement glisser d’un terme à celui qui en est réellement le contraire[46]. Produire l’illusion aussi bien que la discerner suppose donc qu’on ne se contente pas d’opérer sur des opinions incertaines et vagues, mais que l’on connaît l’essence vraie de ce qui, peu ou prou, se ressemble[47]. Autrement, la rhétorique n’a aucun droit de se présenter à la barre pour prétendre qu’elle est un art.
Le recours aux exemples.
C. Mais tout cela n’est-il pas trop peu concret ? Pour nous rendre compte de la différence qui sépare un discours fait avec art d’un discours sans art, considérons, dit Socrate, les trois discours qui ont été prononcés sur l’amour : celui de Lysias et les deux miens. Et Phèdre d’approuver ; élève des rhéteurs, il est en effet habitué à étudier sur des « exemples », qui sont les compositions « épidictiques » du maître. Oui, poursuit Socrate, c’est une heureuse chance, vraiment, qu’aient été prononcés les deux discours qui offrent quelque exemple de la façon dont on peut, bien qu’on connaisse la vérité, se faire de la parole un jeu pour égarer ceux qui vous écoutent (cf. 265 c s. fin.). Les deux discours en question ne peuvent être, à mon avis, que le discours de Lysias et le premier discours de Socrate[48]. N’est-ce pas tout d’abord une heureuse chance que Socrate ait rencontré Phèdre et qu’ainsi il ait connu le discours de Lysias ? De plus, c’est encore un hasard, heureux en un sens, que du lieu même où ils se sont arrêtés émanent tant d’influences particulières (cf. p. xxxii, sq.), sans lesquelles jamais Socrate n’eût cédé aux objurgations de Phèdre ni repris à son tour le thème de Lysias. D’un autre côté, jouer de l’éloquence pour tromper l’auditeur quoiqu’on sache soi-même ce qui est vrai, cela convient seulement, et au discours de Lysias en une acception ironique et comme si celui-ci dissimulait ce que réellement il sait (comparer 271 c déb.), et au premier discours de Socrate, puisque le mensonge de ce discours est celui de l’homme qui sait ce qui est vrai. Sans doute une telle connaissance de la vérité est-elle pareillement impliquée par le second discours ; sans doute celui-ci est-il pareillement un jeu oratoire (cf. 265 c, déb. et fin) ; sans doute aussi suppose-t-il une heureuse chance, savoir que la voix démonique soit intervenue pour déterminer Socrate à sa « palinodie ». Il n’en est pas moins vrai qu’il n’a rien à voir avec l’opposition, si nettement marquée ici, entre vérité au-dedans de la pensée et mensonge dans l’expression de cette pensée au dehors. Enfin n’est-ce pas intentionnellement, plutôt que par négligence grammaticale, que, parlant des deux discours, Platon a écrit qu’ils contiennent un exemple d’une telle opposition ? En fait, d’ailleurs, c’est par le discours de Lysias que commencera cette leçon des exemples ; la critique qu’on en a faite du point de vue de la forme doit tout naturellement dispenser d’examiner pour lui-même le premier discours de Socrate, car il en corrigeait seulement les défauts de forme ; l’unique leçon à en tirer, on le voit en effet (265 a), est celle qui résulte de sa relation au second discours, en tant qu’avec celui-ci la considération du fond remplace celle de la forme, et que la vérité y est cette fois proclamée par l’homme qui la connaît. Ainsi les trois discours seraient trois exemples : celui de Lysias, de jeu mensonger sans art ; le premier des discours de Socrate, de jeu mensonger avec art ; le second, de jeu à la fois véridique et plein d’art.
La critique du discours de Lysias (262 d fin sqq.) porte sur deux points. Le premier précise des indications antérieures (cf. 261 cd) : le domaine où se meut la rhétorique dans toute son extension, c’est celui de ressemblances qui favorisent le passage inaperçu d’une notion à son opposé. Ici ce sont de nouveau les notions de juste et d’injuste, de bien et de mal qui servent d’exemple pour montrer que nulle part la rhétorique n’est plus à son aise pour produire l’illusion que sur les sujets qui prêtent à controverse, étant de ceux sur lesquels flotte, hésitante, la pensée, non seulement de divers hommes, mais de chacun de nous en des moments divers. Pour parler ou écrire avec art il est donc indispensable d’avoir tout d’abord déterminé si tel n’est pas le cas du sujet à traiter et, ensuite, de s’être mis d’accord sur une définition de la chose dont il s’agit (cf. 237 c, 277 b). Or c’est précisément le cas de l’amour : sans quoi Socrate n’aurait pu à son égard adopter successivement dans ses deux discours deux attitudes contraires. Lysias est donc fautif de n’avoir point, comme l’a fait Socrate au début de son premier discours, défini la conception qu’il s’en faisait. — Le second point sur lequel on voit que Lysias a manqué d’art (263 e déb.) se lie à cette première faute : ne sachant pas de quoi il parlait, il ne pouvait ordonner convenablement son discours ; il a commencé par la fin ; l’ordre des parties, étant indifférent, est interchangeable. C’est donc une composition inorganique.
Ce qu’en premier lieu révèle d’autre part l’exemple de la relation qui existe entre les deux discours de Socrate (264 e sqq.), c’est l’importance significative de leur contrariété. Cette contrariété nous mène en effet à reconnaître qu’il y a deux espèces du délire, dont l’une est une vraie maladie dans laquelle déchoit notre nature humaine, tandis que l’autre est une possession divine par laquelle nous sommes au contraire élevés au-dessus de nous-mêmes. Il est possible que la première espèce corresponde à ces délires dont parle le Timée (86 b sqq.) et qui sont suffisamment expliqués par des états du corps. Mais il me paraît plus probable, étant donnée la façon dont cette distinction est introduite, qu’elle doit être rapportée à la différence d’inspiration, déjà notée, des deux discours (cf. p. xxxii sqq.). Or l’amour, de son côté, a été reconnu pour être un délire, aussi bien par le premier discours (241 a 4, b 8 ; cf. 238 e fin) que par le second. En raison toutefois de cette différence d’inspiration, le premier a considéré ce délire comme un mal : jeu impie ; le second y a vu au contraire la plus belle des formes de délire qu’il a distinguées[49] : jeu sacré et qui rend au dieu Amour l’hommage auquel il a droit. Peu importe à quoi Platon a pu penser au juste quand il avoue n’avoir sans doute pas réussi à garder le contact avec la vérité (p. 71, n. 2) ; l’essentiel, c’est que cet hommage est lyrique et mythique, et que le moment où Platon caractérise ainsi son deuxième discours est celui où il introduit la notion de la méthode dialectique (265 bc). En tant qu’il est un hymne mythologique, ce deuxième discours est en lui-même un mélange, c’est-à-dire qu’à la fiction poétique se mêle une vérité. Mais ce n’est pas par lui-même qu’il a motivé l’introduction de la dialectique, c’est par son opposition au premier discours et, comme dit Platon, par la façon dont on a pu passer ainsi du blâme à l’éloge, reconnaître la nécessité d’une division, donc d’une spécification. Aussi, quand Socrate, un peu plus loin (e), parle des deux discours grâce auxquels ce résultat a été obtenu, est-il évident qu’il ne s’agit plus des deux discours, pareillement mensongers, dont il était tout à l’heure question (262 c fin) : celui de Lysias est explicitement mis hors de cause (264 e), et ce qui est par conséquent instructif, c’est la relation du second discours de Socrate au premier. Or ils ont envisagé l’égarement d’esprit dans l’unicité de sa nature ; mais, tandis que l’un a taillé d’un côté et ainsi a abouti à déterminer la branche gauche et funeste de cette nature, l’autre a taillé du côté droit et abouti à déterminer une branche droite, ce qui lui a permis de découvrir une sorte divine d’amour, qu’il a louée comme il convient (265 e sqq.). En résumé, si l’on veut être capable de comprendre comment à une rhétorique fondée sur le pur empirisme on pourra substituer une rhétorique philosophique, il est également impossible d’isoler le premier discours de Socrate de celui de Lysias et, l’un de l’autre, les deux discours de Socrate. Ainsi se manifeste à nouveau, et d’une façon particulièrement éclatante, l’unité décomposition du dialogue, puisqu’ainsi on voit quelle étroite solidarité lie l’examen de la rhétorique à la conception de l’amour.
La rhétorique actuelle
II. — Mais Phèdre ne connaît qu’une rhétorique, celle des rhéteurs qui sont ses maîtres : une rhétorique qui dépendrait de la dialectique ne dit rien à son esprit (cf. p. 73, n. 3). Il réclame donc qu’au contraire, en face de la dialectique, on envisage la rhétorique en elle-même et à titre de genre indépendant (266 c). Si c’est une discipline autonome, elle doit avoir des règles techniques qui lui soient propres (cf. 269 bc). Aussi y a-t-il lieu de passer en revue le contenu des livres où cette discipline est exposée, de nommer quelques-uns des maîtres qui en ont fait profession (cf. section VI). Ce qui seul à la vérité nous intéresse présentement et par rapport au développement du dialogue, c’est l’examen critique de cette prétendue discipline (268 a sqq.) : c’est en effet de cet examen que sortira, réclamée par Phèdre lui-même (269 c), la notion d’une rhétorique qui mérite d’être appelée un art. Cet examen se fait par une méthode comparative : quelles sont les exigences des arts incontestables et, pour ainsi dire, constitués, ayant des représentants illustres et dont l’avis fait autorité quant aux exigences de chacun de ces arts ? Or le médecin, le poète tragique, le musicien s’accordent à reconnaître que l’exercice de leur art suppose des études préliminaires spéciales : un médecin par exemple, avant de soigner des malades, doit avoir appris quel est l’équilibre du chaud et du froid dont est faite la santé, quelles sont les espèces de perturbations qui peuvent survenir dans cet équilibre générique, quelles sont pour chaque effet curatif à obtenir les ressources de la thérapeutique. Mais il sait aussi que de telles connaissances, purement formelles, ne suffisent pas pour être capable de guérir quelqu’un : la grande affaire, c’est de les organiser et de les mettre en œuvre en les adaptant à des sujets individuels et à des circonstances singulières (268 b s. fin. ; cf. 270 b). Tout au contraire, la rhétorique met le tout de l’art dans une théorie qui ne concerne que les éléments, qui est scolaire et livresque, qui se flatte d’être exhaustive parce que, dans l’abstrait et artificiellement, elle envisage les opposés d’un même genre. Quant au surplus, qui est véritablement l’essentiel, elle n’en a cure et c’est affaire aux élèves de se débrouiller tout seuls quand ils auront à parler ou à écrire. Or ce surplus, il n’y a que l’exercice de la dialectique qui puisse le donner (269 bc). C’est justement ce qu’expliquera Platon par la suite quand il parlera de la rhétorique philosophique[50].
La vraie rhétorique.
III. — Celle-ci, la vraie, Platon l’envisage à trois points de vue : il en détermine les conditions, il en explique la méthode, il en précise l’objet par opposition à la rhétorique actuelle.
A. Il commence par prendre à son compte, pour le moment du moins, une proposition qui n’était sans doute déjà qu’un lieu commun[51], mais il en renouvelle complètement l’esprit par le commentaire qu’il fait ici du mot savoir. Les dons naturels sont assurément indispensables à l’orateur. Mais, comme il va le montrer par l’exemple de Périclès (270 cd[52]), ces dons ne sont rien s’ils ne sont soutenus et consolidés par un savoir authentique et approprié, si l’on ne rencontre en outre le maître capable de réaliser un tel accord, si l’on ne pratique enfin la méthode qui convient à l’usage de ce savoir. N’est-ce pas justement toute la doctrine de l’éducation dans la République ? Elle définit le naturel philosophe, en même temps qu’elle explique comment il se corrompt (VI 485 a-487 a, 489 e-495 c) ; elle indique par quelle sorte d’instruction, d’abord scientifique, proprement philosophique ou dialectique ensuite, et qui est l’instruction donnée par les maîtres de l’Académie, un tel naturel sera conservé ; elle suppose enfin des exercices appropriés d’entraînement (VII 521 c sqq., 535 a sqq.). Le caractère fondamental du savoir ainsi acquis, c’est, nous le voyons ici, qu’il soit désintéressé et général : désintéressé (269 d, 270 a), ce qui le fait prendre par les sots pour un vain bavardage et une rêverie « dans la lune », et, pour le caractériser, le Phèdre use des mêmes termes que la République (VI 488 c sq.[53]) ; général (270 bc), parce que chaque chose est solidaire du tout, et c’est la République encore qui insiste (VII 537 c) sur l’aptitude caractéristique du dialecticien philosophe à voir les choses dans leur ensemble, à être un esprit synoptique. Là-dessus Platon indique à quelles conditions générales la recherche doit satisfaire pour n’être pas un tâtonnement d’aveugle[54], à quelles conditions d’autre part devrait avoir satisfait la rhétorique avant de prétendre se constituer en discipline autonome (270 e sqq.). Ce n’est pas encore la détermination de sa méthode propre, mais c’est ce qui y achemine. L’exemple de la médecine lui sert à expliquer sa pensée. On ne peut en effet soigner le corps sans savoir de quel ensemble naturel il fait partie, sans savoir quelle en est la nature et si elle est simple ou composée, sans connaître, dans ce dernier cas, le nombre des parties composantes et la fonction de chacune d’elles, sans avoir déterminé dans ce domaine toutes les actions et les effets qu’il est utile de connaître. Si donc la rhétorique est une psychagogie et si, par conséquent, son objet est l’âme pour y produire la persuasion, c’est ainsi qu’elle devrait procéder, considérant d’une part les espèces d’âmes et, de l’autre, les espèces de discours, déterminant sur quelles âmes agiront tels discours (cf. cxlvii sqq.). Mais comment cela se comprendrait-il si le second discours de Socrate sur l’amour ne nous avait en effet pourvus d’une théorie de la composition de l’âme ? Une classification des genres d’âmes ne s’explique que par la prépondérance de tel ou tel des éléments opposés entre lesquels normalement il doit y avoir harmonie : n’est-ce pas ainsi que s’explique la diversité des tempéraments physiques et la possibilité de les classer ? Ainsi, une fois de plus, la relation du second discours à l’ensemble est évidente, et en même temps on voit en quoi ce discours sur l’Amour est un exemple de ce qu’est une rhétorique fructueuse et qui tend à la vérité.
B. Voilà donc la vraie façon, qui n’est pas celle dont parlent en fait les Maîtres, de bien parler et de bien écrire. Mais Phèdre, cette fois encore, n’a pas compris : il ne voit pas que la méthode de la rhétorique est impliquée par les conditions de ce qu’elle doit être et il demande quelle peut bien être cette façon de s’y prendre. Ainsi Socrate se trouve amené, en reprenant ce qu’il a déjà dit, à déterminer avec une précision accrue la méthode propre de la vraie rhétorique (271 c[55]). Ici, il insiste davantage sur la classification des genres de l’éloquence, tantôt brève, tantôt émouvante, tantôt indignée, faisant siennes, au moins provisoirement, les distinctions des rhéteurs. Mais le plus important de cette théorie, c’est que la seule rhétorique constituant un enseignement positif est celle qui ne se fonde pas seulement sur une classification parallèle des âmes et des discours, mais qui en outre envisage spécialement leur interaction. Au lieu en effet de laisser à l’élève le soin de se tirer tout seul d’affaire en face des cas concrets (cf. 269 c, 277 c s. in.), elle l’aura instruit de la même manière que, par la clinique, un médecin apprend à ses élèves à approprier la médication au tempérament du malade et aux circonstances de la maladie (cf. 268 b, 270 b). Instruit par une telle rhétorique, dont la culture dialectique est la base (cf. 266 b, 269 b, 273 de), un élève saura, le moment venu, quel langage il doit tenir à tels auditeurs, par rapport à telles conjonctures, et aussi quelles sont celles dans lesquelles il est au contraire opportun de se taire (271 d fin, e-272 c ; cf. 270 e). Bref, à une théorie qui reste théorique ou formelle et qui est dépourvue d’efficacité, se substitue une théorie qui est théorie de la pratique et qui s’applique à un contenu réel. Ainsi se trouve finalement confirmée, parmi les facteurs qui conditionnent le mérite de l’orateur et de l’écrivain, la prééminence décisive du savoir.
C. On voit mieux maintenant ce qui creuse un abîme entre la fausse rhétorique et la vraie, entre la rhétorique de fait et la rhétorique de droit : c’est que l’objet de la première est la vraisemblance, celui de la seconde, la vérité et que, en fin de compte, seul est apte à produire la vraisemblance qui connaît aussi la vérité. Sur ce point encore, le dialogue ne fait que reprendre des idées déjà exposées et auxquelles des renvois sont fréquemment indiqués ; mais elles sont mises ici dans la lumière qui doit leur donner toute leur valeur significative. Socrate commence par réfuter une objection des maîtres de rhétorique : s’il y a, disent-ils, une voie très courte pour atteindre le but de l’Art, à quoi bon en préconiser une qui au contraire comporte tant de longueurs et de circuits ? Oui, répliquera-t-on, s’il ne s’agit en effet, comme on le voit dans les débats des tribunaux, que d’une routine du mensonge (272 e-273 c), dont le but est de faire illusion à un juge qui n’a ni le désir ni le loisir de s’enquérir de la vérité, pas plus sur le fait en cause que sur la différence du juste et de l’injuste[56]. Quand c’est à des sommets qu’on aspire à s’élever, on ne reculera pas devant la peine que coûtent les longs circuits[57]. La rapidité de la marche, dira de même le Politique (286 d-287 a), est un avantage de second ordre, et, s’il faut un long circuit pour nous rendre meilleurs dialecticiens, plus habiles à faire toutes les spécifications nécessaires, c’est cette voie qui dans notre estime mérite le meilleur rang. — Le second point est plus important encore : le but apparent de la rhétorique, savoir l’action sociale de ma pensée sur celle d’autrui par le moyen d’un discours adapté à cette fin, n’en est pas le vrai but si ce n’est par surcroît ; ce but c’est, par mon effort vers la vérité, de travailler à complaire à des dieux bons ou, en d’autres termes, de travailler à m’élever vers un idéal dont la souveraine beauté embellira jusqu’à ces objets secondaires ou surérogatoires de mon activité (273 e sq.[58]). Ici encore, le Politique nous fournit un commentaire instructif : quand, pour arriver à définir le politique, nous envisageons l’art du tisserand, notre but véritable n’est pas celui-là ; il est au delà, et c’est de nous rendre plus habiles dialecticiens (286 d). Ainsi, dirons-nous, une étude de la rhétorique n’est sans doute pas notre objet dernier : le problème de l’amour, qui un moment a paru n’être que l’occasion d’exemples utiles pour cette étude, s’affirme comme le problème essentiel ; l’amour est en effet, dans le fond de sa nature, aspiration vers l’idéal, et cet idéal, qui est le bien de l’âme, elle devient par l’amour capable de le retrouver et de rentrer ainsi dans sa légitime patrie.
La quatrième partie.
À cet endroit (274 b), le développement du dialogue accuse, ainsi qu’on l’a déjà noté en passant (p. xxxviii, n. 1), une division assez franche pour qu’on y voie, non pas une nouvelle section de la troisième partie, mais vraiment une quatrième partie de l’entretien. Platon déclare en effet qu’il n’a rien de plus à dire sur l’art et l’absence d’art dans les « discours », et par ce mot il a jusqu’à présent désigné à la fois la parole et l’écrit (cf. 258 b, 259 e, 261 b). Le but qu’on s’était fixé (258 d, 259 e), de savoir à quelles conditions peut devenir mauvais ou bon un usage de l’activité qui, en lui-même, est indifférent, ce but est atteint. Le circuit, qui s’était ouvert (259 e) sur l’exigence de la vérité, se ferme ici avec notre définitive accession à la sphère divine de la vérité. C’est alors qu’apparaît la nécessité de distinguer entre la parole et l’écrit, d’évaluer leurs mérites respectifs et de se poser, à propos de l’écrit tout seul, la question qui jusqu’alors concernait indistinctement l’un et l’autre.
Le mythe de Theuth et la supériorité de l’instruction directe sur l’écrit.
Peut-être n’est-ce pas d’ailleurs par hasard qu’au début de cette dernière partie Platon a mis un mythe, celui de l’invention de l’écriture par Theuth (274 b sqq.), comme il faisait du mythe des Cigales une introduction à la troisième partie. Quoi qu’il en soit, son intention est manifeste ; cette histoire est le symbole d’une idée (cf. p. cxiv, sqq.) : l’écrit tue dans la pensée l’activité vivante de la mémoire ; il ne fait que suppléer artificiellement à sa paresse ou à ses défaillances ; c’est un secours étranger qui nous déshabitue de l’effort intérieur. Le progrès de l’instruction ne peut résulter que de la longue patience d’une culture dirigée par l’homme qui sait, culture appropriée à celui qui la doit recevoir et supposant de la part de ce dernier une communion avec le maître qui la lui donne ; bien loin de servir ce progrès, l’écrit engendre l’illusion orgueilleuse d’un savoir dépourvu de critique et trop facilement acquis pour être solidement fondé (cf. 275 cd). On sait avec quelle sévérité Platon juge la peinture, en tant qu’elle est un trompe-l’œil destiné à nous donner le faux-semblant de la réalité vivante[59] : la vie des figures qu’elle campe devant nos yeux est réellement une vie morte et, à notre appel, ces figures demeurent inertes et silencieuses. Or il en est de même pour l’écrit : on s’imagine y trouver une pensée vivante ; mais, qu’on lui pose une question, il ne sait que se répéter ou se taire[60] ; de plus, incapable comme il est de discerner à qui il doit ou non s’adresser, il tombe à l’aventure en n’importe quelles mains ; enfin, si on l’attaque, il ne peut se défendre lui-même (275 de ; cf. 276 c, 277 e-278 b). C’est tout l’opposé pour la parole vivante. Sa parenté avec l’écrit et la communauté de ce nom de « discours » dont on les désigne ne doivent pas nous tromper : l’écrit est l’enfant bâtard de la pensée. Il n’est en effet que le fruit d’un divertissement, qu’elle s’est occasionnellement accordé en vue d’une satisfaction facile et passagère. Un écrivain ressemble à ceux qui s’enchantent de voir en huit jours pousser une petite plante incapable de fructifier et condamnée à une mort rapide. Toutefois le livre n’est pas toujours uniquement un passe-temps dépourvu de sérieux et un pur jeu[61] : comme tout écrit, il est un moyen de remémoration (276 d, cf. 275 a). Indication capitale, si elle doit être prise au pied de la lettre. La critique moderne[62] s’est montrée disposée à voir dans les derniers ouvrages de Platon des écrits hypomnématiques, destinés à rappeler pour les élèves de l’Académie certaines discussions ou leçons de l’école. À en juger par ce passage du Phèdre, cette conception pourrait être étendue à d’autres ouvrages : n’est-ce pas le cas, semble-t-il, même du Phédon (cf. ma Notice, p. xxi sq.) ? Sans doute la plupart rappelaient-ils à Platon la circonstance particulière qui en avait été l’occasion et les méditations qu’elle avait suscitées ; à nos yeux ils en sont au moins une image (cf. 276 a fin). Pour le philosophe ce seraient donc, comme il le dit lui-même à cet endroit du Phèdre, autant de témoignages, dont s’enchantera sa vieillesse, de l’activité généreuse de sa pensée, et il y a là une confidence que l’historien ne peut pas négliger. Qu’il y ait eu, et probablement dès la fondation de l’Académie, des « doctrines non écrites », c’est ce dont on ne peut douter. Même si l’on répugne à en appeler à leur égard au témoignage des Lettres (par exemple VII 341 c sqq.), qui malgré tout demeure suspect (cf. p. xx n. 1) et qui d’ailleurs inquiète par son parfum d’ésotérisme, il y a tout au moins le témoignage d’Aristote. Le livre serait le reflet de cet enseignement, un reflet que seraient seuls capables de reconnaître les privilégiés qui auraient connu la réalité ainsi reflétée[63].
Ces reflets de sa pensée, ce n’est pas au surplus pour lui seul que l’écrivain philosophe les recueille et les fixe : ils serviront aussi, ajoute Platon dans une phrase qui vaut d’être soigneusement notée (276 d), à quiconque marche sur les traces de cette pensée. Mais, comme Socrate insiste sur la valeur d’un tel divertissement comparé à d’autres, ce qui frappe l’esprit de Phèdre et ce qu’il retient, c’est seulement l’idée de jeu littéraire et d’exercice rhétorique (e et la note ad loc.) ; il concède donc que les thèmes en devront être ceux dont Socrate a parlé, le Juste, le Beau, le Bien (c, s. in. et 277 e déb.). S’il y a là de sa part un malentendu, on verra plus tard de quelle façon il doit être dissipé (cf. p. cxv sqq.). Toujours est-il qu’avec cette indulgence narquoise et polie qui lui est habituelle, Socrate s’abstient de contredire ouvertement. Il y a cependant, ajoute-t-il, bien plus de beauté dans une activité sérieuse s’appliquant à ces mêmes objets et pour eux-mêmes (cf. 278 a, de) : c’est celle qui, appuyée sur un savoir authentique et usant de la dialectique, ensemence par la parole les âmes choisies dont elle a avec amour entrepris la culture. Activité essentiellement élective en effet, car elle sait à l’égard de quelles âmes et dans quelles circonstances elle doit s’exercer ou bien s’abstenir (cf. 276 a). Dire d’autre part que la dialectique en est la méthode, c’est dire qu’elle est un entretien, car il n’y a pas de dialectique sans dialogue[64]. Et cet entretien est un enseignement, mais ce n’est pas un enseignement dogmatique ; il suppose en effet une participation active du répondant (ou, si l’on veut, de l’élève), puisqu’à chacun de ses pas la recherche ne peut avancer qu’à la condition d’un assentiment critique donné à l’interrogateur, c’est-à-dire par l’accord des deux interlocuteurs[65]. Voilà pourquoi un tel enseignement n’est pas stérile, comme le serait celui qui se fige dans la mémoire docile de l’élève. C’est au contraire une semence qui lèvera dans son âme, engendrant ainsi une activité nouvelle où revivra ce qu’on pourrait appeler l’esprit du germe originaire. Enfin, de même qu’un tel discours est capable, quand il vient au jour, de se défendre lui-même contre les attaques et contre les obstacles, la continuation de sa vie à travers les générations lui garantit pour toujours le même pouvoir (276 a, e sq. ; cf. 278 a-c). L’image qu’évoque ce morceau du Phèdre me semble être celle d’une association entre maître et élèves pour la recherche en commun de la vérité, et dans laquelle le maître est seulement un guide. Comment une telle communauté ne serait-elle pas fondée sur l’amour, amour de cette vérité qui en est le principe et l’objet, amour du maître pour les âmes qu’il a choisi de cultiver, amour des âmes élues pour celui qui guide et surveille leur épanouissement, amour de tous ensemble pour ce qui est le fruit impérissable de leur mutuel amour ? Il y a là un parallélisme remarquable avec un passage du Banquet (209 a-e) où, à l’idée d’une éducation fondée sur la communauté dans l’aspiration au Vrai et au Bien, s’associe l’idée d’amour et de fécondité. Dans les deux cas nous serions donc en présence de confidences déguisées au sujet de l’Académie (cf. Banquet, Notice p. xc sqq.). Si ce rapprochement est justifié, c’est de nouveau la notion d’amour qui vient affleurer, comme une eau souterraine courant, invisible, à travers toute cette partie du dialogue, qui semblait n’être consacrée qu’à l’examen de la rhétorique.
Récapitulation.
C’est là pourtant le terrain sur lequel, dès le début, se meut le dialogue, et cette surface ne doit pas finir par éclater sous la poussée de ce dont elle recouvre la vie secrète. Voilà sans doute la raison d’être d’une récapitulation (277 a sqq.) qui, en fait, se borne à dessiner les grandes lignes de la troisième et de la quatrième parties, de la même façon que le mythe des Cigales avait lui-même pour fonction de nous rappeler quel est le terrain effectif de la recherche (cf. p. xxxvi sq.). — Deux points y doivent pourtant retenir l’attention. L’un (278 b) est que tout cet examen de la rhétorique a été une occasion de se divertir. Qu’est-ce à dire ? Même la détermination d’une rhétorique philosophique ? Oui, même cela ; et Platon l’indique très clairement ensuite (cd) : il n’y a qu’une chose vraiment sérieuse, ce sont les objets mêmes que cette rhétorique-là prend pour matière de son action, le Bien, le Beau, le Juste (cf. 277 e déb. et 278 a) ; indépendamment de l’usage qu’elle en fait, la dialectique et le savoir ont leur valeur propre, parce que ces « augustes objets » ont eux-mêmes une réalité indépendante. Ajouterons-nous que l’aspiration qui nous porte éternellement vers eux, c’est justement l’amour totalement épuré ? Ainsi donc ce qui était un jeu, ce n’était pas de parler de l’amour, c’était d’en parler à propos de la rhétorique ; car c’est proprement de prendre celle-ci pour objet qui est le vrai jeu : fût-il voilé, le fond du tableau a plus d’importance que le cadre auquel est attaché le voile. — Le second point (278 cd) est connexe de celui-ci. Si la dénomination de « philosophe » est la seule qui convienne à l’homme qui, de toute son âme, s’attache à ces objets supérieurs, c’est qu’il est en effet tout entier possédé par le divin délire d’amour sous sa forme la plus haute, celle qui seule, selon la Diotime du Banquet (210 a-d, 211 c), est d’ici-bas capable de nous porter là-haut. — Ainsi, jusque dans cette récapitulation, deux lueurs viennent brusquement illuminer les dessous profonds du dialogue, tout en nous en rappelant le visible objet. C’est à ce moment en outre que Platon prend soin de fermer le cadre à l’intérieur duquel il a indiqué ces perspectives. Il avait en parlant de Lysias commencé de le constituer, il l’achève maintenant en parlant d’Isocrate.
L’éloge d’Isocrate.
Ces deux protagonistes de la rhétorique au ive siècle sont les deux termes extrêmes entre lesquels s’est développé tout l’entretien. Quant aux louanges données à Isocrate (278 e-279 b), doit-on les opposer aux critiques par lesquelles Lysias a été si durement malmené ? ou bien sont-elles une dérision ? C’est un problème très discuté. Mais il n’intéresse pas la structure même du dialogue et il devra être examiné séparément (cf. p. clxxiii sq.).
L’épilogue.
Un semblable souci de rejoindre l’un à l’autre les deux bouts du dialogue se manifeste dans la façon dont Platon « boucle » l’entretien de Phèdre avec Socrate. Au moment où les deux amis vont quitter leur retraite, sont de nouveau évoquées les divinités de l’endroit, aussi bien les Nymphes et Achéloüs que Pan, dont le nom est seul prononcé (279 b, cf. 278 b). On leur doit bien cette politesse pour les remercier d’une inspiration qui a permis à Socrate de prononcer son premier discours, sans lequel il n’y aurait pas eu lieu à la « palinodie » du deuxième. Dans la prière que leur adresse Socrate il y a une manifestation religieuse que l’on comparerait volontiers à la recommandation, dans le Phédon (118 a), de ne pas oublier le sacrifice promis à Esculape, ou, dans le Banquet (220 d), à la prière au Soleil. Si toutefois les divinités invoquées ici sont justement responsables d’une faute qu’il a fallu réparer, on sera fondé à se demander pourquoi c’est à des puissances de la Nature capables d’égarer ainsi l’esprit, que s’adresse la prière de Socrate. Peut-être, du fait même que la bienveillance de Pan est seule explicitement invoquée, est-il permis d’inférer des idées analogues à celles que le nom même de Pan inspire à Platon dans le Cratyle (408 b-d[66]). Pan, le Chevrier, est d’après la mythologie fils d’Hermès, et ce dernier, messager du verbe divin, a aussi pour fils le Discours. Pan est donc frère du Discours. Or Pan a une double nature : dans la partie supérieure de son corps sa peau est unie et sans poils, velue au contraire dans la partie inférieure, qui est d’un bouc. Cette dualité ne symbolise-t-elle pas la dualité d’un discours qui se partage entre le vrai, qui est uni, divin, tourné vers le haut, et le faux, qui est tourné vers le bas, capricant, embroussaillé ? Étymologie et mythologie s’accordent donc à suggérer, à propos de Pan, l’idée d’une synthèse de contraires. Dès lors le sens de la prière qui lui est adressée ici serait dans les éléments mêmes qui la constituent, et elle serait comparable à ce que sont, dans le Banquet, ou bien la généalogie de l’Amour ou, mieux encore, cette boîte dont Socrate est l’image et qui, enfermant une figurine sacrée, représente au dehors un grossier silène (cf. p. 96, n. 1). Que demande en effet Socrate ? Qu’à la laideur grotesque du dehors s’unisse la beauté du dedans et que, inversement, aucun des avantages extérieurs qui peuvent bien lui échoir ne fasse tort aux valeurs intérieures ; n’y a-t-il pas là le vœu implicite qu’une bestiale dégradation de l’amour ne vienne jamais appauvrir l’idéal qu’il s’en est fait ? Puisse-t-il en somme être un Sage tout en étant un homme, comme Pan est un Dieu tout en étant un bouc ! C’est, d’autre part, conclure à souhait un entretien sur la rhétorique, au cours duquel à des discours mensongers et pleins de bassesse s’est uni un discours plein de vérité et divinement inspiré : en invoquant le fils du dieu même de la parole, Pan qui est patron d’un double discours, Pan en qui s’unissent la bête et le dieu, Socrate semble demander à un dieu de la rhétorique de lui épargner la dégradation à laquelle est exposé dans son discours quiconque méconnaît l’idéal de la parole[67].
Conclusion.
En résumé, l’unité de la composition du Phèdre ne me paraît pas pouvoir être mise en doute. L’art avec lequel elle est réalisée est d’une légèreté subtile et d’une incomparable souplesse ; on en alourdit nécessairement le libre jeu dans l’effort qu’on fait pour suivre ce jeu dans ses mobiles articulations. L’harmonie de l’ensemble y est faite de la variété des éléments, des sonorités, des rythmes. Ce qu’il faut chercher en effet ici, ce n’est pas la symétrie factice d’un plan conventionnel ; c’est plutôt la puissance créatrice de la vie qui, à travers mille détours et au prix de multiples accommodements, organise ses matériaux. Quoique cette comparaison soit celle-là même que suggère Platon, il en est une autre par laquelle est peut-être rendu plus aisément sensible l’art singulier que le Phèdre révèle : c’est celle qu’en a faite Émile Bourguet avec l’art d’une symphonie musicale[68]. Le thème général est celui du discours. Mais un motif dominant se dessine d’un bout à l’autre, tantôt d’une manière apparente et d’abord avec sécheresse puis avec une majestueuse ampleur, tantôt fondu dans l’ensemble et discrètement rappelé, juste assez pour se faire deviner : c’est le thème de l’amour. D’autres motifs interfèrent avec celui-là : l’un, le thème des divinités locales, qui est comme la voix du lieu où se déroule l’entretien, brode ses arabesques du commencement à la fin de celui-ci ; un autre est celui du délire qui, d’abord étouffé, se fait jour par instants jusqu’au moment où il éclate en accents grandioses ; un troisième, le motif de l’âme, se lie au thème de l’amour dont il est une variation, et le motif de la « psychagogie » s’y rattache à son tour. Tous ces motifs s’enchevêtrent sans se confondre ; ils s’annoncent, se développent, sont réveillés ensuite en sourdine. Joignez à cela la variété du ton : tour à tour froid et d’une pédanterie caricaturale, puis brûlant d’inspiration ; naïf ou persifleur selon que domine la tonalité de l’un ou l’autre des interlocuteurs ; ici brutal et cynique, là incisif et vengeur, selon que la parole est à la rhétorique ou bien à la philosophie. Ces oppositions ou ces alternatives se font valoir réciproquement, sans heurts ni dissonances criardes.
On s’étonne donc que les critiques anciens soient pour la plupart restés insensibles à une réussite aussi merveilleuse. La façon dont Aristote dans sa Rhétorique (III 7 fin) justifie par son caractère ironique l’emploi, dans certaines parties du Phèdre, du style de la poésie paraît indiquer que l’exemple du Phèdre était celui qu’on alléguait pour condamner un tel emploi. De fait, par Diogène Laërce (III 38) nous savons que Dicéarque, le disciple d’Aristote, était très sévère pour notre dialogue, y incriminant la vulgarité ou, tout au moins, l’enflure du style. Ce n’est donc pas, semble-t-il, sans motif que Denys d’Halicarnasse parle du grand nombre de ceux qui, avant lui, ont fait le procès du Phèdre, et sans doute n’était-il pas le premier à dire que l’élévation factice du style y dégénérait en un jargon emphatique et obscur, d’une affectation poétique insupportable (De Demosthene 5-7). On voyait là autant d’indices d’inexpérience et, par conséquent, de « juvénilité » ; ce dernier caractère est celui que notent pareillement Diogène Laërce (ibid.) et Hermias. Ce dernier, dans le Préambule de son commentaire (9, 11-19) distingue trois points sur lesquels on fondait ce reproche : l’ambition de virtuosité qui, à un réquisitoire contre l’amour, fait joindre un plaidoyer en sa faveur ; la malignité chicanière que manifeste la critique du discours de Lysias ; le manque de goût, la boursouflure, l’emphase, l’abus du style poétique. Peut-être la réfutation de ces griefs par Hermias est-elle un peu trop inspirée de l’esprit étroitement conventionnel dont ils procèdent. Elle atteste du moins l’existence, dont l’auteur du Traité du Sublime porte aussi témoignage, d’un courant opposé, néoplatonicien sans nul doute, et où la considération des idées prévalait peut-être sur celle du style. Quoi qu’il en soit, le seul fait que la composition littéraire du Phèdre ait été critiquée dans l’Antiquité suffit à justifier l’effort qu’on a consacré à l’expliquer ainsi qu’à analyser le sentiment que nous éprouvons à le lire : celui d’être en face d’un art à la fois très savant et prodigieusement aisé, pleinement maître enfin de toutes ses ressources.
IV
LE DISCOURS DE LYSIAS ET LE PREMIER DISCOURS DE SOCRATE
I. Le discours de Lysias :
A. est-il authentique ?
Avant d’envisager la structure et le contenu du discours de Lysias[69], un problème singulièrement épineux s’impose à nous : ce discours est-il un pastiche de la main de Platon ? Ou bien celui-ci a-t-il inséré dans son Phèdre une authentique composition de Lysias ? Entre plusieurs témoignages anciens, tous postérieurs au début de notre ère et qui s’échelonnent du ier siècle à la fin du ve, la plupart n’ont pas plus de signification que notre propre expression « le discours de Lysias », où nous n’impliquons rien dans un sens ou dans l’autre[70]. Deux seulement sont précis et formels : celui de Diogène Laërce, III 25 (iiie siècle), et celui d’Hermias (deuxième moitié du ve). Dans le premier nous lisons que Platon a réfuté le discours de Lysias, « ce qu’aucun philosophe n’avait fait avant lui, après avoir transporté dans son Phèdre ce discours mot à mot (ἐκθέμενος αὐτὸν κατὰ λέξιν) ». Le second affirme comme une chose qu’ « on doit savoir », que ce discours est de Lysias lui-même et, de plus, que c’est dans le recueil des Lettres de Lysias un morceau réputé[71]. S’appuyant sur ces témoignages anciens, bon nombre de critiques modernes ont admis l’authenticité du morceau[72], que ce soit d’ailleurs une lettre ou bien ce que les Anglais nomment un « Essai ». Il y aurait, dit-on, de la part de Platon une inconcevable stupidité à critiquer, avec l’âpreté qu’il y met (234 d-236 a et surtout 262 d-264 e), le discours de Lysias si la pièce était de sa main à lui, au lieu d’être connue pour être de Lysias et admirée sous son nom par bien des gens. Puisqu’il se proposait de montrer quels sont les défauts de Lysias dans ses compositions de rhéteur, pourquoi en aurait-il fait un pastiche plutôt que de prendre justement l’une de ces compositions ? Pourquoi, d’autre part, aurait-il commencé ce pastiche comme la suite d’autre chose et l’aurait-il, à chaque nouvelle lecture, repris de la même façon, si ce n’était réellement un fragment détaché d’une pièce authentique ? Pourrait-on en outre y chercher (262 cd) un « exemple » de l’absence d’art chez un écrivain, si cet exemple avait été fabriqué en vue de la critique et pour la justifier par avance ? Au surplus, Platon a tout fait pour nous épargner cette méprise : Phèdre, nous dit-il, a entendu Lysias lire le morceau, il lui en a emprunté le texte, il en a sur lui l’original ; autant de traits qui sont évidemment destinés à nous apprendre que la pièce est en effet de Lysias. Enfin, on comprendrait fort mal que, à la fin du dialogue, le talent d’Isocrate fût comparé à celui de Lysias, si ce n’était pas vraiment le talent personnel de ce dernier qui était en cause au début. Ces raisons sont à la vérité proprement irréfutables, et l’on accordera sans difficulté que les arguments du parti adverse[73] n’ont rien de décisif. C’est en effet ne rien prouver du tout que, par exemple, de rappeler quels incomparables échantillons Platon a donnés ailleurs, et notamment dans le Protagoras et dans le Banquet, de son habileté dans l’art du pastiche ; de se demander par conséquent pourquoi il aurait, cette fois, renoncé à un procédé dans lequel il était passé maître. Raisonner de la sorte, c’est, dit-on, très justement, répondre à la question par la question, ce qui s’appelle une pétition de principe. Mais, répliquerait-on volontiers, n’est-ce pas commettre la même faute de logique, que de fonder la thèse de l’authenticité sur l’hypothèse des Lettres ? Il est fort à craindre en effet que ce ne soit justement sur la thèse que se fonde l’hypothèse : c’est parce qu’on croit le discours authentique et qu’il peut ressembler à une épître, qu’on ajoute foi à l’existence d’un recueil de Lettres de Lysias. Des témoignages aussi tardifs que ceux dont on fait état et d’une autorité aussi faible, ne témoigneraient-ils pas plutôt de la facilité avec laquelle l’érudition de ces temps s’enrichissait d’une fausse monnaie littéraire, que d’astucieux industriels étaient empressés à lui fournir, et plus particulièrement peut-être dans ce genre même de la Lettre ? Le discours de Lysias dans le Phèdre pouvant en faire figure, on a pu être tenté de fabriquer quatre autres semblables lettres à des adolescents, puis de grossir encore un recueil si bien commencé (cf. p. lx et n. 3). — C’est encore commettre une pétition de principe que d’appuyer[74] la thèse de l’authenticité sur l’hypothèse d’une manière différente de composer et d’écrire, que Lysias aurait adoptée, pense-t-on, à la fin de sa vie. Cette hypothèse n’a en effet d’autre raison que l’embarras, pareillement confessé par les deux partis, de retrouver dans le morceau en question la manière du Lysias que nous connaissons, sèche et grêle sans doute, habile aussi, mais sobre et naturelle, exempte de la préciosité et du désordre que nous voyons ici (cf. p. xviii sq.). Assurément, les adversaires de l’authenticité sont moins aventureux en supposant à ce propos que la composition de Platon n’est pas tant un pastiche de Lysias lui-même que de toute une école d’écrivains. La question reste, il est vrai, de savoir quelles raisons a eues Platon de choisir Lysias pour en faire le représentant nominal, et c’est une question à laquelle j’ai tenté de répondre (cf. p. xix sq.). De toute façon, si c’est une opposition de tendances qu’il avait en vue, il lui fallait un nom illustre à mettre en face de celui d’Isocrate, l’opposition de tendances étant d’ailleurs aussi facile à admettre qu’une opposition de personnes. Sur un terrain aussi mal connu, il est sage de ne pas avancer avec trop d’assurance. Ainsi, peut-on sérieusement prétendre que, parce que le morceau commence à la façon d’une continuation, Platon n’en saurait être l’auteur ? Il est tout au contraire permis de penser que Platon a voulu l’écrire sous cette forme, pour montrer d’une façon plus comique (264 a) à quel point, dans l’école qu’il a en vue, on dédaigne les exigences de la composition. — De même, c’est trop aisément se confier à une vue arbitraire des choses que de refuser à un auteur le droit de forger, pour en analyser ensuite les défauts, un morceau où il rassemblera tous ces défauts (264 e). N’est-ce pas, au contraire, le principe propre du pastiche, même lorsqu’il n’est suivi, ni d’un « corrigé » tel qu’est le premier discours de Socrate, ni d’une critique ? Ce n’est donc pas en niant le principe propre du pastiche qu’on prouvera que le discours de Lysias n’est pas un pastiche ! — Au surplus, ce n’est pas davantage parce qu’il en serait un, qu’il ne pourrait servir d’ « exemple ». Les deux discours de Socrate ne servent-ils pas pareillement d’exemples, et, pour cette raison, voudra-t-on prétendre qu’ils sont authentiquement de Socrate ? Au même titre que le discours de Lysias ou que les cinq premiers discours du Banquet, ils sont conçus et écrits par Platon en vue de l’ensemble dont ils font partie. Cet ensemble, dans le Phèdre, est fait, on l’a vu, d’une gradation de contrastes harmonisés : l’harmonie subsisterait-elle encore si l’un de ses éléments, le discours de Lysias, était extérieur à l’œuvre ? S’il n’était plus que l’occasion accidentelle du choix du thème de l’amour pour motif dominant, on enlèverait à ce thème son pouvoir vivant d’organisation, et au dialogue son unité intérieure originale (cf. p. xxviii sqq., p. lvii sqq.). — Enfin toutes les notations du prologue, où l’on croit trouver la preuve décisive que Lysias a réellement écrit et prononcé ce discours, semblent bien appartenir à un procédé littéraire qui doit produire cette illusion dramatique sans laquelle l’entretien manquerait de couleur et de vie : c’est ainsi que dans le Banquet tout est fait pour donner à croire qu’il s’agit du récit, dûment authentifié et vraiment historique, d’un banquet qui se serait réellement tenu dans la maison du poète Agathon (cf. mon édition, p. xix sq.).
En résumé, jusqu’à ce que les partisans de l’authenticité aient apporté des preuves qui ne soient pas au fond de simples opinions, on sera en droit, à ces opinions, d’en opposer d’autres qui du moins ne prétendent pas à être rien de plus, attendu que, dans l’état actuel de notre information, rien de plus ne semble permis et possible.
B. structure et contenu.
De ce qui vient d’être dit il résulte que le discours de Lysias, étant autre chose qu’un prétexte, ne peut être isolé de l’ensemble et que par conséquent il ne doit pas, ce qui arrive souvent, être sacrifié dans l’étude de cet ensemble. — Ce qu’on y remarque à première vue, c’est qu’il est une mosaïque ; que chaque fragment y est soigneusement travaillé pour lui-même ; que l’assemblage de ces fragments, loin d’être dissimulé, est au contraire nettement marqué par deux particules de liaison, dont l’une signifie un changement d’aspect dans un même motif et l’autre, le passage à un motif nouveau. Le « métier » y est donc à peu près celui que décrit Platon vers la fin du dialogue (278 de), quand il parle de ces gens qui consument leur existence à tourner et retourner leurs phrases, à coller entre eux des morceaux ou à les rogner. Aussi n’y a-t-il dans l’œuvre nulle vie intérieure, par assimilation et croissance organiques ; le développement se fait au petit bonheur, sans progrès réel de la pensée mais d’une façon purement mécanique et par le seul jeu des antithèses. Le sujet même n’intéresse pas : c’est assez qu’il provoque l’étonnement et pique la curiosité (cf. 227 cd). Enfin, c’est l’œuvre d’un ouvrier en mots : il les a tous bien polis, bien tournés ; sa langue est précise et sans bavures (cf. p. 8, n. 2 et p. 13, n. 1).
Il y a donc lieu d’étudier d’assez près la contexture rhétorique du morceau. Il paraît être divisé en quatre parties, plus une conclusion. La première, qu’on pourrait intituler « Amant et aimé », est précédée d’une introduction : « Tu le sais déjà : je te voudrais à moi. Mais ce n’est pas sous l’empire de la passion. Autrement, je ne proportionnerais pas à ma fortune mes dépenses en ta faveur ; ce qui prouve de ma part l’espoir de n’avoir pas plus tard à regretter mes bienfaits ». — 1o (231 a vers la fin) Variation sur l’aimé : à la dépense s’ajoutent la peine prise et les ennuis de famille ; tandis que l’amant passionné s’en fait un mérite qui le dispense de gratitude envers l’aimé, celui-ci n’hésitera pas à complaire à un amant sans amour de qui il n’a pas cela à craindre. — 2o (c déb.) Nouvelle variation, et cette fois sur l’amant : le passionné se dit prêt, pour l’aimé, à braver toutes les haines ; mais sa passion, inconstante, lui fera plus tard haïr celui que jadis il aimait. — 3o (c fin) Reprise, du point de vue de l’aimé : raisonnablement, il ne doit pas céder au caprice d’une folie passagère qui, dans l’avenir, se reniera elle-même. — 4o (d mil.) Complément : et, s’il s’agit pour lui, entre des amoureux, de choisir le plus amoureux[75], le domaine de son choix est évidemment limité ; illimité au contraire, si c’est entre les non-amoureux qu’il veut élire le plus utile.
La deuxième partie traite la question au point de vue social. 1o Si l’aimé redoute les critiques de l’opinion, il a tout à craindre de l’indiscrétion d’un amant passionné et de sa fatuité, tandis qu’un amant qui a de l’empire sur soi préfère à la vanité de se faire valoir l’avantage d’en venir à ses fins. — 2o (232 a mil.) Variation : de toute manière, les assiduités du passionné compromettent son aimé, car celui-ci est soupçonné dès qu’on les voit ensemble ; mais, si l’amant est sans passion, on ne pense qu’à l’amitié ou à d’autres motifs pareillement innocents. — 3o (b mil.) Nouvelle variation, qui précise ce thème de l’amitié (cf. p. 10, n. 1) : l’amitié certes est un lien sujet à se rompre ; mais, tandis qu’avec n’importe quelle autre cause, le dommage est égal des deux côtés, c’est au contraire pour l’aimé qu’il est le plus grand s’il a déjà cédé à la passion d’un amoureux. La jalousie de celui-ci aura en effet écarté de l’aimé tous ceux dont il redoute l’influence ; bien plus elle le force à les éloigner lui-même ; autour de lui elle ruine enfin toute amitié. Inversement, l’amant sans passion la favorise : s’il pense en effet devoir seulement à son mérite le succès de ses vœux, c’est que ce mérite aura été reconnu de l’aimé ; en refusant son amitié à ce dernier, on déprécie par là même la consécration que son mérite a reçue, tandis qu’on la confirme dans le cas contraire ; ainsi, plus l’aimé aura d’amis, plus lui-même il s’estimera flatté[76].
Dans une troisième partie on se place au point de vue moral. 1o (232 e) Constance de l’amant sans amour : le passionné ne songe qu’au corps, de sorte que son amitié mourra avec son désir ; l’autre au contraire a commencé par une amitié dont le motif est la valeur morale et sociale de l’ami ; si donc à celles-ci s’ajoutent des satisfactions sensuelles, ces dernières ne font courir à l’amitié aucun risque. — 2o (233 a, mil.) Amélioration morale de l’aimé (cf. p. 11, n. 1) : par ses flatteries, par son manque de jugement et d’équilibre, l’amant passionné est un corrupteur ; l’autre au contraire, puisqu’il se domine lui-même au lieu d’être dominé par l’amour, reste toujours de sang-froid, et son indulgence est en même temps de bon conseil : nouveaux gages d’une amitié durable[77]. — 3o (233 b s. fin.) Réponse à une objection possible[78] : si la passion amoureuse devait être le principe de tout attachement, la force et la valeur morale des liens de la parenté ne se comprendraient plus.
L’objet de la quatrième partie est d’examiner les caractères de la requête, selon qu’elle vient d’un amant sans passion ou au contraire, passionné. — 1o (233 d mil.) Le besoin à la base de la requête : dans ce cas on devra se dire en effet que, plus est grand le besoin qui fait l’objet de la requête, plus sera grande aussi la gratitude à espérer de celui qu’on aura satisfait ; de sorte que c’est le besoin, non le mérite, qui décidera. — 2o (d fin) Variations ironiques sur le même thème : tandis que la passion d’amour est comparable à la voracité du mendiant ou du parasite, l’amour sans passion est une garantie de mérite, de reconnaissance, de discrétion, de loyauté. — 3o (234 b déb.) Conseil final : puisque favoriser une requête dont tels sont les caractères, bien loin de nuire aux intérêts de l’aimé, les sert au contraire, celui-ci n’a pas à craindre les récriminations de ses proches.
On peut maintenant conclure (b mil.) : la thèse exposée ne signifie pas qu’entre les non-amoureux ce soit au hasard qu’on doive choisir (cf. 231 d, dernière section de la première partie), autrement dit ne pas choisir du tout. Choisir est au contraire un gage de gratitude et de discrétion. Si pourtant je n’en ai pas dit assez pour te convaincre de me choisir, moi qui te parle, je suis prêt à répondre à tes questions[79].
En résumé, ce discours est écrit, on le voit, en style périodique (cf. Banquet Notice, p. xl). Les périodes y sont au nombre de quatre, dont chacune comprend un exorde et une conclusion. Sauf la première qui est de quatre membres (côla), toutes les autres en ont trois : soit en tout, avec l’introduction et l’épilogue, quinze membres, dont treize constituent le corps même du développement et quant au rythme desquels il est difficile de saisir aucune relation.
II. Le premier discours de Socrate.
On a vu comment et dans quelles conditions Socrate a accepté de parler à son tour sur le thème traité par Lysias (p. xxx sqq.). Ce thème, à la vérité, il le change subrepticement : ce n’est en effet, dit-il, qu’une fiction, un faux-semblant ; l’amant en question est réellement amoureux, mais il veut faire croire qu’il ne l’est pas (287 ab). Quant au discours même, il est divisé clairement en deux parties : l’une concerne la nature de l’amour et l’autre, ses effets (237 c fin ; cf. p. 18, n. 3). Elles sont séparées par une pause dont j’ai essayé de déterminer la signification (p. xxxii sq.)
Première partie.
La première partie, à son tour, se divise très nettement en deux. Socrate commence (237 b fin-d) par établir un principe général sans lequel nulle question ne peut être utilement débattue : il faut savoir de quoi l’on débat, s’accorder sur une définition de cet objet ; faute de quoi, ni les interlocuteurs ne peuvent s’entendre entre eux, ni chacun ne peut s’entendre avec soi-même, puisqu’on ne sait au juste de quoi on parle. Or le présent débat porte sur les mérites respectifs de l’amant féru d’amour et de l’amant sans amour. A-t-on donc eu soin de définir l’essence (ousia) de l’amour ? Nullement. Et pourtant, si l’on ignore cette essence, on ne pourra y rapporter ce qu’on voudra dire sur les effets, tels qu’ils découlent de l’essence (cf. 238 d fin). — Ce principe général posé, Socrate va maintenant l’appliquer (237 d-238 c). L’amour est évidemment un désir. Mais est-ce assez dire ? De quiconque désire ce qui est beau, dit-on qu’il est un « amoureux » ? Il faut donc savoir quelque chose de plus pour être à même de saisir, à propos des deux sortes d’hommes sur qui porte notre comparaison, quelle différence il y a entre les deux déterminations en jeu : « aimer » et « ne pas aimer ». Mais voici que, d’un autre côté, une remarque se présente à l’esprit : en nous tous, deux façons de voir se distinguent qui gouvernent notre conduite, et, corrélativement, deux tendances de notre activité. L’une, qui est instinctive et étrangère à la raison, est le désir du plaisir, lequel est jugé être le bien. L’autre, qui est une acquisition de la réflexion raisonnante et raisonnable, est le désir du meilleur. Parfois elles sont concordantes, parfois discordantes, et alors c’est tantôt l’une qui domine, tantôt c’est l’autre : tantôt nous gardons la mesure, tantôt nous la dépassons, nous sommes tempérants ou intempérants[80]. Or l’absence de mesure a justement, dans la langue, une pluralité de dénominations, grâce à laquelle nous pouvons aisément y distinguer une pluralité de formes ; car c’est la prédominance de telle de ces formes en un caractère qui lui vaut le nom dont on le qualifie. Ainsi, nous ferons une classification où nous ayons chance de découvrir, entre toutes les espèces du désir, celle qui comporte particulièrement l’emploi de ces deux expressions : « être amoureux », « ne pas l’être » ; c’est là en effet ce que nous cherchons (cf. 238 b 8). Gloutonnerie, ivrognerie sont données comme exemples de ces formes obsédantes et passionnées du désir, qui sont décelées par le nom qu’on donne au type d’homme où elles prédominent. Or, on appelle « amoureux » celui en qui est prédominante, par rapport à l’aspiration raisonnée et raisonnable vers le meilleur, une impulsion non raisonnée et déraisonnable vers la beauté, désir irrésistible parce qu’il se renforce d’autres désirs du même groupe qui tendent spécialement à la beauté du corps, et c’est ce désir qu’on nomme spécialement « amour ».
Cette première partie vaut qu’on s’y arrête. Elle évoque invinciblement tout d’abord le souvenir du Banquet (cf. p. 19, n. 1). L’amour, y était-il dit, est amour de quelque chose ; ce quelque chose, il le désire ; c’est ce qui est beau, et si l’on dit « bon » au lieu de « beau », on voit tout de suite que c’est en vue d’être heureux par la possession de ce que l’on convoite ; si d’autre part on dit de certains hommes qu’ils aiment et que de certains autres on ne le dise pas, la raison en est qu’une espèce, l’amour au sens étroit, est désignée par un nom qui est celui du genre tout entier. Entre cette analyse et celle du Phèdre il y a toutefois de notables différences. L’analyse du Banquet est à la fois plus précise et plus nourrie ; elle se poursuit avec une magnifique ampleur dans le discours de Diotime. Par contre, deux traits qui sont totalement absents du Banquet s’imposent ici à l’attention : d’une part, le contraste de la modération et de la démesure ; de l’autre, l’idée de chercher dans les dénominations que le langage applique aux variétés de la démesure, un moyen de spécifier et de définir cet amour-passion dont parlait le discours de Lysias. Or c’est précisément parce qu’il s’agit d’un amour-passion que l’analyse devait être prise de ce biais. Mais d’un autre côté, puisqu’il est une démesure, cela nous donne à penser par avance qu’il y en a un autre dans le plan de la mesure, qui est une aspiration vers le meilleur et qui obéit à la rectitude : première anticipation du deuxième discours. — De plus, ce contraste entre la poussée irréfléchie des tendances instinctives et les inhibitions réfléchies de la raison n’a plus du tout la même signification que chez Lysias ; pour celui-ci en effet le premier terme signifiait avant tout imprudence et inconstance, le second, aptitude à bien calculer des intérêts matériels dans le présent et en vue de l’avenir. Au contraire, tel qu’il se présente maintenant, le contraste fait penser à la célèbre analyse du livre IV de la République (430 b-440 d), où Platon distingue les désirs, tels que l’amour ou la faim et la soif, qui mènent impérieusement à leur objet ce qu’il y a en nous de bestial, et la réflexion raisonnante qui toujours s’y oppose bien qu’avec des fortunes diverses. L’analogie de ces deux analyses suggère, une fois de plus, qu’à l’arrière-plan de celle du Phèdre il y a dès maintenant l’idée que développera le deuxième discours. Il existe dans l’âme deux forces diamétralement opposées, l’une de gouvernement et d’ordre, l’autre d’anarchie et de désordre ; s’il arrive cependant que, après avoir cédé à la seconde, on en ait du remords et qu’on veuille dans l’avenir prêter main-forte à la première, cela ne signifie-t-il pas l’existence d’une force moyenne, qui aidera la première à maîtriser la seconde ? Voilà ce que dit la République, et c’est ce que, dans le deuxième discours, montrera le mythe de l’attelage ailé. Ce passage du premier discours est donc comme un germe caché dans un sol ingrat, promis cependant pour plus tard à une brillante éclosion.
Seconde partie.
La seconde partie a pour objet, on l’a vu, les effets de l’amour : a-t-il chance d’être avantageux à l’aimé ou, au contraire, de lui être nuisible (238 d-241 e) ? Puisque la fiction, bien que démasquée, y reste conforme au thème de Lysias, les effets de l’amour n’y peuvent être envisagés que d’un point de vue unilatéral, par rapport à l’aimé ou l’objet de l’amour, non par rapport à l’amant, autrement dit le sujet : point de vue qui sera explicitement rejeté par le deuxième discours (249 e ; cf. 245 b). D’un autre côté, comme la première partie traitait un point que Lysias avait négligé, c’est au contraire dans celle-ci que nous devons nous attendre à voir reprises et corrigées les raisons que Lysias avait alléguées[81]. — Comme la première, cette seconde partie du discours de Socrate se laisse assez aisément subdiviser en deux sections. La première, que précède une sorte de plan, est consacrée à montrer quels dommages cause à un aimé l’amoureux passionné. Socrate a commencé par montrer (238 e 3-239 a 5) que l’homme gouverné par la passion et qui est l’esclave du plaisir est un malade, se félicitant par suite de tout ce qui est dans le sens de sa folie, s’irritant de tout ce qui peut la contrarier ou la maîtriser. D’autre part ce qu’il cherche dans un aimé, c’est son plus grand plaisir : il ne faut donc pas que cet aimé soit son égal, encore moins qu’il puisse lui tenir tête ; par conséquent il le voudra aussi bas que possible pour l’instruction, pour le courage, pour l’habileté à parler, pour la vivacité de l’esprit, etc. Ces divers points sont groupés sous trois rubriques, qui correspondent à la division commune des biens de l’âme, de ceux du corps et des biens extérieurs. S’agit-il d’abaisser l’intelligence de l’aimé (239 a 5-c 2) ? Il s’attachera, par sa direction comme par sa société, à cultiver en lui la sottise naturelle et même à l’accroître, tandis que d’autre part il l’écartera jalousement de toutes les sociétés dans lesquelles il pourrait au contraire se développer et se mûrir, et notamment il l’éloignera de la philosophie : bon moyen pour que de l’amant il soit la chose et le jouet[82]. S’agit-il maintenant du corps (239 c 3-d 7) ? Il le voudra d’une complexion molle et sans vigueur, étranger dans le passé à une culture physique un peu sévère, déjà habitué au régime d’une vie efféminée, artificiellement embelli par les fards et les parures : ainsi, sans courage à la guerre[83]. S’agit-il enfin de la situation sociale de l’aimé (239 d 8-240 a 9) ? Par sa direction comme par sa société, l’amoureux n’est pas à cet égard moins malfaisant. Tous ceux qui, autour de celui qu’il aime, veulent à celui-ci le plus de bien, il en souhaite la disparition comme d’autant de gêneurs, particulièrement celle de ses proches. Afin d’être plus à l’aise pour le conquérir et pour le manier ensuite à sa guise, il le voudrait pauvre ou ruiné. Comme il n’accepte point de partage, il le détournera enfin le plus longtemps qu’il pourra de se marier et de fonder une famille.
La deuxième section concerne, non plus le dommage causé par l’amoureux à l’aimé, mais les sentiments de ce dernier, d’abord tant qu’en effet il est aimé, puis quand il a cessé de l’être. D’une part en effet (240 a 10-e 7), tant que dure sa passion l’amant passionné, bien différent en cela de ces autres plaies sociales que sont la courtisane ou le flatteur, est, sans compensation, insupportable pour sa jeune victime : il ne lui est pas assorti par l’âge et il prétend être, toujours et tout entier, à son service[84] ; mais c’est pour l’avoir plus complètement à lui, pour le soumettre à la tyrannie de sa présence ou de ses espionnages, pour l’assaillir tantôt de compliments outrés, tantôt d’injustes récriminations et, quand il aura bu, de grossiers outrages. Puis (240 e 8-241 c 6), quand s’est éteinte sa passion, il devient alors traître à ses engagements ; en revenant à la raison, il a en effet brisé tout lien avec son passé de folie[85]. Mais aussi, pourquoi l’aimé a-t-il été assez imprudent pour s’abandonner à un fou, duquel il ne pouvait attendre que dommage et désagrément ? — La conclusion (241 c 7-d 1), c’est que l’amitié d’un amoureux est une fausse amitié ; car, le désir se portant exclusivement à ce qui doit le satisfaire, c’est une amitié sans réciprocité.
Ce discours, on l’a déjà dit (p. xxx sq.), est un redressement de celui de Lysias. Mais il n’en redresse que la forme ; lui-même il aura besoin d’être redressé quant au fond, et ce sera la « palinodie » du philosophe. On pourrait donc dire que nous avons ici une première « palinodie », mais elle est, dirait-on, celle de la pure rhétorique. Le progrès de forme qu’elle manifeste n’est pas douteux : en dépit de développements qui sont surtout des amplifications, on y trouve une construction méthodique à la place de l’aventureux assemblage de fragments qui constituait toute la composition de Lysias. Si nous envisageons maintenant l’objet même du débat, le rapport des deux discours est à cet égard particulièrement instructif. L’observation finale de Socrate, avec ce qui la précède, dégage nettement ce qu’il y a de commun dans le point de vue : un amour, qui n’est pas un élan de l’âme par delà l’objet immédiat du désir, ne peut être que la convoitise d’une chose ; si l’objet de l’amour n’en est pas en même temps un sujet, si l’aimé n’est pas, pour autant, lui-même un amant, l’amant de celui qui l’aime, on a le droit de condamner l’amour. Voilà ce que fait Socrate, et l’on n’aurait peut-être pas tort de dire[86] que le contenu de son premier discours, au lieu d’être positif comme de celui de Lysias, est négatif. Lysias en effet prononçait surtout l’éloge de l’absence d’amour ; Socrate nie la valeur de l’amour tel que le comprenait le rhéteur, il se refuse (241 de) à faire à sa suite un éloge positif de l’homme qui n’aime pas. Quant à voir dans ce réquisitoire contre l’amour, soit une parodie des thèses cyniques, soit un exposé des idées mêmes du Socrate historique[87], ce sont là des hypothèses auxquelles je ne veux pas m’aventurer et qu’il est aussi impossible de prouver que de réfuter. S’il y a dans le Phèdre, comme j’ai essayé de le montrer, l’harmonie d’une œuvre d’art, la façon dont cette harmonie découle de l’idée première est plus importante que la recherche conjecturale de prétendues sources, aussi bien d’ailleurs en ce qui concerne ce premier discours de Socrate qu’en ce qui concernait celui de Lysias.
V
LE SECOND DISCOURS DE SOCRATE
Notre premier soin doit être d’examiner la composition et le contenu du deuxième discours de Socrate. Ensuite il y aura lieu de considérer trois questions, à des titres divers pareillement importantes, qui se posent à son sujet : l’emploi qui y est fait du mythe ; la doctrine de l’âme qui y est exposée ; enfin sa conception de l’amour.
I. Structure et contenu du deuxième discours. — L’erreur du premier discours de Socrate était de dénier toute valeur à l’amour passionné sous prétexte que c’est un délire : folie nuisible à l’intérêt de l’aimé, avait déjà dit Lysias, et qui doit lui faire préférer, pour ses mérites, cet amant qui soi-disant n’est pas amoureux. Ce qui va être dit maintenant est bien une rétractation : à la place de l’éloge d’un amant sans passion, que Socrate s’est refusé à prononcer, nous allons entendre un éloge de l’exaltation dans l’amour. Ainsi la rétractation apparaît à la fois comme un changement de point de vue et comme une progression à un point de vue supérieur. Une fois établi de la sorte l’objet du second discours, il est dans l’ordre que soit justifiée tout d’abord l’intention même de cet « éloge de la folie ».
Le délire et ses formes.
1. C’est ce que va faire Platon (244 a 6 sqq.) en exposant trois raisons desquelles il résulte que, loin d’être toujours un mal, le délire est au contraire, sous trois formes bien connues, un grand bien pour les hommes, donc un don des dieux ; ce qui permettra de penser (cf. 245 b sq.) que, si l’amour est lui-même une quatrième forme du délire, l’amour doit être pareillement un privilège que nous accorde la divinité. — La première preuve est double. On allègue d’abord ce fait qu’il y a des prophétesses, femmes d’un esprit plus qu’ordinaire quand elles sont dans leur bon sens, capables au contraire de lire dans l’avenir quand elles sont inspirées du dieu dont elles sont les prêtresses[88]. Le langage d’autre part témoigne dans le même sens. Si en effet, par delà les dénaturations qu’il a subies, on remonte jusqu’aux mots primitifs, on voit que les Anciens liaient au délire la vision immédiate du devin[89], à la réflexion mettant en œuvre certaines connaissances la divination médiate de l’augure, en tant qu’elle se fonde sur des signes : preuve que leur sagesse faisait du délire plus de cas que du raisonnement. — La seconde forme du délire est encore religieuse. On lui doit la découverte de ces initiations, de ces rites purificateurs, de ces prières dont l’effet est, pour l’homme qui a fait ou connu cette découverte, de se racheter de la peine collective qui pèse sur toute sa race, en punition de quelque faute ancienne commise par un individu de cette race : rédemption qui s’étend à l’avenir, soit par rapport à la destinée ultérieure de la race, soit par rapport à celle de l’individu après la mort, comme dans l’Orphisme. — L’inspiration poétique constitue une troisième espèce du délire. Sans inspiration, c’est-à-dire sans enthousiasme ou possession divine, point de poésie ; l’habileté technique ne suffit pas. Encore faut-il pourtant que l’âme inspirée soit elle-même pure pour que l’inspiration puisse vraiment être considérée comme venue d’en haut[90] — Voilà donc de quels grands effets le délire est capable. Puisque l’amour est un délire, pourquoi ne serait-il pas une autre forme de l’inspiration divine ? Les trois premières constituaient un bienfait autant pour celui qui reçoit le don divin que pour celui qui ensuite en bénéficie. Si donc le délire d’amour est à son tour un bien, il le sera tout autant pour l’aimé que pour l’amant, pour celui qui est l’objet de l’enthousiasme amoureux que pour celui qui en est le sujet : c’est ce qui avait été méconnu par la doctrine de Lysias et par celle du premier discours (cf. p. lxxiii).
La nature de l’âme.
2. Mais ce point ne peut être compris qu’à la condition de savoir ce qu’est la nature de l’âme, quelles sont ses affections et ses actions, et cela à propos de l’âme divine aussi bien que de l’âme humaine.
Son immortalité.
A. — Le point de départ de cette recherche sera une démonstration de l’immortalité de l’âme. Elle se fait en quatre moments. — a. Platon commence (245 c 6 sqq.) par distinguer, entre les choses mues et qui existent en tant qu’elles sont mues, d’une part celles qui se meuvent elles-mêmes et, de l’autre, celles qui tiennent leur mouvement d’une autre chose et le communiquent à une autre. Ces dernières cesseront d’exister dès qu’elles cesseront d’être mues, tandis que les premières ne peuvent cesser d’exister puisque leur essence est précisément d’être mues par elles-mêmes et qu’elles ne peuvent perdre leur essence. En outre, c’est d’elles seulement que les autres peuvent recevoir leur mouvement et leur existence pendant qu’elles sont mues et qu’elles existent[91]. La chose qui se meut elle-même ne peut donc périr et elle est un principe. — b. Or un principe (245 c 10 sqq.) est ce qui ne commence pas d’exister, mais à partir de quoi commence d’exister tout ce qui existe. Il serait en effet contradictoire avec la notion même de « Principe » que ce qui est principe pût être quelque chose d’engendré, c’est-à-dire de dérivé ; et d’autre part il n’y aurait plus d’existence, car rien ne pourrait plus commencer d’exister[92]. La chose qui se meut soi-même est donc inengendrée en tant qu’elle est principe. — c. À ce même titre elle se révèle encore (245 d 3 sqq.) comme incorruptible[93]. Il serait en effet contradictoire qu’un principe, une fois anéanti, pût renaître, car ce serait à partir d’autre chose, de sorte qu’il ne serait plus un principe ; contradictoire aussi, pour cette même raison, que rien désormais pût en provenir. — d. Puisque ce qui se meut soi-même est principe et que, à ce titre, il ne peut ni avoir commencé ni cesser d’exister, nous dirons (245 d 7 sqq.) qu’en cela consiste l’essence et la notion[94] de l’âme en tant que distincte du corps. Car un corps, s’il est inanimé, reçoit du dehors son mouvement, mais, s’il est animé, d’un principe interne de mouvement qui est justement son âme. Donc, en raison de l’identité de la chose automotrice avec la réalité qu’on appelle une âme, on doit dire que l’âme est inengendrée et immortelle[95].
Image mythique de la nature de l’âme.
B. — L’immortalité de l’âme étant ainsi démontrée, voyons à présent quelle est la nature de cette chose immortelle (246 a 3 sqq.). Pour la dire telle qu’elle est, un savoir divin serait nécessaire ; mais un savoir humain permet d’en donner une image, c’est-à-dire de montrer à quoi elle ressemble. Autrement dit, quelle est la chose qui, dans le domaine de notre expérience, pourra par ses rapports constitutifs servir à figurer la nature de l’âme et être considérée comme lui étant analogue ? Or, représenter ainsi une réalité, dont on n’a pas d’expérience directe, au moyen de l’image sensible d’une réalité familière, c’est l’essentiel du mythe. La nature de l’âme sera donc exposée d’une façon mythique. Platon commence par dessiner l’image, puis il explique pourquoi dans cette image il y a, si l’on peut dire, des parties lumineuses et d’autres obscures.
a. Nous imaginerons donc l’âme (246 a 6 sqq.) à la ressemblance d’une force active dont la nature soit d’être un attelage ailé que mène sur son char un cocher, ailé lui aussi[96]. Mais, tandis que dans la représentation de l’âme des dieux l’ensemble doit être tenu pour excellent dans ses parties comme dans les éléments de ces parties, il n’en peut être ainsi quand on veut se représenter une âme d’homme. En premier lieu, l’attelage y couple des chevaux qui ne sont point pareils[97]. En second lieu, tandis qu’un des chevaux ainsi appariés est fait de bons éléments, l’autre sera tout l’opposé. Enfin, dans de telles conditions, la fonction même de cocher s’exercera avec un succès incertain. Ainsi ce qui caractérise la chose à laquelle une âme humaine est comparable, c’est un mélange du mauvais avec le bon[98]. — b. Étant donné que l’âme est un principe de vie qui est commun aux hommes et aux dieux, pourquoi cependant (246 b 5 sqq.) à propos des premiers parle-t-on de vie mortelle, de vie immortelle à propos des seconds ? Tout ce qui a nature d’âme[99] est en effet principe de vie à l’égard d’une chose qui, au contraire, est par elle-même sans âme ou inanimée, c’est-à-dire un corps. Mais dans la totalité de l’univers physique[100] cette relation n’est pas la même partout où porte la vie l’âme qui y circule. On est ainsi conduit à distinguer deux formes ou espèces d’âme : celle qui est ailée en perfection et qui se meut dans les régions supérieures de l’univers, du haut desquelles elle est pour l’ensemble de celui-ci le principe d’une vie organisée ; celle qui, pour les raisons qu’on verra bientôt, a cessé d’être ailée et qui ainsi tombe jusqu’à ce qu’elle se soit arrêtée dans cette masse, solidement assemblée (cf. Timée 43 a), qu’est un corps fait principalement de terre. Or c’est à un tel composé d’une âme et d’un corps que nous donnons le nom de « vivant » en y ajoutant l’épithète de « mortel »[101]. Quant au dieu, s’il est vrai que ni l’expérience ni le raisonnement ne permettent de savoir ce qu’il est réellement, du moins pouvons-nous le concevoir pareillement comme un vivant[102] : autrement dit, son âme est principe de vie à l’égard d’un corps ; mais, ce corps n’étant pas un corps dans lequel elle aurait chu faute d’avoir su garder ses ailes, un tel assemblage d’âme et de corps doit, dans le cas du dieu[103], durer sans fin.
La vie céleste des âmes et le lieu au delà du ciel.
C. — Ce qu’il faut expliquer à présent (246 d 3 sqq.), c’est la cause par laquelle l’âme, puisque son attelage est ailé comme l’est aussi son cocher, peut cependant perdre ce qui est une propriété de sa nature. Platon commence donc par exposer (d 6 sqq.) en quoi consiste la fonction propre de l’aile : c’est d’élever vers le haut ce qui est naturellement pesant, d’être ainsi, étant admis que le divin est au-dessus de nous, ce qu’il y a de plus divin parmi les choses corporelles. Mais Platon a hâte de marquer le symbolisme de ce langage : ce qui réside dans ces hauteurs vers lesquelles fait monter l’aile, c’est ce qui est beau, savant et bon[104]. Voilà donc ce qui, étant l’objet auquel tendent les ailes comme à ce qui les nourrit (cf. 246 e), donne à celles-ci leur vertu propre. Inversement, cette vertu est détruite par ce qui est le contraire du beau, du savant et du bon. — Ceci dit, on va voir quels sont les effets de cette vertu, d’abord en ce qui concerne le ciel lui-même ou le monde, puis en ce qui concerne un autre monde qui est par delà le ciel, et, dans chaque cas, pour les âmes qui sont divines comme pour celles qui ne le sont pas.
a. Platon décrit donc (246 e sqq.) une sorte de procession que des âmes de dieux et de démons accomplissent dans le ciel, chacune avec le cortège d’âmes en tête duquel elle s’avance. Celui qui conduit la procession entière, c’est Zeus ; il l’ordonne dans son détail et il pourvoit à tout. Quoiqu’il y ait douze dieux et démons, l’armée entière comprend seulement onze bataillons, parce qu’Hestia n’en fait point partie et que, immobile, elle reste au foyer du palais des dieux[105]. Chaque groupe enfin a son rang et son rôle propres. Si maintenant nous considérons la part que prennent les âmes à cette procession, nous voyons qu’elle est différente selon la constitution de ces âmes. Pour les âmes des dieux, point de difficulté : elles montent allègrement, car la tâche du cocher est facile avec un attelage de tout point excellent, elles montent vers ces objets supérieurs qui, comme on l’a vu, sont l’aliment de leurs ailes. Mais il y a pour les suivre d’autres âmes qui sont divines en leur genre et qui ont faim de cette suprême nourriture. Sans doute leur attelage n’est-il pas excellent ; il est toutefois excellemment apparié ou excellemment dressé et dirigé. Elles suivent donc les dieux, c’est-à-dire qu’en les imitant elles leur ressemblent, aussi souvent qu’elles n’en sont point empêchées par quelque cause, étrangère en tout cas à la volonté des dieux[106], et aussi souvent qu’elles en ont la bonne volonté. De telles âmes doivent donc parvenir, avec les âmes des dieux, jusqu’aux confins du ciel ou du monde et, dressées alors sur la voûte, emportées par la révolution circulaire, elles contemplent les réalités qui sont en dehors du ciel ou du monde. Ce sont là pourtant des âmes privilégiées : la plupart sont au contraire incapables d’étendre ainsi leur horizon parce qu’au bon leur attelage mêle trop de mauvais et parce que leur cocher, faute d’avoir su corriger et dresser le mauvais, sent peser sur sa main le poids d’une résistance.
b. Voici donc les meilleures âmes portées par la bonté même de leurs aspirations au seuil d’un autre monde, extérieur à l’univers physique. Qu’on dise tant qu’on voudra que nous sommes ici en plein mythe. Il n’en est pas moins vrai, si le mythe a un sens, que cette extériorité spatiale marque, avec une clarté qu’on ne rencontre nulle part au même degré, l’intention chez Platon de considérer les réalités intelligibles comme étant tout à fait à part de celles de l’expérience, ou, selon la formule d’Aristote, de séparer les Idées. Jusqu’à présent nous étions au sein d’un monde enveloppé dans la sphère du ciel. Nous voici maintenant (247 c 3), par delà le ciel, en face d’un autre monde qui est celui de la Vérité (cf. 248 b 7). À vrai dire, les âmes des dieux ne sont pas plus capables que les meilleures des autres âmes de quitter le ciel pour passer dans cet autre monde. C’est au premier qu’elles appartiennent. Mais, quand elles sont parvenues au sommet de celui-ci et comme installées sur sa convexité, leur cocher est en état de porter ses regards dans la direction des réalités véritables, qui sont des objets pour l’intellect seul et sur lesquelles, puisqu’elles sont sans couleur et sans figure, les sens n’ont point de prise : la Justice réelle, la Tempérance réelle, le Savoir réel et qui, au lieu de s’appliquer à des apparences dont la diversité se déploie dans un devenir changeant, est une connaissance vraie de vraies réalités, la Pensée pure de tout alliage sensible, la Beauté dans toute sa splendeur, etc. (cf. 250 b-d). De plus, cette contemplation n’est pas offerte aux âmes divines d’une façon indifférente, mais pour le temps précis que doit durer la révolution qui ramènera le ciel au même point[107]. Au terme de cette révolution, le cocher, intellect, s’enfonce de nouveau dans ce ciel qui est la demeure ordinaire de son âme. C’est alors qu’il donne à ses chevaux une nourriture et une boisson choisies, dont les noms prouvent assez que, dans l’esprit de Platon, elles sont le produit de cette contemplation supérieure et la quintessence de ce qui est propre à entretenir la vertu des ailes (247 e fin ; cf. 248 c déb.) ou à satisfaire l’aspiration qui porte l’âme naturellement vers les hauteurs (cf. 248 a 7). — Or cette aspiration, les autres âmes s’efforcent bien de la contenter, mais sans succès : leurs conducteurs ne réussissent même pas à élever la tête d’une façon continue vers les réalités du lieu supracéleste. Ce sont tout au moins des âmes incapables de soutenir quelque temps l’effort de la contemplation et dont la vision restera incomplète. Comme elles sont pourtant avides de s’élever et qu’elles pensent n’y pouvoir réussir qu’au prix d’une concurrence pressée, elles se bousculent et se piétinent (cf. 247 b 5). Mais le résultat, c’est qu’ainsi elles gâtent leurs ailes et que, faute d’être capables de se soutenir sur la voûte du ciel, elles sont contraintes d’y rentrer avant le terme fixé de la révolution circulaire. C’est un accident auquel, semble-t-il, n’échapperont pas les âmes les mieux trempées. Toujours est-il qu’elles tombent alors brutalement et que leur chute ne s’arrête qu’à la terre (cf. 246 c et 248 c fin). Désormais ce sera l’opinion, avec les incertitudes au milieu desquelles elle roule et se traîne, ce ne sera plus le savoir, qui sera leur pâture.
La destinée des âmes déchues : une double eschatologie.
D. — Voilà donc deux sortes d’âmes déchues : les unes ont eu quelque part à la contemplation des réalités vraies, les autres en ont été privées. La question se pose alors (248 c 3 sqq.) de savoir quelle sera inévitablement leur destinée (cf. p. 40, n. 2) en conséquence de l’état où elles seront au terme de la procession : pour les unes, initiation incomplète et révélation ou « époptie » seulement partielle (cf. p. 44, n. 1) ; pour les autres, absence totale de l’une et de l’autre[108]. Mais il y a un autre terme : c’est celui des existences terrestres consécutives à la chute. Nous avons donc ici une double eschatologie, qui n’a chez Platon d’autre analogue que celle du Timée (41 d-42 d, 90 a-c, 91 d-92 c) : il y a une destinée qui dépend de l’antérieur à la vie terrestre et il y en a une autre qui est la conséquence de cette vie même. Ajoutons cependant que, tandis que dans le Timée il s’agit d’un règlement général institué par Dieu, avant « la première naissance », pour les âmes qui indirectement sortiront de ses mains, le Phèdre envisage les conséquences de la conduite préempirique d’âmes déjà existantes. Partout ailleurs, la destinée finale des âmes est envisagée comme une sanction de la manière dont elles se sont comportées ici-bas et dans l’union avec le corps[109].
Prédestinations.
a. La première eschatologie consiste à hiérarchiser des espèces d’hommes et d’occupations d’après la valeur individuelle des âmes par rapport à la contemplation des réalités vraies. D’une part, on l’a vu, il y a des âmes qui, associées à l’un des chœurs divins, ont vu une partie au moins de ces réalités : leur récompense est d’être jusqu’à la prochaine révolution[110] exemptes de dommage, c’est-à-dire sans doute admises à continuer leur existence céleste sans entrer dans la génération[111]. Deux cas peuvent alors se présenter : ou bien elles persévèrent pendant ce temps dans la manière d’être qui leur a valu cette récompense et elles se l’assurent ainsi à tout jamais ; ou bien elles n’y persévèrent pas et elles en sont punies, sans doute à la fin de la révolution, par une déchéance qui les plonge dans la génération. Cette déchéance à son tour peut avoir deux causes : ou bien l’âme n’a pas su garder son équilibre (cf. 247 b) et, devenue incapable de suivre docilement, elle a été privée de la contemplation ; ou bien elle est victime d’une malchance[112] qui la rend oublieuse des visions dont elle avait pu être favorisée et qui pervertit complètement sa nature : elle était chose légère et ailée, elle s’alourdit et perd ses ailes. La voici donc à terre[113]. Une compensation est toutefois promise à cette exilée, c’est qu’elle n’animera pas le corps de n’importe quel vivant, mais, à la première génération, seulement celui d’un homme.
Cependant, comme il y a des degrés dans la dénaturation préempirique des âmes, il doit y avoir aussi, en conséquence, une diversité qualitative dans leur existence empirique et une hiérarchie dans leur genre de vie à la suite de cette « première naissance ». Il y a donc un ordre prédestiné des incarnations. Les âmes qui, avant de se corrompre, ont eu la plus abondante vision des réalités vraies produiront en s’incarnant un homme ami du savoir et de la beauté, c’est-à-dire un philosophe[114]. Le second rang d’incarnation fait paraître un roi fidèle à l’ordre de la Loi ou qui a dans la guerre l’art de commander. Au troisième, c’est un politique, à moins que ce ne soit un bon administrateur ou un financier. Que ces sortes d’hommes viennent ainsi juste au-dessous du philosophe, on se l’explique : il est possible en effet qu’ils s’inspirent des principes que l’autre leur aura dictés, comme dans le Politique (258 e-260 b, 301 a fin-c) et conformément à l’idéal défini dans la République (V 473 cd, cf. IX 587 ab) ou à l’espérance attestée encore par les Lois (IV 709 e sq.). Ces âmes sont inférieures sans doute ; mais, quand les tendances à commander ou à administrer qui les caractérisent auront été réglées scientifiquement[115], elles acquerront une autre valeur. Peut-être même ceci s’appliquerait-il encore aux âmes du quatrième rang, celles d’où naîtront des hommes voués aux soins du corps, maîtres de gymnase ou médecins : ceux-ci en effet sont encore capables de s’ennoblir en se pliant aux directions du philosophe. Avec les rangs qui suivent nous ne trouvons plus au contraire que des âmes vouées à une existence de mensonge ou de sujétion : au cinquième, les marchands de prophéties ou d’exorcismes[116] ; au sixième, les imitateurs de tout ordre, et les peintres sans doute aussi bien que les poètes (cf. p. xl n. 3) ; au septième, les travailleurs manuels, ouvriers ou laboureurs. Ce qui a pu faire penser qu’en dressant cette hiérarchie Platon ne veut que s’amuser, c’est la place qu’il assigne, plus bas encore, au sophiste et au démagogue. Mais n’est-il pas vrai que les deux classes précédentes ont au moins quelque utilité, l’une de nous charmer, l’autre de pourvoir aux nécessités de l’existence ? Les gens du huitième rang au contraire ne sont que malfaisants, également corrupteurs de la conscience privée et de la conscience publique. Quant à l’âme prédestinée à l’état tyrannique, le chiffre de son rang est le même que dans ce passage de la République (IX 587 b-e) où Platon mesure de combien de degrés le bonheur du tyran s’éloigne de celui du roi. S’il y a donc, en somme, dans cet exposé une part de fantaisie, c’est justement celle qu’on y pouvait attendre : comment savoir l’ordre de valeur des prédestinations si l’on ne s’est fait à l’avance quelque opinion sur l’ordre de valeur des prédestinés eux-mêmes, ou du moins de leurs conditions[117] ? comment parler de ces conditions, sinon d’après les types que l’on connaît ? Or c’est justement ce que Platon fait ici.
Sanctions.
b. Ces premières naissances sont pour les âmes la fin d’une précédente existence et le commencement d’une existence nouvelle. Il y a donc lieu de s’interroger sur la destinée finale des âmes par rapport à cette dernière : que deviennent-elles après la première mort ? C’est l’objet de la seconde eschatologie (248 e 5 sqq.). Deux idées la dominent. L’une est que leur sort dépend de ce qu’aura été, dans l’union avec un corps, leur manière de vivre par rapport à la justice et à l’injustice, et qu’il doit donc y avoir un jugement des morts[118]. L’autre idée est que le délai au terme duquel les âmes, de nouveau ailées, reviendront prendre leur place dans le chœur divin auquel elles ont appartenu est de dix mille ans, mais que tous les mille ans elles recommencent une nouvelle existence terrestre[119]. Ceci posé, voici une âme qui achève, souillée d’injustice, sa première existence terrestre : le jugement la condamne (cf. 256 e) à subir dans les demeures souterraines d’Hadès une punition proportionnée à ses fautes, et cela jusqu’à ce qu’elle soit appelée mille ans plus tard à remonter sur la terre pour y vivre une seconde existence. Mais voici maintenant une âme dont la première vie fut juste : si c’est l’âme du vrai philosophe ou de celui qui unit à la philosophie l’amour de la jeunesse, elle montera pour mille ans au ciel ; après quoi elle redescendra sur la terre pour y commencer une nouvelle existence. Que celle-ci soit pareille à la première, consacrée comme elle à la justice, pareille aussi sera la récompense. S’il en est encore de même pour une troisième existence, alors cette âme connaîtra, à la fin seulement du troisième millénaire[120], le privilège d’un retour anticipé à son lieu d’origine. Ce n’est pas cependant au seul philosophe qu’est promis ce retour au ciel. Il l’est aussi, du moins pour « quelque endroit » du ciel[121], à d’autres âmes, mais après que le jugement aura décidé de ce qu’a valu leur existence terrestre ; peut-être même la résidence qui leur sera assignée est-elle proportionnée à cette valeur. Il semble que ce soient les âmes dont il sera question plus loin (256 c-e et p. 55, n. 1), âmes généreuses et nobles mais dénuées de philosophie.
Hommes et bêtes.
Ce qu’il y a de plus important toutefois dans cette double eschatologie, ce sont deux principes par lesquels Platon a voulu résoudre deux problèmes qu’elle implique. — Le premier serait celui-ci. Puisque les bêtes sont des vivants et qu’il n’y a rien de vivant que par une âme, les âmes des bêtes viennent-elles aussi des hauteurs qu’avoisine le royaume de la pure intelligibilité ? et, si elles en sont descendues, comment leur pensée peut-elle être si pauvre et incapable de cette « réminiscence » qui est permise aux âmes humaines ? ou bien comment la richesse de pensée qui est en celles-ci pourrait-elle émerger de cette pauvreté ? Le réponse de Platon (248 cd) est que, à la première génération, ce n’est jamais dans un corps de bête que s’implante une âme déchue, mais toujours dans un corps d’homme, quel que doive être d’ailleurs son rang dans la hiérarchie des valeurs humaines ; que jamais une âme de bête ne peut donc revenir à un corps d’homme qu’à la condition d’avoir originairement animé un tel corps (249 b)[122] ; qu’un tel corps ne peut avoir enfin reçu d’autre âme qu’une âme ayant contemplé les réalités (249 e fin). Autrement dit, toutes les âmes des vivants mortels ont une nature identique et sont pareillement déchues, mais celles des bêtes sont des âmes frappées d’une pénalité additionnelle. — Le second problème est connexe au précédent. Puisqu’une bête a nécessairement été un homme lors de la première génération, l’état de bête ne peut donc se comprendre que par rapport à l’existence terrestre des hommes originaires et par rapport à un moment où, une fois morts et après avoir payé les peines ou reçu les récompenses dues, ils doivent venir à une nouvelle existence. Comment se détermine la condition de cette nouvelle existence ? La réponse est, sommairement indiquée ici, celle que développe le mythe d’Er dans la République (cf. p. 41, n. 1) : il y a un rôle pour le sort et un rôle pour le choix ; c’est le sort qui assigne aux âmes le rang dans lequel elles seront appelées à choisir entre leurs futures existences ; celles-ci, combinées et dosées d’avance, sont proposées à leur choix en plus grand nombre que celui des candidats ; elles sont enfin, semble-t-il (cf. 619 c déb.), comme des paquets clos, qui portent une étiquette simplement générique mais dont le contenu reste ignoré dans son détail. Or, parmi ces existences, il y a des existences de bêtes, et, pour des raisons diverses, elles peuvent à certaines âmes paraître préférables à des existences humaines[123]. Il est à noter enfin que ce choix, limité par le hasard du rang et qui peut s’orienter vers une vie de bête, appartient, d’après le Phèdre, aussi bien aux âmes qui viennent de recevoir en un endroit du ciel la récompense de leur vie terrestre, qu’à celles dont l’expiation vient de s’achever aux enfers. Bien plus, la République fait observer que ces âmes venues du ciel ne sont pas, tant s’en faut, les moins exposées à se tromper dans leur choix : c’est justement parce que la vertu dont elles ont été récompensées se fondait moins sur la philosophie que sur l’inertie des habitudes en relation avec un bon naturel (619 cd). Ce sont des points sur lesquels on aura l’occasion de revenir plus tard (cf. p. cxxix sq.).
Amour et philosophie.
3. La doctrine de l’âme, dans son ensemble, a été appelée par le besoin de faire comprendre comment le délire d’amour est entre tous le plus beau et le plus bienfaisant. Nous passons donc maintenant à la doctrine de l’amour et Platon commence (249 b 8 sqq.) par montrer quel lien existe entre l’une et l’autre doctrine. Nous avons appris que c’est nécessairement dans un corps d’homme que doit, à la première génération, s’implanter toute âme à qui a été donnée la possibilité de contempler les réalités absolues. C’est qu’une intelligence d’homme est, comme nous dirions, une raison : sa fonction est en effet de réduire la multiplicité sensible à l’unité d’une idée dans laquelle cette multiplicité est rassemblée par un acte de réflexion raisonnée[124]. Mais en faisant cela, nous ne créons pas, nous ne faisons que nous remémorer[125] ces réalités vraies que nous avons pu voir par delà le ciel, quand dans ce ciel nous faisions partie de la suite d’un dieu. C’est de ces réalités, divines en elles-mêmes, que ce qui est dieu tient sa divinité[126], et c’est parce que le philosophe s’applique sans cesse à se les rappeler, en suivant la voie dont on vient de parler, que son âme est toujours prête à s’élever vers la perfection du mystère auquel il est parfaitement initié. Mais ainsi il se désintéresse de tout ce qui passionne le reste des hommes : on le prend donc pour un fou[127], tandis qu’en vérité il est possédé d’un dieu.
Le délire d’amour, son origine et ses caractères.
A. — Or c’est justement la même chose qui a lieu dans la quatrième forme du délire, le délire d’amour (249 d 4 sqq.). La vue d’une beauté dans l’ordre sensible provoque le ressouvenir de la Beauté véritable ; l’âme de l’amoureux se sent redevenir ailée, elle voudrait s’envoler et elle ne le peut pas. Mais cette impatience de s’élever ne détache pas des choses de la terre l’amoureux moins qu’elle n’en détachait le philosophe, et lui aussi il passe pour être fou, fou d’amour. Or cette forme de la possession divine est, tout au contraire, la meilleure entre toutes celles qui ont été énumérées. Bien plus, le développement entier est conçu de façon à suggérer que ce délire d’amour est un équivalent de cet autre délire dans lequel la foule fait consister la philosophie. Et de part et d’autre c’est la forme excellente, à la fois pour celui qui en est le sujet, l’amant ou le philosophe, et pour celui qui en est l’objet, l’aimé ou le jeune homme à qui le philosophe brûle de se consacrer[128]. Au reste les occasions efficaces de se ressouvenir sont rares, rares aussi les âmes qui en sont capables (cf. Phédon 69 cd), soit faute d’avoir vu d’une façon suffisante les réalités, soit faute d’avoir, par une vie pure, entretenu en elles-mêmes l’aptitude à se ressouvenir. Aussi, quand une chose sensible n’en est pas seulement l’occasion indirecte, mais qu’elle imite autant que cela est possible une réalité vraie[129], cette chose est-elle propre à causer dans l’âme des transports qui la mettent si bien hors d’elle-même qu’elle ne se possède plus et qu’elle est incapable de s’expliquer à elle-même l’émotion intense qu’elle éprouve.
B. — Ce qu’il faut donc expliquer, c’est pourquoi le bel objet qui fait naître l’amour provoque dans l’âme ces transports (250 b 2 sqq.). Les réalités absolues ne sont pas toutes également lumineuses dans leurs images terrestres : ainsi la Justice, la Tempérance ont besoin, pour être tout juste reconnues, que l’on ait recours à des moyens artificiels de les reconnaître, et encore ces moyens ne sont-ils à la portée que d’un petit nombre d’hommes[130]; si elles brillaient de tout leur éclat dans leurs images terrestres, l’amour qu’elles allumeraient ainsi dans nos âmes serait le plus ardent qui se puisse. À la vérité, même au temps aboli des visions préempiriques[131], le resplendissement de la Beauté était sans pareil. Du moins est-ce un fait qu’ici-bas encore ses images sont les seules qui aient de la clarté par elles-mêmes : c’est à la vue qu’elles s’offrent, et de tous nos sens c’est le plus pénétrant ; elles possèdent un charme qui leur est propre.
C. — Il y a lieu toutefois (250 e sqq.), en ce qui concerne l’impression produite par les images de la Beauté, de voir quelles en sont les différences selon les sujets qui la reçoivent. Chez les uns l’initiation a perdu sa fraîcheur, elle l’a gardée chez d’autres[132] ; les âmes des uns se sont perverties, celles des autres ont été réfractaires à la corruption. Il s’ensuit que, à la vue de l’objet aimable, toutes ne sont pas également promptes à se porter sur les ailes du souvenir vers la Beauté absolue. Bien plus, certaines se comportent en amour à la façon des bêtes, d’autres poussent même le dérèglement jusqu’à chercher des plaisirs contre nature[133]. Mais il en est, tout au contraire, chez qui la vue du bel objet renouvelle les émotions que dans la vie préempirique donnait à leur âme la contemplation de la réalité vraie de la Beauté. Ils sont, en face de lui, comme en face de leur dieu ; tour à tour ils frissonnent et ils brûlent. C’est que de l’aimable émane une chaleur sous l’action de laquelle fond ce qui en leur âme s’était figé et durci, de sorte qu’à l’aile est ainsi donné un élan de vitalité.
D. — Pour qu’il en soit ainsi, une condition est pourtant nécessaire (251 c 6 sqq.) ; c’est qu’entre ce foyer de chaleur et l’âme de l’amoureux rien ne vienne s’interposer. Dans le cas contraire, l’âme déjà prête à s’envoler sent se briser son élan ; elle souffre cruellement, mais elle est dans le même temps joyeuse parce qu’elle pense au bien-aimé. Ce conflit de sentiments la déconcerte, elle ne sait plus où elle en est ni comment sortir de cette contradiction[134]. Dans l’espoir d’y mettre un terme, elle s’emploie avec ardeur à se rapprocher le plus possible de l’objet vers lequel elle tend ; elle travaille, au mépris de tout ce qui l’en pourrait détourner, à se mettre dans la dépendance complète de l’aimé, afin de ne plus souffrir et de réaliser au contraire la plénitude de sa joie[135].
E. — Voilà donc comment sont rendues ses ailes à l’âme de l’amoureux et comment elle fait un effort personnel pour se replacer, en intention et en image, dans le chœur divin auquel elle a appartenu. Aussi allons-nous voir (252 c 4 sqq.) ce qui en résulte, et pour la façon dont l’amant se comporte en amour, et pour la façon dont cet amour se communique à l’aimé. Tout d’abord l’amant, dans sa conduite à l’égard de l’aimé, manifeste son désir d’imiter le dieu duquel il dépend : il le choisit en effet assorti à sa propre nature telle qu’elle est déterminée par cette dépendance et, s’il lui rend un véritable culte, c’est qu’en lui il croit retrouver son dieu ; ce sont ceux qui ont été les suivants de Zeus, dont l’amour sera philosophe (cf. 250 b 7). Ensuite, dans l’âme du bien-aimé ainsi choisi, l’amoureux reverse[136] l’influence à laquelle il est personnellement soumis : il le conseille et le dirige afin de l’élever à son niveau, et ainsi de l’élever, avec lui-même, au niveau de son dieu, car il n’est point jaloux de le voir devenir meilleur[137]. L’amant qui délire, quand son délire s’oriente, comme on l’a dit, vers le divin, quand ce délire est un retour aux contemplations de jadis, fait donc partager son délire à celui qui s’est laissé prendre à son amour.
Le drame intérieur de l’âme :
4. Il s’est donc laissé prendre : il était aimé, et voici qu’à son tour il aime. Comment cela s’est-il fait ? C’est une péripétie du drame qui se joue : quels sont les vrais ressorts de cette péripétie et quel y est le rôle des deux personnages ? Voilà ce qu’il reste à expliquer (253 c 7 sqq.). Le principe de cette explication est dans le mythe de l’âme : l’âme de chacun des deux personnages est en effet comme la coulisse où se joue secrètement un autre drame, qui a lui-même ses acteurs et ses péripéties. Aussi Platon nous invite-t-il tout d’abord à nous rappeler comment il a représenté la nature de l’âme par l’image de l’attelage ailé (cf. 246 ab) : les deux chevaux de l’âme et son cocher. Mais, s’il avait alors indiqué que des deux chevaux de tout attelage mortel l’un est bon et l’autre mauvais, il n’avait pas montré en quoi. Du portrait pittoresque qu’il en fait ici, les éléments en quelque sorte moraux sont les seuls que nous ayons à retenir. Le bon cheval aime la gloire, mais avec sagesse et mesure (σωφροσύνη), il a de la réserve (αἰδώς) ; il y a société entre lui et l’opinion vraie, c’est-à-dire qu’il lui est habituel de juger juste, mais sans que la rectitude de ce jugement soit fondée sur un savoir réel (cf. p. 49 n. 1) ; pour le mener, le cocher n’a besoin que de l’encourager de la voix[138]. L’autre au contraire ne cède qu’à la contrainte : il a partie liée avec la démesure et la vantardise. Aussi en face du bel objet ne se comportent-ils pas de même. Tandis que l’un garde la pudique réserve qui lui est ordinaire, l’autre va de l’avant avec violence, il se flatte d’être à même de procurer à l’aimé les plus vives jouissances. Quant au cocher, son état est complexe : l’émanation qui lui est venue de la beauté l’a échauffé (cf. 251 ab, c fin) et s’est communiquée à la totalité de l’âme, c’est-à-dire aux deux forces qu’il a pour mission de diriger ; or c’est cette chaleur qui, fondant une sève durcie, est capable de rendre à l’appareil ailé sa vitalité, mais en même temps il ressent ces mêmes piqûres que faisait endurer à l’âme l’absence de la beauté (cf. 251 de). Autrement dit, il est dans un état d’instabilité qui lui enlève son pouvoir de contrôle et de direction, si bien que les forces dociles à son action ne savent plus elles-mêmes à quoi obéir et que celles dont la tendance naturelle est déséquilibre et révolte finissent, après diverses alternatives, par prendre le dessus et conduisent au péché l’âme tout entière[139].
dans l’amoureux ;
Cette exposition est toutefois trop générale, et en outre elle ne considère qu’un seul des deux personnages entre lesquels se joue le drame visible de l’amour. Il faut donc reprendre l’analyse du drame intérieur, successivement dans l’âme de chacun d’eux, et d’abord dans l’âme de l’amoureux, autrement dit du sujet de l’amour (254 b 5 sqq.). Supposons que la vision flamboyante du bel objet ait réveillé dans l’âme de l’amant les souvenirs assoupis de la Beauté idéale et des autres réalités absolues que le cocher a jadis contemplées dans le voisinage de celle-ci. Une sorte de religieuse terreur s’empare de lui, il redoute de profaner ce qu’il vénère, il recule devant le sacrilège et il fait ainsi reculer les deux chevaux qu’il a charge de mener, l’un sans qu’il oppose aucune résistance, l’autre de vive force. Le premier a honte d’avoir oublié sa réserve coutumière ; le second est furieux de n’avoir pu aller jusqu’au bout de son désir. Ses exigences, auxquelles les deux autres ont d’abord imposé un délai, deviennent enfin si impérieuses que de nouveau, tous les trois, les voici en face du bien-aimé. De nouveau aussi le cocher est animé des mêmes sentiments de vénération craintive et, sous l’influence de la même cause, il se ressouvient de la Beauté en soi ; de nouveau il recule et fait reculer l’attelage. La même scène s’est-elle plusieurs fois répétée, la bête vicieuse est alors domptée ; la peur l’empêchera désormais de se révolter contre les décisions de son conducteur. De la sorte, en face du bien-aimé, une même attitude de respect et de réserve est commune à tous les acteurs du drame intérieur. Pour substituer cette attitude à la précédente, il a suffi que l’inquiétude désorientée du cocher fît place au ressouvenir de la Beauté vraie.
dans l’aimé.
Plaçons-nous maintenant au point de vue de l’aimé (255 a 1 sqq.), c’est-à-dire de celui qui, étant l’objet de l’amour, doit à son tour en devenir un sujet, aimant lui-même autant qu’il est aimé ; car sans réciprocité il n’y a point d’amour. Celui qui l’aime l’aime d’un amour sincère ; quant à lui, il ne peut s’empêcher d’avoir pour lui de l’amitié. Peut-être, à force de s’entendre dire qu’il est mal de fréquenter un amoureux, repoussera-t-il d’abord le poursuivant. Mais comment, s’il est bon, repousserait-il longtemps celui qui est bon lui aussi ? Ainsi s’établissent entre eux des relations, et plus immédiates se font les manifestations de la bienveillance de l’amoureux (cf. 253 b fin). L’aimé en ressent des transports qui le mettent hors de lui-même : aucune tendresse ne lui semble comparable à celle d’un amant que l’amour inspire et qui est ainsi possédé d’un dieu (cf. 252 a). Avec le temps leur intimité devient encore plus étroite. Alors cette « vague de désir », l’himéros (cf. 251 c fin), qui a sa source dans le bel objet roule vers l’amoureux un flot plus abondant, et celui-ci s’en emplit jusqu’à déborder. Mais ce trop-plein, au lieu de se perdre, revient par le regard vers sa source à la façon d’un écho. Une fois que, ainsi réfléchi, il a comblé l’âme de l’aimé, les ailes de celle-ci reprennent leur vitalité, comme cela avait eu lieu, sous l’action brûlante de la beauté aperçue, pour les ailes recroquevillées de l’âme de l’amant (cf. 251 a-c). L’aimé à son tour est donc lui-même devenu un amoureux, et c’est ce qui le distingue de l’aimé du premier discours (cf. 240 de) qui, au lieu de s’éprendre de son amant, l’avait au contraire à charge un peu plus chaque jour. Voilà comment l’objet de l’amour en devient lui-même un sujet : un amoureux de son amoureux.
Deux amants :
le contre-amour.
Ainsi deux sujets de l’amour sont en face l’un de l’autre : qu’en résulte-t-il pour leurs rapports ? C’est sur ce point que va désormais se poursuivre l’analyse (255 d 3 sqq.). L’éclosion de l’amour chez celui qui n’était d’abord qu’un aimé a déterminé en lui un trouble qu’il ne s’explique pas (cf. 256 a déb.). La vérité est que, sans qu’il s’en rende compte, c’est lui-même qu’il voit dans son amant ainsi qu’en un miroir. Vision directe de l’amant et image réfléchie de l’aimé ne font plus qu’un. Aussi se manque-t-il à lui-même en quelque sorte quand son amant est éloigné de lui, et, quand il le retrouve, c’est vraiment lui-même qu’il retrouve, de sorte qu’aussitôt prend fin la souffrance qu’il éprouvait : réplique fidèle de ce qui avait lieu pour l’amant du fait que son aimé était absent ou présent (cf. 251 de). Une réplique, voilà en effet ce qu’est chez l’aimé cet amour qui est l’image réfléchie de celui de l’amant : un « contre-amour », un ant-éros[140], en face de l’amour, de l’éros, qui en a été le principe et dans lequel il y avait naturellement plus de vigueur : voilà pourquoi « amitié », et non point « amour », est seulement le nom que tout d’abord l’aimé donne à ce qu’il ressent (cf. 255 a 3[141]). Comme cependant les témoignages qu’il donne de cette amitié sont particulièrement chaleureux, il arrivera forcément que le cheval vicieux de l’amant en prendra avantage pour essayer de circonvenir son cocher en vue d’obtenir les jouissances qu’il convoite. Celui de l’aimé en revanche ne sait que dire, puisque l’âme de l’aimé ne s’explique pas ce qu’elle éprouve ; et pourtant le désir dont elle surabonde l’incite à manifester à celui en qui elle voit simplement un ami une brûlante tendresse, expression imparfaite d’une gratitude infinie. Pour peu qu’on le presse, l’aimé est donc sur le point de succomber. Mais voici qu’interviennent alors la réserve naturelle au bon cheval et la réflexion propre au cocher : leur résistance préservera l’aimé de la chute définitive[142].
Deux épilogues possibles du drame.
Aux péripéties qui ont marqué ce drame d’un amour, dont on a reconnu qu’il est un véritable amour puisqu’il est un délire, il ne reste plus qu’à donner un épilogue. Or celui-ci sera différent selon la manière dont se seront dénouées ces péripéties, soit par l’impudence brutale chez l’amoureux et l’abandon complaisant chez l’aimé, soit par le triomphe chez l’un comme chez l’autre de la raison et de la sagesse. Ainsi ce qui reste à considérer, ce sont les effets de l’amour selon la façon dont il aura évolué, c’est l’utilité ou le dommage qui peuvent en résulter, comme disait Socrate dans son premier discours (cf. 238 e et p. 18 n. 3), mais cette fois à propos du véritable amour, de celui qui est un délire. Il y a donc, on le voit, deux épilogues possibles. — Le premier (256 a 7 sqq.) est celui d’un amour qui a été soumis à l’ordre et orienté vers la philosophie, dans lequel l’autorité a appartenu à ce qu’il y a de meilleur dans l’âme, qui a comporté la maîtrise de soi et la mesure, qui a asservi les éléments capables de corrompre cette âme où il y a du mauvais et du bon, qui inversement a libéré ce qui est capable d’empêcher que le mauvais ne l’emporte sur le bon. Après une existence terrestre faite d’harmonie et de bonheur, les amants de cette sorte ont délesté leur âme de ce qui l’appesantissait, et celle-ci, à l’heure où elle quittera son corps, montera portée par ses ailes vers sa patrie céleste. Elle y reprendra, et même définitivement, sa place originelle quand, deux fois encore, elle aura remporté la même victoire sur les désirs sensuels, antagonistes de la raison (cf. p. 54 n. 1). Il n’est pas de bien plus grand que puissent conférer, ni une sagesse pratique humaine, ni tout autre délire divin[143].
Le second épilogue (256 b 8 sqq.) concerne un délire d’amour où la philosophie n’a point de part, mais seulement un certain souci de l’honneur et qui cependant n’est pas exempt de quelque grossièreté. Les âmes des deux amants n’y sont pas sur leurs gardes ; elles sont donc sans défense si, du fait même de l’insouciance morale qui caractérise ce second couple, elles sont surprises par l’ivresse ou par quelque autre cause de moindre résistance. Alors s’établit en effet entre les forces indisciplinées de chacune des deux âmes un accord pour tendre au même but, qui est de se procurer un plaisir dans lequel le vulgaire voit le comble de la félicité (cf. 250 e fin). Or le choix d’un tel but, c’est par ce qu’il y a dans l’âme de plus mauvais qu’il a été dicté : ce n’est point par l’âme tout entière. Aussi ne s’étonnera-t-on pas que par la suite il ne se renouvelle qu’épisodiquement : en d’autres termes, la passion ne comporte pas cette continuité dans la communion de deux âmes, que nous offrait le cas précédent. Ce n’est pas à dire toutefois que ces amants-là ne soient pas fidèlement attachés l’un à l’autre : le culte qu’ils ont de l’honneur les empêche justement de trahir une amitié dont ils se sont donné des gages, à leurs yeux les plus certains qui se puissent. Sans doute n’ont-ils pas mérité le sort des premiers ; ils ont droit néanmoins à être récompensés des efforts qu’ils ont faits, dans leur délire d’amour, pour s’élever au-dessus d’eux-mêmes, et aussi du détachement que signifient ces efforts. N’ayant toutefois fait rien de plus ainsi que se mettre en route pour le céleste voyage, la mort les trouvera donc encore sans ailes, mais du moins allégés ; capables par conséquent, au lieu de descendre sous terre aux demeures d’Hadès, de monter au contraire, mais sans pouvoir dépasser les régions inférieures du ciel. Leurs âmes, toujours unies, y goûteront ensemble les joies d’une existence lumineuse. Puis, quand l’heure en sera venue, c’est-à-dire après un millénaire et une nouvelle existence ici-bas, elles recouvreront toute la vertu de leurs ailes, à la condition sans doute de s’être cette fois mieux comportées en amour (cf. 249 ab). Voilà la destinée promise à ceux qui ont connu une amitié dont le fondement, à vrai dire mal assuré et non philosophique, fut pourtant encore un délire d’amour.
La punition des faux amants.
Quant à ceux (256 e 4 sqq.) dont l’amour est vide de tout délire, les prétendus amants du discours de Lysias et du premier discours de Socrate, ce sont seulement de sages calculateurs et, chez le jeune garçon dont ils se sont faits les poursuivants, ils encouragent la même arithmétique misérable. Comment des âmes de cette sorte pourraient-elles s’élever vers le divin ? Elles s’attachent à ce qui est mortel, elles s’accrochent à la terre et n’obtiennent le suffrage que de la foule. Leur punition naturelle sera donc, après la mort, d’être plongées dans un état d’égarement et de rouler ainsi pendant neuf mille années autour de la terre[144] ou sous la terre.
Le discours s’achève (257 a 3 sqq.) comme s’achèvent ceux du Banquet par des paroles d’offrande à l’Amour. Mais ici l’offrande est en même temps expiation : si le Dieu daigne accueillir avec faveur l’une et l’autre, il le témoignera à Socrate en lui conservant la science des choses d’amour et en ne détachant pas de lui la jeunesse[145]. Les derniers mots sont un encouragement à la philosophie, un conseil à Lysias de s’y adonner sans partage, selon l’exemple de Polémarque son frère (cf. p. 56 n. 1 et Notice, p. xv sq. et xx), et de lui consacrer son éloquence, en se proposant pour but de rendre hommage à l’Amour et de le prendre pour guide (cf. 265 c déb.).
II. Trois problèmes particuliers. — Le second discours de Socrate nous impose, je l’ai dit, l’examen de trois problèmes, aussi importants pour l’intelligence du Phèdre que pour celle du Platonisme tout entier. 1o Dans sa plus grande partie ce discours est un mythe : comment doit-on comprendre l’emploi du mythe par la philosophie ? 2o Il contient une doctrine de l’âme : en quoi cette doctrine diffère-t-elle de ce qu’on trouve ailleurs ? 3o L’amour en est enfin le sujet : par quels traits la conception de l’amour qui y est exposée diffère-t-elle de celle qu’on trouve dans le Banquet ?
1. Le mythe.
Un premier point auquel il convient d’être attentif, c’est que le second discours ne commence pas par être un mythe. Ce que nous y trouvons en effet tout d’abord, c’est une classification des différentes formes que revêt en fait le délire qui est reconnu pour être d’inspiration divine. Bien mieux, quand Platon veut ensuite démontrer que, de toutes ces formes, l’amour est la plus belle et qu’il pose la nécessité d’avoir, au préalable, une connaissance vraie de la nature de l’âme (245 c déb.), il donne tout d’abord à cette démonstration l’aspect d’un raisonnement très élaboré, par lequel il établit logiquement que l’âme est immortelle. C’est seulement après s’être satisfait sur ce premier point, qui sans nul doute, il l’a dit lui-même, concerne la nature de l’âme, que Platon, sans cesser de considérer cette nature (son ἰδέα 246 a 4), change cependant complètement de ton et donne alors à son exposé le tour mythique. C’est, nous dit-il, faute de pouvoir expliquer en quoi consiste essentiellement la nature de l’âme, qu’on doit se contenter de dire à quoi elle ressemble ; c’est parce que nous saisissons cette nature seulement dans ses effets sans en avoir aucune expérience, que nous sommes réduits à en donner une image sensible : celle de l’attelage ailé avec son cocher ailé. Ce sont donc les manifestations observables de la nature de l’âme qui sont au point de départ du « cheminement de la pensée » dans la recherche de l’image sensible appropriée. Or dans le livre IV de la République, quand il s’agit de savoir de quelles fonctions l’âme est capable, autrement dit quelle est sa nature (436 b sqq., surtout à partir de 439 e), c’est aussi de l’observation des effets de cette nature que l’on part : « J’ai furieusement envie de faire quelque chose dont je comprends que je devrais m’abstenir ; je veux m’en abstenir ; si néanmoins je cède à la violence de mon désir, j’en éprouve ensuite regret et remords ». Mais ce n’est pas à une image mythique que conduisent cette observation et d’autres du même genre ; elles sont au contraire les ressorts d’une analyse dont le caractère est principalement logique ; elle se propose en effet, d’après les variations de concomitance qui auront été constatées, de distinguer des notions qu’on pourrait être tenté de confondre, celles des fonctions comprises dans la nature de l’âme. Pourquoi dans le Phèdre Platon procède-t-il autrement ? Puisque en fin de compte le résultat devait y être pareillement de distinguer dans l’âme la notion d’un principe directeur et celle de deux forces motrices dont l’une est équilibrée et l’autre dépourvue d’équilibre, pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de figurer sensiblement cette relation et d’en personnifier les facteurs ? Le problème de l’emploi du mythe est ainsi nettement posé devant nous.
Sans doute y a-t-il quelque témérité à conjecturer les motifs qui ont, cette fois, déterminé Platon à y recourir. À première vue, on croit en apercevoir deux. L’un se rapporte à la fiction initiale du second discours : la « palinodie » de Socrate est censée être prononcée par Stésichore lui-même (244 a, cf. 257 a) ; il est donc naturel de recourir aux procédés ordinaires de la poésie. L’autre motif, qui apparaît assez clairement à 253 d déb., est que Platon se propose de représenter le drame de l’amour, drame visible et drame intérieur, avec les péripéties diverses dont il est susceptible ; il avait donc intérêt à transformer en acteurs les facteurs d’une relation fonctionnelle, et d’une façon qui rendît sensible leur solidarité comme le mode de leur action ou de leur interaction. Sans méconnaître la force que donne à ces motifs le génie poétique et plastique de Platon, ils ont dans le cas particulier quelque chose d’extérieur et qui ne suffit pas à expliquer ce qui est en question. La vérité me semble être plutôt que, de toute façon, l’emploi du mythe s’imposait à Platon par des nécessités internes et qui dérivent de la nature même de ce dont il parle.
La raison d’être du mythe.
Elles ont leur principe générateur dans cette idée qu’il existe deux mondes : l’un, celui d’ici-bas, le monde de notre expérience ou de notre pratique, monde d’illusions et de fantômes ; l’autre au-dessus de nous et dont les réalités sont vraies, c’est-à-dire purement intelligibles et logiques tout en étant réelles. Pour qu’il puisse y avoir de la vérité dans notre connaissance ou dans notre conduite, il faut donc que nous ayons accès de quelque façon à ce monde supérieur. Mais, pour que cela soit possible, il faut aussi que, de quelque façon, notre âme ait participé à l’existence vraie et que dans son existence ici-bas elle soit capable d’y participer à nouveau, soit au cours de celle-ci par un réveil méthodique de ses souvenirs, soit après la mort en récompense de son zèle à s’affranchir ainsi des liens qui l’emprisonnaient. D’autre part les hauteurs du Vrai ne sont pas les seules : il y en a d’autres qui sont plus près de nous et qui nous sont moins étrangères, dont les réalités sont visibles et font partie de notre expérience, qui s’en distinguent cependant parce qu’elles n’en ont ni le désordre ni l’irrégularité. Ce sont les hauteurs du ciel, peuplées d’êtres de lumière et de flamme, dont les révolutions s’accomplissent avec une régularité et suivant un ordre qui ne varient jamais, attestant ainsi la sagesse et la divinité de ces êtres. Il faut donc que l’âme n’appartienne pas au monde des réalités vraies : comment pourrait-elle l’avoir quitté pour un monde d’illusion ? avoir perdu l’éternité du Vrai pour être entraînée dans le tourbillon des générations et des morts ? C’est donc, corrélativement, que le ciel doit être sa patrie d’origine. Mais, puisque le ciel est la patrie imprescriptible d’êtres indéfectiblement divins, il faut aussi qu’il y ait pour l’âme des raisons spéciales d’en avoir été un jour exilée et pareillement des conditions qui un jour la rendront digne, ou bien d’y rentrer avec honneur, ou bien d’être admise par indulgence à y recommencer une épreuve à laquelle auparavant elle n’avait point satisfait.
Tels sont les postulats qui sont à l’arrière-plan de la pensée de Platon. Même en les formulant dans un langage aussi abstrait que possible, nous ne parvenons pas à les dépouiller de leur vêtement d’images sensibles. Voici dans le Phédon[146] les hommes représentés sous l’aspect d’un personnel embrigadé de serviteurs sous la tutelle de dieux qui sont des maîtres excellents ; le corps placé semblablement sous l’autorité d’une âme qui pourtant est en lui comme dans une geôle, prisonnière se complaisant trop souvent dans son sort ; cette âme, apparentée d’autre part à ce qui est pur absolument et rendue digne par la purification de retourner à sa vraie famille. Voici dans la République[147], à côté de l’analyse du livre IV, d’autres traits qui en attestent le caractère exceptionnel, en même temps que la difficulté pour Platon de représenter dans son fond la nature de l’âme autrement que par des symboles : ce sont par exemple les images fameuses de la triple bête, monstre polycéphale, lion, homme ; ou bien encore de Glaucus, le dieu marin défiguré par les algues, les coquillages, les cailloux. Sans doute allèguera-t-on que sur le thème fondamental de la relation des deux mondes, intelligible et sensible, autrement dit sur la participation des choses aux Idées, le Parménide a mis dans la bouche du vieil Éléate une critique incisive de cette façon mythique d’exposer le thème, en lui-même et dans ses conséquences ; que dans le Sophiste et dans le Philèbe elle fera place en effet à des analyses dialectiques qui ne parlent plus à l’imagination. Il n’en reste pas moins que, longtemps après le Parménide, c’est encore le mythe qui dans le Timée s’impose à Platon pour traiter de l’âme et de la divinité.
S’il en est ainsi, comment le Phèdre aurait-il, dans les conditions définies par les deux premiers motifs, échappé à cette exigence foncière du sujet auquel est consacré le deuxième discours de Socrate ? Comme dans la République l’analyse logique du livre IV, la démonstration logique de l’immortalité de l’âme y est une exception. Celle-ci provient de ce que sur l’ensemble de la question on a pu prendre un point de vue particulier, dégager quelques notions très générales et en envisager les rapports : la notion de principe et de ce qui en dépend, la notion de mouvement et de ce qui est requis logiquement pour en rendre compte sans être obligé de reculer sans fin de moteur en moteur. Mais, dès que sont épuisés les avantages de cette situation privilégiée, le mythe apparaît : il pose une donnée et il en développe toutes les conséquences, tant par rapport aux effets constatés qu’il s’agit d’expliquer que par rapport aux exigences générales de la doctrine. Il n’y a pas lieu d’y revenir ; mais, si l’on se reporte à ce que j’ai dit plus haut des postulats qu’elle implique, on verra aisément comment chaque détail vient s’y ajouter à la donnée première pour rendre compte de quelque effet observable ou pour satisfaire quelque exigence doctrinale interne. Ainsi Platon, sous peine de ne donner sur la réalité de l’âme que des vues fragmentaires et inconsistantes, est amené à déployer librement ses conceptions dans l’espace et dans le temps sous la forme d’une fable, en décrivant des configurations sensibles et des rapports de situation, en racontant les moments successifs d’une histoire fictive.
Le mythe serait donc pour lui plus que le réveil fortuit d’un génie poétique volontairement assoupi ; il serait plus aussi qu’un pis-aller, plus qu’un δεύτερος πλοῦς auquel le philosophe, dans sa navigation vers la vérité, demanderait de le conduire au port[148]. Il semble en effet qu’il réponde à une nécessité consciemment acceptée, délibérément utilisée et qu’on fait naître alors même qu’on pourrait s’en passer ; comme si le plus sûr moyen dont on dispose pour se faire entendre des hommes et éveiller en eux la pensée réfléchie était de parler d’abord à leur imagination. Le Phèdre me paraît être à cet égard singulièrement instructif, et autrement que par la seule considération du second discours de Socrate. D’une part on y voit en effet que les mythes traditionnels, ceux du folk-lore même, ont du prix aux yeux de Platon, et précisément en tant qu’on n’en dissout pas le contenu fabuleux. Bien plus, il y semble d’autre part tout prêt à en fabriquer, sans y être obligé par des nécessités internes du genre de celles que nous rencontrions tout à l’heure.
Légendes
Quand Phèdre, au début du dialogue (229 b sqq.), demande à Socrate s’il croit à la légende de l’enlèvement d’Orithye par Borée, celui-ci rejette résolument l’interprétation rationaliste de cette légende comme de toute autre. Mais, s’il leur donne leur congé, ce n’est point du tout pour les repousser elles-mêmes ; c’est au contraire pour leur laisser libre carrière en leur souhaitant bonne chance, à l’inverse de ces esprits tracassiers qui ne leur permettent pas d’aller leur chemin. Ce qui importe en effet à ses yeux, ce n’est pas de dépouiller ces légendes de l’illusion qu’elles enferment, c’est de s’en dépouiller soi-même afin de se connaître et de savoir ce qu’on vaut. Et il ajoute (230 a), comme en exemple, que par comparaison la fable de Typhon, le géant fumant d’orgueil, pourrait aussi bien l’éclairer sur ce qu’il est, que le ferait une autre légende où il s’agirait de quelque animal pacifique et voué à une destinée divine. En d’autres termes ces mythes traditionnels sont autant de suggestions dont il faut tirer parti pour pénétrer dans sa propre conscience d’un regard plus clairvoyant et pour y apercevoir une vérité. Le sens me paraît donc être le même que dans le prologue du Phédon (61 b, cf. 60 bc) : pour obéir à l’ordre du songe Socrate a composé en vers ; or un poète digne de ce nom doit être capable de créer des fables, mais c’est un talent qu’il n’a point ; aussi prend-il où il peut son bien, dans les fables d’Ésope qu’il sait par cœur. Et voici du reste qu’à l’imitation de ces fables traditionnelles il en a imaginé une qui mettrait en évidence, d’une façon dramatique et sensible, les rapports qui en chacun de nous unissent le plaisir et la douleur.
et fictions.
Il appartient donc au philosophe d’inventer des fables sur le modèle de celles qu’a léguées la tradition et pour les faire servir au même genre d’instruction. C’est ce que Platon paraît avoir fait ici dans le mythe des Cigales (258 e sqq.) et dans le mythe de Theuth (274 c sqq.). Le premier n’appartient pas, que nous sachions, à la tradition ; en l’analysant on verra peut-être quelles raisons a eues Platon de l’imaginer. Or il y a une idée qu’il a exprimée avec force dans le Phédon et dans le Banquet[149] :
c’est qu’il y a dans ce monde-ci un être privilégié qui y survit à une humanité très ancienne et par conséquent excellente ; qui est indifférent aux nécessités de l’existence, également supérieur du reste à l’abondance ou au besoin ; qui ne vit que pour l’harmonie de la pensée ; dont la mission est d’examiner les autres hommes et de surveiller leurs occupations ; qui après sa mort se trouve uni à ce à quoi, sa vie durant, il s’était efforcé de ressembler : c’est le philosophe. Or cette idée, il l’exprimait alors sans recourir à la fable : ce qu’il voulait signifier ainsi, c’est que le philosophe est un missionnaire du divin, un médiateur qui sur la terre n’est déjà plus de la terre et dont la mission s’achèvera auprès de ce divin dont il était ici-bas l’envoyé et l’interprète (cf. Banquet, Notice, p. cvi). Telle est l’idée que symbolise le personnage du philosophe, et voici qu’à son tour celui-ci est symbolisé par la Cigale. Il y a donc ici un double symbole : par quoi est-il suggéré et comment s’insère-t-il dans le développement organique de l’œuvre ? Un effort vers la vérité a été commencé ; avons-nous le droit, étant philosophes, d’y renoncer pour éviter de nous fatiguer, et préférerons-nous au souci du vrai celui de notre repos ? Ainsi s’introduit à sa place l’idée de la mission du philosophe, et l’introduction de cette idée signifie même (cf. p. xxxvi sq.) un moment important dans le progrès de l’entretien. Mais d’autre part les cigales dans le platane sont surexcitées par la chaleur, et la musique de leurs ailes bruissantes se fait plus soutenue ; cette impression sonore (déjà notée 230 c) adhère maintenant à l’idée et lui fournit le vêtement qui sera le plus capable de rendre cette idée sensible à l’esprit de Phèdre, une fois qu’auront été piquées ses curiosités de mythologue. Le mythe des Cigales n’est donc pas, semble-t-il, une simple fantaisie poétique : il est une étape dans la réalisation d’un plan et, en un conte historié, il traduit une idée philosophique. — L’invention est moins douteuse encore en ce qui concerne la fable de la découverte de l’écriture : l’observation de Phèdre sur l’aisance de Socrate à fabriquer des contes de ce genre et la réplique de celui-ci sont significatives (275 bc). Cette réplique précise le sens d’une indication donnée au début (229 e sq.) : le philosophe accueillera telles quelles, et naïvement, les fables de la mythologie, non comme une matière à recherches érudites, soit d’interprétation allégorique, soit relatives à la détermination des sources, mais bien comme une occasion concrète pour la conscience de s’interroger elle-même. La curiosité historique est une chose et elle a certes son prix ; elle ne sert en revanche de rien pour apprécier la valeur, par rapport au vrai et au beau, de ce à quoi elle s’applique ; cela est d’un autre ordre et importe davantage au salut de la pensée.Le rôle du mythe.
Un autre endroit du Phèdre mérite, pour l’intelligence du rôle des mythes, une attention particulière : on y trouve (276 e) une opposition fortement marquée entre le divertissement de l’écrivain qui « mythologise » sur le Juste, sur le Beau, sur le Bien, et le sérieux avec lequel, par le dialogue, le dialecticien s’applique à ces mêmes objets. On a eu raison[150] de rapprocher ceci d’un passage du Politique, 304 cd. L’Étranger éléate vient d’établir qu’il appartient à l’art politique de commander à tous les autres, parce que seul il sait dans quels cas il faut avoir recours à la force ou au contraire à la persuasion. Or l’art qui a le pouvoir de persuader la multitude, c’est la rhétorique, et il ne s’exerce pas sous la forme d’une instruction, mais sous la forme d’une mythologie. — Que la rhétorique soit un art de persuader et non d’instruire, c’est une conviction bien assise chez Platon[151]. Mais que cela se fasse par le moyen du mythe il n’y a, je crois, que ces deux passages pour nous le dire. Pensera-t-on que la rhétorique qui use du mythe pour persuader soit celle qui a été si rudement traitée dans le Gorgias ? ou celle qui, ici même, est envisagée avec moins d’âpreté peut-être, mais encore sans indulgence ? Il faudrait alors supposer que, dans l’un et l’autre passage, Platon a en vue des mythes rhétoriques ou sophistiques du type de l’Hercule au carrefour (cf. Banquet, p. 9, n. 3) ou du mythe de Prométhée et d’Épiméthée dans le Protagoras[152]. Sans doute est-ce à cela que Phèdre pense en effet. Mais on doutera qu’il en soit de même quand Socrate lui répond, et aussi que Platon, qui dans sa philosophie a fait aux mythes une si grande place, ait pu voir dans un artifice de la rhétorique des Sophistes un des moyens de gouvernement de son Politique. — Or il existe, c’est justement ce que nous enseigne le Phèdre, au-dessus de cette rhétorique dont l’objet est de produire des vraisemblances illusoires (260 b-e) une autre rhétorique, qui est philosophique. Celle-ci ne se refuse pas sans doute à persuader (271 a, e sq.), mais elle le fait en rattachant le vraisemblable au vrai, qui en est le principe (262 a-c, 273 d, 277 b). Cette rhétorique philosophique consiste en outre à distinguer les diverses sortes d’âmes et les diverses sortes de discours, puis à établir quelle sorte de discours est propre à convaincre telle sorte d’âme (271 b, de ; 277 bc ; 278 d fin). Ne peut-on dès lors penser que son objet sera notamment de savoir dans quels cas il y a lieu, si on veut convaincre, de recourir au mythe parce que l’usage de la dialectique serait sans effet sur les âmes qu’il s’agit de toucher ? C’est ainsi que, avant de travailler à prouver qu’entre les délires l’amour est le plus beau, Socrate sait d’avance que seuls les Sages seront convaincus par son argumentation et qu’elle ne trouvera qu’incrédulité auprès des habiles, c’est-à-dire des esprits forts (245 c). D’autre part, son second discours qui contient sa conception de l’amour est qualifié par lui (265 bc) d’hymne mythologique, où il s’est amusé à la combinaison d’un morceau oratoire auquel ne manquait pas la force persuasive. Enfin on ne peut se défendre de rapprocher le mythe du Timée de ce passage du Phèdre (269 e sq. ; cf. p. cxlviii sq.) où la physique apparaît comme une application de la vraie rhétorique. Ainsi donc, quand celui qui sait le vrai se propose de convaincre, et surtout dans un écrit puisque ce n’est à ses yeux qu’un moyen de se délasser, il peut sans scrupule user du mythe pour rendre sa pensée partiellement accessible à ceux qui sont capables d’être « convertis » (cf. Timée 28 c). Or l’étude des mathématiques et des sciences connexes est aussi, d’après la République (VII 518 cd, 521 c), un moyen de « conversion ». Le mythe, quand c’est la vraie rhétorique qui l’emploie, en serait par conséquent un autre, mais d’ordre inférieur et fait pour des âmes auxquelles manque encore la purification indispensable de la pensée. C’est dire qu’il se justifie dans un écrit appelé à tomber en n’importe quelles mains (cf. 275 e déb.) ; on lui demandera seulement d’avoir égard au respect dû à la divinité (273 e sq.), autrement dit d’éviter l’immoralité des mythes homériques (cf. p. lxxvi, n. 1).
Étymologies.
Peut-être y a-t-il quelque témérité à rapprocher de l’emploi du mythe celui que Platon a fait de l’étymologie. Sans parler du Cratyle, où il est d’ailleurs fort possible que certaines étymologies soient pour lui un objet de risée, nous avons ici même (244 b-d) un échantillon assez significatif ; bien plus il arrive dans le Phèdre que l’étymologie serve à tirer du mythe la leçon qu’il comporte (cf. 230 a et p. 6, n. 2). Il me semble difficile d’admettre que Platon se soit amusé avec une pareille complaisance à se moquer de lui-même : un jeu qui se prolonge à un tel point cesse d’être un jeu, et l’ironie devient fastidieuse à force de se répéter. Sent-on d’ailleurs quoi que ce soit d’ironique dans les étymologies qu’on trouve encore dans les derniers dialogues, ou dans le Timée (43 c, 45 b, 62 ab) ou dans les Lois (IV 714 a déb. ; XII 957 c s. fin.) ? Platon me semble user de l’étymologie ainsi qu’il use du mythe, comme d’un moyen secondaire de rendre tangible une intuition que, pour des raisons accidentelles ou profondes, il est incapable de révéler sous une forme scientifique.
En résumé, ce qui résulterait de la considération du Phèdre, c’est qu’entre les mythes traditionnels et ceux de Platon il n’y a pas de différence quant à la forme ; c’est toujours une histoire : l’histoire des âmes, l’histoire de la procession des Dieux, l’histoire des Cigales, l’histoire de Theuth. Si les étymologies sont elles-mêmes une variété du mythe, c’est qu’elles tentent de retracer l’histoire vraisemblable de la dénaturation d’un langage primitif. Mais toute cette histoire n’est pas immorale, comme celle de la mythologie. D’autre part elle ne prétend pas être une vérité, comme ces « contes » sans agrément que les Physiciens veulent nous faire prendre pour argent comptant, ainsi qu’une expression fidèle de la réalité (cf. Soph. 242 c). Il s’ensuit que seul est en droit d’employer la vraisemblance du mythe, celui qui sait ce qu’est la vérité, et comme un moyen de préparer l’âme à recevoir celle-ci.
2. L’âme.
On a vu tout à l’heure (p. cix) que la conception de la triplicité de l’âme qui s’étale dans le Phèdre avec un réalisme si cru était au contraire fondée dans le livre IV de la République sur une analyse de nature logique. Y a-t-il des anticipations de cette doctrine dans le Phédon (68 c, 82 c), et déjà dans le Gorgias (493 ab)[153] ? Pour les y trouver il faut à la vérité beaucoup de complaisance : distinguer entre l’ami des richesses et l’ami des honneurs pour les opposer ensemble au philosophe, comparer à un tonneau percé ce qui dans l’âme est le siège des désirs, tout cela, d’ailleurs banal[154], est bien loin de la conception définie qui est en question. Encore doit-on même ajouter que, dans le second de ces passages, Platon se réfère expressément à une doctrine orphico-pythagorique. Il est difficile d’autre part de n’être pas frappé de l’insistance avec laquelle Platon introduit cette conception comme une découverte à laquelle l’a conduit la division de la Cité en trois classes (435 bc, 436 ab). On ne peut du moins douter que le cocher de l’attelage de l’âme dans le Phèdre soit ce que la République appelle raison ou fonction de réflexion (λόγος, τὸ λογιστικόν) ; que le bon cheval soit le « cœur » au sens moral du mot, ou ce que nous nommerions fonction inhibito-motrice (ὁ θυμός, τὸ θυμοειδές) ; le mauvais cheval enfin, les appétits et les désirs (τὸ ἐπιθυμητικόν). Que ce soient dans sa pensée des parties ou des aspects (εἴδη) de l’âme, peu importe : le vocabulaire de Platon n’est pas sur ce point bien fixé. Ce sont en tout cas si bien des fonctions distinctes que le mythe du Phèdre, tout en les faisant solidaires, n’hésite pas à les individualiser. Cette tripartition, on le verra plus loin, se retrouve, notablement modifiée il est vrai, dans le Timée, mais avec la même disposition à séparer les trois fonctions : séparation anatomique cette fois, puisque, comme on sait, la raison se loge dans la tête, le « cœur » dans la poitrine au-dessus du diaphragme, les appétits concupiscibles au-dessous et dans l’abdomen jusqu’à la hauteur du nombril.
Simplicité et composition
Or ce n’est pas du tout ainsi que le Phédon se représentait l’âme. En raison de sa ressemblance avec les essences absolues, qui prouve qu’elle leur est apparentée, elle possède l’unicité formelle (μονοειδές) qui justement caractérise ces réalités ; par là elle est le contraire du corps, qui est une pluralité formelle, étant essentiellement un composé. Ce qui en effet définit l’âme, c’est seulement la pensée (φρόνησις), en tant qu’elle est épurée de tout mélange de sensation et qu’ainsi elle entre en contact avec l’intelligible[155]. Or ce point de vue ne semble pas abandonné dans la République, en dépit du soin évident avec lequel la tripartition a été établie au livre IV. Celle-ci en effet est présentée dans le livre X (611 b-612 a) comme une conséquence de l’union avec le corps. En cela d’ailleurs l’accord est complet avec le Phédon, où les désirs et toutes les émotions connexes de crainte, de plaisir, de peine sont la cause de l’asservissement de l’âme au corps : c’est au point qu’aux Purs et aux Saints est promise une existence entièrement incorporelle (66 bc, 82 e sq., 83 cd, 114 bc). Le Phédon à la vérité ne connaît pas de milieu entre les passions ainsi comprises et la raison qui est incorporelle. Or cette fonction moyenne, dont le livre IV s’appliquait à prouver la réalité, le livre X semble lui-même y voir quelque chose d’étranger à la nature essentielle de l’âme. C’est en effet par rapport à l’état dans lequel présentement nous l’observons, et sous la forme humaine, qu’on a pu être en droit de considérer l’âme comme composée. Il est vrai, poursuit Platon, qu’un composé peut l’être d’une façon excellente, mais ce n’est pas le cas de l’âme[156] et, tout au contraire, on voit que sa nature est gâtée du fait de son association avec un corps : ce qui amène la comparaison bien connue avec Glaucus, le dieu marin (cf. p. cxi). Si pourtant on réfléchit à quoi s’attache l’âme et vers quoi elle aspire en tant que inversement elle est apparentée au divin et à l’éternel, à ce qu’elle deviendrait si tout entière elle s’employait à satisfaire une telle aspiration, et que cet élan la fît s’élever du fond de l’abîme où elle est à présent plongée, c’est alors seulement qu’on pourra discerner sa véritable nature, « s’il y a en elle pluralité de forme ou bien unicité, ou bien en quel cas il en est ainsi et de quelle manière. ». Or, vers la fin du Phédon (107 ab), Platon indiquait que les postulats fondamentaux de sa doctrine de l’âme avaient besoin d’être approfondis. Quand il écrit le livre X de la République, et bien qu’un grand pas ait été fait avec le livre IV dans le sens de la composition, il n’estime pourtant pas avoir encore complètement élucidé le problème. Il remet donc à plus tard de décider si, dans la vérité de son essence, l’âme est simple ou bien composée, dans quels vivants elle est simple, dans quels autres composée et enfin quelle est la modalité de cette composition ou de cette simplicité.
À l’époque du Phèdre, il semble au contraire avoir pris parti : l’âme dans son essence est une chose composée. En disant « dans son essence » on veut parler seulement, puisque l’âme n’est pas une Idée, de la plénitude et de la perfection de la sorte de réalité qu’elle est. Or il n’est pas douteux que, d’après le Phèdre, les âmes qui habitent le ciel : âmes des dieux, âmes des démons, âmes qui recevront un jour la forme humaine, sont toutes, à ce stade de l’existence, des âmes composées. La différence qu’il y a entre elles, c’est que, dans les attelages constituant les âmes des deux premières catégories, les chevaux sont également excellents, et parfaits les cochers. Ceux-ci seront donc bien à l’aise, une fois le char parvenu sur le dos de la voûte céleste, pour contempler les réalités vraies du lieu supra-céleste ; ils ne connaîtront pas les tribulations des cochers qui, de leurs deux chevaux, en ont un qui est rétif (246 ab, 247 b, 248 ab). Ainsi, dans les âmes divines elles-mêmes, il y a donc les mêmes facteurs que dans les nôtres : des désirs, de la retenue et un principe directeur dont la fonction est proprement de connaître le vrai. — Mais, dira-t-on, si les désirs sont dans les âmes divines toujours bons, qu’est-il besoin de retenue ? Et, si la retenue est alors dans le désir même, qu’a-t-on besoin d’une direction ? Il ne reste plus au principe à qui semblait en incomber la fonction que l’exercice de la pensée pure. La composition à la vérité ne disparaît pas pour cela ; mais elle se réduirait à deux termes dont l’un est dynamique et l’autre statique : un moteur parfaitement réglé et une intelligence indéfectible. — Il est toutefois probable que Platon fermait les yeux sur ces difficultés de la tripartition. En effet dans les Lois, qui sont son dernier ouvrage, il attribue à l’âme, dont il veut prouver qu’elle est première par rapport au corps, une égale convenance aux états passifs comme aux états actifs ; en elle il met, à côté de la pensée pure, les jugements vrais ou faux, c’est-à-dire l’opinion, les dispositions du caractère c’est-à-dire un certain « comportement », des aspirations et des délibérations, des souvenirs et des préoccupations d’avenir, enfin des émotions et des passions, des joies et des peines, de l’assurance et de la crainte, de la dilection et de la haine : ce sont là les mouvements causes-premières qui, prenant en charge les mouvements causes-secondes, les conduisent à leurs effets qualitatifs et sensibles[157]. Or tout cela s’applique à l’âme en tant que chose qui se meut en elle-même et qui, à ce titre, est principe premier de tout mouvement ; exactement comme dans le Phèdre il s’agit d’une âme qui, en vertu de sa nature même, a la préoccupation et la charge de ce qui est dépourvu d’âme, corps du monde ou corps d’un homme (246 b 7 et p. 36, n. 1). En résumé toute la diversité qui est dans une âme humaine appartient aussi à l’âme divine, mais elle s’y trouve dans une harmonie et un équilibre parfaits.
N’y a-t-il pas cependant, entre ces deux conceptions extrêmes de la simplicité de l’âme et de sa tripartition, un stade intermédiaire auquel la pensée de Platon se serait un moment arrêtée ? Peut-être le trouverait-on dans la doctrine du Timée. Les émotions, aussi bien celles qui sont nobles et généreuses que celles qui sont passionnées et grossières, y sont en effet présentées (42 ab, de ; 69 c-70 b) comme n’appartenant pas à la nature essentielle et primitive de l’âme : elles caractérisent une autre espèce d’âme, l’espèce mortelle, celle que les démiurges inférieurs ont mission de fabriquer afin de constituer des âmes humaines. — Mais, si l’on examine de près cette exposition, une première remarque paraît s’imposer. Quand Platon passe en revue (69 cd) les états caractéristiques de cette espèce mortelle de l’âme, c’est d’une façon péjorative qu’il les détermine : ce sont des émotions violentes et qui nous contraignent ; c’est le plaisir en tant que principal appât du mal, la douleur qui nous fait fuir le bien, l’audace et la crainte qui sont des conseillers déraisonnables ; s’il existe en elle une ardeur généreuse, elle est du moins emportée et n’écoute rien ; l’espérance se laisse aisément décevoir ; enfin la sensation est irraisonnée et l’amour, capable de toutes les entreprises. Aussi est-ce pour éviter la corruption du meilleur par le pire que la cloison du diaphragme a été mise devant le pire et que dans la poitrine a été logée une partie de l’âme qui, en même temps qu’elle ressent le contre-coup des agitations qui ont lieu plus bas, serait capable d’entendre parfois les ordres de la pensée. C’est donc que l’ardeur généreuse n’est pas toujours aussi imprudente et indocile qu’il semblait tout à l’heure. Il suffirait par conséquent d’envisager tous ces états dans l’âme d’un mortel philosophe pour que le caractère en fût radicalement changé. Peut-être est-il dès lors permis de penser que la perversité ne leur est pas essentielle et que ce qui les a pervertis c’est l’union de l’âme avec un corps de terre et mortel, auquel elle s’attache et dont le philosophe au contraire travaille à se dégager. C’est du reste ce que paraît dire Platon dans le premier des passages du Timée auxquels j’ai renvoyé. Or n’est-ce pas cela justement que le Phèdre appelle la chute de l’âme ?
Une seconde remarque prouverait d’une façon plus décisive encore que la doctrine du Timée ne diffère pas au fond de celle du Phèdre et des Lois. La nature parfaite de l’âme y est en effet, sans contestation possible, décrite comme composée. Bien plus, il y a double composition ; car l’âme que fabrique le Démiurge a pour essence propre un mélange de l’Indivisible, qui est l’unité de l’être de chaque réalité intelligible, avec le Divisible, qui est la multiplicité se déployant dans l’étendue ; puis à ce mélange sont à leur tour mélangés le Même et, par contrainte, l’Autre lequel est en effet une nature rebelle (35 ab : cf. 37 a)[158]. Ainsi donc la partie divine de notre âme, celle que le Timée appelle notre « démon » et par laquelle nous sommes capables d’entrer en rapport avec les Idées (90 a-d), serait elle-même tripartite, étant constituée par l’introduction du Même et de l’Autre dans l’essence mixte déjà formée. L’autre tripartition, celle qui résulte de l’existence d’une espèce mortelle de l’âme, serait une image dégradée de la tripartition essentielle, et toutes les deux se retrouveraient dans le Phèdre, séparées par la chute. C’est en substance l’interprétation néoplatonicienne d’Hermias (123, 14-19). Peut-être celle-ci aurait-elle pourtant besoin d’être corrigée. Le Même, dont l’essence est pour Platon d’être l’Uniforme, ne peut en effet être symbolisé en toute rigueur par celui des deux chevaux qui, après la chute, cédera à des entraînements passagers. Celui-ci symboliserait bien plus cette docilité de l’Autre au pouvoir légitime du Même sans laquelle, d’après le Timée (42 cd, 43 a-44 c), il ne peut y avoir que désordre en tout ce qui agit, se meut ou est mû. De même donc que obéissance ou rébellion sont des contraires d’un genre unique, celui de l’ordre et de la règle[159], les deux forces qui tirent le char de l’âme humaine sont, d’après le Phèdre (253 c 9), des contraires dans le genre cheval. En résumé, de part et d’autre, l’âme apparaît triple. Mais le Phèdre se borne à distinguer les âmes des dieux et des hommes, des immortels et des mortels par la qualité des forces qui les meuvent ou par la possession, pleine dans un cas, latente dans l’autre, de l’usage de leurs ailes (246 a-d) ; le Timée, lui, qualifie immédiatement de parties mortelles de l’âme les forces en question, quand elles ne sont pas celles qui meuvent des âmes divines.
Immortalité.
Passons maintenant au problème de l’immortalité de l’âme. Il n’y a pas lieu de rappeler ce qu’on appelle improprement les « preuves » du Phédon (cf. ma Notice, p. xxvii, p. xxxv sqq., p. lxiv sq.). Un seul argument, le dernier, pourrait être considéré comme philosophiquement valable aux yeux de Platon, en raison de son caractère purement dialectique (ibid. p. lv-lx). Mais toujours, et même sur ce point, il y a une nécessité qui transparaît (par ex. 79 b, 106 d) : c’est de déterminer autrement que par analogie l’essence propre de l’âme ; faute de quoi on devra se contenter de dire que l’âme a toutes les chances d’être immortelle. — La meilleure preuve, au reste, que là-dessus Platon ne s’est pas satisfait, c’est que, dans le livre X de la République, on le voit de nouveau en quête de ce caractère essentiel de l’âme duquel on pourrait déduire son immortalité. Or, si en cela il se réfère au Phédon, ce n’est que par prétention, lorsqu’il fait allusion (611 b, s. fin.) à l’existence d’autres arguments, qu’il y aurait lieu par conséquent de remplacer ici par des raisons plus décisives ; de fait, tandis que Socrate pourrait, par avance, donner à Glaucon, qui ignore si l’âme est immortelle, quelques uns des motifs de le croire qu’il en alléguera au moment de mourir, c’est au contraire un argument entièrement différent qui est alors présenté[160]. Ce qui fait périr une chose, c’est, dit-il, le mal qui est en elle ; si donc inversement il y a une chose que son mal ne fait pas périr, cette chose doit être par essence indestructible ; or, si la mort est infligée à l’injuste, c’est là une peine qui atteint seulement son corps et qui est propre à celui-ci ; elle laisse entière la cause de cette peine, savoir l’injustice, un mal qui est celui de l’âme ; puis donc que le mal de l’âme survit, tel quel, à la mort du corps, c’est qu’il y a survivance aussi de l’âme elle-même ; autrement, le supplice ne serait pas une punition, ce serait bien plutôt pour l’âme une guérison et la fin du mal dont elle souffre (608 d-611 a). Quant au corollaire qui suit (611 ab), s’il complète une des raisons du Phédon, c’est en la retournant : si un anéantissement d’âme, y lisait-on (72 a-d), était possible, ce serait bientôt l’anéantissement universel, car l’âme est le principe de la vie ; réciproquement, dit la République, la quantité d’âme ne peut s’accroître dans l’univers sinon aux dépens de ce qui meurt, de sorte que tout y finirait par être immortel. Qu’en conclure ? C’est que, avant la génération et leur existence d’union à un corps mortel, les âmes sont quelque part, et de même après la fin de cette existence ; que le nombre enfin en est fini. Or c’est justement ce qu’exprime le Phèdre par sa double eschatologie (cf. p. lxxxvi sqq.).
Il semble bien pourtant que Platon n’a pas encore trouvé ce qu’il cherchait, puisque la République, au terme même de cette argumentation, remet à plus tard de connaître l’âme dans la vérité de son essence (cf. p. cxix sq.). La preuve décisive, celle qui dérive de l’essence, serait donc la preuve qui se fonde sur la propriété qu’a l’âme de se mouvoir elle-même, celle qui est commune au Phèdre (cf. p. lxxvii sqq.), au Timée et aux Lois (X 894 e-895 c, 896 ab). Un seul point vaut qu’on y revienne. Comme le Phèdre, le Timée attribue en effet à l’âme l’automotricité et il en fait le principe pour les siècles des siècles d’une vie ininterrompue ; il nous accorde à nous-mêmes l’immortalité dans la mesure où, par l’exercice de l’intellect, nos âmes imitant les mouvements qui résultent de cette automotricité essentielle (36 e-37 b, 90 cd ; cf. 43 a-44 b). Mais d’autre part il admet un « divin commencement » de ce mouvement sans défaillance dont l’âme, une fois sortie des mains du Démiurge, « a commencé de » se mouvoir elle-même. Or, tout au contraire, de ce que l’âme est-ce qui se meut soi-même le Phèdre infère qu’elle « devra être à la fois inengendrée et immortelle » (245 e sq. et p. 35 n. 1)[161] : c’est donc qu’elle n’a pas non plus commencé de se mouvoir ; il l’affirme avec force et il en donne les raisons (ibid. c-e). La comparaison des deux passages est intéressante justement en ce qu’elle nous permet de mesurer la portée, dans le Timée, du mythe de la fabrication de l’âme et des commencements de sa vie immortelle. On sait que Xénocrate, le second successeur de Platon à la tête de l’Académie, que Crantor, le premier commentateur du Timée, se refusaient à prendre à la lettre cette histoire de la naissance de l’âme et du monde ; qu’Aristote ait fait le contraire, la raison en est que sa polémique trouve son compte aux interprétations les plus grossièrement réalistes de la doctrine de son maître. Ainsi, sans être à proprement parler une chose éternelle, l’âme a dû toujours exister comme principe de son propre mouvement et du mouvement de tout le reste. Mais pour expliquer cela il faut, semble-t-il, qu’elle soit tripartite ; bien plus, la tripartition que j’ai cru trouver dans l’âme essentielle du Timée le fait mieux comprendre encore que la tripartition du Phèdre. Si en effet l’âme est motrice de nature et par elle-même, c’est parce que dans sa nature il y a de l’Autre ; cela ne s’explique pas par la présence en elle de l’Indivisible et du Divisible, dont le rôle est différent comme on le verra plus tard (p. cxxxiii) ; pas davantage par l’introduction du Même seul dans l’essence mixte, car l’âme n’aurait alors la possibilité d’aucun changement (57 e), fût-ce celui qui consiste à tourner sur soi-même sans changer de place. De l’Autre au contraire dériverait en elle la possibilité du mouvement, puisque ce dernier, d’après la doctrine du Timée (58 a ; cf. 52 e, 53 a fin et aussi 36 b, 57 ab), réside dans le Non-uniforme qui, à son tour, a pour condition l’Inégalité, c’est-à-dire des ruptures d’équilibre. Mais si l’Autre entrait tout seul, sans le Même, dans la composition de l’âme, le mouvement de celle-ci ne pourrait être qu’incohérent, perpétuellement déséquilibré, toujours dépourvu d’ordre et de mesure, bref tout pareil à celui qui résulterait de ce que le Timée appelle la « Cause vagabonde » ou la « Nécessité », si celle-ci n’était pas maîtrisée par la « Cause intelligente » et qui s’oriente délibérément vers le meilleur (30 a, 46 e, 48 a, 52 e). En résumé, il suffit de faire abstraction de la démiurgie mythique du Timée pour apercevoir entre ce dialogue et la démonstration du Phèdre un accord profond.
Âme et idées.
Il n’y a pas lieu de s’interroger ici sur les exigences logiques de cette interprétation : on pourrait en effet se demander si elle ne devrait pas être étendue au delà des âmes humaines, imitations imparfaites des âmes divines des astres, au delà même de celles-ci dont le rapport ne diffère pas à l’égard de cette âme-mère qu’est l’âme du monde sensible, et jusqu’à cet autre monde qui en est le modèle, jusqu’à ce monde intelligible auquel les derniers dialogues, plus spécialement le Sophiste (248 e sq.) et le Philèbe (30 cd, cf. 23 c), attribuent la vie, l’intelligence et le mouvement. Il suffira d’envisager la parenté de l’âme avec les réalités de ce monde intelligible qui sont sa vraie famille. Ce qui, dans le langage symbolique du Phèdre, traduit le pouvoir qu’elle a de rester en contact avec le monde de ces réalités, d’y être chez elle ou d’y retourner si elle en est sortie, ce sont les ailes dont est pourvue chacune de ses parties constitutives. Certes le Phédon affirmait bien cette parenté, mais il parlait seulement (109 e) de la possibilité d’une ascension de notre âme vers des régions supérieures. Le symbole du Phèdre affirme davantage : la faculté pour tout ce qui est âme de planer au voisinage des réalités vraies et de les contempler. Que les ailes se flétrissent, ce sera ravir à nos âmes cette intuition bienheureuse ; elle n’en est pas moins essentielle à l’âme en général. — Dans son premier discours (237 de) Socrate distinguait deux principes ou motifs d’action, l’un primitif et qui nous porte au plaisir, l’autre acquis et qui tend vers le meilleur. Mais ce point de vue est la continuation de celui de Lysias : on était encore dans le bas-fond de l’humaine sagesse, celle qui apprend peu à peu, à l’école de l’expérience, à modérer le penchant au plaisir en vue de s’épargner les ennuis qui en peuvent être l’effet. Élevons cependant notre point de vue ; aussitôt la relation dont il s’agit se renverse : ce qui était jugé acquis apparaîtra au contraire comme primitif et essentiel, et ce qu’on estimait primitif sera jugé secondaire et dérivé. C’est qu’il est en effet naturel à l’âme, tant qu’elle est dans la vérité de sa nature, de n’avoir pas besoin d’effort pour se porter vers le meilleur ; le cocher, pour parler le langage du Phèdre, n’a aucune peine à mener des chevaux qui sont aussi faciles l’un que l’autre. Quand donc l’intellect n’est pas occupé à gouverner ce qui en a besoin, il n’a qu’à faire son œuvre d’intellect (cf. p. cxx), qui est de rester en contact avec ce qui donne à l’âme tout entière son excellence originelle et de la nourrir avec l’aliment qui est naturellement le sien (246 de ; 247 cd ; 248 a déb., b fin et sq.). Le Timée fait de même : bien qu’il ait dans l’essence vraie de l’âme placé l’Autre qui, par soi, est un principe de diversité et de désordre, il n’en donne pas moins au seul intellect le droit de contempler la réalité absolument déterminée, éternelle, immuable ; et cela parce que, dans la constitution originelle et normale de l’âme, il y a subordination nécessaire de l’Autre à l’autorité du Même, organisation réglée du divers par l’identique, unification harmonieuse du multiple par l’un (51 d-52 a ; cf. 35 a fin).
La chute.
Mais, s’il en est ainsi, pourquoi ce qui, même sans être dieu, était du moins divin a-t-il perdu sa divinité ? Pourquoi la plénitude d’un être achevé, et dont toutes les fins sont atteintes dès qu’il est, se dissout-elle parfois dans l’infinité sans borne des désirs et dans le dérèglement ou la méchanceté qui en résultent ? Pourquoi la chute ? Le Phèdre explique celle-ci par une faute originelle et il y ajoute une prédestination. De toute façon il accepte qu’il y ait des élus et des réprouvés. D’abord c’est une nécessité qu’il y ait des âmes de dieux : une sorte d’isonomie veut en effet, puisqu’il y a des hommes, qu’il y ait des dieux ; autrement, le Tout ne serait pas le Tout (cf. Timée 41 bc et ici p. cx et cxxiv). Il y a donc des âmes qui seront, de nature, exclues de cette dignité ; dont les chevaux ne seront pas des pur-sang, dont les cochers seront malhabiles : bref, des âmes qui seront condamnées d’avance au risque de la chute. Or ce qui les perdra, ce qui par suite les privera de la contemplation des Idées, ce sera justement qu’elles l’auront voulue avec trop d’ardeur ! D’où en effet une bousculade, qui témoignerait d’autre part que les dieux n’ont pas su régler avec ordre la procession qu’ils conduisent. En définitive la chute de l’âme supposerait donc bien plutôt malchance et maladresse que mauvaise volonté et faute morale. Ce n’est pas tout : les conséquences de cet accident, qui manifestement ne lui est pas de tout point imputable, seront aggravées du fait que l’une en sera punie plus cruellement qu’une autre, puisque l’échelle des prédestinations en est une des punitions. — À ces difficultés Platon a opposé la solution où, par la suite, viendra toujours se réfugier l’optimisme : il faut qu’il y ait du mal puisqu’il y a du bien et, s’il y a un premier rang, il faut qu’il y en ait un dernier ; mais toutes choses sont cependant arrangées pour le mieux et chacun est au rang qui lui convient ; après tout, si l’on n’était pas tombé, on n’aurait aucun mérite à se relever (Lois X 903 b sqq. surtout 904 a-c). Et en effet, si nous avons été malchanceux dans notre vie céleste, il nous appartient par notre conduite ici-bas de compenser la prédestination qui est résultée de cette malchance.
Le salut.
Encore n’est-ce pas d’ailleurs sans restriction. Platon, il est vrai, concède à l’âme déchue, une fois qu’elle a vécu selon sa prédestination une première existence et que celle-ci a été dûment sanctionnée, le choix d’une nouvelle existence ici-bas. Mais c’est un choix qui, comme on l’a vu, est limité, annulé presque, par les circonstances qui l’entourent, une échappatoire qui permettrait à Dieu de dégager sa responsabilité (p. xciii sq. et p. lxxxiv n. 1). Choisir ainsi sa destinée, c’est au surplus se prédestiner soi-même, car la destinée, une fois choisie, est irrévocable (Rép. X 617 e, 620 e sq.). Comment dès lors Platon peut-il nous offrir l’espérance consolatrice d’un salut qui serait en nos mains ? Comment celui qui, par malheur, se sera trompé dans son choix fera-t-il pour « tenir toujours la route qui mène vers les hauteurs » ? Le seul conseil positif qui soit donné à cet égard, c’est, pendant cette vie, d’écouter les vrais philosophes comparer la valeur des diverses conditions humaines, expliquer les risques de méchanceté inhérents à certaines d’entre elles et raconter à cet effet des mythes eschatologiques (cf. p. cxv sqq.) ; si d’autre part on est convaincu que l’âme est immortelle, on se mettra de la sorte en état la prochaine fois, mille ans plus tard, de faire un meilleur choix (618 b-619 a, 621 c et la fin du Gorgias). — Peut-être le Banquet aiderait-il à comprendre le sens de ce conseil. Alcibiade est-ce qu’il doit être, du bon et du mauvais, en vertu de la condition que son âme a choisie avant de rentrer dans la génération. Or le déroulement de son destin se croise avec celui du destin de Socrate. Mais en ce dernier c’est seulement l’homme qu’il admire et qu’il aime ; il se bouche au contraire les oreilles pour ne point entendre les leçons de la philosophie et pour mieux écouter en lui-même l’appel de l’orgueil et de l’ambition. Pourquoi donc tout ce qui en lui était mauvais est-il devenu pire, au point d’étouffer ce qui y était bon et pouvait devenir meilleur ? Parce qu’il vivait au sein d’une société corrompue et corruptrice, où les passions ne pouvaient être dominées par la voix de la philosophie (cf. Banquet, Notice p. xcix sqq.). Bref, si le salut est possible, s’il ne faut pas désespérer d’apporter un remède aux erreurs originelles et aux autres, on devra demander à la philosophie de recréer l’état social, de régénérer par de saines mesures le troupeau humain, de prendre le gouvernement. C’est ce dont justement la République a dessiné le plan. Bien plus, c’est du pire des maux que sortira ce bien décisif ; car pour le réaliser, telle est la conviction obstinée de Platon (Lois IV 709 e), la philosophie devra commencer par apprivoiser celui dont le Phèdre a fait le dernier des réprouvés : le tyran.
Mais que faut-il au philosophe pour se faire l’initiateur de cette œuvre grandiose et redoutable ? Sans doute cette vocation éducatrice, ce désir divin de féconder pour toujours d’autres âmes par son enseignement en les unissant à la sienne et entre elles par un amour dont la philosophie est la substance. Voilà en effet ce qui caractérise l’homme dont le Banquet (209 bc) fait le portrait enthousiaste, et en lui on reconnaît le loyal « ami du savoir » du Phèdre, celui qui est aussi un ami de la Beauté, qui donne la rectitude à l’amour de la jeunesse et dont la parole enfin est une semence toujours vivante et active (248 d, 249 a déb., 276 e sq.). À la racine de la réforme sociale d’où naîtra le salut, il y a donc une inspiration divine et l’amour qui en est la plus magnifique manifestation. Ainsi l’âme ne peut se relever de sa déchéance que par le moyen d’une dispensation ou grâce divine, d’une θεία μοῖρα, par laquelle un homme devient, pour un temps plus ou moins court, capable de se dépasser lui-même[162]. Quand de la sorte ils prennent « possession » de nous, les dieux témoignent qu’à notre égard ils ne connaissent point l’envie (p. lxxxiv n. 1) : c’est un rayon de leur lumière qui vient se réfléchir sur nous et par lequel nous sommes transfigurés. Enfin, si toute possession divine apporte aux hommes un remède à quelqu’une des misères de leur condition, la précellence de celle qui consiste dans l’amour associé à la philosophie et se confondant même avec elle, est due à ce qu’elle les guérit de la misère d’être des hommes. Il est donc très important de comprendre, et comment s’opère la possession d’une âme humaine par un dieu, et pourquoi elle nous élève au-dessus de nous-mêmes. — Qu’on se rappelle cette étrange physique de la communication de l’amour, dont la doctrine du contre-amour avec l’image réfléchie sur le miroir est l’expression dans le Phèdre (cf. p. ciii) : elle prétend expliquer la naissance de l’enthousiasme par une sorte d’irradiation qui se propage à partir de la Beauté absolue ; ainsi, deux âmes communient dans un contact avec le divin, bien plus avec ce qui est le principe même du divin (250 a, 249 c). Si elles ne font pas ce qu’il faut pour conserver ce contact, pour profiter de la bénédiction qui leur est échue, alors l’enthousiasme aura le sort de tout autre semblable don divin : il s’éteindra soudainement ou par degrés. Pour qu’il n’en soit pas ainsi, il faut que toute l’âme y porte intérêt ; autrement dit, que l’intellect, si l’on peut dire, prenne en main l’émotion et que l’amour devienne philosophie, allant de la sorte à ce qui est l’aimable vrai, la réalité de la beauté et non plus une image de cette réalité (256 c, 250 d 7). Or cette conception présente de remarquables analogies avec la théorie de la divination qu’expose le Timée (71 b-72 b). Il semble tout d’abord qu’en celle-ci l’âme inférieure soit seule en cause. C’est en effet grâce au foie, dont la place est au-dessous du diaphragme, qu’est possible la divination : dans certains cas, ce sont des images terribles qui, venues de l’intelligence, se réfléchissent sur le miroir poli de sa surface et aussitôt il se rétracte et se ride ; inversement, quand de l’intellect émane une « inspiration » contraire, il retrouve son poli et ce sont des images de vérité qui viennent s’y réfléchir. Mais ce n’est pas à celui qui a reçu ces images qu’il appartient de les interpréter : c’est au sage, parce qu’au sage seul il appartient de se connaître lui-même et d’agir selon ce qui est dans sa nature. Ainsi faisait le philosophe quand il mettait en œuvre l’émotion dont la Beauté intelligible est la source. — Au reste certains traits du Phèdre s’expliqueraient fort bien par cette théorie. Pour échapper au péril d’avoir à faire l’éloge de l’homme sans amour, Socrate va repasser la rivière : c’est que de son démon, interprète d’une intelligence divine (cf. Banquet 203 a), lui sont venues obscurément les images terribles d’un péché qu’il allait encore aggraver. Mais alors de l’intelligence sont émanées d’autres images qui lui ont rendu sa sérénité : il les a interprétées et, en comprenant son péché, le sage a découvert la pénitence qui convient. Aussi se dit-il un « devin », de petite envergure il est vrai, et assure-t-il qu’en l’âme réside un pouvoir de divination, et cette divination est la vraie parce qu’elle est inspirée (242 b-d ; cf. 244 b-d)[163].
Le corps et l’âme.
Quels que puissent être les remèdes offerts par l’amour et la philosophie à notre condition d’hommes, il n’en demeure pas moins que nous restons des hommes et qu’il y a des dieux. Il importe donc de définir le mieux possible en quoi ceux-ci diffèrent de nous ; ce qui nous conduira à préciser la nature de la relation qui existe entre le corps et l’âme. — Tout d’abord, on a déjà pu voir (cf. p. lxxxii et cxxii sq.) quelle difficulté il y a de dire ce que sont les dieux. Pour en représenter la nature on est donc obligé, ainsi que pour l’âme, d’user sous certaines conditions d’un langage mythique (cf. p. 36 n. 3). Sans doute on peut énoncer quelle est l’exigence générale d’une nature divine, affirmer que le divin c’est ce qui a bonté, beauté, savoir (246 e déb. ; cf. Banquet 202 c, 204 a déb.), rattacher par conséquent ces caractères à ce qui d’autre part possède la perfection de l’existence et de la vérité (249 c). Mais, au delà de ces convictions très assurées, on ne peut guère faire autre chose que de chercher ce qu’elles excluent ou ce que, inversement, elles impliquent. Or ce qu’elles excluent, c’est justement la théologie traditionnelle, telle qu’elle a été élaborée par les spécialistes de la mythologie : le Timée en parle (40 d-41 a) avec une ironie souverainement méprisante ; c’est une « histoire » où il n’y a nulle vraisemblance et, si nous en croyons sur parole ceux qui nous la content, c’est qu’ils la donnent comme l’histoire même de leur famille ! Ce qu’impliquent au contraire ces convictions, c’est une tout autre théologie, la théologie astrale : les dieux y apparaîtront comme des vivants très sages, très bons et très beaux, dont les révolutions sont si exactement calculées qu’on ne peut, à moins de manquer de sens, y voir les actions d’êtres dépourvus d’âme et d’intelligence ; en chacun d’eux on reconnaîtra au contraire une âme divine et une intelligence parfaite, capables de gouverner toutes choses pour le mieux. Sans doute est-il difficile de savoir comment cette âme meut le corps de chaque astre ; mais il est certain qu’elle est un dieu et, vraisemblablement, un dieu qui a son corps approprié ; donc un vivant analogue au vivant que nous sommes, mais d’une espèce supérieure (Lois X 896 e-897 c, 898 c-899 d ; XII 967 ab, de ; cf. Timée 30 bc, 38 cd, 40 a-d et aussi Philèbe 28 a-30 d).
Ainsi se pose une deuxième question : les âmes des dieux meuvent-elles le corps visible des astres, étant logées en ceux-ci comme nos âmes le sont dans nos corps ? Ou bien pour cela leur faut-il un autre corps à titre d’instrument nécessaire ? Ou bien enfin sont-elles dépourvues de toute solidarité de ce genre et meuvent-elles l’astre en vertu d’on ne sait quel mystérieux pouvoir ? À la vérité Platon ne prend pas parti : une seule chose importe, c’est qu’on ne doute point de l’excellence de telles âmes (898 e-899 b). Son incertitude semble donc concerner moins l’union même de l’âme au corps que le mode de cette union. Au surplus, si dans le noyau de sa constitution l’âme est déjà un composé dont un élément est-ce que le Timée appelle le Divisible selon le corps (cf. p. cxxii), on voit mal comment une telle union ne serait pas nécessaire. L’âme est par nature ce qui se meut soi-même, mais c’est pour être le principe inengendré et impérissable du mouvement de tout le reste (Phèdre 246 a déb.) et, par conséquent, de la génération, c’est-à-dire de tout l’univers de notre expérience. À cet égard il y a dans le livre X des Lois (904 ab ; cf. p. cxxv n. 1) un texte particulièrement instructif : pour que la génération soit impérissable, y est-il dit, il faut que le corps ne soit pas moins impérissable que l’âme. C’est donc que, corrélativement, ils sont aussi nécessaires l’un que l’autre, non sans doute au même rang, par rapport au commencement de la génération à partir de la spontanéité automotrice de l’âme. Que l’Étranger athénien se borne, il est vrai, à déclarer que ni l’un ni l’autre ne sont éternels et que l’éternité appartient seulement aux « dieux légitimes », il n’y a pas lieu d’en être surpris : ce n’est pas à des philosophes qu’il s’adresse. Mais, si ses interlocuteurs avaient entendu les leçons de l’Académie, peut-être comprendraient-ils qu’il ne peut y avoir d’autre éternité divine que celle des réalités intelligibles (cf. p. xciv et n. 3).
En résumé il n’y aurait pas d’âmes entièrement « séparées », fussent-elles des âmes de dieux. Dans le ciel, aucune âme ne serait incorporelle, et il est vraisemblable, bien que Platon n’ait pas « mythologisé » là-dessus, que les âmes dont le rôle est seulement d’essayer de suivre les dieux ne sont pas à cet égard différentes : c’est ce qu’exprime l’image des ailes, qui de la sorte ne serait pas aussi dépourvue qu’on l’a dit de signification doctrinale (cf. p. lxxxii n. 2). Toutes ces âmes sont dans le lieu naturel de l’âme. Celles qui n’y sont plus et qui sont tombées dans la génération s’en distinguent seulement en ce que leur corps n’est plus fait principalement de feu (cf. Timée 40 a), mais principalement de terre (Phèdre 246 c), ou, à parler par symbole, en ce que, si la vertu des ailes subsiste encore à l’état latent, elles en ont du moins perdu l’usage. Quand donc Platon définit la mort une « séparation » de l’âme et du corps (Phédon 64 c), cela se rapporterait seulement à ce corps sans gloire dont la substance principale a tant d’assiette et si peu de mobilité qu’il en résulte pour elle une grande pesanteur relative ; on peut même se demander si les damnés n’en doivent pas conserver quelque équivalent (cf. Phèdre 256 e sq. et Notice du Phédon p. lxii et lxxvii sq.). Enfin cette union nécessaire, dans laquelle l’âme a sur le corps la primauté de nature et d’action, aurait sa raison d’être dans la composition même de l’âme. Le Divisible selon le corps y représente la nécessité essentielle de s’unir à un corps, la possibilité d’une résistance et la réalité d’un point d’application pour ce mouvement dont l’âme est à elle-même le principe. Ainsi ce serait comme un intermédiaire entre les « intentions » de l’intellect, avec ce qu’elles contiennent d’énergie motrice, et, d’autre part, la masse sensible que meut l’âme. La vie du philosophe, disait le Phédon, doit être une mortification ; la prédication morale y était empreinte du mysticisme le plus exalté. Le ton change avec le Phèdre, car il demande à l’âme de recouvrer l’usage de ses ailes : il s’agirait donc alors pour elle, non point de mourir à tout corps, mais de se préparer à reprendre une autre sorte de corps, savoir celle qui originairement lui est propre. C’est ce que déjà le Banquet (212 a) et plus tard le Timée (90 bc) appellent s’immortaliser aussi pleinement que cela est possible à la nature humaine. Or cela se fait moins par l’ascétisme que par le savoir et par l’amour, solidaires l’un de l’autre.
3. L’amour.
Dans la notice du Banquet, j’ai cru devoir remettre à maintenant le soin de fixer, autant que possible, les traits de la conception que Platon se fait de l’amour[164].
L’amour apparaît dans le Banquet comme le grand mystère de l’existence : en lui s’opère en effet une synthèse des opposés qui semblent le moins préparés à s’unir. L’aspiration qui le constitue n’est-elle pas le fruit de la rencontre et de l’union de deux dispositions tout à fait contraires ? L’une est la conscience douloureuse de ce qu’il y a en nous d’indigent et de borné ; l’autre est le sentiment exalté de l’inépuisable richesse de nos ressources inventives. Quand le cœur est mis en fête par le spectacle de la beauté, cette exaltation devient une ivresse, dans laquelle à la fin il s’endort ; et c’est l’occasion d’une entreprise où l’élément douloureux espère se relever de sa misère. C’est de ce jeu rythmé des contraires que naît Amour, fils de Pauvreté et d’Expédient ; Amour dont l’existence est faite de découragement et d’espoir, de timidité et de hardiesse, d’ignorance consciente et d’ardeur pour savoir : nature dans l’unité de laquelle se fondent des opposés qui tour à tour s’annulent sans jamais briser la solidarité qui les unit. Voilà pourquoi il y a dans l’amour une aspiration qui jamais n’est assouvie vers le beau et vers le bon, une mobilité qui se réveille inlassablement, une force d’expansion en vertu de laquelle il ne fait défaut à aucune des sphères de l’existence, à la fois moteur de la « roue des générations » et âme de la philosophie. C’est que l’amour a pour objet la création dans la beauté ; c’est qu’il représente l’effort de la nature mortelle, aussi bien dans l’ordre de la chair que dans celui de l’esprit, pour s’immortaliser autant qu’elle le peut : un effort qui jamais n’atteint pour toujours le terme où il tend et qui pourtant jamais ne s’éteint, un effort qui est le ressort même de la vie, de la vie spirituelle comme de la vie physique. L’amour est donc une synthèse de mortel et d’immortel ; il joint mystérieusement l’un à l’autre deux mondes qu’un abîme semblait séparer ; il refait ainsi l’unité du Tout. Mais, si telle est sa fonction, il ne peut s’en acquitter sans une discipline qui règle ses aspirations, sans une « méthode » qui les empêche de se détourner de leur but : discipline progressive, car elle gravit successivement une suite d’échelons, allant de la beauté sensible des corps à la beauté intellectuelle des connaissances ; et en même temps, à chacune de ses étapes, elle détache l’amour des attachements individuels ou même spéciaux. Le terme en est, pour qui aura été convenablement initié par un guide instruit de la route qui y mène, une révélation soudaine, celle de la Beauté absolue : entre celle-ci et la multiplicité des choses belles qui sont dans le devenir, il n’y a point de parité ; ce n’en est pas une généralisation, mais elle est une par elle-même, étant l’essence intelligible du Beau en soi et par soi.
Les nouveautés du Phèdre.
Tels sont les principaux enseignements du Banquet. Il y a dans la forme qui leur est donnée une remarquable variété : dans la relation des entretiens de Socrate avec Diotime ou dans le discours de la prophétesse, les élévations lyriques accompagnent l’emploi du mythe ; dans la discussion avec Agathon, la recherche est conduite dialectiquement ; enfin dans le discours d’Alcibiade le tour devient dramatique lorsque Socrate, incarnation de la philosophie, nous apparaît comme la vivante image de l’amour (Banquet, Notice p. ciii sqq.). — Dans la façon dont le Phèdre à son tour traite le problème il y a d’évidentes analogies. Le discours de Lysias et le premier discours de Socrate sont l’équivalent des points de vue incomplets des cinq premiers discours du Banquet. D’autre part Stésichore, le poète, tient la place de la prophétesse Diotime : seuls des inspirés sont capables de prendre sur l’amour le point de vue qu’il faut. Mais, tandis que l’amour est l’unique sujet du Banquet, le Phèdre unit, par un lien très serré malgré la complication de ses inflexions, le problème de l’amour au problème de l’éducation. À qui doit appartenir la formation intellectuelle et morale de la jeunesse ? Est-ce à la rhétorique et à sa technique toute formelle de l’illusion, qui fera triompher une vraisemblance où il n’y a point de vérité[165] ? Est-ce à la philosophie, qui par la méthode dialectique vise seulement à faire communier les âmes dans la vérité ? Sur le fond même de la question peut-être n’apporte-t-il rien qui soit spécifique. Il transpose toutefois la doctrine de la manière la plus instructive, autant dans son esprit que dans ses applications.
Sur un premier point cette transposition nous est rendue immédiatement sensible. Comme une conséquence de sa donnée initiale, l’éloge de l’Amour, le Banquet personnifiait celui-ci ; cependant il le qualifiait non pas de dieu, mais seulement de démon, de façon qu’il fût un agent de liaison entre les hommes et les dieux, un intermédiaire entre deux domaines radicalement distincts. Or, dans le Phèdre, à la place du démonisme de l’amour, nous trouvons dans l’âme la possession divine et l’inspiration. Que par là soit impliqué le démonisme ou quelque chose d’analogue, c’est bien certain (cf. p. cxxx sq.). Il n’en est pas moins vrai que, en mettant l’ « enthousiasme » dans l’âme de l’être sensible, en faisant de l’amour une des espèces, et la plus belle, de cette possession divine, on exprime la chose en des termes qui s’éloignent davantage de la mythologie, qui parlent plus directement à l’expérience humaine ; c’est en effet définir un état que chacun connaît plus ou moins, soit chez d’autres soit par lui-même : n’être plus soi ou être hors de soi. La conséquence en est que maintenant ce n’est plus le démon Amour qui est un être intermédiaire, c’est l’âme elle-même. C’est ce que le Phèdre établit doublement ; il le fait certes en un langage mythique, mais sur la signification de ce langage il n’y a pas de méprise possible. L’âme est d’abord intermédiaire en tant que tripartite, touchant à l’Intelligible par ce qu’il y a de meilleur en elle, au Sensible par ce qu’elle a de moins bon, avec une fonction moyenne entre ces deux extrêmes ; et cela n’est pas moins vrai des âmes divines que des âmes humaines (cf. p. cxx sq. et p. cxxxii). En second lieu la région qui est l’habitat naturel des âmes est elle-même une région moyenne : c’est le ciel astronomique, car les âmes des dieux sont les moteurs des astres et elles sont suivies tant bien que mal par les autres âmes ; de plus les astres sont les réservoirs de nos âmes (Timée 41 c-e). Or cette région touche d’un côté au lieu supra-céleste, c’est-à-dire au monde des Idées, et de l’autre au lieu d’ici-bas. Mais, sous cette forme, une telle conception se lie[166] à celle que se fait Platon de l’éducation des philosophes : en étudiant l’astronomie et les autres sciences mathématiques, ils se dégageront du Sensible et ce sera une propédeutique à la science exacte entre toutes, la dialectique, science de l’Intelligible ; il y a donc là une culture moyenne (Rép. VII 524 c-531 c ; Philèbe 56 de). En disant que l’amour est un délire, il s’est donné pour tâche d’intégrer à la doctrine de l’amour une doctrine de l’âme (Phèdre 245 c) ; du même coup il intégrait, plus clairement qu’il ne l’avait fait dans le Banquet, la doctrine de l’amour à toute sa philosophie. On peut même ajouter que l’âme devient ainsi le médiateur dont les objections du Parménide accusent la nécessité : par l’amour vrai dans l’âme, l’Intelligible et le Sensible se rejoignent ; c’est un pont jeté sur le gouffre et ces deux « en soi » deviennent alors « l’un pour l’autre ».
Ce n’est pas tout. L’amour était conçu dans le Banquet (par ex. 203 d) comme une tendance qui est toujours soit en action soit prête à l’action ; parce que l’amour désire toujours autre chose que ce qu’il a, il est sans cesse en chasse, il va toujours de l’avant. Ainsi l’amour est moteur et ce qu’il meut, c’est lui-même, mais aussi du même coup tout le reste, les âmes comme les corps, puisqu’il n’y a de perpétuité dans la génération, pour l’esprit comme pour la chair, que par l’amour. Or cette double motricité, c’est à l’âme qu’elle est transférée par le Phèdre. En même temps le désir de se perpétuer en d’autres âmes ou en d’autres corps, ce désir de s’immortaliser qui était d’après le Banquet le grand ressort de l’amour, se transforme en une immortalité essentielle de l’âme, sans laquelle l’amour même ne saurait être compris. Donc c’est à présent l’âme qui se meut elle-même et qui meut tout le reste. Mais ce mouvement est amour : l’âme s’aime elle-même, et c’est ce qui lui fait accomplir ses révolutions dans le ciel, mue par le désir de contempler ces réalités vraies dont la vision est l’aliment de ce qu’il y a de meilleur en elle. Or l’âme gouverne et administre tout ce qui est dépourvu d’âme ; c’est donc le désir dont elle se meut qui meut aussi tout ce à quoi elle communique le mouvement, car c’est ce désir qui attache les âmes non divines aux traces du dieu, exempt de jalousie, au cortège duquel elles appartiennent. C’est ce désir enfin qui, réveillé dans l’âme par la réminiscence, provoque un enthousiasme, duquel pourra naître ensuite cet amour philosophique où elle trouvera l’élan capable de la ramener à son lieu naturel. Certes, sur ce point encore, le Phèdre ne fait que développer la pensée du Banquet, mais il le fait de façon à lui donner plus de portée et à en approfondir les perspectives. À cet approfondissement se rattacherait peut-être la solution d’une difficulté qui subsistait dans le Banquet (cf. Notice, p. xcvi sqq.) : si l’amour est un mouvement vers un but, peut-être, une fois ce but atteint, ne cessera-t-il pas avec le succès obtenu, mais du moins perdra-t-il son caractère de moteur. Or le Phèdre, par l’image physique du miroir (255 de), représente le mouvement essentiel à l’amour comme un mouvement qui revient deux fois sur lui-même : de l’aimable à l’aimant, puis de l’aimant à l’aimable et, de nouveau, de celui-ci à l’autre. Et l’image ne s’applique pas moins bien à l’amour céleste qu’à celui d’ici-bas. En effet, ce qui meut l’âme dans le ciel, ou plutôt ce qui fait qu’elle s’y meut elle-même, c’est, on l’a vu, le désir de contempler les réalités du lieu supra-céleste, qui sont les aimables absolus. Ainsi c’est en elles qu’est le principe du mouvement, puis il revient spontanément vers elles, et de nouveau il en repart, de façon à posséder une continuité incessante. Par l’éternelle effusion de leur attrait, ces réalités éternelles prolongent sans fin l’élan d’amour qui vers elles avait mis l’âme en branle : elle se meut elle-même parce qu’il y a en elle une soif inextinguible de l’idéal.
Enfin, bien que le Banquet parle beaucoup de l’amour charnel, il est certain que, dans la partie du dialogue où s’exprime la pensée de Platon, le point de vue qui compte est celui de la génération, parce qu’il atteste dans l’ordre de la chair le désir de l’immortalité (cf. 207 a-d, 208 e). Quant à l’amour masculin, ceux qui se complaisent à en faire l’éloge, ce sont les non-philosophes qui prononcent les cinq premiers discours. Il s’agit ensuite, tout au contraire, de dégager l’amour de cette gangue de sensualité, pour insister finalement sur l’aspect spirituel d’un amour qui désire surtout la possession éternelle du bon et du vrai (cf. 210 bc ; 211 de ; 209 a, c-e ; 217 e sq. ; 219 a-c). — Assurément l’idée que l’amour est condition de la reproduction n’est pas étrangère au Phèdre ; mais, à la différence du Banquet, il en fait de préférence ressortir l’abjection (250 e sq.). C’est qu’en réalité il est plus soucieux encore que n’était le Banquet de montrer comment de la sensualité, même la plus naturelle, on peut passer à l’idéalité ; c’est en vue d’expliquer dans quels cas ce passage ne se réalise pas, qu’il est conduit d’autre part à analyser avec le soin le plus attentif l’émotion sensuelle sous l’aspect que le milieu social tenait pour le plus noble et le plus étranger à l’animalité. Il le fait de telle sorte que son analyse en est une peinture si extraordinairement vivante que certains ont voulu y voir le souvenir, encore chaud d’émotion, d’une expérience personnelle[167]. Cette insistance, néanmoins, ne semble pas avoir d’autre objet que de faire sentir à quelles embûches est exposée l’âme dans son union à un corps terrestre ; de donner à comprendre sur quel point précis doit porter son effort pour être capable d’en tourner la bassesse, la perversité même, au profit de son élévation. Sans doute un motif d’équilibre intervient-il aussi dans la pensée de Platon : s’il y a un amour « droit » et un amour « gauche », la méthode de division dichotomique exige que ce dernier, dans l’analyse ou dans la description, ne soit pas escamoté, ni ses jouissances voilées pour faire valoir plus sûrement les joies contemplatives que l’autre promet ; on obtiendrait ainsi l’effet contraire de celui qu’on cherche. Au surplus, à la peinture passionnée d’un amour sensuel perverti, Platon ne manque pas d’entremêler des traits où se marque la réprobation : au milieu des pires emportements de la passion surgissent dans l’âme du coursier docile ou dans celle du cocher des sentiments de honte, de respect, de pudeur (254 a-e, 256 a).
Dès lors, on le comprend, il n’y a plus place dans le Phèdre pour une discipline progressive de l’amour conçue comme une méthode particulière, ainsi que cela se voyait dans le Banquet. Ce que Platon cherche maintenant à créer, c’est une nouvelle « psychagogie », une méthode philosophique générale pour conduire les âmes par la vérité à la vérité, en opposition à la fausse « psychagogie » des rhéteurs, qui ne vise qu’à la persuasion par la vraisemblance. C’est dans le même esprit que sont précisées certaines suggestions du Banquet : il y était question de l’éloquence que déploient l’homme né pour être un éducateur ou celui qui montre à gravir les échelons de l’amour (209 c ; 210 a, c). À la fin du Phèdre cette idée se définit dans une apologie fervente de la parole de vérité, celle où s’exprime la vie d’une âme soucieuse de déposer des semences choisies dans des âmes aptes à les recevoir, préparées à cette fin et dans lesquelles ces semences puissent fructifier, pour se resemer à leur tour dans d’autres âmes ; ainsi une existence impérissable sera assurée à l’âme même dont la pensée leur a donné la vie (276 b, e sq., 277 e-278 b). On pouvait deviner dans le Banquet que Platon songeait au lieu d’amour qui doit dans son École unir les disciples au maître qui les guide. Ici on voit ce qu’il espère : c’est la pérennité de l’action que son enseignement a exercée sur les âmes qu’il a lui-même conquises en les aimant et en s’en faisant aimer.
En résumé, si sur la doctrine de l’amour le Phèdre n’apporte rien qui soit à proprement parler nouveau, en revanche il l’a transformée du fait qu’il y a incorporé une théorie de l’âme, dont le retentissement est profond sur l’ensemble de sa philosophie. La raison en est, je crois, celle que j’ai déjà indiquée (cf. p. c sqq.) : dans le Phèdre, au lieu d’envisager l’amour dans son essence et de transfigurer la mythologie, il a voulu surtout y voir le drame intérieur de l’âme tout entière, avec la diversité des motifs et des mobiles qui, en elle, s’unissent à la pensée réfléchie, avec toutes les péripéties qui en résultent et les dénouements auxquels elles conduisent.
VI
RHÉTORIQUE ET DIALECTIQUE
Si l’on voulait donner à cette section tout le développement qu’elle comporte, elle prendrait dans la Notice, si longue déjà, une place démesurée[168]. Pour le but qu’on s’y propose, il suffira de définir, avec autant de précision qu’on pourra, la position que Platon a adoptée dans le Phèdre envers la rhétorique en général, et de signaler quelles difficultés on rencontre dès qu’il s’agit de déterminer son attitude envers tel ou tel rhéteur en particulier. Au reste, l’objet du débat est clairement marqué par Socrate (266 b ; cf. 269 b) : la discipline qu’il enseigne, « jusqu’à présent, en tout cas », il l’appelle dialectique ; quel nom faut-il pour le présent donner à l’enseignement de l’art oratoire ? Si ce n’est même pas un art, comme on l’a déjà prouvé (262 c), à plus forte raison pourra-t-on penser qu’il n’y a pas non plus de discipline qui l’enseigne. Phèdre en conclut qu’il reste, par conséquent, à définir la rhétorique comme objet distinct d’étude. Est-ce donc à dire, demande alors Socrate, qu’elle existerait comme discipline technique, à part de la dialectique ? Tout entrelacées qu’elles sont, les grandes lignes d’un plan se dessinent pourtant ici : 1o critique de la rhétorique de fait, dans ses productions et dans son enseignement ; 2o détermination idéale d’une rhétorique de droit, qui se fonderait sur la dialectique ; 3o caractère de la dialectique en tant que propre à fonder cette nouvelle rhétorique.
I. Critique de la rhétorique existante. — Pour montrer à quel point sont injustifiées les prétentions de la rhétorique à se dire un art, Platon se place, comme on vient de le noter, à un double point de vue, celui des œuvres et celui de la discipline par laquelle ce soi-disant art serait communicable.
Œuvres :
la logographie.
Le premier point de vue apparaît lorsque, après le second discours de Socrate, est introduite, avec la supposition que Lysias écrira une réplique, la notion capitale de « logographie ». C’est d’autre part sur cette notion que s’achèvera l’examen de la rhétorique : qu’est-ce en effet, à la fin du Phèdre, que l’apologie de l’enseignement vivant sinon une condamnation de la composition oratoire écrite ? Mais, au lieu de prendre le terme dans son sens usuel et concernant spécialement la composition des plaidoyers, Platon le généralise (p. 56, n. 2) : légitimement, il signifie en effet l’acte d’écrire des discours. Peu importe que l’objet n’en ait rien de juridique, qu’il s’agisse par exemple de proposer ou d’édicter une loi, et même simplement de défendre une thèse spéculative ou de la combattre ; la forme littéraire, que ce soit de la prose ou des vers, n’est pas moins indifférente par rapport au caractère de l’œuvre (258 d fin ; 277 e fin ; 278 c, e). Aussi a-t-on grand tort de mépriser ou de suspecter la « logographie » en raison de son application professionnelle : le jugement qu’on portera sur ce qu’elle vaut doit rester indépendant du fait qu’elle est, ou le métier des avocats qui écrivent pour les plaideurs, ou celui des Sophistes qui écrivent pour mettre en évidence (genre épidictique) leur talent de professeurs (257 c-258 d ; cf. 261 a-e, 278 bc). — Ce qui par contre constituera pour la « logographie » un vice essentiel et justement condamnable, c’est qu’elle fasse fi de la vérité par rapport au sujet qu’elle traite ; qu’au contraire elle soit uniquement soucieuse de l’opinion de ceux à qui elle s’adresse, soit pour la flatter en s’y conformant, soit pour la séduire. Quand en effet l’art dont elle procède se donne pour une « psychagogie », pour un art de mener les âmes, le seul objet qu’en cela il ait en vue est la persuasion. Or, si celle-ci ne se rapporte pas à la vérité, elle ne peut être qu’un artifice pour faire croire, en abusant de certaines similitudes, que ceci est cela et, aussi bien, le contraire. Toujours, en effet, et quel que soit le sujet de la composition oratoire, celle-ci se présente comme une opposition de thèses : c’est donc une controverse ou « antilogie », dans laquelle une des deux parties en présence cherche à persuader lecteur ou auditeur, pour faire triompher la thèse qu’elle défend. En vue d’y réussir, on s’appliquera d’abord à dissimuler aux yeux de ceux-ci l’ambiguïté de ce qui est en cause et, au lieu de se mettre là-dessus d’accord avec eux, à les empêcher au contraire de s’en faire une idée nette, à éviter soi-même de le définir préalablement ; d’un autre côté, on fera en sorte de si bien embrouiller les choses en les jetant toutes pêle-mêle que, faute de pouvoir s’y reconnaître, ils passeront à leur insu de la réalité à son contraire. C’est de quoi justement témoigne à merveille le discours de Lysias. Mais si, pareil au rhapsode, on débite ainsi des choses dont on n’a pas auparavant examiné si elles sont vraies, comment ne se laissera-t-on pas prendre soi-même au piège de l’illusion dont on cherche à duper autrui ? La conclusion, c’est que, sans la connaissance du vrai, la composition oratoire ne peut obéir qu’à de mystérieuses « nécessités logographiques » ; qu’il n’y a là par conséquent qu’une routine misérable et un tour d’adresse qui n’est pas transmissible (258 e-264 e ; cf. 273 d, 277 e fin).
Enseignement.
Mais précisément ce qu’assure la rhétorique, c’est qu’elle serait une technique pouvant être enseignée et acquise sans qu’on eût aucune connaissance du vrai. Voici donc le second point de vue : comment enseignerait-on un art dont on vient de dire qu’il n’en est pas un ? Or c’est un fait (266 d-267 e) qu’il y a des traités de rhétorique qui contiennent, dit-on, une foule de merveilles, et qu’il y a des écoles où se donne cet enseignement (266 d ; 269 c ; 271 c déb., e ; 272 c). C’est un fait aussi qu’il y a eu, qu’il y a des maîtres qui ont acquis une grande renommée et qui se font payer très cher (266 c), si soucieux d’ailleurs de graver leurs préceptes dans l’esprit des élèves qu’ils ne dédaignent pas de les consigner en vers mnémotechniques (267 a). Mais, au vrai, que renferment ces traités et qu’apprend-on de ces maîtres dans leurs écoles ? Rien de plus que des expédients qui ont réussi en diverses occasions et dont on donne la formule (σχῆμα, figure) ; ou bien des « lieux communs », développements passe-partout qui serviront à n’importe quel sujet ; ou bien enfin des conseils et des règles qui n’ont rapport qu’à la forme littéraire, soit au style, soit au vocabulaire.
Or ce qui fait l’orgueil des maîtres, ce sont les découvertes dont ils accroissent un si précieux trésor. Platon ne s’attache pas à en détailler les richesses et il se borne à en donner quelques échantillons. On enseigne à choisir ses mots, à les ébarber pour qu’ils soient bien nets, ou à les ciseler ; on recommande au prosateur d’éviter les termes poétiques (234 c, e ; 257 a) ; on donne des conseils pour la correction ou pour l’élégance de la langue (267 c) ; redoubler le mot qu’on vient de dire est un moyen d’exciter l’attention[169] ; il y a un style doctoral et sentencieux, il y a un style imagé et métaphorique (ibid. et 269 a), qu’on apprendra à employer selon les cas ; on dira comment s’y prendre pour être tantôt sobre et tantôt copieux (267 b, 268 c, 269 a, 272 a ; cf. 235 a). Du maître l’élève reçoit en outre une sorte de patron d’après lequel il construira mécaniquement n’importe quel discours, soit devant l’Assemblée, soit au tribunal, et qu’il s’agisse d’accuser ou bien de défendre : exorde ou préambule, exposition des faits ou narration, production des témoignages, indices ou présomptions, puis la preuve à laquelle s’ajoutera au besoin le complément de preuve, enfin ce que les uns nomment le résumé, d’autres la récapitulation, et qui consiste à rappeler les points principaux du discours (266 e sq. ; 267 c ; 272 a, e). Ajoutez à cela toutes les roueries de métier, dont l’expérience du maître est à même de garantir le succès : au lieu de louer ou de blâmer ouvertement, le faire d’une façon détournée et pratiquer l’insinuation (267 a) ; faire naître le soupçon par une adroite calomnie (ibid. d) ; exciter ou apaiser tour à tour les fureurs d’une foule (267 cd, 268 c, 272 a) ; l’apitoyer et lui arracher des larmes (ibid.). En enseignant aux élèves tous ces « moyens », on leur inculque en outre la conviction que l’unique ressort en est, non pas la vérité, mais la probabilité et la vraisemblance : « le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable », gardez-vous donc alors de dire le vrai si vous voulez qu’on vous croie (266 e sq., 272 d-273 d). Quant à la matière à laquelle s’appliqueront ces divers artifices, elle consiste en des thèmes, dûment catalogués, qui appartiennent à la réflexion la plus commune et dont chacun donne lieu à une antithèse facile : richesse et pauvreté, jeunesse et vieillesse, passion brûlante et froid calcul, amour et amitié, etc. (par ex. 227 cd, 235 e, 267 c).
L’invention.
Certes, il est impossible de méconnaître la nécessité de tels développements : ce serait renoncer à dire sur chaque sujet ce qu’il appelle naturellement. Mais ce qu’on reprochera à l’enseignement rhétorique, c’est de voir là-dedans le domaine privilégié de l’invention : ce n’est pas être original que de prendre sur tout sujet le contre-pied de ce qui est raisonnable et de se complaire aux paradoxes. Gonfler de petits sujets pour les faire paraître grands, évider les grands pour qu’ils semblent petits, faire du vieux avec du neuf ou du neuf avec du vieux, rien de tout cela non plus n’est inventer ; c’est seulement donner à des banalités un certain arrangement : tant qu’on s’en tient à des thèmes inévitables, mais rebattus, il n’y a pas place pour l’invention, et c’est là justement quelque chose qui ne se laisse pas formuler en précepte, mais un don de nature (236 a, 267 ab, 268 c). À la vérité, quand les rhéteurs énoncent à quelles conditions on peut, à leur école, devenir un bon orateur, ils ne manquent pas de joindre les dons naturels à l’instruction et à l’exercice (269 d) : en quoi ils ne se trompent pas. Ce n’est pas toutefois par leurs méthodes que cela se fera : la façon superficielle dont ils comprennent l’instruction et le savoir fait que les dons naturels ne signifient plus qu’une agile dextérité dans l’usage des artifices qu’ils ont enseignés, et les exercices par lesquels ils prétendent la faire acquérir ne sont qu’une parodie de culture. Pour atteindre le but ils se flattent d’avoir trouvé la voie la plus courte et la moins pénible (272 d) ; mais la vérité est que leurs élèves n’apprennent d’eux que l’ABC d’un art, et qu’eux-mêmes d’ailleurs, à moins de supposer qu’ils en gardent perfidement le secret, ils ne possèdent pas l’art qu’ils enseignent. Affaire donc au disciple, une fois achevé son cours d’études, de se débrouiller tout seul en face des réalités, d’organiser son discours par rapport aux conjonctures et d’apprécier les questions d’opportunité ! Au lieu d’une base solide de la pratique, tout ce qu’ils lui ont donné ce sont des « corrigés » : ces misérables modèles, tout pleins d’artifice et de convention, n’ayant hors d’eux-mêmes nulle raison d’être, que sont leurs discours « épidictiques ». Quant à lui, il les apprendra par cœur ou bien il s’essaiera à les reconstituer d’après un canevas : ce qui est précisément, au début du dialogue, l’occupation à laquelle se livre Phèdre sur l’Érôticos écrit par Lysias (269 bc ; cf. 268 b sqq., 271 bc, e sq., 277 c, 278 b-e et, d’autre part, 228 a, c-e ; voir p. xxvii n. 1 et p. xlviii n. 1).
Ainsi donc, ni par leurs œuvres, ni par leur enseignement les maîtres de rhétorique ne manifestent qu’il existe en fait un art rhétorique fondé sur un savoir défini, comportant des règles précises, capable enfin d’être enseigné. S’il doit y avoir un tel art de la parole, c’est d’un autre côté qu’il faudra le chercher et c’est par d’autres voies qu’on pourra l’atteindre (269 cd, cf. 271 a).
II. Plan d’une rhétorique nouvelle. — Or cet art, on a le pressentiment, solennellement affirmé, qu’il existe en droit ; qu’un imposteur en a usurpé la place ; qu’il n’a qu’à faire valoir ses titres, à prouver qu’il est la rhétorique dont une philosophie authentique serait le fondement (267 e sq., cf. 257 b et 276 e fin).
Son objet.
Comme c’est en effet pour la parole sa fonction propre de conduire les âmes, d’être une « psychagogie », on dira que l’âme est l’objet propre de la vraie rhétorique (271 c). Mais, tandis que l’autre se fonde sur la pure vraisemblance et emploie l’illusion à produire la persuasion, celle-ci entend n’appuyer sa « psychagogie » que sur la connaissance de la vérité de tout sujet auquel s’appliquera le discours (259 e, cf. 260 e fin). À l’égard de son objet, l’âme, elle se comportera donc comme le fait la médecine à l’égard du sien, qui est le corps (270 b, cf. 268 a-c), comme du reste se comporte tout art digne de ce nom, soit qu’il produise une œuvre, soit qu’il enseigne à autrui la manière de s’y prendre (270 d déb.). Aussi commencera-t-elle par analyser la nature de son objet : c’est ce qu’a fait Socrate quand il a voulu prouver dans son second discours que le plus beau de tous les délires est celui qui est inspiré par l’amour (cf. 245 c-249 d). D’abord, l’objet est-il simple ou ne l’est-il pas ? S’il l’est, quelle est sa propriété, soit à titre d’agent, soit à titre de patient ? S’il est composé, quelles sont les natures simples dont il est formé ? Une fois qu’on les aura dénombrées, on se posera à propos de chacune les mêmes questions qu’on se serait posées à propos de l’objet s’il avait été simple. Voilà donc ce que commencera par faire la rhétorique à propos de l’âme, son objet (270 c-271 a, cf. 277 b).
L’étendue de son domaine.
Mais est-il possible de se faire une idée suffisante de la nature de l’âme indépendamment de la nature du Tout ? Non, si le dire d’Hippocrate est vrai, et que ce soit impossible même en ce qui concerne seulement le corps[170]. C’est qu’en effet, ainsi que Platon vient de le montrer (269 e sq.), tout art important, c’est-à-dire sans doute tout art qui n’est pas un métier manuel, exige en quelque sorte de se dépasser lui-même : autrement, il est impossible d’en comprendre la portée et les relations. L’éloquence de Périclès a dû beaucoup au hasard qui sur sa route mit Anaxagore, savant et philosophe. Si donc la rhétorique veut être un art qui compte, il faut qu’elle ne s’enferme pas dans le cadre de sa spécialité, il faut qu’elle ait la tête en l’air, qu’elle ne craigne pas de jeter les regards au delà de son horizon borné (cf. p. cxvi). On voit à quel point tout cela est loin de la rhétorique usuelle, qui ne songe qu’à grossir ce fatras de procédés et de formules dont est faite sa routine. — Ce n’est pas cependant la seule signification qu’il y ait lieu de donner à cette remarque incidente ; le passage sur Périclès et Anaxagore n’est pas non plus le seul qui l’éclaire. Doutera-t-on en effet que le second discours de Socrate, cet « hymne mythologique » d’où n’est pas absente la force persuasive (265 bc), soit un échantillon de la vraie rhétorique, de celle qui se fonde sur la philosophie ? Or l’âme n’y est pas conçue seulement comme individuelle, ce qui est le cas quand il s’agit de celles de chacun des astres-dieux, ou encore à propos de nos âmes humaines ; elle est conçue essentiellement comme universelle, attendu qu’elle est, en tant qu’automotrice, le principe premier du mouvement et de l’ordre des mouvements dans l’univers. Une parenté réelle existe donc entre la combinaison du mythique et du logique qu’on trouve, concernant l’âme, dans ce morceau central du Phèdre, et une semblable combinaison dans le Timée, embrassant à la fois et l’âme et la Nature. Le Phèdre ne prétendait donner qu’une « image » de la nature de l’âme, rien de plus qu’une façon vraisemblable de se la représenter (246 a) ; c’était là un divertissement et un jeu (265 c, cf. 262 d déb.). De même, à des exigences préliminaires de la raison le Timée combine un mythe simplement vraisemblable (27 d-29 d, 68 d) ; en le faisant on se livre à un divertissement, à un jeu (59 cd, 72 de). Ainsi tout ce qui constitue la partie mythique de ce dialogue, c’est-à-dire presque tout, serait un exemple de ce que réclame le Phèdre : une extension à la Nature et au Tout de la rhétorique philosophique, en tant précisément qu’elle est une « psychagogie » et que l’âme est son objet.
Ses conditions.
Mais la connaissance vraie de son objet, l’âme, n’est pour cette nouvelle rhétorique que la première de ses conditions. La seconde est qu’elle dise au moyen de quoi l’âme agit ou pâtit et de quelle façon il lui est propre d’agir ou de pâtir (271 a). Cette condition est la même que pour le vrai médecin à l’égard de son objet : il doit savoir par quels effets se manifeste la nature du corps tant qu’elle n’est pas pervertie par quelque désordre et, d’autre part, à la fois quelles causes troublent cette nature et quelles causes, neutralisant les précédentes, rétablissent en elle santé et vigueur ; drogues ou régime et exercices sont à leur tour des causes qui, déterminées par lui, serviront à conserver la santé ou à la restaurer par une action appropriée. De même en est-il pour l’âme : si ce par quoi elle agit ou ce qui agit sur elle ce sont des discours et des pratiques, de telles causes ou de tels effets sont assortis à sa nature : tous les mouvements d’ordre physique qui constituent nos actions résultent en effet de ces mouvements, d’ordre moral qui, comme on l’a vu, sont les mouvements propres de l’âme (270 b ; cf. p. cxxi). Ainsi donc, dans le cas qui nous occupe, ce par quoi une âme agit sur une autre âme ou pâtit de la part d’une autre, ce sont des discours par la force persuasive desquels elle sera amenée à telles façons de penser et de se conduire qui soient, en effet, ce qu’elles doivent être (270 b, 271 a déb. ; cf. Banquet 209 b fin sq., 210 bc).
La troisième condition est celle qui concerne le plus immédiatement la pratique. Elle comporte deux moments, dont le premier se rapporte peut-être à l’une et à l’autre, respectivement, des deux premières conditions (cf. 270 d 6). D’une part en effet il s’agit alors de dénombrer et de décrire des espèces d’âme ; or, après le second discours, on sait que l’âme est une chose composée, de sorte qu’il y aura nécessairement une diversité dans le rapport des éléments qui, dans chaque cas singulier, forment ce composé ; d’où une classification des « caractères », fondée sur un principe analogue à celui qui, en médecine, est à la base de la classification des « tempéraments ». D’autre part il y a lieu de procéder à un semblable dénombrement et classement des différentes sortes de discours, chacune étant affectée de sa détermination caractéristique[171]. — Une fois dénombrées et classées les différentes espèces d’âmes et les différentes espèces de discours, il n’y a plus qu’à mettre en parallèle ces deux classifications. C’est le second moment : il consiste à reconnaître quels rapports de causalité lient, chacune à chacune, les espèces de ces deux séries. Voilà qui constitue une pratique véritable, car on sait alors ce qu’il faut dire à telle âme pour produire en elle telle conviction dont elle a besoin et qu’on souhaite pour elle (271 b, d-272 a, 277 c déb., 278 d fin). C’est alors seulement qu’on est, de façon authentique, un orateur ou un professeur de l’art de parler. Faute d’un tel savoir en ce qui regarde le corps, n’est-on pas incapable d’exercer ou d’enseigner la médecine ? Quand au contraire on sait cela, on sait donc aussi l’opportunité et l’inopportunité (εὐκαιρία, ἀκαιρία), soit d’appliquer tel discours, soit d’appliquer tel remède.
Son fondement.
Telles sont les trois conditions d’un usage et a un enseignement légitimes de l’art de parler. Elles sont incomparablement plus efficaces que ces trois autres conditions traditionnelles[172] dont s’accommodent les rhéteurs et qui, nécessaires sans doute, demeurent cependant indéterminées. Or ce qui fait qu’on ne s’en est pas contenté, ce qui a permis d’y substituer des conditions capables de produire à coup sûr l’effet que l’on cherche, c’est la connaissance de la dialectique ; autrement, la rhétorique n’a d’autre base qu’une aptitude aventureuse à conjecturer, à laquelle on se flatte de donner par l’exercice une sûreté qu’elle ne peut avoir[173]. Que dans cette direction la route soit longue et pleine de circuits, il n’importe si elle doit mener certainement au but, au lieu d’être un tâtonnement d’aveugle et de n’y conduire que par l’effet d’une heureuse fortune (272 c déb., d ; 270 de). Quant au but, il est connu : c’est une « psychagogie » légitime. Les caractères du discours qui la constituent attestent assez que ce but est atteint. Ce discours en effet n’aborde pas le sujet avant de savoir s’il ne recèle aucune ambiguïté ; il définit exactement la question (cf. 265 d) ; il n’en poursuit l’analyse qu’après s’être assuré que ceux qui l’écoutent sont là-dessus d’accord avec lui ; il déduit avec ordre et en accord avec lui-même (ibid.) tout ce qui résulte de la définition ainsi posée et acceptée ; bref il ressemble à un être vivant qui a son corps à lui et dont toutes les parties sont réellement solidaires les unes des autres comme de l’ensemble (263 a-c, 264 c, 269 c, 277 bc ; cf. 237 b-d, 238 e sqq.). De plus, en suivant cette « méthode », autrement dit cette route, on donne à l’âme une véritable culture ; surtout à condition de renoncer, sinon en vue de la satisfaction d’avoir fixé ses méditations passées, à la vanité d’immobiliser la vie du discours dans une composition écrite ; à condition de le considérer au contraire comme une semence vivante qui, semée dans une âme propre à la recevoir, y germera pour produire ses fruits et ainsi, indéfiniment, ensemencer d’autres âmes. On voit ainsi quel est l’aboutissement de la route par laquelle nous mène la rhétorique philosophique, art de parler et de penser (266 b) : c’est l’enseignement, mais non pas un enseignement figé et dogmatique ; c’est au contraire celui qui suppose la recherche en commun et un effort vers la vérité, qui est dans l’esprit du disciple aussi vivant et aussi fécond qu’il l’est dans l’esprit du maître. C’est qu’en effet, comme on l’a vu (cf. p. cxli), les liens d’un amour inspiré les unissent l’un à l’autre.
III. La dialectique. — Le fondement de la rhétorique philosophique, c’est donc la dialectique. De fait, dans ce Phèdre dont l’examen de la rhétorique constitue le cadre, se trouve la description la plus élaborée et la plus précise que Platon ait jamais donnée de sa méthode, celle qui selon toute vraisemblance correspond au dernier stade de l’évolution de sa pensée.
Les Idées.
Parmi les traits qui la caractérisent, il y en a plusieurs que nous avons déjà rencontrés et qu’il suffira de rappeler : accord mutuel des interlocuteurs ou, ici, des auditeurs avec l’orateur sur la chose qui est en question ; recherche d’une définition de cette chose dans l’universalité de son essence, mais sans en négliger les espèces, la considération des espèces étant justement, ou bien ce qui nous fait apercevoir les différences qui, progressivement éliminées, laisseront comme résidu l’essence générique, ou bien ce qui nous aide à reconnaître que l’essence en cause a vraiment la généralité que nous lui avons attribuée ; enfin existence réelle et substantielle de l’objet de ces notions, indépendamment des choses sensibles où elles sont d’une certaine façon immanentes et qu’elles dénomment, indépendamment aussi de l’aspect purement logique sous lequel la pensée conçoit ces notions. Or l’affirmation de la transcendance de ces « Idées » est dans le Phèdre plus décidée que nulle part ailleurs. Qu’elle s’exprime sous la forme mythique du « lieu supra-céleste », cela ne peut s’interpréter, semble-t-il, que comme un indice de l’intention chez Platon de dissiper toute incertitude à ce sujet[174]. Mais il y a en outre dans le Phèdre un exposé, qui y est même par deux fois repris, d’un certain aspect de la méthode sur lequel Platon n’avait pas jusqu’alors explicité sa pensée. Peut-être cet aspect était-il impliqué dans d’autres exposés, dans le Phédon par exemple (101 e déb.) ou surtout dans la République (VI 511 bc ; cf. V 454 a). Mais Platon insistait alors principalement sur le mouvement ascendant de sa dialectique, celui qui doit aboutir à un terme inconditionnel ou non dépendant (l’ἀνυπόθετον), et le mouvement de descente, s’il y était fait allusion, n’apparaissait que comme un complément de l’autre. Ici au contraire il devient, sous le nom de « division », le procédé essentiel de la dialectique, sans lequel celle-ci ne serait, comme dit le Parménide (130 ab), qu’un élan enthousiaste vers l’intelligibilité pure. Or ce n’est pas tout de s’envoler ainsi vers les hauteurs les plus sublimes ; il faut en outre être capable de redescendre ensuite jusqu’au point d’où l’on a pris son vol.
Deux procédés.
D’après le Phèdre (260 a-266 c, 273 e déb., 277 b), la dialectique comporte deux démarches, dont chacune a une fonction qu’il s’agit de déterminer techniquement, c’est-à-dire comme procédé d’une méthode. Le premier procédé consiste à rassembler (συναγωγή) ce qui est dispersé un peu partout, en l’embrassant d’un coup d’œil (cf. p. 72, n. 1), et à ramener ainsi cette multiplicité éparse à l’unité d’une forme ou, comme nous disons, d’une Idée qui soit précisément l’unité naturelle de cette multiplicité[175]. Le but de cette première démarche, que précédemment Platon a fondée sur la réminiscence (249 bc), est de définir en son essence l’objet que l’on considère : c’est ainsi que le premier soin de Socrate, en reprenant le thème de Lysias, a été de définir l’amour dans l’unité totale de son essence (263 d déb. ; cf. 277 b 6 et 262 b fin) ; il n’y a pas en effet d’autre moyen de rester, dans la déduction des conséquences, conséquent avec soi-même. — La seconde démarche est donc l’inverse de celle-ci : elle consiste à spécifier l’unité définie dont elle part, et elle cherche à reconnaître quelles formes sont enveloppées dans sa nature et dépendent de cette nature ; on découpe l’unité selon ses articulations naturelles, autrement dit selon ses espèces[176]. L’unité dont il s’agit est en effet comparable à celle d’un être vivant : le découpage ne doit donc pas se faire à l’aventure, mais selon la division naturelle des membres, dont l’ensemble solidaire exprime la constitution de cette individualité vivante. De même que nous y voyons une semblable partie, œil, oreille, bras, jambe exister à droite et exister à gauche, de même, après avoir dit indistinctement que l’amour est un délire, nous nous sommes aperçus que, après avoir dans le premier discours vilipendé l’amour en tant que délire, on l’a dans le second loué au contraire, et encore en tant que délire. Or cette façon de passer du blâme à l’éloge à l’intérieur d’une forme cependant commune (cf. 265 a, c), est particulièrement instructive. Elle montre que, dans cette forme commune, il doit y avoir une espèce gauche et une espèce droite : un délire humain et un délire divin, un amour qui est une sous-espèce de cette première espèce de délire, et un autre amour qui est une des formes comprises dans la seconde espèce. Cette seconde espèce comporte d’ailleurs des sections, dont tout le monde admet qu’elles en sont des manifestations particulières (244 a sqq., 265 b) ; ce qu’il s’agit de faire en établissant que l’amour droit est un amour inspiré des dieux, c’est d’introduire en elle une subdivision de plus. Cette spécification, ajoute Platon, devra se poursuivre jusqu’à ce qu’on ait atteint l’espèce indivisible (277 b) ou, ce qui revient au même, la forme de la chose envisagée[177], car dans cette forme on n’aperçoit plus de contrariété, donc plus de différence pouvant donner lieu à un sectionnement. Elle est le dernier échelon de la descente.
Ainsi les deux démarches seraient liées comme la montée et la descente. Mais, comme la montée s’est souvent faite d’un bond dans la direction de l’unité qu’on suppose être au sommet et sans tenir compte de tous les degrés qu’il doit y avoir entre ce sommet et la base à laquelle est accoutumée notre expérience, rien n’assure que nous ne nous sommes pas lancés dans une fausse direction. Il faut donc que, à partir de notre point d’arrivée, nous cherchions maintenant sous nos pieds un premier appui, puis un autre après celui-là, et ainsi de suite jusqu’à ce que nous retrouvions notre base initiale. C’est à la solidarité même de ces deux démarches que Platon se dit fermement attaché, à la solidarité du « rassemblement » qui unifie et de la « division » qui détaille (266 b ; cf. 273 e déb.). Ceux qui sont capables de faire l’une et l’autre sans les séparer, ceux-là, dit-il (266 c fin et 269 b), à tort ou à raison jusqu’ici je les appelle des « dialecticiens ». La raison de cette dénomination est supposée déjà connue : c’est qu’elle se fonde essentiellement sur l’emploi du dialogue ; on le voit dans le Phédon (73 a, 75 d, 78 d ; cf. p. 12, n. 1 et p. 31, n. 1) quoique le mot « dialectique » ne soit pas prononcé, mais plus clairement encore dans le Cratyle (390 c ; cf. aussi Ménon 75 d) où c’est par là qu’il est explicitement défini. Que le dialogue soit indispensable à la première des deux démarches, les dialogues de jeunesse, avec les inductions qui y sont le but d’une recherche en commun, suffiraient à le prouver. Pour se convaincre d’autre part qu’il n’est pas moins nécessaire à la seconde démarche, on n’a qu’à songer au Sophiste et au Politique.
La division.
L’insistance avec laquelle est soulignée dans le Phèdre l’importance de la division, la place qu’elle tient dans les deux dialogues qu’on vient de nommer, tout cela suggère qu’en ce point le Phèdre apporte une vue nouvelle sur la méthode. Le Sophiste (253 cd[178]) et le Politique (285 ab, 287 c) exposent la fonction de ce procédé presque dans les mêmes termes que le Phèdre. Mais c’est peut-être le Philèbe, écrit tardif lui aussi, qui commente avec le plus de précision (15 c-18 d, surtout 16 c-e) la pensée de notre dialogue. Enfin le XIIe livre des Lois (963 a sqq., surtout 964 a, 960 b-d, 966 a) en est encore une illustration par la façon remarquable dont il applique au problème moral la méthode de division. — Un double mouvement de pensée est envisagé. On part d’une multiplicité confuse et indéterminée, mais dans laquelle on a aperçu une certaine diversité spécifique que signale à notre attention une certaine contrariété ; il y a donc là quelque chose qui déjà nous élève au-dessus du point de vue de la perception sensible[179]. Or, en essayant de surmonter cette contrariété, on s’élève à une unité déterminée, définie, et qui doit être assez large pour envelopper en elle les deux termes de la contrariété en question, de sorte que, du point de vue supérieur où on s’est élevé, celle-ci disparaîtrait. Mais on peut s’être trompé ; il est possible en effet (cf. p. cliv, n. 1) que cette unité soit trop étendue, que par conséquent elle ne soit pas l’unité naturelle dans laquelle se fondra la multiplicité considérée. Il faut donc revenir sur ses pas, et cela progressivement, en observant un ordre régulier de consécution et en dénombrant exactement les étapes. À la place de la multiplicité indéterminée du début, on se trouve maintenant en face d’une multiplicité définie, celle qui est faite de toutes les différences, différences analogues à la contrariété par laquelle initialement la réflexion avait été mise en branle, qui auront successivement été aperçues dans l’unité à laquelle on s’était élevé ; ce sont ces différences qui donneront lieu à constituer des espèces distinctes. On poursuivra de la sorte jusqu’à ce qu’on arrive à une « forme » dans l’unité de laquelle on n’apercevra plus aucune différence qui puisse se définir et donner lieu, par conséquent, à un progrès dans la spécification : c’est l’espèce indivisible. Au delà, l’unité se perdra dans l’infinité des existences individuelles, qui ne se distinguent plus les unes des autres par des caractères définissables et nombrables ; ainsi donc on en revient, mais par degrés, à la multiplicité confuse de laquelle on avait dans le premier moment tenté de s’évader. C’était en effet un essai : il fallait en contrôler la valeur, et c’est le rôle de la division : celle-ci est donc le procédé capital de la dialectique en tant que méthode de la science. Du sensible on est allé vers l’intelligible, et c’est par l’intelligible que l’on revient au sensible ; d’un terme à l’autre la dialectique se meut donc continuellement dans le plan de l’intelligibilité, et c’est ce que déjà disait la République (VI 511 bc) mais sans s’expliquer suffisamment : utiliser les Idées mêmes, en laissant de côté le sensible, pour aller aux Idées par le moyen des Idées et, en terminant, aboutir à des Idées.
Philosophie.
Toutefois, quand on dit de la dialectique qu’elle est la méthode même du savoir en tant qu’elle fait place à la division, il faut bien s’entendre. Cela n’est vrai en effet que d’une aspiration vers le savoir, avec laquelle la possession même du savoir ne saurait être confondue (278 c et cf. Banquet 203 e sq.). Si la division consiste à déduire le sensible en faisant le compte des intermédiaires qui le séparent de l’intelligible, n’est-ce pas le signe d’une renonciation de l’intelligence, puisqu’en atteignant l’espèce indivisible elle avoue son impuissance à spécifier davantage ? L’infinité du sensible n’est peut-être qu’une complication du défini, c’est-à-dire de l’intelligible, mais c’est une complication rebelle à toute détermination et devant laquelle vient échouer l’intelligence humaine. Bref, entre l’infini et le fini il n’y a de commune mesure que dans certaines limites. Autrement dit, pour qu’il y ait une « philosophie », un effort vers le savoir qui ne soit jamais entièrement ni définitivement satisfait, il faut que toujours de l’infini subsiste comme tel à titre d’irréductible inintelligibilité. Or Platon, en nommant dans le Phèdre le « dialecticien », a indiqué que c’était là une dénomination provisoire. Est-ce à dire que, l’ayant jusqu’alors employée, il veuille désormais y renoncer ? Non sans doute, puisqu’il s’en sert encore comme d’un terme technique dans le Sophiste, dans le Politique et dans le Philèbe. C’est à l’intérieur même du Phèdre qu’elle est provisoire, et de fait, quand il cherche quel nom convient à l’homme qui pratique un art de la parole fondé sur le savoir, c’est un autre nom qu’il propose, celui de « philosophe » (278 cd). Qu’il y ait à cette substitution un motif particulier, c’est probable (cf. p. clxx sq.) ; ce qui est certain, c’est qu’il souligne à ce propos l’indication sur laquelle je viens d’insister. Ainsi, la dialectique serait « philosophie » en tant qu’elle est, comme l’amour, une aspiration toujours renaissante, un effort vers le savoir et qui se renouvelle incessamment : de même que, de nature, il y a dans l’amour, à côté d’une déficience irrémédiable, un élan intérieur pareillement indéfectible (cf. Banquet 203 c-204 b), ainsi la philosophie, comprise comme elle doit l’être, comme « la science des hommes libres » (Sophiste 203 c), est une chose vivante et féconde, pour qui les échecs auxquels elle se sait promise seront toujours la raison de nouveaux efforts. Peut-être est-ce pour n’avoir pas compris ce lien de l’amour spirituel et de la philosophie, pour avoir fait de celle-ci une chose définitive et l’objet d’un enseignement figé, qu’Aristote a méconnu la dialectique de son maître. Il l’exclut en effet du nombre des sciences auxquelles, à des degrés divers, il réserve le nom de « philosophie ». Dans le groupe des sciences qu’il nomme « poétiques » et qui étudient les conditions de la création d’une œuvre de la pensée, discours ou poème, la dialectique représente pour lui la science architectonique : c’est qu’elle est, dit-il, celle du vraisemblable et du persuasif. Quoi qu’on puisse dire de l’influence des vues de Platon sur la Rhétorique et sur la Poétique d’Aristote, il n’en est pas moins vrai que, par là, Aristote a complètement trahi la conception platonicienne d’un art de parler qui se fonderait sur un savoir réel, unissant de façon nécessaire à la connaissance du beau et du vrai celle du juste et du bon.
L’Idéal.
Il se peut que cette conception soit chimérique. Le problème qu’elle pose à propos de l’art de parler, c’est en somme le problème général du réalisme et de l’idéalisme dans l’art, et souvent Platon a été rendu responsable des vices de l’art idéaliste, de ce qu’il a d’artificiel et d’abstrait. Or, ce qu’il a voulu dans le cas dont il s’agit, c’est qu’on ne fît pas consister l’art de la parole en artifices conventionnels propres à produire l’illusion et à dénaturer la réalité des valeurs morales ; c’est que, au lieu de s’appliquer à imiter le travestissement qu’inflige à ces valeurs une vie sociale corrompue, on fît effort pour en imiter la réalité vraie, en se donnant toutes les peines imaginables pour la chercher et pour la déterminer par la pensée avec exactitude. Qui voudrait lui en faire un grief ? Il l’a dit, dans le Phèdre même, avec une force admirable (273 e sq.) : il ne s’agit pas de parler de façon à complaire aux préjugés et aux mensonges de la société dans laquelle nous vivons ; ce qu’il faut, c’est chercher inlassablement la vérité et avoir le courage de la dire ; par là se justifie la pénible longueur d’un si grand effort, et celui-ci communique aux discours qui en sont les fruits sensibles la beauté de l’idéal vers lequel il tendait.
IV. Interprétation historique. — Quelles que soient les différences de l’attitude actuelle de Platon à l’encontre de la rhétorique, comparée à celle que manifestait le Gorgias, c’est encore une opposition très vive. Ceux qui estiment que dans le Phèdre elle s’est considérablement atténuée, que Platon y distingue entre l’École sicilienne et une École attique dont Gorgias serait le chef et pour laquelle il aurait plus d’indulgence, ceux-là n’ont guère d’autre raison de le penser que le compliment final adressé à Isocrate, élève de Gorgias. Mais c’est justement une question de savoir si c’est bien un compliment. Or on ne peut, sans pétition de principe, juger de l’attitude présente de Platon en se fondant sur un passage dont l’interprétation est subordonnée à ce jugement même. Il faudrait en outre savoir de façon certaine si c’est réellement contre le seul Lysias qu’est menée la bataille. Par malheur, notre connaissance des milieux littéraires du ive siècle n’est ni assez complète ni assez précise. Faute de pouvoir établir avec quelque assurance la relation chronologique des œuvres, nous ne pouvons, sans risquer de nous fourvoyer complètement, faire l’histoire des polémiques dont ces œuvres portent la trace. Sur ce point encore le vice des inférences est le même : tantôt on conjecture les dates d’après l’opinion qu’on s’est faite sur le sens de la polémique, tantôt c’est la date, gratuitement supposée, qui sert à fonder cette opinion. Une seule chose ici n’est pas douteuse : c’est que la critique de la rhétorique dans le Phèdre suppose de multiples relations et que l’histoire de ces relations nous est très mal connue. Peut-être est-il impossible de ne pas en effet mêler quelque hypothèse à une simple exposition des données du problème, tel qu’il se présente dans le Phèdre ; on laissera du moins à de plus perspicaces le mérite de le résoudre.
Les rhéteurs mentionnés.
Notre dialogue nomme pêle-mêle (266 e-267 c ; cf. 261 cd) une dizaine des maîtres de la rhétorique et, détachés de cette énumération, Lysias dès le commencement et jusqu’au voisinage de la fin, Isocrate dans la dernière page seulement, d’une façon d’ailleurs tout à fait imprévue et sans que jusqu’alors son nom ait été une seule fois prononcé. D’autre part, cette énumération associe des hommes d’époques très différentes et dont le rôle dans l’histoire de la rhétorique n’est, semble-t-il, ni du même ordre, ni de la même importance : manifestement, c’est l’esprit de la rhétorique qui intéresse ici Platon, bien plutôt que la contribution successive de chacun de ses protagonistes au développement de l’Art. On peut donc penser qu’il a surtout affaire à la rhétorique telle qu’elle se pratique et s’enseigne au temps où il écrit et, par conséquent, aux rhéteurs alors les plus en vue. Souvent il a l’air de n’employer les noms propres que pour donner à l’argumentation une couleur individuelle : ici, c’est Lysias ou un autre (258 d, 272 c, 277 d) ; là, Tisias ou tout autre (273 c) ; ailleurs, expressions analogues à propos de Thrasymaque (266 c, 271 a) ; ou bien encore une citation, qui sera ensuite déclarée littérale, est cependant introduite dans les termes les plus généraux, comme représentant le langage de ceux qui s’occupent de cela (272 c sqq., 273 a) ; mais une autre, par contre, est un peu plus loin mise expressément au compte de Tisias (273 bc).
Passons à l’examen des noms qui composent l’énumération même. Pourquoi l’un des premiers est-il celui de Zénon, « le Palamède d’Élée », le héros subtil à qui serait due l’invention de la dialectique ? Difficilement on croira qu’en lui Platon voie un représentant de la rhétorique ; pas davantage, qu’il confonde avec la controverse chicanière et vide des rhéteurs une dialectique sérieuse, qui s’est mise au service d’une philosophie qu’il critique sans la repousser tout entière : Zénon, c’est en effet le défenseur du « vénérable » Parménide (cf. Parménide 128 c-e), et ses héritiers, ce sont ces Socratiques de Mégare pour qui Platon a de l’amitié. S’il lui donne cette place, ne serait-ce pas plutôt qu’il songe à une autre dialectique, la sienne ? Mais la dialectique de Zénon a donné naissance à une éristique, à la dispute philosophique ou à l’escrime rhétorique (par exemple dans l’écrit de Gorgias Sur le non-être), peut-être même, dans son pays d’origine, à la chicane judiciaire. Or ce sont des tares auxquelles sa dialectique échappe, et la rhétorique qu’elle doit fonder sera d’une autre sorte. — Ce sont ensuite les procédés classiques de la rhétorique qui, au hasard de la rencontre, lui suggèrent les noms des maîtres (cf. p. 74, n. 2). Or les uns sont des Sophistes qui furent rhéteurs, soit qu’ils appartiennent, comme Protagoras, Prodicus, Hippias, à la première génération sophistique, ou bien à la seconde, comme Gorgias[180], Polus[181], Évènus ; d’autres sont des spécialistes plus définis de la pure rhétorique et, particulièrement, de la technique du plaidoyer, comme Tisias lequel n’a peut-être pas, autant qu’on le veut parfois, le rôle d’un initiateur[182], Thrasymaque (celui dont le nom revient le plus souvent) qui était vraisemblablement déjà connu à Athènes avant que Gorgias y vînt, Théodore de Byzance enfin, qui paraît avoir été un vieux contemporain de Lysias. — Si maintenant, par rapport à ces maîtres, on tente de marquer la filiation des deux hommes qui, dans le Phèdre, sont les protagonistes de la rhétorique, c’est à Tisias qu’on rattachera Lysias, mort vers 385, et à Gorgias, Isocrate qui est encore en vie. — Notez enfin qu’à l’énumération il manque deux noms importants : celui d’Antiphon de Rhamnonte[183] qui, contemporain de Gorgias, aurait été cependant son élève et qui périt en 411 ; celui d’Alcidamas, autre disciple de Gorgias et son successeur, dit-on, à la tête de l’école, contemporain de Platon et rival d’Isocrate, un rhéteur dont nulle part Platon n’a prononcé le nom et que pourtant il a cité au moins une fois[184]. J’observe simplement le fait, sans prétendre en rien inférer quant aux motifs de ce silence.
Parallèles.
Ceci dit, envisageons les parallèles qu’on peut trouver entre les thèmes du Phèdre et ceux de la rhétorique contemporaine. La plupart me semblent être d’une signification médiocre par rapport à la position chronologique réciproque des écrits en cause et, par conséquent, peu décisifs sur la question des emprunts. Dans un milieu restreint, où certaines questions sont au même moment sur le tapis, il est fatal que reviennent les mêmes expressions sous la plume de divers auteurs, et une revendication de priorité en faveur de tel ou tel semble par là-même fort compromise. De plus, la comparaison des textes fait apparaître à quel point les ressemblances sont extérieures et touchent peu le fond même de la pensée.
Entre tous ces parallèles celui dont on fait le plus volontiers état est celui qui concerne la supériorité du discours vivant sur le discours écrit. On sait assez ce que Platon entend par là (p. lii sq., p. cxli, p. clii). Or, quel est à ce sujet le point de vue d’Isocrate ? C’est qu’il y a des inconvénients à exposer ses idées à quelqu’un dans une lettre ou tout autre écrit et que le tête-à-tête est préférable (cf. Phèdre 275 e 3) : si en effet celui à qui on s’adresse n’est pas instruit de quelque point ou qu’on ne l’ait pas convaincu, on pourra alors lui expliquer ce qu’il ignore ou répondre à ses objections et, de la sorte, défendre ses idées (cf. Phèdre 275 e 5, 276 a 6) ; mais, si l’on n’est pas là, c’est une assistance qui fait défaut autant au correspondant qu’au lecteur lui-même (Lettre à Denys le tyran I 2 sqq.). Pour Platon c’est à l’œuvre écrite, en tant que telle, que manque cette assistance (275 e 5, 276 e 9, 277 a 1, 278 c 6). La pensée d’Isocrate est encore que ce qui manque à l’écrit pour être persuasif, c’est l’autorité personnelle de l’orateur, l’accent de sa parole, l’appui des conjonctures (καιροί) et de l’intérêt qu’offre présentement pour un auditoire l’affaire dont on lui parle ; aussi, ajoute-t-il, n’a-t-on pas tort de surtout voir dans l’écrit une composition d’apparat (ἐπίδειξις) et l’exécution d’une « commande », tandis que les choses sérieuses exigent le discours parlé (Philippe 25-27). Or ces déclarations semblent avoir pour but principal, dans l’intention d’Isocrate, de prévenir cette objection que, puisqu’il s’est avéré incapable de devenir un orateur politique, autrement dit un homme public, les questions sérieuses de la politique lui sont par là même interdites. — Quant à Alcidamas, il avait expressément envisagé la question dans un traité spécial : Sur ceux qui écrivent des discours ou Sur les sophistes, dont l’authenticité est aujourd’hui généralement admise et dans lequel, en tout cas, on s’accorde à voir une attaque contre Isocrate. Or le point de vue d’Alcidamas n’est pas moins éloigné de celui de Platon, en dépit d’analogies d’expression plus nombreuses. Les gens qu’il vise, ce sont ceux qui mettent leur fierté à écrire des discours où ils prétendent faire montre de leur savoir (σοφία ; cf. Phèdre 258 a 7), simplement parce qu’ils sont aussi impuissants à parler que le premier venu. Ils ne comprennent pas qu’écrire n’est qu’un amusement (παιδία ; cf. 276 b-e, 277 b, 278 d) et un passe-temps ; que le discours écrit est une vaine image, comme celles de la peinture et de la sculpture, tandis que le discours parlé est animé, vivant, adapté aux choses (cf. 275 d, 276 a 9) ; que cependant on peut, en certains cas, user de l’écrit comme d’un miroir où l’on contemplera plus aisément ses progrès passés (cf. 276 d). Gardons-nous donc de nous mettre à l’école de gens qui sont seulement des faiseurs de discours, mais non des maîtres (σοφισταί) capables, ainsi qu’ils le promettent, d’instruire autrui, et qui se font en réalité de la rhétorique et de la « philosophie » une idée inférieure (Sur les sophistes 1 sq., 15, 27-30, 32, 35 ; cf. 12). Sur ce dernier point la suite offrira l’occasion de revenir pour en préciser l’intérêt (cf. p. clxx sqq.).
Ce premier parallèle ne semble donc être nullement décisif. À plus forte raison en serait-il de même pour d’autres rencontres analogues. Ainsi, les trois écrivains sont d’accord pour affirmer la nécessité d’adapter le discours aux circonstances dans lesquelles il se produit (καιρός). Mais ce qui, chez Isocrate (Contra Soph. 12 sq., 16 et al.) et chez Alcidamas (3, 9 sq., 22, 28, 33 sq.), est plutôt une agilité à saisir l’occasion et à profiter de conjonctures accidentelles, signifie chez Platon un discernement méthodique, fondé sur une connaissance réelle des genres d’âme et des genres de discours qui y correspondent (271 c-272 a, 278 e). — Les trois conditions qui, d’après le Phèdre (269 d), sont nécessaires pour devenir un orateur accompli se retrouvent chez Isocrate (C. Soph. 17 et cf. 14 sq. ; Antidosis 186-189). Mais ce n’est là qu’un lieu commun, et il n’y a pas matière à parler d’emprunt, de l’un quelconque des deux à l’autre. Au surplus ces trois conditions, Platon les a remplacées, on l’a vu (p. cxlvii sqq.), par trois autres, dont le caractère est nettement technique. — De même, la « logographie » est condamnée par Platon (257 c-258 d), par Isocrate (Antidosis 2, 40-42, 48 fin ; cf. C. Soph. 20) et par Alcidamas (Soph. 13). Mais ce n’est pas dans le même esprit : Alcidamas cherche à atteindre Isocrate où le bât le blesse ; celui-ci proteste que, ruiné, il n’avait pas d’autre moyen d’existence ; Platon enfin estime qu’en soi l’acte d’écrire des discours n’aurait rien de blâmable s’il ne se faisait avec une telle malhonnêteté (272 de, 273 bc). Beaucoup d’autres exemples encore pourraient être cités[185], qui feraient apparaître, sinon la fragilité, du moins l’inutilité de tels rapprochements, pour mieux connaître le jeu des polémiques.
Oppositions.
Il y a, par contre, un avantage positif à noter les points sur lesquels une divergence se manifeste : on voit ainsi où sont les oppositions et en quoi elles consistent. — Une première opposition, tout extérieure en apparence, mais fort importante en un temps où le métier salarié déconsidère celui qui l’exerce, apparaît à propos de la rétribution de l’enseignement. Or Isocrate se faisait payer très cher, dit-on ; et, comme ses élèves étaient nombreux, il avait gagné une grosse fortune (Antid. 41, 86 sq., 159 sq.). Platon, riche personnellement, ne demandait au contraire de contribution aux élèves de l’Académie que pour l’entretien de l’école. Si cette contribution n’avait pas été plus modeste que le salaire exigé par les maîtres de rhétorique, pourquoi attirerait-il railleusement l’attention sur les dons que, pareils à des rois, ceux-ci daignent accepter de leurs disciples (266 c) ? De son côté Isocrate s’excuse, quand il reproche à ses rivaux de déprécier un enseignement auquel ils attribuent une si haute valeur, en le donnant à si bas prix et en affectant de préférer l’immortalité à tous les biens de la terre (C. Soph. 4, 7, 13 fin ; cf. Busiris 1). Évidemment il s’adresse à des concurrents déloyaux qui « gâtent le métier », et on peut penser qu’en fait il vise spécialement Platon. Au reste, si l’école d’Isocrate coûte cher, du moins n’y reste-t-on pas plus longtemps qu’il ne faut : sa méthode est la plus expéditive qui se puisse et la plus dégagée de toute superfétation oiseuse (Antid. 271). Une telle prétention se retrouvait vraisemblablement chez d’autres Maîtres. Toujours est-il que Platon la relève comme on sait (272 b-d ; cf. p. cxlvi et p. clii). — Que maintenant on envisage en elle-même cette méthode : Isocrate est fort embarrassé pour définir la place qu’y occupe l’invention et pour en caractériser le rôle. Sans doute est-ce à certains de ses émules qu’il s’en prend, quand il rejette la comparaison de la rhétorique avec l’éducation de l’orthographe : ce sont, dit-il, toujours les mêmes lettres qui servent, tandis que la rhétorique est un art créateur. À ses yeux, le meilleur technicien est celui qui, parlant comme l’exigent le sujet et les circonstances, sait renouveler un sujet ; qui est capable d’inventer une façon de le présenter différant entièrement de celles auxquelles on a eu recours avant lui ; il saura notamment rapetisser ce qui est grand et grandir ce qui est petit ; il donnera à l’antique (par ex. la politique de Thésée) un air de nouveauté et à ce qui est nouveau un air d’antiquité (C. Soph. 12 sq. ; Panég. 8 ; cf. Hél. 35 sq.). Or, on doit reconnaître que c’est difficile lorsqu’on parle sur un sujet connu ; que ce talent est avant tout un don naturel, lequel peut à la vérité se développer par l’éducation (Hél. 13 ; cf. Philippe 84 fin, C. Soph. 14 sq.). Mais finalement ce pouvoir de création se réduit à choisir dans chaque cas les « formes » oratoires (ἰδέαι) les mieux appropriées, à les mélanger entre elles et à les ordonner ou les arranger comme il faut, en donnant à la langue du rythme et de l’harmonie, sans tomber pourtant dans le style poétique (C. Soph. 16 sq. ; Antid. 46 sq. ; Évagoras 8 sq.) Chacune de ces thèses impose le souvenir de quelque proposition du Phèdre, qui en est l’exact contrepied. Qu’on interprète comme on voudra cette symétrie dans le contraste : je me borne à la constater. Ainsi, ce n’est pas de sa faute si Socrate a abusé du style poétique (257 a) ; quand sur le sujet on a dit ce qu’il y a à dire, il est bien inutile de le reprendre sous des formes différentes ; et se croire alors à même de dire autre chose, c’est le fait, non pas du meilleur technicien, mais d’un écrivain au-dessous même du médiocre ; s’il n’est question que de tourner les choses autrement, c’est simple affaire d’arrangement et il n’y a pas là la moindre parcelle d’invention (234 e-235 b, d-236 a), pas plus qu’il n’y a de mirifique découverte à changer l’apparence des choses pour tromper sur leur réalité (267 ab ; cf. p. cxlvi).
Nous touchons ici à une opposition aussi nette que profonde : à quoi doit avoir égard l’orateur ou l’écrivain ? est-ce à l’opinion de ceux qui l’écoutent ou le lisent, à la δόξα ? est-ce au savoir et à la connaissance du vrai, ἐπιστήμη ? À entendre le langage que Platon fait tenir à la Rhétorique et aux rhéteurs, la réponse ne saurait être douteuse : « Apprenez, si vous voulez, à connaître la vérité par ce qui s’appelle le savoir : que ce soit du moins au commencement, et sans vous attarder à une étude qui ne vous servira absolument de rien pour apprendre à persuader. Si c’est en effet la persuasion qui est le but de l’orateur, il n’y a que nous pour en enseigner l’art. Or le principe de la persuasion n’est pas du tout la vérité : c’est la vraisemblance, à telle enseigne que, si le vrai est invraisemblable, il vaut mieux le taire et que, au contraire, le vraisemblable peut servir à faire douter de la réalité du vrai. C’est donc qu’il est beaucoup moins utile de connaître la vérité que de savoir quelle peut être l’opinion des gens à qui l’on s’adresse » (260 a, d ; 262 c déb. ; 272 de ; 273 a-c ; 277 e déb.). — Tout au contraire, d’après Platon, s’il y a un homme à qui il appartienne, et encore seulement pour s’amuser, d’employer la parole à égarer ses auditeurs, c’est uniquement celui qui sait la vérité (262 d). Ce qui prétend être indépendant d’un tel savoir, et par conséquent la pure instruction rhétorique, voilà ce qui en réalité ne saurait être rien de plus qu’une préparation à ce qu’il est nécessaire d’apprendre (269 bc). — Interrogeons à présent l’ « honnête » Isocrate. On verra sans peine que la thèse qui, selon Platon, est celle de la Rhétorique et des rhéteurs, c’est justement la sienne : il se contente d’en dissimuler les conséquences scandaleuses. Pareil en cela au Calliclès du Gorgias (485 a-d), il engage les jeunes gens à consacrer un peu de temps à étudier les théories de ceux qui s’intitulent « philosophes », mais à ne pas s’y dessécher l’esprit. Comment de pareilles méditations serviraient-elles jamais à la conduite de nos affaires ou de celles de l’État ? Il n’y a rien là (exception faite du profit qu’y trouvent les gens qui en font commerce !) qu’une gymnastique de l’esprit et une préparation à des études plus sérieuses et les seules qui soient utiles (Antid. 261-269, 285). Les gens qui se livrent à des occupations de cette sorte et qui se flattent de posséder le savoir sont incapables de donner le moindre conseil pratique : on a bien raison de les mépriser comme des diseurs de riens et de tenir leurs études, sans rapport avec la culture de l’âme, pour un vain bavardage (ἀδολεσχία ; cf. Phèdre 270 a déb.). Ceux qui en jugent ainsi sont au contraire des hommes de bon sens, qui au lieu de faire des embarras pensent comme tout le monde ; qui préfèrent à la prétendue rigueur d’un savoir vide les opinions généralement reçues. C’est un enfantillage de croire qu’elles puissent être remplacées par des paradoxes auxquels personne, sauf des très jeunes gens n’ajoutera foi ; ce que demande au contraire la rhétorique, c’est de la virilité dans le jugement, et là est le secret de la vérité (Nicoclès 41 ; C. soph. 8, 17 ; Hél. 1, 5, 7, 11 ; Antid. 84 ; Panathénaïque 234 d sqq.). C’est pourquoi il est indispensable, si l’on veut être persuasif, de ne rien dire qui heurte les opinions accréditées. Bien plus, on doit les utiliser pour le succès de la cause qu’on soutient : ainsi, ce qui est reçu pour être une belle qualité, on en exagérera l’existence en celui dont on fait l’éloge ; ce sera l’inverse si on est accusateur (Antid. 273 ; Busiris 4).
La dénomination de philosophe.
Cette opposition du vrai savoir et de l’opinion, de l’ἐπιστήμη et de la δόξα s’exprime d’une façon particulièrement significative dans la dénomination que, de l’un et l’autre côté, on revendique pour l’enseignement. — Rappelons tout d’abord comment au poète, au faiseur de discours, à l’auteur de textes de lois, le Phèdre (278 c-e) oppose son dialecticien ; comment il réclame pour celui-ci, non pas le nom de sage ou de savant, mais celui d’homme qui aspire à la sagesse et au savoir, celui de « philosophe » ; parfois, comme si une équivoque était à craindre, il spécifie que le « philosophe » dont il parle est celui qui l’est « loyalement », « dignement » et « au sens droit » du terme[186]. Or ce nom est celui que se donnait Isocrate, et il serait fastidieux de mentionner tous les passages où ce qu’il enseigne est appelé par lui « philosophie ». C’est du reste un nom qu’Alcidamas (2, 15) lui reproche de s’arroger, sans cependant douter lui-même, semble-t-il, que « philosophie » soit le vrai nom de la rhétorique. — Puisque ce titre était disputé par deux méthodes rivales de culture, ce qui nous intéresse particulièrement c’est de savoir sur quelles raisons Isocrate appuyait sa revendication. La connaissance absolue de ce qu’il faut dire ou faire est, disait-il en substance, impossible à la nature humaine. Aussi la sagesse (σοφία) consiste-t-elle pratiquement dans le bon sens (φρόνησις), une certaine rectitude de jugement qui, dans la plupart des cas (ὡς ἐπὶ τό πολύ), permet de trouver l’opinion qui vaut le mieux. Cette justesse d’esprit, quoiqu’elle soit le plus souvent un don naturel, peut être néanmoins acquise, doit en tout cas être cultivée : ce qui se fait, avec toute la rapidité possible, au moyen de certaines études et pratiques, auxquelles le nom de « philosophie » sera légitimement réservé ; culture de l’âme analogue à ce qu’est la culture du corps par le moyen de la gymnastique (Antid. 270 sq., 181). Ainsi, au lieu d’être un effort, qui n’est jamais entièrement contenté, vers un savoir toujours supérieur au plan humain, la philosophie serait une méthode toute pratique pour s’élever à ce qu’il y a, dans ce plan même, de meilleur par rapport aux croyances communément reçues. Quant à la philosophie des soi-disant philosophes, Isocrate l’englobe tout entière, comme fait Platon pour la rhétorique des rhéteurs, dans le même mépris et la même hostilité. Sans doute, au début de l’Éloge d’Hélène, fait-il des distinctions. Mais, si elles sont obscures pour nous, on peut se demander si elles avaient dans sa propre pensée quelque précision. Disputes logiques, recherches sur la nature des choses, étude de la géométrie et de l’astronomie, enseignement scientifique de la vertu et de la politique, prétention d’atteindre la vérité, tout cela est mis pêle-mêle. S’il est certain qu’Antisthène et les Cyniques sont visés, s’il est très probable que les éristiques de Mégare le sont également, il n’est guère douteux d’autre part que Platon, surtout après la fondation de l’Académie, ait été pour Isocrate un concurrent plus redoutable qu’aucun des philosophes et qu’aucun autre parmi les maîtres de rhétorique. Quand donc Isocrate parle de disputeurs ou d’ « éristiques » qui se targuent de chercher la vérité et puis, tout aussitôt, se mettent à débiter des mensonges ; quand il parle de dialogues éristiques qui ne sont bons qu’à amuser une jeunesse inexpérimentée, de controverses par demandes et réponses[187] ; quand il dit de tout cela, aussi bien que des spéculations sur la Nature, que c’est jonglerie, parade de foire, monstruosité de la pensée, — il est impossible que Platon ne soit pas compris dans cette réprobation. Isocrate ne peut consentir qu’il décore du beau nom de « philosophie » une étude dont l’ambition n’est d’aucune utilité ni pour la parole ni pour l’action[188].
Les relations personnelles d’Isocrate et de Platon.
Mais, dit-on, cette hostilité contre le chef de l’Académie n’a pas toujours existé ; Antisthène est pour tous les deux l’ennemi commun ; le Discours contre les Sophistes témoigne de ménagements à l’égard de Platon. C’est un témoignage, à vrai dire, qui n’est pas d’une évidence aveuglante ; en jugerait-on de même si l’on n’était pas obsédé par le compliment final du Phèdre ? On fait en outre état de quelques assertions de Diogène Laërce, à l’appui desquelles il nomme ses autorités : Isocrate aurait fait à Platon une visite dans la maison de campagne de ce dernier et leur entretien aurait porté sur les poètes (III 8) ; Speusippe, le neveu de Platon aurait le premier donné la clef de ce qu’on appelle les « secrets » d’Isocrate (IV 2). Mais, s’il est vrai que ces « secrets » soient ceux des variations d’Isocrate dans son attitude envers la Macédoine[189], on y verrait un indice d’hostilité plutôt que d’amitié de la part des Platoniciens[190]. Quant à la première assertion, elle est vraisemblablement une fiction de Praxiphane, qui en avait fait le sujet d’un dialogue de sa composition. En fait, il paraît difficile que Platon ait pu avoir beaucoup de sympathie pour l’homme et l’écrivain qu’était Isocrate : ce sont deux esprits dont la structure et l’orientation sont diamétralement opposées. On s’est donné une peine infinie pour essayer de prouver qu’Isocrate ne doit pas être reconnu dans le personnage hybride dont Platon avait fait le cruel portrait dans son Euthydème (305 c-306 c ; cf. la Notice de L. Méridier p. 133 sqq.) ; peut-être se refusera-t-on aussi à voir dans le discours du Pausanias du Banquet une parodie de la manière d’Isocrate (cf. ibid. Notice, p. xl sqq.) ; peut-être n’est-ce pas non plus à lui que devrait se rapporter, contrairement à ce que je crois (cf. ibid.), le passage de la République (VI 498 c sqq.) où c’est le nom de Thrasymaque qui est prononcé. Ce qui du moins est certain, c’est que, dans l’Antidosis (qui est de 354/3) Isocrate parle d’ennemis cachés derrière ceux qui l’attaquent ouvertement, à peu près comme, dans l’Apologie, Socrate parle d’Aristophane dont les calomnies ont de longue date fait mûrir l’accusation dont il est l’objet. Or il y semble bien avoir en vue une hostilité ancienne et tenace, non pas celle de quelques rhéteurs dont il n’a plus à craindre la concurrence, mais celle de rivaux qui ont su acquérir sur l’esprit de la jeunesse et dans le public une autorité dont il y a lieu pour lui de s’alarmer ; ils sont passés maîtres dans « les discours éristiques » et en même temps ils s’occupent de géométrie et d’astronomie : ce sont eux qui ont été les agresseurs et sur son compte ils ont toujours quelque méchanceté à dire ; sans que leur orgueil soit tout à fait injustifié, il l’est cependant (Antid. 257-261 ; cf. 243-247). Bref, il s’agit d’ennemis qu’il est impossible de traiter par le dédain.
L’éloge d’Isocrate à la fin du Phèdre.
Le Phèdre, dans ses deux dernières parties et, par conséquent, dans son ensemble puisque c’est un tout solidaire, m’apparaît donc comme un réquisitoire contre la rhétorique d’Isocrate[191]. Tous les autres Maîtres dont il est question çà et là ne sont nommés que pour donner le change sur l’intention essentielle. Bien plus, si l’objet principal semble en être constamment Lysias, c’est qu’une aversion personnelle se trouve ainsi satisfaite (cf. p. xix sqq.) ; c’est qu’il n’y avait pas, pour donner au trait final sa véritable valeur, de meilleur artifice que de concentrer l’attention tout entière sur l’homme que le public littéraire se plaisait à mettre en parallèle avec Isocrate. Tout au long du dialogue, c’est le nom de celui-ci que devait attendre le lecteur du temps, et il n’était question que de Lysias ! Ce lecteur ne pouvait cependant manquer, si tout ce qui a été dit plus haut est vrai, de ressentir à quel point s’appliquaient mal à Lysias la plupart des observations de Platon, à quel point au contraire elles portaient contre Isocrate. La brusque apparition de son nom quand la lecture est déjà presque achevée, l’inattendu d’un éloge, tout cela lui révélait enfin que son sentiment ne l’avait pas trompé : le compliment n’était qu’une nasarde, et, dans un éclat de rire, il devait savourer la malice de l’effet comique ainsi obtenu.
Examinons au reste les éléments de l’éloge d’Isocrate. — Il a des dons naturels supérieurs. En effet, c’est ce qui, nous l’avons vu, est à ses yeux la condition fondamentale de l’éloquence ; mais qu’est-ce que cela, pour Platon, sans la philosophie entendue comme une recherche désintéressée de la vérité ? — Il y a dans son caractère une particulière noblesse. Or c’est justement ce que sa vanité solennelle ne cesse de proclamer ; mais, quand on a gagné tant d’argent à enseigner par quels adroits mensonges il est possible de duper autrui, suffit-il pour être cru d’affirmer qu’on est honnête ? — Vient ensuite le pronostic sur ce qu’on peut dans l’avenir attendre d’Isocrate quand il aura un peu vieilli. Mais, à quelque date qu’on place la composition du Phèdre, du moment qu’on renonce à en faire un écrit de jeunesse, certainement alors Isocrate est déjà un vieillard ; chacun est donc à même d’apprécier si ces merveilleuses promesses ont été tenues et si, malgré l’étude et l’exercice, la supériorité de ses dons naturels a produit les effets décisifs qu’elle aurait dû produire. — À la vérité, une pointe s’ajoute ici : cela arrivera, même si son éloquence s’applique encore aux mêmes objets que maintenant. C’est rappeler discrètement à Isocrate, devenu professeur d’éloquence et auteur de discours d’apparat, des débuts dont à présent il rougit et son ancienne carrière de « logographe ». — Mais peut-être ces succès écrasants, que le progrès de l’âge doit assurer à Isocrate, ne lui suffiront-ils pas ; peut-être un élan plus divin le portera-t-il plus haut encore. Ne serait-ce pas une allusion à la prétention qu’a eue Isocrate d’être le conseiller de la politique athénienne, à l’intérieur comme à l’extérieur ? Le Panégyrique d’Athènes, vers 380, en fut la première manifestation. Que peuvent valoir au regard d’un Platon, bâtisseur de la Cité future, de telles ambitions chez cet homme qui n’est qu’un vieux routier de la chicane judiciaire et des artifices rhétoriques ? — On revient pour finir à l’idée initiale des dons naturels : si Isocrate atteint un jour l’apogée de sa gloire, c’est que la nature a mis dans sa pensée une certaine philosophie. Quelle sorte de philosophie ? La sienne évidemment : la philosophie du sens commun, des opinions accréditées, celle qui dédaigne un pur savoir, sans emploi dans la vie pratique, pour ne s’attacher qu’aux moyens de réussir ; bref, tout ce que Platon méprise le plus au monde et contre quoi sa philosophie entière est une ardente protestation. — En résumé donc, si le Phèdre n’est pas une œuvre de jeunesse, il semblera difficile[192] de voir où Platon, même au temps où l’ancien logographe, qui vient d’ouvrir son école, publie le discours Contre les sophistes (391/0), aurait pu trouver matière à honorer sérieusement Isocrate du compliment qui termine le Phèdre.
VII
ÉTABLISSEMENT DU TEXTE ET APPARAT CRITIQUE
Manuscrits.
Des quatre manuscrits qui ont été utilisés pour le Phédon et le Banquet, trois seulement contiennent le Phèdre : il manque en effet dans le Vindobonensis 21, Y[193]. Entre T et W il existe, pour notre dialogue, un accord assez général[194] : ainsi, tous deux ont à 243 d 5 la même faute absurde, ἐπιθυμῶι, l’adscription de l’iôta étant ici dans W d’autant plus singulière qu’elle y est le plus souvent omise[195] alors qu’elle serait nécessaire ; à 244 b 7, après ἐπιμαρτύρασθαι, il y a dans la marge de W un γρ. : ἀπὸ τοῦ ὀνόματος, qu’on retrouve pareillement dans la marge de T (à la vérité, ni dans un cas ni dans l’autre, il ne semble être de la main même du copiste) ; à 272 a 2 ils écrivent tous deux τοῦσδε. — En revanche, un cas comme celui de 261 a 4, où W a ὡς ἐάν, tandis que T a ἕως ἄν semble prouver que W ne dépend pas directement de T. En outre W se distingue de T en ce que, pour la désinence de la 2e pers. du sing. de l’indicatif présent moyen, il écrit constamment ῃ au lieu de ει. — Il est à noter enfin que W paraît souvent s’accorder avec le Vindobonensis 109 (Φ de Bekker, V de Burnet), mais qu’il en semble être pareillement indépendant : à 270 a 5 διανοίας V, ἀνοίας W ; à 270 d 7 οὕτω V, αὐτῷ W ; à 274 d 3 ἥν V, ὅν W[196].
Papyrus.
Quatre papyrus nous ont conservé des débris du texte du Phèdre. — Le premier et le plus important, découvert en 1906 au verso d’un acte d’achat de terrain (no 1016[197] des Oxyrynchus Pap. de Grenfell et Hunt, vol. VII p. 115 sqq.), est du premier tiers du iiie siècle de notre ère. Le début du dialogue jusqu’à 230 e 4 s’y trouve dans un état parfait et avec d’excellentes leçons : ainsi, 228 b 5 πάνυ τι, 7 ἰδὼν μέν, 229 e 4 τοιαῦτα, 230 b 7 ὥς γε. — Découvert en même temps que le précédent, le second (no 1017, p. 127 sqq.) serait un peu plus ancien, peut-être de la deuxième moitié du iie siècle, mais il apporte moins de variantes dignes d’attention. Il a été, plus certainement que l’autre, l’objet d’une revision, dont témoignent des corrections dans l’interligne ou en marge (indiquées dans l’Apparat par « Oxy.² ») et l’addition parfois d’esprits ou d’accents. Sauf une grosse lacune de 240 d 5 à 245 a 5 et quelques autres moins étendues (notamment de 246 c 6 à 247 d 2 et de 248 c 1 à 250 b 2), il contient le texte de 238 c 6 à 251 b 3[198]. — Le fragment contenu dans le troisième (no 2102, vol. XVII ; peut-être de la fin du iie siècle) est beaucoup plus court, 242 d-244 d. C’est très probablement un reviseur qui a ajouté dans ce papyrus les signes diacritiques, la ponctuation, l’indication du changement d’interlocuteur. Il n’y a d’ailleurs rien d’intéressant à en tirer pour le texte. — Plus ancien (première moitié du iie siècle), mais plus bref encore (266 b 1-5, d 1-e 3), est le dernier qui appartient à Columbia University (no 492 A ; désigné dans l’Apparat par « Pap. G ») et qui a été publié par C. W. Keyes dans l’American Journal of Philology (vol. L, 1929, p. 260-262)[199].
Tradition indirecte.
La question du recours à la tradition indirecte ne se pose pas pour le Phèdre tout à fait de la même façon que pour le Phédon ou le Banquet. Il y a lieu de distinguer entre celle qui, comme c’était alors le cas, provient de citations et celle que nous devons au commentaire d’Hermias sur le Phèdre, qui nous a été intégralement conservé[200].
Hermias.
Ce commentaire représente la tradition néoplatonicienne de l’interprétation du Phèdre. Avec Proclus, Hermias (deuxième moitié du ve s.) avait été l’élève de Syrianus, et il est possible qu’il n’ait fait que rédiger, peut-être à la vérité en l’enrichissant de ses propres réflexions, des leçons de son maître sur notre dialogue. Ces leçons semblent avoir eu la forme, alors commune dans les écoles, de la diatribe ou de l’entretien : quelque part en effet (92, 6-8), Hermias parle d’une difficulté soulevée par Proclus et de la solution qu’en proposa « le philosophe » ; or, d’après une scholie, sans doute ancienne, qui est répétée en marge de trois bons manuscrits, ce serait Syrianus. C’est plus haut encore pourtant que, selon toute probabilité, on devrait remonter : jusqu’à Jamblique (deuxième moitié de ive s.), dont Proclus (Theol. Platon. IV 16) mentionne expressément un commentaire sur le Phèdre, auquel du reste Hermias lui-même fait plus d’une allusion[201]. — Il n’y a pas lieu de parler ici des idées d’Hermias ni de l’esprit de son commentaire : un échantillon en a été donné en passant (p. xxx n. 2), sur lequel toutefois il ne serait pas équitable de fonder une condamnation globale. Le fatras certes n’y manque pas, ni le pédantisme, ni même la sottise. Mais, pour en déclarer fausse toute l’interprétation, il faudrait d’abord avoir prouvé que les Néoplatoniciens n’ont radicalement rien compris à Platon ; que notamment ils ont eu tort de se servir si souvent du Timée pour interpréter le Phèdre. Or cette preuve n’est pas faite. Mais ce qui maintenant nous importe, c’est seulement la contribution d’Hermias à l’établissement du texte. Elle est d’une valeur critique indéniable : par les lemmes qui donnent les premiers mots de chacune des petites sections entre lesquelles il divise le texte ; par des notes détachées qui expliquent certains des termes du passage ; par l’insertion de tel ou tel mot du texte au cours d’une paraphrase ; par la reprise de membres de phrase entiers ; par des citations faites çà et là en dehors de la suite du texte. Il lui arrive même, à propos de 249 c 6 sq. (p. 171, 32 sqq.), de signaler qu’il existe du passage quatre variantes, dont l’une a ses préférences puisqu’il en fait son lemme. Entre les citations constituées par les lemmes et celles que fait Hermias au courant de son exégèse, une distinction s’impose : dans ces dernières il pouvait en effet ne pas se sentir astreint à la même exactitude. J’ai donc signalé dans l’apparat par la lettre « l », placée en exposant après le nom d’Hermias, toute leçon qui provient de ses lemmes.
Observations.
À ce que j’ai dit dans la notice du Phédon (p. lxxx sqq.) sur la forme usuelle de la tradition indirecte, je voudrais ajouter quelques remarques dont l’étude de cette tradition pour le Phèdre a été l’occasion. — Il n’est certes pas douteux que souvent les auteurs citent de mémoire. Mais, quand en plusieurs endroits un même auteur cite de façon différente, on peut se demander si l’on est en présence d’une variation de sa mémoire ou bien d’une variante réelle, en rapport avec l’utilisation par lui de copies différentes. C’est ainsi que le passage de 246 e 4 ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμών …Ζεύς est cité deux fois par Plutarque. Or, dans les Quaestiones conuiuales VIII 3, 5 722 d, son texte : ὁ γὰρ δὴ μέγας ἡγεμών …Ζεύς est très voisin du nôtre ; dans le Non posse suauiter uini secundum Epicurum, 22 1102 e, il écrit bien ὁ μέν, mais il omet δή, et, ce qui importe davantage, il omet ἡγεμών. C’est un fait pourtant que de ces deux passages celui qui s’éloigne le plus de notre texte est justement celui qui a le plus l’apparence d’une citation textuelle. On peut donc se demander si l’omission de ἡγεμών n’y est pas le témoignage d’une tradition différente. — De même à 250 d 4 : ἔρχεται αἰσθήσεων. Là où Plutarque ne paraît pas citer mais se souvenir (Aqua an ignis utilior 13, 958 e), il écrit : ἐστιν (ou εἶσιν) αἰσθήσεων ; mais là où il semble citer textuellement (Quaest. conuiu. III 6, 4 654 e), on lit : ἔρχεται παθημάτων. Ce dernier mot serait-il une variante réelle de la tradition manuscrite ? — Moins délicat est le cas de 243 d 6 ; car, si deux fois (cf. Apparat) Plutarque écrit κατακλύσασθαι, les deux autres endroits (Quaest. conuiu. VII 5, 4 706 d et De esu carnium II 3, 998 a) où il retient notre ἀποκλύσασθαι sont ceux où il paraît citer la lettre.
Autre observation. Une phrase du Phèdre, 237 b 8-c 2 : περὶ παντός, ὦ παῖ, …ἀνάγκη est citée par trois commentateurs d’Aristote avec des déformations au moins partiellement identiques. Philopon (fin du ve s. et début du vie, in Ar. De an. 33, 21 et 43, 8 Hayduck), David (fin du vie s., Proleg. 9, 21 et Isag. 95, 18 Busse), Élias (fin du viiie s., Isag. 41, 4 et Categ. 127, 7 Busse), au lieu de τοῖς μέλλουσι καλῶς βουλεύεσθαι, s’accordent à écrire : τοῦ κ. β.[202], — περὶ ὅτου au lieu de περὶ οὗ — τοῦ παντός au lieu de παντός. Tandis qu’après ὅτου Philopon a notre texte, les deux derniers donnent une commune variante : ἐστιν ἡ σκέψις. Sans doute est-il possible qu’Élias ait copié David ; mais, puisqu’ils s’accordent aussi avec Philopon, une autre tradition, peut-être dans quelque florilège scolaire, n’est pas invraisemblable.
Enfin un passage du Phèdre, 238 b 9-c 3, est textuellement cité par Denys d’Halicarnasse dans le De Demosthene (I 140, 14 Usener et Radermacher) et dans la Lettre à Cn. Pompée (II 1 230, 12). Or, sauf Vollgraff, tous les éditeurs signalent l’accord complet de la seconde citation avec notre texte, tandis que la première comporte quatre variantes (cf. Apparat). Nous serions donc manifestement ici en présence de deux traditions manuscrites qui auraient été tour à tour suivies par Denys et dont l’une aurait prédominé dans les manuscrits médiévaux[203]. Mais la différence des deux textes est purement apparente, et elle a été fort bien expliquée par les derniers éditeurs de Denys. Les manuscrits de la Lettre ont en effet une lacune à l’endroit où Denys y avait transporté la citation du Phèdre que renfermait son De Demosthene. Or, en voulant combler cette lacune, ce n’est pas au texte de ce dernier traité qu’Henri Estienne a eu recours, mais à son propre Platon. Il n’y a donc ici aucun désaccord de citations[204].
Éditions etc.
Les éditions spéciales du Phèdre sont moins nombreuses encore que celles du Banquet. J’ai utilisé celles de Friedr. Ast (1810, 1830), de Stallbaum (2e éd. 1857) et surtout celle de W. H. Thompson, The Phaedrus of Plato with english notes and dissertations, 1868[205]. L’édition de J. C. Vollgraff[206], professeur à l’Université d’Utrecht, est purement critique et, très souvent, extrêmement hardie. Comme je l’ai fait pour le Banquet et au risque d’allonger abusivement l’apparat critique, j’ai voulu, non pas seulement y rappeler les principales conjectures ou corrections dont le texte a été l’objet[207], mais y donner aussi une image de celui qu’ont imprimé les éditeurs les plus récents[208]. — Si les éditions ont été rares, par contre le nombre est considérable des études qui ont été consacrées à telle ou telle des questions que pose le Phèdre. Or, on a pu s’en rendre compte, il y en a beaucoup et d’espèces très diverses : composition du dialogue ; authenticité de l’Érôticos de Lysias ; rôle du mythe et conception de la dialectique ; aspects particuliers de la théorie des Idées ou de la doctrine de l’âme ; attitude de Platon à l’égard de la rhétorique ou à l’égard de ceux qui l’enseignent, spécialement en ce qui concerne Isocrate, etc. Les bibliographies classiques, par exemple celle de J. Marouzeau, plus accessible au lecteur français, ou la bibliographie spéciale du Phèdre dans le manuel d’histoire de la philosophie ancienne (Grundriss der Geschichte d. Philos. des Altert. d’Ueberweg-Prächter, fourniront aisément des indications) qu’il eût été trop long de donner. On trouvera dans le premier chapitre de la dissertation (citée p. xxvi n. 3) de Z. Diesendruck ou dans le livre de A. Diès, Autour de Platon (surtout p. 100 sqq., p. 400 sqq.) des exposés qui permettent d’avoir un aperçu des conflits d’opinion auxquels le Phèdre a donné lieu.
Texte.
Le texte que j’imprime est, comme dans les deux autres parties de ce tome IV, celui-là même que je traduis : c’est-à-dire que, sans jamais faire usage des crochets droits, je rejette à l’Apparat les mots ou membres de phrase dont l’interpolation m’a paru, ce qui est d’ailleurs très rare[209], tout à fait incontestable. De même, je n’ai pas hésité à introduire dans le texte une transposition qui me semblait améliorer la suite des idées[210]. J’ai adopté plusieurs corrections proposées par mes devanciers[211] ; en face de certaines autres j’ai hésité, non sans regret[212]. De moi-même j’ai rétabli, dans la première lecture que donne Phèdre du discours de Lysias, la conformité du texte avec celui qu’il lit la seconde et la troisième fois[213]. En plusieurs cas, en revanche, le texte des manuscrits m’a semblé devoir être maintenu[214]. Dans d’autres cas cependant, c’est pour la leçon des Papyrus que je me suis décidé[215]. Enfin, pour ce qui est de la ponctuation, je l’ai rarement modifiée d’une façon significative[216].
Il existe en français une excellente traduction du Phèdre par É. Chambry (avec d’autres dialogues, Classiques Garnier, 1919) et aussi par Mario Meunier (Payot, 1922). J’ai souvent utilisé avec grand profit une traduction allemande anonyme, suivie de notes (Leipzig, 1846). Sans parler de celles qui font partie de collections complètes des Œuvres de Platon, il y a en anglais, en allemand (celle d’O. Apelt notamment), d’autres traductions du Phèdre, mais je n’ai pu les avoir à ma disposition.
En terminant cette Notice, il m’est très agréable de témoigner ma profonde gratitude à mon collègue M. Louis Méridier pour l’amical dévouement avec lequel il a accepté de reviser tout mon travail. Celui-ci doit beaucoup à sa compétence, à la sûre précision de ses remarques, à son attention minutieuse. Il y subsiste encore assurément bien des imperfections : c’est qu’il ne pouvait tout redresser et aussi, j’en conviens, que je n’ai pas toujours suffisamment cédé à ses avis.
SIGLES
B = cod. Bodleianus 39.
T = cod. Venetus, app. class. 4, no 1.
W = cod. Vindobonensis 54, suppl. philos. gr. 7.
Sur les Papyrus et la tradition indirecte, voir Notice, p. clxxvi sqq.
- ↑ Pour le premier cas : Rhét. III 7 fin (à propos de l’emploi ironique de la langue de la poésie). Pour le second : Top. VI 3, 140 b 3 sq. ; Métaph. Λ 6, 1071 b, 31-33, 37 sq. À ces textes, les seuls que mentionne Bonitz (Index 598 b, 25 sqq.), il faut sans doute ajouter deux autres passages, qui semblent viser le Phèdre mais où Platon n’est même pas nommé : Phys. VIII 9, 265 b, 32-266 a, 1 et De an. I 2, 404 a, 20-25.
- ↑ Diogène Laërce III 38 ; Hermias, Commentaire du Phèdre p. 9, 14-19 Couvreur ; Olympiodore (le Jeune) Vie de Platon (vol. VI du Platon d’Hermann, p. 192 s. med.), témoignage qui se confond avec celui de la Scholie à 227 a (Hermann p. 262), d’après le commentaire sur le Premier Alcibiade ; car la Vie de Platon est elle-même extraite de ce commentaire (cf. l’éd. de ce commentaire par Creuzer II, p. xviii, n. 2 et p. 2). Cf. Notice p. lix.
- ↑ On la trouvera dans ma Théorie platonicienne de l’Amour (1908), p. 63-109. Voir une excellente mise au point de la question dans A. Diès, Autour de Platon, p. 250-255.
- ↑ Cf. Banquet, Notice, p. xvii et, ici, p. 27, n. 2. L’interprétation que j’ai donnée de καλλίπαις n’est qu’une de celles que propose Hermias (323, 17 sq.), mais c’est celle que développe Plutarque Quaest. platon. II 1, 1000 f sq. — Voir en outre, à propos de 228 b la n. 1 de la p. 3.
- ↑ Voir p. 11, n. 1 fin ; p. 18, n. 3 ; p. 19, n. 1 ; p. 22, n. 1 ; p. 23, n. 2 ; p. 25, n. 1 ; p. 28, n. 3 ; p. 46, n. 3 ; p. 47, n. 1 ; p. 52, n. 1, 2 et 4 ; p. 53, n. 1 fin ; p. 68, n. 1 ; p. 96, n. 1. Cf. aussi Notice p. lxix sq., les notes de p. lxxii, p. civ n. 2, cxxix etc.
- ↑ Contrairement à ce que j’ai dit par erreur dans la Théorie platonicienne de l’Amour, p. 84.
- ↑ Je dois pourtant renoncer à la témérité de mon ancienne conjecture (op. cit., p. 114-118) : je n’oserais plus aujourd’hui considérer tout ce qui, dans le Phèdre, s’apparente à la doctrine des derniers dialogues ou, tout au moins, du Timée, comme un rappel sommaire de ce qui a été établi dans ceux-ci.
- ↑ Platon² I, p. 459. Toutefois il n’en résulte pas nécessairement que, comme il le dit, le Phèdre doive être en quelque sorte le « soupir de soulagement » qu’arrache, sans délai, à Platon la ligne finale de la République.
- ↑ Comme l’a fait L. Parmentier, L’âge de Phèdre dans le dialogue de Platon, Bulletin de l’Association Guillaume Budé, janvier 1926, p. 9.
- ↑ Voir Thompson, The Phaedrus (1868), notes à 229 c et 230 b (p. 7 et 9) ; Wilamowitz, Platon² I, p. 456, n. 1. Je dois tout ce qui suit, ainsi que le plan de la page suivante, à la compétence de mon collègue Ch. Picard, ancien directeur de l’École française d’Athènes, à qui j’exprime ma plus vive gratitude pour l’empressement bienveillant avec lequel, à ma demande, il a étudié les données de ce petit problème.
- ↑ Stuart et Revett l’ont connu.
- ↑ La préposition κατά, 229 a 1, 4 signifie donc en suivant le lit, non en descendant le cours. L’adverbe κάτωθεν (c 1) me paraît signifier en contre-bas du point où on se trouve et par rapport à la direction qu’on a prise ; mais M. Picard voit un autre sens possible : le lit de la rivière, étant plus encaissé, semble plus bas. — S’ils ont utilisé le gué comme le croit Thompson, la correction suggérée par lui : διεβαίνομεν, nous passions, au lieu du présent d’habitude, se justifierait. Toutefois jusqu’au moment où ils sont en face du platane, rien n’indique qu’ils aient quitté le lit de la rivière pour l’une ou l’autre rive. D’autre part, quand Socrate parlera de passer sur l’autre bord (242 a déb., b 8), cela semble indiquer qu’ils sont en effet à proximité du gué d’Agra. Voir en outre la suite.
- ↑ L. Parmentier, art. cité, p. 10 sq., p. 14.
- ↑ Cf. 257 c : ὦ νεανία ; 267 c : ὦ παῖ ; 275 bc.
- ↑ L. Parmentier, art. cité, p. 15-17.
- ↑ Cf. 235 d, 236 ab, 241 d, 257 c, 266 cd.
- ↑ Diogène Laërce (VI 15) parle d’un écrit d’Antisthène qui pouvait être également un parallèle de Lysias et d’Isocrate (cf. Banquet, Notice p. xli, n. 2) ; si en effet il s’agit, dans cet écrit, de l’Amartyros d’Isocrate que nous avons conservé, on sait que Lysias défendait la partie adverse (Clément d’Alexandrie, Strom. VI 626 ; cf. G. Mathieu, Isocrate I, p. 5, Coll. Budé).
- ↑ Pour le second point 257 bc (p. 56, n. 2), 277 a ; pour le premier 227 a et c, 228 ab, 272 c.
- ↑ Cicéron fonde son assertion, en apparence au moins (cf. 46 déb.), sur l’autorité d’Aristote. Mais on doit observer que, dans ce qui nous reste d’Aristote, il n’y a rien de tel : Lysias est cité deux fois dans la Rhétorique et les deux citations proviennent de ses plaidoyers ; dans aucune d’ailleurs il n’est nommé.
- ↑ En tout cas, on ne peut conjecturer la durée de cet enseignement, car la chronologie de Lysias est très incertaine. Autrefois on le faisait naître en 459/8 ; aujourd’hui on tient généralement pour 446, parfois même pour une date plus tardive. La date de 412 pour son retour à Athènes est mieux assurée, pour la raison qu’on va voir. Mais, faute de savoir quand il est né, on ne peut s’aventurer à dire quel âge il avait alors.
- ↑ Comparer dans le Phèdre le passage de 258 b et Notice, p. xxxv, n. 1. — Sur les faits, voir Paul Cloché, La restauration démocratique à Athènes en 403 (1915).
- ↑ Celui de Gorgias est de 392, à la Fête précédente.
- ↑ Voir Wilamowitz Platon², I, p. 259.
- ↑ Brutus 38, 63 sq., 285 fin, 293 ; Orator 29 sq..
- ↑ Ce qui fournirait un terminus a quo, — d’ailleurs indépendamment du principe posé par L. Parmentier (cf. Banquet, Notice, p. xii, n. 2), puisqu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un personnage du dialogue et que d’autre part Isocrate, alors incontestablement en vie, y est nommé et jugé.
- ↑ On ose à peine avouer que les multiples arguments allégués aujourd’hui par tant d’illustres critiques en faveur de l’authenticité, totale ou partielle, du recueil des Lettres ne semblent pas décisifs. Plusieurs d’entre elles, sans doute, reflètent de bons documents et témoignent d’une remarquable habileté. Le scepticisme dont je ne puis me défendre, même à l’égard de la viie, n’est pas diminué, loin de là, par quelques réminiscences, trop adroites, du Phèdre : 344 de, cf. 276 de ; 348 a déb., cf. 249 d.
- ↑ Les motifs qui avaient poussé Anytus à contresigner l’accusation, peut-être même à la provoquer, sont fort bien analysés par M. Eudore Derenne, Les procès d’impiété intentés aux philosophes à Athènes au ve et au ive siècle avant J.-C. (1930), p. 133, sqq.
- ↑ « Quel est l’art dans lequel tu es savant ? demande Socrate à Gorgias (Gorgias 449 a). — La rhétorique ! — C’est donc ῥήτωρ, orateur, qu’il faut t’appeler. » De même, les orateurs dont il est question dans Ménexène (235 c), ce sont ceux qui composent à loisir des Panégyriques d’Athènes, des oraisons funèbres, des éloges des ancêtres, bref des rhéteurs qui écrivent des discours épidictiques. Euthydème 284 b : les orateurs, quand ils parlent dans l’Assemblée du Peuple (cf. Alcib. I 114 cd)… ; 305 b : un orateur, soit de ceux qui ont la pratique des débats judiciaires, soit de ceux qui composent des discours pour les gens engagés dans ces débats… Dans Théétète 201 a, les orateurs sont les avocats. Dans notre dialogue, le mot est pris au sens le plus général : 258 b 10 (où il signifie à la fois l’orateur politique, le logographe, le législateur), 260 a, 269 d. C’est justement pour avoir, dans le passage en question de l’Apologie, entendu ῥήτωρ au sens étroit d’orateur politique, que certains critiques (dont Wilamowitz Platon² II, p. 48, n. 2) ont suspecté les mots « et les hommes politiques » à la suite de « gens de métier » : ces mots seraient, d’après eux, une très ancienne glose (antérieure à Diogène Laërce qui les cite II 40), inspirée du portrait d’Anytus dans le Ménon. Sans doute, dans les pages de l’Apologie qui précèdent notre texte, Socrate n’a mentionné, parmi les gens sur lesquels a porté son enquête, que les hommes d’État, les poètes et les gens de métier. Mais est-il nécessaire qu’il y ait, de part et d’autre, symétrie ? L’enquête est incontestablement très générale (cf. 21 c) : pourquoi se serait-elle limitée à ces trois catégories et comment les Sophistes, maîtres de rhétorique et auteurs de discours épidictiques, en auraient-ils été exceptés ?
- ↑ Sur ceci et sur ce qui suit, voir l’édition d’Isocrate par G. Mathieu et É. Brémond dans la collection Budé (t. I, 1928) et la thèse du premier : Les idées politiques d’Isocrate (1925).
- ↑ Cf. p. xiv sq., et p. xvii n. 2. Sur les antécédents, voir le ch. iii, de G. Mathieu op. cit.
- ↑ Ainsi Raeder, Platos philosophische Entwickelung, p. 267.
- ↑ On voit par Hermias (p. 10, 26 sqq.) que ce débat sur le vrai sujet du Phèdre était fort ancien ; cf. p. lix.
- ↑ Il faut lire l’étude si fine et si pénétrante d’Émile Bourguet Sur la composition du Phèdre, dans la Revue de Métaphysique et de Morale 1919, p. 335-351 et un intéressant mémoire de Z. Diesendruck, Struktur und Charakter des platonischen Phaidros, 1927 (cf. REG. XLV p. 115), où l’on trouvera une bonne revue des opinions principales de la critique allemande sur la question.
- ↑ D’après O. Navarre, Essai sur la Rhétorique grecque, p. 36, l’exercice dont il est question 228 e n’est pas seulement celui par lequel on s’assure de bien posséder ce qu’on s’est proposé de savoir par cœur, mais un exercice de libre reconstruction, à l’aide du plan et des souvenirs qu’on a conservés du détail de l’original : voir ce que dit Phèdre au début du 228 d et que j’interprète un peu autrement.
- ↑ Cf. Banquet Notice p. xxiii et Phédon p. 22 n. 4 de mon édition.
- ↑ Le commentaire d’Hermias sur ces derniers mots (p. 43, 8 sqq.) est un éloquent exemple des interprétations allégoriques de son École. Voici, dit-il en substance, ce que Platon veut nous faire deviner en parlant ici de la « plénitude du cœur » : le cœur est dans la poitrine, qui est au milieu du corps ; or, tout à l’heure (230 b), il a parlé de ses pieds qui lui offrent le témoignage de l’aimable fraîcheur de la source ; bientôt (234 b) il appellera Phèdre « tête divine » et, dans le mythe de l’attelage ailé, il montrera (248 a) le cocher élevant la tête pour contempler les Idées ; c’est une façon de dire qu’il y a des activités affectives inférieures, puis moyennes et psychiques, des activités supérieures enfin et qui nous mènent à ce qui nous dépasse.
- ↑ Cf. p. 17, n. 1. — À 236 c déb., il ne s’agit pas proprement de « se renvoyer la balle ». Hermias, qui d’ailleurs voit bien le sens, donne à l’appui de son interprétation un exemple qui conviendrait mieux à la précédente : une phrase de l’un des interlocuteurs « Je t’ai donné cela », renvoyée à celui-ci par l’autre, sans y rien changer dans sa réplique (p. 46, 8-15). Mais, puisqu’il s’agit d’une comédie, il y a plutôt ici un échange des rôles : la contrainte que Socrate a tout à l’heure exercée sur Phèdre, c’est Phèdre qui va maintenant l’exercer sur Socrate ; le rôle devenant le même, il est naturel que les termes ne changent pas non plus. — Au même endroit, la plupart des éditeurs suspectent ou suppriment le mot grec que j’ai traduit par « Gare à toi ! » (εὐλαβήθητι), ainsi que le δέ qui, dans T, suit ἵνα. C’est aussi l’avis de M. Méridier. On en donne pour raison que la phrase se rattache étroitement à ce qui précède : Tu n’as plus qu’à parler… afin que nous n’en soyons pas réduits à… ; le δέ aurait donc été ajouté par quelqu’un à qui cette relation étroite aurait échappé. L’idée importante, au contraire, me paraît être ici que Socrate devra parler comme il pourra, et c’est sur ces mots qu’il faut achever la pensée. Au μέν, qui accompagne l’obligation de parler tant bien que mal, s’oppose maintenant le δέ : Mais, s’il ne le fait pas, il n’a qu’à se tenir sur ses gardes et à ne pas volontairement s’exposer à… De plus, l’impératif : Ne va pas… (μὴ βούλου) justifie l’autre impératif : Tiens toi sur tes gardes… Je conserve donc εὐλαβήθητι.
- ↑ Voir la note de Thompson ad loc. et, ici, p. 20 n. 2. — Peut-être rappellerait-on utilement à ce propos que l’épilepsie s’appelait chez les Grecs le mal sacré.
- ↑ Socrate relève à cet égard des passages du discours de Lysias (232 cd, 233 c) et de son propre discours, 238 e-239 b.
- ↑ La question d’émoluments est ici secondaire. Ce qui importe surtout, c’est qu’un sophiste, un logographe, un maître de rhétorique ont un faux talent, puisque ce sont des orateurs qui ne parlent pas, des plaideurs qui ne sont pas partie au procès qu’ils plaident, des politiques qui ne prennent pas part à la vie publique ; ils sont comme des flûtistes qui ne joueraient pas de la flûte, mais se borneraient à en fabriquer à l’usage de ceux qui en jouent (cf. Euthydème 288 d-290 a). Il est possible que le passage 257 cd soit une allusion aux déceptions politiques de Lysias (cf. Notice, p. xvi sq.). Mais il pourrait s’appliquer, presque aussi bien, à Isocrate (cf. p. xxiv sq.).
- ↑ 258 de et la n. 1 de la p. 59. Quand Platon fait dire à Phèdre que l’épithète de serviles est donnée, ou a été donnée, aux plaisirs qui sont dans la dépendance d’un besoin, fait-il allusion à l’emploi de cette formule par quelque autre, ou par lui-même ? Du moins n’est-ce pas, comme on le dit parfois, un renvoi au Phédon 69 b (car ce qui a cet endroit est dit servile, ce n’est pas le plaisir, c’est une certaine espèce de vertu [de même République IV 430 b, pour une certaine espèce de courage]), mais peut-être à 66 cd.
- ↑ Que Calliope fût chez les Pythagoriciens le nom de la philosophie (p. 60 n. 1), Maxime de Tyr (VII 2, 63) est seul à le dire, mais peut-être à bon droit ; cf. Empédocle, fr. 131 Diels.
- ↑ La prédilection de Platon pour les divisions ternaires se manifestait dans le Phédon et dans le Banquet. De fait, ici, cette troisième partie est à la première, j’ai tenté de le montrer, dans un rapport dont la seconde est justement la clef. Est-ce à dire pourtant qu’elle doive comprendre tout le reste du dialogue ? Je ne le pense pas : dans ce reste, en effet, il y a une coupe si nettement marquée à 274 b, qu’il me semble impossible de ne pas considérer comme une partie distincte tout ce qui concerne la valeur propre de l’écrit.
- ↑ Sur cette expression, cf. p. cxliii et cxlvii. Je m’attache seulement ici à marquer l’enchaînement des idées ; ces questions seront examinées spécialement dans la section VI.
- ↑ À 261 e 3 οἷς est, je crois, un masculin et, de même, ἐν τοῖς ἄλλοις 262 a 11. Cette proposition correspond à celle de c 10 sq., où Platon a distingué entre l’objet dont on parle et les sujets à qui l’on s’adresse. Nous savons tous ce que c’est qu’un âne et ce que c’est qu’un cheval ; on n’a donc aucune chance de faire prendre à quelqu’un un âne pour un cheval ; c’est ce qui faisait de l’exemple précédent un argument à la fois comique et péremptoire. Mais il n’en est pas ainsi pour le juste et l’injuste ; aussi, devant des sujets qui, sur ces objets, ignorent la vérité, aura-t-on beau jeu pour tout brouiller sans qu’ils s’en aperçoivent.
- ↑ Le genre « ressemblance », dit le Sophiste (231 a) exige qu’on soit constamment sur ses gardes, car « il n’y a pas de genre plus glissant ».
- ↑ Il suit de là qu’en cette matière l’art véritable ne peut appartenir qu’à celui qui emploie à faire illusion un savoir authentique ou qui joue, comme Socrate, la comédie de l’inscience. Cela rappelle, la suite l’indique assez clairement (262 d et p. 66, n. 2), l’audacieux paradoxe par lequel Platon, jeune encore, traduisait en termes saisissants sa conviction profonde de la valeur absolue du savoir, le paradoxe de l’Hippias minor. En même temps, cela annonce l’analyse, plus subtile et plus nuancée que Platon, vieillard, consacre à la question dans le Sophiste (233 a-236 d et surtout 266 d jusqu’à la fin du dialogue) ; analyse préparée d’ailleurs par celle qu’on trouve au livre X de la République, notamment 596 a-603 a. Ces analyses envisagent la mimétique, l’art de l’imitation. Dans cet art le Sophiste distingue explicitement une production de réalités vraies, qui sont des copies, et une production de simulacres, qui sont de fausses apparences. Mais, parmi les simulateurs dont les produits sont de ce dernier genre, il distingue ceux qui ont la connaissance vraie de ce qu’ils imitent et ceux qui en sont dépourvus : l’art des premiers est une mimétique informée (ἱστορική τις μίμησις) et celui des autres, une mimétique d’opinion, une doxomimétique. Puis entre ces derniers apparaît encore une nouvelle distinction : il y a le simulateur candide (εὐήθης), qui croit savoir ce que réellement il ignore (ce serait ici le public, qui se croit en état de juger et de décider, cf. 260 a) et le simulateur astucieux (εἰρωνικός, cf. ici 271 c déb.), qui affiche extérieurement un savoir dont, au-dedans de lui-même, il sent l’effroyable néant ; selon que son hypocrisie s’exerce dans des assemblées publiques ou dans des réunions privées, en longs discours ou bien en argumentations, c’est ou bien un orateur populaire ou bien un sophiste. Dans l’un des cas comme dans l’autre, le Phèdre dirait, d’une façon générale, que c’est un orateur (cf. p. xx, n. 3). tout droit au ciel (cf. 256 b 4), tandis que celles dont les efforts pour redevenir ailées ont besoin d’être estimés doivent attendre le jugement (cf. 256 d 4) ; voir la suite.
- ↑ Sur ce point je m’écarte à regret de l’opinion de M. Bourguet : il s’agit ici d’après lui (art. cit. p. 338) des deux discours de Socrate.
- ↑ Il est assez surprenant que Platon présente à 265 b la distribution des quatre formes du délire entre quatre divinités comme si elle correspondait exactement à la division de 244 b sqq., alors qu’elle constitue une nouveauté réelle. On ne peut cependant soupçonner ici une interpolation.
- ↑ Surtout 271 c-272 b. C’est de cette déficience de la rhétorique actuelle que témoignait déjà l’examen critique du discours de Lysias, 235 e sq., 262 d-264 e.
- ↑ On la rencontre, à peu de chose près, dans Protagoras (Vorsokratiker ch. 74, B 3) ; sous la même forme qu’ici, dans l’écrit connu sous le nom d’Anonyme de Jamblique et qui est probablement contemporain de la guerre du Péloponnèse (95, 13 sqq. Pistelli = Vorsokr. ch. 82, 1-3 ; dans les Doubles raisons (δισσοὶ λόγοι ou Dialexeïs) 9, 2-4 (chap. 83 des Vorsokr.) ; dans l’écrit hippocratique Sur la loi 2 (IV 638 Littré). Voilà pour le ve siècle ; mais au temps de Platon d’autres que lui l’utilisent également comme un principe, cf. p. cxlvi, cli n. 1 et clxviii.
- ↑ Il me paraît guère douteux, malgré l’opinion contraire de Burnet, que à 270 a 5 il faille lire, avec les meilleurs mss. et avec Hermias, ἀνοίας, absence d’intelligence, et non διανοίας, pensée discursive (par opposition à l’Intelligence souveraine). Mais il est peu vraisemblable que, comme le voudrait Hermias (244, 15), l’absence d’intelligence désigne la matière, c’est-à-dire le mélange infini des particules, sur laquelle, d’après Anaxagore, agit l’Intelligence. Il y a là, me semble-t-il, une plaisanterie, à la fois sur l’impopularité où finit par tomber l’ami du Nous, c’est-à-dire Périclès, et sur le procès intenté au Nous lui-même, c’est-à-dire à Anaxagore : c’est ainsi qu’ils en sont venus à connaître, l’un comme l’autre, l’envers de l’intelligence, autrement dit l’anoia.
- ↑ Cf. p. 79 n. 2. Voir en outre Parménide 135 d.
- ↑ On pourrait utilement comparer le passage de 270 de avec le début de la IVe des Regulae de Descartes.
- ↑ Cf. p. 82, n. 2 : je ne crois pas que αὐτὰ μὲν τὰ ῥήματα εἰπεῖν 271 c 6 puisse signifier : dire la chose en termes propres. Toute la suite ne consiste-t-elle pas en effet à dire en termes propres la « façon de s’y prendre » (cf. b 7 οὔτοι ἄλλως, c 3 τὸν τρόπον τοῦτον, c 5 τίνα τοῦτον ⟨τὸν τρόπον⟩ ? D’un autre côté, l’opposition (marquée par μέν… δέ) ne se comprend plus entre ce qui présente de la difficulté et ce qu’au contraire Socrate se dit prêt à montrer et qui concerne précisément la façon dont on doit s’y prendre pour faire œuvre d’art en parlant ou en écrivant (ὡς δὲ δεῖ γράφειν, εἰ μέλλει…). En d’autres termes, tandis que Phèdre, ainsi que l’y ont habitué ses maîtres, attend un modèle ou un corrigé qui lui donne « les phrases elles-mêmes », un « dites ceci, dites cela », où sera mise en action la méthode de l’Art, c’est seulement une théorie de cette méthode que Socrate est prêt à lui offrir.
- ↑ Comparer Gorgias 455 a et surtout Théétète 201 a-c.
- ↑ Cf. p. 86, n. 3. La phrase finale de Socrate à 274 a sur l’acceptation anticipée de toutes les conséquences que peut entraîner la poursuite d’une si magnifique espérance rappelle le « beau risque » que, dans le Phédon (114 d ; cf. 84 a b), le philosophe accepte de courir en pariant pour la croyance à l’immortalité et pour ce qu’elle exige de lui dans sa vie présente.
- ↑ Le souvenir de la garderie (φρουρά) du Phédon 62 b est évident (cf. p. 86, n. 2) : les dieux sont nos maîtres et nous sommes leur bétail humain, leurs esclaves : il ne faut ni déplaire au maître, ni s’évader de sa tutelle.
- ↑ Voir p. xl, n. 3 les textes sur l’imitation et, plus particulièrement, Rép. X 596 de, 597 d-598 d, 602 d et Soph. 235 e-236 c.
- ↑ C’est ce que disait déjà le Protagoras 329 ab, mais en comparant les livres aux orateurs populaires qui parlent interminablement dès qu’on les met en branle et qui se taisent quand on leur pose une question imprévue, pareils à des vases de bronze qui vibrent longuement dès qu’on les heurte jusqu’à ce que, en y posant le doigt, on mette fin à cette vibration.
- ↑ On ne doit pas, je crois, comme le fait Wilamowitz I² 453, 486, 487, mettre trop à l’arrière-plan, au bénéfice de la seule idée du divertissement, cette intention de se constituer pour l’avenir un trésor de remémorations, une sorte de « Journal d’un philosophe », conçu non pas comme la biographie d’un homme, mais comme l’histoire des moments d’une pensée. Une telle intention s’accorderait d’ailleurs, mieux que celle de se divertir, avec « cette impulsion intérieure » du poète dont parle aussi le même critique : en Platon le poète est en effet, si l’on peut dire, un lyrique de la pensée pure ; ce sont des états de sa pensée qu’il exprime avec un magnifique enthousiasme ; ce ne sont pas, comme chez un lyrique ordinaire, des états du sentiment liés aux circonstances de la vie.
- ↑ Par exemple Lutoslawski, Origin and growth of Plato’s Logic.
- ↑ C’est un problème qu’il suffit d’avoir posé et qu’il est impossible de discuter ici. Voir Paul Mazon, Sur une lettre de Platon, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 1930.
- ↑ Cf. mon édition du Phédon, p. 12, n. 2.
- ↑ Cf. 277 a. Voir mon édition du Banquet p. lxxv sq. et du Phédon p. 58, n. 1 et p. 60, n. 4.
- ↑ Comme l’a pensé Hermias, 265, 18 sqq. Il a échappé à Couvreur que le dit-il est, dans l’interprétation du commentateur, un renvoi non douteux au Cratyle.
- ↑ À l’égard d’un philosophe, fût-il poète, rien n’est plus légitime que de chercher à expliciter des intentions qu’il nous laisse deviner. Irait-on cependant jusqu’à penser, avec Z. Diesendruck (op. cit. p. 32), que la réplique de Phèdre, sur laquelle s’achève le dialogue : « Entre amis tout est commun ! », soit un ultime rappel du thème de l’amour, sous prétexte qu’elle suppose la thèse du second discours de Socrate et signifie l’attachement semblable de l’amant et de l’aimé à un bien supérieur, qui leur est commun ? Il ne faut pas voir partout des intentions définies.
- ↑ Il développe cette idée avec un rare bonheur d’expression p. 346 sq. de l’article cité p. xxvi n. 3 : « Chacune des parties composantes a son caractère propre, et en même temps elle contribue avec les autres par des variations ménagées sans choc, par le groupement et la valeur réciproque des effets que les morceaux successifs produisent, à l’effet convergent de l’ensemble… Cette œuvre, construite avec des mots, évoque… l’idée d’une composition musicale par les sonorités profondes qu’elle sait grouper. » Mais aussitôt il introduit une réserve pleine de sagesse : « Même en surchargeant le Phèdre d’un commentaire où tous les motifs seraient notés, je n’arriverais pas à faire sentir la merveille de cet art complexe qui les a tous réunis et orchestrés dans le mystère d’un ensemble vivant. »
- ↑ Une étude très approfondie en a été faite par H. Weinstock De Erotico Lysiaco, Münster, 1912.
- ↑ Denys d’Halicarnasse, Ad Cn. Pompeium 126 (ier s.) ; Maxime de Tyr, Diss. XXIV 5 ; Hermogène, De or. forma II 477 (ces deux derniers du iie s.). Pour le témoignage de Fronton, le maître de Marc-Aurèle, voir la note suivante.
- ↑ Le lexicographe byzantin Suidas (xe s.) parle lui aussi des Lettres de Lysias, dont cinq sur sept étaient adressées à des adolescents ; mais il ne mentionne pas que le morceau du Phèdre fasse partie du recueil. Quant à Fronton, le fait de dire au début de son Ἐρωτικός que c’est son troisième « message » à son élève (σοι… ἐπιστέλλω) et que les deux premiers provenaient de Lysias et de Platon (διὰ Λυσίου καὶ Πλάτωνος ἐπεσταλμένων), ce fait, quoi qu’en pense Thompson (p. 184 sq.), ne peut servir à prouver, ni que Fronton fût convaincu de l’authenticité du morceau, ni qu’il le considérât comme une lettre. L’envoi d’un écrit à quelqu’un n’est pas nécessairement une « missive ». De plus, à ce compte, il faudrait penser que Fronton considérait aussi comme une lettre le premier discours de Socrate. Or celui-ci, même si on en retranche l’invocation aux Muses qui précède le début proprement dit, ne commence nullement à la façon d’une lettre, ce qui devrait être si c’était déjà le cas pour le discours de Lysias ; c’est bien plutôt une histoire dans laquelle s’encadre explicitement un discours : « et son langage était celui-ci… ». Au surplus Platon parle toujours du λόγος de Lysias.
- ↑ La plus solide étude en ce sens, celle de Vahlen (Sitzungsb. de l’Acad. de Berlin, XXXIX, 1903), en bonne partie fondée sur des comparaisons de style, a décidé K. Hude à insérer la pièce dans son édition (Oxford 1912) ; ce que, par prudence, fait aussi M. Bizos (t. II du Lysias de la coll. Budé, 1926). Wilamowitz, Platon I², p. 259, laisse entendre qu’il s’agit là d’un fait entièrement avéré, et A. E. Taylor, dans son Plato (1926), p. 301 sq., estime qu’il est impossible sans absurdité d’en juger autrement. Voir dans Weinstock, p. 34 n. 1, une liste d’autres représentants de cette opinion.
- ↑ C’est celle qui compte le moins grand nombre de partisans, cf. Weinstock, p. 34 n. 2. Dans l’article déjà cité, p. 343 n. 2, É. Bourguet se déclare beaucoup moins sensible (en 1919) qu’il ne l’était autrefois à l’argumentation de Vahlen, dont la thèse est longuement critiquée par Weinstock. Cf. aussi A. Diès, Autour de Platon (La transposition platonicienne, 1913-4), p. 419 sq., p. 423 et la note.
- ↑ Ainsi que le fait Wilamowitz, loc. cit. (ici, p. lxi n. 1).
- ↑ Tel me semble être le sens ici de τὸν βέλτιστον : c’est bien celui « qui a le plus de valeur », non pourtant sous le rapport de l’utilité, mais au point de vue qui à présent occupe Lysias, celui de l’amour passionné. Je m’écarte en ceci de l’opinion de M. Méridier.
- ↑ Contrairement encore à l’avis de M. Méridier, je ne pense pas que s’impose la correction proposée par Heindorf à d 7 et adoptée par d’autres éditeurs. Le sens serait alors que le motif de l’antipathie ou de la sympathie de moi, amant, à l’égard de ceux qui refusent ou acceptent d’être les amis de toi, mon aimé, c’est le dédain qu’ainsi ils te témoignent ou le cas qu’ainsi ils font de ta compagnie. Mais il semble qu’avec ce sens ne se comprenne plus la phrase de laquelle dépend tout le développement en cause : à quoi aurait-il servi de dire que ce n’est pas à sa passion, mais à son mérite propre, que l’amant froid doit son succès, si l’objet de son inquiétude devait être ensuite la réalité du mérite chez l’aimé ?
- ↑ Comme à 231 b 5 et à 232 a 1, ὥστε me semble à 233 b 5 marquer une conclusion destinée à mettre dans tout son jour l’enseignement de l’antithèse qui précède.
- ↑ Bien qu’ici la section ne soit pas marquée, comme elle l’est ordinairement, par ἔτι δέ ou καὶ μὲν δή, je la crois réelle ; cf. Bonitz, Platon. Studien², p. 254 note.
- ↑ La façon solennelle dont la conclusion est présentée ici me fait penser qu’elle doit être détachée du reste, comme elle l’est par Bonitz, loc. cit.
- ↑ Les termes dont se sert Platon sont sôphrosynê et hybris. Le dernier se rend bien par démesure. Mais le premier est difficile à traduire dans toutes nos langues modernes : c’est une sagesse, mais principalement pratique, et surtout faite de mesure, de sorte que modération ou tempérance sont, en fin de compte, des équivalents assez exacts.
- ↑ Comparer en particulier 231 b, 234 b avec 239 e sq. ; 231 cd avec 231 b ; 232 bc, e sq. avec 240 b-e ; 232 cd avec 239 a b ; 233 ab avec 238 e sq.
- ↑ Ces considérations rappellent certains traits du discours de Pausanias dans le Banquet (181 b, d ; 182 b-d, 184 de). Cf. p. 23, n. 1.
- ↑ À l’opposé de ce que, dans le Banquet (178 e-179 b), Phèdre attend de celui qui est aimé d’amour et de ce qu’attestaient les « bataillons sacrés » des peuples doriens, tel celui de Thèbes.
- ↑ Cf. Pausanias dans le Banquet, 184 b-d.
- ↑ Comparer encore Pausanias, ibid., 183 e.
- ↑ Cf. Z. Diesendruck, op. cit. p. 12 sq.
- ↑ La première hypothèse a été défendue par K. Joël (Platons Sokratische Periode und der Phaidros, dans les Philos. Abhandl. für Max Heinze, 1906, p. 78 sqq.), dont on connaît le zèle, toujours ingénieux, à dépister partout Antisthène. Si à la fin du dialogue l’éloge d’Isocrate devait être tenu pour sincère, il ne serait pas impossible que Platon eût en effet l’intention de s’associer ici à son hostilité contre les Cyniques. — L’autre conjecture est de W. Thompson dans le premier appendice de son excellente édition du Phèdre. Il cherche à l’établir par un parallèle avec le langage de Socrate dans le Banquet de Xénophon, étant admis d’autre part que ce dernier, quoique incomplet et trop attaché au détail, n’a pas cherché du moins à transfigurer son maître. Assurément les passages des deux écrits que Thompson met en regard (ch. 8, § 13, 15, 21, 23 en face de 240 cd, 241 c ; comparer aussi 19 fin avec 239 e sq., 21 fin avec 240 de) se ressemblent étrangement. On ne s’arrêtera pas cependant à l’insoluble question de savoir qui des deux écrivains est l’emprunteur (cf. ma Notice du Banquet, IV). Il faudrait en effet pouvoir dater avec sûreté les deux ouvrages. Supposez qu’ils aient tous deux une source commune dans les propos du Socrate historique sur l’amour : propos d’une rare vulgarité de pensée chez Xénophon, d’une singulière étroitesse de vues chez Platon dans ce premier discours, ils seraient de toute façon surprenants de la part d’un homme dont l’action fut sans nul doute prodigieusement animatrice et fécondante.
- ↑ Platon en nomme trois : celle du temple d’Apollon Delphien, la Pythie, dont le trépied reposait au-dessus d’une crevasse du sol ; celle du temple de Zeus à Dodone qui parlait par son chêne (cf. 275 b) ; enfin la Sibylle que, comme Aristophane (Paix, 1096 ; cf. Héraclite fr. 92 D.), il ne désigne pas autrement et qui est sans doute la Sibylle d’Érythrées (plus probablement la cité béotienne, et non sa colonie ionienne).
- ↑ D’après le Timée 72 b le devin est bien supérieur au prophète, qui n’est alors que l’interprète du devin.
- ↑ Cf. Notice p. xxxiv et p. 33 n. 1. La condition posée ici paraît prouver que Platon ne désavoue nullement la sévérité qu’il montre ailleurs envers la poésie (p. ex. Rép. II 377 d sqq., 379 c sqq. ; tout le début du livre III ; X 605 a-c, 606 a et en outre les passages qui seront mentionnés plus bas ; Lois II 656 bc, 658 e sqq., 660 a et VII 817 a-c). Il note en effet, et que l’élève des Sophistes se trompe en croyant qu’on peut se passer de l’inspiration pourvu qu’on connaisse les règles (cf. 268 cd), et qu’un Homère se fait illusion quand il s’imagine que, parce qu’il est inspiré, on le laissera libre de pervertir les âmes par sa propre immoralité (cf. Rép. X 595 bc, 600 ab, 606 e sq.). Mais, s’il arrivait que la poésie réunît ces deux conditions d’inspiration et de moralité, on pourrait alors dans l’éducation, qui est le but suprême du législateur philosophe, lui accorder la place à laquelle son origine divine l’autorise à prétendre. — Il n’y a pas grand intérêt à observer, avec la plupart des critiques et après Cicéron (Div. I 37 déb.) comme après Horace (Ars poet. 296), qu’avant Platon Démocrite avait déjà dit (fr. 18 D.) que la poésie suppose l’enthousiasme et le souffle divin. Est-il croyable en effet que Démocrite ait été le premier à le penser et à le dire ? Rappelons plutôt qu’il y a dans l’Ion toute une théorie de l’inspiration poétique (533 e-534 e), qui est très voisine de celle du Phèdre : le poète ne compose que sous l’influence d’une possession divine ; la preuve en est qu’il est même incapable de composer en dehors du genre d’inspiration qui lui est propre, et qu’il peut même lui arriver de ne connaître qu’une seule fois l’inspiration. Voir plus loin p. cxxxii n. 1.
- ↑ Cf. p. 33, n. 3. Si la proposition initiale était, comme dans le texte ordinairement suivi : « ce qui se meut toujours est immortel », on comprendrait mal que à ce qui se meut toujours Platon opposât (δέ) ce qui ne se meut pas soi-même mais est mû par autre chose. D’autre part, il n’y aurait pas lieu de présenter comme une conséquence (δή) que ce qui se meut soi-même ne peut cesser de se mouvoir sans cesser d’être. Au surplus, la formule employée à e 3 paraît bien signifier que l’immortalité de ce qui se meut soi-même était l’énoncé du premier théorème à démontrer et que maintenant Platon déclare avoir en effet démontré : ce qui est répété au terme de la démonstration est, semble-t-il, ce qui a dû être dit pour signifier ce qu’elle se proposait tout d’abord.
- ↑ Cf. p. 34, n. 1. Comme tout à l’heure à propos de la notion de chose automotrice, Platon me paraît se fonder, pour faire entendre quel est le rôle du principe, sur ce qu’implique logiquement la notion de « Principe ». Or un principe engendré en supposerait un autre pareillement engendré, et ainsi à l’infini ; ce qui serait la négation même de la notion de « Principe » et, corrélativement, la négation d’une existence dépendant du principe comme de sa cause. C’est donc encore une sorte d’argument ontologique.
- ↑ À la vérité Platon dit : « à titre de chose inengendrée, le principe est aussi incorruptible ». En modifiant comme j’ai fait l’expression, j’ai voulu mettre en évidence que nous avons là une nouvelle preuve de l’immortalité de la chose automotrice, mais qui se fonde sur la notion même de « Principe », dont il vient d’être prouvé qu’elle est inhérente à cette chose.
- ↑ À propos de tout objet de la pensée il y a (Lois X 895 d-896 a) trois choses à considérer : la réalité de cette chose ou son ousia, c’est-à-dire, du point de vue de l’idéalisme platonicien, son essence ou Idée ; la notion ou définition de cette réalité, son logos ; enfin son nom. Ainsi la réalité dont le nom est « âme » a pour notion ou définition « ce qui se meut soi-même » et qui est par conséquent le principe de la génération et du mouvement. La notion ou définition de la chose nommée équivaut donc à la réalité de cette chose ; cf. Phédon 99 e sq.
- ↑ Cf. p. 35, n. 1 et Notice, p. cxxv sq.
- ↑ L’origine de cette image peut être (je dois encore cette indication à M. Ch. Picard) dans des représentations figurées comme celles des deux petites faces du sarcophage d’Hagia-Triada (qui remonte au Minoen récent II, environ 1450 av. J.-C.) ou de peintures sur certains vases des Cyclades (vie s.) au Musée d’Athènes. Mais l’âme n’y est pas figurée, comme ici, par l’ensemble des chevaux et du cocher sur son char : elle est sur le char la compagne du cocher. — Il n’y a donc aucune raison de supposer, avec Natorp (Platons Ideenlehre p. 72), un souvenir direct du début du poème de Parménide (fr. 1 D.). Sans doute y a-t-il là des chevaux, un char, un ou plutôt des cochers (v. 24). Mais l’image est très différente : ainsi chez Platon συνωρίς s’applique à l’attelage apparié qui tire le char, tandis que chez Parménide le terme voisin συνάορος s’applique au poète lui-même, qui s’apparie aux immortels cochers qui le conduisent. Au fond, le spectacle de la vie journalière suffisait, exception faite des ailes, à suggérer à Platon cette représentation.
- ↑ Quand il s’agit de l’attelage en général, divin comme humain, Platon se sert en effet du terme général zeugos ; le terme qui est employé ensuite pour l’âme humaine est synôris, qui désigne un attelage dont les chevaux sont couplés mais ne sont pas identiques. La différence ne consiste pas en ce que les chars des âmes divines n’auraient qu’un seul cheval comme si, à la fin de a, le pluriel les chevaux était déterminé par le sujet pluriel, les dieux. Mais, on le verra par la suite, le cas est le même que celui des âmes humaines. Toutefois, en ce qui concerne ces dernières, Platon commence par noter seulement une diversité, qui pourrait n’être que de race ou de taille ou d’âge. Puis il spécifie qu’au bon est associé du mauvais.
- ↑ Ce n’est pas en effet simplement un mélange en tant que tel, comme Platon semble le dire au début de b ; car les âmes divines comportent, on l’a vu, un mélange, mais du bon avec le bon. Ici comme ailleurs, Platon appelle « exempt de mélange » ce qui est mélangé selon des proportions exactement définies et sans mélange de rien d’étranger à sa nature : ainsi dans le Timée (57 c) ces corps premiers qui, loin d’être les éléments ou les lettres des choses, en sont les véritables syllabes, donc des mélanges dont il a déjà expliqué la composition ; ainsi dans le Philèbe (59 c) les objets de la dialectique, c’est-à-dire les Idées, dont l’exactitude a été comparée (58 cd) à la pureté d’un blanc qui n’est mêlé d’aucune autre couleur ou d’un plaisir qui n’est pas mêlé de douleur (53 ab). De même dans le Phèdre 247 d 2, quand il parle de « savoir sans mélange », cela ne doit pas s’entendre à la rigueur, puisqu’il n’y a pas de savoir qui ne comporte des relations (cf. Théét. 201 e-206 b).
- ↑ Cf. p. 36, n. 1. Wilamowitz I2 p. 463 suit le texte de Burnet et traduit comme j’ai fait. L’objet du morceau, qui est d’opposer des vies immortelles à des vies mortelles et de définir le sens de cette opposition, ne me paraît pas pouvoir comporter d’autre texte ni d’autre interprétation.
- ↑ Platon dit « la totalité du ciel », mais cette traduction, pouvant suggérer l’idée du ciel astronomique, m’a semblé équivoque. Il ne paraît pas douteux en effet qu’ici, au lieu de prendre le mot en son sens restreint, Platon ait voulu parler de tout ce qui existe sous la coupole du ciel, et tel est en effet le sens du grec ouranos. C’est ainsi que, après des fluctuations dont témoignerait le vocabulaire auquel s’étaient finalement arrêtés les Pythagoriciens (cf. Vorsokr. ch. 32, A 16 ; Robin, Pensée grecque p. 76 sq.), ouranos en est venu à recevoir pour équivalent le terme cosmos, que justement Platon emploie trois lignes plus bas et que nous traduisons par le Monde. Mais au temps de Platon l’équivalence n’est pas encore assez usuelle pour que l’écrivain puisse se dispenser de la signaler. Ainsi dans le Timée il se sert d’ouranos (31 ab) pour signifier, sans nul doute, le monde entier, alors qu’il a écrit précédemment (28 b) : « la totalité de l’ouranos ou bien du cosmos ou quelque autre nom qu’on veuille lui donner » ; de même Politique 269 d. Dans le Philèbe 28 d on voit que le tout, τό ὅλον, paraît être un autre de ces noms dont on tendait à se servir pour signifier « l’ensemble des choses » τὰ σύμπαντα, et 29 e que le mot cosmos est dans le même cas. Du reste chez Aristote ouranos a une semblable diversité d’acceptions : comme ici il signifie souvent l’ensemble des choses (cf. Bonitz Index Ar. 541 a 56 sqq.). Voir Burnet, Aurore de la philosophie grecque (Early Gr. Philos.), p. 31.
- ↑ La dissolution de ce composé est la mort, mais l’âme est immortelle : elle renaîtra donc, c’est-à-dire qu’elle formera avec un autre corps un nouveau composé. C’est ce que l’Orphisme appelle « le cercle de la génération » : s’il n’existait pas en tant que cercle mais que la génération se fît en ligne droite, alors ce serait la fin du monde (cf. Phédon 72 a-d). Il n’y aurait donc plus de vivants mortels et, en ce sens, cette chute de l’âme a un sens profond ou, comme le dit Z. Diesendruck p. 18, tout à fait positif. Ce n’en est pas moins pour l’âme une diminution d’être que de se trouver désormais condamnée à une vie qui est coupée de morts incessantes (cf. Banquet Notice, p. lxxxvii sq.).
- ↑ Le sens paraît être voisin de celui d’un passage du Banquet (208 ab) où Platon se propose semblablement de distinguer le mode d’existence du mortel et de l’immortel : l’existence du premier est discontinue, mais continuée, toujours nouvelle mais en apparence identique ; celle du second est une existence réellement et à jamais identique à elle-même. De même ici le mortel et l’immortel sont pareillement vivants, mais ce n’est pas de la même manière.
- ↑ Du dieu platonicien seulement, dit entre autres Wilamowitz I 464 ; car Platon ne veut pas l’identifier aux dieux respectés de la religion nationale, et les âmes qui, ailées, gouvernent l’univers sont dépourvues de corps ; c’est le développement subséquent de l’image qui conduit, en leur donnant des ailes, à paraître les pourvoir d’un corps. — Mais les dieux du Panthéon hellénique ne représentent-ils pas plutôt aux yeux de Platon une tradition, qu’il s’agit moins de respecter que de redresser pour en faire sortir une vérité ? Et les seuls dieux qui pour lui soient réellement des dieux ne sont-ils pas justement les dieux planétaires ? Au fond de ceci le vrai problème est celui de la relation du corps à l’âme et nous aurons à l’envisager par la suite ; cf. p. cxxxii sqq.
- ↑ Comparer Banquet 204 a déb. et ici 247 d : le savoir est inhérent à la nature du dieu, et c’est pour cela qu’un dieu ne désire pas le savoir comme un bien dont il serait dépourvu et que, par conséquent, il n’est pas philosophe. Il est remarquable que les trois termes nommés ici semblent répondre, dans un ordre renversé, à la hiérarchie qu’on trouve à la fin du Philèbe, 64 e sq. : le Bien inaccessible, la Beauté, la Vérité ; il ne manque ici que la Proportion.
- ↑ Cf. p. 37, n. 1. — Le mot hestia désigne proprement le foyer auprès duquel est placé l’autel des divinités domestiques : c’est la maison même. Puis le foyer de la famille devient une des grandes divinités olympiennes, petite-fille d’Ouranos et de Gaïa, fille de Cronos et de Rhéa, sœur de Zeus, de Poséïdôn, de Hadès, de Dêmêtêr et de Hêra. Si donc Platon l’identifie ici à la terre, c’est qu’il ne se fonde pas sur la tradition mythologique. Mais, comme dans le Timée 40 b fin, il paraît transposer une métaphore des Pythagoriciens : ce n’était pas en effet la terre, mais le feu central, que Philolaüs appelait, nous dit-on, « le foyer de l’univers », « la demeure de Zeus », « l’autel », etc. (cf. Vorsokr. ch. 32, A 16 et B 7 ; ch. 45, B 37 s. fin.). Quoi qu’il en soit, Cratyle (401 b ; p. 77, n. 3 de l’éd. de L. Méridier) et les Lois (V 745 c) nous disent que Hestia est la première divinité à honorer, avant Zeus et avant Athêna.
- ↑ L’Envie, ce démon qui, selon la tradition, jalouse le bonheur des hommes, est exclue par Platon des chœurs divins, comme dans le Banquet (203 b) Pauvreté a été tenue à l’écart du festin par lequel les dieux célébraient la naissance d’Aphrodite. Ici l’exclusion de l’Envie est l’expression mythologique d’une double intention : d’abord purifier la notion du dieu de cette jalousie méchante qui en était inséparable dans la croyance populaire ; puis dégager la responsabilité des dieux par rapport à des malheurs qui ne sont la conséquence que de notre propre méchanceté. Cette dernière idée serait donc la même que dans la République (II 379 bc, X 617 e) ou dans le Timée (41 e, 42 d ; cf. 29 e) : Dieu est innocent de la méchanceté des hommes parce que, d’une façon générale, le bien seul, non le mal, lui est imputable (cf. aussi Politique 269 e sq., 373 bc).
- ↑ Cf. aussi 248 a 3 et c 4. Quelle est cette révolution ? Est-elle identique à celle dont il sera question 247 e sq. et qui concerne le retour de chaque âme au chœur divin dont elle faisait originairement partie (cf. p. lxxxvii n. 3) ? Si Zeus représente ici la sphère des Fixes, on pourrait penser que la révolution dont il s’agit est la révolution diurne, le jour de 24 heures qui sert d’unité de mesure aux autres périodes de révolution. Mais ce serait sans doute une bien courte durée pour une contemplation pareille, le privilège en dût-il se renouveler régulièrement. Doit-on plutôt penser que Platon a en vue, comme dans le Timée (39 d), « ce nombre parfait du temps qui remplit une année parfaite », c’est-à-dire la durée d’une Grande Année ? Il n’y aurait aucun doute si Platon avait, ainsi que dans le Timée, parlé de révolution qui ramène au même point tous les astres les uns par rapport aux autres. — Certes, un esprit moderne a de la peine à concevoir, surtout chez un penseur de l’envergure de Platon, de pareilles spéculations qui supposent un synchronisme entre les révolutions astronomiques et l’exercice de la pensée pure. Il ne faut pourtant pas se hâter d’y voir de simples fantaisies. On ne doit pas oublier en effet que l’étude de l’astronomie est une voie d’ascension vers la dialectique (cf. p. 38, n. 2), et ce trait de l’éducation platonicienne montre assez clairement toute la portée symbolique du rapport spatial des révolutions célestes aux pures Idées. Ces spéculations ne sont pas du reste plus déconcertantes que d’autres du même genre, celles par exemple qui bientôt concerneront l’eschatologie.
- ↑ Cf. 248 b 5 ; 249 c fin ; 250 bc, e 1 ; 251 a 2 ; 253 c 3 ; 254 b 5.
- ↑ Par exemple Phédon 81 c-82 b, 83 de (cf. mon édition, p. 42 n. , où il faudrait ajouter Lois X 904 cd). — Le fragm. 146 d’Empédocle (qui provient probablement du poème des Purifications) peut avoir inspiré notre passage ; mais, si Platon y a pensé, c’est pour retourner la démarche décrite par Empédocle et qui est une remontée graduelle des âmes déchues vers la condition divine. On peut songer aussi au fr. 115, dans lequel est expliqué comment est bannie du ciel en vertu de l’arrêt de la Nécessité une divinité criminelle.
- ↑ La durée de cette révolution paraît être de mille ans si l’on se réfère à ce qui est dit 249 a et surtout 256 e fin (cf. p. cvii n. 1). Si cette révolution est celle dont il était question 247 d 5 (p. lxxxv n. 1) et que celle-ci dure le temps d’une Grande Année, on en devrait conclure que celle-ci est pour Platon un millénaire. Mais chez personne il n’y a trace d’une évaluation si modeste, et, en ce qui concerne Platon, on est réduit à des conjectures passablement arbitraires ; voir les commentaires du Timée par T. H. Martin (II p. 78) et de A. E. Taylor (p. 216 sqq.).
- ↑ Ainsi comprend Hermias 163, 1-3, 9 sq. Il admet en outre que, s’il y a perpétuité dans cette continuation, cela ne peut être dû qu’à des Génies bienveillants (13 sqq.), comme d’ailleurs le contraire à de mauvais Génies (25 sqq.). Il est superflu d’ajouter que rien chez Platon n’autorise cette interprétation ; voir la note suivante.
- ↑ C’est, dans la vie céleste, le pendant de cette autre malchance dont il est question à 250 a 4 et qui fait perdre ici-bas tout souvenir des visions préempiriques. Il y a quelque chose d’analogue, mais à rebours, dans le mythe d’Er : avant de revenir dans la génération et après leur séjour dans la plaine brûlante du Lêthê, les âmes qui se sont trop largement désaltérées au fleuve Amélès oublient tout ce qu’elles ont appris depuis la mort et chez Hadès.
- ↑ La préposition dont se sert ici Platon (ἐπὶ et non εἶς) semble indiquer que ce n’est pas à la chute même qu’il pense (cf. 246 c), mais plutôt à ce qui doit résulter de la chute, une fois faite, pour l’avenir de l’âme dans la génération.
- ↑ Il ne semble pas qu’ici le ou bien soit disjonctif comme il semble l’être pour les catégories suivantes. Être musicien (avoir de la culture), être instruit des choses d’amour, être ami de la beauté, tout cela converge vers la notion du philosophe ou de « celui qui aime les jeunes gens d’un amour philosophique » ; cf. ici 249 a et Banquet 211 b ; voir aussi p. 29, n. 1.
- ↑ C’est à peu près ainsi qu’Auguste Comte dans son système politique faisait des banquiers les organes, pour l’ordre temporel, de ce que prescrivent les philosophes dans l’ordre spirituel.
- ↑ Comme chez Aristophane les devins des Oiseaux ou de la Paix ; comme chez Euripide ces charlatans auxquels Thésée assimile Hippolyte (Hippol. 952-957 ; cf. les autres textes cités par L. Méridier, Euripide et l’Orphisme, Bulletin Budé, janv. 1938) ; comme enfin tous ces gens que dénonce Platon lui-même dans la République (II 364 b-365 a) et qui exploitent la crédulité d’autrui, surtout celle des riches.
- ↑ De même, Rép. X 618 b, la condition que les âmes ont choisie les détermine qualitativement et fonde entre elles un ordre hiérarchique, τάξις.
- ↑ D’après l’eschatologie du Gorgias (526 c) et de la République (X 614 c d) les âmes les meilleures, celles des vrais philosophes, sont soumises comme les autres au jugement. Or ici il semble qu’il n’y ait de jugement que pour ces dernières (249 a 5) : si en effet le renouveau des ailes est immédiat pour toute âme qui, par une vie philosophique, s’est déchargée de ce qui pesait sur elle (cf. 248 e 8 sqq., 249 a 4, c 4 sq.), les âmes des philosophes semblent monter
- ↑ Ce qui, dans l’eschatologie du Phédon (113 e), est pour toujours refusé aux grands coupables. Ce que leur refuse, semble-t-il, celle de la République (X 615 c-616 a) c’est seulement le droit au recommencement millénaire dont il est question ici. Voir Théorie platon. de l’Amour, p. 167 sqq.
- ↑ Ce cycle de trois millénaires appartenait, d’après Hérodote (II 123), à la doctrine des Égyptiens, à laquelle les Grecs l’auraient emprunté sans le dire. Voir en outre Pindare, Olympiques II 75 sqq.
- ↑ Peut-être ce Paradis que le Phédon (108 c, 110 c-111 c, 114 bc) réservait aux philosophes. Cf. aussi Lois X 904 cd.
- ↑ Il y a sur ce point quelque équivoque dans l’expression. En parlant ici d’âmes qui jamais n’ont vu la vérité et qui par là même sont incapables d’animer un corps d’homme, Platon semble admettre qu’il y a originairement des âmes de bêtes et que toute âme d’homme a eu au contraire originairement cette vision. Or, quand il a dressé le tableau des incarnations originaires, qui toutes sont des incarnations humaines, il paraît bien spécifier que les âmes inférieures sont des âmes qui n’ont pas vu la vérité (248 c 7). On pourrait être tenté de penser que ce sont, dans des corps d’hommes, des âmes de bêtes ; un peu plus loin en effet il est question d’hommes qui, dans les choses de l’amour, ne se comportent pas en hommes, mais en bêtes (250 e fin). Toutefois cette tentation échoue devant le texte décisif de 249 e fin. Il n’y a donc aucun doute sur l’intention profonde ; « ne pas voir » est pris au sens de « voir mal », et l’équivoque signalée est seulement due à l’élan lyrique de tout le morceau qui nuit parfois à la précision de l’expression.
- ↑ On peut se demander cependant si là-dessus la pensée de Platon n’a pas évolué. Dans le Phédon en effet (81 e-82 b, cf. 83 d fin) et, d’autre part, dans le Timée (41 bc, 76 d, 90 e-92 b), la condition de bête n’est pas le fait d’une option, mais le résultat nécessaire d’une vie humaine antérieure que dominaient de mauvais penchants et un résultat en harmonie avec ces penchants ; du supérieur à l’inférieur, la série de ces dégradations de l’homme commence par la femme, qui provient d’un homme lâche et injuste, et elle finit aux animaux aquatiques, qui descendent des hommes les plus intelligents et les plus ignorants. Peut-être, à la vérité, les deux conceptions ne sont-elles pas inconciliables. Peut-être aussi Platon pense-t-il que dans ce domaine mythique une vraisemblance n’est pas loin d’en valoir une autre.
- ↑ Il faut, je crois, garder ici le texte des mss. et d’Hermias. Les objections de Thompson et d’autres me semblent peu décisives : ce n’est pas de l’idée que Platon dit qu’elle va de la multiplicité à l’unité, mais bien de « l’acte de comprendre, comme on dit, selon l’Idée » ; pas davantage ce n’est l’idée qui est rassemblée par une réflexion raisonnée, mais c’est l’unité qui apparaît ainsi comme une totalité unifiée ; cf. 250 e et la note. Il n’y a rien d’autre ici que ce qu’on trouve dans Ménon 74 d-75 a, dans Phédon 65 d-66 a, 76 cd, dans la République VII 523 e-525 a ou X 596 ab, dans Théétète 148 d et ailleurs encore.
- ↑ Sur la réminiscence, cf. Ménon 80 d sqq., Phédon 72 e sqq.
- ↑ Cf. p. 42, n. 2. — Peut-être y a-t-il dans ce passage de quoi lever les doutes qui se sont élevés sur le sens d’une phrase du Timée (37 c) où Platon appelle le monde « une image produite des dieux éternels ». Dans une intéressante discussion de son commentaire (p. 184-186), A. E. Taylor rejette en effet l’interprétation, qui remonte à Plotin, d’après laquelle ces dieux éternels ce seraient les Idées elles-mêmes. Certes il n’est pas contestable que le Démiurge est un dieu éternel (34 a) ; il ne l’est pas non plus que, si les dieux sidéraux et à plus forte raison les autres ne sont pas éternels à la rigueur (41 d déb. ; cf. 40 e-41 a), on peut cependant les considérer comme tels (40 b). Mais, à prendre littéralement l’exposé du Timée, on voit que cet éternel Démiurge a travaillé d’après un modèle qui est lui-même éternel et absolument parfait (28 a-29 a, 30 d sq.), duquel on aurait quelque peine à le distinguer s’il n’était pas l’artisan d’une copie. Dès lors, en quoi serait-il choquant que les réalités intelligibles, toujours identiques à elles-mêmes et qui sont le modèle, c’est-à-dire les Idées, fussent appelées par Platon « les dieux éternels » ? L’expression s’accorde avec celle de « dieu futur », appliquée au monde en opposition à la perpétuelle existence du Démiurge (34 a), et elle se retrouve à la fin du Timée (92 c), où le monde est appelé « le dieu sensible qui est la copie du dieu intelligible ».
- ↑ Comparer Banquet, 218 d (discours d’Alcibiade).
- ↑ À l’opposé de ce que faisaient les deux premiers discours, qui ne se plaçaient qu’au point de vue de l’intérêt de l’aimé et qui tentaient de prouver à celui-ci que son avantage est de céder à l’amant qui est sans amour ou sans passion (cf. lxxiii et lxxvi sq.). D’un autre côté, s’il est vrai que ceci concerne à la fois l’amour et la philosophie, c’est-à-dire l’amour philosophique, la proposition pourrait être illustrée par un fameux passage du Banquet (cf. ma Notice de ce dialogue, p. xci sq.).
- ↑ Cette idée d’imitation (250 a 6) vaut qu’on s’y arrête. Sans doute peut-on dire avec le Phédon (74 a-75 a) que les égalités sensibles font ressouvenir de l’égalité en soi parce qu’elles lui ressemblent et qu’elles tendent à l’imiter quoique toujours imparfaitement. Mais elles sont plutôt une occasion médiate d’y penser et de mesurer la distance qui les en sépare. Aussi n’excitent-elles pas à cette occasion l’émotion qu’excite la beauté sensible, parce que l’évidence lumineuse de celle-ci imite immédiatement la splendeur de la Beauté idéale. C’est sur ce privilège de la beauté qu’insiste le développement qui suit. On pourrait rapprocher Banquet 210 e-212 a.
- ↑ Il ne semble pas que ces « troubles instruments » d’une représentation imaginaire puissent désigner l’homme juste ou tempérant : s’il est une image de la justice ou de la tempérance, par contre on voit mal comment il pourrait être appelé un « instrument ». Platon veut, je crois, parler des législations et des règles, traditionnelles ou codifiées, de la conduite. Ce sont en effet à la fois des instruments et des images, car elles reproduisent artificiellement, tant bien que mal et plutôt mal que bien, l’air de famille de ces réalités absolues ; peu nombreux sont en outre les législateurs capables de produire de tels instruments (cf. 258 c déb.) et le code de la conduite (les nomima) n’est l’œuvre que de Sept Sages. C’est justement l’obscurité et l’indistinction de telles images qui détermine Platon à entreprendre de fonder la société sur de nouvelles bases.
- ↑ Toutes les expressions dont se sert ici Platon viennent sans doute du vocabulaire des Mystères. En tout cas elles doivent être rapprochées de ce qu’il y a d’analogue dans le Phédon 67 ab et dans le Banquet 209 e sq., 210 e, 211 c-212 a.
- ↑ Qui sont ces derniers ? Sans doute il peut s’agir d’âmes qui sont depuis peu incarnées ; non bien entendu d’âmes nouvelles, car si la quantité d’âmes (c’est-à-dire de principes de vie) est constante (Rép. X 611 a ; cf. Phédon 72 a-d, Lois X 904 ab), une telle nouveauté est inconcevable. Ce n’est pas d’ailleurs pour les avoir perdues depuis trop longtemps que les âmes oublient les visions idéales ; c’est parce qu’elles entrent dans la génération et justement parce qu’elles s’unissent à un corps (cf. Phédon 75 d, 76 cd). Ne s’agit-il pas plutôt d’âmes en qui, par l’éducation ou par l’amour philosophique, la sève de l’initiation préempirique a vu sa fraîcheur renouvelée (cf. 251 a-c) ? Leur cas s’oppose très naturellement à celui des âmes dont il a été question auparavant et qui, s’étant laissé corrompre, sont incapables d’un tel renouveau.
- ↑ Ce serait une nouvelle preuve que Platon, tout en parlant le langage de l’amour masculin qui est familier à son milieu, y voit cependant une honteuse aberration ; cf. 256 c 3 sq. et Banquet Notice p. xlv-xlvii.
- ↑ Cf. p. 46 n. 2 et Banquet Notice, p. cii sq. — Le rapprochement de l’atopia et de l’aporia suggère, une fois de plus, l’idée d’une étroite parenté entre l’amour et la philosophie. La conduite de l’amoureux est si étrange qu’elle déroute son entourage (Banquet 182 e-183 c) et il est lui-même dérouté par un étrange dissentiment intérieur (ibid. 216 c). De même Socrate, c’est-à-dire le philosophe, déroute tout le monde par son étrangeté, mais il ne se sent pas moins dérouté lui-même par lui-même (Ménon 80 cd). De là l’embarras où ils sont, amoureux ou philosophe ne sachant comment trouver le chemin qui les mènera à leur but (Banquet 219 d fin, Ménon 80 d). La naissance d’une vérité dont on porte en soi-même la promesse suppose justement, à la racine de la maïeutique, ce sentiment d’embarras intérieur (Ménon 84 a, Théét. 151 a, d).
- ↑ Sur la « vague de désir », par quoi j’ai tenté de rendre le sens étymologique attribué par Platon au mot himéros, cf. p. 46 n. 1 et infra 255 c déb. — Quant à l’impertinence du second des vers cités 252 b fin, elle semble évidente. N’est-il pas inconvenant en effet de se réclamer des Immortels pour donner au dieu Amour un nom qui, si vrai qu’il puisse être, n’est du moins pas le sien et qui, de plus, prête à rire ? La faute de prosodie serait double : devant deux consonnes δέ devrait être une longue et non une brève ; d’autre part, dans πτεροφύτορ’, le ύ devrait à son tour être une brève et non pas une longue, au moins selon l’usage moderne ; car il semble qu’originairement la voyelle ait été longue dans la racine φυ, ainsi qu’elle l’est restée dans plusieurs temps du verbe φύω et comme Aristote en admet la possibilité dans sa Métaphysique, Δ 4 déb.
- ↑ Avec le texte traditionnel ἐκ Διός (à la source de Zeus), il me semble difficile de ponctuer après les mots : pareils aux Bacchantes, ainsi qu’on le fait d’ordinaire. Quand en effet les Bacchantes, comme le dit l’Ion 534 a, sont en état de possession et puisent aux fleuves le lait et le miel, ce n’est pas Zeus qui est l’auteur de cette possession, mais bien (ce que note Hermias 191, 22) Dionysos, qui est leur patron. Si donc Platon les prend ici comme exemple, ce serait pour les montrer faisant part à autrui de ces douceurs que, dans leur ivresse, elles font sortir de l’eau. Ceci n’est pas encore toutefois pleinement satisfaisant, tandis que la conjecture de De Geer (cf. p. 48 n. 1), que je n’ai pas osé transporter dans le texte, paraît propre à faire disparaître toute difficulté. Pourquoi en effet serait-il de nouveau question ici de l’inspiration de Zeus, déjà envisagée 252 e 1 ? Pourquoi Dionysos ne serait-il pas nommé comme le sont plus bas Hèra et Apollon ? Il ne semble pas d’ailleurs que Platon pense à Dionysos en tant qu’il est patron des ivrognes ; mais plutôt ainsi qu’il le fera plus tard (265 b 3, passage auquel se réfère vraisemblablement Hermias loc. cit.), en tant que Dionysos est patron de l’art des initiations. Une dernière remarque : Proclus, dans son commentaire du Premier Alcibiade (p. 26 sq. Creuzer), fait une allusion textuelle à notre passage, mais en omettant, comme s’il en était embarrassé, les mots sur lesquels porte la présente discussion.
- ↑ Comme les dieux qui ne connaissent pas l’envie (247 a fin), et contrairement à ce qui a lieu pour l’amant sans amour du premier discours de Socrate (238 e-239 b).
- ↑ Le terme dont se sert ici Platon, λόγω, est d’une ambiguïté voulue : il signifie à la fois la parole et la raison. De même il dira plus bas du bon cheval (253 e 7 sq.) qu’il « obéit docilement au cocher ». Or, le cocher qui sait ainsi se faire écouter, c’est l’intellect, conducteur ou pilote de l’âme (cf. 247 c fin).
- ↑ Ce passage difficile doit être interprété à la lumière des deux développements qu’il rappelle et auxquels j’ai renvoyé. Le mot dont use Platon 253 e 7, πόθος, signifie à la fois désir passionné et regret. Si on le prend au premier sens, on attribue au cocher une convoitise qui, d’après la description de Platon, est propre au cheval vicieux. Le second sens par contre implique chez le cocher le sentiment d’un manque, auquel s’oppose cette sensation généralisée de chaleur que provoque la vue du bel objet qu’il a devant lui. Hermias (196, 29-197, 7) a raison quand il note que la passion n’est pas le fait du cocher et que son désir ne peut aller que vers la Beauté absolue ; mais il a tort de prétendre que par « sensation » Platon a voulu désigner ici la « remémoration ». Tout au contraire cette sensation dont l’objet est une beauté empirique est nécessaire pour éveiller la réminiscence. Mais celle-ci ne se produit pas encore ; autrement, ce qui déjà aurait lieu, c’est ce qui sera décrit dans la suite immédiate. Donc ici la beauté est à la fois sentie comme présente puisque le bel objet est là, et devinée comme absente puisque la réminiscence de la Beauté absolue n’est encore qu’amorcée (cf. 254 b 6 sq.). C’est le mélange de sentiments contraires dont il était question 251 d.
- ↑ Cf. p. 53, n. L’Antéros est entendu ici au sens où le prend Eschyle, Agamemnon 544 : « Vous brûliez du désir de qui vous désirait » (trad. Paul Mazon). Mais cette émulation, où l’amant et l’aimé rivalisent à qui sera le plus amoureux l’un de l’autre, peut aussi se produire entre deux personnes qui aiment une même chose : ainsi dans ce passage de la République (VII 521 b) où Platon, par rapport à la possession du pouvoir, met en face les uns des autres les amoureux et les contre-amoureux, c’est-à-dire des rivaux qui se disputent un commun objet, extérieur à eux-mêmes. Dans le dialogue pseudoplatonique intitulé Antérastaï, la rivalité est au contraire entre deux amants qui aiment des choses différentes, l’un la philosophie, et l’autre les exercices physiques, chacun s’efforçant de convaincre son aimé de la supériorité de la chose qu’il aime. Il y a donc du mot antéros plusieurs acceptions, qui se rattachent à la diversité des sens de anti : ce préfixe marque en effet aussi bien réciprocité et échange qu’opposition et antagonisme.
- ↑ Ceci pour faire voir que la confusion des deux choses dans le discours de Lysias 232 e-233 d n’était en réalité qu’une méprise sur la dénomination.
- ↑ Cette partie de l’analyse évoque le souvenir, dans le Banquet, de la scène de « tentation » (218 b-219 d) : Alcibiade, amoureux de Socrate bien qu’il en croie être l’aimé, voit ses entreprises conquérantes échouer devant la raison et la réserve d’un homme pour qui l’amour, celui dont il est l’objet aussi bien que celui qu’il donne, dépasse le plan de la sensualité.
- ↑ Platon veut ici distinguer entre les bienfaits du délire d’amour quand le caractère divin en aura été sauvegardé par son application philosophique, et ceux des autres délires dont il a parlé 244 a-245 a : ceux-ci ne sont en effet bienfaisants que par rapport aux choses d’ici-bas. Même ainsi limitée, leur bienfaisance est cependant supérieure à celle des techniques humaines raisonnées, qui en sont de grossières contrefaçons (244 cd). À plus forte raison en doit-il être ainsi d’une forme du délire qui a été proclamée supérieure à toutes les autres (249 e déb. ; cf. 245 b fin). — Il me semble d’autre part moins probable que, comme le suggère Z. Diesendruck (p. 11, 13, 14), la sagesse humaine dont il est ici question soit celle dont le premier discours de Socrate était l’expression. N’étant la source d’aucun bienfait, sévèrement condamnée 256 e, elle ne peut en effet être mise en parallèle avec aucun délire divin, quel qu’il soit. La sagesse en amour n’a de prix que si elle sauvegarde la divinité du délire et si elle n’est pas un froid calcul ; elle caractérise celui des moteurs de l’âme qui est docile à la raison (cf. 253 d). Peut-on dès lors prétendre que le second discours de Socrate ne fasse qu’élargir, mais sans l’abandonner, le point de vue du premier ? La vérité semble être plutôt qu’on passe alors sur un plan qui est entièrement différent.
- ↑ Le Phédon 81 cd parle d’âmes qui, incapables au moment de la mort de se détacher de leur corps, sont retenues du côté du lieu visible et errent à l’entour des tombes. L’eschatologie de 248 e sqq. n’envisage que la destinée souterraine, vers laquelle l’état dont il s’agit ici n’est peut-être qu’un acheminement. — Quant à la substitution du nombre neuf au nombre dix pour les milliers d’années que doit durer l’exil de ces âmes (cf. 248 e fin), elle s’explique sans doute, comme le veut Hermias (205, 23-25), par l’exemption d’épreuve, accordée à toute âme, pour le premier millénaire qui a suivi la révolution céleste au cours de laquelle elle a eu part à la contemplation des réalités absolues (cf. 248 c et p. lxxxvii sq.).
- ↑ Sur ces deux points, voir les textes rassemblés Banquet p. 72 n. 1 et la Notice p. cvii.
- ↑ Voir par ex. 61 de ; 62 bc (cf. ici 273 e sq.) ; 70 b ; 79 ab, e ; 82 d-83 a, cd et Notice, p. xxvii et p. xxxii.
- ↑ Cf. IX 588 b-589 c, 590 a-c ; X 611 b-612 a. Voir Phèdre 250 c 6.
- ↑ Sur le sens de cette formule, voir Phédon, Notice p. xlviii n. 2.
- ↑ Phédon, par ex. 66 a, 67 a, 68 b, 82 d, 83 bc ; Banquet 174 d, 175 ab, 176 c, 220 cd.
- ↑ Thompson, p. xvi de l’Introduction à son édition du Phèdre.
- ↑ Cf. par ex. Gorgias 455 a, Théétète 201 a ; ici 260 a sqq.
- ↑ Voir A. Diès, Autour de Platon, p. 422, n. 1 et Notice p. liii.
- ↑ Ainsi que le font Burnet, Aurore etc. (Early Gr. Ph.) p. 319, n. 3 et A. E. Taylor, Plato p. 120, n. 1.
- ↑ Voir Zeller, Phil. der Griechen, II i⁴, p. 846, n. 1.
- ↑ Voir particulièrement 78 cd (comparer Banquet 211 b, e) et 80 b. Cf. aussi 76 c, e ; 79 de ; 83 e.
- ↑ Le sens de 611 b 6 sq. ne me paraît pas être : « à moins que la composition n’en soit aussi parfaite que vient de nous paraître celle de l’âme ». Par rapport au contexte du présent morceau cela constituerait une contradiction difficilement explicable. De plus, comment parlerait-on de la perfection d’un composé qui précédemment a été comparé (IX 588 b sqq.) à un être fabuleux dont la structure comprend un animal féroce, un animal paisible et enfin un monstre à mille têtes ? Le sens me paraît être : difficilement serait éternel « un composé qui ne jouit pas de la composition la plus belle, et c’est ainsi que maintenant nous est apparue l’âme ».
- ↑ Lois X 894 c, 896 cd, e sq. ; cf. Timée 46 de. La dernière idée est un élargissement d’une indication du Phédon, 98 c-99 c.
- ↑ Il est impossible d’entreprendre ici une discussion d’un texte aussi épineux. Je dirai seulement qu’il semble difficile, avec A. E. Taylor (The Timaeus p. 107 sq.), d’identifier Même et Autre avec Indivisible et Divisible. En effet l’Autre a sa place dans le monde des essences absolues, tandis que la divisibilité selon le corps est quelque chose de l’âme, s’il est vrai, comme nous le verrons tout à l’heure (cf. p. cxxxiii), qu’à ce stade de sa pensée Platon ne conçoit pas d’âme qui ne soit l’âme d’un corps.
- ↑ Le cercle de l’Autre est intérieur au cercle du Même, Timée 43 a.
- ↑ L’antériorité du Phédon sur la République n’est contestée par personne.
- ↑ Le passage des Lois, X 904 ab, où il est dit que âme et corps ne sont pas quelque chose d’éternel (οὐκ αἰώνιον) comme le sont les « dieux légitimes », mais qu’ils sont l’un et l’autre indestructibles, ne contredit pas ceci. L’αἰών en effet c’est l’éternité, et d’aucune façon il ne pourrait être question d’éternité pour une chose composée, sinon en ce qui concerne tel ou tel de ses composants. Au surplus le Phèdre dit simplement que l’âme est inengendrée, et non pas qu’elle est éternelle. Quant au Timée, il déclare (37 d, 38 c) que l’éternité (αἰών), immobile et une, n’appartient qu’au modèle, c’est-à-dire aux Intelligibles, et que les divers astres doivent être plusieurs images mobiles et numériquement mesurables de cette éternité.
- ↑ Le principal exposé s’en trouve dans le Ménon 99 b sq. Mais on la rencontre aussi dans l’Apologie 22 bc, dans l’Ion 534 bc, dans le Banquet 203 a, même dans les Lois III 682 a, IX 875 c ; et le Phèdre s’en souvient très évidemment 244 a, c, e sq., 245 c ; cf. 230 a et 256 b.
- ↑ De même, dans le Phédon 84 e, 85 b Socrate dit être un devin, comme le sont les Cygnes quand ils sentent qu’ils vont mourir : c’est parce qu’il est, comme eux, au service d’Apollon et possédé par ce dieu.
- ↑ Voir p. lxxix et p. xciv sq. — Il va sans dire que, dans ce qui suit, je laisse de côté les cinq premiers discours du Banquet, puisqu’ils ne représentent pas le point de vue de la philosophie sur la question.
- ↑ Il faut du reste noter que, dans le cadre limité du Banquet, le problème de savoir ce que vaut la formation rhétorique de la pensée a sa place : cf. 198 d-199 b.
- ↑ Ce que lui reproche Aristote, d’ailleurs sans le nommer, Métaph. Β 2, 997 b 15-20.
- ↑ Cf. 253 e-254 b, 255 e sq., 256 cd. — L’interprétation à laquelle je fais allusion est notamment celle de Wilamowitz Platon I², p. 468 sq. (cf. p. 44 et saep.). La question serait de savoir si un grand artiste ne peut peindre avec force que les sentiments qu’il a lui-même éprouvés et s’il n’est pas capable d’y réussir par l’observation d’autrui et grâce au pouvoir qu’il possède de faire vivre des émotions qui ne sont pas les siennes, au point même de sympathiser avec elles. Dira-t-on que Plaute ou Molière ou Balzac doivent avoir été eux-mêmes des avares pour avoir pu peindre l’avarice comme ils ont fait ? Peut-être est-il plus sage de voir ce qui est, que d’ériger en fait ce qu’on ignore totalement. Or ce qui est, c’est la condamnation par Platon de pratiques dont il avait autour de lui d’innombrables exemples et dont la psychologie spéciale était pour lui d’un si grand intérêt. Que cette condamnation provienne d’un repentir et manifeste un triomphe de la volonté, c’est une chose que sans doute nous ne saurons jamais. Cf. p. c sqq. et Banquet, Notice p. xliv sqq.
- ↑ Sur la question, voir O. Navarre Essai sur la Rhétorique grecque avant Aristote, 1900 (thèse Paris) ; E. Drerup, die Anfänge der rhetor. Kunstprosa (Jahrb. f. class. Philologie, Supplem.-bd 27, 1902, p. 218-351) ; H. Gomperz, Isokrates und die Sokratik (Wiener Stud. vol. 28, 1906, p. 1-42) ; W. Süss, Ethos, Studien z. älteren Rhetorik, 1910, etc.
- ↑ Platon s’amuse à user de ce procédé dans le passage, plein de verve, qui précède la palinodie : « Épouvantable, Phèdre, épouvantable est le discours… » (242 d).
- ↑ Pour savoir à quel point ce passage a embarrassé et divisé les érudits, on n’a qu’à lire la très intéressante revue qu’a faite A. Diès de ces discussions (en 1912) et qu’il a réimprimée dans le vol. I de Autour de Platon (p. 30-45). On comprendra que je ne puisse m’arrêter sur ce problème, dont tant d’efforts divergents semblent prouver qu’il est actuellement insoluble. Au surplus, si l’importance en est peut-être grande pour la question hippocratique, il n’en est pas de même en ce qui concerne l’intelligence de la pensée exprimée par le Phèdre.
- ↑ Il semble difficile que cette classification des discours puisse ressembler à celle des rhéteurs : discours concis ou abondants, qui excitent la pitié ou bien la fureur, etc. Hermias (247, 29 sq.) parle de discours démonstratifs ou sophistiques, abondants ou secs : ce qui n’est guère plus vraisemblable. L’indication donnée par Platon, 277 c déb., discours variés ou simples selon la qualité de l’âme, est une indication bien générale. Elle suggère cependant l’idée qu’il y a des discours dont le ton est uniforme, par exemple entièrement dialectiques et démonstratifs, comme l’a été dans la Palinodie la preuve de l’immortalité ; d’autres où la poésie du mythe et l’analyse psychologique se mêlent à la dialectique et à la démonstration, comme l’est le tout de la Palinodie, qui précisément a été définie comme un mélange (265 b fin). On peut du reste préciser encore cette indication en considérant que les divers genres de l’âme auxquels doivent correspondre les différentes sortes du discours sont déterminés, semble-t-il, par la prédominance en elle de tel ou tel de ses composants. Ainsi, à une âme où domine l’intelligence on parlera la langue de la démonstration ; les encouragements conviendront à celle qui, capable d’entendre la voix de la raison, est plutôt caractérisée par la noblesse instinctive de ses sentiments ; la remontrance conviendra au contraire à l’égard d’une âme en qui dominent la passion et la démesure qui en est l’accompagnement. Ce que dit Socrate à Calliclès dans le Gorgias, 506 c sqq., serait un échantillon de ce dernier genre de discours et nous en aurions de même un canevas dans Phédon 94 d. Au surplus le Phédon tout entier serait un très bon exemple de cette variété dans le discours : tour à tour on y trouve le plaidoyer, la confidence historique, le sermon réconfortant à l’adresse de ceux qui n’ont pas la foi, l’ « élévation », la démonstration dialectique, l’apologue, le mythe ; et, selon que Socrate parle à Simmias ou à Cébès, on sent qu’il mesure le ton sur la qualité différente de leurs âmes (Notice du Phédon, p. xvi).
- ↑ Cf. p. cxlvi. Voir sur ce point Paul Shorey, φύσις, μελέτη, ἐπιστήμη dans les Transactions of the American philological Association, vol. XL, 1910, p. 185-200.
- ↑ Cf. Gorgias 463 a (à comparer avec Phèdre 260 e et surtout avec Philèbe 55 e sq., 57 e sq., 58 a-59 c) : si la dialectique est pour l’exactitude au sommet de la hiérarchie des arts, il y en a cependant qui, au moins sous ce rapport, en approchent à des degrés divers, soit dans une certaine façon de les pratiquer, soit par une de leurs subdivisions ; mais la rhétorique n’est aucun de ces arts, telle que Gorgias la conçoit, et, quoi qu’il en dise, elle ne peut donc être le premier de tous.
- ↑ Cf. p. lxxxiv sqq. — Si le Parménide est antérieur au Phèdre, ceci donnerait à penser que la critique du début contre la séparation des Idées (130 b sqq.) est tenue pour négligeable ; ce qui a encore besoin d’être expliqué, la seconde partie le suggérait, c’est la liaison de ces Idées séparées avec ce qui en dépend et entre elles.
- ↑ Platon dit tour à tour 265 d 3 μία ἰδέα, e 4 ἕν τι κοινῇ εἶδος, 266 a 3 ἕν… πεφυκός εἶδος, b 5 ἕν καὶ ἐπί πολλᾶ πεφυκὸς εἶδος. Le texte de cette dernière formule est, il est vrai, controversé (p. 73, n. 1). Si l’on adopte la leçon des mss., dont l’altération s’expliquerait d’ailleurs aisément, la formule apparaît du même type que la précédente, sauf que Platon cette fois insiste sur ce point que, dans sa nature, l’unité atteinte doit être précisément l’unité de la multiplicité considérée. C’est ainsi que paraît avoir compris Hermias (236, 6) : « …l’homme qui est capable de poser son regard sur la nature des choses ». Mais ce qui est à mon sens décisif, c’est la comparaison avec Philèbe 16 e sq. (cf. 15 e) : à cet endroit Platon raille « les doctes hommes de ce temps-ci, qui font un comme cela se trouve », car c’est un danger de s’élever à une généralité trop ample et qui ne serait pas de nature à recouvrir (πεφυκὸς ἐπὶ) la multiplicité que seule on envisage. Il est clair en effet que, si on a commis cette faute initiale contre la nature des choses, la division fera découvrir des espèces qui seront prises par erreur pour les espèces du genre, mais qui en réalité supposent une généralité beaucoup plus élevée et plus vaste. Cf. p. clvii sq.
- ↑ Le rapprochement avec Cratyle 387 a, par lequel G. Rodier (Sur l’évolution de la dialectique de Platon, dans Études de philosophie ancienne, p. 62) veut indiquer que là-dessus le Phèdre n’apporte aucune nouveauté, est tout extérieur. À cet endroit il est en effet question, d’une façon très générale, de l’action de couper, puis de l’action de brûler, mais pour signifier enfin que l’action de nommer ne peut se faire n’importe comment ni, non plus, à l’aide de n’importe quel instrument.
- ↑ On voit ici assez bien comment se fait le passage de εἶδος, la nature essentielle de la chose, « forme » ou « Idée », à εἶδος « l’espèce », qui signifie également une détermination formelle, mais conçue comme dépendant d’une autre forme, moins différenciée et, par conséquent, plus élevée, le genre. Ajoutons d’ailleurs que, dans la langue de Platon, le rapport logique de γένος ; et de εἶδος n’est pas constamment le même que celui, dans nos langues modernes, des termes genre et espèce : ainsi, dans le Timée (57 cd), il est question de γένη (genres) qui sont des subdivisions de certaines εἶδη (espèces); langage très naturel si l’on se reporte au sens originaire, car ce sont proprement des familles qui sont issues d’une souche commune, laquelle est la forme initiale, le type de la race. Cf. Zeller, Ph. d. Gr., II 1⁴, p. 626 n. 1.
- ↑ Voir dans l’édition de A. Diès (coll. Budé) les schèmes de division, p. 306, 307, 311.
- ↑ Cette idée est mise en bonne lumière par un morceau très connu de la République VII 523 a-525 a, surtout 524 a, d.
- ↑ À la vérité, l’activité de Gorgias, sous l’influence, dit-on parfois, d’Empédocle, s’était déjà certainement exercée en Sicile avant son ambassade à Athènes en 427. Quant à la date de sa mort, pour la placer en 376 ou 370 comme on le fait d’ordinaire, on s’appuie sur la tradition qui le fait vivre cent sept, huit ou neuf ans. Ne peut-on supposer cependant que cette tradition se fonde sur une mauvaise lecture : ΡΖ (107), au lieu de ΠΖ (87) ? Confusion facile si, comme il arrive dans les anciennes écritures, le second jambage du ΠΖ était dans l’original plus court que le premier. La mort de Gorgias se placerait ainsi aux environs de 396. Par suite, on éviterait d’être obligé de croire que le Gorgias a été écrit alors que vivait encore le grand Sophiste. Et surtout, cela permettrait d’expliquer que dans le Banquet (198 c), dont la composition se place sans doute vers 384, Platon fasse dire à Socrate (par anachronisme, il est vrai, puisque la scène se place en 416) que le discours d’Agathon lui a remis Gorgias en mémoire et qu’il s’attendait à voir lancer sur son discours futur la tête même de Gorgias-Gorgone.
- ↑ Je laisse de côté Licymnius. Aristote, qui en outre le nomme comme poète dithyrambique (Rhét. III 12, 1413 b sq.), parle avec mépris de certaines nouveautés que sa Rhétorique avait introduites dans la terminologie usuelle (ibid. 13 fin) et note enfin que, d’après lui, c’est le sens ou la sonorité qui fait la beauté d’un mot (2, 1405 b 7). Suivant Hermias (239, 12), il aurait appris à Polus la distinction des mots en primitifs et composés, mots de même famille, mots adjectifs, etc.
- ↑ En toute cette histoire des débuts de la rhétorique en Sicile, c’est en effet Corax qui, peut-être encore après Empédocle, passe pour être l’initiateur. Or Corax n’est pas nommé par Platon, à moins qu’il n’ait voulu, comme le pensait Thompson, suggérer son nom dans le passage de 273 c (cf. p. 85 n. 2) : le corbeau (corax) symboliserait cet esprit de rapine duquel est issue la rhétorique judiciaire. — Il est à remarquer qu’un argument (cf. Navarre, op. cit., p. 16-18, p. 135-140), rapporté par Platon à la Rhétorique de Tisias (273 a sqq.), l’est par Aristote (Rhét. II 24, 1402 a 12-20) à celle de Corax et qu’il l’a été, par le même Aristote (ibid. 23, 1400 b 8-16), à celle de Théodore de Byzance ! Tout cela rend sceptique à l’égard de Corax comme auteur authentique de la τέχνη en question, aussi bien d’ailleurs qu’à l’égard de toute attribution qui ne concerne pas une époque récente.
- ↑ Platon le nomme dans le Ménexène (236 a) comme un très bon maître de rhétorique. Étant admis qu’il serait l’auteur des Tétralogies, qui seules intéressent l’histoire de la rhétorique, il n’y a pas à se demander s’il est distinct (ce que je ne crois pas) d’Antiphon le Sophiste, dont on connaît d’autres écrits.
- ↑ Banquet 196 c (cf. p. 52, n. 1 et Notice, p. lxviii n. 1). Il est possible que dans le Théétète il y ait une réponse à Alcidamas ; cf. A. Diès, Autour de Platon, p. 417 n. 1.
- ↑ Rapprochement entre la politique et la rhétorique : Phèdre 258 bc, 277 d, 278 c, e ; Antidosis 79-83. — Platon dit que les choses dont il parle sont grandes et sérieuses, et, d’un autre côté, que ses écrits ne sont qu’un jeu, et il n’attend pas la fin du Phèdre pour le dire (262 d 2, 265 c 1, 8 sq.). Or Isocrate observe (Hélène 11-13) qu’il est bien plus facile de jouer avec les grands sujets que de les traiter avec le sérieux qui leur convient. — Isocrate (Hélène 64) parle dans les mêmes termes que Platon de la « palinodie » par laquelle Stésichore, insulteur d’Hélène, a obtenu que fût levée sa peine. — Il fait remonter (Hél. 67) à la guerre de Troie l’origine des arts et des « philosophies » (entendez : de la rhétorique). Platon évoque (261 b) ces « Arts oratoires » que Nestor et Ulysse ont composés sous les murs de Troie pendant leurs heures de loisir. — Le reproche d’être simplement propédeutique, que Platon adresse à un enseignement de la rhétorique auquel fait défaut la pratique (269 a-c), peut être retrouvé chez Alcidamas (25 sq.), sans doute contre Isocrate. — Lysias, dit Phèdre (228 a 1), a pris tout son temps pour écrire son discours. Alcidamas (4, 10) le dit, exactement dans les mêmes termes, de tout discours écrit. — Quand une partie d’un écrit, dit encore ce dernier (14), a été très soignée, elle fait l’effet d’une déclamation d’acteur ou de rhapsode. Et Platon de son côté dit qu’il ne vaut pas la peine, ni qu’on l’écrive, ni qu’on le récite à la façon des rhapsodes (277 e fin). — Autre ressemblance verbale entre Alcidamas (34) et Phèdre 269 d.
- ↑ Ainsi dans le Phédon, p. ex. 64 b 9, 67 d 6 et e 3, 69 d 1 ; ou bien ici 249 a 1 (ἀδόλως), 261 a 4 (ἱκανῶς) ; comparer la « droite conception de l’amour des jeunes gens » (ὀρθῶς παιδεραστεῖν) du Banquet 211 b 6. Ordinairement c’est le contexte qui détermine l’acception dans laquelle le terme est employé. C’est ainsi que la comparaison de 239 a 4 avec b 4 permet de penser que, dans ce dernier endroit, la « philosophie » dont il est question, toute « divine » qu’elle est, n’est pas entendue en son vrai sens, mais en un sens rhétorique, puisque c’est du point de vue de la rhétorique que Socrate conçoit son premier discours. Peut-être en devrait-il être de même pour la « philosophie » qu’invoque le Pausanias du Banquet 182 c 1, 183 a 1.
- ↑ Le Parménide et le Sophiste pouvaient-ils être considérés autrement que comme des dialogues éristiques par un esprit aussi rebelle à la spéculation philosophique que l’était celui d’Isocrate ? Au surplus, le mot « éristique » n’avait sans doute pas pour lui l’acception historique définie que nous lui attribuons.
- ↑ Sur tout cela, voir C. Soph. 1, 3, 6, 21 ; Hél. 1-10 ; Antid. 45, 84, 258, 266, 269, 274, 285 ; Panathén. 29.
- ↑ Elle aurait été, d’après Speusippe (si la XXXe Lettre Socratique est de lui), primitivement hostile. Cf. H. Gomperz, op. cit., p. 39 ; G. Mathieu, Les idées politiques d’Isocrate, p. 154 sq.
- ↑ Parmi les ouvrages de Speusippe, Diogène mentionne d’ailleurs (IV 5) un Contre l’ἀμάρτυρος (le discours sans témoignages), dont on peut penser qu’il visait le plaidoyer d’Isocrate qui porte ce sous-titre (Contre Euthynoüs). Cf. Banquet, p. xli n. 2 et ici p. xiv n. 1 : Antisthène l’aurait aussi critiqué dans son Isagogê ou Lysias et Isocrate.
- ↑ Ainsi que le suggérait Thompson (173, 178), qui pourtant n’est pas allé tout à fait jusqu’au bout de ce que semble appeler cette suggestion. — Que la comparaison d’Isocrate avec Lysias fût, à l’époque, un thème de dissertation, on en a un indice à la fin de la note précédente.
- ↑ On connaît le mot de Cicéron, Orator 13, 47 : Haec de adulescente Socrates auguratur, at ea de seniore scribit Plato. Il ajoute qu’on ne sera pas de l’avis de Platon, si l’on n’aime pas Isocrate. Mais la question est plutôt de savoir si Platon pouvait l’aimer.
- ↑ Voir Phédon, Notice p. lxxix sq. et ici la Table des Sigles.
- ↑ De quelque façon qu’on doive l’interpréter ; cf. Alline, Histoire du texte de Platon, p. 238.
- ↑ Si souvent que je me suis abstenu d’en faire à chaque fois mention dans l’Apparat. Il s’ensuit, bien entendu, que dans plusieurs cas il est délicat de décider quelle a été sa leçon. Ex. : 250 c 7 μνήμῃ, 251 d 5 ἑκάστη, 252 a 7 ἐγγυτάτω, 256 e 5 σωφροσύνῃ θνητῇ, 279 a 9 ὁρμὴ θειοτέρα.
- ↑ Pour V je me fie aux collations de Burnet, mais il se peut qu’elles ne soient pas plus exactes que celles de W.
- ↑ Sur ce Papyrus et le suivant, cf. Alline, op. cit., p. 144, n. 2 (où l’on trouvera la référence à un important article de la Revue de Philologie, 1910), p. 145, p. 186.
- ↑ Les mots n’étant séparés ni dans l’un ni dans l’autre, les signes d’élision le plus souvent omis ainsi que l’adscription de l’iôta muet, on est parfois incertain du texte. Ex. : 230 d 5 μεθελει, 246 a 6 εοικετωδη). — L’iôta long est constamment écrit ει : (ainsi κεινησις).
- ↑ Je dois à l’obligeance de mon collègue Paul Collart d’avoir connu les deux derniers.
- ↑ Exception faite de deux lacunes, l’une qui porte sur le texte de 232 e 4 à 234 d 1 (p. 39, 7 Couvreur), l’autre au cours d’un long développement sur 245 cd (p. 108, 1), mais par laquelle n’est pas interrompue la consécution de l’exégèse du texte lui-même.
- ↑ Notamment 9, 9 sq. et 215, 12 sqq. ; cf. aussi 143, 23 sqq., 150, 24 et 200, 28 sq. — Sur tout ceci, cf. Am. Bielmeier, Die Neuplatonische Phaidros Interpretation : ihr Werdegang und ihre Eigenart, 1930, dans les Rhetor. Studien de E. Drerup, fasc. 16 (RÉG XLV, p. 116). D’après l’auteur, Jamblique et ceux qui dépendent de lui sont, par rapport à Plotin et à son cercle, les représentants d’une interprétation plus mystique et moins philosophique du dialogue : c’est assez probable.
- ↑ La seconde fois Philopon a pourtant τῷ μέλλοντι. — Simplicius (in Ar. Phys., 75, 3 Diels) lit notre texte.
- ↑ Il y en a des exemples dans Stobée, mais qui intéressent des points sans importance ; cf. ad 239 b 3.
- ↑ La liste qui suit ne comprend que les auteurs (ordre chronologique) mentionnés dans l’Apparat et qui ont fourni une variante ou servi à confirmer une leçon. Pour le surplus, voir les Testimonia de l’édition de Schanz ou de celle de Vollgraff. J’ai pour ma part dépouillé la collection des Commentateurs grecs d’Aristote, tâche facile depuis la publication de l’Académie de Berlin. Je ne mentionne l’édition dont je me suis servi que pour les auteurs au sujet desquels cette indication n’a pas été fournie déjà par les éditions du Phédon (p. lxxxi n. 1) et du Banquet (p. cxvii n. 1). — Aristote (De anima, Apelt, bibl. Teubner ; Métaphysique, W. D. Ross 1924) ; Cicéron (C. F. W. Müller, bibl. Teubner) ; Denys d’Halicarnasse (Usener et Radermacher, ibid.) ; Héraclite le Stoïcien (Allégories homériques, Mehler 1851) ; Sénèque (De tranquillitate animi, Hermes, bibl. Teubner) ; Plutarque ; Aristide ; Alexandre d’Aphrodise (In Ar. Topica, Wallies, Coll. de l’Acad. de Berlin ; De an., Ivo Bruns, ibid.) ; Albinus (Introductio in Platonis Dialogos, vol. VI du Platon de K. Fr. Hermann, bibl. Teubner) ; Lucien (Jacobitz, ibid.) ; Hermogène ; Plotin ; Origène ; Clément d’Alexandrie ; Eusèbe ; Jamblique (in Nicom. arithm. introd., Pistelli, ibid.) ; Synésius ; Aristénète ; Jean Stobée ; Syrianus (in. Ar. Metaph. Kroll, Coll. Acad. de Berlin) ; Hermias ; Proclus (in Rempubl., Kroll ; in Crat., Pasquali, bibl. Teubner) ; Jean Philopon (in Ar. de an. Hayduck, Coll. de l’Acad. de Berlin) ; Simplicius (in Ar. Phys., Diels, ibid.) ; David (Prolegomena et in Porphyrii Isagogê, Busse, ibid.) ; Élias (in Porph. Isag. et in Categ. Busse, ibid.) ; Photius ; Eustathe (ad Hom., Stallbaum) ; Nicéphore ; Anecdota graeca de Bekker.
- ↑ Preface ; Introduction ; Appendix I : On the erotic discourses of Socrates ; II On the philosophy of Isocrates, and the relation to the Socratic schools ; III The Eroticus of Cornelius Fronto.
- ↑ Platonis dialogus qui inscribitur Phaedrus, ad optimorum librorum, codicis Bodl. praecipue, fidem recognovit, Leyde, 1912. Le texte du Bodleianus (B) y est reproduit en face du texte établi par l’éditeur. On y trouve également le recueil des scholies et un recueil de corrections proposées au texte. Au bas de chaque page sont rassemblés les Testimonia.
- ↑ Les conjectures de Gottfried Hermann sur le texte proviennent des notes marginales de son exemplaire du Platon de Heindorf, qui est à la bibliothèque de l’Université de Cambridge. C’est Thompson qui, le premier, les a fait connaître dans son édition. — Dans l’Apparat critique, « Richards » désigne les Platonica de cet auteur et « Richards² », de nouvelles remarques publiées par lui en 1915 dans le Classical Quarterly (p. 205 sq.).
- ↑ J’ai procédé en cela comme pour le Banquet (cf. p. cxvii n. 2) ; ils sont donc signalés seulement quand leur texte n’est pas celui que j’ai adopté, sans que je m’astreigne d’ailleurs à les nommer séparément quand, à l’exception d’un seul (exc.), tous sont du même avis. J’ai négligé de signaler que Burnet et Vollgraff, d’accord en cela, comme on l’a vu (p. clxxvi), avec la copie du Phèdre dans W, adoptent constamment la désinence ῃ pour la 2e pers. sing. de l’indic. prés. moyen. D’autres particularités orthographiques de peu d’importance ont été cependant signalées : pour νῦν δή, que Schanz, Burnet et Vollgraff écrivent constamment νυνδή ; pour ὑιὸς, ὑιεῖς que les mêmes éditeurs, d’accord avec les inscriptions du temps, écrivent ὑός, ὑεῖς ; pour l’augment des verbes commençant par ευ ; pour l’emploi du ξ au lieu du σ dans les mots composés avec συν ; enfin pour le ν ephelkystique. Sur ces deux derniers points j’ai suivi la règle que je m’étais fixée pour le Phédon (cf. Notice p. lxxxv).
- ↑ 251 c 3 περὶ τὰ οὖλα, malgré les mss. et contrairement aux autres éditeurs, cf. p. 45, n. 2 ; 257 d 9 toute la phrase explicative de γλυκὺς ἀγκών, cf. p. 56, n. 3.
- ↑ 229 d 1 sq., transposé entre b 5 et 6 ; cf. p. 5, n. 2.
- ↑ 228 b 6 δέ τῳ, correction d’H. Estienne, adoptée par Thompson et Vollgraff ; 241 d 5 σε μεσοῦν, avec Hermann, au lieu de γε μεσοῦν des mss. et des autres éditeurs, ce verbe s’employant en effet ordinairement avec un sujet de personne (ex. Banquet 175 c 7) et le complément d’objet au génitif ; 244 d 7 ἔνι τισί, correction suggérée par Thompson ; 249 d 7 τε καί placé devant προθυμούμενος, avec Spengel, au lieu de l’être devant ἀναπτερούμενος 6, cf. p. 42, n. 3 ; 255 c 8 ἀναπληρῶσαν, avec Heindorf, car, si le courant a fait l’âme de nouveau ailée (ἀναπτηρῶσαν codd., Eusèbe), on ne comprend plus l’effet dont il est ensuite question ; 258 a 1, sans accepter la suppression de ἀνδρός proposée par Bergk et qui ne paraît pas indispensable, j’adopte sa correction συγγράμματος au lieu de συγγράμματι, codd. ; 260 b 9, en outre de στρατείας au lieu de στρατιᾶς (à l’armée), j’adopte avec Burnet et Vollgraff le πρός γ’ ἐνεγκεῖν de Thompson, au lieu du προσενεγκεῖν des mss., contre lequel celui-ci a apporté d’excellentes raisons ; 260 c 3, en accord avec un passage du Philèbe (cf. p. 61, n. 2), j’ai écrit comme Burnet γελοῖον καὶ φίλον, ce qui paraît avoir été le texte d’Hermias et répond en tout cas à son interprétation (220, 15 sq.).
- ↑ 244 e 3, quoique le αὐτὴν ἔχοντα d’Aristide ou le εὖ ἑαυτῆς ἔχοντα de Richards pussent être tentants, j’ai cependant gardé le τὸν ἑαυτῆς ἔχοντα des mss., en donnant à ce dernier mot le sens de μετέχοντα, comme dans Œdipe Roi, v. 709 ; 253 a 6 je n’ai pas osé suivre Geer en écrivant Διονύσου au lieu de Διός, mais cette correction me semble néanmoins très probable, cf. p. 48, n. 1 (49).
- ↑ Puisque Phèdre lit et relit son cahier, il est peu naturel qu’il y lise une fois γενομένων τούτων (230 e 7), et, les deux autres fois, τούτων γενομένων. La divergence n’existe d’ailleurs que dans B.
- ↑ 232 d 7, avec Burnet je repousse la correction de Heindorf σ’ ὑπ’ ἐκείνων au lieu de ὑπ’ ἐκείνων, car celui qui croit devoir à son mérite d’avoir réussi dans son entreprise aura des satisfactions d’orgueil à voir qu’on recherche le jeune garçon qui a cédé à ce mérite et se sentira personnellement insulté par ceux qui ne font aucun cas de sa conquête (cf. p. lxvi n. ) ; 236 c 3 je garde εὐλαβήθητι qui est dans tous les mss. et, avec T, je lis à la l. 2 ἵνα δέ, en coupant la phrase après εἶ : ce δέ me paraît en effet répondre au μέν de la ligne avant, et, à εὐλαβήθητι que je lie à καὶ μὴ βούλου, répond c 7 un autre impératif ἀλλὰ διανοήθητι (cf. p. xxxi n. 1) ; 238 a 6 κεκλῆσθαι, que lit aussi Stobée, me paraît devoir être préféré à la leçon de B κεκτῆσθαι : quand on a une passion dominante ou qu’on est possédé par elle (a 5, b 2 sq.), on est appelé d’un certain nom ; sur 245 d 3 et e 1, cf. p. 34, n. 1, 2 et Notice p. lxxvii sq. ; 246 a 6, cf. p. 35, n. 2 : il n’y a pas de raison de préférer à la leçon des mss. ἔοικέ τῳ δή ou δή τῳ la variante signalée dans T et dans W ἐοικέτω δή ; 248 b 6 δή), donné par les mss. et par le lemme d’Hermias, me paraît, étant repris à 7, devoir être gardé ici, et de même b 7 οὖ ἐστιν malgré sa proximité de οὖ δὴ ἕνεχ’), qui peut faire penser à l’interprétation d’une dittographie initiale ; 249 c 1 le neutre ἰόν, grammaticalement injustifiable, est cependant maintenu comme se rapportant au groupe ἄνθρωπον ξυνιέναι, et d’ailleurs garanti par l’accord des mss. avec un lemme d’Hermias (234, 22), cf. p. xciv n. 1.
- ↑ 228 b 7 ἱδών, après ἰδὼν μέν, que l’on cherche, soit à corriger, soit à justifier par un étrange motif (p. 3, n. 2), n’est pas répété dans l’Oxy. 1016 et il est d’ailleurs suspecté par un reviseur de T ; 239 e 4 τὰ τοιαῦτα est bien meilleur que αὐτά et surtout que ταῦτα ; 245 c 6 αὐτοκίνητον, pour les raisons données p. lxxvii n. 1 et p. 33, n. 3, doit être préféré à ἀεικίνητον ; 246 b 7 ψυχὴ πᾶσα (cf. p. 36, n. 1), confirmé d’ailleurs par une citation de Plotin, donne un trop bon sens pour que, en dépit des mss., on ne tienne pas compte du fait que cette leçon est retenue en outre par Eusèbe et par Simplicius ; 248 a 2 le pluriel θεοῖς, puisqu’il s’agit en général des âmes autres que celles des dieux, est plus naturel que le singulier θεῷ des mss., et l’idée d’assimilation, exprimée par les mots καὶ εἰκασμένη qui manquent en effet dans l’Oxy. 1017, est tout à fait hors de propos ; si d’autre part à 248 c 3 et 249 c 3 on a le singulier θεῷ, c’est qu’il s’agit du cortège d’un dieu déterminé.
- ↑ 236 c 2, point en haut après ὥσπερ αἱ Βάκχαι, cf. p. précéd. n. 2 ; 253 a 6 je mets, comme Schanz, la virgule devant εἶ et non après ce mot, cf. p. xcix n. 1 ; 269 b 2 je supprime la virgule après σύ, cf. p. 78, n. 2 ; 276 d 4 je lis un point au lieu d’une virgule après μετιόντι parce que, dans ce qui suit, on ne peut disjoindre l’opposition du plaisir en question à d’autres plaisirs qui sont sans délicatesse.