Le Livre des mille nuits et une nuit/Tome 09/Texte entier
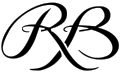
Que ce livre, ennemi des pédants aux pieds plombés, soit un hommage délicat
— non point au membre de l’institut, ni au directeur pour l’arabe à l’école des hautes études, pas plus qu’au maître de l’école des langues orientales — mais simplement comme à l’un des rares savants qui sachent la différence entre une gaze de soie et un treillis de fil de fer.
HISTOIRE D’ABOU-KIR ET D’ABOU-SIR
Schahrazade dit :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait autrefois dans la ville d’Iskandaria deux hommes dont l’un était teinturier et s’appelait Abou-Kir, et l’autre était barbier et s’appelait Abou-Sir. Et ils étaient voisins l’un de l’autre dans le souk, car leurs boutiques se touchaient porte à porte.
Or, le teinturier Abou-Kir était un insigne fripon, un menteur tout à fait détestable, une crapule ! Tellement ! Ses tempes devaient à coup sûr avoir été taillées dans quelque irréductible granit et sa tête façonnée avec les cailloux des marches de quelque église de Juifs, sans aucun doute ! Sinon comment lui serait-elle venue, cette audace sans vergogne dans les méfaits et toutes les vilenies ? Il avait coutume, entre diverses escroqueries, de faire payer d’avance la plupart de ses clients, sous prétexte qu’il avait be- soin d’argent pour l’achat des couleurs, et il ne rendait jamais les étoffes qu’on lui apportait à teindre, bien au contraire ! Non seulement il dépensait l’argent qu’il avait touché d’avance, en mangeant et en buvant tout à son aise, mais il vendait en secret les étoffes qu’on déposait chez lui, et se payait de la sorte toute espèce de jouissances et d’amusements de première qualité. Et quand les clients revenaient pour réclamer leurs effets, il trouvait moyen de les amuser, et de les faire attendre indéfiniment, tantôt sous un prétexte et tantôt sous un autre. Ainsi il disait, par exemple : « Par Allah ! ô mon maître, hier mon épouse a accouché, et j’ai été obligé de faire des courses à droite et à gauche, toute la journée. » Ou bien encore, il disait : « Hier j’ai eu des invités, et j’ai été tout le temps occupé de mes devoirs d’hospitalité à leur égard ; mais si tu reviens dans deux jours, tu trouveras ton étoffe toute prête dès l’aube. » Et il traînait les affaires de son monde en longueur, jusqu’à ce que, impatienté, quelqu’un s’écriât : « Voyons ! veux-tu enfin me dire la vérité au sujet de mes étoffes ? Rends-les-moi ! Je ne veux plus les faire teindre ! » Alors il répondait : « Par Allah ! je suis au désespoir ! » Et il levait les mains au ciel, en faisant toutes sortes de serments qu’il allait dire la vérité. Et s’étant lamenté et frappé les mains l’une contre l’autre, il s’écriait : « Imagine-toi, ô mon maître, qu’une fois les étoffes teintes, je les avais mises à sécher bien tendues sur les cordes devant ma boutique, et je m’étais absenté un instant pour aller pisser ; quand je revins elles avaient disparu, volées par quelque chenapan du souk, peut-être même par mon voisin, ce barbier calamiteux ! » À ces paroles, si le client était un brave homme d’entre les personnes tranquilles, il se contentait de répondre : « Allah m’en dédommagera ! » et il s’en allait. Mais si le client était un homme irritable, il entrait en fureur et chargeait le teinturier d’injures et en venait avec lui aux coups et à la dispute publique dans la rue, au milieu de l’attroupement général. Et malgré cela, et en dépit même de l’autorité du kâdi, il ne parvenait guère à recouvrer ses effets, vu que les preuves manquaient et que, d’un autre côté, la boutique du teinturier ne renfermait rien qui pût être saisi et vendu. Et ce commerce réussit ainsi et eut une assez longue durée, le temps que tous les marchands du souk et tous les habitants du quartier fussent dupés l’un après l’autre. Et le teinturier Abou-Kir vit alors son crédit irrémédiablement perdu et son commerce anéanti, attendu qu’il n’y avait plus personne qui pût encore être dépouillé. Et il devint l’objet de la méfiance générale, et on le citait en proverbe quand on voulait parler des friponneries des gens de mauvaise foi.
Lorsque le teinturier Abou-Kir se vit réduit à la misère, il alla s’asseoir devant la boutique de son voisin le barbier Abou-Sir, et le mit au courant du mauvais état de ses affaires, et lui dit qu’il ne lui restait plus qu’à mourir de faim. Alors le barbier Abou-Sir, qui était un homme qui marchait dans la voie d’Allah, et qui, bien que pauvre, était consciencieux et honnête, compatit à la misère d’un plus pauvre que lui, et répondit : « Le voisin se doit à son voisin ! Reste ici et mange et bois et use des biens d’Allah, jusqu’à des jours meilleurs ! » Et il le reçut avec bonté, et pourvut à tous ses besoins pendant un long espace de temps.
Or, un jour, le barbier Abou-Sir se plaignait au teinturier Abou-Kir de la dureté du temps et lui disait : « Vois, mon frère ! Je suis loin d’être un barbier maladroit, et je connais mon métier, et ma main est légère sur la tête des clients. Mais comme ma boutique est pauvre et que moi-même je suis pauvre, personne ne vient se faire raser chez moi ! C’est à peine si le matin, au hammam, quelque portefaix ou quelque chauffeur s’adresse à moi pour se faire raser les aisselles ou appliquer de la pâte épilatoire sur les aines ! Et c’est avec les quelques pièces de cuivre que ces pauvres donnent au pauvre que je suis, que j’arrive à me nourrir, à te nourrir et à subvenir aux besoins de la famille que supporte mon cou ! Mais Allah est grand et généreux ! » Le teinturier Abou-Kir répondit : « Tu es vraiment bien naïf, mon frère, d’endurer si patiemment la misère et la dureté du temps, quand il y a moyen de s’enrichir et de vivre largement. Toi tu es dégoûté de ton métier qui ne te rapporte rien, et moi je ne puis exercer le mien dans ce pays rempli de gens malveillants. Il ne nous reste donc plus qu’à délaisser ce pays cruel, et à nous en aller d’ici voyager à la recherche de quelque ville où exercer notre art avec fruit et consolation. D’ailleurs tu sais combien d’avantages on retire des voyages ! Voyager, c’est s’égayer, c’est respirer le bon air, c’est se reposer des soucis de la vie, c’est voir de nouveaux pays et de nouvelle terres, c’est s’instruire, et c’est, quand on a entre les mains un métier aussi honorable et excellent que le mien et le tien, et surtout aussi généralement admis dans toutes les terres et chez les peuples les plus divers, l’exercer avec de grands bénéfices, honneurs et prérogatives. Et de plus tu n’ignores point ce qu’a dit le poète sur le voyage :
« Quitte les demeures de ta patrie, si tu aspires aux grandes choses, et invite ton âme aux voyages.
Sur le seuil des terres nouvelles t’attendent les plaisirs, les richesses, les belles manières, la science et les amitiés choisies !
Et si l’on te dit : « Que de peines, ami, tu vas endurer, et de soucis et de dangers sur la terre lointaine ! » réponds : « Il vaut mieux être mort que vivant, si l’on doit toujours vivre dans le même lieu, insecte rongeur, entre des envieux et des espions ! »
« Ainsi donc, mon frère, nous n’avons rien de mieux à faire que de fermer nos boutiques et de voyager ensemble pour un sort meilleur ! » Et il continua à parler d’une langue si éloquente que le barbier Abou-Sir fut convaincu de l’urgence du départ, et se hâta de faire ses préparatifs qui consistèrent à envelopper dans un vieux morceau de toile rapiécée son bassin, ses rasoirs, ses ciseaux, son cuir à repasser et quelques autres petits ustensiles, puis à aller faire ses adieux à sa famille et à revenir dans la boutique retrouver Abou-Kir qui l’y attendait. Et le teinturier lui dit : « Maintenant il ne nous reste plus qu’à réciter la Fatiha liminaire du Korân, pour nous prouver que nous sommes devenus frères, et prendre ensemble l’engagement de mettre désormais en commun dans une cassette notre gain et de le partager entre nous, en toute impartialité, à notre retour à Iskandaria. Comme aussi nous devrons nous promettre que celui d’entre nous qui trouvera de l’ouvrage sera obligé de subvenir à l’entretien de celui qui ne pourra rien gagner ! » Le barbier Abou-Sir ne lit aucune difficulté pour reconnaître la légitimité de ces conditions ; et tous deux alors, pour sceller leurs mutuels engagements, récitèrent la Fatiha liminaire du Korân…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-HUITIÈME
Elle dit :
… et tous deux alors, pour sceller leurs mutuels engagements, récitèrent la Fatiha liminaire du Korân. Après quoi, l’honnête Abou-Sir ferma sa boutique et en remit la clef au propriétaire, qu’il paya intégralement ; puis ils prirent tous deux le chemin du port et s’embarquèrent, sans aucunes provisions, sur un navire qui mettait à la voile.
Le destin leur fut favorable durant le voyage, et leur vint en aide par l’entremise de l’un d’eux. En effet, parmi les passagers et l’équipage dont le nombre s’élevait en tout à cent quarante hommes, sans compter le capitaine, il n’y avait point d’autre barbier qu’Abou-Sir ; et lui seul par conséquent pouvait raser convenablement ceux qui avaient besoin d’être rasés. Aussi, dès que le navire eut mis à la voile, le barbier dit à son compagnon : « Mon frère, ici nous sommes en pleine mer, et il faut bien que nous trouvions de quoi manger et boire. Je vais donc essayer d’offrir mes services aux passagers et aux marins, dans l’espoir que quelqu’un me dira : « Viens, ô barbier, me raser la tête ! » Et moi je lui raserai la tête, moyennant un pain ou quelque argent ou une gorgée d’eau, de quoi pouvoir, moi et toi, en tirer notre profit ! » Le teinturier Abou-Kir répondit : « Il n’y a point d’inconvénient ! » et il s’étendit sur le pont, posa sa tête le mieux qu’il put et s’endormit, sans plus, tandis que le barbier s’apprêtait à chercher de l’ouvrage.
Dans ce but, Abou-Sir prit son attirail et une tasse d’eau, jeta sur son épaule un morceau de torchon pour toute serviette, car il était pauvre, et se mit à circuler parmi les passagers. Alors l’un d’eux lui dit : « Viens, ô maître, me raser ! » Et le barbier lui rasa la tête. Et lorsqu’il eut fini, comme le passager lui tendait quelque menue monnaie, il lui dit : « Ô mon frère, que vais-je pouvoir faire ici de cet argent ? Si tu voulais bien me donner plutôt une galette de pain, cela me serait plus avantageux et plus béni dans cette mer ; car j’ai avec moi un compagnon de voyage, et nos provisions sont bien peu de chose ! » Alors le passager lui donna une galette de pain, plus un morceau de fromage, et lui remplit d’eau sa tasse. Et Abou-Sir prit cela et s’en revint auprès d’Abou-Kir et lui dit : « Prends cette galette de pain, et mange-la avec ce morceau de fromage ; et bois l’eau de cette tasse ! » Et Abou-Kir prit tout cela, et mangea et but. Alors Abou-Sir le barbier reprit son attirail, jeta le torchon sur son épaule, prit la tasse vide à la main, et se mit à parcourir le navire, entre les rangs des passagers accroupis ou étendus, et rasa l’un pour deux galettes, l’autre pour un morceau de fromage ou un concombre ou une tranche de pastèque ou même de la monnaie ; et il fit une si belle recette qu’à la fin de la journée il avait amassé trente galettes, trente demi-drachmes et du fromage en quantité et des olives et des concombres et plusieurs tablettes de laitance sèche d’Égypte, celle qu’on retire des excellents poissons de Damiette. Et, en outre, il avait su si bien gagner la sympathie des passagers, qu’il pouvait leur demander n’importe quoi et l’obtenir. Et même il devint si populaire, que son habileté parvint aux oreilles du capitaine qui voulut se faire raser la tête également par lui ; et Abou-Sir rasa la tête du capitaine et ne manqua point de se plaindre à lui de la dureté du sort et de la pénurie où il se trouvait et du peu de provisions qu’il possédait. Et il lui dit aussi qu’il avait avec lui un compagnon de voyage. Alors le capitaine, qui était un homme à la paume large ouverte, et qui de plus était charmé des bonnes manières et de la légèreté de main du barbier, répondit : « Sois le bienvenu ! Je désire que tous les soirs tu viennes avec ton compagnon dîner avec moi. Et n’ayez plus tous deux aucun souci de quoi que ce soit, tant que durera votre voyage avec nous ! »
Le barbier alla donc retrouver le teinturier qui, selon son habitude, continuait à dormir et qui, une fois réveillé, lorsqu’il eut vu près de sa tête toute cette abondance de galettes, de fromage, de pastèques, d’olives, de concombres et de laitance sèche, s’écria émerveillé : « D’où tout cela ? » Abou-Sir répondit : « De la munificence d’Allah (qu’il soit exalté !) » Alors le teinturier se jeta sur toutes les provisions à la fois d’un geste qui voulait les engloutir dans son estomac chéri ; mais le barbier lui dit : « Ne mange pas de ces choses, mon frère, qui peuvent nous être utiles dans le moment de la nécessité, et écoute-moi. Sache, en effet, que j’ai rasé le capitaine ; et je me suis plaint à lui de notre pénurie en provisions ; et il m’a répondu : « Sois le bienvenu, et viens tous les soirs avec ton compagnon dîner avec moi ! » Or, c’est précisément ce soir le premier repas que nous allons prendre avec lui ! » Mais Abou-Kir répondit : « Il n’y a pas de capitaine qui tienne ! Moi j’ai le vertige de la mer, et je ne puis me lever de ma place. Laisse-moi donc apaiser ma faim avec ces provisions-ci, et va, toi seul, dîner avec le capitaine ! » Et le barbier dit : « Il n’y a pas d’inconvénient à la chose ! » Et, en attendant l’heure du dîner, il se mit à regarder manger son compagnon.
Or le teinturier se mit à attaquer et à mordre les bouchées comme le tailleur de pierres qui tranche des blocs dans les carrières, et à les avaler avec le tumulte que fait l’éléphant à jeun depuis des jours et des jours et qui engloutit avec borborygmes et gargouillements ; et les bouchées venaient en aide aux bouchées pour les pousser dans les portes du gosier ; et le morceau entrait avant que le précédent fût descendu ; et les yeux du teinturier s’écarquillaient sur chaque morceau comme les yeux d’un ghoul, et le cuisaient de leurs éclairs en le brûlant ; et il soufflait et meuglait comme le bœuf qui beugle devant les fèves et le foin.
Sur ces entrefaites, apparut un marin qui dit au barbier : « Ô maître du métier, le capitaine te dit : « Amène ton compagnon et viens pour le dîner ! » Alors Abou-Sir demanda à Abou-Kir : « Te décides-tu à m’accompagner ? » Il répondit : « Moi je n’ai point la force de marcher ! » Et le barbier s’en alla seul et vit le capitaine assis par terre devant une large nappe sur laquelle se trouvaient vingt mets de différentes couleurs, ou même davantage ; et l’on n’attendait que son arrivée pour commencer le repas auquel étaient également invités diverses personnes du bord. Et, le voyant seul, le capitaine lui demanda…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Et, le voyant seul, le capitaine lui demanda : « Où est ton compagnon ? » Il répondit : « Ô mon maître, il a le vertige de la mer et il est tout étourdi ! » Le capitaine dit : « Cela n’a aucune gravité. Ce vertige lui passera ! Assieds-toi là près de moi, et au nom d’Allah ! » Et il prit une assiette et la remplit de toutes les couleurs de mets avec si peu de parcimonie que chaque portion pouvait bien suffire à dix personnes. Et lorsque le barbier eut fini de manger, le capitaine lui tendit une seconde assiette en lui disant : « Porte cette assiette à ton compagnon ! » Et Abou-Sir se hâta d’aller porter l’assiette pleine à Abou-Kir qu’il trouva en train de moudre avec ses crocs et de travailler des mâchoires comme un chameau, tandis que les morceaux énormes continuaient à s’engouffrer dans sa gueule les uns sur les autres, rapidement. Et il lui dit : « Ne t’avais-je pas dit de ne pas fermer ton appétit avec les provisions ? Regarde ! Voici les choses admirables que t’envoie le capitaine. Que dis-tu de ces excellentes brochettes de kabab d’agneau, qui viennent de la table de notre capitaine ? » Abou-Kir, avec un grognement, dit : « Donne ! » Et il se précipita sur l’assiette que lui tendait le barbier, et il se mit à tout dévorer des deux mains avec la voracité du loup ou la rage du lion ou la férocité du vautour qui fond sur les pigeons ou la furie de l’affamé qui a failli finir de faim et ne fait point de façons pour se farcir avec fougue. Et, en quelques instants, il la nettoya et la lécha pour la jeter vide absolument. Alors le barbier ramassa l’assiette et la porta aux gens du bord, pour aller boire ensuite quelque chose avec le capitaine, puis retourner passer la nuit près d’Abou-Kir qui ronflait déjà de toutes ses ouvertures, en faisant autant de vacarme que l’eau heurtant le bateau.
Le lendemain et les jours suivants le barbier Abou-Sir continua à raser les passagers et les marins, en gagnant provendes et provisions, dînant le soir avec le capitaine, et servant en toute générosité son compagnon qui, pour sa part, se contentait de dormir, ne se réveillant que pour manger ou satisfaire la nécessité, et cela durant vingt jours de navigation, jusqu’à ce que, au matin du vingt-unième jour, le navire fût entré dans le port d’une ville inconnue.
Alors Abou-Kir et Abou-Sir descendirent à terre et allèrent louer dans un khân un petit logement que se hâta de meubler le barbier avec une natte neuve achetée au souk des nattiers et deux couvertures de laine. Après quoi le barbier, ayant pourvu à tous les besoins du teinturier, qui continuait à se plaindre du vertige, le laissa endormi dans le khân, et s’en alla par la ville, chargé de son attirail, exercer sa profession au coin des rues, en plein air, en rasant soit des portefaix, soit des âniers, soit des balayeurs, soit des vendeurs ambulants, soit même des marchands assez importants attirés par son rasoir savant. Et il rentra le soir pour aligner les mets devant son compagnon qu’il trouva endormi et qu’il ne réussit à réveiller qu’en lui faisant sentir le fumet des brochettes d’agneau. Et cet état de choses dura de la sorte, Abou-Sir se plaignant toujours d’un reste de vertige marin, quarante jours pleins ; et chaque jour, une fois à midi et une fois au coucher du soleil, le barbier rentrait au khân pour servir et nourrir le teinturier, après le gain que lui octroyaient le destin de la journée et son rasoir ; et le teinturier engloutissait galettes, concombres, oignons frais et brochettes de kabab, sans fatigue aucune pour son estomac chéri ; et le barbier avait beau lui vanter la beauté sans pareille de cette ville inconnue, et l’inviter à l’accompagner à une promenade dans les souks ou les jardins, Abou-Kir répondait invariablement : « Le vertige marin me tient encore la tête ! » et, après avoir roté divers rots et peté divers pets de diverses qualités, il se renfonçait dans son pesant sommeil. Et l’excellent et honnête barbier Abou-Sir se gardait bien de faire le moindre reproche à son crapuleux compagnon, ou de l’ennuyer par des plaintes ou des discussions.
Mais, au bout de ces quarante jours, le barbier, ce pauvre, tomba malade et, ne pouvant plus sortir pour vaquer à son travail, pria le portier du khân de soigner son compagnon Abou-Kir et de lui acheter tout ce dont il pouvait avoir besoin. Mais, quelques jours après, l’état du barbier empira si gravement que le pauvre perdit l’usage de ses sens et devint inerte et comme mort. Aussi, comme il n’était plus là pour nourrir le teinturier ou lui faire acheter le nécessaire, celui-ci finit par sentir cruellement la brûlure de la faim et fut bien obligé de se lever pour chercher de droite et de gauche quelque chose à se mettre sous la dent. Mais il avait déjà tout nettoyé dans le logement, et il ne trouva absolument rien à manger ; alors il fouilla dans les vêtements de son compagnon étendu inerte sur le sol, y trouva une bourse qui contenait le gain du pauvre, amassé cuivre par cuivre durant la traversée et les quarante jours de travail en ville, la serra dans sa ceinture, et, sans plus s’occuper de son compagnon malade que s’il n’existait pas, il sortit en fermant derrière lui, avec le loquet, la porte de leur logement. Et comme le portier du khân était à ce moment-là absent, nul ne le vit sortir et ne lui demanda où il allait.
Or, le premier soin d’Abou-Kir fut de courir chez un pâtissier où il se paya un plateau entier de kenafa et un autre de feuilletés sablés ; et là-dessus il but une cruche de sorbet au musc et une autre à l’ambre et aux jujubes. Après quoi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Après quoi il se dirigea vers le souk des marchands et s’acheta de beaux vêtements et de belles affaires, et, somptueusement accoutré, il se mit à se promener à pas lents par les rues, et à s’égayer et s’amuser des choses nouvelles qu’il découvrait à chaque pas dans cette ville qu’il croyait n’avoir pas sa pareille dans le monde. Mais, entre autres choses, un fait étrange le frappa particulièrement. Il remarqua, en effet, que tous les habitants, sans exception, étaient habillés pareillement d’étoffes uniformes quant à leurs couleurs : on ne voyait que du bleu et du blanc, pas autre chose. Même dans les boutiques des marchands il n’y avait que des étoffes blanches et des étoffes bleues, pas une couleur de plus. Chez les vendeurs de parfums, il n’y avait que du blanc et du bleu ; et le kohl lui-même était visiblement bleu. Chez les marchands de sorbets, il n’y avait que des sorbets blancs dans les carafes et point de rouges ou de roses ou de violets. Et cette découverte l’étonna extrêmement. Mais là où sa stupéfaction parvint à ses extrêmes limites, ce fut à la porte d’un teinturier : dans les cuves du teinturier il ne vit, en effet, que de la teinture bleu-indigo, sans plus. Alors, ne pouvant plus maîtriser sa curiosité et son étonnement, Abou-Kir entra dans la boutique, et tira de sa poche un mouchoir blanc qu’il tendit au teinturier en lui disant : « Pour combien, ô maître du métier, me teindras-tu ce mouchoir ? Et quelle couleur lui donneras-tu ? » Le maître teinturier répondit : « Je ne te prendrai, pour te teindre ce mouchoir, que la somme de vingt drachmes ! Quant à sa couleur, elle sera bleu-indigo, sans aucun doute ! » Abou-Kir, suffoqué de la demande exorbitante, s’écria : « Comment ? tu me demandes vingt drachmes pour teindre ce mouchoir, et encore en bleu ? Mais dans mon pays ça ne coûte qu’un demi-drachme ! » Le maître teinturier répondit : « Dans ce cas retourne le teindre dans ton pays, mon bonhomme ! Ici nous ne le pouvons à moins de vingt drachmes, sans un cuivre de rabais ! » Abou-Kir reprit : « Soit ! mais je ne veux pas le faire teindre en bleu. C’est en rouge que je le veux ! » L’autre demanda : « Dans quelle langue me parles-tu ? Et qu’entends-tu par rouge ? Est-ce qu’il y a de la teinture rouge ? » Abou-Kir, stupéfait, dit : « Alors teins-le-moi en vert ! » Il demanda : « Qu’est-ce que la teinture verte ? » Il dit : « Alors en jaune ! » Il répondit : « Je ne connais pas cette teinture-là ! » Et Abou-Kir continua à lui énumérer les couleurs des diverses teintures, sans que le maître teinturier comprît de quoi il s’agissait. Et comme Abou-Kir lui demandait si les autres teinturiers étaient aussi ignorants que lui, il lui répondit : « Nous sommes dans cette ville quarante teinturiers qui formons une corporation fermée à tous les autres habitants ; et notre art se transmet de père en fils, à la mort seulement de l’un de nous. Quant à employer une autre teinture que la bleue, cela nous ne l’avons jamais entendu ! »
À ces paroles du teinturier, Abou-Kir dit : « Sache, ô maître du métier, que moi aussi je suis teinturier et je sais teindre les étoffes non seulement en bleu, mais en une infinité de couleurs que tu ne soupçonnes pas. Prends-moi donc à ton service, moyennant salaire, et je t’enseignerai tous les détails de mon art, et tu pourras alors te glorifier de ton savoir devant toute la corporation des teinturiers ! » Il répondit : « Nous ne pouvons jamais accepter d’étranger dans notre corporation et notre métier ! » Abou-Kir demanda : « Et si j’ouvrais pour mon propre compte une boutique de teinturier ? » L’autre répondit : « Tu ne le pourras guère non plus ! » Alors Abou-Kir n’insista pas davantage, sortit de la boutique et alla trouver un second teinturier, puis un troisième et un quatrième, et les autres teinturiers de la ville ; et tous le reçurent de même, et lui firent les mêmes réponses, sans l’accepter pas plus comme maître que comme apprenti. Et il alla conter sa plainte au cheikh-syndic de la corporation qui lui répondit : « Je n’y puis rien. Notre coutume et nos traditions nous défendent d’accepter un étranger parmi nous. »
Devant cette réception, unanime dans le refus, de tous les teinturiers, Abou-Kir sentit son foie se gonfler de fureur, et il alla au palais et se présenta devant le roi de la ville et lui dit : « Ô roi du temps, je suis étranger et de ma profession je suis teinturier, et je sais teindre les étoffes de quarante couleurs différentes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
« … et je sais teindre les étoffes de quarante couleurs différentes. Et pourtant il m’est arrivé telle et telle chose avec les teinturiers de cette ville qui ne savent teindre qu’en bleu. Moi, je puis donner à une étoffe les couleurs et les nuances les plus charmantes : le rouge avec ses divers degrés, par exemple le rose et le jujube ; le vert avec ses divers degrés, par exemple le vert-végétal, le vert-pistache, le vert-olive et le vert-aile de perruche ; le noir avec ses divers degrés, par exemple le noir-charbon, le noir-goudron, le noir-bleu de kohl ; le jaune avec ses divers degrés, par exemple le jaune-cédrat, le jaune-orange, le jaune-limon et le jaune d’or, et bien d’autres couleurs extraordinaires ! Tout cela ! Et pourtant les teinturiers n’ont voulu de moi ni comme maître ni comme apprenti salarié ! »
En entendant ces paroles d’Abou-Kir et cette énumération prodigieuse de couleurs dont il n’avait jamais ouï parler ni soupçonné l’existence, le roi s’émerveilla et se trémoussa et s’écria : Ya Allah ! que c’est admirable ! » Puis il dit à Abou-Kir : « Si tu dis vrai, ô teinturier, et si vraiment tu peux avec ton art nous réjouir les yeux de tant de couleurs merveilleuses, tu n’as qu’à chasser tout souci et à tranquilliser ton esprit. Je vais de suite t’ouvrir moi-même une teinturerie, et te donner un gros capital en argent. Et tu n’as rien à redouter de ces gens de la corporation ; car si l’un d’eux par malheur s’avisait de te molester, je le ferais pendre à la porte de sa boutique ! » Et aussitôt il appela les architectes du palais et leur dit : « Accompagnez ce maître admirable, parcourez avec lui toute la ville, et, lorsqu’il aura trouvé un endroit à son goût, que ce soit une boutique, ou un khân, ou une maison, ou un jardin, chassez-en immédiatement le propriétaire, et bâtissez en toute hâte, sur l’emplacement, une grande teinturerie avec quarante cuves de grande dimension et quarante autres d’une moindre dimension. Et, en toute chose, agissez suivant les indications de ce grand maître teinturier ; suivez ponctuellement ses ordres et prenez bien garde de faire mine de lui désobéir en quoi que ce soit ! » Puis le roi fit don à Abou-Kir d’une belle robe d’honneur et d’une bourse de mille dinars, en lui disant : « Dépense pour tes plaisirs cet argent, en attendant que soit prête la nouvelle teinturerie ! » Et il lui fit, en outre, cadeau de deux jeunes garçons pour le servir, et d’un merveilleux cheval harnaché d’une belle selle de velours bleu et d’une housse en soie de même couleur. De plus il mit à sa disposition, pour qu’il l’habitât, une grande maison richement meublée par ses soins et desservie par un grand nombre d’esclaves.
Aussi Abou-Kir, vêtu maintenant de brocart et monté sur son beau cheval, apparaissait-il brillant et majestueux tel un émir fils d’émir ! Et le lendemain il ne manqua pas, toujours monté sur son cheval et précédé de deux architectes et des deux jeunes garçons qui écartaient la foule sur son passage, de parcourir les rues et les souks à la recherche d’un emplacement où bâtir sa teinturerie. Et il finit par fixer son choix sur une immense boutique voûtée, située au milieu du souk, et dit : « Cet endroit-ci est excellent ! » Aussitôt les architectes et les esclaves chassèrent le propriétaire, et commencèrent aussitôt à démolir d’un côté et à bâtir de l’autre, et ils apportèrent un si grand zèle dans l’accomplissement de leur tâche, sous les ordres d’Abou-Kir à cheval qui leur disait : « Faites ici telle et telle chose et là telle et telle autre chose ! » qu’en un rien de temps ils terminèrent la construction d’une teinturerie qui n’avait pas sa pareille dans aucun endroit sur la terre.
Alors le roi le fit appeler et lui dit : « Maintenant il ne s’agit plus que de faire marcher la teinturerie ; mais sans argent rien ne peut marcher. Voici donc, pour commencer, cinq mille dinars d’or comme première mise de fonds. Et me voici tout impatient de voir le résultat de ton art en teinturerie ! » Et Abou-Kir prit les cinq mille dinars, qu’il serra soigneusement dans sa maison, et avec quelques drachmes, tant les ingrédients nécessaires étaient à bon compte et restaient invendus, il acheta chez un droguiste toutes les couleurs qui étaient entassées chez lui dans des sacs encore intacts, et les fit transporter dans sa teinturerie où il les prépara et les délaya savamment dans les grandes et les petites cuves…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… et les délaya savamment dans les grandes et les petites cuves.
Sur ces entrefaites, le roi lui envoya cinq cents pièces d’étoffes blanches en soie, en laine et en lin pour qu’il les teignît selon son art. Et Abou-Kir les teignit de différentes manières en leur donnant soit des couleurs pures de tout mélange, soit des couleurs composées, de telle façon qu’il n’y eût pas une seule étoffe qui ressemblât à l’autre ; puis, pour les faire sécher, il les étendit sur des cordes qui partaient de sa boutique et allaient d’un bout de la rue à l’autre bout ; et les étoffes colorées, en séchant, s’avivaient merveilleusement et produisaient sous le soleil un spectacle splendide.
Lorsque les habitants de la ville virent cette chose si nouvelle pour eux, ils furent ébahis ; et les marchands fermèrent leurs boutiques pour accourir et mieux voir, et les femmes et les enfants poussaient des cris d’admiration, et les uns et les autres demandaient à Abou-Kir : « Ô maître teinturier, quel est le nom de cette couleur-là ? » Et il leur répondait : « Ceci est du rouge grenat ! ceci est du vert d’huile ! ceci est du jaune cédrat ! » Et il leur nommait toutes les couleurs, au milieu des exclamations et des bras levés pour attester une admiration sans bornes.
Mais soudain le roi, qui avait été averti que les étoffes étaient prêtes, déboucha à cheval au milieu du souk, précédé de ses coureurs qui écartaient la foule, et suivi de son escorte d’honneur. Et à la vue des étoffes chatoyantes de tant de couleurs sous la brise qui les faisait onduler dans l’air incandescent, il fut ravi à la limite du ravissement et resta immobile longtemps, sans respiration, avec les yeux tout blancs de dilatation. Et les chevaux eux-mêmes, loin d’être effrayés de ce spectacle inaccoutumé, se montrèrent sensibles aux belles couleurs et, de même qu’ils caracolent au son des fibres et des clarinettes, ils se mirent à danser de côté, ivres de toute cette gloire qui trouait l’air et claquait au vent.
Quant au roi, ne sachant comment honorer le teinturier, il fit descendre de cheval son grand-vizir et monter Abou-Kir à sa place, en le mettant à sa droite, et, ayant fait ramasser les étoffes, il reprit le chemin du palais où il combla Abou-Kir d’or, de présents et de privilèges. Il fit ensuite tailler dans les étoffes colorées des robes pour lui, pour ses femmes et pour les grands du palais, et donner mille nouvelles pièces à Abou-Kir afin qu’il les lui teignît aussi merveilleusement ; si bien, qu’au bout d’un certain temps, tous les émirs d’abord, puis tous les fonctionnaires eurent des robes colorées. Et les commandes affluèrent en quantité si considérable chez Abou-Kir, nommé teinturier en titre du roi, qu’il devint bientôt l’homme le plus riche de la ville ; et les autres teinturiers, avec le chef de la corporation en tête, vinrent lui faire des excuses pour leur conduite passée, et le prièrent de les employer chez lui comme apprentis sans salaire. Mais il refusa leurs excuses et les renvoya honteusement. Et l’on ne voyait plus, à travers les rues et les souks, que des gens habillés d’étoffes multicolores et fastueuses, teintes par Abou-Kir, le teinturier du roi. Et voilà pour lui !
Mais pour ce qui est d’Abou-Sir, le barbier, voici…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
… mais pour ce qui est d’Abou-Sir, le barbier, voici !
Une fois qu’il eut été dépouillé et délaissé par le teinturier, qui était parti après l’avoir enfermé dans le logement, il resta étendu à demi-mort pendant trois jours, au bout desquels le portier du khân finit par s’étonner de ne voir sortir aucun d’eux ; et il se dit : « Ils sont peut-être partis sans me payer le prix de location du logement ! Peut-être aussi sont-ils morts ! Ou encore peut-être c’est autre chose, je ne sais pas ! » Et il se dirigea vers la porte de leur logement, et trouva la clef de bois dans le loquet fermé avec les deux crans ; et il entendit au dedans comme un faible gémissement. Alors il ouvrit la porte et entra et vit le barbier étendu sur la natte, jaune et méconnaissable ; et il lui demanda : « Qu’as-tu, mon frère, que je t’entends gémir de la sorte ? Et qu’est devenu ton compagnon ? » Le pauvre barbier, d’une voix bien faible, répondit : « Allah seul le sait ! C’est aujourd’hui seulement que je suis parvenu à ouvrir les yeux. Je ne sais depuis quand je suis là ! Mais j’ai bien soif, et je te prie, ô mon frère, de prendre la bourse qui est pendue à ma ceinture et de m’acheter quelque chose pour me soutenir. » Le portier retourna la ceinture dans tous les sons ; mais, n’y trouvant point d’argent, il comprit que l’autre compagnon l’avait volé, et dit au barbier : « Ne te préoccupe de rien, ô pauvre ! Allah traitera chacun selon ses œuvres ! Moi je vais m’occuper de toi et te soigner avec mes yeux ! » Et il se hâta d’aller lui préparer une soupe dont il lui remplit une écuelle, et la lui apporta. Et il l’aida à l’avaler, et l’enveloppa d’une couverture de laine, et le fit transpirer. Et de la sorte il agit pendant deux mois, en prenant à sa charge tous les frais du barbier, si bien qu’au bout de ce temps Allah octroya la guérison par son entremise. Et Abou-Sir put alors se lever et dit au bon portier : « Si jamais le Très-Haut m’en donne le pouvoir, je saurai te dédommager de tout ce que tu as dépensé pour moi, et reconnaître tes soins et tes bontés. Mais Allah seul serait capable de te rémunérer selon tes justes mérites, ô fils choisi ! » Le vieux portier du khân lui répondit : « Louanges à Allah pour ta guérison, mon frère ! Moi je n’ai agi de la sorte à ton égard que par le seul désir du visage d’Allah le Généreux ! » Puis le barbier voulut lui baiser la main, mais il s’y refusa en protestant ; et ils se quittèrent en appelant l’un sur l’autre toutes les bénédictions d’Allah.
Le barbier sortit donc du khân, chargé de son attirail ordinaire, et se mit à parcourir les souks. Or sa destinée l’attendait ce jour-là et le conduisit justement devant la teinturerie d’Abou-Kir, où il vit une foule énorme qui regardait les étoffes colorées étendues sur les cordes devant la boutique, et s’émerveillait et s’exclamait tumultueusement. Et il demanda à l’un des spectateurs : « À qui appartient cette teinturerie ? Et pourquoi ce grand rassemblement ? » L’homme questionné répondit : « C’est la boutique du seigneur Abou-Kir, le teinturier du sultan ! C’est lui qui teint les étoffes avec les couleurs admirables que voilà, par des procédés extraordinaires ! C’est un très grand savant dans l’art de la teinturerie ! »
En entendant ces paroles, Abou-Sir se réjouit en son âme pour son ancien compagnon, et il pensa : « Louanges à Allah qui lui a ouvert les portes des richesses ! Tu as eu bien tort, ya Abou-Sir, de mal penser de ton ancien compagnon ! S’il t’a délaissé et oublié, c’est parce qu’il a été très occupé par son travail ! Et s’il t’a pris ta bourse, c’est parce qu’il n’avait rien entre les mains pour acheter des couleurs ! Mais tu vas voir maintenant, lorsqu’il t’aura reconnu, comme il va te recevoir avec cordialité en se souvenant des services que tu lui as autrefois rendus, et du bien que tu lui as fait quand il était dans le besoin. Comme il va se réjouir de te revoir ! » Puis le barbier réussit à se faufiler à travers la foule et à arriver devant l’entrée de la teinturerie. Et il regarda à l’intérieur. Et il vit Abou-Kir nonchalamment étendu sur un haut divan, appuyé contre une pile de coussins, et le bras droit sur un coussin et le bras gauche sur un coussin, et vêtu d’une robe semblable aux robes des rois, et devant lui quatre jeunes esclaves noirs et quatre jeunes esclaves blancs somptueusement habillés ; et tel, il lui apparaissait être aussi majestueux qu’un vizir et aussi grand qu’un sultan ! Et il vit les ouvriers, au nombre de dix, qui avaient la main à l’ouvrage, et exécutaient les ordres qu’il leur donnait du geste seulement.
Alors Abou-Sir fit un pas de plus et s’arrêta juste devant Abou-Kir, en pensant : « J’attendrai qu’il abaisse ses yeux sur moi pour lui faire mon salam ! Peut-être même va-t-il me saluer le premier et se jeter à mon cou pour m’embrasser et me faire ses compliments de condoléances et me consoler ! » Or, à peine leurs regards se furent-ils rencontrés et l’œil fut-il tombé sur l’œil…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, à peine leurs regards se furent-ils rencontrés et l’œil fut-il tombé sur l’œil, que le teinturier bondit en s’écriant : « Ah ! scélérat, voleur, que de fois ne t’ai-je pas défendu de t’arrêter devant ma boutique ! Veux-tu donc ma ruine et mon déshonneur ? Holà, vous autres ! arrêtez-le ! saisissez-le ! »
Aussi les esclaves blancs et les noirs se précipitèrent sur le pauvre barbier, et le renversèrent et le piétinèrent ; et le teinturier lui-même se leva, prit un grand bâton et dit : « Étendez-le sur le ventre ! » Et il lui asséna sur le dos cent coups de bâton. Puis il dit : « Tournez-le sur le dos ! » Et il lui asséna sur le ventre cent autres coups de bâton. Après quoi il lui cria : « Ô misérable gredin, ô traître ! Si jamais je te revois encore devant ma boutique, je t’enverrai chez le roi qui t’écorchera la peau et t’empalera devant la porte du palais ! Va-t’en ! Qu’Allah te maudisse, ô visage de poix ! » Alors le pauvre barbier, bien humilié et endolori de ce traitement, et le cœur brisé et l’âme rabougrie, se traîna de là et reprit le chemin du khân, en pleurant en silence, poursuivi par les huées de la foule ameutée contre lui et par les malédictions des admirateurs d’Abou-Kir le teinturier.
Lorsqu’il fut arrivé à son logement, il s’étendit tout de son long sur la natte et se mit à réfléchir sur ce qu’il venait de subir de la part d’Abou-Kir ; et il passa toute la nuit, sans pouvoir fermer l’œil, tant il se sentait malheureux et endolori. Mais le matin, les traces des coups s’étant refroidies, il put se lever et sortir dans l’intention de prendre un bain au hammam, pour achever de se reposer, et se laver le corps, depuis le temps qu’il était resté malade sans faire ses ablutions. Il demanda donc à un passant : « Mon frère, quel est le chemin du hammam ? » L’homme répondit : « Le hammam ? Qu’est-ce que c’est que le hammam ? » Abou-Sir dit : « Mais c’est l’endroit où l’on va se laver et se faire enlever les saletés et les filaments que l’on a sur le corps ! C’est l’endroit le plus délicieux qui soit au monde ! » L’homme répondit : « Alors va te plonger dans l’eau de la mer ! C’est là qu’on se baigne ! » Abou-Sir dit : « C’est un bain au hammam que je désire ! » L’autre répondit : « Nous ne savons point, nous autres, ce que tu veux dire par hammam. Quand nous voulons prendre un bain, nous allons à la mer ; et le roi lui-même, quand il veut se laver, fait comme nous : il va prendre un bain de mer »
Lorsque Abou-Sir eut appris de la sorte que le hammam était chose inconnue pour les habitants de cette ville, et qu’il fut convaincu qu’ils ignoraient l’usage des bains chauds et des opérations du massage, de l’enlèvement des filaments, et de l’épilation, il se dirigea vers le palais du roi et demanda une audience qui lui fut accordée. Il entra donc chez le roi et, après avoir embrassé la terre entre ses mains et appelé sur lui les bénédictions, il lui dit : « Ô roi du temps, je suis étranger, et barbier de ma profession. Je sais également exercer d’autres métiers, surtout celui de chauffeur de hammam et de masseur, bien que dans mon pays chacune de ces professions soit exercée par des hommes différents qui ne font que cela toute leur vie. Et j’ai voulu aujourd’hui aller au hammam dans ta ville ; mais nul ne sut m’en indiquer le chemin, et nul ne comprit ce que signifiait le mot hammam ! Or il est bien étonnant qu’une ville aussi belle que la tienne soit dépourvue de hammams, alors qu’il n’y a rien au monde d’aussi excellent pour faire les délices et l’embellissement d’une ville ! En vérité, ô roi du temps, le hammam est un paradis sur la terre ! » À ces paroles, le roi fut extrêmement étonné et demanda : « Peux-tu alors m’expliquer ce que c’est que ce hammam dont tu me parles ? Car moi non plus je n’en ai jamais entendu parler. » Alors Abou-Sir dit : » Sache, ô roi, que le hammam est un bâtiment construit de telle et de telle manière, et l’on s’y baigne de telle et de telle façon, et l’on y éprouve telles et telles délices, car l’on y fait telles et telles choses ! » Et il raconta par le détail les qualités, les avantages et les plaisirs d’un hammam bien compris. Puis il ajouta : « Mais ma langue deviendrait plutôt poilue avant qu’elle te donnât une idée exacte d’un hammam et de ses joies. Il faut expérimenter pour comprendre ! Et ta ville ne sera une ville vraiment parfaite que le jour où elle aura un hammam ! »
En entendant ces paroles d’Abou-Sir, le roi se dilata d’aise et s’épanouit et s’écria : « Sois le bienvenu dans ma ville, ô fils des gens de bien…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
… le roi se dilata d’aise et s’épanouit et s’écria : « Sois le bienvenu dans ma ville, ô fils des gens de bien ! » Et il le revêtit de ses propres mains d’une robe d’honneur qui n’avait pas sa pareille, et lui dit : « Tout ce que tu voudras te sera accordé, et au delà ! Mais hâte-toi de construire le hammam, car mon impatience est grande de le voir et d’en jouir ! » Et il lui fit don d’un cheval magnifique, de deux nègres, de deux jeunes garçons, de quatre adolescentes et d’une maison splendide. Et il le traita encore plus généreusement qu’il ne l’avait fait pour le teinturier, et mit à sa disposition ses meilleurs architectes en leur disant : « Il faut que vous bâtissiez le hammam sur l’emplacement qu’il aura lui-même choisi ! » Et Abou-Sir emmena les architectes, et parcourut avec eux toute la ville, et finit par trouver un emplacement qu’il jugea convenable, où il donna l’ordre de bâtir le hammam. Et, d’après ses indications, les architectes bâtirent un hammam qui n’avait pas son pareil dans le monde, et ils l’ornèrent de dessins entrelacés et de marbres de diverses couleurs et d’ornements extraordinaires qui ravissaient la raison. Et tout cela d’après les instructions d’Abou-Sir. Et lorsque la construction fut achevée, Abou-Sir fit faire le grand bassin du milieu en albâtre transparent, et les deux autres bassins en marbres précieux. Puis il alla trouver le roi et lui dit : « Le hammam est prêt ; mais il manque encore les accessoires et les fournitures ! » Et le roi lui donna dix mille dinars, qu’il se hâta d’utiliser pour acheter les divers accessoires et fournitures, tels que serviettes de lin et de soie, essences précieuses, parfums, encens, et le reste. Et il mit chaque chose à sa place, et n’épargna rien pour que tout fût à profusion. Puis il demanda au roi, pour l’aider dans son travail, dix aides vigoureux ; et le roi lui donna à l’instant vingt jeunes garçons bien faits et beaux comme des lunes, qu’Abou-Sir se hâta d’initier à l’art du massage et du lavage, en les massant et les lavant, et en leur faisant répéter les diverses expériences sur lui-même. Et lorsqu’ils furent devenus tout à fait experts dans l’art, il fixa enfin le jour de l’inauguration du hammam et en avisa le roi.
Et ce jour-là Abou-Sir fit chauffer le hammam et l’eau des bassins, et brûler l’encens et les parfums dans les cassolettes, et marcher les eaux des fontaines avec un bruit si admirable que toute musique devenait vacarme à côté ! Quant au grand jet d’eau du bassin central, c’était une merveille incomparable et qui, sans aucun doute, devait ravir les esprits en extase ! Et là dedans une propreté et une fraîcheur régnaient sur toute chose qui défiaient la candeur des lys et des jasmins.
Aussi quand le roi, accompagné de ses vizirs et de ses émirs, eut franchi la grande porte du hammam, il fut agréablement affecté, quant à ses yeux et à son nez et à ses oreilles, par la décoration charmante du lieu et les parfums et la musique de l’eau dans les vasques des fontaines. Et, bien émerveillé, il demanda : « Qu’est-ce cela ? » Abou-Sir répondit : « C’est le hammam, cela ! Mais ce n’en est que l’entrée ! » Et il fit pénétrer le roi dans la première salle, et le fit monter sur l’estrade où il le déshabilla et l’enveloppa de serviettes depuis la tête jusqu’aux pieds, et lui passa aux pieds de hautes socques de bois, et l’introduisit dans la seconde salle où il le fit abondamment transpirer. Alors, aidé des jeunes garçons, il lui frotta les membres au moyen de gants de crin et en fit sortir, sous forme de longs filaments semblables à des vers, toute la saleté intérieure accumulée dans les pores de la peau ; et il les montrait au roi qui s’en étonnait prodigieusement. Puis il le lava à grande eau et à grand renfort de savonnage, et le fit descendre ensuite dans la baignoire de marbre remplie d’eau parfumée à l’essence de roses, où il le laissa un certain temps pour ensuite l’en faire sortir et lui laver la tête avec de l’eau de roses et des essences précieuses. Ensuite il lui teignit les ongles des mains et des pieds avec le henné, qui leur donna une couleur aurore. Et, durant ces préparatifs, l’aloès et le nadd aromatique brûlaient autour d’eux et les pénétraient de suavité.
Cela terminé, le roi se sentit devenir léger comme un oiseau et respirer de tous les éventails de son cœur ; et son corps était devenu si lisse et si ferme qu’en le touchant de la main il rendait un son harmonieux. Mais quel ne fut point son délice quand les jeunes garçons se mirent à lui masser les membres avec une douceur et un rythme tels qu’il s’imaginait être changé en luth ou en guitare ! Et il sentait une vigueur sans pareille l’animer, tellement qu’il fut sur le point de rugir comme un lion. Et il s’écria : « Par Allah ! de ma vie je ne me suis senti si vigoureux. Est-ce cela le hammam, ô maître barbier ? » Abou-Sir répondit : « C’est cela même, ô roi du temps ! » Il dit : « Par ma tête ! ma ville n’est devenue une ville que depuis la construction de ce hammam ! » Et lorsque, après avoir été séché dans les serviettes imprégnées de musc, il eut remonté sur l’estrade pour boire les sorbets préparés à la neige hachée, il demanda à Abou-Sir…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
… pour boire les sorbets à la neige hachée, il demanda à Abou-Sir : « Et combien estimes-tu que vaut un tel bain, et quel prix penses-tu faire payer ? » Il répondit : « Le prix que fixera le roi ! » Il dit : « Moi, je fixe un tel bain à mille dinars, pas moins ! » Et il fit compter mille dinars à Abou-Sir, et lui dit : « Et désormais tu feras payer mille dinars à chaque client qui viendra prendre un bain dans ton hammam ! » Mais Abou-Sir répondit : « Pardon, ô roi du temps ! Tous les gens ne sont pas égaux ! Les uns sont riches et les autres sont pauvres. Si donc je voulais prendre de chaque client mille dinars, le hammam ne ferait plus rien et fermerait, car il n’est pas au pouvoir du pauvre de payer pour un bain mille dinars ! » Le roi demanda : « Comment alors penses-tu faire ? » Il répondit : « Pour ce qui est du prix, je le laisserai à la générosité du client ! Chacun de la sorte payera selon ses moyens et la générosité de son âme ! Et le pauvre ne donnera que ce qu’il pourra donner. Quant à ce prix de mille dinars, c’est là un cadeau de roi ! » Et les émirs et les vizirs, en entendant ces paroles, approuvèrent grandement Abou-Sir et ajoutèrent : « Il dit la vérité, ô roi du temps, et c’est là la justice ! Car toi, ô notre bien-aimé, tu crois que tous les gens peuvent faire comme toi ! » Le roi dit : « C’est possible ! En tout cas cet homme est un étranger, un très pauvre, et le traiter avec largesse et générosité est notre devoir, d’autant plus qu’il dote notre ville de ce hammam dont de notre vie nous n’avons vu le pareil, et grâce auquel notre ville a acquis une importance et un éclat incomparables. Mais du moment que vous me dites ne pouvoir point payer mille dinars le bain, je vous autorise à ne le lui payer cette fois chacun que cent dinars seulement et à lui donner en plus un jeune esclave, un nègre et une adolescente ! Et, dans l’avenir, puisqu’il le juge ainsi, vous lui paierez chacun ce à quoi vous inciteront vos moyens et la générosité de votre âme ! » Ils répondirent : « Certes ! nous le voulons bien ! » Et lorsqu’ils eurent pris leur bain au hammam, ce jour-là, il payèrent chacun à Abou-Sir cent dinars d’or, un jeune esclave blanc, un nègre et une adolescente. Or, comme le nombre des émirs et des grands qui avaient pris leur bain, après le roi, montait à quatre cents, Abou-Sir reçut quarante mille dinars, quarante jeunes garçons blancs, quarante nègres et quarante adolescentes, et, de la part du roi, dix mille dinars, dix jeunes garçons blancs, dix jeunes nègres et dix adolescentes comme des lunes.
Lorsque Abou-Sir reçut tout cet or et ces cadeaux, il s’avança et, après avoir embrassé la terre entre les mains du roi, dit : « Ô roi fortuné, ô visage de bon augure, ô souverain aux idées justes et pleines d’équité, quel est l’endroit qui va pouvoir me loger, avec cette armée entière de jeunes garçons blancs, de nègres et d’adolescentes ? » Le roi répondit : « Moi je t’ai fait donner tout cela pour te rendre bien riche ; car j’ai pensé que peut-être tu songeras un jour à retourner dans ta patrie près de ta famille chérie, souhaitant la revoir ; et alors tu pourras partir de chez nous avec assez de richesses pour vivre chez toi avec les tiens à l’abri du besoin ! » Il répondit : « Ô roi du temps, qu’Allah te conserve prospère ! mais tous ces esclaves c’est bon pour les rois, et non pour moi qui n’ai guère besoin de tout cela pour manger le pain et le fromage avec ma famille ! Comment vais-je faire pour nourrir et habiller cette armée de jeunes blancs, de jeunes noirs et d’adolescentes ? Par Allah ! ils auront vite fait de manger avec leurs jeunes dents tout mon gain et moi après mon gain ! » Le roi se mit à rire et dit : « Par ma vie, tu dis vrai ! Ils sont devenus une puissante armée ; et à toi seul tu ne pourras guère arriver à les satisfaire par n’importe quel endroit ! Veux-tu donc me les vendre, pour t’en débarrasser, chacun à cent dinars ? » Abou-Sir répondit : « Je te les vends à ce prix ! » Aussitôt le roi fit appeler son trésorier qui versa intégralement à Abou-Sir le prix des cent cinquante esclaves ; et le roi, à son tour, renvoya tous ces esclaves chacun à son ancien maître, comme cadeau. Et Abou-Sir remercia le roi pour ses bontés, et lui dit : « Qu’Allah te repose l’âme comme tu m’as reposé l’âme en me sauvant d’entre les dents terribles de ces jeunes ghouls gloutons qu’Allah seul pourrait rassasier ! » Et le roi se mit à rire de ces paroles, et se montra encore très généreux à l’égard d’Abou-Sir ; puis, suivi des grands de son royaume, il sortit du hammam et rentra dans son palais.
Quant à Abou-Sir, il passa cette nuit-là dans sa maison à serrer l’or dans des sacs et à cacheter chaque sac bien soigneusement. Et, pour son train de maison, il avait vingt nègres, vingt jeunes garçons et quatre adolescentes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… vingt nègres, vingt jeunes garçons et quatre adolescentes.
Le lendemain, Abou-Sir fit crier dans toute la ville par les crieurs publics : « Ô créatures d’Allah, accourez tous prendre un bain au hammam du sultan ! Pendant trois jours on ne paiera pas ! » Et il y eut une foule énorme qui, durant trois jours, se précipita prendre pour rien un bain au hammam nommé Hammam du Sultan. Mais dès le matin du quatrième jour Abou-Sir s’installa lui-même derrière la caisse, à la porte du hammam, et se mit à percevoir le prix des entrées qui fut laissé à la bonne volonté de chacun, à sa sortie du bain. Et, le soir venu, Abou-Sir avait encaissé des clients une recette de la contenance de la caisse, avec l’assentiment d’Allah (qu’il soit exalté !) Et il commença de la sorte à amonceler les tas d’or que lui accumulait sa destinée.
Tout cela ! Et, la reine, qui avait entendu parler de ces bains avec enthousiasme par le roi son époux, résolut d’en prendre un comme essai d’abord. Et elle fit prévenir de son intention Abou-Sir qui, pour lui plaire et acquérir également la clientèle des femmes, consacra désormais la matinée aux bains des hommes et l’après-midi aux bains des femmes. Et il se tenait lui-même le matin derrière la caisse, pour les recettes, tandis que l’après-midi il chargeait de ce soin une intendante nommée par lui à cette charge-là. Aussi, lorsque la reine fut entrée au hammam et qu’elle eut expérimenté sur elle-même les effets délicieux de ces bains selon la nouvelle manière, elle fut si charmée qu’elle résolut d’y revenir tous les vendredis après-midi, et ne se montra pas à l’égard d’Abou-Sir moins libérale que le roi, qui avait pris l’habitude d’y retourner tous les vendredis dans la matinée, en payant chaque fois mille dinars d’or, sans préjudice des cadeaux.
Ainsi Abou-Sir s’acheminait-il plus profondément dans les chemins des richesses, des honneurs et de la gloire ! Mais il ne se montra pas, pour cela, moins modeste ou moins honnête, au contraire ! Il continua, comme par le passé, à se montrer affable, souriant et plein de bonnes manières à l’égard des clients, et généreux à l’égard des pauvres gens dont il ne voulait jamais accepter d’argent. Et cette générosité fut d’ailleurs pour lui la cause de son salut, comme il sera prouvé dans le courant de cette histoire. Mais, dès maintenant, que l’on sache bien que ce salut lui viendra par l’entremise d’un capitaine marin qui, un jour, se trouva à court d’argent et put néanmoins prendre un bain tout à fait excellent, sans frais aucunement ! Et comme, en outre, il avait été rafraîchi de sorbets et accompagné jusqu’à la porte avec tous les égards possibles par Abou-Sir en personne, il se mit dès lors à réfléchir sur les moyens de prouver sa gratitude à Abou-Sir, soit par quelque cadeau soit autrement ! Et cette occasion il ne tarda pas à la trouver. Et voilà pour le capitaine marin !
Quant au teinturier Abou-Kir, il finit par entendre parler de ce hammam extraordinaire dont s’entretenait avec admiration toute la ville, en disant : « Certes ! c’est le paradis en ce monde ! » Et il résolut d’aller expérimenter par lui-même les délices de ce paradis, dont il ignorait encore le nom du gardien. Il se vêtit donc de ses plus beaux habits, monta sur une mule richement harnachée, se fit précéder et suivre par des esclaves armés de longs bâtons, et se dirigea vers le hammam. Arrivé à la porte, il sentit l’odeur du bois d’aloès et le parfum du nadd ; et il vit la multitude des gens qui entraient et qui sortaient, et ceux qui étaient assis sur les bancs à attendre leur tour, fussent-ils d’entre les grands notables, ou d’entre les plus pauvres des pauvres, ou les plus petits des petits. Il entra alors dans le vestibule, et aperçut son ancien compagnon Abou-Sir assis derrière la caisse, dodu, frais et souriant. Et il eut même quelque peine à le reconnaître, tant les anciennes cavités de son visage étaient maintenant remplies d’une graisse de bonne nature, et tant son teint était brillant et sa mine avantagée de beaucoup ! À cette vue, le teinturier, bien que surpris et bouleversé, feignit une grande joie et, avec une impudence extrême, il s’avança vers Abou-Sir, qui déjà s’était levé en son honneur, et lui dit d’un ton plein d’amical reproche : « Hé quoi, ya Abou-Sir ! Est-ce là la conduite d’un ami et le procédé d’un homme qui connaît les bonnes manières et la galanterie ? Tu sais que je suis devenu le teinturier en titre du roi et un des personnages les plus riches et les plus importants de la ville, et tu ne viens jamais me voir ni prendre de mes nouvelles ! Et tu ne te demandes même pas : « Qu’est donc devenu mon ancien camarade Abou-Kir ? » Et moi j’ai eu beau te demander partout et envoyer de tous les côtés mes esclaves à ta recherche, dans les khâns et les boutiques, nul n’a pu me renseigner à ton sujet ni me mettre sur tes traces ! » À ces paroles, Abou-Sir hocha la tête avec une grande tristesse, et répondit : « Ya Abou-Kir, tu oublies donc le traitement que tu m’as fait subir, quand je suis venu à toi, et les coups que tu m’as donnés et l’opprobre dont tu m’as couvert devant les gens en m’appelant voleur, traître et misérable ? » Et Abou-Kir se montra bien formalisé et s’écria : « Que dis-tu là ? Serait-ce toi cet homme que j’ai battu ? » Il répondit : « Mais oui, c’était moi ! » Abou-Kir alors se mit à jurer mille serments qu’il ne l’avait pas reconnu, en disant : « Certes ! je t’ai confondu avec un autre, avec un voleur qui avait déjà essayé maintes fois de dérober mes étoffes ! Tu étais si maigre et si jaune qu’il m’a été impossible de te reconnaître ! » Puis il se mit à regretter son acte, à se frapper les mains l’une contre l’autre, disant : « Il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah le Glorieux, l’Exalté ! Comment ai-je pu me tromper de la sorte ! Mais aussi la faute n’est-elle pas surtout à toi qui, m’ayant le premier reconnu, ne t’es pas nommé devant moi, en me disant : « Je suis Tel ! » d’autant plus que ce jour j’étais tout à fait distrait et hors de moi de toute la besogne dont j’étais surchargé ! Je te prie donc, par Allah sur toi, ô mon frère, de me pardonner et d’oublier cette chose-là qui était écrite dans notre destinée ! » Abou-Sir répondit : « Qu’Allah te pardonne, ô mon compagnon, c’était là, en effet, l’arrêt secret du destin ; et la réparation est sur Allah ! » Le teinturier dit : « Pardonne-moi tout à fait ! » Il répondit : « Qu’Allah libère donc ta conscience comme je te libère ! Que pouvons-nous contre les arrêts rendus du fond de l’éternité ? Entre donc au hammam, enlève tes habits et prends un bain qui te soit plein de délices et de rafraîchissement…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … et prends un bain qui te soit plein de délices et de rafraîchissement ! » Et Abou-Kir lui demanda : « Et d’où t’est venue cette félicité ? » Il répondit : « Celui qui t’a ouvert les portes de la prospérité me les a ouvertes également ! » Et il lui raconta son histoire depuis le jour où il avait reçu la bastonnade par ses ordres. Mais il n’y a aucune utilité à la répéter. Et Abou-Kir lui dit : « Ma joie est extrême d’apprendre la faveur dont tu jouis auprès du roi. Je vais m’employer de façon à ce que cette faveur augmente encore, en racontant au roi que tu es mon ami de toujours. » Mais l’ancien barbier répondit : « À quoi bon l’intervention des créatures dans les arrêts du destin ? Allah seul tient dans ses mains les faveurs et les disgrâces ! Quant à toi, hâte-toi de te déshabiller et d’entrer au hammam jouir des bienfaits de l’eau et de la propreté ! » Et il le conduisit lui-même dans la salle réservée et, de ses propres mains, il le frotta, le savonna, le massa et le travailla jusqu’à la fin, ne voulant laisser ce soin à aucun de ses aides. Puis il le fit monter sur l’estrade de la salle fraîche, et lui servit lui-même les sorbets et les réconfortants, et cela avec tant d’égards que tous les clients ordinaires étaient ébahis de voir Abou-Sir en personne remplir cet office et rendre ces honneurs exceptionnels au teinturier, alors que d’ordinaire le roi seul en bénéficiait.
Lorsque vint le moment de partir, Abou-Kir voulut offrir quelque argent à Abou-Sir que celui-ci se garda bien d’accepter, disant : « N’as-tu pas honte de m’offrir de l’argent, alors que je suis ton camarade, et qu’il n’y a aucune différence entre nous ? » Abou-Kir dit : « Soit ! mais, en retour, laisse-moi te donner un conseil qui te sera d’une grande utilité. Ce hammam est admirable, mais pour qu’il soit tout à fait merveilleux il lui manque encore une chose ! » Abou-Sir demanda : « Et quelle est-elle ? » Il dit : « La pâte épilatoire ! J’ai, en effet, remarqué qu’une fois que tu avais fini de raser la tête de tes clients, tu te servais, pour les poils des autres parties du corps, du rasoir également ou de la pince à poils. Or rien ne vaut la pâte épilatoire dont je connais la recette et que je vais te donner pour rien ! » Abou-Sir répondit : « Certes ! tu as raison, ô mon camarade. Je ne demande pas mieux que d’apprendre de toi la recette de la meilleure pâte épilatoire ! » Abou-Sir dit : « Voici ! Prends de l’arsenic jaune et de la chaux vive, pétris-les ensemble en y ajoutant un peu d’huile, mélange-les d’un peu de musc pour en enlever l’odeur désagréable, et renferme la pâte ainsi obtenue dans un pot en terre cuite, pour t’en servir au moment du besoin. Et je te réponds du succès de l’opération, surtout quand le roi verra ses poils tomber comme par enchantement, sans heurt ni frottement, et que sa peau lui apparaîtra toute blanche en dessous ! » Et Abou-Kir, ayant ainsi livré cette recette à son ancien compagnon, sortit du hammam et se dirigea en toute hâte vers le palais.
Lorsqu’il arriva devant le roi et qu’il eut présenté ses hommages entre ses mains, il lui dit : « Je viens chez toi en conseiller, ô roi du temps ! » Le roi dit : « Et quel conseil m’apportes-tu ? » Il répondit : « Louanges à Allah qui t’a sauvegardé jusqu’aujourd’hui des mains malfaisantes de ce méchant, de cet ennemi du trône et de la religion, de cet Abou-Sir maître du hammam ! » Le roi, bien étonné, demanda : « De quoi s’agit-il ? » Il dit : « Sache, ô roi du temps, que si par malheur tu entrais encore une fois dans le hammam, tu serais perdu sans recours ! » Il dit : « Et comment cela ? » Abou-Kir, avec des yeux pleins de terreur menteuse et un large geste d’épouvantement, souffla : « Par le poison ! Il a préparé à ton intention une pâte composée d’arsenic jaune et de chaux vive qui, placée rien que sur les poils de la peau, les brûle comme le feu. Et il te proposera sa pâte en te disant : « Rien ne vaut cette pâte pour faire tomber les poils du derrière, avec confort et sans heurt pour le derrière ! » Et il appliquera la pâte sur le derrière de notre roi, et il le fera mourir empoisonné par cette voie-là, qui est la plus douloureuse d’entre toutes les voies ! Car ce maître du hammam n’est autre chose qu’un espion soudoyé par le roi des chrétiens pour arracher de cette façon-là l’âme de notre roi ! Et moi je me suis hâté de venir t’en aviser, car tes bienfaits sont sur moi ! »
En entendant ces paroles du teinturier Abou-Kir, le roi sentit une terreur intense l’envahir, et tellement qu’il en frissonna et que son cul se rétracta comme s’il était déjà travaillé par le poison brûlant. Et il dit au teinturier : « Je vais tout de suite aller au hammam avec mon grand-vizir pour contrôler ton dire. Mais d’ici là garde soigneusement le secret de la chose ! » Et il emmena son grand-vizir et s’en alla avec lui au hammam.
Là, comme d’habitude, Abou-Sir introduisit le roi dans la salle réservée et voulut le frictionner et le laver ; mais le roi lui dit : « Commence d’abord par mon grand-vizir ! » Et il se tourna vers le grand-vizir et lui dit : « Étends-toi ! » Et le grand-vizir, qui était bien dodu, et poilu comme un vieux bouc, répondit par l’ouïe et l’obéissance, s’étendit sur le marbre et se laissa frotter, savonner et laver d’importance. Après quoi Abou-Sir dit au roi : « Ô roi du temps, j’ai trouvé une drogue qui possède de telles vertus épilatoires que tout rasoir devient superflu pour les poils d’en bas ! » Le roi dit : « Essaie cette drogue sur les poils d’en bas de mon grand-vizir…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Essaie cette drogue sur les poils d’en bas de mon grand vizir ! » Et Abou-Sir prit le pot de terre cuite, en tira un morceau gros comme une amande de la pâte en question, et l’étendit sur le haut du bas ventre du grand-vizir, simplement comme essai. Et l’effet épilatoire de la drogue fut si prodigieux, que le roi ne douta plus que ce ne fût là un redoutable poison ; et, gonflé de fureur à ce spectacle, il se tourna vers les garçons du hammam et leur cria : « Arrêtez ce misérable ! » et il leur montra du doigt Abou-Sir que le saisissement avait rendu muet et comme hébété. Puis le roi et le vizir s’habillèrent en toute hâte, firent livrer Abou-Sir aux gardes du dehors, et rentrèrent au palais.
Là le roi fit appeler son capitaine du port et des navires, et lui dit : « Tu vas t’emparer du traître appelé Abou-Sir, et prendre un sac rempli de chaux vive dans lequel tu l’enfermeras, et tu iras jeter le tout dans la mer, sous les fenêtres de mon palais. Et, de la sorte, ce misérable mourra de deux morts à la fois, par noyade et par combustion ! » Le capitaine répondit : « J’écoute et j’obéis ! »
Or, justement, le capitaine du port et des navires était le capitaine marin qui avait été autrefois l’obligé d’Abou-Sir. Il se hâta donc d’aller trouver Abou-Sir dans le cachot, et l’en tira pour l’embarquer sur un petit vaisseau et le conduire à une petite île située non loin de la ville, et où il put enfin lui parler librement. Il lui demanda : « Ô Tel ! je n’oublie point les égards que tu as eus pour moi, et je veux te rendre le bien pour le bien. Raconte-moi donc ton affaire avec le roi, et le crime que tu as commis pour perdre ses faveurs et mériter la mort cruelle à laquelle il t’a condamné ! » Abou-Sir répondit : « Par Allah ! ô mon frère, je jure que je suis innocent de toute faute, et que je n’ai jamais rien fait qui ait mérité un pareil châtiment ! » Le capitaine dit : « Alors tu dois avoir sûrement des ennemis qui t’ont nui dans l’esprit du roi ! Car tout homme qui est en vue par un bonheur trop apparent et par les faveurs du destin, a toujours des envieux et des jaloux ! Mais ne crains rien ! Ici, dans cette île, tu es en sécurité. Sois donc le bienvenu et tranquillise-toi. Tu passeras ton temps à pêcher, jusqu’à ce que je puisse te faire partir pour ton pays. Maintenant je vais faire devant le roi le simulacre de ta mort ! » Et Abou-Sir baisa la main du capitaine marin qui le quitta pour aller aussitôt prendre un gros sac rempli de chaux vive et s’avancer vers le palais du roi jusque sous les fenêtres qui regardaient la mer.
Le roi précisément était accoudé à attendre l’exécution de son ordre ; et le capitaine, arrivé sous les fenêtres, leva ses regards pour recevoir du roi le signal de l’exécution. Et le roi étendit le bras hors de la fenêtre, et du doigt il fit signe de jeter le sac à la mer. Et cela fut immédiatement exécuté. Mais au même moment le roi, qui avait fait avec la main un geste trop brusque, laissa tomber dans l’eau un anneau d’or qui lui était aussi précieux que son âme.
En effet, cet anneau tombé dans la mer était un anneau talismanique enchanté, dont dépendaient l’autorité et la puissance du roi, et qui servait de frein pour maintenir en respect le peuple et l’armée ; car lorsque le roi voulait donner l’ordre d’exécuter un coupable, il n’avait qu’à lever la main au doigt de laquelle se trouvait l’anneau, et il en jaillissait aussitôt un éclair subit qui renversait à terre le coupable raide mort, en lui faisant sauter la tête d’entre les épaules !
Aussi, quand le roi vit de la sorte tomber son anneau dans la mer, il ne voulut en parler à qui que ce fût et garda le plus profond secret sur sa perte ; sans quoi il lui eût été impossible de tenir plus longtemps ses sujets dans la crainte et l’obéissance. Et voilà pour le roi !
Quant à Abou-Sir, une fois seul dans l’île, il prit le filet de pêche que lui avait donné le capitaine marin, et, pour distraire ses torturantes pensées et chercher sa nourriture, il se mit à pêcher dans la mer. Et, après avoir jeté son filet et attendu un moment, il le retira et le trouva plein de poissons de toutes les couleurs et de toutes les grosseurs. Et il se dit : « Par Allah ! voilà longtemps déjà que je n’ai point mangé de poisson ! Je vais en prendre un et le donner aux deux garçons de cuisine dont m’a parlé le capitaine, afin qu’ils me le fassent cuire à l’huile. » En effet, le capitaine du port et des navires avait également charge de pourvoir, tous les jours, de poisson frais la cuisine du roi ; et, ce jour-là, comme il n’avait pu veiller lui-même à la pêche du poisson, il avait chargé Abou-Sir de ce soin, et lui avait parlé de deux garçons cuisiniers qui viendraient afin qu’il leur livrât le poisson pêché et destiné au roi. Et Abou-Sir fut favorisé de cette pêche nombreuse, dès le premier coup de filet. Il commença donc, avant de livrer sa pêche aux deux garçons qui allaient venir, par choisir pour lui-même le poisson le plus gros et le plus beau ; il tira ensuite de sa ceinture le grand couteau qui y était enfoncé, et le passa d’outre en outre dans les branchies du poisson qui frétillait. Mais il ne fut pas peu surpris en voyant sortir, appendu à la pointe du couteau, un anneau d’or, avalé sans doute par le poisson !
À cette vue, Abou-Sir, bien qu’il ignorât les vertus redoutables de cet anneau talismanique, qui était précisément celui tombé du doigt du roi dans la mer…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENTIÈME NUIT
Elle dit :
… À cette vue, Abou-Sir, bien qu’il ignorât les vertus redoutables de cet anneau talismanique, qui était précisément celui tombé du doigt du roi dans la mer, et sans attacher une grande importance à la chose, prit cet anneau qui lui revenait de droit, et le passa à son propre doigt.
À ce moment arrivèrent les deux garçons pourvoyeurs de la cuisine du roi, et ils lui dirent : « Ô pêcheur, peux-tu nous dire ce qu’est devenu le capitaine du port qui nous livre chaque jour le poisson destiné au roi ? Il y a déjà longtemps que nous attendons son retour ! De quel côté s’est-il dirigé ? » Abou-Sir répondit, en étendant la main de leur côté : « C’est de ce côté-là qu’il est parti ! » Mais au même moment les deux têtes des garçons de cuisine sautèrent d’entre leurs épaules et roulèrent avec leurs propriétaires sur le sol !
C’était l’éclair lancé par l’anneau porté par Abou-Sir qui venait de tuer les deux garçons pourvoyeurs.
En voyant les deux garçons tomber ainsi privés de vie, Abou-Sir se demanda : « Qui a bien pu faire sauter de la sorte la tête de ces deux-là ? » Et il regarda de tous côtés autour de lui, dans les airs et à ses pieds ; et il commençait à trembler de terreur en songeant à la puissance cachée des genn malfaisants, quand il vit revenir le capitaine marin. Et celui-ci, du plus loin qu’il le vit, aperçut en même temps les deux corps inertes sur le sol avec, à leur côté, leurs têtes respectives, et l’anneau porté par Abou-Sir, qui brillait sous le soleil. Et il comprit d’un coup d’œil ce qui venait de se passer. Aussi se hâta-t-il de lui crier, en se garant : « Ô mon frère, ne bouge pas ta main qui porte l’anneau, ou je suis tué ! Ne la bouge pas, de grâce ! »
En entendant ces paroles, qui achevèrent de le surprendre et de le rendre perplexe, Abou-Sir s’immobilisa tout à fait malgré le désir qu’il avait de courir à la rencontre du capitaine marin, lequel, arrivé près de lui, se jeta à son cou et dit : « Tout homme porte sa destinée attachée à son cou. La tienne est supérieure de beaucoup à celle du roi ! Mais raconte-moi comment t’est venu cet anneau, et moi je te dirai ensuite ses vertus ! » Et Abou-Sir raconta au capitaine marin toute l’histoire, qu’il est inutile de répéter. Et à son tour le capitaine, émerveillé, lui narra les vertus redoutables de l’anneau, et ajouta : « Maintenant ta vie est sauve et celle du roi est en danger. Tu peux sans crainte m’accompagner à la ville, et faire tomber, d’un signe de ton doigt porteur de l’anneau, les têtes de tes ennemis et faire sauter celle du roi d’entre ses épaules ! » Et il fit embarquer Abou-Sir avec lui sur le petit vaisseau et, l’ayant ramené en ville, le conduisit au palais devant le roi.
À ce moment, le roi tenait son diwân et était entouré de la foule de ses vizirs, de ses émirs et de ses conseillers ; et bien qu’il fût bourré de soucis et de rage jusqu’au nez, à cause de la perte de son anneau, il n’osait divulguer la chose ni faire faire des recherches dans la mer pour le retrouver, de peur de voir les ennemis du trône se réjouir de sa calamité ! Mais lorsqu’il vit entrer Abou-Sir, il n’eut plus aucun doute sur sa perte complotée, et s’écria : « Ah ! misérable, comment as-tu fait pour revenir du fond de la mer et échapper à la mort par noyade et par combustion ! » Abou-Sir répondit : « Ô roi du temps, Allah est le plus grand ! » Et il raconta au roi comment il avait été sauvé par le capitaine marin, par reconnaissance de sa part pour un bain gratuit, comment il avait trouvé l’anneau et comment, sans connaître la puissance de cet anneau, il avait causé la mort de deux garçons pourvoyeurs. Puis il ajouta : « Et maintenant, ô roi, je viens te rendre cet anneau, par gratitude pour tes bienfaits sur moi, et pour te démontrer que si j’étais un criminel dans l’âme je me serais déjà servi de cet anneau pour exterminer mes ennemis et tuer leur roi ! Et je te supplie, en retour, d’examiner plus attentivement le crime que j’ignore et pour lequel tu m’as condamné, et de me faire périr dans les tortures si je suis reconnu vraiment criminel ! » Et, en disant ces paroles, Abou-Sir retira l’anneau de son doigt et le remit au roi qui se hâta de le passer au sien, en respirant d’aise et de contentement, et en sentant son âme rentrer dans son corps. Il se leva alors sur ses pieds et jeta ses bras autour du cou d’Abou-Sir, en lui disant : « Ô homme, certes ! tu es la fleur de choix d’entre les gens bien nés ! Je te prie de ne point me blâmer trop, et de me pardonner le mal que je t’ai fait et le dommage que je t’ai causé. En vérité, un autre que toi ne m’aurait jamais rendu cet anneau ! » Le barbier répondit : « Ô roi du temps, si vraiment tu souhaites que je libère ta conscience, tu n’as qu’à me dire enfin le crime qui m’est attribué et qui m’a valu ta colère et ton ressentiment ! » Le roi dit : « Ouallah ! à quoi bon ? Je suis maintenant sûr que tu as été accusé à faux. Mais du moment que tu désires savoir le crime que l’on t’a attribué, voici ! Le teinturier Abou-Kir m’a dit de toi telle et telle chose ! » Et il lui raconta tout ce dont l’avait accusé le teinturier, au sujet de la pâte épilatoire expérimentée d’ailleurs sur le haut des poils du bas du grand-vizir…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CINQ CENT UNIÈME NUIT
Elle dit :
… la pâte épilatoire expérimentée d’ailleurs sur le haut des poils du bas du grand-vizir ! Et Abou-Sir, les larmes aux yeux, répondit : « Ouallah ! ô roi du temps, moi je ne connais point le roi des Nazaréens, et de ma vie je n’ai foulé le sol du pays des Nazaréens. Mais la vérité, la voici ! » Et il raconta au roi comment le teinturier et lui s’étaient engagés par serment, après lecture de la Fatiha du Livre, de s’entr’aider mutuellement, comment ils étaient partis ensemble, et toutes les ruses et tous les tours que lui avait joués le teinturier, y compris le traitement de la bastonnade qu’il lui avait fait subir, et la recette de la pâte épilatoire qu’il lui avait lui-même donnée. Et il ajouta : « En tout cas, ô roi, cette pâte épilatoire, appliquée sur la peau, est une chose infiniment excellente ; et elle ne devient poison que si on l’avale. Dans mon pays les hommes et les femmes ne se servent que de cela, au lieu du rasoir, pour se faire tomber en tout confort leurs poils du bas ! Quand aux tours qu’il m’a joués et au traitement qu’il m’a fait subir, le roi n’aura qu’à faire appeler le portier du khân et les apprentis de la teinturerie, et à les interroger pour contrôler la vérité que j’avance ! » Et le roi, pour faire plaisir à Abou-Sir, bien que la preuve fût toute faite pour lui, fit mander le portier du khân et les apprentis ; et tous, après interrogatoire, confirmèrent les paroles du barbier en les aggravant encore par leurs révélations sur la conduite malhonnête du teinturier.
Alors le roi cria aux gardes : « Qu’on m’amène le teinturier, nu tête, nu pieds, et les mains liées derrière le dos ! » Et les gardes aussitôt coururent envahir le magasin du teinturier, qui était alors absent. Ils le cherchèrent donc dans sa maison, où ils le trouvèrent assis à savourer la jouissance des plaisirs tranquilles, et à rêver sans aucun doute à la mort d’Abou-Sir. Et donc ils se précipitèrent sur lui qui à coups de poing sur la nuque, qui à coups de pied dans le derrière, qui à coups de tête dans le ventre, et le piétinèrent et le dépouillèrent de ses vêtements, excepté de la chemise, et le traînèrent, nu pieds, nu tête et les mains liées derrière le dos, jusque devant le trône du roi. Et il vit Abou-Sir assis à droite du roi, et le portier du khân debout dans la salle avec, à ses côtés, les apprentis de la teinturerie. Il vit tout cela, en vérité ! Et de terreur il fit ce qu’il fit au milieu même de la salle du trône ; car il comprit qu’il était perdu sans recours. Mais déjà le roi, le regardant de travers, lui dit : « Tu ne peux nier que ce ne soit là ton ancien compagnon, le pauvre que tu as volé, dépouillé, maltraité, délaissé, battu, chassé, injurié, accusé et fait, en somme, mourir ! » Et le portier du khân et les apprentis de la teinturerie levèrent leurs mains et s’écrièrent : « Oui, par Allah ! tu ne peux nier tout cela. Nous en sommes témoins devant Allah et devant le roi ! » Et le roi dit : « Que tu le nies ou que tu l’avoues, tu n’en subiras pas moins le châtiment écrit par le destin ! » Et il cria à ses gardes : « Prenez-le, promenez-le par les pieds à travers toute la ville, puis enfermez-le dans un sac rempli de chaux vive et jetez-le à la mer, afin qu’il meure de la double mort par combustion et par asphyxie ! » Alors le barbier s’écria : « Ô roi du temps, je te supplie d’accepter mon intercession pour lui, car moi je lui pardonne tout ce qu’il m’a fait ! « Mais le roi dit : « Si toi tu lui pardonnes ses crimes contre toi, moi je ne lui pardonne pas ses crimes contre moi ! » Et il cria encore une fois à ses gardes : « Emmenez-le et exécutez mes ordres ! »
Alors les gardes s’emparèrent du teinturier Abou-Kir. le traînèrent par les pieds à travers toute la ville, en criant ses méfaits, et finirent par l’enfermer dans un sac rempli de chaux vive et le jetèrent à la mer. Et il mourut noyé-brûlé ! Car telle était sa destinée.
Quant à Abou-Sir, le roi lui dit : « Ô Abou-Sir, je veux maintenant que tu me demandes tout ce que tu souhaites, et cela te sera accordé à l’instant ! » Abou-Sir répondit : « Je demande seulement au roi qu’il me renvoie dans ma patrie ; car il m’est désormais pénible de demeurer loin des miens, et je n’ai plus envie de rester ici ! » Et le roi, bien que que fort affecté de son départ, car il voulait le nommer grand-vizir, à la place du dodu-poilu qui remplissait cette charge, lui fit préparer un grand navire qu’il chargea d’esclaves hommes et femmes, et de riches présents, et lui dit, en prenant congé : « Alors tu ne veux pas devenir mon grand-vizir ? » Et Abou-Sir répondit : « Je voudrais bien retourner dans mon pays ! » Alors le roi n’insista pas, et le navire s’éloigna avec Abou-Sir et ses esclaves dans la direction d’Iskandaria.
Or, Allah leur écrivit un bon voyage, et ils touchèrent Iskandaria, en bonne santé. Mais à peine avaient-ils débarqué, que l’un des esclaves aperçut sur la plage un sac que la mer avait jeté à terre. Abou-Sir l’ouvrit et y découvrit le cadavre d’Abou-Kir que les courants avaient entraîné jusque-là ! Et Abou-Sir le fit inhumer non loin de là, sur le rivage de la mer, et lui éleva un monument funèbre et ce fut un lieu de pèlerinage auquel il attacha, pour l’entretien, des biens de mainmorte ; et il fit graver sur la porte de l’édifice cette inscription morale :
Abstiens-toi du mal ! Et ne t’enivre pas à la gourde amère de la méchanceté. Le méchant finit toujours par être terrassé !
L’océan voit flotter à sa surface les carcasses du désert, tandis que les perles reposent tranquilles sur les sables sous-marins.
Dans les régions sereines, il est écrit sur les pages transparentes de l’air : Celui qui sème le bien récoltera le bien ! Car toute chose revient à son origine !
Et telle fut la fin d’Abou-Kir le teinturier, et le début d’Abou-Sir dans la vie désormais heureuse et sans soucis. Et c’est pourquoi la baie où fut enterré le teinturier fut depuis lors nommée la baie d’Abou-Kir ! Gloire à celui qui vit dans Son Eternité, et qui par Sa Volonté fait suivre leur cours aux jours de l’hiver et de l’été !
— Puis Schahrazade dit : « Et voilà, ô Roi fortuné, tout ce qui m’est revenu de cette histoire ! » Et Schahriar s’écria : « Par Allah ! cette histoire est édifiante. C’est pourquoi me vient maintenant le désir de t’entendre me raconter une ou deux ou trois anecdotes morales ! » Et Schahrazade dit : « Ce sont celles que je connais le mieux ! »
— À ce moment, elle vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT DEUXIÈME NUIT
Schahrazade dit :
ANECDOTES MORALES DU JARDIN PARFUMÉ
Les anecdotes morales, ô Roi fortuné, sont celles que je connais le mieux. Je vais t’en raconter une ou deux ou trois, tirées du Jardin Parfumé. » Et le roi Schahriar dit : « En ce cas, hâte-toi de commencer, car je sens mon âme envahie par un grand ennui, ce soir ! Et je ne suis plus certain de la conservation de la tête sur tes épaules jusqu’au matin ! » Et Schahrazade, souriante, dit : « Voici ! Mais je te préviens, ô Roi fortuné, que ces anecdotes, toutes morales qu’elles soient, peuvent passer, aux yeux des gens grossiers à l’esprit étroit, pour des anecdotes libertines ! » Et le roi Schahriar dit : « Que cette crainte ne t’arrête point, Schahrazade ! Toutefois, si tu penses que ces anecdotes morales ne peuvent être entendues par cette petite qui t’écoute, blottie à tes pieds sur le tapis, dis-lui de s’en aller au plus vite. D’ailleurs, je ne sais point au juste ce qu’elle fait ici, cette petite-là ! » À ces paroles du Roi, la petite Doniazade, craignant d’être chassée, se jeta dans les bras de sa grande sœur qui la baisa sur les yeux, la serra contre sa poitrine et calma son âme chérie. Puis elle se tourna vers le roi Schahriar et dit : « Je crois tout de même qu’elle peut rester ! Car il n’est point répréhensible de parler des choses situées au-dessous de la taille, vu que « toutes choses sont propres et pures aux âmes propres et pures ! »
Et aussitôt elle dit :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’un certain homme aux bonnes intentions avait passé toute sa vie dans l’attente de la nuit miraculeuse que promet le Livre aux Croyants doués de foi ardente, cette nuit nommée la Nuit des Possibilités de la Toute-Puissance, où l’homme pieux voit se réaliser ses moindres désirs. Or, une nuit des dernières nuits du mois de Ramadân, cet homme, après avoir jeûné strictement toute la journée, se sentit soudain vivifié des grâces divines, et il appela son épouse et lui dit : « Écoute-moi, femme ! Je me sens ce soir en état de pureté devant l’Éternel, et sûrement cette nuit va être pour moi la Nuit des Possibilités de la Toute-Puissance. Comme tous mes vœux et souhaits seront sûrement exaucés par le Rétributeur, je t’appelle pour te consulter auparavant sur les demandes qu’il me faut faire, car je te sais de bon conseil, et souvent tes avis m’ont été profitables. Inspire-moi donc les souhaits à formuler ! » L’épouse répondit : « Ô homme, à combien de souhaits as-tu droit ? » Il dit : « À trois ! » Elle dit : « Commence alors par exposer à Allah le premier des trois désirs. Tu sais que la perfection de l’homme et ses délices résident dans sa virilité, et que l’homme ne peut être parfait s’il est chaste, eunuque ou impuissant. Par conséquent, plus le zebb de l’homme est considérable, plus sa virilité est grande et le fait s’acheminer dans la voie de la perfection. Prosterne-toi donc humblement devant la face du Très-Haut, et dis : « Ô Bienfaiteur, ô Généreux, fais grossir mon zebb jusqu’à la magnificence ! » Et l’homme se prosterna et, tournant ses paumes vers le ciel, dit : « Ô Bienfaiteur, ô Généreux, fais grossir mon zebb jusqu’à la magnificence ! »
Or, à peine ce désir avait-il été formulé, qu’il fut exaucé, et au delà, à l’heure et à l’instant. Car aussitôt le saint homme vit son zebb se gonfler et se magnifier, tellement qu’on l’eût pris pour une calebasse reposant entre deux grosses citrouilles. Et le poids de tout cela était si considérable qu’il obligeait son propriétaire à se rasseoir quand il se levait, et à se lever quand il se couchait.
Aussi l’épouse fut si terrifiée à cette vue qu’elle s’échappait par la fuite toutes les fois que l’appelait à l’essai le saint homme. Et elle s’écriait : « Comment veux-tu que je fasse l’essai de cet outil dont le simple jet est capable de perforer les rochers d’outre en outre ? » Et le pauvre homme finit par lui dire : « Ô femme exécrable, que me faut-il faire de cela maintenant ! C’est ton œuvre, ô maudite ! » Elle répondit : « Le nom d’Allah sur moi et autour de moi ! Prie sur le Prophète, ô vieillard à l’œil vide ! Moi, par Allah ! je n’ai point besoin de tout cela, et ne t’ai point dit d’en demander autant ! Prie donc le ciel de te le diminuer ! Ce sera là ton second souhait ! »
Le saint homme leva alors les yeux au ciel et dit : « Ô Allah, je te supplie de me débarrasser de cette encombrante marchandise, et de me délivrer du tracas qu’elle me procure ! » Et aussitôt l’homme devint lisse quant à son ventre, sans plus de trace de zebb et d’œufs que s’il eût été une jeune fille impubère.
Mais cette disparition complète ne le satisfit guère, pas plus lui que son épouse, qui se mit à l’invectiver et à lui reprocher de l’avoir à jamais frustrée de son dû. Aussi la peine du saint homme fut-elle extrême ; et il dit à son épouse : « Tout cela est ta faute et vient de tes conseils insensés ! Ô femme sans jugement, moi j’avais droit à trois souhaits devant Allah, et je pouvais choisir à mon gré ce qui me plaisait le mieux des biens de ce monde et de l’autre. Et voilà que deux de mes vœux ont été déjà exaucés, mais c’est tout comme si de rien n’était. Et me voici dans une condition pire que la précédente ! Mais comme il me reste encore le droit de formuler mon troisième souhait, je vais demander à mon Seigneur de me faire réintégrer dans ce que je possédais tout à fait au commencement ! »
Et il pria son Seigneur qui exauça son vœu. Et il rentra dans ce qu’il possédait au commencement !
La morale de cette anecdote est qu’il faut se contenter de ce que l’on a.
— Puis Schahrazade dit :
Il est raconté, ô Roi fortuné, qu’un certain masseur de hammam avait pour clients ordinaires les fils des notables et des plus riches habitants, car le hammam où il exerçait son métier était le mieux achalandé de toute la ville. Or, un jour d’entre les jours, entra dans la salle où il attendait les baigneurs un garçon encore vierge de poils, mais bien dodu et riche en rondeurs de tous les côtés à la fois ; et ce garçon était bien beau de visage ; et il était le fils même du grand-vizir du roi de la ville. Aussi le masseur se réjouit-il de masser le corps si doux de cet adolescent délicat, et il se dit en son âme : « Voilà un corps où la graisse a partout mis des coussins soyeux ! Quelle richesse de formes, et qu’il est dodu ! » Et il l’aida à s’étendre sur le marbre tiède de la salle chaude, et commença à le frictionner avec un soin tout spécial. Et lorsqu’il fut arrivé près des cuisses il fut à la limite de la stupéfaction en remarquant que le zebb du gros garçon atteignait à peine le volume d’une noisette…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… il fut à la limite de la stupéfaction en remarquant que le zebb du gros garçon atteignait à peine le volume d’une noisette. Et, voyant cela, il se mit à se lamenter en son âme, et à frapper ses mains l’une contre l’autre, en s’arrêtant tout court dans le massage qu’il faisait.
Lorsque le jeune garçon vit le masseur en proie à un tel chagrin et sa mine bouleversée de désespoir, il lui dit : « Qu’as-tu, ô masseur, à te lamenter ainsi au dedans de ton âme et à frapper tes mains l’une contre l’autre ? » Il répondit : « Hélas ! mon seigneur, mon désespoir et mes lamentations sont à ton sujet ! Car je vois que tu es affligé du plus grand malheur dont un homme puisse être atteint ! Tu es jeune, dodu et beau, et tu possèdes toutes les perfections de corps et de visage, et tous les bienfaits dispensés par le Rétributeur à ceux qu’Il élit. Mais justement tu manques de l’instrument de délices, celui sans lequel on n’est pas un homme et on n’a pas les apanages de la virilité qui donne et reçoit ! Est-ce que la vie serait la vie, sans le zebb et tout ce qui s’en suit ? » À ces paroles, le fils du vizir baissa tristement la tête et répondit : « Mon oncle, tu as bien raison ! Et tu viens justement de me faire penser à ce qui fait le sujet de mon seul tourment ! Si l’héritage de mon vénéré père est si petit, la faute est à moi seul qui jusqu’aujourd’hui ai négligé de le faire fructifier. Comment veux-tu, en effet, que le chevreau devienne un puissant bouc s’il se tient loin des chèvres incendiaires, ou que l’arbre se développe si on ne l’arrose pas ? Moi jusqu’aujourd’hui je me suis tenu loin des femmes, et nul désir n’est encore venu réveiller mon enfant dans son berceau ! Mais il est temps, je pense, que se réveillent les endormis et que le berger s’appuie sur son bâton ! »
À ce discours du fils du vizir, le masseur du hammam dit : « Mais comment fera le berger pour s’appuyer sur un bâton qui n’est pas plus gros que la phalangette du petit doigt ? » Le garçon répondit : « Je compte pour cela, mon bon oncle, sur ton généreux vouloir. Tu vas aller sur l’estrade où j’ai laissé mes vêtements, et tu prendras la bourse que tu trouveras dans ma ceinture ; et avec l’or qu’elle contient tu iras me chercher une adolescente capable de commencer ce développement. Et moi je ferai avec elle mon premier essai ! » Et le masseur répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il alla sur l’estrade, prit la bourse et sortit du hammam chercher l’adolescente en question.
En cours de route, il se dit : « Ce pauvre garçon s’imagine qu’un zebb est une pâte de caramel mou, qui se développe tant et plus dès qu’on la touche ! Ou peut-être croit-il que le concombre devient concombre du jour au lendemain, ou que la banane mûrit avant de devenir banane ! » Et, riant de l’aventure, il alla trouver son épouse et lui dit : « Ô mère d’Ali, sache que je viens de masser au hammam un jeune garçon beau comme la lune dans son plein. Il est le fils du grand-vizir, et il a toutes les perfections ; mais, le pauvre ! il n’a point un zebb comme celui des autres hommes ! Ce qu’il possède est à peine aussi gros qu’une noisette. Et moi comme je me lamentais sur sa jeunesse, il m’a donné cette bourse pleine d’or afin que je lui procure une adolescente capable de développer en un instant le pauvre héritage qu’il tient de son vénérable père ; car le naïf s’imagine que son zebb va s’ériger comme ça en un instant dès le premier essai ! Moi alors j’ai pensé qu’il valait mieux que tout cet or restât dans la maison ; et je viens te trouver pour te décider à m’accompagner au hammam où tu feras le simulacre de te prêter à l’essai sans conséquence du pauvre garçon. Il n’y a aucun inconvénient à la chose ! Et tu pourras même passer une heure à rire sur lui, sans aucun danger ni crainte ! Et moi je veillerai du dehors sur vous deux, et je ferai en sorte de vous protéger contre la curiosité des baigneurs.
En entendant ces paroles de son époux, la jeune femme répondit par l’ouïe et l’obéissance et se leva, et se para et se vêtit de ses plus belles robes. D’ailleurs, même sans parures ni ornements, elle pouvait faire tourner toutes les têtes et s’envoler tous les cœurs, car elle était la plus belle d’entre les femmes de son temps…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… car elle était la plus belle d’entre les femmes de son temps.
Le masseur emmena donc son épouse et l’introduisit auprès du jeune fils du vizir, qui attendait toujours étendu sur le marbre de la salle chaude ; et il les laissa seuls et sortit se poster au dehors pour empêcher les importuns de passer leur tête au travers de la porte. Et il leur dit de refermer cette porte sur eux deux en dedans.
Quand donc la jeune femme vit l’adolescent, elle fut charmée de sa beauté de lune ; et lui également. Et elle se dit : « Quel dommage qu’il n’ait pas ce que possèdent les autres hommes ! Car ce que m’a raconté mon époux est bien vrai : il est à peine aussi gros qu’une noisette ! » Mais déjà l’enfant endormi entre les cuisses de l’adolescent s’était ému au contact de la jeune femme ; et, comme sa petitesse n’était qu’apparente seulement et qu’à l’état de sommeil il était de ceux qui rentrent entièrement dans le giron de leur père, il commença par secouer sa torpeur. Et voici qu’il surgit soudain comparable à celui d’un âne ou d’un éléphant, et vraiment très grand et très puissant ! Et l’épouse du masseur, à cette vue, jeta un cri d’admiration et s’élança au cou de l’adolescent qui la monta comme un coq triomphant. Et, en une heure de temps, il la pénétra une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et ainsi de suite jusqu’à la dixième fois, alors que, tumultueuse, elle s’agitait et gémissait et se remuait éperdument.
Tout cela !
Et, de derrière le treillis en bois de la porte, le masseur voyait toute la scène et n’osait, par crainte de l’opprobre public, faire du bruit ou casser la porte. Et il se contentait d’appeler à mi-voix son épouse qui ne lui répondait pas ! Et il lui disait : « Ô mère d’Ali, qu’attends-tu donc pour sortir ? La journée s’avance et tu as oublié à la maison ton nourrisson qui attend le sein ! » Mais elle, située en dessous de l’adolescent, continuait ses ébats et, au milieu des rires et des halètements, disait : « Non, par Allah ! je n’aurai désormais à donner le sein à d’autre nourrisson que cet enfant ! » Et le fils du vizir lui dit : « Pourtant tu pourrais bien aller un instant le nourrir, pour aussitôt revenir ! » Elle répondit : « On me ferait sortir plutôt l’âme avant de me décider à rendre pour une heure orphelin de sa mère mon nouvel enfant ! »
Aussi, quand le pauvre masseur vit son épouse lui échapper de la sorte, et refuser avec cette effronterie de revenir à lui, il fut dans un tel désespoir et une telle rage de jalousie qu’il monta sur la terrasse du hammam et se jeta de là pour aller se briser la tête dans la rue. Et il mourut.
Or, cette histoire est pour prouver que le sage ne doit point se fier aux apparences.
— Mais, continua Schahrazade, l’anecdote que je vais te raconter démontrera mieux encore combien sont trompeuses les apparences, et comme il est dangereux de se laisser guider par elles :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’un homme d’entre les hommes s’éprit à l’extrême d’une charmante et belle adolescente. Et cette adolescente, modèle de grâce et de perfections, était mariée à un homme qu’elle aimait et dont elle était aimée. Et comme elle était, en outre, chaste et vertueuse, l’homme qui en était amoureux ne pouvait arriver à trouver le moyen de la séduire. Et comme il y avait déjà longtemps qu’il usait sa patience sans résultat, il pensa à employer quelque expédient soit pour se venger d’elle, soit pour vaincre son abstension.
Or, l’époux de cette jeune femme avait chez lui, comme serviteur de confiance, un jeune garçon qu’il avait élevé dès l’enfance, et qui gardait la maison pendant l’absence des maîtres. Aussi l’amoureux évincé alla trouver ce jeune garçon et se lia d’amitié avec lui, en lui faisant divers cadeaux et le comblant de prévenances, tant et tant que le jeune garçon finit par être entièrement à sa dévotion et par lui obéir, sans restriction, en toutes choses.
Quand donc l’affaire fut à ce point, l’amoureux dit un jour au jeune garçon : « Ô Tel, je voudrais bien aujourd’hui visiter la maison de ton maître, une fois que ton maître et ta maîtresse seront sortis ! » Il répondit : « Certainement ! » Et lorsque son maître fut parti pour sa boutique et que sa maîtresse fut sortie pour aller au hammam, il alla trouver son ami, le prit par la main et, l’ayant introduit dans la maison, lui fit visiter toutes les pièces et voir tout ce qu’elles contenaient. Or l’homme, qui était fermement résolu à se venger de la jeune femme, avait déjà préparé le tour qu’il lui voulait jouer. Donc, lorsqu’il fut arrivé dans la chambre à coucher, il s’approcha du lit et y versa le contenu d’un flacon qu’il avait pris soin de remplir de blanc d’œuf. Et il fit si discrètement la chose, que le jeune garçon ne s’aperçut de rien. Après quoi il sortit de l’appartement et s’en alla en sa voie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… il sortit de l’appartement en s’en alla en sa voie. Et voilà pour lui !
Quant à l’époux, voici. Lorsque, vers le coucher du soleil, il eut fermé sa boutique, il rentra dans sa maison et, comme il était fatigué de toute une journée de ventes et d’achats, il alla à son lit et voulut s’y étendre pour se reposer, mais il aperçut une large tache qui maculait les draps, et recula étonné et méfiant à la limite de la méfiance. Puis il se dit : « Qui a bien pu pénétrer dans ma maison et faire ce qu’il a pu faire avec mon épouse ? Car ceci que je vois est de la semence d’homme, sans aucun doute ! » Et, pour mieux s’en assurer le marchand plongea son doigt au milieu du liquide et dit : « C’est cela même ! » Alors, plein de fureur, il voulut tout d’abord tuer le jeune garçon, mais il se ravisa, pensant : « Une tache si énorme ne peut être sortie de ce jeune garçon, car il n’est pas encore à l’âge où se gonflent les œufs ! » Il l’appela pourtant et, la voix tremblante de fureur, lui cria : « Misérable avorton, où est ta maîtresse ? » Il répondit : « Elle est allée au hammam ! » À ces mots, le soupçon ne fit que se consolider dans l’esprit du marchand, puisque la loi religieuse veut que les hommes et les femmes aillent au hammam faire une ablution complète toutes les fois qu’il y a eu copulation. Et il cria au garçon : « Cours vite la presser de rentrer ! » Et le garçon s’empressa d’exécuter l’ordre.
Lorsque son épouse fut rentrée, le marchand, dont les yeux roulaient de droite et de gauche dans la chambre même où se trouvait le lit en question, sans prononcer une parole, bondit sur elle, la saisit par les cheveux, la renversa à terre et commença par lui administrer une raclée à grand renfort de coups de pied et de coups de poing. Après quoi il lui lia les bras, prit un grand couteau et s’apprêta à l’égorger. Mais à cette vue, la femme se mit à lancer de grands cris et à hurler de travers, et si fort que tous les voisins et voisines accoururent au secours et la trouvèrent sur le point d’être égorgée. Alors ils éloignèrent de force le mari, et demandèrent la cause qui nécessitait un tel châtiment. Et la femme s’écria : « Je ne sais point la cause ! » Alors tous crièrent au marchand : « Si tu as à te plaindre d’elle, tu as le droit soit de divorcer d’avec elle, soit de la réprimander avec douceur et aménité. Mais tu ne peux la tuer, car, pour être chaste, elle est chaste et nous la connaissons comme telle et en témoignerons devant Allah et devant le kâdi ! Elle est depuis longtemps notre voisine, et nous n’avons remarqué dans sa conduite rien de répréhensible ! » Le marchand répondit : « Laissez-moi l’égorger, cette débauchée. Et si vous voulez avoir la preuve de ses débauches, vous n’avez qu’à regarder la tache liquide qu’ont laissée les hommes introduits par elle dans mon lit ! » À ces paroles, les voisins et les voisines s’approchèrent du lit et chacun à son tour plongea le doigt dans la tache et dit : « C’est là un liquide d’homme ! » Mais à ce moment, le jeune garçon, s’étant approché à son tour, recueillit dans une poêle à frire le liquide qui n’avait pas été absorbé par le drap, approcha la poêle du feu et en fit cuire le contenu. Après quoi il prit ce qu’il venait de cuire, en mangea la moitié et en distribua l’autre moitié aux assistants, en leur disant : « Goûtez-en ! c’est du blanc d’œuf ! » Et tous, ayant goûté, s’assurèrent de la sorte que c’était réellement du blanc d’œuf ; même le mari, qui comprit alors que son épouse était innocente et qu’il l’avait injustement accusée et maltraitée. Aussi il se hâta de se réconcilier avec elle et, pour sceller leur bonne entente, lui fit cadeau de cent dinars d’or et d’un collier d’or.
Or, cette courte histoire est pour prouver qu’il y a blanc et blanc, et qu’en toutes choses il faut savoir faire la différence.
— Lorsque Schahrazade eut raconté ces anecdotes au roi Schahriar, elle se tut. Et le Roi dit : « En vérité, Schahrazade, ces histoires sont infiniment morales ! Et elles m’ont, en outre, tellement reposé l’esprit que me voici disposé à t’entendre me raconter une histoire tout à fait extraordinaire ! » Et Schahrazade dit : « Justement ! celle que je vais le raconter est celle que tu souhaites ! »
HISTOIRE D’ABDALLAH DE LA TERRE ET D’ABDALLAH DE LA MER
Et Schahrazade dit au roi Schahriar :
Il est raconté — mais Allah est plus savant ! — qu’il y avait un homme, pêcheur de son métier, qui s’appelait Abdallah. Et ce pêcheur avait à nourrir ses neuf enfants et leur mère, et il était pauvre, bien pauvre, tellement que pour tout bien il n’avait que son filet. Et ce filet lui tenait ainsi lieu de boutique et était son gagne-pain, et la seule porte de secours pour sa maison. Aussi avait-il coutume d’aller chaque jour pêcher à la mer ; et s’il pêchait peu de chose, il le vendait et en dépensait le gain sur ses enfants, selon la mesure que lui octroyait le Rétributeur ; mais s’il pêchait beaucoup, il faisait, avec l’argent du gain, cuisiner par son épouse une cuisine excellente, et achetait des fruits et dépensait le tout sur sa famille, sans aucune restriction ou économie, jusqu’à ce qu’il ne lui restât plus rien entre les mains ; car il se disait : « Le pain de demain nous viendra demain ! » Et il vivait ainsi, au jour le jour, n’anticipant point sur la destinée du lendemain.
Or, son épouse, un jour, accoucha d’un dixième garçon, car les neuf autres étaient également des garçons, par la bénédiction ! Et ce jour-là précisément il n’y avait rien du tout à manger dans la pauvre maison du pêcheur Abdallah. Et la femme dit au mari : « Ô mon maître, la maison a un habitant de plus, et le pain du jour n’est pas encore venu ! Ne vas-tu point aller nous chercher quelque chose qui nous soutienne en ce moment pénible ? » Il répondit : « Justement je vais sortir, me fiant à la bonté d’Allah, et m’en aller pêcher à la mer en jetant mon filet à la chance de cet enfant nouveau-né, pour voir de la sorte la mesure de son bonheur futur ! » La femme lui dit : « Mets ta confiance en Allah ! » Et le pêcheur Abdallah prit son filet sur son dos et s’en alla à la mer…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le pêcheur Abdallah prit son filet sur son dos et s’en alla à la mer. Et il le jeta et le disposa dans l’eau, au bonheur de cet enfant nouveau-né, et dit : « Ô mon Dieu, fais que sa vie soit facile et non pas difficile, abondante et non point insuffisante ! » Et, après avoir attendu un moment, il retira le filet et le trouva rempli d’ordures, de sable, de gravier et d’herbes marines, mais n’y vit pas trace de poisson grand ou petit, absolument rien ! Alors il s’étonna et s’attrista en son âme, et dit : « Allah aurait-il donc créé ce nouveau-né pour ne lui allouer aucun lot ni aucune provision ? Cela ne peut être, ne pourra jamais être ! Car Celui qui a formé les mâchoires de l’homme et tracé deux lèvres pour la bouche, ne l’a pas point fait en vain, et a pris lui-même sous sa responsabilité de fournir à leurs besoins, parce qu’il est le Prévoyant, le Généreux. Qu’il soit exalté ! » Puis il chargea son filet sur son dos et alla le jeter à un autre endroit, dans la mer. Et il patienta un bon moment et, après s’être donné une grande peine, car il le trouvait bien lourd, il le retira. Et il y trouva un âne mort, tout gonflé et exhalant une odeur épouvantable. Et le pêcheur sentit la nausée envahir son âme ; et il se hâta de débarrasser son filet de cet âne mort, et de s’éloigner au plus vite vers un autre endroit, en disant : « Il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah le Glorieux, le Très-Haut ! Tout ce qui m’arrive là en fait de malechance est la faute de ma maudite femme ! Que de fois ne lui ai-je pas dit : « Il n’y a plus rien pour moi dans l’eau, et il faut que je cherche ailleurs notre subsistance. Je n’en puis plus de ce métier ! Non, en vérité, je n’en puis plus ! Laisse-moi donc, ô femme, exercer un autre métier que celui de pêcheur ! » Et je lui ai tant de fois répété ces paroles, que les poils m’en ont poussé sur la langue ! Et elle, toujours, elle me répondait : « Allah Karim ! Allah Karim ! Sa générosité est sans bornes ! Ne te désespère pas, ô père des enfants ! » Or est-ce là toute la générosité d’Allah ? Cet âne mort serait-il donc le lot destiné à ce pauvre nouveau-né, ou bien serait-ce le gravier ou le sable recueilli ? »
Et le pêcheur Abdallah resta longtemps immobile, en proie à un chagrin bien profond. Puis il finit par se décider à jeter encore une fois son filet à la mer, en demandant pardon à Allah des paroles qu’il venait de prononcer inconsidérément, et dit : « Sois favorable à ma pêche, ô Toi le Rétributeur qui dispenses à tes créatures les faveurs et les bienfaits, et marques d’avance leur destinée. Et sois favorable à cet enfant nouveau-né, et je te promets qu’il sera un jour un santon dévoué à ton seul service ! » Puis il se dit : « Je voudrais bien ne pêcher qu’un seul poisson, ne serait-ce que pour le porter au boulanger, mon bienfaiteur, qui dans les jours noirs, lorsqu’il me voyait arrêté devant sa boutique à humer du dehors l’odeur du pain chaud, me faisait de la main signe d’approcher et me donnait généreusement de quoi suffire aux neuf et à leur mère ! »
Lorsqu’il eut jeté son filet pour la troisième fois, Abdallah attendit très longtemps, et se mit ensuite en devoir de le retirer. Mais comme le filet était encore plus lourd que les autres fois et d’un poids tout à fait extraordinaire, il éprouva une peine infinie à le ramener sur le rivage ; et il n’y réussit qu’après s’être ensanglanté les mains en tirant sur les cordes. Et alors, à la limite de la stupéfaction, il trouva, engagé entre les mailles du filet, un être humain, un Adamite, semblable à tous les Ibn-Adam, avec cette seule différence que son corps se terminait en queue de poisson, mais, à part cela, il avait une tête, un visage, une barbe, un tronc et des bras, tout comme un homme de la terre.
À cette vue, le pêcheur Abdallah ne douta pas un instant qu’il ne fût en présence d’un éfrit d’entre les éfrits, qui, dans les anciens temps, rebelles aux ordres de notre maître Soleïmân Ibn-Daoûd, avaient été enfermés dans des vases de cuivre rouge et jetés à la mer. Et il se dit : « C’est là certainement l’un d’eux ! Grâce à l’usure du métal par l’eau et les années, il a pu sortir du vase scellé et se cramponner à mon filet ! » Et, poussant des cris de terreur et relevant sa robe au-dessus de ses genoux, le pêcheur se mit à courir sur la plage, fuyant à perdre la respiration, et hurlant : « Amân ! Amân ! Je le demande grâce, ô éfrit de Soleïmân ! »
Mais l’Adamite, de l’intérieur du filet, lui cria : « Viens, ô pêcheur ! Ne me fuis pas ! Car je suis un être humain comme toi, et non point un mared ou un éfrit ! Reviens plutôt m’aider à sortir de ce filet, et ne crains rien ! Je t’en récompenserai largement ! Et Allah t’en tiendra compte au jour du Jugement ! » À ces paroles, le cœur du pêcheur se calma ; et il s’arrêta de fuir et revint, mais à pas lents, avançant d’une jambe et reculant de l’autre, vers son filet. Et il dit à l’Adamite pris dans le filet : « Alors tu n’es point un genni d’entre les genn…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … alors tu n’es point un genni d’entre les genn ? » Il répondit : « Non pas ! Je suis un être humain qui croit en Allah et en son Envoyé ! » Abdallah demanda : « Mais alors qui t’a jeté à la mer ? » Il dit : « Nul ne m’a jeté à la mer, puisque j’y suis né ! Car je suis un enfant d’entre les enfants de la mer. Nous sommes, en effet, des peuples nombreux qui habitons les profondeurs maritimes. Et nous respirons et vivons dans l’eau comme vous autres sur la terre, et les oiseaux dans l’air. Et nous sommes tous des croyants en Allah et en son Prophète (sur lui la prière et la paix !) et nous sommes bons et secourables envers les hommes, nos frères, qui habitent à la surface de la terre ; car nous obéissons aux commandements d’Allah et aux préceptes du Livre ! » Puis il ajouta : « D’ailleurs si j’étais un genni ou un éfrit malfaisant, n’aurais-je pas déjà mis en pièces ton filet, au lieu de te prier de venir m’aider à en sortir sans l’endommager, vu qu’il est ton gagne-pain et la seule porte de secours de ta maison ? » À ces paroles péremptoires, Abdallah sentit se dissiper ses derniers doutes et ses dernières craintes, et, comme il se baissait pour aider l’habitant de la mer à sortir du filet, celui-ci lui dit encore : « Ô pêcheur, la destinée a voulu ma capture pour ton bien. Je me promenais, en effet, dans les eaux, quand ton filet s’est abattu sur moi et m’a pris dans ses mailles. Je désire donc faire ton bonheur et celui des tiens ! Veux-tu que nous fassions un pacte par lequel chacun de nous s’engagera à être l’ami de l’autre, à lui faire des cadeaux et à en recevoir d’autres en échange ? Ainsi toi, par exemple, tous les jours, tu viendras me trouver ici et m’apporter une provision des fruits de la terre qui poussent chez vous autres : des raisins, des figues, des pastèques, des melons, des pêches, des prunes, des grenades, des bananes, des dattes et d’autres encore ! Et moi j’accepterai de toi le tout avec un plaisir extrême. Et, en retour, je te donnerai, chaque fois, des fruits de la mer qui poussent dans nos profondeurs : le corail, les perles, les chrysolithes, les aigues-marines, les émeraudes, les saphirs, les rubis, les métaux précieux et toutes les gemmes et pierreries de la mer. Et je t’en remplirai chaque fois le panier de fruits que tu m’auras apporté ! Acceptes-tu ? »
En entendant ces paroles, le pêcheur qui déjà, dans sa joie et dans le ravissement que lui causait cette énumération splendide, ne se tenait plus que sur une seule jambe, s’écria : « Ya Allah ! Et qui donc n’accepterait pas ? » Puis il dit : « Oui ! mais avant tout qu’entre nous soit la Fatiha, pour sceller notre pacte ! » Et l’habitant de la mer acquiesça. Et tous deux alors récitèrent à haute voix la Fatiha liminaire du Korân. Et, aussitôt après, Abdallah le pêcheur délivra du filet l’habitant de la mer.
Alors le pêcheur demanda à son ami de la mer : « Comment t’appelles-tu ? » Il répondit : « Je m’appelle Abdallah. Ainsi quand tu viendras ici chaque matin, le jour où, par hasard, tu ne me verrais pas, tu n’auras qu’à crier : « Ya Abdallah, ô Maritime ! » Et à l’instant je t’entendrai, et tu me verras t’apparaître hors de l’eau. » Puis il demanda : « Mais toi, ô mon frère, comment t’appelles-tu ? » Le pêcheur répondit : « Je m’appelle aussi Abdallah, comme toi ! » Alors le Maritime s’écria : « Toi tu es Abdallah de la Terre, et moi je suis Abdallah de la Mer ! Et de la sorte nous sommes deux fois frères, par notre nom et par notre amitié. Attends-moi donc ici un instant, ô mon ami, rien que le temps de plonger et de te revenir avec un premier cadeau maritime ! » Et Abdallah de la Terre répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et aussitôt Abdallah de la Mer sauta du rivage dans l’eau et disparut aux yeux du pêcheur.
Alors Abdallah de la Terre, ne voyant plus au bout d’un certain temps apparaître le Maritime, se repentit grandement de l’avoir délivré du filet et se dit en lui-même : « Est-ce que je sais, moi, s’il va revenir ? Il est certain qu’il a dû rire de moi et me dire tout cela afin que je le délivre. Ah ! que ne l’ai-je plutôt capturé ! J’aurais pu de la sorte l’exhiber aux habitants de la ville, et gagner beaucoup d’argent ! Et je l’aurais aussi transporté dans les maisons des gens riches, qui n’aiment pas se déranger, afin de le leur montrer à domicile. Et ils m’auraient largement rétribué ! » Et il continua ainsi à se lamenter en son âme et à se dire : « Ta pêche s’est échappée d’entre tes mains, ô pêcheur…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ta pêche s’est échappée d’entre tes mains, ô pêcheur ! » Mais, à l’instant même, le Maritime apparut hors de l’eau, tenant quelque chose au-dessus de sa tête, et vint se poser sur le rivage à côté du Terrien. Et les deux mains du Maritime étaient pleines de perles, de corail, d’émeraudes, d’hyacinthes, de rubis et de toutes les pierreries. Et il tendit le tout au pêcheur et lui dit : « Prends cela, ô mon frère Abdallah, et excuse-moi du peu. Car, cette fois, je n’ai point de panier pour te le remplir ; mais la prochaine fois tu m’en apporteras un, et je te le rendrai plein de ces fruits de la mer ! » À la vue des gemmes précieuses, le pêcheur se réjouit extrêmement. Et il les prit, et après les avoir fait couler entre ses doigts en s’en émerveillant, il les cacha dans son sein. Et le Maritime lui dit : « N’oublie pas notre pacte ! Et reviens ici tous les matins, avant le lever du soleil ! » Et il prit congé de lui et s’enfonça dans la mer.
Quant au pêcheur, il revint en ville transporté de joie, et commença d’abord par passer devant la boutique du boulanger qui lui avait été si bienfaisant dans les jours noirs, et lui dit : « Ô mon frère, la bonne chance et la fortune commencent enfin à marcher sur notre route ! Je te prie donc de faire le compte de tout ce que je te dois. » Le boulanger répondit : « Un compte ? Et pourquoi faire ? Avons-nous besoin de cela, entre nous ? Mais si vraiment tu as de l’argent de trop, donne-moi ce que tu peux ! Et si tu n’as rien, prends autant de pains qu’il t’en faut pour nourrir ta famille, et attends, pour me payer, que la prospérité réside chez toi définitivement ! » Le pêcheur dit : « Ô mon ami, la prospérité s’est installée solidement chez moi, pour le bonheur de mon nouveau-né, par la bonté et la munificence d’Allah ! Et tout ce que je pourrai te donner sera bien peu en comparaison de ce que tu as fait pour moi, quand me tenait à la gorge la misère ! Mais prends ceci en attendant ! » Et il plongea sa main dans son sein et en retira une grosse poignée de pierreries, si grosse même qu’il ne lui resta pour lui que la moitié à peine de ce que lui avait donné le Maritime. Et il la remit au boulanger, en lui disant : « Je te demande seulement de me prêter quelque argent, en attendant que j’aie vendu au souk ces gemmes de la mer. » Et le boulanger, stupéfait de ce qu’il voyait et recevait, vida son tiroir entre les mains du pêcheur et voulut lui-même lui porter jusqu’à sa maison la charge de pain nécessaire pour la famille. Et il lui dit : « Je suis ton esclave et ton serviteur ! » Et, bon gré mal gré, il prit sur sa tête la hotte de pains et marcha derrière le pêcheur jusqu’à sa maison, où il déposa la hotte. Et il s’en alla après lui avoir baisé les mains. Quant au pêcheur, il remit la hotte de pains à la mère de ses enfants, puis se hâta d’aller leur acheter de la viande d’agneau, des poulets, des légumes et des fruits. Et il fit faire par son épouse, ce soir-là, une cuisine extraordinaire. Et, avec ses enfants et son épouse, il fit un repas admirable, en se réjouissant à la limite de la réjouissance de l’avènement de cet enfant nouveau-né qui apportait avec lui la fortune et le bonheur.
Après quoi, Abdallah raconta à son épouse tout ce qui lui était arrivé, et comment la pêche s’était terminée par la capture d’Abdallah de la Mer, et enfin toute l’aventure dans ses moindres détails. Et il finit par lui mettre entre les mains ce qui lui restait du cadeau précieux de son ami l’habitant de la mer. Et son épouse se réjouit de tout cela ; mais elle lui dit : « Garde bien le secret de cette aventure ! Sinon tu risques de voir les gens du gouvernement te créer de grands embarras ! » Et le pêcheur répondit : « Certes ! je tairai la chose à tout le monde, excepté au boulanger ! Car, bien que d’ordinaire l’on doive cacher son bonheur, je ne puis de mon bonheur faire un mystère à mon premier bienfaiteur ! »
Le lendemain, de très bonne heure, Abdallah le pêcheur se rendit, avec un panier rempli de beaux fruits de toutes les espèces et de toutes les couleurs, au bord de la mer, où il arriva avant le lever du soleil. Et il déposa son panier sur le sable du rivage et, comme il n’apercevait pas Abdallah, il frappa ses mains l’une contre l’autre en criant : « Où es-tu, ô Abdallah de la Mer ? » Et à l’instant, du fond des flots, une voix marine répondit : « Me voici, ô Abdallah de la Terre ! Me voici à tes ordres ! » Et l’habitant de la mer émergea de l’eau et parut sur le rivage. Et, après les salams et les souhaits, le pêcheur lui offrit le panier de fruits. Et le Maritime le prit, en remerciant, et replongea au fond de la mer. Mais quelques instants après, il réapparut tenant dans ses bras le panier vide de fruits, mais lourd d’émeraudes, d’aigues et de toutes les gemmes et productions marines. Et le pêcheur, après avoir pris congé de son ami, chargea le panier sur sa tête et reprit le chemin de la ville, en passant devant le four du boulanger…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le pêcheur, après avoir pris congé de son ami, chargea le panier sur sa tête et reprit le chemin de la ville, en passant devant le four du boulanger. Et il dit à son ancien bienfaiteur : « La paix sur toi, ô père des mains ouvertes ! » Il répondit : « Et sur toi la paix, les grâces d’Allah et ses bénédictions, ô visage de bon augure ! Je viens de t’envoyer à la maison un plateau de quarante gâteaux que j’ai spécialement cuits à ton intention, et dans la pâte desquels je n’ai point économisé le beurre clarifié, la cannelle, le cardamome, la noix muscade, le curcuma, l’armoise, l’anis et le fenouil ! » Et le pêcheur plongea sa main dans le panier, d’où partaient mille feux étincelants, prit trois grosses poignées de pierreries et les lui remit. Puis il continua sa route et arriva à sa maison. Là il déposa son panier, y choisit de chaque espèce et de chaque couleur la plus belle pierrerie, mit le tout dans un morceau de chiffon et s’en alla au souk des bijoutiers. Et il s’arrêta devant la boutique du cheikh des bijoutiers, étala devant lui les merveilleuses pierreries, et lui dit : « Veux-tu me les acheter ? » Le cheikh des bijoutiers regarda le pêcheur avec des yeux chargés de méfiance, et lui demanda : « En as-tu encore d’autres ? » Il répondit : « J’en ai un panier tout plein à la maison. » L’autre demanda : « Et où se trouve ta maison ? » Le pêcheur répondit : « De maison, je n’en ai point, par Allah ! mais simplement une hutte, en planches pourries, située au fond de telle ruelle près du souk des poissons ! » À ces paroles du pêcheur, le bijoutier cria à ses garçons : « Arrêtez-le ! C’est le voleur qui nous a été signalé comme ayant dérobé les bijoux de la reine, épouse du sultan ! » Et il leur ordonna de lui administrer la bastonnade. Et tous les bijoutiers et les marchands l’entourèrent et l’invectivèrent. Et les uns disaient : « C’est certainement lui qui a volé le mois dernier la boutique du hadj Hassân ! » Et les autres disaient : « C’est encore lui, ce misérable, qui a nettoyé la maison de Tel ! » Et chacun racontait une histoire de vol dont l’auteur était resté introuvable, et l’attribuait au pêcheur ! Et Abdallah, durant tout ce temps, gardait le silence et ne faisait aucun geste de négation. Et, après qu’il eut reçu la bastonnade préliminaire, il se laissa traîner devant le roi par le cheikh-bijoutier qui voulait lui faire avouer ses crimes et le faire pendre à la porte du palais.
Lorsqu’ils furent tous arrivés dans le diwân, le cheikh des bijoutiers dit au roi : « Ô roi du temps, lorsque le collier de la reine eut disparu, tu nous as fait prévenir, et tu nous as enjoint de retrouver le coupable. Nous avons donc fait tout notre possible et, avec l’aide d’Allah, nous avons réussi ! Voici donc, entre tes mains, le coupable et les pierreries que nous avons retrouvées sur lui ! » Et le roi dit au chef eunuque : « Prends ces pierreries et va les montrer à ta maîtresse. Et demande-lui si ce sont bien là les pierres du collier qu’elle a perdu ! » Et le chef eunuque alla trouver la reine, et, étalant devant elle les gemmes splendides, lui demanda : « Sont-ce bien là, ô ma maîtresse, les pierres du collier ? »
À la vue de ces pierreries, la reine fut à la limite de l’émerveillement, et répondit à l’eunuque : « Mais pas du tout ! Moi j’ai retrouvé mon collier dans le coffret. Quant à ces pierreries, elles sont de beaucoup plus belles que les miennes, et n’ont pas leurs pareilles dans le monde ! Va donc, ô Massrour, dire au roi d’acheter ces pierres pour en faire un collier à notre fille Prospérité qui est en âge d’être mariée. »
Lorsque le roi eut appris, par l’eunuque, la réponse de la reine, il entra dans une fureur extrême contre le cheikh des bijoutiers, qui venait d’arrêter ainsi et de maltraiter un innocent ; et il le maudit de toutes les malédictions d’Aâd et de Thammoud ! Et le cheikh des bijoutiers, bien tremblant, répondit : « Ô roi du temps, nous savions que cet homme était un pêcheur, un pauvre ; et, le voyant détenteur de ces pierreries et apprenant qu’il en avait encore un panier tout plein dans sa maison, nous avons pensé que c’était là une trop grosse fortune pour que ce pauvre ait pu l’acquérir par les moyens licites ! » À ces paroles, la colère du roi ne fit qu’augmenter et il cria au cheikh des bijoutiers et à ses compagnons : « Ô roturiers impurs, ô hérétiques de mauvaise foi, âmes communes, ne savez-vous donc pas que nulle fortune, quelque soudaine et merveilleuse qu’elle soit, n’est impossible dans la destinée du vrai Croyant ? Ah ! scélérats ! Et vous vous hâtez, comme cela, de condamner ce pauvre sans l’entendre, sans examiner son cas, sous le faux prétexte que cette fortune est trop grosse pour lui ! Et vous le traitez de voleur, et vous le déshonorez parmi ses semblables ! Et pas un instant vous ne pensez qu’Allah l’Exalté, quand il distribue ses faveurs, n’agit jamais avec parcimonie ! Connaissez-vous donc la capacité d’abondance des sources infinies où le Très-Haut puise ses bienfaits, ô sots ignorants, pour juger ainsi, d’après vos calculs mesquins de créatures de boue, de la somme des poids dont est chargée la balance d’une heureuse destinée ? Allez, misérables ! Sortez de ma présence ! Et puisse Allah vous priver à jamais de ses bénédictions ! » Et il les chassa honteusement ! Et voilà pour eux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il les chassa honteusement. Et voilà pour eux !
Quant au pêcheur Abdallah, voici ! Le roi se tourna vers lui et, avant de lui poser la moindre question, lui dit : « Ô pauvre, qu’Allah te bénisse dans les dons qu’il t’a faits ! La sécurité est sur toi ! C’est moi qui te la donne ! » Puis il ajouta : « Veux-tu maintenant me raconter la vérité, et me dire comment te sont venues ces pierreries, si belles que nul roi de la terre n’en possède les pareilles ? » Le pêcheur répondit : « Ô roi du temps, j’ai encore à la maison un panier à poisson rempli de ces pierreries-là ! C’est un don de mon ami Abdallah de la Mer ! » Et il raconta au roi toute son aventure avec le Maritime, sans omettre un détail ! Mais il n’y a point d’utilité à la répéter. Puis il ajouta : « Or, moi, j’ai fait avec lui un pacte, scellé par la récitation de la Fatiha du Korân ! Et par ce pacte, moi, je me suis engagé à lui porter tous les matins, à l’aurore, un panier rempli des fruits de la terre ; et lui, il s’est engagé à me remplir ce même panier des fruits de la mer, dont ces pierreries que tu vois ! »
En entendant ces paroles du pêcheur, le roi s’émerveilla de la générosité du Donateur à l’égard de ses croyants ; et il dit : « Ô pêcheur, cela est dans ta destinée ! Laisse-moi seulement te dire que la richesse demande à être protégée, et que le riche doit avoir un haut rang ! Je veux donc te prendre sous ma protection, toute ma vie durant, et même mieux que cela ! Car je ne puis répondre de l’avenir, et je ne sais le sort que peut te réserver mon successeur, si je viens à mourir ou à être dépossédé du trône. Il est possible qu’il te tue par convoitise et par amour des biens de ce monde. Je veux donc t’assurer contre les vicissitudes du sort, pendant que je suis en vie. Et le meilleur moyen, je pense, c’est de te marier avec ma fille Prospérité, adolescente pubère, et de te nommer mon grand-vizir, en te léguant ainsi le trône directement avant ma mort ! » Et le pêcheur répondit : « J’écoute et j’obéis ! »
Alors le roi appela les esclaves et leur dit : « Conduisez au hammam votre maître que voici ! » Et les esclaves conduisirent le pêcheur au hammam du palais, et le baignèrent avec soin et le vêtirent de vêtements royaux, et le reconduisirent devant le roi qui, séance tenante, le nomma grand-vizir. Et il lui donna les instructions nécessaires pour sa nouvelle charge, et Abdallah répondit : « Tes avis, ô roi, sont ma règle de conduite, et ta bienveillance est l’ombre où je me plais ! »
Ensuite le roi envoya à la maison du pêcheur des courriers et des gardes nombreux avec des joueurs de fifre, de clarinette, de cymbales, de gros tambour et de flûte, et des femmes expertes dans l’art de l’habillement et des parures, avec mission d’habiller et de parer la femme du pêcheur et ses dix enfants, de la placer dans un palanquin porté par vingt nègres, et de la conduire au palais au milieu d’un cortège splendide et aux sons de la musique. Et ces ordres furent exécutés ; et l’épouse du pêcheur, portant son nouveau-né sur son sein, fut placée avec ses neuf autres enfants dans un somptueux palanquin ; et, précédée par le cortège des gardes et des musiciens, et accompagnée par les femmes mises à son service et par les épouses des émirs et des notables, elle fut conduite au palais où l’attendait la reine qui la reçut avec des égards infinis, tandis que le roi recevait ses enfants et les faisait s’asseoir à tour de rôle sur ses genoux et les caressait paternellement, avec le plaisir qu’il aurait eu s’ils avaient été ses propres enfants. Et de son côté la reine voulut marquer son affection à l’épouse du nouveau grand-vizir, et la mit à la tête de toutes les femmes du harem en la nommant grande-vizira de ses appartements.
Après quoi, le roi, qui avait pour fille unique la jeune Prospérité, se hâta de tenir sa promesse en l’accordant en mariage, comme seconde épouse, au vizir Abdallah. Et, à cette occasion, il donna une grande fête au peuple et aux soldats, en faisant décorer et illuminer la ville. Et Abdallah, cette nuit-là, connut les délices de la chair jeune et la différence entre la virginité d’une adolescente fille de roi et la vieille peau usée où il se reposait jusque-là.
Or, le lendemain, à l’aurore, comme le roi, réveillé avant son heure habituelle par les émotions de la veille, s’était mis à sa fenêtre, il vit son nouveau grand-vizir, l’époux de sa fille Prospérité, qui sortait du palais, portant sur sa tête un panier à poisson rempli de fruits. Et il le héla et lui demanda : « Que portes-tu là, ô mon gendre…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT ONZIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il le héla et lui demanda : « Que portes-tu là, ô mon gendre ? et vers où te diriges-tu ? » Il répondit : « C’est un panier de fruits que je vais porter à mon ami Abdallah de la Mer ! » Le roi dit : « Mais ce n’est point l’heure où les gens sortent de leur maison. Et puis il n’est guère convenable que mon gendre porte ainsi lui-même sur sa tête une charge de portefaix ! » Il répondit : « C’est vrai ! Mais j’ai peur de manquer l’heure du rendez-vous et de passer aux yeux du Maritime pour un menteur sans foi, et de l’entendre me reprocher ma conduite en me disant : « Les choses du monde maintenant te distraient de ton devoir et te font oublier tes promesses ! » Et le roi dit : « Tu as raison ! Va trouver ton ami, et qu’Allah soit avec toi ! » Et Abdallah prit le chemin de la mer, en traversant les souks. Et les marchands matinaux qui ouvraient leurs boutiques disaient en le reconnaissant : « C’est Abdallah le grand-vizir, gendre du roi qui va à la mer faire l’échange des fruits contre des pierreries ! » Et ceux qui ne le connaissaient pas l’arrêtaient au passage et lui demandaient : « Ô vendeur de fruits, à combien la mesure d’abricots ? » Et il répondait à tout le monde : « Ce n’est pas à vendre. C’est acheté d’avance ! » Et il disait cela fort poliment, en faisant ainsi plaisir à tout le monde. Et il arriva de la sorte au rivage, où il vit sortir des flots Abdallah de la Mer, auquel il remit les fruits en échange de nouvelles pierreries de toutes les couleurs. Puis il reprit le chemin de la ville, en passant devant la boutique de son ami le boulanger. Mais il fut bien étonné de voir fermée la porte de la boutique, et il attendit un moment pour voir si son ami n’arriverait pas. Et il finit par demander au boutiquier voisin : « Ô mon frère, qu’est devenu ton voisin le boulanger ? » Il répondit : « Je ne sais au juste ce qu’Allah lui a fait. Il doit être malade dans sa maison ! » Il demanda : « Et où est sa maison ? » Il dit : « Dans telle ruelle ! » Et il prit le chemin de la ruelle indiquée et, s’étant fait montrer la maison du boulanger, il frappa à la porte et attendit. Et, quelques instants après, il vit apparaître à une lucarne du haut, la tête épouvantée du boulanger qui, rassuré en voyant le panier à poisson rempli comme à l’ordinaire de pierreries, descendit ouvrir. Et il se jeta au cou d’Abdallah en l’embrassant avec des larmes aux yeux, et lui dit : « Mais alors tu n’as donc pas été pendu par ordre du roi ? Moi, j’ai appris que tu avais été arrêté comme voleur ; et, craignant d’être arrêté à mon tour comme complice, je me suis hâté de fermer le four et la boutique et de me cacher au fond de ma maison. Mais explique-moi, ô mon ami, comment il se fait que tu sois habillé comme un vizir ! » Alors Abdallah lui raconta ce qui lui était arrivé depuis le commencement jusqu’à la fin, et ajouta : « Et le roi m’a nommé son grand-vizir et m’a donné sa fille en mariage. Et j’ai maintenant un harem à la tête duquel se trouve ma vieille épouse, la mère des enfants ! » Puis il dit : « Prends ce panier avec tout son contenu. Il t’appartient, car il est écrit aujourd’hui dans ta destinée ! » Puis il le quitta et rentra au palais avec le panier vide.
Lorsque le roi le vit arriver avec le panier vide, il lui dit en riant : « Tu vois bien ! ton ami le Maritime t’a délaissé ! » Il répondit : « Au contraire ! Les pierreries dont il m’a rempli le panier aujourd’hui, étaient supérieures en beauté à celles des autres jours. Mais je les ai toutes données à mon ami le boulanger qui, autrefois, quand me tenait la misère, me nourrissait et nourrissait mes enfants et leur mère. Et moi, à mon tour, de même qu’il m’était miséricordieux aux jours de ma pauvreté, je ne l’oublie point dans les jours de ma prospérité ! Car, par Allah ! je veux témoigner qu’il n’a jamais froissé ma susceptibilité de pauvre besogneux ! » Et le roi, extrêmement édifié, lui demanda : « Comment s’appelle ton ami ? » Il répondit : « Il s’appelle Abdallah le Boulanger, comme moi je m’appelle Abdallah le Terrien et comme mon ami de la mer s’appelle Abdallah le Maritime ! » À ces paroles, le roi s’émerveilla et se trémoussa et s’écria : « Et comme moi je m’appelle le Roi Abdallah ! Et comme nous tous nous nous appelons les serviteurs d’Allah ! Or, comme tous les serviteurs d’Allah sont égaux devant le Très-Haut et frères par la foi et l’origine, je veux, ô Abdallah de la Terre, que tu ailles tout de suite me chercher ton ami Abdallah le Boulanger, afin que je le nomme mon second vizir ! »
Aussitôt Abdallah le Terrien alla chercher Abdallah le Boulanger que le roi, séance tenante, revêtit des insignes du vizirat, en le nommant son vizir de la gauche, comme Abdallah le Terrien était son vizir de la droite.
Et Abdallah, l’ancien pêcheur, remplit ses nouvelles fonctions avec tout l’éclat désirable, sans oublier un seul jour d’aller trouver son ami Abdallah de la Mer, et de lui porter un panier des fruits de la saison, en échange d’un panier de métaux précieux et de pierreries. Et lorsqu’il n’y eut plus de fruits dans les jardins et chez les vendeurs de primeurs, il remplit le panier de raisins secs, d’amandes, de noisettes, de pistaches, de noix, de figues sèches, d’abricots secs et de confitures sèches de toutes les espèces et de toutes les couleurs. Et chaque fois il rapportait sur sa tête le panier rempli de joyaux, comme à l’ordinaire. Et cela durant l’espace d’une année.
Or, un jour, Abdallah de la Terre, arrivé, comme toujours, à l’aurore sur le rivage, s’assit aux côtés de son ami Abdallah le Maritime, et se mit à causer avec lui sur les usages des habitants de la mer…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… s’assit aux côtés de son ami Abdallah le Maritime et se mit à causer avec lui sur les usages des habitants de la mer. Et, entre autres choses, il lui dit : « Ô mon frère, ô Maritime, est-ce bien beau chez vous autres ? » Il répondit : « Certainement ! Et, si tu veux, je te ferai entrer avec moi dans la mer, et je te montrerai tout ce qu’elle contient, et je te ferai visiter ma ville et te recevrai dans ma maison, en toute cordiale hospitalité ! » Et Abdallah le Terrien répondit : « Ô mon frère, toi tu as été créé dans l’eau, et l’eau est ta demeure. C’est pourquoi tu n’es point incommodé d’habiter dans la mer. Mais peux-tu me dire, avant que je réponde à ton invitation, s’il ne te serait pas extrêmement funeste de séjourner sur la terre ? » Il dit : « Certainement ! Mon corps se dessécherait ; et les vents de terre, en soufflant contre moi, me feraient mourir ! » Le Terrien dit : « Et moi de même ! J’ai été créé sur la terre, et la terre est ma demeure. C’est pourquoi l’air de la terre ne m’incommode pas. Mais si je venais à entrer avec toi dans la mer, l’eau pénétrerait dans mon intérieur et m’étoufferait, et je mourrais ! » Le Maritime répondit : « Sois sans aucune crainte à ce sujet, car je t’apporterai un onguent, dont tu t’enduiras le corps, et l’eau n’aura plus aucun pouvoir nuisible sur toi, même si tu devais y passer le reste de ta vie. Et de cette façon tu pourras plonger avec moi et parcourir la mer dans tous les sens, et y dormir et t’y réveiller, sans que jamais aucun mal t’arrive par n’importe quel endroit ! »
À ces paroles, le Terrien dit au Maritime : « Dans ce cas, il n’y a pas d’inconvénient à ce que je plonge avec toi. Apporte-moi donc l’onguent en question, afin que j’en fasse l’essai ! » Le Maritime répondit : « C’est ce que je vais faire ! » Et il prit avec lui le panier de fruits et plongea dans la mer, pour, au bout de peu d’instants, revenir tenant dans ses mains un vase rempli d’un onguent semblable à la graisse des vaches, et dont la couleur était jaune comme celle de l’or, et dont l’odeur était délicieuse absolument. Et Abdallah le Terrien demanda : « De quoi est composé cet onguent-là ? » Il répondit : « Il est composé avec la graisse du foie d’une espèce d’entre les espèces de poissons appelée dandane. Et ce poisson dandane est le plus énorme de tous les poissons de la mer, tellement que d’une seule bouchée il avalerait sans se gêner ce que vous autres, les terriens, appelez un éléphant et un chameau ! » Et l’ancien pêcheur, épouvanté, s’écria : « Et que peut bien manger cette funeste bête-là, ô mon frère ? » Il répondit : « Elle mange d’ordinaire les bêtes les plus petites qui naissent dans les profondeurs. Car tu connais le proverbe qui dit : Les faibles sont mangés par les forts ! » Le Terrien dit : « Tu dis vrai ! Mais y a-t-il chez vous autres beaucoup de ces dandanes-là ? » Il répondit : « Des milliers et des milliers, et Allah seul en sait le nombre ! » Le Terrien s’écria : « Alors dispense-moi de te faire cette visite, ô mon frère, car j’ai bien peur que cette espèce me rencontre et me mange ! » Le Maritime dit : « N’aie point cette peur, car le poisson dandane, bien que d’une férocité terrible, redoute Ibn-Adam dont la chair est un poison violent pour lui ! » L’ancien pêcheur s’écria : « Ya Allah ! mais à quoi ça me servira-t-il d’être un poison pour le dandane une fois que je serai avalé par le dandane ? » Le Maritime répondit : « Sois absolument sans crainte de ce dandane, car rien qu’en voyant Ibn-Adam il prend la fuite, tant il le redoute ! Et puis comme tu es enduit de sa graisse, il te reconnaîtra à l’odeur, et ne te fera point de mal ! » Et le Terrien, gagné par l’assurance de son ami, dit : « Je mets ma confiance en Allah et en toi ! » Et il se dévêtit et creusa dans le sable un trou où il enfouit ses habits, afin que personne ne les lui volât pendant son absence. Après quoi il s’enduisit de l’onguent en question depuis la tête jusqu’aux pieds, sans oublier les plus petites ouvertures, et, cela fait, il dit au Maritime : « Me voici prêt, ô Maritime mon frère ! »
Alors Abdallah de la Mer prit son compagnon par le bras et plongea avec lui dans les profondeurs marines…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TREIZIÉME NUIT
Elle dit :
… Alors Abdallah de la Mer prit son compagnon par le bras et plongea avec lui dans les profondeurs marines. Et il lui dit : « Ouvre les yeux ! » Et comme il ne se sentait point étouffé ni écrasé par le poids énorme de la mer, et comme il respirait là-dedans mieux que sous le ciel, il comprit qu’il était réellement impénétrable à l’eau ; et il ouvrit les yeux. Et dès cet instant il devint l’hôte de la mer.
Et il vit la mer au-dessus de sa tête se déployer comme un pavillon d’émeraude, tel sur la terre l’admirable azur reposant sur les eaux ; et à ses pieds s’étendaient les régions sous-marines que nul œil terrien n’avait violées depuis la création ; et une sérénité régnait sur les montagnes et les plaines du fond ; et la lumière était délicate qui se baignait autour des êtres et des choses, dans les transparences infinies et la splendeur des eaux ; et des paysages tranquilles l’enchantaient au delà de tous les enchantements du ciel natal ; et il voyait des forêts de corail rouge, et des forêts de corail blanc, et des forêts de corail rose qui s’immobilisaient dans le silence de leurs ramures ; et des grottes de diamant dont les colonnes étaient de rubis, de chrysolithes, de béryls, de saphirs d’or et de topazes ; et une végétation de folie qui se dodelinait sur des espaces grands comme des royaumes ; et, au milieu des sables d’argent, les coquillages aux formes et aux couleurs par milliers qui se miraient éclatants dans le cristal des eaux ; et, tout autour de lui, en éclairs, des poissons qui ressemblaient à des fleurs, et des poissons qui ressemblaient à des fruits, et des poisons qui ressemblaient à des oiseaux, et d’autres, habillés d’écailles d’or rouge et d’argent, qui ressemblaient à de gros lézards, et d’autres qui figuraient plutôt des buffles, des vaches, des chiens et même des Adamites ; et des bancs immenses de royales pierreries qui lançaient mille feux multicolores que l’eau avivait, loin de les éteindre ; et des bancs où s’ouvraient les huîtres pleines de perles blanches, de perles roses et de perles dorées ; et d’énormes éponges gonflées et mobiles lourdement sur leur base qui s’alignaient en d’immenses rangées symétriques, comme des corps d’armées, et semblaient délimiter les différentes régions marines et se constituer les gardiennes fixes des vastitudes solitaires.
Mais soudain Abdallah le Terrien, qui, toujours au bras de son ami, voyait défiler devant lui, en une course rapide sur les abîmes, tous ces spectacles splendides, aperçut une innombrable suite de cavernes d’émeraude, taillées à même les flancs d’une montagne de la même gemme verte, et aux portes desquelles étaient assises ou étendues des adolescentes belles comme des lunes, aux cheveux couleur de l’ambre et du corail. Et elles ressemblaient aux adolescentes de la terre, n’eût été leur queue qui leur tenait lieu de croupe, de cuisses et de jambes. Or c’étaient les Filles de la Mer ! Et cette ville de cavernes vertes était leur domaine.
À cette vue, le Terrien demanda au Maritime : « Ô mon frère, ces adolescentes ne sont-elles donc pas mariées, que je ne vois pas de mâles parmi elles ? » Il répondit : « Celles que tu vois sont des jeunes filles vierges, et elles attendent à l’entrée de leurs demeures l’arrivée de l’époux qui viendra choisir parmi elles celle qui lui plaît. Car, en d’autres endroits de la mer, se trouvent des villes peuplées de mâles et de femelles, et d’où sortent les adolescents en quête de jeunes épouses ; car c’est ici seulement qu’ont droit de séjourner les jeunes filles, qui, de tous les points de notre empire, s’y rendent et vivent entre elles dans l’attente de l’époux ! » Et, comme il finissait cette explication, ils arrivèrent à une ville peuplée de mâles et de femelles ; et Abdallah le Terrien dit : « Ô mon frère, je vois là une ville peuplée, mais je n’y remarque point de boutiques où l’on vende et l’on achète ! Et puis je dois te dire que je suis bien étonné de voir que pas un des habitants n’est couvert d’habits qui le protègent quant aux parties qui doivent être tenues cachées ! » Il répondit : « Pour ce qui est de la vente et de l’achat, nous n’en avons aucun besoin, vu que la vie nous est facile et que notre nourriture consiste en poissons pêchés à portée de notre main. Mais pour ce qui est de cacher certaines parties de notre corps, d’abord nous n’en voyons pas la nécessité, et nous sommes constitués autrement que vous autres quant à ces parties-là ; et puis, nous voudrions les cacher, que nous ne le pourrions pas, vu que nous n’avons point d’étoffes pour les couvrir ! » Il dit : « C’est juste ! Mais comment se font chez vous autres les mariages ? » Il dit : « Chez nous il ne se fait point de mariages, car nous n’avons point de lois qui fixent et régissent nos désirs et nos inclinations ; mais quand une adolescente nous plaît, nous la prenons ; et quand elle cesse de nous plaire, nous la laissons, et elle plaira à un autre ! D’ailleurs, nous ne sommes pas tous musulmans ; parmi nous il y a aussi beaucoup de chrétiens et de juifs ; et ces gens-là n’admettent pas le mariage fixe, car ils aiment beaucoup les femmes, et le mariage fixe les contrarie. Nous seuls, les musulmans, qui vivons à part dans une ville où ne pénètrent point les infidèles, nous nous marions d’après les préceptes du Livre, et nous célébrons des noces qui sont vues d’un bon œil par le Très-Haut et le Prophète (sur Lui la prière et la paix !) Mais, ô mon frère, je veux me hâter de te faire enfin arriver à notre ville ; car si je passais mille années à te montrer les spectacles de notre empire et les villes qui le peuplent, je n’aurais pas encore fini ma lâche, et tu n’aurais pas pu juger d’une mesure sur vingt-quatre mesures ! » Et le Terrien dit : « Oui, mon frère, d’autant plus que j’ai bien faim, et que je ne puis manger comme toi des poissons crus ! » Et le Maritime demanda : « Et comment alors mangez-vous les poissons, vous autres Terriens ? » Il répondit : « Nous les faisons griller ou frire dans l’huile d’olives ou l’huile de sésame ! » Le Maritime se mit à rire et dit : « Et comment ferions-nous, nous qui habitons dans l’eau, pour avoir de l’huile d’olives ou de sésame, et faire frire des poissons sur un feu qui ne s’éteigne pas ? » Le Terrien dit : « Tu as raison, mon frère ! Je te prie donc de me conduire à ta ville que je ne connais pas ! »
Alors le Maritime…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors Abdallah le Maritime lui fit parcourir rapidement diverses régions où les spectacles se succédaient devant ses yeux, et le fit aboutir à une ville, plus petite que les autres, dont les maisons étaient également des cavernes, les unes grandes et les autres petites, suivant le nombre de leurs habitants. Et le Maritime le conduisit devant une de ces cavernes, et lui dit : « Entre, ô mon frère ! C’est ma maison ! » Et il le fit entrer dans la caverne, et cria : « Hé ! ma fille, viens vite par ici ! » Et aussitôt, sortant de derrière une touffe de corail rose, s’approcha une adolescente qui avait de longs cheveux flottants, de beaux seins, un ventre admirable, une taille gracieuse et de beaux yeux verts aux longs cils noirs, mais qui, comme tous les autres habitants de la mer, se terminait en une queue qui lui tenait lieu de croupe et de jambes. Et, voyant le Terrien, elle s’arrêta interdite, et le regarda avec une immense curiosité, puis finit par éclater de rire, et s’écria : « Ô mon père, qu’est-ce donc que ce Sans-Queue que tu nous amènes ? » Il répondit : « Ma fille, c’est mon ami le Terrien qui me donnait tous les jours le panier de fruits que j’apportais, et dont tu mangeais avec délices ! Approche-toi donc poliment et souhaite-lui la paix et la bienvenue ! » Et elle s’avança et lui souhaita la paix avec beaucoup de gentillesse et un langage choisi ; et comme Abdallah, extrêmement charmé, allait lui répondre, l’épouse du Maritime entra à son tour, tenant contre son sein ses deux derniers enfants, chacun sur un bras ; et les enfants avaient chacun un gros poisson qu’ils croquaient à pleines dents, comme les enfants terriens croquent un concombre.
Or, en voyant Abdallah qui se tenait aux côtés du Maritime, l’épouse de celui-ci s’arrêta sur le seuil, immobile de surprise, après avoir déposé ses deux enfants, et soudain s’écria, en riant de toutes ses forces : « Par Allah ! c’est un Sans-Queue ! Comment peut-on être sans queue ? » Et elle s’avança plus près du Terrien ; et ses deux enfants et sa fille s’en approchèrent également ; et tous, amusés à l’extrême, se mirent à l’examiner de la tête aux pieds, et à s’émerveiller surtout de son derrière, vu que de toute leur vie ils n’avaient vu de derrière ou autre chose qui ressemblât à un derrière. Et les enfants et la jeune fille, qui avaient d’abord été un peu effrayés par cette protubérance, s’enhardirent jusqu’à la toucher avec les doigts à plusieurs reprises, tant elle les intriguait et les amusait. Et ils riaient entre eux de cela, et disaient : « C’est un Sans-Queue ! » et ils dansaient de joie ! Aussi Abdallah de la Terre finit-il par se formaliser de leurs façons et de leur sans-gêne, et dit à Abdallah de la Mer : « Ô mon frère, m’aurais-tu conduit jusqu’ici pour faire de moi la risée de tes enfants et de ton épouse ? » Il répondit : « Je te demande bien pardon, ô mon frère, et je te prie de m’excuser, et de ne point prêter attention aux manières de ces deux femmes et de ces deux enfants, car leur intelligence est défectueuse ! » Puis il se tourna vers ses enfants et leur cria : « Taisez-vous ! » Et ils eurent peur de lui, et se turent. Alors le Maritime dit à son hôte : « Ne t’étonne pourtant pas trop de ce que tu vois, ô mon frère, car chez nous celui qui n’a pas de queue ne compte pas ! »
Or, comme il achevait ces paroles, arrivèrent dix individus grands, gros et vigoureux, qui dirent au maître de la maison : « Ô Abdallah, le roi de la Mer vient d’apprendre que tu as reçu chez toi un Sans-Queue d’entre les Sans-Queue de la Terre. Est-ce vrai ? » Il répondit : « C’est vrai. Et c’est celui-ci même que vous voyez devant vous. Il est mon ami et mon hôte, et je vais à l’instant le reconduire sur le rivage où je l’ai pris ! » Ils dirent : « Garde-toi de le faire ! Car le roi nous a envoyés le chercher, vu qu’il désire le voir et examiner comment il est fait ! Et il paraît qu’il a quelque chose d’extraordinaire à l’arrière, et quelque chose de plus extraordinaire encore à l’avant ! Et le roi voudrait voir les deux choses et savoir comment on les appelle ! »
À ces paroles, Abdallah de la Mer se tourna vers son hôte et lui dit : « Ô mon frère excuse-moi, car mon excuse est bien manifeste. Nous ne pouvons désobéir aux ordres de notre roi ! » Le Terrien dit : « J’ai bien peur de ce roi, qui peut-être va se formaliser de ce que j’ai des choses qu’il n’a pas et vouloir ma perte à cause de cela ! » Le Maritime dit : « Je serai là pour te protéger et faire en sorte qu’aucun mal ne t’arrive ! » Il dit : « Alors je m’en rapporte à ta décision, et je mets ma confiance en Allah et te suis ! » Et le Maritime emmena son hôte et le conduisit devant le roi.
Lorsque le roi vit le Terrien, il se mit à rire tellement qu’il fit un plongeon ; puis il dit : « Sois le bienvenu parmi nous, ô Sans-Queue ! » Et tous les hauts dignitaires qui entouraient le roi riaient beaucoup et se montraient du doigt les uns aux autres le derrière du Terrien, en disant : « Oui, par Allah ! c’est un Sans-Queue ! » Et le roi lui demanda : « Comment se fait-il que tu n’aies point de queue ? — « Je ne sais pas, ô roi ! Mais nous tous, les habitants de la terre, nous sommes comme ça ! » Le roi demanda : « Et comment appelez-vous cette chose qui vous tient lieu de queue, en arrière ? » Il répondit : « Les uns l’appellent un cul et les autres un derrière, tandis que d’autres le nomment au pluriel et disent des fesses, à cause qu’il a deux parties. » Et le roi lui demanda : « Et à quoi ça vous sert-il, ce derrière ? » Il répondit : « À s’asseoir, quand on est fatigué, c’est tout ! Mais chez les femmes, il devient un ornement très apprécié ! » Le roi demanda : « Et ce qui est par devant, comment ça s’appelle-t-il ? » Il dit : « Le zebb ! » Il demanda : « Et à quoi ça vous sert-il, ce zebb ? » Il répondit : « À beaucoup d’usages de toutes les espèces, et que je ne puis expliquer, par égard pour le roi. Mais ces usages sont tellement nécessaires, que dans notre monde rien n’est aussi estimé chez l’homme qu’un zebb de valeur, comme chez la femme rien n’est aussi apprécié qu’un derrière d’importance ! » Et le roi et son entourage se mirent à rire extrêmement de ces paroles, et Abdallah le Terrien, ne sachant plus que dire, leva les bras au ciel, et s’écria : « Louanges à Allah qui a créé le derrière pour être une gloire dans un monde et un objet de risée dans un autre…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUINZIÉME NUIT
Elle dit :
« … Louanges à Allah qui a créé le derrière pour être une gloire dans un monde et un objet de risée dans un autre ! » Et, bien gêné de se voir ainsi servir à satisfaire la curiosité des habitants de la mer, il ne savait plus que faire de sa personne, de son derrière et du reste ; et il pensait en son âme : « Par Allah ! je voudrais bien être loin d’ici, ou avoir de quoi couvrir ma nudité ! » Mais le roi finit par lui dire : « Ô Sans-Queue, tu me réjouis tellement avec ton derrière, que je veux t’accorder la satisfaction de tous tes désirs. Demande-moi donc tout ce que tu veux ! » Il répondit : « Je voudrais deux choses, ô roi ! Retourner sur la terre, et rapporter avec moi beaucoup de joyaux de la mer ! » Et Abdallah le Maritime dit : « D’autant plus, ô roi, que mon ami n’a rien mangé depuis qu’il est ici, et qu’il n’aime pas la chair des poissons crus ! » Alors le roi dit : « Qu’on lui donne autant de joyaux qu’il en désire, et qu’on le ramène là d’où il est venu ! »
Aussitôt tous les Maritimes s’empressèrent d’apporter de grandes coquilles vides, et, les ayant remplies de pierreries de toutes les couleurs, demandèrent à Abdallah le Terrien : « Où faut-il te les porter ? » Il répondit : « Vous n’aurez qu’à me suivre et suivre mon ami Abdallah, votre frère, qui va me porter le panier rempli de ces pierreries, selon sa coutume ! » Puis il prit congé du roi et, accompagné de son ami, et suivi par tous les Maritimes porteurs des coquilles pleines de pierreries, il franchit l’empire marin, et remonta sous le ciel.
Là, il s’assit sur le rivage pour se reposer un bon moment et respirer l’air natal. Après quoi il déterra ses habits et s’en vêtit ; et il prit congé de son ami Abdallah le Maritime et lui dit : « Laisse-moi sur le rivage toutes ces coquilles et ce panier, afin que j’aille chercher des portefaix pour qu’ils me les transportent ! » Et il alla chercher les portefaix qui transportèrent au palais tous ces trésors ; puis il entra chez le roi.
Lorsque le roi vit son gendre, il le reçut avec de grandes démonstrations de joie, et lui dit : « Nous avons été tous bien inquiets de ton absence ! » Et Abdallah lui raconta son aventure maritime depuis le commencement jusqu’à la fin ; mais il n’y a point d’utilité à la recommencer. Et il lui mit entre les mains le panier et les coquilles pleines de pierreries. Et le roi, bien qu’émerveillé du récit de son gendre et des richesses qu’il apportait de la mer, fut très formalisé et offusqué de la façon peu convenable dont les Maritimes s’étaient comportés à l’égard du derrière de son gendre et de tous les derrières en général, et lui dit : « Ô Abdallah, je ne veux plus désormais que tu ailles retrouver cet Abdallah de la Mer sur le rivage, car si, cette fois, tu n’as pas éprouvé un grand dommage de l’avoir suivi, tu ne peux savoir ce qui peut t’arriver dans l’avenir, car ce n’est point chaque fois qu’on la jette, que reste intacte la gargoulette ! Et puis tu es mon gendre et mon vizir, et il ne me convient point de te voir t’en aller chaque matin à la mer avec un panier à poisson sur la tête, pour être ensuite un objet de risée aux yeux de toutes ces personnes plus ou moins à queue et plus ou moins inconvenantes. Reste donc au palais, et de la sorte tu auras la paix, et nous aurons la tranquillité à ton sujet ! »
Alors Abdallah de la Terre, ne voulant point contrarier le roi Abdallah, son beau-père, resta désormais au palais avec son ami Abdallah le Boulanger, et n’alla plus retrouver sur le rivage Abdallah de la Mer, dont d’ailleurs on n’entendit plus parler, vu qu’il avait dû se fâcher !
Et ils vécurent tous dans la condition la plus heureuse et la pratique des vertus, au milieu des délices, jusqu’à ce que vînt les visiter la Destructrice des joies et la Séparatrice des amis. Et tous moururent ! Mais gloire au Vivant qui seul ne meurt pas, qui gouverne l’empire du Visible et de l’invisible, qui sur toutes choses est Omnipotent, et qui est bienveillant pour ses serviteurs dont il connaît les intentions et les besoins !
— Et Schahrazade, ayant prononcé ces dernières paroles, se tut. Alors le roi Schahriar s’écria : « Ô Schahrazade, cette histoire est vraiment extraordinaire ! » Et Schahrazade dit : « Oui, ô Roi ; mais, sans aucun doute, et bien qu’elle ait eu la chance de te plaire, elle n’est pas plus admirable que celle que je veux te raconter encore, et qui est l’Histoire du jeune homme jaune. » Et le roi Schahriar dit : « Certes ! tu peux parler ! » Alors Schahrazade dit :
HISTOIRE DU JEUNE HOMME JAUNE
Il est raconté, entre divers contes, ô Roi fortuné, que le khalifat Haroun Al-Rachid sortit une nuit de son palais avec son vizir Giafar, son vizir Al-Fazl, son favori Abou-Ishak, le poète Abou-Nowas, le porte-glaive Massrour et le capitaine de police Ahmad-la-Teigne. Et tous, déguisés en marchands, se dirigèrent vers le Tigre et descendirent dans une barque qu’ils laissèrent aller à l’aventure avec le courant de l’eau. Car Giafar, ayant vu le khalifat pris d’insomnie et l’esprit soucieux, lui avait dit que rien n’était plus efficace pour dissiper l’ennui que de voir ce que l’on n’a pas encore vu, d’entendre ce que l’on n’a pas encore entendu et de visiter un pays que l’on n’a pas encore parcouru.
Or, au bout d’un certain temps, comme la barque se trouvait sous les fenêtres d’une maison qui dominait le fleuve, ils entendirent à l’intérieur de la maison une voix belle et triste qui chantait ces vers en s’accompagnant sur le luth :
« Comme la coupe de vin était là et que dans le fourré du voisinage chantait l’oiseau hazar, je dis à mon cœur :
« Jusqu’à quand repousseras-tu le bonheur ? Réveille-toi, la vie est un prêt à courte échéance !
La coupe et l’échanson, les voici ! C’est un bel et jeune échanson que ton ami ! Regarde-le, et prends de ses mains la coupe qu’il te tend !
Ses paupières sont languissantes et leur regard t’invite ! Ne méprise point ces choses !
J’ai planté de jeunes roses sur ses joues, et quand j’ai voulu à leur maturité les cueillir, j’ai trouvé des grenades !
Ô mon cœur, ne méprise pas ces choses ! C’est le moment où ses joues sont duvetées ! »
En entendant ces couplets, le khalifat dit : « Ô Giafar, qu’elle est belle cette voix ! » Et Giafar répondit : « Ô notre seigneur, certes, jamais voix plus belle ou plus délicieuse n’a encore frappé mon ouïe ! Mais, ô mon maître, entendre une voix de derrière un mur, ce n’est l’entendre qu’à demi ! Que serait-ce si nous l’entendions derrière un rideau…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
« … ô mon maître, entendre une voix de derrière un mur ce n’est l’entendre qu’à demi ! Que serait-ce si nous l’entendions derrière un rideau ? » Alors le khalifat dit : « Pénétrons, ô Giafar, dans cette maison pour demander l’hospitalité au maître du lieu, dans l’espoir de mieux entendre cette voix ! » Et ils arrêtèrent la barque et atterrirent. Puis ils frappèrent à la porte de cette maison et demandèrent à l’eunuque qui vint ouvrir la permission d’entrer. Et l’eunuque alla prévenir son maître, qui ne tarda pas à venir au-devant d’eux et leur dit : « Famille, aisance et abondance aux hôtes ! Soyez les bienvenus dans cette maison dont vous êtes les propriétaires !» Et il les introduisit dans une vaste salle fraîche, au plafond agréablement colorié de dessins sur un fond d’or et d’azur foncé, et au milieu de laquelle, dans un bassin d’albâtre, s’élançait un jet d’eau d’où résultait un son merveilleux. Et il leur dit : « Ô mes maîtres, je ne sais de vous autres quel est le plus honorable ou le plus haut de rang et de condition. Bismillah sur vous tous ! daignez donc vous asseoir aux places que vous trouverez convenables ! » Puis il se tourna vers le fond de la salle où, sur cent chaises d’or et de velours, se trouvaient assises cent adolescentes, et fit un signe. Et aussitôt les cent adolescentes se levèrent et sortirent l’une après l’autre en silence. Et il fit un second signe, et des esclaves, ayant leurs robes relevées à la ceinture, apportèrent de grands plateaux remplis de mets de toutes les couleurs et confectionnés avec tout ce qui vole dans les airs, marche sur le sol ou nage dans les mers ; et des pâtisseries, et des confitures et des tartes sur lesquelles étaient écrits, avec des pistaches et des amandes, des vers à la louange des hôtes.
Et lorsqu’ils eurent mangé et bu, et qu’ils se furent lavé les mains, le maître du lieu leur demanda : « Ô mes hôtes, si maintenant vous m’avez honoré de votre présence pour me faire le plaisir de me demander quelque chose, parlez en toute confiance. Car vos désirs seront exécutés sur ma tête et mes yeux ! » Giafar répondit : « Certes, ô notre hôte, nous sommes entrés dans ta maison pour mieux entendre la voix admirable que nous entendions à demi et voilée, sur l’eau ! »
À ces paroles, le maître de la maison répondit : « Vous êtes les bienvenus ! » Et il frappa dans la paume de ses mains et dit aux esclaves accourus : « Dites à votre maîtresse Sett Jamila de nous chanter quelque chose ! » Et quelques instants après, derrière le grand rideau du fond, une voix à nulle autre pareille chanta avec l’accompagnement léger des luths et des cithares :
« Prends la coupe et bois de ce vin que j’offre à tes lèvres : il ne s’est jamais mélangé au cœur de l’homme !
Mais le temps fuit loin d’une amante qui se flatte en vain de revoir l’objet de son amour.
Combien de nuits j’ai passées, les regards fixés sur les ondes brunies du Tigre, sous la lune obscurcie par l’orage.
Combien de fois à l’occident j’ai vu la lune, au soir, disparaître dans les eaux pourpres sous la forme d’un glaive d’argent ! »
Lorsqu’elle eut fini de chanter, la voix se tut, et les instruments à cordes seuls continuèrent en sourdine à accompagner les vestiges sonores et aériens. Et le khalifat, émerveillé et ravi, se tourna vers Abou-Ishak et dit : « Par Allah ! jamais je n’ai rien entendu de semblable ! » Et il dit au maître du logis : « La maîtresse de cette voix est certainement amoureuse et séparée de son amoureux ! » Il répondit : « Non pas ! sa tristesse a d’autres origines que celle-là ! Ainsi, par exemple, elle pourrait bien être séparée de son père et de sa mère, et chanter de la sorte en se souvenant d’eux ! » Al-Rachid dit : « Il est bien étonnant que la séparation d’avec les parents suscite de pareils accents ! » Et, pour la première fois, il regarda attentivement son hôte, comme pour lire sur son visage une explication plus admissible. Et il vit que c’était un jeune homme dont les traits étaient d’une grande beauté, mais dont le visage était de couleur jaune comme le safran. Et il fut bien étonné de cette découverte, et lui dit : « Ô notre hôte, nous avons encore un souhait à formuler avant de prendre congé de toi et de nous en aller là d’où nous sommes venus ! » Et le jeune homme jaune répondit : « Ton souhait est d’avance satisfait. » Il demanda : « Je désire, et ceux qui sont avec moi le désirent également, apprendre de toi si cette couleur jaune safran de ton visage est une chose acquise dans le cours de ta vie ou bien si c’est une chose originelle que tu as eue en naissant ! »
Alors le jeune homme jaune dit : « Ô vous tous, mes hôtes, la cause de la couleur jaune safran de mon teint est une histoire si extraordinaire que si elle était écrite avec les aiguilles sur le coin intérieur de l’œil, elle servirait de leçon à qui la lirait avec respect. Confiez-moi donc votre ouïe et accordez-moi toute l’attention de votre esprit ! » Et tous répondirent : « Notre ouïe et notre esprit t’appartiennent ! Et nous voici impatients de t’écouter…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Notre ouïe et notre esprit t’appartiennent. Et nous voici impatients de t’écouter ! » Alors le jeune homme au teint jaune dit :
« Sachez, ô mes maîtres, que mon origine est du pays d’Oman, où mon père était le plus grand marchand d’entre les marchands de la mer, et possédait en propriété absolue trente navires dont le rendement annuel était de trente mille dinars. Et mon père, qui était un homme éclairé, me fit apprendre l’écriture et aussi tout ce qu’il est nécessaire de savoir. Après quoi, comme son heure dernière approchait, il m’appela et me fit ses recommandations que j’écoutai respectueusement. Puis Allah le prit et l’admit dans Sa miséricorde. Puisse-t-il, ô mes hôtes, prolonger votre vie !
« Or moi, quoique temps après la mort de mon père, dont je possédais maintenant toutes les richesses, j’étais assis dans ma maison au milieu de mes invités, quand un de mes esclaves m’annonça qu’il y avait un de mes capitaines marins qui était à la porte et m’apportait une corbeille de primeurs. Et je le fis entrer, et j’acceptai son cadeau qui consistait, en effet, en fruits inconnus à notre terre, et vraiment tout à fait admirables. Et je lui remis, en retour, cent dinars d’or pour lui marquer mon plaisir. Puis je distribuai ces fruits à mes invités, et je demandai au capitaine marin : « D’où viennent ces fruits, ô capitaine ? » Il me répondit : « De Bassra et de Baghdad ! » Et, à ces paroles, tous mes invités se mirent à s’exclamer sur la terre merveilleuse de Bassra et de Baghdad, à me vanter la vie qu’on y menait, la bonté de son climat et l’urbanité de ses habitants ; et ils ne tarissaient point d’éloges à ce sujet, les uns renchérissant sur les paroles des autres. Et moi je fus tellement exalté de tout cela que, sans en demander davantage, je me levai à l’heure même et à l’instant et, ne résistant point à mon âme qui désirait ardemment le voyage, je vendis aux enchères mes biens et mes propriétés, mes marchandises et mes navires à l’exception d’un seul que je gardai pour mon usage personnel, mes esclaves hommes et mes esclaves femmes, et je fis argent de tout, réalisant de la sorte une somme d’un millier de mille dinars, sans compter les joyaux, les pierreries et les lingots d’or que j’avais dans mes coffres. Après quoi, je m’embarquai, avec ces richesses ainsi réalisées dans leur poids le plus léger, sur le navire que j’avais gardé, et je fis mettre à la voile pour Baghdad.
« Or Allah m’écrivit une heureuse traversée et j’arrivai sain et sauf, avec mes richesses, à Bassra, d’où, ayant pris place sur un autre navire, je remontai le Tigre jusqu’à Baghdad. Là je m’informai de l’endroit le plus convenable à habiter, et l’on m’indiqua le quartier Karkh comme étant le quartier le mieux fréquenté et la résidence habituelle des personnages importants. Et j’allai à ce quartier et je louai une belle maison dans la rue Zaafarân, où je fis transporter mes richesses et mes effets. Après quoi je fis mes ablutions et, l’âme réjouie et la poitrine dilatée de me trouver enfin dans l’illustre Baghdad, but de mes désirs et envie de toutes les villes, je m’habillai de mes plus beaux vêtements et sortis me promener à l’aventure à travers les rues les plus fréquentées.
« Or, ce jour-là était précisément le vendredi, et tous les habitants étaient en tenue de fête et se promenaient comme moi, en respirant l’air frais du dehors. Et moi je suivais la foule et me portais là où elle se portait. Et j’arrivai de la sorte à Karn-al-Sirat, le but habituel des promeneurs de Baghdad. Et je vis, à cet endroit, entre divers édifices fort beaux, une bâtisse plus belle que les autres et dont la façade donnait sur le fleuve. Et sur le seuil de marbre je vis un vieillard assis et vêtu de blanc qui était bien vénérable d’aspect, avec une barbe blanche qui lui descendait jusqu’à la ceinture en se divisant en deux touffes égales de filigrane d’argent. Et il était entouré de cinq adolescents beaux comme des lunes, et parfumés comme lui d’essences choisies.
« Alors moi, gagné par la belle physionomie du vieillard blanc et par la beauté des adolescents, je demandai à un passant : « Qui est ce vénérable cheikh ? Et quel est son nom ? » Il me fut répondu : « C’est le cheikh Taher Aboul-Ola, l’ami des jeunes gens ! Et tous ceux qui entrent chez lui n’ont qu’à manger, boire et s’amuser au choix avec les adolescents ou les jeunes filles qui logent en permanence dans sa maison…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et tous ceux qui entrent chez lui n’ont qu’à manger, boire et s’amuser avec les adolescents ou les jeunes filles qui logent en permanence dans sa maison ! » Et moi, à ces paroles, ravi à la limite du ravissement, je m’écriai : « Gloire à Celui qui, dès ma descente du navire, m’a mis sur la route de ce cheikh au visage de bon augure ! car je ne suis venu du fond de mon pays à Baghdad, que dans le but de trouver un homme tel que celui-ci ! » Et je m’avançai vers le vieillard et, après lui avoir souhaité la paix, je lui dis : « Ô mon maître, j’ai besoin de te demander quelque chose ! » Et il me sourit comme un père sourit à son fils, et me répondit : « Et que souhaites-tu ? » Je dis : « Je souhaite vivement d’être ton hôte cette nuit ! » Il me regarda encore et me répondit : « Avec amitié cordiale et générosité ! » Puis il ajouta : « Cette nuit, ô mon fils, j’ai un nouvel arrivage de jeunes filles dont le prix, par soirée, varie suivant leurs mérites. Les unes sont cotées dix dinars par soirée, les autres vingt et d’autres atteignent jusqu’à cinquante et cent dinars par soirée. C’est à ton choix ! » Je répondis : « Par Allah ! je veux commencer l’essai d’abord avec une de celles qui n’atteignent que dix dinars par soirée. Ensuite Allah Karim ! » Puis j’ajoutai : « Voici trois cents dinars pour un mois, car un bon essai exige un mois ! » Et je lui comptai les trois cents dinars et les lui pesai dans la balance qu’il avait près de lui. Alors il appela un des adolescents qui étaient là et lui dit : « Emmène ton maître ! » Et l’adolescent me prit par la main et me conduisit d’abord au hammam de la maison, où il me donna un bain excellent et me prodigua les soins les plus attentifs et les plus minutieux. Après quoi il me conduisit à un pavillon et frappa à l’une de ses portes.
« Et aussitôt vint ouvrir une adolescente, au visage riant et plein de bon augure, qui me fit un beau geste d’accueil. Et le jeune garçon lui dit : « Je te confie ton hôte ! » Et il se retira. Alors elle me prit la main que le jeune garçon venait de lui remettre, et m’introduisit dans une chambre miraculeuse d’ornementations, sur le seuil de laquelle nous reçurent deux petites esclaves attachées à son service et jolies comme deux étoiles. Et moi je regardai plus attentivement l’adolescente, leur maîtresse, et je m’assurai de la sorte qu’elle était vraiment telle la lune dans son plein. Lors elle me fit m’asseoir et s’assit à mon côté ; puis elle fit un signe aux deux petites, qui aussitôt nous apportèrent un grand plateau d’or sur lequel étaient assis des poulets rôtis, des viandes rôties, des cailles rôties, des pigeons rôtis et des coqs sauvages rôtis. Et nous mangeâmes jusqu’à satiété. Et de ma vie je n’avais goûté à des mets plus délicieux que ceux-là, ni bu des boissons plus savoureuses que celles qu’elle me servit, une fois enlevé le plateau des mets, ni respiré des fleurs plus suaves, ni ne m’étais dulcifié de fruits, de confitures et de pâtisseries aussi extraordinaires ! Et elle fit preuve ensuite de tant de gentillesse, de charme et de voluptueuses caresses que je passai avec elle le mois entier sans me douter de la fuite des jours.
« Au bout du mois, le petit esclave vint me chercher et me ramena au hammam, d’où je sortis pour aller trouver le cheikh blanc et lui dire : « Ô mon maître, je désire une de celles qui sont à vingt dinars par soirée ! » Il me répondit : « Pèse l’or ! » Et j’allai chercher de l’or à ma maison, et revins lui peser six cents dinars pour un mois d’essai avec une adolescente de vingt dinars par soirée. Et il appela un des adolescents et lui dit : « Emmène ton maître ! » Et l’adolescent me conduisit au hammam où il me soigna mieux encore que la première fois, et me fit ensuite pénétrer dans un pavillon dont la porte était gardée par quatre petites esclaves qui, aussitôt qu’elles nous eurent aperçus, coururent prévenir leur maîtresse. Et la porte s’ouvrit et je vis apparaître une jeune chrétienne du pays des Francs, belle bien plus que la première, et plus richement habillée. Et elle me prit par la main, en me souriant, et m’introduisit dans sa chambre qui m’étonna par la richesse de sa décoration et de ses tentures. Et elle me dit : « Bienvenu soit l’hôte charmant…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Bienvenu soit l’hôte charmant ! » Et après m’avoir servi des mets et des boissons encore plus extraordinaires que la première fois, comme elle avait une très belle voix et savait s’accompagner sur les instruments d’harmonie, elle voulut me griser plus encore que je ne l’étais et, ayant pris un luth persan, elle chanta :
« Ô suaves parfums des terres où s’élève Babylone, allez avec la brise porter un message à ma bien-aimée.
Au loin, en des lieux enchantés, habite celle qui porte le trouble dans l’âme des amants, et les enflamme sans leur accorder le don qui apaise les désirs ! »
« Or moi, ô mes maîtres, je passai le mois entier avec cette fille des Francs, et je dois vous avouer que je la trouvai infiniment plus experte en mouvements que ma première amante. Et vraiment je constatai que je n’avais pas payé un prix exagéré les délices qu’elle me fit éprouver depuis le premier jour jusqu’au trentième.
« Aussi lorsque l’adolescent revint me prendre et me conduire au hammam, je ne manquai point d’aller trouver le cheikh blanc et de lui faire mes compliments sur le choix plein de justesse qu’il faisait de ses adolescentes, et je lui dis : « Par Allah ! ô cheikh je veux habiter toujours dans ta généreuse maison, où l’on trouve la joie des yeux, les délices des sens et le charme d’une société choisie ! » Et le cheikh fut très satisfait de mes louanges, et, pour m’en marquer son contentement, me dit : « Cette nuit, ô mon hôte, est pour nous une nuit de fête extraordinaire ; et seuls ont droit de prendre part à cette fête les clients distingués de ma maison. Et nous l’appelons la Nuit des Visions splendides. Tu n’as donc qu’à monter sur la terrasse, et à juger par tes yeux ! » Et moi je remerciai le vieillard et montai sur la terrasse.
« Or, la première chose que j’aperçus, une fois sur la terrasse, fut un grand rideau de velours qui divisait la terrasse en deux parties. Et, derrière ce rideau, sur un beau tapis, éclairés par la lune, étaient étendus l’un à côté de l’autre deux beaux jeunes gens, une jeune fille et son amoureux, qui s’embrassaient lèvres sur lèvres. Et moi, à la vue de la jeune fille et de sa beauté sans pareille, je fus étourdi et émerveillé, et je restai longtemps là à la regarder sans respirer, ne sachant plus où je me trouvais. Je pus enfin sortir de mon immobilité et, ne pouvant avoir de paix avant de savoir qui elle était, je descendis de la terrasse et courus trouver l’adolescente avec qui je venais de passer un mois d’amour ; et je lui racontai ce que je venais de voir. Et elle vit l’état où j’étais et me dit : « Mais qu’as-tu besoin de te préoccuper de cette jeune fille ? » Je répondis : « Par Allah ! elle m’a arraché la raison et la foi ! » Elle me dit en souriant : « Alors tu désires la posséder ? » Je répondis : « C’est là le vœu de mon âme, car elle règne dans mon cœur ! » Elle me dit : « Eh bien, sache que cette adolescente est la fille même du cheikh Taher Aboul-Ola, notre maître, et nous sommes toutes des esclaves à ses ordres ! Sais-tu combien coûte une nuit passée avec elle ? » Je répondis : « Comment le saurais-je ? » Elle me dit : « Cinq cents dinars d’or ! C’est un fruit digne de la bouche des rois. » Je répondis : « Ouallah ! Je suis prêt à dépenser toute ma fortune pour la posséder, ne serait-ce qu’une soirée ! » Et je passai toute cette nuit-là sans arriver à fermer l’œil, tant mon esprit travaillait à son sujet.
« Aussi le lendemain je me hâtai de me vêtir de mes plus beaux habits, et, accoutré comme un roi, je me présentai devant le cheikh Taher, son père, et je lui dis : « Je désire celle dont la nuit est de cinq cents dinars ! » Il me répondit : « Pèse l’or ! » Et moi aussitôt je lui pesai le prix de trente nuits, en tout quinze mille dinars. Et il les prit et dit à l’un des jeunes garçons : « Conduis ton maître auprès de ta maîtresse Une telle. » Et le jeune garçon m’emmena et me fit entrer dans un appartement dont mon œil n’avait jamais vu le pareil en beauté et en richesse sur le visage de la terre. Et je vis, assise nonchalamment, un éventail à la main, l’adolescente, et du coup je fus stupéfait d’admiration quant à mon esprit, ô mes hôtes honorables…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
« … et du coup, je fus stupéfait d’admiration quant à mon esprit, ô mes hôtes honorables ! Car elle était vraiment comme la lune à son quatorzième jour, et rien qu’à la façon dont elle répondit à mon salam, elle acheva de me ravir la raison par le ton de sa voix plus mélodieuse que les accords du luth ; et toute belle elle était, et de tous les côtés gracieuse et symétrique, en vérité ! Et c’est d’elle sans aucun doute qu’il s’agit dans ces vers du poète :
La belle ! Si elle paraissait au milieu des infidèles, ils délaisseraient pour elle leurs idoles et l’adoreraient comme la seule divinité.
Si toute nue sur la mer elle se montrait, sur la mer aux flots amers et salés, du miel de sa bouche la mer se dulcifierait.
Si à quelque moine chrétien d’Occident elle se montrait en Orient, pour sûr le moine délaisserait l’occident et tournerait ses regards vers l’orient !
Mais moi, l’ayant vue dans l’obscurité qu’illuminaient ses yeux, je m’écriai : « Ô nuit ! Que vois-je ?
Est-ce une apparition légère qui me leurre, ou bien une vierge intacte qui réclame un copulateur ? »
Et je la vis, à ces paroles, serrer avec sa main la fleur de son milieu, et me dire en soupirant de tristes et douloureux soupirs :
« De même que les belles dents ne paraissent bien belles que frottées par la tige aromatique, de même le zebb est aux belles vulves ce que la tige frotteuse est aux jeunes dents !
Ô musulmans, à l’aide ! N’y a-t-il donc plus chez vous autres un maître zebb qui sache se tenir debout ! »
Alors moi je sentis mon zebb craquer sur ses jointures et soulever ma tunique pour prendre un essor triomphant. Et en son langage il dit à la belle : « Le voici ! Le voici ! »
Et je défis ses voiles. Mais elle eut peur et me dit : « Qui es-tu ? » Je répondis : « Un gaillard dont le zebb debout vient répondre à ton appel ! »
Et, sans plus tarder, je l’assaillis, et mon zebb, gros comme un bras, remuait entre ses cuisses gentiment !
Si bien que, comme je finissais de planter le troisième clou, elle me dit : « Plus près, ô gaillard, plus près l’enfoncement ! » Et je répondis : « Plus près, ô ma maîtresse, plus près ! Il arrive ! »
« Or moi, je lui souhaitai la paix, et elle me rendit mon souhait, en me lançant des regards d’une langueur acérée, et me dit : « Amitié, aisance et générosité à l’hôte ! » Et elle me prit la main, ô mes maîtres, et me fit asseoir auprès d’elle ; et des jeunes filles aux beaux seins entrèrent et nous servirent, sur des plateaux, les rafraîchissements de la bienvenue, et des fruits exquis, des conserves de choix et un vin délicieux comme on n’en boit que dans les palais des rois ; et elles nous offrirent des roses et des jasmins, tandis qu’autour de nous les arbustes odoriférants et l’aloès qui brûlait dans les cassolettes d’or exhalaient leurs suaves parfums. Ensuite une des esclaves lui apporta un étui de satin dont elle tira un luth d’ivoire, qu’elle l’accorda, et elle chanta ces vers :
« Ne bois le vin que de la main d’un tendre jouvenceau ; car si le vin procure l’ivresse, le jouvenceau rend meilleur le vin.
Car le vin ne procure point de délices à celui qui le boit, à moins que l’échanson n’ait des joues où brillent de pures roses, candides et fraîches. »
« Or moi, ô mes hôtes, après ces préludes, je m’enhardis, et ma main devint audacieuse, et mes yeux et mes lèvres la dévoraient ; et je lui trouvai des qualités si extraordinaires de savoir et de beauté, que non seulement je passai avec elle le mois déjà payé, mais que je continuai à payer au vieillard blanc, son père, un mois après un autre mois, et ainsi de suite pendant un long espace de temps, jusqu’à ce que, à cause de ces dépenses considérables, il ne me restât plus un seul dinar de toutes les richesses que j’avais apportées avec moi du pays d’Oman, ma patrie. Et alors songeant que j’allais bientôt être forcé de me séparer d’elle, je ne pus empêcher mes larmes de couler en fleuves sur mes joues, et je ne sus plus différencier le jour d’avec la nuit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut
LA CINQ CENT VINGT-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … je ne pus empêcher mes larmes de couler en fleuves sur mes joues, et je ne sus plus différencier le jour d’avec la nuit. Et elle, me voyant ainsi tout en larmes, me dit : « Pourquoi pleures-tu ? » Je dis : « Ô ma maîtresse, parce que je n’ai plus d’argent, et que le poète a dit :
» La pénurie nous rend étrangers dans nos propres demeures, et l’argent nous donne une patrie à l’étranger !
« C’est pourquoi, moi, ô lumière de mes yeux, je pleure dans la crainte de me voir séparé de toi par ton père ! » Elle me dit : « Sache alors que lorsqu’un des clients de la maison s’est ruiné dans la maison, mon père a l’habitude de lui donner l’hospitalité pendant encore trois jours, avec toute la largesse désirable et sans le priver d’aucun des agréments coutumiers ; après quoi il le prie de s’en aller et de ne plus se montrer dans la maison ! Quant à toi, mon chéri, comme dans mon cœur il y a pour toi un grand amour, n’aie aucune crainte à ce sujet, car je vais trouver le moyen de te garder ici aussi longtemps que tu le voudras, inschallah ! J’ai, en effet, toute ma fortune personnelle sous mes propres mains, et mon père en ignore toute l’immensité. Aussi vais-je tous les jours te donner un sac de cinq cents dinars, prix d’une soirée ; et toi tu le remettras à mon père, en lui disant : « Désormais je te paierai les soirées jour par jour ! » Et mon père, te sachant solvable, acceptera cette condition ; et, selon sa coutume, il viendra me remettre cette somme qui m’est due ; et moi de nouveau je te la donnerai afin que tu lui payes une nouvelle soirée ; et il en sera ainsi aussi longtemps qu’Allah le voudra et que tu ne t’ennuieras pas avec moi ! »
« Alors moi, ô mes hôtes, dans ma joie je devins léger comme les oiseaux, et je la remerciai et lui baisai la main ; puis je demeurai avec elle, en ce nouvel état de choses, l’espace d’une année, comme le coq dans le poulailler.
« Or, au bout de ce temps, le sort néfaste voulut que ma bien-aimée, dans un accès de colère, s’emportât contre une de ses esclaves et la frappât douloureusement ; et l’esclave s’écria : « Par Allah ! je te meurtrirai le cœur comme tu m’as meurtrie ! » Et elle courut à l’instant chez le père de mon amie, et lui révéla toute l’affaire depuis le commencement jusqu’à la fin.
« Lorsque le vieux Taher Aboul-Ola entendit le discours de l’esclave, il sauta sur ses pieds et courut me trouver alors que, dans l’ignorance encore de ce qui se passait, j’étais aux côtés de mon amie, en train de me livrer à divers ébats de première qualité ; et il me cria : « Ho ! un Tel ! » Je répondis : « À tes ordres, ô mon oncle ! » Il me dit : « Notre coutume ici, quand un client s’est ruiné, est d’héberger ce client, en ne le privant de rien, pendant trois jours. Mais toi, il y a déjà un an que tu uses par fraude de notre hospitalité, en mangeant, en buvant et en copulant à ton aise ! » Puis il se tourna vers ses esclaves et leur cria : « Chassez d’ici ce fils d’enculé ! » Et ils s’emparèrent de moi et me jetèrent tout nu à la porte, en me mettant dans la main dix petites pièces d’argent et en me donnant un vieux caban rapiécé et tombant en loques, pour couvrir ma nudité. Et le cheikh blanc me dit : « Va-t’en ! je ne veux ni te faire donner la bastonnade ni t’injurier ! Mais hâte-toi de disparaître ; car si tu as le malheur de rester encore dans Baghdad, notre ville, ton sang jaillira au-dessus de ta tête ! »
« Alors moi, ô mes hôtes, je fus bien obligé de sortir en dépit de mon nez, sans savoir où me diriger dans cette ville que je ne connaissais guère, bien que je l’habitasse depuis quinze mois. Et je sentis s’abattre pesamment sur mon cœur toutes les calamités du monde et sur mon esprit le désespoir, les tristesses et les soucis ! Et je dis en mon âme : « Comment, moi qui suis venu ici à travers les mers porteur de mille milliers de dinars d’or avec, en plus, le prix de vente de mes trente navires, ai-je pu dépenser toute cette fortune dans la maison de ce calamiteux vieillard de goudron, pour maintenant en sortir tout nu et le cœur brisé et l’âme humiliée ? Mais il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah le Glorieux, le Très-Haut ! » Et comme, plongé dans ces affligeantes pensées, j’étais arrivé sur les bords du Tigre, je vis un navire qui allait descendre vers Bassra. Et je m’embarquai à bord de ce navire, en offrant mes services comme matelot au capitaine, afin de payer mon passage. Et j’arrivai de la sorte à Bassra.
« Là je me dirigeai sans tarder vers le souk, car la faim me torturait, et je fus remarqué…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Là je me dirigeai, sans tarder, vers le souk, car la faim me torturait, et je fus remarqué par un épicier qui s’approcha vivement de moi et se jeta à mon cou en m’embrassant, et se fit connaître à moi comme un ancien ami de mon père ; puis il m’interrogea sur mon état. Et je lui racontai, sans omettre un détail, tout ce qui m’était arrivé. Et il me dit : « Ouallah ! ce ne sont pas les actes d’un homme sensé ! Mais maintenant, ce qui est passé est passé, que comptes-tu faire ? » Je répondis : « Je ne sais pas ! » Il me dit : « Veux-tu accepter de rester chez moi ? Et, puisque tu sais l’écriture, veux-tu écrire les entrées et sorties de mes fournitures, et toucher par jour comme salaire un drachme d’argent, sans compter ta nourriture et ta boisson ? » Et moi j’acceptai en le remerciant, et demeurai chez lui comme scribe pour les sorties ou entrées des ventes ou achats. Et je vécus de la sorte chez lui assez de temps pour mettre de côté la somme de cent dinars.
« Alors je louai pour mon propre compte un petit local, sur le bord de la mer, afin d’y attendre l’arrivée de quelque navire chargé de marchandises du loin, où m’acheter, avec mon argent, de quoi faire un chargement bon à vendre à Baghdad, où je voulais retourner, dans l’espoir de trouver l’occasion de revoir mon amie.
« Or, la chance voulut qu’un jour un navire vint du loin chargé de ces marchandises que j’attendais ; et moi, mêlé aux autres marchands, je me dirigeai vers le navire et montai à bord. Et voici que, du fond du navire, sortirent deux hommes qui s’assirent sur deux chaises et étalèrent devant nous leurs marchandises. Et quelles marchandises ! Et quel éblouissement des yeux ! Nous ne vîmes là rien que des joyaux, des perles, du corail, des rubis, des agates, des hyacinthes et des pierreries de toutes les couleurs ! Et alors l’un des deux hommes se tourna vers les marchands terriens et leur dit : « Ô compagnie des marchands, tout ceci n’est pas à vendre pour aujourd’hui, car je suis encore fatigué de la mer ; je ne l’ai étalé que pour vous donner une idée de ce que sera la vente de demain ! » Mais les marchands le pressèrent tellement qu’il accepta de commencer la vente immédiatement, et le crieur se mit à crier la vente des pierreries, espèce par espèce. Et les marchands se mirent à augmenter chaque fois le prix, les uns sur les autres, jusqu’à ce que le premier petit sac de pierreries eût atteint le prix de quatre cents dinars. À ce moment, le propriétaire du sac, qui m’avait autrefois connu dans mon pays quand mon père était à la tête du commerce d’Oman, se tourna vers moi et me demanda : « Pourquoi ne dis-tu rien et n’augmentes-tu pas le prix comme les autres marchands ? » Je répondis : « Par Allah, ô mon maître, il ne me reste plus des biens de ce monde que la somme de cent dinars ! » Et je fus bien confus, en disant ces paroles, et des gouttes de larmes tombèrent de mes yeux. Et, à cette vue, le propriétaire du sac frappa ses mains l’une dans l’autre et s’écria, plein de surprise : « Ô Omani, comment d’une si immense fortune ne te reste-t-il plus que cent dinars ? » Et il me regarda ensuite avec commisération et entra dans mes peines ; puis soudain il se tourna vers les marchands et leur dit : « Soyez témoins que je vends à ce jeune homme pour la somme de cent dinars un sac avec tout ce qu’il contient en fait de gemmes, de métaux et d’objets précieux, bien que je sache sa valeur réelle qui monte à plus de mille dinars. C’est donc un cadeau que je lui donne de moi à lui ! » Et les marchands, stupéfaits, témoignèrent qu’ils voyaient et entendaient ; et le marchand me remit le sac avec tout ce qu’il contenait, et même me fit cadeau du tapis, et de la chaise sur laquelle il était assis. Et moi je le remerciai pour sa générosité ; et je descendis à terre et me dirigeai vers le souk des bijoutiers.
« Là je louai une boutique et me mis à vendre et à acheter et à réaliser tous les jours un gain assez appréciable. Or, parmi les objets précieux contenus dans le sac, se trouvait un morceau d’écaille rouge d’un rouge foncé qui, à en juger par les caractères talismaniques gravés sur ses deux faces, sous la forme de pattes de fourmis, devait être quelque amulette fabriquée par un maître fort versé dans l’art des amulettes. Il pesait une demi-livre, mais j’en ignorais l’usage spécial et le prix. Aussi je le fis crier plusieurs fois au souk, mais on n’en offrit au crieur que de dix à quinze drachmes. Et moi, ne voulant pas, tout de même, en prévision d’une excellente occasion, le céder à un prix si modique, je jetai ce morceau d’écaille dans un coin de ma boutique, où il resta une année.
« Or, un jour que j’étais assis dans ma boutique, je vis entrer…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … Or, un jour que j’étais assis dans ma boutique, je vis entrer un étranger qui me souhaita la paix et qui, apercevant le morceau d’écaille, malgré la poussière dont il était recouvert, s’écria : « Loué soit Allah ! Je trouve enfin ce que je cherchais ! » Et il prit le morceau d’écaille, le porta à ses lèvres et à son front, et me dit : « Ô mon maître, veux-tu me vendre ceci ? » Je répondis : « Je veux bien ! » Il demanda : « Quel en est le prix ? » Je dis : « Combien en offres-tu, toi ? » Il répondit : « Vingt dinars d’or ! » Et moi, à ces paroles, je crus, tant la somme me paraissait considérable, que l’étranger se moquait de moi ; et je lui dis d’un ton fort désagréable : « Va t’en en ta voie ! » Alors il crut que je trouvais modique la somme, et me dit : « J’en offre cinquante dinars ! » Mais moi, de plus en plus convaincu qu’il riait de moi, non seulement je ne voulus point lui répondre, mais je ne le regardai même pas et fis semblant de ne plus remarquer sa présence, afin qu’il s’en allât. Alors il me dit : « Mille dinars ! »
Tout cela ! Et moi, ô mes hôtes, je ne répondais pas ; et lui, souriait de mon silence gros de fureur concentrée, et me disait : « Pourquoi ne veux-tu pas me répondre ? » Et moi je finis par répondre encore : « Va-t’en en ta voie ! » Alors il se mit à augmenter mille dinars sur mille dinars jusqu’à ce qu’il m’offrit vingt mille dinars. Et moi je ne répondais pas !
« Tout cela ! Et les passants et les voisins, attirés par cet étrange marché, s’attroupaient autour de nous dans la boutique et dans la rue, et murmuraient tout haut contre moi et faisaient des remarques désobligeantes sur moi, disant : « Il ne faut pas que nous lui permettions de demander davantage pour ce misérable morceau d’écaille ! » Et d’autres disaient : « Ouallah ! la tête dure, les yeux vides ! S’il ne va pas lui céder le morceau d’écaille, nous le chasserons de la ville ! »
« Tout cela ! Et moi je ne savais pas encore ce que l’on me voulait. Aussi, pour en finir, je demandai à l’étranger : « Veux-tu enfin me dire si tu achètes vraiment ou si tu te moques ? » Il répondit : « Et toi, veux-tu vraiment vendre ou te moquer ? » Je dis : « Vendre ! » Et il dit : « Alors je t’offre, comme dernier prix, trente mille dinars ! Et concluons la vente et l’achat ! » Et moi alors je me tournai vers les assistants, et je leur dis : « Je vous prends à témoins dans cette vente ! Mais auparavant je tiens à savoir de l’acheteur ce qu’il veut faire de ce morceau d’écaille ! » Il répondit : « Concluons d’abord le marché, et je te dirai ensuite les vertus et l’utilité de cette chose-là ! » Je répondis : « Je te la vends ! » Il dit : « Allah est témoin de ce que nous disons ! » Et il sortit un sac rempli d’or, me compta et me pesa trente mille dinars, prit l’amulette, la mit dans sa poche, en poussant un grand soupir, et me dit : « Alors c’est bien vendu et conclu ? » Je répondis : « C’est vendu et conclu ! » Et il se tourna vers les assistants et leur dit : « Soyez tous témoins qu’il m’a vendu l’amulette et en a touché le prix consenti à trente mille dinars ! » Et, cela fait, il se tourna vers moi, et, avec un ton de commisération et d’ironie extrême, il me dit : « Ô pauvre, par Allah ! si tu avais su tenir la main dans cette vente en la retardant encore, je serais arrivé à te payer pour prix de cette amulette non point trente mille ou cent mille dinars mais mille milliers de dinars, si ce n’est davantage ! »
« Or, moi, ô mes hôtes, en entendant ces paroles, et en me voyant ainsi frustré, à cause de mon manque de flair, de cette somme fabuleuse, je sentis un grand bouleversement s’opérer dans mon intérieur ; et une révolution soudaine de mon corps fit descendre le sang de mon visage et monter à sa place cette couleur jaune que j’ai conservée depuis et qui a attiré votre attention ce soir, ô mes hôtes !
« Je restai donc hébété un moment, puis je dis à l’étranger : « Peux-tu me dire maintenant les vertus et l’utilité de ce morceau d’écaille ? » Et l’étranger me répondit :
« Sache que le roi de l’Inde a une fille chérie qui n’a point sa pareille en beauté sur la face de la terre ; mais elle est sujette à de violents maux de tête ! Aussi le roi son père, à bout de ressources et de médicaments capables de la soulager, fit assembler les plus forts scribes de son royaume et les hommes de science et les devins ; mais aucun d’eux ne réussit à
enlever de sa tête les douleurs qui la torturaient…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … mais aucun d’eux ne réussit à enlever de sa tête les douleurs qui la torturaient. Alors moi, qui étais présent dans l’assemblée, je dis au roi : « Ô roi, moi je connais un homme appelé Saadallah le Babylonien, qui n’a point son pareil ou son supérieur dans la connaissance de tels remèdes, sur la face de la terre ! Si donc tu juges à propos de m’envoyer vers lui, fais-le ! » Le roi me répondit : « Va vers lui ! » Je dis : « Donne-moi mille milliers de dinars et un morceau d’écaille rouge d’un rouge foncé ! Et, en plus, un cadeau ! » Et le roi me donna tout ce que je lui demandais, et je partis de l’Inde vers le pays de Babylone. Et là je m’informai du sage Saadallah, et on me guida vers lui ; et je me présentai devant lui et lui remis cent mille dinars et le cadeau du roi ; puis je lui donnai le morceau d’écaille, et, après lui avoir soumis le but de ma mission, je le priai de me préparer une amulette souveraine contre les maux de tête. Et le sage de Babylone employa sept mois entiers à consulter les astres, et finit, au bout de ces sept mois, par choisir un jour faste pour tracer sur le morceau d’écaille ces caractères talismaniques pleins de mystère que tu vois sur les deux faces de cette amulette que tu m’as vendue ! Et moi je pris cette amulette et revins auprès du roi de l’Inde, auquel je la remis.
« Or le roi entra dans la chambre de sa fille chérie, et la trouva, selon les instructions données, toujours enchaînée au moyen de quatre chaînes attachées aux quatre coins de la chambre, et cela afin qu’elle ne pût, dans ses crises de douleur, se tuer en se jetant par la fenêtre. Et dès qu’il eut posé l’amulette sur le front de sa fille, elle se trouva guérie à l’heure et à l’instant. Et le roi, à cette vue, se réjouit à la limite de la réjouissance, et me combla de riches présents et m’attacha à sa personne, parmi ses intimes. Et la fille du roi, guérie de la sorte si miraculeusement, attacha l’amulette à son collier, et ne la quitta plus.
« Mais un jour la princesse, se trouvant en promenade dans une barque, jouait avec ses compagnes dont l’une d’elles, dans un mouvement malheureux, cassa le fil du collier, et fit tomber l’amulette dans l’eau. Et l’amulette disparut. Et au même moment la Possession rentra en elle, et elle fut de nouveau possédée par le Possesseur terrible, qui lui donna des maux de tête d’une telle violence qu’il lui égara la raison.
« À cette nouvelle, le chagrin du roi fut au-dessus de toutes paroles ; et il m’appela et me chargea d’une nouvelle mission auprès du cheikh Saadallah le Babylonien, afin qu’il fit une autre amulette. Et je partis. Mais, en arrivant à Babylone, j’appris que le cheikh Saadallah était mort.
« Et depuis lors, accompagné de dix personnes pour m’aider dans mes recherches, je parcours tous les pays de la terre dans le but de trouver, chez quelque marchand ou chez quelque vendeur ou passant, une amulette de ces amulettes que savait seul douer de vertus guérisseuses et exorcisantes le cheikh Saadallah de Babylone. Et le sort a voulu te mettre sur ma voie, et me faire trouver et acheter dans ta boutique cet objet que je désespérais déjà de retrouver jamais ! »
« Puis, ô mes hôtes, l’étranger, après m’avoir raconté cette histoire, serra sa ceinture et s’en alla.
« Et telle est, comme je vous l’ai déjà dit, la cause de la couleur jaune de mon visage !
« Quant à moi, je réalisai en argent tout ce que je possédais, en vendant ma boutique, et, riche désormais, je partis en toute hâte pour Baghdad, où, dès mon arrivée, je volai au palais du vieillard blanc, père de ma bien-aimée. Car, depuis ma séparation d’avec elle, le jour et la nuit elle remplissait mes pensées ; et la revoir était le but de mes désirs et de ma vie. Et l’absence n’avait fait qu’attiser les feux de mon âme et exalter mon esprit.
« Je m’informai donc d’elle auprès d’un jeune garçon qui gardait la porte d’entrée. Et le jeune garçon me dit de lever la tête et de regarder. Et je vis que la maison tombait en ruines, que la fenêtre où d’ordinaire se tenait ma bien-aimée était arrachée, et qu’un air de tristesse et de profonde désolation régnait sur la demeure. Alors les larmes me vinrent aux yeux, et je dis au petit esclave : « Qu’a donc fait Allah au cheikh Taher, ô mon frère ? » Il me répondit : « La joie a abandonné la demeure, et le malheur s’est abattu sur nous depuis que nous a quittés un jeune homme du pays d’Oman, nommé Aboul-Hassan Al-Omani. Ce jeune marchand était resté une année avec la fille du cheikh Taher ; mais comme, au bout de ce temps, il n’eut plus d’argent, le cheikh, notre maître, l’a chassé de la maison. Mais notre maîtresse, l’adolescente, qui l’aimait d’un grand amour…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … mais notre maîtresse, l’adolescente, qui l’aimait d’un grand amour, fut si bouleversée de ce départ qu’elle tomba malade d’une fort grave maladie qui la fit approcher de la mort. Alors notre maître, le cheikh Taher, se repentit de ce qu’il avait fait, en voyant la langueur mortelle où se trouvait sa fille ; et il dépêcha des courriers dans toutes les directions et tous les pays, afin de retrouver le jeune Aboul-Hassan, et promit cent mille dinars de récompense à celui qui le ramènerait ! Mais jusqu’à présent tous les efforts des chercheurs ont été vains, car nul n’a pu se mettre sur ses traces ou avoir de ses nouvelles. Aussi l’adolescente, fille du cheikh, est-elle maintenant sur le point de rendre le dernier soupir ! »
« Alors moi, l’âme déchirée de douleur, je demandai à l’enfant : « Et le cheikh Taher, comment va-t-il, lui ? » Il répondit : « Il a été de tout cela dans un tel chagrin et un tel découragement, qu’il a vendu les adolescentes et les jeunes garçons, et s’est repenti amèrement devant Allah le Très-Haut ! » Alors je dis au jeune esclave : « Veux-tu que je t’indique où se trouve Aboul-Hassan Al-Omani ? Qu’en diras-tu ? » Il répondit : « Par Allah sur toi, ô mon frère, fais-le ! Et tu auras rendu une amante à la vie, une fille à son père, un amoureux à son amie, et tu auras tiré de la pauvreté ton esclave et les parents et ton esclave ! » Alors je lui dis : « Va donc trouver ton maître, le cheikh Taher, et dis-lui : « Tu me dois la récompense promise, pour la bonne nouvelle ! Car à la porte de ta maison se trouve, en personne, Aboul-Hassan Al-Omani ! »
« À ces paroles, le jeune esclave s’envola avec la rapidité du mulet échappé du moulin ; et, en un clin d’œil, il revint accompagné du cheikh Taher, père de mon amie. Et comme il était changé ! Et qu’était devenu son teint si frais autrefois et si jeune malgré les années ? Il avait, en deux ans, vieilli de plus de vingt années. Pourtant il me reconnut aussitôt, et se jeta à mon cou et se mit à m’embrasser en pleurant, et me dit : « Ô mon maître, où étais-tu pendant cette longue absence ? Ma fille, à cause de toi, est proche du tombeau. Viens ! Entre avec moi dans ta maison ! » Et il me fit entrer, et commença par se jeter à genoux sur le sol en rendant grâces à Allah qui avait permis notre réunion ; et il se hâta de remettre au jeune esclave la récompense promise de cent mille dinars. Et le jeune esclave se retira en appelant sur moi les bénédictions.
« Après quoi le cheikh Taher entra d’abord seul chez sa fille pour lui annoncer, sans brusquerie, mon arrivée. Il lui dit donc : « Je t’annonce, ô ma fille, la bonne nouvelle ! Si tu veux consentir à manger un morceau et à aller prendre un bain au hammam, je te ferai revoir aujourd’hui même Aboul-Hassan ! » Elle s’écria : « Ô père, est-ce vrai ce que tu dis ? » Il répondit : « Par Allah le Très-Glorieux, ce que je te dis est vrai ! » Alors elle s’écria : « Ouallahi ! Si je vois son visage, je n’aurai plus besoin de manger ou de boire ! » Alors le vieillard se tourna vers la porte, derrière laquelle je me tenais, et me cria : « Entre, ya Aboul-Hassan ! » Et j’entrai.
« Or, ô mes hôtes, dès qu’elle m’eut aperçu et reconnu, elle tomba en pâmoison, et fut longtemps avant de recouvrer ses sens. Elle put enfin se relever, et, au milieu des pleurs de joie et des rires, nous nous jetâmes dans les bras l’un de l’autre, et nous restâmes longtemps embrassés, à la limite de l’émotion et de la félicité. Et lorsque nous pûmes faire attention à ce qui se passait autour de nous, nous vîmes au milieu de la salle de réception le kâdi et les témoins, que le cheikh avait mandés en toute hâte, et qui écrivirent notre contrat de mariage, séance tenante. Et on célébra nos noces avec un déploiement de faste inouï, au milieu de réjouissances qui durèrent trente jours et trente nuits.
« Et depuis ce temps-là, ô mes hôtes, la fille du cheikh Taher est mon épouse chérie. Et c’est elle que vous avez entendue chanter ces airs mélancoliques qui lui plaisent, en lui rappelant les heures douloureuses de notre séparation et en lui faisant mieux sentir le bonheur parfait dans lequel nous coulons les jours de notre union bénie par la naissance d’un fils aussi beau que sa mère ! Et c’est lui-même que je vais vous présenter, ô mes hôtes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et c’est lui-même que je vais vous présenter, ô mes hôtes ! »
Et, ce disant, Aboul-Hassan, le jeune homme jaune, sortit un moment et revint en tenant par la main un jeune garçon de dix ans, beau comme la lune dans son quatorzième jour. Et il lui dit : « Souhaite la paix à nos hôtes ! » Et l’enfant s’acquitta de la chose avec une grâce exquise. Et le khalifat et ses compagnons, toujours déguisés, furent charmés à l’extrême aussi bien de sa beauté, de sa grâce et de sa gentillesse, que de l’histoire extraordinaire de son père. Et, après avoir pris congé de leur hôte, ils sortirent émerveillés de ce qu’ils venaient de voir et d’entendre.
Et le lendemain matin, le khalifat Haroun Al-Rachid, qui n’avait cessé de penser à cette histoire, appela Massrour et lui dit : « Ô Massrour ! » Il répondit : « À tes ordres, ô mon seigneur ! » Il dit : « Tu vas immédiatement réunir dans cette salle tout le tribut annuel en or que nous avons perçu de Baghdad, tout le tribut de Bassra et tout le tribu du Khorassân ! » Et Massrour, sur l’heure, fit apporter devant le khalifat et amonceler dans la salle les tributs en or des trois grandes provinces de l’empire, qui montaient à une somme qu’Allah seul pouvait dénombrer. Alors le khalifat dit à Giafar : « Ô Giafar ! » Il répondit : « Je suis là, ô émir des Croyants ! » Il dit : « Va vite me chercher Aboul-Hassan Al-Omani ! » Il répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il alla aussitôt le chercher, et l’amena tout tremblant devant le khalifat, entre les mains duquel il embrassa la terre et se tint les yeux baissés dans l’ignorance du crime qu’il avait pu commettre ou de la cause qui nécessitait sa présence.
Alors le khalifat lui dit : « Ô Aboul-Hassan, sais-tu les noms des marchands qui ont été tes hôtes hier au soir ? » Il répondit : « Non, par Allah, ô émir des Croyants ! » Le khalifat se tourna alors vers Massrour et lui dit : « Enlève la couverture qui cache les amas d’or ! » Et, la couverture ayant été enlevée, le khalifat dit au jeune homme : « Et peux-tu au moins me dire si, oui ou non, ces richesses sont plus considérables que celles dont tu as été frustré par ta vente hâtive du morceau d’écaille ? » Et Aboul-Hassan, stupéfait de voir le khalifat au courant de cette histoire, murmura en ouvrant des yeux dilatés : « Ouallah, ô mon seigneur, ces richesses-ci sont infiniment plus considérables ! » Et le khalifat lui dit : « Sache alors que tes hôtes d’hier au soir étaient le cinquième des Bani-Abbas et ses vizirs et ses compagnons, et que tout cet or amassé là est ta propriété, en cadeau de ma part pour te dédommager de ce que tu as perdu dans la vente du morceau d’écaille talismanique ! »
En entendant ces paroles, Aboul-Hassan fut dans un tel émoi, qu’une nouvelle révolution bouleversa son intérieur, et que la couleur jaune descendit de son visage pour être remplacée à l’instant par le sang rouge qui y afflua et lui rendit son ancien teint blanc et rose, éclatant comme la lune durant la nuit de sa plénitude. Et le khalifat, ayant fait apporter un miroir, le présenta devant le visage d’Aboul-Hassan qui tomba à genoux pour rendre grâces au Libérateur. Et le khalifat, après avoir fait transporter dans la demeure d’Aboul-Hassan tout l’or amoncelé, l’invita à venir souvent lui tenir compagnie au milieu de ses compagnons intimes, et s’écria : « Il n’y a d’autre Dieu qu’Allah ! Gloire à Celui qui peut produire changement sur changement, et qui Seul reste Inchangeable et Immuable ! »
— Et telle est, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, l’Histoire du Jeune Homme jaune. Mais certainement elle ne peut être comparée à l’Histoire de Fleur-de-Grenade et de Sourire-de-Lune ! » Et le roi Schahriar s’écria : « Ô Schahrazade, je ne doute point de tes paroles. ! Hâte-toi de me raconter l’histoire de Fleur-de-Grenade et de Sourire-de-Lune, car je ne la connais pas ! »
HISTOIRE DE FLEUR-DE-GRENADE
ET DE SOURIRE-DE-LUNE
Et Schahrazade dit :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait en l’antiquité des âges et les années et les jours d’il y a très longtemps, dans les pays ajamites, un roi nommé Schahramân qui résidait dans le Khorassân. Et ce roi avait cent concubines, toutes affligées de stérilité, car il n’avait pu avoir d’aucune d’elles un enfant, fût-il du sexe féminin. Or, comme, un jour, il était assis dans la salle de réception au milieu de ses vizirs, de ses émirs et des grands du royaume, et qu’il s’entretenait avec eux, non point des affaires ennuyeuses du gouvernement, mais de poésie, de science, d’histoire et de médecine, et en général de tout ce qui pouvait lui faire oublier la tristesse de sa solitude sans postérité et sa douleur de ne pouvoir laisser à ses descendants le trône que lui avaient légué ses pères et ses ancêtres, un jeune mamelouk entra dans la salle et lui dit : « Ô mon seigneur, à la porte il y a, avec un marchand, une esclave jeune et telle que jamais l’œil n’en a vu de plus belle ! » Et le roi dit : « À moi donc le marchand et l’esclave ! » Et le mamelouk se hâta d’introduire le marchand et sa belle esclave.
Or, en la voyant entrer, le roi la compara en son âme à une fine lance d’un seul jet ; et, comme elle avait un voile de soie bleue rayée d’or qui lui enveloppait la tête et lui couvrait le visage, le marchand le lui ôta ; et aussitôt la salle fut illuminée de sa beauté, et sa chevelure s’écroula sur son dos en sept tresses massives qui touchèrent les bracelets de ses chevilles : tels les crins splendides qui balaient le sol sous la croupe d’une jument de noble race. Et elle était royale et cambrée merveilleusement, et défiait en souplesse dansante la tige délicate de l’arbre ban. Ses yeux, noirs et allongés de leur nature, étaient chargés d’éclairs destinés à transpercer les cœurs ; et sa seule vue pouvait guérir les malades et les infirmes. Quant à sa croupe bénie, but des souhaits et des désirs, elle était si fastueuse, en vérité, que le marchand lui-même n’avait pu trouver un voile assez grand pour l’envelopper…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Quant à sa croupe bénie, but des souhaits et des désirs, elle était si fastueuse, en vérité, que le marchand lui-même n’avait pu trouver un voile assez grand pour l’envelopper.
Aussi le roi fut-il émerveillé de tout cela à la limite de l’émerveillement ; et il demanda au marchand : « Ô cheikh, à combien cette esclave ? » Il répondit : « Ô mon seigneur, moi je l’ai achetée de son premier maître pour deux mille dinars ; mais, depuis, j’ai voyagé avec elle pendant trois ans pour arriver jusqu’ici, et j’ai dépensé de la sorte pour elle trois autres mille dinars : aussi n’est-ce point une vente que je viens te proposer, mais c’est un cadeau que je t’offre, de moi à toi ! » Et le roi fut charmé du langage du marchand, et le revêtit d’une splendide robe d’honneur et lui fit donner dix mille dinars d’or. Et le marchand baisa la main du roi, et le remercia pour sa bonté et sa munificence, et s’en alla en sa voie.
Alors le roi dit aux intendantes et aux femmes du palais : « Conduisez-la au hammam et soignez-la et, après avoir fait disparaître d’elle les traces du voyage, ne manquez pas de l’oindre de nard et de parfums, et de lui donner, comme appartement, le pavillon dont les fenêtres regardent la mer. » Et les ordres du roi furent exécutés à l’heure et à l’instant.
Or, la ville capitale où régnait le roi Schahramân se trouvait, en effet, située sur le bord de la mer, et son nom était la Ville-Blanche. Et c’est ainsi que les femmes du palais purent conduire, après le bain, l’adolescente étrangère dans un pavillon qui regardait la mer.
Alors le roi, qui n’attendait que ce moment, pénétra chez elle. Mais il fut bien surpris de voir qu’elle ne se levait pas en son honneur et ne faisait pas plus de cas de lui que s’il n’était pas là. Et il pensa en lui-même : « Elle a dû être élevée par des gens qui ne lui ont pas appris les bonnes manières ! » Et il la regarda mieux, et il ne pensa plus à son manque de politesse, tant il fut charmé de sa beauté et de son visage qui était un rond de lune ou un lever de soleil dans un ciel serein. Et il dit : « Gloire à Allah qui a créé la beauté pour les yeux de ses serviteurs ! » Puis il s’assit près de l’adolescente, et la pressa tendrement sur sa poitrine. Ensuite il la prit sur ses genoux et la baisa sur les lèvres, et savoura sa salive qu’il trouva plus douce que le miel. Mais elle ne disait pas un mot et se laissait faire sans opposer de résistance ni montrer d’empressement. Et le roi fit servir dans la chambre un festin magnifique, et se mit lui-même à lui donner à manger et à lui porter les bouchées aux lèvres. Et, entre temps, il l’interrogeait doucement sur son nom et son pays. Mais elle restait silencieuse, sans prononcer une parole, et sans lever la tête pour regarder le roi, qui la trouvait si belle qu’il ne pouvait se résoudre à se mettre en colère contre elle. Et il pensa : « Peut-être est-elle muette ! Mais il est impossible que le Créateur ait formé une pareille beauté pour la priver de la parole ! Ce serait une imperfection indigne des doigts du Créateur ! » Puis il appela les servantes pour se faire verser de l’eau sur les mains ; et il profita du moment où elles lui présentaient l’aiguière et le bassin pour leur demander à voix basse : « Pendant que vous lui donniez vos soins, l’avez-vous entendue parler ? » Elles répondirent : « Tout ce que nous pouvons dire au roi, c’est que pendant tout le temps que nous étions auprès d’elle à la servir, à la baigner, à la parfumer, à la coiffer et à l’habiller, jamais nous ne l’avons vue remuer les lèvres pour nous dire : « Ceci est bien ! Cela n’est pas bien ! » Et nous ne savons si c’est mépris pour nous ou ignorance de notre langue ou mutisme, mais nous n’avons guère réussi à lui faire proférer une seule parole de merci ou de blâme ! »
À ce discours des esclaves et des matrones, le roi fut à la limite de l’étonnement, et, pensant que ce mutisme était dû à quelque chagrin intime, il voulut essayer de l’en distraire. Dans ce but, il fit assembler dans le pavillon toutes les dames du palais et toutes les favorites afin qu’elle s’amusât et jouât avec elles ; et celles qui savaient jouer des instruments d’harmonie en jouèrent, tandis que les autres chantaient, dansaient ou faisaient les deux choses à la fois. Et tout le monde était dans l’épanouissement, excepté l’adolescente qui continua à rester immobile à sa place, tête basse et bras croisés, sans rire ou parler. Le roi, à cette vue, sentit sa poitrine se rétrécir et ordonna aux femmes de se retirer. Et il resta seul avec l’adolescente.
Là, après avoir encore essayé, mais en vain, d’en tirer une réponse ou une parole, il s’approcha d’elle et se mit en devoir de la déshabiller…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Là, après avoir encore essayé, mais en vain, d’en tirer une réponse ou une parole, il se mit en devoir de la déshabiller. Il commença par lui enlever délicatement les voiles légers qui l’enveloppaient, puis, l’une après l’autre, les sept robes de couleurs et d’étoffes différentes qui la couvraient, et enfin la chemise fine et l’ample caleçon à glands de soie verte. Et, en dessous, il vit son corps éclatant de blancheur et sa chair de pureté et de vierge argent. Et il l’aima d’un grand amour et, se levant, il prit sa virginité, et la trouva intacte et imperforée. Et il s’en réjouit et s’en délecta à l’extrême ; et il pensa : « Par Allah ! n’est-ce point une chose prodigieuse que les divers marchands aient laissé intacte la virginité d’une jeune fille si belle et si désirable ! » Et le roi s’attacha tellement à sa nouvelle esclave, qu’il délaissa pour elle toutes les autres femmes du palais et les favorites et les affaires du royaume, et s’enferma avec elle une année entière, sans se lasser un moment des délices nouvelles que tous les jours il y découvrait. Mais, avec tout cela, il n’avait guère réussi à lui arracher une parole ou un assentiment, ni à l’intéresser à ce qu’il faisait avec elle et autour d’elle.
Tout cela ! Et il ne savait plus comment interpréter ce silence et ce mutisme. Et il n’espérait plus arriver à lui délier la langue et à s’entretenir avec elle.
Or, un jour d’entre les jours, le roi était, selon sa coutume, assis auprès de sa belle et insensible esclave, et son amour pour elle était plus violent que jamais, et il lui disait : « Ô désir des âmes, ô cœur de mon cœur, ô lumière de mes yeux, ne sais-tu donc l’amour que j’éprouve pour toi, et que j’ai délaissé pour ta beauté mes favorites, mes concubines et les affaires de mon royaume, et que je l’ai fait avec plaisir, et que je suis d’ailleurs loin de m’en repentir ? Ne sais-tu que je t’ai gardée pour mon seul lot et mon unique agrément, de tous les biens de ce monde ? Et voici plus d’un an que j’allonge la patience de mon âme sur la cause de ce mutisme et de cette insensibilité que je n’arrive point à deviner ! Si tu es réellement muette, fais-le moi du moins comprendre par signes, afin que je laisse tout espoir de t’entendre jamais, ô ma bien-aimée ! Sinon, puisse Allah attendrir ton cœur et, dans sa bonté, t’inspirer de cesser enfin ce silence que je ne mérite pas ! Et si cette consolation doit m’être toujours refusée, fasse Allah que tu sois enceinte de moi et me donnes un fils chéri qui puisse me succéder sur le trône que m’ont légué mes pères et mes ancêtres ! Hélas ! ne vois-tu pas que je vieillis solitaire et sans postérité, et que bientôt je ne vais plus pouvoir même espérer féconder de jeunes flancs, cassé que je serai par la tristesse et les ans ? Hélas ! hélas ! ô toi, si tu éprouves pour moi le plus léger sentiment de pitié ou d’affection, réponds-moi, dis-moi seulement si oui ou non tu es enceinte, je t’en supplie, par Allah sur toi ! Et qu’ensuite je meure ! »
À ces paroles, la belle esclave, qui, selon sa coutume, avait écouté le roi, les yeux toujours baissés et les mains jointes sur les genoux, dans une pose immobile, soudain, pour la première fois depuis son entrée au palais, eut un léger sourire. Cela seul et rien de plus !
À cette vue, le roi fut dans une telle émotion qu’il crut le palais illuminé en entier par un éclair au milieu des ténèbres. Et il se trémoussa en son âme et exulta et, comme, après un tel signe, il ne doutait plus qu’elle ne consentit à parler, il se jeta aux pieds de l’adolescente et attendit ce moment, les bras levés et les lèvres entr’ouvertes dans l’attitude de la prière.
Et soudain, l’adolescente releva la tête et, souriante, parla ainsi : « Ô roi magnanime, notre suzerain, ô lion valeureux, sache… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Et soudain, l’adolescente releva la tête et, souriante, parla ainsi : « Ô roi magnanime, notre suzerain, ô lion valeureux, sache qu’Allah a répondu à ta prière, car je suis enceinte de toi ! Et le temps est proche de ma délivrance ! Mais je ne sais si l’enfant que je porte dans mon sein est un petit garçon ou une petite fille ! Sache, en outre, que, n’était ma fécondation par toi, j’étais bien résolue à ne jamais t’adresser la parole ni à te dire un seul mot durant ma vie ! »
En entendant ces paroles inespérées, le roi fut dans une telle joie qu’il se trouva d’abord dans l’impossibilité d’articuler un mot ou de faire un mouvement ; puis son visage s’illumina et se transfigura ; et sa poitrine se dilata ; et il se sentit soulever de terre dans l’explosion de sa joie. Et il baisa les mains de l’adolescente et il baisa sa tête et son front, et s’écria : « Gloire à Allah qui m’a accordé deux grâces que je souhaitais, ô lumière de mes yeux : te voir me parler, et t’entendre m’annoncer la nouvelle de ta grossesse ! Alhamdolillah ! la louange à Allah ! »
Puis le roi se leva et sortit de chez elle, après avoir pour un moment pris congé, et alla s’asseoir en grande pompe sur le trône de son royaume ; et il était à la limite de la dilatation et de l’épanouissement. Et il donna l’ordre à son vizir d’annoncer à tout le peuple le sujet de sa joie, et de distribuer cent mille dinars aux indigents, aux veuves et à tous ceux en général qui étaient dans le besoin, en actions de grâces à Allah (qu’il soit exalté !) Et le vizir exécuta immédiatement l’ordre qu’il avait reçu.
Alors le roi vint retrouver sa belle esclave, et s’assit auprès d’elle, et la serra contre son cœur et l’embrassa, et lui dit : « Ô ma maîtresse, ô reine de ma vie et de mon âme, peux-tu maintenant me dire pourquoi tu as gardé vis-à-vis de moi et de nous tous ce silence inébranlable de jour et de nuit, depuis déjà une année que tu es entrée dans nos demeures, et pourquoi tu t’es décidée à m’adresser la parole aujourd’hui seulement ? » L’adolescente répondit : « Comment n’aurais-je pas gardé le silence, ô roi, alors que, réduite à la condition d’esclave, je me voyais ici devenue une pauvre étrangère au cœur brisé, séparée pour toujours de ma mère, de mon frère, de mes parents, et éloignée de mon pays natal ? » Le roi répondit : « J’entre dans tes peines et je les comprends ! Mais comment peux-tu dire que tu es une pauvre étrangère, alors que dans ce palais tu es la maîtresse et la reine, que tout ce qui s’y trouve est ta propriété, et que moi-même, le roi, je suis un esclave à ton service ! En vérité, ce sont là des paroles qui ne sont pas à leur place ! Et si tu es chagrinée d’être séparée de tes parents, pourquoi ne me l’avoir pas dit afin que je les envoie chercher et le réunisse ici même avec eux ? »
À ces paroles, la belle esclave dit au roi : « Sache donc, ô roi, que je m’appelle Gul-i-anar, ce qui dans la langue de mon pays, signifie Fleur-de-Grenade ; et je suis née dans la mer, où mon père était roi. Lorsque mon père mourut, j’eus un jour à me plaindre de certains procédés de ma mère, qui s’appelle Sauterelle, et de mon frère, qui s’appelle Saleh ; et je jurai que je ne resterais plus dans la mer, en leur compagnie, et que je sortirais sur le rivage et me donnerais au premier homme de la terre qui me plairait. Donc, une nuit que la reine ma mère et mon frère Saleh s’étaient endormis de bonne heure, et que notre palais était plongé dans le silence sous-marin, je me glissai hors de ma chambre et, montant à la surface de l’eau, j’allai m’étendre sur le rivage d’une île, au clair de lune. Et là, gagnée par la fraîcheur délicieuse qui tombait des étoiles, et caressée par la brise de la terre, je me laissai gagner par le sommeil. Et soudain je me réveillai, en sentant quelque chose s’abattre sur moi, et je me vis en la possession d’un homme qui me chargea sur son dos et, malgré mes cris et mes protestations, me transporta dans sa maison où il m’étendit sur le dos et voulut abuser de moi par la force. Or moi, voyant que cet homme était laid et sentait mauvais, je ne voulus point me laisser faire, et, rassemblant toutes mes forces, je lui appliquai sur la figure un violent coup de poing qui l’envoya rouler à terre à mes pieds, et je me jetai sur lui et lui administrai une telle raclée qu’il ne voulut plus me garder chez lui et me conduisit en toute hâte au souk, où il me cria aux enchères et me vendit à ce marchand auquel tu m’as achetée toi-même, ô roi ! Et, comme ce marchand était un homme plein de conscience et de droiture, il ne voulut point à son tour, me voyant si jeune, abuser de ma virginité ; et il me fit voyager avec lui et me conduisit entre tes mains. Et telle est mon histoire ! Or, moi, en entrant ici, j’étais bien résolue à ne point me laisser faire ; et j’étais décidée, à la première violence de ta part, à me jeter à la mer, par les fenêtres du pavillon, pour aller retrouver ma mère et mon frère. Et j’ai gardé le silence par fierté, pendant tout ce temps. Mais en voyant que ton cœur m’aimait vraiment et que tu avais délaissé pour moi toutes tes favorites, je commençai à être gagnée par tes bonnes manières ; et, me voyant enfin enceinte de toi, je finis par t’aimer, et je laissai de côté toute idée de m’échapper désormais et de sauter dans la mer, ma patrie. Et d’ailleurs de quel œil et de quelle audace pourrais-je le faire maintenant que je suis enceinte et que ma mère et mon frère, en me voyant dans cet état et en apprenant mon union avec un homme de la terre, risqueraient de mourir de chagrin, et ne me croiraient pas si je leur disais que je suis devenue la reine de la Perse et du Khorassân. et l’épouse du plus magnanime des sultans ! Et voilà ce que j’avais à te dire, ô roi Schahramân ! Ouassalam…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et voilà ce que j’avais à te dire, ô roi Schahramân ! Ouassalam ! »
À ce discours, le roi embrassa son épouse entre les yeux, et lui dit : « Ô charmante Fleur-de-Grenade, ô native de la mer, ô merveilleuse, ô princesse, lumière de mes yeux, quelles merveilles tu viens de me révéler ! Certes, si jamais tu me quittais, ne fût-ce que pour un instant, je mourrais au même moment ! » Puis il ajouta : « Mais, ô Fleur-de-Grenade, tu m’as dit que tu étais née dans la mer, et que ta mère Sauterelle et ton frère Saleh habitaient dans la mer avec tes autres parents, et que ton père était, de son vivant, roi de la mer ! Or, je ne comprends pas tout à fait l’existence des êtres maritimes, et jusqu’à présent je traitais de radotages de vieilles femmes les histoires que l’on me racontait à ce sujet. Mais puisque tu m’en parles, et que tu es toi-même une native de la mer, je ne doute plus de la réalité de ces faits, et je te prie de mieux m’éclairer sur ta race et les peuples inconnus qui habitent ta patrie. Dis-moi surtout comment il se peut que l’on puisse vivre, agir ou se mouvoir dans l’eau sans étouffer ou se noyer. Car c’est la chose la plus prodigieuse que j’aie entendue de ma vie ! »
Alors Fleur-de-Grenade répondit : « Certes ! je te dirai tout cela, et de cœur amical ! Sache que, grâce à la vertu des noms gravés sur le sceau de Soleïmân ben-Daoûd (sur eux deux la prière et la paix !), nous vivons et marchons au fond de la mer comme on vit et on marche sur la terre ; et nous respirons dans l’eau comme on respire dans l’air ; et l’eau, au lieu de nous étouffer, entretient notre vie, et ne peut même mouiller nos vêtements ; et elle ne nous empêche pas de voir dans la mer, où nous gardons les yeux ouverts sans aucun inconvénient ; et nous avons des yeux si excellents qu’ils percent les profondeurs marines, malgré leur masse et leur étendue, et nous font distinguer tous les objets aussi bien quand le soleil fait pénétrer ses rayons jusqu’à nous, que lorsque la lune et les étoiles se mirent dans nos eaux. Quant à notre royaume, il est bien plus vaste que tous les royaumes de la terre, et se trouve divisé en provinces où il y a de grandes villes bien peuplées. Et ces peuples sont, comme sur la terre, suivant les régions qu’ils occupent, de mœurs et de coutumes différentes, et aussi de conformation différente ; les uns sont des poissons ; les autres des demi-poissons, moitié humains, avec une queue qui remplace leurs pieds et leur derrière ; et les autres, comme nous, tout à fait des humains qui croient en Allah et en son Prophète, et parlent un langage qui est le même que celui dans lequel est gravée l’inscription du sceau de Soleïmân. Mais pour ce qui est de nos demeures, ce sont des palais splendides, d’une architecture que vous ne pourriez jamais imaginer sur la terre ! Ils sont de cristal de roche, de nacre, de corail, d’émeraude, de rubis, d’or, d’argent et de toutes sortes de métaux précieux et de pierreries, sans parler des perles qui, de quelque grosseur ou de quelque beauté qu’elles soient, ne sont pas bien estimées chez nous, et n’ornent que les demeures des pauvres et des indigents. Enfin, quant à ce qui est de nos moyens de transport, comme notre corps est doué d’une agilité et d’un glissement merveilleux, nous n’avons pas besoin, comme vous autres, de chevaux et de chars, bien que nous en ayons dans nos écuries pour nous en servir seulement dans les fêtes, les réjouissances publiques et les expéditions lointaines. Bien entendu, ces chars sont formés de nacre et de métaux précieux, et sont pourvus de sièges et de trônes en pierreries, et nos chevaux marins sont si beaux que nul roi de la terre ne possède les pareils ! Mais je ne veux pas, ô roi, t’entretenir plus longtemps des pays marins, car je me réserve, dans le courant de notre vie qui sera longue, si Allah veut, de te parler d’une infinité d’autres détails qui achèveront de te mettre au courant de cette question qui t’intéresse. Pour le moment, je me hâte d’arriver à une chose beaucoup plus pressante et qui te touche plus directement. Je veux parler des couches de femmes. Sache, en effet, ô mon maître, que les couches des femmes de mer sont absolument différentes des couches des femmes de terre ! Or, comme le moment de mes couches est tout proche, je crains fort que les sages-femmes de ton pays ne m’accouchent de travers ! Je te prie donc de me permettre de faire venir chez moi ma mère Sauterelle et mon frère Saleh et mes autres parents ; et je me réconcilierai avec eux ; et mes cousines, aidées par ma mère, veilleront à la sûreté de mes couches et prendront soin du nouveau-né, héritier de ton trône…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … et mes cousines, aidées par ma mère, veilleront à la sûreté de mes couches et prendront soin du nouveau-né, héritier de ton trône ! »
En entendant ces paroles, le roi, émerveillé, s’écria : « Ô Fleur-de-Grenade, tes désirs sont ma règle de conduite, et je suis l’esclave qui obéit aux ordres de sa maîtresse ! Mais, dis-moi, ô merveilleuse, comment vas-tu pouvoir en si peu de temps aviser ta mère, ton frère et tes cousines, et les faire venir avant tes couches dont le moment est si proche ? En tout cas, je tiens à le savoir au plus tôt, pour tâcher de faire les préparatifs nécessaires et de les recevoir avec tous les honneurs qu’ils méritent ! » Et la jeune reine répondit : « Ô mon maître, il n’est guère besoin entre nous de cérémonies ! Et d’ailleurs mes parents vont être ici dans un instant. Et si tu tiens à voir de quelle manière ils vont arriver, tu n’as qu’à entrer dans cette chambre voisine de la mienne, et à me regarder et à regarder aussi par les fenêtres qui donnent sur la mer. »
Aussitôt le roi Schahramân entra dans la chambre voisine, et regarda avec attention aussi bien ce qu’allait faire Fleur-de-Grenade que ce qui allait se produire sur la mer.
Et Fleur-de-Grenade tira de son sein deux morceaux de bois d’aloès des Îles Comores, les mit dans une cassolette d’or, et les alluma. Et dès que s’en dégagea la fumée, elle lança un sifflement long et aigü, et prononça sur la cassolette des paroles inconnues et des formules conjuratoires. Et, au même moment, la mer se troubla et s’agita, puis s’entr’ouvrit, et il en sortit d’abord un adolescent comme la lune, beau et de belle taille, et semblable, quant au visage et à l’élégance, à Fleur-de-Grenade, sa sœur ; et ses joues étaient blanches et roses, et ses cheveux et ses moustaches naissantes étaient d’un vert de mer ; et, comme dit le poète, il était plus merveilleux que la lune elle-même, car si la lune a pour demeure ordinaire un seul signe du ciel, cet adolescent habite indistinctement dans tous les cœurs ! Après quoi il sortit de la mer une vieille très ancienne, aux cheveux blancs, qui était dame Sauterelle, mère de l’adolescent et de Fleur-de-Grenade. Et elle fut immédiatement suivie de cinq jeunes filles comme des lunes, qui avaient une certaine ressemblance avec Fleur-de-Grenade, dont elles étaient les cousines. Et l’adolescent et les six femmes marchèrent sur la mer, et s’avancèrent à pied sec jusque sous les fenêtres du pavillon. Et là ils prirent leur élan et sautèrent avec légèreté l’un après l’autre sur la fenêtre où leur était apparue Fleur-de-Grenade qui s’effaça à temps pour les laisser entrer.
Alors le prince Saleh et sa mère et ses cousines se jetèrent au cou de Fleur-de-Grenade, et l’embrassèrent avec effusion en pleurant de joie de l’avoir retrouvée, et lui dirent : « Ô Gul-i-anar, comment as-tu pu avoir le cœur de nous quitter et de nous tenir pendant quatre ans sans nouvelles de ta part et sans même nous indiquer l’endroit où tu te trouvais ? Ouallah ! le monde s’est rétréci sur nous, tant nous étions accablés de la douleur de ta séparation ! Et nous n’éprouvions plus de plaisir à manger et à boire, car tous les aliments étaient devenus insipides à notre goût ! Et nous ne savions que pleurer et sangloter le jour et la nuit, de toute la douleur cuisante de ta séparation ! Ô Gul-i-anar ! vois comme notre visage est amaigri et jauni de tristesse ! » Et Fleur-de-Grenade, à ces paroles, baisa la main de sa mère et de son frère, le prince Saleh, et embrassa de nouveau ses cousines chéries, et leur dit à tous : « Certes ! j’ai commis une grande faute envers votre tendresse, en partant sans vous prévenir ! Mais que peut-on contre la destinée ? Réjouissons-nous maintenant de nous retrouver, et rendons-en grâces à Allah le Bienfaiteur ! » Puis elle les fit tous s’asseoir auprès d’elle, et leur raconta toute son histoire depuis le commencement jusqu’à la fin ! Mais il est inutile de la répéter. Puis elle ajouta : « Et maintenant que je suis mariée à ce roi excellent et parfait à la limite des perfections, qui m’aime et que j’aime, et qui m’a rendue enceinte, je vous ai fait venir pour me réconcilier avec vous et vous prier de m’assister dans mes couches. Car je n’ai point confiance dans les sages-femmes terriennes qui ne comprennent rien aux accouchements des Filles de la mer ! » Alors dame Sauterelle, sa mère, répondit : « Ô ma fille, en te voyant dans ce palais d’un prince de la terre, nous avons eu bien peur que tu ne fusses malheureuse ; et nous étions prêtes à te presser de nous suivre dans notre patrie ; car tu sais notre amour pour toi et le degré d’affection et d’estime où nous te tenons, et notre désir de te savoir heureuse, tranquille et sans soucis ! Mais du moment que tu nous affirmes que tu es heureuse, que pourrions-nous pour toi souhaiter de meilleur ?
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Mais du moment que tu nous affirmes que tu es heureuse, que pourrions-nous pour toi souhaiter de meilleur ? Et c’eût été, sans doute, tenter la destinée que de te vouloir, malgré le sort contraire, mariée à un de nos princes de la mer. » Et Fleur-de-Grenade répondit : « Oui, par Allah ! je suis ici à la limite de la tranquillité, des délices, des honneurs, de la félicité et de tous mes vœux ! »
Tout cela ! Et le roi entendait ce que disait Fleur-de-Grenade ; et il se réjouissait en son cœur et la remerciait en son âme de ces bonnes paroles ; et il l’en aima mille milliers de fois plus qu’auparavant ; et pour toujours l’amour qu’il lui portait se consolida dans le noyau de son cœur ; et il se promit bien de lui donner de nouvelles preuves d’attachement et de passion par tous les endroits possibles !
Après quoi, Fleur-de-Grenade frappa des mains pour appeler ses esclaves, et leur donna l’ordre de tendre la nappe et de servir les mets dont elle alla elle-même surveiller la cuisson à la cuisine. Et les esclaves apportèrent les grands plateaux couverts de viandes rôties, de pâtisseries et de fruits ; et Fleur-de-Grenade invita ses parents à s’asseoir avec elle autour de la nappe et à manger. Mais ils répondirent : « Non, par Allah ! nous n’en ferons rien avant que tu sois allée prévenir le roi, ton époux, de notre arrivée. Car nous sommes entrés dans sa demeure sans sa permission, et il ne nous connaît pas ! Ce serait donc une grande incivilité de manger dans son palais et de profiter de son hospitalité à son insu ! Va donc le prévenir, et dis-lui combien nous serions heureux de le voir et de faire en sorte qu’il y ait entre nous le pain et le sel ! »
Alors Fleur-de-Grenade alla trouver le roi, qui se tenait caché dans la chambre voisine, et lui dit : « Ô mon maître, tu as sans doute entendu comment j’ai fait ton éloge devant mes parents, et comment ils étaient décidés à m’emmener avec eux si je leur avais dit la moindre chose qui pût leur faire croire que je n’étais pas dans le bonheur avec toi ! » Et le roi répondit : « J’ai entendu et j’ai vu ! Ouallahi ! C’est dans cette heure bénie que j’ai eu la preuve de ton attachement pour moi, et je ne puis plus douter de ton affection ! » Fleur-de-Grenade dit : « Aussi, après toutes les louanges que je leur ai faites de toi, je dois te dire que ma mère, mon frère et mes cousines ont éprouvé pour toi une affection considérable, et je puis t’assurer qu’ils t’aiment grandement. Et ils m’ont dit qu’ils ne voulaient pas retourner dans leur pays avant de t’avoir vu, de t’avoir présenté leurs hommages et fait leurs souhaits, et d’avoir causé amicalement avec toi ! Je te prie donc de te rendre à leurs désirs, et de venir accepter et leur rendre leurs souhaits, afin que tu les voies et qu’ils te voient, et qu’entre vous soit la pure affection et l’amitié ! » Et le roi répondit : « Entendre, c’est obéir ! car tel est aussi mon désir ! » Et il se leva à l’instant et accompagna Fleur-de-Grenade dans la salle où se tenaient ses parents.
Et, dès qu’il fut entré, il leur souhaita la paix de la manière la plus cordiale, et ils lui rendirent son salam ; et il baisa la main de la vieille dame Sauterelle, et embrassa le prince Saleh, et les invita tous à s’asseoir. Alors le prince Saleh lui fit ses compliments, et lui exprima la joie qu’ils éprouvaient tous de voir Fleur-de-Grenade devenue l’épouse d’un grand roi, au lieu de tomber entre les mains d’un brutal qui l’aurait déflorée, pour la donner ensuite en mariage à quelque chambellan ou à son cuisinier. Et il lui dit combien ils aimaient tous Fleur-de-Grenade, et comme quoi ils avaient voulu anciennement, avant même qu’elle fût pubère, la marier à quelque prince de la mer ; mais que, poussée par sa destinée, elle s’était échappée des pays sous-marins pour se marier à sa guise ! Et le roi répondit : « Oui ! Allah me la destinait. Et je vous remercie, ma belle-mère, la reine Sauterelle, et toi, prince Saleh, et mes cousines si gentilles de vos souhaits et de vos compliments, et de ce que vous voulez bien donner à mon mariage votre consentement ! » Puis le roi les invita à se mettre avec lui autour de la nappe, et s’entretint longtemps avec eux en toute cordialité, et les conduisit ensuite lui-même chacun à son appartement !
Les parents de Fleur-de-Grenade restèrent donc au palais, au milieu des fêtes et des réjouissances données en leur honneur, jusqu’aux couches de la reine, qui ne tardèrent pas à survenir. En effet, au terme fixé, elle accoucha, entre les mains de la reine Sauterelle et de ses cousines, d’un enfant mâle, comme la lune en son plein, et rose et dodu. Et on le présenta, enveloppé de langes magnifiques, au roi Schahramân, son père, qui le reçut avec les transports d’une joie que ni la plume ni la langue ne sauraient décrire. Et, en actions de grâces, il fit de grandes largesses aux pauvres, aux veuves et aux orphelins, et fit ouvrir les prisons et donner la liberté à tous ses esclaves des deux sexes ; mais les esclaves ne voulurent point de la liberté, tant ils se trouvaient heureux sous un pareil maître. Puis, au bout de sept jours de réjouissances continuelles, au milieu de toutes les félicités, la reine Fleur-de-Grenade, avec l’assentiment de son époux, de sa mère et de ses cousines, donna à son fils le nom de Sourire-de-Lune…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… la reine Fleur-de-Grenade, avec l’assentiment de son époux, de sa mère et de ses cousines, donna à son fils le nom de Sourire-de-Lune.
Alors le prince Saleh, frère de Fleur-de-Grenade et oncle de Sourire-de-Lune, prit le petit dans ses bras, et se mit à le baiser et à le caresser de mille manières, en le promenant par la chambre et en le tenant en l’air dans ses mains ; et soudain il prit son élan et, du haut du palais, sauta dans la mer, où il plongea et disparut avec le petit.
À cette vue, le roi Schahramân, saisi d’épouvante et de douleur, se mit à pousser des cris désespérés et à se donner de si grands coups sur la tête qu’il en faillit mourir. Mais la reine Fleur-de-Grenade, loin de se montrer effrayée ou affligée de la chose, dit au roi d’un ton assuré : « Ô roi du temps, ne te désespère pas pour si peu de chose, et sois sans aucune crainte au sujet de ton fils ! car moi, qui certainement aime cet enfant bien plus que toi, je suis tranquille, le sachant avec mon frère qui, s’il savait que le petit devait avoir la moindre incommodité ou prendre froid ou seulement être mouillé, n’aurait pas fait ce qu’il vient de faire. Sois sûr que l’enfant ne court aucun risque ni danger du côté de la mer, quoiqu’il soit à demi de ton sang ! Mais à cause de l’autre moitié qu’il tient de mon sang, il peut impunément vivre dans l’eau, comme sur la terre. Ne sois donc plus alarmé, et sois, en outre, persuadé que mon frère ne va pas tarder à revenir avec l’enfant en bonne santé ! » Et la reine Sauterelle et les jeunes tantes de l’enfant confirmèrent au roi les paroles de son épouse. Mais le roi ne commença à se calmer que lorsqu’il vit la mer se troubler et s’agiter et que, de son sein entr’ouvert, sortit, tenant le petit dans ses bras, le prince Saleh qui s’éleva dans les airs, d’un saut, et rentra dans la salle haute par la même fenêtre d’où il était sorti. Et le petit était aussi tranquille que s’il était sur le sein de sa mère, et il souriait comme la lune à son quatorzième jour.
À cette vue, le roi fut tout à fait tranquillisé et émerveillé ; et le prince Saleh lui dit : « Sans doute, ô roi, tu as dû ressentir une grande frayeur en me voyant sauter et plonger dans la mer avec le petit ? » Et le roi répondit : « Certes ! ô fils de l’oncle, mon épouvante a été extrême, et j’avais même désespéré de le revoir jamais sain et sauf ! » Le prince Saleh dit : « Sois désormais sans crainte à son sujet, car il est pour toujours à l’abri des dangers de l’eau, de la noyade, de l’étouffement, du mouillage et autres choses semblables, et il peut, toute sa vie durant, plonger dans la mer et s’y promener à son aise ; car je lui ai fait acquérir le même privilège qu’à nos propres enfants nés dans la mer, et cela en lui frottant les cils et les paupières avec un certain kohl que je connais, et en prononçant sur lui les Paroles mystérieuses gravées sur le sceau de Soleïmân ben-Daoûd (sur eux deux la paix et la prière !)
Après ce discours, le prince Saleh remit le petit à sa mère, qui lui donna à téter ; puis il tira de sa ceinture un sac dont l’ouverture était scellée, en fit sauter le cachet, et, l’ayant ouvert, il le prit par le fond et en versa le contenu sur le tapis. Et le roi vit scintiller des diamants gros comme des œufs de pigeon, des bâtons d’émeraude de la longueur d’un demi-pied, des filets de grosses perles, des rubis d’une couleur et d’une taille extraordinaires, et toutes sortes de joyaux plus merveilleux les uns que les autres. Et toutes ces pierreries lançaient mille feux multicolores qui éclairaient la salle d’une harmonie de lumières semblables à celles que l’on voit dans les rêves. Et le prince Saleh dit au roi : « Ceci est un cadeau que j’apporte, pour m’excuser d’être venu ici les mains vides la première fois. Mais alors je ne savais point où se trouvait ma sœur Fleur-de-Grenade, et je ne me doutais point que son heureuse destinée l’eût mise sur le chemin d’un roi tel que toi ! Mais ce cadeau n’est encore rien en comparaison de ceux que je me réserve de te faire dans les jours à venir ! » Et le roi ne sut comment remercier son beau-frère de ce cadeau, et se tourna vers Fleur-de-Grenade et lui dit : « Vraiment, je suis confus à l’extrême de la générosité de ton frère à mon égard, et de la magnificence de ce cadeau qui n’a point de pareil sur la terre et dont une seule des pierres vaut mon royaume en entier ! » Et Fleur-de-Grenade remercia son frère d’avoir pensé à s’acquitter des devoirs de la parenté ; mais il se tourna vers le roi et lui dit : « Par Allah, ô roi, cela n’est même pas digne de ton rang ! Quant à nous, jamais nous ne saurons assez nous acquitter des dettes que ta bonté nous a fait contracter ; et si même, nous tous, nous passions mille années à te servir sur nos visages et nos yeux, nous ne pourrions te rendre ce que nous te devons ; car tout est peu, en proportion de tes droits sur nous ! »
À ces paroles, le roi embrassa le prince Saleh, et le remercia chaleureusement. Puis il l’obligea à rester encore au palais quarante jours avec sa mère et ses cousines, au milieu des fêtes et des réjouissances. Mais, au bout de ce temps, le prince Saleh se présenta devant le roi et embrassa la terre entre ses mains. Et le roi lui demanda : « Parle, ô Saleh ! Que souhaites-tu ? » Il répondit : « Ô roi du temps, en vérité nous sommes les noyés de tes faveurs, mais nous venons te demander la permission de partir, car notre âme souhaite vivement de revoir notre patrie, nos parents et nos demeures, depuis si longtemps que nous en sommes éloignés ! Et puis un séjour trop prolongé sur terre est nuisible à notre santé, car nous sommes habitués au climat sous-marin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … un séjour trop prolongé sur terre est nuisible à notre santé, car nous sommes habitués au climat sous-marin ! » Et le roi répondit : « Quel chagrin pour moi, ô Saleh ! » Il dit : « Et pour nous également ! Mais, ô roi, nous reviendrons de temps en temps pour te rendre nos hommages et revoir Fleur-de-Grenade et Sourire-de-Lune ». Et le roi dit : « Oui, par Allah ! faites-le, et souvent ! Quant à moi, je suis bien triste de ne pouvoir t’accompagner, ainsi que la reine Sauterelle et mes cousines, dans ton pays de sous-mer, vu que je crains beaucoup l’eau ! » Alors ils prirent tous congé de lui et, après avoir embrassé Fleur-de-Grenade et Sourire-de-Lune, ils s’élancèrent par la fenêtre, l’un après l’autre, et plongèrent dans la mer. Et voilà pour eux !
Mais pour ce qui est du petit Sourire-de-Lune, voici ! Sa mère, Fleur-de-Grenade, ne voulut point le confier aux nourrices, et lui donna elle-même le sein jusqu’à ce qu’il eût atteint l’âge de quatre ans, afin qu’il suçât avec son lait toutes les vertus marines. Et l’enfant, d’avoir été si longtemps nourri du lait de sa mère, la native de la mer, devint plus beau de jour en jour et plus robuste ; et, à mesure qu’il avançait en âge, il augmentait en force et en agréments ; de telle sorte que lorsqu’il eut atteint sa quinzième année il devint l’adolescent le plus beau, le plus solide, le plus adroit dans les exercices du corps, le plus sage et le plus instruit d’entre les fils des rois de son temps. Et dans tout l’immense empire de son père, il n’était question chaque jour dans les conversations que de ses mérites, de ses charmes et de ses perfections ; car vraiment il était beau ! Et le poète n’exagérait point, qui de lui disait :
Le duvet adolescent a tracé deux lignes sur ses charmantes joues, deux lignes noires sur du rose, ambre gris sur des perles, ou jais sur des pommes !
Les traits assassins logent sous ses languides paupières, et à chacun de ses regards ils partent et tuent !
Quant à l’ivresse, ne la cherchez pas dans les vins ! Ils ne vous la donneraient pas à l’égal de ses joues rougies par vos désirs et sa pudeur.
Ô broderies, merveilleuses et noires broderies dessinées sur ses joues éclatantes, vous êtes un chapelet de grains de musc éclairés par une lampe qui brûle dans les ténèbres !
Aussi le roi qui aimait son fils d’un très grand amour et qui voyait en lui tant de qualités royales, voulut, se sentant lui-même vieillir et approcher du terme de son destin, lui assurer de son vivant la succession au trône. Dans ce but, il convoqua ses vizirs et les grands de son empire, qui savaient combien le jeune prince était en tous points digne de lui succéder, et leur fit prêter le serment d’obéissance à leur nouveau roi ; puis il descendit devant eux du trône, ôta la couronne de dessus sa tête et la mit de ses propres mains sur la tête de son fils Sourire-de-Lune ; et il le soutint par les aisselles et le fit monter et s’asseoir sur le trône à sa place ; et, pour bien marquer qu’il lui remettait désormais toute son autorité et son pouvoir, il embrassa la terre entre ses mains et, se relevant, il lui baisa la main et le pan de son manteau royal, et descendit se placer au-dessous de lui, à droite, tandis que, à gauche, se tenaient les vizirs et les émirs.
Aussitôt le nouveau roi Sourire-de-Lune se mit à juger, à régler les affaires pendantes, à nommer aux emplois ceux qui méritaient une faveur, à destituer les prévaricateurs, à défendre les droits du faible contre le fort et ceux du pauvre contre le riche, et à s’occuper de la justice avec tant de sagesse, d’équité et de discernement qu’il émerveilla son père, et les vieux vizirs de son père, et tous les assistants. Et il ne leva le diwân qu’à midi seulement.
Alors, accompagné du roi son père, il entra chez la reine sa mère, la native de la mer ; et il portait sur sa tête la couronne d’or de la royauté, et était ainsi vraiment comme la lune. Et sa mère, le voyant si beau avec cette couronne-là, courut à lui, en pleurant d’émotion, et se jeta à son cou en l’embrassant avec tendresse et effusion ; puis elle lui baisa la main et lui souhaita règne prospère, longue vie et victoires sur les ennemis.
Et tous les trois vécurent de la sorte, au milieu du bonheur et de l’amour de leurs sujets, pendant la longueur d’une année, au bout de laquelle le vieux roi Schahramân sentit, un jour, son cœur battre précipitamment et n’eut que juste le temps d’embrasser son épouse et son fils, et de leur faire ses dernières recommandations. Et il mourut avec une très grande tranquillité, et s’en alla en la miséricorde d’Allah (qu’il soit exalté !)…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il mourut avec une très grande tranquillité, et s’en alla en la miséricorde d’Allah (qu’il soit exalté !) Et le deuil et l’affliction furent grands de Fleur-de-Grenade et du roi Sourire-de-Lune, et ils le pleurèrent un mois entier sans voir personne, et lui élevèrent un tombeau digne de sa mémoire auquel furent attachés des biens de mainmorte au bénéfice des pauvres, des veuves et des orphelins.
Et, pendant cet intervalle, ne manquèrent pas d’arriver, pour prendre part à l’affliction générale, la grand’mère, dame Sauterelle, et l’oncle du roi, le prince Saleh, et les tantes du roi, natives de la mer. Et, d’ailleurs, ils étaient déjà venus plusieurs fois visiter leurs parents, du vivant du vieux roi. Et ils pleurèrent beaucoup de n’avoir pu assister à ses derniers moments. Et ils mirent tous leur douleur en commun ; et ils se consolaient mutuellement à tour de rôle ; et ils finirent, au bout d’un très longtemps, par faire un peu oublier au roi la mort de son père, et le décidèrent à reprendre ses séances au diwân et à s’occuper des affaires de son royaume. Et il les écouta et consentit, après bien des résistances, à revêtir de nouveau ses habits royaux ouvragés d’or et constellés de pierreries, et à ceindre le diadème. Et il reprit en main l’autorité et rendit la justice, avec l’approbation universelle et le respect des grands et des petits ; et cela pendant encore une année.
Or, un après-midi, le prince Saleh, qui depuis un certain temps, n’était pas revenu voir sa sœur et son neveu, sortit de la mer et entra dans la salle où se tenaient à ce moment la reine et Sourire-de-Lune. Et il leur fit ses salams, et les embrassa ; et Fleur-de-Grenade lui dit : « Ô mon frère, comment vas-tu, et comment va ma mère, et comment vont mes cousines ? » Il répondit : « Ô ma sœur, elles vont très bien et sont dans la tranquillité et le contentement, et il ne leur manque que la vue de ton visage et du visage de mon neveu le roi Sourire-de-Lune ! » Et ils se mirent à causer de choses et d’autres, en mangeant des noisettes et des pistaches ; et le prince Saleh en vint à parler, avec de grandes louanges, des qualités de son neveu Sourire-de-Lune, de sa beauté, de ses charmes, de ses proportions, de ses manières exquises, de son adresse dans les tournois, et de sa sagesse. Et le roi Sourire-de-Lune, qui était là, étendu sur le divan et la tête appuyée sur les coussins, entendant ce que disaient de lui sa mère et son oncle, ne voulut pas avoir l’air de les écouter, et feignit de dormir. Et de la sorte il put entendre commodément ce qu’ils continuaient à dire sur son compte.
En effet, le prince Saleh, voyant son neveu endormi, parla plus librement à sa sœur Fleur-de-Grenade, et lui dit : « Tu oublies, ma sœur, que ton fils va bientôt avoir dix-sept ans, et qu’à cet âge il faut bien songer à marier les enfants ! Or, moi, le voyant si beau et si fort, et sachant qu’à son âge on a des besoins qu’il faut satisfaire d’une façon ou d’une autre, j’ai bien peur qu’il ne lui arrive des choses désagréables. Il est donc de toute nécessité de le marier, en lui trouvant parmi les Filles de la mer une princesse qui lui soit égale en charmes et en beauté ! » Et Fleur-de-Grenade répondit : « Certes ! tel est aussi mon intime désir, car je n’ai qu’un fils, et il est temps qu’il ait, lui aussi, un héritier au trône de ses pères ! Je te prie donc, ô mon frère, de rappeler à ma mémoire les jeunes filles de notre pays, car il y a si longtemps que j’ai quitté la mer, que je ne me souviens plus de celles qui sont belles et de celles qui sont laides ! » Alors Saleh se mit à énumérer à sa sœur les plus belles princesses de la mer, l’une après l’autre, en pesant soigneusement leurs qualités, et le pour et le contre, et les avantages et les désavantages. Et, chaque fois, la reine Fleur-de-Grenade répondait : « Ah ! non, je ne veux pas de celle-ci, à cause de sa mère, ni de celle-ci à cause de son père, ni de celle-ci à cause de sa tante dont la langue est très longue, ni de celle-là à cause de sa grand’mère qui sent mauvais, ni de celle-là à cause de son ambition et de son œil vide ! » et ainsi de suite, refusant toutes les princesses que Saleh lui énumérait.
Alors Saleh lui dit : « Ô ma sœur, tu as raison d’être difficile dans le choix d’une épouse pour ton fils qui n’a point son pareil sur la terre et sous la mer ! Mais je t’ai déjà énuméré toutes les jeunes filles disponibles, et il ne m’en reste plus qu’une seule à te proposer ! » Puis il s’arrêta et, hésitant, il dit : « Il faut auparavant que je m’assure si mon neveu est bien endormi ; car je ne puis te parler de cette jeune fille devant lui : j’ai des motifs pour prendre cette précaution…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … je ne puis te parler de cette jeune fille devant lui : j’ai des motifs pour prendre cette précaution ! »
Alors Fleur-de-Grenade s’approcha de son fils et le tâta et le palpa et l’écouta respirer ; et, comme il avait l’air d’être plongé dans un pesant sommeil, car il avait mangé d’un plat d’oignons qu’il affectionnait beaucoup et qui lui procurait d’ordinaire une sieste très lourde, elle dit à Saleh : « Il dort ! Tu peux sortir ce que tu as ! » Il dit : « Sache donc, ô ma sœur, que si je prends cette précaution, c’est que j’ai à te parler maintenant d’une princesse de la mer qui est extrêmement difficile à obtenir en mariage, non point à cause d’elle, mais à cause du roi, son père. Aussi il n’est guère utile que mon neveu entende parler d’elle, avant que nous soyons sûrs de l’affaire ; car l’amour, ô ma sœur, tu le sais, se transmet plus souvent par l’oreille que par les yeux, chez nous, musulmans, dont les femmes et les filles ont le visage couvert du voile pudique. » Et la reine dit : « Ô mon frère, tu as raison ! car l’amour est d’abord un jet de miel qui ne tarde pas à se transformer en une vaste mer salée de perdition ! Mais hâte-toi, de grâce ! de me dire le nom de cette princesse et de son père ! » Il dit : « C’est la princesse Gemme, fille du roi Salamandre le marin. »
En entendant ce nom, Fleur-de-Grenade s’écria : « Ah ! je me souviens maintenant de cette princesse Gemme ! Quand je vivais encore dans la mer, c’était une enfant d’un an à peine, mais belle entre toutes les petites de son âge. Comme elle doit être devenue merveilleuse, depuis ! » Saleh répondit : « Merveilleuse, elle l’est, en vérité, et ni sur la terre ni dans les royaumes de dessous les eaux on n’a vu pareille beauté ! Oh ! ma sœur, qu’elle est délicieuse et gentille et douce et savoureuse et charmante ! Et un teint ! Et des cheveux ! Et des yeux ! Et une taille ! Et une croupe, heu ! lourde, tendre et ferme à la fois et nonchalante, et ronde de tous les côtés sans exception ! Si elle se balance, elle fait envie au rameau du bân ! Si elle se tourne, les antilopes et les gazelles se cachent ! Si elle se découvre, elle rend honteux le soleil et la lune ! Si elle bouge, elle renverse ! Si elle appuie, elle tue ! Et si elle s’assied, sa trace est si profonde qu’elle ne s’en va plus ! Comment alors, si brillante et si parfaite, ne s’appellerait-elle pas Gemme ? » Et Fleur-de-Grenade répondit : « Certes ! de lui avoir donné ce nom, que sa mère a été bien inspirée d’Allah l’Omniscient ! Voilà vraiment celle qui convient, comme épouse, à mon fils Sourire-de-Lune ! »
Tout cela ! Et Sourire-de-Lune feignait de dormir, mais se délectait en son âme et se trémoussait en pensée de l’espoir de posséder bientôt cette princesse marine si pesante et si fine !
Mais Saleh bientôt ajoutait : « Seulement, ô ma sœur, que te dirai-je du père de la princesse Gemme, le roi Salamandre ? C’est un brutal, un grossier, un détestable ! Il a déjà refusé sa fille à plusieurs princes qui la lui demandaient en mariage, et les a même honteusement chassés après leur avoir cassé les os ! Aussi je ne sais trop quel accueil il va nous faire, ni de quel œil il va regarder notre demande ! Et me voici à cause de cela à la limite de la perplexité ! » La reine répondit : « L’affaire est bien délicate ! Et il nous faut y penser longtemps, et ne point secouer l’arbre avant que le fruit soit mûr ! » Et Saleh conclut : « Oui ! réfléchissons, et après, nous verrons ! » Puis, comme, à ce moment, Sourire-de-Lune faisait mine de se réveiller, ils cessèrent de parler, se réservant de reprendre la conversation plus tard, au point où ils la laissaient. Et voilà pour eux !
Quant à Sourire-de-Lune, il se leva sur son séant, comme s’il n’avait rien entendu, et s’étira tranquillement ; mais, en son intérieur, son cœur brûlait d’amour et grésillait comme sur un cendrier rempli de charbons ardents…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… mais, en son intérieur, son cœur brûlait d’amour et grésillait comme sur un cendrier rempli de charbons ardents !
Or, il se garda bien de dire le moindre mot à ce sujet à sa mère et à son oncle, et il se retira de bonne heure et passa seul toute cette nuit-là en proie à ce tourment si nouveau pour lui ; et il réfléchit, lui aussi, au meilleur moyen d’arriver le plus promptement au but de ses désirs. Et il n’est point utile de dire qu’il resta, jusqu’au matin, sans pouvoir fermer l’œil un instant.
Aussi, dès l’aube, il se leva et alla réveiller son oncle Saleh, qui avait passé la nuit au palais, et lui dit : « Ô mon oncle, je désire aller ce matin me promener sur le rivage, car ma poitrine est rétrécie, et l’air de la mer la dilatera. Je te prie donc de m’accompagner dans ma promenade ! » Et le prince Saleh répondit : « Entendre, c’est obéir ! » Et il sauta sur ses deux pieds, et sortit avec son neveu sur le rivage.
Longtemps ils marchèrent ensemble, sans que Sourire-de-Lune adressât la parole à son oncle. Et il était pâle, avec des larmes dans le coin des yeux. Mais soudain il s’arrêta et, s’étant assis sur un rocher, il improvisa ces vers et les chanta, en regardant la mer :
« Si l’on me dit,
Au milieu de l’incendie,
Alors que flambe mon cœur,
Si l’on me dit :
— « La voir, préfères-tu,
Ou boire une gorgée
D’eau fraîche et pure ?
Que répondras-tu ? »
— « La voir et mourir ! »
Ô cœur devenu si tendre,
Depuis qu’en toi s’est incrustée
La Gemme de Salamandre ! »
Lorsque le prince Saleh eut entendu ces vers chantés tristement par le roi son neveu, il frappa ses mains l’une contre l’autre, à la limite du désespoir, et s’écria : « La ilah ill’Allah ! oua Mohammâd rassoul Allah ! Et il n’y a de majesté et de puissance qu’en Allah le Glorieux, le Très-Grand ! Ô mon enfant, tu as donc entendu ma conversation d’hier avec ta mère au sujet de la princesse Gemme, fille du roi Salamandre le marin ? Ô notre calamité ! car je vois, ô mon enfant, que ton esprit et ton cœur travaillent déjà beaucoup à son sujet, alors que rien n’est fait, et que la chose est difficile à traiter ! » Sourire-de-Lune répondit : « Ô mon oncle, c’est la princesse Gemme qu’il me faut, et non point une autre ! Sans quoi je mourrai ! » Il dit : « Alors, ô mon enfant, rentrons auprès de ta mère afin que je la mette au courant de ton état, et lui demande la permission de t’emmener avec moi dans la mer, pour aller au royaume de Salamandre le marin demander pour toi la princesse Gemme en mariage ! » Mais Sourire-de-Lune s’écria : « Non ! ô mon oncle, je ne veux point demander à ma mère une permission qu’elle me refusera certainement ! Car elle aura peur pour moi du roi Salamandre, qui a de mauvaises manières ; et elle me dira aussi que mon royaume ne peut rester sans son roi, et que les ennemis du trône profiteront de mon absence pour usurper ma place ! Je connais ma mère, et je sais d’avance ce qu’elle me dira ! » Puis Sourire-de-Lune se mit à pleurer beaucoup devant son oncle, et ajouta : « Je veux aller tout de suite avec toi chez le roi Salamandre, sans prévenir ma mère ! Et nous reviendrons bien vite, avant qu’elle ait le temps de s’apercevoir de mon absence ! »
Lorsque le prince Saleh vit que son neveu s’obstinait dans cette résolution, il ne voulut pas le peiner davantage, et dit : « Je mets ma confiance en Allah, à tout événement ! » Puis il tira de son doigt une bague sur laquelle étaient gravés quelques noms d’entre les noms, et la passa au doigt de son neveu, en lui disant : « Cette bague te protégera encore mieux contre les dangers sous-marins, et achèvera de te munir de nos vertus maritimes ! » Et tout de suite il ajouta : « Fais comme moi ! » Et il s’éleva légèrement en l’air, en quittant le rocher. Et Sourire-de-Lune, pour l’imiter, frappa du pied le sol, et quitta le rocher pour s’élever avec son oncle dans les airs. Et de là ils décrivirent une courbe descendante vers la mer, où ils plongèrent tous deux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Et de là ils décrivirent une courbe descendante vers la mer, où ils plongèrent tous deux.
Et Saleh voulut d’abord montrer à son neveu sa demeure sous-marine, afin que la vieille reine Sauterelle pût recevoir chez elle le fils de sa fille, et que les cousines de Fleur-de-Grenade eussent la joie de revoir chez elles leur cher petit cousin. Et ils ne mirent pas beaucoup de temps à y arriver ; et le prince Saleh introduisit tout de suite Sourire-de-Lune dans l’appartement de l’aïeule. Or, justement, dame Sauterelle était assise au milieu des jeunes filles, ses parentes ; et, dès qu’elle vit entrer Sourire-de-Lune, elle le reconnut et éternua de plaisir. Et Sourire-de-Lune s’approcha et lui baisa la main, et baisa la main à ses cousines ; et toutes l’embrassèrent avec émotion, en poussant des cris de joie d’un ton très aigu ; et la grand’mère le fit s’asseoir à côté d’elle et l’embrassa entre les deux yeux, et lui dit : « Ô arrivée bénie ! ô jour de lait ! Tu illumines la demeure, ô mon enfant ! Mais comment va ta mère Fleur-de-Grenade ? » Il répondit : « Elle est en excellente santé et dans le bonheur parfait, et me charge de transmettre ses salams à toi et aux filles de son oncle ! » Voilà ce qu’il dit ! Mais ce n’était pas la vérité, puisqu’il était parti sans prendre congé de sa mère. Mais pendant que Sourire-de-Lune, entraîné par ses cousines qui voulaient lui montrer toutes les merveilles de leur palais, s’était éloigné avec elles, le prince Saleh se hâta de mettre sa mère au courant de l’amour qui était entré par l’oreille de son neveu et s’était emparé de son cœur, sur le seul récit des charmes de la princesse Gemme, fille du roi Salamandre. Et il lui raconta l’aventure depuis le commencement jusqu’à la fin, et ajouta : « Et il n’est venu ici avec moi que pour la demander en mariage à son père ! »
Lorsque la grand’mère du roi Sourire-de-Lune eut entendu ces paroles de Saleh, elle fut à la limite de l’indignation contre son fils, et lui reprocha violemment de n’avoir pas pris assez de précautions pour parler de la princesse Gemme en présence de Sourire-de-Lune, et lui dit : « Tu sais bien pourtant combien le roi Salamandre le marin est un homme violent, plein d’arrogance et de stupidité, et qu’il est avare de sa fille qu’il a refusée déjà à tant de jeunes princes ! Et tu ne crains pas de nous mettre dans une situation humiliante vis-à-vis de lui, en nous amenant à lui faire une demande qu’il repoussera sans aucun doute ! Et alors nous, qui tenons à notre honneur, nous serons bien humiliés et nous reviendrons de là avec le nez allongé certainement ! En vérité, mon fils, dans aucun cas et de n’importe quelle façon, tu n’aurais dû prononcer le nom de cette princesse, surtout devant le fils de ta sœur, fût-il même endormi par un soporifique ! » Saleh répondit : « Oui ! mais la chose est faite maintenant, et le jeune homme est si amoureux de la jeune fille, qu’il m’a affirmé que, s’il ne la possédait pas, il mourrait ! Et puis quoi, à la fin ? Sourire-de-Lune est au moins aussi beau que la princesse Gemme, et il est le descendant d’une illustre lignée de rois, et il est lui-même roi d’un puissant empire terrestre ! Car enfin il n’y a pas seulement que ce stupide Salamandre qui soit roi ! Et puis que pourra-t-il m’objecter que je ne puisse résoudre en lui en opposant la contre-partie ? Il me dira que sa fille est riche, je lui dirai que notre fils est plus riche ! Que sa fille est belle, mais notre fils est plus beau ! Que sa fille est de noble lignée, mais notre fils est encore d’une plus noble lignée ! Et ainsi de suite, ô ma mère, jusqu’à ce que je le convainque qu’en somme il a tout à gagner en consentant à ce mariage ! En tout cas, c’est moi qui suis, par mon indiscrétion, la cause de l’affaire ; et il est juste que je prenne sur moi de la mener à bonne fin, au risque même de me faire casser les os et de rendre l’âme ! » Et la vieille reine Sauterelle, voyant qu’il n’y avait plus, en effet, que cette solution, dit en soupirant : « Qu’il eût été préférable, mon fils, de ne jamais susciter cette dangereuse affaire-là ! Mais puisque c’est la destinée, je me résous, mais bien à contre-foie, à te laisser partir. Mais je garde auprès de moi Sourire-de-Lune jusqu’à ton retour ; car je ne veux pas l’exposer ainsi, sans savoir rien de précis ! Pars donc sans lui, et surtout veille sur tes paroles, de peur qu’un mot malsonnant ne mette en fureur ce roi brutal et grossier, qui ne tient compte de rien et traite tout le monde avec une égale impertinence ! » Et Saleh répondit : « J’écoute et j’obéis ! »
Il se leva alors et prit avec lui deux grands sacs remplis de cadeaux de valeur destinés au roi Salamandre ; et il chargea ces deux sacs sur le dos de deux esclaves, et prit avec eux la route marine qui conduisait au palais du roi Salamandre…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT TRENTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… et prit avec eux la route marine qui conduisait au palais du roi Salamandre.
En arrivant au palais, le prince Saleh demanda la permission d’entrer parler au roi : et on la lui accorda. Et il entra dans la salle où se tenait, assis sur un trône d’émeraude et d’hyacinthe, le roi Salamandre le marin. Et Saleh lui fit ses souhaits de paix de la manière la plus choisie, et déposa à ses pieds les deux grands sacs, remplis de magnifiques cadeaux, que portaient les esclaves sur leur dos. Et le roi, à cette vue, rendit à Saleh ses souhaits de paix, l’invita à s’asseoir et lui dit : « Sois le bienvenu, prince Saleh ! Il y a longtemps que je ne t’ai vu, et j’en suis assez attristé ! Mais hâte-toi de me demander ce pour quoi tu es venu me voir ; car quand on fait un cadeau, c’est toujours dans l’espoir d’obtenir en retour une chose proportionnée ! Parle donc, et je verrai si je puis faire quelque chose pour toi ! » Alors Saleh s’inclina une seconde fois profondément devant le roi, et dit : « Oui ! j’ai une chose en commission que je ne veux obtenir que d’Allah et du roi magnanime, du vaillant lion, de l’homme généreux dont la renommée de gloire, de magnificence, de libéralité, de gracieuseté, de clémence et de bonté s’est étendue au loin des terres et des mers, et dont s’entretiennent avec admiration, le soir, sous les tentes, les caravanes ! » Et le roi Salamandre, à ce discours, diminua le froncement terrible de ses sourcils qui se rejoignaient, et dit : « Expose ta demande, ô Saleh, et elle entrera dans une oreille sensible et un esprit bien disposé ! Si je puis te satisfaire, je le ferai en t’évitant les retards ; mais si je ne le puis pas, ce ne sera pas par mauvais vouloir ! Car Allah, ô Saleh, ne demande point d’une âme un contenu qui dépasse sa capacité ! » Alors Saleh s’inclina devant le roi plus profondément encore que les deux premières fois, et dit : « Ô roi du temps, la chose que j’ai à te demander, tu peux, en vérité, me l’accorder, car elle est en ton pouvoir et sous ta seule autorité ! Et je ne me serais certainement pas hasardé à venir te la demander, si je n’avais pas eu d’avance la certitude qu’elle était dans les possibilités ! Car le sage a dit : « Si tu veux être agréé, ne demande pas l’impossible ! » Et moi, ô roi (qu’Allah te conserve pour notre bonheur !) je ne suis ni dément ni prétentieux ! Or donc, voici ! Sache, ô roi plein de gloire, que je viens chez toi en intermédiaire seulement ! Et c’est, ô roi magnanime, ô généreux, ô le plus grand, pour demander de toi la perle unique, le joyau inestimable, le trésor cacheté, ta fille la princesse Gemme, en mariage pour mon neveu le roi Sourire-de-Lune, fils du roi Schahramân et de la reine Fleur-de-Grenade, ma sœur, et maître de la Ville-Blanche et des royaumes terrestres qui s’étendent des frontières de la Perse jusqu’aux extrêmes limites du Khorassân ! »
Lorsque le roi Salamandre le marin eut entendu ce discours de Saleh, il se mit à rire tellement qu’il se renversa sur son derrière, et là il continua à se convulser et à se trémousser en donnant de grands coups de pieds en l’air ! Après quoi il se releva et, regardant Saleh en silence, il lui cria soudain : « Ho ! Ho ! » Et de nouveau il se mit à rire et à se convulser, et si fort et si longtemps qu’il finit par lancer un pet retentissant. Et, de la sorte, il se calma et dit à Saleh : « En vérité, ô Saleh, je t’ai toujours cru un homme sensé et pondéré, mais je vois bien à présent combien je me trompais ! Ou alors, dis-moi ! qu’as-tu fait de ton bon sens et de ta raison pour oser me faire une demande si folle ? » Mais Saleh, sans se troubler ni perdre contenance, répondit : « Je ne sais pas ! Mais il y a une chose certaine, c’est que le roi Sourire-de-Lune, mon neveu, est au moins aussi beau et aussi riche et d’une aussi noble lignée que ta fille, la princesse Gemme ! Et si la princesse Gemme n’est point faite pour un tel mariage, pour quelle chose alors est-elle faite, dis-le-moi ? Car le sage n’a-t-il point dit : « Pour la jeune fille il n’y a que le mariage ou le tombeau ! » C’est pourquoi les vieilles filles sont inconnues chez nous musulmans ! Hâte-toi donc, ô roi, de saisir cette occasion de sauver ta fille du tombeau ! »
À ces paroles, le roi Salamandre fut à la limite de la fureur, et, se levant sur ses deux pieds, avec les sourcils contractés et du sang dans les yeux, il cria à Saleh : « Ô chien des hommes, est-ce que ceux qui te ressemblent peuvent prononcer en public le nom de ma fille ? Quoi donc es-tu, toi, sinon un chien fils de chien ? Et qui est ton neveu Sourire-de-Lune ? Et qui est son père ? Et qui est ta sœur ? Tous, des chiens fils de chiens ! » Puis il se tourna vers ses gardes, et leur cria : « Hé, vous autres ! empoignez-moi cet entremetteur, et cassez-lui les os ! »
Aussitôt les gardes se précipitèrent sur Saleh et voulurent le saisir et le renverser ; mais, rapide comme l’éclair, il s’échappa de leurs mains et s’élança au dehors pour prendre la fuite. Mais là, à sa surprise extrême, il vit mille cavaliers montés sur des chevaux marins, et couverts de cuirasses d’acier et armés des pieds à la tête, et qui étaient tous de ses parents et des gens de sa maison ! Et ils venaient d’arriver à l’instant même, envoyés par sa mère la reine Sauterelle qui, ayant pressenti la mauvaise réception que pouvait lui faire le roi Salamandre, avait songé, par précaution, à envoyer ces mille hommes pour le défendre contre tout événement !
Alors Saleh, en peu de mots, leur raconta ce qui venait de se passer, et leur cria : « Et maintenant sus à ce roi stupide et fou ! » Alors les mille guerriers sautèrent de leurs chevaux, dégainèrent leurs glaives, et se précipitèrent en un seul bloc derrière le prince Saleh dans la salle du trône…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors les mille guerriers sautèrent de leurs chevaux, dégainèrent leurs glaives, et se précipitèrent en un seul bloc derrière le prince Saleh dans la salle du trône.
Quant au roi Salamandre, lorsqu’il vit entrer avec fracas ce torrent subit de guerriers ennemis qui se répandaient comme les ténèbres de la nuit, il ne perdit point contenance et cria à ses gardes : « Sus à ce bouc des lâches et à son troupeau ! Et que vos sabres soient plus proches de leurs têtes que leur salive n’est proche de leurs langues ! »
Et aussitôt les gardes poussèrent leur cri de guerre : « Ya-lé-Salamandre ! » Et les guerriers de Saleh poussèrent leur cri de guerre : « Ya-lé-Saleh ! » Et les deux partis se ruèrent et s’entrechoquèrent comme les flots de la mer tumultueuse ! Et le cœur des guerriers de Saleh était plus ferme que le roc, et leurs sabres tournoyants se mirent à accomplir les arrêts du destin ! Et Saleh le valeureux, le héros au cœur de granit, le cavalier du sabre et de la lance, frappait les cous et transperçait les poitrines, avec des bonds à renverser les rochers des montagnes ! Oh ! la terrible mêlée ! Quel épouvantable carnage ! Que de cris étouffés dans les gosiers par la pointe des lances brunes ! Que de femmes rendues veuves avec leurs enfants orphelins !… Et le combat continuait acharné, les coups retentissaient, les corps gémissaient sous les blessures douloureuses, et les terres sous-marines tremblaient sous les chocs des guerriers pesants ! Mais que peuvent les sabres et toutes les armes contre les arrêts du destin ? Et depuis quand les créatures peuvent-elles retarder ou devancer l’heure marquée pour leur terme fatal ? Aussi, au bout d’une heure de lutte, les cœurs des gardes de Salamandre ne tardèrent pas à devenir semblables aux pots fragiles ; et tous, jusqu’au dernier, jonchèrent le sol autour du trône de leur roi. Et Salamandre, à cette vue, entra dans une telle rage que ses testicules extraordinaires, qui pendaient jusqu’à ses genoux, se rétractèrent jusqu’à son nombril ! Et il se précipita, en écumant, contre Saleh qui le reçut à la pointe de sa lance et lui cria : « Te voici, ô perfide et brutal, à la limite extrême de la mer de la perdition ! » Et, d’un coup retentissant, il le renversa sur le sol et l’y maintint solidement, jusqu’à ce que ses guerriers l’eussent aidé à le charger de liens et à lui attacher les bras derrière le dos ! Et voilà pour tous ceux-là !
Mais pour ce qui est de la princesse Gemme et de Sourire-de-Lune, voici !
Dès les premiers bruits de la bataille qui se livrait dans le palais, la princesse Gemme, affolée, s’était enfuie avec une de ses servantes, nommée Myrte, et, ayant traversé les régions marines, elle était montée à la surface de l’eau et avait continué sa course jusqu’à ce qu’elle eût atteint une île déserte où elle s’était sauvée en se cachant au haut d’un grand arbre feuillu. Et sa servante Myrte l’avait imitée, et s’était également cachée au haut d’un autre arbre où elle avait grimpé.
Or, le destin voulut que la même chose se passât au palais de la vieille reine Sauterelle. En effet, les deux esclaves qui avaient accompagné le prince Saleh au palais de Salamandre pour porter les sacs des cadeaux, s’étaient eux aussi, dès le commencement de la bataille, hâtés de se sauver et de courir annoncer la nouvelle du danger à la reine Sauterelle. Et le jeune roi Sourire-de-Lune, qui avait interrogé les esclaves à leur arrivée, avait été très alarmé de ces nouvelles peu rassurantes, et s’était considéré, en son âme, comme la cause première du grand danger que courait son oncle et du trouble apporté dans l’empire sous-marin. Aussi, comme il était très timide devant sa grand’mère Sauterelle, il n’avait pas eu le courage de se présenter devant elle après le danger où se trouvait, à cause de lui, le prince Saleh, son oncle. Et il avait profité du moment où sa grand’mère était occupée à écouter le rapport des esclaves, pour s’élancer du fond de la mer et remonter à la surface afin de retourner près de sa mère Fleur-de-Grenade, dans la Ville-Blanche. Mais comme il était ignorant du chemin à suivre, il s’était égaré et était arrivé dans la même île déserte où s’était sauvée la princesse Gemme. Dès qu’il eut touché terre, comme il se sentait fatigué de la course pénible qu’il venait de faire, il alla s’étendre au pied de l’arbre même où se trouvait la princesse Gemme. Et il ne savait pas que la destinée de chaque homme l’accompagne partout où il va, courût-il plus vite que le vent, et qu’il n’y a point de repos pour le poursuivi ! Et il ne se doutait point de ce que, du fond de l’éternité, lui réservait le sort mystérieux.
Une fois donc étendu au pied de l’arbre, il appuya sa tête sur son bras pour dormir, et soudain, en levant les yeux vers le haut de l’arbre, il rencontra le regard de la princesse et son visage, et il crut d’abord voir la lune elle-même entre les branches. Et il s’écria : « Gloire à Allah qui a créé la lune pour illuminer les soirs et éclairer la nuit ! » Puis, en regardant avec plus d’attention, il reconnut que c’était une beauté humaine, et qu’elle appartenait à une adolescente comme la lune…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… il reconnut que c’était une beauté humaine, et qu’elle appartenait à une adolescente comme la lune. Et il pensa : « Par Allah ! je vais tout de suite monter l’attraper et lui demander son nom ! Car elle ressemble étrangement au portrait admirable que m’a fait mon oncle Saleh de la princesse Gemme ! Et qui sait si ce n’est point elle-même ? Elle a dû peut-être prendre la fuite du palais de son père, dès le début du combat ! » Et, ému à l’extrême, il sauta sur ses pieds et, se tenant debout au-dessous de l’arbre, il leva les yeux vers l’adolescente et lui dit : « Ô but suprême de tout désir, qui es-tu et pour quel motif te trouves-tu dans cette île, au haut de cet arbre ? » Alors la princesse se pencha un peu vers le bel adolescent et lui sourit, et dit d’une voix chantante comme l’eau : « Ô charmant jouvenceau, ô très beau, je suis la princesse Gemme, fille du roi Salamandre le marin ! Et je suis ici, car j’ai fui ma patrie, et les demeures de la patrie, et mon père et ma famille, pour échapper au triste sort des vaincus ! Car le prince Saleh, à l’heure qu’il est, a dû réduire mon père en esclavage après avoir massacré tous ses gardes. Et il doit me chercher partout dans le palais ! Hélas ! hélas ! Ô dur exil loin des miens ! Ô malheureux sort du roi mon père ! Hélas ! hélas ! » Et de grosses larmes tombèrent de ses beaux yeux sur le visage de Sourire-de-Lune, qui levait les bras en l’air d’émotion et de saisissement, et qui finit par s’écrier : « Ô princesse Gemme, âme de mon âme, ô rêve de mes nuits sans sommeil, descends, de grâce ! de cet arbre, car je suis le roi Sourire-de-Lune fils de Fleur-de-Grenade, la reine native, comme toi, de la mer ! Ô ! descends, car je suis l’assassiné de tes yeux, l’esclave captif de ta beauté ! » Et l’adolescente, comme ravie, s’écria : « Ya Allah ! ô mon maître, c’est donc toi le beau Sourire-de-Lune, neveu de Saleh et fils de la reine Fleur-de-Grenade ? » Il dit : « Mais oui ! descends, je t’en prie ! » Elle dit : « Ô ! que mon père a donc été peu sage de refuser pour sa fille un époux tel que toi ! Que pouvait-il souhaiter de mieux ? Et où pouvait-il trouver un prince plus beau et plus charmant, sur la terre ou sous les mers ! Ô mon chéri, ne blâme pas trop le refus irréfléchi de mon père, car moi je t’aime ! Et si toi tu m’aimes grand comme un empan, moi je t’aime gros comme le bras ! Dès que je t’ai vu, l’amour que tu as pour moi s’est transporté dans mon foie, et je suis devenue la victime de ta beauté ! »
Et, après avoir prononcé ces paroles, elle se laissa glisser de l’arbre dans les bras de Sourire-de-Lune qui, à la limite de la jubilation, la serra contre sa poitrine et la dévora partout de baisers, alors qu’elle lui rendait caresse pour caresse et mouvement pour mouvement. Et Sourire-de-Lune, à ce contact délicieux, sentit son âme chanter de tous ses oiseaux, et s’écria : « Ô souveraine de mon cœur, ô princesse Gemme tant désirée, toi pour qui j’ai délaissé moi aussi mon royaume, ma mère et le palais de mes pères, certes ! mon oncle Saleh ne m’a détaillé que le quart à peine de tes charmes, alors que les trois autres quarts restent pour moi encore insoupçonnés ! Et il n’a pesé devant moi de ta beauté qu’un carat sur vingt-quatre carats, ô toute d’or ! » Et, ayant dit ces paroles, il continua à la couvrir de baisers, et à la caresser de mille manières. Puis, brûlant de se délecter enfin à sa croupe de bénédictions, sa main hardie descendit vers les glands du cordon. Et l’adolescente, comme pour l’aider dans cette opération, se leva, s’éloigna de quelques pas, et soudain elle étendit toute droite la main dans sa direction, et lui crachant au visage faute d’eau, lui cria : « Ô terrien, quitte ta forme humaine, et deviens un grand oiseau blanc avec le bec et les pieds rouges ! » Et aussitôt Sourire-de-Lune, à la limite de la stupéfaction, fut changé en oiseau aux plumes blanches, aux ailes lourdes et incapables de voler, et au bec et aux pieds rouges ! Et il se mit à regarder l’adolescente, avec des larmes dans les yeux !
Alors la princesse Gemme appela sa servante Myrte, et lui dit : « Prends cet oiseau, qui est le neveu du plus grand ennemi de mon père, de ce Saleh l’entremetteur qui a combattu mon père, et va le porter dans l’Île-Sèche, qui n’est pas loin d’ici, afin qu’il y meure de soif et de faim…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Prends cet oiseau, et va le porter dans l’Île-Sèche, afin qu’il y meure de soif et de faim ! »
Tout cela !
Car la princesse Gemme ne s’était montrée si gracieuse à l’égard de Sourire-de-Lune que pour s’approcher de lui sans inconvénient, et pouvoir de la sorte le métamorphoser en oiseau destiné à mourir d’inanition, et venger ainsi son père et les gardes de son père. Et voilà pour elle !
Quant à l’oiseau blanc ! Lorsque la servante Myrte, pour obéir à sa maîtresse Gemme, l’eut pris, malgré les battements désespérés d’ailes et les cris rauques qu’il poussait, elle eut pitié de lui et n’eut pas le cœur de le transporter dans l’Île-Sèche où l’attendait une si cruelle mort ! Et elle se dit en son âme sensible : « Je vais le porter plutôt dans un endroit où il ne puisse pas mourir d’une façon si cruelle, et où il attendra sa destinée ! Car qui sait si ma maîtresse ne se repentira pas bientôt de son premier mouvement, une fois revenue de sa colère, et ne me reprochera pas de lui avoir trop vite obéi ! » Et là-dessus elle transporta le captif dans une île verdoyante, plantée de toutes sortes d’arbres fruitiers et arrosée de frais ruisseaux, et l’y laissa, pour retourner auprès de sa maîtresse.
Or, laissons pour le moment l’oiseau dans l’île verte, et la princesse Gemme dans la première île, et revenons voir ce qu’est devenu le prince Saleh, victorieux de Salamandre.
Une fois qu’il eut fait enchaîner le roi Salamandre, il l’enferma dans un des appartements du palais, et se fit proclamer roi à sa place. Puis il se hâta de chercher partout la princesse Gemme, mais, bien entendu, il ne la trouva pas. Et lorsqu’il vit que toutes ses recherches étaient vaines, il revint dans son ancienne résidence mettre la reine Sauterelle, sa mère, au courant de tout ce qui venait de se passer. Puis il lui demanda : « Ô ma mère, où est mon neveu le roi Sourire-de-Lune ? » Elle répondit : « Je ne sais pas ! Il doit être en promenade avec ses cousines. Mais je vais envoyer tout de suite le chercher ! » Et comme elle disait ces paroles, les cousines entrèrent, et il n’était pas avec elles. Et on l’envoya chercher partout, mais, bien entendu, nulle part on ne le trouva. Alors la douleur du roi Saleh, de la grand’mère et des cousines fut extrême ; et ils se lamentèrent et pleurèrent beaucoup. Puis Saleh, la poitrine rétrécie, fut bien obligé d’envoyer prévenir de la chose sa sœur la reine Fleur-de-Grenade la marine, mère de Sourire-de-Lune.
Et Fleur-de-Grenade, à la limite de l’affolement, se hâta de plonger dans la mer et de courir au palais de Sauterelle, sa mère. Et, après les embrassades et les pleurs premiers, elle demanda : « Où est mon fils, le roi Sourire-de-Lune ? » Et la vieille mère, après de longs préambules, et des silences pleins de larmes, et, au milieu des sanglots des cousines assises en rond, raconta à sa fille toute l’histoire depuis le commencement jusqu’à la fin. Mais il n’y a point d’utilité à la répéter. Puis elle ajouta : « Et ton frère Saleh, qui a été proclamé roi à la place de Salamandre, a eu beau faire partout des recherches, il n’a pu encore retrouver les traces pas plus de notre fils Sourire-de-Lune que de la princesse Gemme, fille de Salamandre ! »
Lorsque Fleur-de-Grenade eut entendu ces paroles, le monde noircit devant son visage, et la désolation entra dans son cœur, et les sanglots du désespoir la secouèrent toute. Et, pendant un long temps, on n’entendit dans le palais sous-marin, que les cris de deuil des femmes, et les hoquets de la douleur.
Mais il fallut bientôt songer à remédier à un état de choses si étrange et si désolant. Aussi ce fut l’aïeule qui, la première, sécha ses larmes, et dit : « Ma fille, que ton âme ne s’attriste point outre mesure de cette aventure ; car il n’y a pas de raison pour que ton frère ne finisse point par retrouver ton fils Sourire-de-Lune ! Quant à toi, si tu aimes vraiment ton fils et si tu veilles sur ses intérêts, tu feras bien de retourner à ton royaume pour gérer les affaires et tenir à tous secrète la disparition de ton fils. Et Allah pourvoiera ! » Et Fleur-de-Grenade répondit : « Tu as raison, ma mère. Je vais rentrer ! Mais je t’en prie, oh ! de grâce ! ne cesse point de penser à mon fils, et que personne ne se relâche dans les recherches ! Car s’il lui arrive jamais quelque mal, je mourrai sans recours, moi qui ne vois la vie qu’à travers lui et ne goûte de joie qu’à sa vue ! » Et la reine Sauterelle répondit : « Certes ! ma fille, de tout cœur affectueux ! Sois donc sans crainte à ce sujet, et tranquillise ton esprit tout à fait ! » Alors Fleur-de-Grenade prit congé de sa mère, de son frère et de ses cousines, et, la poitrine bien oppressée et l’âme bien triste, elle regagna son royaume et sa ville…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… elle regagna son royaume et sa ville.
Or, maintenant, revenons à l’île verdoyante où la jeune Myrte à l’âme sensible avait déposé Sourire-de-Lune changé par la princesse Gemme en oiseau au plumage blanc, au bec et aux pieds rouges !
Lorsque l’oiseau Sourire-de-Lune se vit abandonné par la secourable Myrte, il se mit à pleurer abondamment ; puis, comme il avait faim et soif, il se mit à manger des fruits et à boire de l’eau courante, tout en pensant à son malheureux sort et en s’étonnant de se voir en oiseau. Et il eut beau essayer ses ailes pour s’envoler, elles ne purent le soutenir dans l’air, car il était très gros et très lourd. Et il finit par se résigner à sa destinée, en pensant : « À quoi me servirait d’ailleurs de quitter cette île, puisque je ne sais où me diriger, et que personne ne voudra reconnaître, à mon extérieur d’oiseau, le roi que je reste en mon dedans ? » Et il continua à vivre dans l’île, assez tristement ; et, le soir, il se juchait sur un arbre pour dormir.
Or, un jour qu’il se promenait tristement sur ses pattes, la tête basse, tant il avait de soucis, il fut aperçu par un oiseleur qui venait dans l’île tendre ses filets de chasse. Et l’oiseleur, charmé par l’aspect magnifique de ce gros oiseau qui n’avait point de pareil et dont le bec rouge et les pieds rouges tranchaient d’une façon si jolie sur la blancheur du plumage, se réjouit fort de pouvoir posséder un tel oiseau dont l’espèce lui était tout à fait inconnue. Il prit donc toutes ses précautions et, avec une adresse lente, il s’approcha derrière lui et d’un coup subtil lança sur lui son filet et le captura. Et, riche de cette belle pièce de gibier, il retourna à la ville d’où il était venu, en portant délicatement par les pattes le grand oiseau sur son épaule.
Et l’oiseleur, en arrivant en ville, se dit : « Par Allah ! moi, de ma vie, je n’ai vu un oiseau pareil à celui-ci, pas plus dans mes chasses sur terre que sur mer. Aussi je me garderai bien de le vendre à un acheteur ordinaire, qui ne peut en connaître ni le prix ni la valeur, et qui probablement le tuera et avec sa famille le mangera ; mais je vais aller le porter en cadeau au roi de la ville, qui s’émerveillera de sa beauté, et m’en dommagera précieusement ! » Et il alla au palais et le porta au roi qui, à sa vue, fut charmé à l’extrême, et admira surtout la belle couleur rouge du bec et des ailes. Et il l’accepta et donna dix dinars d’or à l’oiseleur qui embrassa la terre et s’en alla.
Alors le roi fit faire une grande cage avec un treillis en or, et y enferma le bel oiseau. Et il mit devant lui des grains de maïs et de blé, mais l’oiseau n’y porta point le bec. Et le roi, étonné, se dit : « Il n’en mange pas ! Je vais lui porter autre chose ! » Et il le fit sortir de la cage et mit devant lui du blanc de poulet, des tranches de viande et des fruits. Et aussitôt l’oiseau se mit à en manger avec un plaisir notoire, en faisant de petits cris et en gonflant ses plumes blanches. Et le roi, à cette vue, se trémoussa de joie et dit à un des esclaves : « Cours vite prévenir ta maîtresse, la reine, que j’ai acheté un oiseau prodigieux qui est un miracle d’entre les miracles du temps, afin qu’elle vienne l’admirer avec moi, et voir la façon merveilleuse dont il mange de tous ces mets dont ne se nourrissent pas d’ordinaire les oiseaux ! » Et l’esclave se hâta d’aller appeler la reine qui ne tarda pas à arriver.
Mais, dès qu’elle eut aperçu l’oiseau, la reine se couvrit vivement le visage de son voile, et, indignée, recula vers la porte et voulut sortir. Et le roi courut derrière elle et lui demanda, en la retenant par son voile : « Pourquoi te couvres-tu le visage, alors qu’ici il n’y a que moi, ton époux, et les eunuques et les servantes ? » Elle répondit : « Ô roi, sache que cet oiseau n’est point un oiseau, mais c’est un homme comme toi ! Et il n’est autre que le roi Sourire-de-Lune, fils de Schahramân et de Fleur-de-Grenade la marine. Et il a été ainsi métamorphosé par la princesse Gemme, fille de Salamandre le marin, qui vengea de la sorte son père vaincu par Saleh, oncle de Sourire-de-Lune ! »
En entendant ces paroles, le roi s’étonna à la limite de l’étonnement et s’écria : « Qu’Allah confonde la princesse Gemme et lui coupe la main ! Mais par Allah sur toi, ô fille de mon oncle, donne-moi des détails sur la chose ! » Et la reine, qui était la magicienne la plus insigne de son temps, lui raconta toute l’histoire sans en omettre un détail. Et le roi, prodigieusement émerveillé, se tourna vers l’oiseau et lui demanda : « Est-ce vrai tout cela ? » Et l’oiseau…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… se tourna vers l’oiseau et lui demanda : « Est-ce vrai tout cela ? » Et l’oiseau baissa la tête, en signe d’assentiment, et battit des ailes. Alors le roi dit à son épouse : « Qu’Allah te bénisse, ô fille de l’oncle ! Mais par ma vie devant tes yeux ! hâte-toi de le délivrer de cet enchantement ! ne le laisse pas dans ce tourment ! » Alors la reine, s’étant couvert tout à fait le visage, dit à l’oiseau : « Ô Sourire-de-Lune, entre dans cette grande armoire ! » Et l’oiseau obéit tout de suite et entra dans une grande armoire, cachée dans le mur, que la reine venait d’ouvrir ; et elle entra derrière lui, avec, à la main, une tasse d’eau sur laquelle elle prononça des paroles inconnues ; et l’eau se mit à bouillonner dans la tasse. Alors elle en prit quelques gouttes qu’elle lui lança au visage, en lui disant : « Par la vertu des Noms Magiques et des Puissantes Paroles, et par la majesté d’Allah l’Omnipotent, le Créateur du ciel et de la terre, le Résurrecteur des morts, le Fixateur des termes et le Distributeur des destinées, je t’ordonne de quitter cette forme d’oiseau et de reprendre celle que tu as reçue du Créateur ! »
Et aussitôt il trembla d’un tremblement, et se secoua d’une secousse, et revint à sa forme première. Et le roi, émerveillé, vit que c’était un adolescent qui n’avait pas son pareil sur la face de la terre. Et il s’écria : « Par Allah ! il mérite son nom de Sourire-de-Lune ! »
Or, dès que Sourire-de-Lune se vit revenu à son premier état, il s’écria : « La ilah ill’Allah, oua Môhammâd rassoul Allah ! » Puis il s’approcha du roi, lui baisa la main et lui souhaita une longue vie. Et le roi lui baisa la tête et lui dit : « Sourire-de-Lune, je te prie de me raconter toute ton histoire, dès ta naissance jusqu’aujourd’hui ! » Et Sourire-de-Lune raconta au roi, qui s’en émerveilla à l’extrême, toute son histoire, sans en omettre un détail.
Alors le roi, arrivé à l’extrême limite du plaisir, dit au jeune roi délivré de l’enchantement : « Que veux-tu maintenant, ô Sourire-de-Lune, que je fasse pour toi ? Parle-moi en toute confiance ! » Il répondit : « Ô roi du temps, je voudrais bien rentrer dans mon royaume ! Car, il y a déjà bien longtemps que j’en suis absent, et je crains beaucoup que les ennemis du trône ne profitent de mon éloignement pour usurper ma place. Et puis, ma mère doit être bien anxieuse de ma disparition ! Et qui sait si, dans le doute, elle survit encore à sa douleur et à ses soucis ? » Et le roi, touché par sa beauté et gagné par sa jeunesse et sa piété, répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et il fit préparer sur l’heure un navire, muni de ses provisions, de ses agrès, de ses marins et de son capitaine, où le roi Sourire-de-Lune, après les souhaits de l’adieu et les remercîments, s’embarqua en se fiant à sa destinée.
Mais cette destinée lui réservait encore, dans l’invisible, d’autres aventures ! En effet, cinq jours après le départ, une tempête furieuse s’éleva qui désempara et brisa le navire contre une côte rocheuse, et seul Sourire-de-Lune, à cause de son imperméabilité, put se sauver à la nage et gagner la terre ferme.
Et au loin il vit émerger une ville comme une colombe très blanche, qui, située sur le sommet d’une montagne, dominait la mer. Et soudain, du haut de cette montagne, il vit s’approcher et dévaler sur lui, avec une rapidité d’ouragan, un galop forcené de chevaux, de mulets et d’ânes, innombrables comme les grains de sable. Et cette troupe galopante et effarée s’arrêta tout autour de lui. Et tous les ânes, avec les chevaux et les mulets, se mirent à lui faire de la tête des signes évidents qui signifiaient : « Retourne là d’où tu es venu ! » Mais comme il s’obstinait à rester, les chevaux se mirent à hennir et les mulets se mirent à souffler et les ânes se mirent à braire, mais c’étaient des hennissements, des souffles et des braiements de douleur et de désespoir. Et quelques-uns même se mirent notoirement à pleurer, en reniflant. Et ils poussaient du museau délicatement Sourire-de-Lune, immobile, qui se défendait de retourner à l’eau. Puis comme, au lieu de revenir sur ses pas, il allait de l’avant vers la ville, les animaux à quatre pieds se mirent à marcher qui devant lui, qui derrière lui, en lui faisant comme un cortège funèbre d’autant plus impressionnant que Sourire-de-Lune reconnaissait dans les cris qu’ils poussaient comme une vague psalmodie, en langue arabe, semblable à celle que poussent devant les morts les lecteurs du Korân…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Sourire-de-Lune reconnaissait dans les cris qu’ils poussaient comme une vague psalmodie, en langue arabe, semblable à celle que poussent devant les morts les lecteurs du Korân.
Et Sourire-de-Lune, ne sachant plus s’il dormait, s’il était à l’état de veille, ou si tout cela n’était qu’un effet trompeur de son état de fatigue, se mit à marcher comme on marche dans les rêves, et arriva de la sorte sur la colline, à l’entrée de la ville perchée sur le sommet. Et il vit, assis à la porte d’une boutique de droguiste, un cheikh à barbe blanche auquel il se hâta de souhaiter la paix. Et le cheikh, de son côté, en le voyant si beau, fut charmé à l’extrême, et se leva, lui rendit son salam et s’empressa de faire de la main aux animaux à quatre pieds signe de s’éloigner. Et ils s’éloignèrent, tout en tournant la tête de temps à autre, comme pour marquer l’intensité de leurs regrets ; puis ils se dispersèrent de tous côtés et disparurent.
Alors Sourire-de-Lune, interrogé par le vieux cheikh, raconta en quelques mots son histoire, puis dit au cheikh : « Ô mon oncle vénérable, peux-tu me dire, à ton tour, quelle est cette ville, et qui sont ces étranges animaux à quatre pieds qui m’accompagnaient en se lamentant ? » Le cheikh répondit : « Mon fils, entre d’abord dans ma boutique, et assieds-toi là ! Car tu dois avoir besoin de nourriture. Et après, je te dirai ce que je puis te dire ! » Et il le fit entrer et s’asseoir sur un divan, au fond de la boutique, et lui apporta à manger et à boire. Et lorsqu’il l’eut bien restauré et rafraîchi, il l’embrassa entre les deux yeux et lui dit : « Remercie Allah, ô mon fils, qui t’a fait me rencontrer avant que t’ait vue la reine d’ici ! Si je ne t’ai rien dit encore, c’est que je craignais de te troubler et de t’empêcher de la sorte de manger avec délices ! Sache donc que cette ville s’appelle la Ville-des-Enchantements, et que celle qui règne ici s’appelle la reine Almanakh ! C’est une magicienne redoutable, une enchanteresse extraordinaire, une vraie cheitana ! Or, elle est sans cesse brûlée par le désir ! Et chaque fois qu’elle rencontre un étranger jeune, solide et beau qui débarque dans cette île, elle le séduit et se fait monter et copuler beaucoup de fois par lui, pendant quarante jours et quarante nuits. Or, comme au bout de ce temps, elle l’a complètement épuisé, elle le métamorphose en animal. Et comme, sous cette nouvelle forme d’animal, il récupère de nouvelles forces et de puissantes vertus, elle se métamorphose elle-même à sa guise, chaque fois, selon l’animal à qui elle a affaire, soit en jument, soit en ânesse, et se fait ainsi copuler par l’âne ou le cheval une quantité innombrable de fois. Après quoi, elle reprend sa forme humaine pour se faire de nouveaux amants et de nouvelles victimes parmi les beaux jeunes gens qu’elle rencontre. Et il lui arrive quelquefois, dans les nuits de ses désirs extrêmes, de se faire monter à tour de rôle par tous les quadrupèdes de l’île, et cela jusqu’au matin ! Et telle est sa vie !
« Or moi, comme je t’aime d’un grand amour, mon enfant, je ne voudrais pas te voir tomber entre les mains de cette enchanteresse inassouvie, qui ne vit que pour ce que je viens de te dire ! Et, comme tu es certainement le plus beau de tous les adolescents débarqués dans cette île, qui sait ce qui va arriver si tu es aperçu par la reine Almanakh !
« Quant aux ânes, aux mulets et aux chevaux qui, en t’apercevant, ont dévalé du haut de la montagne à ta rencontre, ce sont justement les jeunes gens métamorphosés par Almanakh. Et, comme ils te voyaient si jeune et si beau, ils eurent pitié de toi et voulurent d’abord, par leurs signes de tête, te décider à regagner la mer. Puis, comme ils te voyaient obstiné à rester, malgré leurs objurgations, ils t’accompagnèrent jusqu’ici en psalmodiant, dans leur langage, les formules funèbres, comme s’ils accompagnaient un homme mort à la vie humaine !
« Or, mon fils, la vie avec cette jeune reine Almanakh, l’enchanteresse, ne serait pas désagréable du tout, n’était l’abus qu’elle fait de celui que le sort lui donne comme amant.
« Pour moi, elle me redoute et me respecte, parce qu’elle sait que je suis plus versé qu’elle dans l’art de la sorcellerie et des enchantements. Seulement moi, mon fils, comme je suis un croyant en Allah et en son Prophète (sur Lui la prière et la paix !), je ne me sers point de la magie pour faire le mal ! Car le mal finit toujours par se tourner contre le malfaiteur ! »
Or, à peine le vieux cheikh avait-il dit ces paroles, que de son côté s’avança un magnifique cortège de mille adolescentes comme des lunes, habillées de pourpre et d’or, qui vinrent se ranger en deux lignes le long de la boutique pour faire place à une adolescente plus belle qu’elles toutes, montée sur un cheval arabe étincelant de pierreries. Et c’était la reine Almanakh elle-même, la magicienne. Et elle s’arrêta devant la boutique, mit pied à terre, aidée par les deux esclaves qui tenaient la bride, et entra chez le vieux cheikh, qu’elle salua avec beaucoup de déférence. Puis elle s’assit sur le divan et, les yeux à demi-fermés, regarda Sourire-de-Lune. Et quel regard…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Puis elle s’assit sur le divan et, les yeux à demi fermés, regarda Sourire-de-Lune. Et quel regard ! Long, perforateur, câlin et étincelant ! Et Sourire-de-Lune se sentit transpercé comme d’un javelot ou brûlé d’un charbon ardent. Et la jeune reine se tourna vers le cheikh et lui dit : « Ô cheikh Abderrahmân, d’où as-tu pu avoir un pareil adolescent ? » Il répondit : « C’est le fils de mon frère. Il vient d’arriver chez moi de voyage ! » Elle dit : « Il est bien beau, ô cheikh ! Ne voudrais-tu pas me le prêter pour une nuit seulement ? Je ne ferais que causer avec lui, sans plus, et je te le rendrais intact demain matin ! » Il dit : « Me fais-tu le serment de ne jamais essayer de l’ensorceler ? » Elle répondit : « J’en fais le serment devant le maître des magiciens et devant toi, vénérable oncle ! » Et elle fit donner en cadeau, au cheikh, mille dinars d’or, pour lui marquer sa gratitude, et fit monter Sourire-de-Lune sur un merveilleux cheval couvert de pierreries, et l’emmena avec elle au palais. Et il apparaissait au milieu du cortège comme la lune au milieu des étoiles.
Or, Sourire-de-Lune, qui se résignait désormais à laisser agir la destinée, ne disait pas un mot et se laissait conduire sans montrer d’aucune manière ses sentiments.
Et la magicienne Almanakh, qui sentait ses entrailles brûler pour cet adolescent bien plus qu’elles n’avaient jamais brûlé pour ses amants passés, se hâta de le conduire dans une salle dont les murs étaient bâtis en or, et dont l’air était rafraîchi par un jet d’eau jaillissant d’un bassin de turquoise. Et elle alla se jeter avec lui sur un grand lit d’ivoire où elle commença par le caresser d’une façon si extraordinaire qu’il se mit à chanter et à danser de tous ses oiseaux ! Et elle n’était pas brutale du tout, au contraire ! Si délicate vraiment ! Aussi ! incalculables furent les saillies du coq sur l’infatigable poularde ! Et il se dit : « Par Allah ! elle est infiniment experte ! Et elle ne me bouscule pas ! Elle prend son temps, et moi également ! Aussi, comme je pense bien qu’il est impossible que la princesse Gemme soit aussi merveilleuse que cette enchanteresse, je veux rester ici toute ma vie, et ne plus penser ni à la fille de Salamandre, ni à mes parents, ni à mon royaume ! »
Et, de fait, il resta là quarante jours et quarante nuits, passant tout son temps avec la jeune magicienne, en festins, danses, chants, caresses, mouvements, assauts, copulations, et autres choses semblables, à la limite du plaisir et de la jubilation.
Et de temps en temps, pour rire, Almanakh lui demandait : « Ô mon œil, te trouves-tu mieux avec moi qu’avec ton oncle, dans la boutique ? » Et il répondait : « Par Allah ! ô ma maîtresse, mon oncle est un pauvre vendeur de drogues, mais toi tu es la thériaque même ! »
Or, comme ils étaient au soir du quarantième jour, la magicienne Almanakh, après un nombre infini d’assauts divers avec Sourire-de-Lune, fut plus agitée que de coutume et s’étendit pour dormir. Mais vers minuit, Sourire-de-Lune, qui feignait de dormir, la vit se lever du lit, avec un visage enflammé. Et elle alla au milieu de la salle où elle prit, dans un plateau de cuivre, une poignée de grains d’orge qu’elle jeta dans l’eau du bassin. Et, au bout de quelques instants, les grains d’orge germèrent, et leurs tiges sortirent de l’eau, et leurs épis mûrirent et se dorèrent. Alors la magicienne recueillit les grains nouveaux, les pila dans un mortier de marbre, y mélangea certaines poudres qu’elle tira de différentes boites, et en fit une pâte arrondie comme un gâteau. Puis elle mit le gâteau ainsi préparé sur la braise d’un réchaud et le fit cuire lentement. Alors elle le retira, l’enveloppa dans une serviette et alla le cacher dans une armoire, après quoi elle revint se coucher dans le lit à côté de Sourire-de-Lune, et s’endormit.
Mais le matin, Sourire-de-Lune, qui, depuis son entrée dans le palais de la magicienne, avait oublié le vieux cheikh Abderrahmân, se souvint de lui à propos et pensa qu’il était nécessaire d’aller le trouver pour le mettre au courant de ce qu’il avait vu faire à Almanakh pendant la nuit. Et il alla à la boutique du cheikh qui fut ravi de le revoir, l’embrassa avec effusion, le fit s’asseoir et lui demanda : « J’espère, mon fils, que tu n’as pas eu à te plaindre de la magicienne Almanakh, tout infidèle qu’elle soit ! » Il répondit : « Par Allah, mon bon oncle, elle m’a traité tout ce temps avec beaucoup délicatesse, et ne m’a bousculé en rien. Mais, cette nuit, j’ai senti qu’elle se levait, et, voyant son visage enflammé, j’ai feint de dormir, et je l’ai vue s’occuper d’une chose qui me fait tout craindre d’elle ! C’est pourquoi, ô mon vénérable oncle, je viens te consulter. » Et il lui raconta l’opération nocturne de la magicienne…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il lui raconta l’opération nocturne de la magicienne.
En entendant ces paroles, le cheikh Abderrahmân entra dans une grande colère, et s’écria : « Ah ! la maudite ! la perfide ! la parjure qui ne veut pas tenir son serment ! Rien ne la corrigera donc de sa mauvaise magie ! » Puis il ajouta : « Il est temps que je mette un terme à ses maléfices ! » Et il alla à une armoire, en tira une galette de tous points semblable à celle confectionnée par la magicienne, l’enveloppa dans un mouchoir et la remit à Sourire-de-Lune en lui disant : « Avec cette galette que je te donne, le mal qu’elle veut te faire va retomber sur elle. En effet, c’est au moyen de galettes confectionnées par elle et qu’elle donne à manger, au bout de quarante jours, à ses amants qu’elle les transforme en ces animaux à quatre pieds qui remplissent l’île. Mais toi, mon enfant, garde-toi bien de toucher au gâteau qu’elle te présentera ! Tâche, au contraire, de lui faire avaler un morceau de celui que je te donne ! Puis fais-lui exactement ce qu’elle aura essayé de te faire, en fait de sorcellerie, en prononçant sur elle les mêmes paroles qu’elle aura prononcées sur toi. Et, de la sorte, tu la changeras en tel animal qu’il te plaira ! Et tu la monteras et tu viendras me trouver. Et alors je saurai ce qu’il me restera à faire. » Et Sourire-de-Lune, après avoir remercié le cheikh de l’affection et de l’intérêt qu’il lui portait, le quitta et retourna au palais de la magicienne.
Et il trouva Almanakh qui l’attendait dans le jardin, assise devant une nappe servie, au milieu de laquelle, sur un plateau, se trouvait la galette préparée à minuit. Et, comme elle se plaignait de son absence, il lui dit : « Ô ma maîtresse, comme il y avait longtemps que je n’avais vu mon oncle, je suis allé lui rendre visite ; et il m’a reçu avec effusion et m’a servi à manger ; et, entre autres choses excellentes, il y avait des gâteaux si délicieux que je n’ai pu m’empêcher de t’en apporter un, pour te le faire goûter ! » Et il tira le petit paquet, dégagea le gâteau, et la pria d’en manger un morceau. Et Almanakh, pour ne pas le désobliger, rompit le gâteau et prit un morceau qu’elle avala. Puis, à son tour, elle offrit du sien à Sourire-de-Lune qui, pour ne pas la désobliger, en prit un morceau, mais, tout en faisant semblant de l’avaler, le fit glisser dans l’ouverture de son vêtement.
Aussitôt la magicienne, croyant qu’il avait réellement avalé le morceau de gâteau, se leva vivement, prit dans le bassin d’à côté un peu d’eau dans le creux de sa main et l’en aspergea en lui criant : « O jeune homme affaibli, deviens un âne puissant ! »
Mais quel ne fut pas l’étonnement de la magicienne en voyant que le jeune homme, loin de se transformer en âne, s’était levé à son tour et s’était vivement approché du bassin où il avait puisé un peu d’eau, pour l’en asperger en lui criant : « Ô perfide, quitte ta forme humaine et deviens ânesse ! »
Et, au même moment, avant qu’elle eût le temps de revenir de sa surprise, la magicienne Almanakh fut changée en ânesse. Et Sourire-de-Lune l’enfourcha et se hâta d’aller trouver le cheikh Abderrahmân auquel il raconta ce qui venait de se passer. Puis il lui livra l’ânesse qui faisait la rébarbative.
Alors le cheikh passa au cou de l’ânesse Almanakh une double chaîne qu’il fixa à un anneau dans la muraille. Puis il dit à Sourire-de-Lune : « Maintenant, mon fils, je vais m’occuper de mettre ordre aux affaires de notre ville, et je vais commencer par lever l’enchantement qui tient un si grand nombre de jeunes gens changés en animaux à quatre pieds. Mais, auparavant, je veux, bien qu’il m’en coûte beaucoup de me séparer de toi, te faire rentrer dans ton royaume, pour que cessent les inquiétudes de ta mère et de tes sujets ! Et, dans ce but, je vais te faire suivre le plus court chemin ! »
Et, ayant dit ces paroles, le cheikh mit deux doigts entre ses lèvres et lança un long et fort sifflement, et aussitôt apparut devant lui un grand genni à quatre ailes, qui se tint debout sur la pointe des pieds, et lui demanda le motif pour lequel il l’avait appelé. Et le cheikh lui dit : « Ô genni l’Éclair, tu vas prendre sur tes épaules le roi Sourire-de-Lune que voici, et tu vas le transporter en toute diligence à son palais, dans la Ville-Blanche ! » Et le genni l’Éclair se courba en deux, en baissant la tête ; et Sourire-de-Lune, après avoir baisé la main du cheikh, son libérateur, et l’avoir remercié, monta sur les épaules de l’Eclair, et, laissant pendre ses jambes sur sa poitrine, il se cramponna à son cou. Et le genni s’éleva dans les airs et vola avec la rapidité de la colombe messagère, en faisant avec ses ailes un bruit de moulin à vent…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… en faisant avec ses ailes un bruit de moulin à vent. Et, infatigablement, il voyagea pendant un jour et une nuit, et parcourut de la sorte un espace de six mois de chemin. Et il arriva au-dessus de la Ville-Blanche, et déposa Sourire-de-Lune sur la terrasse même de son palais. Puis il disparut.
Et Sourire-de-Lune, le cœur fondu aux souffles de la brise de sa patrie, se hâta de descendre dans l’appartement où, depuis sa disparition, se tenait sa mère, Fleur-de-Grenade, pleurant en silence et portant son deuil secrètement en son âme, pour ne point se trahir et tenter de la sorte les usurpateurs. Et il souleva le rideau de la salle, où se trouvaient précisément, en visite chez la reine, la vieille grand’mère Sauterelle, le roi Saleh, et les cousines. Et il entra, en souhaitant la paix à l’assistance, et courut se jeter dans les bras de sa mère, qui, en le voyant, tomba évanouie de joie et de saisissement. Mais elle ne tarda pas à reprendre ses sens, et, serrant son fils contre sa poitrine, elle pleura longtemps, toute secouée de sanglots, tandis que les cousines embrassaient les pieds de leur cousin, et que la grand’mère le tenait par une main et l’oncle Saleh par l’autre main. Et ils restèrent ainsi, dans la joie du retour, sans pouvoir prononcer une parole.
Mais lorsqu’il leur fut enfin permis de s’épancher en paroles, ils se racontèrent mutuellement leurs diverses aventures, et bénirent ensemble Allah le Bienfaiteur qui avait permis leur salut à tous et leur réunion.
Après quoi, Sourire-de-Lune se tourna vers sa mère et sa grand’mère et leur dit : « Il ne me reste plus maintenant qu’à me marier ! Et je persiste à ne vouloir me marier qu’avec la princesse Gemme, fille de Salamandre ! Car, en vérité, c’est une vraie gemme comme l’indique son nom ! » Et la vieille grand’mère répondit : « La chose, ô mon enfant, nous est maintenant aisée, car nous tenons toujours le père prisonnier dans son palais. » Et elle envoya aussitôt chercher Salamandre, que les esclaves firent entrer enchaîné des mains et des pieds. Mais Sourire-de-Lune ordonna qu’on le désenchaînât : et l’ordre fut exécuté sur l’heure.
Alors Sourire-de-Lune s’avança près de Salamandre, et, après s’être excusé d’avoir été la cause première des malheurs survenus, il lui prit la main qu’il baisa avec respect, et dit : « Ô roi Salamandre, ce n’est plus un intermédiaire qui te demande l’honneur de ton alliance ; mais c’est moi-même, Sourire-de-Lune, roi de la Ville-Blanche et du plus grand empire terrestre, qui te baise les mains et te demande ta fille Gemme en mariage. Et si tu ne veux pas me l’accorder, je mourrai. Et si tu acceptes, non seulement tu redeviendras roi dans ton royaume, mais je serai moi-même ton esclave ! »
À ces paroles, Salamandre embrassa Sourire-de-Lune, et lui dit : « Certes ! ô Sourire-de-Lune, nul plus que toi ne saurait mériter ma fille. Or, comme elle est soumise à mon autorité, elle acceptera ce désir de grand cœur ! Aussi me faut-il l’envoyer chercher dans l’île où elle se tient cachée depuis que j’ai été dépossédé du trône. » Et, en disant ces paroles, il fit venir de la mer un messager auquel il enjoignit d’aller immédiatement chercher la princesse dans l’île, et de la lui amener sans retard. Et le messager disparut, et ne tarda pas à revenir avec la princesse Gemme et sa servante Myrte.
Alors le roi Salamandre commença par embrasser sa fille, puis il la présenta à la vieille reine Sauterelle et à la reine Fleur-de-Grenade, et lui dit en lui montrant du doigt Sourire-de-Lune, ébahi d’admiration : « Sache, ô fille mienne, que je t’ai promise à ce jeune roi magnanime, à ce vaillant lion Sourire-de-Lune, fils de la reine Fleur-de-Grenade la marine, car il est certainement le plus beau des hommes de son temps, et le plus charmant, et le plus puissant, et le plus haut en rang et en noblesse, et de beaucoup ! Aussi je juge qu’il est fait pour toi, et que tu es faite pour lui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT QUARANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Aussi je juge qu’il est fait pour toi, et que tu es faite pour lui ! »
À ces paroles de son père, la princesse Gemme baissa les yeux avec modestie, et répondit : « Tes avis, ô mon père, sont ma règle de conduite, et ton affection vigilante est l’ombre où je me plais ! Et, puisque tel est ton désir, désormais l’image de celui que tu me choisis sera dans mes yeux, son nom sera dans ma bouche, et sa demeure dans mon cœur ! »
Lorsque les cousines de Sourire-de-Lune et les autres dames présentes eurent entendu ces paroles, elle firent retentir le palais de leurs cris de joie et de leurs lu-lu perçants. Puis le roi Saleh et Fleur-de-Grenade firent aussitôt mander le kâdi et les témoins pour écrire le contrat de mariage du roi Sourire-de-Lune et de la princesse Gemme. Et l’on célébra les noces en grande pompe et avec un faste tel que, pour la cérémonie du vêtement, on changea neuf fois la robe de la mariée. Quant au reste, la langue deviendrait poilue avant de réussir à en parler comme il sied. Aussi ! gloire à Allah qui unit entre elles les belles choses, et ne retarde la joie que pour donner le bonheur !
— Lorsque Schahrazade eut fini de raconter cette histoire, elle se tut. Alors la petite Doniazade s’écria : « Ô ma sœur, que tes paroles sont douces, et gentilles et savoureuses. Et que cette histoire est admirable ! » Et le roi Schahriar dit : « Certes ! ô Schahrazade, tu m’as appris bien des choses que j’ignorais ! Car je ne savais pas bien jusqu’aujourd’hui les choses du dessous des eaux. Et l’histoire d’Abdallah de la Mer et celle de Fleur-de-Grenade m’ont satisfait grandement ! Mais, ô Schahrazade, ne connaîtrais-tu pas une histoire tout à fait diabolique ? » Et Schahrazade sourit et répondit : « Justement, ô Roi, j’en connais une que je vais tout de suite te raconter ! »
LA SOIRÉE D’HIVER D’ISHAK DE MOSSOUL
Et Schahrazade dit :
Le musicien Ishak de Mossoul, chanteur favori d’Al-Rachid, nous rapporte l’anecdote suivante. Il dit :
Une nuit, j’étais assis dans ma maison, en hiver, et, pendant qu’au dehors les vents hurlaient comme des lions et que les nuages se déchargeaient avec tumulte comme les bouches large ouvertes des outres pleines d’eau, je me chauffais les mains au-dessus de mon brasier en cuivre, et j’étais triste de ne pouvoir, à cause de la boue des chemins, de la pluie et de l’obscurité, ni sortir ni espérer la visite de quelque ami qui me tînt compagnie. Et comme ma poitrine se rétrécissait de plus en plus, je dis à mon esclave : « Donne-moi quelque chose à manger, pour occuper le temps ! » Et comme l’esclave s’apprêtait à me servir, je ne pouvais m’empêcher de songer aux charmes d’une jeune fille que j’avais connue naguère au palais ; et je ne savais pourquoi m’obsédait à ce point son souvenir, ni pour quel motif ma pensée s’arrêtait plutôt sur son visage que sur celui de toute autre de celles si nombreuses qui avaient charmé mes nuits passées. Et tellement je m’appesantissais en son délectable désir, que je finis par ne plus m’apercevoir de la présence de l’esclave debout, les bras croisés, qui, ayant fini de tendre la nappe devant moi sur le tapis, n’attendait plus que le signe de mes yeux pour apporter les plateaux. Et moi, plein de ma songerie, je m’écriai tout haut : « Ah ! si la jeune Saïeda était ici, elle dont la voix est si douce, je ne serais point si mélancolique ! »
Ces paroles, je les prononçai à voix haute, en vérité, je me le rappelle maintenant, bien que d’habitude mes pensées fussent silencieuses. Et ma surprise fut extrême d’entendre ainsi le son de ma voix, devant mon esclave dont les yeux s’ouvraient grandement.
Or, mon souhait à peine était-il exprimé, qu’un heurt se fit à la porte, comme si c’était quelqu’un qui ne pouvait souffrir l’attente, et une jeune voix soupira : « Le bien-aimé peut-il franchir la porte de son ami ? »
Alors, moi, je pensai en mon âme : « Sans doute c’est quelqu’un qui, dans l’obscurité, se trompe de maison ! Ou bien aurait-il déjà porté ses fruits, l’arbre stérile de mon désir ? » Je me hâtai pourtant de sauter sur mes pieds et courus ouvrir moi-même la porte ; et, sur le seuil, je vis la tant désirée Saïeda, mais avec quelle tournure singulière et sous quel étrange aspect ! Elle était vêtue d’une robe courte en soie verte, et sur sa tête était tendue une étoffe d’or qui n’avait pu la garantir de la pluie et de l’eau déversée par les gouttières des terrasses. Du reste, elle avait dû plonger dans la boue tout le long du chemin, comme ses jambes l’attestaient clairement. Et moi, la voyant dans un tel état, je m’exclamai : « Ô ma maîtresse, pourquoi t’exposer ainsi dehors, et par une pareille nuit ! » Elle me dit, de sa voix gentille : « Hé ! pouvais-je ne point m’incliner devant le souhait que tout à l’heure chez moi m’a transmis ton messager ? Il m’a dit la vivacité de ton désir à mon égard, et, malgré cet affreux temps, me voici ! »
Or moi, bien que ne me souvenant point d’avoir donné un ordre pareil, et l’eussé-je donné que mon unique esclave n’eût pu l’exécuter dans le même temps qu’il était demeuré près de moi, je ne voulus point montrer à mon amie combien bouleversé était mon esprit de tout cela ; et je lui dis : « Louange à Allah qui permet notre réunion, ô ma maîtresse, et qui change en miel l’amertume du désir ! Que ta venue parfume la maison et repose le cœur du maître de la maison ! En vérité, si tu n’étais venue, je serais allé moi-même à ta recherche, tant ce soir mon esprit travaillait à ton sujet…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTIÈME NUIT
Elle dit :
« … je serais allé moi-même à ta recherche, tant ce soir mon esprit travaillait à ton sujet ! » Puis je me tournai vers mon esclave et lui dis : « Va vite chercher de l’eau chaude et des essences ! » Et l’esclave, ayant exécuté mon ordre, je me mis à laver moi-même les pieds de mon amie, et lui versai dessus un flacon d’essence de roses. Après quoi je l’habillai d’une belle robe en mousseline de soie verte, et la fis s’asseoir à côté de moi près du plateau des fruits et des boissons. Et lorsqu’elle eut bu avec moi plusieurs fois dans la coupe, je voulus, pour lui plaire, moi qui d’ordinaire ne consens à chanter qu’après force prières et supplications, lui chanter un nouvel air que j’avais composé. Mais elle me dit que son âme n’avait pas envie de m’entendre. Et je lui dis : « Alors, ô ma maîtresse, daigne toi-même nous chanter quelque chose ! » Elle répondit : « Pas davantage ! Car mon âme ne le souhaite pas ! » Je dis : « Pourtant, ô mon œil, la joie ne saurait être complète sans le chant et la musique ! Qu’en penses-tu ? » Elle me dit : « Tu as raison ! Mais ce soir, je ne sais pourquoi, je n’ai guère envie d’entendre chanter qu’un homme du peuple, ou quelque mendiant de la rue. Veux-tu donc aller voir si à ta porte ne passe point quelqu’un qui puisse me satisfaire ? » Et moi, pour ne point la désobliger, et bien que je fusse persuadé que par une nuit pareille il n’y avait point de passants dans la rue, j’allai ouvrir ma porte d’entrée et je passai ma tête par l’entrebâillement. Et, à ma grande surprise, je vis, appuyé sur son bâton contre la muraille d’en face, un vieux mendiant qui disait, se parlant à lui-même : « Quel vacarme fait cette tempête ! Le vent disperse ma voix, et empêche les gens de m’entendre ! Malheur au pauvre aveugle ! S’il chante, on ne l’écoute pas ! Et s’il ne chante point, il meurt de faim ! » Et, ayant dit ces paroles, le vieil aveugle se mit à tâtonner de son bâton sur le sol et contre le mur, cherchant à continuer son chemin.
Alors moi, étonné et charmé à la fois de cette rencontre fortuite, je lui dis : « Ô mon oncle, sais-tu donc chanter ? » Il répondit : « Je passe pour savoir chanter. » Et moi je lui dis : « En ce cas, ô cheikh, veux-tu finir ta nuit avec nous, et nous réjouir de ta compagnie ? » Il me répondit : « Si tu le désires, prends-moi la main, car je suis aveugle des deux yeux ! » Et je lui pris la main, et, l’ayant introduit dans la maison, dont je fermai soigneusement la porte, je dis à mon amie : « Ô ma maîtresse, je t’amène un chanteur qui, en plus, est aveugle ! Il pourra nous donner du plaisir sans voir ce que nous faisons. Et tu n’auras pas à te gêner, ou à te voiler le visage. » Elle me dit : « Hâte-toi de le faire entrer ! » Et je le fis entrer.
Je commençai d’abord par le faire s’asseoir devant nous, et l’invitai à manger quelque chose. Et il mangea avec beaucoup de délicatesse, du bout des doigts. Et lorsqu’il eut fini et se fut lavé les mains, je lui présentai les boissons ; et il but trois coupes pleines, et alors me demanda : « Peux-tu me dire chez quel hôte je me trouve ? » Je répondis : « Chez Ishak fils d’Ibrahim de Mossoul ! » Or, mon nom ne l’étonna pas outre mesure ; et il se contenta de me répondre : « Ah ! oui, j’ai entendu parler de toi. Et je suis aise de me trouver chez toi. » Je lui dis : « Ô mon maître, je suis vraiment réjoui de te recevoir dans ma maison ! » Il me dit : « Alors, ô Ishak, si tu le veux, fais-moi entendre ta voix qu’on dit fort belle ! Car l’hôte doit commencer le premier à faire plaisir à ses invités ! » Et moi je répondis : « J’écoute et j’obéis. » Et, comme cela commençait à m’amuser beaucoup, je pris mon luth et j’en jouai, en chantant, avec tout le talent qui me fut possible. Et lorsque j’eus terminé la finale en la soignant à l’extrême, et que les derniers sons se furent dispersés, le vieux mendiant eut un sourire ironique et me dit : « En vérité, ya Ishak, il ne te manque que peu de chose pour devenir un parfait musicien et un chanteur accompli ! » Or moi, en entendant cette louange qui était plutôt un blâme, je me sentis devenir tout petit à mes propres yeux, et, de dépit et de découragement, je jetai mon luth de côté. Mais, comme je ne voulais point manquer d’égards à mon hôte, je ne jugeai pas à propos de lui répondre, et ne dis plus rien. Alors il me dit : « Personne ne chante et ne joue ? N’y a-t-il donc pas quelqu’un d’autre ici ? » Je dis : « Il y a encore une jeune esclave. » Il dit : « Ordonne-lui de chanter, que je l’entende ! » Je dis : « Pourquoi chanterait-elle, puisque tu en as déjà assez de ce que tu as entendu ? » Il dit : « Qu’elle chante tout de même ! » Alors l’adolescente, mon amie, prit le luth, mais bien à contre-cœur, et, après avoir préludé savamment, chanta de son mieux. Mais le vieux mendiant l’interrompit soudain et dit : « Tu as encore beaucoup à apprendre ! » Et mon amie, furieuse, jeta le luth loin d’elle, et voulut se lever. Et je ne réussis à la retenir qu’à grand’peine, et en me jetant à ses genoux. Puis je me tournai vers le mendiant aveugle, et lui dis : « Par Allah, ô mon hôte, notre âme ne peut donner plus que sa capacité ! Pourtant, nous avons fait de notre mieux pour te satisfaire. À ton tour maintenant d’exhiber ce que tu possèdes, par manière de politesse ! » Il sourit d’une oreille à l’autre, et me dit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Il sourit d’une oreille à l’autre, et me dit : « Alors, commence par m’apporter un luth qu’aucune main n’ait encore touché ! » Et moi j’allai ouvrir une caisse, et lui apportai un luth tout neuf que je lui mis entre les mains. Et il saisit entre ses doigts la plume d’oie taillée, et en toucha légèrement les cordes harmonieuses.
Et, dès les premiers sons, je reconnus que ce mendiant aveugle était de beaucoup le meilleur musicien de notre temps. Mais quel ne fut point mon émoi et mon admiration quand je l’entendis exécuter un morceau selon un mode qui m’était tout à fait inconnu, bien que l’on ne me considérât point comme un ignorant dans l’art ! Puis, d’une voix à nulle autre pareille, il chanta ces couplets :
« À travers l’ombre épaisse, le bien-aimé sortit de sa maison, et vint me trouver au milieu de la nuit.
Et avant de me souhaiter la paix, je l’entendis frapper et me dire : « Le bien-aimé peut-il franchir la porte de son ami ? »
Lorsque nous entendîmes ce chant du vieil aveugle, moi et mon amie nous nous regardâmes, à la limite de la stupéfaction. Puis elle devint rouge de colère et me dit, de façon à ce que je fusse seul à l’entendre : « Ô perfide ! n’as-tu pas honte, pendant les quelques instants où tu es allé ouvrir la porte, de m’avoir trahie en racontant ma visite à ce vieux mendiant ! En vérité, ô Ishak, je ne croyais pas ta poitrine d’assez faible capacité pour ne pas contenir un secret une heure durant ! Opprobre aux hommes qui te ressemblent ! » Mais moi je lui jurai mille fois que je n’étais pour rien dans l’indiscrétion, et lui dis : « Je te jure sur la tombe de mon père Ibrahim, que je n’ai rien dit de cela à ce vieil aveugle ! » Et mon amie voulut bien me croire, et finit par se laisser caresser et embrasser par moi, sans crainte d’être aperçue par l’aveugle. Et moi, tantôt je la baisais sur les joues et sur les lèvres, tantôt je la chatouillais, tantôt je lui pinçais les seins, et tantôt je la mordillais aux endroits délicats ; et elle riait extrêmement. Puis je me tournai vers le vieil oncle et lui dis : « Veux-tu nous chanter encore quelque chose, ô mon maître ? » Il dit : « Pourquoi pas ? » Et il reprit le luth et dit, en s’accompagnant :
« Ah ! souvent je parcours avec ivresse les charmes de ma bien-aimée, et je caresse de ma main sa belle peau nue !
Tantôt je presse les grenades de sa gorge de jeune ivoire, et tantôt je mords à même les pommes de ses joues. Et je recommence ! »
Alors moi, en entendant ce chant, je ne doutai plus de la supercherie du faux aveugle, et je priai mon amie de se couvrir le visage de son voile. Et le mendiant soudain me dit : « J’ai bien envie d’aller pisser ! Où se trouve le cabinet de repos ? » Alors, moi, je me levai et sortis un moment pour aller chercher une chandelle afin de l’éclairer, et je revins pour l’emmener. Mais lorsque je fus entré, je ne trouvai plus personne : l’aveugle avait disparu avec l’adolescente ! Et moi, quand je revins de ma stupéfaction, je les cherchai par toute la maison, mais ne les trouvai point. Et pourtant les portes et les serrures des portes restaient fermées en dedans, et je ne sus de la sorte s’ils étaient partis en sortant par le plafond ou en entrant dans le sol entr’ouvert et refermé ! Mais ce dont depuis je fus persuadé, c’est que c’était Éblis lui-même qui m’avait d’abord servi d’entremetteur, et qui m’avait ensuite enlevé cette adolescente qui n’était qu’une fausse apparence et une illusion.
— Puis Schahrazade, ayant raconté cette anecdote, se tut. Et le roi Schahriar, extrêmement impressionné, s’écria : « Qu’Allah confonde le Malin ! » Et Schahrazade, voyant qu’il fronçait les sourcils, voulut le calmer et raconta l’histoire suivante :
LE FELLAH D’ÉGYPTE ET
SES ENFANTS BLANCS
Voici ce que l’émir Mohammâd, gouverneur du Caire, rapporte dans les livres des chroniques. Il dit :
Comme j’étais en tournée dans la Haute-Égypte, je logeai une nuit dans la maison d’un fellah qui était le cheikh-al-balad de l’endroit. Et c’était un homme d’âge, brun d’une couleur extrêmement brune, avec une barbe grisonnante. Mais je remarquai qu’il avait des enfants en bas âge qui étaient blancs d’une couleur très blanche relevée de rose sur les joues, avec des cheveux blonds, et des yeux bleus. Puis comme il était venu, après nous avoir fait bel accueil et grande chère, converser en notre compagnie, je lui dis, par manière de demande : « Hé, Un Tel, d’où vient donc que toi, ayant le teint si brun, tes fils l’aient si clair avec une peau si blanche et rose, et des yeux et des cheveux si clairs ? » Et le fellah, attirant à lui ses enfants dont il se mit à caresser les fins cheveux, me dit : « Ô mon maître, la mère de mes enfants est une fille des Francs, et je l’ai achetée comme prisonnière de guerre au temps de Saladin le Victorieux, après la bataille de Hattîn qui nous délivra pour toujours des chrétiens étrangers, usurpateurs du royaume de Jérusalem. Mais il y a bien longtemps de cela, car c’était aux jours de ma jeunesse ! » Et moi je lui dis : « Alors, ô cheikh, nous te prions de nous favoriser de cette histoire ! » Et le fellah dit : « De tout cœur amical et comme hommage dû aux hôtes ! Car mon aventure avec mon épouse, la fille des Francs, est bien étrange ! » Et il nous conta :
« Vous devez savoir que, de mon métier, je suis cultivateur de lin ; mon père et mon grand-père semaient le lin avant moi, et, de par ma souche et origine, je suis un fellah d’entre les fellahs de ce pays-ci. Or, une année, il se trouva, par la bénédiction, que mon lin semé, poussé, nettoyé et venu à point de perfection, se montait à la valeur de cinq cents dinars d’or. Et, comme je l’offrais sur le marché et ne trouvais point mon profit, les marchands me dirent : « Va porter ton lin au château d’Acre, en Syrie, où tu le vendras avec de très gros bénéfices ! » Et moi, les ayant écoutés, je pris mon lin et m’en allai dans la ville d’Acre, qui, en ce temps-là, était entre les mains des Francs. Et, effectivement, je commençai par une bonne vente, en cédant la moitié de mon lin à des courtiers, avec crédit de six mois ; et je gardai le reste et séjournai dans la ville pour le vendre au détail, avec des bénéfices immenses.
Or, un jour que j’étais à vendre mon lin, une jeune fille franque, le visage découvert et la tête sans voile, selon la coutume des Franques, vint acheter chez moi. Et elle se tenait là, devant moi, belle, blanche et jolie ; et je pouvais à mon aise admirer ses charmes et sa fraîcheur. Et plus je regardais son visage, plus l’amour envahissait ma raison ! Et je tardais beaucoup à lui vendre le lin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et je tardais beaucoup à lui vendre le lin. Enfin, je fis le paquet, et le lui cédai à très bon compte. Et elle s’en alla, suivie de mes regards.
Or, quelques jours après, elle revint m’acheter du lin, et je le lui vendis à meilleur compte encore que la première fois, sans la laisser me le marchander. Et elle comprit que j’étais amoureux d’elle, et elle s’en alla ; mais ce fut pour revenir, peu de temps après, accompagnée d’une vieille femme qui resta là, pendant la vente, et qui revint ensuite avec elle chaque fois qu’elle avait besoin de faire un achat.
Moi alors, comme l’amour s’était tout à fait emparé de mon cœur, je pris la vieille à part et lui dis : « Or çà, pourrais-tu, moyennant un cadeau pour toi, me procurer une jouissance avec elle ? » La vieille me répondit : « Je pourrai te procurer une rencontre pour que tu en jouisses, mais c’est à condition que la chose reste secrète entre nous trois, moi, toi et elle ; et, en outre, tu consentiras à mettre en œuvre quelque argent ! » Je répondis : « Ô secourable tante, si mon âme et ma vie devaient être le prix de ses faveurs, je lui donnerais mon âme et ma vie. Mais pour ce qui est de l’argent, ce n’est pas une grosse affaire ! » Et je tombai d’accord avec elle pour lui donner, en courtage, la somme de cinquante dinars ; et je les lui comptai sur l’heure. Et, l’affaire ayant été conclue de la sorte, la vieille me quitta pour aller parler à la jeune fille, et revint bientôt avec une réponse favorable. Puis elle me dit : « O mon maître, cette adolescente n’a point de lieu pour de pareilles rencontres, car elle est encore vierge de sa personne, et ne connaît rien à ces sortes de choses. Il faut donc que tu la reçoives dans ta maison, où elle viendra te trouver et demeurera jusqu’au matin ! » Et moi j’acceptai avec ferveur, et m’en allai à la maison apprêter tout ce qu’il fallait, en fait de mets, de boissons et de pâtisseries. Et je restai à attendre.
Et je vis bientôt arriver la jeune fille franque, et je lui ouvris, et la fis entrer dans ma maison. Et comme c’était la saison d’été, j’avais tout apprêté sur la terrasse. Et je la fis s’asseoir à mes côtés, et je mangeai et je bus avec elle. Et la maison où je logeais touchait la mer ; et la terrasse était belle au clair de lune, et la nuit était pleine d’étoiles qui se réfléchissaient dans l’eau. Et moi, regardant tout cela, je fis un retour sur moi-même, et je pensai en mon âme : « N’as-tu pas honte devant Allah le Très-Haut, sous le ciel et en face de la mer, ici même en pays étranger, de te rebeller contre l’Exalté, en forniquant avec cette chrétienne qui n’est ni de ta race ni de ta loi ! » Et, bien que je fusse déjà étendu à côté de la jeune fille qui se blotissait amoureusement contre moi, je dis en mon esprit : « Seigneur, Dieu d’Exaltation et de Vérité, sois témoin que je m’abstiens en toute chasteté de cette chrétienne, fille des Francs ! » Et, pensant ainsi, je tournai le dos à la jeune fille, sans de ma main la toucher ; et je m’endormis, sous la clarté bienveillante du ciel.
Le matin venu, la jeune Franque se leva, sans me dire un mot, et s’en alla fort marrie. Et moi je me rendis à ma boutique où je me remis à vendre mon lin comme d’habitude. Mais, vers midi, la jeune fille, accompagnée de la vieille, vint à passer devant ma boutique, avec une mine fâchée ; et moi derechef, de tout mon être, à en mourir, je la désirai. Car, par Allah ! elle était comme la lune ; et moi je ne pus résister à la tentation ; et je pensai, me gourmandant : « Qui donc es-tu, ô fellah, pour ainsi refréner ton désir d’une telle jouvencelle ? Or çà, toi, es-tu un ascète, ou un soufi, ou un eunuque, ou un châtré ou bien un des morfondus de Baghdad ou de Perse ? N’es-tu point de la race des puissants fellahs de la Haute-Égypte, ou bien ta mère a-t-elle oublié de t’allaiter ? » Et, sans plus, je courus derrière la vieille et, la tirant à part, je lui dis : « Je voudrais bien une seconde rencontre ! » Elle me dit : « Par le Messie, la chose n’est maintenant faisable que moyennant cent dinars ! » Et moi, sur l’heure, je comptai les cent dinars d’or et les lui remis. Et la jeune Franque vint chez moi pour la seconde fois, Mais moi, devant la beauté du ciel nu, j’eus les mêmes scrupules, et je ne tirai pas plus parti de cette nouvelle entrevue que de la première, et m’abstins de la jouvencelle en toute chasteté. Et elle, dans un violent dépit, se leva d’à côté de moi, sortit et s’en alla.
Or moi, le lendemain, derechef, comme elle passait devant ma boutique, je sentis en moi les mêmes mouvements, et mon cœur palpita, et j’allai trouver la vieille et lui parlai de la chose. Mais elle me regarda avec colère et me dit : « Par le Messie, ô musulman ! est-ce ainsi qu’on traite les vierges dans ta religion ? Jamais plus tu ne pourras te réjouir d’elle, à moins toutefois que tu ne veuilles cette fois me donner cinq cents dinars ! » Puis elle s’en alla.
Moi donc, tout tremblant d’émotion, et la flamme d’amour brûlant en moi, je résolus de réunir le prix de tout mon lin, et de sacrifier pour ma vie les cinq cents dinars d’or. Et, les ayant serrés dans une toile, je m’apprêtais à les porter à la vieille, quand soudain…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… je m’apprêtais à les porter à la vieille, quand soudain j’entendis le crieur public qui criait : « Ho ! compagnie des musulmans, vous qui demeurez pour vos affaires dans notre ville, sachez que la paix et la trêve que nous avons conclues avec vous est terminée. Et il vous est donné une semaine pour mettre ordre à vos affaires et quitter notre ville et rentrer dans votre pays ! »
Alors moi, entendant cet avis, je me hâtai de vendre ce qui me restait de lin, je rassemblai l’argent qui me revenait sur ce que j’avais donné à crédit, j’achetai des marchandises bonnes à vendre dans nos pays et royaumes et, quittant la ville d’Acre, je partis, avec, dans le cœur, mille peines et regrets de cette fille chrétienne qui s’était emparée de mon esprit et de ma pensée.
Or, j’allai à Damas, en Syrie, où je vendis ma marchandise d’Acre avec de grands bénéfices et profits, du fait des communications interrompues par la reprise d’armes. Et je fis de très belles affaires commerciales et, avec l’aide d’Allah (qu’il soit exalté !) tout prospéra entre mes mains. Et je pus de la sorte faire, avec grand profit, le commerce en grand des filles chrétiennes captives, prises à la guerre. Et trois années s’étaient passées ainsi, depuis mon aventure d’Acre, et peu à peu l’amertume de ma brusque séparation d’avec la jeune franque commençait à s’adoucir dans mon cœur.
Quant à nous, nous continuâmes à remporter de grandes victoires sur les Francs, tant dans le pays de Jérusalem que dans les pays de Syrie. Et, avec l’aide d’Allah, le sultan Saladin finit, après bien des batailles glorieuses, par vaincre complètement les Francs et tous les infidèles ; et il emmena en captivité à Damas leurs rois et leurs chefs, qu’il avait faits prisonniers, après avoir pris toutes les villes en leur possession sur les côtes, et pacifié tout le pays. Gloire à Allah !
Sur ces entrefaites, j’allai un jour, avec une fort belle esclave à vendre, sous les tentes où campait encore le sultan Saladin. Et je lui montrai l’esclave, qu’il désira acheter. Et moi je la lui cédai pour cent dinars seulement. Mais le sultan Saladin (qu’Allah l’ait en sa miséricorde !) n’avait sur lui que quatre-vingt-dix dinars, car il employait tout l’argent du trésor à mener à bien la guerre contre les mécréants. Alors le sultan Saladin, se tournant vers un de ses gardes, lui dit : « Va, conduis ce marchand sous la tente où se trouvent réunies les filles prisonnières du dernier engagement, et qu’il choisisse parmi elles celle qui lui plaît le mieux, pour remplacer les dix dinars que je lui dois ! » Ainsi agissait, dans sa justice, le sultan Saladin.
Le garde m’emmena donc sous la tente des captives franques, et moi, passant au milieu de ces filles, je reconnus justement dans la première que rencontra mon regard, la jeune franque dont j’avais été si amoureux en Acre. Et elle était, depuis, devenue la femme d’un chef-cavalier des Francs. Moi donc, l’ayant reconnue, je l’entourai de mes bras, pour en prendre possession, et je dis : « C’est celle-ci que je veux ! » Et je la pris, et je m’en allai.
Alors, l’ayant emmenée sous ma tente, je lui dis : « Ô jouvencelle, ne me reconnais-tu pas ! » Elle me répondit : « Non, je ne te reconnais pas ! » Je lui dis : Je suis ton ami, celui-là même chez qui, en Acre, tu es deux fois venue, grâce à la vieille, moyennant une première mise de cinquante dinars, et une seconde mise de cent dinars, et qui s’est abstenu de toi en toute chasteté, en te laissant partir, bien marrie, de sa maison ! Et celui-là même voulait, une troisième fois, t’avoir une nuit pour cinq cents dinars, alors que maintenant le sultan te cède à lui pour dix dinars ! » Elle baissa la tête et soudain, la relevant, elle dit : « Ce qui s’est passé est désormais un mystère de la foi islamique, car je lève le doigt et je témoigne qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et que Mohammâd est l’Envoyé d’Allah ! » Et elle prononça ainsi officiellement l’acte de notre foi, et sur l’heure elle s’ennoblit de l’Islam !
Alors moi, de mon côté, je pensai : « Par Allah ! je ne pénétrerai en elle, cette fois, que lorsque je l’aurai libérée et me serai légalement marié avec elle ! » Et j’allai sur l’heure trouver le kâdi Ibn-Scheddad que je mis au courant de toute l’affaire, et qui vint sous ma tente, avec les témoins, écrire mon contrat de mariage.
Alors je pénétrai en elle. Et elle devint enceinte de moi. Et nous nous établîmes à Damas.
Quelques mois s’étaient passés de la sorte, quand arriva à Damas un ambassadeur du roi des Francs, envoyé auprès du sultan Saladin pour demander, suivant les clauses stipulées entre les rois, l’échange des prisonniers de guerre. Et tous les prisonniers, hommes et femmes, furent scrupuleusement rendus aux Francs, en échange des prisonniers musulmans. Mais quand l’ambassadeur franc eut consulté sa liste, il constata qu’il manquait encore, sur le nombre, la femme du cavalier Un Tel, celui-là même qui était le premier mari de mon épouse. Et le sultan envoya ses gardes la chercher partout, et on finit par leur dire qu’elle était dans ma maison. Et les gardes vinrent me la réclamer. Et moi je devins tout changé de couleur, et j’allai en pleurant trouver mon épouse que je mis au courant de la chose. Mais elle se leva et me dit : « Mène-moi tout de même devant le sultan ! Je sais ce que j’ai à dire entre ses mains ! » Moi donc, prenant ma femme, je la conduisis voilée en présence du sultan Saladin ; et je vis l’ambassadeur des Francs assis à côté de lui, à sa droite…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… et je vis l’ambassadeur des Francs assis à côté de lui, à sa droite.
Alors, moi, j’embrassai la terre entre les mains du sultan Saladin, et je lui dis : « Voici la femme en question ! » Et il se tourna vers mon épouse et lui dit : « Toi, qu’as-tu à dire ? Veux-tu aller dans ton pays avec l’ambassadeur, ou préfères-tu rester avec ton mari ? » Elle répondit : « Moi, je reste avec mon mari, car je suis musulmane et enceinte de lui, et la paix de mon âme n’est pas restée chez les Francs ! » Alors le sultan se tourna vers l’ambassadeur et lui dit : « Tu as entendu ? Mais, si tu veux, parle-lui toi-même ! » Et l’ambassadeur des Francs fit à mon épouse des remontrances et des admonestations, et finit par lui dire : « Préfères-tu rester avec ton mari le musulman, ou retourner auprès du chef-cavalier Un Tel, le Franc ? » Elle répondit : « Moi, je ne me séparerai pas de mon mari l’Égyptien, car la paix de mon âme est chez les musulmans ! » Et l’ambassadeur, bien contrarié, frappa du pied et me dit : « Emmène alors cette femme ! » Et moi je pris ma femme par la main et sortis avec elle de l’audience. Et soudain, l’ambassadeur nous rappela et me dit : « La mère de ton épouse, une vieille Franque qui habitait Acre, m’a remis pour sa fille ce paquet que voici ! » Et il me remit le paquet et ajouta : « Et cette dame m’a chargé de dire à sa fille qu’elle espérait la revoir en bonne santé ! » Moi donc je pris le paquet, et revins avec ma femme à la maison. Et lorsque nous eûmes ouvert le paquet, nous y trouvâmes les vêtements que mon épouse portait en Acre, plus les premiers cinquante dinars que je lui avais donnés et les cent autres dinars de la deuxième rencontre, noués, dans le mouchoir même, du nœud que j’y avais fait moi-même ! Alors moi je reconnus par là la bénédiction que m’avait apportée ma chasteté, et j’en rendis grâces à Allah !
Dans la suite, j’emmenai ma femme, la Franque devenue musulmane, en Égypte, ici même. Et c’est elle, ô mes hôtes, qui m’a rendu père de ces enfants blancs qui bénissent leur Créateur. Et jusqu’à ce jour nous avons vécu dans notre union, mangeant notre pain comme nous l’avons cuit d’abord ! Et telle est mon histoire ! Mais Allah est plus savant ! »
— Et Schahrazade, ayant raconté cette anecdote, se tut. Et le roi Schahriar dit : « Que ce fellah est heureux, Schahrazade ! » Et Schahrazade dit : « Oui, ô Roi, mais certainement il n’est pas plus heureux que ne l’a été Khalife le Pêcheur avec les singes marins et le khalifat ! » Et le roi Schahriar demanda : « Et qu’elle est donc cette Histoire de Khalife et du khalifat ? » Schahrazade répondit : « Je vais tout de suite te la raconter ! »
HISTOIRE DE KHALIFE ET DU KHALIFAT
Et Schahrazade dit :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait, en l’antiquité du temps et le passé de l’âge et du moment, dans la ville de Baghdad, un homme qui était pêcheur de son métier et s’appelait Khalife. Et c’était un homme si pauvre, si malheureux et si dénué de tout, qu’il n’avait jamais pu réunir les quelques cuivres nécessaires pour se marier ; et il restait ainsi célibataire, tandis que les plus pauvres des pauvres avaient femme et enfants.
Or, un jour il prit, selon son habitude, ses filets sur son dos et vint au bord de l’eau pour les jeter de bon matin, avant l’arrivée des autres pêcheurs. Mais, dix fois de suite, il les jeta sans rien prendre du tout. Et son dépit en fut d’abord extrême ; et sa poitrine se rétrécit et son esprit devint perplexe ; et il s’assit sur le rivage en proie au désespoir. Mais il finit par calmer ses mauvaises pensées, et il dit : « Qu’Allah me pardonne mon mouvement ! Il n’y a de recours qu’en Lui ! Il pourvoit à la subsistance de ses créatures, et ce qu’Il donne personne ne peut nous l’ôter, et ce qu’Il refuse personne ne peut nous le donner ! Prenons donc les jours bons et les mauvais comme ils viennent, et préparons une poitrine gonflée de patience contre les malheurs. Car la mauvaise fortune est comme l’abcès qui ne crève et ne s’abolit que par des soins patients ! »
Lorsque le pécheur Khalife se fut réconforté l’âme par ces paroles, il se releva courageusement, et, s’étant retroussé les manches, serré la ceinture et relevé la robe, il lança ses filets dans l’eau aussi loin que pouvait donner son bras, et attendit un bon moment ; après quoi il attira à lui la corde, et tira dessus de toutes ses forces ; mais les filets étaient si lourds, qu’il dut prendre des précautions infinies pour les ramener sans les rompre. Il y réussit enfin, en s’y prenant délicatement ; et, les ayant devant lui, il les ouvrit, le cœur palpitant ; mais il n’y trouva qu’un gros singe borgne et estropié…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… mais il n’y trouva qu’un gros singe borgne et estropié.
À cette vue, le malheureux Khalife s’écria : « Il n’y a de force et de puissance qu’en Allah ! En vérité nous appartenons à Allah et vers Lui nous retournerons ! Mais quelle fatalité me poursuit aujourd’hui ! Et que signifient cette chance désastreuse et ce sort calamiteux ? Que m’arrive-t-il donc en ce jour béni ? Mais tout cela est écrit par Allah (qu’Il soit exalté !) » Et, disant cela, il prit le singe et l’attacha par une corde à un arbre qui poussait sur le rivage ; puis il saisit un fouet qu’il avait sur lui, et, le levant en l’air, il voulut tomber sur le singe à coups bien appliqués, pour ainsi exhaler son désappointement. Mais soudain le singe, avec l’aide d’Allah, remua la langue et, avec un parler éloquent, dit à Khalife : « Ô Khalife, arrête ta main, et ne me frappe pas ! Laisse-moi plutôt attaché à cet arbre, et va encore une fois jeter ton filet dans l’eau, en te fiant à Allah qui te donnera ton pain du jour ! »
Lorsque Khalife eut entendu ce discours du singe borgne et estropié, il s’arrêta dans son geste menaçant et s’en alla vers l’eau où il jeta son filet, en laissant flotter la corde. Et lorsqu’il voulut la tirer à lui, il trouva le filet encore plus lourd que la première fois ; mais, en s’y prenant avec lenteur et précaution, il réussit à le ramener sur le rivage, et voici ! il trouva dedans un second singe, non point borgne ou aveugle, mais fort beau, avec les yeux allongés de kohl, les ongles teints de henné, les dents blanches et séparées par de jolis intervalles, et un derrière rose et non point de couleur crue comme le derrière des autres singes ; et il avait la taille prise dans un habit rouge et bleu, fort agréable à voir, et des bracelets d’or aux poignets et aux chevilles et des pendants d’or aux oreilles ; et il riait en regardant le pêcheur, et clignait des yeux et faisait du bruit avec sa langue.
À cette vue, Khalife s’écria : « C’est donc aujourd’hui la journée des singes ! Louanges à Allah qui a changé en singes les poissons de l’eau ! Je ne suis donc venu ici que pour faire une telle pêche ! Ô journée de poix, voilà ton commencement ! Tu es comme le livre dont on sait le contenu quand on en a lu la première page ! Mais tout cela ne m’arrive qu’à cause du conseil du premier singe ! » Et, disant ces paroles, il courut vers le singe borgne attaché à l’arbre, et leva sur lui son fouet qu’il fit tournoyer d’abord trois fois dans l’air, en criant : « Regarde, ô visage de mauvais augure, ce qui résulte pour moi du conseil que tu m’as donné ! De t’avoir écouté et d’avoir ouvert ma journée avec la vue de ton œil borgne et de ta difformité, me voici condamné à mourir de fatigue et de faim ! » Et il cingla du fouet son dos, et allait recommencer, quand le singe lui cria : « Ô Khalife, plutôt que de me frapper, va d’abord parler à mon compagnon, le singe que tu viens de tirer de l’eau ! Car, ô Khalife, le traitement que tu veux m’infliger ne te servira à rien, au contraire ! Écoute-moi donc, c’est pour ton bien ! » Et Khalife, fort perplexe, lâcha le singe borgne et revint près du second qui le voyait venir en riant de toutes ses dents. Et il lui cria : « Et toi, ô visage de poix, qui donc peux-tu être ? » Et le singe aux beaux yeux répondit : « Comment, ô Khalife ! Ne me reconnais-tu donc pas ? » Il dit : « Non ! je ne te connais pas ! Parle vite, ou bien ce fouet va s’abaisser sur ton derrière ! » Et le singe répondit : « Ce langage, ô Khalife, n’est pas convenable ! Et tu ferais bien mieux de me parler autrement, et de retenir mes réponses, qui t’enrichiront ! » Alors Khalife jeta le fouet loin de lui, et dit au singe : « Me voici prêt à t’écouter, ô seigneur singe, roi de tous les singes ! » Et l’autre dit : « Sache alors, ô Khalife, que j’appartiens à mon maître le changeur juif Abou-Saada, et que c’est à moi qu’il doit sa fortune et sa réussite dans les affaires ! » Khalife demanda : « Et comment cela ? » Il répondit : « Simplement parce que le matin je suis la première personne dont il regarde le visage, et la dernière dont le soir il prend congé avant de s’endormir ! » Et Khalife, à ces paroles, s’écria : « Le proverbe n’est donc pas vrai qui dit : Calamiteux comme le visage du singe… ? » Puis il se tourna vers le singe borgne, et lui cria : « Tu entends, toi, n’est-ce pas ? Ton visage ce matin ne m’a apporté que de la fatigue et du désappointement ! Ce n’est pas comme ton frère que voici ! » Mais le singe aux beaux yeux dit : « Laisse mon frère tranquille, ô Khalife, et écoute-moi enfin ! Commence donc, pour éprouver la vérité de mes paroles, par m’attacher au bout de la corde qui tient à tes filets, et jette-les à l’eau encore une fois. Et tu verras de la sorte si je te porte bonheur…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et tu verras de la sorte si je te porte bonheur ! »
Alors Khalife fit ce que le singe venait de lui conseiller, et, ayant jeté ses filets, amena un magnifique poisson, gros comme un mouton, avec des yeux comme deux dinars d’or, et des écailles comme des diamants. Et, glorieux comme s’il était devenu le maître de la terre et de ses dépendances, il vint le porter en triomphe au singe aux beaux yeux qui lui dit : « Tu vois bien ! Maintenant va ramasser de bonnes herbes fraîches, mets en au fond de ton panier, place le poisson dessus, couvre le tout d’une nouvelle couche d’herbes et, nous laissant nous deux, les singes, attachés à cet arbre, prends le panier sur ton épaule et va le porter dans la ville de Baghdad. Et si les passants t’interrogent sur ce que tu portes, ne leur réponds pas un mot. Et tu entreras dans le souk des changeurs, et tu trouveras au milieu du souk la boutique de mon maître Abou-Saada le juif, cheikh des changeurs. Et tu le trouveras assis sur un divan avec un coussin derrière lui, et deux caisses devant lui, l’une pour l’or et l’autre pour l’argent. Et tu trouveras chez lui des jeunes garçons, des esclaves, des serviteurs et des employés. Alors, toi, tu t’avanceras près de lui, tu déposeras le panier à poisson devant lui et tu lui diras : « Ô Abou-Saada, voici ! Moi je suis allé aujourd’hui à la pêche, et j’ai jeté les filets en ton nom, et Allah a envoyé ce poisson qui est dans ce panier ! » Et tu découvriras délicatement le poisson. Alors il te demandera : « L’as-tu déjà proposé à un autre qu’à moi ? » Toi, dis-lui : « Non, par Allah ! » Et lui, il prendra le poisson et t’offrira, comme prix, un dinar. Mais tu le lui retourneras. Et il t’offrira deux dinars ; mais tu les lui retourneras. Et chaque fois qu’il te fera une offre, tu la repousseras, même s’il t’offre le poids en or du poisson ! N’accepte donc rien de lui, fais-y bien attention. Et il te dira : « Dis-moi alors ce que tu désires ! » Et toi tu lui répondras : « Par Allah ! je ne vends le poisson que contre deux paroles ! » Et s’il te demande : « Quelles sont ces deux paroles ? » Tu lui répondras : « Lève-toi sur tes pieds et dis : « Soyez témoins, ô vous tous qui êtes présents dans le souk, que je consens à échanger le singe de Khalife le pêcheur contre mon singe, que je troque ma chance contre sa chance et mon lot de bonheur contre son lot de bonheur ! » Et toi tu ajouteras, en t’adressant à Abou-Saada : « Tel est le prix de mon poisson. Car je n’ai que faire de l’or ! Je n’en connais ni l’odeur, ni le goût, ni l’utilité ! » Ainsi tu parleras, ô Khalife ! Et si le juif consent à ce marché, moi, étant devenu ta propriété, tous les jours de bon matin je te souhaiterai le bonjour, et le soir je te souhaiterai le bonsoir ; et de la sorte je te porterai bonheur, et tu gagneras cent dinars dans ta journée. Quant à Abou-Saada le juif, il inaugurera tous les matins sa journée par la vue de ce singe borgne et estropié, et il aura tous les soirs la même vision ; et Allah l’affligera chaque jour d’une nouvelle exaction ou d’une corvée ou d’une avanie ; et, de la sorte, au bout de peu de temps, il sera ruiné et, n’ayant plus rien entre les mains, il sera réduit à la mendicité ! Ainsi donc, ô Khalife, retiens bien ce que je viens de te dire, et tu prospéreras et tu te trouveras dans le droit chemin vers le bonheur ! »
Lorsque Khalife le pêcheur eut entendu ce discours du singe, il répondit : « J’accepte ton conseil, ô roi de tous les singes ! Mais alors que faut-il que je fasse de ce borgne de malheur ? Faut-il le laisser attaché à l’arbre ? Car je suis bien perplexe à son sujet ! Puisse Allah ne le bénir jamais ! » Il répondit : « Lâche-le plutôt, pour qu’il retourne à l’eau. Et lâche-moi également. C’est mieux ! » Il répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il s’approcha du singe borgne et estropié, et le détacha de l’arbre ; et il rendit aussi la liberté au singe conseiller. Et aussitôt, en deux gambades, ils furent dans l’eau où ils plongèrent et disparurent.
Alors Khalife prit le poisson, le lava, le mit dans le panier au-dessus de l’herbe verte et fraîche, le couvrit d’herbe également, prit le tout sur son épaule, et s’en alla à la ville, en chantant de tout son gosier.
Or, lorsqu’il fut entré dans les souks, les gens et les passants le reconnurent et, comme d’habitude ils plaisantaient avec lui, ils se mirent à lui demander : « Que portes-tu, ô Khalife ! » Mais il ne leur répondait pas et ne les regardait même pas, et cela tout le long du chemin. Et il arriva de la sorte au souk des changeurs, et il suivit les boutiques une à une jusqu’à ce qu’il fût arrivé à celle du juif. Et il le vit lui-même qui était assis majestueusement au milieu de sa boutique, sur un divan, avec, empressés à son service, des serviteurs en nombre, de tout âge et de toute couleur ; et il avait ainsi l’air d’être un roi du Khorassân ! Et Khalife, après s’être bien assuré qu’il avait affaire au juif lui-même, s’avança jusque entre ses mains, et s’arrêta. Et le juif leva la tête vers lui et, l’ayant reconnu, lui dit : « Aisance et famille, ô Khalife ! Sois le bienvenu…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Aisance et famille, ô Khalife ! Sois le bienvenu ! Et dis-moi quelle est ton affaire et ce que tu désires. Et si quelqu’un par hasard t’a dit de mauvaises paroles ou t’a froissé ou t’a bousculé, hâte-toi de me le dire afin que j’aille avec toi trouver le wali, et lui demander réparation du tort ou du dommage qu’on t’a causé ! » Il lui répondit : « Non, par la vie de ta tête, ô chef des juifs et leur couronne, personne ne m’a dit de mauvaises paroles ni ne m’a froissé ni ne m’a bousculé, bien au contraire ! Mais moi je sortis aujourd’hui de ma maison et m’en allai sur le rivage et jetai, à ta chance et en ton nom, mes filets dans l’eau. Et je les retirai et trouvai dedans ce poisson-ci ! » Et, parlant de la sorte, il ouvrit son panier, tira délicatement le poisson de son lit d’herbes, et le présenta avec ostentation au changeur juif. Et lorsque celui-ci vit ce poisson, il le trouva admirable et s’écria : « Par le Pentateuque et les Dix Commandements ! sache, ô pêcheur, que moi j’étais hier endormi quand je vis en songe la Vierge Marie m’apparaître pour me dire : « Ô Abou-Saada, demain tu auras de moi un cadeau ! » Or, c’est ce poisson-ci qui doit être le cadeau en question, sans aucun doute ! » Puis il ajouta : « Par ta religion, dis-moi, ô Khalife, as-tu déjà montré ou proposé ce poisson à quelqu’un d’autre que moi ? » Et Khalife lui répondit : « Non, par Allah ! je le jure par la vie d’Abou-Bekr le Sincère, ô chef des juifs et leur couronne, personne, hormis toi, ne l’a encore vu ! » Alors le juif se tourna vers l’un de ses jeunes esclaves et lui dit : « Toi, viens ici ! Prends ce poisson et va le porter à la maison, et dis à ma fille Saada de le nettoyer, d’en faire frire la moitié et d’en griller l’autre moitié, et de me tenir le tout au chaud jusqu’à ce que j’aie fini d’expédier les affaires et que je puisse rentrer à la maison ! » Et Khalife, pour renforcer l’ordre, dit au garçon : « Oui, ô garçon, recommande bien à ta maîtresse de ne pas le brûler, et fais-lui voir la belle couleur de ses branchies ! » Et le garçon répondit : « J’écoute et j’obéis, ô mon maître ! » Et il s’en alla.
Quant au juif ! Il tendit du bout des doigts un dinar à Khalife le pêcheur, en lui disant : « Prends ceci pour toi, ô Khalife, et dépense-le sur ta famille ! » Et lorsque Khalife eut pris instinctivement le dinar, et l’eut vu briller dans sa paume, lui qui de sa vie n’avait encore vu de l’or et n’en soupçonnait même pas la valeur, il s’écria : « Gloire au Seigneur, Maître des trésors et Souverain des richesses et des domaines ! » Puis il fit quelques pas pour s’en aller, quand il se rappela tout d’un coup la recommandation du singe aux beaux yeux et, revenant sur ses pas, il jeta le dinar devant le juif et lui dit : « Prends ton or et rends le poisson du pauvre monde ! Crois-tu donc pouvoir impunément te moquer des pauvres comme moi ? »
Lorsque le Juif eut entendu ces paroles, il crut que Khalife voulait plaisanter avec lui ; et, tout en riant de la chose, il lui tendit trois dinars au lieu d’un ! Mais Khalife lui dit : « Non, par Allah ! assez de ce jeu déplaisant ! Crois-tu vraiment que je me résoudrai jamais à vendre mon poisson pour un prix si dérisoire ? « Alors le Juif lui tendit cinq dinars au lieu de trois, et lui dit : « Prends ces cinq dinars pour prix de ton poisson, et laisse de côté l’avidité ! » Et Khalife les prit dans sa main et s’en alla bien content ; et il les regardait, ces dinars d’or, et s’en émerveillait et se disait : « Gloire à Allah ! Il n’y a certes pas chez le khalifat de Baghdad ce qu’il y a dans ma main aujourd’hui ! » Et il continua son chemin jusqu’à ce qu’il fût arrivé au bout du souk.
Alors il se souvint des paroles du singe et de la recommandation qu’il lui avait faite ; et il s’en revint chez le juif et lui jeta l’or avec mépris. Et le juif lui demanda : « Qu’as-tu donc, ô Khalife, et que demandes-tu ? Veux-tu changer tes dinars d’or en drachmes d’argent ? » Il répondit : « Je ne veux ni tes drachmes ni tes dinars, mais je veux que tu me rendes le poisson du pauvre monde ! »
À ces paroles, le juif se fâcha, et cria et dit : « Comment, ô pêcheur ! Tu m’apportes un poisson qui ne vaut pas un dinar, et je t’en donne cinq dinars, et tu n’es pas satisfait ! Es-tu fou ? Ou bien veux-tu enfin me dire à combien tu veux me le céder ? » Khalife répondit : « Je ne veux le céder ni pour de l’argent, ni pour de l’or ; mais je veux le vendre moyennant deux paroles, seulement ! » Lorsque le juif eut entendu qu’il était question de deux paroles, il crut qu’il s’agissait des deux paroles qui servent de formule pour la profession de foi de l’Islam, et que le pêcheur lui demandait, pour un poisson, d’abjurer sa religion ! Aussi, de colère et d’indignation, ses yeux saillirent jusqu’au sommet de sa tête, et sa respiration s’arrêta, et sa poitrine se creusa, et ses dents grincèrent ; et il s’écria : « Ô rognure d’ongle des musulmans ! tu veux donc me séparer de ma religion pour ton poisson, et me faire abjurer ma foi et ma loi, celles qu’avant moi professaient mes pères ? » Et il héla ses serviteurs qui accoururent entre ses mains, et il leur cria : « Malheur ! Sus à ce visage de poix, et prenez-le-moi par la nuque et appliquez-lui une bastonnade soignée qui lui mette la peau en lambeaux ! Et ne l’épargnez pas…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et ne l’épargnez pas ! » Et aussitôt les serviteurs lui tombèrent dessus à coups de bâton, et ne cessèrent de le frapper que lorsqu’il eut roulé jusqu’au bas des marches de la boutique ! Et le juif leur dit : « Laissez-le maintenant se relever ! » Et Khalife se releva debout sur ses pieds, malgré les coups reçus, comme s’il n’avait rien senti ! Et le juif lui demanda : « Veux-tu maintenant me dire le prix que tu prétends recevoir pour ton poisson ? Je suis prêt à te le donner, pour en finir ! Et songe au traitement guère enviable que tu viens de subir ! » Mais Khalife se mit à rire et répondit : « N’aie aucune crainte à mon sujet, ô mon maître, pour ce qui est des coups de bâton ; car, moi, je puis supporter autant de coups que peuvent en manger dix ânes à la fois ! Je n’en suis guère impressionné. » Et le juif se mit également à rire de ces paroles, et lui dit : « Par Allah sur toi ! dis-moi ce que tu désires, et, moi, je te le jure par la vérité de ma foi, je te l’accorderai ! » Alors Khalife répondit : « Je te l’ai déjà dit ! Je ne te demande pour ce poisson que deux paroles seulement ! Et ne va pas encore croire qu’il s’agit pour toi de prononcer notre acte de foi musulman ! Car, par Allah ! ô juif, si tu deviens musulman, ton islamisation ne sera d’aucun avantage pour les musulmans et d’aucun tort pour les juifs ; et si, au contraire, tu t’obstines à rester dans ta foi impie et ton erreur de mécréant, ta mécréantise ne sera d’aucun tort pour les musulmans et d’aucun avantage pour les juifs ! Mais, moi, les deux paroles que je te demande, c’est autre chose ! Je désire que tu te lèves sur tes deux pieds et que tu dises : « Soyez témoins de mes paroles, ô habitants du souk, ô marchands de bonne foi : je consens, de ma propre volonté, à changer mon singe contre le singe de Khalife, et à troquer ma chance et mon sort en ce monde contre sa chance et son sort, et mon bonheur contre son bonheur ! »
À ce discours du pêcheur, le juif dit : « Si c’est là ta demande, la chose m’est aisée ! » Et, à l’heure et à l’instant, il se leva sur ses deux pieds, et dit les paroles que lui avait demandées Khalife le pêcheur. Après quoi il se tourna vers lui, et lui demanda : « Te reste-t-il encore quelque chose chez moi ? » Il répondit : « Non ! » Le Juif dit : « Alors, va-t’en en sécurité ! » Et Khalife, sans plus tarder, se leva, prit son panier vide et ses filets et retourna sur le rivage.
Alors, se fiant à la promesse du singe aux beaux yeux, il jeta ses filets à l’eau puis les ramena, mais avec de grandes difficultés, tant ils étaient pesants, et il les trouva pleins de poissons de toutes les espèces. Et aussitôt passa près de lui une femme qui tenait en équilibre sur sa tête un plateau, et qui lui demanda du poisson pour un dinar ; et il lui en vendit. Et un esclave vint également à passer et lui prit du poisson pour un second dinar. Et, ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il eût vendu pour cent dinars, ce jour-là ! Alors, triomphant à la limite du triomphe, il prit ses cent dinars, et rentra dans le misérable logis où il demeurait, près du marché aux poissons. Et lorsque vint la nuit, il fut très inquiet de tout cet argent qu’il possédait, et se dit en lui-même, avant de s’étendre sur sa natte pour dormir : « Ô Khalife, tout le monde dans le quartier sait que tu es un pauvre homme, un malheureux pêcheur sans rien entre les mains ! Or, maintenant, te voici devenu possesseur de cent dinars d’or ! Et les gens vont le savoir, et le khalifat Haroun Al-Rachid finira par le savoir également, et, un jour qu’il sera à court d’argent, il enverra chez toi les gardes pour te dire : « J’ai besoin de tant d’argent, et j’ai appris que tu avais chez toi cent dinars. Or, je viens te les emprunter ! » Alors moi je prendrai mon air le plus piteux, et je me lamenterai en me donnant de grands coups sur la figure, et je répondrai : « Ô émir des Croyants, je suis un pauvre, un rien du tout ! Comment aurais-je cette somme fabuleuse ? Par Allah ! celui qui t’a raconté la chose est un insigne menteur ! Je n’ai jamais eu et je n’aurai jamais pareille somme ! » Alors, pour me soutirer mon argent et me faire avouer l’endroit où je l’aurai caché, il me livrera au chef de la police Ahmad-la-Teigne, qui me fera ôter mes habits et me donnera la bastonnade jusqu’à ce que j’avoue et que je lui livre les cent dinars. Or, moi, maintenant, je pense que ce qu’il y a de mieux à faire, pour me tirer de cette mauvaise passe, c’est de ne point avouer ! Et pour ne point avouer, il faut que j’accoutume ma peau aux coups, bien que, Allah soit loué ! elle soit déjà passablement endurcie ! Mais il faut qu’elle le soit tout à fait, afin que ma délicatesse native ne regimbe pas sous les coups, et ne me fasse faire ce que mon âme ne désire point ! »
Ayant pensé de la sorte, Khalife n’hésita pas davantage, et il mit à exécution le projet que son âme de mangeur de haschich lui suggérait. Il se leva donc à l’instant, se mit complètement nu…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT CINQUANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Ayant pensé de la sorte, Khalife n’hésita pas davantage, et il mit à exécution le projet que son âme de mangeur de haschich lui suggérait. Il se leva donc à l’instant, se mit complètement nu, et prit un coussin en peau, qu’il avait, et le pendit devant lui à un clou de la muraille ; puis, saisissant un fouet de cent quatre-vingts nœuds, il se mit à donner alternativement un coup sur sa propre peau et un coup sur la peau du coussin, et à pousser en même temps de grands cris comme s’il était déjà en présence du chef de la police et obligé de se défendre de l’accusation. Et il criait : « Aïe ! Hélas ! Par Allah, mon seigneur, c’est un mensonge ! Aïe ! un grand mensonge ! Hélas ! Aïe ! des paroles de perdition contre moi ! Ouh ! Ouh ! comme je suis délicat ! Tous des menteurs ! Je suis un pauvre ! Allah ! Allah ! un pauvre pêcheur ! Je ne possède rien ! Aïe ! rien des biens méprisables de ce monde ! Si ! je possède ! non ! je ne possède pas ! Si ! je possède ! non, je ne possède pas ! » Et il continua de la sorte à s’administrer ce remède, en donnant tantôt un coup sur sa peau, et tantôt un coup sur le coussin ; et, quand il avait trop mal, il oubliait son tour, et donnait deux coups au coussin ; et il finit même par ne plus se donner qu’un coup sur trois, puis sur quatre, puis sur cinq !
Tout cela !
Et les voisins, qui entendaient les cris et les coups résonner dans la nuit, et les marchands du quartier finirent par s’émouvoir et se dirent : « Que peut-il donc être arrivé à ce pauvre garçon pour qu’il crie de la sorte ? Et que sont ces coups qui pleuvent sur lui ? Peut-être sont-ce des voleurs qui l’ont surpris et qui le battent à le faire mourrir ! » Et alors, comme les cris et les hurlements ne faisaient qu’augmenter d’intensité, et que les coups devenaient de plus en plus nombreux, ils sortirent tous de leurs maisons, et coururent à la maison de Khalife. Mais comme ils en trouvèrent la porte fermée, ils se dirent : « Les voleurs ont dû entrer chez lui de l’autre côté, en descendant par la terrasse ! » Et ils montèrent sur la terrasse voisine et de là sautèrent sur la terrasse de Khalife, et descendirent chez lui en passant par l’ouverture du haut. Et ils le trouvèrent seul et tout nu, et en train de se donner des coups alternés, avec le fouet, et de pousser en même temps des hurlements et des protestations d’innocence ! Et il se démenait comme un éfrit, en sautant sur ses jambes !
À cette vue, les voisins, stupéfaits, lui demandèrent : « Qu’as-tu donc, Khalife ? Et quelle est l’affaire ? Les coups que nous entendions et tes hurlements ont mis tout le quartier en émoi, et nous ont tous empêchés de dormir ! Et nous voici avec des cœurs battant tumultueusement ! » Mais Khalife leur cria : « Que voulez-vous de moi, vous autres ? Est-ce que je ne suis plus le maître de ma peau, et ne puis-je pas en paix l’accoutumer aux coups ? Est-ce que je sais, moi, ce que peut me réserver l’avenir ? Allez, braves gens ! Vous feriez bien mieux de faire comme moi et de vous administrer ce même traitement ! Vous n’êtes pas plus que moi à l’abri des exactions et des avanies ! » Et, sans plus faire attention à leur présence, Khalife continua à hurler sous les coups qui claquaient sur le coussin, en pensant qu’ils tombaient sur sa propre peau.
Alors les voisins, voyant cela, se mirent à rire tellement qu’ils se renversèrent sur leur derrière, et finirent par s’en aller comme ils étaient venus.
Quant à Khalife, il se fatigua au bout d’un certain temps mais ne voulut point fermer l’œil, par crainte des voleurs, tant il était dans l’embarras de sa fortune nouvelle. Et le matin, avant d’aller à son travail, il pensait encore à ses cent dinars, et se disait : « Si je les laisse dans mon logis, ils seront volés certainement ; si je les serre autour de ma taille dans une ceinture, ils seront remarqués par quelque larron qui se mettra à l’affût dans un endroit solitaire pour attendre mon passage, et me sautera dessus, me tuera et me dépouillera. Aussi je vais faire mieux que tout cela ! » Alors il se leva, déchira son caban en deux, confectionna un sac avec l’une des moitiés, et enferma l’or dans ce sac qu’il pendit à son cou au moyen d’une ficelle. Après quoi, il prit ses filets, son panier et son bâton, et s’achemina vers le rivage. Et arrivé là, il saisit ses filets et de toute la force de son bras, il les lança dans l’eau. Mais le mouvement qu’il fit était si brusque et si peu mesuré, que le sac d’or sauta de son cou et suivit les filets dans l’eau ; et la force du courant l’entraîna au loin dans les profondeurs.
À cette vue, Khalife lâcha ses filets, se dévêtit en un clin d’œil en jetant ses vêtements sur le rivage, sauta dans l’eau et plongea à la recherche de son sac ; mais il ne réussit point à le retrouver. Alors il plongea une seconde fois et une troisième fois et ainsi de suite jusqu’à cent fois, mais inutilement. Alors, désespéré et à bout de forces, il remonta sur le rivage et voulut se vêtir ; mais il constata que ses vêtements avaient disparu, et il ne trouva que son filet, son panier et son bâton. Alors il frappa ses mains l’une contre l’autre et s’écria : « Ah ! les vils chenapans qui m’ont volé mes habits ! Mais tout cela ne m’arrive que pour donner raison au proverbe qui dit : Le pèlerinage ne s’achève pour le chamelier que lorsqu’il a enculé son chameau…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Le pèlerinage ne s’achève pour le chamelier que lorsqu’il a enculé son chameau ! » Il se décida alors à s’envelopper de son filet, faute de mieux, puis il prit son bâton à la main et, son panier sur son dos, il se mit à parcourir le rivage à grandes enjambées, en allant de côté et d’autre, à droite, à gauche, en avant et en arrière, haletant et désordonné et enragé comme un chameau en rut, et semblable en tous points à quelque éfrit rebelle échappé de l’étroite prison d’airain où le tenait enfermé Soleïmân !
Et voilà pour Khalife le pêcheur !
Mais pour ce qui est du khalifat Haroun Al-Rachid, dont il va être ici question, voici !
Il y avait à Baghdad, en ce temps-là, comme homme d’affaires et bijoutier du khalifat, un gros notable nommé Ibn Al-Kirnas. Et c’était un personnage si important dans le souk, que tout ce qui se vendait à Baghdad en belles étoffes, joyaux, objets précieux, jeunes garçons et jeunes filles, ne se vendait que par son entremise ou après avoir passé par ses mains ou avoir été soumis à son expertise. Or, un jour d’entre les jours qu’Ibn Al-Kirnas était assis dans sa boutique, il vit venir chez lui le chef des courtiers tenant par la main une adolescente dont jamais spectateur n’avait admiré la pareille, tant elle était à la limite de la beauté, de l’élégance, de la finesse et de la perfection. Et cette adolescente, outre les charmes qu’elle avait en elle, connaissait toutes les sciences, les arts, la poétique, le jeu des instruments d’harmonie, le chant et la danse. Aussi Ibn Al-Kirnas n’hésita pas à l’acheter, séance tenante, pour cinq mille dinars d’or ; et, après l’avoir habillée de vêtements pour mille dinars, il alla la présenter à l’émir des Croyants. Et elle passa la nuit chez lui. Et il put de la sorte mettre à l’épreuve, par lui-même, ses talents et ses connaissances variées. Et il la trouva experte en toutes choses et n’ayant point son égale dans l’époque. Elle s’appelait Force-des-Cœurs, et elle était brune et fraîche de peau.
Aussi l’émir des Croyants, enchanté de sa nouvelle esclave, envoya-t-il le lendemain à Ibn Al-Kirnas dix mille dinars comme prix d’achat. Et il ressentit pour l’adolescente une passion si violente, et son cœur fut tellement subjugué, qu’il négligea pour elle Sett Zobéida, sa cousine, fille d’Al-Kassim ; et il délaissa toutes les favorites ; et il resta un mois entier enfermé chez elle, ne sortant que pour la prière du vendredi et rentrant ensuite en toute hâte. Aussi les seigneurs du royaume trouvèrent-ils la chose trop grave pour durer plus longtemps, et allèrent-ils exposer leurs doléances au grand-vizir Giafar Al-Barmaki. Et Giafar leur promit de porter bientôt remède à cet état de choses, et attendit, pour voir le khalifat, la prière du vendredi suivant. Et il entra dans la mosquée et eut une entrevue avec lui et put lui parler pendant un long moment des aventures d’amour et de leurs conséquences. Et le khalifat, après l’avoir écouté sans l’interrompre, lui répondit : « Par Allah ! ô Giafar, je ne suis pour rien dans cette histoire et ce choix ; mais la faute est à mon cœur qui s’est laissé prendre dans les lacets de l’amour, et moi je ne sais guère le moyen de l’en tirer ! » Et le vizir Giafar répondit : « Sache, ô émir des Croyants, que ta favorite Force-des-Cœurs est désormais entre tes mains, soumise à tes ordres, une esclave parmi tes esclaves ; et tu sais que lorsque la main possède, l’âme ne convoite plus. Or, moi, je veux t’indiquer un moyen pour que ton cœur ne se lasse point de la favorite : c’est de t’en éloigner de temps en temps, en allant par exemple à la chasse ou à la pêche, car il est possible que les filets du pêcheur délivrent ton cœur de ceux où l’amour le tient enlacé ! Cela vaut encore mieux pour toi que de t’occuper, pour le moment, des affaires du gouvernement, car, dans la situation où tu te trouves, ce travail te causerait trop d’ennui ! » Et le khalifat répondit : « Ton idée est excellente, ô Giafar, allons nous promener sans retard ni délai ! » Et, dès que les prières furent terminées, ils quittèrent la mosquée, montèrent chacun sur une mule, et prirent la tête de leur escorte pour s’en aller hors de la ville et parcourir les champs.
Après avoir erré longtemps de côté et d’autre, pendant la chaleur du jour, ils finirent par laisser leur escorte loin derrière eux, distraits qu’ils étaient par leur conversation ; et Al-Rachid eut bien soif, et dit : « Ô Giafar, je suis torturé par une soif très forte ! » Et il regarda de tous côtés autour de lui, pour chercher quelque habitation, et aperçut quelque chose au loin, sur un tertre, qui bougeait, et demanda à Giafar : « Vois-tu, toi, ce que je vois là-bas ? » Il répondit : « Oui, ô commandeur des Croyants, je vois quelque chose de vague sur un tertre. Ce doit être quelque jardinier ou quelque planteur de concombres ! En tout cas, comme il doit y avoir certainement de l’eau dans son voisinage, je vais courir t’en chercher ! » Al-Rachid répondit : « Ma mule est plus rapide que ta mule ! Demeure donc ici, pour attendre notre escorte, tandis que je vais aller moi-même boire chez ce jardinier et revenir ensuite ! » Et, disant cela, Al-Rachid poussa sa mule dans cette direction-là, et s’éloigna avec la rapidité d’un vent d’orage ou d’un torrent qui tombe du haut d’un rocher ; et, en un clin d’œil, il atteignit la personne en question, qui n’était autre que Khalife le pêcheur. Et il le vit nu et empêtré dans ses filets, et couvert de sueur et de poussière, et les yeux rouges, saillants et égarés, et d’aspect horrible à regarder. Et il ressemblait de la sorte à un de ces éfrits malfaisants qui errent dans les lieux déserts…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il ressemblait de la sorte à un des ces éfrits malfaisants qui errent dans les lieux déserts. Et Haroun lui souhaita la paix, et Khalife lui rendit le souhait en maugréant et en lui lançant un regard flamboyant. Et Haroun lui dit : « Ô homme, as-tu à me donner une gorgée d’eau ? » Et Khalife lui répondit : « Ô toi, es-tu aveugle ou fou ? Ne vois-tu pas que l’eau coule derrière ce tertre ? » Alors Haroun contourna le tertre et descendit vers le Tigre où il se désaltéra, en s’étendant à plat ventre, et fit également se désaltérer sa mule. Puis il revint auprès de Khalife et lui dit : « Qu’as-tu donc à faire ici, ô homme, et quelle est ta profession ? » Khalife répondit : « En vérité, cette question est encore plus étrange et plus extraordinaire que celle concernant l’eau. Ne vois-tu donc pas sur mes épaules l’outil de mon métier ? » Et Haroun, ayant vu le filet, dit : « Tu dois être pêcheur, sans doute ! » Il dit : « Tu l’as dit ! » Et Haroun lui demanda : « Mais qu’as-tu fait de ton caban, de ta chemise et de ton sac ? » À ces paroles, Khalife, qui avait perdu ces divers objets que venait de nommer Al-Rachid, ne douta pas un instant qu’il ne fût lui-même le voleur qui les avait dérobés sur la rive, et, se précipitant sur Al-Rachid du haut du tertre, comme un éclair, il saisit la mule par la bride, en s’écriant : « Rends-moi mes effets, et fait cesser cette mauvaise plaisanterie ! » Haroun répondit : « Moi, par Allah ! je n’ai point vu tes habits, et je ne sais de quoi tu veux parler ! » Or, Al-Rachid avait, comme on sait, les joues grasses et gonflées et la bouche très petite. Aussi Khalife, l’ayant regardé avec plus d’attention, crut qu’il était un joueur de clarinette, et lui cria : « Veux-tu, oui ou non, ô joueur de clarinette, me rendre mes effets, ou bien préfères-tu danser sous mes coups de bâton et pisser dans tes vêtements ? »
Lorsque le khalifat vit l’énorme matraque du pêcheur levée sur sa tête, il se dit : « Par Allah ! je ne pourrai guère supporter la moitié d’un coup de ce bâton ! » Et, sans hésiter davantage, il se dépouilla de sa belle robe de satin et, l’offrant à Khalife, lui dit : « Ô homme, prends cette robe, pour remplacer tes effets perdus ! » Et Khalife prit la robe, la tourna dans tous les sens, et dit : « Ô joueur de clarinette, mes effets valent dix fois plus que cette vilaine robe ornementée. « Al-Rachid dit : « Soit ! mais revêts-la tout de même, en attendant que je te retrouve tes effets ! » Et Khalife la prit et s’en vêtit ; mais, l’ayant trouvée trop longue, il prit son couteau, qui était attaché à l’anse du panier à poisson, et, d’un coup, en retrancha tout le tiers inférieur dont il se servit pour se confectionner aussitôt un turban, tandis que la robe lui arrivait à peine jusqu’aux genoux ; mais il la préférait ainsi, pour ne pas avoir les mouvements gênés. Puis il se tourna vers le khalifat et lui dit : « Par Allah sur toi, ô joueur de clarinette, dis-moi ce que ton métier de joueur de clarinette te rapporte par mois comme appointements ? » Le khalifat répondit, n’osant plus contrarier son questionneur : « Mon métier de joueur de clarinette me rapporte environ dix dinars par mois ! » Et Khalife dit, avec un geste de commisération profonde : « Par Allah, ô pauvre, tu me rends bien triste à ton sujet ! Moi, en effet, ces dix dinars je les gagne en une heure de temps, rien qu’en jetant mon filet et en le retirant ; car j’ai dans l’eau un singe qui s’occupe de mes intérêts, et se charge chaque fois de pousser les poissons dans mes filets. Veux-tu donc, ô joues gonflées, entrer à mon service pour apprendre de moi le métier de pêcheur et devenir un jour mon associé dans le gain, en commençant d’abord par gagner cinq dinars par jour, comme mon aide ? Et, en outre, tu bénéficieras de la protection de ce bâton contre les exigences de ton ancien maître de clarinette que je me charge, s’il le faut, d’éreinter d’un seul coup ! » Et Al-Rachid répondit : « J’accepte la proposition ! » Khalife dit : « Descends alors du dos de la mule, et attache cette bête quelque part afin qu’elle puisse, au besoin, nous servir à transporter le poisson au marché ! Et viens vite commencer ton apprentissage de pêcheur ! »
Alors le khalifat, tout en soupirant en son âme et en jetant des yeux éperdus autour de lui, descendit du dos de sa mule, l’attacha près de là, retroussa ce qui lui restait de vêtements et attacha les pans de sa chemise à sa ceinture et vint se ranger près du pêcheur qui lui dit : « Ô joueur de clarinette, prends ce filet par un bout, jette-le sur ton bras de telle manière, et lance-le à l’eau de telle autre manière ! » Et Al-Rachid fit appel dans son cœur à tout le courage dont il se sentait capable et, ayant exécuté ce que lui ordonnait Khalife, jeta le filet à l’eau et, au bout de quelques instants, voulut le retirer ; mais il le trouva si pesant, qu’il ne put y arriver tout seul, et Khalife fut obligé de l’y aider ; et, à eux deux, ils le ramenèrent sur le rivage, tandis que Khalife criait à son aide : « Ô clarinette de mon zebb, si par malheur je trouve mon filet déchiré ou endommagé par les pierres du fond, je t’encule ! Et, de même que tu m’as pris mes vêtements, je te prendrai ta mule ! » Mais, heureusement pour Haroun, le filet fut trouvé intact et rempli de poissons de la plus grande beauté ! Autrement Haroun aurait certainement passé par le zebb du pêcheur, et Allah seul sait comment il aurait pu supporter une telle charge. Or, il n’en fut rien ! Au contraire, le pêcheur dit à Haroun : « Ô clarinette, tu es bien laid, et ta figure ressemble à mon derrière, exactement ; mais, par Allah ! si tu fais bien attention à ton nouveau métier, tu seras un jour un pêcheur extraordinaire…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ô clarinette, tu es bien laid, et ta figure ressemble à mon derrière, exactement ; mais, par Allah ! si tu fais bien attention à ton nouveau métier, tu seras un jour un pêcheur extraordinaire ! En attendant, ce que tu as de mieux à faire, c’est de remonter sur ta mule et d’aller au souk m’acheter deux grands paniers pour que j’y mette le surplus de cette pêche prodigieuse, pendant que je vais rester ici pour garder le poisson jusqu’à ton arrivée. Et ne te préoccupe pas d’autre chose, car j’ai ici la balance à poisson, les poids et tout ce qui est nécessaire pour la vente au détail. Et toi tu n’auras pour toute charge, quand nous serons arrivés au souk du poisson, que de me tenir la balance et de toucher l’argent des clients ! Mais hâte-toi de courir m’acheter les deux paniers. Et surtout prends bien garde de flâner, ou le bâton jouera sur ton dos ! » Et le khalifat répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Puis il se hâta de détacher sa mule et de l’enfourcher pour la mettre au grand galop ; et, riant à rendre l’âme, il alla rejoindre Giafar, qui, le voyant accoutré de si bizarre façon, leva les bras au ciel et s’écria : « Ô commandeur des Croyants, sans doute tu as dû trouver sur ta route quelque beau jardin où tu t’es couché et roulé sur l’herbe ! » Et le khalifat se mit à rire, en entendant ces paroles de Giafar. Puis les autres Barmécides de l’escorte, parents de Giafar, embrassèrent la terre entre ses mains et dirent : « Ô émir des Croyants, puisse Allah faire durer sur toi les joies et éloigner de toi les soucis ! Mais quelle est la cause qui t’a retenu si longtemps loin de nous, alors que tu ne nous avais quittés que pour boire une gorgée d’eau ? » Et le khalifat leur répondit : « Il vient de m’arriver une aventure prodigieuse des plus dilatantes et des plus extraordinaires ! » Et il leur raconta ce qui lui était arrivé avec Khalife le pêcheur, et comment, pour remplacer les vêtements qu’il était censé lui avoir volés, il lui avait donné en échange sa robe de satin ouvragé. Alors Giafar s’écria : « Par Allah ! ô émir des Croyants, quand je t’ai vu t’éloigner tout seul, si richement habillé, j’ai eu comme un pressentiment de ce qui allait t’arriver. Mais il n’y a pas grand mal, puisque je vais aller tout de suite racheter au pêcheur cette robe que tu lui as donnée ! » Le khalifat se mit à rire encore plus fort, et dit : « Tu aurais dû, ô Giafar, y penser plus tôt, car le bonhomme, pour l’ajuster à sa taille, en a déjà coupé un tiers et s’est servi du morceau coupé pour se faire un turban ! Mais, ô Giafar, j’ai eu vraiment assez d’une seule pêche, et je ne suis guère tenté de recommencer une telle besogne. Et, d’ailleurs, j’ai pêché en une fois de quoi me dispenser désormais de souhaiter un plus beau succès, car le poisson sorti de mon filet est d’une abondance miraculeuse, et se trouve là-bas, sur le rivage, sous la garde de mon maître Khalife qui n’attend que mon retour avec les paniers pour aller vendre au souk le produit de ma pêche ! » Et Giafar dit : « Ô émir des Croyants, je vais donc aller rabattre vers vous deux les acheteurs ! » Haroun s’écria : « Ô Giafar ! par les mérites de mes ancêtres, les Purs, je promets un dinar par poisson à tous ceux qui iront acheter de ma pêche à Khalife, mon maître ! »
Alors Giafar fit crier aux gardes de l’escorte : « Ho ! gardes et gens de l’escorte, courez au rivage et tâchez de rapporter du poisson à l’émir des Croyants ! » Et aussitôt tous ceux de l’escorte se mirent à courir vers l’endroit indiqué, et trouvèrent Khalife qui gardait la pêche ; et ils l’entourèrent comme les éperviers entourent une proie, et s’arrachèrent les poissons amoncelés devant lui, en se les disputant, malgré le bâton dont Khalife les menaçait en s’agitant. Et Khalife finit tout de même par être vaincu par le nombre, et s’écria : « Nul doute que ce poisson ne soit du poisson du paradis ! » Et il put, en distribuant force coups, réussir à sauver du pillage les deux plus beaux poissons de la pêche ; et il les prit, chacun dans une main, et se sauva dans l’eau pour échapper à ceux qu’il croyait être des brigands, coupeurs de routes. Et, enfoncé de la sorte au loin dans l’eau, il leva ses mains qui tenaient chacune un poisson et s’écria : « Ô Allah ! par les mérites de ces poissons de ton Paradis, fais que mon associé, le joueur de clarinette, ne tarde pas à revenir ! »
Or, comme il achevait cette invocation, un nègre de l’escorte, qui avait été en retard sur les autres, son cheval s’étant arrêté en chemin pour pisser, arriva le dernier sur le rivage et, ne voyant plus trace de poisson, regarda à droite et à gauche et aperçut Khalife dans l’eau, qui tenait un poisson dans chaque main. Et il lui cria : « Ô pêcheur, viens t’en par ici ! » Mais Khalife répondit : « Tourne le dos, ô avaleur de zebb ! » À ces paroles, le nègre, à la limite de la fureur, leva sa lance et, la pointant dans la direction de Khalife, lui cria : « Veux-tu venir ici et me vendre ces deux poissons au prix que tu fixeras, ou bien recevoir cette lance dans ton flanc ? » Et Khalife lui répondit : « Ne frappe pas, ô vaurien ! Il vaut encore mieux te donner le poisson que de perdre la vie ! » Et il sortit de l’eau et vint jeter avec dédain les deux poissons au nègre qui les ramassa, et les mit dans un mouchoir de soie brodé richement ; puis il porta la main à sa poche, pour y prendre de l’argent, mais il la trouva vide ; et il dit au pêcheur : « Par Allah, ô pêcheur, tu n’as pas de chance, car moi présentement je n’ai pas un seul drachme en poche ! Mais demain tu viendras au palais et tu demanderas le nègre eunuque Sandal. Et les serviteurs te mèneront à moi, et tu trouveras auprès de moi accueil généreux et ce que ta chance t’aura fixé ; et tu t’en iras ensuite en ta voie ! » Et Khalife, n’osant trop faire le rébarbatif, jeta à l’eunuque un regard qui en disait plus que mille insultes ou mille menaces d’enculage ou de fornication avec la mère ou la sœur du partenaire, et s’éloigna dans la direction de Baghdad, en frappant ses mains l’une contre l’autre, et en disant, avec un ton d’amertume et d’ironie : « En vérité, voilà un jour qui, dès son commencement, a été béni entre tous les jours bénis de ma vie ! C’est évident ! » Et il franchit de la sorte les murs de la ville, et parvint à l’entrée des souks. Or, lorsque les passants et les boutiquiers…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, lorsque les passants et les boutiquiers virent le pêcheur Khalife qui d’une part portait sur son dos ses filets, son panier et son bâton, et d’autre part était revêtu d’une robe et coiffé d’un turban qui à eux deux valaient bien mille dinars, ils l’entourèrent et marchèrent derrière lui, pour voir quelle pouvait être l’affaire, jusqu’à ce qu’il fût arrivé devant la boutique du tailleur même du khalifat. Et le tailleur, dès le premier regard jeté sur Khalife, reconnut en l’habit qu’il portait celui-là même qu’il avait livré depuis peu au commandeur des Croyants. Et il cria au pêcheur : « Ô Khalife, d’où t’est donc venue cette robe que tu portes ? » Et Khalife, de très mauvaise humeur, lui répondit en le toisant : « Et de quoi te mêles-tu donc, impudent au visage d’excrément ? Sache tout de même, pour voir que je ne cache rien, que cette robe m’a été donnée par l’apprenti auquel j’enseigne la pêche, et qui est devenu mon aide. Et il ne me l’a donnée que pour ne pas avoir la main coupée, à la suite du vol dont il s’est rendu coupable en me dérobant mes effets ! »
À ces paroles, le tailleur comprit que le khalifat avait dû, en sa promenade, rencontrer le pêcheur, et lui faire cette plaisanterie, pour rire de lui. Et il laissa Khalife continuer en paix son chemin, et arriver à sa maison, où nous le retrouverons demain.
Mais il est temps de savoir ce qui s’est passé au palais, pendant l’absence du khalifat Haroun Al-Rachid. Eh bien ! il s’y est passé des choses d’une gravité extrême.
En effet ! nous savons que le khalifat n’était sorti de son palais avec Giafar que pour aller prendre un peu d’air par les champs, et se distraire pour un moment de sa passion extrême pour Force-des-Cœurs. Or, il n’était point le seul que torturât cette passion pour l’esclave. Son épouse et cousine, Sett Zobéida, depuis l’arrivée au palais de cette adolescente, devenue la favorite exclusive de l’émir des Croyants, ne pouvait plus ni manger, ni boire, ni dormir, rien ! tant son âme était remplie par les sentiments de jalousie que ressentent d’ordinaire les femmes pour leurs rivales. Et, pour se venger de cet affront continuel qui la rapetissait à ses propres yeux et aux yeux de son entourage, elle n’attendait qu’une occasion, soit une absence fortuite du khalifat, soit un voyage, soit une occupation quelconque, qui lui permît d’être libre de ses mouvements. Aussi, dès qu’elle eut appris que le khalifat était sorti pour aller à la chasse et à la pêche, elle fit préparer, dans ses appartements, un festin somptueux où ne manquaient ni les boissons ni les plateaux de porcelaine remplis de confitures et de pâtisseries. Et elle envoya inviter, en grande cérémonie, la favorite Force-des-Cœurs, en lui faisant dire par les esclaves : « Notre maîtresse Sett Zobéida, fille de Kassem, épouse de l’émir des Croyants, t’invite aujourd’hui, ô notre maîtresse Force-des-Cœurs, à un festin qu’elle donne en ton honneur. Car elle a bu aujourd’hui un médicament et, comme pour en obtenir les meilleurs effets il faut qu’elle se réjouisse l’âme et se repose l’esprit, elle trouve que le meilleur repos et la meilleure joie ne peuvent lui venir que de ta vue et de tes chants merveilleux, dont elle a entendu parler avec admiration par le khalifat. Et elle souhaite fort en faire par elle-même l’essai ! » Et Force-des-Cœurs répondit : « L’ouïe et l’obéissance sont à Allah et à Sett Zobéida, notre maîtresse ! » Et elle se leva à l’heure et à l’instant ; et elle ne savait pas ce que lui réservait le destin dans ses projets mystérieux. Et elle prit avec elle les instruments de musique qui lui étaient nécessaires, et accompagna le chef-eunuque aux appartements de Sett Zobéida.
Lorsqu’elle fut arrivée en présence de l’épouse du khalifat, elle embrassa à plusieurs reprises la terre entre ses mains, puis se releva et, d’une voix infiniment délicieuse, elle dit : « La paix sur le rideau élevé et le voile sublime de ce harem, sur la descendante du Prophète et l’héritière de la vertu des Abbassides ! Puisse Allah prolonger le bonheur de notre maîtresse aussi longtemps que le jour et la nuit se succéderont l’un à l’autre ! » Et, ayant dit ce compliment, elle recula au milieu des autres femmes et des suivantes.
Alors Sett Zobéida, qui était étendue sur un grand divan de velours, leva lentement les yeux vers la favorite et la regarda fixement. Et elle fut éblouie
de ce qu’elle voyait…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Et elle fut éblouie de ce qu’elle voyait de beauté en cette adolescente accomplie qui avait des cheveux de nuit, des joues comme les corolles des roses, des grenades à la place des seins, des yeux brillants, des paupières languides, un front éclatant et un visage de lune. Et, certes, le soleil devait se lever de derrière la frange de son front, et les ténèbres de la nuit s’épaissir de sa chevelure ; le musc ne devait être recueilli que de son haleine durcie, et les fleurs lui devaient leur grâce et leurs parfums ; la lune ne brillait qu’en empruntant l’éclat de son front ; le rameau ne se balançait que grâce à sa taille, et les étoiles ne scintillaient que de ses yeux ; l’arc des guerriers ne se tendait qu’en imitant ses sourcils, et le corail des mers ne rougissait que de ses lèvres ! Était-elle irritée, ses amants tombaient par terre privés de vie ! Était-elle calmée, les âmes revenaient rendre la vie aux corps inanimés ! Lançait-elle un regard, elle ensorcelait, et soumettait les deux mondes à son empire. Car, en vérité, elle était un miracle de beauté, l’honneur de son temps et la gloire de Celui qui l’avait créée et perfectionnée !
Lorsque Sett Zobéida l’eut admirée et détaillée, elle lui dit : « Aisance, amitié et famille ! Sois la bienvenue parmi nous, ô Force-des-Cœurs ! Assieds-toi et divertis-nous de ton art et de la beauté de ton exécution ! » Et l’adolescente répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Puis elle s’assit et, allongeant la main, elle prit d’abord un tambourin, instrument admirable ; et on put ainsi lui appliquer ces vers du poète :
Ô joueuse de tambourin, mon cœur à t’entendre s’est envolé ! Et tandis que tes doigts battent le rythme profond, l’amour qui me tient suit la mesure, et le contre-coup frappe ma poitrine.
Tu ne prendras qu’un cœur blessé ! Que tu chantes sur un ton léger, ou que tu jettes le cri de la douleur, tu pénètres notre âme !
Ah ! lève-toi, ah ! dépouille-toi, ah ! jette le voile, et, levant tes pieds légers, ô toute belle, danse le pas de la délice légère et de notre folie !
Et, lorsqu’elle eut fait résonner l’instrument sonore, elle chanta, en s’accompagnant, ces vers improvisés :
« Les oiseaux, ses frères, ont dit à mon cœur, oiseau blessé : « Fuis ! fuis les hommes et la société ! »
Mais j’ai dit à mon cœur, oiseau blessé : « Mon cœur, obéis aux hommes et que tes ailes frémissent comme des éventails ! Réjouis-toi pour leur faire plaisir ! »
Et elle chanta ces deux strophes d’une voix si merveilleuse que les oiseaux du ciel s’arrêtèrent dans leur vol, et que le palais se mit à danser de tous ses murs, de ravissement. Alors Force-des-Cœurs laissa le tambourin et prit la flûte de roseau, sur laquelle elle appuya ses lèvres et ses doigts. Et on put de la sorte lui appliquer ces vers du poète :
Ô joueuse de flûte, l’instrument d’insensible roseau, que tiennent sous tes lèvres tes doigts de souplesse, acquiert une âme nouvelle au passage de ton haleine !
Souffle dans mon cœur ! Il résonnera mieux que l’insensible roseau de la flûte aux trous sonores, car tu y trouveras plus que sept blessures qui s’aviveront au toucher de tes doigts !
Lorsqu’elle eut enchanté les assistants d’un air de flûte, elle déposa la flûte et prit le luth, instrument admirable, dont elle régla les cordes, et l’appuya contre son sein en s’inclinant sur sa rotondité, avec la tendresse d’une mère qui s’incline sur son enfant, si bien que c’est certainement d’elle et de son luth que le poète a dit :
Ô joueuse de luth, tes doigts sur les cordes persanes excitent ou calment la violence, au gré de ton désir, comme un médecin habile qui, selon qu’il en est besoin, fait à son gré jaillir le sang des veines ou l’y laisse circuler tranquillement !
Qu’il est beau d’entendre parler, sous les doigts délicats, un luth aux cordes persanes, parler à ceux dont il ne possède pas le langage, et de voir tous les ignorants comprendre son langage sans paroles !
Et alors elle préluda sur quatorze modes différents, et chanta, en s’accompagnant, un chant en entier, qui confondit d’admiration ceux qui la voyaient et ravit de délices ceux qui l’entendaient.
Ensuite, Force-des-Cœurs, après avoir ainsi préludé sur les divers instruments et chanté des chansons variées devant Sett Zobéida, se leva dans sa grâce et sa souplesse ondoyante, et dansa ! Après quoi, elle s’assit et exécuta divers tours d’adresse, jeux de gobelets et d’escamotage, et cela d’une main si légère et avec tant d’art et d’habileté, que Sett Zobéida, malgré la jalousie, le dépit et le désir de vengeance, faillit tomber amoureuse d’elle et lui déclarer sa passion. Mais elle put réprimer à temps ce mouvement, tout en pensant en son âme : « Certes ! mon cousin Al-Rachid ne doit point subir de blâme d’être si amoureux d’elle…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … Certes ! mon cousin Al-Rachid ne doit point subir de blâme, d’être si amoureux d’elle ! » Et elle donna l’ordre aux esclaves de servir le festin, et laissa sa haine prendre le dessus sur ces premiers sentiments. Pourtant elle ne laissa pas la compassion fuir entièrement son cœur, et, au lieu d’accomplir le projet qu’elle avait formé d’abord d’empoisonner sa rivale, et de se débarrasser ainsi d’elle pour toujours, elle se contenta de faire mélanger dans les pâtisseries présentées à Force-des-Cœurs une très forte dose de bang soporifique. Et dès que la favorite eut porté à ses lèvres un morceau de ces pâtisseries, elle tomba la tête en arrière, et s’enfonça dans les ténèbres de l’évanouissement. Et Sett Zobéida, feignant une très grande douleur, ordonna aux esclaves de la transporter dans un appartement secret. Puis elle fit répandre la nouvelle de sa mort, en disant qu’elle s’était étouffée en mangeant trop vite, et fit faire un simulacre de funérailles solennelles et d’enterrement, et lui éleva à la hâte un tombeau somptueux dans les jardins mêmes du palais.
Tout cela eut donc lieu pendant l’absence du khalifat ! Mais lorsque, après son aventure avec le pêcheur Khalife, il fut rentré dans le palais, son premier soin fut de s’informer, auprès des eunuques, de sa bien-aimée Force-des-Cœurs. Et les eunuques, que Sett Zobéida avait menacés de la pendaison en cas d’indiscrétion, répondirent au khalifat sur un ton funèbre : « Hélas, ô notre seigneur, qu’Allah prolonge tes jours et verse sur ta tête l’arriéré dû à notre maîtresse Force-des-Cœurs ! Ton absence, ô émir des Croyants, lui a causé un tel désespoir et une telle douleur, qu’elle n’a pu en supporter la commotion, et une mort soudaine l’a frappée ! Et elle est maintenant dans la paix de son Seigneur ! »
À ces paroles, le khalifat se mit à courir dans le palais, comme un insensé, en se bouchant les oreilles et en demandant à grands cris sa bien-aimée à tous ceux qu’il rencontrait. Et tout le monde, sur son passage, se jetait à plat ventre, ou se cachait derrière les colonnades. Et il arriva de la sorte dans le jardin où s’élevait le faux tombeau de la favorite, et il se jeta le front contre le marbre, et, étendant les bras et pleurant toutes ses larmes, il s’écria :
« Ô tombeau, comment tes ombres froides et les ténèbres de ta nuit peuvent-elles enfermer la bien-aimée ?
Ô tombeau, par Allah, dis-moi ! la beauté, les charmes de mon amie sont-ils à jamais effacés ? S’est-il pour toujours évanoui, ce spectacle réjouissant de sa beauté ?
Ô tombeau ! certes tu n’es ni le Jardin des Délices ni le ciel élevé ; mais, dis-moi, comment alors se fait-il que je vois dans ton intérieur briller la lune et fleurir le rameau ? »
Et le khalifat continua de la sorte à sangloter et à exhaler sa douleur pendant une heure de temps. Après quoi il se leva et courut s’enfermer dans ses appartements, sans vouloir entendre les consolations ni recevoir son épouse et ses intimes !
Quant à Sett Zobéida, lorsqu’elle eut vu le succès de sa ruse, elle fit en secret enfermer Force-des-Cœurs dans un coffre à habits (car elle continuait à éprouver les effets soporifiques du bang) et ordonna à deux esclaves de confiance de porter ce coffre hors du palais, et de le vendre au souk au premier acheteur venu, à condition que l’achat fût fait sans qu’on soulevât le couvercle !
Et voilà pour tous ceux-là !
Mais pour ce qui est du pêcheur Khalife : Lorsque, le lendemain de la pêche, il se fut réveillé, sa première pensée fut pour le nègre châtré qui ne lui avait pas payé les deux poissons, et il se dit : « Je crois bien que ce que j’ai encore de mieux à faire c’est d’aller m’informer, au palais, de cet eunuque Sandal, fils de la maudite aux larges narines, puisqu’il me l’a bien recommandé lui-même ! Et s’il ne veut pas s’exécuter, par Allah ! je l’encule ! » Et il se dirigea vers le palais.
Or, en y arrivant, Khalife trouva tout le monde sens dessus dessous ; et, à la porte même, la première personne qu’il rencontra fut le nègre eunuque Sandal, assis au milieu d’un groupe respectueux d’autres nègres et d’autres eunuques, discutant et gesticulant. Et il s’avança de son côté, et, comme un jeune mamelouk voulait lui barrer la route, il le bouscula et lui cria : « Marche, fils de l’entremetteur ! » À ce cri, l’eunuque Sandal tourna la tête et vit que c’était Khalife le pêcheur. Et l’eunuque, en riant, lui dit de s’approcher ; et Khalife s’avança et dit : « Par Allah ! je t’aurais reconnu entre mille, ô mon blondeau, ô ma petite tulipe ! » Et l’eunuque éclata de rire, en entendant ces paroles, et lui dit avec aménité : « Assieds-toi un moment, ô mon maître Khalife ! Je vais tout de suite te payer ton dû ! » Et il mit la main dans sa poche pour prendre de l’argent et le lui donner, lorsqu’un cri annonça la présence du grand-vizir Giafar, qui sortait de chez le khalifat…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il mit la main dans sa poche pour prendre de l’argent et le lui donner, lorsqu’un cri annonça la présence du grand-vizir Giafar, qui sortait de chez le khalifat. Aussi les eunuques, les esclaves et les jeunes mamelouks se levèrent pour se ranger sur deux lignes ; et Sandal, auquel le vizir fit signe de la main qu’il avait à lui parler, laissa là le pêcheur, et se rendit en toute hâte aux ordres de Giafar. Et tous deux se mirent à causer longuement, en se promenant de long en large.
Lorsque Khalife vit que l’eunuque tardait à revenir près de lui, il crut que c’était une ruse de sa part pour ne pas le payer, d’autant plus que l’eunuque semblait l’avoir complètement oublié et ne s’inquiéter pas plus de sa présence que s’il n’existait pas. Alors il se mit à s’agiter et à faire des gestes de loin à l’eunuque, qui voulaient dire : « Reviens donc ! » Mais comme l’autre n’y prêtait aucune attention, il lui cria, d’un ton ironique : « Ô mon seigneur la Tulipe, donne-moi mon dû pour que je m’en aille ! » Et l’eunuque, à cause de la présence de Giafar, fut très confus de cette apostrophe, et ne voulut point répondre. Au contraire, il se mit à parler avec plus d’animation, pour ne point attirer de ce côté-là l’attention du grand-vizir ; mais ce fut peine perdue ! Car Khalife s’approcha davantage et, d’une voix formidable, s’écria, en lui faisant de grands gestes : « Ô insolvable vaurien, qu’Allah confonde les gens de mauvaise foi, et tous ceux qui dépouillent les pauvres de leur bien ! » Puis il changea de ton, et, ironique, lui cria : « Je me mets sous ta protection, ô mon seigneur Ventre-creux ! Et je te supplie de me donner mon dû pour que je puisse m’en aller. » Et l’eunuque fut à la limite de la confusion, car Giafar, cette fois, avait vu et entendu ; mais comme il ne saisissait pas encore de quoi il s’agissait, il demanda à l’eunuque : « Qu’a-t-il donc, ce pauvre homme ? Et qui a pu le frustrer de son dû ? » Et l’eunuque répondit : « Ô mon seigneur, ne sais-tu pas qui est cet homme-là ? » Giafar dit : « Par Allah ! d’où le connaîtrais-je, puisque c’est la première fois que je le vois ? » L’eunuque dit : « Ô notre seigneur, c’est justement le pêcheur dont nous nous sommes hier disputé les poissons pour les porter au khalifat ! Et moi, comme je lui avais promis de l’argent pour les deux derniers poissons qui lui restaient, je lui ai dit de venir aujourd’hui me trouver pour se faire payer son dû ! Et je voulais le payer tout à l’heure, quand j’ai été obligé d’accourir entre tes mains ! Et c’est pourquoi le bonhomme, impatienté, m’apostrophe maintenant de cette façon-là ! »
Lorsque le vizir Giafar eut entendu ces paroles, il sourit doucement et dit à l’eunuque : « Comment, ô chef des eunuques, as-tu fait ton compte pour manquer ainsi de respect, d’empressement et d’égards envers le maître même de l’émir des Croyants ! Pauvre Sandal ! que dira le khalifat s’il vint à apprendre qu’on n’a pas honoré à l’extrême son associé et maître, Khalife le pêcheur ! » Puis Giafar ajouta soudain : « Ô Sandal, surtout ne le laisse pas s’en aller, car il ne pouvait tomber plus à propos ! Justement le khalifat, la poitrine rétrécie, le cœur affligé, l’âme en deuil, est plongé dans le désespoir, par la mort de la favorite Force-des-Cœurs ; et j’ai inutilement cherché à le consoler, par tous les moyens ordinaires. Mais peut-être à l’aide de ce pêcheur Khalife, allons-nous pouvoir lui dilater la poitrine. Retiens-le donc pendant que je vais aller tâter le sentiment du khalifat à son sujet ! » Et l’eunuque Sandal répondit : « Ô mon seigneur, fais ce que tu juges opportun ! Et qu’Allah te conserve et te garde à jamais comme le soutien, le pilier et la pierre angulaire de l’empire et de la dynastie de l’émir des Croyants ! Et que sur toi et sur elle soit l’ombre protectrice du Très-Haut ! Et puissent la branche, le tronc et la racine rester intacts durant les siècles ! » Et il se hâta d’aller rejoindre Khalife pendant que Giafar se rendait auprès du khalifat. Et le pêcheur, voyant arriver enfin l’eunuque, lui dit : « Te voilà donc, ô Ventre-Creux ! » Et, comme l’eunuque donnait l’ordre aux mamelouks d’arrêter le pêcheur et de l’empêcher de s’en aller, celui-ci lui cria : « Ah ! voilà bien ce à quoi je m’attendais ! Le créancier devient le débiteur, et le demandeur devient le demandé ! Ah ! Tulipe de mon zebb, moi je viens demander ici mon dû, et l’on m’emprisonne sous prétexte d’arriéré de taxes et de non-paiement d’impôts ! » Et voilà pour lui.
Quant au khalifat, Giafar, en pénétrant auprès de lui, le trouva ployé en deux, la tête dans les mains et la poitrine soulevée de sanglots ! Et il se récitait doucement ces vers :
« Mes censeurs me reprochent sans cesse mon inconsolable douleur ! Mais que puis-je, quand le cœur refuse toute consolation ? Est-il sous mon pouvoir, ce cœur indépendant ?
« Et comment pourrais-je, sans mourir, supporter l’absence d’une enfant dont le souvenir remplit mon âme, une enfant charmante et douce, si douce, ô mon cœur !
« Oh non ! jamais je ne l’oublierai ! L’oublier quand la coupe a circulé entre nous, la coupe où j’ai bu le vin de ses regards, le vin dont je reste encore grisé ! »
Et lorsque Giafar fut entre les mains du khalifat, il dit : « La paix sur toi, ô émir des Croyants, ô défenseur de l’honneur de notre Foi, ô descendant de l’oncle du Prince des Apôtres ! Que la prière et la paix d’Allah soient sur Lui et sur tous les siens sans exception ! » Et le khalifat leva vers Giafar des yeux pleins de larmes et un regard douloureux, et lui répondit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le khalifat leva vers Giafar des yeux pleins de larmes et un regard douloureux, et lui répondit : « Et sur toi, ô Giafar, la paix d’Allah et sa miséricorde et ses bénédictions ! » Et Giafar demanda : « Le commandeur des Croyants permet-il à son esclave de parler, ou bien le lui défend-il ? » Et Al-Rachid répondit : « Et depuis quand, ô Giafar, t’est-il défendu de me parler, toi, le seigneur et la tête de tous mes vizirs ! Dis-moi tout ce que tu as à me dire ! » Et Giafar dit alors : « Ô notre seigneur, comme je sortais d’entre tes mains pour rentrer chez moi, j’ai rencontré, debout, à la porte du palais, au milieu des eunuques, ton maître et professeur et associé, Khalife le pêcheur, qui avait beaucoup de griefs à formuler contre toi, et se plaignait de toi, disant : « Gloire à Allah ! je ne comprends rien à ce qui m’arrive ! Je lui ai enseigné l’art de la pêche, et non seulement il ne m’en a aucune gratitude, mais il est parti pour me chercher deux paniers et s’est bien gardé de revenir ! Est-ce là une bonne association et un bon apprentissage ? Ou bien est-ce ainsi qu’on paie ses maîtres en retour ? » Or moi, ô émir des Croyants, je me suis hâté de venir t’aviser de la chose, pour que si tu as toujours l’intention d’être son associé, tu le sois ; sinon, que tu l’avises de la cessation de l’entente entre vous deux, afin qu’il puisse trouver un autre associé ou compagnon ! »
Lorsque le khalifat eut entendu ces paroles de son vizir, il ne put, malgré les sanglots qui l’étouffaient, s’empêcher de sourire, puis de rire aux éclats, et, soudain, il sentit se dilater sa poitrine et dit à Giafar : « Par ma vie sur toi, ô Giafar, dis-moi la vérité ! Est-il bien exact que le pêcheur Khalife soit maintenant à la porte du palais ? » Et Giafar répondit : « Par ta vie, ô émir des Croyants, Khalife lui-même, avec ses deux yeux, est à la porte ! » Et Haroun dit : « Ô Giafar, par Allah ! il me faut aujourd’hui lui faire justice, selon ses mérites, et lui rendre son dû ! Si donc Allah, par mon entremise, lui envoie des supplices ou des souffrances, il les aura intégralement ; si, au contraire, Il lui écrit pour son sort la prospérité et la fortune, il les aura également ! » Et, disant ces paroles, le khalifat prit une grande feuille de papier, la coupa en petits morceaux d’égale mesure, et dit : « Ô Giafar, écris de ta propre main, d’abord, sur vingt de ces petits billets, des sommes d’argent allant d’un dinar à mille dinars, et les noms de toutes les dignités de mon empire, depuis la dignité de khalifat, d’émir, de vizir et de chambellan, jusqu’aux plus infimes charges du palais ; puis écris, sur vingt autres billets, toutes les espèces de punitions et de tortures, depuis la bastonnade jusqu’à la pendaison et la mort ! » Et Giafar répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il prit un calame et écrivit de sa propre main, sur les billets, les indications ordonnées par le khalifat, telles que : Un millier de dinars, charge de chambellan, émirat, dignité de khalifat ; et : arrêt de mort, emprisonnement, bastonnade, et autres choses semblables. Puis il les plia tous de la même manière, les jeta dans un petit bassin d’or, et remit le tout au khalifat, qui lui dit : « Ô Giafar, je jure par les mérites sacrés de mes saints ancêtres, les Purs, et par ma royale ascendance qui remonte à Hamzah et à Akil que, lorsque Khalife le pêcheur va être ici tout à l’heure, je vais lui ordonner de tirer un billet de ces billets dont le contenu n’est connu que de moi et de toi, et que je lui accorderai tout ce qui sera écrit sur le billet qu’il aura tiré, quelle que soit la chose écrite ! Et serait-ce même ma dignité de khalifat qui lui écherrait, je l’abdiquerais à l’instant en sa faveur, et la lui transmettrais en toute générosité d’âme ! Mais si, au contraire, c’est la pendaison, ou la mutilation, ou la castration ou n’importe quel genre de mort qui va être son lot, je le lui ferai subir sans recours ! Va donc le prendre, et me l’amène sans retard ! »
En entendant ces paroles, Giafar se dit en lui-même : « Il n’y a de majesté et il n’y a de puissance qu’en Allah le Glorieux, l’Omnipotent ! Il est possible que le billet tiré par ce pauvre soit un billet de la mauvaise espèce, qui va être l’occasion de sa perte ! Et j’aurai été ainsi, sans le vouloir, la cause première de son malheur ! Car le khalifat en a fait le serment, et il n’y a pas à songer à lui faire changer de résolution ! Je n’ai donc qu’à aller chercher ce pauvre ! Et il n’arrivera que ce qui est écrit par Allah ! » Puis il sortit trouver Khalife le pêcheur et, le prenant par la main, il voulut l’entraîner à l’intérieur du palais. Mais celui-ci, qui n’avait cessé jusque-là de s’agiter, de se plaindre de son arrestation, et de se repentir d’être venu à la cour, faillit en voir sa raison s’envoler tout à fait, et s’écria : « Que j’ai été stupide de m’écouter et de venir trouver ici cet eunuque noir, Tulipe de malheur, ce fils lippu de la maudite aux larges narines, ce Ventre-creux ! » Mais Giafar lui dit : « Allons ! suis-moi ! » Et il l’entraîna, précédé et suivi par la foule des esclaves et des jeunes garçons que Khalife ne cessait d’invectiver. Et on le fit pénétrer à travers sept immenses vestibules, et Giafar lui dit : « Attention ! ô Khalife, tu vas être en présence de l’émir des Croyants, le défenseur de la Foi ! » Et, soulevant une grande portière, il le poussa dans la salle de réception, où sur son trône était assis Haroun Al-Rachid, environné de ses émirs et des grands de sa cour. Et Khalife, qui n’avait pas la moindre idée de ce qu’il voyait, n’en fut nullement déconcerté ; mais, regardant avec la plus grande attention Haroun Al-Rachid au milieu de sa gloire, il s’avança vers lui en éclatant de rire et lui dit : « Ah ! te voilà donc, ô clarinette ! Crois-tu donc avoir agi honnêtement en me laissant hier garder seul le poisson, moi qui t’ai appris le métier et t’ai chargé d’aller m’acheter deux paniers ? Tu m’as ainsi laissé sans défense et à la merci d’un tas d’eunuques qui sont venus, comme une nuée de vautours, me voler et m’enlever mon poisson, qui aurait pu me rapporter au moins cent dinars ! Et c’est toi aussi qui es la cause de ce qui m’arrive maintenant au milieu de tous ces gens qui me retiennent ici ! Mais toi, ô clarinette, dis-moi, qui a bien pu mettre la main sur toi et t’emprisonner et t’attacher sur cette chaise-là…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Mais toi, ô clarinette, dis-moi, qui a bien pu mettre la main sur toi et t’emprisonner et t’attacher sur cette chaise-là ? »
À ces paroles de Khalife, le khalifat sourit et, prenant dans ses deux mains le bassin d’or, où se trouvaient les billets écrits par Giafar, lui dit : « Approche, ô Khalife, et viens tirer un billet d’entre ces billets ! » Mais Khalife, éclatant de rire, s’écria : « Comment ! ô clarinette, tu as déjà changé de métier et abandonné la musique ! Te voici devenu maintenant astrologue ! Et hier tu étais apprenti pêcheur ! Crois-moi, clarinette, cela ne le mènera pas loin ! Car plus on fait de métiers, moins on en tire de profit ! Laisse donc de côté l’astrologie, et redeviens clarinette, ou bien reviens avec moi faire ton apprentissage de pêcheur ! » Et il allait continuer encore à parler, quand Giafar s’avança vers lui, et lui dit : « Assez de paroles comme ça ! Et viens tirer un de ces billets, comme te l’a ordonné l’émir des Croyants ! » Et il le poussa vers le trône.
Alors Khalife, tout en résistant à la poussée de Giafar, s’avança en maugréant vers le bassin d’or et, y plongeant lourdement toute sa main, en tira une poignée de billets à la fois. Mais Giafar, qui le surveillait, lui fit lâcher prise, et lui dit de n’en prendre qu’un seul. Et Khalife, le repoussant du coude, replongea sa main et ne retira cette fois qu’un seul billet, en disant : « Loin de moi toute idée de reprendre désormais à mon service ce joueur de clarinette aux joues gonflées, cet astrologue tireur d’horoscopes ! » Et, ce disant, il déplia le billet et, le tenant à rebours, car il ne savait pas lire, il le tendit au khalifat en lui disant : « Veux-tu me dire, ô clarinette, l’horoscope écrit sur ce billet ? Et surtout ne me cache rien ! » Et le khalifat prit le billet et, sans le lire, le tendit à son tour à Giafar, en lui disant : « Dis-nous à haute voix ce qui est écrit là-dessus ! » Et Giafar prit le billet et, l’ayant lu, leva les bras et s’écria : « Il n’y a de majesté et il n’y a de puissance qu’en Allah le Glorieux, l’Omnipotent ! » Et le khalifat, en souriant, demanda à Giafar : « De bonnes nouvelles, j’espère, ô Giafar ! Quoi ? Parle ! Faut-il que je descende du trône ? Faut-il y faire monter Khalife ? ou bien faut-il le pendre ? » Et Giafar répondit, d’un ton apitoyé : « Ô émir des Croyants, il y a, écrit sur ce billet : Cent coups de bâton au pêcheur Khalife ! »
Alors le khalifat, malgré les cris et les protestations de Khalife, dit : « Qu’on exécute la sentence ! » Et le porte-glaive Massrour fit saisir le pêcheur, qui hurlait éperdument, et, l’ayant fait étendre sur le ventre, lui fit appliquer en mesure cent coups de bâton, pas un de plus, pas un de moins ! Et Khalife, bien qu’il ne ressentit aucune douleur, à cause de l’endurcissement qu’il avait acquis, poussait des cris épouvantables et lançait mille imprécations contre le joueur de clarinette. Et le khalifat riait extrêmement ! Et lorsqu’on eut fini de lui administrer les cent coups, Khalife se releva, comme si de rien n’était, et s’écria : « Qu’Allah maudisse ton jeu, ô bouffi ! Depuis quand les coups de bâton font-ils partie des plaisanteries entre les gens comme il faut ? » Et Giafar, qui avait une âme miséricordieuse et un cœur pitoyable, se tourna vers le khalifat, et lui dit : « Ô émir des Croyants, permets que le pêcheur tire encore un billet ! Peut-être que le sort lui sera plus favorable cette fois. Et d’ailleurs, tu ne voudras pas que ton ancien maître s’éloigne du fleuve de ta libéralité, sans y avoir apaisé sa soif ! » Et le khalifat répondit : « Par Allah, ô Giafar, tu es bien imprudent ! Tu sais que les rois n’ont point l’habitude de revenir sur leur serment ou sur leur promesse ! Or, tu dois être sûr d’avance que si le pêcheur, ayant tiré un second billet, a comme lot la pendaison, il sera pendu sans recours ! Et tu auras été de la sorte la cause de sa mort ! » Et Giafar répondit : « Par Allah ! ô émir des Croyants, la mort du malheureux est préférable à sa vie ! » Et le khalifat dit : « Soit ! Qu’il tire donc un second billet ! » Mais Khalife, se tournant vers le khalifat, s’écria : « Ô clarinette de malheur, qu’Allah te récompense de ta libéralité ! Mais ne pourrais-tu pas, dis-moi, trouver dans Baghdad une autre personne que moi pour lui faire faire cette belle épreuve ? Ou bien n’y a-t-il plus que moi de disponible dans tout Baghdad ! » Mais Giafar s’avança vers lui et lui dit : « Prends encore un billet, et Allah te le choisira ! »
Alors Khalife plongea la main dans le bassin d’or et, au bout d’un moment, en tira un billet qu’il remit à Giafar. Et Giafar le déplia, le lut, et baissa les yeux sans parler. Et le khalifat, d’un ton calme, lui demanda : « Pourquoi donc ne parles-tu pas, ô fils de Yahia ? » Et Giafar répondit : « Ô émir des Croyants, il n’y a rien d’écrit sur ce billet ! C’est un billet blanc ! » Et le khalifat dit : « Tu vois bien ! La fortune de ce pêcheur ne l’attend pas chez nous ! Dis-lui donc maintenant de s’en aller au plus vite de devant mon visage ! J’en ai assez de le voir ! » Mais Giafar dit : « Ô émir des Croyants, je te conjure par les mérites sacrés de tes saints ancêtres, les Purs, de permettre au pêcheur de tirer encore un troisième billet ! Peut-être qu’ainsi il pourra y trouver de quoi ne pas mourir de faim ? » Et Al-Rachid répondit : « Bien ! Qu’il prenne donc un troisième billet, mais pas plus ! » Et Giafar dit à Khalife : « Allons ! ô pauvre, prends le troisième et dernier…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Allons ! ô pauvre, prends le troisième et dernier ! » Et Khalife tira encore une fois, et Giafar, prenant le billet, lut à haute voix : « Un dinar au pêcheur. » En entendant ces mots, Khalife le pêcheur s’écria : « Malédiction sur toi, ô clarinette de malheur ! Un dinar pour cent coups de bâton ! Quelle générosité ! Puisse Allah te le rendre au jour du Jugement ! » Et le khalifat se mit à rire de toute son âme et Giafar, qui avait en somme réussi à le distraire, prit le pêcheur Khalife par la main et le fit sortir de la salle du trône.
Lorsque Khalife arriva à la porte du palais, il rencontra l’eunuque Sandal qui l’appela et lui dit : « Viens, Khalife ! Viens nous faire un peu partager ce dont t’a gratifié la générosité de l’émir des Croyants ! » Et Khalife lui répondit : « Ah ! nègre de goudron, tu veux partager ? Viens donc recevoir la moitié de cent coups de bâton sur ta peau noire ! En attendant qu’Éblis te les administre dans l’enfer, tiens ! voici le dinar que m’a donné le joueur de clarinette, ton maître ! » Et il lui jeta à la figure le dinar que lui avait mis Giafar dans la main, et voulut franchir la porte pour s’en aller en sa voie. Mais l’eunuque courut derrière lui, et, tirant de sa poche une bourse de cent dinars, la tendit à Khalife en lui disant : « Ô pêcheur, prends ces dinars comme prix du poisson que je t’ai acheté hier ! Et va en paix ! » Et Khalife, à cette vue, se réjouit beaucoup et prit la bourse de cent dinars et aussi le dinar donné par Giafar, et, oubliant sa malechance et le traitement qu’il venait de subir, il prit congé de l’eunuque et s’en retourna chez lui, plein de gloire, et à la limite du ravissement.
Maintenant ! Comme Allah, quand Il a une fois décrété une chose, l’exécute toujours, et que cette fois son décret concernait précisément Khalife le pêcheur, sa volonté dut s’accomplir. En effet, en traversant les souks pour rentrer chez lui, Khalife fut arrêté, devant le marché des esclaves, par un cercle considérable de gens qui regardaient tous vers le même point. Et Khalife se demanda : « Que peut-elle bien regarder comme ça, cette foule attroupée ? » Et, poussé par la curiosité, il fendit la foule en bousculant marchands et courtiers, riches et pauvres, qui, le reconnaissant, se mirent à rire en se disant les uns aux autres : « Place ! faites place à l’opulent gaillard qui va acheter tout le marché ! Place au sublime Khalife, maître des enculeurs ! » Et Khalife, sans se déconcerter, et fort de se sentir lesté des dinars d’or serrés dans sa ceinture, arriva jusqu’au milieu du premier rang et regarda pour voir l’affaire. Et il vit un vieillard qui avait devant lui un coffre sur lequel était assis un esclave. Et ce vieillard faisait une criée à haute voix, disant : « Ô marchands ! ô gens riches ! ô nobles habitants de notre ville, qui de vous veut placer son argent dans une affaire du cent pour cent, en achetant, avec son contenu de nous inconnu, ce coffre bien venu, venu du palais de Sett Zobéida fille de Kassem, épouse de l’émir des Croyants ? À vous d’offrir ! Et qu’Allah bénisse le plus offrant ! » Mais un silence général répondait à son appel, car les marchands n’osaient hasarder une somme d’argent sur ce coffre dont ils ignoraient le contenu, et ils craignaient beaucoup qu’il n’y eût là-dedans quelque supercherie ! Mais enfin, l’un d’eux éleva la voix et dit : « Par Allah ! ce marché est bien hasardeux ! Et le risque est bien grand ! Pourtant je vais faire une offre, mais qu’on ne me la reproche pas ! Donc je vais dire un mot, et pas de blâme à mon adresse ! Voici ! vingt dinars, pas un de plus ! » Mais un autre marchand renchérit immédiatement et dit : « À moi pour cinquante ! » Et d’autres marchands renchérirent ; et les offres arrivèrent à cent dinars. Alors le crieur cria : « Y a-t-il parmi vous renchérisseur, ô marchands ? Le dernier offrant ! Cent dinars ! Le dernier offrant ? » Alors Khalife éleva la voix et dit : « À moi ! Pour cent dinars et un dinar ! »
À ces paroles de Khalife, les marchands, qui le savaient aussi net d’argent qu’un tapis secoué et battu, crurent qu’il plaisantait, et se mirent à rire. Mais Khalife défit sa ceinture et répéta d’une voix haute et furieuse : « Cent dinars et un dinar ! » Alors le crieur, malgré les rires des marchands, dit : « Par Allah ! le coffre lui appartient ! Et moi je ne le vends qu’à lui ! » Puis il ajouta : « Tiens ! ô pêcheur, paie les cent et un, et prends le coffre avec son contenu ! Qu’Allah bénisse la vente ! Et que la prospérité soit sur toi à cause de ton achat ! » Et Khalife vida sa ceinture, qui contenait juste cent dinars et un dinar, entre les mains du crieur ; et la vente se fit du plein consentement mutuel des deux parties. Et le coffre devint dès lors la propriété de Khalife le pêcheur.
Alors tous les portefaix du souk, voyant la vente conclue, se précipitèrent sur le coffre en bataillant à qui réussirait à le porter, moyennant salaire. Mais cela ne faisait point l’affaire du malheureux Khalife qui s’était dépouillé, pour cet achat, de tout l’argent qu’il possédait, et qui n’avait plus sur lui de quoi acheter un oignon ! Et les portefaix continuèrent à se battre en s’arrachant le coffre à qui mieux mieux, jusqu’à ce que les marchands fussent intervenus pour les séparer et eussent dit : « C’est le portefaix Zoraïk qui est arrivé le premier ! C’est donc à lui que revient la charge ! » Et ils chassèrent tous les portefaix, à l’exception de Zoraïk et, malgré les protestations de Khalife qui voulait porter lui-même le coffre, ils chargèrent le coffre sur le dos du portefaix, et lui dirent de suivre, avec sa charge, son maître Khalife. Et le portefaix, avec le coffre sur le dos, se mit à marcher derrière Khalife…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CINQ CENT SOIXANTE-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le portefaix, avec le coffre sur le dos, se mit à marcher derrière Khalife. Et Khalife se disait en son âme, tout en marchant : « Je n’ai plus sur moi ni or, ni argent, ni cuivre, pas même l’odeur de tout cela ! Et comment vais-je faire, en arrivant chez moi, pour payer ce maudit portefaix ? Et qu’avais-je besoin de portefaix ? Et qu’avais-je d’ailleurs besoin de ce coffre de malheur ? Et qui a bien pu me mettre en tête cette idée de l’acheter ! Mais ce qui est écrit doit courir ! Moi, en attendant, pour me tirer d’affaire avec ce portefaix, je vais le faire courir et marcher et perdre sa route à travers les rues, jusqu’à ce qu’il soit exténué de fatigue. Alors, de son plein gré, il s’arrêtera et refusera d’avancer davantage. Et moi je profiterai de son refus pour lui refuser à mon tour de le payer, et je prendrai moi-même le coffre sur mon dos ! »
Et, ayant ainsi formé ce projet, il le mit immédiatement à exécution. Il commença donc à aller d’une rue à une autre rue et d’une place à une autre place, et à faire tourner avec lui le portefaix par toute la ville, et cela depuis midi jusqu’au coucher du soleil, si bien que le portefaix fut tout à fait exténué et finit par grogner et murmurer, et se décida à dire à Khalife : « Ô mon maître, où se trouve donc ta maison ? » Et Khalife répondit : « Par Allah ! hier encore je savais où elle se trouvait, mais aujourd’hui je l’ai tout à fait oublié ! Et me voici en train de chercher avec toi son emplacement ! » Et le portefaix dit : « Donne-moi mon salaire, et prends ton coffre ! » Et Khalife dit : « Attends encore un peu, en allant doucement, pour me donner le temps de rassembler mes souvenirs et de réfléchir sur la place où se trouve ma maison ! » Puis, au bout d’un certain temps, comme le portefaix se remettait à geindre et à grommeler entre ses dents, il lui dit : « Ô Zoraïk, je n’ai point d’argent sur moi pour te donner ici-même ton salaire ! J’ai, en effet, laissé mon argent à la maison, et la maison je l’ai oubliée ! »
Et, comme le portefaix s’arrêtait, n’en pouvant plus de marcher, et allait déposer sa charge, vint à passer une connaissance à Khalife qui lui tapa sur l’épaule et lui dit : « Tiens ! c’est toi, Khalife ? Que viens-tu faire dans ce quartier si éloigné de ton quartier ? Et que fais-tu ainsi porter à cet homme ? » Mais avant que Khalife, décontenancé, eût eu le temps de répondre, le portefaix Zoraïk se tourna Vers le passant en question et lui demanda : « Ô oncle, où se trouve-t-elle donc la maison de Khalife ? » L’homme répondit : « Par Allah ! en voilà une question ! La maison de Khalife se trouve juste à l’autre bout de Baghdad, dans le khân en ruines situé près du marché aux poissons, dans le quartier des Rawassîn ! » Et il s’en alla en riant. Alors Zoraïk le portefaix dit à Khalife le pêcheur : « Allons ! marche, ô vilain ! Puisses-tu ne plus vivre ni marcher ! » Et il l’obligea à aller devant lui et à le conduire à son logis, dans le khân en ruines, près du marché aux poissons ! Et il ne cessa, jusqu’à l’arrivée, de l’invectiver et de lui reprocher sa conduite, en lui disant : « Ô toi, visage néfaste, puisse Allah te couper en ce monde le pain quotidien ! Que de fois n’avons-nous pas passé devant ton logis de désastre, sans que tu aies fait mine de m’arrêter ? Allons ! Aide-moi maintenant à descendre de mon dos ton coffre ! Et puisses-tu y être bientôt enfermé pour toujours ! » Et Khalife, sans dire un mot, l’aida à décharger le coffre, et Zoraïk, essuyant du revers de sa main, les grosses gouttes de sueur de son front, dit : « Nous allons voir maintenant la capacité de ton âme et la générosité de ta main dans le salaire qui m’est dû après toutes ces fatigues que tu m’as fait endurer sans nécessité ! Et hâte-toi, pour me laisser aller en ma voie ! » Et Khalife lui dit : « Certes ! mon compagnon, tu seras rétribué largement ! Veux-tu donc que je t’apporte de l’or ou de l’argent ? C’est à ton choix ! » Et le portefaix répondit : « Tu sais mieux que moi ce qui est convenable ! »
Alors Khalife, laissant le portefaix à la porte avec le coffre, entra dans son logement, et en ressortit bientôt tenant à la main un redoutable fouet aux lanières cloutées chacune de quarante clous aigus, capables d’assommer un chameau d’un seul coup ! Et il se précipita sur le portefaix, le bras levé et le fouet tournoyant, et l’abattit sur son dos, et recommença et récapitula, si bien que le portefaix se mit à hurler de travers et, tournant le dos, fila droit devant lui, les mains en avant, et disparut à un tournant de rue.
Débarrassé de la sorte du portefaix, qui, en somme, s’était chargé du coffre de sa propre initiative, Khalife se mit en devoir de traîner ce coffre jusqu’à son logement. Mais, à tout ce bruit, les voisins se rassemblèrent et, voyant l’accoutrement étrange de Khalife avec la robe en satin coupée aux genoux et le turban de même qualité, et apercevant aussi le coffre qu’il traînait, lui dirent : « Ô Khalife, d’où te viennent cette robe et ce coffre si lourd ? » Il répondit : « De mon garçon, un apprenti, clarinette de sa profession, qui s’appelle Haroun Al-Rachid…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
« … De mon garçon, un apprenti, clarinette de sa profession, qui s’appelle Haroun Al-Rachid ! » À ces paroles, les habitants du khân, voisins de Khalife, furent saisis d’épouvante pour leur âme, et se dirent les uns aux autres : « Pourvu que personne ne l’entende parler ainsi, cet insensé ! Sinon il sera appréhendé par la police et pendu sans recours ! Et notre khân sera détruit tout à fait, et nous serons peut-être, nous aussi, à cause de lui, pendus à la porte du khân ou châtiés d’un terrible châtiment ! » Et, terrifiés à l’extrême, ils l’obligèrent à renfermer sa langue dans sa bouche, et, pour en finir au plus vite, ils l’aidèrent à porter le coffre dans son logement, et poussèrent la porte sur lui.
Or, le logement de Khalife était si exigu que le coffre le remplit en entier, exactement, comme s’il avait été fait pour s’y emboîter. Et Khalife, ne sachant plus où se mettre, pour passer la nuit, s’étendit de tout son long sur le coffre, et se mit ainsi à réfléchir sur ce qui lui était arrivé dans la journée. Et soudain il se demanda : « Mais, au fait ! qu’est-ce que j’attends pour ouvrir le coffre et en voir le contenu ? » Et il sauta sur ses deux pieds et travailla des mains tant qu’il put pour essayer de l’ouvrir, mais en vain. Et il se dit : « Qu’est-il donc arrivé à ma raison, pour que je me sois ainsi décidé à acheter ce coffre que je ne puis même pas arriver à ouvrir ! » Et il essaya encore d’en casser le cadenas et de faire sauter la serrure, mais sans davantage réussir ! Alors il se dit : « Attendons à demain, pour mieux voir comment nous y prendre ! » Et il s’étendit de nouveau tout de son long sur la caisse, et ne tarda pas à s’endormir tout de son ronflement !
Or, comme il était là depuis une heure de temps, il se réveilla soudain, en sursautant d’effroi, et se tapa la tête contre le plafond de son logement ! Il venait, en effet, de sentir quelque chose se mouvoir à l’intérieur du coffre. Et, du coup, le sommeil s’envola de sa tête avec sa raison, et il s’écria : « Il y a sans aucun doute des genn là-dedans ! Louanges à Allah qui m’a inspiré, en me faisant ne pas ouvrir le couvercle ! Car si je l’avais ouvert, ils seraient sortis sur moi au milieu de l’obscurité, et qui sait ce qu’ils m’auraient fait ! Certes ! je n’en aurais pas éprouvé grand bien, en tout cas ! » Mais, à l’instant même où il formulait de la sorte sa pensée de terreur, le bruit redoubla à l’intérieur du coffre, et jusqu’à ses oreilles parvint comme une sorte de gémissement. Alors Khalife, à la limite de l’épouvante, chercha d’instinct une lampe pour se faire de la lumière ; mais il oubliait que sa pauvreté l’avait toujours empêché d’en avoir une, et, tout en tâtonnant des mains contre les murs de son logement, il claquait des dents et se disait : « Cette fois, c’est terrible ! tout à fait terrible ! » Puis, sa peur redoublant, il ouvrit sa porte et se précipita au dehors, au milieu de la nuit, en criant à tue-tête : « À mon secours ! Ô habitants du khân ! Ô voisins ! accourez ! À mon secours ! » Et les voisins, qui pour la plupart étaient plongés dans le sommeil, se réveillèrent bien émus et se montrèrent à lui, tandis que les femmes passaient leurs têtes à demi voilées par l’entrebâillement des portes. Et tous lui demandèrent : « Que t’arrive-t-il donc, ô Khalife ? » Il répondit : « Vite, donnez-moi vite une lampe, car les genn sont venus me visiter ! » Et les voisins se mirent à rire, et l’un d’eux finit tout de même par lui donner de la lumière. Et Khalife prit la lumière et rentra chez lui, plus sûr de lui-même. Mais soudain, comme il se penchait sur le coffre, il entendit une voix qui disait : « Ah ! où suis-je ? » Et, plus épouvanté que jamais, il lâcha tout et se précipita au dehors comme un fou en s’écriant : « Ô voisins ! Secourez-moi ! » Et les voisins lui dirent : « Ô maudit Khalife ! quelle est donc ta calamité ? Vas-tu finir de nous troubler ? » Il répondit : « Ô braves gens, le genni est dans le coffre ! Il bouge et parle ! » Ils lui demandèrent : « Ô menteur, et que dit-il, ce genni ? » Il répondit : « Il m’a dit : Où suis-je ? » Les voisins lui répondirent, en riant : « Mais en enfer, sans doute, ô maudit ! Puisses-tu ne jamais goûter de sommeil jusqu’à ta mort ! Tu troubles tout le khân et tout le quartier ! Si tu ne vas pas te taire, nous allons descendre te casser les os ! » Et Khalife, bien que déjà mourant de peur, se décida à rentrer encore une fois dans son logement, et, rassemblant tout son courage, il prit une grosse pierre et brisa la serrure du coffre, et fît sauter du coup le couvercle !
Et il vit, étendue au dedans, languissante et les paupières entr’ouvertes, une adolescente belle comme une houri, et brillante de pierreries. C’était Force-des-Cœurs ! Et, en se sentant délivrée, et en respirant à pleine poitrine l’air frais, elle se réveilla tout à fait, et l’effet du bang soporifique cessa complètement. Et elle était là, pâle et si belle et si désirable, vraiment !
À cette vue, le pêcheur, qui de sa vie n’avait vu à découvert non seulement une pareille beauté mais simplement une femme du commun, tomba à genoux devant elle, et lui demanda : « Par Allah ! ô ma maîtresse, qui es-tu…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… tomba à genoux devant elle, et lui demanda : Par Allah ! ô ma maîtresse, qui es-tu ? » Elle ouvrit les yeux, des yeux noirs aux cils recourbés, et dit : « Où est Jasmin ? Où est Narcisse ? » Or, c’étaient là les noms de deux jeunes filles esclaves qui la servaient au palais. Et Khalife, s’imaginant qu’elle lui demandait du jasmin et du narcisse, répondit : « Par Allah ! ô ma maîtresse, je n’ai ici pour le moment que quelques fleurs desséchées de henné ! » Et l’adolescente, en entendant cette réponse et cette voix, reprit complètement ses sens, et, ouvrant tout grands ses yeux, demanda : « Qui es-tu ? Et où suis-je ? » Et cela fut dit d’une voix plus douce que le sucre, accompagné d’un geste de la main, si charmant ! Et Khalife, qui avait dans le fond une âme très délicate, fut très touché de ce qu’il voyait et entendait, et répondit : « Ô ma maîtresse, ô vraiment très belle, moi je suis Khalife le pêcheur ; et toi, tu te trouves précisément chez moi ! » Et Force-des-Cœurs demanda : « Alors je ne suis plus au palais du khalifat Haroun Al-Rachid ? » Il répondit : « Non, par Allah ! tu es chez moi, dans ce logement qui est un palais puisqu’il t’abrite ! Et tu es devenue mon esclave de par la vente et l’achat, car je t’ai achetée aujourd’hui même avec ton coffre, à la criée publique, pour cent dinars et un dinar ! Et je t’ai transportée chez moi, endormie dans ce coffre ! Et je n’ai appris ta présence que grâce à tes mouvements qui m’ont d’abord épouvanté ! Et, maintenant, je vois bien que mon étoile monte sous d’heureux auspices, alors que je la savais auparavant si basse et si néfaste ! » Et Force-des-Cœurs, à ces paroles, sourit et dit : « Ainsi tu m’as achetée au souk, ô Khalife, sans me voir ? » Il répondit : « Oui, par Allah ! sans même soupçonner ta présence ! » Et Force-des-Cœurs comprit alors que ce qui lui était arrivé avait été comploté contre elle par Sett Zobéida, et se fit raconter par le pêcheur tout ce qui lui était arrivé, depuis le commencement jusqu’à la fin. Et elle causa ainsi avec lui jusqu’au matin. Et alors elle lui dit : « Ô Khalife, n’as-tu donc rien à manger ? Car j’ai bien faim ! » Il répondit : « Ni à manger, ni à boire, rien, rien du tout ! Et, moi, par Allah ! voilà déjà deux jours que je n’ai mis un morceau dans ma bouche ! » Elle demanda : « As-tu au moins quelque argent sur toi ? » Il dit : « De l’argent, ô ma maîtresse ? Qu’Allah me conserve ce coffre pour l’achat duquel, grâce à mon destin et à ma curiosité, j’ai mis ma dernière pièce de monnaie ! Et me voici en faillite sèche ! » Et l’adolescente, à ces paroles, se mit à rire, et lui dit : « Sors tout de même et me rapporte quelque chose à manger, en le demandant aux voisins qui ne te le refuseront pas ! Car les voisins se doivent à leurs voisins ! »
Alors Khalife se leva et sortit dans la cour du khân et, dans le silence du premier matin, se mit à crier : « Ô habitants du khân, ô voisins ! voici que le genni du coffre me réclame maintenant de quoi manger ! Et moi je n’ai rien sous la main à lui donner ! » Et les voisins, qui redoutaient sa voix, et qui aussi s’apitoyaient sur lui à cause de sa pauvreté, descendirent vers lui en lui apportant qui un demi-pain restant du repas de la veille, qui un morceau de fromage, qui un concombre, qui un radis. Et ils lui mirent tout cela dans le creux de sa robe relevée, et remontèrent chez eux. Et Khalife, content de son emplette, rentra dans son logement, et déposa tout cela entre les mains de l’adolescente, en lui disant : « Mange, mange ! » Et elle se mit à rire, et dit : « Comment pourrai-je manger, si je n’ai pas un petit broc ou une petite cruche d’eau pour boire ? Sinon, il est certain que les morceaux s’arrêteront dans mon gosier, et je mourrai ! » Et Khalife répondit : « Loin de toi le mal, ô parfaitement belle ! Je vais courir et te rapporterai non point une cruche, mais une jarre ! » Et il sortit dans la cour du khân, et, de tout son gosier, il cria : « Ô voisins ! ô habitants du khân ! » Et de tous les côtés les voix irritées l’invectivèrent et lui crièrent : « Eh bien ! ô maudit, qu’y a-t-il encore ? » Il répondit : « Le genni du coffre demande à présent à boire ! » Et les voisins descendirent vers lui, lui apportant, qui une gargoulette, qui une cruche, qui un broc, qui une jarre ; et il les prit d’eux, en portant une pièce sur chaque main, une autre en équilibre sur sa tête, une autre sous son bras, et se hâta d’aller porter le tout à Force-des-Cœurs, en lui disant : « Je t’apporte ce que souhaite ton âme ! Désires-tu encore quelque chose ? » Elle dit : « Non ! les dons d’Allah sont nombreux ! » Il dit : « Alors, ô ma maîtresse, parle-moi à ton tour tes paroles si douces, et raconte-moi ton histoire que je ne connais pas ! »
Alors Force-des-Cœurs regarda Khalife, sourit et dit : « Sache donc, ô Khalife, que mon histoire se résume en deux mots ! La jalousie de ma rivale, El Sett Zobéida, l’épouse même du khalifat Haroun Al-Rachid, m’a jetée dans cette situation dont, heureusement pour ton destin, tu m’as sauvée ! Je suis, en effet, Force-des-Cœurs, la favorite de l’émir des Croyants ! Quant à toi, ton bonheur désormais est assuré ! » Et Khalife lui demanda : « Mais est-ce que ce Haroun est le même que celui auquel j’ai enseigné l’art de la pêche ? Est-ce cet épouvantail que j’ai vu dans le palais, assis sur une grande chaise ? » Elle répondit : « Précisément, c’est lui-même ! » Il dit : « Par Allah ! de ma vie je n’ai rencontré un si vilain joueur de clarinette, et un plus grand coquin ! Non seulement il m’a volé, ce misérable à la face bouffie, mais il m’a donné un dinar pour cent coups de bâton ! Si jamais je le rencontre encore, je l’éventre avec ce pieu ! » Mais Force-des-Cœurs, lui imposant silence, lui dit : « Laisse désormais ce langage inconvenant, car dans la nouvelle situation où tu vas te trouver, il te faut avant tout ouvrir les yeux de ton esprit et cultiver la politesse et les bonnes manières ! Et, de la sorte, ô Khalife, tu feras passer sur ta peau le rabot de la galanterie, et tu deviendras un citadin de haute marque et un personnage doué de distinction et de délicatesse…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CINQ CENT SOIXANTE-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et, de la sorte, ô Khalife, tu feras passer sur ta peau le rabot de la galanterie, et tu deviendras un citadin de haute marque et un personnage doué de distinction et de délicatesse ! »
Lorsque Khalife eut entendu ces paroles de Force-des-Cœurs, il sentit une soudaine transformation s’opérer en lui, et s’ouvrir les yeux de son esprit, et s’élargir sa compréhension des choses, et s’affiner son intelligence ! Et tout cela pour son bonheur ! Tant il est vrai que l’influence est grande des âmes fines sur les âmes grossières ! Ainsi, d’une minute à l’autre, à cause des douces paroles de Force-des-Cœurs, le pêcheur Khalife, insensé et brutal jusque-là, devint un citadin exquis, doué de manières excellentes et d’une langue éloquente.
En effet, lorsque Force-des-Cœurs lui eut, de la sorte, indiqué la conduite à tenir, surtout au cas où il serait de nouveau appelé à être en présence de l’émir des Croyants, le pêcheur Khalife répondit : « Sur ma tête et mes yeux ! Tes avis, ô ma maîtresse, sont ma règle de conduite, et ta bienveillance est l’ombre où je me plais ! J’écoute et j’obéis ! Qu’Allah te comble de ses bénédictions, et satisfasse les moindres de tes désirs ! Voici, entre tes mains, obéissant, et plein de déférence pour tes mérites, le plus dévoué de tes esclaves, Khalife le pêcheur ! » Puis il ajouta : « Parle, ô ma maîtresse ! Que puis-je faire pour te servir ? » Elle répondit : « Ô Khalife, il me faut seulement un calame, un encrier et une feuille de papier. » Et Khalife se hâta de courir chez un voisin qui lui procura ces divers objets ; et il les porta à Force-de-Cœurs qui aussitôt écrivit une longue lettre à l’homme d’affaires du khalifat, le joaillier Ibn Al-Kirnas, celui-là même qui l’avait autrefois achetée et offerte en cadeau au khalifat. Et, dans cette lettre, elle le mettait au courant de tout ce qui lui était arrivé, et lui expliquait qu’elle se trouvait dans le logement du pêcheur Khalife dont elle était devenue la propriété par la vente et l’achat. Et elle plia la lettre et la remit à Khalife, en lui disant : « Prends ce billet et va le remettre, dans le souk des joailliers, à Ibn Al-Kirnas, l’homme d’affaires du khalifat, dont tout le monde connaît la boutique ! Et n’oublie pas mes recommandations au sujet des bonnes manières et du langage ! » Et Khalife répondit par l’ouïe et l’obéissance, prit le billet, qu’il porta à ses lèvres puis à son front, et se hâta de courir au souk des joailliers où il s’informa de la boutique d’Ibn Al-Kirnas, qu’on lui indiqua. Et il s’approcha de la boutique et, avec des manières très choisies, s’inclina devant le joaillier et lui souhaita la paix. Et le joaillier lui rendit son souhait, mais du bout des lèvres, en le regardant à peine, et lui demanda : « Que veux-tu ? » Et Khalife, pour toute réponse, lui tendit le billet. Et le joaillier prit le billet du bout des doigts et le déposa sur le tapis à côté de lui, sans le lire ni même l’ouvrir, car il croyait que c’était une requête pour demander l’aumône, et que Khalife était un mendiant. Et il dit à un de ses serviteurs : « Donne-lui un demi-drachme ! » Mais Khalife repoussa cette aumône avec dignité, et dit au joaillier : « Je n’ai que faire de l’aumône ! Je te prie seulement de lire le billet ! » Et le joaillier ramassa le billet, le déplia et le lut ; et soudain il le baisa et le porta respectueusement sur sa tête, et invita Khalife à s’asseoir, et lui demanda : « Ô mon frère, où se trouve ta maison ? » Il répondit : « Dans tel quartier, telle rue, tel khân ! » Il dit : « C’est parfait ! » Et il appela ses deux principaux employés et leur dit : « Conduisez cet honorable à la boutique de mon changeur Mohsen, afin qu’il lui donne mille dinars d’or. Puis ramenez-le-moi au plus tôt ! » Et les deux employés conduisirent Khalife chez le changeur, auquel ils dirent : « Ô Mohsen, donne à cet honorable mille dinars d’or ! » Et le changeur pesa les mille dinars d’or et les remit à Khalife qui s’en revint avec les deux employés chez Ibn Al-Kirnas ; et il le trouva monté sur une mule magnifiquement harnachée, entouré de cent esclaves vêtus de riches habits. Et le joaillier lui montra une seconde mule, non moins belle, et lui dit de l’enfourcher et de le suivre. Mais Khalife dit : « Par Allah ! ô mon maître, de ma vie je ne suis monté sur une mule, et je ne sais guère aller ni à cheval ni à âne ! » Et le joaillier lui dit : « Il n’y a pas d’inconvénient à la chose ! Tu apprendras aujourd’hui, voilà tout ! » Et Khalife dit : « J’ai bien peur qu’elle ne me jette à terre et ne me brise les côtes ! » Il répondit : « Sois sans crainte et monte ! » Et Khalife dit : « Au nom d’Allah ! » Et il enfourcha la mule d’un saut, mais en se mettant à rebours, et il lui prit la queue au lieu de la bride. Et la mule qui était chatouilleuse à l’excès, se rebiffa et, se mettant à ruer de toutes ses forces, ne fut pas longue à le jeter à terre ! Et Khalife, endolori, se releva et dit : « Je savais bien que je ne pourrais jamais aller autrement que sur mes pieds ! »
Mais ce fut là la dernière des tribulations de Khalife ! Et désormais sa destinée devait le conduire résolument dans le chemin des prospérités…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
… Mais ce fut là la dernière des tribulations de Khalife ! Et désormais sa destinée devait le conduire résolument dans le chemin des prospérités.
En effet, le joaillier dit à deux de ses esclaves : « Conduisez votre maître que voici au hammam, et faites-lui donner un bain de première qualité ! Et ensuite menez-le dans ma maison où je le retrouverai ! » Et il alla tout seul au logement de Khalife chercher Force-des-Cœurs, pour la conduire également à sa maison.
Quant à Khalife, les deux esclaves le menèrent au hammam, où de sa vie il n’avait mis les pieds, et le confièrent au meilleur masseur et aux meilleurs baigneurs, qui se mirent aussitôt en devoir de le laver et de le frotter. Et ils retirèrent de sa peau et de ses cheveux des poids et des poids de toutes sortes de saletés, et des poux et des punaises de toutes les variétés ! Et ils le soignèrent et le rafraîchirent et, après l’avoir séché, le vêtirent d’une somptueuse robe de soie que les deux esclaves s’étaient hâté d’aller acheter. Et, ainsi paré, ils le conduisirent à la demeure d’Ibn Al-Kirnas, leur maître, qui y était déjà arrivé avec Force-des-Cœurs.
Et Khalife, en entrant dans la grande salle de la maison, vit la jeune femme assise sur un beau divan, et entourée par la foule des servantes et des esclaves empressées à la servir. Et déjà, d’ailleurs, à la porte même de la maison, le portier en l’apercevant s’était empressé de se lever en son honneur et de lui baiser respectueusement la main. Et tout cela jetait Khalife dans le plus grand étonnement. Mais il n’en fit rien voir, de peur de paraître mal élevé. Et même, lorsque tout le monde se fut empressé autour de lui pour lui dire : « Délicieux soit ton bain ! » il sut répondre avec urbanité et éloquence ; et ses propres paroles, frappant ses oreilles, l’émerveillaient et le flattaient agréablement.
Aussi lorsqu’il fut en présence de Force-des-Cœurs, il s’inclina devant elle et attendit qu’elle lui adressât la parole la première ! Et Force-des-Cœurs se leva en son honneur et lui prit la main, et le fit s’asseoir tout à côté d’elle sur le divan. Puis elle lui présenta une porcelaine remplie de sorbet au sucre parfumé à l’eau de roses ; et il la prit et la but doucement, sans faire de bruit avec sa bouche, et, pour bien montrer sa civilité, il ne la vida qu’à moitié seulement, au lieu de la finir et d’y plonger ensuite le doigt pour la lécher, comme il l’eût certainement fait auparavant. Et même il la déposa, sans la casser, sur le plateau, et dit avec un parler très éloquent la formule de politesse que l’on dit, chez les gens bien élevés, quand on a accepté quelque chose à manger ou à boire : « Puisse-t-elle à jamais durer, l’hospitalité de cette maison ! » Et Force-des-Cœurs, charmée, lui répondit : « Aussi longtemps que ta vie ! » Et, après l’avoir régalé d’un excellent festin, elle lui dit : « Maintenant, ô Khalife, voici venu le moment où tu vas montrer toute ton intelligence et tes mérites ! Écoute-moi donc bien, et retiens ce que tu auras écouté ! Tu vas aller d’ici au palais de l’émir des Croyants, et tu demanderas une audience, qui te sera accordée, et, après les hommages dus au khalifat, tu lui diras : « Ô émir des Croyants, je te prie, en souvenir de l’enseignement que je t’ai donné, de m’accorder une faveur ! » Et il te l’accordera d’avance ! Et tu lui diras : « Je désire que tu me fasses l’honneur d’être mon invité, cette nuit ! » Voilà tout ! Et tu verras bien s’il accepte ou non ! »
Aussitôt Khalife se leva et sortit accompagné d’une suite nombreuse d’esclaves mis à son service, et vêtu d’une robe de soie qui pouvait bien valoir mille dinars. Et, de la sorte, la beauté native de ses traits ressortait pleinement ; et il était bien étonnant ! Car le proverbe dit : « Mets de beaux habits à une canne, et la canne sera une nouvelle mariée ! »
Lorsqu’il fut arrivé au palais, il fut aperçu de loin par le chef-eunuque Sandal qui fut stupéfait de sa transformation, et courut de toutes ses jambes à la salle du trône et dit au khalifat : » Ô émir des Croyants, je ne sais pas ! mais Khalife le pêcheur est devenu roi ! Car le voici qui s’avance vêtu d’une robe qui vaut bien mille dinars, et accompagné d’un cortège splendide ! » Et le khalifat dit : « Fais-le-vite entrer ! »
Or donc, Khalife fut introduit dans la salle du trône, où se tenait au milieu de sa gloire Haroun Al-Rachid. Et il s’inclina, comme seuls savent s’incliner les plus grands d’entre les émirs, et dit : « La paix sur toi, ô commandeur des Croyants, ô khalifat du Maître des Trois Mondes, défenseur du peuple des fidèles et de notre foi ! Qu’Allah le Très-Haut prolonge tes jours et honore ton règne et exalte ta dignité et l’élève jusqu’au plus haut rang ! »
Et le khalifat, voyant et entendant tout cela, fut à la limite de l’émerveillement. Et il ne comprenait point par quel chemin la fortune de Khalife était venue si rapidement. Et il demanda à Khalife : « Peux-tu d’abord me dire, ô Khalife, d’où te vient ce beau vêtement ? » Il répondit : « De mon palais, ô émir des Croyants ! » Il demanda : « Tu as donc un palais, ô Khalife ? » Il répondit : « Tu l’as dit, ô émir des Croyants ! Et précisément je viens t’inviter à l’illuminer cette nuit de ta présence ! Tu es donc mon invité. » Et Al-Rachid, de plus en plus stupéfait, finit par sourire, et demanda : « Ton invité ? Soit ! mais moi tout seul, ou bien moi et tous ceux qui sont avec moi ? » Il répondit : « Toi, et tous ceux que tu souhaites amener avec toi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître
le matin et, discrète, se tut.LA CINQ CENT SOIXANTE-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Toi, et tous ceux que tu souhaites amener avec toi ! » Et Haroun regarda Giafar, et Giafar s’avança vers Khalife et lui dit : « Nous serons cette nuit tes hôtes, ô Khalife ! L’émir des Croyants le désire ! » Et Khalife, sans ajouter un mot de plus, embrassa la terre entre les mains du khalifat et, après avoir donné à Giafar l’adresse de sa nouvelle demeure, s’en retourna auprès de Force-des-Cœurs à laquelle il rendit compte du succès de sa démarche.
Quant au khalifat, il était devenu bien perplexe ; et il dit à Giafar : « Comment peux-tu expliquer, ô Giafar, cette transformation si soudaine de Khalife, le risible bonhomme d’hier, en citadin si affiné et si éloquent, et en riche entre les plus riches des émirs ou des marchands ? » Et Giafar répondit : « Allah seul, ô émir des Croyants, connaît les raccourcis du chemin que suit la destinée ! »
Mais lorsque vint le soir, le khalifat, accompagné de Giafar, de Massrour et de quelques-uns de ses compagnons intimes, monta à cheval et se rendit à la demeure où il était invité. Et, en y arrivant, il vit tout le sol, depuis l’entrée jusqu’à la porte de réception, entièrement couvert de beaux tapis de prix, et les tapis jonchés de fleurs de toutes les couleurs. Et il aperçut, debout au pied des marches, Khalife souriant qui l’attendait, et qui se hâta de lui tenir l’étrier pour l’aider à descendre de cheval. Et il lui souhaita la bienvenue, en s’inclinant jusqu’à terre, et l’introduisit, en disant : « Bismillah ! »
Et le khalifat se trouva dans une grande salle, haute de plafond, somptueuse et riche, au milieu de laquelle se trouvait un trône carré en or massif et en ivoire, monté sur quatre pieds d’or, sur lequel Khalife le pria de s’asseoir. Et aussitôt entrèrent, porteurs d’immenses plateaux d’or et de porcelaine, de jeunes échansons comme des lunes, qui leur présentèrent des coupes précieuses remplies de décoctions glacées, au musc pur, rafraîchissantes et délicieuses ! Puis d’autres jeunes garçons entrèrent, vêtus de blanc, et plus beaux que les précédents, qui leur servirent des mets aux couleurs admirables, des oies farcies, des poulets, des agneaux rôtis, et toutes sortes d’oiseaux à la broche. Ensuite entrèrent d’autres esclaves blancs, jeunes et charmants, la taille serrée et si élégante, qui enlevèrent les nappes et servirent les plateaux des boissons et des dulcifications. Et les vins se coloraient en des vases de cristal et des hanaps d’or enrichis de pierreries ! Et lorsqu’ils coulèrent entre les mains blanches des échansons, ils dégagèrent un arome à nul autre pareil, et tel qu’on pouvait, en vérité, leur appliquer ces vers du poète :
Échanson, Verse-moi de ce vieux vin, et verse aussi à mon camarade, cet enfant que j’aime.
Ô précieux vin ! quel nom te donnerais-je, digne de tes vertus ? Je t’appellerai « la liqueur de la nouvelle mariée » !
Aussi le khalifat, de plus en plus émerveillé, dit à Giafar : « Ô Giafar, par la vie de ma tête ! je ne sais ce que je dois le plus admirer ici, de la magnificence de cette réception ou des manières raffinées, exquises et nobles de notre hôte ! En vérité, cela dépasse mon entendement ! » Mais Giafar répondit : « Tout ce que nous voyons là n’est rien en comparaison de ce que peut encore faire Celui qui n’a qu’à dire aux choses : « Soyez ! » pour qu’elles soient ! En tout cas, ô émir des Croyants, moi, ce que j’admire surtout en Khalife, c’est la sûreté de ses discours et sa sagesse consommée ! Et cela m’est un signe de la beauté de son destin ! Car Allah, quand Il distribue ses dons aux humains, accorde la sagesse à ceux que son choix élit entre tous, et Il la leur accorde de préférence aux biens de ce monde ! »
Sur ces entrefaites, Khalife, qui s’était absenté un moment, revint et, après de nouveaux souhaits de bienvenue, dit au khalifat : « L’émir des Croyants veut-il permettre à son esclave de lui amener une chanteuse, joueuse de luth, pour charmer les heures de sa nuit ? Car il n’y a point en ce moment à Baghdad chanteuse plus experte ou musicienne plus habile ! » Et le khalifat répondit : « Certes ! cela t’est permis ! » Et Khalife se leva et entra chez Force-des-Cœurs et lui dit que le moment était venu.
Alors Force-des-Cœurs, qui était déjà toute parée et parfumée, n’eut qu’à s’envelopper de son grand izar et à jeter sur sa tête et son visage la légère voilette de soie, pour être prête à se présenter. Et Khalife la prit par la main et l’introduisit, ainsi voilée, dans la salle, qui s’émut de sa démarche royale.
Et, après qu’elle eut embrassé la terre entre les mains du khalifat, qui ne pouvait deviner qui elle était, elle s’assit non loi de lui, harmonisa les cordes de son luth, et préluda par un jeu qui ravit en extase tous les auditeurs. Puis elle chanta :
« Le temps ramènera-t-il jamais à notre amour ceux que nous aimons ? Ah ! douce union des amants, te goûterai-je encore ?
Ô charme des nuits dans la demeure amoureuse, ô charme de mes nuits ! Sans ton espoir vivrais-je encore ? »
En entendant cette voix de jadis, dont les accents lui étaient si connus…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQ CENT SOIXANTE-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
… En entendant cette voix de jadis, dont les accents lui étaient si connus, le khalifat, dans une émotion d’une intensité extraordinaire, devint bien pâle et, dès les derniers mots du chant exhalés, il tomba évanoui ! Et tout le monde s’empressa autour de lui, lui prodiguant des soins empressés. Mais Force-des-Cœurs appela Khalife et lui dit : « Dis à tous ceux-là de se retirer un moment dans la salle voisine, et de nous laisser seuls ! » Et Khalife pria les invités de se retirer, afin que Force-des-Cœurs pût en liberté donner au khalifat les soins nécessaires. Et lorsqu’ils eurent quitté la salle, Force-des-Cœurs, d’un mouvement rapide, rejeta loin d’elle le grand izar qui l’enveloppait et la voilette qui lui cachait le visage, et apparut vêtue d’une robe en tous points semblable à celles qu’elle revêtait au palais, quand le khalifat était avec elle. Et elle s’approcha d’Al-Rachid étendu sans mouvement, et s’assit à côté de lui, et l’aspergea d’eau de roses et lui fit de l’air avec un éventail, et finit par le ranimer.
Et le khalifat ouvrit les yeux et, voyant Force-des-Cœurs à ses côtés, il faillit s’évanouir une seconde fois ; mais elle se hâta de lui baiser la main, en souriant, et les larmes aux yeux ; et le khalifat, à la limite de l’émotion, s’écria : « Sommes-nous au jour de la Résurrection, et les morts se réveillent-ils de leurs tombeaux, ou bien est-ce un rêve, que je fais ? » Et Force-des-Cœurs répondit : » Ô émir des Croyants, ce n’est point le jour de la Résurrection, et tu ne rêves point ! Car je suis Force-des-Cœurs, et je vis ! Et ma mort n’a été qu’un simulacre seulement ! » Et elle lui raconta, en quelques mots, tout ce qui lui était arrivé, depuis le commencement jusqu’à la fin. Puis elle ajouta : « Et tout ce qui nous arrive maintenant d’heureux, nous le devons à Khalife le pêcheur ! » Et Al-Rachid, en entendant tout cela, tantôt pleurait et sanglotait, tantôt riait de bonheur. Et lorsqu’elle eut fini de parler, il l’attira à lui, et l’embrassa sur les lèvres, longtemps, en la pressant contre sa poitrine. Et il ne put prononcer aucune parole ! Et ils restèrent ainsi tous deux une heure de temps.
Alors Khalife se leva et dit : « Par Allah ! ô émir des Croyants, j’espère maintenant que tu ne me feras plus donner la bastonnade ! » Et le khalifat, tout à fait remis, se mit à rire et lui dit : « Ô Khalife, tout ce que je pourrais faire pour toi désormais ne serait rien en comparaison de ce que nous te devons ! Veux-tu, tout de même, être mon ami et gouverner une province de mon empire ? » Et Khalife répondit : « L’esclave peut-il refuser les offres de son maître magnanime ? » Alors Al-Rachid lui dit : « Eh bien, Khalife, non seulement tu es nommé gouverneur de province avec des émoluments de dix mille dinars par mois, mais je veux que Force-des-Cœurs te choisisse elle-même, à son goût, parmi les adolescentes du palais et les filles des émirs et des notables, une jeune fille qui deviendra ton épouse ! Et c’est moi-même qui me charge de son trousseau et de la dot que tu apporteras à son père ! Et je veux désormais te voir tous les jours, et t’avoir à mes côtés dans les festins, au premier rang de mes intimes ! Et tu auras un train de maison digne de tes fonctions et de ton rang, et tout ce que pourra souhaiter ton âme ! »
Et Khalife embrassa la terre entre les mains du khalifat. Et tout ce bonheur-là lui arriva, et bien d’autres félicités encore ! Et il cessa d’être célibataire, et vécut des années et des années avec la jeune épouse que lui avait choisie Force-des-Cœurs, et qui était la plus belle et la plus modeste des femmes de son temps. Ainsi ! Gloire à Celui qui accorde ses faveurs, sans compter, à ses créatures, et qui distribue à son gré les joies et les félicités !
— Puis Schahrazade dit : « Mais ne crois point, ô Roi fortuné, que cette histoire soit plus admirable ou plus merveilleuse que celle que je te réserve pour finir cette nuit ! » Et le roi Schahriar s’écria : « Certes ! ô Schahrazade, je ne doute plus de tes paroles. Mais dis-moi vite le nom de cette histoire que tu as tenue en réserve pour cette nuit ! Car elle doit être extraordinaire, si elle est plus admirable que celle de Khalife le pêcheur ! » Et Schahrazade sourit et dit : « Oui, ô Roi ! Cette histoire s’appelle l’…
À CHÂTEAUROUX, INDRE