Le Livre des mille nuits et une nuit/Tome 11/Texte entier
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, que le vizir du roi victorieux le sultan Saladin avait, lui appartenant, au nombre de ses esclaves favoris, un jeune garçon chrétien parfaitement beau qu’il aimait à l’extrême, et si gracieux que les yeux des hommes n’avaient jamais rencontré le pareil. Or, un jour qu’il se promenait avec cet enfant dont il ne pouvait se séparer, il fut remarqué par le sultan Saladin qui lui fit signe d’approcher. Et le sultan, après avoir jeté un regard charmé sur l’enfant, demanda au vizir : « D’où te vient ce jeune garçon ? » Et le vizir, un peu gêné, répondit : « De chez Allah, ô mon seigneur ! » Et le sultan Saladin sourit et dit, en continuant son chemin : « Voilà que maintenant, ô notre vizir, tu trouves le moyen de nous subjuguer par la beauté d’un astre et de nous rendre captif par les enchantements d’une lune ! »
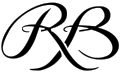
sultan de versailles, poète et savant, ce salam choisi de la reine schahrazade et de son ami
HISTOIRE DU JEUNE NOUR AVEC
LA FRANQUE HÉROÏQUE
Et Schahrazade dit :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait en l’antiquité du temps et le passé de l’âge et du moment, dans le pays d’Égypte, un homme d’entre les notables, appelé Couronne, qui avait passé sa vie à voyager sur terre et sur mer, dans les îles et les déserts, et dans les contrées connues et inconnues, ne craignant ni les périls, ni les fatigues, ni les tourments, et affrontant des dangers si terribles, qu’à les entendre seulement, les cheveux en seraient devenus tout blancs même aux petits enfants. Mais, désormais riche, heureux et respecté, le marchand Couronne avait renoncé aux voyages pour vivre au milieu de son palais, dans la sérénité, assis à son aise sur le divan et le front ceint de son turban de mousseline blanche immaculée. Et rien ne manquait à la satisfaction de ses désirs. Car ses appartements, son harem, ses armoires et ses coffres, remplis de somptuosités, d’habits de Mordîn, d’étoffes de Baâlbeck, de soieries de Homs, d’armes de Damas, de brocarts de Baghdad, de gazes de Mossoul, de manteaux du Maghreb et de broderies de l’Inde, n’avaient pas leurs pareils en magnificence dans les palais des rois et des sultans. Et il possédait, en grand nombre, des esclaves nègres et des esclaves blancs, des mamelouk turcs, des concubines, des eunuques, des chevaux de race et des mulets, des chameaux de la Bactriane et des dromadaires de course, des jeunes garçons de Grèce et de Syrie, des jouvencelles de Circassie, des petits eunuques d’Abyssinie, et des femmes de tous les pays. Et il était ainsi, sans aucun doute, le marchand le plus satisfait et le plus honoré de son temps.
Mais le bien le plus précieux et la chose la plus splendide que possédât le marchand Couronne, c’était son propre fils, jouvenceau de quatorze ans, qui était certainement plus beau, et de beaucoup, que la lune à son quatorzième jour. Car rien, ni la fraîcheur du printemps, ni les rameaux flexibles de l’arbre bân, ni la rose dans son calice, ni l’albâtre transparent, n’égalait la délicatesse de son adolescence heureuse, la souplesse de sa démarche, les tendres couleurs de son visage et la pure blancheur de son corps charmant. Et d’ailleurs le poète, inspiré de ses perfections, l’a ainsi chanté :
Mon jeune ami, qui est si beau, m’a dit : « Ô poète, ton éloquence est en défaut ! » Je lui dis : « Ô mon seigneur, l’éloquence n’a rien à voir dans notre cas ! Tu es le roi de la beauté, et en toi tout est également parfait !
Mais — s’il m’est permis d’élire une préférence — ô ! qu’elle est belle, sur ta joue, la petite tache noire, goutte d’ambre sur une table de marbre blanc ! Et voici les glaives de tes paupières qui déclarent la guerre aux indifférents ! »
Et un autre poète a dit :
Dans la rumeur d’un combat, je demandai à ceux qui s’entretuaient : « Pourquoi ce sang versé ? » Ils me dirent : « Pour les beaux yeux de l’adolescent ! »
Et un troisième a dit :
Il vint lui-même me visiter et, me voyant tout ému et troublé, il me dit : « Qu’as-tu ? Qu’as-tu ? » Je lui dis : « Éloigne les flèches de tes yeux adolescents ! »
Et un autre a dit :
Des lunes et des gazelles viennent concourir avec lui en charmes et en beauté ; mais je leur dis : « Ô gazelles, fuyez vite et ne vous comparez point à ce jeune faon ! Et vous, ô lunes, abstenez-vous ! Toutes vos peines sont inutiles ! »
Et un autre a dit :
Le svelte jouvenceau ! Du noir de sa chevelure et de la blancheur de son front le monde est plongé tour à tour dans la nuit et dans le jour !
Ô ! Ne méprisez point le grain de beauté de sa joue ! La tendre anémone n’est belle dans sa rouge splendeur qu’à cause de la goutte noire qui orne sa corolle.
Et un autre a dit :
L’eau de la beauté se purifie au contact de son visage ! Et ses paupières fournissent les flèches aux archers pour percer le cœur de ses amoureux ! Mais louées soient trois perfections : sa beauté, sa grâce et mon amour !
Ses vêtements légers dessinent les contours de ses gracieuses fesses, comme les nuages transparents laissent apercevoir la douce image de la lune ! Louées soient les trois perfections : ses vêtements légers, ses gracieuses fesses et mon amour !
Les prunelles de ses yeux sont noires, noire la petite tache qui orne sa joue, et noires également mes larmes ! Louées soient-elles pour leur parfaite noirceur !
Son front, les traits si fins de son visage et mon corps consumé par son amour ressemblent au fin croissant de la lune : eux, pour leur éclat, et mon corps consumé, sous le rapport de la forme. Louées soient ses perfections !
Ses prunelles, quoique abreuvées de mon sang, n’ont point rougi et restent douces comme le velours. Trois fois louées soient ses prunelles !
Il m’a désaltéré, au jour de notre union, de la pureté de ses lèvres et de son sourire ! Ah ! en retour je lui donne, pour qu’il en use licitement : mes biens, mon sang et ma vie ! Et qu’à jamais soient louées ses lèvres pures et son sourire !
Enfin un poète, entre mille autres qui l’ont chanté, a dit :
Par les arcs voûtés qui gardent ses yeux, et par ses yeux qui dardent les traits enchanteurs de ses œillades ;
Par ses formes délicates ; par le tranchant cimeterre de ses regards ; par la suprême élégance de son allure ; par la couleur de sa noire chevelure ;
Par ses yeux languissants qui ravissent le sommeil et font la loi dans l’empire de l’amour ;
Par les boucles de ses cheveux, semblables à des scorpions, qui lancent dans les cœurs les traits du désespoir ;
Par les roses et les lis qui fleurissent sur ses joues ; par les rubis de ses lèvres où brille le sourire ; par ses dents de perles éblouissantes ;
Par la suave odeur de ses cheveux ; par les fleuves de vin et de miel qui coulent de sa bouche quand il parle ;
Par le rameau de sa taille flexible ; par sa démarche légère ; par sa croupe fastueuse qui tremble, qu’il soit en marche ou en repos ;
Par les soieries de sa peau d’abricot ; par les grâces et l’élégance qui accompagnent ses pas ;
Par l’affabilité de ses manières, la saveur de ses paroles, la noblesse de sa naissance et la grandeur de sa fortune ;
Par tous ces rares dons, je jure que le soleil, dans son midi, est moins resplendissant que son visage ; que la nouvelle lune n’est qu’une rognure de ses ongles ; que l’odeur du musc est moins douce que son haleine, et que la brise embaumée dérobe son parfum à sa chevelure !
Or, un jour que l’admirable jouvenceau, fils de Couronne le marchand, était assis dans la boutique de son père, quelques adolescents de ses amis vinrent s’entretenir avec lui, et lui proposèrent…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, un jour que l’admirable jouvenceau, fils de Couronne le marchand, était assis dans la boutique de son père, quelques adolescents de ses amis vinrent s’entretenir avec lui, et lui proposèrent d’aller se promener dans un jardin qui appartenait à l’un d’eux, et lui dirent : « Ô Nour, tu verras comme ce jardin est beau ! » Et Nour leur répondit : « Je veux bien ! Mais il faut auparavant que j’en demande la permission à mon père. » Et il alla demander cette permission à son père. Et le marchand Couronne ne fit point trop de difficultés et, accordant à Nour l’autorisation, il lui donna, en outre, une bourse pleine d’or pour qu’il ne fût pas à la charge de ses camarades.
Alors, Nour et les adolescents montèrent sur des mules et des ânes et arrivèrent à un jardin qui renfermait tout ce qui peut flatter les yeux et dulcifier la bouche. Et ils y entrèrent par une porte voûtée, belle comme la porte du Paradis, formée de rangs alternés de marbres de couleur, et ombragée de vignes grimpantes lourdes de raisins rouges et noirs, blancs et dorés, comme a dit le poète :
Ô grappes de raisins gonflés de vins, délicieux comme des sorbets et vêtus de noir comme des corbeaux,
Votre éclat, à travers les sombres feuilles, vous montre semblables à de jeunes doigts féminins fraîchement teints de henné ;
Et de toutes façons vous nous grisez : Que vous pendiez avec grâce sur les ceps, et notre âme est ravie par votre beauté ; que vous reposiez au fond du pressoir, et vous voilà transformées en un miel enivrant.
Et, comme ils entraient, ils virent, au haut de cette porte voûtée, ces vers gravés en beaux caractères d’azur :
Viens, ami ! si tu veux jouir de la beauté d’un jardin, viens me regarder.
Ton cœur oubliera ses peines au frais contact de la brise qui vagabonde, fidèle à mes allées ; à la vue des fleurs qui m’habillent de beaux vêtements, et qui sourient dans leurs manches de pétales.
Le ciel généreux arrose abondamment mes arbres aux branches penchées sous le fardeau de leurs fruits. Et tu verras, quand les rameaux se balanceront en dansant sous les doigts du zéphyr, les Pléiades ravies leur jeter à pleines mains l’or liquide et les perles des nuages.
Et si, fatigué, de jouer avec les rameaux, le zéphyr les abandonne pour caresser l’onde des ruisseaux qui courent à sa rencontre, tu le verras les quitter bientôt pour aller baiser mes fleurs sur la bouche.
Lorsqu’ils eurent franchi cette porte, ils aperçurent le gardien du jardin assis à l’ombre, sous le treillage en berceau des vignes grimpantes, et beau comme l’ange Rizwân qui garde les trésors du Paradis. Et il se leva en leur honneur, et vint au-devant d’eux, et, après les salams et les souhaits de bienvenue, il les aida à descendre de leurs montures, et voulut leur servir lui-même de guide pour leur montrer, dans tous les détails, les beautés du jardin. Et ils purent ainsi admirer les belles eaux qui serpentaient à travers les fleurs et ne les quittaient qu’à regret, les plantes lourdes de leurs parfums, les arbres fatigués de leurs joyaux, les oiseaux chanteurs, les bosquets de fleurs, les arbustes à épices, et tout ce qui faisait de ce merveilleux jardin un morceau détaché des jardins édéniques. Mais ce qui les charmait au-dessus de toutes paroles, c’était la vue, à nulle autre pareille, des arbres fruitiers miraculeux, chantés tour à tour par tous les poètes, comme en font foi ces quelques poèmes entre mille :
Délicieuses à l’écorce polie, grenades entr’ouvertes, mines de rubis encloses dans des cloisons d’argent, vous êtes les gouttes figées d’un sang virginal !
Ô grenades à la peau fine, seins des adolescentes debout, la poitrine en avant, en présence des mâles.
Coupoles ! quand je vous regarde j’apprends l’architecture, et si je vous mange je guéris de toutes les maladies !
Belles au visage exquis, ô pommes douces et musquées, vous souriez en montrant dans vos couleurs, rouges et jaunes tour à tour, le teint d’un amant heureux et celui d’un amant malheureux ; et vous unissez, dans votre double visage, la couleur de la pudeur à celle d’un amour sans espoir !
Abricots aux amandes savoureuses, qui pourrait mettre en doute votre excellence ? Jeunes encore vous étiez des fleurs semblables à des étoiles ; et fruits mûrs dans le feuillage, arrondis et tout en or, on vous prendrait pour de petits soleils !
Ô blanches, ô noires, ô figues bienvenues sur mes plateaux ! je vous aime autant que j’aime les blanches vierges de Grèce, autant que j’aime les filles chaudes d’Éthiopie.
Ô mes amies de prédilection, vous êtes si sûres des désirs tumultueux de mon cœur à votre vue, que vous vous négligez dans votre mise, ô nonchalantes !
Si je vous aime tellement, c’est que peu de connaisseurs savent apprécier votre maturité, ô pleines d’expérience !
Tendres amies, déjà ridées par les désillusions sur les branches élevées qui vous balancent à tous les vents, vous êtes douces et odorantes comme la fleur fanée de la camomille.
Et vous seules, entre toutes vos sœurs, ô pleines de jus, savez laisser briller, au moment du désir, la goutte de suc fait de miel et de soleil !
Ô jeunes filles, encore vierges et quelque peu acides au goût, ô Sinaïtiques, ô Ioniennes, ô Aleppines,
Vous qui attendez, en vous balançant sur vos splendides hanches suspendues à une taille si fine, les amants qui, n’en doutez pas, vous mangeront,
Ô poires ! que vous soyez jaunes ou vertes, que vous soyez grosses ou allongées, que vous soyez sur les branches deux à deux ou solitaires,
Vous êtes toujours désirables et exquises à notre goût, ô fondantes, ô bonnes, vous qui nous réservez des surprises nouvelles chaque fois que nous touchons à votre chair !
Nous défendons nos joues par du duvet, pour que l’air vif ou chaud ne nous heurte pas ! Nous sommes de velours sur toutes nos faces, et rondes et rouges d’avoir longtemps roulé dans le sang des vierges.
C’est pourquoi nos nuances sont exquises, et si délicate notre peau. Goûte donc à notre chair, et mords-y de toutes tes dents, mais ne touche pas au noyau de notre cœur : il t’empoisonnerait !
Elles me dirent : « Vierges timides, nous nous enveloppons de nos triples manteaux verts, comme les perles dans leurs coquilles.
Et quoique bien douces au dedans, et si exquises pour qui sait vaincre notre résistance, nous aimons passer notre jeune temps amères et dures à la surface.
Mais l’âge avance, et la rigueur n’est plus de mise. Alors nous éclatons, et notre cœur, intact et blanc, s’offre dans sa fraîcheur au passant du chemin. »
Et je m’écriai : « Ô amandes candides, ô petites qui tenez toutes ensemble dans le creux de ma main, ô gentilles !
Votre vert duvet est la joue imberbe encore de mon ami, ses grands yeux allongés sont dans les deux moitiés de votre corps, et ses ongles empruntent leur belle forme à votre pulpe.
Même l’infidélité devient chez vous une qualité, car votre cœur, si souvent double et partagé, reste blanc malgré tout, à l’égal de la perle enchâssée dans une coque de jade. »
Regarde les jujubes en grappes, suspendus sur les branches avec des chaînes de fleurs, telles les clochettes d’or qui baisent les chevilles des femmes !
Ce sont les fruits de l’arbre Sidrah qui s’élève à la droite du trône d’Allah. Les houris reposent sous son ombrage. Son bois a servi à construire les tables de Moïse ; et c’est de son pied que jaillissent les quatre merveilleuses sources du Paradis.
Sur la colline, quand souffle le zéphyr, les orangers se dodelinent de tous leurs rameaux, et rient avec grâce de tout le bruissement de leurs fleurs et de leurs feuilles.
Telles des femmes qui ont orné leurs jeunes corps de belles robes de brocart d’or rouge, un jour de fête, ô oranges,
Vous êtes fleurs par l’odeur et fruits par la saveur. Et globes de feu vous renfermez la fraîcheur de la neige ! Neige merveilleuse qui ne fond pas au milieu du feu ! Feu merveilleux sans flamme et sans chaleur !
Et si je contemple votre peau si luisante, puis-je ne point penser à mon amie, la jouvencelle aux belles joues, dont le derrière d’or est granulé ?
Les branches des citronniers s’abaissent vers la terre, alourdies par leurs richesses ;
Et les cassolettes d’or des citrons, au sein des feuilles, ont des parfums qui enlèvent le cœur, et des exhalaisons qui rendent l’âme aux agonisants.
Regarde ces limons qui commencent à mûrir ! C’est la neige qui se teint des couleurs du safran ; c’est l’argent qui se transmue en or ; c’est la lune qui se change en soleil !
Ô limons, boules de chrysolithe, seins des vierges, camphre pur, ô limons ! ô limons !…
Bananes aux formes hardies, chair beurrée comme une pâtisserie,
Bananes à peau lisse et douce, qui dilatez les yeux des jeunes filles,
Bananes ! Quand vous coulez dans nos gosiers, vous ne heurtez point nos organes ravis de vous sentir !
Que vous pendiez, lourdes comme des lingots d’or, sur la tige poreuse de votre mère,
Ou que vous mûrissiez lentement à nos plafonds, ô fioles pleines d’odeur,
Vous savez toujours plaire à nos sens ! Et vous seules, entre tous les fruits, êtes douées d’un cœur compatissant, ô consolatrices des veuves et des divorcées !
Nous sommes les filles saines des palmiers, les Bédouines à la chair brune ! Nous grandissons en écoutant la brise jouer de ses flûtes dans nos chevelures.
Notre père le soleil nous a, dès l’enfance, nourries de lumière : et longtemps nous avons sucé les pudiques mamelles de notre mère.
Nous sommes les préférées du peuple libre des tentes spacieuses, qui ne connaît pas les vestibules des citadins,
Le peuple des rapides cavales, des chamelles efflanquées, des ravissantes vierges, de la généreuse hospitalité et des solides cimeterres.
Et quiconque a goûté le repos à l’ombre de nos palmes, souhaite nous entendre murmurer sur sa tombe !
Or, tels sont, entre des milliers, quelques-uns des poèmes sur les fruits. Mais il faudrait toute une vie pour dire les vers sur les fleurs comme celles que renfermait ce merveilleux jardin, les jasmins, les jacinthes, les lis d’eau, les myrtes, les œillets, les narcisses et les roses dans toutes leurs variétés.
Mais déjà le gardien du jardin avait conduit les adolescents, à travers les allées, à un pavillon enfoui au milieu de la verdure. Et il les invita à y entrer se reposer, et les fit s’asseoir autour d’un bassin d’eau sur des coussins de brocart, en priant le jeune Nour de prendre la place du milieu. Et il lui offrit, pour se rafraîchir le visage, un éventail de plumes d’autruche, sur lequel ce vers était inscrit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il lui offrit, pour se rafraîchir le visage, un éventail de plumes d’autruche, sur lequel ce vers était inscrit :
Aile blanche infatigable, mes bouffées parfumées, qui caressent le visage de celui que j’aime, donnent un avant-goût de la brise du Paradis !
Puis les adolescents, ayant ôté leurs manteaux et leurs turbans, se mirent à causer et à s’entretenir ensemble, et ils ne pouvaient détacher leurs regards de leur beau camarade Nour. Et le gardien leur servit lui-même le repas, qui était très splendide, composé de poulets, d’oies, de cailles, de pigeons, de perdrix et d’agneaux farcis, sans compter les corbeilles de fruits cueillis aux branches. Et, après le repas, les adolescents se lavèrent les mains avec du savon mêlé de musc, et s’essuyèrent avec des serviettes de soie brodées d’or.
Alors, le gardien entra avec un magnifique bouquet de roses, et dit : « Il convient, ô mes amis, qu’avant de toucher aux boissons vous disposiez votre âme au plaisir par les couleurs et le parfum des roses. » Et ils s’écrièrent : « Tu dis vrai, ô gardien ! » Il dit : « Oui. Mais je ne veux vous donner ces roses qu’en échange d’un beau poème sur cette fleur admirable ! »
Alors, l’adolescent auquel appartenait le jardin prit la corbeille de roses des mains du gardien, y plongea la tête, la respira longuement, puis fit de la main un signe pour demander le silence, et improvisa :
« Vierge odorante, mais si timide dans ta jeunesse quand tu cachais la rougeur de ton beau visage dans la soie verte de tes manches,
Ô rose souveraine ! tu es, entre toutes les fleurs, la sultane au milieu de ses esclaves, et le bel émir dans le cercle de ses guerriers.
Tu renfermes dans ta corolle pleine de baume la quintessence de tous les flacons.
Ô rose amoureuse, tes pétales entrouverts sous le souffle du zéphyr sont les lèvres d’une jeune beauté qui s’apprête à donner un baiser à son ami !
Tu es plus douce, ô rose, dans ta fraîcheur, que la joue duvetée du jeune garçon, et plus désirable que la bouche vive d’une intacte jouvencelle !
Le sang délicat qui colore ta chair heureuse te rend comparable à l’aurore veinée d’or, à la coupe remplie d’un vin couleur de pourpre, à une floraison de rubis sur un rameau d’émeraude.
Ô rose voluptueuse, mais si cruelle envers les amants grossiers qui te heurtent sans délicatesse, tu les punis, ceux-là, avec les flèches de ton carquois d’or !
Ô merveilleuse, ô réjouissante, ô délectable ! tu sais également retenir les raffinés qui t’apprécient ! Pour eux tu vêts tes grâces de robes de couleurs différentes, et tu restes la bien-aimée dont on ne se lasse jamais. »
En entendant cette louange admirable de la rose, les adolescents ne purent retenir leur enthousiasme, et poussèrent mille exclamations et répétèrent en chœur, en dodelinant de la tête : « Et tu restes la bien-aimée dont on ne se lasse jamais ! » Et celui qui venait d’improviser le poème vida aussitôt la corbeille et couvrit de roses ses hôtes. Puis il remplit de vin la grande coupe et la fit circuler à la ronde. Et le jeune Nour, lorsque vint son tour, prit la coupe avec un certain embarras ; car il n’avait jamais encore bu de vin, et son palais ignorait le goût des boissons fermentées comme son corps le contact des femmes. Il était vierge, en effet, et ses parents ne lui avaient point encore, vu son jeune âge, fait cadeau d’une concubine, comme c’est la coutume chez les notables qui veulent, avant le mariage, donner de l’expérience et du savoir, en ces questions, à leurs fils pubères. Et ses compagnons connaissaient ce détail de la virginité de Nour, et s’étaient promis, en l’invitant à cette partie de jardin, de l’éveiller de ce côté-là !
Aussi, voyant qu’il tenait la coupe et hésitait comme devant une chose défendue, les adolescents se mirent à faire de grands éclats de rire, si bien que Nour, piqué et tant soit peu mortifié, finit par porter résolument la coupe à ses lèvres et la vida d’un trait jusqu’à la dernière goutte. Et les adolescents, à cette vue, poussèrent un cri de triomphe ; et le maître du jardin s’approcha de Nour, avec la coupe remplie à nouveau, et lui dit : « Que tu as raison, ô Nour, de ne point te priver plus longtemps de cette liqueur précieuse de l’ivresse ! Elle est la mère des vertus, le spécifique contre tous les chagrins, la panacée pour les maux du corps et de l’âme ! Aux pauvres elle donne la richesse, aux lâches le courage, aux faibles la force et la puissance ! Ô Nour, mon charmant ami, je suis, et nous tous ici nous sommes tes serviteurs et tes esclaves ! Mais prends cette coupe, de grâce, et bois ce vin qui est moins enivrant que tes yeux ! » Et Nour ne put refuser, et, d’un trait, vida la coupe que lui tendait son hôte.
Alors, le ferment de l’ivresse commença à circuler dans sa raison ; et l’un des jeunes gens s’écria, en s’adressant à l’hôte : « Cela est bien, ô généreux ami ! mais notre plaisir saurait-il être complet sans le chant et sans la musique de lèvres féminines…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Cela est bien, ô généreux ami ! mais notre plaisir saurait-il être complet sans le chant et sans la musique de lèvres féminines ? Et ne connais-tu les paroles du poète :
« Allons ! qu’on offre du vin à la ronde dans la petite coupe et dans la grande !
Et toi, mon ami, prends la liqueur des mains d’une beauté semblable à la lune.
Mais, pour vider ton verre, attends la musique : j’ai toujours vu le cheval boire avec plaisir, quand on siffle à ses côtés. »
Lorsque le jeune homme, maître du jardin, eut entendu ces vers, il répondit par un sourire, puis se leva aussitôt et sortit de la salle de réunion pour, au bout d’un moment, revenir en tenant par la main une jouvencelle entièrement vêtue de soie bleue. Or, c’était une svelte Égyptienne admirablement taillée, droite comme la lettre aleph, aux yeux babyloniens, aux cheveux noirs comme les ténèbres, et blanche comme l’argent dans la mine ou comme une amande décortiquée. Et elle était si belle et si brillante dans sa robe sombre qu’on l’eût prise pour la lune d’été au milieu d’une nuit d’hiver. Avec cela comment n’aurait-elle pas eu des seins d’ivoire blanc, un ventre harmonieux, des cuisses de gloire et des fesses farcies comme des coussins, avec, au dessous d’elles, lisse, rose et embaumé, quelque chose de semblable à un petit sachet plié dans un gros paquet ? Et n’est-ce point précisément de cette Égyptienne-là que le poète a dit :
Comme la biche, elle s’avance traînant derrière elle les lions vaincus par les œillades acérées de l’arc de ses sourcils.
La belle nuit de sa chevelure étend sur elle, pour la protéger, une tente sans colonnes, une tente miraculeuse.
Elle cache les roses rougissantes de ses joues avec la manche de sa robe ; mais peut-elle empêcher les cœurs de s’enivrer de l’ambre de sa peau embaumée ?
Et si elle vient à soulever le voile qui cache son visage, alors, honte sur toi, bel azur des cieux ! Et toi, cristal de roche, humilie-toi devant ses yeux de pierrerie !
Et le jeune maître du jardin dit à l’adolescente : « Ô belle souveraine des astres, sache que nous ne t’avons fait venir dans notre jardin que pour plaire à notre hôte et ami Nour, que voici, et qui nous honore aujourd’hui, pour la première fois, de sa visite ! »
Alors, la jeune Égyptienne vint s’asseoir à côté de Nour, en lui lançant une œillade extraordinaire ; puis elle tira de dessous son voile un sac de satin vert ; et elle l’ouvrit et y prit trente-deux petits morceaux de bois qu’elle joignit deux à deux, comme se joignent les mâles aux femelles et les femelles aux mâles, et finit par en former un beau luth indien. Et elle releva ses manches jusqu’aux coudes, découvrant ainsi ses poignets et ses bras, pressa le luth sur son sein, comme une mère presse son enfant, et le chatouilla avec les ongles de ses doigts. Et le luth, à ce toucher, frémit et gémit en résonnant ; et il ne put s’empêcher de songer tout à coup à sa propre origine et à sa destinée : il se rappela la terre où il avait été planté, arbre, les eaux qui l’avaient arrosé, les lieux où il avait vécu dans l’immobilité de sa tige, les oiseaux qu’il avait abrités, les bûcherons qui l’avaient abattu, l’habile ouvrier qui l’avait façonné, le vernisseur qui l’avait revêtu d’éclat, le vaisseau qui l’avait apporté, et toutes les belles mains entre lesquelles il avait passé. Et, à ces souvenirs, il gémit et chanta avec harmonie, et sembla répondre dans son langage aux ongles qui l’interrogeaient, par ces couplets rythmés :
Autrefois j’étais un rameau vert habité par les rossignols, et je les balançais amoureusement quand ils chantaient.
Ils me donnaient ainsi le sentiment de l’harmonie ; et je n’osais agiter mon feuillage, pour les écouter attentivement.
Mais une main barbare, un jour, me renversa par terre et me changea, comme vous le voyez, en un luth fragile.
Pourtant, je ne me plains pas de ma destinée ; car, lorsque les fins ongles me touchent, je frémis de toutes mes cordes et souffre avec plaisir les coups d’une belle main.
En récompense de mon esclavage, je repose sur les seins des jeunes filles, et les bras des houris s’enlacent avec amour autour de ma taille.
Je sais charmer par mes accords les amis qui aiment les gaies réunions ; et, chantant comme autrefois mes oiseaux, j’enivre sans l’aide de l’échanson !
Après ce prélude sans paroles, où le luth s’était exprimé dans un langage sensible à l’âme seule, la belle Égyptienne cessa un moment de jouer ; puis, tournant ses regards vers le jeune Nour, elle chanta ces vers en s’accompagnant…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
… la belle Égyptienne, tournant ses regards vers le jeune Nour, chanta ces vers en s’accompagnant :
« La nuit est claire et transparente, et le rossignol, dans le fourré du voisinage, soupire ses transports comme amant passionné.
Ah ! réveille-toi ! la nudité du ciel et sa fraîcheur invitent notre âme au plaisir, et la lune, ce soir, est pleine de sortilèges ! Viens !
Ne craignons point les jaloux, et profitons du sommeil de nos censeurs pour nous plonger sans contrainte au sein des voluptés. Les nuits ne sont pas toujours pleines d’étoiles et embaumées ! Viens !
N’as-tu point, pour goûter le plaisir tranquille, des myrtes, des roses, des fleurs d’or et des parfums ? Et ne possèdes-tu pas les quatre choses nécessaires à la jouissance idéale : un ami, une amante, une bourse pleine et du vin ?
Que faut-il de plus pour le bonheur ? Hâte-toi d’en profiter ! demain tout s’évanouira ! La coupe du plaisir, la voici ! »
En entendant ces vers, le jeune Nour, enivré de vin et d’amour, lança des regards enflammés sur la belle esclave, qui lui répondit par un sourire engageant. Alors, il se pencha sur elle, emporté par le désir ; et elle, aussitôt, poussa tout contre lui la pointe de ses seins, le baisa entre les yeux, et se livra toute entre ses mains. Et Nour, cédant au trouble de ses sens et à l’ardeur qui l’embrasait, colla ses lèvres sur la bouche de l’adolescente et la respira comme une rose. Mais elle, rappelée par les regards des autres adolescents, se dégagea de cette première étreinte du jouvenceau, pour reprendre le luth et chanter :
« Par la beauté de ton visage, par tes joues, parterre de roses, par le vin précieux de ta salive,
Je jure que tu es l’esprit de mon esprit, la lumière de mes yeux, le baume de mes paupières, et que je n’aime que toi seul, ô vie des âmes ! »
En entendant cette brûlante déclaration, Nour, transporté d’amour, improvisa ceci à son tour :
« Ô toi dont le port est superbe comme celui d’un vaisseau de pirate sur la mer, belle au regard de faucon,
Ô jeune fille ceinte de grâce, à la bouche ornée de deux rangs de perles, aux joues épanouies de roses dans un parterre dont la clôture est difficile à franchir,
Ô propriétaire d’une chevelure de splendeur qui se déroule dans toute sa longueur, à droite et à gauche, noire comme un jeune nègre au milieu d’une vente à l’encan,
Tu es devenue la tyrannique pensée de mon âme ! À la vue de tes charmes, l’amour est entré tout droit dans mon cœur et l’a teint de la couleur foncée de la cochenille, de la teinte la plus indélébile ! Et son feu a consumé mon foie jusqu’à la folie.
Si bien que je veux te donner mes biens et toute mon âme. Et si tu me demandes : « Sacrifierais-tu pour moi ton sommeil ? » je répondrai : « Oui, certes ! et même mes yeux, ô magicienne ! »
Lorsque le jeune homme, maître du jardin, vit l’état dans lequel se trouvait son ami Nour, il jugea que le moment était venu de laisser la belle Égyptienne l’initier aux joies de l’amour. Et il fit signe aux adolescents, qui se levèrent l’un après l’autre et se retirèrent de la salle du festin, laissant Nour en tête à tête avec la belle Égyptienne.
Aussitôt que la jouvencelle se vit seule avec le beau Nour, elle se leva toute droite et se dépouilla de ses ornements et de ses habits pour se mettre entièrement nue, avec, pour tout voile, sa seule chevelure. Et elle vint s’asseoir sur les genoux de Nour, et le baisa entre les yeux et lui dit : « Sache, ô mon œil, que le cadeau est toujours proportionné à la générosité du donateur. Or, moi, pour ta beauté, et parce que tu me plais, je te fais don de tout ce que je possède ! Prends mes lèvres, prends ma langue, prends mes seins, prends mon ventre et tout le reste ! » Et Nour accepta le merveilleux cadeau, et lui fit don, en retour, d’un autre plus merveilleux encore. Et la jouvencelle, charmée à la fois et surprise de sa générosité et de son savoir, lui demanda, quand ils eurent fini : « Et pourtant, ô Nour, tes compagnons disaient que tu étais vierge ! » Il dit : « C’est vrai ! » Elle dit : « Que c’est étonnant ! Et comme tu as été expert dans ton premier essai ! » Il dit, en riant : « Quand on frotte le silex, le feu jaillit toujours ! »
Et c’est ainsi qu’au milieu des roses, de la gaieté et des ébats multipliés, le jeune Nour connut l’amour dans les bras d’une Égyptienne belle et saine comme l’œil du coq, et blanche comme l’amande décortiquée…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
… Et c’est ainsi qu’au milieu des roses, de la gaieté et des ébats multipliés, le jeune Nour connut l’amour dans les bras d’une Égyptienne belle et saine comme l’œil d’un coq.
Or, il était écrit dans sa destinée qu’il devait en être ainsi, pour son initiation. Car comment, sans cela, comprendrait-on les choses plus merveilleuses encore qui allaient marquer ses pas dans la voie plane de la vie heureuse ?
Donc, une fois leurs ébats terminés, le jeune Nour se leva, car les étoiles commençaient à briller au ciel, et le souffle de Dieu s’élevait dans le vent de la nuit. Et il dit à l’adolescente : « Avec ta permission ! » Et, malgré ses supplications pour le retenir, il ne voulut pas s’attarder davantage, et la quitta pour remonter sur sa mule et s’en revenir au plus vite à sa maison où, anxieusement, l’attendaient son père Couronne et sa mère.
Or, dès qu’il eut franchi le seuil, sa mère, pleine d’inquiétude de cette absence inaccoutumée de son fils, courut à sa rencontre, le serra dans ses bras et lui dit : « Où as-tu été, mon chéri, pour tarder ainsi hors de la maison ? » Mais dès que Nour eut ouvert la bouche, sa mère s’aperçut qu’il était pris de vin et sentit l’odeur de son haleine. Et elle lui dit : « Ah ! malheureux Nour, qu’as-tu fait ? Si ton père vient à sentir ton odeur, quelle calamité ! » Car Nour, qui avait supporté la boisson tant qu’il était dans les bras de l’Égyptienne, avait été frappé par l’air vif du dehors, et sa raison disloquée le faisait tituber à droite et à gauche comme un ivrogne. Aussi sa mère se hâta-t-elle de l’entraîner vers son lit et de le coucher, en le couvrant chaudement.
Mais, à ce moment, arriva dans la chambre le marchand Couronne, lequel était un observateur fidèle de la loi d’Allah qui défend aux Croyants les boissons fermentées. Et, voyant que son fils était couché pâle et le visage fatigué, il demanda à son épouse : « Qu’a-t-il ? » Elle répondit : « Il souffre d’un violent mal de tête occasionné par le grand air dans ce jardin où tu lui avais permis d’aller se promener avec ses camarades ! » Et le marchand Couronne, bien ennuyé de ce reproche de son épouse et du malaise de son fils, se pencha sur Nour pour lui demander comment il allait ; mais il sentit l’odeur de son haleine, et, indigné, il secoua le bras de Nour et lui cria : « Comment, fils débauché ! tu as enfreint la loi d’Allah et de son Prophète, et tu oses entrer dans la maison sans purifier ta bouche ! » Et il continua à l’admonester durement.
Alors Nour, qui était dans un état d’ivresse complète, sans savoir au juste ce qu’il faisait, leva la main et envoya à son père, le marchand Couronne, un coup de poing qui l’atteignit à l’œil droit, et si violemment qu’il le renversa par terre. Et le vieillard Couronne, à la limite de l’indignation, fit serment, par le divorce à la troisième puissance, de chasser dès le lendemain son fils Nour après lui avoir coupé la main droite. Puis il quitta la chambre.
Lorsque la mère de Nour eut entendu ce serment redoutable, contre lequel il n’y avait pas de recours ou de remède possible, elle déchira ses habits, de désespoir, et passa toute la nuit à se lamenter et à pleurer au pied du lit de son fils plongé dans l’ivresse. Mais, comme la chose était pressante, elle réussit, en le faisant transpirer et pisser beaucoup, à dissiper les fumées du vin. Et, comme il ne se rappelait rien de tout ce qui s’était passé, elle lui apprit l’action qu’il avait commise et le terrible serment de son père Couronne. Puis elle lui dit : « Hélas sur nous ! les regrets maintenant sont inutiles ! Et le seul parti qui te reste à prendre, en attendant que la destinée ait changé la face des choses, c’est de t’éloigner au plus vite, ô Nour, de la maison de ton père ! Pars, mon fils, pour la ville d’Al-Iskandaria, et voici une bourse de mille dinars d’or et cent dinars ! Lorsque tu seras au bout de cet argent, tu m’en feras demander d’autre, en ayant soin de me donner de tes nouvelles. » Et elle se mit à pleurer, en l’embrassant.
Alors Nour, après avoir de son côté versé beaucoup de larmes de repentir, attacha la bourse à sa ceinture, prit congé de sa mère, et sortit en secret de la maison pour aussitôt gagner le port de Boulak et, de là, descendre le Nil, sur un navire, jusqu’à Al-Iskandaria, où il débarqua en bonne santé.
Or, Nour trouva qu’Al-Iskandaria était une ville merveilleuse, habitée par des gens tout à fait charmants, et dotée d’un climat délicieux, de jardins remplis de fruits et de fleurs, de belles rues et de souks magnifiques. Et il se plut ainsi à parcourir les divers quartiers de la ville et tous les souks, l’un après l’autre. Et, comme il passait dans le souk, particulièrement agréable, des marchands de fleurs et de fruits…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Et, comme il passait dans le souk, particulièrement agréable, des marchands de fleurs et de fruits, il vit passer un Persan monté sur une mule avec, en croupe, une merveilleuse adolescente au maintien délicieux et à la taille de cinq palmes pleines. Elle était blanche comme le gland dans son écorce, comme l’ablette dans le bassin, comme le zerboa dans le désert. Son visage était plus éblouissant que l’éclat du soleil et, sous la garde des arcs tendus de ses sourcils, deux grands yeux noirs brillaient, originaires de Babylone. Et, de par l’étoffe transparente qui l’enveloppait, l’on devinait en elle des splendeurs à nulles autres pareilles : des joues polies comme le plus beau satin et plantées de roses ; des dents qui étaient deux colliers de perles ; des seins debout et menaçants ; des hanches onduleuses ; des cuisses semblables aux queues dodues des moutons de Syrie, et abritant, vers leur sommet de neige, un trésor incomparable, et supportant un derrière formé tout entier d’une pâte de perles, de roses et de jasmins. Gloire à son Créateur !
Aussi, lorsque le jeune Nour eut vu cette adolescente, qui surpassait en splendeurs la brune Égyptienne du jardin, il ne put s’empêcher de suivre la mule bienheureuse qui la portait. Et il se mit à marcher ainsi, derrière elle, jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés sur la place du Marché aux Esclaves.
Alors, le Persan descendit de la mule et, après avoir aidé l’adolescente à descendre à son tour, il la prit par la main et la remit au crieur public pour qu’il la criât sur le marché. Et le crieur, écartant la foule, fit asseoir l’adolescente sur un siège d’ivoire enrichi d’or, au centre de la place. Puis il promena ses regards sur ceux qui l’entouraient, et cria :
« Ô marchands ! ô acheteurs ! ô maîtres de richesses ! Citadins et Bédouins ! ô assistants qui m’entourez de près ou de loin, ouvrez l’encan ! Nul blâme à l’ouvreur de l’encan ! Estimez et parlez ! Allah est omnipotent et omniscient ! Ouvrez l’encan ! »
Alors s’avança au premier rang un vieillard, qui était le syndic des marchands de la ville et devant qui nul n’osa élever la voix pour l’enchère. Et il fit lentement le tour du siège où était assise l’adolescente et, après l’avoir examinée avec une grande attention, il dit : « J’ouvre l’encan à neuf cent vingt-cinq dinars ! »
Aussitôt le crieur cria de toute sa voix : « L’encan s’ouvre à neuf cent vingt-cinq dinars ! Ô ouvreur ! Ô omniscient ! Ô généreux ! À neuf cent vingt-cinq dinars la mise à prix de la perle incomparable ! » Puis, comme personne ne voulait augmenter l’enchère, par égard pour le vénérable syndic, le crieur se tourna vers l’adolescente et lui demanda : « Acceptes-tu, ô souveraine des lunes, d’appartenir à notre vénérable syndic ? » Et l’adolescente répondit, de dessous ses voiles : « Serais-tu fou, ô crieur, ou seulement atteint de dislocation dans ta langue, pour me faire une telle offre ? » Et le crieur, interdit, demanda : « Et pourquoi donc, ô souveraine des belles ? » Et l’adolescente, découvrant les perles de sa bouche dans un sourire, dit : « Ô crieur, n’as-tu pas honte devant Allah et sur ta barbe, de vouloir livrer les jeunes filles de ma qualité à un vieillard comme celui-ci, décrépit et sans vertu, auquel sa femme a dû, sans aucun doute, et plus d’une fois, reprocher sa frigidité en termes violents et indignés ! Et ne sais-tu que c’est précisément à ce vieillard-là que s’appliquent ces vers du poète :
« J’ai, m’appartenant en propre, un zebb calamiteux. Il est fait de cire fondante, car plus on le touche, plus il s’amollit.
J’ai beau lui parler raison, il s’entête à dormir quand il est nécessaire qu’il se réveille. C’est un zebb paresseux !
Mais que je sois seul à seul avec lui, et le voilà pris soudain d’un beau zèle guerrier ! Ah ! c’est un zebb calamiteux !
Il est avare quand il faut montrer de la générosité, et prodigue quand il faut économiser. Le fils de chien ! Si je dors, il s’éveille aussitôt ; et si je m’éveille, aussitôt il s’endort. C’est un zebb calamiteux ! Maudit soit celui qui le prendra en pitié ! »
Lorsque les assistants eurent entendu ces paroles et ces vers de l’adolescente, ils furent extrêmement formalisés, à cause du manque d’égards et de l’irrespect témoignés au syndic. Et le crieur dit à l’adolescente : « Par Allah, ô ma maîtresse, tu fais noircir mon visage devant les marchands ! Comment peux-tu dire de telles choses de notre syndic, un homme respectable, un sage, un savant même ? » Mais elle répondit : « Ah ! si c’est un savant, alors vraiment tant mieux ! Puisse la leçon lui être de quelque profit ! Des savants sans zebb, à quoi ça sert-il ? Allons ! Qu’il aille plutôt se cacher…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Des savants sans zebb, à quoi ça sert-il ? Allons ! Qu’il aille plutôt se cacher ! »
Le crieur alors, pour que l’adolescente ne pût continuer à invectiver le vieux syndic, se hâta de recommencer la criée, de toute sa voix, en clamant : « Ô marchands, ô acheteurs ! l’encan est ouvert et reste ouvert ! Au plus offrant, la fille des rois ! » Alors s’avança un autre marchand, qui n’avait pas assisté à ce qui venait de se passer et qui, ébloui par la beauté de l’esclave, dit : « À moi, pour neuf cent cinquante dinars ! » Mais l’adolescente, à sa vue, poussa un éclat de rire ; et, lorsqu’il se fut approché d’elle pour la mieux examiner, elle lui dit : « Ô cheikh, dis-moi, as-tu dans ta maison un solide couperet ? » Il répondit : « Oui, par Allah, ô ma maîtresse ! Mais que veux-tu en faire ? » Elle répondit : « Ne vois-tu donc pas qu’il faut, avant tout, te couper un notable morceau de l’aubergine que tu portes en guise de nez ? Et ignores-tu que c’est à toi, mieux qu’à personne, que s’appliquent ces paroles du poète :
« Sur son visage s’élève un immense minaret qui pourrait laisser s’engouffrer, par ses deux portes, tous les humains. Et du coup la terre serait dépeuplée ! »
Lorsque le marchand au gros nez eut entendu ces paroles de l’adolescente, il fut dans une telle colère qu’il éternua avec un grand éclat, puis, saisissant le crieur au collet, il lui asséna plusieurs coups sur la nuque, en lui criant : « Maudit crieur ! ne nous as-tu amené cette impudente esclave que pour nous injurier et nous rendre un objet de risée ? » Et le crieur, bien marri, se tourna vers l’adolescente et lui dit : « Par Allah ! depuis le temps que j’exerce mon métier, jamais je n’ai eu une journée aussi néfaste que celle-ci ! Ne pourrais-tu réprimer les désordres de ta langue, et nous laisser gagner notre subsistance ? » Puis, pour mettre fin aux rumeurs, il continua la criée.
Alors survint un troisième marchand fortement barbu, qui voulut acheter la belle esclave. Mais avant qu’il eût ouvert la bouche pour faire son offre, l’adolescente se mit à rire et s’écria : « Regarde, ô crieur ! Chez cet homme l’ordre de la nature est interverti : c’est un mouton à grosse queue, mais sa queue lui a poussé au menton ! Et, certes, tu ne songes pas à me céder à un homme qui possède une barbe si longue et par conséquent un esprit fort borné ! Car tu sais que l’intelligence et la raison sont en sens inverse de la longueur de la barbe ! »
À ces paroles, le crieur, à la limite du désespoir, ne voulut pas aller plus loin dans cette vente-là ! Et il s’écria : « Non, par Allah ! je n’exerce plus le métier aujourd’hui ! » Et, prenant l’adolescente par la main, avec un sentiment de terreur, il la remit au Persan, son ancien maître, en lui disant : « Elle est invendable pour nous ! Qu’Allah ouvre pour toi ailleurs la porte de la vente et de l’achat ! » Et le Persan, sans se troubler ni s’émouvoir, se tourna vers l’adolescente et lui dit : « Allah est le plus généreux ! Viens, ma fille ! nous finirons bien par trouver l’acheteur qui te sied ! » Et il l’emmena et s’en alla, la tenant par une main, tandis qu’il conduisait, de l’autre main, la mule par la bride, et que l’adolescente lançait de ses yeux, à ceux qui la regardaient, de longues flèches noires et acérées.
Or, c’est alors seulement que tu aperçus le jeune Nour, ô merveilleuse, et qu’à sa vue tu sentis le désir te mordre le foie et l’amour te bouleverser les entrailles ! Et tu t’arrêtas soudain, et tu dis à ton maître le Persan : « C’est celui-ci que je veux ! Vends-moi à lui ! » Et le Persan se retourna et aperçut à son tour le jouvenceau orné de tous les charmes de la jeunesse et de la beauté, et élégamment enveloppé d’un manteau couleur de pruneau. Et il dit à l’adolescente : « Ce jeune homme était tout à l’heure parmi les assistants, et ne s’est point avancé pour l’enchère. Comment alors veux-tu que j’aille te proposer à lui, contre sa volonté ? Ne sais-tu que cette démarche te déprécierait à l’extrême sur le marché ? » Elle répondit : « Il n’y a point d’inconvénient à la chose. Je ne veux appartenir qu’à ce bel adolescent. Et nul autre que lui ne me possédera. » Et elle s’avança résolument vers le jeune Nour et lui dit, en lui coulant un regard chargé de tentations : « Ne suis-je donc point belle, ô mon maître, pour que tu n’aies point daigné faire une offre aux enchères ? » Il répondit : « Ô ma souveraine, y a-t-il de par le monde une beauté comparable à toi ? » Elle demanda : « Pourquoi donc n’as-tu point voulu de moi, alors qu’on me proposait au plus offrant ? c’est que, sans doute, tu ne me trouves pas à ta convenance ! » Il répondit : « Qu’Allah te bénisse, ô ma maîtresse ! Certes, si j’étais dans mon pays, je t’aurais achetée moyennant toutes les richesses et tous les biens que possède ma main. Mais ici je ne suis qu’un étranger et je ne possède, pour toutes ressources, qu’une bourse de mille dinars ! » Elle dit : « Offre-la pour mon achat et tu ne le regretteras pas ! » Et le jeune Nour, ne pouvant résister à la magie du regard fixé sur lui, défit sa ceinture, où étaient serrés les mille dinars, et compta et pesa l’or devant le Persan. Et tous deux conclurent le marché, après avoir fait venir le kâdi et les témoins, pour la légalisation du contrat de vente et d’achat. Et, pour confirmer l’acte, l’adolescente déclara : « Je consens à ma vente à ce bel adolescent, moyennant les mille dinars donnés à mon maître le Persan ! » Et les assistants se dirent les uns aux autres : « Ouallah ! ils sont bien faits l’un pour l’autre ! » Et le Persan dit à Nour : « Puisse-t-elle être pour toi une cause de bénédictions ! Réjouissez-vous ensemble de votre jeunesse ! vous méritez également le bonheur qui vous attend…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … vous méritez également le bonheur qui vous attend ! »
Alors le jeune Nour, suivi par l’adolescente aux hanches onduleuses, se dirigea vers le grand khân de la ville, et se hâta d’y louer une chambre où loger. Et il s’excusa auprès de l’adolescente de ne pouvoir lui offrir mieux, disant : « Par Allah, ô ma maîtresse, si j’étais au Caire, ma ville, je te logerais dans un palais digne de toi ! Mais, je te le répète, ici je ne suis qu’un étranger ! Et je n’ai plus sur moi, pour subvenir à nos besoins, que juste de quoi payer ce logement ! » Elle répondit, en souriant : « Sois sans inquiétude à ce sujet ! » Et elle tira de son doigt une bague où était enchâssé un rubis d’une grande valeur, et lui dit : « Prends ceci, et va le vendre au souk. Et achète-nous tout ce qu’il faut pour un festin à deux ; et dépense largement et achète ce qu’il y a de mieux en fait de vivres et de boissons, sans oublier les fleurs, les fruits et les parfums ! » Et Nour se hâta d’aller exécuter l’ordre, et ne tarda pas à revenir chargé de provisions de toute nature. Et il releva ses manches et sa robe, et tendit la nappe, et apprêta avec beaucoup de soin le festin. Puis il s’assit à côté de l’adolescente, qui le voyait faire en souriant ; et ils se mirent, pour commencer, par bien manger et bien boire. Et lorsqu’ils se furent rassasiés et que la boisson eut commencé son effet, le jeune Nour, qui était un peu intimidé par les yeux brillants de son esclave, ne voulut point se laisser aller aux désirs tumultueux qui l’agitaient, avant de s’être informé du pays et de l’origine de l’adolescente. Et il lui prit la main et la baisa et lui dit : « Par Allah sur toi, ô ma maîtresse, ne pourrais-tu pas maintenant me dire ton nom et ton pays ? » Elle répondit : « Justement, ô Nour, j’allais moi-même t’en parler la première ! » Et elle s’arrêta un moment, et dit :
« Sache, ô Nour, que je m’appelle Mariam, et que je suis la fille unique du puissant roi des Francs qui règne dans la ville de Constantinia. Aussi ne sois point étonné de savoir que j’ai reçu, dans mon enfance, la plus belle éducation et que j’ai eu des maîtres dans tous les genres. On m’apprit également à manier l’aiguille et le fuseau, à faire des foulards et des broderies, à tisser des tapis et des ceintures, et à travailler les étoffes soit en or sur un fond d’argent, soit en argent sur un fond d’or. Et j’appris également tout ce qui pouvait orner l’esprit et ajouter à la beauté. Et je grandis de la sorte, au milieu du palais de mon père, loin de tous les regards. Et les femmes du palais disaient, en me regardant avec des yeux tendres, que j’étais la merveille du temps. Aussi, un grand nombre de princes et de rois, qui régnaient sur les terres et les îles, ne manquèrent pas de venir me demander en mariage ; mais le roi mon père rejeta toutes leurs propositions, ne voulant pas se séparer de sa fille unique, celle qu’il chérissait plus que sa vie et plus que les nombreux enfants mâles, mes frères !
« Sur ces entrefaites, étant tombée malade, je fis vœu, si je recouvrais la santé, d’aller en pèlerinage à un monastère très vénéré parmi les Francs. Et lorsque je fus guérie, je voulus accomplir mon vœu, et je m’embarquai avec une de mes dames d’honneur, fille d’un grand d’entre les grands de la cour du roi mon père. Mais, dès que nous eûmes perdu la terre de vue, notre navire fut attaqué et pris par des pirates musulmans ; et moi-même, avec toute ma suite, je fus emmenée en esclavage, et conduite en Égypte où je fus vendue au marchand persan que tu as vu et qui, heureusement pour ma virginité, se trouvait être affligé d’eunuquat. Et, pour ma chance également et parce qu’ainsi le voulait ma destinée, mon maître éprouva, dès qu’il m’eut dans sa maison, une longue et dangereuse maladie, pendant laquelle je lui prodiguai les soins les plus attentifs. Aussi, dès qu’il eut recouvré la santé, il voulut me témoigner sa gratitude pour les marques d’attachement que je lui avais données pendant sa maladie, et me pria de lui demander tout ce que pouvait souhaiter mon âme. Et moi je réclamai de lui, pour toute faveur, de me vendre à quelqu’un qui pût utiliser ce qu’il y avait en moi à utiliser, mais de ne me céder qu’à celui que je choisirais moi-même. Et le Persan me le promit à l’instant, et se hâta d’aller me vendre sur la place du marché, où je pus de la sorte fixer mon choix sur toi, ô mon œil, à l’exclusion de tous les vieux et décrépits personnages qui me convoitaient ! »
Et, ayant ainsi parlé, la jeune Franque regarda Nour avec des yeux où flambait l’or des tentations, et lui dit : « Pouvais-je, telle que je suis, appartenir à un autre qu’à toi, ô jouvenceau ? » Et, d’un mouvement rapide, elle rejeta ses voiles et se dévêtit tout entière, pour apparaître dans sa native nudité. Béni soit le ventre qui l’a portée ! C’est alors seulement que Nour put juger de la bénédiction qui était descendue sur sa tête ! Et il vit que la princesse était une beauté douce et blanche comme un tissu de lin, et qu’elle répandait de toutes parts la suave odeur de l’ambre, telle la rose qui sécrète elle-même son parfum originel. Et il la pressa dans ses bras et trouva en elle, l’ayant explorée dans sa profondeur intime, une perle encore intacte. Et il jubila de cette découverte-là à la limite de la jubilation, et s’enflamma à la limite de l’inflammation. Et il se mit à promener sa main sur ses membres charmants et son cou délicat, et à l’égarer parmi les flots et les boucles de sa chevelure, en faisant claquer les baisers sur ses joues, comme des cailloux sonores dans l’eau ; et il se dulcifiait à ses lèvres, et faisait claquer ses paumes sur la tendreté rebondissante de ses fesses. Vraiment tout cela ! Et elle, de son côté, elle ne manqua pas de faire voir une partie considérable des dons qu’elle possédait et des merveilleuses aptitudes qui étaient en elle ; car elle unissait la volupté des Grecques aux amoureuses vertus des Égyptiennes, les mouvements lascifs des filles arabes à la chaleur des Éthiopiennes, la candeur effarouchée des Franques à la science consommée des Indiennes, l’expérience des filles de Circassie aux désirs passionnés des Nubiennes, la coquetterie des femmes du Yamân à la violence musculaire des femmes de la Haute-Égypte, l’exiguïté des organes des Chinoises à l’ardeur des filles du Hedjaz, et la vigueur des femmes de l’Irak à la délicatesse des Persanes. Aussi les enlacements ne cessèrent de succéder aux embrassements, les baisers aux caresses et les copulations aux foutreries, pendant toute la nuit, jusqu’à ce que, un peu fatigués de leurs transports et de leurs multiples ébats, ils se fussent endormis enfin dans les bras l’un de l’autre, ivres de jouissances. Gloire à Allah qui n’a point créé de spectacle plus enchanteur que celui de deux amants heureux qui, après s’être grisés des délices de la volupté, reposent sur leur couche, les bras entrelacés, les mains unies et les cœurs battant en harmonie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENTIÈME NUIT
Elle dit :
… Gloire à Allah qui n’a point créé de spectacle plus enchanteur que celui de deux amants heureux qui, après s’être grisés des délices de la volupté, reposent sur leur couche, les bras entrelacés, les mains unies et les cœurs battant en harmonie !
Lorsque, le lendemain, ils se furent réveillés, ils ne manquèrent pas de recommencer leurs ébats, avec encore plus d’intensité, de chaleur, de multiplicité, de répétitions, de vigueur et d’expérience qu’ils ne l’avaient fait la veille. Aussi la princesse franque, émerveillée et à la limite de l’admiration de voir tant de vertus réunies chez les fils des musulmans, se dit : « Certes ! quand une religion inspire et développe chez ses croyants de tels actes de vaillance, d’héroïsme et de vertu, elle est, sans conteste, la meilleure, la plus humaine et la seule vraie entre toutes les religions ! » Et elle voulut sur le champ s’ennoblir de l’Islam. Elle se tourna donc vers Nour et lui demanda : « Que faut-il que je fasse, ô mon œil, pour m’ennoblir de l’Islam ? Car je veux devenir musulmane comme toi, vu que la paix de mon âme n’est point restée chez les Francs qui placent la vertu dans l’horrible continence et n’estiment rien à l’égal du prêtre émasculé ! Ce sont des pervertis qui ne connaissent point la valeur inestimable de la vie ! Ce sont des malheureux que le soleil ne réchauffe point de ses rayons ! Aussi, mon âme veut demeurer ici, où elle fleurira de toutes ses roses et chantera de tous ses oiseaux ! Dis-moi donc ce qu’il faut que je fasse pour devenir musulmane ! » Et Nour, plein de bonheur d’avoir ainsi contribué, dans la mesure de ses moyens, à convertir la princesse franque, lui dit : « Ô ma maîtresse, notre religion est simple et ne connaît point les complications extérieures ! Tôt ou tard tous les mécréants reconnaîtront la supériorité de nos croyances, et s’achemineront d’eux-mêmes vers nous comme on va des ténèbres à la lumière, de l’incompréhensible au clair et de l’impossible au naturel ! Quant à toi, ô princesse de bénédiction, tu n’as, pour finir de te laver de la crasse chrétienne, qu’à prononcer ces deux mots : « Il n’y a de Dieu qu’Allah et Môhammad est l’envoyé d’Allah ! » Et, à l’instant, tu deviens croyante et musulmane ! À ces paroles, la princesse Mariam, fille du roi des Francs, leva le doigt et prononça : « J’atteste et certifie qu’il n’y a de Dieu qu’Allah, et que Môhammad est l’envoyé d’Allah ! » Et à l’instant elle s’ennoblit de l’Islam ! Gloire à Celui qui, par les moyens simples, ouvre les yeux des aveugles, sensibilise les oreilles des sourds, délie la langue des muets et ennoblit les cœurs des pervertis, le Maître des vertus, le Distributeur des grâces, le Bon pour Ses Croyants ! Amin !
Cet acte important ainsi accompli (qu’Allah soit loué !) ils se levèrent tous deux de leur lit de volupté, et allèrent aux cabinets, pour, ensuite, faire leurs ablutions et les prières prescrites. Après quoi ils mangèrent et burent et se mirent à causer avec beaucoup de charme et à s’entretenir amicalement. Et Nour s’émerveillait de plus en plus des connaissances nombreuses de la princesse et de sa sagesse et de sa sagacité.
Or, dans l’après-midi, vers l’heure de la prière de l’asr, le jeune Nour se dirigea vers la mosquée, et la princesse Mariam alla se promener du côté de la Colonne du Mât. Et voilà pour eux !
Mais pour ce qui est du roi des Francs de Constantinia, père de Mariam, lorsqu’il eut appris la capture de sa fille par les pirates musulmans, il fut affligé à la limite de l’affliction et désespéré à mourir. Et il envoya de tous côtés des chevaliers et des patrices pour faire les recherches nécessaires et racheter la princesse et la sauver, de gré ou de force, d’entre les mains de ses ravisseurs. Mais tous ceux qu’il avait chargés de ces recherches revinrent au bout d’un certain temps, sans avoir rien appris. Alors il fit venir son vizir, chef de la police, un petit vieux, borgne de l’œil droit et boiteux de la jambe gauche, mais un véritable démon entre les espions ; car il était capable de démêler, sans les briser, les fils embrouillés d’une toile d’araignée, d’arracher les dents d’un dormeur sans le réveiller, de subtiliser les bouchées d’entre les lèvres d’un Bédouin affamé, et d’enculer un nègre trois fois de suite sans que ce nègre pût même se retourner. Et il lui donna l’ordre de parcourir tous les pays musulmans et de ne revenir auprès de lui qu’après avoir ramené la princesse. Et il lui promit toutes sortes d’honneurs et de prérogatives pour son retour, mais en lui faisant entrevoir, en cas d’insuccès, le pal. Et le vizir borgne et boiteux se hâta de partir. Et il se mit à voyager, sous un déguisement, à travers les pays amis et ennemis, sans trouver aucune piste, jusqu’à ce qu’il fût arrivé à El-Iskandaria.
Et précisément, ce jour-là, il alla, avec les esclaves qui l’avaient accompagné, faire une partie de plaisir à la Colonne du Mât. Et le destin voulut ainsi qu’il rencontrât la princesse Mariam qui respirait l’air de ce côté-là. Aussi, dès qu’il l’eut reconnue, il se trémoussa de joie, et se précipita à sa rencontre. Et, arrivé devant elle, il mit un genou en terre et voulut lui baiser les mains. Mais la princesse, qui avait acquis toutes les vertus musulmanes et la décence vis-à-vis des hommes, appliqua un vigoureux soufflet au vizir franc, si laid, et lui cria : « Chien maudit ! que viens-tu faire en terre musulmane ? Et penses-tu me faire tomber en ta puissance…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Mais la princesse, qui avait acquis toutes les vertus musulmanes et la décence vis-à-vis des hommes, appliqua un vigoureux soufflet au vizir franc, si laid, et lui cria : « Chien maudit ! que viens-tu faire en terre musulmane ? Et penses-tu me faire tomber en ta puissance ? » Le Franc répondit : « Ô princesse, je ne suis point coupable en cette affaire. Il ne faut t’en prendre qu’au roi ton père, qui m’a menacé du pal si je ne te retrouvais pas ! Il faut donc que tu reviennes avec nous, de gré ou de force, pour me sauver de ce supplice épouvantable. Et d’ailleurs ton père se meurt du désespoir de te savoir captive chez les infidèles, et ta mère est dans les larmes de songer aux mauvais traitements que tu as dû subir entre les mains de ces bandits perforateurs ! » Mais la princesse Mariam répondit : « Pas du tout ! La paix de mon âme, je l’ai trouvée ici même. Et je ne quitterai point cette terre de bénédiction ! Retourne donc là d’où tu es venu, ou crains que je ne te fasse précisément empaler ici-même, au haut de la Colonne du Mât !
À ces paroles, le Franc boiteux comprit qu’il ne déciderait pas la princesse à le suivre de son plein gré, et lui dit : « Avec ta permission, ô ma maîtresse ! » Et il fit signe de se saisir d’elle à ses esclaves, qui, aussitôt, l’entourèrent, la bâillonnèrent et, malgré qu’elle se défendît et les égratignât cruellement, la chargèrent sur leur dos et la transportèrent, à la tombée de la nuit, à bord d’un navire qui faisait voile pour Constantinia. Et voilà pour le vizir borgne et boiteux et pour la princesse Mariam !
Quant au jeune Nour, qui ne voyait point revenir au khân la princesse Mariam, il ne sut à quoi attribuer ce retard. Et, comme la nuit s’avançait et que son inquiétude augmentait, il sortit du khân et se mit à errer à travers les rues désertes, dans l’espoir de la retrouver, et finit par arriver au port. Là, quelques bateliers lui apprirent qu’un navire venait de partir et qu’ils avaient conduit à son bord une adolescente dont le signalement répondait exactement à celui qu’il leur donnait.
En apprenant ce départ de sa bien-aimée, Nour se mit à se lamenter et à pleurer, n’interrompant ses sanglots que par les cris de « Mariam ! Mariam ! » Alors un vieillard, qui le voyait se plaindre de la sorte, touché par sa beauté et son désespoir, s’approcha de lui et l’interrogea avec bonté sur la cause de ses larmes. Et Nour lui raconta le malheur qui venait de lui arriver. Alors le vieillard lui dit : « Ne pleure plus, mon enfant, et ne te désespère pas ! Le navire qui vient de partir a fait voile pour Constantinia, et précisément, moi aussi, qui suis capitaine marin, je vais faire voile pour cette ville-là, cette nuit, avec les cent musulmans que j’ai à mon bord. Tu n’as donc qu’à t’embarquer avec moi, et tu retrouveras l’objet de tes désirs ! » Et Nour, les larmes aux yeux, baisa la main du capitaine marin et se hâta de s’embarquer avec lui sur le navire qui s’envola toutes voiles dehors, sur la mer.
Or, Allah leur écrivit la sécurité, et au bout d’une navigation de cinquante et un jours, ils arrivèrent en vue de Constantinia où ils ne tardèrent pas à atterrir. Mais aussitôt ils furent tous appréhendés par les soldats francs qui gardaient le rivage, et dépouilles et jetés en prison, suivant les ordres du roi, qui voulait ainsi se venger sur tous les marchands étrangers de l’affront fait à sa fille dans les pays musulmans.
En effet, la princesse Mariam était arrivée à Constantinia la veille même de ce jour. Et aussitôt que la nouvelle de son retour eut été répandue dans la ville, on avait décoré toutes les rues en son honneur, et toute la population était allée à sa rencontre. Et le roi et la reine montèrent à cheval avec tous les grands et dignitaires du palais, et vinrent la recevoir à son débarquement. Et la reine, après avoir tendrement embrassé sa fille, lui demanda anxieusement, avant toute chose, si elle était encore vierge ou si, pour son malheur et l’opprobre de son nom, elle avait perdu le sceau inestimable. Mais la princesse, éclatant de rire devant toute l’assistance, répondit : « Que me demandes-tu là, ô ma mère ? Crois-tu donc qu’on peut rester vierge dans le pays des musulmans ? Et ne sais-tu que dans les livres des musulmans, il est dit : « Nulle femme ne vieillira vierge dans l’Islam…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Nulle femme ne vieillira vierge dans l’Islam ! »
Lorsque la reine, — qui n’avait fait publiquement cette question à sa fille que pour répandre, dès son arrivée, la nouvelle que sa virginité était restée intacte et que leur honneur était sauf, — eut entendu ces paroles si imprévues, et cela devant toute la cour, elle devint bien jaune de teint et tomba évanouie dans les bras de ses suivantes émues d’un si énorme scandale. Et le roi, également, bien furieux de cette aventure-là et surtout de la franchise avec laquelle sa fille convenait de ce qui lui était arrivé, sentit sa poche à fiel lui éclater au milieu du foie, et, indigné à la limite de l’indignation, il emmena la princesse et rentra en toute hâte au palais, au milieu de la consternation générale, des nez allongés des dignitaires, et des mines revêches des vieilles matrones suffoquées. Et là il convoqua d’urgence son conseil d’état, et demanda leur avis aux vizirs et aux patriarches. Et les vizirs et les patriarches consultés, répondirent : « Nous sommes d’avis que, pour purifier la princesse de la souillure des musulmans, il n’y a qu’un seul moyen, et c’est de la laver dans leur sang. Il faut donc tirer de la prison cent musulmans, pas un de plus, pas un de moins, et leur couper la tête ! Et l’on recueillera le sang de leur cou, et on en baignera le corps de la princesse, comme pour un nouveau baptême ! »
En conséquence, le roi ordonna d’amener les cent musulmans qui venaient d’être jetés en prison, et parmi lesquels se trouvait, comme il a été dit, le jeune Nour. Et l’on commença par couper la tête au capitaine marin. Puis on coupa la tête à tous les marchands. Et l’on recueillait chaque fois, dans une grande bassine, le sang qui jaillissait des cous sans têtes. Et ce fut le tour du jeune Nour. Et on le conduisit à l’endroit de l’exécution, on lui banda les yeux, on le plaça sur le tapis ensanglanté, et l’exécuteur brandit son glaive pour faire sauter sa tête de sur son cou, quand une vieille femme s’approcha du roi et lui dit : « Ô roi du temps, les cent têtes sont déjà coupées, et la bassine est pleine de sang ! Il faut donc épargner ce jeune musulman qui reste, et me le donner plutôt pour le service de l’église ! » Et le roi s’écria : « Par le Messie ! tu dis vrai ! Les cent têtes sont là, et la bassine est pleine. Prends donc celui-ci et utilise-le pour le service de l’église ! » Et la vieille, qui était la gardienne en chef de l’église, remercia le roi et, pendant qu’il se retirait avec ses vizirs pour procéder au baptême de sang de la princesse, elle emmena le jeune Nour. Et, enchantée de sa beauté, elle le conduisit sans retard à l’église.
Là, la vieille ordonna à Nour de se dévêtir, et lui donna une longue robe noire, un haut bonnet de prêtre, un grand voile noir pour en couvrir ce bonnet-là, une étole et une large ceinture. Et elle l’en habilla elle-même, pour lui enseigner comment il devait s’en servir ; et elle lui donna ses instructions pour qu’il fît, comme il fallait, le service de l’église. Et, pendant sept jours de suite, elle surveilla son travail et encouragea ses aptitudes, tandis qu’il se lamentait en son cœur de Croyant d’être obligé de faire une telle besogne au service des mécréants.
Or, au soir du septième jour, la vieille dit à Nour : « Sache, mon fils, que dans quelques instants la princesse Mariam, qui a été purifiée par le baptême du sang, va venir à l’église pour y passer toute la nuit dans la dévotion et se faire ainsi pardonner les actes de son passé. Je t’avise donc de son arrivée afin que, lorsque je serai partie me coucher, tu restes à la porte pour lui rendre tel service qu’elle pourra demander ou pour m’appeler au cas où elle tomberait évanouie de contrition à cause de ses anciens péchés. As-tu bien compris ? » Et Nour, dont les yeux étincelaient, répondit : « J’ai compris, ô ma maîtresse ! »
Sur ces entrefaites, la princesse Mariam, vêtue de noir de la tête aux pieds et le visage couvert d’un voile noir, arriva dans le vestibule de l’église et, après s’être inclinée profondément devant Nour qu’elle prenait pour un prêtre à cause de ses habits, pénétra dans l’église dont la vieille gardienne lui avait ouvert la porte, et, d’un pas lent, se dirigea vers une sorte d’oratoire intérieur bien ténébreux d’aspect. Alors la vieille, ne voulant point la déranger dans ses dévotions, se hâta de se retirer ; et, après avoir bien recommandé à Nour de veiller à la porte, elle monta dormir dans sa chambre…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… elle monta dormir dans sa chambre.
Lorsque Nour eut constaté que la vieille gardienne endormie ronflait comme une ogresse, il se glissa dans l’église et se dirigea vers l’endroit où se tenait la princesse Mariam, et qui était un oratoire éclairé par une petite lampe brûlant devant les images de l’impiété (que le feu les détruise !) Et il entra doucement dans cet oratoire et, d’une voix tremblante, dit : « Je suis Nour, ô Mariam ! » Et la princesse, ayant reconnu la voix de son bien-aimé, crut d’abord qu’elle rêvait, puis finit par se jeter dans ses bras. Et tous deux, à la limite de l’émotion, se mirent à s’embrasser longtemps en silence. Et, lorsqu’ils purent parler, ils se racontèrent mutuellement ce qui leur était arrivé depuis le jour de la séparation. Et ils rendirent ensemble grâces à Allah qui avait permis leur réunion.
Après quoi la princesse se hâta, pour fêter par la joie ce moment de leur réunion, d’enlever les habits de deuil que la reine, sa mère, l’avait obligée à porter pour lui rappeler sans cesse la perte de sa virginité. Et, s’étant entièrement dévêtue, elle s’assit sur les genoux de Nour qui, de son côté, avait jeté loin de lui sa robe et ses effets de prêtre chrétien. Et ils commencèrent une série de caresses extraordinaires, et telles que jamais ce lieu de perdition des âmes mécréantes n’avait vu se passer les pareilles. Et ils ne cessèrent, durant toute la nuit, de s’abandonner sans restrictions d’aucune sorte aux jouissances les plus diverses de la volupté, en se donnant mutuellement les marques les plus péremptoires du violent amour. Et Nour, en ce moment-là, se sentait revivre avec une telle intensité, qu’il aurait pu égorger, sans arrêt, l’un après l’autre, mille prêtres avec leurs patriarches ! Qu’Allah extermine les impies et donne la force et le courage à Ses vrais Croyants !
Lorsque, vers l’aube, les cloches de l’église sonnèrent le premier appel des mécréants, la princesse Mariam se hâta, mais avec quelles larmes de regret ! de se vêtir de ses habits de deuil ; et Nour également s’habilla des vêtements de l’impiété (qu’Allah, qui voit le fond des consciences, l’excuse dans cette nécessité cruelle !) Mais, avant de se retirer et après l’avoir embrassé une dernière fois, la princesse dit à Nour : « Tu dois maintenant, ô Nour, depuis déjà sept jours que tu te trouves dans cette ville, connaître bien à fond les lieux et les environs de cette église ? » Et Nour répondit : « Oui, ô ma maîtresse ! » Elle dit : « Eh bien, alors, écoute bien mes paroles et retiens-les ! Je viens, en effet, de combiner en mon esprit un projet qui nous permettra de nous échapper pour toujours de ce pays ! Pour cela, demain, à la première veille de la nuit, toi, tu n’auras qu’à ouvrir la porte de l’église qui donne du côté de la mer, et à te rendre sans retard sur le rivage. Là, tu trouveras un petit navire avec dix hommes d’équipage dont le capitaine, en te voyant arriver, se hâtera de te tendre la main. Mais attends qu’il t’appelle par ton nom ; et surtout ne précipite rien ! Quant à moi, n’aie aucune inquiétude à mon sujet : je saurai te retrouver sans encombre. Et Allah nous délivrera d’entre leurs mains ! » Puis, avant de le quitter, elle ajouta encore : « N’oublie pas non plus, ô Nour, pour jouer un tour excellent aux patriarches, de dérober au trésor de l’église tout ce que tu y trouveras de lourd quant au prix et de léger quant au poids, et de vider, avant de t’en aller, le tronc où les infidèles déposent les offrandes en or qu’ils font aux chefs de leur imposture ! » Et la princesse, après avoir fait répéter à Nour, mot par mot, les instructions qu’elle venait de lui donner, sortit de l’église et rentra, avec des yeux bien contrits, au palais où sa mère l’attendait pour lui prêcher le repentir et la continence ! Puissent les Croyants être à jamais préservés de la continence impure et n’avoir de repentir que pour le mal commis envers leur prochain ! Amin !
Donc, à la première veille de la nuit, Nour, après avoir surveillé les ronflements de la vieille ogresse de l’église, ne manqua pas de faire main basse sur toutes les choses précieuses du trésor souterrain et de vider dans sa ceinture de prêtre tout l’or et l’argent contenu dans le tronc des patriarches. Et, chargé de ces dépouilles des mécréants, il se rendit en toute hâte, par la porte qui lui avait été indiquée, sur le rivage de la mer. Et là, suivant ce que lui avait dit la princesse, il trouva le bâtiment, dont le capitaine, après lui avoir tendu la main et l’avoir appelé par son nom, le reçut en toute cordialité avec sa charge précieuse. Et aussitôt fut donné le signal du départ.
Or, les matelots, au lieu d’obéir à l’ordre de leur capitaine et de défaire les amarres qui tenaient le navire attaché aux poteaux du rivage, se mirent à murmurer, et l’un d’eux éleva la voix et dit : « Ô capitaine, tu sais bien pourtant que nous avons reçu des ordres tout différents du roi, notre maître, qui veut faire embarquer demain son vizir sur notre navire, pour aller reconnaître des pirates musulmans signalés comme ayant menacé d’enlever la princesse Mariam ! » Mais le capitaine, à la limite de la fureur devant cette résistance, s’écria : « Qui ose résister à mes ordres ? » et, brandissant son sabre, il abattit, d’un seul coup, la tête de celui qui avait parlé. Et le sabre flamba, dans la nuit, rouge de sang, comme une torche. Mais cet acte de fermeté n’empêcha pas les autres matelots, hommes endurcis, de continuer leurs murmures. Aussi ils partagèrent tous, en un clin d’œil, sous le sabre rapide comme l’éclair, le sort de leur camarade, en perdant tous les dix, l’un après l’autre, la tête de leurs épaules. Et le capitaine repoussa du pied leurs corps dans la mer…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le capitaine repoussa du pied leurs corps dans la mer.
Cela fait, il se tourna vers Nour, et, d’un ton de commandement qui ne comportait pas de réplique, lui cria : « Yallah ! Allons ! Défais les amarres, déploie les voiles et manœuvre les cordages, tandis que je vais me charger du gouvernail ! » Et Nour, dominé par l’ascendant du terrible capitaine, et d’ailleurs sans armes pour se défendre et essayer de se sauver à terre, fut bien obligé d’obéir, et, quoique bien novice dans les choses de la mer, il exécuta, le mieux qu’il put, la manœuvre. Et le petit vaisseau, dirigé par la main ferme du capitaine à la barre, s’éloigna, toutes voiles dehors, vers le large, et, poussé par le vent favorable, mit le cap sur El-Iskandaria.
Pendant ce temps, le pauvre Nour se lamentait en son âme, sans oser se plaindre ouvertement devant le capitaine barbu qui le regardait avec des yeux étincelants ; et il se disait : « Quelle calamité s’est donc abattue sur ma tête au moment où je croyais finies mes tribulations ! Et chaque malheur est pire que celui qui l’a précédé ! Si encore je comprenais quelque chose à tout cela ! Et puis, que vais-je devenir avec cet homme féroce ? Sans doute je ne sortirai pas vivant d’entre ses mains ! » Et il continua à se laisser ainsi aller à ces désolantes pensées, pendant toute la nuit, en surveillant les voiles et les agrès.
Au matin, comme ils étaient en vue d’une ville où ils allaient atterrir pour prendre quelques nouveaux hommes d’équipage, le capitaine se leva soudain, comme en proie à une grande agitation, et commença par jeter son turban à ses pieds ! Puis, comme Nour, stupéfait, le regardait sans rien comprendre, il éclata de rire et, avec ses deux mains, il s’arracha la barbe et les moustaches, et, du coup, se transforma en une adolescente comme la lune à son lever sur la mer. Et Nour reconnut la princesse Mariam. Et, une fois son émotion calmée, il se jeta à ses pieds, à la limite de l’admiration et de la joie, et lui avoua qu’il avait eu une bien grande frayeur de ce terrible capitaine qui faisait si facilement sauter les têtes des gens de sur leurs épaules. Et la princesse Mariam rit beaucoup de sa terreur ; et, après qu’ils se furent embrassés, chacun se hâta de reprendre la manœuvre pour entrer dans le port de la ville. Et, une fois à terre, ils engagèrent plusieurs matelots, et reprirent la mer. Et la princesse Mariam, qui s’entendait à merveille à la navigation, et connaissait les routes maritimes et le jeu des vents et des courants, continua à donner les ordres nécessaires, durant le jour, tout le long du voyage. Mais, pendant la nuit, elle ne manquait pas d’aller se coucher auprès de son bien-aimé Nour, et de goûter avec lui, dans la fraîcheur marine, sous le ciel nu, toutes les voluptés de l’amour. Qu’Allah les garde et les conserve et augmente sur eux Ses faveurs !
Or, Allah leur octroya, jusqu’à la fin du voyage, une navigation sans encombre, et ils aperçurent bientôt la Colonne du Mât. Et, après que le navire fut amarré dans le port et que les hommes de l’équipage furent descendus à terre, Nour dit à la princesse Mariam : « Nous voici enfin en terre musulmane ! Attends-moi seulement ici un moment, tandis que je vais aller t’acheter tout ce qui est nécessaire pour que tu entres décemment dans la ville ; car je vois que tu n’as ni robe, ni voile, ni babouches ! » Et Mariam répondit : « Oui, va m’acheter tout cela, mais ne tarde pas trop à revenir ! » Et Nour descendit à terre pour acheter ces objets-là. Et voilà pour eux !
Mais pour ce qui est du roi des Francs de Constantinia, voici ! Le lendemain du départ nocturne de la princesse Mariam, on vint lui annoncer sa disparition, et on ne put lui donner d’autre détail sinon qu’elle était allée faire ses dévotions dans la grande église patriarcale. Mais au même instant la vieille gardienne vint lui annoncer la disparition du nouveau servant de l’église, et, immédiatement après, on lui apprit aussi le départ du navire et la mort des dix matelots dont on avait trouvé les corps décapités, sur le rivage. Et le roi des Francs, bouillonnant d’une fureur concentrée dans son ventre, réfléchit pendant une heure de temps et dit : « Si mon navire a disparu, il n’y a pas de doute qu’il ait emporté ma fille ! » Et, sur-le-champ, il fit venir le capitaine du port et le vizir borgne et boiteux et leur dit : « Vous avez appris ce qui vient de se passer ! Or, ma fille doit être, sans aucun doute, partie pour le pays des musulmans retrouver ses perforateurs. Si donc vous ne me la ramenez pas, vivante ou morte, rien ne vous sauvera, à votre tour, du pal qui vous attend ! Allez ! »
Alors le vieux vizir borgne et boiteux et le capitaine du port se hâtèrent d’armer un navire et firent voile, sans retard, pour El-Iskandaria où ils arrivèrent au même instant que les deux fugitifs. Et ils reconnurent tout de suite le petit vaisseau amarré dans le port. Et ils aperçurent, à n’en pas douter, la princesse Mariam assise sur un tas de cordages sur le pont. Et aussitôt ils firent descendre dans une barque une troupe d’hommes armés, qui se jetèrent inopinément sur le navire de la princesse, réussirent à s’emparer d’elle à l’improviste, la bâillonnèrent et la transportèrent à leur bord, après avoir mis le feu au petit vaisseau. Et, sans perdre de temps, ils regagnèrent la haute mer et mirent le cap sur Constantinia, où ils furent assez heureux pour arriver sans encombre. Et ils se hâtèrent d’aller livrer la princesse Mariam au roi son père…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ils se hâtèrent d’aller livrer la princesse Mariam au roi son père.
Lorsque le roi des Francs vit entrer sa fille, et que ses yeux rencontrèrent ses yeux, il ne put contenir la violence de ses sentiments et, se penchant sur son trône, le poing en avant, il lui cria : « Malheur à toi, fille maudite ! Tu as, sans doute, abjuré la croyance de tes ancêtres pour ainsi abandonner les demeures de ton père et aller retrouver les mécréants qui t’ont descellée ! Certes ! ta mort peut à peine laver l’affront fait au nom chrétien et à l’honneur de notre race ! Ah ! maudite ! apprête-toi à être pendue à la porte de l’église ! » Mais la princesse Mariam, loin de se troubler, répondit : « Tu connais ma franchise, mon père. Or, je ne suis pas la coupable que tu crois. Quel crime ai-je donc commis pour avoir voulu retourner vers une terre que le soleil réchauffe de ses rayons et dont les hommes sont des mâles solides et vertueux ? Et que serais-je restée faire ici au milieu des prêtres et des eunuques ? » À ces paroles, la colère du roi fut à ses limites extrêmes, et il cria à ses bourreaux : « Ôtez de devant ma face cette fille ignominieuse, et emmenez-la pour la faire périr de la mort la plus cruelle ! »
Comme les bourreaux s’apprêtaient à se saisir de la princesse, le vieux vizir borgne s’avança en boitant jusque devant le trône et, après avoir embrassé la terre entre les mains du roi, dit : « Ô roi du temps, permets à ton esclave de formuler une prière avant la mort de la princesse ! » Le roi dit : « Parle, ô mon vieux vizir dévoué, ô le soutien de la chrétienté ! » Et le vizir dit : « Sache, ô roi, que ton esclave indigne est épris depuis fort longtemps des charmes de la princesse. C’est pourquoi je viens te prier de ne point la faire mourir et, comme seule récompense pour les preuves accumulées de mon dévouement aux intérêts de ton trône et de la chrétienté, de me l’accorder pour épouse. Et d’ailleurs je suis si laid que ce mariage, qui est une faveur pour moi, pourra servir en même temps de châtiment aux fautes de la princesse ! De plus je m’engage à la garder enfermée au fond de mon palais, à l’abri désormais de toute fuite et des entreprises des musulmans ! »
En entendant ces paroles de son vieux vizir, le roi dit : « Il n’y a pas d’inconvénient ! Mais que vas-tu faire, ô pauvre, de ce tison allumé aux feux de l’enfer ? Et ne crains-tu pas les conséquences cornufiantes de ce mariage-là ? Par le Messie ! moi, à ta place, je mettrais longtemps mon doigt à ma bouche pour réfléchir sur une affaire si grave ! » Mais le vizir répondit : « Par le Messie ! je n’ai guère d’illusions à ce sujet-là, et je n’ignore point la gravité de la situation. Mais je saurai agir avec assez de sagesse pour empêcher mon épouse de se porter à des excès répréhensibles ! » Et le roi des Francs, à ces paroles, éclatant de rire, se trémoussa sur son trône et dit au vieux vizir : « Ô père claudicant, je veux bien, moi, voir sur ta tête pousser deux défenses d’éléphant ! Mais je t’avise que si tu laisses échapper ma fille de ton palais ou si tu ne l’empêches pas d’ajouter une aventure de plus à des aventures si déshonorantes pour notre nom, ta tête sautera de sur tes épaules ! À cette seule condition je te donne mon consentement ! » Et le vieux vizir accepta la condition, et baisa les pieds du roi.
Aussitôt, les prêtres, les moines et les patriarches, ainsi que tous les dignitaires de la chrétienté furent informés de ce mariage. Et, à cette occasion, on donna de grandes fêtes au palais. Et, les cérémonies terminées, le vieux vizir dégoûtant pénétra dans la chambre de la princesse. Qu’Allah empêche la laideur de porter atteinte à la splendeur ! Et puisse ce puant cochon expirer son âme avant de souiller les choses pures !
Mais nous le retrouverons !
Quant à Nour, qui était descendu à terre acheter les choses nécessaires à la toilette de la princesse, lorsqu’il revint avec le voile, la robe et une paire de babouches en cuir jaune citron, il vit une grande foule qui allait et venait sur le port. Et il s’informa de la cause de cette agitation ; et on lui dit que l’équipage d’un vaisseau franc venait de s’emparer à l’improviste d’un navire amarré non loin de là et de le brûler, après avoir enlevé une jeune fille qui s’y trouvait. Et, à cette nouvelle, Nour devint bien changé de teint et tomba sans connaissance sur le sol.
Lorsque, au bout d’un certain temps, il fut revenu de son évanouissement, il raconta aux assistants sa triste aventure. Mais il n’y a pas d’utilité à la répéter. Et tous se mirent à blâmer sa conduite et à lui adresser mille reproches, lui disant : « Tu n’as que ce que tu mérites ! Pourquoi l’avais-tu laissée seule ? Qu’avais-tu besoin d’aller lui acheter un voile et des babouches neuves en cuir jaune citron ? Ne pouvait-elle descendre à terre avec ses vieux effets et se couvrir le visage, en attendant, d’un morceau de toile à voile ou de toute autre étoffe ? Oui, par Allah, tu n’as que ce que tu mérites ! »
Sur ces entrefaites, survint un cheikh qui était le propriétaire du khân où avaient logé Nour et la princesse, lors de leur rencontre. Et il reconnut le pauvre Nour, et, le voyant dans un si pitoyable état, il lui en demanda la cause. Et lorsqu’il fut au courant de l’histoire, il lui dit : « Certes ! le voile était tout à fait superflu, ainsi que la robe neuve et les babouches jaunes. Mais il serait encore plus superflu d’en parler davantage. Viens avec moi, mon fils ! Tu es jeune, et tu dois, au lieu de pleurer une femme et te désespérer, profiter plutôt de ta jeunesse et de ta santé. Viens ! La race des belles adolescentes n’est point encore éteinte dans notre pays ! Et nous saurons te trouver une Égyptienne belle et experte qui, sans aucun doute, te dédommagera et te consolera de la perte de cette princesse franque…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et nous saurons te trouver une Égyptienne belle et experte qui, sans aucun doute, te dédommagera et te consolera de la perte de cette princesse franque ! » Mais Nour, continuant à pleurer, répondit : « Non, par Allah, mon bon oncle, rien ne pourra me dédommager de la perte de la princesse, ni me faire oublier ma douleur ! » Le cheikh demanda : « Mais alors que vas-tu faire maintenant ? Le navire s’est éloigné avec la princesse, et tes pleurs n’y pourront rien ! » Il dit : « C’est pourquoi je veux retourner à la ville du roi des Francs, et en arracher ma bien-aimée ! » Il dit : « Ah ! mon fils, n’écoute point les suggestions de ton âme téméraire ! Si tu as réussi à l’emmener la première fois, prends bien garde à la seconde tentative, et n’oublie point le proverbe qui dit : « Ce n’est point toutes les fois qu’on la jette, que reste intacte la gargoulette ! » Mais Nour répondit : « Je te remercie, mon oncle, de tes conseils de prudence, mais rien ne m’effraie, et rien ne m’empêchera d’aller reconquérir ma bien-aimée, même en exposant à la mort mon âme précieuse ! » Et comme, par la volonté du sort, il se trouvait dans le port un navire prêt à faire voile pour les îles des Francs, le jeune Nour se hâta de s’y embarquer ; et on leva l’ancre aussitôt.
Or, le cheikh, propriétaire du khân, avait bien raison qui avait averti Nour des périls au milieu desquels il allait se jeter inconsidérément. En effet, le roi des Francs, depuis la dernière aventure de sa fille, avait juré par le Messie et par les livres de l’impiété d’exterminer, sur terre et sur mer, la race des musulmans ; et il avait fait armer cent navires de guerre pour aller donner la chasse aux vaisseaux des musulmans et ravager les côtes et semer partout la ruine, le carnage et la mort. Aussi, au moment où le navire où se trouvait Nour entrait dans la mer des îles, il fut rencontré par un de ces bâtiments de guerre, et capturé et conduit dans le port du roi des Francs, précisément le premier jour des fêtes que l’on donnait pour célébrer les noces du vizir borgne avec la princesse Mariam. Et le roi, pour mieux célébrer ces fêtes et assouvir sa vengeance, donna l’ordre de faire mourir sur le pal tous les prisonniers musulmans.
On exécuta donc cet ordre féroce, et tous les prisonniers, l’un après l’autre, furent empalés devant la porte du palais où se passait la noce. Et il ne restait plus que le jeune Nour à empaler, lorsque le roi, qui assistait avec toute sa cour à l’exécution, le regarda avec attention et dit : « Je ne sais pas ! mais, par le Messie ! je crois bien que c’est le jeune homme que j’avais cédé, il y a quelque temps, à la gardienne de l’église ! Comment se fait-il qu’il soit ici, après s’être échappé la première fois ? » Et il ajouta : « Ha ! ha ! qu’on l’empale pour s’être échappé ! » Mais, à ce moment, le vizir borgne s’avança et dit au roi : « Ô roi du temps, moi également j’ai fait un vœu ! Et c’est d’immoler, à la porte de mon palais, pour attirer la bénédiction sur mon mariage, trois jeunes musulmans ! Je te prie donc de me donner les moyens d’accomplir mon vœu, en me laissant choisir trois prisonniers au milieu de la cargaison de prisonniers ! » Et le roi dit : « Par le Messie ! je ne connaissais point ton vœu ! Sans quoi, je t’aurais cédé non point trois, mais trente prisonniers ! Il ne me reste plus que celui-ci ; prends-le, en attendant qu’il en revienne d’autres ! » Et le vizir emmena Nour avec lui, dans l’intention d’arroser avec son sang le seuil de son palais ; mais, après avoir réfléchi que son vœu ne serait point entièrement rempli s’il ne sacrifiait pas les trois musulmans à la fois, il fit jeter Nour, tout enchaîné, dans l’écurie du palais, où, en attendant, il comptait le torturer par la faim et la soif.
Or, le vizir borgne avait, dans son écurie, deux chevaux jumeaux d’une beauté miraculeuse, de la plus noble race d’Arabie, et dont la généalogie était attachée à leur cou dans un petit sachet pendu à une chaîne de turquoises et d’or. L’un était blanc comme une colombe et s’appelait Sabik, et l’autre était noir comme un corbeau et s’appelait Lahik. Et ces deux merveilleux chevaux étaient fameux parmi les Francs et les Arabes, et excitaient l’envie des rois et des sultans. Cependant, un de ces chevaux avait une tache blanche sur l’œil ; et la science des plus habiles maréchaux n’avait pu parvenir à la faire disparaître. Et le vizir borgne avait, lui-même, essayé de le guérir, car il était versé dans les sciences et la médecine ; mais il n’avait fait qu’aggraver le mal et augmenter l’opacité de la tache.
Lorsque Nour, conduit par le vizir, fut arrivé dans l’écurie, il remarqua la tache sur l’œil du cheval, et se mit à sourire. Et le vizir le vit qui souriait ainsi, et lui dit : « Ô musulman, pourquoi souris-tu ? » Il dit : « À cause de cette tache-là ! » Le vizir dit : « Ô musulman, je sais que les gens de ta race sont fort experts en chevaux et savent, mieux que nous, l’art de les soigner ! Serait-ce à cause de cela que tu souris ? » Et Nour, qui précisément connaissait à merveille l’art vétérinaire, répondit : « Tu l’as dit ! Il n’y a pas, dans tout le royaume des chrétiens, quelqu’un qui puisse guérir ce cheval ! Mais, moi, je le puis faire ! Que me donneras-tu donc si, demain, tu trouves ton cheval avec des yeux aussi sains que ceux de la gazelle ? » Le vizir répondit : « Je t’accorderai la vie et la liberté, et te nommerai sur le champ chef de mes écuries et vétérinaire du palais ! » Nour dit : « Dans ce cas, défais mes liens ! » Et le vizir défit les liens qui attachaient les bras de Nour ; et Nour, aussitôt, prit du suif, de la cire, de la chaux et de l’ail, les mélangea de jus concentré d’oignons, et en fit un emplâtre qu’il appliqua sur l’œil malade du cheval. Après quoi, il se coucha sur le grabat de l’écurie, et laissa à Allah le soin de la cure…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Après quoi, il se coucha sur le grabat de l’écurie, et laissa à Allah le soin de la cure.
Le lendemain matin, le vizir borgne vint lui-même, en boitant, lever l’emplâtre. Et son étonnement et sa joie furent à leurs limites extrêmes, lorsqu’il vit l’œil du cheval aussi net que la lumière du matin. Et ses transports furent tels, qu’il revêtit Nour de son propre manteau et le nomma sur le champ chef de ses écuries et premier vétérinaire du palais. Et il lui donna, comme habitation, l’appartement situé au-dessus des écuries, en face même du palais où se trouvaient ses propres appartements, qui n’en étaient séparés que par la cour. Après quoi il rentra assister aux fêtes que l’on donnait pour ses noces avec la princesse. Et il ne savait pas que l’homme n’échappe jamais à sa destinée, et quels coups le sort réserve à ceux qui sont d’avance réservés pour servir d’exemple aux générations !
Or, on était donc arrivé au septième jour des fêtes, et le soir même le vieux laid devait entrer prendre possession de la princesse. (Éloigné soit le Malin !) Or, précisément la princesse était accoudée à sa fenêtre et entendait les derniers tumultes et les cris poussés au loin en son honneur. Et, bien triste, elle songeait à son bien-aimé Nour, le vigoureux et bel adolescent d’Égypte qui avait cueilli la fleur de sa virginité. Et une grande mélancolie baignait son âme, à ce souvenir, et lui faisait monter les larmes aux yeux. Et elle se disait : « Certes ! je ne me laisserai jamais approcher par le vieux dégoûtant ! Je le tuerai plutôt et me jetterai ensuite de ma fenêtre dans la mer ! » Et, pendant qu’elle se laissait imprégner par l’amertume de ces pensées, elle entendit, sous ses fenêtres, une belle voix d’adolescent qui chantait, dans le soir, des vers arabes sur la séparation des amants. Or, c’était Nour qui, à ce moment, ayant fini de donner les derniers soins aux deux chevaux, était monté dans son appartement et s’était également accoudé à sa fenêtre pour songer à sa bien-aimée. Et il chantait ces paroles du poète :
« Ô félicité disparue ! je viens te chercher, loin de nos demeures, dans un pays cruel, ou me donner tout au moins l’illusion de te retrouver. Hélas sur moi !
Mes sens abusés aiment te reconnaître dans tout ce qui a quelque grâce ou quelque charme attrayant. Hélas sur moi !
Qu’une flûte, dans le loin, soupire ses mélodies ou que le luth lui réponde par ses accords harmonieux, des larmes me mouillent les yeux de penser à nous deux ! Hélas sur nous deux ! »
Lorsque que la princesse Mariam eut entendu ce chant où le bien-aimé de son cœur exprimait les sentiments de son fidèle amour, elle reconnut aussitôt sa voix et fut émue à la limite de l’émotion. Mais, comme elle était sage et avisée, elle sut se dominer, pour ne point se trahir devant les suivantes qui l’entouraient, et commença par les congédier. Puis elle prit un papier et un calam et écrivit ce qui suit :
« Au nom d’Allah le Clément, le Miséricordieux ! Et ensuite ! Que la paix d’Allah soit sur toi, ô Nour, ainsi que Sa miséricorde et Sa bénédiction !
« Je veux te dire que ton esclave Mariam te salue et brûle du désir de se trouver réunie à toi ! Écoute donc ce qu’elle te dit ici, et fais ce qu’elle t’ordonne.
« À la première veille de la nuit, c’est l’heure propice aux amants, prends les deux coursiers Sabik et Lahik, et conduis-les hors de la ville, derrière la porte Sultanié, où tu m’attendras. Et si l’on te demande où tu conduis les chevaux, réponds que tu les mènes faire un tour de promenade ! »
Puis elle plia ce billet, le serra dans un mouchoir de soie, et agita le mouchoir par la fenêtre, dans la direction de Nour. Et lorsqu’elle vit qu’il l’avait vue et qu’il s’était approché, elle jeta le mouchoir par la fenêtre. Et Nour le ramassa, l’ouvrit, et y trouva le billet qu’il lut, pour le porter ensuite à ses lèvres et à son front, en signe d’acquiescement. Et il se hâta de regagner les écuries, où il attendit avec la plus vive impatience la première veille de la nuit. Il sella alors les deux nobles bêtes et se rendit hors de la ville, sans que personne l’eût inquiété en route. Et il attendit la princesse, derrière la porte Sultanié, en tenant les deux chevaux par la bride.
Or, c’était précisément à ce moment-là que, les fêtes terminées et la nuit venue, le vieux borgne si laid et si dégoûtant avait pénétré dans la chambre de la princesse, pour accomplir ce qu’il avait à accomplir. Et la princesse Mariam le vit entrer, en frissonnant d’horreur, tant son aspect était repoussant. Mais, comme elle avait un plan à suivre qu’elle ne voulait pas faire échouer, elle essaya de dominer ses sentiments de répulsion et, se levant en son honneur, elle l’invita à prendre place à côté d’elle sur le divan. Et le vieux boiteux lui dit : « Ô ma souveraine, tu es la perle de l’Orient et de l’Occident, et c’est à tes pieds que je devrais plutôt me prosterner ! » Et la princesse répondit : « Soit ! mais faisons trêve de compliments. Où est le souper ? J’ai bien faim, et nous devrions, avant tout, commencer par manger ! »
Aussitôt le vieux appela les esclaves, et, en un instant, les plateaux furent servis que couvraient les mets les plus rares et les plus exquis, composés de tout ce qui vole dans les airs, nage dans les mers, marche sur les terres et pousse sur les arbres des vergers et les arbustes des parterres. Et tous deux se mirent à manger ensemble ; et la princesse se contraignait pour lui présenter les morceaux ; et le vieux était ravi de ses attentions et se dilatait quant à sa poitrine et se flattait d’arriver à ses fins bien plus aisément qu’il ne le pensait. Mais soudain il tomba sur le dos, sa tête précédant ses pieds, sans connaissance. Car la princesse avait réussi à jeter subrepticement dans la coupe une pincée de bang marocain capable de renverser un éléphant en faisant entrer sa longueur dans sa largeur. Louange à Allah qui ne permet point à la laideur de souiller la pureté…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… une pincée de bang marocain capable de renverser un éléphant en faisant entrer sa longueur dans sa largeur. Louange à Allah qui ne permet point à la laideur de souiller la pureté !
Lorsque la princesse Mariam vit le vizir rouler de la sorte comme un cochon enflé, elle se leva à l’heure et à l’instant, prit deux sacs qu’elle remplit de pierreries et de joyaux, décrocha un glaive à la lame trempée dans le sang des lions, l’attacha à sa ceinture, se couvrit d’un grand voile et, au moyen d’une corde, se laissa glisser par la fenêtre dans la cour, pour de là sortir, sans être remarquée, du palais et courir dans la direction de la porte Sultanié, où elle arriva sans encombre. Et, dès qu’elle eut aperçu Nour, elle courut à lui, et, sans lui donner le temps même de l’embrasser, elle sauta sur le cheval Lahik et cria à Nour : « Monte sur Sabik, et suis-moi ! » Et Nour, renonçant à toute réflexion, sauta à son tour sur le second cheval et le lança au grand galop pour rattraper sa bien-aimée qui était déjà au loin. Et ils coururent de la sorte toute la nuit, jusqu’à l’aurore.
Lorsque la princesse eut jugé qu’elle avait mis une grande distance entre eux deux et ceux qui auraient pu les poursuivre, elle consentit à s’arrêter Un moment pour se reposer et faire prendre haleine aux deux nobles bêtes. Et comme l’endroit où ils étaient arrivés était délicieux avec des prés verts, de l’ombrage, des arbres fruitiers, des fleurs et de l’eau courante, et que la fraîcheur de l’heure les invitait au plaisir tranquille, ils furent charmés de pouvoir enfin s’asseoir l’un à côté de l’autre, dans la paix de ces lieux, et de se raconter mutuellement ce qu’ils avaient souffert pendant leur séparation. Et, après avoir bu à même l’eau du ruisseau et s’être rafraîchis des fruits cueillis à même les arbres, ils firent leurs ablutions et s’étendirent dans les bras l’un de l’autre, frais, dispos et amoureux. Et, en une séance, ils réparèrent tout le temps perdu dans l’abstinence. Puis, gagnés par la douceur de l’air et le silence, ils se laissèrent aller au sommeil, sous les caresses de la brise du matin.
Or, ils restèrent ainsi endormis jusque vers le milieu du jour, et ne se réveillèrent qu’en entendant la terre résonner comme heurtée par des milliers de sabots. Et ils ouvrirent les yeux, et virent l’œil du soleil obscurci par un tourbillon de poussière, et, du milieu de cette densité, jaillir des éclairs comme d’un ciel orageux. Et ils distinguèrent bientôt le bruit des chevaux et le cliquetis des armes. Or, c’était une armée entière qui était à leur poursuite !
En effet, le matin de ce jour, le roi des Francs s’était levé de très bonne heure pour aller prendre lui-même des nouvelles de la princesse, sa fille, et se tranquilliser à son sujet. Car il était loin d’être sans inquiétude sur l’issue de son mariage avec un vieux dont la moelle devait être sans doute depuis longtemps fondue. Mais sa surprise fut à ses limites extrêmes en ne trouvant pas sa fille et en voyant le vizir étendu par terre, privé de sentiment, sa tête entre ses pieds. Et, comme il voulait avant tout savoir ce qu’était devenue la princesse, il fit couler du vinaigre dans le nez du vizir, qui reprit aussitôt l’usage de ses sens. Et le roi, d’une voix terrifiante, lui cria : « Ô maudit, où est ma fille Mariam, ton épouse ? » Il répondit : « Ô roi, je ne sais pas ! » Alors le roi, plein de fureur, tira son sabre et, d’un seul coup, fendit la tête en deux à son vizir : et l’arme sortit, en brillant, par les mâchoires. Qu’Allah loge à jamais son âme mécréante dans le dernier étage de la Géhenne !
Au même moment, les palefreniers vinrent, en tremblant, annoncer au roi la disparition du nouveau vétérinaire et des deux chevaux Sabik et Lahik. Et le roi ne douta plus de la fuite de sa fille avec le chef des écuries, et aussitôt il fit appeler trois de ses premiers patrices et leur ordonna de se mettre chacun à la tête de trois mille hommes, et de l’accompagner pour aller à la recherche de sa fille. Et il annexa à cette armée les patriarches et les grands de sa cour, s’avança lui-même à la tête des troupes, et se mit à la poursuite de la fugitive, qu’il atteignit dans la prairie en question.
Lorsque Mariam vit s’approcher cette armée, elle sauta à cheval et cria à Nour : « Je veux, ô Nour, que tu restes en arrière, car je vais, à moi seule, attaquer nos ennemis, et te défendre et me défendre contre eux, bien qu’ils soient innombrables comme les grains de sable ! » Et, brandissant son glaive, elle improvisa ces vers :
« C’est aujourd’hui que je veux montrer ma vigueur et ma vaillance, et, à moi seule, écraser mes ennemis coalisés.
Je démolirai jusqu’à la base les remparts des Francs, et mon sabre affilé tranchera les têtes de leurs chefs.
La couleur de mon cheval est celle de la nuit, et ma bravoure est éclatante comme le jour.
Ce que je dis, on en verra aujourd’hui le commentaire : car je suis la cavalière unique parmi les mortels ! »
Elle dit, et s’élança au-devant de l’armée de son père…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsque la princesse eut improvisé ces vers, elle s’élança au-devant de l’armée de son père. Et le roi la vit arriver, en roulant dans ses orbites des yeux comme du vif argent. Et il s’écria : « Par la foi du Messie ! elle est assez insensée pour nous attaquer ! » Et il arrêta la marche de ses troupes, et s’avança seul vers sa fille, en lui criant : « Ô fille de perversité ! voici que tu oses m’affronter et faire mine d’attaquer l’armée des Francs ! Ô insensée, as-tu donc renoncé à toute pudeur et renié la religion de tes pères ? Et ignores-tu que, si tu ne te livres pas à ma clémence, une mort certaine t’attend ? » Elle répondit : « Ce qui est passé l’est irrévocablement, et c’est le mystère de la loi musulmane ! Je crois à Allah l’Unique et à Son envoyé Môhammad le Béni, fils d’Abdallah ! Et je ne renoncerai jamais à ma croyance et à la fidélité de mon affection pour le jouvenceau d’Égypte, dussé-je avaler la coupe de ma ruine ! » Elle dit, et fit caracoler son cheval écumant sur le front de l’armée des Francs, et chanta ces strophes guerrières, en trouant l’air de son sabre étincelant :
« Qu’il est doux de combattre au jour de la bataille ! Viens à moi, si tu l’oses, vile cohue ! Venez, chrétiens, affronter mes coups qui écrasent !
Je plongerai dans la poussière vos têtes coupées, et j’atteindrai le cœur de votre puissance. Et les corbeaux croasseront sur vos demeures et annonceront votre destruction !
Vous boirez au tranchant de mon sabre des gorgées amères comme le suc de la coloquinte. Et je servirai à votre roi la coupe des calamités, pour le dégoûter à jamais de l’eau limpide !
Ho ! venez au-devant de moi, s’il est un brave parmi vous ! Venez alléger mon chagrin et guérir, dans votre sang, ma douleur !
Avancez-vous, si votre âme n’est point pétrie de lâcheté, pour voir comment vous accueillera la pointe de mon glaive, sous l’ombre de la poussière ! »
Ainsi chanta l’héroïque princesse. Et elle se pencha sur son cheval, le baisa sur le cou, le flatta de la main et lui dit à l’oreille : « C’est aujourd’hui, ô Lahik, le jour de ta race et de ta noblesse ! » Et le fils des Arabes frissonna et hennit, et bondit plus rapide que le vent du nord, en lançant le feu de ses naseaux. Et la princesse Mariam, poussant un rugissement effroyable, fit une charge sur l’aile gauche des Francs, et, au galop de son coursier, faucha de son sabre dix-neuf têtes de cavaliers. Puis elle revint au milieu de l’arène, et défia les Francs à grands cris.
À cette vue, le roi appela l’un des trois patrices, chefs de ses troupes, qui s’appelait Barbout. Or, c’était un habile guerrier, vif comme le feu ; il était le plus fort soutien du trône du roi franc, et le premier des grands de son royaume et de sa cour, par sa force et sa vaillance ; et la chevalerie était son essence. Et le patrice Barbout, à l’appel de son roi, s’avança, bouillant d’ardeur, monté sur un cheval de noble race, aux jarrets robustes ; et il était protégé par une cotte d’or surchargée d’ornements, aux mailles étroites comme des ailes de sauterelles. Et ses armes étaient un sabre affilé et destructeur, une lance énorme semblable au mât d’un vaisseau et dont un seul coup eût renversé une montagne, quatre javelines aiguës, et une massue épouvantable hérissée de clous. Et ainsi bardé de fer et d’armes offensives et défensives, il était semblable à une tour.
Or, le roi lui dit : « Ô Barbout, tu vois le carnage fait par cette fille dénaturée ! À toi de la vaincre et de me l’amener vivante ou morte ! » Puis il le fit bénir par les patriarches, couverts de vêtements bariolés et élevant des croix au-dessus de leurs têtes, qui lurent sur sa tête l’Évangile, en implorant en sa faveur les idoles de leur erreur et de leur impiété. Mais nous, musulmans, nous invoquons Allah l’Unique, qui est plein de force et de majesté !
Aussitôt que le patrice Barbout eut fini d’embrasser l’étendard de la croix, il s’élança dans l’arène en barrissant comme un éléphant en fureur, et vomissant, en sa langue, d’horribles injures contre la religion des Croyants. Qu’il soit maudit ! Mais, de son côté, la princesse le vit arriver sur elle, et rugit comme une lionne mère de lionceaux ; et grondant, mugissant et rapide comme l’oiseau de proie, elle lança son coursier Lahik au-devant de son adversaire. Et tous deux s’entrechoquèrent comme doux montagnes mouvantes, et se tinrent tête avec fureur, en hurlant avec la puissance des démons. Puis ils se séparèrent et firent maintes évolutions, et revinrent avec rage pour un nouvel assaut, en parant les coups mutuels avec une adresse et une rapidité merveilleuses, qui frappaient les yeux de stupéfaction. Et la poussière soulevée sous les sabots les dérobait parfois aux regards ; et l’accablante chaleur était si forte que les pierres flambaient comme des buissons. Et la lutte dura une heure, avec un égal héroïsme de part et d’autre.
Mais, essoufflé le premier, le patrice Barbout voulut en finir ; et il porta sa masse d’armes de la main droite à la main gauche, saisit une de ses quatre javelines et la lança contre la princesse, en l’accompagnant d’un cri semblable au fracas du tonnerre. Et l’arme sortit de sa main comme l’éclair qui aveugle le regard. Mais la princesse la vit venir, attendit qu’elle fût proche, et la détourna prestement du revers de son sabre : et la javeline, en sifflant, alla s’enfoncer au loin dans le sable. Et toute l’armée vit cela et fut saisie d’étonnement.
Alors Barbout prit une seconde javeline, et la lança avec fureur en criant : « Qu’elle frappe et tue ! » Mais la princesse évita le trait et le rendit vain. Et la troisième et la quatrième javelines eurent le même sort. Aussitôt Barbout, bouillant de fureur et fou d’humiliation, reprit sa massue de la main droite, rugit comme un lion, et la lança de toute la force de son bras, en visant son adversaire. Et l’énorme masse traversa lourdement l’air, et arriva sur Mariam qu’elle eût écrasé sans recours, si l’héroïne ne l’avait saisie au vol et retenue dans la main : car Allah l’avait douée d’adresse, de ruse et de force. Et elle la brandit à son tour ! Et les regards de quiconque la vit furent aveuglés d’admiration. Et, comme une louve, elle courut sur le patrice et lui cria, tandis que sa respiration sifflait comme siffle la vipère à cornes : « Malheur à toi, maudit ! Viens apprendre à manier une masse d’armes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et, comme une louve, elle courut sur le patrice et lui cria, tandis que sa respiration sifflait comme siffle la vipère à cornes : « Malheur à toi, maudit ! Viens apprendre à manier une masse d’armes ! »
Lorsque le patrice Barbout vit son adversaire saisir de la sorte la masse en l’air, il crut que le ciel et la terre s’évanouissaient à ses yeux. Et, éperdu, oubliant tout courage et toute présence d’esprit, il tourna le dos, tout en protégeant sa fuite de son bouclier. Mais la princesse héroïque le suivit de près, le visa, et faisant tournoyer la pesante masse d’armes, la lança sur son dos. Et la masse retentissante alla tomber sur le bouclier, plus lourde qu’un roc lancé par une machine de guerre. Et elle renversa le patrice de cheval, en lui fracassant quatre côtes. Et il roula dans la poussière, se débattit dans son sang, et déchira la terre de ses ongles. Et sa mort fut sans agonie, car Azraël, l’ange de la mort, s’approcha de lui avec la dernière heure, et lui arracha son âme qui alla rendre compte de ses erreurs et de sa mécréantise à Celui qui connaît les secrets et pénètre les sentiments.
Alors la princesse Mariam, au grand galop, plongea prestement le long du ventre de son cheval jusqu’à terre, ramassa l’énorme lance de son antagoniste tué, et s’éloigna à quelque distance. Et là, elle planta sa lance en terre, profondément, et, faisant face à toute l’armée de son père, elle arrêta brusquement son cheval docile, s’appuya du dos sur la haute lance, et demeura immobile dans cette attitude, la tête haute, et provocatrice. Et de la sorte, ne faisant qu’un seul corps avec son cheval et sa lance fichée dans le sol, elle était inébranlable comme une montagne et immuable comme le Destin.
Lorsque le roi des Francs vit succomber de la sorte le patrice Barbout, dans sa douleur il se frappa le visage, déchira ses habits, et manda le second patrice, chef de son armée, qui s’appelait Bartous et était un héros réputé parmi les Francs pour son intrépidité et sa valeur dans les combats singuliers. Et il lui dit : « Ô patrice Bartous, à toi de venger la mort de Barbout, ton frère d’armes ! » Et le patrice Bartous répondit, en s’inclinant : « J’écoute et j’obéis ! » Et, lançant son cheval dans l’arène, il courut sus à la princesse.
Mais l’héroïne, toujours dans la même attitude, ne bougea pas ; et son coursier resta ferme et arc-bouté sur ses jambes comme un pont. Et voici qu’arriva sur elle le galop furieux du patrice, qui avait lâché les rênes à son cheval, et accourait en pointant sa lance dont le fer ressemblait à l’aiguillon du scorpion. Et le double choc se fit tumultueusement.
Alors, tous les guerriers eurent un pas en avant pour mieux voir les terribles merveilles de ce combat, dont jamais leurs yeux n’avaient contemplé le pareil. Et un frémissement d’admiration courait dans tous les rangs.
Mais déjà les adversaires, ensevelis sous une poussière épaisse, se heurtaient sauvagement et se distribuaient des coups dont gémissait l’air. Et ils combattirent ainsi, longtemps, la rage dans l’âme, et se lançant des injures effroyables. Et le patrice ne tarda pas à reconnaître la supériorité de son antagoniste, et se dit : « Par le Messie ! c’est l’heure de manifester toute ma puissance ! » Et il saisit une pique messagère de la mort, la brandit et la lança en visant son adversaire et criant : « À toi ! »
Mais il ne savait pas que la princesse Mariam était l’héroïne incomparable de l’Orient et de l’Occident, la cavalière des terres et des déserts, et la guerrière des plaines et des montagnes !
Or, elle avait observé le mouvement du patrice et pénétré son dessein. Et quand la pique ennemie partit dans sa direction, elle attendit qu’elle vînt effleurer sa poitrine, la saisit soudain au vol, et, se retournant vers le patrice stupéfait, elle le frappa au milieu du ventre avec cette arme, qui sortit étincelante par les vertèbres du dos. Et il tomba comme une tour qui s’écroule ; et le bruit de ses armes fit retentir les échos. Et son âme alla rejoindre à jamais celle de son compagnon dans les flammes inextinguibles allumées par la colère du Juge Suprême…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT ONZIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il tomba comme une tour qui s’écroule ; et le bruit de ses armes fit retentir les échos. Et son âme alla rejoindre à jamais celle de son compagnon dans les flammes inextinguibles allumées par la colère du Juge Suprême.
Alors, la princesse Mariam fit de nouveau caracoler son cheval Lahik autour de l’armée, en criant : « Où sont les esclaves ? Où sont les chevaliers ? Où sont les héros ? Où est le vizir borgne, ce chien boiteux ? Que le plus vaillant de vous paraisse, s’il a du courage ! Honte sur vous tous, ô chrétiens, qui tremblez devant le bras d’une femme ! »
En entendant et voyant tout cela le roi des Francs, extrêmement mortifié, et bien désespéré de la perte de ses deux patrices, fit venir le troisième, qui s’appelait Fassiân, c’est-à-dire le Péteur, vu qu’il était fameux pour ses vesses et ses pets, et qu’il était un pédéraste illustre, et lui dit : « Ô Fassiân, toi dont la pédérastie est la principale vertu, c’est à toi maintenant de combattre cette débauchée, et de venger par sa mort celle de tes compagnons ! » Et le patrice Fassiân, ayant répondu par l’ouïe et l’obéissance, lança son cheval au galop en lâchant derrière lui un tonnerre de pets retentissants, capables de faire blanchir de terreur les cheveux d’un enfant au berceau, et de faire se gonfler les voiles d’un navire.
Mais déjà, de son côté, Sett Mariam avait pris du champ, et avait lancé Lahik en un galop plus rapide que l’éclair qui brille, que la grêle qui tombe. Et tous deux bondirent l’un sur l’autre comme deux béliers, et se heurtèrent avec une telle violence qu’on eût dit le choc de deux montagnes. Et le patrice, se précipitant sur la princesse, poussa un grand cri et lui porta un coup furieux. Mais elle l’évita avec prestesse, frappa adroitement la lance de son ennemi et la brisa en deux. Puis, au moment où le patrice Fassiân, emporté dans son élan, passait à côté d’elle, elle se retourna soudain, en faisant une rapide volte-face, et, du talon de sa propre lance elle frappa son adversaire entre les deux épaules avec une telle violence, qu’elle le désarçonna. Et, accompagnant ce mouvement d’un cri terrible, elle se précipita sur lui, tandis qu’il gisait renversé sur le dos, et, d’un seul coup, lui planta sa lance dans la bouche, et lui cloua la tête au sol, en fixant la pointe profondément à travers.
À cette vue, tous les guerriers restèrent d’abord muets de stupéfaction. Puis soudain ils sentirent passer sur leurs têtes le frisson de la panique ; car ils ne savaient plus si l’héroïne qui venait d’accomplir de tels exploits était une créature humaine ou un démon. Et, tournant le dos, ils cherchèrent leur salut dans la fuite, en livrant leurs jambes au vent. Mais Sett Mariam vola derrière eux, anéantissant sous ses pas la distance. Et elle les atteignait par groupes ou séparément, les frappait de son sabre tournoyant, et leur faisait boire la mort d’une gorgée, en les plongeant dans l’océan des destins. Et son cœur était si joyeux que le monde lui semblait ne pouvoir le contenir ! Et elle tua ceux qu’elle tua, et blessa ceux qu’elle blessa, et joncha la terre de morts, en large et en long. Et le roi des Francs, les bras levés au ciel de désespoir, s’enfuyait avec ses guerriers, courant au centre de ses troupes débandées, de ses patriarches et de ses prêtres, comme un berger court, poursuivi par l’orage, au milieu d’un troupeau de moutons. Et la princesse ne cessa de les poursuivre de la sorte et d’en faire un grand carnage, jusqu’au moment où le soleil se couvrit entièrement du manteau de la pâleur.
Alors seulement la princesse Mariam songea à arrêter sa course victorieuse. Elle revint donc sur ses pas, et alla retrouver son bien-aimé Nour qui commençait à être bien inquiet à son sujet, et se reposa cette nuit-là dans ses bras, en oubliant, dans les caresses partagées et les voluptés de l’amour, les fatigues et les dangers qu’elle venait d’affronter pour le sauver et se délivrer à tout jamais de ses persécuteurs chrétiens. Et le lendemain, après avoir longtemps discuté ensemble sur l’endroit qui serait le plus agréable à habiter désormais, ils décidèrent d’aller essayer du climat de Damas. Et ils se mirent en route pour cette ville délicieuse-là. Et voilà pour eux !
Quant au roi des Francs ! Lorsque, le nez bien allongé et le sac de son estomac fort retourné à cause de la mort de ses trois patrices Barbout, Bartous et Fassiân, et à cause aussi de la défaite de son armée, il fut de retour dans son palais, à Constantinia, il convoqua son conseil d’état, et, après avoir exposé sa disgrâce dans les moindres détails, il demanda quel parti il devait prendre. Et il ajouta : « Je ne sais pas maintenant où elle a pu aller, cette fille des mille cornards de l’impudeur ! Mais je penche à croire qu’elle a dû aller en pays musulman, là où elle dit que les hommes sont des mâles vigoureux et inlassables ! Car cette fille de putain est un tison enflammé originaire de l’enfer ! Et elle ne trouvait pas les chrétiens assez membrus pour calmer ses désirs incessants ! Je vous demande donc de me dire, ô patriarches, ce qu’il faut que je fasse dans cette fâcheuse situation ! » Et les patriarches et les moines et les grands du royaume réfléchirent durant une heure de temps, puis répondirent : « Nous pensons, ô roi du temps, qu’il ne te reste plus qu’un parti à prendre, après tout ce qui s’est passé, et c’est d’envoyer une lettre, avec des cadeaux, au puissant chef des musulmans, le khalifat Haroun Al-Rachid, qui est le maître des terres et des pays où vont arriver les deux fugitifs ; et, dans cette lettre que tu lui écriras de ta propre main, tu lui feras toutes sortes de promesses et de serments d’amitié, pour qu’il consente à faire arrêter les fugitifs et à te les envoyer, sous escorte, à Constantinia. Et cela ne t’engagera et ne nous engagera à rien avec ce chef des mécréants, puisque, dès qu’il nous aura rendu les fugitifs, nous nous hâterons de massacrer les musulmans de l’escorte et d’oublier nos serments et nos engagements, comme nous avons l’habitude de le faire toutes les fois que nous avons un traité avec ces infidèles, sectateurs de Môhammad ! » Ainsi parlèrent les patriarches et les conseillers du roi des Francs. Qu’ils soient maudits en cette vie et dans l’autre, pour leur mécréantise et leur félonie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
… Ainsi parlèrent les patriarches et les conseillers du roi des Francs. Qu’ils soient maudits en cette vie et dans l’autre, pour leur mécréantise et leur félonie !
Or, le roi des Francs de Constantinia, qui avait l’âme aussi basse que celle de ses patriarches, ne manqua pas de suivre ce conseil plein de perfidie. Mais il ignorait que la perfidie tourne tôt ou tard contre ses auteurs, et que l’œil d’Allah veille toujours sur Ses Croyants et les défend contre les embûches de leurs puants ennemis !
Il prit donc un papier et un calam et écrivit, en caractères grecs, une lettre au khalifat Haroun Al-Rachid, où, après les formules les plus respectueuses et les plus remplies d’admiration et d’amitié, il lui disait :
« Ô puissant émir des musulmans nos frères, j’ai une fille dénaturée appelée Mariam, qui s’est laissé séduire par un jeune Égyptien du Caire, qui me l’a enlevée, et l’a conduite dans les pays qui sont sous ta dépendance et ta domination. Je te supplie, en conséquence, ô puissant émir des musulmans, de vouloir bien faire faire les recherches nécessaires pour la retrouver, et me la renvoyer au plus tôt sous une sûre escorte.
« Et moi, en retour, je comblerai d’honneurs et d’égards cette escorte que tu m’auras envoyée avec ma fille, et je ferai tout ce qui pourra t’être agréable ! Ainsi, pour te montrer ma reconnaissance et faire preuve de mes sentiments d’amitié, je te promets, entre autres choses, de faire bâtir une mosquée dans ma capitale, par des architectes que tu auras toi-même choisis. Et je t’enverrai, en outre, des richesses indescriptibles, dont homme ne vit jamais les pareilles : des jeunes filles semblables à des houris, des jeunes garçons imberbes, comme des lunes, des trésors que le feu ne saurait détruire, des perles, des pierreries, des chevaux, des juments et des poulains, des chamelles et de jeunes chameaux, et des charges précieuses de mulets contenant les plus belles productions de nos climats ! Et, si tout cela ne te suffit pas, je diminuerai les confins de mon royaume, pour augmenter tes domaines et tes frontières ! Et ces promesses je les scelle de mon sceau, moi, César, roi des adorateurs de la Croix ! »
Et le roi des Francs, après avoir scellé cette lettre, la remit au nouveau vizir qu’il avait nommé à la place du vieux borgne et boiteux, et lui adressa ces paroles : « Si tu obtiens audience de ce Haroun-là, tu lui diras : « Ô très puissant khalifat ! je viens réclamer auprès de toi notre princesse : car c’est là l’objet de l’importante mission qui nous est confiée. Si tu accueilles favorablement notre demande, tu peux compter sur la reconnaissance du roi, notre maître, qui t’enverra les plus riches présents ! » Puis, pour exciter encore le zèle de son vizir, qu’il envoyait ainsi comme ambassadeur, le roi des Francs lui promit, à lui également, si son ambassade avait un heureux succès, de lui donner sa fille en mariage et de le combler de richesses et de prérogatives. Puis il lui donna congé, et lui recommanda expressément de remettre la lettre au khalifat lui-même. Et le vizir, après avoir embrassé la terre entre les mains du roi, se mit en chemin.
Or, après un long voyage, il arriva, avec sa suite, à Baghdad, où il commença par prendre un repos de trois jours. Ensuite il demanda où était le palais du khalifat, et, lorsqu’on le lui eut indiqué, il s’y rendit pour demander audience à l’émir des Croyants. Et lorsqu’il fut introduit dans le diwân des réceptions, le vizir, se jetant aux pieds du khalifat, embrassa par trois fois la terre entre ses mains, lui dit en quelques mots l’objet de la mission qui lui était confiée, et lui remit la lettre de son maître, le roi des Francs, père de la princesse Mariam. Et Al-Rachid décacheta la lettre, la lut et, après en avoir saisi toute la portée, il se montra favorable à la demande qu’elle contenait, bien qu’elle lui vînt d’un roi mécréant. Et il fit écrire sur le champ aux gouverneurs de toutes les provinces musulmanes, pour leur donner le signalement de la princesse Mariam et de son compagnon, avec l’ordre exprès de faire toutes recherches nécessaires pour les retrouver, les menaçant des pires châtiments en cas d’insuccès ou de négligence, et de les envoyer sans retard, sous bonne escorte, à sa cour, aussitôt qu’on les aurait découverts. Et les courriers à cheval ou à dos de dromadaire de course partirent dans toutes les directions, chargés, chacun, d’une lettre pour un wali de province. Et, en attendant, le khalifat retint auprès de lui, au palais, l’ambassadeur franc et toute sa suite. Et voilà pour ce qui est de ces différents rois et de leurs pourparlers !
Mais pour ce qui est des deux amants, voici ! Lorsque la princesse eut mis en déroute, à elle seule, l’armée du roi des Francs, son père, et qu’elle eut donné en pâture aux vautours les trois patrices qui s’étaient mesurés avec elle, elle se mit en route, avec Nour, pour la Syrie, et arriva heureusement aux portes de Damas. Mais, comme ils voyageaient par petites étapes, s’arrêtant aux beaux endroits pour se livrer aux manifestations de leur amour, et qu’ils ne se souciaient point des embûches de leurs ennemis, ils arrivèrent à Damas quelques jours après que les rapides courriers du khalifat, qui les y avaient précédés, eurent communiqué au wali de la ville les ordres les concernant. Et, comme ils ne se doutaient point de ce qui les y attendait, ils donnèrent sans méfiance leurs noms aux espions de la police qui les reconnurent aussitôt et les firent arrêter par les gardes du wali. Et les gardes, sans perdre de temps, leur firent rebrousser chemin, sans leur permettre l’entrée de la ville, et, les entourant d’armes menaçantes, les obligèrent à les accompagner à Baghdad où, après dix jours de marches forcées à travers le désert, ils arrivèrent exténués de fatigue. Et ils furent introduits dans le diwân des audiences, entourés par les gardes du palais…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ils furent introduits dans le diwân des audiences, entourés par les gardes du palais. Et lorsqu’ils furent en la présence auguste du khalifat, ils se prosternèrent devant lui, et embrassèrent la terre entre ses mains. Et le chambellan qui était alors de service dit : « Ô émir des Croyants, voici la princesse Mariam, fille du roi des Francs, et Nour, son ravisseur, fils du marchand Couronne, du Caire. Et c’est à Damas que, d’après les ordres du wali de la ville, on les a arrêtés tous deux ! » Alors le khalifat jeta les yeux sur Mariam, et fut ravi de l’élégance de sa taille et de la beauté de ses traits ; et il lui demanda : « Est-ce bien toi la nommée Mariam, fille du roi des Francs ? » Elle répondit : « Oui, c’est bien moi la princesse Mariam, ton esclave à toi seul ô émir des Croyants, protecteur de la Foi, descendant du prince des envoyés d’Allah ! » Et le khalifat, bien étonné de la réponse, se tourna ensuite vers Nour, et fut également charmé des grâces de sa jeunesse et de sa bonne mine ; et il lui dit : « Et toi, es-tu le jeune Nour, fils de Couronne, le marchand du Caire ? » Il répondit : « Oui, c’est moi, ton esclave, ô émir des Croyants, soutien de l’empire, défenseur de la Foi ! » Et le khalifat lui dit : « Comment as-tu osé enlever cette princesse franque, au mépris de la loi ? » Alors Nour, profitant de la permission de parler, raconta toute son aventure, dans ses moindres détails, au khalifat qui écouta son récit avec beaucoup d’intérêt. Mais il n’y a point d’utilité à le répéter.
Alors, Al-Rachid se tourna vers la princesse Mariam et lui dit : « Sache que ton père, le roi des Francs, m’a envoyé cet ambassadeur que voici, avec une lettre écrite de sa propre main. Et il m’assure de sa gratitude et de son intention de bâtir une mosquée dans sa capitale, si je consens à te renvoyer dans ses états ! Or, toi, qu’as-tu à répondre ? » Et Mariam releva la tête et, d’une voix à la fois ferme et délicieuse, répondit : « Ô émir des Croyants, tu es le représentant d’Allah sur la terre et celui qui maintient la loi de Son Prophète Môhammad (sur Lui à jamais la paix et la prière !) Or, moi je suis devenue musulmane, et je crois à l’unité d’Allah, et je la professe en ton auguste présence, et je dis : Il n’y a de Dieu qu’Allah, et Môhammad est l’envoyé d’Allah ! Pourrais-tu donc, ô émir des Croyants, me renvoyer dans le pays des infidèles qui donnent des égaux à Allah, croient à la divinité de Jésus fils de l’homme, adorent les idoles, révèrent la croix et rendent un culte superstitieux à toutes sortes de Créatures mortes dans l’impiété et précipitées dans les flammes de la colère d’Allah ? Or, si tu agis ainsi en me livrant à ces chrétiens, moi, au jour du Jugement, où toutes les grandeurs seront comptées pour rien, et où les cœurs purs seront seuls regardés, je t’accuserai de ta conduite, devant Allah et devant notre Prophète, ton cousin (sur Lui la prière et la paix !) »
Lorsque le khalifat eut entendu ces paroles de Mariam et sa profession de foi, il exulta en son âme de savoir musulmane une telle héroïne et, les larmes aux yeux, il s’écria : « Ô Mariam, ma fille, puisse Allah ne jamais permettre que je livre aux infidèles une musulmane qui croit à l’unité d’Allah et à Son Prophète ! Qu’Allah te garde et te conserve et répande sur toi sa miséricorde et ses bénédictions, en augmentant la conviction de ta foi ! Et maintenant, pour ton héroïsme et ta bravoure, tu peux réclamer tout de moi ; et je fais le serment de ne te refuser rien, fût-ce la moitié de mon empire ! Réjouis donc tes yeux, dilate ton cœur et bannis toute inquiétude ! Et dis-moi, afin que je fasse le nécessaire, si tu ne seras point satisfaite que ce jeune homme, fils de notre serviteur Couronne, le marchand du Caire, devienne ton époux légal. » Et Mariam répondit : « Comment ne le désirerais-je point, ô émir des Croyants ? N’est-ce point lui qui m’a achetée ? N’est-ce point lui qui a cueilli ce qu’il y avait en moi à cueillir ? N’est-ce point lui qui a si souvent exposé sa vie pour moi ? Et n’est-ce point lui enfin qui a donné la paix à mon âme en me révélant la pureté de la foi musulmane ? »
Aussitôt le khalifat fit appeler le kâdi et les témoins, et dresser sur le champ le contrat de mariage. Puis il fit avancer le vizir, ambassadeur du roi des Francs, et lui dit : « Tu vois bien avec tes propres yeux et tu entends bien avec tes propres oreilles que je ne puis agréer la demande de ton maître, puisque la princesse Mariam, devenue musulmane, nous appartient. Sinon je commettrais une action dont je devrais rendre compte à Allah et à Son Prophète, au jour du Jugement ! Car il est écrit dans le Livre d’Allah : « Il ne sera jamais donné aux infidèles d’avoir le dessus sur les Croyants ! » Retourne donc auprès de ton maître, et apprends-lui ce que tu as vu et entendu…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Il ne sera jamais donné aux infidèles d’avoir le dessus sur les Croyants ! » Retourne donc auprès de ton maître, et apprends-lui ce que tu as vu et entendu ! »
Lorsque l’ambassadeur eut compris de la sorte que le khalifat ne voulait pas livrer la fille du roi des Francs, il osa s’emporter, plein de dépit et de superbe, car Allah l’avait aveuglé sur les conséquences de ses paroles ; et il s’écria : « Par le Messie ! fût-elle musulmane encore vingt fois davantage, il faudra que je la ramène à son père, mon maître ! Sinon il viendra envahir ton royaume et couvrira de ses troupes ton pays depuis l’Euphrate jusqu’à l’Yamân ! »
À ces paroles, le khalifat, à la limite de l’indignation, s’écria : « Comment ! ce chien de chrétien ose proférer des menaces ? Qu’on lui tranche la tête et qu’on la place à l’entrée de la ville, en crucifiant son corps, et que cela serve désormais d’exemple aux ambassadeurs des infidèles ! » Mais la princesse Mariam s’écria : « Ô émir des Croyants, ne souille pas ton sabre glorieux du sang de ce chien-là ! Je veux le traiter moi-même comme il le mérite ! » Et, ayant dit ces mots, elle arracha le sabre que le vizir franc portait au côté, et l’ayant brandi, d’un seul coup elle lui abattit la tête et la jeta par la fenêtre. Et elle repoussa du pied le corps, en faisant signe aux esclaves de l’emporter.
À cette vue, le khalifat fut émerveillé de la promptitude avec laquelle la princesse s’était acquittée de cette exécution, et la revêtit de son propre manteau. Et il fit également revêtir Nour d’une robe d’honneur, et les combla tous deux de riches présents ; et, selon le désir qu’ils lui exprimaient, il leur donna une magnifique escorte qui les accompagnerait jusqu’au Caire, et leur remit des lettres de recommandation pour le wali d’Égypte et les oulémas. Et Nour et la princesse Mariam retournèrent de la sorte en Égypte, chez les vieux parents. Et le marchand Couronne, en revoyant son fils qui amenait dans sa maison une princesse pour belle-fille, fut à la limite de la fierté et pardonna à Nour sa conduite d’autrefois. Et il invita, en son honneur, pour une grande fête, tous les grands du Caire, qui comblèrent de présents les jeunes époux, en se surpassant à l’envi les uns les autres.
Et le jeune Nour et la princesse Mariam vécurent de longues années à la limite de la dilatation et de l’épanouissement, ne se privant de rien du tout, et mangeant bien, et buvant bien, et copulant fort, sec et longtemps, au milieu des honneurs et de la prospérité, dans la vie la plus tranquille et la plus délicieuse, jusqu’à ce que vînt les visiter la Destructrice des félicités, la Séparatrice des amis et des sociétés, celle qui renverse les maisons et les palais et pourvoit les ventres des tombeaux ! Mais gloire au Seul Vivant qui ne connaît pas la mort et qui tient dans Ses mains les clefs du Visible et de l’invisible ! Amin.
— Lorsque le roi Schahriar eut entendu cette histoire, il se leva soudain à demi et s’écria : « Ah ! Schahrazade, cette histoire héroïque, en vérité, me transporte ! » Et, ayant ainsi parlé, il s’accouda de nouveau sur les coussins, en se disant : « Je crois bien qu’elle n’a plus, après celle-là, d’autres histoires à me raconter ! Et je vais ainsi réfléchir sur ce qui me reste à faire, concernant sa tête ! » Mais Schahrazade, qui le voyait froncer les sourcils, se dit : « Il n’y a pas de temps à perdre ! » Et elle dit : « Oui, ô Roi, cette histoire héroïque est admirable, mais qu’est-elle en comparaison de celles que je veux encore te raconter, si toutefois tu me le permets ? » Et le Roi demanda : « Que dis-tu, Schahrazade ? Et quelles histoires encore penses-tu me raconter qui soient plus admirables ou plus étonnantes que celle là ? » Et Schahrazade sourit et dit : « Le Roi jugera ! Mais, cette nuit, pour terminer notre veillée, je ne veux te dire qu’une courte anecdote, de celles qui ne sont pas fatigantes à écouter ! Elle est tirée des séances de la générosité et du savoir-vivre. »
Et aussitôt elle dit :
LES SÉANCES DE LA GÉNÉROSITÉ
ET DU SAVOIR-VIVRE
Or, cela donna à réfléchir au vizir qui se dit : « En vérité, il ne m’est plus possible de garder cet enfant, après que le sultan l’a remarqué ! » Et il prépara un riche cadeau, appela le bel enfant chrétien et lui dit : « Par Allah, ô jouvenceau, n’était la nécessité, mon âme ne se serait jamais séparée de toi ! » Et il lui remit le cadeau, disant : « Tu porteras ce cadeau de ma part à notre maître le sultan, et tu seras toi-même une partie de ce cadeau, car dès cet instant je te cède à notre maître ! » Et il lui donna en même temps, pour qu’il le remît au sultan Saladin, un billet où il avait tracé ces deux strophes :
« Voici, o mon seigneur, une pleine lune pour ton horizon ; car il n’y a point sur terre d’horizon plus digne de cette lune !
Pour t’être agréable, je n’hésite point à me séparer, afin de te la donner, de mon âme précieuse, alors que — ô rareté sans pareille ! — je ne connais pas d’exemple d’un homme qui ait jamais consenti à se défaire volontairement de son âme ! »
Or, le cadeau plut d’une façon toute particulière au sultan Saladin, qui, généreux et grand selon son habitude, ne manqua pas de dédommager son vizir de ce sacrifice, en le comblant de richesses et de faveurs, et en lui faisant sentir, à toute occasion, combien il était entré dans ses bonnes grâces et son amitié…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, le cadeau plut d’une façon toute particulière au sultan Saladin, qui, généreux et grand, selon son habitude, ne manqua pas de dédommager son vizir de ce sacrifice, en le comblant de richesses et de faveurs et en lui faisant sentir, à toute occasion, combien il était entré dans ses bonnes grâces et son amitié.
Sur ces entrefaites, le vizir acquit, au nombre des adolescentes de son harem, une jeune fille d’entre les jeunes filles les plus délicieuses et les plus accomplies du temps. Et cette jeune fille, dès son arrivée, sut toucher le cœur du vizir ; mais avant de s’y attacher comme il avait fait pour le jeune garçon, il se dit : « Qui sait si la renommée de cette perle nouvelle n’arrivera pas aux oreilles du sultan ! Il vaut donc mieux pour moi, avant de laisser mon cœur s’attacher à cette jeune esclave, que j’en fasse également cadeau au sultan. De cette façon le sacrifice sera moins grand, et la perte me sera moins cruelle ! » Pensant ainsi, il fit venir la jouvencelle, la chargea pour le sultan d’un cadeau encore plus riche que la première fois, et lui dit : « Tu seras toi-même une partie du cadeau ! » Et il lui donna, pour qu’elle le remît au sultan, un billet où il avait tracé ces vers :
« Ô mon seigneur, une lune a déjà paru sur ton horizon, et maintenant voici le soleil.
Ainsi, sur le même ciel, s’unissent ces deux astres de lumière, pour former, réservée à ton règne, la plus belle des constellations. »
Or, de ce fait, le crédit du vizir redoubla dans l’esprit du sultan Saladin, qui ne manquait plus une occasion de témoigner, devant toute sa cour, l’estime et l’amitié qu’il ressentait pour lui. Et cela fit que le vizir eut de la sorte beaucoup d’ennemis et d’envieux qui, ayant comploté sa perte, résolurent de lui porter d’abord tort dans l’esprit du sultan. Ils firent donc entendre à Saladin, par diverses allusions et affirmations, que le vizir conservait toujours de l’inclination pour le jeune garçon chrétien, et qu’il ne cessait, notamment quand la brise fraîche du nord l’incitait au souvenir des promenades anciennes, de le désirer ardemment et de l’appeler de toute son âme. Et ils lui dirent qu’ainsi il se reprochait avec amertume le don qu’il avait fait, et que même, de dépit et de repentir, il se mordait les doigts et s’arrachait les molaires. Mais le sultan Saladin, loin d’incliner son ouïe vers ces allégations indignes du vizir en qui il avait mis sa confiance, cria d’une voix courroucée à ceux qui lui tenaient ces discours : « Assez mouvoir vos langues de perdition contre le vizir, ou vos têtes vont quitter à l’instant vos épaules ! » Puis, comme il était avisé et juste, il leur dit : « Je veux tout de même faire la preuve de vos mensonges et calomnies, et laisser vos propres armes se retourner contre vous ! Je vais donc éprouver la droiture d’âme de mon vizir ! » Et il appela l’enfant en question, et lui demanda : « Sais-tu écrire ? » Il répondit : « Oui, ô mon seigneur ! » Il dit : « Prends alors un papier et un calam et écris ce que je vais te dicter ! » Et il dicta, comme venant en propre de l’enfant lui-même, la lettre suivante adressée au vizir :
« Ô mon ancien maître bien-aimé, tu sais, par les sentiments que tu dois toi-même éprouver à mon égard, la tendresse que j’ai pour toi et le souvenir que laissent en mon âme nos délices d’autrefois. C’est pourquoi je viens me plaindre à toi de mon sort actuel dans le palais, où rien ne réussit à me faire oublier tes bontés, surtout qu’ici la majesté du sultan et le respect que j’éprouve pour lui m’empêchent de goûter ses faveurs. Je te prie donc de trouver un expédient pour me reprendre au sultan, soit par un moyen soit par un autre. D’ailleurs le sultan jusqu’ici ne s’est point trouvé seul à seul avec moi, et tu me verras tel que tu m’as laissé ! »
Et cette lettre écrite, le sultan la fit porter par un petit esclave du palais, qui la remit au vizir en lui disant : « C’est ton ancien esclave, l’enfant chrétien, qui me charge de te remettre cette lettre de sa part. » Et le vizir prit la lettre, la regarda un moment et, sans même la décacheter pour la lire, écrivit ceci sur le revers :
« Depuis quand l’homme d’expérience expose-t-il, comme l’insensé, sa tête dans la gueule du lion ?
Je ne suis point de ceux dont la raison se soumet et succombe à l’amour, ni de ceux dont se rient les envieux aux manœuvres sournoises.
Si j’ai fait le sacrifice de mon âme, en la donnant, c’est que je savais bien qu’une fois l’âme sortie, elle ne doit plus revenir habiter le corps abandonné ! »
Au reçu de cette réponse, le sultan Saladin exulta, et ne manqua pas de la lire devant les nez allongés des envieux. Puis il fit appeler son vizir et, après lui avoir donné de nouvelles marques d’amitié, lui demanda : « Peux-tu nous dire, ô père de la sagesse, comment tu fais pour avoir tant de pouvoir sur toi-même ? » Et le vizir répondit : « Je ne laisse jamais mes passions arriver au seuil de ma volonté ! »
Mais Allah est encore plus sage !
— Puis Schahrazade dit : « Mais, ô Roi fortuné, maintenant que je t’ai raconté comment la volonté du sage l’aide à vaincre ses passions, je veux te raconter une histoire sur l’amour passionné ! » Et elle dit :
Abdallah, fils d’Al-Kaïssi, nous rapporte, dans ses écrits, cette histoire.
Il dit :
J’étais allé une année en pèlerinage à la Maison Sainte d’Allah. Et lorsque j’eus accompli tous mes devoirs de pèlerin, j’étais retourné à Médine, pour visiter encore une fois la tombe du Prophète — sur Lui la paix et la bénédiction d’Allah ! — Or, une nuit, comme j’étais assis dans un jardin, non loin de la tombe vénérée, j’entendis une voix qui chantait tout doucement dans le silence. Et, charmé, je tendis toute mon attention, et écoutant ainsi, j’entendis ces vers qu’elle chantait :
« Ô rossignol de mon âme qui exhales tes chants au souvenir de la bien-aimée !… Ô tourterelle de sa voix, quand répondras-tu à mes gémissements ?
Ô nuit ! Combien tu parais longue à ceux que tourmente la fièvre de l’impatience, à ceux que torturent les soucis de l’absence !
Ô lumineuse apparue, ne brillas-tu sur mon chemin comme un phare que pour disparaître et me laisser errant à l’aveugle, dans les ténèbres ? »
Puis ce fut le silence. Et je regardais de tous côtés pour voir celui qui venait de chanter cette tirade passionnée, quand apparut devant moi le propriétaire de la voix. Et, à la clarté qui tombait du ciel nocturne, je vis que c’était un adolescent beau à ravir l’âme et dont le visage était baigné de larmes. Et je me tournai vers lui et ne pus m’empêcher de m’écrier : « Ya Allah ! quel beau jeune homme ! » Et je tendis mes deux bras dans sa direction. Et il me regarda et me demanda : « Qui es-tu, et que me veux-tu ? » Et je répondis, en m’inclinant devant sa beauté : « Que pourrais-je vouloir de toi, si ce n’est bénir Allah en te regardant ? Quant à ce qui est de moi et de mon nom, je suis ton esclave Abdallah, fils de Ma’amar Al-Kaïssi. Ô mon seigneur, comme mon âme désire te connaître ! Ton chant, tout à l’heure, m’a troublé à l’extrême, et ta vue achève de me transporter. Et me voici prêt à te sacrifier ma vie, si elle peut t’être utile ! » Alors l’adolescent me regarda, ah ! avec quels yeux ! et me dit : « Assieds-toi donc près de moi ! » Et je m’assis tout près de lui, avec mon âme frémissante, et il me dit : « Écoute maintenant, puisque ton cœur travaille à mon sujet, ce qui vient de m’arriver ! » Et il continua en ces termes : « Je suis Otbah, fils d’Al-Houbab, fils d’Al-Moundhir, fils d’Al-Jamouh l’Ansarite. Or, hier matin, je faisais mes dévotions dans la mosquée de la tribu, lorsque j’y vis entrer, ondulant sur leurs tailles et leurs hanches, plusieurs femmes belles à en mourir, qui accompagnaient une toute jeune adolescente dont les charmes effaçaient ceux de ses compagnes. Et, à un moment donné, cette lune s’approcha de moi au milieu de la foule des fidèles, sans être remarquée, et me dit : « Otbah ! il y a si longtemps que je guettais cette occasion de te parler ! Ô Otbah ! que dirais-tu de ton union avec celle qui est ton amante et désire être ton épouse ? » Puis, avant que j’eusse le temps d’ouvrir la bouche pour lui répondre, elle me quitta et disparut au milieu de ses compagnes. Puis toutes ensemble sortirent de la mosquée, et se perdirent dans la foule des pèlerins.
Et moi, malgré tous mes efforts pour la retrouver, je ne pus la revoir depuis cet instant. Et mon âme et mon cœur sont auprès d’elle. Et jusqu’à ce qu’il me soit donné de la revoir, je ne pourrai goûter aucun bonheur, fussé-je au milieu des délices du paradis…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et mon âme et mon cœur sont auprès d’elle. Et jusqu’à ce qu’il me soit donné de la revoir, je ne pourrai goûter aucun bonheur, fussé-je au milieu des délices du paradis ! »
Il parla ainsi, et ses joues duvetées rougissaient à mesure, et mon amour pour lui s’intensifiait d’autant. Et je lui dis, quand il se tut : « Ô Otbah, ô mon cousin ! mets ton espoir en Allah, et prie-le de t’accorder le pardon de tes fautes ! Quant à moi, me voici prêt à t’aider de tout mon pouvoir et de tous mes moyens pour te faire retrouver l’adolescente, objet de ta pensée. Car, en te voyant, je sentis mon âme se porter d’elle-même vers ta charmante personne, et désormais ce que je ferai pour toi sera uniquement pour voir tes yeux s’abaisser contents vers moi ! » Et, parlant ainsi, je le serrai affectueusement contre moi, et je l’embrassai comme un frère embrasse son frère ; et, toute la nuit, je ne cessai de calmer son âme chérie. Et certes ! de ma vie je n’oublierai ces moments délicieux et inassouvis passés amicalement à ses côtés.
Or, le lendemain, j’allai avec lui à la mosquée, et l’y fis entrer le premier, par égard pour lui. Et nous y restâmes ensemble depuis le matin jusqu’à midi, heure où les femmes viennent d’ordinaire à la mosquée. Mais, à notre grand désappointement, nous remarquâmes que les femmes étaient toutes arrivées dans la mosquée, mais que l’adolescente ne se trouvait point parmi elles. Et moi, voyant le chagrin que causait cette découverte à mon jeune ami, je lui dis : « Que cela ne t’inquiète point ! Je vais m’informer de ta bien-aimée auprès de ces femmes, puisqu’elle était hier dans leur société ! »
Et aussitôt je me glissai jusqu’à ces femmes, et je réussis à apprendre d’elles que l’adolescente en question était une jeune fille vierge, de haute naissance, qu’elle se nommait Riya, et était la fille d’Al-Ghitrif, chef de la tribu des Bani-Soulaim. Et je leur demandai : « Ô femmes de bien, pourquoi n’est-elle point revenue aujourd’hui avec vous ? » Elles répondirent : « Et comment l’aurait-elle pu ? Son père, qui avait accordé sa protection aux pèlerins pour la traversée du désert depuis l’Irak jusqu’à la Mecque, s’en est retourné hier avec ses cavaliers vers sa tribu, aux bords de l’Euphrate, et a emmené avec lui sa fille Riya. » Et moi je les remerciai pour ces renseignements, et revins auprès d’Otbah ; et je lui dis : « Les nouvelles que je t’annonce ne sont point hélas ! selon mes désirs ! » Et je le mis au courant du départ de Riya, avec son père, vers la tribu. Puis je lui dis : « Mais tranquillise ton âme, ô Otbah, ô mon cousin ! car Allah m’a accordé des richesses nombreuses, et je suis prêt à les dépenser pour te faire arriver à tes fins. Et, dès cet instant, je vais m’occuper de ton affaire, et réussir, avec l’aide d’Allah ! » Et j’ajoutai : « Prends seulement la peine de m’accompagner ! » Et il se leva, et m’accompagna jusqu’à la mosquée des Ansarites, ses parents.
Là, nous attendîmes que le peuple fût rassemblé ; et je saluai l’assemblée, et je dis : « Ô Croyants Ansarites réunis ici ! quelle est votre opinion sur Otbah et sur le père d’Otbah ? » Et tous répondirent, d’une voix unanime : « Nous disons tous que ce sont des Arabes d’une illustre famille et d’une noble tribu ! » Et je leur dis : « Sachez donc qu’Otbah, fils d’Al-Houbab, est consumé par une passion violente. Et je viens justement vous prier d’unir vos efforts aux miens pour assurer son bonheur ! » Ils répondirent : « De tout cœur amical ! » Je dis : « En ce cas, il vous faut m’accompagner vers les tentes des Bani-Soulaim, chez le cheikh Al-Ghitrif, leur chef, afin de lui demander en mariage sa fille Riya pour votre cousin Otbah, fils d’Al-Houbab ! » Et tous répondirent par l’ouïe et l’obéissance. Alors je montai à cheval, ainsi qu’Otbah ; et toute l’assemblée en fit autant. Et nous poussâmes nos chevaux à toute vitesse, sans arrêt. Et nous réussîmes de la sorte à atteindre les tentes des cavaliers du cheikh Al-Ghitrif, à six journées de Médine.
Lorsque le cheikh Al-Ghitrif nous vit arriver, il sortit à notre rencontre jusqu’à la porte de sa tente ; et nous, après les salams, nous lui dîmes : « Nous venons te demander l’hospitalité, ô père des Arabes ! » Il répondit : « Soyez les bienvenus sous nos tentes, ô nobles hôtes ! » Et, parlant ainsi, il donna aussitôt à ses esclaves les ordres nécessaires pour nous bien recevoir. Et les esclaves étendirent en notre honneur les nattes et les tapis ; et l’on tua, pour nous offrir un splendide festin, des moutons et des chameaux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Et l’on tua, pour nous offrir un splendide festin, des moutons et des chameaux. Mais lorsque vint le moment de s’asseoir pour le festin, nous nous récusâmes tous ; et moi, au nom de toute l’assemblée, je déclarai au cheikh Al-Ghitrif : « Par le mérite sacré du pain et du sel et par la foi des Arabes ! nous ne toucherons à aucun de tes mets, que tu ne nous aies accordé notre demande ! » Et Al-Ghitrif dit : « Et quelle est votre demande ! » Je répondis : « Nous venons te solliciter pour le mariage de ta noble fille Riya avec Otbah, fils d’Al-Houbab l’Ansarite, fils d’Al-Moundhir, fils d’Al-Jamouh, le brave, le bon, l’illustre, le victorieux, l’excellent ! » Et le père de Riya, devenu soudain bien changé quant à son teint et à ses yeux, nous dit d’une voix calme : « Ô frères arabes, celle que vous me faites l’honneur de me demander en mariage pour l’illustre Otbah, fils d’Al-Houbab, est seule maîtresse de la réponse. Et je ne contrarierai point sa volonté. C’est donc à elle de prononcer ! Et je vais à l’instant la trouver pour lui demander son avis ! » Et il se leva d’entre nous, bien jaune, avec de la colère plein le nez et un visage qui, à lui seul, démentait le sens de ses paroles.
Il s’en fut donc trouver, dans sa tente, sa fille Riya qui, effrayée de l’expression de son visage, lui demanda : « Ô père mien, pourquoi la colère émeut-elle si violemment ton âme intérieure ? » Et il s’assit auprès d’elle, en silence ; et, comme nous l’avons appris par la suite, il finit par lui dire : « Sache donc, ô Riya, ma fille, que je viens d’accorder l’hospitalité à des Ansarites, venus chez moi afin de te demander en mariage pour l’un d’eux ! » Elle dit : « Ô père, la famille des Ansarites est l’une des plus illustres parmi les Arabes ! Et ton hospitalité est à sa place, certes ! Mais, dis-moi ! et pour qui donc d’entre eux viennent-ils me demander en mariage ? » Il répondit : « Pour Otbah, fils de Houbab ! » Elle dit : « C’est un jeune homme connu ! Et il est digne d’entrer dans ta race ! » Mais il s’écria, plein de fureur : « Quelles paroles viens-tu de prononcer ? Aurais-tu déjà noué des rapports avec lui ? Or, moi, par Allah ! j’ai juré autrefois à mon frère de t’accorder à son fils, et nul, plus que le fils de ton oncle, n’est digne d’entrer dans ma généalogie ! » Elle dit : « Ô père, et que vas-tu répondre aux Ansarites ? Ce sont des Arabes pleins de noblesse et fort susceptibles sur toutes les questions de préséance et d’honneur ! Et si tu me refuses en mariage à l’un d’eux, tu vas attirer sur toi et la tribu leur ressentiment et l’effet de leur vengeance. Car ils se croiront méprisés par toi et ne te le pardonneront pas ! » Il dit : « Tu dis vrai ! Mais je vais déguiser mon refus en demandant, pour ton prix, une dot exorbitante. Car le proverbe dit : Si tu ne veux point marier ta fille, exagère ta demande de dot ! »
Il quitta donc sa fille, et revint auprès de nous, pour nous dire : « La fille de la tribu, ô mes hôtes, ne s’oppose point à votre demande en mariage ; mais elle exige une dot qui soit digne de ses mérites. Qui donc d’entre vous pourra me donner le prix de cette perle incomparable ? » À ces paroles, Otbah s’avança et dit : « C’est moi ! » Il dit : « Eh bien ! ma fille demande mille bracelets en or rouge, cinq mille pièces d’or au coin de Hajar, un collier de cinq mille perles, mille pièces d’étoffes en soie indienne, douze paires de bottes en cuir jaune, dix sacs de dattes de l’Irak, mille têtes de bétail, une jument de la tribu des Anazi, cinq boîtes de musc, cinq flacons d’essence de roses, et cinq boîtes d’ambre gris ! » Et il ajouta, en se tournant vers Otbah : « Es-tu homme à consentir à cette demande ? » Et Otbah répondit : « Ô père des Arabes, en doutes-tu ? Non seulement je consens à payer la dot demandée, mais j’y ajouterai encore ! »
Alors moi, je retournai à Médine, avec mon ami Otbah, et nous pûmes réussir, non sans bien des recherches et des peines, à rassembler toutes les choses demandées. Et moi je dépensai de mon argent, sans discontinuer, avec plus de plaisir que si j’eusse fait pour moi-même tous ces achats. Et nous revînmes aux tentes des Bani-Soulaim, avec tous nos achats, et nous nous hâtâmes de les livrer au cheikh Al-Ghitrif. Et le cheikh, ne pouvant plus de la sorte revenir sur sa parole, fut obligé de recevoir tous les Ansarites, ses hôtes, qui se réunirent pour lui faire leurs compliments sur le mariage de sa fille. Et les fêtes commencèrent et durèrent quarante jours. Et l’on égorgea nombre de chameaux et de moutons, et l’on fit cuire des chaudrons de mets de toutes sortes, où chaque membre de la tribu pouvait manger à sa faim.
Or, au bout de ce temps, nous préparâmes un palanquin somptueux, sur le dos de deux chameaux à la file, et nous y plaçâmes la nouvelle mariée. Et nous partîmes tous, à la limite de la joie, suivis d’une caravane entière de chameaux chargés de présents. Et mon ami Otbah exultait dans l’attente du jour de l’arrivée, où il allait enfin se trouver seul à seul avec sa bien-aimée. Et durant le voyage, il ne la quittait pas un instant, et lui tenait compagnie, dans son palanquin, d’où il ne descendait que pour venir me favoriser d’une causerie, en toute amitié, confiance et gratitude…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Et durant tout le voyage, il ne la quittait pas un instant, et lui tenait compagnie, dans son palanquin, d’où il ne descendait que pour venir me favoriser d’une causerie, en toute amitié, confiance et gratitude. Et, moi, je me réjouissais en mon âme et me disais : « Te voilà devenu, ô Abdallah, pour toujours l’ami d’Otbah ! car tu as su, oubliant tes propres sentiments, toucher son cœur en l’unissant à Riya ! Un jour, n’en doute pas, ton sacrifice sera compensé, et au delà ! Et tu connaîtras, toi aussi, l’amour d’Otbah dans ce qu’il a de plus désirable et de plus exquis ! »
Or, nous n’étions plus qu’à une journée de marche de Médine, et, à la tombée de la nuit, nous nous étions arrêtés dans une petite oasis, pour nous reposer. Et la paix était complète ; et la lumière de la lune riait à la joie de notre camp ; et, sur nos têtes, douze palmiers, comme des jeunes filles, accompagnaient du froissement de leurs palmes la chanson des brises de nuit. Et nous, comme les auteurs du monde aux jours anciens, nous jouissions de l’heure pleine de quiétude, de la fraîcheur de l’eau, de l’herbe grasse et de la douceur de l’air. Mais, hélas ! on ne peut échapper à la destinée, même si on la fuit avec des ailes. Et c’est mon ami Otbah qui devait boire jusqu’à lie, en une gorgée, la coupe inévitable ! En effet, nous fûmes soudain tirés de notre repos par une attaque terrible de cavaliers armés qui fondirent sur nous, en poussant des cris et des hurlements. Or, c’étaient des cavaliers de la tribu des Bani-Soulaim, envoyés par le cheikh Al-Ghitrif pour enlever sa fille. Car il n’avait point osé violer, sous ses tentes, les lois de l’hospitalité, et avait attendu notre éloignement pour nous faire attaquer de la sorte, sans manquer aux coutumes du désert. Mais il comptait sans la valeur d’Otbah et de nos cavaliers qui, avec un grand courage, soutinrent l’attaque des Bani-Soulaim, et finirent, après en avoir tué un grand nombre, par les mettre en déroute. Mais, au milieu de la mêlée, mon ami Otbah reçut un coup de lance, et, quand il fut de retour au camp, il tomba mort dans mes bras.
À cette vue, la jeune Riya poussa un grand cri et vint s’abattre sur le corps de son amant. Et elle passa toute la nuit à se lamenter. Et quand vint le matin, nous la trouvâmes morte de désespoir. Qu’Allah les ait tous deux en Sa Miséricorde ! Et nous leur creusâmes dans le sable un tombeau, et nous les enterrâmes l’un à côté de l’autre. Et, l’âme en deuil, nous regagnâmes Médine. Et moi, ayant terminé ce que j’avais à terminer, je rentrai dans mon pays.
Mais, sept ans plus tard, le désir m’envahit de refaire un pèlerinage aux lieux saints. Et mon âme souhaita aller visiter le tombeau d’Otbah et de Riya. Et lorsque je fus arrivé au tombeau, je le vis ombragé par un bel arbre d’une espèce inconnue, que ceux de la tribu des Ansarites avaient pieusement planté. Et je m’assis, pleurant, sur la pierre, à l’ombre de l’arbre, avec mon âme attristée. Et je demandai à ceux qui m’accompagnaient : « Ô mes amis, dites-moi le nom de cet arbre qui pleure avec moi la mort d’Otbah et de Riya ! » Et ils me répondirent : « Il s’appelle l’Arbre des Amants. » Ah ! puisses-tu, ô Otbah, reposer dans la paix de ton Seigneur, à l’ombre de l’arbre qui se lamente sur ton tombeau !
— Et c’est là ce que je sais, ô Roi fortuné sur le Tombeau des Amants ! » Puis, comme elle voyait le roi Schahriar assombri par cette histoire, elle se hâta, cette nuit-là, de raconter encore l’Histoire de Hind, de son divorce et de son mariage.
Il est raconté que la jeune Hind, fille d’Al-Némân, était l’adolescente la plus belle entre les adolescentes de son temps, et tout à fait une gazelle par les yeux, la finesse et les charmes. Or, la renommée de sa beauté parvint jusqu’aux oreilles d’Al-Hajage, gouverneur de l’Irak ; et celui-ci la demanda en ma- riage. Mais le père de Hind ne voulut la lui accorder que pour le prix d’une dot de deux cent mille drachmes d’argent, à payer avant le mariage, avec la condition de lui payer encore, en cas de divorce, deux cents autres mille drachmes. Et Al-Hajage accepta toutes les conditions, et emmena Hind dans sa maison.
Or, Al-Hajage, pour son amertume et sa calamité, était impuissant. Et il était venu au monde tout difforme quant à son zebb, avec l’anus obstrué. Et comme, ainsi bâti, l’enfant refusait la vie, le diable était apparu à sa mère, sous une forme humaine, et lui avait prescrit, si elle voulait que son enfant pût survivre, de lui donner à téter, au lieu de lait, du sang de deux chevreaux noirs, d’un bouc noir et d’un serpent noir. Et la mère avait suivi cette prescription, et avait obtenu l’effet désiré. Seulement l’impuissance et la difformité, qui sont un don de Satan et non point d’Allah le Généreux, étaient restées l’apanage de l’enfant, devenu un homme.
Aussi Al-Hajage, une fois qu’il eut emmené Hind dans sa maison, resta un long temps sans oser l’approcher autrement que de jour et sans la toucher, malgré tout le désir qu’il en avait. Et Hind ne tarda pas à connaître le motif de cette abstinence, et s’en lamenta beaucoup avec ses esclaves.
Or, un jour, Al-Hajage vint la voir, selon son habitude, pour se réjouir les yeux de sa beauté. Et elle avait le dos tourné à la porte, et était occupée à se regarder dans un miroir, en chantant ces vers :
« Hind, cavale issue de noble sang arabe, te voici condamnée à vivre avec un misérable mulet !
Oh ! qu’on me débarrasse de ces riches habits de pourpre, et qu’on me rende mes hardes en poil de chameau.
Je quitterai ces palais odieux pour retourner aux lieux où les tentes noires de la tribu claquent au vent de mon désert,
Là où la flûte et le zéphyr se répondent en mélopées à travers les trous de la tente, et me sont plus doux que la musique des luths et des tambours,
Et où les jeunes gens de la tribu, nourris du sang des lions, sont puissants et beaux comme les lions !
Ici, Hind mourra sans postérité aux côtés d’un misérable mulet ! »
Lorsque Al-Hajage entendit le chant où Hind le comparait à un mulet, il sortit, plein de désappointement, de la chambre, sans que son épouse se fût aperçue de sa présence et de sa disparition, et envoya chercher à l’instant le kâdi Abdallah, fils de Taher, pour faire prononcer son divorce. Et Abdallah se rendit auprès de Hind, et lui dit : « Ô fille d’Al-Némân, voici qu’Al-Hajage Abou-Môhammad t’envoie deux cent mille drachmes d’argent, et me charge, en même temps, de remplir, en son nom, les formalités de son divorce avec toi ! » Et Hind s’écria : « Grâces à Allah, voilà mon vœu exaucé et me voilà libre de m’en retourner chez mon père ! Ô fils de Taher, tu ne pouvais m’annoncer une nouvelle plus agréable qu’en m’apprenant que je suis délivrée de ce chien importun. Garde donc pour toi ces deux cent mille drachmes, comme récompense de l’heureuse nouvelle que tu m’apportes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Garde donc pour toi les deux cent mille drachmes, comme récompense de l’heureuse nouvelle que tu m’apportes ! »
Sur ces entrefaites, le khalifat Abd Al-Malek ben-Merwân, qui avait entendu parler de l’incomparable beauté et de l’esprit de Hind, la désira et l’envoya demander en mariage. Mais elle lui répondit par une lettre où, après les louanges à Allah et les formules de respect, elle lui disait : « Sache, ô émir des Croyants, que le chien a souillé le vase, en le touchant avec le nez, pour le renifler ! » Et le khalifat, en recevant cette lettre, se mit à rire aux éclats, et écrivit aussitôt cette réponse : « Ô Hind, si le chien a souillé le vase, en le touchant avec le nez, nous le laverons sept fois, et, par l’usage que nous en ferons, nous le purifierons ! »
Alors Hind, voyant que le khalifat, malgré les obstacles qu’elle lui opposait, continuait à la désirer ardemment, ne put faire autrement que de s’incliner. Elle accepta donc, mais en y mettant une condition, comme elle le lui écrivit dans une seconde lettre où, après les louanges et les formules, elle disait : « Sache, ô émir des Croyants, que je ne partirai qu’à une seule condition : c’est qu’Al-Hajage, pieds nus, conduise, pendant ce voyage, mon chameau par la bride jusqu’à ton palais ! »
Or, cette lettre fit encore plus rire le khalifat que n’avait fait la première. Et il envoya sur le champ ordre à Al-Hajage de conduire par la bride le chameau de Hind. Et Al-Hajage, malgré tout son dépit, savait bien qu’il ne pouvait qu’obéir aux ordres du khalifat. Il se rendit donc, pieds nus, jusqu’à la demeure de Hind, et prit le chameau par la bride. Et Hind monta dans sa litière, et ne manqua pas, durant toute la route, de s’égayer de toute son âme aux dépens de son conducteur. Et elle appela sa nourrice et lui dit : « Ô ma nourrice, écarte un peu les rideaux du palanquin ! » Et la nourrice écarta les rideaux ; et Hind mit la tête à la portière, et jeta à terre un dinar d’or, au milieu de boue. Et elle se tourna vers son ancien époux et lui dit : « Ô chancelier, rends-moi cette pièce d’argent ! » Et Al-Hajage ramassa la pièce et la rendit à Hind, en lui disant : « C’est un dinar d’or et non une pièce d’argent ! » Et Hind, éclatant de rire, s’écria : « Louanges à Allah qui fait se changer l’argent en or, malgré la souillure de la boue ! » Et Hajage vit bien, à ces paroles, que c’était encore là un tour de Hind pour l’humilier. Et il devint bien rouge de honte et de colère. Mais il baissa la tête et fut obligé de cacher son ressentiment contre Hind, devenue l’épouse du khalifat !
— Lorsque Schahrazade eut raconté cette histoire, elle se tut. Et le roi Schahriar lui dit : « Ces anecdotes, Schahrazade, me plaisent. Mais j’aimerais entendre maintenant une histoire merveilleuse. Et si tu n’en connais plus, dis-le-moi afin que je le sache ! » Et Schahrazade s’écria : « Et où y a-t-il une histoire plus merveilleuse que celle que je vais précisément raconter tout de suite au Roi, si toutefois il me le permet ! » Et Schahriar dit : « Tu peux ! »
HISTOIRE MERVEILLEUSE DU
MIROIR DES VIERGES
Et Schahrazade dit au roi Schahriar :
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, ô doué d’idées excellentes, qu’il y avait, en l’antiquité du temps et le passé des âges et des moments, dans la ville de Bassra, un sultan qui était un adolescent admirable et délicieux, plein de générosité et de vaillance, de noblesse et de puissance, et il s’appelait le sultan Zein. Mais ce jeune et charmant sultan Zein était, malgré les grandes qualités et les dons de toutes sortes qui faisaient qu’il n’avait pas son pareil dans le monde en large et en long, un tout à fait extraordinaire dissipateur de richesses, un prodigue qui ne connaissait ni frein ni règles, et qui, par les largesses de sa paume ouverte à de jeunes favoris gloutons à l’extrême, et par ses dépenses pour les femmes innombrables de toutes les couleurs et de toutes les tailles qu’il entretenait dans des palais somptueux, et par l’achat ininterrompu d’adolescentes nouvelles qu’on lui procurait tous les jours, dans leur virginité, à des prix exorbitants, pour qu’il se les mit sous la dent, avait fini par épuiser complètement les immenses trésors accumulés, depuis des siècles, par les sultans et les conquérants, ses aïeux. Et son vizir vint un jour, après avoir embrassé la terre entre ses mains, lui annoncer que les coffres de l’or étaient à sec et que les fournisseurs du palais n’étaient pas payés pour le lendemain ; et, lui ayant annoncé cette mauvaise nouvelle, il se hâta, par crainte du pal, de s’en aller comme il était venu.
Lorsque le jeune sultan Zein eut appris de la sorte que toutes ses richesses étaient consumées, il se repentit de n’avoir pas eu la pensée d’en réserver une partie pour les jours noirs de la destinée ; et il s’attrista en son âme à la limite de la tristesse. Et il se dit : « Il ne te reste plus, sultan Zein, qu’à t’enfuir d’ici en cachette et, abandonnant à leur sort tes favoris tant aimés, tes concubines adolescentes, tes femmes et les affaires du gouvernement, à laisser le trône déchu du royaume de tes pères à qui veut s’en emparer. Car il est préférable d’être un mendiant sur le chemin d’Allah qu’un roi sans richesses et sans prestige, et tu connais le proverbe qui dit : Il vaut mieux être dans le tombeau que dans la pauvreté ! » Et, pensant ainsi, il attendit la tombée de la nuit pour se déguiser et, sans être remarqué, sortir par la porte secrète de son palais. Et il se disposait à prendre un bâton et à se mettre en route, quand Allah le Tout-Voyant, le Tout-Entendeur, lui remit en mémoire les dernières paroles et recommandations de son père. Car son père, avant de mourir, l’avait appelé et, entre autres choses, lui avait dit : « Et surtout, ô mon fils, n’oublie pas que, si la destinée se tourne un jour contre toi, tu trouveras dans l’Armoire-des-papiers un trésor qui te permettra de faire face à tous les coups du sort ! »
Lorsque Zein se fut rappelé ces paroles, qui s’étaient complètement effacées de sa mémoire, il courut, sans tarder, à l’Armoire-des-papiers et l’ouvrit, en tremblant de joie. Mais il eut beau regarder, fouiller et examiner, en bouleversant les papiers et les registres et en mettant sens dessus dessous les annales du règne, il ne trouva dans cette armoire-là ni or, ni odeur d’or, ni argent, ni odeur d’argent, ni joyaux, ni pierreries, ni quoi que ce fût qui ressemblât de près ou de loin à ces choses-là. Et désespéré au delà de ce que sa poitrine rétrécie pouvait contenir de désespoir, et bien furieux d’avoir été trompé dans son attente, il se mit à tout saccager et à lancer les papiers du règne dans toutes les directions, et à les fouler aux pieds avec rage, quand soudain il sentit résister à sa main dévastatrice un objet dur comme du métal. Et il le retira et, l’ayant regardé, il vit que c’était un pesant coffret en cuivre rouge. Et il se hâta de l’ouvrir ; et il n’y trouva qu’un petit billet plié et cacheté du sceau de son père. Alors, bien que fort dépité, il rompit le cachet et lut sur le papier ces mots tracés par la main même de son père : « Va, ô mon fils, à tel endroit du palais, avec une pioche, et creuse toi-même la terre avec tes mains, en invoquant Allah ! »
Lorsqu’il eut lu ce billet, Zein se dit : « Voilà que maintenant il va falloir que je fasse le travail pénible des laboureurs ! Mais puisque telle est la dernière volonté de mon père, je ne veux point désobéir ! » Et il descendit dans le jardin du palais, prit une pioche contre le mur de la maison du jardinier et alla à l’endroit désigné, qui était un souterrain situé au-dessous du palais…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-UNIÈME NUIT
La petite Doniazade, sœur de Schahrazade, se leva du tapis où elle était blottie et s’écria : « Ô sœur mienne, que tes paroles sont douces et gentilles et savoureuses en leur fraîcheur ! » Et Schahrazade dit, en baisant sa petite sœur sur les yeux : « Oui ! mais qu’est cela comparé à ce que je vais raconter cette nuit, si toutefois me le permet ce Roi bien élevé et doué de bonnes manières ! » Et le roi Schahriar dit : « Tu peux ! » Alors Schahrazade continua ainsi :
… Le jeune sultan Zein prit donc une pioche et alla au souterrain situé au-dessous du palais. Et il alluma une torche, et, à cette clarté, il commença par frapper, du manche de sa pioche, contre le sol du souterrain, et finit de la sorte par entendre une résonnance profonde. Et il se dit : « C’est là qu’il faudra travailler ! » Et il se mit à piocher ferme ; et il leva plus de la moitié des carreaux du pavé sans apercevoir la moindre apparence du trésor. Et il quitta l’ouvrage pour se reposer, et, s’adossant contre le mur, il pensa : « Par Allah ! et depuis quand, sultan Zein, te faut-il courir derrière ta destinée et aller à sa recherche jusque dans les profondeurs de la terre, au lieu de l’attendre sans soucis, sans tracas et sans travail ? Ne sais-tu donc que ce qui est passé est passé, et que ce qui est écrit est écrit et devra courir ? » Néanmoins, lorsqu’il se fut un peu reposé, il continua sa besogne, en arrachant les carreaux, sans trop d’espoir, et voici que tout à coup il mit à découvert une pierre blanche qu’il souleva ; et dessous il trouva une porte sur laquelle était attaché un cadenas d’acier. Et il rompit ce cadenas à coups de pioche et ouvrit la porte.
Alors il se vit au haut d’un magnifique escalier de marbre blanc qui descendait vers une large salle carrée toute en porcelaine blanche de Chine et en cristal, et dont les lambris et le plafond et la colonnade étaient en lazulite céleste. Et, dans cette salle, il remarqua quatre estrades de nacre, sur chacune desquelles il y avait dix grandes urnes d’albâtre et de porphyre, alternées. Et il se demanda : « Qui sait ce que contiennent ces belles jarres-là ! Il est bien probable que mon défunt père les a fait remplir d’un vieux vin, qui maintenant doit être aux extrêmes limites de l’excellence ! » Et, pensant ainsi, il monta sur l’une des quatre estrades, s’approcha de l’une des urnes et en ôta le couvercle. Et, ô surprise ! Ô joie ! ô danse ! il vit qu’elle était remplie, jusqu’au bord, de poudre d’or. Et, pour mieux s’en assurer, il y plongea le bras, sans pouvoir en atteindre le fond, et le retira tout doré et ruisselant de soleil. Et il se hâta d’enlever le couvercle d’une seconde urne, et vit qu’elle était pleine de dinars d’or et de sequins d’or de toutes les tailles. Et il visita, l’une après l’autre, les quarante urnes, et trouva que toutes celles en albâtre contenaient leur plein de poudre d’or, et toutes leurs sœurs en porphyre leur plein de dinars et de sequins d’or.
À cette vue, le jeune Zein se dilata et s’épanouit, et se trémoussa et se convulsa ; puis il se mit à crier de joie, et, après avoir enfoncé sa torche dans une cavité de la paroi de cristal, il inclina vers lui une des urnes d’albâtre, et fit couler sur sa tête, sur ses épaules, sur son ventre, et partout, la poudre d’or ; et il s’y baigna avec plus de volupté qu’il n’en avait jamais ressenti dans les plus délicieux hammams. Et il s’écriait : « Ha ! ha ! sultan Zein, déjà tu avais pris le bâton du derviche et tu te disposais à parcourir les chemins d’Allah, en mendiant ! Et voici que la bénédiction est descendue sur ta tête, parce que tu n’as point douté de la générosité du Donateur et que tu as dépensé, la paume large ouverte, les biens premiers qu’il t’avait donnés ! Rafraîchis donc tes yeux, et tranquillise ton âme chérie. Et ne crains point de puiser de nouveau, selon ta capacité, à même les dons incessants de Celui qui t’a créé ! » Et, en même temps, il inclinait toutes les autres urnes de porphyre ; et il en versait le contenu dans la salle de porcelaine. Et il fit de même pour les urnes d’albâtre, dont les dinars et les sequins faisaient tressaillir, de leurs chutes sonores et de leurs cliquetis, les échos de la porcelaine et l’harmonieux cristal. Et il plongea amoureusement son corps au milieu de cet amoncellement d’or, tandis que, sous la torche, la salle blanche et bleue mariait l’éclat de ses parois miraculeuses aux fulgurantes étincelles et aux gerbes glorieuses lancées du sein de ce froid incendie.
Lorsque le jeune sultan se fut ainsi baigné dans l’or, s’y exaltant pour oublier le souvenir de la misère qui avait menacé sa vie et failli lui faire abandonner le palais de ses pères, il se releva tout ruisselant de coulées enflammées, et, devenu plus calme, il se mit à examiner toutes choses avec une curiosité extrême, s’étonnant que le roi, son père, eût fait creuser ce souterrain et bâtir cette salle admirable si secrètement que nul dans le palais n’en avait jamais ouï parler. Et ses yeux attentifs finirent par remarquer, dans un petit coin, abrité entre deux colonnettes de cristal, un minuscule coffret de tous points semblable, mais en plus petit, Et celui qu’il avait trouvé dans l’Armoire-des-papiers…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ses yeux attentifs finirent par remarquer, dans un petit coin, abrité entre deux colonnettes de cristal, un minuscule coffret de tous points semblable, mais en plus petit, à celui qu’il avait trouvé dans l’Armoire-des-papiers. Et il l’ouvrit et trouva dedans une clef d’or incrustée de pierreries. Et il se dit : « Par Allah ! cette clef doit être celle qui ouvre le cadenas que j’ai brisé ! » Puis il réfléchit et pensa : « Mais alors comment se fait-il que le cadenas ait été fermé du dehors ? Cette clef doit, par conséquent, servir à un autre usage. » Et il se mit à chercher partout, pour voir s’il ne découvrirait pas à quel usage elle était destinée. Et il examina toutes les parois de la salle avec une attention extrême, et finit par trouver, au milieu d’un lambris, une serrure. Et, jugeant qu’elle devait être celle dont il avait la clef, il en fit l’essai sur le champ. Et aussitôt une porte céda et s’ouvrit toute grande. Et il put ainsi pénétrer dans une seconde salle, encore plus merveilleuse que la précédente. En effet, du sol au plafond, elle était tout en faïence verte, d’un poli creusé d’or, et telle qu’on l’aurait crue taillée dans l’émeraude marine. Et elle était si belle vraiment, dans sa nudité de tout ornement, que nul rêve n’eût jamais imaginé la pareille. Et, au milieu de cette salle, sous la voûte, se tenaient debout six adolescentes comme des lunes et brillantes par elles-mêmes d’un tel éclat que la salle en était tout éclairée. Et elles se tenaient sur des piédestaux d’or massif, et ne parlaient pas. Et Zein, charmé à la fois et stupéfait, s’avança vers elles pour les voir de plus près et leur adresser son salam ; mais il s’aperçut qu’elles étaient non point vivantes, mais faites chacune d’un seul diamant.
À cette vue, Zein, à la limite de l’étonnement, s’écria : « Ya Allah ! comment mon défunt père avait-il pu faire pour posséder de pareilles merveilles ! » Et il les examina avec encore plus d’attention, et remarqua que, debout de la sorte sur leurs piédestaux, elles entouraient un septième piédestal, vide de toute adolescente de diamant, sur lequel était posé une tapisserie de soie où étaient écrits ces mots :
Sache, ô mon fils Zein, que ces adolescentes de diamant m’ont coûté beaucoup de peine à acquérir. Mais, quoiqu’elles soient des merveilles de beauté, ne crois point qu’elles soient ce qu’il y a de plus admirable sur terre. Il existe, en effet, une septième adolescente, plus brillante et infiniment plus belle, qui les surpasse et vaut mieux toute seule que mille comme celles que tu vois. Si donc tu souhaites la voir et t’en rendre possesseur, pour la placer sur le septième piédestal qui l’attend, tu n’as qu’à faire ce que la mort ne m’a pas permis d’accomplir. Va dans la ville du Caire, et cherches-y un de mes anciens esclaves fidèles, appelé Moubarak, que tu n’auras d’ailleurs nulle peine à découvrir. Et, après les salams, raconte-lui tout ce qui t’est arrivé. Et il te reconnaîtra pour mon fils, et il te conduira jusqu’au lieu où se trouve cette incomparable adolescente. Et tu en deviendras l’acquéreur. Et elle réjouira ta vue pour le restant de tes jours. Ouassalam, ya Zein !
Lorsque le jeune Zein eut lu ces paroles, il se dit : « Certes, je me garderai bien de différer ce voyage au Caire ! Il faut, en effet, que cette septième adolescente soit une pièce bien merveilleuse, pour que mon père m’assure qu’elle vaut, à elle seule, toutes celles-ci réunies et mille autres pareilles ! » Et, ayant ainsi résolu son départ, il sortit un instant du souterrain, pour y revenir avec une couffe qu’il remplit de dinars et de sequins d’or. Et il la transporta dans son appartement. Et il passa une partie de la nuit à transporter chez lui une partie de cet or, sans que personne eût remarqué ses allées et venues. Et il referma la porte du souterrain, et monta se coucher pour prendre quelque repos.
Or, le lendemain, il convoqua ses vizirs, ses émirs et les grands du royaume ; et il leur fit part de son intention d’aller en Égypte, pour changer d’air. Et il chargea son grand-vizir, celui-là précisément qui avait redouté le pal pour la mauvaise nouvelle annoncée, de gouverner le royaume pendant son absence. L’escorte qui devait l’accompagner en voyage était composée d’un petit nombre d’esclaves d’élite soigneusement choisis. Et il partit sans pompe ni cortège. Et Allah lui écrivit la sécurité ; et il arriva sans encombre au Caire.
Là, il se hâta de demander des nouvelles de Moubarak ; et on lui apprit qu’on ne connaissait au Caire, sous ce nom, qu’un très riche marchand, syndic du souk, qui vivait en toute générosité et largesse dans son palais dont les portes étaient ouvertes aux pauvres et aux étrangers. Et Zein se fit conduire au palais de ce Moubarak-là ; et il trouva à la porte un grand nombre d’esclaves et d’eunuques qui se hâtèrent, après avoir prévenu leur maître, de lui souhaiter la bienvenue. Et ils lui firent passer une grande cour et traverser une salle magnifiquement ornée, où, assis sur un divan de soie, l’attendait le maître du lieu. Et ils se retirèrent.
Alors, Zein s’avança vers son hôte, qui se leva en son honneur et qui, après les salams, le pria de s’asseoir à ses côtés, en lui disant : « Ô mon maître, la bénédiction est entrée dans ma maison, avec tes pas ! » Et il l’entretint avec beaucoup de cordialité, se gardant bien de manquer aux devoirs de l’hospitalité en lui demandant son nom et le dessein qui motivait sa présence. Aussi ce fut Zein qui le premier interrogea son hôte, lui disant : « Ô mon maître, tel que je suis, je viens d’arriver de Bassra, mon pays, à la recherche d’un homme appelé Moubarak, qui avait été autrefois au nombre des esclaves du défunt roi, dont je suis le fils. Et si tu me demandes mon nom, je te dirai que je m’appelle Zein. Car c’est moi-même qui suis maintenant le sultan de Bassra…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et si tu me demandes mon nom, je te dirai que je m’appelle Zein ! Car c’est moi-même qui suis maintenant le sultan de Bassra ! »
À ces paroles, le marchand Moubarak, à la limite de l’émotion, se leva de sur le divan, et, se jetant aux genoux de Zein, embrassa la terre entre ses mains, et s’écria : « Louanges à Allah, ô mon seigneur, qui a permis la réunion du maître et de l’esclave ! Ordonne et je te répondrai par l’ouïe et l’obéissance ! Car c’est moi-même qui suis ce Moubarak, esclave du défunt roi, ton père ! L’homme qui engendre ne meurt point ! Ô fils de mon maître, ce palais est ton palais, et je suis ta propriété ! » Alors Zein, ayant relevé Moubarak, lui raconta tout ce qui lui était arrivé, depuis le commencement jusqu’à la fin, sans omettre un détail. Mais il n’y a point d’utilité à le répéter. Et il ajouta : « Je viens donc en Égypte pour que tu m’aides à trouver cette merveilleuse adolescente de diamant ! » Et Moubarak répondit : « De tout cœur féal et comme hommages dus ! Je suis l’esclave non libéré, et ma vie et mes biens t’appartiennent de droit. Mais, avant d’aller à la recherche de l’adolescente de diamant, ô mon seigneur, il est bon que tu te reposes des fatigues du voyage et que tu me permettes de donner un festin en ton honneur ! » Mais Zein répondit : « Sache, ô Moubarak, que pour ce qui est de ta qualité d’esclave, désormais tu peux te considérer comme libre ; car je t’affranchis et je retranche ta personne de mes biens et propriétés. Quant à ce qui est de l’adolescente de diamant, il faut que, sans retard, nous allions à sa recherche, car le voyage ne m’a pas fatigué, et l’impatience où je suis m’empêcherait de goûter le moindre repos ! » Alors Moubarak, voyant que la résolution du prince Zein était bien arrêtée, ne voulut point le contrarier ; et, après avoir embrassé une seconde fois la terre entre ses mains, pour le remercier du don qu’il venait de lui faire de sa liberté, et après avoir baisé le pan de son manteau et s’en être couvert la tête, il se leva et dit à Zein : « Ô mon seigneur, as-tu seulement réfléchi aux dangers que tu vas courir dans cette expédition ? En effet, l’adolescente de diamant se trouve dans le palais du Vieillard des Trois Îles ! Et les Trois Îles sont situées dans un pays dont le seuil est interdit au commun des hommes. Toutefois je puis t’y conduire, car je connais la formule qu’il faut prononcer pour y pénétrer. » Et le prince Zein répondit : « Je suis prêt à affronter tous les périls, pour acquérir cette merveilleuse adolescente de diamant, car rien n’arrivera que ce qui doit arriver. Et me voici avec tout mon courage gonflant ma poitrine, pour aller trouver le Vieillard des Trois Îles ! »
Alors, Moubarak ordonna aux esclaves de tenir toutes choses prêtes pour le départ. Et, après avoir fait leurs ablutions et la prière, ils montèrent à cheval et se mirent en chemin. Et ils voyagèrent pendant des jours et pendant des nuits, à travers les plaines et les déserts, et dans des solitudes où il n’y avait que l’herbe et la présence d’Allah. Et ils étaient, durant ce voyage, sans cesse frappés par la vue des choses de plus en plus étranges qu’ils rencontraient pour la première fois de leur vie. Et ils finirent par arriver dans une prairie délicieuse, où ils descendirent de cheval ; et Moubarak, se tournant vers les esclaves qui les suivaient, leur dit : « Vous autres, demeurez dans cette prairie, jusqu’à notre retour, pour garder les chevaux et les provisions ! » Et il pria Zein de le suivre, et lui dit : « Ô mon seigneur, il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah l’Omnipotent ! Nous voici sur le seuil des terres interdites, où se trouve l’adolescente de diamant. Or, il faut que nous avancions tout seuls, sans avoir désormais un moment d’hésitation. Et c’est maintenant qu’il faut manifester notre fermeté et notre courage ! » Et le prince Zein le suivit ; et ils marchèrent longtemps, sans arrêt, jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au pied d’une haute montagne à pic qui barrait tout l’horizon de sa muraille inflexible.
Alors, le prince Zein se tourna vers Moubarak et lui dit : « Ô Moubarak, et quelle est la puissance qui va maintenant nous faire gravir cette montagne inaccessible ? Et qui nous donnera des ailes pour arriver à son sommet ? » Et Moubarak répondit : « Nous n’avons point besoin de la gravir ou d’arriver à son sommet avec des ailes pour la franchir ! » Et il tira de sa poche un vieux livre, sur lequel étaient tracés, à rebours, des caractères inconnus, semblables à des pattes de fourmis ; et il se mit à lire à haute voix, devant la montagne, en dodelinant de la tête, des versets en une langue incompréhensible. Et aussitôt la montagne, roulant sur elle-même de deux côtés à la fois, se sépara en deux parties, en laissant à ras du sol un intervalle assez large pour permettre le passage à un seul homme. Et Moubarak prit le prince par la main, et s’engagea résolument, tout le premier, dans cet étroit intervalle. Et ils marchèrent de la sorte, l’un derrière l’autre, durant une heure de temps, et arrivèrent à l’autre bout du passage. Et dès qu’ils furent sortis, les deux moitiés de la montagne se rapprochèrent et s’unirent d’une façon si parfaite, qu’elles ne laissèrent guère entre elles un interstice où pût pénétrer même la pointe d’une aiguille.
Et ils se trouvèrent, à leur sortie, sur le rivage d’un lac, grand comme la mer, du sein duquel émergeaient, dans le loin, trois îles couvertes de végétation. Et le rivage où ils étaient réjouissait la vue par les arbres, les arbustes et les fleurs qui se regardaient dans l’eau, et embaumaient l’air des plus douces senteurs, tandis que les oiseaux, sur des modes divers, chantaient des mélopées qui ravissaient l’esprit et capturaient le cœur.
Et Moubarak s’assit sur le rivage et dit à Zein : « Ô mon seigneur, tu vois, comme moi, ces îles dans le loin. Or, c’est là précisément qu’il faut que nous allions ! » Et Zein, bien surpris, demanda : « Et comment pourrons-nous traverser ce lac, vaste comme la mer, pour nous rendre à ces îles-là ? » Il répondit : « Sois sans inquiétude à ce sujet. » En effet, une barque, dans quelques instants, viendra nous prendre pour nous transporter dans ces îles, belles comme les terres promises par Allah à ses Croyants. Car c’est là que se trouve le Vieillard, propriétaire de l’adolescente de diamant. Seulement, ô mon seigneur, je te supplie, quoi qu’il puisse arriver et quoi que tu puisses voir, de ne point faire la moindre réflexion. Et surtout, ô mon seigneur, quelque singulière que puisse te paraître la figure du batelier, et quoi que tu puisses remarquer d’extraordinaire en lui, prends bien garde de bouger ! Car, si, une fois embarqués, tu as le malheur de prononcer un seul mot, la barque coulera avec nous sous les eaux ! » Et Zein, extrêmement impressionné, répondit : « Je garderai ma langue entre mes dents, et mes réflexions dans mon esprit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Je garderai ma langue entre mes dents, et mes réflexions dans mon esprit ! »
Or, comme ils parlaient ainsi, ils virent tout à coup apparaître sur le lac une barque avec un batelier, et si proche d’eux qu’ils ne surent si elle était sortie du sein de l’eau ou si elle était descendue du fond de l’air. Et cette barque était en bois de sandal rouge avec, en son milieu, un mât de l’ambre le plus fin, et des cordages de soie. Quant au batelier, il avait un corps d’être humain, fils d’Adam ; mais sa tête ressemblait à celle d’un éléphant, et possédait deux oreilles qui tombaient jusqu’à terre, et pendaient derrière lui comme la traîne d’Agar.
Lorsque la barque ne fut plus qu’à cinq coudées du rivage, elle s’arrêta ; et le batelier à tête d’éléphant dressa sa trompe en l’air et saisit, l’un après l’autre, les deux compagnons ; et il les transporta dans la barque, avec autant d’aisance que s’il se fût agi de deux plumes ; et il les y déposa bien doucement. Et aussitôt il plongea sa trompe dans l’eau, et, s’en servant à la fois comme de rames et de gouvernail, il s’éloigna du rivage. Et il releva ses immenses oreilles traînantes ; et il les déploya au-dessus de sa tête dans le vent, qui les gonfla comme des voiles, tumultueusement. Et il les manœuvra, les faisant tourner suivant le sens de la brise, avec plus de sûreté qu’un capitaine ne fait manœuvrer les agrès de son vaisseau. Et la barque, ainsi poussée, s’envola sur le lac, comme un grand oiseau.
Lorsqu’ils furent arrivés sur le rivage de l’une des îles, le batelier les reprit l’un après l’autre avec sa trompe, et les déposa sans heurt sur le sable, pour disparaître aussitôt avec sa barque.
Alors, Moubarak reprit le prince par la main, et s’enfonça avec lui dans l’intérieur de l’île, en suivant un sentier pavé, au lieu de cailloux, de pierreries de toutes les couleurs. Et ils marchèrent ainsi jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés devant un palais entièrement construit de pierres d’émeraude, entouré d’un large fossé sur les bords duquel, d’espace en espace, étaient plantés des arbres si hauts qu’ils couvraient de leur ombrage tout le palais. Et vis-à-vis de la grande porte d’entrée, qui était d’or massif, il y avait un pont fait en écaille précieuse et ayant, pour le moins, six toises de long sur trois de large.
Et Moubarak, n’osant point franchir ce pont, s’arrêta et dit au prince : « Nous ne pouvons aller plus avant. Mais si nous voulons voir le Vieillard des Trois-Îles, il faut que nous fassions une conjuration magique ! » Et, parlant ainsi, il tira d’un sac qu’il avait caché sous sa robe quatre bandes de soie jaune. Et de l’une il s’entoura la taille, et en mit une autre sur son dos. Puis il donna les autres bandes au prince, qui en fit le même usage. Et Moubarak tira alors de son sac deux tapis de prière en soie légère, les déplia par terre, et répandit dessus quelques grains de musc et d’ambre, en marmonnant des formules incantatoires. Ensuite il s’assit, les jambes repliées, au milieu de l’un de ces tapis, et dit au prince : « Mets-toi au milieu du second tapis ! » Et Zein exécuta l’ordre ; et Moubarak lui dit : « Je vais maintenant conjurer le Vieillard des Trois-Îles, qui habite ce palais. Or, fasse Allah qu’il vienne à nous sans colère ! Car je t’avoue, ô mon seigneur, que je ne suis guère rassuré sur la façon dont il va nous recevoir, ni sans inquiétude sur les conséquences de notre entreprise. En effet, si notre arrivée dans cette île ne lui agrée point, il paraîtra à nos yeux sous la forme d’un monstre effroyable ; mais s’il n’est pas offusqué de notre venue, il se montrera sous la forme d’un Adamite de la bonne qualité. Mais toi, dès qu’il sera devant nous, il faudra te lever en son honneur et, sans sortir du milieu du tapis, tu lui feras les salams les plus respectueux, et tu lui diras : « Ô puissant maître, souverain des souverains, nous voici debout dans l’enceinte de ta juridiction, et entrés sous la porte de ta protection ! Or moi, ton esclave, je suis Zein, sultan de Bassra, fils du défunt sultan qui a été emporté par l’ange de la mort, après avoir trépassé dans la paix de son Seigneur. Et je viens solliciter de ta générosité et de la puissance les mêmes faveurs que tu avais accordées à mon défunt père, ton serviteur ! » Et s’il te demande quelle grâce tu veux qu’il t’accorde, tu lui répondras : « Ô mon souverain, c’est la septième adolescente de diamant que je viens solliciter de ta générosité ! » Et Zein répondit : « J’écoute et j’obéis ! »
Alors, Moubarak, ayant fini de la sorte d’instruire le prince Zein, commença à faire des conjurations, des fumigations, des récitations, des adjurations et des incantations qui n’avaient pour Zein aucune signification. Et, aussitôt après, le soleil fut enseveli sous un amoncellement de nuages noirs, et toute l’île se couvrit d’épaisses ténèbres, et un long éclair brilla qui fut suivi d’un coup de tonnerre. Et il s’éleva un vent furieux qui souffla dans leur direction ; et ils entendirent un cri épouvantable qui ébranla l’air ; et la terre eut un tremblement pareil à celui que l’ange Israfil doit causer au jour du jugement.
Lorsque Zein eut vu et entendu tout cela, il se sentit pris d’une grande émotion, qu’il eut soin toutefois de ne pas laisser voir ; et il pensa en lui-même : « Par Allah ! c’est là un bien mauvais présage. » Mais Moubarak, qui devinait ce qu’il ressentait, se mit à sourire et lui dit : « N’aie pas peur, ô mon seigneur ! Ces signes, au contraire, doivent nous rassurer ! Avec l’aide d’Allah, tout va bien ! »
En effet, à l’instant même où il prononçait ces mots…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… En effet, à l’instant même où il prononçait ces mots, le Vieillard des Trois-Îles apparut devant eux, sous la forme d’un Adamite à l’aspect vénérable, et si beau qu’il n’y avait, pour le surpasser en perfection, que Celui-là seul à qui appartient toute beauté, toute qualité et toute gloire ! (Qu’Il soit exalté !) Et il s’approcha de Zein, en lui souriant comme sourit un père à son enfant. Et Zein se hâta de se lever en son honneur, sans toutefois quitter le centre du tapis, pour ensuite s’incliner devant lui et embrasser la terre entre ses mains. Et il ne manqua point de lui faire les salams et les compliments que lui avait enseignés Moubarak. Et alors seulement il lui exposa le motif de sa venue dans l’île.
Lorsque le Vieillard des Îles eut entendu les paroles de Zein et qu’il en eut bien compris la signification, il sourit d’un sourire encore plus engageant, et dit à Zein : « Ô Zein, en vérité j’aimais ton père d’un grand amour ; et, toutes les fois qu’il venait me visiter, je lui faisais don d’une adolescente de diamant ; et je prenais soin de la lui faire transporter moi-même à Bassra, de crainte que les chameliers ne l’endommageassent. Mais ne crois point que j’aie moins d’amitié pour toi, ô Zein ! Sache, en effet, que c’est moi-même qui, de mon propre mouvement, ai voulu promettre à ton père de te prendre sous ma protection, et l’ai poussé à écrire les deux avertissements et à les cacher, l’un, dans l’Armoire-des-Papiers et, l’autre, dans le coffret du souterrain. Et me voici prêt à te donner l’adolescente de diamant qui vaut à elle seule toutes les autres réunies et mille autres pareilles. Seulement, ô Zein, je ne pourrai te faire ce cadeau merveilleux qu’en échange d’un autre que je veux te demander ! » Et Zein répondit : « Par Allah ! ô mon seigneur, tout ce qui m’appartient est ta propriété, et moi-même je suis compris dans ce qui t’appartient ! » Et le Vieillard sourit et répondit : « Oui, ô Zein, mais ma demande sera bien difficile à satisfaire ! Et je ne sais si tu pourras jamais réussir à me contenter ! » Il demanda : « Et quelle est-elle ? » Il dit : « C’est qu’il faut que tu me trouves, pour me l’amener dans cette île, une adolescente de quinze ans, qui soit à la fois une vierge intacte et une beauté sans rivale ! » Et Zein s’écria : « Si c’est là tout ce que tu me demandes, ô mon seigneur, par Allah ! il me sera bien aisé de te satisfaire. Car rien n’est plus commun dans nos pays que les adolescentes de quinze ans à la fois vierges et belles ! »
À ces paroles, le Vieillard regarda Zein et se mit à rire tellement qu’il se renversa sur le derrière. Et lorsqu’il se fut un peu calmé, il demanda à Zein : « Est-il donc si facile de trouver ce que je te demande, ô Zein ? » Et Zein répondit : « Ô mon seigneur, je puis te procurer non seulement une, mais dix adolescentes comme celle que tu me demandes ! Quant à moi, j’ai déjà eu dans mon palais un nombre considérable d’adolescentes de cette variété-là, et elles étaient bien intactes, et je me suis bien délecté en leur ravissant leur virginité ! » Et le Vieillard, en entendant ces paroles, ne put s’empêcher d’éclater de rire pour la seconde fois. Puis il dit, d’un ton plein de pitié, à Zein : « Sache, mon fils, que ce que je te demande est une chose si rare, que nul jusqu’aujourd’hui n’a pu me l’apporter. Et si tu penses que les adolescentes que tu as possédées étaient des vierges, tu te trompes et t’illusionnes ! Car tu ne sais pas que les femmes ont mille moyens de faire croire à leur virginité ; et elles réussissent à tromper les hommes les plus expérimentés en assauts. Mais, comme je vois, par l’assurance de tes paroles, que tu ne sais rien à leur sujet, je veux te fournir le moyen de contrôler leur état d’ouverture ou de fermeture, sans les toucher du doigt, sans les déshabiller et sans qu’elles puissent s’en douter ! Car du moment que je te demande une adolescente vierge, il est essentiel que nul homme ne l’ait touchée ni qu’il ait vu avec ses yeux ses organes délicats ! »
Lorsque le jeune Zein eut entendu ces paroles du Vieillard des Îles, il se dit : « Par Allah ! il doit être fou. Si, comme il le prétend, il est tellement difficile de savoir si une adolescente est intacte, comment veut-il que je puisse lui en trouver une sans la voir ni la toucher ! » Et il réfléchit pendant un moment, et tout à coup il s’écria : « Par Allah ! je le sais maintenant. Ce sera son odeur qui me mettra sur la voie ! » Le Vieillard sourit et dit : « La virginité n’a point d’odeur ! » Il dit : « Ce sera, en la regardant fixement dans les yeux ! » Il dit : « La virginité ne se lit point dans les yeux ! » Il demanda : « Mais alors, comment faut-il que je fasse, ô mon seigneur ? » Il dit : « C’est cela précisément que je vais t’indiquer ! »
Et soudain il disparut à leurs yeux ; mais ce fut pour revenir au bout d’un moment ; et il tenait dans sa main un miroir. Et il se tourna vers Zein et lui dit : « Je dois te dire, ô Zein, qu’il est impossible à un fils d’Adam de reconnaître, à sa mine, si une fille d’Ève est vierge ou perforée. Et c’est une connaissance qui n’appartient qu’à Allah et aux élus d’Allah. Aussi, comme je ne puis m’en remettre à toi là-dessus, je t’apporte, pour te le donner, le miroir qui sera plus sûr que toutes les conjectures des hommes. Or, toi, dès que tu auras vu une adolescente de quinze ans parfaitement belle, et que tu croiras vierge ou qu’on te donnera comme telle, tu n’auras qu’à regarder dans ce miroir. Et aussitôt tu y verras t’apparaître l’image de l’adolescente en question. Et, toi, ne crains pas de bien examiner cette image : car la vue d’une image dans un miroir ne porte point atteinte à la virginité d’un corps, comme le fait la vue directe du corps lui-même. Or, si l’adolescente n’est pas vierge, tu le verras bien à l’examen de son histoire qui t’apparaîtra grossie et béante comme un abîme ; et tu verras également le miroir se ternir comme d’une buée. Mais si, au contraire, Allah veut que l’adolescente soit restée vierge, tu verras t’apparaître une histoire pas plus grosse qu’une amande décortiquée ; et le miroir se conservera clair, pur et net de toute buée…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Mais si, au contraire, Allah veut que l’adolescente soit restée vierge, tu verras t’apparaître une histoire pas plus grosse qu’une amande décortiquée ; et le miroir se conservera clair, pur et net de toute buée ! »
Et, ayant ainsi parlé, le Vieillard des Îles remit le miroir magique à Zein, en ajoutant : « Je souhaite, ô Zein, que la destinée te fasse rencontrer au plus tôt la vierge de quinze ans que je te demande. Et n’oublie pas qu’il faut qu’elle soit parfaitement belle ! Car à quoi sert la virginité sans la beauté ? Et prends bien soin de ce miroir, dont la perte serait pour toi un dommage irréparable ! » Et Zein répondit par l’ouïe et l’obéissance, et, après avoir pris congé du Vieillard des Trois Îles, il reprit avec Moubarak le chemin du lac. Et le batelier à tête d’éléphant vint à eux avec sa barque et les repassa de la même manière qu’il les avait passés. Et la montagne s’ouvrit de nouveau pour leur livrer passage. Et ils se hâtèrent d’aller retrouver les esclaves qui gardaient les chevaux. Et ils retournèrent au Caire.
Or, le prince Zein consentit à prendre enfin quelques jours de repos, dans le palais de Moubarak, pour se remettre des fatigues et des émotions du voyage. Et il pensait : « Ya Allah ! comme il est naïf, ce Vieillard des Îles qui n’hésite pas à me donner la plus merveilleuse de ses adolescentes de diamant en échange d’une Adamite vierge ! Et il s’imagine que la race des vierges s’est éteinte sur la face de la terre ! » Puis, lorsqu’il eut jugé qu’il avait pris le repos nécessaire, il appela Moubarak et lui dit : « Ô Moubarak, levons-nous et allons-nous-en à Baghdad et à Bassra, où les filles vierges sont innombrables comme les sauterelles. Et nous choisirons entre elles toutes la plus belle. Et nous reviendrons l’offrir, en échange de l’adolescente de diamant, au Vieillard des Trois Îles ! » Mais Moubarak répondit : « Et pourquoi donc, ô mon seigneur, aller si loin chercher ce que nous avons sous notre main ? Ne sommes-nous donc point au Caire, la ville des villes, le séjour préféré des gens délicieux et le rendez-vous de toutes les beautés de la terre ? Ne te préoccupe donc pas de cette recherche-là, et laisse-moi agir en conséquence ! » Il demanda : « Et comment vas-tu faire ? » Il dit : « Je connais, entre autres connaissances, une vieille rouée fort experte en adolescentes, et qui nous en procurera plus que nous n’en désirons. Je vais donc la charger de nous amener ici toutes les jeunes filles de quinze ans qui se trouvent non seulement au Caire, mais dans toute l’Égypte. Et je lui recommanderai, pour nous rendre la besogne plus facile, de faire elle-même un premier choix, en ne nous amenant ici que celles qu’elle aura jugées dignes d’être offertes en cadeau aux rois et aux sultans. Et je lui promettrai, pour attiser son zèle, un somptueux bakhchich. Et de la sorte elle ne laissera pas en Égypte une jeune fille présentable qu’elle ne nous l’ait amenée, au su ou à l’insu de ses parents. Et nous, nous fixerons notre choix sur celle qui nous aura paru la plus belle parmi les Égyptiennes, et nous l’achèterons ; ou, si elle appartient à une famille de notables, je la demanderai pour toi en mariage et tu te marieras avec elle, pour la forme seulement ; car il sera entendu que tu ne la toucheras pas. Après quoi nous irons à Damas, puis à Baghdad et à Bassra ; et là nous ferons faire les mêmes recherches. Et dans chaque ville nous achèterons, ou nous nous procurerons, par le mariage apparent, celle qui nous aura le plus frappés par sa beauté, après que, bien entendu, nous aurons constaté sa virginité au moyen du miroir. Et alors seulement nous réunirons toutes les adolescentes que nous aurons eues de cette manière-là, et nous choisirons entre elles celle qui nous paraîtra, sans conteste, la plus merveilleuse. Et, de la sorte, mon seigneur, tu auras tenu ta promesse au Vieillard des Trois Îles qui, à son tour, tiendra la sienne en te donnant, en échange de la merveilleuse vierge de quinze ans, l’adolescente de diamant ! » Et Zein répondit : « Ton idée, ô Moubarak, est tout à fait excellente ! Et ta langue vient de sécréter les paroles de la sagesse et de l’éloquence ! »
Alors, Moubarak alla trouver la vieille rouée en question, qui n’avait point sa pareille pour les expédients et artifices de toutes sortes, car elle était capable de donner des leçons de finesse, de fourberie et subtilité à Éblis lui-même. Et, après lui avoir mis dans la main, pour commencer, un bakhchich d’une certaine importance, il lui exposa le motif qui l’amenait chez elle, et ajouta : « Car cette adolescente incomparablement belle et tout à fait vierge que je te demande à choisir entre toutes les adolescentes de quinze ans qui se trouvent en Égypte est destinée à devenir l’épouse du fils de mon maître. Et sois bien certaine que tes recherches et peines seront largement rétribuées. Et tu n’auras qu’à te louer de notre générosité ! » Et la vieille répondit : « Ô mon maître, tranquillise ton esprit et rafraîchis les yeux, car moi, par Allah ! je vais me consacrer à satisfaire ton désir au delà de ce que tu me demandes. Sache, en effet, que j’ai sous ma main des jeunes vierges de quinze ans, inégalables en grâces et en beauté et qui sont toutes filles d’hommes honorables et de notables. Et je te les amènerai toutes, l’une après l’autre ; et tu seras bien perplexe pour faire un choix entre toutes ces lunes plus merveilleuses les unes que les autres ! »
Ainsi parla la vieille rouée. Mais, malgré toute sa finesse et sa science, elle ne savait rien du tout au sujet du miroir. Aussi ce fut avec son assurance habituelle qu’elle sortit rôder à travers la ville, dans les voies et chemins de ses expédients, à la recherche des adolescentes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Aussi, ce fut avec son assurance habituelle qu’elle sortit rôder à travers la ville, dans les voies et chemins de ses expédients, à la recherche des adolescentes. Et effectivement elle ne tarda pas à amener au palais de Moubarak un premier lot, fort considérable, d’adolescentes de choix, toutes âgées de quinze ans, plutôt moins que plus, et toutes intactes quant à leur virginité. Et elle les introduisit l’une après l’autre, enveloppées de leurs voiles, avec leurs yeux modestement baissés, dans la salle où les attendait le prince Zein, muni de son miroir et assis à côté du marchand Moubarak. Et vraiment, à voir toutes ces paupières baissées et ces visages candides et ce maintien pudique, nul n’aurait pu douter de la pureté et de la virginité des adolescentes que la vieille introduisait. Mais voilà ! Il y avait le miroir, et rien ne pouvait tromper le miroir, ni les paupières baissées, ni les visages candides, ni le maintien pudique. En effet, chaque fois qu’entrait une adolescente, le prince Zein, sans prononcer une parole, tournait la face du miroir du côté de l’adolescente à inspecter, et regardait. Et elle apparaissait toute nue, malgré les nombreux vêtements qui la recouvraient ; et aucune partie de son corps ne restait invisible ; et son histoire se reflétait dans ses moindres détails, tout comme si elle était placée dans un coffret de cristal diaphane.
Or, chaque fois que le prince Zein inspectait au miroir les adolescentes qui entraient, il était loin de voir une histoire minuscule en forme d’amande sans écorce ; et il s’étonnait prodigieusement de constater dans quel abîme sans fond il aurait pu inconsidérément se jeter ou jeter le Vieillard des Trois Îles, sans le secours du miroir magique. Et il renvoyait, après examen, toutes celles qui entraient, sans toutefois expliquer à la vieille le vrai motif de son abstention ; car il ne voulait pas faire tort à ces jeunes filles, en dévoilant ce qu’Allah avait voilé, et en révélant ce qui était ordinairement caché. Et il se contentait, chaque fois, d’essuyer du revers de sa manche l’épaisse buée qui venait, après que l’image avait apparu, ternir la face du miroir. Et la vieille, sans se décourager et excitée par l’espoir de la rémunération, lui amena un second lot encore plus important que le premier, et un troisième et un quatrième et un cinquième lots, mais sans plus de résultat que la première fois. Et de la sorte, ô Zein, tu vis les histoires des Égyptiennes, des Cophtes, des Nubiennes, des Abyssines, des Soudaniennes, des Maghrébines, des Arabes et des Bédouines ! Et, certes ! dans le nombre, il y en avait qui étaient excellentes au possible, et appartenaient à des propriétaires incomparablement belles et délicieuses. Mais pas une fois, au milieu de toutes ces histoires-là, tu ne vis l’histoire requise, vierge de tout contact, semblable à une amande décortiquée !
Et c’est pourquoi le prince et Moubarak, n’ayant pu trouver en Égypte, pas plus parmi les filles des grands que parmi celles du peuple, une adolescente remplissant les conditions nécessaires, jugèrent qu’il ne leur restait plus qu’à quitter ce pays, pour aller d’abord en Syrie continuer leurs recherches. Et ils partirent pour Damas, et louèrent un magnifique palais dans le quartier le plus beau de la ville. Et Moubarak entra en rapport avec les vieilles femmes marieuses et avec les entremetteuses, et leur exposa ce qu’il avait à leur exposer. Et toutes lui répondirent par l’ouïe et l’obéissance. Et elles entrèrent en pourparlers avec les adolescentes, filles des grands et des petits, aussi bien avec les musulmanes qu’avec les juives et les chrétiennes. Et, ne se doutant pas des vertus du miroir magique, dont elles ignoraient d’ailleurs jusqu’à l’existence, elles les amenèrent à tour de rôle dans la salle réservée à l’inspection. Mais il arriva pour les Syriennes exactement ce qui était arrivé pour les Égyptiennes et les autres ; car, malgré leur maintien modeste et la pureté de leurs regards et leurs joues rougissantes de pudeur et leurs quinze ans, elles se trouvèrent toutes être perforées quant à leurs histoires. Et, dans ces conditions, aucune d’elle ne fut agréée. Et les entremetteuses et les autres vieilles furent obligées de s’en retourner avec leurs nez allongés jusqu’à leurs pieds. Et voilà pour elles !
Mais pour ce qui est du prince Zein et de Moubarak, voici ! Lorsqu’ils eurent constaté que la Syrie, aussi bien que l’Égypte, était complètement dénuée d’adolescentes aux histoires encore scellées, ils furent bien stupéfaits ; et Zein pensa : « Cela est énorme ! » Et il dit à Moubarak : « Ô Moubarak, je crois que nous n’avons plus rien de commun avec ce pays, et qu’il nous faut chercher, dans d’autres contrées, ce que nous désirons. Car mon cœur et mon esprit travaillent beaucoup au sujet de la septième adolescente de diamant ; et je suis toujours prêt à continuer les recherches pour trouver la vierge de quinze ans qui doit être donnée, en échange de son cadeau, au Vieillard des Îles ! » Et Moubarak répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il ajouta : « Mon avis est qu’il est inutile d’aller ailleurs que dans l’Irak. Car c’est là seulement que nous avons chance de rencontrer ce que nous cherchons. Préparons donc la caravane et allons à Baghdad, la cité de paix…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Préparons donc la caravane et allons à Baghdad, la cité de paix ! »
Et Moubarak fit les préparatifs du départ, et lorsque la caravane fut au complet, il prit avec le prince Zein le chemin qui, à travers le désert, conduit à Baghdad. Et Allah leur écrivit la sécurité ; et ils ne firent aucune rencontre de Bédouins coupeurs de routes ; et ils arrivèrent en bonne santé dans la cité de paix.
Or, ils commencèrent, comme ils l’avaient fait à Damas, par louer un palais, situé sur le Tigre et qui avait une vue merveilleuse et un jardin semblable au Jardin-des-Délices du khalifat. Et ils y menèrent un train extraordinaire, faisant bonne chère et donnant des festins à nuls autres pareils. Et, une fois que leurs invités avaient mangé et bu jusqu’à satiété, ils faisaient distribuer les restes aux pauvres et aux derviches. Et parmi ces derviches il y en avait un qui s’appelait Abou-Bekr, et qui était une crapule, une canaille tout à fait détestable, qui haïssait les gens riches, précisément parce qu’ils étaient riches et qu’il était pauvre. Car la misère endurcit le cœur de l’homme doué d’une âme basse, tandis qu’elle ennoblit le cœur de l’homme doué d’une âme élevée. Et comme il voyait l’abondance et les biens d’Allah dans la demeure des nouveaux venus, il ne lui en fallut pas davantage pour les prendre tous deux en aversion. Aussi, un jour d’entre les jours, il vint à la mosquée pour la prière de l’après-midi, et il se tint au milieu du peuple assemblé, et s’écria : « Ô Croyants, vous devez savoir que dans notre quartier sont venus loger deux étrangers qui dépensent tous les jours des sommes immenses et font parade de leurs richesses, uniquement pour offusquer les yeux des pauvres comme nous. Or, nous ne savons point qui sont ces étrangers-là, et nous ignorons si ce ne sont pas des scélérats qui ont volé dans leur pays des biens considérables, pour venir dépenser à Baghdad le produit de leurs larcins et l’argent des veuves et des orphelins ! Je vous adjure donc par le nom d’Allah et les mérites de notre seigneur Môhammad (sur Lui la prière et la paix !) de vous mettre en garde contre ces inconnus et de ne rien accepter de leur fausse générosité ! D’ailleurs, si notre maître le khalifat venait à apprendre qu’il y a des hommes de cette sorte dans notre quartier, il nous rendrait tous responsables de leurs méfaits et nous châtierait de ne l’en avoir pas averti. Mais, pour ce qui est de moi, je tiens à vous déclarer que je retire mes deux mains de cette affaire-là, et que je n’ai rien de commun avec ces étrangers et avec ceux qui acceptent leurs invitations et entrent dans leur maison ! » Et tous ceux qui étaient présents répondirent d’une seule voix : « Certes ! tu as raison, ô cheikh Abou-Bekr ! Et nous te chargeons de rédiger une plainte au khalifat à ce sujet-là, pour qu’il fasse examiner leur cas ! » Puis toute l’assemblée sortit de la mosquée. Et le derviche Abou-Bekr rentra chez lui pour méditer sur le moyen de nuire aux deux étrangers.
Sur ces entrefaites, Moubarak ne tarda pas à apprendre, par un décret de la destinée, ce qui venait de se passer à la mosquée ; et il eut de grandes craintes au sujet des menées du derviche ; et il pensa que si la chose s’ébruitait, il ne pourrait plus inspirer confiance aux entremetteuses et aux marieuses. Aussi, sans perdre de temps, il mit cinq cents dinars d’or dans un sac et courut à la maison du derviche. Et il frappa à la porte ; et le derviche vint lui ouvrir et, l’ayant reconnu, il lui demanda d’un ton courroucé : « Qui es-tu ? Et que veux-tu ? » Et il répondit : « Je suis Moubarak, ton esclave, ô mon maître l’imam Abou-Bekr ! Et je viens vers toi de la part de l’émir Zein qui a entendu parler de ta science, de tes connaissances et de ton influence dans la ville ; et il m’a envoyé pour te présenter ses hommages et se mettre à ton entière disposition. Et, pour te marquer son bon vouloir, il m’a chargé de te remettre cette bourse de cinq cents dinars, comme hommage d’un féal à son souverain, en s’excusant auprès de toi de ce que le cadeau n’est guère proportionné à l’immensité de tes mérites. Mais, si Allah veut, il ne manquera pas, dans les jours à venir, de te prouver encore mieux combien il est ton obligé et le perdu dans le désert sans bornes de ta bienveillance ! »
Lorsque le derviche Abou-Bekr eut vu le sac de l’or et supputé son contenu, il devint bien tendre quant à ses yeux et bien doux quant à ses intentions. Et il répondit : « Ô mon seigneur, j’implore ardemment mon pardon de ton maître l’émir pour ce que ma langue a pu dire d’inconsidéré sur son compte ; et je me repens à la limite du repentir d’avoir failli à mes devoirs à son égard ! Je te prie donc d’être mon délégué auprès de lui pour lui exposer ma contrition pour le passé et mes dispositions pour l’avenir. Car dès aujourd’hui, si Allah veut, je veux réparer en public ce que j’ai pu commettre d’inconsidéré, et mériter de la sorte les faveurs de l’émir ! » Et Moubarak répondit : « Louanges à Allah qui remplit ton cœur de bonnes intentions, ô mon maître Abou-Bekr ! Mais je te supplie de ne point oublier de venir, après la prière, honorer notre seuil de ta présence et exalter notre esprit de ta société ! Car nous savons que la bénédiction accompagnera, dans notre demeure, les pas de ta sainteté ! » Et, ayant ainsi parlé, il baisa la main du derviche et s’en retourna à la maison.
Quant à Abou-Bekr, il ne manqua pas d’aller à la mosquée, à l’heure de la prière ; et là, debout au milieu des fidèles rassemblés, il s’écria : « Ô Croyants, mes frères, vous savez qu’il n’y a personne qui n’ait ses ennemis ; et vous savez également que l’envie s’attache principalement sur les traces de ceux sur qui sont descendues les faveurs et les bénédictions d’Allah ! Or, je tiens aujourd’hui, pour libérer ma conscience, à vous dire que les deux étrangers dont je vous ai parlé hier inconsidérément sont des personnes douées de noblesse, de tact, de vertus et de qualités inestimables. De plus, les renseignements que j’ai pris sur leur compte m’ont permis d’établir que l’un d’eux est un émir de haut rang et de grand mérite ; et sa présence ne peut que faire du bien à notre quartier. Il faut donc que vous l’honoriez partout où vous le rencontrerez, et que vous lui rendiez les honneurs dus à son rang et à sa qualité. Ouassalam ! »
Et le derviche Abou-Bekr détruisit ainsi dans l’esprit de ses auditeurs l’effet de ses paroles de la veille. Et il les quitta pour rentrer chez lui changer d’habits et se vêtir d’un caban tout neuf dont les pans traînaient jusqu’à terre et dont les larges manches s’allongeaient jusqu’à ses genoux. Et il alla rendre visite au prince Zein, et entra dans la salle réservée aux visiteurs…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il alla rendre visite au prince Zein, et entra dans la salle réservée aux visiteurs. Et il s’inclina jusqu’à terre en présence du prince, qui lui rendit son salam et le reçut avec cordialité et l’invita à s’asseoir à côté de lui sur le divan. Puis il lui fit servir à manger et à boire, et lui tint compagnie, en partageant le repas avec lui et avec Moubarak. Et ils causèrent comme deux excellents amis. Et le derviche, complètement gagné par les manières du prince, lui demanda : « Ô mon seigneur Zein, penses-tu illuminer longtemps notre ville de ta présence ? » Et Zein qui, malgré son jeune âge, était fort avisé et savait tirer profit des occasions fournies par la destinée, lui répondit : « Oui, ô mon maître l’imam. Mon intention est de demeurer à Baghdad jusqu’à ce que mon but soit atteint ! » Et Abou-Bekr dit : « Ô mon seigneur l’émir, quel est le noble but que tu poursuis ? Ton esclave serait fort aise s’il pouvait t’aider en quelque chose, et il se dévouerait de tout cœur amical à tes intérêts ! » Et le prince Zein répondit : « Sache alors, ô vénérable cheikh Abou-Bekr, que mon souhait est le mariage. Je désire, en effet, trouver, pour la prendre comme épouse, une jeune fille de quinze ans qui soit à la fois excessivement belle et tout à fait vierge. Et il faut que sa beauté soit telle qu’elle n’ait pas sa pareille parmi les jeunes filles de son temps, et que sa virginité soit de bon aloi au dehors comme au dedans. Et c’est là le but que je poursuis, et le motif qui m’a conduit à Baghdad, après m’avoir fait séjourner en Égypte et en Syrie. » Et le derviche répondit : « Certes ! ô mon maître, c’est là une chose bien rare et bien difficile à trouver. Et, si Allah ne m’avait pas envoyé sur ton chemin, ton séjour à Baghdad n’aurait jamais vu son terme, et toutes les marieuses auraient perdu vainement leur temps dans les recherches. Or, moi, je sais où tu pourras trouver cette perle unique ; et je te le dirai, si toutefois tu le permets ! »
À ces paroles, Zein et Moubarak ne purent s’empêcher de sourire. Et Zein lui dit : « Ô saint derviche, es-tu donc bien sûr de la virginité de celle dont tu me parles ? Et, dans ce cas, comment as-tu fait pour avoir cette certitude ? Si tu as toi-même vu dans cette adolescente ce qui doit être caché, comment pourrait-elle être vierge ? Car la virginité réside aussi bien dans la conservation du sceau que dans son invisibilité ! » Et Abou-Bekr répondit : « Certes, je ne l’ai point vue ! Mais je me couperais la main droite, si elle n’était pas comme je te l’indique ! Et d’ailleurs toi-même, ô mon seigneur, comment pourras-tu faire pour avoir, avant la nuit des noces, une certitude si complète ? » Et Zein répondit : « Ce sera fort simple : je n’aurai besoin que de la voir un instant, tout habillée et complètement enveloppée de ses voiles ! » Et le derviche, par égard pour son hôte, ne voulut point rire, et se contenta de répondre : « Notre maître l’émir doit se connaître en physionomies, pour deviner de la sorte, en ne voyant que les yeux derrière le voile, l’état de la virginité chez une adolescente qu’il n’a jamais connue ! » Et Zein dit : « C’est ainsi ! Et tu n’as qu’à me faire voir l’adolescente, si vraiment tu penses que l’affaire est possible ! Et sois certain que je saurai reconnaître tes services et les estimer au delà de leur valeur ! » Et le derviche répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il sortit à la recherche de l’adolescente en question.
Or, Abou-Bekr connaissait, en effet, une jeune fille qui pouvait présenter les conditions requises, et qui n’était autre que la fille du cheikh des derviches de Baghdad. Et son père l’avait élevée loin de tous les regards, dans une vie simple et cachée, suivant les préceptes sublimes du Livre. Et elle avait grandi dans la demeure, ignorant la laideur, et poussé comme une fleur. Elle était blanche et élégante et d’une délicieuse tournure, étant sortie sans défaut du moule de la beauté. Et admirables étaient ses proportions, et noirs ses yeux, et polis comme des morceaux de lune ses membres délicats. Et elle était toute ronde d’un côté et toute fine au-dessus ! Quant à ce qui était situé entre les colonnes, nul ne saurait le décrire, ne l’ayant jamais vu. C’est pourquoi le miroir magique sera le seul qui l’aura, pour la première fois, reflété, et qui pourra en permettre la description, avec l’assentiment d’Allah !
Le derviche Abou-Bekr alla donc à la maison du cheikh de la corporation et, après les salams et les compliments de part et d’autre, lui fit un long discours, appuyé sur divers textes du Livre saint, au sujet de la nécessité du mariage pour les jeunes filles pubères ; et il finit par lui exposer la situation dans tous ses détails, en ajoutant : « Or, cet émir, si noble, si riche et si généreux, est prêt à te payer n’importe quelle dot que tu demanderas pour ta fille ; mais, en retour, il exige, comme seule condition, de jeter un seul regard sur elle, tandis qu’elle sera tout habillée, voilée et complètement enveloppée de l’izar ! » Et le cheikh des derviches, père de la jeune fille, réfléchit pendant une heure de temps, et répondit : « Il n’y a point d’inconvénient ! » Et il alla trouver son épouse, mère de la jeune fille, et lui dit : « Ô mère de Latifah, lève-toi et prends notre fille Latifah et marche derrière notre fils, le derviche Abou-Bekr, qui te conduira dans un palais où la destinée de ta fille l’attend aujourd’hui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut :
LA SEPT CENT TRENTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ô mère de Latifah, lève-toi et prends notre fille Latifah et marche derrière notre fils, le derviche Abou-Bekr, qui te conduira dans un palais où la destinée de ta fille l’attend aujourd’hui ! » Et l’épouse du cheikh des derviches obéit tout de suite et s’enveloppa de ses voiles et alla dans la chambre de sa fille et lui dit : « Ô ma fille Latifah, ton père désire qu’aujourd’hui, pour la première fois, tu sortes avec moi ! » Et, après l’avoir peignée et habillée, elle sortit avec elle et suivit, à dix pas de distance, le derviche Abou-Bekr qui les conduisit au palais où, assis sur le divan de la salle d’audience, les attendaient Zein et Moubarak.
Et tu entras, ô Latifah, avec de grands yeux noirs, bien étonnés sous le petit voile de ton visage. Car de ta vie tu n’avais vu d’autre figure d’homme que la figure vénérable du cheikh des derviches, ton père. Et tu ne baissas point les yeux, car tu ne connaissais ni la fausse modestie, ni la fausse pudeur, ni rien des choses qu’apprennent d’ordinaire les filles des hommes pour captiver les cœurs ! Mais tu regardas toutes choses avec tes beaux yeux noirs de gazelle tremblante, hésitante et charmante ! Et le prince Zein, à ton apparition, sentit sa raison s’envoler ; car parmi toutes les femmes de son palais de Bassra, et toutes les adolescentes d’Égypte et de Syrie, il n’avait point vu quelqu’une qui pût égaler, de près ou de loin, ta beauté. Et tu parus dans le miroir, reflétée et toute nue. Et il put ainsi voir, blottie au sommet des colonnes, semblable à une toute petite colombe blanche, une miraculeuse histoire scellée du sceau intact de Soleïmân (sur Lui la paix et la prière !) Et il la considéra plus attentivement, et, à la limite de la jubilation, il constata que ton histoire, ô Latifah, était en tous points semblable à une amande décortiquée. Gloire à Allah qui conserve les trésors et les réserve à ses Croyants !
Lorsque le prince Zein, grâce au miroir magique, eut ainsi trouvé l’adolescente qu’il cherchait, il chargea Moubarak d’aller faire immédiatement la demande de mariage. Et Moubarak, accompagné d’Abou-Bekr le derviche, alla aussitôt chez le cheikh des derviches, lui fit part de la demande du prince, et prit son consentement. Et il le conduisit au palais ; et on envoya chercher le kâdi et les témoins ; et l’on fit le contrat de mariage. Et l’on célébra les noces avec une pompe extraordinaire ; et Zein donna de grands festins et fit de grandes largesses aux pauvres du quartier. Et quand tous les invités furent partis, Zein retint auprès de lui le derviche Abou-Bekr et lui dit : « Sache, ô Abou-Bekr que nous partons ce soir même pour un pays assez éloigné. Et, en attendant mon retour à Bassra, mon pays, voici pour toi dix mille dinars d’or, comme rémunération de tes bons services. Mais Allah est le plus grand ! et un jour je saurai te mieux prouver ma gratitude ! » Et il lui donna les dix mille dinars, se réservant de le nommer un jour grand-chambellan, à son arrivée dans son royaume. Et, après que le derviche lui eut baisé les mains, il donna le signal du départ. Et l’adolescente vierge fut placée dans une litière, sur le dos d’un chameau. Et Moubarak ouvrit la marche, et Zein marcha le dernier. Et, accompagnés de leur suite, ils prirent le chemin des Trois Îles.
Or, les Trois Îles étant fort loin de Baghdad, le voyage dura de longs mois, pendant lesquels le prince Zein se sentait tous les jours de plus en plus gagné par les charmes de la merveilleuse enfant virginale devenue son épouse légale. Et il l’aima, dans son cœur, pour ce qu’elle avait en elle de douceur, de charmes, de gentillesse et de vertus naturelles. Et, pour la première fois, il éprouva l’effet du véritable amour qu’il n’avait jamais soupçonné jusque-là. Aussi ce fut avec une grande amertume dans le cœur qu’il vit arriver le moment de la remettre au Vieillard des Trois Îles. Et il fut bien des fois tenté de rebrousser chemin et de s’en retourner à Bassra, en emmenant l’adolescente. Mais il se sentait retenu par le serment qu’il avait fait au Vieillard des Trois Îles ; et il ne pouvait ne point le tenir !
Sur ces entrefaites, ils entrèrent dans le territoire interdit, et, par le même chemin et les mêmes moyens qu’autrefois, ils parvinrent dans l’île où demeurait le Vieillard. Et, après les salams et les compliments, Zein lui présenta l’adolescente, toute voilée. Et il lui remit, en même temps, le miroir. Et le Vieillard des Îles la regarda avec attention, sans se servir du miroir ; et ses yeux semblaient être eux-mêmes deux miroirs. Et, au bout de quelques instants, il s’approcha de Zein et, se jetant à son cou, il l’embrassa avec beaucoup d’effusion, et lui dit : « Sultan Zein, je suis, en vérité, fort content de ta diligence à me satisfaire et du résultat de tes recherches. Car l’adolescente que tu m’amènes est tout à fait celle que je souhaitais ! Elle est admirablement belle et surpasse en charmes et en perfections toutes les adolescentes de la terre ! De plus, elle est vierge d’une virginité de bon aloi, vu qu’elle est comme scellée du sceau de notre maître Soleïmân ben-Daoûd (sur eux deux la prière et la paix !) Quant à toi, tu n’as plus qu’à retourner dans tes états ; et, lorsque tu entreras dans la seconde salle en faïence où sont les six statues, tu y trouveras la septième que je t’ai promise et qui vaut, à elle seule, plus que mille autres réunies ! » Et il ajouta : « Fais maintenant comprendre à l’adolescente que tu me la laisses, et qu’elle n’a plus rien de commun avec toi ! »
À ces paroles, la charmante Latifah, qui elle aussi s’était fort attachée au beau prince Zein, poussa un profond soupir et se mit à pleurer. Et Zein se mit à pleurer également. Et, bien triste, il lui expliqua tout ce qui s’était conclu entre lui et le Vieillard des Îles, et lui dit : « Tu es divorcée ! » Et, sanglotant, il sortit de chez le Vieillard des Îles, tandis que Latifah s’évanouissait de douleur. Et, après avoir baisé la main du Vieillard, il reprit avec Moubarak le chemin de Bassra. Et, durant tout le voyage, il ne cessait de penser à cette si charmante et si douce Latifah ; et il se reprochait amèrement de l’avoir trompée, en lui faisant croire qu’elle était devenue son épouse ; et il se regardait comme la cause de leur malheur à tous deux. Et il ne pouvait s’en consoler.
Or, ce fut dans cet état de désolation qu’il arriva enfin à Bassra, où les grands et les petits, charmés de son retour, firent de grandes réjouissances. Mais le prince Zein, devenu bien triste, ne prenait point part à ces fêtes, et, malgré les instances de son fidèle Moubarak, se refusait à descendre dans le souterrain où devait se trouver l’adolescente de diamant si longtemps attendue, si longtemps souhaitée. Enfin, cédant aux conseils de Moubarak, qu’il avait nommé vizir dès son arrivée à Bassra, il consentit à descendre au souterrain. Et il traversa la salle de porcelaine et de cristal, toute rutilante de dinars et de poudre d’or, et pénétra dans la salle de faïence verte creusée d’or…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TRENTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il traversa la salle de porcelaine et de cristal, toute rutilante de dinars et de poudre d’or, et pénétra dans la salle de faïence verte creusée d’or. Et il vit les six statues à leurs places respectives ; et il jeta un regard las sur le septième piédestal d’or. Et voici ! Debout et souriante se tenait une adolescente nue, plus brillante que le diamant, que le prince Zein, à la limite de l’émotion, reconnut pour celle qu’il avait conduite dans les Trois Îles. Et, immobilisé, il ne sut qu’ouvrir la bouche, sans pouvoir prononcer un seul mot. Et Latifah lui dit : « Oui ! c’est bien moi Latifah, celle que tu ne t’attendais pas à trouver ici ! Hélas ! tu venais dans l’espoir de posséder quelque chose de plus précieux que moi ! » Et Zein put enfin s’exprimer, et s’écria : « Non, par Allah ! ô ma maîtresse, je ne suis descendu ici que malgré mon cœur qui ne travaillait qu’à ton sujet ! Mais béni soit Allah qui a permis notre réunion ! »
Et, comme il prononçait ces derniers mots, un coup de tonnerre se fit entendre qui fit trembler la souterrain, et, au même moment, parut le Vieillard des Îles. Et il souriait avec bonté. Et il s’approcha de Zein, et lui prit la main et la mit dans la main de l’adolescente, en lui disant : « Ô Zein, sache que dès ta naissance je t’ai pris sous ma protection. Je devais donc assurer ton bonheur. Et je ne pouvais le mieux faire qu’en te donnant le seul trésor qui soit inestimable. Et ce trésor, plus beau que toutes les adolescentes de diamant et toutes les pierreries de la terre, c’est cette jeune fille vierge. Car la virginité, unie à la beauté du corps et à l’excellence de l’âme, est la thériaque qui dispense de tous les remèdes et tient lieu de toutes les richesses ! » Et, ayant ainsi parlé, il embrassa Zein et disparut.
Et le sultan Zein et son épouse Latifah, à la limite du bonheur, s’aimèrent d’un grand amour, et vécurent de longues années dans la vie la plus délicieuse et la plus choisie, jusqu’à ce que vînt les visiter la Séparatrice inévitable des amis et des sociétés ! Gloire au Seul Vivant qui ne connaît pas la mort !
— Lorsque Schahrazade eut fini de raconter cette histoire, elle se tut. Et le roi Schahriar dit : « Ce Miroir des Vierges, Schahrazade, est extrêmement étonnant ! » Et Schahrazade sourit et dit : « Oui, ô Roi ! Mais qu’est-il en comparaison de la Lampe Magique ? » Et le roi Schahriar demanda : « Quelle est cette lampe magique que je ne connais pas ? » Et Schahrazade dit : « C’est la lampe d’Aladdin ! Et je vais justement t’en parler ce soir ! » Et elle dit :
HISTOIRE D’ALADDIN ET DE LA
LAMPE MAGIQUE
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, ô doué de bonnes manières, qu’il y avait — mais Allah est plus savant — en l’antiquité du temps et le passé des âges et des moments, dans une ville d’entre les villes de la Chine, dont je ne me rappelle pas le nom pour l’instant, un homme qui était tailleur de profession et pauvre de condition. Et cet homme avait un fils nommé Aladdin[1], qui était un garçon tout à fait à rebours comme éducation, et qui paraissait être, dès son enfance, un gamin bien fâcheux. Or, lorsqu’il eut atteint l’âge de dix ans, son père voulut d’abord lui faire apprendre quelque métier honorable ; mais, comme il était fort pauvre, il ne put subvenir aux frais de l’instruction, et il dut se contenter de prendre avec lui l’enfant à la boutique, pour lui enseigner son propre métier, le travail à l’aiguille. Mais Aladdin, qui était un enfant dévoyé, habitué à jouer avec les jeunes garçons du quartier, ne put s’astreindre à rester un seul jour à la boutique. Au contraire ! au lieu d’être attentif au travail, il guettait l’instant où son père était obligé soit de s’absenter pour quelque affaire, soit de tourner le dos pour s’occuper d’un client, et aussitôt il détalait en toute hâte et courait rejoindre dans les ruelles et les jardins les jeunes vauriens qui lui ressemblaient. Et telle était la conduite de ce garnement qui ne voulait ni obéir à ses parents ni apprendre le travail de la boutique. Aussi son père, fort chagriné et désespéré d’avoir un fils enclin à tous les vices, finit par l’abandonner à son libertinage ; et, dans sa douleur, il fit une maladie dont il mourut. Mais cela ne corrigea point Aladdin de sa mauvaise conduite, pas du tout !
Alors la mère d’Aladdin, voyant que son époux était mort et que son fils n’était qu’un vaurien dont il n’y avait rien à faire, se décida à vendre la boutique et tous les ustensiles de la boutique, afin de pouvoir subsister quelque temps avec le produit de la vente. Mais comme cela fut bien vite épuisé, elle dut prendre l’habitude de passer ses jours et ses nuits à filer la laine et le coton pour tâcher de gagner quelque chose dont se nourrir et nourrir son fils, le garnement.
Quant à Aladdin, lorsqu’il se vit délivré de la crainte de son père, il n’eût plus aucune sorte de retenue et s’enfonça bien plus dans la gaminerie et la perversité. Et il passait ainsi toutes ses journées hors de la maison, pour n’y rentrer que juste aux heures des repas. Et la pauvre mère, cette malheureuse, continua, malgré tous les torts de son fils à son égard et l’abandon où il la laissait, à le faire vivre du travail de ses mains et du produit de ses veilles, en pleurant toute seule des larmes bien amères. Et ce fut ainsi qu’Aladdin atteignit l’âge de quinze ans. Et il était vraiment beau et bien fait, avec deux magnifiques yeux noirs, et un teint de jasmin, et un aspect séduisant, tout à fait.
Or, un jour d’entre les jours, comme il était au milieu de la place située à l’entrée des souks du quartier, uniquement occupé à jouer avec les petits gamins et les vagabonds de son espèce, un derviche maghrébin vint à passer par là, qui s’arrêta à regarder obstinément les enfants. Et il finit par attacher ses regards sur Aladdin et par l’observer d’une façon bien singulière et avec une attention toute particulière, sans plus s’occuper des autres petits garçons, ses camarades. Et ce derviche, qui venait du fin fond du Maghreb, des contrées de l’intérieur lointain, était un insigne magicien fort versé dans l’astrologie et la science des physionomies ; et il pouvait, par la puissance de sa sorcellerie, faire se mouvementer et se heurter les unes contre les autres les plus hautes montagnes. Il continua donc à observer Aladdin avec beaucoup d’insistance, en pensant : « Le voilà enfin le garçon qu’il me faut, celui que je cherche depuis si longtemps, et pour lequel je suis parti du Maghreb, mon pays…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TRENTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Le voilà enfin le garçon qu’il me faut, celui que je cherche depuis si longtemps, et pour lequel je suis parti du Maghreb, mon pays ! » Et il s’approcha doucement de l’un des petits garçons, sans toutefois perdre Aladdin de vue, le prit à part sans se faire remarquer, et s’informa minutieusement auprès de lui du père et de la mère d’Aladdin, ainsi que de son nom et de sa condition. Et, muni de ces renseignements, il s’approcha d’Aladdin, en souriant, réussit à l’attirer dans un coin, et lui dit : « Ô mon enfant, n’es-tu point Aladdin, fils du tailleur tel ? » Et Aladdin répondit : « Oui, je suis Aladdin. Quant à mon père, il y a bien longtemps qu’il est mort ! » À ces paroles, le derviche maghrébin se jeta au cou d’Aladdin, et le prit dans ses bras, et se mit à le baiser sur les joues fort longtemps, en pleurant sur lui, à la limite de l’émotion. Et Aladdin, extrêmement surpris, lui demanda : « Quelle est la cause de tes larmes, seigneur ? Et d’où connais-tu le défunt, mon père ? » Et le Maghrébin, d’une voix triste et comme brisée, répondit : « Ah ! mon enfant, comment pourrais-je ne point verser les larmes du deuil et de la douleur, alors que je suis ton oncle, et que tu viens de me révéler, d’une manière si inattendue, la mort de mon pauvre frère, ton défunt père ? Ô fils de mon frère, sache, en effet, que j’arrive dans ce pays, après avoir quitté ma patrie et affronté les dangers d’un long voyage, uniquement dans l’espoir joyeux de revoir ton père et d’éprouver avec lui le bonheur du retour et de la réunion ! Et voici, hélas ! que tu m’apprends sa mort ! » Et il s’arrêta un instant, comme suffoqué d’émotion ; puis il ajouta : « D’ailleurs je dois te dire, ô fils de mon frère, que, sitôt que je t’ai aperçu, mon sang s’est de suite porté vers ton sang et m’a fait vite te reconnaître, sans hésitation, au milieu de tous tes camarades ! Et, bien qu’au moment où je quittai ton père, tu ne fusses pas encore né, vu qu’il n’était pas marié, je n’ai pas tardé à reconnaître en toi ses traits et sa ressemblance ! Et c’est cela précisément qui me console un peu de sa perte ! Ah ! calamité sur ma tête ! Où es-tu maintenant, mon frère, toi que j’espérais embrasser au moins une fois, après une si longue absence et avant que la mort vînt nous séparer à jamais ? Hélas ! qui peut se flatter d’empêcher d’être ce qui est ? Et qui peut fuir sa destinée ou éviter ce qui a été prescrit par Allah Très-Haut ? » Puis après un moment de silence, il reprit Aladdin dans ses bras, le serra contre sa poitrine, et lui dit : « Pourtant, ô mon fils, glorifié soit Allah qui me fait te rencontrer ! Tu vas désormais être ma consolation et tu remplaceras ton père dans mon affection puisque tu es son sang et sa descendance ; car le proverbe dit : Celui qui a laissé une postérité, n’est pas mort ! »
Puis le Maghrébin tira de sa ceinture dix dinars d’or et les mit dans la main d’Aladdin, en lui demandant : « Ô mon fils Aladdin, où donc demeure-t-elle, ta mère, la femme de mon frère ? » Et Aladdin, tout à fait gagné par la générosité et la figure souriante du Maghrébin, le prit par la main, le conduisit jusqu’à l’extrémité de la place et lui montra du doigt le chemin de leur maison, en disant : « C’est par là qu’elle demeure ! » Et le Maghrébin lui dit : « Ces dix dinars que je t’ai donnés, ô mon enfant, tu les remettras à l’épouse de mon défunt frère, en lui transmettant mes salams. Et tu lui annonceras que ton oncle vient d’arriver de voyage, après sa longue absence à l’étranger, et que, dans la journée de demain, il espère, si Allah veut, pouvoir se présenter à la maison pour faire lui-même ses souhaits à l’épouse de son frère, et voir les lieux où le défunt a passé sa vie, et visiter son tombeau ! »
Lorsque Aladdin eut entendu ces paroles du Maghrébin, il voulut se montrer empressé dans l’exécution de ses souhaits et, après lui avoir baisé la main, il se hâta, dans sa joie, de courir au logis où il arriva, contrairement à ses habitudes, à une heure qui n’était guère celle du repas, et, en entrant, il s’écria : « Ô ma mère, je viens t’annoncer que mon oncle, après sa longue absence à l’étranger, vient d’arriver de voyage, et t’envoie ses salams ! » Et la mère d’Aladdin, fort étonnée de ce langage nouveau et de cette entrée inaccoutumée, répondit : « On dirait, mon fils, que tu veux te moquer de ta mère ! Quel est, en effet, cet oncle dont tu me parles ? Et d’où et depuis quand as-tu un oncle encore en vie ? » Et Aladdin dit : « Comment, ô ma mère, peux-tu dire que je n’ai point d’oncle ou de parent encore en vie, alors que l’homme en question est le frère de mon défunt père ? Et la preuve est qu’il me serra contre sa poitrine, et m’embrassa en pleurant et me chargea de venir t’annoncer la nouvelle et te mettre au courant ! » Et la mère d’Aladdin dit : « Oui, mon enfant, je sais bien que tu avais un oncle, mais il y a de longues années qu’il est mort. Et je ne sache pas que, depuis, tu aies jamais eu un second oncle ! » Et elle regarda avec deux yeux bien étonnés son fils Aladdin qui déjà s’occupait d’autre chose. Et elle ne lui dit plus rien à ce sujet, ce jour-là. Et Aladdin, de son côté, ne lui parla pas du don du Maghrébin.
Or, le lendemain matin, dès la première heure, Aladdin sortit de la maison ; et le Maghrébin, qui était déjà à sa recherche, le rencontra au même endroit que la veille, déjà en train de s’amuser, selon sa coutume, avec les vagabonds de son âge. Et il s’approcha vivement de lui, lui prit la main, le serra sur son cœur, et l’embrassa tendrement. Puis il tira deux dinars de sa ceinture et les lui remit, en disant : « Va trouver ta mère et dis-lui, en lui donnant ces deux dinars : Mon oncle a l’intention de venir ce soir prendre le repas avec nous ; c’est pourquoi il t’envoie cet argent, afin que tu puisses nous préparer des mets excellents ! » Puis il ajouta, en s’inclinant vers son visage : « Et maintenant, ya Aladdin, montre-moi une seconde fois le chemin de la maison ! » Et Aladdin répondit : « Sur ma tête et mes yeux, ô mon oncle ! » Et il marcha devant lui et lui montra le chemin de leur maison. Et le Maghrébin le quitta et s’en alla en sa voie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TRENTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Et le Maghrébin le quitta et s’en alla en sa voie. Et Aladdin entra à la maison, raconta la chose à sa mère et lui remit les deux dinars, en lui disant : « Mon oncle va venir ce soir manger avec nous ! »
Alors, la mère d’Aladdin, voyant les deux dinars, se dit : « Je ne connais peut-être pas tous les frères du défunt ! » Et elle se leva et alla en toute hâte au souk où elle acheta les provisions nécessaires pour un bon repas, et revint pour se mettre aussitôt à préparer les mets. Mais comme cette pauvre n’avait point d’ustensiles de cuisine, elle alla emprunter chez ses voisines ce dont elle avait besoin en fait de casseroles, d’assiettes et de vaisselle. Et elle cuisina toute la journée ; et, vers le soir, elle dit à Aladdin : « Mon fils, voici le repas qui est prêt, et peut-être que ton oncle ne connaît pas bien le chemin de notre maison. Tu feras donc bien d’aller à sa rencontre ou de l’attendre dans la rue ! » Et Aladdin répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et, comme il se disposait à sortir, on frappa à la porte. Et il courut ouvrir. Or, c’était le Maghrébin. Et il était accompagné d’un portefaix qui avait sur la tête une charge de fruits, de pâtisseries et de boissons. Et Aladdin les introduisit tous deux. Et le portefaix, après avoir déposé sa charge dans la maison, fut payé et s’en alla en son état. Et Aladdin conduisit le Maghrébin dans la pièce où se tenait sa mère. Et le Maghrébin, d’une voix bien émue, s’inclina et dit : « Que la paix soit sur toi, ô épouse de mon frère ! » Et la mère d’Aladdin lui rendit le salam. Alors le Maghrébin se mit à pleurer en silence. Puis il demanda : « Où est l’endroit où avait coutume de s’asseoir le défunt ? » Et la mère d’Aladdin lui montra l’endroit en question ; et aussitôt le Maghrébin se jeta à terre et se mit à baiser cette place et à soupirer, avec des larmes aux yeux, et à dire : « Ah ! quelle chance est la mienne ! Ah ! mon misérable sort de t’avoir perdu, ô mon frère, ô veine de mon œil ! » Et il continua à pleurer et à se lamenter tellement, et avec une figure si altérée et un tel bouleversement d’entrailles, qu’il fut sur le point de s’évanouir, et que la mère d’Aladdin ne douta pas un instant que ce ne fût là le propre frère de son défunt mari. Et elle s’approcha de lui, le releva du sol et lui dit : « Ô frère de mon époux, tu vas te tuer sans fruit, à force de pleurer ! Hélas ! ce qui est écrit doit courir ! » Et elle continua à le consoler par de bonnes paroles jusqu’à ce qu’elle l’eût décidé à boire un peu d’eau pour se calmer, et à s’asseoir pour le repas.
Or, quand la nappe fut tendue, le Maghrébin commença à s’entretenir avec la mère d’Aladdin. Et il lui raconta ce qu’il avait à lui raconter, en lui disant :
« Ô femme de mon frère, ne trouve pas extraordinaire que tu n’aies pas encore eu l’occasion de me voir et que tu ne m’aies point connu du temps de mon frère, le défunt. Il y a trente ans, en effet, que j’ai quitté ce pays et que je suis parti pour l’étranger, en renonçant à ma patrie. Et depuis lors je n’ai cessé de voyager dans les contrées de l’Inde et du Sindh, et de parcourir le pays des Arabes et les terres des autres nations. Et j’ai été aussi en Égypte et j’ai habité la ville magnifique de Masr, qui est le miracle du monde ! Et, après y avoir séjourné un long temps, je suis parti pour le pays du Maghreb central, où j’ai fini par me fixer pour vingt années.
« Sur ces entrefaites, ô femme de mon frère, comme, un jour d’entre les jours, j’étais assis dans ma maison, je me mis à penser à ma terre natale et à mon frère. Et en moi le désir augmenta de revoir mon sang ; et je me mis à pleurer et à me lamenter sur mon séjour en pays étranger. Et, à la fin, les regrets de ma séparation et de mon éloignement de l’être qui m’était cher devinrent si intenses, que je me décidai à entreprendre le voyage vers la contrée qui avait vu apparaître ma tête de nouveau-né. Et je pensais en mon âme : « Ô homme ! que d’années écoulées depuis le jour où tu délaissas ta ville et ton pays et la demeure du seul frère que tu possèdes au monde ! Lève-toi donc et pars le revoir avant la mort ! Car qui sait les calamités du destin, les accidents des jours et les révolutions du temps ? Et ne serait-ce point misère suprême que de mourir avant de t’être réjoui les yeux de la vue de ton frère, maintenant surtout qu’Allah (glorifié soit-Il !) t’a donné la richesse et que ton frère est peut-être toujours dans une condition d’étroite pauvreté ! N’oublie donc pas qu’en partant tu ferais deux actions excellentes : revoir ton frère et le secourir ! »
« Or, moi, à ces pensées, ô femme de mon frère, je me levai sur l’heure et me préparai au départ. Et, après avoir récité la prière du vendredi et la Fatiha du Korân, je montai à cheval et me dirigeai vers ma patrie. Et, après bien des périls et les longues fatigues du chemin, je finis, avec l’aide d’Allah (glorifié et honoré soit-Il) par arriver en sécurité dans ma ville, celle-ci. Et je me mis aussitôt à parcourir les rues et les quartiers à la recherche de la maison de mon frère. Et Allah permit que je rencontrasse de la sorte cet enfant en train de jouer avec ses camarades. Et moi, par Allah le Tout-Puissant ! ô femme de mon frère, à peine le vis-je que je sentis mon cœur se fendre pour lui d’émoi ; et, comme le sang reconnaît le sang, je n’hésitai pas à voir en lui le fils de mon frère. Et, au même moment, j’oubliai mes fatigues et mes préoccupations, et je faillis m’envoler de joie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TRENTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et, au même moment, j’oubliai mes fatigues et mes préoccupations, et je faillis m’envoler de joie. Mais hélas ! pourquoi me fallut-il bientôt apprendre de la bouche de cet enfant que mon frère avait trépassé dans la miséricorde d’Allah Très-Haut ? Ah ! la terrible nouvelle qui faillit me faire tomber à la renverse de saisissement et de douleur ! Mais, ô femme de mon frère, l’enfant a dû probablement te raconter comment il a réussi, par sa vue et sa ressemblance avec le défunt, à me consoler un peu en me faisant ainsi souvenir du proverbe qui dit : L’homme qui laisse une postérité ne meurt pas ! »
Ainsi parla le Maghrébin. Et il s’aperçut que la mère d’Aladdin, à ces souvenirs évoqués de son époux, pleurait amèrement. Et, pour lui faire oublier sa tristesse et changer ses idées noires, il se tourna vers Aladdin et, pour engager la conversation, lui demanda : « Mon fils Aladdin, qu’as-tu appris en fait de métier, et quel travail fais-tu pour venir en aide à ta mère, cette pauvre, et subsister tous deux ? »
En entendant cela, Aladdin, pris de honte pour la première fois de sa vie, baissa la tête en regardant par terre. Et comme il ne disait mot, sa mère répondit à sa place : « Un métier, ô frère de mon époux ! un métier pour Aladdin ? Et comment cela ? Par Allah, il ne sait rien du tout ! Ah ! un enfant comme ça, tout de travers, je n’en ai jamais vu ! Toute la journée il est à courir avec les enfants du quartier, des vagabonds, des garnements, des vauriens comme lui ! Et cela au lieu de suivre l’exemple des enfants gentils qui restent dans la boutique avec leur père ! Ah ! son père à lui n’est mort, ô regrets cuisants ! qu’à cause de lui ! Et d’ailleurs, moi aussi, maintenant, je suis réduite à un triste état de santé ! Et c’est à peine si je puis encore voir un peu avec mes yeux usés par les larmes et les veilles, travaillant sans relâche et passant mes journées et mes nuits à filer le coton pour arriver à avoir de quoi acheter deux galettes de maïs, juste de quoi nous nourrir tous deux. Et telle est ma condition ! Et je te jure par ta vie à toi, ô frère de mon époux, qu’il ne rentre à la maison que juste aux heures des repas ! Et puis c’est tout ! Aussi, des fois, quand il me délaisse de la sorte, moi, sa mère, je pense à fermer la porte de la maison et à ne plus la lui ouvrir, pour l’obliger à aller chercher quelque travail qui le fasse vivre ! Et puis je n’ai pas la force de le faire, car le cœur de la mère est pitoyable et miséricordieux ! Mais l’âge vient, et je deviens une femme bien vieille, ô frère de mon époux ! Et mes épaules ne supportent plus les fatigues comme autrefois ! Et c’est à peine maintenant si mes doigts consentent à tourner le fuseau ! Et je ne sais jusqu’à quand je vais pouvoir continuer une tâche pareille, sans être trahie par la vie comme je suis délaissée par mon fils, cet Aladdin qui est là, devant toi, ô frère de mon époux ! »
Et elle se mit à sangloter.
Alors le Maghrébin se tourna vers Aladdin et lui dit : « Ah ! ô fils de mon frère, en vérité je ne savais pas tout cela sur ton compte ! Pourquoi marches-tu dans ce sentier du vagabondage ? Quelle honte sur toi, Aladdin ! Cela n’est guère convenable pour les hommes comme toi ! Tu es doué de raison, mon enfant, et tu es un fils de bonne famille ! N’est-ce point un déshonneur pour toi de laisser ainsi ta pauvre mère, une femme âgée, s’occuper de te faire vivre, alors que tu es un homme en âge de te créer une occupation capable de vous faire tous deux subsister ?… Et puis, ô mon enfant, regarde ! grâce à Allah, il n’y a rien de plus nombreux dans notre ville que les maîtres des métiers ! Tu n’auras donc qu’à choisir toi-même le métier qui te plaît le mieux, et je prends sur moi de t’y placer ! Et de la sorte, quand tu seras devenu grand, mon fils, tu auras entre les mains un métier sûr qui te protégera contre les coups du sort ! Ainsi, parle ! Et si le métier de ton défunt père, le travail à l’aiguille, n’est pas à ta convenance, cherche autre chose, et m’en avise ! Et moi, je t’aiderai de tout mon possible, ô mon enfant ! »
Mais Aladdin, au lieu de répondre, continua à tenir la tête baissée et à garder le silence, pour marquer de la sorte qu’il ne voulait point d’autre métier que celui de vagabond. Et le Maghrébin comprit sa répugnance pour les métiers manuels, et essaya de le prendre autrement. Il lui dit donc : « Ô fils de mon frère, que mon insistance ne te formalise ni ne te fasse de la peine ! Laisse-moi seulement ajouter que, si les métiers te rebutent, je suis prêt, si toutefois il te plaît de devenir un honnête homme, à t’ouvrir une belle boutique de marchand de soieries dans le grand souk ! Et je te garnirai cette boutique-là des étoffes les plus chères et des brocarts de la qualité la plus fine. Et de la sorte tu te feras de belles relations dans le monde des grands marchands ! Et tu prendras l’habitude de vendre et d’acheter, de prendre et de donner. Et ta réputation sera excellente dans la ville. Et tu honoreras de la sorte la mémoire de ton défunt père ! Qu’en dis-tu, ô Aladdin, mon fils ? »
Lorsque Aladdin eut entendu cette proposition de son oncle et compris qu’il allait devenir un grand marchand dans le souk, un homme d’importance, habillé de beaux vêtements, avec un turban de soie et une jolie ceinture de couleurs différentes, il fut extrêmement réjoui. Et il regarda le Maghrébin en souriant et en penchant la tête de côté, ce qui, dans son langage, signifiait clairement : « J’accepte…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TRENTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il regarda le Maghrébin en souriant et en penchant la tête de côté, ce qui, dans son langage, signifiait clairement : « J’accepte ! » Et le Maghrébin comprit de la sorte que sa proposition était agréée, et dit à Aladdin : « Du moment que tu veux bien devenir un personnage d’importance, un marchand dans une boutique, tâche désormais de te montrer digne de ta nouvelle situation. Et, dès maintenant, ô fils de mon frère, sois un homme ! Et moi, demain, si Allah veut, je t’emmènerai au souk, et je commencerai par t’acheter une belle robe neuve comme en portent les riches marchands, et tous les accessoires qu’elle comporte. Et, cela fait, nous chercherons ensemble une belle boutique, pour t’y installer ! »
Tout cela ! Et la mère d’Aladdin, qui entendait ces exhortations et voyait cette générosité, bénissait Allah le Bienfaiteur qui lui envoyait d’une façon si inespérée un parent qui la sauvait de la misère et mettait dans la voie droite son fils Aladdin. Et elle servit le repas d’un cœur léger, comme si elle avait rajeuni de vingt ans. Et l’on mangea et l’on but, en continuant à causer sur ce même sujet, qui les intéressait tous tellement ! Et le Maghrébin commença à initier Aladdin à la vie et aux manières des marchands, et à l’intéresser grandement à sa nouvelle condition. Puis, comme il voyait la nuit déjà à moitié écoulée, il se leva et prit congé de la mère d’Aladdin et embrassa Aladdin. Et il sortit, après leur avoir promis qu’il reviendrait le lendemain. Et cette nuit-là Aladdin, dans sa joie, ne put fermer l’œil et ne fit que penser à la vie charmante qui l’attendait.
Or, le lendemain, à la première heure, on frappa à la porte. Et la mère d’Aladdin alla elle-même ouvrir, et vit que c’était précisément le frère de son époux, le Maghrébin, qui tenait sa promesse de la veille. Toutefois il ne voulut point entrer, malgré les instances de la mère d’Aladdin, en prétextant que ce n’était pas l’heure des visites ; et il demanda seulement à emmener Aladdin avec lui au souk. Et Aladdin, déjà debout et habillé, courut avec empressement à son oncle, et lui souhaita le bonjour et lui baisa la main. Et le Maghrébin le prit par la main et s’en alla avec lui au souk. Et il entra avec lui dans la boutique du plus grand marchand et demanda une robe, qui fût la plus belle et la plus riche d’entre les robes, à la taille d’Aladdin. Et le marchand lui en fit voir plusieurs qui étaient plus belles les unes que les autres. Et le Maghrébin dit à Aladdin : « Choisis toi-même, mon fils, celle qui te plait ! » Et Aladdin, extrêmement charmé de la générosité de son oncle, en choisit une qui était tout en soie rayée et luisante. Et il choisit également un turban en mousseline de soie rehaussée d’or fin, une ceinture de cachemire, et des bottes en cuir rouge brillant. Et le Maghrébin paya le tout sans marchander, et remit le paquet à Aladdin en lui disant : « Allons maintenant au hammam, car, avant de t’habiller à neuf, il faut que tu sois bien propre ! » Et il le conduisit au hammam, et entra avec lui dans une salle réservée, et le baigna de ses propres mains ; et il se baigna lui-même également. Puis il fit venir les rafraîchissements d’après le bain ; et ils burent tous deux avec délices et furent contents. Et alors Aladdin revêtit la somptueuse robe en question, en soie rayée et luisante, mit sur sa tête le beau turban, se serra la taille de la ceinture des Indes et se chaussa des bottes rouges. Et il devint de la sorte beau comme la lune et semblable à quelque fils de roi ou de sultan. Et, extrêmement charmé de se voir ainsi transformé, il s’avança vers son oncle et lui baisa la main et le remercia beaucoup pour sa générosité. Et le Maghrébin l’embrassa et lui dit : « Tout cela n’est que le commencement ! » Et il sortit avec lui du hammam, et le mena dans les souks les plus fréquentés, et lui fit visiter les boutiques des grands marchands. Et il lui faisait admirer les plus riches étoffes et les objets de prix, en lui apprenant le nom de chaque chose en particulier ; et il lui disait : « Il est nécessaire, comme tu vas être toi-même un marchand, que tu saches les détails des ventes et des achats ! » Puis il lui fit visiter les édifices remarquables de la ville et les mosquées principales et les khâns où logeaient les caravanes. Et il termina la tournée en lui faisant voir le palais du sultan et les jardins qui l’entouraient. Et il l’emmena enfin au grand-khân, où il était descendu, et le présenta aux marchands, ses connaissances, en leur disant : « C’est le fils de mon frère ! » Et il les invita tous à un repas qu’il donnait en l’honneur d’Aladdin, et les régala de mets les plus choisis, et resta avec eux et avec Aladdin jusqu’au soir.
Alors il se leva et prit congé de ses invités en leur disant qu’il allait reconduire Aladdin à sa maison. Et, de fait, il ne voulut pas laisser Aladdin s’en retourner seul, et il lui prit la main et s’achemina avec lui jusque chez sa mère. Et la mère d’Aladdin, en voyant son fils si magnifiquement habillé, faillit voir sa raison s’envoler de joie, la pauvre ! Et elle se mit à remercier et à bénir mille fois son beau-frère en lui disant : « Ô frère de mon époux, jamais je ne pourrai, même si je te remerciais durant toute la vie, reconnaître assez tes bienfaits ! » Et le Maghrébin répondit : « Ô femme de mon frère, en vérité, je n’ai aucun mérite à agir de la sorte, vraiment aucun mérite, car Aladdin est mon fils, et c’est mon devoir de lui servir de père à la place du défunt ! N’aie donc plus aucune préoccupation à son sujet et sois heureuse ! » Et la mère d’Aladdin dit, en levant les bras au ciel : « Je prie Allah, par l’honneur des saints, anciens et récents, de te garder et de te conserver, ô frère de mon époux, et de prolonger ta vie pour nous, afin que tu sois l’aile dont l’ombre protégera toujours cet enfant orphelin ! Et sois sûr que lui, de son côté, sera toujours obéissant à tes ordres et ne fera que ce que tu lui commanderas ! » Et le Maghrébin dit : « Ô femme de mon frère, Aladdin est devenu un homme sensé, car c’est un excellent garçon, fils de bonne famille. Et j’ai tout espoir qu’il sera le digne descendant de son père et qu’il te rafraîchira les yeux ! » Puis il ajouta : « Excuse-moi, ô femme de mon frère, si je ne puis demain, vendredi, lui ouvrir la boutique promise ; car tu sais que le vendredi les souks sont fermés, et qu’on ne peut traiter les affaires. Mais, après-demain, samedi, la chose sera faite, si Allah veut ! Je viendrai pourtant demain prendre Aladdin pour continuer à l’instruire, et je lui ferai visiter les endroits publics et les jardins situés hors de la ville, où vont se promener les riches marchands, afin que de la sorte il puisse s’habituer à la vue du luxe et du beau monde. Car jusqu’aujourd’hui il n’a guère fréquenté que les enfants, et il faut qu’il connaisse enfin les hommes et qu’ils le connaissent ! » Et il prit congé de la mère d’Aladdin, embrassa Aladdin et se retira…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TRENTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il prit congé de la mère d’Aladdin, embrassa Aladdin et se retira. Et Aladdin songea durant la nuit à toutes les belles choses qu’il venait de voir et aux joies qu’il venait d’éprouver ; et il se promit de nouvelles délices pour le lendemain. Aussi, dès l’aurore, il se leva, sans avoir pu fermer l’œil, et s’habilla des beaux vêtements, et se mit à marcher en long et en large, tout en se prenant les pieds dans la robe longue à laquelle il n’était pas habitué. Puis, comme il pensait, dans son impatience, que le Maghrébin tardait trop à venir, il sortit l’attendre devant la porte, et finit par le voir apparaître. Et il courut au-devant de lui comme un jeune étalon et lui baisa la main. Et le Maghrébin l’embrassa et lui fit beaucoup de caresses, et lui dit d’aller avertir sa mère qu’il l’emmenait. Puis il le prit par la main et s’en alla avec lui. Et ils marchèrent ensemble en causant de choses et d’autres ; et ils franchirent les portes de la ville, d’où jamais n’était encore sorti Aladdin. Et devant eux commencèrent à paraître les belles maisons particulières et les beaux palais entourés de jardins ; et Aladdin les regardait avec émerveillement et trouvait le dernier plus beau que le précédent. Et ils avancèrent ainsi très avant dans la campagne, se rapprochant de plus en plus du but que se proposait le Maghrébin. Mais, à un moment donné, Aladdin commença à se fatiguer, et dit au Maghrébin : « Ô mon oncle, allons-nous encore longtemps marcher ? Voici que nous avons déjà dépassé les jardins, et il n’y a plus devant nous que la montagne ! Or, je suis bien fatigué, et je voudrais manger un morceau ! » Et le Maghrébin tira de sa ceinture un foulard où il y avait des fruits et des galettes et dit à Aladdin : « Voici, ô mon fils, pour ta faim et ta soif. Mais il faut encore marcher un peu pour atteindre l’endroit merveilleux que je veux te montrer et qui n’a pas son pareil dans le monde ! Raffermis donc tes forces et prends courage, Aladdin, maintenant que tu es un homme ! » Et il continua à l’encourager, tout en lui donnant des conseils sur sa conduite dans l’avenir, et en le poussant à se détacher de la fréquentation des enfants pour se rapprocher plutôt des hommes sages et prudents. Et il sut le distraire d’une telle manière, qu’il finit par arriver avec lui au pied de la montagne, au fond d’une vallée déserte où il n’y avait, pour toute présence, que celle d’Allah !
Or, c’était là précisément le but de voyage du Maghrébin ! Et c’était pour arriver dans cette vallée-là qu’il était parti du fond du Maghreb et était venu aux extrémités de la Chine !
Il se tourna donc vers Aladdin exténué de fatigue et lui dit en souriant : « Nous sommes arrivés au but, mon fils Aladdin ! » Et il s’assit sur un rocher et le fit s’asseoir à côté de lui et l’entoura de ses bras avec beaucoup de tendresse et lui dit : « Repose-toi un peu, Aladdin. Car je vais pouvoir enfin te montrer ce que jamais n’ont vu les yeux des hommes. Oui, Aladdin, tu vas voir tout à l’heure, ici même, un jardin plus beau que tous les jardins de la terre. Et c’est seulement après que tu auras admiré les merveilles de ce jardin, que tu auras vraiment raison de me remercier, et que tu oublieras les fatigues de la marche, et que tu béniras le jour où tu m’as rencontré pour la première fois. » Et il le laissa se reposer un instant, avec des yeux tout ronds d’étonnement à la pensée de voir un jardin dans un endroit où il n’y avait que des rochers bouleversés et des buissons. Puis il lui dit : « Lève-toi maintenant, Aladdin, et ramasse parmi ces buissons, les tiges les plus sèches et les morceaux de bois que tu trouveras, et apporte-les-moi ! Et tu verras alors le spectacle gratuit auquel je te convie ! » Et Aladdin se leva et se hâta d’aller ramasser parmi les buissons et les broussailles une quantité de tiges sèches et de morceaux de bois, et les apporta au Maghrébin, qui lui dit : « C’est tout ce qu’il me faut. Retire-toi maintenant et viens te mettre derrière moi ! » Et Aladdin obéit à son oncle et vint se placer à une certaine distance derrière lui.
Alors, le Maghrébin tira de sa ceinture un briquet qu’il battit et mit le feu à l’amas de branches et de tiges sèches, qui flambèrent en crépitant. Et aussitôt il tira de sa poche une boîte en écaille, l’ouvrit et y prit une pincée d’encens qu’il jeta au milieu du feu. Et une fumée fort épaisse s’éleva qu’il se mit à détourner de côté et d’autre avec ses mains, en marmonnant des formules dans une langue tout à fait inconnue d’Aladdin. Et, au même moment, la terre trembla, et les rochers se mouvementèrent sur leur base, et le sol s’entr’ouvrit sur une espace large de dix coudées environ. Et tout au fond de ce trou apparut une plaque de marbre horizontale large de cinq coudées, avec, en son milieu, un anneau de bronze.
À cette vue, Aladdin épouvanté jeta un cri et, prenant le bas de sa robe entre ses dents, tourna le dos et prit la fuite, livrant ses jambes au vent. Mais le Maghrébin, d’un bond, fut sur lui et le rattrapa. Et il le regarda avec des yeux effrayants, le secoua en le tenant par une oreille, et leva la main et lui appliqua un soufflet si terrible qu’il faillit lui enfoncer les dents et qu’Aladdin en fut tout étourdi et s’affaissa sur le sol.
Or le Maghrébin ne l’avait traité de la sorte que pour le dominer une fois pour toutes, vu qu’il était nécessaire à son opération et que, sans lui, il ne pouvait tenter l’entreprise pour laquelle il était venu. Aussi, lorsqu’il le vit gisant hébété sur le sol, il le releva et lui dit d’une voix qu’il essaya de rendre fort douce : « Sache, Aladdin, que si je t’ai traité de la sorte, c’est pour t’apprendre à être un homme ! Car je suis ton oncle, le frère de ton père, et tu me dois l’obéissance ! » Puis il ajouta, d’une voix tout à fait douce : « Allons ! Aladdin, écoute bien ce que j’ai à te dire, et n’en perds pas un mot ! Car, ce faisant, tu en retireras des avantages considérables, et tu oublieras bien vite les divers ennuis qui t’arrivent ! » Et il l’embrassa et, l’ayant désormais tout à fait réduit et dominé, il lui dit : « Tu viens de voir, mon enfant, comment le sol s’est entr’ouvert par la vertu de mes fumigations et des formules que j’ai prononcées ! Or il faut que tu saches que j’ai agi de la sorte uniquement pour ton bien ; car au-dessous de cette plaque de marbre que tu vois au fond du trou, avec un anneau de bronze, se trouve un trésor qui est écrit en ton nom et ne peut s’ouvrir que sur ton visage ! Et ce trésor, qui t’est destiné, te rendra plus riche que tous les rois ! Et, pour te bien prouver que ce trésor est bien destiné à toi et non à un autre, sache qu’il n’est possible qu’à toi seul au monde de toucher cette plaque de marbre et de la soulever ; car moi-même, malgré toute ma puissance qui est grande, je ne pourrais porter la main à l’anneau de bronze ni soulever la plaque, serais-je mille fois plus puissant et plus fort que je ne suis. Et, une fois la plaque soulevée, il ne m’est pas loisible non plus de pénétrer dans le trésor ou d’en descendre une marche seulement ! C’est donc à toi seul qu’il appartient de faire ce que je ne puis faire moi-même ! Et, pour cela, tu n’as qu’à exécuter à la lettre ce que je vais te dire ! Et tu seras ainsi le maître du trésor, que nous partagerons en toute équité, en deux parts égales, une pour toi et une pour moi ! »
À ces paroles du Maghrébin, Aladdin, ce pauvre, oublia et ses fatigues et le soufflet reçu, et répondit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TRENTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… À ces paroles du Maghrébin, Aladdin, ce pauvre, oublia et ses fatigues et le soufflet reçu, et répondit : « Ô mon oncle, commande-moi tout ce que tu veux, et je t’obéirai ! » Et le Maghrébin le prit dans ses bras et le baisa plusieurs fois sur les joues, et lui dit : « Ô Aladdin, tu es pour moi comme un fils et plus cher ! car je n’ai point sur terre d’autres parents que toi ; et c’est toi qui seras mon unique héritier et ma descendance, ô mon enfant ! Car enfin c’est pour toi, en somme, que je travaille en ce moment et que je suis venu de si loin. Et si je t’ai un peu brusqué, tu comprends maintenant que ce fut pour te décider à ne point laisser t’attendre en vain ta merveilleuse destinée. Voici donc ce que tu vas faire ! Commence d’abord par descendre avec moi au fond du trou, et là prends l’anneau de bronze et soulève la plaque de marbre ! » Et, ayant ainsi parlé, il sauta tout le premier dans le trou, et tendit la main à Aladdin, pour l’aider à descendre. Et Aladdin, une fois descendu, lui dit : « Mais comment vais-je faire, ô mon oncle, pour soulever une plaque si lourde, alors que je ne suis qu’un tout jeune garçon ? Si au moins tu voulais m’aider, je m’y emploierais volontiers ! » Le Maghrébin répondit : « Ah non ! ah non ! Si, par malheur, j’y mettais la main, tu ne pourrais plus rien faire, et ton nom serait effacé à tout jamais du trésor ! Essaie tout seul et tu verras que tu soulèveras la plaque avec autant de facilité que si tu ramassais une plume d’oiseau ! Tu n’auras seulement qu’à prononcer, en prenant l’anneau, ton nom et le nom de ton père et le nom de ton grand-père ! »
Alors, Aladdin se pencha et prit l’anneau et le tira à lui en disant : « Je suis Aladdin, fils du tailleur Mustapha, fils du tailleur Ali ! » Et il souleva la plaque de marbre avec une grande facilité, et la posa aussitôt à côté. Et il aperçut un caveau qui, par douze degrés de marbre, descendait vers une porte à deux battants de cuivre rouge à gros clous. Et le Maghrébin lui dit : « Mon fils Aladdin, descends maintenant dans ce caveau. Et quand tu seras au bas de la douzième marche, tu entreras par cette porte de cuivre qui s’ouvrira d’elle-même devant toi. Et tu arriveras sous une grande voûte divisée en trois salles communiquant les unes avec les autres. Or, tu trouveras dans la première salle quatre grandes cuves de bronze remplies d’or liquide, et dans la seconde salle quatre grandes cuves d’argent remplies de poudre d’or, et dans la troisième salle quatre grandes cuves d’or remplies de dinars d’or. Mais, toi, passe sans t’arrêter ! et lève bien haut ta robe et serre-la bien autour de ta taille, de peur qu’elle ne touche les parois des cuves : car si tu as le malheur de toucher avec tes doigts ou même d’effleurer avec les vêtements l’une des cuves ou leur contenu, tu seras changé à l’instant en un bloc de pierre noire. Tu entreras donc dans la première salle, et bien vite tu passeras dans la seconde d’où, sans t’arrêter un instant, tu pénétreras dans la troisième, où tu trouveras une porte cloutée, semblable à celle de l’entrée, qui s’ouvrira aussitôt devant toi. Et tu la franchiras, et tu te trouveras soudain dans un jardin magnifique planté d’arbres pliant sous le poids de leurs fruits. Mais ne t’y arrête pas non plus ! Tu le traverseras, en marchant tout droit devant toi, et tu arriveras à un escalier à colonnes, de trente marches, que tu graviras pour aboutir à une terrasse. Or, quand tu seras sur cette terrasse, Aladdin, fais bien attention ! car tu verras, juste en face de toi, une sorte de niche à ciel ouvert ; et dans cette niche tu trouveras, sur un piédestal de bronze, une petite lampe de cuivre. Et cette lampe sera allumée. Or, toi, fais bien attention, Aladdin ! tu prendras cette lampe, tu l’éteindras, tu en verseras l’huile par terre, et tu la cacheras bien vite dans ton sein ! Et ne crains point de salir ta robe, car cette huile que tu auras jetée n’est pas de l’huile, mais un tout autre liquide qui ne laisse aucune trace sur les vêtements. Et tu reviendras vers moi, par le même chemin que tu auras suivi ! Et, au retour, tu pourras t’arrêter un peu dans le jardin, s’il te plaît, et cueillir autant que tu voudras des fruits de ce jardin. Et, une fois près de moi, tu me remettras la lampe, but et motif de notre voyage et cause de notre richesse et de notre gloire dans l’avenir, ô mon enfant ! »
Lorsque le Maghrébin eut ainsi parlé, il retira un anneau qu’il avait au doigt et le mit au pouce d’Aladdin, en lui disant : « Cet anneau, mon fils, te sauvegardera de tous les dangers et te préservera de tout mal. Enhardis donc ton âme, et remplis ta poitrine de courage, car tu n’es plus un enfant, mais un homme ! Et, avec l’aide d’Allah, il ne t’arrivera que du bien ! Et nous serons dans la richesse, grâce à la lampe, et dans les honneurs pour toute la vie ! » Puis il ajouta : « Seulement, encore une fois, Aladdin, fais bien attention de relever très haut ta robe et de la serrer tout contre toi ! sinon, tu es perdu, et le trésor avec toi ! »
Puis il l’embrassa, en lui donnant plusieurs petites tapes sur les joues, et lui dit : « Pars en sécurité ! »
Alors, Aladdin, extrêmement enhardi, descendit en courant les degrés de marbre, et, relevant sa robe jusque par-dessus sa ceinture, et la tenant bien serrée contre lui, il franchit la porte de cuivre dont les deux battants s’étaient d’eux-mêmes ouverts à son approche. Et, sans rien oublier des recommandations du Maghrébin, il traversa avec mille précautions la première, la deuxième et la troisième salles, en contournant les cuves remplies d’or, arriva devant la dernière porte, la franchit, traversa le jardin sans s’y arrêter, gravit les trente marches de l’escalier à colonnes, monta sur la terrasse et se dirigea tout droit vers la niche qui se trouvait en face de lui. Et il vit, sur le piédestal de bronze, la lampe allumée…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT TRENTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il vit, sur le piédestal de bronze, la lampe allumée. Et il tendit la main et la prit. Et il en versa le contenu sur le sol, et, voyant que ses parois s’étaient aussitôt séchées, il la cacha bien vite dans son sein, sans craindre de salir sa robe. Et il descendit de la terrasse et arriva de nouveau dans le jardin.
Alors, délivré de son souci, il s’arrêta un instant sur la dernière marche de l’escalier à regarder le jardin. Et il se mit à considérer ces arbres dont il n’avait pas eu le temps de remarquer les fruits, à son arrivée. Et il vit, en effet, que les arbres de ce jardin pliaient sous le poids de leurs fruits, qui étaient extraordinaires de forme, de grosseur et de couleur. Et il vit que, contrairement aux arbres des vergers, chaque rameau de chacun des arbres portait des fruits de couleurs différentes. Il y en avait qui étaient blancs d’un blanc transparent comme le cristal, ou d’un blanc trouble comme le camphre, ou d’un blanc opaque comme la cire vierge. Et il y en avait qui étaient rouges, d’un rouge comme les grains de la grenade, ou d’un rouge comme l’orange sanguine. Et il y en avait qui étaient verts, d’un vert foncé et d’un vert tendre ; et d’autres qui étaient bleus et violets et jaunes ; et d’autres qui avaient des couleurs et des teintes d’une variété infinie. Et Aladdin, le pauvre, ne savait pas que les fruits blancs étaient des diamants, des perles, de la nacre et des pierres lunaires ; que les fruits rouges étaient des rubis, des escarboucles, des hyacinthes, du corail et des cornalines ; que les verts étaient des émeraudes, des béryls, des jades, des prases et des aigues-marines ; que les bleus étaient des saphirs, des turquoises, des lapis et des lazulites ; que les violets étaient des améthystes, des jaspes et des sardoines ; que les jaunes étaient des topazes, de l’ambre et des agates ; et que les autres, aux couleurs inconnues, étaient des opales, des aventurines, des chrysolithes, des cymophanes, des hématites, des tourmalines, des péridots, des jayets, et des chrysoprases ! Et le soleil tombait de tous ses rayons sur le jardin. Et les arbres, avec tous leurs fruits, flambaient sans se consumer.
Alors Aladdin, à la limite du plaisir, s’approcha de l’un de ces arbres et voulut en cueillir quelques fruits pour les manger. Et il constata alors qu’ils n’étaient pas du tout bons à se mettre sous la dent, et qu’ils ne ressemblaient guère que par leurs formes aux oranges, aux figues, aux bananes, aux raisins, aux pastèques, aux pommes et à tous les autres fruits excellents de la Chine. Et il fut bien déçu, en les touchant ; et il ne les trouva point du tout à son goût. Et il pensa qu’ils n’étaient que des boules de verre coloré, car de sa vie il n’avait eu l’occasion de voir des pierres précieuses. Toutefois, bien que fort dépité, il pensa à en cueillir quelques-uns pour en faire cadeau aux jeunes garçons, ses anciens camarades, et aussi à sa mère, cette pauvre ! Et il en prit plusieurs de chaque couleur, et en remplit sa ceinture, ses poches et le dedans de sa robe, entre la robe et la chemise, et entre la chemise et la peau ; et il s’en mit là-dedans une telle quantité qu’il avait l’air d’un âne chargé des deux côtés. Et, lourd de tout cela, il releva soigneusement sa robe, en la serrant étroitement autour de sa taille, et, plein de prudence et de précaution, il traversa avec légèreté les trois salles des cuves, et regagna l’escalier du caveau, à l’entrée duquel l’attendait anxieusement le Maghrébin.
Or, dès qu’Aladdin eut franchi la porte de cuivre, et fut monté sur la première marche de l’escalier, le Maghrébin, qui se trouvait au-dessus de l’ouverture, près de l’entrée même du caveau, n’eut pas la patience d’attendre qu’il fût arrivé au haut des marches et qu’il fût sorti tout à fait du caveau ; et il lui dit : « Eh bien, Aladdin, où est la lampe ? » Et Aladdin répondit : « Je l’ai là, dans mon sein ! » Il dit : « Hâte-toi de l’en tirer et de me la donner ! » Mais Aladdin lui dit : « Comment veux-tu que je te la donne tout de suite, ô mon oncle, alors qu’elle est embarrassée au milieu de toutes les boules de verre dont j’ai bourré mes vêtements de tous côtés ! Laisse-moi plutôt monter cet escalier, et aide-moi à sortir du trou ; et moi alors je me déchargerai de toutes ces boules, en lieu sûr, et non point sur ces degrés où elles risqueraient de rouler et de se briser ! Et, de la sorte, délivré de cette gêne insurmontable, je pourrai retirer la lampe de mon sein et te la donner ! D’ailleurs, elle a déjà glissé derrière mon dos, et me heurte violemment la peau ! et je serais fort aise d’en être débarrassé ! » Mais le Maghrébin, furieux de la résistance d’Aladdin et persuadé qu’Aladdin ne faisait ces difficultés que parce qu’il voulait garder pour lui la lampe, lui cria d’une voix effrayante comme celle d’un démon : « Ô fils de chien, veux-tu tout de suite me donner cette lampe ou mourir ? » Et Aladdin, qui ne sut guère à quoi attribuer ce changement de manières de son oncle, et terrifié de le voir dans une telle fureur, et redoutant de recevoir un second soufflet plus violent que le premier, se dit : « Par Allah ! il vaut mieux que je l’évite ! Et je vais rentrer dans le caveau, en attendant qu’il se soit calmé ! » Et il tourna le dos, et, relevant sa robe, il rentra prudemment dans le souterrain.
À cette vue, le Maghrébin poussa un cri de rage et, à la limite de la fureur, il trépigna et se convulsa, en s’arrachant la barbe, dans son désespoir et son impossibilité de courir derrière Aladdin dans ce caveau qui lui était interdit par les puissances magiques. Et il s’écria : « Ah ! maudit Aladdin, tu vas être puni comme tu le mérites ! » Et il courut au feu, qui n’était pas encore éteint, et il y jeta un peu de la poudre d’encens qu’il avait sur lui, en marmonnant une formule magique. Et aussitôt la plaque de marbre qui servait à fermer l’entrée du caveau se souleva d’elle-même et se remit à sa place première, en bouchant exactement le trou de l’escalier ; et la terre trembla et se referma ; et le sol devint aussi net qu’avant son ouverture. Et Aladdin se trouva de la sorte enfermé dans le souterrain. Or, le Maghrébin était, comme il a été déjà dit, un magicien insigne venu du fond du Maghreb, et non point l’oncle ni le parent de près ou de loin du jeune Aladdin. Et il était véritablement né en Afrique, qui est le pays et la souche des magiciens et des sorciers de la pire qualité…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit aparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il était véritablement né en Afrique, qui est le pays et la souche des magiciens et des sorciers de la pire qualité. Et, dès sa jeunesse, il s’était appliqué avec entêtement à l’étude de la sorcellerie et des envoûtements, et à l’art de la géomancie, de l’alchimie, de l’astrologie, des fumigations et des enchantements. Et, au bout de trente années d’opérations magiques, il était parvenu, par la force de sa sorcellerie, à découvrir qu’il y avait, dans un endroit inconnu de la terre, une lampe extraordinairement magique dont la vertu était de rendre plus puissant que tous les rois et les sultans l’homme assez heureux pour en devenir le possesseur. Alors il avait redoublé de fumigations et de sorcellerie et, par une dernière opération géomantique, il avait réussi à connaître que la lampe en question se trouvait dans un souterrain situé dans les environs de la ville de Kolo-ka-tsé, dans le pays de Chine. (Et cet endroit était précisément celui que nous venons de voir avec tous ses détails.) Et le magicien, sans tarder, s’était mis en route et, après un long voyage, était venu à Kolo-ka-tsé, où il s’était mis aussitôt à explorer les environs et avait fini par délimiter exactement la situation du souterrain avec ce qu’il contenait. Et, par sa table divinatoire, il avait appris que le trésor et la lampe magique étaient écrits, par les puissances souterraines, au nom d’Aladdin, fils de Mustapha, le tailleur, et que lui seul pouvait réussir à faire ouvrir le souterrain et à enlever la lampe, tandis que tout autre devait perdre infailliblement la vie s’il tentait la moindre entreprise de ce côté-là ! Et c’est pourquoi il s’était mis à la recherche d’Aladdin et avait usé, une fois qu’il l’eut trouvé, de tous les détours et expédients pour l’attirer à lui et le conduire dans cet endroit désert, sans éveiller ses soupçons ou ceux de sa mère. Et, une fois qu’Aladdin eut réussi dans l’entreprise, il ne lui avait si hâtivement réclamé la lampe que parce qu’il voulait la lui dérober et le murer à jamais dans le souterrain. Mais nous avons vu comment Aladdin, par crainte de recevoir un second soufflet, s’était enfui à l’intérieur du caveau où ne pouvait pénétrer le magicien, et comment le magicien, pour se venger, l’avait tout de même enfermé là-dedans, pour qu’il mourût de faim et de soif !
Or, cet acte accompli, le magicien, écumant et convulsé, s’en alla en sa voie, probablement vers l’Afrique, son pays. Et voilà pour lui ! Mais il est certain que nous le retrouverons.
Quant à Aladdin, voici !
Dès qu’il fut rentré dans le souterrain, il entendit le tremblement de terre causé par la magie du Maghrébin, et, terrifié, il eut peur que la voûte ne s’écroulât sur sa tête, et il se hâta de regagner l’entrée. Mais, en arrivant à l’escalier, il vit que la lourde plaque de marbre bouchait l’ouverture ; et il fut à l’extrême limite de l’émotion et du saisissement. Car, d’un côté, il ne pouvait comprendre la méchanceté de l’homme qu’il croyait être son oncle et qui l’avait tant caressé et cajolé, et, d’un autre côté, il ne pouvait songer à soulever la plaque de marbre, vu qu’il ne pouvait l’atteindre d’en bas. Dans ces conditions, le désespéré Aladdin se mit à pousser de grands cris, en appelant son oncle et en lui promettant, par toutes sortes de serments, qu’il était prêt à lui donner tout de suite la lampe. Mais il est clair que ses cris et ses sanglots ne furent guère entendus du magicien, qui était déjà bien loin. Et Aladdin, voyant que son oncle ne lui répondait pas, commença à avoir quelques doutes à son sujet, surtout en se rappelant qu’il l’avait appelé fils de chien, injure fort grave et qu’un véritable oncle n’aurait jamais adressée au fils de son frère. Quoi qu’il en soit, il résolut alors d’aller dans le jardin, où il y avait de la lumière, et de chercher une issue pour se sauver de ces lieux de ténèbres. Mais, en arrivant à la porte qui donnait sur le jardin il constata qu’elle était fermée et qu’elle ne s’ouvrait plus devant lui. Alors, affolé, il courut de nouveau à la porte du caveau et se jeta en pleurant sur les marches de l’escalier. Et il se voyait déjà enterré tout vif entre les quatre murs de ce caveau plein de noir et d’horreur malgré tout l’or qu’il contenait. Et il sanglota longtemps, abîmé dans sa douleur. Et, pour la première fois de sa vie, il se mit à penser à toutes les bontés de sa pauvre mère et à son dévouement inlassable, malgré la mauvaise conduite qu’il menait et son ingratitude. Et la mort dans ce caveau lui parut bien plus amère, de ce fait qu’il n’avait pu, durant sa vie, rafraîchir le cœur de sa mère par quelque amélioration dans son caractère et par quelques sentiments de reconnaissance. Et il soupira beaucoup à cette pensée-là, et se mit à se tordre les bras et à se frotter les mains, comme font d’ordinaire les désespérés, disant, en manière de renoncement à la vie : « Il n’y a de recours et de puissance qu’en Allah ! » Or, dans ce mouvement, Aladdin, sans le vouloir, frotta l’anneau qu’il avait au pouce et que lui avait prêté le magicien pour le prémunir contre les dangers du souterrain. Et il ne savait pas, ce Maghrébin maudit, que cet anneau devait précisément sauver la vie à Aladdin, sans quoi il ne le lui aurait certes pas confié, ou se serait hâté de le lui arracher, ou même il n’aurait fermé le souterrain qu’après le lui avoir fait rendre. Mais les magiciens sont tous, par leur essence même, semblables à ce Maghrébin, leur frère : malgré la puissance de leur sorcellerie et de leur science maudite, ils ne savent point prévoir les conséquences des actions les plus simples, et ne songent jamais à se prémunir contre les dangers que distinguent les hommes du commun. Car, dans leur orgueil et leur confiance en eux-mêmes, ils n’ont jamais recours au Maître des créatures, et leur esprit reste constamment obscurci d’une fumée plus épaisse que celle de leurs fumigations, et leurs yeux sont voilés d’un bandeau, et ils tâtonnent dans les ténèbres !
Donc, lorsque le désespéré Aladdin eut frotté, sans le vouloir, l’anneau qu’il avait au pouce et dont il ignorait la vertu…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Donc, lorsque le désespéré Aladdin eut frotté, sans le vouloir, l’anneau qu’il avait au pouce et dont il ignorait la vertu, il vit soudain surgir devant lui, comme s’il sortait de terre, un immense et gigantesque éfrit, semblable à un nègre noir, avec une tête comme un chaudron et une figure épouvantable et des yeux rouges, énormes et flamboyants, qui s’inclina devant lui et, d’une voix aussi retentissante que le roulement du tonnerre, lui dit : « Entre tes mains, ici, ton esclave le voici ! Parle, que veux-tu ? Je suis le serviteur de l’anneau, sur la terre, dans les airs et sur l’eau ! »
À cette vue, Aladdin, qui n’était guère courageux, fut bien terrifié ; et, en tout autre lieu ou dans toute autre circonstance, il serait tombé évanoui ou aurait livré ses jambes au vent. Mais, dans ce caveau où il se voyait déjà mort de faim et de soif, l’intervention de cet effroyable éfrit lui parut d’un grand secours, surtout quand il eut entendu la question qu’il lui posait. Et il put remuer la langue et répondre : « Ô grand cheikh des éfrits de l’air, de la terre et de l’eau, fais-moi vite sortir de ce caveau ! »
Or, à peine Aladdin eut-il prononcé ces mots que la terre se mouvementa et s’entr’ouvrit au-dessus de sa tête, et il se trouva en un clin d’œil transporté hors du caveau, à l’endroit même où le Maghrébin avait allumé le feu. Quant à l’éfrit, il avait disparu.
Alors Aladdin, tout tremblant encore d’émotion, mais bien heureux d’être revenu à l’air libre, remercia Allah le Bienfaiteur qui l’avait délivré d’une mort certaine et sauvé des embûches du Maghrébin. Et il regarda autour de lui et vit, dans le loin, la ville au milieu de ses jardins. Et il se hâta de reprendre le chemin par où l’avait conduit le magicien, sans tourner la tête une seule fois en arrière, vers la vallée. Et il arriva au milieu de la nuit, exténué et à bout d’haleine, dans la maison où sa mère, bien anxieuse de son retard, l’attendait en se lamentant. Et elle courut lui ouvrir, et eut juste le temps de le prendre dans ses bras, où, n’en pouvant plus d’émotion, il était tombé évanoui.
Lorsqu’Aladdin, à force de soins, fut revenu de son évanouissement, sa mère lui donna de nouveau à boire un peu d’eau de roses. Puis, bien anxieuse, elle lui demanda ce qu’il éprouvait. Et Aladdin répondit : « Ô ma mère, j’ai bien faim ! Je te prie donc de me donner à manger, car depuis ce matin je n’ai rien pris ! » Et la mère d’Aladdin courut lui apporter tout ce qu’il y avait dans la maison. Et Aladdin se mit à manger avec tant de hâte, que sa mère, craignant qu’il n’étouffât, lui dit : « Ne te presse pas, mon fils ! ton gosier va éclater ! Et si tu manges si vite pour me raconter plus tôt ce que tu as à me raconter, sache que nous en avons tout le temps ! Du moment que je te revois, je suis tranquille ! mais Allah sait quelle a été mon anxiété, quand j’ai vu la nuit s’avancer sans que tu fusses de retour ! » Puis elle s’interrompit pour lui dire : « Ah ! mon fils, modère-toi, de grâce ! prends des morceaux plus petits ! » Et Aladdin, qui avait eu tôt fait de dévorer tout ce qui était devant lui, demanda à boire, et prit la cruche d’eau et la vida dans son gosier, sans arrêt. Après quoi il fut content, et dit à sa mère : « Je vais pouvoir enfin, ô mère, te raconter tout ce qui m’est arrivé avec l’homme que tu croyais être mon oncle et qui m’a fait voir la mort à deux doigts de mes yeux ! Ah ! tu ne savais pas que ce n’était pas du tout mon oncle, le frère de mon père, ce trompeur qui me faisait tant de caresses et m’embrassait si tendrement, ce maudit, ce Maghrébin, ce sorcier, ce menteur, ce fourbe, ce roué, cet entortilleur, ce chien, ce sale, ce démon qui n’a point son pareil parmi les démons, sur la face de la terre ! Éloigné soit le Malin ! » Puis il ajouta : « Écoute plutôt, ô mère, ce qu’il m’a fait ! » Et il dit encore : « Ah ! que je suis content d’être délivré d’entre ses mains ! » Puis il s’arrêta un moment, respira à plusieurs reprises et, soudain, tout d’une haleine, il se mit à raconter tout ce qui lui était arrivé, depuis le commencement jusqu’à la fin, y compris le soufflet, l’injure et le reste, sans omettre un seul détail. Mais il n’y a aucune utilité à le répéter.
Et, lorsqu’il eut fini son récit, il défit sa ceinture et laissa tomber sur le matelas étendu par terre la merveilleuse provision des fruits transparents et colorés qu’il avait cueillis dans le jardin. Et la lampe était également dans le tas, au milieu des boules de pierreries.
Et il ajouta, pour terminer : « Voilà, ô mère, mon aventure avec ce magicien maudit, et voilà tout ce que m’a rapporté mon voyage au souterrain ! » Et, parlant ainsi, il montrait à sa mère les boules merveilleuses, mais avec une moue bien méprisante qui signifiait : « Je ne suis plus un enfant pour jouer avec des boules de verre ! »
Or, pendant tout le temps qu’avait parlé son fils Aladdin, la mère avait écouté en jetant, dans les endroits les plus surprenants ou les plus touchants du récit, des exclamations de colère contre le magicien et de commisération pour Aladdin. Et, sitôt qu’il eut fini de raconter cette étrange aventure, elle ne put se retenir davantage, et éclata en injures contre le Maghrébin, l’appelant de tous les noms que l’indignation et la colère d’une mère qui a failli perdre son enfant peut trouver pour qualifier la conduite de l’agresseur. Et, lorsqu’elle se fut un peu déchargée, elle serra son fils Aladdin contre sa poitrine et l’embrassa en pleurant et dit : « Remercions Allah, ô mon fils, qui t’a tiré sain et sauf des mains de ce sorcier maghrébin ! Ah ! le traître, le maudit ! Il a voulu ta mort, sans aucun doute, pour posséder cette misérable lampe de cuivre qui ne vaut pas une demi-drachme ! Comme je le déteste ! Comme je l’abomine ! Mon pauvre enfant, mon fils Aladdin, je te retrouve ! Mais quel danger n’as-tu pas couru de ma propre faute, moi qui aurais dû pourtant deviner, aux yeux louches de ce Maghrébin, qu’il n’était ni ton oncle ni rien d’approchant, mais un magicien maudit et un mécréant ! »
Et, en parlant ainsi, la mère avait pris son fils Aladdin tout contre elle, sur le matelas, et l’embrassait et le berçait doucement. Et Aladdin, qui n’avait pas dormi depuis trois jours, occupé qu’il avait été par son aventure avec le Maghrébin, ne tarda pas, bercé de la sorte, à fermer les yeux et à s’endormir sur les genoux de sa mère. Et elle le coucha avec mille précautions sur le matelas, et ne tarda pas, elle aussi, à se coucher auprès de lui et à s’endormir.
Or, le lendemain, à leur réveil…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, le lendemain, à leur réveil, ils commencèrent par s’embrasser beaucoup, et Aladdin dit à sa mère que son aventure l’avait corrigé à jamais de la gaminerie et du vagabondage, et qu’il allait désormais chercher du travail, comme un homme. Puis, comme il avait encore faim, il demanda à déjeuner, et sa mère lui dit : « Hélas ! mon fils, tout ce qu’il y avait dans la maison, je te l’ai donné hier au soir, et je n’ai plus un seul morceau de pain. Mais prends un peu de patience, jusqu’à ce que je puisse aller vendre le peu de coton que j’ai filé ces jours derniers et t’acheter quelque chose avec l’argent de la vente ! » Mais Aladdin répondit : « Laisse le coton pour une autre fois, ô mère, et aujourd’hui prends cette vieille lampe que j’ai rapportée du souterrain, et va la vendre dans le souk des marchands de cuivre. Et probablement tu en retireras quelque argent qui nous permettra de subsister toute cette journée ! » Et la mère d’Aladdin répondit : « Tu dis vrai, mon fils ! Et demain je prendrai les boules de verre que tu as également rapportés de ce lieu maudit, et j’irai les vendre dans le quartier des nègres, qui me les achèteront à un meilleur prix que les marchands ordinaires ! »
La mère d’Aladdin prit donc la lampe, pour aller la vendre ; mais elle la trouva bien sale, et dit à Aladdin : « Je vais d’abord, mon fils, nettoyer cette lampe qui est sale, afin de la rendre luisante et de pouvoir en tirer le meilleur prix ! » Et elle alla à sa cuisine, prit dans sa main un peu de cendre qu’elle mélangea avec de l’eau, et se mit à nettoyer la lampe. Or, elle avait à peine commencé à la frotter que soudain surgit devant elle, sorti d’on ne sait où, un effroyable éfrit, certainement plus laid que celui du souterrain, et si énorme que sa tête touchait le plafond. Et il s’inclina devant elle et dit d’une voix assourdissante : « Entre tes mains, ici, ton esclave le voici ! Parle, que veux-tu ? Je suis le serviteur de la lampe, soit que dans les airs je vole, soit que sur la terre je rampe ! »
Lorsque la mère d’Aladdin eut vu cette apparition à laquelle elle était loin de s’attendre, et comme elle n’était pas habituée à de telles choses, elle fut clouée à sa place de terreur ; et sa langue se lia, et sa bouche s’ouvrit ; et, folle d’épouvante et d’horreur, elle ne put supporter davantage d’avoir sous les yeux une figure aussi hideuse et épouvantable que cellelà, et elle tomba évanouie.
Alors Aladdin, qui se trouvait aussi dans la cuisine, et qui avait déjà été un peu habitué à des figures de cette sorte-là par celle, peut-être plus laide et monstrueuse, qu’il avait vue dans le caveau, ne fut pas aussi ému que sa mère. Et il comprit que cette lampe était la cause de l’apparition de l’éfrit ; et il se hâta de la prendre d’entre les mains de sa mère, toujours évanouie ; et il la tint d’une façon ferme entre les dix doigts, et dit à l’éfrit : « Ô serviteur de la lampe, j’ai bien faim, et je désire que tu m’apportes, pour que je les mange, des choses extrêmement excellentes ! » Et le genni disparut aussitôt, mais pour revenir, un instant après, portant sur sa tête un grand plateau d’argent massif, sur lequel étaient rangés douze plats d’or pleins de mets odorants et exquis au goût et à la vue, avec six pains tout chauds et blancs comme neige et dorés en leur milieu, deux grands flacons d’un vieux vin clair et excellent, et, entre ses mains, un tabouret d’ébène incrusté de nacre et d’argent et deux tasses d’argent. Et il posa le plateau sur le tabouret, rangea rapidement ce qui était à ranger et, discrètement, disparut.
Alors Aladdin, voyant que sa mère était toujours évanouie, lui jeta de l’eau de roses sur le visage, et cette fraîcheur jointe aux délicieuses odeurs des mets fumants ne manqua pas de réunir les esprits qui s’étaient disjoints et de faire revenir à elle la pauvre femme. Et Aladdin se hâta de lui dire : « Allons, ô mère, cela n’est rien ! Lève-toi et viens manger ! Grâce à Allah, voici de quoi te remettre tout à fait le cœur et les sens et satisfaire notre faim ! De grâce, ne laissons pas refroidir ces mets excellents ! »
Lorsque la mère d’Aladdin eut vu le plateau d’argent posé sur ce beau tabouret, les douze plats d’or avec leur contenu, les six merveilleuses galettes, les deux flacons et les deux tasses, et que son odorat eut été touché par l’odeur sublime qui s’exhalait de toutes ces bonnes choses, elle oublia les circonstances de son évanouissement et dit à Aladdin : « Ô mon fils, qu’Allah protège la vie de notre sultan ! Il a sans doute entendu parler de notre pauvreté et nous a envoyé ce plateau par un de ces cuisiniers ! » Mais Aladdin répondit : « Ô ma mère, ce n’est pas le moment des suppositions ou des demandes ! Commençons d’abord par manger, et je te raconterai ensuite ce qui est arrivé. »
Alors la mère d’Aladdin vint s’asseoir à côté de lui, en ouvrant des yeux pleins d’étonnement et d’admiration devant de si merveilleuses nouveautés ; et tous deux se mirent à manger de grand appétit. Et ils éprouvèrent un tel plaisir, qu’ils restèrent longtemps autour du plateau, ne se lassant pas de goûter à des mets si bien apprêtés, tant et tant qu’ils finirent par joindre ensemble le repas du matin et celui du soir. Et lorsqu’ils eurent enfin fini, ils mirent de côté les restes du repas, pour le lendemain. Et ce fut la mère d’Aladdin qui alla serrer dans l’armoire de la cuisine les plats et leur contenu, mais pour revenir aussitôt près d’Aladdin écouter ce qu’il avait à lui raconter concernant ce généreux cadeau. Et Aladdin lui révéla alors ce qui s’était passé, et comment le genni serviteur de la lampe avait exécuté l’ordre, sans hésitation.
Alors, la mère d’Aladdin, qui avait écouté le récit de son fils avec une épouvante de plus en plus grande, fut prise d’une grande agitation et s’écria : « Ah ! mon fils, je te conjure par le lait dont j’ai allaité ton enfance, de jeter loin de toi cette lampe magique et de te défaire de cet anneau, don des éfrits maudits ! car, moi, je ne pourrai point une seconde fois supporter la vue de si laides et effroyables figures, et j’en mourrai certainement. D’ailleurs, je sens que ces mets que je viens de manger me remontent à la gorge et vont m’étouffer. Et puis notre prophète Môhammad (qu’Il soit béni !) nous a bien recommandé de nous tenir en garde contre les genn et les éfrits, et de ne jamais chercher leur société ! » Aladdin répondit : « Tes paroles, ma mère, sont sur ma tête et mes yeux ! Mais, vraiment, je ne puis me défaire ni de la lampe ni de l’anneau ! Car l’anneau m’a été d’un grand secours en me sauvant d’une mort certaine dans le caveau, et tu viens d’être témoin toi-même du service que nous a rendu cette lampe que voici et qui est si précieuse que le maudit Maghrébin n’avait pas hésité à venir de si loin à sa recherche. Toutefois, ma mère, pour te faire plaisir et par égard pour toi, je vais cacher la lampe, afin que sa vue ne heurte pas tes yeux et ne soit pas pour toi un sujet de crainte dans l’avenir ! » Et la mère d’Aladdin répondit : « Fais ce que tu veux, mon fils. Mais, pour ma part, je déclare que je ne veux plus avoir affaire avec les éfrits, pas plus avec le serviteur de l’anneau qu’avec celui de la lampe ! Et je désire que tu ne m’en parles plus, quoi qu’il puisse arriver…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et je désire que tu ne m’en parles plus, quoi qu’il puisse arriver ! »
Or, le lendemain, lorsque les excellentes provisions furent épuisées, Aladdin, ne voulant pas, pour éviter à sa mère de nouvelles frayeurs, recourir trop vite à la lampe, prit un des plats d’or, le cacha sous sa robe, et sortit dans l’intention de le vendre au souk et, avec l’argent de la vente, de rapporter les provisions nécessaires à la maison. Et il alla à la boutique d’un juif, qui était plus rusé que le Cheitân. Et il tira de sa robe le plat d’or et le remit au juif, qui le prit, l’examina, le gratta et, d’un air détaché, demanda à Aladdin : « Combien demandes-tu de ça ? » Et Aladdin, qui de sa vie n’avait vu de plats d’or et était loin de connaître la valeur de pareilles marchandises, répondit : « Par Allah, ô mon maître, tu sais mieux que moi ce que peut valoir ce plat ; et je m’en rapporte là-dessus à ton estimation et à ta bonne foi ! » Et le juif, qui avait bien vu que le plat était de l’or le plus pur, se dit : « Voilà un garçon qui ignore le prix de ce qu’il possède. C’est une excellente aubaine que m’envoie aujourd’hui la bénédiction d’Abraham ! » Et il ouvrit un tiroir dissimulé dans le mur de la boutique, et en tira une seule pièce d’or qu’il tendit à Aladdin, et qui ne représentait pas la millième partie de la valeur du plat, et lui dit : « Tiens, mon fils, voici pour ton plat ! Par Moïse et Aaron ! jamais je n’aurais offert une pareille somme à un autre qu’à toi ! mais c’est seulement pour t’avoir comme client dans l’avenir ! » Et Aladdin prit le dinar d’or avec un grand empressement et, sans penser même à se retourner, il se hâta, tant il était content, de livrer ses jambes au vent. Et le juif, voyant la joie d’Aladdin et sa hâte à s’éloigner, regretta fort de ne lui avoir pas donné un prix encore plus modique et fut sur le point de courir derrière lui pour essayer de soutirer quelque chose de la pièce d’or ; mais il renonça à son projet, en voyant qu’il ne pourrait pas le rattraper.
Quant à Aladdin, sans perdre de temps, il courut chez le boulanger, lui acheta du pain, fit de la monnaie avec le dinar d’or, et rentra à la maison pour donner à sa mère et le pain et la monnaie, en lui disant : « Ma mère, va maintenant nous acheter, avec cette monnaie, les provisions nécessaires ; car, moi, je ne m’y connais pas ! » Et la mère se leva et s’en alla au souk acheter tout ce dont ils avaient besoin. Et, ce jour-là, ils mangèrent et furent contents. Et Aladdin se mit depuis lors, chaque fois qu’ils n’avaient plus d’argent, à aller au souk vendre un plat d’or au même juif, qui lui remettait toujours un dinar, n’osant pas, lui ayant donné cette somme la première fois, lui donner moins, de peur de le voir aller proposer sa marchandise à d’autres juifs, qui réaliseraient ainsi, à sa place, le bénéfice immense de l’affaire. Aussi Aladdin, qui continuait à ignorer la valeur de ce qu’il possédait, lui vendit de la sorte les douze plats d’or. Et il songea alors à lui porter le grand plateau d’argent massif ; mais comme il le trouvait très pesant, il alla quérir le juif qui vint à la maison, examina le plateau précieux et dit à Aladdin : « Celui-ci vaut deux pièces d’or ! » Et Aladdin, enchanté, consentit la vente, et prit l’argent que le juif ne voulut lui donner que moyennant la remise, par dessus le marché, des deux tasses d’argent.
De cette façon, Aladdin et sa mère eurent encore de quoi subsister pendant quelques jours. Et Aladdin continua à aller dans les souks s’entretenir gravement avec les marchands et les gens de distinction ; car, depuis son retour, il s’était soigneusement abstenu de la fréquentation de ses anciens camarades, les jeunes garçons du quartier ; et il s’appliquait maintenant à s’instruire en écoutant les conversations des personnes âgées ; et il acquit, en peu de temps, vu qu’il était plein de sagacité, toutes sortes de notions précieuses que bien peu de jeunes gens de son âge étaient capables d’acquérir.
Sur ces entrefaites, l’argent vint de nouveau à manquer à la maison, et Aladdin, ne pouvant faire autrement, fut bien obligé, malgré toute la terreur de sa mère, de recourir à la lampe magique. Toutefois la mère, avertie du projet d’Aladdin, se hâta de sortir de la maison, ne pouvant souffrir de s’y trouver au moment de l’apparition de l’éfrit. Et Aladdin, libre alors d’agir à sa guise, prit la lampe à la main, et chercha l’endroit précis qu’il fallait toucher, et qui était reconnaissable à l’impression laissée par le premier nettoyage avec la cendre ; et il le frotta, sans hâte, et fort légèrement. Et aussitôt apparut le genni, qui s’inclina et, d’une voix bien calme, à cause précisément de la légèreté du frottement, dit à Aladdin : « Entre tes mains, ici, ton esclave le voici ! Parle, que veux-tu ? Je suis le serviteur de la lampe, soit que dans les airs je vole, soit que sur la terre je rampe ! » Et Aladdin se hâta de répondre : « Ô serviteur de la lampe, j’ai bien faim, et je désire un plateau de mets en tous points semblable à celui que tu m’as apporté la première fois ! » Et le genni disparut, mais pour reparaître, en moins d’un clin d’œil, chargé du plateau en question qu’il posa sur le tabouret ; et il se retira on ne sait où.
Or, peu de temps après, revint la mère d’Aladdin ; et elle vit le plateau et son odorant et si charmant contenu ; et elle ne fut pas moins émerveillée que la première fois. Et elle s’assit à côté de son fils, et toucha aux mets qu’elle trouva encore plus exquis que ceux du premier plateau. Et, malgré la terreur que lui inspirait le genni serviteur de la lampe, elle mangea de grand appétit ; et elle ne put, pas plus elle qu’Aladdin, s’arracher de devant le plateau avant de s’être rassasiée complètement ; mais comme ces mets excitaient l’appétit en proportion même de la quantité qu’on en mangeait, elle ne se leva qu’à la nuit tombante, ayant ainsi uni le repas du matin avec celui de midi et celui du soir. Et Aladdin également.
Lorsque les provisions du plateau furent épuisées, comme la première fois…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Lorsque les provisions du plateau furent épuisées, comme la première fois, Aladdin ne manqua pas de prendre un des plats d’or et d’aller au souk, selon son habitude, pour le vendre au juif, comme il l’avait déjà fait pour les autres plats. Et, comme il passait devant la boutique d’un vénérable cheikh musulman, orfèvre très estimé pour sa probité et sa bonne foi, il fut appelé par son nom et s’arrêta. Et le vénérable orfèvre lui fit signe de la main et l’invita à entrer un moment dans la boutique. Et il lui dit : « Mon fils, j’ai déjà eu bien des fois l’occasion de te voir passer dans le souk, et j’ai remarqué que tu portais toujours sous ta robe quelque chose que tu cherchais à dissimuler ; et tu entrais dans la boutique de mon voisin le juif, pour ensuite sortir sans l’objet que tu cachais. Or, je dois te prévenir, mon fils, d’une chose que tu ignores peut-être, à cause de ton jeune âge ! Sache, en effet, que les juifs sont les ennemis nés des musulmans ; et ils considèrent que nos biens sont chose licite à dérober par tous les moyens possibles. Et, entre tous les juifs, celui-là précisément est le plus détestable, le plus adroit, le plus trompeur et le plus nourri de haine contre nous qui croyons en Allah l’Unique ! Si donc, ô mon enfant, tu as quelque chose à vendre, commence par me le montrer, et moi, par la vérité d’Allah Très-Haut ! je te l’estimerai à sa juste valeur, afin qu’en le cédant tu saches exactement ce que tu fais ! Montre-moi donc sans crainte ni défiance ce que tu caches sous ta robe ! et qu’Allah maudisse les trompeurs et confonde le Malin ! Éloigné soit-il à jamais ! » En entendant ces paroles du vieil orfèvre, Aladdin, mis en confiance, n’hésita pas à tirer le plat d’or de dessous sa robe et à le lui montrer. Et le cheikh jugea au premier coup d’œil la valeur de l’objet et demanda à Aladdin : « Peux-tu maintenant me dire, mon fils, combien de plats de cette sorte tu as vendus à ce juif, et à quel prix tu les lui as cédés ? » Et Aladdin répondit : « Par Allah, ô oncle, je lui ai déjà donné douze plats semblables à celui-ci, à un dinar chacun ! » Et le vieil orfèvre, à ces paroles, fut à la limite de l’indignation et s’écria : « Ah ! le maudit juif, le fils de chien, la postérité d’Éblis ! » Et, en même temps, il mit le plat dans la balance, le pesa et dit : « Sache, mon fils, que ce plat est de l’or le plus fin et qu’il vaut, non point un dinar, mais exactement deux cents dinars ! Ce qui fait que le juif t’a volé, à lui tout seul, autant que le font, en une seule journée, au détriment des musulmans, tous les juifs réunis du souk ! » Puis il ajouta : « Hélas ! mon fils, ce qui est passé est passé, et nous ne pouvons, faute de témoins, faire empaler ce juif maudit ! En tout cas, pour l’avenir, tu sais à quoi t’en tenir ! Et, si tu veux, je vais te compter sur le champ deux cents dinars pour ton plat. Et même je préfère, avant de te l’acheter, que tu ailles le proposer et le faire estimer à d’autres marchands ; et s’ils t’en offrent davantage, je consens à payer le surplus, et quelque chose d’autre par dessus le marché ! » Mais Aladdin, qui n’avait aucun motif de douter de la probité fort connue du vieil orfèvre, se trouva fort heureux de lui céder le plat à un si beau prix. Et il prit les deux cents dinars. Et, par la suite, pour vendre les onze autres plats et le plateau, il ne manqua pas de s’adresser au même honnête orfèvre musulman.
Or, devenus riches de la sorte, Aladdin et sa mère n’abusèrent point des bienfaits du Rétributeur. Et ils continuèrent à mener une vie modeste, en distribuant aux pauvres et aux besogneux le surplus de leurs besoins. Et Aladdin, pendant ce temps, ne manquait aucune occasion de continuer son instruction et d’affiner son esprit au contact des gens du souk, des marchands de distinction et des personnes de bon ton qui fréquentaient les souks. Et il prit de la sorte, en peu de temps, les manières du beau monde, et se mit en relations suivies avec les orfèvres et les joailliers dont il était devenu l’hôte assidu. Et il apprit de la sorte, en s’habituant à la vue des joyaux et des pierreries, que les fruits du jardin qu’il avait rapportés et qu’il s’imaginait être des boules de verre coloré, étaient des merveilles inestimables qui n’avaient pas leurs pareilles chez les plus puissants et les plus riches des rois et des sultans ! Et, comme il était devenu fort sage et intelligent, il eut la prudence de n’en parler à personne, pas même à sa mère. Seulement, au lieu de laisser ces fruits de pierrerie traîner derrière les coussins du divan et dans tous les coins, il les ramassa avec beaucoup de soin et les cacha dans un coffre qu’il acheta tout exprès. Or, il devait bientôt éprouver les effets de sa sagesse, de la manière la plus brillante et la plus splendide.
En effet, un jour d’entre les jours, comme il causait devant une boutique avec quelques marchands de ses amis…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… En effet, un jour d’entre tous les jours, comme il causait devant une boutique avec quelques marchands de ses amis, il vit circuler à travers les souks deux crieurs du sultan, armés de longs bâtons, et il les entendit qui criaient ensemble, à haute voix : « Ô vous tous, marchands et habitants ! de par l’ordre de notre maître magnanime, le roi du temps et le seigneur des siècles et des moments, sachez que vous devez fermer vos boutiques à l’instant et vous enfermer dans vos maisons, toutes portes closes au dehors et au dedans ! car la perle unique, la merveilleuse, la bienfaisante, notre jeune maîtresse Badrou’l-Boudour, la pleine lune des pleines lunes, fille de notre glorieux sultan, va passer pour aller prendre son bain au hammam ! Que le bain lui soit délicieux ! Quant à ceux qui oseront enfreindre l’ordre et regarder à travers les portes ou les fenêtres, ils seront punis par le glaive, le pal ou le gibet ! Avis est donc donné à ceux qui tiennent à conserver leur sang dans leurs cous ! »
En entendant ce cri public, Aladdin fut pris de l’envie irrésistible de voir passer la fille du sultan, cette merveilleuse Badrou’l-Boudour dont s’entretenait toute la ville et dont on vantait la beauté de lune et les perfections. Aussi, au lieu de faire comme tout le monde et de courir s’enfermer dans sa maison, il eut l’idée d’aller en toute hâte au hammam et de se dissimuler derrière la grande porte, de façon à pouvoir, sans être vu, regarder à travers l’encoignure et admirer à son aise la fille du sultan, à son entrée dans le hammam.
Or, il était à peine là depuis quelques instants qu’il vit arriver le cortège de la princesse, précédé par la foule des eunuques. Et il la vit elle-même au milieu de ses femmes, comme la lune au milieu des étoiles, couverte de ses voiles de soie. Mais, dès qu’elle fut arrivée au seuil du hammam, elle se hâta de se dévoiler le visage ; et elle apparut dans tout l’éclat solaire d’une beauté qui surpassait tout ce qu’on avait pu en dire. C’était, en effet, une adolescente de quinze ans, plutôt moins que plus, droite comme la lettre aleph, d’une taille qui défiait le jeune rameau de l’arbre bân, avec un front éblouissant comme le croissant de la lune au mois de Ramadân, des sourcils déliés et parfaitement tracés, des yeux noirs, grands et langoureux comme les yeux de la gazelle assoiffée, des paupières modestement baissées et telles deux pétales de rose, un nez sans défaut comme une lame de choix, une bouche toute menue avec deux lèvres incarnadines, un teint d’une blancheur lavée dans l’eau de la fontaine Salsabil, un menton souriant, des dents comme des grêlons d’égale grosseur, un cou de tourterelle, et le reste, qui ne se voyait pas, à l’avenant. Et c’est bien d’elle que le poète a dit :
Ses yeux magiciens, avivés de kohl noir, percent les cœurs de leurs flèches acérées ;
C’est aux roses de ses joues qu’empruntent leurs couleurs les roses des bouquets ;
Et sa chevelure est une nuit ténébreuse illuminée par le rayonnement de son front.
Lorsque la princesse fut arrivée à la porte du hammam, et comme elle ne craignait plus les regards indiscrets, elle releva son petit voile de visage, et parut ainsi dans toute sa beauté. Et Aladdin la vit, et du coup il sentit son sang tourner trois fois plus vite dans sa tête. Et c’est alors seulement qu’il s’aperçut, lui qui n’avait jamais eu l’occasion de voir les visages des femmes à découvert, qu’il pouvait y avoir des femmes belles et des femmes laides, et qu’elles n’étaient pas toutes vieilles et semblables à sa mère. Et cette découverte, jointe à la beauté incomparable de la princesse, le stupéfia et l’immobilisa en extase, derrière la porte. Et la princesse était déjà depuis longtemps entrée dans le hammam, qu’il restait encore là interdit et tout tremblant d’émotion. Et, lorsqu’il put rentrer un peu dans ses sens, il se décida à se glisser hors de sa cachette et à regagner sa maison, mais dans quel état de changement et de bouleversement ! Et il pensait : « Par Allah ! qui aurait jamais pu imaginer sur terre une créature si belle ! Béni soit Celui qui l’a formée et douée de la perfection ! » Et, tout plein d’une rumeur de pensées, il entra chez sa mère et, le dos cassé d’émotion et le cœur tout entier saisi d’amour, il se laissa tomber sur le divan, et ne bougea plus.
Or, sa mère ne tarda pas à le voir dans cet état si extraordinaire, et elle s’approcha de lui et le questionna anxieusement. Mais il se refusa à faire la moindre réponse. Alors elle lui apporta le plateau des mets, pour le déjeuner ; mais il ne voulut point manger. Et elle lui demanda : « Qu’as-tu, ô mon enfant ? As-tu mal dans quelque endroit ? Dis-moi ! que t’est-il arrivé ? » Et il finit par répondre : « Laisse-moi ! » Et elle insista pour qu’il mangeât, et le pressa tellement, qu’il consentit à toucher aux mets ; mais il en mangea infiniment moins qu’à l’ordinaire ; et il tenait les yeux baissés, et gardait le silence, sans vouloir répondre aux questions inquiètes de sa mère. Et il resta dans cet état de songerie, de pâleur et d’abattement jusqu’au lendemain.
Alors, la mère d’Aladdin, à la limite de l’anxiété, s’approcha de lui, avec les larmes aux yeux, et lui dit : « Ô mon fils, par Allah sur toi ! dis-moi ce que tu éprouves, et ne torture pas davantage mon cœur par ton silence. Si tu as quelque maladie, ne me la cache pas ! et moi j’irai aussitôt te chercher le médecin. Et précisément nous avons aujourd’hui, de passage dans notre ville, un médecin fameux du pays des Arabes, que notre sultan a fait venir expressément pour le consulter. Et on ne parle que de sa science et de ses remèdes merveilleux ! Veux-tu donc que j’aille te le chercher…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et on ne parle que de sa science et de ses remèdes merveilleux ! Veux-tu donc que j’aille te le chercher ? » Alors Aladdin releva la tête et, d’un ton de voix bien triste, il répondit : « Sache, ô mère, que je suis bien portant et ne souffre pas de maladie ! Et si tu me vois dans cet état de changement, c’est que jusqu’à présent je m’imaginais que toutes les femmes te ressemblaient ! Et ce n’est qu’hier seulement que je me suis aperçu qu’il en était tout autrement ! » Et la mère d’Aladdin leva les bras et s’écria : « Éloigné soit le Malin ! que dis-tu là, Aladdin ? » Il répondit : « Je sais bien, moi, ce que je dis, sois tranquille ! J’ai, en effet, aperçu, à son entrée au hammam, la princesse Badrou’l-Boudour, fille du sultan ! et sa seule vue me révéla l’existence de la beauté ! Et je ne suis plus bon à rien ! Et c’est pourquoi je n’aurai de repos et ne pourrai rentrer en moi-même que lorsque je l’aurai obtenue en mariage du sultan son père ! »
En entendant ces paroles, la mère d’Aladdin pensa que son fils avait perdu l’esprit, et lui dit : « Le nom d’Allah sur toi, mon enfant ! rentre dans ta raison ! ah ! pauvre Aladdin, pense à ta condition, et laisse ces folies ! » Aladdin répondit : « Ô ma mère, je n’ai pas du tout à rentrer dans ma raison, car je ne suis pas du nombre des fous. Et tes paroles ne me feront point renoncer à mon idée de mariage avec El Sett Badrou’l-Boudour, la fille si belle du sultan ! Et mon intention est plus que jamais de la demander à son père ! » Elle dit : « Ô mon fils, par ma vie sur toi ! ne prononce pas de telles paroles, et prends bien garde que l’on ne t’entende dans le voisinage et que l’on aille rapporter tes paroles au sultan qui te ferait pendre sans recours. Et d’ailleurs, si vraiment tu as pris une si folle résolution, penses-tu pouvoir trouver quelqu’un que tu puisses charger de cette demande ? » Il répondit : « Et qui pourrais-je charger d’une mission si délicate, alors que tu es là, ô mère ? et en qui pourrais-je avoir plus de confiance qu’en toi ? Oui, certes ! c’est toi qui iras faire pour moi au sultan cette demande en mariage ! » Elle s’écria : « Qu’Allah me préserve d’une pareille entreprise, ô mon fils ! Je ne suis pas, comme toi, à la limite de la folie ! Ah ! je vois bien à présent que tu oublies que tu es le fils d’un tailleur des plus pauvres et des plus ignorés de la ville, et que moi aussi, ta mère, je ne suis guère d’une famille plus noble ou plus connue ! Comment donc as-tu osé penser à une princesse que son père n’accordera même pas aux fils des puissants rois et des sultans ? » Et Aladdin resta un moment silencieux, puis répondit : « Sache, ô mère, que j’ai déjà pensé et longuement réfléchi à tout ce que tu viens de me dire ; mais cela ne m’a pas empêché de prendre la résolution que je t’ai expliquée, bien au contraire ! Je viens donc te supplier, si vraiment je suis ton fils et si tu m’aimes, de me rendre le service que je te demande ! Sinon, ma mort serait préférable à ma vie ; et tu me perdrais bientôt, sans aucun doute ! Encore une fois, ô mère mienne, n’oublie pas que je suis toujours ton fils Aladdin ! »
En entendant ces paroles de son fils, la mère éclata en sanglots et dit, entre ses larmes : « Ô mon fils, oui, certes ! je suis ta mère, et tu es mon unique enfant, le noyau de mon cœur ! Et mon vœu le plus cher a toujours été de te voir un jour marié et de me réjouir de ton bonheur, avant de mourir ! Ainsi donc, si tu veux bien te marier, je m’empresserai d’aller te chercher une femme parmi les gens de notre condition ! Et encore faudra-t-il que je sache ce que je dois leur répondre quand ils me demanderont des renseignements sur toi, sur le métier que tu exerces, le gain que tu fais et les biens et les terres que tu possèdes ! Et cela me trouble beaucoup ! Mais que sera-ce s’il s’agit, non plus d’aller chez des gens de condition humble, mais de demander pour toi au sultan de la Chine sa fille unique El Sett Badrou’l-Boudour. Voyons, mon fils ! réfléchis un instant avec modération ! Je sais bien que notre sultan est plein de bienveillance et qu’il ne renvoie jamais aucun de ses sujets sans lui rendre la justice que nécessite son cas ! Et je sais également qu’il est généreux à l’excès et qu’il ne refuse jamais rien à celui qui a mérité ses grâces par quelque action d’éclat, quelque fait de bravoure ou quelque service grand ou petit ! Mais, toi, peux-tu me dire en quoi tu t’es fait remarquer jusqu’à présent, et quels titres tu peux avoir qui puissent te mériter cette faveur incomparable que tu sollicites ? Et encore ! où sont les cadeaux que tu dois, comme tout solliciteur de grâces, aller offrir au roi, en hommage d’un sujet féal à son suzerain ? » Il répondit : « Justement ! S’il ne s’agit que de faire un beau cadeau pour obtenir ce que souhaite tant mon âme, eh bien ! je crois que nul homme sur la terre ne peut lutter avec moi en pareille matière ! Sache en effet, ô mère, que ces fruits de toutes les couleurs que j’ai rapportés du jardin souterrain et que je croyais être simplement des boules de verre sans valeur aucune et bons tout au plus à servir de jeu aux petits enfants, sont des pierreries inestimables dont nul sultan sur la terre ne possède les pareilles. Et d’ailleurs tu vas pouvoir toi-même en juger, malgré ton peu d’expérience en ces sortes de choses-là ! Tu n’as pour cela qu’à m’apporter de la cuisine un plat de porcelaine assez grand pour les contenir, et tu en verras alors l’effet merveilleux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Tu n’as pour cela qu’à m’apporter de la cuisine un plat de porcelaine assez grand pour les contenir, et tu en verras alors l’effet merveilleux. »
Et la mère d’Aladdin, bien que fort surprise de tout ce qu’elle entendait, alla à la cuisine chercher un grand plat de porcelaine blanche bien propre et le remit à son fils. Et Aladdin, qui avait déjà apporté les fruits en question, se mit à les ranger avec beaucoup d’art dans la porcelaine, en tenant compte de leurs couleurs différentes, de leurs formes et de leurs variétés. Et quand il eut fini, il les mit sous les yeux de sa mère, qui en fut absolument éblouie, tant à cause de leur éclat que de leur beauté. Et elle ne put s’empêcher, malgré qu’elle ne fût guère habituée à la vue des pierreries, de s’écrier : « Ya Allah ! que c’est admirable ! » Et elle fut même obligée, au bout d’un moment, de fermer les yeux d’éblouissement. Et elle finit par dire : « Je vois bien à présent, mon fils, que le cadeau pourra être agréé du sultan ! c’est vrai ! Mais la difficulté n’est plus là ! elle est dans la démarche que j’aurai à faire ; car je sens bien que je ne pourrai guère soutenir la majesté de la présence du sultan, et que je resterai immobile, avec ma langue liée, ou peut-être même que je m’évanouirai d’émoi et de confusion ! Mais en supposant même que, me faisant violence à moi-même pour satisfaire ton âme pleine de ce désir, je puisse arriver à exposer ta demande au sultan concernant sa fille Badrou’l-Boudour, que va-t-il arriver ? Oui, que va-t-il arriver ? Eh bien, mon fils, ou l’on croira que je suis folle et l’on me chassera du palais, ou le sultan, irrité d’une telle demande, nous punira tous deux d’une façon terrible ! Si tout de même tu penses le contraire, et que le sultan donne suite à ta demande, encore va-t-il m’interroger sur ton état et ta condition. Et il me dira : « Oui ! ce cadeau est fort beau, ô femme ! Mais qui es-tu ? Et qui est ton fils Aladdin ? Et qu’est-ce qu’il fait ? Et qui est son père ? Et quel est son gain ? Et telle chose, et telle autre chose ? » Et alors, moi, je serai bien obligée de lui dire que tu n’exerces aucun métier et que ton père n’était qu’un pauvre tailleur d’entre les tailleurs du souk ! » Mais Aladdin répondit : « Ô mère, sois tranquille ! il est impossible que le sultan te fasse de pareilles questions, lorsqu’il aura vu les merveilleuses pierreries rangées, comme des fruits, dans la porcelaine ! Sois donc sans crainte, et ne te préoccupe pas de ce qui ne va pas arriver. Au contraire, lève-toi seulement et va lui offrir le plat avec son contenu, et demande-lui pour moi, en mariage, sa fille Badrou’l-Boudour ! Et ne commence pas à appesantir tes pensées sur une affaire si aisée et si simple ! N’oublie pas, en effet, si tu as encore des doutes sur la réussite, que j’ai en ma possession une lampe qui suppléera pour moi à tous les métiers et à tous les gains ! »
Et il continua à parler à sa mère avec tant de chaleur et d’assurance, qu’il finit par la convaincre complètement. Et il la pressa de mettre ses plus beaux habits ; et il lui remit le plat de porcelaine qu’elle se hâta d’envelopper dans un foulard en le liant par les quatre coins, pour le porter à la main. Et elle sortit de la maison et se dirigea vers le palais du sultan. Et elle pénétra dans la salle des audiences, avec la foule des solliciteurs. Et elle se plaça tout au premier rang, mais dans une attitude bien humble au milieu des assistants qui se tenaient les bras croisés et les yeux baissés avec le plus profond respect. Et la séance du diwân s’ouvrit, quand le sultan eut fait son entrée, suivi de ses vizirs, de ses émirs et de ses gardes. Et le chef des scribes du sultan se mit à appeler, les uns après les autres, les demandeurs, selon l’ordre des requêtes. Et l’on jugea les affaires, séance tenante. Et les demandeurs s’en allèrent les uns contents du gain de leur procès, les autres bien allongée quant à leurs nez, et d’autres n’ayant pas été appelés, faute de temps. Et la mère d’Aladdin fut précisément au nombre de ces derniers.
Aussi, lorsqu’elle vit que la séance était terminée et que le sultan s’était retiré, suivi de ses vizirs, elle comprit qu’elle n’avait plus, elle aussi, qu’à s’en aller. Et elle sortit du palais et s’en retourna chez elle. Et Aladdin, qui, dans son impatience, l’attendait à la porte, la vit rentrer tenant toujours à la main le plat de porcelaine ; et il fut bien ému et bien perplexe et, craignant quelque malheur survenu ou quelque sinistre nouvelle, il ne voulut point lui poser de questions dans la rue et se hâta de l’entraîner dans la maison, où, bien jaune de teint, il l’interrogea du geste et des yeux, vu qu’il ne pouvait ouvrir la bouche d’émotion. Et la pauvre femme lui raconta ce qui était arrivé, en ajoutant : « Il faut excuser ta mère pour cette fois, mon fils ; car je n’ai point l’habitude des palais ; et la vue du sultan m’a tellement troublée, que je n’ai pu avancer pour faire ma demande. Mais demain, si Allah veut, je retournerai au palais et j’aurai plus de courage que cette fois-ci ! » Et Aladdin, malgré toute son impatience, fut tout de même heureux d’apprendre qu’il n’y avait pas de motif plus grave du retour, entre les mains de sa mère, de la porcelaine. Et il fut même bien satisfait que la démarche la plus difficile eût été faite sans encombre et sans mauvaises conséquences pour sa mère et pour lui. Et il se consola à la pensée que le retard allait bientôt être réparé.
En effet, le lendemain la mère s’en alla au palais, en tenant par les quatre coins le foulard qui renfermait le présent de pierreries…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT QUARANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… En effet, le lendemain la mère s’en alla au palais, en tenant par les quatre coins le foulard qui renfermait le présent de pierreries. Et elle était bien résolue à surmonter sa timidité et à faire sa demande. Et elle entra au diwân, et se plaça au premier rang, devant le sultan. Mais, comme la première fois, elle ne put faire un pas de plus ni un geste qui attirât sur elle l’attention du chef des scribes. Et la séance fut levée, sans résultat ; et elle s’en retourna, la tête basse, annoncer à Aladdin l’insuccès de sa tentative, mais en lui promettant la réussite pour la prochaine fois. Et Aladdin fut bien obligé de faire une nouvelle provision de patience, tout en admonestant sa mère pour son manque de courage et de fermeté. Mais cela ne servit pas à grand’chose, car la pauvre femme, six jours de suite, se rendit au palais, avec la porcelaine, et se plaça toujours en face du sultan, mais sans plus de courage ou de succès que la première fois. Et, certainement elle y serait retournée cent autres fois, aussi inutilement, et Aladdin serait mort de désespoir et d’impatience rentrée, si le sultan lui-même, qui avait fini par la remarquer, vu qu’elle était au premier rang à chaque séance du diwân, n’avait eu la curiosité de s’informer d’elle et du motif de sa présence. En effet, le septième jour, après la fin du diwân, le sultan se tourna vers son grand-vizir et lui dit : « Regarde cette vieille femme qui tient à la main quelque chose dans un foulard. Depuis plusieurs jours elle vient régulièrement au diwân et se tient immobile sans rien demander. Peux-tu me dire ce qu’elle fait ici ou ce qu’elle désire ? » Et le grand-vizir, qui ne connaissait guère la mère d’Aladdin, ne voulut point demeurer à court de réponse, et dit au sultan : « Ô mon maître, c’est une vieille d’entre les nombreuses vieilles qui ne viennent au diwân que pour des futilités. Et celle-ci doit, sans aucun doute, avoir à se plaindre de ce qu’on lui a vendu de l’orge pourri, par exemple, ou de ce que sa voisine lui a dit des injures, ou de ce que son mari l’a battue ! » Mais le sultan ne voulût point se contenter de cette explication et dit au vizir : « Je désire tout de même interroger cette pauvre femme. Fais-la avancer, avant qu’elle se retire avec les autres ! » Et le vizir répondit par l’ouïe et l’obéissance, en portant sa main à son front. Et il fit quelques pas vers la mère d’Aladdin et, de la main, lui fit signe d’avancer. Et la pauvre femme, toute tremblante, s’avança jusqu’au pied du trône, et tomba plutôt qu’elle ne se prosterna, et embrassa la terre entre les mains du sultan, comme elle l’avait vu faire aux autres assistants. Et elle demeura dans cette posture, jusqu’à ce que le grand-vizir vint lui toucher l’épaule et l’aider à se relever. Et elle se tint debout, pleine d’émoi ; et le sultan lui dit : « Ô femme, il y a déjà plusieurs jours que je te vois venir au diwân et rester immobile sans rien demander. Dis-moi donc ce qui t’amène ici, et ce que tu désires, afin que je te rende justice. Et la mère d’Aladdin, un peu encouragée par la voix bienveillante du sultan, répondit : « Qu’Allah fasse descendre ses bénédictions sur la tête de notre maître le sultan. Quant à ta servante, ô roi du temps, elle te supplie, avant d’exposer sa demande, de daigner lui accorder la promesse de la sécurité, sinon j’aurai bien peur d’offenser les oreilles du sultan, vu que ma demande peut paraître étrange ou singulière ! » Or, le sultan, qui était un homme bon et magnanime, se hâta de lui promettre la sécurité ; et même il donna l’ordre de faire complètement évacuer la salle, afin de permettre à la femme de lui parler en toute liberté. Et il ne garda auprès de lui que son grand-vizir. Et il se tourna vers elle et lui dit : « Tu peux parler, — la sécurité d’Allah est sur toi, ô femme ! » Mais la mère d’Aladdin, qui avait repris complètement courage à cause de l’accueil affable du sultan, répondit : « Je demande également d’avance à notre sultan le pardon pour ce qu’il pourra trouver d’inconvenant dans ma requête, et pour l’audace extraordinaire de mes paroles ! » Et le sultan, de plus en plus intrigué, dit : « Hâte-toi de parler sans restriction, ô femme ! Le pardon d’Allah est sur toi et sa grâce, pour tout ce que tu pourras dire et demander ! »
Alors, la mère d’Aladdin, après s’être prosternée une seconde fois devant le trône et avoir appelé sur le sultan toutes les bénédictions et les faveurs du Très-Haut, se mit à raconter tout ce qui était arrivé à son fils, depuis le jour où il avait entendu les crieurs publics proclamer l’ordre aux habitants de se cacher dans leurs maisons pour livrer passage au cortège de Sett Badrou’l-Boudour. Et elle ne manqua pas de lui dire l’état dans lequel se trouvait Aladdin qui avait menacé de se tuer s’il n’obtenait pas la princesse en mariage. Et elle raconta toute l’histoire dans ses détails, depuis le commencement jusqu’à la fin. Mais il n’y a point d’utilité à la répéter. Puis, ayant fini de parler, elle baissa la tête, en proie à une grande confusion, en ajoutant : « Et il ne me reste plus, ô roi du temps, qu’à supplier Ta Hautesse de ne point me tenir rigueur de la folie de mon fils, et de m’excuser si la tendresse de la mère m’a poussée à venir te transmettre une demande si singulière ! »
Lorsque le sultan, qui avait écouté ces paroles avec beaucoup d’attention, vu qu’il était juste et bienveillant, vit que la mère d’Aladdin s’était tue, loin de se montrer indigné de sa demande, il se mit à rire avec bonté, et lui dit : « Ô pauvre, et que portes-tu donc dans ce foulard que tu tiens par les quatre coins…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut
LA SEPT CENT QUARANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… il se mit à rire avec bonté, et lui dit : « Ô pauvre, et que portes-tu donc dans ce foulard que tu tiens par les quatre coins ? »
Alors la mère d’Aladdin dénoua le foulard, en silence, et, sans ajouter un mot de plus, présenta au sultan le plat de porcelaine où étaient rangés les fruits en pierreries. Et aussitôt tout le diwân fut illuminé de leur éclat, bien plus que s’il avait été éclairé par les lustres et les flambeaux. Et le sultan fut ébloui de leur clarté et demeura interdit de leur beauté. Puis il prit la porcelaine des mains de la bonne femme et examina, l’une après l’autre, en les prenant entre ses doigts, les merveilleuses pierreries. Et il resta longtemps à les regarder et à les palper, à la limite de l’admiration. Et il finit par s’écrier, en se tournant vers son grand-vizir : « Par la vie de ma tête ! ô mon vizir, que tout cela est beau, et que ces fruits sont merveilleux ! En as-tu jamais vu de pareils ou seulement as-tu jamais entendu parler de l’existence de choses si admirables sur la face de la terre ? Qu’en penses-tu ? dis-le-moi ! » Et le vizir répondit : « En vérité, ô roi du temps, je n’ai jamais vu et n’ai jamais entendu parler de choses si merveilleuses ! Certes, ces pierreries sont uniques en leur espèce ! Et les plus précieux joyaux de l’armoire de notre roi ne valent pas, réunis, le plus petit de ces fruits-là ! non, je ne le pense pas ! » Et le roi dit : « Et n’est-ce pas, ô mon vizir, que le jeune Aladdin qui m’envoie, avec sa mère, un si beau présent, mérite sans aucun doute, et bien plus que n’importe quel fils de roi, de voir agréer sa demande de mariage avec ma fille Badrou’l-Boudour ? »
À cette question du roi, à laquelle il était loin de s’attendre, le vizir devint bien changé de teint et bien lié de langue et bien chagriné ! Car le sultan lui avait promis, depuis fort longtemps, de n’accorder en mariage la princesse à d’autre qu’à un fils qu’il avait et qui brûlait d’amour pour elle depuis l’enfance. Aussi, après un long moment de perplexité, d’émoi et de silence, il finit par répondre d’une voix fort triste : « Oui, ô roi du temps ! Mais Ta Sérénité oublie qu’elle a promis la princesse au fils de ton esclave ! Je te demande donc en grâce, si ce cadeau d’un inconnu t’agrée vraiment, de m’accorder seulement un délai de trois mois, au bout duquel je m’engage à trouver moi-même un présent encore plus beau que celui-ci à offrir en dot, pour mon fils, à notre roi ! »
Or, le roi, qui savait bien, à cause de ses connaissances en fait de joyaux et de pierreries, que nul homme sur la terre, fût-il fils de roi ou de sultan, n’était capable de trouver un cadeau qui approchât, de près ou de loin, de ces merveilles uniques en leur espèce, ne voulut point désobliger son vieux vizir en lui refusant la grâce qu’il sollicitait, quelque inutile qu’elle fût ; et, dans sa bienveillance, il lui répondit : « Certes ! ô mon vizir, je t’accorde le délai que tu demandes. Mais sache bien qu’au bout de ces trois mois, si tu n’as pas réussi à trouver, pour ton fils, une dot à m’offrir pour ma fille qui surpasse ou même seulement qui égale la dot que m’offre cette bonne femme au nom de son fils Aladdin, j’aurai fait pour ton fils tout le possible, à cause de tes bons et loyaux services ! » Puis il se tourna vers la mère d’Aladdin et lui dit, avec beaucoup d’affabilité : « Ô mère d’Aladdin, tu peux retourner en toute joie et sécurité auprès de ton fils, et lui dire que sa demande est agréée, et que ma fille est désormais en son nom ! Mais dis-lui que le mariage ne pourra se faire que dans trois mois seulement, pour nous donner le temps de faire préparer le trousseau de ma fille et exécuter l’ameublement qui convient à une princesse de sa qualité ! »
Et la mère d’Aladdin, extrêmement émue, leva les bras au ciel et fit des vœux pour la prospérité et la longueur de vie du sultan et prit congé pour aussitôt, une fois sortie du palais, s’envoler de joie vers sa maison. Et, dès qu’elle fut entrée, Aladdin vit son visage illuminé de bonheur et courut à elle et, bien troublé, lui demanda : « Eh bien, ô mère, dois-je vivre ou dois-je mourir ? » Et la pauvre femme, exténuée de fatigue, commença par s’asseoir sur le divan et enlever son voile de son visage, et dit : « Je t’annonce la bonne nouvelle, ô Aladdin ! La fille du sultan est désormais en ton nom ! » Et ton cadeau, comme tu le vois, est agréé avec joie et contentement ! Seulement, ton mariage avec Badrou’l-Boudour ne pourra avoir lieu que dans trois mois ! Et ce retard est dû au grand-vizir, cette barbe calamiteuse, qui a parlé en secret au roi et lui a suggéré de différer la cérémonie, je ne sais pour quelle raison ! Mais, inschallah ! il n’arrivera que du bien ! Et ton désir sera satisfait au delà de toutes les prévisions, ô mon enfant ! » Puis, elle ajouta : « Quant à ce grand-vizir, ô mon fils, qu’Allah le maudisse et le réduisse au pire état ! Car je suis fort préoccupée de ce qu’il a pu dire à l’oreille du roi ! Sans lui, le mariage aurait eu lieu, apparemment, aujourd’hui ou demain, tant le roi était ravi des fruits en pierreries du plat de porcelaine ! »
Puis, sans s’arrêter et sans respirer, elle raconta à son fils tout ce qui était arrivé depuis son entrée au diwân jusqu’à sa sortie, et termina en disant : « Qu’Allah conserve la vie de notre glorieux sultan, et te garde pour le bonheur qui t’attend, ô mon fils Aladdin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et se tut discrètement.
LA SEPT CENT CINQUANTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Qu’Allah conserve la vie de notre glorieux sultan, et te garde pour le bonheur qui t’attend, ô mon fils Aladdin ! »
Et Aladdin, en entendant ce que venait de lui annoncer sa mère, se trémoussa d’aise et de contentement et s’écria : « Glorifié soit Allah, ô mère, qui fait descendre Ses grâces sur notre maison et te donne pour fille une princesse du sang des plus grands rois ! » Et il baisa la main de sa mère, et la remercia beaucoup pour toutes les peines qu’elle s’était données dans la poursuite de cette affaire si délicate. Et sa mère l’embrassa tendrement et lui souhaita toutes sortes de prospérités et pleura en pensant que son époux le tailleur, père d’Aladdin, n’était plus là pour voir la fortune et les effets merveilleux de la destinée de son fils, le garnement d’autrefois !
Et, depuis ce jour, ils se mirent à compter, avec une impatience extrême, les heures qui les séparaient du bonheur qu’ils se promettaient, à l’expiration des trois mois. Et ils ne cessaient de s’entretenir de leurs projets et des fêtes et des largesses qu’ils comptaient donner aux pauvres, en songeant qu’hier encore ils étaient eux-mêmes dans la misère et que la chose la plus méritoire aux yeux du Rétributeur était, sans aucun doute, la générosité.
Or, deux mois s’écoulèrent de la sorte. Et la mère d’Aladdin, qui sortait tous les jours pour faire les achats nécessaires d’avant les noces, était allée, un matin, au souk et commençait à entrer dans les boutiques, en faisant mille emplettes, grandes et petites quand elle s’aperçut d’une chose qu’elle n’avait pas remarquée en arrivant. Elle vit, en effet, que toutes les boutiques étaient décorées et ornées de feuillage, de lanternes et de banderoles multicolores qui allaient d’un bout de la rue à l’autre bout, et que tous les boutiquiers, les acheteurs et les gens du souk, les riches comme les pauvres, faisaient de grandes démonstrations de joie, et que toutes les rues étaient encombrées de fonctionnaires du palais, richement vêtus de leurs brocarts de cérémonie et montés sur des chevaux harnachés merveilleusement, et que tout le monde allait et venait avec une animation inaccoutumée. Aussi s’empressa-t-elle de demander au marchand d’huile, chez qui elle faisait ses provisions, quelle fête inconnue d’elle célébrait toute cette foule réjouie, et ce que signifiaient toutes ces démonstrations. Et le marchand d’huile, extrêmement formalisé d’une telle question, la regarda de travers, et répondit : « Par Allah ! on dirait que tu te moques ! Ou serais-tu une étrangère pour ignorer de la sorte le mariage du fils du grand-vizir avec la princesse Badrou’l-Boudour, fille du sultan ? Et c’est justement l’heure où elle va sortir du hammam ! Et tous ces cavaliers richement vêtus d’habits d’or sont les gardes qui vont former son escorte jusqu’au palais ! »
Lorsque la mère d’Aladdin eut entendu ces paroles du marchand d’huile, elle ne voulut pas en apprendre davantage et, affolée et éplorée, elle se mit à courir à travers les souks, oubliant ses achats chez les marchands, et arriva à sa maison, où elle entra, et se jeta, hors d’haleine, sur le divan, où elle resta un moment sans pouvoir prononcer une parole. Et lorsqu’elle put parler, elle dit à Aladdin accouru : « Ah ! mon enfant, la destinée a tourné vers toi la page néfaste de son livre ! et voici que tout est perdu, et que le bonheur vers lequel tu marchais s’est évanoui avant qu’il se fût réalisé ! » Et Aladdin, fort alarmé de l’état où il voyait sa mère et des paroles qu’il entendait, lui demanda : « Qu’est-il donc arrivé de si néfaste, ô mère ? Hâte-toi de me le dire ! » Elle dit : « Hélas ! mon fils, le sultan a oublié la promesse qu’il nous a faite ! Et il marie aujourd’hui, précisément, sa fille Badrou’l-Boudour au fils du grand-vizir, ce visage de goudron, ce calamiteux que je craignais tellement ! Et toute la ville est décorée, comme dans les grandes fêtes, pour les noces de ce soir ! » Et Aladdin, en entendant cette nouvelle, sentit la fièvre lui envahir le cerveau et faire tourner son sang à coups précipités. Et il resta un moment interdit et hébété, comme s’il allait tomber et mourir du coup. Mais il ne tarda pas à se dominer, en se souvenant de la lampe merveilleuse qu’il avait en sa possession et qui allait lui être, plus que jamais, d’un grand secours. Et il se tourna vers sa mère et lui dit, d’un ton fort tranquille : « Par ta vie, ô mère, je crois bien que le fils du vizir ne jouira pas cette nuit de toutes les délices qu’il se promet à ma place ! Sois donc sans crainte à ce sujet et, sans plus tarder, lève-toi et prépare-nous à manger. Et nous verrons ensuite ce qu’il nous reste à faire, avec l’assistance du Très-Haut ! »
La mère d’Aladdin se leva donc et prépara le repas qu’Aladdin mangea de grand appétit, pour, aussitôt après, se retirer dans sa chambre, en disant : « Je désire rester seul et ne point être dérangé ! » Et il ferma sur lui la porte à clef, et tira la lampe magique de l’endroit où il la tenait cachée. Et il la prit et la frotta à l’endroit qu’il connaissait. Et, au même moment, l’éfrit esclave de la lampe parut devant lui et dit : « Entre tes mains, ici, ton esclave le voici ! Parle, que veux-tu ? Je suis le serviteur de la lampe, soit que dans les airs je vole, soit que sur la terre je rampe ! » Et Aladdin lui dit : « Écoute-moi bien, ô serviteur de la lampe ! car il ne s’agit plus maintenant de m’apporter de quoi manger et boire, mais de me servir dans une affaire d’une tout autre importance ! Sache, en effet, que le sultan m’a promis en mariage sa merveilleuse fille Badrou’l-Boudour, après avoir reçu de moi un présent de fruits en pierreries. Et il m’a demandé un délai de trois mois pour la célébration des noces. Et maintenant il a oublié sa promesse et, sans même songer à me renvoyer mon cadeau, il marie sa fille avec le fils du grand-vizir ! Or il ne faut point que les choses se passent de la sorte ! Et je te demande de me servir dans l’accomplissement de mon projet ! » Et l’éfrit répondit : « Parle, ô mon maître Aladdin ! Et tu n’as guère besoin de me donner tant d’explications ! Ordonne et j’obéirai ! » Et Aladdin répondit : « Ce soir donc, dès que les deux nouveaux mariés seront couchés dans leur lit nuptial, et avant qu’ils aient le temps de seulement se toucher, tu les enlèveras avec leur lit et tu les transporteras ici même, où je verrai ce qu’il me reste à faire ! » Et l’éfrit de la lampe porta sa main à son front et répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et disparut…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Et l’éfrit de la lampe porta sa main à son front et répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et disparut. Et Aladdin alla retrouver sa mère et s’assit à côté d’elle et se mit à causer avec tranquillité de choses et d’autres, sans plus se préoccuper du mariage de la princesse que si rien de tout cela n’était arrivé. Et, le soir venu, il laissa sa mère libre d’aller se coucher, et rentra dans sa chambre où il s’enferma de nouveau à clef, et attendit le retour de l’éfrit. Et voilà pour lui !
Quant aux noces du fils du grand-vizir, voici ! Lorsque la fête et les festins et les cérémonies et les réceptions et les réjouissances furent à leur fin, le nouveau marié, précédé par le chef des eunuques, pénétra dans la chambre nuptiale. Et le chef des eunuques se hâta de se retirer et de refermer la porte derrière lui. Et le nouveau marié, après s’être dévêtu, souleva la moustiquaire et entra se coucher dans le lit, pour y attendre l’arrivée de la princesse. Or, elle ne tarda pas à faire son entrée, accompagnée de sa mère et des femmes de sa suite, qui la déshabillèrent, la vêtirent d’une simple chemise de soie et lui dénouèrent sa chevelure. Puis elles la mirent dans le lit comme par force, tandis que, selon l’usage des nouvelles mariées en pareille circonstance, elle faisait semblant de résister beaucoup et se contournait en tous sens, cherchant à s’échapper de leurs mains. Et lorsqu’elles l’eurent mise au lit, sans chercher à regarder le fils du vizir qui y était déjà couché, elles se retirèrent toutes ensemble, en faisant des vœux pour la consommation. Et la mère, qui sortit la dernière, ferma la porte de la chambre, en poussant, selon l’usage, un grand soupir.
Or, dès que les deux nouveaux mariés se trouvèrent seuls, et avant qu’ils eussent le temps de se faire la moindre caresse, ils se sentirent soudain soulevés avec leur lit, sans pouvoir se rendre compte de ce qui leur arrivait. Et, en un clin d’œil, ils se virent transportés hors du palais et déposés dans un endroit qu’ils ne connaissaient pas, et qui n’était autre que la chambre d’Aladdin. Et, pendant qu’ils étaient plongés dans l’épouvante, l’éfrit vint se prosterner devant Aladdin et lui dit : « Ton ordre, ô mon maître, est exécuté. Et me voici prêt à t’obéir pour tout ce qu’il te reste à me commander ! » Et Aladdin lui répondit : « Il me reste à te demander d’enlever ce jeune entremetteur et d’aller l’enfermer, pour toute la nuit, dans le cabinet d’aisances ! Et, demain matin, reviens ici prendre mes ordres ! » Et le genni de la lampe répondit par l’ouïe et l’obéissance, et se hâta d’obéir. Il enleva donc brutalement le fils du vizir et alla l’enfermer dans les cabinets, en lui enfonçant la tête dans le trou. Et il jeta sur lui un souffle froid et puant qui l’immobilisa comme un morceau de bois dans la situation où il se trouvait. Et voilà pour lui !
Quant à Aladdin, lorsqu’il fut seul avec la princesse Badrou’l-Boudour, il ne songea pas un instant, malgré le grand amour qu’il éprouvait pour elle, à abuser de la situation. Et il commença par s’incliner devant elle, en tenant la main sur son cœur, et, d’une voix bien passionnée, il lui dit : « Ô princesse, sache qu’ici tu es plus en sécurité que dans le palais du sultan, ton père ! Si tu te trouves en cet endroit que tu ne connais pas, c’est seulement pour que tu ne subisses pas les caresses de ce jeune crétin, fils du vizir de ton père ! Et moi, bien que je sois celui auquel tu as été promise en mariage, je me garderai bien de te toucher, avant que le temps soit venu et avant que tu sois devenue mon épouse légitime, par le Livre et par la Sunnah ! »
À ces paroles d’Aladdin la princesse ne put rien comprendre, d’abord parce qu’elle était bien émue et parce que, ensuite, elle ignorait et la promesse ancienne de son père et toutes les particularités de l’affaire. Et, ne sachant que dire, elle se contenta de pleurer beaucoup. Et Aladdin, pour lui bien prouver qu’il n’avait aucune mauvaise intention à son sujet et pour la tranquilliser, se jeta tout habillé sur le lit, à la place même qu’occupait le fils du vizir, et prit la précaution de mettre un sabre nu entre elle et lui, pour bien montrer par là qu’il entendait se donner la mort plutôt que de la toucher, fût-ce du bout des doigts. Et même il tourna le dos du côté de la princesse, pour ne pas la gêner par n’importe quel endroit. Et il s’endormit en toute tranquillité, sans plus se soucier de la présence tant désirée de Badrou’l-Boudour, que s’il était seul dans son lit de célibataire.
Quant à la princesse, l’émotion que lui causait cette aventure si étrange, et la situation nouvelle où elle se trouvait, et les pensées tumultueuses qui l’agitaient, tantôt d’effroi et tantôt de stupéfaction, l’empêchèrent de fermer l’œil de toute la nuit. Mais, certes ! elle était encore bien moins à plaindre que le fils du vizir, qui se trouvait dans les cabinets, la tête enfoncée dans le trou, et qui ne pouvait faire un mouvement à cause du souffle épouvantable que lui avait jeté l’éfrit pour l’immobiliser. Quoi qu’il en soit, le sort des deux époux, pour une première nuit de noces, n’avait rien que de bien affligeant et de bien calamiteux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Quoi qu’il en soit, le sort des deux époux, pour une première nuit de noces, n’avait rien que de bien affligeant et de bien calamiteux.
Le lendemain matin, sans qu’Aladdin eût besoin de frotter à nouveau la lampe, l’éfrit, selon l’ordre qui lui avait été donné, vint de lui-même attendre le réveil du maître de la lampe. Et, comme il tardait à se réveiller, il poussa plusieurs exclamations qui épouvantèrent la princesse, qui n’avait pas le pouvoir de l’apercevoir. Et Aladdin ouvrit les yeux ; et, dès qu’il eut reconnu l’éfrit, il se leva d’à côté de la princesse, et alla un peu à l’écart, pour n’être entendu que de l’éfrit, et lui dit : « Hâte-toi d’aller tirer des cabinets le fils du vizir ; et reviens le déposer dans le lit, à la place qu’il occupait. Puis transporte-les tous deux dans le palais du sultan, à l’endroit même où tu les as pris. Et, surtout, surveille-les bien pour les empêcher de se caresser ou même de se toucher ! » Et l’éfrit de la lampe répondit par l’ouïe et l’obéissance, et se hâta d’aller d’abord retirer le morfondu jeune homme des cabinets et de le déposer sur le lit, à côté de la princesse, pour aussitôt, en moins de temps qu’il n’en faut pour battre des paupières, les transporter tous deux dans la chambre nuptiale, au palais du sultan, sans qu’ils pussent ni voir ni comprendre ce qui leur arrivait, ni par quel moyen ils changeaient si rapidement de domicile. Et d’ailleurs c’est ce qui pouvait leur arriver de mieux, car la seule vue de l’effroyable genni, serviteur de la lampe, les eut, sans aucun doute, épouvantés jusqu’à en mourir.
Or, à peine l’éfrit avait-il transporté les deux nouveaux mariés dans la chambre du palais, que le sultan et son épouse, impatients de savoir comment la princesse leur fille avait passé cette première nuit de noces, et désireux de la féliciter et d’être les premiers à la voir pour lui souhaiter le bonheur et la durée des délices, firent leur entrée matinale. Et ils s’approchèrent, bien émus, du lit de leur fille, et la baisèrent tendrement entre les deux yeux en lui disant : « Bénie soit ton union, ô fille de notre cœur ! Et puisses-tu voir germer de ta fécondité une longue suite de descendants beaux et illustres, qui perpétueront la gloire et la noblesse de ta race ! Ah ! dis-nous comment tu as passé cette nuit première, et de quelle manière s’est comporté ton époux visà-vis de toi ! » Et, ayant ainsi parlé, ils se turent, attendant sa réponse ! Et voici que soudain ils la virent, au lieu de montrer un visage frais et souriant, éclater en sanglots et les regarder avec de grands yeux tristes pleins de larmes.
Alors ils voulurent interroger son époux, et regardèrent du côté du lit où ils le croyaient encore couché ; mais il était précisément sorti de la chambre, juste au moment de leur entrée, pour aller se laver de tous les immondices qui lui barbouillaient la face. Et ils pensèrent qu’il était allé au hammam du palais prendre le bain d’usage après la consommation. Et ils se tournèrent de nouveau du côté de leur fille et l’interrogèrent anxieusement du geste, du regard et de la voix, sur le motif de ses larmes et de sa tristesse. Et, comme elle continuait à se taire, ils crurent que seule la pudeur de la première nuit de noces l’empêchait de parler, et que ses larmes étaient des larmes de circonstance ; et ils se tinrent un moment tranquilles, ne voulant pas trop insister, pour commencer. Mais comme cette situation menaçait de durer fort longtemps, et que ses pleurs ne faisaient qu’augmenter, la reine ne put davantage patienter ; et, d’un ton plein d’humeur, finit par dire à la princesse : « Voyons, ma fille, veux-tu enfin me répondre et répondre à ton père ? Et vas-tu longtemps encore faire avec nous ces façons, qui durent depuis déjà trop longtemps ? Moi aussi, ma fille, j’ai été nouvelle mariée comme toi et avant toi ! mais j’ai su avoir le tact de ne pas faire trop durer ces manières de poule offusquée. Et tu oublies, en outre, que tu manques présentement au respect que tu nous dois, en continuant à ne pas répondre à nos questions ! »
À ces paroles de sa mère formalisée, la pauvre princesse, accablée de tous les côtés à la fois, se vit bien obligée de sortir du silence qu’elle gardait, et, poussant un grand et bien triste soupir, elle répondit : « Qu’Allah me pardonne si j’ai manqué au respect que je dois à mon père et à ma mère ! mais mon excuse est que je suis troublée à l’extrême et bien émue et bien triste et bien stupéfaite de tout ce qu’il m’est arrivé cette nuit ! » Et elle se mit à raconter tout ce qui lui était arrivé, la nuit précédente, non point comme les choses s’étaient réellement passées, mais comme elle avait pu elle-même en juger seulement par ses yeux. Elle dit comment, à peine couchée dans son lit, à côté de son époux le fils du vizir, elle avait senti le lit se mouvementer au-dessous d’elle, comment elle s’était vue transportée en un clin d’œil de la chambre nuptiale dans une maison qu’elle n’avait jamais connue auparavant, comment son époux avait été séparé d’elle, sans qu’elle pût savoir de quelle manière il avait été enlevé et remis, comment il avait été remplacé, durant toute la nuit, par un beau jeune homme, fort respectueux d’ailleurs et extrêmement attentionné qui, pour ne point se voir exposé à abuser d’elle, avait mis son sabre nu entre eux deux et s’était endormi, le visage tourné du côté du mur, et comment enfin, au matin, une fois son époux de retour au lit, elle avait été de nouveau transportée avec lui, dans leur chambre nuptiale, au palais, où il s’était alors hâté de se lever pour de là courir au hammam se délivrer d’un tas d’horribles choses qui lui couvraient la figure ! Et elle ajouta : « Et c’est à ce moment que je vous vis tous deux entrer, pour me souhaiter le bonjour et me demander de mes nouvelles ! Hélas sur moi ! Il ne me reste plus qu’à mourir ! » Et, ayant ainsi parlé, elle se cacha la tête dans les oreillers, en proie aux sanglots douloureux.
Lorsque le sultan et son épouse eurent entendu ces paroles de leur fille Badrou’l-Boudour, ils furent stupéfaits, et se regardèrent, avec des yeux blancs et des mines allongées, ne doutant pas qu’elle n’eût perdu l’esprit à cause de cette nuit où sa virginité avait été heurtée pour la première fois. Et ils ne voulurent ajouter foi à aucune de ses paroles ; et sa mère lui dit, d’une voix chuchotante…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ils ne voulurent ajouter foi à aucune de ses paroles ; et sa mère lui dit d’une voix chuchotante : « C’est toujours ainsi que les choses se passent, ma fille ! Mais garde-toi bien d’en rien dire à personne, car on ne raconte jamais ces choses-là ! Et les gens qui t’entendraient te prendraient pour une folle ! Lève-toi donc et ne te préoccupe plus à ce sujet, et fais en sorte de ne pas troubler, par ta mauvaise mine, les fêtes que l’on donne aujourd’hui au palais, en ton honneur, et qui vont durer quarante jours et quarante nuits, non seulement dans notre ville mais dans tout le royaume. Allons, ma fille ! sois contente, et oublie vite les divers incidents de cette nuit ! »
Puis la reine appela ses femmes et les chargea du soin de la toilette de la princesse ; et elle sortit, avec le sultan, qui était fort perplexe, à la recherche de son gendre, le fils du vizir. Et ils finirent par le rencontrer qui revenait du hammam. Et la reine, pour être fixée sur les dires de sa fille, se mit à interroger le morfondu jeune homme sur ce qui s’était passé. Mais il ne voulut rien avouer de ce qu’il avait enduré, et, dissimulant toute l’aventure, de peur d’être tourné en dérision et rejeté par les parents de son épouse, il se contenta de répondre : « Par Allah ! et que s’est-il donc passé, pour que vous ayez, en m’interrogeant, cet air singulier ? » Et la sultane, alors, de plus en plus persuadée que tout ce que lui avait raconté sa fille était l’effet de quelque cauchemar, crut bien faire en n’insistant point auprès de son gendre, et lui dit : « Glorifié soit Allah de ce que tout se soit passé sans heurt ni douleur ! Je te recommande, mon fils, beaucoup de douceur vis-à-vis de ton épouse, car elle est délicate ! »
Et elle le quitta, sur ces paroles, et alla dans ses appartements, surveiller les réjouissances et les divertissements de la journée. Et voilà pour elle et pour les nouveaux mariés !
Quant à Aladdin, qui se doutait bien de ce qui arrivait au palais, il passa sa journée à se délecter à la pensée du tour excellent qu’il venait de jouer au fils du vizir. Mais il ne se tint point pour satisfait, et voulut jusqu’au bout savourer l’humiliation de son rival. Aussi jugea-t-il à propos de ne pas lui laisser un moment de répit ; et, dès que la nuit tomba, il prit sa lampe et la frotta. Et le genni parut devant lui, en prononçant la même formule que les précédentes fois. Et Aladdin lui dit : « Ô serviteur de la lampe, va au palais du sultan ! Et, dès que tu verras les nouveaux mariés couchés ensemble, enlève-les avec leur lit, et apporte-les-moi ici, comme tu l’as fait la nuit précédente. Et le genni se hâta d’aller exécuter l’ordre, et ne tarda pas à revenir avec sa charge qu’il déposa dans la chambre d’Aladdin, pour aussitôt enlever le fils du vizir et le fourrer, tête première dans les cabinets. Et Aladdin ne manqua pas de prendre la place vide et de se coucher aux côtés de la princesse, mais avec la même décence que la première fois. Et après avoir posé le sabre entre eux deux, il se tourna du côté du mur et s’endormit tranquillement. Et, le lendemain, les choses se passèrent exactement comme la veille, en ce sens que l’éfrit, suivant les ordres d’Aladdin, remit le morfondu auprès de Badrou’l-Boudour et les transporta tous deux, avec le lit, dans la chambre nuptiale, au palais du sultan.
Or, le sultan, plus impatient que jamais d’avoir des nouvelles de sa fille, après la seconde nuit, arriva à ce moment précis dans la chambre nuptiale, tout seul cette fois ; car il redoutait par-dessus tout la mauvaise humeur de la sultane, son épouse, et préférait interroger lui-même la princesse. Et dès que le fils du vizir, à la limite de la mortification, eut entendu les pas du sultan, il sauta du lit et s’enfuit hors de la chambre, pour courir se débarbouiller au hammam. Et le sultan entra et s’avança jusqu’au lit de sa fille ; et il souleva la moustiquaire ; et, après avoir embrassé la princesse, il lui dit : « Dis-moi, ma fille ! j’espère bien que tu n’as pas eu cette nuit le même affreux cauchemar, dont tu nous as raconté, hier, les extravagantes péripéties ! Allons ! peux-tu me dire comment tu as passé cette nuit-ci ? » Mais la princesse, au lieu de répondre, éclata en sanglots, et se cacha le visage dans ses mains, pour ne pas voir les yeux irrités de son père, qui ne comprenait plus rien à tout cela. Et il attendit un bon moment, pour lui donner le temps de se calmer ; mais comme elle continuait à pleurer et à hoqueter, il finit par se mettre en fureur et tira son sabre et s’écria : « Par ma vie, si tout de suite tu ne veux me dire la vérité, ta tête sautera de tes épaules ! »
Alors, la pauvre princesse, doublement épouvantée, fut bien obligée d’arrêter ses larmes ; et, d’une voix brisée, elle dit : « Ô mon père bien-aimé, de grâce ! ne t’irrite pas contre moi ! Car si tu voulais bien m’écouter, maintenant que ma mère n’est plus là pour t’exciter contre moi, tu m’excuserais, sans aucun doute, et tu me plaindrais et tu prendrais les précautions nécessaires pour m’empêcher de mourir de confusion et d’épouvante ! Car, certainement, si j’éprouvais encore une fois les terribles choses que j’ai éprouvées cette dernière nuit, tu me trouverais, le lendemain, morte dans mon lit ! Aie donc pitié de moi, ô mon père, et fais que ton ouïe et ton cœur compatissent à mes peines et à mon émoi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
« … Aie donc pitié de moi, ô mon père, et fais que ton ouïe et ton cœur compatissent à mes peines et à mon émoi ! » Et le sultan, dont le cœur était pitoyable, et qui ne sentait plus la présence excitante de son épouse, se pencha vers sa fille, et l’embrassa et la cajola, et apaisa son âme chérie. Puis il lui dit : « Et maintenant, ma fille, calme ton esprit et rafraîchis tes yeux ! Et raconte en toute confiance, à ton père, dans leurs détails, les incidents qui t’ont mise, cette nuit, dans un tel état d’émotion et de terreur ! » Et la princesse, la tête dans le soin de son père, lui raconta, sans rien oublier, tout ce qui lui était arrivé de fâcheux pendant les deux nuits qu’elle venait de passer, et termina son récit en ajoutant : « Et puis, ô mon père bien-aimé, il vaut encore mieux que tu interroges le fils du vizir, afin qu’il puisse te confirmer mes paroles ! »
Et le sultan, en entendant le récit de cette étrange aventure, fut à l’extrême limite de la perplexité, et partagea la peine de sa fille, et sentit ses yeux se mouiller de larmes, tant il l’aimait. Et il lui dit : « Certes ! ma fille, c’est moi seul qui suis la cause de tout ce qui t’arrive de fâcheux, puisque je t’ai mariée à un morfondu qui ne sait pas te défendre et te garantir de ces aventures singulières. Car, en vérité, c’est ton bonheur que j’ai voulu, par ce mariage, et non point ton malheur et ton dépérissement ! Or, par Allah ! je vais tout de suite faire venir le vizir et son fils, le crétin, et leur demander des explications sur toutes ces choses-là ! Mais, quoi qu’il en soit, tu peux être tout à fait tranquille, ma fille ! car ces faits ne se répéteront plus, je te le jure par la vie de ma tête ! » Puis il la quitta, la laissant aux soins de ses femmes, et rentra dans ses appartements, en bouillonnant de colère.
Et aussitôt il fit venir son grand-vizir ; et sitôt qu’il se présenta entre ses mains, il lui cria : « Où est-il, ton fils, l’entremetteur ? Et que t’a-t-il dit au sujet des faits de ces deux dernières nuits ? » Le grand-vizir, stupéfait, répondit : « Je ne sais, ô roi du temps, de quoi il s’agit ! Mon fils ne m’a rien dit qui puisse m’expliquer la colère de notre roi ! Mais, si tu me le permets, je vais tout de suite aller le trouver et l’interroger ! » Et le sultan dit : « Va ! Et reviens vite m’apporter la réponse ! » Et le grand-vizir, le nez fort allongé, sortit en courbant le dos, et alla à la recherche de son fils, qu’il trouva au hammam en train de se laver des immondices qui le couvraient. Et il lui cria : « Ô fils de chien, pourquoi m’as-tu caché la vérité ? Si tout de suite tu ne me mets pas au courant des faits de ces deux dernières nuits, ce jour sera ton dernier ! » Et le fils baissa la tête et répondit : « Hélas ! ô mon père, seule la honte m’a empêché jusqu’à présent de te révéler les fâcheuses aventures de ces deux nuits, et les inqualifiables traitements que j’ai subis, sans avoir la possibilité de me défendre, ou seulement de savoir comment et par la puissance de quelles forces ennemies tout cela nous arrivait à tous deux, dans notre lit ! » Et il raconta à son père toute l’histoire, dans ses détails, sans rien oublier. Mais il n’y a point d’utilité à la répéter. Et il ajouta : « Quant à moi, ô mon père, je préfère la mort à une telle vie ! Et, devant toi, je fais le triple serment du divorce définitif d’avec la fille du sultan ! Je te supplie donc d’aller trouver le sultan, et de lui faire agréer la déclaration de nullité de mon mariage avec sa fille Badrou’l-Boudour ! Car c’est le seul moyen de voir cesser ces mauvais traitements, et d’avoir la tranquillité ! Et je pourrai alors m’endormir dans mon lit, au lieu de passer mes nuits dans les cabinets ! »
En entendant ces paroles de son fils, le grand-vizir fut fort chagriné. Car le souhait de sa vie avait été de voir son fils marié à la fille du sultan, et cela lui coûtait beaucoup de renoncer à ce grand honneur. Aussi, bien que convaincu de la nécessité du divorce dans de telles conditions, il dit à son fils : « Certes, ô mon fils ! il n’est pas possible d’endurer davantage de pareils traitements. Mais songe à ce que tu vas quitter par ce divorce ! Ne vaut-il pas mieux prendre patience pendant encore une nuit, durant laquelle nous veillerons tous autour de la chambre nuptiale, avec les eunuques armés de sabres et de gourdins ! Qu’en dis-tu, mon fils ? » Il répondit : « Fais ce qui te plaît, ô mon père le grand-vizir ! Quant à moi, je suis bien résolu à ne plus entrer dans cette chambre de goudron ! »
Alors, le vizir laissa son fils, et alla retrouver le roi. Et il se tint debout entre ses mains, en baissant la tête. Et le roi lui demanda : « Qu’as-tu à me dire ? » Il répondit : « Par la vie de notre maître, ce qu’a raconté la princesse Badrou’l-Boudour est bien vrai ! Mais la faute n’est point à mon fils ! En tout cas, ô roi du temps, il ne faut pas que la princesse reste exposée à de nouveaux ennuis à cause de mon fils. Et, si tu le permets, il vaut mieux que les doux époux vivent désormais séparés par le divorce ! » Et le roi dit : « Par Allah ! tu as raison. Mais si l’époux de ma fille n’était point ton fils, c’eût été par la mort que j’en eusse délivré ma fille ! Qu’ils soient donc divorcés ! » Et aussitôt le sultan donna les ordres nécessaires pour faire cesser les réjouissances publiques, aussi bien dans le palais que dans la ville et par tout le royaume de la Chine ; et il fit proclamer le divorce de sa fille Badrou’l-Boudour d’avec le fils du grand-vizir, en donnant bien à comprendre que rien n’avait été consommé, et que la perle restait vierge et imperforée.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il fit proclamer le divorce de sa fille Badrou’l-Boudour d’avec le fils du grand-vizir, en donnant bien à comprendre que rien n’avait été consommé et que la perle restait vierge et imperforée. Quant au fils du grand-vizir, le sultan, par égard pour le père, le nomma gouverneur d’une province éloignée de la Chine, et lui donna l’ordre de partir sans retard. Ce qui fut exécuté.
Lorsqu’Aladdin eut appris, en même temps que les habitants de la ville, par la proclamation des crieurs publics, le divorce de Badrou’l-Boudour, sans consommation du mariage, et le départ du morfondu, il se dilata à la limite de la dilatation et se dit : « Bénie soit cette lampe merveilleuse, cause première de toutes mes prospérités ! Il est encore préférable que le divorce ait eu lieu sans une intervention plus directe du genni de la lampe, qui, sans aucun doute, aurait abîmé sans recours le crétin ! » Et il se réjouit également de ce que sa vengeance eût eu ce succès, sans que personne, pas plus le roi que le grand-vizir ou même sa mère, se fût douté de la part qu’il avait prise à toute l’affaire. Et, sans plus se préoccuper que si rien d’anormal n’était survenu depuis sa demande en mariage, il attendit, en toute tranquillité, que les trois mois du délai demandé par le sultan fussent écoulés, pour, le lendemain même du dernier jour, envoyer au palais sa mère, revêtue de ses plus beaux habits, rappeler au sultan sa promesse.
Or, dès que la mère d’Aladdin fut entrée dans le diwân, le sultan qui, selon son habitude, était en train de régler les affaires du règne, jeta les yeux de son côté et la reconnut aussitôt. Et elle n’eut pas besoin de parler, car il se rappela, de lui-même, la promesse qu’il lui avait faite et le délai qu’il avait fixé. Et il se tourna vers son grand-vizir et lui dit : « Voici, ô vizir, la mère d’Aladdin ! C’est elle qui nous a apporté, il y a trois mois, la merveilleuse porcelaine pleine de pierreries. Et je crois bien qu’elle vient, à l’expiration du délai, me demander la réalisation de la promesse que je lui avais faite concernant ma fille ! Béni soit Allah qui n’a pas permis le mariage de ton fils, pour me faire souvenir de la parole donnée alors que j’avais oublié mes engagements à cause de toi ! » Et le vizir qui, en son âme, demeurait bien dépité de tout ce qui était arrivé, répondit : « Certes, ô mon maître, les rois ne doivent jamais oublier leurs promesses ! Mais, en vérité, quand on marie sa fille, on doit se renseigner sur l’époux ! et notre maître le roi n’a guère pris de renseignements sur cet Aladdin et sur sa famille ! Or, moi, je sais que c’est le fils d’un pauvre tailleur, mort dans la misère, et de basse condition ! D’où peut donc venir la richesse au fils d’un tailleur ? » Le roi dit : « La richesse vient d’Allah, ô vizir ! » Il dit : « Oui, ô roi ! Mais nous ne savons si cet Aladdin est réellement aussi riche que son présent nous le donnait à croire ! Pour nous en assurer, le roi n’aura qu’à demander, pour prix de la princesse, une dot si considérable que seul pourra la payer un fils de roi ou de sultan. Et de la sorte le roi ne mariera sa fille qu’à bon escient, sans risquer de lui donner, encore une fois, un époux indigne de ses mérites ! » Et le roi dit : « Ta langue sécrète l’éloquence, ô vizir ! Fais donc avancer la femme, pour que je lui parle ! » Et le vizir fit signe au chef des gardes, qui fit avancer la mère d’Aladdin jusqu’au pied du trône.
Alors, la mère d’Aladdin se prosterna et embrassa la terre, par trois fois, entre les mains du roi, qui lui dit : « Sache, ô tante, que je n’ai point oublié ma promesse ! Mais jusqu’à présent je ne t’ai pas encore parlé de la dot exigée pour le prix de ma fille, dont les mérites sont très grands ! Tu diras donc à ton fils que son mariage avec ma fille, El Sett Boudrou’l-Boudour, aura lieu dès qu’il m’aura envoyé ce que j’exige comme dot pour ma fille, à savoir : quarante grands plats d’or massif, remplis jusqu’aux bords des mêmes espèces de pierreries, en forme de fruits de toutes les couleurs et de toutes les tailles, qu’il m’avait déjà envoyées dans le plat de porcelaine ; et ces plats d’or seront portés au palais par quarante esclaves adolescentes, belles comme des lunes, qui seront conduites par quarante esclaves nègres, jeunes et robustes ; et tous marcheront en cortège, habillés très magnifiquement et viendront déposer entre mes mains les quarante plats de pierreries ! Et voilà toute ma demande, ma bonne tante ! Car je ne veux pas exiger davantage de ton fils, par égard pour le présent qu’il m’a déjà envoyé ! »
Et la mère d’Aladdin, bien atterrée de cette demande exorbitante, se contenta de se prosterner une seconde fois devant le trône, et se retira pour aller rendre compte à son fils de sa mission. Et elle lui dit : « Ah ! mon fils, je t’avais bien conseillé, dès le commencement, de ne pas penser à ce mariage avec la princesse Badrou’l-Boudour ! » Et, avec force soupirs, elle raconta à son fils la manière, d’ailleurs affable, dont le roi l’avait reçue, et les conditions qu’il exigeait avant de consentir définitivement au mariage ! Et elle ajouta : « Quelle folie est la tienne, ô mon enfant ! Passe encore pour les plats d’or et pour les pierreries exigées ! car j’imagine que tu seras assez insensé pour aller au souterrain dépouiller tous les arbres de leurs fruits enchantés ! Mais pour ce qui est des quarante esclaves adolescentes et des quarante jeunes nègres, comment vas-tu faire, dis-le-moi ? Ah ! mon fils, c’est encore la faute à ce maudit vizir, si cette demande est si exorbitante ; car je l’ai vu, à mon entrée, se pencher à l’oreille du roi, et lui parler en secret ! Crois-moi, Aladdin, renonce à ce projet qui te conduira à ta perte, sans recours ! » Mais Aladdin se contenta de sourire et répondit à sa mère : « Par Allah ! ô mère, en te voyant entrer avec ce visage de travers, j’ai pensé que tu allais m’annoncer une fort mauvaise nouvelle ! Mais je vois bien à présent que tu te préoccupes toujours de choses qui n’en valent vraiment pas la peine ! Sache, en effet, que tout ce que le roi vient de me demander pour prix de sa fille n’est rien en comparaison de ce que je pourrai réellement lui donner ! Rafraîchis donc tes yeux et tranquillise ton esprit. Et ne songe, pour ta part, qu’à nous préparer le repas, vu que j’ai bien faim. Et laisse-moi le soin de satisfaire le roi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et ne songe, pour ta part, qu’à nous préparer le repas, vu que j’ai bien faim. Et laisse-moi le soin de satisfaire le roi ! »
Or, dès que la mère fut sortie pour aller au souk acheter les provisions nécessaires, Aladdin se hâta d’entrer s’enfermer dans sa chambre. Et il prit la lampe et la frotta à l’endroit qu’il connaissait. Et aussitôt apparut le genni, qui, après s’être incliné devant lui, dit : « Entre tes mains, ici, ton esclave le voici ! Parle, que veux-tu ? Je suis le serviteur de la lampe, soit que dans les airs je vole, soit que sur la terre je rampe ! » Et Aladdin lui dit : « Sache, ô éfrit, que le sultan veut bien m’accorder sa fille, la merveilleuse Badrou’l-Boudour que tu connais, mais c’est à condition que je lui envoie au plus tôt quarante plats d’or massif, de qualité pure, remplis jusqu’aux bords de fruits en pierreries semblables à ceux du plat en porcelaine, que j’avais cueillis aux arbres du jardin, là même où j’ai trouvé la lampe dont tu es le serviteur. Mais ce n’est pas tout ! Il me demande, en outre, pour lui porter ces plats d’or remplis de pierreries, quarante esclaves adolescentes, belles comme des lunes, qui soient conduites par quarante jeunes nègres, beaux, solides, et très magnifiquement habillés. Voilà donc ce que j’exige de toi, à mon tour ! Hâte-toi donc de me satisfaire, en vertu du pouvoir que j’ai sur toi comme maître de la lampe ! » Et le genni répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et disparut, mais pour revenir au bout d’un moment.
Et il était accompagné des quatre-vingts esclaves en question, tant hommes que femmes, qu’il rangea dans la cour, le long du mur de la maison. Et les esclaves femmes portaient sur la tête, chacune, un grand bassin d’or massif plein jusqu’au bord de perles, de diamants, de rubis, d’émeraudes, de turquoises et de mille autres espèces de pierreries, en forme de fruits de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Et chaque bassin était recouvert d’une gaze de soie tissée de fleurons d’or. Et vraiment les pierreries étaient plus merveilleuses, et de beaucoup, que celles présentées au sultan dans la porcelaine. Et le genni, une fois qu’il eut fini de ranger contre le mur les quatre-vingts esclaves, vint s’incliner devant Aladdin et lui demanda : « As-tu encore, ô mon maître, quelque chose à exiger du serviteur de la lampe ? » Et Aladdin lui dit : « Non, rien d’autre pour le moment ! » Et aussitôt l’éfrit disparut.
Or, à ce moment entra la mère d’Aladdin, chargée des provisions qu’elle avait achetées au souk. Et elle fut bien surprise de voir sa maison envahie par tant de monde ; et elle crut, au premier moment, que c’était le sultan qui envoyait saisir Aladdin pour le punir de l’insolence de sa demande. Mais Aladdin ne tarda pas à l’en dissuader, car avant qu’elle eût le temps d’ôter son voile de visage, il lui dit : « Ne perds pas le temps à enlever ton voile, ô mère, car tu vas être obligée de ressortir, sans retard, pour aller accompagner au palais ces esclaves que tu vois rangés dans notre cour ! Les quarante esclaves femmes portent, comme tu peux le remarquer, la dot réclamée par le sultan pour prix de sa fille ! Je te prie donc, avant même de préparer le repas, de me rendre le service d’accompagner le cortège, pour le présenter au sultan ! »
Aussitôt la mère d’Aladdin fit sortir en bon ordre de sa maison les quatre-vingts esclaves, en les plaçant l’un derrière l’autre, par groupes de deux : une esclave adolescente précédée immédiatement par un jeune nègre, et ainsi de suite jusqu’au dernier groupe. Et chaque groupe était séparé du précédent par un intervalle de dix pieds. Et lorsque le dernier groupe eut franchi la porte, la mère d’Aladdin marcha derrière le cortège. Et Aladdin, fort rassuré sur le résultat, ferma la porte et alla dans sa chambre attendre tranquillement le retour de sa mère.
Or, dès que le premier groupe fut arrivé dans la rue, les passants commencèrent à s’attrouper ; et, lorsque le cortège fut au complet, la rue fut remplie d’une foule immense pleine de rumeurs et d’exclamations. Et tout le souk accourut autour du cortège, pour admirer un spectacle si magnifique et si extraordinaire. Car chaque groupe, à lui seul, était une merveille finie ! car sa mise admirable de goût et de splendeur, sa beauté, composée d’une beauté blanche de femme et d’une beauté noire de nègre, son bel air, son maintien avantageux, sa marche grave et cadencée, à distance égale, l’éclat du bassin de pierreries que portait sur la tête chaque adolescente, les feux lancés par les joyaux enchâssés dans les ceintures d’or des nègres, les étincelles qui jaillissaient de leurs bonnets de brocart, où se balançaient des aigrettes, tout cela formait un spectacle ravissant, à nul autre pareil, qui faisait que le peuple ne doutait pas un instant qu’il ne s’agissait de l’arrivée au palais de quelque étonnant fils de roi ou de sultan.
Et le cortège, au milieu de l’ébahissement de tout un peuple, finit par arriver au palais. Et dès que les gardes et les portiers eurent aperçu le premier groupe, ils furent dans un tel émerveillement que, saisis de respect et d’admiration, ils formèrent spontanément la haie sur son passage. Et leur chef, à la vue du premier nègre, persuadé que le sultan des nègres en personne venait en visite chez le roi, s’avança vers lui et se prosterna et voulut lui baiser le bas de la robe ; mais il vit alors la file merveilleuse qui le suivait. Et, en même temps, le premier nègre lui dit en souriant, car il avait reçu les instructions nécessaires de l’éfrit : « Je ne suis, et nous tous ne sommes que les esclaves de celui qui viendra, quand le moment sera venu ! » Et, ayant ainsi parlé, il franchit la porte, suivi de l’adolescente qui portait le bassin d’or, et de toute la file des groupes harmonieux. Et les quatre-vingts esclaves franchirent la première cour et allèrent se ranger en bon ordre dans la seconde cour, qui donnait de plain-pied sur le diwân de réception.
Or, dès que le sultan, qui présidait à ce moment aux affaires du royaume, vit dans la cour ce cortège magnifique qui effaçait par sa splendeur l’éclat de tout ce qu’il possédait au palais, il fit immédiatement évacuer le diwân, et donna l’ordre de recevoir les nouveaux arrivés. Et ils entrèrent gravement, deux par deux, et se rangèrent avec lenteur, en formant un grand croissant devant le trône du sultan. Et les esclaves adolescentes, aidées par leurs compagnons nègres, déposèrent chacune, sur le tapis, le bassin qu’elles portaient. Puis les quatre-vingts, tous ensemble se prosternèrent et embrassèrent la terre entre les mains du sultan, pour se relever aussitôt et, tous à la fois, découvrir d’un même geste adroit les bassins débordants de leurs fruits merveilleux. Et, les bras croisés sur la poitrine, ils demeurèrent debout, dans l’attitude du plus profond respect.
Alors seulement, la mère d’Aladdin, qui venait la dernière, s’avança jusqu’au milieu du croissant formé par les quarante groupes alternés, et, après les prosternations et les salams d’usage, elle dit au roi, qui était devenu tout à fait muet de ce spectacle sans pareil : « Ô roi du temps, mon fils Aladdin, ton esclave, m’envoie avec la dot que tu as demandée comme prix de Sett Badrou’l-Boudour, ta fille honorable ! Et il me charge de te dire que tu t’es trompé dans l’appréciation de la valeur de la princesse, et que tout cela est bien au-dessous de ses mérites ! Mais il espère que tu l’excuseras pour le peu, et que tu agréeras ce faible tribut, dans l’attente de ce qu’il fera à l’avenir ! »
Ainsi parla la mère d’Aladdin. Mais le roi, qui n’était guère en état de bien saisir ce qu’elle lui disait, restait ébahi et les yeux écarquillés devant le spectacle qui s’offrait à sa vue. Et il regardait alternativement les quarante bassins, le contenu des quarante bassins, les esclaves adolescentes qui avaient porté les bassins, et les jeunes nègres qui avaient accompagné les porteuses des bassins. Et il ne savait ce qu’il devait le plus admirer, de ces joyaux qui étaient les plus extraordinaires qu’il eût jamais vus au monde, ou de ces esclaves adolescentes qui étaient comme des lunes, ou de ces esclaves nègres qui étaient comme autant de rois ! Et il resta ainsi une heure de temps, sans pouvoir prononcer une parole ni détacher ses regards des merveilles qu’il avait devant lui. Et il finit enfin, au lieu de s’adresser à la mère d’Aladdin pour lui exprimer ses sentiments au sujet de ce qu’elle lui apportait, par se tourner vers son grand-vizir et lui dire : « Par ma vie ! que deviennent les richesses que nous possédons et que devient mon palais devant une telle magnificence ? Et que devons-nous penser de l’homme qui peut, en moins de temps qu’il n’en faut pour les souhaiter, réaliser de telles splendeurs et nous les envoyer ? Et que deviennent les mérites de ma fille elle-même devant une telle profusion de beauté ? » Et le vizir, malgré tout le dépit et le ressentiment qu’il éprouvait de tout ce qui était arrivé à son fils, ne put s’empêcher de dire : « Oui, par Allah ! tout cela est beau ; mais, tout de même, ne vaut pas le trésor unique qu’est la princesse Badrou’l-Boudour ! » Et le roi dit : « Par Allah ! ça la vaut et ça en dépasse de beaucoup la valeur ! C’est pourquoi je ne crois plus faire un marché de dupe en l’accordant en mariage à un homme aussi riche, aussi généreux et aussi magnifique que l’est le seigneur Aladdin, notre fils ! » Et il se tourna vers les autres vizirs et les émirs et les notables qui l’entouraient, et les interrogea du regard. Et tous répondirent en s’inclinant profondément jusqu’à terre par trois fois, pour bien marquer leur acquiescement aux paroles de leur roi.
Alors le roi n’hésita plus…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Et tous répondirent en s’inclinant profondément jusqu’à terre par trois fois, pour bien marquer leur acquiescement aux paroles de leur roi.
Alors le roi n’hésita plus. Et, sans davantage se préoccuper de savoir si Aladdin possédait toutes les qualités requises de la part de quelqu’un destiné à devenir l’époux d’une fille de roi, il se tourna vers la mère d’Aladdin, et lui dit : « Ô vénérable mère d’Aladdin, je te prie d’aller dire à ton fils que, dès cet instant, il est entré dans ma race et dans ma descendance, et je n’attends plus que de le voir, pour l’embrasser comme un père embrasse son enfant, et pour l’unir, par le Livre et la Sunnah, à ma fille Badrou’l-Boudour ! »
Et la mère d’Aladdin, après les salams de part et d’autre, se hâta de se retirer pour aussitôt, défiant la rapidité du vent, s’envoler vers sa maison et mettre son fils au courant de ce qui venait de se passer. Et elle le pressa de se hâter d’aller se présenter au roi, qui était dans la plus vive impatience de le voir. Et Aladdin, dont cette nouvelle satisfaisait tous les vœux, après une si longue attente, ne voulut point laisser voir combien il était ivre de joie. Et, d’un air fort calme et d’un accent mesuré, il répondit : « Tout ce bonheur me vient d’Allah et de ta bénédiction, ô mère, et de ton zèle inlassable ! » Et il lui baisa les mains, et la remercia beaucoup, et lui demanda la permission de se retirer dans sa chambre, pour se préparer à aller chez le sultan.
Or, dès qu’il se trouva seul, Aladdin prit la lampe magique, qui lui avait été jusque-là d’un si grand secours, et la frotta comme à l’ordinaire. Et à l’instant parut l’éfrit qui, après s’être incliné devant lui, lui demanda, par la formule habituelle, quel service il pouvait lui rendre. Et Aladdin répondit : « Ô éfrit de la lampe, je désire prendre un bain ! Et, après le bain, je veux que tu m’apportes une robe qui n’ait point sa pareille en magnificence chez les plus grands sultans de la terre, et si belle que les connaisseurs puissent l’estimer à plus de mille milliers de dinars d’or, pour le moins ! Et c’est tout pour le moment ! »
Alors l’éfrit de la lampe, après s’être incliné en signe d’obéissance, courba l’échine complètement, et dit à Aladdin : « Monte, ô maître de la lampe, sur mes épaules ! » Et Aladdin monta sur les épaules de l’éfrit, en faisant pendre ses jambes sur sa poitrine ; et l’éfrit l’enleva dans les airs, en le rendant invisible comme lui, et le transporta dans un hammam si beau qu’on ne pouvait en trouver le frère chez les rois et les kaïssars. Et le hammam était tout en jade et en albâtre transparent, avec des bassins en cornaline rose et en corail blanc et des ornementations en pierre d’émeraude d’une délicatesse charmante. Et les yeux et les sens pouvaient là-dedans véritablement se délecter à leur aise, car rien n’y pouvait heurter la vue soit par l’ensemble, soit par les détails ! Et la fraîcheur y était délicieuse, et la tiédeur y était égale et la chaleur y était mesurée et harmonieuse. Et pas un baigneur n’était là pour troubler par sa présence ou sa voix la paix des voûtes blanches. Mais, dès que le genni eut déposé Aladdin sur l’estrade de la salle d’entrée, un jeune éfrit de toute beauté, semblable, mais en plus séduisant, à une jouvencelle, parut devant lui et l’aida à se déshabiller, et lui jeta une grande serviette parfumée sur les épaules, et le soutint avec beaucoup de précaution et de douceur et le conduisit dans la plus belle des salles, qui était toute pavée de pierreries de couleurs diversifiées. Et aussitôt d’autres jeunes éfrits, non moins beaux et non moins séduisants, vinrent le prendre des mains de leur compagnon, et l’assirent commodément sur un banc de marbre, et se mirent à le frotter et à le laver avec plusieurs sortes d’eaux de senteurs ; et ils le massèrent avec un art admirable, et le relavèrent à l’eau de roses musquée. Et leurs soins savants lui donnèrent un teint aussi frais qu’un pétale de rose et blanc et vermeil à souhait. Et il se sentit devenir léger à pouvoir s’envoler comme les oiseaux. Et le jeune et bel éfrit qui l’avait amené vint le reprendre et le reconduire sur l’estrade, où il lui offrit, comme rafraîchissement, un délicieux sorbet à l’ambre gris. Et il trouva le genni de la lampe qui tenait entre ses mains un habit d’une somptuosité incomparable. Et aidé par le jeune éfrit aux mains si douces, il revêtit cette magnificence, et devint semblable, avec plus de prestance encore, à quelque fils de roi d’entre les grands rois ! Et l’éfrit le reprit sur ses épaules et le reporta dans la chambre de sa maison, sans secousse.
Alors Aladdin se tourna vers l’éfrit de la lampe et lui dit : « Et, maintenant, sais-tu ce qu’il te reste à faire ? » Il répondit : « Non, ô maître de la lampe ! Mais ordonne et j’obéirai, soit que dans les airs je vole, soit que sur la terre je rampe ! » Et Aladdin dit : « Je désire que tu m’amènes un cheval de race pure, qui n’ait point un frère en beauté, pas plus dans les écuries du sultan que chez les plus puissants monarques du monde. Et il faut que son harnachement, à lui seul, vaille pour le moins mille milliers de dinars d’or. En même temps, tu m’amèneras quarante-huit jeunes esclaves de belle tournure, de taille avantageuse et pleins de grâce, habillés avec beaucoup de propreté, d’élégance et de richesse, pour que vingt-quatre d’entre eux, rangés en deux files de douze, puissent ouvrir la marche devant mon cheval, tandis que les vingt-quatre autres suivront derrière moi, sur deux files de douze, également. En outre, tu n’oublieras pas surtout de trouver, pour le service de ma mère, douze jeunes filles comme des lunes, uniques en leur espèce, habillées avec beaucoup de goût et de magnificence et portant sur leurs bras, chacune, une robe d’étoffe et de couleur différentes, et telle que pourrait s’en vêtir, en toute confiance, une fille de roi ! Enfin, tu donneras à chacun de mes quarante-huit esclaves, pour qu’il le passe à son cou, un sac de cinq mille dinars d’or, afin que je puisse en faire l’usage qui me plaît.
Et voilà tout ce que je désire de toi, pour aujourd’hui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT CINQUANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et voilà tout ce que je désire de toi, pour aujourd’hui ! »
Or, à peine Aladdin avait-il fini de parler que le genni, après la réponse de l’ouïe et de l’obéissance, se hâta de disparaître, mais pour revenir au bout d’un moment avec le cheval, les quarante-huit jeunes esclaves, les douze jeunes filles, les quarante-huit sacs de cinq mille dinars chacun, et les douze robes d’étoffe et de couleur différentes. Et le tout était tout à fait de la qualité demandée, sinon d’une plus belle encore. Et Aladdin prit possession de tout et congédia le genni, en lui disant : « Je t’appellerai dès que j’aurai besoin de toi ! » Et, sans perdre de temps, il prit congé de sa mère, dont il embrassa encore une fois les mains, et mit à son service les douze esclaves adolescentes en leur recommandant de ne rien épargner pour contenter leur maîtresse et pour lui enseigner la façon de mettre les belles robes qu’elles avaient apportées.
Après quoi Aladdin se hâta de monter à cheval, et de sortir de la cour de sa maison. Et bien que ce fût pour la première fois qu’il se trouvait sur le dos d’un cheval, il sut s’y tenir avec une élégance et une fermeté que lui auraient enviées les cavaliers les plus accomplis. Et il se mit en marche, selon le plan du cortège qu’il avait imaginé, précédé de vingt-quatre esclaves, rangés sur deux files de douze, accompagné, sur les deux côtés, de quatre esclaves qui tenaient les cordons de la housse du cheval, et suivi des autres, qui fermaient la marche.
Or, dès que le cortège se fut engagé dans les rues, une foule immense, bien plus considérable que celle qui était accourue au-devant du premier cortège, s’amassa de tous les côtés, aussi bien dans les souks que sur les fenêtres et les terrasses. Et les quarante-huit esclaves se mirent alors, suivant les ordres qui leur avaient été donnés par Aladdin, à prendre de l’or dans leurs sacs et à le jeter par poignées, tantôt à droite et tantôt à gauche, au peuple qui se pressait sur leurs pas. Et les acclamations retentissaient par toute la ville, tant à cause de la générosité du magnifique donateur qu’à cause de la beauté du cavalier et de ses esclaves splendides. Car Aladdin, sur son cheval, était vraiment bien beau à voir, avec son visage rendu encore plus charmant par la vertu de la lampe magique, son maintien royal et l’aigrette de diamant qui se balançait sur son turban. Et ce fut ainsi qu’au milieu des acclamations et de l’émerveillement de tout un peuple Aladdin arriva au palais, où l’avait déjà précédé la rumeur de sa venue, et où tout avait été préparé pour le recevoir avec tous les honneurs dus à l’époux de la princesse Badrou’l-Boudour.
Or, le sultan l’attendait précisément sur le haut de l’escalier d’honneur qui s’ouvrait sur la seconde cour. Et dès qu’Aladdin, aidé par le grand-vizir lui-même qui lui tenait l’étrier, eut mis pied à terre, le sultan descendit deux ou trois marches en son honneur. Et Aladdin monta vers lui et voulut se prosterner entre ses mains ; mais il en fut empêché par le sultan qui, émerveillé de sa prestance, de son bel air et de la richesse de son habillement, le reçut dans ses bras et l’embrassa comme s’il était son propre enfant. Et, au même moment, l’air retentit des acclamations poussées par tous les émirs, les vizirs et les gardes, et du son des trompettes, des clarinettes, des hautbois et des tambours. Et le sultan, le bras passé autour du cou d’Aladdin, le conduisit dans la grande salle des réceptions, et le fit s’asseoir à côté de lui sur le lit du trône, et l’embrassa une seconde fois et lui dit : « Par Allah, ô mon fils Aladdin, je regrette beaucoup que ma destinée ne m’ait pas fait te rencontrer avant ce jour, et d’avoir ainsi différé pendant trois mois ton mariage avec ma fille Badrou’l-Boudour, ton esclave ! » Et Aladdin sut répondre à cela d’une façon si charmante que le sultan sentit augmenter son amour pour lui et lui dit : « Certes ! ô Aladdin, quel roi ne pourrait souhaiter t’avoir comme époux de sa fille ! » Et il se mit à causer avec lui et à l’interroger avec beaucoup d’affection, et à admirer la sagesse de ses réponses et l’éloquence et la finesse de ses discours. Et il fit préparer, dans la salle même du trône, un festin magnifique, et mangea seul avec Aladdin, en se faisant servir par le grand-vizir, dont le nez, de dépit, s’allongeait à la limite de l’allongement, et par les émirs et les autres hauts dignitaires.
Lorsque le repas fut terminé, le sultan, qui ne voulait pas davantage différer la réalisation de sa promesse, fit appeler le kâdi et les témoins, et leur ordonna d’écrire sur le champ le contrat de mariage d’Aladdin et de sa fille la princesse Badrou’l-Boudour. Et le kâdi, en présence des témoins, se hâta d’exécuter l’ordre, et d’écrire le contrat dans toutes les formes requises par le Livre et la Sunnah. Et lorsqu’il eut fini, le sultan embrassa Aladdin, et lui dit : « Ô mon fils, est-ce cette nuit même que tu veux pénétrer dans la chambre nuptiale pour la consommation ? » Et Aladdin répondit : « Ô roi du temps, certes ! si je n’écoutais que le grand amour que j’éprouve pour mon épouse, c’est ce soir même que je pénétrerais pour la consommation. Mais je désire que la chose soit faite dans un palais digne de la princesse et qui lui appartienne en propre. Permets-moi donc de différer la pleine réalisation de mon bonheur jusqu’à ce que j’aie fait bâtir le palais que je lui destine. Et, à cet effet, je te prie de m’accorder la concession d’un vaste terrain situé en face même de ton palais, afin que mon épouse ne soit pas trop éloignée de son père et que je puisse moi-même être toujours pràs de toi, à te servir ! Et, moi, pour ma part, je me charge de faire bâtir ce palais dans le plus bref délai ! » Et le sultan répondit : « Ah ! mon fils tu n’as guère besoin de me demander cette permission ! Prends, en face de mon palais, tout le terrain qu’il te faut. Mais hâte-toi, je t’en prie, que ce palais soit achevé au plus tôt ; car je voudrais bien jouir de la postérité de ma descendance, avant de mourir ! » Et Aladdin sourit et dit : « Que le roi tranquillise son esprit à ce sujet ! Le palais sera bâti avec plus de diligence qu’il ne peut en souhaiter ! » Et il prit congé du sultan, qui l’embrassa tendrement, et s’en retourna à sa maison, avec le même cortège qui l’avait accompagné, au milieu des acclamations du peuple et des vœux de bonheur et de prospérité.
Or, dès qu’il fut rentré dans sa maison, il mit sa mère au courant de ce qui s’était passé, et se hâta de se retirer, tout seul, dans sa chambre. Et il prit la lampe magique et la frotta, comme à l’ordinaire…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il prit la lampe magique et la frotta, comme à l’ordinaire. Et l’éfrit ne manqua pas de paraître et de se mettre à ses ordres. Et Aladdin lui dit : « Ô éfrit de la lampe, j’ai d’abord à te louer pour le zèle que tu as déployé à mon service. Et ensuite j’ai à te demander quelque chose de plus difficile, je crois, à réaliser que ce que tu as fait pour moi jusqu’aujourd’hui, en vertu du pouvoir qu’exercent sur toi les vertus de ta maîtresse, cette lampe que j’ai en ma possession. Or, voici ! je veux, que, dans le plus court délai possible, tu me bâtisses, en face même du palais du sultan, un palais qui soit digne de mon épouse El Sett Badrou’l-Boudour ! Et, pour cela, je laisse à ton bon goût et à tes connaissances déjà éprouvées le soin de tous les détails d’ornementation et le choix des matériaux précieux, tels que pierres de jade, de porphyre, d’albâtre, d’agate, de lazulite, de jaspe, de marbre et de granit ! Prends soin seulement de m’élever, au milieu de ce palais, un grand dôme de cristal construit sur des colonnes d’or massif et d’argent, alternativement, et percé de quatre-vingt-dix-neuf fenêtres enrichies de diamants, de rubis, d’émeraudes et d’autres pierreries, mais en veillant à ce que la quatre-vingt-dix-neuvième fenêtre reste imparfaite, non point d’architecture mais d’ornementation. Car j’ai un projet à ce sujet. Et n’oublie pas de tracer un beau jardin, avec des bassins et des jets d’eau, et des cours spacieuses. Et surtout, ô éfrit, ménage-moi, dans un souterrain dont tu m’indiqueras l’emplacement, un très grand trésor rempli de dinars d’or. Et pour tout le reste, ainsi que pour les cuisines, les écuries, et les serviteurs, je te laisse pleine liberté, me fiant à ta sagacité et à ton bon vouloir ! » Et il ajouta : « Dès que tout sera prêt, tu viendras m’en aviser ! » Et le genni répondit : « J’écoute et j’obéis ! » et disparut.
Or, le lendemain, à la pointe du jour, Aladdin était encore dans son lit, quand il vit paraître devant lui l’éfrit de la lampe, qui, après les salams d’usage, lui dit : « Ô maître de la lampe, tes ordres sont exécutés. Et je te prie de venir en contrôler la réalisation ! » Et Aladdin acquiesça à la chose, et l’éfrit le transporta aussitôt à l’endroit désigné et lui montra, vis-à-vis du palais du sultan, au milieu d’un magnifique jardin, et précédé de deux immenses cours de marbre, un palais bien plus beau que celui qu’il attendait. Et le genni, après lui en avoir fait admirer l’architecture et l’aspect général, lui en fit visiter, en détail, tous les endroits. Et Aladdin trouva que les choses avaient été faites avec un faste, une splendeur et une magnificence inimaginables ; et il trouva, dans un immense souterrain, un trésor qui s’étageait jusqu’à la voûte, formé de sacs superposés remplis de dinars d’or. Et il visita également les cuisines, les offices, les magasins des provisions et les écuries, qu’il trouva tout à fait à son goût, dans une grande propreté ; et il admira les chevaux et les juments qui mangeaient dans des mangeoires d’argent, tandis que les palefreniers les soignaient et les pansaient. Et il passa en revue les esclaves des deux sexes et les eunuques rangés en bon ordre, suivant l’importance de leurs fonctions. Et lorsqu’il eut tout vu et tout examiné, il se tourna vers l’éfrit de la lampe, qui n’était visible que pour lui seul et qui l’accompagnait partout, et le félicita de la diligence, du bon goût et de l’intelligence dont il avait fait preuve dans cette œuvre parfaite. Puis il ajouta : « Tu as seulement oublié, ô éfrit, d’étendre, de la porte de mon palais à celle du sultan, un grand tapis qui permette à mon épouse de ne pas se fatiguer les pieds en traversant l’intervalle ! » Et le genni répondit : « Ô maître de la lampe, tu as raison ! Mais dans un instant cela sera fait ! » Et, en effet, en un clin d’œil, un magnifique tapis de velours se trouva étendu dans l’intervalle qui séparait les deux palais, avec des couleurs qui s’unissaient à ravir aux tons des pelouses et des corbeilles.
Alors Aladdin, à la limite de la satisfaction, dit à l’éfrit : « Maintenant tout est parfait ! Ramène-moi à la maison ! » Et l’éfrit l’enleva et le transporta dans sa chambre, tandis que dans le palais du sultan les gens de service commençaient à ouvrir les portes pour vaquer à leurs occupations.
Or, dès qu’ils eurent ouvert les portes, les esclaves et les portiers furent à la limite de la stupéfaction, en constatant que la vue était complètement bouchée du côté où la veille encore se voyait un immense meidân pour les tournois et les cavalcades. Et ils virent d’abord le magnifique tapis de velours qui s’étendait entre les pelouses fraîches et mariait ses couleurs aux teintes naturelles des fleurs et des arbustes. Et ils aperçurent alors, en accompagnant ce tapis du regard, à travers les pelouses du jardin miraculeux, le superbe palais bâti en pierres précieuses et dont le dôme de cristal brillait comme le soleil. Et, ne sachant que penser, ils préférèrent aller rapporter la chose au grand-vizir qui, à son tour, après avoir regardé du côté du nouveau palais, alla prévenir de la chose le sultan, en lui disant : « Il n’y a pas de doute, ô roi du temps ! L’époux de Sett Badrou’l-Boudour est un insigne magicien ! » Mais le sultan lui répondit : « Tu m’étonnes beaucoup, ô vizir, en voulant insinuer que le palais dont tu me parles est l’œuvre de la magie ! Tu sais bien pourtant que l’homme qui m’a déjà fait don de si merveilleux présents est bien capable, moyennant les richesses qu’il doit posséder et le nombre considérable d’ouvriers qu’il a dû employer grâce à sa fortune, de faire construire tout un palais en une seule nuit ! Pourquoi donc hésites-tu à croire qu’il ait obtenu ce résultat par le moyen des forces naturelles ? Et n’est-ce point plutôt ta jalousie qui t’aveugle et te fait mal juger des faits et te pousse à médire de mon gendre Aladdin ? » Et le vizir, comprenant par ces paroles que le sultan aimait Aladdin, n’osa pas insister, de peur de se faire du tort à lui-même, et se fit muet par prudence. Et voilà pour lui !
Quant à Aladdin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… Quant à Aladdin, une fois transporté dans sa vieille maison par l’éfrit de la lampe, il dit à l’une des douze esclaves adolescentes d’aller réveiller sa mère, et leur donna à toutes l’ordre de lui mettre l’une des belles robes qu’elles avaient apportées, et de la parer du mieux qu’elles pouvaient. Et lorsque sa mère fut habillée comme il le désirait, il lui dit que le moment était venu d’aller au palais du sultan pour prendre la nouvelle mariée et la conduire au palais qu’il lui avait fait bâtir. Et la mère d’Aladdin, après avoir reçu à ce sujet toutes les instructions nécessaires, sortit de sa maison, accompagnée par ses douze esclaves, et fut bientôt suivie par Aladdin à cheval au milieu de son cortège. Mais, arrivés à une certaine distance du palais, ils se séparèrent pour aller, Aladdin à son nouveau palais, et sa mère chez le sultan.
Or, dès que les gardes du sultan eurent aperçu la mère d’Aladdin, au milieu des douze jeunes filles qui lui faisaient cortège, ils coururent prévenir le sultan qui se hâta de venir à sa rencontre. Et il la reçut avec les marques du respect et les égards dus à son nouveau rang. Et il donna l’ordre au chef des eunuques de l’introduire dans le harem, auprès de Sett Badrou’l-Boudour. Et dès que la princesse l’eut aperçue et eut appris qu’elle était la mère de son époux Aladdin, elle se leva en son honneur et alla l’embrasser. Puis elle la fit s’asseoir à côté d’elle, et la régala de diverses confitures et friandises, et acheva de se faire habiller par ses femmes et parer des joyaux les plus précieux dont lui avait fait présent son époux Aladdin. Et peu après entra le sultan, et, pour la première fois, il put, grâce à la nouvelle parenté, voir à découvert le visage de la mère d’Aladdin. Et il remarqua, à la délicatesse de ses traits, qu’elle avait dû être bien avenante dans sa jeunesse, et que maintenant, vêtue comme elle l’était d’une belle robe et arrangée à son avantage, elle avait plus grand air que beaucoup de princesses et d’épouses de vizirs et d’émirs. Et il lui fit beaucoup de compliments à ce sujet : ce qui toucha et remua profondément le cœur de la pauvre femme du défunt tailleur Mustapha, si longtemps malheureuse, et lui remplit les yeux de larmes.
Après quoi, ils se mirent tous trois à causer en toute cordialité, faisant ainsi plus ample connaissance, jusqu’à l’arrivée de la sultane, mère de Badrou’l-Boudour. Or, la vieille sultane était loin de voir d’un bon œil ce mariage de sa fille avec le fils de gens inconnus ; et elle était du parti du grand-vizir qui continuait, en secret, à être bien mortifié de la bonne tournure que prenait toute l’affaire à son détriment. Cependant elle n’osa pas, malgré le désir qu’elle en avait, faire trop mauvaise figure à la mère d’Aladdin ; et, après les salams de part et d’autre, elle s’assit avec les autres, sans toutefois s’intéresser à la conversation.
Or, lorsque vint le moment des adieux pour le départ au nouveau palais, la princesse Badrou’l-Boudour se leva et embrassa avec beaucoup de tendresse son père et sa mère, en mêlant ses baisers de beaucoup de larmes, pour la circonstance. Puis, soutenue par la mère d’Aladdin, qui se tenait à sa gauche, et précédée de dix eunuques vêtus de leurs habits de cérémonie, et suivie de cent jeunes filles esclaves habillées avec une magnificence de libellules, elle se mit en marche vers le nouveau palais, au milieu de deux files de quatre cents jeunes esclaves blancs et noirs alternés, rangés entre les deux palais, et qui tenaient chacun un flambeau d’or où brûlait une grande bougie d’ambre et de camphre blanc. Et, lentement, la princesse s’avança au milieu de ce cortège, en traversant le tapis de velours, tandis que, sur son passage, un concert admirable d’instruments se faisait entendre, aussi bien dans les allées du jardin que sur le haut des terrasses du palais d’Aladdin. Et, dans le loin, les acclamations retentissaient, poussées par tout le peuple accouru autour des deux palais, et mêlaient leur rumeur d’allégresse à toute cette gloire. Et la princesse finit par arriver à l’entrée du nouveau palais, où l’attendait Aladdin. Et il vint en souriant à sa rencontre ; et elle fut charmée de le voir si beau et si brillant. Et elle entra avec lui dans la salle du festin, sous le grand dôme aux fenêtres de pierreries. Et ils s’assirent tous les trois devant les plateaux d’or servis par les soins de l’éfrit de la lampe ; et Aladdin était assis au milieu, entre son épouse à droite et sa mère à gauche. Et ils commencèrent leur repas, aux sons d’une musique qu’on ne voyait pas, et qui était jouée par un chœur d’éfrits des deux sexes. Et Badrou’l-Boudour, enchantée de tout ce qu’elle voyait et entendait, se disait en elle-même : « De ma vie je n’ai imaginé de si merveilleuses choses ! » Et même elle s’arrêta de manger, pour mieux écouter les chants et le concert des éfrits. Et Aladdin et sa mère ne cessaient de la servir et de lui verser à boire des boissons, dont elle pouvait d’ailleurs se passer, tant elle était déjà ivre d’émerveillement. Et ce fut pour eux une journée splendide, qui n’avait pas eu sa pareille aux temps d’Iskandar et de Soleïmân…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et ce fut pour eux une journée splendide, qui n’avait pas eu sa pareille aux temps d’Iskandar et de Soleïmân.
Et lorsque vint la nuit, le repas fut desservi, et aussitôt une troupe de danseuses fit son entrée dans la salle du dôme. Et elle était composée de quatre cents adolescentes, filles de mareds et d’éfrits, habillées comme des fleurs et légères comme des oiseaux. Et, aux sons d’une musique aérienne, elles se mirent à danser plusieurs sortes de motifs et de pas de danses comme on n’en peut voir que dans les régions du paradis. Et ce fut alors qu’Aladdin se leva et, prenant son épouse par la main, s’achemina avec elle, d’un pas cadencé, vers la chambre nuptiale. Et les esclaves adolescentes, précédées par la mère d’Aladdin, les suivirent en bon ordre. Et on déshabilla Badrou’l-Boudour ; et on ne lui mit sur le corps que juste ce qui était nécessaire pour la nuit. Et elle devint ainsi semblable à un narcisse qui sort de son calice. Et, après qu’on leur eut souhaité les délices et la joie, on les laissa seuls dans la chambre nuptiale. Et Aladdin, à la limite du bonheur, put enfin s’unir à Badrou’l-Boudour, la fille du roi. Et leur nuit, de même que leur journée ; n’eût point sa pareille aux temps d’Iskandar et de Soleïmân.
Or, le lendemain, après toute une nuit de délices, Aladdin sortit des bras de son épouse Badrou’l-Boudour, pour aussitôt se faire revêtir d’une robe plus magnifique encore que celle de la veille, et se disposer à aller chez le sultan. Et il se fit amener un superbe cheval des écuries pourvues par l’éfrit de la lampe, et le monta et se dirigea vers le palais du père de son épouse, au milieu d’une escorte d’honneur. Et le sultan le reçut avec les marques de la plus vive réjouissance, et l’embrassa et lui demanda, avec beaucoup d’intérêt, de ses nouvelles et des nouvelles de Badrou’l-Boudour. Et Aladdin lui fit à ce sujet la réponse qu’il fallait, et lui dit : « Je viens sans retard, ô roi du temps, t’inviter à venir aujourd’hui illuminer ma demeure de ta présence et partager avec nous le premier repas d’après les noces ! Et je te prie de te faire accompagner, pour visiter le palais de ta fille, du grand-vizir et des émirs ! » Et le sultan, pour bien lui marquer son estime et son affection, ne fit aucune difficulté à accepter l’invitation, et se leva à l’heure et à l’instant, et, suivi de son grand-vizir et de ses émirs, il sortit avec Aladdin.
Or, à mesure que le sultan approchait du palais de sa fille, son admiration augmentait considérablement, et ses exclamations se faisaient plus vives, plus accentuées et plus rapprochées. Et tout cela quand il n’était encore qu’au dehors du palais. Mais, quand il y fut entré, quel émerveillement ! Il ne voyait partout que splendeurs, somptuosités, richesses, bon goût, harmonie et magnificence ! Et ce qui acheva de l’éblouir, ce fut la salle du dôme de cristal, dont il ne pouvait se lasser d’admirer l’architecture aérienne et l’ornementation. Et il voulut compter le nombre des fenêtres enrichies de pierreries, et trouva qu’en effet elles étaient au nombre de quatre-vingt-dix-neuf, pas une de plus, pas une de moins. Et il s’en étonna énormément. Mais il remarqua également que la quatre-vingt-dix-neuvième fenêtre était restée inachevée et n’avait aucune sorte d’ornement ; et, bien surpris, il se tourna vers Aladdin et lui dit : « Ô mon fils Aladdin, voici certainement le plus merveilleux palais qui ait jamais existé sur la face de la terre ! Et je suis dans l’admiration de tout ce que je vois ! Mais peux-tu me dire le motif qui t’a empêché d’achever le travail de cette fenêtre qui dépare ainsi, par son imperfection, la beauté de ses autres sœurs ? » Et Aladdin sourit et répondit : « Ô roi du temps, je te prie de ne point croire que ce soit par oubli ou par économie ou par simple négligence que j’ai laissé cette fenêtre en l’état imparfait où tu la vois ; car c’est bien à dessein que je l’ai ainsi voulue. Et le motif était de laisser à Ta Hautesse le soin de faire achever ce travail, pour sceller de la sorte dans la pierre de ce palais ton nom glorieux et le souvenir de ton règne. C’est pourquoi je te supplie de consacrer, par ton consentement, la construction de cette demeure qui, toute convenable qu’elle soit, reste indigne des mérites de ta fille, mon épouse ! » Et le roi, extrêmement flatté de cette délicate attention d’Aladdin, le remercia et voulut qu’à l’instant ce travail commençât. Et, à cet effet, il donna l’ordre à ses gardes de faire venir au palais, sans retard, les joailliers les plus habiles et les mieux fournis en pierreries, pour achever les incrustations de la fenêtre. Et, en attendant leur arrivée, il alla voir sa fille et lui demander des nouvelles de sa première nuit de noces. Et, rien qu’au sourire qu’elle lui fit et à son air satisfait, il comprit qu’il serait superflu d’insister. Et il embrassa Aladdin, en le félicitant beaucoup, et alla avec lui dans la salle où le repas était préparé avec toute la splendeur qui convenait. Et il mangea de tout, et trouva que les mets étaient les plus excellents qu’il eût jamais goûtés, et que le service était bien supérieur à celui de son palais, et que l’argenterie et les accessoires étaient tout à fait admirables.
Sur ces entrefaites, arrivèrent les joailliers et les orfèvres…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… Sur ces entrefaites, arrivèrent les joailliers et les orfèvres, que les gardes étaient allés querir par toute la capitale ; et on vint prévenir le roi, qui aussitôt remonta sous le dôme aux quatre-vingt-dix-neuf fenêtres. Et il montra la fenêtre inachevée aux orfèvres, en leur disant : « Il faut que, dans le plus bref délai, vous finissiez le travail que nécessite cette fenêtre, en fait d’incrustations de perles et de pierreries de toutes les couleurs ! » Et les orfèvres et les joailliers répondirent par l’ouïe et l’obéissance et se mirent à examiner avec beaucoup de minutie le travail et les incrustations des autres fenêtres, en se regardant entre eux avec des yeux bien dilatés d’étonnement. Et, après s’être concertés entre eux, ils revinrent auprès du sultan et, après les prosternations, lui dirent : « Ô roi du temps, nous n’avons point dans nos boutiques, malgré tous nos lots de pierres précieuses, de quoi orner la centième partie de cette fenêtre ! » Et le roi dit : « Je vous fournirai tout ce qu’il faudra ! » Et il fit apporter les fruits en pierres précieuses qu’Aladdin lui avait donnés en présent, et leur dit : « Employez le nécessaire, et rendez-moi le reste ! » Et les joailliers prirent leurs mesures et firent leurs calculs, en les répétant plusieurs fois, et répondirent : « Ô roi du temps, tout ce que tu nous donnes, et tout ce que nous possédons, ne suffira pas à orner la dixième partie de la fenêtre ! » Et le roi se tourna vers ses gardes et leur dit : « Allez envahir les maisons de mes vizirs, grands et petits, de mes émirs et de tous les gens riches de mon royaume, et faites-vous remettre, de gré ou de force, toutes les pierres précieuses qu’ils possèdent ! » Et les gardes se hâtèrent d’aller exécuter l’ordre.
Or, en attendant leur retour, Aladdin, qui voyait bien que le roi commençait à être inquiet sur l’issue de l’entreprise et qui, en son âme, se réjouissait à l’extrême de la chose, voulut le distraire par un concert. Et il fit signe à l’un des jeunes éfrits, ses esclaves, qui aussitôt fit entrer une troupe de chanteuses si belles que chacune d’elles pouvait dire à la lune : « Lève-toi, que je m’asseye à ta place ! » et douées d’une voix enchanteresse qui pouvait dire au rossignol : « Tais-toi pour m’entendre chanter ! » Et, en effet, elles réussirent, par l’harmonie, à faire prendre un peu patience au roi.
Mais dès que les gardes furent arrivés, le sultan remit aussitôt aux joailliers et aux orfèvres les pierreries qui provenaient de la dépouille des gens riches en question, et leur dit : « Eh bien ! que dites-vous maintenant ? » Ils répondirent : « Par Allah, ô notre maître, nous sommes encore bien loin de compte ! Et il nous faudra huit fois plus de matériaux que nous n’en possédons présentement ! De plus, pour mener à bien ce travail, il nous faut, pour le moins, trois mois de délai, si nous poursuivons jour et nuit l’ouvrage ! »
À ces paroles, le roi fut à la limite du désappointement et de la perplexité, et sentit son nez s’allonger jusqu’à ses pieds de la honte qu’il avait de se voir impuissant dans des circonstances si pénibles pour son amour-propre. Alors Aladdin, ne voulant pas prolonger davantage l’épreuve à laquelle il le soumettait et se tenant pour satisfait, se tourna vers les orfèvres et les joailliers et leur dit : « Reprenez ce qui vous appartient, et sortez ! » Et il dit aux gardes : « Rendez les pierreries à leurs maîtres ! » Et il dit au roi : « Ô roi du temps, il ne sied point que je te reprenne ce que je t’ai une première fois donné ! Je te prie donc de tenir pour agréable que je te restitue ces fruits en pierreries, et que je te remplace dans ce qui reste à faire pour mener à bien l’ornementation de cette fenêtre ! Je te prie seulement de m’attendre dans l’appartement de mon épouse Badrou’l-Boudour, car je ne puis travailler ni donner aucun ordre pendant que je sais que l’on me regarde ! » Et le roi se retira chez sa fille Badrou’l-Boudour, pour ne pas gêner Aladdin.
Alors, Aladdin tira du fond d’une armoire de nacre, la lampe magique qu’il s’était bien gardé d’oublier dans le déménagement de sa vieille maison au palais ; et il la frotta comme il avait coutume de le faire. Et l’éfrit parut à l’instant et s’inclina devant Aladdin, attendant ses ordres. Et Aladdin lui dit : « Ô éfrit de la lampe, je t’ai fait venir pour que tu rendes la quatre-vingt-dix-neuvième fenêtre en tous points semblable à ses sœurs ! » Et il avait à peine formulé cette demande, que l’éfrit disparut. Et Aladdin entendit comme une infinité de coups de marteaux et de bruits de limes sur la fenêtre en question ; et, en moins de temps qu’il n’en faut à l’altéré pour avaler un verre d’eau fraîche, il vit apparaître et se parachever la miraculeuse ornementation en pierreries de la fenêtre. Et il ne put guère la différencier d’avec les autres. Et il alla trouver le sultan et le pria de l’accompagner dans la salle du dôme.
Lorsque le sultan fut arrivé en face de la fenêtre qu’il avait vue si imparfaite quelques instants auparavant, il crut s’être trompé de côté, ne la reconnaissant pas. Mais quand, après avoir fait plusieurs fois le tour du dôme, il eut constaté que le travail avait été fait en si peu de temps, alors que tous les joailliers et orfèvres réunis avaient demandé trois mois entiers pour le finir, il fut à la limite de l’émerveillement, et il embrassa Aladdin entre les deux yeux et lui dit : « Ah ! mon fils Aladdin, plus je te connais, plus je te trouve admirable…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… et il embrassa Aladdin entre les deux yeux et lui dit : « Ah ! mon fils Aladdin, plus je te connais, plus je te trouve admirable ! » Et il envoya chercher le grand-vizir, et lui montra du doigt la merveille qui l’exaltait et lui dit, d’un ton ironique : « Eh bien ! vizir, après cela que penses-tu ? » Et le vizir, qui n’oubliait point son ancienne rancune, fut de plus en plus persuadé, en voyant la chose, qu’Aladdin était un sorcier, un hérétique et un philosophe alchimiste. Mais il se garda bien de rien laisser paraître de ses pensées au sultan, qu’il savait fort attaché à son nouveau gendre, et, sans entrer en contestation avec lui, il le laissa dans son émerveillement et se contenta de répondre : « Allah est le plus grand ! »
Or, depuis ce jour, le sultan ne manqua pas de venir passer chaque soir, après le diwân, quelques heures en compagnie de son gendre Aladdin et de sa fille Badrou’l-Boudour, pour contempler les merveilles du palais, où, chaque fois, il trouvait de nouvelles choses, plus admirables que les précédentes, et qui l’émerveillaient et le transportaient.
Quant à Aladdin, loin de se laisser enfler ou amollir par sa nouvelle vie, il eut soin de se consacrer, pendant les heures qu’il ne passait pas avec son épouse Badrou’l-Boudour, à faire le bien autour de lui et à s’informer des gens pauvres, pour les soulager. Car il n’oubliait pas son ancienne condition et la misère où il avait vécu, avec sa mère, pendant les années de son enfance. Et, en outre, chaque fois qu’il sortait à cheval, il se faisait escorter par quelques esclaves qui, d’après ses ordres, ne manquaient pas de jeter, sur tout le parcours, des poignées de dinars d’or à la foule accourue. Et, tous les jours, après le repas de midi et celui du soir, il faisait distribuer aux pauvres les restes de sa table, qui suffisaient à nourrir plus de cinq mille personnes. Aussi sa conduite si généreuse et sa bonté et sa modestie lui gagnèrent l’affection de tout le peuple et attirèrent vers lui les bénédictions de tous les habitants. Et il n’y en avait pas un qui ne jurât par son nom et par sa vie. Mais ce qui acheva de lui gagner les cœurs et de mettre le comble à sa renommée, ce fut une grande victoire qu’il remporta sur des tribus révoltées contre le sultan, et où il avait fait preuve d’un courage merveilleux et de qualités guerrières qui laissaient loin derrière elles les exploits des héros les plus fameux. Et Badrou’l-Boudour ne l’en aima que mieux, et se félicita de plus en plus de son heureuse destinée qui lui avait donné comme époux le seul homme qui la méritait vraiment. Et Aladdin vécut de la sorte plusieurs années de bonheur parfait, entre son épouse et sa mère, entouré de l’affection et du dévouement des grands et des petits, et plus aimé et plus respecté que le sultan lui-même qui, d’ailleurs, continuait à le tenir en haute estime et à avoir pour lui une admiration illimitée. Et voilà pour Aladdin !
Quant au magicien maghrébin, qui s’était trouvé à l’origine de tous ces événements et qui, sans le vouloir, avait été la cause initiale de la fortune d’Aladdin, voici !
Lorsqu’il eut laissé Aladdin dans le souterrain, pour le faire mourir de soif et de faim, il s’en retourna dans son pays, au fond du Maghreb lointain. Et il passa tout ce temps à s’attrister de la mauvaise tournure de son expédition et à regretter les peines et les fatigues qu’il s’était données si vainement pour conquérir la lampe magique. Et il songeait à la fatalité qui lui avait enlevé d’entre les lèvres la bouchée qu’il avait pris tant de soin à confectionner. Et pas un jour ne s’écoulait sans que le souvenir plein d’amertume de ces choses lui revînt à la mémoire et lui fit maudire Aladdin et le moment où il avait rencontré Aladdin. Et il finit, un jour qu’il était plus qu’à l’ordinaire plein de cette tenace rancune, par avoir la curiosité de savoir les détails de la mort d’Aladdin. Et, à cet effet, comme il était fort versé dans la géomancie, il prit sa table de sable divinatoire, qu’il tira du fond d’une armoire, s’assit sur une natte carrée, au milieu d’un cercle tracé en rouge, égalisa le sable, rangea les points mâles et les points femelles, les mères et les enfants, marmonna les formules géomantiques, et dit : « Voyons, ô sable, voyons ! Qu’est devenue la lampe magique ? Et comment est-il mort, ce fils d’entremetteur, ce coquin qui s’appelait Aladdin ? » Et, en prononçant ces mots, il agita le sable selon le rite. Et voici que les figures naquirent et que l’horoscope se forma. Et le Maghrébin, à la limite de la stupéfaction, découvrit, à n’en pas douter un instant, après un examen détaillé des figures de l’horoscope, qu’Aladdin n’était point mort mais bien vivant, qu’il était le maître de la lampe magique, et qu’il était dans la splendeur, les richesses et les honneurs, marié à la princesse Badrou’l-Boudour, fille du roi de la Chine, qu’il aimait et qui l’aimait, et qu’enfin il n’était plus connu, par tout l’empire de la Chine et jusqu’aux frontières du monde, que sous le nom de l’émir Aladdin !
Lorsque le magicien eut appris de la sorte, par les opérations de sa géomancie et de sa mécréantise, ces choses auxquelles il était si loin de s’attendre, il écuma de rage et cracha en l’air et par terre, en disant : « Je crache sur ta figure, ô fils des bâtards et des chiffons ! Je pisse sur ta tête, ô Aladdin l’entremetteur, ô chien, fils de chien, ô oiseau de pendaison, ô visage de poix et de goudron…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … Je crache sur ta tête, ô fils des bâtards et des chiffons ! Je pisse sur ta tête, ô Aladdin l’entremetteur, ô chien, fils de chien, ô oiseau de pendaison, ô visage de poix et de goudron ! » Et il se mit, pendant une heure de temps, à cracher en l’air et par terre, à fouler aux pieds un imaginaire Aladdin, et à l’accabler de jurons atroces et d’insultes de toutes les variétés, jusqu’à ce qu’il se fût un peu calmé. Mais alors il résolut, coûte que coûte, de se venger d’Aladdin et de lui faire expier les félicités dont il jouissait à son détriment par la possession de cette lampe magique qui lui avait coûté, à lui magicien, tant d’efforts et tant de peines inutiles. Et, sans hésiter un instant, il se mit en route pour la Chine. Et, comme la rage et le désir de la vengeance lui donnaient des ailes, il voyagea sans s’arrêter, en réfléchissant longuement sur les meilleurs moyens à employer pour venir à bout d’Aladdin ; et il ne tarda pas à arriver dans la capitale du royaume de Chine.
Et il descendit dans un khân, où il loua un logement. Et, dès le lendemain de son arrivée, il se mit à parcourir les endroits publics et les lieux les plus fréquentés ; et, partout, il n’entendit parler que de l’émir Aladdin, de la beauté de l’émir Aladdin, de la générosité de l’émir Aladdin et de la magnificence de l’émir Aladdin. Et il se dit : « Par le feu et par la lumière ! bientôt ce nom ne sera prononcé que pour la sentence de mort ! » Et il arriva de la sorte devant le palais d’Aladdin, et s’écria, en voyant son aspect imposant : « Ah ! ah ! c’est là qu’habite maintenant le fils du tailleur Mustapha, celui qui n’avait pas un morceau de pain pour s’en nourrir à la fin de la journée ! Ah ! ah ! Aladdin, tu verras bientôt si ma destinée ne vaincra pas la tienne, et si je n’obligerai pas ta mère à filer, comme autrefois, la laine, pour ne pas mourir de faim, et si je ne creuserai pas de mes propres mains la fosse où elle viendra te pleurer ! » Puis il s’approcha de la grande porte du palais et, après avoir lié conversation avec le portier, il réussit à savoir de lui qu’Aladdin était allé à la chasse pour plusieurs jours. Et il pensa : « Voilà déjà le commencement de la chute d’Aladdin ! Je vais pouvoir agir ici plus librement pendant son absence ! Mais il faut que je sache, avant tout, si Aladdin a emporté la lampe avec lui à la chasse, ou s’il l’a laissée au palais ! » Et il se hâta de retourner à sa chambre du khân, où il prit sa table géomantique et l’interrogea. Et l’horoscope lui révéla que la lampe avait été laissée par Aladdin au palais.
Alors le Maghrébin, ivre de joie, alla au souk des chaudronniers et entra dans la boutique d’un marchand de lanternes et de lampes de cuivre, et lui dit : « Ô mon maître, j’ai besoin d’une douzaine de lampes de cuivre toutes neuves et bien polies ! » Et le marchand répondit : « J’ai ce qu’il te faut ! » Et il rangea devant lui douze lampes bien brillantes, et lui en demanda un prix que le magicien lui paya sans marchander. Et il les prit et les mit dans un panier qu’il avait acheté chez le vannier. Et il sortit du souk.
Et il se mit alors à parcourir les rues, avec le panier de lampes au bras, et en criant : « Lampes neuves ! Les lampes neuves ! J’échange des lampes neuves contre des vieilles ! Qui veut de cet échange, vienne prendre la neuve ! » Et il se dirigea de cette manière vers le palais d’Aladdin.
Or, dès que les petits gamins des rues eurent entendu ce cri inaccoutumé et vu le large turban du Maghrébin, ils s’arrêtèrent de jouer et accoururent en troupe. Et ils se mirent à gambader derrière le Maghrébin, en le huant, et en criant en chœur : « Ho ! le fou ! ho ! le fou ! » Mais lui, sans prêter la moindre attention à leurs gamineries, continuait à lancer son cri, qui dominait leurs huées : « Lampes neuves ! Les lampes neuves ! J’échange des lampes neuves contre des vieilles ! Qui veut de cet échange, vienne prendre la neuve ! »
Et il arriva de la sorte, suivi par la foule hurlante des petits enfants, sur la place qui s’étendait devant la porte du palais, et se mit à la parcourir d’un bout à l’autre, pour, de nouveau, revenir sur ses pas et recommencer, en répétant son cri de plus en plus fort, sans se lasser. Et il fit si bien que la princesse Badrou’l-Boudour, qui se trouvait à ce moment-là dans la salle aux quatre-vingt-dix-neuf fenêtres, entendit cette rumeur inaccoutumée et ouvrit l’une des fenêtres et regarda sur la place. Et elle vit la foule gambadante et hurlante des petits gamins et entendit le cri étrange du Maghrébin. Et elle se mit à rire. Et ses femmes entendirent le cri et se mirent également à rire avec elle. Et l’une d’elles lui dit : « Ô ma maîtresse, j’ai justement remarqué aujourd’hui, sur un tabouret, en nettoyant la chambre de mon maître Aladdin, une vieille lampe de cuivre ! Permets-moi donc d’aller la prendre et de la montrer à ce vieux Maghrébin, pour voir s’il est réellement aussi fou que son cri nous le donne à entendre, et s’il consentira à nous l’échanger contre une lampe neuve ! » Or, la lampe vieille dont parlait cette esclave était précisément la lampe magique d’Aladdin. Et, par un malheur écrit par la destinée, il avait oublié, avant de partir, de l’enfermer dans l’armoire de nacre où il la tenait ordinairement cachée, et l’avait laissée sur le tabouret ! Mais peut-on lutter contre les arrêts de la destinée ?
Or, la princesse Badrou’l-Boudour ignorait complètement et l’existence de cette lampe et ses vertus merveilleuses. Aussi elle ne vit aucun inconvénient à l’échange dont lui parlait son esclave, et répondit : « Mais certainement ! Prends cette lampe et remets-la à l’agha des eunuques afin qu’il aille l’échanger contre une lampe neuve, et que nous puissions rire aux dépens de ce fou ! »
Alors la jeune esclave alla à la chambre d’Aladdin, prit la lampe magique sur le tabouret, et la remit à l’agha des eunuques. Et l’agha descendit aussitôt sur la place, appela le Maghrébin, lui fit voir la lampe qu’il tenait et lui dit : « Ma maîtresse désire échanger cette lampe-ci contre une des neuves que tu as dans ce panier ! »
Lorsque le magicien eut vu la lampe, il la reconnut au premier coup d’œil et se mit à trembler d’émotion. Et l’eunuque lui dit : « Qu’as-tu ? Peut-être que tu trouves cette lampe-ci trop vieille pour l’échanger ! » Mais le magicien, qui déjà avait dominé son agitation, tendit la main avec la rapidité du vautour qui fond sur la tourterelle, saisit la lampe que lui tendait l’eunuque et la fit disparaître dans son sein. Puis il présenta le panier à l’eunuque, en disant : « Prends celle qui te plaît le mieux ! » Et l’eunuque choisit une lampe bien polie et battant neuf, et se hâta d’aller la porter à sa maîtresse Badrou’l-Boudour, en éclatant de rire et en se moquant de la folie du Maghrébin…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et l’eunuque choisit une lampe bien polie et battant neuf, et se hâta d’aller la porter à sa maîtresse Badrou’l-Boudour, en éclatant de rire et en se moquant de la folie du Maghrébin. Et voilà pour l’agha des eunuques et pour l’échange de la lampe magique, pendant l’absence d’Aladdin !
Quant au magicien, il se mit aussitôt à courir, en lançant son panier avec son contenu à la tête des gamins qui continuaient à le huer, pour les empêcher de le suivre. Et, débarrassé de la sorte, il franchit l’enceinte des palais et des jardins et s’enfonça à travers les ruelles de la ville, en faisant mille détours afin que sa trace fût perdue pour ceux qui auraient voulu continuer à le poursuivre. Et, arrivé dans un quartier tout à fait désert, il tira la lampe de son sein et la frotta. Et l’éfrit de la lampe répondit à cet appel, en paraissant aussitôt devant lui, et en disant : « Entre tes mains, ici, ton esclave le voici ! Parle, que veux-tu ? Je reste le serviteur de la lampe, soit que dans les airs je vole, soit que sur la terre je rampe ! » Car l’éfrit obéissait indistinctement à quiconque était le possesseur de cette lampe-là, fût-il, comme le magicien, dans la voie de la scélératesse et de la perdition.
Alors le Maghrébin lui dit : « Ô éfrit de la lampe, je t’ordonne d’enlever le palais que tu as bâti pour Aladdin et de le transporter avec tous les êtres et toutes les choses qu’il contient dans mon pays que tu connais, au fond du Maghreb, parmi les jardins. Et tu m’y transporteras moi également avec le palais ! » Et le mared, esclave de la lampe, répondit : « J’écoute et j’obéis ! Ferme un œil et ouvre un œil, et tu te trouveras dans ton pays, au milieu du palais d’Aladdin ! » Et, effectivement, en un clin d’œil, la chose fut faite. Et le Maghrébin se trouva transporté, avec le palais d’Aladdin, au milieu de son pays, dans le Maghreb africain. Et voilà pour lui !
Mais pour ce qui est du sultan, père de Badrou’l-Boudour, le lendemain, à son réveil, il sortit de son palais pour aller, selon son habitude, visiter sa fille qu’il aimait. Et il ne vit, à la place où s’élevait le merveilleux palais, qu’un large meidân coupé par les fossés vides des fondations. Et, à la limite de la perplexité, il ne sut s’il ne perdait pas la raison ; et il se mit à se frotter les yeux pour mieux se rendre compte de ce qu’il voyait. Et il constata qu’avec la clarté du soleil levant et la limpidité du matin il n’y avait pas moyen de se tromper, et que le palais n’était plus là ! Mais il voulut se mieux convaincre de cette affolante réalité, et remonta à l’étage supérieur, et ouvrit la fenêtre qui donnait du côté de sa fille. Et il ne vit ni palais ni trace de palais, ni jardins ni trace de jardins, rien qu’un immense meidân où les cavaliers auraient pu, n’eussent été les fossés, jouter tout à leur aise.
Alors le malheureux père, déchiré d’anxiété, se mit à frapper ses mains l’une contre l’autre et à s’arracher la barbe en pleurant, bien qu’il ne pût se rendre bien compte de la nature et de l’étendue de son malheur. Et, pendant qu’il était écroulé de la sorte sur le divan, son grand-vizir entra pour lui annoncer, selon sa coutume, l’ouverture de la séance de justice. Et il le vit dans l’état où il était, et ne sut qu’en penser. Et le sultan lui dit : « Approche ici ! » Et le vizir s’approcha, et le sultan lui dit : « Qu’est devenu le palais de ma fille ? » Il dit : « Qu’Allah garde le sultan ! mais je ne comprends pas ce qu’il veut dire ! » Il dit : « On dirait, ô vizir, que tu n’es pas au courant de la triste affaire ! » Il répondit : « Pas du tout, ô mon seigneur, par Allah ! je ne sais rien du tout, absolument rien ! » Il dit : « C’est qu’alors tu n’as pas regardé du côté du palais d’Aladdin ! » Il dit : « J’ai été hier au soir me promener dans les jardins qui l’entourent, et je n’y ai rien remarqué de particulièrement singulier ! sinon que la grande porte en était fermée à cause de l’absence de l’émir Aladdin ! » Il dit : « Dans ce cas, ô vizir, regarde par cette fenêtre et dis-moi si tu ne remarques rien de particulièrement singulier dans ce palais dont tu as vu hier la grande porte fermée ! » Et le vizir mit sa tête à la fenêtre et regarda, mais ce fut pour lever les bras au ciel en s’écriant : « Éloigné soit le Malin ! le palais a disparu ! » Puis il se tourna vers le sultan et lui dit : « Et maintenant, ô mon seigneur, hésites-tu à croire que ce palais, dont tu admirais tellement l’architecture et l’ornementation, soit autre chose que l’œuvre de la plus admirable sorcellerie ? » Et le sultan baissa la tête et réfléchit pendant une heure de temps. Après quoi il releva la tête, et son visage était habillé de fureur. Et il s’écria : « Où est-il, ce scélérat, cet aventurier, ce magicien, cet imposteur, ce fils de mille chiens qui s’appelle Aladdin ? » Et le vizir, le cœur dilaté de triomphe, répondit : « Il est absent, à la chasse ! mais il a annoncé son retour pour aujourd’hui, avant la prière de midi ! Et, si tu veux, je me charge d’aller moi-même m’informer auprès de lui de ce qu’est devenu le palais avec son contenu ? » Et le roi se récria, disant : « Non, par Allah ! Il faut qu’on le traite comme les voleurs et les menteurs ! Que les gardes aillent et me l’amènent chargé de chaînes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Il faut qu’on le traite comme les voleurs et les menteurs ! Que les gardes aillent et me l’amènent chargé de chaînes ! »
Aussitôt le grand-vizir sortit communiquer l’ordre du sultan au chef des gardes, en l’instruisant de quelle manière il devait s’y prendre pour qu’Aladdin ne réussît pas à leur échapper. Et le chef des gardes, accompagné de cent cavaliers, sortit de la ville sur le chemin par où devait revenir Aladdin, et le rencontra à cinq parasanges des portes. Et il le fit aussitôt environner par les cavaliers, et lui dit : « Émir Aladdin, ô notre maître, excuse-nous, de grâce ! mais le sultan, dont nous sommes les esclaves, nous a donné l’ordre de t’arrêter et de t’amener entre ses mains chargé de chaînes, comme les criminels ! Et nous ne pouvons désobéir à un ordre royal ! Mais, encore une fois, excuse-nous de te traiter de la sorte, après que nous avons tous été les noyés de ta générosité ! »
À ces paroles du chef des gardes, la langue d’Aladdin. se lia de surprise et d’émotion. Mais il finit par pouvoir parler, et dit : « Ô braves gens, savez-vous au moins pour quel motif le sultan vous a donné un ordre pareil, alors que je suis innocent de tout crime envers lui ou envers l’État ! » Et le chef des gardes répondit : « Par Allah ! nous ne le savons pas ! » Alors Aladdin descendit de son cheval, et dit : « Faites de moi ce qui vous a été ordonné par le sultan ! car les ordres du sultan sont sur la tête et sur l’œil ! » Et les gardes se saisirent, mais bien à regret, d’Aladdin, lui lièrent les bras, lui passèrent au cou une chaîne fort grosse et fort lourde, dont ils lui entourèrent également le milieu du corps, et le traînèrent vers la ville par le bout de cette chaîne, en le faisant suivre à pied, pendant qu’ils continuaient leur route à cheval.
Lorsque les gardes furent arrivés aux premiers faubourgs de la ville, les passants qui virent Aladdin traité de cette manière ne doutèrent pas que le sultan, pour une cause qu’ils ignoraient, ne se disposât à lui faire couper la tête. Et comme Aladdin, par sa générosité et son affabilité, avait gagné l’affection de tous les sujets du royaume, ceux qui le virent se hâtèrent de marcher derrière lui, en s’armant les uns de sabres, des autres de gourdins et d’autres de pierres et de bâtons. Et leur nombre augmenta, à mesure que le convoi s’approchait du palais, si bien qu’à l’arrivée sur la place du meidân ils étaient devenus milliers et milliers. Et tous criaient et protestaient, en brandissant leurs armes et en menaçant les gardes qui eurent les plus grandes peines à les contenir et à pénétrer dans le palais sans être maltraités. Et, pendant qu’ils continuaient à vociférer et à hurler sur le meidân, en demandant qu’on leur rendit sain et sauf leur maître Aladdin, les gardes introduisirent Aladdin, toujours chargé de chaînes, dans la salle où, assis dans sa colère et son anxiété, l’attendait le sultan.
Or, dès qu’Aladdin fut en sa présence, le sultan, pris d’une fureur inimaginable, ne se donna même pas le temps de lui demander ce qu’était devenu le palais qui contenait sa fille Badrou’l-Boudour, et cria au porte-glaive : « Coupe tout de suite la tête de cet imposteur maudit ! » Et il ne voulut ni l’entendre ni le voir un instant de plus. Et le porte-glaive emmena Aladdin sur la terrasse qui dominait le meidân où était amassée la foule tumultueuse, fit s’agenouiller Aladdin sur le cuir rouge des exécutions, après lui avoir bandé les yeux, lui ôta la chaîne qu’il avait au cou et autour du corps, et lui dit : « Fais ton acte de foi, avant de mourir ! » Et il se disposa à lui donner le coup de la mort, en tournant trois fois autour de lui et en faisant flamboyer le sabre par trois fois, en l’air. Mais, à ce moment précis, la foule, voyant que le porte-glaive allait exécuter Aladdin, se mit en mesure, en poussant des cris terribles, d’escalader les murs du palais et de forcer les portes. Et le sultan vit cela, et, craignant quelque événement funeste, il fut pris d’une grande épouvante. Et il se tourna vers le porte-glaive et lui dit : « Diffère, pour l’instant, de couper la tête à ce criminel ! » Et il dit au chef des gardes : « Fais crier au peuple que je lui accorde la grâce du sang de ce maudit ! » Et l’ordre, aussitôt crié du haut des terrasses, calma le tumulte et la fureur de la foule, et fit abandonner leur dessein à ceux qui forçaient les portes et à ceux qui escaladaient les murs du palais.
Alors Aladdin, à qui on avait pris soin d’enlever ostensiblement le bandeau des yeux, et dont on avait défait les liens qui lui attachaient les mains derrière le dos, se leva du cuir des exécutions où il était agenouillé, et leva la tête vers le sultan, et, les yeux pleins de larmes, il lui demanda : « Ô roi du temps, je supplie Ta Hautesse de me dire seulement quel crime j’ai pu commettre pour encourir ta colère et cette disgrâce ! » Et le sultan, bien jaune de teint et d’une voix pleine de colère contenue, lui dit : « Ton crime, misérable ? Tu feins donc de l’ignorer ? Mais tu ne feindras plus, lorsque je te l’aurai fait constater avec tes yeux ! » Et il lui cria : « Suis-moi ! » Et il marcha devant lui, et le conduisit vers l’autre bout du palais, du côté du second meidân, où s’élevait naguère le palais de Badrou’l-Boudour entouré de ses jardins, et lui dit : « Regarde par cette fenêtre, et dis-moi, puisque tu dois bien le savoir, ce qu’est devenu le palais qui contenait ma fille ? » Et Aladdin mit sa tête à la fenêtre et regarda. Et il ne vit ni palais, ni jardin, ni trace de palais ou de jardin, mais l’immense meidân désert tel qu’il était au jour où il avait donné l’ordre à l’éfrit de la lampe d’y construire la demeure merveilleuse. Et il fut dans une telle stupéfaction et une telle douleur et un tel saisissement qu’il fut sur le point de tomber évanoui. Et il ne put prononcer une seule parole. Et le sultan lui cria : « Eh bien, maudit imposteur, où est le palais et où est ma fille, le noyau de mon cœur, mon unique enfant ? » Et Aladdin poussa un gros soupir et fondit en larmes ; puis il dit : « Ô roi du temps, je ne le sais pas ! » Et le sultan lui dit : « Écoute-moi bien ! Je ne veux pas te demander de restituer ton maudit palais, mais je t’ordonne de me rendre ma fille. Et si tu ne le fais pas à l’instant, ou si tu ne veux pas me dire ce qu’elle est devenue, par ma tête ! je te ferai couper la tête ! » Et Aladdin, à la limite de l’émotion, baissa les yeux et réfléchit pendant une heure de temps. Puis il releva la tête et dit : « Ô roi du temps, nul n’échappe à sa destinée. Et si ma destinée est que ma tête soit coupée pour un crime que je n’ai pas commis, aucune puissance ne pourra me sauver ! Je te demande seulement, avant de mourir, un délai de quarante jours pour faire les recherches nécessaires au sujet de mon épouse bien-aimée, qui a disparu avec le palais pendant que j’étais à la chasse, et sans que j’aie pu me douter de quelle manière est survenue cette calamité, je te le jure par la vérité de notre foi et les mérites de notre seigneur Môhammad (sur Lui la prière et la paix !) » Et le sultan répondit : « Soit, je veux bien t’accorder ce que tu me demandes. Mais sache que, ce délai passé, rien ne pourra te sauver d’entre mes mains, si tu ne me ramènes pas ma fille ! Car, en quelque endroit de la terre où tu pourras te cacher, je saurai bien l’atteindre et te punir ! » Et Aladdin, à ces paroles, sortit de la présence du sultan et, la tête bien basse, il traversa le palais, au milieu des dignitaires qui avaient de la peine à le reconnaître, tant il était subitement changé par l’émotion et la douleur. Et il arriva au milieu de la foule et se mit à demander, avec des yeux hagards : « Où est mon palais ? Où est mon épouse ? » Et tous ceux qui le voyaient et l’entendaient, se dirent : « Le pauvre ! il a perdu la raison ! C’est la disgrâce du sultan et la vue de la mort qui l’ont rendu fou ! » Et Aladdin, voyant qu’il n’était plus pour tout le monde qu’un objet de compassion, s’éloigna rapidement, sans que personne eût le cœur de le suivre. Et il sortit de la ville, et se mit à errer, sans savoir ce qu’il faisait, à travers la campagne…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il sortit de la ville, et se mit à errer, sans savoir ce qu’il faisait, à travers la campagne. Et il arriva de la sorte sur le bord d’un grand fleuve, en proie au désespoir, et en se disant : « Où chercheras-tu ton palais, Aladdin, et ton épouse Badrou’l-Boudour, ô pauvre ? En quel pays inconnu iras-tu la trouver, si elle est encore vivante ? Et sais-tu seulement de quelle manière elle a disparu ? » Et, l’âme obscurcie par ces pensées, et ne voyant plus que ténèbres et tristesse devant ses yeux, il voulut se jeter à l’eau et y noyer sa vie et sa douleur. Mais, à ce moment, il se souvint qu’il était musulman, un croyant, un pur ! Et il témoigna de l’unité d’Allah et de la mission de Son Envoyé. Et, réconforté par son acte de foi et son abandon à la volonté du Très-Haut, il se mit en devoir, au lieu de se jeter à l’eau, de faire ses ablutions pour la prière du soir. Et il s’accroupit sur le bord du fleuve, et prit l’eau dans le creux de ses mains, et se mit à s’en frotter les doigts et les extrémités. Or, en faisant ces mouvements, il frotta l’anneau que lui avait donné, dans le caveau, le Maghrébin. Et, au même moment, apparut l’éfrit de l’anneau, qui se prosterna devant lui, en disant : « Entre tes mains, ici, ton esclave le voici ! Parle, que veux-tu ? Je suis le serviteur de l’anneau, sur la terre, dans les airs et sur l’eau ! » Et Aladdin reconnut parfaitement, à son aspect hideux et à sa voix terrifiante, l’éfrit qui l’avait autrefois délivré du souterrain. Et, agréablement surpris d’une apparition à laquelle il était si loin de s’attendre, dans l’état misérable où il se trouvait, il interrompit ses ablutions et se leva sur ses deux pieds et dit à l’éfrit : « Ô éfrit de l’anneau, ô secourable, ô excellent ! Qu’Allah te bénisse et t’ait en ses bonnes grâces ! Mais hâte-toi de me rapporter mon palais et mon épouse la princesse Badrou’l-Boudour ! » Mais l’éfrit de l’anneau lui répondit : « Ô maître de l’anneau, ce que tu me demandes là n’est guère de ma compétence, car, sur la terre, dans les airs et sur l’eau, je ne suis serviteur que de l’anneau ! Et je suis bien fâché de ne pouvoir te satisfaire sur ce point qui est du ressort du serviteur de la lampe ! Pour cela, tu n’as qu’à t’adresser à cet éfrit-là ; et il te satisfera ! » Alors Aladdin, fort perplexe, lui dit : « Dans ce cas, ô éfrit de l’anneau, et puisque tu ne peux t’immiscer dans ce qui ne te regarde pas en transportant ici le palais de mon épouse, je t’ordonne, par les vertus de l’anneau que tu sers, de me transporter moi-même jusqu’à l’endroit de la terre où se trouve mon palais, et de me déposer, sans secousse, sous les fenêtres de la princesse Badrou’l-Boudour, mon épouse ! »
Or, à peine Aladdin eut-il formulé cette demande, que l’éfrit de l’anneau répondit par l’ouïe et l’obéissance et, le temps de seulement fermer un œil et d’ouvrir un œil, il le transporta au fond du Maghreb au milieu d’un jardin magnifique où s’élevait, avec sa beauté architecturale, le palais de Badrou’l-Boudour. Et il le déposa bien doucement au-dessous des fenêtres de la princesse, et disparut.
Alors Aladdin, à la vue de son palais, sentit se dilater son cœur et se tranquilliser son âme et se rafraîchir ses yeux. Et l’espoir entra de nouveau en lui avec la joie. Et de même que celui qui confie une tête au vendeur de têtes cuites au four, est préoccupé et ne dort pas, de même Aladdin, malgré ses fatigues et ses chagrins, ne voulut prendre aucun repos. Il éleva seulement son âme vers son Créateur pour le remercier de ses bontés et reconnaître que ses desseins sont impénétrables aux créatures bornées. Après quoi, il se leva et se mit bien en évidence sous les fenêtres de son épouse Badrou’l-Boudour.
Or, depuis son enlèvement avec le palais par le magicien maghrébin, la princesse, dans sa douleur d’avoir été séparée d’avec son père et son époux bien-aimé, et par suite de toutes les violences qu’elle endurait, sans toutefois céder, de la part du maudit Maghrébin, avait l’habitude de se lever de son lit tous les jours, dès la première aube, et passait son temps à pleurer et ses nuits à veiller, pleine de ses tristes pensées. Et elle ne dormait, ni ne mangeait, ni ne buvait. Or, ce soir-là, par un décret de la destinée, sa servante était entrée chez elle, pour essayer de la distraire. Et elle ouvrit une des fenêtres de la salle de cristal, et regarda au-dehors, en disant : « Ô ma maîtresse, viens voir comme ce soir les arbres sont beaux et comme l’air est délicieux ! » Puis, soudain, elle poussa un grand cri, en s’exclamant : « Ya setti, ya setti ! Voilà mon maître Aladdin, voilà mon maître Aladdin ! Il se trouve sous les fenêtres du palais…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … Ya setti, ya setti ! Voilà mon maître Aladdin, voilà mon maître Aladdin ! Il se trouve sous les fenêtres du palais ! »
À ces paroles de sa servante, Badrou’l-Boudour se précipita à la fenêtre, et vit Aladdin, qui la vit également. Et ils faillirent tous deux s’envoler de joie. Et, la première, Badrou’l-Boudour put ouvrir la bouche, et cria à Aladdin : « Ô mon chéri, viens vite, viens vite ! ma servante descend t’ouvrir la porte secrète ! Tu peux monter ici sans crainte. Le magicien maudit est absent pour le moment ! » Et, la servante lui ayant ouvert la porte secrète, Aladdin monta à l’appartement de son épouse, et la reçut sur son sein. Et ils s’embrassèrent, ivres de joie, en pleurant et en riant. Et, lorsqu’ils se furent un peu calmés, ils s’assirent l’un à côté de l’autre, et Aladdin dit à son épouse : « Ô Badrou’l-Boudour, je désire, avant toutes choses, te demander ce qu’est devenue la lampe en cuivre que j’avais laissée dans ma chambre, sur un tabouret, avant mon départ pour la chasse ! » Et la princesse s’écria : « Ah ! mon chéri, c’est précisément cette lampe-là qui est la cause de notre malheur ! Mais c’est par ma faute, à moi seule, que tout cela est arrivé ! » Et elle raconta à Aladdin tout ce qui était arrivé au palais, lors de son absence, et comment, dans le but de rire de la folie du vendeur de lampes, elle avait échangé la lampe du tabouret contre une lampe neuve, et tout ce qui s’en était suivi, sans oublier un détail. Mais il n’y a point d’utilité à le répéter. Et elle conclut, en disant : « Et ce n’est qu’après notre transport ici, avec le palais, que le maudit Maghrébin est venu me révéler qu’il avait, par la puissance de sa sorcellerie et les vertus de la lampe échangée, réussi à m’enlever à ton affection, pour me posséder. Et il me dit qu’il était Maghrébin et que nous étions dans le Maghreb, son pays ! » Alors Aladdin, sans lui faire le moindre reproche, lui demanda : « Et que désire faire de toi ce maudit ? » Elle dit : « Chaque jour, une fois, sans plus, il vient me faire une visite et essaie par tous les moyens de me séduire. Et, comme il est plein de perfidie, il n’a cessé, pour vaincre ma résistance, de m’affirmer que le sultan t’avait fait couper la tête comme imposteur, et que tu n’étais, après tout, que le fils de pauvres gens, d’un misérable tailleur nommé Mustapha, et que tu ne devais qu’à lui seul la fortune et les honneurs où tu étais parvenu ! Mais, jusqu’à présent, il n’a reçu de moi, pour toute réponse, que le silence du mépris et le détournement du visage. Et il est obligé, chaque fois, de se retirer l’oreille rabattue et le nez allongé ! Et je craignais, chaque fois, qu’il n’eût recours à la violence ! Mais te voici, Allah soit loué ! » Et Aladdin lui dit : « Dis-moi maintenant, ô Badrou’l-Boudour, en quel endroit du palais se trouve cachée, si tu le sais, la lampe qu’a réussi à m’enlever ce maudit Maghrébin ? » Elle dit : « Il ne la laisse jamais au palais ; mais il la porte continuellement dans son sein. Que de fois ne la lui ai-je pas vu sortir en ma présence, pour me la montrer comme un trophée. » Alors Aladdin lui dit : « C’est bien ! mais, par ta vie ! il ne la montrera pas longtemps encore ! » Puis il ajouta : « Je connais le moyen de châtier notre perfide ennemi ! Dans ce but, je te demanderai seulement de me laisser seul un instant dans cette chambre ! Et je t’appellerai quand il en sera temps ! » Et Badrou’l-Boudour sortit de la salle et alla rejoindre ses suivantes.
Alors Aladdin frotta l’anneau magique qu’il avait au doigt, et dit à l’éfrit qui se présenta : « Ô éfrit de l’anneau, connais-tu les diverses espèces de poudres soporifiques ? » Il répondit : « C’est ce que je connais le mieux ! » Il dit : « Dans ce cas, je t’ordonne de m’apporter une once de bang crétois, dont une seule prise est capable de renverser l’éléphant ! » Et l’éfrit disparut, mais pour revenir au bout d’un moment, en tenant entre ses doigts un petit étui qu’il remit à Aladdin, en disant : « Voilà, ô maître de l’anneau, du bang crétois de la qualité la plus fine ! » Et il s’en alla. Et Aladdin appela son épouse Badrou’l-Boudour et lui dit : « Ô ma maîtresse Badrou’l-Boudour, si tu veux que nous triomphions de ce maudit Maghrébin, tu n’as qu’à suivre le conseil que je vais te donner. Et le temps presse, puisque tu m’as dit que le Maghrébin était sur le point d’arriver ici, pour essayer de te séduire ! Voici donc ce que tu vas être obligée de faire ! » Et il lui dit : « Tu feras telle et telle chose, et tu lui diras telle et telle chose ! » Et il l’instruisit longuement de la conduite qu’elle devait tenir vis-à-vis du magicien. Et il ajouta : « Quant à moi, je vais me cacher dans cette armoire. Et j’en sortirai quand le moment sera venu ! » Et il lui remit l’étui de bang, en disant : « N’oublie pas le moyen que je viens de t’indiquer ! » Et il la quitta pour aller s’enfermer dans l’armoire.
Alors la princesse Badrou’l-Boudour, malgré la répugnance qu’elle avait à remplir le rôle en question, ne voulut pas perdre l’occasion de tirer vengeance du magicien, et se mit en devoir de suivre les instructions de son époux Aladdin. Elle se leva donc et se fit peigner par ses femmes et coiffer de la manière qui allait le mieux à son visage de lune, et se fit habiller de la plus belle robe de ses armoires. Ensuite elle se serra la taille avec une ceinture d’or incrustée de diamants, et s’orna le cou d’un collier de perles nobles de la même grosseur, sauf celle du milieu qui était du volume d’une noix ; et elle se passa aux poignets et aux chevilles des bracelets d’or dont les pierreries se mariaient merveilleusement aux couleurs des autres atours. Et parfumée et semblable à quelque houria choisie, et plus brillante que les plus brillantes des reines et des sultanes, elle se regarda avec attendrissement dans son miroir, pendant que ses femmes s’émerveillaient de sa beauté et s’exclamaient d’admiration. Et elle s’étendit nonchalamment sur ses coussins, en attendant l’arrivée du magicien…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Et elle s’étendit nonchalamment sur ses coussins, en attendant l’arrivée du magicien.
Or, il ne manqua pas de venir à l’heure annoncée Et la princesse, contre ses habitudes, se leva en son honneur et l’invita, avec un sourire, à s’asseoir à côté d’elle sur le divan. Et le Maghrébin, fort ému de cette réception, et ébloui de l’éclat des beaux yeux qui le regardaient et de la beauté ravissante de cette princesse tant désirée, ne voulut s’asseoir, par mesure de politesse et de déférence, que sur le bord du divan. Et la princesse, toujours souriante, lui dit : « Ô mon maître, ne sois point étonné de me voir aujourd’hui dans cet état de changement, car mon tempérament, qui est de sa nature fort opposé à la tristesse, a fini par prendre le dessus sur mon chagrin et mon inquiétude. Et d’ailleurs j’ai réfléchi sur tes paroles au sujet de mon époux Aladdin, et je suis maintenant persuadée qu’il est mort par l’effet du terrible courroux du roi mon père. Or, ce qui est écrit doit courir ! Et ni mes larmes ni mes regrets ne redonneront la vie à un mort. C’est pourquoi j’ai renoncé à la tristesse et au deuil et résolu de ne plus repousser tes avances et tes bontés. Et tel est le motif de mon changement d’humeur ! » Puis elle ajouta : « Mais je ne t’ai pas encore fait offrir les rafraîchissements de l’amitié ! » Et elle se leva, dans son éblouissante beauté, et se dirigea vers le grand tabouret sur lequel était posé le plateau des vins et des sorbets, et, tout en appelant une de ses suivantes pour servir le plateau, elle jeta une pincée du bang crétois dans la coupe d’or du plateau. Et le Maghrébin ne savait comment la remercier pour ses faveurs. Et quand la jeune suivante se fut avancée avec le plateau des sorbets, il prit la coupe et dit à Badrou’l-Boudour : « Ô princesse, cette boisson, quelque délicieuse qu’elle soit, ne saurait me rafraîchir autant que le sourire de tes yeux ! » Et, ayant ainsi parlé, il approcha la coupe de ses lèvres et la vida d’un seul trait, sans respirer. Mais ce fut pour rouler à l’instant, sur le tapis, aux pieds de Badrou’l-Boudour, la tête avant les jambes !
Or, au bruit de sa chute, Aladdin poussa un grand cri de triomphe et sortit de l’armoire pour courir aussitôt vers le corps inerte de son ennemi. Et il se précipita sur lui, ouvrit le haut de sa robe et tira de son sein la lampe qui y était cachée. Et il se tourna vers Badrou’l-Boudour, qui, à la limite de la joie, accourait pour l’embrasser, et lui dit : « Je te prie de me laisser seul encore une fois ! Car il faut que tout soit terminé aujourd’hui ! » Et lorsque Badrou’l-Boudour se fut éloignée, il frotta la lampe à l’endroit qu’il connaissait bien, et vit aussitôt apparaître l’éfrit de la lampe qui, après la formule ordinaire, attendit l’ordre. Et Aladdin lui dit : « Ô éfrit de la lampe, je t’ordonne, par les vertus de cette lampe, ta maîtresse, de transporter ce palais, avec tout ce qu’il contient, dans la capitale du royaume de la Chine, au même endroit exactement d’où tu l’avais enlevé pour l’apporter ici ! Et fais en sorte que ce transport ait lieu sans heurt, sans encombre et sans secousse ! » Et le genni répondit : « Ouïr, c’est obéir ! » et disparut. Et au même moment, le temps de seulement fermer un œil et d’ouvrir un œil, le transport se fit, sans que personne s’en fût douté ; car il ne se fit sentir que par à peine deux légères agitations, l’une au départ et l’autre à l’arrivée.
Alors Aladdin, après avoir constaté que le palais était réellement arrivé et posé bien en face du palais du sultan, à la place qu’il occupait autrefois, alla trouver son épouse Badrou’l-Boudour, et l’embrassa beaucoup et lui dit : « Nous voici arrivés dans la ville de ton père ! Mais, comme il fait déjà nuit, il vaut mieux que nous attendions à demain matin pour aller annoncer notre retour au sultan ! Pour le moment ne pensons qu’à nous réjouir de notre triomphe et de notre réunion, ô Badrou’l-Boudour ! » Et comme Aladdin, depuis la veille, n’avait encore rien mangé, ils s’assirent tous deux et se firent servir par les esclaves un repas succulent, dans la salle aux neuf cent quatre-vingt-dix-neuf croisées. Puis ils passèrent ensemble cette nuit-là, dans les délices et le bonheur.
Or, le lendemain, le sultan sortit de son palais pour aller, selon son habitude, pleurer sa fille à l’endroit où il croyait ne trouver que les fossés des fondations. Et, bien triste et bien endolori, il jeta les yeux de ce côté-là, et demeura stupéfait en voyant la place du meidân occupée de nouveau par le palais magnifique, et non point vide comme il se l’imaginait. Et il crut d’abord que c’était l’effet de quelque brouillard ou de quelque imagination de son esprit inquiet, et se frotta les yeux à plusieurs reprises. Mais comme la vision subsistait toujours, il ne put plus douter de sa réalité, et, sans se soucier de sa dignité de sultan, il se mit à courir en agitant les bras et en poussant des cris de joie, et, bousculant gardes et portiers, il monta l’escalier d’albâtre sans, malgré son grand âge, prendre haleine, et entra sous la voûte de cristal, dans la salle aux quatre-vingt-dix-neuf fenêtres où, précisément, attendaient sa venue, en souriant, Aladdin et Badrou’l-Boudour. Et ils se levèrent tous deux en le voyant, et coururent à sa rencontre. Et il embrassa sa fille en versant des larmes de joie, à la limite de l’attendrissement ; et elle également…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
… Et il embrassa sa fille, en versant des larmes de joie, à la limite de l’attendrissement ; et elle également. Et, lorsqu’il put ouvrir la bouche et prendre la parole, il dit : « Ô ma fille, je vois avec étonnement que ton visage n’est guère plus changé ou plus jaune de teint, du fait de tout ce qui t’est arrivé, que le jour où je t’ai vue pour la dernière fois ! Pourtant, ô fille de mon cœur, tu as dû beaucoup souffrir de ton éloignement, et ce n’est pas sans de grandes alarmes et de terribles angoisses que tu as dû te voir transporter d’un endroit à un autre avec tout le palais ! Car moi-même, rien que d’y penser, je me sens envahi par le tremblement de l’épouvante ! Hâte-toi donc, ô ma fille, de me dire le motif de si peu de changement en ta physionomie, et de me raconter, sans me rien cacher, tout ce qui t’est arrivé depuis le commencement jusqu’à la fin ! » Et Badrou’l-Boudour répondit : « Ô père mien, sache que si je suis si peu changée de visage et si peu jaune de teint, c’est que j’ai regagné ce que j’avais perdu par mon éloignement de toi et de mon époux Aladdin. Car c’est la joie de vous retrouver tous deux qui me rend ma fraîcheur et mon teint d’autrefois. Mais j’ai bien souffert et bien pleuré, autant d’être ravie à ton affection et à celle de mon époux bien-aimé que d’être tombée en la puissance d’un maudit magicien maghrébin, qui est la cause de tout ce qui est arrivé, et qui me tenait des discours qui ne me plaisaient pas et voulait me séduire, après m’avoir enlevée. Mais tout cela est dû à mon étourderie qui m’a poussée à céder à autrui ce qui ne m’appartenait pas ! » Et elle raconta sans arrêt, à son père, toute son histoire, dans ses moindres détails, sans rien oublier. Mais il n’y a aucune utilité à la répéter. Et quand elle eut fini de parler, Aladdin, qui jusque-là n’avait pas ouvert la bouche, se tourna vers le sultan stupéfait à la limite de la stupéfaction et lui montra, derrière un rideau, le corps inerte du magicien, dont le visage était tout noir par la violence du bang, et lui dit : « Le voilà l’imposteur, cause de notre malheur passé et de ma disgrâce ! Mais Allah l’a puni ! »
À cette vue, le sultan, entièrement convaincu de l’innocence d’Aladdin, l’embrassa bien tendrement, en le serrant contre son sein, et lui dit : « Ô mon fils Aladdin, ne me blâme pas trop pour ma conduite à ton égard, et pardonne-moi les mauvais procédés dont j’ai usé contre toi ! Car je mérite un peu que tu m’excuses, à cause de l’affection que j’éprouve pour ma fille unique Badrou’l-Boudour, et parce que tu sais bien que le cœur du père est plein de tendresse et que moi, en particulier, j’eusse préféré perdre tout mon royaume qu’un cheveu de la tête de ma fille bien-aimée ! » Et Aladdin répondit : « C’est vrai, ô père de Badrou’l-Boudour, tu es bien excusable ! car c’est seule ton affection pour ta fille, que tu croyais perdue par ma faute, qui t’a fait user de procédés expéditifs à mon égard. Et je n’ai pas le droit de te reprocher quoi que ce soit. C’était à moi, en effet, à prévenir les desseins perfides de cet infâme magicien, et à me précautionner contre lui. Et tu ne pourras comprendre réellement sa malice, que lorsque, une fois que j’en aurai le temps, je t’aurai fait le récit de toute mon histoire avec lui ! » Et le sultan embrassa encore une fois Aladdin et lui dit : « Certes ! ô Aladdin, il faut absolument que tu trouves bientôt le loisir de me raconter tout cela. Mais il est plus urgent, à l’heure qu’il est, de nous débarrasser de la vue de ce corps maudit qui gît inanimé à nos pieds, et de nous réjouir ensemble de ton triomphe ! » Et Aladdin donna l’ordre à ses éfrits adolescents d’enlever le corps du Maghrébin et de le brûler au milieu de la place du meidân sur un lit de fumier, et d’en jeter les cendres dans la fosse aux ordures. Ce qui fut exécuté ponctuellement, en présence de toute la ville assemblée, qui se réjouissait de cette punition méritée et du retour de l’émir Aladdin dans les bonnes grâces du sultan.
Après quoi, le sultan fit annoncer par les crieurs, au milieu des joueurs de clarinettes, de timbales et de tambours, qu’il accordait la liberté aux prisonniers, en signe de réjouissance publique ; et il fit distribuer de grands secours aux pauvres et aux besogneux. Et le soir il fit illuminer toute la ville ainsi que son palais et celui d’Aladdin et de Badrou’l-Boudour. Et c’est ainsi qu’Aladdin, grâce à la bénédiction qu’il avait sur lui, échappa pour la seconde fois au danger de la mort. Et c’est cette même bénédiction qui devait le sauver encore pour la troisième fois, comme vous allez l’entendre, ô mes auditeurs !
En effet, il y avait déjà quelques mois qu’Aladdin était de retour et qu’il menait avec son épouse, sous l’œil attendri et vigilant de sa mère, devenue maintenant une dame vénérable à l’air imposant mais dénué de fierté et d’arrogance, une vie tout à fait délectable, quand son épouse entra un jour, avec un visage un peu triste et dolent, dans la salle à la voûte de cristal, où il se tenait d’ordinaire pour jouir de la vue des jardins, et s’approcha de lui et lui dit : « Ô mon maître Aladdin, Allah, qui nous a comblés tous deux de ses faveurs, me refuse jusqu’à présent la consolation d’avoir un enfant. Car il y a déjà assez longtemps que nous sommes mariés, et je ne sens pas mes entrailles fécondées par la vie. Or, je viens te supplier de me permettre de faire venir au palais une sainte vieille nommée Fatmah, arrivée depuis quelques jours dans notre ville, et que tout le monde vénère pour les guérisons et les cures merveilleuses qu’elle fait et la fécondité qu’elle donne aux femmes stériles, rien que par l’imposition de ses mains…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Or, je viens te supplier de me permettre de faire venir au palais une sainte vieille nommée Fatmah, arrivée depuis quelques jours dans notre ville, et que tout le monde vénère pour les guérisons et les cures merveilleuses qu’elle fait et la fécondité qu’elle donne aux femmes stériles, rien que par l’imposition de ses mains ! » Et Aladdin, qui ne voulait point contrarier son épouse Badrou’l-Boudour, ne fit aucune difficulté d’accéder à sa demande, et donna l’ordre à quatre eunuques d’aller trouver la vieille sainte et de l’amener au palais. Et les eunuques exécutèrent l’ordre et ne tardèrent pas à revenir avec la sainte vieille, le visage voilé d’un voile fort épais et le cou entouré d’un immense chapelet à trois tours qui lui descendait jusqu’au bas de la poitrine. Et elle tenait à la main un grand bâton sur lequel elle appuyait sa marche cassée par l’âge et les pratiques de la piété. Et dès que la princesse l’eut vue, elle alla vivement à sa rencontre, et lui baisa la main avec ferveur, et lui demanda sa bénédiction. Et la sainte vieille, d’un accent bien pénétré, appela sur elle les bénédictions d’Allah et ses grâces, et fit pour elle une longue prière afin de demander à Allah de continuer et d’augmenter en elle la prospérité et le bonheur et de satisfaire ses moindres désirs. Et Badrou’l-Boudour la pria de s’asseoir à la place d’honneur sur le divan, et lui dit : « Ô sainte d’Allah, je te remercie de tes bons vœux et de tes prières ! Et comme je sais qu’Allah ne te refusera rien de ce que tu lui demanderas, j’espère que j’obtiendrai de sa bonté, par ton intercession, ce qui est le souhait le plus cher de mon âme ! » Et la sainte répondit : « Je suis la plus humble des créatures d’Allah ! mais Il est l’Omnipotent, l’Excellent ! ne crains donc pas, ô ma maîtresse Badrou’l-Boudour de formuler ce que souhaite ton âme ! » Et Badrou’l-Boudour devint bien rouge de teint, et baissa la voix, et d’un accent bien ardent, dit : « Ô sainte d’Allah, je désire avoir de la générosité d’Allah un enfant ! Dis-moi ce qu’il faut que je fasse pour cela, et quels bienfaits et quelles bonnes actions il me faudra accomplir pour mériter une telle faveur ! Parle ! Je suis prête à tout pour obtenir ce bien qui m’est plus cher que ma propre vie ! Et moi, en retour, pour te montrer ma gratitude, je te donnerai tout ce que tu peux souhaiter ou désirer, non point pour toi qui, je le sais, ô notre mère à tous, es à l’abri des besoins des créatures faibles, mais pour le soulagement des infortunés et des pauvres d’Allah ! »
À ces paroles de la princesse Badrou’l-Boudour, les yeux de la sainte, qui jusque-là étaient restés baissés, s’ouvrirent et s’illuminèrent sous le voile d’un éclat extraordinaire, et son visage rayonna comme d’un feu du dedans, et tous ses traits exprimèrent le sentiment d’une extase de jubilation. Et elle regarda la princesse pendant un moment, sans prononcer un mot ; puis elle étendit ses bras vers elle, et lui fit sur la tête l’imposition des mains, en remuant les lèvres dans une prière comme intérieure, et finit par lui dire : « Ô ma fille, ô ma maîtresse Badrou’l-Boudour, les saints d’Allah viennent de me dicter le moyen infaillible que tu dois employer pour voir la fécondité habiter dans tes entrailles ! Mais, ô ma fille, je crois que ce moyen est bien difficile, sinon impossible à employer, car il faut une puissance surhumaine pour réaliser ce qu’il réclame de force et de vaillance ! » Et la princesse Badrou’l-Boudour, en entendant ces paroles, ne put retenir davantage son émotion, et se jeta aux genoux de la sainte en les entourant de ses bras, et lui dit : « De grâce, ô notre mère, indique-moi ce moyen quel qu’il soit ! car rien n’est impossible à réaliser pour mon époux bien-aimé, l’émir Aladdin ! Ah ! parle, ou je vais mourir à tes pieds de désir rentré ! » Alors la sainte leva un doigt en l’air et dit : « Ma fille, il faut, pour que la fécondité pénètre en toi, que tu aies, suspendu à la voûte de cristal de cette salle, un œuf de l’oiseau rokh, qui habite au plus grand sommet du mont Caucase. Et la vue de cet œuf, que tu regarderas aussi longtemps que tu le pourras, durant les journées, modifiera ta nature intime et remuera le fond inerte de ta maternité ! Et c’est là ce que j’avais à te dire, ma fille ! » Et Badrou’l-Boudour s’écria : « Par ma vie ! ô notre mère, je ne sais pas ce qu’est l’oiseau rokh, et je n’ai jamais vu de ses œufs, mais je ne doute pas qu’Aladdin ne puisse, en un instant, me procurer un de ses œufs fécondants, fût-il dans son nid au plus haut sommet du mont Caucase ! » Puis elle voulut retenir la sainte, qui déjà se levait pour s’en aller ; mais elle lui dit : « Non, ma fille, laisse-moi maintenant m’en aller soulager d’autres infortunes et des douleurs plus grandes encore que la tienne. Mais demain, inschallah, je viendrai de moi-même te visiter et prendre de tes nouvelles qui me sont précieuses ! » Et, malgré tous les efforts et les prières de Badrou’l-Boudour pleine de gratitude, qui voulait lui faire don de plusieurs colliers et joyaux d’une valeur inestimable, elle ne voulut pas s’arrêter un moment de plus au palais, et s’en alla, comme elle était venue, en refusant tous les cadeaux.
Or, quelques moments après le départ de la sainte, Aladdin revint auprès de son épouse, et l’embrassa tendrement, comme il le faisait chaque fois qu’il s’était absenté, ne fût-ce qu’un instant ; mais il lui sembla bien qu’elle avait l’air fort distrait et préoccupé ; et il lui en demanda la cause, avec beaucoup d’anxiété…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SEPT CENT SOIXANTE-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
… Mais il lui sembla bien qu’elle avait l’air fort distrait et préoccupé ; et il lui en demanda la cause, avec beaucoup d’anxiété. Alors Sett Badrou’l-Boudour, tout d’une haleine, lui dit : « Je mourrai certainement si je n’ai pas au plus tôt un œuf de l’oiseau rokh, qui habite au plus haut sommet du mont Caucase ! » Et Aladdin, à ces paroles, se mit à rire et dit : « Par Allah, ô ma maîtresse Badrou’l-Boudour, s’il ne s’agit que d’avoir cet œuf-là pour t’empêcher de mourir, rafraîchis tes yeux ! Mais dis-moi seulement, afin que je le sache, ce que tu entends faire de l’œuf de cet oiseau-là ! » Et Badrou’l-Boudour répondit : « C’est la sainte vieille qui vient de m’en prescrire la vue, comme souverainement efficace pour guérir la stérilité des femmes ! Et je veux l’avoir pour le suspendre au milieu de la voûte de cristal de la salle aux neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fenêtres ! » Et Aladdin répondit : « Sur ma tête et sur mes yeux, ô ma maîtresse Badrou’l-Boudour ! Tu vas avoir cet œuf de rokh à l’instant ! »
Aussitôt il quitta son épouse et alla s’enfermer dans sa chambre. Et il tira de son sein la lampe magique qu’il portait toujours sur lui, depuis le terrible danger qu’il avait couru par sa négligence, et il la frotta. Et, au même moment, parut devant lui l’éfrit de la lampe, prêt à exécuter ses ordres. Et Aladdin lui dit : « Ô excellent éfrit, qui m’obéis grâce aux vertus de ta maîtresse la lampe, je te demande de m’apporter à l’instant, pour le suspendre au milieu de la voûte de cristal, un œuf du gigantesque oiseau rokh, qui habite au plus haut sommet du mont Caucase ! »
Or, à peine Aladdin avait-il prononcé ces mots, que l’éfrit se convulsa d’une façon épouvantable, et ses yeux flamboyèrent, et il lança à la figure d’Aladdin un cri si effrayant que le palais en fut ébranlé dans ses fondements et qu’Aladdin en fut projeté, comme une pierre de fronde, contre le mur de la salle et si violemment que sa longueur faillit entrer dans sa largeur. Et l’éfrit, de sa voix pleine de tonnerre, lui cria : « Misérable Adamite, qu’as-tu osé me demander ? Ô le plus ingrat des gens de basse condition, voici que maintenant, malgré tous les services que je t’ai rendus en toute ouïe et toute obéissance, tu as le front de m’ordonner d’aller te chercher le fils de mon maître suprême, le rokh, pour le pendre à la voûte de ton palais ! Ignores-tu, insensé, que, moi et la lampe et tous les genn serviteurs de la lampe, nous sommes les esclaves du grand rokh, père des œufs ? Ah ! tu as de la chance d’être sous la sauvegarde de ma maîtresse, la lampe, et de porter au doigt cet anneau plein de vertus salutaires ! Sinon ta longueur serait déjà entrée dans ta largeur ! » Et Aladdin, stupide et immobile contre le mur, dit : « Ô éfrit de la lampe, par Allah ! ce n’est point de moi que vient cette demande, mais elle a été suggérée à mon épouse Badrou’l-Boudour par la sainte vieille, mère de la fécondation et guérisseuse de la stérilité ! » Alors l’éfrit se calma soudain et reprit son ton ordinaire vis-à-vis d’Aladdin, et lui dit : « Ah ! je ne le savais pas ! Ah ! c’est comme ça ! c’est donc de cette créature-là que vient l’attentat ! Tu es bien heureux, Aladdin, de n’être pour rien là-dedans ! Sache, en effet, que c’est ta destruction et celle de ton épouse et celle de ton palais qu’on voulait obtenir par ce moyen-là ! La personne que tu appelles une sainte vieille n’est point une sainte ni une vieille, mais un homme déguisé en femme. Et cet homme n’est autre que le propre frère du Maghrébin, ton ennemi exterminé. Et il ressemble à son frère, comme la moitié d’une fève ressemble à sa sœur. Et le proverbe est vrai qui dit : Le frère cadet du chien est plus immonde que son aîné, car la postérité d’un chien va toujours en s’abâtardissant ! Et ce nouvel ennemi, que tu ne connaissais pas, est encore plus versé dans la magie et la perfidie que son frère aîné. Et lorsqu’il apprit, par les opérations de sa géomancie, que son frère avait été exterminé par toi et brûlé par ordre du sultan, père de ton épouse Badrou’l-Boudour, il résolut de le venger sur vous tous, et vint ici du Maghreb, déguisé en vieille sainte, pour arriver jusqu’à ce palais. Et il réussit à s’y introduire et à suggérer à ton épouse cette demande pernicieuse qui est le plus grand attentat contre mon maître suprême, le rokh ! Je t’avise donc de ses projets perfides, afin que tu puisses t’en garer. Ouassalam ! » Et l’éfrit, après avoir ainsi parlé à Aladdin, disparut.
Alors Aladdin, à la limite de la colère, se hâta d’aller dans la salle aux neuf cent quatre-vingt-dix-neuf fenêtres retrouver son épouse Badrou’l-Boudour. Et, sans rien lui révéler de ce que l’éfrit venait de lui apprendre, il lui dit : « Ô Badrou’l-Boudour, mes yeux ! il est absolument nécessaire, avant de t’apporter l’œuf de l’oiseau rokh, que j’entende de mes propres oreilles la sainte vieille qui t’a prescrit ce remède. Je te prie donc de l’envoyer chercher en toute diligence, et, pendant que je serai caché derrière le rideau, de lui faire répéter sa prescription, sous prétexte que tu ne te souviens plus de sa teneur exacte ! » Et Badrou’l-Boudour répondit : « Sur ma tête et sur mon œil ! » et envoya aussitôt chercher la sainte vieille.
Or, dès qu’elle fut entrée dans la salle à la voûte de cristal et que, toujours voilée de son épais voile de visage, elle se fut approchée de Badrou’l-Boudour…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA SEPT CENT SOIXANTE-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
… Or, dès qu’elle fut entrée dans la salle à la voûte de cristal et que, toujours voilée de son épais voile de visage, elle se fut approchée de Badrou’l-Boudour, Aladdin bondit sur elle, hors de sa cachette, le glaive à la main, et, avant qu’elle pût dire : « Bem ! » d’un seul coup, il lui fit sauter la tête des épaules !
À cette vue, Badrou’l-Boudour, terrifiée, s’écria : « Ô mon maître Aladdin, quel attentat ! » Mais Aladdin se contenta de sourire et, pour toute réponse, il se baissa, prit, par le toupet du milieu, la tête coupée, et la montra à Badrou’l-Boudour. Et, à la limite de la stupéfaction et de l’horreur, elle vit que la tête était rasée comme celle des hommes, sauf le toupet du milieu, et que le visage en était barbu prodigieusement. Et Aladdin, ne voulant pas l’épouvanter plus longtemps, lui raconta la vérité au sujet de la prétendue Fatmah, fausse sainte et fausse vieille, et conclut : « Ô Badrou’l-Boudour, rendons grâces à Allah qui nous a délivrés à jamais de nos ennemis ! » Et tous deux se jetèrent dans les bras l’un de l’autre, en remerciant Allah de ses faveurs.
Et depuis lors ils vécurent de la vie bien heureuse, avec la bonne vieille, mère d’Aladdin, et avec le sultan, père de Badrou’l-Boudour. Et ils eurent des enfants beaux comme des lunes. Et Aladdin, à la mort du sultan, régna sur le royaume de la Chine. Et plus rien ne manqua à leur bonheur, jusqu’à l’arrivée inévitable de la Destructrice des délices et de la Séparatrice des amis.
— Et Schahrazade, ayant ainsi raconté cette histoire, dit : « Et voilà, ô Roi fortuné, tout ce que je sais au sujet d’Aladdin et de la Lampe Magique ! Mais Allah est plus savant ! » Et le roi Schabriar dit : « Cette histoire, Schahrazade, est admirable. Mais elle m’étonne beaucoup par sa discrétion ! » Et Schahrazade dit : « Dans ce cas, ô Roi, permets-moi de te raconter l’histoire de…
TABLE DES MATIÈRES
- ↑ En arabe : Alâ-eddin, — hauteur ou gloire de la foi.