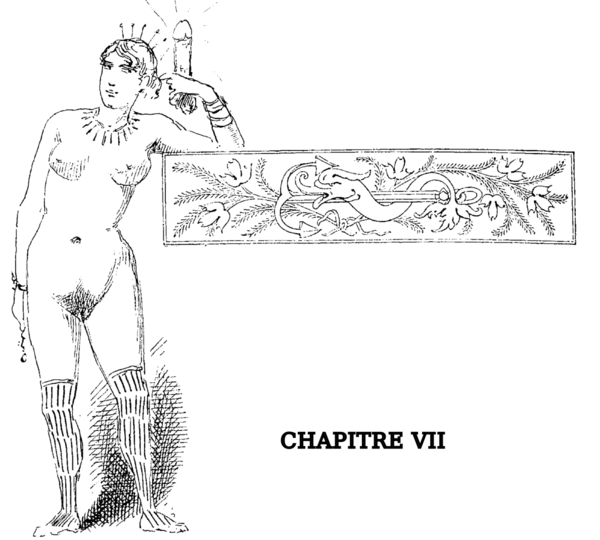Souvenirs d’une cocodette/7
CHAPITRE VII
 i le marquis de B*** avait eu le talent
d’écrire, et si l’envie de publier ses
idées lui avait traversé l’esprit, je suis
certaine qu’il n’aurait pas manqué de
se faire une réputation dans les lettres, car il était
instruit, lisait beaucoup, et surtout de vieux livres,
et il avait sur toutes choses les opinions les plus
originales, et même les plus excentriques. Dès
l’instant où il enfourchait son dada, il se montrait
plein d’intelligence et d’invention. Grâce aux
conseils qu’il me donnait, concernant les moindres
détails de ma toilette, et que j’avais le bon
esprit de suivre docilement, mes succès, comme
femme, ne tardèrent pas à dépasser ceux que
j’avais obtenus comme jeune fille.
i le marquis de B*** avait eu le talent
d’écrire, et si l’envie de publier ses
idées lui avait traversé l’esprit, je suis
certaine qu’il n’aurait pas manqué de
se faire une réputation dans les lettres, car il était
instruit, lisait beaucoup, et surtout de vieux livres,
et il avait sur toutes choses les opinions les plus
originales, et même les plus excentriques. Dès
l’instant où il enfourchait son dada, il se montrait
plein d’intelligence et d’invention. Grâce aux
conseils qu’il me donnait, concernant les moindres
détails de ma toilette, et que j’avais le bon
esprit de suivre docilement, mes succès, comme
femme, ne tardèrent pas à dépasser ceux que
j’avais obtenus comme jeune fille.
« Le plus sûr moyen pour une femme de réussir dans le monde, m’écrivait-il un jour où je me trouvais à Galardon, auprès de mon père malade, c’est d’avoir une certaine originalité qu’on ne puisse retrouver chez personne d’autre ; c’est d’être toujours, et dans un certain sens, dans le sens le plus accentué chez elle par le caprice de la nature, un type représentant une grâce particulière, un type doué d’un charme distinct. Il ne faut jamais qu’une femme cherche à ressembler à une autre femme, à se modeler sur personne. Si, dès son début dans le monde, elle ne sait pas être « elle-même », elle est perdue. Recherchons maintenant le moyen, pour une femme, d’être véritablement et intelligemment originale. La chose est simple. Si cette femme a une qualité qui n’appartienne qu’à elle seule, il faut qu’elle ait le talent de la mettre en relief, qu’elle l’exagère, la pousse à l’excès. Il suffit quelquefois de fort peu de chose pour se constituer une originalité. Telle femme a la beauté de ses yeux, de ses dents, de ses mains, de ses pieds. Telle autre a le caractère particulier de sa démarche, de son maintien, de sa tournure. Telle autre encore a su se faire une réputation de « femme séduisante », uniquement à cause de sa manière originale de se coiffer, ou des soins qu’elle met à choisir ses chaussures. Quelquefois, une femme qui n’a ni qualité ni beauté suffisante pour attirer l’attention sur elle, trouve moyen de réussir par un défaut corporel[1]. Ceci est le comble de l’art féminin. Quand la femme dont je parle est intelligente, elle se hâte de transformer ce défaut en qualité. C’est en l’exagérant qu’elle y parvient.
« Telle femme réussira donc par un léger accent étranger, auquel elle aura donné quelque chose de musical. Telle autre a les hanches trop fortes, le corsage trop accentué : elle en fait une séduction par la manière de se vêtir, de se tenir et de marcher. Certaines femmes qui ont ce défaut de vision qu’on appelle le « regard incertain » ont pu faire des passions, grâce à cette excentricité de leurs yeux. Le monde est si gâté, si blasé, il aime tant l’imprévu, l’inattendu, le bizarre, quelquefois même l’inouï, le baroque, le fantasque, qu’il finit par trouver piquante l’expression de deux yeux ne marchant pas ensemble. »
Toute la lettre était sur le même ton.
J’ai eu le bon esprit de la conserver. Si je ne la cite pas en entier, c’est seulement afin d’éviter les redites.
On peut voir maintenant quelle était l’originalité particulière du caractère de mon mari. C’est en vertu des principes développés dans sa lettre, c’est en les appliquant à ma personne, trouvant d’ailleurs en moi une élève docile, qu’il parvint en peu de temps à faire de moi, selon ses propres expressions, « une femme à la mode des plus accomplies ». Jusqu’alors[2], grâce à la beauté de l’impératrice Eugénie, à celle de quelques dames de son entourage, toutes blondes, ou d’un blond doré, il semblait qu’une femme ne pouvait mériter dépasser pour jolie en France, si ses cheveux n’étaient pas de la nuance que le Titien rendit si célèbre. L’engouement à cet égard était devenu tel, il était si irréfléchi que, peu à peu, quelques femmes du monde, qui avaient les cheveux noirs ou châtains, se modelant sur certaines courtisanes en renom, n’avaient point hésité à se faire teindre. Mon mari, qui avait toujours eu, disait-il, une horreur instinctive pour toutes les nuances du jaune, ne m’eut pas plutôt épousée qu’il déclara que le moment était venu de rendre aux brunes la justice qui leur était due en les remettant à la mode. Me voilà donc, pour lui complaire, soignant plus que jamais mes beaux cheveux noirs, me coiffant de façon à les faire valoir et bien voir. Comme je ne pouvais pas toucher à mes yeux sans m’exposer à leur faire tort, je me contentais de les laisser briller de tout leur éclat. Mais ce n’était pas tout. Il y avait alors à Paris, sans me compter, deux autres femmes bien connues, deux brunes, toutes deux fort belles et appartenant à des catégories différentes de la société. Elles auraient pu me porter ombrage, ou, selon l’expression de mon ironique mari, « me disputer l’empire des cœurs ». La première de ces femmes était madame Viardot, la grande cantatrice, que la reprise de l’Orphée de Gluck venait de remettre en évidence. La seconde était une courtisane de la plus haute volée, célèbre dans l’Europe entière, autant pour son esprit que pour sa distinction et sa beauté, madame Barucci. À ne nous juger toutes trois que par une de nos qualités physiques, nous avions, d’après l’opinion de mon mari, la même magnifique et abondante chevelure d’un noir bleuâtre, les mêmes grands yeux de velours noir et les mêmes sourcils. Entre madame Barucci et moi surtout, il y avait, dans le teint très mat et cependant rosé, dans la beauté des dents, des pieds et des mains, une ressemblance un peu plus précise. Nous nous faisions habiller toutes les deux chez la même couturière ; nous nous y rencontrions quelquefois, nous portions forcément des costumes à peu près semblables, et il était arrivé parfois, aux courses de Longchamps, comme à la promenade et au théâtre, qu’on nous avait prises l’une pour l’autre. Sans même s’inquiéter des inconvénients qu’une pareille ressemblance, quoique si flatteuse pour moi, pouvait avoir, mon mari se mit dans la tête de me faire effacer les femmes qu’il appelait mes « deux rivales. »
— Tu n’as rien à redouter de madame Viardot, me dit-il. Elle se montre peu, sort à peine, on ne la voit que sur la scène. Ensuite, elle est plus âgée que toi, elle a les traits plus gros. Les avantages réels qu’elle a sur toi ne peuvent être appréciés que sur les planches : c’est son talent incomparable, sa voix d’or, comme pourrait dire un poète ; ensuite, ce sont ses jambes, qu’elle montre dans le rôle d’Orphée, et qui sont vraiment admirables. Quant à madame Barucci, dont le sang est florentin, comme celui qui coule dans tes veines, c’est une autre affaire. Je l’ai beaucoup connue autrefois. Elle est extrêmement séduisante. Mais rassure-toi, tu lui es supérieure. Ainsi, elle a le teint mat ; le tien est coloré, agréablement nuancé de blanc et de rose. Ta véritable supériorité sur elle, cependant, n’est pas là. Elle est tout entière dans ce fait que tu es plus grande qu’elle, qui, cependant, est déjà si grande.
Si tu veux suivre mes conseils, tu l’éclipseras par ton défaut même. Entre nous, sans vouloir te faire un sot compliment, il est évident que tu es trop grande. Pour un observateur, il y aura toujours un défaut de proportion entre l’élévation de ta taille et celle de la moyenne des femmes que l’on rencontre. Tes formes sont très élégantes, minces, sveltes ; c’est dans ces formes élégantes et dans ta taille si grande, trop grande, que consistent ton originalité et ton plus grand charme.
C’est donc par là, en exagérant ton défaut, le poussant à l’excès, accentuant son originalité, c’est en faisant de ce défaut une qualité, une beauté, que tu dois vaincre et que tu vaincras.
Si tu étais jamais assez mal inspirée pour chercher, par ta manière de t’habiller, de te tenir et de marcher, à réduire ta taille, à la ramener aux dimensions ordinaires, tu perdrais tout ton charme, tout ton chic, devrais-je dire afin de me faire mieux comprendre, et, cherchant à corriger un défaut précieux, tu ne parviendrais qu’à te suicider. Je termine, ma chère Aimée, en résumant tout ce que je t’ai dit dans un seul principe : « Tu es trop grande : pour réussir, il faut que tu te grandisses encore. »

Telles étaient les préoccupations les plus vives de mon mari, telles étaient les conversations que nous avions ensemble. Quoique j’eusse déjà le goût de la toilette, quoique le mariage n’eût fait que développer encore en moi la passion des chiffons, il me semblait souvent que, entre deux nouveaux mariés, il aurait pu y avoir de plus sérieux sujets de méditation et d’épanchement. Je m’étais figuré, comme toutes les jeunes femmes l’eussent fait à ma place, que mon mari s’attacherait à cultiver mon esprit et former mon cœur.
Malheureusement pour lui et pour moi, ma personne matérielle, seule, l’intéressait.
Pour obéir aux prescriptions qu’il m’avait indiquées, qui me paraissaient naïves[3], originales, et répondaient d’ailleurs à mon inclination personnelle, j’opérai une transformation radicale dans toute ma personne. La première, à Paris, j’eus le courage de renoncer aux cages en fer et à la crinoline. Je me fis faire des robes collantes et longues, qui me moulaient tout le corps, me serraient les épaules, les hanches, et découvraient mes pieds, dont j’étais très coquette, mon mari affirmant que les jolis pieds étaient faits pour être montrés, et que c’était aux femmes qui avaient les pieds difformes[4] de les cacher.
Les bottines en peau de chevreau fines et souples que je portais invariablement à la promenade, moulant parfaitement la forme de mes pieds, avec leurs talons hauts, évidés, me faisaient paraître encore plus grande, et contribuaient à donner à ma démarche le balancement voluptueux que recherchent les Andalouses. Ce fut encore moi qui, la première, pour m’étoffer un peu, eus l’idée de faire bouffer ma jupe sur les hanches et de porter en arrière de très larges nœuds de ceinture aux longs bouts flottants.
En marchant, et je m’exerçais à marcher à grands pas, je me tenais habituellement les bras un peu serrés au corps, le buste penché en avant. Mon mari trouvait ce maintien ravissant. La première encore, j’affectai de me parer de mes cheveux noirs, de les montrer le plus possible. J’en avais toujours quelques longues boucles qui me pendaient, par derrière, entre les épaules. Une innovation dont je ne fus pas peu fière fut de renoncer aux chapeaux fermés.
On ne me vit plus à Paris que coiffée d’un de ces chapeaux de voyage et de campagne dont on peut varier la forme à l’infini, au gré de son imagination, et qui se prêtent si bien à faire valoir la beauté du visage des femmes. Les miens étaient invariablement noirs, presque toujours formés de velours et de dentelles[5].


La voilette seule était blanche, en « tulle illusion », extrêmement légère, transparente et renfermait tout le visage. Mes yeux ne perdaient rien à briller à travers la trame très fine de ce tulle. Mon mari me disait qu’on aurait pu les comparer à des étoiles scintillant derrière un nuage. Les femmes ne se lassent jamais de parler d’elles-mêmes. Je continue donc. En peu de temps, grâce à la docilité que je mis à suivre les conseils de mon mari, je devins l’une des femmes les plus élégantes et les plus recherchées de Paris[6]. Chaque jour, lorsque le pavé était sec, je remontais[7] à pied, vers cinq heures, l’avenue des Champs-Élysées, suivie à quelques pas par ma voiture ou par mon valet de pied. Tout le monde se tournait pour me voir passer. Je tranchais tellement, par mon costume, comme par le caractère particulier de mon visage et de ma tournure, sur les grosses blondes à crinoline et chignon jaune qu’on rencontrait partout depuis dix ans ; je ressemblais si peu, de visage et de manières, à aucune autre[8], que mon apparition dans un lieu public causait toujours une visible[9] sensation. Les petits journaux ne tardèrent point à parler de moi. Comme j’étais habituellement vêtue d’étoffes sombres, ils me surnommèrent la « Dame noire ». Et de fil en aiguille, afin d’amuser le public, ils me prêtèrent insolemment des aventures qui n’étaient jamais arrivées.
Mon mari était radieux. Il avait donc enfin une femme selon son rêve. Rien en moi ne clochait, du moins pour ses goûts. Il me quittait le moins possible. Quand vint l’hiver, il prit l’habitude de m’accompagner chaque soir à l’Opéra ou aux Italiens. De là, nous allions dans le monde, où mon succès ne faisait que grandir. Il y a une très grande différence entre le succès qu’une jeune fille peut obtenir dans les salons et celui qu’on y fait à une femme mariée.
C’est à peine si les hommes peuvent parler — et encore, ce n’est que de banalités convenables, — à une jeune fille. Ils ne lui manifestent donc guère leur admiration que par les regards. Ce sont les femmes qui, seules, sont autorisées à dire à la jeune fille qu’on la trouve belle. Une fois qu’elle est mariée, la scène change. Tous les hommes, jeunes et vieux, et surtout les vieux, sollicitent l’honneur de se faire présenter à elle. Ils ne se gênent guère, ils ne se gênent même pas du tout, pour lui dire tous, quelques-uns en observant les convenances les plus parfaites, le plus grand nombre, malheureusement, avec une liberté de langage encouragée par la trop grande facilité des relations, « qu’elle est douée de toutes les grâces, de toutes les beautés, qu’on ne peut s’empêcher de l’adorer, et qu’on ose espérer qu’elle ne se montrera pas toujours insensible. »
J’étais fière de mon succès, surtout de voir que les hommes paraissaient me préférer aux autres femmes. Laquelle de nous n’aurait éprouvé les mêmes sentiments, à ma place ? Mais j’étais quelquefois un peu choquée d’apprendre que les belles choses qu’on me débitait, on ne se gênait nullement, ne pensant même pas mal faire, pour les débiter à d’autres femmes, et dans les mêmes termes, et je ne me sentais pas peu mortifiée de voir que, même sur le ton de l’enjouement, on paraissait admettre, comme une chose probable et toute naturelle, que je pourrais être un jour infidèle à mon mari. Encore une fois, je ne ressentais pas d’amour pour ce mari. Mais, que l’on juge une fois comme il doit l’être le cœur de la femme : en dépit de ses petites manies, l’habitude de vivre ensemble, autant que sa générosité, commençait insensiblement à m’attacher à lui. Je ne me décidais pas toujours facilement à lui complaire, mais je ne lui aurais pas fait volontairement la moindre peine, et, s’il avait la plus légère indisposition, je le soignais avec dévouement.
Pour revenir au monde, mon succès y était très grand. Je puis dire sans immodestie que j’étais la reine de toutes les fêtes. Comme j’avais su me faire, grâce à mon mari, une originalité bien tranchée, je ne tardai pas à trouver un grand nombre d’imitatrices. Grâce à moi, les femmes brunes redevinrent à « la mode ». Les cheveux noirs, tantôt disposés de chaque côté de la figure en nattes longues et épaisses, tantôt répandus sur la nuque en rouleaux allongés, les cheveux noirs, bleuâtres et lustrés, éclipsèrent les affreuses tignasses jaunes et rousses. Ce fut encore à moi que l’on dut la disparition de la crinoline, qui faisait ressembler les femmes à des cloches. Je fus la première, quelque temps la seule, qui osât découvrir ses pieds en marchant. Les femmes m’exécraient ; les hommes « comme il faut » me faisaient tous des compliments, et les gamins des rues m’appelaient la Girafe.
Comme il y a, comme il y aura toujours certains côtés futiles dans le caractère de la femme — et n’est-ce pas ce qui fait son charme ? — je me sentais heureuse et fière d’être devenue une personnalité. Il me semblait, dans ma naïveté, que la mode m’appartenait, parce que dans quelque salon que j’allasse, tous les hommes, toutes les femmes elles-mêmes, me disaient que j’étais la belle des belles ; parce que je ne pouvais traverser une rue sans que toutes les personnes qui s’y trouvaient, sans exception, se retournassent pour me regarder.
J’étais heureuse et vaine ; mais je n’allais pas tarder à expier, bien cruellement, les quelques mois de satisfaction que j’avais goûtés.
Jusqu’alors, avec l’insouciance de mon âge, je ne m’étais jamais inquiétée, ni même occupée de notre situation de fortune. J’avais si peu d’expérience, j’étais si peu habituée à me priver et à compter, qu’il me semblait que les gens du monde devaient être tous riches, par le seul fait de leur naissance et de leur éducation, et ne pouvaient jamais, en aucune circonstance, perdre leur fortune. Si quelqu’un m’avait dit que je serais un jour tourmentée à la pensée d’un mémoire à payer à mon cordonnier ou à ma couturière, je lui aurais simplement ri au nez. Mon mari, qui voyait et faisait tout en grand, avait mis, dès le premier jour, notre maison sur le pied le plus respectable. Nous avions dix chevaux, un piqueur, deux cochers, trois garçons d’écurie, un jardinier, un portier, un chef, un sommelier, deux aides de cuisine, trois valets de pied, une lingère, un valet de chambre pour le service de mon mari, deux femmes de chambre pour le mien, et un courrier. Tout ce monde coûtait cher, mangeait beaucoup, buvait de même et se donnait le mot pour nous voler. Ni mon mari ni moi ne tenions compte de l’argent dépensé. Grâce au sang maternel, je n’avais que trop malheureusement des dispositions pour le luxe et la toilette. Loin de me retenir, mon mari me poussait constamment à me modeler sur les femmes de la société les plus dépensières et les plus riches. À l’entendre, et quoi que je fisse, je n’étais jamais trop bien mise. Et puis, ne nous fallait-il pas tenir table ouverte ? Dès que l’une de nos voitures commençait à se détériorer, les livrées de nos gens à n’être plus fraîches, on les changeait. Tout cela se paie, d’une manière ou d’une autre, tôt ou tard. Un jour, à l’occasion d’un mémoire de carrosserie, d’une quinzaine de mille francs, l’orage éclata. À la suite de longues et pénibles discussions, il devint avéré pour moi que mon mari, en m’épousant, n’avait d’autre fortune que des dettes ; que, depuis notre mariage, nous avions vécu de ma dot et fait quelques dettes nouvelles ; que l’hôtel où nous logions était hypothéqué pour la totalité de sa valeur ; que mon beau-père, le vieux duc de B***, ne pouvait nous aider, étant aussi à court d’argent et aussi endetté que nous-mêmes. Comme, du côté de ma famille, la fortune, depuis notre exil, n’avait jamais été bien considérable, ni même bien liquide, nous ne pouvions attendre de là aucun secours. Mon père, d’ailleurs, avait quatre enfants, sans compter celui dont l’avait affublé Gobert, à doter et à marier.
Il se devait à eux bien plus qu’à moi, puisque j’avais déjà reçu ma dot. Comment aurais-je osé, au surplus, avouer à mon père, et surtout à ma mère, l’affreuse situation dans laquelle nous nous trouvions ? Mon mari, aux abois, avait commencé à vendre quelques-uns de ses plus beaux tableaux. Dans l’espoir de se procurer un peu d’argent comptant, de temps à autre, il faisait une petite opération à la Bourse, ou jouait à son club.
Et c’est ainsi que nous vivions après six mois de mariage.

- ↑ Variante, ligne 9, au lieu de corporel ; lire : original.
- ↑ Variante, ligne 10, au lieu de jusqu’alors, grâce à la beauté de l’impératrice Eugénie, à celle de quelques dames de son entourage, toutes blondes ; lire : À cette époque, grâce aux succès de beauté qu’avaient obtenus à Paris quelques étrangères qui avaient toutes les cheveux rouges, ou tout au moins…
- ↑ Variante, ligne 14, au lieu de naïve ; lire : neuve.
- ↑ — ligne 25, au lieu de les pieds difformes ; lire ; des pattes de singe.
- ↑ Variante, ligne 1, après dentelles ; lire : avec une longue et large plume noire qui me faisait presque tout le tour de la tête et retombait sur mon épaule.
- ↑ Variante, ligne 12, au lieu de Paris ; lire : de tout Paris.
- ↑ — ligne 13,au lieu de remontais ; lire : montais.
- ↑ — ligne 22, au lieu de à aucune autre ; lire : âme qui vive.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de visible ; lire : véritable.