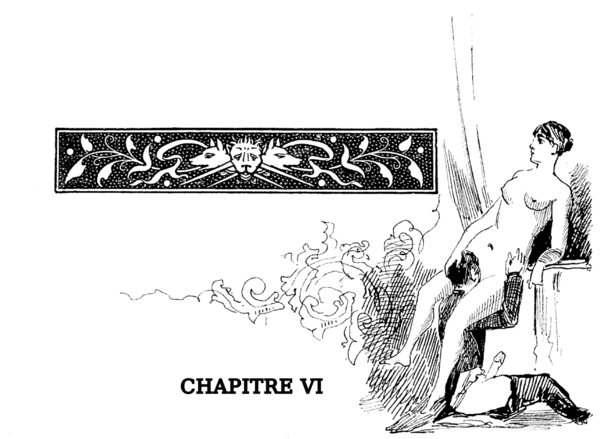Souvenirs d’une cocodette/6
CHAPITRE VI
 est-ce donc là le mariage ! me disais-je
le lendemain en m’éveillant. Comment
les femmes s’y soumettent-elles ?
est-ce donc là le mariage ! me disais-je
le lendemain en m’éveillant. Comment
les femmes s’y soumettent-elles ?
J’éprouvais une telle honte que je n’osa sortir ni recevoir personne pendant quinze jours. Les figures même des domestiques qui me servaient m’étaient odieuses. Il me semblait toujours que chacun pouvait voir sur mon visage tout ce que j’avais laissé faire et fait dans cette abominable nuit.
Il est vrai que au bout de quelques jours, l’absence de douleurs nouvelles et la nécessité aidant, je finis par m’habituer à ma situation de femme. Mon mari se faisait de plus en plus tendre.
Il mettait un peu plus d’intelligence et d’humanité, une sorte de bonté, dans ses transports. Néanmoins, il y avait, dans toute sa manière d’être et dans ses paroles, certaines choses qui me paraissaient de plus en plus singulières. Ce fut lui-même qui se chargea de me les expliquer.
Il avait une qualité qui, en certaines occasions pouvait passer pour un grand défaut ; je veux dire qu’il était extrêmement expansif et communicatif. Il ne lui suffisait jamais de goûter un plaisir. Pour que ce plaisir fût complet, il fallait à toute force qu’il en parlât. Pendant les longues journées qui suivirent notre mariage et que nous passâmes en tête-à-tête, ne sortant que de loin en loin, et toujours ensemble, en voiture fermée, pour aller faire un tour dans les recoins les plus déserts du Bois de Boulogne, il crut devoir me confier, afin de se distraire lui-même, les motifs qui l’avaient déterminé à m’épouser.
— Voyez-vous, me dit-il un jour, il ne faut pas que vous vous imaginiez avoir pour époux un homme vulgaire. Je ne ressemble à qui que ce soit[1], et, quand je serai mort, on ne verra[2] plus ici-bas d’original de mon espèce. Vous allez en juger. Dans toute mon existence, je n’ai jamais eu qu’une passion, passion ardente, indomptable : celle des femmes, ou plutôt « de la femme ». Cette passion ne s’est pas éteinte en moi avec la fougue de la jeunesse ; au contraire. La maturité de l’âge n’a fait que la rendre plus vive. C’est pour la satisfaire en toute sécurité que je me suis donné le luxe de vous épouser. Après avoir longtemps expérimenté la possession des femmes qui passent pour les plus belles, fatigué de ne pouvoir jamais parvenir à en rencontrer une qui approchât de la perfection, ou, tout au moins, qui satisfît mon goût, je finis par tomber dans un profond découragement.
Et il y avait un peu de quoi. Les femmes qui voulurent bien se donner à moi ne manquaient ni de charme, ni de beauté ; mais chacune d’entre elles péchait par quelque côté contre mon désir. L’une était blonde, j’aime les brunes ; une autre était petite, ou de taille moyenne, et je préfère les grandes femmes ; une autre encore, quoique jolie, avait les pieds mal faits, ou elle était un peu replète, ou bien elle avait les yeux bleus, et je ne puis me passionner que pour les pieds élégants, un peu allongés, les tailles élancées et les yeux noirs. De guerre lasse, je finis par me trouver complètement absurde de faire des simagrées et des coquetteries avec une passion aussi tenace, et, ne pouvant prendre sur moi de l’étouffer, je lui donnai toute carrière. En un mot, je me mis résolument, désespérément à aimer toutes les femmes… Vous frémissez, ma chère. Peut-être me croyez-vous devenu fou. Je vous donne ma parole d’honneur que je jouis du bon sens le plus absolu, et je vais vous le prouver, en raisonnant sur ma passion comme les hommes les plus intelligents et les plus froids ne seraient peut-être pas capables de le faire. Oui, je me suis mis à aimer toutes les femmes, toutes sans exception, sauf cependant celles qui étaient vieilles et laides. Pendant plus de vingt ans, il me suffit qu’une femme rencontrée par hasard, dans le monde, au théâtre, dans quelque magasin, même dans la rue, fût douée d’une certaine grâce, d’un certain charme, eût quelque chose d’attractif, un rien, le plus souvent, pour que l’idée me vînt de lui rendre des soins. L’une me plaisait pour ses yeux, une autre pour ses cheveux, ou pour ses mains. L’une m’attirait encore par son sourire, parfois un minime détail de son costume.
J’en aimai quelques-unes à cause de leurs dents blanches, ou de leur parler musical, et quelques-unes aussi pour leurs défauts. Mais pouvez-vous vous figurer un pareil supplice ?
La chose, quand je me trouvais dans la rue, allait jusqu’à l’obsession.
Il suffisait qu’une jupe passât à portée de ma vue pour me faire tourner la tête. J’en maigrissais ; j’étais réellement malheureux, car vous comprenez bien que, malgré ma fortune, mon nom, m’adressant à toutes les femmes, de toutes les conditions possibles, depuis les femmes et filles de princes jusqu’aux servantes, je devais rencontrer moins de complaisantes que de cruelles. D’ailleurs, si les désirs de l’homme sont infinis, ses forces sont malheureusement limitées, et je craignais toujours de rencontrer en moi-même le pire des obstacles. Cette crainte, grâce à Dieu et à ma constitution robuste, se trouva toujours mal fondée. Mais je n’en fus pas plus heureux.
Le monde, s’il le connaissait, serait sans pitié pour un supplice de cette espèce. Il en est peu, pourtant, de plus douloureux. On est perpétuellement aux prises avec l’impossible. À qui se confier ? Nul ne voudrait vous croire, personne ne vous comprendrait. Et cependant, c’est une chose adorablement amusante que le changement, — pour ceux qui l’aiment. — Moi, je ne l’aimais pas ; du moins, je lui préférais un certain type, qui n’existait que dans mon imagination et dont je vous parlerai tout à l’heure. Il y a un proverbe qui dit : Faute de grives, on mange des merles. Quand j’eus atteint l’âge de quarante ans je pensai qu’il était grand temps de croquer au moins une grive. N’en pouvant rencontrer nulle part une seule qui me convînt parfaitement, qui n’eût aucun défaut, selon mon goût, je m’avisai d’en créer une dans mon esprit, et celle-là fut naturellement douée de toutes les perfections. Pour me faire mieux comprendre, je vous dirai que je me formai un idéal de grâce, de charme, de beauté. Je le comblai des plus doux attraits, je n’oubliai aucune des séductions qui pouvaient le rendre parfait.
Puis, quand cette merveille idéale fut créée dans mon imagination, et bien complète, je me complus à vivre avec elle, à la caresser, me promettant, si jamais j’avais le bonheur de rencontrer, dans n’importe quelle condition, une femme qui ressemblât à cet idéal, de lui offrir mon nom, ma fortune, ma vie, pour l’unique satisfaction de la posséder.

Je cherchai dans toute l’Europe, avec la plus grande patience. Je ne trouvai pas. Cela dura longtemps. Il est vrai que j’étais excessivement[3] difficile. Je ne voulais pas qu’entre mon idéal et la réalité, il s’en fallût du plus minime détail. Je croyais rencontrer une femme qui devait faire le bonheur de ma vie parmi ces charmantes filles sur lesquelles il est facile de se livrer aux investigations les plus minutieuses, moyennant une rémunération suffisante. Mais point.
Je ne trouvai que de lointains équivalents. J’étais profondément perplexe, quand un jour, dans un bal, sans même savoir qui vous étiez, je vous vis entrer. Je vous reconnus tout de suite. C’était la fille[4] de mon rêve, et c’était vous. Mais vous, jeune fille, appartenant au monde, bien élevée, bien née. Comment faire pour acquérir la certitude que vous ressembliez de tous points à mon idéal ? Quel moyen employer pour le vérifier ? Il n’y en avait d’autre que celui de vous épouser. Mais si, une fois le mariage conclu, alors que l’examen était permis, facile même, j’allais m’apercevoir qu’il s’en fallait de peu ou de beaucoup, la quantité importait peu, que vous ne fussiez la réalisation de ma chimère ! Je me sentais si malheureux que je voulus en courir la chance, quitte à me faire sauter la cervelle, si, par malheur, je m’étais trompé ! Il est vrai que ce que je connaissais de votre personne, ce que vous en laissiez voir à tout le monde, faisait prévoir les plus douces choses à celui qui serait assez heureux pour admirer ce que vous cachez[5]. Et maintenant, ma chère Aimée, je puis vous le dire avec autant d’orgueil que de bonheur : Vous égalez, vous dépassez même mon rêve, en charmes, en attraits, en grâce. Tout en vous est parfait, complet.
C’est à ne pas le croire, tout en vous est conforme au modèle que j’avais créé.
Je vous en supplie à mains jointes, ne me prenez pas pour un fou, ni même pour un maniaque. Je conviens que ma confession peut passer pour singulière ; mais je jouis[6] de tout mon bon sens.
J’éprouve un plaisir infini à vous la faire. Vous allez juger maintenant si j’ai sujet de remercier Dieu. Une femme, pour être belle, selon mon goût, ne sera jamais de trop grande taille, et je ne pense pas qu’on puisse voir, à Paris et nulle autre part, de femme aussi grande que vous. J’ai toujours éprouvé une sorte de répulsion instinctive pour les femmes « aux belles chairs. » Je place la beauté dans la distinction, l’élégance, la sveltesse des formes[7]. En pourrait-on trouver de plus élégantes que les vôtres ? J’aime les épaules étroites, les corsages accusés[8], virginalement modelés, les hanches modestes. Vous avez tout cela, ma chère ! Parlerai-je de cette profusion de cheveux noirs qui vous descendent jusqu’aux jarrets, de vos yeux noirs remplis de flammes ? Sans en avoir rien vu encore, j’en raffolais ! Tout enfin, votre peau blanche, si rose et si fine, vos dents, vos oreilles mignonnes, vos belles mains, vos pieds délicieux[9], tout, oui tout, jusqu’à votre démarche provocante[10], votre voix mélodieusement timbrée, vous avez tout réalisé.
Mon mari dit encore une foule d’autres choses si élogieuses, qu’un sentiment de modestie m’empêche de les relater.
Et, au surplus, je n’oserais affirmer que j’ai transcrit précédemment ses paroles textuelles. J’en garantis le sens et l’esprit. C’est tout ce que je puis faire. Et si je me suis décidée à consigner ici le singulier exposé de principes que mon mari crut devoir me faire quelques jours seulement après notre mariage, c’est uniquement par cette raison que son caractère s’y peint tout entier.
Le jour où il me fit la bizarre confession dont ma mémoire ne m’a permis de citer que les parties les plus saillantes, nous nous promenions à pied dans l’une des avenues[11] les plus solitaires[12] du Bois de Boulogne. Je ne répondais rien, étant un peu surprise de ce que j’entendais. Tout autre aurait été découragé par mon silence. Lui, point, ce silence fut pris par lui comme une invitation amicale à continuer de m’ouvrir son cœur. Il reprit donc :
— Vous pouvez objecter à ce que je vous ai fait connaître de moi-même que la beauté d’une femme, sa personne matérielle, tout en étant et devant être considérée comme une chose très importante par l’homme qui l’aime, ne constitue cependant pas toute la femme. Chaque femme, en effet, a un certain esprit, un certain caractère, un cœur, des idées qui lui appartiennent, des goûts particuliers, quelquefois des talents et souvent des manies. Pour que l’homme qui l’aime soit heureux avec elle, il est indispensable qu’il existe une certaine conformité entre leurs goûts réciproques ; il faut aussi que leurs caractères sympathisent, qu’ils aient quelques idées communes, et qu’ils poursuivent le même but dans la vie. Ici, ma chère, je vais probablement vous étonner. En matière d’amour, je suis de l’opinion d’un écrivain de grand mérite que vous devez connaître au moins de nom : je veux parler de La Bruyère. « Il faut juger les femmes, dit-il, depuis la chaussure jusqu’à la coiffure exclusivement, à peu près comme on mesure le poisson entre la queue et la tête. » Cela veut dire en langage vulgaire que, lorsqu’on est un homme de bon sens, on ne doit attendre des femmes ni cœur, ni esprit, ni caractère, ni bonté, ni intelligence, ni bons procédés, ni raison, qu’on n’est en droit d’exiger d’elles que la beauté.
Et, en effet, quand la beauté d’une femme vous est sympathique, elle vous rapporte toujours assez de plaisirs. Ne serait-on pas fou de demander de l’esprit à une rose ; d’exiger qu’une pêche, ou tout autre beau fruit, eût de la raison ; d’attendre du cœur d’un flacon de bon vin ? Non. Pourvu que la pêche ait toutes les qualités d’un excellent fruit, que la chair en soit savoureuse et parfumée ; pourvu que l’odeur de la rose flatte notre odorat, que sa vue réjouisse nos yeux ; pourvu enfin que le vin soit suffisamment excitant, agréable à notre palais, nous n’avons pas l’idée de leur demander autre chose. Chacun de ces objets nous a-t-il procuré un moment de plaisir, malheureusement trop fugitif, nous sommes satisfaits.
Il en est, il doit en être de même de la femme. Comme la pêche, le vin, la rose, elle a été créée pour flatter nos sens. La nature n’a rien inventé de plus beau, de plus réellement délicieux que notre compagne, lorsque toutefois elle est belle, complaisante, et veut bien se laisser aimer. Cependant, comme il y a toujours dans la vie un inconvénient attaché à une satisfaction, un danger qui accompagne une joie, un supplice qui fait expier un moment de plaisir, la nature a donné à la femme un certain caractère, de certaines idées, de certains goûts dans l’unique but de faire expier à l’homme l’excès de jouissance de toute sorte que la femme lui procure. Si la nature, ayant doué la femme comme elle l’est physiquement, lui avait donné, en plus, du cœur, de l’esprit et du bon sens, la femme aurait trop de puissance.
La sottise et la passion de l’homme aidant, la femme finirait par pouvoir modifier le monde. D’après tout ce que je viens de vous dire, reprit mon mari, je ne me crois en droit d’attendre de vous, ma chère, aucune des vertus et des qualités qui ne sont pas le fait de votre sexe. Je serai bon pour vous, je vous ferai du bien, vous me récompenserez en me faisant du mal, je m’y attends. Je vous serai fidèle ; si vous me trompez, j’en souffrirai peut-être, mais je n’en serai pas surpris. La seule chose que je vous demande, que j’exige de vous, c’est que vous respectiez toujours votre beauté, c’est que vous suiviez aveuglément les conseils que je vous donnerai pour la conserver.
Tel était l’espèce de fou philosophique, et tant soit peu naïf, que mon étoile m’avait donné pour mari. Je dois lui rendre la justice de convenir que sa folie était douce, et qu’il s’ingéniait constamment à me rendre l’existence agréable et facile. Il me laissait la plus entière liberté de tout ranger et déranger dans la maison, de recevoir qui je voulais, d’aller et de venir à ma guise. Il était généreux, parfois même prodigue, et se plaisait à me faire de jolis cadeaux. Je m’attachais à lui insensiblement, autant par reconnaissance que par habitude.
— Vous pensez, lui disais-je un jour, que les femmes sont toutes sans cœur. Je vous assure que vous avez tort, au moins en ce qui me concerne. La preuve en est que je ferai toujours mon possible pour vous rendre heureux.
— Je ne dis point que les femmes n’ont pas de cœur, répondit-il, mais seulement qu’il n’est point nécessaire quelles en aient. Je ne vous demande pas de m’aimer ; ce serait inutile. Je n’exige de vous que de la soumission à mes idées.
Malheureusement, comme il arrive presque toujours, c’était précisément ce qu’il me demandait que je ne pouvais prendre sur moi de lui accorder. J’ai toujours été chatouilleuse ; et il passait son temps, dans mon cabinet de toilette, gravement occupé à me déshabiller, m’examiner, des pieds à la tête, me toucher et me caresser. Je ne pouvais ni me vêtir, ni me dévêtir, ni prendre un bain, ni me mettre au lit, ni en sortir, ni même procéder à mes ablutions, sans l’avoir là, à trois pas de moi, s’extasiant à haute voix sur « mes beautés ». On ne peut se faire une idée de l’agacement nerveux que cette manie me causait. Mon humeur, douce et complaisante d’habitude, avait fini par s’en altérer. Et mon mari était assez sot pour s’en chagriner.
Je ne dois pas manquer d’ajouter qu’il faisait tout ce qu’il pouvait pour éveiller mes sens et les exciter. Tantôt par ses paroles, tantôt par la lecture d’ouvrages licencieux qu’il m’apportait, tantôt par des caresses pleines de recherches et passionnées, il me poussait à chercher les plus voluptueuses sensations. Je faisais les plus grands efforts pour lui complaire sous ce rapport, sans cependant y parvenir.
Il y avait des jours où, étant mieux disposée que d’autres, il me semblait que j’allais me laisser vaincre. Mais ma froideur native reprenait bientôt le dessus, et je finis par ne plus accorder à mon mari les faveurs auxquelles le mariage lui donnait droit, sans exiger de lui, d’avance, qu’il me fît cadeau de quelque bijou de grand prix.
Il poussait la bonhomie jusqu’à rire et à plaisanter de cette situation anormale. Moi, j’en riais aussi, et j’en abusais.
— Tu vois, je fais tout ce que tu veux, lui disais-je.
Et j’ajoutais bien vite :
— Excepté ce qui m’est désagréable.
Il affirmait que j’avais beaucoup d’esprit. Je lui fis un jour une confession de principes qui faillit le rendre fou de bonheur.
— Malgré la répulsion instinctive que me fait éprouver certain acte que vous aimez trop, lui dis-je un jour, répulsion qui, je crois, provient du souvenir de ma première nuit de noces, je ne puis m’empêcher d’admirer la nature, de trouver qu’il y a je ne sais quoi de grand, et même de touchant, dans l’action de la femme qui ouvre son corps à l’homme qu’elle aime, et qui lui dit : « Sois heureux par moi, et dans moi. »
— Ô Aimée, tu étais faite pour me comprendre ! s’écria-t-il en m’embrassant.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de qui que ce soit ; lire : âme qui vive.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de verra ; lire : reverra.
- ↑ Variante, ligne 26, au lieu de excessivement ; lire : atrocement.
- ↑ Variante, ligne 12, au lieu de fille ; lire : femme.
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de cachez ; lire : en cachiez.
- ↑ — ligne 12, au lieu de mais je jouis de tout mon bon sens ; lire : mais elle n’est qu’un excès de sincérité.
- ↑ Variante, ligne 23, au lieu de formes ; lire : femmes.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de accusés ; lire : peu accusés.
- ↑ Variante, ligne 9, après délicieux ; lire : vos jambes de fée.
- ↑ Variante, ligne 10, après provocante ; lire : votre meneo.
- ↑ Variante, ligne 3, au lieu de l’une des avenues ; lire : l’un des sentiers.
- ↑ Variante, ligne 3, après solitaires ; lire : des environs du pré Catelan.