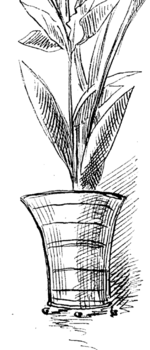Souvenirs d’une cocodette/3
CHAPITRE III
 a grossesse de ma mère, qui était déjà assez avancée, me fit voir sous un
jour nouveau les trois personnes
qu’elle intéressait le plus. Mon excellent
père avait l’air timide et honteux. Si je ne
l’avais connu pour un homme extrêmement
spirituel, j’aurais cru, à sa mine, qu’il voulait se
faire pardonner une peccadille dont il rougissait.
a grossesse de ma mère, qui était déjà assez avancée, me fit voir sous un
jour nouveau les trois personnes
qu’elle intéressait le plus. Mon excellent
père avait l’air timide et honteux. Si je ne
l’avais connu pour un homme extrêmement
spirituel, j’aurais cru, à sa mine, qu’il voulait se
faire pardonner une peccadille dont il rougissait.
Mais il avait bien trop d’esprit pour se croire coupable, à soixante ans passés, du nouveau rejeton qui allait lui naître. L’attitude de ma mère avait quelque chose de gêné et de touchant. Il est évident que sa pudeur souffrait de montrer au public, pour la sixième fois, qu’elle s’était laissé endoctriner[1] par un homme.
Quant au Gobert, il rayonnait. Pour un rien, si on l’eût laissé faire, il aurait mis un écriteau à son chapeau portant ces mots, en grandes lettres : « C’est moi qui suis l’auteur de l’aimable délit. »
Si j’avais été homme, je l’aurais giflé !
Une chose me surprenait, chez ma mère, plus encore que sa grossesse.
Elle qui m’avait éloignée de sa maison parce que mes charmes de seize ans lui portaient ombrage, comment n’avait-elle point hésité à me la rouvrir, quand j’avais dix-neuf ans, et que j’étais dans toute l’efflorescence luxuriante de ma beauté ? Loin de se montrer jalouse maintenant, elle paraissait fière de moi, se faisait une fête de me produire.
Je me cassai longtemps la tête à chercher la cause de cette singularité. Cette cause était cependant bien simple : mon excellente mère ne pouvait rien opposer à une chose irrémédiable, et en avait tout bonnement pris son parti. Cette année, nous n’attendîmes pas l’époque des vacances, comme d’habitude, pour aller nous installer à la campagne.
Ma mère ne cessait de se plaindre de la fatigue que lui causait sa grossesse.
On aurait juré, à l’entendre, que c’était la première fois qu’elle se trouvait dans une situation intéressante.
Un peu de fausse honte s’ajoutait à ses maux, vrais ou supposés, pour l’engager à quitter Paris. Il fut donc décidé qu’elle ferait ses couches dans notre château de Galardon, où s’était écoulée la plus grande partie de mon enfance. Nous partîmes vers la fin de l’été. Monsieur Gobert et mes deux tantes paternelles étaient du voyage. Je n’ai jamais eu les goûts bucoliques ; néanmoins, cette fois, ce ne fut pas sans un très vif plaisir que je me retrouvai dans le vieux château féodal, entouré d’eaux vives. Toute mauvaise pensée à part, mon couvent me manquait un peu, par moments. Je regrettais mes études musicales et, de même parfois, la société de mes compagnes. Mon père, qui, en sa qualité de naturaliste, adorait les champs, me promenait souvent dans le parc, me faisant admirer la hauteur et la beauté des sapins centenaires.
Et puis, il me menait visiter le verger qu’il avait créé et qui était rempli des arbres fruitiers les plus rares. Mes deux sœurs, pendant ce temps-là, s’ébattaient sur les pelouses avec mes frères, sous la surveillance de nos tantes, et ma mère, en grande toilette, accompagnée de Monsieur Gobert, qui portait son pliant, son tabouret et son ombrelle, traînait l’interminable queue de sa robe sur le sable de la terrasse.
Chacun de nous faisait tous ses efforts pour ne pas se laisser gagner par l’ennui. Nous sortions en voiture, nous montions à cheval, nous faisions des parties de chasse et de pêche. Nous avions d’aimables voisins qui venaient nous voir. Nous changions jusqu’à trois et quatre fois de costume par jour. Enfin, notre existence était supportable.
Vers le milieu du mois de septembre, arriva au château une nouvelle qui me transporta de joie.
Mon cousin Alfred allait venir nous rejoindre et passer avec nous la fin de la saison. Il faut ici que je dise quelques mots de ce cousin. Il était fils unique de celle des sœurs de mon père que nous appelions tous à la maison, « ma tante Aurore », parce qu’elle ressemblait trait pour trait à l’actrice qui remplissait le rôle de ce nom dans je ne sais quel opéra-comique. Alfred et moi, nous avions été élevés ensemble. Étant si proches parents, presque du même âge, — Alfred n’avait qu’un an de plus que moi, — nous ne nous étions, pour ainsi dire, pas quittés durant notre enfance.
Les soins qu’il avait fallu donner à nos éducations respectives nous avaient seuls séparés. J’aimais beaucoup Alfred. Je ne l’avais pas vu depuis mon entrée au couvent. Je me souvenais encore, avec émotion, que, tout enfant, je l’appelais « mon petit mari » ; lui me nommait « sa petite femme ». Nous avions été élevés dans l’idée que nous étions destinés l’un à l’autre. Nos mères, nous voyant nous caresser, dès l’âge de trois ans, le plus gentiment du monde, avec toute sorte de petites mines gracieuses, nous comparaient à Paul et Virginie… Maintenant, on me disait que les études d’Alfred étaient faites et complètes, qu’il avait grandi, pris des forces, était devenu homme. Mon père même le critiquait, grondait sa sœur devant nous tous, à table, lui soutenant qu’Alfred s’était émancipé trop vite, qu’il avait fait de « mauvaises connaissances ». À vingt ans, il sortait chaque jour, tout seul, et dans Paris, en tilbury ou à cheval il allait au bois de Boulogne faire le gandin, était, membre d’un cercle, jouait, perdait, pariait aux courses, faisait des dettes. Enfin, et c’était là le comble, il avait des maîtresses.
Il avait des maîtresses ! Et mon père, et ma mère, et ma tante elle-même, en parlaient si librement devant moi, comme d’une chose toute simple et indifférente. Le seul, M. Gobert, à ce gros vilain mot de « maîtresse », baissait pudiquement les yeux sur son assiette[2].
M. Gobert, dans ses paroles, était exactement l’opposé de mon père. L’expression la plus ordinaire, la plus courante, le choquait. On aurait dit qu’il n’avait pas eu de jeunesse, était venu au monde avec sa cravate et son air gourmé. Maman, malheureusement, qui l’admirait tant, après avoir été, toute sa vie, d’une tolérance parfaite, à l’imitation de mon père, finit par adopter les scrupules les plus ridicules de son amant. Mais je reviens à mon cousin.
Je ne me possédais déjà plus, tant j’avais hâte de le revoir. Ma mère le critiquait trop. Elle disait qu’il était un « franc mauvais sujet ». Chose étrange ! la seule idée des maîtresses d’Alfred me faisait de la peine et me rendait fière.
Un matin, comme je venais de quitter ma chambre et entrais au salon, — c’était l’heure du déjeuner, — un jeune homme qui se tenait assis sur un canapé, auprès de ma mère, se leva en m’apercevant, vint à moi, puis, tout à coup, sans dire gare, me sauta au cou.
C’était lui, mon cœur me le dit. Quand je fus parvenue à me dégager de son étreinte, encore toute honteuse d’avoir été menée si lestement, je le regardai à loisir. Combien je le trouvai changé !
Il avait toujours les mêmes cheveux blonds, bouclés, les mêmes yeux bleus, le même teint clair, et ce je ne sais quoi d’aimable et de doux qui m’avait jadis plu en lui. Mais il avait aussi, en plus, de fines moustaches et des favoris.
Autrefois, on le plaisantait sur sa petite taille. Maintenant, ses épaules étaient larges, sa ceinture paraissait bien prise. Il me semblait qu’il avait les bras forts et la voix mâle.
Quelque chose d’énergique et de résolu, qui n’était pas absolument désagréable, apparaissait dans toute sa personne.
Enfin, c’était un homme. Je remarquai, non sans plaisir, qu’il était soigné dans sa mise, qu’il avait les ongles bien faits.
La première impression que mon cousin fit sur moi avait été bonne. Une semaine à peine après son arrivée au château, je devais éprouver un cruel désenchantement. C’était le soir. Le dîner venait de finir. Nous étions tous réunis dans le grand salon, au rez-de-chaussée, autour d’une table, les hommes lisant le journal, les femmes travaillant à l’aiguille. Une grosse lampe nous éclairait. En levant la tête, par hasard, je fus frappée de voir la lune, alors très large et dans son plein, briller d’un éclat magnifique sur les vitres de la porte et de la fenêtre.
La lumière qu’elle projetait était si vive qu’elle éclairait toute la pièce.
Je me levai, sans trop me rendre compte du désir qui venait de naître en moi, et, posant ma broderie, je proposai à ma mère de faire un tour du parc pour jouir de la beauté de la soirée.
M. Gobert, à cette proposition, fit la grimace.
— Pour attraper un rhume, dit-il ; n’y allez pas, Madame.
— Non, non, je n’irai pas, répondit ma mère, il faut que tu sois folle, Aimée, pour avoir de telles idées.
Naturellement, personne ne voulut se décider à m’accompagner. Chacun craignait le froid, le serein, que sais-je ? Comme il n’était pas facile, cependant, de m’empêcher d’exécuter un dessein que j’avais en tête, je continuai à m’acheminer vers la porte.
— Prends donc un châle, au moins, entêtée, me dit mon père.
Le châle était déjà sur mes épaules, lorsque ma mère, se tournant vers mon cousin, lui dit :
— Alfred, fais-moi le plaisir d’accompagner ta cousine. Je ne trouve ni prudent, ni même convenable, qu’elle s’en aille ainsi seule dans le parc, à une pareille heure.
Alfred s’était levé sans dire un mot. Et moi, qui tenais déjà sous la main le bouton de la porte, je ne lui adressai pas une parole pour l’encourager à me suivre. Depuis quelques jours, je n’étais pas contente de l’attitude et des manières de mon cousin. Il me semblait qu’il n’avait point assez d’égards pour moi, me traitait trop en camarade. Ce même soir surtout, feignant de lire, assis en face de moi, de l’autre côté de la table, il n’avait presque pas cessé de m’adresser des regards que je trouvais alors trop gouailleurs et irrévérencieux — aujourd’hui que j’ai un peu plus d’expérience, je les qualifierais de « libertins. » Bref, il me fut très désagréable de le voir me suivre ; j’étais mal disposée ; j’avais comme un pressentiment que la poétique promenade que je voulais faire allait être toute gâtée.
Il y avait dans le parc de Galardon une longue et large avenue de coudriers qui, partant de la terrasse, juste en face la porte d’honneur du salon, s’en allait aboutir à un pavillon de repos entouré de fleurs.
J’avais eu, de tout temps, une prédilection particulière pour cette avenue ombreuse et mystérieuse dont les arbres, se rejoignant et entrecroisant leurs rameaux à vingt pieds en l’air, formaient une sorte de longue voûte verdoyante et pleine de murmures. De distance en distance, dans une sorte de niche ou de renfoncement de la charmille, une blanche statue de marbre, représentant une nymphe ou une bacchante, s’élevait sur son piédestal. Il y avait aussi quelques bancs de pierre. Je ne crois pas qu’on puisse rencontrer rien de plus caractéristique et de plus monumental nulle part que cette avenue de vieux coudriers, même à Versailles.
Un grand silence régnait au dehors, et la lune était toujours très brillante. Alfred avait commencé par m’offrir galamment son bras. Je crus devoir le refuser, en souvenir de ses mauvais regards. Lorsque nous eûmes fait quelques pas, sans rien nous dire, il s’approcha, et, tout à coup, comme s’il n’avait même pas eu la pensée qu’il pouvait m’offenser, il me passa le bras autour de la taille, privauté singulière, que, jusqu’alors, il ne s’était jamais permise. Après cela, voyant que je ne disais rien, il commença à me faire, tout en marchant, d’affectueux reproches sur ce qu’il appelait « mon inexplicable froideur ».
Je me sentais assez embarrassée pour lui répondre, étant mécontente de lui, mais cependant n’ayant, en somme, rien de grave à lui reprocher.
Cela fit que je continuai à marcher à petits pas, auprès de lui, tenant les yeux baissés, et ne prononçant pas une parole. Je ne puis deviner à quoi il attribua mon silence, mais le fait est qu’il s’enhardit. Son bras me pressa plus fortement, de la main qu’il avait de libre, il s’empara de l’une des miennes, et enfin, tout en cheminant, il commença, à ma grande stupéfaction, à me tenir le langage le plus passionné.
À l’entendre, « il m’aimait de toutes les forces de son âme, il n’avait jamais aimé, il ne voulait jamais aimer que moi. J’avais été la douce, poétique et ravissante compagne de son enfance. Il espérait que je serais celle de toute sa vie. »
Le discours me plaisait, mais les attouchements qui continuaient grand train me mettaient au supplice.
Je lui dis :
— Si tu es sincère, ton bonheur ne dépend que de toi-même. Tu n’as qu’à demander ma main à mon père. Tu sais qu’il t’aime comme un fils, il ne te la refusera certainement pas.
Alfred se serrait de plus en plus contre moi. Il osa même me donner sur le cou, sous mes cheveux, un long baiser qui me brûla comme un fer rouge.
— Oh !… dit-il, nous ne nous entendons pas, ma chère Aimée. Ce n’est pas de mon oncle que je veux te tenir, c’est de toi seule.
Et, ce disant, à ma grande indignation, le voilà qui recommence à m’embrasser, à me presser contre sa poitrine, voulant à toute force disposer de ma main, pour l’employer à je ne sais quelles caresses, dont je n’avais pas la plus faible idée, mais qui, d’instinct, me causaient une répulsion insurmontable.
Les confessions de Jean-Jacques Rousseau, circulant librement, sont dans toutes les mains.


Il n’est pas une seule personne, appartenant au monde, en Europe, qui n’ait pris plaisir à les lire, et l’on peut dire de ce livre que chaque nouvel individu qui ouvre les yeux à la lumière est un lecteur de plus qu’il est assuré de compter. Comme tout le monde, j’ai lu les confessions, comme tout le monde encore, je me suis sentie révoltée à la lecture de certaines scènes, spécialement de celle qui se passe à Turin, à l’hospice des Catéchumènes, entre l’auteur et un Esclavon, qui se donnait pour un Maure et qui voulait abuser de l’innocence du jeune Génevois.
Il est une chose cependant qui, selon moi, fait pardonner à Jean-Jacques Rousseau l’obscénité de la scène que j’indique, c’est la parfaite sincérité de l’auteur, la franche indignation qu’il manifeste en racontant cet affreux épisode de sa vie. Quoique, Dieu merci[3] ! je ne sois point obligée d’aller aussi loin que le philosophe de Genève dans la suite du récit de mon aventure avec mon cousin Alfred, je m’efforcerai d’imiter la sincérité du grand écrivain, afin de me faire pardonner, à un plus haut degré que lui encore, la hardiesse de langage à laquelle je me vois condamnée pour conclure.
Il y avait quelque temps déjà que mon cousin s’agitait auprès de moi dans la demi-obscurité de la charmille, m’embrassant, me faisant violence pour me serrer contre son cœur, et tourmentant toujours ma main, lorsqu’une chose que je ne puis prendre sur moi de nommer et de décrire — et cependant Rousseau est allé beaucoup plus loin dans le récit de l’épisode dont je parlais tout à l’heure — une chose dont, jusque-là, dans mon innocence relative, j’avais à peine dû soupçonner l’existence, se trouva soudain sous ma main.
Tout ce que j’en puis dire, c’est que cela se rébellionnait et que son contact me répugnait. Il me suffit de mon instinct de femme, de jeune fille, pour comprendre immédiatement que mon cousin me faisait une grosse injure. Mes sens qui, au couvent, m’avaient un jour semblé tout prêts à s’éveiller, se révoltaient.

Une peur soudaine me saisit. Je crus Alfred atteint d’une infirmité monstrueuse, et je me mis à pousser des cris. Heureusement, il me fit taire, me calma. J’eus la chance inappréciable de rentrer en possession de ma main, et fis subitement un saut en arrière.
Puis, honteuse de tout ce que j’avais vu, senti et compris pendant cette minute de violence indigne, je me mis à fondre en larmes.
Alfred s’était précipité à mes pieds.
— Mais je t’aime ! je t’aime ! s’écria-t-il.
Et le voilà qui se relève et veut me prendre encore la main.
Grâce à la lune qui ne cessait de s’élever dans le ciel, il faisait presque aussi clair qu’en plein jour sous les coudriers. Les statues, qui me regardaient, me semblaient autant de muets témoins de ma honte. Je me sentis littéralement défaillir.
— Est-ce donc là l’amour ? lui dis-je avec une naïveté peinée qui aurait dû le désarmer.
Mais, à son âge, on est sans pitié. Il me reprit le bras, la main, cherchant à m’entraîner vers le pavillon. Je ne voulus point y aller. Je sentais que de vilaines choses m’y attendaient.
— Tu me dis que tu m’aimes, m’écriai-je en me dégageant de ses bras. Et tu me traites comme si j’étais une de ces femmes perdues dont parle mon père, et qu’il t’accuse de fréquenter.
Il se jeta de nouveau à mes pieds.
— Ta beauté est cause de tout ! me dit-il, ainsi que la passion que tu m’inspires.
Il ajouta une foule d’autres choses, que j’ai oubliées depuis lors. Je le quittai enfin, et me sauvai à toutes jambes, folle de peur, m’estimant trop heureuse d’en être quitte au prix de ma promenade perdue.
Aujourd’hui que plusieurs années se sont écoulées et que de cette vilaine aventure où la polissonnerie de mon cousin tourna à sa confusion, il ne me reste plus qu’un pénible souvenir, je voudrais qu’il me fût permis de revenir sur elle en peu de mots, de dire quelles pensées, quelles sensations elle fit naître dans mon âme de jeune fille. J’y trouverai une sorte de consolation, de réparation. Il faut se rappeler que j’avais alors dix-neuf ans, que si mon âme et ma personne n’étaient pas absolument pures, puisque j’avais subi une sorte de défloraison morale et physique au couvent, j’ignorais encore cependant, et de la façon la plus absolue, en quoi la nature faisait consister la différence des sexes. Pour moi, quoique, dans mon enfance, ma mère, un peu imprévoyante, comme tant d’autres, m’eût fait parfois baigner dans le même bassin où s’ébattaient mes frères, pour moi donc, un homme n’était autre chose qu’une femme aux cheveux courts, barbue, dépourvue de gorge, et qui portait des pantalons au lieu de robes. Mon ignorance, à cet égard, était si grande, si complète que, lorsque mon cousin essaya de commettre contre ma pudeur et ma volonté l’attentat que je viens de décrire, le voyant dans un tel état de surexcitation, et ne pouvant me rendre compte ni de ce qu’il voulait, ni de ce qu’il faisait pour éveiller mes sens, je le crus sérieusement atteint de quelque difformité horrible et cruelle, et je fus tout naïvement sur le point d’appeler pour lui faire porter du secours. Mais je ne puis continuer plus longtemps à retracer mes méditations sur un tel sujet. Je craindrais de me laisser entraîner beaucoup plus loin que je veux aller, en ce temps de réserve un peu hypocrite[4], où il me faudrait, au surplus, une autorité et une hardiesse masculine que je n’ai pas, pour oser me servir de la liberté de langage de Montaigne et de Brantôme. Je me contenterai de dire, pour terminer, que mon premier mouvement, dans la honte mêlée de terreur que je ressentais, aurait été de tout divulguer à ma mère, quoique sa manière d’être avec moi n’attirât pas les épanchements, si le souvenir de la position où je l’avais surprise un jour, toujours présent à ma mémoire, ne m’avait invinciblement arrêtée.
Quant à mon père, je serais plutôt morte que d’oser lui dire un seul mot de ce qui s’était passé[5].
Pendant le peu de jours que mon cousin demeura encore au château, il ne s’avisa plus de renouveler une tentative qui lui avait si mal réussi.
De mon côté, je ne pus jamais prendre sur moi de la lui pardonner. J’avais été trop grossièrement, trop brutalement offensée. Depuis lors donc, quoique demeurant convenablement affectueux l’un pour l’autre devant nos parents, nous nous maintînmes toujours, au fond, sur le pied d’une rancune assez prononcée.
Ce serait peut-être ici l’occasion, pour une femme qui aimerait à philosopher, de montrer les inconvénients qui peuvent résulter des liaisons trop étroites, contractées dès l’enfance, entre cousins et cousines, liaisons toujours favorisées, lorsqu’elles ne sont pas déterminées par les parents. On se dit ; « C’est comme s’ils étaient frère et sœur. Ils sont si jeunes. C’est une chose charmante de les voir se caresser et s’embrasser ! Cela ne présente aucun danger. » On se trompe. C’est une erreur. Si le danger n’existe pas dans le présent, il n’est que plus à craindre pour l’avenir. L’anecdote[6] que je viens de raconter est de nature à le prouver. Mais je m’arrête, ne voulant pas avoir l’air de prêcher.
Que serait-il arrivé cependant si, profitant habilement d’une surprise possible de mes sens, mon cousin avait été plus hardi ? Le pavillon était là, tout près. Nul ne pouvait nous voir, nous entendre…
Cette année, nous n’attendîmes pas le retour de l’hiver pour rentrer à Paris.
Il avait été décidé que nous quitterions la campagne dès que les couches de ma mère seraient faites.
Ce fut vers le milieu du mois d’octobre que cet heureux événement vint nous surprendre. Après trente heures des plus cruelles souffrances, et pendant que mon père pleurait d’attendrissement, ma mère mit au monde un gros garçon qui ressemblait trait pour trait à Monsieur Gobert.- ↑ Variante, ligne 6, au lieu de s’était laissé endoctriner ; lire : avait daigné compatir aux souffrances ;
- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de sur son assiette ; lire : dans sa cravate.
- ↑ Variante, ligne 18, au lieu de Quoique Dieu merci ! etc ; lire :
Quoique les conventions sociales que, en ma qualité de femme, je suis tenue de respecter à l’égal des articles de foi, m’interdisent de la manière la plus absolue de relater les détails de la scène qui se passa entre mon cousin et moi, je puis dire, pour être comprise sans blesser aucune pudeur, que les choses n’allèrent point tout à fait aussi loin entre nous que les Confessions assurent qu’elles se passèrent entre le catéchumène et le philosophe de Genève. Au moment où mon cousin me pressait le plus et où je commençais à désespérer de ma résistance, je fis subitement un saut en arrière et j’eus la chance inappréciable de rentrer en possession de ma main. - ↑ Variante, ligne 14, au lieu de un peu hypocrite ; lire : tout extérieure.
- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de ce qui s’était passé ; lire : sur un tel sujet.
- ↑ Variante, ligne 25, au lieu de l’anecdote ; lire : l’incident.