Les Lions de mer/Chapitre 6
CHAPITRE VI.
a visite du capitaine Dagget eut pour effet de hâter l’équipement
du Lion de Mer. Le diacre connaissait trop bien le caractère
des marins de l’île pour traiter légèrement un incident de
cette importance. Il ne savait point ce qu’on avait pu dire aux
gens du Vineyard de ses grands secrets ; mais il ne doutait pas
qu’ils n’en sussent assez et qu’ils n’en eussent assez appris par la
visite du capitaine Dagget, pour attiser toutes leurs convoitises
et pour les pousser vers les régions polaires.
Pour un tel peuple, les distances et les difficultés ne sont rien, le même homme qui a été occupé aujourd’hui à couper les blés dans son champ solitaire, où l’on pourrait croire que l’ambition et l’amour de l’argent ne sauraient pénétrer, est prêt à quitter ses foyers en vingt-quatre heures, prenant l’épissoir en même temps qu’il met la fourche de côté, et partant pour l’autre extrémité du monde avec aussi peu d’hésitation que d’autres pourraient en mettre à faire un voyage d’une semaine. Le diacre n’ignorait pas que tel était le caractère de ceux auxquels il avait affaire, et il comprit la nécessité de la plus grande prudence unie à la persévérance et à l’activité.
Philip Hasard, dont il a déjà été question, reçut l’ordre de ne pas perdre de temps, et les hommes déjà recrutés pour le voyage commencèrent à traverser le Sund et à se montrer à bord du schooner. Quant au vaisseau, il avait tout ce qui lui était nécessaire, et le diacre commença à témoigner quelque impatience de ce qu’il ne voyait pas arriver deux ou trois hommes d’un mérite supérieur, à la recherche desquels était Philip Hasard, et que le capitaine Gardiner voulait avoir.
Le digne armateur ne supposait guère que les gens du Vineyard fussent en marché avec ces hommes et les empêchassent de s’entendre avec Philip Hasard, afin de se donner le temps d’équiper un autre Lion de Mer qu’ils armaient déjà depuis près d’un mois. Ils avaient acheté ce vaisseau à New-Bedford, pour profiter des renseignements incomplets qu’ils avaient reçus des capitaines du brick et du sloop. L’identité de nom était l’effet du hasard, ou il serait plus exact de dire qu’elle avait été suggérée par la nature commune de l’entreprise ; mais il en résulta que la compagnie qui s’était formée au Vineyard adopta le plan de confondre, pour ainsi dire, les deux vaisseaux, et espéra tirer quelque avantage de cette combinaison ; mais nous ne parlerons pas encore de ce plan.
Après un délai de plusieurs jours, Hasard envoya de Bonnington un homme du nom de Watson, qui avait la réputation d’être un grand chasseur de veaux marins. Cette recrue parut excellente, et, en l’absence de ses deux officiers qui étaient l’un et l’autre absents et occupés à recruter des hommes, Roswell Gardiner, pour lequel le commandement était une chose nouvelle, consulta fréquemment cet habile marin. Il fut heureux pour le diacre qu’il n’eût encore rien révélé de ses deux grands secrets au jeune capitaine : Gardiner savait sans doute que le sloop devait aller à la chasse des veaux marins, des lions de mer, des éléphants de mer, et de tous les animaux de l’espèce du phoque ; mais on ne lui avait rien dit des révélations de Dagget.
Nous disons qu’il fut heureux que le diacre eût été si prudent, car Watson n’avait aucunement l’intention de faire voile d’Oyster-Pond, étant engagé comme second du Lion de Mer rival, qu’on avait acheté à New-Bedford, et dont on complétait alors l’équipement. En un mot, Watson était un espion envoyé par les gens du Vineyard pour s’assurer des intentions de l’armateur du schooner, pour s’insinuer dans la confiance de Gardiner, et pour rapporter exactement l’état des choses. Les Américains aiment à se vanter de n’avoir pas d’espions chez eux. Cela est vrai, si l’on tient à la signification ordinaire du mot, mais il n’y a rien de moins exact sons d’autres rapports. Il n’y a peut-être pas, au contraire, dans toute la chrétienté, de pays plus livré à l’espionnage, pour peu qu’il s’agisse de l’empressement qu’on y met à se mêler des affaires d’autrui. Un système très-général et très-notoire d’espionnage existe parmi les négociants, et, un grand nombre d’hommes de presse s’enrôlent eux-mêmes comme espions dans un but politique et aussi dans d’autres intérêts.
Il ne faut donc pas que le lecteur se contente des impressions qu’il aura pu recevoir, à cet égard, d’assertions générales, et récuse, parce qu’ils ne reflètent pas l’hypocrisie du jour, la vérité des tableaux que nous traçons avec l’exactitude du daguerréotype.
Watson, qui s’était presque engagé à faire partie de l’équipage du Lion de Mer, du capitaine Roswell Gardiner, n’était pas seulement un espion, mais un espion envoyé dans un camp ennemi avec les motifs les plus vils et avec des intentions aussi hostiles que la nature des circonstances pourrait le permettre.
Tel fut l’état des choses à Oyster-Pond pendant la semaine qui suivit la visite du capitaine Dagget. Le schooner était maintenant tout à fait prêt à partir, et le capitaine Gar’ner commença à parler de quitter le quai. Les hommes expérimentés qu’il attendait n’arrivaient point cependant, et le jeune commandant en montrait quelque impatience, car il avait toutes ses nouvelles recrues, et s’il voulait s’éloigner du quai, c’était pour les exercer au maniement des rames.
— Je ne sais pas ce que font Hasard et Green, cria un jour Roswell Gardiner à son armateur, du gaillard d’arrière où il se trouvait, tandis que le diacre se tenait sur le quai et que Watson était occupé dans les grands haubans. — Ils ont été assez longtemps à terre pour recruter une douzaine d’équipages, et il nous manque encore deux hommes, lors même que celui-ci signerait l’engagement qu’il n’a pas encore signé. À propos, Watson, il serait temps que nous vissions votre écriture.
— Je ne suis qu’un ignorant, capitaine Gard’ner, et il me faut du temps, même pour signer mon nom.
— Oui, oui, vous êtes un gaillard, prudent, et je ne vous en aime que mieux. Mais vous avez eu tout le temps qu’il vous fallait pour prendre votre parti.
— Eh ! oui, Monsieur, tout cela est assez vrai tant qu’il ne s’agit que du vaisseau. S’il n’était question que d’un voyage aux Indes Orientales, je n’hésiterais pas une minute à signer l’engagement, et je ne vous demanderais même pas si le vaisseau est assez grand pour une expédition baleinière ; mais la chasse des veaux marins est une autre affaire ; et il suffit d’un homme inhabile pour exposer une expédition à bien des échecs.
— Tout cela est assez vrai, mais nous n’avons l’intention ni d’embarquer des hommes inhabiles, ni de nous exposer à des échecs. Vous me connaissez…
— Oh ! si tout le monde était comme vous, capitaine Gar’ner, je ne prendrais pas même le temps d’essayer la plume ; votre réputation s’est faite dans le Midi, et personne ne peut contester votre habileté.
— Eh bien, les deux seconds sont d’anciens marins qui entendent ce genre d’expédition, et nous voulons qu’il n’y ait pas un homme dans l’équipage qui ne soit aussi déterminé que vous.
— Il faut des hommes de cœur, Monsieur, pour se mettre à l’ouvrage au milieu de ces éléphants de mer, de ces chiens de mer, plutôt, car c’est comme cela que je les appelle. On dit que les veaux marins deviennent rares ; mais je prétends qu’avant tout, il faut savoir son affaire. Ainsi, dis-je, voilà le jeune capitaine Gar’ner qui arme un schooner pour quelque partie inconnue du monde, peut-être pour le pôle sud ; ou tout autre coin du globe ; il reviendra plein, ou je ne m’y connais pas.
— Eh bien ! si c’est là votre opinion, vous n’avez qu’à signer un engagement et à faire partie de l’expédition.
— Oui, oui Monsieur, quand j’aurai vu mes camarades. Il n’y a pas d’industrie sous le soleil qui exige un plus grand dévouement de la part de chaque homme que la chasse des éléphants de mer. Avec un équipage énergique, on peut triompher d’animaux plus petits, mais lorsqu’on en vient aux véritables vieux taureaux de mer, aux bouledogues de mer, comme on pourrait les appeler, donnez-moi des cœurs et des bras intrépides.
— Eh bien, suivant moi, Watson, il est quelquefois moins dangereux d’attaquer un éléphant de mer que de lutter contre un de ces bouledogues de vieille baleine qui a déjà été harponné une demi-douzaine de fois.
— Oui, c’est quelquefois difficile aussi, quoique je ne me préoccupe pas autant d’une baleine que d’un éléphant de mer ou d’un lion de mer. Ce que je voudrais savoir, ce sont les noms de mes camarades lorsqu’il s’agit d’une expédition dont le but est la chasse des veaux marins.
— Capitaine Gard’ner, dit le diacre qui avait entendu toute cette conversation, il faudrait savoir si cet homme veut s’embarquer sur le schooner, oui ou non.
— Je m’engagerai à l’instant, reprit Watson aussi hardiment que s’il avait été sincère ; seulement, que je sache ce que j’entreprends. Si l’on me disait vers quelles îles le schooner va se diriger, cela pourrait changer ma résolution.
Cette question de l’espion était habilement posée, quoiqu’elle manquât son effet par suite de la prudence avec laquelle le diacre avait évité de communiquer son secret même au capitaine de son schooner. Si Gardiner avait su exactement où il allait, le grand désir qu’il éprouvait d’engager un homme aussi habile que Watson aurait pu lui arracher quelque révélation téméraire ; mais, ne sachant rien lui-même, il se trouva forcé de répondre de son mieux.
— Vous demandez où nous allons ? dit-il. Eh ! nous allons à la chasse des veaux marins, et nous les chercherons partout où on peut les trouver.
— Oui, oui, Monsieur, reprit Watson en riant ; ce n’est ni ici, ni là, voilà tout.
— Capitaine Gar’ner, interrompit le diacre d’un ton solennel, cela tombe dans la plaisanterie, et il faut engager cet homme ou en engager un autre à sa place. Venez à terre, Monsieur, j’ai à traiter d’affaires avec vous à la maison.
Le ton sérieux du diacre surprit également le capitaine et le marin. Quant au premier, il descendit pour mettre une cravate noire, avant de se rendre dans la maison du diacre, où il s’attendait à rencontrer Marie. Pendant que le capitaine Gardiner faisait ce changement à sa toilette, Watson descendit des haubans et en même temps que le jeune capitaine se hâtait de gagner la demeure du diacre Pratt, Watson se trouva sur le pont et appela Baiting Joe, qui pêchait non loin du quai. Au bout de quelques minutes, Watson fut dans le bateau de Joe, avec son sac ; il n’avait pas apporté de valise, et il se rendait au port. Il fit voile le même jour dans un bateau baleinier qui l’attendait, et il alla porter à Holmes Hole la nouvelle que le Lion de Mer d’Oyster-Pond serait prêt à partir dès la semaine suivante. Quoique Watson parût avoir quitté son poste en s’éloignant d’Oyster-Pond, ce n’était point sans l’agrément de ceux dont il était l’agent. Il avait besoin de quelques jours pour faire ses préparatifs, avant de quitter le quarante et unième degré de latitude nord, et d’aller au midi aussi loin qu’un vaisseau pût aller. Il ne laissa pas cependant son poste tout à fait vacant. Un des voisins du diacre Pratt, moyennant finances, s’était engagé à fournir tous les renseignements qu’il pourrait se procurer relativement au schooner, au moment où il mettrait à la voile. Ce moment n’était pas aussi rapproché que Roswell Gardiner l’avait espéré, car les agents de la compagnie du Vineyard avaient réussi à débaucher deux des meilleurs marins de Hasard ; et comme on ne ramasse pas d’habiles chasseurs de veaux marins comme des cailloux sur la grève, le retard qui en résultait pouvait avoir quelque chose de sérieux.
Pendant ce temps-là, le Lion de Mer de Holmes Hole faisait tous ses préparatifs avec une activité infatigable, et il était probable qu’il pourrait partir aussitôt que son rival.
Mais revenons à Oyster-Pond.
Le diacre Pratt était sous le porche de sa maison avant que Roswell Gardiner l’atteignît. Là le diacre fit encore entendre à son jeune ami qu’il avait à traiter avec lui d’affaires importantes, et il le conduisit dans son appartement, qui lui servait en même temps de bureau, de chambre à coucher et d’oratoire, l’excellent homme ayant l’habitude d’adresser ses supplications au trône de la miséricorde dans le même endroit où il faisait ses affaires temporelles. Fermant la porte et tournant la clef dans la serrure, à la grande surprise de Roswell, le vieillard regarda le jeune marin de l’air le plus sérieux et le plus solennel, lui déclarant qu’il allait l’entretenir d’un sujet du plus haut intérêt.
Le jeune marin ne savait trop que penser, mais il espérait que Marie se trouverait quelque peu mêlée au résultat.
— D’abord, capitaine Gar’ner, poursuivit le diacre, il faut que je vous demande de prêter un serment.
— Un serment, diacre ! Cela est tout à fait nouveau dans la chasse des veaux marins.
— Oui, Monsieur, un serment, et un serment qu’il faudra garder très-religieusement après l’avoir prêté sur cette Bible. Ce serment est la condition que je mets à toute affaire entre nous, capitaine Gar’ner.
— Qu’à cela ne tienne, diacre, je prêterai deux serments s’il le faut.
— C’est bien. Je vous demande, Roswell Gar’ner, de jurer sur ce saint livre que les secrets que je vais vous révéler, vous ne les communiquerez à personne, excepté de la manière que je vous prescrirai ; que vous ne vous en servirez dans l’intérêt de personne, et que vous serez en tous points fidèle à vos engagements envers moi. Ainsi, Dieu vous soit en aide !
Roswell Gardiner baisa le livre, très-surpris et fort curieux de voir ce qui allait suivre. Le diacre posa le livre sacré sur une table, ouvrit un tiroir, et y prit les deux cartes si importantes où il avait transcrit les notes de Dagget.
— Capitaine Gar’ner, reprit le diacre en étendant sur le lit la carte de l’Océan antarctique, il y a assez longtemps que vous me connaissez pour éprouver quelque surprise de me trouver, à cette époque de ma vie, occupé pour la première fois de l’armement d’un vaisseau.
— Si j’ai éprouvé quelque surprise, diacre, c’est qu’un homme de votre jugement se soit tenu si longtemps éloigné d’une occupation qui est seule digne d’un homme de capacité et d’énergie,
— Voilà le langage d’un marin, mais vous aurez de la peine à faire entrer dans vos idées ceux qui n’ont pas navigué.
— Parce que ceux qui n’ont pas navigué pensent et agissent suivant la manière dont on les a élevés. Maintenant, diacre, voyez cette carte ; voyez combien elle renferme d’eau et combien peu de terre. Le ministre Whittle nous a dit le dernier jour de sabbat que rien n’avait été créé sans dessein, et qu’on retrouvait dans toutes les œuvres de la nature une sage dispensation de la divine Providence. Si donc la terre avait dû l’emporter sur la mer, y aurait-il autant de l’une et aussi peu de l’autre ? C’est là la pensée qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai entendu les paroles du ministre ; et si Marie…
— Et qu’avez-vous à me dire de Marie ? reprit le diacre, voyant que le jeune homme faisait une pause.
— J’espérais, diacre, dit Roswell Gardiner, que, dans ce que vous aviez à me dire il était un peu question d’elle.
— Le sujet dont j’ai à vous entretenir, reprit le diacre, offre plus d’intérêt qu’une cinquantaine de Maries. Quant à ma nièce, Gard’ner, si elle veut de vous, soyez le bienvenu. Mais vous voyez cette carte… regardez-la bien, et dites-moi si vous y trouvez quelque chose de nouveau ou de remarquable.
— Cela me rappelle le temps passé, diacre ; voilà bien des îles que j’ai visitées et que je connais. Qu’est-ce que cela ? Des îles tracées au crayon, avec la latitude et la longitude en chiffres. Qui dit qu’il y ait là de la terre, diacre Pratt, si je puis vous poser cette question ?
— Moi, je le dis, et c’est une bonne terre pour des chasseurs de veaux marins. Ces îles, Gar’ner, peuvent faire votre fortune aussi bien que la mienne. Peu importe comment je sais qu’elles sont là, pourvu que je le sache, et que je sois résolu à y envoyer en droite ligne le Lion de Mer ; remplissez-le d’huile d’éléphant, d’ivoire et de peaux, et ramenez-le aussi promptement que vous pourrez.
— Des îles dans cette latitude et cette longitude ! dit Roswell Gardiner en examinant la carte d’aussi près que si c’eût été une fort belle gravure. Je n’ai jamais entendu parler de rien de pareil.
— Cela est cependant, et ces îles, comme toutes les terres dans les mers lointaines, n’étant pas souvent fréquentées par les hommes, sont remplies abondamment de tout ce qui peut défrayer des marins de leur voyage.
— Oh ! je n’en doute pas, si en effet il y a là des îles. Ce peut être un faux cap qu’un marin aura cru voir dans un brouillard. L’Océan est pleinde ces îles !
— Non, ce n’est point cela, c’est de la véritable terre, comme je l’ai appris de l’homme qui l’a foulée de ses pieds. Il faut prendre garde, Gar’ner, et ne pas y aller toucher, ajouta le diacre, en se permettant un petit éclat de rire, comme un homme qui est peu habitué à se donner ce genre de satisfaction. — Je ne suis pas assez riche pour acheter et équiper des Lions de Mer, si vous devez les briser sur quelque rocher.
— C’est là une haute latitude pour y mener un vaisseau. Cook lui-même n’est pas allé si loin !
— Ne songez pas à Cook ; c’était un marin du roi, tandis que mon homme était un chasseur de veaux marins américain, et ce qu’il a vu une fois, un Américain doit le retrouver. Voilà les îles ; il y en a trois, vous les trouverez et sur leurs rivages autant d’animaux qu’il y a de coquillages su la grève.
— Je l’espère, s’il y a là de la terre, et que vous risquiez le schooner, je tâcherai d’y aller voir. Je vous demanderai cependant de m’écrire l’ordre de me rendre aussi loin.
— Vous aurez tous les pouvoirs qu’un homme peut demander. Sur ce point il ne peut y avoir de difficulté entre nous ; c’est moi qui réponds du risque à courir pour le schooner, mais je vous le recommande d’une manière toute spéciale. Allez donc vers ces parages, et remplissez le schooner. Mais, Gar’ner, ce n’est pas tout ! aussitôt que le schooner sera plein, vous vous dirigerez vers le midi, et vous sortirez des glaces le plus vite possible.
— C’est assurément ce que j’aurais fait, diacre, quoique vous n’en eussiez pas encore parlé.
— Oui, d’après tout ce qu’on en dit, ce sont des mers orageuses, et le plus tôt qu’on peut en sortir est le mieux.
— Maintenant, Gar’ner, il me reste encore un serment à vous demander. J’ai un autre secret à vous dire ; baisez encore une fois ce livre sacré, et jurez de ne jamais révéler à personne ce que je vais vous dire, à moins que ce ne soit devant un tribunal et pour obéir à la justice, et ainsi Dieu vous soit en aide !
— Comment diacre, un second serment ? Vous êtes comme les douaniers qui vous fouillent dans tous les coins, et qui ne vous croient pas encore quand c’est fini. Il me semble que j’ai déjà prêté serment.
— Baisez le livre et jurez ce que je vais vous dire, ou ne vous embarquez jamais sur un vaisseau qui m’appartienne, dit sévèrement le diacre. Promettez de ne jamais révéler ce que je vous dirai maintenant, à moins que là justice ne vous y oblige, et ainsi Dieu vous soit en aide !
Roswell Gardiner, ainsi mis au pied du mur, n’hésita plus ; il jura ce qu’on lui demandait, en baisant le livre avec respect. Après avoir obtenu ce gage, le diacre déploya la seconde carte, qui remplaça la première sur le lit.
— Voici s’écria-t-il d’un ton qui avait quelque chose de triomphant, voici le véritable but du voyage.
— Ce parage ! Mais, diacre, c’est la latitude de nord−0, et vous me faites prendre une route beaucoup plus longue lorsque vous me dites d’aller au midi pour m’y rendre.
— Il est bon d’avoir deux cordes à son arc ; quand vous saurez ce que vous devez apporter de ce parage, vous comprendrez pourquoi je vous envoie au midi avant que vous reveniez ici avec notre cargaison.
— On ne peut trouver là que des tortues, dit Roswell Gardiner en riant. Rien ne croît sur ces parages que quelques arbustes rabougris, et on n’y trouve jamais que des tortues.
— Gard’ner, reprit le diacre d’un ton encore plus solennel, cette île, tout insignifiante qu’elle peut vous paraître, contient un trésor. Il y a longtemps que des pirates l’y ont déposé, et je suis seul aujourd’hui dépositaire de ce secret.
Le jeune homme regarda le diacre avec étonnement, comme s’il avait douté que le vieillard fut dans son bon sens.
Il connaissait bien son faible, et il lui était facile d’apprécier l’influence qu’une pareille hypothèse pouvait exercer sur son esprit ; mais il semblait bien improbable que, demeurant à Oyster-Pond, il eût pu apprendre un fait de cette nature, ignoré de tout le monde, et le jeune homme fut près de penser que le diacre avait tant rêvé d’argent qu’il en avait perdu la tête. Puis il se souvint du matelot mort, des entrevues nombreuses que le diacre avait eues avec lui, de l’intérêt qu’il avait toujours paru témoigner à cet homme, et de l’achat comme de l’armement imprévu et soudain du schooner, et il devina tout.
— C’est Dagget qui vous a dit cela, diacre Pratt, reprit Gardiner, et c’est lui aussi qui vous a parlé des îles des veaux marins.
— En admettant qu’il en soit ainsi, pourquoi pas Dagget aussi bien qu’aucun autre homme ?
— Assurément, s’il était sûr de la vérité de ce qu’il avançait ; mais les histoires d’un matelot ne sont pas toujours l’Évangile.
— Dagget allait mourir, et l’on ne peut le ranger parmi ceux qui parlent légèrement dans l’orgueil de leur santé et de leur force, et qui sont toujours prêts à dire : « Dieu l’a oublié. »
— Pourquoi vous l’a-t-il dit, à vous, puisqu’il avait tant de parents et d’amis au Vineyard ?
— Il y avait cinquante ans qu’il n’avait vu ses parents et ses amis. Qu’on vous sépare de Marie seulement le quart de ce temps, et vous oublierez si elle a les yeux bleus ou noirs ; vous ne vous souviendrez même plus de sa figure.
— S’il pouvait en être ainsi, je me regarderais comme un misérable. Non, diacre, deux fois cinquante ans ne pourraient me faire oublier ni les yeux ni la figure de Marie !
— Oui, voilà ce qu’éprouvent et ce que disent tous les jeunes gens. Mais qu’ils fassent l’épreuve du monde, et ils reconnaissent leur folie. Dagget m’a fait sa confidence parce que la Providence m’avait mis sur son chemin, et parce qu’il espérait assez bien se rétablir pour faire lui-même le voyage sur le schooner et tirer un profit personnel de l’expédition.
— A-t-il eu l’imprudence d’avouer qu’il avait été pirate et qu’il avait aidé à enfouir un trésor sur ce parage ?
Ce n’est point là son histoire : Dagget n’a jamais été pirate lui-même, mais il s’est trouvé dans la même prison et dans la même chambre qu’un pirate. Ce fut là que les deux hommes se lièrent, et le prisonnier, qui était condamné à mort, en faisant part de son secret à Dagget, voulut lui rendre un dernier service.
— J’espère, diacre, que vous n’attendez pas de grands résultats de cette partie du voyage ?
— C’est de là que j’en attends le plus, Gar’ner, et vous penserez comme moi quand vous saurez toute l’histoire.
Le diacre entra alors dans tous les détails des révélations que le pirate avait faites à Dagget, comme Dagget lui-même les lui avait racontées.
Le jeune homme écouta d’abord ce récit avec incrédulité, puis avec intérêt, et enfin avec une certaine disposition à croire que ce fait était plus vrai qu’il ne l’avait d’abord supposé. Ce changement dans les idées du jeune capitaine résultait du sérieux que le diacre mettait à raconter cette histoire autant que de la nature même du récit, car la passion qui l’inspirait en le dominant donnait à ses paroles quelque chose de très-précis et de très-positif. Le récit de Dagget avait produit sur l’esprit du vieillard une telle impression et y avait excité de telles convoitises, qu’il n’omettait rien, qu’il apportait dans tous les détails la plus minutieuse exactitude, et qu’il communiquait à son auditeur les impressions qu’il avait reçues lui-même lorsqu’on lui avait raconté l’histoire.
— C’est là un récit bien extraordinaire, par quelque bout que vous le preniez, s’écria Roswell Gardiner, aussitôt qu’une pose du diacre lui permit de dire un mot. C’est l’histoire la plus extraordinaire que j’aie jamais entendu raconter ! Comment est-il possible qu’on ait pu abandonner si longtemps tant d’or et d’argent ?
— Trois officiers l’enfouirent, craignant de le confier à l’équipage à bord de leur vaisseau. Ils donnèrent pour prétexte qu’ils voulaient prendre des tortues, comme vous ferez vous-même. Tandis que les matelots étaient ainsi occupés, les officiers s’écartèrent du rivage, et firent ce dépôt dans le trou d’un rocher de corail, comme vous me l’avez entendu dire. Oh ! il est impossible que cela ne soit pas vrai.
Roswell vit que les espérances du vieillard étaient trop ardentes, pour qu’il fût facile de les contrarier, et que toute son avarice était en jeu. Toutes ses passions se trouvaient ainsi absorbées par une seule. Il ne s’agissait plus pour lui d’occuper une position politique, bien qu’autrefois il eût beaucoup désiré, de représenter Suffolk à Albany ; il songeait même bien moins au meeting et à ses honneurs, tandis qu’il ne regardait les autres hommes et ses parents eux-mêmes que comme des rivaux ou des instruments de son avarice.
— Il est facile de donner à un mensonge l’apparence de la vérité, pour peu qu’on ait l’habitude de cette manœuvre. Ce Dagget a-t-il dit le total de la somme qu’il prétendait avoir été laissée par les pirates sur ce parage ?
— Oui, reprit le diacre, et toute cette âme étroite et avare sembla étinceler dans ses yeux pendant qu’il faisait cette réponse. D’après le récit du pirate, il ne pouvait y avoir dans ce trésor moins de trente mille dollars, et presque tous en bons doublons frappés au coin des rois, doublons qui pèsent bien seize onces à la livre.
— La cargaison du Lion de Mer, si elle est bien choisie, vaudra le double, pourvu que l’on trouve les animaux auxquels il faudra donner la chasse.
— C’est possible, mais pensez, Gar’ner, il s’agit ici d’or monnayé, d’or tout brillant, tout étincelant !
— Mais quel droit avons-nous à cet or, en admettant même qu’il soit là et que nous le trouvions ?
— Quel droit ! s’écria le diacre avec beaucoup de surprise. Ce que la divine providence donne à l’homme ne lui appartient-il pas ?
— En vertu de la même règle, on pourrait dire que la divine Providence avait donné cet or aux pirates. Il doit y avoir de légitimes possesseurs de cet argent ; si l’on pouvait les découvrir ?
— Oui, si l’on pouvait les découvrir. Écoutez, Gar’ner, avez-vous dépensé dernièrement un shilling ou un quart de shilling ?
— Un bon nombre de l’un et de l’autre, répondit le jeune homme avec un sourire qui montrait combien il avait le cœur léger. Je voudrais être aussi économe que vous, et je deviendrais riche. Il n’y a que deux heures que j’ai dépensé un quart[1] pour acheter du poisson au vieux-Baitiug Joe.
— Eh bien, dites-moi comment était cette pièce ; y remarquait-on une tête ? Quelle était la date, et sous quel règne a-t-elle été frappée ? Peut-être venait-elle de l’hôtel de la monnaie de Philadelphie. S’il en est ainsi, y voyait-on le nouvel aigle ou l’ancien ? En un mot, Gar’ner, pourriez-vous prêter un serment à l’égard de cette pièce ou de toute autre pièce que vous avez dépensée dans votre vie ?
Peut-être non, diacre ; on ne se met pas à dessiner l’empreinte d’une pièce de monnaie toutes les fois qu’on reçoit un peu d’or ou d’argent.
— Et il n’est pas probable que personne pût dire : « Voilà mon doublon ! »
— Cependant il doit y avoir un légitime possesseur de chacune de ces pièces de monnaie, s’il y a là, en effet, de l’argent, reprit Roswell Gardiner avec une certaine énergie. En avez-vous parlé à Marie ?
— Moi, parler d’une telle affaire avec une femme ! Croyez-vous que je sois fou, Gar’ner ? Si je voulais que le secret courût tout le vieux Suffolk, comme le feu court au printemps sur les prairies salées, je n’aurais rien de mieux à faire, mais non pas autrement. Je n’ai entretenu d’un pareil sujet que le capitaine du vaisseau que je vais envoyer à la recherche de cet or et des îles des Veaux Marins que je vous ai montrées. Si je n’avais eu qu’un objet en vue, je n’aurais pas autant hasardé ; mais avoir devant les yeux deux buts aussi importants et ne point agir, ce serait manquer de gratitude envers la Providence.
Roswell vit que les arguments seraient inutiles en présence d’une
cupidité aussi vivement excitée. Il se contenta d’écouter le diacre.
Il semblait que Dagget avait été assez explicite dans les indications
qu’il avait données pour trouver le trésor caché, pourvu que son
ami le pirate se fût montré non moins sincère avec lui, et n’eût
point cherché à le mystifier. 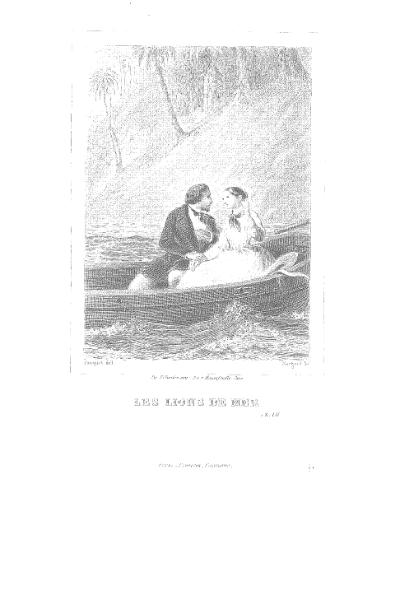
La probabilité de cette hypothèse s’était présentée à un esprit aussi prudent que celui du diacre ; mais Dagget avait détruit cette crainte par l’énergie qu’il avait mise à témoigner de la sincérité de son ami.
Le jour qui suivit cette conférence, le Lion de Mer s’éloigna du quai, et il ne fut plus possible de communiquer avec le schooner qu’au moyen de bateaux. La subite disparition de Watson pouvait contribuer à ce changement. Trois jours après, le schooner leva l’ancre et fit voile. Il traversa le canal étroit mais profond qui sépare Shelter-Island d’Oyster-Pond, quittant les eaux de Peconic-Bay. Cependant le schooner n’avait point un air de départ. Le diacre ne paraissait pas très-agité, une partie du linge de Roswell Gardiner se trouvait encore chez la blanchisseuse, circonstances qui se trouvèrent expliquées quand on vit le schooner jeter l’ancre dans Gardiner’s-Bay, qui est la grande route extérieure de tous les ports de cette région.
- ↑ Monnaie américaine.