Le Livre des mille nuits et une nuit/Tome 03/Texte entier
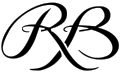
Aucun des contes renfermés dans ce volume et dans les cinq suivants, — à l’exception de deux contes seulement qui paraîtront l’un à la fin du quatrième et l’autre au commencement du cinquième, — n’a jamais été traduit, même fragmentairement, en français. — J. C. M.
LES MILLE NUITS ET UNE NUIT
HISTOIRE DU ROI OMAR AL-NÉMÂN ET DE SES DEUX FILS MERVEILLEUX SCHARKÂN ET DAOUL’MAKÂN
Alors Schahrazade dit au roi Schahriar :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, qu’il y avait dans la ville de Baghdad, après le règne de bien des khalifats et avant celui de bien d’autres, un roi qui s’appelait Omar Al-Némân[1]. Il était formidable de puissance et avait vaincu tous les Chosroès possibles et subjugué tous les Césars imaginables. Il était ardent et tel ! que le feu qui réchauffe lui était chose inutile, et tel ! que nul ne le pouvait égaler aux luttes de valeur sur le champ de course, et tel ! que s’il entrait en fureur ses narines jetaient des flammes étincelantes. Il avait conquis toutes les contrées et étendu sa domination sur toutes les villes et les capitales. Il avait, avec l’aide d’Allah, soumis toutes les créatures et fait pénétrer ses armées victorieuses dans les terres les plus reculées. Il avait sous sa suzeraineté l’Orient et l’Occident et, entre autres pays, l’Inde, le Sindh, la Chine, l’Yémen, le Hedjaz, l’Abyssinie, le Soudan, la Syrie, la Grèce, les provinces de Diarbekr, ainsi que toutes les îles de la mer et ce qu’il y a sur la terre de fleuves illustres, tels que Seihoun et Djihân, le Nil et l’Euphrate. Il avait envoyé des courriers aux extrêmes limites de la terre pour la mettre au courant de la vérité des faits et des nouvelles de son empire ; et tous les courriers étaient revenus lui annoncer que le monde entier était dans la soumission et que les dominateurs reconnaissaient avec respect sa suprématie. De son côté, il avait étendu, sur eux tous, les bienfaits de sa générosité et les avait noyés dans les flots de sa magnanimité ; et il avait fait régner parmi eux la concorde douce et la sécurité : car magnanime il était et d’âme élevée, en vérité.
Aussi de tous les côtés affluaient vers son trône les cadeaux et les présents, ainsi que tous les tributs de la terre en large et en long. Car juste il était et aimé très fort, en vérité.
Or, le roi Omar Al-Némân avait un fils appelé Scharkân. Et Scharkân ainsi s’appelait-il parce qu’il se révélait comme un prodige d’entre les prodiges de ce temps-là, et qu’il surpassait en valeur les héros les plus courageux par lui terrassés dans les tournois, et qu’il maniait merveilleusement la lance, le glaive et le carquois. Aussi son père l’aimait-il d’un amour indépassable et sans égal et le désignait-il comme son successeur sur le trône du royaume. C’était chose certaine, en effet, qu’à peine arrivé à l’âge d’homme cet étonnant Scharkân de vingt ans avait vu, avec l’aide d’Allah, s’incliner toutes les têtes devant sa gloire, tant il avait en lui d’héroïsme et de témérité, et tant il illuminait par l’éclat de ses exploits. Car il avait déjà pris d’assaut bien des places fortes et réduit bien des contrées, et étendu sa renommée sur toute la surface de l’univers ; et il grandissait sans cesse en belle fierté et en puissance.
Mais le roi Omar Al-Némân n’avait point d’autre enfant que Scharkân. Il est vrai qu’il avait, comme le permettent le Livre et la Sunnat[2], quatre femmes légitimes ; mais l’une d’elles seulement avait été féconde et les trois autres étaient restées stériles. Et pourtant, outre ces quatre femmes légitimes qui habitaient le palais même, le roi Omar avait trois cent soixante concubines, à l’égal des jours de l’année cophte ; et chacune de ces femmes était de race différente. Il avait donné à chacune d’elles un appartement réservé et indépendant; et ces différents appartements étaient groupés en douze bâtisses, comme les mois de l’année, et tous construits dans l’enceinte même du palais ; et chacune de ces douze bâtisses contenait trente concubines, chacune dans son appartement réservé ; de la sorte il y avait trois cent soixante appartements réservés. Or, le roi Omar avait, en toute justice, consacré une nuit de l’année à chacune de ses concubines à tour de rôle ; et il couchait ainsi une seule nuit par an avec chaque concubine, qu’il ne revoyait plus que l’année suivante. Et le roi Omar ne cessa d’agir de la sorte durant un grand espace de temps ; et, d’ailleurs, durant toute sa vie. C’est pourquoi il fut réputé pour sa sagesse admirable et sa virilité.
Or, un jour, avec la permission de l’Ordonnateur de toutes choses, l’une des concubines du roi Omar devint enceinte, et sa grossesse fut bientôt connue de tout le palais, et la nouvelle en arriva au roi qui se réjouit à la limite de la joie et s’écria : « Puisse Allah faire que toute ma postérité et ma descendance soient formées seulement par des enfants mâles ! » Puis il fit inscrire sur un registre la date de la grossesse, et se mit à combler sa concubine de toutes sortes d’égards et de cadeaux.
Sur ces entrefaites, Scharkân, le fils du roi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit s’approcher le matin, et, discrète, remit son récit au lendemain.
LA QUARANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
Sur ces entrefaites, Scharkân, le fils du roi, apprit également la nouvelle de la grossesse de la concubine et fut dans un chagrin considérable, surtout en pensant que le nouveau venu pourrait lui disputer la succession au trône ; et il résolut en lui-même de supprimer sans faute l’enfant de la concubine, au cas où ce serait un enfant mâle. Voilà pour Scharkân !
Mais, pour ce qui est de la concubine, c’était une jeune esclave grecque qui s’appelait Safîa[3]. Elle avait été envoyée en présent au roi Omar par le roi des Grecs de Kaïssaria[4], avec une quantité de choses somptueuses. De toutes les jeunes esclaves du palais, c’était elle qui était de beaucoup la plus belle certainement et la plus jolie de visage et la plus fine de taille et la plus forte de cuisses et d’épaules. Avec cela elle était douée d’une intelligence fort rare et de qualités peu communes ; et elle savait, durant les nuits que le roi Omar passait maintenant avec elle, lui dire des paroles fort douces qui lui charmaient les sens et le flattaient beaucoup, des paroles mousseuses et pénétrantes, fort douces et pénétrantes. Et elle ne cessa de la sorte jusqu’à ce que fût venu le terme de sa grossesse. Elle s’assit alors sur la chaise de l’accouchement, en proie aux douleurs de l’enfantement, et se mit à implorer Allah dévotement, et Allah l’écouta sans aucun doute et à l’instant[5].
De son côté, le roi Omar chargea un eunuque de venir lui annoncer sans retard la naissance de l’enfant et son sexe ; et Scharkân, de son côté, ne manqua pas de charger un autre eunuque de ce soin. À peine Safîa eut-elle accouché, que les sages-femmes reçurent l’enfant et l’examinèrent et, ayant vu que c’était une fille, se hâtèrent de l’annoncer à toutes les assistantes et aux eunuques, disant : « C’est une fille ! Et son visage est plus brillant que la lune ! » Alors l’eunuque du roi se hâta d’aller rapporter la chose à son maître ; et l’eunuque de Scharkân courut également annoncer la nouvelle : et Scharkân s’en réjouit extrêmement.
Mais à peine les eunuques étaient-ils partis, que Safîa dit aux sages-femmes : « Oh ! attendez ! je sens que mes entrailles contiennent autre chose encore ! » Puis elle fut prise de nouveau par les « ah ! » les « ouh ! » et les douleurs de l’enfantement ; puis, avec l’aide d’Allah, elle finit par accoucher d’un second enfant. Et les sages-femmes se penchèrent vivement et examinèrent l’enfant : et c’était un enfant mâle qui ressemblait à la pleine lune, avec un front éclatant de blancheur, et des joues roses fleuries. Aussi se réjouirent fort les esclaves, les suivantes et toutes les invitées ; et, aussitôt après la délivrance de Safîa, toutes les femmes, à l’unisson, remplirent le palais de cris perçants de joie sur la note la plus aiguë, et de façon telle que toutes les autres concubines entendirent et comprirent et en séchèrent d’envie et de malaise.
Quant au roi Omar Al-Némân, à peine eut-il appris la nouvelle, qu’il en remercia Allah dans sa joie, et se leva et courut à l’appartement de Safîa, et s’approcha d’elle et lui prit la tête dans ses mains et l’embrassa sur le front. Puis il se pencha sur le nouveau-né et l’embrassa : et aussitôt toutes les esclaves frappèrent rythmiquement sur les tambours, et les joueuses d’instruments pincèrent les cordes harmonieuses, et les chanteuses chantèrent les chants de circonstance.
Cela fait, le roi ordonna de nommer le nouveau-né Daoul’makân et la fille Nôzhatou’zamân[6]. Et tous s’inclinèrent et répondirent par l’ouïe et l’obéissance.
Puis le roi choisit les nourrices et les servantes pour les deux nourrissons, ainsi que les esclaves et les suivantes ; puis il fit porter à tout le monde du palais les vins, les boissons et les parfums, et tant d’autres choses que la langue serait incapable de les énumérer.
Lorsque les habitants de Baghdad eurent appris la nouvelle de cette double naissance, ils décorèrent et illuminèrent la ville et firent de grandes démonstrations de contentement. Puis vinrent les émirs, les vizirs et les grands du royaume et ils présentèrent leurs hommages et félicitations au roi Omar Al-Némân pour la naissance de son fils Daoul’makân et de sa fille Nôzhatou. Et le roi les en remercia et leur fit présent de robes d’honneur et les combla de faveurs et de grâces, et fit à tous les assistants de grandes largesses, aussi bien aux notables qu’au commun du peuple. Et il ne cessa de la sorte jusqu’à ce que quatre années se fussent écoulées. Et pendant tout ce temps, il ne laissait pas passer un seul jour sans envoyer prendre des nouvelles de Safîa et des enfants ; et il ne manqua pas d’envoyer à Safîa une quantité prodigieuse de bijoux, d’orfèvreries, de robes et de soieries ; et de l’or et de l’argent, et des merveilles ; et il prit bien soin de confier l’éducation des enfants et leur garde aux plus dévoués et aux plus avisés d’entre ses serviteurs.
Tout cela ! et Scharkân, qui était au loin à guerroyer et à combattre, à prendre des villes et à s’illustrer dans les batailles, à lutter et à vaincre les héros les plus valeureux, n’avait seulement appris que la naissance de sa sœur Nôzhatou, par la bouche de l’eunuque ! Mais, quant à la naissance de son frère Daoul’makân, survenue après le départ de l’eunuque, nul n’avait songé à lui en faire part.
Un jour d’entre les jours, comme le roi Omar Al-Némân était assis sur son trône, les chambellans du palais entrèrent et baisèrent la terre entre ses mains et dirent : « Ô roi, voici que nous arrivent des envoyés du roi Aphridonios, souverain des Roum et de Constantinia la Grande[7]. Et ils souhaitent être reçus par toi en audience et présenter leurs hommages entre tes mains. Si donc tu veux leur en donner la permission, nous les ferons entrer ; sinon, ton refus pour eux sera sans réplique ! » Et le roi donna la permission.
Lorsque les envoyés entrèrent, le roi les reçut avec bonté, les fit s’approcher, leur demanda des nouvelles de leur santé et les interrogea sur le motif de leur venue. Alors ils baisèrent la terre entre ses mains et dirent :
« Ô roi grand et vénérable, à l’âme haut placée et généreuse infiniment, sache que celui qui vers toi nous a envoyés est le roi Aphridonios, maître du pays de Grèce et d’Ionie et de toutes les armées des contrées chrétiennes, et dont le siège est sur le trône de Constantinia. Il nous charge de t’aviser qu’il vient d’entreprendre une guerre terrible contre un tyran féroce, le roi Hardobios, maître de Kaïssaria.
« La cause de cette guerre est la suivante : un chef de tribus arabes avait trouvé, dans un pays nouvellement conquis, un trésor des âges reculés, du temps d’El-Iskandar aux Deux Cornes[8] ; ce trésor contenait des richesses incalculables et dont l’estimation même nous serait impossible ; mais, entre autres merveilles, il contenait trois gemmes arrondies, aussi grosses que des œufs d’autruche, arrondies et blanches, pierreries sans tare et sans défaut et défiant en beauté et en valeur toutes les pierreries de la terre et de l’eau. Ces trois gemmes précieuses étaient percées en leur milieu pour être enfilées à un cordon et servir de collier. Elles portaient, gravées en caractères ioniens, des inscriptions mystérieuses ; mais on savait qu’elles avaient en elles de très nombreuses vertus dont l’un des moindres effets était de préserver toute personne qui porterait l’une d’elles au cou de toutes les maladies et notamment de la fièvre et des échauffements. Les nouveau-nés surtout étaient sensibles à ces vertus.
« Aussi, lorsque le chef arabe se fut rendu compte de ces effets merveilleux, et qu’il eut soupçonné toutes les autres vertus mystérieuses, il pensa que c’était là pour lui la meilleure occasion de gagner les bonnes grâces de notre roi, et il se disposa immédiatement à lui envoyer en cadeau les trois gemmes précieuses ainsi qu’une grande partie du merveilleux trésor. Il fit donc préparer deux navires, l’un chargé des richesses et des trois gemmes précieuses destinées en cadeau à notre roi Aphridonios, et l’autre chargé des hommes destinés à escorter ce précieux trésor et à le préserver des attaques des voleurs ou des ennemis. Pourtant le chef arabe était sûr que personne n’oserait s’attaquer soit à lui directement soit aux choses envoyées par lui, et destinées à notre puissant roi Aphridonios, d’autant plus que la route que devaient suivre les navires était dans la mer au bout de laquelle se trouvait Constantinia.
« Aussi, à peine les deux navires furent-ils prêts qu’ils partirent, et mirent à la voile de notre côté. Mais un jour qu’ils avaient relâché dans une rade, non loin de notre pays, soudain des soldats grecs de notre vassal, le roi Hardobios de Kaïssaria, les assaillirent et en enlevèrent tout ce qu’il y avait de richesses, de trésors accumulés et de merveilleuses choses, et, entre autres, les trois gemmes précieuses ; puis ils tuèrent tous les hommes et s’emparèrent des navires.
« Lorsque cet acte fut parvenu à la connaissance de notre roi, il envoya immédiatement contre le roi Hardobios un corps d’armée qui fut anéanti ; il envoya alors un second corps qui fut également anéanti. Alors notre roi Aphridonios entra dans une grande fureur et jura qu’il se mettrait lui-même à la tête de toutes ses armées réunies et qu’il ne s’en retournerait qu’après avoir détruit la ville de Kaïssaria, ravagé tout le royaume de Hardobios et ruiné de fond en comble tous les bourgs sous sa dépendance.
« Or maintenant, ô sultan plein de gloire, nous venons réclamer ton assistance et solliciter ton efficace et puissante alliance ! Et en nous aidant de tes forces et de tes soldats, tu ne peux qu’augmenter en gloire et t’illustrer en exploits.
« Et voici que notre roi nous a chargés de pesants cadeaux de toutes les espèces en hommage à ta générosité, et qu’il te prie instamment de lui accorder la faveur de les voir de bon œil et de les accepter d’un cœur magnanime ! »
À ces paroles, les envoyés se turent et se prosternèrent et baisèrent la terre entre les mains du roi Omar Al-Némân.
Et voici en quoi consistaient ces présents du roi Aphridonios, maître de Constantinia…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit poindre le matin, et, discrètement, se tut.
LA QUARANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
Et voici en quoi consistaient ces présents du roi Aphridonios, maître de Constantinia.
Il y avait cinquante jeunes filles vierges, belles d’entre les plus belles des filles de la Grèce. Il y avait cinquante jeunes garçons choisis d’entre les mieux faits du pays des Roum ; et chacun de ces merveilleux garçons était vêtu d’une ample robe aux larges manches, toute en soie à dessins d’or avec des figures en couleur, et une ceinture d’or à ciselures d’argent où venait s’attacher une double jupe inégale de brocart et de velours ; chacun d’eux avait à ses oreilles un anneau d’or d’où pendait une blanche perle ronde valant plus de mille poids titrés d’or. Et les jeunes filles, d’ailleurs, portaient également sur elles d’incalculables somptuosités.
Voilà pour les deux présents principaux. Mais il y avait d’autres cadeaux d’une grande richesse qui ne déparaient en rien les cadeaux énumérés.
Aussi le roi Omar les accepta-t-il, non sans plaisir, et ordonna-t-il de rendre aux envoyés tous les égards dûs. Puis il fit assembler ses vizirs pour avoir leur avis sur la demande de secours du roi Aphridonios de Constantinia. Alors d’entre les vizirs se leva un vieillard vénérable, respecté de tous et aimé également ; et il était le grand-vizir et se nommait Dandân.
Donc le grand-vizir Dandân dit :
« Il est vrai, ô sultan de gloire, que ce roi Aphridonios, maître de Constantinia la Grande, est un chrétien, mécréant et infidèle à la loi d’Allah et de son Prophète (que sur lui soient la prière et la paix !) et que son peuple est un peuple de mécréants. Et celui contre lequel il nous demande secours est également un infidèle et un mécréant. Aussi leurs affaires ne regardent qu’eux seuls et ne sauraient intéresser et toucher les Croyants ! Mais, tout de même, je t’engage à accorder ton alliance au roi Aphridonios et à lui envoyer une armée nombreuse à la tête de laquelle tu mettrais ton fils Scharkân, qui justement vient de rentrer de ses expéditions glorieuses. Et cette idée que je te propose est bonne pour deux raisons : la première est que le roi des Roum vient de t’envoyer ses ambassadeurs chargés de cadeaux que tu as acceptés, et il te demande aide et protection ; la seconde est que, comme nous n’avons rien à craindre de ce petit roi de Kaïssaria, en aidant le roi Aphridonios à vaincre son ennemi tu retireras de cette action d’excellents résultats et tu seras considéré comme le véritable vainqueur. Et cet exploit sera connu de tous les pays et parviendra jusqu’en Occident. Et alors les rois de l’Occident rechercheront ton amitié et t’enverront des porteurs nombreux de présents de toutes sortes et de cadeaux extraordinaires. »
Lorsque le sultan Omar Al-Némân eut entendu les paroles de son grand-vizir Dandân, il en exprima un grand contentement, les trouva grandement dignes d’approbation et lui donna une robe d’honneur en lui disant : « Tu es bien fait, en vérité, pour être l’inspirateur et le conseil des rois ! Aussi ta présence est-elle de toute nécessité à la tête de l’armée, à l’avant-garde ; et, quant à mon fils Scharkân, il commandera seulement l’arrière-garde. »
Là-dessus, le roi Omar fit venir son fils Scharkân, lui soumit toute la question, lui raconta ce qu’avaient dit les envoyés et ce qu’avait proposé le grand-vizir Dandân, et lui recommanda de faire ses préparatifs de départ et de ne pas oublier de distribuer aux soldats les largesses ordinaires et les donations, après avoir choisi ces soldats un à un d’entre les meilleurs de toute l’armée, et constitué de la sorte un corps de dix mille cavaliers au harnachement complet et durs aux privations et aux fatigues. Et Scharkân se soumit avec respect aux paroles de son père Omar Al-Némân, et se leva aussitôt et choisit d’entre ses soldats dix mille cavaliers pleins de superbe, auxquels il distribua largement de l’or et des richesses, et il leur dit : « Maintenant, je vous donne trois jours entiers de repos et de liberté ! » Et les dix mille cavaliers baisèrent la terre entre ses mains, en soumission à sa volonté, et sortirent, comblés de largesses, se restaurer et s’équiper élégamment pour le départ.
Scharkân entra alors dans la salle où se trouvaient les coffres du trésor et les réserves d’armes et de munitions, et choisit les plus belles armes aux niellures d’or et aux inscriptions sur ivoire et sur ébène, et prit tout ce qui tentait son goût et sa préférence. Puis il se dirigea vers les écuries du palais, où se trouvaient réunis les plus beaux chevaux du Nedjed et de l’Arabie, qui portaient chacun sa généalogie attachée à son cou, dans un sachet de cuir ouvragé de soie et d’or et ornementé de pierres de turquoise. Là, il choisit les chevaux appartenant aux races les plus fameuses, et, pour lui-même, il prit un cheval bai brun à la robe lustrée, aux yeux à fleur de tête, aux larges sabots, à la queue haute superbement et aux oreilles fines comme celles de la gazelle. Et ce cheval était un cadeau fait à Omar Al-Némân par un cheikh d’une puissante tribu arabe ; et c’était un cheval de race seglaoui-jedrân[9].
Et lorsque les trois jours furent écoulés, les soldats s’assemblèrent en ordre hors de la ville ; et sortit également le roi Omar Al-Némân pour faire ses adieux à son fils Scharkân et à son grand-vizir Dandân. Et il s’approcha de Scharkân, qui baisa la terre entre ses mains, et il lui fit don de sept coffres entièrement remplis de monnaie, et lui recommanda de demander toujours conseil au sage vizir Dandân. Et Scharkân écouta respectueusement et promit la chose à son père. Alors le roi se tourna vers le vizir Dandân et lui recommanda beaucoup son fils Scharkân et les soldats de Scharkân. Et le vizir baisa la terre entre ses mains et répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Puis Scharkân, devant le roi et le vizir, monta son cheval seglaoui-jedrân, et fit défiler devant lui les principaux chefs de son armée et ses dix mille cavaliers. Puis il baisa la main du roi Omar Al-Némân, et, accompagné du vizir Dandân, il lança son cheval au galop. Et l’on poussa en avant, et l’on partit au milieu du roulement des tambours de guerre, du son des fifres et des clairons. Et au-dessus d’eux s’éployaient les étendards et les signaux, et battaient au vent les bannières et les drapeaux.
Et les envoyés servaient de guides. Et l’on se mit en marche et on continua de la sorte durant tout ce jour, puis tout le jour suivant et les autres jours, et cela pendant vingt jours. Et l’on ne s’arrêtait que la nuit, pour le repos. Et l’on finit par arriver à une large vallée couverte de forêts et pleine d’eau murmurante. Et, comme c’était la nuit, Scharkân donna l’ordre du campement et fit savoir que le repos serait de trois jours. Et descendirent les cavaliers et dressèrent les tentes et se dispersèrent de tous côtés, à droite et à gauche. Et le vizir Dandân fit placer sa tente au milieu même de la vallée, et tout près de lui les tentes des envoyés du roi Aphridonios de Constantinia.
Quant à Scharkân, il attendit que tous les soldats fussent partis, et ordonna à ses gardes de le laisser seul et d’aller auprès du vizir Dandân. Puis il lâcha les rênes en toute liberté à son coursier, et voulut reconnaître lui-même toute la vallée et mettre ainsi en pratique les conseils de son père, qui lui avait soigneusement recommandé de prendre toutes les précautions en approchant du pays des Roum, ennemis ou amis. Et il ne cessa, toujours sur le dos de son cheval, de marcher tout autour de la vallée jusqu’à ce que le quart de la nuit fût écoulé. Alors le sommeil lui tomba pesamment sur les paupières, et il fut dans l’impossibilité d’aller au galop. Et, comme il avait l’habitude de dormir sur le dos de son cheval, il laissa son cheval aller au pas et s’endormit.
Le cheval se mit ainsi à marcher jusqu’à minuit, et soudain, au milieu d’une solitude boisée, il s’arrêta et frappa violemment du sabot contre terre. Et Scharkân s’éveilla et se vit au milieu des arbres de la forêt, qui était en ce moment éclairée par la clarté de la lune. Et Scharkân fut extrêmement ému de se trouver au milieu de cet endroit solitaire ; mais il dit à haute voix la parole qui vivifie : « Il n’y a de puissance et de force qu’en Allah le Très-Haut ! » Et aussitôt il sentit son âme s’apaiser et ne plus craindre les bêtes sauvages de la forêt, alors qu’en face la lune miraculeuse argentait la clairière ; et si belle en devenait la clairière qu’elle semblait l’une d’entre les clairières du paradis. Et Scharkân entendit, comme près de lui, des paroles délicieuses à l’excès et une voix parfaitement belle et des rires. Et quels rires ! Les humains, à les entendre, en seraient devenus éperdus de délicate volupté, éperdus du désir de les boire sur la bouche même et de mourir.
Alors Scharkân sauta à bas de son cheval et s’enfonça entre les arbres à la recherche des voix ; et il marcha jusqu’à ce qu’il fût arrivé sur le bord d’une rivière blanche à l’eau joyeuse et courante et chantante ; et à ce chant de l’eau répondaient la voix naturelle des oiseaux et les plaintes ivres des gazelles et l’assentiment parlé de tous les animaux ; et tous ensemble formaient un chant d’harmonie plein d’épanouissement. Et l’endroit lui-même était brodé et semé de fleurs et de végétaux, comme dit le poète :
N’est belle la terre, ô ma folie, que colorée de ses fleurs, et n’est belle l’eau que mariée côte à côte avec les fleurs !
Gloire à celui qui créa la terre et les fleurs de la terre et les eaux de la terre, et te plaça, ô ma folie, près des fleurs et de l’eau sur la terre !
Et Scharkân regarda et vit sur la rive opposée s’élever la façade, éclairée par la lune, d’un monastère blanc dominé par une haute tour imposante qui s’élançait dans les airs. Et ce monastère rafraîchissait son pied dans les eaux vives de la rivière ; et, en face, une pelouse s’étendait, où étaient assises dix jeunes femmes qui en entouraient une onzième. Pour les dix femmes, elles étaient comme des lunes et vêtues légèrement de vêtements amples et doux, et toutes étaient vierges et merveilleuses, comme le disent d’ailleurs ces vers du poète :
Il luit ! Et voici que la pelouse luit ! Et c’est de tout ce qu’elle contient de blanches filles à la chair candide, de filles candides et blanches à la haute lueur ! Et la pelouse en tressaille et frémit !
De belles filles surnaturelles ! Une taille mince, pliante. Une démarche souple et savante et mélodieuse. Et la pelouse en tressaille et frémit.
Éparse la chevelure, retombante sur le col la chevelure, telle la grappe sur le cep. Blondes ou brunes, grappes blondes, grappes brunes ! ô chevelures !
Attrayantes filles, ô séductrices ! Et vos yeux ! La tentation de vos yeux, les flèches de vos yeux, et ma mort !
Quant à celle qu’entouraient les dix jeunes esclaves blanches, elle était comme la pleine lune, tout à fait. Ses sourcils étaient splendidement arqués, son front tel la première lueur du matin, ses paupières frangées de cils veloutés et recourbés, et les cheveux de ses tempes frisés en courbes délicieuses ; et elle était aussi parfaite de qualités que le dépeint le poète en ces vers :
Fière elle me regarde, mais quels regards admirables ! Et sa taille droite et dure ! Ô lances droites et dures, courbez-vous de confusion !
Elle s’avance ! La voici ! Vois ses joues, les fleurs roses de ses joues ! Je connais leur douceur et toute leur fraîcheur !
Vois de ses cheveux la boucle noire s’arrondir sur la candeur de son front ! C’est l’aile de la nuit qui se repose sur la sérénité du matin !
Et c’était celle dont Scharkân avait entendu la voix. Et elle parlait maintenant et elle disait en arabe, tout en riant, aux jeunes esclaves qui étaient entre ses mains : « Par le Messie ! ce que vous faites là, petites dévergondées, est chose pas jolie et horrible même ! Si l’une de vous recommence encore, je la lierai avec sa ceinture et je la battrai sur les fesses ! » Puis elle rit et dit : « Voyons, petites filles, qui de vous pourra me vaincre à la lutte ! Que celles d’entre vous qui veulent bien se lèvent et viennent avant le coucher de la lune et l’apparition du matin ! »
Alors l’une des jeunes filles se leva et voulut essayer de lutter avec sa maîtresse ; mais elle fut vite terrassée ; puis une deuxième et une troisième, et toutes également. Et comme la jeune femme triomphait et, pour prix de son triomphe, allait faire avec les jeunes filles ce qui devait être fait, soudain, de la forêt, sortit une vieille femme qui s’approcha du groupe gentil des jeunes lutteuses et s’adressa à la jeune victorieuse et lui dit : « Que vas-tu faire, ô libertine perverse, avec ces jeunes filles ? Et penses-tu donc avoir remporté un si beau triomphe en terrassant des jeunes filles sans force ? Si vraiment tu sais lutter, me voici devant toi ! Je suis vieille, mais je puis encore être ta maîtresse ! Viens donc ! à la lutte ! » Alors la jeune victorieuse, quoique devenue pleine de fureur, se contint et sourit et dit à la vieille : « Ô ma maîtresse Mère-des-Calamités, par le Messie ! veux-tu vraiment lutter avec moi, ou bien as-tu seulement voulu plaisanter ? » La vieille répondit : « Pas du tout ! c’est sérieux. »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUARANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la vieille Mère-des-Calamités dit : « Pas du tout ! c’est sérieux. » Alors la belle victorieuse dit : « Ô ma maîtresse Mère-des-Calamités, si tu es vraiment de force à lutter, mon bras t’éprouvera ! » Elle dit, et bondit vers la vieille que la colère étrangla à ces paroles, et dont tous les poils du corps se dressèrent comme les épines du hérisson. Et la vieille dit : « Par le Messie ! Nous ne lutterons ensemble que complètement nues ! » Et la vieille libertine se dévêtit promptement de tous ses habits et défit son caleçon qu’elle rejeta loin d’elle, et s’entoura seulement la taille d’un mouchoir, au-dessus du nombril ; et elle apparut ainsi dans toute l’horreur de sa laideur, et elle ressemblait à quelque serpent tacheté de noir et de blanc. Puis elle se tourna vers la jeune femme et lui dit : « Qu’attends-tu donc pour faire comme moi ? »
Alors la jeune femme lentement s’étira et un à un enleva délicatement ses habits, et en dernier lieu son caleçon de soie immaculée. Et alors, d’en dessous, moulées dans le marbre, ses cuisses apparurent dans leur gloire avec, au-dessus d’elles, de lait et de cristal, un monticule doux, éclatant, arrondi, cultivé, et un ventre aromatique aux fossettes roses et dégageant une délicatesse de musc, tel un parterre d’anémones ; et une gorge ornée de deux grenades jumelles, gonflées superbement et couronnées de leur bouton.
Et soudain les deux lutteuses s’enlacèrent en se courbant.
Tout cela ! et Scharkân regardait, d’une part, la laideur de la vieille, et il en riait ; et, de l’autre, les perfections de la jeune lutteuse aux membres d’harmonie. Et il leva la tête vers le ciel et demanda fervemment à Allah la victoire de la jeune sur la vieille.
Et voici que, du premier entrelacement, légère la jeune lutteuse se dégagea et de sa main gauche saisit la vieille par le cou et enfonça sa main droite dans la fente de ses cuisses, et la souleva en l’air et la rejeta à ses pieds par terre, où la vieille retomba lourdement sur le dos, en se tordant. Et du coup ses jambes furent projetées en l’air et découvrirent dans toute leur horreur risible les détails poilus de sa peau ridée. Alors la vieille lança deux terribles pets dont l’un souleva un nuage de poussière et dont l’autre monta en colonne fumante vers le ciel. Et la lune en haut éclairait toute la scène !
Alors Scharkân se mit à rire considérablement et en silence, et tellement qu’il tomba à la renverse. Mais il se releva et se dit : « Vraiment cette vieille mérite bien ce nom de Mère-des-Calamités ! C’est, je le vois, une chrétienne, comme, d’ailleurs, la jeune victorieuse et les dix autres femmes également. » Puis il s’approcha un peu plus de l’endroit de la lutte, et vit la jeune lutteuse jeter un grand voile de soie fine sur la nudité de la vieille et l’aider à remettre ses habits et lui dire : « Ô ma maîtresse, excuse-moi, car, si j’ai lutté avec toi, c’était pour déférer à ta demande ; mais tout ce qui s’en est suivi n’est pas de ma faute ; et si tu es tombée, c’est que tu m’as glissé des mains. Mais, grâce à Allah, tu n’as aucun mal. » Mais la vieille ne répondit rien, et, pleine de confusion, s’éloigna rapidement et disparut dans le monastère. Et sur la pelouse il n’y avait plus que le groupe des dix jeunes filles entourant leur jeune maîtresse.
Et Scharkân dit en son âme : « Quelle que soit la destinée, elle sert toujours à quelque chose ! Il était écrit que je devais m’endormir sur mon cheval et me réveiller ici-même, et cela pour ma bonne chance. Car j’espère bien que cette désirable lutteuse aux muscles parfaits et ses dix non moins enivrantes compagnes vont servir de pâture au feu de mon désir ! » Et il remonta sur son cheval seglaoui-jedrân et le poussa dans la direction de la pelouse ; et il tenait en l’air son sabre dégainé ; et le cheval partit rapide comme le trait lancé par l’arc bandé d’une puissante main. Et voici Scharkân sur la pelouse, s’écriant : « Allah est le seul grand ! »
À cette vue, la jeune femme vivement se leva, courut vers la rive du fleuve qui était large de six bras, et d’un bond agile fut sur la rive opposée, debout sur ses deux pieds. Et, d’une voix haute mais fine, elle s’écria : « Qui donc es-tu, toi qui oses ainsi venir troubler nos ébats solitaires et qui ne crains pas de fondre sur nous l’épée haute, comme un soldat d’entre les soldats ? Dis-nous tout de suite d’où tu viens et où tu vas ; et sois véridique dans tes paroles, car le mensonge te sera nuisible ; et sache bien que tu es dans un endroit d’où sortir sauf est pour toi une chose fort douteuse ; car il me suffit de jeter un seul cri pour que tout de suite accourent à notre aide quatre mille guerriers chrétiens, accompagnés de leurs chefs ! Dis-nous donc ce que tu veux. Et si tu es simplement égaré dans la forêt, nous te ferons retrouver ta route. Parle ! »
Lorsque Scharkân eut entendu les paroles de la belle lutteuse, il lui dit : « Je suis un homme étranger, un musulman d’entre les musulmans. Je ne me suis point égaré, au contraire ! Je suis simplement à la recherche de quelque butin de chair jeune capable de rafraîchir le feu de mon désir, cette nuit, à la clarté de la lune ! Et justement voici dix jeunes esclaves qui, par Allah ! me conviennent fort et que je satisferai bien, tout à fait ! Et si elles sont contentes, je les emmènerai avec moi près de mes amis. » Alors la jeune femme dit : « Insolent soldat ! sache que cette pâture dont tu parles n’est pas encore prête à et tomber entre les mains ! Et, d’ailleurs, tel n’a pas été ton but, et, malgré mon avis, tu viens de mentir ! » Il répondit : « Ô dame, heureux alors celui qui peut se contenter, pour tout bien, d’Allah seulement, et qui n’a point en lui d’autre désir ! » Elle dit : « Par le Messie ! je devrais appeler à moi les guerriers et te faire prendre par eux ! Mais j’aime compatir au sort des étrangers, surtout quand, comme toi, ils sont jeunes et attrayants. Tu parles de pâture à tes désirs, eh bien ! je consens ; mais à condition que tu descendes de ton cheval et que tu jures, par ta foi, que tu ne te serviras point de tes armes contre nous et que tu consentiras à engager un combat singulier avec moi. Si tu viens à me terrasser, moi et toutes ces jeunes filles nous t’appartiendrons, et tu pourras même m’emporter sur ton cheval. Mais si tu es le vaincu, tu seras un esclave à mes ordres, toi-même. Jure donc par ta religion ! »
Et Scharkân, en lui-même, pensa : « Ignore-t-elle donc, cette jeune fille, le degré de ma force, et que la lutte avec moi est inégale ? » Puis il lui dit : « Je te promets, ô jeune fille, que je ne toucherai point à mes armes, et que je ne lutterai avec toi que de la façon dont tu voudras lutter. Si je suis vaincu, j’ai assez d’argent pour payer ma rançon ; mais si je suis le vainqueur, alors, te posséder toi-même, quel butin digne d’un roi ! Je te le jure donc par les mérites du Prophète ! — que sur lui soient la prière et la paix d’Allah ! » Et la jeune fille dit : « Jure aussi par Celui qui a soufflé les âmes dans les corps et a donné ses lois aux humains ! » Et Scharkân fit le serment. Alors la jeune fille prit son élan, de nouveau, et, d’un bond agile, franchit le fleuve et revint sur la rive, près de la pelouse. Et toute rieuse, elle dit à Scharkân : « Vraiment je serai peinée de te voir partir, ô seigneur, mais c’est pour ton bien : pars donc ! car voici le matin qui s’avance et les guerriers vont venir et tu tomberas entre leurs mains. Car comment pourrais-tu résister à mes guerriers, toi qu’une seule de mes femmes ferait ployer et terrasserait ? » Et sur ces paroles, la jeune lutteuse voulut s’éloigner dans la direction du monastère, sans engager la lutte dont elle avait parlé.
Alors Scharkân fut à la limite de l’étonnement et voulut essayer de retenir la jeune femme, et lui dit : « Ô ma maîtresse, dédaigne, si tu veux, de lutter avec moi ; mais de grâce ! ne t’éloigne pas, et ne me laisse pas ici tout seul, moi l’étranger plein de cœur ! » Alors elle sourit et lui dit : « Et que veux-tu, ô jeune étranger ? Parle et ton souhait sera exaucé ! » Il répondit : « Comment, après avoir foulé ton sol, ô ma maîtresse, et m’être dulcifié de la douceur de ta gentillesse, m’éloigner sans avoir goûté les mets de ton hospitalité ! Et me voici devenu un esclave d’entre tes esclaves ! » Elle répondit, en appuyant du sourire : « Tu dis vrai, jeune étranger, il n’y a que le cœur dur et peu généreux qui refuse l’hospitalité ! Fais moi donc la grâce, seigneur, d’accepter la mienne, et ta place sera sur ma tête et dans mes yeux ! Remonte donc sur ton cheval et marche à côté de moi en suivant la rive du fleuve : dès ce moment, tu es mon hôte ! » Alors Scharkân fut plein de joie et remonta sur son cheval et se mit à marcher à côté de la jeune femme, suivi de toutes les autres, jusqu’à ce qu’ils fussent tous arrivés à un pont-levis en bois de peuplier, qui s’élevait et s’abaissait au moyen de chaînes et de poulies et était jeté sur le fleuve en face de la porte principale du monastère. Alors Scharkân descendit de cheval, et la jeune femme appela l’une de ses suivantes et lui dit dans le parler grec : « Prends le cheval et conduis-le aux écuries, et donne l’ordre de ne le laisser manquer de rien. » Alors Scharkân dit à la jeune femme : « Ô souveraine de beauté, voici que tu deviens pour moi une chose sacrée, et doublement sacrée à cause de ta beauté et à cause de ton hospitalité. Veux-tu, sans plus avancer, revenir sur tes pas et m’accompagner au pays des musulmans, dans ma ville, Baghdad, où tu verras bien des choses merveilleuses et tant d’admirables guerriers ! Et alors tu sauras qui je suis. Viens, jeune chrétienne, allons à Baghdad ! » À ces paroles de Scharkân, la belle lui dit : « Par le Messie ! je te croyais sensé, ô jeune homme ! C’est donc mon enlèvement que tu souhaites ? et c’est à Baghdad que tu veux m’emmener, dans cette ville où je tomberais entre les mains de ce terrible roi Omar Al-Némân qui a, pour son lit, trois cent soixante concubines qui habitent douze palais, juste selon le nombre des jours et des mois de l’année. Et je servirais une nuit à ses désirs, pour être ensuite délaissée ; et il jouirait ainsi farouchement de ma jeunesse ! Ce sont là des mœurs par vous autres admises, ô musulmans ! Ne parle donc point de la sorte, et n’espère point me persuader. Serais-tu Scharkân en personne, le fils du roi Omar Al-Némân, dont les armées sont, je le sais, sur notre territoire, que je ne t’écouterais pas ! Je sais, en effet, que dix mille cavaliers de Baghdad, ayant à leur tête Scharkân et le vizir Dandân, traversent en ce moment les frontières de notre pays pour aller rejoindre l’armée du roi Aphridonios de Constantinia. Et, si je le voulais, j’irais moi toute seule au milieu de leur camp, et de ma propre main je tuerais Scharkân et le vizir Dandân : car ce sont pour nous des ennemis. Et maintenant, viens avec moi, ô étranger ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUARANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la jeune femme dit à Scharkân, qu’elle était loin de connaître pour tel : « Et maintenant, viens avec moi, ô étranger ! » Et Scharkân, en entendant ces paroles, fut extrêmement mortifié d’apprendre l’inimitié vouée par cette jeune femme à lui, au vizir Dandân et à tous les siens. Et, certes, s’il n’avait écouté que sa mauvaise inspiration, il se serait fait connaître et se serait emparé de la jeune femme ; mais il en fut empêché par les devoirs de l’hospitalité et surtout par l’ensorcellement de sa beauté ; et il récita cette strophe :
« Tu commettrais tous les délits, que ta beauté, ô jeune fille, est là pour les effacer et en faire un délice de plus ! »
Alors elle traversa le pont-levis lentement et se dirigea vers le monastère. Et Scharkân marchait derrière elle, et la regardait ainsi de dos, et voyait sa croupe somptueuse monter et descendre comme des vagues de la mer. Et il regretta que le vizir Dandân ne fût pas là pour s’émerveiller avec lui de cette splendeur. Et il pensa à ces vers du poète qu’il se récita :
« Regarde la pureté de ses flancs argentés, et tu verras la pleine lune apparaître à tes yeux émerveillés.
Regarde la rondeur de sa croupe bénie, et tu verras, dans le ciel, deux croissants juxtaposés ! »
Et ils arrivèrent à un grand portail avec des arceaux en marbre transparent. Et ils entrèrent et arrivèrent à une longue galerie qui courait le long de dix arceaux soutenus par des colonnes d’albâtre. Et au milieu de chaque arceau était suspendue une lampe de cristal de roche, aussi éclatante que le soleil. Là, vinrent au-devant de leur maîtresse des jeunes suivantes qui tenaient des flambeaux allumés, d’où se dégageaient des odeurs aromatiques. Et elles avaient le front ceint de bandeaux de soie diadémés de pierreries de toutes les couleurs. Et elles ouvrirent la marche et conduisirent les deux jeunes gens jusque dans la salle principale du monastère. Et Scharkân vit de magnifiques coussins rangés en ordre contre les murs, tout autour de la salle ; et, aux portes et sur les murs, de grands rideaux surmontés chacun d’une couronne d’or ; et tout le sol était recouvert de précieux marbres de couleur finement découpés ; et au milieu de la salle il y avait un bassin où l’eau coulait par vingt-quatre embouchures d’or ; et l’eau tombait musicalement avec des scintillements de métal et d’argent. Au fond de la salle, il y avait un lit tout tendu de soie comme il n’en existe que dans le palais des rois.
Alors la jeune femme dit à Scharkân : « Monte, seigneur, sur ce lit, et laisse toi faire. » Et Scharkân monta sur le lit, tout disposé à se laisser faire. Et elle sortit de la salle et laissa Scharkân seul avec les jeunes esclaves au front diadémé de pierreries.
Mais comme elle tardait à revenir, Scharkân demanda aux jeunes filles où elle était allée. Elles répondirent : « Mais elle est allé dormir. Et nous voici devant toi pour te servir, selon ses ordres. » Et Scharkân ne sut que penser. Alors les jeunes filles lui apportèrent, sur de grands plateaux orfévrés, toutes sortes de mets admirables et de toutes les espèces ; et il en mangea bien, et jusqu’à satiété. Après cela, on lui présenta l’aiguière d’or et la cuvette d’or aux rehaussements d’argent ; et il laissa sur ses mains couler l’eau parfumée à la rose et aux fleurs d’oranger. Mais il commença aussi à se soucier de ses soldats, qu’il avait laissés seuls dans la vallée, et à se réprimander fort d’avoir oublié les conseils de son père ; et sa peine s’accroissait encore du fait qu’il ignorait tout de la jeune hôtesse du palais et du lieu où il se trouvait. Et il se récita alors ces strophes du poète :
« Si j’ai perdu ma fermeté et mon courage, ma faute est légère, car j’ai été trompé et trahi par tant de choses !
Délivrez-moi, ô mes amis, de ma douleur, de la douleur d’aimer qui m’a fait perdre ma force et toute ma gaîté !
Voici que mon cœur s’est égaré dans l’amour, s’est égaré et a fondu. Il a fondu, et je ne sais à qui jeter mon cri de détresse ! »
Lorsque Scharkân eut fini de réciter ces strophes, il s’endormit, et ne se réveilla que le matin. Et il vit entrer dans la salle une troupe de beauté, composée de vingt jeunes filles comme des lunes qui entouraient leur maîtresse ; et elle était au milieu d’elles, telle la lune entre les étoiles. Elle était vêtue d’étoffes de soie ornées de dessins et de figures, royalement ; sa taille paraissait encore plus fine et ses hanches plus somptueuses sous la ceinture qui les tenait captives ; et c’était une ceinture d’or filigrané, toute diamantée de pierreries ; et de la sorte, avec ces hanches et cette taille, elle était telle une masse de cristal diaphane où se ploierait en son milieu, délicatement, un fin rameau d’argent. Les seins étaient plus superbes et plus saillants. Quant à ses cheveux, ils étaient retenus par un filet de perles fines emmêlées de toutes les espèces de pierreries. Et, elle-même, entourée des vingt jeunes filles à sa droite et à sa gauche, qui soulevaient les traînes de sa robe, s’avançait, toute merveilleuse, en se balançant.
À cette vue, Scharkân sentit sa raison s’envoler d’émotion ; et il oublia et ses soldats et son vizir et les conseils de son père ; et il se leva debout sur ses deux pieds, aimanté par tant de charmes, et récita ces strophes :
« Lourde de hanches, penchée, balancée ; les membres souples et fuselés ; la gorge douce et glissante et dorée ;
Tu recèles, ô très belle, tes trésors du dedans ! Moi, j’ai des yeux aigus qui percent toute opacité. »
Alors la jeune femme vint tout près de lui et le regarda longuement, longuement. Puis soudain elle lui dit : « Tu es Scharkân ! Je n’en doute plus. Scharkân, fils d’Omar Al-Némân, ô héros, ô magnanime, voici que tu éclaires cette demeure et l’honores ! Dis, ô Scharkân, ta nuit a-t-elle été tranquille et bonne ? Parle-moi ! Et surtout ne feins plus, et laisse le mensonge aux maîtres du mensonge ; car la feinte et le mensonge ne sont point les attributs des rois, et surtout du plus grand d’entre les rois ! »
Lorsque Scharkân eut entendu ces paroles, il comprit qu’il ne lui servirait guère de nier, et répondit : « Ô toi, ô très douce, je suis Scharkân ibn-Omar Al-Némân. Je suis celui qui souffre de la destinée qui l’a jeté sans défense et tout meurtri entre tes mains ! Fais de moi selon ton gré et tes désirs, ô inconnue aux yeux noirs ! » Alors l’inconnue abaissa un instant ses yeux vers la terre, et réfléchit ; puis, regardant Scharkân elle lui dit : « Apaise ton âme et adoucis tes regards ! oublies-tu que tu es mon hôte et qu’entre nous il y eut le pain et le sel ? Et oublies-tu, en outre, qu’entre nous il y eut déjà mainte causerie amicale ? Tu es donc désormais sous ma protection et tu bénéficies de ma loyauté. Sois donc sans crainte, car, par le Messie ! si toute la terre se ruait contre toi, tu ne serais pas touché avant que mon âme fût sortie de mon corps, pour ta défense ! » Elle dit, et vint gentiment s’asseoir à ses côtés et se mit à causer avec un sourire très doux. Puis elle appela l’une de ses esclaves et lui parla en langue grecque ; et l’esclave sortit, pour revenir accompagnée de servantes qui portaient sur leur tête de grands plateaux chargés de mets de toutes les espèces, et d’autres qui portaient toutes sortes de flacons et des vases de boissons. Mais Scharkân hésita à toucher à ces mets ; et la jeune femme s’en aperçut et lui dit : « Tu hésites, ô Scharkân, et tu crois à la trahison. Ne sais-tu donc que j’aurais pu, dès hier, t’enlever la vie ? » Puis elle tendit, la première, sa main, et prit une bouchée de chaque plat. Et Scharkân eut honte de ses soupçons, et se mit à manger, et elle avec lui, et cela jusqu’à satiété. Puis, après s’être lavé les mains, ils firent apporter les fleurs et les boissons, dans de grands vases d’or, d’argent et de cristal ; et il y en avait de toutes les couleurs et des meilleures sortes. Alors la jeune femme remplit une coupe d’or et la but, la première ; puis elle la remplit de nouveau et la lui offrit ; et il la but. Elle lui dit : « Ô musulman, vois comme ainsi la vie est facile et pleine d’agrément ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUARANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la jeune inconnue dit à Scharkân : « Ô musulman, vois comme ainsi la vie est facile et pleine d’agrément ! » Puis tous deux continuèrent à boire de la sorte, jusqu’à ce que la fermentation eût joué dans leur raison, et que l’amour se fût bien incrusté dans le cœur de Scharkân. Alors la jeune femme dit à l’une de ses suivantes préférées, nommée Grain-de-Corail : « Ô Grain-de-Corail, hâte-toi de nous apporter les instruments de plaisir ! » Et Grain-de-Corail répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Elle s’absenta un instant, et revint accompagnée de jeunes filles qui portaient un luth de Damas, une harpe de Perse, une cithare de Tartarie et une guitare d’Égypte. Et la jeune femme prit le luth, en accorda savamment le jeu et, accompagnée des trois jeunes filles qui s’étaient assises sur les tapis, elle pinça un instant les cordes vibrantes et, d’une voix pleine de délices et plus douce que la brise et plus agréable et plus pure que l’eau de roche, elle chanta :
« Les victimes de tes yeux, ô dure bien-aimée, sais-tu leur nombre ? Les flèches détachées de tes regards, et qui répandent le sang vif des cœurs, sais-tu leur nombre ?
Mais ô bienheureux les cœurs qui souffrent de tes yeux ! et mille fois heureux tes esclaves d’amour ! »
Et le chant fini, elle se tut. Alors, d’une voix plus lente, l’une des jeunes filles qui jouaient des instruments continua en langue grecque par une chanson incomprise de Scharkân. Et sa jeune maîtresse répondait, de temps en temps, dans la même tonalité. Et qu’il était doux, ce chant alterné et plaintif qui semblait sortir des flancs mêmes des mandores ! Et la jeune femme dit à Scharkân : « Ô musulman, as-tu compris notre chanson ? » Il répondit : « En vérité ! je n’ai point compris ; mais le son seul et l’harmonie m’en ont ému extrêmement, et l’humidité des dents souriantes, et la légèreté des doigts sur les instruments m’ont ravi à l’infini ! » Elle sourit et dit : « Mais alors, ô Scharkân, si je te disais un chant arabe, que ferais-tu, que ferais-tu ? » Il répondit : « Je perdrais certainement ce qui me reste de raison ! » Alors elle changea le ton et la clef de son luth, le pinça un instant, et chanta ces paroles du poète :
« Le goût de la séparation est plein d’amertume. Aussi, est-il encore moyen de patienter ? …
Trois choses à mon choix on a offertes : l’éloignement, la séparation et l’abandon, trois choses pleines d’effroi.
Comment choisir, moi qui suis tout liquéfié de l’amour d’un être beau qui m’a conquis et me soumet maintenant à de si dures épreuves ? »
Lorsque Scharkân eut entendu cette chanson, et comme aussi il avait bu considérablement, il fut tout à fait grisé et perdit tout sentiment. Et lorsqu’il fut revenu à lui, la jeune femme n’était plus là. Et Scharkân s’informa auprès des esclaves qui lui répondirent : « Elle a regagné son appartement pour dormir, car voici la nuit. » Et Scharkân, quoique fort contrarié, dit : « Qu’Allah l’ait sous sa protection ! » Mais le lendemain, la jeune esclave préférée, Grain-de-Corail, vint le prendre, dès son réveil, pour le conduire à l’appartement même de sa maîtresse. Et comme il franchissait le seuil, Scharkân fut reçu au son des instruments et aux chants des chanteuses qui, de la sorte, lui souhaitaient la bienvenue. Et il entra par une porte massive d’ivoire incrusté de perles et de pierreries ; et il vit une grande salle toute tendue de soie et de tapis du Khorassân ; et elle était éclairée par de hautes fenêtres qui avaient vue sur des jardins touffus et des cours d’eau ; et contre les murs, il y avait une rangée de statues habillées comme des vivants et qui mouvaient bras et jambes d’une façon étonnante, et dont l’intérieur était machiné avec un art tel, qu’elles chantaient et parlaient comme de vrais fils d’Adam.
Mais lorsque la maîtresse du logis vit Scharkân, elle se leva et vint à lui et le prit par la main et le fit s’asseoir à côté d’elle et lui demanda avec intérêt comment il avait passé la nuit, et lui fit d’autres questions aussi, auxquelles il fit la réponse qu’il fallait. Puis ils se mirent à causer et elle lui demanda : « Sais-tu des paroles de poètes sur les amoureux et les esclaves d’amour ? » Il dit : « Oui, ô ma maîtresse, j’en sais quelques-unes. » Elle dit : « Je voudrais les entendre. » Il lui dit : « Voici ce que l’éloquent et fin Kouçaïr disait au sujet de la parfaitement belle Izzat, qu’il aimait :
« Oh, non ! jamais d’Izzat je ne dévoilerai les charmes ; jamais pour Izzat je ne parlerai de mon amour ! D’ailleurs, elle m’a fait faire tant de serments et prêter tant de promesses ! Ah ! si l’on savait tous les charmes d’Izzat ! …
Les ascètes qui pleurent dans la poussière et se garent tant des peines d’amour, s’ils entendaient le gazouillement que je connais, ils accourraient, et devant Izzat s’agenouilleraient pour l’adorer ! Ah ! si l’on savait tous les charmes d’Izzat ! »
Et la jeune femme dit : « En vérité, l’éloquence lui était un don, à cet admirable Kouçaïr qui ajoutait que :
« Si Izzat, devant un juge digne d’elle et de sa beauté, se présentait avec le doux soleil matinal pour rival, certes elle serait la préférée !
Et pourtant, quelques femmes malignes ont osé devant moi critiquer les détails de la beauté d’Izzat. Puisse Allah les confondre et faire de leurs joues un tapis foulé par les semelles d’Izzat ! »
Et la jeune maîtresse du logis dit encore : « Qu’elle était aimée cette Izzat ! Et toi, prince Scharkân, si tu te rappelles les paroles que le beau Djamil disait à cette même Izzat, que tu serais gentil de nous les dire ! » Et Scharkân dit : « Vraiment, des paroles de Djamil à Izzat je ne me rappelle que cette seule strophe :
» Ô belle trompeuse, tu ne souhaites que ma mort, et tous tes désirs s’arrêtent là ! Et pourtant, malgré tout, c’est toi seule que je désire parmi toutes les filles de la tribu ! »
Et Scharkân ajouta : « Car, si tu ne le comprends pas, ô ma maîtresse, sache que je suis exactement dans la même situation que Djamil, et toi, comme Izzat pour Djamil, tu souhaites me faire mourir sous tes yeux ! » À ces paroles, la jeune femme sourit mais ne dit rien. Et l’on continua à boire jusqu’à l’apparition du matin. Alors elle se leva et disparut. Et Scharkân dut passer cette nuit encore, tout seul sur sa couche. Mais lorsque fut le matin, les servantes, comme d’habitude, vinrent le prendre au son des instruments et au rythme des doufouf, et, après avoir baisé la terre entre ses mains, lui dirent : « Fais-nous la grâce de venir avec nous chez notre maîtresse, qui t’attend ! » Alors Scharkân se leva, et sortit avec les esclaves qui jouaient des instruments et tapaient sur les doufouf, et arriva dans une seconde salle, bien plus merveilleuse que la première, et où il y avait des statues et des peintures figurant des animaux et des oiseaux, et beaucoup d’autres choses qui dépassaient toute description. Et Scharkân fut extrêmement charmé de tout ce qu’il voyait et ces strophes chantèrent sur ses lèvres :
« Je cueillerai l’étoile qui se lève parmi les fruits d’or de l’Archer aux Sept Étoiles.
Elle est la noble perle annonciatrice des aubes argentées ; elle est la goutte d’or de la constellation.
Elle est l’œil d’eau qui se fluidifie en tresses d’argent ; elle est la rose de chair des joues vivantes ; elle est une topaze brûlée, figure d’or !
Ses yeux ! C’est la couleur de la sombre violette, ses yeux cerclés de kohl bleu ! »
Alors la jeune femme se leva et vint prendre Scharkân par la main et le fit s’asseoir à ses côtés et lui dit : « Prince Scharkân, sans doute joues-tu aux échecs. » Il dit : « Certes, ô ma maîtresse, mais, de grâce ! ne sois point comme celle dont se plaint le poète :
« Je parle en vain ! Broyé par l’amour, que ne puis-je à sa bouche heureuse me désaltérer et, d’une gorgée à ses lèvres bue, respirer la vie !
Ce n’est point qu’elle me néglige ou ne soit point pour moi pleine d’attentions ; ce n’est point qu’elle diffère de faire porter le jeu d’échecs pour me distraire. Mais est-ce là la distraction ou le jeu dont a soif mon âme ?
Et d’ailleurs, pourrais-je lui tenir tête, moi qui suis fasciné par le jeu en coulisse de ses yeux, les regards de ses yeux qui pénètrent mon foie ! »
Mais la jeune femme, souriante, approcha les échecs et commença le jeu. Et Scharkân, chaque fois que c’était son tour, au lieu de faire attention à son jeu, la regardait au visage, et il jouait tout de travers, mettant le cheval à la place de l’éléphant et l’éléphant à la place du cheval. Alors elle se mit à rire et lui dit : « Par le Messie ! que ton jeu est savant ! » Il répondit : « Oh ! mais c’est la première partie. D’ordinaire ça ne compte pas ! » Et l’on rangea le jeu de nouveau. Mais elle le vainquit une seconde fois, et une troisième, quatrième, et cinquième fois. Puis elle lui dit : « Voici qu’en toutes choses tu es vaincu ! » Il répondit : « Ô ma souveraine, il sied d’être le vaincu d’une partenaire telle que toi ! » Alors elle fit tendre la nappe et l’on mangea et l’on se lava les mains ; puis on ne manqua pas de boire de toutes les boissons. Alors elle prit une harpe ; et, comme elle était fort habile sur la harpe, elle préluda par quelques notes lentes et déliées et chanta ces strophes :
« On n’échappe point à sa destinée, qu’elle soit cachée ou apparente, qu’elle ait le visage serein ou allongé. Oublie donc tout, ami, et
Bois à la beauté, si tu le peux, et à la vie. Je suis la beauté vivante que nul fils de la terre ne saurait regarder avec indifférence ! »
Elle se tut ; et seule la harpe résonna sous les fins doigts de cristal. Et Scharkân, ravi, se sentait perdu dans des désirs infinis. Alors, sur un prélude nouveau elle dit encore :
« Une amitié peu sincère pourrait seule supporter l’amertume de la séparation. Le soleil lui-même pâlit quand il doit quitter la terre. »
Mais à peine ce chant venait-il de cesser, que tous deux entendirent au dehors un tumulte énorme et des cris ; et ils regardèrent, et virent s’avancer une grande troupe de guerriers chrétiens armés de glaives nus et qui criaient : « Te voilà tombé entre nos mains, ô Scharkân. Et voici ton jour de perdition ! » Lorsque Scharkân entendit ces paroles, il pensa d’abord à une trahison, et ses soupçons se portèrent sur la jeune femme ; et comme il se tournait de son côté pour lui en faire le reproche, il la vit, toute pâle, s’élancer au dehors, et, parvenue en face des guerriers, leur dire : « Que voulez-vous ? » Alors leur chef s’avança et lui dit, après avoir baisé la terre entre ses mains : « Ô reine pleine de gloire, ô notre maîtresse Abriza, la perle la plus noble d’entre les perles des eaux, ignores-tu donc la présence de celui qui est dans ce monastère ? » Alors la reine Abriza leur dit : « Et de qui parlez-vous ? » Ils dirent : « Nous parlons de celui que l’on appelle le maître des héros, le destructeur des cités, le terrible Scharkân ibn-Omar Al-Némân, celui qui n’a pas laissé une tour sans la détruire, ni une forteresse sans l’abattre. Or, ô reine Abriza, le roi Hardobios, ton père et notre maître, a appris à Kaïssaria, sa ville, par la bouche même de la vieille Mère-des-Calamités, que le prince Scharkân était ici. Car Mère-des-Calamités a dit au roi avoir vu Scharkân, dans la forêt, se diriger vers le monastère. Aussi, ô notre reine, quel mérite est le tien d’avoir pris le lion dans tes filets et d’être ainsi la cause de notre victoire future sur l’armée des musulmans ! »
À ces paroles, la jeune reine Abriza, fille du roi Hardobios, maître de Kaïssaria, regarda avec colère le chef des guerriers et lui dit : « Quel est ton nom, toi ? » Il répondit : « Ton esclave le patrice Massoura ibn-Mossora ibn-Kacherda ! » Elle lui dit : « Comment se fait-il que tu aies osé, insolent Massoura, entrer dans ce monastère sans me prévenir et obtenir l’entrée ? » Il dit : « Ô ma souveraine, aucun des portiers ne m’a barré la route ; tous, au contraire, se sont levés et nous ont conduits près de la porte de ton appartement. Et maintenant, suivant les ordres du roi ton père, nous attendons que tu nous livres ce Scharkân, le guerrier le plus redoutable d’entre les musulmans ! » Alors la reine Abriza dit : « Que dis-tu là ? Ne sais-tu que la vieille Mère-des-Calamités est une menteuse pleine de perfidies. Par le Messie ! j’ai bien ici un homme, mais il est loin d’être le Scharkân dont tu parles ; c’est un étranger qui est venu nous demander l’hospitalité, et nous la lui avons aussitôt généreusement accordée. Et d’ailleurs, même au cas où cet étranger serait Scharkân, les devoirs de l’hospitalité ne me commandent-ils pas de le protéger contre toute la terre ? Il ne sera jamais dit qu’Abriza a trahi l’hôte, après qu’entre elle et lui il y eut le pain et le sel ! Il ne te reste donc, ô patrice Massoura, qu’à retourner auprès du roi mon père ; tu baiseras la terre entre ses mains et tu lui diras que la vieille Mère-des-Calamités en a menti et l’a trompé ! » Le patrice Massoura dit : « Reine Abriza, je ne puis m’en retourner auprès du roi Hardobios, ton père, qu’avec celui dont il nous a ordonné la prise. » Elle dit, pleine de colère : « De quoi te mêles-tu, soldat ? Tu n’as qu’à combattre, quand tu le peux, et puisque tu es payé pour combattre ; mais prends garde de te mêler d’affaires qui ne te concernent point ! D’ailleurs, si tu osais attaquer Scharkân, en admettant que cet étranger fût Scharkân, tu le payerais de ta vie et de la vie de tous les guerriers qui sont avec toi ! Et voici que je vais le faire venir ici, avec son glaive et son bouclier ! » Le patrice Massoura dit : « Malheur ! si j’échappais à ta colère, je ne saurais échapper au ressentiment du roi ! Aussi si ce Scharkân se présentait ici, je le ferais immédiatement arrêter par mes guerriers, qui le conduiraient, humble captif, entre les mains du roi de Kaïssaria, ton père ! » Alors Abriza dit : « Tu parles beaucoup pour un guerrier, ô patrice Massoura ! Et tes paroles sont pleines de prétention et d’insolence ! Oublies-tu donc que vous êtes ici cent guerriers contre un ? Si donc ton patriciat ne t’a pas enlevé jusqu’aux traces du courage, tu n’as qu’à le combattre, seul à seul. Et si tu es vaincu, un autre prendra ta place et le combattra, et cela jusqu’à ce que Scharkân tombe entre vos mains ! Et cela décidera qui de vous tous est le héros ! »
— Mais, à ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CINQUANTIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la jeune reine Abriza dit : « Et nous verrons qui de vous tous est le héros ! » Et le patrice Massoura dit : « Par le Messie ! tu dis vrai ! Aussi est-ce moi qui me présenterai le premier sur le terrain de lutte ! » Elle dit : « Attends alors que j’aille le prévenir et prendre sa réponse. S’il accepte, la chose est faite ; s’il refuse, il sera tout de même l’hôte honoré et protégé ! » Et Abriza se hâta d’aller trouver Scharkân et le mit au courant, mais sans lui dire qui elle était. Alors Scharkân comprit combien il avait mal pensé de la générosité de la jeune femme, et il se réprimanda fort, et doublement : pour avoir mal pensé de la jeune femme et pour s’être jeté inconsidérément au milieu du pays des Roum. Puis il dit : « Ô ma maîtresse, je n’ai point l’habitude de combattre ainsi contre un seul guerrier, mais contre dix guerriers à la fois ; aussi est-ce de la sorte que j’entends engager le combat ! » Il dit et sauta sur ses deux pieds et s’élança au-devant des guerriers chrétiens. Et il tenait à la main son glaive et son bouclier.
Lorsque le patrice Massoura eut vu Scharkân qui s’approchait, il bondit sur lui d’un bond et le chargea avec violence. Mais Scharkân para le coup porté, et s’élança comme un lion sur son adversaire et lui asséna sur l’épaule un coup si terrible que le glaive sortit en brillant par le flanc, après avoir traversé ventre et intestins.
À cette vue, la valeur de Scharkân augmenta considérablement aux yeux de la jeune reine, et elle se dit : « Voilà vraiment le héros avec lequel j’aurais pu lutter dans la forêt ! » Puis elle se tourna vers les guerriers et leur cria : « Qu’attendez-vous donc pour continuer le combat ! Ne songez-vous plus à venger la mort du patrice ? » Alors s’avança à grandes enjambées un géant à l’aspect redoutable et à la figure respirant l’énergie ; et il était le frère même du patrice Massoura ; mais Scharkân ne lui laissa pas le temps de parader, et lui asséna sur l’épaule un coup tel que le glaive sortit en brillant par le flanc, après avoir traversé ventre et intestins. Alors, un à un, d’autres guerriers s’avancèrent ; mais Scharkân leur faisait subir le même sort, et son glaive se faisait un jeu du vol de leurs têtes. Et de la sorte il en tua cinquante. Lorsque les cinquante qui restaient eurent vu le traitement infligé à leurs compagnons, ils se réunirent en une seule masse et se précipitèrent tous ensemble sur Scharkân ; mais c’en fut fait d’eux ! Ils furent reçus par Scharkân avec un cœur plus dur que la pierre, et battus comme sur l’aire les grains sont battus, et éparpillés, eux et leur âme, pour toujours !
Alors la reine Abriza cria à ses suivantes : « Y a-t-il encore d’autres hommes au monastère ? » Elles répondirent : « Il n’y a plus d’autres hommes que les portiers ! » Alors la reine Abriza s’avança au-devant de Scharkân, et le prit dans ses bras et l’embrassa avec ferveur ; puis elle compta le nombre des morts, et en trouva quatre-vingts ; quant aux vingt autres combattants, ils avaient pu, malgré leur état, s’échapper et disparaître. Et Scharkân songea alors à essuyer la lame sanglante de son glaive et, entraîné par Abriza, rentra au monastère en récitant ces strophes guerrières :
« Au jour de ma vaillance, pour me combattre, les bandes avec fureur se sont élancées !
J’ai jeté en pâture aux lions leurs fiers chevaux bai-brun, à mes frères les lions.
— Allons, jeunes gens ! soulagez-moi du poids de mes habits, si vous voulez ! —
Au jour de ma vaillance, je n’ai fait que passer, et voilà tous ces guerriers tout de leur long étendus sur la brûlante terre de mon désert ! »
Et comme ils étaient arrivés dans la grande salle du monastère, la jeune Abriza, toute souriante de plaisir, prit la main de Scharkân et la porta à ses lèvres ; puis elle releva sa robe, et en dessous apparurent une cotte de mailles aux mailles très serrées et une épée en acier fin de l’Inde ; et Scharkân, étonné, lui demanda : « Pourquoi, ô ma maîtresse, cette cotte de mailles et cette épée ? » Elle dit : « Ô Scharkân, dans le feu de ton combat je m’en étais vêtue à la hâte pour courir à ton secours ; mais mon bras ne t’a point été utile ! »
Puis la reine Abriza fit venir les portiers du monastère et leur dit : « Comment se fait-il que vous ayez laissé pénétrer ici les hommes du roi, sans ma permission ? » Ils dirent : « Ce n’est point encore l’habitude de demander un permis d’entrée pour les hommes du roi et surtout pour son grand patrice ! » Elle dit : « Je vous soupçonne fort d’avoir voulu me perdre et faire tuer mon hôte ! » Et elle pria Scharkân de leur couper la tête ; et Scharkân leur coupa la tête. Alors elle dit à ses autres esclaves : « Ils ont mérité bien pis que cela ! » Puis elle se tourna vers Scharkân et lui dit : « Voici, ô Scharkân, que je vais te dévoiler ce qui pour toi a été caché jusqu’à cette heure ! » Alors elle dit :
« Sache, ô Scharkân que je suis la fille unique du roi grec Hardobios, maître de Kaïssaria, et je m’appelle Abriza. Et j’ai pour ennemie inexorable la vieille Mère-des-Calamités, qui a été la nourrice de mon père et est très écoutée et crainte au palais. Et la cause de cette inimitié entre moi et elle est une cause que tu me dispenseras de te raconter, car il y a des jeunes filles mêlées à cette histoire dont tu connaîtras certes les détails avec le temps. Aussi je ne doute pas que Mère-des-Calamités ne fasse tout pour me perdre, maintenant surtout que j’ai été la cause de la mort du chef des patrices et des guerriers. Et elle dira à mon père que j’ai embrassé la cause des musulmans. Aussi, pour moi, le seul parti à prendre, tant que Mère-des-Calamités me persécute, est de m’en aller loin de mon pays et de mes parents. Et je te demande de m’aider à partir, et d’agir avec moi comme j’ai agi avec toi ; car tu es un peu la cause de ce qui vient d’arriver. »
À ces paroles, Scharkân sentit sa raison s’envoler de joie et sa poitrine s’élargir et tout son être s’épanouir, et il dit : « Par Allah ! et quel est celui qui osera t’approcher, tant que mon âme est dans mon corps ? Mais pourrais-tu vraiment supporter d’être éloignée de ton père et des tiens ? » Elle répondit : « Mais certainement ! » Alors Scharkân lui fit jurer qu’elle le pourrait, et elle fit le serment, puis ajouta : « Maintenant mon cœur s’est tranquillisé. Mais j’ai encore à te faire une demande. » Il dit : « Et quelle est-elle ? » Elle dit : « C’est que tu retournes à Baghdad, ton pays, avec tous tes soldats ! » Il dit : « ma maîtresse, mon père Omar Al-Némân ne m’a envoyé dans le pays des Roum que pour combattre et vaincre ton père, contre lequel le roi Aphridonios de Constantinia nous a demandé secours. Car ton père a fait saisir un navire chargé de richesses, de jeunes esclaves et de trois gemmes précieuses auxquelles sont attachées d’admirables vertus ! » Alors Abriza répondit : « Calme ton âme et adoucis tes yeux ! Car voici que je vais te dire la véritable histoire de notre hostilité avec le roi Aphridonios :
« Sache que nous avons, nous autres Grecs, une fête annuelle qui est la fête de ce monastère-ci. Et chaque année, à pareille date, tous les rois chrétiens se réunissent ici de toutes les contrées, ainsi que tous les nobles et les grands commerçants ; et aussi ne manquent pas de venir les femmes et les filles des rois et des autres ; et cette fête dure sept jours entiers. Or, une année, je vins moi-même au nombre des visiteurs, et il y avait aussi la fille du roi Aphridonios de Constantinia, qui se nommait Safîa, et qui est maintenant la concubine de ton père Omar Al-Némân, et mère d’enfants. Mais à ce moment elle était encore jeune fille.
« Lorsque, la fête terminée, vint le septième jour, qui était le jour du départ, Safîa dit : « Je ne veux pas retourner à Constantinia par la voie de terre, mais par mer. » Alors on lui prépara un navire et elle y descendit, elle et ses compagnes, et y fit embarquer toutes les choses qui lui appartenaient ; et l’on déploya les voiles et l’on partit.
« Mais à peine le navire s’était-il éloigné que le vent contraire s’éleva et fit dévier le navire de sa route. Et la Providence voulut que justement il y eût, dans ces parages, un grand navire plein de guerriers chrétiens de l’île de Kâfour, au nombre de cinq cents Afrangi[10] ; et ils étaient tous armés et vêtus de fer ; et ils n’attendaient qu’une occasion comme celle-là pour faire du butin, depuis le temps qu’ils tenaient la mer. Aussi dès qu’ils virent le navire où était Safîa, ils l’abordèrent et y jetèrent leurs grappins et s’en emparèrent ; puis ils le traînèrent à la remorque et remirent à la voile. Mais une tempête s’éleva, furieuse, qui les jeta tous sur nos côtes, désemparés. Alors nos hommes se jetèrent sur eux, tuèrent les pirates et s’emparèrent à leur tour des soixante jeunes filles, au nombre desquelles se trouvait Safîa, et de toutes les richesses qui étaient accumulées dans les navires. Puis ils vinrent offrir les soixante jeunes filles en cadeau au roi de Kaïssaria, mon père, et gardèrent les richesses pour eux. Alors mon père choisit pour lui les dix plus belles jeunes filles et distribua le reste à sa suite. Puis, sur les dix, il tria les cinq les plus belles et les envoya en cadeau au roi Omar Al-Némân, ton père ; et parmi ces cinq il y avait justement Safîa, la fille du roi Aphridonios ; mais nous ne nous en doutions pas, car ni elle ni personne ne nous avait révélé sa condition ni son nom. Et c’est ainsi, ô Scharkân, que Safîa devint la concubine du roi Omar Al-Némân, ton père ; et elle lui fut d’ailleurs envoyée avec beaucoup d’autres choses telles que soieries, étoffes de laine et broderies de Grèce.
« Mais voici qu’au commencement de cette année le roi mon père reçut une lettre du père de Safîa, le roi Aphridonios. Et dans cette lettre il y avait des choses que je ne puis vraiment te répéter ; mais il y était dit ceci, en outre :
« Tu as, il y a deux ans, pris à des pirates soixante jeunes filles, dont ma fille Safîa ; et ce n’est que maintenant seulement que je l’apprends, car tu ne m’as rien fait savoir, ô roi Hardobios ! Et c’est là la plus grande offense et le plus grand opprobre pour moi, sur moi et autour de moi. Si donc tu ne veux pas devenir mon ennemi, tu dois, sitôt ma lettre reçue, me renvoyer ma fille Safîa, intacte et intégrale. Sinon, et si tu diffères son renvoi, tu seras traité comme tu le mérites, et des représailles terribles contre toi seront prises par ma colère et mon ressentiment. »
« Aussi, lorsque mon père eut lu cette lettre, il fut dans une grande perplexité et un grand émoi, puisque la jeune Safîa avait été envoyée en cadeau à ton père Omar Al-Némân, et qu’il n’y avait plus de chance qu’elle fût encore intacte et intégrale, puisqu’elle avait été déjà rendue mère par le roi Omar Al-Némân, en un instant d’ailleurs et sans difficultés de l’une ou de l’autre part.
« Et nous comprîmes alors que c’était là une grande calamité. Et mon père n’eut d’autre moyen de recours qu’une lettre au roi Aphridonios où il lui exposait la situation, en s’excusant beaucoup de l’ignorance où il avait été de l’identité de Safîa, et en lui faisant là-dessus mille serments.
« Au reçu de la lettre de mon père, le roi Aphridonios entra dans une fureur inexprimable ; il se leva, et s’assit, et s’agita, et écuma, et dit : « Est-il possible que ma fille, celle dont tous les rois chrétiens se disputent l’alliance et la main, soit devenue une esclave d’entre les esclaves d’un musulman, et qu’elle ait été ployée à ses désirs, et qu’elle ait servi à sa couche, sans contrat légal ! Mais, par le Messie ! je tirerai de ce musulman, monteur inassouvi de tant de femmes, une vengeance dont parleront longtemps l’Orient et l’Occident ! »
« Et c’est alors que le roi Aphridonios, ô Scharkân, songea à envoyer des ambassadeurs à ton père, avec de riches présents, et à lui faire croire qu’il était en guerre avec nous, et à lui demander son secours. Mais, en réalité, c’était seulement pour te faire tomber toi-même, ô Scharkân, et tes dix mille cavaliers, dans un guet-apens par quoi serait satisfaite sa vengeance préméditée.
« Maintenant, pour ce qui est des trois merveilleuses gemmes auxquelles tant de vertus sont attachées, elles existent. Elles étaient la propriété de Safîa, et tombèrent entre les mains des pirates et ensuite entre les mains de mon père, qui m’en a fait cadeau. Et c’est moi qui les ai ; et je te les montrerai. Mais pour le moment il te faut, avant tout, retourner près de tes cavaliers et reprendre avec eux le chemin de Baghdad, plutôt que de tomber dans les filets du roi de Constantinia et avant que toutes les communications ne soient, pour vous autres, coupées ! »
Lorsque Scharkân eut entendu ces paroles, il prit la main d’Abriza et la porta à ses lèvres, et dit : « Louange à Allah dans ses créatures ! Il t’a mise sur ma route pour que tu sois la cause de mon salut et du salut de mes compagnons. Mais, ô délicieuse et secourable reine, je ne puis plus me séparer de toi, et, surtout après tout ce qui s’est passé, je ne souffrirai point que tu restes toute seule ici, car je ne sais point ce qui peut t’arriver. Viens, Abriza, allons à Baghdad ! »
Mais Abriza, qui avait eu le temps de réfléchir, lui dit : « Ô Scharkân, hâte-toi de partir le premier et de te saisir des envoyés du roi Aphridonios qui sont au milieu de tes tentes, et tu les obligeras à t’avouer la vérité ; et, de la sorte, tu contrôleras mes paroles. Et moi, avant que trois jours ne soient écoulés, je te rejoindrai, et ensemble nous entrerons dans Baghdad. »
Puis elle se leva et s’approcha de lui, et prit sa tête dans ses mains et l’embrassa ; et Scharkân également. Et elle pleura des larmes abondantes, et des pleurs à faire fondre les pierres. Et Scharkân, en voyant ces yeux qui pleuraient, fut encore plus attendri et endolori, et pleura aussi beaucoup et récita ces deux strophes :
« Je lui fis mes adieux, et ma main droite séchait mes larmes et ma main gauche entourait son cou.
Elle me dit, peureuse : « Oh ! ne crains-tu pas de me compromettre aux yeux des femmes de ma tribu ? »
Je lui dis : « Que non ! car le jour des adieux n’est-il pas par lui-même la trahison des amoureux ? »
Et Scharkân quitta Abriza et sortit du monastère et remonta sur son coursier que deux jeunes filles tenaient par la bride, et s’en alla. Il passa le pont aux chaînes d’acier et s’engagea parmi les arbres de la forêt et finit par arriver à la clairière située au milieu de la forêt. Et à peine y était-il parvenu qu’il vit trois cavaliers en face de lui, arrêtés brusquement dans leur galop. Et il tira sa flamboyante épée et s’en couvrit, prêt au choc. Mais soudain il les reconnut et ils le reconnurent, car les trois cavaliers étaient le vizir Dandân et les deux principaux émirs de sa suite. Alors les trois cavaliers mirent vivement pied à terre et vinrent respectueusement souhaiter la paix au prince Scharkân, et lui exprimèrent toute l’angoisse où son absence avait jeté l’armée. Et Scharkân leur raconta l’histoire dans tous ses détails, depuis le commencement jusqu’à la fin, et la prochaine arrivée de la reine Abriza et la trahison projetée par les envoyés d’Aphridonios ; et il leur dit : « Il est probable qu’ils ont dû profiter de votre absence à vous trois pour s’échapper et aller prévenir leur roi de notre arrivée sur ses terres. Et maintenant, qui sait si leur armée n’a pas déjà détruit la nôtre ! Au plus vite, courons donc au milieu de nos soldats ! »
Et bientôt, au galop de leurs chevaux, ils arrivèrent dans la vallée où les tentes étaient dressées ; et l’ordre y régnait, mais les envoyés avaient disparu, en effet. Alors, en hâte, on leva le camp et l’on partit vers Baghdad. Et au bout de quelques jours on arriva aux premières frontières connues ; et l’on fut, par le fait, dans la sécurité. Et tous les habitants de la contrée s’empressèrent de venir leur apporter des provisions pour eux et des vivres pour les chevaux. Et l’on se reposa en cet endroit quelque temps, et l’on repartit. Mais Scharkân confia la direction de toute l’avant-garde au vizir Dandân, et ne garda pour lui, comme arrière-garde, que cent cavaliers qu’il choisit un à un parmi l’élite de tous les cavaliers. Et il laissa l’armée le devancer d’un jour entier ; après quoi il se mit lui-même en marche avec ses cent guerriers.
Et comme ils avaient déjà parcouru près de deux parasanges[11], ils finirent par arriver à un défilé fort étroit situé entre deux très hautes montagnes, et à peine y étaient-ils qu’ils virent à l’autre bout du défilé s’élever une poussière fort dense, qui se rapprocha rapidement et se dissipa pour laisser paraître cent cavaliers, aussi intrépides que des lions et disparaissant sous les cottes de mailles et les visières d’acier. Et lorsque ces cavaliers furent à portée de voix, ils s’écrièrent : « Descendez de vos chevaux, musulmans, et livrez-vous à discrétion en nous remettant vos armes et vos chevaux, sinon par Mariam et Youhanna ! vos âmes ne tarderont pas à s’envoler de vos corps ! »
À ces paroles, Scharkân vit le monde noircir à ses yeux, et ses yeux lancèrent des éclairs de colère et ses joues s’enflammèrent, et il s’écria : « Ô chiens de chrétiens, comment osez-vous nous menacer, après avoir déjà eu l’audace de franchir nos frontières et de fouler notre sol ! Et non seulement cela, mais encore vous venez de nous adresser de telles paroles ! Et pensez-vous, maintenant, pouvoir vous échapper intacts d’entre nos mains et revoir votre pays ? » Il dit ! et cria à ses guerriers : « Croyants, sus à ces chiens ! » Et, le premier, Scharkân fonça sur l’ennemi. Alors les cent cavaliers de Scharkân, au grand galop de leurs chevaux, fondirent sur les cent cavaliers afrangi, et les deux masses d’hommes se mêlèrent avec des cœurs plus durs que la roche ; et les aciers se heurtèrent aux aciers, et les épées aux épées, et les coups se mirent à pleuvoir en crépitant, et les corps s’enlacèrent aux corps, et les chevaux se cabrèrent et retombèrent pesamment sur les chevaux, et l’on n’entendit plus d’autre bruit que le cliquetis des armes et le choc tumultueux des métaux contre les métaux. Et le combat dura de la sorte jusqu’à l’approche de la nuit et des ténèbres de la nuit. Alors seulement les deux partis se séparèrent, et l’on put se compter. Et Scharkân, parmi ses hommes, n’en trouva pas un seul qui fût atteint de blessure grave. Alors il dit :
« Ô compagnons, vous savez que toute ma vie j’ai navigué sur la mer des batailles sonores où s’entrechoquent les flots des glaives et des lances ; et j’ai combattu bien des héros ; mais je n’ai encore jamais trouvé d’hommes aussi intrépides, de guerriers aussi valeureux, et de héros aussi virils que ces adversaires ! »
Alors ils lui répondirent : « Prince Scharkân, ta parole est la vérité ! Mais, en outre, sache qu’il y a, parmi ces guerriers chrétiens, leur chef qui est le plus admirable parmi eux tous, et le plus héroïque. Et, de plus, chaque fois que l’un de nous tombait entre ses mains, il se détournait pour ne pas le tuer, et le laissait échapper à la mort ! »
À ces paroles, Scharkân fut dans une grande perplexité ; puis il dit : « Au jour de demain nous nous alignerons et nous les attaquerons, car nous sommes cent contre cent. Et nous demanderons au Maître du ciel la victoire ! » Et, sur cette résolution, ils s’endormirent tous cette nuit-là.
Quant aux chrétiens, ils se réunirent autour de leur chef et lui dirent : « Nous n’avons vraiment pas pu, aujourd’hui, venir à bout de ceux-là ! » Et il leur dit : « Mais demain nous nous alignerons et nous les terrasserons l’un après l’autre ! » Et sur cette résolution, ils s’endormirent également.
Aussi dès que brilla le matin — et qu’il éclaira le monde de sa lumière et que se leva le soleil indifféremment sur le visage des pacifiques et des guerriers, et qu’il salua Mohammad ornement de toutes choses belles — le prince Scharkân monta sur son cheval, s’avança entre les deux rangs de ses cavaliers alignés et leur dit : « Voici que nos ennemis sont en ordre de bataille. Lançons-nous sur eux, mais un contre un. Et d’abord, que l’un de vous sorte du rang et, d’une voix haute, qu’il aille inviter l’un des guerriers chrétiens à un combat singulier. Puis chacun à son tour affrontera la lutte de la sorte. »
Alors, l’un des cavaliers de Scharkân sortit des rangs, et poussa son cheval vers l’ennemi et s’écria : « Ô vous tous ! parmi vous y a-t-il un combattant, y a-t-il un champion assez intrépide pour accepter aujourd’hui la lutte avec moi ? » À peine avait-il prononcé ces mots que, d’entre les chrétiens, sortit un cavalier entièrement couvert d’armes et de fer, et de soie et d’or ; et il était monté sur un cheval gris, et avait un visage rose aux joues vierges de poil. Et il poussa son cheval jusqu’au milieu de la lice, et, l’épée haute, il se précipita sur le champion musulman, et, rapide, d’un coup de lance, il le désarçonna et le força à se rendre et l’emmena, humble prisonnier, au milieu des cris de victoire et de joie des guerriers chrétiens. Et aussitôt un autre chrétien sortit des rangs et s’avança au milieu de la lice à la rencontre d’un autre musulman qui y était déjà et qui était le frère du captif. Et les deux champions engagèrent la lutte ; et elle ne tarda pas à se terminer par la victoire du chrétien ; car, profitant d’une faute du musulman, qui n’avait pas su parer, il lui asséna un coup de pommeau de lance qui le désarçonna ; et il l’emmena captif. Et l’on continua de la sorte à se mesurer, et chaque fois la lutte se terminait par la capture d’un musulman vaincu par le chrétien, et cela jusqu’à la tombée de la nuit et la capture de vingt guerriers d’entre les musulmans.
Lorsque Scharkân eut vu ce résultat, il en fut très affecté ; et il réunit ses compagnons et leur dit : « Ce qui vient de nous arriver n’est-il vraiment pas énormément extraordinaire ? Aussi vais-je, demain même, m’avancer seul en face de l’ennemi et provoquer au combat le chef de ces chrétiens. Et je verrai ensuite la raison qui l’a poussé à violer notre territoire et à nous attaquer. Et s’il refuse de s’expliquer, nous le tuerons ; et s’il accepte nos propositions, nous ferons avec lui la paix. » Et sur cette résolution, ils s’endormirent tous jusqu’au matin.
Alors Scharkân, déjà à cheval, s’avança tout seul vers les rangs des ennemis ; et il vit s’avancer, au milieu de cinquante guerriers descendus de leurs chevaux, un cavalier qui n’était autre que le chef des chrétiens en personne. Il portait, agrafée aux épaules, une chlamyde de satin bleu qui flottait au-dessus d’une cotte de mailles aux mailles très serrées ; et il brandissait une épée nue en acier indianisé ; et il montait un cheval noir qui avait le front étoilé d’une tache blanche, large comme un drachme d’argent. Et ce cavalier avait une figure fraîche d’enfant, aux joues roses et vierges de poil ; et il était aussi beau que la lune qui se lève glorieuse à l’horizon oriental.
Lorsqu’il fut au milieu de la lice, le jeune cavalier s’adressa à Scharkân en langue arabe, avec l’accent le plus pur, et lui dit : « Ô Scharkân, ô fils d’Omar Al-Némân qui règne sur les bourgs et les villes, les places fortes et les tours, prépare-toi à la lutte, car elle sera dure ! Et comme tu es le chef des tiens et moi le chef des miens, il est entre nous, dès maintenant, entendu que le vainqueur dans cette lutte s’emparera des soldats du vaincu, et sera le maître reconnu ! »
Mais déjà Scharkân, le cœur chargé de courroux, avait lancé son coursier contre le chrétien, semblable au lion en fureur. Et ils se heurtèrent l’un contre l’autre d’un heurt héroïque, et les coups crépitèrent ; et l’on aurait cru voir s’entrechoquer deux montagnes ou se mêler bruyamment deux mers soudain se rencontrant. Et ils ne cessèrent de combattre depuis le matin jusqu’à la nuit noire. Et alors ils se séparèrent et chacun retourna au milieu des siens.
Alors Scharkân dit à ses compagnons : « De ma vie je n’ai rencontré pareil combattant ! Mais ce que j’ai trouvé en lui de plus surprenant, c’est l’habitude qu’il a, chaque fois que son adversaire est à découvert, de ne le point blesser, mais seulement de le toucher légèrement, à l’endroit découvert, du pommeau de sa lance ; et je ne comprends plus rien à toute cette aventure. Mais il serait à souhaiter qu’il y eût beaucoup de nos guerriers doués d’une pareille intrépidité ! »
Et le lendemain on recommença une lutte identique, mais sans plus de résultat. Mais le troisième jour, voici ce qui arriva. Au milieu du combat, soudain le beau jeune homme chrétien lança son cheval au galop, et l’arrêta brusquement, et tira maladroitement sur les rênes ; alors le cheval se cabra, et le jeune homme se laissa désarçonner et tomba à terre, comme naturellement. Alors Scharkân sauta à bas de son cheval et, l’épée haute, se précipita sur son adversaire et voulut le transpercer. Et le beau chrétien s’écria : « Est-ce ainsi que se comportent les héros ? ou est-ce de la sorte que la galanterie commande les égards aux femmes ? » À ces mots, Scharkân, étonné, regarda attentivement le jeune cavalier et, l’ayant bien examiné, reconnut la reine Abriza. Car c’était bien la reine Abriza avec laquelle il lui était arrivé, dans le monastère, ce qui était arrivé !
Alors Scharkân jeta au loin son épée, et se prosterna devant la jeune fille et baisa la terre entre ses mains et lui dit : « Mais pourquoi donc, ô reine, tout cela ? » Elle lui dit : « J’ai voulu t’éprouver moi-même sur un champ de bataille, et voir ton degré d’endurance et de valeur ! Et sache que tous mes guerriers, les cent qui ont combattu les tiens, sont des jeunes filles, et vierges et miennes. Et quant à moi, n’eût été mon cheval, qui s’est cabré, tu aurais vu bien d’autres choses, ô Scharkân ! » Et Scharkân sourit et répondit : « Louange à Allah qui nous a réunis, ô reine Abriza, ô souveraine des temps ! » Et la reine aussitôt donna à ses compagnes l’ordre du départ et rendit à Scharkân les vingt prisonniers, l’un après l’autre. Et tous vinrent s’agenouiller devant elle et baisèrent la terre entre ses mains. Et Scharkân se tourna vers les belles adolescentes et leur dit : « Les rois seraient honorés de pouvoir compter sur une réserve de héros tels que vous autres ! »
Puis on leva les campements, et les deux cents cavaliers prirent ensemble la route de Baghdad et marchèrent de la sorte six jours entiers, au bout desquels ils virent, au loin, luire les glorieux minarets de la
Ville de paix.— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQUANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
Ils virent, au loin, luire les glorieux minarets de la Ville de paix. Alors Scharkân pria la reine Abriza et ses compagnes d’enlever leurs armures guerrières et de les échanger contre de vrais habits de femmes grecques. Et elles le firent. Puis il envoya à Baghdad quelques-uns de ses compagnons le devancer et l’annoncer à son père Omar Al-Némân, lui et la reine Abriza, pour qu’un cortège somptueux fût envoyé à leur rencontre. Puis on mit, ce soir-là, pied à terre, et l’on dressa les tentes pour la nuit, et l’on s’endormit jusqu’au matin.
Aussi, dès le lever du jour, le prince Scharkân et ses cavaliers, la reine Abriza et ses guerrières remontèrent sur leurs coursiers et prirent le chemin de la ville. Et voici que sortit de la ville, venant à leur rencontre, le grand-vizir Dandân avec une suite de mille cavaliers ; et il s’approcha de la jeune fille et de Scharkân et baisa la terre entre leurs mains ; puis tous ensemble entrèrent dans la ville.
Et Scharkân le premier monta au palais voir son père, le roi Omar Al-Némân. Et le roi se leva pour lui et l’embrassa et lui demanda de ses nouvelles. Et Scharkân lui raconta toute son histoire avec la jeune Abriza, fille du roi Hardobios de Kaïssaria, et la perfidie du roi de Constantinia et son ressentiment à cause de Safîa, la concubine, qui n’était autre que la fille même du roi Aphridonios ; et il lui raconta l’hospitalité et les bons conseils d’Abriza et son dernier exploit, et toutes ses qualités de valeur et de beauté.
Lorsque le roi Omar Al-Némân eut entendu ces dernières paroles, il fut pris d’un grand désir de voir la jeune fille merveilleuse, et tout son être s’alluma aux détails entendus. Et il pensa en lui-même aux délices de sentir dans sa couche la solidité et la sveltesse harmonieuse d’un corps de fille ainsi aguerrie, et vierge de mâle, et tant aimée de ses compagnes guerrières. Et il ne dédaigna pas non plus ces compagnes elles-mêmes dont le visage, sous les habits de guerre, était celui d’un enfant aux joues fraîches et vierges de poil et de duvet. Car le roi Omar Al-Némân était un admirable vieillard aux muscles plus exercés que ceux des jeunes gens. Et il ne craignait point les luttes de la virilité, et il sortait toujours victorieux d’entre les bras de ses femmes les plus allumées.
Aussi comme Scharkân ne pouvait penser que son père eût des vues sur la jeune reine, il se hâta d’aller la chercher et vint la lui présenter. Et le roi était assis sur son trône, et avait congédié tous ses chambellans et tous ses esclaves, à l’exception des eunuques. Et la jeune Abriza arriva jusqu’à lui et baisa la terre entre ses mains, et lui tint un langage d’une pureté et d’une élégance délicieuses. Aussi le roi Omar Al-Némân fut-il à la limite de l’émerveillement et il la remercia et la glorifia pour tout ce qu’elle avait fait avec son fils, le prince Scharkân, et l’invita à s’asseoir. Et Abriza, alors, s’assit et enleva le petit voile qui lui couvrait le visage ; et ce fut un éblouissement ! Et tel, que le roi Omar Al-Némân faillit en perdre la raison. Et aussitôt il lui fit donner, dans le palais même, pour elle et pour ses compagnes, le plus somptueux des appartements réservés, et lui fixa un train de maison digne de son rang. Et, alors seulement, il l’interrogea au sujet des trois gemmes précieuses pleines de vertus.
Alors Abriza lui dit : « Ces trois blanches gemmes, ô roi du temps, c’est moi-même qui les ai et elles ne me quittent jamais. Et je vais te les montrer ! » Et elle fit apporter une caisse et l’ouvrit, et en tira une boîte dont elle enleva le couvercle, et tira de la boîte un écrin en or ciselé, qu’elle ouvrit. Et alors apparurent, rayonnantes, les trois gemmes précieuses, rayonnantes et blanches et arrondies. Et Abriza les prit et les porta à ses lèvres l’une après l’autre, et les offrit au roi Omar Al-Némân en cadeau pour l’hospitalité qu’il lui accordait. Et elle sortit.
Et le roi Omar Al-Némân sentit son cœur s’en aller avec elle : Mais, comme les gemmes étaient là qui brillaient, il fit venir son fils Scharkân et lui donna l’une d’elles en présent ; et Scharkân lui demanda ce qu’il allait faire des deux autres gemmes. Et le roi lui dit : « Mais je vais les donner, l’une, à ta sœur la petite Nôzhatou et, la seconde, à ton petit frère Daoul’makân. »
À ces mots relatifs à son frère Daoul’makân, dont il ignorait absolument l’existence, Scharkân fut désagréablement affecté, car il ne savait que la naissance de Nôzhatou. Aussi se tourna-t-il vers le roi Omar Al-Némân, en lui disant : « Ô père, as-tu donc un autre fils que moi ? » Il dit : « Mais certainement, âgé de six ans, le frère jumeau de Nôzhatou, et tous deux nés de mon esclave Safîa, la fille du roi de Constantinia ! » Alors Scharkân, bouleversé à cette nouvelle, ne put s’empêcher de secouer ses habits de dépit et de colère, mais il se contint tout de même et dit : « Puissent-ils tous deux être sous la bénédiction d’Allah le Très-Haut ! » Mais son père remarqua son agitation et son dépit et lui dit : « Ô mon fils, pourquoi donc te mettre dans un état pareil ? Ne sais-tu pas que c’est à toi seul que revient la succession au trône, à ma mort ? Et ne t’ai-je pas donné à toi, le premier, la plus belle d’entre les trois gemmes pleines de merveilles ? » Mais Scharkân ne se sentit point en état de répondre et, ne voulant pas contrarier ou peiner son père, il sortit, la tête basse, de la salle du trône. Et il se dirigea vers l’appartement réservé d’Abriza ; et Abriza aussitôt se leva pour le recevoir, le remercia gentiment de ce qu’il avait fait pour elle et le pria de s’asseoir à côté d’elle. Puis, comme elle le voyait le visage sombre et attristé, elle le questionna tendrement ; et Scharkân lui raconta le motif de sa peine et ajouta : « Mais ce qui me préoccupe surtout, ô Abriza, c’est que j’ai fini par remarquer chez mon père des intentions non douteuses à ton endroit, et j’ai vu ses yeux s’éclairer du désir de ta possession. Qu’en dis-tu donc, toi-même ? » Elle répondit : « Tu peux tranquilliser ton âme, ô Scharkân, car ton père ne me possédera que morte ! Ses trois cent soixante femmes et les autres ne peuvent-elles donc plus lui suffire, qu’il convoite ma virginité, qui n’est certes pas faite pour ses dents ! Sois donc en paix, ô Scharkân, et chasse tes soucis ! » Puis elle fit apporter à manger et à boire ; et tous deux mangèrent et burent, et Scharkân, toujours l’âme en peine, rentra chez lui dormir, cette nuit-là. Voilà pour Scharkân !
Mais pour ce qui est du roi Omar Al-Némân, une fois Scharkân sorti, il alla trouver sa concubine Safîa, dans son appartement ; et il tenait à la main les deux gemmes précieuses, suspendues chacune à une chaîne d’or. Et, en le voyant entrer, Safîa se leva debout sur ses deux pieds et ne s’assit qu’une fois le roi assis le premier. Et alors vinrent à lui les deux enfants, Nôzhatou la fillette et le petit Daoul’makân. Et le roi les embrassa et leur suspendit au cou, à chacun, l’une des précieuses gemmes. Et les deux enfants en furent très réjouis ; et leur mère souhaita au roi la prospérité et le bonheur. Alors le roi lui dit : « Ô Safîa, tu es la fille du roi Aphridonios de Constantinia, et tu ne m’en as jamais rien dit ! Pourquoi donc me cacher la chose et m’empêcher, de la sorte, d’avoir pour toi les égards dûs à ton rang et de te hausser en estime et en honneur ! » Et Safîa lui dit : « Ô roi généreux, et que pourrais-je souhaiter de plus, en vérité ? Tu m’as déjà comblée de tes dons et de les faveurs, et tu m’as rendue mère de deux enfants beaux comme des lunes ! » Alors le roi Omar Al-Némân fut très charmé de cette réponse qu’il trouva délicieuse et pleine de goût et de tact, de savoir-vivre et de délicatesse. Et il fit donner à Safia un palais encore bien plus beau que le premier, et augmenta considérablement son train de maison et ses frais de dépenses. Puis il rentra à son palais pour juger et destituer et nommer, selon la coutume.
Mais il restait toujours l’esprit et le cœur fort tourmentés à l’endroit de la jeune reine Abriza. Aussi passait-il chez elle toutes ses nuits à causer avec elle et à lui glisser des sous-entendus. Mais Abriza, chaque fois, pour toute réponse, lui disait : « Ô roi du temps, vraiment, je n’éprouve point de désirs pour les hommes ! » Mais cela ne faisait que l’exciter et le tourmenter davantage ; et il finit par en devenir malade. Et c’est alors qu’il fit venir son vizir Dandân, et lui découvrit tout l’amour qu’il avait dans le cœur pour l’admirable Abriza, et le peu de résultat obtenu, et son désespoir d’arriver jamais à la posséder.
Lorsque le vizir eut entendu ces paroles, il dit au roi : « Voici. À la tombée de la nuit, tu auras soin de prendre avec toi un morceau de ce soporifique sûr, le banj, et tu iras trouver Abriza et tu te mettras à boire un peu avec elle, et, dans la dernière coupe, tu glisseras le morceau de banj ; et elle ne sera pas plutôt arrivée à son lit que tu en seras le maître ; et tu pourras alors faire d’elle tout ce qui te semblera propre à satisfaire ton désir et à calmer ton ardeur. Et telle est mon idée. » Et le roi répondit : « Vraiment, ton conseil est excellent et le seul réalisable. »
Alors il se leva et alla à l’une de ses armoires, qu’il ouvrit, et prit un morceau de banj pur, et tellement fort que sa seule odeur eût jeté dans le sommeil, d’un bout de l’année à l’année suivante, même un éléphant. Et il mit ce morceau de banj dans sa poche et attendit que vînt la nuit. Alors il alla trouver la reine Abriza qui se leva pour le recevoir et ne s’assit qu’une fois le roi assis et la permission donnée. Et il se mit à causer avec elle et exprima le désir de boire ; et aussitôt elle fit apporter les boissons et tous les accessoires, tels que : fruits, amandes, noisettes, pistaches et le reste ; et le tout dans de grandes coupes d’or et de cristal. Et tous deux se mirent à boire, et à s’inviter jusqu’à ce que l’ivresse eût commencé à se consolider dans la tête d’Abriza. Ce que voyant, le roi sortit de sa poche le morceau de banj, et le cacha entre ses doigts ; puis il remplit une coupe et la but à moitié et, discrètement, y glissa le morceau de banj, et l’offrit à la jeune fille et lui dit : « Ô royale adolescente, prends cette coupe et bois cette boisson de mon désir ! » Et la reine Abriza, inconsciente, prit la coupe et, rieuse, la but. Elle la but et aussitôt le monde tourna devant ses yeux ; et elle n’eut que le temps de se traîner vers sa couche où, lourdement, elle tomba sur le dos, les bras étendus et les jambes écartées. Et deux grands flambeaux étaient placés l’un au chevet et l’autre au pied du lit.
Alors le roi Omar Al-Némân s’approcha d’Abriza et commença par lui délier les cordons de soie de son ample caleçon, et ne lui laissa sur la peau que la fine chemise légère. Et il souleva l’aile de la chemise et d’en-dessous apparut, entre les cuisses, éclairé en détail par la lumière des flambeaux, quelque chose qui lui ravit l’esprit et la raison. Mais il eut la force de se retenir pour avoir le temps d’enlever, lui aussi, sa robe et son caleçon. Et alors il put librement se laisser aller à l’extrême ardeur qui le poussait ; et il se jeta sur le jeune corps étendu, et le couvrit. Et qui sait la mesure de tout ce qui se passa ! Et c’est ainsi que disparut et s’effaça la virginité de la jeune reine Abriza.
Une fois sa chose faite, le roi Omar Al-Némân se releva et alla dans la chambre voisine trouver l’esclave préférée d’Abriza, la fidèle Grain-de-Corail, et lui dit : « Cours vite chez ta maîtresse qui a besoin de toi ! » Et Grain-de-Corail se hâta d’entrer chez sa maîtresse et la trouva étendue sur le dos et saccagée, et la chemise relevée et les cuisses toutes teintes de sang et la figure toute pâle. Et Grain-de-Corail comprit que les soins étaient urgents ; et aussitôt elle prit un mouchoir dont délicatement elle tamponna la chose honorable de sa maîtresse ; puis elle prit un second mouchoir dont elle lui essuya soigneusement le ventre et les cuisses ; ensuite elle lui lava le visage, les mains et les pieds, et l’aspergea avec de l’eau de roses, et lui lava les lèvres et la bouche avec de l’eau de fleurs d’oranger.
Alors la reine Abriza éternua ; puis elle ouvrit les yeux et se releva sur son séant. Et elle aperçut sa préférée, Grain-de-Corail, et lui dit : « Ô Grain-de-Corail, que m’est-il donc arrivé ? Dis le moi. Voici que je me sens défaillir. » Et Grain-de-Corail ne put que lui raconter l’état dans lequel elle l’avait trouvée, étendue sur le dos et le sang lui filtrant à travers les cuisses. Et Abriza comprit alors que le roi Omar Al-Némân avait satisfait sur elle ses désirs et avait consommé en elle la chose irréparable. Et sa douleur et son chagrin furent tels, qu’elle ordonna à Grain-de-Corail de refuser à toute personne l’entrée de son appartement, et lui recommanda de dire au roi Omar Al-Némân, quand il viendrait demander de ses nouvelles : « Ma maîtresse est malade et ne peut recevoir personne. »
Aussi lorsque le roi Omar Al-Némân eut appris la chose, il se mit à envoyer chaque jour à Abriza des esclaves chargés de grands plateaux remplis de mets de toutes sortes et de boissons, et des coupes pleines de fruits et de confitures, et aussi des bols de porcelaine remplis de crèmes et de douceurs. Mais elle continua à rester enfermée dans son appartement jusqu’à ce qu’un jour elle se fût aperçue que son ventre grossissait, que sa taille devenait épaisse, et qu’elle était certainement enceinte. Alors son chagrin augmenta considérablement et le monde se rétrécit devant son visage ; et elle ne voulut point écouter les paroles consolatrices de Grain-de-Corail ; puis elle lui dit : « Ô Grain-de-Corail, c’est moi seule qui me suis mise dans cet état, en me comportant mal vis-à-vis de moi-même, en quittant mon père et ma mère et mon royaume ! Et voici que maintenant je suis dégoûtée de moi-même et de la vie, et mon courage s’est évanoui et ma force en allée ! Avec ma virginité, j’ai perdu toute ma fermeté, et ma grossesse me rend incapable de résister au choc d’un enfant. Et je ne pourrais même plus tenir les rênes de mon coursier, moi Abriza, la jeune Abriza, jadis pleine de flamme et de vigueur ! Que faire désormais ? Si j’accouche dans ce palais, je serai un objet de risée pour toutes les musulmanes qui l’habitent et qui sauront la manière dont j’ai perdu ma virginité. Et si je retourne chez mon père, avec quelle figure oserai-je le regarder ! Oh ! comme elles sont vraies ces paroles du poète :
» Ami ! sache bien que, dans le malheur, tu ne trouveras plus ni parents, ni patrie, ni maison hospitalière ! »
Alors Grain de Corail lui dit : « Ô ma maîtresse, je suis, moi, ton esclave, et je reste tout entière à tes ordres et sous ton obéissance ! Ordonne ! » Elle répondit : « Alors, ô Grain-de-Corail, écoute bien ! Il faut absolument que je sorte de ce palais, sans que personne puisse s’en douter, et que je retourne chez mon père et chez ma mère, malgré tout ; car vois-tu, ô Grain-de-Corail, si le cadavre vient à sentir, il est à la charge des siens ! Et je ne suis plus qu’un corps sans vie. Mais ensuite, qu’Allah accomplisse sa volonté ! » Et Grain-de-Corail répondit : « Ô reine, ce que tu désires faire est le mieux ! » Pui6 elle se mit, dès l’instant, à commencer secrètement les préparatifs du départ. Mais elles durent attendre l’occasion favorable, qui bientôt se présenta, et ce fut le départ du roi pour la chasse et le départ de Scharkân pour les frontières de l’empire où il avait à inspecter les places fortes. Mais, tandis qu’elles subissaient ce retard le temps de l’accouchement était devenu plus proche et Abriza dit à Grain-de-Corail : « Il faut que nous partions cette nuit même ! Mais que faire contre la destinée qui m’a marquée au front et a écrit que, dans trois ou quatre jours, mon accouchement devait avoir lieu ! Partons tout de même, car je préfère tout, plutôt que d’accoucher dans ce palais. Il te faut donc nous trouver un homme qui veuille nous accompagner dans notre voyage, car je n’ai plus la force de tenir moi-même l’arme la plus légère. » Et Grain-de-Corail répondit : « Par Allah ! ô ma maîtresse, je ne connais qu’un seul homme capable de nous accompagner et de nous défendre, c’est le grand nègre Morose, l’un des nègres du roi Omar Al-Némân ; car je l’ai bien des fois obligé et bien des fois je lui ai donné des gratifications ; et de plus, il m’a dit qu’autrefois il avait été brigand et coupeur de grands chemins. Et comme c’est lui qui est le gardien de la porte de notre palais, j’irai le trouver et je lui donnerai de l’or et je lui dirai qu’arrivées dans notre pays nous lui ferons faire un très beau mariage avec la plus jolie Grecque de Kaïssaria ! » Alors Abriza dit : « Ô Grain-de-Corail, ne lui dis rien toi-même, mais conduis-le-moi ici et je lui parlerai moi-même. »
Alors Grain-de-Corail sortit et alla trouver le nègre et lui dit : « Ô Morose, voici que le jour de ta fortune s’est enfin présenté. Mais pour cela tu n’auras qu’à faire ce que va te dire ma maîtresse. Viens donc ! » Et elle le prit par la main et le conduisit chez la reine Abriza.
Lorsque le nègre Morose eut vu la jeune femme, il s’avança et lui baisa les mains. Mais elle sentit que son cœur le repoussait, et son aspect lui déplut grandement ; pourtant elle pensa en elle-même : « La nécessité crée des obligations ! » et, malgré toute l’horreur qu’elle ressentait, elle lui dit : « Ô Morose, te sens-tu capable de nous venir en aide et de nous assister dans les coups du temps et nos infortunes ? Et si je te révélais mon secret, serais-tu assez discret pour ne pas le divulguer ? »
Alors le nègre Morose, qui à la seule vue d’Abriza avait senti l’amour enflammer son cœur, dit : « Ô ma maîtresse, je ferai tout ce que tu me commanderas ! » Et Abriza dit : « Je te demande, dans ce cas, de nous préparer à l’instant deux mulets pour porter nos bagages, et deux chevaux pour nous, et de nous faire sortir d’ici, moi et mon esclave-ci, Grain-de-Corail. Et je te promets que, dès que nous serons arrivés tous les trois dans notre pays, je te marierai avec la plus belle d’entre les Grecques, avec celle que tu choisiras. Et nous te comblerons d’or et de richesses. Et, si tu désires ensuite retourner dans ton pays, nous te renverrons dans ton pays comblé de dons et de bienfaits. »
À ces paroles, le nègre Morose se dilata d’une considérable dilatation, et s’écria : « Ô ma maîtresse, je vous servirai toutes deux avec mes deux yeux ! Et je partirai avec vous, certes ! Et je vais tout de suite vous préparer les montures et tout ce qu’il faut ! » Puis il sortit en pensant en lui-même : « Quel butin et quelle chance ! Certes je vais me réjouir et me délecter de la chair de ces deux lunes ! Et si l’une d’elles me repoussait, je la tuerais ! Et je volerais toutes leurs richesses ! » Et, bien résolu à la chose, il fit tous les préparatifs nécessaires ; et tous les trois purent sortir sans être remarqués, et malgré l’état de la reine Abriza.
Mais la reine Abriza, qui souffrait des douleurs de l’enfantement, fut obligée, dès le quatrième jour, de s’arrêter dans le voyage. Et, ne pouvant plus en endurer davantage, elle dit au nègre : « Ô Morose, aide-moi à descendre de cheval, car mes douleurs deviennent intolérables, et c’est la fin ! » Et elle dit à Grain-de-Corail : « Ô Grain-de-Corail, descends de cheval, toi aussi, et viens te mettre au-dessous de moi pour m’aider à accoucher ! »
Mais, une fois tous trois descendus de cheval, le nègre Morose, à la vue des appâts de la reine, fut dans un extrême état d’excitation, et son outil s’érigea terriblement et souleva sa robe. Alors il ne put plus le retenir, et, le tirant en l’air, il s’approcha de la jeune femme qui faillit s’évanouir d’indignation et d’horreur. Et il lui dit : « Ô ma maîtresse, laisse-moi, de grâce, t’approcher ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, elle renvoya la suite du récit au lendemain.
LA CINQUANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que l’horrible nègre Morose dit à la reine : « Ô ma maîtresse, de grâce, laisse-moi te posséder ! » Alors la reine Abriza dit : « Ô nègre, fils de nègre, ô fils des esclaves ! tu oses ainsi t’exhiber devant ma figure ! Quelle honte est la mienne d’être maintenant, sans défense, entre les mains du dernier d’entre les esclaves noirs ! Misérable ! qu’Allah seulement m’aide à me délivrer de l’état où je suis et à guérir mes parties féminines qui me rendent impuissante, et je punirai ton insolence de ma propre main ! Plutôt que de me voir toucher par toi, je préférerais me tuer moi-même et en finir avec mes souffrances et les malheurs de ma vie ! » Et elle récita ces strophes :
« Ô toi qui ne cesses de me poursuivre, quand donc finiras-tu ? Suffisamment, j’ai goûté à la dureté des épreuves suscitées par mon sort et mon destin. Mais j’espère que le Seigneur me délivrera du moins des brutes violatrices.
Pourquoi persistes-tu ? Ne t’ai-je point dit que je n’ai nulle envie ni penchant aucun pour la débauche basse ?… Assez donc me regarder avec cet œil avide de misérable affamé !
Et n’espère point me jamais toucher, à moins de me couper d’abord en morceaux avec le tranchant d’un glaive à la lame trempée dans l’Yaman.
Et n’oublie point que je suis une d’entre les pures, une d’entre les nobles et les plus sublimes de sang ! Comment donc, esclave, oses-tu vers moi lever les yeux, toi qui es loin d’appartenir à une race élégante et affinée ?… »
Lorsque le nègre Morose eut entendu ces vers, il entra dans une fureur très grande, et sa figure se congestionna de haine et ses traits se convulsèrent de dépit et ses narines s’enflèrent et ses grosses lèvres se contractèrent et tout son être trépida ; et il récita ses strophes :
« Ô femme ! ne me repousse point ainsi, victime de ton amour, massacré par tes regards triomphants ! Mon cœur déjà est morcelé de l’espérer ! Et mon corps entièrement épuisé avec ce qui restait en moi de patience.
Ta voix, seulement à l’entendre, m’ensorcelle et me captive. Et tandis que je suis tué par le désir, je m’aperçois que ma raison s’est envolée.
Mais je t’avise, ô implacable, que, couvrirais-tu même la terre de tes gardes et défenseurs, je saurais atteindre le but de mes désirs et boire l’eau dont je suis privé, l’eau naturelle qui me désaltérerait ! »
En entendant ces vers, Abriza se mit à pleurer de colère et s’écria : « Indécent esclave, ô nègre adultérin, penses-tu donc que toutes les femmes se ressemblent et oses-tu encore continuer à me parler de la sorte ? » Alors le nègre Morose, voyant qu’Abriza le repoussait absolument, ne put plus se contenir de fureur ; et il s’élança sur elle, l’épée à la main ; et il la saisit par les cheveux et lui passa son arme à travers le corps. Et ce fut de la main de ce nègre que mourut, de la sorte, la reine Abriza.
Alors le nègre Morose se hâta de s’emparer des mulets chargés des richesses et des biens d’Abriza, et, les poussant devant lui, s’enfuit à toute vitesse dans les montagnes.
Quant à la reine Abriza, elle avait, en expirant, accouché d’un fils entre les mains de la fidèle Grain-de-Corail qui, dans sa douleur, s’était couvert la tête de poussière et déchiré les habits et frappé les joues à en faire jaillir le sang ; et elle s’était écriée : « Ô ma maîtresse infortunée ! comment, toi la guerrière, la valeureuse, finir de cette manière sous les coups d’un misérable esclave noir ! »
Mais à peine Grain-de-Corail avait-elle cessé de se lamenter, qu’elle vit un nuage de poussière remplir le ciel et s’approcher rapidement ; et, soudain, il se dissipa et, d’en-dessous, apparurent des soldats et des cavaliers, et tous vêtus à la mode militaire de Kaïssaria. Or, c’était, en effet, l’armée du roi Hardobios de Kaïssaria, le père d’Abriza. Car des rumeurs étaient parvenues jusqu’au roi Hardobios, lui apprenant qu’Abriza s’était enfuie du monastère : il avait aussitôt rassemblé ses troupes, en avait pris lui-même le commandement et s’était mis en marche sur Baghdad ; et c’est ainsi qu’il arriva au lieu où venait de succomber sa fille Abriza.
À la vue du corps ensanglanté de sa fille, le roi se jeta à bas de son cheval et tomba évanoui en embrassant le corps étendu ; et Grain-de-Corail se remit à pleurer plus chaudement et à se lamenter. Puis, quand le roi fut revenu à lui, elle lui raconta toute l’histoire et lui dit : « Celui qui a tué ta fille est un nègre d’entre les nègres du roi Omar Al-Némân, ce roi plein de lubricité qui a fait ce qu’il a fait avec ta fille ! » Et le roi Hardobios, à ces paroles, vit le monde entier en noir, et résolut une vengeance terrible. Mais il se hâta de faire apporter une litière sur laquelle il plaça le corps de sa fille, et il fut obligé de retourner d’abord à Kaïssaria pour les devoirs de l’inhumation et les funérailles.
Lorsque le roi Hardobios fut arrivé à Kaïssaria, il entra dans son palais et fit venir sa nourrice, Mère-des-Calamités, et lui dit : « Nourrice, vois ce que les musulmans ont fait de ma fille ! Le roi a ravi sa virginité, et l’esclave l’a voulu violer et l’a tuée ! Et d’elle est né cet enfant que soigne Grain-de-Corail. Or, je jure par le Messie de venger ma fille et de laver l’opprobre dont on m’a couvert. Sinon je préférerais me tuer de ma propre main ! » Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Alors Mère-des-Calamités lui dit : « Pour ce qui est de la vengeance, ne t’en préoccupe pas, ô roi ! c’est moi seule qui ferai expier ses crimes à ce musulman. Car je le tuerai, lui et ses enfants, et d’une manière à faire longtemps l’objet des histoires que l’on racontera dans les temps futurs, dans toutes contrées de la terre. Mais il faut que tu écoutes bien ce que j’ai à te dire et que tu l’exécutes fidèlement. Voici. Il faut faire venir dans ton palais les cinq jeunes filles les plus belles de Kaïssaria, celles aux seins les plus beaux et à la virginité intacte. Et il faut faire venir, en même temps, les plus grands savants et les plus fins lettrés des contrées musulmanes qui avoisinent ton royaume. Et tu donneras l’ordre à ces savants musulmans d’élever les adolescentes d’après leur méthode. Et ils leur enseigneront ainsi la loi musulmane, l’histoire des Arabes, les annales des khalifes et tous les actes des rois musulmans ; de plus, ils leur enseigneront l’art de se conduire, la politesse, la façon de parler aux rois, la façon de leur tenir compagnie en leur servant à boire, les plus beaux vers et la plus gentille manière de les réciter, la manière de composer les poèmes et les discours, ainsi que l’art des chansons. Et il faut que cette éducation soit complète, même au risque de durer dix années ; car il nous faut prendre patience et savoir que les Arabes du désert disent : « La vengeance est encore réalisable même au bout de quarante ans. » Car la vengeance que je prémédite n’est réalisable que par cette éducation accomplie des adolescentes ; et, pour t’édifier, je te dirai que ce roi musulman a un grand faible pour la copulation avec ses esclaves et qu’il en a déjà trois cent soixante, outre les cent compagnes laissées par notre défunte reine Abriza et outre les cadeaux en femmes qui lui viennent en tribut de tous les côtés. C’est donc par son penchant que je le ferai périr ! »
À ces paroles, le roi Hardobios se réjouit d’une grande joie, et embrassa la tête de Mère-des-Calamités, et envoya immédiatement à la recherche des savants musulmans et des jeunes adolescentes aux seins arrondis et à l’intacte virginité.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CINQUANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le roi Hardobios envoya immédiatement à la recherche des savants musulmans et des jeunes adolescentes aux seins arrondis et à l’intacte virginité. Et il combla les savants de prévenances et de cadeaux, et les reçut avec une grande générosité ; puis il leur confia les belles adolescentes, choisies une à une, et leur recommanda de donner à ces adolescentes l’éducation musulmane la plus soignée. Et les savants lettrés obéirent et firent exactement ce que le roi leur avait ordonné. Voilà pour le roi Hardobios.
Mais pour ce qui est d’Omar Al-Némân, lorsqu’il fut de retour de la chasse et qu’il entra dans son palais et apprit la fuite d’Abriza et sa disparition, il fut très affecté et s’écria : « Comment se fait-il qu’une femme puisse sortir de mon palais sans que personne le sache ? Si mon royaume est aussi bien gardé que mon palais, c’est, en vérité, notre perte irrémédiable à tous ! Mais une autre fois que j’irai à la chasse, je saurai bien faire garder mes portes ! » Et pendant qu’il parlait de la sorte, voici que Scharkân revint aussi de son expédition et se présenta devant son père qui lui apprit la disparition d’Abriza. Aussi Scharkân, dès ce jour, ne put plus supporter la vue du palais de son père, d’autant plus que la petite Nôzhatou et le petit Daoul’makân étaient l’objet des soins les plus attentifs du roi. Et il s’attrista davantage de jour en jour et tellement, que le roi lui dit : « Qu’as-tu donc, ô mon fils, à jaunir de teint et à maigrir de corps ? » Et Scharkân lui dit : « Ô mon père, voici que, pour plusieurs raisons, le séjour de ce palais me devient intolérable. Je te demanderai donc, comme une faveur, de me nommer gouverneur d’une place forte quelconque d’entre les places fortes, où j’irai m’enterrer pour le restant de mes jours ! » Puis il récita ce vers du maître des proverbes :
« Pour moi, l’éloignement devient plus doux que le séjour ; mon œil ne verra plus ni mon oreille n’entendra les choses qui me rappellent la douce amie perdue ! »
Alors le roi Omar Al-Némân comprit les causes du chagrin de son fils Scharkân et se mit à le consoler et lui dit : « Ô mon enfant, que ton souhait soit satisfait ! Et comme le point le plus important de tout mon empire est la ville de Damas, voici que je te nomme gouverneur de Damas, à partir de ce moment ! » Et immédiatement il fit venir les scribes du palais et tous les grands du royaume et nomma, en leur présence, Scharkân gouverneur de la province de Damas. Et le décret de sa nomination fut écrit et promulgué séance tenante ; et aussitôt on prépara tout ce qu’il fallait pour le départ ; et Scharkân fit ses adieux à son père et à sa mère et au vizir Dandân auquel il fit ses dernières recommandations. Puis, après avoir accepté les hommages des émirs et des vizirs et des notables, il se mit à la tête de ses gardes et ne cessa de voyager qu’une fois arrivé à Damas. Et les habitants le reçurent au son des fifres et des cymbales, des trompettes et des clairons ; et ils ornèrent pour lui la ville et l’illuminèrent ; et ils allèrent tous en un grand cortège au-devant de lui, sur deux rangs bien distincts, les uns gardant bien la droite et les autres gardant bien la gauche. Et voilà pour Scharkân.
Mais pour ce qui est du roi Omar Al-Némân, quelque temps après le départ de Scharkân pour le gouvernement de Damas, il reçut la visite des savants qu’il avait chargés du soin et de l’éducation de ses deux enfants Nôzhatou et Daoul’makân. Et les savants dirent au roi : » Ô notre maître, nous venons enfin t’annoncer que tes enfants ont complètement fini d’apprendre et d’étudier, et ils savent bien les préceptes de la sagesse et de la politesse, les belles-lettres et la manière de se conduire. » À cette nouvelle, le roi Omar Al-Némân se dilata d’aise et de joie et fit de magnifiques cadeaux aux savants. Et il vit bien, en effet, que, surtout son fils Daoul’makân, âgé maintenant de quatorze ans, se faisait de plus en plus gracieux et beau et devenait un cavalier solide et admirable, en même temps qu’il était fort attaché aux pratiques religieuses et à la piété et aimait les pauvres et préférait sur toutes choses au monde la fréquentation des savants et des poètes, et la société des hommes versés dans la jurisprudence et le Koran. Et tous les habitants de Baghdad, hommes et femmes, l’aimaient et appelaient sur lui les bénédictions d’Allah.
Or, un jour arriva qui était le jour du passage à Baghdad des pèlerins venant de l’Irak pour se rendre à la Mecque, accomplir les devoirs du hadj annuel et ensuite aller à Médine visiter le tombeau du Prophète (que sur lui soient la prière et la paix d’Allah !)
Aussi lorsque Daoul’makân vit le saint cortège, sa piété s’attisa et il courut trouver le roi son père, et lui dit : « Je viens te trouver, ô père, pour prendre de toi la permission de faire le pèlerinage saint. » Mais le roi Omar Al-Némân essaya fort de l’en dissuader et lui refusa la permission et lui dit : « Tu es encore trop jeune, mon fils. Mais l’année prochaine, si Allah veut, j’irai moi-même au hadj et je te prendrai avec moi, sûrement ! »
Mais Daoul’makân, qui trouvait la chose future trop éloignée, courut chez sa sœur jumelle Nôzhatou et la trouva qui se disposait à faire la prière. Il la laissa donc achever la prière, puis il lui dit : « Nôzhatou, je suis tué par le désir d’aller au hadj et visiter le tombeau du Prophète (que sur lui soient la prière et la paix !) et j’en ai demandé l’autorisation à notre père qui me l’a refusée. Or, mon but maintenant est de prendre quelque argent et de m’en aller secrètement en pèlerinage, et surtout sans en aviser notre père ! » Alors Nôzhatou, enthousiasmée elle aussi, s’écria : « Par Allah sur toi ! je te conjure de m’emmener avec toi et de ne pas me laisser ici et me priver de la visite au tombeau du Prophète (que sur lui soient la prière et la paix !) ô mon frère ! » Il lui dit : « Soit ! à la tombée de la nuit, tu viendras me trouver. Et surtout prends bien garde d’en parler à qui que ce soit ! »
Aussi, à minuit, Nôzhatou se leva, s’habilla d’habits d’homme, pour se déguiser, habits que lui avait donnés son frère, qui était de sa taille et de son âge, prit avec elle quelque argent et sortit, en se dirigeant directement vers la porte du palais. Là, elle trouva son frère Daoul’makân qui était à l’attendre avec deux chameaux. Alors Daoul’makân aida sa sœur à monter sur l’un des chameaux accroupis, et monta lui-même sur le second chameau ; et, les bêtes s’étant relevées et mises en marche, ils arrivèrent, à la faveur de la nuit, au milieu des pèlerins et se mêlèrent à eux sans que personne se fût aperçu de leur arrivée. Et toute la caravane de l’Irak prit la route de la Mecque et sortit de Baghdad.
Et Allah leur écrivit la sécurité. Aussi ne tardèrent-ils pas à arriver tous en paix à la Mecque Sainte.
Là, Daoul’makân et Nôzhatou furent à la limite de la joie en arrivant sur le mont Arafat et en accomplissant, d’après le rite, les obligations sacrées ; et quel ne fut pas leur bonheur en faisant le tour de la Kaâba !
Mais ils ne voulurent pas se contenter de la Mecque et poussèrent la dévotion jusqu’à aller à Médine vénérer la tombe du Prophète (que sur lui soient la prière et la paix !).
Alors, comme le retour des pèlerins dans leur pays allait avoir lieu ; Daoul’makân dit à Nôzhatou : « ma sœur, je désire fort maintenant visiter en outre la ville sainte d’Abraham, l’ami d’Allah, celle que les juifs et les chrétiens nomment Jérusalem. » Et Nôzhatou dit : « Et moi aussi ! » Alors, après s’être bien mis d’accord à ce sujet, ils profitèrent du départ d’une petite caravane pour se mettre en route pour la ville sainte d’Abraham.
Après un voyage fort difficile, ils finirent par arriver à Jérusalem ; mais, en route, Daoul’makân et Nôzhatou eurent des accès de fièvre froide ; la jeune Nôzhatou, après quelques jours, finit par guérir ; mais Daoul’makân continua à être malade et son état ne fit que s’aggraver. Aussi, à Jérusalem, ils louèrent une petite chambre dans un des khâns, et Daoul’makân s’étendit dans un coin, en proie à la maladie ; et cette maladie empira d’une si grave façon que Daoul’makân finit par perdre entièrement connaissance et entra dans la période du délire. Et la bonne Nôzhatou ne le quittait pas un instant, et était fort soucieuse et fort chagrinée, ainsi seule dans un pays étranger, sans personne pour la consoler et l’aider.
Et comme la maladie ne s’éliminait pas et durait déjà depuis un temps assez long, Nôzhatou finit par épuiser ses dernières ressources, et n’eut plus un seul drachme entre les mains. Alors elle envoya au souk des crieurs publics le garçon qui servait les voyageurs au khân, après lui avoir donné un de ses propres vêtements pour qu’il le vendît et lui rapportât quelque argent. Et le garçon du khân le fit. Et Nôzhatou continua à agir de la sorte et à vendre tous les jours quelque chose de ses effets, pour soigner son frère, jusqu’à épuisement complet de tout ce qu’elle avait. Et il ne lui resta plus, pour tout bien, que les habits vieux dont elle était vêtue et la vieille natte en loques qui leur servait de couche, à elle et à son frère. Alors, se voyant dans ce dénûment, la pauvre Nôzhatou se prit à pleurer en silence.
Mais le soir même, Daoul’makân, par la volonté d’Allah, reprit connaissance et se sentit un peu mieux et, se tournant vers sa sœur, lui dit : « Ô Nôzhatou, voici que je sens les forces me revenir, et j’ai une bien grande envie de manger une brochette de petits morceaux de viande grillée de mouton. » Et Nôzhatou lui dit : « Par Allah ! ô mon frère, comment faire pour acheter la viande ? Je ne puis ne résoudre à aller demander l’aumône aux gens charitables ! Mais, sois tranquille, dès demain j’irai chez quelque riche notable et je m’engagerai chez lui, comme servante. Et de la sorte je pourrai gagner le nécessaire. Et, en tout cela, il n’y a qu’une seule chose qui me coûte, c’est d’être obligée de te laisser seul pendant la journée. Mais que faire ? Il n’y a de force et de puissance qu’en Allah le Très-Haut, ô mon frère ! et Lui seul peut nous faire retourner dans notre pays ! » Et Nôzhatou, à ces paroles, ne put s’empêcher d’éclater en sanglots.
Aussi le lendemain, à l’aube, Nôzhatou se leva et se couvrit la tête d’un vieux morceau de manteau en poil de chameau, que leur avait donné un bon chamelier, leur voisin au khân, et embrassa la tête de son frère et lui jeta les bras autour du cou en pleurant, et sortit tout en larmes du khân, sans savoir exactement où se diriger.
Et toute la journée Daoul’makân attendit le retour de sa sœur ; mais la nuit vint, et Nôzhatou n’était pas de retour. Et il l’attendit toute la nuit, sans fermer l’œil, et Nôzhatou ne revint pas ; puis le lendemain et la nuit suivante il en fut de même. Alors Daoul’makân fut pris d’une crainte très grande pour sa sœur, et son cœur se mit à trembler ; et de plus il était resté deux jours sans prendre aucune nourriture. Il se traîna alors péniblement jusqu’à la porte de la petite chambre et de là se mit à appeler le garçon du khân, qui finit par l’entendre ; et Daoul’makân le pria de l’aider à arriver jusqu’au souk. Alors le garçon le chargea sur ses épaules et le porta au souk et le déposa contre la porte fermée d’une boutique en ruines, et s’en alla.
Alors tous les passants et les marchands du souk s’attroupèrent autour de lui, et, en le voyant dans cet état de faiblesse et d’amaigrissement, ils se mirent à se lamenter sur lui et à le plaindre. Et Daoul’makân, n’ayant pas la force de parler, leur fit signe qu’il avait faim. Alors on se hâta de faire une quête pour lui, dans un plat de cuivre, auprès des marchands du souk, et on lui acheta tout de suite de quoi manger. Et comme la quête avait rapporté trente drachmes, on délibéra sur ce qu’il y avait à faire pour le mieux, dans l’intérêt du malade. Alors un vieux brave homme du souk dit : « Le mieux est de louer un chameau pour ce pauvre jeune homme et de le transporter à Damas, afin de le mettre à l’hôpital consacré aux malades par la générosité du khalifat. Car ici il mourrait certainement en restant sans soins, dans la rue. » Alors tout le monde fut d’accord ; mais, comme c’était déjà la nuit, on renvoya la chose au lendemain, et l’on mit à côté de Daoul’makân, à portée de sa main, une cruche d’eau et des vivres ; et tous rentrèrent chez eux, à la fermeture des portes du souk, en plaignant beaucoup le sort du jeune homme malade. Et Daoul’makân passa toute la nuit sans pouvoir fermer l’œil, tant il était préoccupé du sort de sa sœur Nôzhatou ; et il put à peine manger et boire, tant il était las et affaibli.
Aussi le lendemain, les braves gens du souk louèrent un chameau et dirent au conducteur : « Ô chamelier, tu vas prendre ce malade sur ton chameau et le transporter à Damas pour le mettre à l’hôpital, où il pourra guérir. » Et le chamelier répondit : « Sur ma tête, ô seigneurs ! » Mais, en lui-même, le perfide se dit : « Comment pourrais-je transporter de Jérusalem à Damas un homme qui est sur le point de mourir ! » Puis il fit s’accroupir son chameau, y plaça le malade, et, couvert de bénédictions par les gens du souk, il parla à son chameau en le tirant par le licou, et le chameau se releva et se mit en marche. Mais à peine avait-il traversé quelques rues, qu’il s’arrêta ; et, comme il était arrivé devant la porte d’un hammam, il prit Daoul’makân, qui n’avait plus sa connaissance, le déposa sur le tas de bois qui servait à chauffer le hammam, et s’en alla en toute hâte.
Aussi lorsque le chauffeur du hammam vint à l’aube pour vaquer à son travail, il trouva devant la porte ce corps étendu sur le dos, comme inanimé, et il se dit en lui-même : « Qui a bien pu ainsi jeter ce cadavre devant le hammam, au lieu de l’enterrer ? » Et, comme il se disposait à pousser le cadavre loin de la porte, Daoul’makân fit un mouvement. Alors le chauffeur s’écria : « Ce n’est point là un mort, mais c’est sûrement un mangeur de haschich, qui est venu échouer cette nuit sur mon tas de bois ! Ho ! ivrogne, mangeur de haschich ! » Puis, comme il se penchait pour lui crier la chose à la figure, il vit que c’était un tout jeune homme qui n’avait pas encore de poil aux joues et dont toute la physionomie dénotait une grande distinction et une grande beauté, malgré sa maigreur et les ravages de la maladie. Alors une grande pitié vint au chauffeur du hammam, qui s’écria : « Il n’y a de force et de puissance qu’en Allah ! Voici que je viens de juger témérairement un pauvre jeune homme, étranger et malade, alors que notre Prophète (que sur lui soient la prière et la paix d’Allah !) nous a tant recommandé de prendre garde au jugement hâtif et d’être charitables et hospitaliers envers les étrangers, surtout envers les étrangers malades ! » Et le chauffeur du hammam, sans hésiter un instant, prit le jeune homme sur ses épaules et retourna à sa maison et entra chez son épouse et le lui mit entre les mains en la chargeant de le soigner. Alors l’épouse du chauffeur étendit un tapis par terre, mit sur le tapis un oreiller tout neuf et bien propre, et coucha doucement l’hôte malade. Puis elle courut allumer le feu, à la cuisine, et chauffa de l’eau, et revint laver les mains, les pieds et le visage du jeune homme. De son côté, le chauffeur alla au souk acheter de l’eau de roses et du sucre ; et il revint vite asperger le visage du jeune homme avec l’eau de roses, et lui fit boire du sorbet au sucre et à l’eau de roses. Puis il tira de la grande caisse une chemise bien propre, parfumée par les fleurs de jasmin, et la lui mit lui-même sur le corps. Ces soins venaient à peine de se terminer, que Daoul’makân sentit aussitôt une fraîcheur entrer en lui et le vivifier comme une brise délicieuse…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CINQUANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que Daoul’makân sentit aussitôt une fraîcheur entrer en lui et le vivifier comme une brise délicieuse, et il put relever un peu la tête et s’appuyer sur les coussins. À cette vue, le chauffeur fut dans le bonheur, et il s’écria : « Louange à Allah pour le retour de la santé ! Ô Seigneur, je demande à ta miséricorde infinie d’accorder la guérison à ce jeune garçon par mon entremise ! » Et durant encore trois jours, le chauffeur ne cessa de faire des vœux pour sa guérison et de lui donner à boire des tisanes rafraîchissantes et de l’eau de roses, et de lui prodiguer les soins les plus délicats. Alors les forces se mirent à circuler petit à petit dans son corps ; et il put enfin ouvrir les yeux à la lumière et commencer à respirer librement. Et juste au moment où il se sentait mieux, le chauffeur entra et le trouva assis à son aise, avec une mine vive ; et il lui dit : Comment te sens-tu maintenant, mon fils ? » Et Daoul’makân répondit : « Je me sens en bonne santé et en vigueur. » Alors le chauffeur remercia Allah et courut au souk et acheta dix poulets, les plus beaux du souk, et revint et les donna à son épouse et lui dit : « Ô fille de mon oncle, voici dix poulets que je t’apporte. Il faut en tuer deux tous les jours, un le matin et un le soir, et les lui servir. »
Et aussitôt l’épouse du chauffeur se leva et égorgea un poulet et le fit bouillir ; puis elle le lui apporta et le lui donna à manger et lui fit boire le bouillon. Puis, lorsqu’il eut fini, elle lui présenta de l’eau chaude pour qu’il se lavât les mains. Alors il se reposa tranquillement en s’appuyant sur les coussins, une fois que l’épouse du chauffeur l’eut bien couvert pour qu’il ne prît pas froid. Et, il s’endormit de la sorte jusqu’au milieu de l’après-midi. Alors l’épouse du chauffeur se leva et fit bouillir le second poulet et le lui apporta, après l’avoir dépecé délicatement, et lui dit : « Mange, ô mon enfant ! Et que cela te soit sain et te procure la santé ! » Et pendant qu’il mangeait, le chauffeur du hammam entra et vit que son épouse suivait bien ses instructions ; et il s’assit au chevet du jeune garçon et lui dit : « Comment te sens-tu, ô mon enfant ? » Il répondit : « Grâce à Allah, en forces et en bonne santé. Et puisse Allah t’en récompenser par ses bienfaits ! » Et le chauffeur, à ces paroles, fut dans une très grande joie ; et il alla au souk et en rapporta du sirop de violettes et de l’eau de roses ; et il lui en fit boire.
Or, le chauffeur ne gagnait en tout que cinq drachmes par jour au hamman ; et sur ces cinq drachmes il en consacrait deux à Daoul’makân pour l’achat des poulets, du sucre, de l’eau de roses et du sirop de violettes. Et il continua à dépenser de la sorte pendant encore un mois de temps, au bout duquel les forces revinrent complètement à Daoul’makân et toute trace de maladie disparut. Alors le chauffeur et son épouse se réjouirent beaucoup, et le chauffeur dit à Daoul’makân : « Mon fils, veux-tu maintenant venir avec moi au hammam pour prendre un bain qui te sera salutaire, depuis le temps ! » Et Daoul’makân dit : « Mais certainement. » Alors le chauffeur alla au souk et revint avec un ânier et un âne, et fit monter Daoul’makân sur l’âne et, tout le long de la route jusqu’au hammam, il marcha à côté de lui en le soutenant avec beaucoup de soin et d’attention. Et il le fit entrer au hammam et, pendant que Daoul’makân se déshabillait, le chauffeur alla au souk acheter toutes les choses nécessaires pour le bain, et revint au hammam et dit : « Au nom d’Allah ! je vais commencer. » Et il se mit à frotter le corps de Daoul’makân en débutant par les pieds. Et pendant qu’il le lavait de la sorte, le masseur du hammam entra et fut tout confus de voir le chauffeur remplir ses fonctions à lui, masseur ; et il s’excusa beaucoup auprès du chauffeur pour le retard qu’il avait mis à venir dans la salle de massage ; mais le bon chauffeur dit : « En vérité, compagnon, je suis heureux de t’obliger et en même temps de servir ce jeune homme qui est l’hôte de ma maison. » Alors le masseur fit appeler le barbier et l’épileur, qui se mirent à raser et à épiler Daoul’makân ; et puis on le lava à grande eau. Alors le chauffeur le fit monter sur l’estrade et lui mit une chemise fine et une robe d’entre ses robes et un très gentil turban ; et il lui serra la taille avec une belle ceinture en laine multicolore, et le ramena à la maison sur l’âne en question. Et justement l’épouse du chauffeur avait tout préparé pour le recevoir : la maison avait été lavée entièrement, et les nattes bien nettoyées et le tapis et les coussins. Alors le chauffeur fit se coucher à son aise Daoul’makân et lui donna à boire un sorbet frais au sucre et à l’eau de roses ; et puis il lui donna à manger l’un des poulets en question, en lui dépeçant lui-même les bons morceaux et en lui faisant boire le bouillon, et cela jusqu’à satiété. Alors Daoul’makân remercia Allah pour ses bienfaits et le retour de la santé, et dit au chauffeur : « Oh ! combien ne te dois-je pas de remercîments pour tout ce que tu as fait pour moi ! » Mais le chauffeur dit : « Laisse cela, mon fils ! Et, si j’ai une chose maintenant à te demander, c’est de me dire enfin d’où tu viens et quel est ton nom. Car je ne doute plus, à voir ton visage et tes manières, que tu ne sois quelqu’un de distinction et de haut rang. » Alors Daoul’makân lui dit : « Dis-moi d’abord comment et où tu m’as trouvé, pour qu’ensuite je te raconte moi-même mon aventure. »
Alors le chauffeur du hammam dit à Daoul’makân : « Pour ce qui est de moi, je t’ai trouvé abandonné sur le tas de bois devant la porte du hammam, un matin que je me rendais à mon travail. Et je n’ai point su qui t’avait ainsi jeté ; et je t’ai recueilli simplement dans ma maison. Et voilà tout. » À ces paroles, Daoul’makân s’écria : « Louange à Celui qui redonne la vie aux ossements sans vie ! Et toi, mon père, sache maintenant que tu n’as pas obligé un ingrat ; et bientôt, je l’espère, tu en auras les preuves. Mais, dis-moi, je t’en prie, en quel pays suis-je donc ? » Le chauffeur lui dit : « Tu es dans la ville sainte de Jérusalem. » Alors Daoul’makân sentit amèrement l’éloignement où il se trouvait et qu’il était séparé de sa sœur Nôzhatou ; et il ne put s’empêcher de pleurer et il raconta son aventure au chauffeur, mais sans lui révéler la noblesse de sa naissance ; puis il récita ces strophes :
« On m’a mis sur les épaules une charge qu’elles ne peuvent porter, et le poids m’en est lourd et étouffant.
Je dis à l’amie, cause de ma douleur, à celle qui est toute mon âme : « Ô maîtresse ! ne saurais-tu encore un peu patienter avant l’irrémédiable séparation ? » Elle me dit : « Que dis-tu donc là ? Patienter ! La patience n’est point dans mes habitudes. »
Alors le chauffeur lui dit : « Ne pleure plus, mon enfant, et remercie au contraire Allah pour ta délivrance et ta guérison. » Et Daoul’makân lui demanda : « Quelle distance nous sépare de Damas ? » Le chauffeur dit : « Il faut, d’ici, six jours de marche. » Daoul’makân dit : « Je voudrais tant y aller ! » Mais le chauffeur répondit : « Ô mon jeune maître, comment pourrais-je te laisser aller seul à Damas, toi, un si jeune garçon ! Je crains beaucoup pour toi ! Si donc tu persistais à désirer ce voyage, je t’accompagnerais moi-même, et je déciderais aussi mon épouse à venir avec nous. Et de la sorte nous irions tous vivre à Damas, dans le pays de Scham, dont les voyageurs vantent tellement les eaux et les fruits. » Et, se tournant vers son épouse, le chauffeur lui dit : « Ô fille de mon oncle, veux-tu nous accompagner dans cette délicieuse ville de Damas, dans le pays de Scham, ou bien préfères-tu rester ici et attendre mon retour ? Car il me faut absolument accompagner notre hôte là-bas, vu que, par Allah ! il m’est fort pénible de m’en séparer ici et de le laisser, lui si jeune, aller tout seul à travers des routes inconnues dans une ville dont les habitants sont, dit-on, fort enclins à la corruption et aux excès. » Alors l’épouse du chauffeur s’écria : « Mais certainement, je vous accompagnerai. » Et le chauffeur fut ravi et dit : « Louange à Allah qui nous met ainsi d’accord, ô fille de mon oncle ! » Et, séance tenante, le chauffeur se leva et rassembla les effets et les meubles de la maison, tels que nattes, coussins, casseroles, chaudrons, mortier, plateaux et matelas, et les porta au souk des crieurs publics et les vendit à la criée. Et le tout lui rapporta cinquante drachmes qu’il commença à utiliser en louant un âne pour le voyage…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CINQUANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le chauffeur loua un âne sur lequel il fit monter Daoul’makân, et lui et son épouse marchèrent derrière l’âne et quittèrent la ville sainte pour Damas et ne cessèrent de voyager jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés dans cette ville. Et ils y parvinrent à la tombée de la nuit et allèrent loger dans le khân ; et le chauffeur se hâta d’aller au souk acheter, pour eux trois, de quoi manger et boire.
Et cet état ne cessant pas, ils restèrent ainsi au khân pendant encore cinq jours, au bout desquels l’épouse du chauffeur, épuisée par les fatigues du voyage, eut une fièvre froide dont en peu de jours elle mourut. Et l’épouse du chauffeur mourut en la grâce et la miséricorde d’Allah.
Aussi Daoui’makân fut-il fort affecté de cette mort, car il s’était habitué à cette femme charitable qui le servait avec tant de dévouement ; et il en prit le deuil en son âme ; et il se tourna vers le pauvre chauffeur qui était abîmé dans sa douleur et lui dit : « Ne t’afflige pas, mon père, car nous suivons tous le même chemin et nous franchirons la même porte. » Et le chauffeur se tourna vers Daoul’makân et lui dit : « Qu’Allah te récompense pour ta compassion, ô mon enfant ! Et puisse-t-il un jour changer nos peines en joies et éloigner de nous l’affliction ! Aussi à quoi sert-il de nous affliger plus longtemps, tout est écrit ! Levons-nous donc et parcourons un peu cette ville de Damas que nous n’avons pas encore eu le temps de voir, car je veux que tu aies enfin la poitrine dilatée et l’esprit heureux. » Et Daoul’makân dit : « Ton idée est un ordre ! »
Alors le chauffeur se leva et, la main dans la main, il sortit avec Daoul’makân ; et ils se mirent à parcourir lentement les souks et les rues de Damas. Et ils finirent par arriver devant une grande bâtisse où étaient les écuries du wali de Damas, car, à la porte, ils virent une quantité considérable de chevaux et de mulets, et beaucoup de chameaux accroupis que les chameliers chargeaient de matelas, de coussins, de ballots, de caisses et toutes sortes de charges ; et il y avait une foule d’esclaves et de serviteurs jeunes et vieux ; et tout ce monde criait et parlait et était dans le tumulte et le fracas. Et Daoul’makân se dit en lui-même : « Qui sait à qui appartiennent tous ces esclaves, ces chameaux et ces caisses ! » Puis il finit par s’en informer auprès de l’un des serviteurs, qui lui répondit : « C’est un cadeau du wali de Damas ; et il est destiné au roi Omar Al-Némân. Et tout le reste est le tribut annuel de la ville de Damas au roi Omar Al-Némân. »
Lorsque Daoul’makân eut entendu ces paroles, ses yeux se remplirent de larmes et il se récita doucement ces strophes :
« Si les amis du loin accusent mon silence et l’interprètent mal, comment pourrai-je répondre ?
Si mon absence a usé et tué en eux la vieille amitié, que me restera-t-il à faire ?
Et si je prends mes peines en patience, moi qui ai tout perdu et l’énergie, pourrai-je toujours répondre du restant de ma patience ? »
Puis il se tut un instant, et ces vers lui chantèrent à la mémoire :
« Il leva sa tente et s’en alla ; très loin il s’en alla fuir mes yeux qui l’adoraient.
Il fuit mes yeux qui l’adoraient, alors qu’il faisait frémir toutes mes entrailles.
Le beau s’est au loin en allé ! Ô ma vie ! mais mon désir est là et ne s’est point au loin en allé !
Hélas ! hélas ! te verrai-je encore, ô beau ? Alors quels reproches longs et détaillés ne te ferai-je pas ? »
Lorsque Daoul’makân eût fini ces strophes, il pleura. Alors le bon chauffeur lui dit : « Ô mon enfant, sois donc raisonnable ! C’est à grand’peine que nous avons fini par te faire regagner la santé, et tu vas maintenant retomber malade de toutes ces larmes que tu verses ! Calme-toi, de grâce, et ne pleure plus, car ma peine est grande et j’ai bien peur pour toi d’une rechute ! » Mais Daoul’makân ne put se retenir encore et, tout en pleurant au souvenir de sa sœur Nôzhatou et de son père, il récita ces vers admirables :
« Jouis de la terre et de la vie, car, si la terre reste, ta vie ne reste pas.
Aime la vie et jouis de la vie et, pour cela, pense que la mort est inévitable.
Jouis donc de la vie ! Le bonheur n’a qu’un temps, hâte-toi ! Et songe que tout le reste n’est rien.
Car tout le reste n’est rien ; car, en dehors de l’amour de la vie, tu ne recueilleras que vacuité et inanité, sur la terre !
Car le monde doit être comme le logis du cavalier voyageur. Ami, sois le cavalier voyageur de la terre ! »
Lorsqu’il eut fini de réciter ces vers, que le chauffeur du hammam avait écoutés extatiquement et qu’il essaya d’apprendre en les répétant à plusieurs reprises, Daoul’makân se mit à réfléchir pendant un certain temps. Alors le chauffeur, qui ne voulait pas l’importuner, finit par lui dire : « Ô mon jeune maître, tu penses toujours à ton pays et à tes parents, je crois ! » Daoul’makân dit : « Oui, mon père ! Aussi je sens que je ne puis plus rester un instant de plus dans ce pays-ci et je vais te faire mes adieux et partir avec cette caravane par petites étapes, sans me fatiguer trop, et j’arriverai de la sorte avec elle dans Baghdad, ma ville. » Alors le chauffeur du hammam lui dit : « Et moi avec toi ! Car je ne puis point te laisser seul ni me séparer de toi et, comme j’ai déjà commencé à être ton gardien, je ne veux pas m’arrêter maintenant en chemin. » Et Daoul’makân dit : « Qu’Allah te rende ton dévouement en bienfaits et en toutes sortes de dons ! » Et il fut extrêmement réjoui de cette bonne fortune.
Alors le chauffeur pria Daoul’makân de monter sur l’âne et lui dit : « Tu resteras sur l’âne, pendant le voyage, tant que tu voudras ; et quand tu seras fatigué de cette pose, tu pourras, si tu veux, descendre et marcher un peu. » Et Daoul’makân le remercia chaleureusement et lui dit : « En vérité, ce que tu fais pour moi, le frère ne le fait pas pour son frère ! » Puis tous deux attendirent le coucher du soleil et la fraîcheur de la nuit pour se mettre en route avec la caravane et sortir de Damas dans la direction de Baghdad. Et voilà pour Daoul’makân et le chauffeur du hammam.
Mais pour ce qui est de la jeune Nôzhatou, sœur jumelle de Daoul’makân, elle était sortie du khân de Jérusalem pour essayer de trouver une place de servante chez quelque notable et pouvoir, de la sorte, gagner un peu d’argent et soigner son frère et lui acheter les brochettes de viande grillée de mouton qu’il désirait. Et elle s’était couvert la tête avec la vieille pièce du manteau en poil de chameau et s’était mise à parcourir les rues au hasard, sans savoir où se diriger ; et elle avait l’esprit et le cœur fort préoccupés au sujet de son frère et à cause de l’éloignement où ils étaient tous deux de leurs parents et de leur pays ; et elle élevait sa pensée vers Allah miséricordieux, et ces vers lui vinrent sur les lèvres :
« Les ténèbres s’épaississent et enveloppent mon âme de tous côtés, et la flamme inexorable me mine et m’affaiblit ; et le désir en moi crie douloureusement et fait sur ma figure se peindre mes peines du dedans.
La souffrance de la séparation, dans mes entrailles habite avec dureté ; et la continuité d’une passion que rien ne rafraîchit m’abîme déplorablement.
L’insomnie est devenue la compagne de mon deuil et le feu du désir, mon aliment. Comment pourrai-je désormais taire le secret de mon âme ?
Moi qui ne connais rien de l’art et des moyens de cacher ce que j’ai de chagrin dans le cœur,
Dans ce cœur consumé des flammes liquides de l’amour qui me noient dans leur torrent.
Ô nuit, tu le sais ! Dans le calme de tes heures, ô messagère, va dire à celui que tu connais l’intensité de ma souffrance et témoigne que jamais tu ne m’as vue fermer l’œil dans tes bras. »
Et tandis que la jeune Nôzhatou se dirigeait ainsi vaguement à travers les rues, elle vit venir à elle un chef bédouin, accompagné de cinq de ses Bédouins, qui la regarda longuement et ressentit aussitôt un violent désir de posséder la belle fille à la tête couverte du vieux morceau de manteau, et dont les charmes ressortaient encore mieux sous cette étoffe grossière en loques. Et il s’avança hardiment de son côté et attendit qu’elle fût arrivée à une ruelle solitaire et fort étroite, et il s’arrêta devant elle et lui dit : « Ô jeune fille, es-tu libre ou esclave ? » À ces paroles du Bédouin, la jeune Nôzhatou resta immobile, puis elle dit : « De grâce, ô passant, ne me pose point de questions qui avivent mes peines et mon malheur ! » Il lui dit : « Ô jeune fille, si je te fais cette question, c’est que j’avais six filles ; j’en ai perdu déjà cinq et il ne me reste plus que la sixième qui vit seule tristement dans ma maison. Et je voudrais bien trouver pour ma fillette une compagne qui lui tiendrait compagnie et lui ferait passer le temps agréablement. Et je désirerais beaucoup que tu fusses libre pour te demander d’accepter l’hospitalité de ma maison et devenir ma fille adoptive et être de ma famille, pour faire oublier à ma fillette le deuil qu’elle garde depuis la mort de ses sœurs. »
Lorsque Nôzhatou eut entendu ces paroles, elle fut toute confuse et dit : « Ô cheikh, je suis une jeune fille étrangère, et j’ai un frère malade avec lequel je suis venue du pays du Hedjaz. Et je veux bien accepter d’aller dans ta maison pour tenir compagnie à ta fille, mais à condition d’être libre de m’en retourner, tous les soirs, auprès de mon frère. » Alors le Bédouin lui dit : « Mais certainement, ô jeune fille, tu ne tiendras compagnie à ma fille que le jour. Et même, si tu le veux, nous transporterons ton frère chez moi, pour qu’il ne soit jamais seul. » Et le Bédouin parla et fit si bien qu’il décida la jeune fille à l’accompagner. Mais le perfide n’avait songé, en tout cela, qu’à la séduire, car il n’avait pas trace d’enfants d’aucune espèce, ni gîte ni maison. En effet il ne tarda pas, lui et Nôzhatou et les quatre autres Bédouins, à arriver hors de la ville, à un endroit où tout était préparé pour le départ : les chameaux étaient déjà chargés et les outres remplies d’eau. Et le chef des Bédouins monta sur son chameau et plaça vivement Nôzhatou en croupe, derrière lui, et donna le signal du départ. Et l’on s’éloigna rapidement.
Alors la pauvre Nôzhatou comprit que le Bédouin l’avait enlevée et l’avait trompée complètement ; et elle se mit à se lamenter et à pleurer sur elle et sur son frère abandonné sans secours. Mais le Bédouin, sans s’émouvoir de ses supplications, marcha toute la nuit jusqu’à l’aube, sans s’arrêter, et finit par arriver en lieu sûr, loin de toute habitation, dans le désert. Alors, comme Nôzhatou continuait à pleurer, le Bédouin arrêta sa troupe et descendit de chameau et fit descendre Nôzhatou et s’approcha d’elle en fureur et lui dit : « Ô vile citadine sédentaire au cœur de lièvre, veux-tu cesser de pleurer, ou préfères-tu recevoir des coups de fouet à en mourir ? » À ces paroles brutales du Bédouin grossier, la pauvre Nôzhatou sentit son cœur se révolter et souhaita la mort pour en finir et s’écria : « Ô chef des brigands du désert, homme de malheur, tison d’enfer, comment oses-tu tromper de la sorte ma confiance et trahir ta foi et renier tes promesses ? Ô traître perfide, que veux-tu donc faire de moi ? » À ces paroles, le Bédouin, furieux, s’approcha d’elle, le fouet levé, et lui cria : « Vile citadine, je vois que tu aimes sentir le fouet sur ton derrière ! Or, je te préviens que si tout de suite tu ne cesses tes pleurs qui m’importunent et les paroles que ta langue insolente ose répondre devant ma face, je te prendrai la langue avec mes doigts, et je te la couperai et je te l’enfoncerai au milieu de ta chose entre tes cuisses ! Et cela, je te le jure sur mon bonnet ! » À cette menace horrible, la pauvre jeune fille, qui n’était pas habituée à ces brutalités de langage, se mit à trembler et se contint, de terreur, et elle se cacha la tête dans son voile et ne put s’empêcher de soupirer ce poème plaintif :
« Oh ! qui pourrait aller vers la demeure chérie où j’habitais, et faire parvenir mes larmes à leur destinataire ?
Hélas ! saurai-je plus longtemps endurer mon malheur dans une vie pleine d’amertume et de douleur ?
Hélas ! avoir si longtemps vécu heureuse et cajolée, pour maintenant tomber dans cet état de pitoyable misère ?
Oh ! qui pourrait aller vers la demeure chérie où j’habitais, et faire parvenir mes larmes à leur destinataire ? »
À ces vers admirablement rythmés, le Bédouin, qui adorait d’instinct la poésie, fut touché de pitié pour la belle malheureuse et il s approcha d’elle et lui essuya les larmes et lui donna à manger une galette d’orge et lui dit : « Une autre fois, il ne faut plus essayer de répondre quand je suis en colère, car mon caractère ne supporte pas cela. Et, comme tu me demandes ce que je peux faire de toi, voici ! Sache que je ne veux plus de toi ni comme concubine ni même comme esclave, mais je veux te vendre à quelque riche marchand qui te traitera avec douceur et te rendra la vie heureuse, comme je l’aurais, d’ailleurs, fait moi-même. Et je vais, dans ce but, te mener à Damas. » Et Nôzhatou répondit : « Que ta volonté soit faite ! » Et aussitôt on remonta à chameau et l’on repartit dans la direction de Damas ; et Nôzhatou toujours en croupe derrière le Bédouin. Et comme la faim la pressait, elle mangea un morceau de la galette d’orge donnée par son ravisseur.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CINQUANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que Nôzhatou mangea un morceau de la galette d’orge donnée par son ravisseur. Et l’on arriva bientôt à Damas, et on alla se loger dans le khân Sultani situé près de Bab El-Malek. Et comme Nôzhatou était fort triste et pâle de chagrin, et qu’elle continuait à pleurer, le Bédouin lui dit d’un ton furieux : « Si tu ne cesses point tes larmes, tu vas perdre ta beauté et ta valeur, et je ne pourrai plus te vendre qu’à quelque juif hideux. Réfléchis à cela, ô citadine ! » Puis le Bédouin enferma soigneusement Nôzhatou dans l’une des chambres du khân et se hâta d’aller au marché des esclaves voir les marchands d’esclaves ; et il leur proposa la belle fille ravie, en leur disant : « J’ai avec moi une jeune esclave que j’ai amenée de Jérusalem ; et elle a un frère malade que j’ai été obligé de laisser là-bas chez des parents à moi pour le faire bien soigner. Aussi il faut que celui d’entre vous qui voudra l’acheter n’oublie pas de lui dire, pour la tranquilliser, que son frère malade est soigné à Jérusalem dans sa maison même, à lui, acheteur. Et je me déciderai ainsi à la céder à bon compte. »
Alors l’un des marchands se leva et lui demanda : « Quel est l’âge de cette esclave ? » Le Bédouin répondit : « C’est une toute jeune fille encore vierge, mais déjà nubile. Elle est pleine d’intelligence, de politesse, de finesse d’esprit, de beauté et de perfections. Malheureusement, depuis la maladie de son frère, le chagrin l’a affaiblie, l’a amaigrie et lui a fait perdre un peu de la plénitude de ses formes. Mais tout cela, il est facile de le faire revenir avec un peu de soins et d’oubli. » Alors le marchand lui dit : « Je vais avec toi voir ton esclave, puisque tu m’en as énuméré les qualités ; mais à la condition que, si je ne la trouve pas à ma convenance, rien n’est conclu entre nous ; mais si elle est vraiment comme tu dis, je te l’achèterai au prix sur lequel nous tomberons d’accord ; mais je ne te payerai ce prix qu’une fois que j’aurai revendu moi-même l’esclave. Car il faut bien que je te dise mon intention : sache que je la destine au roi Omar Al-Némân, maître de Baghdad et du Khorassân et dont le fils, le prince Scharkân, est gouverneur de Damas, notre ville. Je monterai donc chez le prince Scharkân, qui me connaît, et je lui exposerai la chose, et il me donnera une lettre d’introduction auprès du roi Omar Al-Némân qui, en raison de son goût connu pour les esclaves vierges, ne manquera pas de me l’acheter un prix très avantageux. Et je te paierai alors le prix convenu entre nous deux. » Et le Bédouin répondit : « J’accepte de toi ces conditions. »
Alors ils se dirigèrent tous deux vers le khân Sultani, où était enfermée Nôzhatou, et le Bédouin appela à haute voix la jeune fille, dissimulée derrière la cloison, en lui disant : « Ho ! Nahia ! ho ! Nahia ! » car c’était là le nom que le Bédouin avait cru bon de donner à son esclave. Mais, à ce nom nouveau pour elle, la pauvre adolescente se mit à pleurer et ne répondit pas. Alors le Bédouin dit au marchand d’esclaves : « Tiens, la voici, là derrière. Je te permets de t’en approcher et de la bien examiner, mais sans l’effaroucher, et parle lui gentiment comme j’ai l’habitude de le faire moi-même. » Et le marchand passa derrière la cloison et s’avança vers l’adolescente et lui dit : « La paix sur toi, ô jeune fille ! » Et Nôzhatou répondit, d’une voix douce comme le sucre et avec la prononciation la plus exquise, en langue arabe : « Et sur toi la paix et les bénédictions d’Allah ! » À cet accent, le marchand fut charmé extrêmement ; et il regarda attentivement la jeune esclave, qui avait le visage recouvert du voile grossier, et se dit en lui-même : « Allah ! qu’elle est gracieuse et quelle pureté de langage ! » Et elle aussi regarda le marchand et pensa : « Ce vieillard a une figure très douce et un aspect vénérable et fort engageant. Fasse Allah que je devienne son esclave pour échapper à ce grossier Bédouin aux mœurs féroces et à l’aspect repoussant ! Aussi me faut-il répondre avec intelligence et faire ressortir mes bonnes manières et ma façon de parler gentiment, car ce marchand ne vient ici que pour entendre mon parler. » Et comme le marchand l’interrogeait en lui disant : « Comment te portes-tu, ô jeune fille ? » elle regarda modestement par terre et, doucement, répondit : « Ô vieillard vénérable, tu m’interroges sur mon état, et mon état ne peut être souhaité au pire de tes ennemis ! Mais toute personne porte sa destinée attachée à son cou, dit notre Prophète Mohammad — que sur lui soient la prière et la paix d’Allah ! »
Lorsque le marchand eut entendu ces paroles, il fut émerveillé à la limite de l’émerveillement et sa raison s’envola de joie, et il se dit : « Certes ! je suis sûr maintenant, bien que je n’aie pas encore vu ses traits, qui doivent être ravissants, que j’en tirerai ce que je voudrai du roi Omar Al-Némân ! » Puis il se tourna vers le Bédouin et ne put s’empêcher de lui dire : « Cette esclave est admirable ! Combien en demandes-tu ? » À ces paroles, le Bédouin, furieux, s’écria : « Comment oses-tu dire qu’elle est admirable, alors qu’elle est la plus vile des créatures ? Ne sais-tu que maintenant elle va s’imaginer qu’elle est vraiment admirable, et que je ne pourrai plus avoir d’autorité sur elle ? Va-t’en ! je ne veux plus la vendre ! » Alors le marchand comprit que le Bédouin était une brute absolue, et qu’aucun raisonnement ne pouvait avoir de prise sur lui. Aussi il le prit autrement et essaya de tourner la difficulté et dit : « Ô cheikh des Bédouins, je l’accepte pourtant, bien qu’elle soit la plus vile des créatures, et je l’achète malgré ses tares ! » Alors le Bédouin, un peu calmé, dit : « Soit ! mais combien m’en offres-tu, voyons ? » Le marchand répondit : « Le proverbe dit : c’est le père qui donne un nom à son fils ! Demande donc toi-même ce que tu penses légitime. » Mais le Bédouin ne voulut rien entendre et dit : « C’est à toi à faire ton offre. » Et le marchand pensa : « Ce Bédouin est une brute entêtée et totale. Que pourrais-je lui offrir, surtout maintenant que cette jeune fille vient de conquérir mon cœur par la douceur de son parler et son éloquence. Et je pense que, de plus, elle doit savoir lire et écrire ; certainement. C’est là l’effet d’une bénédiction bien rare d’Allah sur elle ! Et dire que ce Bédouin ne sait pas l’estimer à sa valeur ! » Puis, il se tourna vers le Bédouin et lui dit : « Je t’en offre deux cents dinars d’or, outre les arrhes et les droits de vente qui reviennent au Trésor et que je prends sur moi de payer. » Mais le Bédouin, furieux, s’écria : « Oh ! marchand, allons-nous en ! Je ne vends pas ! Car je ne céderais pas pour deux cents dinars même le vieux morceau de sac dont elle a la tête couverte ! C’est fini ! je ne veux pas la vendre, et je veux la garder avec moi et la ramener au désert pour lui faire paître mes chameaux et moudre mes grains ! » Puis il cria à la jeune fille : « Viens ici, ô pourrie ! Nous partons ! » Et comme le marchand ne bougeait pas, le Bédouin se tourna vers lui et lui cria : « Par mon bonnet ! je ne vends plus rien ! Tourne ton dos et va-t’en, ou sinon tu entendras de moi des choses qui ne t’agréeront pas ! »
Alors le marchand pensa à part lui : « Il n’y a plus de doute, ce Bédouin qui jure par son bonnet est un fou extraordinaire ! Je saurai tout de même lui faire lâcher prise, car cette jeune fille vaut tout un trésor de pierreries ; et si j’en avais le prix sur moi je le donnerais tout de suite à cette brute, pour en finir. » Puis il dit tranquillement au Bédouin en le tenant persuasivement par le manteau : « Ô cheikh des Bédouins, ne t’impatiente pas, de grâce ! Tu n’as pas, je le vois, l’habitude des ventes et des achats. Il faut beaucoup de patience et de savoir-faire dans ces questions. Sois tranquille, et, moi, je te donnerai, crois-le, tout ce que tu voudras. Mais me faudra-t-il encore, avant tout, comme cela se fait dans ces sortes d’affaires, voir le visage et les traits de l’esclave. » Et le Bédouin dit : « Je veux bien ! Regarde-la tant que tu voudras et mets-la, si tu le veux, complètement nue, et palpe-la et touche-la partout et tant que cela te plaira ! » Mais le marchand leva ses mains au ciel et s’écria : « Qu’Allah me garde de la mettre nue comme les esclaves ! je veux seulement voir son visage. »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQUANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le marchand dit : « Je veux seulement voir son visage. » Et il s’avança vers Nôzhatou, tout en s’excusant de la liberté, et s’assit plein de confusion à côté d’elle et lui demanda doucement : « Ô ma maîtresse, quel est ton nom ? » Elle lui dit en soupirant : « Me demandes-tu le nom que je porte à présent, ou mon nom du temps passé ? » Il lui dit, étonné : « Tu as donc un nom nouveau et un nom ancien ? » Elle répondit : « Oui, ô vieillard ! Mon nom ancien est Délices-du-Temps et mon nouveau est Oppression-du-Temps ! » À ces paroles, dites avec l’accent le plus triste, le vieux marchand sentit ses yeux se mouiller de larmes. Et la jeune Nôzhatou aussi ne put retenir ses larmes et récita plaintivement ces strophes :
« Mon cœur te garde, ô voyageur ! Vers quelles terres inconnues es-tu parti, chez quels peuples, dans quelle demeure habites-tu ?
À quelle source bois-tu, ô vagabond ? Ici, moi, celle qui te pleure, je me nourris des roses de mon souvenir et je me désaltère à l’abondante source de mes yeux.
Et de difficile ou dur à ma pensée, il n’est rien que ton éloignement. Car tout le reste, à côté, m’est maintenant chose riante et aisée. »
Mais le Bédouin trouva que la conversation durait trop longtemps et il s’approcha de Nôzhatou, le fouet levé, et lui dit : « Qu’as-tu à bavarder de la sorte ? Lève ton voile de visage et finissons-en ! » Alors Nôzhatou regarda le marchand et lui dit d’un ton désolé : « Ô vénérable vieillard, de grâce ! délivre-moi des mains de ce brigand sans foi qui ne connaît pas Allah ! Sinon, cette nuit même, je me tuerai certainement ! » Alors le marchand se tourna vers le Bédouin et lui dit : « Ô cheikh des Bédouins, en vérité, cette jeune fille est pour toi un embarras. Vends-la-moi donc au prix que tu veux ! » Mais le Bédouin s’écria : « Je te répète que c’est à toi à faire l’offre, ou je vais tout de suite la reprendre et la ramener au désert faire paître les chameaux et ramasser les excréments des bestiaux ! » Alors le marchand lui dit : « Eh bien ! pour en finir, je t’en offre, entends-moi bien, la somme de cinquante mille dinars d’or. » Mais cette brute entêtée répondit : « Ah, non ! Qu’Allah nous assiste ! cela ne fait pas l’affaire ! » Alors le marchand dit : « Soixante-dix mille dinars ! » Mais le Bédouin dit : « Qu’Allah nous assiste ! cela ne couvre pas même pas le capital que j’ai dépensé à la nourrir et à lui acheter des galettes d’orge ! car, sache-le bien, ô marchand, j’ai dépensé pour elle, rien qu’en galettes d’orge, quatre-vingt-dix mille dinars d’or ! » Alors le marchand, ahuri par la folie de cette brute, lui dit : « Mais, ô Bédouin, toi et tes parents et tous ceux de ta tribu, pendant toute votre vie, vous n’avez certainement pas mangé pour seulement cent dinars d’orge ! Mais, enfin, je vais te faire ma dernière offre et te dire ma dernière parole, et si tu refuses, j’irai de ce pas trouver le prince Scharkân, wali de Damas, et lui rapporter les mauvais traitements subis par cette jeune esclave que tu as certainement volée, ô brigand pillard ! » À ces paroles, le Bédouin dit : « Soit ! propose un peu cette somme, voyons ! » Et le marchand dit : « Cent mille dinars ! » Alors le Bédouin dit : « Je te cède l’esclave à ce prix, car j’ai besoin d’aller au souk acheter du sel. » Alors le marchand ne put s’empêcher de rire ; et il prit le Bédouin et la jeune esclave et les conduisit chez lui, et paya intégralement au Bédouin la somme convenue, après l’avoir fait peser soigneusement, dinar par dinar, par le peseur public. Alors le Bédouin sortit et remonta sur son chameau et prit le chemin de Jérusalem en se disant : « Si la sœur m’a rapporté cent mille dinars, le frère m’en rapportera au moins autant. Je vais donc aller à sa recherche. » Et, en arrivant à Jérusalem, il se mit en effet à la recherche de Daoul’makân dans tous les khâns ; mais comme celui-ci était déjà parti avec le chauffeur du hammam, le cupide Bédouin ne le trouva pas. Et voilà pour le Bédouin. Mais pour ce qui est de la jeune Nôzhatou…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQUANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
Mais pour ce qui est de la jeune Nôzhatou, voici ! Le bon marchand, une fois qu’il l’eut conduite dans sa maison, lui donna des vêtements fort riches et d’une grande finesse, tout ce qu’il y avait de plus beau, puis il alla avec elle au souk des orfèvres et des bijoutiers et lui fit choisir, à son goût, les bijoux et les joyaux qui lui plaisaient et il les mit tous dans une écharpe de satin et les porta à la maison et les lui mit entre les mains. Puis il lui dit : « Maintenant, tout ce que je désire de toi, en retour, c’est que tu n’omettes pas de dire au prince Scharkân, lorsque je t’aurai conduite dans son palais, le prix exact dont je t’ai achetée, pour qu’il n’oublie pas de le mentionner, à son tour, dans la lettre de recommandation que je désire avoir pour le roi Omar Al-Némân à Baghdad. Et, de plus, je voudrais que le prince Scharkân me donnât un sauf-conduit et une patente pour que les marchandises que désormais je prendrais avec moi, dans l’intention de les vendre à Baghdad, ne payent pas de droits ni d’impositions, à leur entrée à Baghdad. »
À ces paroles, Nôzhatou eut un soupir et ses yeux se mouillèrent de larmes. Alors le marchand lui dit : « Ô ma fille, pourquoi, chaque fois que je prononce le nom de Baghdad, te vois-je ainsi soupirer avec des larmes dans les yeux ? Y aurais-tu quelqu’un de toi aimé, ou un parent, ou un marchand ? Parle, ne crains rien ; car je connais tous les marchands de Baghdad et les autres. » Alors Nôzhatou dit : « Par Allah ! je n’y ai d’autre connaissance que le roi Omar Al-Némân lui-même, maître de Baghdad ! »
Lorsque le marchand de Damas eut entendu cette chose extraordinaire, il ne put s’empêcher de soupirer un grand soupir de bonheur et de contentement et se dit en lui-même : « Voilà mon but atteint ! » Puis il demanda à la jeune fille : « Lui aurais-tu été proposée déjà par un marchand d’esclaves, avant cette fois ? » Elle répondit : « Non ; mais simplement j’ai été élevée, dans son propre palais, avec sa fille. Et il me chérissait beaucoup ; et toute demande que je lui ferais, serait pour lui chose sacrée. Si donc tu voulais obtenir de lui une faveur quelconque, tu n’aurais qu’à me le dire et à m’apporter une plume, une écritoire et une feuille de papier, et je t’écrirais une lettre que tu remettrais en mains propres au roi Omar Al-Némân, et tu lui dirais : « Ô roi, ton humble esclave Nôzhatou a éprouvé les vicissitudes du sort et du temps et les souffrances des nuits et des jours ; et elle a été vendue et revendue, et a changé de maîtres et de maisons ; et elle se trouve pour le moment dans la demeure même de ton représentant à Damas. Et, de plus, elle te fait parvenir son salut et son souhait de paix ! »
À ces paroles surprenantes et pleines d’éloquence, le marchand fut à la limite de la joie et de l’étonnement, et l’affection pour Nôzhatou augmenta considérablement dans son cœur ; et, plein de respect, il lui demanda : « Sans doute, ô jeune fille merveilleuse, tu as dû être enlevée de ton palais et trompée et vendue. Et sans doute tu dois être versée dans les les lettres et la lecture du Koran. » Et Nôzhatou dit ; « En effet, ô vénérable cheikh ! Je connais le Koran et les préceptes de sagesse ; et, en outre, les sciences médicales ; le livre de l’Introduction aux arcanes ; les commentaires des œuvres d’Hippocrate et de Galien le Sage que j’ai moi-même annotés ; j’ai lu les livres de philosophie et de logique ; je connais les vertus des simples et les explications d’Ibn-Bitar ; j’ai discuté, avec les savants, le Kânoun d’Ibn-Sîna ; j’ai trouvé l’explication énigmatique des allégories et je les ai dénouées ; j’ai tracé toutes les figures de géométrie ; j’ai parlé avec connaissance de l’architecture ; j’ai longuement étudié l’hygiène et les livres Chafîat ; la syntaxe, la grammaire et les traditions de la langue ; et j’ai fréquenté la société des savants et des érudits dans toutes les branches ; et je suis moi-même l’auteur de plusieurs livres sur l’éloquence, la rhétorique, l’arithmétique, le syllogisme pur ; et je connais les sciences spirituelles et divines ; et j’ai retenu tout ce que j’ai appris ! Et maintenant donne moi le calam et la feuille de papier pour que j’écrive la lettre, si tu veux ! et je t’écrirai toute la lettre en vers bien rythmés, pour que, durant toute la route de Damas à Baghdad, tu puisses éprouver du plaisir à la lire et la relire, et te dispenser d’emporter avec toi des livres de voyage ; car elle te sera une douceur dans la solitude et un ami discret dans les loisirs ! »
Alors le pauvre marchand, complètement ahuri, s’exclama : « Ya Allah ! ya Allah ! heureuse la demeure qui te servira de gîte ! Et combien heureux celui qui habitera avec toi ! » Et il lui apporta respectueusement l’écritoire et les accessoires. Et Nôzhatou prit le calam, le trempa dans le tampon imbibé d’encre, l’essaya d abord sur son ongle, et écrivit ces vers :
« Cette écriture est de la main de celle aux pensées égales en tumulte aux vagues plaintives ;
» Celle dont l’insomnie a brûlé les paupières, et les veilles usé la beauté ;
» Celle qui, dans sa douleur, ne différencie plus le jour d’avec la nuit et se tord, lamentable, sur la couche solitaire ;
» Et qui n’a pour confidents que les astres silencieux dans la solitude fatale des nuits !
» Voici ma plainte en vers cadencés, à rime égale, que j’ai tissés en mémoire de tes yeux, ô toi, de mes doigts naturels.
» Des délices de la vie je n’ai senti nulle corde vibrer en mon âme,
» Et ma jeunesse n’a éprouvé nulle joie débordante ni sourire heureux dans un jour de félicité.
» Car ton absence a appris à mes yeux les veilles et m’a pour toujours enlevé le sommeil.
» Et j’ai eu beau confier à la brise mes soupirs, jamais la brise ne les a transmis à celui vers qui ils s’exhalaient.
» Aussi, désespérée, je n’ose plus insister. Mais je veux signer ma plainte et mon nom.
» Moi la douloureuse, l’éloignée de ses parents et son pays, la torturée de cœur et d’esprit,
Lorsque Nôzhatou eut fini d’écrire, elle sabla la feuille, la plia soigneusement et la remit au marchand qui la prit respectueusement, la porta à ses lèvres puis à son front, la serra dans une étoffe de satin et s’écria : « Gloire à Celui qui ta modelée, ô merveilleuse créature ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CINQUANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le marchand s’écria : « Gloire à Celui qui t’a modelée, ô merveilleuse créature ! » Et il ne sut comment faire pour rendre les honneurs dûs à son hôtesse ; et il lui prodigua toutes les marques du respect et de l’admiration ; et il pensa que probablement il fallait commencer par lui proposer un bain, dont elle devait avoir bien besoin. Et, en effet, la jeune fille y consentit avec empressement ; et il l’accompagna jusqu’au hammam, en marchant devant elle et en lui portant, dans une étoffe de velours, les effets propres dont elle devait s’habiller après le bain. Et il fit venir la meilleure masseuse du hammam et lui recommanda beaucoup la jeune fille et lui dit : « Une fois que le bain sera fini, tu viendras m’appeler. » Et pendant que Nôzhatou, aidée par la masseuse, prenait son bain, le vieux marchand alla au souk acheter toutes sortes de fruits et de sorbets et vint les déposer sur l’estrade où Nôzhatou devait venir s’habiller.
Alors la masseuse, une fois le bain terminé, accompagna Nôzhatou, en la soutenant, jusqu’à l’estrade et l’enveloppa de linges et de serviettes parfumées ; et elles se mirent toutes deux à manger les fruits et à boire les sorbets ; et, quand elles eurent fini, elles donnèrent le reste à la gardienne du hammam.
Et, à ce moment, arriva le bon marchand, et il portait un coffre en bois de santal. Il déposa le coffre sur l’estrade et l’ouvrit en invoquant le nom d’Allah, et commença, aidé par la masseuse, à procéder à l’habillement de Nôzhatou, pour la conduire ensuite chez le prince Scharkân. Et la toilette commença.
Le marchand donna d’abord à Nôzhatou une chemise fine en soie blanche et, pour la mettre sur ses cheveux, une écharpe tissée d’or qui coûtait à elle seule mille dinars. Il lui mit ensuite une robe taillée à la mode turque, toute brodée de fils d’or, et aux pieds, des bottines en cuir rouge parfumé au musc ; et ces bottines étaient recouvertes de paillettes d’or et ornées de fleurs incrustées de perles et de pierreries. Il lui passa ensuite aux oreilles des pendeloques en perles fines qui coûtaient chacune mille dinars d’or ; et il lui passa au cou un collier d’or filigrane et lui cercla les seins de réseaux de pierreries, puis, au-dessus du nombril, il lui entoura la taille d’une ceinture de dix rangs de boules d’ambre et de croissants d’or ; et dans chaque boule d’ambre était incrustée une pierre de rubis, et dans chaque croissant il y avait neuf perles et dix diamants. Et c’est ainsi que fut habillée la jeune Nôzhatou ; et elle portait sur elle, de la sorte, pour plus de cent mille dinars de bijoux et de joyaux.
Alors le marchand la pria de le suivre et il sortit avec elle du hammam et marcha devant elle, d’un air grave et respectueux, en écartant les passants sur sa route. Et tous les passants étaient ébahis de sa beauté et émerveillés de sa vue et ils s’écriaient : « Ya Allah ! Maschallah ! Gloire à Lui dans ses créatures ! Ô bienheureux l’homme dont elle est la propriété ! » Et le marchand continua à marcher, et elle derrière lui, jusqu’à ce qu’il fût arrivé au palais du prince Scharkân, gouverneur de Damas.
Et lorsqu’il fut entré chez le prince Scharkân, il baisa la terre entre ses mains et dit : « Voici que je t’apporte un présent incomparable, la plus belle et la plus merveilleuse chose de ce temps, un objet qui réunit en lui tous les charmes et tous les dons, toutes les qualités et toutes les délices ! » Alors le prince Scharkân lui dit : « Hâte-toi de me le montrer ! » Et le marchand sortit et revint en conduisant Nôzhatou par la main et la plaça debout devant le prince. Mais le prince Scharkân fut loin de reconnaître en cette merveille sa sœur Nôzhatou qu’il avait laissée toute jeune à Baghdad et qu’il n’avait d’ailleurs jamais vue, étant donné la jalousie qu’il avait ressentie à sa naissance et à celle de son frère Daoul’makân. Et il fut à la limite du ravissement devant cette taille et ces formes admirables, et surtout lorsque le marchand eut ajouté : « La voilà, cette chose incomparable, l’unique de son siècle. Mais, outre la beauté qui lui est un don naturel, elle possède toutes les vertus et elle est versée dans toutes les sciences religieuses, civiles, politiques et mathématiques. Et elle est prête à répondre à toutes les questions des plus grands savants de Damas et de l’empire ! »
Aussi le prince Scharkân n’hésita pas un instant et dit au marchand : « Dis au trésorier de t’en payer le prix et laisse-la-moi, et va en paix ! » Alors le marchand lui dit : « Ô prince valeureux, cette jeune fille, dans ma pensée, était primitivement destinée au roi Omar Al-Némân, ton père ; et je ne venais te voir que pour te prier de me donner une lettre de recommandation pour lui ; mais, puisqu’elle te plaît, qu’elle reste ici. Et ton désir est sur ma tête et dans mes yeux ! Mais, en retour, je te prierai seulement de me donner le droit de franchise désormais pour toutes mes marchandises, et le privilège de ne jamais plus payer d’impositions d’aucune sorte. » Alors Scharkân lui dit : « Je te l’accorde. Mais, en outre, dis-moi ce que la jeune fille t’a coûté, pour qu’à mon tour je t’en fasse rembourser le prix. » Et le marchand dit : « Elle m’a coûté cent mille dinars d’or ; et elle a sur elle pour cent mille autres dinars d’or. » Et Scharkân aussitôt fit appeler son trésorier et lui dit : « Paye tout de suite à ce vénérable cheikh deux cent mille dinars d’or et, en plus, cent vingt mille autres. Et, en outre, donne-lui la plus belle robe d’honneur de mes armoires. Et que dorénavant on sache qu’il est le protégé de ma puissance et que nulle imposition ne doit jamais plus lui être réclamée. »
Ensuite le prince Scharkân fit venir les quatre grands kâdis de Damas et leur dit…
Mais à ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTIÈME NUIT
Elle dit :
« Vous m’êtes témoins que, dès cet instant, j’affranchis et libère cette jeune esclave, que je viens d’acheter, et que j’en fais mon épouse. » Alors les quatre kâdis se hâtèrent d’écrire le certificat d’affranchissement ; et ils écrivirent ensuite le contrat de mariage et le scellèrent de leur sceau. Et le prince Scharkân ne manqua pas, dans sa générosité, de distribuer une grande quantité d’or à tous les assistants, pour fêter sa joie, et il en jeta à pleines mains des poignées qui s’éparpillèrent et furent ramassées par les serviteurs et les esclaves.
Alors le prince Scharkân congédia tous les assistants et ne garda dans la salle que les quatre grands kâdis et le marchand. Et il se tourna vers les kâdis et leur dit : « Maintenant, je veux que vous écoutiez les paroles que cette jeune fille va nous dire pour nous donner une preuve de son éloquence et de son savoir et pour que vous contrôliez les affirmations de ce vieux marchand. » Et les kâdis répondirent : « Nous écoutons et nous obéissons ! » Alors le prince Scharkân fit tomber un grand rideau au milieu de la salle, et plaça la jeune fille derrière pour qu’elle ne fût pas gênée et qu’elle pût se mettre à son aise et parler sans être vue par des hommes étrangers.
Et aussitôt que le rideau fut abaissé, les femmes de service vinrent entourer leur nouvelle maîtresse, et l’aidèrent à se mettre plus à son aise et à s’alléger d’une partie de ses vêtements ; et elles l’admiraient et s’émerveillaient de ses perfections, et, dans leur joie, lui embrassaient les pieds et les mains. Et, de leur côté, les épouses des émirs et des vizirs ne tardèrent pas à apprendre la nouvelle, et se hâtèrent de se rendre auprès de Nôzhatou pour lui présenter leurs hommages et entendre les paroles qu’elle allait dire devant le prince Scharkân et les grands kâdis de Damas. Et, avant de se rendre auprès d’elle, elles ne manquèrent pas d’en demander l’autorisation à leurs époux.
Lorsque Nôzhatou vit entrer les épouses des vizirs et des émirs, elle se leva pour les recevoir et les embrassa avec cordialité et les fit s’asseoir à côté d’elle derrière le rideau ; et elle leur souriait gentiment et leur disait des paroles de bienvenue pour répondre à leurs souhaits et à leurs hommages ; et elle fut si gentille que toutes s’émerveillèrent de sa politesse, de sa beauté, de ses manières et de son intelligence, et se dirent entre elles : « On nous a dit que c’est une esclave affranchie ; mais, en vérité, elle ne peut être qu’une reine de naissance et fille de roi. » Et elles lui dirent : « Ô notre maîtresse, tu as illuminé notre ville par ta présence et tu as comblé d’honneur notre pays et ce royaume. Et ce royaume est ton royaume, et ce palais, ton palais, et toutes nous sommes tes esclaves ! » Et elle les remercia beaucoup pour leurs paroles, et de la manière la plus douce et la plus agréable.
Mais, à ce moment, Scharkân l’interpella de l’autre côté du rideau, et lui dit : « Ô jeune fille très chère, le joyau de ce temps, nous sommes tous ici prêts à t’entendre nous dire quelques mots délicieux, toi qu’on dit versée dans toutes les sciences et même dans les règles si difficiles de notre syntaxe. » Alors la jeune Nôzhatou, d’une voix aussi douce que le sucre, répondit de derrière le rideau : « Ton désir est un ordre, et il est sur ma tête et dans mes yeux ! Aussi, pour satisfaire à ton souhait, je te dirai, ô mon maître, des paroles admirables sur les trois portes de la vie. »
PAROLES SUR LES TROIS PORTES
Et Nôzhatou, derrière le rideau, dit :
« Je te parlerai d’abord, ô prince valeureux, de la Première Porte : l’art de se conduire.
« Sache donc que la vie a un but et que le but de la vie est le développement de la ferveur.
« Or, la ferveur principale est la passion belle dans la foi.
« Mais nul n’atteint à la ferveur que par une vie ardente et passionnée. Et la vie passionnée peut être vécue et réalisée dans n’importe laquelle des quatre grandes voies de l’humanité : le Gouvernement, le Commerce, l’Agriculture et les Métiers.
« Pour ce qui est du gouvernement. Il est nécessaire que ceux-là, les rares qui sont appelés à gouverner le monde, soient doués d’une grande science politique, d’une finesse parfaite et d’une habileté accomplie. Et, dans aucun cas, ils ne doivent se laisser conduire par leur humeur, mais par un haut dessein dont la fin est Allah le Très-Haut. Et s’ils réglaient leur conduite sur cette fin, la justice régnerait parmi les humains et la discorde cesserait sur la surface de la terre. Mais, le plus souvent, ils ne suivent que leur penchant et glissent dans les errements irrémédiables. Car un chef n’est utile qu’en tant qu’il peut être équitable et impartial et empêcher les forts d’opprimer les faibles et les petits : sinon, il est sans nécessité.
« D’ailleurs, le grand Ardéchir, troisième roi des Perses, l’un d’entre les descendants de Sassân, a dit cette parole : « L’autorité et la foi sont deux sœurs jumelles : la foi est un trésor et l’autorité est son gardien. »
« Et notre Prophète Mohammad (sur lui soient la paix et la prière !) a dit : « Deux choses régissent le monde : droites et pures, le monde marche dans la voie droite ; corrompues et mauvaises, le monde tombe dans la corruption : c’est l’Autorité et c’est la Science !
« Et le Sage a dit : « Le roi doit être le gardien de la foi, de tout ce qui est sacré, et des droits de ses sujets. Mais, avant tout, il doit veiller à maintenir l’accord entre ceux qui tiennent la plume et les gens d’épée : car celui qui manque à l’homme qui tient la plume glissera et se relèvera bossu ! »
« Et le roi Ardéchir, qui fut un grand conquérant, divisa son empire en quatre districts ; et il se fit faire quatre sceaux sur quatre anneaux qu’il mit à ses doigts ; et chaque sceau était destiné à l’un des quatre districts. Le premier sceau était l’anneau du District maritime. Et ainsi de suite pour les trois autres. Et il avait fait ainsi afin d’assurer l’ordre dans toutes les parties de son royaume. Et sa méthode fut suivie jusqu’à l’ère islamique.
« Et le grand Kesra, roi des Perses, écrivit un jour à son fils, à qui il avait confié une armée d’entre
ses armées : « Ô mon fils…— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, arrêta son récit.
LA SOIXANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« Le grand Kesra, roi des Perses, écrivit un jour à son fils, à qui il avait confié une armée d’entre ses armées : « Ô mon fils, méfie-toi de la pitié, elle aliénerait ton autorité ; mais n’agis pas non plus avec trop de dureté, car elle ferait fermenter, parmi tes soldats, la révolte ! »
« Ceci nous a été rapporté également. Un Arabe vint trouver le khalifat Abou-Giafar-Abdallah Al-Mansour et lui dit : « Affame ton chien, si tu veux qu’il te suive. » Et le khalifat fut irrité contre l’Arabe. Et l’Arabe lui dit : « Mais prends garde aussi qu’un passant ne tende un pain à ton chien, car alors ton chien t’abandonnera pour suivre le passant ! » Alors Al-Mansour comprit et en fit son profit ; et il renvoya l’Arabe après lui avoir donné un cadeau.
« On raconte aussi que le khalifat Abd El-Malek ben-Merouân écrivit ceci à son frère Abd El-Aziz ben-Merouân, qu’il avait envoyé à la tête de son armée en Égypte : « Tu peux te passer de tes conseillers et de tes scribes, car ils ne te renseigneront que sur les choses que tu connais ; mais ne néglige jamais ton ennemi : il est le seul à te faire connaître la force de tes soldats ! »
« On dit que l’admirable khalifat Omar ibn-Al-Khattâb ne prenait jamais quelqu’un à son service sans lui poser ces quatre conditions : ne jamais monter sur une bête de somme, ne jamais s’approprier le butin fait sur l’ennemi, ne jamais s’habiller de vêtements somptueux et ne jamais être en retard pour l’heure de la prière. — Et voici les paroles qu’il aimait à répéter : « Il n’y a point de richesse qui vaille l’intelligence, ni de pierre de touche meilleure que la culture de l’esprit, ni de gloire plus grande que l’étude et la science. »
« C’est également Omar (qu’Allah l’ait en ses bonnes grâces !) qui a dit : « Les femmes sont de trois sortes : la bonne musulmane qui ne se préoccupe que de son mari et n’a d’yeux que pour lui ; la musulmane qui ne cherche dans le mariage qu’à avoir des enfants ; et la putain qui sert de collier au cou de tout le monde. Et les hommes également sont trois : l’homme sage qui réfléchit et agit après réflexion ; l’homme plus sage encore qui réfléchit, mais demande l’avis des hommes éclairés, et ainsi n’agit qu’avec une extrême prudence ; et l’écervelé qui n’a aucun jugement et ne demande jamais le conseil des sages. »
« Et le sublime Ali ben-Abou-Taleb (qu’Allah l’ait en ses bonnes grâces !) a dit : « Tenez-vous sur vos gardes contre les perfidies des femmes ; et jamais ne demandez leur avis ; mais ne les opprimez pas, si vous ne voulez pas les voir augmenter en ruses et en trahisons. Car celui qui ne connaît pas la modération marche vers la folie. Et, en toutes choses, vous devez user de justice, surtout envers vos esclaves. »
Et comme Nôzhatou allait continuer à développer ce chapitre, elle entendit, derrière le rideau, les kâdis s’écrier : « Maschallah ! jamais nous n’avons entendu de si belles paroles que celles dites par cette jeune fille pleine d’éloquence ; mais nous voudrions bien maintenant entendre quelque chose sur les deux autres Portes ! » Alors Nôzhatou, avec une transition d’une grande habileté, dit :
« Un autre jour, je parlerai de la ferveur dans les trois autres voies de l’humanité ; car il est temps que je vous entretienne de la Seconde Porte. « Cette seconde Porte est celle des bonnes manières et de la culture de l’esprit.
« Cette Porte, ô prince du temps, est la plus large de toutes, car elle est la Porte des Perfections. Ne peuvent la parcourir dans toute son étendue que ceux-là seuls qui ont sur leur tête une bénédiction native.
« Je vous en citerai seulement quelques traits choisis.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète selon son habitude, se tut.
LA SOIXANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« Je vous en citerai seulement quelques traits choisis.
« Un jour, l’un des chambellans du khalifat Moawiah vint lui annoncer que le plaisant pied-bot Aba-Bahr ben-Kaïs était à la porte dans l’attente d’une audience. Alors le khalifat dit : « Fais-le vite entrer. » Et Aba-Bahr le pied-bot entra, et le khalifat Moawiah lui dit : « Ô Aba-Bahr, approche-toi encore, que je me délecte mieux de tes paroles. » Puis il lui dit : « Ô Aba-Bahr, quelle est ton idée sur moi ? » Le pied-bot répondit : « Moi ? Mais mon métier, ô émir des Croyants, est de raser les têtes, de couper les moustaches, de curer et soigner les ongles, d’épiler les aisselles, de raser l’aine, de nettoyer les dents et au besoin de saigner les gencives ; mais jamais je ne fais rien de tout cela le jour du vendredi, car ce serait un sacrilège. » Alors le khalifat Moawiah lui dit : « Et quelle est ton idée sur toi-même ? Et Aba-Bahr le pied-bot dit : « Je mets un pied devant l’autre et lentement je le fais avancer en le suivant de l’œil. » Le khalifat lui demanda alors : « Et quelle est ton idée sur tes chefs ? » Il répondit : « En entrant, je les salue sans faire de geste, et j’attends qu’ils me rendent mon salut. » Alors le khalifat lui demanda : « Et quelle est ton idée sur ton épouse ? » Mais Aba-Bahr s’écria : « Dispense-moi de cette réponse, ô émir des Croyants ! » Et le khalifat dit : » Je t’adjure de me répondre, ô Aba-Bahr ! » Il dit : « Mon épouse, comme toutes les femmes, a été créée de la dernière côte, laquelle était une côte de mauvaise qualité et toute tordue. » Le khalifat dit : « Et comment fais-tu lorsque tu veux coucher avec elle ? » Il répondit : « Je lui parle agréablement pour la bien disposer, puis je lui donne des baisers un peu partout et vivement, pour la bien exciter ; et lorsqu’elle est au point que tu comprends, ô émir des Croyants, je la renverse sur le dos et je la charge. Et alors, lorsque la goutte de nacre s’est bien incrustée dans son fondement, je m’écrie : « Ô Seigneur, fais que cette semence soit couverte de bénédictions, et ne la façonne pas sous une forme mauvaise ; mais modèle-la selon la beauté ! » Cela fait, je me relève et je cours faire mes ablutions ; je prends l’eau dans mes deux mains et je la fais couler sur mon corps ; et enfin je glorifie Allah pour ses bienfaits ! » Alors le khalifat s’écria : « En vérité, tu as répondu délicieusement. Aussi je veux te voir me demander quelque chose. » Et Aba-Bahr le pied-bot dit : « Seulement que la justice soit égale entre tous ! » Et il s’en alla. Et le khalifat Moawiah dit : « Si dans tout le pays de l’Irak il n’y avait que ce sage, cela suffirait ! »
« Également sous le règne du khalifat Omar ibn-Al-Khattab, le trésorier était le vieux Moaïkab…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA SOIXANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la jeune Nôzhatou dit :
« Sous le règne du khalifat Omar ibn-Al-Khattab, le trésorier était le vieux Moaïkab. Or, le jeune fils d’Omar vint un jour voir Moaïkab, accompagné de sa nourrice. Et Moaïkab donna à l’enfant un drachme d’argent. Mais quelque temps après, le khalifat le fit appeler et lui dit : « Ô dilapidateur ! qu’as-tu fait ! » Et Moaïkab, qui était un homme intègre, s’écria : « Et qu’ai-je donc fait, ô émir des Croyants ? » Et Omar lui dit : « Ô Moaïkab, ce drachme d’argent que tu as donné à mon fils est un vol commis sur toute la nation musulmane ! » Et Moaïkab reconnut que c’était une faute, et toute sa vie il ne cessa de s’écrier : « Où y a-t-il, sur la terre, un homme aussi admirable qu’Omar ? »
« On raconte aussi que le khalifat Omar sortit une fois se promener la nuit, accompagné du vénérable Aslam Abou-Zeid. Et il vit au loin un feu qui flambait, et il s’en approcha, croyant sa présence utile, et il vit une pauvre femme qui allumait un feu de bois sous une marmite ; et elle avait à ses côtés deux petits enfants chétifs qui gémissaient lamentablement. Et Omar dit : « La paix sur toi, ô femme ! Que fais-tu donc là, seule dans la nuit et le froid ? » Elle répondit : « Seigneur, je fais chauffer un peu d’eau pour la donner à boire à mes enfants qui meurent de faim et de froid ; mais, un jour, Allah demandera compte au khalifat Omar de la misère où nous sommes réduits ! » Et le khalifat, qui était déguisé, fut ému extrêmement et lui dit : « Mais crois-tu, ô femme, qu’Omar connaisse ta misère, s’il ne la soulage pas ? » Elle répondit : « Pourquoi donc Omar est-il le khalifat, s’il ignore ainsi la misère de son peuple et de chacun de ses sujets ? » Alors le khalifat se tut et dit à Aslam Abou-Zeid : « Vite, allons-nous en ! » Et il marcha très vite jusqu’à ce qu’il fût arrivé à l’intendance de sa maison ; et il entra dans le magasin de l’intendance, et il tira un sac de farine d’entre les sacs de farine et aussi une jarre remplie de graisse de mouton, et il dit à Abou-Zeid : « Aide-moi à les charger sur mon dos, ô Abou-Zeid ! » Mais Abou-Zeid se récria et dit : « Laisse-moi les porter moi-même sur mon dos, ô émir des Croyants ! » Il répondit avec calme : « Mais serait-ce donc toi aussi, Abou-Zeid, qui porterait le fardeau de mes péchés au jour de la Résurrection ? » Et il obligea Abou-Zeid à lui mettre sur le dos le sac de farine et le vase de graisse de mouton. Et le khalifat marcha vite, ainsi chargé, jusqu’à ce qu’il fût parvenu auprès de la pauvre femme ; et il prit de la farine et il prit de la graisse et les mit dans la marmite sur le feu, et, de ses propres mains, il prépara cette nourriture, et il se pencha lui-même sur le feu pour souffler dessus ; et, comme il avait une très grande barbe, la fumée du bois se frayait chemin par les interstices de la barbe. Et lorsque cette nourriture fut prête, Omar l’offrit à la femme et aux petits enfants, qui en mangèrent jusqu’à satiété au fur et à mesure qu’Omar la leur refroidissait de son souffle. Alors Omar leur laissa le sac de farine et la jarre de graisse, et s’en alla en disant à Abou-Zeid : « Ô Abou-Zeid, maintenant que j’ai vu ce feu, sa lumière m’a éclairé ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la jeune Nôzhatou continua ainsi :
« Et c’est le même khalifat Omar qui, ayant un jour rencontré un esclave qui menait paître le troupeau de son maître, l’arrêta pour lui acheter une chèvre. Mais le berger lui dit ; « Elle ne m’appartient pas. » Alors le khalifat dit au berger : « Esclave admirable, je vais t’acheter toi-même et te libérer ! » Et il acheta le berger à son maître et l’affranchit. Car Omar se disait en lui-même : « On ne rencontre pas tous les jours un homme intègre ! »
« Un autre jour, Hafsa, la parente d’Omar, vint le trouver et lui dit : « Ô émir des Croyants, j’ai appris que l’expédition que tu viens de faire t’a procuré beaucoup d’argent. Aussi je viens, par le droit de ma parenté, t’en demander un peu. » Et Omar lui dit : « Ô Hafsa, Allah m’a constitué le gardien des biens des musulmans ; et tout cet argent est pour le bien commun des musulmans. Je n’y toucherai pas pour ton plaisir et ma parenté avec ton père ; et de la sorte je ne léserai pas les intérêts de l’ensemble de mon peuple ! »
Là, Nôzhatou, derrière le rideau, entendit les exclamations de ses auditeurs invisibles au comble de la satisfaction. Et elle cessa un instant de parler ; puis elle dit :
« Je parlerai maintenant de la Troisième Porte qui est la porte des vertus.
« Et ce sera par des exemples tirés de la vie des compagnons du Prophète (la paix et la prière sur lui !) et des hommes justes parmi les musulmans.
» On nous raconte que Hassan Al-Bassri a dit : « Il n’y a personne qui avant de rendre l’âme ne regrette trois choses en ce monde : de n’avoir pu jouir pleinement de ce qu’il avait amassé sa vie durant ; de n’avoir pu atteindre ce qu’il avait espéré avec constance ; et de n’avoir pu réaliser un projet longuement prémédité. »
» Et quelqu’un demanda un jour à Safiân : « Un homme riche peut-il être vertueux ? » Et Safiân répondit : « Il peut l’être, et c’est lorsqu’il use de patience contre les vicissitudes du sort et lorsqu’il remercie l’homme envers qui il a été généreux en lui disant : « Ô mon frère, je te dois d’avoir fait devant Allah une action parfumée ! »
« Et lorsque Abdallah ben-Scheddad vit s’approcher la mort, il fit venir son fils Mohammad près de lui et lui dit : « Voici, ô Mohammad, mes recommandations dernières : cultive la piété envers Allah en ton particulier et en public ; sois toujours véridique dans tes discours ; et glorifie toujours Allah pour ses dons et remercie-le, car le remercîment appelle d’autres bienfaits. Et sache bien, mon fils, que le bonheur n’est point dans les richesses accumulées, mais dans la piété ; car Allah te dispensera toutes choses ! »
« On nous raconte aussi que lorsque le pieux Omar ben-Abd El-Aziz devint le huitième khalifat ommiade, il rassembla tous les membres de la famille des Ommiades, qui étaient fort riches, et les obligea à lui remettre toutes leurs richesses et tous leurs biens, qu’il fit verser immédiatement au trésor public. Alors ils allèrent tous trouver Fatima, fille de Merouân, tante du khalifat, pour laquelle Omar avait beaucoup de respect, et la prièrent de les tirer de ce malheur. Et Fatima vint trouver le khalifat, une nuit, et s’assit en silence sur le tapis. Et le khalifat lui dit : « Ô ma tante, à toi la parole ! » Mais Fatima répondit : « Ô émir des Croyants, c’est toi le maître, et je ne saurais élever la voix, moi, la première. Et, d’ailleurs, rien ne t’est caché, même le motif de ma présence ici. » Alors Omar ben-Abd El-Aziz dit : « Allah Très-Haut a envoyé son prophète Mohammad (sur lui la paix et la prière !) afin qu’il fût un baume pour les créatures et une consolation pour toutes les générations futures. Alors Mohammad (sur lui la paix et la prière !) rassembla et prit tout ce qu’il jugea nécessaire, mais il laissa aux hommes un fleuve où étancher leur soif jusqu’à la fin des siècles. Et, à moi, le khalifat, il m’est échu ce devoir de ne point laisser ce fleuve dévier ni se perdre dans le désert ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA SOIXANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la jeune Nôzhatou, derrière le rideau, alors que l’écoutaient le prince Scharkân, les quatre kâdis et le marchand, continua de la sorte :
« Et à moi, le khalifat, il m’est échu ce devoir de ne point laisser le fleuve dévier ni se perdre dans le désert ! » Alors sa tante Fatima lui dit : « Ô émir des Croyants, les paroles, je les ai comprises, et les miennes deviennent inutiles. » Et elle s’en alla retrouver les Bani-Ommiah qui l’attendaient, et leur dit : « Ô descendants d’Ommiah, vous ignorez combien votre fortune est grande d’avoir pour khalifat Omar ibn-Abd El-Aziz ! »
« C’est toujours l’intègre khalifat Omar ibn-Abd El-Aziz qui, ayant senti l’approche de la mort, réunit autour de lui tous ses enfants et leur dit : « Le parfum de la pauvreté est agréable au Seigneur. » Alors l’un des assistants, Mosslim ibn-Abd El-Malek, lui dit : « Ô émir des Croyants, comment peux-tu laisser ainsi tes fils dans la pauvreté, alors que tu es leur père et le pasteur du peuple, et que tu pourrais les enrichir en puisant dans le trésor ? Cela ne vaudrait-il pas mieux que de laisser toutes ces richesses à ton successeur ? » Alors le khalifat, sur son lit étendu mourant, eut une grande indignation et une grande surprise et dit : « Mosslim, comment pourrais-je leur donner cet exemple de corruption, dans mes derniers instants, alors que toute ma vie je leur ai fait suivre la voie droite ? Ô Mosslim, j’ai assisté, dans ma vie, aux funérailles de l’un de mes prédécesseurs, l’un des fils de Merouân, et mes yeux virent des choses et les comprirent. Et alors je me suis bien juré de ne point agir comme il avait agi de son vivant, si je devais jamais être le khalifat ! »
« Et ce même Mosslim ben-Abd El-Malek nous raconte ceci : « Un jour, dit-il, que je venais de m’endormir au retour de l’enterrement d’un cheikh, un ascète, j’eus un rêve où m’apparut ce cheikh vénérable tout habillé de vêtements plus blancs que le jasmin ; et il se promenait dans un lieu de délices arrosé par des eaux courantes et rafraîchi par une brise enivrée de s’être arrêtée sur les citronniers fleuris. Et il me dit : « Ô Mosslim, que ne ferait-on pas, dans la vie, pour une telle fin ? »
« Et il est parvenu jusqu’à moi qu’un homme, sous le règne d’Omar ibn-Abd El-Aziz, dont le métier était de traire les brebis, ayant été voir un berger de ses amis, vit au milieu du troupeau deux loups qu’il crut être des chiens, et il fut grandement effrayé de leur aspect sauvage, et il dit au berger : « Que fais-tu là de ces terribles chiens ? » Et le berger lui dit : « Ô laitier, ce ne sont point des chiens, mais des loups apprivoisés. Et ils ne font pas de mal au troupeau, car je suis la tête qui dirige. Et quand la tête est saine, le corps est sain. »
« Et un jour le khalifat Omar ibn-Abd El-Aziz, du haut d’une chaire construite de boue desséchée, fit à son peuple assemblé un prône qui se réduisait à trois paroles seulement. Et il conclut par ces mots : « Abd El-Malek est mort, et morts aussi ses prédécesseurs et ses successeurs. Et moi aussi, Omar, comme eux tous, je mourrai ! » Alors Mosslim lui dit : « Ô émir des Croyants, cette chaire n’est point digne du khalifat, et elle n’a même pas une chaîne de rampe. Laisse-nous au moins y mettre une chaîne de rampe ! » Mais le khalifat lui dit d’une voix calme : « Ô Mosslim, voudrais-tu donc qu’Omar, au jour du jugement, portât au cou un morceau de cette chaîne ? »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA SOIXANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la jeune Nôzhatou dit ensuite :
« Le même khalifat dit un jour : « Je ne désire point qu’Allah me dispense de la mort, car c’est le dernier bienfait accordé au vrai Croyant ! »
« Et Khaled ben-Safouân alla un jour chez le khalifat Hescham, qui était sous les tentes entouré de ses écrivains et de ses serviteurs ; et lorsqu’il fut arrivé en sa présence, il lui dit : « Qu’Allah te comble de ses grâces, ô émir des Croyants, et qu’il ne mêle à ta félicité aucune goutte d’amertume. Et voici que j’ai à te dire des paroles non point neuves, mais douées de la valeur des choses anciennes ! » Et le khalifat Hescham lui dit : « Dis ce que tu as à dire, ô Ibn-Safouân ! » Il dit : « Il y avait, ô émir des Croyants, un roi d’entre les rois qui t’ont précédé, en une année d’entre les années passées sur la terre, et ce roi dit à ceux qui étaient assis autour de lui : « Ô vous tous, y a-t-il quelqu’un parmi vous qui ait connu un roi m’égalant en prospérité, ou généreux à l’égal de ma générosité ? » Or, parmi les assistants, se trouvait un homme sanctifié par le pèlerinage et doué de la vraie sagesse, qui dit : « Ô roi, tu nous as posé une question d’une importance considérable, à laquelle j’oserai te demander la permission de répondre. » Il dit : « Tu le peux ! » L’homme dit : « La gloire où tu es et ta prospérité sont-elles durables, ou passagères comme toutes choses ? » Il répondit : « Passagères. » L’homme dit : « Alors comment peux-tu poser une question aussi grave pour une chose aussi passagère et dont tu seras appelé à rendre compte un jour ? » Le roi répondit : « Tu dis vrai, ô très vénérable. Que me faut-il faire maintenant ? » L’homme dit : « Te sanctifier. » Alors le roi déposa sa couronne et revêtit l’habit de pèlerin et partit pour la Ville Sainte. » — Et toi, ô khalifat d’Allah, continua Ibn-Safouân, que penses-tu faire ? » Et le khalifat Hescham fut ému à la limite de l’émotion, et pleura extrêmement et si longtemps qu’il mouilla toute sa barbe. Et il rentra dans son palais s’y enfermer pour méditer. »
À ce moment, derrière le rideau, les kâdis et le marchand s’écrièrent : « Ya Allah ! que c’est admirable ! »
Alors Nôzhatou s’arrêta et dit : « Cette Porte de la Morale contient une telle quantité de traits encore plus sublimes qu’il m’est impossible de vous les narrer en une seule séance, ô mes maîtres ! Mais Allah nous accordera encore de longs jours, et je pourrai alors vous édifier tout à fait ! »
Puis Nôzhatou se tut.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, remit son récit au lendemain.
LA SOIXANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, qu’à ces paroles Nôzhatou se tut.
Alors les quatre kâdis s’écrièrent : « Ô prince du temps, en vérité cette jeune fille est la merveille du siècle et de tous les siècles. Quant à nous, jamais nous n’avons vu quelqu’un qui lui fût comparable, ni entendu dire qu’il y eût son égal dans une époque quelconque d’entre les époques ! »
Et, ayant ainsi parlé, ils se levèrent en silence et baisèrent la terre entre les mains du prince Scharkân, et s’en allèrent en leur chemin.
Alors Scharkân appela ses serviteurs et leur dit : « Il faut vous hâter de faire les préparatifs de la noce et d’apprêter toutes sortes de mets et de douceurs pour le festin. » Et les serviteurs se hâtèrent de suivre ses ordres et préparèrent immédiatement tout ce qu’il leur avait commandé. Et Scharkân retint pour la noce les épouses des émirs et des vizirs qui étaient venu écouter les paroles de Nôzhatou, et les invita à être du cortège de la mariée.
Aussi, à peine l’asr venu, le festin commença et les nappes furent tendues et l’on servit toutes choses pouvant satisfaire les sens et réjouir les yeux. Et tous les invités mangèrent et burent jusqu’à satiété. Alors Scharkân fit venir les chanteuses les plus illustres de Damas et toutes les almées du palais. Et la noce fit retentir la salle du festin et la joie emplit toutes les poitrines. Et tout le palais, la nuit venue, fut illuminé depuis la citadelle jusqu’aux portes extérieures, ainsi que toutes les allées, à droite et à gauche, du jardin. Et les émirs et les vizirs vinrent, une fois Scharkân sorti du hammam, présenter leurs hommages entre ses mains et leurs vœux de prospérité.
Et comme Scharkân était assis sur l’estrade spéciale des nouveaux mariés, voici que soudain entrèrent les femmes du palais, lentement sur deux rangs, avec la nouvelle mariée Nôzhatou soutenue par ses deux marraines. Et, après les cérémonies de rhabillement, elles conduisirent Nôzhatou dans la chambre nuptiale, et la déshabillèrent et voulurent procéder à sa toilette de corps ; mais elles virent qu’en vérité la toilette de corps était superflue pour ce miroir immaculé et cette chair d’encens. Alors les marraines firent à la jeune Nôzhatou les recommandations que font les marraines la nuit des noces aux jeunes filles, et lui souhaitèrent toutes sortes de délices et, l’ayant vêtue de la chemise fine seulement, elles la laissèrent seule, sur le lit.
Alors Scharkân fit son entrée dans la chambre nuptiale. Et il était loin de soupçonner que cette merveilleuse adolescente fût sa sœur Nôzhatou ; et elle également ignorait que le prince de Damas fût son propre frère Scharkân.
Aussi, cette nuit-là, Scharkân entra en possession de la jeune Nôzhatou ; et leurs délices, à tous deux, furent considérables ; et la chose fut si bien faite que du coup Nôzhatou devint enceinte. Et elle ne manqua pas de le révéler à Scharkân.
Alors Scharkân fut extrêmement réjoui et, lorsque vint le matin, il ordonna aux médecins d’inscrire ce jour heureux de la grossesse ; et il monta s’asseoir sur le trône pour recevoir les félicitations de ses émirs, de ses vizirs et des grands du royaume.
Cela fini, Scharkân fit venir son secrétaire particulier et lui ordonna d’écrire, sous sa dictée, à son père, le roi Omar Al-Némân, qu’il avait épousé une jeune fille achetée à un marchand et douée de beauté, de sagesse et de toutes les perfections de la science et de la culture ; qu’il l’avait affranchie pour en faire son épouse légitime ; qu’elle venait, dès la première nuit, d’être enceinte de lui, et qu’il avait l’intention de l’envoyer bientôt à Baghdad visiter le roi Omar Al-Némân, son père, sa sœur Nôzhatou et son frère Daoul’makân. Puis, la lettre écrite, Scharkân la cacheta et la remit à un courrier rapide qui partit aussitôt pour Baghdad et, au bout de vingt jours, revint avec la réponse du roi Omar Al-Némân. Et cette réponse était ainsi conçue…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
Et cette réponse la voici.
Après l’invocation à Allah :
« Ceci est de la part du désolé, du consterné, de l’accablé par la douleur et la tristesse, de celui qui a perdu son trésor d’âme et ses enfants, du malheureux roi Omar Al-Némân à son fils bien-aimé Scharkân.
« Apprends, ô mon enfant, mes malheurs, et sache qu’après ton départ pour Damas, je sentis tellement le logis se rétrécir sur mon âme que, n’en pouvant plus d’affliction, je partis à la chasse respirer l’air et tâcher de dissiper un peu mon chagrin.
« Et je restai ainsi à la chasse durant un mois, au bout duquel je rentrai dans mon palais et appris que ton frère Daoul’makân et ta sœur Nôzhatou étaient partis pour le Hedjaz, avec les pèlerins de la Mecque Sainte. Et ils avaient ainsi profité de mon absence pour s’échapper ; car je n’avais pas voulu autoriser Daoul’makân, à cause de son jeune âge, à entreprendre le pèlerinage cette année-là ; mais je lui avais promis de partir avec lui l’année suivante. Et il ne voulut point patienter, et s’échappa de la sorte, avec sa sœur, après avoir pris à peine de quoi subvenir aux dépenses de la route. Et je n’ai plus de leurs nouvelles. Car les pèlerins sont revenus sans tes frères ; et nul n’a pu me dire ce qu’ils sont devenus. Et voici que maintenant je me suis vêtu pour eux de mes habits de deuil, et je suis noyé dans mes larmes et ma douleur.
» Et ne tarde pas, ô mon fils, à me donner de tes nouvelles. Et je t’envoie mon souhait de paix à toi et à tous ceux qui sont chez toi ! »
Or, quelques mois après le reçu de cette lettre, Scharkân se décida à raconter le malheur de son père à son épouse, qu’il n’avait pas voulu troubler jusqu’alors, à cause de sa grossesse. Mais maintenant qu’elle avait accouché d’une fillette, Scharkân entra chez elle et commença d’abord par embrasser la fillette. Et son épouse lui dit : « La fillette vient d’avoir sept jours d’âge ; il te faut donc, selon la coutume, aujourd’hui que c’est le septième jour, lui donner un nom ! » Alors Scharkân prit la fillette dans ses bras et, comme il la regardait, il vit à son cou, suspendue par une chaîne d’or, l’une des trois merveilleuses gemmes d’Abriza, l’infortunée princesse de Kaïssaria.
À cette vue, Scharkân eut une telle émotion qu’il s’écria : « D’où as-tu cette gemme, ô esclave ? » Alors Nôzhatou, à ce mot d’esclave, se sentit étouffer d’indignation et s’écria :
« Je suis ta maîtresse et la maîtresse de tous ceux qui habitent ce palais ! Comment oses-tu m’appeler esclave, alors que je suis ta reine ! Ah ! mon secret ne saurait plus longtemps être gardé ! Oui, je suis ta reine, je suis fille de roi ! Je suis Nôzhatou’zamân, fille du roi Omar Al-Némân ! »
Lorsque Scharkân eut entendu ces paroles…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Lorsque Scharkân eut entendu ces paroles, il fut pris d’un tremblement de tout le corps et baissa la tête, atterré et plein de consternation ; puis il pâlit progressivement et tomba évanoui. Et lorsqu’il fut revenu à lui, il ne put encore croire à la chose, et demanda à Nôzhatou : « Ô ma maîtresse, es-tu la fille même du roi Omar Al-Némân ? » Elle répondit : « Je suis sa fille. » Alors il lui dit : « La gemme précieuse m’est déjà un signe de vérité ; mais donne moi d’autres preuves. » Et Nôzhatou raconta à Scharkân toute son histoire. Et il est inutile de la répéter.
Alors Scharkân fut complètement convaincu et se dit en lui-même : « Qu’ai-je fait, et comment ai-je pu me marier à ma propre sœur ! Aussi, comme seul moyen de tout sauver, il ne me reste qu’à lui trouver un autre mari ; et pour cela je la donnerai en mariage à l’un de mes chambellans, et, dans le cas où la chose viendrait à être connue, je ferais répandre le bruit que j’ai divorcé avant de coucher avec elle. » Puis Scharkân se tourna vers sa sœur et lui dit : « Ô Nôzhatou, sache à ton tour que tu es ma sœur, car je suis Scharkân, fils d’Omar Al-Némân, dont tu n’as sans doute jamais entendu parler au palais de notre père ! Et qu’Allah nous pardonne ! »
Lorsque Nôzhatou eut entendu ces mots, elle poussa un grand cri et tomba évanouie. Puis, revenue à elle, elle se mit à se frapper les joues et à se lamenter et à pleurer ; et elle dit : « Voici que nous sommes tombés dans une faute terrible ! Comment faire désormais ? Et que répondre à mon père et à ma mère lorsqu’ils me demanderont : « D’où as-tu cette fillette ? » Et Scharkân dit : « J’ai idée que la meilleure manière de tout arranger est de te donner en mariage à mon grand-chambellan ; car de la sorte tu pourras aisément élever notre fillette dans sa maison, comme si elle était sa propre fille, et personne ne pourra soupçonner l’affaire. Sois donc sûre, ô Nôzhatou, que tel est le meilleur moyen de sauver la situation. Je vais aussitôt faire appeler mon grand-chambellan, avant que ne s’ébruite notre secret. » Puis Scharkân se mit à consoler sa sœur et à lui embrasser tendrement la tête. Alors elle lui dit : « Je veux bien, ô Scharkân ! Mais, dis-moi, quel nom vas-tu maintenant choisir pour notre fille, car il n’est que temps ? » Et Scharkân dit : « Je l’appellerai Force-du-Destin ! »
Et Scharkân se hâta de faire appeler son grand-chambellant, lui donna Nôzhatou en mariage, séance tenante, et l’envoya chez lui, elle et la petite fille, en le comblant lui-même d’autres cadeaux. Et le grand-chambellan emmena Nôzhatou et sa fille dans sa maison, et ne manqua pas de la combler elle-même d’égards et de largesses et de confier la fillette aux soins des nourrices et des servantes.
Tout cela ! Et Daoul’makân, le frère de Nôzhatou, et le bon chauffeur du hammam s’apprêtaient à partir pour Baghdad avec la caravane de Damas.
Or, sur ces entrefaites, arriva un second courrier de la part du roi Omar Al-Némân, porteur d’une seconde lettre pour le prince Scharkân. Et voici le contenu de cette lettre.
Après l’invocation :
« Ceci est pour te dire, ô mon fils bien-aimé, que je continue à être en proie à ma douleur et à goûter l’amertume d’être séparé de mes pauvres enfants.
« Et ensuite ! Sitôt ma lettre reçue, il te faudra m’envoyer le tribut annuel de la province de Scham, et profiter de la caravane pour m’envoyer également ta jeune épouse que je désire beaucoup connaître, et dont surtout je souhaite fort mettre à l’épreuve la science et la culture d’esprit. Car je dois te dire que je viens de voir arriver dans mon palais, venant du pays des Roum, une vénérable vieille femme accompagnée de cinq adolescentes aux seins arrondis et à l’intacte virginité. Et ces cinq adolescentes connaissent tout ce qu’un homme peut atteindre dans les sciences et les connaissances humaines. Et la langue est impuissante à décrire les qualités de ces adolescentes et la sagesse de la vieille, car elles ont toutes les perfections. Aussi je me suis pris pour elles d’une véritable affection, et j’ai voulu les tenir en ma possession dans mon palais et mon royaume, à portée de ma main ; car nul roi sur la terre n’a semblable ornement pour son palais. J’en ai donc demandé le prix d’achat à la vieille qui me répondit : « Je ne pourrais les vendre qu’au prix du tribut annuel qui te revient de la province de Scham et de Damas. » Et moi, par Allah ! je n’ai point trouvé que ce prix fût élevé, et je l’ai même trouvé indigne d’elles ; car chacune des cinq adolescentes, à elle seule, vaut bien plus que cela. J’ai donc accepté ce prix d’achat et je les ai invitées à habiter dans mon palais, en attendant l’envoi prochain du tribut annuel que j’attends au plus vite de ta sollicitude, ô mon enfant. Car ici la vieille s’impatiente et a hâte de retourner dans son pays.
« Et surtout, mon fils, n’oublie pas de m’envoyer, en même temps, ta jeune épouse, dont la science nous sera utile pour juger des connaissances des cinq adolescentes. Et je te promets, si ta jeune épouse parvient à les vaincre en science et en culture d’esprit, de t’envoyer les adolescentes en présent à toi-même, et, en plus, de te faire cadeau du tribut annuel de la ville de Baghdad.
« Et que la paix soit sur toi et sur tous ceux de ta maison, ô mon fils ! »
Lorsque Scharkân eut lu cette lettre de son père…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
Lorsque Scharkân eut lu cette lettre de son père, il fit venir immédiatement son beau-frère le chambellan et lui dit : « Envoie tout de suite chercher la jeune esclave que je t’ai donnée en mariage. » Et lorsque Nôzhatou fut arrivée, Scharkân lui dit : « Ô ma sœur, lis cette lettre de notre père et dis-moi ce que tu en penses. » Et Nôzhatou, ayant lu la lettre, répondit : « Ce que tu penses est toujours bien pensé et ton projet est le meilleur. Mais, si tu m’interroges, je te dirai que mon désir le plus ardent est de voir mes parents et mon pays, et je te prierai de me laisser partir, en compagnie de mon époux le grand-chambellan, pour que je puisse raconter mon histoire à notre père et lui dire tout ce qui m’est arrivé avec le Bédouin et comment le Bédouin m’a vendue au marchand, et comment le marchand m’a vendue à toi, et comment toi, tu m’as donnée en mariage au premier-chambellan après avoir divorcé d’avec moi sans coucher. » Et Scharkân lui répondit : « Cela sera ainsi. »
Alors Scharkân appela le premier-chambellan, qui était loin de se savoir le beau-frère du prince, et lui dit : « Tu vas partir pour Baghdad à la tête de la caravane qui porte à mon père le tribut de Damas et tu prendras avec toi ton épouse, la jeune esclave que je t’ai donnée. » Et le premier-chambellan répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Alors Scharkân lui fit préparer une grande litière sur un beau chameau ; il fit préparer une seconde litière pour Nôzhatou, en vue du voyage, et remit une lettre au grand-chambellan pour le roi Omar Al-Némân, et leur fit ses adieux, après avoir gardé chez lui au palais la petite fillette Force-du-Destin et avoir bien constaté qu’elle avait toujours au cou, pendue à une chaîne d’or, l’une des trois gemmes précieuses de la malheureuse Abriza. Et il confia la fillette aux nourrices et aux servantes du palais ; et, lorsque Nôzhatou se fut bien assurée que sa fillette ne manquait de rien, elle s’éloigna avec son époux le chambellan. Et tous deux s’installèrent chacun sur un beau dromadaire de course et allèrent se mettre à la tête de la caravane.
Or, ce fut juste en cette nuit-là que le chauffeur du hammam et Daoul’makân, qui étaient sortis faire leur promenade jusqu’au palais du gouverneur de Damas, avaient vu les chameaux, les mulets et les porteurs de flambeaux. Et c’est alors que Daoul’makân avait demandé à l’un des serviteurs : « À qui appartiennent donc toutes ces charges ? » Et l’homme avait répondu : « C’est le tribut de la ville de Damas au roi Omar Al-Némân. »
Alors Daoul’makân demanda : « Et qui est le chef de la caravane ? » L’homme dit : « C’est le grand-chambellan, l’époux de la jeune esclave qui est tellement versée dans les sciences et la sagesse. » Alors Daoul’makân se mit à pleurer abondamment, car le souvenir lui revenait de sa sœur Nôzhatou, de sa famille et de son pays ; et il dit au bon chauffeur : « Ah ! mon frère, partons avec la caravane ! » Et le chauffeur dit : « Et je vais avec toi ; car je ne saurais te laisser seul aller à Baghdad après t’avoir accompagné de Jérusalem à Damas ! » Et Daoul’makân répondit : « Ô mon frère, je t’aime et te respecte ! » Alors le chauffeur prépara toutes choses, mit le bât sur l’âne et une besace sur l’âne et des provisions dans la besace ; puis il se serra la taille et releva les pans de sa robe et les attacha à sa ceinture, et fit monter Daoul’makân sur l’âne. Alors Daoul’makân lui dit : « Monte derrière moi. » Mais le chauffeur se récusa en disant : « Je m’en garderai bien, ô mon maître, car je veux être entièrement à ton service. » Et Daoul’makân dit : « Il faut au moins monter te reposer une heure derrière moi, sur l’âne ! » Il répondit : « Si par hasard je venais à me trop fatiguer, je monterais me reposer une heure derrière toi. » Alors Daoul’makân lui dit : « Ô mon frère, je ne puis, en vérité, rien te dire maintenant ; mais, à notre arrivée chez mes parents, tu verras, je l’espère, comment je saurai reconnaître tes bons services et ton dévouement. »
Et comme la caravane, profitant de la fraîcheur nocturne, se mettait en marche, le chauffeur, à pied, et Daoul’makân, sur l’âne, la suivirent, alors que le grand-chambellan et son épouse Nôzhatou, entourés de leur nombreuse suite, tenaient la tête de la caravane, montés chacun sur un dromadaire de race.
Et l’on marcha toute la nuit jusqu’au lever du soleil. Et, comme la chaleur devenait trop forte, le grand-chambellan donna l’ordre de faire halte à l’ombre d’un bouquet de palmiers. Et l’on descendit pour se reposer et l’on donna à boire aux chameaux et aux bêtes de somme. Après quoi l’on repartit et l’on marcha encore durant cinq nuits, au bout desquelles on arriva à une ville où l’on s’arrêta trois jours ; puis on continua le voyage jusqu’à ce que l’on ne fût plus qu’à quelque distance de la ville de Baghdad : ce dont on jugea à la brise qui en venait et qui ne pouvait venir que de la seule Baghdad…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
Lorsque Daoul’makân eut senti cette brise de son pays, les bouffées emplirent sa poitrine du souvenir de sa sœur Nôzhatou, de son père et de sa mère, et il pensa aussitôt à l’absence de sa sœur et à la douleur de ses parents le voyant revenir sans Nôzhatou ; et il pleura et se sentit oppressé extrêmement et récita ces strophes :
« Objet que j’aime ! ne pourrai-je jamais de toi me rapprocher ? objet que j’aime ! et ce silence sera-t-il toujours triomphant ?
Ah ! qu’elles sont courtes les heures de l’union et leurs délices ! Ah ! qu’ils sont longs les jours de l’absence !
Viens ! viens ! prends-moi par la main ! Voici que mon corps a fondu de toute l’ardeur de mon désir !
Viens ! et ne me dis pas d’oublier. Par Allah ! ne me dis pas de me consoler. Ma seule consolation serait de te sentir dans mes bras ! »
Alors le bon chauffeur lui dit : « Mon enfant, assez pleurer ainsi. Songe, d’ailleurs, que nous sommes assis tout près de la tente du chambellan et de son épouse. » Il répondit : « Laisse-moi pleurer et me réciter des poèmes qui me bercent et peuvent éteindre un peu la flamme de ce cœur ! » Et, sans plus écouter le chauffeur, il tourna son visage dans la direction de Baghdad, sous la clarté de la lune. Et comme en ce moment Nôzhatou, de son côté, étendue sous la tente, ne pouvait dormir, toute à la pensée des absents, et qu’elle rêvait tristement, les larmes aux yeux, elle entendit non loin de la tente la voix qui chantait passionnément ces vers :
« Il a brillé un instant, l’éclair de félicité. Mais après l’éclair, la nuit est encore plus la nuit. Ainsi pour moi se changea la douce coupe où l’ami me fit boire ses délices.
En allée au loin, la paix de mon cœur, quand apparut la face du destin, et morte mon âme avant la réunion attendue avec le bien-aimé. »
Et, ayant fini ce chant, Daoul’makân s’effondra sans connaissance.
Quant à la jeune Nôzhatou, épouse du chambellan, lorsqu’elle eut entendu ce chant qui s’élevait dans la nuit, elle se dressa anxieuse et appela l’eunuque qui dormait à l’entrée de la tente et qui accourut aussitôt et demanda : « Que désires-tu, ô ma maîtresse ? » Elle lui dit : « Cours vite chercher l’homme qui vient de chanter ces vers et amène-le-moi ici ! » Alors l’eunuque lui dit : « Mais je dormais et je n’ai rien entendu ! Et je ne pourrais le trouver dans la nuit, à moins de réveiller tous nos gens, qui sont endormis. » Elle lui dit : « Il le faut ! Celui que tu trouveras réveillé sera certainement celui dont je viens d’entendre la voix. » Alors l’eunuque n’osa pas insister et sortit à la recherche de l’homme à la voix.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA SOIXANTE-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
Alors l’eunuque n’osa insister et sortit à la recherche de l’homme à la voix. Mais il eut beau regarder de tous côtés et marcher dans toutes les directions, il ne trouva d’autre homme réveillé que le vieux chauffeur du hammam, car Daoul’makân gisait évanoui. Et, d’ailleurs, le bon chauffeur, à la vue de l’eunuque qui, à la clarté de la lune, paraissait de fort méchante humeur, eut grand peur que Daoul’makân eût troublé le sommeil de l’épouse du chambellan, et se tint coi. Mais déjà l’eunuque l’avait vu ; et il lui dit : « C’est bien toi qui viens de chanter ces vers que ma maîtresse a entendus ? » Alors le chauffeur fut complètement convaincu que l’épouse du chambellan avait été dérangée, et s’écria : « Oh, non ! ce n’est pas moi ! » L’eunuque dit : « Mais qui donc alors ? Indique-le-moi, car certainement tu as dû l’entendre et le voir, du moment que tu ne dormais pas. » Et le bon chauffeur, de plus en plus effrayé pour Daoul’makân, dit : « Mais non, je ne le connais pas et je n’ai rien entendu. » L’eunuque dit : « Par Allah ! tu mens avec impudence, et tu ne me feras pas croire, du moment que tu es réveillé et assis ici même, que tu n’aies rien entendu ! » Alors le chauffeur dit : « Je vais te dire la vérité ! Celui qui chantait ces vers est un nomade qui vient de passer par là monté sur un chameau. Et c’est lui qui m’a réveillé avec sa maudite voix ! Et puisse Allah le confondre ! » Alors l’eunuque se mit à hocher la tête d’un air guère convaincu et retourna, en maugréant, dire à sa maîtresse : « C’est un bonhomme de nomade qui est déjà loin sur son chameau ! » Et Nôzhatou, désolée de ce contre-temps, regarda l’eunuque et ne dit plus rien.
Sur ces entrefaites, Daoul’makân revint de son évanouissement ; et il vit, au-dessus de sa tête, la lune au fond du ciel ; et en son âme se leva la brise enchanteresse des évocations lointaines ; et en son cœur chanta la voix d’innombrables oiseaux et la modulation des flûtes invisibles de l’esprit ; et il fut pris de l’irrésistible désir d’exhaler en chants les intimes postulations qui le faisaient comme s’envoler. Et il dit au chauffeur : « Écoute ! » Mais le chauffeur lui demanda : « Que vas-tu faire, mon enfant ? » Il dit : « Réciter quelques vers admirables qui me calmeraient le cœur ! » Le chauffeur dit : « Ne sais-tu donc point ce qui est arrivé, et que ce n’est qu’en usant de bonnes manières envers l’eunuque que j’ai réussi à nous sauver d’une perte certaine ? » Et Daoul’makân demanda : « Que me dis-tu là, et quel eunuque ? » Le chauffeur répondit : « Ô mon maître, l’eunuque de l’épouse du chambellan est venu ici, avec une mine de travers, pendant que tu étais évanoui ; et il brandissait un grand bâton en bois d’amandier ; et il se mit à dévisager tous les gens endormis ; et, comme il ne trouvait que moi de réveillé, il me demanda, d’un ton courroucé, si c’était moi qui avais élevé la voix. Mais je lui répondis : « Ah, non ! pas du tout. C’est tout bonnement un nomade qui passait par le chemin ! », Et l’eunuque n’eut pas l’air de me croire tout à fait, car, avant de s’en aller, il me dit : « Si par hasard tu entendais la voix, tu saisirais l’homme pour me le livrer, afin que je puisse le conduire chez ma maîtresse ! Et je t’en rends responsable ! » Tu vois donc, ô mon maître, que c’est à grand’peine que j’ai pu détourner l’attention de ce noir soupçonneux. »
Lorsque Daoul’makân eut entendu ces paroles, il fut très affecté et s’écria : « Et quel est l’homme qui osera m’empêcher de me chanter à moi-même les poèmes qui me plaisent ? Je veux chanter tous les vers que j’aime, et il arrivera ce qui arrivera ! Et, d’ailleurs, qu’ai-je à craindre, maintenant que nous sommes tout proches de mon pays ; rien désormais ne saurait me troubler ! » Alors le pauvre chauffeur lui dit : « Je vois bien maintenant que tu veux absolument te perdre ! » Il répondit : « Il faut absolument que je chante ! » Le chauffeur dit : « Ne m’oblige pas à me séparer de toi, car je préfère m’en aller plutôt que de voir t’arriver du mal ! Oublies-tu, mon enfant, que voilà déjà un an et demi que tu es avec moi, et que jamais tu n’eus rien à me reprocher ? Pourquoi veux-tu maintenant me forcer à m’en aller ? Songe que tout le monde ici est harassé de fatigue et dort tranquillement. De grâce, ne va pas nous troubler avec tes vers, qui, d’ailleurs, je le reconnais, sont de toute beauté ! » Mais Daoul’makàn ne put se retenir davantage, et, comme la brise au-dessus d’eux chantait dans les palmes touffues, de toute sa voix il clama :
« Ô temps ! où sont les jours où nous étions les favoris du destin, où nous étions réunis dans la demeure chérie, dans la plus adorable des patries ?
Ô temps !… ? mais que tout cela est passé ! Car nous eûmes des jours pleins de rires et des nuits pleines de sourires !
Ah ! où sont les jours où s’épanouissait Daoul’makân, à côté d’une fleur nommée Nôzhatou’zamân !… »
Et, ayant fini ce chant, il poussa trois grands cris et tomba évanoui. Alors le bon chauffeur se leva et se hâta de le couvrir de son manteau.
Quant à Nôzhatou, lorsqu’elle eut entendu ces vers où étaient cités son nom et le nom de son frère, et où elle se reconnaissait bien dans ses malheurs, elle fut suffoquée par les sanglots, puis elle se hâta d’appeler l’eunuque et lui cria : « Malheur à toi ! L’homme qui a chanté la première fois vient de chanter une seconde fois, car je viens de l’entendre là, tout près ! Or, par Allah ! si tu ne me l’amènes pas tout de suite, j’irai trouver mon époux sous sa tente, et il te donnera la bastonnade et te chassera. Maintenant prends ces cent dinars et donne-les à l’homme à la voix, et décide-le avec douceur à venir ici ; et s’il refuse donne-lui cette bourse qui contient mille dinars ; et s’il refuse, n’insiste plus mais informe-toi de l’endroit où il loge et de ce qu’il fait et de quel pays il est ; et reviens vite me mettre au courant. Et surtout ne tarde pas ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
« Et surtout ne tarde pas ! »
Alors l’eunuque sortit de la tente de sa maîtresse, à la recherche de l’homme à la voix : et il se mit à marcher entre les jambes des gens endormis et à les dévisager tous un à un ; mais il ne trouva personne qui fût éveillé. Alors il s’approcha du chauffeur, qui était assis sans manteau et la tête découverte, et il le saisit par le bras et lui cria : « C’est toi seul qui es le chanteur ! » Mais le chauffeur, terrifié, s’écria : « Non, par Allah ! ce n’est pas moi, ô chef des eunuques ! » L’eunuque dit : « Je ne te laisserai point avant que tu ne m’indiques le diseur de vers ! Car je n’oserai jamais plus retourner, sans lui, auprès de ma maîtresse ! » À ces paroles, le pauvre chauffeur eut une très grande peur pour Daoul’makân, et il se mit à se lamenter et dit à l’eunuque : « Par Allah ! Je t’affirme que le chanteur est un passant du chemin ! Et ne me torture pas davantage, car tu en rendras compte au Jugement d’Allah ! Je ne suis qu’un pauvre homme qui viens de la ville d’Abraham, l’ami d’Allah ! » Mais l’eunuque lui dit : « Soit ! mais viens alors avec moi dire cela de ta bouche à ma maîtresse qui ne me croit pas ! » Alors le chauffeur lui dit : « Ô grand et admirable serviteur, crois-moi, retourne tranquillement sous la tente ; et si la voix vient encore à se faire entendre, tu m’en rendras, cette fois, absolument responsable. Et moi seul, dans ce cas, je serai le coupable ! » Puis, pour calmer l’eunuque et le décider à s’en aller, il lui dit des paroles très agréables et lui fit beaucoup de compliments et lui embrassa la tête.
Alors l’eunuque se laissa convaincre et le lâcha ; mais, au lieu de retourner chez sa maîtresse devant laquelle il n’osait plus se présenter, il fit demi-tour et revint se blottir à l’affût non loin du chauffeur du hammam.
Pendant ce temps, Daoul’makân était revenu de son évanouissement ; et le chauffeur lui dit : « Lève-toi maintenant, que je te raconte ce qui vient de nous arriver à cause de tes vers ! » Et il lui raconta la chose. Mais Daoul’makân, qui l’écoutait sans attention, lui dit : « Oh ! je ne veux plus rien savoir, et je n’ai plus de raison pour comprimer en moi mes sensations, maintenant surtout que nous sommes tout près de mon pays ! » Alors le chauffeur, épouvanté, lui dit : « mon enfant, assez écouter de la sorte les mauvaises suggestions ! Comment as-tu cette assurance, quand je suis moi-même plein de crainte pour toi et pour moi ? Par Allah sur toi, je te conjure de ne plus chanter des vers avant d’être arrivé tout à fait dans ton pays ! En vérité, mon enfant, jamais je ne t’eusse cru si entêté que cela ! Songe enfin que l’épouse du chambellan veut te faire châtier, car tu lui es une cause d’insomnie, alors qu’elle est fatiguée du voyage et indisposée : et elle a déjà par deux fois envoyé son eunuque te chercher ! »
Mais Daoul’makân, sans faire attention aux paroles du chauffeur, pour la troisième fois éleva la voix et, de toute son âme, il chanta ces strophes :
« Au loin ! Je ne veux plus de ces blâmes qui jettent le trouble dans mon âme et l’insomnie dans mes yeux.
Ils m’ont dit : « Comme tu es changé ! » Je leur dis : « Vous ne savez pas ! » Ils m’ont dit : « C’est l’amour ! » Je leur dis : « Est-ce que l’amour peut ainsi faire dépérir ? »
Ils m’ont dit : « C’est l’amour ! » Et je leur dis : « Je ne veux plus de l’amour, ni de la coupe de l’amour, ni des tristesses de l’amour.
Ah ! je ne veux plus que des choses subtiles qui calment et soient un baume à mon cœur torturé ! »
Mais à peine Daoul’makân avait-il fini de chanter ces vers que soudain devant lui l’eunuque apparut. À cette vue, le pauvre chauffeur fut tellement terrifié qu’il s’enfuit au plus vite et se mit de loin à regarder ce qui allait arriver.
Alors l’eunuque s’avança respectueusement près de Daoul’makàn et lui dit : « La paix sur toi ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que l’eunuque dit : « La paix sur toi ! » Alors Daoul’makân répondit : « Et sur toi la paix et la miséricorde d’Allah et ses bénédictions ! » Et l’esclave dit : « Ô mon maître, voici que, pour la troisième fois, ma maîtresse m’envoie à ta recherche, car elle désire te voir. » Mais Daoul’makàn répondit : « Ta maîtresse ! et quelle est cette chienne-là qui a l’audace de m’envoyer chercher ? Puisse Allah la confondre et la maudire, elle, et son époux avec elle ! » Et, non content de cette sortie, Daoul’makân se mit à injurier l’eunuque sans discontinuer, pendant un bon moment. Et l’eunuque ne voulut rien répondre, car sa maîtresse lui avait bien recommandé de ne prendre le chanteur que par la douceur et de ne l’amener chez elle que de son propre vouloir. Aussi l’eunuque fit tout son possible pour lui dire des paroles onctueuses et adoucir son emportement ; il lui dit, entre autres choses : « Mon enfant, cette démarche que je fais auprès de toi n’est point pour t’offenser ou pour te faire de la peine, mais simplement pour te supplier de vouloir bien diriger tes pas généreux de notre côté, pour parler à ma maîtresse qui désire ardemment te voir. Et, d’ailleurs, elle saura bien reconnaître ta bonté pour elle ! »
Alors Daoul’makân fut touché et consentit à se lever et à accompagner l’eunuque sous la tente, tandis que le pauvre chauffeur, de plus en plus tremblant de peur pour Daoul’makàn, se décidait à le suivre de loin, en pensant en lui-même : « Quel malheur pour sa jeunesse ! Sûrement demain, au lever du soleil, il sera pendu ! » Puis il eut une pensée terrible qui le rendit encore plus épouvanté que jamais, car il se dit : « Qui sait même si Daoul’makân, pour se disculper, ne va pas maintenant rejeter la faute sur moi et prétendre que c’est moi qui ai chanté les vers ! Oh ! cela serait bien vilain de sa part ! »
Or, pour ce qui est de Daoul’makân ét de l’eunuque, ils se mirent à circuler avec difficulté entre les gens endormis et les bêtes et finirent par arriver à l’entrée de la tente de Nôzhatou. Alors l’eunuque pria Daoul’makân d’attendre et entra tout seul prévenir sa maîtresse en lui disant : « Voici que je t’amène l’homme en question. Et c’est un tout jeune homme de très belle figure et dont le maintien prouve une haute et noble origine. » À ces paroles, Nôzhatou sentit se précipiter les battements de son cœur et dit à l’eunuque : « Fais-le s’asseoir tout près de la tente et prie-le de nous chanter encore un peu de ses vers, pour que je les entende de près. Et ensuite tu t’informeras de son nom et de son pays. » Alors l’eunuque sortit et dit à Daoul’makân : « Ma maîtresse te prie de lui chanter quelques-uns de tes vers, et elle est à t’écouter, dans la tente. Et elle désire également savoir ton nom et ton pays et ton état. » Il répondit : « De tout cœur généreux et comme hommage dû ! Mais pour ce qui est de mon nom, il est depuis longtemps effacé, comme mon cœur est consumé et mon corps abîmé. Et mon histoire est digne d’être écrite avec les aiguilles sur le coin intérieur de l’œil. Et je suis devenu tel l’ivrogne qui a tellement abusé des vins qu’il en est devenu infirme pour la vie ! Et je suis comme le somnambule ! Et je suis comme le noyé de la folie ! »
Lorsque Nôzhatou, dans la tente, eut entendu ces paroles, elle se mit à sangloter et dit à l’eunuque : « Demande-lui s’il a perdu quelqu’un de cher, comme, par exemple, une mère, un père ou un frère ! » Et l’eunuque sortit et questionna Daoul’makân comme le lui avait ordonné sa maîtresse. Il répondit : « Hélas ! oui, j’ai perdu tout cela et, en plus, une sœur qui m’aimait et dont je n’ai plus de nouvelles, car le destin nous a séparés ! » Et Nôzhatou, à ces paroles que lui rapporta l’eunuque, dit : « Fasse Allah que ce jeune homme puisse trouver une consolation dans ses malheurs et se réunir à ceux qu’il aime ! » Puis, elle dit à l’eunuque…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que Nôzhatou, l’épouse du chambellan, dit à l’eunuque : « Va maintenant le prier de nous chanter quelques vers sur l’amertume de la séparation. » Et l’eunuque alla lui faire la prière comme l’avait ordonné sa maîtresse. Alors Daoul’makân, assis non loin de la tente, appuya sa joue sur sa main, et comme la lune éclairait les gens endormis et les bêtes, sa voix fusa dans le silence :
« Dans mes vers aux rimes mélodieuses, j’ai assez chanté l’amertume de l’absence et le triomphe de cette cruelle, de l’éloignement de qui j’ai tant souffert.
Maintenant, moi qui de poudre d’or sertis mes vers admirablement ouvrés, je ne veux plus chanter que les choses de joie et l’épanouissement,
Les jardins de roses parfumés, et les gazelles aux yeux noirs et les cheveux des gazelles.
Bien que la cruelle ait déjà été le jardin de mes délices, et ses joues les roses du jardin, et ses seins les poires et les grenades, et sa chair le miel et la rosée.
Mais désormais, sans m’attarder ni m’attacher, je veux passer ma vie dans la sérénité, entre de tendres vierges flexibles comme les jeunes rameaux flexibles, entre des beautés intactes comme les perles imperforées,
Au son des luths suaves et des guitares, en buvant la coupe aux mains de l’échanson, dans les prairies de roses et de narcisses.
Et je humerai tous les parfums de la chair, et je sucerai la salive délicate sur les lèvres, en choisissant des lèvres épaisses et de couleur rouge foncé.
Et je reposerai mes yeux sur leurs tièdes paupières. Et nous serons assis en rond près de Veau vive chantante de mes jardins ! »
Lorsque Daoul’makân eut fini de chanter ce poème sublime, Nôzhatou, qui l’avait écouté en extase, ne put plus se retenir et, soulevant fiévreusement la portière de latente, elle pencha la tête au dehors et regarda le chanteur, à la clarté de la lune. Et elle poussa un grand cri, car elle reconnut son frère. Et elle s’élança au dehors, les bras tendus, en s’écriant : « Ô mon frère ! ô Daoul’makân ! »
À cette vue, Daoul’makân regarda la jeune femme et il reconnut également sa sœur Nôzhatou. Et ils se jetèrent dans les bras l’un de l’autre en s’embrassant, puis tombèrent tous deux évanouis.
Lorsque l’eunuque eut vu cela, il fut à la limite de l’étonnement et tout à fait interloqué ; mais il se hâta de prendre dans la tente une grande couverture et l’étendit sur eux, en signe de respect et pour les mettre à l’abri contre les passants du hasard. Et il attendit, tout songeur, qu’ils fussent revenus de leur évanouissement.
Bientôt, en effet, Nôzhatou se réveilla la première, et puis Daoul’makân. Et Nôzhatou, dès cet instant, oublia toutes ses peines passées et elle fut au comble du bonheur, et elle récita ces strophes :
« Tu avais juré, ô destin, que mes peines ne passeraient jamais. Et voici que je t’ai forcé à violer ton serment.
Car mon bonheur est complet et l’ami est à mes côtés. Et toi-même, ô destin, tu seras l’esclave qui, relevant les pans de sa robe, nous servira. »
En entendant cela, Daoul’makân serra sa sœur contre sa poitrine, et les larmes de joie débordèrent de ses paupières, et il récita ces strophes :
« Le bonheur en moi a pénétré, et sa violence est telle que les pleurs jaillissent de mes yeux.
Ô mes yeux ! vous avez pris l’habitude des larmes ; vous pleuriez hier de chagrin et pleurez aujourd’hui de bonheur. »
Alors Nôzhatou invita son frère à entrer avec elle sous la tente et lui dit : « Ô mon frère, raconte-moi à présent tout ce qui t’est arrivé pour qu’à mon tour je te raconte mon histoire ! » Mais Daoul’makân lui dit : « Raconte-moi, toi la première, toute ton histoire ! » Alors Nôzhatou narra à son frère tout ce qui lui était arrivé, sans omettre un détail. Et il n’y a pas d’utilité à le répéter. Puis elle ajouta : « Quant à mon époux le chambellan, tout à l’heure je te le ferai connaître ; et il t’agréera, car c’est un très brave homme. Mais d’abord hâte-toi de me raconter tout ce qui t’est survenu depuis le jour où je t’ai laissé malade dans le khân de la Ville Sainte. » Alors Daoul’makân ne manqua pas de la satisfaire, et termina son histoire en lui disant : « Mais surtout, ô Nôzhatou, je ne saurai jamais assez te dire combien cet excellent chauffeur du hammam a été bon pour moi, car il a dépensé pour me soigner tout ce qu’il avait d’argent mis de côté, et il m’a servi nuit et jour, et il a agi à mon égard comme n’agit point un père ou un frère ou un ami très dévoué, et il a poussé le désintéressement jusqu’à se priver de nourriture pour m’en donner, et de son âne pour me faire monter dessus, alors que lui-même le conduisait en me soutenant ; et, en vérité, si je suis encore en vie, c’est à lui que je le dois ! » Alors Nôzhatou dit : « Si Allah veut, nous saurons reconnaître ses bons services, autant qu’il sera en notre pouvoir ! »
Ensuite Nôzhatou appela l’eunuque qui accourut aussitôt et baisa la main de Daoul’makân et se tint debout devant lui ; alors Nôzhatou lui dit : « Bon serviteur au visage de bon augure, comme c’est toi le premier qui m’as annoncé la bonne nouvelle, tu vas garder pour toi la bourse que je t’ai donnée avec les mille dinars qu’elle contient. Mais cours vite prévenir ton maître que je désire le voir ! » Alors l’eunuque, fort réjoui de tout cela, se hâta d’aller prévenir son maître le chambellan, qui ne tarda pas à arriver sous la tente de son épouse. Et il fut au comble de la surprise de voir chez elle un jeune homme étranger, et, de plus, au milieu de la nuit. Mais Nôzhatou se hâta de lui raconter leur histoire depuis le commencement jusqu’à la fin et ajouta : « C’est ainsi, ô chambellan vénérable, qu’au lieu d’épouser en moi une esclave comme tu le croyais, tu as épousé la fille même du roi Omar Al-Némân, Nôzhatou’zamân ! Et voici mon frère Daoul’makân ! »
Lorsque le grand-chambellan eut entendu cette histoire extraordinaire, dont il ne mit pas en doute la véracité un seul instant, il fut à la limite de la dilatation de se savoir devenu le gendre même du roi Omar Al-Némân ; et il pensa en lui-même : « Cela va me faire devenir au moins gouverneur d’une province d’entre les provinces ! » Puis il s’approcha respectueusement de Daoul’makân et lui présenta ses compliments et félicitations pour la délivrance de tous ses maux et pour sa réunion à sa sœur. Et aussitôt il voulut donner l’ordre aux serviteurs de dresser une seconde tente pour y loger son nouvel hôte ; mais Nôzhatou lui dit : « La chose est maintenant inutile, car nous ne sommes plus qu’à une faible distance de notre pays ; et d’ailleurs comme il y a un long temps que moi et mon frère ne nous sommes vus, nous allons être très heureux d’habiter sous la même tente et de nous rassasier de la vue l’un de l’autre avant l’arrivée. » Et le chambellan répondit : « Que cela soit fait selon tes désirs ! » Puis il sortit pour les laisser librement s’épancher, et il leur envoya des flambeaux, des sirops, des fruits et toutes sortes de douceurs et de confitures dont il avait pris soin de charger deux mulets et un chameau, avant de quitter Damas, pour les distribuer comme cadeaux aux personnages de Baghdad en réponse aux souhaits de bienvenue. Et il envoya à Daoul’makân trois habillements complets des plus somptueux, et lui fit apprêter un magnifique dromadaire de race tout harnaché de housses aux longues tresses multicolores. Puis il se mit à se promener de long en large devant sa tente, la poitrine dilatée d’aise, et tout à la pensée de l’honneur qui lui venait d’Allah, et de son importance présente et de sa grandeur future.
Puis, le matin venu, le chambellan se hâta d’aller sous la lente de son épouse saluer son beau-frère. Et Nôzhatou lui dit : « Il ne faut pas oublier le chauffeur du hammam, ni omettre de dire à l’eunuque de lui préparer une bonne monture, et de prendre soin de lui en le servant au déjeuner et au dîner. Et surtout il faut qu’il ne s’éloigne pas de nous ! » Alors le chambellan donna les ordres nécessaires à l’eunuque qui répondit : « J’écoute et j’obéis ! »
Et, en effet, il se hâta de prendre avec lui quelques-uns des gens de la suite du chambellan et alla avec eux à la recherche du chauffeur. Et il finit par le trouver tout à fait à la queue de la caravane, tremblant de peur, et en train de seller son âne pour s’échapper au plus vite de cet endroit où on lui avait pris son jeune ami Daoul’makân. Aussi à la vue de l’eunuque et des esclaves qui soudain avaient couru à lui et l’avaient entouré, il se sentit mourir et son teint jaunit et ses genoux s’entrechoquèrent et tous ses muscles frémirent de terreur. Et il ne douta plus que Daoul’makân, pour se disculper, ne l’eût indiqué à la vindicte de l’épouse du chambellan. Car aussitôt l’eunuque lui cria : « Ô menteur !… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que l’eunuque cria au terrifié chauffeur : « Ô menteur ! pourquoi m’avoir dit que, non seulement tu n’avais pas chanté les vers, mais que tu ne savais même pas qui les avait chantés. Or, nous savons bien maintenant que le chanteur était ton propre compagnon. Aussi sache bien que, d’ici à Baghdad, je ne te quitte plus d’un pas ; et tu subiras, à notre arrivée, le même sort que ton compagnon ! » À ces paroles de l’eunuque, l’effaré chauffeur se mit à se lamenter et pensa en lui-même : « Voici que je vais éprouver juste ce que je voulais tant éviter ! » Et l’eunuque dit aux esclaves : « Prenez-lui cet âne, et donnez-lui ce cheval ! » Et les esclaves, malgré les larmes du pauvre chauffeur, prirent l’âne, et l’obligèrent lui-même à monter un magnifique cheval d’entre les chevaux du chambellan. Puis l’eunuque leur dit en particulier : « Vous allez être, durant tout le voyage, les gardes de ce chauffeur ; et chaque cheveu perdu de sa tête sera la perte de l’un de vous ! Ayez donc pour lui toutes sortes d’égards et soyez attentifs à ses moindres besoins ! »
Aussi lorsque le chauffeur se vit ainsi gardé par tous ces esclaves, il ne douta plus de sa mort ; puis il dit à l’eunuque : « Ô capitaine généreux, je te jure que ce jeune homme n’est ni mon frère ni mon parent, car je suis seul au monde, et je suis un pauvre chauffeur d’entre les chauffeurs du hammam. Mais j’ai trouvé ce jeune homme étendu mourant sur les déchets et les morceaux de bois à la porte du hammam, et je l’ai ramassé pour Allah ! Et je n’ai rien fait qui mérite de châtiment ! » Puis il se mit à pleurer et à penser mille pensées plus troublantes les unes que les autres, tandis que la caravane avançait, et que l’eunuque marchait à côté de lui et s’amusait à ses dépens en lui disant de temps en temps : « Tu as troublé le sommeil de notre maîtresse avec tes maudits vers, toi et ce jeune homme ; et tu n’avais guère l’air effrayé à ce moment-là ! » Toutefois, à chaque halte, l’eunuque ne manquait pas d’inviter le chauffeur à manger avec lui dans le même récipient et à boire avec lui le vin dans la même gargoulette, après en avoir bu, lui, le premier. Mais, malgré tout, la larme ne séchait pas dans l’œil du chauffeur, qui était plus perplexe que jamais et n’avait plus de nouvelles de son ami Daoul’makân, dont l’eunuque se gardait bien de l’entretenir.
Quant à Nôzhatou et à Daoul’makân et au chambellan, ils ne cessèrent de voyager à la tête de la caravane dans la direction de Baghdad. Et il ne leur restait plus qu’une seule journée de marche pour arriver au but tant désiré. Et comme, le dernier matin, après la dernière halte de nuit, ils s’apprêtaient à continuer leur route, ils virent soudain s’élever devant eux une épaisse poussière qui obscurcit le ciel et fit la nuit autour d’eux. Alors le chambellan essaya de les tranquilliser et leur dit de ne pas bouger, et il prit avec lui ses mamalik au nombre de cinquante et s’avança du côté de la poussière.
Or, au bout de très peu de temps, la poussière s’éclaircit devant eux et à leurs yeux apparut une armée formidable, bannières et signaux au vent, et marchant en ordre de bataille au son des tambours. Et aussitôt de l’armée se détacha un corps de guerriers qui s’avança vers eux au galop ; et chaque mamelouk du chambellan fut cerné par cinq guerriers à cheval.
À cette vue, le chambellan, fort surpris, leur demanda : « Qui êtes-vous pour agir de la sorte envers nous ? » Ils répondirent : « Mais qui donc êtes-vous, vous mêmes, et d’où venez-vous et où allez-vous ? » Le chambellan répondit : « Je suis le grand-chambellan de l’émir de Damas, le prince Scharkân, fils du roi Omar Al-Némân maître de Baghdad et du pays de Haurân. Et c’est le prince Scharkân qui m’envoie vers son père, à Baghdad, lui porter le tribut de Damas et des cadeaux. »
À ces paroles, tous les guerriers soudain tirèrent leurs mouchoirs et s’en couvrirent les yeux et se mirent à pleurer en sanglotant. Et le chambellan fut étonné extrêmement.
Et lorsqu’ils eurent fini de pleurer, leur chef s’avança vers le chambellan et lui dit : « Hélas ! où est le roi Omar Al-Némân ! Le roi Omar Al-Némân est mort ! Et il est mort empoisonné ! Ô notre désespoir ! » Puis il ajouta : « Mais toi, ô chambellan vénérable, viens avec nous et nous te mènerons au grand-vizir Dandân qui est là, au centre de l’armée ; et il te donnera tous les détails de ce malheur. »
Alors le chambellan ne put s’empêcher lui aussi de pleurer et s’écria : Oh ! quel voyage de malheur nous venons de faire ! » Puis il se laissa conduire auprès du grand-vizir Dandân qui aussitôt lui accorda l’audience demandée. Et le chambellan entra sous la tente du vizir Dandân qui l’invita à s’asseoir. Et il raconta au vizir la mission dont il était chargé et lui détailla les cadeaux dont il était porteur pour le roi Omar Al-Némân.
Mais à ces mots qui lui rappelaient son maître et son roi, le grand-vizir Dandân se mit à pleurer, puis il dit au chambellan : « Sache pour le moment que le roi Omar Al-Némân est mort empoisonné, et tout à l’heure je t’en raconterai les détails. Mais j’ai d’abord à te mettre au courant de la situation actuelle. Voici.
» Lorsque le roi mourut en la miséricorde d’Allah et sa clémence sans bornes, le peuple se souleva pour savoir qui il fallait élire comme successeur au trône ; et les partis en seraient venus aux mains si les grands et les notables ne les en avaient empêchés.
Et l’on finit par tomber d’accord pour demander l’avis des quatre grands kâdis de Baghdad et s’en rapporter à leur décision. Et les quatre grands-kâdis consultés décidèrent que le successeur au trône devait être le prince Scharkân, gouverneur de Damas. Et aussitôt que je fus avisé de cette décision, je me mis à la tête de l’armée pour aller à Damas au devant du prince Scharkân et lui annoncer et la mort de son père et son élection au trône.
Mais je dois te dire, ô chambellan vénérable, qu’il y a à Baghdad un parti favorable à l’élection du jeune Daoul’makân. Mais nul ne sait, depuis longtemps, ce qu’il est devenu, ni lui ni sa sœur Nôzhatou’zamân. Car voici cinq ans bientôt qu’ils sont partis pour le Hedjaz et qu’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles. »
À ces paroles du grand-vizir Dandân, le chambellan, époux de Nôzhatou, bien que fort chagriné de la mort du roi Omar, fut réjoui à la limite de la joie en pensant à la chance qu’avait Daoul’makân de devenir roi de Baghdad et du Khorassân. Aussi il se tourna vers le grand-vizir Dandân et lui dit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le chambellan se tourna vers le grand-vizir Dandân et lui dit : « En vérité, l’histoire que tu viens de me raconter est bien étrange et étonnante. Et, à mon tour, comme tu m’as témoigné une entière confiance, laisse-moi t’annoncer une nouvelle qui te réjouira le cœur et terminera tous tes soucis. Sache donc, ô grand-vizir, qu’Allah vient de nous aplanir toute voie en nous rendant le prince Daoul’makân et sa sœur Nôzhatou’zamân ! »
À ces paroles, le vizir Dandân fut dans une joie extrême et s’écria : « Ô vénérable chambellan, hâte-toi de me raconter les détails de cette nouvelle inattendue et qui me met au comble du bonheur ! » Alors le chambellan lui raconta toute l’histoire du frère et de la sœur, et ne manqua pas de lui apprendre que Nôzhatou était devenue son épouse.
Alors le vizir Dandân s’inclina devant le chambellan et lui présenta ses hommages et se reconnut comme son féal. Puis il fit s’assembler tous les émirs et les chefs de l’armée et les grands du royaume qui étaient présents, et les mit au courant de la situation. Et aussitôt tous vinrent baiser la terre entre les mains du chambellan et lui présentèrent leurs hommages et compliments, et se réjouirent extrêmement de ce nouvel ordre de choses, en admirant l’œuvre du Destin qui combinait de telles merveilles.
Après quoi le chambellan et le grand-vizir Dandân s’assirent chacun sur un grand siège dressé sur une estrade, et réunirent les notables, les émirs et les autres vizirs, et tinrent conseil sur la situation. Et le conseil dura une heure de temps, et la décision fut prise unanimement de nommer Daoul’makân successeur au trône du roi Omar Al-Némân, au lieu d’aller à Damas à la recherche du prince Scharkân. Et le vizir Dandân se leva aussitôt de son siège pour marquer son respect au vénérable chambellan qui devenait ainsi le personnage le plus marquant du royaume, et, pour se le rendre favorable, lui offrit de magnifiques présents et lui souhaita la prospérité ; et firent de même tous les vizirs, les émirs et les notables. Et le vizir Dandân, au nom de tous, dit : « Ô chambellan vénérable, nous espérons que, grâce à ta magnanimité, chacun de nous conservera ses fonctions sous le règne du nouveau sultan. Quant à nous, nous allons nous hâter de vous devancer à Baghdad pour recevoir dignement notre jeune sultan, pendant que toi-même tu vas aller lui annoncer son élection, faite grâce à notre décision. » Et le chambellan leur promit sa protection à tous et la conservation de leurs emplois, et les quitta pour retourner vers les tentes de Daoul’makân, tandis que le vizir Dandân et toute l’armée regagnaient la ville de Baghdad. Mais il ne manqua pas auparavant de se faire donner par le vizir Dandân des hommes et des chameaux porteurs de tentes somptueuses et de toutes sortes d’ornements et d’habits royaux et de tapis.
Et, en s’acheminant vers la tente de Nôzhatou et de Daoul’makân, le chambellan sentait augmenter en lui son respect pour son épouse Nôzhatou, et il se disait en lui-même : « Quel voyage béni et de bon augure ! » Et, en arrivant, il ne voulut point entrer chez son épouse sans lui en demander d’abord l’autorisation, autorisation qui lui fut d’ailleurs immédiatement accordée.
Alors le chambellan entra sous la tente et, après les saluts d’usage, il leur conta tout ce qu’il avait vu et entendu, et la mort du roi Omar et l’élection de Daoul’makân de préférence à Scharkân. Puis il ajouta : « Et maintenant, ô roi généreux, il ne te reste plus qu’à accepter le trône sans hésitation, de peur que, dans le cas d’un refus, il ne t’arrive malheur de la part de celui qui sera élu à ta place ! »
À ces paroles, Daoul’makân, quoique douloureusement affecté par la mort de son père, le roi Omar, et bien que lui et Nôzhatou fussent tout en larmes, dit : « J’accepte l’ordre du Destin, puisqu’on ne peut y échapper, et que tes paroles sont pleines de bon sens et de sagesse. » Et il ajouta : « Mais, ô vénérable beau-frère, quelle sera ma conduite envers mon frère Scharkân, et que dois-je faire pour lui ? » Il répondit : « La seule solution équitable est de partager l’empire entre vous deux, et tu seras le sultan de Baghdad et ton frère Scharkân sera le sultan de Damas. Tiens-toi donc fermement dans cette résolution, et il n’en résultera que toutes choses de paix et de concorde. » Et Daoul’makân agréa le conseil de son beau-frère le chambellan.
Alors le chambellan prit l’habit royal que le vizir Dandân lui avait donné et en revêtit Daoul’makân, et lui remit le grand sabre d’or de la royauté et baisa la terre entre ses mains et se retira. Et il alla aussitôt choisir un endroit élevé où il fit dresser la tente royale qu’il avait reçue du vizir Dandân. Et c’était une grande tente, surmontée d’une haute coupole, en toile doublée en son intérieur de soie de toutes les couleurs avec des dessins d’arbres et de fleurs. Et il ordonna aux tapissiers d’étendre les grands tapis sur le sol, après avoir bien battu et arrosé la terre tout autour de la tente. Et il se hâta d’aller prier le roi de venir s’y reposer cette nuit-là. Et le roi y dormit jusqu’au matin.
Or, à peine l’aube apparue, on entendit au loin le son des tambours de guerre et des instruments. Et bientôt on vit sortir d’un nuage de poussière l’armée de Baghdad, à la tête de laquelle marchait le vizir Dandân qui venait recevoir le roi, après avoir tout arrangé à Baghdad. Alors le roi Daoul’makân…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
Alors le roi Daoul’makân, vêtu de ses habits royaux, monta s’asseoir sur le trône dressé au milieu de la tente, sous la haute coupole, et plaça sur ses genoux son grand sabre de commandement, sur lequel il appuya ses deux mains, et, immobile, attendit. Et, tout autour de lui, vinrent se ranger les mamalik de Damas et les anciens gardes du chambellan, l’épée nue à la main, tandis que le chambellan lui-même se tenait debout à droite du trône, respectueusement.
Et aussitôt, selon les ordres donnés par le chambellan, le défilé des hommages commença. Alors, par le corridor de toile qui conduisait à la tente royale, entrèrent les chefs de l’armée, dix par dix, hiérarchiquement, en commençant par les grades inférieurs ; et, dix par dix, ils prêtèrent le serment de fidélité entre les mains du roi Daoul’makân et baisèrent la terre en silence. Et il ne restait plus que le tour des quatre grands-kâdis et du grand-vizir Dandân. Et les quatre grands-kâdis entrèrent et prêtèrent le serment de fidélité et baisèrent la terre entre les mains du roi Daoul’makân. Mais quand entra le grand-vizir Dandân, le roi Daoul’makân se leva de son trône en son honneur, et s’avança lui-même au-devant de lui et lui dit : « Bienvenu soit notre père à tous, le très vénérable et très digne grand-vizir, celui dont les actes sont parfumés de haute sagesse et les arrangements faits délicatement par de savantes mains ! » Alors le grand-vizir Dandân prêta le serment de fidélité sur le Livre et la Foi et baisa la terre entre les mains du roi.
Et tandis que le chambellan était sorti pour donner les ordres nécessaires, et préparer le festin, et faire tendre les nappes et cuisiner les mets les plus choisis, et assurer le service des échansons, le roi dit au grand-vizir : « Avant tout il faut, pour fêter mon avènement, faire de grandes largesses aux soldats et à tous leurs chefs ; et pour cela fais-leur distribuer tout le tribut que nous apportons avec nous de la ville de Damas, sans en rien économiser. Et il faut leur donner à manger et à boire à satiété. Et ensuite seulement, ô mon grand-vizir, tu viendras me raconter en détail la mort de mon père et la cause de cette mort. » Et le vizir Dandân se conforma aux ordres du roi, et donna trois jours de liberté aux soldats pour qu’ils pussent s’amuser et prévint leurs chefs que le roi ne voulait recevoir personne durant ces trois jours entiers. Alors toute l’armée fit des vœux pour la vie du roi et la prospérité de son règne, et le vizir Dandân revint sous la tente. Mais le roi, pendant ce temps, était allé trouver sa sœur Nôzhatou et lui avait dit : « Ô ma sœur, tu as appris la mort de notre père, le roi Omar, mais tu ne sais pas encore la cause de sa mort. Viens donc avec moi pour l’entendre raconter de la bouche même du vizir Dandân. » Et il amena Nôzhatou sous la coupole, et fit tomber un grand rideau de soie entre elle et les assistants ; et il s’assit sur le trône tandis que Nôzhatou seule prenait place derrière le rideau de soie.
Alors il dit au vizir Dandân : « Maintenant, ô vizir de notre père, raconte-nous les détails de la mort du plus sublime d’entre les rois ! » Et le vizir Dandân dit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il raconta cette mort comme suit :
HISTOIRE DE LA MORT DU ROI OMAR
AL-NÉMÂN ET LES PAROLES
ADMIRABLES QUI LA PRÉCÉDÈRENT.
Un jour d’entre les jours, le roi Omar Al-Némân se sentant la poitrine rétrécie de la douleur de votre absence, nous avait tous appelés autour de lui pour que nous essayions de le distraire, quand nous vîmes entrer une vénérable vieille femme dont le visage était empreint des marques de la sainteté ; et elle avait avec elle cinq adolescentes vierges aux seins arrondis, et belles comme des lunes, et si parfaitement belles, en vérité, que nulle langue ne saurait en rendre toutes les perfections ; et, avec toute leur beauté, elles savaient étonnamment le Koran et les livres de la science et les paroles de tous les sages d’entre les musulmans. Et la vénérable vieille s’avança entre les mains du roi et baisa la terre avec respect et dit : « Ô roi, voici que je t’apporte cinq joyaux que ne possède aucun roi de la terre. Et je te prie d’en examiner la beauté et de les mettre à l’épreuve ; car la beauté n’apparaît qu’à celui qui la cherche avec amour ! »
À ces paroles, le roi Omar fut extrêmement charmé, et la vue de la vieille lui inspira un très grand respect et la vue des cinq adolescentes lui plut infiniment. Et il dit à ces jeunes filles…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le roi Omar dit aux jeunes filles : « Ô jeunes filles gentilles, s’il est vrai que vous soyez si versées dans la connaissance des choses délicieuses du temps passé, que chacune de vous s’avance à son tour et m’en dise quelques paroles dont je puisse me dulcifier ! »
Alors la première adolescente, qui avait un regard modeste et fort doux, s’avança et baisa la terre entre les mains du roi et dit :
« Sache, ô roi du temps, que la vie n’existerait pas sans l’instinct de la vie. Et cet instinct a été placé dans l’homme afin que l’homme puisse, avec l’aide d’Allah, être le maître de lui-même et en profiter pour se rapprocher d’Allah le Créateur. Et la vie a été donnée à l’homme afin que l’homme puisse se développer en beauté, tout en se mettant au-dessus des errements. Et les rois, qui sont les premiers parmi les hommes, doivent être les premiers dans la voie des vertus nobles et du désintéressement. Et l’homme sage, à l’esprit cultivé, ne doit, en toute circonstance, et surtout envers ses amis, agir qu’avec douceur et juger qu’avec aménité. Et il doit se garder soigneusement de ses ennemis et choisir ses amis avec circonspection ; et, une fois qu’il les a choisis, il ne doit plus faire intervenir entre eux et lui un juge quelconque, mais tout régler par la bonté ; car, ou il a choisi ses amis parmi les hommes détachés de ce monde et voués à la sainteté, et alors il doit les écouler sans arrière-pensée et se rapporter à leur jugement, ou il les a choisis parmi ceux qui sont attachés aux biens de la terre, et alors il doit veiller à ne jamais les léser dans leurs intérêts, ni les contrarier dans leurs habitudes, ni les contredire dans leurs paroles ; car la contradiction aliène même l’affection du père et de la mère, et elle est superflue ; et un ami est une chose si précieuse ! Car l’ami n’est point comme la femme d’avec qui on peut divorcer pour la remplacer par une autre ; et la blessure faite à un ami ne se cicatrise jamais, comme dit le poète :
« Songe que le cœur de l’ami est chose bien fragile et qu’on doit le surveiller comme toute chose fragile ;
« Car le cœur de l’ami y une fois blessé, est comme le verre délicat qui, brisé, ne peut jamais être raccommodé.
« Laisse-moi maintenant te rapporter quelques paroles des Sages. Sache, ô roi, qu’un kâdi, pour rendre un jugement vraiment juste, doit faire faire la preuve d’une façon évidente, et traiter les deux partis en toute égalité, sans témoigner plus de respect à l’inculpé noble qu’à l’inculpé pauvre ; mais surtout il doit tendre à réconcilier les deux partis entre eux, pour faire toujours régner la concorde entre les musulmans. Et, particulièrement dans le doute, il doit réfléchir longuement et revenir à plusieurs reprises sur son raisonnement, et s’abstenir si le doute continue. Car la justice est le premier des devoirs, et revenir vers la justice, si l’on a été injuste, est plus noble de beaucoup que d’avoir toujours été juste, et de beaucoup plus méritoire devant le Très-Haut. Et il ne faut point oublier qu’Allah Très-Haut a placé les juges sur la terre pour juger seulement des choses apparentes, et Il s’est réservé pour Lui seul le jugement des choses secrètes. Et il est du devoir du kâdi de ne jamais essayer de tirer des aveux d’un inculpé en le soumettant à la torture ou à la faim, car cela n’est point digne des musulmans. Et d’ailleurs Al-Zahri a dit : « Trois choses font déchoir un kâdi : qu’il témoigne de la condescendance ou du respect à un coupable haut placé, qu’il aime la louange, qu’il craigne de perdre sa situation. » Et le khalifat Omar ayant un jour destitué un kâdi, celui-ci lui demanda : « Pourquoi m’as-tu destitué ? » Il répondit : « Parce que tes paroles outrepassent tes actes ! » Et le grand Al-Iskandar aux Deux Cornes réunit un jour son kâdi, son cuisinier et son scribe principal ; et il dit à son kâdi : « Je t’ai confié la plus haute et la plus lourde de mes prérogatives royales. Aie donc l’âme royale ! » Et il dit à son cuisinier : « Je t’ai confié le soin de mon corps, qui désormais dépend de ta cuisine. Sache donc le traiter avec un art sans violence ! » Et il dit à son scribe principal : « Quant à toi, ô frère de la plume, je t’ai confié les manifestations de mon intelligence. Je t’adjure de me transmettre intégral aux générations, au moyen de ton écriture ! »
Et la jeune fille, ayant dit ces paroles, ramena son voile sur son visage et recula parmi ses compagnes. Alors s’avança la seconde adolescente, qui avait…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
Le vizir Dandân continua de la sorte :
Alors s’avança la seconde adolescente, qui avait un regard éclairé et un menton fin et divisé d’un sourire, et elle baisa sept fois la terre entre les mains de ton défunt père, le roi Omar Al-Némân, et dit :
« Sache, ô roi fortuné, que Lokmân le Sage a dit à son fils : « Ô mon fils, il y a trois choses qui ne peuvent être contrôlées que dans trois circonstances : on ne peut savoir qu’un homme est vraiment bon que lors de sa colère, qu’un homme est valeureux que lors du combat, et qu’un homme est fraternel que lors de la nécessité ! » Et le tyran ou l’oppresseur est torturé et expiera ses injustices, malgré les flatteries de ses courtisans ; tandis que l’opprimé, malgré l’injustice, sera sauf de toute torture. Et ne traite point les gens d’après ce qu’ils disent, mais d’après ce qu’ils font. Et, d’ailleurs, les actions elles-mêmes ne valent que par l’intention qui les inspira ; et chaque homme sera jugé d’après ses intentions, et non d’après ses actions. Sache aussi, ô roi, que la chose la plus admirable en nous, c’est notre cœur. Et comme on demandait, un jour, à un sage : « Quel est le pire des hommes ? » Il répondit : « C’est celui qui laisse le mauvais désir s’emparer de son cœur. Car il perd toute virilité. Et comme le dit le poète, d’ailleurs fort bien :
« La seule richesse est celle recelée dans les poitrines. Mais qu’il est difficile d’en trouver le chemin ! »
« Et notre Prophète (sur lui la paix et la prière !) a dit : « Le véritable sage est celui qui préfère aux choses périssables les immortelles. » On raconte que l’ascète Sabet pleura tellement que ses yeux furent malades ; alors on appela un médecin qui lui dit : « Je ne puis te traiter, à moins que tu ne me promettes une chose. » Il répondit : « Et quelle chose ? » Le médecin dit : « De cesser de pleurer. » Mais l’ascète répondit : « À quoi donc me serviraient mes yeux si je ne pleurais plus ! »
« Mais, ô roi, sache aussi que l’action la plus belle est celle qui est désintéressée. On raconte, en effet, que dans Israël il y avait deux frères ; et l’un de ces frères dit un jour à l’autre : « Quelle est l’action la plus effroyable que tu aies jamais faite ? » Il répondit : « C’est celle-ci : comme je passais un jour près d’un poulailler, je tendis le bras et je saisis une poule, et, l’ayant étranglée, je la rejetai dans le poulailler. C’est là la plus effroyable chose de ma vie. Mais toi, ô mon frère, qu’as-tu fait de plus effroyable ? » Il répondit : « C’est d’avoir fait ma prière à Allah pour lui demander une faveur. Car la prière n’est belle que lorsqu’elle est la simple élévation de l’âme vers les hauteurs. » Et d’ailleurs…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGT-UNIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la deuxième adolescente continua ainsi :
« Et, d’ailleurs, le poète dit excellemment cela en ce vers :
« Il y a deux choses dont tu ne dois jamais t’approcher : l’idolâtrie envers Allah et le mal envers ton prochain ! »
Puis la seconde jeune fille, ayant dit ces paroles, recula au milieu de ses compagnes. Alors la troisième adolescente, qui réunissait en elle les perfections des deux premières, s’avança entre les mains du roi Omar Al-Némân, et dit :
« Quant à moi, ô roi fortuné, je ne te dirai que peu de paroles en ce jour, car je suis un peu indisposée et, d’ailleurs, les sages nous recommandent la brièveté dans nos discours.
« Sache donc, ô roi, que Safiân a dit : « Si l’âme habitait le cœur de l’homme, l’homme aurait des ailes et s’envolerait léger vers des paradis ! »
« Et ce même Safiân a dit : « En vérité sachez que le simple fait de regarder au visage une personne atteinte de laideur constitue le plus lourd péché contre l’esprit ! »
Et, ayant dit ces deux phrases admirables, la jeune fille recula au milieu de ses compagnes. Alors s’avança la quatrième adolescente qui avait des hanches sublimes, et dit :
« Et moi, ô roi fortuné, me voici prête à le dire les paroles qui me sont parvenues de l’histoire des hommes justes. On raconte que Baschra le Déchaussé a dit : « Gardez-vous bien de la plus abominable chose ! » Alors ceux qui l’écoutaient lui dirent : « Et quelle est la plus abominable chose ? » Il répondit : « C’est le fait de rester longtemps à genoux pour faire parade de la prière. C’est l’ostentation de la piété. » Alors l’un d’eux lui demanda : « Ô mon père, apprends-moi à connaître les vérités cachées et le mystère des choses ! » Mais le Déchaussé lui dit : « Ô mon fils, ces choses ne sont point faites pour le troupeau. Et nous ne pouvons les mettre à la portée du troupeau. Car c’est à peine si sur cent justes il y en a cinq qui soient purs comme le vierge argent. »
« Et le cheikh Ibrahim raconte : « Je rencontrai un jour un homme pauvre qui venait de perdre une petite pièce de monnaie de cuivre. Alors je m’avançai vers lui et lui tendis un drachme d’argent, mais l’homme le refusa et me dit : « À quoi me servira tout cet argent de la terre, à moi qui ne vise que les félicités immortelles ? »
« On raconte également que la sœur du Déchaussé alla un jour…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« On raconte également que la sœur du Déchaussé alla un jour trouver l’imam Ahmad ben-Hanbal et lui dit : « Ô saint imam de la foi, je viens m’éclairer. Éclaire-moi ! J’ai coutume de veiller la nuit sur la terrasse de notre maison à filer la laine à la clarté des flambeaux qui passent ; car nous n’avons point de lumière à la maison. Et le jour je travaille et je prépare la nourriture de la maison. Dis-moi donc s’il m’est permis d’user ainsi d’une clarté qui ne m’appartient pas. » Alors l’imam lui demanda : « Qui es-tu, ô femme ? » Elle dit : « Je suis la sœur de Baschra le Déchaussé. » Et le saint imam se leva et baisa la terre entre les mains de la jeune fille et lui dit : « Ô sœur du plus parfumé d’entre les saints, que ne puis-je toute ma vie humer la pureté de ton cœur ! »
« On raconte aussi qu’un sage d’entre les sages a dit cette parole : « Lorsque Allah veut du bien à l’un de ses serviteurs, il ouvre devant lui la porte de l’inspiration. »
« Il m’est parvenu que lorsque Malek ben-Dinar passait dans les souks et voyait des objets qui lui plaisaient, il se réprimandait en se disant : « Mon âme, c’est inutile ! Je ne t’écouterai pas ! » Car il aimait à répéter : « Le seul moyen de sauver son âme, c’est de ne point lui obéir ; et le sûr moyen de la perdre, c’est de l’écouter. »
« Et Mansour ben-Omar nous raconte le fait suivant : « J’étais une fois allé en pèlerinage à la Mecque en passant par la ville de Koufa. Et c’était une nuit pleine de ténèbres. Et j’entendis, dans le sein de la nuit, près de moi, sans distinguer d’où elle sortait, une voix haute qui disait cette prière : « Ô Seigneur Dieu plein de grandeur, je ne suis point de ceux qui se révoltent contre tes lois ni de ceux qui ignorent tes bienfaits. Et pourtant, Seigneur, dans les temps passés, j’ai peut-être péché lourdement, et je viens implorer ton pardon et la rémission de mes erreurs. Car mes intentions n’étaient pas mauvaises, et mes actes m’ont trahi ! »
« Et, cette prière une fois terminée, j’entendis un corps tomber pesamment sur le sol. Et je ne savais point ce que pouvait être cette voix, dans cette nuit ; et je ne comprenais pas ce que signifiait cette prière, dans ce silence, alors que mes yeux ne pouvaient distinguer la bouche qui la disait ; et je ne devinais pas ce qu’était ce corps qui tombait sur le sol pesamment. Alors je m’écriai à mon tour : « Je suis Mansour ben-Omar, un pèlerin de la Mecque ! Qui donc a besoin d’un secours ? » Et rien ne me répondit. Et je m’en allai. Mais le lendemain je vis passer un convoi mortuaire et je me mêlai aux gens qui suivaient le convoi ; et devant moi marchait une vieille femme épuisée par la peine. Et je lui demandai : « Qui est donc ce mort ? » Elle me répondit : « Hier, mon fils, ayant dit la prière, récita les versets du Livre d’Allah qui commencent par ces mots : « Ô vous qui croyez à la parole, fortifiez vos âmes… » Et lorsque mon fils eut fini les versets, cet homme, qui est maintenant dans ce cercueil, sentit son foie éclater et il tomba mort. Et c’est tout ce que je puis dire. »
Et la quatrième jeune fille, ayant dit ces paroles, recula au milieu de ses compagnes. Alors s’avança la cinquième adolescente, qui était la couronne sur la tête de toutes les adolescentes, et dit :
« Moi, ô roi fortuné, je te dirai ce qui est parvenu jusqu’à moi des choses spirituelles du temps passé.
« Le sage Moslima ben-Dinar a dit : « Tout plaisir qui ne pousse pas ton âme plus près d’Allah, est une calamité. »
« On raconte que lorsque Moussa (la paix sur lui !) était à la fontaine de Modaïn, arrivèrent deux jeunes bergères avec le troupeau de leur père Schoaïb. Et Moussa (la paix sur lui !) donna à boire aux deux jeunes filles, qui étaient deux sœurs, et au troupeau dans l’abreuvoir en tronc de palmier. Et les deux jeunes filles, de retour à la maison, racontèrent la chose à leur père Schoaïb qui dit alors à l’une d’entre elles : « Retourne près du jeune homme et dis-lui de venir chez nous. » Et la jeune fille retourna à la fontaine ; et lorsqu’elle fut près de Moussa, elle se couvrit le visage de son voile et lui dit : « Mon père m’envoie vers toi te dire de m’accompagner à la maison afin de partager notre repas en récompense de ce que tu as fait pour nous. » Mais Moussa fut très affecté et ne voulut point d’abord la suivre ; puis il finit par s’y décider. Et il marcha derrière elle. Or, la jeune bergère avait un très gros derrière…
— À ce moment de sa narration Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE-VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la cinquième adolescente continua ainsi :
« Or la jeune bergère avait un très gros derrière, en vérité, et le vent tantôt collait la robe légère contre sa rondeur et tantôt soulevait la robe et faisait apparaître, tout nu, le derrière de la jeune bergère. Mais Moussa, chaque fois que le derrière apparaissait, fermait les yeux pour ne le point voir. Et comme il craignait que la tentation ne devînt trop forte, il dit à la jeune fille : « Laisse-moi plutôt marcher devant toi. » Et la jeune fille, assez étonnée, vint marcher derrière Moussa. Et ils finirent tous deux par arriver à la maison de Schoaïb. Et lorsque Schoaïb vit entrer Moussa (sur eux deux la paix et la prière !) il se leva en son honneur et, comme le dîner était prêt, il lui dit : « Ô Moussa, qu’ici l’hospitalité te soit large et cordiale pour ce que tu as fait à mes filles ! » Mais Moussa répondit : « Ô mon père, je ne vends point sur la terre, pour de l’or et de l’argent, des actes qui ne sont faits qu’en vue du Jugement ! » Et Schoaïb reprit : « Ô jeune homme, tu es mon hôte et j’ai coutume d’être hospitalier et généreux envers mes hôtes ; et c’était d’ailleurs aussi la coutume de tous mes ancêtres. Reste donc et mange avec nous. » Et Moussa resta et mangea avec eux. Et à la fin du repas Schoaïb dit à Moussa : « Ô jeune homme, tu demeureras avec nous et tu mèneras paître le troupeau. Et au bout de huit ans, pour prix de tes services, je te marierai avec celle de mes filles qui était allée te chercher à la fontaine. » Et Moussa, cette fois, accepta et se dit en lui-même : « Maintenant que la chose devient licite avec la jeune fille, je pourrai user sans réticence de son derrière béni ! »
« Il est raconté qu’Ibn-Bitar ayant rencontré un de ses amis, celui-ci lui dit : « Où étais-tu donc tout ce temps que je ne t’ai point vu ? » Ibn-Bitar dit : « J’étais occupé avec mon ami Ibn-Schéab. Le connais-tu ? » Il répondit : « Si je le connais ! Il est mon voisin depuis plus de trente ans. Mais je ne lui ai jamais adressé la parole. » Alors Ibn-Bitar lui dit : « Ô pauvre homme, ne sais-tu donc pas que celui qui n’aime pas ses voisins n’est pas aimé d’Allah ? Et ne sais-tu pas qu’un voisin doit autant d’égards à son voisin qu’à son propre parent ? »
« Un jour Ibn-Adham dit à un de ses amis qui revenait avec lui de la Mecque : « Comment vis-tu ? » Il répondit : « Lorsque j’ai à manger je mange, et lorsque j’ai faim et qu’il n’y a rien je patiente ! » Et Ibn-Adham répondit : « En vérité tu ne fais pas autrement que ne font les chiens du pays de Balkh ! Quant à nous, lorsque Allah nous donne notre pain nous le glorifions, et lorsque nous n’avons rien à manger nous le remercions tout de même. » Alors l’homme s’écria : « Ô mon maître ! » Et ne dit pas autre chose.
« On dit que Mohammad ben-Omar demanda un jour à un homme qui vivait dans l’austérité : « Que penses-tu de l’espoir qu’on doit avoir en Allah ? » L’homme dit : « Si je base ma confiance en Allah, c’est à cause de deux choses : j’ai appris par expérience, que le pain que je mange n’est jamais mangé par un autre ; et je sais, d’autre part, que si je suis venu au monde, c’est avec la volonté d’Allah. »
Et, ayant dit ces paroles, la cinquième jeune fille recula au milieu de ses compagnes. Alors seulement, d’un pas grave, s’avança la sainte vieille femme. Elle baisa neuf fois la terre entre les mains de ton défunt père, le roi Omar Al-Némân, et dit :
« Tu viens, ô roi, d’entendre les paroles édifiantes de ces jeunes filles sur le mépris des choses d’ici-bas, dans la mesure où ces choses doivent être méprisées. Moi, je te parlerai de ce que je sais concernant les faits et gestes des plus grands d’entre nos anciens.
« Il est raconté que le grand imam Al-Schâfi (qu’Allah l’ait en ses bonnes grâces !) divisait la nuit en trois parties : la première pour l’étude, la seconde pour le sommeil et la troisième pour la prière. Et, vers la fin de sa vie, il veillait toute la nuit, ne réservant plus rien pour le sommeil.
« Le même imam Al-Schâfi (qu’Allah l’ait en ses bonnes grâces !) a dit : « Durant dix ans de ma vie, je n’ai point voulu manger à ma faim de mon pain d’orge. Car trop manger est nuisible de toutes les manières. Cela épaissit le cerveau, endurcit le cœur, annihile les facultés intellectuelles, attire le sommeil et la paresse et enlève jusqu’à la dernière énergie. »
« Le jeune Ibn-Fouâd nous raconte : « J’étais un jour à Baghdad, au moment où l’imam Al-Schâfi y séjournait. Et j’étais allé sur la rive du fleuve pour faire mes ablutions. Or, pendant que j’étais accroupi à faire mes ablutions, un homme, suivi d’une foule silencieuse, passa derrière moi et me dit : « Ô jeune homme, soigne bien tes ablutions et Allah te soignera ! » Et je me retournai et je vis cet homme qui avait une grande barbe et un visage sur lequel était empreinte la bénédiction ; et aussitôt je me hâtai de terminer mes ablutions et je me levai et le suivis. Alors il me vit et se tourna vers moi et me dit : « As-tu besoin de me demander quelque chose ? » Je lui dis : « Oui, ô vénérable père ! Je désire que tu m’apprennes ce que certainement tu tiens d’Allah le Très-Haut ! » Et il me dit : « Apprends à te connaître ! Et alors seulement agis ! Et alors seulement agis selon tous tes désirs, mais en prenant garde de ne pas léser ton voisin ! » Et il continua son chemin. Alors je demandai à l’un de ceux qui le suivaient : « Qui donc est-il ? » Il me répondit : « C’est l’imam Mohammad ben-Edris Al-Schâfi ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète selon son habitude, se tut.
LA QUATRE-VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la sainte vieille continua de la sorte :
« On raconte que le khalifat Abou-Giafar Al-Mansour voulut nommer kâdi Abi-Hanifa et lui allouer dix mille drachmes par an. Mais lorsque Abi-Hanifa eut appris l’intention du khalifat, il pria la prière du matin, puis s’enveloppa de sa robe blanche et s’assit sans dire un mot. Alors entra l’envoyé du khalifat pour lui remettre d’avance les dix mille drachmes et lui annoncer sa nomination. Mais, à tout le discours de l’envoyé, Abi-Hanifa ne répondit pas un mot. Alors l’envoyé lui dit : « Sois pourtant bien sûr que tout cet argent que je t’apporte est chose licite et admise par le Livre. » Alors Abi-Hanifa lui dit : « Cet argent est chose licite, en vérité, mais Abi-Hanifa ne sera jamais le serviteur des tyrans ! »
Et, ayant dit ces paroles, la vieille ajouta : « J’eusse voulu, ô roi, te rapporter encore des traits admirables de la vie de nos anciens sages. Mais voici que la nuit approche, et d’ailleurs les jours d’Allah sont nombreux pour ses serviteurs ! » Et la sainte vieille ramena son grand voile sur ses épaules et recula au milieu du groupe formé par les cinq adolescentes.
Ici le vizir Dandân cessa un moment de parler au roi Daoul’makân et à sa sœur Nôzhatou qui était derrière le rideau. Mais, après quelques instants, il reprit :
Lorsque ton défunt père, le roi Omar Al-Némân, eut entendu ces paroles édifiantes, il comprit que vraiment ces femmes étaient les plus parfaites de leur siècle, en même temps que les plus belles et les plus cultivées de corps et d’esprit. Et il ne sut quels égards leur témoigner qui fussent dignes d’elles, et il fut complètement sous le charme de leur beauté, et il les désira avec ardeur, en même temps qu’il fut plein de respect pour la sainte vieille, leur conductrice. Et en attendant, il leur donna, pour y demeurer, l’appartement réservé qui avait appartenu jadis à la reine Abriza, reine de Kaïssaria. Et, durant dix jours de suite, il alla lui-même prendre de leurs nouvelles et voir par lui-même si rien ne leur manquait ; et chaque fois qu’il y allait, il trouvait la vieille en prière, qui passait ses journées dans le jeûne et ses nuits dans la méditation. Et il fut tellement édifié de sa sainteté qu’un jour il me dit : « Ô mon vizir, quelle bénédiction que d’avoir dans mon palais une si admirable sainte ! Mon respect pour elle est devenu extrême et mon amour pour ces jeunes filles, sans limites. Viens donc avec moi pour demander enfin à la vieille, puisque les dix jours de notre hospitalité sont passés et que nous pouvons parler affaires, quelle somme elle veut nous fixer comme prix de ces adolescentes, ces cinq vierges aux seins arrondis. » Nous allâmes donc à l’appartement réservé et ton père demanda la chose à la vieille, qui lui dit : « Ô roi, sache que le prix de ces jeunes filles consiste en des conditions qui sont en dehors des conditions ordinaires des ventes et des achats. Car leur prix ne se paie point en or, ni en argent, ni en pierreries. »
À ces paroles, ton père fut extrêmement étonné et lui demanda : « Ô femme vénérable, en quoi consiste donc le prix de vente de ces jeunes filles ? » Elle répondit : « Je ne puis te les vendre qu’à cette seule condition : un jeûne d’un mois entier que tu ferais en passant tes journées dans la méditation et tes nuits dans les veilles et la prière. Et au bout de ce mois de jeûne complet, par lequel ton corps serait purifié et deviendrait digne de communier avec le corps de ces jeunes filles, tu pourrais jouir totalement de leurs douceurs. »
Alors ton père fut édifié à la limite de l’édification et son respect pour la vieille ne connut plus de bornes. Et il se hâta d’accepter ses conditions. Et la vieille lui dit : « De mon côté, je t’aiderai par mes prières et mes vœux à supporter le jeûne. Maintenant apporte-moi un broc de cuivre. » Alors le roi ton père lui donna un broc de cuivre qu’elle remplit d’eau pure, et elle abaissa ses regards sur le broc et se mit à dire dessus des prières en une langue inconnue et à marmonner pendant une heure des paroles auxquelles nul de nous ne comprit un mot. Puis elle couvrit le broc d’une étoffe légère qu’elle cacheta de son sceau, et le remit à ton père en lui disant : « Au bout des dix premiers jours de jeûne, tu décachèteras l’étoffe et tu couperas ton jeûne en buvant cette eau sainte qui te fortifiera et te lavera de toutes tes souillures passées. Et maintenant, moi, je vais aller trouver mes frères qui sont les Gens de l’Invisible, car il y a longtemps que je ne les ai vus ; et au matin du onzième jour je viendrai te voir. »
Et la vieille, ayant dit ces paroles, souhaita la paix à ton père et s’en alla.
Alors ton père prit le broc et se leva et choisit une cellule complètement isolée du palais, dans laquelle pour tout meuble il mit le broc de cuivre, et s’y enferma pour jeûner et méditer et mériter de la sorte l’approche de ces corps de jeunes filles. Et il ferma la porte à clef, à l’intérieur, et mit la clef dans sa poche…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète selon son habitude, se tut.
LA QUATRE-VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
Et il ferma la porte à clef, à l’intérieur, et mit la clef dans sa poche. Et il commença immédiatement le jeûne.
Et lorsque fut le matin du onzième jour, le roi ton père prit le broc et en décacheta l’étoffe légère et le porta à ses lèvres et le but d’un seul trait. Et aussitôt il éprouva un bien-être général et des effets d’une grande douceur sur ses entrailles. Et, à peine l’avait-il bu, que l’on frappa à la porte de la cellule. Et, la porte ouverte, la vieille entra en tenant à la main un paquet fait avec des feuilles fraîches de bananier.
Alors le roi ton père se leva en son honneur et lui dit : « Bienvenue soit ma mère vénérable ! » Elle lui dit : « Ô roi, voici que les Gens de l’Invisible m’envoient vers toi pour te transmettre leur salut ; car je leur ai parlé de toi et ils ont été très réjouis d’apprendre notre amitié. Et ils t’envoient, comme signe de leur bienveillance, ce paquet qui contient, sous les feuilles de bananier, des confitures délicieuses, de celles faites par les doigts des vierges aux yeux noirs du paradis. Aussi lorsque viendra le matin du vingt-unième jour, tu enlèveras ces feuilles de bananier et tu couperas ton jeûne en mangeant les confitures. » À ces paroles, ton père se réjouit extrêmement et dit : « Louange à Allah qui m’a donné des frères parmi les Gens de l’Invisible ! » Puis il remercia beaucoup la vieille et lui baisa les mains et l’accompagna avec beaucoup d’égards jusqu’à la porte de la cellule.
Or, comme elle l’avait dit, au matin du vingt-unième jour la vieille ne manqua pas de revenir et dit à ton père : « Ô roi, sache que j’ai appris à mes frères de l’Invisible que j’ai l’intention de te donner les jeunes filles en cadeau ; et cela les a réjouis beaucoup à cause de l’amitié qu’ils ont maintenant pour toi. Aussi, avant de les mettre entre tes mains, je vais les conduire chez les Gens de l’Invisible afin qu’ils mettent en elles leur souffle et répandent en elles l’odeur agréable qui te charmera ; et elles te reviendront avec un trésor du sein de la terre, qui leur aura été donné par mes frères de l’Invisible ! »
Lorsque ton père eut entendu ces paroles, il la remercia pour toutes les peines qu’elle prenait et lui dit : « C’est trop, en vérité ! Et quant au trésor du sein de la terre, vraiment je craindrais d’abuser. » Mais elle répondit à cela comme il fallait ; et ton père lui demanda : « Et quand penses-tu me les ramener ? » Elle dit : « Au matin du trentième jour, une fois que tu auras terminé ton jeûne et que tu te seras ainsi purifié le corps ; et de leur côté elles auront en elles une pureté de jasmin et elles t’appartiendront totalement, ces adolescentes dont chacune vaut plus que tout ton empire ! » Il répondit : « Oh ! que cela est vrai ! » Elle dit : « Maintenant si même tu voulais me confier la femme que tu aimes le mieux parmi tes femmes, je la prendrais avec moi et les adolescentes pour que les grâces purificatrices de nos frères les Gens de l’Invisible rejaillissent également sur elle. » Alors le roi ton père lui dit : « Comme je te remercie ! J’ai en effet, dans mon palais, une femme grecque que j’aime, nommée Safîa ; et elle est la fille du roi Aphridonios de Constantinia ; et Allah m’a déjà accordé d’elle deux enfants que j’ai, hélas ! perdus depuis de nombreuses années. Prends-la donc avec toi, ô vénérable, pour que sur elle rejaillisse la grâce des Gens de l’Invisible et qu’elle puisse, par leur intercession, recouvrer ses enfants dont nous avons perdu toute trace ! » Alors la vieille sainte lui dit : « Mais certainement. Fais-moi vite amener la reine Safîa ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
Alors la vieille dit : « Fais-moi vite amener la reine Safîa ! » Et le roi ton père fit immédiatement venir la reine Safîa, ta mère, et la confia à la vieille qui la réunit aussitôt aux adolescentes. Puis la vieille alla un instant dans son appartement et en revint avec une coupe cachetée ; et elle donna cette coupe au roi Omar Al-Némân et lui dit : « Au matin du trentième jour, une fois ton jeûne terminé, tu iras prendre un bain au hammam, et tu reviendras te reposer dans ta cellule et tu boiras cette coupe qui complètera ta purification et te rendra enfin digne de tenir dans ton sein les adolescentes royales ! Et maintenant que sur toi soient la paix, la miséricorde d’Allah et toutes ses bénédictions, ô mon fils ! »
Et la vieille emmena les cinq jeunes filles et ta mère, la reine Safîa, et s’éloigna.
Or, le roi continua son jeûne jusqu’au trentième jour. Et au matin de ce trentième-là il se leva et alla au hammam et, son bain fini, il revint à la cellule et défendit à quiconque de le venir déranger. Et, étant entré dans la cellule, il en referma sur lui la porte à clef, et prit la coupe, en enleva le cachet, la porta à ses lèvres et la but, puis s’étendit se reposer.
Quant à nous tous, qui savions que ce jour-là était le dernier jour du jeûne, nous attendîmes jusqu’au soir, et puis pendant toute la nuit, et jusqu’au lendemain au milieu de la journée. Et nous pensâmes : « Le roi se repose probablement de toutes les veilles qu’il a supportées ! » Mais comme le roi persistait à ne pas ouvrir, nous nous approchâmes de la porte et nous donnâmes de la voix. Et personne ne répondit. Alors nous fûmes très effrayés de ce silence et nous nous décidâmes à casser la porte et à entrer. Et nous entrâmes.
Or, le roi n’était plus là. Mais nous trouvâmes seulement ses chairs en lambeaux et ses os émiettés et noirs. Alors nous tombâmes tous évanouis.
Et lorsque nous fûmes revenus à nous, nous prîmes la coupe et nous l’examinâmes. Et nous trouvâmes dans le couvercle un papier sur lequel ceci était écrit :
« Nul homme nuisible ne saurait inspirer du regret ! Et que toute personne qui lira ce papier sache que telle est la punition de celui qui séduit les filles des rois et les corrompt. Tel est le cas de cet homme-ci ! Il a envoyé son fils Scharkân enlever de notre pays la fille de notre roi, la malheureuse Abriza ! Et il l’a prise et a consommé sur elle, vierge, ce qu’il a consommé ! Puis il la donna à un esclave noir qui lui fit subir les pires outrages et la tua ! Et maintenant, à cause de cet acte indigne d’un roi, le roi Omar Al-Némân n’est plus. Et, moi qui l’ai tué, je suis la courageuse, la vengeresse dont le nom est Mère-des-Calamités ! Et non seulement, ô vous tous, infidèles qui me lirez, j’ai tué votre roi, mais j’ai emmené la reine Safîa, fille du roi Aphridonios de Constantinia ; et je vais la rendre à son père ; et puis nous reviendrons tous en armes vous assaillir et ruiner vos maisons et vous exterminer tous jusqu’au dernier ! Et il n’y aura plus sur la terre que nous, les chrétiens, qui adorons la Croix ! »
Lorsque nous eûmes lu ce papier, nous comprîmes toute l’horreur de notre calamité, et nous nous frappâmes le visage de nos mains et nous pleurâmes longtemps. Mais à quoi devaient nous servir nos larmes, puisque l’irréparable était accompli ?
Et c’est alors, ô roi, que l’armée et le peuple furent en désaccord pour l’élection du successeur du défunt roi Omar Al-Némân. Et ce désaccord dura un mois entier, au bout duquel, comme on n’avait aucune nouvelle de ton existence, on résolut d’aller élire le prince Scharkân, à Damas. Mais Allah te mit sur notre chemin, et il arriva ce qui arriva !
Et telle est, ô roi, la cause de la mort de ton père, le roi Omar Al-Némân !
Lorsque le grand-vizir Dandân eut fini le récit de la mort du roi Omar Al-Némân, il tira son mouchoir et s’en couvrit les yeux et se mit à pleurer. Et le roi Daoul’makân et la reine Nôzhatou, qui était derrière le rideau de soie, se mirent aussi à pleurer, ainsi que le grand-chambellan et tous ceux qui étaient là.
Mais le chambellan, le premier, sécha ses larmes et dit à Daoul’makân : « Ô roi, en vérité ces larmes ne peuvent plus servir à rien. Et il ne te reste plus qu’à prendre courage et à te raffermir le cœur pour veiller aux intérêts de ton royaume. Et d’ailleurs ton défunt père continue à vivre en toi, car les pères vivent dans les enfants dignes d’eux ! » Alors Daoul’makân cessa de pleurer et se prépara à tenir la première séance de son règne.
À cet effet, il s’assit sur son trône, sous la coupole, et le chambellan se tint debout à ses côtés et le vizir Dandân devant lui et les hommes d’armes derrière le trône ; et les émirs et les grands du royaume se placèrent chacun selon son rang.
Alors le roi Daoul’makân dit au vizir Dandân : « Dénombre-moi le contenu des armoires de mon père. » Et le vizir Dandân répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il énuméra tout ce que contenaient les armoires du trésor en argent, en richesses et en joyaux ; et il lui en remit la liste détaillée. Alors le roi Daoul’makân lui dit : « Ô vizir de mon père, tu continueras à être également le grand-vizir de mon règne. » Et le vizir Dandân baisa la terre entre les mains du roi et lui souhaita longue vie. Ensuite le roi dit au chambellan : « Quant à ce qui est des richesses que nous avons apportées avec nous de Damas, il faut les distribuer à l’armée. »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Alors le chambellan ouvrit les caisses qui contenaient les richesses et les somptuosités apportées de Damas, et n’en garda absolument rien et les distribua toutes aux soldats en donnant les plus belles choses aux chefs de l’armée. Et tous les chefs baisèrent la terre entre ses mains et firent des vœux pour la vie du roi et se dirent entre eux : « Jamais nous n’avons vu pareille générosité ! »
Et c’est alors seulement que le roi Daoul’makân donna le signal du départ ; et on leva aussitôt les campements ; et le roi, à la tête de son armée, fit son entrée dans Baghdad.
El tout Baghdad était décoré ; et tous les habitants étaient massés sur les terrasses ; et les femmes, sur le passage du roi, lançaient des cris de joie aigus.
Et le roi monta dans son palais, et la première chose qu’il fit fut d’appeler le scribe principal et de lui dicter une lettre destinée à son frère Scharkân, à Damas. Cette lettre contenait la narration détaillée de tout ce qui était arrivé du commencement à la fin. Et elle concluait, en substance, par ceci :
« Et nous te prions, ô notre frère, au reçu de notre lettre, de faire les préparatifs nécessaires et de rassembler ton armée et de venir unir tes forces aux nôtres, pour aller ensemble faire la guerre sainte aux Infidèles qui nous menacent, et venger la mort de notre père et laver la tache qui doit être lavée ! »
Puis il plia la lettre et la cacheta lui-même de son cachet et appela le vizir Dandân et lui remit la lettre en disant : « Il n’y a que toi seul, ô grand vizir, qui sois capable de remplir une mission aussi délicate auprès de mon frère. Et tu sauras lui parler très gentiment et très doucement et tu lui diras bien ceci de ma part : « Je suis tout prêt à te céder le trône de Baghdad et à être à ta place gouverneur de Damas. »
Alors le vizir Dandân se prépara immédiatement au départ ; et le soir même partit pour Damas.
Or, pendant son absence, deux choses importantes extrêmement eurent lieu au palais du roi Daoul’makân. La première est que Daoul’makân fit venir son ami le vieux chauffeur du hammam, et le combla d’honneurs et de grades, et lui donna pour lui seul un palais qu’il fit tendre des plus beaux tapis de la Perse et du Khorassân. Mais il sera parlé longuement, dans le courant de cette histoire, de ce bon chauffeur du hammam.
Quant à la seconde chose, c’est celle-ci : un cadeau consistant en dix jeunes esclaves blanches arriva au roi Daoul’makân de la part de l’un de ses féaux. Or, l’une d’entre ces jeunes filles, dont la beauté défiait tout discours, plut beaucoup au roi Daoul’makân qui aussitôt la prit et coucha avec elle, et l’engrossa à l’instant même. Mais nous reviendrons sur cet événement, dans le courant de cette histoire.
Quant au vizir Dandân, il fut bientôt de retour et annonça au roi que son frère Scharkân avait très favorablement écouté sa demande et qu’il s’était mis en route, à la tête de son armée, pour répondre à cet appel. Et le vizir ajouta : « Aussi faut-il maintenant sortir à sa rencontre. » Et le roi répondit : « Mais certainement, ô mon vizir ! » Et il sortit de Baghdad, et à peine avait-il fait dresser le campement, à une journée de marche, que le prince Scharkân apparut avec son armée, précédé par ses éclaireurs.
Alors Daoul’makân prit les devants et alla à la rencontre de son frère ; et sitôt qu’il l’eût vu, il voulut descendre de cheval. Mais Scharkân, de loin, le conjura de n’en rien faire et, le premier, il sauta à terre et courut se précipiter dans les bras de Daoul’makân qui était, tout de même, descendu de cheval. Et ils s’embrassèrent longuement en pleurant ; et, après s’être dit des paroles de consolation l’un à l’autre pour la mort de leur père, ils retournèrent ensemble à Baghdad.
Et, sans perdre de temps, on convoqua les guerriers de toutes les parties de l’empire, qui ne manquèrent pas de se rendre à l’appel tant on leur promettait de butin et de faveurs. Et, durant un mois, les guerriers ne cessèrent d’affluer. Et pendant ce temps Scharkân avait raconté à Daoul’makân toute son histoire ; et Daoul’makân également raconta la sienne, mais en insistant beaucoup sur les services du chauffeur du hammam. Aussi Scharkân lui demanda : « Certainement tu as récompensé déjà cet homme vertueux pour tout son dévouement ? » Et Daoulmakân lui répondit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
Et Daoul’makân lui répondit : « Pas entièrement. Car je me réserve de le faire, sitôt de retour de la guerre, si Allah veut ! » Et c’est alors que Scharkân put contrôler la véracité des paroles de Nôzhatou, qui avait été sa femme alors qu’il ignorait qu’elle fût sa sœur, et dont il avait eu la fillette Force-du-Destin. Et cela lui rappela qu’il devait demander de ses nouvelles. Aussi pria-t-il le grand-chambellan de lui transmettre le salut de sa part. Et le grand-chambellan s’acquitta de la chose et rapporta également à Scharkân le salut de Nôzhatou qui, en outre, demandait des nouvelles de sa fille Force-du-Destin. Et Scharkân lui fit dire de se tranquilliser, car Force-du-Destin était en parfaite santé à Damas. Alors Nôzhatou remercia Allah pour cela.
Puis lorsque toutes les troupes furent rassemblées et que les Arabes des tribus eurent apporté leur contingent, les deux frères se mirent à la tête de leurs forces réunies ; et, après que Daoul’makân eût fait ses adieux à la jeune esclave qu’il avait rendue enceinte, et qu’il lui eût créé un train de maison digne d’elle, on sortit de Baghdad demandant les contrées des Infidèles.
L’avant-garde de l’armée était formée par des guerriers turcs dont le chef s’appelait Bahramân ; et l’arrière-garde était formée par des guerriers du Deïlam[12] dont le chef s’appelait Rustem. Le centre était commandé par Daoul’makân, tandis que l’aile droite était sous les ordres du prince Scharkân et l’aile gauche sous les ordres du grand-chambellan. Et le grand-vizir Dandân fut chargé du sous-commandement général de l’armée.
Et ils ne cessèrent de voyager pendant un mois entier, en se reposant trois jours au bout de chaque semaine de marche, jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au pays des Roum. Alors, à leur approche, s’enfuirent de tous côtés les habitants épouvantés et allèrent se réfugier à Constantinia en mettant le roi Aphridonios au courant de la marche agressive des musulmans.
À cette nouvelle, le roi Aphridonios se leva et fit appeler la vieille Mère-des-Calamités qui venait de lui ramener sa fille Safîa, en même temps qu’elle avait décidé le roi Hardobios de Kaïssaria, qu’elle avait élevé, à venir avec elle, lui et toute son armée, se joindre au roi Aphridonios. Et le roi de Kaïssaria, non content de la mort du roi Omar Al-Némân, et désireux de venger davantage sa fille Abriza, s’était hâté d’accompagner Mère-des-Calamités à Constantinia, à la tête de son armée.
Lorsque le roi Aphridonios eut donc fait appeler la vieille, elle se présenta aussitôt entre ses mains ; et il lui demanda les détails de la mort d’Omar Al-Némân, qu’elle se hâta de lui rapporter. Alors le roi lui demanda : « Et maintenant que l’ennemi approche, que faut-il faire, ô Mère-des-Calamités ? » Elle répondit : « Ô grand roi, ô représentant de Christ sur la terre, je vais t’indiquer la conduite à tenir ; et le Cheitân lui-même avec tous ses artifices ne pourra débrouiller les fils où je vais prendre nos ennemis ! »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« Et le Cheitân lui-même, malgré tous ses artifices, ne pourra débrouiller les fils où je vais prendre nos ennemis ! Or voici le plan à suivre pour les anéantir :
« Tu vas envoyer cinquante mille guerriers sur des navires qui mettront à la voile pour aller à la Montagne-Fumante, au pied de laquelle campent nos ennemis. Et d’un autre côté, par la voie de terre, tu enverras toute ton armée surprendre ces mécréants. Et de la sorte ils seront pris de tous les côtés, et nul d’entre eux ne pourra échapper à l’anéantissement. Et tel est mon plan. »
Et le roi Aphridonios dit à la vieille : « En vérité, ton idée est supérieure, ô reine de toutes les vieilles et inspiratrice des plus sages ! » Et il agréa le plan et le mit aussitôt à exécution.
Aussi les navires chargés de guerriers mirent à la voile et arrivèrent à la Montagne-Fumante, et débarquèrent les hommes qui se massèrent sans bruit derrière les hauts rochers. Et par la voie de terre l’armée ne tarda pas à arriver en face de l’ennemi. Or, en ce moment, telles étaient les forces des combattants : l’armée musulmane de Baghdad et du Khorassân comprenait cent vingt mille cavaliers commandés par Scharkân. Et l’armée des impies chrétiens s’élevait à mille mille et six cent mille combattants. Aussi quand tomba la nuit sur les montagnes et sur les plaines, la terre sembla un brasier de tous les feux qui l’éclairaient.
Or, en ce moment, le roi Aphridonios et le roi Hardobios réunirent leurs émirs et les chefs de l’armée pour tenir la grande séance du conseil. Et ils résolurent de livrer bataille, dès le lendemain, aux musulmans, de tous les côtés à la fois. Mais la vieille Mère-des-Calamités qui écoutait, les sourcils froncés, se leva et dit au roi Aphridonios et au roi Hardobios et à tous les assistants :
« Ô guerriers, les batailles des corps, quand les âmes ne sont pas sanctifiées, ne sauraient avoir que des résultats funestes ! Ô chrétiens, avant la lutte il faut vous approcher du Christ, et vous purifier avec l’encens suprême des fèces patriarcales ! » Et les deux rois et les guerriers répondirent : « Tes paroles sont les bienvenues, ô vénérable mère ! »
Or, voici en quoi consistait cet encens suprême des fèces patriarcales.
Lorsque le grand-patriarche des chrétiens de Constantinia faisait ses fèces, les prêtres les recueillaient soigneusement dans des étoffes de soie et les séchaient au soleil ; puis ils en faisaient une pâte qu’ils mêlaient de musc, d’ambre et de benjoin ; et ils pulvérisaient cette pâte, une fois tout à fait sèche, et la mettaient dans des petites boîtes d’or, et l’envoyaient à tous les rois chrétiens et à toutes les églises chrétiennes. Et c’est cette poudre des fèces patriarcales qui servait d’encens suprême pour sanctifier les chrétiens dans toutes les occasions solennelles, et notamment pour bénir les nouveaux mariés et fumiger les nouveau-nés et bénir les prêtres nouveaux. Mais comme les seules fèces du grand-patriarche pouvaient à peine suffire à dix provinces, et ne pouvaient servir à tant d’usages pour tous les pays chrétiens, les prêtres falsifiaient cette poudre en y mélangeant d’autres fèces moins saintes, par exemple les fèces des autres patriarches moindres et des vicaires. Et il était fort difficile de les différencier, d’ailleurs. Aussi cette poudre, à cause de ses vertus, était très estimée de ces porcs de Grecs qui, outre les fumigations, l’employaient également en collyres secs pour les maladies des yeux, et en stomachiques pour les maladies de l’estomac et des intestins. Mais c’était là le traitement employé surtout chez les plus grands d’entre les rois et les reines ; et c’est ce qui faisait que le prix en était très élevé et que le poids d’un drachme en était vendu mille dinars d’or. Et voilà pour l’encens des fèces patriarcales…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE-VINGT-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
Et voilà pour l’encens des fèces patriarcales. Mais pour ce qui est du roi Aphridonios et des chrétiens, voici.
Lorsque vint le matin, le roi Aphridonios, d’après le conseil de Mère-des-Calamités, fit assembler les chefs principaux de l’armée et tous ses lieutenants et leur fit baiser une grande croix de bois et les fumigea avec l’encens suprême déjà décrit, et qui était fait avec d’authentiques fèces du grand-patriarche, sans falsification aucune. Aussi son odeur était-elle terriblement forte et aurait tué un éléphant des armées musulmanes ; mais les porcs grecs y étaient accoutumés.
Alors la vieille Mère-des-Calamités se leva et dit : « Ô roi, avant de livrer bataille à ces mécréants, il faut, pour assurer notre victoire, nous débarrasser du prince Scharkân qui est le Cheitân en personne et qui commande toute l’armée. Car c’est lui qui anime tous ses soldats et leur donne le courage. Mais, lui mort, son armée est notre proie ! Envoyons-lui donc le guerrier le plus valeureux de nos guerriers pour le défier à un combat singulier et le tuer. »
Lorsque le roi Aphridonios eut entendu ces paroles, il fit venir aussitôt le fameux guerrier Lucas, fils de Camlutos, et, de sa propre main, il le fumigea avec l’encens fécal. Puis il prit un peu de cette fiente et l’humecta de salive et lui en oignit les gencives, les narines et les deux joues, et lui en fit priser un peu et, avec le restant, il lui frotta les sourcils et les moustaches.
Or, ce maudit Lucas était le guerrier le plus effrayant de tous les pays des Roum ; et nul parmi les chrétiens ne savait comme lui lancer le javelot, ou frapper du glaive ou percer de la lance. Mais son aspect était aussi repoussant que sa valeur était grande. Il était extrêmement hideux de visage, car son visage était celui d’un âne de mauvaise qualité ; mais, considéré attentivement, il ressemblait à un singe ; et, observé avec beaucoup de soin, il était tel un effroyable crapaud ou un serpent d’entre les pires serpents ; et son approche était plus insupportable que la séparation de l’ami ; et il avait volé à la nuit ses ténèbres et aux latrines la fétidité de leur haleine. Et c’est pour toutes ces raisons qu’il était surnommé Glaive-de-Christ.
Donc lorsque ce maudit Lucas eut été fumigé et oint fécalement par le roi Aphridonios, il lui baisa les pieds et se tint debout devant lui. Alors le roi lui dit : « Je veux que tu ailles attaquer, en combat singulier, ce scélérat nommé Scharkân, et que tu nous débarrasses de ses calamités ! » Et Lucas répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et le roi lui ayant fait embrasser la croix, Lucas s’en alla et monta un magnifique cheval alezan recouvert d’une somptueuse housse rouge et sellé d’une selle de brocart enrichie de pierreries. Et il s’arma d’un long javelot à trois fers ; et, de la sorte, on l’eût pris pour le Cheitân en personne. Puis, précédé de hérauts d’armes et d’un crieur, il se dirigea vers le camp des Croyants.
Donc le crieur, devant le maudit Lucas, de toute sa voix se mit à crier en langue arabe : « Ô vous, les musulmans, voici le champion héroïque qui a mis en fuite bien des armées d’entre les armées turques, kurdes et deïlamites ! C’est Lucas l’illustre, fils de Camlutos ! Que d’entre vos rangs sorte votre champion Scharkân, maître de Damas au pays de Scham ! Et, s’il l’ose, qu’il vienne affronter notre géant ! »
Or, à peine ces paroles avaient-elles été criées qu’on entendit un tremblement dans l’air retentissant et un galop qui fit frémir le sol et jeta l’épouvante jusque dans le cœur du maudit mécréant, et fit se tourner toutes les têtes dans cette direction. Et apparut Scharkân en personne, fils du roi Omar Al-Némân, et il arrivait droit sur ces impies, semblable au lion en courroux, et monté sur un cheval tel la plus légère des gazelles. Et il tenait à la main sa lance, farouchement, et déclamait ces vers :
« À moi appartient un alezan aussi léger que le nuage qui passe dans l’air. Il me contente !
À moi appartient une lance indianisée, au fer coupant. Je la brandis ! Et ses éclairs ondulent comme les vagues ! »
Mais l’abruti Lucas, qui était un barbare sans culture, des pays obscurs, ne comprenait pas un mot d’arabe, et ne pouvait goûter la beauté de ces vers et l’ordonnance de ces rythmes. Aussi se contenta-t-il de toucher son front, qui était tatoué d’une croix, et de porter ensuite sa main à ses lèvres par respect pour ce signe étrange.
Et soudain, plus hideux qu’un porc, il poussa son cheval sur Scharkân. Puis il s’arrêta brusquement dans son galop et lança très haut dans l’air l’arme qu’il tenait à la main, et si haut qu’elle disparut aux regards. Mais bientôt elle retomba. Et, avant qu’elle n’eût touché terre, le maudit, tel un sorcier, la rattrapa au vol. Et alors, de toute sa force, il lança son javelot à trois fers sur Scharkân. Et le javelot partit rapide comme la foudre. Et c’en était fait de Scharkân !
Mais Scharkân, au moment même où le javelot passait en sifflant et l’allait transpercer, détendit son bras et l’attrapa au vol. Or, gloire à Scharkân ! Et il saisit ce javelot d’une main ferme, et le lança dans l’air, si haut qu’il se perdit aux regards. Et il le rattrapa de la main gauche, en un clin d’œil. Et il s’écria : « Par Celui qui créa les sept étages du ciel ! je vais donner à ce maudit une leçon éternelle ! » Et il lança le javelot.
Alors l’abruti géant Lucas voulut faire le tour de force accompli par Scharkân et tendit la main pour arrêter l’arme volante. Mais Scharkân, profitant de ce moment où le chrétien se découvrait, lui lança un second javelot qui l’atteignit au front, à l’endroit même où il était tatoué d’une croix. Et l’âme mécréante de ce chrétien s’exhala de son cul et alla s’enfoncer dans les feux de l’enfer…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE-VINGT-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
Et l’âme mécréante de ce chrétien s’exhala de son cul et alla s’enfoncer dans les feux de l’enfer.
Lorsque les soldats de l’armée chrétienne eurent appris, par la bouche des compagnons de Lucas, la mort de leur champion, ils se lamentèrent et se frappèrent le visage de douleur, et puis se précipitèrent tous sur leurs armes en lançant des cris de mort et de vengeance.
Alors les crieurs appelèrent les hommes, qui se rangèrent en ordre de bataille et, au signal donné par les deux rois, se précipitèrent en masse sur l’armée des musulmans. Et la mêlée s’engagea. Et les guerriers s’enlacèrent aux guerriers. Et le sang inonda les moissons. Et les cris succédèrent aux cris. Et les corps furent écrasés sous les sabots des chevaux. Et les hommes s’enivrèrent de sang et non de vin, et titubèrent comme les ivrognes. Et les morts s’entassèrent sur les morts, et les blessures sur les blessures. Et la bataille dura ainsi jusqu’à la tombée de la nuit, qui sépara les combattants.
Alors Daoul’makân, après avoir félicité son frère Scharkân pour son exploit qui devait illustrer son nom durant les siècles, dit au vizir Dandân et au grand-chambellan : « Ô grand vizir et toi, ô vénérable chambellan, prenez vingt mille guerriers, et allez à la distance de sept parasanges vers la mer. Là vous vous embarquerez dans la vallée de la Montagne-Fumante, et, au signal que je vous donnerai en hissant le pavillon vert, vous vous lèverez soudain prêts à la bataille décisive. Or, nous, ici, nous ferons semblant de prendre la fuite. Alors les Infidèles nous poursuivront. À ce moment-là, vous-mêmes, vous les poursuivrez, et nous, nous retournant, nous les attaquerons ; et ils seront ainsi cernés de tous côtés ; et pas un de ces Infidèles n’échappera à notre glaive, lorsque nous crierons : Allah akbar !
Aussi le vizir Dandân et le grand-chambellan répondirent par l’ouïe et l’obéissance et mirent immédiatement à exécution le plan qui était ordonné. Et ils se mirent en marche durant la nuit et allèrent prendre position dans la vallée de la Montagne-Fumante, là même où s’étaient d’abord embusqués les guerriers chrétiens venus de la mer et qui s’étaient ensuite joints à l’armée de terre : chose qui devait causer leur perte, car le premier plan de Mère-des-Calamités était le meilleur.
Or, avec le matin, tous les guerriers étaient debout sous les armes. Et sur les tentes flottaient les pavillons et brillaient les croix, de tous côtés. Et les guerriers des deux camps firent d’abord leurs prières. Les Croyants écoutèrent la lecture du premier chapitre du Koran, le Chapitre de la Vache ; et les mécréants invoquèrent le Messie fils de Mariam et se purifièrent avec les fèces du patriarche, mais des fèces certainement falsifiées, à cause de la grande quantité de soldats fumigés. Or, cette fumigation ne les sauvera pas du glaive !
En effet, au signal donné, la lutte recommença plus terrible. Les têtes s’envolaient comme des balles ; les membres jonchèrent le sol ; et le sang coula par torrents, et tellement que les chevaux en eurent jusqu’au poitrail.
Mais soudain, comme par l’effet d’une panique considérable, les musulmans, qui jusque-là avaient combattu en héros, tournèrent le dos et s’enfuirent tous jusqu’au dernier.
À ce spectacle de l’armée musulmane qui s’enfuyait de la sorte, le roi Aphridonios de Constantinia dépêcha un courrier au roi Hardobios, dont les troupes jusque-là n’avaient pas pris part à la bataille, en lui disant : « Voilà que fuient les musulmans ! Car nous avons été rendus invincibles par l’encens suprême des fèces patriarcales, dont nous nous étions fumigés et dont nous avions enduit nos barbes et nos moustaches. Maintenant, à vous autres d’achever la victoire en vous mettant à la poursuite de ces musulmans et en les exterminant jusqu’au dernier ! Et de la sorte nous vengerons la mort de Lucas, notre champion…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE-VINGT-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
« Et de la sorte nous vengerons la mort de Lucas, notre champion ! »
Alors le roi Hardobios, qui n’attendait que l’occasion de venger enfin le meurtre de sa fille, l’admirable Abriza, cria à ceux de son armée : « Ô guerriers ! sus à ces musulmans qui fuient comme des femmes ! » Or, il ne savait point que c’était là une tactique du brave d’entre les braves, le prince Scharkân, et de son frère Daoul’makân.
En effet, au moment où les chrétiens de Hardobios, les ayant poursuivis, étaient arrivés jusqu’à eux, les musulmans s’arrêtèrent dans leur fuite simulée, et, à la voix de Daoul’makân, se précipitèrent sur leurs poursuivants, en criant : « Allahou akbar ! » Et Daoul’makân, pour les exciter à la lutte, leur jeta cette harangue :
« Ô musulmans, voici le jour de la religion ! Voici le jour où vous gagnerez le paradis ! Car le paradis ne se gagne qu’à l’ombre des glaives ! » Alors ils s’élancèrent comme des lions. Et ce jour-là ne fut point pour les chrétiens le jour de la vieillesse, car ils furent fauchés sans avoir eu le temps de voir blanchir leurs cheveux.
Mais les exploits accomplis par Scharkân, dans cette bataille soudaine, sont au-dessus de toutes paroles. Et pendant qu’il mettait en pièces tout ce qui se présentait sur sa route, Daoul’makân fit hisser le drapeau vert, signal convenu avec ceux de la vallée. Et il voulut se précipiter lui aussi dans la mêlée. Mais Scharkân le vit soudain qui se préparait à s’élancer. Alors vivement il s’approcha de lui et lui dit : « Ô mon frère, tu ne dois pas exposer ta personne aux chances de la lutte, car tu es nécessaire au gouvernement de ton empire. Aussi, dès maintenant, je ne vais plus m’éloigner de toi, et je me battrai seulement à côté de toi, en te défendant moi-même contre toutes les attaques ! »
Or, pendant ce temps, les guerriers musulmans, commandés parle vizir Dandân et le grand-chambellan, à la vue du signal convenu, se développèrent sur un demi-cercle et coupèrent ainsi à l’armée chrétienne toute chance de salut du côté de ses navires, sur la mer. Aussi la lutte engagée dans ces conditions ne pouvait plus être douteuse. Et les chrétiens furent exterminés terriblement par les soldats musulmans, tant kurdes que persans et turcs et arabes. Et ceux qui purent échapper furent en bien petit nombre. Car il y eut jusqu’à cent vingt mille porcs d’entre eux qui trouvèrent la mort, tandis que les autres réussirent à s’échapper dans la direction de Constantinia. Voilà pour les Grecs du roi Hardobios ! Mais pour ceux du roi Aphridonios, qui s’étaient retirés sur les hauteurs avec leur roi, sûrs d’avance de l’extermination des musulmans, quelle dut être leur douleur de voir la fuite de leurs semblables !
Or, ce jour-là, outre la victoire, les Croyants gagnèrent une quantité énorme de butin. D’abord tous les navires, à l’exception de vingt qui avaient encore des hommes à bord et qui purent regagner Constantinia pour annoncer le désastre. Ensuite toutes les richesses et toutes les choses précieuses accumulées dans ces navires ; puis cinquante mille chevaux avec leur harnachement ; et les tentes et tout ce qu’elles contenaient en armes et en vivres ; et enfin une quantité incalculable de choses que nul chiffre ne saurait rendre. Aussi leur joie fut-elle très grande, et remercièrent-ils Allah pour la victoire et le butin. Et voilà pour les musulmans !
Mais pour ce qui est des fugitifs, ils finirent par arriver à Constantinia, l’âme hantée par les corbeaux des désastres. Et toute la ville fut plongée dans l’affliction, et les édifices et les églises furent tendus des draps du deuil, et toute la population se massa en groupes de révolte et lança des cris de sédition. Et la douleur de tous ne put qu’augmenter en ne voyant revenir de toute la flotte que vingt navires et de toute l’armée que vingt mille hommes. Alors la population accusa ses rois de trahison. Et le trouble du roi Aphridonios fut tel et sa terreur telle que son nez s’allongea jusqu’à ses pieds et que le sac de son estomac se retourna…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète selon son habitude, se tut.
LA QUATRE-VINGT-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
Son nez s’allongea jusqu’à ses pieds et le sac de son estomac se retourna, et son intestin se relâcha et son intérieur s’écoula. Alors il fit appeler la vieille Mère-des-Calamités pour lui demander conseil sur ce qui lui restait à faire. Et la vieille arriva aussitôt.
Or, cette vieille Mère-des-Calamités, cause réelle de tous ces malheurs, était vraiment une horreur de vieille femme : rouée, perfide, pétrie de malédictions ; sa bouche était putride ; ses paupières rougies et sans cils ; ses joues ternes et poussiéreuses ; son visage noir comme la nuit ; ses yeux chassieux ; son corps galeux ; ses cheveux sales ; son dos voûté ; sa peau ratatinée. Elle était une vraie plaie d’entre les pires plaies, et une vipère d’entre les plus venimeuses. Et cette horrible vieille passait la plus grande partie de son temps chez le roi Hardobios, à Kaïssaria ; et elle se plaisait dans son palais à cause de la quantité très grande de jeunes esclaves qui s’y trouvaient, tant hommes que femmes ; car elle obligeait les jeunes esclaves mâles à la monter, et elle aimait à son tour à monter les jeunes esclaves femmes ; et elle préférait à toute chose le chatouillement de ces vierges et le frottement de leur jeune corps contre le sien. Et elle était terriblement experte dans cet art du chatouillis ; et elle savait sucer comme une goule leurs parties délicates, et titiller agréablement leurs tétons ; et, pour les faire parvenir au spasme dernier, elle leur macérait la vulve avec le safran préparé : ce qui les jetait mortes de volupté dans ses bras. Aussi avait-elle enseigné son art à toutes les esclaves du palais, et, anciennement, aux suivantes d’Abriza ; mais elle n’avait pu réussir à gagner la svelte Grain-de-Corail, et tous ses artifices avaient échoué contre Abriza ; car Abriza l’avait en horreur à cause de la fétidité de son haleine et de l’odeur d’urine fermentée qui se dégageait de ses aisselles et de ses aines, et du dégagement putride de ses nombreux pets, plus odorants que l’ail pourri, et de la rugosité de sa peau, plus poilue que celle du hérisson et plus dure que les fibres du palmier. Car, en vérité, on pouvait bien appliquer à cette vieille ces paroles du poète :
Jamais l’essence de roses dont elle s’humecte la peau n’abolira la pestilence de ses pets silencieux !
Mais il faut dire que Mère-des-Calamités était pleine de générosité pour toutes les esclaves qui se laissaient faire par elle, comme elle était pleine de rancune pour celles qui lui résistaient. Et c’est pour son refus qu’Abriza était tellement haïe par cette vieille.
Donc lorsque la vieille Mère-des-Calamités fut entrée chez le roi Aphridonios, il se leva en son honneur ; et le roi Hardobios fit de même. Et la vieille dit :
« Ô roi, il nous faut maintenant laisser de côté tout cet encens fécal et toutes ces bénédictions du patriarche qui n’ont fait qu’attirer les malheurs sur nos têtes. Et songeons plutôt à agir à la lumière de la vraie sagesse. Voici. Comme les musulmans s’acheminent, à marches forcées, pour venir assiéger notre ville, il faut envoyer des crieurs par tout l’empire inviter les populations à se rendre à Constantinia, pour repousser avec nous l’assaut des assiégeants. Et que tous les soldats des garnisons se hâtent d’accourir s’enfermer dans nos murs, car le danger est pressant !
« Quant à moi, ô roi, laisse-moi faire, et bientôt la renommée fera parvenir jusqu’à toi le résultat de mes ruses et le bruit de mes méfaits contre les musulmans. Car, dès cette minute, je quitte Constantinia. Et que le Christ, fils de Mariam, te garde sauf ! »
Alors le roi Aphridonios se hâta de suivre les conseils de Mère-des-Calamités qui était, comme elle l’avait dit, sortie de Constantinia.
Or, voici le stratagème imaginé par la vieille rouée.
Lorsqu’elle fut sortie de la ville, après avoir pris avec elle cinquante guerriers d’élite versés dans la connaissance de la langue arabe, son premier soin fut de les déguiser en marchands musulmans de Damas. Car elle avait également pris avec elle cent mulets chargés d’étoffes de toutes sortes, de soieries d’Antioche et de Damas, de satins à reflets métalliques et de brocarts précieux, et beaucoup d’autres choses royales. Et elle avait eu soin de prendre, du roi Aphridonios, une lettre, comme sauf-conduit, qui contenait ceci, en substance :
« Les marchands tels et tels sont des marchands musulmans de Damas, étrangers à notre pays et à notre religion chrétienne ; mais comme ils ont fait le commerce dans notre pays, et que le commerce constitue la prospérité d’un pays et sa richesse, et comme ce ne sont point des hommes de guerre, mais des hommes pacifiques, nous leur donnons ce sauf-conduit afin que nul ne les lèse dans leur personne ou leurs intérêts, et que nul ne leur réclame une dîme quelconque ou un droit d’entrée ou de sortie sur leurs marchandises. »
Ensuite, une fois les cinquante guerriers habillés en marchands musulmans, la perfide vieille se déguisa en ascète musulman, en s’habillant d’une grande robe de laine blanche ; puis elle se frotta le front avec un onguent de sa composition qui lui donna un éclat et un rayonnement de sainteté hors de pair ; enfin elle se fit lier les pieds de façon à ce que les cordes s’enfonçassent jusqu’au sang et laissassent des marques indélébiles. Alors seulement elle dit à ses compagnons :
« Il faut maintenant me frapper avec des fouets et me mettre les chairs en sang, de façon à me laisser des cicatrices ineffaçables. Et, pour cela, n’ayez aucun scrupule, car la nécessité a ses lois. Ensuite mettez-moi dans une caisse semblable à ces caisses de marchandises, et placez la caisse sur un de ces mulets. Et mettez-vous alors en marche jusqu’à ce que vous soyez arrivés au campement des musulmans dont le chef est Scharkân. Et à ceux qui voudront vous barrer la route, vous montrerez la lettre du roi Aphridonios, qui vous dépeint comme des marchands de Damas, et vous demanderez à voir le prince Scharkân ; et lorsque vous serez introduits en sa présence et qu’il vous aura interrogés sur votre état et sur vos bénéfices réalisés dans le pays des Roum infidèles, vous lui direz :
« Ô roi fortuné, le bénéfice le plus net et le plus méritoire de tout notre voyage commercial au pays de ces chrétiens mécréants, a été la délivrance d’un saint ascète que nous avons pu tirer d’entre les mains de ses persécuteurs, qui le torturaient dans un souterrain, depuis quinze années, pour lui faire abjurer la sainte religion de notre Prophète Mohammad (sur lui la paix et la prière !) Et voici comment la chose s’est passée :
« Il y avait déjà quelque temps que nous étions à Constantinia à vendre et à acheter, quand, une nuit que nous étions assis dans notre logement à calculer le gain de la journée, nous vîmes soudain, tout contre le mur de la salle, une grande image apparaître, d’un homme triste, dont les larmes remplissaient les yeux et coulaient le long de la vénérable barbe blanche. Et les lèvres du vieil homme triste remuèrent lentement et nous dirent ces paroles : « Ô musulmans ! Si parmi vous il y a des hommes qui craignent Allah et suivent à la lettre les préceptes de notre Prophète (sur lui la paix et la prière !) qu’ils se lèvent et sortent de ce pays des mécréants et aillent vers l’armée du prince Scharkân dont la destinée a été écrite de devoir un jour prendre des mains des Roum la ville de Constantinia. Et, sur votre route, vous trouverez un monastère, au bout de trois jours de marche. Et dans ce monastère, à tel endroit dans tel lieu, vous trouverez un souterrain où est enfermé depuis quinze ans un saint ascète de la Mecque nommé Abdallah, dont les vertus sont agréables à Allah Très-Haut. Et il est tombé entre les mains des moines chrétiens qui l’ont enfermé dans ce souterrain et le torturent horriblement en haine de sa religion. Aussi la délivrance de ce saint serait pour vous autres l’action la plus méritoire devant le Très-Haut ; et par elle-même déjà elle est une très belle action ! Je ne vous en dirai donc pas davantage. Et que la paix soit sur vous ! »
« Et, cela dit, la figure du vieillard triste s’effaça à nos yeux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
« Et, cela dit, la figure du vieillard triste s’effaça à nos yeux.
« Alors immédiatement, sans hésiter, nous emballâmes tout ce qui nous restait de marchandises et tout ce que nous avions acheté dans le pays des Roum, et nous sortîmes de Constantinia. Et, en effet, au bout de trois journées de marche, nous trouvâmes le monastère en question, au milieu d’un village. Alors, pour ne pas éveiller l’attention sur nos projets, nous déballâmes une partie de nos marchandises sur la place publique du village, selon la coutume des marchands, et nous nous mîmes ainsi à vendre jusqu’à la tombée de la nuit. Alors, à la faveur des ténèbres, nous nous glissâmes dans le monastère et nous bâillonnâmes le moine portier ; et nous pénétrâmes dans le souterrain. Et, comme nous l’avait dit l’apparition, nous trouvâmes le saint ascète Abdallah, qui est maintenant là dans une de nos caisses, ô roi, et que nous allons amener entre tes mains. »
Et, ayant enseigné ces paroles à ses compagnons, la vieille Mère-des-Calamités, déguisée en ascète, ajouta : « Et alors, moi, je me chargerai de l’extermination de tous ces musulmans ! »
Lorsque la vieille eut fini de parler, ses compagnons répondirent par l’ouïe et l’obéissance, et se mirent aussitôt à la fouetter jusqu’au sang, et puis l’enfermèrent dans une caisse vide, qu’ils placèrent sur le dos de l’un des mulets, et se mirent en route pour mettre à exécution le plan de cette perfide.
Mais pour ce qui est de l’armée victorieuse des Croyants, après la déroute des chrétiens elle se partagea le butin et glorifia Allah pour ses bienfaits. Ensuite Daoul’makân et Scharkân se tendirent la main pour se féliciter et s’embrassèrent, et Scharkân, dans sa joie, dit à Daoul’makân : « Ô mon frère je souhaite qu’Allah t’accorde de ton épouse enceinte un enfant mâle, afin que je puisse le marier à ma fillette Force-du-Destin ! » Et ils ne cessèrent de se réjouir ensemble jusqu’à ce que le vizir Dandân leur eût dit : « Ô rois, il est sage et tout indiqué que, sans perdre de temps, nous nous mettions à la poursuite des vaincus, et que, sans leur donner le temps de se reprendre, nous allions les assiéger dans Constantinia, et les exterminer totalement de la surface de la terre. Car, comme dit le poète :
» Le pur délice des délices est de tuer de sa main les ennemis, et de se sentir emporté sur un coursier fougueux.
Le pur délice est l’arrivée d’un messager de la bien-aimée vous annonçant l’arrivée de la bien-aimée.
Mais le plus pur délice des délices n’est-ce point l’arrivée de la bien-aimée avant même l’arrivée du messager ?
Et puis, ô délice de tuer de sa main les ennemis, et de se sentir emporté sur un coursier fougueux ! »
Lorsque le vizir Dandân eût récité ces vers, les deux rois agréèrent son avis et donnèrent le signal du départ pour Constantinia. Et toute l’armée se mit en marche, avec ses chefs en tête.
Et l’on marcha sans répit, et l’on traversa de grandes plaines brûlées où ne poussait d’autre végétation qu’une herbe jaune disséminée dans ces solitudes habitées seulement par la présence d’Allah. Et au bout de six jours de cette marche harassante, dans ces déserts sans eau, ils finirent par arriver dans un pays qui bénissait le Créateur. Devant eux s’étendaient des prairies pleines de fraîcheur où se promenaient les eaux bruissantes, où fleurissaient les arbres fruitiers. Et cette contrée, où s’ébattaient les gazelles et où chantaient les oiseaux, apparaissait tel un paradis avec ses grands arbres ivres de la rosée qui embellissait leurs branches, et ses fleurs qui souriaient à la brise vagabonde, comme dit le poète :
Regarde, enfant ! La mousse du jardin s’étend heureuse sous la caresse des fleurs endormies. Elle est un grand tapis couleur d’émeraude avec des reflets adorables.
Ferme tes yeux, enfant ! Écoute l’eau chanter sous les pieds des roseaux. Ah ! ferme tes yeux !
Jardins ! parterres ! ruisseaux ! je vous adore ! ruisseau au soleil, tu brilles comme une joue, duveté de l’ombre des saules inclinés !
Eau du ruisseau qui t’attaches aux tiges des fleurs, ô grelots d’argent aux chevilles blanches ! Et vous, fleurs, couronnez mon bien-aimé !…
Lorsqu’ils eurent rassasié leurs sens de ces délices, les deux frères songèrent à se reposer quelque temps en ce lieu. En effet, Daoul’makân dit à Scharkân : « Ô mon frère, je ne crois pas que tu aies vu à Damas des jardins aussi beaux. Restons donc ici pour nous reposer deux ou trois jours et donner à nos soldats le temps de respirer un peu le bon air et de boire de cette eau si douce afin qu’ils puissent mieux lutter contre les mécréants. » Et Scharkân trouva que l’idée était excellente.
Or, comme il y avait déjà deux jours qu’ils étaient là et qu’ils allaient se préparer à faire plier les tentes, ils entendirent des voix dans le lointain ; et, s’étant informés, il leur fut répondu que c’était une caravane de marchands de Damas qui retournaient dans leur pays, après avoir vendu et acheté dans le pays des Infidèles, et que les soldats leur barraient maintenant la route pour les punir d’avoir fait le commerce avec les Infidèles.
Mais, juste à ce moment, les marchands arrivèrent en protestant et en se démenant, entourés par les soldats. Et ils se jetèrent aux pieds de Daoul’makân et lui dirent : « Nous avons été dans le pays des Infidèles, qui nous ont respectés et ne nous ont lésés ni dans nos personnes ni dans nos biens ; et voici que maintenant les Croyants, nos frères, nous pillent et nous maltraitent en pays musulman ! » Puis ils sortirent la lettre, sauf-conduit du roi de Constantinia, et la tendirent à Daoul’makân qui la lut, ainsi que Scharkân. Et Scharkân leur dit : « Ce qui vous a été enlevé vous sera rendu sur l’heure. Mais aussi pourquoi, vous, des musulmans, être ailés ainsi faire le commerce avec les mécréants ? » Alors les marchands répondirent : « Ô notre maître, Allah nous a conduits chez ces chrétiens pour être la cause d’une victoire plus importante que toutes les victoires des armées et toutes celles que tu as remportées toi-même ! » Et Scharkân dit : « Et quelle est donc cette victoire, ô marchands ? » Ils répondirent : « Nous ne pouvons en parler que dans un endroit isolé, à l’abri des indiscrets ; car, si la chose venait à s’ébruiter, aucun musulman ne pourrait jamais plus, même en temps de paix, mettre les pieds dans le pays des chrétiens. »
À ces paroles, Daoul’makân et Scharkân emmenèrent les marchands, et les conduisirent sous une tente retirée, complètement à l’abri des oreilles indiscrètes. Alors les marchands…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA QUATRE-VINGT-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que les marchands racontèrent alors aux deux frères l’histoire fabriquée et enseignée par la vieille Mère-des-Calamités. Et les deux frères furent émus extrêmement en entendant le récit des souffrances du saint ascète et sa délivrance du souterrain du monastère. Et ils demandèrent aux marchands : « Mais où est-il maintenant, le saint ascète ? L’avez-vous laissé ensuite au monastère ? » Ils répondirent : « Lorsque nous eûmes tué le moine gardien du monastère, nous nous hâtâmes d’enfermer le saint dans une caisse, que nous chargeâmes sur un de nos mulets, et nous nous enfuîmes au plus vite. Et nous allons maintenant l’amener entre vos mains. Mais, avant de nous enfuir du monastère, nous pûmes constater qu’il renfermait des quintaux et des quintaux d’or, d’argent et de pierreries et joyaux de toutes sortes, dont va d’ailleurs vous mieux parler le saint ascète, dans quelques instants. »
Et ces marchands se hâtèrent d’aller décharger le mulet, et ouvrirent la caisse et amenèrent le saint ascète devant les deux frères. Et il apparut aussi noir qu’une gousse de cassier, tant il avait maigri et s’était ratatiné ; et il portait sur sa peau les cicatrices laissées par les coups de fouet et que l’on aurait cru des traces de chaînes enfoncées dans les chairs.
À sa vue (c’était, en réalité, la vieille Mère-des-Calamités !) les deux frères furent convaincus qu’ils avaient devant eux le plus saint des ascètes, surtout lorsqu’ils virent que le front de l’ascète était brillant comme le soleil, grâce à l’onguent mystérieux dont la perfide vieille s’était oint la peau. Et ils s’avancèrent vers elle et lui baisèrent les mains et les pieds avec ferveur en lui demandant sa bénédiction, les larmes aux yeux, et se mirent même à sangloter tant ils étaient touchés des souffrances subies par celle qu’ils croyaient être un saint ascète. Alors elle leur fit signe de se relever et leur dit : « Cessez maintenant de pleurer et écoutez mes paroles ! » Alors les deux frères obéirent tout de suite, et elle leur dit :
« Sachez que, pour moi, je me soumets passivement à la volonté de mon Souverain Maître, car je sais que les fléaux qu’il m’envoie sont seulement pour éprouver ma patience et mon humilité. Qu’il soit béni et glorifié ! Car celui qui ne sait pas supporter les épreuves du Très-Bon ne parviendra jamais à goûter les délices du paradis. Et si maintenant je suis heureux de ma délivrance, ce n’est point à cause de la fin de mes souffrances, mais à cause de ma venue au milieu de nos frères musulmans et de mon espoir de mourir sous le pas des chevaux des guerriers luttant pour la cause de l’Islam ! Car les Croyants qui sont tués dans la guerre sainte ne meurent pas, leur âme est immortelle ! »
Alors les deux frères lui prirent encore les mains et les baisèrent et voulurent donner l’ordre de lui apporter à manger, mais elle refusa en disant : « Je suis dans le jeûne depuis bientôt quinze ans, et je ne puis, maintenant qu’Allah m’a accordé tant de faveurs, être assez impie pour couper ce jeûne et mon abstinence, mais, peut-être, au coucher du soleil, mangerai-je un morceau. » Alors ils n’insistèrent pas ; mais, le soir venu, ils firent apprêter les mets et les lui présentèrent eux-mêmes ; mais la perfide refusa encore en disant : « Ce n’est point le temps de manger, mais de prier le Très-Haut ! » Et aussitôt elle se mit dans l’attitude de la prière au milieu du mihrab. Et elle resta ainsi à prier toute la nuit, sans prendre de repos, et aussi les deux nuits suivantes. Alors les deux frères furent pris pour elle d’une grande vénération, la croyant toujours un homme, un saint ascète ; et ils lui donnèrent une grande tente pour elle seule et des serviteurs spéciaux et des cuisiniers ; et à la fin du troisième jour, comme elle persistait à ne prendre aucune nourriture, les deux frères vinrent eux-mêmes la servir et lui firent porter dans sa tente tout ce que l’œil et l’âme peuvent souhaiter de choses agréables. Mais elle ne voulut toucher à rien et ne mangea qu’un morceau de pain et un peu de sel. Aussi le respect des deux frères ne fit qu’augmenter, et Scharkân dit à Daoul’makân : « En vérité, cet homme a absolument renoncé à toutes les jouissances de ce monde ! Et n’était cette guerre qui m’oblige à combattre les mécréants, je me consacrerais entièrement à sa dévotion, et je le suivrais toute ma vie pour avoir sur moi ses bénédictions ! Mais allons le prier de nous entretenir un peu, car demain nous devons marcher sur Constantinia, et nous n’aurons pas meilleure occasion de profiter de ses paroles. » Alors le grand-vizir Dandân dit : « Moi aussi, je voudrais bien voir ce saint ascète et le prier de faire des vœux pour moi, afin que je puisse trouver la mort dans la guerre sainte et aller me présenter devant le Souverain Maître : car j’en ai assez, de cette vie. »
Alors tous les trois prirent le chemin de la tente qu’habitait cette perfide vieille Mère-des-Calamités ; et ils la trouvèrent enfoncée dans l’extase de la prière. Alors ils se mirent à attendre qu’elle eût fini de prier ; mais comme, au bout de trois heures d’attente, malgré les pleurs d’admiration qu’ils versaient et leurs sanglots, elle ne se départait pas de cette attitude à genoux, et ne leur prêtait pas la moindre attention, ils s’avancèrent vers elle et baisèrent la terre. Alors elle se releva, et leur souhaita la paix et la bienvenue et leur dit : « Que venez-vous donc faire à cette heure ? » Ils répondirent : « Ô saint ascète, il y a déjà plusieurs heures que nous sommes ici. N’as-tu pas entendu nos pleurs ? » Elle répondit : « Celui qui se trouve en présence d’Allah ne peut entendre ni voir ce qui se passe dans ce bas monde ! » Ils lui dirent : « Nous venons te voir, ô saint ascète, pour te demander ta bénédiction avant le grand combat et pour entendre, de ta bouche, le récit de ta captivité chez les mécréants que nous allons demain, avec l’aide d’Allah, exterminer jusqu’au dernier ! » Alors la vieille maudite leur dit : « Par Allah ! si vous n’aviez été les chefs des Croyants jamais je ne vous eusse raconté ce que je vais vous raconter ! Car les conséquences vont en être pour vous d’un avantage considérable. Écoutez donc !
« Sachez, ô vous, que j’ai longtemps séjourné dans les Lieux Saints, en compagnie d’hommes pieux et éminents ; et je vivais avec eux en toute modestie, ne me préférant jamais à eux, car Allah Très-Haut m’a accordé le don de l’humilité et du renoncement. Et je pensais même passer le restant de mes jours de la sorte dans la tranquillité, l’accomplissement des devoirs pieux et le calme d’une vie sans incidents. Mais je calculais sans le destin.
« Une nuit que j’étais allé vers la mer, que je n’avais jamais vue, je fus poussé par une force irrésistible à marcher sur l’eau. Et je m’y dirigeai résolument et, à mon grand étonnement, je me mis à marcher sur l’eau sans m’y enfoncer et sans même mouiller mes pieds nus. Et je me mis ainsi à me promener sur la mer, à pied, pendant un certain temps ; après quoi je revins vers le rivage. Alors, l’esprit encore tout émerveillé de ce don surnaturel que je possédais sans savoir, je m’enorgueillis dans mon intérieur et je pensai : « Qui donc comme moi peut marcher sur la mer ? » À peine avais-je formulé mentalement cette pensée, qu’Allah me punit pour mon orgueil en mettant aussitôt dans mon cœur l’amour du voyage. Et je quittai les Lieux Saints. Et, depuis lors, je me mis à vagabonder de ci de là, sur toute la surface de la terre.
« Or, un jour que je voyageais à travers les pays des Roum, tout en accomplissant rigoureusement les devoirs de notre sainte religion, j’arrivai à une haute montagne sombre au sommet de laquelle était un monastère chrétien qui était sous la garde d’un moine. J’avais connu ce moine autrefois, dans les Lieux Saints, et il s’appelait Matrouna. Aussi à peine m’eut-il vu qu’il accourut respectueusement à ma rencontre et m’invita à entrer me reposer dans le monastère. Or, le perfide mécréant complotait ma perte, car à peine étais-je entré dans le monastère qu’il me fit suivre une longue galerie au bout de laquelle s’ouvrait une porte dans l’obscurité. Et il me poussa soudain dans le fond de cette obscurité et fit tourner la porte et m’enferma. Et là il me laissa quarante jours sans me donner à boire ni à manger, pensant ainsi me faire mourir de faim, en haine de ma religion.
« Sur ces entrefaites, arriva au monastère, en tournée extraordinaire, le chef général des moines ; et il était accompagné, selon l’habitude des chefs de moines, d’une suite choisie de dix jeunes moines fort jolis et d’une jeune fille aussi belle que les dix jeunes moines ; et cette jeune fille était vêtue d’un habit de moine qui lui serrait la taille et faisait saillir ses hanches et ses seins. Et Allah seul sait les horreurs que perpétrait ce chef de moines avec cette jeune fille qui s’appelait Tamacil et avec ses jeunes compagnons moines.
» Aussi, à l’arrivée de son chef, le moine Matrouna lui raconta mon emprisonnement et ma torture par la faim depuis quarante jours. Et le chef des moines, dont le nom est Dechianos, lui ordonna d’ouvrir la porte du souterrain et d’en retirer mes os pour les jeter, en disant : « Ce musulman doit, à l’heure qu’il est, être une carcasse si dénudée que les oiseaux de proie ne la voudront même pas approcher ! » Alors Matrouna et les jeunes moines ouvrirent la porte des ténèbres et me trouvèrent à genoux dans l’attitude de la prière. À cette vue, le moine Matrouna s’écria : « Ah ! le maudit sorcier ! Cassons-lui les os ! » Et ils me tombèrent tous dessus à grands coups de bâton et de fouet, et tellement que je crus trépasser. Et je compris alors qu’Allah me faisait subir ces épreuves pour me punir de ma vanité passée : je m’étais enflé d’orgueil en voyant que je marchais sur la mer, alors que je n’étais qu’un instrument entre les mains du Très-Haut.
« Donc, lorsque le moine Matrouna et les autres jeunes fils de chiens m’eurent mis dans cet état pitoyable, ils m’enchaînèrent et me rejetèrent dans le souterrain des ténèbres. Et j’y serais certainement mort d’inanition si Allah n’avait voulu toucher le cœur de la jeune Tamacil qui, chaque jour, me visita en secret pour me donner un pain d’orge et une cruche d’eau, tout le temps que resta le chef des moines au monastère. Or, le chef des moines resta longtemps dans ce monastère, où il se plaisait fort, et il finit même par le choisir pour sa résidence habituelle ; et lorsqu’il était obligé de le quitter, il y laissait la jeune Tamacil sous la garde du moine Matrouna.
« Je demeurai de la sorte enfermé dans le souterrain durant cinq ans : et, de son côté, la jeune fille grandissait et devenait d’une beauté qui défiait celle des plus belles filles de son temps. Car je puis vous certifier, ô rois, que ni dans notre pays ni dans le pays des Roum on ne peut trouver son égale. Mais cette jeune fille n’est pas le seul joyau que renferme ce monastère, car on y a entassé des trésors innombrables en or, en argent, en bijoux et en richesses de toutes sortes qui dépassent tout calcul. Aussi il faut vous hâter d’aller prendre d’assaut ce monastère et vous emparer de la jeune fille et des trésors ; et je vous servirai moi-même de guide pour vous ouvrir les portes des cachettes et des armoires que je connais, et notamment de la grande armoire du chef des moines Dechianos, celle qui contient les plus beaux vases en or ciselé ; et je vous livrerai cette merveille digne des rois qu’est la jeune Tamacil ; car, outre sa beauté, elle possède le don du chant et connaît toutes les chansons arabes des villes et des Bédouins. Et elle vous fera passer des journées lumineuses et des nuits de sucre et de bénédiction.
« Quant à ma délivrance du souterrain, vous l’avez apprise déjà de la bouche de ces bons marchands qui exposèrent leur vie pour me tirer d’entre les mains de ces chrétiens — qu’Allah maudisse, eux et leur postérité, jusqu’au jour du Jugement ! »
Lorsque les deux frères eurent entendu cette histoire, ils furent joyeux extrêmement en songeant à toutes les acquisitions qu’ils allaient faire et surtout à la jeune Tamacil, que la vieille disait fort experte, malgré sa jeunesse, dans l’art des plaisirs. Mais le vizir Dandân n’avait écouté cette histoire qu’avec un grand sentiment de méfiance et s’il ne s’était pas levé et en allé, c’était seulement par respect pour les deux rois ; car les paroles de cet ascète étrange ne lui entraient guère dans la tête et étaient loin de le convaincre ou de le satisfaire. Pourtant il cacha son impression et ne voulut rien dire, de peur de se tromper.
Quant à Daoul’makân, il voulait d’abord marcher sur le monastère à la tête de toute son armée ; mais la vieille Mère-des-Calamités l’en dissuada en lui disant : « J’ai peur que le chef des moines, Dechianos, à la vue de tous ces guerriers, ne prenne peur et ne s’échappe du monastère en emmenant la jeune fille. » Alors Daoul’makân fit appeler le grand-chambellan et l’émir Rustem et l’émir Bahramân et leur dit : « Demain, à la pointe du jour, vous marcherez sur Constantinia, où nous ne tarderons pas nous-mêmes à vous rejoindre. Toi, ô grand-chambellan, tu prendras le commandement général de l’armée à ma place ; et toi, Rustem, tu remplaceras mon frère Scharkân ; et toi, Bahramân, tu remplaceras le grand-vizir Dandân. Et surtout prenez bien garde de faire connaître à l’armée que nous sommes absents. D’ailleurs notre absence ne sera que de trois jours. » Puis Daoul’makân, Scharkân et le vizir Dandân choisirent cent guerriers d’entre les plus valeureux et cent mulets chargés de caisses vides destinées à contenir les trésors du monastère ; et ils emmenèrent aussi la vieille Mère-des-Calamités, cette perfide, qu’ils croyaient toujours un ascète aimé d’Allah ; et, suivant son indication, ils prirent le chemin du monastère.
Quant au grand-chambellan et aux troupes musulmanes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et s’arrêta discrètement dans son récit.
LA QUATRE-VINGT-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
Quant au grand-chambellan et aux troupes musulmanes, suivant l’ordre du roi Daoul’makân, le lendemain, à l’aube, ils plièrent les tentes et firent route sur Constantinia.
De son côté, la vieille Mère-des-Calamités ne perdit point de temps. À peine furent-ils tous hors des tentes, qu’elle tira de l’une des caisses qu’elle avait sur son mulet deux pigeons apprivoisés par elle ; et elle attacha au cou de chacun de ces pigeons une lettre adressée au roi Aphridonios de Constantinia, dans laquelle elle le mettait au courant de tout ce qu’elle venait de faire et elle terminait en disant :
« Aussi, ô roi, il faut tout de suite envoyer au monastère dix mille guerriers des plus éprouvés parmi les plus vaillants d’entre les Roum. Et, lorsqu’ils seront arrivés au bas de la montagne, qu’ils ne bougent pas avant mon arrivée ! Et alors je leur livrerai les deux rois et le vizir et les cent guerriers musulmans.
« Pourtant je dois te dire, ô roi, que ma ruse ne peut s’accomplir sans la mort du gardien du monastère, le moine Matrouna ; je le sacrifierai donc pour le bien commun des armées chrétiennes, car la vie d’un moine n’est rien devant le salut de la chrétienté.
« Et loué soit le Christ, notre Seigneur, au commencement et à la fin ! »
Et les pigeons, porteurs de la lettre, arrivèrent à la haute tour, à Constantinia ; et l’apprivoiseur prit la lettre suspendue au cou des pigeons et alla tout de suite la remettre au roi Aphridonios. Et à peine le roi eut-il lu la lettre, qu’il fit rassembler les dix mille guerriers nécessaires et leur fit donner à chacun un cheval et, en outre, un chameau de course et un mulet pour porter le butin qu’ils devaient faire sur l’ennemi. Et il les fit se diriger en toute hâte dans la direction du monastère.
Quant au roi Daoul’makân et à Scharkân et au vizir Dandân et aux cent guerriers, une fois arrivés au bas de la montagne, ils durent faire seuls l’ascension du monastère, car la vieille Mère-des-Calamités, s’étant trouvée extrêmement fatiguée par le voyage, était restée au bas de la montagne, en disant : « Montez d’abord, vous autres, et moi, ensuite, une fois le monastère en votre pouvoir, je monterai vous en révéler les trésors cachés. »
Or, ils arrivèrent au monastère, un à un, en se dissimulant ; et, arrivés sous les murs, ils les escaladèrent prestement et sautèrent tous à la fois dans le jardin. Alors, au bruit, accourut le gardien, le moine Matrouna ; mais c’en fut fait de lui, car Scharkân cria à ses guerriers : « Sus à ce chien maudit ! » Et aussitôt cent coups le pénétrèrent ; et son âme mécréante s’exhala de son cul et alla s’enfoncer dans les feux de l’enfer. Et le pillage du monastère commença avec ordre. D’abord ils entrèrent dans l’endroit sacré où les chrétiens déposent leurs offrandes ; et là ils trouvèrent, pendus aux murs, de haut en bas, une quantité énorme de joyaux et de choses très riches, bien plus que ne leur avait dit le vieil ascète. Et ils remplirent leurs caisses et leurs sacs et les chargèrent sur les mulets et les chameaux.
Mais pour ce qui est de la jeune fille nommée Tamacil, que leur avait dépeinte l’ascète, aucune trace, pas plus d’elle que des dix jeunes garçons aussi beaux qu’elle, ni du déplorable chef des moines Dechianos. Aussi pensèrent-ils que la jeune fille, ou était sortie se promener ou s’était cachée dans une chambre ; et ils fouillèrent tout le monastère ; et ils restèrent à l’attendre pendant deux jours ; mais la jeune Tamacil n’apparaissait pas davantage. Et Scharkân, impatienté, finit par dire : « Par Allah ! ô mon frère, mon cœur et ma pensée travaillent beaucoup au sujet des guerriers de l’Islam que nous avons laissés aller seuls à Constantinia, et dont nous n’avons aucune nouvelle ! » Et Daoul’makân dit : « Je crois bien aussi que, pour ce qui est de la nommée Tamacil et de ses jeunes compagnons, il faut faire notre acte de renoncement, car je ne vois rien venir. Aussi, maintenant que nous avons assez attendu en vain et que d’ailleurs nous avons chargé nos mulets et nos chameaux d’une grande partie des richesses du monastère, contentons-nous de ce qu’Allah nous a déjà accordé, et allons nous-en rejoindre nos troupes pour, avec l’aide d’Allah, écraser les Infidèles et prendre leur capitale, Constantinia ! »
Alors ils descendirent du monastère pour aller prendre le vieil ascète au bas de la montagne et faire route vers leur armée. Mais à peine s’étaient-ils engagés dans la vallée, que de toutes parts apparurent sur les hauteurs les guerriers des Roum, qui poussaient leur cri de guerre, et de tous les côtés à la fois ils se mirent à descendre vers eux pour les envelopper. À cette vue, Daoul’makân s’écria : « Qui donc a pu aviser les chrétiens de notre présence au monastère ? » Mais Scharkân, sans lui laisser le temps de continuer, lui dit : « Ô mon frère, nous n’avons pas de temps à perdre en conjectures ; dégainons courageusement et attendons de pied ferme tous ces chiens maudits, et faisons-en une telle tuerie que nul d’entre eux ne puisse s’échapper pour aller raviver le feu de son foyer ! » Et Daoul’makân dit : « Si du moins nous avions été prévenus, nous aurions pris avec nous un plus grand nombre de nos guerriers pour lutter un peu plus efficacement ! » Mais le vizir Dandân dit : « Si même nous avions avec nous dix mille hommes, cela ne nous serait d’aucune utilité dans cette gorge étroite. Mais Allah nous fera surmonter toutes les difficultés et nous tirera de ce mauvais pas. Car, du temps que je guerroyais ici, avec le défunt roi Omar Al-Némân, j’ai appris à connaître toutes les issues de cette vallée et toutes les sources d’eau glacée qu’elle contient. Suivez-moi donc avant que toutes les issues ne soient occupées par ces mécréants ! »
Mais au moment où ils allaient se mettre à l’abri, devant eux apparut le saint ascète qui leur cria : « Où courez-vous ainsi, ô Croyants ? Fuyez-vous donc en face de l’ennemi ? Ne savez-vous que votre vie est dans les mains d’Allah seul et qu’il est le maître de vous la conserver ou de vous l’enlever, quoi qu’il puisse vous arriver ? Oubliez-vous que, moi-même, enfermé sans nourriture dans le souterrain, j’ai survécu parce qu’il l’a ainsi voulu ? En avant donc, ô musulmans ! Et si la mort est là, le paradis vous attend ! »
À ces paroles du saint ascète, ils se sentirent l’âme remplie de courage et attendirent de pied ferme l’ennemi qui fondait sur eux avec impétuosité. Or, ils n’étaient en tout que cent trois, mais un Croyant ne vaut-il point mille Infidèles ? En effet, à peine les chrétiens furent-ils à portée de la lance et du glaive, que le vol de leurs têtes devint un jeu pour les bras des Croyants. Et Daoul’makân et Scharkân de chaque tournoiement de leur sabre jetaient en l’air cinq tètes coupées ! Alors les Infidèles s’élancèrent dix par dix sur les deux frères ; mais un instant après dix têtes coupées sautaient en l’air. Et, de leur côté, les cent guerriers firent de ces chiens qui les attaquaient un carnage mémorable, et cela jusqu’à la tombée de la nuit qui sépara les combattants.
Alors les Croyants et leurs trois chefs se retirèrent dans une caverne au flanc de la montagne pour s’y abriter cette nuit-là. Et ils songèrent à s’informer du sort du saint ascète ; et ils le cherchèrent en vain, après s’être comptés eux-mêmes un à un et avoir constaté qu’ils n’étaient plus que quarante-cinq survivants. Et Daoul’makân dit : « Qui sait si maintenant ce saint homme n’est pas mort martyr de sa foi, dans la mêlée ! » Mais le vizir Dandân s’écria : « Ô roi, durant la bataille je l’ai vu, cet ascète ! Et il m’a semblé le voir exciter les Infidèles au combat ; et il me paraissait tel un éfrit noir de la plus épouvantable espèce ! » Mais, au moment même où le vizir Dandân émettait ce jugement, l’ascète parut à l’entrée de la grotte ; et il tenait par les cheveux une tête coupée aux yeux convulsés. Et c’était la tête même du général en chef de l’armée chrétienne, lequel était un bien terrible guerrier.
À cette vue, les deux frères se levèrent debout sur leurs deux pieds et s’écrièrent : « Louange à Allah qui t’a sauvé, ô saint ascète, et t’a rendu à notre vénération ! » Alors cette perfide maudite répondit : « Mes chers fils, pour moi j’ai voulu mourir dans la mêlée et bien des fois je me suis jeté au milieu des combattants ; mais ces Infidèles eux-mêmes me respectaient et détournaient leur glaive de ma poitrine. Alors, moi, je profitai de cette confiance que je leur inspirais pour m’approcher de leur chef, et, d’un seul coup de sabre, avec l’aide d’Allah, je lui ai coupé la tête ! Et cette tête je vous l’apporte, pour vous encourager à continuer la lutte contre cette armée sans chef ! Quant à moi… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que la vieille Mère-des-Calamités continua ainsi : « Quant à moi, je vais courir au plus vite vers votre armée, sous les murs de Constantinia, et vous chercher du renfort pour vous tirer des mains des mécréants. Fortifiez donc votre âme et, en attendant l’arrivée de vos frères musulmans, réchauffez vos glaives dans le sang des Infidèles, pour être agréables au Maître Suprême des armées ! » Alors les deux frères embrassèrent les mains du vénérable ascète et le remercièrent pour son dévouement et lui dirent : « Mais comment allez-vous faire, ô saint ascète, pour sortir de cette gorge dont toutes les issues sont occupées par les chrétiens, et alors que toutes les hauteurs sont peuplées des guerriers ennemis qui vous lapideront certainement sous une pluie continue de roches déracinées ! » Mais la perfide vieille répondit : « Allah me cachera à leurs regards, et je passerai inaperçu. Et si même ils parvenaient à me voir, ils ne pourraient me faire aucun mal, car je serai entre les mains d’Allah qui sait protéger ses vrais adorateurs et exterminer les impies qui le méconnaissent ! » Alors Scharkân lui dit : « Tes paroles sont pleines de vérité, ô saint ascète ! Car je t’ai vu au milieu du combat donner de ta personne avec héroïsme, et nul de ces chiens n’osait t’approcher ni même te regarder. Maintenant il ne te reste plus qu’à nous sauver d’entre leurs mains ; et plus vite tu partirais pour nous chercher du secours, mieux cela vaudrait. Voici la nuit. Pars à la faveur de ses ténèbres, sous l’égide d’Allah le Très-Haut ! »
Alors la maudite vieille essaya d’entraîner avec elle Daoul’makân pour le livrer aux ennemis. Mais le vizir Dandân, qui, en son âme, se méfiait des manières étranges de cet ascète, dit à Daoul’makân ce qu’il fallait pour l’empêcher d’en rien faire. Et la maudite fut obligée de s’en aller seule en jetant sur le vizir Dandân un regard de travers.
D’ailleurs, pour ce qui est de la tête coupée du général en chef de l’armée chrétienne, la vieille avait menti en disant que c’était elle qui avait tué ce redoutable guerrier. Elle n’avait fait que seulement lui couper la tête, une fois mort ; car il avait été tué, dans le feu du combat, par l’un des guerriers d’élite d’entre les cent gardes musulmans. Et ce guerrier musulman avait payé son exploit de sa vie ; car à peine le chef chrétien avait-il remis son âme aux démons de l’enfer, que les soldats chrétiens, voyant tomber leur chef sous la lance du musulman, se précipitèrent en masse sur ce dernier et le lardèrent de coups d’épée et le mirent en morceaux. Et l’àme de ce Croyant alla aussitôt au paradis entre les mains du Rémunérateur.
Quant aux deux rois et au vizir Dandân et aux quarante-cinq guerriers qui avaient passé la nuit dans la caverne, ils se réveillèrent à l’aube, et se mirent aussitôt dans l’attitude de la prière pour accomplir leurs devoirs religieux du matin, après avoir fait les ablutions prescrites. Puis ils se levèrent regaillardis et prêts à la lutte ; et à la voix de Daoul’makân ils se précipitèrent comme des lions sur un troupeau de cochons. Et ils firent ce jour-là un carnage satisfaisant de leurs nombreux ennemis ; et les glaives s’entrechoquèrent aux glaives, et les lances aux lances, et les javelots firent éclater les armures ; et les guerriers s’élançaient au combat comme des loups altérés de sang. Et Scharkân et Daoul’makân firent couler tant de flots de sang que la rivière de la vallée en déborda, et la vallée elle-même disparut sous les monceaux de cadavres. Aussi à la tombée de la nuit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
Aussi à la tombée de la nuit les combattants furent obligés de se séparer, et chaque parti regagna son camp ; or, le camp des musulmans était toujours cette cachette dans la caverne ; et ils purent, une fois rentrés dans la caverne, se compter et constater que trente-cinq d’entre eux étaient restés ce jour-là sur le champ de bataille : ce qui réduisait leur nombre à dix guerriers avec, en plus, les deux rois et le vizir, et les obligeait à compter désormais, et plus que jamais, seulement sur l’excellence de leurs épées et l’aide du Très-Haut.
Pourtant Scharkân, à cette constatation, sentit sa poitrine se rétrécir considérablement et ne put s’empêcher de pousser un grand, soupir et de dire : « Comment allons-nous faire maintenant ? » Mais tous ces guerriers croyants lui répondirent à la fois : « Rien ne s’accomplira sans la volonté d’Allah ! » Et Scharkân passa toute cette nuit sans dormir.
Mais le matin, au jour, il se leva et réveilla ses compagnons et leur dit : « Compagnons, nous ne sommes plus que treize, y compris le roi Daoul’makân, mon frère, et notre vizir Dandân. Je pense donc qu’il serait funeste de faire une sortie contre l’ennemi, car, malgré les prodiges de valeur que nous accomplirions, nous ne pourrions longtemps résister à la meute innombrable de nos ennemis ; et nul de nous ne reviendrait avec son âme. Nous allons donc, l’épée à la main, nous tenir un instant à l’entrée de cette grotte et provoquer nos ennemis à venir eux-mêmes nous chercher ici. Et tous ceux qui auront l’audace de pénétrer nous attaquer seront facilement mis en pièces dans cette caverne où nous sommes les plus forts. Et cela nous permettra d’attendre, en décimant nos ennemis, l’arrivée du renfort promis par le vénérable ascète. »
Alors tous répondirent : « L’idée est tout à fait bonne, et nous allons tout de suite la mettre en pratique. » Alors cinq d’entre les guerriers sortirent de la caverne et se tournèrent du côté du campement des ennemis et se mirent à les provoquer à grands cris. Puis, voyant qu’un détachement s’avançait de leur côté, ils rentrèrent dans la caverne et en occupèrent l’entrée, en se mettant sur deux rangs.
Or, les choses se passèrent d’après les prévisions de Scharkân. Car chaque fois que des chrétiens essayaient de franchir l’entrée de la caverne, ils étaient saisis et coupés en deux, et nul ne réapparaissait au dehors pour mettre les autres en garde contre cet assaut dangereux. Aussi, ce jour-là, le carnage de chrétiens fut encore plus considérable que les autres jours, et il ne s’arrêta qu’aux ténèbres de la nuit. Et c’est ainsi qu’Allah aveuglait les impies pour mettre la vaillance dans le cœur de ses serviteurs.
Mais, le lendemain, les chrétiens tinrent conseil et dirent : « Cette lutte avec ces musulmans ne saurait avoir de fin qu’on ne les ait exterminés jusqu’au dernier. Au lieu donc d’essayer de prendre cette caverne d’assaut, enveloppons-la de toutes parts par nos soldats, et entourons-la de bois sec en quantité prodigieuse, et mettons le feu à ce bois qui les brûlera tous vifs. Alors, s’ils consentent, au lieu de se laisser brûler, à se rendre à discrétion, nous les emmènerons captifs et nous les traînerons devant notre roi Aphridonios, à Constantinia. Sinon, nous les laisserons se changer en charbon ardent pour alimenter les feux de l’enfer. Et puisse le Christ les enfumer et les maudire, eux et leurs ascendants et leur postérité, et en faire le tapis foulé aux pieds de la chrétienté ! »
Et, cela dit, ils se hâtèrent d’entasser les bûches de bois tout autour de la grotte…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, remit son récit au lendemain.
LA QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Ils se hâtèrent d’entasser les bûches de bois tout autour de la grotte, à une hauteur énorme, et y mirent le feu.
Alors les musulmans, dans la caverne, sentirent la chaleur qui les cuisait et qui, augmentant de plus en plus, finit par les chasser. Ils se massèrent donc en un seul bloc et se précipitèrent tous au dehors et, à travers les flammes, firent une trouée rapide. Mais, hélas ! de l’autre côté, encore aveuglés par la flamme et la fumée, le destin les jeta vivants entre les mains des ennemis qui aussitôt voulurent les mettre à mort. Mais le chef des chrétiens les en empêcha et leur dit : « Par Allah ! attendons pour les faire mourir qu’ils soient en présence du roi Aphridonios, à Constantinia, qui éprouvera une grande joie de les voir captifs. Mettons-leur les chaînes au cou et traînons-les derrière les chevaux à Constantinia ! »
Alors on les lia avec des cordes et on les mit sous la garde de quelques guerriers. Puis, pour fêter cette capture, toute l’armée chrétienne se mit à manger et à boire ; et ils burent tant que, vers le milieu de la nuit, ils tombèrent tous sur le dos comme morts.
À ce moment, Scharkân regarda tout autour de lui et vit tous ces corps étendus, et il dit à son frère Daoul’makân : « Y a-t-il encore pour nous un moyen de nous tirer de ce mauvais pas ? » Mais Daoul’makân répondit : « Ô mon frère, en vérité, je ne sais pas ; car nous voici comme les oiseaux dans la cage. » Et Scharkân fut dans une telle rage et poussa un si grand soupir, que l’effort considérable qu’il donna fit craquer les cordes qui le liaient et les fit sauter. Alors il bondit sur ses pieds et courut à son frère et au vizir Dandân et se hâta de les délivrer de leurs liens ; puis il s’approcha du gardien en chef et lui enleva les clefs des chaînes dont étaient enchaînés les dix guerriers musulmans et il les délivra également. Alors, sans perdre de temps, ils s’armèrent des armes des chrétiens ivres et s’emparèrent de leurs chevaux et, sans bruit, s’éloignèrent, en remerciant Allah pour leur délivrance.
Ils se mirent alors à une allure fort rapide et finirent par arriver au haut de la montagne. Alors Scharkân les fit s’arrêter un instant et leur dit : « Maintenant qu’avec l’aide d’Allah nous sommes en sûreté, j’ai une idée à vous communiquer. » Ils répondirent tous : « Et quelle est cette idée ? » Il dit : « Nous allons nous disperser un peu de tous les côtés sur le sommet de cette montagne, et nous allons grossir nos voix et crier de toutes nos forces : « Allahou akbar ! » Alors toutes les montagnes et les vallées et les rochers résonneront, et les impies, encore ivres, croiront que toute l’armée des musulmans s’abat sur eux. Alors, étourdis, ils s’entretueront dans les ténèbres et feront d’eux-mêmes un carnage très grand jusqu’au matin. »
À ces paroles, ils répondirent par l’ouïe et l’obéissance, et firent tous ce que leur avait conseillé Scharkân. Aussi, à ces voix qui tombaient des montagnes, répercutées mille fois dans les ténèbres, les mécréants se levèrent avec effroi et revêtirent en hâte leurs armures en s’écriant : « Par le Christ ! l’armée musulmane est tout entière sur nous ! » Et, affolés, ils se jetèrent les uns sur les autres et firent d’eux-mêmes un grand carnage, et ne s’arrêtèrent qu’avec le matin, alors que la petite troupe des Croyants s’éloignait rapidement dans la direction de Constantinia.
Or, pendant que Daoul’makân et Scharkân, avec le vizir Dandân et les guerriers, marchaient vers le matin, ils virent devant eux s’élever une poussière très dense. …
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin, et se tut discrètement.
LA CENTIÈME NUIT
Elle dit :
Ils virent devant eux s’élever une poussière très dense, et entendirent des voix qui criaient : « Allahou akbar ! » Et, quelques instants après, ils aperçurent, avec ses étendards déployés, une armée musulmane qui s’avançait vers eux rapidement. Et sous les grands étendards sur lesquels étaient écrits les mots de la foi : « Il n’y a d’autre Dieu qu’Allah ! Et Mohammad est l’Envoyé d’Allah ! » apparurent, à cheval, à la tête de leurs guerriers, les émirs Rustem et Bahramân. Et derrière eux, comme les vagues innombrables, s’avançaient les guerriers musulmans.
Aussitôt que les émirs Rustem et Bahramân virent le roi Daoul’makân et ses compagnons, ils mirent pied à terre et vinrent lui présenter leurs hommages. Et Daoul’makân leur demanda : « Et comment vont nos frères musulmans, sous les murs de Constantinia ? » Ils répondirent : « En toute santé et en tous bienfaits ! Et c’est le grand-chambellan qui nous a dépêchés vers vous autres, avec vingt mille guerriers, pour vous porter secours. » Alors Daoul’makân leur demanda : « Et comment avez-vous su le danger que nous courions ? » Ils répondirent : « C’est le vénérable ascète qui, après une marche de jour et de nuit, est accouru nous annoncer la chose et nous presser de courir ici. Et il se trouve maintenant en sécurité auprès du grand-chambellan ; et il encourage les Croyants à la lutte contre les Infidèles enfermés dans les murs de Constantinia. »
Alors les deux frères furent très réjouis d’apprendre cette nouvelle et ils remercièrent Allah pour l’arrivée du saint ascète en toute sécurité. Et ils mirent les deux émirs au courant de tout ce qui s’était passé depuis leur arrivée au monastère, et leur dirent : « Maintenant les Infidèles, qui se sont décimés durant toute la nuit, doivent être dans le tumulte et l’épouvante de voir leur erreur. Aussi, sans leur laisser le temps de se reprendre, nous allons leur tomber dessus du haut de la montagne et les exterminer et prendre tout leur butin ainsi que les richesses que nous avions enlevées du monastère. »
Et immédiatement l’armée entière des Croyants, commandée maintenant par Daoul’makân et Scharkân, se précipita comme le tonnerre du sommet de la montagne et tomba sur le camp des Infidèles et fit jouer dans leurs corps le glaive et la lance. Et à la fin de cette journée il ne restait plus, parmi les Infidèles, un seul homme capable d’aller raconter le désastre aux maudits enfermés dans les murs de Constantinia.
Une fois les guerriers chrétiens exterminés, les musulmans prirent toutes les richesses et tout le butin, et passèrent cette nuit-là dans le repos, en se congratulant mutuellement de leur succès et en remerciant Allah de ses bienfaits.
Et le matin venu, Daoul’makân décida le départ et dit aux chefs de l’armée : « Il nous faut maintenant gagner au plus vite Constantinia pour nous joindre au grand-chambellan qui assiège la ville et qui n’a plus avec lui que très peu de troupes. Car si les assiégés savaient votre présence ici, ils comprendraient que les musulmans qui sont sous les murs sont en très petit nombre, et ils feraient une sortie funeste pour les Croyants. »
Alors on leva le campement et on marcha sur Constantinia, tandis que Daoul’makân, pour soutenir le courage de ses guerriers, improvisait, durant la marche, cette sublime élévation :
« Seigneur ! je t’offre ma louange, Toi qui es la gloire et la louange, ô Dieu qui n’as cessé de me diriger dans la voie difficile, par la main.
Tu m’as donné la richesse et les biens, un trône et tes grâces ; et tu as armé mon bras du glaive de la vaillance et des victoires.
Et tu m’as rendu le maître d’un empire à l’ombre considérable, et tu m’as comblé de [excès de ta générosité.
Et tu m’as nourri, étranger dans les pays étrangers, et tu t’es fait mon garant quand j’étais si obscur parmi les inconnus !
Gloire à toi ! Tu as orné mon front de ton triomphe. Avec ton aide, notis avons écrasé les Roum qui méconnaissent ta puissance ; et nous les avons pourchassés sous nos coups comme un bétail en déroute.
Gloire à toi ! Sur les rangs des impies tu as prononcé la parole de ta colère, et les voici ivres à jamais, non point du ferment généreux des vins, mais de la coupe de la mort.
Et si d’entre tes Croyants quelques-uns sont restés dans la bataille, l’immortalité les possède, assis sous les touffes heureuses, aux bords du fleuve édénique de miel parfumé ! »
Lorsque Daoul’makân eut fini de réciter ces vers, pendant la marche des troupes, on vit s’élever une poussière noire qui, s’étant dissipée…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA CENT-UNIÈME NUIT
Elle dit :
On vit s’élever une poussière noire qui, s’étant dissipée, laissa apparaître la maudite vieille Mère-des-Calamités, toujours sous l’aspect d’un vénérable ascète. Alors tous s’empressèrent de lui baiser les mains, tandis que, les larmes aux yeux et la voix altérée, elle leur dit :
« Apprenez le malheur, ô peuple des Croyants ! Et surtout hâtez vos pas ! Vos frères musulmans, qui étaient campés sous les murs de Constantinia, ont été attaqués à l’improviste, dans leurs tentes, par les forces considérables des assiégés ; et ils sont maintenant en complète déroute. Courez donc à leur secours, sinon du chambellan et de ses guerriers vous ne retrouverez même plus la trace ! »
Lorsque Daoul’makân et Scharkân eurent entendu ces paroles, ils sentirent s’envoler leur cœur à force de battements, et, au comble de la consternation, ils s’agenouillèrent devant le saint ascète et lui baisèrent les pieds ; et tous les guerriers se mirent à pousser des cris de douleur et des sanglots.
Mais il n’en fut pas de même du grand-vizir Dandân. Car il fut le seul à ne pas descendre de cheval et à ne pas baiser les mains et les pieds de l’ascète de malheur. Et, à haute voix, devant tous les chefs réunis, il s’écria : « Par Allah ! ô musulmans, mon cœur éprouve une singulière aversion pour cet ascète étrange ; et je sens qu’il est un des réprouvés, de ceux-là qui sont bannis loin de la porte de la miséricorde divine ! Croyez-moi, ô musulmans, repoussez loin de vous ce sorcier maudit ! Croyez-en le vieux compagnon du défunt roi Omar Al-Némân ! Et, sans plus tenir compte des paroles de ce réprouvé, hâtons-nous vers Constantinia ! »
À ces paroles, Scharkân dit au vizir Dandân : « Chasse de ton esprit ces soupçons désobligeants qui prouvent bien que tu n’as pas vu, comme moi, ce saint ascète relever dans la mêlée le courage des musulmans et affronter sans crainte les glaives et les lances. Tâche donc de ne plus médire de ce saint, car la médisance est blâmée, et l’attaque dirigée contre l’homme de bien est condamnée. Et sache bien que si Allah ne l’aimait pas, il ne lui aurait pas donné cette force et cette endurance, et ne l’aurait pas sauvé autrefois des tortures du souterrain. »
Puis, ayant dit ces paroles, Scharkân fit donner comme monture au saint ascète une belle mule vigoureuse harnachée somptueusement et lui dit : « Monte cette mule et cesse d’aller à pied, ô notre père, ô le plus saint d’entre les ascètes ! » Mais la perfide vieille s’écria : « Comment pourrais-je prendre du repos alors que les corps des Croyants gisent sans sépulture sous les murs de Constantinia ! » Et elle ne voulut point monter la mule, et se mêla aux guerriers, et se mit à marcher et à circuler parmi les piétons et les cavaliers comme le renard en quête d’une proie. Et, tout en circulant, elle ne cessait de réciter à voix haute les versets du Koran et de prier le Clément, jusqu’à ce qu’enfin on vît accourir en désordre les débris de l’armée commandée par le grand-chambellan.
Alors Daoul’makân fit approcher le grand-chambellan et lui demanda de raconter les détails du désastre éprouvé. Et le grand-chambellan, le visage défait et l’âme torturée, lui raconta tout ce qui était arrivé.
Or, tout cela avait été combiné par la maudite Mère-des-Calamités. En effet, lorsque les émirs Rustem et Bahramân, chefs des Turcs et des Kurdes, furent partis au secours de Daoul’makân et de Scharkân, l’armée qui campait sous les murs de Constantinia se trouva du coup fort diminuée en nombre ; aussi, par crainte que la chose ne fût connue des chrétiens, le grand-chambellan ne voulut point en parler à ses soldats de peur qu’il se trouvât un traître parmi eux.
Mais la vieille, qui n’attendait que ce moment et qui recherchait depuis longtemps cette occasion qu’elle avait combinée avec beaucoup de peines et de soins, courut aussitôt vers les assiégés et héla à haute voix l’un des chefs qui étaient sur les murailles et lui dit de lui tendre une corde. Alors on lui tendit une corde ; et elle y attacha une lettre écrite de sa main et dans laquelle elle disait au roi Aphridonios :
« Cette lettre est de la part de la subtile et rouée et terrible Mère-des-Calamités, le plus effroyable fléau de l’Orient et de l’Occident, au roi Aphridonios que le Christ ait en ses bonnes grâces !
« Et ensuite !
« Sache, ô roi, que désormais la tranquillité va régner dans ton cœur, car j’ai combiné un stratagème qui est la perte dernière des musulmans. Après avoir réduit en captivité et jeté dans les chaînes leur roi Daoul’makân et son frère Scharkân et le vizir Dandân et détruit la troupe avec laquelle ils avaient pillé le monastère du moine Matrouna, j’ai réussi à affaiblir les assiégeants en les décidant à envoyer les deux tiers de leur armée dans la vallée, où ils seront détruits par l’armée victorieuse des soldats du Christ.
« Il ne te reste donc plus qu’à faire une sortie en masse contre les assiégeants et à les attaquer dans leur camp et à brûler leurs tentes et à les mettre en pièces jusqu’au dernier : ce qui te sera facile avec le secours de Notre Seigneur Christ et de sa mère Vierge. Et puissent-ils un jour me rémunérer pour tout le bien que je fais à toute la chrétienté ! »
À la lecture de cette lettre, le roi Aphridonios éprouva une très grande joie et fit immédiatement appeler le roi Hardobios, qui était venu s’enfermer à Constantinia avec le contingent de ses troupes de Kaïssaria ; et il lui lut la lettre de Mère-des-Calamités…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
Et il lui lut la lettre de Mère-des-Calamités. Alors le roi Hardobios fut à l’extrême limite de la dilatation et s’écria : « Admire, ô roi, les ruses merveilleuses de ma nourrice Mère-des-Calamités ! En vérité, elle nous a été plus utile que toutes les armes de nos guerriers ; et rien que son regard lancé sur nos ennemis produit plus de terreur que la vue de tous les démons de l’enfer au terrible jour du Jugement ! » Et le roi Aphridonios répondit : « Puisse le Christ ne jamais nous priver de la vue de cette femme inestimable ! Et puisse-t-il la faire fructifier en ruses et en stratagèmes ! »
Et aussitôt il donna l’ordre aux chefs de son armée de faire crier aux soldats l’heure de l’attaque et de la sortie. Alors de tous les côtés affluèrent les soldats, et ils aiguisèrent leurs épées et invoquèrent la croix et la ceinture et sacrèrent et blasphémèrent et se démenèrent et hurlèrent. Et tous ensemble sortirent par la grande porte de Constantinia.
À la vue des chrétiens qui s’avançaient en ordre de bataille et le glaive nu à la main, le grand-chambellan comprit le danger ; il fit aussitôt appeler les hommes aux armes et leur jeta ces quelques mots : « Ô guerriers musulmans, mettez votre confiance dans votre foi ! Ô soldats, si vous reculez vous êtes perdus ; mais si vous tenez ferme, vous triompherez. Et, d’ailleurs, le courage n’est que la patience durant un moment ; et il n’y a pas de chose étroite qu’Allah ne puisse élargir ! Je demande donc au Très-Haut de vous bénir et de vous regarder d’un œil clément ! »
Lorsque les musulmans eurent entendu ces paroles, leur courage ne connut plus de limites et ils crièrent tous : « Il n’y a d’autre Dieu qu’Allah ! » Et, de leur côté, les chrétiens, à la voix de leurs prêtres et de leurs moines, invoquèrent le Christ, la croix et la ceinture. Et, à ces cris mêlés, les deux armées en vinrent aux mains terriblement ; et le sang coula à flots ; et les têtes s’envolèrent des corps. Alors les bons anges furent du côté des Croyants ; et les mauvais anges embrassèrent la cause des mécréants ; et l’on vit où étaient les poltrons et où étaient les intrépides ; et les héros bondissaient dans la mêlée, et les uns tuaient et les autres étaient renversés de leurs selles ; et la bataille se fit sanglante et les corps jonchèrent le sol et s’entassèrent à hauteur de cheval. Mais que pouvait l’héroïsme des Croyants contre la quantité prodigieuse des Roum maudits ! Aussi, à la tombée de la nuit, les musulmans étaient repoussés, et leurs tentes saccagées, et leur campement était tombé au pouvoir des gens de Constantinia.
Et c’est alors qu’en pleine déroute ils rencontrèrent l’armée victorieuse du roi Daoul’makân qui s’en revenait de la vallée où avaient trouvé la défaite les chrétiens du monastère.
Alors Scharkân appela le grand-chambellan et à haute voix, devant les chefs réunis, le félicita et le glorifia pour sa fermeté dans la résistance et sa prudence dans la retraite et sa patience dans la défaite. Puis tous les guerriers musulmans, maintenant réunis en une armée massive, ne respirèrent plus que l’espoir de la vengeance et, les étendards déployés, s’avancèrent sur Constantinia.
Lorsque les chrétiens virent s’approcher cette armée formidable sur laquelle s’éployaient les bannières où étaient inscrites les Paroles de la Foi, ils devinrent d’une pâleur de safran et se lamentèrent et invoquèrent le Christ et Mariam et Hanna et la croix, et prièrent leurs patriarches et leurs prêtres infâmes d’intercéder pour eux auprès de leurs saints.
Quant à l’armée musulmane, elle arriva sous les murs de Constantinia et songea à se disposer pour le combat. Alors Scharkân s’avança vers son frère Daoul’makân et lui dit : « Ô roi du temps, il est certain que les chrétiens ne refuseront pas la lutte, et c’est ce que nous souhaitons avec ardeur. Aussi je désirerais émettre un avis, car la méthode est la qualité essentielle de l’ordre et de tout arrangement. » Et le roi lui dit : « Et quel est l’avis que tu désires émettre, ô le maître des idées admirables ? » Et Scharkân dit : « Voici. La meilleure disposition pour la bataille est de me placer au centre, juste en face du front de l’ennemi ; le grand-vizir Dandân commandera le centre droit, l’émir Torkash le centre gauche, l’émir Rustem l’aile droite et l’émir Bahramân l’aile gauche. Quant à toi, ô roi, tu resteras sous la protection du grand étendard pour avoir l’œil sur tout le mouvement, car tu es notre colonne et notre seul espoir après Allah ! Et nous tous, nous serons là pour te servir de rempart ! » Alors Daoul’makân remercia son frère pour son avis et son dévouement et donna l’ordre de mettre ce plan à exécution.
Sur ces entrefaites, voici que d’entre les rangs des guerriers des Roum un cavalier rapide s’avança du côté des musulmans. Et lorsqu’il fut plus près, on vit qu’il était sur une mule aux pas très serrés et très rapides, dont la selle était de soie blanche recouverte d’un tapis du Cachemire ; et ce cavalier était un beau vieillard à la barbe blanche, à l’aspect vénérable, enveloppé d’un manteau de laine blanche. Il s’approcha de l’endroit où se trouvait Daoul’makân et dit : « Je suis envoyé vers vous autres pour vous porter un message ; comme je ne suis que l’intermédiaire, et que l’intermédiaire doit bénéficier de la neutralité, accordez-moi le droit de parler sans être inquiété, et je vous communiquerai le sujet de ma mission. »
Alors Scharkân lui dit : « Tu as la sécurité ! » Et le messager descendit de cheval, et enleva la croix qui lui pendait au cou et la remit au roi et lui dit : « Je viens vers vous de la part du roi Aphridonios qui a bien voulu suivre les conseils que je lui donnais de cesser enfin cette guerre désastreuse qui abolit tant de créatures faites à l’image de Dieu. Je viens donc vous proposer en son nom de mettre fin à cette guerre par un combat singulier entre lui, roi Aphridonios, et le chef des guerriers musulmans, le prince Scharkân. »
À ces paroles, Scharkân dit : « Ô vieillard, retourne près du roi des Roum et dis-lui que le champion des musulmans, Scharkân, accepte la lutte. Et demain matin, une fois que nous serons reposés de cette longue marche, nos armes se heurteront. Et si je suis vaincu, nos guerriers n’auront plus qu’à trouver leur salut dans la fuite. »
Alors le vieillard retourna auprès du roi de Constantinia et lui transmit la réponse. Et le roi faillit s’envoler de joie en l’apprenant, car il était sûr de tuer Scharkân, et avait pris toutes ses dispositions à cet égard. Et il passa cette nuit-là à manger et à boire et à prier et à dire des oraisons. Et, lorsque vint le matin, il s’avança au milieu du meïdân, et il était monté sur un haut coursier de bataille, et était vêtu d’une cotte de mailles d’or au milieu de laquelle brillait un miroir enrichi de pierreries ; il tenait à la main un grand sabre recourbé, et avait passé sur l’une de ses épaules un arc fabriqué à la manière compliquée des gens d’Occident. Et lorsqu’il fut tout près des rangs des musulmans, il releva sa visière et s’écria : « Me voici ! celui qui sait qui je suis doit savoir à quoi s’en tenir ; et celui qui ignore qui je suis bientôt me connaîtra ! Ô vous tous, je suis le roi Aphridonios à la tête couverte de bénédictions ! »
Mais il n’avait pas encore fini de parler, qu’en face de lui était déjà le prince Scharkân, monté sur un cheval alezan qui valait plus de mille pièces d’or rouge et était sellé d’une selle de brocart toute brodée de perles et de pierreries ; et il tenait à la main un glaive indien niellé d’or, à la lame capable de trancher l’acier et de niveler toutes choses difficiles. Et il poussa son cheval tout contre celui d’Aphridonios et cria à ce dernier : « Garde à toi, ô maudit ! me prendrais-tu donc pour un de ces jeunes hommes à la peau de jeune fille, et dont la place serait le lit des putains plutôt que le champ de bataille ! Voici mon nom, ô maudit ! » Et, sur ces paroles, Scharkân, de son glaive tournoyant, asséna un coup terrible à son adversaire qui, d’une volte de son cheval, réussit à se garer. Puis tous deux, s’élançant l’un sur l’autre, parurent telles deux montagnes se rencontrant ou deux mers s’entre-choquant. Puis ils s’éloignèrent et se rapprochèrent pour se séparer encore et revenir ; et ils ne cessèrent de se donner des coups et de les parer, sous les yeux des deux armées qui tantôt criaient que la victoire était à Scharkân et tantôt qu’elle était au roi des Roum, jusqu’au coucher du soleil, sans que de part ou d’autre il y eût un résultat.
Mais, au moment même où l’astre allait disparaître, soudain Aphridonios cria à Scharkân : « Par le Christ ! regarde derrière toi, champion de la défaite, héros de la fuite ! Voici qu’on t’amène un nouveau cheval pour lutter avantageusement contre moi qui garde toujours le mien ! C’est là une coutume d’esclaves et non de guerriers valeureux ! Par le Christ ! ô Scharkân, tu es au-dessous des esclaves ! »
À ces paroles, Scharkân, au comble de la rage, se retourna pour voir ce qu’était ce cheval dont lui parlait le chrétien ; mais il ne vit rien venir. Or, c’était là une ruse du maudit chrétien qui, profitant de ce mouvement qui mettait Scharkân à sa merci, brandit son javelot et le lui lança dans le dos. Alors Scharkân poussa un cri terrible, un seul cri, et tomba sur le pommeau de sa selle. Et le maudit Aphridonios, le laissant pour mort, lança son cri de victoire et de traîtrise, et galopa vers les rangs des chrétiens.
Mais aussitôt que les musulmans virent Scharkân tomber, le visage sur le pommeau de la selle, ils accoururent à son secours ; et les premiers qui arrivèrent à lui furent…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, s’arrêta dans son récit.
LA CENT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
Les premiers qui arrivèrent à lui furent le vizir Dandân et les émirs Rustem et Bahramân. Et ils le soulevèrent dans leurs bras et se hâtèrent de le porter sous la tente de son frère, le roi Daoul’makân, qui était à la limite extrême de la rage, de la douleur et du désir de vengeance. Et aussitôt on fit appeler les médecins et on leur confia Scharkân ; puis tous les assistants éclatèrent en sanglots, et passèrent toute la nuit autour du lit où était étendu le héros évanoui.
Mais vers le matin arriva le saint ascète qui entra près du blessé et lut sur sa tête quelques versets du Koran et lui fit l’imposition des mains. Alors Scharkân poussa un long soupir et ouvrit les yeux et ses premières paroles furent un remercîment pour le Clément qui lui permettait de vivre. Puis il se tourna vers son frère Daoul’makân et lui dit : « Il m’a blessé en traître, le maudit. Mais, grâce à Allah, le coup n’est pas mortel. Où est le saint ascète ? » Daoul’makân dit : « Le voici à ton chevet. » Alors Scharkân prit les mains de l’ascète et les baisa ; et l’ascète fit des vœux pour son rétablissement et lui dit : « Mon fils, souffre ton mal avec patience, et tu en seras récompensé par le Rémunérateur ! »
Sur ces entrefaites, Daoul’makân, qui était sorti un moment, rentra sous la tente et embrassa son frère Scharkân et les mains de l’ascète, et dit : « Ô mon frère, qu’Allah te protège ! Voici que je cours te venger en immolant ce traître maudit, ce chien fils de chien, Aphridonios le roi des Roum ! » Alors Scharkân essaya de le retenir, mais en vain ; et le vizir Dandân et les deux émirs et le chambellan s’offrirent à aller eux-mêmes tuer le maudit ; mais Daoul’makân avait déjà sauté à cheval en criant : « Par le puits de Zamzam ! c’est moi seul qui punirai ce chien ! » Et il poussa son cheval au milieu du meïdân ; et, à le voir, on l’eût pris pour Antar lui-même au milieu de la mêlée, sur son cheval noir, plus rapide que le vent et les éclairs.
Or, de son côté, le maudit Aphridonios avait lancé son cheval dans le meïdân. Et les deux champions se rencontrèrent et ce fut à qui porterait à son adversaire le coup final, car la lutte, cette fois, ne pouvait se terminer que par la mort. Et la mort, en effet, frappa le traître maudit ; car Daoul’makân, les forces multipliées par le désir de la vengeance, après plusieurs passes infructueuses, réussit à atteindre son ennemi au cou et, en une seule fois, il lui traversa la visière, la peau du cou et l’échine, et fit voler sa tête au delà de son corps.
À ce signal, les musulmans se précipitèrent comme le tonnerre sur les rangs des chrétiens et en firent un massacre sans égal ; et ils en tuèrent de la sorte cinquante mille, jusqu’à la tombée de la nuit ; alors, à la faveur des ténèbres, les mécréants purent rentrer dans Constantinia, et ils refermèrent les portes sur eux pour empêcher les musulmans victorieux de pénétrer dans la ville. Et c’est ainsi qu’Allah accorda la victoire aux guerriers de la Foi.
Alors les musulmans rentrèrent sous leurs tentes, chargés des dépouilles des Roum ; et les chefs s’avancèrent et félicitèrent le roi Daoul’makân qui remercia le Très-Haut pour la victoire. Puis le roi entra chez son frère Scharkân et lui annonça la bonne nouvelle ; et Scharkân aussitôt se sentit le cœur dilaté et le corps en voie de guérison et il dit à son frère : « Sache, ô mon frère, que la victoire n’est due qu’aux prières de ce saint ascète qui n’a cessé, durant la bataille, d’invoquer le Ciel et d’appeler ses bénédictions sur les guerriers croyants ! »
Or, la maudite vieille, en entendant la nouvelle de la mort du roi Aphridonios et de la défaite de son armée, changea de couleur ; et son teint jaune devint vert et les pleurs l’étouffèrent ; mais elle parvint à se dominer et fit entendre que ses pleurs étaient dus à la joie qu’elle éprouvait de la victoire des musulmans. Mais en elle-même elle complota la pire des machinations pour brûler de douleur le cœur de Daoul’makân. Et, ce jour-là comme d’habitude, elle appliqua les pommades et les onguents sur les blessures de Scharkân, et le pansa avec le plus grand soin, et ordonna à tout le monde de sortir pour le laisser dormir tranquillement. Alors tous sortirent de la tente et laissèrent Scharkân seul avec l’ascète de malheur.
Lorsque Scharkân fut complètement plongé dans le sommeil…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
Lorsque Scharkân fut complètement plongé dans le sommeil, l’horrible vieille, qui le guettait comme une louve féroce ou comme une vipère des pires, se leva sur ses pieds et se glissa affreusement jusque près du chevet et tira de son vêtement un poignard empoisonné avec un poison si terrible que, posé simplement sur le granit, il l’eût fait fondre. Elle tint ce poignard de sa main calamiteuse et, l’abaissant brusquement sur le cou de Scharkân, sépara la tête du tronc. Et c’est ainsi que mourut, par la force de la fatalité et les machinations d’Eblis dans l’esprit de la vieille maudite, celui qui fut le champion des musulmans, l’inégalable héros Scharkân, fils d’Omar Al-Némân.
Et, sa vengeance satisfaite, la vieille déposa près de la tête coupée une lettre écrite de sa main et où elle disait :
« Cette lettre est de la part de la noble Schaouahi, celle qui, à cause de ses exploits, est connue sous le nom de Mère-des-Calamités, aux musulmans présents au pays des chrétiens.
« Sachez, ô vous tous, que c’est moi seule qui ai éprouvé la joie de supprimer autrefois votre roi Omar Al-Némân, au milieu de son palais ; c’est moi qui ai ensuite été la cause de votre déroute et extermination dans la vallée du monastère ; c’est moi enfin qui, de ma propre main et grâce à mes ruses bien combinées, ai coupé la tête aujourd’hui à votre chef Scharkân. Et j’espère qu’avec l’aide du Ciel, je couperai également la tête à votre roi Daoul’makân et à son vizir Dandân !
« À vous autres maintenant de réfléchir pour savoir s’il vous est avantageux de rester dans notre pays ou de retourner dans le vôtre. En tout cas, sachez bien que jamais vous ne parviendrez à vos fins ; et vous périrez tous jusqu’au dernier, sous les murs de Constantinia, par mon bras et mes stratagèmes, et grâce à Christ, notre Seigneur ! »
Et, ayant déposé cette lettre, la vieille se glissa hors de la tente et rentra à Constantinia mettre les chrétiens au courant de ses méfaits ; puis elle entra à l’église prier et pleurer sur la mort du roi Aphridonios et remercier le démon pour la mort du prince Scharkân.
Mais pour ce qui est du meurtre de Scharkân, voici ! À l’heure même où cela s’accomplissait, le grand-vizir Dandân se sentait pris d’insomnie et d’inquiétude, et il était oppressé comme si le monde entier lui eût pesé sur la poitrine. Il se décida enfin à se lever de son lit ; et il sortit de sa tente pour respirer l’air ; et, comme il se promenait, il vit l’ascète qui, déjà loin, s’éloignait rapidement hors du camp. Alors il se dit : « Le prince Scharkân doit être seul maintenant. Je vais aller veiller près de lui, ou causer avec lui s’il est réveillé. »
Lorsque le vizir Dandân arriva dans la tente de Scharkân, la première chose qu’il vit fut une mare de sang par terre ; puis, sur le lit, il aperçut le corps et la tête de Scharkân assassiné.
À cette vue, le vizir Dandân jeta un cri si haut et si terrible qu’il réveilla tous les hommes endormis et mit sur pied tout le camp et toute l’armée, et aussi le roi Daoul’makân, qui aussitôt accourut sous la tente. Et il vit le vizir Dandân qui pleurait à côté du corps sans vie de son frère le prince Scharkân. À ce spectacle, Daoul’makân s’écria : « Ya Allah ! ô terreur ! » et tomba évanoui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, cessa de parler.
LA CENT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
À ce spectacle, Daoul’makân s’écria : « Ya Allah ! ô … terreur ! » et tomba évanoui. Alors le vizir et les émirs s’empressèrent autour de lui et lui firent de l’air avec leurs robes ; et Daoul’makân finit par revenir à lui et s’écria : « Ô mon frère Scharkân, ô le plus grand d’entre les héros, quel démon t’a mis dans cet irrémédiable état ? » Et il se mit à fondre en larmes et à sangloter, et le vizir Dandân aussi et les émirs Rustem et Bahramân et surtout le grand-chambellan.
Et soudain le vizir Dandân vit la lettre et la prit et la lut au roi Daoul’makân devant tous les assistants, et dit : « Ô roi, tu vois maintenant pourquoi la vue de cet ascète maudit m’inspirait tant de répulsion ! » Et le roi Daoul’makân, tout en pleurant, s’écria : « Par Allah ! je prendrai bientôt cette vieille et, de ma propre main, je lui ferai couler dans le vagin du plomb fondu et je lui enfoncerai dans le derrière un poteau effilé ; et puis je la pendrai par les cheveux et je la clouerai vivante sur la porte principale de Constantinia ! »
Après quoi Daoul’makân fit faire des funérailles considérables à son frère Scharkân, et suivit le convoi en pleurant toutes les larmes de ses yeux, et le fit enterrer au pied d’une colline, sous un grand dôme d’albâtre et d’or.
Puis, durant de longs jours, il continua à pleurer tellement qu’il devint comme l’ombre de lui-même. Alors le vizir Dandân, réprimant sa propre douleur, vint le trouver et lui dit : « Ô roi, mets enfin un baume à ta douleur et essuie tes yeux. Ne sais-tu que ton frère est en ce moment entre les mains du Juste Rémunérateur ? Et, d’ailleurs, à quoi te sert tout ce deuil pour de l’irréparable, alors que toute chose est écrite pour arriver à son temps ! Lève-toi donc, ô roi, et reprends tes armes ; et songeons à pousser avec vigueur le siège de cette capitale des mécréants : ce serait le meilleur moyen de nous venger complètement ! »
Or, pendant que le vizir Dandân encourageait de la sorte le roi Daoul’makân, un courrier arriva de Baghdad porteur d’une lettre de Nôzhatou à son frère Daoul’makân. Et cette lettre contenait ceci en substance :
« Je t’annonce, ô mon frère, la bonne nouvelle !
« Ton épouse, la jeune esclave que tu as rendue enceinte, vient d’accoucher, en santé, d’un enfant mâle aussi lumineux qu’une lune au mois de Ramadan. Et j’ai cru bon d’appeler cet enfant Kanmakân[13].
« Or, les savants et les astronomes prédisent que cet enfant accomplira des choses mémorables, tant sa naissance a été accompagnée de prodiges et de merveilles.
« Je n’ai pas manqué, à cette occasion, de faire faire des prières et des vœux dans toutes les mosquées pour toi, pour l’enfant et pour ton triomphe sur les ennemis.
« Je t’annonce également que nous sommes tous ici en parfaite santé, et notamment ton ami, le chauffeur du hammam, qui est à la limite de l’épanouissement et de la paix, et qui souhaite ardemment, ainsi que nous, avoir de tes nouvelles.
« Ici, cette année, les pluies ont été abondantes, et les récoltes s’annoncent excellentes.
« Et que la paix et la sécurité soient sur toi et autour de toi ! »
Lorsque Daoul’makân eut parcouru cette lettre, il respira longuement et s’écria : « Maintenant, ô vizir, qu’Allah m’a gratifié de mon fils Kanmakân, mon deuil est atténué, et mon cœur recommence à vivre ! Aussi nous faut-il songer à célébrer dignement la fin de ce deuil de mon défunt frère, selon nos coutumes. » Et le vizir répondit : « L’idée est juste. » Et aussitôt il fit dresser de grandes tentes autour du tombeau de Scharkân, où prirent place les lecteurs du Koran et les imams ; et on immola une grande quantité de moutons et de chameaux, dont on distribua la chair aux soldats ; et on passa toute cette nuit dans la prière et la récitation du Koran.
Mais, le matin, Daoul’makân s’avança vers la tombe où reposait Scharkân, et qui était toute tendue d’étoffes précieuses de la Perse et du Cachemire, et devant l’armée entière…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
Daoul’makân s’avança près de la tombe où reposait Scharkân et qui était toute tendue d’étoffes précieuses de la Perse et du Cachemire et, devant l’armée entière, il versa des pleurs abondants et improvisa ces strophes à la mémoire du défunt :
« Scharkân, ô mon frère, voici que sur mes joues mes larmes ont écrit des lignes régulières, significatives plus que les rythmes réguliers des vers, désolées, suggestives, à tous les regards qui les liront, de ma douleur, ô mon frère !
Derrière ton cercueil, ô Scharkân, avec moi tous les guerriers sortirent en pleurant. Et ils lançaient des cris douloureux plus haut que le cri de Moussa sur le Jabal-Tor.
Et nous arrivâmes tous à ton tombeau dont la fosse est creusée plus profondément dans le cœur de tes guerriers que dans la terre ou tu reposes, ô mon frère !
Hélas, ô Scharkân ! comment eussé-je pu supposer voir mon bonheur ensemble avec toi sous le linceul du brancard, sur les épaules des porteurs !
Où es-tu, astre de Scharkân dont la clarté faisait confuses dans la poussière toutes les étoiles des cieux ?
L’abîme infini de la tombe qui te recèle, ô joyau, est lui-même illuminé de la clarté que tu lui apportes, au sein de notre mère finale, mon frère !
Et le linceul lui-même qui te recouvre, les plis du linceul, à ton contact prirent vie et s’étendirent et, comme des ailes, te protégèrent ! »
Lorsque Daoul’makân eut fini de réciter ces vers, il fondit en larmes et, avec lui, toute l’armée poussa de grands soupirs. Alors s’avança le vizir Dandân et se jeta sur le tombeau de Scharkân et l’embrassa et, la voix étranglée par les larmes, il récita ces vers du poète :
« Ô sage ! tu viens d’échanger les choses périssables pour celles immortelles. En cela tu suivis l’exemple de tous tes prédécesseurs dans la mort.
Et tu as pris ton essor, sans hésiter, vers les hauteurs, là où les blancheurs étales des roses font des tapis parfumés sous les pieds des houris. Puisses-tu t’y délecter de toutes choses nouvelles !
Et veuille le Maître du Trône illuminé te réserver la place la meilleure de son paradis, et mettre à portée de tes lèvres les joies réservées aux justes de la terre ! »
Et c’est ainsi qu’on fit la clôture du deuil de Scharkân.
Mais, malgré tout, Daoul’makân continuait à être triste d’être séparé de son frère, d’autant plus que le siège de Constantinia menaçait de traîner en longueur. Et il s’en ouvrit un jour à son vizir Dandân et lui dit : « Que faire, ô mon vizir, pour oublier ces chagrins qui me tourmentent et chasser l’ennui qui pèse sur mon âme ? »
Le vizir Dandân répondit : « Ô roi, je ne connais qu’un seul remède à tes maux, et c’est de te raconter une histoire des temps passés et des rois fameux dont parlent les annales. Et la chose m’est aisée, car, sous le règne de ton défunt père le roi Omar Al-Némân, ma plus grande occupation était de le distraire, toutes les nuits, en lui narrant un conte délicieux et en lui récitant des vers des poètes arabes ou de mes improvisations. Cette nuit donc, quand tout le camp sera endormi, je te raconterai, si Allah veut, une histoire qui t’émerveillera et te dilatera la poitrine et te fera trouver le temps du siège excessivement court. Je puis dès maintenant t’en dire le titre qui est : histoire des deux amants aziz et aziza ».
À ces paroles de son vizir Dandân, le roi Daoul’makân sentit son cœur battre d’impatience, et n’eut plus d’autre souci que de voir enfin arriver la nuit pour entendre le conte promis, dont le seul titre le faisait déjà se trémousser de plaisir.
Aussi à peine la nuit avait-elle commencé à tomber, que Daoul’makân fit allumer tous les flambeaux de sa tente et toutes les lanternes du corridor de toile et fit apporter de grands plateaux chargés de choses pour manger et boire et des cassolettes chargées d’encens, d’ambre et de beaucoup d’aromates agréables ; puis il fit venir les émirs Bahramân, Rustem et Turkash et le grand-chambellan, époux de Nôzhatou. Et lorsque tous furent là, il fit dire au vizir Dandân de venir ; et lorsque Dandân arriva entre ses mains, il lui dit : « Ô mon vizir, voici la nuit qui étend sur nos têtes sa vaste robe et ses cheveux ; et nous n’attendons plus, pour nous délecter, que l’histoire que tu nous as promise d’entre les histoires. »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, remit son récit au lendemain.
LA CENT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
Le roi Daoul’makàn dit donc au vizir Dandân : « Ô mon vizir, voici la nuit qui étend sur nos têtes sa vaste robe et ses cheveux ; et nous n’attendons plus, pour nous délecter, que l’histoire que tu nous as promise d’entre les histoires. » Et le vizir Dandân répondit : « De tout cœur généreux et comme hommages dus ! car sache, ô roi fortuné, que l’histoire que je vais te raconter sur Aziz et Aziza, et sur toutes les choses qui leur sont arrivées, est une histoire qui est faite pour dissiper tous les chagrins des cœurs et pour consoler d’un deuil fût-il plus grand que celui de Yâcoub ! La voici.
HISTOIRE D’AZIZ ET AZIZA
ET DU BEAU PRINCE DIADÈME
Il y avait, en l’antiquité du temps et le passé des âges et du moment, une ville d’entre les villes de Perse, derrière les montagnes d’Ispahân. Et le nom de cette ville était la Ville-Verte. Et le roi de cette ville s’appelait Soleïmân-Schah. Il était doué de grandes qualités de justice, de générosité, de prudence et de savoir. Aussi de toutes les contrées les voyageurs affluaient vers sa ville, tant sa bonne renommée s’était étendue au loin et inspirait de confiance aux marchands et aux caravanes.
Et le roi Soleïmân-Schah continua à gouverner de la sorte, durant un très long espace de temps, dans la prospérité et entouré de l’affection de tout son peuple. Mais il ne manquait à son bonheur qu’une femme et des enfants ; car il était célibataire.
Et le roi Soleïmân-Schah avait un vizir qui lui ressemblait beaucoup par ses qualités de libéralité et de bonté. Aussi un jour que sa solitude lui pesait plus que de coutume, le roi fit appeler son vizir et lui dit : « Mon vizir, voici que ma poitrine se rétrécit et ma patience s’épuise et mes forces diminuent ; quelque temps encore ainsi, et je n’aurai plus que la peau sur les os. Car je vois bien à présent que le célibat n’est point un état de nature, surtout pour les rois qui ont un trône à transmettre à leurs descendants. Et, d’ailleurs, notre Prophète béni (sur lui la prière et la paix !) a dit : « Copulez ! et multipliez vos descendants, car je me glorifierai de votre nombre, devant toutes les races, au jour de la Résurrection ! » Conseille-moi donc, ô mon vizir, et dis-moi ce que tu en penses. »
Alors le vizir lui dit : « En vérité, ô roi, c’est là une question fort difficile et d’une délicatesse extrême. J’essaierai de te satisfaire en restant dans la voie prescrite. Sache donc, ô roi, que je ne verrais point avec agrément une esclave inconnue devenir l’épouse de notre maître ; car comment pourra-t-il connaître l’origine de cette esclave et la noblesse de ses ascendants et la pureté de son sang et les principes de sa race, et comment pourra-t-il, par conséquent, conserver intacte l’unité impolluée du sang de ses propres ancêtres ? Ne sais-tu que l’enfant qui naîtra d’une telle union sera toujours un bâtard plein de vices, menteur, sanguinaire, maudit d’Allah, son créateur, à cause de ses abominations futures ? Et une pareille souche ressemble à la plante qui pousse dans un terrain marécageux à l’eau saumâtre et stagnante, et qui tombe en pourriture avant même d’atteindre à sa pleine croissance. Aussi n’attends point de ton vizir, ô roi, le service de t’acheter une esclave, fût-elle la plus belle adolescente de la terre ; car je ne veux pas être la cause de pareils malheurs et supporter le poids des péchés dont j’aurais été l’instigateur. Mais, si tu veux écouter ma barbe, je serais d’avis de choisir, parmi les filles des rois, une épouse dont la généalogie fût connue et la beauté donnée en exemple aux yeux de toutes les femmes ! »
À ces paroles, le roi Soleïmân-Schah dit : « Ô mon vizir, je suis tout prêt, si tu parviens à me trouver une femme pareille, à la prendre pour épouse légitime afin d’attirer sur ma race les bénédictions du Très-Haut ! » Alors le vizir lui dit : « Ton affaire, grâce à Allah, est déjà toute faite. » Et le roi s’écria : « Comment cela ? » Il dit : « Sache, ô roi, que mon épouse m’a raconté que le roi Zahr-Schah, maître de la Ville-Blanche, a une fille d’une beauté sans égale et dont la description est tellement au-dessus des paroles que ma langue deviendrait poilue avant de pouvoir t’en donner la moindre idée ! » Alors le roi s’écria : « Ya Allah ! » Et le vizir continua : « Car, ô roi, comment pourrais-je jamais te parler dignement de ses yeux aux paupières de couleur brune, de ses cheveux, de sa taille si fine qu’elle en est invisible, de la lourdeur de ses hanches et de ce qui les soutient et les arrondit ? Par Allah ! nul ne peut l’approcher sans rester en arrêt, comme nul ne peut la regarder sans mourir ! Et c’est d’elle que le poète a dit :
» Ô vierge au ventre d’harmonie ! Ta taille mince défie le rameau pliant du jeune saule et la sveltesse même des peupliers du paradis.
Ta salive est miel sauvage ! Ah ! de ta salive mouille la coupe et dulcifie le vin, puis donne-le moi, ô houria. Mais surtout, je t’en conjure, ouvre tes lèvres et réjouis mes yeux de tes perles ! »
À ces vers, le roi se trémoussa de jouissance et s’écria du fond de son gosier : « Ya Allah ! » Mais le vizir continua : « Aussi, ô roi, je suis d’avis d’envoyer le plus tôt possible au roi Zahr-Schah un de tes émirs, un homme de confiance, doué de tact et de délicatesse, qui sache le goût de ses paroles avant de les prononcer, et dont l’expérience te soit déjà connue. Et tu le chargeras d’employer toute sa persuasion à obtenir que le père te donne la jeune fille. Et tu te marieras enfin pour suivre la parole du Prophète (sur lui la paix et la prière !) qui a dit : « Les hommes qui se disent chastes doivent être bannis de l’Islam ! Ce sont des corrupteurs ! Pas de célibat pour les prêtres dans l’Islam ! » Or, en vérité, cette princesse est le seul parti digne de toi, elle qui est la plus belle pierrerie sur toute la surface de la terre, et en deçà et au-delà ! »
À ces paroles, le roi Soleïmân-Schah sentit son cœur se dilater, et il soupira d’aise et dit à son vizir : « Et quel homme, mieux que toi, saura mener à bonne fin cette mission toute de délicatesse ? Ô mon vizir, c’est toi seul qui iras arranger la chose, toi qui es plein de sagesse et de politesse. Lève-toi donc, et va dans ta maison faire tes adieux à ceux de ta maison, et termine avec diligence les affaires pendantes ; et va à la Ville-Blanche demander pour moi en mariage la fille du roi Zahr-Schah. Car voici que mon cœur et ma raison sont fort tourmentés et travaillent beaucoup à ce sujet. » Et le vizir répondit : « J’écoute et j’obéis ! »
Et aussitôt il se hâta d’aller terminer ce qu’il avait à terminer, et embrasser ceux qu’il avait à embrasser, et se mit à faire tous les préparatifs du départ. Il prit avec lui toutes sortes de cadeaux riches à satisfaire des rois, par exemple des joyaux, des orfèvreries, des tapis de soie, des étoffes précieuses, des parfums, de l’essence de roses tout à fait pure, et toutes choses légères de poids et lourdes de prix et de valeur. Il ne manqua pas non plus de prendre dix chevaux choisis des plus belles races et des plus pures de l’Arabie. Il prit aussi de très riches armes niellées d’or à poignées de jade incrusté de rubis, et des armures légères d’acier et des cottes de mailles aux mailles dorées ; sans compter les grandes caisses chargées de toutes sortes de choses somptueuses et aussi de choses bonnes à manger, telles que conserves de roses, abricots laminés en feuilles légères, confitures sèches parfumées, pâtes d’amandes aromatisées au benjoin des îles chaudes, et mille friandises destinées à réjouir le goût et à disposer agréablement les jeunes filles. Puis il fit charger toutes ces caisses sur le dos des mulets et des chameaux ; et il prit avec lui cent jeunes mamalik et cent jeunes nègres et cent jeunes filles, destinés tous à faire cortège, au retour, à l’épousée. Et comme le vizir, à la tête de la caravane, les bannières éployées, se disposait à donner le signal du départ, le roi Soleïmân-Schah l’arrêta encore un instant et lui dit : « Et surtout prends garde de revenir ici sans m’amener la jeune fille ; et ne tarde pas, car je suis à rôtir sur le feu ; et je n’aurai de repos et de sommeil qu’après l’arrivée de cette épouse dont la pensée ne me quittera ni de jour ni de nuit et pour qui je suis déjà tout enflammé d’amour ! » Et le vizir répondit par l’ouïe et l’obéissance. Et il partit avec toute sa caravane et se mit à voyager avec célérité, le jour comme la nuit, traversant montagnes et vallées, rivières et torrents, plaines désertes et plaines fertiles, jusqu’à ce qu’il ne fût plus qu’à une journée de marche de la Ville-Blanche.
Alors le vizir s’arrêta, pour le repos, sur le bord d’un cours d’eau, et envoya un courrier rapide prendre les devants pour annoncer son arrivée au roi Zahr-Schah.
Or, il se trouva justement qu’au moment où le courrier, arrivé aux portes de la ville, allait y pénétrer, le roi Zahr-Schah, qui prenait le frais dans un de ses jardins situé près de là, vit ce courrier et devina que c’était un étranger. Il le fit aussitôt appeler et lui demanda qui il était. Et le courrier répondit : « Je suis l’envoyé du vizir tel, campé sur le bord de la rivière telle, et qui vient chez toi de la part de notre maître le roi Soleïmân-Schah, maître de la Ville-Verte et des montagnes d’Ispahân ! »
À cette nouvelle, le roi Zahr-Schah fut extrêmement ravi, et fit offrir des rafraîchissements au courrier du vizir, et donna à ses émirs l’ordre d’aller à la rencontre du grand envoyé du roi Soleïmân-Schah, dont la suzeraineté était respectée jusque dans les pays les plus reculés et sur le territoire même de la Ville-Blanche. Et le courrier baisa la terre entre les mains du roi Zahr-Schah en lui disant : « Demain le vizir arrivera. Et maintenant, qu’Allah te continue ses hautes faveurs et qu’il ait tes défunts parents en ses grâces et sa miséricorde ! » Voilà pour ceux-là.
Mais pour ce qui est du vizir du roi Soleïmân-Schah, il resta se reposer sur les bords de la rivière jusqu’à minuit. Alors il se remit en marche dans la direction de la Ville-Blanche ; et, au lever du soleil, il était aux portes de la ville.
À ce moment, il s’arrêta un moment pour satisfaire un besoin pressant et uriner à son aise. Et, lorsqu’il eut fini, il vit venir à sa rencontre le grand-vizir du roi Zahr-Schah avec les chambellans et les grands du royaume et les émirs et les notables. Alors il se hâta de remettre à un de ses esclaves l’aiguière dont il venait de se servir pour faire ses ablutions, et remonta en toute hâte à cheval. Et, les salutations d’usage ayant été faites de part et d’autre ainsi que les souhaits de bienvenue, la caravane et son cortège entrèrent dans la Ville-Blanche.
Lorsqu’ils furent arrivés devant le palais du roi, le vizir mit pied à terre et, guidé par le grand-chambellan, pénétra dans la salle du trône.
Dans cette salle, il vit un haut trône de marbre blanc diaphane, incrusté de perles et de pierreries, et soutenu par quatre pieds très élevés, formés chacun d’une défense complète d’éléphant. Sur ce trône, il y avait un large coussin de satin vert moiré, tout brodé de paillettes d’or rouge et orné de franges et de glands d’or. Et au-dessus de ce trône, il y avait un dais tout flamboyant de ses incrustations d’or, de pierres précieuses et d’ivoire. Et sur le trône en question, le roi Zahr-Schah était assis…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète selon son habitude, se tut.
LA CENT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
Et sur le trône en question, le roi Zahr-Schah était assis, entouré des principaux personnages du royaume et des gardes immobiles dans l’attente de ses ordres.
À cette vue, le vizir du roi Soleïmân-Schah sentit l’inspiration illuminer son esprit et l’éloquence délier sa langue et l’inciter aux dires savoureux. Aussitôt, d’un geste agréable, il se tourna vers le roi Zahr-Schah, et improvisa ces strophes en son honneur :
« À ta vue, mon cœur lui-même me délaissa pour voler vers toi ; et le sommeil lui-même s’enfuit loin de mes yeux, me laissant tout à mes tortures !
Ô mon cœur, eh bien ! puisque tu es déjà chez lui, reste où tu es ! Je t’abandonne à lui, bien que tu sois ce qui m’est le plus cher et le plus nécessaire !
Rien ne saurait plus agréablement reposer mes oreilles que la voix de ceux qui savent chanter les louanges de Zahr-Schah, le roi de tous les cœurs !
Et si je passais toute ma vie, après l’avoir regardé ne fût-ce qu’une seule fois au visage, sans le bonheur d’un second regard, cela me rendrait riche à jamais.
Ô vous tous qui entourez ce roi magnifique, sachez que si quelqu’un prétendait avoir trouvé un roi qui dépasse Zahr-Schah en qualités, il mentirait, et ne serait point un vrai Croyant ! »
Et, ayant fini de réciter ce poème, le vizir se tut sans en dire davantage. Alors le roi Zahr-Schah le fit s’approcher de son trône, et le fit s’asseoir à ses côtés, et lui sourit avec bonté, et l’entretint agréablement pendant un bon moment, en lui donnant les marques les plus démonstratives de l’amitié et de la générosité. Ensuite le roi fit tendre la nappe en l’honneur du vizir, et tout le monde s’assit à manger et à boire jusqu’à satiété. Alors seulement le roi désira rester seul avec le vizir ; et tous sortirent, à l’exception des principaux chambellans et du grand-vizir du royaume.
Alors le vizir du roi Soleïmân-Schah se leva debout sur ses deux pieds, et fit encore un compliment, et s’inclina et dit : « Ô grand roi plein de munificence, je viens vers toi pour une affaire dont le résultat pour nous tous sera plein de bénédictions, de fruits heureux et de prospérité ! Le but de ma mission est, en effet, de demander en mariage ta fille pleine d’estime et de grâce, de noblesse et de modestie, pour mon maître et la couronne sur ma tête, le roi Soleïmân-Schah, sultan plein de gloire de la Ville-Verte et des montagnes d’Ispahân ! Et, à cet effet, je viens vers toi porteur de riches cadeaux et de choses somptueuses, pour te montrer le degré d’ardeur où mon maître se trouve dans son désir de t’avoir comme beau-père ! Je voudrais donc savoir de ta bouche si tu partages également ce désir et si tu veux lui accorder l’objet de ses souhaits. »
Lorsque le roi Zahr-Schah eut entendu ce discours du vizir, il se leva et s’inclina jusqu’à terre ; et ses chambellans et ses émirs furent à la limite de l’étonnement de voir le roi marquer tant de respect à un simple vizir. Mais le roi continua à rester debout devant le vizir et lui dit : « Ô vizir doué de tact et de sagesse, d’éloquence et de grandeur, écoute ce que je vais te dire. Je me considère comme un simple sujet du roi Soleïmân-Schah, et je me fais le plus grand honneur de pouvoir compter parmi ceux de sa race et de sa famille ! Aussi ma fille n’est plus désormais qu’une esclave d’entre ses esclaves ; et dès cet instant même elle est sa chose et sa propriété ! Et telle est ma réponse à la demande du roi Soleïmân-Schah, notre suzerain à tous, maître de la Ville-Verte et des montagnes d’Ispahân ! »
Et aussitôt il fit venir les kâdis et les témoins, qui dressèrent le contrat du mariage de la fille du roi Zahr-Schah avec le roi Soleïmân-Schah. Et le roi porta le contrat à ses lèvres avec joie, et reçut les félicitations et les vœux des kâdis et des témoins, et les combla tous de ses faveurs ; et il donna de grandes fêtes pour faire honneur au vizir, et de grandes réjouissances qui dilatèrent le cœur et les yeux de tous les habitants ; et il distribua des vivres et des cadeaux aussi bien aux pauvres qu’aux riches. Puis il fit faire les préparatifs du départ, et choisit les esclaves pour sa fille : des grecques et des turques, des négresses et des blanches. Et il fit faire pour sa fille un grand palanquin en or massif incrusté de perles et de pierreries, qu’il fit mettre sur le dos de dix mulets rangés en bon ordre. Et tout le convoi se mit en marche. Et le palanquin apparaissait, dans la lueur du matin, tel un grand palais d’entre les palais des génies, et la jeune fille couverte de ses voiles, telle une houria d’entre les plus belles hourias du paradis.
Et le roi Zahr-Schah accompagna lui-même le cortège l’espace de trois parasanges ; puis il fit ses adieux à sa fille, au vizir et à ceux qui l’accompagnaient, et retourna vers sa ville au comble de la joie et de la confiance dans le futur.
Quant au vizir et au convoi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, renvoya son récit au lendemain.
LA CENT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
Quant au vizir et au convoi, ils voyagèrent en sécurité et, arrivés à trois journées de marche de la Ville-Verte, envoyèrent un courrier rapide les annoncer au roi Soleïmân-Schah.
Lorsque le roi eut appris l’arrivée de son épouse, il se trémoussa de plaisir, et donna une belle robe d’honneur au courrier annonciateur. Et il ordonna à toute son armée d’aller à la rencontre de la nouvelle mariée, avec tous les étendards éployés ; et les crieurs publics invitèrent toute la ville au cortège, de façon à ce qu’il ne restât pas à la maison une seule femme, ni une seule jeune fille, ni même une seule vieille, cassée par l’âge fût-elle ou impotente. Et nul ne manqua de sortir au-devant de la nouvelle mariée. Et lorsque tout ce monde fut arrivé autour du palanquin de la fille du roi, on décida que l’entrée en ville se ferait la nuit en grande pompe.
Aussi, la nuit venue, les notables de la ville firent illuminer à leurs frais toutes les rues et la route qui conduisait jusqu’au palais du roi. Et tous se rangèrent en deux rangs, le long du chemin ; et, sur son passage, les soldats firent la haie, à droite et à gauche ; et, sur tout le parcours, les illuminations éclatèrent dans l’air limpide, et les gros tambours firent entendre leur roulement profond, et les trompettes chantèrent à voix haute, et les drapeaux battirent sur les têtes, et les parfums brûlèrent dans les cassolettes, dans les rues et sur les places, et les cavaliers joutèrent de la lance et du javelot. Et au milieu d’eux tous, précédée par les nègres et les mamalik et suivie par ses esclaves et ses femmes, la nouvelle mariée, vêtue de la robe magnifique que lui avait donnée son père, arriva au palais de son époux le roi Soleïmân-Schah.
Alors les jeunes esclaves délièrent les mulets et, au milieu des cris aigus de joie de tout le peuple et de toute l’armée, prirent le palanquin sur leurs épaules et le transportèrent jusqu’à la porte secrète. Alors les jeunes femmes et les suivantes succédèrent aux esclaves et firent entrer l’épousée dans son appartement réservé. Et aussitôt l’appartement s’illumina de la clarté de ses yeux et les lumières pâlirent de la beauté de son visage. Et elle paraissait au milieu de toutes ses femmes comme la lune parmi les étoiles ou comme la perle solitaire au milieu du collier. Puis les jeunes femmes et les suivantes sortirent de l’appartement et se rangèrent sur deux rangs, depuis la porte jusqu’au bout du corridor, après avoir toutefois fait se coucher la jeune fille sur le grand lit d’ivoire enrichi de perles et de pierreries.
Alors seulement le roi Soleïmân-Schah, traversant la haie formée par toutes ces étoiles vivantes, pénétra dans l’appartement jusqu’au lit d’ivoire, où, toute parée et parfumée, s’allongeait l’adolescente. Et Allah incita à l’heure même une grande passion dans le cœur du roi et lui donna l’amour de cette vierge. Et le roi posséda cette virginité et s’en délecta dans la félicité, et oublia sur cette couche, parmi les cuisses et les bras, toutes ses peines d’impatience et son attente d’amour.
Et le roi, durant un mois entier, demeura dans l’appartement de sa jeune épouse, sans la quitter un seul instant, tant leur union était étroite et conforme à leur tempérament. Et il la rendit enceinte dès la première nuit.
Après quoi, le roi sortit s’asseoir sur le trône de sa justice, et s’occupa des affaires de son royaume pour le bien de ses sujets ; et, le soir venu, il ne manquait pas d’aller visiter l’appartement de son épouse, et cela jusqu’au neuvième mois.
Or, à la dernière nuit de ce neuvième mois, la reine fut prise des douleurs de l’enfantement et s’assit sur la chaise de parturition et, à l’aurore, Allah lui facilita l’accouchement, et elle mit au monde un enfant mâle marqué de l’empreinte de la chance et de la fortune.
Aussitôt que le roi eut appris la nouvelle de cette naissance, il se dilata à la limite de la dilatation et se réjouit d’une haute joie, et fit cadeau de grandes richesses à l’annonciateur ; puis il courut vers le lit de son épouse et, prenant l’enfant dans ses bras, le baisa entre les deux yeux, et fut émerveillé de sa beauté, et vit combien ces vers du poète lui étaient applicables :
Dès sa naissance. Allah lui accorda la gloire et la limite des hauteurs, et le fit lever comme un astre nouveau.
Ô nourrices aux seins splendides et délicats, ne l’accoutumez pas à la courbe de votre taille ! car sa seule monture sera le dos solide des lions et des chevaux cabrés.
Ô nourrices au lait trop doux et trop blanc, hâtez-vous de le sevrer ! car le sang de ses ennemis lui sera la plus délicieuse boisson.
Alors les suivantes et les nourrices prirent soin du nouveau-né, et les sages-femmes lui coupèrent le cordon et lui allongèrent les yeux de kohl noir. Et, comme il était né d’un roi fils de rois et d’une reine fille de reines, et qu’il était si beau et si brillant, on l’appela Diadème.
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA CENT-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
On l’appela Diadème. Et il fut élevé au milieu des baisers et dans le sein des plus belles ; et les jours s’écoulèrent et les années s’écoulèrent ; et l’enfant atteignit l’âge de sept ans.
Alors le roi Soleïmân-Schah, son père, fit venir les maîtres les plus savants et leur ordonna de lui enseigner la calligraphie, les belles-lettres et l’art de se conduire ainsi que les règles de la syntaxe et de la jurisprudence.
Et ces maîtres de la science restèrent avec l’enfant jusqu’à ce qu’il eût quatorze ans. Alors, comme il avait appris tout ce que son père désirait qu’il apprît, il fut jugé digne d’une robe d’honneur ; et le roi le retira des mains des savants et le confia à un maître d’équitation qui lui apprit à monter à cheval et à jouter de la lance et du javelot et à chasser le daim à l’épervier. Et le prince Diadème devint bientôt le cavalier le plus accompli ; et il était devenu si parfaitement beau que lorsqu’il sortait à pied ou à cheval il faisait se damner tous ceux qui le regardaient.
Et lorsqu’il eut atteint l’âge de quinze ans, ses charmes étaient devenus tels que les poètes lui dédièrent leurs odes les plus amoureuses ; et les plus chastes et les plus purs d’entre les sages sentirent leur cœur s’effriter et leur foie s’émietter de tout ce qu’il avait en lui de charme magicien. Et voici l’un des poèmes qu’un poète amoureux avait composé pour l’amour de ses yeux :
L’embrasser, c’est s’enivrer du parfum de musc de toute sa peau ! C’est sentir sous l’étreinte ployer son corps comme la délicate branche humide nourrie seulement de brise et de rosée.
L’embrasser ! mais c’est s’enivrer sans toucher à nul vin ! Ne le sais-je pas, moi qui me trouve au soir tout fermentant du vin musqué de sa salive !
Elle-même la Beauté, en se réveillant au matin, se regarde à son miroir et se reconnaît sa vassale et sa captive ! Alors comment, ô ma folie ! les cœurs mortels pourraient-ils échapper à sa beauté ?
Par Allah ! par Allah ! si la vie m’est encore possible, je vivrai avec, dans mon cœur, sa brûlure ! Mais si je venais à mourir de ma passion et de son amour, ah ! quel bonheur !
Or, tout cela, quand il avait quinze ans d’âge ! Mais lorsqu’il eut atteint sa dix-huitième année, ce fut bien autre chose ! Alors un jeune duvet velouta le grain rose de ses joues, et l’ambre noir mit une goutte de beauté sur la blancheur de son menton. Alors, en toute évidence, il ravit toutes les raisons et tous les yeux, comme dit le poète à son sujet :
Son regard ! s’approcher du feu sans se brûler n’est point si étonnante chose que son regard ! Comment suis-je encore en vie, ô sorcier, moi qui passe ma vie sous tes regards !
Ses joues ! si ses joues transparentes sont duvetées, ce n’est point de duvet comme toutes les joues, mais de soie furtive et dorée.
Sa bouche ! Il y en a qui viennent me demander naïvement où se trouve l’élixir de vie et sa source, sur quelle terre coule l’élixir de vie et sa source !…
Et je leur dis : « L’élixir de vie, je le connais et sa source aussi, je la connais !…
« Elle est la bouche même d’un adolescent, svelte et doux comme un jeune daim, le cou tendre et penché, d’un adolescent à la taille flexible.
« Elle est la lèvre humide et moussue d’un jeune daim mince et vif, d’un adolescent à la douce lèvre humide et de couleur rouge foncé ! »
Mais tout cela quand il avait dix-huit ans ; car, lorsqu’il eut atteint l’âge d’homme, le prince Diadème devint si admirablement beau qu’il fut un exemple cité dans tous les pays musulmans, en large et en long. Aussi le nombre de ses amis et de ses intimes fut très considérable ; et tous ceux qui l’entouraient souhaitaient avec ardeur le voir enfin régner sur le royaume comme il régnait sur les cœurs.
À cette époque, le prince Diadème devint très passionné de chasses et d’expéditions à travers les bois et forêts, malgré toute la terreur que ses absences continuelles inspiraient à son père et à sa mère. Et un jour il ordonna à ses esclaves d’emporter des provisions pour dix jours et il partit avec eux à la chasse à pied et à courre. Et ils marchèrent durant quatre jours pour arriver enfin à une contrée giboyeuse, couverte de forêts habitées par toutes sortes d’animaux sauvages, et arrosée par une multitude de sources et de ruisseaux.
Alors le prince Diadème donna le signal de la chasse. Aussitôt on étendit le grand filet de corde autour d’un très large espace de terrain touffu ; et les rabatteurs rayonnèrent de la circonférence vers le centre, et chassèrent devant eux tous les animaux affolés, qu’ils rabattirent de la sorte vers le centre. Alors on lâcha les panthères, les chiens et les faucons à la poursuite des bêtes difficiles à rabattre. Et l’on fit ce jour-là une chasse à courre très fructueuse en gazelles et en toutes sortes de gibier. Et ce fut une grande fête pour les panthères de chasse, les chiens et les faucons. Aussi, une fois la chasse terminée, le prince Diadème s’assit sur le bord d’une rivière pour prendre quelque repos, et divisa le gibier entre les chasseurs, et réserva la plus belle part à son père le roi Soleïmân-Schah. Puis il s’endormit cette nuit-là, en cet endroit, jusqu’au matin.
Or, à peine réveillés, ils virent à côté d’eux le campement d’une grande caravane qui était arrivée la nuit ; et bientôt ils virent sortir des tentes et descendre faire leurs ablutions à la rivière une quantité de gens, d’esclaves noirs et de marchands. Alors le prince Diadème envoya un de ses hommes s’informer auprès de ces gens de leur pays et de leur qualité. Et le courrier revint dire au prince Diadème : « Ces gens m’ont dit : « Nous sommes des marchands qui avons campé ici, attirés par le vert de cette pelouse et cette eau délicieuse qui coule. Et nous savons que nous n’avons rien à craindre ici, car nous sommes sur les terres pleines de sécurité du roi Soleïmân-Schah, de qui la réputation de sagesse dans le gouvernement est connue de toutes les contrées et tranquillise tous les voyageurs. Et d’ailleurs nous lui apportons en cadeau une grande quantité de choses belles et de valeur, surtout pour son fils, l’admirable prince Diadème ! »
À ces paroles, le beau Diadème, fils du roi, répondit : « Mais, par Allah ! si ces marchands ont avec eux de si belles choses qu’ils me réservent, pourquoi n’irions-nous pas les chercher nous-mêmes ? Cela, d’ailleurs, contribuera à nous faire passer gaiement notre matinée. » Et aussitôt le prince Diadème, suivi de ses amis les chasseurs, se dirigea vers les tentes de la caravane.
Lorsque les marchands virent arriver le fils du roi et comprirent qui il était, ils accoururent tous à sa rencontre et l’invitèrent à entrer sous leurs tentes, et lui dressèrent à l’instant même une tente d’honneur en satin rouge, ornementée de figures multicolores, d’oiseaux et d’animaux, et toute tapissée de soieries de l’Inde et d’étoffes du Cachemire. Et pour lui ils placèrent un magnifique coussin sur un merveilleux tapis de soie dont tout le pourtour était enrichi de plusieurs rangs entremêlés de fines émeraudes. Et le prince Diadème s’assit sur le tapis et s’appuya sur le coussin et ordonna aux marchands de lui étaler leurs marchandises. Et, les marchands lui ayant étalé toutes leurs marchandises, il choisit dans le tas ce qui lui plaisait le plus, et, malgré leurs refus réitérés, les obligea à en accepter le prix qu’il leur paya largement.
Puis, ayant fait ramasser tous ses achats par les esclaves, il voulut remonter à cheval pour retourner à la chasse, quand tout à coup il aperçut devant lui, parmi les marchands, un jeune…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète comme elle était, remit son récit au lendemain.
LA CENT-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
… Quand tout à coup le prince Diadème aperçut devant lui, parmi les marchands, un jeune homme d’une beauté surprenante, d’une pâleur attirante, et vêtu de très beaux habits fort bien arrangés. Mais son visage, si pâle et si beau, portait empreinte une grande tristesse, comme de l’absence d’un père, d’une mère ou d’un ami très cher.
Alors le prince Diadème ne voulut point s’éloigner sans connaître ce beau jeune homme vers lequel son cœur était attiré ; et il s’approcha de lui et lui souhaita la paix, et lui demanda avec intérêt qui il était et pourquoi il était si triste. Mais le beau jeune homme, à cette question, eut les yeux remplis de larmes et ne put dire que ces deux mots : « Je suis Aziz ! » et il éclata en sanglots, et tellement qu’il tomba évanoui.
Lorsqu’il fut revenu à lui, le prince Diadème lui dit : « Ô Aziz, sache que je suis ton ami. Dis-moi donc le sujet de tes peines. » Mais le jeune Aziz, pour toute réponse, s’accouda et chanta ces vers :
« De ses yeux évitez le regard magicien, car nul n’a échappé au cercle de son orbite.
Les yeux noirs sont terribles quand ils sont langoureux. Car les yeux noirs et langoureux traversent les cœurs comme l’acier luisant des glaives effilés.
Et surtout n’écoutez pas la douceur de son langage, car, tel un vin de feu, il fait fermenter la raison des plus sages.
Si vous la connaissiez ! Elle a des regards si doux ! Et son corps de soie ! s’il touchait le velours il l’éterniserait de douceur.
La distance entre sa cheville cerclée de l’anneau d’or et ses yeux cerclés de kohl noir est remarquable.
Ah ! où est l’odeur délicate de ses robes parfumées, et son haleine qui distille l’essence de roses ! »
Lorsque le prince Diadème eut entendu ce chant, il ne voulut pas, pour le moment, trop insister, et, pour lier conversation, il lui dit : « Pourquoi, ô Aziz, ne m’as-tu pas étalé ta marchandise comme tous les autres marchands ? » Il répondit : « Ô mon seigneur, ma marchandise, en vérité, ne contient rien qui puisse convenir à un fils de roi. » Mais le beau Diadème dit au bel Aziz : « Par Allah ! je veux tout de même que tu me la montres ! » Et il obligea le jeune Aziz à s’asseoir à côté de lui sur le tapis de soie et à lui étaler, pièce par pièce, toute sa marchandise. Et le prince Diadème, sans même examiner les belles étoffes, les lui acheta toutes sans compter, et lui dit ; « Maintenant, Aziz, si tu me racontais le motif de tes peines… Je te vois les yeux en larmes et le cœur affligé. Or, si tu es opprimé, je saurai châtier tes oppresseurs ; et si tu es endetté, je paierai tes dettes de tout cœur. Car voici que je me sens attiré vers toi, et mes entrailles brûlent à ton sujet ! »
Mais le jeune Aziz, à ces paroles, se sentit de nouveau suffoqué par les sanglots, et ne put que chanter ces strophes :
« Ah ! la coquetterie de tes yeux noirs allongés de kohl bleu ! Ah !
La flexibilité de ta taille droite sur tes hanches mouvantes ! Ah !
Le vin de tes lèvres et le miel de ta bouche ! Et la courbe de tes seins et la braise qui les fleurit ! Ah ! A-hah !
T’espérer m’est plus doux qu’au cœur du condamné l’espoir du salut ! Ô nuit ! »
À ce chant, le prince Diadème se remit, pour faire diversion, à examiner une à une les belles étoffes et les soieries. Mais soudain, d’entre les étoffes, tomba de ses mains une pièce carrée de soie brodée que le jeune Aziz aussitôt se hâta de vivement ramasser. Et il la plia, en tremblant, et la mit sous son genou. Et il s’écria :
« Ô Aziza, ma bien-aimée ! les étoiles des Pléiades sont plus faciles à atteindre !
Sans toi maintenant où irai-je, désolé ! Et comment supporter désormais ton absence qui me pèse, alors que je puis à peine supporter le poids de mes vêtements ? »
Lorsque le prince vit ce mouvement effaré du bel Aziz et entendit ces derniers vers, il fut extrêmement surpris et, à la limite de la curiosité, il s’écria…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade, la fille du vizir, vit s’approcher le matin et, discrète comme elle était, ne voulut pas abuser de la permission accordée.
Alors sa sœur, la petite Doniazade, qui avait écouté toute cette histoire en se retenant de respirer, s’écria de l’endroit où elle était blottie : « Ô ma sœur Schahrazade, que tes paroles sont douces et gentilles et pures et délicieuses au goût et savoureuses en leur fraîcheur ! Et que ce conte est charmant et tous ces vers admirables ! »
Et Schahrazade lui sourit, et dit : « Oui, ma sœur ! Mais qu’est cela comparé à ce que je vous raconterai à tous deux la nuit prochaine, si je suis encore en vie par la grâce d’Allah et le bon plaisir du Roi ! »
Et le roi Schahriar dit en son âme : « Par Allah ! je ne la tuerai point avant d’avoir entendu la suite de son histoire, qui est une histoire merveilleuse et étonnante en vérité, extrêmement !
Puis il prit Schahrazade dans ses bras. Et tous deux passèrent le reste de la nuit, enlacés jusqu’au jour.
Après quoi, le roi Schahriar sortit vers la salle de sa justice ; et le Divan fut rempli de la foule des vizirs, des émirs, des chambellans, des gardes et des gens du palais. Et le grand-vizir arriva aussi avec, sous le bras, le linceul destiné à sa fille Schahrazade, qu’il croyait déjà morte. Mais le Roi ne lui dit rien à ce sujet, et continua à juger, à nommer aux emplois, à destituer, à gouverner et à terminer les affaires pendantes, et cela jusqu’à la fin de la journée. Puis le Divan fut levé et le Roi entra dans son palais. Et le vizir fut dans la perplexité et à l’extrême limite de l’étonnement.
Mais aussitôt que vint la nuit, le roi Schahriar alla trouver Schahrazade dans son appartement, et ne manqua pas de faire sa chose ordinaire avec elle.
LA CENT-DOUZIÈME NUIT
Aussi la petite Doniazade, une fois la chose terminée, se leva du tapis et dit à Schahrazade : « Ô ma sœur, je t’en prie, continue cette histoire si belle du beau prince Diadème et d’Aziz et Aziza, que le vizir Dandân racontait, sous les murs de Constantinia, au roi Daoul’makân ! »
Et Schahrazade sourit à sa sœur et lui dit : « Oui, certes ! de tout cœur généreux et comme hommages dûs ! Mais pas avant que ne me le permette ce Roi bien élevé et doué de bonnes manières ! »
Alors le roi Schahriar, qui ne pouvait dormir tant il attendait la suite avec ardeur, dit : « Tu peux parler ! »
Et Schahrazade dit :
Il m’est parvenu, ô Roi fortuné, que le prince Diadème s’écria : « Ô Aziz ! que caches-tu donc ainsi ! » Mais Aziz répondit : « Ô seigneur, c’est juste à cause de cela même que je ne voulais pas, dès le début, étaler devant toi mes marchandises. Que faire maintenant ! » Et il poussa un soupir de toute son âme. Mais le prince Diadème insista tant et lui dit de si gentilles paroles que le jeune Aziz finit par dire :
« Sache, ô mon maître, que mon histoire, au sujet de ce carré d’étoffe, est bien étrange ; et elle est pour moi pleine de souvenirs fort doux. Car les charmes de celles qui m’ont donné cette double étoffe ne s’effaceront jamais devant mes yeux. Celle qui m’a donné la première étoffe s’appelle Aziza ; quant à l’autre, son nom m’est amer à prononcer pour le moment ! Car c’est elle qui, de sa propre main, m’a fait ce que je suis. Mais comme j’ai déjà commencé à te parler de ces choses, je vais t’en raconter les détails ; ils te charmeront certainement, et serviront à édifier ceux qui les écouteront avec respect. »
Puis le jeune Aziz tira l’étoffe de dessous son genou, et la déplia sur le tapis où tous deux étaient assis. Et le prince Diadème vit qu’il y avait deux carrés distincts : en soie, sur l’un des carrés était brodée, en fils d’or rouge et fils de soie de toutes les couleurs, une gazelle ; et sur l’autre carré était également une gazelle, mais brodée en fils d’argent et portant au cou un collier d’or rouge d’où pendaient trois pierres de chrysolithe orientale.
À la vue de ces gazelles si merveilleusement brodées, il s’écria : « Gloire à celui qui met tant d’art dans l’esprit de ses créatures ! » Puis il dit au beau jeune homme :
« Ô Aziz, de grâce, hâte-toi de nous raconter ton histoire avec Aziza et avec la maîtresse de la seconde gazelle ! » Et le bel Aziz dit au prince Diadème :
« Sache, mon jeune seigneur… »
- ↑ Omar Al-Némân. — Pour être plus grammatical, je devrais écrire : « en-Némân ». C’est pour ne pas troubler le lecteur européen, que j’emploierai l’article « al », au lieu de « en ». (Voir grammaire arabe : lettres lunaires et lettres solaires.)
- ↑ La Sunnat est le recueil, par la tradition, des lois, décisions et conseils oraux du Prophète, et des détails minutieux de sa vie.
- ↑ Safia : Limpide et pure comme l’eau.
- ↑ Kaïssaria : Césarée de Cappadoce, peut-être.
- ↑ Ces allitérations et assonances : par souci du texte arabe.
- ↑ Daoul’makân : Lumière de l’endroit. Nôzhatou’zamân : Délices du temps.
- ↑ Constantinople.
- ↑ Les Arabes appellent ainsi Alexandre le Grand, à cause de son cheval Bucéphale.
- ↑ Une des plus belles races chevalines de l’Arabie du nord et du centre.
- ↑ Nom générique donné à tous les Européens, par extension et arabisation du mot Français.
- ↑ Le parasange (pharsakh) correspond à peu près à cinq kilomètres.
- ↑ Le Deïlam : province de la Perse, bornée au nord par la Caspienne. Les Deïlamites appartiendraient au groupe Turc-Tartare plutôt qu’à la Perse proprement dite.
- ↑ Kanmakân signifie : Il fut ce qui fut.