Le Livre des mille nuits et une nuit/Tome 07/Texte entier
strictement réservés.
Vingt-cinq exemplaires sur papier du Japon ;
Soixante-quinze exemplaires sur papier de Hollande.
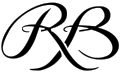
J’ai longtemps animé avec mes flûtes justes
. . . . . . . .
HISTOIRE PRODIGIEUSE DE LA
VILLE D’AIRAIN
LA TROIS CENT TRENTE-NEUVIÈME NUIT
Schahrazade dit :
On raconte qu’il y avait sur le trône des khalifats Ommiades, à Damas, un roi — Allah seul est roi ! — qui s’appelait Abdalmalek ben-Merwân. Il aimait souvent à s’entretenir, avec les sages de son royaume, de notre maître Soleïmân ben-Daoud (sur lui la prière et la paix ! ), de ses vertus, de sa puissance et de son pouvoir illimité sur les fauves des solitudes, les éfrits qui peuplent l’air, et les génies maritimes et souterrains.
Un jour que le khalifat, au récit qu’on lui faisait de vases de cuivre ancien dont le contenu était une étrange fumée noire aux formes diaboliques, s’étonnait à l’extrême et avait l’air de mettre en doute la réalité de faits si avérés, d’entre les assistants se leva Taleb ben-Sehl, le voyageur fameux, qui confirma le récit que l’on venait d’entendre, et ajouta : « En effet, ô émir des Croyants, ces vases de cuivre ne sont autres que ceux où furent enfermés, dans les temps anciens, les génies rebelles aux ordres de Soleïmân, et qui furent jetés, une fois scellés du sceau redoutable, au fond de la mer mugissante, aux confins du Maghreb, dans l’Afrique occidentale. La fumée qui s’en échappe est tout simplement l’âme condensée des éfrits, lesquels ne manquent pas de reprendre à l’air libre leur première forme formidable. »
À ces paroles, la curiosité et l’étonnement du khalifat Abdalmalek augmentèrent considérablement, et il dit à Taleb ben-Sehl : « Ô Taleb, je désire beaucoup voir l’un de ces vases de cuivre qui renferment les éfrits en fumée ! Crois-tu la chose possible ? Dans ce cas je suis prêt à aller moi-même faire les recherches nécessaires. Parle. » Il répondit : « Ô émir des Croyants, tu peux avoir cet objet ici même, sans te déplacer, et sans fatigues pour ta personne vénérée. Tu n’as pour cela qu’à envoyer une lettre à l’émir Moussa, ton lieutenant au pays du Maghreb. Car la montagne au pied de laquelle se trouve la mer qui renferme ces vases est reliée au Maghreb par une langue de terre qu’on peut traverser à pied sec. L’émir Moussa, au reçu de la lettre, ne manquera pas d’exécuter les ordres de notre maître le khalifat ! »
Ces paroles eurent le don de convaincre Abdalmalek qui, à l’instant, dit à Taleb : « Et qui mieux que toi, ô Taleb, est capable d’aller avec célérité au pays du Maghreb porter ma lettre à l’émir Moussa, mon lieutenant ? Je te donne tous pouvoirs de puiser à mon trésor ce que tu juges nécessaire pour les frais du voyage, et de prendre autant d’hommes qu’il t’en faut pour ta suite. Mais hâte-toi, ô Taleb ! » Et à l’heure même le khalifat écrivit une lettre de sa propre main à l’émir Moussa, la cacheta, et la remit à Taleb qui embrassa la terre entre ses mains et, une fois les préparatifs faits, partit en toute diligence pour le Maghreb, où, sans encombre, il arriva.
L’émir Moussa le reçut avec joie et avec tous les égards dus à l’envoyé de l’émir des Croyants ; et Taleb lui remit la lettre, qu’il prit, et, après l’avoir parcourue et en avoir compris le sens, il la porta à ses lèvres, puis à son front, et dit : « J’écoute et j’obéis ! » Et aussitôt il fit mander auprès de lui le cheikh Abdossamad, homme qui avait parcouru toutes les régions habitables de la terre, et qui maintenant passait les jours de sa vieillesse à noter avec soin, pour les âges, ses connaissances acquises dans une vie de voyages sans répit. Et lorsque le cheikh arriva, l’émir Moussa le salua avec respect et lui dit : « Ô cheikh Abdossamad, voici que l’émir des Croyants m’envoie ses ordres pour que j’aille à la recherche des vases de cuivre ancien où furent enfermés les génies rebelles par notre maître Soleïmân ben-Daoud. Ils gisent au fond d’une mer située au pied d’une montagne qui, paraît-il, se trouverait aux confins extrêmes du Maghreb. Bien que je connaisse de longue date tout le pays, je n’ai jamais ouï parler de cette mer ni de la route qui y conduit ; mais toi, ô cheikh Abdossamad qui as parcouru le monde entier, tu n’ignores sans doute pas l’existence de cette montagne et de cette mer-là ! »
Le cheikh réfléchit une heure de temps et répondit : « Ô émir Moussa ben-Nossaïr, cette montagne et cette mer ne sont pas inconnues à ma mémoire ; mais jusqu’aujourd’hui je n’ai pu, malgré le désir, y aller moi-même : le chemin qui y conduit est très difficile à cause du manque d’eau dans les citernes ; et il faut bien deux ans et quelques mois pour y aller et davantage pour en revenir, si toutefois on peut revenir d’une contrée dont les habitants n’ont jamais donné un signe quelconque de leur existence et vivent dans une ville située, dit-on, au sommet même de la montagne en question, une ville où nul n’a pu encore pénétrer et qu’on nomme la Ville d’Airain ! »
Et, ayant dit ces paroles, le vieillard se tut, réfléchit encore un moment, et ajouta : « De plus je ne dois pas te cacher, ô émir Moussa, que cette route est semée de dangers et de choses pleines d’effroi, et qu’il y a un désert à traverser qui est peuplé par les éfrits et les génies, gardiens de ces terres vierges de pas humains depuis l’antiquité. Sache, en effet, ô Ben-Nossaïr, que ces contrées de l’extrême occident africain sont interdites aux fils des hommes ; deux d’entre eux ont pu seuls les traverser, l’un est Soleïmân ben-Daoud, et l’autre El-Iskandar aux Deux-Cornes. Et depuis ces époques abolies, le silence est devenu le maître introublé de ces vastitudes désertées ! Si donc tu tiens, dédaigneux des obstacles mystérieux et des périls, à exécuter les ordres du khalifat et à tenter ce voyage dans un pays sans routes tracées, et sans autre guide que ton serviteur, fais charger mille chameaux d’outres remplies d’eau et mille autres chameaux de vivres et de provisions ; prends le moins de gardes possible, car nul pouvoir humain ne nous préserverait de la colère des puissances ténébreuses dont nous allons violer les domaines, et il ne nous faut pas les indisposer par un déploiement d’armes menaçantes et vaines. Et lorsque tout sera prêt, fais ton testament, émir Moussa, et partons…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUARANTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et lorsque tout sera prêt, fais ton testament, émir Moussa, et partons ! »
À ces paroles, l’émir Moussa, gouverneur du Maghreb, après avoir invoqué le nom d’Allah, ne voulut pas avoir un moment d’hésitation : il rassembla les chefs de ses soldats et les principaux du royaume, testa devant eux tous et nomma comme son remplaçant son fils Haroun. Après quoi, il fit faire les préparatifs en question, ne prit avec lui que quelques hommes choisis, et, accompagné du cheikh Abdossamad et de Taleb, l’envoyé du khalifat, il prit la route du désert, suivi de mille chameaux chargés d’eau et de mille autres chargés de vivres et de provisions.
La caravane marcha dans les solitudes plates pendant des jours et des mois, sans rencontrer sur sa route un être vivant dans ces immensités unies comme la mer lorsqu’elle est tranquille. Et le voyage continua de la sorte au milieu du silence infini, jusqu’à ce qu’un jour ils eussent aperçu au loin comme un nuage brillant, à ras de l’horizon, vers lequel ils se dirigèrent. Et ils reconnurent que c’était un édifice aux hautes murailles en acier chinois, et soutenu par quatre rangées de colonnes d’or de quatre mille pas de circonférence. Mais le dôme de ce palais était en plomb, et servait de reposoir à des milliers de corbeaux, seuls habitants visibles sous le ciel. Sur la grande muraille où s’ouvrait la porte principale en ébène massif lamé d’or, une plaque immense de métal rouge laissait lire sur sa table, tracés en caractères ioniens, ces mots que déchiffra le cheikh Abdossamad et qu’il traduisit à l’émir Moussa et à ses compagnons :
Entre ici pour apprendre l’histoire de ceux qui furent les dominateurs !
Ils passèrent, tous ceux-là ! Ils eurent à peine le temps de se reposer à l’ombre de mes tours.
Ils furent dispersés comme des ombres par la mort ! Ils furent dissipés comme la paille au vent par la mort !
L’émir Moussa fut excessivement ému en entendant ces paroles, que traduisait le vénérable Abdossamad, et murmura : « Il n’y a d’autre Dieu qu’Allah ! » Puis il dit : « Entrons ! » et, suivi de ses compagnons, il franchit le seuil de la porte principale, et pénétra dans le palais.
Devant eux surgissait, au milieu du vol muet des grands oiseaux noirs, dans sa haute nudité de granit, une tour dont le sommet se perdait au regard, et au pied de laquelle s’alignaient en rond quatre rangées de cent sépulcres qui entouraient un monumental sarcophage de cristal poli autour duquel se lisait cette inscription, gravée en caractères ioniens, avec des lettres d’or rehaussées de pierreries :
L’ivresse de la jouissance est passée comme le délire des fièvres.
De combien d’événements n’ai-je pas été témoin ?
De quelle brillante renommée n’ai-je pas joui durant les jours de ma gloire ?
Combien de capitales n’ont-elles pas retenti du sabot sonore de mon cheval ?
Que de villes n’ai-je pas saccagées comme le simoun destructeur ? Que d’empires n’ai-je pas détruits comme le tonnerre ?
Que de potentats n’ai-je pas traînés derrière mon char ?
Que de lois n’ai-je pas dictées à l’univers ?
Et voici !
L’ivresse de ma jouissance est passée comme le délire de la fièvre, sans laisser plus de trace que l’écume sur le sable.
La mort m’a surpris sans que ma puissance l’ait repoussée, sans que mes armées ni mes courtisans aient pu me défendre contre elle !
Écoute donc, voyageur, les paroles que jamais mes lèvres ne prononcèrent de mon vivant :
Conserve ton âme ! Jouis en paix du calme de la vie, de la beauté calme de la vie ! Demain la mort t’enlèvera !
Demain la terre répondra à ceux qui t’appelleront : « Il est mort ! Jamais mon sein jaloux ne rend ceux qu’il enferme pour l’éternité ! »
En entendant ces paroles, que traduisait le cheikh Abdossamad, l’émir Moussa et ses compagnons ne purent s’empêcher de pleurer. Et ils restèrent longtemps debout devant le sarcophage et les sépulcres, en se répétant les paroles funèbres. Puis ils se dirigèrent vers la tour qui était fermée par une porte à deux battants d’ébène, sur laquelle cette inscription se lisait, également gravée en caractères ioniens rehaussés de pierreries :
Au nom de l’Éternel, de l’Immuable,
Au nom du Maître de la force et de la puissance !
Apprends, voyageur qui parcours ces lieux, à ne point t’enorgueillir des apparences ! Leur éclat est trompeur.
Apprends par mon exemple à ne point te laisser éblouir par les illusions ! Elles te précipiteraient dans l’abîme !
Je te parlerai de ma puissance !
J’avais dix mille coursiers généreux dans mes écuries, soignés par les rois captifs de mes armes.
J’avais dans mes appartements privés, comme concubines, mille vierges issues du sang des rois, et mille autres vierges choisies parmi celles dont les seins sont glorieux et dont la beauté fait pâlir l’éclat de la lune.
Mes épouses me donnèrent, pour postérité, mille princes royaux, courageux comme des lions.
Je possédais d’immenses trésors ; et sous ma domination se courbaient les peuples et les rois, depuis l’Orient jusqu’aux extrêmes limites de l’Occident, subjugués par mes armées indomptables.
Et je croyais éternelle ma puissance, et assise pour les siècles la durée de ma vie, quand soudain, la voix se fit entendre qui m’annonçait les irrévocables décrets de Celui qui ne meurt pas !
Alors je réfléchis sur ma destinée !
Je rassemblai mes cavaliers et mes fantassins par milliers, armés de leurs lances et de leurs glaives.
Et je rassemblai les rois, mes tributaires, et les chefs de mon empire et les chefs de mes armées.
Et devant eux tous, je fis apporter mes cassettes et les coffres de mes trésors, et à tous ceux-là je dis :
« Ces richesses, ces quintaux d’or et d’argent, je vous les donne si vous prolongez d’un jour seulement ma vie sur la terre ! »
Mais ils tinrent leurs yeux baissés, et gardèrent le silence. Alors moi je mourus ! Et mon palais devint l’asile de la mort.
Si tu veux savoir mon nom, je m’appelais Kousch ben-Scheddad ben-Aâd le Grand !
En entendant ces sublimes vérités, l’émir Moussa et ses compagnons éclatèrent en sanglots et pleurèrent longuement. Après quoi ils pénétrèrent dans la tour, et se mirent à parcourir d’immenses salles, habitées par le vide et le silence. Ils finirent de la sorte par arriver dans une chambre, plus grande que les autres, à la voûte arrondie en dôme, et qui, seule dans la tour, contenait un meuble. C’était une colossale table en bois de sandal, ciselée merveilleusement, et sur laquelle se détachait cette inscription en beaux caractères semblables aux précédents :
Autrefois, à cette table, s’asseyaient mille rois borgnes et mille rois qui avaient de bons yeux. Maintenant dans la tombe ils sont également aveugles !
L’étonnement de l’émir Moussa ne fit qu’augmenter devant ce mystère ; et, ne pouvant en avoir la solution, il transcrivit ces paroles sur ses parchemins ; puis il sortit du palais, ému à l’extrême, et reprit, avec ses compagnons, la route de la Ville d’Airain…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUARANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
… et reprit, avec ses compagnons, la route de la Ville d’Airain.
Ils marchèrent durant le premier, le second et le troisième jour, jusqu’au soir. Alors ils virent leur apparaître, dressée sur un haut piédestal, découpée par les rayons du soleil rouge au couchant, une silhouette de cavalier immobile brandissant une lance au large fer qui semblait être une flamme embrasée, de la couleur même de l’astre en feu à l’horizon.
Lorsqu’ils furent tout proches de cette apparition, ils reconnurent que le cavalier et son cheval et le piédestal étaient d’airain, et que sur le fer de lance, du côté éclairé par les derniers rayons de l’astre, ces mots étaient gravés en caractères de feu :
Audacieux voyageurs qui avez pu arriver jusqu’aux terres interdites, maintenant vous ne sauriez retourner sur vos pas !
Si le chemin de la Ville vous est inconnu, faites-moi, par l’effort de vos bras, mouvoir sur mon piédestal et dirigez-vous du côté où, en m’arrêtant, je resterai le visage tourné.
Alors l’émir Moussa s’approcha du cavalier et le poussa de la main. Et aussitôt, avec la rapidité de l’éclair, le cavalier tourna sur lui-même et s’arrêta le visage vers une direction tout opposée à celle qui avait été suivie par les voyageurs. Et le cheikh Abdossamad reconnut qu’en effet il s’était trompé, et que la direction nouvelle était la bonne.
Aussitôt la caravane, revenant sur ses pas, s’engagea dans cette nouvelle voie, et continua de la sorte le voyage, durant des jours et des jours, jusqu’à ce qu’elle fût arrivée, à une tombée de nuit, devant une colonne de pierre noire à laquelle était enchaîné un être étrange dont on ne voyait émerger que la moitié du corps, l’autre moitié étant enfoncée profondément dans le sol. Ce tronc qui sortait de terre semblait quelque enfantement monstrueux poussé là par la force des puissances infernales. Il était noir et grand comme le tronc d’un vieux palmier déchu dépouillé de ses palmes. Il avait deux énormes ailes noires et quatre mains dont deux étaient semblables aux pattes griffues des lions. Une chevelure hérissée en crins rudes de queue d’onagre se mouvait sauvagement sur son crâne épouvantable. Sous les arcades orbitaires deux yeux rouges flambaient, tandis que le front aux doubles cornes de bœuf était troué d’un œil unique qui béait immobile et fixe en lançant des lueurs vertes comme l’œil des tigres et des panthères.
À la vue des voyageurs, le tronc agita les bras en faisant des cris effroyables et des mouvements désespérés comme pour briser les chaînes qui l’attachaient à la colonne noire. Et la caravane, prise d’une terreur extrême, se figea sur place, n’ayant la force ni d’avancer ni de reculer.
Alors l’émir Moussa se tourna vers le cheikh Abdossamad et lui demanda : « Peux-tu, ô vénérable, nous dire ce que peut bien être cela ? » Le cheikh répondit : « Par Allah ! ô émir, cela dépasse mon entendement ! » Et l’émir Moussa dit : « Alors avance plus près et interroge-le ! Peut-être nous éclairera-t-il lui-même ! » Et le cheikh Abdossamad ne voulut point montrer d’hésitation : il s’approcha du monstre, auquel il cria : « Au nom du Maître qui tient sous sa main les empires du Visible et de l’Invisible, je t’adjure de me répondre ! Dis-moi qui tu es, depuis quand tu es là et la cause qui te valut un si étrange châtiment ! »
Alors le tronc aboya. Et voici les paroles qu’entendirent l’émir Moussa, le cheikh Abdossamad et leurs compagnons :
« Je suis un éfrit de la postérité d’Éblis, père des genn. Je m’appelle Daësch ben-Alaëmasch. Ici je suis enchaîné par la Force Invisible jusqu’à l’extinction des siècles.
« Autrefois, dans ce pays gouverné par le roi de la Mer, il y avait, comme protectrice de la Ville d’Airain, une idole d’agate rouge dont j’étais le gardien à la fois et l’habitant. J’avais, en effet, élu domicile dans son intérieur ; et de tous les pays on venait en foule consulter le sort par mon entremise et écouter les oracles que je rendais et mes prédictions augurales.
« Le roi de la Mer, dont j’étais moi-même le vassal, avait sous son commandement suprême toute l’armée des génies rebelles aux ordres de Soleïmân ben-Daoud ; et il m’avait nommé le chef de cette armée pour le cas où éclaterait une guerre entre lui et ce maître redoutable des génies. Et cette guerre ne tarda pas, en effet, à éclater.
« Le roi de la mer avait une fille d’une beauté dont le renom était parvenu jusqu’aux oreilles de Soleïmân. Celui-ci, désireux de l’avoir au nombre de ses épouses, dépêcha un envoyé au roi de la Mer pour la lui demander en mariage, en même temps qu’il lui enjoignait de briser la statue d’agate et de reconnaître qu’il n’y a point d’autre Dieu qu’Allah et que Soleïmân est le prophète d’Allah ! Et il le menaçait de son courroux et de sa vengeance si l’on ne se soumettait immédiatement à ses désirs. »
« Alors le roi de la Mer assembla ses vizirs et les chefs des genn et leur dit : « Voici que Soleïmân me menace de toutes sortes de calamités pour m’obliger à lui donner ma fille et à briser la statue qui sert d’habitation à votre chef Daësch ben-Alaëmasch. Que pensez-vous de ces menaces ? Dois-je m’incliner ou résister ? »
« Les vizirs répondirent : « Et qu’as-tu, ô notre roi, à redouter de la puissance de Soleïmân ? Nos forces sont au moins aussi redoutables que les siennes. Et celles-ci, nous saurons bien les anéantir ! » Puis ils se tournèrent vers moi et me demandèrent mon avis. Alors, moi je dis : « Notre seule réponse à Soleïmân est de donner la bastonnade à son envoyé ! » Cela fut exécuté sur le champ. Et nous dîmes à cet envoyé : « Retourne maintenant instruire ton maître de l’aventure ! »
« Lorsque Soleïmân eut appris le traitement infligé à son envoyé, il fut à la limite de l’indignation, et rassembla aussitôt toutes ses forces disponibles en génies, hommes, oiseaux et animaux. Il confia à Assaf ben-Barkhia le commandement des guerriers hommes, et à Domriat, roi des éfrits, le commandement de toute l’armée des génies au nombre de soixante millions, et celui des animaux et des oiseaux de proie, rassemblés de tous les points de l’univers et des iles et des mers de la terre. Cela fait, Soleïmân vint, à la tête de cette armée formidable, envahir le pays du roi de la Mer, mon suzerain. Et dès son arrivée il rangea son armée en ordre de bataille. »
« Il commença par placer sur les deux ailes les animaux, par rangs alignés de quatre, et posta dans les airs les grands oiseaux de proie destinés à servir de sentinelles pour l’aviser de nos mouvements et à fondre soudain sur les guerriers pour leur crever et leur arracher les yeux. Il composa l’avant-garde avec l’armée des hommes et l’arrière-garde avec l’armée des génies ; et il plaça à sa droite son vizir Assaf ben-Barkhia et à sa gauche Domriat, roi des éfrits de l’air. Lui-même demeura au centre, assis sur un trône de porphyre et d’or, porté par quatre éléphants formant carré. Et il donna alors le signal de la bataille.
« Aussitôt une clameur se fît entendre, grandissante avec la course au galop et le vol tumultueux des génies, des hommes, des oiseaux de proie et des fauves de guerre ; et l’écorce de la terre résonnait sous la formidable poussée des pas, tandis que l’air retentissait des battements de millions d’ailes et des huées et des cris et des rugissements.
« Moi, de mon côté, j’eus le commandement de l’avant-garde de l’armée des génies soumis au roi de la Mer. Je donnai le signal à mes troupes, et à leur tête je me précipitai sur le corps des génies ennemis commandé par le roi Domriat…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUARANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Je donnai le signal à mes troupes, et à leur tête je me précipitai sur le corps des génies ennemis commandé par le roi Domriat. Et moi-même je cherchais à attaquer le chef des adversaires, quand je le vis soudain se muer en une montagne enflammée qui se mit à vomir le feu par torrents, en s’efforçant de m’accabler et de m’étouffer sous les débris lancés qui retombaient de notre côté en nappes embrasées. Moi, longtemps, stimulant les miens, je me défendis et j’attaquai avec acharnement ; et ce ne fut que lorsque je vis bien que le nombre de mes ennemis allait indubitablement m’écraser que je donnai le signal de la retraite et que je me retirai en m’enfuyant à tire d’aile à travers les airs. Mais nous fûmes, sur l’ordre de Soleïmân, poursuivis et de tous les côtés à la fois environnés par nos adversaires, génies, hommes, animaux et oiseaux : et nous fûmes les uns anéantis, les autres écrasés sous les pieds des quadrupèdes, et d’autres précipités du haut des airs, les jeux crevés et les chairs en lambeaux. Moi-même je fus atteint dans ma fuite qui dura trois mois. Alors, pris et garrotté, je fus condamné à être attaché à cette colonne noire jusqu’à l’extinction des âges, tandis que tous les génies à mes ordres étaient faits prisonniers, transformés en fumée et enfermés dans des vases de cuivre qui, scellés du sceau de Soleïmân, furent précipités au fond de la mer où baignent les murailles de la Ville d’Airain !
« Quant aux hommes qui habitaient ce pays, je ne sais exactement ce qu’ils sont devenus, enchaîné que je suis depuis la ruine de notre pouvoir. Mais, si vous allez à la Ville d’Airain, peut-être verrez-vous leurs traces et apprendrez-vous leur histoire ! »
Lorsque le tronc eut fini de parler, il se mit à s’agiter éperdument comme pour essayer de se désenchaîner de la colonne. Et l’émir Moussa et ses compagnons, craignant qu’il ne parvînt à se mettre en liberté ou à les obliger à seconder ses efforts, ne voulurent point stationner davantage et se hâtèrent de continuer leur route vers la Ville dont ils voyaient déjà au loin se profiler dans le rouge du soir les tours et les murailles.
Lorsqu’ils ne furent plus qu’à une légère distance de la Ville, comme la nuit tombait et que les choses d’alentour prenaient un aspect hostile, ils préférèrent attendre le matin pour s’approcher des portes ; et ils dressèrent les tentes pour passer la nuit, harassés qu’ils étaient des fatigues du voyage.
À peine l’aube première eut-elle commencé à éclaircir les sommets des montagnes à l’orient, l’émir Moussa réveilla ses compagnons et se mit en route avec eux pour arriver à l’une des portes d’entrée. Alors, devant eux ils virent, dans la clarté matinale, se dresser, formidables, des murailles d’airain, si lisses qu’on les eût dites sorties toutes neuves du moule où elles avaient été coulées. Leur hauteur était telle qu’elles semblaient former le premier plan des monts gigantesques qui les entouraient et dans les flancs desquels elles semblaient s’incruster, taillées à même quelque métal originel.
Lorsqu’ils purent sortir de la surprise immobile où les avait cloués ce spectacle, ils cherchèrent des yeux une porte par où entrer dans la Ville. Mais ils n’en trouvèrent point. Alors ils se mirent à marcher, en longeant les murailles, espérant toujours trouver l’entrée. Mais ils ne virent point d’entrée. Et ils continuèrent à marcher encore des heures sans voir ni porte ni brèche quelconque, ni personne qui se dirigeât vers la Ville ou en sortît. Et malgré l’heure déjà avancée du jour, ils n’entendaient aucun bruit pas plus au dedans qu’au dehors des murs, et ils ne remarquaient aucun mouvement pas plus sur les sommets des murs qu’à leur pied. Mais l’émir Moussa, sans perdre espoir, encouragea ses compagnons à marcher encore ; et ils marchèrent ainsi jusqu’au soir, et toujours ils voyaient se déployer devant eux la ligne inflexible des murailles d’airain, qui suivaient les mouvements du sol, les vallées et les côtes et semblaient surgir du sein même de la terre.
Alors l’émir Moussa ordonna à ses compagnons de s’arrêter pour le repos et la nourriture. Et lui-même s’assit quelque temps pour réfléchir à la situation. Lorsqu’il se fut reposé, il dit à ses compagnons de rester là à veiller sur le campement jusqu’à son retour et, suivi du cheikh Abdossamad et de Taleb ben-Sehl, il fit avec eux l’ascension d’une haute montagne, dans le dessein d’inspecter les environs et de reconnaître cette Ville qui ne voulait pas se laisser violer par les tentatives des humains…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUARANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… cette Ville qui ne voulait pas se laisser violer par les tentatives des humains.
D’abord ils ne purent rien distinguer dans les ténèbres, car la nuit avait déjà épaissi les ombres sur la plaine ; mais soudain la lueur à l’orient se fit plus vive, et sur le sommet de la montagne la lune magnifique s’élança et d’un clignement de ses yeux illumina le ciel et la terre. Et à leurs pieds un spectacle se déroula qui les fit s’arrêter de respirer.
Ils dominaient une ville de songe.
Sous la nappe blanche qui tombait de haut, aussi loin que pouvait s’étendre le regard vers des horizons noyés dans la nuit, des dômes de palais, des terrasses de maisons, de calmes jardins s’étageaient dans l’enceinte d’airain, et des canaux illuminés par l’astre se promenaient en mille circuits clairs dans le sombre des massifs, tandis que, tout au bout, une mer de métal contenait dans son sein froid les feux du ciel réfléchi : ce qui faisait que l’airain des murailles, les pierreries allumées des dômes, les terrasses candides, les canaux et toute la mer, ainsi que les ombres projetées vers l’occident, se mariaient sous la brise nocturne et la lune magique.
Cependant cette vastitude était ensevelie dans le silence universel comme dans un tombeau. Nulle vie humaine ne se laissait soupçonner là-dedans. Mais de hautes figures d’airain, chacune sur quelque socle monumental, mais de grands cavaliers taillés dans le marbre, mais des animaux ailés au vol sans vertu, se profilaient dans un même geste figé ; et dans le ciel, à ras des édifices, tournoyaient, seuls êtres mobiles sur cette immobilité, d’immenses vampires par milliers, tandis que, trouant le silence étale, d’invisibles hiboux jetaient leurs lamentations et leurs appels funèbres sur les palais morts et les terrasses endormies.
Lorsque l’émir Moussa et ses deux compagnons eurent rempli leurs yeux de ce spectacle étrange, ils descendirent de la montagne en s’étonnant à l’extrême de n’avoir pas aperçu, dans cette ville immense, trace de quelque être humain vivant. Et ils arrivèrent au pied des murs d’airain, dans un endroit où ils virent quatre inscriptions gravées en caractères ioniens, et que le cheikh Abdossamad déchiffra aussitôt et traduisit à l’émir Moussa.
La première inscription disait :
Ô fils des hommes ! que tes calculs sont vains ! La mort est proche. Ne compte pas sur l’avenir. Il est un Maître de l’Univers qui disperse les nations et les armées, et de leurs palais aux vastes magnificences précipite les rois dans l’étroite demeure du tombeau. Et leur âme réveillée dans l’égalité de la terre les voit réduits en amas de cendre et de poussière.
À ces paroles, l’émir Moussa s’écria : « Ô sublimes vérités ! Ô réveil de l’âme dans l’égalité de la terre ! Que tout cela est frappant ! » Et il transcrivit aussitôt ces paroles sur ses parchemins. Mais déjà le cheikh traduisait la seconde inscription, qui disait :
Ô fils des hommes ! pourquoi t’aveugles-tu de tes propres mains ? Comment peux-tu mettre ta confiance dans un monde vain ? Ne sais-tu pas que c’est un séjour passager, une demeure transitoire ? Dis ! Où sont les rois qui jetèrent les fondements des empires ? Où sont les conquérants, les maîtres de l’Irak, d’Ispahan et du Khorassân ? Ils ont passé comme s’ils n’avaient jamais été !
L’émir Moussa transcrivit également cette inscription, et, fort ému, écouta le cheikh qui traduisait la troisième :
Ô fils des hommes, voici que les jours s’écoulent, et tu vois ta vie avec indifférence marcher vers le terme final. Songe au jour du Jugement devant le Seigneur, ton maître. Où sont les souverains de l’Inde, de la Chine, de Sina et de Nubie ? Le souffle implacable de la mort les a renversés dans le néant !
Et l’émir Moussa s’écria : « Où sont les souverains de Sina et de Nubie ? Renversés dans le néant ! » Or la quatrième inscription disait :
Ô fils des hommes ! Tu noies ton âme dans les plaisirs, et tu ne vois pas sur tes épaules la mort cramponnée qui suit tes mouvements ! Le monde est comme la toile de l’araignée, et derrière cette fragilité te guette le néant ! Où sont les hommes aux vastes espérances et leurs projets éphémères ? Ils ont échangé contre la tombe les palais où maintenant habitent les hiboux !
L’émir Moussa ne put alors contenir son émotion et se mit à pleurer longtemps, les tempes dans les mains, et il se disait : « Ô mystère de la naissance et de la mort ! Pourquoi naître s’il faut mourir ? Pourquoi vivre si la mort donne l’oubli de la vie ? Mais Allah seul connaît les destinées, et notre devoir est de nous incliner dans l’obéissance muette ! » Ces réflexions faites, il reprit avec ses compagnons la route du campement, et ordonna à ses hommes de se mettre sur-le-champ à l’ouvrage pour construire, avec du bois et des branchages, une échelle longue et solide qui leur permît d’atteindre le haut des murs, pour de là essayer de descendre dans cette ville sans portes.
Aussitôt les hommes se mirent à la recherche de bois et de grosses branches sèches, les rabotèrent le mieux qu’ils purent avec leurs sabres et leurs couteaux, les lièrent entre elles avec leurs turbans, leurs ceintures, les cordes des chameaux, les sangles et les cuirs des harnachements, et réussirent à construire une échelle assez haute pour atteindre au faite des murailles. Ils la portèrent alors à l’endroit le plus propice, la soutinrent de tous côtés avec de grosses pierres, et, en invoquant le nom d’Allah, commencèrent à y grimper lentement…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUARANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… commencèrent à y grimper lentement, l’émir Moussa en tête. Mais quelques-uns restèrent au bas des murs, pour surveiller le campement et les environs.
L’émir Moussa et ses compagnons se mirent à marcher sur les murs pendant quelque temps, et finirent par arriver devant deux tours reliées entre elles par une porte d’airain dont les deux battants étaient fermés et joints d’une façon si parfaite qu’on n’aurait pu introduire la pointe d’une aiguille dans leur interstice. Sur cette porte était gravée l’image en relief d’un cavalier d’or qui avait le bras tendu et la main ouverte ; et sur la paume de cette main des caractères ioniens étaient tracés, que le cheikh Abdossamad déchiffra aussitôt et traduisit ainsi : « Frotte douze fois le clou qui est dans mon nombril. »
Alors l’émir Moussa, bien que fort surpris de ces paroles, s’approcha du cavalier et remarqua qu’en effet un clou d’or se trouvait enfoncé juste au milieu de son nombril. Il tendit la main et frotta ce clou douze fois. Et au douzième frottement les deux battants s’ouvrirent dans toute leur largeur sur un escalier de granit rouge qui s’enfonçait en tournant. Aussitôt l’émir Moussa et ses compagnons descendirent les marches de cet escalier qui les conduisit au centre d’une salle donnant de plain-pied sur une rue où stationnaient des gardes armés d’arcs et de glaives. Et l’émir Moussa dit : « Allons à eux pour leur parler avant qu’ils ne nous inquiètent ! »
Ils s’approchèrent donc de ces gardes dont les uns étaient debout le bouclier au bras et le sabre nu, et les autres assis ou étendus ; et l’émir Moussa, se tournant vers celui qui avait l’air d’être leur chef lui souhaita la paix avec affabilité ; mais l’homme ne bougea pas et ne lui rendit pas le salam ; et les autres gardes restèrent également immobiles et les yeux fixes, ne prêtant pas plus attention aux nouveaux venus que s’ils ne les voyaient pas.
Alors l’émir Moussa, voyant que ces gardes ne comprenaient pas l’arabe, dit au cheikh Abdossamad : « Ô cheikh, adresse-leur la parole dans toutes les langues que tu connais ! » Et le cheikh commença à leur parler d’abord en langue grecque ; puis, voyant l’inanité de sa tentative, il leur parla en indien, en hébreu, en persan, en éthiopien et en soudanais ; mais nul d’entre eux ne comprit un mot de ces langues et ne fit un geste quelconque d’intelligence. Alors l’émir Moussa dit : « Ô cheikh, ces gardes sont peut-être offensés de ce que tu ne leur ébauches pas le salut de leur pays. Il te faut donc leur faire des salams gesticulés selon tous les pays que tu connais ! » Et le vénérable Àbdossamad exécuta à l’instant tous les gestes des salams usités chez les peuples de toutes les contrées qu’il avait parcourues. Mais aucun des gardes ne bougea, et chacun resta immobilisé dans la même attitude qu’au commencement.
À cette vue, l’émir Moussa, à la limite de l’étonnement, ne voulut pas davantage insister ; il dit à ses compagnons de le suivre et continua sa route, ne sachant à quelle cause attribuer un tel mutisme. Et le cheikh Abdossamad se disait : « Par Allah ! jamais, dans mes voyages, je n’ai vu une chose si extraordinaire ! »
Ils continuèrent à marcher de la sorte jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés à l’entrée du souk. Ils trouvèrent les portes ouvertes et pénétrèrent à l’intérieur. Le souk était rempli de gens qui vendaient et achetaient ; et les devantures des boutiques étaient merveilleusement garnies de marchandises. Mais l’émir Moussa et ses compagnons remarquèrent que tous les acheteurs et vendeurs, ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans le souk, s’étaient, comme d’un commun accord, arrêtés dans leurs gestes et leurs mouvements dès qu’ils les eurent aperçus ; et l’on eût dit qu’ils n’attendaient que le départ des étrangers pour reprendre leurs occupations habituelles. Pourtant ils semblaient ne faire aucune attention à leur présence, et se contentaient d’exprimer leur mécontentement de cette intrusion par le mépris et la négligence. Et, pour donner plus de signification encore à cette attitude dédaigneuse, un silence général se faisait sur leur passage, de façon que l’on entendait dans l’immense souk voûté résonner leurs pas de marcheurs solitaires au milieu de l’immobilité d’alentour. Et ils parcoururent de la sorte, ne rencontrant nulle part ni geste bienveillant ou hostile ni sourire de bienvenue ou de moquerie, le souk des bijoutiers, le souk des soieries, le souk des selliers, le souk des marchands de drap, celui des savetiers, et le souk des marchands d’épices et d’aromates.
Lorsqu’ils eurent traversé le souk des aromates, ils débouchèrent soudain sur une place immense où le soleil mettait une clarté d’autant plus éblouissante que les souks avaient une lumière tamisée qui avait habitué les regards à sa douceur. Et tout au fond, entre des colonnes d’airain d’une hauteur prodigieuse qui servaient de piédestaux à de grands animaux d’or aux ailes éployées, se dressait un palais de marbre flanqué de tours d’airain, et gardé par une ceinture d’hommes armés et immobiles dont les lances et les glaives flambaient sans se consumer. Une porte d’or donnait accès à ce palais où l’émir Moussa pénétra, suivi de ses compagnons.
Ils virent d’abord, courant tout le long de l’édifice et limitant une cour aux bassins de marbres de couleur, une galerie supportée par des colonnes de porphyre ; et cette galerie servait de réserve d’armes, car on y voyait partout, suspendues aux colonnes, aux murs, et au plafond, d’admirables armes, merveilles enrichies d’incrustations précieuses, et provenant de tous les pays de la terre. Tout autour de cette galerie ajourée étaient adossés des bancs d’ébène d’un travail merveilleux, niellés d’argent et d’or, et où étaient assis ou couchés des guerriers, vêtus de leurs costumes de parade, qui ne firent aucun mouvement, soit pour barrer la route aux visiteurs soit pour les inviter à continuer leur promenade étonnée…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUARANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… soit pour barrer la route aux visiteurs, soit pour les inviter à continuer leur promenade étonnée.
Ils suivirent donc cette galerie, dont la partie supérieure était ornée d’une corniche fort belle, et où ils virent, gravée en lettres d’or sur un fond d’azur, une inscription en langue ionienne qui contenait des préceptes sublimes dont voici la traduction fidèle faite par le cheikh Abdossamad :
Au nom de l’Immuable, Souverain des destinées ! Ô fils des hommes, tourne la tête et lu verras la mort prête à fondre sur ton âme ! Où est Adam, père des humains ? Où est Nouh et sa descendance ? Où est Nemroud le redoutable ? Où sont les rois, les conquérants, les Khosroès, les Césars, les Pharaons, les empereurs de l’Inde et de l’Irak, les maîtres de la Perse et ceux de l’Arabie, et Iskandar aux Deux-Cornes ? Où sont les souverains de la terre, Hamam et Karoun, et Scheddad fils d’Aâd et tous ceux de la postérité de Kanaân ? Par ordre de l’Éternel ils ont quitté la terre pour aller rendre compte de leurs actions au jour de la Rétribution.
Ô fils des hommes ! ne t’abandonne pas au monde et à ses plaisirs ! Crains le Seigneur et sers-le d’un cœur pieux ! Crains la mort ! La piété envers le Seigneur et la crainte de la mort sont la base de toute sagesse ! De la sorte tu moissonneras de belles actions qui te parfumeront pour le jour terrible du Jugement !
Lorsqu’ils eurent écrit sur les parchemins cette inscription qui les émut beaucoup, ils franchirent une grande porte qui s’ouvrait au milieu de la galerie, et entrèrent dans une salle au centre de laquelle était un beau bassin de marbre transparent d’où s’élançait un jet d’eau. Au-dessus de ce bassin se déployait, formant un plafond agréablement colorié, un pavillon en étoffes de soie et d’or aux teintes diverses et mariées entre elles avec un art parfait. L’eau, pour arriver dans ce bassin, suivait quatre canaux tracés dans le sol de la salle en contours charmants et chaque canal avait un lit d’une couleur particulière : le premier canal avait un lit de porphyre rose ; le second, de topazes ; le troisième, d’émeraudes, et le quatrième, de turquoises ; si bien que l’eau se teintait selon son lit et, frappée par la lumière atténuée filtrant des soieries du haut, projetait sur les objets d’alentour et les murs de marbre une douceur de paysage marin.
De là ils franchirent une seconde porte et entrèrent dans une seconde salle. Ils la trouvèrent remplie de monnaies anciennes d’or et d’argent, de colliers, de bijoux, de perles, de rubis et de toutes les pierreries. Et tout cela formait de tels amoncellements que l’œil pouvait à peine circuler et traverser cette salle pour pénétrer dans une troisième.
Celle-ci était remplie d’armures en métaux précieux, de boucliers d’or enrichis de pierreries, de casques anciens, de sabres de l’Inde, de lances, de javelots et de cuirasses du temps de Daoud et de Soleïmân ; et ces armes étaient toutes dans un état tel de conservation qu’on les eût dites sorties la veille des mains qui les avaient fabriquées.
Ils entrèrent ensuite dans une quatrième salle, occupée entièrement par des armoires et des étagères en bois précieux où, en bon ordre, étaient rangés de riches habits, des robes somptueuses, des étoffes de prix et des brocarts admirablement ouvragés. De là ils se dirigèrent vers une porte qui, ouverte, leur livra l’accès d’une cinquième salle.
Elle ne contenait, du sol au plafond, rien que des vases et des objets destinés aux boissons, aux mets et aux ablutions : des vases d’or et d’argent, des bassins en cristal de roche, des coupes de pierres précieuses, des plateaux en jade ou en agate de diverses couleurs.
Lorsqu’ils eurent admiré tout cela, ils songeaient à revenir sur leurs pas, quand ils furent tentés de relever un immense rideau de soie et d’or qui couvrait l’un des murs de la salle. Et ils virent derrière ce rideau une grande porte ouvragée de fines marqueteries d’ivoire et d’ébène et fermée par des verrous massifs d’argent sans aucune trace de trou pour y adapter une clef. Aussi le cheikh Abdossamad se mit-il à étudier le mécanisme de ces verrous et finit-il par trouver un ressort caché qui céda à ses efforts. Aussitôt la porte tourna d’elle-même et donna libre accès aux voyageurs dans une salle miraculeuse creusée entièrement en dôme dans un marbre si poli qu’il semblait être un miroir d’acier. Des fenêtres de cette salle filtrait, à travers des treillis d’émeraudes et de diamants, une clarté qui nimbait les objets d’une splendeur inouïe. Au centre se dressait, soutenu par des pilastres d’or sur chacun desquels se tenait un oiseau au plumage d’émeraude et au bec de rubis, une sorte d’oratoire tendu d’étoffes de soie et d’or qui venait lentement, par une suite de degrés d’ivoire, prendre contact avec le sol où un magnifique tapis aux couleurs glorieuses, à la laine savante, fleurissait de ses fleurs sans odeur, de son gazon sans sève, et vivait de toute la vie artificielle de ses forêts pleines d’oiseaux et d’animaux saisis dans leur exacte beauté de nature et leurs rigoureuses lignes.
L’émir Moussa et ses compagnons montèrent les degrés de cet oratoire et, arrivés sur la plate-forme, ils s’arrêtèrent dans une surprise qui les cloua muets. Sous un dais de velours piqué de gemmes et de diamants, sur un large lit de tapis de soie superposés reposait une adolescente au teint éblouissant, aux paupières alanguies de sommeil sous leurs longs cils recourbés, et dont la beauté se rehaussait du calme admirable de ses traits, de la couronne d’or qui retenait sa chevelure, du diadème de pierreries qui étoilait son front et du collier humide de perles qui caressaient de leur chair sa peau dorée. À droite et à gauche du lit se tenaient deux esclaves, dont l’un était blanc et l’autre noir, armés d’un glaive nu et d’une pique d’acier. Au pied du lit, il y avait une table de marbre sur laquelle ces paroles étaient gravées :
Je suis la vierge Tadmor, fille du roi des Amalécites. Cette ville est ma ville ! Toi qui as pu pénétrer jusqu’ici, voyageur, tu peux emporter tout ce qui plaît à ton désir. Mais prends garde d’oser, attiré par mes charmes et la volupté, porter sur moi une main violatrice !
Lorsque l’émir Moussa fut revenu de l’émotion que lui avait causée la vue de l’adolescente endormie, il dit à ses compagnons : « Il est temps que nous nous éloignions de ces lieux, maintenant que nous avons vu toutes ces choses étonnantes, et que nous allions vers la mer pour essayer de trouver les vases de cuivre. Vous pouvez toutefois prendre dans ce palais tout ce qui vous tente ; mais gardez-vous de porter la main sur la fille du roi ou de toucher à ses vêtements…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUARANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … mais gardez-vous de porter la main sur la fille du roi ou de toucher à ses vêtements ! »
Alors Taleb ben-Sehl dit : « Ô notre émir, rien dans ce palais ne peut se comparer à la beauté de cette adolescente. Ce serait dommage de la laisser là au lieu de l’emporter à Damas pour l’offrir au khalifat. Ce cadeau vaudrait mieux que tous les vases d’éfrits de la mer ! » L’émir Moussa répondit : « Nous ne pouvons toucher à la princesse. Ce serait l’offenser et attirer sur nous les calamités ! » Mais Taleb s’écria : « Ô notre émir, les princesses ne s’offensent jamais de telles violences, qu’elles soient vivantes ou endormies ! » Et, ayant dit ces paroles, il s’approcha de l’adolescente et voulut l’enlever dans ses bras. Mais soudain il tomba mort, transpercé par les sabres et les piques des deux esclaves qui le frappèrent en même temps sur la tête et dans le cœur.
À cette vue, l’émir Moussa ne voulut point stationner un moment de plus dans ce palais et ordonna à ses compagnons d’en sortir à la hâte pour prendre le chemin de la mer.
Lorsqu’ils furent arrivés sur le rivage, ils virent une quantité d’hommes noirs occupés à sécher leurs filets de pêche, et qui leur rendirent, en arabe, leurs salams selon la formule musulmane. Et l’émir Moussa dit à celui qui était le plus âgé d’entre eux et paraissait être le chef : « Ô vénérable cheikh, nous venons de la part de notre maître le khalifat Abdalmalek ben-Merwân chercher dans cette mer des vases où se trouvent des éfrits du temps du prophète Soleïmân ! Peux-tu nous aider dans nos recherches, et nous expliquer le mystère de cette Ville où tous les êtres sont sans mouvement ! » Le vieillard répondit : « Mon fils, sache d’abord que nous tous ici, les pêcheurs de ce rivage, nous sommes des croyants à la parole d’Allah et à celle de son Envoyé (sur lui la prière et la paix !) ; mais tous ceux qui se trouvent dans cette Ville d’Airain sont enchantés depuis l’antiquité, et resteront dans cet état jusqu’au jour du Jugement. Mais pour ce qui est des vases où se trouvent les éfrits, rien n’est plus facile que de vous les procurer, puisque nous en avons là une provision dont nous nous servons, une fois débouchés, pour faire cuire nos poissons et nos aliments. Nous pouvons vous en donner tant que vous voudrez. Seulement il est nécessaire, avant de les déboucher, de les faire résonner en les frappant avec les mains et d’obtenir de ceux qui les habitent le serment de reconnaître la vérité de la mission de notre prophète Môhammad, pour qu’ils rachètent leur faute première et leur rébellion contre la suprématie de Soleïmân ben-Daoud ! » Puis il ajouta : « Quant à nous, nous voulons également vous donner, comme preuve de notre fidélité à notre maître à tous, l’émir des Croyants, deux Filles de la Mer, que nous avons pêchées aujourd’hui même et qui sont plus belles que toutes les filles des hommes ! »
Et, ayant dit ces paroles, le vieillard remit à l’émir Moussa douze vases de cuivre, scellés de plomb au sceau de Soleïmân, et les deux Filles de la Mer qui étaient deux merveilleuses créatures aux longs cheveux ondulés comme les vagues, à la figure de lune, et aux seins admirables et arrondis et durs comme les galets marins ; mais elles manquaient à partir du nombril des somptuosités charnues qui d’ordinaire sont l’apanage des filles des hommes, et les remplaçaient par un corps de poisson qui se mouvait de droite et de gauche avec les mêmes mouvements que font les femmes quand elles voient qu’on fait attention à leur démarche. Leur voix était fort belle et leur sourire charmant, mais, elles aussi, ne comprenaient et ne parlaient aucun des langages connus, et se contentaient seulement, à toutes les questions qu’on leur adressait, de répondre par le sourire de leurs yeux.
L’émir Moussa et ses compagnons ne manquèrent pas de remercier le vieillard pour sa généreuse bonté et l’invitèrent, lui et tous les pêcheurs qui étaient avec lui, à quitter ce pays et à les accompagner au pays des musulmans, à Damas la ville des fleurs, des fruits et des eaux douces. Le vieillard et les pêcheurs acceptèrent l’offre et tous ensemble revinrent d’abord à la Ville d’Airain où ils prient tout ce qu’ils purent emporter en choses précieuses, en joyaux, en or, et tout ce qui était léger de poids et lourd de prix. Ils redescendirent, ainsi chargés, des murailles d’airain, remplirent leurs sacs et leurs caisses à provisions de ce butin inouï, et reprirent la route de Damas, où ils arrivèrent en sécurité au bout d’un long voyage sans incidents.
Le khalifat Abdalmalek fut charmé à la fois et émerveillé du récit que lui fit l’émir Moussa de cette aventure, et s’écria : « Mon regret est extrême de n’avoir pas été avec vous à cette Ville d’Airain. Mais, avec la permission d’Allah, j’irai moi-même bientôt admirer ces merveilles et essayer d’éclaircir le mystère de cet enchantement ! » Puis il voulut ouvrir de sa propre main les douze vases de cuivre. Il les ouvrit donc l’un après l’autre. Et chaque fois il en sortait une fumée fort dense qui se muait en un éfrit épouvantable, lequel se jetait aussitôt aux pieds du khalifat et s’écriait : « Je demande pardon à Allah et à toi de ma rébellion, ô notre maître Soleïmân ! » Et il disparaissait à travers le plafond, à la surprise de tous les assistants.
Le khalifat fut ensuite non moins émerveillé de la beauté des deux Filles de la Mer. Leur sourire et leur voix et leur langage inconnu ne manquèrent pas de le toucher et de l’émouvoir. Il les fit placer dans un grand bassin, où elles vécurent quelque temps et finirent par mourir de consomption et de chaleur.
Quant à l’émir Moussa, il obtint du khalifat la permission de se retirer à Jérusalem la Sainte pour y passer le reste de sa vie dans la méditation des paroles anciennes qu’il avait pris soin de transcrire sur ses parchemins. Et il mourut dans cette ville, après avoir été l’objet de la vénération de tous les Croyants qui vont encore visiter la koubba où il repose dans la paix et la bénédiction du Très-Haut !
— Et telle est, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, l’histoire de la Ville d’Airain !
« Alors le roi Schahriar dit : « Ce récit, Schahrazade, est vraiment prodigieux ! » Elle dit : « Oui, ô Roi ! mais je ne veux pas laisser passer cette nuit sans te raconter une histoire tout à fait gentille qui arriva à Ibn Al-Mansour ! » Et le roi Schahriar, étonné, dit : « Mais qui est cet Ibn Al-Mansour-là ? Je ne le connais point ! » Alors Schahrazade, avec un sourire, dit : « Voici ! »
HISTOIRE D’IBN AL-MANSOUR
AVEC LES DEUX ADOLESCENTES
Il est déjà venu à notre connaissance, ô Roi fortuné, que le khalifat Haroun Al-Rachid souffrait de fréquentes insomnies provoquées par les soucis que lui causait son royaume. Or, une nuit, il eut beau se tourner dans son lit tantôt sur un côté et tantôt sur l’autre, il ne put réussir à s’assoupir ; et même il fut bien fatigué de l’inutilité de ses tentatives. Il repoussa alors violemment du pied les couvertures et, frappant dans ses mains, il appela Massrour, son porte-glaive, qui veillait toujours à la porte, et lui dit : « Massrour, trouve-moi un moyen de me distraire puisque je ne puis arriver à m’assoupir ! » Il répondit : « Mon seigneur, rien n’égale les promenades nocturnes pour calmer l’âme et assoupir les sens ! Dehors la nuit est belle dans le jardin. Nous descendrons parmi les arbres, parmi les fleurs ; et nous contemplerons les étoiles et leurs incrustations magnifiques, et nous admirerons la beauté de la lune qui lentement s’avance au milieu d’elles et descend jusqu’au fleuve se baigner dans l’eau. » Le khalifat dit : « Massrour, mon âme ne souhaite point voir ces choses, cette nuit ! » Il reprit : « Mon seigneur, tu as dans ton palais trois cents secrètes ; et chaque secrète a, pour elle seule, un pavillon. J’irai les prévenir toutes d’être prêtes ; et alors toi tu viendras derrière les rideaux de chaque pavillon et tu admireras chacune d’elles dans sa simple nudité, d’autant mieux que tu ne trahiras pas ta présence ! » Le khalifat dit : « Massrour, ce palais est mon palais, et ces jeunes femmes sont ma propriété ; mais mon âme, ce soir, ne souhaite rien de tout cela ! » Il reprit : « Mon seigneur, ordonne et je ferai s’assembler entre tes mains les savants, les sages et les poètes de Baghdad. Les sages te diront de belles sentences ; les savants te mettront au courant de leurs découvertes dans les annales ; et les poètes te charmeront l’esprit de leurs rythmes en vers ! » Le khalifat répondit : « Massrour, mon âme ne souhaite rien de tout cela, ce soir ! » Il reprit : « Mon seigneur, dans ton palais il y a de charmants échansons et de délicieux jeunes gens agréables à voir. Je vais, si tu me l’ordonnes, les faire venir pour qu’ils te tiennent compagnie ! » Le khalifat répondit : « Massrour, mon âme ne souhaite rien de tout cela, ce soir ! » Massrour dit : « Mon seigneur, alors coupe-moi la tête ! Ce sera peut-être le seul moyen de dissiper ton ennui…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUARANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Mon seigneur, alors coupe-moi la tête ! Ce sera peut-être le seul moyen de dissiper ton ennui ! » À ces paroles, Al-Rachid se mit à rire aux éclats ; puis il dit : « Hé, Massrour, cela peut-être t’arrivera un jour ! Mais à présent va voir s’il y a encore dans la salle d’entrée quelqu’un de vraiment agréable à voir et à écouter ! »
Aussitôt Massrour sortit exécuter l’ordre, et revint bientôt en disant au khalifat : « Ô émir des Croyants, je n’ai trouvé dehors que ce vieux mauvais sujet d’Ibn Al-Mansour ! » Et Al-Rachid demanda : « Quel Ibn Al-Mansour ? Est-ce bien Ibn Al-Mansour de Damas ? » Le chef des eunuques dit : « Lui-même, le vieux malicieux ! » Al-Rachid dit : « Fais-le vite entrer ! » Et Massrour introduisit Ibn Al-Mansour qui dit : « Le salam sur toi, ô émir des Croyants ! » Il lui rendit le salam et dit : « Ya Ibn Al-Mansour, mets-moi au courant d’une de tes aventures ! » Il répondit : « Ô émir des Croyants, dois-je t’entretenir d’une chose que j’aie vue par moi-même ou d’une chose que j’aie entendue seulement ? » Le khalifat répondit : « Si tu as vu quelque chose de tout à fait étonnant hâte-toi de m’en parler, car les choses que l’on a vues sont de beaucoup préférables à celles qu’on a seulement entendu raconter ! » Il dit : « Alors, ô émir des Croyants, donne-moi toute ton ouïe et une attention sympathique ! » Le khalifat répondit : « Ya Ibn Al-Mansour, me voici prêt à t’écouter de mon oreille, à te voir de mon œil et à te donner une attention d’un cœur sympathique ! » Alors Ibn Al-Mansour dit :
« Sache, ô émir des Croyants, que chaque année j’allais à Bassra passer quelques jours auprès de l’émir Môhammad Al-Haschami, ton lieutenant dans cette ville. Une année, j’allai donc à Bassra, selon mon habitude, et, en arrivant au palais, je vis l’émir qui était sur le point de monter à cheval pour aller à la chasse à courre. Lorsqu’il me vit, il ne manqua pas, après les salams de bienvenue, de m’inviter à l’accompagner ; mais je lui dis : « Excuse-moi, seigneur ; car vraiment la vue seule d’un cheval m’arrête la digestion, et c’est tout au plus si je sais me tenir à âne. Je ne puis aller à la chasse à courre à dos d’âne ! » L’émir Môhammad m’excusa, mit à ma disposition tout le palais et chargea ses officiers de me servir avec tous les égards, et de ne me laisser manquer de rien durant tout mon séjour. Et c’est ce qu’ils firent.
Lorsqu’il fut parti, moi je me dis : « Par Allah ! Ya Ibn Al-Mansour, voici des années et des années que tu viens régulièrement de Baghdad à Bassra, et jusqu’aujourd’hui tu t’es contenté, pour toutes promenades en ville, d’aller du palais au jardin et du jardin au palais. Cela n’est pas suffisant pour ton instruction. Va donc, maintenant que tu en as tout le loisir, essayer de voir quelque chose d’intéressant par les rues de Bassra. D’ailleurs il n’y a rien de préférable à la marche pour aider à la digestion ; et ta digestion est bien lourde ; et tu engraisses et tu te gonfles comme une outre ! » Alors moi j’obéis à la voix de mon âme offusquée de mon embonpoint, et sur l’heure je me levai, je mis mes plus beaux habits, et sortis du palais pour errer un peu, de ci, de là, à l’aventure.
Or tu sais bien, ô émir des Croyants, qu’il y a dans Bassra soixante-dix rues, et que chaque rue est longue de soixante-dix parasanges en mesure de l’Irak. Aussi moi, au bout d’un certain temps, je me vis soudain perdu au milieu de tant de rues, et, dans ma perplexité, je me mis à marcher plus vite, n’osant pas demander ma route de peur d’être tourné en ridicule. Cela fit que je me mis à transpirer beaucoup ; et j’eus également bien soif ; et je crus que le soleil terrible allait indubitablement liquéfier la graisse sensible de ma peau.
Je me hâtai alors de prendre la première ruelle de traverse pour chercher à me mettre un peu à l’ombre, et j’arrivai de la sorte dans un cul-de-sac où se trouvait l’entrée d’une grande maison de fort belle apparence. Cette entrée était à moitié cachée par une portière en soie rouge, et donnait sur un grand jardin qui précédait la maison. De chaque côté, il y avait un banc de marbre ombragé par le feuillage d’une vigne grimpante, et qui m’invita à m’y asseoir pour prendre haleine.
Pendant que je m’essuyais le front et soufflais de chaleur, j’entendis venir du jardin une voix de femme qui chantait ces paroles sur un air plaintif :
« Depuis le jour où m’a quittée mon jeune daim, mon cœur est devenu l’asile de la douleur.
Est-ce donc, comme il le prétend une faute si lourde de se laisser aimer par les jeunes filles ? »
La voix qui chantait était si belle et je fus tellement intrigué par ces paroles que je dis en mon âme : « Si la propriétaire de cette voix est aussi belle que ce chant me le donne à croire, elle est une bien merveilleuse créature !» Alors moi je me levai et m’approchai de l’entrée dont je relevai tout doucement le rideau ; et petit à petit je regardai, de façon à ne pas donner l’éveil. Et j’aperçus, au milieu du jardin, deux adolescentes dont l’une semblait être la maîtresse et l’autre l’esclave. Et toutes deux étaient extraordinaires de beauté. Mais la plus belle était celle justement qui chantait ; et l’esclave l’accompagnait du luth. Et moi je crus voir la lune elle-même descendue dans le jardin, à son quatorzième jour ; et je me rappelai, à son sujet, ces vers du poète :
Babylone la voluptueuse brille dans ses yeux qui tuent par leurs cils recourbés plus sûrement que les grandes épées et le fer trempé des lances.
Quand retombent ses cheveux noirs sur son cou de jasmin, je me demande si c’est la nuit qui vient la saluer !
Mais sur sa poitrine sont-ce deux petites gourdes en ivoire ou des grenades ou ses seins ? Et sous sa chemise qu’est-ce qui ondule ainsi ? Est-ce sa taille ou du sable mouvant ?
Et elle me fit également penser à ces vers du poète :
Ses paupières sont deux pétales de narcisse ; son sourire est comme l’aurore ; sa bouche est scellée par deux rubis, — ses lèvres délicieuses ; et tous les jardins du paradis dodelinent sous sa tunique.
Alors moi, ô émir des Croyants, je ne pus m’empêcher de m’exclamer : « Ya Allah ! ya Allah ! » et je restai là, immobile, mangeant et buvant des yeux des charmes si miraculeux. Aussi l’adolescente, ayant tourné la tête de mon côté, m’aperçut et vivement abaissa son petit voile de visage ; puis, avec tous les signes d’une grande indignation, dépêcha vers moi la jeune esclave, la joueuse de luth, qui accourut et, après m’avoir dévisagé, me dit : « Ô cheikh, n’as-tu pas honte de regarder ainsi les femmes dans leur maison ? Et ta vieillesse et ta barbe blanche ne te conseillent-elles donc pas le respect des choses honorables ? » Je répondis, à haute voix de façon à être entendu de l’adolescente assise : « Ô ma maîtresse, tu as raison, ma vieillesse est notoire, mais pour ce qui est de ma honte, c’est autre chose…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUARANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … mais pour ce qui est de ma honte, c’est autre chose ! »
Lorsque l’adolescente eut entendu ces paroles, elle se leva et vint rejoindre son esclave pour me dire, émue à l’extrême : « Hé ! y a-t-il donc honte plus grande sur tes cheveux blancs, ô cheikh, que l’action de t’arrêter avec une telle impudence à la porte d’un harem qui n’est pas ton harem, et d’une demeure qui n’est pas ta demeure ? » Je m’inclinai et répondis : « Par Allah ! ô ma maîtresse, la honte sur ma barbe n’est pas considérable, je le jure sur ta vie ! Mon intrusion ici a une excuse ! » Elle demanda : « Et quelle est ton excuse ? » Je répondis : « Je suis un étranger altéré par une soif dont je vais mourir ! » Elle répondit : « Nous acceptons cette excuse, car, par Allah ! elle est valable ! » Et aussitôt elle se tourna vers sa jeune esclave et lui dit : « Ma gentille, cours vite lui chercher à boire ! »
La petite disparut pour revenir au bout d’un moment avec une tasse en or sur un plateau et un foulard de soie verte. Elle m’offrit la tasse qui était remplie d’eau fraîche parfumée agréablement au musc pur. Moi je la pris et me mis à boire fort lentement et à longs traits en jetant à la dérobée des regards admiratifs à l’adolescente principale, et des regards notoirement reconnaissants à toutes les deux. Au bout d’un certain temps de ce manège, je rendis la tasse à la jeune fille qui m’offrit alors la serviette de soie en m’invitant à m’essuyer la bouche. Je m’essuyai la bouche, je lui rendis la serviette qui était délicieusement parfumée au sandal, et je ne bougeai pas de ma place.
Lorsque la belle adolescente vit mon immobilité dépasser les limites permises, elle me dit d’un ton gêné : « Ô cheikh, qu’attends-tu encore pour t’en retourner en ta voie sur le chemin d’Allah ? » Je répondis d’un air songeur : « Ô ma maîtresse, j’ai des pensées qui me préoccupent l’esprit extrêmement, et tu me vois plongé dans des réflexions que je ne puis arriver à résoudre par moi-même ! » Elle me demanda : « Et quelles sont ces réflexions ? » Je dis : « Ô ma maîtresse, je réfléchis au revers des choses et à la marche des événements qui sont les fruits du temps ! » Elle me répondit : « Certes, ce sont là de graves pensées, et nous avons tous à déplorer quelque méfait du temps ! Mais toi, ô cheikh, qu’est-ce qui a pu t’inspirer de pareilles réflexions à la porte de notre maison ? » Je dis : « Justement, ô ma maîtresse, je pensais au maître de cette maison ! Je me le rappelle bien maintenant ! Il m’avait dit autrefois demeurer dans cette ruelle composée d’une seule maison avec jardin. Oui, par Allah ! le propriétaire de cette maison était mon meilleur ami ! » Elle me demanda : « Alors tu dois bien te rappeler le nom de ton ami ? » Je dis : « Certes, ô ma maîtresse ! Il s’appelait Ali ben-Môhammad, et était le syndic respecté de tous les bijoutiers de Bassra ! Il y a des années que je l’ai perdu de vue, et je pense qu’il est maintenant dans la miséricorde d’Allah ! Permets-moi donc, ô ma maîtresse, de te demander s’il a laissé de la postérité ? »
À ces paroles, les yeux de l’adolescente se mouillèrent de larmes, et elle dit : « Que la paix et les grâces d’Allah soient sur le syndic Ali ben-Môhammad ! Sache, ô cheikh, puisque tu as été son ami, que le défunt syndic a laissé une fille nommée Badr, comme seule descendance. Et c’est elle qui est l’unique héritière de ses biens et de ses immenses richesses ! » Moi je m’écriai : « Par Allah ! la fille bénie de mon ami ne peut être que toi-même, ô ma maîtresse ! » Elle sourit et répondit : « Par Allah ! tu l’as deviné ! » Je dis : « Qu’Allah accumule sur toi ses bénédictions, ô fille d’Ali ben-Môhammad ! Mais, autant que j’en puis juger à travers la soie qui te voile le visage, ô lune, il me semble que tes traits sont empreints d’une grande tristesse ! Ne crains pas de m’en révéler la cause ; car peut-être qu’Allah m’envoie pour que j’essaie de porter remède à cette douleur qui altère ta beauté ! » Elle répondit : « Mais comment puis-je te parler de ces choses intimes, puisque tu ne m’as encore dit ni ton nom ni ta qualité ! » Je m’inclinai et répondis : « Je suis ton esclave Ibn Al-Mansour, de Damas, un de ceux que notre maître le khalifat Haroun Al-Rachid honore de son amitié et a choisis comme ses compagnons intimes ! »
À peine eus-je prononcé ces paroles, ô émir des Croyants, que Sett Badr me dit : « Sois le bienvenu dans ma maison, ô cheikh Ibn Al-Mansour, et puisses-tu trouver ici l’hospitalité large et amicale ! » Et elle m’invita à l’accompagner et à entrer m’asseoir dans la salle de réception.
Alors tous trois nous entrâmes dans la salle de réception, au fond du jardin, et lorsque nous fûmes assis, et, après les rafraîchissements d’usage, qui furent exquis, Sett Badr me dit : « Puisque tu veux, ô cheikh Ibn Al-Mansour, savoir la cause d’une peine que tu as devinée sur mes traits, promets-moi le secret et la fidélité ! » Je répondis : « Ô ma maîtresse, le secret est dans mon cœur comme dans un coffret d’acier dont la clef est introuvable ! » Elle me dit alors : « Écoute donc mon histoire, ô cheikh ! » Et, après que la jeune esclave, si gentille, m’eut encore offert une cuillerée de confiture de roses, Sett Badr dit :
« Sache, ô Ibn Al-Mansour, que je suis amoureuse et que mon amoureux est loin de moi ! Voilà toute mon histoire ! »
Et Sett Badr, après ces paroles, poussa un grand soupir et se tut. Et moi je lui dis : « Ô ma maîtresse, tu es douée de la beauté parfaite, et celui que tu aimes doit être parfaitement beau ! Comment s’appelle-t-il ? » Elle me dit : « Oui, Ibn Al-Mansour, mon amoureux est, comme tu l’as dit, parfaitement beau. C’est l’émir Jobaïr, chef de la tribu des Bani-Schaïbân. Il est sans aucun doute l’adolescent le plus admirable de Bassra et de l’Irak ! » Je dis : « Ô ma maîtresse, il ne peut en être autrement. Mais votre mutuel amour a-t-il été en paroles seulement, ou bien vous en êtes-vous donné des preuves intimes par diverses rencontres prolongées ou riches de conséquences ? » Elle dit : « Certes, nos rencontres eussent été riches de conséquences, si leur longue durée eût pu suffire à lier les cœurs ! Mais l’émir Jobaïr m’a été infidèle sur un simple soupçon ! »
À ces paroles, ô émir des Croyants, moi je m’écriai : « Hé ! peut-on soupçonner le lys d’aimer la boue si la brise l’incline vers le sol ! Même si les soupçons de l’émir Jobaïr sont fondés, ta beauté est l’excuse vivante, ô ma maîtresse ! » Elle sourit et me dit : « Encore, ô cheikh, s’il s’était agi d’un homme ! Mais l’émir Jobaïr m’accuse d’aimer une jeune fille, celle-ci même qui est sous tes yeux, la gentille, la douce qui nous sert ! » Je m’écriai : « J’en demande pardon à Allah pour l’émir, ô ma maîtresse ! Que le Malin soit confondu ! Et comment les femmes peuvent-elles s’entr’aimer ? Mais veux-tu, du moins, me dire sur quoi l’émir a basé ses soupçons ? » Elle répondit :
« Un jour, après avoir pris mon bain dans le hammam de ma maison, je m’étais étendue sur ma couche et livrée aux mains de mon esclave favorite, cette jeune fille que voici, pour les soins de ma toilette et pour me faire peigner les cheveux. La chaleur était suffocante et mon esclave, pour me donner de la fraîcheur, avait fait glisser les grandes serviettes qui drapaient mes épaules et couvraient mes seins et s’étais mise à arranger les tresses de ma chevelure. Lorsqu’elle eut fini, elle me regarda et, m’ayant trouvée belle ainsi, elle m’entoura le cou de ses bras, et me baisa sur la joue en me disant : « Ô ma maîtresse, je voudrais être un homme pour t’aimer encore plus que je ne fais ! » Et, par mille jeux aimables, elle essayait de m’amuser, la gentille. Et voici que juste à ce moment entra l’émir ; il nous jeta à toutes deux un regard singulier, et ressortit brusquement, pour m’envoyer quelques instants après un billet sur lequel ces mots étaient tracés : « L’amour ne peut rendre heureux que lorsqu’il est sans partage ! » Et depuis ce jour-là je ne l’ai plus revu ; et il n’a jamais voulu m’envoyer de ses nouvelles, ya Ibn Al-Mansour ! »
Alors moi je lui demandai : « Mais vous étiez-vous unis par un contrat de mariage ? » Elle répondit : « Et pourquoi faire, un contrat ? Nous n’étions unis que par notre volonté, sans l’intervention du kâdi et des témoins ! » Je dis : « Alors, ô ma maîtresse, si tu veux me le permettre, moi je veux être le trait d’union entre vous deux, simplement pour le plaisir de savoir de nouveau ensemble deux êtres de choix ! » Elle s’écria : « Béni soit Allah qui nous amis sur ta route, ô cheikh au visage blanc ! Ne crois pas que tu vas obliger une personne oublieuse qui ignore le prix des bienfaits ! Je vais donc sur l’heure écrire de ma main à l’émir Jobaïr une lettre que tu lui remettras en tâchant de lui faire entendre raison. » Et elle dit à sa favorite : « Ma gentille, apporte-moi l’encrier et une feuille de papier ! » Elle les lui apporta, et Sett Badr écrivit :
« Mon bien-aimé, pourquoi cette durée dans la séparation ? Ne sais-tu que la douleur bannit le sommeil loin de mes yeux, et que ton image, lorsqu’en songe elle m’apparaît, n’est plus reconnaissable, tant elle est altérée ?
« Dis ! je t’en conjure, pourquoi avoir laissé ta porte ouverte à mes calomniateurs ? Lève-toi, secoue la poussière des mauvaises pensées, et reviens-moi sans délai ! Quel jour de fête pour nous deux, celui qui verra notre réconciliation ! »
Lorsqu’elle eut fini d’écrire cette lettre, elle la plia, la cacheta, et me la remit…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT CINQUANTIÈME NUIT
Elle dit :
…Lorsqu’elle eut fini d’écrire cette lettre, elle la plia, la cacheta et me la remit ; et, en même temps, elle glissa dans ma poche, sans me donner le temps de l’en empêcher, une bourse qui contenait mille dinars d’or et que je me décidai à garder en souvenir des bons offices qu’autrefois j’avais rendus au digne syndic, son défunt père, et en prévision de l’avenir. Je pris alors congé de Sett Badr et je me dirigeai vers la demeure de Jobaïr, émir des Bani-Schaïbân, dont j’avais également connu le père, mort depuis de longues années.
Lorsque j’arrivai au palais de l’émir Jobaïr, on m’apprit qu’il était également à la chasse, et j’attendis son retour. Il ne tarda pas à arriver et, dès qu’il eut appris mon nom et mes titres, il me fit prier d’accepter son hospitalité et de considérer sa maison comme la mienne propre. Et lui-même vint bientôt me recevoir en personne.
Or moi, ô émir des Croyants, en constatant la beauté accomplie du jeune homme, je demeurai interdit, et je sentis ma raison me quitter définitivement. Et lui, en voyant que je ne bougeais pas, crut que c’était la timidité qui me retenait, et il vint vers moi en me souriant et, selon l’usage, m’embrassa ; et moi aussi je l’embrassai, et crus à ce moment embrasser le soleil, la lune et l’univers entier avec tout son contenu. Et, comme le temps était venu de nous restaurer, l’émir Jobaïr me prit par le bras et me fit m’asseoir à côté de lui sur le matelas. Et aussitôt les esclaves apportèrent devant nous la table.
C’était une table couverte de vaisselle du Khorassân, en or et en argent, et de tous les mets frits ou rôtis que le palais, le nez et les yeux pouvaient souhaiter, vraiment. Il y avait là, entre autres choses admirables, des oiseaux farcis de pistaches et de raisins, et des poissons assis sur des galettes soufflées, et surtout une salade de pourpier dont le seul aspect me remplissait d’eau la bouche. Je ne parle pas des autres choses, par exemple un merveilleux riz à la crème de buffle, où j’eusse voulu plonger ma main jusqu’au coude, ni de la confiture de carottes aux noix, que j’aime tant — ô ! celle-ci, je n’en doute pas, me fera mourir quelque jour — ni des fruits ni des boissons.
Pourtant, ô émir des Croyants, je le jure sur la noblesse de tes ancêtres ! moi je comprimai les sollicitations de mon âme, et je ne pris pas une bouchée. Au contraire ! j’attendis que mon hôte m’eût invité beaucoup à tendre la main, et je lui dis : « Par Allah ! j’ai fait vœu de ne toucher à aucun des mets de ton hospitalité, émir Jobaïr, avant que tu n’aies accédé à une prière qui est l’objet même de ma visite dans ta maison ! » Il me demanda : « Puis-je au moins savoir, ô mon hôte, avant de m’engager à une chose si grave et qui risque de te faire renoncer à mon hospitalité, quel est l’objet de cette visite ? » Moi, pour toute réponse, je tirai de mon sein la lettre et la lui tendis.
Il la prit, l’ouvrit et la lut. Mais aussitôt il la déchira, en jeta les morceaux à terre, les piétina et me dit : « Ya Ibn Al-Mansour ! demande-moi tout ce que tu veux, et cela te sera accordé à l’instant. Mais ne me parle pas du sujet de cette lettre, à laquelle je n’ai aucune réponse à faire ! »
Alors moi je me levai sur l’heure et voulus m’en aller ; mais il me retint en s’attachant à mes vêtements, et me supplia de rester, en me disant : « Ô mon hôte ! si tu savais le motif de mon refus, tu n’insisterais pas un instant de plus ! D’ailleurs, ne crois point que tu sois le premier auquel on aurait confié une pareille mission ! Et, si tu veux, je vais te dire exactement les paroles qu’elle t’a chargé de me répéter ! » Et aussitôt il me répéta les paroles en question, absolument comme s’il avait été là au moment où on les avait prononcées. Puis il ajouta : « Crois-moi ! ne t’occupe plus de cette affaire-là ! Et reste te reposer dans ma maison tant que le souhaitera ton âme ! »
Ces paroles me décidèrent à rester. Et je passai le reste de la journée et toute la soirée à manger, à boire et à m’entretenir avec l’émir Jobaïr. Cependant comme je n’entendais pas de chants ni de musique, je m’étonnai de constater cette exception à des usages si établis dans les festins ; et je me décidai à la fin à en témoigner ma surprise au jeune émir. Je vis aussitôt son visage s’assombrir et je remarquai en lui une grande gêne ; puis il me dit : « Depuis longtemps j’ai supprimé les chants et la musique de mes festins. Toutefois, puisque tel est ton désir, je vais te satisfaire ! » Et à l’instant il fit appeler une de ses esclaves qui vint avec un luth indien enveloppé d’un étui de satin, et s’assit devant nous pour aussitôt préluder sur vingt et un tons différents. Elle revint ensuite au premier ton, et chanta :
« Les filles du destin, les cheveux défaits, pleurent et gémissent dans la douleur, ô mon âme !
La table est pourtant chargée des mets les plus exquis, les roses sont odorantes, les narcisses nous sourient et l’eau rit dans le bassin.
Ô mon âme, âme triste, arme-toi de courage. Un jour l’espoir, de nouveau, luira dans les yeux, et tu boiras à la coupe du bonheur ! »
Elle passa ensuite à un ton plus plaintif, et chanta :
« Celui qui n’a pas savouré les délices de l’amour et goûté son amertume, ne sait ce qu’il perd par la perte d’un ami !
Celui que n’ont pas atteint les blessures de l’amour, ne peut savoir les tourments délectables qu’elles procurent.
Où sont les nuits heureuses aux côtés de mon ami, nos jeux aimables, nos lèvres unies, le miel de sa salive ! Ah ! douceur ! ah ! douceur !
Nos nuits jusqu’au matin, nos jours jusqu’au soir ! Ô passé ! Que faire contre les décrets d’un destin farouche, ô cœur brisé ! »
À peine la chanteuse eut-elle laissé expirer ces dernières plaintes, que je vis mon jeune hôte tomber évanoui en poussant un cri douloureux. Et l’esclave me dit : « Ô cheikh, c’est ta faute ! Car il y a longtemps que nous évitons de chanter devant lui, à cause de l’état d’émotion où cela le met et de l’agitation que lui procure tout poème sur l’amour ! » Et moi j’eus beaucoup de regret d’avoir été la cause d’un ennui pour mon hôte et, sur l’invitation de l’esclave, je me retirai dans ma chambre, pour ne point le gêner davantage par ma présence.
Le lendemain, au moment où je me disposais à partir et où je priais l’un des serviteurs de transmettre à son maître mes remercîments pour cette hospitalité, un esclave vint qui me remit une bourse de mille dinars de la part de l’émir, en me priant de l’accepter pour le dérangement, et en me disant qu’il était chargé de recevoir mes adieux. Alors moi, n’ayant guère réussi dans mon ambassade, je quittai la maison de Jobaïr et retournai vers celle dont j’étais l’envoyé.
En arrivant au jardin, je trouvai Sett Badr à la porte qui m’attendait, et qui, sans me donner le temps d’ouvrir la bouche, me dit : « Ya Ibn Al-Mansour, je sais que tu n’as guère réussi dans ta mission ! » Et elle me fit, point par point, le récit de tout ce qui s’était passé entre moi et l’émir Jobaïr, et si exactement que je supposai à sa solde des espions qui lui rendaient compte de ce qui pouvait l’intéresser. Pourtant je lui demandai : « Comment se fait-il, ô ma maîtresse, que tu sois si bien informée ? Étais-tu donc là même, sans que l’on t’ait aperçue ? » Elle me dit : « Ya Ibn Al-Mansour, sache que les cœurs des amants ont les yeux qui voient ce que les autres ne peuvent soupçonner ! Mais tu n’es pour rien dans le refus, je le sais. C’est ma destinée ! » Puis elle ajouta, en levant les yeux au ciel : « Ô Seigneur, maître des cœurs, souverain des âmes, fais que désormais je sois aimée sans jamais aimer ! Fais que ce qui reste d’amour en ce cœur pour Jobaïr, soit déversé, pour son tourment, dans le cœur de Jobaïr ! Fais qu’il revienne me supplier de l’écouter, et donne-moi de le faire souffrir ! »
Après quoi, elle me remercia pour ce que j’avais voulu faire pour elle, et me donna congé. Et moi je retournai au palais de l’émir Môhammad, et de là je revins à Baghdad.
Or, l’année suivante je dus, selon mon habitude, aller de nouveau à Bassra pour mes affaires ; car je dois te dire, ô émir des Croyants, que l’émir Môhammad était mon débiteur, et je n’avais que ce moyen de voyages réguliers pour arriver à lui faire payer l’argent qu’il me devait. Or moi, le lendemain de mon arrivée, je me dis : « Par Allah ! il me faut savoir la suite de l’aventure des deux amants ! » Et je me rendis d’abord à la maison de Sett Badr.
Je trouvai la porte du jardin fermée et je fus affecté de la tristesse émanant du silence d’alentour. Je regardai alors, à travers le grillage de la porte, et, au milieu de l’allée, sous un saule aux branches en larmes, je vis un tombeau de marbre encore tout neuf dont je ne réussis guère, à cause de l’éloignement, à lire l’inscription funéraire. Et je me dis : « Elle n’est donc plus ! Sa jeunesse a été fauchée ! Quel dommage qu’une pareille beauté soit à jamais perdue ! Le chagrin a dû la déborder et lui noyer le cœur…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT CINQUANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … Quel dommage qu’une pareille beauté soit à jamais perdue ! Le chagrin a dû la déborder et lui noyer le cœur ! »
Je me décidai alors, la poitrine rétrécie d’angoisse, à me rendre au palais de l’émir Jobaïr. Là un spectacle bien plus attristant m’attendait. Tout était désert ; les murs tombaient en ruines ; le jardin était desséché et l’on n’y voyait pas trace d’un soin quelconque. La porte du palais n’était gardée par aucun esclave, et il n’y avait là pas un être vivant qui pût me renseigner sur ceux qui habitaient à l’intérieur. À ce spectacle, moi je dis en mon âme : « Lui aussi a dû mourir ! » Puis, bien triste, bien en peine, je m’assis à la porte et improvisai cette élégie :
« Ô demeure ! je m’arrête à ton seuil pour pleurer avec tes pierres au souvenir de l’ami qui n’est plus.
Où est-il, l’hôte généreux dont l’hospitalité s’étendait largement sur les voyageurs ?
Où sont les amis pleins de gaieté qui t’habitaient, palais, au temps de ta splendeur ?
Fais comme eux, toi qui passes ; mais du moins n’oublie pas les bienfaits dont les traces existent encore malgré les ruines du temps ! »
Pendant que je me laissais aller ainsi à exprimer la tristesse qui était en moi, parut un esclave noir qui s’avança vers moi et me dit, sur un ton violent : « Tais-toi, vieux cheikh ! Puisses-tu avoir ta vie coupée ! Pourquoi dis-tu des choses funèbres à notre porte ? » Je répondis : « J’improvisais simplement des vers à la mémoire d’un ami d’entre mes amis qui habitait cette maison et s’appelait Jobaïr, de la tribu des Bani-Schaïbân ! » L’esclave répliqua : « Le nom d’Allah sur lui et autour de lui ! Prie pour le Prophète, ô cheikh ! Mais pourquoi dis-tu que l’émir Jobaïr est mort ! Glorifié soit Allah ! Notre maître est toujours en vie, au sein des honneurs et des richesses ! » Moi je m’écriai : « Mais pourquoi donc cet air de tristesse épars sur la maison et le jardin ? » Il répondit : « À cause de l’amour ! L’émir Jobaïr est en vie, mais c’est comme s’il était déjà au nombre des morts ! Il est étendu sur son lit sans mouvement ; et quand il a faim il ne dit jamais : « Donnez-moi à manger ! » et quand il a soif il ne dit jamais : « Donnez-moi à boire ! »
À ces paroles du nègre, je dis : « Va vite, par Allah sur toi ! ô visage blanc, lui faire part de mon désir de le revoir ! Dis-lui : « C’est Ibn Al-Mansour qui attend à la porte ! » Le nègre s’en alla et, au bout de quelques instants revint me prévenir que son maître pouvait me voir. Il me fit entrer en me disant : « Je te préviens qu’il n’entendra rien de ce que tu lui diras, à moins que tu ne saches le toucher par certaines paroles ! »
Je trouvai, en effet, l’émir Jobaïr étendu sur sa couche, le regard perdu dans le vide, le visage bien pâle et amaigri, et méconnaissable vraiment. Je le saluai aussitôt ; mais il ne me rendit pas le salam. Je lui parlai, mais il ne me répondit pas. Alors l’esclave me dit dans l’oreille : « Il ne comprend que le langage des vers ! Pas autre chose ! » Or par Allah ! moi je ne demandais pas mieux, pour entrer en causerie avec lui. Je me recueillis donc un instant ; puis, d’une voix distincte, j’improvisai ces vers :
« L’amour de Sett Badr te tient-il encore à l’âme, ou as-tu trouvé le repos après les transes de la passion ?
Passes-tu toujours tes nuits dans les veilles, ou bien tes paupières connaissent-elles enfin le sommeil ?
Si tes larmes suivent encore leur cours, si tu nourris encore ton âme de désolation, sache que tu atteindras le comble de la folie ! »
Lorsqu’il entendit ces vers, il ouvrit les yeux et me dit : « Sois le bienvenu, Ibn Al-Mansour ! Les choses ont pris en moi une tournure grave ! » Je répondis aussitôt : « Puis-je au moins, seigneur, t’être de quelque utilité ? » Il dit : « Toi seul peux encore me sauver ! Mon intention est d’envoyer une lettre par ton entremise à Sett Badr, car tu es capable de lui persuader de me répondre ! » Moi je répondis : « Sur ma tête et sur mon œil ! » Alors, ranimé, il se leva sur son séant, déroula une feuille de papier sur la paume de sa main, prit un calam et écrivit :
« Ô dure bien-aimée, j’ai perdu la raison, et je roule dans le désespoir. J’avais, avant ce jour, cru chose futile l’amour, chose aisée, chose légère. Mais je vois, hélas ! par mon naufrage sur ses flots, que c’est, pour qui s’y aventure, une mer terrible et démontée. Je reviens à toi le cœur meurtri, et j’implore le pardon du passé. Aie pitié de moi, et souviens-toi de notre amour ! Si tu veux ma mort, oublie la générosité. »
Il cacheta alors cette lettre et me la remit. Moi, bien que je fusse ignorant du sort de Sett Badr, je n’hésitai pas : je pris la lettre et me rendis au jardin. Je traversai la cour et entrai, sans avertir, dans la salle de réception.
Or, quel ne fut point mon étonnemement d’apercevoir, assises sur les tapis, dix jeunes esclaves blanches au milieu desquelles se trouvait, pleine de vie et de santé, mais en habits de deuil, Sett Badr, tel un pur soleil, devant mes regards étonnés. Je me hâtai pourtant de m’incliner en lui souhaitant la paix ; et elle, sitôt qu’elle m’eut vu entrer, me sourit, me rendit mon salam et me dit : « Sois le bienvenu, Ibn Al-Mansour ! Assieds-toi ! La maison est tienne ! » Alors moi je lui dis : « Que tous les malheurs soient loin d’ici, ô ma maîtresse ! Mais pourquoi te vois-je ainsi en habits de deuil ? » Elle répondit : « Oh ! ne m’interroge pas, Ibn Al-Mansour ! Elle est morte, la gentille ! Tu as pu voir, dans le jardin, la tombe où elle dort ! » Et elle fondit en larmes, tandis que toutes ses compagnes essayaient de la consoler.
Je crus d’abord de mon devoir de garder le silence, puis je dis : « Qu’Allah l’ait en sa miséricorde ! Et qu’en retour, sur toi-même, ô ma maîtresse, soit déversé tout l’arriéré que la vie devait encore à cette jeune fille, ta douce favorite, que tu pleures ! Car c’est certainement elle-même qui est morte ! » Elle dit : « C’est elle-même, cette pauvre ! »
Alors moi, je profitai de cet état d’attendrissement ou elle était et lui remis, l’ayant tirée de ma ceinture, la lettre. Et j’ajoutai : « De ta réponse, ô ma maîtresse, dépendra sa vie ou sa mort ! Car, en vérité, l’attente de cette réponse est la seule chose qui l’attache encore à la terre ! » Elle prit la lettre, l’ouvrit, la lut, sourit et dit : « Est-il donc maintenant arrivé à un tel état de passion, lui qui ne voulait même pas lire mes lettres autrefois ? Il m’a suffi depuis lors de garder le silence et d’user de dédain pour le voir me revenir plus enflammé que jamais ! » Moi je répondis : « Certes, tu as raison ! Oui, certes ! Tu as même le droit d’en parler avec plus d’amertume…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT CINQUANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Tu as même le droit d’en parler avec plus d’amertume. Mais le pardon des torts est l’apanage des âmes généreuses. Et puis que ferais-tu dans ce palais, seule avec ta douleur, puisqu’elle est morte, la gentille amie qui te consolait par sa douceur ? » À ces paroles, je vis ses yeux se remplir de larmes, et elle-même rester songeuse pendant une heure de temps. Après quoi, elle me dit : « Ibn Al-Mansour, je crois que tu as dit vrai. Je vais lui répondre ! »
Alors, ô émir des Croyants, elle prit du papier et écrivit une lettre dont jamais les meilleurs scribes de ton palais ne sauraient égaler l’éloquence émue. Je ne me souviens pas des termes exacts de cette lettre ; mais, en substance, il y était dit :
« Malgré le désir, ô mon amant, jamais je n’ai compris le motif de notre séparation. Il est possible, à bien réfléchir, que j’aie été fautive dans le passé. Mais le passé n’est plus, et toute jalousie doit mourir avec la victime de la Séparatrice.
« Laisse-moi maintenant te mettre sous mes paupières pour reposer mes yeux mieux que ne le ferait le sommeil.
« Alors ensemble nous boirons à nouveau les gorgées désaltérantes ; et, si nous nous grisons, nul ne pourra nous blâmer. »
Puis elle cacheta cette lettre et me la remit ; et moi je lui dis : « Par Allah ! voilà de quoi apaiser la soif de l’altéré et guérir les maux de l’infirme ! » Et je me disposai à prendre congé pour aller porter la bonne nouvelle à celui qui l’attendait, quand elle m’arrêta encore pour me dire : « Ya Ibn Al-Mansour, tu peux également ajouter que cette nuit sera sur nous deux une nuit de bénédiction ! » Et moi, plein de joie, je courus chez l’émir Jobaïr, que je trouvai les yeux rivés à la porte par où je devais entrer.
Lorsqu’il eut parcouru la lettre et en eut compris la portée, il poussa un grand cri de joie et tomba évanoui. Il ne tarda pas à revenir à lui, et me demanda, encore bien anxieux : « Dis-moi, est-ce que c’est elle-même qui a rédigé cette lettre ? Et l’a-t-elle écrite avec sa main ? » Je lui répondis : « Par Allah ! je ne savais pas jusqu’ici que l’on pût quelquefois écrire avec le pied ! »
Or, ô émir des Croyants, moi j’avais à peine prononcé ces mots que nous entendîmes un cliquetis de bracelets derrière la porte, et un bruit de grelots et de soieries, pour, un instant après, voir apparaître l’adolescente en personne.
Comme la joie ne peut se décrire dignement par la parole, je n’essaierai point une tentative vaine. Je te dirai seulement, ô émir des Croyants, que les deux amants coururent l’un vers l’autre et s’embrassèrent dans le ravissement, leurs bouches unies en silence.
Lorsqu’ils sortirent de cette extase, Sett Badr resta debout en refusant de s’asseoir, malgré les instances de son ami. Cela m’étonna beaucoup et je lui en demandai la raison. Elle me dit : « Je m’assiérai seulement lorsque notre pacte sera exécuté ! » Je dis : « Quel pacte, ô ma maîtresse ? » Elle dit : « C’est un pacte qui ne regarde que les amoureux ! » Et elle se pencha vers l’oreille de son ami et lui parla à voix basse. Il répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et il appela un de ses esclaves auquel il donna un ordre ; et l’esclave disparut.
Quelques instants après, je vis entrer le kâdi et les témoins qui dressèrent le contrat de mariage des deux amants, et s’en allèrent ensuite avec un cadeau de mille dinars que leur donna Sett Badr. Je voulus également me retirer, mais l’émir n’y consentit pas, me disant : « Il ne sera pas dit que tu auras seulement pris parte nos tristesses, sans partager notre joie ! » Et ils m’invitèrent à un festin qui dura jusqu’à l’aurore. Alors ils me laissèrent me retirer dans la chambre qu’ils m’avaient fait réserver.
Le matin, à mon réveil, un petit esclave entra dans ma chambre porteur d’une cuvette et d’une aiguière, et moi je fis mes ablutions et ma prière du matin. Après quoi j’allai m’asseoir dans la salle de réception où bientôt je vis arriver, sortant encore frais du hammam, après leurs amours, les deux époux. Je leur souhaitai une matinée heureuse et leur adressai mes compliments de bonheur et mes félicitations ; puis j’ajoutai : « Je suis heureux d’avoir été pour quelque chose dans votre réunion. Mais, par Allah ! émir Jobaïr, si tu tiens à me donner une preuve de ton bon vouloir à mon égard, explique-moi ce qui a pu autrefois t’irriter à ce point et te pousser à te séparer, pour ton malheur, de ton amoureuse Sett Badr. Elle m’a bien expliqué elle-même la scène où la petite esclave, après lui avoir peigné et tressé les cheveux, l’avait embrassée et câlinée ! Mais, émir Jobaïr, il est inadmissible, il me semble, que cela seul ait pu causer ton ressentiment, si par ailleurs tu n’avais eu une autre cause de courroux ou d’autres preuves et soupçons ! »
L’émir Jobaïr, à ces paroles, sourit et me dit : « Ibn Al-Mansour, ta sagacité est excessivement merveilleuse. Maintenant que la favorite de Sett Badr est morte, ma rancune est éteinte. Je puis donc te dire sans mystère l’origine de notre mésintelligence. Elle provient simplement d’une plaisanterie que me rapporta, comme ayant été dite par elles deux, un batelier qui les avait prises dans sa barque un jour qu’elles faisaient une promenade sur l’eau. Il me dit : « Seigneur, comment prends-tu sur toi-même de voir une femme qui se moque de toi avec une favorite qu’elle aime. Sache, en effet, que dans ma barque elles étaient appuyées avec nonchalance l’une sur l’autre, et chantaient des choses bien inquiétantes sur l’amour des hommes. Et elles finirent leurs chants sur ces vers :
» Le feu est moins brûlant que mes entrailles ; mais si je m’approche de mon maître, l’incendie s’éteint et la glace est moins froide que mon cœur devant ses désirs.
Mais mon maître, c’est autre chose ! Chez lui ce qui doit être dur est mou et ce qu’il doit avoir de tendre est dur ; car dur est son cœur comme la roche, et son autre chose est molle comme l’eau !
« Alors moi, à ce récit du batelier, je vis le monde noircir devant mes yeux et je courus à la maison de Sett Badr où je vis ce que je vis. Et cela a suffi à consolider mes soupçons…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT CINQUANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … je courus à la maison de Sett Badr où je vis ce que je vis. Et cela a suffi à consolider mes soupçons. Mais, grâce à Allah ! maintenant tout est oublié ! »
Alors il me pria d’accepter, comme preuve de sa gratitude pour mes bons offices, la somme de trois mille dinars ; et moi je lui réitérai mes vœux… »
Ibn Al-Mansour s’arrêta soudain dans son récit. Il venait, en effet, d’entendre un ronflement qui lui coupa la parole. C’était le khalifat qui dormait profondément, gagné enfin par le sommeil que lui avait procuré cette histoire. Aussi Ibn Al-Mansour, craignant de le réveiller, s’esquiva doucement par la porte que lui ouvrit plus doucement encore le chef des eunuques.
Et Schahrazade, ayant fini de parler, se tut un instant, regarda le roi Schahriar et lui dit : « En vérité, ô Roi fortuné, je m’étonne que le sommeil ne t’ait pas gagné également, à cette histoire ! » Le roi Schahriar dit : « Pas du tout ! Tu te trompes, Schahrazade ! Je n’ai guère envie de dormir cette nuit ; et prends garde, si tu ne me racontes tout de suite une histoire instructive, que je ne mette moi-même à exécution à ton égard la menace d’Al-Rachid à son porte-glaive ! Ainsi n’aurais-tu pas à me dire quelques mots sur, par exemple, le remède contre les femmes qui tourmentent leurs époux par un désir de chair jamais satisfait et leur ouvrent de la sorte la porte du tombeau ? »
Schahrazade, à ces paroles, réfléchit un instant et dit : « Justement, ô Roi fortuné, il n’y a aucune histoire dont je me souvienne aussi bien que celle ayant trait à ce sujet-là, et je vais tout de suite te la raconter ! »
Et Schahrazade dit :
HISTOIRE DE WARDÂN LE BOUCHER AVEC LA FILLE DU VIZIR
On raconte, entre divers contes, qu’il y avait au Caire un homme appelé Wardân qui était, de sa profession, boucher pour la viande de mouton. Tous les jours il voyait venir à sa boutique une adolescente splendide de corps et de visage, mais les yeux bien fatigués et aussi les traits bien fatigués et le teint fort pâle. Elle arrivait toujours suivie d’un portefaix chargé de sa hotte, choisissait le morceau le plus tendre de la viande et aussi les œufs du mouton, payait le tout d’une pièce d’or pesant deux dinars ou plus, mettait son achat dans la hotte du portefaix, et continuait sa tournée au souk en s’arrêtant à toutes les boutiques et en achetant quelque chose à tous les marchands. Et elle continua à agir de la sorte un long espace de temps, jusqu’à ce qu’un jour le boucher Wardân, intrigué à la limite de l’intrigue de l’air et du silence et des manières de sa jeune cliente, résolut d’éclaircir la chose, pour se débarrasser des pensées qui le travaillaient à son sujet.
Or, il trouva justement l’occasion qu’il cherchait en voyant un matin le portefaix de la jeune femme passer seul devant la boutique. Il l’arrêta, lui mit dans la main une tête de mouton excellente au possible, et lui dit : « portefaix, recommande bien au maître du four de ne pas trop brûler la tête, sans quoi elle perdrait de sa saveur ! » Puis il ajouta : « Ô portefaix, tu me vois bien perplexe au sujet de cette adolescente qui te prend tous les jours à son service ! Qui est-elle et d’où vient-elle ? Que fait-elle de ces œufs de mouton ? Et surtout pourquoi ses yeux et ses traits sont-ils si fatigués ? » Il répondit : « Par Allah ! tu me vois à son sujet tout aussi perplexe que toi ! Ce que je sais, je te le dirai tout de suite, puisque ta main est généreuse aux pauvres comme moi. Voici ! Une fois tous ses achats terminés, elle prend encore, chez le marchand nazaréen du coin, pour un dinar ou plus d’un vieux vin précieux, et m’emmène, ainsi chargé, jusqu’à l’entrée des jardins du grand-vizir. Là elle me bande les yeux avec son voile, me prend la main et me conduit jusqu’à un escalier dont elle descend les marches avec moi, pour ensuite me décharger de ma hotte, me donner un demi-dinar pour ma peine et une hotte vide à la place de la mienne, et me reconduire, les yeux toujours bandés, jusqu’à la porte des jardins, où elle me donne congé jusqu’au lendemain. Et moi je n’ai jamais pu savoir ce qu’elle faisait de cette viande, de ces fruits, de ces amandes, de ces chandelles et de toutes les choses qu’elle me faisait porter jusqu’à cet escalier souterrain ! » Le boucher Wardân répondit : « Tu ne fais qu’augmenter ma perplexité, ô portefaix ! » Et, comme d’autres clients arrivaient, il laissa le portefaix et se mit à les servir.
Le lendemain, après une nuit passée à songer à cet état de choses qui le préoccupait à l’extrême, il vit arriver, à la même heure, l’adolescente suivie du portefaix. Et il se dit : « Par Allah ! il me faut cette fois, coûte que coûte, savoir ce que je veux savoir ! » Et, après que l’adolescente se fût éloignée avec ses divers achats, il chargea son aide, le garçon boucher, du soin de la boutique comme vente et achat, et se mit à la suivre de loin, de façon à ne pas en être remarqué. Il marcha de la sorte derrière elle jusqu’à l’entrée des jardins du vizir, et se cacha derrière les arbres pour attendre le retour du portefaix, qu’il vit, en effet, les yeux bandés et conduit par la main à travers les allées. Après une absence de quelques instants, il la vit revenir à l’entrée, enlever le voile des yeux du portefaix, le congédier et attendre que ce portefaix eût disparu pour rentrer dans le jardin.
Alors il se leva de sa cachette et la suivit, pieds nus, en se dissimulant derrière les arbres. Il la vit de la sorte arriver devant un quartier de rocher, le toucher d’une certaine façon, le faire tourner sur lui-même, et disparaître par un escalier dont il vit les marches descendre sous terre. Il attendit alors quelques instants et s’approcha du rocher qu’il se mit à manipuler de la même façon, et qu’il réussit à faire tourner. Il s’enfonça alors sous terre, en ramenant le rocher à sa place, et voici raconté par lui-même, ce qu’il vit.
Il dit :
« D’abord je ne distinguai rien dans l’obscurité souterraine ; puis je finis par apercevoir un corridor au fond duquel filtrait de la lumière ; je le suivis, toujours pieds nus et me retenant de respirer, et j’arrivai à une porte derrière laquelle je perçus des rires et des grognements. J’appliquai alors mon œil sur la fissure par où passait le rai de lumière, et je vis, enlacés sur un divan, au milieu de divers contorsions et mouvements, l’adolescente et un singe énorme à figure humaine tout à fait. Au bout de quelques instants, l’adolescente se désenlaça, se mit debout et défit tous ses vêtements pour s’étendre à nouveau sur le divan, mais toute nue. Et aussitôt le singe fondit sur elle et la couvrit, en la prenant dans ses bras. Et lorsqu’il eut fini sa chose avec elle, il se leva, se reposa un instant, puis la reprit en possession en la couvrant. Il se releva ensuite et se reposa encore, mais pour fondre de nouveau sur elle et la posséder, et ainsi de suite, dix fois de la même manière, alors qu’elle, de son côté, lui donnait tout ce que la femme donne à l’homme de plus fin et de plus délicat. Après quoi, tous deux tombèrent évanouis d’anéantissement. Et ils ne bougèrent plus.
Moi, je fus stupéfait…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT CINQUANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Moi, je fus stupéfait. Et je dis en mon âme : « C’est le moment ou jamais de saisir l’occasion ! » Et d’un coup d’épaule j’enfonçai la porte, et me précipitai dans la salle en brandissant mon couteau de boucher si aiguisé qu’il pouvait atteindre l’os avant la chair.
Je me jetai résolument sur l’énorme singe dont pas un muscle ne bougeait, tant ses exercices l’avaient anéanti, je lui appuyai brusquement mon couteau sur la nuque et, du coup, je lui séparai la tête du tronc. Alors la force vitale qui était en lui sortit de son corps avec grand fracas, râles et convulsions, tant que l’adolescente ouvrit soudain les yeux et me vit le couteau plein de sang à la main. Elle jeta alors un cri de terreur tel que je crus un moment la voir expirer morte sans retour. Elle put pourtant, voyant que je ne lui voulais pas de mal, recouvrer ses esprits peu à peu et me reconnaître. Alors elle me dit : « Est-ce ainsi, ô Wardân, que tu traites une cliente fidèle ? » Je lui dis : « Ô l’ennemie de toi même ! N’y a-t-il donc plus d’hommes valides pour que tu aies recours à de pareils expédients ? » Elle me répondit : « Ô Wardân, écoute d’abord la cause de tout cela et peut-être tu m’excuseras !
« Sache, en effet, que je suis la fille unique du grand-vizir. Jusqu’à l’âge de quinze ans je vécus tranquille dans le palais de mon père ; mais, un jour, un nègre noir m’apprit ce que j’avais à apprendre et me prit ce qu’il y avait en moi à prendre. Or, tu dois savoir qu’il n’y a rien de tel qu’un nègre pour enflammer notre intérieur, à nous, les femmes, surtout quand le terrain a senti cet engrais noir la première fois. Aussi ne t’étonne pas de savoir que mon terrain devint depuis lors si altéré qu’il fallait que le nègre l’arrosât toutes les heures sans discontinuer.
« Au bout d’un certain temps, le nègre mourut à la tâche, et moi je contai ma peine à une vieille femme du palais qui m’avait connue dès l’enfance. La vieille hocha la tête et me dit : « La seule chose qui désormais peut remplacer un nègre auprès de toi, ma fille, c’est le singe. Car rien n’est plus fécond en assauts que le singe. »
« Moi je me laissai persuader par la vieille, et un jour, voyant passer sous les fenêtres du palais un montreur de singes qui faisait exécuter des cabrioles à ses animaux, je me découvris soudain le visage devant le plus gros d’entre eux qui me regardait. Aussitôt il cassa sa chaîne et, sans que son maître pût l’arrêter, il s’enfuit à travers les rues, fit un grand détour et, par les jardins, revint dans le palais et courut droit à ma chambre où il me prit aussitôt dans ses bras et fit ce qu’il fit dix fois de suite, sans discontinuer.
« Or, mon père finit par apprendre mes relations avec le singe et faillit me tuer ce jour-là. Alors moi, ne pouvant me passer désormais de mon singe, je me fis creuser en secret ce souterrain où je l’enfermai. Et je lui portai moi-même à manger et à boire jusqu’aujourd’hui où la fatalité te fit découvrir ma cachette et te poussa à le tuer ! Hélas ! que vais-je maintenant devenir ? »
Alors moi j’essayai de la consoler, et lui dis, pour la calmer : « Sois sûre, ô ma maîtresse, que je puis avantageusement remplacer le singe auprès de toi. À l’essai tu contrôleras, car je suis réputé comme monteur ! » Et, de fait, je lui montrai, ce jour-là et les suivants, que ma vaillance dépassait celle du défunt singe et du défunt nègre.
Cela pourtant ne put aller longtemps de cette façon-là ; car, au bout de quelques semaines, j’étais perdu là-dedans comme dans un abîme sans bord. Et l’adolescente voyait au contraire augmenter de jour en jour ses désirs et s’attiser son feu du dedans.
Dans cette fâcheuse situation, j’eus recours à la science d’une vieille femme que je connaissais comme incomparable dans l’art de préparer les philtres et de confectionner les remèdes aux maladies les plus indéracinables. Je lui racontai l’histoire depuis le commencement jusqu’à la fin et lui dis : « Maintenant, ma bonne tante, je viens te demander de me faire une préparation capable d’éteindre les désirs de cette femme et de calmer son tempérament ! » Elle me répondit : « Rien n’est plus facile ! » Je dis : « Je me fie entièrement à ta science et à ta sagesse ! »
Alors elle prit une marmite dans laquelle elle mit une once de grains de lupin d’Égypte, une once de vinaigre vierge, deux onces de houblon et quelques feuilles de digitale. Elle fit bouillir le tout pendant deux heures de temps, décanta soigneusement le liquide et me dit : « Le remède est prêt. » Alors je la priai de m’accompagner au souterrain ; et là elle me dit : « Il faut d’abord la monter jusqu’à ce qu’elle tombe épuisée ! » Et elle se retira dans le corridor pour attendre l’exécution de son ordre.
Moi je fis ce qu’elle me commandait, et si bien que l’adolescente perdit connaissance. Alors la vieille entra dans la salle, et, après avoir réchauffé le liquide en question, le mit dans un petit bassin de cuivre et le porta entre les cuisses de la fille du vizir. Elle lui fit des fumigations qui lui pénétrèrent bien avant dans les parties fondamentales, et durent produire un effet radical, car soudain je vis tomber d’entre les cuisses écartées deux objets, l’un après l’autre, qui se mirent à frétiller. Je les examinai de plus près et je vis que c’étaient deux anguilles, l’une jaune et l’autre noire.
À la vue des deux anguilles…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT CINQUANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… À la vue des deux anguilles, la vieille fut à la limite de la jubilation et s’écria : « Mon fils, rends grâces à Allah ! L’effet du remède est produit ! Sache, en effet, que ces deux anguilles étaient la cause de l’inassouvissement dont tu t’étais plaint à moi. L’une des anguilles est née des copulations du nègre et l’autre des copulations du singe. Maintenant qu’elles sont sorties, l’adolescente va jouir d’un tempérament modéré, et ne se montrera plus fatigante et désordonnée dans ses désirs ! »
Et, en effet, je constatai que l’adolescente, une fois revenue à elle-même, ne demandait plus à satisfaire ses sens. Et je la trouvai si tranquille que je n’hésitai pas à la demander en mariage. Elle consentit, car elle s’était habituée à moi. Et nous vécûmes ensemble, depuis lors, dans la vie la plus douce et les délices les plus parfaites, après avoir recueilli dans notre maison la vieille qui avait opéré cette guérison stupéfiante et nous avait appris de la sorte le remède aux désirs immodérés.
Glorifié soit le Vivant qui ne meurt pas et qui tient dans Sa main les empires et les royaumes ! »
Et Schahrazade continua : « C’est là, ô Roi fortuné, tout ce que je sais au sujet du remède à appliquer aux femmes à tempérament trop gênant ! » Et le roi Schahriar dit : « J’aurais bien voulu connaître cette recette, l’année dernière, pour faire fumiger la maudite que j’avais surprise au jardin avec l’esclave noir ! Mais toi, Schahrazade, tu vas maintenant laisser les histoires scientifiques et me raconter cette nuit, si tu le peux, une histoire plus étonnante que toutes celles entendues ; car je me sens la poitrine plus rétrécie que d’habitude ! » Et Schahrazade dit : « Je le peux ! » Et aussitôt elle dit :
HISTOIRE DE LA REINE YAMLIKA,
PRINCESSE SOUTERRAINE
On raconte qu’il y avait, dans l’antiquité du temps
et le passé des âges et des siècles, un sage d’entre les
sages de la Grèce qui s’appelait Danial. Il avait beaucoup
de disciples respectueux qui écoutaient son
enseignement et profitaient de sa science, mais il
n’avait point la consolation d’avoir un fils qui pût
devenir l’héritier de ses livres et de ses manuscrits.
Comme il ne savait plus que faire pour obtenir ce
résultat, il eut l’idée de prier le Maître du ciel de lui
accorder ce bienfait. Or le Très-Haut, qui n’a point
de portier à la porte de Sa générosité, écouta cette
prière, et rendit enceinte l’épouse du savant, à
l’heure et à l’instant.
Pendant les mois que dura la grossesse de son épouse, le sage Danial, qui se voyait déjà bien vieux, se dit : « La mort est proche, et je ne sais si le fils que j’aurai pourra trouver un jour intacts mes livres et mes manuscrits ! » Et aussitôt il se mit à consacrer tout son temps à résumer en quelques feuilles toute la science qui était contenue dans ses divers écrits. Il remplit de la sorte, d’une très fine écriture, cinq feuilles qui contenaient la quintessence de tout son savoir et des cinq mille manuscrits qu’il possédait. Puis il les relut, réfléchit, et trouva que ces cinq feuilles elles-mêmes contenaient des choses qui pouvaient être encore plus quintessenciées. Alors il consacra encore une année à réfléchir, et finit par résumer les cinq feuilles en une seule qui était elle-même cinq fois plus petite que les premières. Et lorsqu’il eut fini ce travail, il sentit que sa fin était proche.
Alors le vieux savant, de peur que ses livres et ses manuscrits ne devinssent la propriété d’autrui, les jeta dans la mer jusqu’au dernier, et ne conserva que la petite feuille de papier en question. Il appela son épouse enceinte et lui dit : « Mon temps est fini, ô femme, et il ne m’est pas donné d’élever moi-même l’enfant que le ciel nous accorde et que je ne verrai pas. Mais je lui laisse comme héritage cette petite feuille de papier que tu lui donneras le jour seulement où il te demandera sa part dans les biens de son père. Et lui, s’il arrive à la déchiffrer et à en comprendre la portée, il sera l’homme le plus sage de son siècle. Je désire qu’il soit appelé Hassib ! » Et, ayant dit ces paroles, le sage Danial expira dans la paix d’Allah.
On lui fit des funérailles auxquelles assistèrent tous ses disciples et tous les habitants de la ville. Et tous le pleurèrent beaucoup et prirent le deuil de sa mort.
Or, quelques jours après, l’épouse de Danial mit au monde un enfant mâle bien fait qui, selon la recommandation du défunt, fut appelé Hassib. Elle fit en même temps appeler les astrologues qui, une fois leurs calculs faits et leur observation des astres terminée, tirèrent l’horoscope de l’enfant et dirent : « Ô femme, ton fils vivra de longues années s’il échappe à un danger qui est suspendu sur sa jeunesse. S’il évite ce danger, il atteindra à un grand degré de science et de richesse ! » Et ils s’en allèrent en leur voie.
Lorsque l’enfant eut cinq ans d’âge, sa mère le mit à l’école pour y apprendre quelque chose ; mais il n’y apprit rien du tout. Elle le retira alors de l’école et voulut lui faire embrasser une profession ; mais il passa de longues années à ne rien faire, et atteignit l’âge de quinze ans sans rien apprendre, et sans arriver à quoi que ce fût pour gagner sa vie et aider sa mère dans les dépenses. Alors sa mère se mit à pleurer et les voisines lui dirent : « Il n’y a que le mariage qui soit capable de lui donner de l’aptitude au travail ; car alors il verra bien que lorsqu’on a une femme on travaille pour la faire subsister ! » Ces paroles décidèrent la mère à se lever et à chercher parmi ses connaissances une jeune fille ; et en ayant trouvé une qui était à sa convenance, elle la lui donna en mariage. Et le jeune Hassib fut parfait pour son épouse, et ne la négligea pas, au contraire ! Mais il continua à ne rien faire, et à ne prendre goût à aucun travail.
Or, parmi les voisins, il y avait des bûcherons qui un jour dirent à la mère : « Achète à ton fils un âne, des cordes et une hache, et laisse-le aller avec nous couper du bois sur la montagne. Nous vendrons ensuite le bois et nous partagerons le profit avec lui. De la sorte il pourra t’aider dans les dépenses et mieux entretenir son épouse ! »
À ces paroles, la mère de Hassib, pleine de joie, lui acheta tout de suite un âne, des cordes et une hache, et le confia aux bûcherons en le leur recommandant beaucoup ; et les bûcherons lui répondirent : « N’aie aucun souci à son sujet. Il est le fils de Danial, notre maître, et nous saurons le protéger et veiller sur lui ! » Et ils remmenèrent avec eux à la montagne, où ils lui apprirent à couper le bois et à le charger sur le dos de l’âne, pour le vendre ensuite au marché. Et Hassib prit un goût extrême à ce métier qui lui permettait de se promener tout en venant en aide à sa mère et à son épouse.
Or, un jour d’entre les jours comme ils coupaient du bois dans la montagne, ils furent surpris par une tempête, accompagnée de pluie et de tonnerre, qui les obligea à courir se réfugier dans une caverne située non loin de là, et où ils allumèrent du feu pour se réchauffer. En même temps ils chargèrent le jeune Hassib, fils de Danial, de fendre les bûches pour alimenter le feu.
Pendant que Hassib, retiré au fond de la caverne, s’occupait à casser du bois, il entendit soudain sa hache résonner sur le sol avec un bruit, sonore comme si, à cet endroit, il y avait un espace vide sous terre. Il se mit alors à creuser à ses pieds et mit ainsi à nu un marbre ancien avec un anneau de cuivre…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT CINQUANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… un marbre ancien avec un anneau de cuivre. À cette vue, il héla ses compagnons qui accoururent et parvinrent à soulever la plaque de marbre. Ils mirent alors à découvert une cavité très large et très profonde où étaient rangés des pots, en quantité innombrable, dont l’aspect était bien vieux et dont le col était scellé soigneusement. Ils descendirent alors Hassib au fond de la cavité, au moyen de cordes, pour qu’il vît le contenu de ces pots et pour qu’il les attachât avec les mêmes cordes, au moyen desquelles on les remonterait dans la caverne.
Le jeune Hassib, une fois descendu dans la cavité, commença par casser avec sa hache le col de l’un de ces pots de terre cuite ; et aussitôt il vit s’en écouler un miel jaune de qualité excellente. Il fit part de sa découverte aux bûcherons qui, bien qu’un peu déçus de trouver du miel là où ils espéraient tomber sur un trésor des temps anciens, ne furent pas peu satisfaits à la pensée du gain que devait leur procurer la vente de ces innombrables pots avec leur contenu. Ils hissèrent donc tous les pots, l’un après l’autre, au fur et à mesure que le jeune Hassib les attachait, les chargèrent sur leurs ânes à la place du bois et, sans vouloir retirer du fond leur compagnon, ils s’en allèrent tous vers la ville en se disant : « Si nous le tirons de la cavité, nous serons obligés de partager avec lui le profit de la vente. C’est d’ailleurs un vaurien dont la mort est préférable à la vie ! »
Ils s’en allèrent donc au marché avec leurs ânes, et dépêchèrent quelqu’un d’entre eux auprès de la mère de Hassib pour lui dire : « Pendant que nous étions dans la montagne, l’âne de ton fils, quand l’orage éclata sur nous, prit la fuite et obligea ton fils à courir derrière lui pour le rattraper, pendant que nous nous étions réfugiés dans une caverne. Le malheur voulut que soudain un loup sortît de la forêt, tuât ton fils et le mangeât ainsi que l’âne. Et nous n’avons retrouvé de leurs traces qu’un peu de sang et quelques ossements ! »
À cette nouvelle, la malheureuse mère et la pauvre femme de Hassib se frappèrent le visage et se couvrirent la tête de poussière en pleurant toutes les larmes de leur désespoir. Et voilà pour elles !
Quant aux bûcherons, ils vendirent les pots de miel à un prix fort avantageux, et réalisèrent un gain si considérable qu’ils purent ouvrir chacun une boutique de marchand pour vendre et acheter. Et ils ne se privèrent d’aucun plaisir, mangeant et buvant les plus excellentes choses, tous les jours. Et voilà pour eux !
Mais pour ce qui est du jeune Hassib, voici ! Lorsqu’il vit qu’on ne le tirait pas de la cavité, il se mit à crier et à supplier, mais en vain, puisque les bûcherons étaient partis et avaient résolu de le laisser mourir là sans le secourir. Il essaya alors de creuser des trous dans les parois pour s’y accrocher des mains et des pieds ; mais il constata que les parois étaient de granit et résistaient à l’acier de la hache. Alors son désespoir fut sans bornes, et il allait se jeter au fond de la cavité pour s’y laisser mourir, quand soudain il vit un gros scorpion sortir d’un interstice de la paroi de granit, et s’avancer vers lui pour le piquer. Il l’écrasa d’un coup de hache et examina l’interstice en question, d’où il vit s’échapper un rai de lumière. Il eut alors l’idée d’enfoncer la lame de la hache dans cet interstice et d’appuyer dessus fortement ; et, à sa grande surprise, il put de la sorte soulever une porte qui remonta peu à peu en ménageant une ouverture assez large pour laisser passer un corps d’homme.
À cette vue, Hassib n’hésita pas un instant, pénétra dans l’ouverture et se trouva de la sorte dans une longue galerie souterraine de l’extrémité de laquelle venait la lumière. Il suivit cette galerie pendant une heure de temps, et arriva à une porte considérable en acier noir avec une serrure d’argent et une clef d’or. Il ouvrit cette porte et se trouva soudain en plein air, sur le rivage d’un lac, au pied d’une colline d’émeraude. Sur le bord de ce lac, il vit un trône d’or resplendissant de pierreries, et, tout autour, se reflétant dans l’eau, des sièges d’or, d’argent, d’émeraude, de cristal, d’acier, de bois d’ébène et de sandal blanc. Il compta ces sièges, et trouva qu’ils étaient au nombre de douze mille, ni plus ni moins. Lorsqu’il eut fini de les compter et d’admirer leur beauté et le paysage, et l’eau qui les reflétait, il alla s’asseoir sur le trône du milieu, pour mieux jouir du spectacle merveilleux du lac et de la montagne.
À peine le jeune Hassib était-il assis sur le trône d’or, qu’il entendit des sons de cymbales et de gongs, et soudain il vit s’avancer, de derrière les flancs de la colline d’émeraude, et se déployer vers le lac, une file de personnes qui glissaient plutôt qu’elles ne marchaient ; et il ne sut distinguer leurs formes à cause de l’éloignement. Lorsqu’elles furent plus près, il vit que c’étaient des femmes à la beauté ravissante mais dont toute la moitié inférieure se terminait en un corps allongé et rampant comme celui des serpents. Leur voix était fort agréable, et elles chantaient en grec les louanges d’une reine qu’il ne voyait pas. Mais bientôt apparut de derrière la colline un carré formé par quatre femmes serpentines qui portaient, sur leurs bras élevés au-dessus de leur tête, un grand bassin d’or où se trouvait, souriante et pleine de grâce, la reine. Les quatre femmes s’avancèrent jusqu’au trône d’or, d’où Hassib s’était hâté de s’éloigner, y déposèrent leur reine, arrangèrent les plis de ses voiles, et se placèrent derrière elle, tandis que toutes les autres femmes serpentines avaient glissé chacune vers un des sièges précieux disposés autour du lac. Alors la reine, d’une voix au timbre charmant, dit quelques mots en grec à celles qui l’entouraient ; et aussitôt un signal fut donné avec les cymbales, et toutes les femmes serpentines entonnèrent un hymne grec en l’honneur de la reine, et s’assirent sur les sièges.
Lorsqu’elles eurent fini leur chant, la reine, qui avait remarqué la présence de Hassib, tourna la tête gentiment de son côté et lui fit un signe pour l’encourager à s’approcher. Et Hassib, bien que fort ému, s’approcha, et la reine l’invita à s’asseoir et lui dit : « Sois le bienvenu dans mon royaume souterrain, ô jeune homme que la bonne destinée a conduit jusqu’ici ! Chasse toute crainte loin de toi et dis-moi ton nom, car je suis la reine Yamlika, princesse souterraine. Et toutes ces femmes serpentines sont mes sujettes. Parle donc et dis-moi qui tu es, et comment tu as pu arriver jusqu’à ce lac qui est ma résidence d’hiver et où je viens passer quelques mois chaque année, en quittant ma résidence d’été du mont Caucase. »
À ces paroles, le jeune Hassib, après avoir embrassé la terre entre les mains de la reine Yamlika, s’assit à sa droite sur un siège d’émeraude et dit : « Je m’appelle Hassib, et je suis le fils du défunt Danial, le savant. De ma profession je suis bûcheron, bien que j’eusse pu arriver à être marchand parmi les fils des hommes, ou même un grand savant. Mais j’ai préféré respirer l’air des forêts et des montagnes, m’étant dit qu’il était toujours temps de s’enfermer, après la mort, entre les quatre murs du tombeau ! » Puis il raconta en détail ce qui lui était arrivé avec les bûcherons et comment, par l’effet du hasard, il avait pu pénétrer jusqu’à ce royaume souterrain.
Ce discours du jeune Hassib plut beaucoup à la reine Yamlika qui lui dit : « Hassib, tu dois, depuis le temps que tu as été abandonné dans la fosse, avoir bien faim et bien soif ! » Et elle fit signe à l’une de ses suivantes qui aussitôt glissa jusqu’au jeune homme en portant sur sa tête un plateau d’or rempli de raisins, de grenades, de pommes, de pistaches, de noisettes, de noix, de figues fraîches et de bananes. Puis, lorsqu’il eut mangé et calmé sa faim, il but d’un sorbet délicieux contenu dans une coupe taillée dans un rubis. Alors la porteuse s’éloigna avec le plateau, et la reine Yamlika, s’adressant à Hassib, lui dit : « Maintenant, Hassib, tu peux être assuré que, tant que durera ton séjour dans mon royaume, il ne t’arrivera rien que d’agréable. Si tu as, donc, l’intention de passer une semaine ou deux au milieu de nous, sur le bord de ce lac et à l’ombre de ces montagnes, je te raconterai, pour te faire mieux passer le temps, une histoire qui servira à ton instruction lorsque tu seras de retour au pays des hommes ! »
Et la reine Yamlika, princesse souterraine, au milieu de l’attention des douze mille femmes serpentines assises sur les sièges d’émeraude et d’or, raconta ce qui suit, en langue grecque, au jeune Hassib, fils de Danial le savant :
« Sache, ô Hassib, qu’il y avait dans le royaume des Bani-Israïl un roi fort sage qui, à son lit de mort, appela son fils, l’héritier de son trône, et lui dit : « Ô mon fils Beloukia, je te recommande, lorsque tu prendras possession du pouvoir, de faire toi-même l’inventaire de toutes les choses qui se trouvent dans ce palais, et de ne rien laisser passer sans l’examiner avec la plus grande attention ! »
Aussi le premier soin du jeune Beloukia, en devenant roi, fut de passer en revue les effets et les trésors de son père et de parcourir les différentes salles qui servaient de réserve à toutes les choses précieuses amassées dans le palais. Il arriva de la sorte dans une salle retirée où il aperçut une cassette de bois d’ébène placée sur une petite colonne de marbre blanc qui s’élevait au milieu même de la pièce. Beloukia se hâta d’ouvrir la cassette d’ébène et y trouva un petit coffret en or. Il ouvrit ce coffret en or et y vit un rouleau de parchemin qu’il déploya aussitôt. Il y était dit en langue grecque : Celui qui désire devenir le maître et le souverain des hommes, des génies, des oiseaux et des animaux, n’aura qu’à trouver l’anneau que le prophète Soleïmân porte au doigt dans l’Île des Sept Mers, qui est son lieu de sépulture. C’est cet anneau magique qu’Adam, père des hommes, portait au doigt dans le paradis, avant sa faute, et qui lui fut enlevé par l’ange Gobraïl qui en fit don plus tard au sage Soleïmân. Mais traverser les mers et aborder à cette île située au delà des Sept Mers, nul navire ne pourrait le tenter. Celui-là seul réussira dans cette entreprise qui trouvera la plante avec le suc de laquelle il suffit de se frotter la plante des pieds pour pouvoir marcher sur la surface de la mer. Cette plante se trouve dans le royaume souterrain de la reine Yamlika. Et seule cette princesse sait l’endroit où croît cette plante ; car elle connaît le langage de toutes les plantes et des fleurs, et elle n’ignore aucune de leurs vertus. Que celui qui veut trouver cet anneau aille d’abord au royaume souterrain de la reine Yamlika. Et s’il est assez heureux pour réussir et prendre l’anneau, il pourra alors, non seulement dominer tous les êtres créés, mais pénétrer aussi dans la Contrée des Ténèbres pour boire à la Fontaine de Vie qui donne la beauté, la jeunesse, la science, la sagesse et l’immortalité !
Lorsque le prince Beloukia eut lu ce parchemin, il rassembla aussitôt les prêtres, les mages et les savants de Bani-Israïl…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT CINQUANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… il rassembla aussitôt les prêtres, les mages et les docteurs de Bani-Israïl et leur demanda s’il y avait quelqu’un d’entre eux capable de lui montrer le chemin qui conduisait au royaume souterrain de la princesse Yamlika. Alors tous les assistants lui montrèrent du doigt le sage Offân qui se trouvait au milieu d’eux. Or, le sage Offân était un vénérable vieillard qui avait approfondi toutes les sciences connues et possédait les mystères de la magie, les clefs de l’astronomie et de la géométrie, et tous les arcanes de l’alchimie et de la sorcellerie. Il s’avança donc entre les mains du jeune roi Beloukia qui lui demanda : « Peux-tu vraiment, ô sage Offân, me conduire au royaume de la princesse souterraine ? » Il répondit : « Je le peux ! »
Alors le jeune roi Beloukia nomma son vizir comme son remplaçant dans la direction des affaires du royaume pour toute la durée de son absence, enleva ses attributs royaux, se vêtit du manteau de pèlerin et se chaussa des chaussures de voyage. Après quoi, suivi du sage Offân, il sortit de son palais et de sa ville, et s’enfonça dans le désert.
Alors seulement le sage Offân lui dit : « C’est ici le lieu propice pour faire les conjurations qui doivent nous montrer la route ! » Ils s’arrêtèrent donc, et Offân traça autour de lui, sur le sable, le cercle magique, fit les conjurations rituelles et ne tarda pas à découvrir le lieu où se trouvait, de ce côté-là, l’entrée de mon royaume souterrain. Il fit alors encore quelques autres conjurations, et la terre s’entr’ouvrit et leur livra passage à tous deux jusqu’au lac que tu as sous les yeux, ô Hassib.
Moi, je les reçus avec tous les égards que je rends à quiconque vient visiter mon royaume. Alors ils m’exposèrent l’objet de leur visite, et aussitôt je me fis porter dans mon bassin d’or sur la tête de mes porteuses, et je les conduisis au sommet de cette colline d’émeraude où, sur mon passage, les plantes et les fleurs se mirent à parler chacune en son langage, qui à droite, qui à gauche, en vantant, à voix haute ou à voix basse, leurs vertus particulières. Et, au milieu de ce concert qui montait ainsi vers nous, musical et parfumé de sucs essentiels, nous arrivâmes devant les touffes d’une plante qui, de toutes les corolles rouges de ses fleurs, chantait sous la brise qui l’inclinait : « C’est moi la merveilleuse qui donne à celui qui se frotte les pieds avec mon suc la vertu de marcher sans se mouiller à la surface de toutes les mers créées par Allah Très-Haut ! »
Alors moi je dis à mes deux visiteurs : « La voilà devant vous, la plante que vous cherchez ! » Et Offân aussitôt cueillit de cette plante autant qu’il en voulut, en écrasa les pousses et en recueillit le suc dans un grand flacon que je lui donnai.
Moi je songeai alors à interroger Offân et lui dis : « Ô sage Offân, peux-tu maintenant me dire le motif qui vous pousse tous deux à traverser les mers ? » Il me répondit : « Ô reine, c’est pour aller à l’Île des Sept Mers chercher l’anneau magique de Soleïmân, maître des genn, des hommes, des animaux et des oiseaux ! » Je lui dis : « Comment, ô sage, ne sais-tu pas que personne après Soleïmân ne pourra, quoi qu’il fasse, devenir le propriétaire de cet anneau ? Crois-moi, Offân ! et toi aussi, ô jeune roi Beloukia, écoute-moi ! Abandonnez ce projet téméraire, ce projet insensé, de courir les mers de la création pour aller à la recherche de cet anneau que nul ne possédera. Cueillez plutôt ici de la plante qui donne à ceux qui en mangent une jeunesse éternelle ! » Mais ils ne voulurent point m’écouter, et, ayant pris congé de moi, disparurent par où ils étaient venus. »
Ici la reine Yamlika s’arrêta de parler, éplucha une banane qu’elle tendit au jeune Hassib, mangea elle-même une figue, et dit : « Avant que je continue, ô Hassib, l’histoire de Beloukia et que je te raconte son voyage sur les Sept Mers et ses autres aventures, ne voudrais-tu savoir exactement la situation de mon royaume au pied du mont Caucase, qui entoure la terre comme une ceinture, et connaître son étendue, ses environs, ses plantes animées et parlantes, ses genn et ses femmes serpentines, nos sujettes, dont Allah seul connaît le nombre ? Veux-tu que je te dise comment le mont Caucase repose tout entier sur un rocher merveilleux d’émeraude, El-Sakhrat, dont le reflet donne aux cieux leur couleur azurée ? Je pourrais par la même occasion te parler de l’endroit précis du Caucase où se trouve le Gennistân, capitale des genn soumis au roi Jân ben-Jân, et te révéler la place où demeure l’oiseau rokh, dans la Vallée des Diamants ; et, en passant, je te montrerais les champs de bataille qui retentirent des exploits de héros fameux ! »
Mais le jeune Hassib répondit : « Ô reine Yamlika, je préfère de beaucoup connaître la suite des aventures du roi Beloukia ! »
Alors la princesse souterraine continua ainsi :
« Lorsque le jeune Beloukia et le sage Offân m’eurent quittée pour aller à l’île située au bout des Sept Mers, là où se trouve le corps de Soleïmân, ils arrivèrent sur le rivage de la Première Mer, et là ils s’assirent par terre et commencèrent par se frotter énergiquement la plante des pieds et les chevilles avec le suc qu’ils avaient recueilli dans le flacon. Puis ils se relevèrent et s’avancèrent d’abord avec beaucoup de précaution sur la mer. Mais lorsqu’ils eurent constaté qu’ils pouvaient, sans crainte de se noyer, marcher mieux encore sur l’eau que sur la terre ferme, ils s’enhardirent et se mirent en route d’une allure accélérée pour ne pas perdre de temps. Ils marchérent de la sorte sur cette mer durant trois jours et trois nuits et, au matin du quatrième jour, ils arrivèrent à une île qu’ils prirent pour le paradis, tant ils furent émerveillés de sa beauté…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT CINQUANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… une île qu’ils prirent pour le paradis, tant ils furent émerveillés de sa beauté. La terre qu’ils foulaient était de safran doré ; les pierres étaient de jade et de rubis ; les prairies se déployaient en parterres de fleurs exquises aux corolles ondulantes sous la brise qu’elles embaumaient, où se mariaient les sourires des roses aux tendres regards des narcisses, où voisinaient les lis, les œillets, les violettes, les camomilles et les anémones, et où, entre les haies blanches des jasmins, folâtraient, légères, les bondissantes gazelles ; les forêts de bois d’aloès et d’arbres à grandes fleurs éclatantes bruissaient de toutes leurs branches où roucoulaient les tourterelles pour répondre au murmure des ruisseaux, où les rossignols racontaient aux roses d’une voix émue leur martyre amoureux, tandis que les roses les. écoutaient attentivement ; là les sources mélodieuses se cachaient sous les touffes délicates des cannes à sucre, seuls roseaux ; là la terre naturelle montrait à l’aise ses jeunes richesses et respirait de tout son printemps.
Aussi le roi Beloukia et Offân se promenèrent-ils avec ravissement jusqu’au soir sous l’ombrage des bosquets, en contemplant ces merveilles qui leur remplissaient l’âme de délices. Puis, comme la nuit tombait, ils montèrent sur un arbre pour s’y endormir ; et ils allaient effectivement fermer les yeux quand soudain l’île retentit d’un formidable mugissement qui l’ébranla jusque dans ses fondements, et ils aperçurent, sortant des flots de la mer, un animal monstrueux qui tenait dans sa gueule une pierre brillante comme un flambeau, et, immédiatement derrière lui, une multitude d’autres monstres marins qui tenaient également chacun dans sa gueule une pierre lumineuse. Aussi l’île devint-elle bientôt aussi éclairée de toutes ces pierres qu’en plein jour. Au même moment, et de tous les côtés à la fois, vinrent des lions, des tigres et des léopards en quantité telle qu’Allah seul aurait pu les dénombrer. Et les animaux de la terre se rencontrèrent sur le rivage avec les animaux marins, et tous se mirent à causer et à converser entre eux jusqu’au matin. Alors les monstres marins retournèrent dans la mer et les fauves se dispersèrent dans les forêts. Et Beloukia et Offân, qui n’avaient pu fermer l’œil de toute la nuit, tant la peur les avait tenus, se hâtèrent de descendre de l’arbre et de courir au rivage où ils se frottèrent les pieds avec le suc de la plante, pour aussitôt poursuivre leur voyage maritime.
Ils voyagèrent de la sorte sur la Deuxième Mer pendant des jours et des nuits jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au pied d’une chaîne de montagnes au milieu desquelles s’ouvrait une vallée merveilleuse où tous les cailloux et tous les rochers étaient en pierre d’aimant, mais où il n’y avait pas trace de fauves ou d’autres animaux féroces. Aussi se promenèrent-ils toute la journée, un peu à l’aventure, se nourrissant de poissons séchés, et, vers le soir, ils s’assirent au bord de la mer pour voir se coucher le soleil, quand soudain ils entendirent un miaulement effrayant et, à quelques pas derrière eux, ils virent un tigre qui était tout prêt à bondir sur eux. Ils eurent juste le temps de se frotter les pieds avec le suc de la plante et de s’enfuir, hors de portée, sur la mer.
Or, c’était la Troisième Mer. Et cette nuit-là fut une nuit bien noire, et la mer, sous un vent qui soufflait avec violence, devint très agitée, ce qui rendit la marche extrêmement fatigante surtout pour des voyageurs déjà exténués par le manque de sommeil. Heureusement ils arrivèrent, à l’aube, dans une île où ils commencèrent d’abord par s’étendre pour se reposer. Après quoi ils se levèrent pour parcourir l’île et la trouvèrent couverte d’arbres fruitiers. Mais ces arbres avaient cette particularité merveilleuse que leurs fruits croissaient tout confits sur les branches. Aussi les deux voyageurs se plurent-ils extraordinairement dans cette île, surtout Beloukia qui aimait à l’extrême les fruits confits, et en général toutes les choses confites, et qui passa toute la journée à se régaler. Il obligea même le sage Offân à s’arrêter là dix jours entiers pour avoir le temps de se rassasier de ces délicieux fruits-là. Pourtant, à la fin du dixième jour, il avait tellement abusé de ces douceurs, qu’il eut mal au ventre et, dégoûté, il se hâta de se frotter la plante des pieds et les chevilles avec le suc de la plante, ainsi qu’Offân, et de se mettre en route sur la Quatrième Mer.
Ils voyagèrent quatre jours et quatre nuits sur cette Quatrième Mer et atterrirent à une île qui n’était qu’un banc de sable très fin de couleur blanche, où nichaient des reptiles de toutes formes dont on voyait les œufs couver au soleil. Comme ils n’apercevaient sur cette île aucun arbre ni un seul brin d’herbe, ils ne voulurent s’y arrêter que juste le temps de se reposer et de se frotter les pieds avec le suc contenu dans le flacon.
Sur la Cinquième Mer, ils voyagèrent seulement un jour et une nuit, car ils trouvèrent au matin une petite île dont les montagnes étaient de cristal, avec de larges veines d’or, et étaient couvertes d’arbres étonnants dont les fleurs étaient d’un jaune brillant. Ces fleurs, à la tombée de la nuit, étincelèrent comme des astres, et leur éclat, reflété par les rochers de cristal, illumina l’île et la rendit plus brillante qu’en plein jour. Et Offân dit à Beloukia : « Tu as sous les yeux l’Île des Fleurs d’or. Ce sont ces fleurs qui, une fois tombées des arbres et desséchées, se réduisent en poudre et finissent par former, par leur fusion, les veines d’où l’on tire l’or. Cette Île des Fleurs d’or n’est qu’une parcelle du soleil, détachée de l’astre, et tombée ici-même autrefois. » Ils passèrent donc dans cette île une nuit magnifique, et le lendemain, ils se frottèrent les pieds avec le liquide précieux et pénétrèrent dans la sixième région maritime. Ils voyagèrent sur la Sixième Mer…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTIÈME NUIT
Elle dit :
… Ils voyagèrent sur la Sixième Mer assez longtemps pour éprouver un grand plaisir à arriver à une île couverte d’une très belle végétation, où ils purent prendre quelque repos sur le rivage. Ils se levèrent ensuite et se mirent à se promener dans l’ile. Mais quelle ne fut point leur épouvante de voir que les arbres portaient, en guise de fruits, des têtes humaines suspendues par les cheveux ! Ces fruits à tête humaine n’avaient pas tous la même expression : les uns souriaient, les autres pleuraient ou riaient, tandis que ceux qui étaient tombés des arbres se roulaient dans la poussière et finissaient par se transformer en globes de feu qui éclairaient la forêt et faisaient pâlir la lumière du soleil. Et les deux voyageurs ne purent s’empêcher de penser : « Quelle singulière forêt ! » Mais ils n’osèrent pas trop s’approcher de ces fruits étranges, et préférèrent retourner sur le rivage. Or, comme le soir tombait, ils s’assirent derrière un rocher et virent soudain émerger de l’eau et s’avancer sur le rivage douze Filles de la Mer, d’une beauté sans pareille et le cou entouré d’un collier de perles, qui se mirent à danser en rond, à sauter et à se livrer entre elles à mille jeux folâtres pendant une heure de temps. Après quoi elles se mirent à chanter au clair de lune, et s’éloignèrent en nageant sur l’eau. Et Beloukia et Offân, bien que fort charmés de la beauté, des danses et des chants des Filles de la Mer, ne voulurent point prolonger davantage leur séjour dans cette île, à cause des fruits effrayants à tête humaine. Ils se frottèrent donc la plante des pieds et les chevilles avec le suc renfermé dans le flacon et s’avancèrent sur la Septième Mer.
Leur voyage sur cette Septième Mer fut de très longue durée, car ils marchèrent deux mois, jour et nuit, sans rencontrer aucune terre sur leur route. Et ils étaient obligés, pour ne pas mourir de faim, d’attraper prestement les poissons qui venaient de temps en temps à la surface de l’eau, et de les manger crus, tels quels. Et ils commencèrent ainsi à sentir combien sages étaient les conseils que je leur avais donnés, et à regretter de ne les avoir pas suivis. Ils finirent tout de même par arriver à une île qu’ils conjecturèrent être l’Île des Sept Mers où devait se trouver le corps de Soleïmân portant l’anneau magique à l’un de ses doigts.
Ils trouvèrent cette Île des Sept Mers couverte de très beaux arbres fruitiers, et arrosée par de nombreux cours d’eau. Et comme ils avaient bien faim et avaient la gorge desséchée depuis le temps où ils étaient réduits à ne prendre pour tout aliment que des poissons crus, ce fut avec un plaisir extrême qu’ils s’approchèrent d’un grand pommier aux branches pesantes de grappes de pommes mûres. Et Beloukia tendit la main et voulut cueillir de ces fruits : mais soudain, de l’intérieur même de l’arbre, une voix terrible se fit entendre qui leur cria à tous deux : « Si vous touchez à ces fruits, vous allez être coupés en deux moitiés ! » Et, au même instant, en face d’eux apparut un énorme géant haut de quarante bras, en mesure de ce temps-là ! Et Beloukia, à la limite de la terreur, lui demanda : « Ô chef des géants, nous allons mourir de faim, et nous ne savons pourquoi tu nous défends de toucher à ces pommes ! » Le géant répondit : « Comment pouvez-vous prétendre ignorer le motif de cette défense ? Avez-vous donc oublié, ô fils des hommes, que le père de votre race, Adam, a désobéi aux ordres d’Allah en mangeant de ces fruits défendus ? Or, depuis ce temps-là, je suis chargé de garder cet arbre et de tuer tous ceux qui tendraient la main vers ces fruits ! Éloignez-vous donc, et cherchez ailleurs de quoi vous nourrir ! »
À ces paroles, Beloukia et Offân se hâtèrent de quitter cet endroit, et s’enfoncèrent dans l’intérieur de l’île. Ils cherchèrent d’autres fruits et les mangèrent ; puis ils se mirent à la recherche du lieu où pouvait se trouver le corps de Soleïmân.
Après avoir erré dans l’île pendant un jour et une nuit, ils arrivèrent à une colline dont les rochers étaient en ambre jaune et en musc, et dans les flancs de laquelle s’ouvrait une grotte magnifique dont la voûte et les parois étaient en diamants. Comme elle se trouvait ainsi éclairée aussi bien qu’en plein soleil, ils s’y engagèrent profondément ; et, à mesure qu’ils s’avançaient, ils voyaient s’augmenter la clarté et s’élargir la voûte. Ils marchaient ainsi, en s’émerveillant, et commençaient à se demander si la grotte avait une fin, quand ils arrivèrent tout à coup dans une salle immense creusée dans le diamant et qui avait en son milieu un grand lit d’or massif sur lequel était étendu Soleïmân ben-Daoud, reconnaissable à son manteau vert orné de perles et de pierreries et à l’anneau magique qui cerclait son doigt de la main droite et lançait des feux dont pâlissait l’éclat de la salle de diamant. Sa main qui portait l’anneau au petit doigt reposait sur sa poitrine, et son autre main étendue tenait le sceptre d’or aux yeux d’émeraude.
À cette vue, Beloukia et Offân furent saisis d’un grand sentiment de respect, et n’osèrent plus avancer. Mais bientôt Offân dit à Beloukia : « Si nous avons affronté tant de périls et éprouvé toutes ces fatigues, ce n’est point pour reculer, maintenant que nous avons atteint le but. Je vais donc m’avancer seul près de ce trône où dort le prophète, et toi, de ton côté, tu vas prononcer les formules de conjuration que je t’ai enseignées et qui sont nécessaires pour faire glisser l’anneau du doigt rigide. »
Alors Beloukia commença à prononcer les formules conjuratoires, et Offân s’approcha du trône et tendit la main pour enlever l’anneau. Mais Beloukia, dans son émotion, avait prononcé de travers les paroles magiques, et cette erreur fut fatale à Offân ; car aussitôt du plafond lumineux tomba une goutte de diamant liquide qui l’enflamma tout entier et, en quelques instants, le réduisit en une poignée de cendres, au pied du trône de Soleïmân.
Lorsque Beloukia vit le châtiment infligé à Offân pour sa tentative sacrilège, il se hâta de se sauver à travers la grotte et d’arriver à la sortie pour courir directement à la mer. Là il voulut se frotter les pieds et s’en aller de l’ile, mais il vit bien qu’il ne le pouvait plus désormais, puisque…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-UNIÈME NUIT
Elle dit :
…mais il vit bien qu’il ne le pouvait plus désormais, puisque Offân était brûlé et que le flacon miraculeux avait été consumé avec lui.
Alors, bien triste, il comprit enfin toute l’exactitude et toute la justesse des paroles que je lui avais dites en lui annonçant les malheurs qui l’attendaient dans cette entreprise, et il se mit à marcher dans l’île, au hasard, ne sachant ce qu’il allait devenir, maintenant tout seul, sans personne qui pût lui servir de guide.
Pendant qu’il marchait de la sorte, il vit un grand tourbillon de poussière d’où sortait un tumulte qui devint assourdissant comme le tonnerre ; et il entendit là-dedans le choc des lances et des épées, et le vacarme produit par des galops et des cris qui n’avaient rien d’humain ; et soudain il aperçut, sortant de la poussière dissipée, une armée entière d’éfrits, de genn, de mareds, de ghouls, de khotrobs, de saals, de baharis, en un mot toutes les espèces d’esprits de l’air, de la mer, de la terre, des bois, des eaux et du désert.
Cette vue lui causa une terreur telle qu’il n’essaya même plus de bouger, et il attendit là jusqu’à ce que le chef de cette armée étonnante s’avançât jusqu’à lui et lui demandât : « Qui donc es-tu, toi ? Et comment as-tu fait pour arriver jusqu’à cette île, où nous venons chaque année pour surveiller la grotte où dort notre maître à tous, Soleïmân ben-Daoud ? » Beloukia répondit : « Ô chef des braves, je suis Beloukia, roi des Bani-Israïl. Je me suis égaré sur mer, et voilà pourquoi je suis ici. Mais permets-moi, à mon tour, de te demander qui tu es, et qui sont tous ces guerriers ? » Il répondit : « Nous sommes les genn, ceux de la descendance de Jân ben-Jân. Nous venons en ce moment du pays où réside notre roi, le puissant Sakhr, maître de la Terre-Blanche où régna autrefois Scheddad fils d’Aâd ! » Beloukia demanda : « Mais où est-elle située cette Terre-Blanche où règne le puissant Sakhr ? » Il répondit : « Derrière le mont Caucase, qui est à une distance de soixante-quinze mois d’ici, en mesure humaine. Mais nous, nous pouvons y aller en l’espace d’un clin d’œil. Si tu veux, puisque tu es un fils de roi, nous pouvons te prendre et te présenter à notre maître ! » Beloukia ne manqua pas d’accepter, et fut aussitôt transporté par les genn dans la résidence du roi Sakhr, leur roi.
Il vit une plaine magnifique sillonnée par des canaux au lit d’or et d’argent ; cette plaine, dont le sol était couvert de musc et de safran, était ombragée par des arbres artificiels aux branches d’émeraudes et aux fruits de rubis, et couverte de tentes superbes en soie verte soutenues par des colonnes d’or incrustées de pierreries. Au milieu de cette plaine s’élevait un pavillon plus haut que les autres, en soie rouge et bleue, soutenu par des colonnes d’émeraude et de rubis, et où, sur un trône d’or massif, était assis le roi Sakhr, ayant à sa droite les autres rois, ses vassaux, et à sa gauche ses vizirs et ses lieutenants, ses notables et ses chambellans.
Lorsqu’il fut en présence du roi, Beloukia commença par embrasser la terre entre ses mains, et lui fit son compliment. Alors le roi Sakhr l’invita, avec beaucoup de bienveillance, à s’asseoir sur un siège d’or, à ses côtés. Puis il lui demanda de lui dire son nom et de lui raconter son histoire. Et Beloukia lui dit qui il était et lui raconta, sans omettre un détail, toute son histoire depuis le commencement jusqu’à la fin.
Le roi Sakhr et tous ceux qui l’entouraient furent, en entendant ce récit, à la limite de l’étonnement. Puis, sur un signe du roi, la nappe fut tendue pour le festin, et les genn serviteurs apportèrent les plateaux et les porcelaines. Les plateaux d’or contenaient cinquante jeunes chameaux bouillis et cinquante autres rôtis, tandis que les plateaux d’argent contenaient cinquante têtes de moutons, et que les fruits, merveilleux de grosseur et de qualité, étaient disposés en rangs bien alignés sur les porcelaines. Et, lorsque tout fut prêt, on mangea et on but avec abondance ; et, le repas terminé, il ne resta absolument pas trace sur les plateaux et les porcelaines des mets et des choses exquises qui les remplissaient.
Alors seulement le roi Sakhr dit à Beloukia : « Tu ignores sans doute, ô Beloukia, notre histoire et notre origine. Or, je vais te renseigner en quelques mots pour que, à ton retour parmi les fils des hommes, tu puisses transmettre aux âges la vérité sur ces questions encore obscures parmi eux. »
« Sache donc, ô Beloukia…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Sache donc, ô Beloukia, qu’au commencement des temps Allah Très-Haut créa le Feu, et le renferma dans le Globe dans sept différentes régions, placées les unes au-dessous des autres, chacune à une distance de mille années, en mesure humaine.
« Il appela la première région du Feu Gehannam, et, dans son esprit, la destina aux créatures rebelles et non repentantes. Il appela la seconde région Lazy, car il la creusa en gouffre, et la destina à tous ceux qui, après la venue future du prophète Môhammad (sur lui la prière et la paix !) resteraient dans leurs erreurs et leurs ténèbres et refuseraient de devenir des Croyants ! Il constitua ensuite la troisième région et, lui ayant donné la forme d’une chaudière bouillante, l’appela El-Jahim, et y enferma les démons Gog et Magog. Après quoi il forma la quatrième région, la nomma Saïr, et en fit l’habitation d’Éblis, le chef des anges rebelles, qui avait refusé de reconnaître Adam et de le saluer, désobéissant ainsi aux ordres formels du Très-Haut. Puis il limita la cinquième région, lui donna le nom de Saqhar et la réserva aux impies, aux menteurs et aux orgueilleux. Cela fait, il creusa une immense caverne, la remplit d’air embrasé et pestilentiel, l’appela Hitmat, et la destina aux tortures des juifs et des chrétiens. Quant à la septième, nommée Hawya, il en fit une réserve toute prête à contenir le surplus des juifs et des chrétiens, et de ceux qui ne seraient Croyants qu’extérieurement. Ces deux dernières régions sont les plus effroyables, tandis que la première est fort supportable. Leur structure est assez pareille. Ainsi dans la première, Gehannam, on ne compte pas moins de soixante-dix mille montagnes de feu, qui renferment chacune soixante-dix mille vallées ; chaque vallée renferme soixante-dix mille villes ; chaque ville, soixante-dix mille tours ; chaque tour, soixante-dix mille maisons, et chaque maison, soixante-dix mille bancs. Or, chacun de ces bancs, dont le nombre vous sera donné par la multiplication de tous ces chiffres, contient soixante-dix mille tortures et supplices divers, dont Allah seul connaît la variété, l’intensité et la durée. Et, comme cette région est la moins brûlante des sept, tu peux te faire idée, ô Beloukia, des tourments renfermés dans les six autres régions.
« Si je t’ai donné cet aperçu et ces explications sur le Feu, ô Beloukia, c’est que nous, les genn, sommes les fils du Feu.
« En effet, les deux premiers êtres qu’Allah a créés du Feu, sont deux genn dont Il fit sa garde particulière et qu’il appela Khallit et Mallit ; et Il donna à l’un la forme d’un lion et à l’autre la forme d’un loup. Il donna au lion des organes mâles et au loup des organes femelles. La queue du lion Khallit avait une longueur égale à une distance parcourue pendant vingt années, et la vulve de Mallit, la louve, avait la forme d’une tortue, dont la grosseur était proportionnée à la longueur de la queue de Khallit. L’un était de couleur bigarrée de blanc et de noir, et l’autre était rose et blanche. Et Allah unit Khallit et Mallit sexuellement, et de leur copulation fit naître des dragons, des serpents, des scorpions et des bêtes puantes dont il peupla les Sept Régions pour le supplice des damnés. Ensuite Allah ordonna à Khallit et à Mallit de copuler une seconde fois, et, de ce second accouplement, fit naître sept mâles et sept femelles qui grandirent dans l’obéissance. À leur majorité, l’un d’eux, qui donnait les plus belles espérances par sa conduite exemplaire, fut spécialement distingué par le Très-Haut qui en fit le chef de ses cohortes constituées par la reproduction incessante du lion et de la louve. C’est lui justement dont le nom était Éblis. Mais plus tard, lors de sa désobéissance aux ordres d’Allah, qui lui enjoignait de se prosterner devant Adam, il fut précipité dans la quatrième région avec tous ceux qui l’avaient soutenu. Et c’est Éblis et sa descendance qui peuplèrent l’enfer de démons mâles et femelles. Quant aux dix autres garçons et aux autres filles, restés dans la soumission, ils s’unirent entre eux et eurent comme enfants les genn, dont nous sommes, ô Beloukia. Et telle est, en peu de mots, notre généalogie. Ne t’étonne donc pas si tu nous vois manger tellement, puisque nous tenons notre origine d’un lion et d’une louve. Pour te donner une idée de la capacité de notre ventre, je te dirai que chacun de nous, dans sa journée, avale dix chameaux, vingt moutons, et boit quarante cuillerées de bouillon, chaque cuillerée de la contenance d’un chaudron.
« Maintenant, ô Beloukia, pour qu’à ton retour parmi les fils des hommes ton instruction soit parfaite, sache que la terre que nous habitons est toujours rafraîchie par les neiges du mont Caucase qui l’environne comme une ceinture. Sans cela, notre terre serait insupportable à habiter à cause du feu souterrain. Elle est constituée, elle aussi, par sept étages qui reposent sur les épaules d’un genni doué d’une force merveilleuse. Ce genni est debout sur un rocher qui repose sur le dos d’un taureau ; le taureau est porté par un énorme poisson, et le poisson nage à la surface de la Mer de l’Éternité.
« La Mer de l’Éternité a, comme lit, l’étage supérieur de l’enfer, lequel, avec ses sept régions, est contenu dans la gueule d’un monstrueux serpent qui restera immobile jusqu’au jour du Jugement. Alors il vomira de sa gueule l’enfer et son contenu en présence du Très-Haut qui prononcera son arrêt d’une façon définitive.
« Voilà, ô Beloukia…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT SOIXANTE-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
« … Voilà, ô Beloukia, rapidement résumées, notre histoire, notre origine et la formation du globe.
« Je dois également te dire, pour achever ton instruction à ce sujet, que notre âge reste toujours le même ; nous ne vieillissons jamais, tandis que sur la terre, autour de nous, la nature et les hommes et tous les êtres créés s’acheminent invariablement vers la décrépitude. Cette vertu, nous la devons à la fontaine de vie dont nous buvons et dont, dans la région des Ténèbres, Khizr est le gardien. C’est lui, ce vénérable Khizr, qui égalise les saisons, revêt les arbres de leurs couronnes vertes, fait courir les eaux fugitives, déroule le tapis verdoyant des prairies et, revêtu de son manteau vert dans les soirs, mêle les teintes légères dont se colorent les cieux au crépuscule.
« Et maintenant, ô Beloukia, comme tu m’as écouté avec une grande attention, pour te récompenser je vais te faire emporter d’ici et déposer à l’entrée de ton pays, si toutefois tu le désires ! »
À ces paroles, Beloukia remercia avec effusion le roi Sakhr, chef des genn, de son hospitalité, de ses leçons et de son offre, qu’il accepta avec empressement. Il prit donc congé du roi, de ses vizirs et des autres genn, et monta à califourchon sur les épaules d’un fort solide éfrit qui, en moins d’un clin d’œil, lui fit traverser l’espace et le déposa doucement en pays connu, vers les frontières de son pays.
Comme Beloukia, une fois qu’il eut reconnu la direction à suivre, se disposait à prendre la route de sa capitale, il vit, assis entre deux tombeaux et pleurant avec amertume, un jeune homme d’une beauté ravissante, mais au teint pâle et à l’air bien triste. Il s’approcha de lui, le salua amicalement, et lui dit : « Ô bel adolescent, pourquoi te vois-je assis pleurant entre ces deux tombeaux ? Pourquoi cet air affligé, dis-le moi, pour que j’essaie de te consoler ! » Le jeune homme leva ses regards tristes vers Beloukia et lui dit, les larmes aux yeux : « Ô voyageur, pourquoi t’arrêter dans ta voie ? Laisse mes larmes couler, dans la solitude, sur ces pierres de ma douleur ! » Mais Beloukia lui dit : « Ô frère d’infortune, sache que j’ai un cœur compatissant prêt à t’écouter. Tu peux donc sans crainte me révéler la cause de ta tristesse ! » Et il s’assit sur le marbre tout contre lui, lui prit les mains dans les siennes et, pour l’encourager à parler, lui raconta sa propre histoire depuis le commencement jusqu’à la fin. Ensuite il lui dit : « Et toi, ô mon frère, quelle est ton histoire ? Hâte-toi, je t’en prie, de me la raconter, car je pressens qu’elle doit être attachante infiniment ! »
HISTOIRE DU BEL ADOLESCENT TRISTE
Alors l’adolescent à la figure douce et triste, qui pleurait entre les deux tombeaux, dit au jeune roi Beloukia :
« Sache, ô mon frère, que moi aussi je suis un fils de roi ; et mon histoire est si étrange et si extraordinaire que si elle était écrite avec les aiguilles sur le coin intérieur de l’œil elle servirait de leçon salutaire à qui la lirait avec sympathie. Je ne veux donc pas différer davantage de te la raconter ! »
Il se tut alors quelques instants, essuya ses larmes, et, le front appuyé sur la main, il commença ainsi cette merveilleuse histoire :
« Je suis né, ô mon frère, dans le pays de Kaboul où règne le roi Tigmos, mon père, chef des Bani-Schalân et de l’Afghanistân. Mon père, qui est un roi très grand et très juste, a sous sa suzeraineté sept rois tributaires, maîtres chacun de cent villes et de cent forteresses. Il commande à cent mille cavaliers courageux et à cent mille braves guerriers. Quant à ma mère, elle est la fille du roi Bahrawân, souverain du Khorassân. Mon nom est Jânschah.
Dès mon enfance, mon père me fit instruire dans les sciences, les arts et les exercices du corps, de sorte qu’à l’âge de quinze ans je comptais parmi les meilleurs cavaliers du royaume et dirigeais les chasses et les courses sur mon cheval plus rapide que l’antilope.
Un jour d’entre les jours, dans une chasse où se trouvaient le roi mon père et tous ses officiers, nous étions depuis trois jours dans les forêts et nous avions tué beaucoup de gibier, quand, à la tombée de la nuit, j’aperçus une gazelle d’une élégance extrême apparaître à quelques pas de l’endroit où je me trouvais avec sept de mes mamalik. Lorsqu’elle nous vit, elle s’effaroucha et, bondissant, elle fila de toute sa légèreté. Alors moi, suivi de mes mamalik, je la poursuivis pendant plusieurs heures ; et nous arrivâmes de la sorte devant un fleuve très large et très profond, où nous crûmes pouvoir la cerner et la prendre. Mais elle, après une courte hésitation, se jeta à l’eau et se mit à nager pour atteindre l’autre bord. Et nous, nous descendîmes vivement de nos chevaux, nous les confiâmes à l’un de nous, nous nous élançâmes dans une barque de pêche qui se trouvait là amarrée, et nous manœuvrâmes rapidement pour atteindre la gazelle. Mais lorsque nous arrivâmes au milieu du fleuve, nous ne pûmes plus être les maîtres de notre embarcation que le vent et le courant très fort se mirent à entraîner à la dérive, au milieu de l’obscurité grandissante, sans que nos efforts parvinssent à nous mettre dans une direction salutaire. Et nous fûmes ainsi entraînés toute la nuit, avec une rapidité effrayante, croyant à chaque instant nous fracasser contre quelque rocher à fleur d’eau ou quelque autre obstacle sur notre route forcée. Et cette course dura également toute la journée et toute la nuit suivante. Et ce ne fut que le lendemain matin que nous pûmes enfin aborder à une terre où nous avait jetés le courant.
Pendant ce temps, le roi Tigmos, mon père, avait appris notre disparition sur le fleuve, en interrogeant le mamelouk qui gardait nos chevaux. Et à cette nouvelle, il fut dans un tel désespoir qu’il éclata en sanglots, jeta sa couronne à terre, se mordit les mains de douleur, et se hâta d’envoyer de toutes parts à ma recherche des émissaires connaissant ces contrées inexplorées. Quant à ma mère, en apprenant ma disparition, elle se donna de grands coups au visage, déchira ses habits, se meurtrit la poitrine, s’arracha les cheveux, et revêtit les habits de deuil.
Pour nous, en abordant à cette terre, nous trouvâmes une belle source qui coulait sous les arbres, et un homme assis tranquillement à se rafraîchir les pieds dans l’eau. Nous le saluâmes poliment et nous lui demandâmes où nous étions. Mais l’homme, sans nous rendre notre salut, nous répondit d’une voix de fausset semblable au cri d’un corbeau ou de quelque autre oiseau de proie…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… nous répondit d’une voix de fausset semblable au cri d’un corbeau ou de quelque autre oiseau de proie. Puis il se leva tout d’un coup, se divisa d’un mouvement en deux parties, en se coupant par la moitié, et courut à nous par son tronc seulement, tandis que sa partie inférieure courait dans une autre direction. Et au même moment, de tous les points de la forêt, apparurent d’autres hommes semblables à celui-là, qui coururent à la fontaine, se divisèrent en deux parties d’un mouvement de recul, et s’élancèrent sur nous quant à leur tronc seulement. Ils se jetèrent alors sur trois de mes mamalik qui étaient les plus proches d’eux et se mirent immédiatement à les dévorer vivants, tandis que moi et mes trois autres mamalik, à la limite de l’épouvante, nous nous élancions dans notre barque et, préférant mille fois être engloutis dans l’eau que dévorés par ces monstres, nous nous hâtions de nous éloigner du rivage, nous laissant à nouveau emporter par le courant. Et nous vîmes alors courir sur le rivage, en essayant de nous atteindre, pendant que les troncs dévoraient mes trois malheureux mamalik, toutes les jambes et les cuisses en un galop forcené et sans ordre qui nous terrifia dans notre barque déjà hors de leur portée. Et nous étions aussi bien étonnés de l’appétit farouche de ces troncs au ventre coupé, et nous nous demandions comment une pareille chose était possible, tout en déplorant le sort de nos malheureux compagnons.
Nous fûmes emportés par le courant jusqu’au lendemain, et nous arrivâmes alors à une terre couverte d’arbres fruitiers et de fleurs charmantes dans de grands jardins. Mais, lorsque notre barque fut amarrée, moi je ne voulus pas descendre à terre cette fois, et je chargeai mes trois mamalik d’aller d’abord inspecter les lieux. Ils s’en allèrent donc les premiers et, après s’être absentés une demi-journée, ils revinrent me raconter qu’ils avaient parcouru une grande distance, en allant à droite et à gauche, sans rien trouver de suspect ; après quoi ils avaient vu un palais de marbre blanc dont les pavillons étaient de cristal pur, et au milieu duquel se déployait un jardin magnifique avec un lac superbe ; ils étaient entrés dans le palais et avaient vu une salle immense où des sièges d’ivoire étaient rangés autour d’un trône d’or enrichi de diamants et de rubis ; mais ils n’avaient vu personne, pas plus dans les jardins que dans le palais.
Lorsqu’ils m’eurent fait ce rapport rassurant, moi je me décidai à sortir de la barque et je pris avec eux le chemin du palais. Nous commençâmes d’abord par satisfaire notre faim en mangeant les fruits délicieux des arbres du jardin, puis nous entrâmes dans le palais nous reposer. Moi, je m’assis sur le trône d’or et mes mamalik sur les sièges d’ivoire ; et, à ce spectacle, je me rappelai le roi mon père, ma mère et le trône que j’avais perdu, et je me mis à pleurer ; et mes mamalik aussi, pleurèrent d’émotion.
Pendant que nous étions plongés dans ces souvenirs attristants, nous entendîmes un grand bruit, pareil au tumulte de la mer, et nous vîmes bientôt entrer dans la salle où nous étions un cortège formé par des vizirs, des émirs, des chambellans et des notables, mais tous étaient de l’espèce des singes. Il y en avait qui étaient de la grande variété et d’autres qui étaient de la petite espèce. Et nous crûmes notre fin cette fois arrivée. Mais le grand-vizir des singes, qui était de la variété la plus énorme, vint, avec les signes les plus évidents du respect, s’incliner devant moi et me dire, en langage humain, que lui et tout le peuple me reconnaissaient pour leur roi, et nommaient mes trois mamalik chefs de leur armée. Puis, après nous avoir fait servir à manger des gazelles rôties, il m’invita à venir passer en revue l’armée des singes, mes sujets, avant le combat que nous devions livrer à leurs ennemis anciens, les ghouls qui habitaient la contrée voisine.
Alors moi, comme j’étais bien fatigué, je congédiai le grand-vizir et les autres, ne gardant auprès de moi que mes trois mamalik. Après nous être entretenus pendant une heure de temps sur notre nouvelle situation, nous résolûmes de nous enfuir au plus vite de ce palais et de cette terre, et nous nous dirigeâmes vers notre embarcation ; mais, en arrivant au fleuve, nous constatâmes qu’elle avait disparu, et nous fûmes obligés de revenir au palais où nous dormîmes jusqu’au matin. A notre réveil, le grand-vizir de mes nouveaux sujets vint me saluer, et me dit que tout était prêt pour le combat contre les ghouls. Et en même temps, les autres vizirs amenèrent, à la porte du palais, pour moi et mes mamalik, quatre gros chiens qui devaient nous servir de chevaux et qui étaient bridés avec des chaînes d’acier. Et moi et mes mamalik nous fûmes bien obligés de monter sur ces chiens, et de prendre les devants, tandis que derrière nous, avec des hurlements et des cris effroyables, nous suivait toute l’armée innombrable de mes sujets singes dirigée par mon grand-vizir.
Au bout d’une journée et d’une nuit de marche, nous arrivâmes en face d’une haute montagne noire où se trouvaient les repaires des ghouls, lesquels ne tardèrent pas à se montrer. Ils étaient de différentes formes, toutes plus épouvantables les unes que les autres. Les uns avaient une tête de bœuf sur un corps de chameau, d’autres ressemblaient à des hyènes, tandis que d’autres avaient un aspect indescriptible d’horreur et qui ne ressemblait à rien de connu, pour établir une comparaison.
Lorsque les ghouls nous eurent aperçus, ils descendirent de la montagne, et, s’arrêtant à une certaine distance, ils commencèrent par nous accabler sous une pluie de cailloux. Mes sujets ripostèrent de la même façon, et la mêlée devint bientôt terrible de part et d’autre. Moi et mes mamalik, armés de nos arcs, nous lançâmes aux ghouls une grande quantité de flèches qui en tuèrent un grand nombre, à la joie de mes sujets que ce spectacle remplit d’ardeur. Aussi nous finîmes par remporter la victoire, et nous nous mîmes à la poursuite des ghouls.
Alors moi et mes mamalik, nous résolûmes de profiter du désordre de la course pour, montés sur nos chiens, échapper à mes sujets les singes, en prenant la fuite du côté opposé, sans qu’ils nous aperçussent ; et, au grand galop, nous disparûmes à leur vue.
Au bout d’une longue course, nous nous arrêtâmes pour laisser respirer nos montures, et nous vîmes en face de nous un grand rocher taillé en forme de table où se trouvait gravée une inscription en langue hébraïque, qui contenait ceci :
Ô toi, captif que la destinée a jeté dans cette région pour faire de toi le roi des singes, si tu veux renoncer à ta royauté par la fuite, deux chemins s’ouvrent devant toi pour la délivrance : L’un de ces chemins se trouve à ta droite, et il est le plus court pour te conduire au bord de l’océan qui entoure le monde ; mais il traverse des déserts farouches remplis de monstres et de genn malfaisants. L’autre, à gauche, est long de quatre mois de route, et traverse une grande vallée qui est la Vallée des Fourmis. En prenant ce chemin et en te garant des fourmis, tu aboutiras à une montagne de feu au pied de laquelle se trouve la Ville des Juifs. Moi, Soleïmân ben-Daoud, j’ai écrit ceci pour ton salut !
Lorsque nous eûmes lu cette inscription, nous fûmes à la limite de l’étonnement, et nous nous hâtâmes de prendre le chemin de gauche qui devait nous conduire à la Ville des Juifs en passant par la Vallée des Fourmis…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
… le chemin de gauche qui devait nous conduire à la Ville des Juifs en passant par la Vallée des Fourmis. Mais nous n’étions pas en marche depuis une journée quand nous entendîmes le sol trembler sous nos pieds, et bientôt, derrière nous, nous vîmes poindre et arriver à toute vitesse mes sujets les singes avec le grand-vizir à leur tête. Lorsqu’ils nous eurent atteints, ils nous entourèrent de tous côtés en poussant des hurlements de joie de nous avoir retrouvés, et le grand-vizir se fit l’interprète de tous en prononçant une harangue de compliments pour notre salut.
Cette rencontre nous causa un grand désappointement, que nous prîmes soin de ne pas montrer, et nous allions reprendre avec mes sujets la route du palais, quand nous vîmes sortir de la vallée que nous traversions à ce moment une armée de fourmis dont chacune était grosse comme un chien. Et, en un clin d’œil, une mêlée effroyable eut lieu, entre mes sujets et les fourmis monstrueuses, où les fourmis prenaient les singes dans leurs serres et d’un coup les cassaient en deux, et où les singes se jetaient dix par dix sur une fourmi pour arriver à la tuer.
Quant à nous, nous voulûmes profiter du combat pour nous enfuir sur nos chiens ; mais malheureusement je fus le seul à pouvoir m’échapper, car mes trois mamalik furent aperçus par les fourmis et saisis et cassés en deux dans les serres formidables. Et moi je me sauvai en déplorant la perte de mes derniers compagnons et j’arrivai à un fleuve que je traversai à la nage, en abandonnant ma monture, et j’arrivai sain et sauf sur l’autre rive où je commençai par faire sécher mes vêtements ; et ensuite je m’enfonçai dans le sommeil jusqu’au matin, sûr que j’étais maintenant de n’être plus poursuivi, puisque j’avais mis le fleuve entre moi, les fourmis et les singes mes sujets.
Lorsque je me réveillai, je me mis à marcher pendant des jours et des jours, mangeant des plantes et des racines, jusqu’à ce que je fusse arrivé à la montagne en question au pied de laquelle je vis effectivement une grande ville qui était la Ville des Juifs, exactement comme me l’avait indiqué l’inscription. Mais un détail dont ne parlait pas l’inscription, et que je remarquai plus tard, m’étonna beaucoup dans cette ville : je constatai, en effet, qu’un fleuve que je traversai à pied sec ce jour-là pour arriver à la ville, était rempli d’eau tout le reste de la semaine ; et j’appris ainsi que ce fleuve, abondant les autres jours, ne coulait plus le samedi, jour de fête chez les Juifs.
Or, moi j’entrai dans cette ville ce jour-là et je ne vis personne dans les rues. Alors je me dirigeai vers la première maison que je rencontrai sur mon chemin, j’en ouvris la porte et y pénétrai. Je me trouvai alors dans une salle où étaient assis en cercle un grand nombre de personnages à l’aspect vénérable. Alors, encouragé par leur mine, je m’approchai d’eux respectueusement et je leur dis, après le salut : « Je suis Jânschah, fils du roi Tigmos, maître de Kaboul et chef des Bani-Schalân. Je vous prie, ô mes maîtres, de me dire à quelle distance je suis de mon pays, et quel chemin il me faut prendre pour y arriver. De plus, j’ai bien faim ! » Alors tous ceux qui étaient assis là me regardèrent sans me répondre, et celui qui paraissait être leur cheikh me dit, par signes seulement, sans prononcer une parole : « Mange et bois, mais ne parle pas ! » Et il me montra un plateau de mets étonnants que je n’avais jamais vus ailleurs, et dont la base, à en juger par l’odeur, était de l’huile. Alors moi je mangeai, je bus, et je gardai le silence.
Lorsque j’eus fini, le cheikh des Juifs s’approcha de moi et me demanda, par signes également : « Qui ? d’où ? où ? » Alors moi je lui demandai par signes si je pouvais répondre, et, sur son signe affirmatif suivi d’un autre qui voulait dire : « Ne prononce que trois mots ! » Je demandai : « Caravane Kaboul quand ? » Il me répondit : « Je ne sais pas ! » toujours sans prononcer une parole, et il me fit signe de sortir, puisque j’avais terminé mon repas.
Alors moi je le saluai, ainsi que tous ceux qui étaient là, et sortis en m’étonnant à l’extrême de ces manières étranges. Arrivé dans la rue, je voulais tâcher de me renseigner, quand enfin j’entendis un crieur public qui disait à haute voix : « Que celui qui désire gagner mille pièces d’or et posséder une jeune esclave d’une beauté sans égale, me suive pour faire un travail d’une heure de temps ! » Moi, dénué de tout comme j’étais, je m’approchai du crieur et lui dis : « J’accepte le travail et en même temps les mille dinars et la jeune esclave ! » Alors il me prit la main et me conduisit dans une maison fort richement meublée où, sur un siège d’ébène, était assis un vieux juif devant lequel le crieur vint s’incliner en me présentant, et dit : « Voici enfin un jeune étranger, le seul qui ait répondu à mon appel depuis trois mois que je crie la chose ! »
À ces paroles, le vieux juif, maître de la maison, me fit m’asseoir à ses côtés, me montra beaucoup de bienveillance, me fit servir à manger et à boire sans parcimonie et, le repas terminé, me donna une bourse contenant mille pièces d’or pas fausses, en même temps qu’il ordonnait à ses esclaves de me revêtir d’une robe de soie et de me conduire auprès de la jeune esclave qu’il me donnait d’avance pour le travail projeté que je ne connaissais pas encore…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
… la jeune esclave qu’il me donnait pour le travail projeté que je ne connaissais par encore.
Alors les esclaves, après m’avoir vêtu de la robe de soie en question, me conduisirent dans la chambre où m’attendait la jeune fille, qui devait être vierge d’après ce que m’affirmait le vieux juif. Et moi je trouvai, en effet, une jeune fille fort belle avec laquelle les esclaves me laissèrent seul pour passer la nuit. Et, de fait, je couchai avec elle, et la trouvai parfaite, en vérité.
Je passai avec elle trois jours et trois nuits à manger, à boire et à faire ce que j’avais à faire, et au matin du quatrième jour le vieillard me fit appeler et me dit : « Es-tu prêt maintenant à exécuter le travail pour lequel je t’ai payé et que, d’avance, tu as accepté ? » Je déclarai que j’étais prêt à m’acquitter de ce travail-là, sans savoir de quoi il s’agissait.
Alors le vieux juif ordonna à ses esclaves de préparer et d’amener deux mules ; et les esclaves amenèrent deux mules harnachées. Il monta sur l’une et moi sur l’autre, et me dit de le suivre. Nous allâmes à une bonne allure et nous cheminâmes de la sorte jusqu’à l’heure de midi, où nous arrivâmes au pied d’une haute montagne à pic sur les flancs de laquelle on ne voyait aucun sentier où pût s’aventurer un homme ou une monture quelconque. Nous mîmes alors pied à terre, et le vieux juif me tendit un couteau en me disant : « Enfonce-le dans le ventre de ta mule ! C’est le moment du travail ! » Moi, j’obéis et j’enfonçai le couteau dans le ventre de la mule qui ne tarda pas à succomber ; puis, sur l’ordre du juif, j’écorchai la bête, et nettoyai la peau. Alors il me dit : « Il faut maintenant t’étendre par terre sur cette peau, pour que je te couse dedans comme dans un sac. » Et moi j’obéis également et m’étendis sur la peau où le vieillard me cousit soigneusement ; puis il me dit : « Écoute bien mes paroles ! Un grand oiseau va venir à l’instant fondre sur toi et t’enlever pour te porter dans son nid situé sur le sommet de cette montagne escarpée. Prends bien garde de bouger quand tu te sentiras dans les airs, car l’oiseau te lâcherait et, dans ta chute, tu te fracasserais sur le sol ; mais, lorsqu’il t’aura déposé sur la montagne, fends la peau avec le couteau que je t’ai donné et sors du sac. L’oiseau sera effrayé et te lâchera. Alors, toi tu ramasseras les pierres précieuses dont est jonché le sommet de cette montagne, et tu me les jetteras ! Cela fait, tu redescendras me rejoindre. »
Or, à peine le vieux juif avait-il fini de parler, que je me sentis enlever dans les airs et, au bout de quelques instants, déposer de nouveau sur le sol. Alors moi, avec mon couteau, je fendis le sac et en sortis ma tête. Cette vue effraya l’oiseau monstrueux qui s’enfuit à tire-d’aile. Je me mis alors à ramasser des rubis, des émeraudes et d’autres pierres précieuses qui couvraient le sol, et je les jetai au vieux juif. Mais lorsque je voulus descendre je constatai qu’il n’y avait pas un sentier où pouvoir poser le pied, et je vis le vieux juif qui enfourchait sa mule, une fois qu’il eut recueilli les pierres, et s’éloignait rapidement pour disparaître à ma vue.
Alors moi, à la limite du désespoir, je me mis à pleurer sur ma destinée, et me décidai à chercher de quel côté il valait mieux me diriger. Je finis par marcher droit devant moi, à l’aventure, et j’errai de la sorte durant deux mois jusqu’à ce que je fusse arrivé à l’extrémité de la chaîne de montagnes, à l’entrée d’une vallée magnifique où les ruisseaux, les arbres et les fleurs glorifiaient le Créateur au milieu du gazouillis des oiseaux. Là je vis un immense palais qui s’élevait haut dans les airs et vers lequel je me dirigeai. J’arrivai à la porte, où je trouvai assis, sur le banc du vestibule, un vieillard dont le visage s’auréolait de lumière. Il tenait à la main un sceptre de rubis, et portait sur la tête une couronne de diamants. Moi, je le saluai ; et il me rendit le salut avec bienveillance et me dit : « Assieds-toi à côté de moi, mon fils ! » Et, lorsque je fus assis, il me demanda : « D’où viens-tu ainsi sur cette terre que jamais n’a foulé le pied d’un adamite ? Et où penses-tu aller ? » Moi, pour toute réponse, j’éclatai en sanglots, et je faillis m’étouffer de mes pleurs. Alors le vieillard me dit : « Cesse de pleurer ainsi, mon enfant : car tu m’endoloris le cœur. Prends courage, et commence par te fortifier en mangeant et en buvant. » Et il m’introduisit dans une grande salle où il m’apporta à manger et à boire. Et, lorsqu’il me vit dans de meilleures dispositions, il me pria de lui raconter mon histoire ; et moi je satisfis à sa demande, et le priai à mon tour de me dire qui il était et à qui appartenait ce palais. Il me répondit : « Apprends, mon fils, que ce palais a été autrefois bâti par notre maître Soleïmân, dont je suis le lieutenant pour gouverner les oiseaux. Chaque année tous les oiseaux de la terre viennent ici me rendre hommage. Si donc tu désires retourner dans ton pays, je te recommanderai à eux la première fois qu’ils reviendront prendre mes ordres, et ils te transporteront dans ton pays. Mais, pour passer le temps jusqu’à leur arrivée, tu peux circuler partout dans cet immense palais, et tu peux entrer dans toutes les salles à l’exception d’une seule qui s’ouvre avec la clef d’or que tu vois au milieu de toutes ces clefs que je te donne. » Et le vieillard, lieutenant des oiseaux, me remit les clefs et me laissa libre de mes mouvements.
Je commençai par visiter d’abord les salles qui donnaient sur la grande cour du palais, puis je pénétrai dans les autres chambres qui étaient toutes aménagées pour servir de cages aux oiseaux, et j’arrivai de la sorte devant la porte qui s’ouvrait avec la clef d’or…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… j’arrivai de la sorte devant la porte qui s’ouvrait avec la clef d’or, et je restai longtemps à la regarder, n’osant même pas la toucher de la main, à cause de la défense que m’avait faite le vieillard ; mais à la fin je ne pus résister à la curiosité dont mon âme était remplie, je mis la clef d’or dans la serrure, j’ouvris la porte, et je pénétrai, saisi de crainte, dans le lieu défendu.
Or, loin d’avoir sous les yeux un spectacle effrayant, je vis d’abord, au milieu d’un pavillon au sol incrusté de pierreries de toutes les couleurs, un bassin d’argent entouré d’oiseaux d’or qui laissaient l’eau couler de leurs bouches avec un bruit si merveilleux que je croyais entendre la voix de chacun d’eux résonner mélodieuse contre les parois d’argent. Tout autour de ce bassin, il y avait, divisés en variétés ravissantes, des parterres de fleurs aux suaves parfums, qui mariaient leurs couleurs à celles des fruits dont étaient chargés les arbres qui mettaient leur fraîcheur d’ombre sur l’eau. Le sable que je foulais était de poudre d’émeraude et de diamant, et s’étendait jusqu’aux degrés d’un trône qui s’élevait en face du bassin merveilleux. Ce trône était fait d’un seul rubis dont les facettes projetaient dans le jardin le rouge de leurs rayons froids qui faisaient scintiller l’eau en pierreries.
Moi, je m’arrêtai en extase devant ces simples choses nées de l’union pure des éléments ; puis j’allai m’asseoir sur le trône de rubis que surmontait un baldaquin de soie rouge, et là je fermai un instant les yeux pour laisser cette fraîche vision mieux pénétrer mon âme ravie.
Quand j’ouvris les yeux, je vis s’avancer vers le bassin, en secouant leurs plumes blanches, trois élégantes colombes qui venaient prendre leur bain. Elles sautèrent avec grâce sur le large rebord du bassin d’argent et, ô mes yeux émerveillés ! je les vis, après s’être embrassées et fait mille caresses charmantes, rejeter loin d’elles leur virginal manteau de plumes et en sortir, dans une nudité de jasmin, sous l’aspect de trois jeunes filles belles comme des lunes. Et aussitôt elles plongèrent dans le bassin pour se livrer entre elles à mille jeux et mille folies, des fois disparaissant et des fois reparaissant au milieu de grands remous brillants, pour disparaître encore en riant aux éclats, tandis que seules leurs chevelures émergeaient en un vol déployé de flamme sur l’eau.
À ce spectacle, ô mon frère Beloukia, moi je sentis ma raison nager dans mon cerveau et essayer de s’en échapper. Et, ne pouvant plus maîtriser mon émotion, je courus affolé au bassin et je criai : « Ô jeunes filles, ô lunes, ô souveraines ! »
Lorsque les jeunes filles m’eurent aperçu, elles poussèrent un cri d’effroi, et, sortant légères de l’eau, elles coururent à leurs manteaux de plumes qu’elles jetèrent sur leur nudité, et s’envolèrent sur l’arbre le plus haut de ceux qui ombrageaient le bassin, et là se mirent à rire en me regardant.
Alors je m’approchai de l’arbre, je levai les yeux et leur dis : « Ô souveraines, je vous en prie, dites-moi qui vous êtes ! Moi, je suis Jânschah, fils du roi Tigmos, souverain de Kaboul et chef des Bani-Schalân ! » Alors la plus jeune des trois, celle justement dont les charmes m’avaient impressionné le plus, me dit : « Nous sommes les filles du roi Nassr qui habite dans le palais des diamants. Nous venons ici faire une promenade et nous amuser seulement. » Je dis : « Dans ce cas, ô ma maîtresse, aie compassion de moi, et descends compléter le jeu avec moi ! » Elle me dit : « Et depuis quand les jeunes filles peuvent-elles jouer avec les jeunes gens, ô Jânschah ! En tout cas, si tu tiens absolument à mieux me connaître, tu n’as qu’à me suivre au palais de mon père ! » Et, ayant dit ces paroles, elle me lança un regard qui me pénétra le foie, et elle s’envola avec ses deux sœurs pour disparaître à mes yeux.
À cette vue, moi, à la limite du désespoir, je poussai un grand cri et tombai évanoui sous l’arbre.
Je ne sais combien de temps je restai étendu de la sorte ; mais, lorsque je revins à moi, le vieillard, lieutenant des oiseaux, était à mes côtés et m’aspergeait le visage avec de l’eau de fleurs. Lorsqu’il me vit ouvrir les yeux, il me dit : « Tu vois, mon enfant, ce qu’il t’en coûte de me désobéir ! Ne t’avais-je pas défendu d’ouvrir la porte de ce pavillon ? » Moi, pour toute réponse, je ne pus qu’éclater en sanglots, puis j’improvisai ces vers :
« Mon cœur est ravi par une svelte adolescente au corps harmonieux.
Ravissante est sa taille entre toutes les tailles. Quand elle sourit, ses lèvres excitent la jalousie des roses et des rubis.
Sa chevelure se balance sur sa belle croupe arrondie.
Les flèches lancées par les arcs de ses sourcils atteignent même de loin et font d’inguérissables blessures !
Ô sa beauté ! tu es sans rivale, et tu effaces toutes les beautés de l’Inde ! »
Lorsque j’eus fini de réciter ces vers, le vieillard me dit : « Je comprends ce qui t’est arrivé. Tu as vu les jeunes filles vêtues comme des colombes, qui viennent ici quelquefois prendre leur bain. » Je m’écriai : « Je les ai vues, mon père, et je te prie de me dire où se trouve le palais des diamants qu’elles habitent avec leur père, le roi Nassr ? » Il répondit : « Il ne faut guère songer à y aller, mon fils, car le roi Nassr est un des chefs les plus puissants des genn, et je doute fort qu’il t’accorde l’une de ses filles en mariage. Occupe-toi plutôt à te préparer à retourner dans ton pays. Je vais moi-même te faciliter la tâche en te recommandant aux oiseaux qui vont bientôt venir me présenter leurs hommages, et qui te serviront de guides. » Je répondis : « Je te remercie, mon père, mais je renonce à retourner auprès de mes parents si je ne dois plus revoir la jeune fille qui m’a parlé ! » Et, en disant ces paroles, je me jetai aux pieds du vieillard en pleurant, et le suppliai de m’indiquerle moyen de revoir les jeunes filles habillées en colombes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT SOIXANTE-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… le moyen de revoir les jeunes filles habillées en colombes. Alors le vieillard me tendit la main, me releva et me dit : « Je vois que ton cœur est consumé de passion pour la jeune fille, et je vais t’indiquer le moyen de la revoir. Tu vas donc te cacher derrière les arbres et attendre patiemment le retour de ces colombes. Tu les laisseras se déshabiller et descendre dans le bassin, et alors, soudain, tu te précipiteras sur leurs manteaux de plumes et tu t’en empareras. Elles, alors, adouciront beaucoup leur langage à ton égard ; elles s’approcheront de toi, te feront mille caresses et te supplieront, en te disant des paroles extrêmement gentilles, de leur rendre leurs plumes. Mais, toi, garde-toi bien de te laisser fléchir, car alors ce serait fini pour toujours des jeunes filles. Au contraire ! refuse énergiquement de les leur rendre, et dis-leur : « Je veux bien vous donner vos manteaux, mais pas avant que ne revienne le cheikh ! » Et tu attendras, en effet, mon retour en les entretenant avec galanterie ; et moi je saurai bien trouver le moyen de faire tourner les choses selon ton gré ! »
À ces paroles, je remerciai beaucoup le vénérable lieutenant des oiseaux, et courus aussitôt me cacher derrière les arbres, tandis qu’il se retirait dans son pavillon pour recevoir ses sujets.
Je restai assez longtemps à attendre leur venue. Enfin j’entendis des battements d’ailes et des rires aériens, et je vis les trois colombes s’abattre sur le rebord du bassin et regarder à droite et à gauche pour voir si personne ne les observait. Puis, celle qui m’avait parlé s’adressa aux deux autres et leur dit : « Ne croyez-vous pas, mes sœurs, qu’il y ait quelqu’un de caché dans le jardin ? Qu’est-il devenu, le jeune homme que nous avions vu ? » Mais ses sœurs lui dirent : « Ô Schamsa, ne te préoccupe donc pas tellement, et hâte-toi de faire comme nous ! » Et toutes les trois alors se dépouillèrent de leurs plumes et plongèrent dans l’eau pour aussitôt se livrer à mille jeux folâtres, blanches et nues comme le vierge argent. Et je crus voir trois lunes réfléchies dans l’eau.
J’attendis qu’elles eussent nagé jusqu’au milieu du bassin et je me levai debout sur mes deux pieds pour aussitôt m’élancer avec la rapidité de l’éclair et m’emparer du manteau de la jeune fille que j’aimais. Et à mon geste ravisseur répondirent trois cris d’effroi, et je vis les jeunes filles, honteuses d’être surprises dans leurs ébats, plonger entièrement, en ne laissant que la tête hors de l’eau, et courir vers moi en me jetant des regards éplorés. Mais moi alors, sûr de les tenir cette fois, je me mis à rire en reculant du bord et en brandissant le manteau de plumes d’un air de victoire.
À cette vue, la jeune fille qui m’avait parlé la première fois, et dont le nom était Schamsa, me dit : « Comment oses-tu, ô jeune homme, t’emparer de ce qui ne t’appartient pas ? » Je répondis : « Ô ma colombe, sors du bassin et viens causer avec moi ! » Elle dit : « Je veux bien causer avec toi, ô bel adolescent, mais je suis toute nue et je ne puis sortie ainsi du bassin. Ronds-moi donc mon manteau et je te promets de sortir de l’eau pour m’entretenir avec toi, et même je te laisserai me caresser et m’embrasser tant que tu voudras ! » Je dis : « Ô lumière de mon œil, ô ma maîtresse, ô souveraine de beauté, ô fruit de mon foie, si je te rends ton manteau c’est la mort que je me donne de ma propre main. Je ne puis donc le faire, en tout cas pas avant que n’arrive mon ami le cheikh lieutenant des oiseaux ! » Elle me dit : « Alors du moment que tu n’as pris que mon manteau, éloigne-toi un peu et tourne la tête de l’autre côté pour me laisser sortir du bassin et donner le temps à mes sœurs de se couvrir ; et alors elles me prêteront quelques-unes de leurs plumes pour cacher le plus essentiel ! » Moi je dis : « Cela, je puis le faire ! » Et je m’éloignai et me mis derrière le trône de rubis.
Alors les deux sœurs aînées sortirent les premières, et se vêtirent vivement de leurs manteaux ; puis elles enlevèrent quelques-unes des plumes les plus duvetées et en firent une sorte de petit tablier ; ensuite elles aidèrent leur sœur cadette à sortir à son tour de l’eau, lui ceignirent son essentiel avec ce tablier, puis me crièrent : « Tu peux maintenant venir ! » Et moi je courus au-devant de ces gazelles, et me jetai aux pieds de l’aimable Schamsa et lui embrassait les pieds, tout en tenant solidement son manteau de peur qu’elle ne le prît et ne s’envolât. Alors elle me releva et se mit à me dire mille paroles gentilles et à me faire mille caresses pour me décider à lui rendre son manteau ; mais je me gardai bien de céder à ses désirs, et je réussis à l’entraîner vers le trône de rubis où je m’assis en la prenant sur mes genoux.
Alors elle, voyant qu’elle ne pouvait m’échapper, se décida enfin à répondre à mes désirs, et jeta ses bras autour de mon cou et me rendit baiser pour baiser et caresse pour caresse, tandis que ses sœurs nous souriaient en regardant de tous côtés pour voir si personne n’arrivait.
Pendant que nous étions en cet état, le cheikh, mon protecteur, ouvrit la porte et entra. Alors nous nous levâmes en son honneur, nous nous avançâmes pour le recevoir, et nous lui baisâmes les mains respectueusement. Il nous pria alors de nous asseoir et, se tournant vers l’aimable Schamsa, lui dit : « Je suis charmé, ma fille, du choix que tu as fait de ce jeune homme qui t’aime à la folie. Sache, en effet, qu’il est d’une illustre origine ! Son père est le roi Tigmos, maître de l’Afghanistân. Tu feras donc bien d’accepter cette alliance et de décider également le roi Nassr, ton père, à te donner son consentement ! » Elle répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Alors le cheikh lui dit : « Si vraiment tu acceptes cette alliance, fais m’en le serment et promets-moi d’être fidèle à ton époux et de ne jamais l’abandonner ! » Et la belle Schamsa se leva aussitôt et prêta le serment en question entre les mains du vénérable cheikh. Alors il nous dit : « Remercions le Très-Haut de votre union, mes enfants. Et puissiez-vous être heureux ! Voici que j’appelle sur vous deux la bénédiction ! Vous pouvez maintenant vous aimer librement. Et toi, Jânschah, tu pourras lui rendre son manteau, car elle ne te quittera plus ! » Et, ayant dit ces paroles, le cheikh nous introduisit dans une salle où il y avait des matelas avec des tapis, et aussi des plateaux couverts de beaux fruits et d’autres choses exquises. Et Schamsa, après avoir prié ses sœurs de la précéder au palais de leur père, pour lui annoncer son mariage et le prévenir de son retour avec moi, fut extrêmement gentille et voulut elle-même m’éplucher les fruits et les partager avec moi. Après quoi nous nous couchâmes ensemble dans les bras l’un de l’autre, à la limite de la jubilation…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT SOIXANTE-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… Après quoi nous nous couchâmes ensemble dans les bras l’un de l’autre, à la limite de la jubilation.
Le matin, Schamsa fut la première debout. Elle se vêtit de son manteau de plumes, me réveilla, m’embrassa entre les deux yeux et me dit : « Il est temps que nous allions au palais des diamants voir le roi Nassr, mon père. Hâte-toi donc de t’habiller ! » J’obéis aussitôt et, lorsque je fus prêt, nous allâmes baiser les mains du cheikh lieutenant des oiseaux et nous le remerciâmes beaucoup. Alors Schamsa me dit : « Maintenant mets-toi sur mes épaules et tiens-toi solidement, car le voyage sera un peu long, bien que je me propose d’aller à toute vitesse ! » Et elle me prit sur ses épaules et, après les derniers adieux à notre protecteur, elle me transporta à travers les airs avec la rapidité de l’éclair et en peu de temps me déposa à quelque distance de l’entrée du palais des diamants. Et de là nous nous dirigeâmes doucement vers le palais, tandis que des genn serviteurs, postés par le roi, couraient lui annoncer notre arrivée.
Le roi Nassr, père de Schamsa et maître des genn, éprouva une joie extrême à me voir ; il me prit dans ses bras et me pressa contre sa poitrine. Puis il ordonna qu’on me revêtît d’une magnifique robe d’honneur, me mit sur la tête une couronne taillée dans un seul diamant, puis me conduisit auprès de la reine, mère de mon épouse, qui m’exprima son contentement, et félicita sa fille du choix qu’elle avait fait en ma personne. Elle fit ensuite cadeau à sa fille d’une quantité énorme de pierreries, puisque le palais en était plein ; et nous fit conduire tous deux au hammam où l’on nous lava et nous parfuma d’eau de roses, de musc, d’ambre et d’huiles aromatiques qui nous rafraîchirent merveilleusement. Après quoi on donna en notre honneur des festins qui durèrent trente jours et trente nuits consécutives.
Alors j’exprimai le désir de présenter à mon tour mon épouse à mes parents dans mon pays. Et le roi et la reine, bien que fort peinés de se séparer de leur fille, approuvèrent mon projet, mais me firent promettre de revenir chaque année passer chez eux un certain temps. Puis le roi fit construire un trône d’une magnificence et d’une grandeur telles qu’il pouvait contenir sur ses marches deux cents génies mâles et deux cents génies femmes. Nous montâmes tous deux sur le trône, et les quatre cents génies des deux sexes, qui étaient là pour nous servir, se tinrent debout sur les marches, tandis que toute une armée d’autres génies servaient de porteurs. Lorsque nous eûmes fait nos derniers adieux, les porteurs s’élevèrent dans les airs avec le trône, et se mirent à parcourir l’espace avec une rapidité telle qu’en deux jours ils accomplirent un trajet de deux ans de marche. Et nous arrivâmes sans encombre au palais de mon père, à Kaboul.
Lorsque mon père et ma mère me virent arriver, après une absence qui leur avait enlevé tout espoir de me retrouver, et qu’ils eurent contemplé mon épouse et appris qui elle était et dans quelles circonstances je l’avais épousée, ils furent à la limite de la joie, et pleurèrent beaucoup en m’embrassant et en embrassant ma bien-aimée Schamsa. Et même ma pauvre mère fut si émue qu’elle tomba évanouie et ne revint à elle que grâce à l’eau de roses dont un grand flacon appartenait à mon épouse Schamsa.
Après tous les festins et toutes les réjouissances données à l’occasion de notre arrivée et de nos épousailles, mon père demanda à Schamsa : « Que puis-je faire, ma fille, qui puisse t’agréer ? Et Schamsa, dont les goûts étaient modestes, répondit : « Ô roi fortuné, je souhaite seulement avoir pour nous deux un pavillon au milieu d’un jardin arrosé de ruisseaux. » Et le roi mon père donna aussitôt les ordres nécessaires, et au bout d’un très court espace de temps nous eûmes notre pavillon et notre jardin où nous vécûmes à la limite de la félicité.
Au bout d’une année, passée de la sorte au milieu d’une mer de délices, mon épouse Schamsa voulut revoir son père et sa mère au palais des diamants, et me rappela la promesse que je leur avais faite d’aller chaque année passer un certain temps au milieu d’eux. Moi je ne voulus pas la contrarier, car je l’aimais beaucoup ; mais, hélas ! le malheur devait s’abattre sur nous à cause de ce maudit voyage !
Nous nous plaçâmes donc sur le trône porté par nos génies serviteurs et nous voyageâmes à une grande vitesse, parcourant tous les jours une distance d’un mois de chemin, et nous arrêtant, le soir, près de quelque source ou sous l’ombrage des arbres, pour nous reposer. Or, un jour nous nous arrêtâmes juste à cet endroit-ci pour passer la nuit, et mon épouse Schamsa voulut aller se baigner dans l’eau de cette rivière qui coule devant nous. Je fis tous mes efforts pour l’en dissuader, lui parlant de la fraîcheur trop grande du soir et du malaise qui pouvait en résulter : elle ne voulut pas m’écouter et emmena quelques-unes de ses esclaves se baigner avec elle. Elles se déshabillèrent sur le rivage et entrèrent dans l’eau, où Schamsa paraissait être la lune à son lever au milieu du cortège des étoiles. Elles étaient là à folâtrer et à jouer entre elles, quand soudain Schamsa poussa un cri de douleur et tomba entre les bras de ses esclaves qui se hâtèrent de la faire sortir de l’eau et de la porter sur le rivage. Mais quand je voulus lui parler et la soigner, elle était morte. Et les esclaves me montrèrent sur son talon la trace d’une morsure de serpent d’eau.
À ce spectacle, moi je tombai évanoui, et je restai si longtemps en cet état que l’on me crut mort également. Mais hélas ! je devais survivre à Schamsa pour la pleurer et lui bâtir ce tombeau que tu vois. Quant au second tombeau, c’est le mien propre que je fis construire à côté de celui de ma pauvre bien-aimée. Et je passe maintenant ma vie dans les larmes et dans ces souvenirs cruels, en attendant le moment où je dormirai à côté de mon épouse Schamsa, loin de mon royaume auquel j’ai renoncé, loin du monde devenu pour moi un désert affreux, dans cet asile solitaire de la mort ! »
Lorsque le bel adolescent triste eut fini de raconter
son histoire à Beloukia, il cacha son visage dans
ses mains et se mit à sangloter. Alors Beloukia lui dit : « Par Allah ! ô mon frère, ton histoire est si
étonnante et si extraordinaire que j’en ai oublié mes
propres aventures, que je croyais pourtant prodigieuses
entre toutes les aventures. Qu’Allah te soutienne
dans ta douleur, ô mon frère, et puisse-t-il
enrichir ton âme de l’oubli…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète selon son habitude, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … Qu’Allah te soutienne dans ta douleur, ô mon frère, et puisse-t-il enrichir ton âme de l’oubli ! »
Il resta encore avec lui pendant une heure de temps, essayant de le décider à l’accompagner dans son royaume pour changer d’air et de vue ; mais ce fut en vain. Alors il fut bien obligé de le laisser, de peur de l’importuner, et, après l’avoir embrassé et lui avoir encore dit quelques paroles de consolation, il prit la route de sa capitale où il arriva sans incidents, après s’en être absenté cinq années. Et depuis lors je n’ai plus eu de ses nouvelles !
Et d’ailleurs, maintenant que tu es là, ô Hassib, j’oublie tout à fait ce jeune roi Beloukia que j’espérais jusqu’ici revoir un jour ou l’autre. Toi, du moins, tu ne vas pas me quitter de sitôt, et je pense bien te garder avec moi pendant de longues années, en ne te laissant manquer de rien, sois-en bien persuadé ! J’ai d’ailleurs encore tant d’histoires étonnantes à te raconter, que celles du roi Beloukia et du bel adolescent triste te sembleront simples aventures de tous les jours ! En tout cas, pour te donner dès maintenant une preuve du bien que je te veux, pour m’avoir écoutée tout ce temps avec une telle attention, voici mes femmes qui vont nous servir à manger et à boire et qui vont chanter pour nous charmer et nous délasser l’esprit jusqu’au matin ! »
Lorsque la reine Yamlika, princesse souterraine,
eut fini de raconter au jeune Hassib, fils de Danial
le savant, l’histoire de Beloukia et celle du bel adolescent
triste, et lorsque le festin et les chants et les
danses des femmes serpentines eurent pris fin, la
séance fut levée et le cortège fut formé pour retourner
à l’autre résidence. Mais le jeune Hassib, qui
aimait à l’extrême sa mère et son épouse, répondit :
« Ô reine Yamlika, je ne suis qu’un pauvre bûcheron,
et tu m’offres ici une vie pleine de délices,
mais il y a dans ma maison la mère et l’épouse ! Et
je ne puis, par Allah ! les laisser plus longtemps
dans mon attente et dans le désespoir de mon absence.
Permets-moi donc de retourner auprès d’elles,
sinon elles mourraient sûrement de douleur. Mais il
est certain que je regretterai toute ma vie de n’avoir
pu écouter les autres histoires dont tu as l’intention
de charmer mon séjour dans ton royaume ! »
À ces paroles, la reine Yamlika comprit que le motif du départ de Hassib était le seul valable, et lui dit : « Je veux bien, ô Hassib, te laisser retourner auprès de ta mère et de ton épouse, bien qu’il m’en coûte extrêmement de me séparer d’un auditeur aussi attentionné que toi. Seulement, j’exige de toi un serment, sans lequel il me sera impossible de te laisser partir. Tu vas me promettre de ne jamais aller prendre de bain au hammam désormais, toute ta vie durant. Sinon, il y va simplement de ta perte. Je ne puis pour le moment t’en dire plus long ! »
Le jeune Hassib, que cette demande étonnait à l’extrême, ne voulut pas contrarier la reine Yamlika, et lui fit le serment en question, par lequel il lui promettait de ne jamais aller prendre de bain au hammam, toute sa vie durant. Alors, la reine Yamlika, une fois les adieux finis, le fit accompagner par une de ses femmes serpentines jusqu’à la sortie de son royaume dont l’ouverture était cachée dans une maison en ruines, du côté opposé à l’endroit où se trouvait le trou à miel par lequel Hassib avait pu pénétrer dans la résidence souterraine.
Le soleil jaunissait à l’horizon quand Hassib arriva dans sa rue et frappa à la porte de sa maison. Sa mère vint lui ouvrir et, en le reconnaissant, poussa un grand cri et se jeta dans ses bras en pleurant de joie. Et son épouse, de son côté, en entendant le cri et les sanglots de la mère, courut à la porte, le reconnut également et le salua respectueusement en lui baisant les mains. Après quoi ils entrèrent dans la maison et s’abandonnèrent librement aux transports les plus vifs de la joie.
Lorsqu’ils se furent un peu calmés, Hassib leur demanda des nouvelles des bûcherons, ses anciens camarades, qui l’avaient abandonné dans le trou à miel. Sa mère lui raconta comment ils étaient venus lui apprendre la nouvelle de sa mort sous les dents d’un loup, comment ils étaient devenus de riches marchands et des propriétaires de grands biens et de belles boutiques, et comment ils avaient vu le monde grandir devant eux de plus en plus tous les jours.
Alors Hassib réfléchit un instant et dit à sa mère : « Demain tu iras les trouver au souk, tu les réuniras et tu leur annonceras mon retour, en leur disant que je serai bien content de les voir ! » Aussi, le lendemain, la mère de Hassib ne manqua pas de faire la chose, et les bûcherons, en apprenant la nouvelle, changèrent de teint et répondirent par l’ouïe et l’obéissance en ce qui concernait la visite de bienvenue. Puis ils se concertèrent entre eux, et résolurent d’arranger au mieux la chose. Ils commencèrent d’abord par donner à la mère de Hassib de belles soieries et de belles étoffes, et l’accompagnèrent à la maison, en convenant de donner à Hassib chacun la moitié de ce qui était sous leurs mains en richesses, en esclaves et en propriétés. En arrivant auprès de Hassib, ils le saluèrent et lui baisèrent les mains en lui offrant tout cela et en le priant de l’accepter et d’oublier leurs torts à son égard. Et Hassib ne voulut pas leur garder rancune, accepta leurs offres, et leur dit : « Ce qui est passé est passé, et nulle précaution ne peut empêcher d’arriver ce qui doit arriver ! » Alors ils prirent congé de lui, en l’assurant de leur gratitude, et Hassib devint dès ce jour un homme riche, et s’établit dans le souk comme marchand en ouvrant une boutique qui devint la plus belle entre toutes les boutiques.
Un jour qu’il se rendait à sa boutique, selon son habitude, il passa devant le hammam situé à l’entrée du souk. Or, le propriétaire du hammam était justement à prendre l’air devant sa porte, et, ayant reconnu Hassib, il le salua et lui dit : « Fais-moi l’honneur d’entrer dans mon établissement. Je ne t’ai jamais eu une seule fois comme client. Mais aujourd’hui je veux te traiter pour mon plaisir simplement, et les masseurs te frotteront avec un gant neuf en crin, et te savonneront avec des filaments de lifa dont personne ne s’est servi ! » Mais Hassib, qui se souvenait de son serment, répondit : « Non, par Allah ! je ne puis accepter ton offre, ô cheikh ! car j’ai fait vœu de ne jamais entrer au hammam…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT SOIXANTE-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
« … car j’ai fait vœu de ne jamais entrer au hammam ! » À ces paroles, le maître du hammam, qui ne pouvait croire à un serment de cette sorte, vu que nul homme ne peut, même au risque de mourir, s’empêcher de prendre des bains toutes les fois qu’il s’est approché sexuellement de son épouse, s’écria : « Pourquoi me refuses-tu, ô mon maître ? Or, par Allah ! je jure à mon tour que, si tu persistes dans ta résolution, j’irai immédiatement divorcer d’avec mes trois épouses ! Je le jure trois fois par le divorce ! » Mais comme Hassib, malgré le serment si grave qu’il venait d’entendre, continuait à ne pas accepter, le propriétaire du hammam se jeta à ses pieds en le suppliant de ne pas l’obliger à accomplir son serment ; et il lui embrassa les pieds en pleurant, et lui dit : « Je prends sur ma tête la responsabilité de ton acte et toutes les conséquences ! » Et tous les passants qui s’étaient attroupés autour d’eux, en apprenant ce dont il s’agissait et en entendant le serment du divorce, se mirent également à supplier Hassib de ne pas faire gratuitement le malheur d’un homme qui lui offrait un bain sans rémunération. Puis, comme ils voyaient l’inutilité de leurs paroles, ils se décidèrent tous à employer la force, se saisirent de Hassib, l’emportèrent, malgré ses cris terrifiés, à l’intérieur du hammam, le dépouillèrent de ses vêtements, lui versèrent tous ensemble vingt ou trente bassins d’eau sur le corps, le frictionnèrent, le massèrent, le savonnèrent, le séchèrent, et l’entourèrent de serviettes chaudes et lui enveloppèrent la tête d’un grand foulard ourlé et brodé. Puis, le propriétaire du hammam, à la limite de la joie de voir qu’il était délié de son serment de divorce, apporta à Hassib une tasse de sorbet parfumé à l’ambre et lui dit : « Que le bain te soit léger et béni ! Que cette boisson te rafraîchisse comme tu m’as rafraîchi ! » Mais Hassib, que tout cela terrifiait de plus en plus, ne savait s’il devait refuser ou accepter cette dernière invitation, et allait répondre, quand soudain le hammam fut envahi par les gardes du roi qui se précipitèrent sur lui, l’enlevèrent tel qu’il était, dans son accoutrement de bain, et, malgré ses protestations et sa résistance, le portèrent au palais du roi et le remirent entre les mains du grand-vizir qui les attendait à la porte dans la plus grande impatience.
Le grand-vizir, à la vue de Hassib, fut dans une joie extrême, le reçut avec les marques les plus notoires du respect, et le pria de l’accompagner auprès du roi. Et Hassib, résolu maintenant à laisser courir sa destinée, suivit le grand-vizir qui l’introduisit auprès du roi dans une salle où se trouvaient, rangés suivant leur rang hiérarchique, deux mille gouverneurs de provinces, deux mille officiers principaux, et deux mille bourreaux porte-glaives qui n’attendaient qu’un signe pour faire voler les têtes. Quant au roi lui-même, il était couché sur un grand lit d’or et semblait dormir, la tête et le visage recouverts d’un foulard de soie.
À la vue de tout cela, le terrifié Hassib se sentit mourir et tomba au pied du lit en protestant publiquement de son innocence. Mais le grand-vizir se hâta de Le relever avec tous les signes du respect, et lui dit : « Ô fils de Danial, nous attendons de toi de sauver notre roi Karazdân ! Une lèpre, sans remède jusqu’ici, lui couvre le visage et le corps ! Et nous avons pensé à toi pour le guérir, car tu es le fils de Danial le savant ! » Et tous les assistants, les gouverneurs, les chambellans, les officiers et les bourreaux s’écrièrent à la fois : « De toi seul nous attendons la guérison du roi Karazdân ! »
À ces paroles, l’effaré Hassib se dit : « Par Allah ! ils me prennent pour un savant ! » Puis il dit au grand-vizir : « Je suis en vérité le fils de Danial. Mais je ne suis qu’un ignorant ! On m’a mis à l’école et je n’ai rien appris ; on a voulu m’enseigner la médecine, mais au bout d’un mois on y a renoncé, en voyant la mauvaise qualité de mon entendement. Et ma mère, à bout de ressources, m’acheta un âne et des cordes, et fit de moi un bûcheron. Et voilà tout ce que je sais ! » Mais le vizir lui dit : « Il est inutile, ô fils de Danial, de cacher davantage tes connaissances. Nous savons fort bien que si nous parcourions l’Orient et l’Occident nous ne trouverions point ton égal en médecine ! » Hassib, atterré, dit : « Mais comment, ô vizir plein de sagesse, pourrais-je le guérir, puisque je ne connais guère ni les maladies ni les remèdes ? » Le vizir reprit : « Allons, jeune homme, il est inutile de nier davantage. Nous savons tous que la guérison du roi est entre tes mains ! » Hassib leva les mains au ciel et demanda : « Comment cela ? » Le vizir dit : « Oui certes ! tu peux obtenir cette guérison, car tu connais la princesse souterraine, la reine Yamlika dont le lait virginal, pris à jeun ou employé comme dictame, guérit les maladies les plus incurables…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT SOIXANTE-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
« … la reine Yamlika dont le lait virginal, pris à jeun ou employé comme dictame, guérit les maladies les plus incurables ! »
En entendant ces paroles, Hassib comprit que cette information résultait de son entrée au hammam, et il essaya de nier. Il s’écria donc : « Je n’ai jamais vu ce lait, ô mon maître, et je ne sais point qui est la princesse Yamlika ! C’est la première fois que j’entends ce nom-là ! » Le vizir sourit et dit : « Puisque tu nies, je vais te démontrer que cela ne te servira à rien ! Je dis que tu as été chez la reine Yamlika ! Or, tous ceux qui y sont allés avant toi, dans les temps anciens, sont revenus avec la peau du ventre noire. C’est ce livre que j’ai là sous les yeux qui me le dit. Ou plutôt, ô fils de Danial, la peau du ventre ne devient noire, chez le visiteur de la reine Yamlika, qu’après son entrée au hammam. Or, les espions que j’avais postés au hammam pour examiner le ventre de tous les baigneurs sont venus tout à l’heure me dire que toi tu avais eu soudain le ventre noir, tandis qu’on te baignait. Inutile donc de continuer à nier ! »
À ces paroles, Hassib s’écria : « Non, par Allah ! Je n’ai jamais été chez la princesse souterraine ! » Alors le grand-vizir s’approcha de lui, lui enleva les serviettes qui l’enveloppaient et mit son ventre à découvert. Il était noir comme le ventre d’un buffle.
À cette vue, Hassib faillit tomber évanoui d’épouvante ; puis il eut une idée et dit au vizir : « Je dois t’avouer, ô mon maître, que je suis né avec le ventre tout noir ! » Le vizir sourit et dit : « Il ne l’était pas à ton entrée au hammam. Les espions me l’ont dit ! » Mais Hassib, qui ne voulait pas tout de même trahir la princesse souterraine en révélant sa résidence, continua à nier d’avoir eu des rapports avec elle ou de l’avoir jamais vue. Alors, le vizir fit signe à deux bourreaux qui s’approchèrent de lui, retendirent par terre, nu comme il était, et se mirent à lui administrer sur la plante des pieds des coups si cruels et si répétés qu’il en serait mort s’il ne s’était décidé à crier grâce en avouant la vérité.
Aussitôt le vizir le fit relever et ordonna qu’on remplaçât par une magnifique robe d’honneur, les serviettes dont il était enveloppé en arrivant. Après quoi il le conduisit lui-même dans la cour du palais, où il le fit monter sur le plus beau cheval des écuries royales, monta également à cheval et, accompagnés tous deux d’une nombreuse suite, ils prirent le chemin de la maison en ruines d’où Hassib était sorti de chez la reine Yamlika.
Là le vizir, qui avait appris dans les livres la science des conjurations, se mit à brûler des parfums et à prononcer les formules magiques de l’ouverture des portes, pendant que Hassib, de son côté, sur l’ordre du vizir, conjurait la reine de se montrer à lui. Et soudain se produisit un tremblement qui renversa à terre la plupart des assistants, et un trou s’ouvrit par où apparut, sur un bassin d’or porté par quatre serpents à tête humaine qui vomissaient des flammes, la reine Yamlika dont le visage brillait comme l’or. Elle regarda Hassib avec des yeux pleins de reproches et lui dit : « Est-ce ainsi, ô Hassib, que tu tiens le serment que tu m’as fait ? » Et Hassib s’écria : « Par Allah ! ô reine, la faute en est au vizir qui a failli me faire mourir sous les coups ! » Elle dit : « Je le sais ! Et c’est pour cela que je ne veux point te punir. On te fait venir ici et l’on m’oblige moi-même à sortir de ma demeure pour la guérison du roi. Et tu viens me demander du lait pour opérer cette guérison. Je veux bien t’accorder la chose, en souvenir de l’hospitalité que je t’ai donnée et de l’attention avec laquelle tu m’as écoutée ! Voici donc deux flacons de mon lait. Pour opérer la guérison du roi, il faut que je t’enseigne le moyen à employer. Approche-toi donc plus près ! » Hassib s’approcha de la reine qui lui dit à voix basse, de façon à n’être entendue que de lui : « L’un des flacons, qui est marqué d’un trait rouge, doit servir à guérir le roi. Mais l’autre est destiné au vizir qui t’a fait donner la bastonnade. En effet, lorsque le vizir aura vu la guérison du roi, il voudra boire de mon lait pour se préserver des maladies, et toi tu lui donneras à boire du second flacon. » Puis, la reine Yamlika remit à Hassib les deux flacons de lait, et disparut aussitôt, tandis que la terre se refermait sur elle et sur ses porteurs.
Lorsque Hassib fut arrivé au palais, il fit exactement comme le lui avait indiqué la reine. Il s’approcha donc du roi et lui donna à boire du premier flacon. Et aussitôt que le roi eut bu de ce lait, il se mit à transpirer de tout le corps, et, en quelques instants, toute sa peau atteinte de lèpre commença à tomber par morceaux, et elle était, au fur et à mesure Remplacée par une peau douce et blanche comme l’argent. Et il fut guéri sur l’heure. Quant au vizir, il voulut également boire de ce lait, prit le second flacon et le vida d’un trait. Et aussitôt il se mit à enfler peu à peu et, devenu gros comme un éléphant, il éclata soudain de toute sa peau et mourut sur le champ. Et on se hâta de l’enlever de là pour l’enterrer.
Quand le roi se vit guéri de la sorte, il fit s’asseoir Hassib à ses côtés, le remercia beaucoup et le nomma grand-vizir à la place de celui qui venait de mourir sous ses yeux. Il le fit ensuite revêtir d’une robe d’honneur enrichie de pierreries, et fit crier sa nomination par tout le palais, après lui avoir donné en cadeau trois cents mamalik, et trois cents jeunes filles comme secrètes, outre trois princesses de sang royal qui, avec sa femme, faisaient ainsi quatre épouses légitimes ; il lui donna également trois cent mille dinars d’or, trois cents mules, trois cents chameaux et beaucoup de bétail en buffles, bœufs et moutons.
Après quoi, tous les officiers, les chambellans et les notables, sur l’ordre du roi qui leur dit : « Celui qui m’honore l’honore ! » s’approchèrent de Hassib et lui baisèrent la main à tour de rôle, en lui faisant leur soumission et en l’assurant de leur respect. Puis Hassib prit possession du palais de l’ancien vizir, et l’habita avec sa mère, ses épouses et ses favorites. Et il vécut ainsi dans les honneurs et les richesses pendant de longues années, durant lesquelles il avait eu le temps d’apprendre à lire et à écrire.
Lorsque Hassib eut ainsi appris à lire et à écrire, il se rappela que son père Danial avait été un grand savant et il eut la curiosité de demander à sa mère s’il ne lui avait pas laissé en héritage ses livres et ses manuscrits. La mère de Hassib répondit : « Mon fils, ton père, avant de mourir, a détruit tous ses papiers et tous ses manuscrits, et ne t’a laissé en héritage qu’une petite feuille de papier qu’il m’a chargée de te remettre lorsque tu m’en aurais exprimé le désir ! » Et Hassib dit : « Je souhaite beaucoup l’avoir, car maintenant je désire m’instruire pour mieux diriger les affaires du royaume ! » Alors la mère de Hassib…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
… alors la mère de Hassib courut tirer de la malle, où elle l’avait cachée avec ses bijoux, la petite feuille de papier, seul legs du savant Danial, et vint la remettre à Hassib qui la prit et la déroula. Et il y lut ces simples paroles : « Toute science est vaine, car les temps sont venus où l’Élu d’Allah indiquera aux hommes les sources de la sagesse. Il s’appellera Môhammad ! Que sur lui et ses compagnons et ses croyants soient la paix et la bénédiction jusqu’à l’extinction des âges ! »
Et telle est, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, l’histoire de Hassib fils de Danial et de la reine Yamlika, princesse souterraine. Mais Allah est plus savant !
— Lorsque Schahrazade eut fini de raconter cette histoire extraordinaire, le roi Schahriar tout d’un coup s’écria : « Je sens un grand ennui m’envahir l’âme, Schahrazade. Fais donc bien attention, car si cela continue je crois bien que demain matin ta tête sera d’un côté et ton corps de l’autre ! » À ces paroles, la petite Doniazade, apeurée, se blottit davantage sur le tapis, et Scharazade, sans se troubler, répondit : « Dans ce cas, ô Roi fortuné, je vais te raconter une ou deux petites histoires, juste de quoi passer la nuit. Après cela, Allah est l’Omniscient ! » Et le roi Schahriar demanda : « Mais comment vas-tu faire pour me trouver une histoire à la fois courte et amusante ? » Schahrazade sourit et dit : « Justement, ô Roi fortuné, ce sont ces histoires-là que je connais le mieux. Je vais donc te raconter à l’instant une ou deux petites anecdotes tirées du Parterre fleuri de l’esprit et du Jardin de la galanterie. Et après cela je veux avoir la tête coupée ! »
Et aussitôt elle dit :
LE PARTERRE FLEURI DE L’ESPRIT
ET LE JARDIN DE LA GALANTERIE
Il m’est revenu, ô Roi fortuné, que le khalifat Haroun Al-Rachid, pris d’ennui et se trouvant dans le même état d’esprit où se trouve en ce moment Ta Sérénité, sortit se promener sur la route qui va de Baghdad à Bassra, en emmenant avec lui son vizir Giafar Al-Barmaki, son échanson favori Abou-Ishak et le poète Abou-Nowas.
Pendant qu’ils se promenaient et que le khalifat avait l’œil sombre et les lèvres fermées, un cheikh vint à passer sur la route, monté sur son âne. Alors le khalifat se tourna vers son vizir Giafar et lui dit : « Interroge ce cheikh sur son lieu de destination ! » Et Giafar, qui depuis un moment ne savait qu’inventer pour distraire le khalifat, résolut aussitôt de l’amuser aux dépens du cheikh qui allait tranquillement son chemin en laissant flotter la corde sur le cou de son âne amène. Il s’approcha donc du cheikh et lui demanda : « Pour où comme ça, ô vénérable ? » Le cheikh répondit : « Pour Baghdad en venant de Bassra, mon pays ! » Giafar demanda : « Et pour quel motif un si long voyage ? » Il répondit : « Par Allah ! c’est pour trouver à Baghdad un médecin savant qui me prescrive un collyre pour mon œil ! » Il dit : « La chance et la guérison sont entre les mains d’Allah, ô cheikh ! Mais que me donneras-tu si, pour t’éviter les recherches et les dépenses, je te prescris ici, moi-même, un collyre capable de te guérir l’œil en une nuit ? » Il répondit : « Allah seul est capable de te rémunérer selon tes mérites ! » Alors Giafar se tourna vers le khalifat et vers Abou-Nowas et leur cligna de l’œil ; puis il dit au cheikh : « Puisqu’il en est ainsi, mon bon oncle, retiens bien la prescription que je vais te faire, car elle est fort simple. Voici : prends trois onces de souffle de vent, trois onces de rayons de soleil, trois onces de rayons de lune et trois onces de lumière de lanterne ; mêle soigneusement le tout dans un mortier sans fond et laisse-le pendant trois mois exposé au grand air. Alors il te faudra piler le mélange pendant trois mois et le verser dans une écuelle percée que tu exposeras au vent et au soleil pendant encore trois mois. Cela fait, le collyre se trouvera à point, et tu n’auras plus qu’à t’en saupoudrer l’œil trois cents fois la première nuit, en employant trois grosses pincées chaque fois, et tu dormiras. Le lendemain tu te réveilleras guéri, si Allah veut ! »
En entendant ces paroles, le cheikh, en signe de gratitude et de respect, s’inclina à plat ventre sur son âne devant Giafar, et tout d’un coup lâcha un détestable pet suivi de deux longues vesses, et dit à Giafar : « Hâte-toi, ô médecin, de les recueillir avant qu’ils ne s’éparpillent. C’est pour le moment la seule réponse de ma gratitude à ton remède venteux ; mais crois bien qu’à peine de retour dans mon pays, si Allah veut, je t’enverrai en cadeau une esclave au derrière aussi ridé qu’une figue sèche, qui te donnera tant de plaisir que tu en expireras ton âme ; et alors ton esclave aura tant de douleur et d’émotion que, pleurant sur toi, elle ne pourra se retenir ainsi de pisser sur ton visage si froid et d’arroser ta barbe sèche ! »
Et le cheikh caressa tranquillement son âne et continua sa route, tandis que le khalifat, à la limite du trémoussement, se laissait tomber sur son derrière et étouffait de rire en voyant la mine de son vizir, cloué dans une surprise embarrassée et sans répartie, et Abou-Nowas qui, paterne, lui ébauchait des gestes de félicitation.
— Lorsqu’il eut entendu cette anecdote, le roi Schahriar se rasséréna soudain et dit à Schahrazade : « Hâte-toi, Schahrazade, de me raconter encore cette nuit une anecdote au moins aussi amusante ! » Et la petite Doniazade s’écria : « Ô Schahrazade, ma sœur, que tes paroles sont douces et savoureuses ! » Alors, après un court silence, elle dit :
On raconte que le vizir Badreddîn, gouverneur du Yamân, avait un frère qui était un jouvenceau doué d’une beauté incomparable, tellement que sur son passage les hommes et les femmes se retournaient pour l’admirer et se baigner les yeux de ses charmes. Aussi le vizir Badr, craignant pour lui quelque aventure considérable, le tenait-il soigneusement éloigné des regards des hommes et l’empêchait-il de fréquenter les jeunes gens de son âge. Comme il ne voulait pas le mettre à l’école, de peur de ne pouvoir assez le surveiller, il lui fit venir à la maison, comme maître, un cheikh vénérable et pieux, aux mœurs notoirement chastes, et le mit entre ses mains. Et le cheikh se rendait ainsi tous les jours auprès de son élève, avec lequel il s’enfermait quelques heures dans une chambre que le vizir leur avait réservée pour les leçons.
Au bout d’un certain temps, la beauté et les charmes de l’adolescent ne manquèrent pas d’opérer leur effet habituel sur le cheikh qui finit par devenir éperdument épris de son élève et sentir son âme, à sa vue, chanter de tous ses oiseaux et réveiller par son chant tout ce qui était endormi.
Aussi, ne sachant plus que faire pour calmer son émoi, il se décida un jour à faire part du trouble de son âme à l’adolescent et lui déclara qu’il ne pouvait plus se passer de sa présence. Alors l’adolescent, fort touché de l’émoi de son maître, lui dit : « Hélas ! tu sais bien que j’ai les mains liées et que tous mes mouvements sont surveillés par mon frère ! » Le cheikh soupira et dit : « Je voudrais bien passer une soirée en tête à tête avec toi ! » L’adolescent répondit : « Y songes-tu ! Si mes journées sont si surveillées, que ne doivent point être mes nuits ! » Le cheikh reprit : « Je le sais bien, mais la terrasse de ma maison fait suite, sans discontinuer, à la terrasse de cette maison où nous sommes, et cela te serait chose facile, une fois ton frère endormi, cette nuit, de monter sans bruit là-haut, où je te cueillerai et t’emmènerai, en traversant simplement le petit mur bas de séparation, sur ma terrasse où personne ne viendra nous surveiller ! »
L’adolescent accepta la proposition en disant : « J’écoute et j’obéis… »
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
Et le roi Schahriar se dit : « Je ne la tuerai certes pas avant de savoir ce qui va se passer entre cet adolescent et son maître ! »
LA TROIS CENT SOIXANTE-QUINZIÈME NUIT
Schahrazade dit :
… L’adolescent accepta la proposition et, la nuit venue, il fit semblant de dormir et, lorsque le vizir se fut retiré dans sa chambre, il monta sur la terrasse où l’attendait le cheikh qui le prit aussitôt par la main et se hâta de le conduire sur sa terrasse où étaient rangés les coupes pleines et les fruits. Ils s’assirent donc sur la natte blanche, au clair de lune, et, l’inspiration aidant et la sérénité d’une belle nuit, ils se mirent à chanter et à boire, tandis que les doux rayons de l’astre les illuminaient jusqu’à l’extase.
Pendant qu’ils passaient ainsi le temps, le vizir Badr eut l’idée, avant de se coucher, d’aller voir son jeune frère, et fut bien surpris de ne le trouver pas. Il se mit à sa recherche par toute la maison et finit par monter sur la terrasse et s’approcher du mur bas de séparation : il vit alors son frère et le cheikh, la coupe à la main, assis à chanter l’un à côté de l’autre. Mais le cheikh également avait eu le temps de le voir s’avancer de loin et, avec un à propos admirable, il interrompit la chanson qu’il disait pour, sans changer de ton, improviser aussitôt sur le même mode ces vers qu’il chanta :
« Il me fait boire un vin mêlé à la salive de sa bouche ; et le rubis de la coupe brille sur ses joues que colore à la fois la pourpre de la pudeur.
Mais quel nom lui donnerais-je ? Son frère s’appelle déjà la Pleine-Lune de la Religion, et d’ailleurs nous éclaire comme la lune en ce moment. Je l’appellerai donc la Pleine-Lune de la Beauté ! »
Lorsque le vizir Badreddîn eut entendu ces vers qui contenaient cette allusion délicate à son égard, comme il était discret et fort galant, et que d’ailleurs il ne voyait se passer rien d’inconvenant, il se retira en se disant : « Par Allah ! je ne troublerai pas leur entretien ! » Et tous deux furent dans une parfaite félicité.
— Et, ayant raconta cette anecdote, Schahrazade s’arrêta un instant et dit ensuite :
On raconte que le khalifat Haroun Al-Rachid, tourmenté une nuit par une de ses fréquentes insomnies, fit venir Giafar, son vizir, et lui dit : « Ô Giafar, cette nuit ma poitrine est rétrécie à l’extrême par l’insomnie, et je souhaite fort te voir me la dilater ! » Giafar répondit : « Ô émir des Croyants, j’ai un ami appelé Ali le Persan, qui possède dans sa sacoche quantité d’histoires délicieuses propres à effacer les chagrins les plus tenaces et à calmer les humeurs irritées ! » Al-Rachid répondit : « À moi donc ton ami à l’instant ! » Et Giafar le fit venir aussitôt entre les mains du khalifat qui le fit s’asseoir et lui dit : « Écoute, Ali ! On m’a dit que tu savais des histoires capables de dissiper le chagrin et l’ennui, et même de procurer le sommeil à qui souffre de l’insomnie. Je désire de toi une de ces histoires-là ! » Ali le Persan répondit : « J’écoute et j’obéis, ô émir des Croyants ! Mais je ne sais s’il faut t’en raconter une que j’aie entendue avec mon oreille ou bien une que j’aie vue avec mon œil ! » Al-Rachid dit : « Je préfère une de celles où tu as toi-même figuré ! » Alors Ali le Persan dit :
« J’étais un jour assis dans ma boutique à vendre et à acheter, quand un Kourde vint me marchander quelques objets ; mais soudain il s’empara d’un petit sac qui était à ma devanture et, sans même prendre la peine de le cacher, voulut s’en aller avec, absolument comme s’il lui appartenait depuis la naissance. Alors moi je bondis de ma boutique dans la rue, je l’arrêtai par le pan de sa robe, et lui enjoignis de me rendre mon sac ; mais il haussa les épaules et me dit : « Ce sac ! mais il m’appartient avec tout ce qu’il contient ! » Alors moi, à la limite de la suffocation, je m’écriai : « Ô musulmans ! sauvez mon bien des mains de ce mécréant ! » À mes cris, tout le souk s’attroupa autour de nous, et les marchands me conseillèrent d’aller me plaindre au kâdi à l’instant. Moi, j’acceptai, et ils m’aidèrent à entraîner le Kourde, ravisseur de mon sac, chez le kâdi.
Lorsque nous fûmes arrivés devant le kâdi, nous restâmes debout respectueusement entre ses mains et il commença par nous demander : « Qui de vous est le plaignant, et de qui se plaint-il ? » Alors le Kourde, sans me laisser le temps d’ouvrir la bouche, fit quelques pas en avant et répondit : « Qu’Allah donne l’appui à notre maître le kâdi ! Ce sac que voici est mon sac, et tout ce qu’il contient m’appartient. Je l’avais perdu, et je viens de le retrouver à la devanture de cet homme ! » Le kâdi lui demanda : « Quand l’avais-tu perdu ? » Il répondit : « Dans la journée d’hier, et sa perte m’a empêché de dormir toute la nuit ! » Le kâdi lui demanda : « Dans ce cas, énumère-moi les objets qu’il contient ! » Alors le Kourde, sans hésiter un instant, dit : « Dans mon sac, ô notre maître le kâdi, il y a deux flacons de cristal remplis de kohl, deux baguettes d’argent pour étendre le kohl, un mouchoir, deux verres à limonade dont le pourtour est doré, deux flambeaux, deux cuillers, un coussin, deux tapis pour table de jeu, deux pots à eau, deux bassins, un plateau, une marmite, un réservoir à eau en terre cuite, une louche de cuisine, une grosse aiguille à tricoter, deux sacs à provisions, une chatte enceinte, deux chiennes, une écuelle à riz, deux ânes, deux litières de femme, un habit de drap, deux pelisses, une vache, deux veaux, une brebis avec ses deux agneaux, une chamelle et deux petits chameaux, deux dromadaires de course avec leurs femelles, un buffle et deux bœufs, une lionne et deux lions, une ourse, deux renards, un divan, deux lits, un palais avec deux grandes salles de réception, deux tentes en toile verte, deux baldaquins, une cuisine à deux portes et une assemblée de Kourdes de mon espèce tout prêts à témoigner que ce sac est mon sac ! »
Alors le kâdi se tourna vers moi et me demanda…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors le kâdi se tourna vers moi et me demanda : « Et toi, qu’as-tu à répondre ? »
Moi, ô émir des Croyants, j’étais stupéfait de tout cela. Pourtant je m’avançai un peu et répondis : « Qu’Allah élève et honore notre maître le kâdi ! Moi, je sais que dans mon sac il y a seulement un pavillon en ruine, une maison sans cuisine, un logement pour les chiens, une école de garçons, des jeunes gens qui jouent aux dés, un repaire de brigands, une armée avec ses chefs, la ville de Bassra et la ville de Baghdad, le palais antique de l’émir Scheddad ben-Aâd, un fourneau de forgeron, un filet de pêcheur, un bâton de berger, cinq jolis garçons, douze jeunes filles intactes, et mille conducteurs de caravane prêts à témoigner que ce sac est mon sac ! »
Lorsque le Kourde eut entendu ma réponse, il éclata en pleurs et en sanglots, puis s’écria en larmoyant : « Ô notre maître le kâdi, ce sac qui m’appartient est connu et reconnu, et tout le monde sait qu’il est ma propriété. Il renferme en outre deux villes fortifiées et dix tours, deux alambics d’alchimiste, quatre joueurs d’échecs, une jument et deux poulains, un étalon et deux chevaux hongres, deux longues lances, deux lièvres, un garçon enculé et deux entremetteurs, un aveugle et deux clairvoyants, un boiteux et deux paralytiques, un capitaine marin, un navire avec ses matelots, un prêtre chrétien et deux diacres, un patriarche et deux moines, et enfin un kâdi et deux témoins prêts à témoigner que ce sac est mon sac ! »
Le kâdi, à ces paroles, se tourna vers moi et me demanda : « Qu’as-tu à répondre, toi, à tout cela ? » Moi, ô émir des Croyants, je me sentais bourré de rage jusqu’à mon nez. J’avançai pourtant de quelques pas et répondis avec tout le calme dont j’étais capable : « Qu’Allah éclaire et consolide le jugement de notre maître le kâdi ! Je dois ajouter que dans ce sac il y a, en outre, des médicaments contre le mal de tête, des philtres et des enchantements, des cottes de mailles et des armoires remplies d’armes, mille béliers dressés à lutter des cornes, un parc à bestiaux, des hommes adonnés aux femmes, des amateurs de garçons, des jardins remplis d’arbres et de fleurs, des vignes chargées de raisin, des pommes et des figues, des ombres et des fantômes, des flacons et des coupes, des nouveaux mariés avec toute la noce, des cris et des plaisanteries, douze pets honteux et autant de vesses sans odeur, des amis assis dans une prairie, des bannières et des drapeaux, une mariée sortant du hammam, vingt chanteuses, cinq belles esclaves Abyssines, trois Indiennes, quatre Grecques, cinquante Turques, soixante-dix Persanes, quarante Kachemiriennes, quatre-vingts Kourdes, autant de Chinoises, quatre-vingt-dix Géorgiennes, tout le pays de l’Irak, le Paradis Terrestre, deux étables, une mosquée, plusieurs hammams, cent marchands, une planche de bois, un clou, un nègre qui joue de la clarinette, mille dinars, vingt caisses remplies d’étoffes, vingt danseuses, cinquante magasins de réserve, la ville de Koufa, la ville de Gaza, Damiette, Assouân, le palais de Khosrou-Anouschirwân et celui de Soleïmân, toutes les contrées situées entre Balkh et Ispahân, les Indes et le Soudan, Baghdad et le Khorassân ; il contient, en outre, — qu’Allah préserve les jours de notre maître le kâdi ! — un linceul, un cercueil et un rasoir pour la barbe du kâdi si le kâdi ne veut point reconnaître mes droits et juger que ce sac est mon sac ! »
Lorsque le kâdi eut entendu tout cela, il nous regarda et me dit : « Par Allah ! ou bien vous êtes deux garnements qui vous moquez de la loi et de son représentant, ou bien ce sac doit être un abîme sans fond ou même la Vallée-du-Jour-du-Jugement ! »
Et aussitôt le kâdi, pour contrôler nos paroles, fit ouvrir le sac devant les témoins. Il contenait quelques écorces d’oranges et des noyaux d’olives !
Alors moi, je déclarai au kâdi ahuri à la limite de l’ahurissement que ce sac-là appartenait au Kourde, mais que le mien avait disparu ! Et je m’en allai. »
Lorsque le khalifat Haroun Al-Rachid eut entendu cette histoire, il se renversa sur son derrière par la force explosive de son rire, et donna un magnifique cadeau à Ali le Persan. Et cette nuit-là il dormit d’un profond sommeil jusqu’au matin !
— Puis Schahrazade ajouta : « Mais ne crois point, ô Roi fortuné, que cette anecdote soit plus délicieuse que celle où Al-Rachid se trouve dans un cas embarrassant d’amour ! » Et le roi Schahriar demanda : « Quelle est cette anecdote que je ne connais pas ? » Alors Schahrazade dit :
On raconte qu’une nuit Haroun Al-Rachid s’étant couché entre deux belles adolescentes qu’il aimait également, dont l’une était de Médine et l’autre de Koufa, ne voulut pas exprimer sa préférence, quant à la terminaison finale, spécialement à l’une au détriment de l’autre. Le prix devait donc revenir à celle qui le mériterait le mieux. Aussi l’esclave de Médine commença par lui prendre les mains et se mit à les caresser gentiment, tandis que celle de Koufa, couchée un peu plus bas, lui massait les pieds et en profitait pour glisser sa main jusqu’à la marchandise du haut et la soupeser de temps en temps. Sous l’influence de ce soupèsement délicat, la marchandise se mit soudain à augmenter de poids considérablement. Alors l’esclave de Koufa se hâta de s’en emparer et, l’attirant en entier à elle, de la cacher dans le creux de ses mains ; mais l’esclave de Médine lui dit : « Je vois que tu gardes le capital pour toi seule, et tu ne songes même pas à m’abandonner les intérêts ! » Et, d’un geste rapide, elle repoussa sa rivale et s’empara du capital à son tour en le serrant soigneusement dans ses deux mains. Alors l’esclave ainsi frustrée, qui était fort versée dans la connaissance des traditions du Prophète, dit à l’esclave de Médine : « C’est moi qui dois avoir droit au capital, en vertu de ces paroles du Prophète (sur lui la prière et la paix !) : Celui qui fait revivre une terre morte, en devient le seul propriétaire ! » Mais l’esclave de Médine, qui ne lâchait pas la marchandise, n’était pas moins versée dans la Sunna que sa rivale de Koufa, et lui répondit aussitôt : « Le capital m’appartient en vertu de ces paroles du Prophète (sur lui la prière et la paix !), qui nous ont été conservées et transmises par Sofiân : « Le gibier appartient, non point à celui qui le lève, mais à celui qui le prend ! »
Lorsque le khalifat eut entendu ces citations, il les trouva si justes qu’il satisfit également les deux adolescentes cette nuit-là !
— Puis Schahrazade ajouta : « Mais, ô Roi fortuné, aucune de ces anecdotes ne vaut celle où deux femmes discutaient pour savoir s’il fallait donner la préférence en amour à l’adolescent ou à l’homme mûr !
À L’ADOLESCENT OU À L’HOMME MÛR ?
L’anecdote suivante nous est rapportée par Aboul-Aïna. Il dit :
« J’étais un soir monté sur ma terrasse pour prendre l’air, quand j’entendis une conversation de femmes sur la terrasse voisine. Celles qui causaient ainsi étaient les deux épouses de mon voisin, lesquelles avaient chacune un amant qui les contentait autrement que ne le faisait le vieil époux impotent. Mais l’amant de l’une était un bel adolescent, encore tout à fait tendre et les joues roses et imberbes, et l’amant de l’autre était un homme mûr et poilu dont la barbe était compacte et drue. Or, justement mes deux voisines, ne se sachant pas écoutées, discutaient sur les mérites respectifs de leurs amoureux. L’une disait…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… l’une disait : « Ô ma sœur, comment peux-tu faire pour supporter la rudesse de la barbe de ton amant, lors du baiser, quand sa barbe vient frotter tes seins et que ses moustaches viennent heurter de leurs épines tes joues et tes lèvres ? Comment fais-tu pour ne pas être chaque fois abîmée quant à ta peau, et cruellement déchirée ? Crois-moi, ma sœur, change d’amoureux et fais comme moi : trouve-toi quelque adolescent aux joues légèrement duvetées et désirables comme un fruit, à la chair délicate qui fonde dans ta bouche sous le baiser. Par Allah ! il saura bien compenser auprès de toi son manque de barbe par tant d’autres choses pleines de saveur ! »
À ces paroles, sa compagne lui répondit : « Que tu es sotte, ma sœur, et que tu manques de finesse et de bon sens ! Ne sais-tu donc pas que l’arbre n’est beau que chargé de ses feuilles, et que le concombre n’est savoureux qu’avec tout son duvet et ses aspérités ? Quoi de plus laid au monde qu’un homme imberbe et chauve comme un topinambour ? Sache donc que la barbe et les moustaches sont pour l’homme ce que les tresses des cheveux sont pour les femmes. Et cela est tellement notoire qu’Allah Très-Haut (qu’il soit glorifié !) a spécialement créé dans le ciel un ange qui n’a d’autre occupation que de chanter les louanges du Créateur pour avoir donné la barbe aux hommes et doué les femmes de longs cheveux ! Que me dis-tu donc de choisir pour amoureux un adolescent imberbe ? Crois-tu que je consentirais à m’étendre sous quelqu’un qui, à peine monté, songe à descendre, à peine tendu, songe à se détendre, à peine noué, songe à dénouer le nœud, à peine en place, songe à se défaire, à peine solidifié, songe à fondre, à peine érigé, songe à s’effondrer, à peine enlacé, songe à se délier, à peine collé, songe à se dissoudre, et à peine tiré, songe à se relâcher ? Détrompe-toi, ma pauvre sœur ! Jamais je ne quitterai l’homme qui à peine a reniflé qu’il enlace, qui lorsqu’il entre reste en place, lorsqu’il se vide se remplit, lorsqu’il finit recommence, lorsqu’il remue est excellent, lorsqu’il s’agite est supérieur, lorsqu’il donne est généreux, et lorsqu’il fonce perfore ! »
En entendant cette explication, la femme dont l’amant était imberbe, s’écria : « Par le Maître de la Kaâba sainte ! ô ma sœur, tu me donnes envie de goûter à l’homme barbu ! »
— Puis Schahrazade, après un court silence, dit immédiatement :
Un jour l’émir Moïn ben-Zaïda rencontra à la chasse un Arabe, monté sur son âne, qui venait du désert. Il alla au-devant de lui et, après les salams, lui demanda : « Où vas-tu ainsi, frère Arabe, et que portes-tu si soigneusement enroulé dans ce petit sac ? » L’Arabe répondit : « Je vais trouver l’émir Moïn pour lui porter ces concombres qui ont poussé avant leur temps dans ma terre dont c’est la première récolte. Comme c’est l’homme le plus généreux que l’on connaisse, je suis sûr qu’il me payera mes concombres un prix digne de sa libéralité ! » L’émir Moïn, que l’Arabe n’avait pas encore vu jusque-là, lui demanda : « Et combien espères-tu que te donnera l’émir Moïn pour ces concombres ? » L’Arabe répondit : « Au moins mille dinars d’or ! » Il demanda : « Et si l’émir te disait que c’est trop ? » Il répondit : « Je n’en demanderais que cinq cents ! » — « Et s’il te disait que c’est trop ? » — « Je demanderais trois cents ! » — « Et s’il te disait que c’est trop ? » — « Cent ! » — « Et s’il te disait que c’est trop ? » — « Cinquante ! » — « Et s’il te disait que c’est trop ? » — « Trente ! » — Et s’il te disait que c’est encore trop ? » — « Oh ! alors je ferais entrer mon âne dans son harem et je prendrais la fuite les mains vides ! »
En entendant ces paroles, Moïn se mit à rire et éperonna son cheval pour courir rejoindre sa suite et rentrer en hâte à son palais où il avisa ses esclaves et son chambellan de laisser entrer l’Arabe avec ses concombres.
Aussi lorsque, une heure plus tard, l’Arabe arriva au palais, le chambellan s’empressa-t-il de le conduire dans la salle de réception où l’attendait l’émir Moïn assis majestueusement au milieu de la pompe de sa cour et entouré de ses gardes l’épée nue à la main. Aussi l’Arabe fut loin de reconnaître en lui le cavalier qu’il avait rencontré sur la route et, le sac de concombres entre les mains, il attendit, après les salams, que l’émir l’interrogeât le premier. L’émir lui demanda : « Que m’apportes-tu dans ce sac, frère Arabe ? » Il répondit : « Confiant dans la libéralité de notre maître l’émir, je lui apporte la primeur de jeunes concombres qui ont poussé dans mon champ ! » — « Quelle bonne inspiration ! Et combien estimes-tu ma libéralité ? — « Mille dinars ! » — « C’est un peu trop ! » — « Cinq cents ! » — « C’est trop ! » — « Trois cents ! » — « C’est trop ! » — « Cent ! » — « C’est trop ! » — « Cinquante ! » — C’est trop ! » — « Trente alors ! » — « C’est encore trop ! » Alors l’Arabe s’écria : « Par Allah ! quelle rencontre de mauvais augure ai-je faite tout à l’heure à rencontrer ce visage de goudron que j’ai vu dans le désert ! Non, par Allah ! ô émir, je ne puis laisser mes concombres à moins de trente dinars ! »
En entendant ces paroles, l’émir Moïn sourit et ne répondit pas. Alors l’Arabe le regardait, s’étant aperçu que l’homme rencontré dans le désert n’était autre que l’émir Moïn lui-même, il dit : « Par Allah ! ô mon maître, fais venir les trente dinars, car l’âne est attaché là-bas à la porte ! » À ces paroles, l’émir Moïn partit d’un tel éclat de rire qu’il tomba sur son derrière ; et il fit venir son intendant et lui dit : « Il faut compter immédiatement à ce frère Arabe d’abord mille dinars, puis cinq cents, puis trois cents, puis cent, puis cinquante, et enfin trente, pour le décider à laisser son âne attaché où il est ! » Et l’Arabe fut à la limite de la stupéfaction de recevoir mille neuf cent quatre-vingts dinars pour un sac de concombres. Or, telle était la libéralité de l’émir Moïn ! Que la miséricorde d’Allah soit sur eux tous à jamais !
— Puis Schahrazade dit :
Aba-Souwaïd raconte :
« J’étais un jour entré dans un verger pour y acheter des fruits, quand j’aperçus de loin, assise à l’ombre d’un abricotier, une femme qui se peignait les cheveux. Je m’en approchai aussitôt et je vis qu’elle était vieille et que ses cheveux étaient blancs ; mais son visage était parfaitement gentil et son teint frais et délicieux. En me voyant m’approcher d’elle, elle ne fit aucun mouvement pour se voiler le visage ni aucun geste pour se couvrir la tête, et continua en souriant à se démêler les cheveux avec son peigne qui était d’ivoire. Moi je m’arrêtai en face d’elle et, après les salams, je lui dis : « Ô vieille par l’âge, mais si jeune de visage, pourquoi ne pas te teindre les cheveux et ressembler alors tout à fait à une jeune fille ? Quel motif t’empêche de le faire…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT SOIXANTE-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
« … Quel motif t’empêche de le faire ? » Elle leva alors la tête, me regarda avec de grands yeux et me répondit par les vers suivants :
« Je les ai teints autrefois, mais la couleur a disparu et celle du temps est restée.
« Pourquoi les teindrais-je encore, puisque je puis, quand je veux, balancer ma croupe fastueusement, et me le faire mettre au choix par devant ou par derrière ? »
— Et Schahrazade dit ensuite
On raconte que le vizir Giafar reçut chez lui une nuit le khalifat Haroun Al-Rachid, et n’épargna rien pour l’amuser agréablement. Soudain le khalifat lui dit : « Giafar, il m’est revenu que tu as acheté pour toi une esclave fort belle que j’avais remarquée et que je voulais acheter pour moi-même. Je désire donc de toi que tu me la cèdes au prix qui te convient ! » Giafar répondit : « Je n’ai guère l’intention de la vendre, ô émir des Croyants ! » Il dit : « Alors offre-la-moi en présent ! » Giafar répondit : « Je n’ai point cette intention-là, ô émir des Croyants ! » Alors Al-Rachid fronça les sourcils et s’écria : « Je jure par les trois serments[1] que je divorce à l’instant d’avec mon épouse Sett Zobéida, si tu ne veux pas consentir à me vendre l’esclave ou à me la céder ! » Giafar répondit : « Je jure par les trois serments que je divorce à l’instant d’avec mon épouse, la mère de mes enfants, si je consens à te vendre l’esclave ou à te la céder ! » Lorsqu’ils eurent fait tous deux ce serment, soudain ils s’aperçurent qu’ils s’étaient laissés aller trop loin, aveuglés par les fumées du vin, et, d’un commun accord, se demandèrent quel moyen employer pour sortir d’embarras. Après quelques instants de perplexité et de réflexion, Al-Rachid dit : « Nous n’avons d’autre moyen de sortir de ce cas si embarrassant que de recourir aux lumières du kâdi Abi-Youssouf, si versé dans la jurisprudence en matière de divorce ! » Ils l’envoyèrent aussitôt chercher, et Abi-Youssouf pensa : « Si le khalifat m’envoie chercher au milieu de la nuit, c’est qu’un événement fort grave se passe dans l’Islam ! » Puis il sortit en toute hâte de sa maison, enfourcha sa mule, et dit à son esclave qui suivait la mule : « Prends avec toi le sac à fourrage de la bête qui n’a pas encore fini sa ration, et n’oublie pas de le lui suspendre à la tête, à notre arrivée, pour qu’elle continue à manger ! »
Lorsqu’il entra dans la salle où l’attendaient le khalifat et Giafar, le khalifat se Leva en son honneur et le fit s’asseoir à côté de lui : privilège qu’il n’accordait jamais qu’au seul Abi-Youssouf. Puis il lui dit : « Je t’ai mandé pour une affaire de la plus grande gravité ! » Et il lui expliqua le cas. Alors Abi-Youssouf dit : « Mais la solution, ô émir des Croyants, est la chose la plus simple qui soit ! » Il se tourna alors vers Giafar et lui dit : « Tu n’as qu’à vendre au khalifat la moitié de l’esclave et à lui donner en présent la seconde moitié ! »
Cette solution ravit le khalifat à l’extrême, et il en admira toute la finesse : car elle les déliait tous deux de leur serment en le faisant bénéficier de l’esclave qu’il souhaitait. Ils firent donc venir l’esclave sur le champ, et le khalifat dit : « Je ne puis attendre que soit passé le temps réglementaire pour la libération définitive qui me permettra de prendre l’esclave à son premier maître. Il faut donc, ô Abi-Youssouf, que tu me trouves également le moyen de faire immédiatement cette libération ! » Abi-Youssouf répondit : « La chose est encore plus facile ! Qu’on fasse venir un jeune mamelouk ! » Aussitôt on fit venir le mamelouk en question, et Abi-Youssouf dit : « Pour que cette libération immédiate soit licite, il faut que l’esclave soit légitimement mariée. Je vais donc la donner en mariage à ce mamelouk qui, moyennant rétribution, divorcera d’avec elle avant de la toucher ! Et alors seulement, ô émir des Croyants, l’esclave pourra t’appartenir comme concubine ! » Et il se tourna vers le mamelouk et lui dit : « Acceptes-tu cette esclave comme épouse légitime ? » Il répondit : « Je l’accepte ! » Alors le kâdi lui dit : « Tu es marié ! Maintenant voici mille dinars pour toi ! Divorce d’avec elle ! » Le mamelouk répondit : « Du moment que je suis marié légitimement, je tiens à rester marié, car l’esclave me plaît ! »
En entendant cette réponse du mamelouk, le khalifat fronça les sourcils de colère, et dit au kâdi : « Par l’honneur de mes ancêtres ! ta solution va te mener à la potence ! » Mais Abi-Youssouf, amène, dit : « Que notre maître le khalifat ne se préoccupe pas du refus de ce mamelouk, et qu’il soit persuadé que la solution devient plus facile que jamais ! » Puis il ajouta : « Permets-moi seulement, ô émir des Croyants, d’user de ce mamelouk comme s’il était mon esclave ! » Le khalifat lui dit : « Je te le permets ! Il est ton esclave et ta propriété ! » Alors Abi-Youssouf se tourna vers l’adolescente et lui dit : « Je te fais cadeau de ce mamelouk et te le donne comme esclave acheté ! L’acceptes-tu ainsi ? » Elle répondit : « Je l’accepte ! » Abi-Youssouf s’écria : « Dans ce cas le mariage qu’il vient de contracter avec toi est cassé de lui-même. Et tu es déliée d’avec lui ! Ainsi le veut la loi du mariage ! J’ai jugé ! »
En entendant ce jugement, Al-Rachid, à la limite de l’admiration, se leva debout sur ses deux pieds et s’écria : « Ô Abi-Youssouf, il n’y a pas ton second dans l’Islam ! » Et il lui fit apporter un grand plateau rempli d’or et le pria de l’accepter. Le kâdi remercia le khalifat, mais ne sut comment emporter tout cet or. Soudain il se rappela le sac à picotin de la mule, et, l’ayant fait apporter, il y vida tout l’or du plateau et s’en alla.
Or, cette anecdote est pour nous prouver que l’étude de la jurisprudence mène aux honneurs et à la richesse. Que la miséricorde d’Allah soit donc sur tous ceux-là ! »
— Ensuite Schahrazade dit :
On raconte que le khalifat Haroun Al-Rachid qui aimait d’un amour extrême son épouse et cousine Sett Zobéida, lui avait fait construire, dans un jardin réservé à elle seule, un grand bassin d’eau environné d’un bosquet d’arbres touffus, où elle pouvait se baigner sans jamais être exposée aux regards des hommes ni aux rayons du soleil, tant ce bosquet était impénétrable et feuillu.
Or, un jour que la chaleur était grande Sett Zobéida vint toute seule dans le bosquet, se dévêtit complètement au bord du bassin, et descendit dans l’eau. Mais elle n’y baigna seulement que ses jambes jusqu’aux genoux ; car elle avait peur du frisson que donne l’eau au corps qui s’y plonge en entier, et, en outre, elle ne savait pas nager. Mais avec une tasse qu’elle avait apportée elle se versait de l’eau sur les épaules par petites ondées en tressaillant sous la caresse humide de la fraîcheur.
Le khalifat, qui l’avait vue se diriger vers le bassin, la suivit doucement et, amortissant le bruit de ses pas, arriva au moment où elle était déjà nue. À travers les feuilles, il se mit à l’observer et à admirer sa nudité blanche sur l’eau. Comme il avait la main appuyée sur une branche, soudain la branche craqua et Sett Zobéida…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… soudain la branche craqua et Sett Zobéida, saisie de frayeur, se retourna en portant ses deux mains sur son histoire pour, d’un geste instinctif, la soustraire aux regards. Or, l’histoire de Sett-Zobéida était chose si considérable que les deux mains ne parvenaient guère à la cacher qu’à moitié ; et cette histoire-là était si grasse et si glissante que Sett Zobéida ne put réussir à la retenir, et elle lui glissa entre les doigts et apparut dans toute sa gloire aux yeux du khalifat.
Al-Rachid, qui jusqu’alors n’avait pas eu l’occasion d’observer l’histoire de sa cousine à l’air libre et au naturel, fut émerveillé à la fois et stupéfait de son énormité et de son faste, et se hâta de s’éloigner furtivement comme il était venu. Mais ce spectacle éveilla en lui l’inspiration, et il se sentit en veine d’improviser. Il commença par trouver, sur un rythme léger, le vers suivant :
Dans le bassin, j’ai vu l’argent candide…
Mais il eut beau ensuite se torturer l’esprit pour construire d’autres rythmes, il ne put guère réussir non seulement à achever le poème mais à faire un second vers qui donnât la rime ; et il se sentait bien malheureux, et il transpirait en répétant : « Dans le bassin, j’ai vu l’argent candide… » et il ne parvenait point à sortir d’embarras. Alors il se décida à faire venir le poète Abou-Nowas, et lui dit : « Voyons si toi tu peux arriver à composer un court poème dont le premier vers serait : « Dans le bassin j’ai vu l’argent candide… » Alors Abou-Nowas, qui, lui aussi, avait rôdé aux alentours du bassin et remarqué toute la scène en question, répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Et, à la stupéfaction du khalifat, il improvisa tout de suite les vers suivants :
« Dans le bassin j’ai vu l’argent candide, et mes yeux se sont enivrés de lait.
« Une gazelle a captivé mon âme sous l’ombre de ses hanches, quand de ses doigts joints a glissé son histoire.
« Oh ! que n’ai-je pu me changer en onde pour caresser cette délicate histoire qui glisse, ou me changer en poisson pour une heure ou deux ! »
Le khalifat ne chercha pas à savoir comment Abou-Nowas avait pu donner à ses vers une signification exacte, et le rémunéra largement pour lui prouver sa satisfaction.
— Puis Schahrazade ajouta : « Mais ne crois point, ô Roi fortuné, que cette finesse d’esprit d’Abou-Nowas ait été plus admirable que sa charmante improvisation dans l’anecdote que voici :
Une nuit le khalifat Haroun Al-Rachid, pris d’une tenace insomnie, se promenait seul sous les galeries de son palais, quand il aperçut une de ses esclaves, qu’il aimait à l’extrême, se diriger vers son pavillon réservé. Il la suivit et pénétra derrière elle dans le pavillon. Il la prit alors dans ses bras et se mit à la caresser et à jouer avec elle, si bien que le voile tomba qui l’enveloppait, et que la tunique glissa également de ses épaules.
À cette vue, le désir s’alluma dans l’âme du khalifat qui voulut à l’instant posséder sa belle esclave ; mais elle se récusa, disant : « De grâce ! ô émir des Croyants, remettons la chose à demain, car ce soir je ne m’attendais pas à l’honneur de ta visite, et je ne me suis guère préparée pour cela. Mais demain, si Allah veut ! tu me trouveras toute parfumée, et sur la couche mes jasmins embaumeront ! » Alors Al-Rachid n’insista pas et retourna se promener.
Le lendemain, à la même heure, il envoya le chef des eunuques, Massrour, prévenir l’adolescente de la visite projetée. Mais justement l’adolescente avait eu dans la journée un commencement de fatigue et, se sentant lasse et plus mal disposée que jamais, se contenta, pour toute réponse à Massrour qui lui rappelait sa promesse de la veille, de citer le proverbe : « Le jour efface les paroles de la nuit ! » Au moment où Massrour rapportait au khalifat ces paroles de l’adolescente, entrèrent les poètes Abou-Nowas, El-Rakaschi, et Abou-Mossâb. Et le khalifat se tourna vers eux et leur dit : « Que chacun de vous m’improvise à l’instant quelques rythmes en y faisant entrer ces mots : « Le jour efface les paroles de la nuit ! »
Alors, le premier, le poète El-Rakaschi dit :
« Garde-toi, mon cœur, d’une belle enfant inflexible qui n’aime ni faire ni recevoir les visites, qui promet un rendez-vous et n’y est point fidèle, et qui s’excuse en disant : « Le jour efface les paroles de la nuit ! »
Ensuite, Abou-Mossâb s’avança et dit :
« Mon cœur vole à toute vitesse, et elle se joue de son ardeur. Mes yeux pleurent, et mes entrailles brillent de son désir ; mais elle se contente de sourire. Et si je lui rappelle sa promesse, elle me répond : « Le jour efface les paroles de la nuit ! »
Le dernier, Abou-Nowas s’avança et dit :
« Ô ! qu’elle était jolie dans son trouble, ce soir-là ! et que sa résistance avait de charme !
« Le vent ivre de la nuit lentement balançait le rameau de sa taille et sa lourde croupe qui ondulait ; et son buste pliait aussi où pointaient deux petites grenades, ses seins.
« Par des jeux aimables, par des caresses hardies ma main fit glisser le voile qui la drapait ; et de ses épaules, ô rondeur de perles ! la tunique aussi glissa.
« Elle parut alors à moitié nue, sortant de sa robe retournée comme une fleur de son calice.
« Alors, comme la nuit abaissait sur nous le rideau des ombres, je voulus être plus audacieux ; et je lui dis : « Le couronnement ! »
« Mais elle me répondit : « La suite à demain ! »
« Je vins à elle le lendemain et lui dis : « La promesse ! » Elle se renversa, riant, et me répondit : « Le jour efface les paroles de la nuit ! »
Ayant entendu ces diverses improvisations, Al-Rachid lit donner une grosse somme d’argent à chacun des poètes, excepté à Abou-Nowas dont il ordonna la mise à mort à l’instant, en s’écriant : « Par Allah ! tu es d’intelligence avec la jeune fille ! Sinon comment as-tu pu faire une si exacte description d’une scène où j’étais seul présent ? » Abou-Nowas se mit à rire et répondit : « Notre maître le khalifat oublie que le vrai poète est celui qui sait deviner ce qu’on lui cache, d’après ce qu’on lui dit ! Et d’ailleurs le Prophète (sur lui la prière et la paix !) nous a dépeints excellemment quand, parlant de nous, il a dit : « Les poètes suivent toutes les routes comme des insensés. Seule leur inspiration les guide, et le démon ! Et ils racontent et disent des choses qu’ils ne font pas ! »
Al-Rachid, à ces paroles, ne voulut pas approfondir davantage ce mystère et, après avoir pardonné à Abou-Nowas, lui donna une somme double de celle qu’avaient reçue les deux autres poètes.
— Lorsque le roi Schahriar eut entendu cette anecdote, il s’écria : « Non ! par Allah, moi je ne lui aurais pas pardonné à cet Abou-Nowas-là, et j’aurais approfondi ce mystère, et j’aurais fait couper la tête de ce vaurien. Je ne veux plus, m’entends-tu, Schahrazade, que tu me parles encore de cette crapule-là qui ne respectait ni les khalifats ni les lois ! » Et Schahrazade dit : « Alors, ô Roi fortuné, je vais te raconter l’anecdote de l’âne ! »
L’ÂNE
Un jour, un brave homme d’entre les hommes qui sont tellement les dupes d’autrui, marchait dans le souk en conduisant son âne derrière lui par une simple corde qui servait de licou à la bête. Un larron fort expérimenté l’aperçut, et résolut de lui voler l’âne. Il fit part de son projet à un de ses compagnons qui lui demanda : « Mais comment feras-tu pour ne pas éveiller l’attention de l’homme ? » Il répondit : « Suis-moi, et tu vas voir…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGTIÈME NUIT
Elle dit :
« … Suis-moi, et tu vas voir ! » Il s’approcha alors de l’homme par derrière, et, tout doucement, défit le licou de l’âne, se le passa à lui-même, sans que l’homme se fût aperçu du changement, et marcha comme une bête de somme, tandis que son compagnon s’éloignait avec l’âne mis en liberté.
Lorsque le larron se fut assuré que l’âne était déjà loin, il s’arrêta brusquement dans sa marche ; et l’homme, sans se retourner, essaya en tirant sur lui de l’obliger à marcher. Mais, sentant de la résistance, l’homme se retourna pour objurguer l’âne, et vit le larron pris dans le licou à la place de la bête, et l’air bien humble et avec des yeux qui imploraient. Il fut si stupéfait qu’il resta immobile en face du larron ; et, au bout d’un moment, il put enfin articuler quelques syllabes et demander : « Quelle chose es-tu ? » Le larron, des larmes plein la voix, s’écria : « Je suis ton âne, ô mon maître ! Mais mon histoire est étonnante ! Sache, en effet, que j’étais dans ma jeunesse un vaurien adonné à toutes sortes de vices honteux. Un jour, je rentrai tout à fait ivre et dégoûtant chez ma mère, qui, à ma vue, ne put guère maîtriser son ressentiment, m’accabla de reproches et voulut me chasser de la maison. Mais moi je la repoussai et même, dans mon ivresse, je la frappai. Alors, indignée de ma conduite à son égard, elle me maudit, et l’effet de sa malédiction fut que je changeai aussitôt de forme et devins un âne. Alors toi, ô mon maître, tu m’as acheté au souk des ânes pour cinq dinars, et tu m’as gardé tout ce temps-là et tu t’es servi de moi comme bête de somme, et tu m’aiguillonnais le derrière, quand, fourbu, je refusais de marcher, et tu me lançais mille jurons que je n’oserais jamais te répéter. Tout cela ! et moi je ne pouvais guère me plaindre, puisque la parole m’était enlevée, et c’est tout au plus si, des fois, mais rarement, je réussissais à péter pour remplacer la parole qui me manquait ! Enfin, aujourd’hui ma pauvre mère a dû certainement se souvenir de moi avec aménité, et la pitié a dû entrer dans son cœur et l’inciter à implorer pour moi la miséricorde du Très-Haut. Or c’est, je n’en doute pas, par l’effet de cette miséricorde que tu me vois maintenant revenir à ma forme première humaine, ô mon maître ! »
À ces paroles, le pauvre homme s’écria : « Ô mon semblable, pardonne-moi mes torts à ton égard, par Allah sur toi ! et oublie les mauvais traitements que je t’ai fait endurer à mon insu ! Il n’y a de recours qu’en Allah ! » Et il se hâta de défaire le licou qui attachait le larron, et s’en alla bien contrit à sa maison, où il ne put fermer l’œil cette nuit-là, tant il avait de remords et de chagrin.
Quelques jours après, le pauvre homme alla au souk des ânes, pour s’acheter un autre âne, et quelle ne fut point sa surprise de retrouver sur le marché son premier âne sous l’aspect qu’il avait avant son changement ! Et il pensa en lui-même : « Certainement le vaurien a dû commettre encore quelque délit ! » Et il s’approcha de l’âne, qui s’était mis à braire en le reconnaissant, se pencha sur son oreille et lui cria de toutes ses forces : « Ô l’incorrigible vaurien ! tu as encore dû outrager et frapper ta mère, pour de nouveau être ainsi transformé en âne. Mais, par Allah ! ce n’est pas moi qui t’achèterai encore ! » Et, furieux, il lui cracha au visage et s’en alla acheter un autre âne notoirement connu comme descendant de père et de mère de l’espèce des ânes.
— Et, cette nuit-là, Schahrazade dit encore :
On raconte que le commandeur des Croyants Haroun Al-Rachid entra un jour faire sa sieste dans l’appartement de Sett Zobéida, son épouse, et il allait s’étendre sur le lit quand il y remarqua, juste sur le milieu, une large tache encore fraîche dont l’origine était péremptoire d’elle-même. À cette vue, le monde noircit devant son visage et il fut à la limite de l’indignation. Il fit aussitôt mander Sett Zobéida et, les yeux enflammés de colère et la barbe tremblante, il lui cria : « Qu’est-ce que c’est que cette tache-là sur notre lit ? » Sett Zobéida pencha la tête sur la tache en question, la renifla et dit : « C’est de la semence d’homme, ô émir des Croyants ! » Il lui cria, contenant à grand’peine le bouillonnement de sa colère : « Et peux-tu m’expliquer la présence de ce liquide-là encore tout tiède sur un lit où je n’ai pas couché avec toi depuis plus d’une semaine ? » Elle s’écria, bien émue : « La fidélité sur moi et autour de moi, ô émir des Croyants ! Me soupçonnerais-tu par hasard de fornication ? » Al-Rachid dit : « Je te soupçonne tellement que je vais tout de suite faire venir le kâdi Abi-Youssouf pour qu’il expertise la chose et me donne là-dessus son sentiment. Et, par l’honneur de nos ancêtres ! ô fille de mon oncle, je ne reculerai devant rien si tu es reconnue coupable par le kâdi ! »
Lorsque le kâdi fut arrivé, Al-Rachid lui dit : « Ô Abi-Youssouf, dis-moi ce que peut bien être cette tache-là ! » Le kâdi s’approcha du lit, mit son doigt au milieu de la tache, le porta ensuite à la hauteur de son œil et de son nez et dit : « C’est de la semence d’homme, ô émir des Croyants…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-UNIÈME NUIT
Elle dit :
« … C’est de la semence d’homme, ô émir des Croyants ! » Il demanda : « Quelle peut en être l’origine immédiate ? » Le kâdi, fort perplexe et ne voulant pas affirmer une chose qui lui aurait attiré l’inimitié de Sett Zobéida, leva la tête au plafond comme pour réfléchir, et aperçut dans une fente l’aile d’une chauve-souris qui y était blottie. Aussi une idée de salut lui illumina l’entendement, et il dit : « Donne-moi une lance, ô émir des Croyants ! » Le khalifat lui remit une lance, et Abi-Youssouf en perça la chauve-souris qui tomba lourdement. Alors il dit : « Ô émir des Croyants, les livres de médecine nous enseignent que la chauve-souris a une semence qui ressemble étrangement à celle de l’homme. Le délit a donc certainement été commis par elle, à l’aspect de Sett Zobéida endormie ! Tu vois que je viens de l’en châtier par la mort ! »
Cette explication satisfit pleinement le khalifat qui, ne doutant plus de l’innocence de son épouse, combla le kâdi de présents, en signe de gratitude. Et Sett Zobéida, de son côté, à la limite de la jubilation, lui fit de somptueux cadeaux et l’invita à rester avec elle et le khalifat manger quelques fruits et des primeurs, qu’on lui avait apportés. Le kâdi s’assit entre le khalifat et Sett Zobéida, sur les tapis, et Sett Zobéida éplucha une banane et, la lui offrant, lui dit : « J’ai dans mon jardin d’autres fruits, rares en cette époque-ci de l’année ; les préfères-tu aux bananes ? » Il répondit : « J’ai pour principe, ô ma maîtresse, de ne jamais prononcer de jugement par défaut. Il faut donc que je voie d’abord ces primeurs-là pour les comparer à ces primeurs-ci, et donner ensuite mon avis sur leur excellence respective ! » Sett Zobéida fit aussitôt cueillir et apporter les primeurs de son jardin et, les ayant fait goûter au kâdi, lui demanda : « Lesquels de ces fruits préfères-tu maintenant ? » Le kâdi sourit d’un air entendu, regarda le khalifat, puis Sett Zobéida et leur dit : « Par Allah ! la réponse est bien difficile ! si je préférais l’un de ces fruits, je condamnerais l’autre par le fait même, et je risquerais ainsi une indigestion que, dans sa rancune contre moi, il m’occasionnerait ! »
En entendant cette réponse, Al-Rachid et Zobéida se mirent tellement à rire qu’ils se renversèrent sur leur derrière !
— Et Schahrazade, voyant à certains indices que le roi Schahriar avait l’air, lui, plutôt de vouloir condamner sans miséricorde Sett Zobéida, en la chargeant elle-même du délit, se hâta, pour faire diversion, de lui raconter l’anecdote suivante :
On raconte, entre diverses anecdotes sur le roi de Perse le grand Khosrou, que ce roi était un grand amateur de poissons. Un jour qu’il était assis sur sa terrasse avec son épouse la belle Schirîn, un pêcheur vint lui apporter en présent un poisson d’une grosseur et d’une beauté extraordinaires. Le roi fut émerveillé de ce présent, et ordonna de faire donner quatre mille drachmes au pêcheur. Mais la belle Schirîn, qui n’approuvait jamais la généreuse prodigalité du roi, attendit le départ du pêcheur et dit : « Il n’est pas permis d’être prodigue au point de donner à un pêcheur quatre mille drachmes pour un seul poisson. Tu devrais te faire rendre cette somme, sinon tous ceux qui, à l’avenir, t’apporteraient un présent, régleraient leurs espoirs sur ce prix-là, comme point de départ ; et tu ne pourrais plus faire face à leurs prétentions ! » Le roi Khosrou répondit : « Ce serait pourtant un opprobre pour un roi de reprendre ce qu’il a donné. Oublions donc ce qui est passé ! » Mais Schirîn répondit : « Non ! il n’est pas possible de laisser la chose courir de la sorte ! Il y a moyen de reprendre la somme sans que le pêcheur ni personne puisse trouver à redire. On n’a pour cela qu’à faire revenir le pêcheur et à lui demander : « Le poisson que tu m’as apporté est-il mâle ou femelle ? » S’il te répond que c’est un mâle rends-lui le poisson en disant : « C’est une femelle que je veux ! » et s’il te dit que c’est une femelle, rends-le tout de même en disant : « C’est un mâle que je veux ! »
Le roi Khosrou, qui aimait d’un amour extrême la belle Schirîn, ne voulut pas la contrarier, et se hâta de faire, mais avec regret, ce qu’elle lui conseillait. Seulement, le pêcheur était un homme doué de finesse d’esprit et d’à-propos, et lorsque Khosrou, l’ayant fait revenir, lui eut demandé : « Le poisson est-il mâle ou femelle ? » il embrassa la terre et répondit : « Ce poisson-là, ô roi, est hermaphrodite ! »
À ces paroles, Khosrou se dilata d’aise et se mit à rire, puis ordonna à son intendant de donner au pêcheur huit mille drachmes au lieu de quatre mille. Le pêcheur s’en alla avec l’intendant qui lui compta les huit mille drachmes ; et il les mit dans le sac qui lui avait servi à apporter le poisson, et sortit.
Lorsqu’il fut dans la cour du palais, il laissa, par inadvertance, tomber du sac un drachme d’argent. Aussitôt il s’empressa de poser son sac par terre, de chercher ce drachme et de le ramasser avec une satisfaction très grande.
Or, Khosrou et Schirîn l’observaient de la terrasse, et virent ce qui venait de se passer. Alors Schirîn, contente de l’occasion qui s’offrait à elle, s’écria…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUXIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors Schirîn, contente de l’occasion qui s’offrait à elle, s’écria : « Voilà ce pêcheur ! Quelle ignominie est la sienne ! Il laisse tomber un drachme, et, au lieu de le laisser là pour qu’il soit ramassé par quelque pauvre, il est assez vil pour le reprendre et en frustrer le besogneux ! » À ces paroles, Khosrou fut très impressionné et, faisant rappeler le pêcheur, lui dit : « Ô être abject ! tu n’es certes pas un homme, pour avoir une âme si petite ! Ton avarice te perd, qui te fait déposer un sac rempli d’or pour ramasser un seul drachme tombé pour la chance du besogneux ! »
Alors le pêcheur embrassa la terre et répondit : « Qu’Allah prolonge la vie du roi ! Si j’ai ramassé ce drachme ce n’est point parce qu’il m’est cher comme prix, mais parce que sa valeur est grande à mes yeux ! Ne porte-t-il pas, en effet, sur une de ses faces l’image du roi et sur l’autre son nom ? Je n’ai point voulu le laisser exposé à être foulé par inadvertance aux pieds de quelque passant. Et je me suis hâté de le ramasser, suivant en cela l’exemple du roi qui m’a tiré moi-même de la poussière, moi qui vaux un drachme à peine ! »
Cette réponse plut tellement au roi Khosrou qu’il fit encore donner quatre mille drachmes au pêcheur, et ordonna aux crieurs publics de crier par tout l’empire : « Il ne faut jamais se laisser guider par le conseil des femmes. Car celui qui les écoute commet deux fautes en voulant éviter la moitié d’une ! »
— Le roi Schahriar, en entendant cette anecdote dit : « J’approuve fort la conduite de Khosrou et sa méfiance des femmes. Elles sont la cause de bien des calamités ! » Mais déjà Schahrazade, souriante, disait :
Une nuit, le khalifat Haroun Al-Rachid se plaignait de ses insomnies devant son vizir Giafar et son porte-glaive Massrour, quand soudain Massrour partit d’un éclat de rire. Le khalifat le regarda en fronçant les sourcils, et lui dit : « Et de quoi ris-tu donc ainsi ? Serait-ce par folie ou par moquerie ? » Massrour répondit : « Non, par Allah ! ô émir des Croyants, je te le jure par la parenté qui te rattache au Prophète, si je ris ce n’est point par l’effet d’aucune de ces causes, mais simplement parce que je me suis rappelé les bons mots d’un certain Ibn Al-Karabi autour duquel on faisait cercle hier sur le Tigre pour l’écouter. » Le khalifat dit : « Dans ce cas, va vite me chercher cet Ibn Al-Karabi. Peut-être réussira-t-il à me dilater un peu la poitrine ! »
Aussitôt il courut à la recherche du plaisant Ibn Al-Karabi et, l’ayant rencontré, lui dit : « J’ai parlé de toi au khalifat, et il m’envoie te chercher pour que tu le fasses rire. » Il répondit : « J’écoute et j’obéis ! » Massrour alors ajouta : « Oui ! je veux bien te conduire auprès du khalifat, mais c’est, bien entendu, à la condition que tu me donneras les trois quarts de ce que t’accordera le khalifat comme rémunération ! » Ibn Al-Karabi dit : « C’est trop ! Je te donnerai les deux tiers pour ton courtage. Ce sera suffisant ! » Massrour, après quelques difficultés, pour la forme, finit par accepter l’accord, et conduisit l’homme auprès du khalifat.
Al-Rachid, en le voyant entrer, lui dit : « On prétend que tu sais de bons mots fort amusants. Dévide-les pour voir ! Mais sache bien que si tu ne parviens pas à me faire rire, la bastonnade t’attend ! »
Cette menace eut pour résultat de glacer complètement l’esprit d’Ibn Al-Karabi qui ne sut alors trouver que des banalités à l’effet désastreux ; car Al-Rachid, au lieu d’en rire, sentit augmenter son irritation, et à la fin s’écria : « Qu’on lui administre cent coups de bâton sur la plante des pieds pour faire dévier vers ses extrémités le sang qui lui obstrue le cerveau ! » Aussitôt on étendit l’homme et on lui administra des coups de bâton en mesure sur la plante des pieds. Soudain, lorsque le chiffre de trente coups fut dépassé, l’homme s’écria : « Qu’on rémunère maintenant Massrour à qui reviennent, d’après l’accord intervenu entre nous, les deux autres tiers ! » Les gardes alors, sur un signe du khalifat, s’emparèrent de Massrour, l’étendirent, et commencèrent, sur la plante de ses pieds, à faire sentir le rythme du bâton. Mais dès les premiers coups, Massrour s’écria : « Par Allah ! je veux bien me contenter du tiers seulement et même du quart, et je lui abandonne tout le reste ! »
À ces paroles, le khalifat se mit à rire tellement qu’il se renversa sur son derrière, et fit donner mille dinars à chacun des deux patients.
— Ensuite Schahrazade ne voulut pas laisser passer la nuit sans raconter l’anecdote suivante :
Une fois, un homme, dont le métier était de vagabonder et de vivre aux dépens d’autrui, eut l’idée, bien qu’il ne sût ni lire ni écrire, de se faire maître d’école, puisque c’était le seul métier qui pût lui permettre de gagner de l’argent sans rien faire ; car il est notoire qu’on peut être maître d’école, et ignorer complètement les règles et les premiers éléments de la langue ; il suffit pour cela d’être assez roué pour faire croire aux autres qu’on est soi-même un grand grammairien ; et l’on sait qu’un savant grammairien est d’ordinaire un pauvre homme à l’esprit étroit, mesquin, déprimant, incomplet et impotent.
Donc, notre vagabond s’improvisa ainsi maître d’école, et n’eut pour cela que la peine d’augmenter le nombre de tours et le volume de son turban, et aussi d’ouvrir, au fond d’une petite rue, une salle qu’il décora de tableaux d’écriture et autres choses semblables, et où il attendit les clients.
Or, à la vue d’un turban si imposant, les habitants du quartier ne doutèrent pas un instant de la science de leur voisin, et se hâtèrent de lui envoyer leurs enfants…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-TROISIÈME NUIT
Elle dit :
… et se hâtèrent de lui envoyer leurs enfants.
Mais, comme il ne savait ni lire ni écrire, il trouva un moyen fort ingénieux de se tirer d’affaire : ce moyen consistait à faire donner des leçons par les enfants qui savaient un peu lire et écrire, à ceux qui ne savaient rien du tout, pendant que lui faisait semblant de surveiller, d’approuver et de désapprouver. De cette façon, l’école prospéra et les affaires du maître prirent une tournure excellente.
Un jour qu’il tenait sa baguette à la main et faisait des yeux terribles aux malheureux petits enfants effondrés d’épouvante, une femme entra dans la salle, en tenant à la main une lettre, et se dirigea vers le maître pour le prier de la lui lire, comme il est d’usage chez les femmes qui ne savent pas lire. À sa vue, le maître d’école ne sut comment faire pour éviter une pareille épreuve, et soudain se leva en hâte pour sortir. Mais la femme le retint, en le suppliant de lui lire la lettre avant de sortir. Il répondit : « Je ne puis attendre davantage : le muezzin vient d’annoncer la prière de midi, et il faut que je me rende à la mosquée ! » Mais la femme ne voulut pas le lâcher, et lui dit : « Par Allah sur toi ! cette lettre me vient de mon époux, absent depuis cinq années, et toi seul, dans le quartier, peux me la lire ! » Et elle l’obligea à prendre la lettre.
Le maître d’école fut bien forcé alors de prendre la lettre ; mais il la tint à rebours, et, dans l’embarras extrême où il se trouvait, il se mit à froncer les sourcils, en regardant l’écriture, à se frapper le front, à déplacer son turban et à transpirer de peine.
À cette vue, la pauvre femme pensa : « Il n’y a plus de doute ! pour que le maître d’école devienne si agité, il doit lire de mauvaises nouvelles ! Ô calamité ! mon époux est peut-être mort ! » Puis, pleine d’anxiété, elle demanda au maître d’école : « De grâce ! ne me cache rien ! Est-il mort ? » Pour toute réponse il haussa la tête d’un signe vague, et garda le silence. Elle s’écria alors : « Ô calamité sur ma tête ! dois-je me déchirer les habits ? » Il répondit : « Déchire ! » Elle demanda, à la limite de l’anxiété : « Dois-je me frapper et me griffer les joues ? » Il répondit : « Frappe et griffe ! »
À ces paroles, la pauvre femme, affolée, s’élança hors de l’école et courut à sa maison qu’elle remplit de cris de deuil. Alors toutes les voisines accoururent chez elle, et se mirent à la consoler, mais en vain. À ce moment, un des parents de la malheureuse entra, vit la lettre et, l’ayant lue, dit à la femme : « Mais qui donc a pu t’annoncer la mort de ton époux ? Il n’y a rien de cela dans la lettre. En voici le contenu : « Après les salams et les souhaits. Ô fille de mon oncle, je continue à jouir d’une excellente santé, et j’espère être de retour auprès de toi dans quinze jours. Mais auparavant, je t’envoie, pour te prouver ma sollicitude, une toile de lin enveloppée dans une couverture. Ouassalam ! »
La femme prit alors la lettre et retourna à l’école pour reprocher au maître de l’avoir ainsi induite en erreur. Elle le trouva assis à sa porte, et lui dit : « N’est-ce point une honte sur toi de tromper de la sorte une pauvre femme et de lui annoncer la mort de son époux, alors que dans la lettre il est écrit que mon époux doit bientôt revenir, et qu’il m’envoie à l’avance une toile et une couverture ? » À ces paroles, le maître d’école répondit : « Certes ! ô pauvre femme, tu as raison de me faire ces reproches. Mais pardonne-moi, car au moment où j’avais ta lettre entre les mains, j’étais fort préoccupé, et, ayant lu un peu vite et de travers, j’ai cru que la toile et la couverture étaient un souvenir qu’on t’envoyait des effets de ton époux mort ! »
— Schahrazade dit ensuite :
On raconte qu’El-Amîn, frère du khalifat El-Mâmoun, étant allé un jour en visite chez son oncle El-Mahdi, aperçut une jeune esclave d’une grande beauté, qui jouait du luth ; et il en devint aussitôt amoureux. Aussi El-Mahdi ne tarda pas à remarquer l’impression que l’esclave avait produite sur son neveu, et, pour lui faire un agréable cadeau, attendit qu’il fût parti pour lui envoyer l’esclave chargée de bijoux et de riches habits. Mais El-Amîn crut que son oncle avait déjà eu la primeur de l’adolescente, et la lui donnait défraîchie ; car il le savait excessivement amateur de fruits encore acides. Il ne voulut donc pas accepter l’esclave, et la lui renvoya avec une lettre où il lui disait qu’une pomme mordue par le jardinier avant la maturité ne dulcifiait jamais la bouche de l’acheteur.
Alors El-Mahdi fit déshabiller complètement l’adolescente, lui mit un luth à la main, et la renvoya de nouveau à El-Amîn, vêtue seulement d’une chemise de soie sur laquelle cette inscription courait en lettres d’or :
Le butin caché à l’ombre de mes plis est vierge de tout toucher.
Seul le regard l’a examiné pour en admirer les perfections !
En voyant les charmes de l’esclave ainsi vêtue de cette chemise gentille, et en lisant l’inscription, El-Amîn n’eut plus de raison de résister, et accepta le cadeau qu’il honora particulièrement.
— Schahrazade, cette nuit-là, dit encore :
Le khalifat El-Motawakkel tomba un jour malade, et son médecin Yahia lui prescrivit des remèdes si excellents que la maladie se dissipa, et survint la convalescence. Alors de tous côtés affluèrent auprès du khalifat les cadeaux de félicitation. Or, entre autres envois, le khalifat reçut d’Ibn-Khakân, en cadeau, une jeune fille intacte dont les seins défiaient par leur belle forme les seins de toutes les femmes de son époque. En même temps que sa beauté, la jeune fille apportait au khalifat, en se présentant à lui, une admirable carafe de cristal remplie d’un vin choisi. Elle tenait d’une main la carafe et de l’autre main une coupe d’or sur laquelle, en rubis, était gravée cette inscription…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATRIÈME NUIT
Elle dit :
… Elle tenait d’une main la carafe et de l’autre main une coupe d’or sur laquelle, en rubis, était gravée cette inscription :
Quel philtre ou quelle thériaque, quel baume ou quel dictame vaut cette liqueur de pourpre au goût exquis, ce remède universel aux maux du corps et à l’ennui ?
Or, le savant médecin Yahia se trouvait à ce moment auprès du khalifat. En lisant cette inscription, il se mit à rire et dit au khalifat : « Par Allah ! ô émir des Croyants, cette adolescente et la médecine qu’elle t’apporte feront mieux pour le retour de tes forces que tous les remèdes anciens et modernes ! »
— Puis Schahrazade, sans s’arrêter, commença immédiatement l’anecdote suivante :
L’histoire que voici nous est rapportée par le fameux chanteur Ishak de Mossoul. Il dit :
« J’étais une nuit sorti tard d’un festin chez le khalifat El-Mâmoun, et, comme j’étais fort gêné d’une rétention d’urine dont je souffrais, je pris une ruelle où l’on ne voyait pas de lumière, je m’approchai d’un mur, pas trop près cependant de peur de recevoir le jet de ma propre urine, je m’accroupis commodément et je pissai mon plein avec soulagement. À peine avais-je fini et m’étais-je secoué, que je sentis quelque chose me tomber sur la tête au milieu de l’obscurité. Je sautai sur mes jambes, bien saisi, en vérité, j’attrapai l’objet et, l’ayant tâté de tous côtés, je remarquai, à ma surprise extrême, que c’était une grande corbeille attachée par ses quatre oreilles à une corde qui pendait de la maison sous laquelle je me trouvais. Je la tâtai encore, et la trouvai garnie de soie intérieurement, avec deux coussins qui sentaient bon.
Or moi, ayant bu un peu plus que de coutume, je fus poussé par mon esprit enivré à entrer m’asseoir dans cette corbeille qui s’offrait d’elle-même à mon repos. Je ne pus résister à la tentation et je me mis dans la corbeille, pour aussitôt, avant d’avoir pu sauter à terre, me voir enlever rapidement jusqu’à la terrasse où je fus cueilli, sans un mot, par quatre jeunes filles qui me déposèrent dans la maison et m’invitèrent à les suivre. L’une d’elles marcha devant moi, un flambeau à la main, et les trois autres se tinrent derrière moi, et me firent descendre un escalier de marbre et entrer dans une salle d’une magnificence comparable à celle du palais du khalifat. Et moi je pensai en mon âme : « On doit me prendre pour un autre à qui l’on aura donné rendez-vous cette nuit ! Allah arrangera la situation ! »
Comme j’étais encore dans cette perplexité, un grand rideau de soie qui cachait une partie de la salle se souleva, et j’aperçus dix jeunes filles ravissantes, à la taille souple, à la démarche exquise, qui portaient les unes des flambeaux et les autres des cassolettes d’or où brûlaient du nard et de l’aloès de la qualité la plus fine. Au milieu d’elles s’avançait, comme une lune, une adolescente qui aurait rendu jalouses toutes les étoiles. Elle se balançait en marchant et regardait gentiment de côté, à faire s’envoler les âmes les plus lourdes. Or moi, à sa vue, je sautai sur mes deux pieds et m’inclinai devant elle jusqu’à terre. Et elle me regarda en souriant et me dit : « Bienvenu le visiteur ! » Puis elle s’assit et, d’une voix charmante, me dit : « Repose-toi, seigneur ! » Moi, je m’assis avec déjà l’ivresse du vin dissipée et remplacée par une griserie bien plus forte. Alors elle me dit : « Et comment as-tu fait, seigneur, pour venir dans notre rue et t’asseoir dans la corbeille ? » Je répondis : « Ô ma maîtresse, c’est l’angoisse de mon urine, seulement qui m’a poussé jusqu’à la rue ; c’est ensuite le vin qui m’a fait m’asseoir dans la corbeille ; et maintenant, c’est ta générosité qui m’introduit dans cette salle où tes charmes ont remplacé dans mon cerveau l’ivresse par la griserie ! »
À ces paroles, l’adolescente fut visiblement satisfaite, et me demanda : « Quel métier exerces-tu ? » Moi je me gardai bien de lui dire que j’étais le chanteur et le musicien du khalifat, et lui répondis : « Je suis tisserand dans le souk des tisserands à Baghdad ! » Elle me dit : « Tes manières sont exquises et font honneur au souk des tisserands. Si à cela tu unis la connaissance de la poésie, nous n’aurons point à regretter de t’avoir reçu au milieu de nous ! Sais-tu des vers ? » Je répondis : « J’en sais un peu ! » Elle dit : « Dis-nous en quelques-uns ! » Je répondis : « Ô ma maîtresse, le visiteur est toujours un peu ému de la réception qu’on lui fait. Encourage-moi donc en commençant, toi la première, à nous réciter quelques-unes des poésies de ton choix ! » Elle me répondit : « Volontiers ! » Et aussitôt elle me récita un choix d’admirables poèmes des poètes les plus anciens, tels qu’Amri’lkaïs, Zohaïr, Antara, Nabigha, Amrou ben-Kalthoum, Tharafa et Chanfara, et des poètes les plus modernes tels qu’Abou-Nowas, El-Rakaschi, Abou-Mossab et les autres ! Et moi j’étais aussi émerveillé de sa diction qu’ébloui de sa beauté. Puis elle me dit : « J’espère maintenant que ton émotion est passée ! » Je dis : « Oui ! par Allah ! » Et à mon tour je choisis, parmi les vers que je connaissais, ceux qui étaient les plus délicats, et je les lui récitai avec beaucoup de sentiment. Lorsque j’eus fini, elle me dit : « Par Allah ! je ne savais point qu’il y eût des gens aussi exquis dans le souk des tisserands…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-CINQUIÈME NUIT
Elle dit :
« … des gens aussi exquis dans le souk des tisserands.
Après quoi on servit le festin où ne furent épargnés ni les fruits ni les fleurs ; et elle me servit elle-même les meilleurs morceaux. Puis, la nappe enlevée, on apporta les boissons et les coupes, et elle me versa elle-même à boire, et me dit : « Voici le meilleur moment de la causerie. Connais-tu de belles histoires ? » Moi je m’inclinai et lui racontai aussitôt quantité de détails amusants sur les rois, leur cour et leurs manières, tant qu’elle m’arrêta soudain pour me dire : « En vérité, je suis surprise prodigieusement de voir un tisserand si au courant des usages des rois ! » Je répondis : « Il n’y a là rien d’étonnant, car j’ai pour voisin un homme délicieux qui est reçu chez le khalifat, et qui, dans ses loisirs, se plaît à m’orner l’esprit de ses propres connaissances ! » Elle me dit : « Dans ce cas, je n’admire pas moins la sûreté de ta mémoire qui retient si exactement des détails aussi précis ! »
Tout cela ! Et moi, en sentant les parfums de nard et d’aloès qui embaumaient la salle, et en regardant cette beauté et en l’écoutant me parler des yeux et des lèvres, je me sentais à la limite du ravissement, et je pensais en mon âme : « Que ferait le khalifat s’il était ici à ma place ? Sûrement il ne se posséderait plus d’émoi, et s’envolerait d’amour ! »
L’adolescente me dit ensuite : « En vérité, tu es un homme excessivement distingué, ton esprit est orné de fort belles connaissances et tes manières sont raffinées à l’extrême. Il ne me reste plus qu’une seule chose à te demander ! » Je répondis : « Sur ma tête et sur mon œil ! » Elle dit : « Je désire t’entendre me chanter quelques vers en t’accompagnant sur le luth ! » Or moi, musicien de profession, il ne m’était guère agréable de chanter moi-même ; aussi je répondis : « Autrefois j’ai cultivé l’art du chant ; mais comme je ne suis guère arrivé à un bon résultat, j’ai préféré le délaisser. Je voudrais bien pouvoir m’exécuter, mais mon excuse est dans mon ignorance. Quant à toi, ô ma maîtresse, tout m’indique que ta voix doit être parfaitement belle ! Si donc tu voulais nous chanter quelque chose pour rendre notre nuit plus délicieuse encore ! »
Elle fit alors apporter un luth et chanta. Or, de ma vie je n’avais entendu timbre de voix plus plein, plus grave ou plus parfait, et une science si consommée des effets. Elle vit mon émerveillement et me demanda : « Sais-tu de qui sont les vers et de qui la musique ? » Je répondis, bien que je fusse fixé à ce sujet : « Je l’ignore tout à fait, ô ma maîtresse ! » Elle s’écria : « Est-il possible vraiment que quelqu’un au monde puisse ignorer cet air-là ! Sache-le donc, les vers sont d’Abou-Nowas, et la musique, qui est admirable, est du grand mucisien Ishak de Mossoul ! » Je répondis, sans me trahir : « Par Allah ! Ishak n’est plus rien à côté de toi ! » Elle s’écria : « Bakh ! bakh ! quelle erreur est la tienne ! Y a-t-il au monde quelqu’un qui soit l’égal d’Ishak ? On voit bien que tu ne l’as jamais entendu ! » Puis elle se mit à chanter encore, en s’interrompant pour voir si je ne manquais de rien ; et nous continuâmes à nous réjouir de la sorte jusqu’à l’apparition de l’aurore.
Alors une vieille femme, qui devait être sa nourrice, vint la prévenir que l’heure était arrivée de lever la séance ; et l’adolescente, avant de se retirer, me dit : « Ai-je besoin de te recommander la discrétion, ô mon hôte ? Les réunions intimes sont comme un gage qu’on laisse à la porte avant de se retirer ! » Je répondis en m’inclinant : « Je ne suis pas de ceux qui ont besoin de pareilles recommandations ! » Et, une fois que j’eus pris congé d’elle, on me mit dans la corbeille et on me descendit dans la rue.
J’arrivai chez moi où je fis ma prière du matin, et me mis au lit où je dormis jusqu’au soir. À mon réveil, je m’habillai à la hâte et me rendis au palais ; mais les chambellans me dirent que le khalifat était sorti et me faisait dire d’attendre son retour, car il avait un festin pour la nuit et ma présence lui était nécessaire pour le chant. Moi j’attendis un bon moment ; puis, comme le khalifat tardait à revenir, je me dis que ce serait folie de manquer une soirée comme celle de la veille, et je courus à la ruelle où je trouvai la corbeille qui pendait. Je me mis dedans, et, une fois remonté, je me présentai à la dame.
En me voyant, elle me dit, en riant : « Je crois bien, par Allah ! que tu as l’intention d’établir ta demeure auprès de nous ! » Je m’inclinai et répondis : « Et qui ne ferait pareil souhait ! Seulement tu sais bien, ô ma maîtresse, que les droits de l’hospitalité durent trois jours, et je ne suis qu’au deuxième. Si je revenais après le troisième, tu aurais le droit de prendre mon sang ! »
Nous passâmes cette nuit fort agréablement, à nous entretenir, à raconter des histoires, à réciter des vers et à chanter, comme la veille. Mais, au moment de descendre dans la corbeille, je pensai à la colère du khalifat, et me dis : « Il n’admettra aucune excuse, à moins que je ne lui raconte l’aventure. Et il ne croira pas à l’aventure, à moins qu’il ne la contrôle par lui-même ! » Je me tournai donc vers l’adolescente et lui dis : « Ô ma maîtresse, je vois que tu aimes le chant et les belles voix. Or, j’ai un cousin qui est bien plus gentil de visage que moi, bien plus distingué de manières, qui a beaucoup plus de talents que moi et connaît mieux que n’importe qui au monde les airs d’Ishak de Mossoul ! Veux-tu donc me permettre de l’amener avec moi demain, qui est le troisième et dernier jour de ton hospitalité charmante…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIXIÈME NUIT
Elle dit :
« … le troisième et dernier jour de ton hospitalité charmante ? » Elle me répondit : « Voilà que déjà tu vas commencer à être indiscret. Mais puisque ton cousin est si agréable, tu peux me l’amener ! » Je la remerciai et m’en allai par le même chemin.
En arrivant chez moi, j’y trouvai les gardes du khalifat qui m’accablèrent d’injures, s’emparèrent de moi et me traînèrent devant El-Mâmoun. Je le vis assis sur son trône, comme aux pires jours de sa colère, les yeux flamboyants et terribles. Et à peine m’aperçut-il qu’il me cria : « Ah ! fils de chien, tu as osé me désobéir ! » Je lui dis : « Non par Allah ! ô émir des Croyants ! J’ai ma justification ! » Il dit : « Et quelle est-elle ? » Je répondis : « Je ne puis t’en parler qu’en secret ! » Il ordonna aussitôt à tous ceux qui étaient là de se retirer, et me dit : « Parle ! » Alors je lui racontai l’aventure dans tous ses détails, et j’ajoutai : « Et maintenant l’adolescente nous attend tous deux pour cette nuit ; car je le lui ai promis ! »
Lorsque El-Mâmoun eut entendu mes paroles, il se rasséréna et me dit : « Certes ! la raison est excellente. Et tu as été bien inspiré de songer à moi pour cette nuit ! » Et, dès cet instant, il ne sut plus comment faire pour attendre avec patience la tombée de la nuit. Et moi je lui recommandai beaucoup de bien se garder de se trahir et de me trahir en m’appelant par mon nom devant l’adolescente. Il me le promit formellement et, dès que le moment propice fut venu, il se déguisa en marchand et m’accompagna à la ruelle.
Nous trouvâmes, à la place ordinaire, deux corbeilles au lieu d’une, et nous prîmes place chacun dans l’une d’elles. Nous fûmes aussitôt enlevés et déposés sur la terrasse, d’où nous descendîmes dans la magnifique salle en question, où bientôt vint nous rejoindre l’adolescente, plus belle cette nuit qu’elle ne l’avait jamais été.
À sa vue, je remarquai que le khalifat en devenait éperdument épris. Mais lorsqu’elle se mit à chanter, ce fut du délire, d’autant plus que déjà les vins qu’elle nous présentait avec grâce avaient échauffé nos raisons. Dans sa gaîté et son enthousiasme, le khalifat oublia soudain la résolution qu’il avait prise, et me dit : « Eh bien ! Ishak, qu’attends-tu pour lui donner la réplique par quelque chant sur un air nouveau de ton invention ? » Alors moi, bien embarrassé, je fus obligé de répondre : « J’écoute et j’obéis à ton ordre, ô émir des Croyants ! »
Sitôt qu’elle eut entendu ces paroles, l’adolescente nous regarda un instant et se leva en toute hâte pour se couvrir le visage et disparaître, comme il était séant de la part d’une femme en présence de l’émir des Croyants. Alors El-Mâmoun, un peu désappointé de son départ, du fait de l’oubli qu’il avait eu, médit : « Informe-toi à l’instant du maître de cette maison ! » Alors je fis appeler la vieille nourrice et lui demandai le renseignement de la part du khalifat. Elle me répondit : « Quelle calamité sur nous ! ô opprobre sur notre tête ! C’est la fille du vizir du khalifat, Hassan ben-Sehl ! » Aussitôt El-Mâmoun dit : « À moi le vizir ! » La vieille disparut en tremblant, et, quelques instants après, le vizir Hassân ben-Sehl, à la limite de la stupéfaction, faisait son entrée entre les mains du khalifat.
En le voyant, El-Mâmoun se mit à rire et lui dit : « Tu as une fille ? » Il dit : « Oui ! ô émir des Croyants ! » Il demanda : « Comment s’appelle-t-elle ? » Il répondit : « Khadiga ! » Il demanda : « Est-elle mariée ou vierge ? » Il répondit : « Vierge, ô émir des Croyants ! » Il dit : « Je la veux de toi comme épouse légitime ! » Il s’écria : « Ma fille et moi, nous sommes les esclaves de l’émir des Croyants ! » Il dit : « Je lui reconnais cent mille dinars de dot que tu toucheras pour toi-même demain matin au palais, sur le trésor ! En même temps, tu feras conduire ta fille au palais, avec toute la magnificence que comporte la cérémonie du mariage, et tu feras distribuer au sort, à toutes les personnes qui seront du cortège de la mariée, en cadeau de ma part, mille villages et mille terres de mes propriétés particulières ! »
Après quoi le khalifat se leva, et je le suivis. Nous sortîmes cette fois par la porte principale, et il me dit : « Garde-toi bien, Ishak, de parler de l’aventure à qui que ce soit. Ta tête me répondra de ta discrétion ! »
Moi je gardai le secret jusqu’à la mort du khalifat et de Sett Khadiga, qui était certainement la femme la plus belle que mes yeux aient vue parmi les filles des hommes. Mais Allah est plus savant ! »
— Lorsque Schahrazade eut raconté cette anecdote, la petite Doniazade, de la place où elle était blottie, s’écria : « Ô ma sœur, que tes paroles sont douces et savoureuses et gentilles ! » Et Schahrazade sourit et dit : « Mais que sera-ce lorsque tu auras entendu l’anecdote du Nettoyeur de tripes ? » Et aussitôt elle dit :
On raconte qu’un jour à la Mecque, au temps du pèlerinage annuel, au moment où la foule compacte des hadjs faisait les sept tours autour de la Kaâba sainte, un homme se détacha du groupe, s’approcha du mur de la Kaâba et, prenant des deux mains le voile sacré qui recouvrait tout l’édifice, se mit dans l’attitude de la prière et, avec un accent qui lui partait du fond du cœur, s’écria : « Fasse Allah que de nouveau cette femme s’irrite contre son mari, pour que je puisse coucher avec elle ! »
Lorsque les hadjs eurent entendu cette étrange prière, dite en ce lieu saint, ils furent si scandalisés qu’ils se précipitèrent sur l’homme, le jetèrent à terre et le rassasièrent de coups. Après quoi ils le traînèrent devant l’émir el-hadj, dont l’autorité s’exerçait sur tous les pèlerins avec les droits les plus étendus, et lui dirent : « Nous avons entendu cet homme, ô émir, proférer des paroles impies en tenant le voile de la Kaâba ! » Et ils lui répétèrent les paroles prononcées. Alors l’émir el-hadj dit : « Qu’on le pende…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors l’émir el-hadj dit : « Qu’on le pende ! » Mais l’homme se jeta aux pieds de l’émir et lui dit : « Ô émir, par les mérites de l’Envoyé d’Allah (sur lui la prière et la paix !) je te conjure d’écouter d’abord mon histoire, et tu feras ensuite de moi ce que tu jugeras équitable de faire ! » L’émir acquiesça d’un signe de tête, et le condamné à la pendaison dit :
« Sache, ô notre émir, que de mon métier je ramasse les immondices des rues et, en outre, je nettoie les tripes des moutons pour les vendre et gagner ma vie. Or, un jour je marchais tranquillement derrière mon âne chargé de tripes encore pleines, que je venais d’enlever de l’abattoir, quand je rencontrai quantité de personnes affolées qui s’enfuyaient de tous côtés ou se cachaient à l’intérieur des portes ; et, un peu plus loin, je vis paraître plusieurs esclaves armés de longs bâtons qui chassaient devant eux tous les passants. Moi je m’informai de ce que pouvait bien être l’affaire, et il me fut répondu que le harem d’un grand personnage allait passer dans la rue, et qu’il fallait que la rue fût déserte de passants. Alors moi, sachant que je m’exposais à un grand danger si je persistais à continuer ma route, j’arrêtai mon âne et m’enfonçai avec lui dans un coin de muraille, en m’effaçant le plus que je pouvais, et en tournant le visage du côté du mur pour ne pas être tenté de regarder les femmes de ce grand personnage. Bientôt j’entendis le passage du harem, que je n’osais regarder, et j’allais songer à me retourner et à continuer mon chemin, quand je me sentis brusquement saisi par deux bras de nègre, et je vis mon âne entre les mains d’un autre nègre qui le prit et s’éloigna. Et moi, terrifié, je tournai la tête, et je vis dans la rue, toutes me regardant, trente adolescentes au milieu desquelles s’en trouvait une semblable, par ses regards languissants, à une gazelle que la soif rend moins farouche et, par sa taille souple et élégante, au rameau flexible de l’arbre de ban. Et moi, les mains liées derrière le dos par le nègre qui me tenait, je fus entraîné de force par les autres eunuques, malgré mes protestations et malgré les cris et les témoignages de tous les passants qui m’avaient vu contre le mur, et qui disaient à mes ravisseurs : « Il n’a rien fait ! C’est un pauvre homme, balayeur d’immondices et nettoyeur de tripes ! Il est illicite devant Allah d’arrêter et de ligoter un innocent ! » Mais eux, sans rien vouloir entendre, continuèrent à m’entraîner derrière le harem.
« Pendant ce temps, moi je pensais en moi-même : « Quel délit ai-je pu commettre ? Sans doute ce doit être l’odeur assez désagréable des tripes qui a offusqué l’odorat de la dame, laquelle doit être probablement enceinte et, par le fait, a dû ressentir quelque dérangement dans son intérieur. Je crois bien que c’est là le motif, ou peut-être aussi mon aspect assez dégoûtant et ma robe déchirée qui laisse voir les parties malséantes de mon individu. Il n’y a de recours qu’en Allah seul ! »
« Je continuai donc à être ainsi entraîné par les eunuques, au milieu des protestations des passants apitoyés sur moi, jusqu’à ce que nous fussions tous arrivés à la porte d’une grande maison et que l’on me fît entrer dans une avant-cour dont je ne saurais jamais dépeindre la magnificence. Et moi je pensai en mon âme : « Voilà l’endroit réservé à mon supplice. Je vais être mis à mort, et personne de ma famille ne saura la cause de ma disparition ! » Et je pensai aussi, dans ces derniers instants, à mon pauvre âne qui était si serviable et qui ne buttait jamais du pied, jamais, et ne renversait ni les tripes ni les hottes d’immondices. Mais bientôt je fus tiré de mes affligeantes pensées par l’arrivée d’un joli petit esclave qui vint me prier doucement de le suivre, et me conduisit dans un hammam où me reçurent trois belles esclaves qui me dirent : « Hâte-toi de te débarrasser de tes haillons ! » Moi je m’exécutai, et aussitôt elles m’introduisirent dans la salle chauffée où elles me baignèrent de leurs propres mains, en se chargeant qui de ma tête, qui de mes jambes, qui de mon ventre, me massèrent, me frictionnèrent, me parfumèrent et me séchèrent. Après quoi elles m’apportèrent de magnifiques habits, et me prièrent de m’en revêtir. Mais moi je fus bien perplexe, et je ne sus par quel bout les prendre, ni comment les mettre n’en ayant jamais vu dans mon existence ; et je dis aux jeunes filles : « Par Allah ! ô mes maîtresses, je crois bien que je vais rester nu, car jamais je ne parviendrai à me vêtir tout seul de ces habits extraordinaires ! » Alors elles s’approchèrent de moi en riant, et m’aidèrent à m’habiller, tout en me chatouillant et me pinçant et soulevant le poids de ma marchandise, qu’elles trouvèrent énorme et de bon aloi…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
»… tout en me chatouillant et me pinçant et soulevant le poids de ma marchandise qu’elles trouvèrent énorme et de bon aloi. Et moi, au milieu d’elles, je ne savais ce que j’allais devenir, quand, ayant fini de m’habiller et de m’asperger avec de l’eau de roses, elles me prirent par les bras et, comme on conduit un nouveau marié, elles me guidèrent vers une salle meublée avec une élégance que jamais ma langue ne saurait dépeindre, et ornée de peintures en lignes entrelacées et coloriées fort agréablement. Et à peine y étais-je entré que je vis, étendue avec nonchalance sur un lit de bambou et d’ivoire, et vêtue d’une robe légère en étoffe de Mossoul, la dame elle-même entourée de quelques-unes de ses esclaves. En me voyant, elle m’appela en me faisant signe d’approcher. Je m’approchai, et elle me dit de m’asseoir ; je m’assis. Elle ordonna alors aux esclaves de nous servir le repas ; et on nous servit des mets étonnants dont je ne pourrais jamais citer le nom, n’en ayant jamais de ma vie vu de semblables. J’en mangeai quelques porcelaines, de quoi satisfaire ma faim ; puis je me lavai les mains pour manger les fruits. Alors on apporta les coupes des boissons et les cassolettes remplies de parfums ; et, après que l’on nous eût parfumés aux vapeurs d’encens et de benjoin, la dame me versa à boire de ses propres mains, et but avec moi à la même coupe, jusqu’à ce que nous fussions ivres tous les deux. Alors elle fit un signe à ses esclaves qui disparurent toutes et nous laissèrent seuls dans la salle. Aussitôt elle m’attira à elle et me prit dans ses bras. Et moi je lui servis la confiture de façon à la dulcifier, en lui donnant à la fois les tranches du fruit et la gelée. Et chaque fois que je la pressais contre moi, je me sentais grisé par le parfum de musc et d’ambre de son corps et je croyais être en rêve ou tenir dans mes bras quelque houria du paradis.
« Nous demeurâmes ainsi enlacés jusqu’au matin ; puis elle me dit que le moment était venu pour moi de me retirer ; mais auparavant elle me demanda où je demeurais ; et, lorsque je lui eus donné les indications nécessaires à ce sujet, elle me dit qu’elle enverrait me prévenir au moment favorable, et me donna un mouchoir brodé d’or et d’argent, dans lequel il y avait quelque chose de noué de plusieurs nœuds, en me disant : « C’est pour acheter de quoi manger à ton âne ! » Et je sortis de chez elle, absolument dans le même état que si je sortais du paradis.
« Lorsque je fus arrivé à la triperie où j’avais mon logement, je dénouai le mouchoir en me disant : « Il ne contiendrait que cinq ronds de cuivre, que j’aurais tout de même de quoi m’acheter à déjeuner ! » Or, quelle ne fut point ma surprise d’y trouver cinquante mitkals d’or ! Je me hâtai de creuser un trou et de les y enterrer pour les jours mauvais, et je m’achetai, pour deux cuivres, du pain et un oignon dont je fis mon repas, assis à la porte de ma triperie et rêvant à l’aventure qui m’arrivait.
« À la tombée de la nuit, un petit esclave vint me chercher de la part de celle qui m’aimait ; et moi je le suivis. Arrivé dans la salle où elle m’attendait, j’embrassai la terre entre ses mains ; mais elle me releva aussitôt et s’étendit avec moi sur le lit de bambou et d’ivoire, et me fit passer une nuit aussi bénie que la précédente. Et le matin elle me donna un second mouchoir contenant, comme la veille, cinquante mitkals d’or. Et je continuai à vivre de la sorte pendant huit jours entiers, avec, chaque fois, un festin de la confiture sèche et humide, de part et d’autre, et cinquante mitkals d’or pour moi.
« Or, je m’étais rendu un soir chez elle, et j’étais déjà sur le lit prêt à déballer ma marchandise, selon la coutume, quand une esclave entra soudain, dit quelques mots à l’oreille de sa maîtresse, et m’entraîna vivement hors de la salle pour m’emmener à l’étage supérieur, où elle m’enferma à clef, et s’en alla. Et moi j’entendis en même temps un grand bruit de chevaux dans la rue, et je vis, par la fenêtre qui donnait sur la cour, entrer dans la maison un jeune homme comme la lune, accompagné d’une suite nombreuse de gardes et d’esclaves. Il entra dans la salle où se trouvait l’adolescente, et passa avec elle toute la nuit, en ébats, assauts et autres choses semblables. Et moi j’entendais leurs mouvements et je pouvais compter sur mes doigts le nombre des clous qu’ils enfonçaient, au bruit étonnant qu’ils faisaient chaque fois. Et je pensais en mon âme : « Par Allah ! ils ont installé sur le lit un établi de forgeron ! Et la barre de fer doit être bien chaude pour que l’enclume gémisse tellement…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
« … la barre de fer doit être bien chaude pour que l’enclume gémisse tellement ! »
« Enfin le bruit cessa avec le matin, et je vis le jeune homme au marteau retentissant sortir par la grande porte, et s’en aller suivi de son escorte. À peine avait-il disparu, que l’adolescente vint me trouver et me dit : « Tu as sans doute vu le jeune homme qui vient de partir ? » Je répondis : « Certainement ! » Elle me dit : « C’est mon mari ! Mais je vais tout de suite te raconter ce qui s’est passé entre nous et t’expliquer la cause qui m’a fait te choisir pour amant ! Sache donc que j’étais assise un jour à côté de lui dans le jardin, quand il me quitta soudain pour disparaître du côté de la cuisine. Je crus d’abord qu’il était allé satisfaire quelque besoin pressant ; mais au bout d’une heure de temps, comme je ne le voyais pas revenir, j’allai à sa recherche là où je le croyais trouver, mais il n’y était pas. Je revins alors sur mes pas, et me dirigeai vers la cuisine pour demander aux servantes de ses nouvelles. En y entrant, je le vis couché sur la natte avec la servante la plus grossière, celle qui lavait les assiettes. À cette vue, je me retirai en toute hâte et je fis le serment de ne pas le recevoir dans mon lit avant que je ne me fusse vengée de lui en me livrant à mon tour à un homme de la condition la plus basse et de l’aspect le plus dégoûtant. Et je me mis aussitôt à parcourir la ville à la recherche de cet homme-là. Or, il y avait déjà quatre jours que je parcourais les rues dans ce but, quand je t’ai rencontré, et que ton aspect sale et ton odeur infecte m’ont décidée à te choisir comme l’homme le plus dégoûtant entre tous ceux que j’avais vus. Maintenant il s’est passé ce qui s’est passé, et j’ai accompli mon serment, en ne me réconciliant avec mon mari qu’après m’être livrée à toi. Tu peux donc te retirer, et être sûr que, si mon mari venait à coucher une seconde fois avec l’une de ses esclaves, je ne manquerais pas de te faire appeler pour lui rendre la pareille ! » Et en me congédiant, elle me remit encore, quatre cents mitkals de gratification. Moi je m’éloignai alors, et je vins ici implorer Allah de pousser le mari à retourner auprès de la servante, pour que la femme me fît appeler auprès d’elle ! Et telle est mon histoire, ô maître émir el-hadj ! »
En entendant ces paroles, l’émir el-hadj se tourna vers les assistants et leur dit : « Il nous faut pardonner à cet homme ses paroles condamnables à la Kaâba ; car son histoire l’excuse ! »
— Puis Schahrazade dit :
Amrou ben-Môsseda nous raconte l’anecdote suivante :
« Un jour Abou-Issa, fils de Haroun Al-Rachid, aperçut chez son parent Ali, fils de Hescham, une jeune esclave nommée Fraîcheur-des-Yeux dont il devint violemment épris. Abou-Issa s’étudia à cacher avec le plus grand soin le secret de son amour, et à ne faire part à personne des sentiments qu’il éprouvait ; mais il fit tous ses efforts pour décider indirectement Ali à lui vendre son esclave. Au bout d’un long espace de temps, il vit que toutes ses peines à ce sujet étaient inutiles, et se décida à changer de plan. Il alla trouver son frère le khalifat Al-Mâmoun, fils d’Al-Rachid, et le pria de l’accompagner au palais d’Ali afin de faire à ce dernier une surprise de leur visite. Le khalifat approuva l’idée ; on fit préparer les chevaux, et l’on se rendit au palais d’Ali, fils de Hescham.
Lorsque Ali les vit entrer, il embrassa la terre entre les mains du khalifat, et fit ouvrir la salle des festins où il les introduisit. Et ils trouvèrent une salle de toute beauté dont les piliers et les murs étaient de marbres de différentes couleurs, avec des incrustations de style grec qui faisaient des dessins fort agréables à l’œil ; et le parquet de la salle était recouvert d’une natte des Indes sur laquelle se déployait un tapis de Bassra fait d’une seule pièce, et occupant toute la superficie de la salle en large et en long. Et Al-Mâmoun s’arrêta d’abord un instant à admirer le plafond, les murs et le parquet, puis il dit : « Eh bien, Ali ! qu’attends-tu pour nous donner à manger ? » Aussitôt Ali frappa des mains, et des esclaves entrèrent chargés de mille variétés de poulets, de pigeons, et de rôtis de toute espèce, chauds et froids ; il y avait aussi toutes sortes de mets liquides et de mets solides, et surtout beaucoup de gibier farci de raisins secs et d’amandes ; car Al-Mâmoun aimait énormément le gibier, surtout farci de raisins secs et d’amandes. Le repas fini, on apporta un vin étonnant extrait de grappes choisies grain par grain, et cuit avec des fruits parfumés et des noyaux odorants comestibles ; et il fut servi dans des coupes d’or, d’argent et de cristal, par de jeunes garçons comme des lunes, qui étaient vêtus de légères étoffes ondulantes d’Alexandrie, ornées de délicates broderies d’argent et d’or ; et ces jeunes garçons, en même temps qu’ils présentaient les coupes aux convives, les aspergeaient d’eau de roses musquée, au moyen d’aspersoirs d’or enrichis de pierreries.
Le khalifat fut si charmé de tout cela qu’il embrassa son hôte et lui dit : « Par Allah ! ô Ali, désormais je ne t’appellerai plus Ali, mais le Père-de-la-Beauté ! » Et Ali, fils de Hescham, qui fut, en effet, depuis lors surnommé Aboul-Jamal, baisa la main du khalifat, puis fit un signe à son chambellan. Aussitôt un grand rideau se souleva, au fond de la salle, et apparurent dix jeunes chanteuses habillées de soieries noires, et belles comme un parterre de fleurs. Elles s’avancèrent et vinrent s’asseoir sur des sièges d’or que dix esclaves noirs avaient aussitôt rangés en cercle dans la salle. Elles préludèrent par les jeux des instruments à cordes avec une science parfaite, puis chantèrent en chœur une ode d’amour. Alors Al-Mâmoun regarda celle des dix qui l’avait le plus vivement ému et lui demanda : « Comment t’appelles-tu ? » Elle répondit : « Je m’appelle Harmonie, ô émir des Croyants ! » Il dit : « Que tu portes bien ton nom, Harmonie ! Je désire t’entendre toute seule chanter quelque chose ! » Alors Harmonie accorda son luth et chanta :
« Ma douceur
craint les regards,
et mon cœur sensible
redoute
les yeux des ennemis.
Mais à l’approche de l’ami
le plaisir
me fait frémir,
et toute fondue
je me rends à lui.
Mais s’il s’éloigne,
je tremble d’émoi
comme la gazelle
qui perd son enfant. »
Al-Mâmoun, charmé, lui dit : « Tu as excellé, ô jeune fille ! Et qui a composé ces vers ? » Elle répondit : « C’est Amrou Al-Zobaïdi ; et la musique est de Môbed. » Le khalifat vida la coupe qu’il tenait, et son frère Abou-Issa et Aboul-Jamal firent de même. Comme ils déposaient leurs coupes, entrèrent dix nouvelles chanteuses habillées de soie bleue, et ceintes d’écharpes du Yamân brodées d’or ; elles prirent la place des dix premières, qui s’éloignèrent, accordèrent leurs luths et préludèrent par un chœur d’une science remarquable. Alors le khalifat fixa ses regards sur l’une d’elles, qui était comme un cristal de roche, et lui demanda : « Quel est ton nom, ô jeune fille ? » Elle répondit : « Biche, ô émir des Croyants ! »
Il dit : « Eh bien, Biche, chante-nous quelque chose ! » Alors celle qui s’appelait Biche accorda son luth et chanta…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIXIÈME NUIT
Elle dit :
… Alors celle qui s’appelait Biche accorda son luth et chanta :
« Libres houris et vierges
nous nous rions des soupçons.
Nous sommes les gazelles de la Mecque
qu’il est défendu de chasser.
Les gens grossiers
nous accusent de vices
à cause de nos yeux langoureux
et de notre langage charmant.
Nous avons des gestes indécents
qui font se détourner
les pieux musulmans ! »
Al-Mâmoun trouva délicieuse cette chanson et demanda à l’adolescente : « De qui est-elle ? » Elle répondit : « Les vers sont de Jarir, et la musique est d’Ibn-Sôraïj. » Alors le khalifat et les deux autres vidèrent leurs coupes, tandis que les esclaves se retiraient pour être aussitôt remplacées par dix autres chanteuses vêtues de soie écarlate, et ceintes d’écharpes écarlates, avec leurs cheveux dénoués et retombant lourdement dans le dos. Elles ressemblaient ainsi, en cette couleur rouge, à quelque pierre de rubis aux multiples éclats. Elles s’assirent sur les sièges d’or et chantèrent en chœur en s’accompagnant chacune de son luth. Et Al-Mâmoun se tourna vers celle qui brillait le plus au milieu de ses compagnes, et lui demanda : « Comment t’appelles-tu ? » Elle répondit : « Séduction, ô émir des Croyants ! » Il dit : « Alors, ô Séduction, hâte-toi de nous faire seule entendre ta voix. Et Séduction, en s’accompagnant du luth, chanta :
« Les diamants et les rubis,
les brocarts et les soieries
inquiètent peu les belles filles.
Leurs yeux sont des diamants,
leurs lèvres sont des rubis,
et le reste est la soierie ! »
Le khalifat, extrêmement charmé, demanda à la chanteuse : « De qui ce poème, ô Séduction ? » Elle répondit : « Il est d’Adi ben-Zeïd ; quant à la musique, elle est très ancienne, et l’auteur en est inconnu. » Al-Mâmoun, son frère Abou-Issa et Ali ben-Hescham vidèrent leurs coupes, et dix nouvelles chanteuses, vêtues d’étoffes d’or et la taille serrée par des ceintures d’or étincelantes de pierreries, vinrent se placer sur les sièges et chantèrent comme les précédentes. Et le khalifat demanda à la plus fine de taille : « Ton nom ? » Elle dit : « Goutte-de-Rosée, ô émir des Croyants ! » Il dit : « Eh bien, Goutte-de-Rosée, nous attendons quelques vers de toi ! » Aussitôt elle chanta :
« J’ai bu le vin sur sa joue
et ma raison s’est envolée.
Alors, vêtue seulement
de ma chemise parfumée
de nard et d’aromates,
je me montrai à toute la rue
pour témoigner de nos amours,
dans ma chemise parfumée
de nard et d’aromates ! »
En entendant ces vers, Al-Mâmoun s’écria : « Ya Allah ! tu as excellé, ô Goutte-de-Rosée ! Répète encore ces derniers vers ! » Et Goutte-de-Rosée, ayant pincé les cordes de son luth, répéta, sur un ton plus senti :
« Je me montrai à toute la rue
pour témoigner de nos amours,
dans ma chemise parfumée
de nard et d’aromates ! »
Et le khalifat lui demanda : « De qui sont ces vers, ô Goutte-de-Rosée ? » Elle dit : « D’Abou-Nowas, ô émir des Croyants ; et la musique est d’Ishak. »
Lorsque les dix esclaves eurent fini leur jeu, le khalifat voulut lever la séance et se retirer. Mais Ali ben-Hescham s’avança et lui dit : « Ô émir des Croyants, j’ai encore une esclave que j’ai achetée pour dix mille dinars et que je désire montrer au khalifat ; qu’il daigne donc rester encore quelques moments ! Si elle lui plaît, il pourra la garder comme sienne ; si elle ne lui plaît pas, je l’aurai tout de même soumise à son appréciation ! » Al-Mâmoun dit : « À moi donc cette esclave ! » Au même moment apparut une adolescente d’une incomparable beauté, souple et mince comme un rameau de ban, avec des yeux babyloniens pleins d’enchantements, des sourcils comme l’arc rigoureux, et un teint emprunté aux jasmins ; elle avait le front ceint d’un diadème d’or enrichi de perles et de pierreries, sur lequel ce vers courait, en lettres de diamants :
Enchanteresse, élevée par les génies, elle sait percer les cœurs avec les flèches d’un arc sans corde !
L’adolescente continua à s’avancer lentement, et vint s’asseoir en souriant sur le siège d’or qui lui était réservé. Mais à peine Abou-Issa, le frère du khalifat, l’eut-il vue entrer qu’il laissa tomber sa coupe, et changea de couleur d’une si inquiétante façon qu’Al-Mâmoun s’en aperçut et lui demanda : « Qu’as-tu donc, mon frère, à changer ainsi de teint ? » Il répondit : « Ô émir des Croyants, c’est seulement par suite d’un malaise au foie qui me prend quelquefois ! » Mais Al-Mâmoun insista et lui dit : « Connaîtrais-tu, par hasard, cette adolescente, et l’aurais-tu vue avant ce jour ? » Il ne voulut plus nier, et dit : « Y a-t-il quelqu’un, ô émir des Croyants, qui ignore l’existence de la lune ? » Le khalifat se tourna alors vers l’adolescente et lui demanda : « Comment t’appelles-tu, jeune fille ? » Elle répondit : « Fraîcheur-des-Yeux, ô émir des Croyants ! » Il dit : « Eh bien, Fraîcheur-des-Yeux, chante-nous quelque chose ! » Et elle chanta :
« Sait-il aimer, celui qui ne porte l’amour que sur sa langue et loge l’indifférence dans son cœur ?
Sait-il aimer, celui dont le cœur est un rocher alors que son visage feint la passion ?
On m’a dit que l’absence guérit les tortures de l’amour ! Mais, hélas ! l’absence ne nous a point guéri !
On nous a dit de revenir près de l’objet aimé ; mais le remède est sans vertu, puisque l’aimé méconnaît notre amour ! »
Le khalifat, émerveillé de sa voix, lui demanda : « Et de qui cette chanson, ô Fraîcheur-des-Yeux ? » Elle dit : « Les vers sont d’El-Kherzaï et la musique est de Zarzour. » Mais Abou-Issa, que l’émotion suffoquait, dit à son frère : « Permets-moi de lui répondre, ô émir des Croyants ! » Le khalifat donna son approbation et Abou-Issa chanta :
« Un corps amaigri se trouve dans mes vêtements, et un cœur torturé dans mon sein !
Si j’ai tu mon amour sans le montrer dans mes yeux, c’est par crainte d’offenser la lune qui en est l’objet ! »
Lorsque Ali Père-de-la-Beauté eut entendu cette réponse, il comprit qu’Abou-Issa aimait éperdument son esclave Fraîcheur-des-Yeux. Il se leva aussitôt et, s’inclinant devant Abou-Issa, lui dit : « Ô mon hôte, il ne sera pas dit qu’un souhait ait été formulé, même mentalement, par quelqu’un dans ma maison sans avoir été exaucé à l’instant. Si donc le khalifat veut bien me permettre une offre en sa présence, Fraîcheur-des-Yeux est devenue ton esclave ! » Et le khalifat, ayant donné son consentement, Abou-Issa emmena l’adolescente.
Or telle était la générosité sans pareille d’Ali, et des hommes de son époque ! »
— Puis Schahrazade, pour finir, dit encore cette anecdote :
Le sage Omar Al-Homsi raconte :
« En l’année hégirienne cinq cent soixante-unième vînt en tournée à Hama la femme la plus instruite et la plus éloquente de Baghdad, celle que tous les savants de l’Irak appelaient la Maîtresse des Maîtres. Or, en cette année-là, de tous les points des pays musulmans, étaient venus à Hama les hommes les plus versés dans les diverses branches des connaissances ; et tous étaient heureux de pouvoir entendre et interroger cette femme merveilleuse entre toutes les femmes, qui voyageait ainsi de pays en pays, en compagnie de son jeune frère, pour soutenir des thèses publiques sur les questions les plus difficiles, et interroger et être interrogée sur toutes les sciences, la jurisprudence, la théologie et les belles-lettres.
Moi, désireux de l’entendre, je priai mon ami le savant cheikh El-Salhani de m’accompagner au lieu où elle argumentait ce jour-là. Le cheikh El-Salhani accepta, et nous nous rendîmes tous deux dans la salle où Sett Zahia se tenait derrière un rideau de soie, pour ne pas contrevenir à la coutume de notre religion. Nous nous assîmes sur un des bancs de la salle, et son frère eut soin de nous en nous servant des fruits et des rafraîchissements.
Moi, après m’être fait annoncer à Sett Zahia et avoir décliné mon nom et mes titres, j’entamai avec elle une discussion sur la jurisprudence divine et sur les différentes interprétations de la loi faites par les plus savants théologiens des anciens temps. Quant à mon ami, le cheikh El-Salhani, dès l’instant qu’il eut aperçu le jeune frère de Sett Zahia, jouvenceau d’une beauté extraordinaire de visage et de formes, il fut ravi d’admiration à la limite du ravissement, et ne parvint plus à détacher de lui ses regards. Aussi Sett Zahia ne tarda pas à s’apercevoir de la distraction de mon compagnon et, l’ayant observé, finit par comprendre les sentiments qui l’agitaient. Elle l’appela soudain par son nom, et lui dit : « Il me semble, ô cheikh, que tu dois être de ceux qui préfèrent les jouvenceaux aux adolescentes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-ONZIÈME NUIT
Elle dit :
« … de ceux qui préfèrent les jouvenceaux aux adolescentes ! » Mon ami sourit et dit : « Assurément ! » Elle demanda : « Et pourquoi, ô cheikh ? » Il dit : « Parce qu’Allah a modelé le corps des jouvenceaux avec une perfection admirable, au détriment des femmes, et que mes goûts me poussent à préférer en toute chose le parfait à l’imparfait ! » Elle rit derrière le rideau et dit : « Eh bien, si tu veux défendre ton opinion, je suis prête à te répondre ! » Il dit : « Très volontiers ! » Alors elle lui demanda : « En ce cas, explique-moi comment tu pourras me prouver la préexcellence des hommes et des adolescents sur les femmes et les jeunes filles ! » Il dit :
« Ô ma maîtresse, la preuve que tu me demandes peut se faire d’une part par la logique du raisonnement et d’autre part par le Livre et par la Sunna.
« En effet, il est dit dans le Korân : « Les hommes surpassent de beaucoup les femmes, car Allah leur a donné la supériorité. » Il y est dit encore : « Dans un héritage, la part de l’homme doit être le double de celle de la femme ; ainsi le frère héritera deux fois plus que sa sœur. » Ces paroles saintes nous prouvent donc, et établissent d’une façon permanente, qu’une femme ne doit être regardée que comme la moitié d’un homme.
« Quant à la Sunna, elle nous enseigne que le Prophète (sur lui la prière et la paix !) estimait le sacrifice expiatoire d’un homme comme ayant deux fois plus de valeur que celui d’une femme.
« Si maintenant nous recourons à la logique pure, nous voyons que la raison confirme la tradition et renseignement. En effet, si nous nous demandons simplement : « Qui a la priorité ? L’être actif ou l’être passif ? » La réponse sera, sans nul doute, en faveur de l’être actif. Or, l’homme est le principe actif, et la femme est le principe passif. Donc aucune hésitation. L’homme est au-dessus de la femme, et le jeune garçon est préférable à la jeune fille ! »
Mais Sett Zahia répondit : « Tes citations sont exactes, ô cheikh ! Et je reconnais avec toi qu’Allah, dans son Livre, a donné la préférence aux hommes sur les femmes. Seulement Il n’a rien spécifié, et Il a parlé d’une façon générale. Pourquoi donc, si tu cherches la perfection des choses, vas-tu seulement aux jeunes garçons ? Tu devrais plutôt préférer les hommes à barbe, les vénérables cheikhs au front ridé, puisqu’ils sont allés bien plus loin dans la voie de la perfection ! »
Il répondit : « Oui certes ! ô ma maîtresse ! Mais je ne compare pas ici les vieillards avec les vieilles femmes ; il ne s’agit guère de cela, mais seulement des jeunes garçons auxquels j’arrive par la déduction. En effet, tu m’accorderas, ô ma maîtresse, que rien chez la femme ne peut être comparé aux perfections d’un bel adolescent, à sa taille souple, à la finesse de ses membres, au mélange des couleurs tendres sur ses joues, à la gentillesse de son sourire, et au charme de sa voix. D’ailleurs le Prophète lui-même, pour nous mettre en garde contre une chose si claire, nous dit : « Ne prolongez pas vos regards sur les jeunes garçons sans barbe, car ils ont des yeux plus tentants que ceux des houris ! » Tu sais, en outre, que la plus grande louange qu’on puisse donner à la beauté d’une jeune fille, c’est de la comparer à celle d’un jouvenceau. Tu connais bien les vers où le poète Abou-Nowas parla de tout cela, et le poème où il dit :
« Elle a les hanches d’un jeune garçon, et se balance au vent léger comme au souffle du nord se balance le rameau du ban ! »
« Donc, si les charmes des jeunes garçons n’étaient pas notoirement supérieurs à ceux des jeunes filles, pourquoi les poètes s’en serviraient-ils comme point de comparaison ?
« De plus, tu n’ignores pas que l’adolescent ne se contente pas seulement d’être bien fait, mais il sait ravir nos cœurs par le charme de son langage et l’agrément de ses manières. Avec cela il est si délicieux quand un jeune duvet commence à ombrager ses lèvres et ses joues où se marient les pétales des roses ! Et peut-on trouver quelque chose au monde qui soit comparable au charme qu’il dégage à ce moment-là ? Qu’il avait donc raison le poète Abou-Nowas qui s’écriait :
» Ils me dirent, ses calomniateurs envieux : « Les poils commencent à rendre rugueuses ses lèvres ! » Je leur dis : « Que votre erreur est grande ! Comment pouvez-vous regarder cet ornement comme un défaut ?
« Ce duvet relève la blancheur de son visage et de ses dents, comme une parure verte relève l’éclat des perles ! Il est un signe charmant des forces nouvelles qu’acquiert sa croupe !
« Les roses ont fait le serment solennel de ne jamais effacer de ses joues leurs miraculeuses couleurs. Ses paupières savent nous parler un langage plus éloquent que celui des lèvres, et ses sourcils savent répondre avec précision.
« Les poils, objet de votre médisance, n’ont poussé que pour préserver ses charmes et les garder à l’abri de vos yeux grossiers. Ils donnent au vin de sa bouche un goût plus savoureux ; et le vert de sa barbe sur ses joues d’argent y ajoute une couleur gaie pour nous charmer ! »
« Un autre poète a dit également :
» Les envieux me dirent : « Que ta passion est aveugle ! Ne vois-tu donc que les poils recouvrent déjà ses joues ? »
« Je leur dis : « Si la blancheur de son visage n’était tempérée par l’ombre douce de ce duvet, il serait impossible à mes yeux d’en soutenir l’éclat.
« Et d’ailleurs comment pourrais-je, après avoir aimé une terre alors qu’elle était stérile, la délaisser alors que l’a fertilisée le printemps ? »
« Un autre a dit aussi :
« Je n’ai point délaissé l’ami lorsque ses joues n’avaient que des roses ! Comment le quitterais-je quand autour des roses ont poussé les myrtes et les violettes ?
« Enfin un autre, entre mille, a dit :
« Le svelte garçon ! Ses regards et ses joues luttent entre eux à qui ferait le plus de victimes parmi les hommes.
« Il répand le sang des cœurs avec un glaive fait de pétales de narcisse dont le fourreau et le ceinturon sont empruntés aux myrtes.
« Ses perfections suscitent de telles jalousies, que la beauté désire se changer elle-même en joue duvetée ! »
« Voilà donc, ô ma maîtresse, assez de preuves pour démontrer la supériorité de la beauté des garçons sur celle des femmes en général…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-DOUZIÈME NUIT
Elle dit :
« … la supériorité de la beauté des garçons sur celle des femmes en général ! »
En entendant ces paroles, Sett Zahia répondit : « Qu’Allah te pardonne tes arguments erronés, à moins que tu n’aies parlé par jeu simplement ou pour plaisanter. Mais, maintenant, au tour de la vérité à triompher ! N’endurcis donc pas ton cœur et prépare ton ouïe à mes arguments.
« Par Allah sur toi ! dis-moi ! où est l’adolescent dont la beauté peut être comparée à celle d’une jeune fille ? Oublies-tu que la peau d’une jeune fille n’a pas seulement l’éclat et la blancheur de l’argent, mais encore la douceur du velours et des soieries ! Sa taille ! mais c’est le rameau du myrte et de l’arbre de ban. Sa bouche ! mais c’est une camomille en fleur, et ses lèvres, deux anémones humides ! Ses joues, des pommes ; ses seins, de petites gourdes d’ivoire. Son front rayonne de clarté, et ses deux sourcils hésitent sans cesse pour savoir s’ils doivent se réunir ou se séparer. Lorsqu’elle parle, les perles fines s’égrènent de sa bouche ; lorsqu’elle sourit, des torrents de lumière coulent de ses lèvres qui sont plus douces que le miel et plus fondantes que le beurre. Le sceau de la beauté est imprimé sur la fossette de son menton. Quant à son ventre, il est joli ! Il a des lignes de flanc admirables et des plis généreux qui se superposent l’un sur l’autre. Ses cuisses sont faites d’un seul morceau d’ivoire et sont soutenues par les colonnes de ses pieds formés de pâte d’amande. Mais pour ce qui est de ses fesses, elles sont de bonne nature, et quand elles s’élèvent et s’abaissent on les prendrait pour les vagues d’une mer de cristal ou pour des montagnes de lumière. Ô pauvre cheikh ! peut-on comparer les hommes aux génies ? Ne sais-tu que les rois, les khalifats et les plus grands personnages dont parlent les annales ont été les esclaves obéissants des femmes, et ont considéré comme une gloire de porter leur joug ? Que d’hommes éminents ont courbé le front, subjugués par leurs charmes ! Combien ont tout quitté pour elles : richesses, pays, père et mère ! Que de royaumes ont été perdus par elles ! Ô pauvre cheikh ! n’est-ce point pour elles qu’on élève les palais, qu’on brode la soie et les brocarts, qu’on tisse les riches étoffes ? N’est-ce point pour elles que l’ambre et le musc sont tellement recherchés pour leur parfum si doux ? Oublies-tu que leurs charmes ont damné les habitants du paradis et bouleversé la terre et l’univers, et fait couler des fleuves de sang ?
« Mais pour ce qui est des Paroles du Livre que tu as citées, elles sont bien plus favorables à ma cause qu’à la tienne. Les Paroles sont : « Ne prolongez pas vos regards sur les jeunes garçons sans barbe, car ils ont des yeux plus tentants que ceux des houris ! » En effet, c’est là une louange directe aux houris du paradis, qui sont des femmes et non pas des garçons, puisqu’elles servent de point de comparaison. Et d’ailleurs, vous autres, les amateurs de jeunes garçons, quand vous voulez dépeindre vos amis, vous comparez leurs caresses à celles des jeunes filles ! Vous n’avez point honte de vos goûts corrompus, vous en faites parade, et les satisfaites en public. Vous oubliez les paroles du Livre : « Pourquoi rechercher l’amour des mâles ? Allah n’a-t-il point créé les femmes pour la satisfaction de vos désirs ? Jouissez-en donc à votre guise ! Mais vous êtes un peuple obstiné ! »
« Si toutefois il vous arrive de comparer les jeunes filles aux garçons, c’est uniquement pour donner le change à vos désirs corrompus et à votre goût perverti ! Oui ! nous les connaissons bien, vos poètes amateurs de garçons ! Le plus grand d’entre eux, le cheikh des pédérastes, Abou-Nowas, n’a-t-il pas dit en parlant d’une jeune fille :
« Tel un jeune garçon, elle n’a point de hanches, et s’est même coupé les cheveux ! Mais un tendre duvet veloute son visage et double ses charmes. Elle satisfait ainsi le pédéraste et l’adultérin !
« Mais pour ce qui est du prétendu attrait que donne la barbe aux jeunes hommes…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZIÈME NUIT
Elle dit :
« Voici qu’aux premiers poils poussés sur sa joue, son amant a pris la fuite.
Quand, en effet, le charbon de la barbe noircit le menton, il réduit en fumée les charmes du jeune homme.
Et quand la page blanche du visage est remplie par le noir de l’écriture, qui voudrait encore prendre la plume, sinon seul l’ignorant ?
« Donc, ô cheikh, rendons hommage à Allah Très-Haut qui a su réunir dans les femmes toutes les jouissances qui peuvent remplir la vie, et qui a promis aux prophètes, aux saints et aux Croyants, comme récompense au paradis, les houris merveilleuses. D’ailleurs, si Allah Très-bon savait qu’il pût y avoir réellement d’autres voluptés en dehors des femmes, il les aurait certainement promises et réservées à ses fidèles Croyants. Or, Allah ne cite jamais les jeunes garçons autrement que pour les représenter comme les serviteurs des élus dans le paradis ; mais aucune fois il ne les a promis pour d’autre fin que celle-là ! Et le Prophète lui-même (sur lui la prière et la paix !) n’a jamais eu un penchant quelconque de ce côté-là, au contraire ! Il avait, en effet, coutume de répéter à ses compagnons : « Trois choses me font aimer ce monde vôtre : les femmes, les parfums et la fraîcheur de l’âme dans la prière ! » Mais je ne saurais mieux résumer mon opinion, ô cheikh, que par ces vers du poète :
« Entre un derrière et un derrière il y a de la différence. Si vous approchez de l’un, votre robe se teinte de jaune, mais si vous touchez l’autre, elle se parfume !
Qui vient comparer le garçon à la fille ? Osa-t-on jamais préférer au bois odorant du nadd les excréments des pourceaux ?
« Mais je vois que la discussion m’a trop animée et m’a fait dépasser les limites de la convenance dont ne doivent point se départir les femmes, surtout en présence des cheikhs et des savants. Je me hâte donc d’en demander pardon à ceux qui auraient pu s’en formaliser ou s’en offusquer, et je compte sur leur discrétion au sortir de cet entretien, car le proverbe dit : « Le cœur des hommes bien nés est un tombeau pour les secrets ! »
— Lorsque Schahrazade eut fini de raconter cette anecdote, elle dit : « Et tel est, ô Roi fortuné, ce que je puis me rappeler des anecdotes renfermées dans le Parterre fleuri de l’esprit et le Jardin de la galanterie ! » Et le roi Schahriar dit : « En vérité, Schahrazade, ces anecdotes m’ont charmé à l’extrême, et me font maintenant souhaiter entendre une histoire comme celles que tu me racontais auparavant ! » Schahrazade répondit : « Justement j’y pensais ! » Et aussitôt elle dit :
- ↑ Voir, pour plus de détails sur ce serment, le tome VI, dans l’Histoire de Grain-de-Beauté, la scène du Délieur.
L’ÉTRANGE KHALIFAT
On raconte qu’une nuit le khalifat Haroun Al-Rachid, pris d’insomnie, fit appeler son vizir Giafar Al-Barmaki et lui dit : « Ma poitrine est rétrécie, et je désire aller me promener par les rues de Baghdad et pousser jusqu’au Tigre, pour essayer de me distraire cette nuit ! » Giafar répondit par l’ouïe et l’obéissance, et se déguisa aussitôt en marchand, après avoir aidé le khalifat à se déguiser également et appelé le porte-glaive Massrour pour qu’il les accompagnât, déguisé aussi comme eux. Puis ils sortirent du palais par la porte secrète, et se mirent à parcourir lentement les rues, silencieuses à cette heure, de Baghdad, et parvinrent de la sorte au bord du fleuve. Ils virent dans une barque amarrée un vieux batelier qui se disposait à s’enrouler dans sa couverture pour dormir. Ils s’approchèrent de lui et, après les salams, lui dirent : « Ô cheikh, nous souhaitons de ton obligeance que tu veuilles bien nous faire descendre dans ta barque pour nous promener un peu sur le fleuve, maintenant que l’heure est fraîche et la brise délicieuse ! Et voici un dinar pour ta peine ! » Il répondit, avec un accent de terreur dans la voix : « Que me demandez-vous là, seigneurs ! Ne connaissez-vous donc pas la défense ? Et ne voyez-vous pas venir à nous le bateau où se trouve le khalifat avec toute sa suite ? » Ils demandèrent, fort étonnés : « Es-tu sûr que ce bateau qui s’avance contienne le khalifat lui-même ? » Il répondit : « Par Allah ! et qui ne connaît pas à Baghdad la figure de notre maître le khalifat ? C’est lui-même, mes seigneurs, avec son vizir Giafar et son porte-glaive Massrour ! Et voici avec eux les mamalik et les chanteurs ! Entendez le crieur, debout sur la proue, qui crie : « Défense aux grands et aux petits, aux jeunes et aux vieux, aux notables et aux hommes du peuple de se promener sur le fleuve ! Quiconque contreviendra à cet ordre aura la tête coupée ou sera pendu au mât de son bateau ! »
En entendant ces paroles…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME NUIT
Elle dit :
…En entendant ces paroles, Al-Rachid fut à la limite de l’étonnement, car il n’avait jamais donné un ordre pareil, et depuis plus d’une année il ne s’était promené sur le fleuve. Il regarda donc Giafar et l’interrogea des yeux sur la signification de ce procédé. Mais Giafar, aussi étonné que le khalifat, se tourna vers le vieux batelier et lui dit : « Ô cheikh, voici pour toi deux dinars. Seulement, hâte-toi de nous faire descendre dans ta barque et de nous cacher dans un de ces abris voûtés qui sont sur l’eau, simplement pour que nous puissions, sans être aperçus et appréhendés, voir le passage du khalifat et de sa suite. » Le batelier, tout hésitant, finit par accepter l’offre, et, les ayant fait descendre tous les trois dans sa barque, les conduisit sous un abri voûté, et étendit sur eux une couverture noire pour qu’ils fussent encore moins remarqués.
À peine étaient-ils dans cette position, qu’ils virent s’approcher le bateau éclairé par la lueur des torches et des flambeaux qu’alimentaient, avec du bois d’aloès, de jeunes enclaves vêtus de satin rouge, les épaules couvertes de manteaux jaunes et la tête enveloppée de mousseline blanche. Les uns se tenaient à la proue et les autres à la poupe, et ils élevaient leurs torches et leurs flambeaux en criant, de temps en temps, la défense en question. Ils virent aussi deux cents mamalik debout, rangés sur les deux bords du bateau, et entourant une estrade située au centre où, sur un trône d’or, était assis un jeune homme habillé d’une robe en drap noir, que rehaussaient des broderies d’or ; et à sa droite se tenait un homme qui ressemblait étonnamment au vizir Giafar, et à sa gauche se tenait un autre homme, l’épée nue à la main, qui ressemblait exactement à Massrour, tandis qu’au bas de l’estrade étaient assis en bon ordre vingt chanteuses et joueurs d’instruments. À cette vue, Al-Rachid s’écria : « Giafar ! » Le vizir répondit : « À tes ordres, ô émir des Croyants ! » Il dit : « Ce doit être sûrement un de nos fils, ou bien Al-Mâmoun, ou bien Al-Amîn ! Et les deux qui sont debout à ses côtés ressemblent l’un à toi et l’autre à mon porte-glaive Massrour. Et tous ceux qui sont assis au bas de l’estrade ressemblent étrangement à mes chanteurs habituels et à mes joueurs d’instruments. Que penses-tu de tout cela ? Moi je sens mon esprit dans une bien grande perplexité ! » Giafar répondit : « Moi aussi, par Allah ! ô émir des Croyants ! »
Mais déjà le bateau illuminé s’était éloigné de leurs yeux, et le vieux batelier, délivré de ses angoisses, s’écria : « Enfin ! la sécurité est sur nous. Personne ne nous a vus ! » Et il sortit de l’abri et ramena ses trois passagers sur le rivage : Lorsqu’ils eurent débarqué, le khalifat se tourna vers lui et lui demanda : « Ô cheikh, tu dis que le khalifat vient de la sorte se promener toutes les nuits dans le bateau ainsi illuminé ? » Il répondit : « Oui, seigneur, et cela depuis déjà une année ! » Il dit : « Ô cheikh, nous sommes des étrangers en voyage qui aimons à nous réjouir de tous les spectacles et à nous promener partout où il y a à voir de belles choses ! Veux-tu donc prendre ces dix dinars et nous attendre ici même, demain, à cette heure ? » Il répondit : « J’aime et j’honore ! » Alors le khalifat et ses deux compagnons prirent congé de lui et s’en retournèrent au palais en s’entretenant de ce spectacle étrange.
Le lendemain, le khalifat, après avoir tenu toute la journée son diwân et reçu ses vizirs, ses chambellans, ses émirs et ses lieutenants, et expédié les affaires en cours et jugé et condamné et absous, se retira dans ses appartements où il enleva ses habits royaux pour se déguiser en marchand, et prit, avec Giafar et Massrour, le même chemin que la veille pour arriver bientôt au fleuve, où les attendait le vieux batelier. Ils descendirent dans la barque et allèrent se cacher sous la voûte, où ils attendirent l’arrivée du bateau illuminé.
Ils n’eurent pas le temps de s’impatienter, car, quelques instants après, le bateau, au son des instruments, apparut sur l’eau embrasée par les flambeaux. Ils aperçurent les mêmes personnes que la veille, le même nombre de mamalik et les mêmes convives avec, au milieu d’eux, assis sur l’estrade entre l’étrange Giafar et l’étrange Massrour, l’étrange khalifat.
À cette vue, Al-Rachid dit à Giafar : « Ô vizir, je vois là une chose que je n’aurais jamais crue si l’on était venu me la raconter ! » Puis il dit au batelier : « Ô cheikh, prends encore ces dix dinars, et conduis-nous sur la trace de leur bateau ; et ne sois point effrayé, car ils ne nous verront pas, puisqu’ils sont dans la lumière et que nous serons dans les ténèbres. Notre but est de jouir du beau spectacle de cette illumination sur l’eau ! » Le batelier accepta les dix dinars et, bien qu’ému de crainte, se mit à ramer sans bruit dans le sillage du bateau, en se gardant d’entrer dans le cercle lumineux…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZIÈME NUIT
Elle dit :
… en se gardant d’entrer dans le cercle lumineux jusqu’à ce qu’ils fussent tous arrivés à un parc qui descendait en pente jusqu’au fleuve, et où le bateau fut amarré. L’étrange khalifat et toute sa suite débarquèrent, et, au son des instruments, pénétrèrent dans le parc.
Lorsque le bateau se fut éloigné, le vieux cheikh fit accoster sa barque dans l’obscurité pour permettre à ses trois passagers de débarquer à leur tour. Une fois à terre, ils allèrent se mêler à la foule des gens qui tenaient les flambeaux et marchaient autour de l’étrange khalifat.
Or, pendant qu’ils suivaient ainsi le cortège, ils furent soudain remarqués par quelques-uns des mamalik et reconnus comme intrus. Aussitôt ils furent saisis et conduits devant le jeune homme qui leur demanda : « Comment avez-vous fait pour entrer ici, et pour quelle raison y êtes-vous venus ? » Ils répondirent : « Ô notre seigneur, nous sommes des marchands étrangers à ce pays. Nous sommes arrivés aujourd’hui seulement, et nous avons poussé notre promenade jusqu’ici, sans savoir que l’accès de ce jardin fût défendu. Et nous marchions tranquillement quand nous avons été appréhendés par vos gens et conduits entre vos mains, sans que nous » ayons pu nous douter de la faute commise ! » Il leur dit : « Soyez donc sans crainte, puisque vous êtes étrangers à Baghdad ! Sans cela, je vous eusse certainement fait trancher la tête ! » Puis il se tourna vers son vizir et lui dit : « Laisse ceux-là venir avec nous. Ils seront nos hôtes ce soir ! »
Ils accompagnèrent alors le cortège et arrivèrent de la sorte à un palais qui ne pouvait être comparé en magnificence qu’à celui de l’émir des Croyants. Sur la porte de ce palais était gravée cette inscription :
En cette demeure où l’hôte est le bienvenu, le temps a mis la beauté de ses teintes, l’art a semé sa décoration, et l’accueil généreux du maître ouvre l’esprit au contentement.
Ils entrèrent alors dans une salle magnifique dont le sol était couvert de tapis de soie jaune, et l’étrange khalifat, s’étant assis sur un trône d’or, permit à tous les autres de s’asseoir autour de lui. On servit immédiatement le festin ; ils mangèrent et se lavèrent les mains ; puis, les boissons rangées sur la nappe, ils burent largement dans la même coupe à tour de rôle. Mais lorsque vint le tour du khalifat Haroun Al-Rachid, celui-ci se défendit de boire. Alors l’étrange khalifat se tourna vers Giafar et lui demanda : « Pourquoi ton ami ne veut-il pas boire ? » Il répondit : « Il y a longtemps, seigneur, qu’il ne boit plus ! » L’autre dit : « En ce cas, je vais lui faire servir autre chose ! » Aussitôt il donna un ordre à un de ses mamalik qui se hâta d’apporter un flacon rempli de sorbet aux pommes, et l’offrit à Al-Rachid, qui cette fois accepta et se mit à boire avec beaucoup de plaisir.
Lorsque la boisson eut eu raison de leur cerveau, l’étrange khalifat, qui tenait à la main une petite baguette d’or, frappa trois coups sur la table, et aussitôt les deux battants d’une large porte s’ouvrirent au fond de la salle pour livrer passage à deux nègres qui portaient sur leurs épaules un siège d’ivoire sur lequel était assise une jeune esclave blanche, au visage brillant comme le soleil. Ils vinrent déposer le siège en face du maître, et allèrent se tenir debout derrière, dans une pose immobile. Alors l’esclave prit un luth indien, l’accorda, et préluda par vingt-quatre modes différents avec un art qui ravit l’esprit des auditeurs. Puis elle revint au premier mode, et chanta :
« Comment peux-tu, loin de moi, te consoler, alors que mon cœur est dans le deuil de ton absence ?
La destinée a séparé les amants, et la demeure est vide qui résonnait des chants du bonheur ! »
Lorsque l’étrange khalifat eut entendu ces vers chantés, il poussa un grand cri, déchira sa belle robe constellée de diamants, sa chemise et ses autres vêtements, et tomba évanoui. Aussitôt les mamalik s’empressèrent de jeter sur lui une couverture de satin, mais pas assez vite pour que le khalifat, Giafar et Massrour n’eussent le temps de remarquer que le corps du jeune homme portait de larges cicatrices et des traces de coups de bâton et de fouet.
À cette vue, le khalifat dit à Giafar : « Par Allah ! quel dommage qu’un jeune homme si beau porte sur le corps des signes qui nous démontrent, d’une façon évidente, que nous avons affaire à quelque brigand ou à quelque criminel étonnant échappé des prisons ! » Mais déjà les mamalik avaient habillé leur maître d’une nouvelle robe, plus belle que la précédente ; et le jeune homme reprit sa place sur le trône, comme si rien ne s’était passé. Il aperçut alors ses trois invités qui se parlaient à voix basse, et leur dit : « Pourquoi cet air étonné et ces paroles à voix basse ? » Giafar répondit : « Mon compagnon que voici me disait qu’il avait parcouru tous les pays et fréquenté bien des personnages et des rois, mais qu’il n’avait jamais vu quelqu’un d’aussi généreux que notre hôte. Il s’étonnait, en effet, de te voir déchirer une robe de la valeur certainement de dix mille dinars. Et il me citait ces vers en ton honneur…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEIZIÈME NUIT
Elle dit :
« … Et il me citait ces vers en ton honneur :
« La générosité a bâti sa demeure au milieu de ta paume, et a fait de cette demeure l’asile désiré.
Si la générosité un jour fermait ses portes, ta main serait la clef qui en ouvrirait les serrures ! »
En entendant ces vers, le jeune homme se montra fort satisfait, et ordonna qu’on fît présent à Giafar de mille dinars et d’une robe aussi belle que celle qu’il avait lui-même déchirée, et l’on se remit à boire et à s’amuser. Mais Al-Rachid, qui ne pouvait avoir de paix depuis qu’il avait aperçu les traces des coups sur le corps du jeune homme, dit à Giafar : « Demande-lui donc l’explication de la chose ! » Giafar répondit : « Il vaut mieux prendre encore patience, et ne pas paraître indiscret ! » Il dit : « Par ma tête et par la tombe d’Abbas ! si tout de suite tu ne l’interroges pas à ce sujet, ô Giafar, ton âme ne t’appartiendra plus à notre arrivée au palais ! »
Or, le jeune homme, s’étant tourné vers eux, les aperçut qui causaient encore à voix basse et leur demanda : « Qu’avez-vous donc de si important à vous dire en secret ? » Giafar répondit : « Rien que du bien ! » Il reprit : « Je te supplie par Allah de me mettre au courant de ce que vous vous disiez, sans rien me cacher ! » Il dit : « Mon compagnon a remarqué sur tes flancs, seigneur, des cicatrices et des traces de coups de verge et de fouet ! Et il en a été étonné à la limite de l’étonnement ! Et il désirerait ardemment savoir à la suite de quelle aventure notre maître le khalifat a subi un pareil traitement, si peu compatible avec sa dignité et ses prérogatives ! » À ces paroles, le jeune homme sourit et dit : « Soit ! je veux bien vous révéler, puisque vous êtes des étrangers, la cause de tout cela ! Et d’ailleurs, mon histoire est si prodigieuse et si pleine de merveilleux que, si elle était écrite avec les aiguilles sur le coin intérieur de l’œil, elle servirait de leçon à qui la considérerait avec attention ! » Puis il dit :
« Sachez, mes seigneurs, que je ne suis point l’émir des Croyants, mais je suis simplement le fils du syndic des bijoutiers de Baghdad. Je m’appelle Môhammad-Ali. Mon père, en mourant, me laissa en héritage beaucoup d’or, d’argent, de perles, de rubis, d’émeraudes, de bijoux et de pièces d’orfèvrerie ; il me laissa, en outre, des propriétés bâties, des terrains, des vergers, des jardins, des boutiques et des magasins de réserve ; et il me laissa le maître de ce palais avec tout ce qu’il contient en esclaves hommes et femmes, en gardes et en serviteurs, en jeunes garçons et jeunes filles.
Or, un jour, comme j’étais assis dans ma boutique au milieu de mes esclaves empressés à exécuter mes ordres, je vis s’arrêter à la porte, et descendre d’une mule richement harnachée, une adolescente accompagnée de trois autres adolescentes, toutes les trois comme des lunes. Elle entra dans ma boutique et s’assit, tandis que je me levais en son honneur ; puis elle me demanda : « Tu es bien, n’est-ce pas, Môhammad-Ali, le joaillier ! » Je répondis : « Mais oui, ô ma maîtresse, et je suis ton esclave prêt à t’obéir ! » Elle me dit : « Aurais-tu quelque bijou vraiment beau, qui pût me plaire ? » Je lui dis : « Ô ma maîtresse, je vais apporter tout ce que j’ai de plus beau dans ma boutique et le mettre entre tes mains. Si quelque chose, dans le nombre, peut arriver à te convenir, nul ne se considérera plus heureux que ton esclave ; et si rien ne peut arrêter tes regards, je déplorerai ma mauvaise chance pendant toute ma vie ! »
Or, moi j’avais justement dans ma boutique cent colliers précieux, merveilleusement ouvragés, que je me hâtai de faire apporter et d’exposer devant elle. Elle les mania et les regarda longuement l’un après l’autre, avec plus de connaissance que je n’en aurais eu moi-même à sa place, puis me dit : « Je veux mieux que cela ! » Je pensai alors à un tout petit collier qu’avait acheté autrefois mon père pour cent mille dinars, et que je tenais, serré tout seul dans un coffret précieux, à l’abri de tous les regards. Je me levai alors et lentement j’apportai le coffret en question avec mille précautions, et je l’ouvris avec cérémonie devant l’adolescente, en lui disant : « Je ne crois pas qu’il y ait l’égal de cela chez les rois ou chez les sultans, chez les petits ou chez les grands ! »
Lorsque l’adolescente eut jeté un rapide coup d’œil sur le collier, elle poussa un cri de joie et s’écria : « Voilà ce que j’ai vainement souhaité toute ma vie ! » Puis elle me dit : « À combien ? » Je répondis : « Son prix de revient, à mon défunt père, a été exactement de cent mille dinars. S’il te plaît, ô ma maîtresse, je serai à la limite du bonheur de te l’offrir pour rien ! » Elle me regarda, sourit légèrement et me dit : « Au prix que tu viens de dire ajoute cinq mille dinars, pour les intérêts du capital mort, et le collier devient ma propriété ! » Je répondis : « Ô ma maîtresse, le collier et son propriétaire actuel sont ta propriété et se trouvent entre tes mains ! Je n’ai rien de plus à ajouter ! » Elle sourit encore, et répondit : « Et moi aussi j’ai fixé l’achat. J’ajoute que je deviens par le fait ta débitrice en gratitude ! » Et, ayant dit ces paroles, elle se leva vivement, sauta avec une légèreté extrême sur sa mule, sans recourir à l’aide de ses suivantes, et me dit en partant : « Ô mon maître, veux-tu tout de suite m’accompagner pour me porter le collier et venir toucher l’argent à ma maison ? Crois bien que cette journée, grâce à toi, est devenue pour moi comme le lait ! » Moi je ne voulus pas insister davantage, de peur de la contrarier, j’ordonnai à mes serviteurs de fermer la boutique, et suivis l’adolescente, au pas, jusqu’à sa maison…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÈME NUIT
Elle dit :
… et suivis l’adolescente, au pas, jusqu’à sa maison. Là je lui remis le collier, et elle pénétra dans son appartement après m’avoir prié de m’asseoir sur le banc du vestibule pour y attendre l’arrivée du changeur qui devait me payer les cent mille dinars avec leurs intérêts.
Pendant que j’étais assis sur ce banc du vestibule, je vis arriver une jeune servante qui me dit : « Ô mon maître, prends la peine d’entrer dans l’antichambre de la maison, car le stationnement à la porte n’est pas fait pour les gens de ta qualité ! » Je me levai alors et pénétrai dans l’antichambre où je m’assis sur un escabeau tendu de velours vert, et restai ainsi à attendre un certain temps. Alors je vis entrer une seconde servante qui me dit : « Ô mon maître, ma maîtresse te prie d’entrer dans la salle de réception où elle désire que tu te reposes en attendant l’arrivée du changeur ! » Je ne manquai pas d’obéir, et suivis la jeune fille dans la salle de réception. J’y étais à peine arrivé qu’un grand rideau au fond fut soulevé, et quatre jeunes esclaves s’avancèrent portant un trône d’or où était assise l’adolescente, avec un visage beau comme un rond de lune, et le collier au cou.
À sa vue, le visage ainsi sans voile et complètement à découvert, je sentis ma raison s’affoler, et se précipiter les battements de mon cœur. Mais elle fit signe à ses esclaves de se retirer, s’avança vers moi et me dit : « Ô lumière de mon œil, est-ce que tout être beau doit, ainsi que tu le fais, agir si durement envers celle qui l’aime ? » Je répondis : « La beauté tout entière est en toi, et ses restes, s’il y en a, sont distribués aux autres humains ! » Elle me dit : « Ô joaillier Môhammad-Ali, sache que je t’aime, et que je n’ai usé de ce moyen que pour te décider à venir dans ma maison ! » Et, ayant prononcé ces paroles, elle se pencha sur moi nonchalamment et m’attira à elle en me coulant des yeux langoureux. Moi alors, extrêmement ému, je lui pris la tête dans mes mains et l’embrassai à plusieurs reprises, tandis qu’elle me rendait mes baisers sans avarice et me pressait contre ses seins, que je sentais durs à s’incruster dans ma poitrine. Alors je compris que je ne devais pas reculer, et je voulus mettre à exécution ce qu’il était de ma vertu d’exécuter. Mais au moment où l’enfant, complètement réveillé, réclamait hardiment sa mère, celle-ci me dit : « Que veux-tu donc faire avec cela, ô mon maître ? » Je répondis : « Le cacher, pour m’en débarrasser ! » Elle me dit : « Certes ! tu ne pourras guère le cacher chez moi, car la maison n’est pas ouverte. Il faudrait pour cela d’abord qu’on y ménageât une brèche ! Or, sache bien que je suis une vierge intacte de toute perforation ! De plus, si tu crois que tu as affaire à quelque femme inconnue ou à quelque chiffon d’entre les chiffons de Baghdad, hâte-toi de te détromper ! Apprends, en effet, ô Môhammad-Ali, que, telle que tu me vois, je suis la sœur du grand-vizir Giafar ; je suis la fille de Yahia ben-Khaled Al-Barmaki. »
En entendant ces paroles, ô mes maîtres, moi soudain je sentis l’enfant retomber dans un profond sommeil, et je compris combien il avait été malséant de ma part d’écouter ses cris et de vouloir les apaiser en demandant l’aide de l’adolescente. Pourtant je lui dis : « Par Allah ! ô ma maîtresse, la faute n’est pas à moi si j’ai voulu faire profiter l’enfant de l’hospitalité accordée au père. C’est toi même qui avais bien voulu être généreuse à mon égard, en me faisant voir la route du gîte à travers les portes ouvertes de ton hospitalité ! » Elle me répondit : « Tu n’as point de reproches à te faire, au contraire ! Et tu parviendras à tes fins, si tu veux, mais par les seules routes légales. Avec la volonté d’Allah tout peut arriver ! Je suis, en effet, la maîtresse de mes actes, et nul n’a le droit de les contrôler ! Veux-tu donc de moi comme épouse légitime ? » Je répondis : « Certainement ! » Aussitôt elle fit venir le kâdi et les témoins, et leur dit : « Voici Môhammad-Ali fils d’Ali le défunt syndic. Il me demande en mariage et me reconnaît comme dot ce collier qu’il m’a donné. Moi j’accepte et je consens ! » Aussitôt on écrivit notre contrat de mariage, et, cela fait, on nous laissa seuls. Les esclaves apportèrent les boissons, les coupes et les luths, et nous commençâmes tous deux à boire, jusqu’à ce que notre esprit eût resplendi ! Elle prit alors le luth et chanta en s’accompagnant :
« Par la souplesse de ta taille, par ta démarche fière, je jure que je souffre de ton éloignement.
Aie pitié d’un cœur brûlé du feu de ton amour !
La coupe d’or m’exalte où je trouve, en buvant à sa liqueur, ton souvenir vivace.
De même, au milieu des roses éclatantes, la fleur de myrte me fait mieux apprécier les vives couleurs ! »
Lorsqu’elle eut fini de chanter, je pris le luth à mon tour, et, après avoir montré que je savais en tirer le meilleur parti, je dis ces vers du poète, en m’accompagnant en sourdine :
« Ô prodige ! Je vois sur tes joues s’unir les choses contraires : la fraîcheur de l’eau et la rougeur de la flamme.
Tu es pour mon cœur le feu et la fraîcheur ! Ô ! que tu es amère et douce dans mon cœur ! »
Lorsque nous eûmes terminé nos chants, nous vîmes qu’il était temps de songer au lit. Je l’enlevai dans mes bras et l’étendis sur la couche somptueuse que nous avaient préparée les esclaves…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et se tut discrètement.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME NUIT
Elle dit :
… sur la couche somptueuse que nous avaient préparée les esclaves. Alors, l’ayant mise nue, je pus constater qu’elle était une perle imperforée et une cavale non montée. Je me réjouis de cela grandement, et, en outre, je puis assurer que de ma vie je n’ai passé une nuit aussi agréable que cette nuit-là, où, jusqu’au matin, je la tins serrée contre moi comme on tient un pigeon les ailes repliées dans la main !
Or, ce ne fut point une nuit seulement que je passai de la sorte, mais un mois entier, sans discontinuer. Et j’en oubliai mes intérêts, ma boutique, mes biens à gérer, et ma maison avec tout ce qu’elle contenait, jusqu’à ce qu’elle vînt me trouver un jour, qui était le premier jour du second mois, et me dit : « Je suis obligée de m’absenter quelques heures, le temps seulement d’aller au hammam et d’en revenir. Toi, je t’en supplie, ne quitte pas ce lit ; et ne te lève pas jusqu’à ce que je sois de retour. Et je te reviendrai toute fraîche du hammam, et légère et parfumée ! » Puis, pour être plus sûre de l’exécution de cet ordre, elle me fit prêter le serment de ne point bouger du lit. Après quoi elle emmena deux de ses esclaves, qui prirent les serviettes et les paquets de linge et de vêtements, et s’en alla avec elles au hammam.
Or, ô mes maîtres, elle était à peine sortie de la maison, que je vis, par Allah ! la porte s’ouvrir, et entrer dans ma chambre une vieille femme qui me dit, après les salams : « Ô mon maître Môhammad, l’épouse de l’émir des Croyants, Sett Zobéida, m’envoie vers toi pour te prier de te rendre au palais où elle désire te voir et t’entendre ; car on lui a parlé en termes si admiratifs de tes manières distinguées, de ta politesse et de ta belle voix, qu’elle a eu grande envie de te connaître ! » Je répondis : « Par Allah ! ma bonne tante, Sett Zobéida me fait un honneur extrême de m’invitera aller la voir ; mais je ne puis quitter la maison avant le retour de mon épouse qui est allée au hammam. » La vieille me dit : « Mon enfant, je te conseille, dans ton intérêt, de ne pas différer d’un instant la visite qu’on te demande, si tu ne veux pas que Sett Zobéida devienne ton ennemie !
Or, peut-être l’ignores-tu, elle est bien dangereuse, l’inimitié de Sett Zobéida ! Lève-toi donc et va lui parler ! Puis tu reviendras bien vite à ta maison ! »
Ces paroles me décidèrent à sortir, en dépit du serment que j’avais fait à mon épouse, et je suivis la vieille qui marcha devant moi, et me conduisit au palais où elle m’introduisit sans difficulté.
Lorsque Sett Zobéida me vit entrer, elle me sourit, me fit m’approcher d’elle, et me dit : « Ô lumière de l’œil ! c’est toi le bien-aimé de la sœur du grand-vizir ? » Je répondis : « Je suis ton esclave et ton serviteur ! » Elle me dit : « En vérité, ils n’ont guère exagéré tes mérites, ceux qui m’ont dépeint tes manières charmantes et ton parler distingué. Je désirais te voir et te connaître, pour juger par mes yeux du choix et des goûts de la sœur de Giafar. Maintenant je suis satisfaite. Mais tu ferais parvenir mon plaisir à ses limites extrêmes, si tu voulais bien me faire entendre ta voix en me chantant quelque chose ! » Je répondis : « J’aime et j’honore ! » Et je pris un luth, que m’apporta une esclave, et, après l’avoir accordé, je préludai doucement et chantai deux ou trois strophes sur l’amour partagé. Lorsque je cessai de chanter, Sett Zobéida me dit : « Qu’Allah achève son œuvre en te rendant encore plus parfait que tu n’es, ô charmant jeune homme ! Je te remercie d’être venu me voir. Maintenant hâte-toi de rentrer chez toi, avant le retour de ton épouse, pour qu’elle ne s’imagine point que je veuille te ravir à son affection ! » Moi j’embrassai alors la terre entre ses mains, et je sortis du palais par la porte même de mon entrée.
Lorsque je fus arrivé à la maison, je trouvai au lit mon épouse, qui m’y avait précédé. Elle dormait déjà, et ne fit aucun mouvement de réveil. Je me couchai alors à ses pieds, et, tout doucement, je me mis à lui masser les jambes. Mais soudain elle ouvrit les yeux et froidement me donna un coup de pied dans le flanc, qui m’envoya rouler au bas du lit, par terre, et me cria : « Ô traître ! ô parjure ! Tu as manqué à ton serment, et tu t’es rendu auprès de Sett Zobéida ! Par Allah ! si je n’avais horreur de l’opprobre et horreur de livrer mon intimité, au public, j’irais à cette heure même lui faire voir, à Sett Zobéida, ce qu’il en coûte de débaucher les maris des autres femmes ! Mais toi, en attendant, tu vas payer pour elle et pour toi ! » Et elle frappa dans ses mains et cria : « Ya Saouab ! » Aussitôt apparut son chef eunuque, un nègre qui m’avait toujours regardé de travers, et elle lui dit : « Coupe tout de suite le cou à ce traître, à ce menteur, à ce parjure ! » Le nègre aussitôt brandit son épée, déchira un coin du bas de sa robe, et me banda les yeux avec le lambeau d’étoffe qu’il avait ainsi arraché. Puis il me dit : « Fais ton acte de foi ! » et se disposa à me couper le cou. Mais à ce moment entrèrent toutes les esclaves, envers lesquelles j’avais toujours été généreux, les grandes et les petites, les jeunes et les vieilles…
— À ce moment de sa narration, Schahrazade vit apparaître le matin et, discrète, se tut.
LA TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME NUIT
Elle dit :
… les grandes et les petites, les jeunes et les vieilles, et lui dirent : « Ô notre maîtresse, nous te supplions de lui faire grâce à cause de son ignorance de la gravité de sa faute. Il ne savait pas que rien ne te pouvait davantage contrarier que sa visite à Sett Zobéida, ton ennemie ! Il ignorait absolument ce qu’il pouvait y avoir de rivalité entre vous deux ! Pardonne-lui, ô notre maîtresse ! » Elle répondit : « Soit ! je veux bien lui laisser la vie sauve, mais je désire également lui faire garder un souvenir ineffaçable de son manquement ! » Et elle fit signe à Saouab de laisser l’épée pour le bâton. Et le nègre prit aussitôt une verge d’une souplesse terrible, et se mit à m’en donner des coups sur les endroits les plus sensibles de mon corps. Après quoi il prit un fouet et m’en asséna cinq cents tournées, ajustées cruellement sur mes parties les plus délicates et sur mes côtes. C’est ce qui vous explique, mes seigneurs, les traces et les cicatrices que vous avez pu observer tout à l’heure sur mon corps.
Lorsque ce traitement m’eut été infligé, elle me fit emporter de là et jeter comme une hotte d’ordures dans la rue.
Alors, moi je me ramassai comme je pus, et me traînai jusqu’à ma maison, tout ensanglanté, pour tomber évanoui tout de mon long, à peine arrivé dans ma chambre depuis si longtemps abandonnée.
Lorsque, au bout d’un long temps, je fus revenu de mon évanouissement, je fis venir chez moi un savant rebouteur, à la main très légère, qui pansa délicatement mes blessures et, à force de baumes et d’onguents, réussit à obtenir ma guérison. Je restai pourtant étendu dans l’immobilité pendant deux mois ; et lorsque je pus sortir, je commençai par aller au hammam ; et, mon bain terminé, je me rendis à ma boutique. Là je me hâtai de vendre aux enchères tout ce qu’elle contenait de choses précieuses, je réalisai tout ce que je pus réaliser, et, avec la somme acquise, j’achetai quatre cents jeunes mamalik que j’habillai richement, et ce bateau où vous m’avez vu cette nuit en leur compagnie. Je choisis l’un, d’eux, qui ressemblait à Giafar, pour en faire mon compagnon de droite, et un autre pour lui donner les prérogatives de porte-glaive, à l’exemple de l’émir des Croyants. Et, dans le but d’oublier mes tribulations, je me déguisai moi-même en khalifat, et pris l’habitude de me promener chaque nuit sur le fleuve, au milieu de l’illumination de mon bateau et des chants et des jeux des instruments. Et c’est ainsi que, depuis une année, je passe ma vie, me donnant à moi-même cette illusion suprême d’être le khalifat, pour tâcher de chasser de mon esprit le chagrin qui l’a habité à partir du jour où mon épouse m’a fait châtier si cruellement, pour satisfaire la rivalité que Sett Zobéida et elle-même nourrissaient à l’égard l’une de l’autre ! Et c’est moi seul, l’ignorant de tout cela, qui ai subi les conséquences de cette dispute de femmes ! Or, telle est ma triste histoire, ô mes maîtres ! Et je n’ai plus qu’à vous remercier d’avoir bien voulu vous joindre à nous pour passer cette nuit amicalement ! »
Lorsque le khalifat Haroun Al-Rachid eut entendu cette histoire, il s’écria : « Louanges à Allah qui a fait que chaque effet ait sa cause ! » Puis il se leva et demanda au jeune homme la permission de se retirer avec ses compagnons. Le jeune homme le lui permit ; et il sortit de là pour se rendre au palais, en songeant au moyen de réparer l’injustice commise par les deux femmes à l’égard du jeune homme. Et, de son côté, Giafar se désolait fort que sa sœur fût la cause d’une pareille aventure, maintenant destinée à être connue de tout le palais.
Le lendemain, le khalifat, revêtu des insignes de son autorité, au milieu de ses émirs et de ses chambellans, dit à Giafar ; « À moi le jeune homme qui nous a donné l’hospitalité hier dans la nuit ! » Et Giafar sortit immédiatement, pour revenir bientôt avec le jeune homme qui embrassa la terre entre les mains du khalifat et, après les salams, lui fit en vers un compliment. Al-Rachid, charmé, le fit s’approcher, et s’asseoir à côté de lui et lui dit : « Ô Môhammad-Ali, je te fais venir pour entendre de ta bouche l’histoire que tu as racontée hier aux trois marchands. Elle est prodigieuse et pleine de leçons utiles ! » Le jeune homme, bien ému, dit : « Je ne puis parler, ô émir des Croyants, avant que tu ne m’aies donné le mouchoir de la sécurité ! » Le khalifat aussitôt lui jeta son mouchoir, en signe de sécurité, et le jeune homme répéta son récit, sans omettre un détail. Lorsqu’il eut fini, Al-Rachid lui dit : « Et maintenant aimerais-tu voir ton épouse revenir auprès de toi, malgré ses torts à ton égard ? » Il répondit : « Tout ce qui me viendrait de la main du khalifat serait le bienvenu ; car les doigts de notre maître sont les clefs des bienfaits, et ses actions ne sont pas des actions mais des colliers précieux, ornements des cous ? » Alors le khalifat dit à Giafar : « À moi ta sœur, ô Giafar, la fille de l’émir Yahia ! » Et Giafar fit aussitôt venir sa sœur ; et le khalifat lui demanda : « Dis-moi, ô fille de notre fidèle Yahia ! reconnais-tu ce jeune homme ? » Elle répondit : « Ô émir des Croyants, depuis quand les femmes ont-elles appris à connaître les hommes ? » Il sourît et dit : « Eh bien ! je vais te dire son nom. Il s’appelle Môhammad-Ali, fils du défunt syndic des bijoutiers. Tout ce qui est passé est passé, et dans le présent je désire te donner à lui comme épouse ! » Elle répondit : « Le don de notre maître est sur nos têtes et dans nos yeux ! »
Le khalifat fit aussitôt venir le kâdi et les témoins, et fit écrire légalement le contrat de mariage, qui unit cette fois les deux jeunes gens d’une façon durable, pour leur bonheur qui fut parfait. Et il voulut retenir auprès de lui Môhammad-Ali pour qu’il devînt l’un de ses intimes jusqu’à la fin de ses jours. Et voilà comment Al-Rachid savait consacrer ses loisirs à unir ce qui était désuni et à rendre heureux ceux que le destin avait trahis !
— Mais ne crois point, ô Roi fortuné, continua Schahrazade, que cette histoire, que je ne t’ai racontée que pour faire simplement diversion aux courtes anecdotes, puisse égaler, de près ou de loin, la merveilleuse Histoire de Rose-dans-le-Calice et Délice-du-Monde ! »