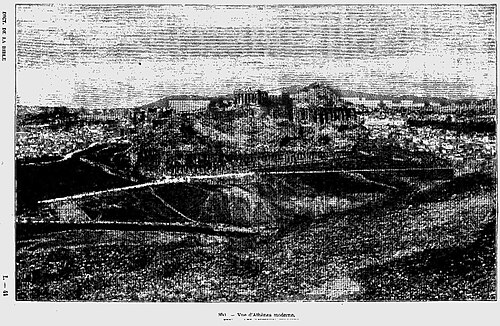Dictionnaire de la Bible/Tome I.2.a ARNALD-AZZONI
ARNALD Richard, théologien anglican, né à Londres en 1700, mort le 4 septembre 1756. Il fit ses études à Cambridge, et obtint dans la suite une prébende à Lincoln. Il est surtout connu par son commentaire sur les livres deutérocanoniques, le premier qui ait été publié sur ce sujet en Angleterre, A critical commentary on the books of the Apocrypha, in-f° », Londres, 1748. Ce travail fut imprimé comme une suite des commentaires de l’Écriture par Patricket Lowth. Voir Patrick. Le commentaire du livre de la Sagesse avait paru en 1744 ; celui de l’Ecclésiastique en 1748 ; ceux de Tobie, de Judith, de Baruch, de l’histoire de Susanne, de Bel et du dragon, avec des dissertations sur les livres des Machabées, parurent en 1752. J. R. Pitman a publié une nouvelle édition du Critical commentary upon the apocryphal Books, in-4°, Londres, 1822. Voir History of Corpus Christi College, Cambridge, 1831, p. 456 ; W. Orme, Bibliotheca biblica, 1824, p. 13-14.
ARNAN (hébreu : ’Arnân, « agile » ; Septante : Ὀρνά), père d’Obdia, de la postérité de Zorobabel. I Par., III, 21.
ARNAULD Antoine, surnommé le Grand, théologien
janséniste français, né à Paris le 6 février 1612, mort à
Bruxelles le 8 août 1694, était le vingtième enfant d’Antoine Arnauld, avocat général de Catherine de Médicis.
Il fit ses études au collège de Calvi-Sorbonne, et sa philosophie au collège de Lisieux. Sur les conseils de l’abbé
de Saint-Cyran, il se destina à l’état ecclésiastique, et
suivit les cours du Dr Lescot, confesseur de Richelieu,
et depuis évêque de Chartres. En 1636, il présentait une
thèse sur la grâce, et ne craignait pas de se mettre en
contradiction avec les doctrines de son maître. En 1641.
il était ordonné prêtre, mais ne put être admis parmi
les docteurs de la maison de Sorbonne qu’après la mort
de Richelieu. En 1642 paraissait son trop célèbre ouvrage
De la fréquente communion. A partir de ce moment,
Arnauld devint un des chefs du parti janséniste. Il prit
ouvertement la défense de l’évêque d’Ypres et de l'Augustinus, et en 1656 il fut exclut de la Société de
Sorbonne. Il se retira alors à Port-Royal, où il resta
douze ans. De retour à Paris en 1668, lors delà paix de
Clément IX, son ardeur lui suscita bientôt de nouveaux
embarras. Il se cacha pendant quelque temps dans cette
ville, puis se réfugia dans les Pays-Bas. Il mourut à
Bruxelles, le 8 août 1694, entre les bras du P. Quesnel,
son fidèle disciple, et sans avoir voulu se soumettre aux
décisions de l’Église.
Arnauld a composé un très grand nombre d’ouvrages
et on compte jusqu’à cent trente-cinq volumes sortis de
sa plume. Ses œuvres ont été publiées en quarante-huit
volumes in-4°, Lausanne, 1775 et suiv. Les tomes v-ix
contiennent ses travaux exégétiques, qui sont :
Réflexions sur le psaume cxxxvi : Super flumina Babylonis.
Historia et concordia evangelica, Paris, 1653. Le
Dr Arnauld publia lui-même une traduction de cet ouvrage, qui parut pour la première fois en 1669.
Remarques sur les principales erreurs d’un livre intitulé : L’ancienne nouveauté de l’Écriture Sainte, ou l’Eglise triomphante en terre, Paris, 1665. Cet ouvrage
est dirigé contre Nicolas Charpy, dit Sainte-Croix, visionnaire qui annonçait une transformation de l’Église
et la venue prochaine de l’Antéchrist.
Le Nouveau Testament de Notre-Seigneur Jésus-Christ, avec les différences du grec et de la Vulgate. La première édition
de cette traduction, à laquelle travaillèrent Antoine Lemaitre, Isaac Lemaître, Antoine Arnauld, Pierre Nicole
et plusieurs autres jansénistes, parut en 1667, avec l’approbation de l’archevêque de Cambrai. Cet ouvrage est
célèbre sous le nom de Nouveau Testament de Mons. Les
traducteurs abandonnent souvent la Vulgate pour le texte
grec, s’attachent à des traductions calvinistes, et sollicitent
les textes en faveur des erreurs jansénistes. Cette traduction fut condamnée par Clément IX en 1668, et par Innocent XI en 1679.
Défense de la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons contre les sermons du P. Maimbourg, Paris, 1667.
Abus et nullité de l’ordonnance de Monseigneur l’Archevêque de Paris, par laquelle il a défendu de lire et de débiter la traduction française du Nouveau Testament imprimée à Mons, 1668,
Remarques sur la requête présentée au Roi par Monseigneur l’Archevêque d’Ambrun contre la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons, 1668.
Requête au Roi pour demander permission de répondre au livre de M. Mallet contre la traduction du Nouveau Testament de Mons, 1678.
Nouvelle défense de la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons contre le livre de M. Mallet, docteur de Sorbonne, chanoine et archidiacre de Rouen, 2 in-8°, Cologne, 1680.
De la lecture de l’Écriture Sainte contre les paradoxes extravagants et impies de M. Mallet, dans son livre intitulé : De la lecture de l’Écriture Sainte en langue vulgaire, in-8°, Anvers, 1680.
Défense des versions de l’Écriture Sainte, des Offices de l’Église…, contre la sentence de l’Official de Paris du 10 avril 1688, Cologne, 1688.
Règles pour discerner les bonnes et les mauvaises critiques des traductions de l’Écriture Sainte en français pour ce qui regarde la langue, avec des réflexions sur cette maxime que l’usage est le tyran des langues vivantes, Paris,
1707.
Difficultés proposées à M. Steyaert, docteur et professeur en théologie de la faculté de Louvain, Cologne,
1691,
Dissertation critique touchant les exemplaires grecs sur lesquels M. Simon prétend que l’ancienne Vulgate a été faite, et sur le jugement que l’on doit faire du fameux manuscrit de Bèze.
Réponse aux remarques du P. Annat sur l’impression et la publication du Nouveau Testament imprimé à Mons.
Mémoire sur le Bref de Clément IX contre la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons.
Réponse à la lettre d’un docteur en théologie à un de ses amis, sur la traduction du Nouveau Testament imprimée à Mons.
Réponse à la seconde lettre d’un docteur, en théologie sur la même
traduction.
Voir Dacier, Éloge de M. l’abbé Arnauld, dans les Mémoires de l’Académie des inscriptions, t. xlviii, 1808.
ARNDT Josué, En cours ![]() théologien luthérien, né à Gustrow
(Mecklembourg), le 9 septembre 1626, mort le 5 avril 1687.
11 fut successivement professeur de logique à Rostock,
ministre luthérien et bibliothécaire à Gustrow, prédicateur du duc de Mecklembourg, qui l’éleva, en 1662, à la
dignité de conseiller ecclésiastique. — Voici le catalogue
de ses ouvrages relatifs à la science biblique : Miscellaneorum sacrorum liber unus : in quibus przeter Scriptural Veteris et Novi Testamenti loca illustriora ex
antiquitatibus perspicue explicata, usus verus et plus
profanas doctrinal ad gloriam Del et Verbi ejusdem
intellectum ostenditur, in —8°, Copenhague, 1648 ; Lexicon antiquitatum ecclesiasticarum, in-4°, Greifswald,
1669 ; Antiquitatum judaicarurn clavis, Rostock, 1710 ;
Manuale tegum mosaicarum, in-8 », Gustrow, 1666. Ce
dernier ouvrage renferme un exposé méthodique des lois
de Moïse, divisé en trois parties. La première donne ces
lois suivant l’ordre et la division adoptés par les rabbins ;
la deuxième contient le même exposé d’après l’ordre et
la division adoptés chez les chrétiens ; dans la dernière
partie, l’auteur expose, en parallèle avec ces lois, le droit
romain et le droit des gens. Dans le cours de son exposé,
Josué Arndt explique les divers sens du texte des lois
mosaïques. Cet ouvrage, malgré quelques erreurs, ne
manque ni de science ni de mérite. — Charles Arndt,
fils de Josué et professeur de langues orientales à Rostock,
a écrit la vie de son père, qui a été imprimée en 1697,
à Gustrow, sous ce titre : Fama Arndtiana reflorescens.
Voir Nicéron, Mémoires, t. xlih, in-12, Paris, 1745, p. 243.
théologien luthérien, né à Gustrow
(Mecklembourg), le 9 septembre 1626, mort le 5 avril 1687.
11 fut successivement professeur de logique à Rostock,
ministre luthérien et bibliothécaire à Gustrow, prédicateur du duc de Mecklembourg, qui l’éleva, en 1662, à la
dignité de conseiller ecclésiastique. — Voici le catalogue
de ses ouvrages relatifs à la science biblique : Miscellaneorum sacrorum liber unus : in quibus przeter Scriptural Veteris et Novi Testamenti loca illustriora ex
antiquitatibus perspicue explicata, usus verus et plus
profanas doctrinal ad gloriam Del et Verbi ejusdem
intellectum ostenditur, in —8°, Copenhague, 1648 ; Lexicon antiquitatum ecclesiasticarum, in-4°, Greifswald,
1669 ; Antiquitatum judaicarurn clavis, Rostock, 1710 ;
Manuale tegum mosaicarum, in-8 », Gustrow, 1666. Ce
dernier ouvrage renferme un exposé méthodique des lois
de Moïse, divisé en trois parties. La première donne ces
lois suivant l’ordre et la division adoptés par les rabbins ;
la deuxième contient le même exposé d’après l’ordre et
la division adoptés chez les chrétiens ; dans la dernière
partie, l’auteur expose, en parallèle avec ces lois, le droit
romain et le droit des gens. Dans le cours de son exposé,
Josué Arndt explique les divers sens du texte des lois
mosaïques. Cet ouvrage, malgré quelques erreurs, ne
manque ni de science ni de mérite. — Charles Arndt,
fils de Josué et professeur de langues orientales à Rostock,
a écrit la vie de son père, qui a été imprimée en 1697,
à Gustrow, sous ce titre : Fama Arndtiana reflorescens.
Voir Nicéron, Mémoires, t. xlih, in-12, Paris, 1745, p. 243.
ARNHEIM Chayim Halévi, commentateur juif, mort
à Glogau (Prusse), le 22 septembre 1870. On a de lui :
Das Buch Job ûbersetzt und commentirt, in — 8 », Glogau,
1836. Il a de plus collaboré à la version juive —allemande
de la Bible publiée par Zunz, in —8°, Berlin, 1838. Voir
Allemandes (versions), col. 379. Voici les livres qu’il
a traduits : le Pentateuque, les deux livres des Rois, Ézéchiel, Osée, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Zacharie,
Proverbes de Salomon, Job, Ruth, l’Ecclésiaste, Esther
et Néhémie. Voir Steinschneider, Hebràische Bibliographie, 1874, p. 28.
ARNOBE, surnommé le Jeune, pour le distinguer de
l’apologiste africain du même nom, vécut probablement
dans la Gaule méridionale, et fut évêque ou prêtre. Il nous
reste de lui : 1° Commentarii in Psalmos, écrits vers 460,
à la demande des évêques Léonce et Rustique. L’auteur transcrit d’abord le psaume entier, donne ensuite
du texte sacré une interprétation allégorique et typique,
et finit par une doxologie. L’idée mère de ce travail paraît
être de démontrer que le Psautier n’est que l’histoire
anticipée de l’œuvre de la Rédemption. Arnobe est favorable aux théories semi-pélagiennes." Il combat spéciale
ment la doctrine de saint Augustin sur la grâce. Il cite
souvent Origène et plusieurs autres commentateurs. —
2° Annotation.es in quœdam Evangeliorum loca. —
Voir Migne, t. Lin, col. 327-580 ; Ceillier, Histoire des auteurs sacrés, 2e édit., t. x, p. 330-335 ; Histoire littéraire
de la France, 1745, t. ii, p. 342-551.
1. ARNOLD Gottfried, théologien piétiste, né à Annaberg, en Saxe, le 5 septembre 1666, mort à Perleberg, le
30 mai 1714. Après avoir fait ses études à Wittemberg, il
devint, en 1689, professeur à Dresde, et y embrassa les
idées de Spener, dont il fut le plus ardent disciple. Après
la mort de son maître, il fut considéré comme le chef
des piétistes. En 1707, il obtint la charge pastorale à Perleberg, et la garda jusqu’à sa mort. Mécontent des tendances des docteurs de l’Église luthérienne, il les attaqua
dans ses écrits sans aucun ménagement. Persécuté par
ses coreligionnaires, il fut bientôt animé d’une haine
implacable contre les ecclésiastiques de sa confession, et
il en vint à avoir cette idée fixe que le clergé était la source
unique de tous les maux qui avaient affligé l’Église depuis
ses origines. C’est dans cet état d’esprit qu’il écrivit son
Unpartheiische Kirche— und Ketzergeschichte, qui s’étend
depuis le commencement du Nouveau Testament jusqu’en
l’an 1680 de Jésus— Christ. La première édition parut à
Francfort —sur— le —Mein, de 1699 à 1700, 2 in-f° ; nouvelle
édition en 3in-f », Schafïouse, 1740-1743. Cette histoire,
la première qui ait été écrite en langue allemande, et non
en latin, contient l’apologie de toutes les hérésies, et le
clergé y est toujours représenté comme la personnification
du mauvais principe. Parmi ses autres ouvrages, nous mentionnerons comme se rapportant à l’Écriture Sainte:De
lotione manuum ad factura Pilati (in Matth., xxvii, 24),
in-4°, Wittemberg, 1689 ; Kurzgefaste Kirchen— Historié
des alten und neuen Testaments, Leipzig, 1697 ; Wahres
Christenthum des altes Testaments, in-4°, Francfort,
1707 ; Der Historié von der Lehre, Leben und Thaten der
beyden Apostel und Junger Christi Pétri und Pauli, in-8°,
Rostock, 1708 ; Geheime Belrachtungen uber die Psalmen David, in-8°, Cassel, 1713. Voir G. Arnold, Gedoppelter Lebenslauf, Leipzig, 1816, ouvrage qui est en partie
une autobiographie ; Coler, Summarische Nachricht von
G. Arnold’s Leben und Schriften, Wittemberg, 1718 ;
Knapp, Biographie G. Arnold’s, Stuttgart, 1845 ; Gôbel,
Geschichte des christlichen Lebens in der rheinischwestphâlischen evangelischen Kirche, t. ii, p. 698-753 ;
Fr. Dibelius, Gottfried Arnold, sein Leben und seine
Bedeutung fur Kirche und Théologie, Berlin, 1873.
2. ARNOLD Nicolaus, théologien calviniste, né à Lesna,
en Pologne, le 17 décembre 1618, mort le 15 octobre 1680.
En 1639, il devint recteur de l’école de Jablono-w ; en 1641;
il se rendit à Franeker, et, en 1654, il succéda dans cette
ville à Cocceius comme professeur de théologie. On a de
lui, entre autres ouvrages:Lux in tenebris, seu brevis
et succincta vindicatio et conciliatio locorum Veteris et
Novi Testamenti, quibus omnium sectarum adversarii
ad stabiliendos suos errores abutuntur, in-4°, Franeker,
1662 ; 1665 ; édition augmentée, 1680 ; Leipzig, 1698 ; ouvrage
dirigé principalement contre les Sociniens; Exercitationes
theologicm ad Epistolam ad Hebrseos, Franeker, 1679.
ARNON(hébreu :’Arnôn, « rapide » ou « bruyant »,
selon Gesenius, Thésaurus lingux hebrsea}, p. 153 ; Septante :’Apvwv), rivière ou torrent (nahal) qui se jette
dans la mer Morte vers le milieu de son rivage oriental ;
c’est aujourd’hui Vouadi él-Modjib. Limite septentrionale
du pays de Moab, cf. Is., xvi, 2, il le séparait du royaume
des Amorrhéens, Num., xxi, 13, 24, 26 ; Jud., xi, 18, 22,
comme il sépare actuellement le Belqâ’a du pays de
Kérak. Plus tard il marqua la frontière méridionale du
territoire conquis de ce côté par les Israélites (tribu de
Ruben). Deut., u, 24, 36 ; iii, 8, 12, 16 ; iv, 48 ; Jos., xi, « M
ARNON
1022
1, 2 ; xiii, 9, 16 ; Jud., xi, 13 ; IV Reg., x, 33. Voir la carte du pays d’Ammon, col. 490. Dans plusieurs des passages que nous venons d'énumérer, il sert à déterminer le site d’Aroër, « qui est sur la rive de l’Arnon. » Mésa, dans sa fameuse stèle, ligne 26, se vante d’avoir « fait la route de l’Arnon ». Cf. A. de Villefosse, Notice des monuments provenant de la Palestine et conservés au musée du Louvre, Paris, 1879, p. 2, 4 ; F. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., Paris, 1889, t. iv, p. 62. Josèphe le décrit comme « prenant sa source dans les montagnes de l’Arabie, et, après avoir traversé tout le désert (êpriiioç), se jetant dans le lac Asphaltite ». Ant. jud., IV, v, 1. Eusèbe et saint Jérôme parlent d’un endroit de la vallée de l’Arnon, situé au nord d’Aréopolis, « plein d’horreur et de périls, » gardé par des postes militaires, détails qui correspondent exactement à la description des voyageurs modernes. Cf. Onomasticon, Gœttingue, 1870,
VarMaLst Djebel Efoura
Sud-Est
Dj.Chihan.
& « £& ï " >*..&*&&
[[File: [Image à insérer]|300px]]
274. — Coupe transversale de la vallée de l’Ouadi-ModJib.
a. Calcaire à silex rouge à la surface. — o. Marnes à Pholadomya Luynesi. — c. Calcaires gris compacts. — d. Alternances de marnes crayeuses, jaunes et rouges, avec des calcaires tabulaires jaune nankin à Ammonites Luynesi. — e. Calcaire tendre à Ostrea Mermeti, var., minor, 0. vesteularis, var., Jitdaïca. — I. Marnes grises à Eemiaster Foumeli, Ostrea Oliftiponensis, Mermeti, var., carimata, Plicatula Reynesi, Pholadomya, Venus. — g. Calcaire marneux avec bivalves et gastéropodes. — h. Marnes blanchâtres à exogyres. — i. Calcaires jaunes à Ptérodontes et autres gastéropodes. — j. Calcaires à 0. Flabellata, A/ricana, var., Gonyopigus Brossardi, Solectypus Lartetl, Èeterodiadema Libycum, Pterodonta elongata et nodules de spath calcaire. — k. Marne verte salifère. — l. Grès blanc. — m. Grès rouge. — T. Tufs d’inoruetation. — De l’autre coté de l’Ouadl-Modjib, c’est la même succession.
p. 212 ; S. Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxiii, col. 861. La version arabe du Pentateuque, œuvre du Samaritain Abou-Saïd (xi « ou xii B siècle), traduit toujours Arnon par w^= » - ; - « , Mûdjeb. Aboulféda, Tabulée Syrisc, édit. Kœhler, Leipzig, 1766, p. 91, avait également ce nom, changé à tort par l'éditeur. Cf.W. Gesenius, Der Prophet Jesaia, Leipzig, 1821, t. ii, p. 541.
L’ouadi el-Modjib se forme de deux torrents, qui, se creusant un lit dans l'épaisseur du plateau oriental, prennent naissance à une assez grande distance. L’un est le Séil (ruisseau) es-Saidéh, dont la source se trouve au nord-est de Qoutranéh, sur le Derb el-Hadj ou « route des Pèlerins », et qui se dirige vers le nord-ouest entre le Djebel et-Tarfouiyéh et le Djebel el-Ghoûouéitéh. L’autre est l’Enkeiléh, formé lui-même du Ledjoum et du Baloûa, le premier venant du nord-est, le second de l’est. Avant de se jeter dans la mer Morte, il reçoit le Séil Heidân, qui descend également du nord-est.
La vallée de l’Arnon ressemble à une faille énorme, creusée par quelque tremblement de terre dans des assises superposées de basalte, de calcaire, de marne et de grès. (Voir, pour la coupe géologique, fig. 274, d’après Lartet, dans de Luynes, Voyage d’exploration à la mer Morte, Paris, s. d., pi. v, fig. 6 ; cf. t. iii, p. 70). Sa largeur, â l’endroit où on la traverse ordinairement, au-dessous d’Ara’ir (Aroër), est de quatre à cinq kilomètres d’une crête à l’autre, et sa profondeur, du côté sud, un peu plus élevé que le côté nord, est d’environ 650 mètres. La pente septentrionale, à laquelle une végétation assez rare donne une faible teinte de verdure, est si escarpée, qu’il est
-7°
y n bouchure de l’Arnon.
prudent de descendre de cheval. Un sentier mal tracé serpente à travers des terrains où brille le gypse laminaire mêlé à des blocs de basalte, où les bancs calcaires affectent tantôt l’apparence de murs cyclopéens, tantôt celle de colonnes égyptiennes gigantesques, imitant les restes d’un temple antique creusé dans la montagne. C’est une passe dangereuse, où les voleurs, cachés derrière les rochers, attendent et attaquent facilement le voyageur. L’escarpement méridional, encombré par les fragments de roches qui se sont défachés des strates supérieurs, est moins raide. Le point de départ de la descente, sur la route de Rabbah ou Ar-Moab à Dhibân (Dibon), est marqué par un térébinthe, parfaitement visible sur le plateau privé d’arbres, et point de repère précieux pour indiquer le sentier. Celui-ci, suivant une ancienne voie romaine dont on reconnaît çà et là les traces, descend en zigzag sur les flancs abrupts du précipice, au milieu des rocs éboulés.
Au fond de ce gigantesque ravin coule un petit ruisseau, dont le cours est marqué par une bordure d’arbres
et d’arbrisseaux. L’eau limpide murmure sur un lit de cailloux, et nourrit une très grande quantité de poissons qui se laissent facilement prendre ; elle a tracé en plusieurs endroits des marques évidentes de son impétuosité dans la saison des pluies. Après avoir traversé comme un corridor sinueux, creusé dans la montagne, elle vient s'épancher dans la mer Morte (flg. 275) à travers une jungle de saules, de roseaux, de tamaris, d’arbustes divers, d’arbres secs, submergés jusqu’aux branches inférieures, comme on en voit, sur l’autre bord, entre Ain Feschkah et Redjom Louth. On ne compte que quelques passages coriduisant d’un côté à l’autre de cette profonde fissure au fond de laquelle coule l’Arnon. On en signale un près de son embouchure, et un autre, le plus important, dans la partie supérieure de son cours, sur la voie romaine qui allait de Rabbath Moab à Rabbath Amman et franchissait la rivière sur un pont d’une seule arche, aujourd’hui renversée. Deux anciens forts ruinés, avec des débris de colonnes et de constructions diverses, sont les seuls souvenirs du passé.
L’Arnon a été assez bien appelé le Rubicon des Israélites : c’est en le passant qu’ils prirent possession de la Terre Promise. Mais où le passèrent-ils ? Probablement vers ses deux branches du Baloûa et du Ledjoum, là où il coule encore « dans le désert ». Num., xxi, 13. Une double raison, en effet, empêche de croire qu’ils aient suivi la voie débouchant par Aroêr au pays amorrhéen. Comment une si grande multitude se serait-elle, sans nécessité, exposée corps et biens aux dangers d’une route extrêmement difficile, et où le peuple qu’elle voulait vaincre avait tout avantage contre elle ? Ensuite les Israélites, ayant reçu de la part de Dieu défense de combattre les Moabites, Deut., ii, 9, contournèrent leur pays par la frontière orientale, Num., xxi, 11, et arrivèrent à-la partie supérieure de l’Arnon.
Voir J. L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, Londres, 1822, p. 371-375 ; U. J. Seetzen, Reisen durch Syrien, Palâstina, Berlin, 1854, t. ii, p. 364-367 ; E. Robinson, Physical Geography of the Holy Land, , Londres, 1865, p. 16$1-$266 ; duc de Luynes, Voyage d’exploration à la mer Morte, t. i, p. 115-116, 166-167 ; H. B. Tristram, The Land of Moab, Londres, 1874,
p. 124-131.1. AROD (hébreu : 'Arôd ; Septante : 'ApaoSf), sixième fils de Gad. Num., xxvi, 17. Appelé aussi Arodi, Gen., xl vi, 16, d’où la famille des Arodites. Num., xxvi, 17.
2. AROD (hébreu : 'Arâd, « onagre ; » Septante : 'QpîjB), benjamite, cinquième fils de Baria. I Par., viii, 15.
- ARODI##
ARODI, forme du nom d’Arod, Gen., xlvi, 16. Voir Arod 1.
- ARODITE##
ARODITE, de la famille d’Arod. Num., xxvi, 17. Voir Arod 1.
- AROËR##
AROËR (hébreu : 'Ârô'êr ; une fois, Jud., xi, 26, avec transposition du cholem, 'Ar'ôr ; Septante : 'Apoïjp), nom de plusieurs villes situées à l’est et à l’ouest du Jourdain. Gesenius, Thésaurus linguse heb., p. 1073, donne à ce mot le sens de « ruines » ou « édifices dont les fondements sont mis à nu ». D’autres se demandent si l’on ne pourrait pas avec autant de vraisemblance le rapprocher
de l’arabe j££, 'ar’ar, « genévrier ; » dérivation qui
serait semblable à celle de Luz ou Luza, hébreu : Lûz, « amandier, » de Rimmon, « grenadier, » etc.
1. AROËR, ville située « sur le bord du torrent d’Arnon », 'al iefat-nahal 'Arnôn, Deut., ii, 36 ; iv, 48 ; Jos., XII, 2 ; xiii, 9, 16 ; ou « sur le torrent d’Arnon », 'al nafral 'Arnôn, Deut., iii, 12 ; IV Reg., x, 33. Placée sur la rive
droite du fleuve, elle était à l’extrême limite méridionale du royaume de Séhon, roi des Amorrhéens. Jos., XII, 2. Conquise par les Israélites, dont elle marquait également, de ce côté, la frontière sud, Deut., ii, 36 ; iii, 12 ; iv, 48 ; restaurée par la tribu de Gad, Num., xxxii, 34, elle fut, au moment du partage, assignée à la tribu de Ruben. Jos, , xiii, 9, 16 ; IV Reg., x, 33 ; I Par., v, 8. Elle tomba plus tard au pouvoir des Moabites. Jer., xlviii, 19. Plusieurs auteurs prétendent que c’est elle, et non pas celle de Gad, qui est mentionnée II Reg., xxiv, 5 ; elle aurait ainsi servi de quartier général à Joab dès le début de ses opérations pour le dénombrement d’Israël. Voir Aroer 2. Mésa, dans sa stèle, ligne 26, dit qu’il « bâtit », c’està-dire reconstruisit ou releva « Aroër », nyfny]. Cf. A. de Villefosse, Notice des monuments provenant de la Palestine et conservés au musée du Louvre, Paris, 1879, p. 2, 4 ; F. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., Paris, 1889, t. iv, p. 62.
Aroër est ainsi décrite dans VOnomasticon, Gœttirigue, 1870, p. 212 : « Aroër, qui est sur la rive du torrent d’Arnon, ville de Moab, autrefois possédée par l’antique nation des Ommim… On la montre encore aujourd’hui sur le sommet de la montagne ; le torrent, descendant par une pente abrupte, coule dans la mer Morte. » Cf. S. Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum Iieb., t. xxiii, col. 865. Les voyageurs modernes n’ont fait que confirmer ces détails. En suivant la voie romaine qui conduisait autrefois de Rabbath Moab ou Aréopolis à Hésébon (Hesbàn), une heure après avoir franchi le lit de VOuadi el-Modjib (Arnon), et après avoir gravi les flancs escarpés de sa rive septentrionale, on arrive à un site ruiné, appelé 'Ar'âîr par Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, Londres, 1822, p. 372. Le nom et l’emplacement conviennent parfaitement à la cité biblique.
Le sommet sur lequel sont les ruines à." Ar'âîr ne s'élève que faiblement au-dessus du plateau qui l’environne vers le nord, mais du côté du sud il domine la profonde échancrure au fond de laquelle coule l’Arnon. Dans cette dernière direction un magnifique coup d’oeil, tombant sur un paysage qui contraste singulièrement avec celui de la plaine supérieure, embrasse, outre la vallée principale, une seconde vallée, qui vient de l’est, et plusieurs petits vallons. L’ancienne ville d' Aroër était de moyenne grandeur, mais bâtie très régulièrement. On voit encore les restes d’une muraille carrée, composée de grosses pierres brutes, et renfermant un second mur intérieur, plus élevé. Le point central, le plus haut, est marqué par les ruines d’un édifice. On trouve en outre, à l’est et au nord, les traces de faubourgs assez étendus ; celui du nord renferme une pierre dressée sur le point le plus élevé. Cf. C. Schick, Bericht ùber eine Reise nach Moab, im April 1877, dans la Zeitschrift des deutschen Palàstina-Vereins, t. ii, Leipzig, 1879, p. 9 ; traduction dans Palestine Exploration Fund, Londres, 1879, p. 190. « Ces ruines, dit H. B. Tristram, sont sans relief ; je n’y ai pas trouvé trace de temples romains, quoique plusieurs arceaux soient encore debout. » The Land of Moab,
Londres, 1874, p. 130.2. AROËR, « qui est en face de Rabbah, » 'al penê Rabbdh, Jos., xiii, 25, ville de la tribu de Gad, distincte de la précédente. En effet, Josué, déterminant les limites de la tribu de Ruben, dit qu’au sud elles partaient « d' Aroër, qui est sur le bord du torrent d’Arnon », Jos., xm, 16 ; mais, plus loin, fixant les frontières de Gad, il les étend vers l’est « jusqu'à Aroër, qui est en face de Rabbah ». Jos., xiii, 25. En précisant leur situation respective, il prend donc soin de les distinguer l’une de l’autre. Ensuite la Rabbah dont il est question ici ne peut être que celle des Ammonites, Rabbathvmmon, aujourd’hui Amman, puisque, dans le même verset, l’auteur sacré vient de parler de & la moitié de la terre des fils d’Ammon ». Il est clair enfin que V Aroër de l’Arnon, située
à l’extrémité méridionale des possessions israélites, ne pouvait servir de limite commune à deux tribus dont l’une était au nord de l’autre. Cette distinction ressort d’un autre passage, Jud., xi, 33, où il est dit que Jephté, combattant les Ammonites, « frappa d’uu désastre immense vingt villes, depuis Aroër jusqu’aux abords de Mennith et jusqu'à Abel-Keramim. » « Il s’agit certainement ici, de même qu’au ꝟ. 26, d' Aroër de Gad, qui, d’après Jos., xin, 25, n'était pas éloignée de Rabbath-Ammon. Si on voulait y voir Aroër sur l’Arnon, Jephté aurait bien alors poursuivi les ennemis du midi au nord ; mais on n’indiquerait pas comment il eût pu, de l’extrémité méridionale, séparée du pays de Galaad par une longue étendue de terrain, commencer une pareille expédition. Les Ammonites, Jud., x, 17, avaient fixé en Galaad, c’est-à-dire à l’extrême sud de ce pays, leurs tentes, peu éloignées peut-être d' Aroër de Gad. » F. de Hummelauer, Commentarius in libros Judicum et Ruth, Paris, 1888, p. 227.
S’agit-il également de cette ville dans Il Reg., xxiv, 5? La question n’est pas si claire : il importe cependant de la traiter avant de parler d’un emplacement plus ou moins probable. Il est dit, dans ce texte, que Joab et sa suite, partant, d’après l’ordre de David, pour procéder au dénombrement d’Israël, « passèrent le Jourdain et vinrent à Aroër, à droite de la ville, qui est dans la vallée de Gad. » Leur trajet, décrit sommairement, nous les montre remontant de l’est au nord, puis descendant par les côtes de la Méditerranée jusqu'à la ville la plus méridionale de la Terre Sainte, c’est-à-dire Bersabée, pour rentrer de là à Jérusalem. Le commentaire suivant résume l’opinion de ceux qui appliquent notre passage à Aroër sur l’Arnon : « Cette ville célèbre est toujours décrite en ces termes : Aroër, qui est située sur la rive du torrent d’Arnon. Or, qu’elle soit maintenant décrite par ces mots : à droite de la ville, qui est dans la vallée de Gad, cela est tout à fait improbable ; ce serait, en effet, une description du connu par l’inconnu, puisque la vallée de Gad et la ville qui s’y trouvait ne sont mentionnées qu’en ce seul endroit. Donc avec Wellhausen nous unissons Gad au mot suivant : Ils vinrent… en Gad et jusqu'à Jazer. Jazer était presque au milieu de la tribu de Gad, tandis qu' Aroër était dans la tribu de Ruben. L’existence d’une Aroër de Gad, distincte d’Aroër sur l’Arnon, n’est pas suffisamment prouvée d’après Jos., xiii, 25, et Jud., xi, 26, 33 (voir plus haut cependant le commentaire du même auteur sur le dernier texte) ; cette ville existâtelle, il ne s’agit pas d’elle ici, car il est évidemment question d’un circuit commençant par l’extrême limite méridionale au delà du Jourdain, et se terminant à l’extrême limite méridionale en deçà ; enfin, si le trajet commençait à la tribu de Gad, la tribu de Ruben n’eût pas été recensée, quoique, d’après I Par., xxi, 6, les seules tribus de Lévi et de Benjamin soient exceptées. D faut donc traduire ainsi avec Calmet : Et ils campèrent (hébreu, Septante, chaldéen) à Aroër, à droite de cette ville, qui est au milieu de la vallée. Joab, avec sa suite nombreuse, semble s'être successivement arrêté dans les différents endroits où les habitants les plus éloignés pouvaient se rendre… Les mots suivants : en Gad et jusqu'à Jazer, indiquent la direction du voyage à partir d’Aroër, l’auteur ayant toujours devant les yeux le mot suivant : yâbô'û, « ils vinrent. » Il faut avouer cependant que toute la construction devient très simple au moyen d’une légère correction, proposée par Wellhausen, 17H7D, mê'Àrô'êr, au lieu de lyiTn, ba'Àrô'êr : et ils vinrent (Vulgate, syriaque) d’Aroër, de la partie orientale de la ville, qui est au milieu de la vallée, en Gad et jusqu'à Jazer. s, beth, et d, mem, sont très souvent mis l’un pour l’autre ; si le beth se lit maintenant dans tous les textes, ir peut se faire aussi que le changement soit antérieur à toutes les versions. » F. de Hummelauer, Commentarius in libros Samuelis, Paris, 1886, p. 447-448. On trouvera peut-être l’explication un peu compliquée.
BICT. DE LA BIBLE
Ceux qui, sans changer le texte, l’appliquent à Aroër de Gad, cherchent cette ville dans une vallée quelconque au-dessus ou aux environs d’Amman. Pour Gesenius, Thésaurus, p. 1074, la « rivière de Gad » est un bras du Jaboc (Nahr Zerka) ; pour d’autres, le Jaboc lui-même. Pour Keil, Josua, Leipzig, 1874, p. 109, c’est Youadi Amman, et la ville serait Qala’at Zerka Gadda, au nordest d’Amman, sur la route des Pèlerins. Mais peut-on dire d’une localité située à cette distance qu’elle est « en face de Rabbah s ? Et puis n’estelle pas trop dans le territoire ammonite ? Inutile aussi de chercher notre Aroër à Ayra ou Airéh, village situé au sud-ouest d’Es-Salt, sur une colline qui s’avance dans la plaine entre deux cours d’eau : ni le nom ni la distance ne conviennent. En somme, tout en maintenant la distinction entre les deux Aroër, nous restons jusqu’ici dans l’impossibilité de trouver à celle de Gad une identification plausible.
Les deux villes d’Aroër dont nous venons de parler sont vraisemblablement mentionnées dans Isaïe, xvii, 2. Le prophèfe, annonçant la ruine de Damas et celle d’Israël, débute par ces mots :
1. Voici que Damas va cesser d'être une ville, Et elle deviendra un monceau de ruines. _2. Les villes d’Aroër seront abandonnées, Livrées aux troupeaux qui s’y reposeront Sans que personne les en cbasse.
Quelques interprètes ont pensé qu’il s’agit ici d’une ville distincte d’Aroër sur l’Arnon et d’Aroër de Gad. Nous ne le croyons pas. Voici du reste les renseignements que nous fournit l’exégèse. Les manuscrits hébreux n’offrent pour 'Arô'êr aucune variante. Cependant les versions anciennes présentent des divergences. Les Septante, lisant 17 nr, 'âdê 'ad, au lieu de iy"ny, 'Ârô'êr,
ont traduit par eîç tov atwva, « abandonnée pour toujours. » La paraphrase chaldaïque a vu ici un verbe : « leurs villes abandonnées seront dévastées. » La version syriaque porte 'Adô'îr ; mais c’est une faute facile à comprendre, le dolath et le risch ne différant que par un point placé au-dessous ou au-dessus du signe. — Les principales opinions émises par les commentateurs sont les suivantes. J. F. Schelling, qui, dans ses Animadversiones philologico-crit. in difficiliora Jesaix loca, p. 29 et suiv., expose et réfute les conjectures des interprètes modernes, pense qu’il faut lire : ny _ ny, 'âdê-'Ar, « les
villes seront abandonnées jusqu'à Ar, » c’est-à-dire Ar-Moab. D’autres, admettant la leçon du texte hébreu, disent que 'ârê 'Arô'êr est mis pour « villes auprès ou autour d’Aroër », comme, Jos., xiii, 17, 'ârê Ifésbôn signifie « villes autour d’Hésébon », expression correspondant à celle que l’on retrouve si souvent : une ville et ses filles. Dans ce cas, quelques-uns, comme Adrichomius, Iheatrum Terrse Sanctæ, Cologne, 1590, p. 78, font « des villes d’Aroër » une contrée de la Syrie Damascène ; mais on n’en trouve mention nulle part. Gesenius, Der Prophet Jesaia, Leipzig, 1821, 1. 1, p. 556, applique le passage à l' Aroër du nord, celle de la tribu de Gad, et rapporte la dévastation de ce pays à l’invasion de Théglathphalasar. IV Reg., xv, 29. Enfin la plupart des auteurs pensent qu’il s’agit simplement ici des deux Aroër, celle de Ruben et celle de Gad, comme représentant tout le territoire transjordanique, menacé des mêmes châtiments que Damas. Cf. J. Knabenbauer, Commentarius in Isaiam, Paris, 1887, p. 358 ; Trochon, Isaïe, Paris, 1878, p. 105 ; Fr. Delitzsch, Commentar ùber dos Buch Jesaia, Leipzig, 1889, p. 233 ; Rosenmûller, Scholia in Vêtus Testamentum, Jesaias, Leipzig, 1829, t. i, p. 588-589. À. Legendre.
3. AROËR, ville de Juda, mentionnée une seule fois, I Reg., xxx, 28, à propos des dons que David, revenu à Siceleg, après sa victoire sur les Amalécites, envoya à
I. — 35
différentes villes. Le contexte ne permet pas de la confondre avec celles dont nous venons de parler ; les localités citées avec elle appartiennent au midi de la Palestine. Aroër est nommée en égyptien sous la forme Harhorar. Voir Mariette, Listes géographiques des pylônes deKarnak, 1875, p. 36. Robinson croit l’avoir retrouvée à’Ar’ârah, près de l’ouadi du même nom, à l’est-sudest de Bersabée (Bires-Séba). Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, t. ii, p. 199. La ville ancienne est marquée par quelques restes d’habitations, des fragments de poterie et plusieurs puits. Vers le nord, des solitudes formées de collines crayeuses et de vallées sablonneuses présentent çà et là quelques champs cultivés, et forment les limites entre la Judée et le désert.
- AROLA François##
AROLA François, frère mineur, docteur en théologie, a publié : Concordantise majores Bibliorum, Lyon, 1551. Possevin, Wadding, Jean de Saint -Antoine et les autres bibliographes citent cet auteur et son œuvre, sans fournir aucun autre détail, P. Apollinaire.
- AROMATES##
AROMATES, substances végétales qui ont une odeur agréable et pénétrante. Voir Parfums.
1. ARORITE (hébreu : hâ’ârârî). II Reg., xxiii, 33. Dans le passage parallèle, I Par., si, 34, on trouve hahârârî, orthographe légèrement différente ( hé pour aleph) du même mot. Il indique le surnom ou la patrie d’Ahiam, baillant guerrier de l’armée de David. Voir Arari.
2. ARORITE (hébreu : hahârôrî. I Par., xi, 27). — Dans II Reg., xxiii, 25, on lit hahârôdi ; Vulgate : de Harodi. Désignation de la patrie, Harod, d’un autre guerrier renommé de l’armée de David, appelé Semma.
3. ARORITE (hébreu : hâ’ârô’êrî, « l’Aroérite, » c’est-à-dire originaire d’Aroër, patrie de Hotam, père de deux vaillants guerriers de l’armée de David. I Par., xi, 44.
- ARPHAD##
ARPHAD (hébreu : ’Arpâd ; Septante : ’ApçiS), ville de Syrie mentionnée dans l’Écriture, et toujours à côté d’Émath : IV Reg., xviii, 34 ; xix, 13 ; Is., x, 9 ; xxxvi, 19 ; xxxvil, 13 ; Jer., xlix, 23. Sennachérib ou ses envoyés insistent sur la prise d’Arphad et d’Émath pour effrayer les habitants de Jérusalem et les engager à se rendre. En effet, les textes cunéiformes assyriens mentionnent fréquemment une ville de ce nom, Arpaddu, comme ayant pris une grande part à la lutte engagée contre l’Assyrie par tous les États coalisés de l’Asie occidentale, qui tentèrent vainement de sauvegarder leur indépendance. Ramman-Nirari l’avait attaquée dès 806 ; Théglathphalasar, l’allié d’Achaz contre Phacée et Razin, la prit après un siège de trois ans, 743-740 ; elle se révolta, ainsi que les villes d’Émath, de Damas et de Samarie, contre Sargon, père de Sennachérib, et fut de nouveau reconquise par l’Assyrie. The cuneiform Inscriptions of Western Asia, t. ii, pi. 52, rev., 1. 12-26 ; obv., 1. 30, 32, 34 ; Botta, Le monument de Ninive, t. iii, pi. 145, II, 9 ; Menant, Annales des rois d’Assyrie, p. 129, 148, 182 ; Eb, Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, p. 121 et 122, 235, 310, 449. Si Sargon ou Sennachérib la détruisirent, elle ne tarda pas à se relever de ses ruines, à ce qu’il semble, d’après Jérémie, xlix, 23 ; mais les inscriptions cunéiformes n’en disent rien depuis cette époque. Au temps du géographe arabe Iakout, elle était encore habitée ; maintenant il n’en reste plus que des ruines, qui ont conservé leur nom ancien, Tell-Erfâd ou Arfâd. Celte localité est à vingt kilomètres environ au nord de la ville d’Alep. — Une opinion assez commune, suivie par Winer, D. Calmet, Comment, litt. in IV Reg., xviii, 34, édit. lat., Wurzbourg, 1791, p. 435 ; Dictionnaire de la Bible, Genève, 1730, t. i, p. 299, etc., avait confondu Arphad avec Arad ; c’est à tort, car les inscriptions cunéiformes
distinguent soigneusement ces deux villes, absolument comme la Bible : tandis qu’elles mettent Arphad en relation étroite avec Émath et Damas, elles nous disent d’Arad, Aruadu ou Armadu, qu’elle était située ina qabal tihamti, « au milieu de la mer, » ce qui est bien la situation exacte de l’Arad ou Arvad de Phénicie. Michælis la confondait avec la Raphanée de Josèphe et des géographes grecs, à l’ouest d’Émath ; la situation conviendrait assez bien, mais les noms sont trop différents : VArphas de Josèphe, Bell, jud., III, iii, 5, placée à la frontière nord-est de la tétrarchie d’Hérode Agrippa, n’est pas assez au nord pour répondre aux exigences des textes assyriens, tandis que le nom et la situation des ruines A’Erfâd satisfont toutes les exigences. Aussi cette identification est-elle acceptée par les assyriologues : Schrader-Whitehouse, The cuneiform Inscriptions and the Old Testament, t. ii, p. 8 ; Riehm, Handwôrterbuch der bibl. Alterthums, t. i, p. 87 ; Delitzsch, Wo lag dos Paradies, p. 275 ; Kiepert, Zeitschrift des deutschen morgenlàndkchen Gesellschaft, t. xxv, p. 655, et Ndldeke,
ibid., p. 258.ARPHASACHÉENS. Le nom de peuple ainsi écrit, I Esdr., v, 6, doit se lire Apharsachéens, comme le porte le texte original et la Vulgate elle-même, I Esdr., VI, 6. Voir Apharsachéens.
1. ARPHAXAD (hébreu : ’Arpaksad ; Septante : ’Aptpa^aS), mentionné dans la table ethnographique de la Genèse, x, 22, comme fils de Sem, né deux ans après le déluge, et mort à l’âge de 438 ans selon l’hébreu, les Targums et le Syriaque, de 338 suivant la Vulgate, 465, 365 et 335 ans suivant les différentes éditions grecques. Gen., xi, 10-13. Il fut père de Salé et aïeul d’Héber suivant l’hébreu, la Vulgate, etc. ; et au contraire père de Caïnan et aïeul de Salé suivant les Septante reproduits dans la généalogie de Jésus-Christ selon saint Luc, iii, 36.
Comme les noms qui précèdent et qui suivent dans la descendance de Sem sont ethnographiques, Élain désignant la souche des Élamites, Assur celle des Assyriens, Arain celle des Araméens, on s’est demandé si le nom d’Arphaxad n’avait pas également une signification ethnographique. Josèphe, Ant. jud., i, vi, 4, suivi par Eusèbe et saint Jérôme, y avait déjà reconnu l’ancêtre ou le fondateur de l’empire des Chaldéens, qu’il prétend avoir été appelés autrefois Arphaxadiens, ’Apça£a8° iou ; . Suivant l’opinion de Bochart, Phaleg, p. i, 1. ii, c. iv, col. 74, Arphaxad serait la souche ou la personnification des races habitant l’Arrapachitis des géographes anciens (Plolémée, As, , vi, 1, 2), actuellement nommée YAlbak, vers le nord du Zab supérieur, dans la région montagneuse et nord-est de la Mésopotamie ; c’est YArrapha ou Arbafya des textes cunéiformes assyriens. VoirEb. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, p. 164 et 167, note. Cette opinion a été embrassée par D. Calmet, Tuch, Delitzsch, Dillmann, Kautzsch dans Riehm, Handwôrterbuch der biblischen Alterthums, et Gesenius, Thésaurus linguse hebrxx, p. 153. Mais d’abord rien ne prouve que les descendants d’Héber et les Joctanides soient originaires du nord-est de la Mésopotamie ; de plus il est philologiquement impossible d’identifier de quelque façon que ce soit Arphaxad et Arrapha, la syllabe assyrienne ha ne pouvant correspondre à la fois au caf, au schin et au daleth de la forme hébraïque’Arpaksad.
D’autres auteurs, s’attachant à l’indication fournie par Josèphe, voient dans ce nom la souche des Chaldéens, population méridionale de la Mésopotamie de laquelle étaient sortis les Hébreux ; le nom hébreu des Chaldéens Keséd, pluriel Kaèdîm, se retrouve sans trop d’invraisemblance dans la désinence du nom d’Arpa-ksad ; mais le premier élément de ce nom s’explique moins facilement : on y a vu Our ou Irou, « ville » en assyrien, ou même Ur Casdim, la patrie d’Abraham ; Knobel lit Arma-Ksad, le
pays élevé des Chaldéens ; d’autres y voient la racine arp ou arpou, conservée en arabe et en éthiopien, mais disparue des autres dialectes sémitiques, avec le sens de forteresse, mur ou frontière des Chaldéens. Cette dernière conjecture est regardée comme la meilleure par Westcott, dans Smith, Dict. ofthe Bible., 1. 1, p. 115 ; elle est suivie également par Ewald, Geschichte Isræls, Gœttingue, 1864, t. i, p. 405 ; Eb. Schrader-Whitehouse, The cuneifonn Inscriptions and the Old Testament, 1. 1, p. 97. Michælis, Spicilegium geographise tieb. exter., 1780, t. ii, p. 75, avait aussi proposé cette étymologie tout en rejetant pour ce nom d’Arphaxad la signification ethnique. Cependant elle repose sur une coupure tout arbitraire ; de plus le composé ainsi formé n’a pas un seul analogue dans tous les noms de la table ethnographique, qui sont ou des noms d’individus, comme Noé, Sem, ou de simples noms ethniques comme Ha-Iebousi (le Jébuséen) ; enfin les inscriptions cunéiformes qui nous ont conservé un grand nombre d’appellations géographiques mésopotamiennes en renferment qui commencent par Bit, comme Bit-lakin, maison de lakin ; Bit-Houmri, maison d’Omri, c’est-à-dire le royaume d’Israël ; par Dour, comme Dour - ili, forteresse de Dieu, en Bubylonie ; par Kar, etc. ; mais aucun élément initial ne rappelle dans la Mésopotamie méridionale l’Arp d’Arphaxad.
Frd. Delitzsch, Wo lag dus Paradies, p. 255-256, croit pouvoir le rapprocher de l’expression arba kisadi, que l’on retrouve pour désigner le royaume des monarques soitd' Assyrie, soit de Babylonie : sar arba kisadi, « roi des quatre régions » ; mais ce terme n’est pas une localité géographique définie, il désigne uniquement les quatre points cardinaux, et s’emploie aussi bien à Ninive qu'à Babylone ; en outre la formule consacrée n’est jamais celle que propose M. Delitzsch, c’est généralement kiprat irbitti, qui n’offre plus aucune ressemblance avec le nom d’Arphaxad. À cette raison décisive s’ajoutent encore, contre cette opinion, celles que nous avons opposées à l’identification précédente.
L’analogie nous incline donc à penser qu’il se cache quelque désignation ethnographique sous le nom d’Arphaxad, comme cela est certain pour Élam, Assur, Aram et Lud ; suivant l’indication fournie par Josèphe, ce nom doit s’appliquer à quelques populations sémitiques de la Mésopotamie, comme les Chaldéens ou les Babyloniens, dont la Bible ne donnerait pas sans cela les origines ; cette hypothèse est donc vraisemblable : mais la science, à l’heure présente, ne nous donne encore aucun moyen de la vérifier. E. Panmer.
2. ARPHAXAD (Septante : 'AppaÇcfô), roi mède mentionné dans Judith, I, 1-12, comme adversaire de Nabuchodonosor, roi d’Assyrie. Celui-ci le défit à Ragau. Les Septante ajoutent que les États d’Arphaxad furent envahis par le roi d’Assyrie, qui le fit prisonnier et le mit à mort. 1, 12-15.
On remarque dans le livre dé Judith des altérations considérables, particulièrement dans les noms propres. Celui d’Arphaxad est altéré, comme aussi très probablement celui de son adversaire Nabuchodonosor. II est certain d’ailleurs qu’on trouve, dans le livre de Judith, un tableau fidèle de l'état général de l’empire assyrien et des nations tributaires durant le règne d’Assurbanipal, vers l'époque de la révolte de Samas - soum - oukin, roi de Babylone. Robiou, Deux questions de chronologie et d’histoire éclaircies par les annales d’Assurbanipal, dans la Revue archéologique, 1875, et Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 4e série, t. iii, p. 231 ; Vigouroux, La Bible et les' découvertes modernes, 5e édit., t. iv, p. 281-286. C’est, en effet, vers cette époque que les Mèdes, jusque-là divisés en tribus indépendantes, arrivent à constituer un royaume unique, capable bientôt d’entrer « n lutte avec l’Assyrie et de sub juguer les Perses : G. Rawlinson, The five great Monarchies, t. ii, p. 378-383 ; les inscriptions cunéiformes nous représentent aussi les Mèdes comme vaincus par Assurbanipal, roi de Ninive ; malheureusement, les annales d’Assurbanipal faisant défaut pour la dernière moitié de son règne, il ne nous est pas donné d'établir le parfait accord entre les textes assyriens et le texte biblique, et la personnalité d’Arphaxad reste toujours obscure. Comme l’attribution à l'époque de Manassé et d’Assurbanipal des événements rapportés au livre de Judith a seule en sa faveur de très hautes probabilités, nous laisserons de côté sans les discuter les identifications proposées qui ne satisfont pas à cette condition chronologique, par exemple celle de Kitto, Biblical Cyclopœdia, t. i, p. 233, qui voit dans Arphaxad Assuérus ou l’Astyage d’Hérodote ; celle de Kaulen, Einleitung in die heilige Schrift, p. 223, qui le confond avec Arbace.
Hérodote, i, 98, attribue à Déjocès la fondation d’Ecbatane : aussi plusieurs commentateurs ou chronologistes, comme Ussher, Bellarmin, Huet, et récemment Gillet, dans la Bible de Lethielleux, Judith, p. 74, le confondent avec TArphaxad biblique ; mais la Vulgate ne dit pas que ce prince fut le premier fondateur d’Ecbatane ; le terme ledificavit qu’elle emploie, comme l’wxo8<5|Aii<7E des Septante, peut signifier simplement qu’il fortifia, agrandit sa capitale. C’est bien le sens du mot « bâtir » chez les écrivains anciens, sacrés et profanes. Cf. III Reg., XII, 25 ; Strabon, xi, 13, édit. Didot, p. 450, etc. H faut bien reconnaître ainsi que la forme Déjocès, ou sa transcription assyrienne Daiakku, ne se rapprochent guère de la forme biblique. Quant à dire que ce Déjocès s’appelait aussi Phraazad, du nom d’un Phraorte, souche de cette lignée royale, c’est pour le moins très hypothétique.
Houbigant, Montfaucon, dom Calmet, et plus récemment O. Wolf, Bas Buch Judith als geschichlliche Urkunde vertheidigt, 1861 ; Smith, Dictionary of the Bible, t. i, p. 116, et F. Vigouroux, Les Livres Saints et la crirtique rationaliste, ¥ édit., t. iv, p. 568-571, ont rapproché Arphaxad d’un autre Phraorte, fils de ce même Déjocès, en transcription mède et perse Parruvartis ou Pirruvartis, qui régna de 657 à 635. L’bistoire de ce dernier, rapportée par Hérodote, i, 102, s’accorde assez facilement avec le récit biblique : il s’asservit d’abord les Perses, puis d’autres nations circon voisines, et attaqua enfin les Assyriens de Ninive ; mais il fut vaincu et périt avec la plus grande partie de son armée, après un règne de plus de vingt et un ans. Tandis que Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, 1886, p. 496 et 508, et G. Rawlinson, The five great Monarchies, t. ii, p. 383, n. 10, contestent l’existence même de Déjocès et de Phraorte, sans raison bien décisive d’ailleurs, Fr. Lenormant, Lettres assyriologiques, 1™ série, t. i, p. 55-72 ; Lenormant-Babelon, Histoire ancienne de l’Orient, t. v, p. 420-421, 424-428, et Delattre, Le peuple et l’empire des Mèdes, p. 129-175, démontrent l’authenticité des récits d’Hérodote relatifs à ces deux règnes, au moins dans les grandes lignes. Non seulement cette conclusion est aussi admise par M. J. Oppert, mais ce savant n’hésite même pas à attribuer la défaite de Phraorte à Assurbanipal, roi de Ninive (668626), qui est très vraisemblablement le Nabuchodonosor de Judith, Ije peuple et la langue des Mèdes, p. 21. Il est possible que cet événement ait pris place dans la seconde moitié du règne d’Assurbanipal, dont nous n’avons pas les annales ; mais on peut aussi en retrouver quelque trace dans la première partie des annales, qui relatent, avant un soulèvement général des tributaires de l’empire ninivite, à l’instigation de Samas-soum-oukin de Babylone, une campagne contre la Médie et les régions voisines dans laquelle le roi d’Assyrie combattit « Birizljatri, chef des Mèdes, le prit vivant, et l’emmena à Ninive », après s'être emparé aussi « de soixante - quinze places fortes ». The cuneiform Inscriptions of Western Asia, t. iii, p. 31, col. iii, J. 111, col. iv, 1. 15 ; J. Menant, Anna les des rois
d’Assyrie, p. 281 ; Eb. Schrader, Keilinschriftiche Bibliothek, t. ii, p. 178-181, n. 16. La transcription assyrienne Birizhatri recouvre-t-elle les éléments de la forme médique Pirruvartis, grécisée en Phraortès, et à laquelle un scribe hébreu aura cherché un équivalent dans l’onomastique de lui déjà connue ? C’est ce qui ne paraît pas impossible à M. Robiou, Deux questions de chronologie et d’histoire, p. 28-29. Du reste, les noms propres du livre de Judith paraissent tellement altérés, et les différences entre notre Vulgate et les autres versions sont si considérables, qu’il est permis, en l’absence du texte original qui est perdu, de ne pas se montrer trop exigeant pour les questions de détail, une fois qu’on a trouvé dans l’histoire un cadre qui convienne â l’ensemble. Voir Judith.
ARRHES. On entend par « arrhes » une somme d’argent ou quelque autre objet, que l’une des parties contractantes remet à l’autre, au moment du contrat, pour en mieux assurer l’exécution. Dans la vente, le plus souvent c’est l’acheteur qui donne les arrhes ; elles consistent ordinairement alors en argent monnayé, et s’imputent sur le prix total, dont elles sont comme un acompte. Les effets juridiques des arrhes ont varié dans les différentes législations et même dans les phases successives d’une même législation. Néanmoins, on peut dire, d’une manière générale, qu’elles produisent deux effets : 1° elles sont un signe du consentement donné ; 2° elles garantissent l’exécution du contrat, au moins dans ce sens que la partie qui a donné les arrhes se voit obligée d’exécuter ses promesses, sous peine de perdre ses arrhes, n’ayant pas de moyen légal de les retirer avant l’exécution du contrat. Quand les arrhes consistent en une somme d’argent donnée par l’acheteur, et forment ainsi une partie du prix payée d’avance, ce sont les arrhes proprement et strictement dites, très distinctes du « gage » ; mais quand les arrhes consistent en un objet quelconque qui pourra être retiré, lors de l’exécution du contrat, par celui qui l’a donné, elles se rapprochent du « gage ».
I. Dans l’Ancien Testament. — Nous trouvons l’usage des arrhes chez les Hébreux, et même dès la plus haute antiquité. Thamar fait avec Juda, son beau-père, une convention qui engage celui-ci à envoyer à sa bru un chevreau. Thamar, avant de rien exécuter, demande des « arrhes » à Juda. Celui-ci lui remet, à ce titre, son anneau à cachet, le cordon qui le supporte, et son bâton. Gen., xxxviii, 17-18. Nous trouvons dans ce texte, non seulement la chose, mais le mot, répété trois fois, ꝟ. 17, 18, 20 ; hébreu : 'êrâbôn ; Septante : àp’paëwv, d’où sont venus les mots latins arrhabo, arrhes. D’après Gesenius, Thésaurus linguse hebrseie, p. 1064, le mot 'êrâbôn est un terme commercial, signifiant « arrhes » ou « gage », emprunté par les Hébreux aux Phéniciens.
Chez les Hébreux, nous trouvons encore les « arrhes » dans le contrat de mariage, ou plutôt dans les fiançailles, Gen., xxiv, 53 ; toutefois elles sont confondues avec les « présents de noces », d’avec lesquels il serait très difficile de les distinguer. Quelques auteurs ont donné le nom d' « arrhes » à la pièce de monnaie que, chez les Hébreux, dans la cérémonie des fiançailles, le fiancé remettait à sa fiancée ; nous croyons plutôt que la remise de cette pièce de monnaie, d’une valeur ordinairement insignifiante, était une simple cérémonie liturgique, mais symbolisant un fait beaucoup plus important, c’est-à-dire l’achat ou l’acquisition que le fiancé faisait de la jeune fille, en payant à ses parents une certaine somme convenue. Voir Fiançailles. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’on voulut ajouter des arrhes proprement dites aux premières stipulations matrimoniales ; chacune des deux parties déposait une certaine somme, et si l’une des deux rompait l’engagement contracté, l’autre acquérait, en dédommagement, la somme déposée par la partie infidèle. Buxtorf, DeSponsalibus et divortiis, i, 51, dans Ugolini, Thésaurus antir çuitatum sacrarum, Venise, 1765, t. xxx, p. 69.
II. Dans le Nouveau Testament. — Le mot àp’jS aêiiv, « arrhes, » est employé trois fois dans le sens figuré, dans les Épitres de saint Paul. II Cor., i, 22 ; v, 5 ; Eph., i, 14. Dans le premier texte, II Cor., i, 22, l’Apôtre veut prouver que sa prédication et celle de ses collègues dans l’apostolat, Silvain et Timothée, sont conformes à la doctrine infaillible de Jésus-Christ lui-même. « Car, dit-il, celui qui nous confirme en Jésus-Christ, qui nous a oints, c’est Dieu lui - même, lequel nous a marqués de son sceau et. nous a donné les arrhes du Saint-Esprit dans nos cœurs. » D’après l’interprétation la plus probable, 1' « Esprit » dont il s’agit ici désigne les dons du Saint-Esprit, que les théologiens appellent « gratuitement donnés », gratise gratis datée, c’est-à-dire ces dons de prophétie, de miracles, de glossolalie, etc., qui n'étaient pas rares aux premiers siècles de l’Eglise, et qui prouvaient, aux yeux des fidèles, que celui qui les possédait était vraiment l’envoyé de Dieu ; ces dons étaient par conséquent les « arrhes » ou le « gage » de la mission divine et de la véracité doctrinale. Cf.Cornely, Commentarius in S. Pauli epistolam ad Corinthios alteram, Paris, 1892, p. 46-50. — Dans les deux autres passages, le mot àppaëaiv se rapproche encore des « arrhes » proprement dites. Saint Paul, II Cor., v, 5, dit que nous désirons la gloire éternelle, de l'âme et du corps, « et que celui qui nous a préparés à cela, c’est Dieu lui-même, qui nous a donné les arrhes du Saint-Esprit ; » il veut dire que le Saint-Esprit nous est donné comme « des arrhes de notre héritage éternel » ; c’est ce qu’il dit expressément, Eph., i, 14 : âppaëùv tîji ; xXv)povo[ « ac tjh<5v. De même que les arrhes sont une partie du prix, donnée d’avance, pour garantir le payement complet, ainsi Dieu nous donne le Saint-Esprit comme une partie, un avant-goût, et, si nous osions le dire, comme un acompte de notre héritage éternel, afin de nous garantir ainsi la complète exécution de ses promesses.
Aussi, en nous donnant le Saint-Esprit, ce n’est pas simplement un « gage » que Dieu nous a donné ; ce sont des « arrhes » strictement dites, comme portent le texte grec, àp’pa6wv, et la Peschito, rahbuno', mot araméen qui correspond à l’hébreu 'êrâbôn. La Vulgate actuelle, dans les trois endroits cités du Nouveau Testament, a traduit le grec àp’paëiiv par le mot pignus, « gage. » Quant à l’ancienne Italique, ses manuscrits portaient tantôt la leçon arrhee pu arrhabo, tantôt la leçon pignus, ainsi que nous l’apprenons par saint Augustin, Sermo xxiii, 8, t. xxxviii, col. 158-159. Le saint docteur préfère la leçon arrhee ou arrhabo. « Le mot arrhee, dit-il, convient mieux que le mot pignus au don du Saint-Esprit, accordé au juste ; le gage est retiré, quand le contrat s’exécute ; les arrhes ne sont pas retirées, mais complétées ; quand Dieu accomplit sa promesse en donnant au juste la via éternelle, le Saint-Esprit ne lui est pas ôté, mais il est connu plus pleinement ; le don du Saint-Esprit n’est donc pas un simple gage, ce sont des arrhes proprement dites. » S. Augustin, loc. cit., et aussi Sermo clvi, 15, t. xxxviii, col. 858 ; Sermo ccclxxviii, t. xxxix, col. 1673-1674. C’est aussi le sentiment de saint Jérôme ; quoique ce saint docteur ait conservé dans la Vulgate la leçon pignus, « gage, » qui probablement était la plus commune, Divina Bibliotheca, II Cor., i, 22 ; v, 5 ; Eph., i, 14, t. xxix, col. 762, 765, 779, cependant il avoue que la leçon arrhee est préférable à l’autre, et que l’ancien traducteur de l’Italique a substitué le mot « gage » au mot « arrhes » du texte grec. S. Jérôme, In Epistolam ad Eph., i, 14, t. xxvi, col. 457.
S. Many.
- ARROCHE HALIME ou pourpier de mer##
ARROCHE HALIME ou pourpier de mer, plante vivace du genre Atriplex ( arroche), de la famille des chénopodées. C’est un arbrisseau habitant les bords de la Méditerranée, de la mer Morte et des lacs salés. Les fleurs, de couleur pourpre, sont petites et disposées en épis. Les feuilles sont alternes et riches en suc aqueux
et de saveur amère à cause des sels marins renfermés dans leurs cellules (fig. 276).
D’après un grand nombre d’auteurs modernes, l’arroche halime est mentionnée par Job, xxx, 4, sous le nom de mallûah, dans la description qu’il fait des aliments misérables dont se nourrit une tribu qui habite dans des cavernes. C’est le seul endroit de l'Écriture où cette plante soit nommée. Le mot mallûah doit dériver de mêla)}, « sel, » et signifier par conséquent une plante à saveur salée. Cette interprétation est confirmée par la version des Septante, qui ont traduit mallûah par £Xt[ia, de _âX ; ou âXaç, « sel ». (Les éditions des Septante portent ordinairement aXijjLa, avec l’esprit doux, au lieu de l’esprit rude, mais probablement par erreur. La Vulgate a traduit par
[[File: [Image à insérer]|300px]]
276. — Arroche halime. — 6. Fleur. — a. Graine,
un mot vague et général, « herbes » ). De toutes les explications qu’on a données du mot mallûah, celle qui en lait une espèce d’arroche est la plus vraisemblable. Elle est préférable à l’opinion qui voit dans cette plante la mauve ou bien la corréte potagère. Voir Mauve, Corrète. Les feuilles de l’arroche halime, petites et charnues, peuvent être mangées au besoin, et le sont, en effet, par les pauvres en Orient, comme elles l'étaient par les pythagoriciens indigents, d’après Athénée (âXtjjLa Tpwyovreç, Deipnos., iv, 16) ; mais rien ne peut mieux donner l’idée qu’une pareille nourriture de la vie misérable que mènent les troglodytes dont parle Job. « L’arroche halime, dit M. Tristram, croît abondamment sur les cotes de la Méditerranée, dans les marais salés et aussi plus encore sur les côtes de la mer Morte. Nous en trouvâmes des fourrés d’une étendue considérable sur la rive occidentale de la mer Morte et elle nous servit exclusivement à faire du feu pendant plusieurs jours. Elle atteint là une hauteur de dix pieds (trois mètres), plus du double que sur les bords de la Méditerranée… Les feuilles sont petites, épaisses et d’un goût amer ; on peut les manger comme celles de l’A triplex hortensis ou arroche des jardins, mais c’est une bien mauvaise nourriture. » Natural History of the Bible, 8e édit., 1889, p. 466. A. Orban.
ARROSAGE. Voir Irrigation.
- ARROWSMITH John##
ARROWSMITH John, célèbre prédicant anglais de la secte des puritains, né à Newcasfle, le 29 mars 1602, mort en février 1659. Il professa la théologie à Cambridge, où il avait été élevé ; il devint ensuite ministre à Lynn, puis à Londres, et enfin maître de Saint-John’s Collège et de Trinity Collège à Cambridge. De ses nombreux ouvrages, nous ne citerons que le suivant : In priores 18 versus capitis i Evangelii Joannis, in-4°, Londres, 1660. Voir Brook, Lives of the Puritans, t. iii, p. 315-418 ; Neal, History of the Puritans, t. iir, p. 115.
ARSA (hébreu : 'Arsâ, » terre ; » Septante : 'Q<t3 ; Codex Alexandrinus : 'Aptrâ), maître de la maison du roi, à Thersa. Pendant qu’il donnait un festin au roi d’Israël Éla, Zarnbri entra dans sa maison, tua le prince, i|ui s'était enivré, et lui succéda sur le trône. III Reg., xvi, 9.
ARSACE VI Mithridate I" (' kpaixic), 174-136 avant T.-C, fils d’Arsace IV et frère d’Arsace V, roi des Parthes (fig. 277). Ce prince conquérant s’empara de la Bactriane sur le roi Eucratides ; il ajouta également à son empire
, 277. — Monnaie d’Arsace YI.
Tdte dladémée d’Arsaoe TI, à ganche. — ^. BA2IAEQ2 MErAAOV APSAKOT Eni*ANOTS. Arsace I « assis, à droite, sur l’omphalos, et bandant tm arc ; à droite, une palme.
la Médie, et le pays des Élyméens, qui appartenaient aux rois de Syrie, et s’avança jusqu'à l’Inde. Il réunit sous sa domination tout le pays compris entre l’Euphrate et l’Indus. L'Écriture l’appelle roi de Perse et de Médie, parce que c'étaient là les deux provinces les plus importantes du royaume des Parthes. I Mach., xiv, 2. Démétrius II Nicator, roi de Syrie, marcha contre lui pour reconquérir ses États (140 avant J.-C.) ; mais après quelques succès il fut battu. Un des généraux d’Arsace, qui avait reçu l’ordre de le faire prisonnier, accomplit sa mission et l’amena vivant au roi des Parthes ( 138). I Mach., xiv, 2-3 ; Josèphe, Ant.jud., XIII, v, 11 ; Justin, xxxvi, 1 ; xxxviii, 9. Arsace traita son prisonnier avec respect et lui donna sa fille Rodogune en mariage, mais il ne lui rendit pas la liberté. Appien, Syr., 67, 68 ; Diodore, dans Mûller, Hist. Grsec. Fragm., t. ii, 19 ; Josèphe, Ant.jud., XIII, viii, 4. Arsace était un prince sage, qui donna d’utiles lois à son peuple. Pour s’assurer sa protection, Jonathas et Simon lui firent écrire en leur faveur par les Romains. Voir Lucius. I Mach., xv, 22. E. Beuruer.
- ARSENAL##
ARSENAL (Vulgate : amiamentarium). Jusqu'à l'établissement de la royauté en Israël, comme il n’existait encore ni pouvoir central ni armée organisée, il n’y eut nulle part de dépôt d’armes. David, qui fut l’organisateur militaire des douze tribus, commença à rassembler des armes ; il ne les mit point dans un arsenal, mais il les consacra « Dieu dans le tabernacle, II Reg., viii, 7, 10-12 ; I Par., xxvi, 26-27, où l’on pouvait les reprendre pendant la guerre, en cas de besoin. Salomon, son fils, créa de véritables arsenaux, comme en avaient les Égyptiens (fig. 278 et 279). Il en établit un à Jérusalem, dans son palais de la forêt du Liban. La Vulgate porte : In armamen
tario quod erai consitum nernore. II Par., ix, 16. Cf. Is., xxil, 8. Le texte hébreu ne contient pas le mot « arsenal », mais il dit très clairement que le roi se servit de son palais de la forêt du Liban pour y faire un dépôt d’armes. Ses tributaires lui en fournissaient, avec les autres produits de leurs royaumes. III Reg., x, 25. Il avait fait faire des boucliers d’or qui devinrent le butin de Sésac, roi d’Egypte, sous Roboam. III Reg., xiv, 26 ; II Par., xii, 9. Le Cantique des cantiques, iv, 4, semble faire allusion à ces boucliers, et quelques orientalistes pensent que le mot hébreu talpîyyôf (Vulgate : cum propugnaculis) désigne
omis ce mot). Du temps des Machabées, les Juifs prirent beaucoup d’armes sur leurs ennemis. II Mach., viii, 27. Jonathas, I Mach., x, 21, en fit fabriquer en grand nombre. Simon Machabée eut des officiers chargés de s’occuper des arsenaux. I Mach., xiv, 42. Il avait fait, lui aussi, de grandes provisions d’armes. I Mach., xv, 7. Nulle part, du reste, le texte sacré ne nous apprend ce qu'étaient ces arsenaux où l’on déposait les armes, et aucun indice ne nous est donné pour en faire la description. La seule chose qu’on puisse dire, c’est qu’ils étaient vraisemblablement de simples dépôts, et que ce n'était pas là, mais
[[File: [Image à insérer]|300px]]
278. — Collection d’armes égyptiennes. Thèbes. Abd el-Qourna. xviii<> dynastie. D’après Lepsras, Dmkmdler, Abth. iii, pi. et.
l’arsenal où ils étaient conservés. Le fils de Salomon, Roboam, marchant sur les traces de son père, établit des arsenaux dans les principales villes de son royaume : « Il mit dans chaque ville, dit le texte original, des boucliers et des javelots. » II Par., xi, 12. (La Vulgate, pour rendre plus clairement la pensée de l’historien sacré, traduit : ira singulis urbibus fecit armamentarium scutorum et hastarum.)
La suite de l’histoire sainte nous montre que, à l’exemple de David, qui avait offert des armes au tabernacle, ses successeurs en offrirent aussi au temple. Le grand prêtre
probablement chez les ouvriers mêmes, que les armes étaient fabriquées. F. VigouROUx.
- ARSÈNE DE SAINTROBERT##
ARSÈNE DE SAINTROBERT, carme, de la province wallo-belge, professeur de théologie, mort en 1759. Il a édité un livre intitulé : Antilogise sive contradictiones apparentes S. Scripturse a sanctis Patribus et diversis interpretibus eœpositse in breviorem et faciliorem methodum collectée, in-8°, 1744 ; 2= édit., 1751.
J. Olivier.
ART HÉBRAÏQUE. Les beaux-arts ne furent cultivés
Arsenal égyptien. Distribution des armes. Thèbes, Médlnet-Abou. Palais de Eamsès IV. D’après Champolllon, Monuments d’Egypte, t. iii, pi. 218.
Joïada s’en servit pour rendre à Joas le trône de son père. II Par., xxiii, 9. Indépendamment de ces armes conservées dans les dépendances de la maison du Seigneur, les rois de Juda continuèrent à établir des dépôts dans divers arsenaux. Ozias fit fabriquer en grand nombre des boucliers, des cuirasses, des casques, des lanees, des arcs, des frondes et des machines de siège. II Par., xxvi, 14-15. Sous Ézéchias, d’après un passage d’Isaïe, xxil, 8, le palais de la forêt du Liban paraît avoir servi encore d’arsenal. (Le mot hébreu nêséq est traduit par beaucoup d’interprètes, dans ce passage, comme l’a fait la -Vulgate, par « arsenal ».)Ceroi avait fait de grands approvisionnements d’armes, II Par., xxxii, 5, 27, et il montra avec orgueil ses arsenaux (hébreu : bê( kêlâv ; Vulgate : domwmvasorum suorum) aux envoyés de Mérodach-Baladan, roi de Babylone. IV Reg., XX, 13. Depuis Ézéchias jusqu’après la captivité, nous ne lisons rien dans les Écritures qui soit relatif aux dépôts d’armes. Après le retour des Juifs dans leur patrie, un arsenal est mentionné accidentellement par Néhémie, Il Esdr., iii, 19, dans la description qu’il fait des murs de Jérusalem (nêséq ; la Vulgate a
qu’assez tard chez les Hébreux, et ils ne prirent jamais parmi eux un grand développement, à l’exception de la musique. Voir Musique.
Ce peuple fut pendant de longs siècles exclusivement voué à l’agriculture. En Egypte, la masse des descendants de Jacob s’occupa d'élevage et de travaux agricoles. Il en fut de même dans la terre de Chanaan, jusqu'à l'époque des premiers rois. Quelques artistes s'étaient formés en Egypte, tels que Bézélêel et Ooliab. Exod., xxxi, 1-6. Mais dans la terre de Chanaan, l’organisation politique et religieuse de la nation, qui ne réclamait, avant l'établissement de la royauté, ni capitale ni monuments civils ou religieux, n'était point favorable à la culture des arts plastiques ; aussi, quand on en eut besoin pour la construction du temple et des palais royaux, on fut obligé d’emprunter à l'étranger des artistes et des ouvriers. Même sous les rois, l’art fit peu de progrès. Il ne pouvait se développer, à cause de la défense formelle de la loi : « Tu ne feras aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est au-dessous de la terre dans les eaux. 1037
art hébraïque — artaxerxès
1038
Tu ne les adoreras pas et tu ne les serviras pas. » Exod., xx, 4, 5. Toutes les représentations d'êtres vivants étaient donc prohibées. Cette loi fut une des mieux observées. Les violations, telles que Jud., xvii, 5, sont rares. Les Hébreux obéirent à la lettre du précepte divin. Aussi, dans la Bible, n’est-il jamais question de peinture exécutée par les Hébreux, ou par d’autres à leur intention. Les ouvrages de sculpture qui décoraient le temple, les monuments, les tombeaux, ne comportaient guère que des motifs empruntés au règne végétal. C’est tout au plus si, le long des murs du sanctuaire, les bas-reliefs représentaient des chérubins au milieu des coloquintes, des palmiers et des fleurs épanouies. III Reg., vi, 23-35 ; Ezech., xli, 18. De Vogué, Le temple de Jérusalem, p. 32. Cette exception semblait autorisée par la présenee des deux chérubins d’or qui se dressaient sur l’arche d’alliance, et des deux autres qui se tenaient debout dans le Saint des 'saints. Quelques figures d’animaux, comme par exemple les bœufs qui soutenaient la mer d’airain, furent aussi introduites dans le mobilier du temple. II Par., iv, 4. Ces figures apparaissaient d’ailleurs avec l’attitude respectueuse et subalterne qui convient à de simples créatures. Quant à la loi prohibant toute représentation d'êtres vivants, elle s’explique d’elle-même. La peinture et la sculpture ont été chez les anciens les auxiliaires et comme les véhicules de l’idolâtrie. Pour empêcher l’abus des arts, chez un petit peuple isolé au milieu d’un monde tout entier idolâtre, le Seigneur jugea à propos d’en restreindre l’usage, et laissa à d’autres le soin de cultiver la sculpture, la peinture et tous les autres arts représentatifs.
Dans ces conditions, il ne pouvait donc y avoir, à proprement parler, d’art hébraïque. Ce n’est pas à dire que les Hébreux aient vécu étrangers à tout sentiment artistique ; mais toutes les fois qu’ils ont dû faire appel aux ressources de l’art, ils n’ont point su être originaux, et sont restés tributaires des étrangers. Ainsi au désert, après la sortie d’Egypte, leur art est tout égyptien de conception et d’exécution. Voir Arche d’alliance. Quand Salomon veut construire le temple et ses palais royaux, il s’adresse aux Phéniciens, qui fournissaient alors architectes, artistes et ouvriers aux nations avec lesquelles leur commerce les mettait eh rapport, et se faisaient les entrepreneurs de toutes sortes de grands travaux publics. Ces étrangers étaient en même temps fabricants et exportateurs de céramique, de mobilier artistique, de bijouterie, etc. Du reste, ils ne visaient pas à l’originalité ; leur art s’inspirait presque exclusivement de l’art des Égyptiens et des Assyriens, et s’accommodait aisément aux fantaisies ou aux exigences de ceux qui réclamaient leurs services. En un mot, les Phéniciens étaient beaucoup moins artistes qu’habiles entrepreneurs ; le profit leur importait plus que la gloire. En les invitant à travailler pour leur compte, les Hébreux, si peu artistes eux-mêmes, n’appelaient donc à leur aide qu’un art composite et de seconde main. Voir Architecture hébraïque. Les choses ne se passèrent guère autrement à l'époque de Zorobabel et à celle d’Hérode. Après la captivité, quelques Israélites s’adonnèrent à la culture des arts ; mais ce fut toujours un art étranger qui fut mis à contribution par les Juifs ; ils se contentèrent de lui imposer les modifications réclamées par la loi divine ou par les nécessités du service du temple.
Les monuments qui permettraient de se faire quelque idée de l’art hébraïque sont extrêmement rares. Il n’y a pas lieu de s’en plaindre outre mesure. Les monuments égyptiens, assyriens, phéniciens, perses, grecs et romains fournissent lés éléments de ce qu’ont été, suivant les époques, les œuvres d’art exécutées ou commandées par les Hébreux. Voir Architecture, Peinture, Sculpture, Glyptique, Temple, Tombeaux. Pour les arts mécaniques, voir Artisans. Cf. Gugler, Kunst der Hehrâer, Landshut, 1614 ; Cleghorn, History of ancient and modem
Art, Edimbourg, 1848 ; de Saulcy, Histoire de l’art judaïque, Paris, 1858 ; Perrot et Chipiez, Histoire de l’art
dans l’antiquité, t. IV.- ARTABAN##
ARTABAN, historien juif. Voir Artapan.
- ARTABE##
ARTABE (àpTâ6ï|), mesure de capacité employée par les Perses, et aussi par les Égyptiens et les Arabes. Elle est mentionnée seulement dans le chapitre xiv, 2, de Daniel, que nous n’avons plus qu’en grec. Nous y lisons que les Babyloniens offraient tous les jours à l’idole de Bel « douze artabes de farine ». Hérodote, I, 192, édit. Teubner, p. 102, nous apprend que l’artabe des Perses valait un médimne attique, plus trois chénices, c’est-à-dire environ 55 litres. D’après Polyen, iv, 3, 32, édit. Teubner, p. 141, l’artabe équivalait au médimne, c’est-à-dire à 51 litres 79. Comme à l'époque où se passe l'événement raconté par le livre de Daniel, les Perses étaient maîtres de Babylone, c’est certainement de l’artabe dont ce peuple faisait usage qu’il est question ici. — Les Septante ont aussi, employé le mot « artabe », dans leur traduction d’Isaïe, v, 10. Le texte original porte « un hômér t> (Vulgate : triginta rnodii) ; le grec met : « six artabes, » qui équivalent, en effet, à peu près à un hômér. Cf. Revue égyptologique, t. ii, 1881, p. 197. Voir Hômér.
- ARTAPAN##
ARTAPAN, historien juif, de date incertaine, qui vivait en Egypte avant notre ère, et qui écrivit un livre en grec sur les Juifs, LUpl 'Iou6cua>v. Il n’en reste qu’un très petit nombre de fragments qui nous ont été conservés par Clément d’Alexandrie, Strom., i, 23, t. viii, col. 900 ; la Chronique pascale (an 2 de Moïse), t. xcii, col. 201 ; Eusèbe, Prsep. Ev., ix, 18, 23, 27, t. xxi, col. 709, 719, 728, etc., et une Chronique anonyme, dans J. A. Cramer, Anecdola grsscae codicibus manuscriplis Bibliothecse regise Parisiensis, 4 in-8°, Oxford, 1839-1841, t. ii, p. 176. Josèphe avait l’ouvrage d' Artapan entre les mains, et il s’en est servi dans la composition de ses Antiquités judaïques. Voir J. Freudenthal, Alexander Polyhistor, in-8°, Breslau, 1875, p. 169-171. Par ce qui nous reste du Tlept 'IouScu’oiv, on voit que l’auteur s'était proposé la glorification des Juifs : c’est à eux, d’après lui, que les Égyptiens devaient leur science : Abraham, lors de son voyage en Egypte, apprit l’astronomie au roi de ce pays, Pharéthotès ; Joseph et Moïse enseignèrent l’agriculture aux habitants des bords du Nil, etc., Moïse (Eusèbe, Prsep. Ev., ix, 27, t. xxi, col. 728) leur apprit même à honorer les dieux, il divisa l’Egypte en trente-six nomes, et donna aux prêtres les signes de l'écriture. Cette défiguration de l’histoire profane en faveur des Juifs est le trait commun de plusieurs des écrivains de cette nation, qui vécurent à Alexandrie. Voir Alexandrie (École exéoétique d'), col. 359. Cf. C. Mûller, Fragmenta histor. grœc., t. iii, p. 207-208 ; E. Schûrer, Geschichte des jûdischen Volkes, t. u (1886), p. 735-736 ; Vaillant, De historicis qui ante Josephum Judaicos res scripsere, in-8°, Paris, 1851, p. 74-83.
ARTAXERXÈS. Hébreu : 'ArtahSaStâ', 'Artahsastâ' et 'ArfahSaSte' ; Septante : 'ApTaÇépÇï|ç ; dans Hérodote et dans Plutarque : . 'ApToÇépÇïji ; . En susien ou médique :
A - r - tak - sas - sa. En assyrien :
Artaaksaatsu,
Artaksatsu. 1039
ARTAXERXÉS I »
1040
Voir Oppert, Expédition en Mésopotamie, t. ii, p. 14 et 194. En perse, le nom se lisait Artakhsatra,
ttt ^T^TtK^T^^ ttt
Artkhstr~ a,
corrompu ensuite en Artakhcasda, d’où proviennent les formes hébraïques, et en Artakhchaarcha, qui a donné lieu à la transcription grecque. La forme pehlvie Artashatra est un retour à l’ancienne prononciation perse. Voir Oppert, Le peuple et la langue des Mèdes, Paris, 1879, p. 232. Artakhsatra signifie « le grand guerrier », ou « celui qui a un grand pouvoir ». Le nom d’Artaxerxès revient plusieurs fois dans la Bible.
— 1° Il se trouve d’abord dans la partie grecque du livre d’Esther, mais uniquement par suite d’une faute de transcription, les Septante ayant cru à tort que l’Assuérus d’Esther, c’est-à-dire Xerxès I er, était Artaxerxès.Voir Assuérus.
— 2° Il se lit ensuite dans les livres d’Esdras. Les anciens commentateurs, écrivant antérieurement à la découverte des inscriptions perses, ont cru que l’Artaxerxès nommé I Esdr., iv, 7, après un Assuérus qu’ils n’avaient pas les moyens d’identifier sûrement, était Cambyse ou le faux Smerdis (Bardiya). Mais aujourd’hui l’identification d' Assuérus et de Xerxès I er est établie avec toute la certitude désirable ; l’Artaxerxès du livre d’Esdras est donc nécessairement un prince postérieur à Xerxès I er. D’ailleurs le nom perse d’Artaxerxès est absolument irréductible à ceux de Cambyse ou du faux Smerdis ou Bardiya. Ce dernier même, dont le règne usurpé n’a duré que sept mois, n’a pu avoir ni le temps de s’occuper des affaires juives, ni surtout l’idée de s’aliéner les Israélites qui vivaient au cœur même de l’empire, en mettant obstacle à la reconstruction de Jérusalem. L’Artaxerxès du livre d’Esdras doit en conséquence être cherché parmi les trois rois de ce nom que l’on compte dans la dynastie des Achéménides. Le dernier, Artaxerxès III OchUs (358-337), est beaucoup plus récent que les événements qui font le sujet des livres d’Esdras ; nous n’avons donc pas à nous occuper de lui. Seuls, Artaxerxès I er et, selon quelques-uns, Artaxerxès II, ont été mêlés à ces événements et doivent être mentionnés ici.
1. ARTAXERXÈS I" (464-424 avant J.-C), surnommé Longue -Main, parce qu’il avait une main plus longue que l’autre, était fils de Xerxès I er (fig. 280). La date de son accession au trône est importante à préciser, parce que d’elle dépend celle des décrets qui ont permis la re 580. — Darique d’Artaxerxès Longue -Main. Artaxerxès I « ', agenouillé, portant la couronne sur la tête, et tenant dans la main droite unejaveline, dans la gauche un arc. — ç. Un carré creux irrégulier.
construction des murs de Jérusalem, et, dans une certaine mesure, celle qui sert de point de départ aux soixante et dix semaines de Daniel. Xerxès fut assassiné par Artaban, la quatrième année de la lxxviii 8 olympiade (465 avant J.-C.). Diodore de Sicile, xi, 69, et le Canon de Ptolémée. Mais l’usurpateur garda sept mois le pouvoir. Ces sept mois sont comptés tantôt au régne de Xerxès, tantôt à celui de son successeur. En réalité, Artaxerxès ne put monter sur le trône qu’en 464. C’est en cette année-là que Thémistocle, arrivant à Suse, le trouva inaugurant
- ûn règne. Thucydide, i, 137 ; Charon deLampsaque, dans
Plutarque, Themistocl., 27. Le nouveau roi eut d’abord à lutter contre son frère Hystaspe, qui avait soulevé contre lui la Bactriane. Il remporta deux victoires et soumit le
pays (462). Mais le roi d’Egypte, Inaros, avait profité de ces troubles pour tâcher de secouer le joug des Perses. Les Athéniens, qui ne pouvaient se passer de la bienveillance de l’Egypte, parce que c'était de ce pays qu’ils tiraient la plus grande partie du blé nécessaire à leur subsistance, se hâtèrent de venir au secours d’Inaros. Grâce à leur intervention, le général Achéménès put anéantir, près de Memphis, une armée perse de trois cent mille hommes. Artaxerxès ne voulut pas rester sous le coup de ce désastre ; il leva une nouvelle armée, rassembla une nouvelle flotte, et, cette fois, le général perse, Mégabyze, battit les Égyptiens et les Grecs à Prosopitis et mit fin à la guerre (455). Thucydide, i, 109 et suiv. Cette lutte occupa Artaxerxès de la quatrième à la neuvième année de son règne. Cependant la septième année (457), aors probablement que ses affaires prenaient meilleure tournure en Egypte, le prince autorisa le scribe Esdras à revenir de Babylone à Jérusalem avec une nombreuse caravane d’exilés. Il fournit lui-même et permit à ses sujets d’offrir une quantité considérable d’or et d’argent pour le temple, et donna à Esdras le pouvoir de puiser dans le trésor royal jusqu'à cent talents d’argent (environ 850000 fr.), sans compter les réquisitions en nature. I Esdr., vii, 23. Peut-être voulait-il, par ces largesses et ces mesures bienveillantes, s’assurer le dévouement et la reconnaissance des Juifs, et faire de cette petite nation comme une sentinelle avancée sur le chemin de l’Egypte.
Après la victoire de Prosopitis, Mégabyze avait promis la vie sauve au roi Inaros. Cédant aux instances de sa mère, Amestris, et de sa sœur, Amytis, qui exerçaient sur lui la plus grande influence, Artaxerxès respecta d’abord ; la parole donnée, mais ensuite fit périr le malheureux vaincu (450). Mégabyze, indigné, souleva la Syrie. Les ennemis des Juifs mirent cette circonstance à profit pour faire obstacle à la reconstruction de Jérusalem, commencée par Zorobabel. Ils écrivirent à Artaxerxès que la ville de Jérusalem sortie de ses ruines était une cité « rebelle et perverse », qu’elle refuserait de payer le tribut, que d’ailleurs elle avait toujours été « nuisible aux rois et aux provinces », et que, si on la laissait rebâtir, le roi ne posséderait bientôt plus rien au delà de l’Euphrate. I Esdr., iv, 11-16. Artaxerxès prit au sérieux la dénonciation. Craignant que les Juifs ne devinssent un appui pour les Syriens révoltés, et plus tard pour les Égyptiens, si ces derniers tentaient de relever la tête, il ordonna à ses satrapes d’empêcher la reconstruction de la ville. I Esdr., iv, 17-22. Bientôt après, sur l’intervention des deux princesses, Mégabyze rentra en grâce ; plus tard, il leur dut encore de n'être qu’exilé, quand le roi voulut le faire périr, pour avoir tué à la chasse un lion que le prince eût désiré frapper luimême. D’un autre côté, les Athéniens n’avaient pas pris leur parti de la défaite essuyée en Egypte. Ils ne tardèrent pas à recommencer les hostilités. Mais, en 449, le roi renonça à toute entreprise contre les pays de la confédération attique, et la paix fut rétablie. Thucydide, i, 112 ; Plutarque, Cimon, 19 ; Pericl., 11 ; Curtius, Histoiregrecque, trad. Bouché -Leclerq, in-8°, Paris, 1882, t. ii, p. 394 et suiv.
Artaxerxès n’avait plus rien à craindre d’aucun côté, quand, la vingtième année de son règne (445), le juif Néhémie, qui remplissait à la cour la fonction d'échanson, . osa lui demander l’autorisation d’aller rebâtir Jérusalem. Néhémie n’avait probablement pas manqué d’intéresser la reine à sa cause, et c’est pourquoi il note si soigneusement sa présence auprès du roi, au moment où il lu » adressa sa requête. II Esdr., ii, 6. Il fut autorisé à revenir en Judée, avec pleins pouvoirs pour reconstruire Jérusalem. II Esdr., ii, 1-8. U y resta jusqu'à la trente-deuxièmeannée du règne (433). Cette année-là, il alla visiter le roi à Suse, II Esdr., v, 14 ; xiii, 6, puis revint pour continuer son œuvre en Judée. L'Écriture ne fait plus ensuite mention d’Artaxerxès, qui mourut neuf ans après.
Les faits que racontent les livres d’Esdras trouvent, . 4041
ARTAXERXËS I" — ARTAXERXÈS II
1042
comme on le voit, leur place naturelle et très suffisamment justifiée dans la trame de l’histoire d’Artaxerxès I er. On a pensé pourtant que le récit qui termine le premier livre, vii-x, n'était peut-être pas à sa vraie place ; il a paru peu naturel qu’Esdras ait été autorisé à recueillir des sommes considérables et à réquisitionner des provisions dans le pays même que les troupes royales allaient avoir à traverser. Frappé de ces raisons, M. Van Hoonacker, professeur à l’université de Louvain, a cherché à démontrer que le retour d’Esdras n’avait pas eu lieu treize ans avant Néhémie, sous Artaxerxès I er, mais cinquante-neuf ans plus tard, sous Artaxerxès II. Voici les principales raisons sur lesquelles il appuie sa thèse : 1° Néhémie est envoyé à Jérusalem pour rebâtir la ville sainte et ses murs, II Esdr., ïi, 5 ; Esdras, au contraire, trouve la ville rebâtie, et s’y occupe surtout de l’organisation du culte et de la réforme des mœurs. I Esdr., vii-x. — 2° Quand Néhémie revient, c’est le grand prêtre Éliasib qui est en fonction, II Esdr., iii, 1 ; sous Esdras, c’est Johanan, fils d'Éliasib. I Esdr., x, 6. Ce Johanan ne serait autre que Jonathan, nommé dans la liste des grands prêtres, II Esdr., XII, 10-11, comme fils de Joïada et petit-fils d'Éliasib. Josèphe, Ant.jud., XI, vii, 1, 2, l’appelle aussi 'Iioâwïi ; . Bien que petit-fils d'Éliasib, il est présenté comme son fils, parce que le pontificat de Joïada ne paraît avoir été ni long ni important. — 3° Esdras fait rompre les mariages contractés avec les femmes étrangères, et cette mesure est si bien acceptée, que l’on fait le dénombrement de ceux qui avaient contracté ces unions, et que l’on garde la liste des prêtres qui eurent à répudier les étrangères. IEsdr., x, 11-44. Sous Néhémie, ces sortes de mariages sont fortement blâmés, mais non rompus ; on ne fait aucune allusion à la réforme radicale qui aurait été exécutée vingt-cinq ans auparavant, et on voit même un petit-fils du grand-prêtre Éliasib marié à une étrangère. II Esdr., xin, 23-28. — 4° Si, la septième année d’Artaxerxès I « r, Esdras arrive à Jérusalem muni de pleins pouvoirs et exerce parmi ses compatriotes une autorité incontestée, comment peut-il, treize ans plus tard, n’apparaître que comme simple scribe, lecteur de la loi, aux côtés de Néhémie, sans qu’il soit fait allusion au grand rôle rempli par lui précédemment ? — 5°> Si, en l’an 457, Artaxerxès I er, malgré les grandes difficultés qui le préoccupaient, s’est montré si franchement sympathique aux Juifs et si généreux envers leur temple ; si, au moment où ses armées allaient et venaient à travers la Palestine, il a constaté que Jérusalem méritait toutes ses faveurs, comment, six ou sept ans plus tard, a-t-on osé lui écrire une lettre de dénonciation si calomnieuse contre ses protégés, I Esdr., iv, 11, et comment a-t-il pu l’accueillir si facilement ? Voir Van Hoonacker, Néhémie et Esdras, in-8°, Louvain, 1890, et Le Muséon, janvier 1892, t. xi, p. 83. Les conclusions qui ressortent de ces remarques sont que les chapitres vu-x du premier livre d’Esdras traitent de faits postérieurs et non antérieurs à ceux que raconte le second livre, et qu’Esdras, venu une première fois à Jérusalem avec Néhémie, comme simple scribe, âgé d’une trentaine d’années, retourna ensuite en Perse, et revint en Judée, à la tête d’une nouvelle caravane, avec l’autorisation et la faveur d’un autre Artaxerxès. A. Kuenen a combattu ces conclusions dans un mémoire présenté à l’Académie royale des sciences d’Amsterdam, et intitulé De chronologie van hel perzische lijdvak der joodsche geschiedenis, 1890. La principale raison invoquée est la supposition que la réforme des mariages mixtes entreprise par Esdras aurait avorté. Le célèbre rationaliste ajoute d’ailleurs que l’ancienne hypothèse maintenait mieux « le terrain sur lequel la critique moderne élevait l'édifice de sa théorie sur la formation de l’Hexateuque ». M. Van Hoonacker a répondu en réfutant les objections de Kuenen, et en démontrant que la réforme d’Esdras a pleinement réussi, ce dont le texte sacré ne permet pas de douter. Néhémie en Van 20 d’Artaxerxès I", Esdras
en Van 7 d’Artaxerxès II, Gand, 1892. Voir Le Muséon, janvier 1892, p. 86. Voici comment les faits rapportés I Esdr., vu-x, prendraient place, d’après lui, dans l’histoire d’Artaxerxès II. L’exposé de son système. sera suivi de la discussion critique des raisons sur lesquelles il s’appuie.
2. artaxerxès II (fig. 281) (405-358 avant J.-C.) fut surnommé Mnémon à cause de sa mémoire extraordinaire. Second fils de Darius II Nothus, il fut investi de la royauté au détriment de Cyrus, son frère aîné. Sa douceur et sa générosité le portèrent à laisser à ce dernier les titres de vice-roi et de généralissime des troupes royales.
Î81. — Darlque d’Artaxerxès Mnémon.
Artaxerxès II, tenant une javeline de la main droite et un arc dô
la main gauche. — Sf. Carré creux irréguller.
Mais Cyrus mit les Grecs dans ses intérêts, se révolta contre son frère, fut défait et périt à la bataille de Cunaxa, près de Babylone (401). Xénophon, Anabas., i, 8, 24 et suiv. ; Plutarque, Artaxerx., 10. Les treize mille Grecs qui l’avaient soutenu entreprirent alors cette fameuse retraite dont l’Athénien Xénophon fut le chef et plus tard l’historien. Anabas., ii, 5, 24 et suiv. La lutte séculaire entre les Perses et les Grecs se concentra alors en Asie Mineure. Les Spartiates y guerroyèrent, avec des péripéties diverses, contre Tissapherne, satrape des provinces maritimes, et Pharnabaze, satrape des provinces septentrionales de l’Asie Mineure (Xénophon, Hellenic., iii, 1, 3 ; Diodore de Sicile, xiv, 35). En 399, ce dernier conclut un armistice, Diodore, xiv, 39, qui ne fut rompu qu’en 396, par Tissapherne. Xénophon, Hellenic., iii, 4, 11-15. La lutte se poursuivit jusqu’en 387, où le traité d’Antalcidas consacra la souveraineté d’Artaxerxès II sur les villes et plusieurs lies d’Asie. Xénophon, Hellenic., v, 1, 31 ; Diodore, xiv, 110 ; Plutarque, Artaxerx., 21. Voir Curtius, Histoire grecque, t. iv, p. 161 et suiv. Artaxerxès II n’eut donc point à subir de grands revers, comme Artaxerxès I" ; après la bataille de Cunaxa, la paix régna sur le continent asiatique, et le théâtre de la lutte avec les Grecs resta très éloigné de la Chaldée, de la Judée et des provinces intermédiaires. Une caravane de Juifs pouvait donc se rendre en toute sécurité de Babylone à Jérusalem. Bien plus, la septième année de son règne, en 398, Artaxerxès II, dont le caractère était bienveillant, n’avait rien à démêler avec les Grecs. Les ressources du trésor royal étaient alors en partie disponibles. Esdras aurait profité de ces heureuses conjonctures et des dispositions favorables du prince, pour obtenir l’autorisation de conduire à Jérusalem une nouvelle caravane. Agé d’une trentaine d’années quand il accompagna Néhémie à Jérusalem, en 445, il en aurait eu alors environ soixante-quinze. C'était un âge assez avancé, mais qui permettait fort bien à Esdras de remplir le rôle qu’on lui suppose.
Les arguments invoqués en faveur de la thèse qui place le retour d’Esdras sous le règne d’Artaxerxès II sont spécieux, parfois même paraissent assez plausibles. Toutefois, jusqu'à présent du moins, ils ne semblent pas suffisants pour autoriser une modification si considérable dans l’histoire traditionnelle d’Esdras et dans la disposition des livres qui la racontent. Voici ce qu’on pourrait opposer aux principaux arguments de M. Van Hoonacker, résumés plus haut : — 1° Il est bien vrai que Néhémie arriva à Jérusalem avec le projet de rebâtir la ville, II Esdr., ii, 5, et sa qualité de gouverneur le mettait à même d’exécuter ce dessein. Quant à Esdras, qui n'était qu’un simple prêtre, ,
sans autorité civile, son rôle devait se borner, d’après la teneur même du décret d’Artaxerxès I", à la réorganisation du culte dans le temple de Jérusalem, rétabli avant la ville elle-même. Rien, dans les chapitres vn-x du premier livre, ne suppose la ville déjà relevée de ses ruines. Il n’y est question que d’institutions religieuses et de réformes morales. Les événements racontés dans ces chapitres peuvent donc parfaitement être antérieurs à l’arrivée de Néhémie. — 2° Néhémie accomplit sa mission sous le pontificat d'Éliasib, II Esdr., iii, 1, et, de son côté, Esdras se retira au temple dans la chambre de Johanan, fils d'Éliasib, I Esdr., x, 6. Mais il est loin d'être démontré que l'Éliasib, père de Johanan, soit le même personnage que le grand prêtre. Johanan et Jonathan peuvent sans doute être deux formes différentes d’un même nom ; mais deux versets consécutifs du second livre, xii, 22, 23, autorisent à admettre une distinction entre le grand prêtre Éliasib, qui a pour fils et successeurs Joïada, Johanan et Jeddoa, et Éliasib, chef des familles lévitiques, et qualifié de père de Jonathan. Quoi qu’il en soit d’ailleurs de ces deux versets, nous trouvons dans le premier livre un Éliasib père de Johanan, un Éliasib chantre, un Éliasib fils de Zéthua, et un Éliasib fils de Bani. I Esdr., x, 6, 24, 27, 36. Le Johanan fils d'Éliasib, dans la chambre duquel se rendit Esdras, peut donc fort bien être contemporain du grand prêtre Eliasib. — 3° La conduite différente d’Esdras et de Néhémie au sujet des mariages mixtes n’implique point la nécessité de faire agir Néhémie antérieurement à Esdras. Ce dernier, en sa qualité de prêtre, a imposé des mesures plus radicales que Néhémie, dont l’autorité était purement civile. La réforme d’Esdras a réussi, sans nul doute ; mais il n’est pas extraordinaire que l’abus ait reparu par la suite, et que vingt-cinq ans plus tard Néhémie se soit contenté de jeter la défaveur sur ces unions étrangères, sans cependant les prohiber. La loi d’ailleurs ne défendait formellement que les mariages avec les Chananéens, Deut., vii, 3, 4, et ceux des femmes d’Israël avec des Moabites et des Ammonites, Deut., xxiii, 3. Les autres unions étrangères pouvaient être tolérées, et la descendance qui en provenait faisait partie de la nation après quelques générations. La conduite de Néhémie s’explique donc ; pour autoriser la mesure relativement indulgente qu’il prenait, il n’avait pas à s’appuyer sur la prohibition beaucoup plus sévère portée antérieurement par le célèbre scribe. — 4° La septième année d’Artaxerxès I er, Esdras exerce à Jérusalem une incontestable autorité, mais cette autorité est surtout religieuse. Treize ans plus tard arrive Néhémie, qui est tirSâtd' (voir Athersatha), c’est-à-dire personnage officiel muni de pleins pouvoirs pour gouverner la province de Judée au nom du roi. Pour la postérité, Esdras, le savant scribe t le pieux et énergique réformateur, le restaurateur du culte, fut un homme bien supérieur au firSatâ' ; mais, aux yeux des contemporains, le gouverneur, revêtu de l’autorité officielle, occupait incontestablement le premier rang. Il est done tout naturel qu’Esdras apparaisse seulement à ses côtés pour remplir les fonctions de son ordre, c’est-à-dire faire la lecture de la loi dans une circonstance solennelle. — 5° Enfin le changement d’attitude d’Artaxerxès I er vis-à-vis des Juifs peut être aisément expliqué par les circonstances. En sept années, bien des idées se modifient dans l’esprit d’un prince circonvenu par une multitude de courtisans ou d’intrigants, qui lui présentent les faits conformément à leurs passions ou à leurs intérêts. Les arguments apportés par le critique belge ne sont donc pas suffisants pour rejeter la thèse traditionnelle.
ARTÉMAS ('ApTe|xîç, contraction d"Apte(iî8wpoc, « don d’rvtémis ou Diane » ), disciple que saint Paul, au cours du voyage qu’il fit en Orient, après sa première captivité, se proposait d’envoyer à Tite, en Crète. Tit., iii, 12. On ne sait rien de ce personnage. Il avait du moins l’estime de saint Paul, qui le jugeait capable de suppléer Tite dans le
gouvernement de l'Église de Crète. On croit qu’il fut ensuite évêque de Lystres. Voir Acta Sanctorum, xxi juin.
ARTÉMIS ("ApT5|xi<), nom grec de la déesse des Éphésiens, appelée Diane dans la Vulgate. Act., xix, 24, 27, 28, 34, 35. Voir Diane….
- ARTIGNY##
ARTIGNY (Antoine Gachat d'), né à Vienne, en Dauphiné, le 8 novembre 1706, mort le 6 mai 1778. Il était chanoine et passa sa vie dans les recherches littéraires et bibliographiques. Connu principalement par ses travaux littéraires, il est néanmoins rangé parmi les auteurs du xviiie siècle qui ont écrit sur la Bible, à cause de son ouvrage intitulé : Nouveaux mémoires d’histoire, de critique et de littérature, 4 in-12, Paris, 1749-1751 (Bibliothèque nationale. Z 28794). Dans le tome I er de cet ouvrage, il traite plusieurs questions se rapportant à la science biblique. Son œuvre a vieilli ; néanmoins il y a encore d’excellentes choses à glaner parmi ces travaux remplis d’observations judicieuses. — Voici les titres des articles du tome I er que visent nos réflexions : De l'étude de la chronologie ; Observations sur les antiquités des Égyptiens et des Chaldéens ; Particularités romanesques de la vie de Moïse, inventées par les anciens rabbins ; Remarques sur l’origine des fables du paganisme " ; Recherches sur l'époque du règne de Sésostris ; De l’origine de l’idolâtrie ; Des prétendus restes de l’arche de Noé ; De l’existence des géants ; Remarques sur l’origine et sur les dieux des Philistins ; Des richesses immenses que David laissa à Salomon pour la construction du temple ; Description du temple de Salomon ; De la situation du pays d’Ophir ; Remarques sur la destruction de l’armée de Sennachérib ; Réflexions sur l’histoire de Cyrus ; Histoire de la version des Septante ; Remarques historiques et critiques sur les sectes des Juifs ; De l’origine du grand Hérode ; Remarque sur le Scilo. 0. Rey.
- ARTINGER Johann Petrus##
ARTINGER Johann Petrus, théologien catholique, né en ! 668 àlngolstadt, en Bavière, mort le 2 octobre 1729. On a de lui le Plectrum Davidicum, sive Psalmodia practica et explanata, Ingolstadt, 1726 ; Of/icium divinum, sive methodus recitandi horas canonicas, 1727. J. Oliviéri.
1. ARTISANS (VALLÉE DES) (hébreu : Gèharasim ; Septante, 'AysaSSouç), I Par., iv, 14 ; II Esd., XI, 35. Voir Joab 2 et Vallée des Artisans.
2. ARTISANS CHEZ LES HÉBJtEUX (hébreu : fyârâS, « celui qui entame » avec un outil le fer, la pierre ou le bois, et bôsêb, « celui qui combine » pour exécuter un travail ; Septante : èp^â-nr)?, téxtov, cr/vi’O) ; ; Vulgate : artifex, faber, operarius, opifex). Les artisans sont les hommes qui exercent un art mécanique, et, en général, ceux qui s’occupent d’un travail manuel. L’artisan travaille soit en son propre nom, soit pour le compte d’un maître. Dans ce second cas, il est iâkir, (j.i<t8° t41 ; , mercenarncs, (l mercenaire. »
I. Différentes sortes d’artisans. — La Bible fait allusion assez souvent aux différents métiers des artisans ; mais elle est loin de les mentionner tous, et ordinairement elle suppose connus les détails qui nous intéresseraient et les passe sous silence. Les Hébreux, avant la captivité et surtout avant l'époque des rois, ne s’adonnaient pas d’ailleurs à l’industrie, et les artisans proprement dits étaient chez eux fort rares. Voici les indications générales fournies sur ce sujet par les Livres Saints. (Pour les détails, voir les articles spéciaux.)
A) ouvriers de la terre, — ï. Cultivateur, 'ôbêd 'âdâmâh, « serviteur de la terre, » comme Caïn, Gen., iv, 2 ; 'ÎS 'âdâmâh, « homme de la terre, » comme Noé, Gen., K, 20, ou 'îs éâdéh, « homme des champs, » comme
Ésaû. Gen., xxv, 27. Le laboureur proprement dit s’appelle 'ikkâr, « celui qui creuse » la terre. Is., lxi, 5 ; Jer., Ll, 23. Cf. Jacob., v, 7 ; Eccli., xxxviii, 26-27.
2. Pasteur, rô'êh. Ce métier se rattache au précédent. Il était commun en Palestine. Gen., xxxi, 38-40 ; Am., vu, 14 ; Luc, xv, 4, 5 ; Joa., x, 11, 12.
3. Vignerofl, kôrêm, du nom de la vigne, kérém, « la plante excellente. » Is., lxi, 5 ; Jer., iii, 16 ; Joël, I, 11 ; IV Reg., xxv, 12 ; II Par., xxvi, 10 ; Matth., xx, 1 ; xxi, 34-41.
B) ouvriers sur métaux.— 1. Forgeron, fyârâS barzél, a ouvrier du fer. » Tubalcaïn fut le premier qui travailla le bronze et le fer. Gen., iv, 22. « Le forgeron a le ma'âsâd ( petite hache) ; il façonne le fer au brasier avec les maqqâbôt ( marteaux), il travaille d’un bras robuste, souffre la faim jusqu'à épuisement ; il ne boit pas et se fatigue. » Is., xuv, 12. Cf. Eccli., xxxviii, 29-31 ; I Reg., xin, 20, 21.
2. Ouvrier du bronze, fyârâs nehosét. On trouve déjà mention, dès le temps du séjour dans le désert du Sinaï, de ceux qui travaillent ce métal. Exod., xxvii, 2, 3, etc. Leur industrie était importante, parce que le bronze fut longtemps le plus commun des métaux employés pour fabriquer les outils et les ustensiles de ménage. Pratiquement, ils ne se distinguaient pas des forgerons. III Reg., vu, 14 ; II Par., xxiv, 12. Ils exerçaient en même temps l'état d’armurier, parce que chez les Hébreux, comme chez les Philistins et les autres peuples de l'époque, la plupart des armes offensives et défensives étaient en bronze, sauf parfois les pointes de lances. I Reg., xvii, 5-7 ; II Reg., xxii, 35. Quand Nabuchodonosor se fut emparé de Jérusalem, il eut soin d’emmener en captivité les ouvriers qui auraient pu fabriquer des armes à l’usage de la population laissée en Palestine, particulièrement le forgeron et le rnasgêr, sorte de serrurier ou d’autre ouvrier travaillant le fer et le bronze. II (IV) Reg., xxiv, 14, 16 ; Jer., xxiv, 1.
3. Orfèvre, sorêf, « celui qui liquéfie » le métal. Jud., xvii, 4 ; Is., XL, 19 ; Prov., xxv, 4, etc. Ses principaux instruments sont nommés dans la Bible : le creuset, mâferêf, Prov., xvii, 3 ; xxvii, 21 ; le soufflet, màpuah, Jer. vi, 29 ; l’enclume, pâ'as, et le marteau, pattîs, Is., xli, 7 ; les pinces, mélqâfjiaîm, Is., vi, 6 ; le ciseau ou burin, fyérét. Exod., xxxii, 4 ; Is., viii, 1. L’art de l’orfèvre fut d’un grand emploi dans la fabrication des vases sacrés et dans la décoration du tabernacle, de l’arche et du temple. Béséléel eut grâce d'état pour exécuter les pièces d’orfèvrerie qui ornèrent le tabernacle. Exod., xxxvii, 1. Les orfèvres furent aussi les grands fabricants d’idoles, depuis l’argentier qui façonna un dieu à l’usage de Micha, Jud., xvii, 4, jusqu'à ceux dont les prophètes stigmatisèrent l'œuvre impie. Is., xl, 19 ; xliv, 11 ; Sap., xiii, 11, etc. Enfin ils étaient fort occupés pour suffire aux exigences de la parure féminine, qui comportait une grande variété de bijoux. Is., iii, 18-23.
C) ouvriers sur sois. — 1. Charpentier, foc « 'êfîm, « ouvrier des bois, » travaillant les bois pour la charpente, la menuiserie, la charronnerie, l'ébénisterie, etc. Le charpentier a en main le crayon à tracer, èéréd ; la corde à mesurer, qâv ; le compas, mefyûgâh ; le ciseau, màqsû'âh, Is., xliv, 13 ; la hache, garzén, Is., x, 15, ou qârdom,
I Reg., xiii, 20 ; la scie, massôr, Is., x, 15, et le marteau, maqqâbâh, III Reg., vi, 7, ou halmûf, Jud., v, 26.
2. Sculpteurs sur bois. Ils apparaissent surtout à titre de fabricants d’idoles. Is, xl, 20 ; xliv, 13 ; Sap., xiii, 11-16.
D) ouvriers de coustruction.— 1. Maçons, godrîm,
II (IV) Reg., xii, 13 (12). — Ils sont aussi appelés giblim, « gens deGébal, » ville delà côte phénicienne, parce que les hommes de cette localité étaient habiles maçons en même temps qu’excellents marins. I (III Reg.), v, 18 ; Ezech., xxvii, 9. Les maçons se servaient de la scie à couper les pierres, megêrâh, Il Sam. (II Reg.), xii, 31 ; 1 (III Reg.), vii, 9 ; et de la perche à mesurer, qànéh,
Ezech., xl, 3, 5. Dans Amos, vii, 7, la Vulgate parle de truelle ; mais le texte hébreu porte 'ânâk, « plomb. » Ces artisans employaient la chaux, sid, Is., xxxiii, 12 ; Am., ii, 1, et un enduit, fâfèl, pour crépir ou blanchir les murailles. Ezech., xiii, 10 ; Matth., xxiii, 27. Les maçons phéniciens furent associés aux maçons hébreux pour la construction du temple de Salomon ; les uns et les autres étaient en même temps tailleurs de pierre. III Reg., xvii, 18.
E) ouvriers de L’alimentation. — Il est question dans Osée d’un 'ôfèh, « celui qui fait cuire, » soit boulanger, soit cuisinier. Ose., vii, 4. Les gens de ce métier ne pouvaient se trouver que dans les villes, parce qu’ailleurs chaque famille cuisait pour son usage. Jérémie mentionne à Jérusalem une place ou rue des Boulangers, hûs hâ'ôfîm, Jei xxxvii, 21 (hébr.). Josèphe appelle « vallée des Fromagers », xupowoiwv, la vallée qui traversait Jérusalem du nord au sud. Bell, jud., V, iv, 1. C’est là sans doute qu’on travaillait le laitage à l'époque des Jébuséens.
F) OUVRIERS DU VÊTEMENT, DES USTENSILES, DE LA TOILETTE, etc. — 1. Tisserand, 'ôrêg. Ce métier, plus ordinairement exercé par les femmes, l'était aussi quelquefois par les hommes. On y employait le fuseau, kîsôr ou pélék, Prov., xxxi, 19 ; l’ensouple ou rouleau, mentir 'orgîrn, I Reg., xvii, 7 ; II Reg., xxi, 19 ; la broche, yâtêd, Jud., xvi, 14 ; la navette, 'érég. Job, vii, 6. Les Hébreux avaient appris en Egypte les arts du tissage, de la broderie et de
4a teinture, et ils s’en servirent pour travailler à l’ornementation du tabernacle et à la confection des vêtements sacrés. Exod., xxv, 4, 5 ; xxxv, 25, 26, 35, etc. Il y avait du resle des familles au sein desquelles se transmettaient les procédés propres au métier. I Par., iv, 21.- Dans chaque ménage on filait et on tissait, Prov., xxxi, 13, et parfois le luxe réclamait un grand raffinement dans les étoffes. IV Reg., xxiii, 7 ; Ezech., xvi, 16.
2. Foulon, kôbês, pour l’apprêtage des étoffes neuves et le nettoyage des anciennes. Mal., iii, 2 ; Marc, ix, 2. Il y avait un champ du Foulon près de Jérusalem. Is., vii, 3 ; xxxvi, 2 ; IV Reg., xviii, 17.
3. Tanneurs. Il est question de leur travail dans la construction du tabernacle. Exod., xxv, 5 ; xxvi, 14, etc. Les Actes, IX, 43, parlent d’un corroyeur de Joppé, nommé Simon, chez lequel saint Pierre logea assez longtemps.
4. Potier, yôsêr. Cette industrie était très ancienne chez les Hébreux, I Par., iv, 23, et elle se perpétua jusqu’aux temps évangéliques. Jer., xviii, 4 ; xix, 1 ; Eccli., xxxviii, 32-34 ; Matth., xxvii, 7, 10.
5. Faiseurs de tentes, <sx » ]vo7roioi. C'était le métier exercé par saint Paul. Act., xviii, 3.
6. Parfumeur, rôqêafy. Les Hébreux avaient appris cette industrie en Egypte, car il est déjà questionne parfumeurs au désert. Exod., xxx, 25, 35. Les femmes s’occupaient aussi de la préparation des parfums. IReg., viii, 13. Les parfumeurs composaient leurs produits pour l’usage des vivants, Eccle., vii, 2 ; x, 1 ; Matth., xxvi, 7, et pour l’ensevelissement des morts. II Par., xvi, 14 ; Joa., xix, 40. Ils étaient en même temps pharmaciens. Eccli., xxxviii, 7.
7. Barbier, gallâb. Ézéchiel, v, 1, en fait seul mention.
8. Graveurs. « Ceux qui exécutent la gravure des cachets s’occupent à varier leurs figures ; ils mettent tout leur cœur à reproduire la peinture et ne songent qu'à parfaire leur ouvrage. » Eccli., xxxviii, 28 ; xlv, 13.
IL Condition des artisans. — 1° Le travail manuel. — Imposé à l’homme innocent comme agréable occupation, Gen., ii, 15, il devint pénible à la suite du péché. Gen, , m, 17. Aussi « l’ouvrier mercenaire soupire après la fin de sa journée », et il est heureux quand elle est terminée. Job, vii, 2 ; xiv, 6. Dans les anciens temps, le travail manuel paraît avoir été le lot exclusif des esclaves et des artisans. Pendant la captivité, chacun dut pourvoir à sa subsistance, à l'étranger, par le travail de ses mains. Aussi, au retour, devint-il de règle de faire apprendre un métier manuel à chaque enfant. On lit dans le Talmud : « Au père incombe la tâche de circoncire son fils, de lui 1047
ARTISANS CHEZ LES HÉBREUX — ARTOP^US
4043
apprendre la loi et de lui enseigner un état. » Tosaphot in Kidduschin, c. 1. « Quiconque n’enseigne pas un état à son fils, c’est comme s’il lui enseignait le brigandage. » Talm. de Babyl. Kidduschin, 29 a, 30 b. Voir Stapfer, La Palestine au temps de Notre-Seigneur, p. 142. « C’est une belle chose que l'étude de la loi, avec une industrie terrestre par laquelle on se procure son entretien. » Pirke Aboth, 2, 2. Le livre ajoute que cette étude et cette industrie font éviter le péché. C’est pour se conformer à cet usage national, si humblement suivi par Notre-Seigneur lui - même, que les Apôtres, et particulièrement saint Paul, travaillèrent de leurs mains. Act., xviii, 3 ; xx, 34 ; I Cor., iv, 12 ; I Thess., ii, 9 ; II Thess., iii, 8. Il y avait cependant certains métiers moins honorés ou plus rudes, comme ceux d'ànier, de chamelier, de batelier, etc., qu’il était recommandé d'éviter. Kidduschin, 30a, 82a.
2° Groupements d’artisans. — La « vallée des Artisans », I Par., iv, 14 ; II Esdr., xi, 35, au nord et à proximité de Jérusalem, suppose un groupement analogue à celui de la « vallée des Fromagers ». Il est aussi parlé des « familles de la maison où se travaille le byssus », ce qui permet de croire à l’existence d’une sorte de filature célèbre dans les anciens temps, I Par., IV, 21 ; il est jencore question de potiers habitant à Neta'ïm (Vulgate : Plantations) et à Gédéra (Vulgate : les Haies), I Par., IV, 23, où ils trouvaient l’argile nécessaire, à leur industrie. Sous les rois apparaissent des groupements plus ou moins considérables d’ouvriers aux ordres du prince. Samuel, qui sait ce qui se passe dans les monarchies, avertit ses compatriotes que le roi prendra leurs serviteurs, leurs servantes et leurs meilleurs jeunes gens, et les fera travailler pour lui ; que de leurs fils il fera ses soldats, ses laboureurs, ses moissonneurs, ses armuriers et ses charrons ; de leurs filles ses parfumeuses, ses cuisinières et ses boulangères.
I Reg., viii, 12-16. David avait ses cultivateurs, ses vignerons, ses pasteurs, ses employés de toutes sortes, avec des intendants à leur tête. I PaK, xxvii, 25-31. Les grands travaux entrepris par Salomon nécessitèrent une organisation ouvrière habilement combinée. David avait réuni un très grand nombre d’artisans, tailleurs de pierres, maçons, charpentiers, orfèvres, forgerons, etc., I Par., xxii, 15, 16, en vue de la construction du temple. Salomon employa 70000 porteurs de fardeaux et 80000 tailleurs de pierres, à la tête desquels il plaça 3600 contremaîtres. HPar., ii, 2, 18. Il enrôla aussi 30000 charpentiers pour travailler dans le Liban, conjointement avec les ouvriers d’Hiram ; il les envoyait au Liban tour à tour, 10000 chaque mois, de sorte qu’ils étaient deux mois dans leurs maisons. III Reg., v, 13, 14. Un système analogue de service alternatif est en usage aujourd’hui pour la garde des phares situés en mer. Ces immenses travaux durèrent sept ans. Pendant treize autres années, Salomon employa de nombreux ouvriers à la construction de son palais. -III Reg., vii, 1. Il fit aussi exécuter de grands travaux d’utilité publique. III Reg., ix, 15, 17-19 ; II Par., vin, 2, 4-6. Du temps de Joas, on retrouve des charpentiers et des maçons travaillant dans la maison du Seigneur, sous la direction de leurs chefs. IV Reg., xii, 11 ;
II Par., xxiv, 12. Ils sont encore là du temps de Josias. IV Reg., xxii, 5-6 ; II Par., xxxiv, 11, 17. Les grands travaux recommencèrent sous Zorobabel et sous Hérode, mais l’Ecriture ne fournit pas d’indications sur l’enrôlement des ouvriers à ces deux époques.
3° Le salaire des artisans. — À l’origine, le salaire se payait en nature. Gen., xxx, 32. La loi mosaïque exigeait que le salaire fût justement payé à celui qui avait travaillé. Aussi quand, au début de l’année sabbatique, on rendait la liberté à l’Hébreu qui s'était engagé comme esclave, on était obligé de lui compter un salaire pour tout le travail qu’il avait fourni. Lev., xxv, 40 ; Deut., xv, 13, 18. Même l'étranger réduit en esclavage devait être rémunéré, et pouvait se racheter avec le prix de son travail. Lev., xxv, 50. Ceux qui se louaient à l’année étaient sans doute
nourris chez le maître qui les employait, et payés à la fin de leur service. Cf. Is., xvi, 14 ; xxi, 16. Les artisans libres recevaient leur salaire à des époques très rapprochées. Quand l’ouvrier était pauvre, la loi ordonnait même de le payer le soir de la journée, avant le coucher du soleil. Lev., xix, 13 ; Deut., xxiv, 14, 15 ; Tob., iv, 15 ; Matth., xx, 2, 8. Il était expressément défendu de frauder l’ouvrier. Lev., xix, 13 ; Eccli., vii, 22. L’injustice à son égard pouvait être assimilée à l’homicide, Eccli-, xxxiv, 27, puisque la vie de l’artisan dépendait de son sahire. Prov., xvi, 26. Aussi Dieu devait-il prendre en main la cause de l’artisan lésé dans ses droits. Job, xxxi, 39 ; Mal., iii, 5 ; Matth., x, 10 ; Luc, x, 7 ; I Tim., v, 18 ; Jacob., v, 4. La Bible ne fournit aucun renseignement sur la quotité du salaire. Nous voyons seulement, dans le Nouveau Testament, qu’un vigneron recevait un denier pour une journée de travail. Matth., xx, 2. À l'époque impériale, le denier valait 1 fr. 07. Si l’on tient compte de la facilité de la vie en Palestine au I er siècle, un denier équivalait largement au salaire que reçoit un ouvrier ordinaire de nos jours, surtout à la campagne. Voir Salaire.
'4° Remarques morales sur les artisans. — Chaque ouvrier doit s’appliquer à son métier. Eccli., xxxvii, 13, 14. S’il travaille et est économe, il sera heureux, Eccli., XL, 18 ; il ne s’enrichira pas, s’il est ivrogne. Eccli., xix, 1. Malheureusement les mauvais ouvriers n’ont jamais manqué. Phil., iii, 2. Voici en quels termes Jésus, fils de Sirach, détermine le rôle social et la dignité morale de l’artisan. Après avoir montré comment le laboureur, le charpentier, le constructeur, le graveur, le forgeron, le potier, en un mot tous les "artisans, sont trop occupés de leurs travaux pour avoir le loisir d’acquérir la science du lettré, il ajoute : « Tous ceux-là attendent leur vie du travail de leurs mains, et chacun d’eux a l’habileté propre à son métier. Sans eux tous, on ne bâtirait aucune ville, on n’y habiterait pas, on n’y voyagerait pas. Toutefois ils ne se font pas remarquer dans l’assemblée, ils ne prennent point place sur le siège du juge, ils ne comprennent pas la loi qui préside au jugement, ils n’enseignent pas la doctrine ni la justice, et on ne les trouve pas là où sont les paraboles (c’est-à-dire là où se débitent les propos subtils et savants). Mais ils sont les soutiens des choses du temps, et leur prière se rapporte aux travaux de leur métier. C’est à quoi ils appliquent leur âme, en s’efforçant de vivre selon la loi du Très -Haut. » Eccli., xxxviii, 35-39. D’après cette théorie sociale, qui est l’expression même de la pensée de l’Esprit -Saint, le rôle de l’artisan se réduit donc à deux choses : s’appliquer aux devoirs de son état, aussi indispensable à la société que la sagesse des esprits supérieurs, et vivre conformément à la loi divine. Ainsi se prépare pour l’artisan la possession de cette vie meilleure, où il n’y a d’autre distinction que celle des mérites acquis ici-bas.
1. ARTOP./EUS Johannes Christopher, nom grécisé de Becker ('aptroirotdç, « boulanger » ), historien protestant, né à Strasbourg, en 1626, mort dans cette ville le 21 juin 1702. Il se voua à l’enseignement avec succès, lumen académies patries, dit Fabricius, et fut chanoine du chapitre de Saint-Thomas. Il prit part à la publication du Compendium historiée ecclesiasticee, in usum gymnasii gothani, in-8°, 1666. — Parmi ses thèses et dissertations, dont Audifreddi donne la liste dans sa Bibliotheca Cassinatensis, on remarque le Meletema historicum, quod narratio de Judith et Holoferne non historia sil ? sed epopseia, in-4°, Strasbourg, 1694, qui fut réfuté par Bernard de Monfaucon dans La vérité de l’histoire de Judith, in-12, Paris, 1696. Voir Io. Alb. Fabricius, Bibliotheca grseca, édit. de 1752, 1. iii, c. xxix, p. 742.
J. Oliviéri.
2. ARTOP^SUS Petrus, en allemand Becker, commentateur^ luthérien, né eii 1491, à Côslin, en Poméranie, mort en 1563. Il étudia les langues et la théologie à l’université de Wittemberg, et devint ministre protestant de la 1049
ARTOPEUS — ARVADIEN
1050
principale église de Stettin. C'était un ami d’Osiander. Parmi ses ouvrages on remarque une Biblia Veteris et JVodï Teslamenti, et historié, arliflciosis picturis effigiata, cum explicatione latine et germanice, in- 8°, Francfort, 1557 ; Evangelicx conçûmes Dominicarum totius anni, in-8°, Francfort, 1537, ouvrage mis à l’Index par Pie IV. Voir Pantaleon, Prosopographia heroum et illustrium virorum totius Germanise, Bâle, 1565 ; Gesner, Bibliotheca Gesneri in epitomen redàcta, Zurich, 1863, qui mentionne du même auteur quelques autres ouvrages d'érudition biblique. J. Oliviéri.
- ARUBOTH##
ARUBOTH (hébreu : 'Ârubbôt ; Septante : 'Apa6<16), la troisième des circonscriptions territoriales qui, sous Salomon ; devaient tour à tour, pendant l’année, subvenir à l’entretien de la table royale. III Reg., IV, 10. L’officier qui était chargé d’y lever les impôts s’appelait Benhésed, ayant dans son ressort « ; Socho et toute la terre d'Épher ». De la mention de Socho nous pouvons conclure que ce district appartenait à la tribu de Juda. Mais il existait deux villes de ce nom : l’une dans la plaine, citée entre Adullam et Azéca, Jos., xv, 35, et généralement identifiée avec Khirbet Schoueikéh, localité située au nord-est de BeitDjibrin ; l’autre dans la montagne, Jos., xv, 48, et dont l’emplacement est également connu sous l’appellation de Schoueikéh, au sud-ouest d"Hébron. De laquelle des deux s’agitil ici ? On ne sait au juste. Nous serions plus tenté d’y voir la première. En effet, « la terre d'Épher » ne se rapporte évidemment pas à la Geth-Hépher de Zabulon, Jos., xix, 13, mais bien plutôt à la ville chananéenne (hébreu : Ifêfér ; Vulgate : Opher) citée, Jos., xii, 17, entre Taphua et Aphec. Or ces deux dernières appartenaient à la région nord-ouest de la tribu de Juda. Voir Aphec 1. Aruboth aurait ainsi fait partie de la grande et fertile plaine de la Séphéla, dont les richesses devaient
être mises â contribution par Salomon.- ARUCH##
ARUCH (hébreu : 'Arûk, « arrangé » par ordre alphabétique), titre d’un célèbre dictionnaire talmudique composé au XIIe siècle par rabbi Nathan ben Jéchiel, surnommé pour cette raison par les auteurs juifs Ba’al 'Arûk, « l’auteur d’Aruch. » Voir Nathan ben Jéchiel.
ARUM (hébreu : Hârum, « haut ; » Septante : 'Iapt’v), père d’Aharéhel et fils de Gos, descendant de Juda. I Par., iv, 8.
- ARUMAH##
ARUMAH ( 'Â rûmâh), forme hébraïque du nom d’une localité de la tribu d'Éphraïm appelée dans la Vulgate Ruma. Jud., rx, 41. Voir Ruma 2.
ARUSPICES. Chez les Romains, on appelait aruspices les prêtres chargés d’examiner à l’autel les entrailles des victimes, pour en tirer des présages et prédire les événements futurs (fig. 282). Ce nom étant familier aux Latins, saint Jérôme s’en est servi pour traduire dans Daniel le mot chaldaïque gdzerin, qui désigne une classe de devins babyloniens, Dan., ii, 27 ; iv, 4 ; v, 7, 11. Comme gâzerîn vient de la racine gezar, « couper, mettre en morceaux, » cette expression a dû rappeler naturellement au traducteur de la Vulgate les aruspices qui examinaient les victimes immolées. Voir Gazerîn. Saint Jérôme a employé encore le mot d' « aruspices », IV Reg., XXI, 6, pour rendre l’hébreu ide'ônîm, dont la signification est « ceux qui savent [l’avenir] », devins en général ; et IV Reg., xxiii, 5, pour rendre l’hébreu kemârim, dont la signification est « prêtres [des faux dieux] ». L’expression d' « aruspices » ne doit donc pas être prise dans sa signification propre et rigoureuse dans la traduction de la Vulgate. Voir Foie, 1°.

282. — Aruspice examinant les entrailles d’une victime. Bas-relief romain du Musée du Louvre
- ARVAD##
ARVAD, forme hébraïque du nom de l’ile phénicienne connue sous le nom d’Arad. Voir Arad 2.
- ARVADIEN##
ARVADIEN (hébreu : hâ-'Arvàdî, avec l’article),
forme hébraïque du nom « thnique : Aradien, dans Gen., x, 18 ; I Par., i, 16. Voir Aradien.
ARVADITE. Voir Aradien.
- ARVIVO Isaac ben Mosêh##
ARVIVO Isaac ben Mosêh, rabbin de Salonique au xvi » siècle, a laissé un commentaire philosophique sur le Pentateuque, fanffumôt 'El, « Consolations de Dieu, » Job, xv, 11, in-f°, Salonique, 1583, et un autre sur l’Ecclésiaste, in-4°, Salonique, 1597. E. Levesque.
1. AS (appelé aussi assis, assarius ; en grec, io-dâpiov), nom de l’unité monétaire de bronze chez lès Romains. Le Nouveau Testament parle deux fois de l’iatràpcov, Matth., x, 29 ; Luc, xii, 6. Dans le premier passage, la Vulgate rend àcraiptov par as ; elle traduit les deux assorti de saint Luc par dipondium, nom de l’as double en
- As de Cnéus Pompée, Tête lanrée de Janus. — $. CN. MAG IMP ( Gneus Magma tmperator, fils du grand Pompée). Proue de navire. Devant I, marque de Tas.
Italie. Le poids, la valeur et la forme de l’as ont beaucoup varié, suivant les époques, chez les Latins. L’as primitif devait peser régulièrement une livre romaine (environ 327 grammes). Au commencement de l’empire, du temps de Notre-Seigneur, l’as pesait un tiers d’once, c’est-à-dire 9 grammes, et valait par conséquent de 6 à 7 centimes. Il portait de face une figure de Janus, et au revers une proue de navire (fig. 283). Notre-Seigneur dit en saint Matthieu, x, 29, que de son temps, en Palestine, deux passereaux se vendaient un as ; et en saint Luc, XII, 6, que pour deux as on pouvait avoir cinq passereaux.
2. AS… Voir à Az… les noms propres commençant par As qui ne se trouvent pas ici à leurs places respectives, les noms en As étant écrits par Az dans diverses éditions de la Vulgate.
A
ASA, hébreu : 'Asâ', « médecin. » Nom d’un roi de Juda et d’un lévite.
1. ASA (Septante : 'A<r<x), troisième roi de Juda depuis la séparation des dix tribus, fils et successeur d’Abia., monta sur le trône la vingtième année du règne de Jéroboam, roi d’Israël, III Reg., xv, 9-10 ; II Par., xiv, 1 ; cf. Matth., i, 7-8, et régna pendant quarante et un ans (955-914), pendant lesquels il vit se succéder sur le trône d’Israël Jéroboam I er, Nadab, Baasa, Éla, Zambri, Amri et Achab. Pieux autant que son père avait été irréligieux, il avait été donné par Dieu au peuple de Juda, malgré les impiétés des règnes précédents, III Reg., xiv, 22-24 ; xv, 3 ; II Par., xii, 14, « à cause de David, » pour resplendir « comme un flambeau », III Reg., xv, 4, c’està-dire pour relever la gloire de Jérusalem et du royaume. Les trois années du règne d’Abia avaient été agitées par une guerre presque sans trêve contre Israël, II Par., xiii, 2 ; Asa, par sa prudence, sut maintenir pendant dix ans une paix dont il profita pour fortifier le pays, en reconstruisant les places fortes que Sésac avait ruinées, II Par., xii, 4, et se constituer une armée considérable, composée
de 580000 guerriers, dont 300000, pris en Juda, portaient le grand bouclier (sinnâh) et la lance, et 280000, pris en Benjamin, étaient armés du petit bouclier (màgèn). III Reg., xv, 23 ; II Par., xiv, 1-8. Cette paix fut interrompue par l’invasion du roi d’Egypte et d’Ethiopie Zara, conduisant une formidable armée d'Éthiopiens (un million d’hommes et trois cents chars de guerre, d’après le texte actuel). II Par., xiv, 9-10 ; xvi, 8. Asa, mettant toute sa confiance en Jéhovah, s’avança résolument à sa rencontre, et, après l’avoir défait dans la vallée de Séphata, près de la place forte de Marésa, dans la plaine de Juda, Jos., xv, 44, il le poursuivit jusqu'à Gérare, et avec tant de succès, que l’armée de Zara fut anéantie, laissant aux mains du vainqueur un immense butin. II Par., xiv, 13.
Asa, soit avant, soit après cette expédition, s’occupa avec zèle de la réforme religieuse et de la restauration du culte divin. L’idolâtrie, introduite en Juda par ses ancêtres, avait trouvé une ardente propagatrice dans la reine mère Maacha, fille ou bien petite - fille, II Reg., xiv, 27, d’Absalom, probablement grand’mère d’Asa et non sa mère. III Reg., xv, 2. Cette femme, qui avait conservé à la cour d’Asa le rang et les attributions dont elle jouissait sous le règne précédent, usait de toute son influence pour propager le culte d’Astarté. II Par., xv, 16. En l’honneur de cette déesse, elle avait institué toutes sortes d’usages et de symboles détestables, dont la nature n’est pas bien précisée (hébreu : elle avait fait un mifléséf, — c’est-à-dire un symbole idolâtrique, et, selon quelquesuns, un symbole honteux, — pour V'àsêrâh ou statue de bois d’Astarté) ; toutes choses qu’Asa fit disparaître, aussi bien que les autres statues et autels de divinités étrangères, les stèles (massêbôf) et colonnes (liammânim) en l’honneur de Baal, le dieu-soleil, III Reg., xiv, 23 ;
II Par., xiv, 4 ; cf. Exod, xxxiv, 13 ; Lev., xxvi, 30, et la plupart des bois sacrés et hauts lieux, excepté quelquesuns, appelés bâmôf, qui étaient consacrés à Jéhovah.
III Reg., xv, 14 ; II Par., xv, 17. Car cet usage, non autorisé par la loi, s'était introduit de multiplier les autels en l’honneur de Dieu, comme on l’avait fait avant la construction du temple, 1Il Reg., iii, 2 ; xxii, 44, et d’y offrir des sacrifices ou d’y brûler de l’encens. Asa, soit par faiblesse, soit pour éviter un plus grand mal, les laissa donc subsister ; et s’il se montra impitoyable à l'égard de la statue d’Astarté, qu’il mit en pièces et dont il brûla les fragments dans le torrent du Cédron, III Reg., xv, 13 ; II Par., xv, 16 ; s’il fut sévère à l'égard de Maacha, qu’il destitua de sa dignité, III Reg., xv, 13, il semble avoir été indulgent pour "quelques hauts lieux même idolâtriques, puisque Josias, plus énergique que lui, est loué pour en avoir détruit plusieurs, que Salomon avait consacrés à Astàroth, à Chamos et à Melchom, sur le mont des Oliviers. IV Reg., xxiii, 13.
Dans ses réformes, Asa était guidé par un profond sentiment de sa royauté théocratique et des droits souverains de Jéhovah. Et non content d’avoir écarté ces profanations sacrilèges, il restaura avec un « cœur parfait », III Reg., xv, 14, le culte divin, d’abord en enrichissant le trésor du temple, vide depuis l’invasion de Sésac, III Reg., xiv, 26, de tout le butin fait par son père sur Jéroboam, II Par., xiii, 16-19 ; xv, 18, et de celui qu’il avait fait lui-même sur les Éthiopiens. III Reg., xv, 15 ; cf. II Par., xiv, 13-15. Puis il voulut que Jérusalem redevînt le centre religieux de Juda, et pour favoriser ce mouvement il rétablit ou restaura, devant le portique du temple, l’autel des holocaustes, détérioré et peut-être profané par le culte des idoles. II Par., xv, 8. Les Juifs répondirent à cet appel, et même beaucoup d’Israélites, malheureux dans leur pays et frappés de voir combien le Seigneur était avec Asa, II Par., xv, 9, vinrent s'établir en Juda.
Tout était préparé pour une rénovation solennelle et populaire de l’antique alliance du peuple avec Jéhovah. îos., xxiv, 14-25. Dieu la provoqua lui-même en envoyant à Asa un prophète, uniquement connu par ce passage, II Par.,
XV, 1-8, Azarias, fils d’Oded, qui, abordant le roi, lui rappela que l’alliance théocratique était un élément constitutif du royaume : « Jéhovah a été avec vous parce que vous avez été avec lui, » II Par., XV, 2, et dans un tableau prophétique lui découvrit les malheurs réservés à son peuple le jour où il romprait ce pacte. Asa écouta avec respect, et, encouragé par ce message, il s’appliqua plus que jamais à la destruction de l’idolâtrie. Bientôt il convoqua le peuple à la rénovation de l’alliance théocratique. C'était le troisième mois de la quinzième année du règne d’Asa. II Par., xv, 10. Après un sacrifice solennel de sept cents bœufs et sept mille moutons, réservés sans doute de l’immense bétail pris sur Zara, II Par., xiv, 15, le peuple, à la suite d’Asa, prit l’engagement « de chercher le Seigneur Dieu de ses pères de tout son cœur et de toute son âme », II Par., xv, 12-15, tandis que la fanfare des cors et des trompettes portait au loin l'écho de cette grande manifestation.
Peu de temps après, peut-être l’année suivante, le Royaume d’Israël, qui jusque-là avait vécu en paix avec Jnda, entra en hostilités. Il y a manifestement une altération de chiffres dans le passage du second livre des Paralipomènes qui fixe cette guerre à la trente-sixième année du règne d’Asa, II Par., xv, 19 ; xvi, 1, puisque d’après III Reg., xvi, 8, Baasa, le roi d’Israël qui fit cette guerre, mourut la vingt - sixième année du règne d’Asa. C’est donc « la quinzième » et « la seizième année » qu’il faut lire, au lieu de « la trente-cinquième » et de « la trentesixième ». Cette guerre fut poussée avec vigueur par Baasa, qui, franchissant la frontière, s’avança jusqu'à deux lieues de Jérusalem, s’empara de Rama, clef du passage de Juda en Israël, la fortifia et coupa ainsi toute communication par le nord avec la capitale de Juda. III Reg., xv, 27 ; II Par., xvi, 1. Asa n’osa pas, en face de l’armée d’Israël, compter sur Dieu, comme il l’avait fait en face de l’innombrable multitude des Éthiopiens : ses vues étaient devenues plus humaines, sa foi moins ferme. Il préféra au secours de Jéhovah celui des Syriens, dont le royaume, depuis Razon, III Reg., xi, 23-24, avait prospéré, tant au point de vue militaire que commercial. Bénadad, lié jusque-là à Israël par un traité, se rendit facilement à la demande d’Asa et à ses présents, pour lesquels on avait épuisé le trésor du temple et celui du roi. III Reg., xv, 18. Il voyait là d’ailleurs une occasion très favorable de tirer parti de son travail d’organisation militaire et d'étendre sa domination. C’est pourquoi, sans tarder, il entra en campagne en faveur d’Asa, et, se jetant sur Israël, il força Baasa à lâcher Rama, qu’Asa occupa aussitôt. Il fit plus que l’occuper : à l’aide d’une réquisition universelle de tous les hommes valides de Juda, il la démantela, et avec les matériaux de construction fortifia Gabaa de Benjamin et Maspha, deux places qui dès lors devenaient pour Jérusalem un rempart assuré contre l'éventualité d’une nouvelle invasion du côté du nord. III Reg., xv, 18-22 ; II Par., xvi, 2-6. Jérémie nous apprend qu’Asa avait fait construire à Maspha une grande piscine, afin de l’approvisionner d’eau. Jer., xli, 9.
Le recours d’Asa aux Syriens n'était pas seulement un acte de défiance à l'égard de Dieu, mais encore une violation sacrilège de la constitution théocratique de Juda, que Dieu reprocha sévèrement au roi, par la bouche du prophète Hanani, II Par., xvi, 7-9, lui annonçant en même temps des guerres sanglantes, en punition de son infidélité. Malheureusement le cœur d’Asa s’endurcit, et, rebelle à l’avertissement de Dieu, il entra en fureur, fit saisir le -prophète, qu’il condamna au cruel supplice des entraves, II Par., xvi, 10 ; cf. Jer., xx, 2 ; xxix, 26, tandis qu’il faisait mourir à cette occasion plusieurs de ses sujets. Cet acte de brutale tyrannie fut une tache sur le règne d’Asa, jusque-là si glorieux. Ceu fut d’ailleurs le dernier trait. Les guerres prédites par le prophète, II Par., xvi, 9, n’eurent pas lieu pendant les dernières années d’Asa, bien que la paix ne semble pas avoir été désormais solide du
côté d’Israël. III Reg., xv, 16. La trente-neuvième année de son règne, il fut pris de douleurs de pieds très violentes, probablement de la goutte, III Reg., xv, 23 ; II Par, , xvi, 12, et il mit trop sa confiance dans l’art des médecins, pas assez dans le secours de Dieu. Les paroles du texte sacré, II Par., xvi, 12, donnent à entendre que l’affaiblissement du sentiment religieux déjà signalé persistait dans le cœur du roi, bien qu’il demeurât fidèle au culte divin et fut toujours très éloigné de l’idolâtrie. Asa mourut après deux ans de cette maladie, et fut enseveli avec magnificence, II Par., xvi, 14, dans le tombeau que, selon la coutume, il s'était fait préparer dans Jérusalem, auprès de ses pères. III Reg., xv, 24 ; II Par., xvi, 14. Son fils Josaphat lui succéda. P. Renard.
2. ASA (Septante : 'Ouo-â ; Codex Alexandrinus : 'A<ra), père ou ancêtre de Barachie, lévite qui, après la captivité, habitait un des hameaux dépendant de Nétophah, aux environs de Bethléhem. I Par., ix, 16.
ASAA. Officier du roi Josias, II Par., xxxiv, 20, nommé ailleurs Asaia. Yoir Asau 1.
- ASAËL##
ASAËL, hébreu : 'Aèah'êl, « Dieu a fait, créé ; » Septante : 'AsarjX. Nom de cinq Israélites.
1. ASAËL, le plus jeune des trois fils de Sarvia, sœur de David. Le seul fait que la Bible raconte de lui est un trait de bravoure qui lui coûta la vie. Avant d’en faire le récit, l’historien sacré a soin de dire qu’Asaël « était extrêmement agile à la course, pareil aux gazelles qui vivent dans les bois ». II Reg., ii, 18. L’agilité à la course était, en effet, une des qualités physiques les plus prisées des anciens, à cause surtout des services qu’elle rendait à la guerre : le principal héros de l’Iliade est Achille « aux pieds légers » ; le dictateur Papirius fut honoré du surnom de Cursor, parce que, au rapport de Tite Live, Hist. rom., IX, 16, « aucun homme de son temps ne pouvait le vaincre à la course. » Cette agilité d’Asaël lui fut funeste le jour où, commandée par ses deux frères aînés, Joab et Abisaï, l’armée de David battit à Gabaon les troupes d’Abner, général d’Isboseth. Au moment de la déroute, il s’attacha aux pas d’Abner, et le serra de si près que celui-ci, malgré son désir de ne pas encourir la haine de Joab en tuant son frère, dut prendre l’offensive et frapper Asaël. Le jeune guerrier tomba mort sur le coup. II Reg., n, 19-23. Voir Abner.
C’est avec une visible sympathie que l’auteur du second livre des Rois parle de la bravoure d’Asaël, qu’il rapporte d’abord le trait de courage qu’elle lui fit accomplir, puis sa mort, la compassion de ses compagnons, s’arrêtant devant son cadavre à mesure qu’ils passaient, et enfin la sépulture qu’ils lui donnèrent dans le tombeau de son père, à Bethléhem ; il a même soin de le comptera part en faisant le recensement des soldats de David tués à Gabaon. II Reg., Il, 30. On sent qu’il était aimé et admiré., ce guerrier qui, malgré sa jeunesse, avait déjà pris place pafrni les officiers désignés dans l'Écriture sous le nom de sâlîsîm, (la Vulgate traduit ce mot par « trente », II Reg., xxiir, 24), et se faisait distinguer même entre les vaillants de l’armée de David. I Par., xi, 26. Le soin de venger Asaël servit de prétexte à Joab pour se débarrasser d’Abner, qui portait ombrage à son ambition ; il le tua par trahison à Hébron, avec la complicité d' Abisaï, « pour venger le sang de son frère Asaël. » II Reg., iii, 27, 30. E. Palis.
2. ASAËL, un des lévites que le roi de Juda, Josaphat, associa aux prêtres qui devaient parcourir le pays pour instruire le peuple de la loi du Seigneur. II Par., xvii, 8.
3. ASAËL, un des lévites préposés à la garde des dîmes et des offrandes faites au temple, sous les ordres de Chonénias et de Séméï, au temps d'Ézéchias. II Par., xxxi, 13.
4. ASAËL (Vulgate : Azahél), père de Jonathan, un de ceux qui avec Esdras recherchèrent les Israélites qui avaient épousé des femmes étrangères pendant la captivité. I Esdr., x, 15. Voir Azahel.
5. ASAËL (Septante : 'A<71ri>. ; omis dans la Vulgate), de la tribu de Nephthali et ancêtre de Tobie. Tob., i, 1.
- ASAIA##
ASAIA, hébreu : 'Âsâyâh, « Jéhovah a fait, créé ; » Septante : 'Aaatoe. Nom de quatre Israélites.
. ASAIÂ, officier du roi Josias, un de ceux qui furent envoyés vers la prophétesse Holda, pour la consulter sur le livre de la Loi trouvé dans le temple. IV Reg., xxii, 12, 14. La Vulgate, II Par., xxxiv, 20, le nomme Asaa.
2. ASAIA, chef d’une des familles de la tribu de Siméon, qui sous le règne d'Ézéchias chassèrent de Gador les pasteurs chananéens. I Par., iv, 36,
3. ASAIA, lévite, sous le règne de David, chef de la famille de Mérari. Il prit part à la translation de l’arche de la maison d’Obédédom à Jérusalem. I Par., VI, 30, " xv, 6, 11.
4. ASAIA, de la postérité de Juda et de la branche de Séla. Il fut des premiers à habiter Jérusalem avec sa famille au retour de la captivité. I Par., îx, 5.
- ASALELPHUNI##
ASALELPHUNI (hébreu : Hasselélpônî, « l’ombre qui me regarde, fixe [?] ; » Septante : 'E<r/)), e6êa>v), sœur des fils d’Etham, de la postérité de Juda. I Par., iv, 3.
ASAN (hébreu : 'Aëân ; Septante : 'Acrctv, Jos., Xix, 7 ; I Par., vi, 59 (hébr. : 44) ; 'Aî<rap, I Par., iv, 32), ville de la tribu de Juda, mentionnée après Labana et Èther, Jos., 15, 42 ; assignée plus tard à la tribu de Siméon. Jos., xix, 7 ; I Par., iv, 32. Elle est donnée comme ville sacerdotale, I Par., vi, 59 ; mais il est bon de remarquer que, dans ce passage, elle occupe la même place que 'Ain dans la liste de Josué, xxi, 16. On la reconnaît généralement aussi dans une des villes auxquelles David, revenu à Siceleg après sa victoire sur les Amalécites, envoya des présents. I Reg., xxx, 30. Citée entre Arama et Athach, elle est appelée Kôr-'Asân ( « fournaise fumante, » d’après Gesenius, Thésaurus, p. 672) ; mais la Vulgate, avec les anciennes versions et plusieurs manuscrits hébreux, a lu Bar 'Âsân, « la citerne d’Asan. »
Son emplacement n’est pas facile à déterminer. D’après Jos., xv, 42, elle se trouvait dans la troisième région de la plaine ou de la Séphéla. Or, parmi les villes du même groupe, plusieurs sont bien connues, comme Nésib (BeitNasib), Geila (Khirbet Kila), Achzib (Ain el-Kezbéh), Warésa (Kkirbet Mérach), qui toutes semblent tourner autour de Beit-Djibrin (Éleuthéropolis). D’un autre côté, Asan est citée, Jos., xix, 7, et I Par., iv, 32, après Ain et Remmon, dont la dernière est bien identifiée avec Khirb’et Oumm er-Roumâmin, à trois heures au nord de Bersabée. Voir Aïn 2. Cette proximité la rapproche du sud, et par là même des localités mentionnées I Reg., xxx, 27-31, Jéther (Khirbet 'Attir), Aroêr ('Ar'ârah), Esthamo (EsSemou’a). Aussi Conder propose de la placer à 'Aséiléh, site peu distant d’Oumm er-Roumâmin, à l’est. Cf. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, 1876, p. 150. Mais, outre le nom, dont le rapport avec 'Asân est assez éloigné, la position elle-même offre une certaine difficulté. Aséiléh, en effet, se trouve tout près d’Anab (Khirbet Anab el-Kebir ou Anab es-Serhir) qui faisait partie du premier groupe de « la montagne ». Jos., xv, 50. Asan, comptée parmi les villes de « la plaine », devrait donc être cherchée plus à l’ouest, et peut - être un peu plus au nord, entre Rimmon et Beit-Djibrin. Eusèbe et saint Jérôme, parlant d' « Asan, dans la tribu de Juda »,
qu’ils distinguent d' « Asan, dans la tribu de Siméon », mentionnent un village appelé encore de leur temps Bethasan, situé à quinze milles à l’ouest de Jérusalem. Cf. Onomasticon, Gœttingue, 1870, p. 221, 222 ; S. Jérôme, Liber de situ et norninibus locorum hebr., t. xxiii, col. 871, 872. Il est probable que ce village marquait plutôt l’emplacement d’Aséna. Voir AsÉNA- 2.
ASANA (hébreu : Has-senû'âh, « le hérissé [?], » nom avec l’article ; Septante : 'Amvou), de la tribu de Benjamin, ancêtre de Salo, un des premiers habitants de Jérusalem après le retour de la captivité. I Par., rx, 7.
- ASAPH##
ASAPH, hébreu : Âsâf, « collecteur ; » Septante : 'Aaâç. Nom de quatre personnages.
1. ASAPH, un des lévites établi par David chef des chantres et des musiciens sacrés, à l'époque où l’arche d’alliance fut définitivement fixée à Sion. I Par., vi, 31, 39 ; xvi, 4, 5, 7 et 37 ; xxv, 1 et 6 ; II Esdr., xii, 45. Fils de Barachie, Asaph descendait de Lévi par Gersom. I Par., vi, 39-43 ; xv, 17. D’abord préfet du second chœur, il se tenait à la droite d’Héman, président primitif de tout le collège des musiciens. I Par., vi, 39. Bientôt après, Asaph est distingué par le titre de <s chef », I Par., xvi, 5 et 7, et mentionné avant Héman et Éthan. I Par., xvi, 37, 41 ; xxv, 1-4, 6 ; II Par., v, 12 ; xxix, 13 et 14 ; xxxv, 15. Patrizi, Cent psaumes, trad. franc., p. 24, en conclut que David substitua Asaph à Héman, et il conjecture que ce changement eut pour cause la supériorité d' Asaph dans la poésie. Il se tenait tout proche du roi et avait ses quatre fils sous ses ordres. I Par., xxv, 2. Dès l’institution des chœurs, il sonnait des cymbales, I Par., xvi, 5, et sa famille reprit cet office après le retour de la captivité,
I Esdr., iii, 10. À la dédicace du temple de Salomon, Asaph était placé à l’orient de l’autel. II Par., v, 12. Il n'était pas simple exécutant des psaumes composés par David, I Par., xvi, 7, etc. ; il était lui-même psalmiste et poète ; aussi est-il appelé « voyant », inspiré, II Par., xxix, 30, « prophète, » I Par., xxv, 2 ; II Par., xxxv, 15, et mentionné avec David comme auteur de cantiques.
II Esdr., xii, 45. Les légendes arabes rapportées par Schegg, Die Psalmen, Munich, 1857, t. i, p. 24, en font le grand vizir de Salomon, le premier sa^e et le plus grand musicien de l'époque, gouvernant les peuples avec autant d’habileté qu’il dirigeait les chœurs sacrés, l’idéal de tous les vizirs. Cf. d’Herbelot, Bibliothèque orientale, Paris, 1697, au mot Assaf, p. 132.
Les titres du psautier hébraïque lui attribuent la composition de douze psaumes, le XLixe et les Lxxiie -Lxxxii « ; la version syriaque y ajoute le c. Ce sont des maskîl ou poèmes didactiques, supérieurs à ceux de David du même genre ; ils en diffèrent pour les pensées et les expressions, la régularité du plan et la beauté de l’exécution. Asaph a moins de naturel et de charme que David, mais plus d'énergie et de doctrine ; son langage est grave, sévère, quelquefois hardi et obscur. Voir Herder, Histoire de la poésie des Hébreux, trad. Garlowitz, 1845, IIe partie, chap. x, p. 502 ; Schegg, Die Psalmen, t. i, p. 25. Toutefois, si l’on en juge d’après le contenu, la plupart des psaumes attribués à Asaph appartiennent à une époque postérieure à David et à Salomon. Le lxxxi » et le lxxxii 6 semblent avoir été composés sous le règne de Josaphat, le lxxix 8 du temps d’Achaz, les lxxiv « , lxxv « et Lxxxe du temps d'Ézéchias ; le Lxxme et le Lxxviiie se rapporteraient à la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. On ne peut guère attribuer avec certitude au premier Asaph que les psaumes xlix et lxxvii. Les autres, inscrits à son nom, sont vraisemblablement l'œuvre de quelques-uns de ses descendants, héritiers de sa charge et de son inspiration. Ses fils, en effet, se distinguèrent sous Josaphat, II Par., XX, 14, sous Ézéchias, II Par., xxix, 13, et sous Josias, II Par., xxxv, 15. Au retour de la captivité, ils reprirent
an nombre de cent vingt-huit (ou de cent quarante-huit, II Esdr., vii, 45), dans le nouveau temple, les anciennes fonctions de leur famille. I Esdr., ii, 41 ; iii, 10 ; II Esdr., xi 17 et 22. Voir F. Dubois, Essai sur les auteurs des Psaumes, Strasbourg, 1834, p. 25-29 ; H. Lesêtre, Le livre des Psaumes, Paris, 1883, p. lvi-lvii et 340-341.
E. Mangenot.
2. ASAPH, père ou ancêtre de Johahé, qui fut l’annaliste officiel du royaume de Juda sous le règne d'Ézéchias. IV Reg, , xviii, 18, 37 ; Is., xxxvi, 3, 22..
3. ASAPH, lévite, ancêtre de Mathania, qui fut un des premiers à se fixer à Jérusalem après la captivité, I Par, ix, 15, et devint chef des chanteurs sous Néhémie. II Esdr., xi, 17. Asaph fut père de Zechri (hébreu : Zikrî), I Par., ix, 15, appelé par erreur de copiste « Zébédée » ( hébreu : Zabdi) dans II Esdr., xi, 17.
4. ASAPH, grand maître des forêts royales d’Artaxerxès. Néhémie obtint du roi une lettre pour se faire donner par cet officier le bois nécessaire aux constructions du temple et de la ville. II Esdr., ii, 8.
- ASARAMEL##
ASARAMEL (Sapaçié'A ; dans plusieurs manuscrits : 'A<7<xpa[jiX), place où se tint l’assemblée dans laquelle les Juifs conférèrent pour toujours à Simon Machabée et à sa postérité le titre et les fonctions de grand prêtre et de prince de la nation. I Mach., xiv, 27. Précédé de la préposition èv, iii, ce nom semble bien être un nom propre de lieu ; cependant, comme il n’est mentionné qu’en ce seul endroit de l'Écriture, il a reçu diverses interprétations, dont il suffit d’indiquer les principales.
1° Quelques auteurs croient y voir une corruption du mot Jérusalem. « En effet, la deuxième et la troisième lettre nous donnent la syllabe SA ; les trois dernières lettres, lues de droite à gauche, nous donnent LEM ; et il nous reste À — RA, qui se rapproche assez de IERV. » F. de Saulcy, Histoire des Machabées, Paris, 1880, p. 276, note. Castalion traduit de même par « Jérusalem ». Mais n’est-il pas inconcevable qu’un nom si connu ait été pareillement estropié ?
2 J Un plus grand nombre d’interprètes y reconnaissent un nom de lieu, tout en le rapprochant de l’hébreu de trois manières différentes : — a) ni"?d nsn, hâsar Millô", « la cour ou le parvis de Mello, » dont il est parlé II Reg., v, 9 ; III Reg., ix, 15, 24. Telle est l’opinion de Grotius, Opéra theologica, Londres, 1679, t. i, p. 758, et de Calmet, Les livres des Machabées, Paris, 1722, p. 225. — 6) Sn ny nsn, hàfar 'am 'El, « la cour du peuple de Dieu, »
c’est-à-dire le grand parvis du temple. Ewald, Geschiehte des Volkes Israël, Gœttingue, 3e édit, t. iv, p. 438. — c) in ny nytfrt, hassa’ar 'am 'El, « la porte du peuple
de Dieu. » Cf. Winer, Biblisches Realwôrterbuch, Leipzig, 1848, t. ii, p. 382.
3° D’autres commentateurs font dériver ce mot de "m ay (ou nwn) Ytf, èar (ou hassar avec l’article) 'am 'El, « prince du peuple de Dieu, » et appliquent ce titre à Simon, reconnu en même temps grand prêtre et souverain temporel. Cette explication, proposée pour la première fois par Wernsdorf, Convmentatio historico - critica de fide historica librorum Machabœorum, Breslau, 1747, p. 176, a été adoptée par Trendelenburg, Gaab, Scholz, C. L. W. Grimm, Dos erste Buch der Makkabâer, in-8°, Leipzig, 1853. p. 214 ; J. Derenbourg, Essai sur l’histoire et la géographie de la Palestine, in-8°, Paris, 1867, p. 451 ; cf. Frd. Keil, Commentar ûber die Bûcher der Makkabàer, Leipzig, 1875, p. 230. Il est naturel, d’après cette opinion, de trouver dès le début du décret officiel les deux litres. du héros machabéen, mentionnés plus loin, t- 42, 47. La version syriaque porte du reste Rabba d’Israël, « prince ou chef d’Israël, » et la préposition èv OICI. DE LA BIBLE.
n’a été ajoutée que par un copiste embarrassé. À ce sentiment, Keil, loc. cit., oppose une double objection. Pourquoi d’abord ce second titre de Simon serait-il donné en hébreu et non pas en grec comme àp-/cepé&>ç, lorsqu’on le rencontre traduit dans les autres passages, xiii, 42 ; xiv, 35, 41 ; xv, 2? Ensuite, si l’on considère la préposition Iv comme une addition maladroite, il ne faut cependant pas oublier qu’elle se trouve dans tous les manuscrits grecs et latins. Comme on le voit, l’explication de ce mot
est encore à l'état de problème.- ASARÉLA##
ASARÉLA (hébreu : 'ÂSar'êldh, « droit devant Dieu ; » Septante : 'EpairçX), quatrième fils d’Asaph 1, chef de la septième classe des chantres du temple sous David. I Par., xxv, 2. Il est appelé Isréela (hébreu : YeSar'êlâh [même sens]) au ꝟ. 14.
- ASARHADDON##
ASARHADDON (hébreu : 'Êsar-haddôn ; Septante : 'AtropSàv ; Canon de Ptolémée : 'AtrapfSivoç ; textes cunéiformes : T ► » — TJX >A^- —, Asur-ah-iddin(a), c’est-à-dire « [le dieu] Assur a donné un frère » ; d’où
284. — Asarhaddon. Bas-relief près de l’embouchure du Nahr el-Kelb en Syrie.
les transcriptions corrompues : Axerdis, dans les fragments d’Abydène ; Ea-/spSov6 ; , dans le livre de Tobie des Septante, I, 21 et 22, et, selon plusieurs commentateurs VA sénaphar de I Esdr., iv, 10, roi d’Assyrie de 681 à 668, d’après le Canon assyrien, fils et successeur de Sennachérib (fig. 284). La Vulgate l’appelle Asarhaddon, IV Reg., xix, 37 ; Is., xxxvii, 38, et Asor-Haddan, I Esdr., iv, 2.
Après le meurtre de Sennachérib, Asarhaddon expulsa par les armes ses frères parricides, et monta lui-même
I. — 36
sur. le trône de son père. IV Reg., xix, 37. Il habita tour à tourNinive, Calach-Nimroud et Babylone. L'événement principal de son règne fut la conquête de l’Egypte, qui avait osé menacer Sennachérib, et qui disputait l’Asie occidentale aux monarques assyriens, en excitant en Palestine, en Phénicie et en Syrie, des révoltes continuelles. Dans le but d’assurer sa sécurité durant son absence, Asarhaddon commença par saccager la Chaldée et la Phénicie, où se montraient des velléités d’indépendance ; puis il transplanta en Assyrie les Hatti (ou Phéniciens, Palestiniens et Syriens), et mit à leur place les Chaldéens prisonniers et leurs alliés, Élamites, etc., dont ses victoires et celles de Sennachérib son père lui laissaient l’entière disposition. L'Écriture fait allusion à ces événements, I Esdr., IV, 2, 9, 10 : les Babyloniens et les Erchuéens ou habitants d'Ërech, l’Arach de la Genèse, représentent la Chaldée ; les Élamites et les Dinéens appartiennent au pays d'Élam ; enfin les Diévéens, les Apharséens, les Apharsatachéens, — Duua, Parsua et Partakka, dans les textes cunéiformes, — paraissent être des tribus mèdes. Quelques auteurs, H. Gelzer, E. Schrader, Fr. Delitzsch, etc., attribuent exclusivement la transportation de tous ces peuples à Assurbanipal, fils d' Asarhaddon ; mais c’est peu probable, ces dernières populations n'étant pas mentionnées dans les inscriptions de cette époque, tandis qu’on les retrouve dans celles d’Asarhaddon ou de Sennachérib son père.
Pour s’assurer aussi de la fidélité de ceux qui échappaient à la déportation, non moins que pour donner une autre démonstration préalable de sa puissance, Asarhaddon convoqua, probablement à l’entrée ou à l’issue d’une de ses campagnes en Egypte, ses vingt-deux tributaires, rois du pays des Hatti ( Syrie, Judée, Philistie, Phénicie, y compris les colonies phéniciennes de la Méditerranée, Chypre, etc.). Parmi ces tributaires, Asarhaddon mentionne M inasie Sar ir laudi, « Manassé, roi de la ville juive : » nous savons, en effet, par la Bible, qu'à cette époque ce prince avait déjà remplacé sur le trône son père Ézéchias. Quant à la captivité de Manassé, elle trouve sa place marquée par l’assyriologie sous Assurbanipal.
C’est alors que le roi d’Assyrie envahit l’Egypte, détenue par le conquérant éthiopien Tharaca, celui-là même qui avait menacé Sennachérib pendant son expédition de Judée. IV Reg., xix, 9. Après trois ou quatre campagnes (675-671) dirigées contre lui par les Assyriens, Tharaca dut lâcher prise et se réfugier dans sa capitale éthiopienne, nommée Napata, tandis qu' Asarhaddon, maître de la vallée du Nil jusqu’au delà de Thèbes, y plaçait des garnisons, y rétablissait une sorte de féodalité, comprenant une vingtaine de petits États, sous l’hégémonie de Néchao I" de Sais (fondateur de la xxvi c dynastie), et prenait pour lui-même les titres de Sar Musur Sar Sarrani Musur Paturisi Kûsi, « roi d’Egypte, roi des rois d’Egypte, de Thébaïde et d’Ethiopie. » — En 668, Asarhaddon remit le pouvoir à son fils Assurbanipal, et se retira à Babylone, où il ne tarda pas à mourir (667) ; à la même époque, l’Egypte, travaillée et reconquise par Tharaca, se soulevait de nouveau.
Voir Cuneiform inscriptions of Western Asia, t. i, pi. XLvm, 5 ; pi. xlv-xlvii ; t. iii, pi. xv-xvi ; pi. xxix, 2 ; 1. 6-18 ; Layard, Inscriptions in the cuneiform character, pi. xx-xxix ; liv-lvih ; Oppert, Les inscriptions des Sargonides, p. 59 et suiv. ; Fox Talbot, Records of the past, t. iii, p. 109 et suiv. ; Menant, Annales des rois d’Assyrie, p. 239 et suiv. ; Budge, History of Esarhaddon, in-8% Londres, 1880 ; Fr. Harper, Cylinder À of Esarhaddon Inscriptions, in-8°, New-Haven, 1888 ; Eb. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, t. ii, p. 120-152, p. 282-285 ; Babylonian Chronicle, dans les Records of the past, new séries, 1. 1, p. 26-29 ; édit. Pinches, p. 9 et 17 ; SchraderWhitehouse, The cuneiform inscriptions and Old Testament, t. ii, p. 17 et suiv. ; Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., t. iv, p. 251-261 ; Lenor mant-Babelon, Histoire ancienne de l’Orient, t. IV, p. 521 et suiv. ; t. ii, p. 268-275 ; Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, b* édit., p. 449-457 ; G. Rawlinson, The five great Monarchies, t. ii, p. 185-200.
- ASARMOTH##
ASARMOTH (hébreu : Hâsarmâvét ; Septante : 2ap(iciO). C’est le nom du troisième des treize fils de Jectan, descendant de Sem par Arphaxad, Salé et Héber. Gen., x, 26 ; I Par., i, 20. Les descendants de Jectan, jectanides ou qahtanides, peuplèrent la péninsule arabique. Les fils d’Asarmoth descendirent jusqu'à la partie méridionale qui est en bordure sur l’océan Indien. Ils y trouvèrent déjà établies des peuplades d’origine chamitique, les tribus de Sabatha, Gen., x, 7, avec lesquelles elles se disputèrent la possession du pays. Les Chamites finirent par passer en Afrique, de l’autre côté du détroit, ne laissant que quelques représentants de leur race dans la région primitivement occupée. L’antique territoire des fils de Râsarmâvêt a conservé son nom jusqu'à nos jours ; il s’appelle en arabe ….'1 <ÂC T Hadramaut. Pline, H. N., vi, 28, . en nomme les habitants les « Chatramotites ». L’Hadramaut est borné à l’ouest par l’Yémen, au nord par le désert el-Akhaf, à l’est par le pays d’Oman, au sud par la mer d’Oman et le golfe d’Aden. C’est une région torride et assez insalubre, qui justifie jusqu'à un certain point son nom de « vestibule de la mort » ; car tel est le sens du mot hébreu et du mot arabe correspondant. Le pays est en partie montagneux, et fertile en produits recherchés, la gomme, la myrrhe et surtout l’encens. Les habitants faisaient le commerce de ces divers produits, et servaient d’intermédiaires entre l’Egypte, la Syrie, la Mésopotamie, l’Inde et l’Afrique. Leurs ports sur l’océan Indien étaient des entrepôts ouverts aux navigateurs étrangers ; car eux-mêmes ne s’aventuraient pas loin sur la mer. On ne sait rien de bien précis sur l’histoire de ce peuple avant la conquête musulmane.
H. Lesêthe.
- ASASONTHAMAR##
ASASONTHAMAR (hébreu : Hasàsôn et Hasesôn tâmâr ; Septante : 'A<ro « 70v6aii.ap et 'Adajav ©a[i<£p), nom primitif, Gen., xiv, 7, et II Par., xx, 2, de la ville appelée plus tard Engaddi, sur la rive occidentale de la mer Morte. Voir Engaddi.
- ASBAÏ##
ASBAÏ (hébreu : 'Ezbâï ; Septante : 'AÇoêaOi père de Naaraï, un des vaillants guerriers de l’armée de David, d’après I Par., xi, 37 ; mais ce nom paraît altéré. D’après, le passage parallèle, II Reg., xxiii, 35, Asbaï est poui* Arbi ou plutôt Arab, ville de Juda d’où ce guerrier était originaire (voir Arab et Arbi), et il faut lire Pharaï au lieu de Naaraï. J ^
ASBÊA'. Voir Aschbéa.
- ASBEL##
ASBEL (hébreu : 'ASbêl ; Septante : 'Aaë-f[l, 'A<ru6rip), deuxième fils de Benjamin. Gen., xlvi, 21 ; Num., xxvi, 38 ; I Par., viii, 1.
- ASBÉLITES##
ASBÉLITES (hébreu : Hâ'asbêli (avec l’article) ; Septante : 6 'Aavtirp(), les descendants d’Asbel, fils de Benjamin. Num., xxvi, 38.
- ASCALON##
ASCALON ( hébreu : 'ÂSqelôn ; Septante : 'AdxâXuv), une des cinq principales villes des Philistins, Jos., xiii, 3 ; I Reg., vi, 17, sur la Méditerranée, dans la plaine de la Séphéla, entre Gaza et Azot (fig.285). C'était la seule des cités philistines située sur le rivage de la mer. Elle était à 520 stades (Josèphe, Bell, jud., III, ii, 1, édit. Didot, t. ii, p. 145) ou 53 milles (Table de Peutinger) de Jérusalem (97 kilomètres envi 285. — Monnaie dMscalon.
Tête de femme tourelée.
fy AS. Une galère.
ron) ; à 16 milles (Itinéraire d’Antonin) de Gaza (23 kilomètres ; cf. Ptolémée, v, 16, édit. d’Amsterdam, 1605, p. 140) ; à 200 stades (Strabon, xvi, 29, édit. Didot, p. 646) de Jamnia (environ 37 kilomètres). Son nom antique s’est conservé sous la forme arabe moderne d’Askulan. L’origine en est inconnue ; elle ne semble pas être sémitique. D’après une vieille tradition (Xanthus et Nicolas de Damas, dans Mûller, Histor. Grsec. Fragm., 11, « la ville misérable, que prit Sa Majesté, quand elle se révolta. » Les soldats égyptiens montent à l’assaut des murs sur dès échelles ; les défenseurs de la place paraissent être des Chananéens (flg. 286). Cf. Brugsch, Geographische Inschriften altâgypt. Denkmaler, t. i, 1857, p. 61 ; t. ii, 1858, p. 74 ; Id., Reiseberichten nus Aegypten, 1855, p. 117 ; Id., Geschichte Aegyptens, 1877, p. 516. Les Philistins n’occupaient pas encore la
[[File: [Image à insérer]|300px]]
286. — Prise d’Aecaton par Eamsès II. Thèbes. Grand temple de Earnak. D’après Lepsius, Denkmaler, Abth. iii, pi. 145.
t. i, p. 38 ; 26, t. iii, p. 372), d’ailleurs sans vraisemblance (Mignot, Sixième Mémoire sur les Phéniciens, dans les Mémoires de l’Académie des inscriptions, 1770, t. xxxiv, p. 339 ; Bochart, Phaleg, ii, 12, Opéra, Leyde, 1692, t. i, col. 87-88), elle aurait été fondée par les Lydiens. Elle est déjà nommée dans les lettres cunéiformes trouvées à Tell el-Amarna. Zeitschrift fur Assyriologie, t. vi, 1891, p. 252. Ramsès II la prit, l’an xi de son règne, et il a fait représenter sa conquête sur les murs d’un temple de Karnak (Lepsius, Denkmaler,
Abth. iii, pi. 145 C). On y voit p ^ <Ç J^ > Asgalna,
ville du temps de Ramsès II, mais ils ne tardèrent pas à en devenir les maîtres. Voir Philistins.
Les Egyptiens rencontraient Ascalon sur leur chemin, quand ils se rendaient de la vallée du Nil en Syrie, en longeant la mer Méditerranée ; mais comme elle n'était point sur la route qui conduisait de Palestine en Egypte, et qu’elle se trouvait assez loin et à l'écart du pays qu’habitèrent les Hébreux, c’est parmi les cités philistines celle qui est le moins souvent mentionnée dans les Écritures. Elle est nommée pour la première fois comme nom ethnique dans Josué, xiii, 3, dans rénumération des frontières occidentales du territoire Occupé par les Israélites ; et quoique la tribu de Juda s’en emparât, Jwl., i, 18, elle ne resta pas en sa possession. L’exploit de Samson est à peu près le seulWénement, relatif à cette ville, rapporté .par l'Écriture avant la captivité de Babylone ; ce héros s’y rendit de Thamnatha (distant à vol d’oiseau de près de 39 kilomètres) et y tua trente hommes, dont il donna les dépouilles aux Philistins qui avaient deviné son énigme, grâce à la perfidie de sa femme. Jud., xiv, 19. Le premier livre des Rois, vi, 17, mentionne seulement Ascalon avec les quatre autres capitales philistines qui offrirent chacune un tehôr (Vulgate : anus) d’or à Jéhovah, lorsque les Philistins, frappés par la vengeance divine, renvoyèrent en Israël l’arche d’alliance dont ils s'étaient emparés dans un combat. David, dans son élégie suiMa mort de Saùl et de Jonathas, tués à la bataille de Gelboé, recommande de ne point annoncer à Geth et à Ascalon la nouvelle du désastre d’Israël, de peur que les filles des Philistins n’en soient remplies de joie. II Reg., i, 20. Les prophètes nomment quelquefois Ascalon : Amos, i, 8 ; Sophonie, ii, 4, 7 ; Jérémie, xxv, 20 ; xlvii, 5, 7 ; Zacharie, ix, 5, prédisent sa désolation et sa ruine.
Quelques autres traits de son histoire nous sont
connus par des sources profanes. D’après Justin, xviii, 3,
la ruine de Sidon aurait été l'œuvre d’un roi d' Ascalon
qui, par sa victoire, força leshabitants de cette ville
à chercher un refuge à Tyr un an avant la guerre de
Troie. Les inscriptions cunéiformes nous ont révélé un
épisode plus certain et encore plus intéressant de l’histoire de cette ville : il date de l'époque de l’invasion de
la Palestine par Sennachérib (701 avant J. -C). « Sidka,
roi d' Ascalon, ![]() , is-qa-al-lu-na, dit Sennachérib dans le cylindre de
Taylor, ne s'était pas courbé sous mon joug ; je pris les
dieux de la maison de son père, sa propre personne, sa
femme, ses fils, ses filles, la famille de la maison de son
père, et je les emmenai en Assyrie. J'établis roi des Ascalonites Sarludari, fils de Rukibti, leur ancien roi, et je
lui imposai un tribut. » Cuneiform Inscriptions of western
Asia, t. i, pl. 37, col. ii, lignes 58-63. Voir aussi, ibid.,
l’inscription des taureaux de Koyoundjik, t. iii, pi. 12,
lignes 20-21. Le roi d’Assyrie y raconte de plus, ligne 29,
qu’il donna au roi d' Ascalon une partie des places qu’il prit
à Ézéchias, roi de Juda. On peut déduire de ce récit que
les habitants d’Ascalon avaient pris parti avec les Juifs
contre les Assyriens, dont, ils avaient été déjà tributaires
du temps de Théglathphalasar ( Cuneiform Inscriptions,
t. ii, pl. 67, ligne 61), sous leur roi Mitinti. Rukibti était
probablement resté fidèle au roi de Ninive, et c’est pour
ce motif que Sennachérib donna le trône à son fils Sarludari. Les Ascalonites cpntinuérent à payer tribut aux
deux successeurs de Sennachérib, Asarhaddon et Àssurbanipal : ces deux princes nomment « Mitinti, , roi de la
ville d’Ascalon », parmi les vingt-deux rois de « la terre
d’Occident » qui leur étaient soumis. Cuneiform Inscriptions, t. iii, pl. 16, ligne 5 ; G. Smith, History of
Assurbanipal, Cylindre C, ligne 7, in-8°, Londres, 1871,
p. 30. Plus tard, du temps de la suprématie des Perses,
Ascalon passa sous la domination des Tyriens (Scylax,
Peripl., 104, dans les Geographi grxci minores, édit.
Millier, t. i, p. 79), puis sous celle d’Alexandre, comme
l’attestent ses monnaies (L. Müller, Numismatique
d’Alexandre le Grand, 1885, p. 308, pi. n » 1472 et suiv.),
et, après lui, sous celle de ses successeurs-, les Ptolémées
d’Egypte d’abord (Josèphe, Ant. jud., XII, iv, 5, t. i,
p. 451), et ensuite les Séleucides de Syrie, d’après le
témoignage du premier livre des Machabées, x, 86, et des
monnaies frappées à Ascalon au nom d’Antiochus III,
d’Antiochus IV, etc. (Voir Mionnet, Description des médailles, t. v, p. 25, 38, 72, 525, etc. ; Gardner, Catalogue
of the Greek coins, Seleucid Kings, 1878, p. 68, 81, etc. ;
E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes, t. ii, Leipzig,
1886, p. 65-67.)
, is-qa-al-lu-na, dit Sennachérib dans le cylindre de
Taylor, ne s'était pas courbé sous mon joug ; je pris les
dieux de la maison de son père, sa propre personne, sa
femme, ses fils, ses filles, la famille de la maison de son
père, et je les emmenai en Assyrie. J'établis roi des Ascalonites Sarludari, fils de Rukibti, leur ancien roi, et je
lui imposai un tribut. » Cuneiform Inscriptions of western
Asia, t. i, pl. 37, col. ii, lignes 58-63. Voir aussi, ibid.,
l’inscription des taureaux de Koyoundjik, t. iii, pi. 12,
lignes 20-21. Le roi d’Assyrie y raconte de plus, ligne 29,
qu’il donna au roi d' Ascalon une partie des places qu’il prit
à Ézéchias, roi de Juda. On peut déduire de ce récit que
les habitants d’Ascalon avaient pris parti avec les Juifs
contre les Assyriens, dont, ils avaient été déjà tributaires
du temps de Théglathphalasar ( Cuneiform Inscriptions,
t. ii, pl. 67, ligne 61), sous leur roi Mitinti. Rukibti était
probablement resté fidèle au roi de Ninive, et c’est pour
ce motif que Sennachérib donna le trône à son fils Sarludari. Les Ascalonites cpntinuérent à payer tribut aux
deux successeurs de Sennachérib, Asarhaddon et Àssurbanipal : ces deux princes nomment « Mitinti, , roi de la
ville d’Ascalon », parmi les vingt-deux rois de « la terre
d’Occident » qui leur étaient soumis. Cuneiform Inscriptions, t. iii, pl. 16, ligne 5 ; G. Smith, History of
Assurbanipal, Cylindre C, ligne 7, in-8°, Londres, 1871,
p. 30. Plus tard, du temps de la suprématie des Perses,
Ascalon passa sous la domination des Tyriens (Scylax,
Peripl., 104, dans les Geographi grxci minores, édit.
Millier, t. i, p. 79), puis sous celle d’Alexandre, comme
l’attestent ses monnaies (L. Müller, Numismatique
d’Alexandre le Grand, 1885, p. 308, pi. n » 1472 et suiv.),
et, après lui, sous celle de ses successeurs-, les Ptolémées
d’Egypte d’abord (Josèphe, Ant. jud., XII, iv, 5, t. i,
p. 451), et ensuite les Séleucides de Syrie, d’après le
témoignage du premier livre des Machabées, x, 86, et des
monnaies frappées à Ascalon au nom d’Antiochus III,
d’Antiochus IV, etc. (Voir Mionnet, Description des médailles, t. v, p. 25, 38, 72, 525, etc. ; Gardner, Catalogue
of the Greek coins, Seleucid Kings, 1878, p. 68, 81, etc. ;
E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes, t. ii, Leipzig,
1886, p. 65-67.)
Du temps des Machabées, Jonathas ayant battu les troupes d’Apollonius, envoyé contre lui par le roi de Syrie, Démétrius II Nicator (147 avant J.-C), Ascalon ouvrit ses portes au vainqueur et le reçut à deux reprises avec dé grands honneurs. IMach., x, 86 ; xi, 60. Elle resta fidèle aux Machabées, sous son gouvernement. I Mach., xii, 33. Dans la suite, elle devint ville libre [oppidum liberum, Pline, H. N., v, 14), sous le protectorat de Rome. De l'établissement de son indépendance date une ère qui commence à l’an 104 avant J.-G.Voir Chron., pasc. ad ann.' U. C. 655, et la note ibid., Patr. gr., t. xcii, col. 448. Les années sont marquées d’après cette ère sur un certain nombre de monnaies frappées à Ascalon (fig. 287).

287. — Monnaie d’Ascalon.
ΣΕΒΑ[Σ]ΤΟΣ. Tête laurée de Néron, à droite ; devant, l’extrémité supérieure d’un candélabre. — ꝶ. ΑΣΚΑΛΩ[Ν]. Le génie
de la ville, tourelé, debout sur une barque tenant nn trident
et Facrostolium ; à droite une colombe et la date AOP (171,
c’est-à-dire an 67 de notre ère) ; à gauche, un candélabre.
L’ancienne cité philistine y est quelquefois représentée par un génie dont la tête est couronnée de tours ; il est debout sur une barque qui indique la situation de la ville sur le bord de la mer ; à droite est une colombe qui rappelle le culte de la déesse Atergatis ou Dercéto, en grande faveur auprès des Ascalonites. Cf., sur les monnaies d’Ascalon, de Saulcy, Numismatique de le Terre Sainte, p. 178208. C’est là, disait-on, que Dercéto avait donné le jour à la fabuleuse Sémiramis. Diodore de Sicile, ii, 4, 2, édit. Didot, t. i, p. 83. Cf. Eusèbe, Prasp. Ev., viii, 14, t. xxi, col. 672-673. Voir Atargatis. Le temple qu’on avait érigé à Dercéto dans cette ville était, d’après Hérodote, i, 105, le plus ancien qui eût été construit en son honneur. Lorsque les Scythes, après la défaite de Cyaxare I er, roi des Mèdes, envahirent l’Asie occidentale, ils poussèrent jusqu’en Egypte, d’où Psammétique ne les chassa qu'à force de présents ; à leur retour, un de leurs détachements pilla à Ascalon le temple d' Atergatis (625 avant J.-C.). Hérodote, i, 105.
Josèphe nous fait connaître l’histoire de cette ville à son époque. Hérode le Grand y était né. (Eusèbe, H. E., i, 6, t. xx, col. 85 ; S. Justin, Dial. cum Tryph., 52, t. vi, col. 589-592 ; cf. E. Schürer, Geschichte des jûdischen Volkes, t. i, 1'= part., 1889, p. 233-234.) Quoiqu’elle n’appartînt pas à son royaume, il y fit bâtir de magnifiques portiques, des thermes, des fontaines. (Josèphe, Bell, jud., I, xxi, 11, p. 53.) Après sa mort, sa sœur Salomé reçut en don de l’empereur Auguste le château royal d’Ascalon. (Josèphe, Ant. jud., XVII, xi, 5, p. 688 ; Bell, jud., II, vi, 3, p. 94.) Pendant la guerre des Romains contre les Juifs, cette ville eut beaucoup à souffrir et se montra très hostile à l'égard des sectateurs de la loi mosaïque (Josèphe, Bell, jud., II, xym, l, 5 ; III, ii, l-3, p. 126, 128, 145-147 ; Philo, Légat, ad Caium, 30, édit. Mangey, t. ii, p. 576), de même que, dans la suite, à l'égard des chrétiens. Elle se signala dans les premiers siècles par son attachement au paganisme ; le culte qu’elle rendait aux dieux, les jeux qu’elle célébrait en leur honneur, ont été vantés par les anciens et sont mentionnés dans les monuments épigraphiques. Une antique Descriptio orbis nous apprend que ses athlètes et ses lutteurs étaient les plus renommés de la Syrie. (Geographi grxci minores, édit. Müller, t. ii, p. 519. Pour les inscriptions, voir Corpus inscr. greec, n" 4472, t. iii, p. 237 ; Le Bas et Waddington,
Inscriptions grecques et latines, t. iii, n° 1839.) Son zèle polythéiste éclata contre les chrétiens, qui y furent cruellement persécutés. Chron. pasc, ad ann. 361, t. xcil, col. 741- Elle eut néanmoins un siège épiscopal Voir Le Quien, Oriens christiamts, t. iii, p. 598 et suiv. ; Gams, Séries Episcoporum, 1873, p. 453. Le christianisme en disparut sans doute avec l’invasion musulmane. Elle joua un grand rôle pendant les guerres des croisés, mais elle fut enfin complètement détruite en 1270 par Bibars Bondokdar, et depuis elle n’a jamais été relevée. Celle que les auteurs arabes appelaient, à cause de sa beauté, « la Fiancée de la Syrie » (Ritter, Erdkunde, t. xvi, p. 73)^ n’est plus qu’un monceau de ruines, en partie ensevelies sous les sables. Tous ceux qui les ont visitées s’accordent à dire qu’elles sont comme l’image de la désolation. Ed. Robinson, Biblical Researches in Palestine, Boston, 1841, 1. ii, p. 369. Le site est magnifique, mais c’est une solitude, sans un seul habitant. V. Guérin, La Judée, t. ii, p. 149. Si, après avoir marché au milieu des décombres et des nombreux débris de colonnes de marbre et de granit, l’on monte au haut de ce qui reste des murs de l’antique citadelle, on a sous les yeux Ascalon, ou plutôt la place où elle fut jadis. « De cette élévation, dit Porter, M peine peuton voir quelque ruine isolée, à part les murailles de la ville. Comme j'étais assis là un matin, je comptai cinq paires de bœufs qui labouraient (dans l’enceinte d’Askulan), deux autres qui tiraient l’eau pour arroser, et vingt-huit hommes ou femmes occupés aux -travaux des champs. Telle est une partie de la ville, l’autre partie est encore plus tristement désolée. Le sable ilanc a franchi le mur du côté du midi, le recouvrant presque en entier, même dans ses parties les plus hautes, et il s'étend en larges bandes sur le sol à l’intérieur. La scène présente un tel aspect de désolation, qu’il est pénible de la contempler : d’antiques fondations de maisons, de palais peut-être, et les jeunes vignes qui ont été plantées par des hommes encore vivants, sont également submergées sous des flots de sable. Et le sable avance toujours, de sorte que probablement avant un demi-siècle le site même d' Ascalon aura disparu. Que les paroles de Sophonie, ii, 4, prononcées il y a vingt-cinq siècles sont exactes : Ascalon sera désolée, ainsi que celles de Zacharie, ix, 5 : Ascalon ne sera plus habitée… Un petit village est à côté d’Askulan, mais il n’existe pas une seule habitation humaine dans l’intérieur de ses murs. » Porter, 'Handbook for Syria, p. 276.
L’aspect imposant de ses ruines atteste cependant encore aujourd’hui son ancienne splendeur. Voir Rosenmûller, Handbuch der biblischen Alterthùmer, t. ii, part, ii, p. 383. Elles sont, avec celles de Césarée de Palestine, les plus importantes qu’on rencontre sur la côte de Ja Méditerranée entre Gaza et Beyrouth, et elles permettent de reconstituer encore aujourd’hui fidèlement le plan de l’antique cité (fig. 288). Quoique Ascalon fût de grandeur médiocre (Strabon, xvi, 29, p. 646), sa position en faisait une place très forte. Josèphe, Bell, jud., III, II, 1, t. ii, p. 145. Un des historiens contemporains des croisades, Guillaume, archevêque de Tyr, Hist. rerum transmarinarum, xvii, 22, Patr. làt., t. CCI, col. 696-697, a décrit Ascalon avec justesse de la manière suivante : « Ascalon, dit-il, est située sur le rivage de la mer. Elle a la forme d’un demi-cercle dont la corde ou le diamètre court parallèlement à la mer, tandis que la circonférence ou arc de cercle est tourné à l’orient du côté de la terre ferme. Xa cité est comme enterrée dans une fosse, et s’abaisse "vers la mer, entourée de remblais faits de mains d’homme, sur lesquels s'élèvent les remparts, flanqués de nombreuses iours et construits avec beaucoup de solidité. » Pour être tout à fait exact, Guillaume de Tyr aurait dû ajouter qu’une .grande partie des fortifications n'était pas artificielle, mais formée du côté ouest et nord-est par des rochers qui ont de neuf à vingt mètres de haut, et qui dessinaient en fros le plan de la ville. La nature avait préparé elle-même
cet amphithéâtre, au milieu de ce magnifique paysage, pour servir de siège à une ville florissante. Le pourtour de l’arc avait approximativement 1600 mètres. La muraille, qui était comme le diamètre du demi-cercle, mesurait environ 1 200 mètres de longueur. Vers le milieu était la porte appelée de la Mer, parce qu’elle y conduisait. C’est à l’angle sud-ouest que le niveau du terrain est le plus bas. Il y
l.TtaiHiër.diF
[[File: [Image à insérer]|300px]]
288. — Plan d' Ascalon.
avait là un petit port, dans l’intérieur même de la ville. Des deux côtés de l’entrée de ce port, les fortifications étaient particulièrement considérables. Ascalon avait d’ailleurs une rade plutôt qu’un véritable port, et cette rade n'était guère bonne. Dans le côté sud des murailles s’ouvrait une porte sur la route de Gaza ; elle est aujourd’hui presque, ' complètement ensablée. À l’est sont les points les plus élevés et les plus forts de l’enceinte. On peut supposer que là se trouvait la citadelle, au nord de laquelle était la porte, flanquée de deux tours, qui conduisait en Judée. Au nord était une quatrième porte qui menait à Jaffa. Les murailles devaient avoir environ dix mètres de hauteur, et en moyenne deux-mètres de largeur. Il faut une heure pour faire le tour de l’enceinte. Les restes actuels sont ceuK de la ville des croisés^ mais, à cause de sa configuration naturelle, elle a dû être à peu près la même à toutes les époques.
A l’intérieur des murs, on est frappé d’un spectacle inattendu. Ce ne sont point seulement des débris et des monceaux de décombres qu’on y rencontre, mais presque partout une végétation luxuriante. Les chemins sont marqués par de petits murs formés de pierres superposées, et semblent correspondre aux rues anciennes. M. V. Guérin, La Judée, t. ii, p. 144-148, y a remarqué les ruines de trois églises, les restes d’un théâtre et un grand nombre de citernes et de puits. Celui qui est marqué sur le plan, au nord-ouest, est taillé dans le roc ; il est rond et profond, et l’eau qu’il renferme est au niveau de la mer. Comme l’avait très bien observé Guillaume de Tyr, Hist., t. CCI, col. 697 : « On ne trouve aucune source ni à l’intérieur de la ville ni dans le voisinage, mais les puits abondent au dehors et au dedans, et l’eau en est bonne et agréable à boire. On avait aussi construit, pour plus de sûreté, dans l’enceinte des murs, quelques citernes destinées à recevoir l’eau de pluie. » D’après une tradition mentionnée dans Origène, Cont. Cels., iv, 44, t. xi, col. 1100 (cf. S. Jérôme et Eusèbe, Onomasticon, édit. de Lagarde, Gcettingue, 1887, p. 176, 288), quelques-uns des puits d’Ascalon auraient été creusés par Abraham. Cette tradition se retrouve dans la version samaritaine
du Pentateuque, qui a substitué le nom d’Ascalon à celui de Gérare, dans la Genèse, xx, 1, 2, et xxvi, 1. Die Samaritanische Pentateuch -Version, die Genesis, éditée par M. Heidenheim, in-8°, Leipzig, 1884, p. 23 et 31.
Les vallées qui entourent Askulan ont « té envahies par les sables au sud et au sud-est, et sont par conséquent stériles ; mais au nord et au nord-est la fertilité est merveilleuse. À côté des ruines de la citadelle, de magnifiques caroubiers et d'énormes sycomores marquent la limite entre le sable et la terre cultivée (flg. 289). De là, des jardins et des vergers, séparés les uns des autres par de
arabe : el-henna), qui a servi de tout temps aux Orientaux pour teindre en jaune rougeâtre les ongles et diverses parties du corps ; Dioscoride, De re mediea, i, 124, édit. Sprengel, 1. 1, p. 118, et Pline, H.N., xii, 24, édit. Teubner, t. ii, p. 306, disent que le cypre d’Ascalon était, avec celui de Canope, le meilleur et le plus estimé de leur temps. Quelques essais de fouilles faits à Ascalon ont donné peu de résultats. En 1815, lady Stanhope y employa pendant quinze jouis cent cinquante ouvriers indigènes, pour retrouver le temple de Dercéto, où elle croyait qu’un trésor était enfoui ; mais elle n’y trouva guère qu’un beau
[[File: [Image à insérer]|300px]]
289. — Ruines d’Ascalon, vues du cété de l’est.
petits murs et par des haies de cactus et d’autres arbustes épineux, s'étendent au nord jusqu’au village d’el-Djora, et, comme ceux de l’intérieur d’Ascalon, sont remplis d’oliviers, de figuiers, d’orangers, de citronniers, de grenadiers, d’amandiers, d’abricotiers, de palmiers. Parmi les légumes que produit ce riche sol, soigneusement arrosé, pousse spontanément l'échalotte, allium ascalonicum (voir Ail, col. 310-311), qui a tiré son nom de cette ville. Pline, H. N., xix, 6. Cf. Théophraste, De historia plant., vii, 4 ; Columelle, De re rustica, xii, 2. On y voit aussi, à l'état sauvage, la vigne et le henné ( Lawsonia alba ou inermis), qui rappellent le vin d’Ascalon, célèbre dans l’antiquité (Alexandre de Tralles, viii, 3 ; Orbis descriptio, 29, dans Mûller, Geographi minores, édit. Didot, t. ii, p. 519 ; Oribase, Œuvres, traduct. Bussemaker et Daremberg, 6 in-8°, Paris, t. i, 1851, p. 423, 649), et le cypre (hébreu ; kôfér, Gant., i, 13 ;
torse de marbre qui fut mis en pièces. Travels of Lady Hester Stanhope, narrated by her physician, 3 in-8°, Londres, 1846, p. 87-94, 152-169. Cf. J. Kinnear, Cairo, Petra and Damascus in 1839, in-8°, Londres, 1841, p. 211-214. Ibrahim -Pacha, en 1832, voulut faire revivre Ascalon en créant une ville nouvelle avec les débris de l’antique, et ses travaux mirent au jour quelques restes. Voir Dav. Roberts, Vues et monuments de la Terre Sainte, in-f°, Bruxelles, 1845, livr. 8, n" 46, Ascalon. En 1866, M. Schick en a relevé le plan, qui a été publié en 1879 dans la Zeitschrift des deutschen Palàstina-Vereins, t. ii, Tafel v. Le Survey of the Palestine Exploration Fund a donné depuis un autre plan plus détaillé et plus complet dans ses M emoirs, t. m (1883), vis-à-vis la p. 237. Au mois de septembre 1887, on y a trouvé deux statues mutilées de la Victoire. Th. Reinach, Les sculptures d’Ascalon, dans la Revue des études juives, janviermars 1888,
t. xvi, p. 24-27. On n’y a jamais fait jusqu’ici de fouilles méthodiques.
VoirV. Guérin, Description des ruines d’Ascalon, dans le Bulletin de la Société de géographie, 4e série, t. xiii, février 1857, p. 81-95 ; Id., Description de la Palestine, Judée, t. ii, p. 135-149, 153-171 ; T. Tobler, Dritte Wanderung nach Palâstina im Jahre 1851, in-8°, Gotha, 1859, p. 32-44 ; Ritter, Erdkunde, t. xvi, 1852, p. 69-89 ; H. Guthe, Die Ruinen Ascalon’s, dans la Zeitschrift des deutschen Palâstina -Vereins, t. ii, 1879, p. 164-171 ; Ebers et Guthe, Palâstina in Bild und Wort, 2 in-4°, Stuttgart, 1884, t. ii, p. 180-182, 454-455 ; Stark, Gaza und die philistâische Kûste, in-8°, léna, 1852, p. 23, 455, 561 ; Warren, The Plain of Philistia, dans le Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, avril 1871, p. 87-89 ; Gonder et Kitchener, The Survey of Western Palestine (avec plan et vues), Memoirs, t. ru, 1883, p. 237-247 ; W. Thomson, The Land and the Book, Southern Palestine, in-8°, Londres, 1881, p. 170-178 ; Conder, Tentwork in Palestine, 1878, t. ii, p. 164-166.
F. Vigouroux.
- ASCALONITE##
ASCALONITE (hébreu : hâ-'Esqelônî ; Septante ; 'AuxaWvtTYjc), nom ethnique, habitant d’Ascalon. Jos., XIII, 3. Voir Ascalon.
- ASCENEZ##
ASCENEZ (hébreu : 'ASkenaz ; Septante : 'Acr/oevaÇ, Gen., x, 3 ; I Par., i, 6 ; mît 'AxavaÇéoiç, Jer., xxviii (li), 27), le premier des trois fils de Gomer, fils de Japheth, c’est-à-dire un des peuples de la grande race japhétique. Gen., x, 3 ; I Par., i, 6. Pour savoir quel rameau ethnographique il représente, il nous faut consulter les traditions anciennes, étudiées à la lumière de la critique et des découvertes modernes. « Aschanaz, dit Josèphe, fut le père des Aschanaziens, qui maintenant sont appelés 'P^iveç par les Grecs. » Ant. jud., i, vi, 1. L’historien juif est reproduit par différents auteurs, entre autres par saint Jérôme, Hebr. Qusest. in Gènes., t. xxiii, col. 951. Que signifie ce nom de Rhégines, absolument inconnu d’ailleurs ? Désigne-t-il la Rhagiane, 'Payiavii, une des provinces de la Médie, don la capitale était Rhagse, 'Payotî, ou le canton delà Babylonie qui renfermait la ville de Rhagsea, 'Potyata ? On ne sait. Faut-il le rapporter aux Rugii du nord de la Germanie ? Tacite, German., 43 ; Ptolémée, II, 11, 27. Quelques savants l’ont cru. Mais cette double hypothèse semble inadmissible, car Josèphe suit ordinairement avec exactitude le système d’assimilation des anciens docteurs juifs, et tous ces noms nous transportent bien en dehors des limites assignées à Ascenez par leurs plus vieilles traditions.
En effet, dans les deux Talmuds, celui de Jérusalem, Mégillah, i, 1, et celui de Babylone, Yoma, 10 a, de même que dans les Targums, 'Askenaz est expliqué par Asia. Cf. A. Neubauer, La géographie du Talmud, Paris, 1868, p. 309-310, 423. Et il ne s’agit pas ici, comme l’a pensé -4£nobel, Die Vôlkertafel der Genesis, Giessen, 1850, p. 40, du petit canton de l’Asie propre en Lydie, Strabon, xiii, p. 627 ; mais bien de la province romaine de l’Asie proconsulaire, toujours désignée dans les Talmuds par ce nom d’Asta. La tradition des écoles juives, à l'époque la plus reculée où nous puissions la saisir, plaçait donc dans l’Asie Mineure occidentale la patrie du fils aîné de Gomer. Et c’est précisément dans cette contrée, comme nous le verrons, que se rencontre tout un groupe de noms géographiques dont les meilleurs critiques n’hésitent pas à reconnaître la parenté incontestable avec celui d' 'Askenaz. Cf. F. Lenormant, Les origines de l’histoire, Paris, 1880-1884, t. ii, p. 389.
Cependant les commentateurs juifs du moyen âge croient que les Germains sont les descendants d' Ascenez. (Les Juifs allemands s’appellent encore aujourd’hui Askenàzi.) Knobel, ouvr. cit., adopte cette opinion. Il regarde le mot Askenaz comme un nom composé, As-kenaz,
dont le dernier élément serait l'équivalent du grec titoç, latin gens, genus, et dont la signification serait alors : « race ou nation d’As. » C’est « la tribu qui de très bonne heure vint s'établir dans les pays Scandinaves et germains, les Ases, opinion que favorise la légende allemande de Mannus et de ses trois fils, Iscus (Ash, 'A<rxdmoç), Ingus et Hermino. On trouve encore de nos jours, dans le Caucase, une peuplade que Knobel rapporte à la même origine. Elle se nomme elle-même Ir, Iron ; mais elle est appelée par les autres peuples caucasiens Osi, Oss ; par les Russes Iases, et par les anciens voyageurs As ou Aas. C’est une tribu primitive qui se distingue de toutes les autres du Caucase, et dans laquelle la physionomie européenne, en particulier les yeux bleus et les cheveux blonds ou rouges, mérite d'être remarquée. Sa langue est indogermanique, et a beaucoup de mots communs avec l’allemand ; elle a même quelque chose de germanique dans le son et le débit. » Crelier, La Genèse, Paris, 1889, p. 126. Nous croyons avec M. A. Maury, Journal des savants, 1869, p. 224, que Knobel se laisse trop influencer par les identifications arbitraires des Juifs modernes, enclins à faire rentrer dans le chap. x de la Genèse les populations les plus éloignées. Outre son peu de fondement, cette opinion est de date trop récente pour être acceptée. Malgré une racine plus ancienne dans la Chronique d’Eusèbe (version latine de saint Jérôme, t. xxvii, col. 71), où le nom est interprété par gentes Gothicæ, elle ne se rencontre pas avant le ixe siècle de notre ère.
Un grand nombre de critiques modernes, après Bochart, Phaleg, libf iii, cap. IX, se rattachent à la tradition talmudique, et cherchent Ascenez dans l’Asie Mineure, où la géographie et l’histoire fournissent des données importantes. Elles signalent dans la Bithynie un district i’Ascania, habité par des Phrygiens et des Mysiens, Homère, Ilia., Il, 862 et suiv. ; Strabon, xii, p. 564 ; Pline, H. N., v, 40 ; un lac Ascanien près de Nicée, Strabon, xii, p. 565 ; Pline, xxxi, 10 ; et un fleuve Ascanios, Pline, v, 40, 43 ; enfin les îles Ascaniennes et le golfe Ascanien sur le littoral de la Troade. Pline, v, 32, 38. C’est ce nom d’Ascanie et d’Ascaniens qui suggéra la création du personnage mythique d’Ascanios ou Ascagne, donné pour fils à Énée. Quelques savants établissent aussi un rapprochement, plus ingénieux peut-être que fondé, entre les noms d’Askenaz, Ascanios, et celui de la mer Noire, appelée d’abord IIôvtoç "AÇevoc, Strabon, vii, p. 300 ; Pline, iv, 24, ou "Agsivoc, e ' P ws * ar rï seulement IIovtoç EtfÇeivo ; , dénomination qui, à l’origine, aurait été empruntée à l’un des principaux peuples qui habitaient les bords du PontEuxin. Quoi qu’il en soit de ce dernier point, la géographie ancienne de l’Asie Mineure nous montre assez nettement l’existence et l’extension d’une province d’Ascanie, qui fut, d’après certaines traditions, le premier siège des Phrygiens, et à laquelle se rattache assez naturellement le nom d’Ascenez.
Mais ces données s’accordent-elles bien avec le passage de Jérémie, li, 27, où Dieu, ordonnant aux nations de se réunir pour combattre Babylone, convoque contre elle « les rois d’Ararat, de Menni et d’Ascenez » ? Ararat et Menni, d’après l’opinion généralement reçue, représentent l’Arménie. Ascenez doit donc désigner une province voisine de ce pays. Cette conclusion ressort également de la table ethnographique, Gen., x, 3, dans laquelle Ascenez a pour frère Thogorma, qu’on place de même en Arménie. Enfin M. P. de Lagarde, Gesammelle Abhandlungen, Leipzig, 1866, p. 255, observe que la désinence az sert à tonner les patronymiques en arménien, et que Asken s’y est conservé dans l’usage comme nom propre ; c’est là un vestige de la descendance askenazienue des Arméniens.
Il est vrai, 'répondrons-nous avec F. Lenormant, Origines de l’histoire, t. ii, p. 393-394, que l’Ascenez de Jérémie ne saurait être le canton de l’Ascanie bithynienne, ni même l’ancienne province d’Ascanie ; elle est beaucoup trop reculée dans l’ouest, et elle ne dépendait pas de la Médie, mais, à ce moment, du royaume de Lydie. C’est un pays vassal de la monarchie médique, c’est-à-dire situé à l’est du fleuve Halys, qui forma la frontière entre les Mèdes et les Lydiens, à la suite de la grande guerre entre Alyatte d’une part, Cyaxare, puis Astyage de l’autre ; c’est en même temps un pays contigu à ceux d’Ararat et de Menni, dont la réunion forme l’Arménie majeure ou orientale. Il n’y a donc pas moyen de douter qu’Ascenez ne désigne ici l’Arménie propre ou occidentale, l’Arménie au sens primitif du nom.
Mais il faut remarquer que Ἀσ-κάνιος semble, par sa composition même, avoir un caractère plutôt ethnique que géographique, désigner une tribu ou une nation plutôt qu’un pays. Le nom d’’Aškenaz, expliqué de la façon la plus vraisemblable par celui d’Ascaniens, indique, dans l’ethnographie biblique, non pas la province spéciale d’Ascanie, mais l’ensemble de la nation phrygienne, auquel il appartient en dehors même de son premier séjour, plus spécialement qualifié d’Ascanie, car elle l’a transporté avec elle dans la Phrygie. Le passage de Jérémie nous fournit donc une date de la plus haute valeur pour déterminer l’époque où les Arméniens d’origine phrygienne étaient déjà limitrophes des pays d’Ararat et de Menni, où ils allaient bientôt pénétrer Les éléments linguistiques que nous avons signalés tout à l’heure avec P. de Lagarde font croire que le pays ou le peuple arménien avait été nommé d’après Ascenez avant de l’être d’après Thogorma.
On a rapproché l’hébreu ’Aškenaz de l’assyrien (mât) Aš-gu-za, nom d’un pays mentionné dans un cylindre d’Asarhaddon. Ce prince fit deux expéditions contre les gens de Manna et d’Askhouz. Cf. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, Paris, 1886, p. 450. Nous retrouvons ici deux des noms cités dans Jérémie, li, 27, et M. Sayce, Journal of the Royal Asiatic Society, t. xix, 2e part., p. 397, propose même de corriger en Askhouz l’Askenaz du prophète. Il est plus simple d’admettre que le mot primitif Ašgunza, Aškunza = אשכנז, est devenu peu à peu, par l’assimilation du nun, Ašguzza, et finalement Ašguza. Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften und dos Alte Testament, Giessen, 1883, Nachträge von Dr Paul Haupt, p. 610.
ASCENSION. Ce mot signifie l’élévation miraculeuse de Notre-Seigneur au ciel, quand il y monta en corps et en âme, par sa propre puissance, en présence de ses disciples, le quarantième jour après sa résurrection. Act., i, 3.
1° Circonstances de cet événement.
Quand fut venu pour Jésus le moment de retourner à son Père, il apparut une dernière fois à ses disciples à Jérusalem, et il les conduisit sur le mont des Oliviers. Après leur avoir renouvelé la promesse de l’Esprit-Saint, et leur avoir déclaré qu’ils seraient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre, il leva les mains au ciel et il les bénit. Act., i, 8 ; Luc, xxiv, 51. Ainsi le dernier acte de Jésus sur la terre fut une bénédiction. Au moment où il les bénissait, il s’éleva au ciel. Lus., xxiv, 51. Le texte sacré semble indiquer qu’il ne disparut pas subitement, comme il l’avait fait pour les disciples d’Emmaüs ; mais qu’il s’éleva vers le ciel graduellement et avec une majestueuse lenteur. Comme les témoins de cette scène tenaient leurs yeux fixés sur leur divin Maître, une nuée resplendissante le déroba à leurs regards, Act, i, 9, et voici que deux anges sous une forme humaine, vêtus de blanc, se présentèrent devant eut et leur dirent:« Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous là, regardant au ciel ? Ce Jésus, qui du milieu de vous a été enlevé au ciel, viendra de la même manière que vous l’avez vu allant au ciel. » Act., i, 11. A ces mots, les disciples se prosternent et adorent Jésus comme le vrai Fils de Dieu, Luc, xxiv, 52; puis ils quittent le mont des Oliviers et reviennent à Jérusalem avec une grande joie. Luc, xxiv, 52. Ainsi Jésus monta au ciel, où il est assis à la droite de Dieu. Marc., xvi, 19.
Quand nous disons qu’il monta au ciel, nous entendons qu’il y est monté comme homme. Comme Dieu, étant présent partout par son immensité, il était déjà au ciel et n’avait pas besoin d’y monter. Ce fut l’humanité de Jésus, toujours unie à la divinité, qui monta au ciel, c’est-à-dire son corps et son âme, qui n’y étaient pas encore.
Quand nous disons que Jésus est assis à la droite de Dieu, nous prenons ces mots dans un sens métaphorique. Parmi les hommes, être placé à la droite d’un personnage est regardé comme un honneur. C’est par allusion à cet usage et en appliquant aux choses du ciel le langage de la terre, que l’on dit de Jésus qu’il est à la droite de Dieu. On veut faire entendre qu’il participe à la puissance de son Père. Les mots « est assis » ne doivent pas non plus se prendre dans le sens d’une attitude corporelle, mais dans le sens de la perpétuelle possession du souverain pouvoir qu’il a reçu de son Père.
Nous ne croyons pas que les Apôtres furent les seuls témoins de l’Ascension. Les évangélistes ont gardé le silence sur ce point. Il paraît cependant très probable que cette faveur fut accordée au moins à tous ceux qui, étant entrés au cénacle avec les Apôtres, priaient avec eux. C’est le sentiment de Benoît XIV, De festis D. N. J. C, vi, 46 et 47. Il est certain qu’au livre des Actes, saint Luc, après avoir raconté l’ascension, le retour du mont des Oliviers à Jérusalem et l’entrée des Apôtres au cénacle, ajoute:« Tous ceux-ci persévéraient unanimement dans la prière, avec les femmes, et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre, se levant au milieu des frères (or le nombre des hommes réunis était d’environ cent vingt), leur parla. » Act., i, 14-15.
2° Lieu de l’Ascension.
L’endroit précis d’où Notre-Seigneur s’éleva au ciel est le sommet central du mont des Oliviers. Voir Oliviers (Mont des). Saint Matthieu, saint Marc et saint Jean ne nous renseignent pas sur le lieu de l’Ascension ; mais saint Luc nous aide à le fixer d’une manière certaine. Dans son Évangile, xxiv, 50, il nous montre Jésus conduisant ses Apôtres à Béthanie, et, après les avoir bénis, s’élevant vers le ciel, xxiv, 51. Il ne faut pas en conclure que Béthanie fut le théâtre de l’Ascension. En effet, saint Luc, dans les Actes, i, 12, nous apprend que les Apôtres, après avoir été témoins de cette merveille, retournèrent à Jérusalem de la montagne des Oliviers, et n’eurent à parcourir que le chemin que l’on peut faire le jour du sabbat. On sait que le chemin d’un jour de sabbat était la distance qu’un Juif pouvait franchir sans violer le repos sabbatique ; cette distance est évaluée, d’après les rabbins, à 1 392 mètres environ. Bacuez et Vigouroux, Manuel biblique, 8e édit., t. i, n° 187, p. 311. Or Béthanie est à trois ou quatre kilomètres de Jérusalem, c’est-à-dire à la distance de deux mesures sabbatiques. Les Apôtres n’étaient donc pas à Béthanie même quand ils furent témoins de l’Ascension, mais sur le sommet du mont des Oliviers, qui est à la distance d’une mesure sabbatique de Jérusalem. Le passage dé l’Évangile de saint Luc, xxiv, 51, qui donne Béthanie comme le théâtre de ce mystère, s’accorde avec le passage des Actes, i, 12, du même saint Luc, soit en supposant, comme le fait Benoit XIV, De festis D. N. J. C, vi, 46-47, que Jésus conduisit d’abord ses Apôtres à Béthanie, et les ramena ensuite au sommet du mont des Oliviers, d’où il s’éleva au ciel ; soit en supposant, comme le fait M. V. Guérin, Jérusalem, p. 343, que le territoire de Béthanie commençait au sommet même de la montagne des Oliviers, et que le lieu où Jésus s’éleva au ciel faisait partie de ce territoire. Voir aussi Lamy, Comm. in harm., 1. v, c. xlvi, 19. Ajoutons que la leçon dés manuscrits B, C, D, L, Sinaiticus, Bedæ, porte ἕος πρὸς Βηθανίαν au lieu de ἕως εἰς Βηθανίαν. D’après cette leçon, le ꝟ. 50 du chapitre xxiv de saint Luc signifie : Jésus mena les Apôtres vers Béthanie, du côté de Béthanie, et non à Béthanie.
Aussi bien toutes les traditions des premiers siècles placent sur le sommet central du mont des Oliviers le théâtre de l’Ascension. Sainte Hélène, en y élevant une basilique, ne fit que consacrer par un monument la croyance de tous les chrétiens. Cette basilique, détruite en 614 par les Persans, et relevée de ses ruines au viie siècle, fut renversée par l’ordre de Hallem, et plus tard reconstruite par les croisés. La troisième basilique fut démolie par les musulmans redevenus maîtres de la Terre Sainte. Ils laissèrent cependant subsister Pédicule octogonal qui renfermait, selon la tradition, les vestiges des pieds de Notre-Seigneur. Cet édicule fut muré par eux et transformé en un petit oratoire musulman y au milieu duquel ils ont respecté la pierre qui garde encore les vestiges, aujourd’hui très dégradés, d’un pied qui passe pour être le pied gauche de Notre-Seigneur. Voir V. Cuérin, Jérusalem, p. 345-346 ; Mislin, Les Saints Lieux, t. ii, p. 468. Cf. Eusèbe, Vita Constantini, iii, 43, t. xx, col. 1104 ; Dem. evang., vi, 18, t. xxii, col. 460 ; Pseudo-Jérôme, Liber nom. loc. ex Actis, au mot Mons Oliveti, t. xxiii, col. 1301-1302.
Le mot « Ascension » signifie aussi la fête qui est célébrée, le quarantième jour après la résurrection et dix jours avant la Pentecôte, en mémoire de l’ascension du Sauveur. Elle est d’origine très ancienne. Voir S. Augustin, Epist. cxviii, 1, t. xxxiii, col. 200 ; Serm. cxxxrv de tempore, t. xxxviii, col. 1209 ; Constit. Apost., viii, t. i, col. 1136 ; Suarez, De præceptis affirmativis ad Dei cultum, l. ii, De Sacrorum seu festorum dierum observatione et præcepto, c. vii, 1 ; Duchesne, Origine du culte chrétien, in-8°, Paris, 1889. G. Martin.
2. ASCENSION D’ISAÏE, livre apocryphe. Voir Apocalypses apocryphes, 9°, col. 764.
ASCHBÉA (hébreu :’Ašbêa‘; Septante :Ἐσοβά), nom propre que la Vulgate a traduit, d’après sa signification, I Par., iv, 21, par « Jurement ». Il n’est pas possible de savoir s’il désigne dans ce passage une personne ou une localité. Certains commentateurs croient que c’est le nom d’un chef de famille descendant de Juda, fils de Jacob, par Séla, lequel s’appelait Aschbéa, et faisait travailler le lin dans sa maison. D’autres pensent que le mot aschbéa doit se joindre au mot Bêṭ (« maison »), qui précède dans le texte original, et se lire par conséquent Beth-Aschbéa, nom. d’une localité inconnue, où auraient habité les descendants de Juda qui travaillaient le lin. Le laconisme du récit sacré ne permet pas de décider laquelle de ces deux opinions est la plus vraisemblable.
ASCHDOTH HAP-PISGAH (’Ašdôṭ hap-Pisgâh ;
Septante : Ἀσηδὼθ τὴν Φασγά, Deut., iii, 17 ; Ἀσηδὼθ τὴν λαξευτήν, Deut., iv, 49 ; , Jos., x, 40 ; xii, 8 ; Ἀσηδὼθ Φαργά, Jos., xii, 3 ; Vulgate : ad radices montis Phasga, Deut., iii, 17 ; iv, 49 ; Asedoth, Jos., x, 40 ; xii, 8 ; Asedoth Phasga (il ne faut point, entre Asédoth et Phasga, la virgule que portent les éditions de la Vulgate ; car ces deux mots ne forment qu’un seul et même nom), Jos., xii, 3. Voir Asédoth.
ASCHER ben Josef, rabbin de Cracovie, qui vécut dans la première moitié du xvie siècle. Il laissa un commentaire sur les Lamentations de Jérémie, in-4°, Cracovie, 1585.
ASCHÉRA est un nom hébreu, ’Ăšêrâh, qui se lit
dans le texte original dix-huit fois au singulier, Deut.,
xvi, 21 ; Jud., vi, 25, 26, 28, 30 ; I (III) Reg., xv, 13 ;
xvi, 33 ; xviii, 19 ; II (IV) Reg., xiii, 6 ; xvii, 16 ;
xviii, 4 ; xxi, 3, 7 ; xxiii, 4, 6, 7, 15 ; II Par., xv, 16 ;
trois fois au féminin pluriel, ’ăšêrôṭ: Jud., iii, 7 ; II Par.,
xix, 3; xxxiii, 3, et dix-neuf fois au masculin pluriel,
’ăšêrim : Exod., xxxiv, 13 ; Deut, vii, 5 ; xii, 3 ; I (III) Reg.,
xiv, 15, 23 ; II (IV) Reg., xvii, 10 ; xxiii, 14 ; II Par.,
xiv, 2 (3) ; xvii, 6 ; xxiv, 18 ; xxxi, 1 ; xxxiii, 19 ; xxxiv,
3, 4, 7 ; Is., xvii, 8 ; xxvii, 9 ; Jer., xvii, 2; Mich., v, 13. Il
désigne tantôt une déesse, qui n’est autre sans doute qu’Astarthé, tantôt la stèle ou pieu de bois symbolique qui la
représentait ou lui était consacré. D’après son sens étymologique, « être droit, être heureux, » ce nom peut convenir
aussi bien à la déesse du plaisir qu’à la colonne dressée
en son honneur. Les anciens traducteurs ont méconnu
le sens propre de ce mot, que les Septante rendent
presque partout par ἄλθος, et la Vulgate, d’après eux, par lucus ou nemus, « bois, bosquet » Dans plusieurs
passages, cette traduction est insoutenable : par exemple,
là où il est question de ’Ăšêrâh placé sur un autel, Jud.,
vi, 25, ou élevé sous tout arbre vert. III Reg., xiv, 23 ;
IV Reg., xvii, 10. Dans Deut., xvi, 21, le verbe planter
a pu donner lieu à cette traduction ; mais le passage ne la
justifie nullement, si on l’examine sur l’hébreu : « Tu ne
planteras en ’ăšêrâh aucun arbre près de l’autel de Jéhovah ton Dieu. » On remarquera en outre la suite de la
prescription au ꝟ.22 ; Dieu ne veut près de son autel ni
’ăšêrâh ni maṣṣêbâh (pierre levée, stèle). Enfin partout
où se rencontre ailleurs le nom ’ăšêrâh, l’une des deux
significations proposées cadre parfaitement avec le contexte.
1° Nous citerons d’abord les passages où ’Ăšêrâh figure comme une divinité étrangère, à laquelle on rend un culte à côté de Baal et de toute l’armée du ciel. IV Reg., xxiii, 4 ; cf. xxi, 3 ; II Par., xxxiii, 3. Elle a une image taillée, pésél, IV Reg., xxi, 7 ; une idole. III Reg. xv, 13 ; II Par., xv, 16. Il y a des prophètes de ’Ăšêrâh comme des prophètes de Baal. III Reg., xviii, 19. Elle est le plus souvent associée à Baal, ce qui nous autorise à voir en elle l’inséparable compagne de ce dieu, qui est ailleurs nommée Astarthé. La manière même dont les deux noms sont échangés dans Jud., ii, 13, et iii, 7, confirme cette identification. (La Vulgate a traduit dans les deux endroits Astaroth, tandis que, si nous avons dans l’hébreu pour le premier ’Ašṭârôṭ, nous avons pour le deuxième ’Ăšêrôṭ.) Nous pouvons donc, pour la nature de cette déesse et l’histoire de son culte chez les Hébreux, renvoyer à l’article Astarthé.
Une inscription phénicienne place dans un rapport étroit les noms ’ăšêrâh et ’aṭoreṭ, en qualifiant ainsi une déesse : « ’Ašṭôrét en ’ăšêraṭ de ’El Hamman. » עשתרת באשרת אל חמן. Corpus inscriptionum semiticarum, t. i, p. 331. Mais en dehors de la Bible, on n’avait, jusqu’à ces derniers temps, aucune indication permettant de considérer Aschéra comme le nom propre d'une déesse. On pouvait penser que les Hébreux avaient appliqué à Astarté un vocable commun, « la bonne, l’heureuse, » ou qu’ils l’avaient désignée par le nom de sa représentation symbolique. Sur une des tablettes cunéiformes trouvées en Egypte, à Tell-Amarna, un officier chananéen porte un nom dans lequel Aschéra figure comme celui d’une divinité : Abdaširti ou Abdašrati, c’est-à-dire « serviteur d’Ašerat », de même qu’Astarthé dans le nom phénicien Abdastérét, « serviteur d’Astarthé. » Cf. Halévy, Revue des études juives, 1890, t. xxi, p. 57.
2° Là où ’ăšêrâh désigne l’emblème de la déesse, il s’agit toujours, dans la Bible, d’un pieu de bois que les Israélites fidèles coupent et brûlent. Exod., xxxiv, 13 ; Jud., vi, 25, 26, 28, 30 ; IV Reg., xxiii, 6, etc. De même que les Chananéens joignaient ce pieu à l’autel de Baal, la divinité mâle, de même les Hébreux auraient pu être tentés d’en élever près de l’autel de Jéhovah. Le Deutéronome, xvi, 21, interdit cette profanation. Cf. Mich., v, 13 ; Is., xvii, 8 ; xxvii, 9. Dans ces deux derniers passages, les ’ăšêrîm figurent à côté des ḥammânim, représentations solaires de Baal. On leur rendait un culte comme aux autres idoles : « Ils servirent les ’ăšêrîm et les idoles ». II Par., xxiv, 8. La colonne symbolique se trouve associée au culte d’Astarté là où, honorée comme déesse du plaisir, on l’assimile, à l’époque gréco-romaine,
à Aphrodite ou Vénus. Une représentation du temple de Paphos, sur une monnaie chypriote du temps de SeptimeSévère, nous permet de voir le cippe qui était l’emblème de la déesse (flg. 290). Cf. F. Lajard, Recherches sur le culte de Vénus, 1837, pi. I, n os 10-12. À l’occasion de la visite de Titus au temple de Paphos, Tacite décrit ainsi la singulière image : « L’idole de la déesse n’a pas la forme humaine ; c’est une colonne ronde dont la base est plus large que le sommet, à la façon d’une borne ; on en ignore
[[File: [Image à insérer]|300px]]
290. — Temple de Paphos.
ATTOK. KA18. A. 2EIIT. 2EOTHPOS. Tête lanréede l’empereur SeptimeSévère. — % KOINON KYIIPIQN. Temple d’Aphrodite -Astarthé à Paphos. Au fond, au milieu, le cippe de la déesse et, à droite et & gauche, une étoile. De chaque côté, un candélabre. Au haut, le croissant et une étoile. Sur le toit plat du temple, à droite et à gauche, une colombe, l’oisean consacré a Astarthé.
la raison. » Hist., ii, 3. Les colonnes qu’Hérodote, ii, 106, avait vues dans la Palestine de Syrie, et qu’il altribue au conquérant légendaire Sésostris, n'étaient peut-être que des 'Àsêrîm chananéens. — Voir G. W. Collins, 'Asthoreth and the 'Ashera, dans les Proceedings of the Society of Biblical Archxology, juin 1889, p. 291-303. L’auteur a réuni un grand nombre de documents, mais, contrairement à l’opinion commune, il n’identifie point Aschéra et Astarthé ; il soutient même qu’Aschéra était exclusivement un symbole impur. J. Thomas.
- ASCHI ben Simaï##
ASCHI ben Simaï, appelé aussi Asché et Asser, un des derniers et des plus célèbres Amoraïm, né en 352, devint chef de l’importante école de Sora, en Babylonie, où il mourut (427), après l’avoir dirigée cinquante - deux ans. Son autorité fut très considérable parmi ses contemporains, et il reçut le titre de Rabbana, « notre maître. » L'élaboration du Talmud de Babylone fut commencée grâce à son initiative. Il consacra sa longue carrière à cette œuvre colossale, rassemblant, coordonnant l'énorme quantité d’explications, de déductions, de développements ajoutés à la Mischna, accumulés pendant trois générations d' Amoraïm, et confiés à la seule mémoire. Il ne se borna pas à une simple compilation, car il ajouta de lui-même de nombreuses et importantes rectifications, décisions, solutions de questions obscures, etc. Son travail fut complété par son fils Mar, par son successeur immédiat Marémar, et surtout par R. Abina. E. Levesque.
- ASCHKÉNASI Éliézer ben Elias##
ASCHKÉNASI Éliézer ben Elias, d’abord rabbin à Crémone, alla s'établir à Gonstantinople, puis à Posen, enfin à Gracovie, où il mourut en 1586. Il a donné un commentaire sur le livre d’Esther, Yôsif léqah, ( « Il croîtra en science », Prov., i, 5), in-4', Crémone, 1576. Il en a été donné plusieurs éditions, la dernière, in-4°, Varsovie, 1838. On a aussi de lui une explication de la partie historique du Pentateuque, in-f°, Venise, 1583 ; in f », Cracovio, 1584 ; in-4°, la Haye, 1777, et in-4°, Zolkiew, 1802.
E. Levesque.
- ASDOD##
ASDOD, forme hébraïque {'Asdôd) du nom de la ville philistine appelée Azot dans la Vulgate. Voir Azoï.
. ASEBAÏM (hébreu : hassebâîm, nom avec l’article, « les gazelles ; » Septante : 'Atnêweîp, SoSatp.. La Vulgate porte Asebaïm, comme les Septante, I Esdr., ii, 57, . et Sabaïm, II Esdr., vii, 59. Pour les traducteurs grecs, 'A<re6uiet'[i ou Siëaiji est un nom de personne : viol « fa^epâO, utot 'A<Teë<oet'[<., ou vîoi *axapâ8, uiol Saêaiji. Le traducteur latin en fait un nom de lieu ; peut-être parce qu’il a rapproché ce nom du nom à peu près sembable de deux autres localités : Sebo Hm, ville de la vallée de Siddim, Gen., x, 19 ; Deut., xxix, 23, ou Sebo'îm, cité d’ailleurs inconnue, située sur le territoire de Benjamin. I Reg., xiii, 18. La Vulgate a été suivie par un certain nombre de commentateurs. Cependant il paraît difficile de voir dans hassebâîm un nom de lieu. D’abord on ne connaît aucune localité de ce nom. De plus, dans la longue liste de Nathinéens et de descendants dés esclaves de Salomon, donnée dans les deux passages cités, il n’est pas fait mention du lieu d’origine pour les autres personnes. Enfin le texte original, conservé sans variante, Pokérét hassebâîm, ne peut se traduire régulièrement Phoché-. reth de Sabaïm ; il faudrait avant hassebâîm une préposition, jn, min, indiquant le lieu d’origine. Nous avons là
simplement, avec l’article, le nom sebdîm, qui veut dire « gazelles ». Ce mot dépend du précédent, pokérét, de la racine pâkar, « prendre, capturer. » Ces deux mots forment ainsi un nom composé, « le preneur de gazelles : » c’est un surnom qui vraisemblablement supplanta dans l’usage le vrai nom de cet individu. Il faut néanmoins remarquer que la version des Septante suppose que le texte hébreu qu’ils ont traduit portait, non pas benê Pokérét hassebâîm, comme notre texte actuel, mais benê Pokérét, benê hassebâîm, « les fils de Pokérét, les fils de Sébaïm, » et cette leçon pourrait bien être la leçon primitive. E. Levesque.
- ASÉDOTH##
ASÉDOTH (hébreu : 'Aëdôp ; Septante : 'A<r » )8tt>6), nom d’une localité voisine du mont Phasga, d’après la Vulgate et les Septante ; mais peut-être aussi nom commun signifiant, d’une façon générale, « le pied d’une montagne, » radiées montis, comme la version latine a traduit elle-même deux fois, Deut., iii, 17 ; iv, 49, ou bien « sources ». Ce doit être un mot très ancien, puisqu’on ne le trouve que dans le Deutéronome, iii, 17 ; iv, 49, et dans le livre de Josué, x, 40 ; xii, 3, 8 ; xiii, 20. Il se rattache à la racine inusitée 'â'sàd, « répandre, » et à l’expression 'éséd hannehaiîm ( Vulgate : scopuli torrentium, « rochers des torrents » ), Num., xxi, 15, que Gesenius, Thésaurus, p. 158, explique ainsi : « lieux bas où se déversent les torrents descendant des montagnes. » On peut diviser en deux catégories les passages dans lesquels il se rencontre. Dans la première, il est employé seul avec l’article, hâ'âsêdôf, Jos., x, 40 ; bâ'âsêdôt, Jos., xii, 8 ; il fait partie d’une énumération comprenant les divisions naturelles d’un pays : hâhâr, « la montagne ; » hannégéb, « le midi ; » hassefêlâh, « la plaine ; » hâ'ârdbâh, « le désert. » Il semble donc conforme au contexte de lui laisser sa signification commune de féminin pluriel, désignant les vallées arrosées par les torrents. Dans la seconde, il est uni au mot Phasga, Deut., iii, 17 ; iv, 49 ; Jos., xii, 3 ; xiii, 20. Il s’agit, dans ces divers endroits, des régions situées au delà du Jourdain et conquises par les Israélites. L’expression 'aMôf hap-Pisgâh paraît destinée à déterminer le massif montagneux qui enferme la mer Morte à l’est, et dans lequel se trouve le mont Phasga. On peut donc encore ici y voir le sens général que nous avons indiqué, « le pied du mont Phasga. » Cependant les explorateurs anglais du Palestine Exploration Fund, prenant le mot 'asdôt dans son sens étymologique, « écoulement, » le traduisent par « sources », et l’identifient avec 'Ayûn Musa, les remarquables « t sources de Moïse » (fig. 291) qui se trouvent au bas du mont Nébo. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and places in the Old and New Testament, Londres, 1889, p. 17 ; Old and New Testament Map of Palestine, Londres, 1890, feuille 15. Cette opf
nion ne manque pas de vraisemblance. En effet, la rareté et l’importance des eaux en Orient expliquent assez comment une source considérable a puétre l’objet d’une mention particulière. Ensuite le sens étymologique de 'asddf s’applique mieux à des sources, quand elles sont surtout comme celles de Moïse. Enûn les Septante ont toujours rendu le mot par un nom propre, et la Vulgate elle-même a été obligée de l’employer comme tel, Jos., x, 40 ; xii, 3, 8 ; xiii, 20.
Situées au pied du pic fameux qui fut témoin de la mort mystérieuse de Moïse, et au-dessous d’un sommet voisin, identifié avec le Phasga, les sources de Moïse
petites chutes. Cf. de Luynes, Voyage d’exploration à la mer Morte, 3 in-i », Paris, t. i, p. 153 ; H. B. Tristram, The Land of Moab, Londres, 1871, p. 335-336 ; Conder, Heth and Moab, Londres, 1889, p. 131-132. — Eusèbe et saint Jérôme font d’Asédoth « une ville des Amorrhéens, qui échut à la tribu de Ruben » ; ils expliquent 'AuyiSwô ia<r(â. comme l’ont fait une fois les Septante, Deut., iv, 49, traduisant le dernier terme par Xa£.£VTirj, « taillée. » Ils distinguent une autre ville de même nom, assiégée et prise par Josué, xii, 8. Cf. Onomasticon, Gœttingue, 1870,
p. 216, 217 ; S. Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxiii, col. 867, 868.[[File: [Image à insérer]|300px]]
291. — Sources et cascades. d’Ayoun-Mouça, au pied do mont Phasga,
offrent une oasis de fraîcheur et de verdure au milieu de cette contrée aride. Elles forment deux groupes principaux. Le premier se compose de plusieurs petites sources contiguës, qui sortent de la base d’un rocher très pittoresque où sont creusées des grottes naturelles ou artificielles. Leurs eaux, se réunissent bientôt sur une large chaussée, éboulement d’un banc de calcaire, pour se précipiter de là en une belle cascade, haute de sept à huit mètres. Cette plate-forme est comme le toit d’une grotte humide et sombre qui s'étend assez loin en arrière sous ce plafond de roches. Les eaux s'épanchent sur de. longues guirlandes vertes formées de mousses et de plantes à feuillage fin et chevelu. En baignant continuellement ces végétaux, elles ont produit des incrustations dont l'épaississement continuel a fini par créer une gigantesque stalactite qui semble une colonne conique, inclinée suivant la pente de la chute. Un peu plus loin, le second groupe sort des profondeurs de la montagne : le courant, clair comme le cristal, fuit sur un lit composé de pierres et de cailloux, couverts par des coquillages d un noir luisant ; il rejoint le premier par une série de
ASEL (héb. : 'Açel, (. noble » ; Sept. : 'EtvJX), Benjamite, fils d'Élasa, de la postérité de Cis, père de Saûl. I Par., vin, 37-38 ; ix, 43-44. Pour Asel, ville, voir Beth-Ésely
ASEM (hébreu : 'A}ém [à la pause], Jos., xv, 29 ; xix, 3 ; 'Ésém, l Par., iv, 29 ; Septante : 'Auott ; Jos., xv, 21) ; 'laffôv, Jos., xix, 3 ; 'Atcrépi., IPar., iv, 29 ; Vulgate : Asem, Jos., xix, 3 ; Eseni, Jos., xv, 29 ; Asom, I Par., iv, 29), ville de la tribu de Juda, appartenant à l’extrémité méridionale de la Palestine, Jos., xv, 29, et attribuée plus tard à la tribu de Siméon. Jos., xix, 3 ; I Par., iv, 29. Son emplacement est inconnu jusqu'à présent, la plupart des villes qui composent ce premier groupe, Jos., xv, 21-32, n’ayant pas été identifiées. Dans les trois passages que nous venons de citer, elle occupe une place régulière entre Baala ouBala, et Eltholad ou Tholad. Cette dernière est rebelle à toute assimilation, et Baala est, pour certains auteurs, placée d’une manière très problématique à Deir el-Belah, au sud-ouest de Gaza, non loin de la mer. Parmi les noms qui précèdent, les plus connus sont Bersabée [Bir es-Sébâ) et Molada (Khirbet Tell el-Melah)^
parmi ceux qui suivent, Bemmon, qui termine la liste, correspond bien à Khirbel Oumm er-Èoumamîn. Cf. Guérin, Description de la Palestine, Judée, t. ii, p. 277-284, 352-354 ; t. iii, p. 184-188. C’est donc dans ces parages qu’il faudrait chercher Asem, d’autant plus que, en comparant les trois énumérations, Jos., xv, 21-32 ; xix, 2-7 ; I Par., iv, 28-32, elle ne paraît éloignée ni de Bersabée ni de Molada. On a voulu l’identifier avec Eboda, aujourd’hui Abdéh, localité située à huit heures au sud d'Élusa {Kkalasak). Cf. Keil, Josua, Leipzig, 1874, p. 126. La raison étymologique sur laquelle on s’appuie n’a pas de fondement, et la situation d’Asem serait beaucoup trop
au sud.- ASÉMONA##
ASÉMONA (hébreu : 'Asmônâh [avec / » élocal], Num., xxxiy, 4 ; Jos., xv, 4 ; 'Asmôn, Num., xxxiv, 5 ; Septante : 'A<rs|itDvâ, Num., xxxiv, 4, 5 ; SeXjtwvdt, Jos., xv, 4), ville frontière, située à l’extrémité méridionale de la Terre Sainte, Num., xxxiv, 4, 5, et appartenant à la tribu de Juda. Jos., xv, 4. Dans la ligne tracée par les auteurs sacrés, formant l’arc de cercle depuis la pointe sud de la mer Morte jusqu'à la Méditerranée, en passant par Cadèsbarné, elle se trouve la plus éloignée vers l’ouest : c’est tout ce que nous savons de certain. On a cependant proposé quelques identifications. Wetzstein, s’appuyant sur la racine du mot 'âsam, « être fort, » 'ésém, « ossements, » pense qu’il s’agit de la longue chaîne du Djebel Yélék, dont le pied occidental est baigné par « le Torrent d’Egypte », Ouadi el-Arisch, ou des deux chaînes parallèles du Djebel RèlâX et du Djebel Yélék, Cf. Keil, Josua, Leipzig, 1874, p. 118. Sur la position respective des deux montagnes, voir Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, 1. 1, p. 185, et là carte. Le fondement de cette opinion semble bien fragile. Trumbull, KadeshBarnea, New-York, 1884, p. 117, 289-291, propose de reconnaître Asémona dans Qaséiméh, groupe de sources ou de bassins, situé à l’est du Djebel Muweiléh, près de la grande route des caravanes entre l’Egypte et la Syrie. Son sentiment s’appuie sur ce fait que le Targum du pseudo -Jonathan, Num., xxxiv, 4, a rendu 'Asmon par DDp, Qesâm, et celui de Jérusalem par D0>p, Qêsam, ce qui répond exactement à l’arabe JU* « .ï, Qaséiméh. La différence entre les lettres initiales, 'aîn et qof, vient des diverses manières d'écrire, Q, K, G, ou les aspirées A, 'A, représentant les variations d’un son guttural. C’est ainsi qu’il identifie une des villes précédentes, Adar, avec Qadeirah, ou Ain Qoudeirah, un peu plus à l’est. En plaçant Cadèsbarné à Aïn-Qadis, comme le veulent bon nombre d’auteurs, il est certain que YOuadi et VAïn Qaséiméh rentrent parfaitement dans la ligne de la frontière méridionale, telle qu’elle est décrite par les Livres Saints.
Voir Cadès. °1. ASÉNA (hébreu : 'Asnâh, « épine, » ou, selon d’autres, « grenier [?] ; » Septante : 'A<tev « ), chef de famille nathinéenne, dont les descendants revinrent de l’exil avec Zorobabel. I Esdr., ii, 50.
2. ASÉNA (hébreu : 'ASnâh ; Septante : "As-ua), ville de la tribu de Juda. Citée après Estaol et Saréa, Jos^ ; xv, 33, elle appartenait' au premier groupe des villes, de « la plaine », et se trouvait sur la frontière des deux tribusde Juda et de Dan. Jos., xix, 41. Si son emplacement certain nous est inconnu, les noms qui précèdent nous permettent de le fixer d’une manière approximative. Estaol est bien identifiée avec Achou’a, et Saréa avec Sara’a, toutes deux voisines l’une de l’autre, et situées 1 en droite ligne à l’ouest de Jérusalem. De même Zanoé, qui suit, est bien Kkirbet Zànou’a. Plusieurs localités ont été proposées pour l’identification de cette première Aséna : — 1° 'Aslin, village formant triangle, vers le nord, avec Achou’a et Sara’a. La position convient parfaitement ; mais le nom laisse un peu à désirer à cause
de l’aï » initial, quoique la permutation entre le schïn hébreu et le sin arabe, entre le nun et le lâm, soit facile à comprendre. — 2° Kefr ffasan, situé un peu plus au nordouest. CI. G. Armstrong, W. Wilson etConder, Names and places in the Old and New Testament, Londres, 1889, p. 18. Cet endroit ne s'écarte pas non plus de la ligne déterminée par le contexte. — 3° Beit Schenna, bien audessus, au nord d’Amouas, Cf. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, 1876, p. 151 ; 1877, p. 22. Cette localité, au contraire, s'éloigne beaucoup trop des limites voulues, et se trouve plutôt renfermée dans la tribu de Dan. Eùsèbe et saint Jérôme mentionnent une « Asna, de la tribu de Juda », mais sans en indiquer la position. Cf. Onornaslicon, Gœttingue, 1870, p. 220 ; S. Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxill, col. 871. Le village de Bethasan dont parlent ces Pères quelques lignes plus loin, à propos d' « Asan, de la tribu de Juda », semble, à raison de sa distance de Jérusalem, convenir plutôt à notre Aséna. Voir Asan.
3. ASÉNA ( nom omis par les Septante ; Vulgate : Esna). Jos. T xv, 43. Voir Esna.
- ASÉNAPHAR##
ASÉNAPHAR (chaldéen : 'Osnappar ; dans quelques manuscrits : 'Asnappar ; Septante : 'A(j<jevaq>âp), nom d’un personnage qualifié de grand et de glorieux, mentionné dans la lettre que les ennemis des Juifs écrivirent contre eux au roi de Perse Artaxerxès, I Esdr., rv, 10. Il est dit dans cette lettre, dont le texte est reproduit en chaldéen bu araméen, que divers peuples, au nom desquels la lettre est rédigée, Dinéens, Apharsathachéens, Babyloniens, Susiens, etc., ont été déportés en Samarie par Asénaphar. Cet acte d’autorité, de même que les titres de grand et de glorieux qui lui sont donnés, indiquent que cet Asénaphar est un roi. Or, comme la Samarie fut repeuplée par les rofe d’Assyrie, ce roi est certainement un roi de Ninive. Mais son nom a dû être défiguré par les copistes, comme tant d’autres noms propres, car aucun des monarques qui ont.régné à Ninive "n’est ainsi appelé. Plusieurs commentateurs ont cru à tort qu’Asénaphar était une altération du nom de Salmanasar ou de Sennachérib, les inscriptions assyriennes prouvent qu’il ne peut être question de ces deux rois dans la lettre des ennemis des Juifs. Asarhaddon et Assurbanipal, le fils et le petit-fils de Sennachérib, sont les seuls princes qui aient pu déporter en Samarie les peuples mentionnés I Esdr., iv, 9. Plusieurs exégètes pensent qu’Asarhaddon doit être préféré à Assurbanipal, parce que c’est lui qui est nommé expressément I Esdr., iv, 2 (Asor Haddan) comme l’auteur d’une transportation en Samarie, et que les annales de ce roi nous apprennent qu’il fit déporter dans la terre de Hatti, qui comprenait la Palestine, divers peuples de l’est de son empire qu’il ne nomme pas. Cùneiform Inscriptions of Western Asia, t. i, pi. 45, col. i, lig. 24-34. Néanmoins, comme les Susiens sont nommés parmi les déportés, I Esdr., iv, 9, et qu’Assurbanipéï est le premier roi d’Assyrie qui, d’après ce qu’on sait maintenant, ait pénétré au cœur de l’Elam et se soit emparé de Suse (Annales, col. v, lig. 128-129 ; Alden Smith, Die Keilschrif texte Assurbanipals, in-8°, Leipzig, 1887-1889, Heft i, p. 46-47), il est plus probable qu’Asénaphar est Assurbanipal. Asarhaddon n’a fait aucune campagne contre l'Élam. Assurbanipal, au contraire, lui fit une guerre acharnée, dont il a reproduit une foule d'épisodes dans son palais (fig. 292) ; non seulement il s’empara de Suse, la capitale de ce pays, mais.il nous apprend, dans ses inscriptions, qu’il en déporta les habitants et « les dispersa dans toute l'étendue de son royaume ». (Voir les textes dans G. Smith, History of Assurbanipal, p. 224-233, 247, et dans H. Gelzer, Die Colonie des Osnappar, dans la Zeitschrift fur àgyptische Sprache, 1875, t. xiii, p. 81.) Assurbanipal fit aussi la guerre aux Babyloniens, qui figurent dans la liste I Esdr., iv, 9 ; ils s'étaient révoltés
contre lui, et il les en punit durement. L’altération du nom d’Assurbanipal en Asénaphar s’explique d’ailleurs plus fecilement que celle d’Asarhaddon : hsjdn venant par contraction de Sa : [an] DN = bs-M-nDN. Le changement de la syllabe finale phal ou pal en phar ou par n’a rien qui puisse surprendre : Phul est devenu Por, dans le Canon de Ptolémée. Aussi cette identification est-elle acceptée par Frd. Delitzsch, Wo lag dos Parodies, in-12, Leipzig, 1881, p. 329 ; ainsi que par Eb. Schrader, qui, après avoir admis l’identification d’Asarhaddon dans la première édition de ses KeiUnschriften und dos Alte
ou au fils leur translation â Samarie, soit à Asarhaddon, parce que c’est lui sans doute qui en avait fait transporter un plus grand nombre, soit à Assurbanipal, son fils, parce que son règne avait été plus glorieux et qu’il était demeuré plus célèbre que celui de son prédécesseur.
F. VlGOUROUX. ASENETH (hébreu : 'Âsenat ; Septante : 'AuevfO, 'Ao-svvéO), fille de Putiphar (hébreu : Pôtîféra'), prêtre d’Héliopolis (hébreu : 'On). Le Pharaon la donna pour épouse à Joseph, qui en eut deux fils, Manassé et Éphraïm. Gen., xli, 45-50 ; xlvi, 20. C’est pour relever l’autorité de
292. — Bataille livrée par Assurbanipal dans le paya dTÉlam. Bas-reliet de Koyoundjik. D’après Layârd, Monuments of Nineveh, t. ii, pi.
Testament, 1872, p. 246, se prononce pour celle d’Assurbanipal dans la seconde, 1883, p. 376. Les textes cunéiformes leur semblent décisifs en faveur d’Assurbanipal.
Il faut observer cependant que, si Assurbanipal seul a pu déporter les Susiens en Samarie, c’est Asarhaddon qui a dû y transporter les Apharsatachéens et les Aphârséens, car c’est Asarhaddon qui s’est emparé des villes médiques de Partakka, Partukka. Guneiform Inscriptions of western A$ia, t. i, pi. 46, col. iv, lignes 19-20 ; Budge, History of Esarhaddon, in-8°, Londres, 1880, p. 68 ; cf. Frd. Delitzsch, dans Bær et Frz. Delitzsch, Libri Danielis, Ezrse et Nehemise, in-8°, Leipzig, p. IX. D’où il faut conclure que les peuples énumérés, LEsdr., IV, 10, ont été déportés, les uns, et c’est probablement le plus grand nombre, par Asarhaddon, et les autres, tels que les Susiens, par Assurbanipal. Les choses étant ainsi, il est difficile de dire avec certitude, en s’en tenant aux renseignements fournis par les inscriptions cunéiformes, quel est le nom de roi caché sous la forme Asénaphar : les déportés ont pu attribuer au père
son premier ministre que ce roi l’unit à la fille du grand prêtre d’un des sacerdoces les plus renommés de l’Egypte. Aseneth, d’après quelques commentateurs, ne serait pas le nom que portait la fille de Putiphar avant son mariage, mais le nom hébraïque que Joseph lui aurait donné. Dans cette hypothèse, on le compare au nom d’homme 'Asnâh, I Esdr., ii, 50, signifiant « grenier » ; on y voit une allusion à l’histoire de Joseph et au nom d'Éphraïm. Cette étymologie n’est guère satisfaisante. Du reste, tout dans ce récit nous porte à voir dans Aseneth le nom égyptien de la fille de Putiphar. Il est cependant difficile de déterminer d’une façon certaine son étymologie. C’est un mot composé pro as, « demeure, siège, » et du nom
bablement de
de
en
la déesse ! W ^.î, NU ou Net : ce qui donne J a *"* J,
Asneth, « demeure (ou siège) de Neith. » Sans doute ce nom n’a pas encore été trouvé sur les monuments, mais il en existe de tout à fait semblables : ainsi AsPtah, « demeure de Ptah ; » As-Menti, « demeure de Menti »
(cf. Lieblein, Dictionnaire des noms hiéroglyphiques, n 08 193, 241) ; As-Hathor, « la demeure d’Hathor, » qui est le nom de deux femmes de la XIIIe dynastie. Lieblein, ibid., n° 508. De plus cette expression est employée dans le Papyrus magique du British Muséum, pi. 16, 3. Cf. Birch, Revue archéologique, novembre 1863, t. vnr, p. 435 : « la
chapelle du siège (ou demeure) de Neith. » D’autres explications ont été proposées, moins heureuses peut-être. Aseneth pourrait venir de '-—< fc J,
Nésnet, « qui appartient àNeith. » On sait que cette préposition nés, qui entre dans la composition de beaucoup de noms propres, a été rendue en grec par un Ç, à l'époque ptolémaïque. Ainsi Nes-bæn-dad a donné Z6ev8eTr)ç. Nesnet aurait fait alors snet dans la transcription hébraïque, et 'asnet avec un aleph prosthétique. On pourrait encore proposer
I V H * » i J, Ausennet, « elle est à Neith, » qui se rapproche de la forme grecque 'AævvéO. On trouve des noms composés de la même manière, par exemple : Ausenmutés, Ausna. Cf. Lieblein, Dictionnaire des noms hiéroglyphiques, n° s 343, 201, 361, etc. Neith, qui entre certainement dans la composition du nom d' Aseneth, était une des déesses du premier ordre dans le Panthéon égyptien ( fig. 293). Émanation d’Ammon, elle était associée à ce dieu comme principe femelle dans la production de l’univers ; elle présidait à la sagesse et à l’art de la guerre, comme Minerve. Vénérée spécialement à Sais, on l’honorait dans toute l’Egypte comme la mère du soleil. Aussi il était naturel qu’un prêtre d’Héliopolis donnât à sa fille un nom où entrait celui de la mère de ce dieu. Des légendes se sont formées sur Aseneth : Prière d' Aseneth, voir Apocryphes, col. 771, et Légende d’Asnath, dans la Bévue des études juives, 1891, t. xxii, p. 87. E. Lëvesque.
ASER (hébreu : 'Asêr ; Septante : 'Aorjp), nom d’un fils de Jacob (et d’un fils de Coré, dans laVulgate), d’une des douze tribus d’Israël, d’une ville de Manassé (et enfin d’une ville de Nephthali dans le texte grec de Tobie).
1. ASER, huitième fils de Jacob, le second qu’il eut de Zelpha, servante de Lia. Gen., xxx, 13. Ce nom veut dire « heureux », et, à la naissance de l’enfant, il se trouve par trois fois sur les lèvres de Lia, qui, dans l’excès de sa joie, s'écrie : be’osrî, « dans mon bonheur, » c’est-à-dire heureuse que je suis ; 'isserûnî, « bienheureuse me proclament les femmes ; c’est pourquoi elle l’appela 'ASêr. » Aser, comme son frère aîné Gad, naquit en Mésopotamie, hébreu : Paddan Aram. Gen., xxxv, 26. Il eut quatre fils et une fille, nommée Sara, Gen., xlvi, 17 ; ses descendants sont énumérés I Par., vii, 30-40. La bénédiction que Jacob
293.
La déesse Neith.
Thèbes. xixe dynastie. — D’après Lepsins. Denltmaler, Abth. iii, pi. 123.
mourant lui donna tïen., xlix, 20, s’accomplit à la lettre dans la tribu dont il fut le père. Voir Aser 3.
2. ASER (hébreu : 'Assîr ; Septante : 'Aotip), fils aine de Coré et arrière-petit-fils de Caath, de la tribu de Lévi. Exod., vi, 24. Il est appelé Asir dans laVulgate (Septante : 'Aa-fip), I Par., vi, 22. Voir Asm 2.
3. ASER, une des douze tribus d’Israël. — I. Géographie. — La tribu d’Aser occupait la partie nord-ouest delà Palestine, depuis le Carmél jusqu’aux confins de la Phénicie, c’est-à-dire le versant occidental des montagnes qui s'étendent, comme un prolongement affaibli, du pied du Liban à la plaine d’Esdrelon. Les principales villes son ! énumérées dans le livre de Josué, xix, 24-31, et dans celui des Juges, i, 31-32 ; mais la délimitation exacte du territoire présente de très grandes difficultés. Nous ne savons, en effet, sur quelles bases eut lieu le partage de la Terre Promise, et l’identification de certains noms est encore à l'état de problème. Cependant les travaux modernes, en particulier ceux de E. Robinson, de V. Guérin et des explorateurs anglais de l’Exploration Fund, ont jeté une lumière nouvelle sur beaucoup de points obscurs, et permettent de tracer d’une manière satisfaisante les limites de chaque tribu, ou au moins de réformer les indications fantaisistes de certains auteurs. La carte que nous avons dressée pour cet article présente le résultat actuel de nos connaissances : les identifications ou certaines, ou probables, ou douteuses que nous adoptons sont basées d’abord sur les données de la Bible, ensuite sur les règles de l’onomastique, enfin sur les traditions anciennes.
1° villes principales. — Voici, dans l’ordre même suivi par Josué, xix, 24-31, les principales villes d’Aser. Nous renvoyons, pour les développements, aux articles qui concernent chacune d’elles en particulier :
1. Halcatb (hébreu : ffélqaf ; Septante : 'E5eXexé6, Jos., Xix, 25 ; Xikuid, Jos., xxi, 31), appelée Hucac, Ifûqôq, 'Axàx, dans la liste des villes lévitiques, I Par., vi, 75 (hébreu, 59). C’est très probablement aujourd’hui le village de Yerka, au nord-est d’Accho (Saint-Jean-d’Acre). V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 16-17. '*?
2. Chali( hébreu : IJâli ; Septante : 'AXécp ; Codex Alexàndrinus.-'Oo’kzi), probablement Khirbet 'Alla, au nord de la précédente. V. Guérin, Galilée, p. 62.
3. Béten (hébreu : Bétén ; Septante : BaiSôx ; Codex Alexandrinus : Bocrvé), probablement El Banéh, au sudest de Yerka. G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and places in the Old and New Testament, Londres, 1889, p. 27.
4. Axaph, Achsapb (hébreu : 'AkSâf ; Septante : Ke<£ç, Jos., xix, 25 ; 'AÇîç, Jos., xi, 1 ; xii, 20 ; Vulgate : Achsaph, Jos., xi, 1 ; xii, 20) ; c’est Khirbet Ksâf ou Iksâf, ruines situées au sud de l’angle formé par le Léontès, suivant Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, t. iii, p. 55, et V. Guérin, Galilée, p. 269 ; mais, plus probablement, pour nous, c’est Kefr Yasif, village situé à quelque distance au nord-est de Saint-Jean-d’Acre. Palestine Exploration Fund, Quart. St., 1876, p. 76. C’est l’Aksaphou des Listes de Thotmès III, n° 40.
5. Elmélech (hébreu : 'Allammélék ; Septante : 'E/.tliiXéx)> inconnue ; peut-être cependant VOuadi el-Malek, qui se jette dans le Cison (Nahr el-Mouqatta), en conserve-t-il le nom. Van de Velde, Memoir to accompany the Map of the Holy Land, 1858, p. 283.
6. Amaad (hébreu : 'Am'âd ; Septante : 'Apn^X), Khirbet el-'Amoud, au sud-est d’Ez-Zib, suivant G. Armstrong, Wilson et Conder, Names and places, p. 9 ; Oumm el-'Amed, village situé entre Beit-Lahm (Bethléhem de Zabulon) et Khirbet el-Beidha (Abès d’Issachar), au sud de VOuadi el-Malek, selon Van de Velde, Memoir, p. 284.
7. Messal (hébreu : Mis'âl, Jos., xix, 26 ; xxi, 30 ; Mâsâl, I Par., iii, 74 ; Septante : Maao-â, Jos., xix, 26, Dictionnaire âelaBible
LetOUzeyetvllf, Éditeurs
Imp. Itu/réruryPa7>is :
Trjv' BxoeUiv, Jos., xxi, 30, MacuriX, I Par., VI, 74 ; Vulgate : Masal, Jos., xxi, 30 ; I Par., vi, 74) doit se retrouver dans certaines ruines de VOuadi Maisléh, au nordest de Saint -Jean-d’Acre, suivant Armstrong, Wilson et Conder, Names and places, p. 129 ; mais probablement plutôt à celles de Misalli, au-dessous de la pointe du Carmel, non loin de la mer et au nord d’Athlit ; Van de Velde, Memoir, p. 335, d’après VOnomasticon, au mot Masan. C’est la MâSal des Listes de Thotmès III, n° 39.
8. Sihor et Labanath ( hébreu, sans conjonction : êîhôr Libnât ; Septante : tù Siwv xaî AaëavàB), inconnu. Les explorateurs anglais, Names and places, p. 164, et grande carte, feuille 6, proposent le Nahr Na’mein, ancien Bélus, au-dessous de Saint -Jean-d’Acre ; Conder, Palestine Exploration Fund, Quart. St., 1877, p. 50, propose VOuadi Schaghûr, à l’est de la même ville ; d’autres descendent jusqu’au Nahr Zerka, l’ancien Crocodilon flumen, au nord de Césarée.
9. Bethdagon (hébreu : Bêt Dâgôn ; Septante : BaiOs-fevé6), peut-être Tell Dâ'ûk, au sud-est et non loin de Saint-Jean-d’Acre. Palestine Exploration Fund, Quart. St., 1877, p. 22.
10. Zabulon (hébreu : Zebûlun ; Septante : tù ZaêouXc6v), Neby Sabelân, à l’est de Khirbet 'Alia, suivant Armstrong, Wilson et Conder, Names and places, p. 183 ; plus probablement Abilin, au sud-est de Tell Dâ'ûk, suivant bon nombre d’auteurs, entre autres V, Guérin, Galilée, t. i, p. 420-421.
11. Vallée de Jephtahel (hébreu : Gê Yffab-'Êl ; Septante : 'Ex-fat xat "ÊOairiX), peut-être VOuadi Abilin, qui prend naissance près de Djéfat, la Jotapata de Josèphe, la Yodaphath du Talmud. Robinson, Biblical Researclies, t. iii, p. 107.
12. Bethémec ( hébreu : Bêt Hâ'êméq ; Septante : B3n9(il), probablement 'Amka, un peu au-dessus de Kefr Yasif. Guérin, Galilée, t. ii, p. 23.
13. Néhiel (hébreu : Ne'î'êl ; Septante : 'IvariX ; Codex Alexandrinus : 'AvtviX), peut-être Khirbet Yânin, à l’est de Saint-Jean-d’Acre, suivant Armstrong, Wilson et Conder, Names and places, p. 136 ; ou le village de Mî'ar, peu éloigné de Khirbet Yanîn, suivant d’autres auteurs.
14. Cabul (hébreu : Kâbûl ; Septante : X(aêxp.xa’oyA, union de Kâbûl. et du mot suivant : Mièiem'ôl ; Codex Alexandrinus : XaëwX), certainement Kaboul, un peu au sud de Khirbet Yanîn. V. Guérin, Galilée, t. j, p. 422.
15. Abran (hébreu : 'Ébrôn ; Septante : 'EXëtàv), inconnue ; V. Guérin, Galilée, t. i, p. 432, propose Berouéh, à l’est de Saint-Jean-d’Acre. Ailleurs, Jos., xxi, 30, et I Par., VI, 74, on lit Abdon (hébreu : 'Abdôn ; Septante : 'A68(4v, Aaëêtiv), qui correspond certainement à Khirbet 'Abdéh, village situé à quelque distance au nordest d’Ez-Zib. V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 36.
16. Rohob (hébreu : Rehôb ; Septante : 'Paa6), inconnue ; nous proposons Tell er-Rahib, au nord-est de Khirbet 'Abdéh ; il y a convenance au point de vue du nom, de la signification et de la position.
17. Hamon (hébreu : Biammôn ; Septante : 'Enepiauv), rappelée par VOuadi et VAïn Hamoul, au nord-est de Bas en-Naqoura, suivant Robinson, Van de Velde et d’autres ; placée à Khirbet Oumm él-A’amid, tout près des mêmes endroits, par V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 147.
18. Cana (hébreu : Qânâh ; Septante : Kavfjâv ; Codex Alexandrinus : Kavâ), certainement le grand village de Kânah, au sud-est de Tyr. V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 391. Ce n’est pas la Caiia évangélique ; c’est peut-être la Qaïnaou des Listes de Thotmès III, n° 26.
19. Horma ( hébreu : Hârâmâh, avec l’article ; Septante : 'Pana), selon toute apparence, le village de Raméh, à l’est de Ras en-Naqoura ; V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 125, après Robinson, Biblical Researches, t. iii, p. 64.
20. Hosa (hébreu : Hiôsâh ; Septante : 'Iaoîç), peut-être
les ruines d’Ezzîyât el-Fôfta ou et-Tahta, au sud de Tyr. Armstrong, Wilson et Conder, Names and places, p. 90.
21. Achziba (hébreu : 'Akzîbâh ; Septante : 'E-^àê), généralement identifiée avec le village actuel d’Ez-Zib, sur le bord de la mer, au nord de Saint-Jean-d’Acre. C’est l’ancienne Ecdippe, VAk-zi-bi des tablettes cunéiformes. V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 164.
22. Amman (hébreu : 'Ummâh ; Septante : v Ay.y.ii), Khirbet 'Amméh, au nord-ouest d’El-Djich (Giscala), suivant V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 114 ; mais plus probablement 'Aima ou 'Aima ech-Chaoub, à une faible distance de Ras en-Naqoura. Armstrong, Wilson et Conder, Names and places, p. 178.
23. Aphec (hébreu : 'Âfêq ; Septante : 'Açix), inconnue ; nous ne croyons pas que ce soit VAfka du Liban.
24. Çohob (hébreu : Rehôb ; Septante : 'Paaû), inconnue.
La Bible ne compte que « vingtdeux villes avec leurs villages s. Jos., xix, 30. Il est probable qu’elle ne comprend pas dans la somme totale les deux dernières qui restèrent habitées par les Chananéens. Jud., i, 31. À ces cités épargnées et qui rentrent néanmoins dans le territoire de la tribu, il faut ajouter les trois suivantes, Jud., i, 31 :
25. Accho (hébreu : 'Akkô ; Septante : 'Ax^w, Jud., I, 31 ; riroXeiiaiç, I Mach., v, 15, 22, 55, etc.), aujourd’hui 'Akka ou Saint-Jean-d’Acre, ville maritime, située à douze kilomètres au nord-est du Carmel.
26. Ahalab (hébreu : 'Ahlâb ; Septante : AaXiip), probablement El-Djich, au nord-ouest de Safed et non loin du Djebel Djermakk. Jud., i, 31.
27. Helba (hébreu : Jlélbâh ; Septante : Xe68ci), inconnue. Jud., i, 31.
Sidon et Tyr ne sont vraisemblablement nommées, Jos., xix, 28 et 29, que comme les frontières de la tribu d’Aser, qui ne devait pas les englober dans son territoire.
2° limites. — Nous pouvons maintenant déterminer les limites de la tribu d’Aser. Une remarque préliminaire, mais très importante, doit nous éclairer : c’est que l’auteur sacré, loin de marcher au hasard dans ses énumérations, procède toujours avec méthode, par groupes réguliers ou suivant une certaine direction. C’est là un fait évident, en particulier, pour les tribus de Juda et de Benjamin, Jos., xv, 20-63 ; xviii, 11-28, et facile à saisir ici ; c’est un élément qu’on a trop négligé dans le problème* des identifications. En effet, pour un assez grand nombre de localités, citées une ou deux fois seulement, les données de la Bible font défaut ; d’un autre côté l’onomastique a parfois quelque chose de spécieux ; enfin les traditions anciennes sont plus ou moins vagues. Dans ces cas, l’ordre suivi par l'écrivain inspiré et la place qu’occupe le nom dans ses listes sont pour nous d’un très grand poids. C’est en vertu de cette règle, applicable surtout au livre de Josué, que nous sommes disposé à placer, par exemple, Amaad à Oumm el-'Amed plutôt qu'à Khirbet el-'Amoud, et Messal à Misalli plutôt qu'à Maisléh.
Voici, en effet, la marche de l’historien sacré. Il commence par le centre de la tribu avec Halcath, Chali, B^ten et Axaph ; puis il descend vers le sud avec Elmélech, Amaad, Messal, le Carmel, Sihor-Labanath. De là il se dirige « vers l’orient » par Bethdagon, Zabulon et la vallée. de Jephtahel. Remontant « vers le nord » avec Bethémec, il reprend plus bas quelques villes du centre, Néhiel, Cabul et Abran, pour aller, par Rohob, Hamon et Cana, « jusqu'à la grande Sidon. » Enfin il revient vers Horma pour finir par l’ouest avec Tyr, Hosa, Achzib et Amma. La frontière orientale peut donc se traduire par la ligne suivante : partant des bords de la mer, au sud du Carmel, elle se dirige vers le nord-est par l’Ouadi el-Malek et la vallée de Jephtahel ; passant ensuite entre le Djebel Djermak et le Djebel Adathir, elle englobe El-Djich ; enfin, après une inclinaison vers le nord-ouest, elle remonte au
nord pour couper le Nahr el-Qasmiyéh un peu au delà du milieu vers l’est. Plusieurs villes de Nephthali nous « servent de jalons pour ces limites : Arama (Er-Raméh), Jéron (Yàrûn), Enhasor (Khirbet Haziréh), Iléleph (Beil-Lif) et Magdalel (Mudjeidel). Jos., xix, 36, 37, 38. D’un autre côté, nous savons que la frontière occidentale de Zabulon descendait par la vallée de Jephtahel jusqu'à Bethléhem (Beit-Lahm). Jos., xix, 14, 15. Nous arrêtons la pointe méridionale au sud de Misalli, puisque Dor [Tantoura) fut enlevée à Aser pour être donnée à Manassé. Jos., xvii, 11. Jusqu’où s'étendait la tribu au nord ? Nous ne savons au juste ; tout ce que nous pouvons constater, c’est qu’il n’y a pas actuellement au delà du Nahr el-Qasmiyéh, ou « fleuve de la séparation », d’identifications certaines. À l’exception de plusieurs villes importantes, telles qu’Accho et Achzib, elle occupai^ vers l’ouest, toute la côte méditerranéenne, comme on le voit d’après le cantique de Débora, Jud., v, 17 :
Aser habitait sur le rivage de la mer, Et se reposait dans ses ports.
Elle était ainsi, bornée à l’est par la tribu de Nephthali, au sud-est par celle de Zabulon, au sud par celles d’Issachar et de Manassé.
3° description. — La tribu d’Aser comprenait donc tout le versant méditerranéen du massif septentrional de la Palestine, massif dont l’arête principale est formée de trois sommets avec leurs prolongements vers le nord et le sud, le Djebel Adâthir (i 025 mètres), le Djebel Djermak (1199 mètres), le Djebel Zaboûd (1114 mètres). A l’ouest de cet axe se profilent transversalement ou obliquement des chaînons tourmentés, rattachés entre eux par des contreforts latéraux, surtout près de la mer, où ces contreforts semblent les restes d’une chaîne bordière parallèle ou littorale. Le Râs Oumm Qabr, au nord de Ya’ter, y atteint 715 mètres ; le Tell Bêlât, plus bas, s'élève à 616 mètres ; enfin, plus au sud encore, le rebord de Terchiha est à 632 mètres d’altilude. Les rivières de ce versant, arrêtées jadis dans les cavités des entrecroisements, ont rompu cette barrière, et quelques marais seulementindiquent aujourd’hui pendant les pluies la place des anciens lacs. Les nombreuses vallées qui forment tout ce dédale occidental réunissent leurs eaux en plusieurs courants principaux, les ouadis El-Houbeichiyéh, El-Ezziyéh, Ez-Zerka, Kerkera, El-Qourn, les Nahr Mefchoukh, Semiriyéh et Na’mein. La plaine côtiére, depuis le Léontès jusqu’au Râs eh-Abiad ou « cap Blanc », en passant par Tyr, est large en moyenne de deux kilomètres. Barrée par le Bas en-Naqoura ou « Échelle des Tyriens », promontoire qui tombe à pic sur le rivage, elle s'élargit à six ou huit kilomètres en passant par Êz-Zîb et Accho. La baie de Khaïfa et le Carmel terminent cet ensemble.
Dans ces vallées, sur les flancs ou sur le plateau supérieur des montagnes, s'élevaient autrefois une multitude de villes et de bourgades, aujourd’hui renversées ou encore en partie debout et habitées, jouissant sur ces hauteurs d’une vue plus étendue, d’un air plus salubre et d’un.e sécurité plus grande. Au milieu de fourrés presque inextricables de lentisques, d’arbousiers, de chênes verts, de térébinthes et de caroubiers, le voyageur rencontre des ruines d’un haut intérêt : arasements de murs d’enceinte, de tours, d'édifices et de maisons avec les pieds-droits et les linteaux de leurs portes encore en place. Ces ruines appartenant quelquefois à toutes les époques et à toutes les civilisations, ruines chananéennes, judaïques, byzantines, ou datant des croisades, sont comme autant de couches superposées et successives des nombreuses populations, conquérantes ou conquises, qui ont tour à tour habité le pays. Des excavations de toutes sortes pratiquées dans le roc, telles que tombeaux, magasins souterrains, réservoirs, citernes, puits, pressoirs, attestent que cette contrée était autrefois très peuplée et merveilleusement
cultivée, dans les endroits même les plus désertés aujourd’hui par l’homme, et les plus rebelles en apparence à toute culture. Cf. V. Guérin, Galilée, t. i, p. 79-80.
Dans les plaines, comme celles de Saint-Jean-d’Acre et de Tyr, et sur les collines cultivées jusqu'à leur sommet, croissaient en abondance, comme maintenant encore, du blé, de l’orge et d’autres céréales. Sur les pentes des montagnes s'étageaient de belles plantations d’oliviers, de figuiers, de vignes et d’autres arbres fruitiers, que des broussailles ont en partie remplacées depuis longtemps ; malgré cela ce territoire, boisé et fertile, passe encore pour un des plus beaux cantons de la Palestine. C’est ainsi que s’accomplit à la lettre la prophétie de Jacob, Gen., xlix, 20 :
D’Aser vient un pain excellent, Il fait les délices des rois.
Ainsi se réalisa également la bénédiction de Moïse, Deut., xxxin, 24, 25, promettant à la tribu l’accomplissement du présage contenu dans son nom, Aser, « bienheureux : »
ꝟ. 24. Béni soit Aser en enfants ;
Qu’il soit agréable à ses frères,
Et qu’il baigne ses pieds dans l’huile, y. 25. Que le fer et l’airain soient tes verroux,
Et que ta force dure autant que tes jours !
Comblé des biens terrestres et toujours en paix dans de puissantes forteresses, Aser trouvait de l’huile en abondance dans le pays qui lui échut en partage. On dit dans les Talmuds, à propos du verset biblique, que « dans les possessions d’Aser l’huile coule comme un ruisseau », Siphré, Deutéronome, 355 (édit. Friedmann, p. 148 a), et qu' « il est plus facile d'élever une légion (forêt) d’oliviers en Galilée que d'élever un enfant en Palestine ». Bereschith rabba, ch. 20. On fabriquait en Galilée un genre de vases tout particuliers pour conserver l’huile. Cf. A. Neubauer, La géographie du Talmud, Paris, 1868, p. 180. La ville la plus renommée pour l’abondance de ses huiles était précisément Gouch Halab, l’ancienne Ahalab, aujourd’hui El-Djich. Voir Ahalab. Le fer et l’airain, dont il est question au J. 25, marquent, suivant certains auteurs, l’esprit guerrier de la tribu. I Par., vu, 40. Ils font allusion, selon d’autres, aux métaux qu’on trouvait dans cette tribu ou dans son voisinage au Liban. D’autres appliquent ces mots aux habitations d’Aser, fermées avec des verroux solides, fortes et imprenables comme « des forteresses de fer et d’airain ». Cf. Trochon, Les Nombres et le Deutéronome, Paris, 1887, p. 212-213.
II. Histoire. — Dans le premier dénombrement qui fut fait du peuple hébreu, au Sinaï, la tribu d’Aser comptait 41500 hommes en état de porter les armes. Num.„ i, 40, 41. Le chef qui fut chargé de procéder au recensement était Phégiel, fils d’Ochran. Num., i, 13. Dans le campement et la marche à travers le désert, elle se trouvait placée entre Dan et Nephthali, au nord du tabernacle. Num., ii, 27. Les dons qu’elle offrit à Dieu pour la dédicace de l’autel, par les mains de Phégiel, sont ainsi énumérés : « Un plat d’argent pesant cent trente sicles, une coupe d’argent pesant soixante-dix sicles, au poids du sanctuaire, pleins l’un et l’autre de farine pétrie d’huile pour le sacrifice ; un petit vase d’or pesant dix sicles, plein d’encens ; un bœuf du troupeau et un bélier, et un agneau d’un an pour l’holocauste, et un bouc pour le péché ; et pour hosties pacifiques, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d’un an. » Num., vii, 72-77. Parmi les explorateurs du pays de Chanaan, celui qui la représentait était Sthur, fils de Michaël. Num., xiii, 14.
Au second dénombrement qui fut fait dans les plaines de Moab, elle comptait 53400 hommes. Num., sxvi, 47. Après l’entrée dans la Terre Promise, elle se tint, « pour prononcer la malédiction, sur le mont Hébal, avec Ruben, Gad, Zabulon, Dan et Nephthali. » Deut., xxvii, 13. Après le partage du territoire, elle fournit quatre villes aux Lé
vites, fils de Gerson : Masal, Abdon, Helcath et Rohob, avec leurs faubourgs. Jos., xxi, 30, 31 ; I Par., vi, 62, 74, 75. Pendant que « Zabulon et Nephthali exposaient leur vie à la mort », pour combattre sous Débora et Barac les ennemis d’Israël, les enfants d’Aser se reposaient tranquillement dans leurs ports. Jud., v, 17, 18. Ils aidèrent cependant Gédéon à poursuivre les Madianites. Jud., vii, 23. Les guerriers de cette tribu qui contribuèrent à conférer à David la royauté étaient au nombre de 40000. I Par., xii, 36. Du temps de Salomon, la tribu d’Aser forma, sous le gouvernement de Baana, fils d’Husi, l’une des douze divisions territoriales qui devaient subvenir chacune pendant un mois à l’entretien de la cour. III Reg., iv, 16. Lorsque Ézéchias convoqua Israël et Juda à Jérusalem pour la cérémonie de la Pàque, « quelques hommes d’Aser répondirent à son appel. » II Par., xxx, 11. Dans le - partage symbolique de la Terre Sainte qui termine la prophétie d’Ezéchiel, Aser garde sa position naturelle au nord, Ezech., xlviii, 2, 3, et donne son nom à l’une des trois portes occidentales de la nouvelle Jérusalem. Ezech., xlviii, 34. Dans le Nouveau Testament, Anne la prophétesse, fille de Phanuel, la pieuse veuve qui, au jour de la Présentation du Sauveur, « chantait les louanges du Seigneur, et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d’Israël, » est de la tribu d’Aser. Luc, ii, 36-38. Cette tribu est enfin nommée pour la dernière fois dans l’Apocalypse, vii, 6 : S. Jean voit parmi les élus qui sont marqués du signe du Dieu vivant « douze mille hommes de la tribu d’Aser », comme des autres tribus d’Israël. A. Legehdre.
4. ASER, ville frontière de la demi-tribu cisjordanienne de Manassé. Jos., xvii, 7. On reconnaît généralement qu’il s’agit ici d’une localité, et non de la tribu de ce nom. L’Onomaslicon, Gœttingue, 1870, p. 222, la mentionne en ces termes : « Aser, ville de la tribu de Manassé ; il existe encore maintenant un village de ce nom, que l’on rencontre près de la grande route, quand on descend de Néapolis à Scythopolis, au quinzième mille de la première de ces villes. » Cf. S. Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxiii, col. 871. Or précisément à cette même distance (environ 22 kilomètres) de Naplouse (autrefois Néapolis), sur la route qui conduit à Beïçân, l’ancienne Scythopolis, se trouve un village appelé Teiasir, dont les deux dernières syllabes reproduisent fidèlement l’antique dénomination 'Aorip. Quelques voyageurs même écrivent Yasir. Cf. Van de Velde, Memoir to accompany the Map of the Holy Land, 1859, p. 289.
M. V. Guérin, pour qui cette identification est incontestable, décrit Teiasir comme un pauvre « village dont plusieurs maisons sont renversées ; d’autres sont très dégradées ; un certain nombre de pierres de taille, engagées comme matériaux de construction dans la bâtisse de quelques-unes d’entre elles, indiquent que ce village a succédé à une ville antique, dont l’existence en cet endroit est en outre attestée par beaucoup de citernes creusées dans le roc, éparses çà et là ; par les tombeaux de la vallée voisine, et par un très beau mausolée qui se trouve à 250 mètres au sud de la colline. Ce monument, de forme Carrée, mesure extérieurement neuf mètres sur chaque face. Il a été construit avec de magnifiques blocs très bien appareillés et agencés entre eux, et reposant sans ciment les uns sur les autres… Quatre pilastres ornaient les trois faces est, ouest et sud. Quant à la face nord, elle n’en avait que deux. Là, en effet, s’ouvre la baie, encore assez bien conservée, qui donne accès dans la chambre intérieure. Cette baie consiste en deux pieds-droits formés de beaux blocs superposés horizontalement et couronnés d’un superbe linteau monolithe, décoré de moulures à crossettes, moulures qui descendent également le long des pieds-droits… Après l’avoir franchie, on pénètre, par une sorte de petit vestibule, dans une chambre qui, sous
trois niches, devait contenir probablement trois sarcophages, aujourd’hui disparus. » Description de la Palestine, Samarie, t. i, p. 355-357.
5. ASER. Le texte grec de Tobie, i, 2, mentionne aussi une ville d’Aser, 'A<rijp, de la tribu de Nephthali, dans la Galilée. Aucun autre texte ne parle d’une ville de ce nom dans cette contrée. Il faut peut-être lire Asor
('Aaûp), la ville de Jabin. VoirvsoR 1.ASÊRÂH. Voir Aschérah.
- ASERGADDA##
ASERGADDA (hébreu : Hâsar Gaddâh ; Septante, Codex Alexandrinus : 'AfrspyaSSâ), ville de la tribu de Juda, située à l’extrémité méridionale de la Palestine. Jos., xv, 27. Son emplacement est inconnu. La première partie du nom, Hâsar, est l'état construit de hâsêr, « lieu entouré de clôtures, » expression correspondant, chez les tribus pastorales de la Bible, au douar des Arabes d’Afrique, Voir Haséroth. On a remarqué que presque toutes les localités dont la dénomination comprend cet élément, comme Hasersual ( HâsarSu' âl), Jos., xv, 28 ; Hasersusa (HâsarSûsâh), Jos., xix, 5, se trouvent dans le désert ou sur les confins du désert. Tel est le cas d’Asergadda. Elle fait partie d’un groupe dont malheureusement peu de noms sont connus, et elle est citée entre Molada et Hassémon. Cette dernière ville n’a pas été retrouvée, mais l’autre est généralement identifiée avec Khirbet el-Milh ou Melah, à l’est de Bersabée (Bir es-Séba). Cf. V. Guérin, Description de la Palestine, Judée, t. iii, p. 184. Trois noms seulement, dans l'énumératîon de Josué, xv, 27-28, la séparent de Bersabée, ce qui nous permet de regarder sa situation comme circonscrite dans ces parages. Eusèbe et saint Jérôme mentionnent Aser et Gadda comme deux villes distinctes de la iribu de Juda. Cf. Onomasticon, Gœttingue, 1870, p. 220, 245 ; S. Jérôme, Liber de situ et nortiinibus locorum hebr., t. xxiii, col. 870, 901. L’absence du vav empêche de diviser ainsi les deux mots Hâsar Gaddâh, et les indications données par Eusèbe et S. Jérôme ne répondent pas au contexte biblique. Cf. Reland, Paleestina ex rnonumentis veteribus illustrata,
Utrecht, 1714, t. ii, p. 707.- ASFELD##
ASFELD (Jacques Vincent Bidal d'), théologien français, abbé de Vieu ville, né le 23 janvier 1664, mort à Paris, âgé de quatre-vingt-deux ans, le 21 mai 1745. Tout dévoué à la secte janséniste, il fut un des plus ardents appelants de la bulle Unigenitus, et mêlé à toutes les controverses de cette époque. Exclu de la Sorbonne, exilé en 1721 à Villeneuve-le -Roi, au diocèse de Sens, il persista jusqu'à la fin dans son opiniâtreté. Très lié avec Duguet, attaché comme lui à l’hérésie janséniste, il collabora aux ouvrages que ce dernier publia sur l'Écriture Sainte, sans qu’il soit possible de déterminer d’une manière absolument précise quelle fut sa part de collaboration. Les rédacteurs des Nouvelles ecclésiastiques de 1745, dans la notice élogieuse qu’ils ont consacrée à ce personnage, disent en parlant de ses écrits : « Nous ne connaissons d’ouvrage qui soit constamment de M. l’abbé d’Asfeld, que la préface du livre des Règles pour l’intelligence des Saintes Écritures ; quelque morceau particulier dans les lettres du Prieur pour la défense de ce même ouvrage, qui est de M. Duguet ; l’analyse (du moins tout le monde assure qu’elle est de lui) qui fait les IVe, v" et VIe tomes de l’Explication de la prophétie d’Isaïe, par M. Duguet ; enfin V Explication des livres des Rois et des Paralipomènes, 3 vol. in - 12. » Outre ces ouvrages, divers auteurs attribuent encore à l’abbé d’Asfeld les écrits suivants : 1° Explication littérale de l’ouvrage des six jours, mêlée de réflexions morales (sans nom d’auteur), Bruxelles, 1731, in-12 ; Paris, 1736 ; 2° La Genèse en latin et en français, avec une explication du sens littéral et du sens spirituel, 2 in-12, Paris, 1732 ; 3° Explication
1.-3, 1
du livre de la Genèse, selon la méthode des saints Pères, 3 in-12, Paris, 1732. G. Legeay.
- ASH Edward##
ASH Edward, commentateur protestant, né à Bristol (Angleterre) en 1797, mort dans cette ville en 1873. Il fut reçu docteur en médecine en 1825, et exerça sa profession à Norwich, où il s'établit en 1826. Il appartenait à, la secte des Amis (Friends), et en devint ministre en 1832. Il continua néanmoins à pratiquer la médecine jusqu’en 1837, époque à laquelle il se retira à Bristol, pour ne plus s’occuper que de religion. Il avait étudié avec soin le texte grec du Nouveau Testament, et l’on a de lui Explanatory Notes and Camments on the New Testament, 3 in-8°, Londres, 1849.
- ASHDOWNE William##
ASHDOWNE William, unitarien anglais, né à Turnbridge Wells, en 1723, mort le 2 avril 1810. Son père était commerçant et remplissait les fonctions de pasteur de la General JBaptist Society (société unitarienne). Il devint lui-même prédicateur et pasteur de la secte. On a de lui : On the true Character of John the Baptist (anonyme), 1757 ; À Dissertation on St John, iii, 5, publiée avec son nom, en 1768 ; À Scripture Key to the Evangelists, 1777. Il composa aussi quelques écrits théologiques. La plupart de ses œuvres avaient été imprimées à Cantorbéry. — Voir Monthly Beview, juin 1757, p. 285 ; Monthly Repository, t. v, p. 480 ; Kippis’s Doddrige’s Lectures, t. ii, p. 175, 390.
- ASHUR##
ASHUR (hébreu : 'Ashûr, « noirceur ; » Septante : 'A<rx<i, 'Auoùp), fils posthume d’Hesron, de la tribu de Juda, et père de Thécuâ. I Par., ii, 24. Au chap. IV, 5, il est appelé Assur. Voir Assur 1.
- ASIARQUE##
ASIARQUE (grec : 'Autâpxiî ; Vulgate : Asise princeps), prêtre de l’empereur et président de l’assemblée provinciale d’Asie. Les Actes racontent que, lors de l'émeute excitée à Éphèse contre saint Paul par les orfèvres de la
[[File: [Image à insérer]|300px]]
295. — Monnaie portant le nom d’un asiarque.
Ar[ToxpaTw P ] KAI[<rap] M. ANT[wvtoç] TOPAIANOS. Tête laurée de l’empereur Gordien III, à droite. — % SMYP. NA1ÛN T NEQ[xopH EU[i] TEPTIOT ASIAPXOT. Homme couché sons on arbre ; à côté de loi, deuxNémésis debout.
ville, quelques asiarques, qui étaient des amis de l’Apôtre, l’avertirent du danger qu’il courait, et l’invitèrent à ne pas aller au théâtre haranguer la foule. Act., xix, 31. Pour comprendre l’importance de ces personnages, il est nécessaire de dire quelques mots de l’assemblée provinciale d’Asie, dont ils étaient les présidents.
C’est en Asie que les provinciaux commencèrent à rendre un culte à l’empereur. En l’an 29 avant J.-C, un temple, consacré à Rome et à Auguste (cf. fig. 298, col. 1096), fut Mti à Pergame avec l’autorisation impériale, tandis qu'à Éphèse s'élevait un temple en l’honneur de César divinisé. Dion Cassius, Ll, 20 ; Tacite, Ann., IV, 37. Plus tard, d’autres temples semblables furent bâtis à Smyrne, à Sardes, à Laodicée, à Philadelphie, etc. Une assemblée composée de délégués nommés par les villes de la province se réunissait
chaque année pour célébrer les fêtes du culte impérial, tantôt dans l’une de ces villes, tantôt dans l’autre. Ces délégués élisaient un prêtre qui était en même temps le président de l’assemblée et des jeux institués en l’honneur des princes. Il portait le titre d"Aatdîpxr|ç ou d"Ap^ispeùç 'Aaixç. Plusieurs savants ont cru que ces titres se rapportaient à deux personnages distincts, d’autres que î'asiarque était le grand prêtre nommé tous les cinq ans, parce que cette année-là les fêtes étaient plus solennelles ; il est aujourd’hui démontré que le titre d’asiarque et celui de grand prêtre d’Asie étaient identiques, et appartenaient tous deux au président de l’assemblée annuelle. L’asiarque avait donc pour fonctions de présider l’assemblée ou xoivov 'Acrt’etç, d’accomplir les sacrifices offerts à l’empereur et à la déesse Rome, de présider les jeux, enfin de surveiller les temples bâtis par la province dans les villes où se tenait tour à tour l’assemblée. Les asiarques étaient de très grands personnages ; leur nom servait à désigner l’année pour la province entière et était parfois gravé sur les monnaies (fig. 295). Avant de parvenir à ces hautes fonctions, ils avaient exercé les magistratures les plus importantes dans leur cité. L’illustration de leurs ancêtres et leur fortune les désignaient le plus souvent aux suffrages de leurs compatriotes. Ds avaient, en effet, de grandes dépenses à faire, car une partie des frais des fêtes était à leur charge. Nous savons notamment qu’ils entretenaient des troupes de gladiateurs et des bêtes féroces pour les jeux du cirque.
Le passage des Actes que nous avons cité a paru à un certain nombre de commentateurs contenir la preuve qu’il y avait à la fois plusieurs asiarques, formant comme une sorte de collège dont le grand prêtre d’Asie était le président. Quelques-uns ont même poussé la précision jusqu'à dire qu’ils étaient au nombre de dix. À l’appui de leur opinion, ils citent un passage d’Aristide, Orat. 26, édit. Dindorf, t. i, p. 516, et un passage de Strabon, xiv, p. 649. Ces textes, comme celui des Actes, s’expliquent naturellement, sans avoir recours à une théorie démentie par tous les textes. En effet, les asiarques n'étaient nommés que pour un an, et après l’expiration de leur charge ils conservaient comme un titre honorifique le nom qu’ils avaient porté. Il devait donc y avoir à Éphèse un certain nombre de ces asiarques honoraires, puisque, depuis la fondation du culte impérial jusqu’au moment où éclata l'émeute des orfèvres, il y avait eu plus de quatre-vingts titulaires. De plus, les prêtres chargés de desservir les temples provinciaux bâtis dans les villes où se tenait l’assemblée portaient aussi le titre d’asiarques. Celui d'Éphèse, par exemple, s’appelait : 'Asiip^ïjç vaoO toù h 'Eçéo™. Corpus inscript, grsec, 2464, 2987 b ; Waddington, Inscriptions d’Asie Mineure, 146, 755, 1821, etc. etc.
Bibliographie. — RynReynen, Dissertatio deasiarchis, in-4°, Utrecht, 1753 ; Th. Mommeen et J. Marquardt, Manuel d’antiquités romaines, trad. franc., t. ix ; Organisation de l’empire romain, par J. Marquardt, t. ii, p. 508 et suiv. ; G. Perrot, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Saglio, art. Asiarcha ; P. Monceaux, De Communi Asise provincæ ; P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans V empire romain, p. 97 et suiv. ; cf. Bulletin critique, 1888, p. 101 ; Otto Ilirschfeld, Zur Geschichte des rômischen Kaisercultus, dans les Sitzungsberichte der kôniglich. Preussisch. Akademie der Wissenschaften vu Berlin, phil. - histor. Classe, t. xxxv, p. 833 et suiv. ; Bûchner, De Neocoria, p. 116 et suiv. ; Mommsen, Histoire romaine, trad. franc., t. x, p. 124 ; E. Beurlier, Le culte impérial d’Auguste à Justinien, p. 17, 110, 122 et suiv. E. Beurlier.
- ASIATIQUE##
ASIATIQUE (Vulgate : Asianus). II Mach., x, 24. D’Asie, nom donné au royaume des Séleucides. Voir Asie, i, col. 1093. — La Vulgate appelle aussi Asiani ('Airtavoî), Act., xx, 4, c’est-à-dire originaires de la province ro
maine d’Asie (voir Asie, ii, col. 1094), deux compagnons de saint Paul, Tychique et Trophime.
ASIE (i[ 'A<rîa). Le mot « Asie » désignait, pour les anciens, les régions occidentales de la partie du monde que nous appelons de ce nom. La racine As, qui entre dans la composition de ce mot, lui donne la signification de « pays du soleil », ou « pays de l’Est », par opposition à l’Europe (Éreb ou Érob), « pays de l’Ouest, » Pott, Etymolog. Forschungen, t. ii, p. 190. L'Écriture emploie le mot « Asie » dans deux sens différents. Dans les livres des Machabées, il désigne l’empire des Séleucides ; dans le Nouveau Testament, la province romaine d’Asie, mais jamais la partie du monde que nous appelons maintenant Asie.
I. Asie, empire des Séleucides. — Les rois de la dynastie
En 283, Séleucus fit la conquête de l’Asie Mineure. Appien, Syr., 62, 63. Séleucus possédait ainsi à peu près toute la partie asiatique de l’empire d’Alexandre. De là le nom de rois d’Asie donné aux Séleucides. Voir la carte, fig. 296. Mais cet empire ne conserva pas longtemps son étendue. Déjà, sous Antiochus II Théos, le roi de Médie Atrôpatène agrandit son territoire en s’emparant des régions comprises entre les Portes Caspiennes et Ecbatane. Polybe, v, 44, 7 ; Strabon, xi, 9, 2. Vers 250, la Bactriane et la Parthie se proclamèrent indépendantes. Strabon, ibid. Cf. Droysen, Histoire de l’hellénisme, trad. franc., t. iii, p. 342-350. Antiochus III le Grand tenta de reconquérir les provinces perdues par ses prédécesseurs. À l’aide d’Achæos, il reprit les provinces d’Asie Mineure situées à l’ouest du Taurus, et dont Attale I er, roi dé Pergame, avait dépouillé Antiochus II. Polybe, v, 40, 7 ; Tite Live,
L.TIrai]]ier.ael ?
[[File: [Image à insérer]|300px]]
296. — Carte de l’Asie, empire des Séleucides.
des Séleucides sont appelés rois d’Asie. C’est le nom par lequel est désigné Antiochus III le Grand. I Mach., viii, 6. De même quand Ptolémée VI Philométor s’empara d’Antioche, après sa victoire sur Alexandre Balas (voir Alexandre Balas), et quand Tryphon, après avoir assassiné le jeune roi Antiochus VI (voir Tryphon et Antiochcs VI), voulut régner à sa place, l'Écriture dit qu’ils mirent sur leur tête le diadème d’Asie. I Mach., xi, 13 ; xii, 39 ; xiii, 32. Enfin Séleucus VI (voir Séleucus VI) est encore appelé roi d’Asie. II Mach., iii, 3.
Dans le partage que les généraux d’Alexandre firent entre eux de son héritage, Séleucus, après la bataille d’Ipsus, « reçut, nous dit Appien, la souveraineté de la Syrie en deçà de l’Euphrate jusqu'à la mer, et celle de la Phrygie jusqu’au milieu du pays ; … il obtint aussi la souveraineté de la Mésopotamie, de l’Arménie et de toutes les parties de la Cappadoce qui portent le nom de Séleucide, celle des Perses, des Parthes, des Bactriens, des Arabes, des Tapuriens, de la Sogdiane, de l’Arachosie et de l’Hyrcanie, ainsi que de tous les peuples qu’Alexandre avait soumis jusqu'à l’Indus. » Appien, Syr., 55. Mais tous ces pays n'étaient pas soumis immédiatement au roi de Syrie. Un certain nombre d’entre eux étaient gouvernés par des princes vassaux. Tels étaient l’Arménie et la Cappadoce.
xxxiii, 38. Il conquit également la Cœlésyrie, la Phénicie et la Palestine, dont s'était emparé Ptolémée III Évergète ; mais, en 217, il céda ces provinces à Ptolémée IV Philopator, après la défaite qu’il essuya à Raphia. Polybe, v, 51-87 ; Justin, xxx, 1. (Voir Antiochus III, Ptolémée III et Ptolémée IV.) Il essaya également de reprendre la Bactriane et la Parthie ; mais il ne réussit qu'à reculer un peu les frontières de la Parthie, agrandie par les conquêtes d’Arsace I 9r. Polybe, x, 27-31 ; Justin, xli, 5. Enfin il fut obligé de céder à Eumène II, roi de Pergame, l’Ionie, la Mysie, la Lydie et la Phrygie. I Mach., viii, 8. (Voir, pour la correction du texte, Antiochus III, col. 691.) Tite Live, xxxvii, 55 ; xxxviii, 39 ; Justin, xxxi, 6 ; Polybe, xxi, 13. Au temps d’Alexandre Balas et de Ptolémée VI Philométor, et, plus tard, au temps de Tryphon, le royaume des Séleucides resta ce qu’il était à la mort d' Antiochus III. Le titre de roi d’Asie n’indique donc pas que les Séleucides aient jamais régné sur l’Asie entière.
II. Asie, province romaine. — Dans le Nouveau Testament, le mot « Asie » désigne la province romaine de ce nom, c’est-à-dire l’ancien royaume de Pergame, ou l’Asie Mineure, conquise et organisée en province. Appien, Mithr., LXI, lxii ; Tacite, Ann., III, 62. Voir la carte, fig. 297. Parmi les étrangers qui étaient présente à Jéru^
salem, le jour de la Pentecôte, figurent des habitants de l’Asie. Act., ii, 9. Les Juifs d’Asie habitant Jérusalem sont également nommés parmi ceux qui entrent en discussion avec le diacre saint Etienne, Act., vi, 9, et ce sont eus qui reconnaissent saint Paul dans le temple et le font arrêter comme perturbateur par le tribun qui commandait à la tour Antonia. Act., xxi, 27-30. Dans son premier voyage apostolique (45-50) ; saint Paul, accompagné de saint Barnabe, passa par l’Asie Mineure ; mais il ne put que faire un court séjour à Antioche de Pisidie. Act., xiii, 14, 50. Il y passa de nouveau à son retour. Act., xiv, 18. A son second voyage, l’Apôtre voulait encore évangéliser
1. T hlriTH.r. doit 297. —
Carte de la province romaine d’Asie.
l’Asie ; mais le Saint-Esprit l’en empêcha et lui fit connaître que Dieu voulait que la foi fût prêchée d’abord en Macédoine. Act., xvi, 6. Pendant son troisième voyage i'54-57), saint Paul prêcha à Éphèse et à Milet. Act., xix, 10, 22, 26 ; xx, 16-38. À partir du jour où il quitta cette dernière ville, l’Apôtro ne remit plus les pieds sur la terre d’Asie ; mais le navire qui l’emmenait prisonnier à Rome longea les côtes de cette province. Act., xxvii, 2. C’est pendant son séjour en Asie que saint Paul écrivit sa première Épître aux Corinthiens, qu’il salue au nom des Églises asiatiques, I Cor., xvi, 19, et dans la seconde Épître, adressée à la même Église, il fait allusion aux tribulations qu’il vient d'éprouver en Asie. II Cor., i, 8. Saint Pierre énumère les Églises d’Asie parmi celles à qui il adresse sa première Épître. I Petr., i, 1. Deux disciples de saint Paul, Tychique et Trophime, étaient d’Asie. Act., xx, 4.
La création de la province d’Asie remonte à l’an 133 avant J.-C. Attale III, roi de Pergame, avait, en mourant, légué son empire aux Romains. Tite Live, Epit., lviii, lix. Plutarque, Ti. Gracch., xiv ; Justin, xxxvi, 4 ; Strabon, xiii, p. 624. Mais la province ne fut réellement constituée qu’en 129, par" M. Aquilius. Strabon ~ xiv, p. 646 ; Justin, xxxyi, 4. Elle comprenait la Mysie jusqu’au mont Olympos, l'Éolide, la Lydie, l’Ionie et la Carie. Sylla, en 84,
organisa la nouvelle province. En 82, Cibyra, et, en 62, Apaméé et Synnada, qui toutes trois appartiennent à la Phrygie, furent réunies à l’Asie. Strabon, xiii, p. 631 ; Cicéron, Pro Flacco, 27. Sur ce point, voir Bergmann, Phïlologus, t. ii, p. 644, 670-678. Réunis à la Cilicie, de 56 à 50, ces trois districts firent de nouveau partie de la province d’Asie à partir de 49. Cicéron, Ad famil., xiii, 67. Voir Bergmann, Philologus, t. ii, p. 681, 684. L’attribution des diverses parties de la Phrygie à des provinces différentes explique pourquoi saint Luc la nomme séparément dé l’Asie. Act., Il, 9 ; xvi, 6. Dans ce dernier passage des Actes, saint Luc mentionne également la Mysie et la Troade, qui faisaient partie de la province d’Asie : c’est pour marquer plus nettement les endroits par où passa saint Paul. Act., xvi, 6.
Lors du partage des provinces entre le sénat et l’empereur, en l’an 27 avant J.-C, l’Asie fut laissée au sénat et
298. — Monnaie de la province romaine d’Asie. TI CLAVD OAB8 AUG. Tête de l’empereur Claude, tournée à gauche. — Hj. COMimune] ASUse]. Temple à deux colonnes dans lequel on voit Claude debout en habit militaire, tenant une haste de la main droite et couronné par la Fortune ou la Paix, qui tient une corne d’abondance. Sur la frise on lit : ROM ET ATS. Frappée & Pergame.
fut gouvernée par un proconsul, qui était toujours l’un-des plus anciens consulaires. Elle était divisée en grandes circonscriptions, appelées conventus juridici, dans les capitales desquelles le proconsul, dont la résidence officielle était à Éphèse, se transportait pour rendre la justice. Parmi les villes nommées dans l'Écriture figurent plusieurs de ces chefs-lieux de conventus, ce sont : Éphèse, Laodicée, Pergame, Philadelphie, Sardes et Smyrne. Ces villes figuraient aussi parmi les métropoles, c’est-à-dire dans la catégorie des villes les plus importantes. Éphèse, la première d’entre elles et le véritable cheflieu de la province, prenait le titre de itptÔTj] nao-ûv xocï y.i*((<m, irptin) xaî lAE-j-t’o-rn, [t^tpéiroXiç 'Ao-faç. Les noms des sept Églises d’Asie aux évêques desquelles saint Jean adresse les lettres qui sont placées en tête de l’Apocalypse, Apoc, 1, 11, nous montrent que les villes les plus importantes de la province avaient été évangélisées au moment où fut écrit ce livre. Ils nous donnent en même temps la preuve que le mot « Asie » désigne bien la province romaine avec ses limites officielles. Ces Églises sont celles d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Sardes et de Philadelphie en Lydie, de Pergame en Mysie et de Laodicée en Phrygie. Apoc, i, 11 ; ii, 1, 8, 12, 18, 24 ; iii, 1, 7, 14.
La province d’Asie était l’une des plus riches de l’empire. Le charme de son site, l’excellence de son climat, la variété de ses productions, lui assuraient une prospérité hors pair. Sans doute elle avait beaucoup souffert des tremblements de terre qui, sous Tibère, détruisirent douze villes florissantes, entre autres Sardes ; mais la générosité privée et surtout les largesses impériales avaient relevé ces villes de leurs ruines. L’industrie et le commerce du pays avaient très vite fait disparaître les traces des désastres. Parmi les richesses du pays, il faut citer les laines de Milet, les draps de Laodicée, l’orfèvrerie d'Éphèse, les laines tissées de Philadelphie et d'Éphèse. L’activité littéraire n'était pas moins grande que l’activité industrielle. Les professeurs, les médecins, les sophistes, les rhéteurs
d’Asie étaient célèbres dans tout l’empire. Les villes d’Asie étaient réunies en confédération (fig. 298) pour la célébration du culte impérial. (Voir Asiarque.)
Bibliographie. — Bergmann, De Asia Rornanorum provincia, 1846 ; Th. Mommsen et J. Marquardt, Manuel des antiquités romaines, trad. franc., t. ix ; J. Marquardt, Organisation de l’empire romain, t. ii, p. 234-262 ; Th. Mommsen, Histoire romaine, trad. franc., t. x, p. 90 et suiv. E. Beurlier.
- ASIEL##
ASIEL (hébreu : 'Asyêl, « créé de Dieu ; » Septante : 'A<ny)X), père de Saraïa, de la tribu de Siméon. Un de ses descendants, Jéhu, vivait sous le règne d'Ézéchias. I Par., iv, 35.
- ASILE##
ASILE (DROIT D'). Voir Refuge (villes de).
- ASIMAH##
ASIMAH (hébreu -.'Âsimâ' ; Septante : 'A<ri(j, â8), idole dont les Hamathites, captifs originaires de la ville d'Émath, introduisirent le culte dans la Samarie, où les avait transplantés Sargon, roi d’Assyrie, après la destruction du royaume d’Israël et la prise de sa capitale. IV Reg., xvii, 30. Les anciens commentateurs juifs, cités par Selden, De diis Syris, 1668, t. i, p. 326-328 ; t. ii, p. 305 et suiv., lui attribuaient la forme d’un singe, d’un âne ou d’un bouc à poil ras. Mais on ne voit pas sur quelle tradition ils s’appuyaient, outre que leur désaccord n’engage guère à les suivre. L’identification proposée avec le dieu phénicien Esmoun, — le huitième des Cabires, enfants de Sadyk,
— serait géographiquement acceptable, le culte de cette divinité étant assez répandu, comme le montrent les noms propres dont il est un élément : Esmounazar, Esmounsalah, etc. ; mais les différences orthographiques sont si considérables, qu’elles paraissent s’opposer à cette identification : la chute d’un nun qui appartient cependant à la racine même du nom Esmoun, l’insertion d’un î long non pas entre le mem et le nun, mais entre le lin et le mem, etc. Cf. Schrader, Die phônizische Sprache, 1869, p. 89 et 136, où est donnée, d’après Sanchoniaton et Damascius, l'étymologie du nom d’Esmun, « le huitième. » Les incriptions cunéiformes ne nous ont non plus donné aucune lumière à ce sujet. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., t. iv, p. 174 ; Eb. Schrader -Whitehouse, The cuneiforni Inscriptions and the Old Testament, 1885, t. î, p. 276, et aussi le même Eb. Schrader, dans Riehm, Handwbrterbuck des Biblischen Altertums, 1884, t. î, p. 95. E. Paknier.
- ASIONGABER##
ASIONGABER (hébreu : 'Ésyôn Gébér ; à la pause : 'Ésyôn Gâbér, le cholem avec vav ou sans vav ; Septante : TernÙM Tàêep, Num., xxxiii, 35, 36 ; Deut., Il, 8 ; Vaaitùv Taëép, III Reg., ix, 26 ; II Par., viii, 17 ; xx, 36 ; 'A<tewm Ta$ip [Codex Alexandrinus], III Reg., xxii, 49), ville d’Idumée, à la pointe septentrionale du golfe Elanitique. Elle est mentionnée dans l'Écriture en trois circonstances.
— 1° Les Hébreux, pendant leur séjour dans le désert, campèrent à Asiongaber, venant d’Hébrona, et se rendirent de là dans le désert de Sin, à Cadès. Num., xxxiii, 35-36. Cf. Deut., ii, 8, où le campement à Asiongaber est sommairement rappelé. Quelques commentateurs supposent que les Israélites passèrent deux fois à Asiongaber : une première fois, quand ils retournèrent de cette ville à Cadès, et une seconde, celle dont il est parlé Deut., ii, 8, quand ils se dirigèrent d' Asiongaber vers les plaines de Moab. Mais il est plus probable que Moïse, dans le Deu "téronome, rappelle seulement quelques-unes des stations principales de son peuple, et passe les autres sous silence, en particulier le retour au désert de Sin. — 2° Salomon fit partir sa flotte, montée par les marins phéniciens, des ports d' Asiongaber et d’Elath, pour aller trafiquer dans le pays d’Ophir. Ces villes, conquises par David sur les Iduméens, III Reg., xi, 15-16, étaient les ports de la mer Rouge les plus proches de Jérusalem. Salomon s’y rendit
en personne pour surveiller l'équipement de ses vaisseaux. III Reg., ix, 26 ; II Par., viii, 17. C’est là que ses matelots débarquèrent, à leur retour, les richesses qu’ils apportaient d’Ophir. Ils renouvelèrent ce voyage tous les trois ans, pendant le règne du fils de David. III Reg., x, 22 ; II Par., ix, 21, — 3° Roboam ne put songer à continuer l'œuvre de son père, ayant été réduit au petit royaume de Juda ; mais, plus tard, l’un de ses successeurs, qui vivait en paix avec Israël, Josaphat, tenta sans succès d’imiter Salomon : il réussit bien, d’accord avec Ochozias, roi d’Israël, à construire une flotte à Asiongaber, pendant que l’Idumée n’avait point de roi, III Reg., xxii, 48 ; mais Dieu désapprouva par son prophète Éliézer l’alliance du roi de Juda avec le roi d’Israël, et il l’en punit en suscitant une violente tempête : elle brisa ses navires contre les rochers et les récifs de corail qui abondent à l’extrémité septentrionale du golfe d’Akaba. III Reg., xxii, 49 ; II Par., xx, 36-37. Les eaux du golfe sont généralement très claires. La hauteur de la marée au printemps est d’environ deux mètres. Les tempêtes y sont terribles, et les rochers, presque à fleur d’eau en beaucoup d’endroits, sont très dangereux, de sorte que les marins de Josaphat, sans doute peu expérimentés, furent impuissants à sauver ses vaisseaux. Ochozias, après ce désastre, proposa à Josaphat de construire une nouvelle flotte, mais le roi de Juda s’y refusa. III Reg., xxii, 50.
La situation d' Asiongaber est indiquée par l'Écriture d’une manière générale : c'était une ville iduméenne, près d'Élath, sur la mer Rouge, III Reg., IX, 26 ; II Par., vm, 17, par conséquent à l’extrémité septentrionale du golfe Elanitique ; mais parce que cette ville a complètement disparu et qu’on n’en a retrouvé jusqu’ici aucune trace, le site précis en est incertain. — On croit généralement que les deux mots dont se compose Asion-gaber sont hébreux et signifient « l'échiné de l’homme » ou du géant, par allusion à une croupe de montagne au pied de laquelle la ville était bâtie. « Son nom, dit M. Hull, Mount Seir, in-8°, Londres, 1885, p. 71, 78, lui fut donné peut-être à cause de la grande chaîne de porphyre qui, courant du nord au sud, atteint la côte à Ras el-Musry… La chaîne de granit rougeâtre à l’est de la faille est rayée par des bandes de porphyre couleur rouge foncé et de basalte, qui s’entrecroisent à un angle d’environ 60 degrés, et forment dans le roc des sections en forme de losange, de façon à avoir une certaine ressemblance avec les vertèbres de l'épine dorsale. »
D’après Chabas, Voyage d’un Égyptien au xiv siècle avant notre ère, in-4°, Paris, 1866, p. 284, Asiongaber est nommé dans le papyrus hiératique qui contient le
récit de ce voyage sous la forme ^~" j^ Il i 1,
'uzaïna, laquelle correspond au premier élément du nom hébreu 'âsyôn ; il y avait là un fort qui est mentionné dans ce passage à cause de son importance, et qui avait sans doute pour but de défendre cet endroit fréquenté par les caravanes. Voir J. Wilson, The Lands of the Bible, 2 in-8°, Edimbourg, 1847, t. î, p. 284. Il est curieux de remarquer qu’il y a encore aujourd’hui une forteresse à Élath pour protéger le golfe et la route des pèlerins de la Mecque. Le Targum de Jonathan suppose aussi que le nom d’Asiongaber signifie « fort du coq », et les géographes arabes appellent simplement la ville, comme le texte hiératique, Asioun ou Azioum. Seetzen a signalé, dans la Géographie de Mourad Machmed, le passage suivant : « Près d'Élath était une ville du nom d’Azioum, où se trouvaient beaucoup de palmiers, de fruits et de champs cultivés. » U. J. Seetzen, Beytràge zur Kenntniss von Arabien, dans F. von Zach, Monatliche Correspondenz, zur Befôrderung der Erdund Himmels-Kunde, t. xx, octobre 1809, p. 306. Makrizi dit également : « Près d’Aila était autrefois située une grande et belle ville appelée 'Asyûn i AJ^s.) » Voir J. L. Burckhardt, Travels in Syria, in-4°, Londres, 1822, p. 511.
Le nom de^j^juafi, 'Asyûn, que les géographes arabes donnent à Asiongaber, est le même que celui du papyrus hiératique, le même que l’hébreu 'Ésyôn. Celui que nous ont conservé Eusèbe et saint Jérôme, De loc. heb., t. xxiii, col. 876, c’est-à-dire Aisia ou Essia, rappelle également 'Ésyôn. On croit même le reconnaître dans Ad Dianam, forme altérée d’une localité ainsi désignée dans la Table de Peutinger, sur la route romaine entre Élath et Rasa, à dix ou seize milles romains d'Élath.
L.THaiKer.aeif
[[File: [Image à insérer]|300px]]
299. — Carte du golfe Élanitique.
D’après plusieurs savants, les traces de cette dénomination antique ne sont même pas complètement perdues sur place. « Le souvenir du nom subsiste encore aujourd’hui, disent Ebers et Guthe, Palâstina, t. ii, p. 251, dans celui d’une source d’eau saumâtre appelée 'Aïn el-Ghudyân, à seize kilomètres et demi au nord du rivage actuel de la mer ; mais de la ville même on n’a retrouvé aucune trace. y> Voir aussi E. Robinson, Biblical Researches, Boston, 1841, t. i, p. 250-251. Le nom de Ghudyân, en arabe, correspond par les consonnes à celui de 'Ésiôn. La petite vallée où se trouve cette source porte aussi le nom d’ouadi Ghudyân et vient de l’Arabah à l’est ; " mais, quoique la mer se soit retirée à l’extrémité nord du golfe d’Akabah, et qu’il y ait là aujourd’hui des marais, on ne peut guère supposer que la ville d' Asiongaber et son port étaient aussi loin de la côte actuelle. On ne sait pas même si la ville était sur la rive orientale ou sur la rive occidentale du golfe. M. Hull, Mount Seir, p. 78, suppose qu' Asiongaber et Élath, l’Akabah actuelle, n'étaient pas du même côté, mais vis-à-vis l’une de l’autre, sur les deux rives opposées, à peu près comme Messine et Reggio. H n'émet d’ailleurs aucune opinion sur la position d’Asiongaber. Josèphe, Ant. jud., VIII, vi, 14, paraît la placer sur la rive orientale ; il dit que, de son temps, Asiongaber ('A<roioYÔëapoç) s’appelait Bérénice et était tout près d'Élath.
On croit généralement que l’historien juif s’est trompé, et qu’il a confondu avec l’ancien port iduméenune ville qui se trouvait bien sur la côte de Nubie, mais qui n'était pas voisine d'Élath. Voir sur Bérénice et ses ruines, Wellsted, Travels in Arabia, 2 in-8°, Londres, 1838, t. ii, p. 332-346.
Parmi les savants modernes, Pococke, Montaigu, Shaw, A. Fr. Bûsching, Erdbeschreibung, Th. xi, part, i, in-8°, Hambourg, 1792, p. 619-621, placent Asiongaber à l’ouest,
au port de Scherm (^yw), ou, comme l’appelle Bûsching, Sbarme. Scherm est entouré de hantes falaises et situé sur la côte occidentale du golfe, prés de son extrémité méridionale. Cette position est certainement beaucoup trop au sud. J. B. Wellsted, Travels in Arabia, t. ii, p. 153-155, la place un peu moins bas, à Dahab (Mersa Dahab, « le port d’or » ), aussi sur la rive occidentale du golfe, à peu près en face du mont Sinaï qui est à gauche, et de la ville de Magnah qui est à droite, de l’autre côté du golfe ; c’est là que se trouve, d’après lui, le seul bon port de cette mer, et comme il est entouré d’une ceinture demi-circulaire de bancs de coraux, il suppose que c’est contre ces récifsque se brisa la flotte de Josaphat. III Reg., xxii, 49. Mais la situation de Dahab est trop éloignée d’Akabah, l’antique Élath, près de laquelle se trouvait Asiongaber, d’après III Reg., ix, 26 ; II Par., vin, 17 ; les vaisseaux de Salomon ne pouvaient s’arrêter ainsi à mi-chemin sur la côte, et débarquer leurs marchandises loin d'Élath, lorsqu’il leur était possible de les amener à un point plus rapproché de la Palestine. Aussi place-t-on communément Asiongaber plus au nord et près de la pointe du golfe. Voir la carte, fig. 299.
Une des opinions qui ont rallié le plus de partisans est celle de Schubert et de Léon de Laborde. Schubert, Reise in das Morgenland, 3 in - 8°, Erlangen, 1839, t. ir, p. 377-379, ainsi que L. de Laborde, Commentaire géographique sur l’Exode, in-f°, Paris, 1841, p. 124, croient qu' Asiongaber était située ou dans l’Ile ou vis-à-vis de l'île de Djézirat Pharaoun ou Kureiyéh, rocher de 270 mètres de long, appelé Abu Sanira Unda el-Galga par les Bédouins qui accompagnaient Schubert, Graie par L. de Laborde, Gouriah par Elisée Beclus, Èmrag par d’autres voyageurs. Voir E. Riippell, JReisen in Nubien, in-8°, Francfort-sur-le-Mein, 1829, p. 253. Voici les raisons qu’apporte L. de Laborde en faveur de son sentiment : « Élath, Asiongaber et le mont Séir, paraissent comme trois points voisins, qui tiennent les uns aux autres, dans le plus ancien document où ces trois noms se trouvent mentionnés. Deut., ii, 8. Le mont Séir doit s’entendre de toute la montagne des Édomites. Gen., xxxvi, 9. C’est le Djebel Scherra, qui s'étend depuis l’ouadi Gétoun jusqu’aux anciennes possessions des Moabites. À coté de cette montagne s'élevaient donc deux villes qui ne pouvaient être que très voisines, puisque le chemin de la mer Rouge, que nous avons reconnu être l’ouadi Araba, est en même temps appelé le chemin d'Élath et d’Asiongaber. Deut., il, 8. Nous savons… qu'Élath, dont le nom s’est conservé dans Ailah, se retrouve aujourd’hui dans Akabah, et que cette ville est située sur le bord de la mer, à l’extrémité septentrionale du golfe de l’Akabah. Nous avons donc une position qui nous est connue et une autre position qu’il faut chercher, sans qu’il nous soit permis de nous éloigner d’un voisinage très rapproché. Il n’y a pas assez d’espace dans l’extrémité du golfe pour placer deux villes, deux ports de mer, deux industries rivales. Ailah y a conservé ses ruines ; cherchons plus loin Asiongaber… Au nord de" l'île de Graie et du golfe où les vaisseaux trouvent un abri contre les vents, on rencontre des ruines qui s'étendent en forme d’enceinte et de buttes de décombres. Il y a de l’eau, des palmiers, des acacias et une plaine qu’une industrie persévérante peut avoir cultivée (fig. 300). Je vois là cet Azioum [dés géographes arabes] qui répond à la partie d’Asiongaber située sur la côte, un faubourg
d’approvisionnement de l'île [qui était Asiongaber] et dû port. Ce port est bien protégé contre les vents d’ouest et du nord. L’Ile le défend contre ceux de l’est… Dans les expéditions maritimes [de Salomon], Asiongaber ressort comme le point important, tandis qu’Ailah ne semble pas avoir été utilisée dans cette entreprise. Plus tard, cette dernière ville n’est même plus citée ; Asiongaber est seule indiquée comme l’endroit où se construisent les vaisseaux qui doivent naviguer sur la mer. [Le récit de la destruction de la flotte de Josaphat] peut nous servir à mieux déterminer la nature du lieu. D laisse supposer un abri
cependant d’une certaine probabilité. Elle est, en tout cas, plus acceptable que celle de Kneucker (SchenkeVs BibelLexicon, t. ii, p. 256 ; voir aussi G. Bénédite, La péninsule sinaïtique, in-12, Paris, 1891, p. 736 ter). Kneucker suppose qu' Asiongaber avait un seul et même port avec Élath et était située au sud de cette dernière ville, sur la rive orientale, près de l’emplacement du fort actuel d’Akabah (Qala’at el-Akaba). Pourquoi l'écrivain sacré aurait-il dit que les marins de Salomon partaient d’Asiongaber, si Élath était plus rapprochée de la Palestine ? L’opinion de M. Elisée Reclus n’est pas mieux établie : il con 300. — Vue de l'île de Graie pu Djézlrat Pharaoun.
pour les vaisseaux qui n’offre pas toute sûreté, qui devient même dangereux sous l’influence de certaine direction du" vent, puisque les vaisseaux se brisent sur sa côte hérissée de rochers. Tout ici convient encore à l'île de Graie et à la position de l’Azioum des Arabes, où des caravanes nombreuses et armées déposaient les matériaux de construction et les marchandises précieuses, qui, une fois transportés dans l’Ile, étaient, les uns transformés en vaisseaux, les autres mises en magasin ou à l’abri des peuplades environnantes, dont il eût été difficile autrement que par l’isolement de contenir longtemps l’avidité. Les vaisseaux, une fois construits, étaient amarrés à l'île et tenus au large par des ancres. Ils étaient à l’abri, par l'élévation du rocher, du vent de nord-est et de nord-nord-est, qui règne presque toute l’année et souffle avec violence dans ce golfe. Mais un changement subit au sud-ouest ou au nordouest portait les vaisseaux sur l'île et les brisait contre les rochers. » L. de Laborde, Comment, géograph. sur l’Exode, p. 126-127.
Cette opinion, sans être certaine, surtout dans le rôle attribué à l'île de Djézirat Pharaoun, et parce qu’elle place Asiongaber un peu bas au sud, ne manque pas
sidère Asiongaber simplement comme le port d'Élath. Nouvelle géographie universelle, t. ix, 1884, p. 823. H. Ewald l’avait déjà fait avant lui, Geschichte des Volkes Israël, 2e édit., t. m (1853), p. 77 ; mais cette explication paraît peu d’accord avec le texte biblique, qui semble bien faire d' Asiongaber une ville comme Élath. — Quant au sentiment de d’Anville, qui avait résolu la difficulté, Mémoire sur le pays d’Ophir, dans les Mémoires de l’Académie des inscriptions, t. xxx, 1764, p. 91 (carte, vis-à-vis la p. 87), en supposant que le golfe d’Akabah avait deux pointes, à l’extrémité desquelles se trouvaient, d’un côté Élath, et de l’autre Asiongaber, elle n’a plus un seul partisan, parce que ces deux pointes n’ont jamais existé. — Voir Ritter, Erdkunde, t. xiv, p. 227-230.
F. Vigouroux. ASIR, hébreu : 'Assîr, i> captif ; » Septante : 'Aoetp, 'A<Tri p.
1. ASIR, fils de Jéchonias, dernier roi de Juda. I Par., m, 17. L’existence de cet Asir est problématique, car on peut traduire ainsi le texte hébreu : « Les fils de Jéchonias captif [à Babylone] furent Salathiel, etc. » ; au lieu de : « Les fils de Jéchonias furent Asir, Salathiel, etc. »
.2. ASIR, fils de Coré, de la tribu de Lévi. I Par., vi, 22 (dans l’hébreu, vi, 7). Il est nommé Aser, Exod., vi, 24. Voir Aser 2.
3. ASIR, fils d’Abiasaph, des fils de Caath, arrièrepetit-fils d’Asir 2. I Par., vi, 23, 37.
- ASLAC Conrad##
ASLAC Conrad, théologien luthérien, né le 28 juin 1564, à Bergen, en Norvège, mort le 7 février 1624, professeur à l’université de Copenhague. Parmi les écrits qu’il a laissés, on peut citer comme se rapportant à l'Écriture Sainte : 1° Physica et Ethica Mosaïca ex tribus capitibus prioribus Geneseos, in-S", Copenhague, 1602 ; 2° DeCreatione disputationes très, in-4°, 1607rl612 ; 3° Grwmmaticse hebraicse libri duo, in-8°, Copenhague, 1606 ; 4° Thèses théologien de Sacrx Scripturse perfectione, traditionibus non scriptis, in-4°, Copenhague, 1607 ; 5° Disputationes de Sacra Scriplura et Dei cognitione, in-i°, Copenhague, 1607. On mentionne encore de lui un commentaire sur l’Exode, resté manuscrit. G. Legeay.
- ASLIÂ##
ASLIÂ (hébreu : 'Âsalyâhu, a Jéhovah réserve ; » Septante : 'EÇeiîaç, 'EdeMa ; ), père de Saphan, le scribe, sous le règne de Josias. IV Reg., xxii, 3. Dans la Vulgate, II Par., xxxiv, 8, il est appelé Ésélias.
'. ASMODÉE ('A(j(ioSaîoç ; rabbinique : Esmadaï, de l’hébreu sâmad, a. celui qui perd » ) est le nom du démon qui, d’après le livre de Tobie, iii, 8 ; cf. vi, 14, avait mis à mort les sept époux donnés successivement à Sara, fille de Raguel. Ses maléfices ayant été déjoués en faveur du jeune Tobie, par l’intervention de l’archange Raphaël, Tob., vi, 5, 8, 19, Asmodée fut relégué dans le désert de l’Egypte supérieure, Tob., viii, 3. Cette relégation, d’après l’interprétation de la plupart des commentateurs, veut dire simplement qu' Asmodée fut éloigné et mis dans l’impossibilité de nuire à Tobie.
; Voilà ce que la Bible nous apprend de ce démon. Les
traditions juives ont singulièrement amplifié et altéré ces données. Les kabbalistes en particulier ont inventé la généalogie suivante. D’après Rabbi Bechaya, dans son explication du Pentateuque (traité Bereschith), le démon Sammæl eut quatre femmes : Lilith, Naamah, Agrath et Machlat. Or, s’il faut en croire Menachem Ziuni ( édit. de Crémone, 1559, p. 14 b), Naamah fut la mère d’Eschmadai. La même tradition est rapportée par Menachem Recanat dans. son interprétation du Pentateuque (édit. de Venise, 1560, p. 33 c). Toutefois Kohut a justement remarqué ( Ueber die jûdische Angelologie und Dàmonologie in ihrer Abhàngigkeit vom Parsismus, p. 95) que ces fantaisies généalogiques sur Eschmadai ne se trouvent pas dans les anciens hagadas ; il pense pourtant qu’elles proviennent de traditions populaires.
Quant au caractère d' Asmodée, les détails suivants, fournis par le Talmud, en esquissent les principaux traits. 1° Il est un roi de démons (Talmud, tr. Gîtin, p. 68 b ; Pesakhim, p. 110 ; Targum Koheleth, i, 13). — 2° Il connaît l’avenir. À preuve les anecdotes rapportées par le Talmud. Asmodée, ayant rencontré un aveugle et un ivrogne, les remet tous deux sur le droit chemin. Il se met à pleurer à la vue d’une noce qui passe ; mais, en entendant demander par quelqu’un une paire de souliers qui doit durer sept ans, et en voyant un magicien faire ses tours de prestidigitation, il éclate de rire. Interrogé sur ces diverses actions, il répond que l’aveugle est un homme pieux, l’ivrogne un scélérat ; que la mariée doit mourir dans trente jours, que celui qui demandait des souliers pour sept ans avait encore sept jours à vivre, et que le magicien ignorait qu’il foulait aux pieds un trésor royal. — 3° Asmodée est lui-même un grand magicien, comme le montre l’histoire rapportée par Lightfoot, Horse hebraicse et talmudicæ, p. 703. — 4° Il est le démon de la colère. Le Talmud, loc. cit., raconte que dans sa rage
il déracine un arbre et renverse une maison, et quand il s’empara de Salomon, il le traîna avec fureur pendant l’espace de quatre cents parasanges. — 5° Il est le démon de la luxure, des unions coupables (cf. Pesakhim, 110 a).
La principale question relative à Asmodée est celle de son origine. Bon nombre d’auteurs n’hésitent point à admettre ici un emprunt fait par la Bible à la doctrine de Zoroastre. Voir Benfey, Monatsnamen, p. 201 ; Windischmann, Zoroastrische Studien, p. 138-147 ; Michel Bréal, Mélanges de linguistique et de mythologie comparée, p. 123 ; Kohut, Jûdische Angelologie, p. 72-80. Il suffira de citer M. Bréal pour voir dans quel esprit on fait ces rapprochements. « Le livre de Tobie, dit-il, contient des traces évidentes de la démonologie iranienne. Asmodée, ce mauvais esprit qui aime Sara, fille de Raguel, et tue successivement sept hommes qui lui sont donnés en mariage, appartient à la Perse par son rôle comme par son nom. C’est Aêshma daêva (en parsi : Eshemdev), c’est-à-dire le démon de la concupiscence, une sorte de Cupidon, plusieurs fois nommé dans l’Avesta comme le plus dangereux de tous les devs (démons). »
Sans doute, au premier abord, l’identité philologique de Aêshma daêva avec Eëmadai, 'A<j[to8aïoç, paraît bien séduisante. Pourtant, rien de moins certain. Il faut d’abord observer que Aêshma daêva, sous cette forme complète, est une création de fantaisie. Dans tout l’Avesta, on ne rencontre que Aêshma. Si, dans le Bùndehesh, xxviii, 15, le pehlvi fournit Aêshmshêdâ, qui suppose une forma avestique Aêshmadaêva, et qui, d’après la théorie des. idéogrammes pehlvis, pourrait se prononcer Aéshmdêv, il faut observer que l’histoire de Tobie est de plusieurs siècles antérieure à tous les livres pehlvis. Du reste, Ms p de Harlez, dans La Controverse, 16 décembre 1881, p. 722, fait justement observer que l’iranien daêva n’aurait pu devenir dai en hébreu. Kohut lui-même, favorable pourtant à l’identité, admet cette impossibilité, ouvr. cit., p. 75, 76.
Mais il y a bien davantage qu’une difficulté philologique pour nier le rapprochement d"A<T[to8aîoç, Esmadai, avec VAêshma avestique : il y a la complète divergence du rôle des deux personnages dans la Bible et dans l’Avesta. Asmodée est le démon de la concupiscence, mais « Aêshma, dit Msf r de Harlez, ouvr. cit., n’est nullement le démon de la concupiscence, encore moins une sorte de Cupidon ; nous pourrions dire qu’il en est l’opposé. Aêshma, dans toute la littérature mazdéenne, tant ancienne que moderne, est partout et toujours le déva de la violence, de la colère. Son nom, comme substantif commun, signifie violence, attaque injuste et cruelle. Neriosengh le traduit kopa déva, « le déva de la colère. » Son attribut principal est une lance sanglante, khrvidru. Jamais Aêshma, jamais déva même n’eût aimé une femme. » L’Asmodée du livre de Tobie n’est donc pas emprunté à la mythologie iranienne. D’ailleurs, même en supposant que le nom d’Asmodée fût identique dans la Bible et dansl’Avesta, on n’aurait pas le droit de conclure que la démonologie juive est d’origine iranienne. Ce ne serait pas la seule fois qu’on aurait appliqué des noms étrangersà des concepts déjà connus. — Sur les moyens qu’emploie le jeune Tobie, d’après le conseil de l’ange, pour chasser Asmodée, voir Raphaël. J. Van den Gheyn.
- ASMONÉENS##
ASMONÉENS, nom donné à la famille des Machabées, qui affranchit la Judée de la domination des rois de SyrieVoir Machabées 1.
- ASNAA##
ASNAA (hébreu : Hassenâ'âh, « l'épineuse ; » Septante : 'A<jav « ). Les fils d’Asnaa, après la captivité, construisirent la porte des Poissons, au nord de la ville. II Esdr., iii, 3. La terminaison semble indiquer un nom de ville plutôt qu’un nom d’homme, la ville de Sénaa, dont le nom est précédé de l’article ha. Cf. I Esdr., ii, 35 ; II Esdr., vii, 38. Voir Sénaa.
ASOM, hébreu : 'Osém, « valide [?] ; » Septante : 'Aaôy., 'Ao-iv. Nom d’homme.
1. ASOM, sixième fils d’Isaï, le père du roi David. I Par., ii, 15.
2. ASOM, fils de Jéraméel, de la postérité de Juda. I Par., Il, 25.
3. ASOM (hébreu : 'Asém), nom, dans la Vulgate, I Par., iv, 29, de la ville appelée Asem, Jos., xix, 3. Voir Asem.
ASOR, hébreu : Hâsôr ; Septante : 'Ao-wp, nom de plusieurs villes de Palestine. Il se rattache à la racine inusitée Hdsar, « entourer, » d’où Hâsêr, état construit Hàsar, « lieu entouré de clôtures, » qui se retrouve dans Asergadda, Hasersual, etc. Voir ces mots et Haséroth. Il s’est conservé, sous les formes Hazîréh, Hazûr, Hûzzûr, dans plusieurs localités actuelles, qui ne répondent pas toujours pour cela à l’une des cités bibliques. Il entre aussi dans la composition de certains noms comme Baal-Hazor, Enhasor.
1. ASOR (hébreu : Hàsôr ; Septante : 'Acwp, partout, excepté III Reg., ix, 15, où on lit 'Eoip ; c’est probablement aussi T’Ao-Yip du texte grec de Tobie, i, 2 ; Na<rwp de I Machabées, xi, 67, est une faute due à la répétition de la dernière lettre du mot précédent, iteSfov ; Vulgate : Asor, Jud., iv, 2, 17 ; Hasor, I Reg., xii, 9 ; Héser, III Reg., ix, 15), ville royale chananéenne, Jos., xi, 1 ; xii, 19, qui tenait le premier rang parmi les cités du nord et fut enlevée à Jabin par Josué, XI, îO. Elle fut assignée à la tribu de Nephthali. Jos., xix, 36. Comme les autres places fortes de ce pays, elle était bâtie sur une hauteur (hébreu : tel ; arabe : tell), et était défendue par de puissantes murailles. Jos., XI, 13. Elle devait dominer une plaine propre aux manœuvres des nombreux chariots qui constituaient la principale force du roi et de ses alliés. Jos., xi, 4, 6, 9 ; Jud., iv, 3. Mentionnée avec Madon (Khirbet Madîn [?]), Sémeron et Achsaph (Kefr Yasif) dans deux passages, Jos., xi, 1 ; xii, 19, 20, elle est placée entre Arama (ErRaméh) et Cédés (Qadès).dans l'énumération des villes de Nephthali. Jos., xix, 36, 37. D’après le récit de I Mach., xi, 63-74, elle devait certainement se trouver entre le lac de Génésareth et Cadès. Enfin Josèphe, Ant. jud., V, v, 1, ajoute un détail important en nous apprenant qu’elle était située au-dessus du lac Séméchonitis ou de Mérom, aOtr, 8'ÛTOpy.siTat xri Ss(jle^(i)vit150 ; Xi[ivr|ç. Voir la carte de la tribu de Nephthali. Elle fait partie des Listes de Thout mès III, n° 32, sous la forme Huzar, __ k..,
dont les consonnes répondent bien à l’hébreu l’an.
Cf. A. Mariette, Les listes géographiques des pylônes de Karnak, Leipzig, 1875, p. 23 ; E. de Rougé, Etude sur divers monuments du règne de Thoutmès III, dans la Revue archéologique, Paris, 1861, p. 361 ; G. Maspéro, Sur les noms géographiques de la Liste de Thoutmès III qu’onpeut rapporter à la Galilée, extrait des Transactions of the Victoria Inslitute, or philosophical Society of Great Britain, 1886, p. 5.
I. Identification. — Tels sont les renseignements qui doivent nous guider dans la recherche de l’emplacement d’Asor. Plusieurs auteurs se sont égarés pour avoir négligé les détails les plus importants de cet ensemble, ou pour s'être trop appuyés sur l’onomastique seule. C. Ritter, The comparative geography of Palestine and the Sinaitic Peninsula, 4 in-8°, Edimbourg, 1866, t. ii, p. 221-225, s’applique à prouver par de nombreux arguments que la cité chananéenne est représentée par les ruines actuelles i’Hazuri, à l’est du lac Mérom et du Jourdain, au nordest de Banias, l’ancienne Césarée de Philippe. Tel est aussi le sentiment de Stanley, Sinai and Palestine, in-8°,
Londres, 1866, p. 391, 397. La similitude des noms les â trompés. Robinson, Biblical Researches in Palestine, Londres, 1856, 3 in-8°, t. iii, p. 402, combat justement cette opinion, en faisant remarquer qu’il y n’a là que des ruines insignifiantes. Nous ajouterons qu’elle est en opposition formelle avec les textes de Josué, xix, 36, 37, de I Machabées, XI, 63 -74, et de Josèphe, comme nous le verrons plus loin.
M. de Saulcy crut avoir retrouvé Asor au nord de VArdh el-Houléh, dans un site qu’il appelle ElKhan ( « caravansérail » ou espèce d’hôtellerie), près du village " d’Ez-Zouk ou Es-Souq. Là d'énormes murailles cyclopéennes seraient, d’après lui, les vestiges de la vieille cité de Jabin. Cf. Voyage autour de la mer Morte, 2 in-8°, Paris, 1853, t. ii, p. 533-542 ; Dictionnaire des antiquités bibliques, in-4°, Paris, 1859, col. 347-353. Le savant voyageur s’est ici, comme en plusieurs circonstances, laissé séduire par son imagination. H veut parler sans doute des ruines des deux villages de Khân ez-Zouk el-Fôkani et Khân ez-Zouk et-Tahtani, et surtout de la longue chaîne de monticules volcaniques qui s'étend un peu plus loin vers le sud v l’espace de deux kilomètres au moins. Or M. V. Guérin, qui à deux reprises différentes a visité cet endroit, résume ainsi son impression : « Un peu plus au sud [du premier village], d'énormes blocs basaltiques offrent de loin l’apparence d’assises gigantesques placées par la main de l’homme le long de l’Oued Derdara, comme pour en fortifier la rive orientale ; mais, en m’approchant de plus près, je m’aperçois que ces roches ont été disposées ainsi par la nature, et qu’elles simulent seulement des assises factices. » Description de la Palestine, Galilée, t. ii, p. 351. Après un nouvel examen de la chaîne volcanique, le même auteur ajoute : * Je me convaincs, en la.parcourant tout entière et en suivant avec attention le plateau étroit et mamelonné qui la couronne, que les énormes blocs basaltiques qui la couvrent confusément d’un bout à l’autre ont été déposés là par la nature, et ne sont pas les restes désagrégés et entassés pèle - mêle de constructions antiques. ». Galilée, t. ii, p. 534. En dehors de cela même, le site proposé par M. de Saulcy, tout en se rapprochant de l’emplacement le plus probable, ne répond pas avec une complète exactitude aux données bibliques. J. L. Porter, Five years in Damascus, 2 in-8°, Londres, 1855, t. i, p. 304, place Asor dans les mêmes parages.
Van de Velde, Memoir to accompany the Map of the Holy Land, in-8°, 1859, p. 318-319, distingue la ville chananéenne de Josué, xi, 1 ; xil, 19, de celle qui est mentionnée au livre des Juges, iv, 2, 17. Celle-ci aurait été bâtie, après la destruction de la première, sur un emplacement différent, et se retrouverait, d’après lui, à Hazûr (ou plutôt Hazîréh), village situé au centre de l’ancienne Galilée des nations, environ deux heures à l’ouest de BintDjéheil ; de plus, elle serait identique avec Enhasor de Nephthali. Jos., xix, 37. Quant à l' Asor de Josué, xix, 36, il la place à Tell Hazûr, au sud-est d ? Er-Raméh (Arama). Si nous admettons volontiers l’identification d’Enhasor avec Hazîréh, nous ne voyons aucune raison pour assigner aux deux rois du nom de Jabin deux villes différentes, la première ayant dû se relever promptement de ses ruines, comme nous le disons plus loin. Il n’y a pas plus de motif pour distinguer l’Asor de Josué, xix, 36, de la cité royale, et l’assimiler à Tell Hazûr nous paraît impossible. Malgré l’identité complète du nom, il suffit de faire valoir, avec Robinson, Biblical Researches, t. iii, p. 81, les difficultés suivantes : Péloignement du lac Houléh ; l’absence de ruines anciennes et importantes ; nulle trace même sur la colline de fortifications ou de constructions. Vojr aussi V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 458. Hazîréh, proposée par W. M. Thomson, The Land and the Book, in-8°, Londres, 1890, p. 285, ne s’adapte pas mieux aux indications que nous ont laissées l'Écriture et Josèphe.
Le choix nous reste maintenant entre deux opinions, soutenues par deux auteurs également compétents, an
puyées en somme sur les mêmes raisons, différant seulement en quelques points. Pour Robinson, Biblical Research.es, t. iii, p. 365-386, il faut chercher Asor à Tell Khuréibéh, colline élevée, qui se trouve juste à l’ouest et non loin du lac Houléh, et un peu au sud de Qadès. Pour V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 363-368, on doit plutôt la reconnaître à Tell el-Harr août ou Harraouéh (Harrah dans la grande carte anglaise, Londres, 1890, feuille 6), éminence située à une heure et au nord-est de la première, plus rapprochée du lac. Les arguments peuvent se résumer ainsi : — 1° Jabin, roi d’Asor, voulant s’opposer à la conquête de Josué, rassemble son armée et celle des princes, ses alliés, « près des Eaux de Mérom, » Jos., xi, 5, ce qui sup pose la capitale peu éloignée du champ de bataille. Josèphe, Ant. jud., V, i, 18, raconte le même combat comme ayant été livré près de la ville de Bérotha, dans la haute Galilée, non loin de Qadès. — 2° Dans rénumération des villes fortifiées de Nephthali, Josué, allant du sud au nord, la mentionne entre Arama (Er-Raméh) et Cédés (Qadès), ce qui la place au-dessous de cette dernière. Jos., xrx, 35-39. Citée dans un ordre inverse parmi les villes qui tombèrent aux mains de Téglathphalasar, roi d’Assyrie, c’est-à-dire Aïon (Tell Dibbin), Abel-Beth-Maacha (Abil el-Kamh), Janoé (Yanouh) et Cédés (Qadès), elle retrouve la même situation. — 3° Le passage le plus précieux pour fixer le site d’Asor est celui de I Mach., XI, 63-74. Les généraux de Démétrius sont à Cadès avec une puissante armée. Jonathas vient camper pendant la nuit « près des eaux de Génésar », c’est-à-dire près du lac de Tibériade, et le lendemain, avant le jour, il arrive « dans la plaine d’Asor », où il rencontre les troupes ennemies. Ses soldats, surpris par une embuscade placée dans les montagnes qui bordent la plaine vers l’ouest, sont d’abord en proie à une telle panique, qu’ils prennent la fuitesmais, à la vue de Jonathas combattant intrépidement avec quelques hommes, ils reviennent à la charge et poursuivent leurs adversaires jusqu'à leur camp de Cadès. De ce témoignage, confirmé par le récit analogue de Josèphe, Ant. jud., XIII, v, 7, il résulte que la plaine d’Asor, située très probablement au pied de la ville de ce nom, qui, comme la plupart des cités fortes d’alors, devait être placée sur une hauteur, se trouvait entre le lac de Génésareth au sud et la ville de Cadès au nord, et non loin des deux, puisque Jonathas, parti des rives du lac, arrive dans la plaine avant le lever de l’aurore, et poursuit l’ennemi jusqu'à son camp de Cadès. Les deux sites proposés répondent également bien à ces données du texte sacré. — 4° Enfin Josèphe, dans un endroit, Ant. jud., IX, XI, , mentionne Asor, "A<7<opa, à côté de Cadès, Kv8î<r « , et, dans un autre, V, v, 1, la place au-dessus du lac Séméchonitis. Sous ce dernier rapport, l’opinion de V. Guérin semble prévaloir, car Tell el-Harraoui est plus rapproché du lac Mérom.
IL Description. — La hauteur dite Djebel el-Harraoui est couronnée par un sommet oblong, « qui constitue une plate-forme inégale, longue de cent douze pas du nord au sud, sur vingtcinq pas de large vers le nord, cinquante vers le centre et quarante vers le sud. Une puissante enceinte environne ce tell. Aux trois quarts renversée, elle était flanquée de plusieurs tours carrées, construites, comme la muraille elle-même, avec de gros blocs plus ou moins bien équarris et reposant sans ciment les uns audessus des autres. Au dedans, et principalement vers le sud-est, on distingue les arasements de plusieurs constructions importantes, bâties avec des blocs polygonaux. Un certain nombre de citernes creusées dans le roc, particulièrement sous les tours, sont ou intactes ou à moitié comblées. Des sycomores et des térébinthes ont pris çà et là racine au milieu des ruines. La ville dont cette forteresse formait l’acropole s'étendait au-dessous, vers l’est, sur plusieurs terrasses successives. Bouleversée de fond en comble, elle n’est plus parcourue que par de pauvres bergers, qui promènent leurs troupeaux sur ces débris solitaires. Des herbes sauvages, des broussailles et des
chardons gigantesques, entremêlés de caroubiers, de térébinthes et de chênes verts, croissent partout sur l’emplacement qu’occupaient jadis des maisons et quelques édifices publics. La ville paraît avoir été détruite dès l’antiquité elle-même, car rien n’y atteste des réédifications modernes, et tout, au contraire, y porte la trace des âges les plus reculés, notamment l’appareil polygonal des blocs employés et l’absence de ciment. » V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 363-364.
Le Tell el-Khuréibéh, « colline des ruines, » se trouve à une heure vers le sud-ouest, s Le plateau supérieur de cette colline est environné d’un mur épais à gros blocs à peine taillés et dont quelques assises sont encore debout. Au dedans de cette enceinte oblongue, qui s'étend de l’ouest à l’est, gisent les débris de nombreuses petites maisons bâties en pierres sèches et d’apparence arabe ; elles avaient succédé à d’autres plus anciennes, dont il subsiste encore un certain nombre de citernes creusées dans le roc. Vers le nord principalement, les flancs de la colline sont soutenus d'étage en étage par plusieurs gros murs d’appui. Au milieu de l’une de ces plates-formes artificielles, on avait pratiqué sur une surface aplanie trois belles cuves sépulcrales, parallèles et contiguës. » V. Guérin, Galilée, t. ii, p. 368-369. Le même savant explorateur fait remarquer que les ruines du Tell elKhuréibéh sont moins importantes et moins étendues que celles du Tell el-Harraoui, ce qui, ajouté à la distance du lac Mérom, lui fait préférer cette dernière colline comme site d’Asor. D’après les auteurs anglais, G. Armstrong, W. Wiison et Conder, Names and places in the Old and New Testament, in-8°, Londres, 1889, p. 83, le nom d’Hazor survit encore dans le Djebel Hadîréh, situé un peu au sud-ouest des deux localités que nous venons de décrire.
III. Histoire. — À l’entrée des Israélites dans la Terre Promise, Asor était la plus importante des cités du nord, et la capitale du roi Jabin. Aussi est-ce dans ses environs, non loin de ses puissantes murailles, qu'à la voix de celui-ci se rassemblèrent tous les princes de la contrée, pour opposer une barrière à la conquête de Josué. Après les avoir mis en déroute et poursuivis jusqu'à Sidon, le chef du peuple hébreu revint sur ses pas, frappa du glaive le roi et les habitants et réduisit la ville en cendres. Jos., xi, 1-13. Elle ne tarda sans doute pas à se relever de ses ruines ; ce qui du reste n’a rien d’invraisemblable, car, dans ces temps-là, une fois le vainqueur parti, on s’empressait de reconstruire les cités détruites, comme le témoignent les inscriptions assyriennes, sans parler des récits bibliques. Cf. F. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., Paris, 1889, t. iii, p. 281, notel. Cent cinquante ans plus tard, un des descendants de Jabin, portant le même nom, et comme lui habitant Asor, était, comme lui aussi, à la tête des Chananéens, qui avaient eu le temps de réparer leur défaite et de retrouver leurs forces. Pendant vingt ans, il soumit les Hébreux du nord à un dur tribut, sans qu’ils cherchassent à secouer le joug, n’osant se mesurer avec les terribles chariots de fer que conduisait Sisara, son général ou roi vassal. Débora et Barac mirent fin à l’oppression par la victoire remportée dans la plaine d’Esdrelon. Jud., iv.
Nous devons, à propos de ce dernier épisode, répondre à une objection de Keil, Josua, Richter und Rulh, Leipzig, 1874, p. 90, tendant à prouver qu’Asor ne pouvait être dans le voisinage immédiat de Cadès, parce qu’alors Barac n’aurait pas pu rassembler son armée dans cette dernière ville, sous les yeux de Jabin, ni la conduire de là, c’est-à-dire des portes d’Asor, à la montagne du Thabor. Nous ferons simplement remarquer le plan de bataille, si admirablement inspiré. Débora et Barac se rendirent à Cadès, et là firent appel au patriotisme des Hébreux, en les prévenant secrètement du projet qu’ils méditaient. Les hommes de bonne volonté se rendirent, chacun de leur côté, en évitant les villes chananéennes, au lieu aoo
ASOR DE NEPHTHALI — ASOR EN ARABIE
1110
du rendez-vous. Le rassemblement des troupes israélites se fit donc silencieusement et sans éveiller les soupçons de l’ennemi. Cf. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, t. iii, p. 286, 289.
Salomon la fortifia en même temps que Mageddo et Gazer. 1Il Reg., ix, 15. Mageddo commandait la grande plaine d’Esdrelon, champ de bataille célèbre à toutes les époques de l’histoire ; Gazer commandait la route de Jérusalem et la Séphéla. Asor avait donc dans le nord une égale importance stratégique. Aussi le roi d’Assyrie Téglathphalasar s’en empara-t-il comme des autres places fortes de la contrée. IV Reg., xv, 29. Enfin nous avons vu comment elle fut témoin de la victoire de Jonathas sur les généraux de Démétrius. I Mach., xi, 63-74.
2. ASOR (Septante : 'Aaopmva.lv), ville de la tribu de Juda. Jos., xv, 23. Elle fait partie du premier groupe, comprenant les villes de l’extrémité méridionale, où elle est citée entre Cadès et Jethnam. C’est sans doute ce dernier nom, hébreu : Ifnân, que les Septante ont uni à Asor dans 'Aooptmvaîv. Leur autorité ne suffit pas pour nous y faire reconnaître un seul nom, tant cette partie des listes est corrompue dans le texte grec. Le texte hébreu distingue nettement Asor et Jethnam, le nom de cette dernière étant précédé de la conjonction ve, « et ». Cf. Reland, Palsestina ex monumentibus veteribus illustrata, Utrecht, 1714, t. i, p. 143-144 ; t. ii, p. 709. Cette Asor est jusqu’ici complètement inconnue. Peut-être cependant le souvenir de ces villes méridionales, Asor ou Hesron, s’est-il conservé dans le Djebel Hadîréh, au nordest d’Aïn-Qadis (Cadèsbamé, suivant plusieurs auteurs).
3. ASOR (hébreu : Ifâsôr hâdaftâh, « Asor la neuve ; » omise par les Septante ; Vulgate : Asor nova), autre ville de la tribu de Juda, comprise dans le même groupe que la précédente. Jos. xv, 25. « U y en a, dit E. F. C. Rosenmùller, qui prennent Ifâdatfâh pour un nom de ville. Mais, comme dans toute cette liste les noms des différentes localités sont distingués par le vav qui les précède, il n’est pas croyable que la conjonction ait été omise dans ce seul endroit. Il est vrai que les traducteurs syriaque et arabe mettent cette particule ; mais on ne sait s’ils l’ont trouvée dans leurs manuscrits ou s’ils l’ont ajoutée d’après leur conjecture. Cette dernière supposition est la plus vraisemblable, puisque le chaldéen et saint Jérôme n’ont remarqué aucun signe copulatif, et qu’on n’en rencontre pas non plus dans les manuscrits actuels. Ensuite les deux noms sont unis par l’accent conjonctif Mahpach comme l’adjectif au substantif. » Sckolla in Vêtus Testamenturn, Josua, Leipzig, 1833, p. 302-303. Asor est appelée « nouvelle » pour la distinguer d’une autre, peut-être la précédente, plus ancienne. L’Onomasticon, Gœttingue, 1870, p. 217, après avoir mentionné la cité chananéenne de Jabin, ajoute : « Il y a jusqu’ici un autre village d’Asor sur les frontières d’Ascalon, vers l’orient, qui échut à la tribu de Juda, et dont l'Écriture parle en l’appelant Asor la neuve, 'Auwp tïjv xaivrjv, pour 1a distinguer de l’ancienne. » Cf. S. Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxiii, col. 868.
M. V. Guérin, s’appuyant sur le texte d’Eusèbe, croit reconnaître cette ville dans une localité actuelle, nommée
Yazour, « jL », par les uns, jvwL » > Yasour, par les
autres, et située dans la plaine de la Séphéla. « Le village d’Yazour, il est vrai, dit-il, n’est point à l’est d’Ascalon, mais au nord-nord-est ; ce qui n’est point un argument décisif contre l’identification que je propose, attendu que les indications d’Eusèbe ne sont pas toujours très précises, et peut-être, au lieu des mots : « sur les frontières d’Ascalon, » fautil lire : « sur les frontières d’Azot, à l’est. » Judée, t. ii, p. 67. Aucun débris antique n’attire l’attention en cet endroit, sinon, Drès d’un puits, un fût de colonne mutilée, de marbre gris blanc. Les maisons,
bâties sur une colline, sont construites comme celles de la plupart des villages de la plaine, c’est-à-dire avec des briques séchées seulement au soleil. Des plantations de tabac et des bouquets d’oliviers les précèdent.
Robinson, Biblical Researches, t. ii, p. 34, note 2, admet aussi que Yazour correspond bien à l’Asor de l’Onomasticon. « Cependant, ajoute-t-il, si c’est le même nom, nous avons là un changement inusité de la gutturale hébraïque, Heth, en l’arabe Ya avec une voyelle longue. En tout cas, Eusèbe a tort de prendre cette localité pour une des Asor du sud de Juda. » Placer si haut et si loin notre ville nous paraît également tout à fait contraire à la marche méthodique suivie par Josué dans ses énumêrations, principalement en ce qui concerne la tribu de Juda. L’auteur sacré procède par groupes bien déterminés : Asor la Neuve appartient à « l’extrême sud de la tribu, près des frontières d'Édom », Jos., xv, 21, tandis que Yazour, par sa position au nord-ouest et par les villes qui l’entourent, rentre plutôt dans le premier ou le second groupe des villes de « la plaine ». Jos., xv, 33-41. Il est bien plus clair pour nousque Yazour répond à YA-zu-ru prise par Sennachérib dans sa campagne contre Ézéchias, suivant le récit qu’il en fait lui-même dans le prisme de Taylor, col. ii, 66. Cf. E. Schrader, Die Keilinschriften und dos Alte Testament, in-8°, Giessen, 1883, p. 289 ; F. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., t. iv, p. 207. Elle vient tout naturellement, en effet, après Bit-Da-gan-na, Beth-Dagon (aujourd’hui Beit-Dedjan), Jos., xv, 41 ; Jaap-pu-u, Joppé (Yafa), et Ba^na-ai-bar-ka, Bané-Barach (Ibn-Ibrak, suivant les uns ; Barka, plus au sud, suivant les autres). Jos., xix, 45. Elle occupait ainsi une place importante sur la route de l’Egypte à travers la plaine des
Philistins.4. ASOR, ville de Juda, à l’extrémité méridionale de la Palestine, identique à Hesron, hébreu : Hésrôn M' TJLâsôr ; Septante : 'Auspwv, « vit » ) 'Aoiop ; Vulgate : Hesron, hsec est Asor. Jos., xv, 25. Le texte veut-il dire que Hesron s’appelait primitivement Asor, ou qu’elle n’est autre que l’une des deux villes de ce nom, précédemment indiquées ? Impossible de trancher la question. D’autres difficultés du reste se rattachent à Carioth et à Hesron, pour savoir s’il faut faire du premier mot un nom propre ou un nom commun. Voir Carioth, Hesron.
5. ASOR, « royaumes » contre lesquels prophétisa Jérémie, xlix, 28, 30, 33. La Vulgate a fait un nom propre de Hàsôr dans tout ce passage, où il s’agit de prédictions contre Cédar, peuple arabe. Les Septante, lisant isn,
l)âsêr, ont, au contraire, régulièrement traduit par a-ùX-q, « cour, » et bon nombre d’auteurs admettent ici le nom commun, comme si l’on disait « les royaumes du douar n. Cédar, en effet, représente, comme dans Isaïe, xxi, 16, toute l’Arabie, ou au moins une portion de ce pays, dans lequel nous ne trouvons aucune contrée du nom d’Asor. D’un autre côté, il ne saurait être question des différentes villes de la Palestine occidentale, dont nous avons parlé, puisque l’objet même de la prophétie nous reporte nécessairement vers les benê-Qédém, ou « les fils de l’Orient », expression générale qui désigne les Arabes, et surtout les tribus nomades du nord. Voir Arabe 1. Il est donc probable que le prophète a employé le mot Hàsôr pour désigner les Arabes qui habitent dans des onsm, ffàsêrîm, « villages » ou « cours », et les distinguer ainsi des Nomades, qui vivent sous la tente. Isaïe, xiii, 11, se sert de ce terme pour caractériser Cédar, de même que la Genèse, xxv, 16, pour les enfants d’Ismaël. Aujourd’hui encore les Arabes sédentaires sont appelés Hadariyéh, yèjJl J^ ! (ahl alhaouâder', « les gens de la demeure fixe » ), par opposition avec les Ouabariyéh, jjjJî Jjb) (uhl al-ouabar, « les gens du poil » ), qui habitent dans des tentes (faites avec Uil
ASOR EN ARABIE — ASPALATHE
M2
du poil de chameau ou de chèvre). Les « royaumes d’Asor » sont donc ainsi les régions habitées par les tribus sédentaires. Cf. E. F. C. Rosenmûller, Scholia in Vêtus Testamentum, , /eremias, Leipzig, 1827, t. ii, p. 368 ; C. F. Keil, Biblischer Commentar ûber den Prophète », Jeremia, Leipzig, 1872, p. 490 ; J. Knabenbauer, Commentarius in Jeremiam, Paris, 1889, p. 554 ; Trochon, La Sainte Bible, Jérémie, Paris, 1878, p. 303. *
Il faut dire cependant que la paraphrase chaldaïque et la version syriaque ont, comme la Vulgate, traduit par Asor, rendant exactement l’hébreu Bâsôr. Aussi d’autres auteurs ont vu là un nom propre. M. J. Halévy dit que ce royaume, défait par Nabuchodonosor en même temps que les Cédar, « était probablement la localité nommée aujourd’hui el-Akhdar, presque à moitié chemin entre Teboûk et Teima. » Voir Arabie, col. 864, et la carte, col. 857. On ne saurait néanmoins souscrire à l’opinion de Marc von Niebuhr, qui identifie Ilâsôr avec le Hadjar actuel, pays situé au nord-est du Nedjed. Si l’hébreu -|"isn répond à
l’arabe "il, , hasar, ou, i>>-^, hadar, il diffère complètement de-s », hadjar, ou _^", hadjai : Cf. Keil,
Jeremia, p. 490, note. 1.6. ASOR, ville habitée par les Benjamites après leur retour de la captivité. II Esdr., xi, 33. Les noms qui la précèdent et la suivent sont bien connus, et nous aident à déterminer sa position. Elle est mentionnée entre Anania, aujourd’hui Beit-Hanina, village situé à une faible distance au nord de Jérusalem, et Rama, Er-Ram, au nord - est du précédent. Voir la carte de la tribu de Benjamin. Robinson, Biblical Researches in Palestine, t. ii, p. 264, note 1, et V. Guérin, Samarie, t. i, p. 209, se demandent si l’on ne pourrait pas la reconnaître dans Tell Azour (Robinson écrit y&£., 'Asour, avec aïn et
sàd, édit. 1841, t. iii, p. 232 ; Guériu, yy, 'Azour, avec aleph et zâ), colline élevée, au nord-est de Béthel, d’où l’on embrasse un magnifique horizon, depuis la vallée du Jourdain jusqu'à la Méditerranée. Ce site nous paraît s'éloigner trop des villes parmi lesquelles est nommée Asor : il convient plutôt à Baalhazor de II Reg., xiii, 23. Nous préférons, avec les auteurs anglais, l’emplacement de Khirbet Hazzûr, village caché parmi les oliviers au pied des hauteurs de Néby Samouïl, vers l’est, et tout près de Beit-Hanina ; c’est exactement la place qu’occupe la cité benjamite dans la liste donnée par le texte sacré. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Nantes and places in the Old and New Testament, in-8°, Londres, 1889, p. 83 ; C. R. Conder, Tent Work in Palestine, ih-8°, Londres, 1889, p. 259. — Tobler, Topogr., t. ii, p. 400, avait déjà proposé un site identique ou très voisin, qu’il appelle Khirbet Arsûr (ou Asûr), et qu’il place huit minutes à l’est et au-dessous de Bir Nebala et non loin de Rama. Cf. Van de Velde, Memoir to accompany the map of the Holy Land, in-8°, 1859, p. 319. A, Legendre.
- ASORHAOOAN##
ASORHAOOAN, ASOR HAOOAN, en un ou deux mots, selon les divers exemplaires de la Vulgate. Forme particulière du nom d’Asarhaddon, roi de Ninive, dans la version latine de I Esdras, iv, 2. Le texte original d’Esdras "porte en deux mots : 'Êsar haddôn, comme II (IV) Reg., xix, 37, et Is., xxxvii, 38. Voir Asarhaddon.
- ASOTH##
ASOTH (hébreu : 'Asvaf ; Septante : 'AutO), fils de Jèphlat, de la tribu d’Aser. I Par., vii, 33.
- ASPALATHE##
ASPALATHE (àaitâxoceoç), parfum mentionné une seule fois dans l'Écriture. Eccli., xxiv, 15 (texte grec). La Vulgate traduit ce mot par balsamum, « .baume, » Eccli., xxiv, 20 ; mais il est certain qu’il désigne un aromate particulier, dont il est souvent question dans les auteurs grecs et dans Pline : ils parlent de la plante, du
parfum qu’on en tirait et de l’usage qu’on en faisait comme remède. Il est cependant possible qu’ils aient désigné sous le nom dCaspalalhos, à cause de certaines ressemblances, des plantes en réalité très différentes. Théognide, 1193, édit. Siztler, in-8°, Heidelberg, 1880, p. 127 ; Théocrite, Idyll., iv, 57 ; xxiv, 88, édit. Didot, p. 9, 49, et Scholia in Theocrit., édit. Didot, p. 36 ; Hippocrate, Œuvres, 10 in-8°, trad. Littré, t. viii, 1853, p. 446 ; Théophraste, Hist. plant., ix, 7 ; Fragm. iv de odor., 25, 33, édit. Teubner, t. i, p. 237 ; t. iii, p. 80, 83 ; Galien, Opéra, édit. Kiihn, dans les Medicorum grsecorûm Opéra, t. xi r p. 840 ; t. xix, p. 725, etc.
L’aspalathe était particulièrement estimé en Orient. « Cette plante… [est] mentionnée dans la plupart des recettes de parfumerie égyptienne que nous connaissons. »
SOI.
Myrica sapida mâle.
V. Loret, La flore pharaonique, in-8°, Paris, 1887, n° 61, p. 26. Elle entrait comme ingrédient dans la composition du célèbre parfum égyptien appelé par les Grecs kyphi ; c’est ce qu’attestent les trois écrivains grecs qui l’ont décrit : Dioscoride, De mater, med., i, 24, édit. Sprengel, t. i, p. 38-39 ; Plutarque, De Is. et Osir., 80, édit. Parthey, in-8°, Berlin, 1850, p. 143 (cf. les notes de Parthey, p. 278-280) ; Galien, De anlidot., édit. Kûhn, t. xiv, p. 118. R était donc tout naturel que l’aspalathe eût une place dans l'énumération de parfums faite par l’auteur de l’Ecclésiastique, xxiv, 20-21. La difficulté consiste à savoir quelle en était la nature. Nous en avons deux descriptions, l’une par Dioscoride, l’autre par Pline. « L’aspalathe, dit Dioscoride, est un arbuste épineux qui pousse à Istrus, à Nisyre, en Syrie et à Rhodes ; les parfumeurs s’en servent pour donner de la consistance à leurs parfums. Le meilleur est lourd, et, quand il est dépouillé de son écorce, il est rouge, tirant sur le pourpre, dur, d’odeur agréable et d’un goût amer. Il en existe une autre espèce qui est blanche, ligneuse, inodore. » De re medica, i, 19, édit. Sprengel, t. i, 1829, p. 35-36. Cf. la note de l'éditeur, t. ii, p. 359. Pline à son tour le décrit ainsi : « Dans la même contrée [en Cypre] croît l’aspalafhe, à épines blanches, de la taille d’un arbuste, à fleurs de rosier. La racine est recherchée par la parfumerie… La bonne qualité [de cet aromate J se reconnaît à une couleur rousse ou semblable au feu, à son grain compact et à son odeur qui est celle du castoréum. » H. N., xii, 52. Au livre xxiv, 68, Pline dit qu’on le trouve aussi dans l'île de Rhodes.
Ces descriptions des anciens sont malheureusement trop vagues pour qu’il soit possible de déterminer avec certitude quelle était la plante d’où l’on tirait l’aspalathe, Dioscoride et Pline s’expriment avec si peu de précision, qu’on s’est demandé s’ils avaient parlé autrement que par ouï-dire. Le seul point certain qu’on puisse déduire des passages des auteurs anciens, c’est que ce parfum était produit par un arbuste épineux : tous ceux qui en ont
[[File: [Image à insérer]|300px]]
302. — Myriea aapUta femelle. Fruit entier, coupes et noyau.
parlé, naturalistes, médecins, poètes, sont d’accord làdessus. Platon fait allusion à ces épines comme Théocrite. Pour peindre les tourments des méchants dans l’autre vie, il dit qu’ils seront traînés au milieu des épines des aspalathes. De republ., x, édit. Didot, t. ii, p. 191. Cf. S. Justin, Cohort. ad Grsec, 27, t. vi, col. 292 ; Clément d’Alexandrie, Strotn., v, 14, t. ix, col. 133 ; Eusèbe, Priep. Ev., Mil, 13, t. xxi, col. 1105. Mais ce caractère est insuffisant pour identifier l’aspalathe. Aussi les savants sont-ils très divisés à ce sujet.
De nos jours, on donne le nom d’aspalathe, Aspalathus, à un genre de plantes de la famille des Papilionacées, tribu des Lotées, toutes originaires du cap de Bonne-Espérance.' De Candolle, Prodromus regni vegetabilis, 16 in-8°, Paris, 1824-1870, t. n (1826), p. 136. Il n’existe en Orient aucune espèce de plantes appartenant au genre qu’on appelle aujourd’hui Aspalathe. D’après quelques-uns, l’aspalathe des anciens était une espèce d’aloès. (Voir Aloès, col. 400.) Cf. F. V. Mérat et A. J. de Lens, Dictionnaire universel des matièresmédicales, in-8°, Paris, t. i, 1829, p. 469. Cette opinion n’est qu’une hypothèse sans fondement. — D’après d’autres savants, l’aspalathe est YAspalathus cretica de Linné. Cf. KittOj Cyclopsedia of Biblicàl Literature, 1862, t. i, p. 245. Cette plante, qui forme des touffes buissonnantes extrêmement épineuses et groupées en boules comme un hérisson, semble bien répondre à ce qu’en dit Platon, mais on n’en tire aucun parfum. Elle n’est, au témoignage de JBoissier, Flora jorientalis, t. ii, p. 156, qu’une forme aberrante de VAnthyllis Éermanniæ, petit arbuste très épineux, à fleurs jaunes, à feuilles ovales, étroites, à rameaux touffus, qui croît en Grèce, dans les lies de l’Archipel eten quelques endroits du littoral asiatique de la Méditerranée.
Certains naturalistes pensent que l’aspalathe venait de
l’Inde. Les auteurs arabes, tels qu’Avicenne (Avicennse libri inre medica, 1. ii, tr. 2, c. 211, in-f°, Venise, 1564, p. 295), disent que dar-sisaan est le nom qui correspond en leur langue à aspalathe, et, d’après quelques-uns d’entre eux, cet aromate vient de l’Inde. Or, dans l’Inde, on appelle dar-sisan l'écorce d’un arbre qui porte le nom de kaiful ou kyful. Il croit à l'état sauvage sur l’Himalaya », depuis le Nepaul jusqu’au Setledge. On le cultive aussi dans les jardins. N. Wallich, Tentamen Florse Nepatensis illustratss, in-f, Calcutta, 1824-1826, p. 59, cf. pi. 45, l’a décrit sous le nom de Myriea sa 803. — Convolvulus scoparlus.
pida. C’est un arbre touffu, qui atteint environ trente pieds (neuf mètres) de hauteur, au tronc large, couvert d’une écorce brune, rugueuse et crevassée, à feuilles lancéolées. Les fleurs de l’arbre mâle (fig. 301) sont différentes de celles de l’arbre femelle (fig. 302). Les unes et les autres, en forme de chatons, s'épanouissent en mars ; elles sont blanchâtres, avec de légères teintes roses. Le fruit, de couleur rouge, gros comme une petite cerise, mûrit à l'époque des pluies ; il a un goût acidulé et est rafraîchissant. Le bois est dur, d’un brun foncé. Quand on frotte les feuilles, elles exhalent une odeur aromatique légère et agréable. Les Hindous en estiment beaucoup l'écorce pour ses propriétés aromatiques et médicinales, et on la trouve dans tous les bazars. Voir Enumeration of plants, dans les Asiatic Researches, Londres, 1801, t. VI, p. 380-381. Les descriptions des auteurs grecs et latins ne conviennent certainement pas à cet arbre sans épines et de taille assez grande.
On a aussi proposé d’identifier l’aspalathe avec certaines espèces de genêts qu’on trouve en Orient, entre autres avec le Genista aspalathoides, arbuste épineux, à fleurs d’un jaune d’or, ayant quelque ressemblance avec l’As
patathus ; par malheur, on ne lui connaît pas de propriétés aromatiques. Il n’en est pas de même de YAmyris balsamifera, dans lequel quelques-uns ont cru reconnaître l’aspalathe des anciens. C’est un arbre de la famille des Térébinthacées, assez semblable à la plante qui produit le baume de la Mecque. Voir K. Fraas, Synopsis plantarum florse classicee oder Uebersichtlicke Darstellung der in dm klassischen Schriften der Griechen und Rômer vorkommenden Pflanzen, in-8°, Munich, 1845, p. 49-50 ; Bussemaker et Daremberg, Œuvres d’Oribase, 6 in-8° t. ii, 1854, p. 490, 513, 618.
L’opinion la plus commune est que l’aspalathe se tirait de la plante appelée aujourd’hui Convolvulus scoparius de Linné (fi g. 303). C’est le sentiment de plusieurs savants, tels que Littré, dans sa traduction de Pline, édit. Nisard, t. i, 1848, p. 493 (quoique dans sa traduction d’Hippocrate, Œuvres, t. viii, 1853, p. 447, il l’identifie avec le Genista acanthoclada) ; les annotateurs du même Pline, dans l'édition Panckoucke, t. viii, 1830, p. 451-452 (cf. t. xv, p. 197-199) ; V. Loret, qui a spécialement étudié la flore égyptienne. D’après lui, la plante appelée dans
la vallée du Nil i "V *=. jS, djalem ou djalmâ, et ^"1 I j. i djabi, est l’aspalathe, qui n’est pas autre que
le Convolvulus scoparius, « Je crois, dit-il, que l’aspalathe, ou du moins l’aspalathe égyptien de Pline, est bien le Convolvulus scoparius L., dont le bois, fort employé en parfumerie, est connu dans le commerce sous le nom de' Bois de Rhodes ou Bois de rose. L’Egypte renferme encore aujourd’hui un certain nombre de ces Convolvulus ligneux et non volubiles, auxquels appartient le Convolvulus scoparius. Tous poussent dans les rochers et les endroits pierreux ou sablonneux. » Le kyphi, dans le Journal asiatique, juillet-août 1887, p. 120. « L’Egypte moderne possède dix espèces de Convolvulus, mais le Convolvulus scoparius en a disparu. » V. Loret, La flore pharaonique, p. 26. Cf. A. Raffeneau-Delile, Florse ëgyptiacss illustratio, dans la Description de l’Egypte, édit. Panckoucke, in-8°, t. xix, 1824, n » * 222-231, p. 78.
Les convolvulus sont des herbes ou des plantes sousfrutescentes. Un assez grand nombre sont volubiles et s’enroulent autour des autres plantes. Parmi celles qui n’ont point cette propriété se range le Convolvulus scoparius. Il atteint deux mètres de hauteur, le tronc a trente-cinq centimètres environ de circonférence. « Son port très spécial rappelle celui d’un genêt : ses souches ligneuses émettent, en effet, des rameaux tout droits, joncif ormes, qui portent sur leur longueur, assez largement espacées, des feuilles simples, linéaires, très étroites, et à l’extrémité des fleurs relativement petites, jaunâtres, disposées en épis ou en grappes paniculées. La partie intéressante de la plante est la souche ligneuse et les grosses racines qui s’en détachent. Ces parties, généralement contournées, sont recouvertes d’une écorce grise, fongueuse ou un peu crevassée. Le bois luimême, blanchâtre dans les couches extérieures, est d’un jaune orangé au centre et tout imprégné d’une certaine quantité d’une huile peu volatile, qui a une odeur de rose prononcée. Aussi donne-ton à ce bois le nom de Bois de rose des parfumeurs ou Bois de rose des Canaries. II. est aussi connu sous le nom de Bois de Rhodes ( lignunt Rhodium) ; mais cette dénomination ne signifie pas autre chose que Bois à odeur de rose ; elle n’indique nullement l’origine géographique de la substance. La plante ne se trouve, en effet, qu'à une très grande distance de l'île de Rhodes ; elle croît seulement à Ténériffe, dans les Canaries. » Planchon, dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, i" série, t. xx, 1877, p. 235. On peut supposer qu’elle a été cultivée autrefois en des lieux où on ne la trouve plus, aujourd’hui : ; mais l’identification de l’aspalathe, on le voit, n’est pas encore bien établie. Quoique certains convolvulus soient
épineux, comme Varmatus (Description de l’Egypte, Histoire naturelle, Botanique, pi. 18), le scoparius ne l’est pas et, sur ce point, il ne répond pas à la description des anciens. — Voir E. P. Ventènat, Choix de plantes, in-f°, Paris, 1803, p. 24, pi. 24 ; Ch. Barker Webb et S. Berthelot, Histoire naturelle des îles Canaries, Phytographia, Paris, 1836-1850, t. iii, part, ii, sect. 3, p. 29-30.
F. VlGOUROUX.
ASPERSION. Dans le sens strict du mot, l' « aspersion » consiste en ce qu’on répand ou plutôt qu’on jette, sur des personnes ou sur des choses, quelques gouttes d’un liquide, soit avec les doigts, soit avec un rameau de feuillage, soit avec tout autre instrument ou vase destinés à cet usage. L’aspersion se distingue ainsi soit de 1' « ablution » totale ou partielle du corps, soit de 1' « effusion » d’un liquide. Nous trouvons chez les Hébreux la plus grande variété dans la matière et le rite des aspersions.
I. Aspersion avec l’eau lustrale. — Moïse, Num., Xix, détermine avec le plus grand soin tout ce qui concerne ce genre d’aspersion. — 1° Matière de l’aspersion. — C’est l’eau lustrale, qu’on obtient de la manière suivante : on immole et on fait brûler une génisse, de couleur rousse, sans défaut, sans tache, et n’ayant pas porté le joug ; dans le bûcher de la génisse, on jette aussi du bois de cèdre, de l’hysope et de l'écarlate teinte deux fois, Num., xix, 1 -6. Sur l’immolation et l’incinération de. la victime, voir Vache rousse. Les cendres ainsi obtenues sont recueillies par un homme « pur », et elles sont déposées hors du camp (plus tard hors de Jérusalem), dans un lieu <( très pur », pour être sous la garde et au service de tous les enfants d’Israël. Num., xix, 9. Quand on veut avoir de l’eau lustrale, on dépose un peu de ces cendres au fond d’un vase, on verse pardessus de l’eau « vive », c’està-dire de l’eau de source ou de rivière, par opposition à l’eau de citerne ou à toute eau dormante ; le mélange obtenu est l’eau lustrale. Num., xix, 17. L’action même de mélanger l’eau et les cendres est appelée par les rabbins « consécration » de l’eau lustrale.
2° Nom de cette eau. — Dans l’hébreu, Num., xix, 9, 13, 20, 21 ; xxxi, 23, elle est appelée mê niddâh, c’està-dire « eau de séparation » ou « d’impureté » (du radical nâdad, « séparer, rejeter » ), soit parce qu’elle servait à réconcilier et à rapprocher de Dieu ceux qui étaient « séparés » de lui par certaines impuretés légales, soit parce que la génisse dont les cendres servaient à faire cette eau était elle-même « séparée » et immolée ; d’autres interprètent ces mots mê niddâh dans le sens d' « eau d’aspersion » (du radical yâdâh, « répandre » ) ; c’est ainsi que les Septante traduisent, aux passages indiqués, ûSùp pavTia-fioCi, « eau d’aspersion, » sauf une fois : ùêùp à^viaixoG, « eau de purification. » Num., xxxi, 23. La Vulgate traduit tantôt aqua aspersionis, Num., xix, 9 ; tantôt aqua lustrationis, Num., xix, 20 ; tantôt aqua expiationis, Num., xix, 13, 21 ; xxxi, 23.
3° Forme et instrument de cette aspersion. — La forme est indiquée Num., xix, 18-19 ; un homme « pur » trempe un rameau d’hysope (hébreu : 'êzôb) dans l’eau lustrale, et asperge ainsi les personnes ou les objets contaminés. Pour faire l’aspersion, la loi n’exige pas un prêtre, ni même un lévite ; le premier Israélite venu suffit, pourvu qu’il soit « pur » ; aussi, pour être plus sûrs que cette condition fût accomplie, les Hébreux choisissaient de préférence, pour faire l’aspersion, de jeunes enfants ; c'étaient eux qui allaient puiser l’eau, qui la mettaient dans le vase avec la cendre sacrée, qui plongeaient dans l’eau le rameau d’hysope, et qui faisaient l’aspersion. Cet usage s’est transmis par la tradition ; il est mentionné par l’auteur de la Lettre de saint Barnabe, qui dit que trois enfants, itaïSeç, faisaient l’aspersion. Barnabse epistula, viii, dans Opéra Patrum apostolicorum, édit. Funk, Tubingue, 1881, . p. 27- Quant à l’instrument de l’aspersion, la loi exige un rameau d’hysope ; l’hysope avait déjà servi soit pour l’aspersiondu sang de l’agneau pasGal sur lesportes « 17
ASPERSION
1118
des Hébreux, Exod., xii, 22, soit pour l’aspersion qui accompagna l’inauguration de l’alliance. Exod., xxiv, 2. On aurait pu se contenter d’un rameau d’hysope, la loi n’exigeant que cela ; mais comme, dans d’autres purifica(ions légales, la loi exigeait un rameau d’hysope joint à une branche de cèdre au moyen d’une bandelette de laine écarlate, Lev., xiv, 4, 6, 49-52, cette prescription fut étendue à l’aspersoir de l’eau lustrale. Barnabee epistula, loc. cit. On peut voir dans la Mischna les subtilités des rabbins au sujet de l’espèce d’hysope qui était requise pour la légitimité de l’aspersion. Mischna, tr. Pârâh, xi, 7-9 ; xii ; édit. Surenhusius, t. vi, p. 307-313.
4° Usage et efficacité de cette aspersion. — Le principal usage était d’enlever l’impureté légale qui provenait du contact du cadavre humain. Quiconque touchait un mort, ou même simplement un tombeau, un ossement humain, était impur devant la loi ; bien plus, quand la mort avait lieu dans une tente, plus tard dans une maison, l’impureté légale frappait tous ceux qui entraient dans la tente ou la maison, et même tout le mobilier, sauf les vases à couvercle. Num., xix, 11-16 ; v, 2 ; xxxi, 19. Cette espèce d’impureté était très tenace ; elle durait sept jours, et excluait non seulement du temple et de la participation aux choses saintes, mais encore de la société des hommes. Voir Impuretés légales. Or c’est l’aspersion dont nous parlons qui enlevait cette impureté légale ; on la répétait deux fois, le troisième et le septième jour (à partir du moment où la souillure avait été contractée) ; le septième jour, la personne « impure » prenait un bain, lavait ses vêtements, demeurait encore « impure » jusqu’au soir, et le lendemain se trouvait purifiée. Num., xix, 12, 18-19. Outre cet usage principal, nous voyons encore l’eau lustrale employée dans la consécration des lévites, Num., vhi, 7 ; puis, dans un cas spécial, pour la purification du butin. Num., xxxi, 20-33. On s’est demandé si l’aspersion de l’eau lustrale, qui enlevait l’impureté légale contractée par le contact d’un mort, avait la même efficacité sur les autres impuretés. Quoi qu’en disent certains auteurs, par exemple, Tostat, In Num., xix, q. xv, Venise, 1596, t. iv, p. 269 b ; Cornélius a Lapide, In Num., xix, 9, il paraît certain que l’eau lustrale n’effaçait que l’impureté dont nous parlons ; comme nous le voyons dans le Lévitique, xii, Xili, XIV, xv, chaque impureté légale avait son rite particulier de purification, approprié à sa nature ; le rite fixé pour telle impureté n’avait aucune efficacité pour telle autre ; pourquoi ne dirions-nous pas la même chose de l’aspersion de l’eau lustrale, que Moïse, Num., xix, prescrit expressément pour purifier de l’impureté provenant des cadavres, sans faire aucune mention des autres impuretés'? Aussi la plupart des commentateurs juifs et chrétiens disent ou supposent qu’on n’employait l’eau lustrale que dans le cas dont nous parlons, sauf peut-être quelques cas moins importants ajoutés par les rabbins.
Mentionnons un effet curieux de l’eau lustrale : elle purifiait, avons-nous dit, les « impurs », sur lesquels on la répandait avec l’hysope ; au contraire, elle souillait les « purs ». Celui qui faisait l’aspersion devait, après cet acte, laver ses vêtements ; quiconque touchait l’eau lustrale était impur jusqu’au soir. Num., xix, 21. Les exégètesont cherché à expliquer cette anomalie. S. Augustin, Qusest. in Hep ta t., Num., xix, t. xxxiv, col. 735 ; Spencer, De Legibus Hebrœorum ritualibus, La Haye, 1686, t. i, p. 361 ; Deyling, De aqua expialoria, dans ses Observationes sacrée, Leipzig, 1739, t, iii, p. 101 ; J. Leclerc, In Num., Xix, Amsterdam, 1710, p. 409. Leurs explications, très subtiles, ne sont guère satisfaisantes ; disons plutôt simplement que l’eau cendreuse, n'étant guère propre par elle-même au point de vue physique f causait chez tous Ceux qui la touchaient une très légère impureté légale, pour laquelle le législateur voulut imposer une purification proportionnée de quelques heures ; c’est la pensée de Cornélius a Lapide, In Num., XIX, 21.
5° Notions historiques. — Moïse, dans l’institution de
cette eau lustrale, put être guidé par les usages des peuples environnants ; car la cendre, et spécialement la cendre de veau, était employée par les païens dans leurs lustrations. Cf. Ovide, Fast., iv, 638-640, 725-727, 732-733, édit. Lemaire, Paris, 1822, t. vi, p. 284, 291, 292 ; Virgile, Ecloga viii, 101, édit. Lemaire, Paris, 1819, t. i, p. 190 ; Arnobe, Adversus Gentes, vii, 32, t. v, col. 1262-1263. Les Juifs observèrent fidèlement le rite prescrit par leur législateur. C’est à lui que fait allusion David, Ps. L, 9. Comme l’impureté légale provenant du contact des morts était par sa nature même extrêmement fréquente, il est fort probable que la cérémonie de l’immolation de la vache rousse avait lieu tous les ans ; c’est l’opinion de saint Jérôme, Epist. cviii, Ad Euslochium, XII, t. xxii, col. 887, suivie par la plupart des commentateurs chrétiens, malgré l’opinion contraire des rabbins, qui font cette immolation beaucoup plus rare. Reland, Antiquitates sacras, II, v, 10, Utrecht, 1708, p. 108-109 ; Lorinus, In Num., xix, 9, Lyon, 1622, p. 706 ; Cornélius a Lapide, In Num., xix, 22. Pour la même raison, il est très vraisemblable que les cendres de la génisse, après avoir été recueillies dans le lieu du sacrifice, étaient ensuite distribuées au moins dans les principales villes de Judée, afin que les Hébreux ne fussent pas obligés de faire si fréquemment le voyage de Jérusalem. Bonfrère, Pentateuchus Mosis, In Num., xix, 12, Anvers, 1625, p. 821 ; Cornélius a Lapide, In Num., xix, 9. Ce rite mosaïque était en pleine vigueur du temps de Notre-Seigneur ; saint Paul en parle comme d’une chose parfaitement connue et pratiquée, Heb., rx, 13 ; Philon et Josèphe le signalent comme institué par Moïse ; Philon, De victimas offerenlibus, dans ses Opéra omnia, Paris, 1640, p. 847-849 ; Josèphe, Ant. jud., IV, iv, 6 ; Cont. Apion., Il, 23. La Mischna ; écrite vers l’an 200 de notre ère, expose avec un détail infini tout ce qui concerne ce rite, Mischna, tr. Pârâh, édit. Surenhusius, Amsterdam, 1702, t. vi, p. 269-313 ; mais il est bien probable qu’alors ce rite n'était plus observé ; car depuis la destruction du temple de Jérusalem, en 70, et surtout depuis la terrible répression de 137 par Adrien, les Juifs prétendent que ce rite et les rites similaires concernant les impuretés légales ne les obligent plus ; c’est ce que dit le rabbin Léon de Modène, Cérémonies et coutumes des Juifs, I, viii, 1, Paris, 1681, p. 18.
6° Symbolisme et but de la loi. — L’eau lustrale était la figure du sang de Jésus-Christ. Saint Paul, Hebr., IX, 13-14, fait entre l’une et l’autre un rapprochement frappant. De même que l’eau lustrale répandue par l’aspersion sur les personnes ou les objets souillés par le contact d’un mort les purifiait de cette impureté, ainsi le sang de Jésus-Christ répandu sur la croix purifie notre âme des souillures contractées par nos péchés, qui sont des œuvres mortes. Ce symbolisme a été mis en pleine lumière par les Pères et les saints docteurs. Barnabee epistula, viii, p. 27 ; S. Augustin, Qusest. in Heptat., iv, 33, t. xxxiv, col. 732-737 ; Théodoret, Qusest. in Num., q. xxxv, t. lxxx, col. 386 ; Bonfrère, Pentateuchus Mosis, p. 826 ; Cornélius a Lapide, In Num., xix, 4, 9. Cette interprétation a été suivie par les auteurs protestants, Witsius, Mqyptiaca sacra cum Hebraicis collata, II, viii, 5-11, dans Ugolini, Thésaurus antiquitatum sacrarum, Venise, 1744, t. i, p. 855-858 ; Deyling, De aqua expiatoria, dans ses Observationes sacras, Leipzig, 1739, t. iii, p. 89-102 ; Lightfoot, De ministerio templi, xvil, 11, Opéra omnia, Utrecht, 1699, t. i, p. 752-753 ; Otho, Lexicon rabbinico-philologicum, Genève, 1675, p. 659 ; Constantin L’Empereur, Talmudis babylonici Codex Middotk, Leyde, 1630, p. 14. Il n’y a pas jusqu’aux Juifs qui n’aient vu dans l’eau lustrale dont nous parlons le symbole de l’expiation de nos péchés. Cf. Deyling, loc. cit., p. 98-99. Philon en donne une explication allégorique ; d’après lui, Moïse a voulu rappeler aux Juifs que, de même que l’eau lustrale est composée d’eau et de cendres, ainsi le corps de l’homme n’est qu’un composé de poussière et de liquide. Philon, « 19
ASPERSION
4120
De somniis, et De victimas offerentibus, Opéra, Paris, 1640, p. 596-597, 848-849. Il est probable aussi que Moïse, en prescrivant aux Juifs cette eau expiatoire, s’est proposé de les. détourner de l’emploi de certaines eaux lustrales en usage chez plusieurs peuples païens, et peu dignes d’une nation polie et civilisée. Ainsi, chez les Perses, l’eau lustrale renfermait de l’urine de bœuf ; chez les Indiens, de la bouse ou de l’urine de vache ; chez les indigènes du Malabar, de la fiente de vache, desséchée et réduite en poussière. Zend-Avesta, traduit en français par Anquetil Duperron, Paris, 1771, t. ii, p. 544-550 ; Paulin de SaintBarthélémy, Systema brahmanicum, Rome, 1791, p. 202 ; Lois de Manou, v, 105, 122, 124, dans Pauthier, Les livres sacrés de l’Orient, Paris, 1841, p. 384-385 ; Winer, Bïblisches Realwôrterbuch, au mot Sprengwasser, Leipzig, 1838, t. ii, p. 587. Qui ne voit combien le rite de purification des Hébreux était supérieur à ces rites païens, au double point de vue de la dignité morale et de l’hygiène ? Cf. Saalschûtz, Bas Mosaische Recht, Berlin, 1853, k. 40, p. 340, note. Pour le symbolisme complet du rite mosaïque, voir aussi Vache rousse.
7° Eau bénite des chrétiens. — D’après quelques auteurs, qui l’affirment ou le supposent, 1' « eau bénite » des chrétiens est une imitation de l’eau lustrale des Hébreux. Rien ne s’oppose à cette hypothèse, pourvu qu’on regarde notre eau bénite non pas comme un type ou une figure, ainsi qu'était l’eau lustrale des Hébreux, mais comme un rite pieux institué par l'Église pour exciter en nous la foi et la dévotion, et nous attirer ainsi des grâces qui nous aideront à obtenir le pardon de nos fautes. Ce qui est certain, c’est que l’usage de l’eau bénite remonte aux premiers siècles. Cf. Const. Apost., viii, 29, dans Migne, Patr. gr., t. i, col. 1125. On a retrouvé, dans les catacombes, des vases, des coquilles, en marbre ou en terre cuite, assujettis à une colonne, à la portée de la main, qui évidemment étaient ce que nous appelons des « bénitiers ». Cf. Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, Paris, 1865, p. 222. S’il faut en croire le Liber Pontificale, l’institution de l’eau bénite est due au pape Alexandre, qui régnait vers l’an 110. Il est à remarquer que le Liber Pontificalis donne à cette eau le nom d’aqua sparsionis, « eau d’aspersion ; » nom analogue à celui que la Vulgate Num., xix, 9 (aqua aspersionis), donne à l’eau lustrale des Hébreux. Liber Pontificalis, In Aleœandrnm, édit. Duchesne, Paris, 1886, t. i, p. 127.
II. Aspersion avec l’eau ordinaire. — D’après quelques auteurs, les Hébreux avaient aussi des « aspersions » proprement dites avec de l’eau ordinaire ; ils donnent comme exemple l’aspersion qui est mentionnée Num., viii, 7, et qui devait se faire dans la consécration des lévites ; l’eau de cette aspersion, disentils, se puisait sans doute dans le bassin d’airain dont il est question Exod., xxx, 17-21, et qui ne contenait que de l’eau commune. Nous croyons qu’il s’agit ici encore d’une aspersion avec l’eau lustrale ; car l’eau qui devait servir à cette aspersion est appelée, Num., viii, 7, mê hattâ't, « eaii de péché, » c’est-à-dire eau symbolisant la rémission du péché ; or ce nom ne convient bien qu'à l’eau lustrale ; aussi la Vulgate traduit - elle aqua lustrationis ; de plus, nous voyons, Num., xix, 17, que la vache rousse, dont les cendres servaient à faire l’eau lustrale, est appelée hattâ't, « péché » ou « victime pour le péché » (cf. Maimonide, More Nebochim, iii, 47, traduction latine de Buxtorf, Bâle, 1629, p. 494) ; le nom de mê hatlâ'f, « eau de péché, » convient donc parfaitement à l’eau lustrale ; aussi les rabbins lui donnaient ce nom, Winer, Bïblisches Realwôrterbuch, t. ii, p. 585 ; il est donc très probable que l’aspersion dont il s’agit Num., viii, 7, se faisait avec l’eau lustrale. Cornélius a Lapide, In Num., viii, 7 ; Rosenmùller, In Num., Vin, 7. — Sans doute il est possible que les Hébreux, qui avaient tant d' « ablutions » avec l’eau ordinaire, aient eu aussi des aspersions avec cette eau, d’autant plus que ces aspersions étaient en usage chez tous les peuples païens.
Tertullien, De Baptismo, , t. i, col. 1204-1205 ; Virgile, Enéide, ii, 717-720 ; iv, 635 ; vi, 229-231, 635-636, édit. Lemaire, Paris, 1819, t. ii, p. 293, 549 ; t. iii, p. 126, 173 ; Ovide, Metam., i, 369-372 ; vii, 189-190, édit. Lemaire, Paris, 1821, t. iii, p. 91-92, 490. Cf. D. Classenius, Theologia Gentilis, iii, 6, dans Gronovius, Thésaurus grœcarum antiquitatum, Venise, 1735, t. vii, p. 131-132. Mais ce genre d’aspersion, pour les Hébreux, n’est signalé, au moins d’une manière expresse et formelle, ni dans la Bible, ni dans la Mischna, qui a plusieurs traités sur les purifications légales, ni dans les commentaires hébreux sur ces purifications ; bien plus, Philon oppose ces aspersions païennes avec une eau commune à l’aspersion juive avec l’eau lustrale, et fait ressortir l’excellence de celle-ci sur la première, à raison même de sa matière prescrite par Moïse : ce qui semble supposer que les Juifs n’avaient aucune aspersion semblable, pour la matière, à celle des païens. Philon, De victimas offerentibus, loc. cit.
III. Aspersion avec le sang. — L’aspersion avec le sang des victimes est souvent prescrite par la loi ; nous la trouvons, d’une manière ordinaire, dans certains sacrifices, dans certaines fêtes ou cérémonies ; nous la rencontrons aussi, d’une manière extraordinaire, dans quelques événements plus importants de l’histoire du peuple hébreu.
1° Aspersions ordinaires. — Dans les sacrifices, le sang des victimes était offert à Dieu ou appliqué aux personnes ou aux choses, de différentes manières, tantôt sous forme d’aspersion, Lev., iv, 5, 6 ; xvi, 14, 15, 19 ; tantôt par effusion, lente ou rapide, Lev., i, 5, 11, 15 ; iii, 1, 8, 13 ; iv, 7, etc. ; d’autres fois par simple attouchement. Lev., 1% 7, 18, 25. Nous n’avons à parler ici que des « aspersions » strictement dites, renvoyant pour tout le reste à l’article Sacrifice. — 1. Nous trouvons l’aspersion avec le sang dans deux sacrifices solennels, le sacrifice « pour le péché » du pontife suprême, et le sacrifice « pour le péché » du peuple tout entier. Dans ces deux cas, le pontife, prenant, dans un vase sacré destiné à cet usage, une partie du sang de la victime offerte en sacrifice, pénètre dans le tabernacle, plus tard dans la partie du temple appelée le Saint, et, trempant son doigt dans ce sang, il en fait sept fois l’aspersion devant le voile du Saint des saints. Lev., iv, 5-6, 16-17 ; cf. Lev., vi, 30 ; Heb., XIH, 11. — 2. Dans l’immolation de la vache rousse, la loi prescrit aussi ces aspersions ; le prêtre, ayant égorgé la victime en dehors du camp, plus tard en dehors de Jérusalem, trempe son doigt dans le sang recueilli, et fait sept aspersions dans la direction du tabernacle ou du temple. Num., xix, 4. — 3. Nous retrouvons ce même genre d’aspersion dans une fête très solennelle, qui revenait chaque année, la fête de l’Expiation. Lev., xvi. Le grand prêtre, étant entré dans le Saint des saints ( ce qu’il ne pouvait faire que ce jour-là dans l’année), trempait son doigt dans le sang du jeune taureau immolé pour ses péchés et ceux de sa famille, et en faisait sept aspersions vers la partie orientale du propitiatoire ; il faisait, de la même manière, sept aspersions avec le sang du bouc offert pour les péchés du peuple ; et il renouvelait dans le Saint cette double série d’aspersions. Lev., xvi, 14-16. — La tradition rabbinique fit précéder chacune de ces quatre séries d’une aspersion générale, ce qui portait le nombre de ces aspersions à trente-deux. Puis le grand prêtre, ayant ainsi purifié le Saint des saints et le Saint, s’approchait de l’autel des parfums, et faisait avec le sang mélangé des deux victimes onze nouvelles aspersions, quatre aux angles et sept sur l’ensemble de l’autel. Lev., xvi, 18-19 ; Josèphe, Ant. jud., III, x, 3. Les rabbins avaient compté avec un soin minutieux toutes ces aspersions, dont le nombre, quarante-trois, était sacré ; le grand prêtre ne devait en faire ni une de plus ni une de moins ; on lui enseignait la manière de les faire ; la moindre faute entraînait la nullité des opérations. Mischna, traité Yômâ', v, 1-7, édit. Surenhusius, t. ii, p. 231-239 ; Maimonide, Yâd hâzàqâh, VIII, viii, De solemni die Expiationum, traductraduction latine de Louis de Compiègne, Paris, 1678, p. 330-352 ; Carpzov, Apparatus antiquitatum sacri codicis, Leipzig, 1748, p. 436 ; Ménochius, De republica Hebræorum, Paris, 1648, p. 276-282 ; Reland, Antiquitates sacræ, Utrecht, 1708, p. 240 ; Ugolini, Altare intenus, dans son Thesaurus antiquitatum sacrarum, Venise, 1750, t. xi, p. 18-73 ; Deyling, De Ingressu S. Pontificis in Sanctuarium, xxvi-xxviii, dans ses Observationes sacræ, Leipzig, 1735, t. ii, p. 191-193. — 4. Dans la purification des lépreux, Moïse prescrit une aspersion aussi intéressante que mystérieuse. Le lépreux guéri offre au prêtre deux passereaux ; l’un des deux est immolé, et c’est avec son sang que se fait l’aspersion ; l’usage de l’autre est ainsi indiqué par Moïse : le prêtre, au moyen d’une bande de laine écarlate, ajuste ensemble les ailes de cet oiseau vivant, avec un rameau d’hysope et une branche de cèdre, puis il plonge cet aspersoir d’un nouveau genre dans le sang de l’oiseau immolé, et fait enfin sept aspersions sur le lépreux. Lev., xiv, 4-7. Le même cérémonial est prescrit pour la « lèpre des maisons ». Les sept aspersions sont faites dans la maison infectée. Lev., xiv, 49-52.
2° Aspersions extraordinaires. — Nous trouvons des aspersions avec le sang des victimes dans trois circonstances mémorables de l’histoire du peuple hébreu. — 1. Dans la fameuse nuit où le Seigneur fit périr tous les premiers-nés d’Égypte, les Hébreux, suivant les ordres de Moïse, avaient, avec un rameau d’hysope trempé dans le sang d’un agneau immolé, fait trois aspersions sur la porte de leurs maisons ; c’est ce signe qui les préserva de la mort, et donna lieu à l’institution de la Pâque annuelle, que les Juifs célèbrent encore aujourd’hui. Exod., xii, 6-7, 22. — 2. Lorsque Dieu, par l’intermédiaire de Moïse, contracta une alliance solennelle avec le peuple hébreu, qui se trouvait alors au pied du Sinaï, un des principaux actes de la cérémonie fut une aspersion faite par Moïse sur tout le peuple avec le sang des victimes. « Voici, dit-il, le sang de l’alliance que le Seigneur a faite avec vous. » Exod., xxiv, 5-8. Saint Paul complète ces détails en disant que Moïse avait pris, comme instrument de cette aspersion, un rameau d’hysope orné d’une bande de laine de couleur écarlate. Heb., ix, 18-20. Il ajoute que Moïse avait mêlé de l’eau avec le sang, Heb., ix, 19 ; nous savons, en effet, d’après le Lévitique, xiv, 5, 50-52, que dans ces sortes d’aspersions, probablement pour les rendre plus faciles, on avait coutume de mêler de l’eau avec le sang. Rosenmüller, In Epistolam ad Heb., IX, 19. — 3. Enfin la troisième circonstance où nous voyons une aspersion avec le sang fut la consécration du tabernacle et de tout son mobilier. L’Exode ne parle que d’une onction avec l’huile sainte faite par Moïse sur le tabernacle et tous les objets et vases sacrés qu’il devait contenir, Exod., XL, 9-11 ; mais nous ne pouvons douter qu’il n’y ait eu aussi une aspersion avec le sang. Saint Paul la mentionne expressément. Heb., ix, 21. Josèphe signale les deux cérémonies, l’onction avec l’huile sainte et l’aspersion avec le sang. Josèphe, Ant. jud., III, viii, 3, 6. — 4. Quant à la dédicace du temple de Salomon, qui est racontée III Reg., viii-ix, 9 ; II Par., v- vii, 22 ; Josèphe, Ant. jud., VIII, iv, 1-5, il n’est pas fait mention d’une aspersion avec le sang sur les murs du temple ; il est probable néanmoins qu’elle eut lieu, car nous voyons que la plupart des rites accomplis par Moïse dans la dédicace du tabernacle furent répétés dans la dédicace du temple de Salomon. La même observation s’applique au temple de Zorobabel, I Esdr., vi, 16-18, et à celui d’Hérode. Josèphe^ Ant. jud., XV, xi, 1-6.
3° Symbolisme. — Saint Paul nous le fait connaître, Heb., ix, 3. Si le sang des victimes sanctifie ceux qui étaient souillés en leur donnant cette pureté extérieure dont ils étaient privés par une souillure légale, combien plus le sang de Jésus-Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes ? Le sang des victimes était la figure ou sang de Jésus-Christ. Le sang des victimes purifiait tout, personnes et choses, en sorte que, dit saint Paul, « dans l’ancienne loi tout était purifié par le sang, et qu’il n’y avait aucun pardon de faute sans effusion de sang. » Heb., IX, 22. Ainsi le sang de Jésus-Christ efface les souillures de notre âme, et en dehors de lui nous ne pouvons espérer de pardon. I Joa., i, 7 ; Apoc. i, 5. Le sang des victimes a préservé les premiers-nés des Hébreux de la mort temporelle ; le sang de Jésus-Christ nous préserve de la mort éternelle. Apoc, y, 9. Le sang des victimes a scellé la première alliance de Dieu avec le peuple hébreu, Exod., xxiv, 8 ; Heb., ix, 18 ; le sang de Jésus-Christ est le principe et le gage du testament nouveau. Matth., xxvi, 28 ; I Cor., xi, 25. Par le sang des victimes furent dédiés et consacrés à Dieu le tabernacle et tous les objets sacrés de l’ancien culte ; par le sang de Jésus-Christ, nous sommes séparés de la masse des profanes, nous sommes « achetés, acquis » à Dieu, et consacrés à lui comme son peuple de prédilection. Act., xx, 28 ; Heb., xiii, 12 ; I Petr., i, 19. Voir Sacrifice.
IV. Aspersion avec l’huile sainte. — En général, l’huile sainte s’employait par onction ou par effusion. Toutefois, dans l’ancienne loi, nous trouvons quelques exemples d’aspersions proprement dites avec l’huile sainte. Dans la dédicace de l’autel des holocaustes, Moïse fit avec l’huile sainte sept aspersions sur cet autel, Lev., viii, 10-11 ; l'écrivain sacré emploie, pour exprimer ces aspersions, le même mot hébreu qu’il a employé pour les autres, c’est-à-dire le verbe nâzâh à la forme hiphil ; bien plus, il distingue expressément les deux cérémonies, l’aspersion et l’onction. Cf. Scheidius, Oleum unctionis, il, § 18, dans Ugolini, Thesaurus antiquitatum sacrarum, t. xii, p. 935-938. Parmi les rites de la purification des lépreux, nous trouvons encore l’aspersion avec l’huile, Lev., xiv, 15-16, 26-27 ; ce texte nous apprend que ce genre d’aspersion se faisait avec le doigt (l’index, disent les rabbins, dans Scheidius, loc. cit., p. 938). Pour le symbolisme, voir Huile d’onction.
V. Aspersion avec un mélange d’huile sainte et de sang. — Nous ne trouvons qu’un exemple de l’emploi de cette*matière dans une aspersion sacrée. Dans la consécration d’Aaron et de ses fils comme prêtres, Moïse, prenant l’huile d’onction et le sang qui était sur l’autel des holocaustes, fit avec les deux liquides mélangés des aspersions sur Aaron et ses vêtements, puis sur ses deux fils et leurs vêtements. Lev., viii, 30. En cela il ne faisait qu’exécuter les ordres précis qu’il avait reçus de Dieu lui-même. Exod., xxix, 21. Qu’il y ait eu là non pas des aspersions distinctes, tantôt avec l’huile, tantôt avec le sang, mais des aspersions avec les deux liquides mélangés, nous ne pouvons en douter ; c’est le sens naturel de ces deux passages, et, de plus, c’est l’interprétation commune des commentateurs juifs et chrétiens. Philon, De Vita Mosis, iii, Opera, Paris, 1640, p. 676 ; Cornélius a Lapide, In Lev., vm, 30 ; Ménochius, De republica Hebræorum, ii, 5, Paris, 1648, p. 130-132 ; Goodwin, Moses et Aaron, I, v, 3, Brème, 1694, p. 24-25 ; Carpzov, Apparatus antiquitatum Sacri Codicis, Leipzig, 1748, p. 66-67 ; Reland, Antiquitates sacræ, II, i, 6, Utrecht, 1708, p. 67-68 ; Jahn, Archæologia biblica, § 355, dans Migne, Sacræ Scripturæ cursus completus, t. ii, col. 1038 ; Leydekker, De republica Hebræorum, X, iii, 5, Amsterdam, 1704, p. 591.
VI. Acceptions diverses. — Nous trouvons encore, dans la Sainte Écriture, des « aspersions » faites avec de la cendre, en signe de deuil, II Reg., xiii, 19 ; Jer., xxv, 34 ; avec des parfums, Prov., vii, 17 ; avec de la poussière, II Mach., x, 25 ; avec une eau épaissie, II Mach., i, 20-21. Dieu nous est représenté faisant sur la terre comme une « aspersion » de neige, Eccli., xliii, 19. Le mot « asperger » est employé dans le sens métaphorique, soit par David ; « Vous m’aspergerez, ô mon Dieu, avec l’hysope, et je serai purifié, » Ps. L, 9 ; soit par saint Paul : « Ayant, par une aspersion intérieure, nos cœurs purifiés de leurs souillures. » Heb., x, 22. Dans Isaïe, lxiii, 3, et dans l’Apocalypse, XIX, 13, le Messie apparaît avec une robe tout
t aspergée de sang », pour marquer le triomphe remporté par lui sur ses ennemis, qu’il a immolés dans sa colère, et dont le sang a rejailli sur ses vêtements. Dans lsaïe, lu, 15, il est dit, au moins d’après la traduction de la Vulgate, que le Messie « aspergera beaucoup de nations » ; cette figure annonçait le sacrifice de Jésus, dans lequel il a répandu son sang pour tous les hommes et tous les peuples. Sur les difficultés de ce dernier verset, traduit difTéremment par les Septante, voir Gesenius, Commentar ûber den Jesaia, lii, 15, Leipzig, 1821, p. 174-176, et Thésaurus linguse hebrsex, p. 868 ; Rosenmùller, In Isaiam prophetam, lii, 15, Leipzig, 1820, p. 334-338. Un grand nombre de commentateurs modernes expliquent ce passage d’Isaïe de la manière suivante : « Ainsi il fera lever de nombreuses nations devant lui, » par respect pour sa personne, sens qui s’accorde avec le second membre du parallélisme : « Et les rois [eux-mêmes] se taisent » remplis d’étonnement. — Pour la défense de la traduction donnée par la Vulgate, Aquila, Théodotion, la Peschito et plusieurs modernes, voir Knabenbauer, Commentarius in Isaiam, t. ii, Paris, 1887, p. 293-295.
S. Many,
ASPHALTE. Voir Bitume,
- ASPHALTITE##
ASPHALTITE (LAC). Voir Morte (mer).
- ASPHAR##
ASPHAR (Xâxxoç’Adipâp ; Vulgate : lacus Asphar), endroit du désert de Thécué où, pour échapper aux poursuites de Bacchide, Jonathas et Simon vinrent camper avec la troupe des Juifs fidèles. I Mach., ix, 33. Thécué se retrouve aujourd’hui, avec son antique dénomination exactement conservée, dans Khirbet Teqou’a, au sud de Bethléhem. Le désert commence ainsi à deux lieues environ de cette dernière ville, et s’étend jusqu’à la mer Morte. Voilà pourquoi un certain nombre d’auteurs voient ici mention du lac Asphaltite, pensant que Xâxxoç’Auçôp est une corruption de Xâxxo ; ’AiwpaXTiTYiç. Citons entre autres Calmet, Les livres des Machabées, Paris, 1722, p. 149 ; M. de Saulcy, Histoire des Machabées, in-8°, Paris, 4880, p. 219 ; M. Guérin, Description de la Palestine, Judée, t. iii, p. 145. -Il faut bien remarquer cependant que Xâxxoç ne signifie pas lac, mais citerne, puits. Les Septante, en effet, emploient ce mot pour traduire l’hébreu be’êr, que la Vulgate rend elle-même par « puits », II Reg., xvii, 18, 19, 21 ; bô’r, II Reg., xxiii, 15, 16, 20 ; bô’rô{, Jer., h, 13 ; bôrôf, Gen., xxxvii, 20 ; Vulgate : « citernes. » Josèphe, Ant. jud., XIII, 1, 2, racontant le même fait, emprunte l’expression de l’écrivain sacré, tandis qu’en parlant du lac Asphaltite, il dit régulièrement Xtfivyj 'A<r<pa>TÏTi< ; . Cf. Ant. jud., i, ix ; IV, v, 1 ; IX, x, 1 ; Bell, jud., i, xxxiii, 5 ; III, x, 7 ; IV, viii, 4. Il s’agit donc ici d’un de ces réservoirs d’eau si importants en Orient, et particulièrement recherchés dans les contrées désertes. Or, à une heure et demie au sud de Teqou’a, se trouve un plateau où gisent des ruines appelées Khirbet Bir ez-Za’ferâneh, c’est-à-dire « ruines du puits de Za’ferânéh (ou du safran) ». Elles consistent en quelques arasements de maisons renversées, restes d’un ancien village, qui était alimenté d’eau par plusieurs citernes creusées dans le roc. Cf. V. Guérin, Judée, t. iii, p 149. Ne serait-il pas permis de voir dans l’arabe ez-Za’ferânéh, &M_ÂfcJI, 1’'Aaçâp du texte biblique, malgré Vain intercalé ? Cf. R. Riess, Bîbel-Atlas, Fribourg-en-Brisgau,
1887, p. 3.- ASPHENEZ##
ASPHENEZ (hébreu : ’ASpenaz ; Théodotion [dans nos éditions de la Bible grecque] : ’AoçavéÇ ; Septante : ’AëiecrôpÉ [Daniel secundum Septuagintae Chisiano codice, in-f°, Rome, 1772, p. 1] ; syriaque des tétraples : jLv*d)> Abiézer [Bugati, Daniel secundum editioneni I*XX interpretum ex tetraplis desumptam ex codice syro-estranghelq, m-4°, Milan, 1788, p. 8]), un des
principaux officiers de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Dan., i, 3. L’étymologie du nom est obscure. D’après Rédiger, dans Gesenius, Thésaurus linguse hebrmm, Addenda, p. 73, il viendrait du perse ou du sanscrit, et signifierait « nez de cheval » (sanscrit : açva, « cheval ; » nasa, « nez » ). Cf. Gesenius, Hebrâisches Handwôrterbuch, 9e édit. parMùhlau et Volck, 1883, p. 79 ; d’après Hitzig, Dos Buch Daniel, in-8°, Leipzig, 1850, p. 6, le premier élément du mot’éiék, serait hébreu, et le second, naç, serait zend, et’Aipenaz voudrait dire « eunuque ». M. Halévy, Journal asiatique, août - septembre 1883, p. 282-284, croit reconnaître dans ce nom le mot perse aspandj (avec chute de Yélif initial sipandji), « hôtel, lieu où l’on reçoit les hôtes ». « L’auteur hébreu, dit-il, p. 283, aurait ainsi appliqué à l’officier qui introduisait les hôtes étrangers dans le palais royal le nom de l’asile où ceux-ci étaient reçus et hébergés. » Il est néanmoins plus naturel de demander à l’assyrien, non au perse ou au sanscrit, l’explication de ce nom babylonien. Malheureusement il est altéré. Voici comment on peut l’expliquer d’après Fr. Lenormant : « Il n’y a guère moyen de douter, dit-il, qu’un r final n’en soit tombé ; car les Septante l’écrivent en conservant cet r, mais en laissant tomber une autre lettre, ’AêieoSpf, ou, dans quelques manuscrits, ’AêvsoSpi, c’est-à-dire >itj3N. Nous avons donc, comme altérations divergentes de la forme que portait le texte original, tjsutn et >-n » ii, ce qui impose de restituer cette forme en ti : bwn ou-itj3wn (’aSpenazar ou’asbenazar), transcription rigoureusement exacte d’un mot dont on a plusieurs exemples, Assa - ibni - zir, la dame (Istar de Ninive) a formé le germe. » La divination chez le* Chaldéens, in-8°, Paris, 1875, p. 182-183. Cf. J. Fabre d’Envieu, Le livre du prophète Daniel, t. i, 1888, p. 147.
Quoi qu’il en soit de l’étymologie douteuse de son nom, Asphenez était rab sarïsîm de Nabuchodonosor. La’Vulgate a traduit ce titre par « chef des eunuques », et cette traduction a été universellement acceptée jusqu’à nos jours, d’après le sens du mot hébreu sarîs. Mais une tablette cunéiforme du British Muséum (n° 82-7-14, 3570), contenant une liste de noms, écrit ce titre rabû-sa-reêu (rabû-sa-ri-e-su), c’est-à-dire « chef des têtes ou des princes », celui qui est chargé des princes royaux. Th. G. Pinches, Rab-saris, dans Y Academy, 25 juin 1892, p. 618. Cf. H. Winckler, Untersuchungen zur altorienlalischen Geschichte, in-8°, Leipzig, 1889, p. 138.
Asphenez fut chargé par Nabuchodonosor de choisir un certain nombre de jeunes captifs d’origine juive et de race royale, destinés à être élevés dans l’école du palais royal, pour y être instruits dans la langue et les sciences des Chaldéens. Il reçut en même temps l’ordre de les entretenir et de veiller sur eux. Parmi ces enfants de Juda se trouvèrent Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Selon l’usage du pays, Asphenez leur donna des noms chaldéens : Baltassar, Sidrach, Misach et Abdénago. De peur de violer la loi mosaïque en mangeant des viandes impures, Daniel demanda à Asphenez, pour lui et ses compagnons, l’autorisation de ne manger que des légumes et de ne boire que de l’eau. Le rab sarïsîm hésitait à le permettre, craignant que ce régime ne fut nuisible à leur santé, et appréhendant dans ce cas la colère du roi. Daniel lui proposa d’être soumis, avec Ananias, Misaël et Azarias, à une épreuve de dix jours ; il y consentit, et elle fut tout à fait à leur avantage. Dan., i, 3-15. F. Vigouroux.
- ASPIC##
ASPIC (hébreu : pétén, « l’animal qui se recourbe, » et’akSûb, même sens ; Septante : àainç ; Vulgate : aspis). L’aspic de notre Vulgate désigne donc deux espèces différentes de serpent, le péten et le’aksûb.
1° Le pétén est le naja ou vipère haje, le cobra des Égyptiens. C’est un ophidien de l’ordre des vipéridés, dont on connaît deux espèces : le naja tripudians, ou serpent à lunettes, qui habite l’Inde et la Perse, et le naja aspis, qui se trouve en Afrique et au sud de la Palestine Le
naja aspis (fig. 304) a la taille des grandes couleuvres et atteint de un à deux mètres. Il est généralement de teinte verdàtre, et a le ventre plus foncé que le dos et parfois strié de bandes transversales. Il porte au cou des taches brunes, qui toutefois n’affectent pas la forme de lunettes.
[[File: [Image à insérer]|300px]]
304. — Naja aspis ou vipère haje.
Il peut élargir ses premières côtes et dilater considérablement son cou. Quand il craint quelque danger, il dresse la partie supérieure de son corps en se faisant une base de ses vertèbres inférieures, horizontalement disposées en cercle. Les monuments égyptiens le représentent souvent dans cette position (fig. 305). Ses crochets venimeux sont cannelés, et son poison est d’une telle violence, qu’il donne la mort en quelques instants à l’homme et aux animaux. Cf. Élien, De anim., ii, 24 ; vi, 38 ; Plutarque, Moral., p. 380 ; Oppien, Cyneget., iii, 433. C’est à la morsure de ce serpent que Cléopâtre demanda la mort : « Elle eut l’intrépidité de porter les mains sur les redoutables aspics, pour en faire passer le noir poison dans ses veines. » Horace, Carm. I, xxxii, 26. Les charmeurs orientaux savent pourtant rendre le naja incapable de nuire, soit en épuisant son venin, soit en lui arrachant ses crochets, soit même en l’apprivoisant. Son nom égyptien est ârâ. Horapollon, 1, 1, dit que « ce serpent a la queue repliée sous le reste du corps ; les Égyptiens, continue-t-il, l’appellent oûpaïoç, les Grecs pota-tXia-xoç, et son image en or est placée sur la tête des dieux. » Cet ornement, appelé, d’après ce passage, urseus, est en effet placé sur la coiffure des dieux et aussi des rois (fig. 306).
La Bible parle du venin terrible de l’aspic comme d’une cause de mort inévitable. Deut., xxxii, 33 ; Job, xx, 14, 16. Il est donc très dangereux de mettre le pied sur la bête ou la main dans son trou. Ps. xc (xci), 13 ; Is., xi, 8 ; Marc, xvi, 18. Le pouvoir faire impunément est la marque d’une protection divine, qui s’exercera surtout spirituellement au temps de la loi nouvelle. Le venin de l’aspic est le symbole de la calomnie, et le serpent qui refuse d’obéir au charmeur est l’image du pécheur endurci, à la langue perfide. Ps.cxxxix(cxl), 4 ; lvii (uvm), 5, 6.— VoirW. Pleyte, Le naja, dans les Proceedings of the Society of Biblical
— L’aspic dressé.
Temple de Semaéh.
xriu 8 dynastie.
D’après Lepslus, Denk maler, Abth. iii, pi. 56.
Archseology, novembre 1890, t. su, p. 14 ; A.M.C. Duméril et G. Bibron, Erpétologie générale ou Histoire naturelle des reptiles, t. vii, in-8°, Paris, 1854, p. 1275 ; Description de l’Egypte, Histoire naturelle, t. i, 1809, p. 157-160. 2° Le second serpent appelé « aspic » par la Vulgate, le 'aksûb, n’est nommé qu’une seule fois dans la Bible
306. — L’urœus sur la coiffure royale de Séti I « r. Bas-relief û'Abydos, d’après une photographie.
hébraïque, Ps. cxl (cxxxix), 4 : « Sous leurs lèvres est le venin du 'aksûb. » Les Septante, la Vulgate en cet endroit et Ps. xiii, 3, et saint Paul, Rom., iii, 13, traduisent ce mot par « aspic ». On ne lui a pas trouvé d'équivalent en arabe, et d’ailleurs, d’après son étymologie, il peut s’appliquer à toute espèce de serpent. Le 'aksûb est, en tout cas, très certainement une vipère des
[[File: [Image à insérer]|300px]]
307. — Le toxiooa.
plus venimeuses. La supposition la plus vraisemblable qu’on ait faite à son sujet l’identifie avec le toxicoa d’Egypte et du nord de l’Afrique, connu encore sous les noms d’echis arenicola et de « scytale des pyramides ». Voir Description de l’Egypte, t. i, p. 151-154. On le trouve aussi en Syrie. C’est un vipéridé dont la taille varie de trente centimètres à un mètre, mais dont le venin est très redoutable (fig. 307). Les deux autres serpents les plus venimeux de ces contrées, la vipère haje (pé(én) et le céraste (Sefîfôn) ayant déjà leur nom hébreu, il est bien possible que le 'aMûb représente le toxicoa.
ASRAËL (hébreu : 'Àiar'êl, « Dieu a lié [par un vœu] ; » Septante : 'EuepviX), un des fils de Jaleléel, de la tribu de Juda. I Par., iv, 16.
- ASRIEL##
ASRIEL (hébreu : 'AsrVêl, « vœu de Dieu ; » Septante : 'Eo-pttiX, 'hÇi^X), fils de Galaad et descendant de Manassé. Num., xxvi, 31. Il est nommé Esriel, Jos., xvii, 2 ; 1 Par*, 711^14.
- ASRIÉLITES##
ASRIÉLITES (hébreu : Hâ'aêrïyêlî ; Septante : d 'Eopi-rl(), famille de la tribu de Manassé, descendue d’Asriel. Num., xxvi, 31.
- ASSARIUS##
ASSARIUS, monnaie romaine. Voir As.
ASSAUT. Voir Siège des villes.
- ASSÉDIM##
ASSÉDIM (hébreu : Hassiddim, avec l’article, « les flancs, les pentes » ; Septante : t<ôv Tupîuv), une des villes fortifiées de la tribu de Nephthali. Jos., xix, 35. La traduction des Septante, qui paraît singulière, s’explique très bien par le changement du i, daleth, en-i, resch ; au lieu de D » tsn, Hassiddim, ils ont lu nnsn, Hassorim, « : les Tyriens, »
tandis que, dans la version syriaque, on a lu jVts, $idôn.
Cette confusion vient aussi probablement de ce que les traducteurs ont pris le mot suivant is, Sér, pour-iï, $ôr, nom
de la ville de Tyr. Cette lecture est inadmissible, car Tyr et Sidon, loin de toucher même à la tribu de Nephthali, en étaient séparées par la tribu d’Aser. Dans le Talmud de Jérusalem, Megillah, i, 1, Hassiddim est rendu par Kefar PZattya ou Hitya, que beaucoup d’auteurs identifient avec. Hattin, au nord-ouest de Tibériade ; cf. A. Neubauer, La géographie du Talmud, in-8°, Paris, 1868, p. 207 ; pu, plus précisément, selon M. V. Guérin, avec Hattin el-Kedim, « Hattin l’ancien, » ruines qui couronnent une colline élevée, au sud du village actuel et au nord d’une autre colline plus célèbre, appelée Qoroun ou « cornes de » Hattin. « Ces ruines sont actuellement très confuses. On distingue seulement les vestiges d’un mur d’enceinte construit avec des pierres basaltiques de toute grandeur, et au dedans de cette enceinte renversée de nombreux tas de matériaux amoncelés au milieu des broussailles, restes de maisons démolies. Çà et là on remarque quelques arbres séculaires, tels que figuiers et oliviers. » Description de la Palestine, Galilée, t. i, p. 193. Ce qu’il y a de certain, c’est que eet emplacement cadre parfaitement avec la position des villes mentionnées immédiatement après, Émath, Reccath et Cénéreth, qui, quelle que soit leur identification, se trouvaient évidemment sur les bords du lac de Génésareth. Cependant quelques auteurs, comme Knobel, placent Assedim à Khirbet es-Saudéh, un peu à l’ouest de la pointe méridionale du lac de Tibériade (c’est probablement le Khirbet es-Saïadéh de V. Guérin, Galilée, 1. 1, p. 268, ou le Khirbet Seiyadéh de la grande carte anglaise, Old and New Testament Map of Palestine, Londres, 1890, feuille 6). Cet emplacement rentre parfaitement dans les limites de la tribu de Nephthali, quoi qu’en dise Keil, Josua, in-8°, Leipzig, 1874, p. 161. K. Furrer, Pie Ortschaften am See Genezareth, dans la Zeitschrift des Peutschen Palàstina - Vereins, t. ii, 1879, p. 58, indiqué un autre endroit, es-Sattîyéh, situé quelques heures plus loin, au nord d’Hattin, dans VOuadi Elvmoud. Voir Nephthali (tribu et carte).
ASSEM (hébreu : HâSem ; Septante : 'Ao-in). Il semble que Benê-HâSem, traduit dans laVulgate par filii Assern, est un nom propre individuel : Bené-hàsem le Gézonite, un des vaillants guerriers de l’armée de David. I Par., xi, 33. Dans la liste parallèle, II Reg., xxiii, 32, on lit filii Jassen (hébreu : Benê-Yasen).
- ASSEMBLÉES##
ASSEMBLÉES (hébreu : mô'êd, 'âséréf, 'êdâh, qâhâl ; Septante : èxxXriuia, auvayârflj tav^yiip' ; ; Vulgate : cœtus, concilium, concio, congregatio, conventus, ecclesia, synagoga). Ce mot a deux sens différents dans l'Écriture. Il désigne soit l’ensemble du peuple Dieu, soit
la réunion d’une partie plus ou moins considérable de ce peuple dans un lieu donné.
I. L’assemblée du peuple de Dieu. — C’est l’ensemble de tous ceux qui appartiennent officiellement à la nation et à la religion juive, soit par naissance, soit par naturalisation. Les termes 'âdât ttrâ'êl, « assemblée d’Israël ; » 'âdât benê Isrâ'êl, « assemblée des enfants d’Israël ; » 'âdât Yehovâh, « assemblée de Jéhovah ; » qehal Iérâ'êl, « assemblée d’Israël ; » qehal Yehovâh, « assemblée de Jéhovah ; » qehal hâ'èlôhîm, « assemblée de Dieu, » ou simplement haqqâhâl, « l’assemblée, » ont donc un sens analogue à celui que comporta, depuis Notre-Seigneur, le mot « Église » ; ils impliquent en même temps cet ensemble de droits civils et religieux qui s’appelait 7toXii£(a chez les Grecs, et civitas chez les Romains. L’assemblée, c’est tout le peuple hébreu constitué en corps de nation. Lev., x, 6 ; xvi, 17 ; Num., i, 2 ; xra, 27, etc. ; Ps. lxi, 9 ; lxxiii, 2 ; Eccli., xlvi, 17 ; l, 22, etc. ; Prov., v, 14 ; I Mach., iii, 13 ; II Mach., ii, 7. Elle est divisée en tribus, les tribus en familles, les familles en maisons, chaque maison comprenant tous les descendants d’un ancêtre plus rapproché. A la têle de l’assemblée se trouvent les anciens et les « chefs de l’assemblée convoqués à la réunion », Num., xvi, 2, engageant par leurs décisions la responsabilité de tout le peuple. Jos., ix, 18. C’est par leur intermédiaire que Moïse et Aaron s’adressent « à toute l’assemblée des enfants d’Israël », pour faire connaître leur mission et prescrire la célébration de la première Pâque en Egypte. Exod., ni, 16 ; xii, 3, 21, 47. "Voir Anciens.
Si quelque étranger voulait être admis à faire partie de l’assemblée, et par conséquent de la nation, il devait se faire circoncire et s’engager à pratiquer toute la loi. Exod., xii, 48. Cette faculté était interdite aux eunuques, aux fils de prostituée, aux Ammonites et aux Moabites. Deut., xxm, 1-3 ; II Esdr., xiii, 1 ; Lam., i, 10. Les Iduméens et les Égyptiens n'étaient admis à la naturalisation qu'à la troisième génération. Deut., xxiii, 8. Pour certaines fautes, on était mis « hors de l’assemblée », c’est-à-dire excommunié. On cessait alors de faire partie du peuple de Dieu. Exod., xii, 19 ; Num., xix, 20 ; I Esdr., x, 8 ; Mich., ii, 5 ; Joa., ix, 22 ; xvi, 2.
II. Les assemblées extraordinaires du peuple. — 1° À l'époque du tabernacle. — Pour convoquer le peuple devant le tabernacle, on faisait une simple sonnerie avec deux trompettes d’argent. Num., x, 3, 7. On ne peut guère déterminer ce qu’il faut entendre par « tout le peuple ». Parfois il ne s’agissait que des anciens et des chefs de tribus, représentants de toute la nation. D’autres fois tous les hommes, ou à peu près, étaient convoqués, et alors ils prenaient place derrière leurs chefs de tribus et leurs anciens. Au désert, l’assemblée est convoquée pour recevoir les tables de la loi, Exod., xxxiv, 32 ; Deut., ix, 10 ; xviii, 16 ; pour entendre proclamer à nouveau l’institution du sabbat, Exod., xxxv, 1 ; pour assister à la consécration d’Aaron, Lev., viii, 3, 4 ; pour être témoin du châtiment de Coré, Num., xvi, 19 ; pour voir jaillir l’eau miraculeuse, Num., xx, 8, 10 ; xxi, 16 ; pour recevoir les instructions de Moïse, Lev., xix, 2, et entendre son cantique. Deut., xxxi, 30. Sous Josué, il y a des assemblées du peuple, en présence de l’arche, à Galgala, après le passage du Jourdain, Jos., iv, 21 ; pour la circoncision générale, Jos., v, 2-3 ; au mont Hébal et au mont Garizim, pour la lecture de la loi, Jos., viii, 29-35 ; à Silo, pour y fixer le tabernacle, Jos., xviii, 1, et une autre fois pour y protester contre l'érection d’un autel sur les bords du Jourdain, parles tribus transjordaniques, Jos., xxii, 12 ; enfin à Sichem, pour y faire profession de fidélité au Seigneur, Jos., xxiv, 1. Pendant la période des Juges, il n’est parlé que d’une assemblée de quatre cent mille hommes à Maspha, « devant le Seigneur, » pour y aviser aux moyens de châtier les Benjamites. Jud., xx, 1-2. Sous Samuel, il y a des assemblées générales à Maspha (Masphath), pour y renoncer aux idoles et faire pénitence,
I Reg., vil, 6, et, plus tard, pour la proclamation de Saûl, I Reg., x, 17 ; à Galgala, pour y entendre de nouveau proclamer Saûl, I Reg., xi, 14, 15, et à Ramatha, pour les funérailles du prophète. Ces dernières assemblées, signalées à raison de leur caractère théocratique, n’ont toutefois pas lieu en présence de l’arche.
David' convoque le peuple pour son sacre à Hébron, I Par., xi, 1-3, et ensuite pour le transport de l’arche de la maison d’Abinadab à celle d’Obédédom, Il Reg., vi, 1 ; I Par., xiii, 1-6, puis à Sion même. I Par., xv, 3. À propos de cette translation, le livre des Paralipomènes, xiii, 1-6, fournit de précieuses indications sur la composition et le fonctionnement de l’assemblée d’Israël. David réunit « les chefs de mille, les chefs de cent, tous les chefs », et il dit à « toute l’assemblée d’Israël : Si cela vous plaît, et si la parole que je vous dis vient du Seigneur notre Dieu, envoyons à nos autres frères dans toutes les régions d’Israël, aux prêtres et aux lévites, qui habitent dans les villes de leurs pâturages, pour qu’ils se réunissent à nous ». Par « toute l’assemblée », il faut donc entendre ici, comme dans bien d’autres cas, la réunion des représentants de la nation. En conséquence de cette convocation, « tout Israël, » du ruisseau d’Egypte à Émath, sur l’Oronte, se trouva réuni. Or le second livre des Rois, vi, 1, dit qu’en cette circonstance « tous les délégués d’Israël furent trente mille ». L’assemblée de « tout Israël » était donc loin de comprendre la totalité de la nation. David convoqua encore tout le peuple pour le sacre de Salomon, I Par., xxix, 20-22, et celui-ci fit Une nouvelle assemblée bientôt après à Gabaon, où était le tabernacle. II Par., i, 3.
2° À l'époque du temple. — Tout Israël fut appelé pour assister au transfert définitif de l’arche et à la dédicace du temple. III Reg., viii, 14, 22, 55 ; II Par., v, 1-6 ; vii, 8. Quelques assemblées sont mentionnées dans la suite de l’histoire : quand le peuple est réuni à Sichem pour la proclamation de Roboam, III Reg., xii, 1 ; quand le prophète Élie convoque les Israélites au mont Carmel, sous Achab, III Reg., xviii, 19, 21 ; quand Josaphat assemble dans la maison du Seigneur, pour y implorer le secours divin, les hommes de Juda et de Jérusalem, II Par., xx, 5 ; quand Ézéchias invite ceux d’Israël et ceux de Juda à célébrer la Pâque en commun. II Par., xxx, 13. Au retour de la captivité, Esdras appelle tout le peuple à Jérusalem pour la consécration de l’autel. I Esdr., iii, 1. Il réunit les hommes, les femmes et les enfants, dans deux assemblées consécutives, pour demander pardon au Seigneur. I Esdr., x. 1, 9. Enfin Judas Machabée reconstitue l’assemblée du peuple, I Mach., iii, 13, et la réunit pour la consécration du nouvel autel, iv, 59.
III. Les assemblées religieuses ordinaires. — 1° Devant le tabernacle et au temple. — La loi portait : « Trois fois tous les ans chaque homme se présentera devant le Seigneur Dieu. » Exod., xxiii, 17. Le Seigneur Dieu résidait au-dessus de l’arche ; c’est donc devant le tabernacle ou au temple qu’il fallait se présenter. Les trois époques désignées étaient la Pàque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Exod., xxxiv, 18, 22-24 ; Deut, xvi, 16. Ces fêtes étaient les mô'âdîm par excellence, et le Talmud les appelle regâlîm, « pèlerinages, » parte que les hommes se rendaient à Jérusalem pour les célébrer. Les malades et les vieillards étaient dispensés du voyage. Ceux qui se trouvaient trop éloignés ne venaient que pour la Pâque, et ceux qui habitaient à l'étranger faisaient le pèlerinage a u moins une fois dans leur vie. Les femmes n'étaient pas soumises à la loi, non plus que les enfants ; mais beaucoup aimaient à se présenter devant le Seigneur, au moins à la fête pascale. I Reg., i, 7 ; ii, 19 ; Luc, ii, 41. Ces solennités amenaient donc devant le tabernacle ou au temple des multitudes considérables. Pendant la fête, qui durait ordinairement sept jours, les prêtres et les lévites accomplissaient leurs différentes fonctions, sans que l’assemblée, dont les parvis du temple ne pouvaient contenir qu’une faible partie, fût obligée de s’y associer directement. Dans
le parvis d’Israël et dans celui des femmes, il était possible de contempler les rites sacrés et de prier ; dans le parvis des gentils, le recueillement était d’autant moins aisé que la joie du peuple y éclatait plus bruyante, et que la loi autorisait même, surtout à la fête des Tabernacles, d’y manger et d’y boire. Cf. Deut., xiv, 23-26 ; Is., lxii, 9. Si grande que fût la multitude, chacun avait le temps, pendant la durée de l’octave, de pénétrer dans l’enceinte sacrée, d’y prier et d’y faire offrir des sacrifices particu-* liers. Les Psaumes graduels, cxix-cxxxiii, expriment les sentiments de ceux qui se rendaient à ces solennelles assemblées. Chacune avait d’ailleurs son caractère particulier : à la Pâque, on immolait les agneaux ; à la Pentecôte, on fêtait la clôture de la moisson ; à la fête des Tabernacles, on habitait dans des tentes de feuillages, et l’on entendait la lecture de la loi. Deut., xxxi, 11 ; II Esdr., viii, 9-12. Ces assemblées tenaient une grande place dans la vie du peuple juif. Aussi le prophète gémit-il amèrement quand « les routes de Sion se lamentent, parce qu’il ne vient plus personne à la solennité, et que le Seigneur a mis en oubli à Sion la fête et le sabbat ». Lam., i, 4 ; ii, 6.
Outre ces trois grandes solennités, on célébrait encore les néoménies et le sabbat. Num., xxviii, 11-15 ; I Par., xxm, 31 ; II Par., ii, 4 ; I Esdr., iii, 5. Ces jours-là, on offrait des sacrifices plus importants, et les Israélites de Jérusalem et du voisinage s’assemblaient au temple. Les prophètes font allusion à ces assemblées, ainsi qu’aux précédentes : « Le Seigneur fera cesser la joie, les fêtes, les néoménies, le sabbat et les assemblées… Que ferezvous au jour de la solennité, au jour de l’assemblée ? » Ose., Il, 11 ; IX, 5. « Lorsque vous venez en ma présence, qui réclame ces dons de vos mains, quand vous entrez dans mon temple ? Je ne souffrirai plus vos néoménies, vos sabbats et vos autres fêtes ; vos assemblées sont pleines de malice. » Is., i, 12, 13. Ces assemblées sont, au contraire, agréables au Seigneur quand on s’y rend pour faire pénitence, Joël, i, 14 ; ii, 15, pour offrir de dignes sacrifices, Eccli., l, 15, ou pour chanter les louanges de Dieu. Ps. xxi, 23, 26 ; xxv, 12 ; xxxiv, 18 ; xxxix, 10 ; lxvii, 27 ; lxxxviii, 6 ; cvi, 32 ; ex, 1 ; cxlix, 1.
Enfin chaque matin, dans le temple, s’offrait le sacrifice quotidien. Une sonnerie de trompettes en annonçait le commencement, et des signaux donnés par des sonnettes permettaient de suivre toutes les phases de la cérémonie. Le soir, à trois heures, on faisait un autre office, à la suite duquel le prêtre prononçait la bénédiction sur le peuple. Mischna, Tamid, iv, v, vu. On immolait un agneau, comme le matin, et on offrait le vin et la farine, au nom de toute la nation. Les pieux Israélites de Jérusalem et les Juifs de la province où de l'étranger, qui se trouvaient de passage dans la ville, choisissaient de préférence l’heure des cérémonies sacrées pour se rendre au temple. Act., iii, 1. Ils se tenaient dans les parvis d’Israël et des femmes ; le premier, large de soixante mètres, et profond seulement de cinq, n'était accessible qu’aux hommes ; le second, formant un carré de soixante mètres de côté, s’ouvrait à tous les Juifs, hommes et femmes. « Le peuple n’assistait probablement pas sans prier aux cérémonies religieuses du matin et du soir. En y assistant, il prenait part aux prières et aux chants, qui s’introduisirent dans le culte sous les règnes de David et de Salomon. Les habitants de Jérusalem faisaient' de préférence leur prière dans les parvis du temple. » Dœllinger, Paganisme et judaïsme, x, 2, in - 8°, Bruxelles, p. 143.
2° Dans les synagogues. — En temps ordinaire, la fréquentation du temple n'était possible qu'à ceux qui habitaient dans le voisinage. Le mot « synagogue » désigne à la fois le lieu où l’on se réunissait et ceux qui faisaient partie de la réunion. Voir Synagogue. On s’y assemblait pour entendre la lecture et l’explication de la loi et pour prier. Les assemblées principales y avaient lieu le jour du sabbat, et aussi le lundi et le jeudi. De
plus, la synagogue s’ouvrait trois fois par jour pour la prière. Dans ces assemblées, on trouvait ce qui ne se donnait pas au temple, l’explication de la loi et l’instruction morale. C’est là, en effet, que se faisaient entendre les sages. Eccli., xv, 5 ; xxi, 20 ; xxiv, 2 ; xxxviii, 37. NotreSeigneur prit souvent la parole dans ces assemblées en Galilée, et plus tard les Apôtres et les disciples firent entendre l'Évangile dans les synagogues du monde entier. — Quand, pour une raison quelconque, les Juifs qui vivaient parmi les nations ne pouvaient se bâtir une synagogue, ils avaient au moins un oratoire, ou un endroit clos en plein air, où ils s’assemblaient pour prier. Cet endroit et cette assemblée prenaient le nom de irpoGeu^ ! * prière. » Les deux mots de la Bible grecque, tfuvaytflYï) et èxxXn]ain, servant à désigner les anciennes assemblées du peuple de Dieu, ont passé dans la langue chrétienne avec des sens bien différents : la Synagogue est le peuple juif, avec ses rites et ses croyances antiques, mais aussi avec son aveuglement et son attente stérile d’un Messie déjà venu ; l'Église est le peuple nouveau, qui croit à ce Messie et profite des lumières et des grâces apportées par lui sur la terre. H. Lesêtre ;
- ASSENSIO Michel##
ASSENSIO Michel, frère mineur de la Régulière Observance de la province d’Aragon, réédita et augmenta l’ouvrage de son confrère du xvie siècle, François de Robles : Copia, sive ratio accentuum omnium fere dictionurn difficilium, tant linguse latinse quam hebraicee, nonnuUarumque grasearum, sed prxcipue earum quse in Bïbliis, Breviario et Martyrologio romano reperiuntur, in-8°, Saragosse, 1621, 1628. P. Apollinaire.
- ASSEOIR##
ASSEOIR (S’J et se lever est une locution hébraïque qui désigne l’ensemble des actions de l’homme, parce que « se lever et s’asseoir » en est comme le résumé, Ps. cxxxviii, 2 ; cxxvi, 2 ; Lament., ra, 63, de même que « entrer et sortir », IPar., i, 10 ; cf. IIReg., iii, 25, IIIReg., m, 7 ; IV Reg., xix, 27 ; Ps cxx, 8 ; Is., xxxvii, 28. — Sur la manière dont s’asseyaient les Hébreux, voir Siège 1.
- ASSIDÉENS##
ASSIDÉENS (Septante : 'AaiSaïoi ; Vulgate : Assidœi). Ce nomvient de l’hébreu /fàsîdîni, « les hommes pieux, » les fidèles serviteurs de Dieu. Prov., ii, 8 ; Ps. xxxix, 5 ; xlix, 5 ; cxlviii, 14 ; cxlix, 1, 5, etc. Du temps des Machabées, les Juifs infidèles, par opposition aux Assidéens, sont appelés « les impies », o àaeëeïc, I Mach., iii, 8 ; vl, 21 ; vil, 5, etc. ; « les adversaires de la loi, » oi #vo[aoi, I Mach., iii, 8 ; ix, 23, etc. ; « les transgresseurs de la loi, » oî itapâvofioi, I Mach., i, 11. Il est à croire qu’au retour de la captivité, les hommes pieux et intelligents qui se groupèrent autour d’Esdras et de Néhémie, pour les seconder dans leur œuvre, furent distingués peu à peu sous le nom de fyâsîdîm, et léguèrent cette appellation aux héritiers de leur zèle. Ce nom devint dès lors une désignation officielle. Les Assidéens durent voir avec effroi le péril que faisait courir à la foi religieuse de leur peuple l’influence des princes grecs, Ptolémées et Séleucides. Ils redoublèrent certainementd’efforts pour sauver les mœurs antiques, mises à une rude épreuve par le contact de plus en plus fréquent de la civilisation et de la corruption grecques. Comme il arrive toujours, leur zèle ne fut pas du goût de tous, et il y eut parmi leurs compatriotes des Juifs « hellénistes », visant à accommoder les préceptes mosaïques avec les mœurs nouvelles, et au besoin sacrifiant totalement les premiers, au grand scandale du peuple, toujours favorable aux anciennes coutumes. La persécution d’Antiochus r^ Épiphane.fit passer la crise à l'état aigu. Quand Mathathias et ses fils appelèrent leurs compatriotes à la résistance, « la troupe des Assidéens, vaillante et forte en Israël, se joignit à eux, avec tous ceux qui tenaient fermement à la loi, et tous ceux qui fuyaient devant les calamités. » I Mach., ii, 42, 43. Les Assidéens formaient donc une sorte d’association, qui ne comprenait même
pas tous les zélateurs de la loi. Ils aidèrent puissamment à la résistance contre le tyran, et s’acquirent même un renom considérable dans la lutte. Lorsque, en effet, Alcime, ce pontife apostat qui devait sa dignité à Démétrius I er Soter, voulut payer par la trahison de ses frères la dette contractée envers le prince, il dit au roi : « Ceux d’entre les Juifs qu’on nomme Assidéens, et à la tête desquels est Judas Machabée, entretiennent la guerre, excitent des séditions, et ne souffrent pas que le royaume soit en paix. » II Mach., xiv, 6 ; I Mach., vii, 6. Cependant, quand ils virent Alcime, devenu grand prêtre par la faveur du roi, jouer en public un rôle conciliateur, ils se laissèrent abuser par ces dehors hypocrites, et s’imaginèrent que les Machabées montraient trop d’intransigeance. C’est pourquoi « une troupe de scribes vinrent auprès d' Alcime et de Bacchide, à la recherche du droit, et les Assidéens, qui étaient les premiers parmi les enfants d’Israël, réclamèrent d’eux la paix, en se disant : Cet homme, qui est venu avec les armées, est un prêtre de la race d’Aaron ; il ne nous maltraitera pas ». I Mach., vii, 13, 14 (grec). Ils furent trop confiants, et mal leur en prit. Alcime s’empara de soixante d’entre eux et les fit périr le même jour. Cette tendance des Assidéens à s'éloigner des Machabées pour se rapprocher de l’apostat, et la manière dont ils en furent récompensés, leur firent grand tort aux yeux de la nation. Ayant perdu leur raison d'être, ils disparurent de l’histoire vers l'époque de Jonathas. Or c’est précisément à propos de la souveraineté de Jonathas que Josèphe fait mention pour la première fois d’esséniens, de pharisiens et de sadducéens. Ant. jud., XIII, xii, 2 ; Bell.jud., i, iii, 5. Les sadducéens se recrutèrent naturellement parmi les Juifs partisans du pouvoir étranger et des mœurs helléniques. Les Assidéens se fondirent soit avec les pharisiens ou « séparés », qui prétendaient garder une attitude nettement hostile vis-à-vis des sadducéens et de la civilisation grecque, soit avec les esséniens, qui renoncèrent à toute polémique pour se vouer à une vie ascétique. Voir Drusius, De Hasidseis quorum mentio in libris Machabseorum libellus, 1603 ; Hamburger, RealEncyclopâdie fur Bibel und Talmud, Abth. ii, p. 132 ; E. Schùrer, Geschichte des jûdischen Volkes, ^' édit., t-I,
p. 157,- ASSISTANCE##
ASSISTANCE, ASSISTANTS dans les synagogues. Voir Synagogue.
ASSOMPTION. Sous ce nom on désigne ordinairement la résurrection de la sainte Vierge et son entrée triomphante dans le ciel en corps et en âme. Dans cet article, nous allons : 1° dire ce qu’il faut penser de la réalité du mystère de l’assomption ; 2° exposer ce que nous savons des circonstances dans lesquelles il s’accomplit ; 3° retracer l’histoire de la fête instituée par l'Église pour célébrer le souvenir de la résurrection glorieuse de la Mère de Dieu.
I. Réalité de l’assomption corporelle. — L’assomption corporelle de la sainte Vierge n’est pas une vérité de foi catholique, mais ce qu’on appelle une vérité de religion ou de doctrine théologique. Elle n’a été l’objet d’aucune définition proprement dite. Néanmoins on ne peut nier que l'Église ne la favorise et ne l’approuve, ainsi que le dit très justement Baronius, dans ses notes sur le Martyrologe romain, 15 août : « Dei Ecclesia in eam partem propensior videtur, ut una cum carne assumpta sit (Maria) in cœlum. » Cette approbation se présente à nous sous deux formes différentes, à savoir : dans l’attitude qu’observe l'Église vis-à-vis du consentement des théologiens, et dans la liturgie.
Nous avons nommé en premier lieu le consentement des théologiens. Nous n’avons pas ici à prouver ce consentement. Les docteurs scolastiques s’accordent si unanimement à enseigner l’assomption corporelle de Marie, qu’il serait inutile de recueillir leurs témoignages. Ce que
nous voulons faire remarquer, c’est qu’ici comme toujours la croyance des docteurs n’est que le reflet de la croyance de l'Église. C’est sous le contrôle de l'Église que les théologiens enseignent. En les laissant défendre l’assomption, l'Église a évidemment donné à leur enseignement une approbation tacite.
La liturgie offre, disons-nous, une seconde forme de cette approbation. Sans doute les prières liturgiques insistent surtout sur le triomphe spirituel de Marie au ciel, et sur la puissance dont elle y est investie. Pourtant les homélies de saint Jean Bamascène et de saint Bernard, que saint Pie V a introduites dans le Bréviaire, prouvent que l'Église entend célébrer la résurrection et l’assomption corporelle de la Mère de Dieu, non moins que la gloire dont son âme fut remplie. — Le nom lui-même de la fête, Assumptio, dépose en faveur de cette même croyance. Nous n’ignorons pas que ce terme était employé primitivement pour désigner la mort d’un saint, et qu’ainsi il était synonyme des expressions transitus, exitus. Mais, en le réservant à la sainte Vierge, l'Église lui a évidemment donné un sens spécial. Il faut donc reconnaître que le mot assumptio désigne un privilège propre à Marie, privilège qui ne peut être que celui de la résurrection et de l’entrée au ciel en corps et en âme.
Si l'Église approuve et recommande la croyance à l’assomption corporelle, il s’ensuit que cette croyance s’impose à nous dans une certaine mesure. C’est du reste ce dont conviennent tous les théologiens. Ils ne vont pas jusqu'à taxer d’hérésie celui qui se permettrait de dire ou de penser que le corps de Marie est resté dans le tombeau ; mais ils n’hésitent pas à le déclarer coupable d’une grande témérité : « Beatam Virginem non esse in cœlos cum corpore assumptam petulanti temeritate diccretur. » Ainsi s’exprime Melchior Cano au liv. xii, chap. x, de ses Lieux théologiques. Suarez tient le même langage, 3= part., Disp. 25, sect. 2 ; Baronius, dans ses Annales, ad annum 48, § 17, n’est pas d’un autre avis. Et comme, selon la remarque de Thomassin, on ne se trompe pas en acceptant les opinions que l'Église juge probables, sans les ériger en dogmes, il faut conclure avec ce savant théologien qu’on ne doit pas douter que le corps de.la Mère de Dieu n’ait fait son entrée au ciel avec son âme. — Mais, par cela même qu’il s’impose à nous, dans la mesure que nous venons de préciser, le mystère de l’assomption corporelle doit pouvoir être prouvé, et il importe d’exposer les preuves sur lesquelles repose notre croyance.
La première question qui se présente dans un Dictionnaire de la Bible est de savoir si l’assomption corporelle de la sainte Vierge peut être démontrée par la. Sainte Écriture. Nous répondrons sans hésiter qu’on ne saurait trouver, dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, aucun texte dont le sens littéral soit de nature à établir la sublime prérogative de Marie. Sans doute les Pères du vni" siècle et les saints docteurs du moyen âge appliquent, dans leurs homélies, divers passages de la Bible à l’assomption de la sainte Vierge. Parmi les textes que nous rencontrons le plus ordinairement, nous pouvons citer les suivants : « Ingredere in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tuæ, » Ps. cxxxi, 8, d’où les Pères, et à leur suite les commentateurs, ont conclu que Notre - Seigneur a introduit dans le ciel le corps auguste auquel il devait sa naissance temporelle. — « Astitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate, « Ps.xliv, 10, qui, appliqué à Notre-Seigneur, nous montre à ses côtés Marie, portant une parure royale, ornement de son corps glorieux. — Enfin le texte de l’Apocalypse, xii, 1 : « Et signum magnum apparuit in cœlo, mulier amicta sole, » etc. Cette femme mystérieuse, en effet, qui enfante un fils en présence du Dragon, n’est-ce pas la Vierge Marie mettant au monde le Sauveur, qui devait écraser le serpent infernal ? Et quand le texte ajoute que cette femme reçoit deux grandes ailes pour s’envoler au désert, ne peuton pas voir là un symbole de la Mère de Dieu quittant la terre pour s’en voler au ciel ? Tous ces textes néanmoins ne s’appliquent à l’assomption de la sainte Vierge que dans le sens allégorique, sens qui fournit, il est vrai, à l'éloquence sacrée des ressources abondantes non moins que légitimes, mais dont on ne peut se servir pour prouver une vérité, pour établir un fait. En parlant ainsi, nous ne nous mettons point en opposition avec les vénérables docteurs du moyen âge. Ils ne se faisaient point illusion sur la valeur des textes qu’ils empruntaient à l'Écriture. Ds se proposaient, par ces textes, d'éclairer et d’illustrer le mystère de l’assomption ; ils ne se proposaient point de le prouver. C’est ce que déclare expressément Suarez, 3= part., Disp. 21, sect. 2 : « Sententiam Virginis Maria ? non esse de fide, quia neque ab Ecclesia deflnitur, neque est testimonium Scripturœ. »
Étranger à l'Écriture Sainte, le mystère de l’assomption est donc une de ces vérités qui se sont transmises par l’enseignement oral, et sur lesquelles il appartient à la tradition de nous instruire. Interrogée, la tradition nous montre la croyance à cette vérité en vigueur au commencement du Vil 8 siècle. À partir de cette époque, en effet, les écrivains ecclésiastiques dans leurs livres, les orateurs dans leurs discours, s’accordent à affirmer la résurrection de la Mère de Dieu et son glorieux enlèvement au ciel. C’est alors que saint Modeste de Jérusalem et saint André de Crète prononcent leurs homélies sur le sommeil de la sainte Vierge : Eî ; ttjv Ko((jiyi<jiv tt|c 8ecr7toivY|Ç 7)|jiâ>v 6eoto’xov. Migne, Patr. gr., t. lxxxvi, 2 « part., col. 32773312 ; t. xcvii, col. 1045-1100. C’est à la même date, ou plutôt à la fin du vie siècle, que saint Grégoire le Grand écrit son Sacramentaire, où nous lisons, à la date du 15 août, la célèbre collecte : « Veneranda nobis, Domine, hujus est diei festivitas, in qua sancta Dei Genitrix mortem subiit temporalem, nec tamen mortis nexibus deprimi potuit. » Voir, pour l’explication de ce texte, Serry, Exercitationes historicse de Christo, 66, et le Mariale attribué à Albert le Grand, q. 132, t. XX des œuvres de ce théologien. — C’est encore à la fin du VIe siècle que saint Grégoire de Tours écrit son livre De gloria martyrum, où nous lisons, Mirac., lib. i, c. IV, t. lxxi, col. 708 : « Dominus susceptum corpus [Virginis] sanctum in nube deferri jussit in paradisum. » Si nous descendions le cours des siècles, nous rencontrerions sur notre chemin, en Orient, les homélies de saint Jean Damascène ; en Occident, les sermons de saint Anselme et de saint Bernard. Cette recherche ne serait pas à sa place ici. D’ailleurs l’assomption de Marie n’a pas suscité les querelles ardentes dont a été l’objet son Immaculée Conception. Non pas pourtant qu’elle ait conquis tous les suffrages et gagné tous les esprits. Au IXe siècle commença à circuler, sous le nom de saint Jérôme, un écrit intitulé : Lettre à Paule et à Eustochie, où la résurrection de la sainte Vierge était révoquée en doute. Nous savons aujourd’hui que saint Jérôme n’est pour rien dans cette prétendue lettre à Paule et à Eustochie. Nous savons que non seulement il ne l’a pas écrite, mais qu’il n’a pas pu l'écrire, puisque cette lettre a été composée vers la fin du vme siècle. Mais, pendant tout le moyen âge, l’imposture fit son chemin, et le nom de saint Jérôme jeta le trouble dans certaines âmes, qui n’osèrent pas contredire le grand docteur. C’est ainsi qu’il faut expliquer l’attitude d’Usuard et d’Adpn, qui, dans leurs Martyrologes, s’inscrivirent en faux contre la croyance à l’assomption corporelle. Ces exemples furent heureusement rares : aucun des docteurs scolastiques ne se laissa ébranler par la lettre à Paule et à Eustochie, et tous, ainsi que nous l’avons dit, furent d’accord à professer la résurrection glorieuse de Marie. La lettre à Paule est souvent désignée sous le nom de Lettre du faux Sophrone, parce que le bénédictin Martianay l’attribua au moine Sophrone, contemporain de saint Jérôme. Voir Opéra sancti Hieronyrni, par Martianay, t. v, p. 33, et Migne, Patr., t. xxx, p. 122.
Ainsi donc, à partir du vu » siècle, et même à partir de la fin du vi « , la croyance à l’assomption corporelle se
présente à nous de tous les côtés ; nous la recueillons sous la plume des écrivains comme sur les lèvres des orateurs. Nous devons ajouter qu’au delà de cette époque il n’en est plus de même. Tout au plus peut-on conjecturer que saint Grégoire le Grand a emprunté l’oraison « Veneranda », que nous avons citée plus haut, au Sacramenlaire de saint Gélase. Le Sacramentaire de saint Gélase, que nous a fait connaître Tommasi, ne contient pas l’oraison « Veneranda », pas plus du reste qu’aucune oraison. On croit cependant que les oraisons existaient dans la liturgie de saint Gélase, et que saint Grégoire les a adoptées. De cette façon, nous atteindrions la fin du Ve siècle. En tout cas, nous ne pouvons aller plus loin. Dans les quatre premiers siècles, on chercherait vainement un témoignage autorisé en faveur de l’assomption de Marie. Nous savons qu’on a. souvent allégué un passage du livre des Noms divins, attribué à saint Denys l’Aréopagite, et un texte de la Chronique d’Eusèbe. Pour nous, nous renonçons à nous appuyer sur de pareilles autorités. Le livre des Noms divins, en effet, a été écrit à la fin du Ve siècle, tout le monde en convient aujourd’hui, et non par le disciple de saint Paul. D’ailleurs ce livre ne dit point ce qu’ordinairement on lui fait dire. D’après plusieurs auteurs, le. pseudoDenys aurait fait le récit des derniers moments de la sainte Vierge ; il aurait raconté que les Apôtres, assemblés autour du lit de la Mère de Jésus, recueillirent son dernier soupir, et aurait ajouté qu’un grand prodige eut lieu ensuite. Tout cela ne prouve point l’assomption. D’ailleurs tout cela.n’est pas dans le texte du pseudo-Denys, texte très obscur, dont il est difficile de préciser le sens, et qui, au dire de Tillemont et de Thomassin, ne parle même pas de la sainte Vierge. Pour l’explication du texte, voir Thomassin, De dierum festivorum celebritate, 1. ii, ch. xx, § 12, et Tillemont, note xv sur la sainte Vierge, -- Quant au texte de la Chronique d’Eusèbe, Patr. lat., t. xxvii, col. 581, c’est différent : on ne peut nier qu’il y a une allusion non équivoque à l’assomption corporelle dans la phrase : « Maria Virgo… ad Filium assumitur in cœlum, ut quidam fuisse sibi revelatum scribunt. » Par malheur, cette phrase est regardée comme apocryphe par les érudits. Nous ne parlerons même pas d’un sermon attribué à saint Augustin, où la résurrection de Marie est proclamée et prouvée longuement. Ce sermon est du XIIe siècle, et les bénédictins l’ont rélégué ad calcem (cf. Migne, Patr. lat., t. xl, p. 1142). Faut-il donc conclure que la croyance à l’assomption de la sainte Vierge ne remonte pas plus haut que le VIe siècle, et que, si on n’en saisit aucune trace avant cette époque, c’est qu’elle était encore inconnue à l'Église ? Une telle conclusion serait erronée. Le grave Thomassin, frappé du peu de place que le culte de la sainte Vierge occupait dans l'Église primitive, en trouve la raison dans une disposition de la Providence. « Comme dans les premiers siècles, dit-il, on avait sujet de craindre le renouvellement de l’idolâtrie, on se ménageait sur les honneurs de la sainte Vierge, pour ne pas donner occasion de lui en rendre d’excessifs. Les païens avaient adoré je ne sais combien de déesses mères de faux dieux. Il était à craindre que l’on en vint à adorer la Mère du véritable Dieu. » — Qu’on explique ce fait comme on voudra, il est du moins incontestable que plusieurs des vérités qui font partie du dépôt de la Révélation, et qui par conséquent sont d’origine apostolique, ont traversé les premiers siècles enveloppées en quelque sorte d’un voile d’ombre et de mystère, et n’ont fait leur apparition au grand jour qu’au sortir des persécutions. Et sans aller bien loin chercher un exemple, le dogme de l’Immaculée Conception n’est-il pas de ces vérités ? Lui aussi n’a-t-il pas attendu le vie et le vu siècle pour s'épanouir ? N*a-t-il pas traversé les premiers âges de l'Église, vivant d’une vie latente, comme la graine qui n’a pas encore rencontré le terrain propre à sa germination ? La croyance à l’assomption peut donc être d’origine apostolique, bien que l’on doive attendre
le vie siècle pour en constater la présence dans l'Église. Cette origine apostolique semble même être la seule explication raisonnable du consentement que nous apercevons dans l'Église à l'époque de saint Grégoire le Grand. De là vient qu’au concile du Vatican plus de trois cents Pères ont signé diverses propositions tendant à solliciter la définition dogmatique de l’assomption corporelle. Voir Martin, Documenta concilii Vaticani, p. 105. Ces Pères étaient persuadés que la croyance générale de l'Église remonte jusqu’aux Apôtres, qui eux-mêmes ont été instruits sur ce point par Dieu. Il ne nous appartient pas de prévenir la décision de l'Église. La croyance à l’assomption de la sainte Vierge pourrait devoir son origine à une révélation privée que la Providence aurait faite au sortir des persécutions, ou encore à l'époque où Nestorius lançait ses blasphèmes contre la Mère de Dieu. Elle pourrait par conséquent être en dehors du dépôt confié aux Apôtres sans cesser d'être vraie. Dans ce cas-là même, elle s’imposerait à nous dans une certaine mesure, comme étant une vérité que l'Église approuve et favorise, sans être susceptible toutefois d'être érigée au rang des dogmes, catholiques. Nous avons voulu seulement établir qu’on ne devait pas rejeter à priori son origine apostolique, ni déclarer impossible une définition de l'Église à son sujet.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons appliquer à l’assomption les paroles de Bossuet sur l’Immaculée Conception, nous pouvons la ranger au nombre de ces propositions « qui jettent au premier aspect un certain éclat dans lésâmes, qui fait que souvent on les aime avant même de les connaître ». Bossuet, 1 er Sermon sur la Conception. De toutes les raisons de convenance, en effet, qu’on invoque en faveur de l’Immaculée Conception, il n’en est pas une qui ne puisse, à un certain degré, être transportée à l’Assomption. On ne peut nier qu’il était peu convenable à NotreSeigneur de laisser au tombeau et d’abandonner à la pourriture le corps de sa divine Mère. Comment ne pas reconnaître tout ce qu’il y a de fondé dans ces paroles du pieux auteur dont nous avons vu le sermon attribué à saint Augustin ? « Tanta sanctifîcatio dignior est cœlo quam terra, et tam pretiosum thesaurum dignius est cœlum servare quam terra. » Et si quelqu’un voyait dans la résurrection un miracle difficile à admettre, nous lui répondrions avec Bossuet, loc. cit. ; « Sa maternité glorieuse met Marie dans un rang tout singulier, qui ne souffre aucune comparaison.Combien y a-t-il de lois générales dont Marie a été dispensée ?… Si nous y remarquons, au contraire, une dispense presque générale de toutes les lois, si nous y voyons un enfantement sans douleur, une chair sans fragilité, des sens sans rébellion…, qui pourra croire que ce soit le seul endroit de sa vie qui ne soit point marqué de quelque insigne miracle ? »
II. Circonstances du mystère. — Nous n’avons aucune donnée certaine sur les circonstances de temps et dé lieu dans lesquelles s’est accompli le mystère de l’Assomption. Et d’abord, pour ce qui est de la date, Baronius lui assigne l’année 48 ; mais il a soin de nous dire qu’il n’attache à cette date aucune importance, et qu’elle est à ses yeux, purement hypothétique. Dans cette hypothèse, la sainte Vierge était âgée de soixante-neuf ans environ lorsqu’elle monta au ciel. D’autres Pères pensent qu’elle avait de soixante-douze à soixante-quinze ans. Mais, nous le répétons, il est impossible d’appuyer un calcul quelconque sur un fondement certain.
Quant au lieu qu’habitait la sainte Vierge lorsqu’elle quitta la terre, deux opinions sont en présence : l’une place la mort de Marie et sa résurrection à Éphèse ; l’autre place ces deux événements à Jérusalem. La première opinion s’appuie sur la lettre synodale du concile d'Éphèse, . dans laquelle, parlant de la ville où ils sont rassemblés, les Pères s’expriment ainsi : "Ev8<x & ôsoXAyoî 'Ieacfovv)ç, xai 7) ŒOTÔxoç IlapOévoç î) àysa Mapta, <l. où le théologien Jean et la Vierge sainte Marie. » Voir Labbe, Collect. Concil., t. iii, p. 573. Inutile de faire remarquer
combien est vague et obscure cette phrase, qui reste ainsi suspendue sans verbe. Telle que nous l’avons elle est évidemment incomplète, et pour lui donner un sens il faut y ajouter quelques mots. Mais lesquels ? Le concile a-t-il voulu dire que la Vierge Marie et saint Jean ont leurs tombeaux à Éphèse ? N’a-t-iî point voulu dire simplement que cette ville contient une église dédiée à la sainte Vierge et à saint Jean ? Tillemont défend la première interprétation, mais la plupart des auteurs ont abandonné Tillemont sur ce point et ont entendu le texte de la seconde manière. Il s’ensuit donc que l’opinion qui place l’Assomption à Éphèsé n’a aucune base solide.
Saint Grégoire de Tours, saint André de Crète et saint Jean Damascène nous disent que c’est à Jérusalem que Marie rendit le dernier soupir et monta au ciel. D’après les détails dont ils accompagnent le récit du mystère de l’Assomption, on sent que ces vénérables Pères ont emprunté la plupart de leurs renseignements à un livre intitulé De transitu Mariée virginis, livre dont l’auteur s’est dissimulé sous le nom de Méliton, le célèbre apologiste du IIe siècle, mais qui, en réalité, n’a été composé qu'à la fin du v ». Voir Marguerin, Bibliothèque des Pères de Lyon, t. ii, 11e partie. L’opinion qui place à Jérusalem la mort et l’assomption de la sainte Vierge n’a donc pas, elle non plus, une autorité incontestable. Est-ce à dire que l’on doive n’en tenir aucun compte ? Non, certes. Le récit du faux Méliton dérive d’un écrit beaucoup plus ancien, et qui remonte probablement au IIe siècle ; récit entaché, il est vrai, de graves erreurs, et qui pour cela a été condamné par le pape Gélase, mais qui prouve du moins que la croyance à l’Assomption remonte aux âges les plus reculés. Benoît XIV, examinant, dans son livre Ses fêtes, les deux opinions que nous venons de résumer, n’osa prendre parti pour aucune. Il ne nous siérait pas d'émettre un avis que ce savant pape a refusé de donner. Nous dirons seulement que l’opinion qui met l’Assomption à Jérusalem est plus généralement admise aujourd’hui.
Dans tout ce qui précède, nous avons supposé que la sainte Vierge était morte, et que son assomption avait été précédée du privilège de la résurrection. Pour être complet, nous devons dire que la mort de Marie a été mise en doute par saint Épiphane, Hseres., 78 ; t. xlii, col. 716, et que le grand évêque de Salamine n’a pas voulu décider si les anges étaient allés chercher dans le tombeau le corps de leur reine, ou si, au contraire, ils l’avaient transportée au ciel avant qu’elle eût subi les atteintes de la mort. Mais, comme le remarque Baronius, saint Épiphane s’est laissé entraîner par l’ardeur de la controverse ; il a trop cédé au désir de rabaisser les hérétiques, qui rabaissaient la Mère de Dieu au rang des autres femmes. L'Église a abandonné sur ce point le grand docteur du IVe siècle, et elle affirme, dans la Messe de l’Assomption, que Marie a été soumise à la loi commune de la mort : « Subveniat, Domine, plebi tuae Dei Genitricis oratio, quam etsi pro con ditione carnis migrasse cognoscimus, » etc.
III. Histoire de la fête de l’Assomption. — Nicéphore nous rapporte, au 1. xvii, cli. xxviii, de son Histoire, t. cxlvii, col. 292, que l’empereur Maurice fixa, pour l'Église d’Orient, la fête de l’Assomption au 15 août. A la même époque (vers l’an 600), le pape saint Grégoire établissait aussi, pour Rome, la célébration de cette fête au jour fixé en Orient par Maurice. Avant saint Grégoire le Grand, l’Assomption était célébrée dans l'Église d’Occident, mais à la date du 18 janvier. C’est ce qui ressort des Martyrologes hiéronymiens, du Sacrameniaire de saint Gélase, et surtout d’un texte de saint Grégoire de Tours, De gloria martyrum, ix, t. lxxi, col. 713. Voir l’explication de ce texte dans Mabillon, Liturgia gallicana, p. 118. L'Église gallicane conserva plusieurs siècles encore cette date du 18 janvier, et ce fut seulement sous le règne de Louis le Débonnaire que la France adopta l’usage de Rome. Vers la fin du vne siècle, le pape Sergius instituait une procession pour rehausser la solennité de l’As somption. Au ix 8 siècle, le pape Léon IV donnait à cette fête une Octave. Vers le même temps, le pape Nicolas, dans une lettre aux Bulgares, nous apprend que les fidèles se préparaient par un jeûne à célébrer le 15 août. Et ainsi la fête de l’Assomption a grandi en éclat dans le cours des âges. Voir Baronius, Annales ecclesiast., ad annum 48 ; Tillemont, t. i, Notes sur la sainte Vierge ; Thomassin, Traité des fêtes, 1. ii, ch. xxj Benoît XIV, Tractatus de festis Mariée, c.vm ; Le Hir, Études bibliques, 2 in-8°, Paris, 1869, t. i, art. 3 et 4. J. Turmel.
2. ASSOMPTION DE MARIE, livre apocryphe attribué à Méliton. Voir Méliton.
3. ASSOMPTION DE MOlSE, livre apocryphe. Voir Apocalypses apocryphes, col. 759.
- ASSON##
ASSON, Act., xx, 1$1-$24. Voir Assos 1. — Asson, Act., XXVH, 13. Voir Assos 2.
1. ASSOS ("A<7<ïo< ; ), ville de Mysie (fig. 308). Saint Paul, dans son voyage de Corinthe à Jérusalem par la
308. — Monnaie d' Assos. Tête de Pallaa, coiffée d’un casque orné d’une couronne de laurier. — ij. AEEION. Griffon accroupi ; à l’exergue, u.i caducée.
Macédoine et là côte d’Asie, traversa Assos pour se rendre à Mitylène et de là à Milet. Il fut rejoint à Assos par saint Luc et ses autres compagnons, qui étaient venus d’Alexandrie de Troade dans cette ville par la route de mer. Act., xx, 13-14. Assos, ville de l’ancienne Mysie (province d’Asie), était un port situé sur la côte septentrionale du golfe d’Adrumète, en face de l’Ile de Lesbos, dont elle était séparée par un bras de mer d’une dizaine de kilomètres. Une route romaine reliait les principaux ports de la côte d’Asie. D’Alexandrie de Troade à Assos, elle coupait en diagonale la presqu'île, que devait contourner le vaisseau monté par les compagnons de saint Paul ; la distance était de trente kilomètres. Cette disposition des lieux explique que l’Apôtre a pu, à pied, faire le voyage aussi rapidement que le vaisseau, parti de Troade en même temps que lui. — Assos était autrefois une ville importante et toute grecque. Sa situation sur un rocher d’un accès difficile en faisait une place très forte. Ses restes sont encore magnifiques (fig. 309) ; plusieurs archéologues, Texier, Clarac, Fellows, Choiseul-Gouffier, Clarke, les ont décrits et reproduits. « De nombreuses colonnes finement sculptées et de la plus belle époque, une rue des Tombeaux, des remparts en blocs de granit, reliés sans ciment, intéressent les touristes. La porte par laquelle Paul entra dans la ville est toujours debout. De la mer on voit l’acropole, autour de laquelle la ville était bâtie. » Le Camus, Notre voyage aux pays bibliques, t. iii, p. 169. Il existe sur Assos trois monographies : Quandt, De Asson, Ratisbonne, 171Ô ; Amnelle, De "Ao-ow, Upsal, 1758, et Jos. Thacher, Report on the investigations at Assos, Clarcke, in-8°, Boston, 1882. — Le bourg qui occupe l’emplacement de l’ancienne ville s’appelle aujourd’hui Behram-Kalessi.
E. Jacquier. 2. ASSOS, ville de Crète. Elle n’est mentionnée dans notre version latine que par suite d’une fausse traduction. Au chap. xxvii, 13, des Actes des Apôtres, nous lisons dans la Vulgate : Cum sustulissent de Asson, legebant Cretam, « Quand ils eurent levé l’ancre d’Assos, ils côtoyaient la Crète. » Le navire que montait saint Paul pri
sonnier a-t-il donc abordé un port de l'île de Crète appelé Assos ? Il y eut autrefois en Crète une ville appelée Asus ou Asum, Pline, Jî. N., iv, mais cette ville était dans l’intérieur de l'île et non sur la côte. Saint Paul ne put donc y passer. Le texte original doit se traduire autrement que ne l’a fait la Vulgate. On lit dans les manuscrits grecs, dans le Textus receptus ainsi que dans les éditions cri Chaque peuple a transcrit le nom perse suivant sa phonétique particulière, et à l’aide des ressources que lui fournissait son alphabet. On voit toutefois que dans l’hébreu 'ÂhaSvêrôs, comme dans l’assyrien hisi’arsa et le grec EépÇ » i ; , sont reproduites les consonnes fondamentales h ou kh, s, r et s du mot perse. Le nom de khsaydrsâ signifie « le roi pieux », ou, d’après le persan moderne,
Vue d’AsBoe.
tiques : "ApavTeç àauov izapsltywco "l v Kpivtï)v, « On leva l’ancre et on longea de près la Crète ; » àuuov n’est pas un nom de ville, mais un adverbe, « plus près de. » ("Aîto-ov est le comparatif de l’adverbe ay^i, « près de. » ) t A<t<tov d’ailleurs, étant gouverné par apavxec, ne pourrait être un nom de ville qu'à la condition de le supposer à l’accusatif de direction, sans préposition. Mais apavreç n’indique pas la direction. Enfin, cette forme est poétique et étrangère au Nouveau Testament. E. Jacquier.
ASSUÉRUS. Hébreu : 'AhaSvêrôs ; Septante : ' A<N70ur[pot. C’est le nom de Xerxès, appelé par les inscriptions perses : « îî<<K-m^î<<îïï
Khsay- à- rs- â
La transcription hébraïque se rapproche davantage de la forme que le nom a prise en susien ;
Jksiirsa et en assyrien :
ï<a<ï-<a-<HhY
Hisi- '- arsa
Un vase d’albâtre (iîg. 310) trouvé en Egypte, et conservé à Paris, au Cabinet des médailles, présente ces trois inscriptions cunéiformes du nom du grand roi. Au-dessous se voit un cartouche avec le nom de Xerxès en hiéroglyphes :
Khsiars a
Voir Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit, t. i, p. 140-143. En grec classique, Khsayarsa est devenu Eép£r, ç. « le roi lion. » L'Écriture parle de trois Assuérus : celui du premier livre d’Esdras et d’Esther, qui est Xerxès I er ;
J ?<S
[[File: [Image à insérer]|300px]]
310. — Vase de Xerxès.
celui du texte grec de Tobie, xjv, 15, et celui de Daniel, IX, 1, qui peu. être identique avec le second. a a
ASSUÉRUS
1142
1. ASSUÉRUS ou Xerxès I" (485-465 avant J.-C.) (Fig. 311). Dans le premier livre d’Esdras, iv, 6, Assuérus, roi de Perse, est nommé entre Darius et Artaxerxès.Yoir la liste des rois achéménides, au mot Perse. Les anciens commentateurs ont pensé que cet Assuérus et cet Artaxerxès, qui paraissent peu bienveillants pour les Juifs, étaient les successeurs immédiats de Cyrus, et que c’est sous Darius
[[File: [Image à insérer]|300px]]
311. — Darique qu’on peut attribuer à Xerxès I er.
Le roi Xerxès I", à demi agenouillé, tenant un arc de la main gauche et de la main droite une javeline ornée d’un pommeau ; sur son dos est un carquois rempli de flèches. Il est coiffé de la cldaris crénelée et vêtu de la candys. — ij. Carré oreux allongé. Poids de la darique : 8 gr. 42.
seulement qu’un meilleur état de choses commença. I Esdr., iv, 24. Mais de nouvelles lumières ont depuis éclairé la question. « Un des premiers résultats de la lecture des inscriptions perses fut l’identification d' Assuérus à Xerxès. Cette conquête de la science ne fait plus l’ombre d’un doute. » Oppert, Commentaire historique et philologique du livre d’Esther, dans les Annales de philosophie chrétienne, janvier 1864. Cf. Theologische Studien und Kritiken, 1867, p. 467 et suiv. Assuérus ne saurait donc être le même que Cambyse. Tout en éclairant la question d’Assuérus, les inscriptions perses ont amené à une meilleure exégèse de ce chapitre îv d’Esdras. Des versets 1 à 5, l’historien parle des obstacles que les ennemis des Juifs suscitèrent à la construction du temple ; puis, soit qu’il ait voulu grouper dans un même passage le récit de toutes les vexations infligées aux Juifs, soit que le morceau ait été transporté d’ailleurs, il rappelle les menées hostiles qui portèrent plus tard Artaxerxès à interdire le relèvement de la ville. I Esdr., iv, 6-23. Après cette digression, il revient à Darius, pour dire que la construction du temple fut suspendue jusqu'à la seconde année de son règne. Le passage I Esdr., iv, 6-23, doit donc être détaché du contexte. Voir Clair, Esdras et Néhémias, p. 28 ; Cornely, Introd. in libr. sacr., t. ii, p. 354. Assuérus est ici Xerxès, et cela d’autant plus sûrement, que son nom est suivi du nom d’Artaxerxès, comme dans la liste des Achéménides.
L' Assuérus du livre d’Esther est ce même Xerxès I", et les détails donnés par l’historien sacré sont en concordance exacte avec ceux que nous ont transmis les chroniqueurs grecs. Xerxès, quatrième successeur de Cyrus, était l’aîné des quatre fils que Darius T er eut d’Atossa, fille de Cyrus. Sa mère lui fit attribuer l’empire au détriment de trois autres fils que Darius avait eus de la fille de Gobryas. Darius « avait reculé les frontières de l’empire perse jusqu'à l’Indus et l’Iaxarte ; il avait porté ses armes au nord jusqu’au Caucase, en Afrique jusqu’aux Syrtes, et de l’autre côté de l’Hellespont jusqu'à l’Ister ». Curtius, Histoire grecque, traduct. Bouché-Leclercq, t. ii, p. 268. Xerxès se trouva ainsi « régner des Indes jusqu'à l’Ethiopie ». Esth., i, 1. Son empire était divisé en cent vingt-sept medînôt ou provinces, distribuées en vingtneuf satrapies. Hérodote, vii, 9, 97, 98 ; viii, 65, 69. À la fin de sa vie, Darius allait partir' en guerre contre les Grecs, après trois ans d'énormes préparatifs faits contre eux, quand il fut arrêté soudain, d’abord par la nouvelle de l’insurrection qui venait d'éclater en Egypte, et presque aussitôt après par la mort. Xerxès à son avènement se trouvait donc avec une double guerre sur les bras. « Il n’avait point passé par les mêmes épreuves que son père,
qui avait conquis lui-même son trône. Il avait grandi dans le luxe du palais, et n’avait point personnellement d’envie belliqueuse qui le poussât à quitter les jardins de Suse. » Curtius, p. 272. Il se laissa néanmoins déterminer par les conseils de sa mère et de son entourage, et consacra les deux premières années de son règne à la guerre contre l’Egypte. C’est pendant cette période, « au commencement de son règne, » que les ennemis des Juifs lui « écrivirent une accusation contre les habitants de la Judée et de Jérusalem ». I Esdr., iv, 6. Il était permis aux accusateurs de croire que le prince accueillerait facilement la dénonciation portée contre un peuple si voisin des Égyptiens. Xerxès, renseigné par ses officiers, ne paraît pas avoir ajouté foi à la calomnie. Du moins il n’est question d’aucune mesure prise contre les Juifs.
Cette première guerre menée à bonne fin, Xerxès songea aux Grecs. « On reprit les préparatifs commencés par Darius, mais sur une plus grande échelle, et même dans un tout autre esprit. Ce ne devait plus être une campagne ordinaire, mais bien une marche triomphale, une exhibition des inépuisables ressources de l’Asie. L’excessif était précisément ce qui souriait à l’esprit de Xerxès ; il voulait réunir une armée comme le monde n’en avait jamais vu. » Curtius, p. 274. Hérodote, vii, 8, rapporte qu’il appela à sa cour tous les grands de son empire, afin de s’entendre avec eux. C’est à cette occasion qu’eurent lieu les longues fêtes racontées par le livre d’Esther, i, , 3-8, et dans lesquelles on déploya, pendant cent quatrevingts jours, tout le luxe asiatique. On était alors à la troisième année du règne. Esth., i, 3. Invitée à se présenter devant Xerxès, la reine Yasthi refusa, et fut en conséquence solennellement répudiée et éloignée du trône. Esth., i, 9-22. On se mit alors à la recherche d’une jeune fille capable de remplacer dignement Yasthi dans le harem royal. La jeune Esther, présentée par Mardochée, fut agréée par le chef des eunuques, pour faire partie de celles qui, après des soins luxueux, devaient être amenées au roi. Esth., ii, 1-11. Cet incident domestique n’avait pas interrompu le cours des préoccupations belliqueuses de Xerxès. Sur le rapport des gouverneurs, « les messagers royaux partirent de Suse à toute vitesse dans toutes les directions, vers le Danube comme vers l’Indus, vers l’Iaxarte comme vers le haut Nil. Les manufactures d’armes et les chantiers maritimes furent mis en activité ; les préparatifs prirent deux années. » Curtius, p. 274. La troisième année, les combattants se réunirent en Cappadoce, lieu du rendez-vous général. L’armée, d’après la supputation de Ctésias, De Rébus persicis, 54, qui est la plus modérée, comptait 800000 hommes, 80000 chevaux, et une flotte de 1 200 trirèmes. À l’automne de 481, Xerxès vint prendre ses quartiers d’hiver près de Sardes, pendant qu’on préparait les approvisionnements, qu’on jetait un pont sur l’Hellespont, et qu’on perçait l’isthme d’Athos. Une tempête détruisit en quelques heures le pont construit à grand effort. « Cette nouvelle mit le roi hors de luimême. Il n’entendait pas qu’il y eût chose au monde capable de traverser ses plans. Dans chaque insuccès, il voyait une rébellion criminelle contre sa toute-puissance, une faute qui méritait un châtiment épouvantable. Les architectes furent décapités, et les éléments eux-mêmes durent porter la peine de leur indocilité. » Curtius, p. 278. Hérodote, vii, 35, dit que Xerxès fit fouetter l’Hellespont et jeter des chaînes dans ses eaux, comme pour le réduire en esclavage. On fit un autre pont, sur lequel passa l’immense armée ; mais, au lieu des victoires attendues, ce fut d’abord la journée des Thermopyles, et, deux mois après, la défaite de Salamine (480). Hérodote, viii, 1-94. Humilié, et craignant de trouver coupé le pont de l’Hellespont, Xerxès laissa son armée aux ordres de Mardonius, et s’enfuit en toute hâte. Cette armée fut anéantie à la bataille de Platée (479). Plutarque, Aristid., 19, 20. A son retour, le prince trouva les Babyloniens en révolte, et à leur tête un usurpateur, Samas-Irib, avec ïe titre de
roi. Il le défit, dévasta la ville et détruisit ses temples. Strassmaier, dans les Comptes rendus de l’Académie des inscriptions, 19 juin 1891. Ce Sa’mas-Irib est sans doute le Zopire dont parle Ctésias, 53. La cause de cette révolte semble avoir été un outrage commis par Xerxès envers le dieu Bel. En Grèce, il ne s'était pas montré plus respectueux envers l’Apollon de Delphes, dont il tenta de piller le temple.
. - Quand le roi fut revenu à Suse, on lui présenta Esther, le dixième mois de la septième année de son règne (478), Esth., ii, 16, et il la choisit pour remplacer Vasthi. Peu après, Mardochée fit connaître le complot tramé contre la vie du roi par les deux eunuques Bagathan et Tharès, qui voulaient peut-être exploiter le mécontentement causé par les récents désastres. Esth., ii, 21-23. La douzième année du règne (473), Aman, devenu premier ministre, fit décréter le massacre des Juifs ; mais la reine Esther, qui jouissait des bonnes grâces de Xerxès, dévoila la perfidie du ministre, et Aman fut pendu, pendant que Mardochée prenait sa place à la cour. J. Gilmore, Ctesise Persica, 37, conjecture que Mardochée (en hébreu Mordecai) est probablement ce Matacas que Ctésias appelle « le plus grand des eunuques ». Un nouvel édit atténua ensuite dans la mesure du possible celui qui avait prescrit le massacre des Juifs, et qui était irrévocable, d’après la loi du royaume. Esth., iii, 1-x, 3.
Xerxès fut incapable de relever son prestige militaire, à la suite de ses désastres en Grèce. Ceux qu’il avait attaqués ne le laissèrent jamais en repos. La dernière défaite qu’eut à enregistrer l’orgueilleux monarque fut celle de l’Eurymédon, où Cimon battit successivement la flotte et l’armée des Perses, et ensuite la flotte phénicienne (465). Thucydide, i, 100 ; Diodore de Sicile, xi, 61 ; Plutarque, Cimon, 12. « Xerxès vécut assez longtemps pour assister à cette honte ; mais il fut impuissant à la venger, ou plutôt il la sentit à peine… Toutes les horreurs, tous les crimes et toutes les hontes s’accumulèrent dans les dernières années de l’existence de Xerxès. Impuissant et méprisé dans sa propre cour, il fut enfin assassiné par le commandant de ses gardes du corps, l’Hyrcanien Artabane. » Curtius, p. 392. L'Écriture ne présente pas Xerxès sous son plus mauvais jour. Elle fait mention de son luxe, de ses mœurs asiatiques, de sa puissance, qui survécut à ses désastres. Esth., x, 1, 2. Elle se tait sur ses défaites et sur ses débauches, parce qu’elles étaient étrangères à son sujet et que c'était la reconnaissance pour un grand service rendu aux Juifs qui inspirait l’historien sacré. Notons cependant que la trame de la narration biblique trouve sa place sans difficulté dans lhistoire de Xerxès, telle que nous l’ont transmise les écrivains grecs. Voir Esther, et, pour le palais d’Assuérus, voir Palais.
2. ASSUÉRUS. Le texte grec du livre de Tobie, xiv, 15, nomme un Assuérus ( 'A<7Ô7)po « ) comme conquérant de Ninive. La forme grecque semble corrompue, et être une altération du nom de Cyaxare (perse : UvakSatra), le roi mède qui détruisit l’empire d’Assyrie avec Nabopolassar, roi de Babylone, père de Nabuchodonosor. Voir Cyaxare. Cf. F. Fritzsche, Die Bûcher Tobi und Judith, in-8°, Leipzig, 1853, p. 69 ; C. Gutberlet, Dos Buch Tobias, in-8°, Munster, 1877, p. 355.
3. ASSUÉRUS, père de Darius le Mède. Dan., ix, 1. Il est confondu avec l’Assuérus de Tobie xiv, 15 (grec), par un certain nombre de commentateurs, et regardé par eux comme étant Cyaxare, roi des Mèdes ; mais cette identification est loin d'être certaine et universellement acceptée. Pour la solution de ce problème historique, voir Darius le Mède.
1. ASSUR, père de Thécua, I Par., iv, 5, dans la Vulgate, qui l’appelle plus exactement I Par., ii, 24, Ashur. Voir Ashur.
2. ASSUR (hébreu : 'Assûr ; Septante : 'Acoo&p ; en
assyrien : -^< *-TJp r ij — j [mat, « terre, pays » ]
'Assur), l’Assyrie. La Vulgate n’appelle jamais l’Assyrie Assyria ; elle lui donne toujours le nom assyrien et hébreu d' Assur, ou bien, s’il s’agit des habitants de ce pays, elle traduit souvent par Assyrius, « Assyrien. » Voir Assyrie et Assyrien.
3. ASSUR (hébreu ; 'ASSûr ; Septante : 'Arooùg). Ézéchiel, xxvii, 23, énumérant les pays ou les villes avec lesquelles Tyr trafiquait, nomme Assur après Saba. On entend par là communément l’Assyrie. Movers, Die Phônizier, t. ii, part, m (1856), p. 252, et, à sa suite, Keil, Ezechiel, 1868, p. 245 ; Trochon, Ézéchiel, 1880, p. 496, etc., ont supposé qu’il n'était pas question ici du royaume de ce nom, mais de la ville de Sura, l’Essuriéh actuelle, dans le district de Palmyre. Elle était située sur la rive droite de l’Euphrate, au-dessus de Thapsaque, sur la route de caravanes qui va de Palmyre par Rusapha (Réseph, Is., xxxvii, 12 ; IV Reg., xix, 12) à Nicéphorium ou Rakka, puis au nord vers Haran, et par un embranchement au sud, le long de la rive du fleuve, dans la direction de Chelmad, en supposant, comme le font les partisans de cette opinion, que Chelmad est Charmandi. Voir Chelmad. Cf. Ritter, Erdkunde, t. xi, p. 1081 ; Chesney, Expédition for the Survey of Euphrates, 4 in-8°, Londres, 1850, t. i, p. 416 ; W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, 1857, t. H, p. 1048. L’opinion commune, qui voit l’Assyrie dans le passage d'Ézéchiel, xxvii, 23, est la plus probable.
- ASSURBANIPAL##
ASSURBANIPAL (textes cunéiformes :
T ►->— j jCl _. T|, A$ur-ban-apal,
c’est-à-dire « [le dieu] Assur a donné un fils » ; d’où Sardanapallos, pour (Â)sarbanapattos, dans les historiographes grecs ; nommé dans la Bible simplement rex Assyriorum, II Par., xxxiii, 9-13, ou même probablement Nabuchodonosor, Judith, i, 5, etc. ; suivant plusieurs auteurs, c’est aussi ÏAsénaphar de I Esdr., iv, 10 ; le Kandalanou des textes babyloniens, et le KcvïiXaSôcv du Canon de Ptolémée), roi d’Assyrie, de 668 à 625 [?], fils et successeur d’Asarhaddon ("fig. 312). Bien que la Bible ne le mentionne pas expressément par son nom, il est certain, par les inscriptions que ce prince a laissées à Ninive, sa résidence, qu’il fut souvent en rapport avec le royaume de Juda, pendant les règnes de Manassé, d’Amon, et les premières années de Josias. Manassé fut mêlé à deux des principaux événements du règne d’Assurbanipal : la conquête de l’Egypte et la répression d’une révolte de Babylone et de ses alliés.
L’Egypte, déjà soumise par Asarhaddon, n’avait pas attendu la mort de ce prince pour secouer le joug. Tharaca, puis son beau-fils Ourd-Amen, deux princes éthiopiens, en avaient repris possession depuis Thèbes jusqu'à Memphis ; Néchao de Sais, à qui les Assyriens avaient confié le soin de maintenir les différents chefs égyptiens dans le devoir, s'était lui - même révolté : fait prisonnier et conduit à Ninive par les généraux assyriens, il y avait trouvé grâce et recouvré son trône, comme plus tard Manassé de Juda, mais pour périr bientôt par le fait de l'Éthiopien Ourd-Amen.
Assurbanipal fit deux grandes campagnes contre l’Egypte (668 et 663 [?]) ; la première contre Tharaca, la seconde contre Ourd - Amen ; au cours de cette dernière, il prit et saccagea Thèbes, là demeure du dieu Amon, la Nih des textes cunéiformes, la Nô'-'Amôn du texte hébreu deNahum, iii, 7-10, qui fait allusion à cet événement ; il emporta à Ninive les trésors qu’il y trouva, et rétablit encore pour quelques années la domination assyrienne dans la vallée du Nil, sous l’hégémonie de Psammétiqua de Sais, qui avait supplanté Paqrour de Pasoupti. Durant
ces campagnes contre l’Egypte, les vingtdeux rois du pays de Hatti (Syrie, Judée, Philistie, Phénicie, etc., y compris les colonies phéniciennes de la Méditerranée, Chypre, etc.), déjà tributaires de son père Asarhaddon, durent également « baiser ses pieds », c’est-à-dire se reconnaître ses vassaux : parmi eux, Minsie Sar mat Iaudi, « Manassé, roi de Juda », vient en seconde ligne, immédiatement après Baal, roi de Tyr.
L’autre événement auquel fut mêlé Manassé eut son dénouement environ quinze années plus tard (647). Assur Assurbanipal, après avoir vaincu et mis à mort son frère révolté, s'était emparé de cette ville, où il résida quelque temps. Alors, nous apprend la Bible, Manassé se tourna vers Dieu, dont il obtint sa délivrance : rentré en grâce devant son vainqueur, il se vit tiré de prison, reconduit à Jérusalem et réintégré sur le trône. Les annales d’Assurbanipal nous le montrent, en effet, sujet à ces revirements subits : Néchao de Sais, d’abord vassal comme le roi juif, s'était pareillement révolté contre le monarque ninivite ; aussitôt il fut, comme lui encore, chargé de chaînes et
…
! ' ' '
[[File: [Image à insérer]|300px]]
312. — Le roi Assurbanipal. Bas - relief du Musée du Louvre.
banipal avait confié la vice-royauté de Babylone à son frère Sammughes, SaouSoù^ivoc, en assyrien, SamaS-Sumukin. Celui-ci voulut se rendre indépendant, et dans ce but fomenta contre son aîné un soulèvement général, depuis la Lydie et son roi Gugu ou Gygès jusqu'à Psammétique ^'Egypte, y compris mat Aram, mat À harri, mat tihamti, c’est-à-dire la Syrie, la Judée et la Phénicie, avec la Philistie le long de la Méditerranée. Manassé n’est pas désigné par son nom, pas plus que les autres Hatti révoltés ; mais il ne tarda pas à expier sa rébellion : car, continue Assurbanipal, confirmant ainsi le texte biblique, II Par., xxxiu, 11 - 13, tous ces peuples « je les soumis, leur imposai le joug du dieu Assur, avec des gouverneurs et des préfets établis par mes mains ». The cuneiform Inscriptions of Western Asia, t. iii, pi. xxi, col. v, 1. 38-39. Manassé, remplacé par un gouverneur assyrien, se vit donc chargé de chaînes et conduit prisonnier, non pas à Ninive, capitale de l’Assyrie, mais à Babylone : c’est qu’en effet
conduit à la capitale : là, au lieu de recevoir un juste châtiment comme les autres révoltés, il trouva grâce, se vit comblé de présents et renvoyé en Egypte pour en reprendre le gouvernement. Abiathéh, prince arabe, éprouva un sort à peu près analogue ; de sorte que l’histoire de Manassé, loin d'être en contradiction avec le caractère d' Assurbanipal, concorde merveilleusement avec les faits que les textes assyriens nous apprennent sur ce prince.
Il semble qu’il faut intercaler à cette époque les récits du livre de Judith : du moins ils cadrent bien avec la suite des annales d’Assurbanipal. En comparant le récit d' Assurbanipal avec la Bible, il ne faut pas" oublier que le texte original de Judith est perdu, et que les versions qui en restent présentent des différences notables, surtout dans les noms propres ; quelques - uns, devenus méconnaissables à la suite d’erreurs de transcription, semblent avoir été remplacés par d’autres, sans doute lus fami
Iiers aux copistes. Assurbanipal nous apprend donc, dans ses annales, qu’après la défaite de Samas-ëum-ukin de Babylone, il châtia tous les alliés de ce prince : les Ciliciens et les Lydiens ayant déjà éprouvé l’effet de ses armes (cf. Judith, ii, 12, 15), vint le tour des Aribi, Nabahati, Udumi, Arnmani, Jfaurina, Kidri, nomades Arabes, Nabatéens, Iduméens, Ammonites, du Hauran et de Cédar (cf. Judith, ii, 16, 17 ; iii, 12, 14, 15) ; tout leur pays fut envahi et pillé. Sans nul doute la Palestine, coupable de, la même faute et voisine de ces mêmes peuples, éprouva un sort analogue : un bon nombre de ses cités furent prises et ravagées, comme l’aurait été Béthulie sans le secours de Judith. Le texte sacré appelle le roi ninivite Nabuchodonosor ; nous ne saurions dire s’il y a là une méprise du tvanscripteur, ou si Assurbanipal n’a pas réellement aussi porté ce nom : les textes cunéiformes semblent, en effet, le désigner sous plusieurs noms différents.
Malgré les nombreuses inscriptions laissées par Assurbanipal, nous ignorons comment il employa ses dernières années ; nous savons seulement qu’il renonça à entreprendre une nouvelle campagne contre l’Egypte, probablement après l’issue peu satisfaisante de la campagne de Judée ; mais, au prix de nombreux combats, il avait établi ou maintenu sa domination sur les Biatti, l'Élam, la Babylonie et la Chaldée, la Médie, l’Arménie, la Cilicie et jusqu'à la Lydie. Partout où il rencontrait de la résistance, il employait sur une large échelle le système de la déportation en niasse. Aussi plusieurs auteurs, comme H. Gelzer, Eb. Schrader, Fr. Delitzsch, croient-ils le retrouver désigné encore dans la Bible sous le nom d’Asenaphar, pour Asenapal ou As [ ar-ba ] ne-pal. I Esdr., lv, 2, 10. Mais le texte sacré, ainsi que les noms des peuples transportés, semblent plutôt désigner Asarhaddon ; peutêtre, d’ailleurs, les deux monarques eurent-ils l’un après l’autre leur part dans ces événements. Voir Asénaphar.
Assurbanipal s'était fait construire à Ninive un magnifique palais, exploré principalement par l’Anglais A. H. Layard (1841-1845), l’indigène Hormuzd Rassam (185$1-$2854) et l’Anglais George Smith (1873-1876), qui en ont tiré de riches bas-reliefs, et surtout d’innombrables fragments de tablettes d’argile ou livres assyriens. Ce monarque avait, en effet, rassemblé dans son palais une bibliothèque célèbre, où se trouvaient accumulées toutes les sciences du temps : théologie, histoire, chronologie, géographie, droit, sciences naturelles, astrologie et magie, linguistique, littérature, etc. Pour enrichir cette précieuse collection, il avait fait transcrire les anciens ouvrages de la Chaldée et de la Babylonie. C’est de là qu’on a extrait les récits assyriens de la création, du déluge, et bien d’autres textes fort utiles aux études bibliques. On peut évaluer à trente mille environ les tablettes ou fragments que la bibliothèque d' Assurbanipal a fournis au British Muséum de Londres. Assurbanipal mourut probablement en 625, ou, suivant quelques auteurs, en 646, laissant à son fils Asur-etil-ilani un empire étendu, dont la durée et la puissance semblaient assurées pour longtemps. Cependant Ninive et l’Assyrie étaient alors bien près de leur ruine totale.
Voir, pour les inscriptions, transcriptions ou traductions : The cuneiform inscriptions of Western Asia, t. iii, pi. xvi-xxxviii ; t. iv, pi. lii-liv ; t. y, pi. i-x ; G. Smith, ilistory of Assurbanipal, translatée from the cuneiform inscriptions, Londres, 1871 ; Samuel Alden Smith, Die Keilschrifttexte Asurbanipals, Leipzig, 1887 ; Menant, Annales des rois d’Assyrie, p. 250-294 ; Records of the past, t. i, p. 55 ; t. ix, p. 37 ; Eb. Schrader, Keilinschriftliche Bibliotek, t. ii, p. 152-269 ; Schrader -Whitehouse, The cuneiform inscriptions and the Old Testament, t. ii, p. 10, 18, 40, 56 ; F. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., t. iv, p. 263-316 ; Id., Les Livres Saints et la critique rationaliste, &' édit., t. iv, p. 512-516, 570-573 ; Lenormant-Babelon, Histoire an cienne de l’Orient, t. iv, p. 333-378 ; Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, 4e édit., 1886, p. 458-471 ; G. Rawlinson, The fuie great Monarchies, t. ii, p. 200-230. Sur la bibliothèque d' Assurbanipal, voir aussi Menant, La bibliothèque du palais de Ninive, Paris, 1880 ; G. Smith -Delitzsch, Chaldàische Genesis, 1-37 ; Vigouroux, La Bible et les découvertes, 1. 1, p. 175-188 ; Lenormant-Babelon, ouvr. cit., t. v, p. 160-169, 140-148.
- ASSURIM##
ASSURIM (hébreu : 'Assûrîm ; Septante : 'Aduoupiefjj.), tribu arabe, descendant d’Abraham et de Cétura par Jecsan, leur second fils, et par Dadan, second fils de Jecsan. Elle est nommée deux fois dans l'Écriture, Gen., xxv, 3, et I Par., i, 32, avec les Latusim et les Laomim. Ils devaient habiter dans la partie sud-ouest du Hauran, mais ils n’ont pu être jusqu’ici identifiés (voir Arabie, col. 860). Cf. A. Knobel, Die Vôlkertafel der Genesis, in-8°, Giessen, 1850, p. 269.
Le nom ethnique 'Asurî (Septante : 'Auspt) se lit aussi II Sam. (II Reg.), ii, 9, dans le texte original. La Vulgate, de même que le syriaque et l’arabe, porte en cet endroit Gessuri. Voir GessurI. Quel que soit le pays qu’il faille entendre par là, il ne s’agit pas, en tout cas, de celui desvssurim. — Le mot 'âsûrîm se trouve aussi dans Ézéchiel, xxvii, 6 (Vulgate : prssteriola, « chambres, cabines » ), mais c’est par erreur que quelques interprètes ont pensé que c'était un nom propre : dans ce passage, il ne peut désigner qu’une espèce de bois, probablement le buis. Voir Buis.
- ASSYRIE##
ASSYRIE (hébreu : 'ASSûr, érés 'ASsûr ; Septante : 'AddoOp ; chez les écrivains grecs, on trouve 'Ao-o-vpi’a, 'AToupfa, cette dernière forme correspondant au perse Athurâ, et au chaldéen 'Athur et 'âthur ; Vulgate : Assur, terra Assyriorum, mais jamais Assyria ; textes cunéiformes : mat Ausar, et plus fréquemment mat
ASSur, matvhir, ameliASSurî).~^i >— ►— ^CE ? T ^ : |
I. Géographie. — Ces expressions sont employées par les anciens, et même quelquefois par la Bible, en deux sens bien distincts : au sens large, elles comprennent toute la Mésopotamie, c’est-à-dire tout le bassin du Tigre et de l’Euphrate, l’Arménie exceptée ; la Chaldée et la Babylonie en font alors partie géographiquement, comme elles en ont dépendu politiquement, sous les dernière rois de Ninive. Voir Is., xxiii, 13 ; Jer., ii, 18 ; Lament., v, 6 ; IV Reg., xxiii, 29 ; Judith, i, 5 ; ii, 1 ; I Esdr., vi, 22 ; Zach., x, 10 ; Mich., v, 6 ; Strabon, xvi, 184 ; Ptolémée, vi, 1 ; Hérodote, 1, 106, 192 ; iii, 92 ; Pline, H. N., yi, 26. Mais au sens strict, qui est le plus fréquent dans la Bible, les limites de l’Assyrie étaient beaucoup plus restreintes. Le Tigre et l’Euphrate, à leur sortie des montagnes d’Arménie, laissent entre aux un triangle irrégulier dont ces montagnes forment la base, et au sommet duquel vient se greffer une sorte de losange. Ce losange appartenait à la Babylonie et à la Chaldée ; le triangle renfermait l’Assyrie propre. Elle comprenait à la vérité les deux rives du Tigre ; mais, de l’Euphrate, la rive droite ne lui appartenait pas, non plus que la portion septentrionale de la rive gauche, située au nord du Chabour : là commençait la Mésopotamie araméenne, où les points de rencontre des empires héthéen, mosque et assyrien, formaient unp ligne flottante et indécise. Au sud-ouest, l’Assyrie était bornée par l’Euphrate, qui la séparait du désert de Syrie et d’Arabie ; au sud, par la frontière babylonienne et la forteresse du Dour-Kourigalzou, un peu au nord de Bagdad ; du sudest jusqu’au nord, les chaînes du Zagros, les monts actuels du Kurdistan, la séparaient de la Médie ; au nord, les diverses ramifications du Masius et du Nipnatès, prolongements du Taurus actuel, la séparaient de l’Arménie et de la Commagène. L’aire renfermée entre ces limites (36° 50' à 33° 30' de latitude septentrionale, et 38° à 42° de longitude est de Paris) comprend à peu près
la superficie de la Grande-Bretagne, répartie, à largeur variable, sur environ 330 kilomètres de longueur. (Voir la carte, fig. 313).
Cette contrée est arrosée et presque entourée par le Tigre et l’Euphrate ; le nom grec de Mésopotamie, « au milieu des fleuves » et le nom arabe de Djéziréh, « île, » font allusion à cette situation. En allant du nord au sud, l’Euphrate reçoit sur sa rive gauche le Bélikh, puis le Chabourou Chaboras ; son cours inférieur ne reçoit guère d’affluents, la contrée qu’il traverse est tour à tour déserte et marécageuse. Le Tigre, au contraire, reçoit sur sa rive gauche de nombreux et puissants tributaires : le Chabour au nord de l’Assyrie, qu’il ne faut pas confondre avec l’affluent de l’Euphrate du même nom ; le Chauser, qui baigne les ruines de Ninive ; le Zab grand ou supérieur (anciennement Zabu élu ou Aûxoç), le Zab petit ou inférieur (Zabu supalu ou Kâirpo ?), l’Adhem (Radânu ou 1°û<txoç) ; les affluents méridionaux, le Schirvan, le Tornadotus, le Kerkhan et le Karoun n’appartiennent pas à l’Assyrie, non plus que les nombreux canaux, comblés presque entièrement aujourd’hui, qui unissaient autrefois le Tigre et l’Euphrate dans leur bassin inférieur.
La partie nord-est de l’Assyrie est couverte de chaînes de montagnes dont la direction générale est parallèle au Zagros, devant lequel elles semblent former une sorte de gradin, les premières assises n’ayant que quelques centaines de mètres, les dernières atteignant jusqu'à 2600 mètres, dominées elles-mêmes par les sommets du Zagros, qui atteignent jusqu'à 4300 mètres, la région des neiges éternelles. Quant à la portion sud-ouest, elle ne présente que de légères ondulations ; il faut cependant mentionner sur la rive droite du Tigre la rangée de collines nommée Singar, à la hauteur de Mossoul. Enfin on trouve souvent des collines ou tells artificiels, qui ne sont que d’anciennes cités en ruines.
Le climat des diverses parties de l’Assyrie ne peut naturellement pas être le même. Dans l’est, l'été est tempéré par la brise descendant des montagnes ; mais bien que la chaleur y soit moins étouffante que sur la rive occidentale du Tigre, elle est cependant encore assez forte pour être nuisible aux Européens. La pluie tombe très largement durant l’hiver et le printemps, le reste du temps une rosée abondante entretient un peu de fraîcheur dans l’atmosphère et de végétation dans la plaine. Plusieurs des fleuves d’Assyrie ont aussi leur période de débordement pendant la fonte des neiges, d’avril à juillet, aux endroits où leurs rives ne sont pas trop élevées. Au nord, l’hiver est assez rigoureux, à cause de l’altitude du pays et du voisinage de l’Arménie, avec ses neiges éternelles et ses six mois de froid. Mais la chaleur de l'été y est assez intense : à Orfa et à Haran, le thermomètre atteint souvent 48° centigrade. Au sud, le. climat se rapproche beaucoup de celui de la Babylonie, les chaleurs y sont véritablement étouffantes. Autrefois une canalisation savante et une luxuriante végétation procuraient sans doute à l’Assyrie un peu plus de fraîcheur. Le palmier, l’olivier, le citronnier, la vigne et quelques arbustes ou plantes aromatiques, les céréales surtout, avaient rendu célèbre la fertilité de l’Assyrie. On y rencontre aussi le myrte, le laurier rose, le sycomore, le platane, le chêne, le peuplier, le sumac et le noyer ; parmi les arbres fruitiers, l’oranger, le grenadier, Fabricotier, le figuier, le pistachier et le mûrier ; enfin on y a introduit le tabac, le riz, le coton, Je maïs. La faune du pays est également riche : les monuments semblent indiquer qu’on y trouvait le lion, le tigre, le léopard, l’hyène, l’ours, la gazelle, le chacal, le porcépic, l'âne sauvage, le buffle, l’autruche, etc. Actuellement plusieurs espèces ont disparu de la contrée, notamment le buffle et l’autruche. Enfin le sol ou les rochers du Masius et du Zagros offraient aux architectes assyriens l’argile, le calcaire, les grès, le basalte, l’albâtre et plusieurs sortes de marbre ; ils recelaient aussi le fer, le cuivre, le plomb,
l’antimoine, l’argent, le soufre, l’alun, le bitume, le naphte et le sel.
Les villes les plus célèbres étaient Assur, entre les deux Zab, maintenant Kaléh-Sergat ; Halah, aujourd’hui Nimroud, au confluent du Zab supérieur ; enfin, à la jonction du Chauser et du Tigre, Ninive, dont les ruines, situées en face de la Mossoul actuelle, forment les tells de Koyundjick et de Nebi -Younous : ces trois villes furent tour à tour les capitales de l’Assyrie. Mentionnons encore DourSargani, actuellement Khorsabad, résidence du roi Sargon, à quatre lieues environ au nord de Ninive ; Arbèles ou Arbil, à soixante kilomètres est de Nimroud ; Singar, au pied de la chaîne de montagnes du même nom, à l’ouest du Tigre ; Nisibe, près du Chabour, résidence de Tigrane et citadelle des Romains contre les Parthes ; Haran, près du Belikh, l’ancienne Charræ où séjourna Abraham, Gen., XI, 31, et Orfa, l’antique Édesse. Voir El. Reclus, Géographie universelle, t. IX, p. 377-461 ; Frd. Delitzsch, Wo lag dos Parodies, p. 182-192, 252-262 ; G. Rawlinson, The five great monarchies, t. i, p. 181-236 ; LenormantBabelon, Histoire ancienne de l’Orient, t. iv, p. 120 ; Perrot, Histoire de l’art dans l’antiquité, t. ii, p. 1-14 ; Layard, Nineveh and Babylon, passim ; Nineveh and its remains, t. i, passim ; M. von Niebuhr, Geschichte Assurés und Babel’s, p. 378-428, etc.
II. Ethnographie. — L'Écriture nous apprend que les Assyriens étaient Sémites : la table ethnographique, Gen., x, 22, les mentionne, sous le nom hébraïque d"A§sur, parmi les descendants de Sem. Le ꝟ. Il du même chapitre signifie de plus, au dire d’un bon nombre de commentateurs anciens et modernes, non pa% que Nemrod partit en Assyrie pour y fonder Ninive, Résen et Chalé ; mais que les Assyriens étaient une colonie originaire du Sennaar, où vivaient côte à côte des races différentes, issues de Sem et de Cham. D’après l’interprétation contraire, ce verset indiquerait au moins une action très marquée de Nemrod et de la civilisation babylonienne sur les origines du royaume assyrien.
Ces deux assertions, maintenant pleinement justifiées par les découvertes assyriologiques, ont été assez généralement contredites jusqu’au milieu de ce siècle. D’après M. Renan, dans son Histoire des langues sémitiques, 1858, p. 61-68, des cinq fils de Sem, Elam, Assur, Arphaxad, Lud et Aram, ce dernier seul aurait été Sémite ; l’Assyrie se montrait tout l’opposé de la race sémitique par son caractère sédentaire, sa civilisation matérielle avancée, son architecture colossale, ses aptitudes militaires, sa religion presque iranienne, sa tendance à envisager ses rois comme des divinités, son esprit de centralisation et de domination ; les noms mêmes de ces rois n’auraient rien eu de sémite, et il aurait fallu, avec Lorsbach, Gesenius et Bohlen, les faire dériver du persan, etc. Le même auteur fait pourtant une légère concession à la Bible, ouvr. cit., p. 69, en reconnaissant que le fond de la population aurait bien pu être sémitique, mais entremêlé d'éléments couschites ; il pense néanmoins que la puissance de Ninive était d’origine aryenne.
L’assyriologie a tranché la question : Ninive est étrangère aux Aryens, et les Assyriens sont des Sémites. Leur langue, comme les idiomes araméens, palestiniens, arabes et éthiopiens, est trilittère, c’est-à-dire que la généralité des racines y est formée exclusivement de trois consonnes ; mais c’est avec l’hébreu qu’elle offre les affinités les plus frappantes, tant pour le vocabulaire que pour la grammaire, phonologie, morphologie et syntaxe, prose ou poésie ; un bon nombre d’idiotismes hébraïques, long^ temps demeurés sans explication, se sont éclaircis par une simple comparaison avec l’assyrien. Voir Assyrienne (langue).
Les caractères physiologiques confirment l’induction tirée du langage. Sur les bas-reliefs, qu’on possède en très grand nombre, tous les Assyriens, rois ou sujets, ont le type sémite fort accentué, particulièremant celui
du Juif méridional : Iront droit peu élevé, nez aquilin souvent un peu épais et recourbé par le bas, bouche assez forte aux lèvres épaisses, menton plein et rond, chevelure et barbe généralement abondantes, et toujours très soignées chez les Assyriens. Leur taille est moyenne ; leurs formes trapues et leurs muscles très accusés indiquent une grande force physique (fig. 314). Ils paraissent donc différer assez notablement des Babyloniens, que les cylindres sculptés représentent communément grands et maigres (fig. 31E), particularités qui, à la vérité, semblent, dans bien des cas, exagérées par l’inexpérience des graveurs. — Les deux peuples se distinguaient davantage par
l'Écriture, qui nous représente la civilisation assyrienne, sinon la population de l’Assyrie elle-même, comme originaire de la Babylonie ou du Sennaar, où vivaient, mélangés plus ou moins intimement, des descendants de Cham et des Sémites. Il est certain que la langue assyrienne était la langue vulgaire de la Babylonie, avec un peu de rudesse en plus. L'écriture, les arts, les sciences, les lois, la religion, étaient de provenance babylonienne ; l’emprunt était surtout frappant pour l’architecture. Dans l’Assyrie, pays élevé et montagneux, où le bois et la pierre se trouvaient en abondance, dont les ressources et les exigences étaient tout autres que celles des plaines d’alluvion de la
314, — Soldats assyriens. Botta, Monument Se Ninive, t. ii, pi,
le côté intellectuel et moral ; les Assyriens ormaient un peuple de soldats, moins livré aux études et au commerce, mais plus porté à la rapine et à la violence, ami de la guerre et des expéditions lointaines, qu’ils renouvelaient presque chaque année ; d’une énergie persévérante, sauvage et cruelle, mutilant, détruisant, ravageant et brûlant tout ; empalant, aveuglant ou mettant en pièces les rebelles ; pratiquant sur une large échelle le système de la déportation en masse, auquel les inscriptions cunéiformes et l'Écriture font de fréquentes allusions. Au retour, les rois faisaient consigner dans leurs inscriptions et représenter sur les bas-reliefs de leurs palais toutes ces scènes de carnage. Voir J. Menant, Annales des rois d’Assyrie, p. 70, 71, 72 et passim.
C’est bien avec ce caractère que les prophètes nous ont dépeint le peuple assyrien : Is., x, 7-14 ; xxvii, 24-28 ; xxviii, 2 ; xxxiii, 8-19 ; Nah., iii, 1 ; Ezech., xxxi, 1-11. Quant aux récits des historiens grecs, principalement de Ctésias, qui lui attribuent les mœurs efféminées de Ninyas et de Sardanapale, ils sont infirmés par les résultats des découvertes assyriologiques.
La science confirme également la seconde assertion de
basse Mésopotamie, on avait conservé par routine les procédés babyloniens, l’usage des tertres artificiels, l’usage restreint de la pierre, les murs épais d’argile crue ou cuite, les pyramides ou tours étagées, les motifs d’ornementation empruntés aux légendes chaldéennes. Ajoutons enfin qu’il suffit d'étudier la marche de la civilisation assyrienne pour arriver à la même conclusion : la capitale fut Assour, puis Calach, en dernier lieu Ninive et Khorsabad ; cette marche ascendante du sud au nord montre clairement quel en fut le point de départ.
Cette civilisation finit toutefois par prendre, à la longue, une physionomie un peu particulière : l’architecture apprit à faire un usage moins rare de la pierre ; au lieu de l’enduit et des moulures géométriques de Babylone, les palais assyriens se revêtaient de plaques d’albâtre, travaillées et. bas-reliefs, et représentant des scènes religieuses, militaires, des chasses, etc., ou couvertes d’inscriptions cunéiformes, véritables annales qui conservaient l’histoire de chaque règne. Jusqu’aujourd’hui la Babylonie n’a rien fourni de semblable. — Les arts industriels présentent également, en Assyrie, un cachet à part, qui trahit souvent au premier coup d'œil la provenance des objets : 1153
ASSYRIE
statuettes, vases de bronze, plaques métalliques gravées ou repoussées, céramique, meubles, bijoux, cachets ou amulettes. Aussi Ninive devint-elle à son tour un centre important de commerce : Nahum nous dit que ses négociants étaient nombreux comme les étoiles, et ses richesses infinies. Nah., ii, 19 ; iii, 13.
Voir Eb. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, p. 523-527 ; F. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., t. i, p. 308-312, 422-453 ; Schrader-Whitehouse, The Cuneiform Inscriptions and the Old Testament, t. i, p. 76-85 ; Victor Place, Ninive et l’Assyrie, t. i, p. 214-217 ; G. Rawlinson, The five great Monarchies, t. i, chap. ii-vn ; second monarchy, p. 210-orf fin. ; Lenormant-Babelon, Histoire ancienne de l’Orient, t. v, p. 1-125 ; Perrot et Chipiez, Histoire de l’art dans l’antiquité, t. ii, p. 14-33, 91-112, etc. Voir aussi Fr. Homme], Geschichte Babyloniens und Assyriens, Berlin, 1885.
III. Religion. — La religion assyrienne, qui semble
316. — Chaldéens. — Cylindre royal du premier empire chaidéen. Cérémonie religieuse. Initié devant le dieu assis. Grandeur naturelle. Collection de Clercq, n » 121.
assez compliquée, et qui est encore peu connue dans les détails, avait été empruntée à ta Babylonie et à la Chaldée ; seulement à la tête de ce panthéon figure un personnage nommé Assur (assyrien : Assur ; et souvent dans les textes cunéiformes, ASur), qui, semble-t-il, du rang de divinité éponyme de la première capitale assyrienne, la ville d’Assur, devint, à mesure que l’empire prenait de l’extension, un dieu national : c’est par son ordre et pour propager son culte et ses lois que les monarques assyriens firent toutes leurs conquêtes. Assur paraît avoir le même sens que tabu, « [le dieu] bon. » À la différence des autres dieux, il est considéré volontiers comme sans épouse et sans descendants ; il n’a pas non plus de représentation matérielle : un simple disque ailé est son emblème ordinaire, avec ou sans buste humain (fig. 60, col. 312 et fig. 237, col. 909).
Au-dessous d’Assur, il y avait d’abord une triade Anou, Bel, Ea ; puis, dans un rang inférieur, un nombre considérable de dieux (en assyrien, ilu ; plur., ilani) et d’esprits, _de nom et de rang divers, dont Assur était le maître, et qui doivent leur origine tant à la religion sidérale qu’au culte des forces de la nature, bonnes ou mauvaises. À nu était l’esprit du ciel, il avait pour épouse Anatu, et les dieux principaux issus de leur union étaient Rammanu, dieu de l’atmosphère, représenté sous la forme humaine, tenant en main un symbole de la foudre, et nommé Bin par quelques assyriologues ; Isu, dieu du feu, dont le culte lut assez vite oublié, ou se confondit avec celui du soleil ; enfin Istar, à la fois déesse de la guerre sous le nom 1 Tw r. d '^ J " bèles ' et déesse, du plaisir sous le nom d’Istar de Ninive, à ce titre en relation particulière avec Tammouzvdonis ; on la représentait en conséquence tantôt sous la forme d’une femme nue, tantôt sous la forme 'lune femme armée, tenant en mains un arc et des
ni it S ' 6t ayant SUr la tête une étoile - 1 ui appelait la pianète Venus, avec laquelle elle était aussi identifiée, tfel était l’esprit de la terre et le maître du genre DICTDE LA BIBLE.
1154
humain, nommé souvent Bel labaru, « Bel l’Ancien » pour le distinguer de Bel-Marduk, « le seigneur Mardouk, » belu ou bilu ayant en assyrien, comme l’hébreu ba'àl le sens de « seigneur », outre son emploi comme nom propre ; il avait pour épouse la déesse Bêlit, et pour fils Sin, « le dieu-lune, » nommé aussi Nannar, « le brillant » fort yénéré, principalement à cause des indications astronomiques qu’il fournissait ; ses principaux sanctuaires
- s>
Dieu poisson. Musée du Louvre.
étaient à Ur et à Haran ; Sin avait lui-même pour fils ëamas, « le soleil, » dieu de la lumière physique et morale, et juge des hommes, adoré surtout à Sippar ou Sépharvaïm et à Larsa en Babylonie. (Voir fig. 38, col. 237.)
Enfin l’esprit de l’abîme, de l’océan et des fleuves était Éa, V"Qr[, "Ao « , 'Euomvis ou '£}<%vvy|{ des Grecs, le dieu de la sagesse et de la magie, représenté, pense-t-on, sous la forme d’un homme-poisson, ou du moins d’un homme revêtu d’une peau de poisson, dont la tête lui sert de tiare (fig. 316). C’est à lui qu’on attribuait l’origine de toutes les connaissances humaines. Voir Bérose, dans les Fragmenta hisloricorum grxœrum, édit. Didot, t. ii, p. 496. De son
I. - 39
union arec la déesse Dam-kina était né Marduk, nommé souvent Bel-Marduk, ou même simplement Bel, « le seigneur [Mardouk], » le Bt ; Xoç des Grecs : c'était le dieu particulier de Babylone, et en général le bienfaiteur et le libérateur de l’humanité ; c’est lui que son père Éa chargeait de guérir les maladies envoyées aux hommes par les esprits mauvais. Son épouse Zir-banit ou Bêlit, la Mylilta d’Hérodote, i, 31, était la déesse de la génération, honorée à Babylone par les prostitutions sacrées. De ce couple étaient nés Nabu (Nébo) et TaSmêtu, le dieu
' w^'Tw^r^^^j ' w^^s^ ' ^WH^wa^ ' ^i^f^
[[File: [Image à insérer]|300px]]
817. — Génie allé. Muses du Louvre.
et la déesse de l'écriture, des lettres et des sciences, et auxquels étaient consacrées toutes les bibliothèques publiques de l’Assyrie.
Ces liens généalogiques ne sont pas d’ailleurs d’une rigueur absolue : ainsi Istar, qui est donnée comme fille d’Anou dans le poème d’Isdubar, est appelée « fille de Sin » dans la Descente aux enfers. On convenait aussi généralement qu’il y avait douze grands dieux, présidant chacun à l’un des mois de l’année ; mais le nombre seul était hors de doute, tandis que les noms et le rang de chacun des titulaires étaient variables.
Aux dieux déjà nommés venait s’ajouter ou se superposer en partie un cycle formé de divinités planétaires : Sin et SamaS, la lune et le soleil, Nabu ou Mercure, Marduk ou Jupiter, Istar ou Vénus, Nin-eb = Vraè ou Saturne, et Nergal ou Mars. Nin-eb, que plusieurs assyriologues appellent aussi Sandan et Adar, en s’appuyant sur de pures conjectures, était regardé comme le dieu de la force et des combats, et principalement adoré à Ninive ; tandis que Nergal, dont les attributions étaient à peu près les mêmes, l'était surtout à Cutha, sous l’image d’un dieu-lion. Dagan ou Dagon est encore mentionné
dès la plus haute antiquité comme une divinité assyrienne, mais d’un caractère qui nous est inconnu.
Au-dessous de ces dieux, on comptait un grand nombre de divinités inférieures et d’esprits bons ou mauvais, auxquels on donnait les formes composites les plus bizarres : génies ailés, à tête d’aigle (voir fig. 56, col. 302), d’homme (fig. 317), de lion, sur un corps d’espèce différente, de lion, de taureau, d’homme ou de scorpion, etc. C’est à cette classe qu’appartenaient les kirubi et les nirgalli, taureaux et lions (voir Chérubin et fig. 69, col. 314) à face humaine, placés comme gardiens aux portes des temples et des palais, ainsi que les êtres multiformes que les sculptures assyriennes et babyloniennes nous représentent fréquemment gardant l’arbre sacré ou arbre de
318. — Esiirits mauvais. Bas-relief du palais d’Assurbanipal à Kinive. Musée Britannique.
vie. — Les esprits mauvais étaient aussi en nombre incalculable, se répandaient partout, et causaient, sous la direction de Namtar, tous les maux qui bouleversent le monde, maladies, épidémies, famines, guerres, etc. (fig. 318). C’est à les exorciser en particulier que les médecins employaient toute leur science et leurs sortilèges, et les malades leurs prières.
Naturellement ces dieux n'étaient pas considérés comme éternels, ni comme créateurs ; mais les plus anciens avaieni rempli le rôle de démiurges ; Lufymu et Lafyamu, c’està-dire Anou et Anat, puis Bel et Belit, Éa et Damkina, s'étaient engendrés eux-mêmes, après un laps de temps durant lequel il n’y avait ni ciel ni terre, mais seulement AbSu, « l’abîmé, » et Tiâmat, « le chaos, » au sein desquels le ciel et la terre s’engendrèrent également : c’est alors que les dieux formèrent les êtres qui peuplent le monde, tandis que Mardouk combattait contre les ténèbres et le chaos, personnifiés en Tiâmat.
Le culte rendu aux dieux consistait, outre les jeûnes et une sorte de sabbat, en prières, en offrandes, en sacrifices, en cérémonies extérieures, fêtes et processions. On a retrouvé un bon nombre de prières, qui offrent beaucoup de ressemblance avec nos Psaumes, contenant comme ceux-ci soit les louanges de la divinité, soit quelque sollicitation, soit enfin une expression de repentir et une demande de pardon pour les fautes commises ; mais souvent
ces psaumes assyriens finissent par dégénérer en exorcismes et en formules magiques. — Les offrandes, mentionnées dans Daniel, wv, 2, et Baruch, vi, 9-42, sont fréquemment énumérées dans les inscriptions cunéiformes ; « lies consistaient surtout en encens et parfums, aliments et liquides, vêtements et bijoux, à l’usage des dieux et de leurs ministres. — Enfin les bas-reliefs et les cylindres
319. — Le roi Assurnasirpal offrant une libation. Bas-relief du Musée Britannique. Hauteur : 2 mètres 61.
gravés, non moins que les inscriptions, nous ont familiarisés avec les libations (fig. 319) et les sacrifices d’animaux (fig. 320), y compris les produits de la chasse (fig. 321) et delà pêche, qui sont souvent offerts aux dieux. On les faisait devant le naos ou tabernacle sous lequel trônait l’idole, ordinairement représentée sous la forme humaine et accompagnée d’un symbole, disque solaire, croissant, etc., qui la caractérisait, et coiffée d’une tiare sur laquelle s’enroulent plusieurs paires de cornes ; un autel, généralement assez étroit, permettait de brûler au moins quelques portions choisies de la victime ; sur le devant on voit aussi un chandelier surmonté d’une flamme ou feu perpétuel, comme celui du chandelier à sept branches dans le temple de Jérusalem ; on y voit également une sorte de table de proposition pour déposer les offrandes
( fig. 321 et 322) ; à l’entrée on remarque un grand vase, une sorte de mer d’airain, pour l’eau lustrale. Les sacrifices étaient accompagnés de musique instrumentale et du chant des psaumes. Non loin du temple il y avait généralement une pyramide ou tour étagée, consacrée aux observations astronomiques ou astrologiques. Le roi était le chef de la religion ; mais il y avait pour les fonctions du culte différents ordres de prêtres, sur lesquels nous n’avons pas encore de renseignements bien certains. Quant aux sacrifices humains, leur existence n’est pas également admise par tous les assyriologues. Il faut évidemment mettre de côté les scènes de carnage qui accompagnaient les guerres, et qui étaient censées accomplies par l’ordre d’Assur, d’Istar, etc., et en leur honneur : ce n'étaient évidemment pas de vrais sacrifices. Le seul texte concluant était donné par Sayce, dans les Transactions of the Society of Biblical Archseology, t. iv, p. 25-29 ; The Cuneiform Inscriptions of Western Asia, t. iv, pi. 26, n. 7 ; mais le mot uritsu, qu’il traduisait a enfant », parait bien signifier « jeune chevreau ». D’un autre côté, la Bible nous montre cette pratique en usage chez les habitants de Sippar ou Sépharvaïm non loin de Babylone, IV Reg., xvii, 31 ; et un certain nombre de pierres gravées, à usage de cachet ou d’amulette, de date fort reculée et de provenance babylonienne ou chaldéenne, semblent représenter clairement des sacrifices humains (fig. 323). Voir C. J. Bail, dans les Proceedings of the Society of Biblical Archœology, février 1892, t. xiv, p. 149-153. Toutefois en présence du silence absolu gardé à ce sujet par les annales assyriennes, il faut présumer, jusqu'à découverte de nouvelles inscriptions, que les Assyriens n’empruntèrent pas à la mère patrie cette cruelle coutume, et se contentèrent ordinairement de sacrifier des animaux. Quant aux prostitutions sacrées, elles devaient faire partie du culte d’Istar de Ninive.
A ceux qui accomplissaient toutes les lois morales et religieuses, les textes promettent généralement, de la part des dieux, balatu, unii rukuti, « une vie et des jours longs, » tub libbi, « le bien-être, » etc. Ils avaient cependant l’idée d’une vie future, dans une sorte de Schéol qu’ils nommaient Aralu, asar la amari, e-kur-bat, « l’Aral, le lieu où l’on ne voit pas, la maison du pays des morts. » Cette région souterraine est décrite, ainsi que ses habitants, dans la Descente d’IStar aux enfers. C’est « le pays d’où il n’y a pas de retour, — dont les habitants, privés de lumière, — ont la poussière pour nourriture, la boue pour aliment ; — là demeurent les anciens possesseurs de couronnes, — les porteurs de couronnes qui dominaient la terre aux temps antiques ; — là demeurent les gardiens de l’abîme des grands dieux ». Toutefois le sort de tous les défunts n’est pas le même : quelquesuns, comme Isdubar-Gilgamès et son ami Éa-bani, vont habiter un séjour de bonheur ; Ilasis-Adra habite dans l’assemblée des dieux, suivant l’auteur du même poème d’Isdubar ; enfin, dans plusieurs poèmes, on demande d’habiter « la montagne du ciel d’argent » : ces textes et d’autres analogues semblent indiquer, outre l’idée claire de la survivance de l'âme, la croyance au moins confuse à une certaine rétribution.
Quant aux cadavres et aux tombeaux, on n’en a guère trouvé en Assyrie ; il est à croire que l’on tenait à envoyer ses morts en Chaldée, comme les Persans modernes envoient de bien loin leurs morts à Nedjef et à Kerbela : c’est ce qui explique le nombre incalculable de tombeaux, — petits caveaux, jarres ou même plateaux et étuis en terre cuite de différentes formes, servant de cercueil, -— que l’on retrouve empilés les uns sur les autres jusqu'à former de vraies collines, particulièrement à Mughéir, l’ancienne r des Chaldéens (fig. 324 et 325), à Warka, l’ancienne Arach. À côté du mort enveloppé de bandelettes enduites de bitume, étendu sur une dalle de terre cuite ou emboîté dans sa jarre, on plaçait les objets à son usage, cachet, armes, bijoux, avec un peu de nourriture (fig. 325).
Priver quelqu’un de sépulture ou violer ses cendres était la dernière insulte et la plus terrible vengeance qu’on pût exercer à l’endroit de ses ennemis. Ils ont peut-être aussi pratiqué quelquefois l’incinération. Journal des Savants, décembre 1891, p. 721.
Telles sont, dans leurs grandes lignes, les croyances et la religion assyriennes. Les tablettes cunéiformes extraites des bibliothèques assyriennes et traitant de sujets religieux sont en très grand nombre ; mais il ne faut pas
the origin and growth of religion as ïllustrated by the religion of the ancient Babylonians, Londres, 1887, principalement p. 59-63 pour le sacerdoce ; 68-84 et 437-440 pour le culte, fêtes, sacrifices, temples ; 315-366 et 441-550 pour les compositions religieuses, psaumes et exorcismes ; SJ$1-$266 pour l’eschatologie ; J. Jeremias, Die Cultustafel von Sippar, Leipzig, p. 25-32 et suiv. ; G. Rawlinson, The five great monarchies, 1. 1, p. 308-322 ; t. ii, p. 1-42 ; Fr. Lenormant, Les origines de l’histoire,
320.
Sacrifice offert par un roi assyrien. Obélisque de Nimroud. — Autel chargé d’offrandes ; chandelier surmonté d’une flamme : grand rase d’eau ; roi versant une libation ; taureau prêt à être immolé en sacrifice.
oublier que leur interprétation est des plus difficiles, tant par la nature même du sujet que par le soin pris par les prêtres assyriens et babyloniens de ne pas vulgariser leurs connaissances théologiques ; aussi, dans ces matières, ils emploient généralement les caractères d'écriture plutôt avec la valeur idéographique qu’avec la valeur phonétique ; cela explique pourquoi le nom exact de certains dieux ou
1. 1, p. 493-531, 580-589 ; t. ii, p. 7-9 et suiv. ; LenormantBabelon, Histoire ancienne de l’Orient, t. v, p. 191-312 ; J. Menant, La bibliothèque du palais de Ninive, ^. 102-158 ; G. Smith -Delitzsch, Chaldàiscke Genesis, f>. 268-285, 306-307, 196-204 et suiv. ; T. Pinches, Guide to the Kouyunjik Galloy, British Muséum, Londres, 1884, p. 42-47 ; Perrot, Histoire de l’art dans l’antiquité, t. ii,
[[File: [Image à insérer]|300px]]
321. — Roi d’Assyrie offrant aux dieux les lions tués à la chasse. Bas-relief de Koyoundjttc. D’après Place, pi. 37.
esprits nous est encore inconnu : nous savons à quefle idée correspond tel caractère idéographique, tout en ignorant quelle en était, dans tel cas particulier, la véritable prononciation. Autant l’on est certain de l’interprétation des textes historiques, autant les textes mythologiques donnent lieu à hésitation, surtout dès qu’on prétend arriver aux détails. Nous avons élagué de cette étude tous les points sur lesquels on n’a pas encore de lumières suffisantes.
Voir Fr. Lenormant, Les dieux de Babylone et de l’Assyrie, Paris, 1877 ; Tiele, Die Assyriologie und ihre Ergebnisse fur die vergleichende Religionsgeschichte, Leipzig ; Histoire comparée des anciennes religions de l’Egypte et des peuples sémitiques, Paris, 1882 ; Manuel de l’histoire des religions, Paris, 1880 ; Sayce, Lectures on
p. 56-91, 347-378, 378-414 et suiv. — En outre, la plupart des textes religieux sont publiés dans les cinq volumes des Cuneiform Inscriptions of Western Asia, et beaucoup sont traduits dans les Records of the Past, l re et 2 « séries, et dans les Proceedings et Transactions of the Society of Biblical Archxology, publiés à Londres.
IV. Histoire. — L’histoire de l’Assyrie est une des
mieux documentées de toute l’antiquité. À la vérité, les
renseignements fournis par Hérodote, Gtésias et Diodore
de Sicile sont généralement suspects ; ceux qui nous
viennent par Bérose, prêtre babylonien contemporain des
premiers Séleucides, sont malheureusement dans un état
très fragmentaire. Mais d’abord on trouve dans la Bible
une source précieuse d’imformations. Nous avons vu que
En cours ![]() les Prophètes nons ont laissé une peinture fidèle du
caractère des Assyriens. Les Livres Saints nous ont tracé
aussi un tableau non moins exact de leurs conquêtes,
principalement en ce qui regardait Israël, Juda et les
peuples avoisinants, tableau soit historique, soit prophétique. Les deux derniers livres des Rois et le second livre
des Paralipomènes contiennent l’histoire des conquêtes
assyriennes ; les prophètes les prédisent généralement
comme punition des crimes d’Israël et de Juda. — Déjà
Balaam avait annoncé que la domination d’Assur s'étendrait jusque sur les Cinéens, les Kénites, qu’ils emmèneraient en captivité. Num., xxiv, 22-24. Ces Cinéens,
les Prophètes nons ont laissé une peinture fidèle du
caractère des Assyriens. Les Livres Saints nous ont tracé
aussi un tableau non moins exact de leurs conquêtes,
principalement en ce qui regardait Israël, Juda et les
peuples avoisinants, tableau soit historique, soit prophétique. Les deux derniers livres des Rois et le second livre
des Paralipomènes contiennent l’histoire des conquêtes
assyriennes ; les prophètes les prédisent généralement
comme punition des crimes d’Israël et de Juda. — Déjà
Balaam avait annoncé que la domination d’Assur s'étendrait jusque sur les Cinéens, les Kénites, qu’ils emmèneraient en captivité. Num., xxiv, 22-24. Ces Cinéens,

322. — Objets de culte.
Portes de bronze de Balawat. Musée Britannique.
mentionnés ici avec Amalec, paraissent distincts de la
tribu qui se fusionna avec les Hébreux, et habitaient au
sud de la Palestine. Balaam termine son oracle en disant
en termes généraux qu’Assur à son tour aura à souffrir
des vaisseaux de Kiltim, c’est-à-dire venus de la Méditerranée, proprement de Chypre, et, dans le sens large,
de l’Occident en général. Jér., ii, 10 ; Dan., xi, 30. —

323. — Sacrifice humain.
Cylindre babylonien. J. Menant, Recherches sur la glyptique
orientale, t. i, p. 151.
Dès le commencement de l'époque prophétique, Amos, v-vi, annonce la ruine d’Israël et sa transplantation plus loin que Damas, dès le temps de Jéroboam II, c’est-à-dire à l'époque de la plus grande prospérité d’Israël, vers le temps où Jonas menaçait Ninive. Plus tard, Osée blâme Israël de s’appuyer sur l’Assyrie et l’Egypte, vii, H -12 ; vin, 8-10 ; il annonce la chute de Samarie et des dix tribus, viii, 10 ; IX, 3 ; XIII, 15-16 ; il ajoute que l’Assyrien sera leur roi, xi, 5-7 ; xiii, 11 ; mais il laisse aussi entrevoir que la captivité aura un terme, xi, 1-11. Isaïe rassure Achaz en lui annonçant que Samarie, vii, 7-9 ; vin, 4 ; xxviii, 1-4, et la Syrie de Damas, viii, 4 ; xvii, 1-16, tomberont bientôt sous les coups des Assyriens ; il prophétise le même sort à l’Egypte et à l’Ethiopie, xx, 1-6 ; xix, 1-17, auprès de qui les rois juifs cherchaient sans cesse un appui contre l’Assyrie ; il annonce enfin l’invasion de la Judée elle-même par Sennachérib, la
désolation du pays, mais l’insuccès final du monarque assyrien devant Jérusalem, xxviii-xxxiii ; xxxvi-xxxviii ; x, 5-11 ; xiv, 24-27. Les Assyriens se chargèrent aussi de réaliser bon nombre des Massa ( dans la Vulgate Onus, prophétie de menaces) contre les nations, telles que les Philistins, Is., xiv, 28-32, les Arabes, Is., xxi, 13-17. Mais Ninive et la puissance assyrienne tombent bientôt à leur tour sans pouvoir se relever. Nahum l’annonce, i, 3, au moment même où l’Assyrie, immédiatement après la conquête de l’Egypte et le sac de Thèbes ou No-Ammon, est à son apogée sous le roi Assurbanipal Enfin, au

324. — Tombeau de Mughéir. Forme extérieure. D’après Loftus.
temps où ces menaces commencent à recevoir leur accomplissement et où Ninive est déjà bien déchue de son ancienne splendeur, Sophonie, ii, 13-15, annonce que la dévastation ira jusqu’au bout, que l’Assyrie sera détruite et que sa capitale deviendra une solitude et un désert.

825. — Tombeau de Mughéir. Vue intérieure. D’après Loftus.
Outre les renseignements donnés par la Bible, nous avons une source inespérée de renseignements dans les bas-reliefs (fig. 326) et les œuvres d’art qui font revivre sous nos yeux leur civilisation et leurs coutumes et surtout dans les textes cunéiformes eux-mêmes, textes authentiques, contemporains des événements, émanant de presque tous les rois assyriens, et dont le seul défaut est celui de former une histoire officielle, par conséquent suspecte quelquefois de partialité. La partie chronologique, outre les indications abondamment contenues dans les textes soit d’histoire publique, soit d’intérêt privé, nous est fournie par la liste ou Canon des limu. Ces limu, sorte de consuls éponymes, donnaient leur nom à l’année où ils étaient en fonction ; aux listes ainsi formées on joignait les indications relatives aux changements de règne, ou même souvent l'événement principal de l’année. Nous possédons le Canon sans interruption depuis le Xe siècle jusqu’au vne avant J.-C. ; mais nous savons, par des textes plus anciens, que l’institution des limu fonctionnait déjà iiês
ASSYRIE
1ÎB4
an XIVe, sans qu’on puisse encore assigner de date certaine à son origine. C’est cette liste des limu qui nous guide pour la chronologie assyrienne. Il faut remarquer qtte tous les mois de règne précédant celui de Nisan, éjui commençait l’année assyrienne, sont adjugés non pas au souverain régnant, mais à son prédécesseur, de sorte que l’accession au trône tombe généralement dans
échappe. — Quand commence la période des inscriptions historiques, c’est-à-dire dès le xviii 8 siècle, les Assyriens sont déjà constitués en monarchie absolue : le titre de patesi ou isSakkUj porté alors par les rois d’Assyrie, paraît indiquer, selon plusieurs, une sorte de vassalité de Babylone ; mais c’est plutôt un titre religieux, signifiant que le monarque tient la place des dieux, et particulièrement du
38 « — Le roi Asaurbanipal tuant un lion. Bas-relief, avec inscription cunéiforme, de son palais à Ninlve. Musée du Louvre.
l’année qui précède celle que nous indiquons d’après les limu comme première année de chaque règne. Une éclipse de soleil en 763 et la prise de Samarie en 722, mentionnés dans les textes assyriens, donnent des points de repère assurés à cette série chronologique.
Les textes cunéiformes ne donnent aucune indication directe ni sur la naissance ni sur la chute de l’empire assyrien (Voir cependant, Academy, 16 juillet 1892, p. 53, un texte qui paraît relatif à la colonisation de l’Assyrie par les Babyloniens). L’ethnographie nous apprend que le peuple d’Assur quitta la Chaldée pour remonter le long des rives du Tigre, à une époque dont l’antiquité nous
dieu Assur, ou bien est leur grand prêtre. Au-dessous du roi, les textes cunéiformes, k la vérité d'époque postérieure, mentionnent le Rab-Ékal ou Nîr-Ekal, « chef du palais, le Bab-bilub (?), le Tukultu, sans doute une espèce de vizir, le Rab-sak, « chef des grands ou officiers ; » le Rabsaris, « chef des princes » (Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles - lettres, 1886, p. 201) ; le Turtanu, « général en chef ; » la dignité de limu ou consul éponyme est portée tour à tour par le roi, les officiers de sa cour et les gouverneurs des villes principales. La première résidence royale fut AsSur, ville située sur le Tigre, au sud de Ninive. Déjà les patesi
ISme-Dagan et SamH-Ramman y avaient élevé un temple à leur dieu tutélaire^&tr, vers la fin du xixe siècle ou le commencement du xviiie.
Plus tard, l’Assyrie fut conquise par les rois égyptiens de la xviir 3 dynastie, particulièrement par Thothmès III, qui soumit les villes de Nini (qu’on a cru être Ninive, mais qui eu est probablement différente), Assur et Senkara ou Singar (Armais of Thothmès III, p. 24, 25, 49, 61, 62, dans les Records of the pasl, 1 N sér., t. Il ; 2e sér., t. v, p. 29 ; Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, 1886, p. 190, 198 et suiv.), et Amen-hotep II, qui s’empara encore de la ville de Nini ; on a retrouvé effectivement les cartouches de ces deux conquérants gravés en Assyrie, à Arban, sur le Ghabour. Layard, Nineveh and Babylon, p. 280-282 ; G. Rawlinson, History of ancient Egypt, 1881, t ii, p. 229 et suiv. ; 234-236.
Le temps de l’exode, qui paraît correspondre à une période d’amoindrissement pour l’Egypte ( fin de la XIXe dynastie), correspond à une période d’extension pour l’Assyrie. Le joug de l’Egypte une fois brisé, l’Assyrie commence par profiter de l’occupation de Babylone par les monarques KaëH pour traiter avec eux sur le pied d'égalité, et prendre, au lieu du titre d’isSakku, la qualification plus relevée de Sarru, « roi. » C’est ainsi que vers la fin du XVe siècle et le commencement du xiv « , Asur - bel - niSiSu, Pusur-ASur et Asur - uballit firent alliance avec Kara-indaS, Burna-Burias et leurs successeurs. Le xiii 8 siècle et les suivants voient succéder à ces bons rapports une lutte acharnée entre la mère patrie et la colonie, avec des alternatives pour chacune de succès et de revers, et un commun affaiblissement ; cela permet aux Hébreux de s’organiser à loisir en Palestine, et même, sous David et Salomon, d'étendre leur influence jusqu'à l’Euphrate, sans se heurter contre la puissance assyrienne. Durant cette période, un seul roi d’Assyrie, ïhéglathphalasar, vers le milieu du XIIe siècle, se rendit redoutable à ses voisins, les Mosques, la Commagène, l’Arménie et l’Aram ; il s’empara de Charcamis, la capitale de l’empire héthéen, et se vante même dans ses inscriptions d’avoir porté sa domination jusqu'à la Méditerranée. Cette extension, bien que passagère, était une menace pour l’avenir de l’Asie occidentale.
Asur-nasir-apal (883-858), l’un des rois d’Assyrie les plus belliqueux et les plus cruels, se chargea d’y donner suite. Il se choisit une nouvelle capitale, Halo ! }, la Chalé de la Bible, Gen., x, 11, actuellement Nimrud, ville ancienne, située au nord d' Assur, sur la rive gauche du Tigre, par conséquent moins exposée aux attaques venant de Babylone ou de la Syrie. Ayant recouvré toutes les provinces septentrionales autrefois occupées par Théglathphalasar, il prit la route de la Phénicie, et soumit le pays jusqu’au mont Liban ; les villes phéniciennes de Tyr, Sidon, Gébal, Arvad (Arad), etc., lui envoyèrent alors leurs tributs, pour s'éviter l’invasion. La Palestine avait été respectée ; mais sous Salmanasar (858-823), fils du précédent, le royaume d’Israël se vit attaqué, tant comme étant plus proche que celui de Juda de la route suivie par les Assyriens, que comme particulièrement compromis par l’imprudence d’Achab. Ce prince était entré dans une ligue formée contre Salmanasar, entre tous les chefs syriens, par les soins de Bénadad, roi de Damas ; les confédérés furent battus à Karkar et à Kirzau [?]. Non contents de les écraser en masse, quand l’occasion s’en présentait, Salmanasar et ses successeurs cherchèrent à détacher de la confédération ainsi formée l’un ou l’autre royaume, auquel ils accordaient une protection largement payée d’abord, et que le moindre prétexte changeait bientôt en oppression et en asservissement. Jéhu paya tribut a Salmanasar pour se faire protéger contre Hazaël de Damas ; et bien que les textes n’en disent rien, il est croyable que Joachaz, Joas et Jéroboam II firent de même. Durant cette période, SamH-Ramman (823-810), Ramnmn-nirar (810-781), Salmanu-asir (781-771), Asur dan-ili (771-753) et Asur-nirar (753-743), tout en portant le principal de leurs efforts contre l’Arménie et les districts du nord, n’oublièrent pas non plus de surveiller et au besoin de châtier Damas et la Syrie. Mais Théglathphalasar, qui est sans doute aussi le Phul de l'Écriture, IV Reg., xv, 19-20 ; I Par., v, 26, et le Pulu des textes babyloniens (743-727), agit avec plus de vigueur : la coalition des princes syriens s'étant organisée de nouveau sous la conduite du roi d'Émath et avec le concours d’Azarias, roi de Juda, Théglathphalasar survint, battit à plusieurs reprises les confédérés, annexa à l’Assyrie le pays d' 'Amatti, l'Émath biblique, en transplanta les habitants vers les sources du Tigre, et soumit au tribut les autres rois, y compris Rasin de Damas, Manahem d’Israël et Azarias de Juda. Achaz de Juda aggrava encore la situation : menacé à la fois par Phacée d’Israël et Rasin de Damas, IV Reg., xv, 37 ; Is., vii, 1, il sollicita l’appui de son suzerain. Théglathphalasar se hâta, en effet, d’intervenir ; il en coûta la vie à Rasin, avec le pillage et la destruction de son royaume ; la vie aussi à Phacée, avec la déportation en Assyrie d’un grand nombre d’Israélites ; à Achaz enfin d'écrasantes contributions de guerre. IV Reg., xv, 29 ; xvi, 7-10.
Théglathphalasar avait fait ailleurs une conquête plus riche et plus dangereuse à la fois, en s’emparant de la Babylonie : mécontent de plusieurs vice-rois qu’il y avait établis ou reconnus, il avait fini par prendre lui-même le titre de « roi de Babylone, roi de Soumir et d’Akkad ». Mais la Babylonie était riche et puissante, bien peuplée et jalouse de son indépendance, aussi essaya-t-elle souvent de secouer le joug de son ancienne colonie ; les efforts continuels que durent faire les successeurs de Théglathphalasar pour garder cette conquête finirent par affaiblir à la longue la monarchie assyrienne, et il arriva un jour où celle-ci succomba sous les coups des Babyloniens révoltés.
De Salmanasar (727-722) nous n’avons jusqu'à présent aucune inscription historique ; nous savons seulement, par le Canon des limu et une Chronique babylonienne, qu’il régna cinq ans sur l’Assyrie et la Babylonie. L'Écriture, IV Reg., xviii, 9-12, semble lui attribuer la prise de Samarie, la destruction du royaume d’Israël et la déportation des Israélites, comme châtiment de leur alliance avec l’Egypte et l’Ethiopie. Dans les inscriptions assyriennes, ces exploits sont revendiqués, au moins en bonne partie, par son successeur Sargon (722-705). Voir Salmanasar, Sargon. Quoi qu’il en soit, la Bible, Is., vu, 18, etc., et les inscriptions cunéiformes se rencontrent pour mettre aux prises à cette époque l’Egypte et l’Assyrie, d’abord sourdement, puis à force ouverte ; cette lutte, d’une durée d’un demi-siècle, qui eut d’abord la Palestine, et ensuite la vallée du Nil pour théâtre, fut fatale à l’Egypte : elle succomba et resta aux mains des Assyriens, puis des Babyloniens leurs héritiers, pour passer de là aux Perses et enfin aux Grecs ; fatale aussi aux peuples circonvoisins, particulièrement aux Juifs, qui ne savaient ni ne pouvaient rester neutres ; désastreuse même pour l’Assyrie, que ces expéditions lointaines et souvent répétées finirent par épuiser, malgré toutes ses victoires.
Sargon avait ajouté à l’empire assyrien une grande partie de la Syrie, de la Palestine et de la Médie. Cf. Is., xx, 1. Sennachérib (705-681) dut élargir encore ce cercle d’action : la Babylonie se révoltant fréquemment, à l’instigation et avec l’appui des Élamites, il fallut entreprendre la conquête du pays d'Élam. À l’autre extrémité de l’empire, l’Egypte poussait à la révolte la Syrie et la Palestine, et leur promettait son secours : Sennachérib dut venir ravager le royaume de Juda, rançonner Ézéchias, battre les Egyptiens à Altakou, menacer Jérusalem. IV Reg., xviii, 13-xix, 36. À la suite du désastre inattendu qu’il essuya en Palestine, il quitta précipitamment le pays, sans poursuivre plus loin sa vengeance contre Juda et l’Egypte,
et alla se consoler de son échec en guerroyant sur les autres frontières de son empire, et en se construisant un magnifique palais à Ninive, qui devint désormais, jusqu'à la fin de la monarchie, le séjour préféré des monarques assyriens. Sennachérib ayant été assassiné par deux de ses enfants, Adrammélech et Sarasar, IV Reg., xix, 37, Asarhaddon (681-668) succéda à son père, après avoir expulsé les parricides : tout en maintenant les conquêtes de ses prédécesseurs, il envahit et pilla l’Egypte, vainement défendue par. Tharaca, prince éthiopien de la xxv s dynastie, et établit des garnisons assyriennes dans les principales villes. Il tenta aussi de s’annexer l’Arabie, mais les déserts et le climat l’empêchèrent d’y asseoir sa puissance d’une manière durable. Parmi les rois ses tributaires, il mentionne Manassé, roi de Juda, fils d'Ézéchias. Une révolte ayant éclaté en Egypte en 668, Asarhaddon remit le pouvoir à son fils Assurbanipal (668-625 [?]), se contentant de la Babylonie, qu’il gouverna jusqu'à sa mort, arrivée un an plus tard. Durant son long règne, Assurbanipal dut recommencer presque toutes les conquêtes de ses prédécesseurs : l’Egypte, soulevée successivement par Tharaca, Néchao et Ourd-Amen, fut reprise de nouveau et sévèrement châtiée ; l'Élam fut écrasée, et ses principales villes, la capitale surtout, Suse, furent ravagées de fond eh comble. La Babylonie eut le même sort. Après la mort d' Asarhaddon, Assurbanipal lui avait, donné pour roi SamaS-sum-ukin, son propre frère. Celui-ci, ayant suscité contre son aîné une formidable coalition de tous les royaumes tributaires de l’Assyrie, vit ses alliés battus les uns après les autres, ne put se défendre en Babylonie, fut pris et brûlé vif. Manassé de Juda, qui avait trempé dans le complot, eut son royaume ravagé, fut lui-même pris et chargé de chaînes, conduit à Babylone ; puis, contre toute attente, réintégré sur le trône. II Par, , xxxiii, 11-13. Grâce à cette énergie indomptable, soutenue par quelques actes d’utile clémence, Assurbanipal maintint presque partout son autorité. Mais ce qui le rendit surtout célèbre, ce furent ses constructions magnifiques à Ninive et ses travaux littéraires ; il profita de ses conquêtes en Babylonie pour y rechercher et faire transcrire les textes anciens, et il déposa toutes ces copies dans la bibliothèque de son palais, à Ninive.
B eut pour successeur son fils ASur-etil-ilani ( 625 [?] - [?]) Ce prince, au lieu d’une succession brillante, recevait en réalité un empire épuisé, qui succombait sous le poids de toutes ces conquêtes ; les Assyriens ne savaient pas tirer parti de leurs victoires pour fonder d'établissement durable, et il fallait recommencer la guerre à chaque règne nouveau, sur toutes les frontières de l’empire. Vainement changeaiton les dynasties régnantes pour investir dç l’autorité les créatures des Assyriens, comme Osée d’Israël ; les exigences du suzerain rendaient toujours fréquentes les révoltes des vassaux. Le système de la déportation en masse, si largement pratiqué, ne donna pas de meilleurs résultats : les transportés restaient toujours des rebelles, prêts à faire cause commune avec les ennemis de l’Assyrie ; et ceux qui échappaient à la déportation, et qui formaient naturellement le grand nombre, n’en devenaient pas des vassaux plus attachés ni plus fidèles. Ce grand empire, formé de nationalités si diverses et si dépourvues de cohésion, devait bientôt s'écrouler. — Il est impossible de dire avec certitude quel ennemi donna le coup décisif, car les inscriptions assyriennes nous font ici défaut, et l'Écriture ne nous donne que des indications trop vagues : quant aux écrivains grecs, les découvertes assyriologiques nous ont appris à nous défier de leurs récits. Les Cimmériens, chassés d’Europe par les Scythes, envahirent l’Assyrie sous un roi nommé Asarhaddon, que Lenormant, Sayce et Schrader croient postérieur à Assurbanipal. Déjà Asarhaddon Ie ', le père de celui-ci, avait battu les Cimmériens, la quatrième année de son règne, si la restitution proposée par Winckler à la Chronique babylonienne est exacte (677) ; Liais les Scythes les suivirent un demi-siècle plus tard. A
cette époque (625 [?]), Ninive était menacée, assiégée même par un tributaire révolté, Cyaxare ou Vvahsatara, chef des Mèdes. L’arrivée des Scythes obligea Cyaxare à lever le siège, pour aller défendre ses propres États ; mais les envahisseurs, grâce à leur nombre plutôt qu'à leur force, ne purent être arrêtés, et se répandirent dans la Médie et surtout dans toute l’Assyrie, plus riche et plus capable d’exciter leurs convoitises : Ninive échappa au pillage derrière ses fortes murailles ; mais les autres cités assyriennes, Assur et Chalé, furent totalement dévastées ; les Scythes débordèrent même sur le reste de l’Asie occidentale, et ne s’arrêtèrent qu’aux confins de l’Egypte, grâce aux prières et aux riches présents de Psammétique I er. Mais Cyaxare, leur ayant laissé le temps de s’affaiblir, recouvra son indépendance en joignant à la force la tra ? hison. Quant à Assur-etil-ilani, il essayait aussi de relever l’Assyrie de ses ruines, lorsqu’il mourut, laissant le trône à Sin-ëar-iSkun, après lequel aurait régné encore ASur-ahi-iddin II, suivant Sayce, Schrader et Lenormant. Les historiographes grecs nous ont laissé pour les derniers rois de Ninive les noms-de Saracus et Sardanapale. Ce qui parait certain, c’est que Cyaxare revint à la charge, aidé du vice-roi révolté de Babylone Nabopolassar, peut-être encore des Cimmériens ; et, cette fois, Ninive finit par succomber sous leurs coups ([?] 606), entraînant dans sa chute l’empire assyrien, que les deux vainqueurs se partagèrent entre eux : SchraderWhitehouse, The Cuneiform Inscriptions and the Old Testament, t. ii, p. 443-471, qui renverse l’opinion de M. de Saulcy, Chronologie des empires de Ninive, de Babylone et dEcbatane, p. 79-80, lequel plaçait la chute de l’empire assyrien en 625 ; A. H. Sayce, Records of the past, 2e sér., t. iv, p. vnxiii ; voir aussi Delattre, Le Peuple et l’empire des Mèdes, p. 122-125. L’Assyrie et ses conquêtes septentrionales échurent à Cyaxare ; tandis que celles du sud, l'Élam, la vallée de l’Euphrate et la Syrie firent partie de la monarchie babylonienne, dont elles subirent désormais toutes les vicissitudes ; quant à Ninive, les menaces des prophètes, Tobie, xiv, 6 ; Nah., ii-m ; Sophon., ii, 13, reçurent un accomplissement si littéral, que, deux cents ans plus tard, on ne connaissait déjà plus d’une manière certaine son emplacement.
C’est seulement en ce siècle qu’on découvrit ses ruines, sous les tells ou collines artificielles, formés par l'éboulement de ses palais et de leurs épais murs de brique crue. Sur les indications du secrétaire de la Société asiatique de Paris, J. Mohl, qu’avaient vivement frappé quelques poteries et inscriptions cunéiformes rapportées antérieurement de Mésopotamie par l’Anglais Rich, Emile Botta, agent consulaire français à Mossoul, pratiqua des fouilles à Koyundjik et à Khorsabad (1842-1845) ; ces dernières mirent au jour le palais du roi Sargon et l’ancienne ville de Dour-Sargani (Khorsabad), dont V. Place acheva l’exploration (1851-1855) ; l’Anglais Austin Layard, ayant repris les fouilles de Koyundjik, que Botta avait laissées interrompues, découvrait Ninive et ses nombreux palais ; d’autres excavations pratiquées par le même explorateur à Nimroud et à Kaléh-Sergat rendaient à la lumière l’ancienne Halah, la Chalé biblique, et Assur, la première capitale de l’Assyrie (1845-1847, 1849-1851). Les Anglais W. K. Loftus (1852-1853) et George Smith (1873, 1874, 1876), ainsi que l’indigène Hormuz Rassam (1852-1854, 1878), achevèrent ces importantes découvertes. Le musée du Louvre a tiré ses principales antiquités assyriennes de Khorsabad, tandis que les riches galeries du Musée Britannique de Londres doivent surtout leurs trésors à Ninive.
Pour juger équitablement l’Assyrie, il ne faut pas la séparer de la Babylonie, sa mère patrie, à laquelle elle se rattache par une communauté d’origine, de développements et d’action extérieure. Sans doute on peut accuser les Assyriens d’avoir trop aimé la guerre, et de s’y être laissé entraîner à des actes de cruauté ; mais ce reproche 1-JG9
ASSYRIE — ASSYRIENNE (LANGUE)
1470
retombe à peu près également sur tous les peuples de la haute antiquité. Au point de vue politique, l’Assyrie joua un rôle prépondérant dans la formation des grands empires asiatiques, dans lesquels la force armée servait, volontairement ou à son insu, à étendre les relations de peuple à peuple et à propager la civilisation. Au point de vue commercial, industriel ou artistique, elle entretint d'étroites relations avec la Syrie, la Phénicie, les colonies grecques de l’Asie Mineure, les Héthéens et l’Arménie, de sorte que son influence se fit sentir jusqu’en Europe ; directement ou indirectement, elle marqua de son empreinte les origines de l’art grec. L’art assyrien, sans être parfait, produisit des œuvres remarquables. C’est aussi de la Mésopotamie que vinrent aux Grecs les rudiments de presque toutes les sciences, non seulement à l'époque de la conquête de Babylone par Alexandre, mais dès leurs premiers établissements en Asie Mineure. Enfin il ne faut pas oublier que c’est surtout grâce aux scribes assyriens et à leurs tablettes d’argile que la littérature si considérable et si intéressante de cette époque, tant babylonienne qu’assyrienne, nous a été conservée ; comme c’est aux sculpteurs de Ninive, de Khorsabad, de Chalé et d’Assur, bien plus, qu’a ceux de Babylone, que nous devons des trésors archéologiques incomparables : et l’on se sentira porté à se montrer moins sévère pour l’empire des Assyriens.
Voir, outre les auteurs indiqués pour chaque règne ou chaque événement particulier : H. Rawlinson, Outlines of Assyrian History from the inscriptions of Nineveh, Londres, 1852 ; G. Rawlinson, The five great Monarchies of the ancient Eastern warld, Londres, 1879, t. i et n : Schrader-Whitehouse, The Cuneiform Inscriptions and the Old Testament, Excursus on chronology, t. ii, p. 160-175 ; J. Oppert, Histoire des empires de Chaldée et d’Assyrie, d’après les monuments, Paris, 1866 ; Sayce, Synchronous history of Assyria and Babylonia, Londres, 1873 ; J. Menant, Annales des rois d’Assyrie, traduites et mises en ordre sur le texte assyrien, Paris, 1874 ; G. Smith, The Assyrian Eponym Canon, Londres, 1876 ; Assyria, from the earliest times to the fall of Nineveh, Londres, 1877 ; Lenormant-Babelon, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, Paris, 1885-1887 ; Fr. Hommel, Geschichte Babyloniens und Assyriens, 1885 ; Tiele, Babylonisch - assyrische Geschichte, Gotha, 1886-1888 ; Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, Paris, 1886. Voir les textes, transcriptions, traductions, dans The Cuneiform Inscriptions of Western Asia ; Transactions and proceedings of the Society of Biblical Archseology, Londres ; Eb. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, Berlin, et dans les autres collections indiquées ci - dessus.
- ASSYRIEN##
ASSYRIEN, habitant de l’Assyrie. La Vulgate emploie très souvent ce mot, mais il n’a pas d'équivalent direct dans le texte original. L’hébreu emploie sans exception le mot 'Assur, pour désigner soit l’Assyrie, Gen., ii, 14, etc., soit collectivement ceux qui l’habitent. Is., xix, 23, etc. Notre version latine a emprunté le mot ethnique « Assyrie » aux Septante, qui ont aussi fréquemment traduit l’hébreu 'Assûr par 'Aærupt’o ; . Gen., ii, 14 ; xxv, 18, etc. Voir Assyrie.
- ASSYRIENNE##
ASSYRIENNE (LANGUE). L’assyrien fait partie de la famille des langues sémitiques. Cette famille de langues, ainsi désignées parce que la plupart des peuples qui les parlaient sont issus de Sem, Gen., x, 21-31, se partage en deux groupes : le groupe sémitique du nord et le groupe sémitique du sud. L’assyrien appartient au groupe du nord. Il a sa place marquée entre l’hébreu et l’araméen ; plus voisin cependant de l’hébreu que de l’araméen, qui déjà, par la dentalisation des sifflantes, se rapproche davantage de l’arabe, et peut être regardé comme la transition entre les idiomes du nord et les idiomes du sud.
On a distingué en assyrien deux dialectes : le dialecte ninivite et le dialecte babylonien, qui présentent entre eux certaines différences : par exemple, la confusion en babylonien des consonnes fortes et des consonnes douces b et p, d et f, s et z, k et g. Ainsi qu’on le voit, le terme de « langue assyrienne » est impropre, l’Assyrie n’ayant jamais servi à désigner, dans l’histoire, que le royaume qui eut pour capitale Ninive. Le terme de langue assyrobabylonienne conviendrait mieux. Cette dénomination aurait le double avantage de répondre à la fois à la séparation des dialectes et à leur distribution géographique elle-même.
I. Extension. — La langue assyro-babylonienne était parlée à Ninive et à Babylone, tout le long des rives du Tigre et de l’Euphrate, depuis le golte Persique jusqu’aux montagnes d’Arménie.
IL Durée. — Cette langue nous offre l’exemple d’une vitalité prodigieuse. Sans doute l'état actuel de nos connaissances ne nous permet pas de marquer d’une façon précise ses lointaines origines ; mais du moment où nous pouvons la saisir, c’est-à-dire environ 4000 ans avant J.-C, elle nous apparaît comme entièrement constituée. Historiquement, elle a persisté pendant quarante siècles, presque sans subir de variations. Quand elle eut cessé d'être la langue officielle et ne fut plus employée dans les inscriptions royales, elle demeura longtemps encore la langue courante et servit pour la rédaction des contrats privés. Nous possédons les inscriptions de Sargon d’Agadé, qui, d’après certains documents, remontent peut-être à 3800 ans avant J.-C, et nous trouvons des contrats privés jusque sous les Arsacides, vers la fin du I er siècle de l'ère chrétienne.
III. Écriture. — Les signes qui ont servi à l’expression de la langue assyro-babylonienne se rattachent à un système d'écriture absolument différent de celui des autres langues sémitiques. Tout d’abord leur origine est diverse. L'écriture phénicienne et, par son intermédiaire, la plupart des écritures sémitiques, dérivent du système hiéroglyphique des Égyptiens. Voir Alphabet. L'écriture assyrobabylonienne, au contraire, procède directement du système hiéroglyphique des Chaldéens. De cette diversité d’origine découlent des différences multiples, soit dans la direction de l'écriture, soit dans la forme extérieure et la structure intime des signes. D’abord l'écriture assyrobabylonienne se lit non plus de droite à gauche, mais de gauche à droite. En outre, les caractères qui la composent ne sont pas formés de traits et de ligatures diversement combinés, mais d’un élément unique, le clou ou
coin, |, *_—, produisant, suivant la disposition et le
nombre même des éléments, des assemblages plus ou moins complexes : d’où le nom de cunéiformes, donné aux écritures de ce type. Enfin ces signes sont syllabiques, c’est-à-dire qu’ils expriment un groupe de lettres, une voyelle avec une ou plusieurs consonnes, à la différence des signes alphabétiques, qui expriment une seule lettre, une consonne ou une voyelle. Quelquefois ils sont purement idéographiques, c’est-à-dire qu’ils reproduisent l’objet lui-même, soit directement, soit indirectement au moyen d’un symbole. Par suite, le syllabaire assyrobabylonien est bien autrement compliqué que l’alphabet phénicien. Il ne comprend pas seulement vingtdeux consonnes, mais bien plusieurs centaines de signes, représentant des syllabes ou des idéogrammes, le plus souvent l’un et l’autre à la fois. Comment s’est produite une telle complication, il est aisé de l’expliquer. En effet, à chaque hiéroglyphe répondait primitivement un mot unique ; mais, par un besoin de simplification, i le même signe ne tarda pas à désigner plusieurs mots l synonymes ou de sens voisin. De ces valeurs idéographiques elles-mêmes dérivèrent des valeurs syllabiques simples ( une consonne précédée ou suivie d’une voyelle : ab, ki, ru) ou complexes (une voyelle comprise entre un
- ASSYRIENNE##
ASSYRIENNE (LANGUE)
1172
deux consonnes : bat, mit, tum). Soit, par exemple, le signe formé de plusieurs traits entre-croisés, représentant une étoile, p > ^[<f — À ce si ë ne correspondent les
valeurs idéographiques : kakkabu, « étoile ; » ëamu, Samie, « ciel ; » Anu, « le dieu suprême ; » ilii, « dieu ; » et la valeur syllabique simple an (dérivée visiblement de Anu). Autre exemple : soit le signe figurant un triangle, une surface
limitée et terminée par un sommet, ^V4. À ce signe correspondent les valeurs idéographiques : matu, « pays ; » kuru, kurtu, « région ; » Sadu, « montagne ; » kasadu, « posséder, conquérir ; » ktëittu, « propriété ; » napahu, « s'élever ; » niphu, « lever » (en parlant du soleil), et les valeurs syllabiques complexes mat, kur, Sat (abrégées de matu, kuru, kurtu, sadu), lat, mit (dont l’origine est inconnue). Qu’on ajoute à cette polyphonie la polymorphie, — car chaque signe a subi, au cours des temps, de nombreuses modifications, qui souvent, d’une inscription à l’autre, le rendent méconnaissable, — et l’on aura une idée des difficultés de la lecture et du déchiffrement de l’assyrien.
IV. Caractères. Affinités et différences Avec les autres langues SÉMITIQUES. — La langue assyrobabylonienne offre les principaux traits caractéristiques des langues sémitiques : trilittéralité des racines, riche gradation des lettres gutturales, rôle prépondérant des consonnes dans la constitution des mots, nuances de sens amenées par le déplacement des voyelles, pauvreté des temps du verbe, dualité des genres, addition de préfixes et suffixes, absence de composés, simplicité de la syntaxe.
Outre ces caractères, communs à tous les idiomes sémitiques, elle présente certaines particularités remarquables, qui constituent son originalité et lui font une place à part dans ce groupe de langues. Nous noterons seulement les principales : 1° Chute des lettres emphatiques, ', ii, ii, '. Exemples : hébreu, 'âh ; assyrien, al}U, « frère ; » héb., hâlak ; ass., alaku, « aller ; » héb., râhôq ; ass., rûqu, « lointain ; » héb., 'ârab ; ass., erebu, « entrer. » — 2° Suppression des diphtongues. Ex. : héb., bait ; ass., bitu, « maison. » — 3° Changement de S en l devant les dentales d, f, t, et en s après ces mêmes lettres. Ex. : altur ( pour asfur), « j'écrivis ; » lubultu ( pour lubuStu), « vêtement ; » belutsu (pour belutsu), « sa seigneurie. » — 4° Dans les noms, substantifs ou adjectifs, la terminaison en u souvent complétée par l’addition de la lettre finale m ou mimmalion ( la mimmation se retrouve en sabéeri dans les noms propres, et devient en arabe la nunnalion) : Sarru, « roi ; » sarrum-ma, « le roi aussi ; » les cas obliques marqués par les désinences i au génitif et a à l’accusatif (on les rencontre aussi en arabe) : sarri, « du roi ; » Sarra, « le roi ; » l'état construit (il n’existe que dans les langues sémitiques du nord, hébreu et araméen) : sar (mat) Assur, « roi d’Assyrie ; » la terminaison du pluriel en âni ou ê : ilàni, o les dieux ; » samie, « les cieux. » — 5° Dans le pronom personnel, la forme anaku, pour la première personne (elle s’est conservée dans l’hébreu 'dnokî et est tombée dans les autres langues sémitiques), et, pour la troisième personne, les formes Su, Si, au lieu de hû', M' (elles ont persisté dans le dialecte minéen). — 6° Dans le verbe, le prétérit caractérisé par des préformantes, iskun, taSkun, etc. (à la différence des autres langues sémitiques, où le prétérit est caractérisé par des adformantes ; hébreu : qâpal, qâflâh, etc.) ; le temps du permansif (il ne se retrouve pas ailleurs) sakin, saknat, etc. ; le schaphel, conjugaison de sens causatif, usâskin, tusâskin, etc. ; les formes verbales dérivées obtenues par l’insertion des deux consonnes t et ii, eomme Viphtanaal, Vuphtanaal, etc. — 7° La formation ordinaire des adverbes par l’accession de la finale is : rab-is, « grandement ; » agg-is, « fortement, s — 8° Le remplacement des prépositions sémi tiques ordinaires be, le, par les prépositions originales : ina, « dans ; » ana, « vers. »
V. Développement littéraire. — La littérature assyrienne avait produit des œuvres importantes et nombreuses, si l’on en juge par les fragments considérables que nous ont révélés, en moins d’un demi-siècle, de Botta à M. de Sarzec, les fouilles opérées à Ninive, à Babylone et dans la basse. Chaldée. Les inscriptions qui nous ont été conservées sur ces fragments, bas-reliefs, prismes ou cylindres, tablettes, sont de nature fort diverse. Elles comprennent : 1° des documents historiques qui ont permis de reconstituer, sauf les lacunes, les annales des rois de Babylone et d’Assyrie, depuis Sargon d’Agadé et Naram-Sin (vers 3800 avant J.-C.) jusqu'à Nabonide (538 avant J.-C) ; — 2° des contrats d’intérêt privé qui nous renseignent exactement sur les institutions, mœurs et coutumes ; — 3° des grammaires et lexiques, des recueils de littérature, mythologie, magie, statistique et droit civil, des traités de sciences naturelles et mathématiques, des livres d’astronomie et d’astrologie, enfin des pièces d’archives (tout cela constituant le fond même de la bibliothèque d’Assurbanipal) ; — 4° toute une littérature épistolaire inscrite sur de nombreuses tablettes, dont les plus importantes, découvertes à Tell el-Amama, en 1887, contiennent la correspondance des rois et satrapes orientaux avec Aménophis III et Aménophis IV.
Ces documents ont été dispersés, au hasard des découvertes et des acquisitions, dans les divers musées d’Europe. Dans ce partage des antiquités assyro-babyloniennes, un lot important est échu au musée du Louvre ; mais au British Muséum est dévolue sans contredit la meilleure part. C’est là que se trouvent réunis les débris de la fameuse bibliothèque d’Assurbanipal, qui à eux seuls forment une masse de plus de cent mètres cubes, et dont le contenu représente environ cinq cents volumes de cinq cents pages in-quarto.
VI. Utilité de la langue assyro-babylonienne pour les études bibliques. — Elle est d’un précieux secours pour l’interprétation littérale et critique de la Bible. Voici quelques exemples :
1° Pour l’interprétation littérale. — 1° Dans le récit du déluge, la plupart des interprètes ont donné au terme sohar, Gen., vi, 16, le sens de « fenêtre », et y ont vu un synonyme de halôn. Gen., viii, 6. Quelques-uns cependant, s’appuyant sur l’arabe zahr, lui attribuaient la signification de « dos, toit », et le rapprochaient de miksêh. Gen., viii, 13. L’assyro-babylonien siru, « dos, plaine, » est venu confirmer cette dernière interprétation, qui d’ailleurs s’accorde parfaitement avec le contexte. — 2° Avant le déchiffrement des textes assyro-babyloniens, on n’avait pas bien compris le mot 'orên, qui se trouve une seule fois dans Isaïe, xliv, 14. Les Septante avaient traduit iutuç, et la Vulgate pinus. On savait donc seulement que ce mot désignait « une sorte de pin ». Or rien de plus fréquent, en assyro - babylonien, que le terme erinu, avec le sens de « cèdre ». Orèn doit être entendu de même. C’est un synonyme de 'êrêz, qui, en hébreu, est le terme ordinaire pour exprimer l’idée de « cèdre ». — 3° Le passage suivant, I Esdr., iv, 13 : Mindàh belô vahâlâk la' întenûn ve’aptôm malkîm (ehanziq, avait été jusqu’ici mal rendu par les interprètes. Dans ce seul membre de phrase, ils n’avaient pas pu rendre compte de la vraie signification des mots mindah, belô et ve’aptôm. Ils attribuaient à mindàh le sens de « mesure », en rattachant ce mot à la racine mâdad, « mesurer. » En nous fondant sur les formes assyro-babyloniennes correspondantes madatu, mandatu (pour mandantu), _s& rattachant à la racine nadânu, « donner, » nous arrivons pour mindàh au sens de « contributions ». Quant au terme belô, on le dérivait de bâlàh, « vieillir, périr, consumer ; » puis, en rapprochant d’une manière forcée les mots « consumer, consommer, » en faisant un véritable calembour, on lui découvrait la signification de « redevances en nature ». Or belô désigne tout
simplement « un tribut, un impôt », ainsi que l’assyrobabylonien biltu, dérivé de la racine abâlu, « apporter. » Mais, entre ces divers mots, le dernier, ve’aptôm, a eu sans contredit la fortune la plus singulière. Il est curieux de noter les vicissitudes qu’il a subies, au cours des temps, dans l'œuvre des traducteurs et commentateurs, depuis les plus anciens ( Septante, Vulgate, syriaque), qui se tiraient de la difficulté en sautant le mot, pour n’avoir pas à le traduire, jusqu'à Gesenius lui - même, qui lui trouve un équivalent dans le pehlvi afdom, « fin ; » avdom, « dernier, » et le perse fd’m. Voir Gesenius, Thésaurus linguse hebrsese, p. 143. Or ce terme doit être rapproché de l’assyrien anapiti-ma, contracté en apitima (cf. ammini, « pourquoi, » contracté de ana mini) et de l’hébreu pif om. Il dérive de la racine sémitique pd(a', pâfah, pâtal}, pâfa' (elle existe sous ces diverses formes), qui exprime l’idée « d’ouvrir, de commencer ». 'Apfôm doit se traduire « dès l’abord, aussitôt ». D’après ces indications, le sens de la phrase est celui-ci : « S’ils ne payent pas les redevances, le tribut et les droits commerciaux, ce sera d’abord, pour les rois, un réel dommage. »
2° Pour l’interprétation critique. — Certains exégètes, frappés de la similitude qui existe entre la langue du Pentateuque et celle des Psaumes et des Prophètes, prétendent tirer de là une confirmation en faveur de la thèse qui assigne une date relativement récente à la composition de ce livre. Ils ne peuvent comprendre que la langue hébraïque, de Moïse à Jérémîe, ait subi si peu de variations. Cet argument doit être définitivement abandonné. En effet, la fixité de l’hébreu n’est pas un phénomène isolé dans l’histoire des langues sémitiques. L’assyrien, comme nous l’avons dit plus haut, est resté sensiblement le même durant quarante siècles. La comparaison d’Horace, Ars poet., 60-62 :
Ut silvaB foliis pronos mutante in annos, Prima cadunt ; ita verborum vêtus interit âetas, Et juvenum ritu florerit modo nata vigentque,
ne peut être appliquée qu'à nos langues occidentales ; elle ne saurait être étendue aux langues sémitiques.
L’emploi de tel ou tel mot, moins encore, de telle ou telle forme orthographique, peut nous renseigner sur la provenance d’un morceau, sur son caractère d’antiquité ou de modernité. Voici deux exemples empruntés à M. J. Halévy : 1° Dans une étude sur Noé, le déluge et les Noahides (Recherches bibliques, 13e fasc., xxrv), ce savant a cru découvrir une preuve de l’origine babylo' nienne du récit biblique dans l’exacte correspondance des mots hébreux gofêr, tébah, kofêr, avec les mots babyloniens giparu, « espèce de roseau ; » tebitu, « sorte de vaisseau ; » kupru, « bitume » (ce dernier mot est ici particulièrement significatif : il désigne d’une façon spéciale lé bitume babylonien, par opposition au mot hémâr, Gén., xiv, 10 ; Exod., ii, 3, qui sert à désigner le bitume palestinien ou égyptien). — 2° Ailleurs, dans ses Notes sur quelques textes araméens du Corpus inscriptionum semiticarum (Recherches bibliques, 11e fasc), ce même savant a relevé minutieusement, d’après des inscriptions remontant au ixe siècle avant notre ère, comme date inférieure, les formes orthographiques anciennes pour des mots tels que frs, « demi-mine » (n° 10) ; sqln, « sicle » (n° 13, passim) ; 'H, « femme » (n° 15), et constaté que la transformation de la chuintante primitive en sifflante (frs au lieu de frS) ne s’est effectuée que lentement. Or une telle remarque est immédiatement vérifiable dans les livres du recueil biblique. Nous avons de cela un exemple frappant pour le mot shd (ce mot a été heureusement conservé sur un texte entièrement fruste, n" 35), orthographié avec s, comme le Sâhâdûtâ' du passage araméen de la Genèse, xxxi, 47 ; cf. Job, xvi, 19, et non avec un s (shd), forme usuelle de Paraméen postérieur. Voir F. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., 1. 1, p. 402 ; Frd. Delitzsch, The Hebrew language viewed in the light of Assyrian research, in-12, Londres, 1883.
VII. Bibliographie. — 1° Syllabaires. — Schrifttafel, dans Frd. Delitzsch, Assyrische Lesestûcke, in-4°, Leipzig, 1™ édit., 1876 ; 2e édit., 1878 ; 3e édit., 1885 ; Schrifttafel et Zeichensammlung, dans P. Haupt, Accadische und Sumerische Keilschrif texte, in-4°, Leipzig, 1881-1882 ; Amiaud et Méchineau, Tableau comparé des écritures babylonienne et assyrienne archaïques et modernes, in-8°, Paris, 1887 ; Brûnnow, À classified list of ail simple and compound cuneiform ideographs, in-4°, Leyde, 1889.
2° Grammaires. — Sayce, Assyrian grammar, in-4°, Londres, 1™ édit., 1875 ; 2= édit., 1883 ; Frd. Delitzsch, Assyrische Grammatik, in-12, Berlin, 1889.
3° Dictionnaires. — Norris, AssyrianDietionary (inachevé), 3 in » 4°, Londres, 1868-1872 ; P. Strassmaier, Alphabetisches Verzeichniss der assyrischen und accadischen Wôrter, in-4°, Leipzig, 1882-1886 ; Frd. Delitzsch, Assyrisches Wôrterbuch ( en voie de publication), in-4°, Leipzig, 1887-1888.
4° Textes. — Frd. Delitzsch, Assyrische Lesestûcke (1876, 1878, 1885) ; Layard, Inscriptions in the cuneiform character, in-f°, Londres, 1851 ; H. Rawlinson, The Cuneiform Inscriptions of Western Asia, in-f", Londres, 1861, 1866, 1870, 1875, 1880-1884 ; F. Lenormant, Choix de textes cunéiformes inédits ou incomplètement publiés jusqu'à ce jour, 3 fasc. in-4°, Paris, 1873-1875 ; P. Haupt, Accadische und Sumerische Keilschrif texte (1881-1882) ; Pinches, Textsin the babylonian Wedge-writing, in-8°, Londres, 1882 ; P. Haupt, Das Babylonische Nimrodepos, in-4°, Leipzig, 1884-1891 ; Mittheilungen aus den Orientalischen Sammlungen. Heft i, ii, in : Der Thontafelfund von El Amarna, par W’inckler et Abel, 3 fasc. in-f », Berlin, 1889-1890. J. Sauveplane.
1. ASTAROTH (hébreu : 'ASfârôf, féminin pluriel de 'Astôrét, déesse des Phéniciens). La Vulgate a employé quelquefois ce nom comme un pluriel, pour désigner en général les déesses adorées par les Phéniciens, en compagnie de Baal, Jud.^ iii, 17 ( hébreu : 'âsêrôt) ; x, 6 ; I Reg., vii, 3, 4 ; xii, 10 ; d’autres fois, elle l’a employé comme substantif singulier, IV Reg., xxiii, 13 (hébreu : 'Astôrét) et aussi, d’après plusieurs commentateurs, Jud., ii, 13, et I Reg., xxxi, 10 ; dans ces deux passages, le texte original porte 'Astarôf, comme la Vulgate, ce qui doit s’entendre d’une seule idole, d’après les uns, et de plusieurs, selon les autres. C’est là, d’ailleurs, une question sans importance. Astoreth ou Astaroth est la déesse qui est appelée Astarthé dans la Vulgate, III Reg., xi, 5, 33. Voir Astarthé.
2. ASTAROTH (hébreu : 'ASfârôf ; Septante : 'A<rrapi£6), ville de Basan, résidence du roi Og, Deut., i, 4 ; Jos., ix, 10 ; xii, 4 ; xiii, 12 ; plus tard assignée à la tribu de Manassé, Jos., xiii, 31, enfin mentionnée comme ville lévitique, dans I Par., vi, 56 (et dans Jos. xxi, 27, sous la forme Bosra ; Septante : BEsaŒpa ; hébreu : be'ésferâh, peut-être pour Bêf'ésferâh, « maison d’Astarté. » Voir Bosra).
Nous lisons en outre, Gen., xiv, 5, que Chodorlahomor et ses alliés défirent les Réphaïtes à Astaroth - Camaïm (hébreu : 'Asferôt Qarnaïm ; Septante : 'A<rrap(16 Kapvai’v ; Codex Vaticanus : 'Adrapwfj x « i Kecpvatv). Carnaïm seul (grec : Kotpvaïv) est mentionné I Mach., v, 26, 43, 44 ; II Mach., xii, 21, 26 [Camion, Kotpvîov), et Josèphe, Ant. jud, , XH, viii, 4, comme une ville fortifiée et d’un accès difficile. Judas Machabée néanmoins s’en rendit maître. Un temple, qui paraît avoir eu une certaine célébrité, fut brûlé à cette occasion. — Astaroth, AstarothCarnaïm et Camion sont-ils une seule et même ville ou des villes différentes ? La question est controversée.
V Onomasticon d’Eusèbe, traduit par saint Jérôme, distingue Astaroth, résidence d’Og, d' AstarothCarnaïm. La première ville y est mentionnée comme étant à six milles
(neuf kilomètres) d’Adraa (Édrei, aujourd’hui Der'ât) ; la dernière, par une erreur assez singulière, y est placée dans les environs de la mer Morte, in supercilio Sodomorum. Cependant le même article mentionne deux villages du même nom d’Astaroth, en Batanée, situés à neuf milles l’un de l’autre, entre Adara et Abila. Ailleurs le même livre nous apprend que Carnaïm-Astaroth était alors (IVe siècle) « un grand village », appelé Carnæa, là, ajoutent-ils, d’après la tradition, on montre la maison de Job. Et c’est pour vénérer le tombeau de ce saint pahiarche que sainte Sylvie, vers 387, fit le pèlerinage de Carneas. (Peregrinatio, édit. Gamurrini, p. 56 et suiv.) Malheureusement le seul manuscrit que nous ayons de cet intéressant « Pèlerinage » présente ici une regrettable lacune.
Le Talmud babylonien (Soukka, 2 a ; voir Neubauer, Géographie du Talmud, p. 246) met Astaroth-Carnaïm entre deux hautes montagnes qui y répandaient beaucoup d’ombre : interprétation fantastique du mot Qarnaïm = « deux cornes » (voir Buxtorf, Leodcon, au mot 'Astarôf). Dans un autre traité talmudique (Pesikta rabbatha, ch. xvii, dans Neubauer, Géographie, p. 258, 276), un Kefar-Qarnaïm est mis en relation avec l’histoire de Job. — Ajoutons que d’après Trochon (Introd., t. ii, p. 273), les célèbres listes géographiques de Thothmès III mentionnent une ville d’Astartu.
Des savants éminents, récemment encore R. von Riess, Bibelvtlas, 2e édit., p. 3, ont pensé que tous ces renseignements n’ont trait qu'à une seule ville, qu’ils placent soit à Tell el - As’arï, soit à Tell 'Astarâ : deux anciennes ruines dans le Hauran occidental, à peu de distance à l’ouest du « chemin des Pèlerins » (de la Mecque), entre Naouâ au nord et El-Mozeirïb au sud. (Pour les noms nous suivons l’orthographe de Schumacher, qui d’ordinaire est très exact ; notons néanmoins que sur les lieux j’ai entendu prononcer El-'Asâri pour El-As’arl. Cependant la dernière forme est aussi donnée par Wetzstein.)
Le Tell el-AS’ari est une colline artificielle qui s'élève à 25 ou 30 mètres sur la plaine environnante, et à 470 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur le sommet, on remarque une dépression de terrain qui court du centre à l’extrémité méridionale, — et c’est dans les deux pointes ainsi formées des deux côtés que Schumacher a voulu voir les deux cornes qui auraient donné à Astarolh le surnom de Carnaïm, « Astaroth aux deux cornes. » — La colline est occupée par un petit village de nègres : en 1885, Schumacher y comptait une cinquantaine de huttes ; mais, en 1890, on ne me parlait plus que de vingt familles. C’est le seul village de Syrie où les habitants m’aient dit qu’ils n’avaient pas de bétail. D’après leur témoignage, cet endroit n’est habité que depuis dix ans. Les gens y sont venus de Seih Sa’d. (Voir ci-dessous.)
Les ruines anciennes, dispersées sur le reste du plateau, ne sont que des pierres informes de nature basaltique. On y découvre néanmoins les restes d’un mur qui semble avoir entouré le sommet, à l’exception peut-être du côté ouest et nord-ouest, où il était protégé naturellement par le profond Ouadi el-Ehreir, aux flancs presque perpendiculaires. M. Schumacher a trouvé les traces d’un second et même d’un troisième mur de défense au pied méridional de la colline ; et de nombreux vestiges d’anciennes habitations, dispersées de ce côté dans la plaine, le font incliner à chercher là l’ancienne ville, dont le tell n’aurait été que l’acropole. Maintenant ce terrain est couvert de petits jardins et de vignes, où les anciens débris finiront bientôt par disparaître. J’y ai cherché en vain une pierre basaltique avee une inscription arabe, mentionnée par le même explorateur.
Plus loin, vers le midi, se trouve le Bahret el-AS’art, espèce de petit lac ou plutôt de marais, d’où sort un ruisseau qui ne tarit jamais, et qui, après avoir fait tourner
un moulin, tombe par jolies cascades dans l’ouadi, où il continue à couler et où il est grossi, à quelque distance du marais (toujours vers le midi), par une source, le 'Aïn el-Modjâ'ibé : ces eaux s arrosant un sol admirablement fertile, expliquent à merveille pourquoi l’homme s’est établi très anciennement dans ce heu. À l’est de la colline et à très peu de distance, on remarque un monceau considérable de pierres, restes informes d’un édifice dont la tradition du pays fait des thermes et un mausolée ; la crédulité populaire croit même que les trésors des califes ommyades y sont enfouis.
En partant d’ici vers le nord-est, pour traverser l’Ouadi el-Ehreir sur le djisr (pont) du même nom, on suit jusqu'à la Route des Pèlerins le tracé d’une belle voie romaine. Pour arriver à Tell 'Astarâ, il faut| de nouveau quitter le grand chemin, car le tell se trouve directement au nord du précédent, à une distance d’environ sept kilomètres. Il doit avoir à peu près la même hauteur et la même étendue. Sa plus grande dimension est du nord au sud. Ici une dépression bien marquée court dans la même direction, sur toute la longueur du plateau. Les ruines aussi ont le même aspect général, mais les pierres, dont on a bâti quelques enclos pour le bétail, m’ont semblé plus anciennes : c’est peut-être parce que les pierres taillées y étaient plus rares. On remarque des arasements de murs si larges, qu’on pourrait les prendre pour des ruelles. À l’extrémité méridionale du plateau se voient des restes qui paraissent être ceux d’une porte. En bas on aperçoit de ce côté des traces de fortifications, nommément d’une sorte de tour, bâtie de blocs basaltiques qu’on pourrait appeler cyclopéens. Il est vrai qu’au pied de cette colline les débris anciens ne couvrent qu’un espace bien restreint, en comparaison de ce que nous avons vu à Tell el-AS’arl.
Ici encore le tell est presque entièrement entouré d’eau. A l’est, c’est un ruisseau large, mais peu profond et peu rapide, sortant d’une petite source située au nord du tell, le "Aïn 'Aëtarà ou 'Aïn Abou - '1 - Hammam (source du père du bain). À l’ouest, la colline est longée par le Moyet en-Nebi Éyoub (eau du prophète Job), dont nous trouverons la source à Seih Sa’d.
Car on s’approche ici du pays traditionnel de Job. En se dirigeant vers le nord-nord-est, on franchit après vingt minutes un petit cours d’eau ; cinq minutes après, on trouve une petite source, et après vingt autres minutes, on arrive à la partie méridionale du ëeilj Sa’d, le Merkez (centre) ou siège du Motasarrif (gouverneur) du Hauran (fig. 327). C’est un groupe d'édifices modernes, bâtis en belles pierres taillées, autour d’une place carrée d’environ cent mètres de côté : le serâya (hôtel du gouvernement) au sud, le bureau télégraphique à l’est » une caserne au nord, et la résidence privée du Motasarrif à l’ouest. Plus loin, vers l’est, on voit les maisons des divers employés et un petit bazar.
C’est ici que se trouvait le célèbre « couvent de Job », peut-être le plus ancien couvent du monde, bâti, selon des auteurs arabes, par le roi jefnide 'Amr I", probablement vers le milieu du IIIe.siècle après J.-C. Wetzstein, en 1860, en trouva encore des restes considérables, qui ont dû faire place au Merkez. Il n’y reste maintenant que deux pièces anciennes : l’une est dans l’angle nord-ouest et fait partie de la caserne ; l’intérieur, tout badigeonné en blanc, n’a rien de remarquable ; à l’extérieur, sur le linteau de la porte, une croix avec À et Û en atteste encore l’origine chrétienne. L’autre pièce ancienne se trouve à l’ouest de la place carrée, et porte le nom de Maqâm Éyoub, « Place de Job ; » c’est là que les musulmans viennent vénérer les tombeaux du saint patriarche et de sa femme. Malheureusement ces tombeaux sont de date très récente. On montrait encore à Wetzstein le tombeau de Job là où nous allons trouver celui de Seih Sa’d, c’est-à-dire à un. bon kilomètre plus loin vers-le nord. « 77
ASTAROTH
4178
Là se trouve, adossé à une colline oblongue qui n’a guère qu’une douzaine de mètres de hauteur, le village de Seih Sa’d ou Es-Sa’dîyéh, habité par deux ou trois cents nègres, dont les ancêtres auraient été emmenés ici du Soudan par le scheich (Seih) même qui a donné son nom au pays. Le pauvre hameau n’a rien d’intéressant, si ce n’est un bon nombre de chambres souterraines qui en attestent la haute antiquité. Au pied méridional de la colline s'élèvent deux sanctuaires, moitié anciens, moitié modernes, et surmontés l’un et l’autre d’un large dôme. Le premier, auquel on arrive en venant du Méritez, est le maqàm ou ouéli de Seih Sa’d, où se trouve le tombeau de ce personnage avec un oratoire. Pour y
(est-ouest), surmonté à l’extrémité méridionale d’une petite tour couronnée d’un dôme blanc. Le toit est fait de grandes plaques de basalte, et soutenu par six colonnes carrées et dix pilastres adossés aux murs, réunis ensemble par des arcs pointus. Dans le fond méridional, on remarque un joli mihrâb (niche de pierre), flanqué de deux petites colonnes de marbre. Malheureusement l'édifice tombe en ruines ; une immense brèche s’est déjà faite dans le mur oriental, et tout le pavé est couvert de débris. — Mais l’objet principal de la vénération des musulmans est la « Pierre de Job », bloc de basalte d’environ deux mètres de haut et de plus d’un mètre de large, placé à peu près entre les premières colonnes, en face du mihrâb.
sÉÉtï ; : ; rtSSpiïi
3sr.
Vue de Seih Sa’d.
entrer, il faut traverser une grande cour plantée de beaux saules et ayant un bassin au milieu. C’est bien l’ancien sanctuaire de Job, le Maqâm Eyoub de Wetz"stein, où le tombeau du patriarche de l’Ancien Testament se vénérait alors, à côté de celui du seih soudanais. Mais celui-ci, en abusant de l’hospitalité repue, a fini par chasserJob de son propre ouéli, pour se l’approprier tout seul. Cependant l’autre sanctuaire, situé tout près vers l’est, porte encore son nom : c’est le Hammam Eyoub, « bain de Jeb. » Là, dit-on, le grand patriarche venait se baigner. L’eau y vient d’une source abondante, située à peu de distance, également au pied de la colline. Cette « source de Job » fournit aussi l’eau nécessaire au village, arrose les jardins bien cultivés qui se trouvent au midi et à l’ouest, et donne encore naissance au ruisseau que nous avons rencontré près de Tell 'Astarâ, sous le nom de Moyet (en-nebi) Éyoub.
Enfin, au-dessus du village, à l’extrémité sud-est de la colline, on aperçoit de bien loin la mosquée du Sahret Eyoub (Pierre de Job), édifice rectangulaire de plus de treize mètres de long (nord-sud) et dix mètres de large
C’est la pierre, — diton, — qui servait d’appui au saint patriarche, « au jour où il 'était visité par Dieu. » En réalité, c’est un monument égyptien représentant le roi Ramsès II dans l’acte de sacrifice ou d’adoration devant un dieu portant la double couronne. Nous ne saurions douter que c’est la même pierre qui est mentionnée déjà par sainte Sylvie, et qu’on disait alors avoir été trouvée sur le tombeau du saint patriarche. C’est pourquoi nous pensons que ce sanctuaire-ci doit être le plus ancien, d’autant plus que, selon Wetzstein, il est vénéré aussi par les rares chrétiens du Hauran. La mosquée actuelle néanmoins nous paraît être d’origine musulmane. Du reste tous ces souvenirs de Job, le couvent, le bain, la source, la mosquée et la pierre, sont mentionnés par les auteurs arabes dès le Xe siècle. Aux témoignages connus de Mas’oudi, Yâqout, Qazouîni, Moqaddasî, nous pourrions ajouter celui de Mohammed el-Halebî, dans son livre Sur les beautés de la Syrie, 11e partie, ch. vi (Bibl. de Leyde, Cod. Arab., 1466, fol. 140 verso). Une allusion à la source se trouve encore dans le Coran, xxxviii, 41, où Dieu dit à Job de frapper la terre du pied, et il jaillit une
source « purifiante, rafraîchissante et étanchant la soif *. — La localité de 'AStarâ est nommée dans Bohâ ed-dïn, Vita Saladini, Liège, 1732, p. 66 et suiv.
Les auteurs chrétiens du moyen âge n’ont guère connu ces localités. Néanmoins Jin catalogue de reliques du xme siècle, publié par M. Battifol, dans la Revue biblique, 1892, p. 202, nous informe qu’alors le tombeau quramus) de Job était en vénération chez les chrétiens orientaux aussi bien que chez les musulmans. ( Voir, sur tous les lieux mentionnés : "Wetzstein, Das Iobskloster, dans Delitzsch, Das Buch lob, p. 507 et suiv. ; Schumacher, Across the Jordan, p. 187-209 ; et, dans la Zeitschrift des deutschen Palàstina - Vereins, divers articles de Schumacher, t. xiv, p. 1Ï2 et suiv. ; comte de SchackSchackenberg, t. xx, p. 193 et suiv. ; Erman, p. 205 et suiv., et Van Kasteren, t. xiv, p. 213 et suiv., et t. XV, p. 196 et suiv.)
Reste à traiter la question de l’emplacement d’Astaroth et de Carnaïm (peut-être des Astaroth et des Carnaïm) de la Bible. D’abord l’existence des traditions de Job à èeih Sa’d ne nous laisse aucun doute sur l’identité de cet endroit avec le Carnæa de YOnomasticon et le Carnéas de sainte Sylvie ; l’Astaroth (près de) Carnaïm d’Eusèbe et saint Jérôme devra donc être le Tell 'Astarâ ; rien n’empêche d’y trouver aussi l’Astaroth de Genèse, XIV, 5, même en préférant la leçon du Codex Vaticanus : « Astaroth et Carnaïm. »
Cette leçon étant admise, il n’y a rien dans la Bible qui nous empêche d’identifier encore le même Astaroth avec la résidence d’Og. Il nous reste cependant bien des doutes si celle-ci ne doit pas être placée à Tell el-As’ari : d’abord la leçon citée reste au moins bien douteuse ; les deux villages du même nom, connus par Eusèbe ; l’existence enfin d’un nom assez semblable, attaché à des ruines importantes, jusqu’ioi sans nom ancien : tout cela nous fait incliner de ce côté. La distinction entre les deux Astaroth a été. admise aussi par Wetzstein, Sepp et d’autres, qui ont cherché la résidence d’Og dans la ville célèbre de Bosrâ, au pied des montagnes du Hauran. Avouons cependant que le nom actuel, ElAè'arï, diffère sensiblement d"As[taroth, et même du, mot plus ou moins synonyme d’Alera, et. que les distances d'Édréi et de l’autre Astaroth (dix-huit et sept kilomètres) ne répondent pas exactement aux chiffres de YOnomasticon.
D’autres autorités récentes (Bùhl et Furrer, dans la Zeitschrift des deutschen Palàstina - Vereins, t. xiii, p. 42, 198), tout en laissant Astaroth à Tell 'Astarâ, le séparent complètement de Carnaïm. Selon Buhl, Carnaïm est encore inconnu ; Furrer dit : « Karnaïm (Gen., xrv, 5), Karnaïn ( Septante, loc. cit., et I Mach., v, 26, 43, 44), Karnion (II Mach., xii, 21), Agræna, Græna dans les inscriptions (voir Le Bas et Wa’ddington, iii, 561), est le Krën actuel (d’autres écrivent Dschrën, Dschurên), dans le Ledjah. De cette localité, il est dit très exactement, II Mach., xii, 21, qu’elle est d’un siège difficile et d’un accès difficile, à cause de l'étroitesse de tous les lieux ( Sià-rïiv 7tâvTtov xùv xàitwj otiv6vrtit.). » — Pour le Carnaïm de Genèse, xiv, 5, cette opinion ne nous paraît pas admissible ; quelque leçon qu’on admette, Carnaïm y reste trop intimement lié à Astaroth pour ne pas l’identifier avec Carnaïm - Astaroth de YOnomasticon, pays de Job. Peut-être l’hypothèse de Furrer est-elle applicable au Carnaïm des Machabées. Les noms composés, Carnaïmvstaroth = Carnaïm (près) d’Astaroth, et Astaroth - Carnaïm = Astaroth (près) de Carnaïm, ne semblent devoir leur origine qu’au besoin de les distinguer l’un et l’autre d’autres localités homonymes. C’est ainsi qu’on dit maintenant : Safed (de = près de) Qatamoun, Busr ( de = près de) el-Harîri, Yâfa (de = près de) en-Nâsira (Nazareth), etc. Ces noms supposeraient donc l’existence d’un autre Carnaïm, aussi bien que celle d’un autre Astaroth. Il faut avouer aussi que le texte cité par Furrer (II Mach., xii, 21) ne saurait
s’appliquer aux environs immédiats de Seih Sa’d, ce village se trouvant adossé à une basse colline, au milieu d’une plaine. Mais il n’est peut-être pas nécessaire de le restreindre aux environs immédiats ; le plateau du Hauran occidental, quoique n’offrant à l'œil qu’une plaine aussi unie qu’immense, est en réalité, surtout dans la partie méridionale, coupé par un réseau compliqué d’ouadis aussi raides que profonds, et parfaitement invisibles à distance : ce qui en fait un pays bien traître pour une armée étrangère. Les croisés en ont fait de tristes expériences. — Si cette conformation du pays ne suffit pas pour justifier les expressions du texte sacré, on sera obligé de chercher ailleurs le Carnaïm ou Carnion des Machabées. Rien du reste ne s’y oppose.
Ainsi au lieu d’une seule ville (Astaroth-Carnaïm) nous en aurons au moins deux, très rapprochées l’une de l’autre, assez probablement trois ; et même l’hypothèse d’une quatrième, le Carnaïm des Machabées, ne peut être définitivement rejetée. J. van Kasteren.
3. ASTAROTH-CARNAÏM, ville à l’est du Jourdain. Gen., xiv, 5. Voir Astaroth 2.
- ASTARTHE##
ASTARTHE, divinité chananéenne dont le culte s’introduisit chez les Hébreux à diverses époques ; à ce titre seulement elle ^est plusieurs fois mentionnée dans la Bible. Astarté est la forme grecque du nom : Septante, 'AorapTTi ; en hébreu, il se prononce au singulier 'ASporep, au pluriel 'Aspârôp ; de là, dans la Vulgate, Astarthe, III Reg., xi, 5, 33, et Astaroth, Jud., ii, 13 ; iii, 7, etc. L’emploi du pluriel pour le nom de la déesse doit s’expliquer, comme pour le nom du dieu, Baalim : ou bien parce qu’il se rapporte à la pluralité des images (Gesenius, Thésaurus, p. 1082, et déjà S. Augustin, Lib. quœst. in Jud., ii, 13, t. xxxiv, col. 797), ou bien parce que l’hébreu emploie souvent la forme du pluriel pour un singulier abstrait ; la signification primitive de ces noms de dieux serait abstraite. Schlottmann, Zeitschrift der deutschen morgenlândisches Gesellschaft, t. xxiv, p. 649-650. Notons qu’en assyrien le pluriel tëtarati est pris parfois dans le sens de déesses en général : « Les dieux (ili) et les iStarati qui habitent le pays d’Assur. » Schrader, Keilinschriften und A. T., 2e édit., 1883, p. 180. — L'étymologie du nom reste encore problématique. Les uns, s’appuyant sur le caractère sidéral de la divinité, l’ont rattaché à la racine qui a donné en zend açtar, en grec iarfp, et qui est passée chez les Hébreux sous la forme du nom judéopersan Esther. Gesenius, Thésaurus, p. 1083 ; Schrader, Keïlinschriften, p. 179, et Frd. Delitzsch, Smith’s chaldâische Genesis, in-8°, Leipzig, 1876, p. 273, pensent aussi que ce nom n’est pas d’origine sémitique, mais appartient plutôt au suméro-accadieri, dont l’existence est aujourd’hui contestée. D’autres, au contraire, le rattachent à une racine sémitique qui donne en arabe le verbe 'asara, « unir ; » il conviendrait ainsi à la déesse de l’amour et de la fécondité, comme le nom de la déesse babylonienne Mylitta, de la racine yâlad, « celle qui fait concevoir, enfanter ; » ou bien ce nom laisserait encore entendre, d’après Schlottmann, qu’Astarthé forme le lien d’union de plusieurs tribus ou cités, comme le Baalberith ou Baal de l’alliance ; en fait, elle était devenue, en Chypre et en Sicile, une Aphrodite Pandémos. En faveur de l’origine sémitique du nom, contentons-nous de remarquer que 'astârôt se rencontre comme nom commun dans Deut., vii, 13 ; xxviii, 4, 18, 51, partout dans une mémo formule où il se rapporte à la fécondité des femelles du troupeau. Dieu doit bénir ou maudire « les portées des bœufs et les 'aSpârôt du troupeau ». Le nom peut donc répondre à l’idée d’un dédoublement féminin de la divinité : idée qui a été, chez les peuples anciens, une source de tant de rêveries mythologiques, et un principe de corruption dans les croyances et le sentiment religieux. — Cette idée est absolument opposée à la conception reli4181
ÀSTARTH&
1182
gieuse de la Bible, qui ne nous parle d’Astarthé que pour nous dire en quelles circonstances les Hébreux se laissèrent entraîner à son culte, interdit comme celui de toutes les divinités étrangères. (Nous mettons entre crochets les passages où la déesse est appelée Aschéra, car la Bible désigne aussi sous ce nom tantôt la déesse ellemême et tantôt sa représentation symbolique. Voir Aschéra.) — À peine établis au milieu des populations chananéennes, après la conquête, les Hébreux se mêlèrent aux cultes locaux de Baal et d’Astarthé. Jud., ii, 13 ; [ni, 10] x, 6 ; cf. I Reg., xii, 10. Le prophète Samuel parvint à les en détourner. I Reg, vii, 3, 4. Dans les dernières années de Salomon, parmi les divinités qui eurent des sanctuaires royaux, figure « Astarthé, dieu [déesse] des Sidoniens ». III Reg., xi, 5, 33. Ce ne fut que sous le troisième successeur de Salomon, Asa, que ces cultes impurs furent déracinés à Jérusalem, III Reg., xv, 12, et en particulier celui d' Aschéra, ꝟ. 13. Chassé du royaume de Juda, il s’introduisait quelque temps après dans celui d’Israël, à la suite de l’alliance de la maison d’Amri avec celle' des rois de Sidon. Jézabel, mariée à Achab, ramena avec elle dans le royaume d’Israël le culte de Baal et celui d’Astarthé. [III Reg., xvi, 31-33 ; xviii, 19.] Avec Athalie, la fille de Jézabel, ces cultes pénétrèrent aussi en Juda. [IV Reg., xi, 18 ; cf. II Par., xxiv, 7, 18.] Dieu suscita les prophètes Elie et Elisée contre l’invasion de ces divinités en Israël, et aussi la réaction violente de Jéhu. Sous Achaz et surtout sous Manassé, l’emblème de la déesse reparut à Jérusalem. [IV Reg., xviii, 4 ; xxi, 7 ; xxm, 4 ] Malgré les réformes successives d'Ézéchias et de Josias, elle eut encore des dévots, que les derniers malheurs du royaume de Juda ne parvinrent pas à corriger ; car c’est elle sans doute que s’obstinaient à adorer comme « la reine du ciel » ces égarés dont nous parle Jérémie, xliv, 17, 18, 19, 25 ; cf. vii, 18. — Nous n’avons guère, dans tous ces passages, que le nom de la déesse, et, en passant, quelques données incomplètes sur l’extension de son culte, sur ses attributs, sur la nature même de ce culte, données qu’il importe d'éclairer par des renseignements puisés aux monuments profanes.
I. Extension de son culte. — La Bible la donne en particulier comme « la divinité des Sidoniens ». III Reg., xi ] 5, 33 ; IV Reg., xxiii, 13. On a retrouvé en Phénicie de nombreuses représentations de la déesse. Une figurine conservée maintenant au Louvre nous la représente debout, vêtue d’une longue tunique et tenant une colombe de la main gauche (fig. 328). Nous connaissions aussi, par les auteurs grecs et romains, les attaches phéniciennes d’Astarthé. Les inscriptions phéniciennes nous ont surtout montré l’importance de son culte à Sidon ; elles nous parlent du temple de la déesse, contenant des ex-voto. Les médailles la représentent comme la divinité tutélaire. Dans les noms propres phéniciens, le nom d’Astarthé entre souvent en composition : Abdastart, Bodostart, Ger(?)astart, Astaryathan, pour les hommes ; Amastart, pour les femmes. Corpus inscript, semitic, t. i, p. 13, 21, 264, 269, 340, 341, etc. Les rois de Sidon placent même le titre de prêtre
[[File: [Image à insérer]|300px]]
328. — Astarthé.
Terre cuite phénicienne.
Musée du Louvre.
d’Astarthé avant celui ae roi, comme le montre l’inscription d’un sarcophage royal trouvé à Saïda ; elle commence ainsi : « C’est moi, Tabnit, prêtre d’Astarthé, roi des Sidoniens, fils d’Eschmunazar, prêtre d’Astarthé, roi des Sidoniens, qui suis couché dans cette arche. » Acad. des inscript, et belles-lettres, 1887, 4e série, t. xv, p. 183, 340. Après la mort de Tabnit, le sacerdoce d’Astarthé passa à sa veuve Amastart, appelée « prêtresse (kohenef) d’Astarthé » sur le sarcophage d’Eschmunazar II, conservé au Louvre. Corp. inscript., 1. 1, n. 3°, 1. 14-15. Bien avant Tabnit, le père de Jézabel devait aussi réunir en sa personne les dignités sacerdotale et royale ; d’après ni Reg., xvi, 31, Ethbaal
[[File: [Image à insérer]|300px]]
329. — Arche d’Astarthé.
IULIA PATTLA AUG. Tête de Julia Paula. — ^. COL AVR PI À MBTB SID. Emblème d’Astarthé, placé sur un char surmonté d’un dais à quatre colonnettes.
est roi des Sidoniens, et, d’après Josèphe, prêtre d’Astarthé. Des médailles frappées à Sidon, à l'époque romaine, représentent tantôt le char ou l’arche roulante d’Astarthé (fig. 329), tantôt le vaisseau qui porte la déesse (fig. 330). Les Phéniciens répandirent le nom et le culte d’Astarthé dans leurs colonies, et on le retrouve sur leurs inscriptions
[[File: [Image à insérer]|300px]]
330. — Astarthé maritime de Sidou.
SIA. Tête de femme tourelée. — fy SIAÛNIÛN. Astarthé debout sur une galère tenant de la main droite le gouvernail et de la gauche la stylis cruciforme.,
à Citium et Idalium, en Chypre ; à Malte, en Sicile, à Car-^ thage, en Sardaigne. À l'époque gréco-romaine, beaucoup de ces sanctuaires prirent le nom d’Aphrodite -Vénus ; mais son origine et son vrai nom n'échappaient pas aux gens instruits. Cf. Cicéron, De nat. deor., iii, 23 : « La quatrième (Vénus) est la Syrienne, conçue à Tyr ; elle est appelée Astarthé, et l’on dit qu’elle épousa Adonis. » Dans la région syro-palestinienne, on trouve partout des traces de son culte : à Hiérapolis dans la Syrie du nord, à Héliopolis dans la Syrie centrale, des temples lui sont consacrés. Chez les Philistins, il y avait un temple d’Asr tarthé, où furent déposées les armes de Saûl. I Reg., xxxi, 10. À l’est du Jourdain, une ville, célèbre dès le temps d’Abraham, Gen., xiv, 5, porte le nom de la déesse, Astaroth-Carnaïm ; ailleurs, dans le Hauran, près de Qanaouât (autrefois Canath, I Par., ii, 23), on a trouvé parmi les ruines d’un temple une figure colossale d’Astarthé, exécutée en haut relief. Il ne reste qu’une partie du visage de la déesse. J. L. Porter, Randbook for Syriaand Palestine, 1875, p. 480. Id., Five years in Damascus, 1856, t. ii, p. 106 ; S. Merril, East of the Jordan, 1881, p. 40-42. Un autre bas-relief, mieux conservé, trouvé au même lieu, nous représente la déesse sur le côté d’un autel. Des rayons sont au-dessus de sa tête. À gauche, on
voit les restes du croissant dans lequel elle était placée (fig. 331). Voir J. Pollard, On the Baal and Ashtoreth altar discovered at Kanawat in Syria, dans les Proceedings of the Society of Biblical Arctueology, avril 1891, t. xiii, p. 293. La stèle de Mésa, ligne 17, nomme AstorKamos, divinité à laquelle le roi moabite voua les prisonniers. Enfin, avec les inscriptions cunéiformes, nous voyons s'étendre bien au delà, vers l’Orient, le domaine de la déesse. On retrouve, en effet, l’Astarthé chananéo-phé 331.
Tête d’Astarthé, sur un autel de Qanaouat. Fitz-WlUlam Muséum, à Cambridge.
nicienne dans Istar, comptée parmi les grandes divinités du pays d’Assur. Malgré l’absence de la terminaison féminine, l’identité du nom n’est pas douteuse ; les épithètes qui l’accompagnent indiquent que c’est une déesse. Cf. Schrader, Keilinschriften, p. 177. Les sanctuaires des cités chaldéennes d'Érek (Arach) et d’Accad, non moins que l'épopée chaldéenne d’Izdubar, où Istar joue un rôle considérable, nous montrent que la déesse appartient au vieux fond des croyances sémitiques, et nous reporte vers cette terre d’où paraissent avoir rayonné au Nord et vers l’Occident les populations chananéennes et sémitiques. De grandes villes assyriennes sont placées sous la protection spéciale d’Istar ; la localisation du culte amène même une sorte de dédoublement d’Istar ; dans l'énumération des grands dieux, par exemple, sur le prisme d’Asarhaddon (col. i, 1. 7-8), le roi compte, comme si elles étaient distinctes, Istar de Ninive et Istar d’Arbèles. L’Istar chaldéenne avait pour époux le dieu Thammuz, mourant à la fleur de l'âge et pleuré tous les ans par les femmes vouées à la déesse, cf. Ezech., viii, 14 ; ce trait la rapproche encore de l’Astarthé chananéenne qui se lamentait aussi sur son jeune époux Adoni ( « mon seigneur s). Sur Istar et Thammuz, voir A. Loisy, Études sur la religion ckaldéo-assyrienne dans la Revue des religions, 1891, p. 53-55 ; 102 et suiv.
IL Caractère et attributs de la déesse. — Dans la Bible, Astarthé est le plus souvent associée à Baal ; elle est aussi honorée avec « l’armée des cieux », II Reg., xxiii, 4 ; ses adorateurs l’appellent, nous l’avons vii, « la reine des cieux. » Elle nous apparaît donc comme la divinité féminine de Baal et avec un caractère sidéral. Les données plus complètes que nous fournissent les auteurs anciens, les inscriptions et les monuments figurés, nous la présentent sous le même aspect, mais, suivant les milieux qu’elle traverse, avec des formes multiples et des attributs vagues, comme la plupart des divinités orientales ; sous ce rapport, du reste, elle ressemble au dieu mâle Baal. Elle lui est parfois si étroitement unie, que la ' pensée chananéenne paraît avoir traversé une époque où, tout en distinguant dans la divinité l'élément masculin et l'élément féminin, on ne les séparait pas encore en deux personnages. Quelques formules rappellent cet état ; dans l’inscription d’Eschmunazar, Corp. inscr. semit., 1. 1, n. 3, 1, 18, la déesse est appelée As{oréf sém Ba’al, « Astoreth nom de Baal ; » de même à Carthage, où elle porte le nom
de Tanit, on lit sur les ex-voto : « À la grande Tanit face de Baal et au seigneur Baal. » Corp. inscript., 1. 1, n os 180 et suiv. Des étrangers pouvaient demeurer incertains sur le genre de la divinité de Carthage, comme le montre la formule d’imprécation que nous a laissée Macrobe, Saturnal., iii, 9 : « Si c’est un dieu, si c’est une déesse, sous la tutelle de qui est le peuple et la ville de Carthage. » Parfois le nom de la déesse ne forme qu’un tout avec celui d’une divinité masculine : Eschmun-Astoret, Molok 332. — Astarthé en cuirasse.
IMP CAÉS M AV ANTONINUS AV<}. Tête laurée de l’empereur Héliogabale. — fy BBPTIM TYRO. Astarthé, debout, tourelée, en tunique courte, la main droite appuyée sur un trophée, la stylis dans la main gauche. Elle est couronnée par une Victoire, debout sur un cippe. À ses pieds, le murex et une petite figure de Silène, portant une outre sur l'épaule. Monnaie frappée à Tyr.
Astoret, Corp. inscript., 1. 1, n" 16, 8 ; comme sur la stèle de Mésa (1. 17) : Astor-Kamos. De cet état, où elle restait comme confondue avec la divinité mâle, viennent peutêtre certaines manières de la représenter avec des vêtements d’homme dans le temple d’Héliopolis, Pline, H. N., v, 23 ; ou avec une barbe et armée, d’après Macrobe, Satumal., iii, 8. Une médaille du temps d’Héliogabale nous montre Astarthé en cuirasse et entourée de trophées (fig. 332). Chez les Assyriens, Istar est appelée « maîtresse des combats et des batailles (bilît qabli utahazi) », bien que dans l'épopée d’Isdubar elle apparaisse plutôt comme la déesse de la fécondité. À cause de ces divers aspects, Astarthé a été identifiée plus tard avec différentes divinités grecques ou romaines, en particulier avec HéraJunon (cf. S. Augustin, Qusest. xvi in Jud., t. xxxiv, col. 797 : « Junon est sans aucun doute appelée Astarthé par les Carthaginois ; » ) ou avec Aphrodite -Vénus. Philon de Byblos, dans Eusèbe, Prxparat. Evang., i, 10, t. xxi, p. 84 ; Lucien, De syria dea, 4 ; Pausanias, Attica, i, 14, édit. Didot, p. 20. L’auteur du Mercator, act. IV, a réuni dans une seule invocation ces aspects divers d’Astarthé :
Diva Astarte, hominum deorumque vis, vita, salus, rursus eadem
quse est Pernicies, mors, interitus, mare, tellus, cœlum, sidéra.
(Plaute, Supposita, édit. Lemaire, t. ii, p. 306.)
Baal et Astarthé réunis représentent en somme la grande force de la nature, l’un comme le principe mâle, actif, générateur, mais aussi destructeur ; l’autre comme le principe femelle, passif, productif, la mère. Là où on considère Baal comme le ciel, Astarthé est la terre fécondée par le ciel. Quand Baal représente le soleil qui fait pousser les plantes et aussi les dessèche, Astarthé est la lune dont la douce lumière semble distiller la rosée fécondante de la nuit. Cf. Diogène Lærte, vii, 145 ; Pline, H. N., ii, 101 ; Plutarque, De Isid. et Osir., 41. Lucien identifie la syrienne Astarthé à Séléné, la lune. Une figurine en albâtre du musée du Louvre représente Astarthé avec un croissant d’or au-dessus de la tête (fig. 333). Le nom de l’ancienne ville transjordanique rappelle ce caractère lunaire de la déesse : Astaroth-Carnaitn, « Astarthé aux deux cornes. » D’après Sanchoniaton, Historicor. greec. fragm., « 85
ASTARTHÉ
1186
édit. Didot, t. iii, p. 569, elle était aussi représentée avec la tête et les cornes d’une vache ; et nous la trouvons
333. — Astarthé. Statuette en albâtre. Musée du Louvre, ainsi sur une monnaie de Corycus, en Cilicie (fig. 334). Chez
[[File: [Image à insérer]|300px]]
334. — Astarthé à tête de vache.
[A]YT KA IOYAIOS *IAirmQS 2EB. Tête laurée de
Philippe père, a droite. - fy KÛPTKIQTQN AYTONOM.
Astarthé a tête de vache, debout, de face, la main droite
étendue et tenant, dans la gauche, un gouvernail et un aplustre.
les Assyriens, la déesse Istar avait de même un caractère
sidéral. Dans l'épopée d’Izdubar, elle est appelée « fille de Sin », c’està-dire du dieu Lune ; elle est plus souvent l'étoile du matin, la planète Vénus ; aussi l’Istar assyrienne a-t-elle une étoile sur la tête (fig. 335). Sur une monnaie d’Aphrodisias, en Carie, l'étoile et le croissant se trouvent ensemble à côté d' Astarthé, derrière sa tête et devant elle (fig. 336). De même, sur une monnaie d’Hipporegius, on voit le croissant avec une étoile au-dessus de la tête de la déesse (fig. 337). L. Mûller, Numismatique de l’ancienne Afrique, 3 in-4°, Copenhague, 1862, t. iii, p. 53. Dans tous les cas, le caractère sidéral de la déesse est bien attesté ; et que les adorateurs dont parle Jérémie aient rendu hommage à DICT. DE LA. BIBLE.
335. — Tstar assyrienne. D’après un cjlindre du Brltisb. Muséum.
l’Astarthé lunaire phénicienne ou à la divinité chaldéenne que les textes assyriens qualifient de riSti Sami, « princesse du ciel, » le titre de « reine du ciel, » melékéf Samaim, s’explique également, comme celui dont se sert Hérodien, II, 5, 10 : . « dominatrice des astres, » 'Aarpoapxv D’après l’inscription d’Assurbanipal, une tribu d’Arabes de Cédar avait pour déesse une Atarsamaïm, « Athar des cieux. » Eb. Schrader, Keilinschriften, p. 414. Cf. Id., Die Gôllin
336. — Astarthé au croissant. AHMOS.Tête laurée imberbe du Démos, a droite. — fy AIPOÀEI21EQN. Astarthé debout, vêtue d’une tunique talaire, le modius sur la tête, la main droite levée » Dans le champ, devant elle, le croissant ; derrière, une étoile ; à ses pieds, un vase et une petite figure d'Éros.
Islar als nialkatu und Sarratu, dans la Zeitschrift fur 1 Assyrïologie, 1888, t. iii, p. 353-364.
III. Culte d' Astarthé. — On offrait des gâteaux et des libations « à la reine du ciel », en particulier les femmes ; les hommes prenaient part aussi à ces rites défendus par la loi. « Est-ce sans nos maris que nous lui préparons les
337. — Astarthé voilée, au croissant. Tête barbue et laurée de Melqart, avec un sceptre sur l'épaule. Devant riSN. — % -|nysiD. Tête voilée d’Astarthé, surmontée du croissant et d’une étoile.
gâteaux pour l’honorer, et que nous lui faisons des libations ? » disent les femmes juives, dans Jérémie, xlfv, 19. Le prophète montre avec quel empressement tous commettaient la faute : « Les enfants ramassent le bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. » Jer., vii, 18. La déesse était représentée, parmi les populations chananéennes, par un pieu de bois symbolique. Cf. fig. 290, col. 1074. Ce symbole se retrouve sous différentes formes sur des cylindres cypriotes (fig. 338). Cf. di Cesnola, Safamma, in-4°, Turin, 1887, p.l32.Quand son culte avait en Israël la faveur royale, il se déployait avec une grande pompe ; on comptait, aux jours de Jézabel sur le Carmel, quatre cents prophètes d’Aschéra, III Reg., xviii, 19 ; mêlés
aux prophètes de Baal, ils durent prendre part à ces danses frénétiques où, pour invoquer le dieu, ils se faisaient des incisions sanglantes, ꝟ. 28. Mais on retrouve aussi, chez les Hébreux, le culte d’Astarthé sous sa forme impure ; autour de l’Aschéra, il est question de courtisanes et d’hommes voués à l’immoralité, consacrés à la déesse, qedêsîm (Vulgate : , effeminati). III Reg.,
I. — 40
338. — Cylindre cypriote représentant le symbole d’Astarthé.
xiv, 24 ; xv, 12-13 ; IV Reg., xxiii, 6-7 ; Ose., iv, 13-14. Le culte de l’Astarthé chananéenne, rappelant qu’elle était à la fois divinité de la guerre, de la destruction et de la fécondité, était cruel et voluptueux. Le sang coulait dans ses fêtes ; il y avait des victimes humaines, comme dans celles de Moloch. Lucien, De syria dea, 10, a décrit le temple de la déesse syrienne à Hiérapolis et certaines cérémonies. À la fête du Printemps ou des Flambeaux, qui attirait un grand concours de peuple, on brûlait de gros arbres portant les offrandes ; puis on enfermait des enfants dans des outres, et on les précipitait du haut des murailles en criant : « Ce sont des veaux, non des enfants ! » Au bruit étourdissant des cymbales, des flûtes et des chants, les prêtres dansaient et se meurtrissaient les bras. Les spectateurs, emportés par le même délire, finissaient par les imiter et se mutilaient avec des tessons semés à cet effet dans l’enceinte sacrée. Les auteurs anciens nous renseignent aussi sur le caractère impur du culte de l’Astarthé phénicienne. Certains de ses temples, comme celui d’Aphéca, dans le Liban, détruit par ordre de Constantin, étaient de vrais repaires d’immoralité. Eusèbe, Vita Const., iii, 55, t. xx, c. 1120. Les Phéniciens sacrifiaient à leur déesse l’honneur de leurs filles ; S. Augustin, De Civit. Dei, ii, 4, t. xxxvii, p. 50. Là même où on la vénérait sous son aspect chaste, comme par exemple la Vierge céleste à Carthage, certaines cérémonies donnaient lieu à des représentations licencieuses dont parle saint Augustin, De Civit. Dei, ii, 26 ; iv, 10, t. xxxvii, p. 75, 121. L’inscription phénicienne trouvée à Chypre, en 1879, près de Larnaka (Citium), nous présente un compte mensuel dans lequel figure }e personnel d’un temple d’Astarthé, Corp. inscript., 1. 1, n. 86 ; nous y voyons mentionné le prix qu’ont gagné les courtisanes sacrées appelées 'alamof, « les aimées, » et aussi les hommes désignés sous le nom de chiens, comme dans Deut., xxiii, 18. Nous comprenons mieux par là l’importance des prescriptions par lesquelles Dieu a voulu empêcher l’introduction de tels usages dans son culte chez les Hébreux.
Voir J. Selden, De dits syris, ii, c. 2, édit. de 1680, p. 157 et suiv. ; D. Calmet, Dissertation sur les divinités phéniciennes, en tête du Comment, sur les juges ; Movers, Die Phônizier, 1841, t. i, p. 559 et suiv. ; J. J. Dœllingcr, Paganisme et judaïsme, trad. franc., , 1858, t. ii, p. 241 et suiv. ; F. Lajard, Recherches sur le culte de Vénus, in-4°, Paris, 1837-1848 ; de Vogué, Mélanges d’archéologie orientale, Paris, 1868, p. 41 et suiy. ; F. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., 1889, t. iii, p. 257 et suiv. ; Fr. Bâlhgen, Beitràge zur semilisch Religionsgeschichte, der Gott Isræls und die Gbtter der Heiden, 1888. J. Thomas.
ASTÈRE. Voir Astéiuus.
1. ASTÉRIU S, philosophe arien, vivait sous l’empereur Constance (337-361). Il était d’origine païenne, né en Cappadoce, d’après le plus grand nombre. Voir Socra te, H. E., i, 36, t. lxvii, col. 172 ; Sozomène, H. E., ii, t. lxvii, col. 1029 ; J. A. Fabricius, Biblioth. grseca, édit. Harless, t. ix, p. 519. Quelques historiens croient qu’il était de Scythopolis. Voir S. Jérôme, Ep. lxx, 4 ; cxii, 20 „t. xxii, col. 667, 929. C'était un disciple de saint Lucien d’Antioche (Socrate, H. E., i, 36 ; Philostorge, H. E., ii, 14, 15 ; iv, 4, t. lxv, col. 477, 520), et il appartient à l'école exégétique de cette ville. (Voir Antioche [École exégétique d'], col. 683.) Il tomba dans l’hérésie, fut l’ami personnel d’Arius et en défendit les erreurs par la parole et par la plume. S. Athanase, Orat. contr. Arian., ii, 28, t. xxvi, col. 205, etc. ; cf. col. 1473. Il écrivit, au témoignage de saint Jérôme, De vir. Ut., 94, t. xxiii, col. 698, des commentaires sur les Psaumes, les Évangiles et l'Épître aux Romains, qui eurent une grande réputation dans son parti. Tous ses ouvrages sont perdus ; il ne nous en reste que l’Exposition du Psaume ir, que Montfaucon a publiée en grec et
en latin dans la Nova Collectw Patrum et scriptorum graxorum, Paris, 1706, t. i, p. 28-30. Voir H. Kihn, Die Bedeutung der antiochenischen Schule, in-8°, Wissembourg, 1866, p. 50 ; Ph.Hergenrôther, Die antiochenische Schule, in-8°, Wurzbourg, 1866, p. 15.
2. ASTÉRIUS (saint), orateur grec contemporain de saint Jean Chrysostome, mort vers 410, métropolitain d’Amasée, dans le Pont. Il avait eu pour maître un Scythe très versé dans la littérature grecque. Il ne reste de lui que des homélies, au nombre de vingt et une, dont huit sur les psaumes v, vi et vii, et six sur divers sujets bibliques : Lazare et le mauvais riche, Daniel et Susanne, etc. Astérius a étudié Démosthènes, Homil. xiï, t. xl, col. 353. Il est avant tout orateur. La pensée est juste, le style limpide. L’auteur sent très vivement, s’exprime avec énergie, et s'élève parfois jusqu'à la véritable éloquence. Son orthodoxie n’a jamais été contestée. En Orient, son crédit fut grand et durable. Son autorité fut surtout mise en avant pour réfuter les iconoclastes (Mansi, Conc, t. xiii, p. 15-18). Photius à longuement analysé ses principales œuvres. Bibl. cod., 271, t. civ, col. 201-223. Voir Migne, Patr. gr., t. xl, col. 155-487 ; J. Fessier, Institutiones Patrologise, édit. B. Jungmann, 1890, t. i, p. 623.
J. Gondal.
3. ASTÉRIUS Turcius Rufius Apronianus, patricien qui fut consul en 494 (en Occident) avec Flavius Prsesidius (en Orient). Il publia plusieurs poèmes de Sédulius, entre autres la Collatio Veleris et Novi Testamenti, en vers élégiaques. Certains critiques, comme les éditeurs de la Bibliotheca Patrum, t. ix, p. 464, ont attribué ce poème à Astérius lui-même. Voir SÉDULrus et cf. Migne, Patr. lai., t. xix, col. 486-493.
- ASTORETH##
ASTORETH (hébreu : 'AStôréf), forme hébraïque du nom de la déesse des Phéniciens, appelée Astarthé et Astaroth dans la Vulgate. Astaroth est le pluriel d’Astoreth. Le singulier n’est employé que trois fois dans le texte original, I (III) Reg., xi, 5, 33 ; II (IV) Reg., xxiii, 13. Voir Astarthé.
ASTRAGALE. Plante de la famille des légumineusespapilionacées, qui produit probablement le nek'ôf (Septante : èu|j.tdi[j.ctTa, 8u[iîa[i.a ; Vulgate : aromata, storax), dont il est ( question Gen., xxxvii, 25, et xliii, 11. Les astragales sont des herbes ou petits arbrisseaux trapus, très rameux, au port extrêmement variable ; les feuilles, composées pennées ou digitées trifoliolées, sont assez ; souvent armées de piquants ; les fleurs, jaunes, blanches, roses ou pourprées, disposées en épis axillaires ou terminaux, ont un calice à cinq dents, une corolle papilionacée à carène obtuse ; le fruit, en forme de gousse, a deux loges séparées par une fausse cloison provenant de la suture dorsale. Ce genre compte un grand nombre d’espèces, dont soixante-dix environ ont été trouvées en Palestine ou dans les pays limitrophes. Voir Tristram, Survey of Western Palestine, Fauna and Flora, p. 282-287. Toutes ces espèces ne produisent pas des sucs gommeux, mais seulement quelques-unes, entre autres VAstragalus verus de la Perse, de l’Arménie et de l’Asie Mineure ; VAstragalus Creticus de l’Ile de Crète et de l’Ionie (fig. 339), et les espèces Aristatus, Parnassi, Microcephalus, Strobiliferus, etc. Pour VAstragalus tragacantha, c’est par erreur que Linné lui attribue la propriété de produire de la gomme ; le nom d' « adragante » vient cependant du nom de cette espèce par altération. Une espèce de Syrie donne un produit similaire, la gomme pseudoadragante : c’est le Gummifer, qui croît dans le Liban (fig. 340). Cf. Gandoger, Flora Europse, t. vi (1886), p. 26. On en trouve aussi sur la variété ou espèce voisine, le Roussseanus, qui pousse dans les plaines arides du nord de la Palestine. Sur deux espèces très rapprochées répandues en Syrie, le Kurdicus et le Stromatodes, les indigènes recueillent également une gomme, qu’ils appellent aintab.
La gomme, soit adragante, soit pseudo-adragante, découle du tronc, des branches et des feuilles mêmes îles astragales, par les fissures qui se font naturellement ou par les incisions pratiquées à dessein. Elle sort en liqueur visqueuse, qui se durcit peu à peu à l’air, en filets ou en bandelettes tortillées (fig. 340), selon la forme de la fente qui la laisse s'échapper au dehors : de là les deux espèces commerciales, la gomme vermiculée et la gomme en plaque. C’est pendant les chaleurs de l'été et au commencement de l’automne qu’a lieu cet écoulement ; il se fait la nuit et peu après le lever du soleil. Si le temps est clair et chaud, la gomme est d’un blanc plus ou moins pur et transparent : alors deux ou trois jours suffisent
Astragale creticua de Slbthorp.
pour qu’elle se dessèche et puisse se recueillir. Si le ciel est chargé de nuages et l’atmosphère humide, elle devient jaune ou roussâtre, et la dessiccation est beaucoup plus lente. Ce n’est pas une sécrétion naturelle de la plante ; « c’est à une maladie qu’est due la production de l’adragante, mais à une maladie qui affecte endémiquement la plupart des pieds qui croissent dans une localité donnée. » H ; Bâillon, Traité de botanique médicale, in-8°, Paris, 1884, p. 644. Sous l’action de la Chaleur, certaines portions de la plante, comme la moelle et les rayons médullaires, subissent cette affection, nommée gommose : la cellulose ou d’autres substances amylacées qu’elles contiennent se transforment en adragante molle. Cette gomme diffère de la gomme arabique : elle ne se dissout pas comme cette dernière dans l’eau froide ; elle s’y gonfle seulement en s’hydratant. Même dans l’eau bouillante, la dissolution est très imparfaite. Elle sert en pharmacie, spécialement pour la préparation des loochs ; dans l’industrie et les arts, pour donner du lustre et de la consistance.
D’après l’opinion commune, la gomme de l’astragale n’est autre que le nek'ôt, dont il est parlé deux fois dans la
Bible : Gen., xxxvii, 25, et xliii, H. (Quant à nekôtôh, qu’on lit IV Reg., xx, 13, et au passage parallèle d’Isaïe, xxxix, 2, c’est un mot différent, et il n’a pas le sens de gomme, d’aromates, comme l’a traduit la Vulgate, mais il signifie « trésor ». Voir Nekôtôh et Trésor.) Les marchands ismaélites qui venaient de Galaad et rencontrèrent les enfants de Jacob à Dothaïn, près de la citerne où ils avaient jeté Joseph, portaient en Egypte du nek'ôt. Dans ce passage, Gen., xxxvii, 25, les Septante rendent ce mot par 6u[iià[is(T « , et la Vulgate par aromata : ces versions y voient un terme générique pour désigner les parfums. Plus loin, Gen., xliii, 11, le nek'ôf se retrouve parmi les présents envoyés par Jacob à son fils Joseph en Egypte.
SiO. — Astragale gummifer. — À droite, rameau avec gomme.
Les Septante traduisent encore Ouj « a(ita ; mais la Vulgate met storax. Placé près du baume et du ladanum, le nek'ôf ne semble pas être un nom générique des parfums, il faut y voir une substance particulière. Ce n’est pas la gomme du styrax, qui correspond plutôt m nâtàf des Hébreux ; c’est celle que les Arabes appellent naka’at, et qui est regardée généralement comme la résine ou gomme produite par plusieurs espèces du genre astragale. Les marchands madianites ou ismaélites l’avaient-ils recueillie dans le pays de Galaad, ou l’avaient-ils reçue par le commerce des contrées du Liban, de la Syrie ou de pays plus éloignés ? Le texte n’en dit rien ; mais ce que nous savons, comme nous l’avons vu plus haut, c’est qu’ils pouvaient la récolter sur V Astragalus Gummifer et V Astragalus Roussœanus, au nord de la Palestine, et sur d’autres espèces de la Syrie ou des pays voisins. D’ailleurs, comme on le constate pour plusieurs autres plantes, par exemple, l’arbre à baume, quelques-unes de ces espèces pouvaient alors être assez abondamment répandues au cœur de la Palestine et dans le pays de Galaad, et ont pu depuis remonter vers le nord.
Les Égyptiens, auxquels les trafiquants madianites venaient vendre le nek'ôf, connaissaient la gomme ; ils
la désignaient sous le nom de qomi, garni, a U II …, copte : KO M H, d’où les Grecs ont fait w>|i|i£, forme qui a donné le latin gumtni et notre mot « gomme ». Cf. Mas-. ll&l
ASTRAGALE — ASTRONOMIE
4192
pero, De quelques navigations des Égyptiens sur les côtes de la mer Erythrée, dans la Revue historique, janvier 1879, p. 5, note. Le mot qomi s’appliquait d’une manière générale à toutes les exsudations de certains végétaux, gommes ou substances mucilagineuses, odorantes ou non. La gomme servait dans la confection des nombreux parfums destinés au culte, dans l’embaumement et la conservation des momies ; on l’utilisait aussi pour la préparation des couleurs : « Peint avec du lapis-lazuli dans une solution de gomme, » lit-on au Livre des morts. R. Lepsius, Das Todtenbuch der Aegypter, in-4 « , Leipzig, 1842, pi. lxxix, c. 165, 12. Les Égyptiens faisaient donc une grande consommation des différentes espèces de gomme ; aussi celle du pays ne suffisant pas, ils allaient en chercher par mer, comme le montrent les textes, jusque dans le pays de Poun ( Arabie et terre de Somal) : qomi-u n Poun, « grains de gomme de Poun ». Dûmichen, Historische Inschriften altâgyptischer Denkmâler, in-f°, Leipzig, 1867, pi. xxxil ; Mariette, Deir el-Bahari, pi. 6 et p. 28, note. Cf. Maspero, Revue historique, janvier 1879, p. 24, 25. Si la gomme de Palestine n’est pas mentionnée expressément dans les textes, il y a lieu de croire cependant que les Égyptiens en recevaient de ce pays. De Syrie leur venaient diverses sortes d’aromates. « Anubis remplit ta tête (de la momie) de parfums de Syrie, baume, résine, cèdre, etc. ». Cf. Brugsch, H. Rhind’s zwei bilingue Papyri, in-4°, Leipzig, 1865, p. 5 du texte et lignes 3 et 4, planche vi. Avec le baume et le ladanum qui servaient dans les embaumements, les marchands ismaélites apportaient en Egypte le nek'ôf, la gomme, qui devait être employée probablement pour le même usage. On sait que la tête des momies était enveloppée d’un réseau de bandes gommées. Maspero, Lectures historiques, Histoire ancienne, in-12, Paris, 1892, p. 136. — Voir de la Billardière, Mémoire sur l’arbre qui donne là gomme adragante, dans le Journal de physique, t. xxxvi, janvier 1790, p. 46-53 ; H. Bâillon, Traité de botanique médicale, in-8°, Paris, 1884, p. 639-645 ; A. Héraud, Nouveau dictionnaire des plantes médicinales, in-8', Paris, 1884, 2e édit., p. 111-112 ; F. Vigoureux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., t. ii, p. 15 ; A. P. de Candolle, Astragalogia, in-f", Paris, 1802 ; A. de Bunge, Astragali gerontogei, in-i », Saint-Pétersbourg, 1868 ; E. Boissier, Flora orientalis, 5 in-8°, 1869-1884, t. ii, p. 205-498. E. Levesque.
ASTRE est employé dans la Vulgate comme synonyme d'étoile (hébreu : kôkâb). Deut., iv, 19 ; x, 22 ; xxviii, 62 ; Job, xxxviii, 7 ; Is., xiv, 13. Voir Étoile. Pour le culte rendu aux astres, voir Sabéisme.
- ASTROLATRIE##
ASTROLATRIE, culte rendu aux astres. Voir Sabéisme.
- ASTROLOGUES##
ASTROLOGUES, devins qui prédisent l’avenir au moyen des astres. Ceux de Babylone étaient célèbres ; Isaie les mentionne, xlvii, 13, et ils sont sans doute désignés dans Daniel, ii, 2, sous le nom de Chaldéens. On attribue à ce peuple l’invention de l’astrologie. J. F. Montucla, Histoire des mathématiques, 2e édit., 4 in-4°, Paris, 1799-1802, t. iv, p. 371. Voir Chaldéen 2.
ASTRONOMIE. La science des astres est regardée comme la plus ancienne de toutes. Elle fut cultivée d’abord par les Chaldéens et les Égyptiens. C’est à ces deux peuples que les auteurs classiques en attribuent généralement l’invention. Platon, Epinomis, Opéra, édit. Didot, t. ii, p. 512 ; Aristote, De cœlo, ii, 12, édit. Didot, t. ii, p. 401 ; Cicéron, De divinat., 1, 1, 19 ; Ptolémée, Almagest., iv, 2, édit. grecque-française de Halma, 2 in-4°, Paris, 1813, t. i, p. 216 et passim ; Sénèque, Quxst. nat., vii, 3-4 ; Simptfcius, Comment, in libros iv Aristotelis de cœlo, ex F$e6mione Karstenii, ii, 12, in-4°, Utrecht, 1865.
p. 216, 226. Cf. J. F. Mohtucla, Histoire des mathématiques, 2= édit., t. i (an VII), p. 50-74 ; L. A. Sédillot, Matériaux pour servir à l’histoire comparée des sciences mathématiques chez les Grecs et tes Orientaux, 2 in-8°, Paris, 1845-1849, t. i, p. 4-7 ; Laplace, Précis de l’histoire de l’astronomie, in-12, Paris, 1821, p. 13 ; Bailly, Histoire de l’astronomie ancienne, in-4°, Paris, 1775, p. 12, 129-154, 353-394, pour les Chaldéens, et pour les Égyptiens, p. 155-182, 395-419 ; Id., Traité de l’astronomie indienne et orientale, in-4°, Paris, 1781, p. 268 ; Delambre, Histoire de l’astronomie ancienne, 2 in-8°, Paris, 1817, t. i, p. 10, 14, 131, 288 ; R. Wolf, Geschichte der Astronomie, in-8°, Munich, 1877, p. 9, 23 ; Ed. Mahler, Die Astronomie bei den Vôlkern des alten Orients (Beilage zur Allgemeinen Zeitung), 31 août 1892, p. 1-3.
Josèphe fait remonter les origines de la science astronomique aux descendants immédiats d’Adam et de Seth, Ant.jud., i, ii, 3, t. i, p. 8, et il raconte qu’Abraham enseigna l’arithmétique et l’astronomie aux Égyptiens, Ant. jud., i, viii, 2, p. 19. — Malalas, Chronogr., Patr. gr., t. cxvii, col. 68, 69 (cf. Glycas, Ann., ii, Patr. gr., t. cxviii, col. 240), va même plus loin : il dit que Seth divisa le ciel en constellations et donna des noms aux planètes et aux étoiles. Ce sont là des fables qui n’ont d’autre fondement que l’ancienneté des observations astronomiques chez les Chaldéens et les Égyptiens.
Pline, dans le passage célèbre de son Histoire naturelle, vii, 57 (56), édit. Teubner, t. ii, p. 49, où il fait l’histoire des inventions, parle des observations astronomiques des Babyloniens, consignées sur des briques cuites, coctilibus laterculis, et qui remontent à 2 200 ans avant son époque. Simplicius, Comment., ii, 12, édit. de » 1865, p. 226, rapporte, d’après Porphyre, qu’Alexandre envoya à Aristote une série d’observations astronomiques embrassant, une période de 1 900 ans. Quelques tablettes astronomiques de Babylone ont été retrouvées. Voir J. Epping et J. N. Strassmaier, Astronomisches aus Babylon, m-8' >, Fribourg-en-Brisgau, 1889 ; A. H. Sayce, The Astronomy and À strology of the Babylonians with translations of the tablets relating to thèse subjects, dans les Transactions of the Society of Bïblical Archseology, t. m (1874), p. 145-339> F. Hommel, Die semitischen Vôlker, in-8°, Leipzig, 1883, t. i, p. 418, 515 ; J. Oppert, Die astronomischen Angaben der assyrischen Keilinschriften, in-8°, Vienne, 1885 (extrait des Sitzb. der Akad. der Wissensch. de Vienne, avril 1885, t. xci) ; Jensen, Die Kosmologie der Babylonier, in-8°, Strasbourg, 1890 ; Ed. Mahler, Die Zeitund Festrechnung der âltesten Vôlker des Morgenlandes (Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 16 septembre 1891), p. 3 ; F. Hommel, Die Astronomie der alten Chaldâer, dans Das Ausland, 1891, n°* 12-14 ; 20-21, p. 221-227 ; 249-253 ; 270-272 ; 381-387 ; 401-406 ; Zeitschrift fur Assyriologie, t. v, 1890, p. 341 ; t. vi, 1891, p. 89, 217.
Diodore de Sicile, i, 28, édit. Didot, t. i, p. 21, raconte que les Égyptiens se vantaient d’avoir appris l’astronomie aux Babyloniens, et plusieurs auteurs anciens font, en effet, honneur de cette découverte aux habitants de la vallée du Nil. Diogène Lærce, Proœm., 7, édit. Didot, p. 3 ; Lucien, De astrol., 3-9, édit. Didot, p. 373 ; Macrobe, Comm. in Somn. Scip., i, 21, 9, édit. Teubner, p. 561 ; Clément d’Alexandrie, Strom., i, 16, t. viii, col. 784 ; Lactance, Div. inst., ii, 14, t. vi, col. 328 ; S. Isidore de Séville, Etymol., iii, 25, 1, t. lxxxii, col. 169.
Pline, H. N., vii, 56 (57), édit. Teubner, t. ii, p. 49 ; Manilius, Astronom., i, 40-45, édit. Lemaire, Poetse min., t. vi, p. 199 ; Achille Tatius, Isag., i, édit. Petau, Uranologia, Paris, 1630, p. 73, font les honneurs de l’invention et aux Chaldéens et aux Égyptiens. Ce qui est certain aujourd’hui, c’est que les Chaldéens ont été, en astronomie, supérieurs à tous les autres peuples de l’antiquité, J. Epping et J. N. Strassmaier, Astronomisches aus Babylon, p. 187. Pour l’Egypte, voir H. Brugsch, Astro
les idées vulgaires sur le cours du soleil, et s’en rapportent aux apparences qui tombent sous les sens. Jos., x, 12 ; Ps. xviii, 6. Ils ne voient que ce qui frappe tous les hommes, la multitude des étoiles, Gen., xxii, 17 ; Exod., xxxii, 13 ; Nahum, iii, 16, etc., leur brillante et douce lumière, Is., xiv, 12, etc. Nous ne trouvons dans l’Ancien Testament aucune trace de la distinction des planètes, des étoiles fixes et des comètes ; ces « astres errants », àa-clpeç nXavîjTai, ne sont mentionnés que dans le Nouveau Testament. Saint Jude, dans son Épître, }. 13, leur compare les hérétiques ; mais il emprunte sa comparaison à la science grecque.
Les Hébreux distinguaient seulement, en dehors du soleil et de la lune, quelques étoiles et quelques constellations particulièrement remarquables, qu’ils désignent par des noms spéciaux. Job, ix, 9, énumère 'âS, kesîl, kîmâh et hadrê (êmân (Vulgate : Arcturus, Orion, Hyadte, interiora Austri ; la signification de hadrê têman, « ffis chambres du sud, » est douteuse). Le nom des Pléiades, kîmâh, se retrouve dans Job, xxxviii, 31, et Amos, v, 8 ; celui de kesil (Oridn), dans Amos, v, 8, et, au pluriel, dans Isaïe, xiii, 10, pour signifier les plus grands astres, considérés comme semblables à kesîl ; celui de 'as, sous la forme 'ayis, dans Job, xxxviii, 32 ("Vulgate : Vesper). Le livre de Job, xxvi, 13, nomme encore le nâhâs (Vulgate : Coluber), la constellation du Dragon. On trouve aussi dans l’Ancien Testament, chez les prophètes, quelques noms de planètes : hêlêl (Vulgate : Lucifer), l'étoile du matin ou Vénus, Is., xiv, 12 (â<jr)]p êo>91v6c, Stella matutina, dans l’Ecclésiastique, L, 6) ; — gad (Vulgate : Fortuna), Is., lxv, 11, la planète Jupiter, selon les uns ; Vénus, selon les autres ; — ment (omis dans la Vulgate), Is., lxv, 11, d’après un grand nombre de commentateurs, la Lune ; d’après d’autres, Vénus ; — kîyûn (Vulgate : imago), Amos, v, 26, la planète Saturne. Les noms de Nébo et de Nergal, qui personnifiaient les planètes Mercure et Mars, se lisent aussi Is., xlvi, 1, et IV Reg., xvii, 30, mais comme noms d’idoles. On admet communément que le mot mazzâlôt, II (IV) Reg., xxiii, 5, et le mot analogue, mazzârôf, Job, xxxviii, 32 (Vulgate : duodecim signa et Lucifer), signifie le zodiaque. Les douze signes du zodiaque (fig. 341) sont représentés sur des monuments babyloniens ( Cuneiform Inscriptions of Western Asia, t. iii, pi. 45 ; cf. Epping, Astronomisches aus Babylon, p. 148 ; R. Brown, Remarks on the Euphratean astronomical Names of the signe of the Zodiac, dans les Proceedings of the Society of Biblical Archseology, mars 1891, t. xiii, p. 246-271), et c’est peut-être à quelque représentation de ce genre que fait allusion IV Reg., xxiii, 5. Les rapports que les Juifs avaient eus avec les Assyriens depuis Achaz, IV Reg., xvi, 7, 10, 18, leur avaient donné quelques notions des sciences et des arts cultivés sur les bords de l’Euphrate et du Tigre, et c’est de leurs astronomes qu’Achaz avait dû apprendre la manière de construire un cadran solaire. IV Reg., XX, 11. Cf. Hérodote, il, 109. Le prophète Isaïe, xlvii, 13, fait allusion à' leurs observations astronomiques et astrologiques.
Dans le Nouveau Testament, les Gémeaux, étoiles protectrices des marins ( À16<rxoupoi ; Vulgate : Castores), Act., xxviii, 13, n’apparaissent que comme le nom du navire qui transporte saint Paul de Malte à Pouzzoles. La planète Vénus est nommée dans l’Apocalypse, ii, 28 ; xxii, 16, sous la désignation d' « étoile du matin », à<mip 6 itpwïvi ; , et d' « étoile brillante du matin », » àorrip à X « (iJtpàç xa’i àp61v<5{ (Vulgate : Stella splendida et matutina). Saint Pierre la nomme aussi, en employant l’expression par laquelle elle était désignée ordinairement dans la langue grecque : <pw<jq ; 6po< ; (Vulgate : Lucifer). II Pet., i, 19. Pour les étoiles et les constellations mentionnées dans la Bible, voir les articles spéciaux.
Voir Saalschùtz, Archâologie der Hebrâer, c. xlvi, t. ii, p. 72-74 ; L. Ideler, Historische Untersuchungen
ûber die astronomischen Beobachtungen der Alten, in-8°, Berlin, 1806 ; id., Unstersuchungen ûber den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen, in-8°, Berlin, 1809 ; Stem, Die Sternbilder in Buch Hiob, dans la Jùdische Zeitschrift fur Wissenschaft und Leben, t. iii, 1864, p. 258-276 ; G. Hoffmann, Versuche zu Amos, dans la Zeitschrift fur die alltestamentliche Wissenschaft, t. iii, 1883, p. 107-110, 279 ; M. Uhlemann, Grundzûge der Astronomie und Astrologie der Alten, in-8°, Leipzig, 1857 ; J. H. Kurtz, Die Astronomie und die Bibel, in-8°, Mitau, 1842 (principalement cosmologie) ; 0. M. Mitchel, The Astronomy of the Bible, in-12, NewYork, 1863.
F. Vigouroux. ASTROS (Paul Thérèse David d'), théologien français, né à Tourves (Var) le 15 octobre 1772, mort à Toulouse le 29 septembre 1851. Il supporta avec un grand courage les épreuves de la Révolution. En 1798, il devint secrétaire de Portalis, son oncle, puis grand vicaire du diocèse de Paris, qu’il administra après la mort du cardinal de Belloy (1808). Pie VII lui adressa, en 1809, la bulle d’excommunication contre Napoléon I er. L’empereur le fit alors incarcérer à Vincennes, où il resta jusqu’en 1814. Il accompagna les Bourbons à Gand pendant les Cent jours. À son retour, il fut nommé évéque de Bayonne ; en 1830, il devint archevêque de Toulouse, et le 29 septembre 1850, il fut promu au cardinalat. Il a laissé plusieurs écrits théologiques, canoniques et polémiques. On cite aussi souvent sous son nom La Bible mutilée par les protestants, ou Démonstration de la divinité des Ecritures rejetées par la Béforme, ouvrage publié par ordre de Affl r d’Astros, archevêque de Toulouse, in-8°, Toulouse, 1847. Cet ouvrage est en réalité l'œuvre de B. H. Vieu’sse, Sulpicien, professeur au grand séminaire de Toulouse. Voir Vieusse. Cf. Caussette, Vie du cardinal d’Astros, in-8°, Toulouse, 1853.
- ASTRUC Jean##
ASTRUC Jean, médecin français, né à Sauves, dans le bas Languedoc, le 19 mars 1684, mort à Paris en 1756. Il étudia la médecine à Montpellier, et occupa à partir de 1716 une chaire à la faculté de cette ville. Adonné surtout aux sciences médicales, il se mêla cependant de métaphysique et d’exégèse biblique, et dans cette dernière branche ses conclusions ont eu du rententissement, à cause du parti qu’en ont tiré les rationalistes modernes. Ses Conjectures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse s’est servi pour composer le livre de la Genèse, ouvrage publié à Bruxelles (Paris), en 1753, sous le voile de l’anonyme, ont servi de base à tout un système d’attaques contre l’intégrité du Pentateuque et la réalité de son auteur. Astruc distinguait, dans la Genèse, deux mémoires ou documents principaux, reconnaissablés, d’après lui, au nom différent de Dieu qui y était employé : Elohim, « Dieu, » dans l’un ; Jéhovah (Dominus dans la Vulgate) dans l’autre. Il admettait en outre la présence de divers autres fragments, et prétendait que Moïse s'était servi, pour la composition de son récit, d’une douzaine de mémoires, insérés sans presque aucune modification. Cette distinction, déjà remarquée d’ailleurs par plusieurs Pères ou docteurs de l'Église, qui avaient essayé de l’expliquer, a fait fortune en Allemagne depuis le commencement du siècle, et bon nombre d’exégètes rationalistes l’ont admise, en la modifiant selon leurs vues propres. Vater, l’auteur de l’hypothèse « fragmentaire », reproduit dans son système cette distinction des noms de Dieu, à laquelle il prête une grande importance. Ce furent Eichhorn et surtout Ewald qui popularisèrent au delà du Rhin les idées d’Astruc, d’où tire son origine l’hypothèse « des documents ». Dès lors les critiques de cette école regardèrent comme un fait démontré que le Pentateuque n'était qu’une sorte de mosaïque dans laquelle étaient juxtaposés des documents d’origine diverse. Toutefois l’accord cessa tout à coup lorsqu’il s’agit d’indiquer dans le livre sacré la place qui convenait à chaque document,
et une troisième hypothèse dite' « complémentaire » a essayé, mais sans succès, de faire à chacun une part équitable. Kuenen dans les Pays-Bas, Renan et Michel Nicolas en France, Davidson et Golenso en Angleterre, sont entre beaucoup d’autres les propagateurs d’une théorie qu’ils ont su adapter à leurs propres idées. Le livre d’Astruc fit élever des doutes sur son orthodoxie, et pour combattre la mauvaise impression soulevée par cette publication, il donna deux dissertations sur Y Immortalité, l’immatérialité et la liberté de l'âme, 1755. Voir Vigoureux, Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4e édit., t. ii, p. 479-485. L. Guillereau.
ASTRUC DE LUNEL. Voir Abba Mari, col. 18.
- ASTYAGE##
ASTYAGE (' Aaruâyr^ ; en assyrobabylonien : IStuwigu) fut le quatrième et dernier roi des Mèdes (584-549). D’après les témoignages concordants d’Hérodote et des inscriptions babyloniennes, dont une émane du roi chaldéen contemporain Nabonide, il fut renversé par Cyrus, roi de Perse, et livré au vainqueur par ses propres soldats. Astyage conserva jusqu'à sa chute, qui fut soudaine et imprévue, l’empire dont il avait hérité de son père Cyaxare. Hérodote le fait aïeul maternel de Cyrus, et raconte qu’il voulut faire périr ce dernier, à la suite d’un songe qui lui annonçait, selon l’interprétation des mages qu’il consulta, que son petit-fils, encore à naître, le détrônerait un jour. Mais le récit d’Hérodote porté le cachet de la légende dans cette partie. Le même historien dit qu' Astyage, prisonnier de Cyrus, fut traité avec égard jusqu'à sa mort. Astyage a laissé la réputation d’un prince voluptueux et cruel, et la conduite des Mèdes à son égard tend à la justifier. — Astyage est nommé dans les suppléments deutérocanoniques du livre de Daniel, par Théodotion et la Vulgate, en un verset que la Vulgate, dans les éditions actuelles (xm, 65), rattache à l’histoire de Susanne, et qui appartient néanmoins à l’histoire de Bel et du Dragon, à laquelle il sert d’introduction : « Astyage fut réuni à ses pères, et Cyrus, roi de Perse, lui succéda dans la royauté. » Malgré toutes les peines qu’on s’est données, on n’a pas réussi jusqu'à présent à expliquer la mention d’Astyage en cet endroit, où il est question de Cyrus, roi de Babylone : ce qui n’a qu’un rapport indirect avec l’histoire d’Astyage. Celui-ci, en effet, ne fut jamais roi de Babylone, et il perdit son royaume de Médie dix ans avant la prise de cette ville par Cyrus. Aussi plusieurs voudraient - ils supprimer ce verset, conformément au texte des Septante, où il ne se lit pas. — Voir le cylindre de Nabonide, trouvé à Sippar par H. Rassam, publié par Pinches, dans les Cuneiform Inscriptions of Western Asia, t. v, pi. 64 ; traduit en partie par le même dans les Proceedings of the Society of Biblical Archmology, t. v, p. 7, 8, et en entier, avec commentaires, par Joh. Latrille, dans la Zeitschrift fur Keilschriftforschung, t. ii, p. 231-262, 335-359 ; — la chronique babylonienne relative à Nabonide et à Cyrus, publiée par le même, avec version, dans les Transactions of the Society of Biblical Archxology, t. vii, p. 153-169 ; Hérodote, i, 46, 73-75, 91, 107-112, 114-125, 127-130, 162 ; Ctésias, dans Diodore de Sicile, ii, 34. — Les données de Xénophon, dans la Cyropédie, sont absolument fausses, et contredites par l’Anabase, iii, 4, où l’on voit le dernier roi des Mèdes renversé par le roi de Perse, conformément au témoignage des autres sources. A. Deiattre.
- ASUPPIM##
ASUPPIM ( 'Âsuppîm ; Septante : 'Ao-aipefv, I Par., xxvl, 15, 17). Ce mot hébreu, nom propre d’après quelques-uns, nom commun d’après le plus grand nombre, se lit trois fois dans l’Ancien Testament, I Par., xxvi, 15, 17, et II Esdr., xii, 25. Dans les deux premiers passages, la Vulgate traduit concilium, « [maison où se réunissait] le conseil ; » dans II Esdr., xii, 25, elle traduit vestibula, « parvis » (Septante : lv tw <tuv « y « YS’v ! *£) L’auteur des
Paralipomènes applique le mot à une maison ou à un local particulier : bêf ( « maison » ) 'ixsuppîm, I Par., xxvi, 15 ; le mot bêt n’est pas exprimé, mais il est sous-entendu, I Par., xxvi, 17, et II Esdr., xii, 25. 'Asuppîm signifie « collections, amas ». La maison des 'âsuppîm est donc la salle, magasin ou chambre, où l’on réunissait et gardait des objets divers, appartenant au temple de Jérusalem. Elle était située au sud du temple. Deux lévites de la famille d’Obédédom étaient chargés de la garder. I Par., xxvi, 15. — Néhémie, en énumérant les fonctions des lévites dans le temple restauré après la captivité, II Esdr., xii, 25, l’appelle « l" âsuppîm des portes », parce que ce dépôt ou trésor était près de l’une des portes du temple, dans la cour extérieure. Cf. I Par., xxvi, 15. On peut supposer que deux entrées conduisaient au bêt 'âsuppîm, puisque deux postes étaient destinés à en garder l’accès. I Par., xxvi, 16. Cf. F. Keil, Ckronik, 1870, p. 204.
- ASYNCRITE##
ASYNCRITE (Nouveau Testament : 'Actûyxpitoç, « incomparable » ), chrétien de Rome, que salue saint Paul dans son Épitre aux Romains, xvi, 14. Les Grecs le regardent comme le premier évêque d’Hyrcanie, et font sa fête le 8 avril. Le martyrologe romain le marque au même jour.
1. ATAD (hébreu : Hâ'âtâd, avec l’article hâ ; Septante : 'AtôcS), nom d’une aire où les enfants de Jacob et les Égyptiens qui les accompagnaient célébrèrent pendant sept jours les cérémonies solennelles des funérailles du patriarche, d’où vint que les Chananéens qui habitaient le pays donnèrent à cet endroit le nom d’Abel Misrahn ou « Deuil de l’Egypte » (Vulgate : Planctus JEgypti). Gen., L, 10-1 1. Atad est considéré par quelques-uns comme un nom propre d’homme, désignant le propriétaire de l’aire ; mais comme ce mot, qui signifie « épine, buisson », est précédé de l’article, il est assez probable qu’il doit se prendre comme nom commun, marquant que l’aire était dans le voisinage des buissons 'âtâd, ou avait été ellemême autrefois soit couverte de ces buissons, sqit remarquable par quelque arbuste épineux de l’espèce dé ce nom.
L'événement rapporté par la Genèse est trop ancien et le lieu où il s’accomplit était trop peu important pour que la tradition ait exactement gardé le souvenir de l’emplacement de l’aire d’Atad. L’auteur sacré a bien eu soin de nous apprendre que cette aire était située « au delà du Jourdain », Gen., L, 10 ; mais cette détermination est trop vague et insuffisante pour fixer un lieu précis. On peut s’en servir du moins pour rejeter l’opinion de ceux qui, comme Thomson, The Land and the Book, Southern Palestine, 1881, p. 243-245, supposent qu’Abel Misraïm était dans le voisinage d’Hébron, Cette hypothèse panait de prime abord assez naturelle : le corps de Jacob devant être enterré à Hébron, on comprendrait facilement qu’on eût célébré les rites solennels des obsèques dans le voisinage de cette ville, avant de déposer les restes du saint patriarche dans la caverne de Makpélîh ; mais, quoique le chemin le plus court pour aller d’Egypte à Hébron fut celui qui est à l’ouest de la mer Morte, le cortège funèbre, pour une raison inconnue, probablement à cause des dangers de la route directe, alla passer à l’est et au nord de la mer, comme le prouve l’indication « au delà du Jourdain ». Cette expression ne peut convenir à un lieu voisin de la ville d’Hébron. L’aire d’Atad doit^ donc être cherchée à l’est ou à l’ouest du Jourdain, dans la dernière partie de son cours. La locution be'êbér hayyardên, « au delà du Jourdain, » signifie ordinairement, dans l'Écriture, « à l’est du fleuve, » parce que le territoire de la rive gauche est « au delà » pour celui qui écrit dans la Palestine proprement dite. Aussi divers interprètes l’entendentils ici dans ce sens ; ils croient que l’aire d’Atad était près du fleuve, sur la rive orientale, et comme il n’y avait pas de Chananéens au delà du Jourdain, et que le texte dit
expressément que les Chananéens furent témoins du deuil des enfants de Jacob, Gen., l, -11, ils supposent qu’ils voyaient de la plaine occidentale ce qui se passait de l’autre côté de la rivière. Fr. Delitzsch, Die Genesis, 2e édit., 1853, t. ii, p. 162. Cette explication est forcée. Le sens naturel du texte est que les cérémonies funèbres s’accomplirent au milieu des Chananéens. On comprend sans peine que ce soit aussitôt après être entrés dans la terre de Chanaan que les enfants de Jacob lui rendirent les devoirs funèbres. L’expression be'êbér ne contredit pas cette explication, car cette locution ne signifie pas nécessairement « à l’est » du Jourdain ; et signifierait-elle toujours « au delà, » dans le cas présent pour ceux qui venaient d’Egypte, « au delà du Jourdain, » c'était la terre de Chanaan. Mais, en réalité, be'êbér n’avait pas une signification très précise et rigoureusement déterminée. Cf. Num., xxxii, 19 ; Deut., iii, 20, 25 ; xi, 30. Aussi beaucoup de géographes et de commentateurs n’hésitent-ils pas à reconnaître que l’aire d’Atad était à l’ouest du Jourdain. Raumer, Palâstina, 2e édit., in-8°, Leipzig, 1838, p. 175 ; Ritter, Erdkunde, t. xv, p. 544 ; J. Lamy, Commentarium in librum Genesis, 2 in-8°, Malines, 1884, t. ii, p. 400, etc. D’après une tradition ancienne, attestée par saint Jérôme, De situ et lac. heb., t. xxiii, eol. 863, l’aire d’Atad était à deux milles du Jourdain, à trois milles de Jéricho, au lieu appelé de son temps Bethhagla. Voir Bethhagla. Cf. V. Guérin, Samarie, t. i, p. 58-59. On ne peut dire que l’identification de l’aire d’Atad et de Bethhagla soit certaine ; mais de toutes celles qui ont été proposées, elle paraît la plus acceptable. — Aujourd’hui subsiste encore, en Syrie, la coutume de pleurer les morts pendant une semaine et de placer le corps sur une herse à battre le blé, dans une aire située à l’ouest du village, au milieu d’une tente de peaux de chèvres noires ; c’est là que les parents lui rendent les devoirs funèbres. Voir Wetzstein, Die syrische Drechstafel, dans la Zeitschrift fur Ethnologie, 1873, p. 294-302. Ci. Ritter, Erdkunde, t. xv, p. 544. F. Vigouroux.
2. 'ÂTÂD, nom hébreu d’un arbuste épineux, nommé Jud., ix, 14, 15, et Ps. lviii (lvh), 10, et dont l’identification est douteuse. Septante : pâu.voç ; Vulgate : rhamnus. Voir Lyciet et Rhamnls.
- ATARA##
ATARA (hébreu : 'Âtârâh, « couronne ; » Septante : 'Aiâpct), deuxième femme de Jéraméel, fils aîné d’Hesron, et mère d’Onam. I Par., H, 26.
- ATARGATIS##
ATARGATIS, déesse adorée par les Philistins, les Phéniciens, les Syriens, et appelée aussi Dercéto. Elle n’est pas nommée dans la Sainte Écriture, mais le texte grec de II Machabées, xii, 26, parle d’un temple qui lui était consacré et qui portait son nom, Atargatéion ('AtapyaTeïov ; Codex Alexandrinus : 'ATepyafsïov).
I. Nom. — Les écrivains grecs, par lesquels cette déesse nous est surtout connue, écrivent diversement son nom : 'AtapfâTi ?, 'ATEpyâTtç (l’orthographe Atargatis doit être préférée à celle d’Atergatis, d’après les monuments épigraphiques), AepxîTû. Le nom de Dercéto ne diffère guère de celui d’Atergatis que par l’absence de l’a initial, et par le changement des consonnes de même nature, d et t, g et k ; il en est une forme abrégée. « On appelait aussi Atargatis Athara ('Adâpav) ; Ctésias l’appelle Dercéto, » dit Strabon, XVI, 27, édit. Didot, p. 667. « Prodigiosa Atargatis, dit Hine, H. N., v, 23 (19), 81, Gratis autem Dercéto dicta. » Une inscription votive, trouvée à Astipalya, sur un petit autel rectangulaire en marbre blanc, porte : ANTI0X02 | KAI | ETII0P02 | ATAPrATEITI | ANE9HKAN, « Antiochus et Eupore ont consacré [cet autel] à Atargatis. » Bulletin de correspondance hellénique, 1879, p. 407. (Voir ibid., p. 407-408, les autres monuments êpigraphiques grecs reproduisant le nom d' Atargatis, et ibid., 1882, p. 479-489, 495-500, les inscriptions
du temple des dieux étrangers à Délos, consacrées au dieu Adad ou Hadad et à la déesse Atargatis.)
L'étymologie du nom d’Atargatis est fort discutée. Plusieurs orientalistes veulent y trouver le poisson comme élément. J. Selden, De diis syris syntagmata duo, ii, 3, in-12, Londres, 1617, p. 178 ; Fr. Creuzer, Symbolik und Mythologie der alten Vôlker, 2e édit., 4 in-8°, Leipzig et Darmstadt, . 1819-1821, t. ii, iv, 12, p. 76-77, y voient les deux mots 3T tîn, 'addir ddg, « grand
poisson. » — Gesenius, Commentar ûber den Jesaia, 1821, t. ii, p. 342, le décompose en Ta-h », 'âdér gad, « grandeur de félicité. » — Movers, Phônizier, 1. 1, p. 584 ; Michælis, Lexicon syriacum, 1788, p. 975-976, et L.W. Grimm, Das zweite JBuch der Makkabâer, 1857, p. 179, croient que l’a initial ne fait pas partie intégrante du nom, qui, est écrit, en chaldéen, dans le Talmud, Aboda zara, f. Il b,
NnyiP, 41r ata, en syriaque IK^il » (era’fo, ou I, « y i), tar’fo', dans Jacques de Sarug (voir P. Martin,
Discours de Jacques de Saroug, dans la Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft, 1875, t. xxix, p. 132) T et ils pensent que la signification du nom d’Atargatis. est celui de ce mot araméen, c’est-à-dire « fente, ouverture », ce qui peut être rapproché de la coutume mentionnée par Lucien, De syria dea, 12, 13, édit. Didot, p. 735-736 ; il raconte que-de nombreux pèlerins se rendaient deux fois par an au temple de la déesse, à Hiérapolis, pour verser de l’eau dans l’ouverture d’un gouffre (xàtr[ia), par où, disait-on, s'étaient écoulées autrefois toutes les eaux du déluge. Mais ni la forme talmudique ni la forme employée par Jacques de Sarug ne sont exactes. Les Inscriptions découvertes pendant ces dernières années nous ont révélé la véritable orthographe d’Atargatis. Sur les monuments de Palmyre, elle est appelée rmyiny, ce qu’une inscription bilingue de Palmyre qu. I, n° 3, ligne 4) rend en grec par [AraplfaTec. (De Vogué, Syrie centrale, Inscriptions sémitiques, 1868, p. 7, pi. I. Cf. Waddington, Inscriptions grecques et latines de Syrie, in-f », Paris, 1870, n » 2588, p. 596 ; Corpus inscriptionum
[[File: [Image à insérer]|300px]]
342. — Atargatis.
(IflO^nO (iTWmy). Atargatis, vue de face, avec une haute.
couronne ornée de quatre cercles et de quatre fleurons en acrqtères, lea cheveux nattés tombant sur ses épaules, et un
collier. — fy qq^q^u ("I" ! ~ 137). AbdHadad, prêtre d' Atargatis, barbu, debout, à gauche, coiffé d’un bonnet conique, vêtu d’une longue robe, la main droite levée devant un thymiatérion, sous un toit supporté par deux colonnes.. Pièce fourrée, frappée à Hiérapolis (Bambyce) vers le temps* de l’arrivée d’Alexandre en Syrie.
grœcarwn, n" 4480). Sur une monnaie syrienne, on re-~ marque une légère variante inviny (fig. 342). De Luynes, Essai sur la numismatique des satrapes, 1846, texte, p. 39, et pl.v ; Blau, Beilràge zur phônikischenMùnzkunde, dans la Zeitschrift der deutschen morgenlândischen Gesellschaft, 1852, t. vi, p. 473-474 ; A. de Longpérier, Monuments antiques de l’Asie, dans le Journal asiatique, octobrenovembre 1855, p. 428 ; Id., Œuvres, édit. Schlumberger, 3 in-8°, Paris, 1883, 1. 1, p. 187. Il résulte de là que le nom. d’Atargatis se compose de deux éléments : in ? et rtny, . comme l’avait supposé H. Ewald, Erklârung der grosse », phônikischen Inschrift von Sidon, in-f°, Gœttingue, 1856, .
p. 52. Cf. M. A. Levy, Phônizische Studien, Heft ii, 1857, p. 39 ; Nôldeke, Beitrâge zur Kenntniss der aramàischen Dialehte, dans la Zeitschrift der deutschen morgenlândischen Gesellsehaft, 1870, t. xxiv, p. 92, 109.
II. Caractères de cette déesse. — Atargatis ne diffère pas au fond d’Astoreth ou Astarthé. Un de ses temples se trouvait dans la ville qui portait le nom même d’Astarthé, c’est-à-dire Astaroth-Carnaïm. Le premier élément de son nom est une contraction de ii^ny, ’Attar
ou’Attor, correspondant à l’hébreu m’Eii, ’Àsfôréf, et au phénicien rnniry, ’Asfarle, avec le durcissement de
la sifflante S en t, selon la loi de la.langue araméenne, et la chute de la terminaison féminine t, comme dans le nom assyrien de la même déesse, Istar. Attar est connue comme une déesse hymiarite, et Strabon, xvi, 27, comme nous l’avons vii, dit formellement qu’elle est la même qu’Atargatis. Voir aussi Hésychius, au mot’AmxfâOn (Lexicon, édit. M. Schmidt, 5 in-4°, Iéna, 1858-1868, t. i, p. 317) ; cf. Justin ( Atarathes), Hist. phil. Epit., xxxvi, 2, édit. Teubner, p. 205 ; J. Halévy, Recherches bibliques, dans la Revue des études juives, 1884, t. ix, p. 182-183. La seconde partie du nom, nny, ’atah, semble signifier « bonne fortune ». Cf. la déesse Ati ÇAti), dans pseudo-Méliton, Corpus apolog. christ., édit. Otto, t. ix, p. 505, 426 ; W. Baudissin, dans Herzog, Real-Encyklopâdie, 2e édit., t. i, p. 737 ; M. de Vogué, Inscript, sémit., p. 8, 11 (Palmyre, pi. i, n° 5, ligne 6) ; E. Schrader, Semitismus und Babylonismus, dans les Jahrbûcher fur protestantische Théologie, 1875, t. i, p. 127.
Malgré cette union d’Attar et d’Atti, l’identité primitive d’Atargatis et d’Astarthé n’est pas douteuse. L’une et l’autre
ont à peu près les mêmes
attributs. La colombe leur est
consacrée. Voir, pour Atarga tis-Dercéto, fig. 287, col. 1064. De nombreux monuments
l’attestent pour l’Astarthé
phénicienne. Un cylindre
trouvé en Chypre, par M. di
Cesnola (Salamina, in-4°, Turin, 1887, n » 30, p. 130), d’une longueur de dix-neuf millimètres, représente l’offrande d’une colombe à Astarthé. Un prêtre la reçoit de la main d’une femme, pour la présenter à la déesse. Derrière Astarthé, on voit un lion assis et un griffon ailé (fig. 343). Le lion est mentionné par Macrobe, Saturn., I, 23, 20, édit. Teubner, p. 128, dans la représentation d’Atargatis (Adargatis). Quant aux colombes, la légende en est spécialement rattachée à Dercéto ou Atargatis par les auteurs anciens. Diodore de Sicile, ii, 20, édit. Didot, t. i, p. 96, d’après Ctésias, Fragm., 5, édit. Didot, p. 16 ; cf. Lucien, De syria dea, 14, édit. Didot, p. 736 ; Athénagore, Légat, pro Ckristo, . 30, Patr. gr., t. vi, col. 960. Cf. J. Gilmore, The frag ments of the Persika of
Ctesias, in-8°, Londres,
1888, p. 24-26.
Le poisson était aussi
consacré à Atargatis et à
Astarthé. Les écrivains
grecs et romains, Lucien,
De syria dea, 14 ; Diodore
de Sicile, ii, 4 ; Ovide,
Met., iv, 44-46, disent que
Dercéto était une déesse poisson, comme Dagon était un dieu-poisson, et elle est représentée sous cette forme sur une médaille publiée par J. Swinton, Observations upon five ancient Coins, dans les Philosophical Transactions, t. lxi, 1771, part, ii, in-4°, Londres, 1772, p. 350, pi. xiii, 3. Cf. n » l. Elle tient un poisson dans la main droite et un coquillage dans la main gauche. Malheureusement cette médaille est fruste
343.
Offrande d’une colombe
à Astarthé.
344.
Dercéto.
Dercéto, moitié femme, moitié
poisson. — ^. Une galère et
un cheval ou monstre marin.
et l’interprétation qu’en donne Swinton peut être sujette à quelques difficultés (fig. 344). Cf. aussi J. Eckhel, Doctrina numorum, t. iii, p. 445. D’après les fables conservées par les Grecs, Dercéto, séduite par la beauté d’un jeune homme qu’elle remarqua parmi ceux qui lui offraient des sacrificeSj en eut une fille qui devint la célèbre Sémiramis. Honteuse de sa faute, elle fit disparaître le père, relégua l’enfant dans une solitude où elle fut nourrie par des colombes, et se précipita elle-même, près d’Ascalon, dans un lac où elle fut changée en poisson. Diodore de Sicile, ii, 4. Une autre forme de la légende raconte que Dercéto, étant tombée dans un lac, fut sauvée par un poisson, d’où le culte rendu aux poissons par les Syriens. Hygin, Astron., ii, 30, 41 ; Ératosthène, Catasterism., 38 ; Strabon, xvi, 27, p. 667. Cf. Cicéron, De nat. deor., 6 ; Athénée, Deinosoph. r vin, 37 ; Ovide, Métam., IV, 44-46 ; Selden, De diis syris, n, 3. Atargatis -Dercéto était donc devenue la force fécondante des eaux divinisées. Elle était souvent associée au dieu Hadad. Macrobe, Saturn., i, 23 ; Bulletin de correspondance hellénique, 1882, t. vi, p. 481-489, 495-500. III. Culte. — Le culte d’Atargatis était particulièrement célèbre à Ascalon (voir Ascalon, col. 1064). Cette déesse 845. — Temple d’Astarthé.
avait aussi un temple renommé à Hiérapolis ou Bambyce. Strabon, xvi, 27, p. 667. Cf. Pline, H. N., v, 23 (19), 81 ; J. A. Nickes, De Estherx libro, 2 in-8°, Rome, 1856-1858, t. i, p. 326. On l’honorait également à Palmyre. M. de Vogué, Inscript, sémit., p. 8. Le second livre des Machabées, xii, 26 (grec), nous apprend qu’elle avait un temple à Camion, c’est-à-dire, d’après l’explication commune, à Astaroth-Carnaïm, ville qui tirait son nom de celui de la déesse.
Ce qu’était le temple de Camion, aucun document antique ne nous le fait connaître. Nous pouvons cependant en avoir probablement quelque idée, grâce aux découvertes, de Mycènes. Parmi les objets trouvés par M. Schliemann dans les tombeaux de l’acropole de Mycènes, figure un petit modèle en or d’un temple d’Astarthé, travaillé au repoussé. H. Schliemann, Mycènes, in-8°, Paris, 1879, p. 349 ; cf. L. von Sybel, Weltgeschichte der Kunst, in-4°, Marbourg, 1888, p. 58. Le symbole de la déesse est représenté dans.les trois niches qui figurent l’intérieur du. sanctuaire ; deux colombes aux ailes déployées sont perchées sur deux colonnes placées au-dessus des deus côtés du temple ; une sorte de tour, terminée par quatre cornes, couronne l’édicule (flg 345).
Le premier livre des Machabées, v, 43-44, mentionne aussi le temple de Camion, mais sans dire à quelle divinité il était consacré. Il nous apprend seulement que les habitants du pays de Galaad, battus par Judas Machabée, jetèrent leurs armes et se réfugièrent dans l’enceinte sacrée, espérant sans doute que ce serait pour eux un asile inviolable ; mais le vainqueur fit mettre le feu au temple, et tous ceux qui y étaient enfermés périrent dans les flammes.
Voir Richter, Derketo, dans Ersch et Gruber, Encyklopädie, sect. i, t xxiv, 1833, p. 499-205* C. A. Bottiger, Die phönizisch-karthagische Juno, dans ses Ideen zur Kunst-Mythologie, t. ii (1836), in-8°, Dresde, p. 213-221 ; Movers, Die Phönizier, t. i, 1841, p. 389-410 ; Stark, Gaza und die philistäische Küste, 1852, p. 250-255 ; L. Preller, Römische Mythologie, 3e édit., t. ii, 1883, p. 396-399 ; R. Smith, Lectures on the religion of the Sémites, in-8°, Edimbourg, 1889, p. 159 ; W. H. Roscher, Ausführliches Lexicon griechischen und römischen Mythologie, t. i, 1884-1890, col. 651.
ATAROTH (hébreu : ʿÂtârôṭ, « couronnes, » une fois avec le cholem défectif, Num., xxxii, 34 ; Septante : Ἀταρώθ, nom de plusieurs villes situées des deux côtés du Jourdain. Il se retrouve, à l’état construit, dans les composés suivants : i° ʿÂtrôṭ-Šôfân, Num., xxxii, 35 ; 2° ʿÂtrôṭ-Addâr, Jos., XVI, 5 ; xviii, 13 ; 3° ʿÂtrôṭ-béṭ-Yô’âb, I Par., ii, 54. Il s’est conservé, sous la forme ʿÂtâra, dans plusieurs localités actuelles de la Palestine, sans qu’elles correspondent toujours pour cela aux cités bibliques.
1. ATAROTH, une des villes du « pays de Jazer et du pays de Galaad », Num., xxxii, 1, 3, enlevée à Séhon, roi des Amorrhéens, Num., xxxii, 33, et rebâtie ou fortifiée par les fils de Gad, Num., xxxii, 34. Les cités parmi lesquelles elle est mentionnée suffiraient à elles seules pour nous indiquer son emplacement d’une façon générale : Dibon (Dhibân) et Aroër (Ar’dir), un peu audessus de l’Arnon ; Hesebon (Hesbân), vis-à-vis de la pointe septentrionale de la mer Morte ; Éléale (El ’Al) au nord-est, et Nébo (Neba) au sud-ouest d’Hésebon. Elle se trouvait donc bien dans la région qui s’étend à l’est du lac Asphaltite. Son nom s’est conservé à peu près intact dans le Djebel Attarûs et le Khirbet Attarûs, عتاروس ou عتروس, situés à quelque distance au nord-ouest de Dibon. Voir la carte de la tribu de Ruben. À cette identification on a opposé l’objection suivante : Ataroth ne pouvait être placée si bas, puisque l’extrême limite méridionale de la tribu de Gad ne descendait. pas au-dessous d’Hésebon. Jos., xiii, 26. Cf. Grove, dans Smith’s Dictionary of the Bible, Londres, 1861, 1. 1, p. 134. Nous répondrons d’abord que la difficulté est la même pour Dibon et Aroër, situées plus au sud encore, et dont la position néanmoins ne peut souffrir aucun doute. Ensuite les villes de cette première contrée conquise par les Israélites, après avoir été restaurées indistinctement par les enfants de Ruben et de Gad, furent plus tard réparties entre eux d’une manière spéciale, en sorte que Dibon, Ataroth et Aroër, quoique rebâties par Gad, Num., xxxii, 34, furent, d’après le partage, attribuées à Ruben. Jos., xiii, 16, 17.
Les ruines connues sous le nom de Khirbet Attarûs consistent en une masse de pierres brutes, des rangées de murs démolis, des lignes de fondations éparses sur un long sommet, de larges cavernes et des citernes circulaires. Parmi ces débris s’élèvent quelques figuiers et de vieux térébinthes au tronc noueux. De ce point la vue est très étendue : par un ciel clair on aperçoit Bethléhem et Jérusalem, le Garizim et le Gelboé. Le Tell Chihàn domine la plaine au sud, tandis qu’à l’est de petits points, épars sur le vaste plateau, marquent la position de certains sites ruinés, comme Oumm er-Reçâs et Ziza. De Khirbet Attarûs, une ancienne voie romaine conduit, à travers une contrée boisée et bien cultivée, au Djebel Attarûs, mamelon isolé sur lequel s’élevait l’ancienne citadelle. On y trouve les débris d’un fort et d’un mur qui entourait la crête de la colline. On y jouit d’une belle vue sur l’ouadi Zerqa Main, l’ouadi Habis au nord, et l’ouadi Modjib (Arnon) au sud. Cf. H. B. Tristram, The Land of Moab, in-8°, Londres, 1874, p. 271-274.
Il est question d’Ataroth dans la stèle de Mésa. Le roi de Moab dit : 10. « Et les hommes de Gad habitaient dans la terre d’[Ataro]th depuis longtemps et leur avait bâti le roi [d’I-] 11. sraël A[t]aroth. | Et j’attaquai la ville et je la pris | et je tuai tous les hfommes] 12. de la ville, spectacle agréable à Ghamos et à Moab. Et j’emportai de là l’Ariel ( ?) Dodo et je le [pla-] 13. çai par terre devant Chamos à Carioth. » Cf. A. H. de Villefosse, Notice des monuments provenant de la Palestine et conservés au musée du Louvre, Paris, 1879, p. 1, 3 ; F. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., t. iv, p. 61.
2. ATAROTH. Le texte hébreu mentionne dans le pays de Moab une autre Ataroth, ʿÂtrôṭ-Šôfân ; Septante : τὴν Σοφάρ. Num., xxxii, 35. Elle est appelée dans la Vulgate Etroth et Sopham. Voir Étroth.
3. ATAROTH (Septante : Ἀχαταρώθι, corruption des deux mots Ἀρχί Ἀταρώθ, qu’on distingue généralement, avec les principales versions), ville frontière méridionale de la tribu d’Éphraïm [ ? ]. Jos., xvi, 2. Son emplacement est très difficile à déterminer. Suivons pour cela bien exactement la délimitation tracée par le texte sacré. « Le lot échu aux enfants de Joseph part du Jourdain, auprès de Jéricho et de ses eaux (Aïn es-Soulthân), vers l’orient : [suit] le désert qui monte de Jéricho à la colline de Béthel (Beitin). Et il sort de Béthel Luza et passe vers les frontières de l’Archite, vers Ataroth ; et il descend à l’occident vers la frontière du Japhlétite jusqu’aux confins de Béthoron inférieure et jusqu’à Gazer, et il aboutit à la mer (Méditerranée). » Jos., xvi, 1-3. Deux villages appelés ’Athâra, عطارا, et ’Atâra, عتارا, sont assez rapprochés de la ligne décrite depuis Béthel jusqu’à Béthoron. Le premier, situé au nord-ouest de Beitin et au sud-ouest de Djildjilia, s’élève sur une hauteur, avec une population d’environ trois cents habitants. Robinson, Biblical Researches in Palestine, 3 in-8°, Londres, 1856, t. ii, p. 265, et V. Guérin, Description de la Palestine, Samarie, t. ii, p. 169, pensent qu’on peut probablement l’identifier avec la ville dout nous parlons. Et, en effet, par sa position, Athara pouvait être choisie comme un des points de la frontière sud d’Éphraïm : de là on « descend à l’occident jusqu’aux confins de Béthoron inférieure ». Jos., xvi, 3. Le second, situé entre El-Biréh (Béroth) au nord et Er-Ram (Rama) au sud-est, rentre évidemment dans la tribu de Benjamin ; c’est l’Ataroth mentionnée par l’Onomaslicon, Gœttingue, 1870, p. 222, comme appartenant à cette tribu, une des deux Ataroth indiquées dans le voisinage de Jérusalem. Cf. S. Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxiii, col. 872. Placée au-dessous de Béthel, et, sous le rapport de l’altitude, au-dessus de Béthoron inférieure, cette localité, sans faire partie du territoire d’Éphraïm, pouvait cependant servir aussi, comme direction générale, au tracé des limites. Voir Éphraïm, tribu et carte, ou Benjamin. Cette ville est-elle distincte d’Ataroth Addar ? Voir Ataroth Addar.
4. ATAROTH ADDAR (ʿÂtrôṭ-Addâr ; Septante : Ἀταρώθ καὶ Ἐρώκ, Jos., xvi, 5 ; Μααταρώβ Ὀρέχ Jos., xviii, 13), ville située sur la frontière des deux tribus d’Éphraïm et de Benjamin. Jos., xvi, 5 ; xviii, 13. La leçon des Septante, outre les fautes de copistes glissées dans le texte grec, suppose une lecture primitive différente : pour la dernière partie du mot, les traducteurs ont lu ארך, avec resch et caph final, au lieu de אףך. Nous sommes ici encore en présence de difficultés presque insolubles. Le premier passage où il est question de cette ville, Jos., xvi, 5, n’est qu’un résumé des versets précédents, dans lesquels est décrite la limite méridionale d’Éphraïm et de Manassé. Voir Ataroth 2. Arrivant au tracé spécial des frontières d’Éphraïm, l’auteur sacré reprend la ligne du sud d’une façon générale, de l’orient à l’occident, en ne signalant que deux points principaux : « La frontière des enfants d’Éphraïm selon leurs familles et la frontière de leurs possessions est, à l’orient, Ataroth Addar jusqu’à Béthoron supérieure, et ses confins se terminent à la mer. » La mention de Béthoron supérieure au lieu de Béthoron inférieure ne change rien, car les deux villes si rapprochées se confondent dans l’étendue du plan. Ce qui semble résulter de ce texte, c’est qu’Ataroth Addar est identique à l’Ataroth du v. 2. Cependant que signifie l’expression « à l’orient » ? Ataroth, par sa position même entre Béthel et Béthoron, appartient au midi plutôt qu’à l’est de la tribu. N’y a-t-il point quelque lacune dans ce passage ? Nous trouvons le même nom dans un autre endroit de l’Écriture, Jos., xviii, 13. Il s’agit ici de la frontière nord de Benjamin, qui devait évidemment se confondre avec la frontière sud d’Éphraïm ; aussi le texte est-il à peu près le même que Jos., xvi, 1-3. « Et leur limite est, vers le nord, depuis le Jourdain, et elle monte au côté septentrional de Jéricho, et elle monte vers l’occident sur la montagne, puis vient jusqu’au désert de Bethaven. Elle passe de là près de Luza, la même que Béthel, vers le midi, et elle descend à Ataroth Addar, sur la montagne qui est au midi de Béthoron inférieure. » Jos., xviii, 12-13. Voir la carte de Benjamin. Ataroth Addar, placée ici au-dessous de Béthel, « en descendant, » semblerait devoir s’identifier avec Y’Atâra, située entre Er-Ràm et El-Biréh ; mais la suite du texte, précisant sa position, nous reporte plus loin, au sud de Béthofon inférieure. Aucun nom correspondant au premier élément du mot composé ne se rencontre dans cette région, mais au bas et au sud-ouest de la colline que domine Beit-’Our-et-Tahta (Béthoron inférieure), une localité, Khirbet ed-Dàriéh, semble rappeler le second, Addar. Cf. G. Armstrong, W. Wilson et Conder, Names and places in the Old and New Testament, Londres, 1889, p. 19, et la grande carte, Londres, 1890, feuille 14. Nous ne savons, en somme, s’il y a dans ces deux noms deux villes distinctes. Néanmoins la ligne générale où il faut chercher ces Ataroth est assez bien définie.
5. ATAROTH, ville frontière de la tribu d’Éphraïm, vers l’est, Jos., xvi, 7. Les limites, de ce côté, sont ainsi décrites : « Machméthath au nord, et la frontière contourne à l’orient vers Thanathsélo, et passe de l’orient jusqu’à Janoé ; et elle descend de Janoé à Ataroth et à Naaratha, et parvient à Jéricho et se termine au Jourdain. » Jos., XVI, 6-7. Sur ces noms, deux, en dehors de Jéricho, sont identifiés d’une façon presque certaine : Thanathsélo, aujourd’hui Tâna, à l’est de Naplouse, cf. G. Armstrong, V. Wilson et Conder, Names and places in the Old and New Testament, Londres, 1889, p. 171 ; et Janoé, Khirbet Yanoun, un peu plus bas, cf. V. Guérin, Description de la Palestine, Samarie, t. ii, p. 6. Naaratha, suivant les auteurs anglais, Names and places, p. 133, se retrouve à Khirbet el-Aûdjéh et-Tahtâni, au nord de Jéricho ; ou, un peu plus au nord-ouest, à Khirbet Samiéh, suivant V. Guérin, Samarie, t. i, p. 212. C’est donc entre l’un de ces deux derniers points et Yanoun qu’il faudrait chercher Ataroth. Conder, Handbook to the Bible, in-8°, Londres, 1887, p. 264, propose Tell et-Trûny, à l’ouest de Khirbet el-Aûjéh et-Tahtâni, au pied des collines qui dominent la vallée du Jourdain. C’est une pure hypothèse. On trouve bien, du côté de la frontière nord d’Éphraïm, un village appelé ’Atâra. Il répond certainement à l’Ataroth signalée par Eusèbe, dans l’Onomasticon, Gœttingue, 1870, p. 221, comme étant à quatre milles (environ six kilomètres) de Sébaste (Samarie). Saint Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxiii, col. 871, ajoute que cette bourgade était située au nord de la même ville. Or c’est exactement la position qu’occupe ’Atâra, à la différence d’un mille en plus. Cf. V. Guérin, Samarie, t. ii, p. 214-215. Mais cet emplacement ne rentre pas dans la ligne de la frontière orientale, telle qu’elle est tracée par l’Écriture Sainte. Voir Éphraïm, tribu et carte.
6. ATAROTH (hébreu : ’Atrôt-bê(-Yô’àb ; Septante : Ἀθαρώθ οἴϰου Ἰωάϐ ; Vulgate : Corona domus Joab, « Couronne de la maison de Jacob, » nom qui, dans les listes généalogiques de la maison de Juda, I Par., ii, 54, indique probablement une localité, comme les mots précédents, Bethléhem et Nétopha. Elle est inconnue.
ATHACH, terme cabalistique. Voir Athbasch.
ATER, ATHER, hébreu : Atêr, « lié, muet ; » Septante : Ἀττηρ. Nom de trois Israélites.
1. ATER, chef de famille descendant d’Ézéchias ou Hézécia. Ses fils revinrent de la captivité au nombre de quatre-vingt-dix-huit. I Esdr., ii, 16 (Ather) ; II Esdr., vu, 21 ; x, 17.
2. ATER, chef de famille dont les fils, revenus de l’exil avec Zorobabel, furent portiers du temple. I Esdr., ii, 42 ; II Esdr., vil, 46.
3. ATER, un des chefs du peuple qui signèrent avec Néhémie le renouvellement de l’alliance. II Esdr., x, 17. C’est peut-être le représentant de la famille d’Ater 1.
ATERGATIS, ATERGATÉION. Voir Atargatis.
ATHA, mot syriaque qui veut dire « vient », employé par saint Paul, en parlant de Notre-Seigneur (Maran), I Cor., xvi, 22. Voir Maranatha.
1. ATHACH (hébreu : Hatak ; Septante : Ἀχραταῖος), un des eunuques de la cour d’Assuérus, au service d’Esther. La reine l’envoya à Mardochée pour lui demander la cause de son affliction. Esth., iv, 5, 6, 9, 10.
2. ATHACH (hébreu : ’Âfâk ; omis par les Septante), une des villes auxquelles David, revenu à Siceleg après sa victoire sur les Amalécites, envoya des présents. I Reg., xxx, 30. Elle n’est citée qu’en ce seul endroit de l’Écriture et est complètement inconnue. Comme elle est précédée d’Asan, ville de la tribu de Juda, et qu’Asan est généralement accompagnée d’Éther ou Athar (hébreu : ’Étér), Jos., xv, 42 ; xix, 7, on suppose, peut-être avec raison, qu’il y a eu changement dans la dernière lettre, et qu’au lieu de צחף, ’Atâk, il faut lire צחר, ’Étér ou’Afar. Les Septante cependant ont traduit une fois ’Efér par Ἰθάϰ, Jos., xv, 42, et dans I Par., iv, 32, on trouve avant Asan חכץ, Tôkén, Septante ; θoϰϰά, qui se rapproche de ’Afâk. On peut donc hésiter entre les deux formes. Quelques auteurs regardent comme plus probable la forme ’Étér ou ’Atar. Voir Éther.
ATHAIAS (hébreu : ʿǍṭâyâh ; Septante : Ἀθαῒα), fils d’Aziam, de la tribu de. Juda, demeura à Jérusalem après le retour de la captivité. II Esdr., xi, 4.
ATHALAI (hébreu : ‘Aṭlaï, abréviation de ‘Ǎṭalyâh, « Jéhovah est [ma] force ; » Septante : θαλί) ; un des fils de Bebaï, qui renvoya une femme étrangère qu’il avait épousée dans l’exil. I Esdr., x, 28.
ATHALIA (hébreu : ‘Ǎṭalyâh ; Septante : Ἀθελια), un des descendants d’Élam ou Alam, dont le fils Isaïe revint de Babylone avec Esdras, à la tête de soixante-dix hommes de sa famille. I Esdr., viii, 7.
ATHALIE (hébreu : ‘Ǎṭalyâh, « Jéhovah est [ma] force ; » ailleurs : ‘Ǎṭalyâhû, IV Reg., viii, 26 ; XI, 2 ; Septante : Γοθολία), fille d’Achab, roi d’Israël, appelée aussi « fille », IV Reg., viii, 26 ; II Par., xxii, 2, mais en réalité petite-fille d’Amri, épouse de Joram, roi de Juda. IV Reg., viii, 18 ; II Par., xxi, 6. Elle était par sa mère Jézabel petite-fille d’Ethbaal, III Reg., xvi, 31, probablement le même dont parle Josèphe, Contra Apionem, I, xviii, d’après l’historien Ménandre, et qui avait été grand prêtre d’Astarthé et de Baal avant qu’il devînt par usurpation roi de Tyr et de Sidon. Josèphe, Ant. jud., VIII, vii. Fidèle à son éducation, qui l’avait formée à marcher « dans les voies des rois d’Israël », c’est-à-dire dans l’idolâtrie, elle exerça la plus pernicieuse influence sur son époux et sur son fils Ochozias, II Par., xxii, 3, après qu’il eut succédé à Joram sur le trône de Juda, et mérita l’épithète que lui donne le Saint-Esprit : « la très impie Athalie. » II Par., xxiv, 7. Ochozias ayant péri de mort violente après un an de règne, IV Reg., viii, 24-26 ; II Par., xxii, 1, 9, Athalie voulut régner après lui, et, cruelle autant qu’elle était ambitieuse, elle ne recula devant aucun forfait pour s’emparer du trône, jusqu’à faire mettre à mort tous ceux qui, après les sauvages exécutions de Jéhu, IV Reg., x, 12-14 ; II Par., xxii, 7-8, et des Arabes, II Par., xxi, 17, pouvaient par leur origine prétendre à la succession d’Ochozias. IV Reg., xi, 1 ; II Par., xxii, 10. Elle put ainsi régner en paix. Mais cette paix fut plus funeste à Juda que la guerre la plus sanglante, car le règne d’Athalie ne fut qu’une série d’actes criminels : emploi sacrilège des matériaux du temple et des objets du culte au service de Baal, profanations et dévastations du sanctuaire, IV Reg., xii, 5-12 ; II Par., xxiv, 7, qui attirèrent la malédiction de Dieu sur le royaume.
Se croyant sans rival, Athalie abusait depuis six ans, IV Reg., xi, 3 ; II Par., xxii, 12 (883-877), de son pouvoir usurpé, offensant à la fois Dieu et ses sujets, IV Reg., xi, 18, 20 ; II Par., xxiii, 21, lorsqu’un jour son repos fut troublé par les cris de : « Vive le roi ! » IV Reg., xi, 12-13 ; II Par., xxiii, 11, que de son palais elle entendait retentir du côté du temple. Ce roi était Joas, l’un des plus jeunes fils d’Ochozias, et âgé d’un an seulement lors du massacre de ses frères. Il avait été arraché à la mort comme par miracle et élevé secrètement dans le temple sous les yeux du grand prêtre. C’était lui que Joïada, après avoir pris les mesures les plus sages, II Par., xxiii, 1-11, secondé par des chefs et des soldats fidèles (peut-être pourrait-on entendre ces expressions de prêtres et de lévites armés), produisait au grand jour, le diadème en tête, devant le peuple enthousiasmé, après lui avoir conféré l’onction royale. IV Reg., xi, 4-14 ; II Par., xxiii, 1-11. Voir Joas. Telle était, sous le gouvernement antithéocratique d’Athalie, l’influence de l’ordre sacerdotal, qu’il était en état d’organiser une révolution avec l’appui de l’armée et du peuple, et de renverser le pouvoir ; et en agissant de la sorte il ne pensait pas sortir de ses attributions, tant la cause de Jéhovah était liée au changement de politique dans l’État.
Athalie, habituée à voir tout plier devant elle, crut ou que c’était un jeu, ou que sa seule présence suffirait à tout faire rentrer dans l’ordre. Elle se rendit en toute hâte de son palais, situé au sud du temple, au temple même, accompagnée, selon Josèphe, de ses gardes du corps, Ant. jud., IX, vii, qui durent, sur l’ordre du grand prêtre, rester en dehors de la cour. Entrant seule sous le portique, Athalie fut stupéfaite en voyant assis sur l’estrade qu’on élevait ordinairement pour présenter au peuple le roi après son sacre, IV Reg., xi, 14 ; II Par., xxiii, 13 ; cf. IV Reg., xxiii, 3 ; II Par., xxiv, 31, un enfant de sept ans, entouré des šârîm ou chefs soit des soldats, soit des familles, et recevant les acclamations de la foule, tandis que les ḥaṣôsrôṭ ou trompettes sacrées faisaient retentir les airs de joyeuses fanfares. IV Reg., xi, 14 ; II Par., xxiii, 13 ; cf. I Par., xiii, 8 ; xv, 24. Ce spectacle lui révéla la vérité, et, selon Josèphe, elle aurait d’abord ordonné de mettre à mort le jeune roi, Ant. jud., IX, vii ; mais bientôt, passant de l’arrogance au désespoir, elle déchira ses vêtements et cria au secours. L’heure de la justice était arrivée : sur l’ordre de Jôïada, on l’emmena entre deux rangs de soldats hors de l’enceinte du temple, pour que ce sol sacré ne fût pas souillé par son sang, et la foule, s’écartant pour lui livrer passage, vit sans pitié passer la superbe Athalie conduite au supplice. On l’entraîna dans le chemin qui conduisait aux écuries royales, près de son palais, IV Reg., xi, 15-16 ; II Par., xxiii, 14-15 ; à la porte des chevaux du roi, qui est au sud-est de Jérusalem, Ant. jud., IX, vii ; cf. II Esdr., iii, 28, et là elle périt par l’épée, sans qu’aucune tentative en sa faveur ait été faite soit par le peuple, qui la détestait, IV Reg., XI, 20 ; II Par., xxiii, 21, soit par ceux qui avaient intérêt à sa conservation.
ATHANAI (hébreu : ’Éṭnî, « libéral ; » Septante : Ἀθανι), lévite de la famille de Gerson, ancêtre d’Asaph. Il chantait devant l’arche du Seigneur. I Par., vi, 41 (hébreu, 26).
1. ATHANASE (Saint), docteur de l’Église, né vers 296 à Alexandrie, diacre dès avant 319, évêque d’Alexandrie en 328, mort dans cette ville en 373. Au rapport de saint Grégoire de Nazianze, son panégyriste, il avait été instruit dès son enfance dans les sciences divines, et s’était appliqué à une profonde étude de l’Ancien et du Nouveau Testament, « dont il possédait, dit-il, tous les livres avec plus de perfection que les autres n’en savent un seul en particulier. » Orat. xxi, 6, t. xxxv, col. 1088. Voir les belles paroles qu’il dit de l’Écriture Sainte, à la fin de son traité De l’Incarnation, t. xxv, col. 393-196. Il prit part comme diacre de son évêque au concile de Nicée (325) et à la définition de la consubstantialité. Évêque, sa vie entière fut consacrée à la défendre contre le rationalisme hellénique, que représente l’arianisme. Déposé par le concile arien de Tyr (335), cinq fois exilé, il défendit toujours la vraie doctrine, et s’opposa soit sur son siège, soit en exil, à la sécularisation de l’Église par le parti arien. Par là il a mérité le nom de jurisconsulte, que lui donne Sulpice Sévère, et plus encore de père de la foi orthodoxe, que lui donne saint Épiphane.
De ses œuvres exégétiques, il ne nous reste que divers fragments de commentaires, soit de Job, soit du Cantique des cantiques, soit de saint Matthieu et de saint Lue, soit de saint Paul. Ces fragments se trouvent dans les Chaînes. Montfaucon les a réunis dans son édition des œuvres complètes d’Athanase, reproduite par Migne, Patr. gr., t. xxvii, col. 1344-1408. Leur attribution à saint Athanase ne repose que sur l’autorité des compilateurs des dites Chaînes. Le fragment sur le Cantique des cantiques est d’un auteur qui a visité Jérusalem et les Saints Lieux (col. 1353) : or aucun texte ne nous apprend d’ailleurs que saint Athanase ait jamais fait ce pèlerinage. Le fragment de commentaire de saint Matthieu, développement du texte : Quicumque dixerit verbum contra Filium hominis, Matth., xii, 32, est important par la mention qui y est faite de Novatien, d’Origène, de Photin, mais, par les formules théologiques dont il se sert, il paraît être contemporain du concile de Chalcédoine ou des querelles origénistes du commencement du ve siècle (col. 1381-1385).
Parmi les œuvres apocryphes de saint Athanase figure une Synopsis Scripturæ Sacræ, Patr. gr., t. xxviii, col. 283-437, donnant la liste, l’incipit et l’analyse sommaire des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, et, à la fin, une liste des livres non canoniques. Au jugement de MM. Zahn et James, cette Synopsis aurait été composée aux environs de l’an 500. Elle a été publiée par Montfaucon, d’après un manuscrit unique aujourd’hui disparu, mais dont on a récemment signalé une répétition du xive-xve siècle. Voir Robinson, Texts and Studies, t. II, no 2, p. 7, Cambridge, 1892 ; Zahn, Geschichte des neutestam. Kanons, Leipzig, 1890, t. ii, p. 290-318. — On signale un Athanasii Commentarius in Psalmos, inédit, dont le texte grec existe à Venise et à Milan, et une version slave, à Bologne. Montfaucon, qui avait étudié ce commentaire, le tient pour postérieur au patriarche de Constantinople Germain (✝ 733), qui s’y trouve cité. Voir Patr. gr., t. xxvii, col. 602 et 606. — Plus importante est l’Interpretatio Psalmorum, publiée sous le nom de saint Athanase par Antonelli, Rome, 1747, reproduite par Migne, Patr. gr., t. xxvii, col. 649-1344. C’est un psautier grec, dont chaque psaume est divisé en stiques, excellente méthode pour dégager le parallélisme de la composition ; chaque stique est accompagné d’une courte glose qui en marque le sens allégorique, chaque titre, expliqué selon le même système d’allégories. Nous ne voyons pas que ce commentaire ait d’attestation plus ancienne que le manuscrit qui nous l’a conservé et qui est du IXe siècle (897), le Vaticanus palatinus gr., 44. L’auteur y marque une estime éminente de la vie monastique au désert (col. 1250), le dédain de la science humaine (col. 1054, 1287), son éloignement pour toute dignité ecclésiastique (col. 1247), et la conviction plusieurs fois répétée que le monde, créé en six jours, ne durera que six mille ans (col. 686, 794, 1010). Ce commentaire est vraisemblablement de quelque moine égyptien ou sinaïtique du Ve siècle. — Montfaucon a publié le texte grec d’une Expositio in Psalmos, t. xxvii, col. 55-546, attribuée à saint Athanase par les manuscrits et par la Chronique pascale, au VIIe siècle, Patr. gr., t. XCII, col. 544. Comme la précédente, c’est une édition glosée du Psautier ; mais, plus développée, elle est aussi plus grave et plus relevée. L’auteur entend les Psaumes comme des prophéties concernant le Christ et l’Église, et il applique ce principe d’interprétation historique à tout le Psautier. Contrairement à l’auteur de l’Interpretatio publiée par Antonelli, il s’applique à ne jamais prononcer le nom des hérétiques, et il évite les interprétations théologiques proprement dites : ce qui est surtout sensible dans le commentaire du psaume Dixit Dominus, où, ayant à parler de la « génération du Seigneur », il l’entend de la « génération selon la chair », et détourne le verset Ante luciferum genui te de son interprétation commune. Voir t. xxvii, col. 462 et col. 1146. Il a utilisé Origène et Eusèbe (cf. col. 54), ce dernier notamment. Enfin il a travaillé, le texte des Hexaples sous les yeux (cf. col. 71 et 470). Ce sont là autant de raisons de douter que ce commentaire soit d’Athanase. — On possède enfin un court et élégant traité intitulé Epistula ad Marcellinum in interpretationem Psalmorum, t. xxvii, col. 11-46. Cet opuscule figure déjà dans le Codex Alexandrinus de la Bible grecque (ve siècle), sous le nom d’Athanase, et Cassiodore le connaissait également et le donne comme d’Athanase. De institut. divin. litt., l, t. lxx, col. 1115. Ce petit livre, adressé à un solitaire nommé Marcellin, est un éloge du Psautier, éloge mis dans la bouche d’un saint vieillard dont on ne dit pas le nom. Il groupe les Psaumes par affinités aux divers sentiments de l’âme chrétienne (pénitence, compassion, action de grâce, confiance, etc.), et il les partage entre les divers jours de la semaine et les diverses circonstances de la vie. Quelques critiques identifient ce traité avec le De titulis Psalmorum, œuvre de saint Athanase que connaissait saint Jérôme, De vir. ill., 87, t. xxiii, col. 731. — Voir Möhler, Athanasius der Grosse, in-8o, Mayence, 1827 ; traduct. française, 2 in-8o, Bruxelles, 1841 ; E. Fialon, Saint Athanase, in-8o, Paris, 1877.
2. ATHANASE le Jeune, surnommé Celetes (κηλήτης) ou Herniosus, évêque d’Alexandrie, vers 490, mort vers 497. Sa foi était suspecte ; il adopta l’hénotique de l’empereur Zénon, et, d’après plusieurs auteurs anciens, il mourut même dans l’hérésie. Liberatus, Breviarium, 18, Patr. lat., t. lxviii, col. 1029. Euthalius, qui lui a dédié plusieurs de ses commentaires sur le Nouveau Testament, dit qu’il avait un goût particulier pour les Livres Saints, et qu’il les méditait jour et nuit. Edit. Act., Prol., Patr. gr., t. lxxxv, col. 627. Certains critiques lui attribuent la Synopsis Scripturæ Sacræ, travail remarquable par la clarté et l’érudition, qui correspond à ce qu’on appelle aujourd’hui l’Introduction à l’Écriture Sainte. (Dans les Œuvres de saint Athanase le Grand, t. xxviii, col. 283-438.) Quelques-uns pensent aussi qu’il est l’auteur des Quæstiones ad Antiochum Patr. gr., t. xxviii, col. 597-710.
1. ATHAR (hébreu : ‘Éṭér ; Septante : Ἰεθέρ), ville de la tribu de Siméon. Jos., xix, 7. Elle fut, comme les autres, détachée de la tribu de Juda. Elle est appelée Éther dans Josué, xv, 42. Voir Éther.
2. athar (Chayim ibn ‘Athar), né à Sala, dans le Maroc, se retira à Jérusalem en 1742 ; il y mourut l’année suivante. On a de lui un commentaire sur le Pentateuque, ’Ôr haḥayyîm, « Lumière de vie » (Ps. lvi, 14), in-4o, Venise, 17·· (sic) ; on compte quatre autres éditions, la dernière in-4o, Lemberg, 18·· (sic).
ATHAROTH ADDAR, voir Ataroth 4, col. 1204.
ATHBASCH (אַתְבַּשׁ, ’aṭbaš), terme cabalistique, composé artificiellement pour indiquer le procédé d’après lequel la première lettre de l’alphabet hébreu, א, aleph, est remplacée dans l’écriture par la dernière, ת, thav ; la seconde, ב, beth, par l’avant-dernière, ש, schin, et ainsi de suite. L’usage de cette écriture cryptographique est très ancien. Saint Jérôme, In Jer., l. v, t. xxiv, col. 838-839, en parle (sans lui donner toutefois son nom cabalistique), et croit même qu’elle est employée par Jérémie, xxv, 26. Dans ce passage, le prophète dit que « le roi de Sésach » (hébreu : שֵשַׁךְ, šêšak) boira, à la suite des rois voisins de la Palestine, à la coupe de la colère de Dieu. D’après les règles de l’athbasch, Šêšak doit se lire בבל, Babel ou Babylone. Cette explication se trouve aussi dans le Targum, et elle devait avoir été donnée à saint Jérôme par ses maîtres juifs. Mais il est au moins fort douteux que l’athbasch fût déjà usité du temps de Jérémie et qu’il en ait fait usage. Le traducteur de la Vulgate suppose que le prophète a dissimulé « prudemment », par cet anagramme, le nom de Babylone, « pour ne pas exciter contre lui la fureur des Chaldéens, qui assiégeaient Jérusalem et étaient sur le point de s’en emparer, » In Jer., t. xxiv, col. 839 ; mais cette raison, peu concluante pour le passage de Jérémie, xxv, 26, où le contexte indique assez clairement Babylone, est tout à fait inapplicable à un autre endroit, Jer., li, 41, où Šêšak est mis en parallélisme, comme synonyme, avec Babylone, qui est expressément nommée. Il est certain d’ailleurs que « le roi de Sésach » est le roi de Babylone. Cf. Proceedings of the Society of Biblical Archæology, mai 1884, t. vi, p. 194, 195. Quant à la signification réelle de ce mot, voir Sésach.
Le Targum (ainsi que les Septante, qui ont omis les passages sur Sésach, Jer., xxv, 26, et li, 41) a vu une autre application de l’athbasch dans Jérémie, li, 1 : « J’exciterai contre Babylone et contre les habitants לב קמי, lêb qamaï, dit Dieu par son prophète, un vent qui les perdra. » Lêb qamaï signifie « le cœur de ceux qui se soulèvent contre moi », et saint Jérôme a bien traduit ici dans notre Vulgate : « les habitants de Babylone, qui ont élevé leur cœur contre moi ; » mais comme la tournure est un peu irrégulière, les anciens Juifs y ont vu une désignation cachée des Chaldéens, dont il est en effet question, et ils y ont trouvé le mot hébreu Kašdîm, « Chaldéens, » en remplaçant le lamed par caph, le beth par sin, le qoph par daleth, le mem par yod et le yod par mem, conformément aux règles de l’athbasch. Le résultat obtenu est certainement singulier, mais il ne prouve nullement qu’il ait été prévu par Jérémie, dont le texte s’explique en réalité facilement sans recourir à ce procédé aussi arbitraire que bizarre. Sur l’athbasch, voir J. Buxtorf, De abbreviaturis hebraicis, in-12, Bâle, 1613, p. 37-38 ; Id., Lexicon chaldaieum et talmudicum, édit. Fischer, t. I, p. 131, 137-138 ; Gesenius, Thesaurus linguæ hebrææ, p. 1486.
Les cabbalistes emploient aussi, pour expliquer l’Écriture, un autre procédé analogue, mais plus compliqué, l’atbach (אַטְבַּח, ’aṭbaḥ), qui consiste, comme le nom l’indique, à substituer à l’aleph, א, le teth, ט ; au beth, ב, le cheth, ח, etc. L’alphabet hébreu est divisé en trois séries, comprenant chacune quatre groupes de lettres ; chacune des lettres de chaque paire se met à la place l’une de l’autre ; les groupes de la première série font chacun dix, d’après leur valeur numérique ordinaire ; ceux de la seconde, cent, et ceux de la troisième, mille : 1o אט, בח, גז, דו= 10 ; 2o יצ, כפ, לע, מם= 100 ; 3o קץ, רף, שן, תם= 1000. On voit que des cinq lettres qui ont une forme particulière comme finales, quatre, le mem, le nun, le phé et le tsadé, entrent dans ce tableau ; le caph final, le nun dans sa forme ordinaire et le hé n’y figurent pas, parce qu’il n’y a point de lettre autre qu’elles-mêmes avec laquelle ils puissent se combiner pour former les nombres dix, cent ou mille, הה doublés équivalant, en effet, à dix ; ננ à cent, et ךְךְ à mille. Ces trois groupes, ne pouvant fournir aucun échange, sont supprimés. On suppose cependant le groupe נה existant, et l’on met ces deux lettres à la place l’une de l’autre, de sorte que le ךְ final reste seul solitaire et « veuf ». Voici un exemple de l’application de l’atbach. Le mot מָנוֹן ne se lit qu’une fois dans l’Écriture, Prov., xxix, 21, et le sens en est assez difficile à déterminer avec précision. Pour l’expliquer, les Talmudistes, tr. Succa, ꝟ. 52 b, ont eu recours à l’atbach et, au moyen des règles ci-dessus exposées, ils le transforment en סָהֲדָה, sâhădâh, « témoignage, » cf. Gen. xxxi, 47 ; de sorte que le sens de la maxime est : « Celui qui nourrit délicatement son esclave, la fin sera un témoignage, » c’est à dire lui montrera qu’une éducation molle ou une conduite faible rend l’esclave revêche. Le mem est changé en samech, d’après la combinaison מם ; nun en hé, d’après la combinaison supplémentaire הנ ; vav en daleth, d’après la combinaison דו, et nun de nouveau en hé, comme pour la seconde lettre. Voir J. Buxtorf, De abbreviaturis hebraicis, p. 24-26 ; Id., Lexicon chaldaicum, édit. Fischer, t. i, p. 36, 135.
Quelques rabbins ont fait aussi usage, dans l’interprétation de la Bible, d’une autre sorte d’anagramme, non moins arbitraire, appelé albam (אלבם), parce qu’on met le lamed à la place de l’aleph, le mem à la place du beth, et ainsi de suite, vice versa, en suivant l’ordre de l’alphabet hébreu. Cf. J. Buxtorf, De abbreviaturis, p. 27-28 ; Id., Lexicon chaldaicum, p. 136.ATHÉNÉE (Ἀθηναῖος). C’est, d’après quelques commentateurs, le nom d’un vieillard, conseiller ou officier d’Antiochus IV Épiphane, qui l’envoya à Jérusalem pour obliger les Juifs à abandonner leur religion et à embrasser les rites du paganisme. II Mach., vi, 1 (texte grec). La Vulgate lit Antiochenum, « d’Antioche », au lieu d’Ἀθηναῖος, et la leçon de la Vulgate est adoptée par un certain nombre de critiques. Voir Grotius, Opera, 1679, p. 771. Mais rien n’empêche de conserver la leçon du texte original, qui est confirmée par tous les manuscrits grecs, par la version syriaque, par Théodoret, In Dan., xi, 31, t. lxxxi, col. 1521 ; par le Syncelle, Chronogr., édit. Dindorf, t. i, p. 531, etc. Parmi ceux qui adoptent la lecture du texte grec, la plupart entendent le mot Ἀθηναῖος dans le sens d’originaire d’Athènes, mais quelques-uns croient que le vieillard à qui le roi de Syrie confia la mission de détruire le judaïsme en Palestine s’appelait Athénée. Il est certain que ce nom était fréquemment employé comme nom propre chez les Grecs. Voir W. Pape, qui en énumère quatorze dans son Wörterbuch der griechischen Eigennamen, 3e édit., 2 in-8o, Brunswick, 1863-1870, p. 24. Diodore de Sicile, xxxiv, 17, 2, édit. Didot, t. ii, p. 543, mentionne un Athénée à la cour d’Antiochus VII Sidètes. Mais il est à croire que si l’auteur sacré avait voulu désigner le vieillard par son nom, il se serait exprimé autrement, et qu’au lieu de dire : γέροντα Ἀθηναῖος, il aurait dit par exemple : γέροντα τινα, Ἀθηναῖον ὀνόματι, pour éviter l’équivoque. L’histoire arabe des Machabées nomme ce vieillard Philkos, فيلقوس. II Mach. arab., 3, dans la Polyglotte de Walton, t. iv, p. 114. Josippon ben Gorion le confond sans raison avec le Philippe dont il est question II Mach., v, 22. Josephus Gorionides sive Josephus hebraicus, édit. Breithaupt, iii, 4, in-4o, Gotha, 1707, p. 179. Il n’y a rien d’étonnant d’ailleurs qu’Antiochus IV eût â sa cour un Athénien. Ce roi avait une grande affection pour Athènes (voir Antiochus IV, col. 694), et un officier originaire de cette ville avait pu lui sembler particulièrement propre à implanter le paganisme à Jérusalem.
ATHÈNES (Ἀθῆναι), primitivement Cécropia, du nom de son fondateur Cécrops, et Athènes depuis Érecthé, qui la voua au culte d’Athénè (Minerve), fut la capitale de l’Attique et la ville la plus célèbre de la Grèce (fig. 346).

On ne peut redire ici son histoire et le rôle incomparable qu’elle a joué dans le développement de la civilisation antique, en philosophie, en littérature, dans les sciences et dans les arts. Elle ne se rapproche du cadre des études bibliques que parce que saint Paul, à la suite de son premier voyage en Macédoine, y prêcha et y séjourna quelque temps. Act., xvii, 15-34 ; I Thessal., iii, 1. À ce point de vue, il peut paraître intéressant de savoir ce qu’était alors cette grande cité, dont la vue excita chez lui un saint frémissement de compassion, par les cultes idolâtriques auxquels elle se livrait. Pétrone a dit très malicieusement, mais avec raison, qu’il était plus aisé d’y trouver des dieux que des hommes.
Après les désastres mal réparés de la guerre du Péloponèse, Athènes était passée de la domination macédonienne sous le joug des Romains. Plus récemment, Sylla l’avait saccagée. Il n’était pas jusqu’au courant de vie intellectuelle, seul reste de ses anciennes gloires, que des rivales comme Alexandrie et Tarse ne lui eussent ravi. Sa décadence était d’autant plus navrante, que la plupart de ses superbes monuments, toujours debout, rappelaient au visiteur son incomparable passé. Pausanias, qui la visita près d’un siècle après Paul, nous en a laissé une longue, mais malheureusement assez confuse description.
Des trois ports, Phalères, Munychie et le Pirée, par lesquels Athènes aboutissait à la mer, le Pirée était resté à peu près le seul fréquenté des marins. Les Longs Murs terminés par Périclès, détruits par les Lacédémoniens, et relevés par Conon après la victoire de Cnide, étaient définitivement tombés en ruines, obstruant l’ancienne route qu’ils devaient protéger, et une nouvelle voie (Hamaxitos), qui les longeait au nord, était devenue le chemin ordinaire par lequel les hommes et les marchandises débarqués au Pirée arrivaient à la ville. C’est sur cette route qu’à côté de cippes funéraires, de statues de héros ou de dieux et de monuments de toute sorte, se trouvaient aux promeneurs l’ail, les oignons, l’encens, les épices, les herbes fraîches, dont on était très friand, en même temps que des articles de toilette et le produit des industries les plus diverses. Une série de portiques, avoisinant l’Agora et ornés des chefs-d’œuvre de la statuaire et de la peinture antiques, servaient d’asile aux oisifs et conservaient encore leurs destinations d’autrefois. Au portique Royal on rendait la justice ; à celui des Douze-Dieux, les Athéniens, si curieux de nouvelles, venaient faire ou écouter la chronique du jour ; au Pécile, les successeurs de Zénon enseignaient toujours, mais sans éclat, cette philosophie stoïcienne qui, médiocrement appréciée des Athéniens amollis, était pourtant la consolation des âmes fortes chez les Romains, et, par quelques côtés, demeurait l’honneur

318. — Le Parthénon.
de loin en loin, si nous en croyons les anciens (Pausanias, I, I, 4 ; Philostrate, Vit. Apollon., VI, 2), des autels dédiés au Dieu inconnu : ΑΓΝΟΣΤΩ ΘΕΩ. Ces autels attirèrent l’attention de l’Apôtre. Il sentit aussitôt, et très douloureusement, tout ce qu’il y avait d’effréné dans cette idolâtrie qui, ayant épuisé le répertoire des dieux connus, dressait d’avance des autels à ceux que l’on inventerait encore. On sait l’heureux parti qu’il tira de cette inscription pour entrer en matière devant l’Aréopage. Act., xvii, 23.
Ayant abordé la ville par la porte Sacrée, près du Dipylon, dont les ruines ont été retrouvées récemment entre la gare du chemin de fer et l’église de la Sainte-Trinité, il dut suivre la grande rue du Céramique, ornée de statues de bronze et de marbre, pour atteindre l’Agora, qu’il faut chercher au nord-ouest et non au sud-ouest de l’Acropole. Sur cette place publique où Périclès, Socrate, Alcibiade, Démosthène, étaient remplacés par des Athéniens sans élévation dans la pensée et sans ardeur dans le patriotisme, à l’ombre des platanes ou sous des tentes provisoires, des marchands, classés par groupes, offraient de l’humanité livrée à ses seules forces. De ce centre de la vie publique, autour duquel se groupaient les temples d’Apollon Patroüs et de la Mère des dieux, quelques édifices destinés aux magistrats de la cité, le Bouleutérion pour les réunions du sénat, le Tholus, où les prytanes prenaient leurs repas, et des écoles publiques pour la jeunesse, telles que le portique d’Attale, dont on a récemment retrouvé les ruines, partaient deux rues principales, contournant en sens inverse l’Acropole et passant devant les nombreux monuments édifiés à ses pieds. L’une côtoyait la colline de l’Aréopage. C’est peut-être celle qui était bordée de ces hermès de marbre, sorte de gaines à tête de Mercure, que l’on avait ornés d’inscriptions choisies, aphorismes pour la plupart empruntés à la sagesse antique, et propres à exciter les passants à la vertu. À cette artère principale se soudaient d’autres rues conduisant aux collines des Nymphes, du Pnyx et des Muses, quartiers où les maisons des petits bourgeois étaient, comme on peut en juger par les arasements qu’on y voit encore, échelonnées les unes à côté des autres, dans des propor- tions si mesquines, qu’aucune d’elles ne suffirait aujourd’hui au plus modeste de nos artisans. Mais l’Athénien n’était jamais chez lui, et c’est à l’Agora, chez les marchands devin, dans les temples, chez le barbier, sous les portiques, dans les jardins publics, au théâtre, qu’il fallait aller le chercher. L’autre voie s’appelait la rue des Trépieds. Elle partait de cette tour d’Andronicus qui subsiste encore, et à l’horloge de laquelle Paul, trois cent cinquante ans après Socrate, regarda peut-être plus d’une fois l’heure des jours que son zèle impuissant trouvait bien longs. C’est là que les chefs d’orchestre, vainqueurs au concours du théâtre, aimaient à dresser, sur des monuments du goût le plus exquis, les trépieds qu’ils avaient obtenus en témoignage de leur talent. Celui de Lysicrate subsiste encore. La grande rue tournait au midi pour atteindre ce fameux théâtre de Bacchus où Eschyle, Sophocle, Aristophane, Ménandre, Euripide, avaient fait représenter leurs chefs-d’œuvre. Elle rejoignait de là la rue des Hermès, à une sorte de rond-point d’où l’on montait à l’Acropole. Voir le plan d’Athènes, fig. 347.
M. Beulé a retrouvé dans un mur de marbre blanc la porte dorique, défendue à droite et à gauche par une tour carrée, qui fut la véritable entrée de l’Acropole. Elle était dans l’axe même de la porte centrale des Propylées, et le coup d’œil sur le large escalier qui conduisait au célèbre portique devait être saisissant. En le gravissant, on laissait à droite le gracieux sanctuaire de la Victoire sans ailes, à gauche la statue colossale d’Agrippa, ami d’Auguste, et l’on pénétrait sous le péristyle des Propylées, formé de six colonnes doriques surmontées d’un entablement avec fronton encadré par deux portiques parallèles. À travers un vestibule divisé en trois travées par un double rang de trois colonnes ioniques, et un escalier atteignant cinq portes, dont celle du milieu était la plus grande, on débouchait, par un second portique de six colonnes doriques, sur la plate-forme de l’Acropole. Des ruines dorées par le soleil, et belles jusque dans leurs derniers fragments, permettent encore aujourd’hui au voyageur de reconstituer les Propylées, cet incomparable chef-d’œuvre de Mnésiclès. Sur les degrés qu’on y voit, et dont le dernier est en marbre noir, Paul est certainement passé.La plate-forme de l’Acropole était peuplée de statues célèbres, que dominait celle de Minerve Promachos, coulée en bronze par Phidias, haute de vingt-cinq mètres, et dont le casque, scintillant aux rayons du soleil, était visible du cap Sunium. Appuyée fièrement sur sa lance et le bouclier au bras, la déesse semblait garder le Parthénon (fig. 348), qui, à quelques pas de là, s’élevait splendide, comme l’expression sublime, beaucoup moins de la foi d’un peuple à sa puissante protection, que du triomphe de l’art dans le temple même de celle qui en était l’inspiratrice.
Sur une largeur de cent pieds (30 mètres), rappelant ainsi l’Hécatompédon de Pisistrate, auquel il succédait, et sur une profondeur de deux cent vingt pieds (67 mètres), l’harmonieux rectangle avait un péristyle de huit colonnes sur les façades et de dix-sept sur les côtés. La construction intérieure se divisait en deux salles d’inégale grandeur, dont la plus importante, vers l’orient, était le sanctuaire de Minerve, et l’autre, à l’occident, l’Opisthodomos, ou la maison du trésor public. L’une et l’autre étaient précédées à leur entrée par un portique de six colonnes parallèles à celles des deux façades. Ictinus et Callicratès, en édifiant ce monument, le chef-d’œuvre incontesté de l’architecture antique, avaient voulu prouver aux bâtisseurs de tous les siècles que la beauté idéale est, non pas dans la recherche, mais dans la simplicité des lignes et dans l’exquise harmonie de leurs combinaisons. Phidias et un groupe d’artistes, dont les uns étaient ses élèves et les autres ses rivaux, avaient été chargés de décorer l’édifice. L’entablement, supporté par des colonnes de dix-sept mètres de haut, avait une frise dont les triglyphes, peints en bleu, s’harmonisaient heureusement avec la blancheur du
marbre, tandis que, sur les métopes à fond rouge, on avait représenté en bas-reliefs la guerre des Amazones, les combats des Centaures et la guerre de Troie. Une autre frisé sous le péristyle, autour de la cella, représentait la fête des Panathénées. On y admire encore de jeunes Athéniens se préparant à la cavalcade sacrée, tandis que d’autres courent en avant sur leurs fières montures. C’est aux deux frontons surtout que Phidias avait voulu étaler la variété et la puissance de son génie. Dans le tympan tourné vers l’orient, il avait représenté la naissance de Minerve, et, dans celui qui regardait les Propylées, sa dispute avec Neptune pour le protectorat de l’Attique. Enfin dans la cella était la fameuse statue de la déesse, où le grand artiste avait essayé de sculpter, dans l’or et l’ivoire, le dernier mot de l’art (fig. 349). On comprend que Paul, voyant tout ce qu’un grand peuple avait mis d’empressement religieux, de dons naturels et de génie, au service du polythéisme le plus grossier, ait senti ce brisement de cœur, ce frémissement indigné de l’âme, cette immense pitié qu’inspire l’homme oublieux de sa propre destinée et rendant hommage à la plus dégradante erreur, quand il était fait pour glorifier la vérité.
Un peu plus au nord, dans trois sanctuaires rattachés l’un à l’autre sous le nom d’Érecthéion, on vénérait des souvenirs mythologiques se rapportant à l’origine d’Athènes. Minerve Poliade et Pandrose, fille de Cécrops, y avaient leurs prêtresses. Là se rendait périodiquement la procession fameuse des Panathénées, pour y offrir à la statue de Minerve tombée du ciel le péplum brodé par les jeunes Athéniennes. On peut dire que la roche tout entière de l’Acropole était remplie de sanctuaires idolâtriques, et, quand toute la plate-forme avait été envahie, on avait fouillé les flancs de la montagne ; et tout autour, dans des grottes artificielles, Pan, Apollon, Aglaure au nord, la Terre, Thémis, Vénus, les Nymphes et Esculape au sud, avaient leurs autels, leurs prêtres et leurs adorateurs. Sans doute, ainsi qu’il est dit au livre des Actes, xvii, 17, Paul allait à la synagogue se consoler d’un si douloureux spectacle, en louant, avec les rares Juifs et les prosélytes qui étaient à Athènes, le Dieu d’Israël. Là il essayait d’annoncer le Messie, que ce Dieu avait envoyé au monde ; mais ce cercle restreint du judaïsme ne suffisait plus à son zèle. Il se mit donc à chercher des auditeurs partout, dans l’Agora, Act., xvii, 17, 18, sous les portiques, dans les écoles des philosophes, au Lycée, au Cynosarge, à l’Académie, où les souvenirs de Platon devaient sourire à son âme en extase devant le divin idéal. Sa parole y fit impression, puisque les diverses sectes s’en émurent, et un jour on se saisit de l’étrange discoureur, qui fut amené à l’Aréopage, où il dut s’expliquer sur sa doctrine, nouvelle pour tous, et déraisonnable pour plusieurs.
Cette colline de Mars ou Aréopage, où il fut conduit, existe encore. C’est l’élévation rocheuse qui avoisine l’Acropole vers l’occident. Cf. Pausanias, I, xxviii, 5 ; Hérodote, viii, 52. On y monte par seize degrés taillés dans le roc, et conduisant à une plate-forme où trois bancs de pierre forment un rectangle ouvert du côté de l’escalier. Voir Aréopage, col. 941. Là Paul annonça le vrai Dieu, et, malgré un auditoire d’épicuriens qui ne voulait plus l’entendre parce qu’il prêchait la vie future, il put signifier aux faux dieux que l’heure était venue où ils allaient sortir de leurs temples, le Théséion qu’il avait à ses pieds vers le nord, l’Olympiéion vers le sud-est, le Parthénon sur sa tête. On eut beau sourire et lever la séance sans attendre la fin, sur le Pnyx qui s’élevait au midi, au delà de la route, avec ses grands souvenirs oratoires, Démosthène plaidant contre Philippe avait perdu sa cause ; sur l’Aréopage, Paul plaidant contre le paganisme gagna la sienne. Denys l’Aréopagite et une femme nommée Damaris ne furent que le prélude de plus nombreuses conquêtes. Act., xvii, 34. Avec le temps, le Dieu du Calvaire eut raison des dieux de l’Olympe. Une église dédiée à saint Denys, au pied même de l’Aréopage, a pris la place du sanctuaire des Euménides (fig. 350).
En dehors des anciens auteurs, qui sont la meilleure source sur la topographie d’Athènes, on peut consulter, parmi les modernes, les travaux de Kiepert et de Curtius, l’œuvre remarquable de C. Wachsmuth, Die Stadt Athen in Alterthum, in-8o, Leipzig, 1874 ; W. M. Leake, Topography of Athens, in-8o, Londres, 1821 ; 2e édit., 1841 ; Beulé, L’Acropole d’Athènes, 2 in-8o, Paris, 1854 ; G. F. Hertzberg, Athen, historisch-topographisch dargestelt, in-12, Halle, 1885.
ATHÉNIEN (Ἀθηναῖος), habitant d’Athènes, capitale de l’Attique, en Grèce. — 1o Les Athéniens sont nommés pour la première fois, dans l’Écriture, II Mach., vi, 1, (leçon contestée ; voir Athénée) et ix, 15, dans le récit des derniers jours d’Antiochus IV Épiphane. Ce roi de Syrie, qui avait persécuté si cruellement les Juifs, frappé d’une maladie terrible, implora, mais en vain, la miséricorde de Dieu, lui promettant entre autres choses qu’il « égalerait les Juifs aux Athéniens », c’est-à-dire, probablement, qu’il leur accorderait l’autonomie et une indépendance semblable à celle dont jouissaient les Athéniens. Plusieurs commentateurs, tels que Grotius, Opera, Amsterdam, 1679, t. i, p. 776, et Calmet (Comment. sur les Mach., ix, 15, 1722, p. 351), surpris de trouver ici le nom des Athéniens, lisent « Antiochiens » au lieu d’Athéniens (comme ils le font II Mach., vi, 1, texte grec), parce que, disent-ils, Athènes n’obéissait point à Antiochus IV. Ils supposent que ce prince promettait de donner à tous les Juifs les droits et les privilèges des citoyens d’Antioche, qui jusque-là n’avaient été conférés qu’à quelques habitants de Jérusalem. II Mach., iv, 9 (et 19, texte grec, où Ἀντιοχεῖς signifie les habitants de Jérusalem qui avaient les droits des citoyens d’Antioche). Cette explication n’est pas impossible, mais rien n’empêche de conserver la leçon qu’on lit dans le texte actuel, et qui est confirmée par tous les manuscrits et les anciennes versions. On comprend d’autant plus facilement cette allusion au gouvernement d’Athènes, qu’Antiochus IV avait une grande prédilection pour cette ville (voir Antiochus IV, col. 694). Cf. Polybe, xxviii, 18, 3.
2o Les Athéniens sont nommés deux fois dans le Nouveau Testament. — 1o Saint Paul, dans son discours de l’Aréopage, s’adresse à eux en leur disant : Ἄνδρες Ἀθηναίοι, selon l’usage des orateurs de cette ville. Act., xvii, 22. — 2o Saint Luc, afin d’expliquer pourquoi les Athéniens désirent connaître quelle est la « doctrine nouvelle », καινὴ… διδαχή prêchée par saint Paul, fait cette réflexion : « Tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient [dans la ville] ne s’occupaient que de dire ou d’écouter quelque chose de nouveau (καινότερον). » Act., xvii, 21. (Le comparatif est employé pour signifier : Quelles sont les dernières nouvelles ?) Ce trait du caractère athénien est pris sur le vif ; Démosthène dit en s’adressant à ses compatriotes : « Nous nous demandons à l’agora : Que dit-on de nouveau (λέγεται τι καινόν) ? » Phil. i, Demosthenis quæ supersunt, édit. Reiske, Londres, 1832, t. i, p. 28. Théophraste, dans ses Caractères, viii, édit. Didot, p. 6, fait ainsi le portrait du nouvelliste athénien : « Que racontes-tu ?… As-tu du nouveau (ἔχεις περὶ τοῦδε εἰπεῖν καινόν) ? » Et continuant à interroger : « Ne dit-on rien de nouveau (μὴ λέγεται τι καινοτερόν) ? » Voir aussi Thucydide, iii, 38, 5, édit. Didot, p. 116 ; Plutarque, Moral., De curiosit., 8, édit. Didot, t. i, p. 628. Cf. Sénèque, Epist., l. xv, 2 (94), édit. Teubner, Opera, t. iii, p. 296.
ATHÉNOBIUS (Ἀθηνόβιος) officier d’Antiochus VII Sidètes, roi de Syrie. Il avait le titre d’« ami du roi ». I Mach., xv, 28. (Voir, sur ce titre, col. 705.) Antiochus, après avoir refusé les présents de Simon Machabée, grand prêtre des Juifs, envoya Athénobius à Jérusalem pour demander à Simon de lui rendre Joppé, Gazera et la citadelle de Jéru- raient à la lutte par une série prolongée d’exercices, appelée « agonistique ». Mais bientôt des hommes firent métier de paraître dans les jeux publics pour s’y disputer les prix ; on les nomma « athlètes », et l’agonistique, jadis en honneur parmi les jeunes citoyens, devint une profession à laquelle se vouèrent, pour la plus grande partie de leur vie, ceux qui en avaient le goût et la force. L’agonistique fut définitivement remplacée par l’ « athlétique ». Voici quels étaient les exercices dont la série composait les grands jeux.

351. — Coureurs. On lit au-dessus : Στάδιν ανδρων νεκη. D’après un vase peint du musée de Munich.
- La course, σταδιον ou δρόμος (fig. 351). Elle se faisait dans le stade, espace nivelé pour la course des piétons et celles des chevaux et des chars. Tout autour de cette piste, ou seulement sur un des côtés, s’élevaient des gradins sur lesquels prenaient place de nombreux spectateurs. Les présidents des jeux, agonothètes ou athlothètes, occupaient des sièges d’honneur à l’une des extrémités.
Le stade tirait son nom de la mesure indiquant sa longueur. La mesure appelée « stade » équivalait à 177™ 40. J. Gow, Minerva. traduction S. Reinach, in-12, Paris, 1890, XI, 44, p. 85. Le stade d’Olympie avait juste cette longueur ; ailleurs la piste était plus longue.

352. — Agonothètes assis devant une table où sont déposées huit couronnes pour les vainqueurs des jeux. D’après un calendrier figuré d’Athènes. Lebas, Voyage en Grèce. Monuments figurés, pl.22.
Dans la course simple, il fallait parcourir le stade d’un bout à l’autre. Dans la course double, ou « diaule », le trajet devait être parcouru à l’aller et au retour sans arrêt. Enfin dans la « dolique », le coureur avait à fournir sans nul repos une course de douze à vingt-quatre stades, soit de deux à quatre kilomètres. Un jour, un vainqueur Spartiate, Ladas, tomba mort en arrivant au but. Pour rendre possibles ces deux dernières courses, on avait divisé la piste en deux parties par une ligne de démarcation indiquée par trois colonnes. Sur la colonne dressée à l’extrémité était écrit le mot ϰάψον, « tourne, » et sur les deux autres, ἀρίστειε, « courage, » et σπεῦδε, « dépêche-toi. » Le but à atteindre s’appelait τέρμα. Les juges des jeux, qui prenaient le nom d’ « hellanodices » ou « juges de la Grèce » aux fêtes olympiques, décernaient les couronnes et les autres récompenses aux vainqueurs.

353. — Couronnes et urne pour les vainqueurs des Jeux. Siège
d’athlothète, en marbre, trouvé à Athènes. D’après J. Stuart
et H. Revett, Antiquities of Athens, in-fol., Londres, 1762-1816,
t. iii, p. 29.
Dans un bas-relief découvert à Athènes, on voit les agonothètes assis derrière une table sur laquelle sont déposées les couronnes (fig. 352). Un siège de marbre, trouvé dans la même ville, montre sur l’un des côtés une petite table portant les couronnes et une urne destinée aux vainqueurs (fig. 353). Saint Paul, qui connaissait la passion des Grecs pour le jeu, fait de fréquentes allusions aux courses du stade. Qui mieux que les Corinthiens, par exemple, pouvait le comprendre, quand il écrivait : « Ceux qui courent dans le stade (οἵ έν σταδίῳ τρέχοντες) courent tous ensemble, sans doute ; mais un seul remporte le prix (βραϐεῖον). Courez donc de manière à le remporter. » I Cor., ix, 24. Il aimait à comparer la vie chrétienne à la course. Gal., ii, 2 ; v, 7 ; Phil., ii, 16 ; Rom., IX, 16. Il disait de lui-même : « Je n’estime pas ma vie plus que moi-même, pourvu que j’achève ma course (δρόμον). » Act, xx, 24. Quand il écrit aux Galates, V, 7 : « Vous couriez bien, qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à la vérité ? » il pense à ces coureurs qui cherchaient à barrer la route à leurs concurrents, pour les retarder ou les faire dévier du chemin le plus court. À la fin de sa vie, il écrit à Timothée : « J’ai combattu le bon combat (ἄγῶνα), j’ai achevé la course (δρόμον), j’ai gardé la foi. Désormais m’est réservée la couronne (στέφανος) de justice qu’en ce jour me donnera le Seigneur, le juste juge. » II Tim., iv, 7-8. Ici le combat est l’ἄγῶν, la participation aux jeux publics ; la course et des pensées de ruse : c’est pourquoi, quand les athlètes arrivaient à Olympie, on leur faisait prêter serment de loyauté près de l’image de Jupiter, ainsi qu’à leurs parents et à leurs gymnastes. » Daremberg et Saglio, Dict. des antiq., t. i, p. 516. De fortes amendes punissaient ceux qui avaient contrevenu aux règles prescrites. L’Apôtre écrit : « Si quelqu’un vient lutter (ἀθλῆ) , il ne sera pas couronné, à moins d’avoir lutté (ἀθλήσῃ) loyalement. » II Tim., ii, 5. Faisant allusion à la nombreuse assistance qui entourait le stade, il comparait les chrétiens persécutés à « des hommes donnés en spectacle », et il ajoutait : « Ayant autour de nous une si grande nuée de témoins, mettons de côté tout ce qui nous appesantit et le péché qui nous embarrasse, et courons par la patience à la lutte qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, le point de départ (ἀρχηγόν) et le terme d’arrivée (τελειωτήν) de la foi. » Hebr., x, 33 ; xii, 1, 2. Le Sauveur est ici considéré comme l’agonothète, au signal duquel part le coureur, et auprès duquel il revient, sans quitter des yeux le juge de la course, afin de s’encourager en le voyant.
Une fois dans le stade, l’athlète devait poursuivre la lutte jusqu’au bout, s’il voulait gagner le prix. « Je poursuis avec ardeur, dit encore saint Paul, afin d’atteindre le but en vue duquel j’ai été saisi par le Christ Jésus. Je ne crois pas l’avoir encore atteint. Mais voici : oubliant ce qui est en arrière, et m’étendant vers ce qui est en avant, je cours au but, à la récompense de la vocation céleste. » Phil., iii, 12-14. La récompense accordée aux vainqueurs des jeux grecs était magnifique : la couronne de laurier (fig. 352), les acclamations populaires, l’inscription sur des tables de bronze, l’érection d’une statue, des honneurs extraordinaires dans la ville natale, des privilèges à vie, telles étaient les principales faveurs accordées à l’heureux champion. Nous avons vu saint Paul rappeler cette couronne (στέφανoς) et mettre cette récompense en parallèle avec la récompense éternelle promise au chrétien. Saint Pierre dira à son tour : « Quand paraîtra le Prince des pasteurs, vous recevrez la couronne impérissable de gloire. » I Petr., v, 4. Avant les Apôtres, l’auteur de la Sagesse avait déjà fait allusion aux récompenses accordées aux vainqueurs des jeux. Sap., IV, 2.
Voir Guhl et Koner, traduits par Trawinski, La vie antique, la Grèce, Paris, 1884 ; W. Richter, Die Spiele der Griechen und Römer, Leipzig, 1887 ; J. Howson, The metaphors of saint Paul, in-12, Londres, 1883, p. 135 ; F. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4e édit., t. v, Paris, 1891, p. 540-549.
ATHMATHA (hébreu : Humtâh ; Septante : Εύμά ; Codex Alexandrinus : Χαμματά), ville de la tribu de Juda. Jos., xv, 54. Elle fait partie du second groupe des villes de « la montagne », Jos., xv, 52-54, et précède immédiatement Hébron. C’est sans doute l’αματά de l’Onomasticon, Gœttingue, 1870, p. 221. Il y a une certaine ressemblance entre le Χαμματά des Septante et le Κιμάθ qu’ils ont ajouté à la liste des villes auxquelles David envoya des présents après sa victoire sur les Amalécites. I Reg., xxx, 29. Elle n’a pas été identifiée jusqu’ici.
Voir Juda (tribu).ATTACANTI. Voir Attavanti.
ATTALE II PHILADELPHE, fils d’Attale Ier, roi de Pergame. Des trois rois de cette ville qui portèrent le même nom, Attale II (fig. 357) est le seul nommé dans l’Écriture. I Mach., xv, 22. Les Romains lui écrivirent en faveur des Juifs en 139 ou 138, peu de temps avant sa mort. Il était né en 200 avant J.-C. Lucien, Macrob., 12 ; Strabon, xiii, 4, 2. Attale fut souvent chargé par son frère aîné, le roi Eumène , de diriger des opérations militaires. Il repoussa notamment, en 190, une invasion de Séleucus, fils d’Antiochus III. Tite Live, xxxvii, 18 et suiv. ; Dittenberger, Sylloge inscript, græc., n. 208 ; Frankel, Altertümer von Pergamon, t. i, n. 36 et 64. L’année suivante, il accompagna le consul Cn. Manlius Vulso dans son expédition en Galatie. Tite Live, xxxviii, 12 ; Polybe, xxii, 22 ; xxiv, 1 ; Frankel, Altertümer von Pergamon, t. i, n. 65. En 182, il fit la guerre à Pharnace, Polybe, xxv, 4, 6 ; cf. Dittenberger, Sylloge inscript, græc, n. 215, et, en 171, il se joignit au consul P. Licinius Crassus, en Grèce, Tite Live, xxxv, 23. Plusieurs fois il alla à Rome, en qualité d’ambassadeur : en 192, pour annoncer aux Romains qu’Antiochus venait de traverser l’Hellespont ; en 181, en 167, en 164 et en 160. Tite Live, xxxv, 23 ; Polybe, xxv, 6 ; xxxi, 9 ; xxxii, 3,5.
Depuis 159, date de la mort de son frère Eumène, Attale exerça pendant vingt et un ans l’autorité royale, en qualité de tuteur du jeune Attale III, fils d’Eumène, et il ne remit le pouvoir à son pupille qu’en mourant.
357. — Monnaie des Attale, rois de Pergame.
Tête d’Eumène Ier, oncle d’Attale Ier imberbe. — Ρ. ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ. Pallas assise et casquée, présentant de la main droite une couronne. Derrière elle, un arc ; à côté d’elle, un bouclier. Strabon, xiii, 4, 2. Son premier acte, quand il eut le pouvoir,
fut de rétablir sur le trône de Cappadoce Ariarathe, dont il était l’ami. Polybe, xxxii, 23. Cf. Dittenberger, Sylloge inscript. græc., n. 220. Voir Ariarathe. Le roi de Perse et les Romains soutinrent à leur tour Attale contre Prusias, en 154, et forcèrent celui-ci à signer la paix. Polybe, iii, 5 ; xxxii, 25 et suiv. ; xxxiii, 1, 6, 10, 11 ; Appien, Mithrid., 3 ; Diodore de Sicile, xxxi. En 152, Attale aida Alexandre Dalas à s’emparer du trône de Syrie. Justin, xxxv, 1. Il entreprit ensuite plusieurs guerres, soit contre Prusias, soit comme auxiliaire des Romains. Strabon, xiii, 4, 2 ; Pausanias, vii, 16, 8. Ce prince fonda plusieurs villes, entre autres Philadelphie en Lydie et Attalie en Pamphylie. Droysen, Histoire de l’hellénisme, trad. franc., t. ii, p. 712, 717 et 722. Attale ne fut pas seulement un prince guerrier, il encouragea les arts et les sciences. Pline, H. N., vii, 39 ; xxxv, 36 ; viii, 74 ; Athénée, viii, p. 346 ; xiv, p. 634 ; Strabon, xiv, 1, 29. Attale mourut en 138, âgé de quatre-vingt-deux ans. Son nom figure sur un certain nombre d’inscriptions grecques. À celles que nous avons citées , il faut ajouter notamment une inscription de Delphes, deux inscriptions de Panados, dans la Propontide de Thrace, et de nombreuses inscriptions de Pergame. Cf. Dittenberger, Sylloge inscript. græc., 224, 225, 233, 235. Les inscriptions de Pergame se trouvent réunies dans Frankel, Altertümer von Pergamon, 1891, Inschriften, l. 1. Attale fut honoré comme un dieu à Sestos. Mouaeïov de Smyrne, 1876-1880, p. 18, A. Cf. E. Beurlier, De divinis honoribus quos acceperunt Alexander et successores ejus, 1890, p. 161 et suiv.
L’amitié qui liait Attale à Ariarathe et aux Romains, explique pourquoi ces derniers, à la suite de l’ambassade envoyée à Rome par le grand prêtre Simon, écrivirent aux deux rois une lettre semblable à celle qu’ils avaient envoyée à Ptolémée VII Physcon, à Démétrius et à Arsace. 1 Mach., xv, 22.
ATTALIE (Ἀττάλεια), ville de Pamphylie. Saint Paul et saint Barnabé dans leur premier voyage, après avoir quitté Perga, vinrent à Attalie (fig.358) et s’embarquèrent dans ce port pour Antioche de Syrie. Act., xiv, 24. Ils ne paraissent pas s’être arrêtés à Attalie et y avoir prêché. Cette ville fut fondée par Attale II, roi de Pergame. Etienne de Byzance, au mot Ἀττάλεια ; Strabon, xiv, 4, 1.

360. — Monnaie d’Attalie. ΚΑΙΣΑΡ ΑΔΡΙΑΝΟΣ. Buste d’Adrien, à droite. - v. ΑΤΤΑΛΕΟΝ. Temple tétrastyle. À l’intérieur, Pallas casquée tenant sa lance et une petite Victoire ; à ses pieds son bouclier et un cippe sur lequel est posée une chouette.
Les savants ont beaucoup discuté sur la situation exacte d’Attalie. Strabon, en effet, paraît la placer à l’est du Cataractes. Ptolémée, Géographie, v, 5, 2, et le Stadiasmos, n. 215, dans les Geographi minores, édit. C. Müller, t. i, p. 488 ; cf. pl. xxiv et xxv, la placent au contraire à l’ouest. C’est du même côté du Cataractès que se trouve la ville moderne d’Adalie (fig. 359), dont le nom rappelle celui de la ville ancienne, et qui est la cité la plus considérable de la côte sud de l’Asie Mineure.

359. — Vue de la ville et du port d’Adalie.
Le Cataractès, au dire de Strabon, tire son nom de ce qu’il se précipite du haut d’un rocher fort élevé et forme une cataracte dont le bruit s’entend de très loin. Ibid. Il y a actuellement, à l’ouest d’Adalie, des ruisseaux qui tombent en cascades directement du rocher dans la mer, et qui, s’ils étaient réunis, formeraient une masse d’eau considérable et une véritable cataracte.

358. Carte d’Attalie et de ses environs.
Il est probable qu’au temps de Strabon il en était ainsi, et la séparation a été faite par les dépôts calcaires, qui sont très considérables. Il faut donc, avec le colonel Leake, Journal of a Tour in Asia Minor, 1824, p. 192 et suiv. ; Eug. Petersen.
Reisen in Lykien, 1889, t. ii, p. 178, et H. Kiepert, Special Karte vom westliches Kleinasien, pi. xv, placer l’ancienne Attalie à l’endroit où est aujourd’hui Adalie. Il faut, au contraire, rejeter l’opinion de Beaufort, Kararnania, p. 135, de d’Anville et des autres, qui identifient l’Adalie moderne avec Olbia, et placent Attalie plus à l’est, à l’emplacement actuel de Laara. Toutes les mines qui restent aujourd’hui d’Attalie, les monnaies de la ville (fig. 360), Mionnet, Description des médailles antiques, t. iii, p. 449 ; Supplément, t. vii, p. 30, et les inscriptions trouvées sur son emplacement, appartiennent à l’époque romaine. Cf. E. Petersen, Reisen, t. ii, p. 178. Olbia est placée par Leake sur une élévation voisine d’Adalie, où existent encore aujourd’hui des ruines antiques, ce qui correspond bien avec le texte de Strabon, qui en parle comme d’une citadelle. Les environs d’Attalie sont des rochers stériles. ATTAVANTI ou ATTACANTI Paolo, religieux italien, appelé communément frère Paul de Florence, né dans cette ville en 1419, mort le 6 août 1499. Il entra dans l’ordre des Servîtes. Par ses talents et son mérite, il se trouva lié avec tous les savants que protégeait Laurent de Médicis, et Marcile Ficin, après avoir entendu un de ses sermons, comparait son éloquence à celle d’Orphée. Parmi ses ouvrages, nous remarquons : Spiegazione de’sette Salmi Penitenziali, in-4°, Milan, 1479 ; Commentaria in duodecim Prophetas minores et Apocalypsum Joannis, in-4°, Milan, 1479. — Voir G. Negri, Istoria degli scrittori fiorentini, in-f° Ferrare, 1722, p. 445 ; Mazzuchelli, Scrittori d’Italia, t. i, part. 2, p. 1209 ; Tiraboschi, Storia della Letteratura italiana, t. vi, part. 3 (Milan, 1824), p. 1674.ATTERSOLL William, théologien puritain, mort en 1640, fut probablement quelque temps membre de Jésus Collège, à Cambridge, et devint ministre à Isfield, dans le comté de Sussex, où il demeura plus de quarante ans, et où il fut enterré le 16 mai 1640. Sa vie est peu connue, malgré ses nombreux ouvrages. The Pathway to Canaan, in-4°, 1609 ; The Historie of Balak the king and Balaam the false prophet, in-4°, 1610 ; New Covenant, 1614 ; A Commentarie upon the Epistle of Saint Paule to Philemon, 2e édit., 1633 ; Conversion of Nineveh, 1632. Ces ouvrages sont devenus extrêmement rares. Ils se distinguent par l’érudition et des applications ingénieuses aux événements contemporains de l’auteur ; mais ils sont diffus et mal digérés. Voir L. Stephen, Dictionary of national Biography, t. ii, p. 239.
ATTON, appelé aussi Hatto et Acton, évêque de Verceil, en Piémont, mort vers 960. Il fut, au xe siècle, l’un des hommes les plus remarquables d’Italie par son zèle pour la discipline ecclésiastique, et aussi par ses connaissances. Ses œuvres se trouvent en manuscrit à la bibliothèque Vaticane, à Rome, et dans les archives de Verceil. D’Achery en a publié une partie dans le tome vin de son Spicilegium, et G Buronti del Signore a édité tout ce qui reste de lui en deux volumes in-f°, 1768. Parmi ses œuvres, on remarque une Expositio Epistolarurn sancti Pauli [Patr. lat., t. cxxxiv, col. 125-834), d’après saint Jérôme et les autres Pères de l’Église. À la fin de son Expositio, col. 832, il dit en s’adressant à Dieu : « Vous m’avez mis dans le cœur d’abandonner ma nation et ma patrie, à cause du goût et de la suavité de… la Sainte Écriture, afin que je puisse goûter un peu cette suavité et vous connaître ainsi ; car votre parole a été véritablement un flambeau pour mes pieds et une lumière pour mes sentiers. » Il était donc né hors du Piémont. C’est tout ce qu’on sait de son origine. Voir Herzog, Real-Encyklopädie, 2e édit., t. i, p. 756 ; Hergenröther, Histoire de l’Église, trad. Belet, t. m (1886), p. 348.
AUBERLEN Karl August, théologien protestant, né à Fellbach, près de Stuttgart, le 19 novembre 1824, mort le 2 mai 1864. Il fit ses études à Blaubeuren et à Tubingue. Dans l’université de cette dernière ville, il fut entraîné un instant vers le rationalisme panthéiste, qui y dominait à cette époque sous l’influence de Baur ; mais la foi reprit bientôt le dessus. Après avoir exercé pendant quelque temps le ministère pastoral comme vicaire, il devint, en 1849, répétiteur au collège (Stift) théologique de Tubingue et en 1851, professeur de théologie à Bâle. Son œuvre biblique la plus importante est Der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis, in-8°, Bâle, 1854 ; 2e édit., 1857. Elle a été traduite en français par H. de Rougemont, Le prophète Daniel et l’Apocalypse de saint Jean, considérés dans leur rapport réciproque et étudiés dans leurs principaux passages, in-8° (Lausanne), 1880. Ce n’est pas un commentaire de Daniel et de l’Apocalypse, mais une étude comparée des images symboliques qu’ils renferment. La mort empêcha Auberlen d’achever un autre ouvrage dans lequel il défendait l’Écriture contre les attaques de l’école de Tubingue, Die göttliche Offenbarung, ein apologetischer Versuch, 2 in-8°, Bâle, t. i, 1861 ; t. n (posthume), 1864. La première partie expose les raisons en faveur de l’authenticité des Livres Saints ; la seconde est une histoire succincte de la lutte entre la foi et le rationalisme en Allemagne ; la troisième, qui est restée incomplète, contient une étude dogmatique sur la révélation. Auberlen a aussi publié, dans le Theologischhomiletisches Bibelwerk de Lange, en collaboration avec C. J. Riggenbach, Die beiden Briefe Pauli an die Thessalonicher, in-8°, Bielefeld, 1864 ; 2= édit., 1867 ; 3° édit., 1884.
— Auberlen avait un véritable talent d’écrivain. Son style est clair, simple et plein de chaleur. — Voir un abrégé de sa vie en tête du second volume de la Göttliche Offenbarung ; F. Fabri, dans Herzog, Real-Encyklopädie, 2e édit., t. i, p. 757-759 ; F. Lichtenberger, Histoire des idées religieuses en Allemagne, 3 in-8°, Paris, 1873, t. iii, p. 235.
AUBERT Marius, théologien français, né dans le midi de la France vers 1800, mort en 1858. Il prêcha beaucoup en qualité de missionnaire, et publia dans les dernières années de sa vie une quarantaine de volumes, parmi lesquels un Traité de l’authenticité des Livres Saints avec des traits historiques, 2e édit., in- 18, Lyon, 1844. Ce petit livre de 176 pages n’a pas de valeur scientifique, mais il renferme des citations de grands écrivains et des traits intéressants.
AUDIFFRET Hercule, prédicateur français, né à Carpentras le 15 mai 1603, mort le 6 avril 1659. Il devint général de la congrégation de la Doctrine chrétienne, et fut l’un des bons orateurs de son temps. Fléchier, évêque de Nîmes, était son neveu et son élève. On a imprimé après la mort de l’auteur des ouvrages peu soignés, parmi lesquels sont des Questions spirituelles et curieuses sur les Psaumes, in-12, 1668. Voir Mémoires de Trévoux, novembre 1711, art. clxi, p. 1948-1952.
1. AUERBACH Salomon Heymann ou Salomon ben Michæl Chaïm, commentateur juif, mort à Posen en 1836. Il a laissé : Habaqqûq, traduction allemande et commentaire avec le texte hébreu, in-8°, Breslau, 1821 ; Sêfér Qôhélét, le livre de l’Ecclésiaste traduit et commenté, in-8°, Breslau, 1837.
2. AUERBACH Samuel ben David, rabbin polonais de Lublin, vers le milieu du xviie siècle. Il a composé un commentaire cabalistique sur quelques passages de la Genèse, intitulé Héséd Semû’êl, « Piété de Samuel. » Dans la préface, il dit qu’il mit la main à cet ouvrage en reconnaissance de la protection que Dieu lui accorda dans un massacre des Juifs à Lublin, en 1657. Il fut publié après sa mort par R. Éliacim ben Jacob, in-8°, Amsterdam, 1699. AUGIENSIS (CODEX). Nous possédons quelquesmanuscrits des Épîtres de saint Paul, qui donnent parallèlement le texte en grec et le texte en latin. Le plus célèbre et le plus important est le Codex Claromontanus (D), du VIe siècle, à Paris. Parmi les autres, il faut citer le Codex Sangermanensis (E), du IXe siècle, à Saint-Pétersbourg, lequel est de peu de valeur, n’étant qu’une copie et une copie mal faite du Claromontanus. Il en est deux autres de plus de valeur : le Codex Bœrnerianus (G), du IXe siècle, à Dresde, et le Codex Augiensis (F), de la même époque, à Cambridge. Ce dernier appartient à la bibliothèque de Trinity Collège, où il est coté B. 17. 1. L’écriture, soit grecque, soit latine, est onciale, d’une main de la fin du IXe siècle. Le parchemin est réparti en cahiers de huit feuillets ; chaque page a deux colonnes, chaque colonne vingt-huit lignes ; le texte latin est toujours dans la colonne extérieure. Les initiales, tant grecques que latines, sont écrites au minium, quand elles annoncent le commencement d’un chapitre ou d’une Épître ; partout ailleurs rien ne relève les majuscules. Ni accents, ni esprits dans le grec. Tous les mots sont séparés par un point. Hauteur de chaque feuillet : 228 millimètres. Largeur : 190 millimètres. Le manuscrit compte 136 feuillets. Il renferme tout saint Paul, à l’exception du texte grec de Rom., i, 1-m, 19 ; I Cor., iii, 8-16 ; vi, 7-14 ; Col., ii, 1-H, 8 ; Philem., 21-25 ; enfin de toute l’Épître aux Hébreux. Il manque également le texte latin de Rom., i, i-iii, 19.
Ce manuscrit, on l’a dit, a été écrit à la fin du IXe siècle, et tout porte à croire qu’il a été écrit par un scribe de langue germanique, probablement dans quelque, monastère de la haute vallée du Rhin. Il a appartenu à l’abbaye de Reichenau, dans une île du Rhin, proche de Constance : le nom latin de Reichenau est Augia dives, d’où la dénomination d’Augiensis. En 1718, il fut acheté par le célèbre critique anglais Bentley, au prix de deux cent cinquante florins ; il appartenait alors à L. C. Mieg de Heidelberg, entre les mains duquel il fut collationné par Wetstein, en 1717. Un ex-libris, qui se lit encore sur la garde du manuscrit, indique un certain G. M. Wepfer, de Schaffouse, comme l’ayant possédé précédemment. En 1786, il fut donné par le neveu de Bentley à la bibliothèque de Trinity College. Wetstein en 1717, Tischendorf en 1842, Tregelles en 1845, ont collationné le Codex Augiensis. M. Scrivener en a publié le texte intégralement : An exact transcript of the Codex Augiensis, Cambridge, 1859.
Frappé des étroites ressemblances paléographiques ou textuelles qui existent entre le Codex Augiensis, le Codex Bœrnerianus et le Codex Claromontanus, M. Corssen a émis l’hypothèse que les deux premiers, c’est à savoir l’Augiensis et le Bœrnerianus, dépendaient d’un commun archétype, tant pour le grec que pour le latin ; que cet archétype n’était point le Claromontanus, mais que le Claromontanus et l’archétype de l’Augiensis et du Bœrnerianus dérivaient ensemble d’une même édition bilingue des épîtres pauliniennes, édition qui ne serait point antérieure au commencement du Ve siècle, et qui serait probablement d’origine italienne. Voyez P. Corssen, Epistularum paulinarum codices græce et latine scriptos Aug. Bœrn. Clarom. examinavit, inter se comparavit, ad communem originem revocavit, Kiel, 1887-1889. M. Hort pensait que le texte grec de l’Augiensis avait été copié sur un manuscrit grec des Épîtres, que le texte latin était celui de la Vulgate hiéronymienne, adapté au texte grec qui l’accompagne au moyen du texte latin du Bœrnerianus. Voir Westcott et Hort, The New Testament in the original Greek, Cambridge, 1881, t. ii, p. 203. De son côté, M. Fr. Zimmer, dont Corssen n’a pas discuté les conclusions, avait prétendu démontrer que l’Augiensis était une copie directe du Bœrnerianus. Voir Zeitschrift fur wissenschaftliche Theologie, t. xxx, p. 76 et suiv. Et M. Zimmer a eu l’occasion de montrer depuis qu’il maintenait son opinion et tenait pour inacceptable celle de M. Corssen. Voir Theologische Literaturzeitung, 1890, p. 59-62. La question en est là. Quoi qu’il en puisse être, on tient que le texte latin de l’Augiensis est d’un intérêt médiocre, étant un texte mixte, et plus dépendant de la Vulgate hiéronymienne que d’aucune version latine préhiéronymienne ; le texte grec, au contraire, est avec le Claromontanus et le Bœrnerianus un intéressant représentant de la tradition textuelle que l’on appelle occidentale. — Voir Gregory, Prolegomena, p. 424-429, au Novum Testamentum græce, edit. vm crit. maj., de Tischendorf, Leipzig, 1884 ; W. Sanday, Appendices ad Novum Testamentum Stephanicum, Oxford, 1889, p. 141-167.
AUGURES. On donnait ce nom, chez les Romains, aux prêtres qui annonçaient l’avenir d’après les observations faites sur le vol et le chant des oiseaux. Tite Live, i, 36 ; Cicéron, De divin., i, 17 (fig. 361).
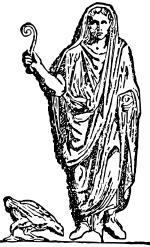
361. — Augure romain, tenant dans la main droite le lituus (bâton
recourbé qui servait à la divination). À ses pieds est un poulet sacré. Bas-relief du musée de Florence.
Ce mot étant très familier aux Latins, saint Jérôme l’a employé Deut., xviil, 14 ; Is., ii, 6 ; xlvii, 13 ; Jer., xxvii, 9. Le féminin auguratrix, « devineresse, » se lit Is., lvii, 3. Le traducteur de la Vulgate s’est servi du verbe auguror, « augurer, » Gen., xliv, 5, 15 (hébreu : nihês) ; Lev., xix, 26 (hébreu : nihês), et plus fréquemment encore du substantif augurium, « augure, présage. » Num., xxiii, 23 ; xxiv, 1 ; Deut., xviii, 10 ; IV Reg., xvii, 17 ; xxi, 6 ; II Par., xxxiii, 6 ; Eccli., xxxiv, 5. Comme les expressions augur, auguror, augurium, étaient devenues en latin, dans bien des cas, de simples synonymes de « devin, deviner, divination ou présage », notre version les emploie dans ce sens général : Gen., xliv, 5, 15, où il s’agit de la divination par la coupe et non par les oiseaux ; Lev., xix, 26 (divination en général ou par la magie) ; Num., xxiii, 23 (naḥaš, « enchantement » ) ; xxiv, 1 (nehâšîm, « divination, présage obtenu par des enchantements » ) ; Deut., rviii, 10 (menahêš, « devin, enchanteur » ) ; xviii, 14 (me’ônenim, « devins » ) ; IV Reg., xvii, 17 (niḥêš) ; xxi, 6 (niḥêš) ; II Par., xxxiii, 6 (niḥêš) ; Is., ii, 6 (’ônenîm, « devins » ) ; xlvii, 13 (ḥôbrê šâmâïm, « par-
tageant, divisant le ciel, » les astrologues de Babylone) ; lvu, 3 {’ônenâh, « devineresse » ) ; Jec, xxvii, 9 (’ônenîm). Dans l’Ecclésiastique, xxxiv, 5, le mot auguria, « augures, présages, » rend exactement le mot grec oî<.)vi(7(jLoi, Eccli., xxxi, 5, qui signifie, en effet, « divination par le moyen des oiseaux ; » mais, le texte original étant perdu, nous ignorons quelle était l’expression hébraïque que le traducteur a ainsi interprétée. Pour le sens des mots hébreux que la Vulgate a rendus par augures et ses dérivés, voir Devins, Divination.
On peut conclure de ce qui précède que les mots « augure, augurer », de la Vulgate, ne doivent pas être pris dans le sens strict, mais dans le sens large. Les anciens traducteurs semblent bien avoir cru cependant qu’il était réellement question d’ornithomancie dans certains passages, comme Deut., xviii, 10, où les Septante traduisent menah.es par oîwviÇojjLevoç, dans le même sens que la Vulgate, qui observât auguria ; les versions syriaque et arabe font de même. Il n’est pas impossible du reste qu’il soit fait allusion dans l’Écriture à la divination par les oiseaux, car elle était pratiquée en Chaldée et dans les pays voisins. Diodore de Sicile, ii, 29 ; Fr. Lenormant, Lçt, divination chez les Chaldéens, in-8°, Paris, 1875, p. 35, 52-55 ; L. Hopf, Thierorakel, in-8°, Stuttgart, 1888, p. 4. Les rabbins et quelques commentateurs ont cru reconnaître en particulier l’ornithomancie dans cette sentence de l’Ecelésiaste, x, 20 : « Ne dis point de mal du roi, même dans ta pensée ; ne dis point de mal du riche, même dans l’intérieur de ta chambre ; car l’oiseau du ciel porterait ta voix, et l’animal ailé révélerait tes paroles. » Mais rien ne prouve qu’il soit ici question de divination. Le sens de ce passage est le même que celui de notre proverbe : Les murs ont des oreilles et parlent ; Salomon veut dire que les rois et les riches ont des moyens de savoir tous les secrets. F. Vigouroux.
- AUGUESTA Nicolas##
AUGUESTA Nicolas, dominicain de Venise, mort en 1446. Il était provincial de la Lombardie inférieure, lorsque Eugène IV le nomma évêque de Tricerico, suffragant d’Acerenza, dans le royaume de Naples. Il a écrit sur l’Écriture Sainte un ouvrage resté manuscrit : Postilke super Sacra Biblia fere omnia. — Voir Échard, Scriptores ordinis sancti Dominici (1719), t. i, p. 806.
- AUGUSTA##
AUGUSTA (COHORTE) (o-mi’pr) Ssgaorr, ), nom de la cohorte à laquelle appartenait le centurion Julius, qui fut chargé de conduire saint Paul à Rome, lorsque l’Apôtre fut envoyé à César par le procurateur romain de la Judée, Portius Festus, en l’an 61. Act., xxvii, 1. — C’était une des cohortes auxiliaires recrutées dans les provinces, et qui se composaient de soldats armés en partie selon l’usage romain, en partie selon les coutumes locales des peuples parmi lesquels ces soldats étaient enrôlés. Voir Hassencam, De cohortibus Romanorum auxiliariis, Gcettingue, 1869. Les cohortes auxiliariæ ou socise se divisaient en quingenarise, de 500 hommes et 5 centuries, et millarias, de 1 000 hommes et 10 centuries ; quelques-unes se composaient exclusivement de fantassins (cohortes peditutss), d’autres avaient un renfort de cavalerie (cohortes equitatse ou équestres). Ordinairement les cohortes auxiliaires étaient commandées par un prœfectus, qui devait avoir été primipilus d’une légion. Quelques cohortes étaient commandées par un tribun égal en grade au tribunus legiouis. Au-dessous du préfet et du tribun étaient les centurions qui commandaient aux centuries comme dans les légions.
Les noms par lesquels se distinguaient ces subdivisions des troupes auxiliaires romaines contenaient, outre l’indication de la nation, par exemple, cohors Cyrenaica, cohors Lusitanorum, celle de la nature des forces de la cohorte, cohors peditata ou equitata, et quelquefois aussi celle de son fondateur, c’est-à-dire celle du chef qui l’avait organisée. À partir de l’époque de Caracalla, on
y trouve joint le nom de l’empereur régnant. Enfin on ajoutait aussi quelquefois une dénomination honorifique, telle que-Victrix, Veterana, Pia, Fidelis, Augusta. Le nom de cohorte Augusta que nous lisons dans les Actes des Apôtres, xxvii, 1, est donc un titre honorifique donné à cette cohorte auxiliaire pour quelque mérite spécial. Diverses cohortes auxiliaires portèrent le titre d’Augusta, comme nous le lisons dans les diplômes militaires recueillis dans le tome iii, part, ii, du Corpus inscriplionum
„62. — Soldat de la cohorte Ituréenne. Musée de Mayence. Pierre tumulaire, portant cette inscription : MONIMTJS JEEOMBALI F[ « ras] MILCes] COHCorfis] I ITVRAEOR[Mm’J ANNEoram] L, STIPlentUorum] XVI H[ic] 8[t*us] Etsfl. — Mouline est vêtu de la pcmula ; il tient trois flèches dans sa main droite et l’arc dans ea main gauche.
latinarum. L’une d’elles fut la Cohors 7° Augusta Iturseorum (fig. 362), mentionnée dans les diplômes militaires des années 80, 98 et 110 de notre ère. Corpus inscript, lat., t. iii, p. 854, 862 et 868. Or cette cohorte, comme son nom l’indique, fut recrutée dans l’Iturée, à l’est du Jourdain, et cette région, qui forma d’abord la tétrarchie de Philippe, fut donnée en 53, par l’empereur Claude, en même temps que la Chalcide, avec le titre de roi, à Hérode Agrippa II, fils d’Hérode Agrippa I er et arrière-petit-fils d’Hérode le Grand, celui-là même qui discuta à Césarée avec saint Paul devant Portius Festus. Act., xxvi, 1-29. On peut donc conclure que, selon toute probabilité, le centurion Julius, qui eut la charge de saint Paul pendant le voyage à Rome, appartenait à la cohorte des Ituréens, dont un détachement se trouvait peut-être à Césarée. C’est à tort que quelques savants ont pensé que la cohorte Augusta ou Sébasté était ainsi appelée parce qu’elle se composait de volontaires de la ville de Sébaste.
H. Marucchi.
- AUGUSTE##
AUGUSTE, surnom qui, à partir de l’an 726 de Rome, désigna officiellement Octave, et passa à ses successeurs dans le pouvoir suprême. Ainsi voyons-nous, Act., XXV, 21, 25, qu’il est donné à Néron par Festus.
Celui qui le porta le premier, Caïus Julius Cœsar Octa vianus Augustus (fig. 363), trouve sa place dans un dictionnaire biblique, puisque c’est sous lui que Notre-Seigneur Jésus-Christ naquit à Bethléhem. Luc, ii, 1. Fils de Caïus Octavius, de la gens Octavia et de l’ordre équestre,
Octave était, par sa mère Attîa et sa grand’mère Julia, petit-neveu de Jules César, qui l’éleva et l’adopta. Né en 691 de Rome, 63 avant J.-C, sous le consulat de Cicéron, il avait dixiieuf ans quand il apprit à Apollonie, où il étudiait l’éloquence, la fin tragique de son père adoptif. En toute hâte, il quitta la {îrèce pour courir à Rome revendiquer son héritage, et s’unir à ceux qui voulaient venger sa mémoire en poursuivant ses assassins. Nous n’entrerons pas dans les détails d’une vie qui appartient toute à l’histoire profane, et ne touche que par hasard à l’histoire sacrée. Qu’il suffise de rappeler qu’après avoir marché contre Antoine, pour l’obliger à lui restituer l’héritage de son oncle et à acquitter les legs
[[File: [Image à insérer]|300px]]
363. — Denier d’Auguste.
Tête laurée d’Auguste, h droite. — CAESAR AVGVSTVS. Bouclier rond, au centre duquel on lit les lettres CLT (Clypeus ToUrns}, À droite et à gauche, un laurier et lee lettres SPQR (_Senatus Populvsque Romanus).
qu’il avait faits au peuple, il trouva plus sage, sur l’avis de Pansa mourant, à Modéne, de faire la paix avec son rival vaincu, mais encore redoutable, par le concours que Lépide se disposait à lui prêter. Les trois généraux -s’entendirent donc pour former un second triumvirat, 43 avant J.-C. Ils se désignèrent eux-mêmes comme triumvirs réformateurs de la république, avec des pouvoirs consulaires. Les premiers résultats de cette alliance furent horribles. Les triumvirs se sacrifièrent mutuellement leurs parents et leurs meilleurs amis Octave donna la tête de Cicéron, en retour de celle du frère de Lépide et de l’oncle d’Antoine. Trois cents sénateurs et deux mille chevaliers furent massacrés. Après quoi les triumvirs marchèrent contre Cassiùs et Brutus, chefs du parli républicain, qu’ils écrasèrent à Philippes. Octave, retenu sous sa tente par une indisposition vraie ou fausse, n’avait pas pris part à la victoire ; mais il n’en eut pas moins le plus beau lot dans le partage de l’empire : on lui attribua l’Italie, les Gaules et l’Espagne. Son triomphe ne lui ôta rien de sa cruauté. Il avait voulu que la tête de Brutus fût jetée aux pieds de la statue de César ; il fit égorger les plus illustres d’entre les prisonniers, et distribua à ses vétérans les terres dont il dépouilla ses adversaires politiques. Enfin quelques guerres heureuses contre ceux qui voulaient faire obstacle à son accroissement l’amenèrent à priver de ses provinces le faible Lépide, qu’il réduisit à la dignité de grand pontife, et à entreprendre contre Antoine, qui avait outragé, en refusant de la recevoir, Octavie, sa femme, sœur d’Octave, une lutte ouverte et décisive. Il le défit à Actium, 31 avant J.-C ; et pour en finir, en demeurant seul maître de l’empire, il Je poursuivit jusqu’à Alexandrie, où le malheureux, entraîné par sa passion pour Cléopâtre, s’était réfugié. Bientôt il ne resta plus aucun espoir de salut à Antoine, qui se poignarda et assura ainsi l’omnipotence de son rival. Le sénat proclama Octave Empereur, Auguste, Préfet des mœurs, Consul à vie, et ainsi, sous des titres divers et avec les pouvoirs absolus qu’il sut concentrer successivement dans ses mains, on le laissa rétablir, sous un nom nouveau, le gouvernement monarchique, 27 avant J.-C. (fig. 364). Jamais on n’avait plus parlé de liberté, et jamais on n’alla plus vite au-devant de la servitude. Il faut dire qu’Octave sut y conduire avec une grande habileté ceux qui semblaient en avoir le plus horreur. On l’appela le Père de la patrie. À l’intérieur, il développa de sages institutions et assura la prospérité de l’empire, favorisant le3
lettres et les arts, transformant Rome, qu’il avait trouvée bâtie en briques, et que, selon sa propre expression, il laissa toute de marbre. On sait qu’Auguste a eu l’honneur de donner son nom à un des trois grands siècles de l’humanité. Au dehors, d’heureuses guerres avaient fini par assurer la tranquillité de l’empire, et, un an avant la naissance de Jésus-Christ, il put, pour la troisième fois depuis la fondation de Rome, fermer le temple de Janus, resté ouvert depuis deux cent cinq ans. On était arrivé à une des heures
36é. — Statue d’Auguste. Musée du Louvre.
les plus solennelles de l’histoire : le Messie allait naître dans une bourgade obscure de la Judée. Par un édit dont il sera parlé plus tard, voir Quirinius, Auguste prescrivit un recensement général de l’empire, et c’est par suite de cet édit, exécuté en Palestine vers la dernière amiée d’Hérode, que, Joseph et Marie s’étant transportés de Nazareth à Befhléhem, Jésus y vint au monde, accomplissant ainsi la célèbre prophétie messianique de Michée, v, 7. Déjà, et d’une manière plus directe, Auguste avait précédemment exercé son inlluence sur les affaires de Palestine. Après la victoire d’Actium, il avait couvert de son plus généreux pardon Hérode, qui s’était imprudemment attaché au parti d’Antoine. L’habile Iduméen, après son entrevue avec le nouveau maître du monde, s’était appliqué à capter toute sa confiance, et il y avait réussi, obtenant de lui de continuelles faveurs. Joséphe, Ant.jud., XV, V7, 5 ; vil, 3 ; x, 3. En revanche, il se montra le. plus flatteur de tous les rois vassaux de l’empire, fondant des villes auxquelles il donnait le nom d’Auguste, ainsi Sébaste et Césarée, et, tout roi des Juifs qu’il fut, allant jusqu’à bâtir à Panéas un temple en l’honneur de son tout-puissant bienfaiteur, Antiq., XV, x, 3. À la mort d’Hérode, an 4 de J.-C., Auguste, confirmant les dernières volontés du roi juif, partagea ses États entre ses enfants. Antiq., XVII, xi, 4. Il attribua la Judée, cf. Matth., ii, 22, l’Idumée et la Samarie à Archélaüs, avec le titre d’ethnarque, en lui promettant celui de roi quand il s’en serait rendu digne ; la tétrarchie de Galilée et de Pérée à Antipas, cf. Matth., xiv, 3 ; celle de Batanée et de Trachonitide à Philippe, cf. Luc, iii, 1 ; certaines villes importantes à Salomé. La dernière intervention d’Auguste dans l’histoire juive fut la déposition d’Archélaùs, qu’il exila dans les Gaules, et l’incorporation de ses États au gouvernement de Syrie, an 6 de J.-C. Josèphe, Ant. jud., XVII, xiii, 2. Le vieil empereur, dont les dernières années furent empoisonnées par des chagrins domestiques et des malheurs publics, finit sa vie, en l’an 13 de J.-C, à Noie, en Gampanie, le -19 août, mois de sextilis auquel il avait donné son nom {Augustus). Avant sa mort, il avait successivement vu disparaître tous ses enfants d’adoption, et s’était trouvé réduit à laisser le pouvoir suprême à Tibère, dont il détestait le caractère astucieux, dissimulé et cruel. Il avait soixante-seize ans. L’histoire de son règne nous a été racontée par Suétone, Les douze Césars ; Dion Cassius, livre, liii, 6 ; Velléius Paterculus, etc.
1. AUGUSTI Friedrich Albrecht, théologien protestant, né le 30 juin 1696 à Francfort-sur-l’Oder, mort le 13 mai 1782. à Eschenberg. Il était d’origine juive. Ses parents lui donnèrent, à la circoncision, les noms de Josué ben Abraham Eschel. Après avoir fait ses études à Bresci, en Lithuanie, il se rendit à Constantinople. Là il fut réduit en esclavage par les Turcs, puis racheté par un négociant polonais. Rendu à la liberté, il s’appliqua de nouveau aux études, d’abord à Cracovie, puis à Prague. Il fut converti au christianisme, en 1722, par le surintendant luthérien Reinhart, dont il avait fait par hasard la connaissance à Sondershausen. Après son baptême, il étudia de nouveau à Leipzig et à Gotha ; il devint, en 1734, pasteur à Eschenberg, dans le duché de Gotha, où il mourut à l’âge de quatre-vingt-cinq ans. On lui doit de bonnes apologies de la religion chrétienne contre les Juifs, et des ouvrages utiles : Fasciculus dissertationum de pontificatu Christi ; Dissertatio Ia de Adventus ejusdem necessitate tempore templi secundi, in-4°, Leipzig, 1729 ; De factis et fatis Abrahami, in-4°, Gotha, 1730 ; Aphorismi de studiis Judæorum hodiernis, in-4°, Gotha, 1731 ; Dissertationes historico-philologiæ in quibus Judæorum hodiemorum consuetudines, mores et ritus, tam in rébus sacris quam civilibus exponuntur, 2 fascicules in-8°, Erfurth, 1735 ; Geheimmisse der Juden von dem Wunderfluss Sambathion, wie auch von den rothen Juden zur Erläuterung II Reg., xvii, 6, in-8°, Erfurth, 1748 ; Beweiss dass der hebraïsche Grundtext des Alten Testaments unverfälscht sey, wider Schöttgen, in-4°, Darmstadt, 1748 ; Gründliche Nachricht von den Karaiten, in-8°, Erfurth, 1752 ; Erklärung des Buchs Hiob, in-8°, Erfurth, 1754. Il s’est attaché particulièrement à démontrer la vérité de la religion chrétienne aux Juifs ses anciens coreligionnaires. — Voir J. G. Meusel, Lexikon der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schrifsteller, 15 in-8°, Leipzig, 1802-1816, 1. 1, p. 117-119 ; Emst Friedrich und Anton Augusti, Nachrichten von dem Leben, Schicksalen und Bekehrung Friedrich Albrecht Augusti, Gotha, 1783.
2. AUGUSTI Johannes Christian Wilhelm, petit-fils du précédent, théologien protestant, né le 27 octobre 1772 à Eschenberg, mort à Bonn le 28 avril 1841. Il étudia la théologie à l’université d’Iéna (1790), puis enseigna les langues orientales dans le même établissement (1798). Il devint, en 1812, professeur de théologie à Breslau, passa en 1819, en la même qualité, à Bonn, où il resta jusqu’à sa mort. Dans son enseignement il se montra positivement croyant. C’est ce qui ressort de sa Dogmatik, in-8°, Leipzig, 1809 ; 2e édit., 1825 ; de son Lehrbuch christlichen Dogmengeschichte, in-8°, Leipzig, 1805 ; 4° édit., 1835, et de son Grundriss einer historich-kritischen Einleitung in’s Alte Testament, in-8°, Leipzig, 1806 ; 2e édit., 1827. Tout en revendiquant pour le théologien la liberté de la critique, il croit à l’Écriture comme à la parole de Dieu ; il est convaincu qu’elle n’a rien à redouter des investigations de l’esprit humain, qu’elle peut braver la critique la plus sagace et la plus pénétrante. Il a beaucoup écrit. Il doit sa renommée surtout à ses travaux sur les antiquités chrétiennes. Son principal ouvrage en ce genre a pour titre : Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie, 12 in-8°, Leipzig. 1817-1831 ; Die christliche Alterthümer, ein Lehrbuch fur akademischen Vorlesungen, in-8°, Leipzig, 1819 ; Sandbuch der christlichen Archäologie, 3 in-8°, Leipzig, 1836-1837. Outre son Introduction à l’Ancien Testament, il a publié : Versuch einer historich-dogmatischen Einleitung in die heiligen Schriften, in-8°, Leipzig, 1832 ; Apocryphi libri Veteris Testamenti, in-8°, Leipzig, 1804 ; J. G. Z. Berger’s Versuch einer praktischer Einleitung ins’ Alte Testament 4 Theile (3 t8r und 4 ter Band fortgesetzt von J. Chr. W. Augusti), 4 in-8°, Leipzig, 1799-1808 ; Die katholischen Briefe neu übersetzt und erklärt, mit Excursen und Abhandlungen, 2 in-8°, Lemgo, 1801 ; Rabbi Sal. Jarchi’s Ausfürlicher Conimentar ûber den Pentateuch, aus dem OriginalTexte zuerst in’s Deutsche ûbersetzt von Haymann, mit einer Vorrede Prof. Dr Augusti, in-8°, Bonn, 1833 ; — en collaboration avec de Wette, Commentar über die Psalmen, in-8°, Heidelberg, 1811 ; 2e édit., 1823 ; Die Schriften des Alten und Neuen Testament, neu übersetzt von. J. C. W. Augusti et W. M. L. de Wette, 6 in-8°, Heidelberg, 1809. Voir Herzog, Realencyclopädie, 2e édit., t. i, p. 777-779 ; Welte, Kirchenlexikon, 2e édit., t. i, col. 1655.
1. AUGUSTIN (Saint), Aurelius Augustinus, évêque d’Hippone et docteur de l’Église, né à Tagaste le 13 novembre 354, mort à Hippone le 28 août 430. Il avait été baptisé à Milan le 24 avril 387, ordonné prêtre en 391, et évêque en 395. C’est vers l’âge de dix-huit ans que saint Augustin, travaillé par le besoin de la vérité, lut pour la première fois la Bible, dont enfant il avait entendu sainte Monique, sa mère, lui vanter la beauté. Mais il ne l’étudia pas d’abord avec la simplicité de la foi. Devenu manichéen, pendant dix ans il accepta les calomnies que les sectateurs de Manès déversaient à plaisir sur le texte sacré : opposition de l’Ancien et du Nouveau Testament, langage indigne du principe bon, œuvre de l’esprit mauvais, etc. Saint Ambroise commença à dissiper les erreurs dont l’esprit d’Augustin était abusé ; la lecture des Épîtres de saint Paul, qui lui parurent combler les lacunes de la philosophie platonicienne sur le péché et la grâce, l’incarnation et la rédemption, acheva de donner au jeune Africain le goût des Écritures. Il doit être compté parmi les Pères latins qui ont le plus écrit sur la Bible. De sa conversion à sa mort, c’est-à-dire pendant près d’un demi-siècle, chaque année vit paraître un ou plusieurs nouveaux écrits exégétiques du saint docteur : traités, commentaires, lettres, sermons. Il cite les Écritures à tout propos ; avec ses seuls ouvrages, on pourrait reconstituer plus des deux tiers de la Bible. Orateur, il en fait goûter à son peuple les saintes beautés ; apologiste, il la défend avec succès contre les calomnies des manichéens et les objections des païens ; théologien et commentateur, il en développe admirablement la doctrine. Il n’avait lu que de très rares commentaires grecs ; l’Orient n’exerça à peu près aucune influence sur son génie original et toujours latin. Il se servit presque exclusivement dans ses écrits de l’ancienne
Vnlgate latine appelée l’Italique. Voir Italique (version). Son esprit, curieux et subtil, a plus d’une fois poussé trop loin la recherche du sens allégorique. Mais il ne méconnaît pas la valeur propre et la nécessité du sens littéral ou historique ; au contraire, il établit en principe qu’il doit passer en première ligne, sinon on ouvre la porte à l’esprit de système, on fournit le moyen d’éluder l’enseignement contenu dans la Bible.
On peut, en prenant pour base l’ordre méthodique combiné avec l’ordre chronologique (d’après les Bénédictins), distribuer les écrits exégétiques de saint Augustin ^ de la manière suivante :
I. Écrits des débuts. — Saint Augustin lui-même a ainsi caractérisé ses premiers écrits. Il ne conserva le De Genesi ad litteram imperfectus liber de l’année 393 que « comme un monument assez curieux à consulter de ses premiers essais dans l’étude et l’exposition des divins oracles ». (Retr., i, 18, t. xxxii, col. 613.) Aux débuts appartiennent : 1° De moribus Ecclesise catholicx et de moribus Manichœorum libri duo (387), t. xxxiii, col. 1309. Réfutation des calomnies des manichéens. Au livre I, chap. ix et chap. xvi, est un essai de concordance de l’Ancien et du Nouveau Testament, qui ont le même enseignement sur chacune des quatre vertus cardinales, la tempérance, la force, la justice, la prudence ; ces vertus sont décrites d’après les Écritures, les. Épltres d3 saint Paul surtout. On y remarque l’emploi du sens allégorique.
— 2° De Genesi contra Manichœos libri duo (vers 389), t. xxxiv, col. 173-220. C’est une explication des trois premiers chapitres de la Genèse, afin de répondre aux difficultés soulevées par les manichéens. Ce livre a été écrit à la hâte, avec le sentiment du sens littéral, mais en faisant un usage excessif du sens figuré. « Pour ne pas être retardé dans mon entreprise, dit saint Augustin, j’ai expliqué sommairement et avec toute la clarté possible le sens figuré des passages dont je n’ai pu trouver le sens propre. ». De Gen. ad litt., viii, 2, 5, t. xxxiv, col. 374.’— 3° De vera religione liber unus (390), t. xxxiv, col. 121-172. L’enseignement de la vraie religion dans l’Ancien comme dans le Nouveau Testament se recommande par son excellence, par l’harmonieuse ordonnance qu’elle leur emprunte (cap. xvif). Il faut donc méditer les Écritures, pour puiser en elles non la vérité qui passe, mais celle qui demeure. Le but de cette étude doit être de chercher sous l’allégorie et sous l’histoire, sous les figures et sous les faits, l’objet immuable de la toi. Mais il faut interpréter l’Écriture d’après le génie de la langue de l’Écriture (cap. l, col. 165). — 4° De utHitate credendi ad Honoratum liber unus (391), t. xlii, col. 65-92. Ordonné prêtre en 391, saint Augustin, dans une magnifique lettre à Valère, demanda du temps pour étudier les divines Écritures (Ep. xxi, t. xxxiii, col. 88). Le premier fruit de cette étude fut le De utilitale credendi. C’est une nouvelle défense de l’Ancien Testament contre les manichéens. On ne peut accepter les explications de l’Écriture que ses ennemis donnent. Le Nouveau Testament reçu des manichéens envisage l’Ancien sous quatre points de vue : l’histoire, l’étiologie, l’analogie et l’allégorie. C’est la clef de la solution de toutes les difficultés.
— 5° De Genesi ad litteram imperfectus liber (393), t. xxxiv, col. 219-246. Commentaire des vingt-six premiers versets de la Genèse. C’est un simple essai, contenant des explications allégoriques. — 6° Contra Adimantum Manichsei discipulum liber unus (394), t. xlii, col. 129-172. Saint Augustin, après avoir donné une réponse générale et de principe, aborde les réponses de détail aux attaques des manichéens, en rétablissant par les Écritures l’accord des deux Testaments par les passages de la Genèse, de l’Exode, du Deutéronome, du Lévitique, des Nombres, des Psaumes, des Proverbes et des prophètes Osée, Amos et Isaïe, qu’ils alléguaient à l’appui de leur système. — La fin de cette période des débuts se signale par un emploi fréquent de l’Écriture, dans la
correspondance, dans la prédication, dans la Disputa (392) avec le manichéen Fortunatus ; il est permis de penser qu’il la savait déjà en grande partie par coaur : Epist. xxii (392), t. xxxiii, col. 91-92 ; Epist. xxin (392), col. 91 ; .De duabus animabus contra manichseos (391), t. xlii, col. 93 ; Acta seu disputatio contra Fortunatum manichœum (28 août 392), t. xlii, col. 114.
II. Grands commentaires. — On entend ici par grands commentaires les commentaires de livres entiers de la Bible, ou de parties notables du même livre et formant une suite. On peut ranger dans cette catégorie : 1° De sermone Domini in monte secundum Matlhœum libri duo (393), t. xxxiv, col. 1229-1308. Le sermon sur la montagne occupe, dans saint Matthieu, les chapitres v, VI et vu : livre I er, explication du chap. v ; livre ii, explication des chap. vi et vu ; division quelque peu artificielle. L’auteur s’étend trop sur le sens allégorique, mais il a en même temps le souci du sens littéral. — 2° Epistolse ad Galatas expositionis liber unus (394), t. xxxv, col. 2105-2148. Commentaire littéral verset par verset, dans lequel il montre quels sont les rapports de la loi et de la foi. Saint Paul a eu raison de reprendre saint Pierre. — 3° Annotationum in Job liber unus (vers 400), t. xxxiv, col. 825-886. Annotations marginales du livre de Job, recueillies et publiées par les amis de saint Augustin, qui les trouvait fort obscures, à cause de leur laconisme. Le sens allégorique y est poussé trop loin, mais il y a encore ici le souci du sens littéral. Cet ouvrage, bien que ne renfermant que des notes fugitives, fut recherché ; de nombreuses copies s’en répandirent. — 4° Enarrationes in Psalmos (404 [ ?]-416), t. xxxvi, col. 67-1967. C’est un commentaire des Psaumes en partie dicté, en partie prêché dans des discours prononcés devant le peuple. Le commentaire dicté est plus bref que le commentaire parlé. Le rriême Psaume a souvent fourni la matière de plusieurs discours. Après le sens littéral, le saint docteur recherche le sens ou les sens spirituels, qu’il applique le plus souvent à Notre -Seigneur. Il a grand soin de suivre le texte le plus pur.
— 3° De Genesi ad litteram libri duodecim (415), t. xxxiv, col. 245-486. Livres i à xi, commentaire des trois premiers chapitres de la Genèse ; livre xli, ravissement de saint Paul au troisième ciel, divers genres de visions. C’est un des principaux commentaires de saint Augustin ; il y donne les règles du sens allégorique, mais il y expose aussi le sens littéral ou historique ; les rapports de la Bible et de la science ; leur accord en principe ; le commentateur ne doit émettre aucune opinion qui ne soit certaine ; il lui faut une grande prudence scientifique. C’est pour avoir suivi trop à la lettre le texte sacré que saint Augustin a cru à un premier jour type de vingt-quatre heures. Cependant sur ce point sa pensée est parfois flottante. — 6° In Joannis Evangelium tractatus centum viginti quatuor (416-417), t. xxxv, col. 137$1-$2976. C’est une explication de l’Évangile de saint Jean faite du haut delà chaire, riche en applications morales, d’après le sens allégorique, mais souvent aussi d’après le sens littéral, déterminé par le langage certain de l’Écriture. À citer le n. 2 du Traité x, où saint Augustin donne d’une manière remarquable l’explication du mot « frères », appliqué aux cousins de Notre - Seigneur. — 7° In Epistolam Joannis ad Parlhos tractatus decem (416, semaine de Pâques), t. xxxv, col. 1977-2062. Explication de la première Èpître de saint Jean donnée au peuple et du haut de la chaire, * saint Augustin s’est attaché à exposer l’enseignement sur le Verbe et la charité divine contenu dans cette Épltre. Ce commentaire est surtout moral.
III. Petits commentaires et questions exégétiques. — Sous ce titre on peut ranger : 1° Expositio quarumdam propositionum ex Epistola ad Romanos liber unus (vers 394), t. xxxv, col. 2063 - 2088. Ce sont des réponses improvisées à des questions soulevées dans une lecture de cette Épltre faite en commun. L’auteur montre quel est
t’t
le rapport de la loi et de la grâce. La doctrine a une saveur pélagienne, corrigée plus tard par saint Augustin lui-même. — 2° Epistolee. a) Lettres à saint Jérôme, Epist. xxviii (394 ou 395), t. xxxiii, col. 111 ; Eplst. xl (397), col. 154-158 ; Epist. lxxi (403), col. 241 ; Epist. lxxiii (403), col. 245-250 ; Epist. lxxxii (404), col. 276291 ; Epist. clxvii (415), col. 733-741. Les quatre premières lettres se réfèrent à deux points : 1° les traductions hiéronymiennes ; saint Augustin essaye de dissuader saint Jérôme de traduire sur l’hébreu ; 2° le sens du passage de VÉpîtve aux Galates, où saint Paul raconte qu’il avait repris saint Pierre ; saint Augustin tient que saint Pierre avait failli et qu’il fut repris justement. Dans la cinquième lettre, saint Augustin demande l’explication du ꝟ. 10, chap. ii, de l’Épître de saint, lacques : « Qùicumque enini totam legem servaverit, offendat autem in uno, faclus est omnium reus. » — b) À saint Paulin, Epist. CXLix (414), t. xxxiii, col. 630-645, sur les Psaumes (Ps. xv, 3 ; xvi ; lviii, 12 ; lxvii, 22), sur les Épilres de saint Paul (Eph., iv, 11 ; I Tim., ii, 1 ; Rom., xi, 2, col. 11, 16) et sur les Évangiles (Joa., xx, 17 ; Luc, ii, 34). Explication savante et iugénieuse. — c) À Évodius, Epist. clxiv (415), t. xxxiii, col. 709 : 1° sur IPetr., iii, 18 ; 2° sur la délivrance des justes par la descente de l’âme de Jésus-Christ aux enfers. Quels justes ? Adam, certainement les patriarches, probablement les philosophes qui ont approché de la vérité sans l’atteindre. — d) À Hésychius, Epist. cxcvii (vers 418), Epist. cxcix (419), t. xxxiii, col. 901. Hésychius, évêque de Salone en Dalmatie, croyant à la fin prochaine du monde, y appliquait la prophétie des Semaines de Daniel. Saint Augustin tient qu’elle a eu avec la mort de Jésus-Christ son entier accomplissement. Etc. — 3° De diversis quiestionibus ad Simplicianum libri duo (397), t. xl, col. 101-148. Ces questions étaient peu importantes et’d’une solution facile. — 4° Queestionum Evangeliorum libri duo (400), t. xxxv, col. 13211364, sur les Évangiles de saint Matthieu et de saint Luc. C’est un commentaire le plus souvent allégorique. — 5° Qusestionum in Heptateuchum libri septem (vers 419’, t. xxxiv, col. 547-824. Saint Augustin donne des réponses rapides, destinées à servir com me de mémento. Il s’attache au sens littéral et fait souvent de la critique textuelle.
IV. Texte et critique textuelle. — On peut ranger sous ce titre : 1° De consensu Evangelistarum libri quatuor (vers 400), t. xxxiv, col. 1041-1230. C’est un des plus importants écrits exégétiques de saint Augustin. II y mit tous ses soins. Livre 1 er, autorité du témoignage des évangélistes, en réponse aux païens prétendant qu’ils avaient ajouté aux doctrines du Sauveur. Livre ii, accord des évangélistes, saint Matthieu étant pris pour base, de la naissance du Sauveur à la Cène. Saint Augustin pose les règles permettant d’établir scientifiquement cet accord. Livre iii, accord des évangélistes de la Cène à la fin. Les quatre Évangiles sont à peu prés fondus eu un seul récit : saint Augustiu ne dit guère que ce qui est nécessaire pour relier les faits. Livre iv, accord des évangélistes sur quelques faits particuliers dans saint Marc (i à vu), dans saint Luc ( vm et ix) ; x, ce que saint Jean ajoute à saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. — 2° Scripturee Sacrée locutionum libri septem (vers 419), t. xxxiv, col. 485-546. Saint Augustin relève, en faveur des Latins, les idiotismes des langues hébraïque et grecque qui se trouvent dans l’Heptateuque. Il en a noté sept cent vingtsix. Plusieurs de ces locutions sont contestables. — 3° Spéculum liber unus (427), t. xxxiv, col. 887-1040. C’est une collection de nombreux extraits de l’Ancien et du Nouveau Testament d’après la traduction de saint Jérôme, où sont exposés les principes universels et immuables de la conscience chrétienne. Saint Augustin n’avait cessé de préconiser la lecture des Écritures. À la fin de sa vie, il a voulu mettre entre les mains de tous un recueil biblique, où chacun put se voir comme dans un miroir.
V. Règles d’interprétation. — De doctrina christiana.
libri quatuor (426), t. xxxiv, col. 15-122. Saint Augustin, synthétisant dans cet ouvrage, commencé en 397 et terminé en 426, sa longue expérience comme exégète, y a donné les règles d’interprétation, qui se ramènent à deux points : comprendre et expliquer. L’amour de Dieu et du prochain est la plénitude, la fin des Écritures, pour l’intelligence desquelles il faut donc avoir une grande pureté de vie. L’intelligence des livres canoniques, énumérés livre ii, chap. viii, nécessite la connaissance des langues, grecque et hébraïque surtout, de l’histoire, des sciences naturelles, de la dialectique, des arts, des institutions, des mœurs particulières et locales. Autant que possible, il convient d’expliquer la Bible par la Bible, les expressions obscures ou ambiguës par les passages clairs, etc. Au livre iii, chap. xxx, saint Augustin analyse les sept règles de Tichonius, qui sont des plus utiles. L’exégète doit, pour expliquer les Écritures, parler une langue toujours claire, dans le seul but de faire connaître la vérité révélée.
Voir Gastius Brisacensis, D. Aurelii Augustini, Hipponensis Episcopi, tam in Vêtus quam in NoVurn Testanientum commentarii, ex omnibus ejusdem lucubrationibus passim in ordinem utriusque capitum, 2 in-f’, Bâle, 1542 ; Lenfant, Biblia Augustiniana, sive Collectio et explicatio omnium locorum Sacrée Scripturee, qux sparsim reperiuntur in omnibus sancti Augustini operibus ordine Biblico, ’iin-f a, Paris, 1661 ; Bindesboll, Augustinus et Hieronymus de Scriptura Sacra ex hebrseo inlerpretanda disputantes, in-8°, Copenhague, 1825 ; Clausen, Aurelius Augustinus Scripturee Sacrée interpres, in-8°, Copenhague, 1822 ; Motais, L’école éclectique sur l’Hexaméron mosaïque, Saint Augustin, dans les Annales de philosophie chrétienne (1885), t. xii, p. 174-191, 286301, 375-390 ; xiii, 65-78, 159-172 ; Overbeck, Aus dem Briefwechsel des Augustin mit Hieronymus, dans Sybel, Historische Zeitschrift (1879), t. vi, p. 222-259 ; Possidius, Sancti Augustini episcopi vita, dans l’édition des Bénédictins ; J. J. B. Poujoulat, Histoire de saint Augustin, sa vie, ses œuvres, 3 in-8°, Paris, 1844 ; 2 in-8°, Paris, 1852 ; Bindemann, Der heil. Augustinus, 3 in-8°, Leipzig, 1854-1869. C. Douais.
2. AUGUSTIN D’ARCOLI (d’Ascoli, de Asculo), religieux augustin, florissait vers 1385. Il a écrit : Super Evangelia dominicalia ; Super Genesim qusedam rnoralia ; Lectiones in universam Scripturam. Au commencement de ce siècle, ses ouvrages se trouvaient manuscrits dans les bibliothèques de Bologne, de Padoue et de Florence. — Voir Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée
(1822), t. iii, p. 213.3. AUGUSTIN DE BASSANO Jean, de l’ordre de Saint -Augustin, né en 1488, mort à Bergame le 10 janvier 1557. Il est quelquefois appelé Augustinus Bassianus ou Bassanensis. Il a laissé un commentaire sur les Épîtres
de saint Paul à Timolhée.4. AUGUSTIN DE VIGUERIA, capucin de la province de Gênes, mort au couvent de Casai en 1617, a laissé, entre autres ouvrages : 1° Lectiones 37 super visionem scalee Jacob ; 2° Conceptus scripturales et morales super Missus est ; 3° Conimentaria scripturalia et moralia super Threnos Jeremiee. Le P. Lelong cite ces titres dans sa Bibliothèque sacrée, et Sbaraglia dit que ces ouvrages sont conservés en manuscrit chez les Capucins de Gênes.
P. Apollinaire.
5. AUGUSTIN SUPERBI. Voir SUPERBI.
- AUMÔNE##
AUMÔNE, secours matériel donné aux pauvres.
I. Aumône chez les Hébreux. — Ils avaient deux catégories d’aumônes : les unes étaient déterminées, au moins quant à l’espèce et aux principales circonstances, far exemple, le glanage des épis réservé aux indigents, etc. j
les autres étaient indéterminées, soit quant à l’espèce, soit quant à la manière ; c’étaient des libéralités, que les Juifs faisaient comme ils voulaient et quand ils voulaient, en argent, nourriture, vêtements, etc. La distinction entre les aumônes venait donc, non de l’obligation, qui était la même pour les deux catégories, mais du degré de détermination.
1 o À VMONES DÉTBSMIlfÉES PAS LA LOI DE MOÏSE. — Les
principales sont les suivantes :
1. La réserve d’un petit coin dans chaque champ. — Le précepte en est porté Lev. xix, 9 (et. xxiii, 22), dont le sens est, d’après l’hébreu : « Lorsque vous ferez la moisson, vous n’irez pas tout à tait jusqu’à l’extrémité de votre champ, mais vous en laisserez une petite partie… pour les pauvres et les étrangers. » La traduction de ce passage, dans la Vulgate, est un peu obscure ; aussi saint Jérôme a - 1 - il eu soin d’en expliquer le sens d’après l’hébreu. Divina biblioth., in Lev., xix, t. xxviii, col. 323. Cette partie, réservée aux indigents, est appelée « angle » ou « coin », parce qu’ordinairement elle devait être à l’extrémité du champ, afin que les pauvres ne pussent s’y méprendre. Ce point est l’objet d’un traité spécial dans la Mischna, tr. Pê’âh, édit. Surenhusius, Amsterdam, 1698, part, i, p. 37-75, qui a été longuement commenté, soit par un disciple de Juda le Saint, auteur de la Mischna, sous le titre de Tosafâh, ou Addition au traité Pê’âh (traduite et imprimée par Ugolini, dans son Thésaurus antiquilatum sacrarum, Venise, 1757, t. xx, p. 55-78), soit par Bartenora et Maimonide, dont on peut voir les savants commentaires à l’endroit cité de Surenhusius. Maimonide en traite aussi longuement dans son ouvrage De jure pavtperis et peregrini, traduction latine de Prideaux, Oxford, 1679, c. i, p. 2-8. D’après le texte mosaïque, aucune mesure n’est fixée pour ce petit coin de terre qu’on doit laisser aux pauvres, si bien que Maimonide va jusqu’à dire qu’à la rigueur un Juif peut satisfaire à la loi en laissant un seul épi debout à l’extrémité de son champ. Mais peu à peu la tradition juive en détermina la mesure ; d’après le tr. Pë’âh, i, 2, le petit coin doit correspondre à la soixantième partie du champ. Quoique le texte sacré, Lev., xix, 9, ne parle que de « moisson », cependant il fut appliqué peu à peu à toute espèce de récolte pouvant servir à la nourriture de l’homme. Tr. Pê’âh, I, 4. Cf. Hottinger, Juris Hebrœorum leges, lex 213, Zurich, 1655 ; p. 314-317 ; Leydekker, De republica Hebrseorum, Amsterdam, 1704, p. 669 ; Selden, De jure naturali, Wittemberg, 1770, VI, VI, p. 724-725.
2. Le glanage et autres droits similaires. — Les épis qui échappent à la faux des moissonneurs, ou tombent des mains de ceux qui lient les gerbes, appartiennent aux pauvres, Lev., xix, 9 ; xxiii, 22 ; les grappes qui restent après la vendange ou les grains qui tombent, sont la propriété du pauvre. Lev., xix, 10 ; Deut., xxiv, 21. Si, pendant la moisson, le propriétaire du champ laisse une gerbe par oubli, il lui est défendu de retourner à son champ pour reprendre cette gerbe ; il doit la laisser aux pauvres, Deut., xxiv, 19 ; quand on fait la récolte des olives, s’il en reste sur l’arbre après la cueillette, elles sont pour les pauvres. Deut., xxiv, 20. Pour ces aumônes spéciales, aucune quantité n’était et ne pouvait être fixée ; mais nous voyons, par l’exemple de Booz, que les Juifs bienveillants laissaient tout exprès des épis dans leurs champs ou des raisins dans leurs vignes, pour rendre plus abondante la part du pauvre. Ruth, ii, 15-16.
3. Les privilèges des années sabbatique et jubilaire. — Pendant l’année sabbatique, qui revenait tous les sept ans, on ne semait pas la terre et on ne taillait pas les vignes ; c’était le repos de la terre, comme le sabbat était le repos de l’homme. Les fruits spontanés de la terre ou des vignes ne devaient pas être recueillis par le propriétaire sous forme de moisson ou de vendange, car ils appartenaient à tous indistinctement ; c’était, pour cette année, la com munauté des fruits. Lev., xxy, 4-6. Or il est évident que ceux qui profitaient le plus de cette communauté, c’étaient les pauvres et ceux qui n’avaient ni champ ni vigne ; car les propriétaires avaient fait leurs provisions les années précédentes, et surtout la sixième, que Dieu s’était engagé à favoriser d’abondantes récoltes. Lev., xxv, 20-21. Aussi tous les auteurs signalent le sabbat de la septième année comme une précieuse ressource pour les pauvres. Michælis, Mosaisches Recht, § 143, t. ii, p. 475. Les prescriptions de l’année sabbatique s’appliquent également à l’année jubilaire, qui revenait tous les cinquante ans. Lev., xxv, 10-11.
4. La dîme des pauvres. — Elle est prescrite Deut., xiv, 28, et xxvi, 12 ; il en est encore question dans le livre de Tobie ; i, 6-8 ; Josèphe la mentionne expressément parmi les préceptes divins. Antig jud., IV, viii, 22. Elle était appelée la « troisième dîme », parce qu’elle venait après deux autres dîmes, l’une payée chaque année aux lévites, l’autre offerte à Dieu dans le lieu même du tabernacle ou du temple, pour être employée surtout en fêtes religieuses. Voir Dîme. D’après le texte même du Deutéronome, xiv, 28, la « troisième dime » n’était payée que tous les trois ans. Quelques auteurs ont cru que, l’année de son échéance, cette dime était surajoutée aux deux autres, en sorte que cette année-là on devait payer trois dîmes ; mais, d’après l’opinion de beaucoup la plus probable, la dîme dont nous parlons n’était pas surajoutée aux deux autres, mais substituée à la seconde, qui n’avait pas lieu cette année-là. Cette opinion, plus raisonnable, est soutenue par Selden dans une dissertation De decimis, que Jean Leclerc a annotée et imprimée à la fin de son commentaire In Pentateuchum, Amsterdam, 1710, t. ii, p. 629-630 ; par Carpzov, De decimis, dans son Ap par atus historico-criticus antiguitatum, etc., Leipzig, 1748, p. 621-622 ; par Rosenmûller, Scholia in Vêtus Testamenlum, in Deut., xxvi, 12, Leipzig, 1824, t. iii, p. 580-581, et surtout par J. C. Hottinger, qui a dégagé cette opinion de toutes ses difficultés et l’a mise en pleine lumière, dans son traité De decimis, exercit. viii, 12, imprimé dans Ugolini, Thésaurus, t. xx, p. 442-449. Cette « troisième dime » est surtout appelée la « dîme des pauvres ». D’après saint Jérôme, c’était là son nom usuel. In Ezech., xlv, 13, t. xx, col. 451. Cette dîme, comme les deux autres, était levée, sans aucune distinction, sur tous les fruits de la terre et des arbres.
La loi qui formule les quatre espèces d’aumônes que nous venons d’exposer nous signale aussi les personnes qui y ont droit, Deut., xiv, 29, et xxv, 12 ; elle signale « le lévite, l’étranger, la veuve et l’orphelin ». Cette expression « la veuve et l’orphelin » n’est qu’une paraphrase pour signifier « les pauvres » en général, qui sont, en effet, désignés par le nom collectif, ’ânî, Lev., xix, 10, et xxiii, 22 ; par le « lévite » dont il est question, il faut entendre le lévite pauvre, tel qu’il s’en rencontrait un grand nombre en Palestine, dans les régions où les récoltes, et par conséquent les dîmes, étaient moins abondantes ; on appelait « étranger », gêr, quiconque ne descendait pas de la famille de Jacob ou d’Israël.
Les aumônes dont nous venons de parler étaient fixées par la loi, et précisées jusqu’à un certain point ; les pauvres pouvaient les réclamer, même par le recours à la justice, et les récalcitrants pouvaient être punis de certaines peines. C’est ce qui suivait naturellement de la loi, et ce qu’affirment les rabbins et les commentateurs les plus au courant des traditions judaïques sur ce point. Maimonide, De jure pauperis et peregrini, c. i, p. 4 ; Hottinger, De decimis, p. 451 ; Selden, De jure naturse, p. 728, 732. Nous avons donc ici une espèce de « taxe » des pauvres ; mais la taxe hébraïque, par la manière même dont elle était perçue, échappait aux deux graves inconvénients des taxes de ce genre ; ces inconvénients sont : 1. de transformer en impôt payé à l’État le devoir de l’aumône, et ainsi d’étouffer dans les individus le sen
timent de la bienveillance et de la charité ; 2. de ne faire parvenir l’argent au pauvre que par une multitude d’intermédiaires, et ainsi de faire subir aux sommes qui lui sont destinées des déchets très considérables, comme on le voit, par exemple, aujourd’hui en Angleterre ; Taparelli, Essai de droit naturel, traduction française, Paris, 1883, t. i, p. 326 et suiv. ; t. ii, p. 305-396 ; les Israélites ont évité ce double écueil : ils remettaient directement leur aumône entre les mains du pauvre ; les aumônes n’étaient pas déterminées quant à la quantité, mais seulement quant à l’espèce et à un certain minimum ; la bienveillance des Juifs était plutôt dirigée que gênée, plutôt excitée que comprimée ; même pour le payement des dîmes, on s’en remettait à l’appréciation de chacun ; on exigeait seulement de lui qu’il déclarât devant Dieu qu’il avait consciencieusement payé ce qu’il croyait devoir sous ce rapport, et qu’il n’avait rien détourné en d’autres usages. Deut., xxvi, 13-14.
En terminant cette énumération des aumônes plus ou moins dues aux pauvres, signalons le privilège dont il est question Deut., xxiii, 24-25 : « Quand vous entrerez dans la vigne de votre prochain, vous pourrez manger des raisins autant que. vous voudrez ; mais vous n’en emporterez point avec vous ; si vous entrez dans la moisson de votre prochain, vous pourrez cueillir des épis et les frotter dans la main, pour les manger ; mais vous n’en pourrez couper avec une faucille. » Cf. Matlh., xii, 1. Quoique général, ce privilège évidemment profitait surtout aux pauvres, auxquels il pouvait offrir une précieuse ressource. Cf. Menochius, De republica Hebrseorum, Paris, 1648, p. 472 ; Michælis, Mosaisches Recht, § 161, t. iii, p. 122-127.
2° À umones imdêtebminêes. — 1. Leur nom. — L’aumône dont il s’agit ici est appelée par les commentateurs juifs sedâqàh, dont le sens original est « justice », du verbe hébreu sâdaq, « être juste. » Tous les rabbins sont unanimes à donner ce nom à l’aumône ; on peut le constater dans Buxtorf, Lexicon chaldaicum, talmudicum, Bàle, 1642, p. 1891. Elle est ainsi appelée par une dérivation naturelle du sens primitif de la racine. Ce nom de « justice » est aussi donné à l’aumône par la Sainte Écriture. Quelques auteurs protestants l’ont nié : par exemple, Prideaux, dans ses notes sur Maimonide, De jure pauperis, c. x, not. 3, p. 106 ; Carpzov, dans une dissertation spéciale, De eleemosynis Judseorwm, insérée dans son Apparatus, p. 728-742, On devine la raison qui a engagé ces auteurs dans cette interprétation : c’est leur opinion dogmatique sur les bonnes œuvres (parmi lesquelles se trouve spécialement l’aumône), dont ils rejettent la nécessité pour la justice et le salut ; or ce nom de « justice » donné à l’aumône par l’Esprit-Saint leur a paru peu conforme à leur opinion. Quoi qu’il en soit de cette raison, il parait incontestable que le mot sedâqâh signifie quelquefois « aumône », même dans la Sainte Écriture. Dan., iv, 24 {sidqâh. Cf. Gesenius, Thésaurus, p. 1151).
2. Obligation de ces aumônes. — Le précepte en est porté clairement Deut., xv, 11 : « Les pauvres ne manqueront jamais parmi vous ; voilà pourquoi je vous commande d’ouvrir vos mains à votre frère pauvre et dénué, qui demeure avec vous dans votre pays. » Cf. Deut., xv, 7-8 ; Lev., xxv, 35. Les rabbins ont entendu rigoureusement ce précepte ; Maimonide enseigne « que les Juifs sont obligés d’être plus soigneux dans l’observation de ce précepte que dans celle de tous les autres préceptes affirmatifs, parce que l’aumône est le caractère distinctif des vrais enfants d’Abraham ». De jure pauperis, c. vii, §§1, 2, p. 70 ; c. x, § 1, p. 99. Ils ont entendu l’obligation de tous les pauvres, non seulement Juifs, mais même Gentils ; ils ont même ajouté à la loi une sanction, consistant dans une flagellation infligée au Juif avare qui refuserait de donner aux pauvres. Ibid., c. vii, § 10, p. 73. Bloch, La foi d’Israël, Paris, 1859, p. 329-338, donne un recueil intéressant des principaux passages de la Mischna et de la Ghemara qui regardent l’aumône.
3. Collecteurs d’aumônes. — Pendant de longs siècles, les Juifs donnèrent eux-mêmes leurs aumônes ; mais, lors de la captivité de Babylone ou immédiatement après, soit à cause du plus grand nombre de pauvres, soit à cause du refroidissement des Juifs dans leurs libéralités, les aumônes ne furent plus suffisantes ; alors on établit des collecteurs ou quêteurs qui, par leur demande ou même leur seule présence, pussent stimuler la charité de leurs compatriotes. Telle est, chez les Juifs, l’origine des « collecteurs d’aumônes », d’après Vitringa, De synagoga veteri, Franeker, 1696, lib. iii, part, i, c. 13, p. 8Il et suiv. ; Carpzov, De eleemosynis Judseorum, p. 745. Cette opinion sur l’origine relativement récente de ces quêteurs est confirmée par le nom de gabbâ’ï sidqâh, « collecteurs d’aumônes, » qui leur fut donné ; ce mot, étant araméen, suppose une époque postérieure à la captivité. Or il y avait des quêtes de deux espèces ; les unes se faisaient toutes les veilles des sabbats au soir ; les offrandes se recueillaient dans une petite boîte ou cassette, appelée qufâh : c’était l’aumône « de la cassette » ; on recueillait surtout de la monnaie, et on la distribuait ensuite aux pauvres, de manière que, jointe aux autres secours, elle pût suffire pour la semaine ; les autres quêtes se faisaient chaque jour, de maison en maison ; on recueillait sur un plat, tamhûï, les morceaux de pain ou de viande, les fruits ou autres aliments, et même de l’argent : c’était l’aumône « du plat ». Suivant l’opinion qui paraît la mieux appuyée, les collecteurs étaient, non pas des fonctionnaires publics, mais de simples particuliers qui acceptaient librement ces fonctions charitables ; du reste l’autorité suprême sur ces aumônes résidait, non dans la synagogue, mais dans le sanhédrin local, qui toutefois agissait de concert avec le Chef de la synagogue. Vitringa, De synagoga veteri, Franeker, in-4°, 1696, p. 814 ; Carpzov, De eleemosynis Judseorwm, p. 746. D’après ces auteurs, fondés sur le témoignage du Talmud et des rabbins, les destinataires des deux espèces de quêtes étaient différents ; les aumônes « de la cassette » étaient destinées aux pauvres domiciliés dans la localité ; celles « du plat » étaient pour tous les autres pauvres de passage dans la ville, quels qu’ils fussent, Juifs, prosélytes de justice ou de la porte, ou même païens. Vitringa ajoute que, depuis l’époque de la dispersion des Juifs, on prélevait sur les aumônes « de la cassette » une certaine part, qui était envoyée à Jérusalem pour les pauvres’de la Palestine. Le rabbin Léon de Modène, Cérémonies et coutumes des Juifs, Paris, 1681, p. 45, dit que cela se faisait encore de son temps, c’est-à-dire au xvil" siècle. La « cassette » en usage dans ces quêtes était mobile et portée à la main par les collecteurs à travers les rues de la localité ; elle différait donc essentiellement de ces troncs (xopgavSç) que l’Évangile, Matth.^ xxvii, 6, nous signale dans le temple de Jérusalem ; la destination n’était pas non plus la même : l’argent jeté dans les troncs était généralement destiné, non pas aux pauvres, mais aux différents services du temple.
4. Manière de faire l’aumône. — Il faut la faire en secret ; c’est une des recommandations les plus pressantes des rabbins. D’après Maimonide, De jure pauperis, c. x, § 8, p. 102, un des degrés les plus parfaits de l’aumône consiste en ce que celle-ci est tellement cachée, que le bienfaiteur ne sait où elle va ni le pauvre d’où elle vient. Le Talmud va plus loin ; le rabbin Jannai, ayant vu un Juif faire l’aumône publiquement, lui dit : « Il vaut mieux ne pas faire l’aumône que de la faire ainsi ; » un autre rabbin disait : « Celui qui fait l’aumône en secret est plus, grand que Moïse lui-même, notre maître. » Le Talmud de Babylone, traités Biagîgâh et Baba’Bafrâ’, dans. Lightfoot, Horee hebraicse, Leipzig, 1675, in Matth., vi, 1, 2, p. 289, 292. Cf. Schœttingen, Horse hebraicse, , Leipzig, 1733, in Matth., vi, 1, p. 50 et suiv. Ce n’est là, on le voit, qu’un faible essai à Côté de l’énergique parole de Jésus-Christ dans l’Évangile : « Quand vous faites l’aumône, n’allez pas sonner de la trompette devant vous, .
comme font les hypocrites… ; mais, quand vous faites l’aumône, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite, afin que votre aumône soit faite en secret ; et votre Père, qui voit dans le secret, vous en donnera la récompense. » Matth., vi, 2-4. Il faut faire l’aumône d’une manière prévoyante et opportune : si le pauvre a faim, qu’on le nourrisse ; s’il est nu, qu’on le couvre ; s’il est captif, qu’on le visite ou qu’on le délivre, etc. Carpzov, De eleemosynis, p. 745 ; Bloch, La foi d’Israël, p. 332. Quant aux aumônes demandées publiquement par les pauvres eux-mêmes, c’est-à-dire la mendicité, voir ce mot.
5. Bienveillance spéciale à l’égard des pauvres. — La Bible recommandait instamment aux Juifs la bienveillance envers les pauvres ; voulant resserrer de plus en plus les liens qui doivent unir ces deux parties de la société, les riches et les pauvres, Moïse désirait que les Hébreux invitassent quelquefois les pauvres à leurs repas. C’est ce qui devait se faire particulièrement dans la ville qui serait le centre du culte ; d’après Deut., xiv, 22-27, chaque chef de famille israélite était tenu d’y porter une seconde dîme en nature ou en argent ; cette dime devait être employée surtout en festins religieux. Or c’était à ces festins que les Juifs devaient inviter soit les lévites, soit les pauvres. Deut., xii, 5-6, 12, 17-18 ; xiv, 22-27 ; xvi, 6, 11-14. Cf. Rosenmûller, In Deut., xii, 7 ; xiv, 22, p. 517-518, 525 ; Michælis, Mosaisches Recht, § 143, t. ii, p. 476-479.
Il est digne de remarque que les Arabes ont sur l’aumône une législation tout à fait semblable à celle des Juifs : même distinction entre les aumônes légales et les aumônes volontaires ; même nom, sadaqatun, « justice, » donné aux aumônes ; "même obligation de prélever l’aumône sur tous les fruits de la terre, des arbres, des animaux, etc. Voir G. Sale, Observations sur le makométisme, dans Pauthier, Les livres sacrés de l’Orient, Paris, 1841, p. 507. Mahomet s’est empressé de consigner et de préciser ces traditions dans le Koran ; voir surtout les passages suivants : ii, 211, 255, 266, 269-275 ; iii, 86, 128 ; IX, 60, 68, 99-100 ; xxx, 38 ; lvii, 7, 10 ; lviii, 13-14 ; lxiii, 10 ; lxiv, 16-17. Plusieurs de ces versets sont tellement semblables à ceux que nous avons cités du Lévitique ou du Deutéronome, qu’évidemment l’auteur du Koran les a copiés dans la Bible.
II. Aumône chez les chrétiens. — Par quelques mots, JésusChrist transporta l’aumône comme dans un monde nouveau, et offrit à ses disciples, pour les porter à secourir les pauvres, un motif d’une élévation et d’une efficacité prodigieuses ; il déclara qu’il regarderait comme fait à lui-même tout ce que l’on ferait, pour l’amour de lui, au plus petit des siens. Matth., xxv, 34-45 ; cf. x, 42 ; xviii, 35 ; Marc, ix, 48. Ce fut là le grand et principal mobile de toutes les manifestations de la charité chrétienne dans tous les temps et chez tous les peuples. Voir saint Jean Chrysostome, De pcenitentia, Hom. vii, 7, t. xlix, col. 334-336 ; In Matth., Hom. lxvi et lxxix, t. lviii, col. 629, 718.
1° Noms de l’aumône dans le Nouveau Testament. — Les paroles citées de Notre -Seigneur donnèrent, dès le commencement de l’Église, la plus haute idée de l’aumône. Outre son nom ordinaire, èXe^tio^ivri, eleemosyna, que nous trouvons Act., xxiv, 17, et d’où vient notre mot « aumône », on lui en donna plusieurs autres qui font bien ressortir son caractère, pour ainsi dire, sacré. Jésus-Christ lui-même l’appelle quelquefois, comme les Juifs d’alors, sidqâh, c’est-à-dire « justice ». Lorsqu’il prononça sur l’aumône les paroles que nous lisons Matth., VI, 1-4, il n’y a pas de doute qu’il ne l’ait appelée, suivant l’usage du temps, de son nom araméen ; car il n’y a pas dans cette langue d’autre nom pour désigner l’aumône, et c’est ce même mot sidqâh que nous retrouvons dans la Peschito aux versets indiqués. C’est ce même mot que la Vulgate a traduit, au ^.1, par justitia, et aux autres versets par eleemosyna. Les Septante l’ont traduit, DICT. DE LA BIBLE
au vers. 1, par Bixsttosûvri, suivant plusieurs manuscrits ; par è>eïj[to(jûvr), suivant d’autres. Cf. Lightfoot, Horse hebraicas, Leipzig, 1675, in Matth., vi, 1-4, p. 287-292.
— L’apôtre saint Paul, .dans ses Épltres, donne à l’aumône les noms suivants : v.oivwv(a (Rom., xv, 26), « communion, communication, » ce qui signifie la participation fraternelle des chrétiens pauvres aux biens de leurs frères plus aisés ; eùXoyfa (II Cor., ix, 55, et ailleurs), « bénédiction, » parce que l’aumône est une bénédiction ou un bienfait du riche à l’égard du pauvre, et parce qu’elle attire sur celui qui la fait les bénédictions du ciel les plus abondantes : « Celui qui sème les bénédictions recueillera les bénédictions, » Il Cor., ix, 6 ; ^dtptç (I Cor., xvi, 3, et ailleurs), « grâce, » ou plutôt « gracieuseté, faveur », parce que l’aumône est par excellence le fruit libre et spontané de la bienveillance des chrétiens les uns pour les autres ; XeiToupyta (II Cor., IX, 12), « fonction sacrée, » parce que l’aumône, s’adressant en définitive à Jésus-Christ, est un acte religieux et saint. Quant à la collecte des aumônes, saint Paul l’appelle Xoyi’o, I Cor., xvi, 1, et il donne le nom de Siaxovîa au service qui a pour but la perception et la distribution des aumônes, II Cor., viii, 4 ; IX, 1, 13. Voir Cornely, In I Cor., XVI, 1, Paris, 1890, p. 519, et Grimm, Lexicon Novi Testamenti, Leipzig, 1888, p. 141, 181, 245, 463.
2° Organisation de l’aumône chez les chrétiens. — Dans les premiers temps de l’Église de Jérusalem, il n’y eut pas lieu, pour les chrétiens, à l’aumône proprement dite ; car, dit le texte sacré, « il n’y avait aucun pauvre, èvBeti ; , parmi eux. » Ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en déposaient le prix aux pieds des Apôtres ; personne n’appelait « sien » ce qu’il possédait ; tous les biens étaient communs, et on distribuait à chacun ce dont il avait besoin. Act., iv, 32-35. Mais le nombre des disciples s’étant accru, la communauté des biens, qui n’est possible que dans un cercle restreint de personnes, fut supprimée ; la propriété privée reparut, et avec elle, peu à peu, l’indigence et la pauvreté : « Vous aurez toujours des pauvres parmi vous, » avait dit le Maître. Joa., xii, 8. C’est alors qu’on organisa l’aumône. Dès l’an 37 ou 38 après J.-C, nous constatons dans la communauté chrétienne de Jérusalem des distributions de secours faites régulièrement, Act., vi, 1 ; ce sont surtout les veuves qui en sont l’objet ; mais il est évident que les autres pauvres ne sont pas exclus ; les fonctions qui se rapportent à ces aumônes constituent « un ministère quotidien » ; il est même probable qu’il y avait des tables communes pour différentes catégories d’indigents, comme nous pouvons le déduire de ces paroles des Apôtres : « Il n’est pas juste que nous abandonnions la parole de Dieu, pour servir aux tables. » Act., vi, 2. Fouard, Saint Pierre, Paris, 1889, p. 72. Le fait que rapporte le livre des Actes, vi, 1, c’est-à-dire le murmure des Juifs hellénistes contre les Hébreux, qui ne paraissaient pas avoir été impartiaux dans ces distributions d’aumônes, fut l’occasion d’une organisation de service plus régulière et plus forte. Jusquelà probablement on avait abandonné le soin des pauvres et des tables à des personnes privées, sous la haute direction des Apôtres ; à partir de ce moment, les Apôtres choisirent et ordonnèrent sept diacres qui furent chargés officiellement de ces soins. Act., vi, 2-6.
Telle était, huit ou neuf ans à peine après l’Ascension du Sauveur, l’organisation des aumônes à Jérusalem. Sans aucun doute, à mesure que l’Église se développait, une organisation analogue s’établissait, au inoins dans les communautés chrétiennes plus nombreuses. Nous en avons comme preuves : 1. le texte I Cor., xvi, 15, où saint Paul, en l’an 56, nous signale, dans la ville de Corinthe, une famille entière, celle de Stéphanas, le premier converti de. toute l’Achaïe, qui se dévoue au service des pauvres ; 2. le texte I Tim., v, 16, où saint Paul, par l’intermédiaire de Timothée, recommande aux fidèles qui ont des veuves et peuvent les nourrir de s’acquitter de ce
I. — 42
4251
AUMONE
1252
devoir envers elles, afin, dit-il, que la communauté soit déchargée d’autant, et qu’elle puisse suffire aux veuves sans ressources ; c’est donc qu’à Éphèse, où était Timothée, la communauté chrétienne s’était chargée des veuves et les nourrissait régulièrement. À Joppé, nous voyons que la maison de Tabitha était comme le refuge de toutes les veuves de l’endroit, qui trouvaient chez elle la nourriture et le vêtement. Act., ix, 36, 39. Ces institutions charitables se développèrent rapidement et largement ; à Rome, nous voyons par une lettre du pape Corneille (*251-253) à Fabius d’Antioche, que l’Église romaine, au temps de ce pape, nourrissait chaque jour plus de mille cinq cents veuves ou indigents. Eusèbe, H. E., vi, 43, t. xx, col. 621.
3° Organisation des aumônes en faveur des pauvres de Jérusalem. — Ce que nous avons vu se pratiquer par les Juifs « de la dispersion », à l’avantage des Hébreux de la Palestine, fut imité par les chrétiens des différentes Églises en faveur de leurs frères de Jérusalem. Ceux-ci, en effet, avaient des besoins spéciaux ; dans les diverses persécutions qu’ils eurent à subir, surtout de la part des Juifs, ils furent dépouillés en grande partie de leurs biens, Heb., x, 34 ; vers l’an 42, une première collecte fut faite a Antioche et portée à Jérusalem, par les soins de Saul et de Barnabe. Act., xi, z9-30 ; xii, 25. La famine prédite par Agabus, Act., xi, 28, et qui arriva environ deux ans plus tard, en 44, sous l’empereur Claude (Act., xi, 28 ; Josèphe, Antiq. jud., XX, ii, 5 ; v, 2), ravagea la Judée, et particulièrement la ville de Jérusalem. Un secours inattendu, que les chrétiens partagèrent avec les Juifs, leur vint des princes de l’Adiabène, et surtout d’Hélène, mère de ces princes, qui fut, en ces temps malheureux, la providence de Jérusalem, où elle vint même se fixer. Josèphe, Ant. jud., XX, ii, 5. Cette assistance écarta le danger présent ; mais après la famine les besoins ordinaires reparurent, et les pauvres furent plus nombreux que jamais. Au concile de Jérusalem, en 52, les Apôtres, en congédiant saint Paul, lui recommandèrent de ne pas oublier les pauvres de la ville sainte. Gal., ii, 10. Saint Paul fut fidèle à cette recommandation ; dans la plupart des villes où il fonda des Églises, il organisa des collectes pour les pauvres de Jérusalem. Voici ce qu’il fit pour Corinthe, 1 Cor., xvi, 1-4. Il devait se rendre dans cette ville au bout de quelques mois ; il veut que les collectes se fassent avant son arrivée, afin qu’elles soient plus spontanées ; le premier jour de chaque semaine, c’est-à-dire tous les dimanches, chaque fidèle doit mettre à part ce que sa charité lui inspirera ; de cette manière tout sera prêt lorsque Paul sera dans les murs de Corinthe ; alors on choisira des délégués pour porter les collectes à Jérusalem, saint Paul leur remettra des lettres de recommandation, et, si la somme est considérable, lui-même présidera la députation. Saint Paul avait agi de la même manière en Macédoine, II Cor., viii, 1-6, et en Galatie,
I Cor., xvi, 1 ; c’est ce qu’il fit encore en beaucoup d’autres villes, et sans difficulté, paraît-il ; car, de l’aveu de saint Paul lui-même, la charité des Corinthiens, que l’Apôtre savait vanter à l’occasion, « provoqua l’émulation chez un très grand nombre. » II Cor., ix, 2 ; Rom., xv, 25-27, 31. Ces collectes pour les pauvres de Jérusalem étaient devenues, grâce au zèle de saint Paul, une chose commune et connue partout, qu’on appelait « le service pour les saints ».
II Cor., viii, 4 ; ix, 1.
4° Recommandation et développement de toutes les (ouvres charitables. — 1. La visite et le rachat des prisonniers et des captifs, Matth., xxv, 34-35 ; Heb., x, 34 ; xiii, 3 ; Philip., iv, 18 ; dès la fin du I er siècle, saint Clément, pape, disait « qu’il en connaissait beaucoup parmi les chrétiens qui s’étaient eux-mêmes jetés dans les fers pour délivrer leurs frères, ou qui s’étaient vendus en esclavage pour avoir de quoi nourrir les pauvres ». S. Clément, I ad Coi : , lv, 2, édit. Funk, Opéra Patrum apo-Uolicorum, Tubingue, 1881, p. 129. Cf. Lucien, De morte
peregrini, Opéra, Paris, 1615, p. 995-997. — 2. Le soin des étrangers, l’hospitalité, Matth., xxv, 34-45 ; I Tim., m, 2 ; v, 10 ; Tit., i, 8 ; III Joa., 5. Cf. S. Clément, I ad Cor., x, 7 ; xi, xii, édit. Funk, p. 75 et suiv. ; S. Justin, I Apol., 67, t. vi, col. 429 ; Tertullien, II ad uxorem, iv, t. i, col. 1294 ; Eusèbe, H. E., iv, 23 ; t. xx, col. 388. — 3. Le soin des orphelins et de toutes les personnes sans ressources, Luc, iii, 11 ; VI, 35 ; Jac, i, 27 ; il, 15 ; cf. S. Ignace, Ad Polycarpum, IV, édit. Funk, p. 249 ; Doctrina duodecim apostolorum, iv, 5, édit. Funk, Tubingue, 1887, p. 15-17 ; Hermas, Mand^. ii, édit. Funk, p. 390 ; Acta SS. Perpétuée et Felicitatis, v, 2, dans Migne, t. iii, col. 47 ; Tertullien, Apologet., 39, t. i, col. 470 et suiv. ; Eusèbe, H. E., iv, 23 ; v, 2, t. xx, col. 388, 436. — 4. Le soin des malades, des infirmes, des vieillards pauvres, etc., Matth., xxv, 36 ; Luc., x, 30-37. Cf. S. Justin, loc. cit. et n° 14, t. vi, col. 348 ; Tertullien, loc. cit. ; Eusèbe, H. E., vii, 22, t. xx, col. 689. — 5. Bonté spéciale pour les pauvres. Jésus-Christ va jusqu’à recommander, à l’égard des pauvres ; des témoignages spéciaux de bienveillance, d’amabilité. « Lorsque vous ferez un festin, appelez les pauvres, les petits, les boiteux, les aveugles, etc. » Luc, xiv, 3. Ceci rappelle les festins des Juifs où ils devaient inviter les pauvres, comme nous l’avons dit plus haut, col. 1246. Le conseil de Jésus-Christ fut mis en pratique dans les agapes chrétiennes, où se réunissaient à des tables communes les riches et les pauvres. Nous en voyons l’origine, malgré des abus-, 1 Cor., xi, 20-22. Saint Ignace signale ces agapes dans sa lettre Ad Smyrn., viii, édit. Funk, p. 240 ; Pline les mentionne dans sa lettre à Trajan, x, 97 ; elles se maintiennent longtemps dans l’Église. Cf. Bingham, Origines ecclesiastiese, XV, viij 6, Halle, 1727, t. vi, p. 504 et suiv. 1U. Résumé doctrinal sur l’aumône, d’après la Bible. — 1° Elle est vivement recommandée ; il est peu de bonnes œuvres qui soient autant conseillées, recommandées et louées que l’aumône, dans la Sainte Écriture ; voir surtout Deut., xv, 7 ; Ps. XL, 1 ; lxxxi, 4 ; exi, 9 ; Prov., xiv, 21, Eccli., iv, 1-2 ; Luc, iii, 11 ; xii, 33. — 2° Elle n’est pas seulement de conseil, mais de précepte. Plusieurs textes de l’Ancien Testament le prouveraient suffisamment, par exemple, Deut., xv, 11 ; mais comme on pourrait dire, ou qu’ils souffrent des exceptions, ou qu’ils ne regardent que les Juifs, nous n’y insistons pas. Trois textes du Nouveau Testament prouvent péremptoirement l’existence du précepte de l’aumône : Matth., xxv, 41-46, où le souverain Juge condamne à la peine éternelle, pour le fait d’avoir refusé l’aumône ; 1 Joa., m, 17, où l’apôtre déclare que la charité de Dieu ne peut demeurer dans l’àme du riche qui néglige de secourir son prochain indigent, cf. Jac, ii, 15 ; enfin I Tim., vi, 17-19, où saint Paul veut que Timothée « commande » aux riches, entre autres choses, de donner leurs biens aux pauvres. Cf. S. Thomas, 2 a 2’", q. xxxii, art. 5. — 3° Effets de l’aumône. Comme toute bonne œuvre, l’aumône a une triple valeur, méritoire, impétratoire, satisfactoire ; mais comme elle est l’exercice de la vertu la plus parfaite, qui est la divine charité, elle a cette triple valeur à un degré éminent. Aussi la Sainte Écriture ne tarit pas sur les effets de l’aumône. La plus petite aumône mérite le ciel, Matth., x, 42 ; xix, 21 ; xxv, 35 ; Luc, xiv, 13 ; l’aumône nous obtient de Dieu les grâces les plus précieuses, et surtout la grâce de la contrition qui efface les péchés, Dan., iv, 24 ; Tob., iv, 7-9 ; xii, 9 ; Luc, xi, 41 ; elle satisfait à la justice de Dieu pour nos offenses, Tob., xii, 9 ; Eccli., iii, 33 ; vii, 36. Elle a même des promesses pour la vie présente, non seulement dans l’Ancien Testament, Prov., iii, 9 ; xix, 17 ; xxii, 9 ; xxviii, 27 ; Tob. T iv, 9 ; Is., lviii, 7 ; mais encore sous le Nouveau, Luc, VI, 38 ; II Cor., viii, IX. —4° Qualités de l’aumône. Pour qu’elle produise ces effets, l’aumône doit avoir plusieurs qualités ; elle doit être faite, non pour la vanité ou l’ostentation, Matth., vi, 1-4, mais pour l’amour de Dieu ei
au nom de Jésus-Çhrist, Matfh., x, 41-42 ; Marc, IX, 40, etc. ; elle doit être faite par chacun suivant ses moyens, Tob., iv, 7-9 ; Prov., iii, 27 ; Marc, xii, 43 ; II Cor., viii, ix ; elle doit être proportionnée aux besoins des pauvres, et faite avec douceur et promptitude. Tob., iv, 9, 17 ; Prov., m, 28 ; Eccli., xviii, 15-17 ; xxxv, 11 ; II Cor., ix, 5, 7.
S. Many.
- AURAN##
AURAN (hébreu : Havrân ; Septante : AûpavîTi ; ), pays mentionné deux fois seulement dans l’Écriture, Ezech., xlvii, 16j 18, comme formant la frontière nordest de la Terre Sainte. Avant d’en expliquer le nom, d’en faire l’exposé géographique et historique, il est nécessaire de rechercher le sens précis du texte prophétique.
I. Texte d’Ézéchiel. — Dans une vision magnifique, le prophète décrit à l’avance le nouveau royaume de Dieu, le nouveau partage de la Terre Promise. Afin d’exprimer plus clairement cette miraculeuse restauration et de don_ier plus de poids à sa parole, i] détermine exactement les limites de la Palestine reconquise. C’est ainsi qu’autrefois, pour une raison semblable, elles avaient été indiquées dans la première promesse faite à Abraham, Gen., xv, 18 ; dans la législation promulguée au Sinaï, Exod., xxiii, 31 ; Deut., i, 7 ; au temps du séjour dans le désert, Num., xxxiv, 3-15, et avant le passage du Jourdain, Deut., xi, 24 ; Jos., i, 4. Mais Ëzéchlel ne trace ici que les lignes générales. Par la forme, la description diffère en plusieurs points de celle des Nombres, xxxiv, 3-15 ; en réalité cependant elle est en harmonie avec le tracé mosaïque. Apre* avoir décrit la frontière septentrionale, qui, partant de la Méditerranée, devait traverser le territoire d’Emath, pour aboutir à Hâsêr haftikôn, « Hazer du milieu, » ou, selon laVulgatè, « la maison dé Tichon, qui est sur la limite d’Auran, » ꝟ. 16, le prophète passe à la frontière orientale, ꝟ. 18. Ce verset doit se traduire ainsi d’après le texte hébreu : « Quant au côté de l’orient, entre le Hauran, et entre Damas, et entre Galaad, et entre la terre d’Israël [ il y a ] le Jourdain ; depuis la frontière (nord), vous mesurerez jusqu’à la mer orientale (mer Morte) : voilà pour la frontière orientale. » Le sens est donc celui-ci : La frontière orientale passe entre le Hauran, Damas et Galaad, d’un côté, et la terre d’Israël, de l’autre, en suivant le Jourdain, qui constitue aussi la limite depuis le nord jusqu’à la mer Morte. Si nous n’avions pas d’autres données pour fixer la situation de l’Auran, nous devrions conclure de ces deux versets qu’il se trouvait au nord de Damas. On ne peut guère douter cependant qu’il ne soit identique avec la province grecque bien connue de VAuranitide, Josèphe, Ant. jud., XV, x, .l ; XVII, xi, 4, le mât Ifa-u-ra-ni des inscriptions cunéiformes, le Hauran actuel. Les consonnes de l’hébreu, en effet, sont exactement les mêmes que celles du nom arabe : pin =
/jl’jjj ! ^., Haourân (cf. Aboulféda, Tabules Syriee, édit.
Koehler, Leipzig, 1766, p. 106), quoique la ponctuation massorétique ait un peu changé la prononciation, qui devrait être Hôrân.
L’opinion générale des commentateurs admet cette identification. Quelques savants néanmoins conservent des doutes à ce sujet, et supposent que le Havrân d’Ézéchiel correspond plutôt au village de Haouârîn, situé au nordest de Damas, entre Sadad et Qaryeteïn. Cf. K. Furrer, Die antiken Stâdte und Ortschaften im Libanongebiete, dans la Zeitschrift des Deutschen Palàstina-Vereins, t. viii, 1885, p. 28 ; H. Guthe, D’A. Stûbel’s Reise nach der Diret et-Tulul und Hauran, 1882, dans la même revue, t. xii, 1889, p. 230. On peut voir, sur I.Iaouârîn ou Khawwârin, E. Sachau, Reise m Syrien und Mesopotamien, Leipzig, 1883, p. 52. Saint Jérôme, Comment, in Ezech., t. xxv, .col. 478, fait aussi d’Auran ce un bourg de Damas, dans la solitude ». Il est eertain que ce passage du prophète, en raison des noms qui, pour la plupart, sont jusqu’ici restés inconnus, est plein d’obscu rités. Cependant nous croyons le sentiment général plus conforme au contexte. Au ꝟ. 18, il s’agit de contrées et non pas de villes, contrées séparées de la terre d’Israël par le Jourdain ; ensuite, puisque le fleuve détermine la - frontière orientale, elle ne pouvait s’étendre jusqu’à Haouârîn au nord-est. Il ressort néanmoins pour nous de ce même verset que l’Auran d’Ézéchiel a un sens plus large que l’Auranitide de Josèphe : situé entre Damas et Galaad, ce pays devait comprendre, outre l’Auranitide proprement dite, ce qui fut plus tard la Gaulanitide, la Batanée, et peut-être aussi l’Iturée.
II. Nom. — Ce nom est diversement interprété. On le rattache généralement à l’hébreu iiii, hûr, racine inusitée, dont les dérivés indiquent le sens de « creuser », d’où le mot nn, hôrî, « troglodyte, » les Horîm de la
Bible (Septante : Xoppoctoi ; Vulgate : Homei et Chorrsei). Cf. Gesenius, Thésaurus, p. 458 ; J. Fûrst, Hebraïsches Handwôrterbuch, Leipzig, 1876, t. i, p. 386. Il possède alors la signification de « pays de cavernes », ce qui s’explique par les nombreuses grottes ou demeures souterraines qu’habitaient encore au temps de Josèphe, Ant. jud., XV, x, 1, les populations de la Trachonitide, et qu’on retrouve de ndsjours dans ce pays et dans le Hauran. Wetzstein n’admet pas cette étymologie ; car, dit-il, à l’exception du Hauran est et sud-est, où les principales éruptions volcaniques ont été fouillées par les Troglodytes, les grottes servant d’habitation ne sont pas communes dans ce pays. Le vrai pays des cavernes, à l’est du Jourdain, est le nerd de Galaad, qui n’appartient pas au Hauran. Reisebericht ûber Hauran und die Trachonen, Berlin, 1860, p. 92. On répond à cela que le nom, donné d’abord à l’ensemble d’une contrée caractérisée par ces phénomènes particuliers, a pu être restreint plus tard à une province à laquelle il convient moins ; ce qui n’enlève rien à la justesse de la dérivation primitive.
Wetzstein fait de Havrân un mot sabéen, signifiant « pays noir », et importé vers la fin de l’exil par des colons sabéens. Ses arguments, basés sur quelques expressions empruntées aux lexicographes et géographes arabes, sont loin d’être concluants. Cf. Frz. Delitzsch, Das Buch lob, Leipzig, 1876, Anhang : Das Hiobskloster in Hauran und das Land Vz, von J. G. Wetzstein, p. 597, note 2. M. J. Halévy donne une explication diamétralement opposée. Rattachant le nom à la racine "lin, hâvar, « être
blanc, » il le regarde comme dû aux neiges qui couvrent les sommets des montagnes pendant une grande partie de l’année, et comme parallèle à celui du Liban, dont le sens est le même. Voir Arabie, col. 857. Quoi qu’il en soit, ce nom, nouveau pour les Israélites, était déjà depuis longtemps usité chez les Assyriens, puisqu’on le trouve mentionné dans les inscriptions de Salmanasar II et d’Assurbanipal, avec celui d’autres tribus araméennes, particulièrement les Nabatéens et les Agaréniens.
III. Géographie. — L’Auran d’Ézéchiel, avons-nous dit, devait comprendre tout le territoire situé entre le lac de Tibériade et les montagnes du Hauran, de l’ouest à l’est, entre Damas et les monts de Galaad, du nord au sud. Pour la province grécoromaine de l’Auranitide, il est impossible, avec les auteurs anciens, d’en fixer nettement les limites. Le plus précis d’entre eux est Josèphe, qui la distingue de la Batanée et de la Trachonitide. Ant. jud., XV, x, 1 ; XVII, xi, 4 ; Bell, jud., i, xx, 4 ; II, xvii, 4 ; et il est probable, d’après ces passages, qu’elle formait une partie du « pays de Trachonitide », Tpa^wvîTiSo ; x^P a » dont parle saint Luc, iii, 1, et qui fut soumis à Philippe ; cf. Ant. jud., XVH, xi, 4. Un historien arabe, Boheddin, Vita et res gestx sultani Saladini, édit. Schultens, Leyde, 1732, p. 70, désigne sous le nom de Hauran toute la région qui s’étend à l’est du Jourdain et au nord du Chériat sl-Mandhoûr (Yarmouk). Actuellement ce nom s’applique à une contrée volcanique, bornée au nord par YOuadi el-Adjem, qui appartient à Damas ; à l’est par le Diret
el-Touloûl, le Safa et le désert El-Hara ; au sud par le Belqâ’a et les steppes du désert El-Hamad ; au sud-ouest par le Djebel Adjloûn ; à l’ouest par le Djaulan (Gaulanitide), et au nord-ouest par le Djédour (Itnrée). Ce pays, dont l’étendue est de quatre-vingts à cent kilomètres du nord au sud, et de soixante à soixante - cinq de l’ouest à l’est, se divise en trois parties distinctes : au nord, le Ledjah ( Trachonitide) ; au sud-est, le Djebel Hauran ; tout autour, mais surtout au sud et au sud-ouest, la plaine En-Nouqrat el-Haourân (la pente du Hauran). Pour l’ensemble du pays, voir Amorrhéens, Basan. Pour le Ledjah, voir Argob, Tra.chûkitide. Notre description doit se borner à la montagne du Hauran et à la plaine qui l’avoisine du côté de l’ouest, c’est-à-dire à l’Auranitide proprement dite.
A une centaine de kilomètres au sud-est du grand Hermon, auquel le rattache un plateau accidenté, se dresse le Djebel Hauran, dominant les solitudes de la contrée, et fermant, au nordest, le pays biblique transjordanien. Il forme un massif de montagnes volcaniques, dont l’axe se dirige à peu près du sud au nord, et dont les cônes prin. cipaux sont : Y À bou Touméïs (1 550 mètres), le Djouéïlil (1782 mètres) et le Qoléïb (1718 mèlres ).ïous les pitons de cette chaîne vont en moyenne de 1100 à 1800 mètres. Rochers de laves ou amas de cendres, ils ressemblent à des blocs calcinés sortis d’un four : un seul sommet, le Qoléïb, estombragédequelques arbres à la
cime. On croirait voir la chaîne des Puys d’Auvergne. Le basalte de l’Abou Touméïs, différant d’aspect avec celui du Djaulan et de la Moabitide, est remarquable par ses propriétés magnétiques, qu’il doit sans doute à une forte proportion de fer oxydulé titanifère répandu dans sa masse. Au nord, quatre cônes latéraux, alignés du sud-ouest au nord-est sur une longueur de dix kilomètres, paraissent avoir vomi la vaste nappe basaltique qui compose le Ledjah. Ce sont, du nord au sud, le Tell Sehihan, le Tell Gharârat eschschemàliyéh (le Gharara du nord), le Tell Djémal et le Tell Gharârat el-qibliyéh (du sud).
La plaine En-Nouqra est un plateau ondulé, coupé par de nombreux ouadis, qui descendent du Djebel Hauran pour former les principaux affluents du Chériat el-Mandhoûr. Le sol se compose de scories de laves et de cendres, répandues sur la contrée par les volcans pendant leur période d’activité, et désagrégées par les agents atmosphériques. On trouve encore de ces fragments non décomposés à trois ou quatre pieds sous terre. Ce sol rougeâtre est en général très fertile, et les fellahs ont peu de peine à recueillir de magnifiques récoltes, si la pluie tombe avec une abondance suffisante. Les céréales qu’on y cultive consistent en une excellente sorte de blé et d’orge : le, grain est transporté par les chameaux soit à Damas, soit sur les bords de la mer, à Akka (Saint-Jean-d’Acre) ou
L.Tkufllier, del*
[[File: [Image à insérer]|300px]]
365. — Carte de l’Auran.
à Khaïfa. Malgré les nombreux cours d’eau qui arrosent ce pays, on y rencontre peu de plantations et pas de forêts : autour des villages, les habitants entretiennent seulement quelques vergers, vignes et jardins. La plaine et les pentes de la montagne sont occupées par une population sédentaire adonnée aux travaux agricoles, mais malheureusement exposée aux incursions continuelles des Bédouins. Depuis quelques siècles, les cantons montagneux ont été colonisés par les Druses, et l’immigration venue des districts du Liban a été si considérable depuis 1861, que le Djebel Hauran est quelquefois appelé « montagne des Druses ». Quelques chrétiens, appartenant à la religion grecque orthodoxe, s’y sont établis à côté d’eux. Le Hauran est remarquable surtout par le grand nombre d’habitations anciennes qu’il renferme : demeures troglodytes ou grottes artificielles creusées sous l’escarpement
des rochers ^chambres ouvertes dans la surface du plateau rocheux et surmontées d’une solide voûte en pierre ; villages souterrains, véritables forteresses presque inexpugnables, comme celui qui se voit encore à Der’al, l’ancienne Édraï, une des résidences d’Og, roi de Basan ; cf. G. Schumacher, Across the Jordan, Londres, 1886, p. 135-148 ; plan, p. 136. Beaucoup de villages sont formés de maisons de pierre, pour la plupart bien conservées et construites en blocs de basalte admirablement jointoyés. Les portes sont généralement basses et sans ornements ; quelques-unes cependant étaient sculptées et ornées d’inscriptions. Elles étaient faites de dalles de pierre, tournant sur un gond pris dans la masse. Les fenêtres étaient obtenues au moyen d’une dalle de dolérite, percée d’ouvertures rondes.
La plaine est couverte dans toutes les directions de villes construites en basalte noir, les unes ruinées, les autres assez bien conservées. Der’ât (Édraï), Bosra (Bostra), Salkhad (Salécha), El-Qanaoudt (Canath), Souéidéh, Ezra, Es-Sanameïn (Aéra) et d’autres localités anciennes ont laissé des vestiges dont les voyageurs admirent l’étendue et la beauté. Les principales d’entre elles sont d’origine syromacédonienne ou romaine, ou du moins elles furent agrandies et singulièrement embellies au temps des Séleucides et des empereurs. Quelques autres paraissent dater d’une époque un peu postérieure. Les édifices remarquables qu’elles renferment furent élevés dans une période qui s’étend du I er au vu" siècle. Au moment de l’occupation romaine, le pays se peupla, et l’activité architecturale ne fit qu’augmenter lorsqu’il eut été réduit en province romaine. De tous côtés s’élevèrent maisons, palais, bains, temples, théâtres, aqueducs, arcs-de-triomphe ; des villes sortirent de terre en quelques années avec cette disposition régulière, ces colonnades symétriques, qui sont comme le cachet uniforme des cités construites en Syrie pendant
l’époque impériale. Le style de tous ces édifices est le style bien connu des colonies romaines, c’est-à-dire le style grec modifié par certaines influences locales, par le souvenir des arts antérieurs ou la nature des matériaux employés. Plus tard, les temples furent convertis en églises, et des sanctuaires nouveaux s’élevèrent. — Cf. J. L. Burckhardt, Travels in.Syria and the Holy Land, in - 4°, Londres, 1822, p. 285-309 ; U. J. Seetzen, Reisen durch Syrien, Palâstina, etc., 4 in-8°, Berlin, 1854, t. i, p. 34-134 ; J. L. Porter, Five years in Damascus, 2 in-8°, Londres, 1855, t. ii, p. 1-272 ; The Giant cities of Bashan, in-8°, Londres, 1871, p. 1-96 ; J. G. Wetzstein, Reisebericht ûber Hauran und die Trachonen, in-8°, Berlin, 1860 ; E. G. Rey, Voyage dans le Haouran, in-8°, Paris, 1860, avec un atlas in-folio ; de Vogué, Syrie centrale, Architecture civile et religieuse du i" au rne siècle, 2 gr. in-4° avec planches, Paris, 1866 ; A. Chauvet et E. Isambert, Syrie et Palestine, in-8°, Paris, 1887, p. 494-551 ; G. Schumacher, Across the Jordan, in-8°, Londres, 1886, p. 20-40, 103-242 ; H. Gulhe, D’A. Stùbel’s Reise nach der Diret et-Tulul und Uauran 1882, dans la Zeitschrift des Deuischen Palâstina -Vereins, t. xii, Leipzig, 1889, p. 225-302, avec carte.
A la contrée du Hauran appartient, d’après la plupart des auteurs modernes, la patrie de Job, nommée Ausitide, Aùffréis, par les Septante, Job, i, 1. Les traditions syrienne et musulmane la placent, en effet, dans la plaine d’En-Nouqra, à Scheikh Sa’ad ou Sa’adîyéh, à quatre ou cinq kilomètres au nord de Tell’Achtarâ. Là plusieurs sites ou monuments portent le nom de Job, Eyyoub : une « eau de Job » sortant d’un « bain de Job », une mosquée avec une « pierre de Job », un sanctuaire nommé « la place de Job », avec son tombeau et celui de sa femme ; enfin quelques restes de l’ancien « couvent de Job ». Cf. G. Schumacher, Across the Jordan, p. 187-198 ; Fr. Delitzsch, Das Buch lob, Leipzig, 1870, Anhang, p. 551 et suiv. Voir Hus.
IV. Histoire. — Si, dans cette contrée singulière, le temps a respecté les demeures de l’homme, l’homme lui-même y a subi de nombreuses révolutions depuis les races les plus anciennes, vaincues par les Hébreux, jusqu’aux Arabes actuels. Voir Amorrhéens, Arabes, Arabie. Le glaive et la captivité dévastèrent plus d’une fois les campagnes et dépeuplèrent les villes. Les inscriptions cunéiformes nous ont conservé le souvenir des ravages exercés dans ces régions par les rois d’Assyrie. L’inscription des taureaux, racontant la guerre faite par Salmanasar II (858-823) à Hazaël, roi de Syrie, nous dit à ce sujet :
15. Dans Damas, sa ville royale, je l’enfermai,
16. ses arbres je coupai. Jusqu’aux montagnes
17. du Hauran j’allai, des villes
18. sans nombre je renversai,-je détruisis,
19. je livrai aux flammes ; du butin
20. je leur pris sans nombre.
Cf. Bull Inscription, Cuneiform Inscriptions of Western Asia, t. iii, pi. 5, n° 6 ; A. Amiaud et V. Scheil, Les inscriptions de Salmanasar II, Paris, 1890, p. 60-61 ; E. Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, Giessen, 1883, p. 209-210 ; F. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit, t. iv, p. 71. Pour se venger de la trahison d’un de ses vassaux, Abiatéh, roi d’Arabie, Assurbanipal (668-625) quitta Ninive au printemps de 642, franchit l’Euphrate et s’enfonça dans le désert à la recherche des rebelles. « Malgré les souffrances de son armée, il traversa le pays de Masch et de Kédar, pillant les bourgs, brûlant les tentes, comblant les puits, et arriva à Damas chargé de butin. Les Arabes terrifiés se soumirent ; restaient les Nabatéens, que l’éloignement de leur pays encourageait à la résistance. Le 3 Ab, quarante jours après avoir quitté la frontière chaldéenne, il partit de Damas dans la direction du sud, enleva la for teresse de Khalkhouliti, au pied du plateau que dominent les montagnes du Hauran, et toutes les bourgades du pays l’une après l’autre, bloqua les habitants dans leurs retraites et les réduisit par la famine. » Maspéro, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, 4° édit., p. 470. Cf. Vigouroux, ouvr. cité, p. 293-294.
La domination des Séleucides et des Romains amena la prospérité dans ces contrées. Les cités reprirent une vie nouvelle ; de grandes voies, comme celles dont on trouve encore des traces entre Der’ât, Bosra et Salkhad, et de nombreuses colonies leur donnèrent le mouvement et le commerce ; quelques-unes s’embellirent de ces monuments dont les restes font toujours l’admiration du voyageur. Après la première actiade (27 à 26 avant l’ère chrétienne, suivant, quelques auteurs), Auguste remit à Hérode le Grand l’Auranitide avec la Trachonitide et la Batanée, pour les soustraire aux brigandages de Zénodore. Josèphe, Ant. jud., XV, x, 1 ; Bell, jud., i, xx, 4. Zénodore, irrité de ce qu’on le dépouillait d’une partie de ses États, se rendit à Rome pour porter une accusation contre son heureux rival ; mais il ne put rien obtenir. Les Arabes, à qui, dans une situation désespérée, il avait vendu l’Auranitide au prix de cinquante talents, se prétendirent injustement dépouillés et disputèrent la possession de ce pays tantôt par de violentes incursions, tantôt par des moyens juridiques. Ant. jud., XV, x, 2. Après la mort d’Hérode, l’Auranitide entra dans la tétrarchie de Phi lippe. Ant. jud., XVII, xi, 4 ; Bell, jud., II, vi, 3. Enfin plus tard Agrippa II envoya à Jérusalem trois mille cavaliers auranites, batanéens et trachonites, pour réprimer une révolte soulevée contre le pouvoir romain. Bell, jud., II, xvii, 4. De nombreuses inscriptions araméennes, grecques et latines, ont été recueillies dans le Hauran par les différents voyageurs ; aucune d’elles n’est antérieure au I er siècle avant l’ère chrétienne. Cf. de Vogué, Syrie centrale, Inscriptions sémitiques, in-f°, Paris, 1869 ; W. Waddington, Inscriptions grecques et latines de la
Syrie, in-4°, Paris, 1870.AURANITIDE. Voir Aurai*.
- AURAT François##
AURAT François, bénéficier de Saint -AUyre, prêtre habitué de l’Église de Lyon (xviie siècle), a donné le Cantique des cantiques expliqué dans le sens littéral, in-8°, Lyon, 1689 et 1693, traduction française, avec notes purement littérales. L. Guilloreau.
- AUREOLUS##
AUREOLUS, AURIOL. Il est appelé ordinairement Oriol en français. Voir Oriol.
- AUREUS##
AUREUS ( CODEX). L’usage d’écrire les textes les plus précieux sur du parchemin pourpré et en lettres d’or était un usage ancien : nous voyons mentionnés, dès la fin du me siècle de notre ère, des manuscrits d’Homère écrits ainsi sur pourpre à l’encre d’or, « libros homericos purpureos aureis litteris scriptos. » Gardthausen, Griechische Palâographie, Leipzig, 1879, p. 84-85. En paléographie latine, on constate que « l’encre d’or a été particulièrement employée du vme au Xe siècle », et surtout pour les Livres Saints. N. de Wailly, Éléments de paléographie, Paris, 1838, t. i, p. 374. L’évangéliaire de Saint-Germain-des-Prés du vin’siècle, l’évangéliaire de Metz, vme siècle, l’évangéliaire de Charlemagne de l’an 781, tous manuscrits aujourd’hui à la Bibliothèque nationale, sont d’illustres spécimens de cet usage. L, Delisle, Le cabinet des manuscrits, Paris, 1881, t. iii, p. 198, 199 et 232. À Constantinople, ce luxe calligraphique fut de mode surtout au Xe et au XIe siècle : la cour byzantine s’en servait pour les instruments diplomatiques d’apparat ; .l’empereur Constantin IX (1042-1053), écrivant au calife de Cordoue, lui écrivait sur pourpre en lettres d’or. Gardthausen, Griech. Palàog., p. 85. La bibliothèque impériale de Vienne possède un évangéliaire de "parche
min pourpre à lettres d’or provenant du couvent de Saint-Jean de Garbonara, à Naples ; ce manuscrit oncial, le plus ancien spécimen de cette calligraphie, est du ixe siècle. Un fac-similé en a été publié par Silvestre, Paléographie universelle, Paris, 1840, II, 156. Le signataire du présent article a décrit le premier un manuscrit cursif des quatre Évangiles sur parchemin pourpre et à encre d’or, œuvre calligraphique du Xe siècle, propriété de l’église de l’Annonciation, à Bérat. P. Batiffol, Les manuscrits grecs de Bérat d’Albanie, Paris, 1886, p. 15.
Cependant le nom de Codex Aureus est de préférence réservé à un manuscrit de la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg, où il est coté VI, 470, au catalogue de M. de Murait. L’écriture est minuscule, d’une main byzantine du Xe siècle, au jugement de M. Gregory et de M. Hort. Le parchemin, réparti en quaternions ou cahiers de huit feuillets, est teint en pourpre. Chaque page ne comporte qu’une colonne de dix-huit lignes en moyenne. Les initiales sont avancées dans la marge et sans décor, comme c’était de mode calligraphique à Constantinople au xe siècle. La marge porte de courtes scolies critiques marquant des variantes, et écrites à l’encre d’argent en petite onciale. Le grec, tant du texte que des scolies, est accompagné de ses accents et de ses esprits, et comporte les abréviations ordinaires à la minuscule de cette époque. Hauteur de chaque feuillet : 207 millimètres. Largeur : 130 millimètres. Nombre des feuillets : 405. Le manuscrit renferme les quatre Évangiles, moins Joa., xi, 26-48, et xiii, 2-23. Les fragments Matth., xx, 18-26 ; xxi, 45-xxii, 9 ; Luc, x, 36-xi, 2 ; xviii, 25-37 ; xx, 24-36 ; Joa., xvii, 1-12, sont des restaurations récentes. Il est probable que ce manuscrit a été écrit à Constantinople. Une tradition sans fondement voudrait faire croire qu’il est de la main de l’impératrice Théodora (842-855). Au commencement du siècle présent, il appartenait au couvent de SaintJean, proche de Houmish-Khan et de Trébizonde ; l’abbé du couvent, l’archimandrite Silvestre, en lit don à l’empereur de Russie, en l(-29. Voir Revue critique, 1860, p. 201.
Le texte du Codex Aureus ne diffère point de la tradition commune aux manuscrits proprement byzantins, sauf en saint Marc. Le texte de saint Marc qu’il nous présente se rattache étroitement à la tradition textuelle que l’on appelle occidentale, et dont il est un remarquable spécimen à rapprocher du Codex Claromontanus. — M. de Murait a donné une bonne description et un fac-similé du Codex Aureus dans le Catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque impériale, Saint-Pétersbourg, 1864. Il en avait collationné le texte pour l’édition donnée par lui du Nouveau Testament grec, Hambourg, 1848. M. Belsheim a publié depuis in extenso le texte de saint Marc : Das Evangelium des Marcus nach dem griechischen Codex Theodoræ imperatricis purpureus petropolilanus, Christiania, 1885. Mais l’exactitude critique de cette édition n’est pas irréprochable. Gregory, Prolegomena, p. 556-557, au Novum Testamentum grœce, edit. vin crit. maj., de Tischendorf, Leipzig, 1890.
P. Batiffol.
- AURIVILIUS Charles##
AURIVILIUS Charles, orientaliste suédois, né à Stockholm en 1717, mort en 1786. Il étudia d’abord les langues orientales sous le savant Tympe, d’Iéna ; puis il alla en Italie, et de là à Paris, où il eut pour maître d’arabe Fourmont ; ensuite il visita Leyde, et y poursuivit ses mêmes études sous Schulten. De retour en Suède, il continua à Upsal le cours de ses travaux sur les langues orientales. En 1764, il occupait à la chancellerie l’emploi de traducteur d’arabe et de turc, et huit ans plus tard il fut promu au titre de professeur de langues orientales à Upsal. En 1773, il fit partie de la commission chargée d’une nouvelle traduction de la Bible en suédois, et pour. sa part il traduisit le Pentateuque, Josué, les Juges, Job, les Psaumes, les. Prophètes et les Lamentations. Il avait publié un certain nombre de dissertations relatives à
l’Écriture Sainte et à la littérature orientale. Les trente plus remarquables furent réunis par J. D. Michælis. Car. Aurivilii Disserlationes ad sacras litteras et philologiam orientaient pertinentes, in-8°, Goettingen et Leipzig, 1790. — Voir Michælis, Neue orientalische und exegetische Bibliothek, t. v, p. 431. L. Guilloreau.
- AUROCHS##
AUROCHS (hébreu : re’êm, ou rêm ; Septante : jjiovéxêptoc ; Vulgate : rhinocéros, et dans les Psaumes et Is., xxxiv, 7 : unicornis, « la licorne » ).
J. Le « re’ém » des Hébreux. — Voici en quels termes la Bible parle du re’êm, dans les huit passages où elle en fait mention. Balaam dit du peuple hébreu : « Sa force est semblable à celle du re’ém. » Num., xxiii, 22 ; xxiv, 8. Moïse caractérise ainsi la descendance de Joseph : « Son premier-né est un taureau, ses cornes sont les cornes du re’êm ; avec elles il lancera en l’air les nations jusqu’aux extrémités de la terre. » Deut., xxxiii, 17. Au psaume xxi, 22, David fait dire au Messie souffrant, accablé par ses ennemis : « Délivre-moi de la gueule du lion et dos cornes du re’ém. » Au psaume xxviii, 6, il fait gronder la voix de l’orage qui « brise les cèdres du Liban et fait bondir les cèdres comme le jeune taureau, le Liban et le Sirion comme le petit du re’êm ». On lit dans le livre de Job : « Le re’êm consentira-t-il à te servir et à demeurer dans ton étable ? Attacheras-tu le re’êm au sillon avec ta corde, et aplanira-til la terre labourée derrière toi ? Pourras-tu compter sur sa vigueur extraordinaire et lui confier tes travaux ? T’attendras - tu à ce qu’il te ramène ta récolte et la recueille sur ton aire ? » Job, xxxix, 9-12. Isaïe compare le massacre des Iduméens et des nations idolâtres à l’immolation des animaux dans les sacrifices : « L’épée du Seigneur est pleine de sang ; elle s’est engraissée de la graisse et du sang des agneaux et des boucs, des gras rognons des béliers. Les re’êmim seront immolés en même temps, avec les plus puissants des taureaux. » Is., xxxiv, 6-7. Enfin au psaume xci, II, qui est sans nom d’auteur, le psalmiste remercie Jéhovah de le faire triompher de ses ennemis : « Tu élèves ma corne comme celle du re’êm. » Ce psaume appartient au quatrième livre du Psautier, et par conséquent date au plus tard des temps qui ont suivi immédiatement Esdras. De tous ces passages, il ressort que le re’êm était un animal bien connu des Hébreux, depuis la sortie d’Egypte jusqu’au retour de la captivité ; que cet animal était pourvu de cornes redoutables, qu’on n’avait pu le domestiquer, qu’il n’était pas sans analogie avec le taureau, puisque les auteurs sacrés le mettent en parallèle avec lui, et qu’enfin il appartenait à une race assimilable à celle du bœuf. Rosenmùller a, en effet, remarqué que, dans le passage cité d’Isaïe, « tous les animaux propres aux sacrifices sont rassemblés. » Le re’êm y est nommé avec les agneaux, les boucs, les béliers et les taureaux, et l’on sait que les Hébreux ne pouvaient offrir au Seigneur que des victimes de race ovine, caprine ou bovine.
Les interprètes ne sont point d’accord pour déterminer l’espèce à laquelle appartient le re’êm de la Bible. On l’a identifié avec la licorne, le rhinocéros, le buffle, l’oryx et l’aurochs. — Dans sept des passages allégués, les Septante traduisent par (lovtixepioç, l’animal « à une corne », et dans Isaïe seulement ils emploient le mot iSpof, « les forts. » Dans le Pentateuque et dans Job, la Vulgate traduit par « rhinocéros » ; dans les Psaumes et dans Isaïe, par unicornis, l’animal « à une corne ». Au psaume lxxvii, 09, elle traduit aussi « licorne », parce que les Septante, dont notre version des Psaumes est la traduction, ont lu re’êmim au lieu de râmîm, « hauteurs. » 1° L’identification du re’êm, soit avec le rhinocéros, soit avec la licorne, est aujourd’hui universellement rejetée. La licorne est un animal fabuleux. Elle n’a jamais pu être décrite avec précision, quoique Aristote, Hist. anim., II, ii, 8 ; PJine, H. N., viii, 21, et d’autres auteurs anciens en aient fait mention. Tout ce que l’on sait, c’est que le trait carac
téristique de cet animal était d’avoir une corne plus ou moins longue et droite au milieu du front. Ce fait est déjà assez anormal en zoologie ; mais, quoi qu’il en soit, il est à remarquer que les versions traduisent par « licorne » des passages où l’on suppose formellement deux cornes à l’animal. Deut., xxxiii, 17 ; Ps. xxi, 21. La licorne n’est donc pas le re’em. Voir Licorne. — 2° Saint Jérôme n’a pas adopté l’explication des Septante, excepté Is., xxxiv, 7, mais il a cru néanmoins que le re’em était un animal à une seule corne et il a traduit toujours, sauf dans le passage d’Isaïe, par rhinocéros. (La traduction des Psaumes dans la Vulgate n’est pas de lui.) Cet animal a, en effet, sur le haut du museau, une corne unique, trapue, formée par l’agglutination d’une grande quantité de poils. Mais les textes bibliques ne peuvent pas plus s’appliquer à cet animal à une seule corne qu’à la licorne elle-même, puisqu’ils parlent de plusieurs cornes, comme
3C6. — Urus ou Bos primigenius.
nous l’avons vu. Deut., xxxiii, 17 ; Ps. xxi, 22. De plus, le rhinocéros ne vit qu’en Afrique et aux Indes orientales, et comme il appartient à la race des pachydermes, on ne l’aurait pas plus admis dans les sacrifices que le cheval ou l’hippopotame. Voir Rhinocéros. — 3° Bochart, Rosenmûller, Winer, etc., pensent que l’animal en question est l’antilope oryx. Bochart, Hierozoicon, ii, 335, remarque que les Arabes appellent encore rim l’antilope Oryx leucoryx du nord de l’Afrique. Mais comme les documents assyriens établissent que le re’em était un bœuf sauvage, cette explication doit être aussi abandonnée. Voir Oryx. — 4° D’après Gesenius, Quatremère (Journal des savants, mai 1845, p. 269-273), Le Hir, Knabenbauer, etc., le re’ém serait le bubalus férus ou buffle. C’est une espèce de bœuf plus sauvage que le bœuf ordinaire, avec des cornes noires rabattues en arrière. Voir Buffle, pour les raisons alléguées pour et contre cette identification. — 5° Enfin un grand nombre croient aujourd’hui que le re’êm est l’aurochs, Vurus de Jules César, le bos primigenius des naturalistes (fig. 366). Cette opinion a été soutenue par Arnold Boot, au xviie siMe, Animad. sacr., iii, 8, Londres, 1644, et suivie depuis par W. Houghton, Dictionary of the Bible, t. iii, p. 1595 ; Trochon, Introduction générale, t. ii, p. 90 ; Fillion, Atlas d’histoire naturelle de la Bible, p. 94 ; Tristram, The natural history of the Bible, 1889, p. 146-150, etc.
II, Description de l’aurochs. — Ce mammifère, dont le nom en allemand ( Auer - Ochs) signifie « bœuf de plaine », forme avec le bison d’Amérique le groupe des « bonases » parmi les « bovidés ». C’est, après l’éléphant et le rhinocéros, le plus gros des mammifères quadrupèdes. Il atteint jusqu’à deux mètres de hauteur et trois
mètres trente-trois centimètres de longueur. Il se distingue du bœuf domestique par son front bombé, plus large que haut, par une paire de côtes de plus, par son pelage composé de poils laineux recouvrant les parties inférieures, et de poils longs et grossiers sur le dos et la partie antérieure du corps^ et par la position de ses cornes, qui sont attachées latéralement, au-dessous de la crête occipitale, et non au sommet du front. Il aies jambes, la queue et les cornes plus longues, mais le poil plus court que le bison ou bœuf sauvage de l’Amérique septentrionale. L’aurochs est aujourd’hui confiné dans les grandes forêts de la Lithuanie, des Karpathes et du Caucase. Il habitait autrefois sous tous les climats tempérés. Il est probablement le même que Y urus, bos priscus ou bos primigenius (fig. 366) de l’époque quaternaire, bien qu’on ne puisse en aucune façon voir en lui la souche de l’espèce bovine actuelle, comme plusieurs naturalistes l’avaient avancé. À l’époque de César, les urus se rencontraient dans la forêt Hercynienne. Voici ce qu’en rapporte le célèbre écrivain : « Ils ne le cèdent guère en taille aux éléphants. Ils ont l’aspect, la couleur et la forme du taureau. Ils sont très forts et très agiles, et quand ils aperçoivent quelque homme ou quelque animal, ils fondent sur lui. Il faut se donner beaucoup de peine pour les capturer dans des fosses et pour les tuer… Quant à s’accoutumer aux hommes et à s’apprivoiser, ils en sont incapables, sauf quand-ils sont très jeunes. Par la grandeur, les formes et l’aspect, leurs cornes diffèrent beaucoup des cornes de nos bœufs. » Bell, gall., vi, 28.
III. Le « re’êm » et le « rîmu » assyrien. — Dans les inscriptions assyriennes, il est souvent question du rimu, dont le nom est écrit en assyrien par des signes idéographiques qui signifient « bœuf de montagne » (voir Bœuf sauvage), et est identique à l’hébreu re’êm. Sennachérib est comparé à un rimu vigoureux, et les énormes taureaux qui ornent le vestibule des palais assyriens sont appelés des rimâni. Voir Delattre, L’Asie occidentale et les inscriptions assyriennes, dans la Revue des questions scientifiques, octobre 1884, p. 517. L’identité du rimu assyrien et du bœuf sauvage ne fait doute pour personne, et M. Fried. Delitzsch, après avoir cru que l’animal en question était le bubale, a reconnu ensuite que Fr. Hommel avait parfaitement démontré l’identité du rîmu et du bœuf sauvage ou aurochs. Voir W. Lotz, Die Inschriften Tiglathpileser’s, mit Beigaben von Frd. Delitzsch, in-8°, Leipzig, 1880, p. 159. La chasse du rîmu était en grande faveur chez les anciens rois d’Assyrie. Téglathphalasar, antérieur d’un siècle environ à David, relate ainsi un de ses exploits- : « Avec le secours de Ninib, mon protecteur, j’ai tué quatre rimâni, puissants, énormes, dans le désert, au pays de Mitani, et dans le territoire d’Araziki, en face du pays de Khatti, » sur la rive droite de l’Euphrate. Prisme de Téglathphalasar I er, vi, 58. Ce même roi chassa aussi le rîmu au pied du Liban. Broken Obelisk, 5. Comme "il ne raconte en détail que les chasses du rîmu, de l’éléphant et du lion, et ne fait qu’une mention générale des autres animaux, il en faut conclure que l’aurochs n’était pas moins redoutable au chasseur que l’éléphant et le lion. M. Maspero, dans ses Lectures historiques, p. 274, décrit en détail l’une de ces chasses. On poursuivait les aurochs sur le char de guerre ou à cheval. Au cours de la chasse (fig. 367), « le roi s’attache au plus gros, qu’il est presque certain d’avoir blessé au défaut de l’épaule, le gagne peu à peu de vitesse, range adroitement son char à côté de lui, sans ralentir l’allure, et, posant son arc, dégaine l’un des poignards qu’il porte à la ceinture. D’une main il saisit à la volée une des cornes de l’animal, de l’autre il lui enfonce son arme dans la nuque : la lame courte et large divise la moelle épinière à la jonction du cou et de l’épaule, le taureau s’affaisse sur lui-même, en bloc, comme foudroyé. » Au retour, on faisait hommage à la déesse Istar de l’aurochs que le roi avait tué (fig. 368), et l’on gardait dans le trésor, après les avoir préparées avec soin »
la tête et la peau des bétes qui avaient été frappées. M. Maspero écrit ensuite, p. 278 : « Téglathphalasar I er se vantait d’en avoir rapporté un bon nombre de Syrie : « Je pris même de jeunes aurochs, ajoute-t- ii, et j’en « formai des troupeaux. » C’était une réserve de chasse qu’il voulait se ménager ; car il ne prétendait certes pas courber sous le joug ces brutes gigantesques, et les réduire à la condition de bœufs domestiques. D’autres après lui
tram en a trouvé les ossements fossiles dans le Liban. The natural history of the Bible, p. 150. D’après les inscriptions assyriennes, les aurochs devinrent de plus en plus rares, si bien qu’au vi « siècle avant J.-G. on les connaissait à peine. Il n’en est point parlé non plus dans les livres bibliques postérieurs à la captivité, et alors même que le Psaume xci serait plus récent, la mention si brève qu’il fait du re’êm ne permet pas de déterminer si
[[File: [Image à insérer]|300px]]
367. — Eoi d’Assyrie chassant le rîmu. Nimrond. D’après Layard, Monuments of Nïneveh, t. i, pi. 11.
essayèrent sans doute, sinon de les apprivoiser, du moins d’en garder dans des parcs ; aucune de leurs tentatives ne paraît avoir réussi ; et nous n’apprenons nulle part, dans les annales d’Assyrie, qu’il y ait jamais eu des troupeaux d’aurochs, nés ou simplement entretenus longtemps en captivité. Leur nom n’est déjà plus pour beaucoup de
le psalmiste le connaissait directement ou par ouï-dire. En tout cas les autres textes, surtout celui de Job, sont trop précis et trop conformes aux données de l’histoire naturelle, pour qu’on puisse les rapporter à une époque où l’animal n’était plus connu que par la légende. II y a là un de ces mille détails que les rationalistes négligent
[[File: [Image à insérer]|300px]]
368. — Offrande à la déesse Istar du rXmu tué à la chasse. Nimrond. D’après Layard, Monuments of Nlneveh, 1. 1, pi. 12.
contemporains (d’Assurbanipal, vie siècle avant J.-C.) qu’un mot dénué de sens précis. Ils ne savent plus trop ce qu’il désigne, un animal réel ou l’un de ces monstres fantastiques dont les races peuplèrent le monde aux premiers jours de la création. Les bas-reliefs commémoratifs sculptés sur les murs des palais sont bientôt seuls à montrer leur figure véritable. »
Toutes ces indications confirment ce que dit la Bible de la force, de la sauvagerie du re’êm, et de ses cornes redoutables. Puisque les rois d’Assyrie venaient le chasser jusque dans le voisinage septentrional de la Palestine, Us Jdébreux devaient bien le connaître/ Du reste M. Tris soigneusement, quand ils rajeunissent à plaisir la composition des Livres Saints. — Voir W. Hou gh ton, On the Unicom of the Ancients, dans Annals and Magazine of nalural History, novembre 1862, t. x, p. 363 - 370, 416-417 ; F. Hommel, Die Namen der Sàugethiere bei den nichtsemitischen Vôlker, in-8°, Leipzig, 1879, p. 227, 409°
- AUROGALLUS Matthieu##
AUROGALLUS Matthieu, philologue allemand, luthérien, dont le véritable nom était Goldhahn, — Aurogallus en est la traduction latine, — né en 1480 à Gomettau, en Bohême. Il étudia le latin, le grec et l’hébreu à l’université de Wittenberg, dont il devint recteur en 1542, et 1265
AUROGALLUS — AUTEL
J266
mourut dans cette dernière ville le 10 novembre de l’année suivante. Il fut l’ami de Luther et l’aida dans sa traduction de la Bible en langue allemande. Voir Allemandes (versions), col. 376. On a encore de lui : Liber de hebrxis urbium, regionum, populorum, fluminum, montium et aliorum locorum nominibus ex Veteri Testamento collectis, in-8°, Wittenberg, 1526 ; édit. augmentée, in-8°, Bâle, 1539 ; Grammatica hébrxse chaldeseque llnguse, Wittenberg, 152r> ; editio auctior, in-8°, Bàle, 1539. — Voir de Wette-Seidemann, Luther’s Briffe, t. vi, p. 709. L. Guilloreau.
- AURORE##
AURORE (Hébreu : saJiar, « ce qui s’élance ; » Septante : ôp6po ; , iw<7cpôpoç ; Vulgate : aurora, antelucanum, diluculum). L’aurore est le crépuscule du matin, dont la rapidité et la brièveté croissent à mesure qu’on se rapproche de l’équateur. Les Grecs et les Romains faisaient de l’aurore une divinité chargée d’ouvrir au soleil les portes du monde. Les Hébreux se sont contentés d’en admirer le merveilleux spectacle du haut de leurs montagnes et d’en parler poétiquement. Les Livres Saints tirent de l’aurore de nombreuses métaphores. L’auteur de Job, XLI, 9, compare aux « paupières de l’aurore » les yeux du crocodile. Les yeux de cet animal étaient, chez les Égyptiens, le signe hiéroglyphique de l’aurore. Les rayons divergents qui partent du soleil encore au-dessous de l’horizon sont comme les cils lumineux qui bordent les paupières de l’aurore personnifiée. Ailleurs elle a des ailes, symboles de sa rapidité. Ps. cxxxrx, 9 (hébreu). Dans le titre du Ps. xxi, qui doit être chanté sur l’air de « la biche de l’aurore », les talmudistes pensent que l’aurore est comparée à une biche, Berachoth, ꝟ. 2, c. 3, soit à cause de sa rapidité, soit parce que les cornes du gracieux quadrupède représentent les rayons du soleil qui va se lever. L’aurore n’est pour les Hébreux qu’un phénomène naturel, œuvre de la puissance divine. Job, xxxviii, 12 ; Ps. lxxiii, 16 ; Amos, iv, 13. C’est le signal de la prière. Sap., xvi, 28. Les rôdeurs de nuit redoutent son apparition, Job, xxiv, 17 ; mais ce serait une malédiction que d’être privé de sa vue. Job, iii, 9 ; Is., viii, 20 ; xlvii, 11.
L’aurore est le symbole de la doctrine qui illumine les âmes, Eccli., xxiv, 41, et de la vertu que Dieu bénit. Is., lviii, 8. Le roi de Babylone est appelé « fils de l’aurore », à cause de l’éclat de sa puissance et de ses richesses. Is., xiv, 12. Dans un sens beaucoup plus relevé, « l’aurore qui se lève » désigne l’épouse du Cantique, c’est-à-dire l’Église et la très sainte Vierge Marie, Cant., vi, 9, et surtout le Messie lui-même, II Reg., xxiii, 4 ; Ose., vi, 3, auquel Zacharie, père de saint Jean-Baptiste, donne le nom d’ « Orient », Luc, i, 78, et dont les enfants spirituels sont comme les gouttes de « la rosée de l’aurore ». Ps. cix, 3
(hébreu).AUSITIDE [Ausites), nom donné par la Vulgate à la terre de Hus, dans Jérémie, xxv, 20. Voir Hus 4.
- AUSPITZ Jacob##
AUSPITZ Jacob, Juif de Buda, qui vivait au commencement de ce siècle, a donné Baêr halluhôf, « Exposition des tables. » C’est une traduction en hébreu, accompagnée de notes tirées de plusieurs rabbins, d’un ouvrage latin sur la géographie de la Palestine et les stations des Israélites dans le désert. Elle parut en 1818, in-8°, sans indication de heu, mais elle avait été imprimée à Vienne.
E. Levesque.
- AUSTEN Andréas##
AUSTEN Andréas, théologien protestant allemand, né à Dantzig le 25 juillet 1658, mort à Elberfeld le 6 septembre 1703. Après avoir étudié dans différentes universités, il devint, en 1685, pasteur à Môllenbeck, près de Rinteln, et, en 1686, professeur de grec et de langues orientales à Rinteln. En 1690, il fut appelé comme prédicateur à Elberfeld, et y demeura jusqu’à sa mort. Il publia un certain nombre de dissertations curieuses sur
des sujets bibliques : Tpt’a ; Qusestionum : 1. An Adamus ante Evam uxorem habuer’U quse appellata Lilith ?2. An xaTaxXyfffuôç Noachï fuerit universalis an particularisa 3. An Moses fuerit cornutus ? in-4°, Rinteln, 1688 ; — Samuel personatus, sive Dissertatio de apparitione Samuelis ex I Sam. xxviii, in-4°, Rinteln, 1688 ; Dissertatio philologica de mortis génère quo Judas proditor vitss suie colophonem imposuit, iu-4°, Rinteln, 1688 ; Dissertatio philologica de Velamine mulieris, ex 1 Cor. xi, 10, in-4°, Rinteln, 1690 ; Thèses philologicse de lingua omnium prima, hebrœa, in-4°, Rinteln, 1690. Voir J. C. Adelung, Fortsetzung zu Jôcher’s Gelehrlen - Lexico, t. i, 1784, col. 1283 ; Frd. W. Strieder, Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten Geschichte, t. i, 1781, p. 190-194.
- AUTEL##
AUTEL, sorte de table en pierre, en terre, en bois ou en métal, sur laquelle on immole des victimes en sacrifice et l’on fait des offrandes à la divinité. Hébreu : mizbêah, « ce sur quoi on sacrifie, » de zàbah, « sacrifier, immoler, » Gen., viii, 20 ; cf. Lev., i, 9, 13, 15 ; I (III) Reg., vm, 31 ; II Par., xxix, 22. Septante : ôutiôpiov, 6u<jia<TTiîptov. On trouve plus rarement l’autel désigné par le mot bâmâh, IV Reg., xxiii, 8, le pwjx6ç des Grecs. Les auteurs inspirés réservent d’ordinaire ce nom pour désigner les hauts lieux, bàmôf, où se pratiquait le culte idolâtrique, Lev., xxvi, 30 ; III Reg., xi, 7 ; IV Reg., xxiii, 8, 9, 15, 19 ; Is., xxxvi, 7 ; Ezech., vi, 3 ; xx, 29, désignation complétée quelquefois par le nom de la divinité, bâmôt Ba’al. Num., xxii, 41 ; Jos., xiii, 17. Voir Hauts lieux. Cependant ce terme est quelquefois employé pour désigner les autels extra-légaux ou les autres lieux sacrés érigés par les Juifs sur les hauteurs en l’honneur de Jéhovah, même après la construction du tabernacle et du temple de Jérusalem. I Reg., ix, 12 ; III Reg., iii, 2-4 ; JV Reg., xii, 3 ; xiv, 4 ; xv, 4, 35 ; II Par., xv, 17 ; xx, 33. — Ézéchiel, xliii, 15, 16, appelle l’autel’âri’êl. Voir Ariel, col. 957.
I. L’autel a l’époque patriarcale. — Le premier autel mentionné dans l’Écriture est celui que construisit Noé après la sortie de l’arche, Gen., viii, 20 ; mais il est probable, bien qu’il n’en soit pas fait une mention expresse, que l’usage en existait déjà auparavant, et que Caïn et Abel employèrent un autel pour offrir leur sacrifice. Gen., iv, 3-4. — Après avoir élevé des autels commémoratifs à Sichem, Gen., xii, 7, près de Béthel, Gen., xii, 8 ; xiii, 4, et dans la vallée de Mambré, Gen., xiii, 18, Abraham en dressa un à l’endroit où il fut sur le point d’immoler son fils, et il y offrit un sacrifice sanglant. Gen., xxii, 9, 13. De même Isaac érigea à Bersabée un autel commémoratif. Gen., xxvi, 25. Jacob, à Béthel, fit une libation d’huile sur ceux qu’il éleva, comme un mémorial, massêbâh, après sa vision et à son retour de Mésopotamie, Gen., xxviii, 18 ; xxxv, 14 ; il immola des victimes à Galaad, Gen., xxxi, 54, et à Bersabée. Gen., xlvi, 1. Ces autels, comme tous ceux qu’on éleva dans ces temps primitifs, étaient construits en plein air, dans les bois, sur la cime des hauteurs, Gen., xxii, 2, 9 ; cf. Ezech., xviii, 6, 15, soit avec des pierres ramassées sur le sol, soit avec des mottes de gazon, sans apprêts, sans ornements, sans figures, usage qui persévéra jusque chez les Grecs et les Romains, dont les autels étaient quelquefois construits de simple terre. Lucain, Phars., IX, 988 ; Ovide, Trist., v ; Eleg., vi ; cf. Horace, Od., m ; Pline, H. N., v, 4.
II. Prescriptions mosaïques relatives aux autels.
— Pour prévenir les dangers de corruption auxquels le culte divin était exposé de la part du paganisme, il fallait que toutes les observances rituelles, et particulièrement celles des sacrifices, fussent réglementées dans le détail. Par suite, l’autel, si intimement lié au sacrifice, devait aussi être l’objet de ces minutieuses prescriptions. Dieu les donna à Moïse à deux reprises différentes, posant d’abord les principes généraux de la construction des autels, puis en faisant une application particulière aux deux autels du tabernacle. 1° Les principes sont que l’autel
élevé en l’honneur de Jéhovah doit être d’une très grande simplicité, construit en terre, Exod., xx, 24, ou tout au plus avec des pierres brutes. Exod., xx, 25. Le nombre des autels n’était pas restreint par ce précepte primitif ; il semble même que les Hébreux reçurent la faculté d’en élever partout où ils voulaient honorer le nom de Jéhovah. Exod., xx, 24. L’hébreu poile littéralement : « partout où je ferai souvenir de mon nom, » c’est-à-dire partout où j’ordonnerai de célébrer mon culte, ce qui doit s’entendre de toutes les circonstances dans lesquelles, soit par un ordre formel, soit par une autorisation implicite résultant d’une manifestation surnaturelle ou d’un bienfait extraordinaire dont il était opportun de garder le souvenir, les Hébreux étaient amenés à ériger des autels en différents lieux distincts du tabernacle, comme sur le mont Hébal, Jos., viii, 30 ; cf. Deut., xxvii, 4-6 ; sur le rocher d’Ophra, Jud., vi, ii, 24-26 ; à Sichem, Jos., xxiv, 26, 27 ; à Masphath, I Reg., vii, 9 ; à Ramatha, I Reg., vir, 17 ; ii Aïalon, I Reg., xiv, 35. Tel était aussi le gigantesque autel élevé par les tribus transjordaniques, Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé, sur les bords du Jourdain, selon le type de celui qui était devant letabernacle. Jos., xxii, 9-34.
— 2° Quand le tabernacle eut été construit, pour prévenir l’îdolâtrie à laquelle les Hébreux étaient toujours enclins, et dont ils auraient pu mêler les observances à l’immolation des animaux qui leur servaient de nourriture, Dieu établit, Lev., xvii, 3-5, que tous les animaux qu’on tuerait, même uniquement pour s’en nourrir, lui seraient offerts devant la porte du tabernacle. Cette loi, d’une observation facile tant que les Hébreux voyagèrent dans le désert, fut abrogée par Moïse quarante ans plus tard, lors de l’entrée dans la Terre Promise. Deut., xii, 15. — 3° À cette époque furent renouvelées, et dans des termes presque identiques, les prescriptions données au Sinaï. Exod., xx, 24-25. Les sacrifices devront être offerts « dans le lieu que Jéhovah aura choisi dans une des tribus ». Deut., xii, 43-14. En attendant qu’il fût déterminé et que Jérusalem devint le seul lieu habituel des sacrifices, la législation du livre de l’alliance subsistait : il était toujours licite d’immoler à Jéhovah là où il avait ordonné « de foire mémoire de son nom », et les expressions de la nouvelle législation, Deut., xii, 13-14, sont telles, que tout en restreignant à un seul lieu l’érection des autels pour le culte ordinaire et officiel, elles n’excluent pas que dans des circonstances extraordinaires on ne put, même après la construction du temple, ériger accidentellement et transitoirement d’autres autels et y offrir des sacrifices. Le seul passage où le mot d’ « autel unique » soit écrit dans la Rible, II Par., xxxii, 12, ne peut être une raison suffisante de nier cette assertion, le sens étant seulement d’opposer V « autel unique » du culte officiel et ordinaire à Jérusalem avec les autels extralégaux élevés par les Juifs sur les hauteurs ; et d’ailleurs celui qui, dans ce passage, allègue cette unicité d’autel en Israël, étant un païen peu au courant des usages religieux des Juifs, il n’y a pas lieu de se baser sur son témoignage.
Il est certain qu’à Gabaon, où le tabernacle resta après la translation de l’arche à Jérusalem, on continua de pratiquer les cérémonies du culte, I Par., xvi, 39 ; xxi, 29 ; cf. III Reg., iii, 4, ce qui suppose l’érection d’un autel. Dans les derniers temps des rois, il y eut des tentatives de réformes entreprises par Asa et Josaphat, pour ramener le culte à sa pureté parfaite. Mais leur résultat n’alla pas jusqu’à l’abolition des autels élevés sur les hauteurs en l’honneur du vrai Dieu. III Reg., xv, 14 ; xxii, 44. Ils subsistèrent du moins jusqn’à Ezéchias et Josias, qui purent les faire disparaître en même temps que les hauts lieux idolâtriques. IV Reg., xviii, 4 ; xxiii, 4-24. En tout cas, ce ne fut que pour un temps, car l’usage reparut avec les successeurs de Josias. Ces autels extra-légaux, par leur existence transitoire et accidentelle, ne faisaient que mieux ressortir le caractère public, officiel et immuable, des deux autels institués par Jéhovah comme éléments
essentiels de l’organisation du culte : l’autel des holocaustes et celui des parfums. Voir Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationaliste, 4e édit., t. iii, p. 172-186 ; de Broglie, La loi de l’unité du sanctuaire en Israël, in-8°, Amiens, 1892.
A ces premières prescriptions sur la construction des autels se rattache la prohibition de disposer des degrés pour y monter, Exod., xx, 26, prohibition qui regardait non seulement l’autel de l’alliance construit au pied du Sinaï, Exod., xxiv, 4, mais aussi tous les autres, et pour la même raison. Les vêtements spéciaux imposés plus tard aux prêtres pour monter à l’autel, Exod., xxviii, 42-43, rendirent cette défense inutile, et elle tomba en désuétude. Il y a lieu de penser que dans le temple de Salomon, et ensuite dans celui d’Hérode, la rampe qui conduisait à l’autel était coupée par trois séries de degrés. Vigouroux, Les Livres Saints et la critique rationaliste^ ¥ édit., t. iii, p. 173.
III. L’autel des holocaustes. — Voir Exod., XXVII, 1-8 ; xxxviit, 1-7. En hébreu : mizbêah hà’ôlâh, Exod., xxx, 28 ; appelé aussi l’autel d’airain, mizbêab. hannehô’set, Exod., xxxix, 39, et quelquefois par excellence hammizbêal, i, « l’autel. » III Reg., ii, 28.
1° Autel des holocaustes du tabernacle. — Selon les règles tracées par Dieu à Moïse, Exod., xxvii, 1-8 ; xxxviii, 1-7, il était de forme quadrangulaire, en bois d’acacia, haut de trois coudées, long et large de cinq, et sur toutes ses faces garni d’un revêtement en airain. Aux quatre angles supérieurs, il se terminait par quatre proéminences ou cornes de même matière, également revêtues d’airain et faisant corps avec lui ; en hébreu : « sortant de lui, » c’est-à-dire ne faisant qu’un morceau avec lui. Exod., xxvii, 2. Le nom de « cornes », qarnôt, leur fut sans doute donné à cause de leur ressemblance avec les cornes des animaux. Quoiqu’on ne puisse dire exactement quelle était la forme de cet ornement, ni si ces cornes émergeaient des parois de l’autel verticalement ou horizontalement, leur nom donne à penser qu’elles s’élevaient verticalement, avec une légère déviation vers le dehors. Sur les autels païens qui nous ont été conservés, elles avaient différentes formes (voir fig. 369 et fig. 377). On versait sur elles le sang des victimes, comme pour signifier que le péché était expié. Lev., iv, 7. Jérémie, voulant signifier un péché d’une gravité inexpiable, dit qu’il est gravé sur les cornes de l’autel « n caractères ineffaçables. Jer., xvii, 1. Celui qui les tenait embrassées, fùt-il le plus criminel des hommes, était réputé inviolable, III Reg., i, 50 ; ii, 28, hormis le cas de meurtre volontaire. Exod., xxi, 14. Si les cornes de l’autel ou seulement l’une d’elles étaient brisées, l’autel perdait son caractère sacré. Am., m, 14.
L’autel des holocaustes était encadré à sa partie supérieure par une sorte de corniche ou bordure, karkôb, Exod., xxvii, 5, au-dessous de laquelle descendait, à mihauteur de l’autel, une sorte de grille ou treillis d’airain, mikbâr, que plusieurs exégètes placent à la partie inférieure, Fillion, Atlas archéol., 2e édit., pi. xcviii, fig. 6, tandis qu’ils entendent par le karkôb une sorte de gradin émergeant autour de l’autel, à mi-hauteur et au-dessus de la grille, gradin sur lequel les prêtres pouvaient aller et venir comme sur un chemin de ronde. Cette dernière interprétation peut difficilement s’harmoniser avec les dimensions de l’autel des holocaustes dans la période du tabernacle. Quatre anneaux d’airain fixés aux quatre coins permettaient d’introduire les bâtons destinés à porter l’autel des holocaustes, que personne ne pouvait toucher excepté les prêtres, Exod., xxix, 37 ; xxx, 29, et les criminels qui s’y réfugiaient. Il était placé dans la cour du tabernacle. Lev., iv, 18.
Les règles de construction semblent n’avoir pas été les mêmes pour l’autel de l’alliance, Exod., xx, 24 ; xxiv, 4, et celui des holocaustes ; car le premier devait être plein et massif, le second creux à l’intérieur. Exod., xxvii, 8 ;
xxxviii, 7. L’hébreu : « Tu le feras creux, en planches, » Exod., xxvii, 8, donne lieu de penser que cette disposition avait été prise pour la facilité de la translation à travers le désert ; mais qu’aux stations, avant d’offrir les sacrifices, on emplissait l’intérieur de petites pierres, ce qui le rendait semblable à l’autel de l’alliance, et c’était alors sur la surface plane de ce remplissage qu’on devait allumer le feu destiné à consumer les victimes. Autrement on ne concevrait pas que les parois du bois ne fussent pas endommagées par ce feu, souvent très ardent. L’expression « descendre de l’autel », Lev., ix, 22, suppose manifestement que l’autel, quand on le dressait pour le sacrifice, était élevé de terre, et que le prêtre y montait par le plan incliné dont il a été question plus haut. Cf. Exod., XX, 26.
Bien que le nom de l’autel des holocaustes, mizbêah
— - -£.S
[[File: [Image à insérer]|300px]]
869. — Aiitel à cornes. Temple d’Isls à Pompél.
hâ’ôlàh, fût tiré des sacrifices sanglants, qui étaient les plus parfaits, on y offrait aussi tous les sacrifices non sanglants, excepté ceux de parfums, auxquels un autel spécial était réservé. Un feu perpétuel était entretenu sur le foyer, non seulement en vue des holocaustes, mais aussi pour les sacrifices d’hosties pacifiques, dans lesquels une partie de la victime devait être brûlée. Lev., iii, 5 ; vii, 2. Chaque matin et chaque soir un holocauste y était offert comme sacrifice officiel et régulier ; c’était ce qu’on aprMait’ôlat hattâmîd, « l’holocauste perpétuel. » Num., xxviii, 6, 10, 15, 23. Voir Holocauste.
Différents instruments avaient été prescrits par Dieu pour le service de cet autel, Exod., xxvii, 3 ; xxxviii, 3, savoir : un bassin, sïrôt, pour recueillir les cendres du loyer, et des pelles, yâim, pour les enlever, Exod., xxvii, 3 ; xxxviii, 3 ; des bassins, mizrâqôf, mizrâqîm, pour recevoir le sang des victimes, Exod., xxvii, 3 ; xxxviii, 3 ; des réchauds pour porter les charbons, mahtôt, Exod., xxvii, 3 ; xxxviii, 3 ; Num., xvi, 6-7 ; de petites fourches pour remuer le feu ou les chairs brûlant sur le brasier, ou encore pour saisir dans la cuve où elles avaient cuit, la part de viande destinée aux prêtres ou à ceux qui offraient la victime, mizlâgôf. Exod., xxvii, 3 ; xxxviii, 3.
Quand l’autel des holocaustes eut été achevé, avant d’être employé pour le culte divin, il fut solennellement consacré. La consécration eut lieu en même temps que celle des prêtres, et s’accomplit par l’onction avec l’huile sacrée, puis des aspersions sept fois répétées avec le sang du sacrifice pour le péché, offert par les prêtres, et renouvelées pendant les sept jours que dura la consécration des prêtres. Exod., xxx, 25-28 ; cf. xxix, 12-13 ; 36-37 ; XL, 9-10 ; Lev., vm, 10-15 ; Num., vii, 1. Après cette cérémonie, l’autel fut inauguré par une série de sacrifices qui durèrent douze jours, pendant lesquels les princes de chaque tribu vinrent offrir à tour de rôle de nombreuses victimes. Num., vii,
10-84. À partir de ce moment, tous les sacrifices durent être offerts sur l’autel des holocaustes.
2° Autel des holocaustes du temple de Salomon. — Il est appelé ordinairement « l’autel d’airain ». III Reg., Vin, 64 ; IV Reg., xvi, 14, 15. Il garda sa place dans le parvis, devant le vestibule du temple, Joël, ii, 17, et fut construit d’après les mêmes règles que celui du tabernacle ; mais ses dimensions furent augmentées, l’ancien autel ayant paru insuffisant pour plusieurs sacrifices plus considérables. III Reg., viii, 64. On lui donna vingt coudées de long, vingt de large et dix de haut, II Par., iv, 1, c’est-à-dire environ dix mètres carrés de surface sur cinq mètres de hauteur. D’après la tradition et d’après la vision du
[[File: [Image à insérer]|300px]]
370. — Autel des holocaustes,
d’après les traditions rabbiniques, dans Surenhustus.
temple symbolique d’Ézéchiel, xliii, 17, on y arrivait par des degrés. Au témoignage du Talmud (Surenhusius, Mischna, Amsterdam, 1690-1703, t. ii, p. 260), la rampe en terre qui y conduisait était coupée par trois séries de degrés (fig. 370).
L’autel des holocaustes construit par Salomon fut restauré sous Asa. II Par., xv, 8. Il subit plusieurs fois des profanations. Achaz, après avoir fait élever dans le parvis un autel de forme païenne, comme celui qu’il avait vu à Damas, relégua sur le côté, et probablement dans la direction du nord, l’ancien autel, et le laissa dans l’oubli. IV Reg., xvi, 10-15. Voir Achaz, col. 13*. La Sainte Écriture laisse entendre qu’une restauration en fut faite par son successeur, le pieux Ézéchias. IV Reg., xviii, 4-6. Manassé en fut tour à tour le profanateur et le restaurateur. IV Reg., xxi, 4-5 ; II Par., xxxiii, 4-5, 16. On voit encore aujourd’hui, dans le Haram esch-Schérif, une roche appelée parles mahométans es-sakkrah, et regardée comme sacrée, parce que, d’après une vieille tradition, elle était enclavée dans l’autel des holocaustes construit par Salomon. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit, t. iii, p. 495.
3° L’autel des holocaustes du temple de Zorobabel. — Après le retour de la captivité, l’autel des holocaustes fut reconstruit conformément à l’ancienne réglementation. I Esdr., iii, 2-6 ; cf. Exod., xxvii, 1-8. D’après Hécatée d’Abdère, cité par Josèphe, Conl. Apion., 1, 22, « il était de forme quadrangulaire et fait de pierres jointes sans l’emploi du marteau ; chacun des côtés était de vingt coudées, et sa hauteur de dix. » Malheureusement l’époque de Néhémie, où la misère était extrême, fut, pendant son absence de Jérusalem, un temps d’indifférence relt
gieuse, et l’autel des holocaustes, comme le temple lui-même, fut oublié, taudis que les prêtres se dispersaient dans les campagnes pour trouver leur subsistance. II Esdr., xiii, 10. L’oubli fut plus grand encore lorsque, par ordre du général des Perses Bagosès, un impôt fut prélevé pendant sept années sur chaque sacrifice. Josèphe, Ant. jud, XI, vii, 1. Avec toutes les choses saintes, il fût profané par Antiochus IV Épiphane, roi de Syrie. 1 Mach., i, 23, 57 ; iv, 38. D’après Josèphe, il dressa dans le temple un autre autel sur lequel on immolait des pourceaux. Ant. jud., Xll, v, 4. Judas Machabée, l’ayant trouvé dans ce délabrement après sa victoire sur les Syriens, le fit démolir entièrement, « parce que les Gentils l’avaient souillé, » I Mach., IV, 44-45 ; et, conservant par respect les pierres dont il était construit, il en érigea un autre avec des pierres neuves non polies, selon les règles données par Jéhovah, Exod., xx, 25 ; Deut., xxvii, 5-6, de sorte que ce second autel « était semblable au premier ». I Mach, iv, 47, 53. La dédicace solennelle en fut faite « le vingt-cinquième jour du mois de Casleu…, au même jour que trois ans auparavant le temple avait si indignement été profané par Antiochus », Josèphe, Ant. jud., XII, vii, 6, et il fût établi que, comme chaque année le peuple célébrait le souvenir de la dédicace du temple, il célébrerait aussi eu cet anniversaire la dédicace de l’autel. I Mach., IV, 56, 59. Josèphe nomme cette fête çôtï, « lumières, » du grand nombre de flambeaux qu’on y allumait. Josèphe, Ant jud., XII, vii, 7.
L’autel des holocaustes ne subit pas de modification importante depuis Judas Machabée. Josèphe, Bell, jud., V, et la Mischna, Middôth, i, 4 ; iii, 1, 2, 4, en font une description sommaire. Il avait cinquante coudées de long, autant de large et quinze de haut, Josèphe, ibid. (trente-deux coudées seulement de long et autant de large, d’après ie Tahnud, Middôth, i, 4). Ni le ciseau ni le marteau n’avaient touché ses pierres, et, à la place du revêtement d’airain, on avait garni les parois extérieures d’un enduit solide, qui pouvait facilement être renouvelé ; il était de moindres dimensions à sa partie supérieure, dont la surface n’avait que vingt-quatre coudées de côté, ce qui s’explique par les terrasses ou chemins de ronde superposés qui étaient pris sur son épaisseur. Gomme à celui du temple de Salomon, on y montait par un plan incliné qui était du côté du midi ; mais les quatre cornes étaient, selon les traditions talmudiques, en forme de cubes de bois d’une coudée de côté, et remplis à l’intérieur de pierres, de poix, de chaux et de plomb (selon Josèphe, elles étaient en forme de poteaux d’angle et semblables à des cornes, xspaToei&î ? Y « vfaç. Bell, jud., V, v, 6). Près de celle du sud-ouest se trouvait le canal par où s’écoulait le sang des victimes, et une autre cavité qui servait à recevoir les libations.
Jésus-Christ fait allusion à l’autel des holocaustes dans le discours sur la montagne, quand il recommande de ne pas y sacrifier avant d’être réconcilié avec le prochain, Matth., v, 23, 24, et ailleurs, quand il nous apprend que les Juifs avaient l’habitude de jurer par l’autel comme par le temple. Matth., xxiii, 18. Voir aussi I Cor., ix, 13.
IV. L’autel des parfums (hébreu : mizbêah haqqetôréf. Exod., xxx, 27). — Il était ainsi nommé parce qu’il était exclusivement réservé à l’oblation des parfums qu’on y faisait brûler en l’honneur de Dieu. Nous n’en n’avons pas de représentation antique ; on n’a retrouvé que des peintures païennes dans lesquelles on voit brûler des substances odorantes en l’honneur des dieux (fig. 371). L’autel des parfums n’est pas nommé dans la première instruction divine donnée à Moïse pour l’organisation du tabernacle. Exod., xxv-xxvii. Ce n’est qu’après la description des ornements des prêtres et des lévites, après la détermination des ri*ss pour leur consécration, qu’il en est question dans une sorte d’appendice. Exod., xxx, 1-10. Son institution paraît donc avoir été postérieure à celle des autres objets placés dans le Saint, Exod., xxvi, 33-35, et avoir été amenée
par l’institution de la grande expiation annuelle. Exod., xxx, 10 ; Lev., xvi, 12-13. Cf. Exod., xxx, 1-10 ; xxxvii, 25-28 ; Lev., iv, 7 ; III Reg., vi, 20 ; vii, 48 ; I Par., xxviii, 18 ; Is., VI, 6 ; I Mach., i, 23 ; IV, 49, etc.
Cet autel était de proportions minimes, une coudée de long, une de large, soit environ cinquante centimètres de côté, et deux coudées ( à peu près un mètre) de haut ; il était fait de planches d’acacia (voir Acacia) revêtues d’un or très pur, d’où son autre nom d’ « autel d’or », mizbêah hazzâhâb. Exod., xxxix, 38 ; XL, 5, 20 ; III Reg., vu, 48. La partie supérieure était surmontée d’une corniche ou rebord, également en bois couvert d’or, qui empêchait les parfums de se répandre. Comme l’autel des holocaustes, il était muni aux quatre angles de cornes de même matière. Deux anneaux d’or étaient fixés aux côtés, pour passer les bâtons d’acacia couvert d’or qui servaient à le porter. Dans les marches, le tout était recouvert
z.S
371. — Autels païens à parfums. Peinture trouvée à Rome. D’après Wiuckelmana, Monuments inédits, pi. 177.
d’une étoffe de couleur pourpre, elle-même protégée par une couverture imperméable en peau de dugong ( hébreu : tahas. Exod., xxv, 5. Voir Dugong.
Cet autel occupait le milieu du Saint, entre le chandelier à sept branches et la table des pains de proposition, tout près du voile qui fermait le Saint des saints. Il était aiftsi en face de l’arche et du propitiatoire, ce qui l’a fait appeler « l’autel de l’oracle », III Reg., VI, 22 ; cf. Heb., ix, 4 ; ou encore « l’autel qui est en face du Seigneur », Lev., iv, 18, par opposition à l’autel des holocaustes, qui était « à l’entrée du tabernacle ». Lev., iv, 18.
L’autel des parfums du temple de Salomon est mentionné plusieurs fois dans les livres des Rois, III Reg., i, 20, 22 ; . vu, 48 ; IX, 25, tandis qu’il y est seulement fait allusion à l’autel des holocaustes. III Reg., ix, 25. L’auteur des Paralipomènes en parle également I Par., xxviii, 18 ; II Par., iv, 19 ; xxvi, 19. Il était en bois de cèdre, III Reg., vi, 20, et non d’acacia comme celui de Moïse. Il est appelé quelquefois « autel d’or », III Reg., vii, 48, parce qu’il était recouvert d’or. III Reg., vi, 20, 22 ; II Par., iv, 19. Il avait les mêmes dimensions que celui du tabernacle, tandis qua celui qu’Ézéchiel contempla dans sa vision avait trois coudées de haut, deux de long et (Septante) deux de large.. Ezech., xli, 22. Il est également mentionné dans le templede Zorobabel, où il fut rétabli après qu’on l’eut retiré de la caverne où Jérémie l’avait caché lors de la prise de Jérusalem, II Mach., ii, 5, et plus tard par Judas Machabée, après qu’Antiochus IV Épiphane l’eut brisé pour en enlever le parement d’or. I Mach., i, 23 ; iv, 49. Josèphe, dans l’énumération des objets précieux enlevés par Titus du temple d’Hérode et apportés à Rome, Bell, jud., Vil, v, 5, ne dit rien de l’autel des parfums, et lorsqu’il raconte la prise de Jérusalem par Pompée et la visite de celui-ci
dans le temple, il n’en est pas explicitement question, bien que d’autres objets du culte de moindre importance soient signalés, Ant. jud., XIV, IV, 4 ; Bell, jud., i, vu, 6 ; mais ailleurs le même auteur le désigne sûrement par le mot (hju.iscriiptoM, que plusieurs traducteurs ont mal rendu par l’expression « vase à parfums ». Bell, jud., V, v, 5 ; cf. Ant. jud., III, viii, 2 ; Bell, jud., VI, viii, 3. C’est par ce mot que l’autel des parfums est désigné dans saint Paul, Hebr., rx, 4. Josèphe, sans le décrire, le met au nombre des trois chefs-d’œuvre contenus dans le sanctuaire, qu’il déclare dignes d’une renommée universelle. Consacré à l’origine par l’onction de l’huile sainte, Exod., xxx, 25-27, cet autel servait chaque matin et chaque soir à l’oblation du sacrifice de l’encens. Exod., xxx, 7-8. Puis chaque année, dans la grande fête de l’Expiation, Lev., xvi, 14-19 ; cf. Exod., xxx, 10, il était solennellement purifié. Voir Expiation (Fête de l’). L’autel des parfums servait encore à deux autres cérémonies expiatoires, ayant pour objet d’expier, l’une, quelques fautes spéciales commises par le grand prêtre, Lev., iv, 2-12, l’autre, les
372. — Alltel égyptien chargé d’offrandes. Tel ! el-Amarna, xviip dynastie. D’après Lepsius, D&nkmaler, Afctb. iii, pi. 96.
péchés d’ignorance du peuple. Lev., iv, 13-14. Le rite consistait à asperger du sang des victimes pour le péché les cornes de l’autel, après avoir aspergé sept fois le voile du Saint des saints. La cérémonie se terminait par l’effusion du sang au pied de l’autel des holocaustes. Lev., iv, 3-21.
V. Autels idolatriques. — Ceux dont la Sainte Écriture parle le plus souvent sont les autels que les Juifs élevèrent, pour satisfaire leur penchant à l’idolâtrie, en l’honneur des divinités étrangères. III Reg., xiv, 23 ; IVReg., xvii, 11 ; II Par., xiv, 5 ; xxviii, 23-25 ; cf. xxxiv, 4 ; Jer., xi, 13, etc. Mais il y est également question de ceux que les peuples voisins érigèrent chez eux, et quelquefois même en Palestine, après s’y être établis en vainqueurs.
i « Autels idolatriques des Hébreux. — Déjà dans le désert du Sinaï ils élevèrent un autel au veau d’or, en souvenir sans doute du bœuf Apis, dont les Hébreux avaient vu les autels et les images, dans leur séjour en Egypte, Exod., xxxii, 5 ; cf. Aet., vii, 41 (voir Apis) ; puis les autels de Baal, le grand dieu des races sémitiques du nord, Chananéens, Tyriens, Syriens, pour le culte duquel les Hébreux semblent avoir eu un attrait prédominant. Déjà, du temps des Juges, ils lui dressaient des autels. Jud., vi, 25, 28, 32. Gédéon détruisit celui d’Éphra ; mais ils se multiplièrent sous les rois soit d’Israël, soit de Juda, excepté sous le règne de quelques princes religieux et zélés, qui les détruisirent pour un temps. III Reg., xvi, 32 ; ÎV Reg., x, 18-24 ; xi, 18 ; xxi, 3 ; xxiii, 4, 5, 8 ; II Par., xxm, 17 ; xxxiii, 3-, 15. Il faut signaler entre tous l’autel de modèle païen, syrien ou peut-être assyrien, que l’impie Achaz fit ériger dans le temple de Jérusalem, après en avoir pris le dessin à Damas. À cet autel s’attache cette particularité, qu’étant de type idolâtrique, et par consé quent contraire à la loi mosaïque, il fut probablement destiné à l’oblation de sacrifices en l’honneur du vrai Dieu. IV Reg., xvi, 12-15. En même temps qu’ils élevaient des autels à Baal, les Hébreux en dressaient pour honorer sa compagne inséparable, Astarthé. Jud., ii, 13 ; I Reg., vu, 4 ; HI Reg., xi, 5 ; II Par., xxiv, 18 ; Jer., xliv, 18. H y eut probablement aussi à certaines époques, chez les Hébreux, des autels en l’honneur de Moloch, le dieu des Ammonites, et de Chamos, le dieu des Moabites, au culte desquels les Juifs se laissèrent quelquefois entraîner. Lev., xviii, 21 ; xx, 2-5 ; III Reg., xi, 5-7, 33 ; Jer., xxxii, 35 ; Am., v, 26. Manassé érigea aussi des autels « à toute l’armée des cieux dans les deux parvis de l’a maison du Seigneur ». IV Reg., xxi, 5 ; cf, xvti, 16 ; xxiii, 4. Achaz avait également dressé des autels idolatriques « dans tous les coins de Jérusalem » et dans toutes les villes de Juda. II Par., xxviii, 24, 25 ; cf. xxx, 14. Vers l’époque delà captivité, les Juifs, au témoignage de Jérémie, en étaient arri 373. — Autel assyrien. Musée du Louvre.
vés à avoir autant d’autels idolatriques qu’il y avait de rues dans Jérusalem. Jer., xi, 13. Enfin par ordre d’Antiochus IV Épiphane furent élevés dans Jérusalem et dans toutes les villes de Juda des autels païens sur lesquels on offrait, par mépris de la loi mosaïque, des pourceaux et des animaux impurs en sacrifices. I Mach., i, 46-50.
2° Autels idolatriques des nations étrangères. — Ceux qui sont signalés dans l’Écriture sont d’abord ceux des Chananéens, que Dieu ordonna aux Hébreux, à différentes reprises, de renverser lors de leur entrée dans la Terre Promise, Exod., xxxiv, 13 ; Deut., vii, 5 ; xii, 3 ; Jud., ii, 2, et particulièrement ceux que dressa Balac, roi des Moabites, sur l’ordre de Balaam, sur les hauts lieux consacrés à Baal, et qui étaient assez grands pour contenir chacun un taureau et un bélier. Num., xxii, 41 ; xxiii, 1-2.
3° Forme des autels païens. — Ces autels, aussi bien que ceux des autres peuples, Égyptiens, Assyriens, Grecs, Romains, étaient de forme très variable. Les monuments de l’antiquité païenne en offrent des spécimens de forme quadrangulaire, rectangulaire, polygonale, ronde, ovale. Voir des autels égyptien, fig. 372 ; assyrien, fig. 373 ; grec, fig. 374 ; romain, fig. 375. On peut dire qu’en général les autels orientaux étaient plutôt quadrangulaires, les autels grecs et latins plus souvent ronds ; mais les exceptions sont nombreuses. La hauteur n’est pas moins variable. Chez les Grecs et les Latins, les uns ne sont pas plus élevés que le genou d’un homme, d’autres dépassent sa tête. L. Agostini, Le Gemme antiche figurate, 2 in-4°, Rome, 1657-1669, t. i, pi. 142.
La distinction des grammairiens entre « petit autel », ara, et « autel élevé », altare (alta-ara), semble confirmée par l’expression de Pline le Jeune : Inter aras et altaria, Pline, Pcmeg., i, 5. Souvent ces autels portaient le nom de la divinité à laquelle ils étaient consacrés. C’est ce que suppose l’inscription de l’autel d’Athènes dont saint Paul tire l’exorde de son discours à l’Aréopage. Act., xvii, 22-23. Voir Athènes, col. 1213. On y représentait souvent des festons de feuillage et de fleurs (fig. 376), et sur quelques-uns, comme celui du temple de Samas, à Sippara, on entretenait un feu perpétuel. Lenormant, Histoire ancienne de l’Orient, 9e édit., t. v, p. 306. Plusieurs avaient à leurs angles supérieurs des proéminences analogues aux cornes prescrites pour les deux autels du tabernacle mosaïque (fig. 377). Ces autels étaient placés dans l’intérieur des temples, ou en dehors, comme était
[[File: [Image à insérer]|300px]]
374. — Autel grec. Vase antique.
D’après Gerhard, Auserles. Vasenbilder, pi. 155.
l’autel des holocaustes à Jérusalem, ou encore dans les rues, comme cet autel des Lares Viales retrouvé dans les ruines de Pompéi, adossé au mur extérieur d’une maison. Voir Rich., Dictionnaire des antiquités romaines et grecques, p.45 ; c{. Plaute, Aul., i, l, 20 ; Most., V, i, 45 ; quelquefois à la porle des villes. Act., xiv, 12. Quand ils étaient à l’intérieur des maisons, ils se trouvaient ordinairement dans l’atrium et étaient consacrés aux dieux pénates.
VI. Autel chrétien. — Il est appelé par saint Paul ft’jutauTïipiov, altare, Heb., xiii, 10, et TpàrceÇa Kupi’ou, mensa Domini, I Cor., x, 21, expressions qui désignent soit le sacrifice offert sur l’autel de la loi nouvelle, soit la table de la dernière cène, sur laquelle ce Bacrifice fut institué et célébré pour la première fois. La seconde de ces dénominations tomba de bonne heure.en désuétude, tandis que la première, traduite chez les Pères latins par altare, demeura presque exclusivement reçue, Cf. S. Ignace, Epist. ad Ephes., t. v, col. 736 ; Origéne, Homil-, x, in Num., t. xii, col. 638 ; S. Irénée, Adv. Hseres., iv, 18, t. vii, col. 1029 ; S. Cyprien, Ep. xl, t. iv, col. 336. Les Pères latins se servent aussi du mot ara.
L’autel sur lequel fut célébré pour la première fois le sacrifice eucharistique fut la table de pierre, ou plus probablement de bois, du Cénacle, où Jésus-Christ fit la dernière Cène avec ses Apôtres. À son exemple, les pre miers chrétiens se servirent d’abord de tables de bois, sur lesquelles se faisaient en même temps les agapes. Act., il, 46 ; xx, 11 ; Cor., xi, 20-34. Lorsque celles-ci furent séparées du sacrifice proprement dit, les autels changèrent déforme tout en conservant leur matière primitive. L’autel conservé à Rome dans la basilique de Saibt-Jean-de Latran, et sur lequel, d’après la tradition, saint Pierre offrait le saint sacrifice, est une table de bois en forme de coffre. Rasponi, De basilica lateran., Rome, 1656 ; Ciampini, De sacris sedificiis a Constantino niagnoconstructis, Rome, 1693, p. 15. Avec le temps, soit sous saint Sylvestre I 8r, soit un peu plus tard, on commença à substituer aux autels de bois des autels de pierre qui fournissaient, avec une plus grande solidité, un symbole plus frappant de Jésus, la pierre fondamentale et vivifiante de l’Église. I Cor., x, 4. Saint Grégoire de Nysse, Orat. de
[[File: [Image à insérer]|300px]]
375. — Autel du temple de Vespasien de Pompéi.
baptism. Christi, t. xlvi, col. 582, et saint Jean Chrysostome, Boni, xx in II Epist. ad Cor., t. lxi, col. 539-540, parlent d’autels de pierre pour le saint sacrifice. Depuis Constantin, on voit aussi les chrétiens élever des au tels d’argent et d’or, ou du moins incrustés d’or, d’argent et de pierres précieuses. AnastaseBiblioth., Hist. devitis Rom. pont., Patr. lat., t. cxxvii, col. 1519-1520, 1523-1524 ; Sozomène, H. E., ix, 1, t. lxvii, col. 1596. Cependant les autels de bois ne disparurent pas complètement (S. Optât de Milève, 1. VI, t. xi, col. 1064, 1065, etc. ; S. Augustin, Ad Bonifac, Ep. clxxxv, t. xxxiii, col. 805 ; cf. Martène, Deantiq. rit., i, iii, 6, n. 5, Rouen, 1700, t. i, p. 301), jusqu’à ce que la législation ecclésiastique en vînt à déterminer la pierre comme la matière obligatoire de l’autel. Concile d’Épaone, 517, can. 33. De plus, les chrétiens, qui pendant la période des persécutions avaient pris l’habitude d’offrir le saint sacrifice sur les tombeaux des martyrs ensevelis aux catacombes, continuèrent après Constantin à élever de préférence leurs autels là où reposaient les corps des saints, ou du moins à y renfermer des reliques. S. Ambroise, Epist. XXII ad Marcellin. soror., t. xvi, col. 1023 ; S.Jérôme, Cont. Vigilant., t. xxiii, col. 346 -347 ; S. Augustin, Cont. Faust., xx, 21, t. xlii, col. 384 ; Prudence, Peristephan. , flymn. iii, 212, t. xl, col. 356 ; Hymn. v, 515 et sq., col. 407. De là vint qu’on donna souvent aux autels
chrétiens la formed’un sépulcre. On en construisit aussi, et dès le Ve siècle, dans lesquels la table de l’autel reposa sur des colonnes en nombre plus ou moins grand, quelquefoissur une seule. C. Kozma de Papi, Liturgica sacra, I, 13, 2e édit., in-8°, Ratisbonne, 1863, p. 28-31.
VII. Autel de l’Apocalypse. — li faut enfin signaler l’autel céleste qui fut montré à saint Jean dans ses visions à Patmos, Apoc, vi, 9 ; viii, 3-5 ; ix, 13 ; xiv, 18 ; xvi, 7, et qui pour la forme et l’usage se rapproche de l’autel des parfums de l’Ancien Testament, Comme celui-ci il était « en or » et placé « devant les yeux de Dieu », avec quatre cornes aux quatre angles. Apoc., viii, 3 ; ix, 13. Sur le feu qui y brûlait, un ange, remplissait une sorte d’office sacerdotal, Lev., xvi, 12-13, répandait des parfums, qui représentaient les prières des saints. Apoc, vm, 3. Il est fait allusion à ce passage dans les prières de la liturgie latine de la messe, lorque le prêtre de Parmi ses nombreux ouvrages, on remarque : Veber das Buch Hiob, Tubingue, 1823 ; Veber den Vrsprung der Beschneidung bei wilden vnd halbwilden Vôikem mit Beziehung auf die Beschneidung der Isræliten, Tubingue, 1829. — Voir K. Klupfel, Geschichte und Beschreibung der UniversitàtTûbingen, m-8°, Tabingue, 1849, p. 254 ; Guilt, dans Biograpkisches Lexicon der Aerzte, t. i, Vienne et Leipzig, 1884, p. 231-233.
- AUTOMNE##
AUTOMNE, l’une des quatre saisons de l’année chez les Grecs et les Latins, celle de la récolte des fruits. La division des quatre saisons était inconnue aux anciens Hébreux (voir Saisons). II n’est donc parlé de l’automne que dans le Nouveau Testament, dans PÉpître de saint Jude, qui, écrivant en grec, fait allusion à une saison bien connue de ses lecteurs. Il compare, jt. 12, les hérétiques, qui ne produisent rien de bon, aux « arbres d’au 376. — Autel orné de fleurs.
Peinture du temple d’Isis à Pompéi. Musée de Naples.
mande à Dieu que « par les mains de son saint ange les offrandes soient présentées sur l’autel céleste, en présence de la divine majesté. » Au-dessous ou au pied de l’autel apocalyptique, l’apôtre vit les âmes de ceux qui avaient été tués « pour la parole de Dieu », allusion probable à l’effusion du sang des victimes au pied de l’autel, dans l’ancienne loi. Krementz, Die Offenbarung des h. Johannes, Fribourg-en-Brisgau, 1883, p. 78, 90, 100. VoirK. Ch. W. Bahr, SymbolikdermosaischenCultus, t. i, p. 419 et suiv. ; Cramer, De ara exteriore templi secundi, Lyon, 1697 ; Cremer, Antiq. sacr., t. t, p. 297 et sq. ; Hamm, De ara suffitûs, 1715 ; Kitto, The Tabernacle and ils furniture, Londres, 1849 ; Lamy, De tabernaculo, de sancta civitate et templo, Paris, 1720, p. 439 et suiv. ; Lempereur, Mischria, Middêth, Leyde, 1630 ; Lightfoot, Descriptio templi hierosolymitani, dans ses Œuvres complètes, 1. 1, p. 549 ; Van Til, Commentar. de Tabernaculomosaïco, dans Ugolini, Thésaurus antiquitatum sacrarum, t. vm. P. Renard,
- AUTENRIETH##
AUTENRIETH (Johannes Hermann Ferdinand von), médecin allemand, né à Stuttgart le 20 novembre 1772, mort à Tubingue, le 2 mai 1835. Après avoir voyagé en Italie et dans l’Amérique du Nord, il s’établit à Stuttgart pour y exercer la médecine. En 1797, il fut nommé professeur d’anatomie, de physiologie et dechirurgie à l’université de Tubingue, dont il devint chancelier en 1822.
[[File: [Image à insérer]|300px]]
377. — Autel à cornes.
Peinture du temple d’Isis à Pompéi. Musée de Naples.
tomne », êsvêoa çOivonupuMâ, parce que les arbres n’ont alors plus de fruits et perdent même leurs feuilles. — Quoiqu’il n’y ait dans l’Ancien Testament aucun mot qui désigne l’automne, saint Jérôme a employé deux fois cette expression dans la traduction des prophètes, Is., xxviii, 4, et Mich., vil, 1, pour rendre l’hébreu qaîs, qui signifie proprement « le temps de la chaleur, l’époque où l’on moissonne et où l’on cueille des figues. » Le traducteur de la Vulgate s’est servi du mot « automne » dans ces deux passages, parce qu’il y est question de la récolte des fruits. F. Vigouroux.
- AUTPERT Ambroise##
AUTPERT Ambroise, appelé aussi Ausbert et Antbert, commentateur bénédictin du vme siècle, « le plus illustre écrivain qu’ait produit la France en ce siècle d’ignorance, » dit l’Histoire littéraire de la France, t. iv, 1738, p. 141. Né en Gaule dans les premières années du VIIIe siècle, et instruit dans les lettres divines à l’exclusion des lettres profanes, il passa en Italie avec les personnagesde la cour de Pépin qui, sur l’ordre de ce roi, accompagnèrent en 754 le pape Etienne IL à Rome. Quelque temps après, en visitant le monastère de SaintVincent, situé sur la rivière de Voltorne, près de Bénévent, il fut si édifié de la sainteté des moines, qu’il s’y fit lui-même religieux. Plus tard, en 776, il en fut élu abbé par une parlie de la communauté, tandis que l’autre partie élut un religieuxiiominé Poton. Le pape Adrien I er manda à Rome les deux élus,
et Autpert mourut en s’y rendant, le 19 juillet 778. Son œuvre la plus considérable est son Expositio in Apocalypsim { Migne, Patr. lai., dans les Œuvres de saint Augustin, t. xxxv, col. 2417-2452). Presque tout y est expliqué dans un sens moral. Deux de ses homélies sur les Évangiles sont dans Migne, Pair, lat., t. lxxxix, col. 1291-1320.
- AUTROCHE##
AUTROCHE (Claude Deloynes d’), littérateur, né à Orléans le 1 er janvier 1744, mort dans la même ville le 17 novembre 1823. Il s’est adonné surtout à la traduction des classiques en vers français ( Horace, Virgile, Milton, Le Tasse). Ses ouvrages, publiés sous le voile de l’anonyme, sont de médiocre valeur. On a également de lui une Traduction nouvelle des Psaumes de David en vers français, avec le latin de la Vulgate en regard, suivie de celle des cantiques adoptés par l’Église dans ses offices de la semaine, par M. d’A***, in-8°, Paris, 1820. En tête de cet ouvrage se trouve un discours préliminaire sur le caractère de la poésie de David, où il soutient que le roi-prophète est l’auteur de tous les psaumes. La traduction est faite sur là Vulgate : c’est une paraphrase sans valeur exégétique. — Voir Les hommes illustres de l’Orléanais, 2 in-8°, Orléans, 1852, t. i, p. 255. E. Levesque.
AUTRUCHE. Hébreu : renânîm, pluriel qui vient de rânan, « faire un bruit strident, » et yâ’ên ou bat hayya-’ànàh, « fille de l’autruche, » hébraïsme pour désigner
[[File: [Image à insérer]|300px]]
378. — L’autruche.
l’animal lui-même. On n’est pas d’accord sur I’étymologie de yâ’ên. Gesenius tire ce mot d’un radical inusité yâ’an, qui, - d’après le syriaque, signifierait « être vorace ». Fr. Delitzsch, Dos Buch Job, in-8°, Leipzig, 1864, p. 476, traduit bat hayya’ânâh, d’après l’arabe, par « habitant du désert ». Robertson et beaucoup d’hébraïsants font dériver le mot yâ’ên de yâ’an ==’ànâh, « pousser des cris plaintifs. » Les deux noms de l’autruche auraient ainsi une signification analogue. Aussi les Septante ont-ils traduit plusieurs fois yâ’ên par <retpijv, « sirène, » et quelques commentateurs par ulula, « chat-huant. » Ces deux traductions, bien que fautives, indiquent qu’on croyait que les noms de l’autruche lui venaient de son cri. Ailleurs les
Septante traduisent par « rtpovflôç, <rtpoj9îov ; Vulgate : struthio, « autruche. »
L’autruche est un oiseau qui appartient à l’ordre des échassiers. Elle est montée sur des pattes hautes et robustes, avec des pieds relativement petits, merveilleusement conformés pour la course (fig. 378). Les ailes sont rudimentaires et impropres au vol. La taille atteint plus de deux mètres, et le poids dépasse quarante kilogrammes. L’autruche est donc un oiseau coureur. Elle défie les meilleurs coursiers, et n’est atteinte que quand elle est exténuée de fatigue, après huit ou dix heures de poursuite. Elle est herbivore, mais d’une voracité telle, qu’elle avale avec ses aliments tous les objets qui se rencontrent. Cette voracité s’explique par la grande dépense de force et de chaleur qu’elle fait dans ses courses. Elle habite les déserts de l’Afrique et de l’Asie occidentale ; on en trouve encore au sud-est de la Palestine. L’autruche pond des œufs qui pèsent plus d’un kilogramme ; elle les dépose dans le sable chaud et ne les couve que la nuit ou pendant la saison froide. On la chasse surtout pour avoir ses plumes, qui sont d’un grand prix, ou pour domestiquer
379. — Autruche prise à la chasse. Plumes et œufs. Thébes. D’après Wilklnson, .2e édit., 1. 1, p. 283.
l’animal lui-même et s’en servir comme de monture. Un dessin égyptien représente un chasseur tenant d’une main le cou de l’oiseau, et de l’autre une corde qui l’attache ; un autre chasseur tient en main des plumes et une corbeille contenant de gros œufs (fig. 379). Les Assyriens l’ont aussi représentée sur leurs monuments (fig. 380).
Il y a eu de tout temps des struthiophages. Diodore de Sicile, iii, 27, édit. Didot, t. i, p. 144 ; Strabon, xvi, 11, édit. Didot, p. 657. Aujourd’hui encore beaucoup d’Arabes mangent la chair de l’autruche, tandis que d’autres se contentent des œufs ou de la graisse. Il était défendu aux Hébreux de s’en nourrir, et c’était pour eux un animal impur. Lev., xr, 16 ; Deut., xiv, 15. La défense d’en manger leur rappelait la nécessité de renoncer aux habitudes de la vie nomade, et l’horreur de toute cruauté ; car on ne peut habituellement surprendre et frapper l’autruche que quand elle couve ses œufs. Le désert est son séjour préféré, et souvent elle court dans les solitudes arides, comme le chameau, d’où le nom de strutliiocamelus, que lui donnaient les anciens. C’est pourquoi les prophètes prennent l’autruche comme le signe de la désolation qui règne dans les lieux maudits de Dieu. Is., xiii, 21 ; xxxiv, 13 ; xlhi, 20 ; Jer., l, 39.
L’auteur du livre de Job parle deux fois de l’autruche. Dans un premier passage, xxx, 29, imité par Michée, i, 8, il compare les cris de sa propre douleur à ceux de l’autruche dans le désert. La comparaison est très expressive. « Quand les autruches se préparent à la course ou au combat, écrit le voyageur Shaw, Travels in Barbary, t. ii, p. 348, elles font sortir de leur grand cou tendu et de leur bec béant un bruit sauvage et terrible, semblable à un sifflement. D’autres fois, en face d’un adversaire plus faible, elles ont une voix qui imite le gloussement des volailles domestiques ; elles semblent déjà se réjouir et se
moquer de la frayeur de leur ennemi. Dans le silence de la nuit, leur organe vocal paraît avoir un timbre tout différent. Elles font entendre alors un grondement plaintif et horrible, qui ressemble parfois au rugissement du lion, et plus souvent rappelle la voix enrouée d’autres quadrupèdes, principalement du taureau et du bœut. Je les ai entendues souvent gémir, comme si elles avaient été en proie aux plus affreuses tortures. » L’autre passage est un portrait poétique de l’animal :
L’aile de l’autruche s’ébat joyeuse,
Mais est-ce l’aile, est-ce la plume de la cigogne ?
Elle abandonne ses œufs dans la terre,
Elle les chauffe dans la poussière.
Elle ne pense pas que le pied peut les fouler,
Et que la bête sauvage peut les écraser.
Dure pour ses petits comme pour des étrangers,
Elle n’a pas souci d’avoir travaillé en vain ;
Car Dieu l’a privée de sagesse,
Et ne lui a point départi d’intelligence.
Mais, quand il en est temps, elle prend un fier essor,
Et se rit du cheval et de son cavalier. Job, xxxix, 13-18.
se contentent de déposer leurs œufs sur un amas de sable qu’elles ont formé grossièrement avec leurs pieds, et où la seule chaleur du soleil les fait éclore. À peine les couvent-elles pendant la nuit, et cela même n’est pas toujours nécessaire, puisqu’on en a vu éclore qui n’avaient point été couvés par la mère, ni même exposés aux rayons du soleil. » Buffon, Œuvres, 27 in-8°, Paris, 1829, t. xix, p. 340-341. L’autruche passe pour stupide. Son cerveau est, en effet, de très petit volume ; elle se croit bien cachée quand sa tête est à l’abri dans un buisson, et elle se laisse facilement prendre au piège. Mais comme la puissance du Créateur éclate dans l’agilité merveilleuse dont il a doué le gracieux coureur ! C’est à ce titre que l’auteur de Job l’a si complaisamment décrite. — Voir E. d’Alton, Die Skelete der straussartigten Vôgel abgebildet und beschrieben, in-f », Bonn, 1827 ; M. Th. vonHeuglin, Ornithologie Nordosl-Afrika’s, in-8°, Cassel, 1869-1875 ; J. de Mosenthal et E. Harting, Ostriches and Oslrich Farming, in-8°, Londres, 1876 ; Frd. Gilbert (Y. Rambaud), L’élevage des autruches, ’ « « « < « « « ( « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « <<
u
380. — Autruches brodées sur les vêtements d’un eunuque assyrien. Palais nord-ouest de Nimrond. D’après Layard, Monuments of Xineveh, t. i, pi. 47.
L’aile de l’autruche ne peut, en effet, que s’ébattre et tressaillir, sans aider l’animal à s’élever dans les airs comme la cigogne, et c’est à peine si, quand l’oiseau marche, on sent qu’il a des ailes. L’auteur fait allusion à une autre différence notable entre les deux oiseaux. La cigogne est appelée hâsîdâh, « la pieuse, » à cause de sa tendresse maternelle. Les Arabes disent au contraire de l’autruche qu’elle est impie, parce qu’elle abandonne ses petits, et Jérémie accuse Israël d’être i cruel comme l’autruche du désert ». Lament., iv, 3. Bien entendu, l’un et l’autre oiseau ne fait qu’obéir à l’instinct que lui a donné la Providence. L’insouciance de l’autruche est même « un don précieux dont la sagesse du Créateur l’a gratifiée, pour lui rendre plus facile la vie périlleuse et sauvage du désert. Si l’autruche était prévoyante et tendre, quelle ne serait pas sa douleur lorsqu’elle est forcée d’abandonner ses petits pour échapper au chasseur, contre lequel elle n’a d’autres armes que son cri perçant et sa course rapide comme le vol ! » Herder, Poésie des Hébreux, Ve dial., traduct. Carlowitz, in-8°, Paris, 1854, p. 93. D’ailleurs les œufs de l’oiseau n’ont pas plus à souffrir de l’abandon et du pillage que ceux des autres. « Dans la zone torride, les autruches in-8°, Paris, 1882 ; Ostrich farming Reports from the Consuls of the United States, in-8°, Washington, 1882 ; Brehm, Vie des animaux, trad. de Z. Gerbe, t. iv, p. 449 ; E. Hobul. et A. von Pelzeln, Beitràge zur Ornithologie Sûd-Afrika’s, in-8°, Vienne, 1881.
AUXILIAIRES. Sous la république, on appelait ainsi les soldats étrangers qui, attachés aux légions, ou formés en corps séparés, étaient obligés de servir les. Romains comme prix de la protection qui était accordée â leur. patrie d’origine. Sous l’empire le nom d’auxilia. s’appliquait à tous les corps autres que la légion, qu’ils> fussent composés de citoyens ou d’étrangers, excepté toutefois à la garde impériale et aux troupes urbaines. Voir Armée romaine, col. 996, 997. Parmi ces auxiliaires, les uns servaient dans la cavalerie, les autres, dans l’infanterie. Ils se distinguaient des soldats romains proprement dits par leur costume et par leurs armes, qui étaient très souvent celles de leur pays d’origine. Tacite, Hist., ii, 89. Même entre les auxiliaires armés à la romaine et les cava^ers légionnaires il y avait en général une différence 4, ’armehient et de cos
4283
AUXILIAIRES — AVA
4284
tume. Tandis que le cavalier légionnaire romain (voir Cavalier romain) porte une cuirasse couverte de plaques de métal, l’auxiliaire (fig. 381) a presque toujours une cuirasse simple ; il est armé d’un bouclier rond moins volumineux, d’une lance plus courte ; on lui demande plus de vitesse pour la poursuite. On trouve cependant sur certains monuments des cavaliers auxiliaires vêtus d’une cuirasse formée de plaques de métal et portant le grand bouclier carré (Bas-relief de Cherche ! ! . Saglio,
[[File: [Image à insérer]|300px]]
381. — Cavalier auxiliaire de l’armée romaine.
Pierre tumulaire du musée de Worms. Inscription : Aboiotaids Smebtulitani p[iïi « s] HAMNIS BQuLes] ALAB…
Diction, des antiquités grecques et romaines, fig. 2741). Les cavaliers dont il est parlé Act., xxiii, 23, étaient des auxiliaires.
Le fantassin auxiliaire était aussi moins armé que le légionnaire-romain. Voir Légionnaire. Au lieu d’une cuirasse en cuir descendant jusqu’au milieu des cuisses, d’un casque qui enveloppe presque toute la tête, du grand bouclier, de la longue lance (le pilum), de la caliga, sorte de brodequin à semelle garnie de clous, l’auxiliaire, tel qu’Hypéranor (fig. 382), faisant partie d’une cohorte d’archers, comme il y en avait en Palestine du temps de Notre-Seigneur et des Apôtres, cf. Matth., viii, 9 ; xxvii, 27, etc. ; Act., xxi, 32, etc., ne porte ni casque ni cuirasse, mais un vêtement court qui laisse toute liberté aux jambes et aux bras ; ses brodequins sont plus légers que la chaussure du légionnaire. Il tient dans les mains un arc et une flèche. Les fantassins auxiliaires étaient du reste, comme les cavaliers, différemment armés, selon les pays et les circonstances, et selon le corps dont ils faisaient partie. Même les corps armés à la romaine se distinguaient toujours des légionnaires par un casque et un bouclier de forme particulière, et par la spatha (épée longue) et la hasta, au lieu du gladius et du pilum réservés aux Romains. Ils jouaient le rôle attribué aux vélites dans la légion avant les réformes de Marius. Les corps auxiliaires d’infanterie s’appelaient cohortes et étaient composés, les uns de six, les autres de dix centuries (quinænarise, milliariœ). Parfois aux fantassins étaient adjoints quelques cavaliers ; les cohortes s’appelaient dans ce cas equitatx. Les corps auxiliaires de cavalerie s’appelaient alœ. Les corps auxiliaires étaient commandés par des préfets et quelquefois par des tribuns. Voir Harster, Die Nationen in den Heeren der Kaiser, in-8°, Spire, 1873 ; L. Lindenschmit, Tracht und Bewaffnung des rômi&chen lleeres wâhrend der Kavserzeit, in-4°, Brunswick, 1882 ; Hassencamp et Shue nemann, De cohortibus romanis auxiliaribus, 2 in-8 ; , Goettingue et Halle, 1869-1883 ; Mommsen et Marquardt,
382. — Fantassin auxiliaire de l’armée romaine, Pierre tumulaire du musée de Kreuznach. L’Inscription porte : Hypeeanok Hyperanoris ï[ilitis], cnETicfws] IjOPPA MiL[es] OHOtftorHs] T SAGllltariorum] A.asLorum} lx Stip lendiorum’} xviii h[*c] sLituel e[ » « ].
Manuel des antiquités romaines, trad. française, t. xi, p. 191 et suiv. F. Vigouroux.
AVA, AVAH (hébreu : ’Awâ’, IV Reg., xvii, 24 ; ’Ivvâh, IV Reg., xviii, 34 ; Is., xxxvii, 13 ; peut-être aussi’Ahâvâ’j I Esdr., viii, 15 et 21 (Vulgate : Ahava) ; Septante : ’A’ca et’Aêà), ville conquise par les Assyriens et mentionnée comme telle à côté de Sépharvaïm et d’Ana, dans la proclamation du Rabsacès aux envoyés d’Éiéchias et aux habitants de Jérusalem. IV Reg., xviii, 34 ; xix, 13 ; Is., xxxvii, 13. Les habitants d’Ava sont nommés *Avvîm dans l’hébreu, Eùaîos dans les Septante, Hevsei dans la Vulgate, II (IV) Reg., xvii, 31 ; mais ils n’ont de commun que le nom avec les tribus des environs de Gaza que subjuguèrent les Philistins. Deut., ii, 23. Transplantés en Samarie par les Assyriens, les Hévéens y introduisirent le culte de leurs idoles Tharthac et Nébahaz. IV Reg., xvii, 24-31. Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 5e édit., t. iv, p. 163 et 165, la place dans le voisinage de Babylone, tout en ajoutant que sa situation exacte est encore inconnue : c’est aussi l’opinion de Schrader, dans Riehm, Handwôrterbuch des bibl Altertums, 1. 1, p. 125. Aux endroits allégués, la Bible mentionne, en effet, deux groupes de villes : l’un placé en Syrie, Émath et Arphad ; l’autre composé de Sépharvaïm, Ana et Ava ; or la première des villes Je ce second groupe étant certainement située en Babylonie^ Is., xxxvii, 13, il est croyable que les deux
autres étaient dans le voisinage. Dom Calmet laisse incertain si Ava cache un nom de ville ou un nom d’idole, Commentarius litteralis, sur IV Reg., xviii, 34, Wurzbourg, 1791, t. iv, p. 436 ; mais outre que les Sépharvaïtes n’eurent point d’idole de ce nom, la comparaison avec IV Reg., xvii, 31, où les Hévéens sont les habitants d’Ava, marque bien qu’il s’agit d’une localité. G. Rawlinson, dans Smith’s Dictionary of the Bible, t. i, p. 906, et dans The five great monarchies, 1. 1, p. 21, incline à retrouver l’A va biblique dans la localité actuelle de Hit, sur la rive droite de l’Euphrate, Vlhih talmudique, 4°AefeoXi{ ou l’"Iç des Grecs, célèbre par ses puits de bitume ; suivant Hérodote, i, 179, c’est de Hit que provenait le bitume qui servit à cimenter les murs de Rabylone. Cette hypothèse a l’avantage de rapprocher les deux sites présumés d’Ana et d’Ava, mentionnées côte à côte dans la Bible ; mais on n’a encore découvert aucun texte cunéiforme pour la confirmer, et de plus il y a bien quelque difficulté orthographique à ramener à une origine commune les formes Ava, ’Avvâ’, ’Ivvâh, ’Ahâvâ’et Hit. Sur Hit, voir en outre Isidore de Charax, Mansiones Parthicx, dans Mûller, Geographi grxci minores, édit. Didot, t. i, p. 249, avec la carte ; ibid., Tabulée in geogr. grxc. min., pars prima ; Elisée Reclus, Nouvelle géographie universelle, t. ix, p. 398, 450, 460.
- AVANCIN Nicolas##
AVANCIN Nicolas, jésuite allemand, né dans le diocèse de Trente (Tyrol) en 1612, mort le 6 décembre 1686. Il entra chez les Jésuites à Gratz, en 1627, et y enseigna la rhétorique, la morale et la philosophie ; il occupa dans la suite d’importantes fonctions dans sa compagnie. On a de lui, entre autres ouvrages : Vita et doctrina Jesu Christi ex quatuor Evangelistis collecta et in piarum comnientalionum materiam ad singulos totius anni dies distributa, in-12, Vienne, 1667 et 1674 ; Paris, 1695, 1850, etc. ; ouvrage très répandu et fort goûté des âmes pieuses. Il a été traduit dans un grand nombre de langues, et en particulier en français par le P. Desruelles, Paris, 1672 et 1713 ; par l’abbé de Saint-Pard, 2 in-12, Paris, 1775 ; par l’abbé Marguet, 2 in-12, Paris, 1837 ; par l’abbé Morel, 2 in-12, Paris, 1854, etc. Avancin fut aussi célèbre en son temps comme latiniste, et il composa un grand nombre de poèmes, parmi lesquels on peut signaler le Psalterium lyricum seu paraphrasis primée quinquagëftse Psalmorùm Davidis ad Horatii modos cantata, in-12, Vienne, 1693 (œuvre posthume). — Voir Allgemeine deutsche Biographie, t. i, p. 698 ; C. G. Jôcher, Gelehrten-Lexicon, 1. 1, 1750, p. 614 ; de Backer et Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. i, 1890, col. 668-681.
- AVARICE##
AVARICE, amour déréglé des biens terrestres. Il n’y a, en hébreu, aucun mot spécial pour désigner ce vice. Le grec wXeoveÇc’ot des Septante et le latin avaritia de la Vulgate, traduisent ordinairement l’hébreu bêsa’, dont la signification propre est « rapine, gain inique, illicite » ; mais l’idée d’avarice ressort du contexte, dans un grand nombre de passages où les écrivains sacrés ont employé le mot bêsa’. Les écrivains du Nouveau Testament se servent du mot tvXeoveSîii, Marc, vii, 22 ; Luc, xii, 15 ; Rom., i, 29 ; Eph., iv, 19 ; v, 3 ; Col., iii, 5 ; I Thess., ii, 5 ; II Petr., ii, 3, 14, etdumot<piXipfupîa, ITim., vi, 10, pour exprimer l’avarice ; l’avare est appelé cpiXâpyupoi ; , Luc, xvi, 14 ; II Tim., iii, .2 ; 71Xsovéxt » iç, I Cor., v, 10, H ; vl, 10 ; Eph., v, 5, et aicrçpoxepSrîç, « avide d’un gain honteux, » I Tim., iii, 3, 8 ; Tit, i, 7 (l’adverbe « îo-^poxepSûç est employé I Petr., v, 2 ; cf. Tit, i, 11). Celui qui n’est pas avare est nommé par saint Paul içtXâpyupo^. I Tim., iii, 3 ; Heb., xiii, 5. Ce dernier mot ne se lit dans aucun écrivain grec profane.
L’Ancien Testament réprouve et condamne l’avarice. Exod., xviii, 21 ; Job, xxxi, 24-25 ; Ps. cxviii (hébreu, cxix), 36 ; Prov., i, 19 ; xi, 28 ; xii, 27 ; xv, 27 ; xxviii, 16 ;
xxix, 4 ; Eccli., vii, 20 (Vulgate) ; x, 9 (Vulgate ; la Polyglotte d’Alcala porte : cptXâpfupoç) ; XIV, 9 (grec, nzovéy.rr l ç) ; Is., v, 8 ; xxxiii, 15 ; lvi, 11 ; lvii, 17 ; Jer., vi, 13 ; viii, 10 ; xxii, 17 ; Ezech., xxii, 12-13, 27 ; xxxiii, 31 ; Hab., ii, 9 ; cf. II Mach., iv, 50. — Achan, Jos., vii, 21-26 ; les fils de Samuel, I Reg., viii, 3 ; Nabal, mari d’Abigaïl, I Reg., xxv, 3-39 ; Giézi, serviteur d’Elisée, IV Reg., v, 20-27 ; comme du temps des Apôtres Ananie et Saphire, Act., v, 1 - 11, sont punis de diverses manières à cause de leur avarice. La trahison de Judas, qui livra son Maître par cupidité, est un des exemples les plus terribles des crimes que peut faire commettre l’amour déréglé de l’argent. Matth., xxvi, 15 ; Marc, xiv, 10-11 ; Luc, xxii, 3-5 ; cf. Joa., xii, 4-6. — Notre-Seigneur range l’avarice parmi les vices produits par la malice du cœur, Marc, vii, 22 ; il recommande à ses disciples de l’éviter, Luc., xii, 15 ; cf. vi, 24 ; Jac, v, 1-6, parce qu’il n’est pas possible de servir à la fois Dieu et l’argent, Matth., vi, 24 ; Luc, xvi, 13 ; cet enseignement déplaît aux Pharisiens, qui sont avares, Luc, xvi, 14 ; mais le Seigneur leur annonce le châtiment qui les attend. Luc, xvi, 15. Les Actes, xxiv, 26, stigmatisent l’avarice du gouverneur Félix. Saint Paul s’élève souvent contre cette espèce de péché. Rom., i, 29 ; I Cor., v, 10-11 ; vi, 10 ; Eph., iv, 19 ; v, 9 ; Col., iii, 5 ; I Tim., vi, 10 ; II Tim., iii, 2 ; Heb., xiii, 5. L’Apôtre, qui a pris grand soin de fuir l’avarice, I Thess., ii, 5, en a une telle horreur, qu’il l’appelle « la racine de tous les maux », I Tim., vi, 10, et qu’il la compare à l’idolâtrie, car l’ai* gent est l’idole de l’avare, Eph., v, 5 ; et il recommande spécialement au clergé de l’éviter. I Tim., iii, 3 ; Tit, I, 7 ; cf. I Petr., v, 2. Saint Pierre la donne comme un des traits distinctifs des hérétiques. II Petr., ii, 3, 14.
F. VlGOUHOUX.
- AVÉDIKIAN Gabriel##
AVÉDIKIAN Gabriel, religieux mékithariste de Venise, né à Constantinople en 1751, mort en 1827. De tous les ouvrages qu’il a composés, celui qui fait le plus d’honneur à sa vaste érudition est sans contredit son Commentaire sur les quatorze ÉpUres de saint Paul
(JB k b$’t"-Pb’^' d’I^ PlP"3 h ^""-î""/’)' en arm énien littéraire, publié à Venise, au couvent de Saint-Lazare, 3 in-4°, 1806-1812. Cet ouvrage, écrit avec beaucoup de talent, dénote chez l’auteur une profonde connaissance de la théologie et des Pères ; il suit fidèlement les traces des docteurs de l’Église, en ajoutant souvent les témoignages des anciens auteurs arméniens. Des pensées fortes et élevées, des éclaircissements touchants et pleins de piété, en sont le trait caractéristique ; les questions les plus ardues et les plus épineuses lui sont familières : il les examine et les élucide avec soin. Au point de vue littéraire, le style est simple et clair, dégagé de tout ornement superflu, plein de sens et de force. J. Miskgian.
AVEN, mot hébreu Çàvén, « vanité » ou « rien » ), appliqué, dans la Bible, au culte idolâtrique, et, par suite, aux idoles elles-mêmes, comme I Reg., xv, 23 ; Is., lxvi, 3. On se demande s’il n’indique pas un nom propre dans les passages suivants :
1° Biq’at-’Âvén, Septante : itsSîov’Ûv ; Vulgate : campus idoli. Amos, I, 5. Voici comment s’exprime le prophète, annonçant les châtiments que Dieu infligera aux Syriens de Damas, en punition des rudes traitements qu’ils ont fait subir aux tribus transjordaniennes, IV Reg., x, 32, 33 :
?. 4. Je mettrai le feu à la maison d’Azaël,
Et il dévorera les palais de Bénadad. ꝟ. 5. Je briserai les verrous de Damas,
J’exterminerai l’habitant de la plaine de l’idole ( Biq’at-’Avén ),
Et celui qui tient le sceptre de la maison de délices ( BU-’Êdén).
On peut voir ici, avec la Vulgate, un nom commun, et tel sera le sens général des versets : Je détruirai par le
feu ces palais que plusieurs rois se sont appliqués à bâtir avec tant de magnificence ; les portes de Damas brisées s’ouvriront à l’ennemi ; hommes du peuple et princes, habitants des vallées livrées au culte des idoles, et seigneurs aux maisons de délices, seront exterminés ou envoyés en exil. Saint Jérôme, dans son Commentaire sur Amos, t. xxv, col. 995, nous dit à propos des anciennes versions : « Pour le « champ de l’idole », hébreu : ’Âvén, les Septante et Théodotion ont traduit par y Q ; Symmaque et la cinquième version par « iniquité » ; Aquila par àvwçeioûç, « inutile, » pour montrer combien serait inutile le secours des idoles lorsque le peuple de Damas serait pris par les Assyriens. » Ajoutons, pour compléter ces renseignements de critique textuelle, que le chaldéen et le syriaque portent, comme le grec, un nom propre.
La plupart des exégètes modernes expliquent Biq’af-’Avén par un nom de lieu. Nous rattachons leurs opinions aux deux catégories suivantes. Les uns cherchent cet endroit dans les environs de Damas. J. D. Michælis, dans ses notes sur Amos, 1, 5, prétend avoir appris d’un ancien habitant de cette ville, qu’aux environs se trouvait une vallée fertile, appelée Un, et qu’un proverbe en rappelait les charmes. Cf. Gesenius, Thésaurus, p. 52. Le malheur est que ce témoignage n’a pas été confirmé par des voyageurs qui ont pourtant bien exploré le pays. Pour Keil, Biblischer Commentar ïiber die zwôlf kleinen Propheten, Leipzig, 1888, p. 175, Biq’at- Âvén et Bêt-’Édén sont peut-être des résidences royales situées prés de la capitale de la Syrie,
Les autres, en. bien plus grand nombre, ont pensé à la fameuse plaine de Ccelésyrie, qui s’étend entre le Liban et l’Anti-Liban, et dont la merveille est Baalbek ou Héliopolis. « La vallée d’Aven, dit Rosenmûller, est la Syrie Damascène, comprise entre le Liban et l’Anti-Liban, appelée aussi « vallée du Liban, s biq’at hal-Lebânôn, dans Josué, xi, 17, xottov tieSîov ; campus concavus dans Strabon, et’Ajjlûx/j, c’est-à-dire’Êméq, « vallée, » dans Polybe, v. » Prophetse minores, Leipzig, 1827, t. ii, p. 22. "Voir aussi Bochart, Phaleg., lib. ii, cap. vi, vm. Le nom actuel d’El-Begâ’a, &UuJI> répond ainsi au nypa, biq’at,
hébreu. C’est évidemment le même mot, mais un nom commun appliqué plus tard comme nom propre à une contrée qu’il caractérise particulièrement. On ne peut donc rien conclure de là. Calmet en fait « une ville de Syrie, nommée aujourd’hui Baal Beh. Apparemment elle s’appelait Békat Baal du temps d’Amos. Comme les Hébreux ne daignaient pas prononcer le nom de Baal, ils lui substituaient un nom de mépris, comme Aven, « iniquité ou vanité ; » ou Boseth, « honte, confusion. » De là vient le nom de Bethaven, au lieu de Béthel, et celui de Jéro-Boseth, au lieu de Jéro-Baal. Les Syriens appellent encore aujourd’hui Baal Bek la ville que les Grecs appelaient Héliopolis, et qui est située vers l’extrémité de cette longue vallée qui s’étend du midi au nord, entre le Liban et l’Anti-Liban. Cette vallée s’appelle encore aujourd’hui Bucca ou Békath, suivant la prononciation hébraïque. » Commentaire littéral sur les douze petits Prophètes, Paris, 1715, p. 187. Pusey explique autrement le nom de Baalbek, et y voit une abréviation de l’ancien nom Baal Bik’ah, s Baal de la vallée, » par contraste avec le BaaI-Hermon voisin, si célèbre aussi par son culte idolâtrique. Cf. Trochon, Les petits Prophètes, Paris, 1883, p. 143.
Ce nom de Biq’atvvén, Ewald et Hitzig l’entendent aussi de Baalbek ou Héliopolis, en se basant sur la traduction des Septante it. heSJou *Qv, rapprochée de l’identification de l’on égyptien avec Héliopolis, qu’on trouve dans les mêmes traducteurs. Gen., xli, 45. Ainsi j’n, ’On, Gen., xli, 45 =’HXio’jitdXiç, donc rw, 7 Qv, Am., I ; 5 = Héliopolis ou Baalbek. Le raisonnement n’est pas juste, parce que la version grecque a rendu’Âvén par
T Qv dans plusieurs endroits où il ne petit être question d’aucune Héliopolis. Cf. Osée, iv, 15 ; v, 8 ; x, 5, 8. Il n’est pas plus juste de changer la ponctuation massorétique d’'Avén en’On. Cf. J. Keil, Die zwôlf kleinen Propheten, p. 175. Cette application du texte d’Amos à la Ccelésyrie et à la ville qui en faisait l’ornement est cependant admise par Robinson, Biblical Besearches in Palestine, Londres, 1856, t. iii, p. 519 ; Grove, dans Smith’s Dictionary of the Bible, Londres, 1861, 1. 1, p. 141 ; Wolfï, dans Riehm, Handwôrterbuch des Biblischen Altertums, Leipzig, 1884, t. i, p. 124-125. D’autres n’y voient qu’une vaine conjecture. Cf. Knabenbauer, Commentarius in Prophetas minores, Paris, 1886, 1. 1, p. 257. Voir Baalbek.
2° Bâmôf-’Avén, Septante : pwjiot T ûv ; "Vulgate : excelsa idoli, « les hauts lieux de l’idole. » Osée, x, 8. Il s’agit évidemment ici des autels élevés aux faux dieux sur la colline de Béthel, appelée Bethaven au ꝟ. 5.
3°’Avén se lit encore dans le texte massorétique d’Ézéchiel, xxx, 17 ; mais, d’après le contexte, il indique sans aucun doute la ville égyptienne de On ; aussi les Septante et la Vulgate sont d’accord pour traduire par’HXiouiuOt ?, Heliopolis. Cependant, comme aucun manuscrit ne porte jiN, avec cholem (cf. J. B. de Rossi, Variée lectiones Veteris Testamenti, Parme, 1786, t. iii, p. 151), on peut croire qu’il y a là, dans la pensée du prophète lui-mêmeou du massorète, une de ces paronomases si fréquentes dans le style prophétique, faisant allusion aux idoles de
la ville égyptienne.- AVENARIUS Jean##
AVENARIUS Jean, vulgairement Habermaun, théologien protestant, né à Éger, en Bohême, en 1520, mort à Zeitz le 5 décembre 1590. Il fut successivement pasteur à Plauen, à Gessnitz, près d’Altenbourg, et à Schcenfels ; il enseigna aussi l’hébreu à Freyberg (Misnie), puis à Iéna, où il prit le degré de docteur en théologie le 10 février 1574, et la même année il alla professer à Wittenberg. Il n’y resta qu’un an, et obtint, en 1575, la surintendance (archevêché) de Zeitz. On a de lui : Explicatio libri Judicum, in-4°, Wittenberg, 1617 ; Liber radicum seuLexicon ebraicum, in-f", Wittenberg, 1568, 1569 (Casaubon et les rabbins de l’époque faisaient le plus grand cas de cet ouvrage) ; Grammatica ebraica, Wittenberg, 1562, 1570, 1575, 1585, 1597, in-8° ; Enarrationes in Evangelia dominicalia, in-8°, Wittenberg, 1586 ; ibid., in-f°, 1589 ; Enarrationes in Epistolas dominicales et (estivales y in-8°, Wittenberg, 1585 ; Harmonia Evangel., seu Vitct Christi ex omnibus Evangelistis, in-12, Bàle, 1583, 1588 ; in-8°, Leipzig, 1616, en allemand ; De diclionibus ebraicis qux in Bibliis aliter scribunlur, aliter leguntur, in-8, Wittenberg, 1562. L. Guilloreau.
1. AVENDANO (Alphonse de), dominicain espagnol, originaire de Léon, mort à Valladolid le Il octobre 1596, profès du couvent de Benavente et prieur de celui de Guadalajara. Très renommé de son temps comme prédicateur, il est plus connu aujourd’hui pour ses deux ouvrages sur la Sainte Écriture, livres un peu lourds, mais très sérieux. 1° Commentaria in Psalmum cxrm, Salamanque, 1584 ; in-8°, Venise, 1587. Il nous apprend lui-même qu’avant d’écrire sur ce psaume en latin, il l’avait commenté pendant sept années en langue vulgaire, dans des sermons prêches à Salamanque. 2° Commentaria in Evangelium divi Matthxi (sous-titre : In hoc opère, candide lector, et sensum lilleralem explicatum et plures conçûmes ad populum habitas luculentissime scriptas reperies), 2 in-f°, Madrid, 1592 et 1593. — Voir Quétif-Échard, Script, ord. Prxd., t. ii, p. 317 6, Antonio, Bibl. hisp. nova (1783), , t. i, p. 11. M. Férotin.
2. AVENDANO (Diego de), théologien espagnol, né à Ségovie en 1593, mort à Lima (Pérou) le 31 août 1688. n entra au noviciat des Jésuites de Lima le 25 avril 1612, et il devint recteur des collèges de Cuzco et de Chuquisæa,
de Saint -Paul et du noviciat à Lima ; il fut deux fois provincial du Pérou. On a de lui : 1° Epithalamium Christi, seu Explanatio Psalmi quadragesimi quarti in qua prsecipuà catholica religionis elucidantur mysteria et multa ac varia pro sanctorum exornalione, ac formations morum expenduntur. Opus totum versatur circa titulum, in quo cum Apostolo I Corinth., c. xir, v. 19, quinque verba auctor loquitur, in-f°, Lyon, 1653. — 2° In amphitheatrum misericordise expositio Psalmi lxxxvhi in qua magnorum mysteriorum lumina, Ulustriorum sanctorum elogia, theologici occursus et utilis pro moribus splendet apparatus, in-f°, Lyon, 1656.
G. SOMMERVOGEL.
- AVÈNEMENT##
AVÈNEMENT (Dernier) de Jésus-Christ. Voir Fin du
- AVEROLDI Ippolito##
AVEROLDI Ippolito, théologien italien, de l’ordre
Exod., iv, 11 ; Joa., ix, 1-3. Accidentelle, elle peut avoir le caractère de châtiment divin, Gen., xix, 11 ; Deut., xxviii, 27, 28 ; Sap., xix, 16 ; Zach., xii, 4 ; II Mach., x, 30, de vengeance exercée par. les hommes, I Reg., xi, 2 ; Jer., xxii, 12, ou simplement d’épreuve imposée par la divine Providence. Tob., Il, 11-13 ; Act., xiii, 11. Le saint homme Tobie est un modèle de patience et de résignation pour ceux qui sont frappés de cette terrible infirmité.
La cécité rendait inhabile à exercer les fonctions du sacerdoce mosaïque. Lev., xxi, 18. Même les animaux aveugles ne pouvaient pas être offerts en sacrifice. Lev., xxii, 22 ; Deut., xv, 21 ; Mal., i, 8. Un proverbe cité II Reg., v, 8 : « L’aveugle et le boiteux n’entreront pas dans le temple, » semble interdire aux aveugles l’accès de la maison de Dieu. (Le texte hébreu porte simplement « la maison », probablement « la citadelle », et jjon pas « le temple ».) Il n’en est rien cependant, comme l’attestent les Évan 38 ?.
Musiciens égyptiens aveugles. Tombeau de Tell el-Amarna.
des Capucins, originaire de Brescia, vivait au commencement du xviie siècle. Il a publié Icônes nonnullx ad pleniorem abstrusissimse litterse libri Apocalypsis intellhgentiam, Brescia, 1638.
- AVEUGLE##
AVEUGLE (hébreu : ’ivvêr, de’wycreuser, « celui dont les yeux sont creux. » Septante : tuçXô ; ). Les aveugles ont toujours été nombreux en Orient (fig. 383). Volney comptait au Caire vingt aveugles par cent habitants, Voyage en Egypte et en Syrie, 5e édit., 2 in-8°, t. i, p. 195. Il y a quelques années, Jaffa avait cinq cents aveugles sur une population de cinq mille âmes. Les causes de cécité se multiplient à mesure qu’on approche des régions équatoriales ; aussi de tout temps les aveugles ont-ils été plus nombreux en Palestine que dans nos pays. Ces causes sont, pour la Palestine en particulier, le vif éclat du soleil, JEccli., xliii, 4, la blancheur du sol ordinairement calcaire, les poussières ténues qui se produisent pendant les longs étés sans pluie et que le vent projette dans les yeux, la fraîcheur des nuits pour ceux qui couchent en plein air, les maladies et spécialement la petite vérole, le défaut d’hygiène et de propreté, le séjour des mouches et des insectes sur les yeux malades, surtout chez les enfants, enfin, comme dans tous les autres pays, le grand âge. Gen., xxvii, 1 ; "XL viii, 10 ; Eccl., xii, 3. La cécité peut être native ou accidentelle. Native, elle est le résultat d’une permission divine.
giles, Matth., xxi, 14, et comme le montre le contexte, II Reg., v, 6 ; I Par., xi, 5. C’est sans doute une manière d’exprimer qu’on peut faire une chose qu’on regardait comme impossible. Les Jébuséens avaient tant de confiance dans l’inviolabilité de leur citadelle, que des aveugles et des boiteux, prétendaient-ils, devaient suffire à la défendre. David s’en empara, et par ironie on garda aux défenseurs vaincus le nom d’aveugles et de boiteux. La loi juive prenait les aveugles sous sa sauvegarde. Défense était faite de mettre devant eux un obstacle sur le chemin, Lev., xix, 14, ou de les égarer. Deut., xxto, 18. C’était au contraire un grand acte de charité que de se faire « l’œil de l’aveugle », Job, xxix, 15, et de l’inviter à sa table. Luc, xiv, 13, 21.
Dans l’Évangile, la guérison des aveugles est un genre de miracles par lesquels Notre -Seigneur prouve sa mission divine et symbolise son rôle d’illuminateur des âmes. Ce miracle, impossible aux idoles, Bar., vi, 36, et au démon, Joa., x, 21, a été opéré d’autant plus souvent par le divin Maître, que les malheureux atteints de cécité étaient plus nombreux. Les Évangélistes racontent avec des détails plus ou moins étendus la guérison de deux aveugles sur le chemin de Capharnaûm, Matth., ix, 27-32, de l’aveugle de Bethsaïde, Marc., viii, 22-26, de l’aveugle-né de Jérusalem, Joa., rx, 1-7, et des aveugles de Jéricho, Matth., xx, 29-34 ; Marc, x, 46-52 ; Luc, xviii, 35-43. Dans ce
dernier miracle, saint Luc parle d’un aveugle guéri à l’entrée de la ville ; saint Marc d’un aveugle, Bartimée, guéri à la sortie, et saint Matthieu de deux aveugles guéris au départ de Jéricho. Cette apparente divergence dans les récits s’explique aisément. Saint Luc et saint Marc parlent d’aveugles différents, et saint Matthieu, comme il le fait assez souvent, réunit ici deux faits en un seul récit. Il est encore possible que sur les deux aveugles de saint Matthieu, les autres Évangélistes ne mentionnent que le plus connu, dont la guérison, sollicitée à l’entrée de la ville, n’aurait été opérée qu’à la sortie.
La Sainte Écriture parle aussi d’aveugles spirituels, c’est-à-dire d’hommes qui refusent d’ouvrir les yeux de l’âme à la lumière des vérités divines. Tels sont les adorateurs des idoles, Is., xliii, 8 ; H Cor., iv, 4, les pécheurs, Joa., iii, 19., 20 ; I Joa., ii, 11, les incrédules, Marc, iii, 5 ; Rom., xi, 25 ; Eph., iv, 18, ceux qui veulent conduire les autres sans en avoir reçu la grâce ou après l’avoir perdue par leur faute, Is., lvi, 10 ; Matth., xv, 14 ; xxiii, 16-26 ; Luc, vi, 39 ; Rom., ii, 19 ; II Petr., i, 9 ; Apoc, iii, 17, enfin ceux dont l’aveuglement est un châtiment divin, IVReg., vi, 18 ; Is., lix, 10 ; Lament., iv, 14 ; Soph., i, 17 ; Joa., ix, 39-41. Le Messie a eu la double mission de rendre la vue aux corps et d’ouvrir les yeux de l’âme. Ps., cxlv, 8 ; Is., xxix, 18 ; xxxv, 5 ; xlii, 7, 16-19 ; Jer., xxxi, 8 ; Matth., ii, 5 ; Luc, i, 79 ; vii, 21, 22. Mais encore la grâce de voir clair dans les choses de la foi réclame-t-elle habituellement le concours de la bonne volonté humaine. Il faut « pratiquer la vérité pour venir à la lumière », Joa., iii, 21 ; il faut « se réveiller de son sommeil, ressusciter d’entre les morts », si l’on veut « être illuminé par le Christ ». Eph., v, 14. —’Voir Th. Shapter, Medica sacra, in-8°, Londres, 1834, p. 138-143.
- AVILA##
AVILA (François d’), espagnol, docteur en théologie et chanoine de l’église collégiale de Belmonte, au diocèse de Cuenca (Vieille-Castille), vivait dans la seconde moitié du xvie siècle. Nous devons à cet écrivain aussi pieux que savant un ouvrage malheureusement trop rare aujourd’hui, et qui a pour titre : Figurée bibliorum Veteris Testamenti, quibus Novi veritas prædicatur et adumbratur, in-8°, Antequera, 1574. — Voir Antonio, Bibl. hisp. nova (1783), t. i, p. 405. M. Férotin.
AVIM (hébreu : Hâ’avvîm, avec l’article, « les ruines » ou [bourg] « des Hévéens » ; Septante : AU(v), ville de la tribu de Benjamin. Jos., xviii, 23. Citée entre Béthel (Beitin) et Aphara (Khirbet Tell el-Fârah), elle fait partie du premier groupe, qui, dans rénumération de Josué, xviii, 21-24, comprend l’est et le nord de la tribu. Sa position est bien indiquée d’une façon générale, mais son identification précise est inconnue. Quelques auteurs pensent que n « iy, ’Avvîm, est une corruption ou une variante de » y, ’Ai, ville chananéenne, située à l’orient de
Béthel. Voir Haï. Peut-être aussi son nom rappelle-t-il le souvenir des Hévéens, ancien peuple du pays de Chanaan.
Voir Hévéens.A VIT (Saint), Alcimius Écdicius Avitus, évêque de Vienne, en Gaule, mort vers 523. Il était de famille sénatoriale. On croit que sa mère, Audentia, était sœur de Mœcilius Avitus, empereur d’Occident (456). Son père Hésychius ou Isicius était devenu évêque de Vienne ; il lui succéda sur son siège vers 490, et se distingua par ses vertus, par sa doctrine et par son zèle pour la défense de la foi contre les Ariens. Parmi celles de ses lettres qui ont été conservées, quelques-unes, adressées au roiGondebaud, expliquent des passages difficiles de l’Écriture, en réponse aux questions que ce prince lui avait faites. Epist. i-iv, xx, Patr. lat., t. lix, col. 199 et suiv., etc. On remarque aussi, dans ses Œuvres, Lîbri quinque de Mosaicæ historiée gestis, en vers héroïques, t. lix, col. 323-368 ; le premier
livre traite de l’origine du monde, le second du péché originel, le troisième de la sentence portée contre les pécheurs, le quatrième du déluge, et le cinquième du passage de la mer Rouge. Les trois premiers livres ont peut-être suggéré à Milton l’idée du Paradis perdu ; ils ont du moins avec ce poème de curieuses ressemblances.
— Voir Acta Sanctorum, 5 februarii, t, i, p. 660-667 ; Histoire littéraire de la France, t. iii, Paris, 1735, p. 115-142 ; R. Peiper, dans Monumenta Germanise hist., auctores antiqui (1883), t. VI, part, ii, p. i-lxxvi ; A. Rilliet de Candolle, Études sur des papyrus du ri’siècle, Genève, 1866, p. 31-106 ; Parizel, Saint Avit, évêque de Vienne, in-8°, Paris, 1859 ; Binding, Geschirchte des burgundischen Kônigsreichs, in-8°, Leipzig, 1868, p. 168.
- AVITH##
AVITH (hébreu : ’Avif ; Septante : rcc6a(ii, Gen. t xxxvi, 35 ; rE90tf[x » I P* 1 " 1° r » 48)> capitale d’un roi iduméen, Adad, fils de Badad, Gen., xxxvi, 35 ; I Par., i, 46. Dans le livre des Paralipomènes, le ketib porte rw, ’âyûf, au lieu de n » 17, ’âvî(, texte de la Genèse ;
mais le qeri corrige ce qu’on peut regarder comme une simple transposition ; du reste une trentaine de manuscrits donnent’Avif. Cf. B. Kennicott, Vêtus Testamentum hebraicum, Oxford, 1776-1780, t. ii, p. 645. On peut comparer ce nom avec celui de El-Ghouéitéh, &ijyjà, chaîne de collines qui s’étend à l’est de la mer Morte, au-dessous de VOuadi Enkeiléh, branche de l’Arnon, entre le Séil es-Saidéh et le Derb el-Hadj ou « route des Pèlerins ». Cf. J. L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, in-4°, Londres, 1822, p. 375.
AVOCAT. Chez les Hébreux, il n’y avait pas d’ « avocats de profession », comme nous en voyons dans toutes les nations modernes. — 1° Nous n’en trouvons aucune trace dans l’Ancien Testament. La langue hébraïque n’a pas de mot correspondant à « avocat » ; lorsque, dans des temps plus récents, les Juifs eurent à exprimer, dans leurs livres, l’idée d’avocat, ils se servirent de termes grecs. Cf. Buxtorf, Lexicon talmudicum, Bâle, 1640, p. 533, 1388, 1509, 1843. Les avocats étaient aussi inconnus dans l’Egypte pharaonique. Diodore de Sicile, i, 76, édit. Didot, 1. 1, p. 62. Cf. Maspero, Une enquête judiciaire à Thèbes au temps de la xx" dynastie, Étude sur le Papyrus Abbott, Paris, 1872, p. 81-85 ; Devéria, Le Papyrus judiciaire de Turin, VI, Partie judiciaire, dans le Journal asiatique, août-septembre 1866, p. 154-161 ; Henry, L’Egypte pharaonique, Paris, Didot, 1846, t. i, p. 496. Ce n’est que beaucoup plus tard qu’on rencontre des avocats de profession cheï les Égyptiens, grâce sans doute à l’influence des Grecs, surtout depuis la conquête macédonienne. Cf. Revillout, Études sur divers points de droit et d’histoire ptolémaïque, Paris, 1880, p. 106, 109, 126. Les lois de Manou, qui, dans leur partie judiciaire (livre viii), donnent des détails très longs sur ce qui concerne les juges, les témoins, les accusateurs, les accusés, etc., ne font non plus aucune mention des avocats. Pauthier, Les livres sacrés de l’Orient, Paris, 1841, p. 402-420.
S’il n’y avait pas, chez les Hébreux, d’avocats de profession, il y avait, à l’occasion, ce que nous pourrions appeler des « défenseurs charitables ». Si bon nombre d’accusés ou de défendeurs pouvaient plaider personnellement leur cause, d’autres ne pouvaient le faire, ou au mctins ne pouvaient le faire convenablement, comme les orphelins, les pauvres, les ignorants, les veuves. Quelques auteurs, par exemple, Michælîs, Mosaisches Recht, § 298, Francfort-sur-le-Mein, 1775, t. vi, p. 122-125, crobnt trouver un exemple de ces défenseurs dans Job, disant de lui-même : « Quand je m’avançais vers la porte de la ville, et qu’on me préparait un siège sur la place publique…, chacun me rendait témoignage, parce que j’avais délivré le pauvre qui criait, et l’orphelin privé de secours…
1293
AVOCAT — AXA
1294
J’étais le père des pauvres, et j’examinais avec an soin extrême la cause que je ne connaissais pas. » Job, xxix, 7, 11-12, 16. Nous préférons dire, avec d’autres auteurs, comme Saalschùtz, Dos Mosaische Recht, k. 87, Berlin, 1853, p. 594, que le saint patriarche accomplissait ces actes vertueux comme chef et juge de sa tribu, ce qu’il semble affirmer lui-même, xxix, 25. Le texte d’Isaïe, i, 17, suppose l’existence des « défenseurs charitables ». S’adressant à ses compatriotes, il dit : « Apprenez à faire le bien, examinez tout avant de juger, assistez l’opprimé, faites justice à l’orphelin, défendez la veuve. » Quelquesuns de ces conseils s’adressent aux juges ; mais d’autres, et surtout celui-ci : « Défendez la veuve, » s’adressent en général aux Juifs. Gesenius, Thésaurus linguse hebrsese, p. 1286 ; Id„ Der Prophet lesaia, Leipzig, 1820, t. i, p. 162-163 ; Rosenmiiller, Scholia in Vêtus Testamen~ tum, lesaiee Vaticinia, t. i, Leipzig, 1829, p. 43.
Nous trouvons un exemple frappant de ces défenseurs charitables dans Ahicam. Jer., xxvi, 8-24. Cette « défense charitable » était aussi libre que la charité qui l’inspirait, et elle n’était gênée par aucun règlement. Elle pouvait se produire à chaque moment de la procédure, et même après le jugement, comme nous le voyons par l’exemple de Daniel, que nous pouvons regarder aussi, dans un sens, comme un « défenseur charitable », suscité de Dieu pour sauver l’innocente Susanne, Dan., xiii, 45-64. La Mischna a consacré cette liberté de la défense, même après le prononcé de la sentence, même sur le chemin du supplice. « Après le jugement, on emmène le condamné. .. Alors si quelqu’un s’offre à prouver l’innocence de ce dernier, il agite son mouchoir, et l’on ramène promptement à la ville le condamné. » Mischna, traité Sanhédrin, VI, 1, édit. Surenhusius, t. iv, p. 233.
A ces « défenseurs charitables » des Hébreux ressemblent assez, sous le rapport qui nous occupe, les patroni primitifs des Romains, dont on fait remonter l’origine jusqu’à Romulus. Denys d’Halicarnasse, Antiq. rom., ii, Opéra omnia, Leipzig, 1691, p. 84 ; Plutarque, Romulus, 13, édit. Didot, t. i, p. 29. Ces « patrons » prenaient sous leur protection une ou plusieurs familles de plébéiens, qui devenaient leurs « clients », leur rendaient les services que des hommes instruits et influents peuvent rendre aux gens du peuple, et particulièrement les assistaient et les défendaient dans toutes leurs affaires judiciaires ; mais cet office de bienveillance se modifia peu à peu, et devint au bout de quelque temps une profession rétribuée, celle des « avocats », advocati, qui dut bientôt être réglementée au point de vue des honoraires ; loi Cincia, an 205 avant J.-C. Cf. Heineccius, Antiq. rom., I, ii, 29 ; IV, x, 1, Venise, 1796, t. i, p. 68-70 ; t. ii, p. 367 ; Daremberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, au mot Advocatio, Paris, 1873, 1. 1, p. 81. Nous ne constatons pas de transformation de ce genre chez les Hébreux de l’Ancien Testament, à ce point que la Mischna, écrite vers l’an 200 de l’ère chrétienne, ne suppose pas encore la profession d’avocat exercée chez les Juifs.
2° Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ nous est présenté comme notre « avocat », advocatus. I Joa., ii, 1. La Vulgate a traduit exactement et littéralement le mot grec itapeMuixoç, qui s’entend d’une manière générale de tout « intercesseur », et qui spécialement, quand il s’agit d’obtenir le pardon d’un coupable, signifie « avocat, défenseur ». C’est le sens qu’a ce mot, soit dans les auteurs classiques, soit dans les auteurs contemporains des Apôtres, par exemple, dans Philon. Cf. Grimm, Clavis Novi Testamenti ; Leipzig, 1888, p. 336. « Si quelqu’un donc, dit saint Jean, commet un péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ, le juste. » L’écrivain sacré emprunte sa comparaison aux coutumes judiciaires. Quand, chez les Grecs et les Romains, auxquels écrivait saint Jean, un homme était accusé et traduit devant les tribunaux, son premier soin était de chercher un « avocat » qui plaidât
sa cause auprès des juges et lui obtint le pardon. Quand le chrétien commet un péché mortel, il mérite la mort éternelle, et c’est, en effet, la vengeance que réclame contre lui le démon, qui est appelé 1’ « accusateur », diabolus, V « adversaire », Satan, Satanas, V « accusateur de nos frères, qui les accusait devant Dieu jour et nuit ». Apoc, XII, 10. Mais que le pécheur reprenne courage ; nous avons un « avocat », Jésus-Christ, d’autant plus puissant qu’il est juste. Si le pécheur recourt à lui avec foi et confiance, le divin avocat plaidera sa cause avec succès et lui obtiendra sa grâce C’est à ces fonctions d’avocat que saint Augustin, Epist. cxlix, 14 t. xxxiii, col. 636, rattache cette « interpellation » qua fait Jésus-Christ au souverain Juge en notre faveur. En effet, dit saint Paul, Jésus-Christ « apparaît maintenant en la présence de Dieu pour nous, — interpelle Dieu pour nous, — vit toujours afin d’interpeller pour nous ». Heb., vii, 25 ; ix, 24 ; Rom., viii, 34. Cette interpellation n’est autre chose que le plaidoyer que notre charitable et puissant avocat fait pour nous auprès du souverain Juge ; « il n’interpelle, dit saint Augustin, loc. cit., que pour postuler ; » postuler, c’est la fonction propre des avocats, par laquelle ils demandent au juge la grâce de leurs clients. S. Many.
- AVOGADRO Vincenzio Maria##
AVOGADRO Vincenzio Maria, dominicain italien appelé aussi Avvocati, né à Palerme le 12 septembre 1702 ; la date de sa mort est inconnue. Après avoir fait ses études à Rome, il enseigna la philosophie au couvent de son ordre à Palerme, et puis la théologie à Girgenti. II publia un ouvrage dédié à Benoît XIV et qui eut un grand succès, De sanctitate-librorum qui in Ecclesia catholica consecrantur, 2 in-f°, Palerme, 1741-1742. Le premier volume a pour titre particulier : Prxparatio biblica ; le second, Demonstratio biblica. — Voir Mazzuchelli, Scrittori d’Italia, t. ii, p. 1272.
- AVORTON##
AVORTON (hébreu : nêfél). Si quelqu’un, dans une querelle, frappe une femme enceinte et la fait avorter, il est tenu de payer ce qui lui sera demandé par le mari et déterminé par les arbitres. Exod., xxi, 22. Voir col. 476 et 887. Le sort de l’avorton mort-né est pris comme terme de comparaison pour exprimer un sort misérable, Num., xii, 12 ; Job, iii, 16 ; Ps. lviii, 9 (Vulgate, lvii, 9, où nêfél est traduit par supercecidit ignis, en lisant nâfal’êS, au lieu de nèfél’êsét) ; Eccl., xi, 3-6. Dans le Nouveau Testament, saint Paui, I Cor., xv, 8, se compare, par humilité, à un avorton (entpcoiia), à un enfant faible, né avant terme, pour signifier qu’il se regarde comme inférieur aux autres Apôtres, « le dernier d’entre eux. » I Cor., xv, 9.
- AVOTHJAÏR##
AVOTHJAÏR, orthographe, dans la Vulgate, III Reg., IV, 13, du nom de lieu qu’elle écrit ailleurs Havoth Jaïr. Num., xxîil, 41 ; Deut., ui, 14 ; Jud., x, 4.VoirHàvoTHjviR.
AVVOCATI. Voir Avogadro.
AXA (hébreu : ’Aksâh ; Septante : ’Aaya), fille de Caleb, fils de Jéphoné et compagnon de Josué. Son nom hébreu signifie « anneau de la cheville », ornement de métal que les femmes israélites portaient au-dessus de la cheville. Is., iii, 16, 18. Axa est l’héroïne d’un trait de mœurs raconté par le livre de Josué, xv, 16-19, et repro-’duit par le livre des Juges, i, 12-25. Caleb avait promis de la donner en mariage à celui qui prendrait la ville de Cariath-Sépher. La condition fut remplie par Othoniel, fils de Cénez, qui était frère de Caleb, et par conséquent cousin germain d’Axa. (Nous suivons ici la leçon des Septante. Elle paraît préférable à la traduction de la Vulgate, qui, rendant le mot hébreu parle nominatif f rater au lieu du génitif fratris, fait d’Othoniel, fils de Cénez, un jeune frère de Caleb, qui est lui-même fils de Jéphoné. Num.,
xm, 7. Dans le cas contraire, Othoniel aurait été l’oncle d’Axa. Ce degré de parenté n’était pas alors un obstacle au mariage. Voir Othoniel.) Caleb donna une terre à sa fille, et le mariage fut célébré. Mais la dot parut insuffisante aux nouveaux époux, et ils se concertèrent pour obtenu-un meilleur lot. Un jour qu’elle cheminait sur son âne aux côtés de son père, Axa descendit tout d’un coup de sa monture, pour adresser au vieillard une respectueuse requête. « Que te faut - il donc 1 lui dit Caleb. — Un bienfait de vous, répondit-elle. Vous m’avez donné une terre qui est au midi et desséchée ; ajoutez-y GuUàt (les sources). » Caleb lui donna alors Gullôt d’en haut et Gullôf d’en bas. C’étaient probablement deux localités situées dans les environs montagneux de Cariath-Sépher
(Dabir) et d’Hébron. Voir Gulloth.- AXAPH##
AXAPH, ville de la tribu d’Aser. Jos., xix, 25. Le nom de cette ville est écrit ailleurs dans la Vulgate Achsaph. Jos., xi, 1 ; xil, 20. Voir Achsaph.
- AYGUANI##
AYGUANI, AYGUANUS Michel. Voir Angbiani.
- AYLLON##
AYLLON (Louis de), docteur en théologie, originaire de Grenade et professeur d’Écriture Sainte au Colegio mayor de Séville. Il vivait au xviie siècle et il a publié un livre docte et assez original, intitulé Elucubratkmes biblicse in Vêtus ac Notiwnx Testamentum, littérales, morales et tropologicse, in-f°, Séville, 1676. — Voir N. Antonio, Bibl. hisp. nova (1783), t. ii, p. 21.
M. Férotin.
- AYROLI Jacques-Marie##
AYROLI Jacques-Marie, orientaliste et exégète italien, né à Gènes en 1660, mort à Rome le 27 mars 1721. Entré au noviciat de la Compagnie de Jésus vers 1676, il professa l’hébreu au Collège romain, puis occupa la chaire de controverses. On a de lui : Disserlatio Biblica in qua Scripturm textits aliquot insigniores, adhibitis linguis hebrxa, syriaca, chaldaica, arabica, grssca, latina, per dialogismum dilucidanlur, in-4°, Rome, 1704. — De prxstantia linguse sanctse oratio habita in Collegio rornano, in-4°, Rome, 1705. — Synopsis dissertationis Biblicse in LXX Danielis hébdomadas, Rome, 1705. — Discours sur les septante semaines de Daniel (dans les Mémoires de Trévoux, lévrier 1713, p. 296-310. Il le prononça à Rome, le 15 décembre 1712, et y attaqua les théories du P. Hardouin). — Liber LXX hebdomadum resignatus, seu in cap. ix Danielis dissertatio, in qua per genuinam editionis Vulgatse interpertàtionem, hebraico textu iliustratam, prophétisa celeberrimse nodus dissolvitur. Accédant conftrmationes ab ànno sabbathico et jubileo, in-8°, Rome, 1713 (il y a des éditions de 1714 et de 1748 semblables à la première. Le P. de Tournemine inséra cette dissertation dans son édition des Commentarii du P. Ménochius). — Dissertatio chronologica deanno, mense et die mortis Domini nostri Jesu Christi, in-f°, Rome, 1718. — Thèses contra Judœos de LXX hebdomadis, in-4°, Rome, 1720. (Il y défend son sentiment contre une dissertation du P. de Tournemine, imprimée dans son supplément de Ménochius.) — Explication du premier verset du chap. xii (pour XIII) du premier livre des Rois (dans les Mémoires de Trévoux, 1721, p. 1369-1387, et dans le Journal des savants, 1722, p. 559-574). — Dissertatio de annis ab exitu Israël de ASgypto ad quartum Salomonis (dans les Commentarii de Ménochius, édit. de Venise, 1722, t. ii, p. 408). — Les Mémoires de Trévoux rendent compte des divers travaux du P. Ayroli : 1705, p. 1821, 1840 ; 1716, p. 2123 ; 1720, p. 657 ; le P. Zaccaria, dans son Historia litteraria, t. xi, p. 233, 236 ; les Acta eruditorum de Leipzig, 1717, p. 422428 ; 1748, p. 551-557. C. Sommervogel.
AYYÉLETH. "intfn nVn*-by, ’al’ayyéléf haMahar.
Ces paroles, qui composent le titre du Psaume xxil (xxi), ont été rendues littéralement par Aquila : ûitàp tri ; iXâfov ttjj
ôp8pivfjç, et par saint Jérôme : Pro eervo matutino. La traduction de Symmaque : ûitèp tîjî floY)0eia « tïjç ôp&ptvijç, et celle des Septante, reproduite par la Vulgate : inèp ufjç àvnÀY)4>eu> ; trfi èarôivîjc, Pro susceptione matulina, reposent sur une autre, lecture de nb’N ; les traducteurs auront rapproché ce mot de mb’N, ’èyàlûf, « force, » lequel
se lit d’ailleurs au ^. 20 du même psaume. Plusieurs interprètes juifs, entre autres Salomon Yarchi (Comment., ii, l.), et avant lui les talmudistes, ont donné une explication analogue. De plus, se fondant sur le mot-mur, sahar, qu’ils
traduisaient par « aurore », ils ont assigné ce psaume au sacrifice du matin. Dans l’une et l’autre signification, ce titre de psaume reste obscur, et les efforts des commentateurs ne lèvent pas la difficulté.
Une autre opinion range’ayyéléf hassabar parmi les instruments de musique, maisies explications qu’on donne en ce sens sont loin d’être satisfaisantes et étymologiquement fondées.
Plus généralement, ces mots du titre, quel que soit le sens qu’on doive leur attribuer, sont regardés, aussi bien que nntfn-bN, ’al tashêt (Ps. lvii-lix et lxxv,
hébreu) et Dtp’im obN Tiy, yônat’élém rehôqîm (Ps. lvi,
hébreu), comme les premières paroles ou comme l’indication du modèle sur lequel auront été rythmés les psaumes qui portent en titre ces sortes de formules. L’usage de ces strophes-types existe dans la poésie des divers peuples orientaux. Les Grecs les appellent eSp[iôç, hirmus, et ils en mettent l’indication en tête de toutes les hymnes liturgiques. Philon semble signaler le même procédé dans les chants des thérapeutes. ( Vit. contempl. , xi, édit. Paris, p. 893 c.) Chez les Grecs comme chez les Asiatiques, Vhirmus provient soit de chants populaires anciennement connus, sur lesquels se modelèrent les chants postérieurement composés ; soit de textes, scripturaires ou liturgiques, employés dans la prière publique, puis disposés pour Je chant, et devenus ensuite le régulateur tonique ou syllabique de l’ode ou du psaume. (Voir Bickell, Metrices biblicse regulm, p. 1 ; Bouvy, Le rythme syllabique des mélodes, dans les Lettres chrétiennes, 1880-1881 ; Christ et Paranikas, Anthologia grseca carminum christianorum, p. cxi ; Vigouroux, Manuel biblique, t. ii, p. 261.) Cette opinion d’ailleurs n’est pas nouvelle ; elle est exprimée par Aben Ezra dans son commentaire sur le Psaume rv : « C’est, dit-il, le commencement d’un chant, ->w nbnn, feftillaf sir, comme’al faShêt, yônat’élém, etc. » L’identification de la formule’al fashef a été très heureusement faite par le P. Bouvy (Lettres chrétiennes, t. ii, p. 294 et suiv.). Voir TaShet. Il en est autrement de la formule ayyéléf haSsahar : elle n’a pu être déterminée ; d’ailleurs la transcription et le rythme même du Psaume xxii (xxi) restent en plusieurs points discutables. Ce fait laisse la place à d’autres explications. La suivante, qui est peu connue, mérite d’être examinée. Le mot nbtN a été rapproché par Jean Harenberg du
nom du mode éolien de la musique grecque. « Éolien se dit nb>N, ’ayyéléf, dans le titre du Psaume xxii, s’il est permis de risquer cette conjecture. Le mode ionien s’appelle itu>, yônaf, dans le titre du Psaume cvi. » (Commentarius de musica velustissima, dans les Miscellan. Lipsise, t. ES, 1752.) Il faudrait alors changer la vocalisation et lire nb$N, ’ayyolit, ou nb*N, èyyolit, defective. Cette ingénieuse interprétation, que nous avons retrouvée dans le traité de Gerbert, De cantu et musica sacra…, 1774, c. i, p. 5, et dans les notices de Vincent, Notices sur les divers manuscrits grecs relatifs à la musique…, de la bibliothèque du Roy, 1847, p. 85, note, mérite d’être signalée. Les superscriptions des psaumes peuvent appartenir à une époque fort postérieure à la composition des pièces qu’elles accompagnent. D’autre part, le système harmonique des Grecs passa de bonne heure en Asie ; il y régnait à l’époque de la captivité
des Juifs à Babylone. Il ne serait donc nullement invraisemblable que nous eussions dans le Psautier hébreu l’indication des deux modes qui, avec le dorien, étaient considérés comme les principaux modes de la musique grecque, et dont l’un au moins est reconnu comme une importation asiatique. Le mode éolien (mode de la, appelé aussi hypodorien, parce qu’il était apparenté de près au mode dorien, la vraie harmonie grecque), à la sonorité grave et calme, fut illustré douze siècles avant J.-C. par Terpandre, Alcée et Sapho. C’était une des harmonies les plus usitées dans tous les genres de musique.
J. Parisot.
AZ… Voira As… les noms propres commençant par Az qui ne se trouvent point ici à leurs places respectives ; certains exemplaires de la Vulgate écrivent avec un s des noms que d’autres exemplaires écrivent avez un z.
1. AZA (hébreu : ’Uzzâ’, « force ; » Septante : ’AÇû, ’OïOi chet d’une famille nathinéenne, qui revint de Babylone avec Zorobabel. I Esdr., ii, 49 ; II Esdr., vii, 51.
2. AZA, ville des Philistins (hébreu : ’Azzâh). La Vulgate l’appelle toujours Gaza. Voir Gaza.
3. AZA (hébreu : ’Azzâh ; Septante : Tâty), ville de la tribu d’Éphraïm. I Par., vii, 28. Ce nom, tel qu’il est écrit dans nos Bibles hébraïques et dans un grand nombre de manuscrits, est le même que celui de Gaza ; mais il n’est évidemment pas question de la célèbre ville des Philistins dans un passage où l’auteur sacré décrit les possessions d’Éphraïm. Aussi beaucoup d’auteurs croient ici à une faute de copiste. Soixante manuscrits et plusieurs Bibles imprimées portent n » y, ’Ayâh, avec yod. Cf. B. Kennicott, Vêtus Testamentum hebraicum, Oxford, 1780, t. ii, p. 656 ; J. B. de Rossi, Varwe lectiones Veteris Testaments, Parme, 1788, t. iv, p. 174-175. Cependant, parmi les anciennes versions, les Septante, le chaldéen et la Vulgate ont gardé le zaïn, comme le texte massorétique actuel ; pas une seule n’a retenu le yod. « Aussi, conclut J. B. de Rossi, loc. cit., p. 175, dans ce désaccord des manuscrits, il faut s’en tenir à’Azzâh. » Quant à la situation de cette ville, ou peut la supposer d’une manière générale à la frontière nord ou nord-ouest de la tribu. En effet, les limites tracées par le livre des Paralipomènes sont bien conformes à celles de Josué, xvi, 1-8 : Béthel au sud, Noran ou sans doute Naaratha à l’est, Gazer au sud-ouest, et Sichem au nord. Comme cette dernière ligne s’étendait « jusqu’à Aza », et que, d’après Jos., xvi, 6-7, sa direction vers le nord-est est bien connue, par Thanatsélo et Janoé, il est permis de voir ici sa direction vers le nordouest, où un. seul point, Machmethath, est mentionné. Jos., xvi, 6 ; xvii, 7. Voir Éphraïm, tribu
et carte.- AZAËL##
AZAËL, roi de Damas, Amos, i, 4, dont le nom est écrit ordinairement Hazaël dans la Vulgate. Voir Ha 2AËL.
- AZAHEL##
AZAHEL, père de Jonathan, contemporain d’Esdras. I Esdr., x, 15. Voir Asæl 4.
AZAL (hébreu : ’Âsal, à la pause ; Septante : ’IaudS ; Codex Alexandrinus : <ya.-rk ; Vulgate : proximum) mot obscur employé dans Zacharie, xiv, 5. Dans le verset précédent, le prophète nous montre comment Dieu, pour sauver le reste de son peuple, fera éclater sa puissance. « Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l’orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, du côté de l’orient et du côté de l’occident, par une immense tranchée, et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l’autre moitié vers le midi. » Puis il ajoute au ꝟ. 5 : « Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée
de mes montagnes atteindra’Asal. » Saint Jérôme nous dit dans son Commentaire sur Zacharie, t. xxv, col. 1525 : « Au lieu de proche, les Septante ont mis Asaël ; Aquila a mis le mot même hébreu Asel Oïn) pare bref (à ?é/) ; Théodotion, àÇrjX ; seul Symmaque a rendu par proche, et nous l’avons suivi. » Il faut avouer cependant que cette traduction est difficile à expliquer. Reuss, Les Prophètes, Paris, 1876, t i, p. 358, a bien raison de regarder comme « conjecturale, sujette à caution », sa traduction : jusque tout près qusqu’aux portes de Jérusalem).
Un certain nombre de commentateurs anciens et modernes trouvent le sens plus simple avec un nom propre. Azal ou Azel doit alors être identique à Bê{-Hâ"êsél de Michée, i, 11 (Vulgate : domus vicina, « maison voisine » ), et être cherché dans les environs de Jérusalem, à l’est de la montagne des Oliviers. On ne peut pas contre cela, dit Keil, Die zwblf kleinen Propheten, Leipzig, 1888, p. 666, arguer du silence de saint Jérôme, parce qu’une localité comme celle-ci pouvait avoir disparu longtemps avant ce Père. M. Clermont-Ganneau a proposé de reconnaître Azal dans YOuadi Âsoûl ou Ouad Yâsoûl (avec sad), au sud de Jérusalem. Cf. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, 1874, p. 101-102.
- AZANIAS##
AZANIAS (hébreu : ’Âzanyâh, « Jéhovah entend ; » Septante : ’AÇavîa ; ), lévite, père de Josué, au temps de Néhémie. II Esdr., x, 9.
- AZANOTTHABOR##
AZANOTTHABOR (hébreu : ’Aznô{- fâbôr, « les oreilles, c’est-à-dire les sommets du Thabor ; » Septante : ’A66a610p), une des villes frontières de la tribu de Nephthali, vers l’occident. Jos., xix, 34. Elle devait, comme le nom l’indique, se trouver dans les environs du Thabor, et elle répond bien à 1’'AÇavtM qu’Eusèbe mentionne sur les confins de Diocæsarée ( Séphoris, Séfoûriyéh). Cf. Onotnasticon, Goettingue, 1870, p. 224 ; S. Jérôme, Liber de situ et nominibus locorum heb., t. xxiii, col. 874.
AZARÉEL. Hébreu : ’Àzar’êl, « Dieu secourt. » Nom de six personnes dans l’Ancien Testament. La Vulgate a transcrit trois fois Azaréel, mais elle a changé le nom de trois autres personnages en Azréel, II Esdr., XI, 13 ; Ezrihel, II Par., xxvii, 22, et Ezrel, I Esdr., x, 41. Voir Azréel, Ezrihel et Ezrel.
1. AZARÉEL (Septante : ’OÇpiift), un des Benjamites qui abandonnèrent le parti de Saùl pour celui de David. I Par., xii, 6.
2. AZARÉEL (Septante : ’Airpi^X), lévite, fils d’Héman, chef de la onzième classe des musiciens du temple sous David. I Par., xxv, 18.
3. AZARÉEL (Septante : ’OÇivft), lévite, musicien sous Néhémie. II Esdr., XII, 35 (hébreu, 36).
AZARIAS. Hébreu : ’Âzaryâh, ’Âzaryâhû, « Jéhovah aide. » Septante : ’Adapta ; . Nom d’un grand nombre d’Israélites.
1. AZARIAS I er, fils du grand prêtre Sadoc. III Reg., IV, 2. Josèphe et plusieurs commentateurs le regardent comme le fils d’Achimaas, et par conséquent comme le petit-fils de Sadoc. (On sait que dans les généalogies bibliques & fils » doit se prendre souvent dans le sens de « petit-fils ».) Ce serait alors le même personnage que l’Azarias de I Par., VI, 9 (hébreu : v, 34-35). Voir Azarias 6. D’après les Septante et la Vulgate, il était l’un des secrétaires royaux à la cour de Salomon ; et c’est ainsi que beaucoup interprètent le texte hébreu. Cependant, si l’on suit la ponctuation massorétique, si l’on tient compte de l’accent distinctif majeur placé sous le mot Sâdôq, et de l’absence de la conjonction ve, « et, ï devant le nom
d’Élihoreph, Azarias n’est pas qualifié du titre de secrétaire, mais bien de celui de kôhên, c’est-à-dire conseiller ou ministre principal du roi Salomon. « Azarias, fils de Sadoc [était] le kôhên. » III Reg., iv, 2. Quelques exemplaires des Septante font également rapporter hakkôhên non à Sadoc, mais à Azarias, en traduisant, il est vrai, par i iepeOç. Après la mort de Sadoc, grand prêtre, il parait lui avoir succédé. C’est à lui probablement, et non à son petit-fils (voir Azarias 7), que se rapporte la remarque de I Par., vi, 10 (hébreu, v, 36) : « C’est lui qui remplit les fonctions sacerdotales dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem, » c’est-à-dire c’est lui qui le premier officia dans le temple après sa consécration. Ce passage a pu être déplacé et transporté par un copiste au ꝟ. 10, à cause de l’identité des noms propres.
2. AZARIAS, fils de Nathan, était préposé aux nmâbîm, sorte de préfets ou de percepteurs généraux, employés à la cour de Salomon. III Reg., iv, 5, 7. On ne sait si son père Nathan est le prophète de ce nom. II Reg., vu, 1-17, ou le fils de David. II Reg., iv, 14.
3. AZARIAS, roi de Juda. Appelé Azarias, IV Reg., xiv, 21 ; xv, 1, 6, 7, 8, 13, 17, 23, 27 ; I Par., iii, 12, il est plus connu sous le nom d’Ozias. Voir Ozias.
4. AZARIAS, fils unique d’Éthan et arrière-petit-fils de Juda et de Thamar, I Par., ii, 8, ou plutôt descendant de Juda en ligne directe, à un degré qui n’est pas précisé.
5. AZARIAS, fils de Jéhu et père de Hellès, de la tribu de Juda, un des descendants d’Hesron par Jéraméel.
I Par., ii, 39.
6. AZARIAS, fils d’Achimaas. I Par., vi, 9 (hébreu, v, 34, 35). Ceux qui regardent Azarias I er, dont il est question III Reg., iv, 2, comme le fils de Sadoc et le frère d’Achimaas, font de celui-ci le neveu de ce premier Azarias. Mais il est plus probable que c’est le même personnage. Achimaas ne paraît pas avoir exercé le souverain pontificat ; à l’époque de l’inauguration du temple, la onzième année du règne de Salomon, ce serait Azarias, son fils et l’héritier de sa charge, qui en aurait rempli les fonctions après Sadoc.
7. AZARIAS II, grand prêtre, fils de Johanan et petit-fils du précédent. I Par., vi, 10 (hébreu, I Par., v, 36). « Ce fut lui, dit le texte sacré, qui remplit les fonctions sacerdotales dans le temple qu’avait bâti Salomon à Jérusalem. » Cette remarque se rapporte probablement au premier Azarias. Voir Azarias 1. Azarias, fils de Johanan, fut vraisemblablement contemporain d’Asa, puisque son fils Amarias était grand prêtre du temps de Josaphat.
II Par., xix, 11.
8. AZARIAS, fils d’Helcias, qui fut le promoteur de la réforme de Josias, et père de Saraïas, le dernier pontife avant la prise de Jérusalem par les Chaldéens. I Par., vi, 13, 14. Il est compté parmi les ancêtres d’Esdras. I Esdr., vii, 3.
9. AZARIAS, lévite, fils de Sophonie et ancêtre d’Héman, célèbre chantre du tabernacle sous David. I Par., VI, 36.
10. AZARIAS, fils ou plutôt descendant d’Helcias. H fut l’un des premiers habitants de Jérusalem après la captivité, et est appelé prince, chef (negîd) de la maison de Dieu : ce qui peut s’entendre ou du chef d’une des classes sacerdotales, ou du chef de toutes les familles sacerdotales, c’est-à-dire du grand prêtre. I Par., rx, 11 ; cf. I Par., xxiv, 3-6. Dans le passage parallèle, II Esdr., xi, 11, à la
place d’Azarias, on lit Saraïa : il y a évidemment, dans l’un des deux livres, une faute de copiste ; mais il n’est pas possible de décider quel est le vrai nom.
11. AZARIAS, fils d’Oded, prophète envoyé par Dieu au-devant d’Asa, roi de Juda, qui revenait victorieux du combat livré contre Zara, roi d’Ethiopie. II Par., xv, 1-8. Dans un tableau saisissant, l’envoyé divin annonce à Asa les maux qui doivent fondre sur la nation, si elle abandonne le vrai Dieu ( ꝟ. 3-6), et l’encourage à garder fidèlement l’alliance théocratique, en lui promettant que le Seigneur l’en récompensera (ꝟ. 7). Cf. col. 1053. Ce tableau tracé par le prophète concerne - 1 - il le passé (époque des Juges), le présent (règne de Roboam, d’Abia et d’Asa) ou l’avenir (captivité de Babylone, destruction de Jérusalem par les Romains) ? Il nous semble, en rapprochant du Deutéronome, xxviii, 15-68, les paroles du prophète, que ce sont plutôt des menaces en cas d’infidélité (cf. contexte, II Par., xv, 2) ; menaces qui, il est vrai, par la faute du peuple juif, sont devenues une prophétie remarquable de l’état déplorable où il a été jeté pendant la captivité de Babylone, et surtout depuis la ruine de Jérusalem par les Romains. Au ꝟ. 8, au lieu de « prophétie d’Azarias, fils d’Oded le prophète », que donne la Vulgate, le texte hébreu actuel porte : « Et la prophétie Oded le prophète. » Il y a là évidemment une lacune. Les mots tombés par distraction d’un copiste devaient probablement être ceux-ci : ’âsér dibbér’Azaryâhû ben…, « la prophétie [que prononça Azarias, fils de] Oded le prophète. »
12. AZARIAS. Deux fils de Josaphat portent ce nom, II Par., xxi, 2. Il doit y avoir une erreur de transcription, par exemple : Azarias pour Amarias dans un des deux cas ; car il n’est pas croyable que deux fils de Josaphat, vivant en même temps, aient porté le même nom. Il est vrai que, dans le texte hébreu, il y a une légère différence de prononciation : ’Azaryâh et "Azaryâhû. Mais c’est une variante insignifiante, qui n’empêche pas les deux noms d’être identiques.
13. AZARIAS. Un des trois compagnons de Daniel, qui porte aussi le nom babylonien d’Abdénago. (Voir Abdénago, col. 20.) De famille royale, comme Ananie, élevé comme lui à la cour de Babylone, investi des mêmes fonctions, il en partage les épreuves et la courageuse fermeté. Dan., i, 3-20 ; ii, 17, 49 ; iii, 12-23 et 91-100 (hébreu, i, 33). Dans les Septante et la Vulgate, iii, 25-45 et 46-90 ; I Mach., ii, 59. (Voir Ananie, 5, col. 540.) Avant l’hymne d’action de grâces connu sous le nom de Benedicite, et chanté par les trois enfants dans la fournaise, se trouve une prière appelée « prière d’Azarias ». Dan., iii, 25-45 (Vulgate). Au nom de la nation entière, Azarias reconnaît la justice de la conduite de Dieu à l’égard de son peuple (ꝟ. 25-33), et, rappelant les magnifiques promesses faites à Abraham, qui contrastent avec la situation actuelle si déplorable (ꝟ. 34-40), il implore la miséricorde divine et demande que la gloire du Seigneur éclate par la restauration du peuple et l’humiliation de ses oppresseurs (ꝟ. 41-45). Sur l’authenticité de la prière d’Azarias, qu’on ne lit pas dans le texte hébreu actuel, voir Daniel.
14. AZARIAS. Dans quelques exemplaires du texte hébreu, II Par., xxii, 6, on lit’Azaryâhû au lieu de’Âhazyâhû (Ochozias). Plusieurs manuscrits et éditions portent ce dernier nom ; et c’est ainsi qu’ont lu les Septante, le syriaque, l’arabe et la Vulgate. C’est du reste la leçon du passage parallèle IV Reg., x, 13. Inutile donc de supposer, avec quelques commentateurs, qu’Azarias était un des noms d’Ochozias ; il est plus naturel de supposer une erreur de copiste, facile à comprendre dans la transcription d’un nom propre.
1301
AZARIAS — AZBOC
1302
15. AZARIAS, fils de Jéroham, un des cinq commandants de cent hommes, appartenante Ja garde royale, choisis par le grand prêtre Joïada pour renverser Athalie et élever sur le trône le jeune Joas. II Par., xxiii, 1-21 ; cf. IV Reg., x, 4-12.
16. AZARIAS (hébreu : ’Âzaryâhû), fils d’Obed, un des cinq chefs de cent hommes qui, comme le précédent, entrèrent dans le complot formé par le grand prêtre contre Athalie en faveur de l’héritier légitime du trône. Ils massacrèrent cette reine idolâtre en dehors de l’enceinte du temple, et reconnurent Joas pour roi. II Par., xxiii, 1-21 ; cf. IV Reg., x, 4-12 ; I Par., ii, 38.
17. AZARIAS III, grand prêtre sous le règne d’Ozias. II Par., xxvi, 16-20. Il eut le courage de résister au roi, quand celui-ci, au mépris de la loi, voulut pénétrer dans le Saint et offrir l’encens sur l’autel des parfums.
18. AZARIAS, fils de Johanam, un des principaux chefs de la tribu d’Éphraïm, sous Phacée, roi d’Israël. II Par., xxviii, 12-15. Suivant le conseil d’Oded, prophète d’Israël, Azarias et trois autres chefs firent rendre la liberté aux sujets d’Achaz, roi de Juda, faits prisonniers. Ils traitèrent ces captifs avec bonté, et les reconduisirent jusqu’à Jéricho.
19. AZARIAS, père de Joël, qui fut l’un des lévites chargés par le roi Ézéchias de purifier le temple. II Par., xxix, 12.
20. AZARIAS, fils de Jalaléel, et l’un des lévites auxquels Ézéchias confia le soin de purifier le temple. Il Par., xxix, 12.
21. AZARIAS IV, grand prêtre de la race de Sadoc, sous le règne d’Ézëchias. II Par., xxxi, 10-13. Pendant son pontificat et sous sa haute surveillance, ce sage roi fit faire autour du temple des magasins destinés à conserver les dons, trop abondants pour pouvoir être consommés immédiatement par les ministres sacrés.
22. AZARIAS, un des lévites préposés à la garde des revenus sacrés, sous le pontificat du précédent Azarias. II Par., xxxi, 13.
23. AZARIAS, fils de Maraioth et père d’Amarias. Il est omis dans la liste des descendants d’Aaron, I Par., vi, 7 et 52, et est nommé parmi les ancêtres d’Esdras.’I Esdr., vii, 3.
24. AZARIAS, prêtre, fils de Maasias. Au retour de la captivité, il bâtit la partie du mur de Jérusalem située vis-à-vis de sa maison, II Esdr., iii, 23-24.
25. AZARIAS, un de ceux qui rentrèrent les premiers à Jérusalem avec Zorobabel. II Esdr., vii, 7. Il est nommé parmi les onze personnages cités à la suite du nom de Zorobabel, et qui paraissent être les chefs du peuple. Dans I Esdr., ii, 2, le nom d’Azarias est remplacé par celui de Saraïa.
26. AZARIAS, un des lévites qui imposait le silence au peuple pendant la lecture de la loi faite par Esdras. II Esdr., viii, 7-11. Ils lisaient eux-mêmes à leur tour et expliquaient le livre de la loi, ꝟ. 8.
27. AZARIAS, un des prêtres signataires de l’alliance théocratique à la suite de Néhémie. II Esdr., x, 2. C’est probablement le même personnage qu’Azarias 25. 28. AZARIAS. Nom que prit l’auge Raphaël, lorsqu’il s’offrit à Tobie pour conduire son fils à Rages. Tob., v, 18 ;
vi, 6 ; ix, 1. « Je suis Azarias (c’est-à-dire « Jéhovah secourt » ), fils du grand Ananie ( « Jéhovah fait grâce » ), » Tob., v, 18, répond l’ange à Tobie, qui lui demande son nom. Il était, en eiïet, la personnification du secours envoyé par la bonté de Dieu. Calmet, Commentaire littéral, Esdras, Tobie, édit. de 1722, p. 261 ; Cornély, Historica introductio in V. T. libros, vol. ii, 1. 1, p. 388 ; Gutberlet, Das Buch Tobxas, in-8°, Munster, 1887, p. 157. Voir Raphaël.
29. AZARIAS, fils d’Osaïas, un des chefs de l’armée qui, après la prise de Jérusalem, accusa Jérémie de tromper le peuple, en le dissuadant de se réfugier en Egypte. Jer., xliii, 2. Il y entraîna lui-même le prophète avec Baruch, son secrétaire, ?. 6. Au chapitre xlii, 1, à la place A’Azarias, on lit Jézonias, fils d’Osaïas. Quelques auteurs regardent ce Jézonias comme le frère d’Azarias, ou comme un second nom d’Azarias. Mais il est plus naturel d’attribuer ce changement de nom à une erreur de transcription, si l’on compare le ꝟ. 1 du chapitre xlii avec le ꝟ. 2 du chapitre xliii, et si l’on observe que les Septante, Jer., xlix, 1 ; l, 2, ont également’Adapta ; dans les deux passages.
30. AZARIAS, un des deux capitaines laissés à Jérusalem par Judas Machabée, pour la garde de cette ville. I Mach., v, 18, 19, 56 et 60. À la nouvelle des succès de Judas, il voulut, malgré la défense qui lui en avait été faite, se mesurer avec l’ennemi, et se porta sur Jamnia. Mais il fut battu par Gorgias, qui sortit de cette place et lui tua environ deux mille hommes. « Il n’était pas, ajoute le texte sacré, de la race de ces hommes par qui Israël devait être sauvé. »
31. AZARIAS DE RUBEIS ou Azariah de Rossi, célèbre rabbin juif du xvi" siècle. Voir Rossi (DE) 1.
E. Levesque.
- AZARICAM##
AZARICAM (hébreu : ’Azrîqâtn, « mon secours s’est levé » ), nom dans l’Ancien Testament de quatre personnes que la Vulgate appelle Ezricam, excepté II Esdr., xi, 15, où elle nomme Azaricam un lévite, ancêtre de Séméi, qui vivait du temps de Néhémie, et qui est appelé Ezricam I Par., ix, 14. Voir Ezricam 3.
AZAU ( hébreu : ffâzô, nom théophore, où une forme pronominale remplace le nom de Dieu, « Lui (Dieu) voit ; » Septante : ’AÇotv), un des huit fils que Nachor, frère d’Abraham, eut de Melcha. Gen, xxil, 22. Fut-il la souche d’une tribu, comme plusieurs de ses frères ? La Bible n’en dit rien. On a rapproché Hâzô de Xai^v-/), contrée située, d’après Etienne de Byzance, édit. Dindorf, in-8°, Leipzig, 1825, t i, p. 454, près de l’Euphrate, en Mésopotamie, ou d’une autre XaSrjvï], que Strabon, xvi, 1, place en Assyrie, aux environs de Ninive, et qu’Assemani, Bïbliotheca orientalis, t. iii, part, ii, p. 710, et t. ii, p. 115, dit être la contrée de ljâzô de la Chronique de Denis, patriarche des Jacobites en 775. E. Levesque.
AZAZ (hébreu : ’Azâz, « fort ; » Septante i’AÇoûÇ) t fils de Samma, de la tribu de Ruben. I Par., v, 8.
- AZAZEL##
AZAZEL (’âzâ’zel), nom hébreu, traduit dans la Vulgate par caper emissarius, « bouc émissaire. » Lev., xvi, 8, 10, 26. Voir Bouc émissaire.
- AZAZIAS##
AZAZIAS (hébreu : ’Âzazyâhû, « Jéhovah fortifie ; » Septante : ’OÇta ; ), un des lévites préposés à la garde des dîmes et des offrandes du temple. II Par., xxxi, 13.
- AZBAI##
AZBAI, orthographe d’Asbaï dans certains exemplaires de la Vulgate. Voir Asbaï.
- AZBOC##
AZBOC (.hébreu : ’Azbûq ; Septante : ’AÇaSoû^Xpère
d’un Néhémias habitant Jérusalem. Il concourut à la reconstruction des murs de la ville sous Néhémie. II Esdr., m, 16.
- AZÉCA##
AZÉCA (hébreu : ’Âzêqâh ; Septante : ’A^xâ, et une fois’lafrixâ, Jos., xv, 35), ville de la tribu de Juda, dans la Séphéla, Jos., xv, 33 et 35, et dans le voisinage de Dummim. I Reg., xvii, 1. Elle est presque toujours nommée avec Socho de Juda, dont elle devait être peu éloignée. Comme cette dernière, elle était située sur les collines qui bordent la vallée du Térébinthe. Jos., xv, 35 ; I Reg., xvii, 1-2. Elle existait avant l’entrée des Hébreux
Azéca avec une ruine nommée Ahbek et écrite Akbéh, sans doute par erreur, dans sa carte de la Terre Sainte. Map of the Holy Land, 1865 ; Menioir, p. 290 et suiv. Conder écrit Habeik. Cf. Map of Western Palestine, 1880, feuille xvii. LeD r Riess, Bibel-Atlas, 2e édit., p. 3, propose le Khirbet esch - Scheketah, qui est à sept kilomètres vers le sud de Beth-Netlf II existe aussi, à treize kilomètres nord - ouest de Schouêkéh, des ruines assez considérables appelées Deir-eWAshek ou’Ashey. D’après une indication de Pierre Diacre (xiie siècle), on pourrait voir Azéca dans Zacharia on Tell-Zacharia, à une heure nord-ouest de Schouêkéh : o Au xxiie mille de Jérusalem,
[[File: [Image à insérer]|300px]]
384. — Tell - Zacharia et l’ouadi ea-Sent. D’après une photographie de M. L. Heldet.
dans la Terre Promise. Après le combat de Gabaon, les Çhananéens furent écrasés par une grêle miraculeuse, et poursuivis par les soldats de Josué jusqu’à Azéca et Max : éda. Jos., x, 10. Les Philistins avaient pris position entre Socho et Azéca, quand le jeune David alla visiter ses frères, soldats de l’armée de Saùl campée en face des Philistins. C’est dans la vallée voisine que le futur roi d’Israël tua le géant Goliath. I Reg., xvii, 1, 48-51. Roboam fit d’Azéca une des villes fortes de Juda. II Par., xi, 9. Sous le roi Sédécias, elle osa résister aux armées de Nabuchodonosor. Jer., xxxiv, 7. Elle fut relevée après la captivité et habitée de nouveau par les fils de Juda. II Esdr., XI, 30. C’est la dernière mention qu’en fasse l’histoire.
Azéca doit être cherchée non loin de Shouêkeh, l’ancienne Socho ; mais sa situation précise ne peut être déterminée avec certitude. Eusèbe de Césarée et saint Jérôme se contentent de dire que l’on trouvait de leur temps « un village nommé Exéca ("E£i)%à) entre (àvâ|i£<Tov) Éleuthéropolis et jElia ». Liber de situ et loc. heb., t. xxiii, col. 868. De ce passage M. V. Guérin conclut qu’Azéca « était probablement plus rapprochée de Jérusalem que .Socho ». Judée, t. iii, p. 334. Van de Velde identifie
entre Sochchot de Juda et entre Zechara Mahel, David tua Goliath le Philistin. » De locis sanctis, édit. Gammurini, Bibliot. dell’Academia storico-giuridica, t. iv, p. 133. Ahbek et Habeik ne ressemblent que de bien loin à Azéca. Le motif qui a déterminé Van do Velde est le voisinage d’une autre ruine, à trois kilomètres nord, qu’il a entendu appeler Damin. Il la considère comme le Dummim de l’Ecriture. Les ingénieurs anglais de l’Exploration Fund ne l’ont plus retrouvée. — Le Khirbet Scheketah du D r Riess désigne sans doute le Khirbet Abou-esch-Schôk, « le père des épines, » c’est-à-dire lieu abondant en épines, ruine à sept kilomètres environ au sudest de Schouêkéh, autant sud-sud-est de Beth-Nettf, et trois kilomètres ouest de Geb’a. Ce heu correspondrait assez aux indications d’Eusèbe et de saint Jérôme, mais l’identité des noms semble bien douteuse. —’Ashek est presque absolument identique, mais un peu loin de Schouêkéh et de la vallée du Térébinthe (ouadi es-Sent). Il n’est cependant pas impossible que l’Écriture ait nommé un lieu un peu éloigné, mais plus important et plus connu. — Zacharia est un village de six cents habitants, situé sur un monticule couvert d’oliviers et de vignes, à
peu de distance d’une colline élevée, appelée Tell-Zacharia. Il est en face de Youadi es-Sent, à une heure nordouest de Schouêkéh (fig. 381). La frontière des territoires d’Israël et des Philistins devait passer dans son voisinage. Sa situation répond bien aux diverses données de la Bible ; mais il est difficile de voir dans Zæhara ou Zacharia une dérivation d’Azéca. Ce nom ou celui de Caphar-Zacharia peut cependant lui avoir été donné par suite de l’invention du corps de saint Zacharie, le prophète, dont parle Sozomène. H. E., rx, 16-17, t. lxvii, col. 1628. Le témoignage de Pierre Diacre est peut-être l’expression d’une tradition conservant avec le nom nouveau le souvenir de l’identité ancienne. L’indication d’Eusèbe est de pure critique et contestable. Zacharia est du reste sur la route de Beth-Gébrin (Éleuthéropolis) à Jérusalem.
L. Heidet.
- AZENBERGER Florian##
AZENBERGER Florian, bénédictin bavarois, né le 2 décembre 1766, mort le 16 avril 1841. Il enseigna avec succès la théologie et l’exégèse sacrée à Salzbourg et à Amberg. Il a résumé ses leçons dans un Brevis conspectus institutionum hermeneuticse, in-8°, Straubing, 1798.
J. Parisot.
AZER (hébreu : ’Êzér, « secours ; » Septante : ’ItÇoiip), lévite, fils de Josué, prince de Maspha, qui aida à la reconstruction des murs de Jérusalem sous Néhémie. II Esdr., iii, 9. Voir Josué, 7, t. iii, col. 1699.
1. AZEVEDO (Joaquim de), religieux de l’ordre de Saint -Augustin, né à Villa -Viciosa, en Portugal, mort en 1808. Il fit profession au couvent de Gracia de Lisbonne en 1762, et il enseigna la théologie à l’université de Coïmbre jusqu’à l’année 1806. On a de lui : Pro Vulgata Sacrorum Bibliorum Latina editione contra Sixtinum Aman Liber Apologeticus, in quo omnla Vulgatx loca, quse originali textu hebrseo a latino Interprète maie translata in censura sua contra Vulgatam contenait Amama, expenduntur, congruis explanationibus illustrantur, cum hebrxoque conciliantur. Accedunt prseter dissertationem prodromam in Vulgatam Latinam editionem, nonnulke alise dissertationes in Sacrant Scripturam Veteris Testamenti ex Prselectionibus Auctoris quas ad calcem Apologelici libri non abs re visum est subjungere, fn-f°, Lisbonne, 1722.
B. Moral.
2. AZEVEDO ( Louis de), jésuite portugais, mort en 1634, après vingt-huit ans d’apostolat en Ethiopie. Pour aider à la conversion des habitants de ce pays, il traduisit le Nouveau Testament en langue amharique ou éthiopien vulgaire. On lui doit aussi une version en ghez du Commentaire de Tolet sur l’Épîlre aux Romains, et de celui de François Ribera sur l’Épître aux Hébreux, 1617. Quelques écrivains lui ont attribué la version amharique du commentaire de Biaise de Viegas sur l’Apocalypse, mais ce travail est plutôt du P. Alphonse Mendez. — Voir la Biblioth. de la Comp. de Jésus, 1. 1 (1890), col. 735-737.
M. Fékotin.
- AZGAD##
AZGAD (hébreu : ’Azgâd, « fort en fortune [ ?] ; » Septante : ’Auyâ8), chef de famille dont les descendants revinrent de la captivité avec Zorobabel au nombre de douze cent vingt-deux, selon I Esdr., ii, 12, ou de deux mille trois cent vingt-deux, selon II Esdr., vii, 17. Une autre troupe de cent dix, Johanan à leur tête, accompagna Esdras dans son second voyage en Palestine. I Esdr., viii, 12. Un représentant de la famille du nom d’Azgad, et chef du peuple, signa avec Néhémie le renouvellement de l’alliance. II Esdr., x, 15.
- AZIAM##
AZIAM (hébreu : ’Vzziy&h, « Jéhovah est ma force ; » Septante : ’A&’a), descendant de Juda, et prince du peuple après le retour de la captivité. II Esdr., xi, 3-4.
- AZITORES##
AZITORES (André de), cistercien espagnol du XVIe siècle, né à Palenzuela, au diocèse de Palencia.
profès de l’abbaye de Valdeiglesias. Il a écrit sur la Sainte Écriture un excellent traité, intitulé : Theologia symbolica sive hieroglyphica, pro totius Scripturse Sacrée juxta primarium et genuinum sensum commentariis aliisque sensibus facile hauriendis, in-4°, Salamanque, 1597. C’est le premier volume d’un travail beaucoup plus considérable, qui devait en compter sept autres, d’après les plans de l’auteur ; mais celui-ci mourut en 1599, et ses notes manuscrites, conservées à Valdeiglesias, n’ont pas été publiées. — Voir Visch, Biblioth. script, ord. Cisterciensis (1656), p. 20 (il se trompe en appelant cet auteur Azorites) ; Antonio, Èibl. hisp. nova (1783), t. i, p. 70 ; Bucelin, Benedictus redivivus, Augsbourg, 1679, p. 146.
M. FÉROTIN.
- AZIZA##
AZIZA (hébreu : ’Àzyzâ’, « fort ; » Septante : ’OKci), de la famille de Jéthua ; un de ceux qui répudièrent les femmes étrangères qu’ils avaient épousées durant l’exil. I Esdr., x, 27.
- AZMAVETH##
AZMAVETH, hébreu : ’Azmâvét, « la mort est forte ». Nom de plusieurs personnes et d’une ville dans l’Ancien Testament. La Vulgate a transcrit le nom hébreu, tantôt Azmaveth, tantôt Azmoth. Voir Azmoth.
1. AZMAVETH (Septante : ’A<j|i<18, ’Açëwv), un des vaillants guerriers de l’armée de David, natif de Berom (hébreu : Bahurim). II Beg., xxiii, 31. Au lieu de Azmaveth de Bérom, on lit dans la liste parallèle, I Par., xi, 32 : « Azmoth le Bauramite. »
2. AZMAVETH (Septante : ’AÇjwie), ville mentionnée dans I Esdr., ii, 24, parmi celles dont les enfants revinrent de captivité avec Zorobabel. Citée avec Anathoth, Cariathiarim, Béroth, Rama, etc., elle devait évidemment appartenir à la tribu de Benjamin. Elle est également signalée dans II Esdr., xii, 29, où nous voyons que, lors de la dédicace des nouvelles murailles de Jérusalem, elle fut, avec Géba, au nombre des villes qui envoyèrent des chantres sacrés à la cité sainte. Il semble donc résulter de ces deux passages qu’elle était dans le voisinage de Géba (Djéba) et d’Anathoth (Anâta). Or entre ces deux localités se trouve le village de Ifazméh ou Hizméh, M^*-, dont la position répond parfaitement, et le nom assez bien, aux données scripturaires. Elle est appelée Bethazmoth (hébreu : Bêf-’Azmâvét ; Septante : Br)9a<ju.<66) dans II Esdr., vii, 28. Le petit village de Hizméh couronne une montagne blanchâtre et crayeuse. « Il compte à peine deux cents habitants. Quelques maisons paraissent construites, au moins dans leur partie inférieure, avec des matériaux antiques ; plusieurs citernes creusées dans le roc doivent également dater de l’antiquité. » V. Guérin, Description de la Palestine t Judée,
t. iii, p. 74-75.- AZMOTH##
AZMOTH (hébreu : ’Azmâvét). Voir Azmaveth.
1. AZMOTH, nom dans la Vulgate, I Par., xi, 32, du guerrier qui est appelé II Reg., xxiii, 31, Azmaveth. Voir Azmaveth 1.
2. AZMOTH (Septante : ’Aqjuie, TaÇiuie), fils de Joada, de la descendance de Saiil par Jonathas. I Par., viii, 36 ; ix, 42.
3. AZMOTH (Septante : ’A<T(iû6), Benjamite, père de Jaziel et de Phallet, vaillants guerriers, habiles à tirer de l’arc. I Par., XII, 3. Peut-être identique à Azmaveth 1. A moins qu’Azmoth n’indique ici une place de ce nom, Azmaveth, dont Jaziel et Phallet auraient été originaires, ce qui les aurait fait appeler « fils d’Azmaveth ». Voir Azmaveth 2.
4. AZMOTH, l’intendant des trésors du roi sous la règne de David. I Par., xxvii, 25.
4307
AZOR — AZOT
4308
1. AZOR (Nouveau Testament : ’AÇe&p), fils d’Éliacim, dans la généalogie de Notre-Seigneur. Matth., i, 13
2. AZOR, ville. I Mach., xi, 67, voir AsorI, col. 1105.
1. AZOT (hébreu : ’Asdôd, « forteresse [ ?] ; » Septante : "AÇwtoç), une des cinq grandes villes des Philistins, Jûs., xiii, 3, aujourd’hui Esdud, à seize kilomètres au nord-est d’Ascalon, à dix milles romains (14 kilom. 80) au sud de Jamnia, d’après la Table de Peutinger, à peu près à moitié chemin entre Gaza et Jaffa. Elle est à cinq kilomètres de la mer Méditerranée. D’après une fable rapportée par Etienne de Byzance, De urbibus, édit. Dindorf, t. i, 1825, p. 22, Azot aurait été ainsi appelée par un fugitif des environs de la mer Rouge, qui lui aurait donné le nom de sa femme Aza (Ty, ’az, « biche » ). C’est là une étymologie imaginaire, qui ne Convient même pas au nom indigène de la cité philistine, ’Asdôd, mais tout au plus à la forme grécisée de ce nom, qui nous a été transmise par les écrivains classiques et par les Septante. Hérodote, ii, 157 ; Strabon, xvi, 29, édit. Didot, p. 646 ; Ptolémée, v, 16, in-f°, Amsterdam, 1605, p. 140 ; Pline, ii, N., v, 14 (69), édit. Teubner, 1. 1, p. 197 ; P. Mêla, 1, 10, coilection Nisard, 1845, p. 612.
Azot fut attribuée à Juda, Jos., xv, 46, 47, et, d’après Josèphe, elle se trouvait à la limite de la tribu de Dan. Ant. jud., V, i, 22. Il y avait là des géants de la race des Énacim ; les Israélites ne réussirent pas à les chasser, non plus que de Gaza et de Geth, Jos., xi, 22. de sorte que cette ville resta indépendante pendant fort longtemps. — À l’époque des Juges, elle prit part aux guerres contre les tribus d’Israël. Vers la fin de la judieature d’Héli, les Philistins, ayant remporté sur les Hébreux deux grandes victoires, s’emparèrent de l’arche et la portèrent à Azot, dans le temple de Dagon, I Reg., v, 1-2. Cf. I Mach., x, 83 ; Jud., xvi, 23. Ils placèrent le trophée de leur victoire devant l’image de leur dieu, mais ils trouvèrent le lendemain cette idole le visage contre terre, devant l’arche du Seigneur et le surlendemain renversée de nouveau et brisée (voir Dagon) ; en même temps un mal épidémjque frappait les habitants, tandis que des troupes de rats ravageaient la campagne. I Reg., v, 3-6. L’arche fut transférée à Geth, puis à Accaron ; sa présence amena partout les mêmes calamités, et elles ne cessèrent que lorsque les gens d’Azot et des autres cités philistines l’eurent renvoyée à Israël, avec des présents expiatoires. I Reg., v, 8-vi, 18.
Le nom d’Azot ne reparaît dans l’Écriture que sous le règne du roi Ozias, neuvième successeur de Roboam. Ce prince fit la guerre aux Philistins, s’empara de Geth, de Jabnia (Jamnia) et d’Azot ; il en renversa les murailles, et « construisit des villes en Azot », dit le texte sacré, c’est-à-dire sans doute qu’il s’établit solidement sur tout son territoire. II Par., xxvi, 6. Nous ignorons combien de temps Juda en resta maître. — D’après l’auteur du De vitis prophetarum, 16, Patr. gr, t. xliii, col. 408, Jonas, qui fut contemporain d’Ozias, serait né près d’Azot ; mais cette opinion est fausse, car ce prophète était de la Palestine du nord. S. Jérôme, Prsef. in Jon., t. xxv, col. 118.
Un mot dit en passant par le prophète Isaïe, xx, 1, nous apprend qu’Azot fut prise sous le règne de Sargon, par le « tharthan » (général) de ce roi de Ninive. Les inscriptions de Sargon nous ont renseignés sur cet événement, qui, jusqu’à ces dernières années, n’avait été connu que par le passage d’Isaïe (716 avant J.-C). Les Assyriens voulant s’emparer de l’Egypte, et la ville d’Azot se trouvant sur la route qui conduit de l’Asie dans la vallée du Nil, la possession de cette place leur était indispensable. Sargon (722-705 avant J.-C.) donna donc au général qui commandait ses troupes l’ordre de soumettre Azuri, qui en
était alors le roi. « Azuri, roi d’Azot, *-^ S JMf *~"| t$>
Ai-du-di, dit Sargon, dans sa grande inscription, lignes
90-109, endurcit son coeur pour ne pas payer tribut ; il envoya aux rois ses voisins des messages hostiles à l’Assyrie. J’en tirai vengeance, je lui enlevai son pouvoir ; j’élevai son frère Achimit à sa place sur le trône. Mais le peuple de Chatti se révolta et refusa de lui obéir ; il mit à sa place Yaman, qui n’était pas le maître légitime du trône, et qui, comme ces [rebelles], ne reconnaissait pas ma puissance. Dans la colère de mon cœur, je ne rassemblai pas toutes mes troupes et je n’employai pas toutes mes forces ; avec les [seuls] guerriers qui étaient près de moi, je marchai contre Azot. Yaman apprit de loin mon approche ; il s’enfuit en Egypte, du côté de Miluhha, et on ne le revit plus. J’assiégeai et je pris Azot, Gimtu, Asdodim ; ses dieux, sa femme, ses fils et ses filles, ses richesses, le trésor de son palais et les hommes du pays devinrent mon butin. Je repeuplai de nouveau ces villes, et j’y plaçai les hommes que mon bras avait conquis dans les pays du soleil levant ; je les fis habiter là, j’établis sur eux un gouverneur, et ils gardèrent mon obéissance. » J. Oprert et J. Menant, Fastes deSargon, in-f", 1863, p. 5-6 ; E. Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek, t. ii, p. 64-07.
Les habitants d’Azot restèrent aussi soumis aux successeurs de Sargon. Son fils Sennachérib (705-681 avant J.-C.) raconte que, lors de sa campagne contre Ézéchias, roi de Juda, il reçut le tribut de Mitinti, roi d’Azût (Cylindre de Taylor, col. ii, ligne 51 ; Keilinschriftliche Bibliothek, t. ii, p. 90), et qu’il lui donna une partie des villes qu’il prit à Ézéchias (CylincYe de Taylor, col. iii, ligne 21 ; Keil. Bibliothek, t. ii, p. 94). Asarhaddon (681-668 avant J.-C), son fils et successeur, énumèrc « Ahimilki, roi d’Azot », parmi ses tributaires | Prisme brisé, col. v, ligne 18 ; Keil. Bibliothek, t. ii, p. 148). Ce même prince figure aussi dans la liste des vingt-deux rois du pays des bords de la mer Méditerranée qui payent tribut à Assurbanipal (668-625 avant J.-C), fils et successeur d’Asarhaddon (Keil. Bibliothek, ligne 12, t. ii, p. 240).
Le roi d’Egypte, Psammétique, voulut enlever Azot à la domination de l’Assyrie. U avait été lui-même vassal de cet empire ; mais, étant parvenu à faire refleurir la puissance de l’Egypte, il résolut, pour se mettre à l’abri des invasions ninivites, qui avaient plusieurs fois désolé la vallée du Nil, de s’emparer du pays des Philistins, et en particulier d’Azot, qui était la clef des routes menant d’Asie en Afrique. Il attaqua donc cette ville, et, s’il faut en croire Hérodote, ii, 157, qui remarque que c’est le plus long siège dont l’histoire fasse mention, il ne s’en rendit maître qu’au bout de vingt-neuf ans (vers 630 avant J.-C). Les Assyriens, qui avaient probablement alors à lutter contre les Mèdes, ne purent la secourir. Elle fut détruite par son vainqueur ; ear Jérémie, qui était contemporain de cet événement, parle, dans son énumération des villes philistines, « de ce qui reste d’Azot, s c’est-à-dire de ses ruines. Jer., xxv, 20. Cf. Hérodote, ii, 157. Le texte grec de Judith, ii, 28, mentionne Azot parmi les villes qui avaient été remplies de terreur par la campagne de Nabuchodonosor contre l’Asie occidentale. Nous ne savons plus rien d’elle jusqu’après la captivité de Babylone.
Quand les Perses se furent rendus maîtres de l’Egypte, Azot dut être soumise à leur domination, comme le reste
de la Palestine. Voir
Stark, Gaza und die
philistàische Kùste,
p. 228. Cette commu nauté de gouvernement
dut favoriser les ma riages des Juifs avec des
filles d’Azot dont il est
question dans II Esdras,
xiu, 23-24. Néhémie
nous apprend, à cette occasion, que les habitants d’Azot avaient un langage particulier. II Esdr., xiii, 24. — Alexandre le Grand s’empara de Gaza (Stark, Gaza, p. 236-214), et tout le pays se soumit au conquérant. Après sa mort, Azot
385. — Monnaie d’Azot.
passa tour à tour sous la domination de ses successeurs, les Ptoléméés et les Séleueides. Une curieuse médaille, qui date probablement dé cette époque, montre que cette ville était redevenue alors une place forte (fig. 385). Le droit représente la tête d’un gouverneur appelé Hirom. (Voir Zeitschrift von Numismatik, 1876, t. iv, p. 266.) Au revers, on voit la déesse d’Azot, Atargatis ou Astarthé, portée sur deux sphinx ailés et tenant une fleur dans sa main droite. La légende est en langue sémitique, mais écrite en caractères grecs, qu’il faut lire au rebours : IP ASAÛA AS1NA ou nj’Dn nw l’y, « la ville d’Azot la forte. »
A l’époque des Machabées, Azot était soumise aux rois de Syrie. Judas Machabée (163 avant J.-C.) marcha contre cette ville, la pilla et y brûla les autels des faux dieux avec les idoles qu’on y adorait. I Mach., v, 68. Quelques années plus tard (143 avant J.-C), Jonathas la traita plus
rable village, comme nous l’apprend Jacques de Vitry (Azotus, dit-il, nunc ad modici casalis reducta est parvitatem), Hist. Hierosol., 41, dans Bongars, Gesia Dei per Franco », in-f°, Hanau, 1611, p. 1070-1071. Aujourd’hui, de son antique gloire, il ne lui reste que son nom d’Esdud. Ses maisons sont de construction grossière, la plupart eu briques crues, et se composant seulement d’un rez-de-chaussée ; le nombre de ses habitants est de quinze à dixhuit cents. La ville ancienne était probablement sur le sommet de la colline, tandis que les masures actuelles sont sur le versant oriental. Les dunes de sable arrivent jusqu’auprès du village. Il est alimenté d’eau par des étangs et par un puits en maçonnerie à l’est. Bâtie sur une petite éminence (fig. 386) et solidement fortifiée, l’antique Azot était, par sa situation, une place importante. Le monticule sur lequel elle s’élevait est verdoyant et d’un agréable aspect, couvert de jardins,
[[File: [Image à insérer]|300px]]
886. — Vue d’Azot
durement encore ; il y poursuivit le général syrien Apollonius, y mit le feu et la brûla avec le temple de Dagon. I Mach., x, 77-84 ; xi, 4. Sous Alexandre Jannée, son territoire appartenait au royaume juif. Josèphe, Ant. jud., XIII, XV, 4. Pompée l’enleva aux Juifs et le réunit à la province de Syrie. Ant. jud, , XIV, IV, 4 ; Bell, jud., i, vu, 7. Le gouverneur romain Gabinius repeupla Azot l’an 55 avant J.-C. Ant. jud., XIV, v, 3 ; Bell, jud., i, vin, 4. Hérode le Grand la légua par son testament à sa sœur Salomé (4 avant J.-C). Ant. jud., XVII, viii, 1 ; XI, v. Quelques années plus tard (38 de notre ère), l’esprit divin transporta le diacre Philippe dans cette ville, après qu’il eut baptisé l’eunuque de Candace, reine d’Ethiopie, Act., viii, 40, et il dut y prêcher l’Évangile. Elle comptait sans doute alors beaucoup de Juifs parmi ses habitants, ce qui fit que Vespasien l’occupa militairement pendant la guerre judaïque. Josèphe, Bell, jud., IV, iii, 2. Il y eut des évêques chrétiens à Azot aux ive, ve et VIe siècles. Lequien, Oriens christianus, t. iii, p. 660-662 ; B Gams, Séries episcoporum, 1873, p. 453. Mais les prophètes avaient annoncé sa ruine. Amos, i, 8 ; Sophonie, ii, 4 ; Zacharie, ix, 6. Elle devait disparaître. Bu temps des croisades, elle n’était déjà plus qu’un misé d’oliviers, de figuiers et de palmiers du côté de l’est. A l’ouest s’étend un grand marais. Une colline de sable, couverte de jardins hérissés de cactus, se dresse au nordouest, et protège Azot contre le vent de mer ; c’est là que s’élevait probablement autrefois la citadelle, cf. I Mach., IX, 15, et peut-être aussi le temple de Dagon. Près du village, au sud-ouest, est un grand caravansérail en ruines.* Tout autour croissent l’oranger, le citronnier, le grenadier, le figuier, l’olivier. Le port d’Azot était à l’endroit appelé aujourd’hui Minet Esdud, « port d’Azot ; » il n’y reste que quelques ruines, et elles ne sont même pas d’une haute antiquité.
Voir Ch. L. Irby et J. Mangles, Travels in Egypt and Nubia, ch. iv, in-12, Londres, 1844, p. 56 ; Ed. Robinson, Biblical Researches, 3 in-8°, Boston, 1841, t. ii, p. 368 ; H. Reland, Palsestina, 2 in-4°, Utrecht, 1714, t. ii, p. 606-609 ; K. B. Stark, Gaza und die philistàische Kûste, 1852, p. 22, 208, 594 ; K. Ritter, Erdkunde, 2e édit., t. xvi, p. 89-101 ; T. Tobler, Dritte Wandrung nach Palàstina, 1859, p. 26-32 ; Survey of western Palestine, Jérusalem, p. 441-442 ; Memoirs, t. ii, p. 409-410 ; 421-422 ; t. iii, p. 318 ; Thomson, The Land and the Book, Southern Palestine, 1881, p. 157-161, 169-171 ; Ebers et Guthe,
Palàstina, t. ii, 1884, p. 177, 179 ; E. Schûrer, Geschichte desjûdischen Volkes, t. ii, 1886, p. 67-68.
F. Vigouroux.
2. AZOT (Montagne d’). Cette montagne, ou plutôt cette colline, mentionnée £ Mach., ix, 15, est sans doute le monticule qui s’élève entre Esdud et la mer, et que
les Arabes appellent aujourd’hui Er-Ras, i » JJt, « le
Sommet. » Pendant la bataille où il devait succomber, Judas Machabée poursuivit jusque-là l’aile droite de l’armée du général syrien Bacchide, qu’il avait rompue. Divers critiques jugent cependant invraisemblable que le combat ait eu lieu dans les environs d’Azot, ’en un endroit si éloigné de la Judée. W. Grimm, Das erste Buch der Maccabâer, 1853, p. 135. Il est impossible de résoudre la question, parce que nous ignorons en quel lieu se livra la bataille Judas avait son camp à Laïsa (grec : ’AXaoô), et la situation de cette ville est inconnue.
- AZRÉEL##
AZRÉEL (hébreu : ’Azar’êl ; Septante : ’EaSpir^), père ou ancêtre d’Amassaï, l’un des prêtres qui habitèrent à Jérusalem après le retour de la captivité de Babylone. II Esdr., xi, 13. Il paraît être le même qu’Adiel, père de Maasaï, dont il est question I Par., ix, 12. Voir Azaréel et Adiel 2.
- AZTÈQUE##
AZTÈQUE (VERSION) de la Bible. Voir Mexicaine (version), t. iv, col. 1055.
- AZUBA##
AZUBA, hébreu : ’Âzûbâh, « délaissée. » Nom de deux femmes.
1. AZUBA (Septante : ’AÇovêi), femme d’Asa, roi de Juda, et mère de Josaphat. III Reg., xxii, 42 ; II Par., xx, 31.
2. AZUBA (Septante : TaÇougô), femme de Caleb, fils d’Hesron, de la tribu de Juda. I Par., ii, 18, 19.
AZUR, hébreu : ’Azzûr, « aide. » Nom de trois Israélites.
1. AZUR (Septante : ’AÇoùp), un des chefs du peuple qui signèrent avec Néhémie le renouvellement de l’alliance. II Esdr., x, 17.
2. AZUR (Septante : ’AÇoSp), Benjamite, père du faux prophète Hananias de Gabaon. Jer., xxviii, 1.
3. AZUR (hébreu : ’Azzur ; Septante : "Ejep), père de Jézonias, chef du peuple, contre lequel Ézéchiel reçut l’ordre de prophétiser. Ezech, , xi, 1.
- AZYME##
AZYME (aÇu(io< : a privatif ; Çtf|u], « levain » ). On appelle azymes les pains et les gâteaux faits avec de la pâte non fermentée ou sans levain. Le nom hébreu était niassâh, plur. massât, de la racine ysn, « être doux, fade. » La Vulgate rend massàh tantôt par azymus, et tantôt par l’équivalent absque fermento, « sans levain, » par exemple : Lev., ii, 4 ; vi, 16 ; Deut., xvi, 3 : « Pendant sept jours tu mangeras des absque fermento ( c’est-à-dire des azymes), pain d’affliction. »
Comme on fait cuire la pâte dès qu’elle est pétrie, on prépare les pains azymes en moins de temps que les antres. Chez les Orientaux, surtout dans les villages et parmi les tribus nomades, où chacun cuit son pain au jour le jour et sans faire de provisions à l’avance, il est des cas où cette préparation rapide est nécessaire, par exemple quand on reçoit un hôte inattendu. C’étaient des massât que la sorcière d’Endor pétrit et fit cuire à la hâte pour Saûl et sa suite, I Reg., xxviii, 24 : il en était de même des pains que Lot servit aux hôtes qui vinrent lui annoncer la ruine imminente de Sodome, Gen., six, 3, et tels
étaient aussi probablement ceux que Sara avait préparés peu auparavant, dans une circonstance analogue. Gen., xvin, 6. En Orient, l’usage ordinaire de pains azymes ne s’est pas perdu : « Le pain le plus commun, surtout parmi les populations rurales, dit le voyageur Van Lennep, est un gâteau plat de pâte non levée, pas plus épais qu’une crêpe, de forme circulaire ou ovale et de dix ou douze pouces (environ trente centimètres) de diamètre. » Et après avoir décrit les fours de divers genres v portatifs et en terre, en usage chez les nomades ( voir Four, Pain), il ajoute : « Quelques-uns emploient des plateaux de fer qui sont chauffés en les posant sur le feu ; d’autres placent les gâteaux non levés directement sur les charbons. Ces pains sont craquants et agréables au goût, mais d’une digestion difficile. On les mange toujours peu après les avoir fait cuire. » Bible Lands, 1875, p. 88, 89.
Quand Gédéon présenta à l’ange de Dieu des pains azymes avec un chevreau, Jud., vi, 19-21, ce n’était pas comme un repas servi à un hôte ordinaire ; son offrande avait un caractère religieux incontestable ; et pour cela les pains offerts, que le feu miraculeux devait consumer, furent préparés sans levain. En effet, les pains azymes, chez les Hébreux, ne comptaient pas seulement parmi les aliments vulgaires ; ils avaient une place importante dans leurs institutions religieuses : 1° dans les sacrifices ; 2° dans la célébration de la fête de Pâques.
1° Dans les sacrifices. — L’offrande des pains ou gâteaux de différentes sortes accompagnait souvent l’immolation de la victime, et même formait une catégorie de sacrifices à part. Lev., ii, 4. Or c’était un principe, plusieurs fois répété dans la Loi, que rien de fermenté ne pouvait être offert sur l’autel. Exod., xxiii, 18 ; xxxiv, 25 ; Lev., ii, 11 ; aussi tous les pains et gâteaux servant au sacrifice non sanglant, minfyâh, devaient-ils être azymes. Lev., ii, 4 ; VI, 16-17 (hébreu, 9-10). Dans les autres espèces de sacrifices où il est question de pains ou gâteaux, il est de même rappelé qu’ils doivent être azymes : Lev., vil, 12, pour le sacrifice de louange ; viii, 2, 26 ; cf. Exod., xxix, 2, 23, pour la consécration des prêtres ; Num., vi, 15, 17, 19, dans l’accomplissement du vœu des Nazaréens. Si, en certaines circonstances, des pains levés devaient accompagner les sacrifices, c’était simplement pour être présentés comme prémices, qorbân rê’Ht, pour les prêtres, mais non pour être offerts sur l’autel, Lev., ii, 12 ; xxiii, 17, et c’est par ces passages qu’il faut expliquer Lev., vii, 13-14, qui, dans sa formule raccourcie, paraît contredire la règlegénérale. — Les prêtres, descendants d’Aaron, avaient seuls le droit de manger ce qui restait des azymes offerts en sacrifice. Lev., VI, 16, 18 (hébreu, 9, 11). On conservamême cette prérogative, dans la réforme religieuse accomplie sous Josias, aux prêtres coupables d’avoir rendu à Dieu un culte illégitime sur les hauts lieux : ramenés dans la capitale, « ils ne montèrent plus à l’autel de Jéhovah à Jérusalem, mais ils mangeaient les massôt au milieu de leurs frères, » IV Reg., xxiii, 8, 9 ; ce qui suppose déjà établie la règle posée dans le Lévitique, dans ce prétendu code sacerdotal dont la critique négative veut rejeter la composition après la captivité. — La préparation des azymes, comme celle des autres pains ou gâteaux destinés aux sacrifices, était confiée aux Lévites. I Par., xxiii, 29. (La Vulgate, en ajoutant sacerdotes autem au début du, verset, attribue ce soin aux prêtres ; mais cette addition, inconnue aux autres versions, ne se justifie pas.) — D’après la tradition juive, Josèphe, Antiq.jud., III, VI, 6 ; Talmud, Minchot, v, 2, 3, les pains de propositions, qui ne pouvaient aussi être consommés que par les prêtres, étaient azymes ; cependant il n’est rien dit à ce sujet dans Lev., , xxiv, 5-9, où est prescrite la manière de les préparer.
2’» À la fête de Pâques. — Ce n’était pas seulement dans les rites de quelques sacrifices que l’on faisait usage de pains azymes ; mais ils étaient prescrits, à l’exclusiom de tout autre, pour la nourriture de tous les Israélites, pendant les sept jours de la fête de Pâques, en souvenir1313 AZYME — AZZONI 1314
de ce qui s’était passé lors de la sortie d’Egypte. Si les azymes des sacrifices ont disparu, chez les Juifs, avec la ruine du temple et du culte mosaïque, l’usage des azymes pascals est toujours religieusement observé. Le commandement à leur égard est plusieurs fois répété, Exod., xii, 8, 15, 17-20, 34, 39 ; xiii, 3, 6-7 ; xxiii, 15 ; xxxiv, 18, où l’on rappelle qu’il a été déjà donné. Il n’est pas étonnant qu’on y revienne encore à l’occasion de la deuxième pâque, Num., lx, 11, et dans le calendrier des fêtes, Num., xxviii, 17 ; Deut., xvi, 3, 4, 8 ; Ezech., slv, 21. — La manière dont l’usage des pains azymes est expliqué dans l’Exode, xii, a donné lieu à une difficulté : au début du chapitre, Dieu ordonne de manger l’agneau pascal avec des azymes et des laitues amères, ꝟ. 8, et d’user de pains semblables pendant sept jours, jL 15. Mais, dans le récit qui suit, si les Israélites sont réduits à manger de tels pains, c’est que, pressés par les Egyptiens, ils durent partir sans attendre que leur pâte eût fermenté, y. 34, 39 ; l’auteur de ce récit ne connaît donc pas, dit-on, l’ordre divin préalable ; il appartient à un autre document que le début du chapitre. — Cette conclusion ne découle nullement du fait constaté ; il y a, en effet, une autre explication plus simple et qui s’accorde avec l’opinion traditionnelle sur l’unité d’auteur. Le ꝟ. 8 présente l’ordre divin relatif à la première nuit, et c’est le seul que nous soyons obligés de reconnaître comme donné avant l’événement. Le récit des ꝟ. 34, 39, n’a pas pour but d’expliquer pourquoi on mangea des azymes avec l’agneau pascal, puisqu’il suppose la sortie d’Egypte déjà réalisée ; mais seulement de dire comment on se trouva encore pendant quelque temps dans la nécessité de se nourrir de pains non levés. Pour perpétuer le souvenir de cet événement, Dieu inspira à Moïse l’ordre de se servir de pains semblables pendant sept jours dans la célébration ultérieure de la Pâque ; dans ce deuxième ordre, ꝟ. 14-20, qui se distingue nettement du premier par le ton, rien n’implique qu’il fut donné comme le premier avant le départ ; au contraire, au ꝟ. 17, le parfait hôsê’fî doit être plutôt traduit par le passé : « j’ai fait sortir, » que par le futur educam, « je ferai sortir, » de la Vulgate.
Bien que ces prescriptions n’aient pas été données simultanément, on comprend que Moïse, écrivant un certain temps après que tous les événements de l’exode s’étaient accomplis, n’ait formé qu’un tout des lois relatives à la Pâque, en joignant à l’ordre donné pour et avant la première nuit celui qui concernait l’avenir, et en rapportant ainsi ce dernier avant de raconter l’événement qui en fut l’occasion. En somme, il n’y a là rien qui implique diversité de documents, ni même une transposition faite après coup dans un but liturgique, parce qu’il n’y à rien qui dépasse la liberté d’un auteur, même témoin oculaire, qui, écrivant non au jour le jour, mais à une certaine distance des faits, ne s’astreint pas rigoureusement à l’ordre chronologique, et s’en écarte pour un juste motif. Au reste Moïse, dans le Deutéronome, xvi, 3, reprend et résume les deux textes de l’Exode, et montre clairement leur rapport tel que nous l’-avons établi : « Sept jours tu mangeras des azymes, pain d’affliction ; car avec hâte tu es sorti du pays d’Egypte ; afin que tu te rappelles le jour de ta sortie du pays d’Egypte tous les jours de ta vie. »
Quand, dans les livres historiques, on rappelle la célébration d’une fête de Pâques, les azymes sont mentionnés comme un trait caractéristique de la solennité, Jos., v, 11 ; car dès l’origine elle fut désignée sous le nom de « fêté des Azymes », fyag ham-massôt. Exod., xxiii, 15 ; xxxiv, 18 ; Lev., xxiii, 6 ; Deut., xvi, 16 ; II Par., viii, 13 ; xxx, 13, 21 ; xxxv, 17 ; I Esdr., vi, 22. De là nous avons le même nom dans le Nouveau Testament : t| éop-rri tûv àïûjiwv, Luc, xxii, 1, ou simplement aussi : « le jour » ou « les jours des Azymes », Luc, xxii, 7 ; Act., xii, 3 ; xx, 6 ; ou encore : « la Pâque et les Azymes. » Marc, xiv, 1. Enfin on comptait ainsi les jours de la fête, par exemple, « le premier jour des Azymes, » Matth., xxvi, 17 ; Marc, xiv, 12, c’est- à-dire le jour où l’on commençait à manger des pains azymes. — Saint Paul, dans I Cor., v, 7-8, nous découvre le symbolisme des pains azymes, emblèmes de sincérité et de vérité, par opposition au vieux levain, qui représente la corruption du siècle. Il écrivait peut-être cette Épltre pendant la fête de Pâques (d’après xvi, 8, un certain temps avant la Pentecôte) ; ce qui expliquerait la soudaine allusion aux azymes. — Notre -Seigneur, ayant célébré la dernière cène « le premier jour des azymes », se conforma au rite juif et se servit de pains non levés : aussi l’Église latine a-t-elle conservé l’usage de tels pains dans la célébration de l’Eucharistie, sans cependant condamner l’usage de l’Église grecque et de plusieurs Églises orientales, qui emploient des pains levés. — De leur côté, les Juifs observent toujours avec grand scrupule l’ordre de manger des pains azymes pendant la Pâquej et d’écarter de leur maison tout ce qui est fermenté. Le Talmud, dans le traité Pesakh rischon, renferme à cet égard de minutieuses prescriptions. Dès le 14 Nisan, veille de la fête, à midi, on doit s’abstenir de manger rien de fermenté, et, dès le 13 au soir, on commence à chercher tous les restes de pains levés ou autres aliments fermentes, pour les jeter ou les brûler. Cf. Maimenide, liâmes u-massa, c. 2, dans Otho, Lexicon rabbin.’philologicurà, 1675, p. 193, 442 ; Buxtorf, Synagoga judaica, p. 290 ; Schôttgen, Horse hebr., t. i, p. 598. — Aussi, le 14 Nisan pouvant être considéré comme le premier jour où l’on mangeait des azymes, cf. Exod., xii, 18, Josèphe comptet-il tantôt huit jours, Ant. jud., II, xv, 1, et tantôt sept, ibid., III, x, 5, pour la fête dès Azymes. J. Thomas.
AZZI, hébreu : ’Uzzi, abréviation de’Uzziyâh, « Jéhovah est une force ; » Septante : ’Oçf. Le texte hébreu nomme sept personnes du nom de’Uzzi. La Vulgate appelle trois d’entre elles Azzi et les quatre autres Ozi. Voir Ozi.
1. AZZI, lévite, fils de Bani, chef des lévites habitant Jérusalem après le retour de la captivité, au temps de Néhémie. II Esdr., xi, 22.
2. AZZI, prêtre, chef de la famille de Jodaia, au temps du grand prêtre Joacim, sous Zorobabel. II Esdr., xii, 19.
3. AZZI, un des prêtres qui assistaient Néhémie à la dédicace des murs de Jérusalem. II Esdr., xii, 41. Il peut être le même que le précédent.
4. AZZI (Orazio degli), religieux italien de l’ordre des Mineurs réformés, appelé communément Horace de Parme, de la ville où il était né le 27 avril 1673, il mourut le Il novembre 1757. On. a de lui : Riflessioni sopra la Genesi, in-8°, Venise, 1707 ; Exposizioni ûtteralie morali sopra la Sacra Scrittura, 13 in-4°, Venise, 1736-1746. Les dix premiers volumes s’occupent de l’Ancien Testament, les trois derniers du Nouveau. L’ouvrage est dédié à Benoit XIV. — Voir G. B. Mazzuchelli, Scrittori d’Italia, t. ii, p. 1228 ; Hurter, Nornenclator litterarius, t. ii, p. 1307.
AZZOGUIDI Valère Félix, savant italien, né à Bologne en 1651, mort en 1728. Il exerça la profession de notaire. On a de lui : Chronologica et apologetica dissertatio super quxstiones in sacrée Genesis historiam excitatas, in-4°, Bologne, 1720. — Voir Acta erudit. Lips., 1721, p. 246. B. Heubtebize.
AZZONI Pierre, commentateur catholique, né à Prague en 1721, mort dans cette ville en 1777. Il entra en 1738 dans la Compagnie de Jésus, professa la philosophie et la théologie à Olmutz, et fut, en 1773, supérieur du séminaire de Troppau. Il Çpublié Commentarius in Scripturam Sacram, in-4°, Olmutz, 1763. C. Sommervogel.