Relation historique de la peste de Marseille en 1720/01
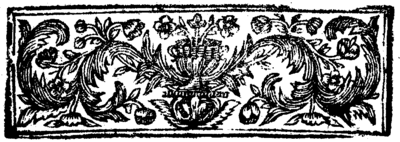
RELATION
HISTORIQUE
De la Peſte de Marſeille.
En 1720.
CHAPITRE PREMIER
E toutes les calamités publiques
la peſte eſt conſtamment
la plus cruelle & la
plus terrible. La guerre & la
famine ne préſentent rien de ſi affreux,
que ce que l’on voit dans une
Ville affligée de ce malheur. On peut,
par la ſoûmiſſion & par l’obéiſſance,
fléchir la colere d’un puiſſant ennemi,
ſe dérober à ſa fureur par la fuite, la
repouſſer par une vigoureuſe reſiſtance.
On peut arrêter la rapidité de ſes
conquêtes, par l’opoſition d’une Place,
que l’art d’accord avec la nature,
auront mis en état de le laſſer, par
une longue défenſe. On peut trouver,
dans la force de ſes remparts, un aſile
à ſa foibleſſe, & obtenir, à la faveur
d’un courage opiniâtre, une honorable
compoſition.
Quelqu’affreux que ſoit le ſpectacle d’une Ville ſaccagée, il ne dure que quelques heures, ou tout au plus que quelques jours. Le Soldat avide de piller, eſt bientôt raſſaſié de ſang & de carnage : ſenſible aux malheurs des vaincus, il accorde ſouvent la vie à leurs larmes ou à leur liberalité. Quelque general que ſoit ce maſſacre, on épargne preſque toûjours ceux que la foibleſſe de l’âge & du ſexe rend innocens du crime commun : enfin, ſouvent le premier ſang répandu, excite la pitié du vainqueur, & procure aux autres un pardon & une amniſtie génerale.
La famine n’entraîne les derniers malheurs, que quand elle eſt génerale & univerſelle. On n’a preſque jamais vû de ces ſortes de famines. Dans celles qui ſont particulieres, & dans une ſeule contrée, on trouve toûjours dans la charité, ou dans l’avarice de ſes voiſins, une reſſource à ſa diſette ou à ſon indigence ; & le plus grand mal qu’elles puiſſent faire, c’eſt d’obliger ceux qu’elles affligent, à chercher, par une vie errante & vagabonde, dans les pays étrangers, les moyens de conſerver une vie, qu’ils auroient vû finir dans la langueur, en reſtant dans leur propre pays.
Les malheurs de la contagion ſont bien plus accablans, plus longs, & plus affreux. C’eſt un ennemi implacable, dont les traits ſont d’autant plus dangereux, qu’ils ſont inviſibles & plus répandus, contre leſquels les précautions les plus exactes ſont ſouvent vaines & inutiles ; & tous les ſecours humains ne ſont qu’une foible reſſource : dans peu de jours, elle fait un déſert affreux de la ville du monde la plus peuplée & la plus opulente, & la remplit d’horreurs & de miſere. Le culte divin ſuſpendu, les Temples fermés, les exercices publics de Religion prohibés, les honneurs de la ſepulture défendus, augmentent l’horreur de ce ſpectacle.
La contagion fait ceſſer le commerce dans une ville ; elle ſemble y diſſoudre la ſocieté, interdire aux hommes la communication des ſecours mutuels qui l’entretiennent, rompre toutes les liaiſons du ſang & de l’amitié, abolir l’amour conjugal, éteindre même l’amitié paternelle. Toutes ſes ſources des ſecours humains taries, laiſſent les malades dans un trouble & un abandonnement plus cruels que la mort même.
On voit les habitans d’une même ville s’éviter & ſe fuir ; chacun craint de recevoir quelque impreſſion mortelle de ceux à qui il donne la même crainte : tout le monde s’enferme & ſe reſſerre, tout devient ſuſpect & dangereux ; les alimens les plus neceſſaires ne ſont pris qu’avec les précautions les plus gênantes ; & le métail le moins ſuſceptible d’impreſſion, n’eſt reçû qu’avec les ménagemens les plus ſcrupuleux. Chaque particulier ſemble former une ſocieté à part, & voudroit pouvoir ſe reſerver juſqu’à l’air qu’il reſpire.
Cette peine d’une attention continuelle à ſe garantir d’un mal, qui ne reſpecte ni âge, ni ſexe, ni condition, deviendroit plus douce, par le plaiſir qu’on auroit de ſe conſerver, ſi on ne tenoit qu’à ſoi-même, & ſi les allarmes continuelles où l’on eſt pour des amis qu’on eſtime, ou pour des parens que l’on aime, ne troubloit la douceur de ce plaiſir. Tous les jours on apprend la chûte de quelqu’un de ceux pour qui on s’intereſſe ; & le chagrin qu’on a de les ſçavoir malades, devient bientôt plus amer & plus cuiſant par la nouvelle de leur mort. Triſte ſituation, où l’on ne peut ſauver ſa vie que par des ſoins infinis, qui ne délivrent pas de la crainte de la perdre à tout moment, ni du cruel chagrin de voir perir ceux que l’on aime.
Chacun attentif à ſa propre conſervation, ſe croit diſpenſé de donner aux autres les ſecours qu’il lui doit naturellement, & la charité la plus vive amortie par la vûë du peril ſe refuſe aux pieux mouvemens qui la preſſent. Une fille malade craint de conſerver ſa vie aux dépens de celle de ſa mere empreſſée à la ſecourir ; & le pere allarmé pour la ſanté de ſes enfans autant que de ſon mal, refuſe les devoirs que la nature lui donne droit d’en exiger. L’opulence, qui dans tout autre tems nous fournit les commodités de la vie, ne ſuffit pas en celui-ci, pour nous procurer les ſecours les plus communs & les plus ordinaires ; ſouvent le riche comme le pauvre manque de tout, au milieu de ſon abondance, & inſpirant l’un & l’autre la même crainte à ceux qui pourroient les ſecourir, ils languiſſent tous deux dans le même abandonnement & dans la même miſere.
A tous ces deſordres, ajoûtons le ſpectacle affreux d’une ville, où l’on ne voit dans les ruës que des gens qui tombent, frapés de mort ſubite, des malades qui traînent une vie languiſſante, prêts à la quitter au premier coin, où les forces les abandonnent, des phrenetiques échapés de leurs lits, qui répandent par tout les traits inviſibles d’une maladie mortelle, des cadavres entaſſés les uns ſur les autres, ſouvent à demi pourris & corrompus, des corps morts traînés ou portez en terre par ceux même que la tendreſſe naturelle ſemble diſpenſer de ce triſte devoir, où toutes les maiſons retentiſſent des pleurs & des gemiſſemens qu’excitent la mort des parens & celle des voiſins ; où ceux qui reſtent en ſanté portent le trouble & la frayeur peinte ſur le viſage, & craignent à tout moment d’éprouver le triſte ſort qu’ils voient ſubir aux autres.
Tant de malheurs qui ſuivent la contagion, devroient la faire regarder plûtôt comme un fleau du Ciel, que comme l’effet d’une revolution naturelle. Ce fût la ſixiéme playe, dont Dieu frapa l’Egypte, pour punir l’endurciſſement de Pharaon. C’eſt ainſi qu’il punit la vanité de David, lorſque, par un mouvement d’orgueil, il voulut faire le dénombrement de ſes ſujets. C’eſt la derniere menace qu’il fait aux peuples contempteurs de ſa Loi. “ Que ſi après cela, (leur dit-il dans le Levitique[1]) vous ne voulez point encore vous corriger ; & ſi vous continuez à marcher contre moi, je marcherai auſſi moi-même contre vous, & je vous fraperai ſept fois davantage à cauſe de vos péchés, & j’envoyerai la peſte au milieu de vous. Et dans un autre endroit[2], juſques à quand ce peuple m’outragera-t’il par ſes paroles ? Je les fraperai donc de peſte, & je les exterminerai. Dans la ſuite il a fait éclater de tems en tems ſa colere ſur les hommes, par ce ſevere châtiment ; mais nous pouvons dire, qu’il n’en a jamais donné d’exemple ſi terrible que celui que nous venons de voir dans la peſte qui a deſolé la ville de Marſeille en 1720.
En effet, quelqu’affreuſe que ſoit la peinture que je viens de faire des malheurs de la contagion, elle n’eſt qu’un foible crayon de ceux qui ont affligé cette ville ; quelque horreur que j’aie de m’en rapeller le ſouvenir, j’oſe pourtant les expoſer ici par un recit, qui ſera d’autant plus fidéle, que j’en ai été des plus maltraités, & que je puis dire des malheurs de Marſeille, comme autrefois Enée de ceux de Troye, & quorum pars magna fui.
C’eſt ici la vingtiéme peſte, & la plus cruelle de toutes celles qui ont deſolé Marſeille, & dont les Hiſtoriens font mention, nous allons les rappeller ici en peu de mots.
La premiere, & la plus ancienne arriva quarante neuf ans avant Jeſus-Chriſt ; c’eſt Ceſar qui en parle[3], & qui dit que les Marſeillois étoient affligés de la peſte, lorſqu’ils ſe rendirent aux Romains ; faiſant voir par là, que c’étoit moins la foibleſſe & le défaut de courage, que les extrêmités de la maladie, qui les obligerent à ſe rendre à ces vainqueurs du monde. L’auteur des antiquités de Marſeille ajoûte, qu’ils n’étoient pas moins preſſés par la famine que par la peſte.
La ſeconde eſt celle de l’an 503. dont Aymonius parle en ces termes[4]. En ce tems-là, il arriva une grande mortalité à Marſeille, & dans les autres villes de la Provence, par une maladie, qui faiſoit ſortir aux hommes des glandes de la groſſeur d’une noix aux aînes & aux parties les plus délicates. Voilà déja un des caracteres de la maladie fort ancien.
Gregoire de Tours fait mention de la troiſiéme en 588[5]. Il dit que cette peſte fût apportée à Marſeille par un navire qui venoit d’Eſpagne chargé de diverſes marchandiſes, qui furent achetées par les habitans, que la premiere maiſon attaquée reſta entierement vuide, par la mort de huit perſonnes, que le mal ne ſe répandit pas d’abord dans toutes les maiſons, mais qu’après avoir ſuſpendu quelque tems ſa fureur, il ſe répandit d’abord avec la même impetuoſité qu’une incendie, qui prend à des moiſſons meures, & prêtes à tomber ſous la fauls, qu’il fit tant de ravages, que les moiſſons ſécherent ſur la terre, faute de moiſſonneurs, & les raiſins ſur les vignes juſques dans l’hyver, ne ſe trouvant perſonne pour les cueillir. Il ajoûte que cette peſte, après avoir ceſſé deux mois, recommença comme auparavant, & que le peuple qui étoit revenu de la campagne avec tant de confiance, perit par cette eſpece de rechûte. Voilà bien de traits de reſſemblance avec celle d’aujourd’hui, Dieu veüille nous garantir du dernier.
Le même Auteur[6] parle de la quatriéme en 591. & dit que Marſeille [7] fût déſolée par la peſte, en même tems que l’Anjou, le Maine, & le pays Nantois furent affligé de la famine.
La cinquiéme eſt marquée dans la Chronique de ſaint Victor, inſerée dans la Biblioteque du P. l’Abbé. Elle porte qu’en 1347. il y eut à Marſeille une mortalité generale, qui ne laiſſa que la troiſiéme partie des Habitans ; que cette contagion ravagea toute la terre, & qu’elle dura trois années. Pluſieurs Autheurs ont parlé de cette peſte. Piſſon[8] dans les annales de l’Egliſe d’Aix, dit qu’on l’appelloit l’année de la grande mortalité, que les villes & villages reſterent ſans habitans ; & Petrarque[9] ajoûte qu’elle dépeupla preſque le monde entier ; peut-être parce qu’elle enleva la belle Laure. Genebrard dit que ce furent les Juifs qui apporterent cette peſte des Indes ; & Piſſon ajoûte que ce fût pour ſe venger de quelque reglement, qui fût fait contre eux dans un Concile National tenu à Avignon en 1337.
L’hiſtoire de Marſeille[10] nous apprend toutes les autres, qui ſe ſuivirent d’aſſez près. En celle de 1476. les Conſuls reſterent dans la ville, & s’acquitterent bien de leur devoir. Mais ceux qui ſe trouverent en place huit ans après que la peſte revint en 1484. abandonnerent la ville, & cederent le gouvernement à d’autres perſonnes qu’ils mirent à leur place. Vingt ans après, Marſeille fût encore attaquée de peſte en 1505. & elle y reprit les deux années ſuivantes en 1506. & 1507. La ſeconde des trois commença au mois de Mars, & dura juſqu’à la Noël ; & après avoir calmé quelque mois, elle ſe ralluma de nouveau, & fit beaucoup de ravage dans toute la Provence.
La peſte deſola encore Marſeille en 1527. & trois ans après parut la douziéme en 1530. dans laquelle l’Hiſtorien dit que tous les habitans quitterent la ville, & que Charles de Monteaux premier Conſul, étant alors à la Cour pour les affaires publiques ; les collegues abandonnerent la ville, & mirent trois Proconſuls à leur place. Ceux d’aujourd’hui ont montré plus de zele & plus de courage.
Le même Autheur releve l’économie & la bonne conduite qui furent gardées en celle de 1547. Il dit que l’on n’y dépenſa que deux mille ſix cens écus, & qu’elle ne fit perir que huit mille perſonnes.
Celles de 1556. & 1557. ne firent pas de grands progrés. La rigueur du froid amortit d’abord le feu de la contagion.
Il n’en fût pas de même de celle qui les ſuivit en 1580. La peſte jointe à la famine fit perir plus de trente mille perſonnes. Le Viguier & le premier Conſul s’enfuirent ; les autres ſe ſacrifierent pour leur Patrie, & augmenterent, par une mort glorieuſe la honte de ceux qui auroient dû les animer par leur exemple. Quoique cette peſte eût été fort vive, elle ſe ralluma le 26. de Mars de l’année ſuivante, qui ſe trouvoit le jour de Pâques, avec tant de fureur, qu’elle ne laiſſa que deux ou trois mille perſonnes. Dans le mois de May que le mal étoit dans ſa vigueur, & que l’on menoit aux infirmeries pluſieurs bâteaux par jour chargés de malades, Pierre Bouquier du Martigues, Capitaine de la Tour du bouc fût nommé, par le Roy, Viguier de la ville ; & il vint ſe mettre à la tête des Conſuls, malgré la fureur du mal. Les galeres d’Eſpagne, qui parurent alors aux environs du Château d’If, augmenterent le trouble & l’épouvante de la ville : mais ce ſage Commandant fit armer ſur le champ ſix mille Païſans, qui vinrent garder les portes de la ville, où l’on n’eût plus d’autre ennemi à craindre que la maladie.
Bien loin de s’aguerrir à ce mal, à meſure qu’il revenoit plus ſouvent, le peuple de Marſeille en étoit toûjours plus effrayé : car ayant reparu le 13. Novembre 1586. dans trois jours la ville fût entierement deſerte : ſoit donc la rareté des habitans, ſoit la rigueur du froid, elle ne fit pas de grands deſordres, mais elle recommença au mois de Mars de l’année ſuivante 1587. Les habitans ſortirent encore de la ville, & elle ceſſa entierement dans le mois de May.
En l’année 1618. l’armée du Marquis d’Uxelles infecta la ville de Lion, & de-là le mal ſe repandit bientôt en Languedoc, en Dauphiné, & en Provence, où la ville de Digne fût la premiere attaquée ; enſuite Aix, & après Marſeille : elle y fût portée par de balles de laine, & ſe declara le 22. Février 1630. La diviſion qui regnoit alors dans la ville fit manquer bien de précautions, qui auroient empêché les approches du mal : mais par la ſageſſe de Leon de Valbelle Seigneur de la Tour, premier Conſul, & de Nicolas de Gratian ſecond Conſul, le bon ordre y fût ſi bien retabli, que l’on n’y vit aucun de ces deſordres publics, qui ſont les ſuites ordinaires de la contagion, quand on ne les prévient pas par une bonne police. Nous renvoyons ſur tout cela à l’Hiſtorien de Marſeille, nous contentant de remarquer que la conduite de ces Conſuls étoit un beau modèle à imiter. Mr. Gaſſendy[11] fait mention de cette peſte dans la vie de Mr. de Peireſc.
Enfin la dix-neuviéme peſte, eſt celle de 1649. qui commença comme celle-ci, au mois de Juin ; & ayant d’abord calmé, elle recommença violemment au mois d’Août, & dura juſqu’au mois de Fevrier de l’année ſuivante. On voit par toutes ces peſtes, que la maladie a été toûjours la même dans tous les tems, même nature de mal, même caractere, mêmes ſymptomes ; elle ne ſe dément point ; & ſi on remonte plus haut juſques aux anciennes peſtes qui ont précedé celles de Marſeille, on reconnoîtra que c’eſt par tout la même maladie, ſi on lit ſur tout la deſcription de celle d’Athenes, que Theucydide nous a laiſſée, combien de traits de reſſemblance n’y trouvera-t’on pas avec celle que nous allons décrire, qui eſt la vingtiéme de celles qui ont affligé Marſeille, & qui paroît avoir été la plus violente de toutes, puiſqu’elle a réuni ſur nous les malheurs de toutes les autres. Après leſquels il ne nous reſte plus qu’à prier le Seigneur qu’il nous garantiſſe de celui qui arriva en la derniere de 1649. qui trois mois après qu’elle eût fini, recommença avec la même violence, & dura encore deux mois. L’Autheur du Capucin charitable, dit que cette rechûte vint de l’ouverture d’une maiſon qui n’avoit pas été deſinfectée. Nous devons eſperer que les bons ordres donnés, par le ſage Commandant qui nous gouverne, préviendront ce dernier malheur.