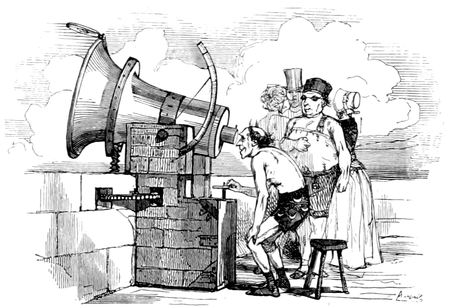Le Monde tel qu’il sera (1846)/Deuxième journée

§ XIII.

Lorsque les doux époux descendirent le lendemain, ils trouvèrent leur hôte avec un de ses parents, le docteur Minimum, qui avait appris l’indisposition de milady Atout, et venait pour s’informer officieusement de sa santé.
Le docteur Minimum était le plus illustre représentant du nouveau système médical, qui consistait à vous donner la maladie que vous n’aviez point encore, et à l’élever en serre chaude pour en hâter le développement. De cette manière, le patient mourait, en général, dès le second ou le troisième jour, ce qui était pour lui une évidente économie de temps.
Quant au médecin, il ne devait se proposer qu’un but, augmenter le mal pour le guérir plus sûrement. Aviez-vous, par exemple, un rhume ? on le transformait en pleurésie : une migraine ? on en faisait une fièvre cérébrale : un étourdissement ? on le poussait à l’apoplexie.
Au moment où les deux époux entrèrent, M. Minimum racontait à son cousin les merveilleux résultats obtenus par cette méthode et le pressait de visiter l’hôpital où il venait d’en faire l’application. M. Atout s’excusa, mais Maurice accepta à sa place, et, après avoir donné rendez-vous à son hôte, chez M. de l’Empyrée, qui les attendait vers le milieu du jour, il monta avec Marthe dans la voiture du médecin.
Celui-ci les conduisit au grand hôpital de Sans-Pair, bâti à l’extrémité du faubourg.
Ils aperçurent, d’abord, d’élégantes galeries entourées de gazons et de bosquets ; c’étaient les salles destinées aux médecins ; puis un édifice somptueux, s’élevant au milieu des fleurs, c’était la maison des sœurs hospitalières ; puis un palais, devant lequel s’étendaient des jardins décorés de grottes, de jets d’eau et d’ombrages ; c’était le logis du directeur.
— La ville a dépensé 20 millions, dit le docteur Minimum, pour faire, de son grand hôpital, un établissement modèle. Médecins, surveillants, administrateurs, sont ici logés et nourris aux frais de la république. Des équipages, toujours attelés, attendent leurs ordres, et leurs filles reçoivent une dot sur la caisse des frais de bureau.
— Mais les malades ? demanda Maurice.
— Ah ! les malades sont là-bas, dit le docteur, en montrant un sombre édifice caché au fond de longues cours, sans air et sans verdure. La vue de leurs salles est triste, elle eût déparé l’ensemble de l’établissement ; on les a cachées derrière, de manière à ne laisser voir que ce qui constitue véritablement l’hôpital, c’est-à-dire, l’habitation des directeurs. Malheureusement le terrain a manqué. Après avoir pris le jardin des médecins, le parterre des religieuses, le parc de l’économe, il n’est resté qu’une petite cour pour les convalescents ; mais comme la plupart des malades succombent, on peut, à la rigueur, se passer de promenade.
— Vous ne les recevez donc qu’au moment de l’agonie ? dit Marthe.
— Quand nous ne les recevons pas après, répliqua Minimum. Quiconque veut être reçu à l’hôpital, doit d’abord se transporter au bureau d’examen, situé à l’autre bout de Sans-Pair, attendre son tour, obtenir un certificat, puis faire huit lieues pour se mettre au lit. Grâce à ces excellentes précautions, nous sommes sûrs de ne jamais admettre de gens bien portants ; seulement, les malades peuvent nous arriver morts : c’est un léger inconvénient du bon ordre établi parmi les administrateurs. Du reste, rien n’a été négligé par eux, pour que le grand hôpital de Sans-Pair puisse servir aux progrès de la science. Nous avons toujours une salle d’essai où l’on expérimente les nouvelles doctrines. Si le malade guérit, le traitement est adopté ; s’il succombe, c’est tant pis pour le système. Il y a, en outre, un laboratoire pour étudier combien il peut entrer de parties, ayant un nom, dans chaque substance ; un chenil, où l’on élève des chiens destinés à être empoisonnés et dépecés dans l’intérêt de l’humanité ; des amphithéâtres, toujours riches en cadavres de choix, et une magnifique collection de squelettes sous verre. Il nous manque bien encore plusieurs choses ; la galerie des monstres n’est pas complète ; nous aurions besoin de renouveler nos bocaux de fœtus, et l’on demande, depuis longtemps, des échantillons des différentes races humaines proprement empaillés ; mais notre économe espère arriver à toutes ces améliorations par les bonis.
Maurice demanda ce que c’était.
— On nomme ainsi, reprit le médecin, les économies réalisées aux dépens des malades. Que le potage soit moins gras, boni ; le pain moins blanc, encore boni ; le vin tempéré d’eau, toujours boni ! C’est une méthode perfectionnée pour faire danser l’anse d’un panier qui renferme dix mille portions. C’est ainsi que les établissements s’enrichissent, et que les économes acquièrent des droits à la reconnaissance et aux gratifications. On peut donc dire, en principe, qu’un hôpital bien administré est celui où les malades sont assez mal pour que la caisse s’en trouve bien.
Tout en parlant, le docteur était arrivé à la première salle.
Le parquet en était soigneusement ciré, les lits élégants, les murs tapissés de nattes coloriées, et les fenêtres garnies de rideaux de soie ; mais ce luxe était déparé par l’aspect des appareils opératoires, de toute dimension, qui dressaient, çà et là, leurs bras d’acier. Quant aux soins, ils n’étaient ni plus tendres, ni plus délicats qu’autrefois. Les médecins examinaient toujours publiquement les malades, en découvrant chaque plaie aux yeux des élèves ; ils décrivaient froidement leurs souffrances, expliquaient, tout haut, les chances heureuses ou fatales. Le râle de l’agonisant épouvantait le malheureux livré à la crise qui devait décider de sa vie ; l’aspect du mort, recouvert par le drap funèbre, glaçait le sourire du convalescent qui se sentait renaître !
Marthe, le cœur serré, tourna vers Maurice ses yeux humides.
— Ah ! ce n’est point là ce que j’espérais, dit-elle à demi-voix ; ceci est toujours, comme de notre temps, l’infirmerie du pauvre et de l’abandonné ! Le parquet peut être plus brillant, le mur moins nu, la fenêtre plus richement ornée ; mais qu’a-t-on fait pour ceux qui souffrent ? ne sont-ils point restés confondus comme un bétail, livrés aux tentatives et aux curiosités de la science, épouvantés par la vue de ces instruments de torture ? Ah ! ce que j’espérais d’une civilisation plus éclairée, c’est que l’hôpital eût perdu son caractère de dureté ; c’est que le malade eut cessé d’être une chose à réparer gratuitement pour devenir un être souffrant dont on eût ménagé les sensations, respecté les effrois, soutenu le cœur ; c’est qu’il eût retrouvé, enfin, dans cette demeure commune, quelques-uns des soins de la famille. À quoi bon tant d’or prodigué pour les choses, si rien, hélas ! n’est changé pour les êtres ? Donnez, à chacun de ces malheureux, un coin qui soit à lui, et où les cris du mourant ne viennent point l’épouvanter ; ne traitez point son corps endolori, comme une propriété qu’il a dû vous abandonner en franchissant le seuil ; ne lui faites point sentir que ce lit est une aumône ; qu’il est à votre discrétion, non-seulement par le mal, mais par la misère. Puisqu’il souffre, c’est lui qui est le roi, vous le serviteur. N’avez-vous donc jamais senti un redoublement de tendresse pour le membre de la famille que la douleur atteint ? Comme sa volonté vous devient sainte, comme on lui pardonne tout : comme on donnerait avec joie une part de sa santé et de ses jours pour le guérir ! Eh bien, le pauvre et le délaissé ne sont-ils point des membres de la grande famille ? Les plus mauvaises mères reprennent quelque amour pour l’enfant malade, pourquoi la société aurait-elle moins de cœur pour ses fils ?
— Parfaitement dit, s’écria le docteur Minimum, qui avait entendu les derniers mots prononcés par Marthe ; j’ai toujours soutenu que l’on ne devait point économiser sur le service des hôpitaux, et que nos appointements devraient être doublés. Mais on méconnaît les véritables besoins. Toutes les ressources de la république sont dévorées par les femmes et par les avocats. Heureusement que l’on a pour consolation le sentiment du devoir accompli… et sa clientèle. La mienne grandit chaque jour, grâce aux succès qu’obtient ici mon traitement. Je lui ai donné le nom de méthode par les infiniment petits, parce que je ne procède que par les atomes ; atomes de tilleul, atomes de fleur d’oranger, atomes de sucre candi. Moins il y en a, plus l’effet est certain. Je prends une molécule d’un corps, quelque chose d’impalpable, d’insapide, d’invisible ; le millième d’un rien ! je le jette dans trente litres d’eau, je mêle, je décante et je fais prendre la lotion par cuillerées. Toute maladie qui résiste à cette médication est positivement incurable, et la mort du sujet ne peut être imputée qu’à son organisation.
Après avoir traversé une partie des salles, les visiteurs ressortirent par l’autre extrémité du grand hôpital, et se trouvèrent en face d’un second édifice destiné aux aliénés. Sur la prière de ses deux compagnons, le docteur Minimum fit demander son confrère Manomane, qui y remplissait les fonctions de premier médecin.
Celui-ci arriva, l’air effaré, examina Marthe et Maurice, et s’écria :
— Je comprends, je comprends… regards attentifs… contraction des sourciliers… physionomie étonnée !… Il doit y avoir absorption des facultés générales au profit d’une préoccupation partielle. L’espèce est depuis longtemps classée et peut se guérir.
— Dieu me pardonne, il vous prend pour des pensionnaires, interrompit Minimum ; veuillez lui déclarer vous-mêmes que vous ne venez point ici en malades, mais en curieux.
— Ah ! c’est une visite, reprit Manomane, qui examina les deux ressuscités d’un œil scrutateur ; une visite de curiosité !… encore un symptôme !…
Et se penchant vers son confrère :
— Méfiez-vous d’eux, ajouta-t-il plus bas… Cette apparence calme… ce sourire… nous connaissons cela ; méfiez-vous.
Et comme Minimum éclatait de rire, il le regarda lui-même plus attentivement et murmura :
— Incapacité de suivre un raisonnement… crédulité aveugle… troisième espèce observée par le docteur Insanus et déclarée incurable !…
Puis, passant devant le médecin et ses deux compagnons, il les invita brusquement à le suivre.
Le contact perpétuel de ses malades était insensiblement devenu contagieux pour le docteur Manomane. Il prétendait que la société avait enfermé certains fous pour faire croire au bon sens de ceux qu’elle laissait libres, mais qu’en réalité le monde ne se trouvait peuplé que d’aliénés à différents degrés. Les plus sages étaient au moins des candidats à la folie. Il développa ses principes à cet égard en énumérant tous les signes auxquels on reconnaissait l’aberration. Pensez-vous à une chose plus souvent qu’à toute autre ? folie ! Préférez-vous quelqu’un à vous-même ? plus grande folie ! Vous réjouissez-vous d’une espérance incertaine ? comble de la folie !…
Manomane compta ainsi, sous forme de litanie, six cent trente-trois variétés différentes des maladies mentales, comprenant tous les élans de la pensée et tous les mouvements du cœur. Il montrait en même temps à ses trois compagnons des exemples de ces différentes aliénations, classées par ordre comme les familles de plantes d’un herbier.
Dans cette espèce d’exhibition, Maurice s’arrêta devant un homme à l’air calme et souriant.
— Celui-ci, dit le docteur, a été un de nos plus riches commerçants. Malheureusement, tout le monde le croyait dans la plénitude de sa raison, lorsqu’un ancien associé ruiné par son père lui intenta un procès en restitution. Les juges décidèrent en faveur de notre millionnaire ; mais lui-même, éclairé par les débats, refusa les bénéfices de l’arrêt et voulut se dépouiller en faveur de son adversaire. Il a fallu, pour empêcher la restitution, le faire interdire et l’enfermer.
Quant au vieillard qui écrit là-bas, nous ne le connaissons que sous le nom de Père des hommes. Il travaille depuis cinquante ans à un système social d’après lequel chacun serait, ici-bas, rétribué selon ses œuvres. Il prétend que Dieu a donné à toutes les créatures humaines un droit égal au bonheur, et que dans une société chrétienne la misère ne devrait pas être le résultat du hasard, mais la punition du vice. Chaque soir et chaque matin il se met à genoux et répète les mains jointes cette seule prière :
« Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre règne nous arrive, et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
L’autorité a jugé une pareille folie dangereuse et me l’a envoyé.
Ils étaient arrivés devant un jeune homme à physionomie pensive et hardie.
— Vous voyez, dit Manomane, un voyageur sans but. Tandis que d’autres parcourent les pays civilisés dans l’intérêt de leurs recherches ou de leur industrie, lui n’aspire qu’aux routes perdues, aux régions ignorées ! Trois fois il s’est enfoncé dans les immenses régions du vieux continent sans autre motif que de visiter des peuples en décadence, de traverser des fleuves oubliés, de dormir sur des ruines sans nom ! Demandez-lui ce qu’il voulait, il vous répondra : Voir ! Vous l’interrogeriez en vain sur la statistique naturelle ou la base géologique des pays qu’il a parcourus ; le malheureux n’a recueilli dans ses voyages, ni le plus petit fragment de roche, ni le moindre scarabée ; il n’en a rapporté que des jugements et des impressions. Aussi, dès son retour, sa famille l’a-t-elle fait enfermer. Et nous le traitons depuis trois mois par les douches et les saignées.
Vous pouvez, du reste, l’entretenir ; il n’est point méchant, et il communique volontiers ses observations.
Maurice profita de la permission pour s’approcher de Pérégrinus et l’interroger sur ce qu’il avait vu. Le jeune voyageur, qui avait parcouru en détail les vieux continents, lui fit une esquisse rapide de l’état du monde en l’an trois mille. Il lui apprit que l’Afrique, initiée au progrès, avait enfin adopté les habitudes civilisées. Le gouvernement constitutionnel venait d’être établi en Guinée ; le roi de Congo préparait une constitution à ses peuples ; les Hottentots avaient formé la république du Capricorne, et l’Afrique centrale était dirigée par un président électif. Pérégrinus vanta surtout à Maurice l’école polytechnique de Tambouctou et le conservatoire de musique du grand désert. Quant à la Sénégambie, elle n’était célèbre que par son commerce de préparations médicales, et fournissait des droguistes au monde entier.
L’Asie, au contraire, était retombée dans une torpeur chaque jour plus profonde ; Pérégrinus l’avait parcourue dans toutes les directions sans pouvoir y retrouver aucune trace de son antique splendeur. L’Indoustan était habité par un peuple de bateleurs qui ne connaissait d’autre industrie que d’avaler des épées et de faire danser des serpents sur la queue ; la Perse se trouvait partagée entre deux sectes, qui s’égorgeaient pour savoir si l’on était plus agréable à Dieu en se fourrant une graine de tamarin dans la narine gauche ou dans la narine droite ; l’empire chinois, endormi par l’opium, n’offrait plus qu’un peuple de somnambules abrutis.
Restait l’Europe, dont la transformation intéressait principalement Maurice et sa compagne ; Pérégrinus y avait longtemps séjourné, et put leur en parler avec détail.
Là, les changements étaient encore plus profonds, car la vitalité ardente des populations avait dû précipiter leur élan sur la pente choisie par chacune. Ailleurs, les races s’étaient laissé glisser nonchalamment vers le but inévitable ; mais en Europe, chacune avait enfourché sa folie comme un coursier infernal, et l’avait excité de la voix et de l’éperon. À les voir ainsi passionnées à leur perte, et y volant au galop de leurs mauvais instincts, on eût dit ces barbares d’Alaric, qui, frappés de vertige au moment de la défaite, lançaient leurs chars au milieu des vainqueurs, qu’ils croyaient fuir, et volaient à la mort de toute la vitesse de leurs quadriges. Pérégrinus avait vu la Russie avortée dans sa civilisation hâtive ; géant élevé à la brochette par des empereurs de génie, qui avaient en vain espéré en faire une nation. Dépouillée de sa personnalité sans avoir la volonté nécessaire pour s’en créer une autre, ni assez policée, ni assez barbare, elle avait épuisé les efforts de cinquante czars, reflétant toujours les civilisations voisines, et rentrant dans l’obscurité à mesure que leur soleil descendait à l’horizon.
L’Allemagne n’avait guère été plus heureuse. Philosophant entre sa pipe et son verre, elle avait discuté un siècle sur l’étymologie du mot liberté, un siècle sur son essence, un siècle sur son étendue, un siècle sur son résultat ! Arrivée là, ses rois lui avaient donné une constitution qui permettait de tout penser, pourvu qu’on se gardât de le dire ; de tout sentir, à la condition de n’en rien laisser voir, et de tout désirer, à charge de ne rien faire pour l’obtenir. L’Allemagne, ravie, avait allumé sa pipe, rempli son verre, et s’était remise à chanter patriotiquement, en montrant le poing à la France :
Par le fait, celle-ci ne songeait guère à le lui réclamer. À force de gouvernements à bon marché, d’électeurs probes et de tentes enlevées à l’empereur de Maroc, elle en était arrivée à la banqueroute publique, suivie des banqueroutes privées. Ramenée à la féodalité par l’omnipotence des banquiers, successivement chassée de toutes les mers que visitait autrefois son commerce, sans autre encouragement pour son agriculture que les rapports des sociétés scientifiques et les appointements accordés aux directeurs des haras, elle avait pris le parti de se consoler par les vaudevilles et les bals masqués. Le peuple français, personnifié par les types de feu Chicard et de défunte Pomaré, exécutait, au milieu de ses plaines en friche, de ses ports déserts et de ses villes en ruines, une polka défendue par le préfet de police.
Une portion de sa gloire avait pourtant survécu à la nation la plus spirituelle, elle fournissait toujours le monde de modistes et de cuisiniers.La Belgique, devenue contrefactrice des publications imprimées dans les cinq parties du monde, avait fini par manquer de places pour emmagasiner ses in-18 et ses in-32. Il avait fallu s’en servir comme de moellons pour construire les villes, uniquement habitées par des papetiers, des compositeurs, des brocheurs et des satineurs, chacun vivant ainsi comme le rat dans son fromage ; mais une étincelle avait un jour enflammé ces montagnes de papier imprimé, et la Belgique avait été dévorée avec son petit peuple. Lorsque Pérégrinus y passa, on en cherchait les restes dans la cendre.
À la même époque, la Suisse venait d’être achetée par une compagnie, qui l’avait enfermée d’une muraille renouvelée des fortifications de Paris, et qui exploitait ses paysages, ses cascades et ses glaciers. Un bureau de péage était établi devant chaque beauté naturelle, et l’on ne pouvait admirer la chute du Rhin qu’en prenant un billet et en déposant son parapluie. Ce parc gigantesque avait douze portes monumentales, sur le fronton desquelles la compagnie avait fait graver l’antique axiome : point d’argent, point de suisse !
L’Italie était également devenue une propriété particulière, mais interdite au public. Les États du pape avaient été achetés par un banquier juif, qui s’était ensuite arrondi en expropriant le roi de Naples, l’empereur d’Autriche et le duc de Toscane. Il avait fait relever les monuments publics, revernir les tableaux et restaurer les statues, mais le peuple était resté nu et affamé.
Pour la Turquie, c’était autre chose ! Longtemps tiraillée par toutes les puissances de l’Europe, comme un vieil habit de pourpre dont chacun veut un morceau, elle était demeurée les jambes croisées et laissant faire. À chaque province enlevée, elle répétait : Dieu est grand ! et prenait un sorbet. Jusqu’au jour où les corbeaux qui la mangeaient par lambeaux se retournèrent l’un contre l’autre et se mirent à se battre pour savoir qui aurait la meilleure part. Après une guerre dans laquelle périrent deux ou trois millions d’hommes, tout le monde finit par accepter ce que tout le monde avait refusé. On convint de partager la proie à l’amiable ; mais quand chacun vint pour prendre possession du lot qui devait lui appartenir, on ne trouva plus rien.Tandis que l’on se disputait à qui l’aurait, la nation turque s’était laissée mourir tout doucement, et là où ses envahisseurs espéraient un morceau de peuple, ils ne trouvèrent que des plaines désertes, dans lesquelles dormaient quelques vieux dromadaires ennuyés.
L’Angleterre songeait pourtant à tirer parti de ces derniers, ne fût-ce qu’en les tuant pour vendre leurs peaux, lorsqu’une révolution arrêta subitement le cours de ses usurpations triomphantes. Jusqu’alors une aristocratie chaudement vêtue de laine fine, nourrie de rosbif et de xérès, et également instruite dans la science du gouvernement et du boxing, avait tenu sous ses pieds la foule en haillons, atrophiée par l’air des fabriques, les pommes de terre et le gin. Elle avait laissé les dernières lueurs d’en haut s’éteindre dans ces âmes. Quand on l’avait avertie que celles-là aussi étaient les filles de Dieu, qu’il fallait leur faire place au soleil des hommes et non les rejeter au rang des brutes, elle avait dit :
— À quoi bon ? la brute travaille avec plus de patience !
Mais un jour cette patience s’était lassée, la douleur avait tenu lieu de courage, la brute s’était changée en bête féroce, et, se jetant contre ses maîtres, les avait égorgés.
Cette première violence accomplie, la colère des misérables avait passé sur l’Angleterre comme une trombe. Que pouvaient-ils conserver, eux qui n’avaient jamais rien possédé ! la propriété était leur ennemie. Pendant vingt siècles ils lui avaient obéi. Hommes, ils avaient été les esclaves des choses ; les choses furent brisées, anéanties ! tout périt dans cette première furie de destruction.
Palais cimentés avec leurs sueurs, fabriques où ils languissaient prisonniers, machines dont les mains d’acier leur avaient arraché, bouchée à bouchée, le pain de la famille, vaisseaux où les embarquait la violence et où les retenait la peur, ports, villes, arsenaux, monuments d’une gloire toujours payée avec leurs larmes ou avec leur sang ! oh ! que de cris de joie sur ces monceaux de débris et de cendre. Ces richesses, cette puissance, cette gloire, c’étaient autant d’anneaux de leur chaîne brisés par la vengeance. Avaient-ils donc un drapeau, eux qui n’avaient pas de droits ? étaient-ils un peuple, eux qui n’étaient pas des hommes ? Ils effaçaient le passé, parce qu’il ne leur rappelait que des souvenirs d’humiliations et de souffrances ; et, quand tout fut à terre, ils dansèrent autour des ruines, comme le sauvage délivré autour du poteau où il a subi ses longues tortures.
Mais à la place de cet édifice détruit, leurs mains inhabiles ne pouvaient rien élever ; les rois de l’Angleterre, en tombant, avaient laissé briser sa couronne ; le vainqueur grossier ne chercha même point à en réunir les débris. Il laissa croître la ronce sur la route déserte ; les glaïeuls sur les canaux infréquentés ; les houx et les aubépines dans les sillons, devenus stériles ; la révolution n’avait point été une réforme, mais seulement une délivrance ; après avoir brisé son licou, la bête de somme était retournée aux forêts. Lorsque Pérégrinus vit les trois royaumes, cette transformation était déjà accomplie. À la place de la race énergique, tenace et hautaine dont le génie avait enchaîné les deux continents dans le sillage de ses vaisseaux, il n’avait plus trouvé qu’un peuple sauvage, vivant de piraterie, toujours en guerre, et mangeant ses prisonniers à défaut du rosbif de la vieille Angleterre… Quelques faibles restes de l’aristocratie proscrite se cachaient encore dans les montagnes, toujours poursuivis par les descendants de John Bull, qui, à défaut de chamois, chassaient aux lords !
L’Espagne avait également passé par cette période de guerre d’affût, mais, grâce à la perfection apportée dans ce genre d’exercice, les partis s’étaient vite décimés et détruits. La mesta avait achevé l’œuvre commencée. À mesure que le nombre des Espagnols diminuait, celui des bêtes à laine allait croissant ; et leurs immenses troupeaux, continuant à brouter les baies, les moissons, les prairies, avaient fini par faire du royaume un grand espace tondu où la nation ne se trouvait plus représentée que par des moutons.
Pendant que Maurice écoutait ces récits, Manomane avait continué sa visite avec Marthe, et tous deux étaient arrivés près d’une jeune femme assise sous un bosquet de cotonniers, dont les flocons soyeux flottaient au vent comme des fleurs épanouies. Vêtue d’un pagne aux couleurs effacées. et le buste à demi enveloppé par une écharpe bleu de ciel, elle se tenait penchée, effeuillant, d’une main distraite, une fleur cueillie à ses pieds. Une branche arrachée aux haies vives, et chargée de ses graines sauvages, était enroulée à ses cheveux noirs.
En entendant un bruit de pas, elle redressa vivement la tête, rougit à la vue des étrangers, et serra l’écharpe contre ses épaules.
Mais ses yeux, qui s’étaient d’abord baissés, se relevèrent presque aussitôt sur Marthe avec une tendresse timide.
La jeune femme, prise d’une subite sympathie, s’arrêta : il y eut, dans leurs deux regards, qui se parlaient en souriant, un de ces rapides échanges d’émotions qui tiennent lieu d’un long épanchement ; puis, par un mouvement qu’on eût dit involontaire, la jeune fille se leva avec une exclamation confuse, et tendit les mains vers Marthe.
— Sur mon âme, notre belle rêveuse vous fait des avances ! dit Manomane avec une brusquerie un peu adoucie.
— Ah !… il m’a semblé… oui… ses traits m’ont rappelé ma mère ! balbutia la jeune fille, dont les yeux étaient devenus humides.
Marthe prit ses mains, qu’elle serra dans les siennes.
— C’est une distinction rare venant de miss Rêveuse, reprit le médecin avec un sourire ; d’habitude, elle fuit à l’approche des visiteurs.
— Pourquoi leur donnerais-je le triste spectacle de ma folie ? dit la jeune fille doucement, les méchants la raillent, et les bons s’en affligent !
— Mais moi ? demanda Marthe en se penchant vers elle.
— Vous, dit miss Rêveuse avec un regard d’où jaillissaient des flots de confiance et de tendresse… vous me comprendrez !

— Avez-vous entendu ? murmura Manomane, qui se pencha vers son confrère ; les fous se devinent ! Laissons-les ensemble, et vous verrez.
Les hommes s’éloignèrent en continuant leur examen, tandis que la jeune fille et Marthe commençaient un de ces entretiens où les âmes, devenues subitement confiantes, s’élancent ensemble à travers la fantaisie, comme deux enfants qui se prennent par les mains et courent devant eux dans la campagne.
Rêveuse parla de sa mère, qu’elle avait à peine connue, et elle pleura ; puis elle montra à Marthe les fleurs qu’elle cultivait, et elle poussa des cris de joie de les voir écloses. Elle raconta en soupirant ses tristesses, et en souriant ses joies. Les flots de ce cœur montaient et descendaient pareils à ceux de la mer, tantôt sombres comme un abîme, tantôt étincelants au plein soleil de l’espoir !
Marthe écoutait ravie, suivant tous les mouvements de cet esprit, comme on suit les mouvements de l’enfant qui marche sans but ; elle cherchait en vain la folie et ne trouvait que les caprices d’une imagination flottante et jeune.
Cependant Rêveuse avouait cette folie, elle la sentait ; elle ne pouvait en parler sans qu’on vît les larmes briller sous ses longs cils bruns ; elle croisait les mains sur sa poitrine avec la résignation plaintive des enfants, et tous ses élans d’espérance s’arrêtaient brusquement devant ce cri :
— Je suis folle !
— Folle ? répétait Marthe incrédule ; qui vous l’a dit, d’où le savez-vous, quelle en est la preuve ?
— Hélas ! ma vie entière ! répondait Rêveuse. Jamais mes pensées n’ont été celles des autres ; jamais je n’ai partagé leurs bonheurs ni leurs affections. Toute petite, je préférais la vue de ma mère à tous les plaisirs ; je m’asseyais à ses pieds sans rien dire, assez heureuse de sentir contre mon épaule les plis de sa robe, et sur mon front son regard. Quand elle mourut, je voulus la rejoindre, je ne comprenais rien de la mort, sinon que c’était une séparation, et je ne voulais point vivre séparée de ma mère. Je m’échappai de la maison, je courus au cimetière, j’allai de tombe en tombe, épelant les noms, et quand j’eus trouvé celui que je cherchais, je m’assis là en disant : C’est moi, mère, ne me renvoie pas !
Le jour se passa sans que je sentisse la faim. Je pleurais d’être seule ; puis je cueillais de grandes herbes dont je formais des bouquets pour ma mère. La nuit vint, je fis ma prière, je criai bonsoir à la morte, et je m’endormis sur sa tombe.
Ce fut là que l’on me trouva le lendemain, et ceux qui me cherchaient durent m’emporter de force, dans leurs bras.
Quand j’arrivai à la maison, je me jetai à genoux en demandant qu’on me rendît ma mère ; je refusais de manger ; je voulais mourir pour qu’on me mît avec elle dans la fosse. Ce fut la première fois que j’entendis dire auprès de moi ;
— Elle est folle.
Le temps adoucit ma douleur sans l’éteindre. Je m’accoutumai à ne plus quitter les endroits que préférait celle que je ne pouvais oublier, à me servir de ce qui lui avait servi, à continuer ses goûts et ses habitudes. On s’était d’abord inquiété de ma persistance d’affection, on finit par la railler. Ces railleries m’y confirmèrent davantage. Seulement, j’évitai d’en parler, de la laisser voir, et je grandis toujours seule avec mon souvenir.
Cette solitude me donna le goût de la lecture ; les livres sont les compagnons consolateurs et fidèles des isolés. J’ouvris mon désert aux créations des vieux romanciers et des vieux poètes ; je pris leurs héros pour amis, je m’attachai à leurs infortunes et à leurs triomphes comme à de vivantes réalités. On me trouvait dans des transports de joie, ou baignée de larmes sans que je pusse en donner d’autre cause que le bonheur de la famille Primerose ou la mort de Marguerite. Je ne vivais plus avec les vivants, mais avec les fantômes. Eux seuls avaient mes admirations, mes amours, ma haine. Je ne savais point quels étaient nos voisins, et je connaissais familièrement Childe Harold, Jocelyn, Faust. Leurs noms venaient sans cesse malgré moi sur mes lèvres, et ceux qui m’entouraient, pris d’une pitié méprisante, répétaient plus haut ;
— Elle est folle.
Mais cette folie, hélas ! devait encore grandir ! À force de fréquenter les charmantes visions des poëtes, j’y pris insensiblement une place : mes désirs s’exaltèrent sous leurs inspirations. Accoutumée à un breuvage enivrant, je repoussai la vie vulgaire comme une boisson sans saveur. Je dressai à l’amour, dans mon cœur, un temple mystérieux où ne pouvaient entrer que les plus nobles et les plus charmantes fantaisies ; je me créai un idéal dont je jurai d’attendre le modèle.
Ma famille m’annonça en vain que l’heure du mariage était venue, que de riches fiancés se présentaient ; le seul fiancé que je voulusse accepter était choisi depuis longtemps ; mais ce n’était qu’une image ! Je ressemblais à ces héros des contes de fées, qui meurent d’amour pour une princesse inconnue, dont ils ont seulement vu le portrait. Je refusai d’abord sans donner de motifs ; puis, comme on passait de la surprise au mécontentement, et du mécontentement aux reproches, je crus tout arrêter en révélant mon espoir. Il n’y eut qu’un seul cri :
— Elle est folle ! elle est folle !
Il fallait bien le croire, car nul ne me comprenait, nul ne sentait comme moi. J’acceptai l’arrêt porté, je me résignai à ne point trouver de place dans un monde fait pour d’autres esprits et d’autres cœurs ; je me dis également à moi-même :
— Tu es folle !
Et je me laissai conduire ici.
— Et vous y restez ? s’écria Marthe, qui pressait les mains de Rêveuse dans les siennes avec une admiration attendrie.
— Jusqu’à ce que le docteur me fasse transporter comme incurable dans l’île des Réprouvés. Mais voici de nouveaux visiteurs. Leur curiosité m’humilie ; je crains leurs questions ; adieu, ne m’oubliez pas.
Elle embrassa tendrement Marthe, et disparut sous les bosquets comme une biche effrayée.
La jeune femme rejoignit ses compagnons, dont Manomane venait de prendre congé, et tous trois s’acheminèrent vers l’Observatoire où les attendait M. Atout.
Ils visitèrent, en passant, le Muséum, où ils aperçurent, parmi les échantillons de races perdues, les animaux domestiques que recommandait seulement leur attachement, et les bêtes fauves qui n’avaient reçu en don que leur beauté. L’utilité bien entendue avait éliminé du règne animal tout ce qui ne produisait pas un bénéfice appréciable et immédiat.
Encore les espèces conservées avaient-elles été perfectionnées par la méthode des croisements, de manière à changer de forme. Ce n’étaient plus des êtres soumis à une loi d’harmonie, mais des choses vivantes modifiées au profit de la boucherie. Les bœufs, destinés à l’engrais, avaient perdu leurs os ; les vaches n’étaient plus que des alambics animés, transformant l’herbe en laitage ; les porcs, des masses de chair qui grossissaient à vue d’œil comme des ballons ! Tout cela était parfait, mais hideux. La création, revue et corrigée, avait cessé d’être un spectacle pour devenir un garde-manger ; Dieu lui-même n’eût pu la reconnaître. La plupart des êtres créés par lui n’existaient d’ailleurs qu’à l’état scientifique ; l’œuvre des sept jours avait été mise en flacon dans de l’esprit-de-vin et confiée à l’art des empailleurs.
Quant au jardin botanique cultivé près du Muséum, on y trouvait la collection complète de toutes les herbes, rangées par familles, avec de beaux écriteaux rouges qui leur donnaient des noms latins de peur qu’on ne pût les reconnaître. Il y avait également des serres où l’on cultivait les plantes des cinq parties du monde pour l’instruction et l’agrément du public, qui n’y entrait jamais. Nos visiteurs rencontrèrent heureusement M. Vertèbre, dont ils avaient fait la connaissance à bord de la Dorade, et qui leur fit ouvrir les portes habituellement fermées. Il leur montra un semis de sapins du Nord sous cloche, des chênes en pots, et une bordure de peupliers de quinze centimètres de hauteur. C’étaient les spécimens des forêts vierges de l’ancien monde ! Mais ils admirèrent, en revanche, des cerises de la grosseur d’un melon, et des ananas qu’il fallait scier au pied comme des arbres de haute futaie.
En quittant les serres, M. Vertèbre les conduisit aux cellules réservées de la ménagerie, où il leur montra des embryons de baleine, qu’il nourrissait, comme des poissons rouges, dans de grands bocaux, de petits phoques élevés par lui au biberon, et des ours blancs, à peine sortis de l’adolescence, qu’il espérait naturaliser dans le pays. Enfin, l’heure les pressant, ils prirent congé de l’honorable professeur de zoologie, qui les rappela pour leur annoncer le prochain accouchement d’un grand saurien des Antilles, et les engager à revenir voir les nouveau-nés.
§ XIV.
Au sortir du jardin des plantes, nos visiteurs furent arrêtés par une longue file de gens qui suivaient un corbillard. Blaguefort se trouvait parmi eux ; il reconnut Maurice et se détacha du cortège pour le saluer. Le jeune homme demanda quel était le mort dont passait le convoi.
— Eh ! parbleu ! vous le connaissez, répliqua Blaguefort, c’est notre ancien compagnon de voyage, l’homme au racahout ! En le faisant maigrir, les dégraisseurs-jurés ont réussi à constater son identité, mais il en est mort. C’est une perte qui sera très-sensible à sa famille, et surtout à la compagnie dont il était le prospectus vivant. J’y suis moi-même pour la façon d’un corset orthonasique dont il m’avait fait la commande, comme vous le savez.
— Ainsi, dit Maurice, l’erreur d’un gendarme aura coûté la vie à un homme, ruiné une famille et compromis de nombreux intérêts !…
— Sans que l’on ait droit de réclamer aucuns dédommagements, acheva Blaguefort. Si un particulier accuse à tort, il est condamné comme calomniateur ; s’il se trompe dans un jugement, s’il fait preuve de précipitation ou d’imprudence, il en demeure responsable. Mais la société a le privilège de l’erreur ; si elle méconnaît un droit, si elle perd un honnête homme, si elle jette la mort et la désolation parmi des innocents, il lui suffit de dire ; — Je me suis trompée, cela passe pour une réparation suffisante. C’est toujours l’histoire du loup qui trouve la grue trop heureuse de n’avoir point été dévorée.
Allez, vous êtes une ingrate,
Ne tombez jamais sous ma patte !
Tout en parlant ainsi, Blaguefort s’était rapproché du convoi, et Maurice et Marthe, qui avaient pris congé du docteur Minimum, le suivirent machinalement.
Ils arrivèrent à l’enceinte funèbre, autour de laquelle s’étendait un bazar.
— Vous voyez le cimetière à la mode, leur dit Blaguefort ; tous les gens qui savent vivre doivent se faire enterrer ici, sous peine de mauvais ton. À la vérité, rien n’a été négligé par les directeurs de cet établissement mortuaire pour lui conserver sa réputation. Ils ont compris qu’il fallait pleurer les morts de la manière la plus confortable pour les vivants ; aussi le cimetière est-il desservi par trois lignes de voitures nommées les plaintives. La veuve et l’orphelin n’ont qu’à tirer le cordon pour que le conducteur les arrête à la porte de leur défunt. Il y a, en outre, des cabinets particuliers pour les personnes qui désirent pleurer seules, et des marchands d’onguent pour les yeux rouges. Le bazar construit à côté du cimetière renferme tout ce qui peut servir aux trépassés et à leurs survivants, depuis les couronnes d’immortelles en raclure de baleine jusqu’aux chapons à la Marengo. On y trouve même des orateurs funèbres qui, moyennant un prix modéré, se chargent de faire l’éloge du mort, et de souhaiter que la terre lui soit légère ! Celui qui parle dans ce moment et que l’éloignement nous empêche d’entendre, est un des plus employés. Autrefois commissaire-priseur, il a apporté dans ses nouvelles fonctions toutes les ruses de son ancien métier. Selon l’argent qu’on lui donne, il fait monter ou descendre de trente pour cent les vertus des trépassés. Du reste, voici la cérémonie achevée, et nous n’avons plus qu’à prendre congé du frère du défunt qui a conduit le deuil.
Ils voulurent approcher de ce dernier, qui venait de saluer les assistants et qui allait gagner une autre porte du cimetière, mais ils le trouvèrent déjà assailli par une multitude d’industriels qui venaient exploiter sa tendresse pour le défunt. Il y avait d’abord le marbrier, présentant des modèles réduits de monuments funèbres à tous prix et de toutes formes ; le fossoyeur, qui sollicitait une gratification en tendant un chapeau sur lequel était écrit : Il est défendu de demander ; le jardinier du cimetière, proposant de planter autour de la tombe des cyprès et des haricots d’Espagne ; le portier, attendant le denier à Dieu que doit tout nouveau locataire ; le buraliste des plaintives, offrant un abonnement de cinquante cachets ; enfin, les marchandes d’immortelles, d’anges en carton-pierre et de lampes funéraires en porcelaine, qui offraient leurs articles au prix de fabrique. Blaguefort lui serra la main, puis, s’éloignant avec ses compagnons :
— Le malheureux sortira ruiné, dit-il ; on vivrait dix ans à Sans-Pair avec la somme qu’il faut payer pour avoir la permission d’y mourir. Encore ne voyez-vous ici que les menus frais. Il y a, en outre, les droits du fisc ! Partout où l’on suspend les draperies noires tachées de larmes, vous le voyez accourir la bouche entr’ouverte et les griffes tendues. Tout héritage est soumis à sa dîme. Comme les vampires de la Bohême, il s’engraisse de morts. Qu’une femme ait perdu le mari qui la faisait vivre ; qu’une veuve pleure le fils sur lequel elle s’appuyait ; qu’un enfant voie succomber le père dont il recevait tout, le fisc accourt, au nom de la société, et leur enlève une part de ce qu’ils ont pour leur permettre de garder le reste. Chaque acte mortuaire est une lettre de change souscrite à son profit. À la vérité, ces droits grossissent l’actif du budget, et permettent d’entretenir trente-deux millions de fonctionnaires publics, occupés huit heures par jour à tailler des plumes et à rayer du papier. C’est une des branches de ce grand arbre toujours en fleurs et en fruits que nous appelons le système d’impôts.
— Et ce système a sans doute un principe ? demanda Maurice.
— Un principe admirable, répliqua Blaguefort ; on avait déjà observé que les hommes les moins riches étaient ceux qui se créaient le moins de besoins ; nos législateurs en ont conclu que le prolétaire, qui vivait de rien, devait avoir, plus qu’aucun autre, du superflu. En conséquence, ils lui ont fait supporter double charge, fournir double service, payer double taxe. Tout ce qu’il consomme passe trois ou quatre fois sous le râteau du fisc. Mais ce résultat n’a point été obtenu sans peine. Longtemps l’obstination du pauvre diable a lutté contre l’équité distributive de la loi. On avait imposé la nourriture, il jeûnait ; les vêtements, il marchait nu ; le jour, il murait ses fenêtres ! Toutes les tentatives pour trouver un impôt auquel il ne pût se soustraire avaient été inutiles, lorsque notre ministre des finances a enfin découvert ce que l’on cherchait vainement, il a créé l’impôt des nez ! Désormais, quiconque jouit de cette annexe paye la taille sans plus ample information ; le percepteur n’a à constater ni l’âge, ni la profession, ni le domicile, ni la fortune, il suffit de constater le nez. Quelques représentants avaient voulu rendre l’impôt proportionnel à ce dernier ; il eût suffi de l’appliquer au mètre rectifié, qui eût donné le rapport du nez de chaque citoyen avec le diamètre de la terre ; mais les députés de l’opposition ont rappelé que tous les hommes devaient être égaux devant la loi, et l’on a renoncé à la naso-statique proposée.
— Cependant, objecta Maurice, les gens qui ne possèdent rien ne peuvent rien payer, par exemple, les mendiants !…
— Nous n’en avons point, répondit Blaguefort.
— Vous avez alors élevé pour eux des asiles.
— Nous avons élevé des poteaux indicateurs. L’argent autrefois consacré à soulager les indigents a été employé à leur annoncer qu’on ne les soulagerait plus. Ils ont beau, désormais, aller devant eux, partout se dresse la fameuse inscription ; La mendicité est défendue dans ce département. De sorte que, de poteaux en poteaux, et de défense en défense, ils arrivent infailliblement à quelque fossé où ils meurent de fatigue et de faim. Vous ne sauriez croire avec quelle rapidité ce procédé a fait disparaître les mendiants. Quelques-uns persistaient pourtant, soutenus par les secours de mauvais citoyens : mais le gouvernement vient de proposer une loi par laquelle l’aumône donnée sera punie de la même peine que l’aumône reçue ! De cette manière, nous espérons extirper des âmes jusqu’aux dernières racines de ce que l’on appelait autrefois la charité. Chacun ne comptant plus sur personne, s’occupera de se secourir lui-même ; on ne demandera plus, parce qu’on aura cessé de donner, et tous les hommes jouiront tranquillement de leur fortune… ou de leur misère ! Mais nous voici au rond-point du cimetière ; avant de partir, ne seriez-vous point curieux de jeter un coup d’œil sur la ville des morts ?
Avertis par cette demande, le jeune homme et sa compagne regardèrent autour d’eux. L’enceinte funèbre était partagée en trois quartiers fermés par des grilles et favorisés d’un concierge. Le plus petit renfermait les morts fameux, dont les tombes ne pouvaient être visitées qu’en compagnie de plusieurs gardiens. Le premier vous montrait les illustres guerriers, recevait son pourboire, et vous remettait à un second gardien, qui, après vous avoir exhibé les grands littérateurs et avoir obtenu une seconde gratification, vous confiait à un confrère spécialement chargé des savants morts, toujours moyennant quelque menue monnaie, lequel vous livrait à un quatrième guide, préposé aux célèbres artistes. Chacun d’eux avait, en outre, de petites industries accessoires, telles que ventes de boutures du saule de Napoléon ; boucles de cheveux de Voltaire, blonds ou noirs, selon la demande ; fragments du cercueil d’Héloïse et d’Abélard ; tabatière de lord Byron, qui ne prenait point de tabac ; roses blanches cueillies sur la tombe de Robespierre, et aconits spontanément poussés sur celle de M. de Talleyrand.
Le second quartier était consacré aux banquiers, bourgeois, rentiers, commerçants et fonctionnaires publics. C’était là que l’on trouvait les croix d’honneur sculptées, les bustes sous cloche et les petits chiens empaillés. Quant aux épitaphes, il n’en existait que trois, toujours ramenées au-dessous des noms. Pour la tombe d’un chef de maison, on mettait :
BON AMI,
ET ÉLECTEUR DE SON ARRONDISSEMENT.
Pour la tombe d’une jeune fille :
L’ESPACE D’UN MATIN.
REQUIESCAT IN PACE.
Pour la tombe d’un enfant :
Le troisième quartier était consacré aux pauvres morts. Ceux-là ne laissaient de monuments que dans les cœurs des survivants… quand ils en laissaient ! tout au plus quelques pierres, quelques croix de bois noirci conduisant à la grande fosse commune, où allaient s’entasser les générations nées dans la misère, vivant sans espérances et mortes dans l’abandon ! Là, plus de croix, plus de pierres, mais de loin en loin quelques enfants à genoux, quelques femmes pleurant en silence, épitaphes vivantes que tout le monde pouvait lire, et qui en disaient plus que celles gravées sur le marbre ou sur le bronze.
Blaguefort et ses compagnons allaient prendre une des avenues de sortie lorsqu’ils furent accostés par un courtier mortuaire qui leur barra le passage. C’était une sorte de géant maigre, vêtu d’un caleçon noir semé de larmes, et d’un manteau de même couleur, portant en guise de broderies des ossements croisés et des têtes de mort.
— Ces messieurs ont vu le cimetière, dit-il avec la volubilité mécanique des marchands forains habitués à filer ces phrases sans ponctuation qui durent une journée… ces messieurs doivent être contents… c’est le plus bel établissement de Sans-Pair, le seul où puissent se faire inhumer les gens comme il faut… les terrains renchérissent tous les jours, on se les arrache, c’est à qui se fera enterrer ici. Avant peu, tout sera acheté. Ces messieurs ne voudraient-ils pas prendre leurs précautions ? choisir d’avance la place qu’ils désirent occuper un jour ? Je puis leur faciliter ce choix, les faire traiter pour trois mètres, six mètres, neuf mètres. Personne ne pourra leur obtenir d’aussi bonnes conditions que moi. Je suis le protégé de l’administration. Ces messieurs peuvent désigner l’endroit… il y en a de tout plantés… Ces messieurs pourraient avoir un saule… bouture de Napoléon… garantie… le saule est très-bien porté !… Je me charge également des monuments à forfait ; tombes simples, tombes historiées, édifices funèbres avec statues et accessoires. Quant aux embaumements, le privilège de la méthode Putridus m’appartient ; je conserve les corps dans toute leur grâce et dans toute leur fraîcheur ; la personne la plus intime ne peut apercevoir aucune différence entre le sujet préparé et le sujet vivant. Je fournis, en outre, des épitaphes inédites ; j’imprime des articles biographiques ; je fais entrer par faveur les défunts dans le quartier des grands hommes… Ces messieurs ne trouveront personne qui puisse les arranger comme moi. Il y a vingt ans que je place des morts ; je connais ici tout le monde, je suis ici chez moi. Si ces messieurs exigent un rabais, on pourra s’entendre. Le moment ne saurait être meilleur ; l’administration projette des embellissements ; elle a besoin d’argent ; on aura une tombe pour presque rien… Ces messieurs sont toujours sûrs de faire une excellente affaire… d’autant que s’ils ne veulent point se servir du terrain pour eux-mêmes, ils pourront le céder à un autre ; il n’est point de propriété dont on se défasse aussi aisément ; c’est une maison qui trouve toujours des locataires… Ces messieurs ne veulent pas se décider… Ces messieurs se repentiront…..
Maurice arrivait heureusement à la porte du cimetière ; le courtier mortuaire s’arrêta à la grille comme un marchand sur le seuil de sa boutique, mais sa voix poursuivit encore quelque temps les visiteurs, qui avaient pris le chemin de l’Observatoire.
§ XV.
L’Observatoire de Sans-Pair était construit au milieu d’un vaste jardin, et sur une hauteur d’où sa vue embrassait l’horizon sans obstacle. C’était là que le grand astronome de Sans-Pair tenait le registre de l’état civil des corps célestes, constatant scrupuleusement leur âge, leurs alliances, leurs divorces et leurs morts. Mais depuis ses dernières découvertes, la lune absorbait seule toute son attention. Il la cherchait le jour, il la contemplait la nuit, il en parlait éveillé et dans ses rêves ! Jamais Endymion n’avait été si tendrement préoccupé de sa pâle amante.
M. Atout et ses hôtes le trouvèrent fixé à son immense télescope, dans une exaltation de joie inexprimable.
— Je les vois encore, disait-il à Blaguefort, qui se tenait debout derrière lui : ce sont les mêmes gens qu’hier !
— Oui donc ? demanda l’académicien en s’approchant.
— Qui ? répliqua Blaguefort ravi ; pardieu ! un couple d’amants lunaires que notre illustre ami observe depuis huit jours. Il a assisté à tous les préliminaires de la passion : signaux télégraphiques par les fenêtres, lettres échangées, murs franchis…
— Les voilà qui s’approchent, interrompit l’astronome. Oh ! je distingue tout, sauf la figure de la femme, qui est voilée… C’est dans un grand jardin… avec un kiosque… et des allées de cocotiers… Les voilà qui vont s’asseoir sous un figuier.
— Ah ! diable ! l’arbre sous lequel notre première mère rencontra Satan ! fit observer M. Atout.
— La femme a l’air d’être effrayée… reprit l’astronome, qui ne quittait point sa lunette… Elle regarde derrière elle…
— Est-ce qu’il y aurait des maris dans la lune ? s’écria le commis voyageur. Pardieu ! je comprends alors pourquoi elle affecte la forme symbolique du croissant !
— Attendez, interrompit M. de l’Empyrée, la femme se décide à s’asseoir…
— Bon…
— Il lui prend la main…
— Et elle la laisse ?…
— Non, elle résiste…
— Alors, c’est pour qu’il serre plus fort…..
— Oui, il la presse contre son cœur…..
— Ah ! bah !…
— Il tombe à genoux…
— Ah çà ! mais tout se passe donc là-bas absolument comme chez nous ? s’écria Blaguefort un peu étonné.
— Je crois qu’il doit y avoir, en effet, identité, interrompit en souriant Maurice, qui avait jusqu’alors tout observé sans rien dire.
— Pourquoi cela ? demanda M. Atout.
— Parce que le télescope a repris sa position horizontale, et qu’au lieu d’être braqué sur la lune il regarde le jardin.
M. de l’Empyrée recula d’un bond.
— Le jardin ! répéta-t-il. Comment !… les cocotiers !… le kiosque !… le figuier !…
— Nous les avons sous les yeux !
L’astronome regarda devant lui.
— C’est la vérité, dit-il ; je n’avais jamais remarqué…
Et se redressant tout à coup :
— Mais la femme, s’écria-t-il ; la femme dont on vient d’écarter le voile !…
Il se précipita vers le télescope, se baissa pour regarder, puis poussa un cri !… c’était madame de l’Empyrée !
Ce qu’il cherchait dans le ciel se passait chez lui !
Il y eut un moment de trouble général. Blaguefort et Atout se regardaient ; Maurice s’éloigna de quelques pas ; M. de l’Empyrée s’était laissé tomber dans son fauteuil, pâle et effaré.
— Ce n’était pas notre satellite ! balbutia-t-il enfin, atterré.
— C’était votre jardin ! répliqua Blaguefort également stupéfait.
— Ce n’était pas une femme lunaire ! reprit l’astronome
— C’était votre femme ! continua le commis voyageur.
— Tout cela se passait à quelques pas ! continua le savant.
— Et nous avons formé une société pour des télégraphes transaériens ! acheva l’industriel.
M. de l’Empyrée porta les deux mains à son front.
— Ainsi, je n’ai rien découvert ! s’écria-t-il avec désespoir.
— Permettez, interrompit Blaguefort, toujours le premier à retrouver son sang-froid ; ce que vous avez vu n’est pas à dédaigner, et l’on peut en tirer parti. Je ne vous propose pas de mettre la chose en actions ; le progrès des lumières ne nous a point encore amenés là ; mais vous pouvez intenter une action judiciaire, exiger des dommages-intérêts.
— Quoi ! pour ?…
— Précisément.
— Mais qui les payera ?
— L’homme lunaire que je viens de reconnaître, et qui est tout simplement notre ministre de la morale et des cultes, pour le moment hors de l’exercice de ses fonctions !
— Ah ! le traître !
— Dites plutôt le malheureux. Vous pouvez lui réclamer ce que la loi appelle une prime de consolation ; quelques centaines de mille francs.
— Avec lesquels je ferai perfectionner le télescope ! s’écria M. de l’Empyrée ; vous avez raison : je veux profiler de mes avantages. Messieurs, vous venez tous de voir l’insulte ; vous allez me suivre au parquet pour en rendre témoignage.
Il s’était levé en cherchant sa canne et son chapeau. Maurice voulut en vain l’apaiser ; l’idée des dommages et intérêts s’était emparée du savant. Il calculait d’avance tous les perfectionnements qu’il pourrait apporter à ses moyens d’exploration. Grâce à l’argent du ministre des cultes, il était sûr de savoir au juste, avant trois mois, si les maris de la lune avaient droit aux mêmes primes de consolation que ceux de la terre.
Ses visiteurs auraient été obligés de le suivre au palais de justice, où devait être reçue sa déclaration, si M. Atout ne se fût, tout à coup, rappelé la grande réunion annuelle de l’Institut de Sans-Pair, dont tous deux étaient membres, et qui avait lieu le matin même. Il ne restait que le temps nécessaire pour s’y rendre. M. de l’Empyrée se résigna donc à ajourner sa dénonciation, et accepta une place dans la voiture de l’académicien, tandis que Maurice et Marthe les suivaient dans le coupé volant de Blaguefort.
Ce dernier, qui avait remarqué le trouble des deux époux au moment de la découverte faite par l’astronome, prit soin de les rassurer.
— Nous ne sommes plus, dit-il, au temps où le mari trompé demandait la condamnation ou le sang du séducteur ; aujourd’hui, il se contente de sa bourse. La trahison d’une femme est un désagrément compensé par les profits : aussi n’a-t-elle plus rien de honteux pour les maris ; les revenus qui en proviennent sont comme des héritages indirects dont l’opulence rachète l’origine. Le moyen d’en vouloir longtemps à la femme qui vous a enrichi ? Si les Juifs eussent connu les primes de consolation, loin de lapider l’épouse adultère, ils lui eussent élevé une statue à côté de celle du veau d’or. Les infidélités matrimoniales ne sont plus des questions de sentiment, mais d’arithmétique. À chaque nouvelle découverte, le mari achète une ferme avec son accident, ou place son malheur en viager. Tout cela se fait sans scandale, sans bruit, par simple jugement de première instance. On dit : — Monsieur *** a été primé, comme on dirait qu’il a été nommé marguillier ou caporal de la garde nationale. C’est une chance qui peut vous enrichir sans aucune peine, et réaliser la fable de l’homme qui court longtemps en vain après la fortune et la trouve, au retour, dans son lit ! Pour être juste, du reste, il faut dire que nous tenons ce procédé de l’Angleterre, et que notre civilisation l’a seulement perfectionné.
Les portes de l’Institut étaient gardées par une compagnie de gardes nationaux. C’était la première fois que Maurice apercevait cette milice urbaine, et il fut frappé de sa tenue.
On l’avait gratifiée des armes et des uniformes reconnus trop incommodes pour l’armée, comme ces enfants auxquels on abandonne de vieux ornements militaires avec lesquels ils jouent au soldat, entre leurs classes. Chaque grenadier citoyen portait un bonnet à poil de trois pieds pour se défendre des coups de soleil, une paire de bottes à l’écuyère, destinées à le garantir des engelures, et un caisson de munitions contenant de la pâte de guimauve ou des bâtons de sucre d’orge. À la place du sabre pendait un étui à lunettes.
— Vous voyez une de nos plus belles institutions, dit Blaguefort. La garde nationale de Sans-Pair s’est en tous temps couverte de gloire, comme le prouvent les décorations de ceux qui en font partie. Vous trouveriez à peine deux ou trois tambours qui n’ont point de croix, encore est-ce faute de protection. Elle est la gardienne de nos libertés, bien qu’il lui soit défendu d’avoir une opinion sous les armes, et le boulevard de l’ordre public, encore que la police soit faite par les municipaux. Elle ouvre d’ailleurs une légitime carrière à des ambitions qui, sans elle, ne trouveraient jamais l’occasion de se satisfaire. Tel droguiste patenté mourrait vierge de toute fonction publique, s’il n’obtenait de ses voisins le titre de sous-lieutenant en second : tel charcutier vendrait son fonds, privé de toute distinction sociale, si ses fonctions de caporal ne lui avaient valu trois décorations. La garde urbaine profite, en outre, à plusieurs industries nationales, telles que celles des cabaretiers, des marchands de blanc d’Espagne et de papier à dérouiller ; elle entretien une population flottante d’enrhumés, de rhumatismants, de courbaturés, qui profite aux médecins et aux fabriques de réglisse ; elle conserve enfin, dans le pays, un esprit militaire d’autant plus précieux à entretenir, que l’on est décidé à ne s’en servir jamais. Quant aux services rendus par les citoyens armés, ils sont trop évidents et trop nombreux pour que j’aie besoin de vous les énumérer. Ils défendent d’abord toutes les portes, déjà défendues par la police ou l’armée ; ils gardent les monuments publics, en dedans des grilles fermées ; ils parcourent la ville chargés de leur caisson, de leur bonnet à poil, de leurs bottes à l’écuyère et de leur tromblon, afin d’arrêter, à la course, les voleurs, chargés de leur seule malice ; ils servent enfin à orner de leurs bataillons les fêtes publiques, comme ces vignettes mobiles dont l’imprimeur encadre tour à tour les annonces de mariage et les billets d’enterrement.
Les deux époux trouvèrent l’Institut de Sans-Pair établi dans une salle circulaire dont le public occupait les tribunes. Chaque académicien portait un caleçon brodé d’une guirlande de lauriers vert-pomme, et une épée suspendue à un ceinturon d’immortelles.
On commença par la réception d’un membre récemment admis à l’Académie du beau langage. Blaguefort apprit à Maurice que les nominations étaient le résultat d’un concours. Celui qui, dans un temps donné, faisait le plus grand nombre de visites était préféré à ses concurrents, d’où il résultait que le titre le plus sûr, pour réussir, n’était point un beau livre, mais un bon équipage. Aussi le récipiendaire l’avait-il emporté sans peine. C’était un grand seigneur, dont les œuvres complètes se composaient de deux chansons, de trois lettres de premier de l’an et d’un madrigal
Le secrétaire perpétuel, chargé d’expliquer pourquoi il se trouvait académicien, rappela la célébrité d’un de ses ancêtres, qui avait été général de cavalerie. Le grand seigneur répondit par l’éloge de son prédécesseur, contre lequel étaient faites ses deux chansons ; puis on passa à la distribution des prix de vertu appelés, selon un antique usage, prix Montyon.
Le rapporteur commença par expliquer, à l’auditoire, ce nom, dont l’origine se perdait dans la nuit des temps. Il lui apprit qu’il se composait primitivement de mont, hauteur, et de ione, pierre précieuse, d’où l’on avait fait mont-ione, et par corruption mont-yjon, expression symbolique que l’on pouvait traduire par montagne précieuse, la vertu étant, en effet, ce qu’il y a de plus précieux et de plus élevé.
Vint ensuite le rapport sur les candidats couronnés par l’Académie. Le premier était un homme dont toute l’occupation avait été de secourir les pauvres de sa paroisse. Après les avoir habillés et nourris pendant vingt années, il se trouvait lui-même sans pain et sans vêtements. L’Académie, qui, par l’organe de son rapporteur, l’avait surnommé le saint Vincent de Paul de la république des Intérêts-Unis, lui accorda, à titre d’encouragement, trois livres de chocolat de santé et un caleçon d’honneur.
Le second candidat était un ouvrier qui, en sauvant une famille à travers les flammes, avait eu la tête broyée sous une poutre et venait d’être trépané. On le compara à Mucius Scévola, et on le gratifia d’un bonnet de coton orné d’une couronne de lauriers.
Un troisième (c’était une femme) avait perdu la vue en travaillant toutes les nuits pour faire vivre son ancien maître. On lui remit une paire de lunettes à l’estampille de l’Institut.
Un quatrième obtint des souliers d’honneur pour avoir successivement sauvé vingt-deux personnes qui se noyaient.
Enfin, plusieurs autres, plus ou moins appauvris, ou estropiés, par suite de leur dévouement, reçurent des gratifications qui varièrent depuis cinquante centimes jusqu’à dix francs.
On couronna également un soldat citoyen, inscrit depuis trente ans sans avoir manqué une seule fois à sa garde ; un cocher arrivé à sa septième femme, et qui ne s’était jamais servi de son fouet qu’avec ses chevaux ; un commis de la caisse d’épargne, toujours poli, et un employé de la bibliothèque complaisant.
Ces deux derniers lauréats furent les seuls dont les vertus parurent invraisemblables, et qui excitèrent quelques murmures d’incrédulité.
On passa ensuite aux prix d’histoire, d’économie politique et de poésie.
En histoire, il s’agissait de décider qui avait eu le plus de génie, d’Annibal ou d’Alexandre (le programme décidant que ce devait être Alexandre).
Le secrétaire perpétuel déclara qu’aucun des concurrents n’avait traité la question comme il l’eût traitée lui-même, et que le prix était, en conséquence, remis à l’année suivante.
On avait également proposé aux économistes la question de savoir par quels moyens on pourrait améliorer le sort des classes les plus ignorantes et les plus pauvres.
Le rapporteur annonça que tous les candidats s’étaient fourvoyés en cherchant ces moyens, qui n’existaient pas, et que la question était retirée de concours.
Enfin, le sujet de poésie était la description du printemps, avec un épisode élégiaque sur la culture des pommes de terre primes.
La commission nommée pour juger les trois mille pièces envoyées fit savoir que tous les poëtes avaient décrit le printemps de leur pays au lieu de peindre le printemps absolu ; et que la plupart étaient tombés dans de grandes erreurs au sujet de la culture des solanées. En conséquence, le prix était transformé en une mention honorable accordée à la pièce portant le no 940, laquelle pièce était sans nom d’auteur.
Ici, la séance fut suspendue. Une partie des immortels quitta la salle, et les marchands de limonade parurent dans les tribunes. Il y eut entre les voisins qui se connaissaient un échange de saluts et de politesses. On s’informa des absents, on parla des bals auxquels on était invité, du cours de la bourse, de l’épidémie régnante, de tout enfin, excepté de ce que l’on venait d’entendre. Ce fut seulement au bout d’une heure que la sonnette du président annonça la reprise de la séance.
Il s’agissait cette fois des communications faites par les différentes académies.
On lut d’abord un mémoire destiné à éclaircir si les rois pasteurs étaient noirs ou seulement brun foncé ; puis une fable développant cette vérité profonde : que le faible est plus souvent opprimé que le fort ; enfin, une dissertation archéologique relative à l’éperon de François Ier.
Mais ce n’étaient là que les préludes de la séance, le lever du rideau destiné à faire attendre la grande pièce. Enfin, le bibliophile parut au pupitre avec le premier chapitre de son fameux Traité sur les mœurs de la France au dix-neuvième siècle. Cette lecture était annoncée depuis trois mois, et l’on en racontait d’avance des merveilles ; aussi tous les auditeurs se penchèrent-ils vers le bord des tribunes ; le silence s’établit plus complet, et l’académicien commença de cet accent solennel et cadencé qui constitue ce que les bourgeois nomment un bel organe.
§ XVI.
« On l’a dit bien des fois, messieurs, tant qu’il reste des traces de la littérature et des arts d’une nation, cette nation n’est point morte ; l’étude peut la reconstituer, la faire revivre comme les créations antédiluviennes devinées par les inductions de la science.
« La littérature et les arts ne sont-ils point, en effet, le reflet fidèle des mœurs d’une époque ? n’y trouvez-vous point la peinture des habitudes, des croyances, des caractères, des sentiments ? Si nous n’avons que des données fausses sur les peuples qui vécurent autrefois, nous ne devons donc accuser que notre paresse ; une étude sérieuse nous les eût révélés dans leur vérité.
« C’est cette étude que nous avons tentée pour les Français du dix-neuvième siècle.
« Quinze années de notre vie ont été employées à visiter les ruines de leurs monuments, à examiner leurs tableaux et leurs statues, à connaître leurs livres surtout, immense galerie où toutes les individualités du passé s’agitent et se coudoient.
« Le travail que nous avons l’honneur de vous soumettre est le résultat de ces longues recherches ! »
(Ici, le lecteur s’arrêta, sous prétexte de boire ; le public, ainsi prévenu qu’il est à un bon endroit, applaudit.)
« Et d’abord, messieurs, protestons contre le préjugé vulgaire, qui a fait regarder jusqu’ici les Français comme des hommes légers, mobiles, amis du plaisir ; loin de là ! L’étude attentive de ce qu’ils ont laissé nous les montre sombres, passionnés, sanguinaires, toujours la main au poignard ou au poison. Leurs dramaturges, leurs poètes, leurs romanciers, qui ont peint les mœurs du temps, ne laissent aucun doute à cet égard.
« Ainsi, pour ne citer qu’un fait, nous avons calculé, d’après la lecture de leurs œuvres, que les dix-sept vingtièmes des unions légitimes amenaient la mort de l’un des conjoints ! La conséquence normale du mariage était le suicide ou le meurtre ; les époux ne se laissaient vivre que par exception !
« Telle était à cet égard la force de l’habitude, qu’un mari étrangla sa femme la première nuit des noces, uniquement parce qu’il ne pouvait se rappeler son nom[1].
« Les amants n’étaient guère plus heureux, soit que la femme tuât l’homme pour le rendre plus prudent[2], soit que l’homme tuât la femme pour lui éviter les reproches de son mari[3], soit que tous deux se tuassent à l’amiable et de compagnie, comme on le voit à chaque page dans les journaux du temps.
« Il y avait, en outre, tous les menus accidents : main prise dans une porte, et qu’il fallait couper[4] ; œil crevé par un mari borgne, trop partisan de l’égalité[5] ; marque au fer rouge faite sur le front[6] ; duels périodiques revenant tous les ans au retour des pois verts[7] ; pierres tombant à dessein du haut d’un échafaudage de maçon[8].
« Du reste, ces accidents et mille autres atteignaient indistinctement toutes les classes et tous les âges. Il suffit de lire les Mystères de Paris, cette admirable peinture de la société au dix-neuvième siècle, pour comprendre combien il était difficile de ne pas mourir noyé, poignardé, empoisonné, muré ou étranglé dans ce centre de la civilisation française. Évidemment, les gens qu’on n’assassinait point formaient une classe particulière, une sorte de rareté sociale qui servait, sans doute, au renouvellement de la chambre haute, composée, comme on le sait, de vieillards, pares œtate, d’où leur était venu le nom de pairs.
« Cette multiplicité de morts violentes était principalement l’ouvrage des notaires, des femmes du grand monde, des millionnaires et des médecins. Les médecins se débarrassaient de leurs malades pour en hériter plus vite[9] ; les millionnaires employaient leurs revenus à faire tuer les hommes par des spadassins, et à empoisonner les femmes dans des bouquets[10] de fleurs ; les grandes dames venaient voir égorger leurs rivales à domicile[11], et les notaires étaient en compte courant avec les empoisonneurs, les assassins et les noyeurs de Paris ou de la banlieue.
« Le seul secours pour les honnêtes gens, au milieu de ce désordre, étaient les princes allemands, qui abandonnaient leurs États déguisés en ouvriers, pour aller défendre la vertu dans les tapis francs de la rue Aux-Fêves[12], ou les forçats en fuite, qui assuraient l’avenir des jeunes gens pauvres, et découvraient, dans un lupanar, la femme qui devait faire leur bonheur[13]
« Encore l’influence de ces défenseurs de la vertu était-elle souvent annulée par la fameuse société de Jésus, que secondaient les dompteurs de bêtes de l’Allemagne, les étrangleurs de l’Inde, et les directeurs de maisons de santé de Paris[14].
« Vous devinez d’avance, messieurs, ce que devaient être les mœurs dans une société pareille ! Sauf les grisettes, vivant comme des saintes au milieu des rapins, des clercs d’avoués et des commis marchands[15], les femmes bien nées n’avaient d’autre occupation que la galanterie, et les bons pères de famille se chargeaient de louer eux-mêmes une petite maison où leurs filles mariées pussent recevoir à l’aise des amants[16]. Si par hasard une grande dame restait chaste, elle ne manquait pas d’en exprimer tout son repentir au moment de la mort[17], et de chanter, d’un accent désespéré, le fameux psaume :
Combien je regrette,
Mon bras si dodu,
Ma jambe bien faite
Et le temps perdu !
« À la vérité, rien n’était négligé pour donner cette direction d’idées aux femmes. Outre l’art, qui n’avait de ciseau, de plume, de pinceau que pour les belles pécheresses, l’administration leur montrait une tendre sympathie. Les préfets élevaient eux-mêmes des monuments aux plus célèbres courtisanes, avec des inscriptions explicatives pour l’instruction des jeunes filles. La tombe d’Agnès Sorel a été récemment découverte sur les bords de la Loire, et on y lit :
DEMANDÈRENT À LOUIS XI
D’ÉLOIGNER SON TOMBEAU DE LEUR CHŒUR.
« J’Y CONSENS, DIT-IL, MAIS RENDEZ LA DOT. »
LE TOMBEAU Y RESTA.
UN ARCHEVÊQUE DE TOURS, MOINS JUSTE.
LE FIT RELÉGUER DANS UNE CHAPELLE.
À LA RÉVOLUTION, IL Y FUT DÉTRUIT.
DES HOMMES SENSIBLES RECUEILLIRENT LES RESTES D’AGNÈS,
ET LE GÉNÉRAL POMMEREUL, PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE,
RELEVA LE MAUSOLÉE DE LA SEULE MAÎTRESSE DE NOS ROIS
QUI AIT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE,
EN METTANT POUR PRIX DE SES FAVEURS
L’EXPULSION DES ANGLAIS DE LA FRANCE.
SA RESTAURATION EUT LIEU EN L’AN M. DCCC. VI.
« Tels étaient les cours de morale, en style lapidaire, qui se voyaient encore au château de Loches en 1845, à la grande édification des hommes sensibles et des Françaises qui voulaient expulser les Anglais de la France.
« Les moyens de faire fortune, à la même époque, n’étaient pas moins extraordinaires. Les uns s’enrichissaient des legs laissés par le Juif-Errant, d’autres devenaient de grands capitalistes en apportant des louis dans les villes où l’or était rare, et en plantant des peupliers aux bords de la rivière[18] ; d’autres en se faisant renverser par la meute d’un grand seigneur[19].
« Quelles que fussent, du reste, ces fortunes, chacun les portait sur soi, dans un portefeuille, comme le prouvent les pièces de M. Scribe, et l’on pouvait ainsi les léguer sans testament ; usage évidemment adopté par suite de la légitime terreur qu’inspiraient les notaires.
« Si des habitudes morales de la nation nous passons maintenant à ses habitudes extérieures, nous ne les trouverons ni moins singulières, ni moins variées. Le costume surtout offrait d’étranges disparates. Tandis que les députés paraissaient à la tribune sans autre vêtement qu’un manteau, comme le prouve le tombeau du général Foy, les chefs militaires portaient, même à pied, la culotte de peau de daim et les grandes bottes à l’écuyère, ainsi qu’on peut le voir dans la statue du général Mortier. Il y a même lieu de croire qu’ils se promenaient parfois revêtus d’une cuirasse, car l’auteur des Méditations dit positivement, en parlant de l’empereur Napoléon :
« Ce qui fait nécessairement supposer qu’il en avait une. La capote grise dont parle Bérenger n’était sans doute que son costume de petite tenue.
« Les statues colossales trouvées parmi les décombres de l’ancienne place de la Concorde, et représentant, comme nous l’avons prouvé ailleurs, les princesses du sang royal, indiquent également le costume des femmes. Il était évidemment plus favorable aux belles formes qu’aux rhumes de poitrine ; aussi tous les auteurs du temps signalent-ils la phthisie comme une des affections les plus communes chez les Françaises du dix-neuvième siècle.
« Le peu d’accord des costumes adoptés dans les différents monuments de l’art français prouve d’ailleurs jusqu’à l’évidence que le vêtement variait selon les circonstances et l’occasion. Pour ne citer qu’un exemple, la peinture nous montre Louis XIV en pied, avec la culotte de velours, l’habit de brocart, les bas de soie et les souliers à grands talons, tandis que sa statue équestre nous le représente sans autre vêtement que sa perruque, d’où l’on doit nécessairement conclure que les rois de France ne gardaient que cette dernière lorsqu’ils montaient à cheval.
« Quant à la science et aux arts mécaniques, si l’on en juge par les monuments échappés à la destruction, les Français du dix-neuvième siècle en étaient, tout au plus, aux connaissances des anciens. Nous voyons, en effet, que pour avoir réussi à relever un obélisque dressé par les Égyptiens deux mille ans auparavant, un de leurs architectes fit graver sur le socle une inscription triomphale, comme s’il eût accompli une œuvre miraculeuse. De plus, leurs flottes n’étaient composées que de trirèmes, ainsi que le prouve la médaille frappée en commémoration de la victoire de Navarin.
« Un débris de borne-fontaine récemment recueilli offre pourtant, en bas-relief, la représentation d’un vaisseau particulier. Il est surmonté de quatre mâts, dont l’un est planté hors de l’axe du navire, et porte le beaupré à l’arrière, ce qui, selon l’observation d’un homme d’esprit, le fait ressembler à un cheval bridé par la queue. Le vent enfle sa voile vers la poupe, ce qui ne l’empêche pas de fendre l’onde avec la proue, à peu près comme une brouette qui marcherait en avant à mesure qu’on la pousserait en arrière !
« Or, comment supposer qu’un navire aussi contraire à toutes les lois de la statique eût été gravé sur un monument public, si la France du dix-neuvième siècle eût connu ces lois ? Un peuple ne se calomnie pas lui-même ; quand la science l’éclaire, il ne laisse pas imprimer sur le fer et sur le granit de faux témoignages de son ignorance, surtout quand il a un ministère des travaux publics, un préfet de la Seine et un directeur des beaux-arts. Nous ne parlons pas du ministre de la marine, sans doute trop occupé des navires qui flottaient sur l’eau salée pour songer à ceux qu’on gravait sur les fontaines d’eau douce.
« Il faut donc reconnaître, messieurs, que la France du dix-neuvième siècle fut ignorante. Quant à sa gloire militaire, je doute que l’on puisse encore en parler sérieusement après les travaux de notre illustre collègue Mithophone. Ils ont prouvé jusqu’à l’évidence que les expéditions du prétendu empereur Napoléon Bonaparte n’étaient que le rajeunissement de celles de Bacchus, modifiées par la même imagination populaire, qui inventa, un peu plus tard, les aventures symboliques de ce Robert Macaire et de ce Bertrand, dans lesquels il est impossible de ne point reconnaître les deux fils jumeaux de Léda. Le seul guerrier de quelque importance que l’on ne puisse contester au dix-neuvième siècle paraît être le général Tom Pouce, à la gloire duquel fut frappée une médaille heureusement conservée. L’auteur du Plutarque universel, qui a fait sur ce sujet de profondes recherches, affirme qu’il parcourut en triomphe l’ancien et le nouveau monde, dans un char au-devant duquel la foule se précipitait. Les têtes couronnées elles-mêmes venaient lui rendre hommage, et les femmes déposaient une offrande pour obtenir un de ses baisers.
« Mais nous renvoyons pour tous ces détails aux travaux cités plus haut, nous contentant d’examiner ici la question littéraire.
« On sait combien les Français de toutes les époques se montrèrent amoureux de l’éclat et du bruit. Ils durent à ce penchant leur premier nom de Galli, ou Coqs, dont ils se montrèrent tellement fiers, qu’ils ne balancèrent point à placer, plus tard, sur leurs drapeaux, le volatile qui leur avait servi de parrain. De pareilles dispositions devaient nécessairement en faire un peuple de journalistes, d’avocats et de gens de lettres ; aussi excellèrent-ils dans ces différentes professions, qu’ils cumulèrent même le plus souvent. Mais le dix-neuvième siècle, surtout, se fit remarquer par la loquacité bruyante de ses écrivains. Ce furent eux qui inventèrent cette littérature en mosaïque, composée de petits riens brillants, dont la réunion a l’air de faire quelque chose, ces clapotements de mots sonores, tournant autour de la pensée sans y atteindre jamais ; enfin cet art de dilater le moi de manière à ce qu’il puisse tout occuper.
« La passion du clinquant et de l’ingénieux les porta même à abandonner leurs véritables noms pour en prendre de composés, car mes récentes études ne m’ont laissé aucun doute à cet égard, messieurs ; il m’est désormais bien démontré que tous les noms sous lesquels nous connaissons les écrivains français du dix-neuvième siècle ne sont que des désignations significatives destinées à révéler le caractère, le talent et les prétentions de l’auteur.
« Nous pourrions appuyer cette opinion d’une multitude de témoignages ; l’espace et le temps nous obligent à choisir seulement quelques exemples.
« Nous citerons le poëte-coiffeur Jasmin, dont le nom parfumé convient évidemment si bien à sa double profession ; le versificateur-maçon Poncy, au sobriquet pierreux et solide comme son talent ; l’écrivain-cordonnier Lapointe, qui, en perçant la foule, justifia son symbolique surnom : l’historien Laurent, ainsi appelé par allusion à son héros, l’empereur Napoléon, cuit à petit feu sur le rocher de Saint-Hélène, comme le fut autrefois saint Laurent sur le gril ; le romancier Dumas, abréviation de Dumanoir, nom guerrier qui rappelle heureusement la manière hardie et cavalière de l’auteur ; le monographe Pitre-Chevalier, qui signa ainsi son beau livre de Bretagne et Vendée, afin de rendre hommage, dès le titre, aux deux pays chevaleresques dont il racontait les grandes aventures.
« Nous ne pousserons pas plus loin, messieurs, cette démonstration, qui devra paraître sans réplique à tous les gens de bonne foi ; mais nous ne pouvons terminer sans parler du curieux langage en usage parmi les Français de l’époque dont nous nous occupons.
« Tout y était devenu nuances et analyse. Voulait-on faire le portrait d’une brune quelque peu barbue ; on disait qu’un duvet follet se montrait le long de ses joues, dans les méplats du cou, en y retenant la lumière, qui s’y faisait soyeuse[20] ; parlait-on de la fraîcheur de ses lèvres, on vantait leur minium vivant et penseur[21], voulait-on faire remarquer ses oreilles petites et bien faites, on les déclarait des oreilles d’esclave et de mère[22] ; entin, si l’on parlait, dans la conversation, d’un voyage en Espagne, il fallait dire : J’ai vu Madrid avec ses balcons de fer ; Barcelone qui étend ses deux bras à la mer comme un nageur qui s’élance ; Cadix qui semble un vaisseau près de mettre à la voile, et que la terre retient par un ruban ; puis, au milieu de l’Espagne, comme un bouquet sur le sein d’une femme, Séville l’andalouse, la favorite du soleil.
« Ce langage prouve combien est peu fondée l’opinion de ceux qui croient la langue française la plus claire, la plus sobre et la plus nette de toutes les langues de l’Europe.
« Je dirai donc, messieurs, pour me résumer, que le dix-neuvième siècle fut, en France, une époque de demi-barbarie, où les esprits subtils, mais ignorants, tenaces et sanguinaires, s’abandonnèrent à tous les excès d’une vitalité surabondante. Mon prochain Mémoire prouvera que ce fut aussi le siècle des ardentes croyances religieuses, comme l’indiquent les odes d’une foule de poètes, s’offrant sans cesse en holocauste, et des grands dévouements politiques, comme on peut s’en assurer par les discours des ministres, qui déclarent ne rester sur leur banc de douleur que dans l’intérêt de la patrie. »
§ XVII.
Au moment où le bibliophile se rassit, la salle entière éclata en applaudissements. On ne pouvait assez admirer cette prodigieuse érudition qui lui permettait de dire, sans hésitation, quelles étaient les mœurs et les habitudes d’un autre peuple, il y avait douze siècles.
Blaguefort n’avait point écouté la lecture, mais il remarqua l’impression produite et quitta brusquement ses compagnons en leur promettant de revenir bientôt.
Maurice croyait rêver. Il regarda Marthe stupéfaite, puis tous deux éclatèrent de rire en même temps.
— Nous saurons désormais ce que c’est que la science historique, dit le jeune homme, et ce qu’il faut croire des vérités démontrées. Je m’explique maintenant pourquoi ces vérités changent à chaque siècle. L’histoire est un écheveau que chacun dévide et tisse à sa manière ; le fil est bien toujours le même, mais l’étoffe et le dessin se modifient selon l’ouvrier.
— Auriez-vous donc remarqué des erreurs dans le Mémoire du bibliophile ? demanda M. Atout, qui venait d’entrer.
— Hélas ! répliqua Maurice, en souriant, il vous a fait connaître la France en l’an trois mille comme nous connaissions l’ancienne Grèce en 1845. Son œuvre ressemble à ces monstres dont chaque membre a été emprunté à un animal réel, mais dont l’ensemble ne peut être qu’un rêve ; tout est vrai, sauf le monstre.
— Et vous pourriez signaler les principales fautes ?
— Si j’avais l’analyse du Mémoire…..
— Vous l’aurez, interrompit vivement l’académicien, qui baissa la voix, nous le trouverons au bureau du journal. Venez vite. Quelque pénible qu’il soit de relever les erreurs d’un collègue, on doit tout sacrifier à l’intérêt de la vérité… Il faudra rédiger une réplique accablante, avec quelques allusions bien aiguisées. Je vous fournirai les pointes d’autant plus sûrement que le bibliophile est mon ami. Je connais les jointures et je sais où il faut frapper.
Ils se dirigèrent vers la grande agence littéraire, qui occupait une rue entière et était exploitée par une société de capitalistes, exerçant à Sans-Pair le monopole de la publicité.
Ils avaient réuni pour cela les journaux des différentes opinions en un seul journal appelé le Grand Pan, qui les soutenait alternativement toutes. Le Grand Pan ne paraissait ni à certain jour, ni à certaine heure ; imprimé sur un papier sans fin, il paraissait toujours !
Un bataillon de journalistes attachés à l’établissement envoyait successivement des piquets de publicistes pour entretenir la rédaction.
Au sortir de l’imprimerie, l’immense feuille se distribuait elle-même à domicile, en courant sur un appareil général de rouleaux. On la voyait traverser les rues, monter aux troisièmes étages, redescendre aux rez-de-chaussée, traverser les cafés, les bazars, les cabinets de lecture, poursuivie par les non abonnés, qui tâchaient de dérober quelques mots au passage ; parcourue en l’air par les gens pressés ; étudiée à loisir par les bourgeois retirés des affaires ; mais toujours immuable dans son mouvement, et faisant disparaître, par le toit ou par la muraille, l’article non achevé que vous aviez lu avec trop de lenteur.
Du reste, des signes particuliers, placés en tête de ces articles, indiquaient leurs tendances et leur couleur, afin que chaque abonné pût reconnaître, au premier coup d’œil, ce qui s’adressait à lui. Était-il monarchique, il ne lisait que là où se montrait le signe de l’écrevisse ; radical, il courait à la balance égale pour le millionnaire et pour le mendiant ; juste-milieu, il cherchait la borne pacifique ; piétiste, il s’arrêtait devant la bourse de quêteuse et le goupillon. Le tout donnait au journal l’aspect pittoresque et littéraire que voici.
 « La nouvelle loi proposée à la chambre de la république des Intérêts-Unis a été acceptée, malgré les efforts de l’opposition ; ce dénoûment, qui semble, au premier abord, une victoire pour le ministère, n’est en réalité pour lui qu’une défaite ; examinez, en effet, quel a été le résultat du scrutin ?
« La nouvelle loi proposée à la chambre de la république des Intérêts-Unis a été acceptée, malgré les efforts de l’opposition ; ce dénoûment, qui semble, au premier abord, une victoire pour le ministère, n’est en réalité pour lui qu’une défaite ; examinez, en effet, quel a été le résultat du scrutin ?
« On a compté 540 votants, sur lesquels le ministère a eu seulement cinq cents voix. Si on ajoute aux quarante boules noires les malades et les absents, qui, comme on le sait, votent toujours avec l’opposition, on trouvera que celle-ci eût pu réunir environ 490 voix, auquel cas les onze voix appartenant à l’opinion monarchique pouvaient faire rejeter la loi.
« Il est donc aujourd’hui avéré, pour tous les gens de bonne foi, que la majorité dépend complètement de ces onze voix, et que, se portant d’un côté ou d’un autre, elles peuvent assurer le succès ou l’empêcher.
« Un tel état de choses n’a pas besoin de commentaires ; quand une opinion en est venue à pouvoir décider de toutes les affaires de l’État, son triomphe est nécessairement peu éloigné. »
 « La république est encore une fois sauvée. Le bon sens de la chambre a fait justice des sophismes de quelques brouillons et de quelques ambitieux, qui voudraient nous ramener à un règne de sang. Le ministère n’a point obtenu la majorité dans la chambre, mais l’unanimité ! Qu’est-ce, en effet, que quarante députés à vues bornées et à mesquines passions, en regard de cinq cents citoyens aussi remarquables par leurs lumières et leur sagesse que par leur désintéressement ? Quant aux députés monarchiques, nous n’en dirons rien, parce qu’ils se sont abstenus de voter. Quand un parti en est arrivé à donner ainsi sa propre démission des affaires, on peut prédire à coup sûr que sa disparition est prochaine. »
« La république est encore une fois sauvée. Le bon sens de la chambre a fait justice des sophismes de quelques brouillons et de quelques ambitieux, qui voudraient nous ramener à un règne de sang. Le ministère n’a point obtenu la majorité dans la chambre, mais l’unanimité ! Qu’est-ce, en effet, que quarante députés à vues bornées et à mesquines passions, en regard de cinq cents citoyens aussi remarquables par leurs lumières et leur sagesse que par leur désintéressement ? Quant aux députés monarchiques, nous n’en dirons rien, parce qu’ils se sont abstenus de voter. Quand un parti en est arrivé à donner ainsi sa propre démission des affaires, on peut prédire à coup sûr que sa disparition est prochaine. »
 « Le ministère l’a emporté ! À la bonne heure ! nous aimons ses triomphes ! — Encore une victoire pareille, disait Pyrrhus à Cinéas, après une bataille contre les Romains, et je n’aurai plus qu’à quitter l’Italie. — Encore une victoire pareille, dirons-nous aux ministres, et vous n’aurez plus qu’à quitter vos hôtels. Vous avez la majorité, dites-vous ! Eh ! malheureux, c’est là ce qui vous tue ! Qu’est-ce, en effet, que cette majorité ? Quelques centaines de privilégiés gorgés de places, écrasés de pensions ! Des complaisants de tous pouvoirs, et dont l’habit croisé recouvre un portefeuille et pas de cœur ! Qu’ils vous soutiennent, ceux-là, ils le doivent, car ils reçoivent vos gages ; ce sont vos gens ; mais aux jours difficiles, qui compte sur ses laquais ? Ah ! croyez-en l’avis d’ennemis loyaux, les temps annoncés sont proches ! Cette minorité dont vous riez a derrière elle tout le peuple, et n’aurait qu’à frapper la terre du pied pour en faire sortir des légions.
« Le ministère l’a emporté ! À la bonne heure ! nous aimons ses triomphes ! — Encore une victoire pareille, disait Pyrrhus à Cinéas, après une bataille contre les Romains, et je n’aurai plus qu’à quitter l’Italie. — Encore une victoire pareille, dirons-nous aux ministres, et vous n’aurez plus qu’à quitter vos hôtels. Vous avez la majorité, dites-vous ! Eh ! malheureux, c’est là ce qui vous tue ! Qu’est-ce, en effet, que cette majorité ? Quelques centaines de privilégiés gorgés de places, écrasés de pensions ! Des complaisants de tous pouvoirs, et dont l’habit croisé recouvre un portefeuille et pas de cœur ! Qu’ils vous soutiennent, ceux-là, ils le doivent, car ils reçoivent vos gages ; ce sont vos gens ; mais aux jours difficiles, qui compte sur ses laquais ? Ah ! croyez-en l’avis d’ennemis loyaux, les temps annoncés sont proches ! Cette minorité dont vous riez a derrière elle tout le peuple, et n’aurait qu’à frapper la terre du pied pour en faire sortir des légions.
« Or, quand on a pour soi le nombre et la justice, la cause n’a même pas besoin d’être débattue, il suffit d’attendre. »
 « Le sort en est jeté ; le siècle ne s’arrêtera point dans son aveuglement, encore une loi impie, inspirée par cette philosophie stérile qui n’a produit que le vent et les tempêtes, ventum et tempestates !
« Le sort en est jeté ; le siècle ne s’arrêtera point dans son aveuglement, encore une loi impie, inspirée par cette philosophie stérile qui n’a produit que le vent et les tempêtes, ventum et tempestates !
« Et l’opposition ne la trouvait point suffisante ; elle voulait plus de libertés ! Des libertés, grand Dieu ! comme si ce n’étaient point elles qui avaient tué la foi : libertas mors Dei. Des libertés ? ah ! demandez plutôt le joug aimable et fort que le piétisme seul sait imposer par les mains de ses ministres ! Mais non, enfoncés dans la fange de votre iniquité, comme le ver immonde, et distillant sur les choses les plus saintes la bave envenimée de votre faconde, vous avez perdu, et les lumières de l’esprit, et la modération du jugement, et l’aménité du langage désormais réservée à nous seuls ! »
M. Atout et Maurice trouvèrent dans la première salle une foule de gens de différents âges et de différentes conditions, qui attendaient l’audience du directeur du Grand Pan. L’académicien en accosta plusieurs qu’il connaissait, et les entretint un instant. Tous affectaient le même dédain pour la puissance à laquelle ils venaient rendre hommage : tous se plaignaient de son iniquité et de sa corruption ; tous se déclaraient également indifférents à son amitié ou à sa haine.
M. Atout, voyant qu’il faudrait attendre quelque temps, proposa à son compagnon de lui faire visiter rapidement ce qu’on appelait les bureaux du journal.
Après avoir traversé plusieurs pièces où des milliers d’employés surveillaient les détails inférieurs, ils arrivèrent à la salle de rédaction, partagée en deux cents cellules grillées, pour les deux cents journalistes de service. Chacun d’eux avait ses fonctions distinctes, indiquées par l’inscription de la cellule. Il y avait un rédacteur pour les empoisonnements de femmes par leurs maris, deux pour les empoisonnements de maris par leurs femmes, trois pour les empoisonnements réciproques, connus sous le nom d'empoisonnements assortis, et ainsi du reste. Venaient ensuite les puffistes, compagnie d’élite dont on ménageait les forces. L’un avait la spécialité des incendies de villes inconnues, des tremblements de terre de pays à découvrir, des naufrages de grands personnages ayant pour nom une initiale ; un second se chargeait des histoires d’ours dévorant les vétérans, de serpents marins et de crocodiles apprivoisés ; un troisième se réservait le règne végétal, embelli des merveilles de la moutarde blanche et du chou colossal.
Chaque article achevé était jeté dans un tube qui le conduisait jusqu’à la machine, où il était imprimé sans l’intermédiaire des compositeurs, ce qui, entre autres avantages, avait celui de laisser les fautes d’orthographe au compte du journaliste.
La seconde salle était celle des rédacteurs de réclames, perpétuellement employés à trouver de nouvelles formules à la fiction ; la troisième, celle des correspondances entretenues au moyen de télégraphes électriques ; enfin, les dernières salles étaient consacrées à la fabrication des feuilletons.
Cette fabrication était exploitée, depuis quelques années, par le fameux César Robinet, qui avait traité à forfait pour tous les romans à publier dans le Grand Pan et dans les autres journaux de la république. Plusieurs machines de son invention confectionnaient des feuilletons de tout genre, à raison de cent lignes à l’heure.
Il y avait d’abord la machine historique, dans laquelle on jetait des chroniques, des biographies, des mémoires, et d’où sortaient des romans dans le genre de ceux de Walter Scott ;
La machine à variétés, que l’on bourrait d’anas, de légendes, d’almanachs anecdotiques, et qui produisait des voyages comme celui de Sterne ;
La machine des fantaisies, qui recevait les anciens poëtes, les vieux romans, les drames oubliés, et dont on obtenait des nouvelles comparables à celles de Bernardin de Saint-Pierre et de l’abbé Prévost ;
Enfin la machine des résidus, où l’on jetait à brassée les rognures que l’on n’avait pu utiliser ailleurs, et qui produisait du Perrault et du Berquin de seconde qualité.
César Robinet ne lisait point ses livres, mais il les signait tous, ce qui le condamnait à quatorze heures de travail forcé par jour. À l’arrivée de Blaguefort, il paraphait le cent trente-troisième volume des aventures du colonel Crakman, récit charmant, dans lequel il avait réussi à faire entrer tous les mémoires imprimés sur le grand Frédéric et sur sa cour.
Soixante secrétaires faisaient autour de lui le triage des livres des autres, qui devaient devenir des livres de lui.
Maurice demeura émerveillé. Le système de retapage, autrefois borné aux chapeaux, s’était étendu jusqu’aux idées. La friperie perfectionnée avait envahi la république des lettres ; les plus vieux volumes décousus, découpés, reteints et regommés, devenaient des nouveautés recherchées ; il suffisait de l’estampille : CÉSAR ROBINET pour que l’étoffe usée parût neuve !
Atout, pensant que l’heure de réception devait être arrivée, rebroussa chemin et se présenta chez le directeur du Grand Pan.
M. Prétorien était à Sans-Pair le véritable fondateur de la liberté de la presse, c’est-à-dire de la liberté de presser les gens. Rien ne pouvant lui être refusé impunément, on ne lui refusait rien. La plume croisée devant son journal, comme la sentinelle devant son camp, il décidait seul qui il fallait repousser ou admettre. Excellent du reste pour ses amis, il leur partageait ses gains, sa puissance, son crédit, et c’était le meilleur roi du monde, pourvu qu’on ne fût point de ses sujets.
Au moment où nos visiteurs entrèrent, il donnait audience à tous ceux que Maurice avait vus faire antichambre. Leur dédain pour le journalisme avait fait place au respect, leur indifférence à l’empressement. C’était à qui se montrerait le plus modestement soumis ou le plus amicalement familier.
Il vit d’abord passer une vingtaine d’auteurs, qui venaient offrir leurs livres embellis de l’autographe sacramentel : hommage de l’auteur.
Puis des peintres, des sculpteurs, des musiciens, qui, pour preuve de leurs talents, remettaient des lettres de recommandation ; des actrices, parfumées de patchouli, tournant sur elles-mêmes avec mille ondulations caressantes, comme des panthères apprivoisées, et ne se retirant qu’après avoir laissé leurs adresses. Des hommes graves, qui apportaient leurs éloges tout faits, et d’autres plus graves encore, qui y joignaient d’utiles diatribes contre leurs adversaires.
Mais la visite qui frappa le plus Maurice, fut celle de Mlle Virginie Spartacus, fondatrice de la société des femmes sages, composée de toutes celles qui n’avaient pu vivre avec leurs maris.
Mlle Spartacus faisait pourtant exception, car, ainsi qu’elle l’avait déclaré elle-même dans son discours d’ouverture, en

Son hostilité contre les hommes était donc libre de tout souvenir personnel ; c’était de la haine métaphysique ; un acharnement vertueux, né des principes et entretenu dans l’intérêt de l’humanité.
Elle venait demander à M. Prétorien l’insertion de plusieurs articles ; car Mlle Spartacus joignait à son titre de fondatrice celui de femme de lettres ; et si elle n’occupait point le premier rang dans la littérature contemporaine, la faute en était aux hommes, ligués contre son sexe. Mais, ainsi qu’elle le faisait remarquer, cette tyrannie touchait à sa fin ; le jour approchait où les maîtres devaient forcément consentir à l’affranchissement des esclaves, et cet affranchissement avait été formulé d’avance par Mlle Virginie ; les droits de la femme étaient aussi simples que clairs ; ils consistaient à n’en point reconnaître aux hommes.
M. Prétorien reçut la reine des insurgeantes avec politesse, mais refusa ses articles, et Mlle Virginie sortit en s’écriant qu’il était temps d’aviser au salut du genre humain.
Lorsque tous les visiteurs se furent enfin retirés, le directeur du Grand Pan vint à M. Atout, les mains tendues et en s’excusant.
— Vous voyez ma vie, dit-il, avec une sorte de dégoût railleur ; elle ressemble à ces arbres plantés sur les grands chemins, et dont chaque passant se croit le droit d’emporter une branche ou une feuille, je n’en puis rien garder pour moi ni pour mes amis.
— Et cependant, fit observer l’académicien, avec un sourire élogieux, vous trouvez moyen de suffire à toutes vos tâches.
— Je viens de m’en imposer une nouvelle, interrompit Prétorien, en se ranimant tout à coup ; une entreprise complètement neuve.
— Encore ?
— Gigantesque ! Du reste, il faut que je vous communique le plan… Asseyez-vous là ; je veux que vous me donniez votre avis.
M. Atout connaissait trop le monde pour ne pas traduire : — Je veux que vous applaudissiez ! Il se résigna donc à l’admiration, bien décidé à se la faire rembourser à la première occasion.
Prétorien, qui avait cherché parmi ses papiers, lui montra le prospectus de sa nouvelle publication. Il s’agissait d’une biographie générale devant comprendre l’histoire publique et privée de tous les citoyens de Sans-Pair !
Le prospectus portait en tête cette maxime philosophique :
Venait ensuite un système de primes si habilement combinées, que l’éditeur remboursait au moins cent vingt fois le prix de chaque souscription ; aussi ne se retirait-il que sur la quantité !
Les privilèges de chaque catégorie étaient, du reste, clairement établis.
Chacun des trente mille premiers souscripteurs avait droit à une calèche ornée de son chiffre et attelée d’un ballon ; c’étaient les demi-fortunes de Sans-Pair.
Les quarante mille souscripteurs suivants devaient obtenir des cartes d’abonnement perpétuel à tous les omnibus de la république, avec correspondance pour les cinq parties du monde.
Enfin, les derniers recevaient tous les matins, à domicile, une tasse de café au lait avec le petit verre de rhum ou de cognac.
Après avoir écouté les détails relatifs à cette entreprise littéraire, et exalté les services qu’elle allait rendre à la civilisation, M. Atout en vint enfin à ce qui l’amenait.
Prétorien tira aussitôt le cordon des sténographes au mot ACADÉMIE, et un papier plié en quatre tomba d’une des bouches de rédaction placées au-dessus de son bureau : c’était le résumé du Mémoire lu par le bibliophile.
M. Atout l’ouvrit et commença à l’examiner avec Maurice, qui l’arrêtait à chaque ligne pour quelque rectification. Prétorien, ravi, déclara qu’il fallait faire un article là-dessus ; cela amènerait du bruit, du scandale, et rien de plus sain pour un journal.
— Ne ménagez pas le bibliophile, ajouta-t-il résolument ; la vérité est toujours bonne à dire, quand elle fait gagner des abonnés. Il a d’ailleurs refusé d’être des nôtres, et qui n’est pas pour nous est contre nous. Il faut noyer dans le ridicule le Mémoire sur les Français du dix-neuvième siècle.
— Hein ? qu’est-ce que j’entends là ? s’écria Blaguefort, dont le visage venait de paraître à la porte entr’ouverte… Un moment, mes petits : peste ! on ne noie pas ainsi la marchandise des amis.
— La marchandise ! répéta Prétorien ; aurais-tu par hasard traité avec le bibliophile ?
— Pour ses cinq Mémoires.
— Tu as signé ?
— Et payé cent vingt mille francs en billets de banque ! Tu comprends qu’on ne peut pas dire de mal d’un livre qui m’a coûté cent vingt mille francs ! et pour lequel je viens faire quatre cents louis d’annonces.
— Diable ! c’est juste, dit Prétorien embarrassé.
— Cependant, objecta M. Atout, je ferai observer que la vérité…
— Est ce qu’elle peut, acheva Prétorien ; les anciens l’avaient eux-mêmes proclamé. Amica veritas, sed magis amicus Blaguefort.
— Ainsi, vous refusez de recevoir les réclamations de mon hôte ? dit l’académicien piqué.
— Par la raison qu’elle me coûterait deux cents louis… et l’amitié de Blaguefort, qui vaut davantage.
— Dix fois davantage ! ajouta le commis voyageur ; je lui paye tous les ans des annonces pour plus de cinquante mille francs.
— Alors M. Maurice verra ailleurs, reprit Atout d’un air composé ; le Grand Pan n’est point le seul organe de la publicité.
— C’est juste, vous pouvez vous adresser au Serpent à sonnettes, dit Prétorien d’un ton railleur.
— Ou au Chacal de l’ouest, ajouta Blaguefort avec indifférence.
— Pourquoi pas au Maringouin ? acheva Atout d’un air de bonhomie.
Le journaliste se mordit les lèvres, et son compagnon parut inquiet. Le Maringouin était un de ces petits journaux que chacun veut lire pour l’amour du mal qu’on y dit des autres ; gamins de la presse, dont vous vous amusez jusqu’à ce qu’ils s’amusent de vous, et qui jettent de la boue à tous ceux qui passent sans craindre les représailles, parce que sur eux la boue ne tache pas. Quelque supérieure que fût sa position dans la presse, Prétorien redoutait le petit journal comme le lion redoute le bourdonnement et la piqûre du moucheron ; quant à Blaquefort, il savait au juste ce que les attaques du Maringouin pouvaient lui enlever d’acheteurs ; aussi prit-il, tout à coup, cette physionomie ouverte des gens d’affaire au moment où ils veulent vous tendre un piège, et passant une main sous le bras de l’académicien qui allait se retirer :
— Nous ne nous séparerons pas ainsi, s’écria-t-il ; non, pardieu ! il ne sera pas dit que les Français du dix-neuvième siècle m’auront brouillé avec le plus illustre écrivain de la république des Intérêts-Unis.
M. Atout voulut protester.
— Avec celui dont la brillante imagination a reculé le domaine de la poésie !…
M. Atout protesta plus fort.
— Avec le génie facile et universel qui nous a assuré la supériorité dans tous les genres.
M. Atout se confondit en protestations.
— Avec le plus grand homme, enfin, de notre époque.
M. Atout serra la main de Blaguefort en affirmant qu’il allait se fâcher.
Celui-ci, qui avait épuisé ses formules d’éloges, parut céder avec peine ; mais, fort de son exorde par insinuation, il commença à effrayer l’académicien sur les suites de la publication annoncée : c’était se faire des ennemis, s’exposer à des représailles, nuire à la considération de cette Académie dont il était le protecteur et la gloire !
Ces raisons étaient fortes, mais on ne renonce point ainsi à l’espoir de rendre un collègue ridicule ; la fraternité des arts descend en droite ligne de celle d’Abel et de Caïn ; Atout résistait et trouvait toujours quelque chose à répondre. Il alléguait l’intérêt de la science, l’intérêt de l’histoire, l’intérêt des principes, enfin, tous les intérêts que l’on cite quand on ne veut rien dire du véritable. Il invoquait surtout les arrêts de sa conscience, idole mystérieuse qui parle ou se tait, selon la volonté du grand prêtre.
Blaguefort, qui était à bout d’éloquence, s’arrêta enfin tout à coup, comme illuminé d’une subite inspiration.
— Je comprends, s’écria-t-il ; vous ne voulez point perdre l’occasion : cette critique de l’ouvrage du bibliophile doit piquer la curiosité ; on peut en vendre autant d’exemplaires que de l’ouvrage lui-même.
— Sinon davantage, ajouta Atout ; puis j’ai d’autres motifs…
— Je sais, je sais, interrompit Blaguefort, la science… les principes… la conscience… eh bien, je vous achète tout !
L’académicien fit un mouvement.
— Cent vingt mille francs pour le livre du bibliophile et cent vingt mille francs pour la réfutation, continua l’homme aux spéculations ; cela arrange tout. Je vendrai d’abord le premier comme un chef-d’œuvre, puis le second pour prouver que c’est une rapsodie. De cette manière, le public aura fait une double étude et moi un double profit. Voyons, c’est convenu, n’est-il pas vrai ? Je vais écrire nos conditions pour éviter tout malentendu.
Blaguefort s’était assis à la table de M. Prétorien, où il rédigea le traité convenu ; M. Atout signa, reçut un billet à ordre, et il allait prendre congé du directeur du Grand Pan lorsque celui-ci, qui se rendait au Musée, proposa d’y conduire les deux ressuscités. Ils acceptèrent avec empressement, et M. Atout se retira seul.
§ XVIII.
En suivant leur guide, Maurice et Marthe passèrent devant un édifice noir gardé par des soldats. Ils l’auraient pris pour une maison de force s’ils n’avaient lu au-dessus de la porte d’entrée :
Ils exprimèrent le désir d’y entrer : mais Prétorien les avertit qu’elle était fermée.
— L’inscription vous a trompés, dit-il en souriant ; à Sans-Pair, une bibliothèque nationale n’est point celle dont le peuple jouit, mais celle qu’il entretient. Il en est pour cela comme de la voie publique toujours barrée par ordre de l’autorité supérieure et que l’on répare perpétuellement de ses réparations. Qu’auriez-vous vu d’ailleurs ? des montagnes de livres superposés au hasard. Le zèle et la science des conservateurs s’évertuent en vain à débrouiller ce chaos. Les fonds dont ils auraient besoin sont absorbés par les gendres et les neveux de députés, qui obtiennent des missions artistiques pour la dégustation des vins de Tokai, l’étude des huîtres d’Ostende, ou l’examen des Circassiennes du Caucase. Voilà trois siècles qu’on travaille au catalogue ; chaque mois on classe cent volumes, et on en reçoit mille qui restent non classés ! C’est une mer dans laquelle se jettent tous les jours de nouveaux fleuves, et que l’on essaye à mettre en bassins avec une coque de noix. Aussi l’édifice eût-il déjà fléchi sous le faix toujours croissant des livres qu’on y entasse, si les rats et les collecteurs ne travaillaient sourdement à son allégement. Du reste, la police la plus rigoureuse est établie à la porte ; on interdit les gros souliers, qui feraient trop de poussière ; les parasols sont sévèrement prohibés, et chacun doit laisser, en entrant, son chapeau au portier. Aussi la bibliothèque de Sans-Pair est-elle partout citée pour modèle, et, sauf les livres, tout y est dans un ordre parfait.
Vis-à-vis la bibliothèque s’étendait un jardin public que Prétorien traversa, et où Maurice put renouveler l’observation qu’il avait déjà faite. Tous les promeneurs se livraient à quelque travail qui utilisait la locomotion. Les uns brodaient en marchant, les autres faisaient de la tapisserie, tressaient des paniers ou fabriquaient des bourses et des faux tours pour les étrennes. Les jeux publics servaient également à la production. Chaque escarpolette mettait en mouvement un pétrin mécanique pour la fabrication des gâteaux ; les chevaux de bois faisaient tourner un moulin à café, et les tirs au pistolet servaient à casser des noisettes.
Maurice remarqua surtout un homme de moyen âge qui avait réussi à rendre sa promenade triplement profitable : il lisait, tricotait et traînait après lui un appareil économique dans lequel cuisait son dîner.
En quittant la promenade, les deux époux se trouvèrent dans un nouveau quartier.
Là, tout avait changé d’aspect. On ne voyait qu’hommes barbus et que femmes échevelées, portant tous les costumes connus, depuis la feuille de figuier de nos premiers pères jusqu’à la robe de chambre du dix-neuvième siècle. M. Prétorien leur apprit que c’était le quartier des artistes.
Leur première et constante préoccupation était celle de ne pas s’habiller comme le bourgeois, de n’avoir pas les mêmes meubles que le bourgeois, de ne pas ressembler au bourgeois ! En conséquence, ils étaient vêtus de toges, de cuirasses, ou de hauts-de-chausses de tricot ; ils marchaient avec des pantoufles de mamamouchi, s’asseyaient sur de grands fauteuils boiteux du temps des croisades, buvaient dans d’anciens hanaps bosselés, et fumaient du tabac de caporal à travers des nargilés de douze pieds. Le tout dans l’intérêt de l’art et par haine pour la bourgeoisie.
Nous avons oublié de dire que la bourgeoisie, c’était tout le monde, excepté eux !
Outre cette grande haine, les artistes de Sans-Pair avaient certains principes qui formaient comme le code de leur association, et que l’on pouvait résumer en six aphorismes :
Article 1er. Le sculpteur trouve que la peinture a cessé d’exister.
Article 2. Le peintre trouve que la sculpture n’existe plus.
Article 3. Peintres et sculpteurs ne reconnaissent de talent qu’aux morts, encore faut-il qu’ils le soient depuis longtemps.
Article 4. La meilleure des républiques est celle où l’on achète le plus de statues et de tableaux.
Article 5. On doit toujours secourir un confrère, mais on n’est jamais tenu de l’admirer.
Article 6. L’artiste a trois ennemis, le marchand de couleurs, le public et son propriétaire.
Prétorien visita d’abord, avec ses compagnons, l’école où l’on envoyait les jeunes gens reconnus propres aux arts. On l’avait ornée de statues ou de tableaux retrouvés dans les ruines de Paris, et qui étaient devenus des chefs-d’œuvre avérés depuis que le temps en avait détruit une partie. Mais le directeur du Grand Pan ne laissa point à Maurice le temps de les voir. Il avait promis de le conduire chez les artistes les plus célèbres de Sans-Pair, et il entra d’abord chez M. Aimé Mignon, peintre de tous les princes, de tous les banquiers et de toutes les jolies femmes de la république.
M. Aimé Mignon était le premier qui eût songé à appliquer au portrait le système de la confection en pacotille. Il avait, pour cela, ramené toutes les physionomies à cinq caractères : le grave, le gai, le sauvage, le voluptueux, l’indifférent, et avait fait peindre, d’avance, une collection de toiles reproduisant ces différents types sans le visage ! Ces toiles étaient exposées dans son atelier avec le prix, calculé en pouces carrés, de sorte que chacun pouvait choisir sa tournure toute faite comme on choisit un habit. Il n’y avait plus que la tête à ajouter ; mais pour celle-ci, M. Aimé Mignon réussissait toujours au gré de l’acheteur. Lui-même développa, sur ce point, son procédé à Maurice.
— La mission du portraitiste, dit-il, n’est point, comme on l’a cru longtemps, de reproduire ce qu’il voit, mais ce qui devrait être. La nature est généralement laide ; notre rôle est de l’embellir ; je dirais même que c’est notre devoir. Car que veulent la plupart des gens qui se font peindre ? acquérir la preuve qu’ils sont plus beaux qu’ils ne le paraissent. Si un portrait ne réussit qu’à reproduire notre laideur, à quoi bon en faire la dépense ? n’est-ce point assez d’avoir la laideur elle-même ? Pensez-vous qu’un bègue payât bien cher pour entendre contrefaire son bégayement ? Le portraitiste a toujours, du reste, un moyen sûr de savoir s’il a réussi : celui qu’il peint se déclare-t-il ressemblant, il faut qu’il efface vite ; se prétend-il flatté, tout est bien ; l’œuvre sera payée sans réclamation et prônée aux amis.
De chez M. Mignon, Marthe et Maurice se rendirent chez le signor Illustrandini, statuaire ordinaire des cinq parties du monde, auxquelles il fournissait indifféremment des Vierges avec ou sans Enfant, des Vénus pudiques ou non pudiques, des Christs morts ou vivants, des martyrs en pied, des païens en gaine et des grands hommes de toutes dimensions. M. Illustrandini avait des carrières de marbre qu’il faisait exploiter, des fonderies toujours en activité, et douze cents jeunes gens qui modelaient et taillaient pour lui.
Prétorien le trouva occupé à expédier soixante colis de saints non canonisés destinés à l’Irlande, et une statue colossale de l’Incrédulité commandée par le club des athées de Boston.
À la vue du journaliste, il s’avança les bras ouverts.
— Le voilà ! s’écria-t-il, notre providence, notre étoile tutélaire, notre soleil ! c’est lui qui a éclairé les ministres.
— Comment ? demanda Prétorien, qui ne parut point comprendre.
— Ne vous rappelez-vous plus ces travaux qu’ils voulaient partager entre plusieurs ? reprit Illustrandini.
— Eh bien ?
— Ils viennent de m’en charger seul.
— Ah ! ils ont enfin cédé, dit le journaliste, avec un mouvement d’orgueil.
— Grâce à vous ! s’écria Illustrandini, en lui prenant les mains ; qui oserait vous résister ? n’êtes-vous pas le roi de l’opinion ? Mais je puis dire qu’en me rendant service, vous n’avez point été non plus inutile à l’art. Je serai digne de vous, maître… d’autant que les premiers prix ont été maintenus… quinze cent mille francs ! Comment ne pas faire un chef-d’œuvre ? Aussi, depuis hier, ma tête est en feu : je vois mes statues ; elles marchent, elles regardent, elles crient…
Illustrandini avait cet enthousiasme mécanique des artistes brouillons qui, au lieu de boire, avec une émotion silencieuse, aux fontaines sacrées, s’y jettent jusqu’au cou avec de grands cris. Quand il parlait d’art, chaque mot avait dans sa bouche le double de syllabes : c’était comme le tonnerre que l’on entend au théâtre, quelque chose de lourd roulant sur quelque chose de creux. Le lourd, c’était la parole, et le creux, l’esprit.
Cependant ces convulsions à froid réussissaient près de tout le monde ; comme Illustrandini manquait de bon sens, on lui avait supposé de l’imagination.
Un riche mariage acheva de le poser dans le monde, il prit équipage, donna des dîners, des bals, et la célébrité de l’amphitryon finit par déteindre sur l’artiste.
Illustrandini l’avait prévu, car c’était, avant tout, un homme d’affaires. Une fois en possession de la vogue, il se mit à l’exploiter avec l’âpreté furieuse des parvenus. Prospectus vivant de son propre mérite, il allait partout se proposant, pressant, sollicitant. Chaque travail confié à un autre était à ses yeux un vol ; il criait à la perte de l’art, déplorait les beaux siècles de Napoléon et de Louis-Philippe, et ameutait contre son rival malencontreux la troupe de ses complaisants et de ses dupes. Pour lui, tout n’était point assez.
Pendant qu’il faisait éclater l’enthousiasme continu qui lui était familier, Prétorien regardait autour de lui avec distraction. Illustrandini s’arrêta tout à coup.
— Ah ! vous contemplez ma Minerve ? s’écria-t-il.
— Une Minerve ! répéta le journaliste, dont les yeux s’arrêtèrent avec hésitation sur un bloc de terre glaise.
— C’est elle ! répéta Illustrandini avec complaisance ; elle est sortie tout armée de mon cerveau comme de celui de Jupiter. Je l’ai modelée dans une telle ardeur, que la terre fumait sous mes doigts.
— Cependant, fit observer Prétorien avec hésitation, il me semble qu’il reste encore beaucoup à faire…
— Pour mes élèves, acheva Illustrandini ; oui, la partie de métier ; les bras, les jambes, le corps ! Mais qu’est-ce que cela quand l’idée a été trouvée ? tout est dans l’idée. La déesse, appuyée d’une main sur sa lance, présente de l’autre une branche d’olivier. Voilà la statue, le reste n’est que du détail et n’a pas besoin du souffle de l’artiste. Revenez dans un mois, le voile qui cache Minerve à vos yeux sera tombé, et vous la verrez dans sa divinité.
Prétorien promit de revenir et se dirigea vers l’atelier de M. Prestet, qui occupait, parmi les peintres, le même rang qu’Illustrandini parmi les sculpteurs.
Seulement le sien n’avait rien de poétique ni de solennel, loin de là ; Prestet chantait les complaintes d’ateliers, cultivait le calembour, donnait du cor de chasse et imitait le cri de toutes sortes d’animaux ; c’était un artiste bon enfant, peignant comme il chassait, comme il jouait au billard, avec une facilité leste et insoucieuse. Aussi essayait-il indifféremment tous les genres ; l’art, pour lui, n’était point une préférence, mais une profession. Il inscrivait sur un livre-journal les commandes qui lui étaient faites et les exécutait par numéro d’ordre. Or, on estimait que, pour y satisfaire, il devrait atteindre l’âge de cent douze ans, et qu’il aurait alors exécuté 745 kilomètres de peinture de tout genre.
Il avait, du reste, réussi à rendre plus rapide le travail des grandes toiles destinées au Panthéon de Sans-Pair, en les peignant sur une locomotive et armé d’une perche à quatre pinceaux. Pour les moindres tableaux, il se contentait d’un appareil ingénieux qui lui permettait d’en exécuter cinq en même temps.
Il reçut nos visiteurs sans se déranger, donnant pour excuse les huit tableaux qu’il devait livrer le soir même, et continua d’en peindre trois, tout en causant.
Maurice voulut connaître ses idées sur la peinture ; M. Preslet les lui indiqua avec son aisance et son aplomb habituels.
— La peinture, dit-il, est l’art de représenter tout ce qu’indiquent les programmes, à la satisfaction du gouvernement et de son auguste famille. On vous ordonne une bataille, vous faites des gens en uniforme qui se battent ; un groupe de nymphes, vous peignez trois femmes peu vêtues ; une machine ingénieuse, vous dessinez un métier d’où sort une paire de chaussettes. Si chacun reconnaît la chose sans inscription, vous pouvez dire comme le vieil Italien : Moi aussi je suis peintre, et la preuve que vous l’êtes, c’est qu’on vous commandera des tableaux. On a parlé de mélodie de tons, de couleurs vibrantes, d’harmonie de lignes ! folie ! toute la peinture se trouve comprise dans un mot : Copier ce qui est, de manière à ce que le ministre des beaux-arts lui-même puisse reconnaître qu’un fagot n’est pas un conseiller d’État ! Tout le reste est de la poésie Grelotin, bon pour Grelotin, digne de Grelotin.
Maurice demanda ce que c’était que Grelotin.
— Un quasi-idiot, qui sert de jouet à nos artistes, répondit Prétorien. Il a étudié l’art vingt ans, et, ne pouvant atteindre à son idéal, il s’est résigné à devenir gardien du Musée, où il continue à étudier son système ; car Grelotin a un système qui ferait infailliblement de lui un grand peintre, ou un grand sculpteur, s’il peignait ou s’il sculptait. Vous pourrez, du reste, l’interroger vous-même quand nous traverserons les galeries.
Ils prirent congé de Prestet et se dirigèrent vers le Musée.
Toutes les écoles, réunies par groupes, comme les différentes familles d’une même race, avaient été entassées dans une seule salle, afin que les autres pussent être réservées à l’art national ; c’est ainsi que l’on désignait, à Sans-Pair, les œuvres d’Illustrandini, de Mignon et de Prestet.
Grelotin se tenait à la porte de l’immense galerie, comme un dragon devant le trésor qu’il garde.
C’était un tout petit homme, mal fait, presque chauve, dont les lèvres étaient agitées d’un tremblement continuel, et qui regardait devant lui avec des yeux doux et à demi égarés.
Prétorien lui présenta Marthe et Maurice comme un couple des vieux siècles ; Grelotin les regarda.
— Vivaient-ils du temps où l’on savait peindre des tableaux qui chantaient ? demanda-t-il avec une curiosité empressée.
Les deux ressuscités regardèrent leur conducteur.
— Oui, oui, reprit Grelotin avec insistance ; il y a eu un temps où la brosse et le ciseau communiquaient une voix mélodieuse à leurs œuvres ; je le sais bien, moi qui les entends ici.
— Vous les entendez ? répéta Marthe étonnée.
— Tous les soirs ! reprit Grelotin ; quand la porte de la galerie est refermée, et que le soleil couchant laisse glisser sur les murs ses grandes lueurs enflammées, vite je cours, là-bas, près des Italiens, et j’entends toutes les toiles qui chantent en chœur sans que leurs accents se confondent. Je reconnais celui de Raphaël, à sa douceur sublime ; celui de Corrége, ample et attendri ; celui du Titien, qui semble vous envelopper ; ceux de Carrache, de Léonard de Vinci, de Guide, de Guerchin, d’André del Sarte, tour à tour fougueux, suaves, expressifs ou caressants. Puis viennent les Flamands, à la mélodie moins céleste, mais plus vibrante ; Rubens, dont la forte voix chante, tour à tour, sur tous les tons ; Vandyck, profond et sombre ; l’harmonieux Jordaëns ; le réjouissant Teniers ; Van-Ostade, Ruysdaël, Berghem, Wouvermans, mêlant leurs agrestes pastorales aux cantilènes de Miéris et de Gérard Dow. Puis c’est le tour des Espagnols, avec Murillo au timbre varié, Riberra le hardi, Velasquèz le chevaleresque, Zurbaran le mystique. Enfin, les vieux peintres français : Poussin, Lesueur, Claude Lorrain, Watteau, Lancret, chœur de voix nobles ou charmantes, que l’on entendrait mieux sans leurs successeurs ; car la peinture française aussi avait perdu l’art. Voyez ces dernières toiles, elles ne chantent plus, elles ne parlent même point, elles ne savent que faire entendre des clameurs discordantes ; on dirait qu’elles luttent à qui poussera le cri le plus aigu. De loin en loin, quelques-unes murmurent encore mélodieusement ; mais au milieu du tumulte, on les distingue à peine, ce sont comme des voix d’anges dans le chaos.
— Heureusement que de ce chaos est sorti un nouveau monde, fit observer Prétorien.
— Oui, dit Grelotin en secouant la tête, un monde muet.
— Comment, notre art national ?…
— A perdu la voix, continua l’idiot tristement. Parcourez ces salles, écoutez ces tableaux et ces statues, vous n’entendrez rien. On croit encore voir l’art, et on n’en a que l’apparence. L’art vivant n’est plus parmi nous ; la toile et le marbre ont cessé de chanter.
Le journaliste éclata de rire et prit congé du gardien : mais Maurice était devenu pensif. De tous ceux qu’il venait d’entendre, Grelotin était le seul qui l’eût touché. Les autres exploitaient l’art ; lui, il le sentait.
§ XIX.
Au sortir du Musée, Prétorien se rappela qu’il devait assister à la première représentation d’un drame dont l’annonce remuait tout Sans-Pair. Il s’agissait d’une pièce intitulée Kléber en Égypte, qui, au dire des initiés, accusait les études historiques les plus profondes. L’auteur avait su ramener ses caractères et ses fables à la simplicité antique du dix-neuvième siècle. Cependant, il n’était arrivé à faire jouer son drame qu’après une série d’épreuves dont le directeur du Grand Pan fit le récit à ses compagnons.
— Autrefois, leur dit-il, dans une représentation scénique, la pièce était l’objet principal ; c’était pour elle que l’on disposait les décorations, les costumes, les acteurs ; on admettait la suprématie de l’esprit sur la matière, la soumission de l’instrument à la musique qu’il devait rendre ; nous avons changé ces trop commodes habitudes. Aujourd’hui, la pièce est l’accessoire ; le directeur l’essaye à ses toiles peintes, l’arrange pour sa troupe. Il la rogne au commencement, l’allonge à la fin, l’élargit au milieu. Chaque comédien, au lieu de représenter un caractère, révèle au public sa propre personnalité ; on ne joue plus de pièces, on joue des acteurs. Le drame de Kléber en Égypte offre, du reste, un exemple éclatant de la souplesse avec laquelle nos auteurs accommodent l’idée à toutes les exigences. La pièce, qui s’appelait d’abord la Jeune esclave, avait été écrite pour les débuts d’une actrice charmante, qui s’est malheureusement trouvée, tout à coup, hors d’état de jouer les vierges. On a alors proposé de lui substituer un amoureux, en prenant pour titre le Jeune esclave ! Ce n’était qu’une modification d’artiste, comme le fit observer spirituellement le directeur (car les directeurs ont de l’esprit depuis qu’ils ne laissent plus les auteurs en avoir) ; mais l’amoureux refusa le rôle à cause du costume, qui ne lui permettait point de porter des bottes à la dragonne. Les bottes à la dragonne étaient sa spécialité et l’origine de tous ses succès ! Un auteur de votre temps eût sans doute renoncé à son œuvre après de tels échecs, mais les nôtres sont plus tenaces. Celui de la pièce nouvelle apprit qu’un célèbre dompteur de bêtes venait d’arriver à Sans-Pair, et son plan fut aussitôt transformé. Il substitua Kléber au grand Sésostris, un aigle chauve au capitaine des gardes, et remplaça l’amoureux par un jeune caïman de la plus haute espérance. C’est lui que nous allons voir. On dit le rôle merveilleusement approprié à ses facultés dramatiques et plein d’effets saisissants. Mais l’heure du spectacle n’est point encore arrivée, et celle du dîner vient de sonner ; entrons au Bœuf de la reine d’Angleterre, c’est un restaurant nouveau établi par notre société, et dont les actions sont déjà de quatre-vingts pour cent au-dessus du pair ; on y accepte tout en payement ; chapeaux-sans bords, breloques de montres, roues de cabriolet. Un pauvre diable peut y échanger ses vieilles bottes contre une côtelette, ou ses bretelles contre un potage ; aussi vous voyez quelle foule. Cependant, les consommateurs qui payent en argent ont une salle particulière et prélèvent les meilleurs morceaux.
Ils entrèrent dans un réfectoire où se dressait une douzaine de tables colossales, sur chacune desquelles étaient servis des animaux tout entiers. Ici, c’était un bœuf couché sur une litière de pommes de terre frites ou de choucroute ; plus loin, des veaux à demi enfoncés dans la gelée, des moutons piqués d’ail, des porcs dorés au feu, des monceaux de poulardes exhalant le parfum de la truffe, et des files de canards nageant dans des rivières de navets ou de pois verts. D’énormes couteaux, mus par la vapeur, procédaient au dépècement de ce festin homérique.
— Vous êtes peut-être surpris d’une pareille exhibition culinaire, dit Prétorien, mais elle a pour but de rassurer contre la fraude des restaurateurs. Ici, chaque convive constate l’identité du nom et de la chose ; ce qu’il mange est bien ce qu’il croit manger ; comme saint Thomas, il peut voir et toucher. Asseyons-nous devant ce bœuf encore intact, auquel les cornes et la peau ont été conservés pour plus d’authenticité, et indiquez vous-même le morceau préféré, il vous sera à l’instant découpé et servi. Quant à la boisson, voyez parmi tous les noms gravés sur les tonneaux, et tournez le robinet de celui que vous aurez choisi.
Les deux époux prirent place à une table défendue, selon la manière anglaise, par des cloisons qui procuraient à chaque consommateur l’agrément de ne pas voir ses voisins et de ne point en être vu. Chacun mangeait comme les chevaux, seul à son râtelier. On n’était jamais exposé à parler à un autre convive, à lui rendre un de ces légers services qui entretiennent la sociabilité entre les hommes ; on était chez soi, avec soi, rien que pour soi !
Du restaurant, Prétorien se rendit au grand théâtre de la république où se donnait la pièce nouvelle.
Le péristyle était décoré des statues de Shakespeare, de Schiller, de Calderon et de Molière, mises sans doute à la porte pour avertir que leur génie n’avait plus de place au dedans. Les arrivants trouvèrent la salle éclairée et déjà garnie de spectateurs. C’était cette foule d’artistes, de gens de lettres, de journalistes, conviés à venir prendre les prémices de toutes les fêtes de l’esprit ou du regard, et n’y venant que pour railler l’amphitryon et le festin ; race blasée, dédaigneuse, qui méprise les plaisirs qu’on lui donne, et qui s’indignerait qu’on les lui refusât.
En traversant un des corridors, Prétorien aperçut un groupe au milieu duquel se trouvait M. Claqueville, assureur de succès en tous genres.
M. Claqueville avait des cheveux blancs, la croix d’honneur, et trois mille six cent quarante-trois médailles reçues de la société des auteurs dramatiques pour autant de pièces sauvées du naufrage. Il était, en outre, l’inventeur d’une multitude de perfectionnements destinés à transformer en chefs-d’œuvre tous les ouvrages assurés par sa maison. Non-seulement il avait des rieurs à gages, des pleureuses patentées et des ouvriers en applaudissement, tous élevés pour ces différentes destinations dans la ménagerie humaine de M. Banqman, mais il entretenait une armée de candataires chargés de figurer de la foule ; huit femmes excellant dans les attaques de nerfs et les évanouissements ; trois vieillards ayant pour spécialité de se faire écraser aux portes des théâtres, afin de prouver l’affluence ; enfin, une escouade de prestidigitateurs chargés d’enlever, dans toutes les poches, les sifflets et les clefs forées.
Au moment où Marthe et Maurice le rencontrèrent, il se trouvait précisément entouré des chefs d’escouade, auxquels il communiquait son ordre du jour.
— Attention sur toute la ligne, s’écriait-il, en levant sa canne comme une épée de commandant ; l’administration a dépensé six cent mille francs, il faut que la pièce fasse l’admiration du ciel et de la terre. Enlevez-moi-la au niveau de la grande pyramide d’Égypte… dont vous verrez la réduction en toile peinte. Il nous faut trois cents représentations, mes agneaux. Les claqueurs qui pourront me montrer des ampoules recevront une gratification, et les pleureuses qui se donneront un rhume de cerveau auront droit à un pourboire. Surtout, soignez les entrées du crocodile, vu qu’il m’a donné des billets.
Prétorien se fit ouvrir une loge d’avant-scène, dans laquelle il avait reconnu madame Facile, en compagnie de MM. Banqman, Ledoux, Blaguefort, et de milord Cant, reconnu à Sans-Pair pour le roi de la fashion.

Milord Cant méritait, à tous égards, cette royauté : il entretenait les plus beaux équipages et les maîtresses les plus dispendieuses, tenait les plus forts paris et se montrait partout où il n’y avait rien d’utile à faire. On eût en vain cherché dans sa vie un trait de dévouement, un élan de sympathie, une heure de nobles efforts. Milord Cant n’avait jamais dévié de cette distinction qui nous fait tirer orgueil du hasard, non de la volonté, de ce qui est en dehors de nous, jamais de nous-mêmes. Pour lui, le but n’était point vivre, mais paraître ; sa loi n’était pas le bien, mais la convenance. Pauvre égoïsme gonflé de vanité, qui jouait dans le monde le rôle de ces colosses brodés d’or que l’on place à la tête des régiments, les jours de revue, pour l’admiration des vieilles femmes et des enfants.
Au moment où Prétorien parut avec ses compagnons, il venait d’approcher de son oreille une petite corne d’ivoire qu’il réussit à y maintenir au moyen d’une contraction particulière. La corne d’ivoire passait à Sans-Pair pour le symbole de la suprême élégance ; elle avait renchéri sur le lorgnon. Après avoir trouvé du bon ton d’être myope, on avait trouvé de meilleur ton d’être sourd. C’était une preuve d’inutilité de plus.
Milord Cant avait, en outre, laissé croître ses ongles, à l’exemple des Chinois, afin de constater son oisiveté. Il portait un vêtement de toile de chanvre, qui, vu la rareté de cette dernière production, était un objet de luxe, et, au lieu de diamants, devenus ridicules depuis qu’on les fabriquait comme du verre, des boutons de pierres à fusil, dont toutes les femmes admiraient la beauté.
Le journaliste et lui se saluèrent comme deux rois, dont l’un a conquis sa couronne et dont l’autre l’a reçue ; Prétorien avec une ironie voilée, milord Cant avec une légèreté un peu dédaigneuse.
Quant à madame Facile, elle parut ravie de voir Marthe et Maurice ; elle les fit asseoir près d’elle, voulut entendre leur histoire, et parut plus émerveillée du souhait qu’ils avaient formé que de le voir accompli.
— Connaître l’avenir du monde ! s’écria-t-elle ; et vous avez, pour cela, franchi tant de siècles ! Que nous importe l’avenir à nous qui n’avons que le présent ? que nous sont les hommes qui viendront après nous ? avons-nous donc d’autre intérêt que ce que nous pouvons voir et sentir ? L’avenir, c’est l’inconnu, et l’inconnu, c’est le vide.
— Non pas pour ceux qui espèrent, dit Maurice. L’inconnu, c’est le champ où sont semés nos rêves, où nous les voyons germer, croître et fleurir. Et qui voudrait vivre sans ce bénéfice de l’incertitude accordée à notre misère ? que serait la vie sans les horizons fuyants et sans les nuées qui embrument son lointain ? Privée de l’inconnu, l’âme serait prisonnière comme le regard qu’arrêtent les murs d’un cachot ; ses ailes oublieraient à voler. Ah ! n’éprouvez-vous donc point cette impatience qui fait regarder par-dessus chaque jour ce qui doit venir ensuite ? n’avez-vous point la soif de connaître, l’aspiration vers l’infini, cette horreur du doute qui crie sans cesse : — En avant ! aimez-vous autant aujourd’hui que demain ? À quoi pensez-vous donc, enfin, quand vous êtes seule et que vous regardez le ciel ?
— À quoi elle pense ? interrompit Banqman, en éclatant de rire ; pardieu ! elle pense au temps qu’il fera.
— Moi, je me rappelle les séances auxquelles je dois me trouver, ajouta Ledoux.
— Moi, les visites à faire, reprit milord Cant.
— Moi, mes échéances, continua Blaguefort.
— Moi, je ne pense à rien, acheva Prétorien.
Maurice les regarda tous avec étonnement.
— Quoi ! pas un rêve ? répéta-t-il ; aucun souci de l’invisible ? Et pourquoi donc vivez-vous alors ?
— Eh ! mais… pour vivre ! répliqua Banqman avec un gros rire.
Et se penchant vers Prétorien :
— Évidemment, votre ressuscité est un peu fou, dit-il à demi-voix.
— Non, répliqua Prétorien sur le même ton ; c’est un enfant !
La conversation fut interrompue par le tintement de la cloche qui annonçait le commencement du spectacle. Chacun prit sa place ; tous les yeux se tournèrent vers la scène ; le rideau se leva !
Ici, nous sommes obligés d’avoir recours à la forme du compte rendu, et de donner à notre récit l’apparence d’un feuilleton du lundi. Que Dieu et nos lecteurs nous le pardonnent !
Le théâtre représente une campagne aux bords du Nil ; vers l’horizon apparaît le Caire, copié sur une vignette anglaise ; à droite se trouve la maison d’Achmet, ancien ministre du Soudan d’Égypte, mais depuis longtemps tombé dans la disgrâce, et qui vient de mourir. Son corps est exposé sur un palanquin, à la porte de sa demeure, et la foule prie autour en silence. Quelques figurantes, pour compléter l’illusion, font le signe de la croix.
On distingue surtout, au milieu d’elles, Astarbé, la fille du défunt, qui tient les bras levés au ciel, tandis que la foule chante en chœur.
Le vertueux Achmet est mort !
Ô Dieu, ta sagesse est profonde !
Sa fille reste seule au monde ;
Sois béni, Dieu prudent et fort.
Quand l’orchestre a fini la ritournelle consacrée à la douleur publique, la foule se retire et laisse Astarbé seule avec un étranger qui, depuis quelques jours, est l’hôte de son père.
Il vient annoncer à l’orpheline son départ !… À cette nouvelle, celle-ci ne peut retenir ses larmes ; l’étranger s’écrie :
Astarbé baisse les yeux et ne répond rien. Son interlocuteur, qui connaît le proverbe, lui propose aussitôt de partir avec lui. Astarbé, qui ne veut pas être en reste de politesse, l’engage, de son côté, à rester avec elle ; mais, à cette demande, l’inconnu regarde de tous côtés pour s’assurer qu’il ne peut être entendu que par les dix mille spectateurs ; il prend Astarbé à part et lui dit :
Écoute… mais toi seule, enfant… Je t’ai trompée !
Mon costume est d’emprunt, mon nom n’est pas le mien.
Achève !
Eh bien, je ne… suis point Égyptien !
Ô ciel !
Je suis Français !
Qu’Osiris nous assiste !
Et quel est donc alors votre nom ?
Jean-Baptiste
Kléber !…
Astarbé, d’abord saisie, s’abandonne ensuite à la joie d’être aimée par le général en chef de l’armée française. Celui-ci ne s’était rendu près du Caire que pour étudier les forces du soudan ; mais maintenant, sa mission est terminée et il doit retourner vers ses soldats. Astarbé consent à le suivre, pourvu qu’un marabout du voisinage bénisse leur union. Kléber, dont la tolérance s’étend aux curés de toutes les nations, accepte le marabout, et il sort pour l’avertir lui-même.
Astarbé, restée seule, se livre à une joie entrecoupée de mélancolie ; elle prend congé de tout ce qui l’environne :
Adieu, toit paternel, terre des brunes filles ;
Fleuve aux flots limoneux musqués de crocodiles ;
Horizon hérissé d’obélisques pierreux,
Que l’on prendrait de loin pour les jambes des cieux ;
Bœufs que l’on mange ailleurs et qu’ici l’on adore ;
Sphinx dont le front coiffé se couronne d’aurore ;
Ibis aux becs pensifs, symboliques lotus ;
Légumes trois fois saints, plus saint papyrius ;
Noble roseau du Nil, dont l’enveloppe frêle
Fixe cet alphabet que notre enfance épèle.
Et toi, père embaumé qu’attend le jugement,
Heureuse de vous fuir, je vous quitte en pleurant ;
Et cependant, où vit Kléber, rien ne me pèse ;
Quand le cœur est français, l’âme est bientôt française !
Puis, entendant tout à coup un frémissement parmi les buissons de la rive, elle se rappelle le nourrisson amphibie apprivoisé par ses soins, et elle s’écrie :
C’est lui, le caïman pour moi devenu doux.
Qu’attirent ma voix et ce plat de couscoussous.
Ici, tous les cuivres de l’orchestre font entendre un forté, le tam-tam déchire l’air, et la tête du crocodile paraît entre deux touffes de roseaux en fer-blanc.
Son entrée est saluée par d’unanimes applaudissements.
L’animal appuie ses courtes pattes sur la planche peinte qui représente les bords du Nil, s’élance lourdement sur le théâtre, court à la pâtée que lui présente Astarbé, l’engloutit en un instant, puis se laisse aller amoureusement sur le dos, et frotte sa tête écailleuse contre les pieds de la jeune fille.
On applaudit de nouveau, et Astarbé commence les exercices innocents qu’elle a enseignés à Moïse : c’est le nom de son crocodile.
D’abord elle lui fait jouer aux osselets, puis sauter à travers un cerceau, puis danser une polonaise.
Un grand bruit, qui se fait entendre derrière la scène, met fin à ces plaisirs. Moïse rentre dans son Nil de carton, et Astarbé, effrayée, remonte vers le fond du théâtre en annonçant le soudan.
Il arrive en effet avec ses gardes et suivi de la foule, qui paraît toujours quand il y a des chœurs. Les gardes chantent :
Voici notre maître suprême,
Ne craignez rien, il veut qu’on l’aime.
Allah ! Allah ! Dieu seul est grand,
Et son prophète est le soudan.
Mais la foule varie ingénieusement ce refrain en répétant d’un ton sournois.
Voici le maître dur et blême,
Puisqu’on le craint, il faut qu’on l’aime.
Allah ! Allah ! Dieu est grand,
Mais prenez bien garde au soudan !
Le chœur fini, le prince fait retirer tout le monde, sauf Astarbé, à qui il déclare qu’il l’a aperçue au bain, il y a trois jours, qu’il en est, en conséquence, tombé amoureux, et qu’il est décidé à en faire sa cinq cent quatre-vingt-douzième femme.
Astarbé épouvantée répond que la chose est impossible ; le roi veut l’entraîner de force ; mais Kléber arrive avec le peuple, qui s’est rassemblé pour le jugement des morts, auquel doit être soumis Achmet avant d’obtenir les honneurs de la sépulture. Le soudan, qui a trop peu de gardes pour faire un coup d’État, feint de se soumettre à la loi ; mais au moment où l’on va accorder une tombe au père d’Astarbé, il présente le titre d’une amende que l’ancien ministre n’a pu lui solder, et réclame, selon l’habitude, son corps pour gage !
Astarbé se jette en vain à ses pieds, en le suppliant de ne point exposer l’ombre du vieillard à errer sans asile sur les sombres bords : le soudan répond par ce vers invincible :
Et il se prépare à faire enlever le corps d’Achmet.
Mais Kléber, touché du désespoir de la jeune fille, saisit un des chevaux du roi, puis, s’élançant avec Astarbé dans ses bras, il pique le coursier de ses deux talons et disparaît au galop, suivi de Moïse emportant le corps d’Achmet.
Stupéfaction obligée.
— Courez ! ramenez-le ! s’écrie le soudan quand il a disparu. L’orchestre joue un air annoncé comme égyptien, et dans lequel Maurice reconnaît celui de va-t’en voir s’ils viennent, Jean.
Le lieu de la scène change. On voit des sables faits de paille hachée qui tournoient ; deux autruches apprivoisées qui se promènent d’un air ennuyé ; des gazelles qui courent après des biscuits, et une pyramide au fond : c’est le désert.
Kléber et Astarbé, et le vieux Achmet, qui, en sa qualité de mort embaumé, joue un personnage muet, arrivent sur leur coursier qui boite. Tous trois succombent à la fatigue. Ils s’arrêtent, et Astarbé, prise d’une sorte de délire, se met à murmurer :
Pourquoi nous reposer, quand là-bas, près du puits,
Je vois l’ombrage frais des grands palmiers, et puis
La maison où l’on donne aux hôtes sans monnaie
Des riz au lait sucrés qu’un remercîment paye ;
Où la femme modeste, en gardant la maison,
Fait le bonheur d’un homme et file du coton
Astarbé ! que dis-tu ? Dieu ! regarde ! l’espace
Est brûlant !
Je voudrais un sorbet à la glace !
N’entends-tu pas venir le Simoun destructeur ?
Je voudrais une rose à mettre sur mon cœur.
Kléber s’efforce de gagner l’ombre de la grande pyramide ; mais la trombe de paille hachée atteint le cheval, l’emporte et laisse à pied le mort et les vivants.
Kléber, au désespoir, appelle son armée. Il énumère ses exploits, ce qui est toujours agréable pour un militaire, et ne s’arrête qu’à un bruit de chevaux ; il en conclut que ce sont ses braves dromadaires qui l’ont entendu, et il fait un mouvement de joie ; mais il reconnaît, presque aussitôt, le soudan et sa cavalerie. On le somme de se rendre ; il refuse et va périr avec sa femme, lorsque le Nil, qui est arrivé à son quantième du mois, déborde à propos et noie les gardes du tyran !
Kléber saisit Astarbé évanouie, monte avec elle au haut de la grande pyramide, et, près de disparaître dans les caveaux funèbres, s’écrie :
Enfin je l’ai sauvée.
Ah ! mon père ! mon père !
S’il est perdu, je veux mourir !
Ô sort prospère !
Voyez, Moïse, là, nous l’apporte en nageant.
Ah ! je veux croire au Dieu qui fit le caïman !
Tableau final composé de la pyramide, de Kléber, d’Astarbé et du crocodile. Musique douce, imitant une inondation ; la toile se baisse.
Nous sommes dans l’intérieur de la grande pyramide ; Achmet a trouvé sa place au milieu des illustres momies qui la peuplent ; il ne reste plus dans l’embarras que les vivants.
Cependant Astarbé,
nourrit fort bien son général en chef, grâce à Moïse, qui lui apporte chaque jour sa pêche et sa chasse. Mais, malgré tout, Kléber maigrit, et, comme la jeune fille s’en étonne et dit en pleurant :
le Français répond :
Au même instant arrive le crocodile avec différentes provisions, parmi lesquelles se trouve une bouteille de bordeaux. Mais elle ne contient que des papiers jetés à la mer par un vaisseau français au moment du naufrage. Le général y voit que l’armée le croit mort et songe à se rembarquer ; cette nouvelle le jette dans un transport de douleur et de rage.
Où sont mes bataillons, gloires numérotées,
Dont la poudre a rongé les pipes culottées !
Que fais-tu, vieux soldat qui reçois sans regret
Le temps comme il te vient, la soupe comme elle est ?
Noble simplicité des grands temps homériques,
Où l’on mangeait des bœufs embrochés dans des piques !
Ah ! je veux (mes efforts me fussent-ils mortels !)
À la nage arriver jusqu’à mes colonels !
Astarbé cherche en vain à calmer ce désespoir. Voyant Kléber décidé à partir :
elle se rappelle divers souterrains qui font communiquer les pyramides avec les bords de la mer, mais elle les cherche en vain ; enfin, à bout d’espérance, elle s’adresse aux restes de son père, qui connaissait les issues.
Le mort, s’entendant appeler, ouvre lentement sa boîte à momie, montre la porte secrète, puis rentre chez lui.
Astarbé et Kléber se précipitent dans le souterrain, précédés du caïman, qui remue la queue en signe de joie.
Le spectateur aperçoit un lieu enchanteur avec la mer au fond, et une île inaccessible dans le lointain. Le soudan est accroupi à la turque sous un bosquet de palmiers, et ses esclaves cherchent en vain à le distraire. On lui sert des confitures de toutes espèces et il ne mange pas ; on lui chante des chansons dans tous les tons et il n’écoute pas ; on lui présente des odalisques de toutes couleurs et il ne regarde pas.
Un officier arrive avec des dépêches relatives à l’armée française ; le Soudan les pose sur son plateau à confitures sans les lire ; enfin, un Éthiopien se présente avec un grand aigle chauve qui a fait l’admiration de toutes les têtes couronnées de l’Afrique, et qu’il vient offrir en présent.
Outre plusieurs autres talents de société, le grand aigle sait porter les lettres, tourner la broche et pêcher à la ligne.
Après avoir suivi ses exercices d’un regard distrait, le soudan jette une bourse d’or à l’Éthiopien, renvoie tout le monde, et, resté seul, tire de son sein une pantoufle qu’il baise avec délire.
Cette pantoufle a été trouvée par lui le jour où il a aperçu Astarbé au bain ; elle appartient à la fille d’Achmet, et sa vue entretient l’amour du soudan.
Après l’avoir longtemps contemplée, il la pose près de lui, prend sa guitare et chante les paroles suivantes sur un air copte, autrefois composé par Mlle Loïsa Puget.
Ô babouche trop connue !
Là je te vois étendue
À mes pieds
Repliés ;
Mais si c’était ta maîtresse,
Que serait-ce ? que serait-ce ?
Babouche, quand je te baise,
J’ai dans l’âme une fournaise !
Dans mes sens,
Des volcans !
Mais si c’était ta maîtresse !
Que serait-ce ? que serait-ce ?
Mais quelque jour, ma charmante
Pour compenser tant d’attente,
Tant d’ennuis,
Si je puis
Voir Astarbé face à face,
Que sera-ce ? que sera-ce ?.
Ici, le chant copte avec accompagnement de guitare fait son effet,  et le soudan s’endort. L’orchestre joue en sourdine pour le bercer, et l’on voit bientôt paraître Kléber conduisant Astarbé, à qui Moïse sert de monture.
et le soudan s’endort. L’orchestre joue en sourdine pour le bercer, et l’on voit bientôt paraître Kléber conduisant Astarbé, à qui Moïse sert de monture.
Tous trois, séduits par la beauté du lieu, vont se reposer, lorsqu’ils aperçoivent le soudan ! Moïse, qui, en sa qualité de crocodile, est quelque peu vorace, ouvre déjà la gueule pour l’engloutir, mais Kléber s’y oppose et s’écrie :
Arrêtez ! le Français combat ses ennemis,
Mais il ne mange point les soudans endormis !
Il permet seulement à Astarbé de reprendre la babouche, tandis que de son côté il saisit les dépêches.
Moïse, à qui on refuse le dormeur pour son déjeuner, s’en dédommage, le mieux qu’il peut, en dévorant d’abord les confitures, puis le plateau.
Mais le général, qui a ouvert les papiers, vient d’apprendre que l’armée française est à quelques lieues. Au comble de la joie, il s’écrie :
Je reviens, je reviens partager vos misères !
Accourez, grenadiers, chasseurs et dromadaires.
Ni les dromadaires, ni les chasseurs n’accourent ; mais le soudan se réveille, ses gardes arrivent, on entoure Kléber, qui met l’épée à la main et qui, pour exciter Moïse à faire son devoir, lui montre la pyramide que l’on aperçoit à l’horizon en disant :
Le caïman, jaloux de donner à de tels spectateurs une haute opinion de sa personne, fait des prodiges de courage. De son côté, Kléber repousse tous les assaillants. Mais l’aigle chauve, qui a tout vu, prend son vol, plane un instant au-dessus de sa tête, puis, plongeant avec un cri sauvage, saisit son épée et l’emporte ; les Égyptiens se précipitent sur leur ennemi désarmé.
Moïse, qui se trouve alors seul contre tous, recule jusqu’à la mer et s’y jette à la nage, en emportant Astarbé, avec laquelle il aborde à l’île que l’on aperçoit vers le fond.
Le soudan ordonne de les poursuivre, mais on lui répond qu’il n’y a point de barque. Il fait un geste de désespoir.
Se peut-il ? nul moyen d’arriver par la mer !
Que faire alors ?
Il reste pensif. Tout à coup, l’aigle reparaît, tenant l’épée de Kléber, qu’il laisse tomber aux pieds du soudan. Celui-ci, frappé d’une subite inspiration, s’écrie :
Ah ! lui peut arriver par l’air !
L’aigle bat des ailes, les gardes agitent leurs épées ; chœur final.
On voit un rocher couvert de grands nids ; c’est la ville natale de Moïse, la capitale des crocodiles.
Ceux-ci s’agitent autour de leurs demeures et vaquent à leurs devoirs domestiques. Les mères soignent leurs petits, les pères de famille partent pour la pêche ou la chasse. Les jeunes caïmans entraînent à l’écart les jeunes caïmanes. Telle est la perfection de la mise en scène, que l’on croirait voir un peuple civilisé.
Séparée de tout ce mouvement, Astarbé se tient mélancoliquement assise aux bords du rocher. Moïse vient de la quitter pour quelques visites de famille. Elle pense à son époux, dont elle tient la miniature, et, après avoir versé un torrent de larmes et de vers, elle s’enveloppe dans son burnous en déclarant que,
L’aigle chauve paraît alors dans les nuages, descend lentement, saisit, dans ses serres, les quatre coins du burnous et emporte la jeune fille à travers les airs !
Moïse, qui arrive dans ce moment, s’élève en vain sur sa queue en tendant vers elle des pattes éplorées ; Astarbé disparaît dans les nuages !
Ici commence un monologue pantomime du caïman qui exprime sa douleur par tous les moyens à son usage : il pousse des gémissements, saisit sa tête à deux pattes, comme s’il voulait s’arracher les cheveux, se roule à terre, où il reste enfin suffoqué de douleur.
Mais il est arraché à cette espèce d’évanouissement par le bruit du tambour : c’est l’armée française qui vient de débarquer à l’île des caïmans.
On voit bientôt arriver l’avant-garde, tambour-major en tête. Le crocodile court à sa rencontre, et, par ses gestes, il engage les soldats à le suivre pour délivrer leur général. Mais les Français, qui ne comprennent point son langage, et que l’expérience a rendus défiants à l’endroit des crocodiles, croisent la baïonnette. Moïse, désespéré, veut s’échapper, on en conclut que c’est un traître, et il est arrêté. Au même instant, un officier aperçoit la miniature échappée aux mains d’Astarbé et dit :
Le portrait de Kléber !… plus de doute possible.
Ce monstre a dévoré notre chef invincible.
Les soldats, furieux, poussent des cris de mort, et Moïse est emmené pour être fusillé.
Sortie militaire sur l’air : On va lui percer le flanc.
Nous sommes dans le palais du soudan ; Kléber est enfermé dans un cachot donnant sur le fleuve, et travaille à un ballon qui doit assurer sa délivrance.
Au milieu de beaucoup de réflexions personnelles, cette fabrication lui inspire une réflexion générale.
De la science humaine, admirable influence !
Le barbare ignorant me croit en sa puissance,
Mais l’art de Montgolfier se rit d’un tyran vil ;
Quelque rusé qu’il soit, le gaz est plus subtil.
Il est interrompu dans l’expression de ces vérités physiques par le bruit du canon; il tressaille, il a reconnu le canon français,
Le soudan arrive en effet tout troublé; la ville est assiégée et va être prise si Kléber n’ordonne à son armée de se retirer. Kléber refuse, malgré les menaces de mort du Soudan ; mais au milieu de leurs débats arrive le grand aigle chauve, qui dépose à leurs pieds Astarbé, toujours dans son burnous !
La fille d’Achmet s’élance dans les bras du général français, et déclare qu’elle veut mourir avec lui. La querelle recommence et s’envenime ; on en vient à se tutoyer.
Tremble !
dit Kléber ;
Tremble !
ajoute Astarbé ;
Tremblez !
répond le soudan.
Et comme on vient l’avertir que les Français sont déjà maîtres de la ville, il tire son épée pour frapper les deux amants. Alors Kléber court à la fenêtre de la prison, arrache un des barreaux de fer, et tous les Égyptiens prennent la fuite.
Mais à travers le guichet de la porte refermée, le soudan lui répète son terrible :
Tremblez !
et ajoute, en s’adressant à ses esclaves :
Ni pitié ni pardon ! Les serpents !
Et les esclaves répondent d’un seul cri :
Les serpents !
Astarbé, épouvantée, se réfugie dans les bras de Kléber, qui regarde autour de lui en frissonnant… L’orchestre joue une marche avec triangle et bonnet chinois ; on entend comme un sourd cliquetis d’écailles, puis on voit une trappe se soulever au fond, et deux monstrueux boas dresser leurs têtes.
Les amants sont restés à la même place, glacés, muets, une main tendue vers les reptiles. Ceux-ci se déroulent lentement, s’avancent de front.
Un souvenir traverse la pensée de Kléber. Il court à son ballon, l’approche de la fenêtre, fait entrer Astarbé dans la nacelle… mais il est déjà trop tard ; les boas ne sont plus qu’à quelques pas ; encore un élan, et ils atteignent leur proie. Tous deux font entendre un sifflement de joie ! quand un hurlement terrible leur répond !
Les deux serpents s’arrêtent ; Moïse vient de paraître à la fenêtre du cachot et se précipite à leur rencontre.
Ils reculent lentement, comme étonnés et incertains. Kléber profite de cette retraite pour entrer à son tour dans la nacelle, et le ballon disparaît.
Cependant les boas ont déjà repris courage ; ils se retournent, et un combat terrible s’engage. Moïse lutte d’abord avec avantage ; deux fois il se dégage des replis de ses ennemis, deux fois il les oblige à reculer ; enfin, ses forces s’épuisent ! enserré de nouveau dans leurs anneaux, il se débat plus faiblement, pousse une plainte sourde et tombe expirant.
Les boas, victorieux, font entendre un sifflement de triomphe et regagnent leur retraite.
Au même instant, un grand bruit de pas et d’armes retentit : Astarbé reparaît avec Kléber à la tête des soldats français ; mais ils arrivent trop tard ; le crocodile ne peut que se soulever, poser une patte sur son cœur, puis il expire !
À cette vue, Astarbé s’évanouit de douleur, le général reste atterré, et chaque grenadier essuie une larme.
Enfin, Kléber reprend le premier ses sens. Il arrache la croix d’honneur qu’il porte à la boutonnière, et, la posant sur le cadavre de Moïse, il dit avec une émotion profonde :
Sauvage enfant du Nil, ah ! garde sur ton cœur
Ce prix du dévoûment, étoile de l’honneur.
Homme ou bête, qu’importe alors que l’on repose ?
C’est l’âme qui fait tout, l’espèce est peu de chose !
Le succès fut immense ; on redemanda le crocodile, qui reparut, fit trois saluts et se retira couvert de bouquets de fleurs.
Vous verrez que la pièce aura trois cents représentations, dit Mme Facile ; les journalistes eux-mêmes en diront du bien, parce qu’elle est jouée par des bêtes, et que les bêtes ne s’inquiètent pas du mal que l’on pourrait dire d’elles. Puis, c’est l’ouvrage d’un auteur inconnu, et vous ne sauriez croire tout ce qu’il y a de recommandation dans ce mot. L’écrivain déjà célèbre n’est point seulement odieux à ceux qui sont arrivés comme lui, mais encore à ceux qui sont en chemin : pour les premiers, c’est un rival ; pour les seconds, un premier occupant ; pour tous, un ennemi naturel. L’auteur ignoré, au contraire, n’inspire ni crainte, ni jalousie ; les candidats à la célébrité l’applaudissent comme un des leurs, et chaque grand homme l’encourage dans l’espoir qu’il usurpera la place d’un de ses voisins de gloire. On s’arme de sa réussite contre ceux qui ont réussi avant lui ; on élève jusqu’aux toits le bout de la planche où il vient de s’asseoir, afin de faire descendre l’autre bout jusqu’au ruisseau. Il est si doux de dire du bien d’un confrère, quand cela donne occasion de dire du mal de plusieurs autres ! Les inconnus sont presque des morts, et vous savez comme nous aimons les morts !… en haine des vivants ! On va faire de l’auteur de Kléber un génie, rien que pour avoir le plaisir de traiter ses prédécesseurs d’imbéciles.
— Il y a encore une autre cause, objecta Prétorien ; le nouveau poête est connu de nous tous ; il nous a consulté sur chaque scène ; il nous a égrené ses vers distique à distique ; nous avons tous, dans son drame, quelque chose qui nous appartient ou que nous croyons nous appartenir, et cette chose est nécessairement admirable. Aussi soutiendrons-nous l’œuvre en indivis. C’est une sorte d’engagement tacite pris d’avance par chacun. La plupart des auteurs viennent nous présenter leur inspiration comme une inconnue subitement offerte à notre admiration, et nous nous tenons en défiance, nous examinons en détail, nous jugeons avec sévérité. Ici, rien de tout cela ; la muse qui a dicté Kléber est une bonne fille qui a dormi sur notre oreiller, et à laquelle nous n’avons rien à refuser, car pour admirer, applaudir une inspiration ou une femme, le principal n’est point qu’elle soit belle, mais qu’elle soit un peu à nous.
— Voilà une explication singulièrement impertinente pour les pauvres admirées, interrompit Mme Facile.
— Pourquoi cela ? reprit Prétorien ; ne savez-vous point qu’être à nous veut dire régner sur nous ?
— Quelle plaisanterie !
— Essayez, je m’offre pour l’expérience.
— Et que dirait la reine de votre destinée ?
— Elle dirait, comme tout le monde, que rien ne peut vous résister.
— Raison de plus pour que je puisse résister à tout.
— Ah ! vous croyez tout arranger avec de l’esprit ?
— N’est-ce point votre monnaie ?
— J’ai depuis longtemps mangé mon fonds.
— Alors, je vous offre à souper !
— Ce soir ?
— Oui, avec ces messieurs ; et j’espère que nos ressuscités en seront : il y aura pour divertissement une séance de la société des femmes sages. Mlle Spartacus doit parler ; venez, ce sera la petite pièce après le drame.
Prétorien accepta pour lui et ses compagnons, et tous prirent le chemin du logis de Mme Facile.

§ XX.
L’habitation de Mme Facile passait pour le plus beau palais de Sans-Pair. Elle était le résultat d’une sorte de rivalité galante établie entre les principaux membres du gouvernement. Le ministre des travaux publics l’avait fait construire avec les démolitions d’une ancienne église de la Vierge ; le directeur des beaux-arts l’avait ornée de tableaux et de statues payés par le budget ; l’inspecteur de la librairie y avait formé une bibliothèque des ouvrages destinés aux dépôts publics : le conservateur des haras avait garni ses écuries des plus beaux étalons achetés pour l’amélioration de la race chevaline ; enfin, le ministre des cultes lui-même avait enrichi sa chapelle d’un dessus d’autel complet.
Mme Facile reconnaissait tous ces dons par quelques services : elle faisait des cavalcades avec le donneur de chevaux, obtenait des missions pour l’inspecteur de livres, recevait les femmes recommandées par le ministre des arts, et gagnait des voix au ministère.
Elle avait, de plus, des amis dans toutes les classes et dans tous les partis, ce qui la mettait à l’abri des récriminations. Sa maison, ouverte à quiconque voulait y entrer, était une sorte de terrain neutre où les adversaires se rencontraient. Toute autre préoccupation que celle du plaisir était laissée à la porte. Là, chacun y raillait les sentiments qu’il montrait ailleurs, et riait librement des autres et de lui-même. On eût dit les coulisses d’un théâtre où les acteurs parodiaient leurs propres rôles. C’était là que la génération nouvelle de Sans-Pair apprenait ce ricanement sceptique, bise glacée qui siffle à travers les moissons fleuries de la jeunesse ; là que l’ironie arrêtait successivement dans leur vol les enthousiasmes naïfs, les ardentes croyances, les espoirs fugitifs, les illusions changeantes, pauvres papillons aux éblouissantes couleurs, qu’elle perce, en riant, de son épingle d’acier, et dont elle expose les convulsions aux moqueries de la foule. L’indifférence du bien et du mal était appelée bon sens, l’égoïsme esprit de conduite, le mépris des hommes expérience. On y regardait la science de la corruption comme la science de la vie ; on ne proposait plus d’élever un gibet pour les Christs, mais on leur donnait pour sceptre la marotte et pour couronne le bonnet orné de grelots. Car le sublime avait même cessé d’exciter la colère, on ne le comprenait point et on en riait.
Maurice arriva quelques instants après Mme Facile et trouva une société nombreuse.
Outre ceux qu’il connaissait déjà, Prétorien lui montra un certain nombre d’hommes célèbres en politique ou dans les arts, pour avoir fait quelque chose, et un plus grand nombre connus dans le monde élégant parce qu’ils ne faisaient rien.
Maurice remarqua surtout, parmi les premiers, un homme maigre et à l’air ennuyé, qui parlait à tout le monde avec une familiarité nonchalante.
— C’est, M. Mauvais, notre grand critique, lui dit Prétorien ; voyant qu’il ne pouvait produire, il s’est mis à déchirer les productions contemporaines comme ces femmes qui, parce qu’elles sont restées stériles, trouvent insupportables les enfants des autres. Tant qu’il n’a été recommandé que par son talent, on ne prenait point garde à lui ; il a eu alors recours à la méchanceté, et c’est aujourd’hui un homme célèbre. Rien de plus simple, du reste, que son procédé de critique. Il consiste à ramener trois ou quatre grands noms qu’il oppose perpétuellement aux nouveaux. Entre ses mains, chaque gloire ancienne devient une coupe de ciguë avec laquelle il empoisonne les gloires présentes. Il oppose à tout livre récent une théorie transcendante qui le condamne d’autant plus sûrement qu’il l’a inventée précisément pour cela. Le moyen ne lui en a pas moins réussi, non près du public, qui s’inquiète médiocrement de ses arrêts, mais près des condamnés, qui s’en indignent et les désirent ; car il y a toujours un peu de la femme dans l’artiste. Mieux vaut qu’on parle de lui pour en médire que de se taire. Nos écrivains ressemblent aux marquises du dix-huitième siècle, qui tenaient à honneur d’être déshonorées par Richelieu : c’est à qui subira les rigueurs de maître Mauvais ; on fait queue pour être étranglé par lui.
— Et c’est le seul aristarque contemporain ?
— Nous avons encore ce petit homme jovial et remuant qui s’est fait le Triboulet du public et tâche d’amuser son maître par des épigrammes ou des scandales. Ce métier lui a valu une réputation assaisonnée de quelques coups de canne, qu’il a acceptés comme appoints naturels. Il est même devenu chef d’école, et à son ombre s’est formée une phalange de bouffons quotidiens qui, n’ayant point assez d’esprit pour savoir louer, ont pris le parti de railler toute chose. Ces fonctions d’exécuteur des hautes œuvres de la pensée leur donnent une sorte de valeur ; l’homme qui tient la corde n’est jamais un homme ordinaire aux yeux de ceux qui peuvent être pendus. On les flatte, on les apprivoise, et ils deviennent célèbres, à force de mauvais vouloir et de mauvaise foi, comme d’autres à force de mérite.
— Et n’avez-vous point d’exceptions ?
— Elles sont rares, mais elles existent. Nous avons encore quelques juges équitables qui traitent l’art comme une fleur dont on respire le parfum, et non comme une proie que l’on égorge pour en vivre. Ceux-là sont les grands esprits et les nobles cœurs ; mais nous y avons rarement recours. Un journal n’est qu’un restaurant ouvert aux appétits intellectuels de la foule, et celle-ci ne demande pas tant des mets sains que des mets épicés.
Des critiques, Prétorien passa aux lions, qui étaient en grand nombre chez Mme Facile. Chacun d’eux avait une spécialité qui le recommandait dans le monde élégant. C’était ou le jeu, ou les meutes, ou les chevaux, ou les maîtresses. Ce qui, du reste, ne les empêchait pas d’avoir des occupations sérieuses, telles que la savatte, le bâton et l’entraînement des chevaux.
Maurice en remarqua un auquel tout le monde semblait témoigner une déférence particulière.
— C’est le comte de Mortifer, dit le journaliste ; le plus redoutable spadassin de toute la république. Il tue presque toujours son adversaire, aussi a-t-on pour lui une haute considération. On lui passe ses impertinences, et l’on souffre ses sottises sans avoir l’air d’y prendre garde, de peur qu’il ne vous en demande raison.
Dans ce moment, le comte se détourna et vint à la rencontre de Prétorien.
— Eh bien, vous savez la nouvelle ? dit-il sans saluer ; ce drôle de Format vient de présenter à la chambre une proposition de loi contre les duels !
— C’est une précaution personnelle, fit observer le journaliste.
— Moi, je dis que c’est une insulte, reprit Mortifer, qui serrait les lèvres ; la proposition est évidemment dirigée contre moi, et je pourrais demander raison…
— À un procureur ? il vous répondra par une fin de non-recevoir.
— Et vous laisserez passer une pareille loi ? continua le comte en s’adressant à Banqman, qui venait de s’approcher ; une loi condamnant à l’amende quiconque tue un homme !
— Avez-vous peur d’être ruiné ? demanda l’industriel en riant.
— Eh morbleu ! qui sait ? reprit Mortifer évidemment flatté ; quand on est un peu chatouilleux sur le point d’honneur… Je me suis battu soixante-quatre fois, monsieur.
— Diable !
— Et j’ai tué trente-deux de mes adversaires.
— C’est-à-dire que vous vous êtes arrangé à cinquante pour cent ? dit Banqman avec la même gaieté aimable.
— Et un cuistre de Format prétendrait m’ôter la liberté de continuer ? reprit le comte indigné ; non, cela ne sera pas ! Le duel est la dernière sauvegarde de la morale et de l’honneur. Sans lui, tous les gens qui ne savent point manier une épée nous diraient effrontément en face ce qu’ils pensent. Il suffirait d’avoir raison pour oser élever la voix. Nous ne souffrirons point une pareille honte ! Le seul moyen d’entretenir la politesse, la justice et la loyauté parmi les bourgeois, est de laisser le droit à quiconque se dira offensé de leur envoyer une balle dans la mâchoire, ou de leur percer la peau.
À ces mots, prononcés d’un air profond, Mortifer tourna sur ses talons et aborda un autre groupe.
— Vous venez d’entendre l’opinion de ceux qui s’appellent eux-mêmes les hommes de cœur, dit Prétorien à son compagnon ; les percements de peau et les brisements de mâchoire leur sourient d’autant plus qu’ils comptent bien en garder le monopole. Ils prouvent la nécessité du duel pour punir les crimes que la loi n’atteint pas, sans ajouter que, dans cette justice de hasard, c’est souvent l’offensé qui meurt et le coupable qui triomphe. Ils le signalent comme une garantie contre l’insolence des lâches, mais ils ne disent pas que c’est en même temps un auxiliaire pour celle des spadassins.

On vint annoncer que le dîner était servi, et les convives passèrent dans la salle à manger.
Ils y trouvèrent une table couverte des mets les plus délicats, c’est-à-dire les plus rares. Maurice cherchait en vain à reconnaître ces inventions nouvelles de la cuisine sans-pairienne, lorsqu’il aperçut aux murs d’immenses cadres émaillés qui donnaient la carte du repas. On y voyait annoncés des tartes aux pépins, des consommés de cœurs de pigeons, des compotes de langues de perdrix, des sautés de foies d’alouettes. Notre héros ne lut pas plus loin. Évidemment, la civilisation imitait ces fées des anciens contes, qui demandaient aux princesses condamnées à les servir des plats d’yeux de sauterelles ou d’ongles de fourmis. L’impossible était devenu le nécessaire.
Les convives prouvèrent, du reste, par leur appétit, combien tout était de leur goût, et les vins ne tardèrent pas à ranimer la conversation un instant languissante.
Maurice avait près de lui un jeune homme, orné d’une barbe de pacha et d’une paire de lunettes, que Prétorien lui avait présenté comme le plus brillant écrivain de la presse piétiste. Les grandes espérances que l’on fondait sur lui l’avaient fait surnommer Marcellus, par allusion au jeune héros qu’avait célébré Virgile : Tu Marcellus eris !
Sa parole était facile, et sa foi d’autant plus solide qu’elle s’accommodait de tout. On le trouvait successivement aux cafés des lions et aux vêpres, aux prédications de l’abbé Gratias, et aux bals masqués ; mais on le retrouvait toujours également orthodoxe, qu’il chantât le Dies iræ ou qu’il dansât une polonaise échevelée.
Marcellus avait d’abord appliqué sa piété à boire et à manger ; mais quand il eut rempli ces premiers devoirs envers sa prison (c’était le nom qu’il donnait à son corps), il commença à s’occuper de son voisin.
— Ainsi, vous avez vécu dans le dix-neuvième siècle, monsieur ? dit-il, le regard fixé sur Maurice, et en avalant une tartelette ; vous avez vu ces âges de croyances naïves où l’homme, dégagé des désirs secondaires, ne songeait qu’à la nourriture de son âme !…
Il prit une seconde tartelette.
— Heureuse époque, à jamais perdue ; générations fortes et fidèles, qui se préparaient au bonheur d’un meilleur monde, en s’abreuvant aux sources pures de la foi !
Il vida son verre, fit claquer sa langue contre son palais, et demeura avec l’air pensif d’un croyant qui digère.
Cependant, la conversation continuait à l’autre bout de la table, où Prétorien racontait l’histoire d’une Sans-Pairienne qui, parmi ses envies de femme grosse, avait eu celle de manger son mari.
— Et elle l’a mangé ? demandait Blaguefort.
— Jusqu’aux orteils ! répliqua le directeur du Grand Pan.
— Elle était dans son droit ; la loi déclare que le mari doit nourrir sa femme.
— Et l’Église ajoute que tous deux ne sont qu’une même chair.
— Ce qui n’a pas empêché le procureur du roi de l’arrêter, reprit Prétorien.
— Il a sans doute craint le mauvais exemple pour sa femme.
— Qui diable voudrait manger un procureur du roi ?
— Quand il s’agit d’un mari, on ne doit point consulter son goût.
— Mais si pourtant la malheureuse prouve qu’elle a cédé à un besoin irrésistible ? objecta Banqman.
— Qu’il y allait de la vie de son embryon ? continua Mauvais.
— Et qu’elle n’a mangé son mari que pour lui conserver un fils ? acheva Blaguefort.
— Est-elle jeune, au moins ? demanda le comte de Mortifer.
— Vingt ans.
— Et jolie ?
— Fraîche comme un satin rose doublé de peau de cygne.
— Alors, il est clair que le régime est bon, interrompit Blaguefort, et que nos jolies femmes doivent l’adopter.
— On a déjà observé que les mangeurs de viande avaient le sang plus beau.
— Incontestablement ; la véritable fontaine de Jouvence est à l’abattoir.
— Comme l’Hippocrène. Shakespeare était fils de boucher.
— Et c’est grâce à ses rosbifs que la vieille Angleterre a été appelée par Byron un nid de cygne.
— À propos d’Angleterre, interrompit milord Cant, vous savez ce qui est arrivé à la fille de notre ambassadeur ?
— Elle a été enlevée par le secrétaire de son père.
— Et tous deux se sont sauvés au Cap.
— C’est de l’histoire ancienne.
— Oui, mais le nouveau, c’est que notre ravisseur a fini par trouver miss Confiance trop douce et trop blonde.
— Alors, il l’a fait teindre ?
— Il l’a jouée au billard en vingt points.
— Ah bah !
— Et il l’a perdue ?
— Le drôle a toujours été heureux au jeu.
— Le capitaine Malgache, qui avait gagné, a voulu alors faire valoir ses droits.
— Et l’enjeu s’est laissé prendre ?
— Il s’est jeté par la fenêtre !
— D’un rez-de-chaussée ?
— D’un troisième étage !
— Ah diable ! Et son amant ?…
— Il l’a fait enterrer proprement, s’est embarqué sur le paquebot sous-marin, et vient d’arriver à Sans-Pair.
— Prêt à recommencer ? Avis aux jeunes filles incomprises qui désirent reposer en terre étrangère. Il faut faire un roman là-dessus. Robinet.
— Au fait, c’est une idée, dit le fabricant de feuilletons, qui achevait un bifteck de kanguroo, j’en parlerai à mon contre-maître.
— Ça sera-t-il moral ou immoral ? demanda Blaguefort.
— Selon la commande, répliqua Robinet en buvant ; nous avons quatre échantillons : le genre dit Louis XV pour les journaux viveurs ; le genre dit allemand pour les journaux mélancoliques ; le genre dit commis voyageur pour les journaux loustics, et le genre dit vertueux pour les journaux que personne ne lit. Tout sujet peut être accommodé à l’une des quatre sauces, selon la volonté du consommateur ; il suffit de changer les épices et de donner le tour de casserole.
— Alors, je vous recommande l’histoire du petit blanc de la Martinique, dit M. Banqman.
— Il y a donc encore des blancs aux Antilles ? demanda Mme Facile avec surprise.
— Une seule famille échappée à l’extermination, et que les noirs se plaisent à torturer.
Philadelphe Ledoux poussa un soupir.
— Pauvres gens, dit-il à demi-voix, les distractions sont si rares !
— Ils ont déjà fait mourir le père avec ses deux fils.
— Par ignorance.
— Et noyé le grand-père.
— Sans mauvaise intention : ce sont de vrais enfants.
— Enfin, la mère a été mise en prison jusqu’à ce qu’elle ait pu se racheter au prix de cent mille piastres.
— Prix qui prouve leur haute estime pour les blancs, interrompit le philanthrope.
— C’est, alors que son fils, âgé seulement de dix ans, est parti pour tâcher de réunir la somme.
— Et il est arrivé à Sans-Pair ?
— Après avoir fait deux fois naufrage.
— En voilà un modèle de piété filiale ! s’écria Blaguefort ; je donne ma voix pour qu’on en fasse une rosière.
— Avec une dot de cent écus.
— Accompagnée d’un discours de M. le maire.
— Il espère mieux, reprit Banqman ; on doit organiser pour lui une loterie et un bal par souscription, où il dansera la polonaise des nègres.
— Pour sa mère, qui est peut-être maintenant étranglée.
— Laissez donc ! s’écria Blaguefort ; je parie que votre petit blanc de la Martinique est un drôle qui fait sa coupe. La chose me paraît un perfectionnement, sans brevet, du vol à l’américaine. Vous êtes bien niais de croire encore aux orphelins. D’ailleurs, s’il s’agit d’une femme esclave, envoyez l’affaire au club de Mlle Spartacus.
— Ah ! j’allais l’oublier, interrompit Mme Facile ; je vous ai promis une séance de la société des femmes sages…
— Dont vous êtes membre ? dit Blaquefort.
— Membre libre ! continua Prétorien.
— Et qui se réunit ici, acheva Mme Facile sans avoir l’air de comprendre la malignité de cette double interruption. J’ai mis à la disposition de Mlle Spartacus la salle où nous jouons les proverbes ; mais je me suis réservé la galerie d’avant-scène, et nous allons y descendre ; la séance doit être ouverte.
Tous les convives se levèrent de table et suivirent leur amphitryon, à qui le ministre des cultes donnait le bras.
Lorsqu’ils arrivèrent à la galerie réservée, la salle était, déjà pleine de femmes de tout âge, depuis trente-six ans jusqu’à soixante, et de toutes conditions, depuis la veuve d’une grande armée quelconque jusqu’à la teneuse de cabinet de lecture inclusivement.
À la vue des hommes qui accompagnaient Mme Facile, une immense clameur de réprobation s’éleva de tous côtés. Les plus frénétiques se mirent à crier : — À la lanterne ! bien qu’il n’y eût que des bougies ; et les mieux élevées montraient déjà les poings fermés, lorsque Mme Facile fit de la main un signe qui demandait le silence ; puis, se penchant vers la foule coiffée et rugissante :
— Mes sœurs, dit-elle d’une voix assurée, je vous ai amené les chefs de l’armée ennemie, afin qu’ils puissent juger de vos forces et de votre résolution. Quand ils auront vu quel danger les menace, ils comprendront qu’une plus longue résistance est inutile, et qu’enfin a brillé le jour annoncé par ces paroles de l’Évangile : Les premiers seront les derniers, ce qui signifie évidemment que les femmes
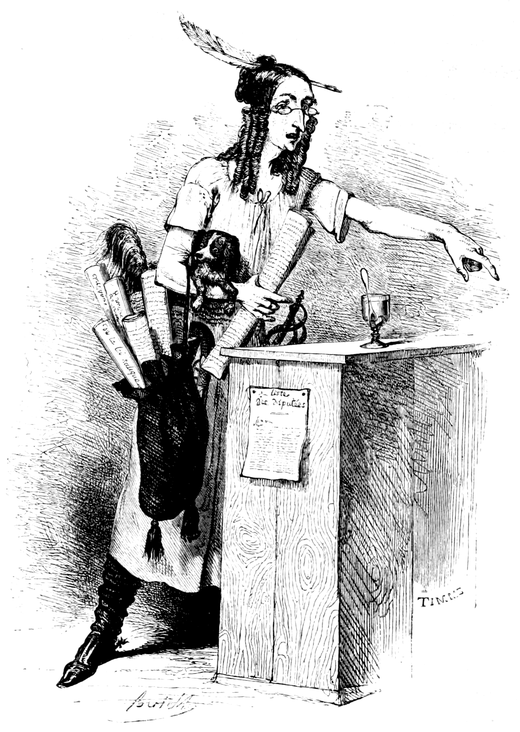
Un bravo général répondit à cette courte explication ; les convives de Mme Facile s’assirent, et il y eut une assez longue pause.
Enfin, une sonnette se fit entendre ; c’était Mlle Spartacus qui venait de prendre place sur le théâtre, avec les autres membres du bureau.
À sa vue, quelques applaudissements s’élevèrent, mais sans ardeur et sans contagion. Il était évident que chacune des assistantes se croyait, pour le moins, autant de droits qu’elle à présider l’assemblée, et que sa suprématie paraissait une usurpation.
Cette disposition des esprits se révéla par un long bourdonnement entrecoupé des phrases habituelles.
— Tiens ! c’est ça notre présidente ?
— C’est pas une merveille.
— A-t-elle une robe mal faite ?
— Et quel nez ?
— Eh bien, quant à me révolter, je voudrais avoir un plus joli général que ça.
— Je comprends qu’elle haïsse les hommes, ils doivent bien le lui rendre.
— Attention ! elle ouvre son ridicule.
— Nous allons avoir un discours.
— Ça va-t-il nous ennuyer ! Dites donc, la commandante, donnez-nous donc une prise.
— On avait dit qu’il y aurait eu de la musique et des rafraîchissements.
— C’est toujours comme ça dans tous les programmes, on promet plus de beurre que de pain.
— Silence ! elle lève le bras, c’est signe qu’elle va commencer.
Mlle Spartacus avait en effet déployé son manuscrit, affermi ses lunettes et rejeté la tête en arrière, pour se donner un air noble. La rumeur qui voltigeait sur l’auditoire s’apaisa, et la présidente du club des femmes sages prit la parole :
« Encore émue des marques universelles de bienveillance qui me sont prodiguées, j’éprouve quelque embarras à aborder la grave question pour laquelle nous nous trouvons réunies. Le trouble de mon cœur est près de passer jusqu’à mon esprit, et je me sens, malgré moi, gagnée par l’attendrissement de la reconnaissance.
« Mais cette reconnaissance même me rappelle plus vivement au souvenir de ma mission ; elle ranime mes forces, échauffe mes espérances, et, après cet élan de sensibilité accordé à la nature, je rentre plus forte et plus inébranlable dans l’accomplissement de mon projet.
« Ce projet, vous le connaissez déjà ! Je veux accomplir pour le sexe la grande révolution que la France accomplit autrefois pour les classes. Mirabeau proclama qu’il n’y avait plus de roturiers ; moi, je proclame à mon tour qu’il n’y a plus de femmes !
« Non, plus de femmes, puisque l’homme les a jusqu’à ce moment condamnées aux soins abjects du ménage et de la maternité ; plus de femmes, puisqu’elles ne peuvent ni diriger des ateliers, ni commander les vaisseaux de L’État, ni faire leur service de gardes nationales ; plus de femmes, puisqu’aux hommes seuls appartient le privilège de se faire tuer ou estropier à la guerre, en voyage, au travail.
« Mais le moyen d’arriver à cette transfiguration, direz-vous ! Là, en effet, était le problème. On en a vainement cherché la solution pendant vingt siècles ; on la chercherait encore sans doute, si Dieu ne m’avait envoyée pour votre délivrance.
« Oui. mesdames et mesdemoiselles, je viens achever l’œuvre incomplètement ébauchée par le Christ ; je viens briser le dernier joug laissé sur la terre ; je viens vous donner le sceptre du monde ! ! ! »
Ici, Mlle Spartacus fit une pause, afin de prolonger l’attente palpitante de l’assemblée ; l’assemblée en profita pour se moucher.
Une fois les nez rentrés au repos (car dans tout auditoire le nez est la partie turbulente et rebelle), l’oratrice releva la main et reprit :
« Un tel résultat vous éblouit, sans doute ; vous supposez d’avance qu’on ne pourra l’obtenir sans de longs et douloureux efforts ; vous prévoyez quelque combinaison nouvelle et inconnue. Détrompez-vous, sexe aimable dont je fais partie ! le moyen inventé par moi l’avait déjà été il y a deux mille ans par un poète grec nommé Aristophane, mais sans qu’il en comprît toute la portée. Basé sur la nature et l’observation, il dompte l’homme aussi sûrement que la faim dompte le cheval auquel l’écuyer veut apprendre à compter les heures : que le manque de sommeil soumet le chien destiné à jouer aux dominos ; que l’opium et la barre de fer rouge maîtrisent la panthère qui doit devenir artiste dramatique. Vous cherchez ce que ce peut être ? cherchez plutôt quelle est chez l’homme la passion la plus ardente, l’entraînement le plus général, le plus continuel, le plus persistant ; rappelez-vous ce qui fit brûler Troie, ce qui transforma Rome en république ; ce qui, sous les anciennes monarchies, maintenait la faveur des familles nobles ou ennoblissait les familles roturières ? Et si ce n’est point s’exprimer assez clairement, lisez l’explication du poète grec lui-même, traduite pour l’instruction des ignorants, et dont chacune de vous peut emporter un exemplaire. »
À ces mots, Mlle Spartacus fit un signe, et les dames du bureau prirent, dans une corbeille, des imprimés qu’elles lancèrent au milieu de la foule. En un instant la salle fut pleine de feuilles volantes que l’on saisissait au passage ou que l’on transmettait de main en main.
Quelques-unes des feuilles tombèrent dans la loge occupée par Mme Facile et par ses invités, et Maurice reconnut la traduction de la troisième scène de Lysistrata ! Le moyen proposé par la présidente du club des femmes sages était en effet clairement expliqué. Il s’agissait de réduire les hommes par la famine, non la famine de bouche, mais la famine de cœur, comme eût dit le chevalier de Boufflers ! Toutes les femmes devaient se soumettre à une sorte de blocus continental (en supposant que ce dernier mot vînt de continence), et leurs tyrans, devenus leurs victimes, ne pouvaient manquer de se rendre à discrétion, à moins de se résigner à chanter solitairement le refrain de Béranger :
La lecture du fragment traduit avait eu évidemment un grand succès dans l’assemblée ; tous les regards le parcouraient avec curiosité, et, après avoir lu, on recommençait pour mieux comprendre.
Quand Mlle Spartacus pensa que tous les esprits se trouvaient suffisamment éclairés, elle reprit son cahier et continua :
« Vous connaissez toutes maintenant, sœurs et amies, le moyen qui doit assurer notre triomphe, et nulle de vous ne peut douter de sa puissance. Le jour où les femmes y auront recours, l’homme sera subjugué. Victus et inermis drago ! cette citation latine ne vous étonnera point, mesdames ; la royauté une fois dévolue à notre sexe, le latin entre nécessairement dans notre domaine, comme l’escrime et les petits verres. Je répète donc victus et inermis drago !
« Or, une fois nos ennemis battus, nous devrons nécessairement profiter de nos avantages pour qu’ils ne se relèvent pas, et le plus sûr moyen pour cela est de refaire la charte de l’humanité.
« La révolution française avait proclamé les droits de l’homme, nous y substituerons les droits de la femme que j’ai formulés en six articles, qui seront désormais notre loi.
« Article 1er. Dieu sera désormais du genre féminin, vu sa toute-puissance et sa perfection.
« Art. 2. Les droits de la femme consistent à n’en point reconnaître aux hommes.
« Art. 3. Toutes les femmes seront égales pour commander, et tous les hommes égaux pour leur obéir.
« Art. 4. Toutes les places seront occupées par le sexe le plus intéressant et le plus faible, sauf celles dont il ne voudra pas, lesquelles appartiendront de droit au sexe le plus laid et le plus fort.
« Art. 5. Tous les hommes se marieront et toutes les femmes resteront filles, c’est-à-dire que les premiers seront enchaînés et n’auront que des devoirs, tandis que les secondes seront libres et n’auront que des droits.
« Art. 6. Les femmes auront seules les clefs des caisses publiques et privées ; on laisse aux hommes le privilège de les remplir ! »
Des acclamations frénétiques accueillirent cet hexalogue qui rétablissait d’une manière si équitable l’égalité humaine. Les cris de vive notre libératrice ! vive mademoiselle Spartacus ! se croisaient avec mille exclamations d’enthousiasme ; chaque auditrice annonçait déjà tout haut ses prétentions. L’une voulait être préfette ou générale de division, l’autre procureuse générale près la cour royale, une troisième inspectrice des remontes, une quatrième grande maîtresse de l’université. C’était une sorte de carnaval de l’esprit, dans lequel toutes les ambitions se croisaient et se heurtaient en courant comme des masques. Mlle Spartacus, enivrée de ce triomphe, avait relevé ses lunettes sur son front et caressait de l’œil les vingt manuscrits qui gonflaient son sac de velours. Là était le véritable nœud de l’affaire ; elle avait d’abord voulu s’assurer la bienveillance de son auditoire ; mais la grande question était de faire agréer le sac avec son contenu.
Elle reprit donc aussitôt que l’enthousiasme de la foule put permettre à sa voix de se faire entendre :
« Je prévoyais ces transports de joie, et j’y vois le nouveau gage d’un triomphe assuré ! Oui, chères complices, vous vous réunirez pour vaincre la barbarie de ce sexe qui repousse ses adversaires sans respect pour leur faiblesse, et n’a pas même la vulgaire générosité de se laisser battre sans se défendre. Mais pour arriver à ce résultat, il faut que toutes les femmes secondent notre complot, qu’elles en comprennent l’importance, qu’elles soient éclairées sur les moyens comme sur le but, et, pour cela, des instructions sont indispensables.
« Or ces instructions existent, j’y ai consacré, depuis dix ans, mes facultés et mes veilles. Romans, poésies, traités philosophiques, impressions de voyages, vaudevilles, j’ai successivement adopté toutes les formes, pris toutes les allures. Ce sac renferme la matière de quatre-vingt-douze volumes in octavo, sans alinéa et sans interlignes, destinés à ramener toutes les femmes à notre opinion. C’est la révolution du monde en manuscrit ; il ne reste plus qu’à en faire les frais d’impression !
« Mais ces frais, en comprenant la juste rétribution du travail de l’auteur, montent à un million deux cent mille francs, et ne peuvent, par conséquent, être couverts que par l’association des parties intéressées. J’ai donc l’honneur de vous proposer, au nom du bureau, une souscription ouverte, séance tenante, dans l’intérêt de la cause, pour l’impression immédiate de mes œuvres complètes.
« Le nom des souscriptrices et le chiffre de leurs cotisations seront inscrits par ma secrétaire, qui attend à la grande porte. »
À ces mots, Mlle Spartacus tira ses lunettes, salua l’assemblée et sortit avec les membres du bureau.
Mais aucun applaudissement ne se fit entendre. L’idée de souscription avait glacé les espérances et amorti les plus fiers courages. Des murmures recommençaient à courir au-dessus des têtes agitées, comme la brise sur les épis.
— C’est un piège, répétaient plusieurs voix, on nous a attirées dans un coupe-gorge.
— Elle veut tout simplement nous forcer à imprimer ses rapsodies.
— Et à lui faire des rentes, afin de trouver un mari malgré ses lunettes et son grand nez.
— C’est une folle.
— Une intrigante.
— Je ne donnerai rien.
— Ni moi.
— Ni moi.
— Ni moi.
Mais, malgré ces affirmations, tous les yeux se portaient avec un certain embarras vers la grande porte, où attendait la secrétaire de Mlle Spartacus. Passer devant un bureau de souscription sans rien donner est toujours chose difficile, non à notre générosité, mais à notre sottise. Que pensera-t-on de nous ? ne nous accusera-t-on point de dureté, d’avarice, de pauvreté ? À cette dernière pensée, notre front rougit, et nous portons vivement la main à la poche.
Ainsi allaient faire les femmes sages, bien à contre-cœur, lorsqu’elles avisèrent une porte dérobée qui permettait d’éviter la grande entrée ; toutes s’y précipitèrent, tandis que la secrétaire et Mlle Spartacus, qui était allée la rejoindre, attendaient toujours les souscriptrices. Enfin, un laquais vint demander s’il pouvait éteindre ; la salle était vide !
La présidente eut besoin de s’en assurer par ses yeux ; mais quand elle ne put douter davantage, elle laissa tomber ses lunettes, et, se voilant la face avec ses deux gants de filoselle tricotée, elle s’écria, comme Caton après la bataille de Philippes :
— Diutius vixi !
Ce que la secrétaire traduisit par :
— J’avais trop de manuscrits !
Pendant ce temps, Mme Facile et sa compagnie quittaient la galerie avec de longs éclats de rire et regagnaient les salons. Maurice et Marthe restèrent seuls en arrière, assis à la même place, les mains unies et se regardant.
— Toujours le même égarement, dit enfin Maurice, qui appuya sur l’épaule de la jeune femme sa tête pensive. Ah ! pourquoi faire deux camps des enfants de Dieu ? Eve n’est-elle donc plus la chair d’Adam ? Ne comprendra-t-on jamais que ce n’est point le droit qui fera disparaître la servitude, mais seulement l’amour ? Est-ce avec les récriminations et les soupçons que se cimentent les alliances ? Aimez bien, et nul n’ambitionnera le rôle de maître, mais celui d’esclave ; aimez davantage, et vous ne saurez même plus qui obéit ou qui commande, car les deux cœurs ne seront plus qu’un seul cœur.
— Oui, dit Marthe, qui se retourna à demi, et dont les lèvres effleurèrent la chevelure du jeune homme ; c’est ainsi que nous avons vécu, ainsi que nous vivrons !
Une larme vint se suspendre aux cils de Maurice ; il tint Marthe longtemps pressée sur sa poitrine ; puis, faisant un effort :
— On doit nous chercher, dit-il, remontons vite ; que penseraient les convives de Mlle Facile s’ils pouvaient nous voir et nous entendre ? Hélas ! ils ne nous comprendraient même pas, car l’intelligence ne peut s’élever que sur les ailes de l’âme. Livrée aux pesanteurs de la réalité, elle s’abaisse aux lieux bas et voit chaque jour rétrécir son horizon. Hier, tu as pleuré sur ce monde nouveau parce que l’amour l’avait quitté ; mais, en s’envolant, il a encore emmené une compagne.
— Qui donc ? demanda Marthe.
— La poésie.
- ↑ Voyez la Confession (J. Janin).
- ↑ Voyez les Mémoires du Diable (F. Soulié).
- ↑ Voyez Antony (A. Dumas).
- ↑ Voyez la Grille du château (F. Soulié).
- ↑ Voyez le Général Guillaume (E. Souvestre).
- ↑ Voyez Mathilde (E. Sue).
- ↑ Voyez Rêve d’amour (F. Soulié).
- ↑ sVoyez l’Histoire des Treize (H. Balzac).
- ↑ Voyez les Réprouvés et les élus (E. Souvestre).
- ↑ Voyez les Réprouvés et les élus (E. Souvestre).
- ↑ Voyez l’Histoire des Treize (H. de Balzac).
- ↑ Voyez les Mystères de Paris (E. Sue).
- ↑ Voyez le Père Goriot et la suite (H. de Balzac).
- ↑ Voyez le Juif Errant (E. Sue).
- ↑ Voyez les Mystères de Paris (E. Sue).
- ↑ Voyez le Père Goriot (H. de Balzac).
- ↑ Voyez le Lys dans la vallée (H. de Balzac).
- ↑ Voyez Eugénie Grandet (H. de Balzac).
- ↑ Voyez le Chemin le plus court (J. Janin).
- ↑ H. de Balzac.
- ↑ Idem.
- ↑ Dumas.