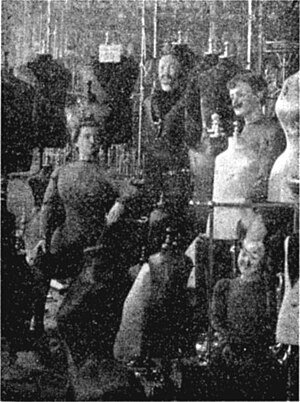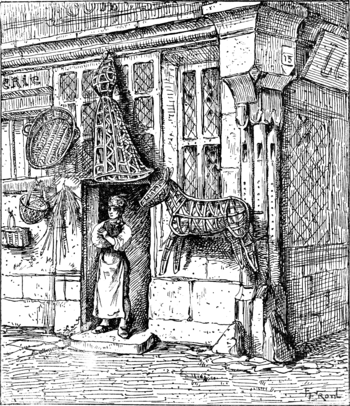Le Mannequin/04
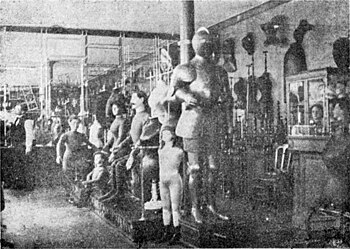
IV
LA MODE ET LE MANNEQUIN


« Ces vilaines basquines Vous font laides comme quines »
mais l’injure de ressembler à des guenons, faut croire, ne les atteignit pas.
La Mode, c’est l’art qui passe, c’est toute une mentalité qui se déroule : on juge une époque par ses costumes.
On dit qu’Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, fit appeler son couturier Charmette et lui ordonna de bâtir « quelque chose » pour essayer ses robes avant de les lui apporter, pour juger ut l fut le mannequin de Choisy-le-Roi,

Joséphine de Beauharnais, impératrice et reine, en usait à la Malmaison. « On lui apportait de grandes corbeilles qui contenaient plusieurs robes différentes » dit Madame de Rémusat, une de ses « dames du palais » qu’il faut relire pour tout ce qui intéresse l’intimité de cette curieuse époque. Ces corbeilles devinrent des figu-rations en osier de la personne impériale, La grande dame d’atours, Madame de la Valette, dirigeait sept ou huit femmes de chambre, dont Madame Aubert « première femme des atours » qui, chargée de la garde-robe, imagina la collection de mannequins dont devait se moquer in-petto le couturier Jacques Leroy en compagnie de sa congénère Mademoiselle Despaux.
Joséphine, qui n’avait « pas de poches à ses robes » (Fréd. Masson) conservait de la nonchalance créole le goût du désordre. Heureuse d’avoir sous la main des accrochoirs aux, mille brimborions, écharpes, gazes, fichus, qui traînaient sous ses doigts, elle trouva très plaisante cette série d’oiers qu’elle pouvait charger à volonté. Ils n’eurent guère d’autres fonctions, semble-t-il.
Et il en fut longtemps ainsi, car le mannequin dans l’art du vêtement, qui « exalte ou modifie la beauté, trompe parfois notre esthétique et pervertit notre goût… dont l’influence se répand de toute part, en littérature, en peinture,… dans la statuaire, ; dans les idées, dans le langage et même dans l’économie politique d’une nation » (Oct. Uzanne), le mannequin support et propagateur de la mode, perpétuel recommencement, n’est qu’une invention toute récente.
Sous la Restauration « Paris comptait quatre tailleurs pour dames renommés, et trois couturières en corsets très recherchées » (Augustin Challamel, Histoire de la Mode). On cite parmi les grandes faiseuses de 1845 et 1855 Palmyre, Alexandrine, Madame Quillet, Madame Beaudrant. Ces artistes eurent-ils besoin de tuteurs ? Non sans doute, car, dit encore Uzanne « les petites reines de l’âge romantique ont montré des trésors d’élégance délicate et affinée, des compréhensions exquises de goût. »
Sous le second Empire le règne de notre tyran d’osier, de fil-de-fer ou de carton, se dessine. C’est la période de déformation. L’impératrice Eugénie avait des goûts espagnols, très personnels, trop personnels, l’amour des couleurs voyantes, et une couturière nommée Caroline, qui a laissé des descendants. Comme elle avait la taille très courte, toutes les élégantes, pour copier leur souveraine, eurent la taille courte, ou plutôt la taille basse. Il fallait un gabarit à cette copie qui ne pouvait s’exercer que d’une façon imparfaite. Il y eut le patron, de cartons cousus, puis il y eut la crinoline. La « taille », première élégance de la femme devint grotesque. Monsieur Lavigne, qui fit les premiers gabarits, indocile, faillit se brouiller avec Madame Conneau, femme du médecin de l’empereur.
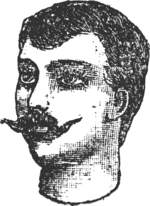




On put appliquer le gabarit anthropomorphe aux diverses phases de l’industrie d’habillement, et obtenir ainsi des proportions graduées, un total répertoire. Par extension, on l’appliqua à l’essai de ces vêtements, puis à l’étalage, et, de nos jours, il n’est pas d’importante maison de couture qui n’ait un matériel de cinquante ou cent mannequins. Articulés au non, avec têtes ou sans têtes, un ingénieux commis dispose ces androïdes recouverts des nouveautés de la saison. Il imagine, puise çà et là dans la vie réelle.
Voici des cartonnages avec des vestes en peau de phoque, casquettés de cuir, prêts à monter en automobile, en voilà qui énumèrent des costumes de soirée en dansant le quadrille américain. Les passants s’amusent de ces saynètes guignolesques. Pourvu qu’ils s’arrêtent ; et achètent !

Oui, désormais, je’mannequin est entré dans les mæurs. — « j’ai un 42, un 44 » ce numéro qui indique
la demini esure du tour de poitrine ! — dit l’amazone. La Madame Bergeret d’Anatole France « contemple le mannequin d’osier sur lequel, depuis de longues années, elle drape ses robes,… le, mannequin d’osier, image conjugale » et je me rappelle le couplet de Désaugiers :
Le Portrait d’un acteur tragique
est vis-à-vis d’un mannequin,
le vois sur la Vénus pudique
une culotte de nankin…
Le mannequin eut sa bonne ét sa mauvaise presse. L’homme de lettres et le journaliste s’en délectèrent, l’écrivain lui découvrit des vertus secrètes et des talents nouveaux, le folliculaire le conspua ainsi qu’un corrupteur de l’époque. Un des maîtres réputés de la nouvelle académie n’a pas craint d’en faire un des chapitres de son Histoire Contemporaine, où le héros le traite comme il convient en le jetant par la fenêtre dès le second acte. Il se produisit devant ces gorges de carton et ces hanches rembourrées des clins d’æil égrillards, des mots d’esprit ; des indignations ben honnêtes et des roucoulements d’horreur. Et patati et patata.