Le Corsaire rouge/Chapitre I
CHAPITRE PREMIER.
- Shakspeare. Tout est bien qui finit bien.
Quiconque sait ce que c’est que le tumulte et l’activité d’une ville commerçante d’Amérique ne reconnaîtrait point, dans le repos qui règne maintenant dans l’ancien marché de Rhode-Island, une place comptée dans ses jours de prospérité au nombre des ports les plus importants de toute la ligne de nos vastes côtes. Il semblerait, au premier coup d’œil, que la nature avait fait ce port tout exprès pour prévenir les besoins, et réaliser les vœux du marin. Jouissant des quatre grands avantages d’un port sûr et heureusement situé, d’un bassin tranquille, d’un havre d’entrée, et d’une rade commode dont l’abord est facile, Newport paraissait, aux yeux de nos ancêtres européens, destiné à servir d’abri aux flottes, et à nourrir une masse de marins robustes et expérimentés. Quoique cette dernière prédiction n’ait pas été entièrement démentie par l’événement combien peu la réalité a répondu à l’attente, relativement à la première ! Un heureux rival s’est élevé jusque dans le voisinage immédiat de ce favori apparent que la nature, pour déjouer tous les calculs de la sagacité commerciale, et ajouter une nouvelle preuve à toutes celles qui attestaient déjà que — la sagesse humaine n’est que folie.
Il est peu de villes de quelque importance, dans l’étendue de nos vastes territoires, qui ait aussi peu changé en un demi-siècle que Newport. Jusqu’à ce que les immenses ressources de l’intérieur fussent développées, la belle île sur laquelle cette ville est située était choisie pour retraite par les nombreux planteurs qui venaient du sud chercher un abri contre les chaleurs et les maladies de leurs climats brûlans. C’est là qu’ils se rendaient en foule pour respirer l’air fortifiant des brises de la mer. Sujets d’un même gouvernement, les habitans de la Caroline et de la Jamaïque s’y réunissaient amicalement pour comparer leurs mœurs et leurs constitutions respectives, et pour s’affermir réciproquement dans une illusion commune, que leurs descendans à la troisième génération commencent aujourd’hui à reconnaître et à regretter.
Ces relations ont laissé sur la postérité simple et sans expérience des puritains leurs impressions naturelles avec toutes les conséquences bonnes on mauvaises. Les habitans du pays, tout en puisant dans ces liaisons une partie de ces manières douces et aimables qui distinguaient si éminemment ceux des colonies anglaises du sud, ne manquèrent point de se pénétrer en même temps de ces idées particulières sur la distinction des races humaines, idées qui ne forment pas un trait moins saillant de leur caractère. Rhode-Island fut la première des provinces de la Nouvelle-Angleterre à s’écarter dans ses mœurs et ses opinions de la simplicité de ses fondateurs. Ce fut elle qui porta le premier coup à ces manières rigides et grossières qui étaient regardées autrefois comme les compagnes nécessaires de la vraie religion, comme une espèce de gage extérieur qui garantissait la santé de l’homme intérieur, et ce fut elle aussi qui se départit la première, d’une manière sensible, de ces principes salutaires qui pourraient faire excuser un extérieur même encore plus repoussant. Par une singulière combinaison de circonstances et de dispositions, qui est néanmoins aussi vraie qu’inexplicable, les négocians de Newport devinrent en même temps marchands d’esclaves et gentlemen, et commencèrent à faire la traite au moment même où leurs mœurs se poliçaient.
Au reste, quel que fût l’état moral de ses habitans en 1759, l’île elle-même n’avait jamais été plus agréable ni plus riante. Les cimes plus altières de ses hauteurs étaient encore couronnées de bois aussi vieux que le monde ; ses petites vallées étaient couvertes de la verdure animée du nord, et ses maisons de campagne sans prétention, mais propres et commodes, étaient ombragées de bosquets et parées de riches tapis de fleurs. La beauté et la fertilité de ces lieux leur valurent un nom qui probablement avait beaucoup plus d’expression qu’on ne le croyait dans ces premiers temps. Les habitans du pays appelèrent leurs possessions le Jardin de l’Amérique, et leurs hôtes venus des plaines brûlantes du sud ne se refusèrent point à confirmer un titre si brillant. Le surnom s’est même transmis jusqu’à nos jours, et il n’a été entièrement abandonné que lorsque les voyageurs furent à même de contempler ces milliers de vastes et délicieuses vallées qui, il y a cinquante ans, étaient ensevelies dans les épaisses profondeurs des forêts[1].
La date que nous venons de nommer était l’époque d’une crise du plus haut intérêt pour les possessions britanniques sur ce continent. Une guerre de sang et de vengeance, qui avait commencé par des défaites et des désastres, allait se terminer par le triomphe. La France était privée de la dernière de ses possessions maritimes, tandis que l’immense contrée qui s’étend entre la baie d’Hudson et le territoire espagnol se soumettait au pouvoir de l’Angleterre. Les habitans des colonies avaient largement contribué aux succès de la mère-patrie. Les pertes et les affronts que leur avaient fait souffrir les insolens préjugés des commandas européens commençaient à s’oublier dans l’ivresse du succès. Les fautes de Braddok, l’indolence de London et l’incapacité d’Abercrombie avaient été réparées par la vigueur d’Amherst et par le génie de Wolfe. Dans toutes les parties du globe les armes anglaises étaient triomphantes. Les fidèles colons étaient les plus ardens dans leur enthousiasme et les premiers à faire éclater leur joie, semblant ne pas faire attention à la faible part de gloire qu’un peuple puissant cède, et ne cède encore qu’avec répugnance, à ceux qui dépendent de lui, comme si l’amour de la gloire, de même que l’avarice, augmentait à mesure qu’on a plus de moyens de le satisfaire.
Le système d’oppression et de tyrannie qui hâta une séparation tôt ou tard inévitable n’avait pas encore été mis en pratique. La mère-patrie, à défaut de justice, montrait au moins de la complaisance. Comme toutes les anciennes et puissantes nations, elle s’abandonnait au plaisir flatteur, mais dangereux, de s’admirer elle-même. Les qualités et les services d’une race qui était regardée comme inférieure furent cependant bientôt oubliés, ou, si elle s’en souvint, ce fut pour les blâmer en les présentant sous un faux jour. Le mécontentement produit par les discordes civiles envenima le mal, et il en résulta des injustices plus frappantes, comme s’il régnait un esprit de vertige. Des hommes qui, d’après leur expérience, auraient dû être mieux au fait, ne rougirent point de manifester jusque dans l’assemblée suprême de la nation l’ignorance, complète où ils étaient du caractère d’un peuple avec lequel ils avaient mêlé leur sang. L’amour-propre donna du crédit à ces opinions insensées. Ce fut sous l’influence de cette fatale présomption qu’on entendit des vétérans dégrader leur noble profession par des forfanteries que l’on n’eût pas tolérées dans la bouche d’un officier de salon ; ce fut sous cette même influence que Burgoyne fit dans la chambre des communes cette mémorable promesse de marcher de Québec à Boston avec une force qu’il jugeait à propos de nommer ; promesse qu’il accomplit ensuite en traversant ce même territoire avec un nombre double de compagnons de captivité ; ce fut enfin sous cette fatale influence que, depuis, l’Angleterre sacrifia follement cent mille hommes et prodigua cent millions de trésors.
L’histoire de cette mémorable lutte est connue de tout Américain. Heureux de savoir que son pays a triomphé, il se contente d’en laisser le glorieux résultat prendre sa place dans les pages de l’histoire. Il voit que l’empire de sa patrie s’appuie sur des bases larges et naturelles, qui n’ont point besoin de l’appui des plumes vénales ; et heureusement pour la paix de sa conscience autant que pour la dignité de son caractère, il sent que la prospérité de la république ne doit pas être achetée au prix de la dégradation des nations voisines.
Notre sujet nous ramène à la période de calme qui précéda l’orage de la révolution. Dans les premiers jours du mois d’octobre 1759, Newport, comme toutes les autres villes de l’Amérique, était livrée tout à la fois à la joie et à la tristesse. Les habitans pleuraient la mort de Wolfe et triomphaient de sa victoire. Québec, la clef du Canada et la dernière place de quelque importance qu’occupait un peuple qu’ils avaient été élevés à regarder comme leur ennemi naturel, venait de changer de maîtres. Cette fidélité à la couronne d’Angleterre, qui s’imposa tant de sacrifices jusqu’à l’extinction de cet étrange principe, était alors dans sa plus grande ferveur, et probablement on n’aurait pas trouvé un seul colon qui l’associât, jusqu’à un certain point, son propre honneur à la gloire imaginaire du chef de la maison de Brunswick.
Le jour où commence l’action de notre histoire avait été spécialement destiné à manifester la part que prenait le peuple de la ville et des environs aux succès des armes royales. Il avait été annoncé, comme mille jours l’ont été depuis, par le son des cloches et par des salves d’artillerie, et la population, s’était de bonne heure répandue dans les rues de la ville, avec cette intention bien prononcée de s’amuser, qui ordinairement rend si insipide un plaisir concerté d’avance. L’orateur du jour avait déployé son éloquence dans une espèce de monodie prosaïque en l’honneur d’un héros mort, et il avait suffisamment fait preuve de dévouement à la couronne en déposant humblement au pied du trône non-seulement la gloire de ce sacrifice, mais encore toute celle que s’étaient acquise tant de milliers de ses braves compagnons.
Satisfaits d’avoir ainsi manifesté leur fidélité, les habitans commençaient à reprendre le chemin de leurs maisons, en voyant le soleil se retirer vers ces immenses contrées où s’étendait alors un désert sans bornes et inconnu, mais que fécondent aujourd’hui les produits et les jouissances de la vie civilisée. Les paysans des environs, et même du continent voisin, se dirigeaient vers leurs demeures éloignées avec cette prévoyance économe qui distingue encore les habitans du pays, même dans le moment où ils paraissaient se livrer aux plaisirs avec le plus d’abandon, de crainte que le soir qui approchait ne les entraînât dans des dépenses qui n’étaient pas regardées comme indispensables pour exprimer les sentimens du jour. En un mot, l’heure des excès était passée, et chacun retournait au simple cours de ses occupations ordinaires, avec un empressement et une discrétion qui prouvaient qu’il n’oubliait pas totalement le temps qu’il avait perdu à manifester des sentimens qu’il paraissait déjà presque disposé à regarder comme étant un peu de surérogation.
Le bruit du marteau, de la hache et de la scie recommençait dans la ville. Les fenêtres de plus d’une boutique étaient à demi-ouvertes, comme si le propriétaire avait fait une sorte de compromis entre ses intérêts et sa conscience ; on pouvait voir les maîtres des trois seules auberges de la ville assis devant leurs portes, regardant les paysans qui se retiraient, d’un air qui annonçait évidemment qu’ils cherchaient des pratiques au milieu d’un peuple qui a toujours été plus disposé à vendre qu’à acheter. Quelques matelots bruyans et désœuvrés, attachés aux vaisseaux du port, et un petit nombre d’habitués des cabarets, furent cependant l’unique conquête que purent faire tous leurs gestes d’amitié, toutes leurs questions sur la santé des femmes et des enfans, et même les invitations, quelquefois directes, faites aux passans de venir boire et se reposer.
Les soins de ce monde, auxquels venait se mêler la pensée constante, mains quelquefois un peu détournée de l’avenir, étaient ce qui occupait le plus et ce qui formait le trait distinctif du peuple qui habitait alors ce que l’on appelait les provinces de la Nouvelle-Angleterre. La grande affaire du jour n’était cependant pas oubliée, quoique l’on crût inutile d’en discuter les détails dans l’oisiveté ou le verre à la main. Les voyageurs, le long des différentes routes qui conduisaient dans l’intérieur de l’île, se formaient en petits groupes, où les résultats politiques du grand événement national qu’ils venaient de célébrer, et la manière dont ils avaient été traités par les différens individus choisis pour jouer le premier rôle dans les cérémonies du jour, étaient examinés librement, quoique néanmoins avec une grande déférence pour la réputation établie des personnages distingués les plus intéressés dans la question. Il était généralement reconnu que le sermon, qu’on aurait pu appeler historique, était aussi soigné qu’édifiant ; et, en somme, quoique cette opinion trouvât une contradiction modérée chez quelques cliens d’un avocat opposé à l’orateur, on convenait que jamais il n’était sorti d’aucune bouche un discours plus éloquent que celui qui, ce jour-là, avait été prononcé en leur présence. C’était précisément de la même manière que discutaient des ouvriers sur un vaisseau qu’on construisait alors dans le port, et qui, suivant eux, d’après ce même esprit d’admiration de province, qui a depuis immortalisé tant d’édifices, de ponts, et même d’individus, dans les limites respectives de leurs pays, était le plus précieux modèle qui existât des proportions parfaites de l’architecture navale.
Il est peut-être nécessaire de dire un mot de l’orateur lui-même, afin qu’un prodige intellectuel si remarquable remplisse sa place dans notre énumération éphémère des grands hommes de cette époque. Il était l’oracle habituel du voisinage quand il était nécessaire que les idées se rencontrassent sur quelque grand événement, tel que celui dont nous venons de parler. Son instruction était regardée à juste titre, par comparaison, comme des plus complètes et des plus étendues ; sa réputation était comme le calorique, qui a d’autant plus d’intensité que les limites dans lesquelles il est enfermé sont plus étroites ; on assurait, non sans raison, qu’il avait étonné plus d’un docteur européen qui avait voulu s’escrimer avec lui dans l’arène de la littérature ancienne. C’était un homme qui savait tirer le plus grand parti de ces dons surnaturels. Dans une seule circonstance il s’était écarté de son attention ordinaire à ne rien faire qui pût diminuer une réputation acquise de cette manière : c’était en permettant qu’un des laborieux chefs-d’œuvre de son éloquence fût imprimé, ou, comme le disait son rival, plus spirituel mais moins heureux, le seul autre homme de loi de la ville, en souffrant que l’on arrêtât au passage un de ses essais fugitifs. Mais cette épreuve même, quels que pussent en être les résultats au-dehors, servit à confirmer sa réputation dans le pays. Il brillait alors aux yeux de ses admirateurs de tout l’éclat de l’impression, et c’était en vain que cette misérable race — d’animalcules qui se nourrissent de la substance du génie — essayèrent de miner une réputation consacrée dans l’opinion de tant de paroisses. La brochure fut colportée avec soin dans les provinces, prônée dans les soirées, portée ouvertement aux nues dans les papiers publics, par quelque plume homogène, comme on s’en apercevait à la ressemblance frappante du style ; et, enfin, grâce au zèle d’un partisan plus enthousiaste, ou peut-être plus intéressé que les autres, chargée à bord du premier vaisseau qui mit à la voile pour retourner dans sa chère patrie[2], comme on appelait alors affectueusement l’Angleterre, sous une enveloppe qui n’était adressée rien moins qu’au roi d’Angleterre. L’effet qu’elle produisit sur l’esprit rigide de l’Allemand dogmatique qui occupait alors le trône du conquérant n’a jamais été connu, quoique ceux qui étaient dans le secret de l’envoi attendissent longtemps en vain la récompense signalée qui devait être le prix d’une si merveilleuse production d’une intelligence humaine.
Malgré ses hautes et précieuses qualités, celui qui en était doué était alors occupé de la partie des travaux de sa profession qui avait le plus de rapport avec les fonctions d’écrivain public, avec autant d’abnégation de lui-même que si la nature, en lui accordant des dons aussi rares, n’y avait pas joint la dose ordinaire d’amour-propre. Un observateur critique aurait pu cependant voir, ou du moins penser voir, à travers l’humilité forcée de son maintien, certains airs de triomphe qu’on pouvait attribuer à une autre cause qu’à la prise de Québec. L’habitude très recommandable d’économiser les moindres minutes était la cause de l’activité extraordinaire qu’il déployait dans l’exercice d’une profession si humble, comparée aux efforts récens de son esprit.
Laissant ce favori de la fortune et de la nature, nous allons passer à un individu tout-à-fait différent et à un autre quartier de la ville. Le lieu dans lequel nous allons maintenant transporter le lecteur n’était ni plus ni moins que la boutique d’un tailleur qui ne dédaignait pas d’entrer dans les plus minces détails de sa profession et d’être lui-même son unique ouvrier. L’humble édifice s’élevait à peu de distance de la mer, à l’extrémité de la ville, et dans une situation telle, que le propriétaire pouvait contempler toute la beauté du bassin intérieur, et même, par un passage ouvert à l’eau entre les îles, la surface, aussi paisible qu’un lac, du havre d’entrée. Un quai petit et peu fréquenté était devant sa porte, tandis qu’un certain air de négligence et l’absence de tout fracas prouvaient assez que ce quartier lui-même n’était pas le siège direct de la prospérité commerciale si vantée de Newport.
L’après-dinée était comme une matinée du printemps, car la brise, qui de temps en temps ridait la surface du bassin, avait cette douceur particulière qui caractérise si souvent l’automne en Amérique. Le digne ouvrier travaillait à son ouvrage, assis sur son établi près d’une fenêtre ouverte, et bien plus satisfait de lui-même que beaucoup de gens que la fortune a placés sous des rideaux de velours et d’or. Du côté extérieur de la petite boutique, un paysan, de grande taille, gauche de manières, mais vigoureux et bien bâti, était à se balancer, l’épaule appuyée sur un des côtés de la boutique ; comme si ses jambes trouvaient la tâche de soutenir sa lourde masse trop forte pour ne pas avoir besoin de support. Il semblait attendre le vêtement auquel travaillait l’autre, et dont il se proposait d’orner les grâces de sa personne dans une paroisse voisine le prochain jour du sabbat.
Pour abréger les instans, et peut-être pour satisfaire une violente démangeaison de parler à laquelle celui qui maniait l’aiguille était quelquefois sujet, il se passa bien peu de minutes sans qu’il se dît un mot de part ou d’autre. Comme leur conversation avait un rapport direct avec le principal sujet de notre roman, nous nous permettrons d’en rapporter les parties qui nous semblent les plus propres à servir à l’exposition de ce qui doit suivre. Le lecteur voudra bien faire attention que celui qui travaillait était un vieillard approchant du déclin de la vie, et dont l’extérieur annonçait que, soit que la fortune lui eût toujours été contraire, soit qu’elle lui eût retiré ses faveurs, il ne parvenait à écarter la pauvreté de sa demeure qu’à l’aide d’un grand travail et d’une extrême frugalité ; et que sa pratique était un jeune homme dont l’âge et l’apparence pouvaient faire présumer que l’acquisition d’un habillement complet était pour lui un grand événement qui faisait époque dans sa vie.
— Oui, s’écriait l’infatigable coupeur de drap en faisant une espèce de soupir qu’on pouvait également prendre pour la preuve de l’excès de son contentement moral, ou de la fatigue physique causée par ses pénibles travaux, oui, rarement, il est sorti de la bouche de l’homme de plus belles paroles que celles que le squire[3] a prononcées aujourd’hui même. Quand il parlait des plaines du père Abraham[4], de la fumée et du carnage de la bataille, mon cher Pardon, il m’a remué si profondément, que, je le crois en vérité, il pourrait me venir en tête de laisser là l’aiguille et de partir moi-même pour aller chercher la gloire sous les drapeaux du roi.
Le jeune homme, dont le nom de baptême, ou le nom donné, comme on le dit encore aujourd’hui dans la Nouvelle-Angleterre, avait été humblement choisi par ses parens spirituels pour exprimer ses espérances pour l’avenir, tourna la tête vers l’héroïque tailleur avec une expression de moquerie dans le regard, qui prouvait que la nature ne lui avait point refusé le don de la plaisanterie, quoique cette qualité fût étouffée par la contrainte d’habitudes toutes particulières, et d’une éducation qui ne l’était pas moins.
— Il y a jour à percer à présent pour un homme ambitieux, voisin Homespun, dit-il, puisque sa majesté a perdu son plus brave général.
— Oui, oui, répondit l’individu qui, dans sa jeunesse ou dans son âge mûr, s’était si gravement trompé dans le choix d’un état, c’est une chance belle et flatteuse pour celui qui ne compte que vingt-cinq ans. Mais moi, la plupart de mes jours sont écoulés, et je dois en passer le reste ici, où vous me voyez, entre le bougran et l’osnabruck. — Qui a teint votre drap, Pardy ? C’est le plus beau en couleur que j’aie manié de cet automne.
— La maman s’y entend, voyez-vous, pour donner une couleur solide à son tissu, et je vous réponds, voisin Homespun, que pourvu que vous lui laissiez le temps de se retourner, il n’y aura pas dans toute l’île un garçon mieux habillé que le fils de ma mère. Mais, puisque vous ne pouvez pas être général, bon homme, vous aurez du moins la consolation de savoir qu’on ne se battra plus sans vous. Tout le monde est d’accord que les Français ne tiendront plus long-temps, et que nous allons avoir la paix faute d’ennemis.
— Tant mieux, tant mieux, jeune homme. Quelqu’un qui a vu comme moi les horreurs de la guerre, et, Dieu merci, j’en ai vu de toutes les couleurs, sait quel prix il doit attacher aux douceurs physiques de la paix.
— Vous n’êtes donc pas tout-à-fait étranger, bon homme, au nouvel état que vous songez à prendre ?
— Moi, j’ai passé par cinq longues et sanglantes guerres, et je puis dire que, grâce à Dieu, je m’en suis tiré assez heureusement, puisque je n’ai pas reçu une égratignure aussi forte que celle que pourrait faire cette aiguille. Oui, ce sont cinq longues, — sanglantes, et, je puis le dire, glorieuses guerres que j’ai traversées sain et sauf !
— C’était un moment bien dangereux pour vous, voisin ; mais je ne me rappelle pas avoir entendu parler dans ma vie de plus de deux querelles avec les Français.
— Vous n’êtes qu’un enfant auprès de celui qui a vu la fin de sa soixantième année. Il y a d’abord cette guerre-ci, qui maintenant est si vraisemblablement à son dernier terme. — Le Ciel, qui règle tout dans sa sagesse, en soit loué ! — Il y eut ensuite l’affaire de 1745, quand le brave Warren parcourut nos rivages dans tous les sens, fléau des ennemis de sa majesté et défenseur de tous ses fidèles sujets. Ensuite il y eut une affaire en Allemagne dont on nous a fait de terribles récits, et où les hommes tombaient comme l’herbe sous la faucille maniée par un bras vigoureux. Cela fait trois. La quatrième, ce fut la révolte de 1715, dont je ne prétends pas avoir vu grand-chose, car j’étais encore tout jeune à cette époque. La cinquième, c’était un bruit terrible qui s’était répandu dans les provinces d’un soulèvement général parmi les noirs et les Indiens, qui devait plonger tous les chrétiens dans l’éternité, sans leur laisser une minute pour se reconnaître.
— Ma foi, je vous avais toujours regardé comme un homme paisible et sédentaire, reprit le paysan étonné, et il ne m’était jamais venu à l’esprit que vous eussiez vu des mouvemens aussi sérieux.
— Je n’ai jamais voulu me vanter, Pardon ; sans cela j’aurais pu ajouter à ma liste d’autres affaires importantes. Il y eut une grande lutte en orient, pas plus tard qu’en 1732, pour le trône de Perse. Vous avez lu les lois des Mèdes et des Perses. Eh bien ! ce même trône qui a donné ces lois inaltérables était alors l’objet d’une querelle terrible où le sang coulait comme de l’eau ; mais ce n’était pas dans un pays chrétien, et je ne puis en rendre compte d’après ma propre expérience, quoique j’eusse pu vous parler de l’émeute relative à Porteous[5] avec certitude, puisqu’elle a eu lieu dans une partie du royaume même où je vivais.
— Vous devez avoir beaucoup voyagé et vous être mis en marche de grand matin, bon homme, pour avoir vu toutes ces choses et n’avoir rien souffert.
— Oui, oui, j’ai tant soit peu été voyageur, Pardy ! J’ai été deux fois par terre à Boston, et j’ai traversé une fois le grand détroit de Long-Island pour descendre à la ville d’York. Cette dernière entreprise est bien périlleuse vu la distance ; et surtout parce qu’il est nécessaire de passer par un endroit qui ressemble par son nom à l’entrée de Tophet[6].
— J’ai souvent en tendu parler du lieu appelé Porte de l’Enfer, et je puis vous dire aussi que je connais parfaitement un homme qui l’a traversé deux fois, l’une allant à York, l’autre en revenant chez lui.
— Il y en a eu assez, j’en suis bien sûr. Vous a-t-il parlé de la grande Marmite qui bouillonne et frémit comme si Belzébuth attisait au dessous ses feux les plus violens ? Vous a-t-il parlé du Dos de Sanglier par dessus lequel l’eau se précipite avec plus de fureur qu’elle ne tombe, je le parierais, aux grandes cascades de l’ouest ? Grace à la sage adresse de nos marins, et au rare courage de nos passagers, nous en eûmes bon marché, et cependant, je dois l’avouer, et peu m’importe qui en rira, c’est une rude épreuve pour le courage que d’entrer dans ce terrible détroit. Nous jetâmes l’ancre à certaines îles, situées à peu de verges de ce côté de la ville, et nous envoyâmes la chaloupe avec le capitaine et deux vigoureux matelots pour reconnaître l’endroit, afin de voir si tout y était paisible. Le rapport ayant été favorable les passagers furent mis à terre, et les vaisseau arriva, grâce à Dieu, sain et sauf. Nous eûmes raison de nous féliciter de nous être recommandés aux prières de l’Église avant de quitter la paix et la sécurité de nos demeures.
— Vous traversâtes la Porte d’Enfer par terre ? demanda le paysan attentif.
— Certainement : c’aurait été blasphémer et tenter la Providence d’une manière impie que d’agir autrement, quand nous voyions que notre devoir ne nous appelait pas à un tel sacrifice ; mais tout le danger est passé comme se passera, je l’espère, cette guerre sanglante où nous avons tous deux joué un rôle, et alors, je l’espère humblement, sa gracieuse majesté aura le loisir de tourner ses augustes pensées sur les pirates qui infestent la côte, et d’ordonner à quelques-uns de ses braves capitaines de rendre aux coquins le traitement qu’ils aiment tant à infliger aux autres. Ce serait un joyeux spectacle pour mes yeux affaiblis de voir le fameux Corsaire Rouge, si long-temps poursuivi, traîné dans ce même port, à la remorque d’un vaisseau du roi.
— C’est donc un coquin enragé que celui dont vous parlez ?
— Lui ! il y en a plus d’un dans ce vaisseau de contrebande, et ce sont tous des brigands altérés de sang et de rapines, jusqu’au dernier des mousses de l’équipage. C’est un véritable chagrin, une vraie désolation, Pardy, d’entendre le récit de leurs méfaits sur les terres du roi !
— J’ai souvent ouï parler du Corsaire, répondit le paysan, mais jamais on n’est entré avec moi dans les détails compliqués de ses pirateries.
— Comment pourriez-vous, jeune homme, vous qui vivez dans l’intérieur des terres, connaître ce qui se passe sur le vaste océan, aussi bien que nous qui habitons un port si fréquenté par les marins ? Je crains que vous ne rentriez tard chez vous, Pardon, ajouta-t-il en jetant les yeux sur certaines lignes tracées sur les planches de sa boutique, à l’aide desquelles il savait calculer la marche du soleil ; cinq heures vont sonner, et vous avez deux fois ce nombre de milles à faire avant de pouvoir, — moralement parlant, atteindre le point le plus voisin de la ferme de votre père.
— La route est facile et le peuple honnête, répondit le paysan, qui ne s’inquiétait pas qu’il fût minuit, pourvu qu’il pût porter le récit de quelques terribles vols sur mer aux oreilles de ceux qui, comme il le savait bien, se presseraient autour de lui à son retour pour apprendre des nouvelles du port.
— Et est-il en effet aussi craint et aussi recherché que le peuple le dit ?
— Recherché ! Tophet est-il recherché par les chrétiens en prière ? Il y a peu de marins sur le vaste océan, fussent-ils aussi braves à la guerre que l’était Josué, le grand capitaine juif, qui n’aimassent mieux voir la terre que les voiles de ce maudit pirate. Les hommes combattent pour la gloire, Pardon, comme je puis dire l’avoir vu, après avoir traversé tant de guerres, mais personne n’aime à rencontrer un ennemi qui de prime abord hisse un étendard sanglant, et qui est prêt à faire sauter en l’air amis et ennemis, s’il vient à trouver que le bras de Satan n’est pas assez long pour le secourir.
— Si le coquin est si enragé, reprit le jeune homme redressant ses membres vigoureux d’un air d’orgueil, pourquoi l’île et ses plantations n’envoient-elles pas un vaisseau côtier pour nous le ramener ici, afin qu’il puisse jouir du spectacle d’un gibet salutaire ? Que le tambour batte à cet effet dans notre voisinage, et je réponds qu’il se présentera un volontaire pour le moins.
— Voilà bien les propos d’un homme qui n’a jamais vu la guerre ! Que serviraient les fléaux et les fourches contre des hommes qui se sont vendus au diable ? On a souvent vu le Corsaire la nuit, ou au moment où le soleil venait de se coucher, à côté des croiseurs de sa majesté, qui, ayant bien entouré les brigands, avaient de bonnes raisons pour croire qu’ils les tenaient déjà dans les fers ; mais quand le matin venait, l’oiseau était déniché, le diable sait comment.
— Et les scélérats sont si altérés de sang qu’on les a surnommés Rouges ?
— Tel est le titre de leur chef, répondit le digne tailleur, tout fier de l’importance que lui donnait la connaissance d’une légende si remarquable, et tel est aussi le nom qu’ils donnent au vaisseau ; car aucun homme qui y a mis le pied n’est jamais revenu dire s’il en avait un autre meilleur ou pire, — mon Dieu non, ni voyageur ni matelot. Le bâtiment est du calibre d’un sloop royal, à ce qu’on dit, et semblable au sloop pour la forme et pour l’équipement. Mais il a échappé miraculeusement à plus d’une brillante frégate, et une fois — on se le dit tout bas, car aucun loyal sujet n’oserait prononcer tout haut un aussi scandaleux récit, — il resta pendant une heure entière sous le feu d’un vaisseau de cinquante canons, et il parut à tous les yeux s’enfoncer comme la sonde jusqu’au fond de l’eau ; mais au moment où chacun battait des mains, et félicitait son voisin de l’heureuse punition des coquins, il entra dans le port un bâtiment des Indes Occidentales, qui avait été pillé par le Corsaire le matin même après la nuit où l’on pensait qu’ils étaient partis tous ensemble pour l’éternité. Et ce qui rend l’affaire encore pire, jeune homme, c’est que, tandis que le vaisseau du roi se radoubait, et qu’on bouchait les ouvertures faites par les boulets de canon, le Corsaire courait des bordées le long de la côte aussi frais et aussi dispos que le jour où il était sorti du chantier.
— Eh bien ! voilà qui est inouï, répondit le campagnard, sur qui le récit commençait à faire une impression sensible. Est-ce un vaisseau bien tourné, et qui soit beau à voir ? Et, pour tout dire, est-on bien sûr que ce soit un vaisseau vivant ?
— Les opinions diffèrent : les uns disent oui, les autres non. Mais je connais parfaitement un homme qui a voyagé une semaine dans la compagnie d’un marin qui, emporté par une bourrasque, a passé à la distance de cent pieds de ce vaisseau. Bien lui en a pris que la main du Seigneur se fît sentir si puissamment sur les flots, et que le Corsaire eût assez à faire d’empêcher son propre bâtiment de s’abîmer. L’ami de mon ami vit donc parfaitement et le vaisseau et le capitaine, sans courir le moindre danger. Il disait que le pirate était un homme qui pouvait être plus gros de moitié que le grand prédicateur, là-bas, qu’il avait des cheveux de la couleur du soleil dans un brouillard, et des yeux qu’aucun homme n’aimerait à regarder une seconde fois. Il le vit aussi bien que je vous vois ; car le coquin se tenait sur le tillac de son vaisseau, faisant signe à l’honnête marchand, d’une main aussi large qu’un pan d’habit, de ne pas avancer, de crainte que les deux navires ne l’endommageassent en se heurtant.
— C’était un intrépide marin que ce marchand, pour oser approcher si près d’un pareil brigand sans pitié.
— Je vous assure, Pardon, que c’était diablement contre sa volonté. Mais la nuit était si obscure !
— Obscure ! interrompit l’autre. Comment réussit-il donc à voir si bien ?
— C’est ce que personne ne saurait dire, répondit le tailleur : mais pour ce qui est de voir, il a bien vu tout ce que je vous ai dit. Bien plus, il a pris bonne note du vaisseau, afin de pouvoir le reconnaître, si le hasard ou la Providence le remettait jamais sur son passage. C’était un long bâtiment noir, enfoncé dans l’eau comme un serpent dans le gazon, ayant un air de scélératesse diabolique, et d’une dimension tout-à-fait malhonnête. Ensuite tout le monde dit qu’il paraît voguer plus vite que les nuages, et qu’il semble s’inquiéter peu de quel côté souffle le vent ; aussi ajoute-t-on qu’il n’est pas plus facile d’échapper à sa poursuite qu’au traitement qu’il vous prépare. D’après tout ce que j’ai entendu dire, il a quelque rapport avec ce bâtiment négrier là-bas qui a mouillé la semaine passée, Dieu sait pourquoi, dans notre havre d’entrée.
Comme le tailleur babillard avait nécessairement perdu beaucoup de momens précieux à raconter l’histoire qui précède, il se mit alors à les réparer avec une extrême activité, en aidant le raide mouvement de la main tenant l’aiguille par des gestes correspondans de la tête et des épaules. En même temps le paysan, dont, l’esprit était tout rempli de ce qu’il venait d’entendre, tourna les yeux sur le vaisseau que l’autre lui montrait du doigt, pour en prendre une idée, et se bien mettre dans l’esprit tout ce qui avait rapport à une histoire aussi intéressante, afin de pouvoir la raconter ensuite dans tous ses détails. Il y eut nécessairement un instant d’interruption dans l’entretien, pendant que les deux interlocuteurs s’occupaient ainsi chacun de leur côté. Mais le silence fut soudainement rompu par le tailleur, qui coupa le fil avec lequel il venait d’achever le costume de Pardon, jeta tout sur l’établi, releva ses lunettes sur son front, et croisant ses bras sur ses genoux de manière à former avec ses jambes un labyrinthe parfait, pencha son corps en avant, assez pour passer la tête hors de la fenêtre, dirigeant également ses regards vers le vaisseau sur lequel les yeux de son compagnon restaient constamment fixés.
— Savez-vous, Pardy, lui dit-il, quelles pensées étranges, quels cruels soupçons me sont venus dans l’esprit relativement à ce vaisseau ? On dit que c’est un négrier venu ici pour prendre de l’eau et du bois ; voilà une semaine qu’il est là, et je veux mourir si l’on y a transporté seulement une planche ; pour ce qui est de l’eau, je vous réponds que pour une goutte d’eau il en passe à bord au moins dix de rum de la Jamaïque. Ensuite vous pouvez voir qu’il a jeté l’ancre dans un endroit où il n’y a qu’un seul canon de la batterie qui puisse l’atteindre ; tandis que si c’eût été réellement un timide vaisseau marchand, il se serait naturellement mis dans un lieu où, si quelque corsaire avide venait rôder autour du port, il l’aurait trouvé dans le plus chaud du feu.
— Vous êtes bien futé, bon homme, répondit le paysan ébahi ; eh bien ! un vaisseau se serait mis sous la batterie même de l’île, que je l’aurais à peine remarqué.
— C’est l’usage, c’est l’expérience, Pardon, qui fait des
hommes de nous tous. Je dois savoir quelque chose des batteries,
moi qui ai vu tant de guerres, et qui ai servi pendant une campagne
d’une semaine dans ce même fort, quand le bruit se répandit
que les Français envoyaient une flotte de Louisbourg croiser
le long de la côte. Dans cette occasion, j’eus pour consigne de
faire sentinelle auprès de ce même canon, et j’ai vingt fois pour
une examiné la pièce dans tous les sens, afin de voir dans quelle
direction le coup partirait en cas que le malheur voulût qu’il 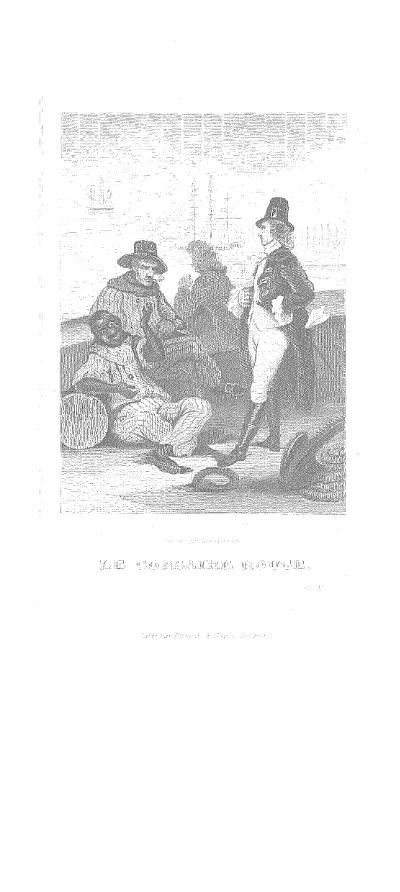 devînt nécessaire d’y mettre le feu en la chargeant de bons et francs
boulets.
devînt nécessaire d’y mettre le feu en la chargeant de bons et francs
boulets.
— Et qui sont ces hommes ? demanda Pardon avec cette espèce de curiosité niaise qu’avaient éveillée chez lui les merveilles racontées par le tailleur. Sont-ce des matelots du négrier, ou des oisifs du Newport ?
— Eux ! s’écria le tailleur en regardant le petit groupe que lui montrait le paysan, à coup sûr ce sont de nouveaux venus, et il peut être bon de les examiner de plus près dans ces temps de trouble. Holà ! Nah, prenez cet habit, et rabattez-en les coutures, fainéante, car le voisin Hopkins est pressé par l’heure, tandis que votre langue va comme celle d’un jeune avocat dans une cour de justice. N’épargnez pas vos coudes, jeune fille ; ce n’est pas de la mousseline que vous allez presser sous le fer, mais une étoffe sur laquelle on pourrait appuyer une maison. Ah ! c’est que votre mère s’y entend, Pardy, et ce qui a été une fois sur son métier n’a pas souvent besoin de la ravaudeuse.
S’étant ainsi déchargé du reste de l’ouvrage sur une servante à mine renfrognée, qui fut forcée de cesser de babiller avec un voisin pour obéir à ses ordres, il sortit promptement de sa boutique, tout boiteux qu’il était depuis sa naissance, et se trouva en plein air. Mais comme nous sommes sur le point de présenter au lecteur des personnages plus importans, nous nous permettrons de différer leur introduction jusqu’au commencement du chapitre suivant.
- ↑ Il y a un état et une île qui portent le même nom. L’état de Rhodes est le plus petit des vingt-quatre autres qui composent l’Union américaine. Il n’est pas plus grand que beaucoup de comtés d’Angleterre. Sa population se compose d’environ cent mille âmes. Il est connu par son industrie manufacturière.
- ↑ Home. On connaît toute la magie de ce mot anglais, qui exprime à la fois les foyers domestiques et le pays natal. — Éd.
- ↑ Nous avons déjà fait observer que ce mot ne saurait être traduit par écuyer ; il signifie aussi un titre d’honneur donné par pure courtoisie ; c’est le mot monsieur dans la bouche d’un industriel en échoppe. — Éd.
- ↑ La plaine d’Abraham est près de Québec. — Éd.
- ↑ Voyez la Prison d’Édimbourg, chap. I. — Éd.
- ↑ Nom donné quelquefois à l’enfer dans la Bible. — Éd.