Le Bravo/Chapitre XXVIII
CHAPITRE XXVIII.
On a déjà vu la manière dont le Conseil des Trois tenait ses assemblées publiques, si rien de ce qui a rapport à ce corps mystérieux peut être appelé public. Dans l’occasion présente, il y avait les mêmes robes, les mêmes déguisements et les mêmes officiers de l’inquisition dont nous avons parlé dans un chapitre précédent. Le seul changement était dans le caractère des juges et dans celui de l’accusé. Par un arrangement particulier de la lampe, une partie de la lumière était dirigée sur la place que devait occuper le prisonnier, tandis que le côté où étaient assis les inquisiteurs restait dans une obscurité en harmonie avec leurs sombres et mystérieux devoirs. Avant qu’on eût ouvert la porte par laquelle l’accusé devait paraître, on entendit le bruit des chaînes ; c’était un indice que cette affaire était regardée comme sérieuse. Les gonds tournèrent, et le Bravo parut en présence des juges inconnus qui devaient décider de son sort.
Comme Jacopo s’était souvent trouvé en la présence de ce lugubre Conseil, quoiqu’il n’eût jamais été prisonnier, il ne montra aucune crainte, aucune surprise. Ses traits étaient pâles, mais calmes ; ses membres immobiles et son maintien décent. Lorsque la légère rumeur que causa son arrivée fut apaisée, il régna un profond silence dans l’appartement.
— On t’appelle Jacopo Frontoni ? dit le secrétaire-greffier qui servait d’organe aux trois juges dans cette occasion.
— Oui.
— Tu es le fils d’un certain Ricardo Frontoni, un homme bien connu pour avoir volé les douanes de la république, et qu’on croit avoir été banni dans une île éloignée ou puni d’une autre manière.
— Oui, Signore, puni d’une autre manière.
— Tu es gondolier ?
— Oui, Signore.
— Ta mère est…
— Morte ! dit Jacopo, s’apercevant que le secrétaire s’arrêtait pour examiner ses notes.
L’accent profond dont ce mot fut prononcé causa un silence que le secrétaire n’interrompit pas avant d’avoir jeté un regard sur les juges.
— Elle n’était pas accusée du crime de ton père ?
— Si elle l’avait été, Signore, elle est depuis longtemps hors du pouvoir de la république.
— Peu de temps après que ton père eut encouru le déplaisir du sénat, tu quittas l’état de gondolier ?
— Oui, Signore.
— Tu es accusé, Jacopo, d’avoir abandonné l’aviron pour le stylet.
— Oui, Signore.
— Pendant plusieurs années le bruit de tes sanglants exploits s’est répandu dans Venise, et depuis quelque temps aucun individu n’a péri de mort violente sans qu’on t’accusât d’avoir porté les coups.
— Cela n’est que trop vrai, signore secrétaire. Je voudrais que cela ne le fût pas.
— L’oreille de Son Altesse et celle des membres du Conseil n’ont pas été fermées aux plaintes portées contre toi ; elles ont écouté ces bruits avec l’inquiétude qui convient à un gouvernement paternel. Si le sénat t’a laissé libre, c’était simplement pour ne pas souiller l’hermine de la justice par un arrêt prématuré.
Jacopo s’inclina sans parler ; cependant un sourire si expressif brilla sur son visage à cette déclaration, que le secrétaire du tribunal secret qui servait d’organe aux juges courba la tête presque sur son papier, comme s’il eût voulu chercher quelques notes plus attentivement.
Que le lecteur ne revienne pas à cette page avec surprise lorsqu’il connaîtra le dénouement de cet ouvrage ; car, de notre temps même, des corps politiques se sont rendus coupables de réticences aussi évidentes, sinon aussi cruelles.
— Il y a maintenant contre toi une accusation terrible, Jacopo Frontoni, continua le secrétaire ; et dans l’intérêt de la vie des citoyens, le Conseil secret lui-même s’est saisi de cette affaire. N’as-tu pas connu un certain Antonio Vecchio, pêcheur de nos lagunes ?
— Oui, Signore ; j’ai été dernièrement avec lui, et je regrette que ç’ait été si peu de temps avant sa mort.
— Tu sais aussi qu’il a été trouvé noyé dans la haie ?
Jacopo frémit, n’exprimant son assentiment que par un signe. L’effet de cet acquiescement tacite fut profond sur le plus jeune des trois membres, car il se tourna vers ses compagnons comme un homme frappé de la franchise de cet aveu. Ses collègues s’inclinèrent d’une manière significative, et cette communication silencieuse cessa.
— Sa mort a excité le mécontentement parmi ses confrères, et elle est devenue une affaire sérieuse pour l’illustre Conseil.
— La mort du plus pauvre homme de Venise doit exciter l’intérêt des patriciens, Signore.
— Sais-tu, Jacopo, que tu es accusé d’être son meurtrier ?
— Oui, Signore, je le sais.
— On dit que tu te mêlas parmi les gondoliers dans la dernière regatta, et que, sans le vieux pêcheur, tu aurais remporté le prix.
— C’est la vérité, Signore.
— Tu ne nies pas cette accusation ? dit l’examinateur avec surprise.
— Il est certain que, sans le pêcheur, j’aurais remporté le prix.
— Et tu le désirais, Jacopo ?
— Oui, Signore, de toute mon âme, répondit l’accusé avec une émotion qu’il n’avait point encore montrée. J’étais un homme condamné par ses confrères, et l’aviron a été ma gloire depuis mon enfance jusqu’à présent.
Un nouveau mouvement du jeune inquisiteur trahit également son intérêt et sa surprise.
— Tu confesses donc le crime ?
Jacopo sourit avec dérision.
— Si les illustres sénateurs qui sont ici présents veulent se démasquer, dit-il, je pourrai répondre à cette question avec plus de confiance.
— Ta demande est hardie et inusitée. Personne ne connaît les patriciens qui président aux destinées de l’État. Confesses-tu le crime ?
L’entrée d’un officier, qui se présenta avec précipitation, empêcha la réponse. Cet homme plaça un rapport écrit entre les mains de l’inquisiteur revêtu d’une robe rouge, et se retira. Après une courte pause, les gardes reçurent l’ordre d’emmener le prisonnier.
— Grands sénateurs, dit Jacopo en s’avançant vers la table, comme s’il voulait saisir le moment de parler : miséricorde ; permettez-moi de visiter un prisonnier qui est sous les plombs ; j’ai des raisons puissantes pour désirer de le voir, et je vous demande, comme hommes et comme pères, de m’accorder cette demande.
Les deux vieux sénateurs, qui se consultaient sur la nouvelle communication qu’ils venaient de recevoir, n’écoutèrent pas cette requête. Le troisième, qui était le signor Soranzo, s’était approché de la lampe afin de lire sur les traits d’un homme si coupable, et regardait Jacopo avec surprise. Touché de l’émotion de la voix du Bravo et agréablement trompé par le visage qu’il étudiait, il prit sur lui de lui accorder sa demande.
— Faites ce qu’il désire, dit-il aux hallebardiers ; mais qu’il soit prompt à reparaître.
Jacopo jeta sur le jeune sénateur un regard qui exprimait toute sa reconnaissance ; mais craignant que ses collègues ne s’opposassent à l’exécution de cet ordre, il quitta précipitamment la salle. La marche du cortège qui se rendait de la salle d’inquisition aux cachots d’été des prisonniers eût offert au besoin un des tableaux caractéristiques du gouvernement de Venise. Jacopo traversa de sombres et secrets corridors cachés aux regards du vulgaire, tandis que de minces cloisons seulement les séparaient de l’appartement du doge, dont la splendeur, semblable à la pompe extérieure de l’État, voilait la nudité et la misère. En atteignant les toits, Jacopo s’arrêta et se tourna vers ses conducteurs :
— Si vous êtes des créatures formées par Dieu, dit-il, ôtez-moi ces chaînes bruyantes, quand ce ne serait que pour un instant.
Ses conducteurs se regardèrent avec surprise, et ni l’un ni l’autre ne s’offrit à lui rendre ce charitable service.
— Je vais voir probablement pour la dernière fois, continua le prisonnier, un homme alité, je pourrais dire un père mourant qui ne connaît pas ma situation… Voudriez-vous qu’il me vît ainsi ?
Cet appel, qui tirait sa force plutôt de la manière expressive dont il était fait que des paroles elles-mêmes, produisit son effet : un des conducteurs ôta les chaînes du Bravo et lui dit d’avancer. Jacopo entra d’un pas prudent, et lorsque la porte fut ouverte, il pénétra seul dans la chambre, car les conducteurs ne trouvaient pas dans une entrevue entre un spadassin et son père un intérêt suffisant pour endurer la chaleur brûlante de la prison. La porte fut fermée sur lui et le cachot retrouva son obscurité.
Malgré sa fermeté habituelle, Jacopo hésita lorsqu’il se trouva si subitement dans la silencieuse demeure du captif abandonné. Le bruit produit par une respiration qui tenait du râle de la mort lui fit connaître promptement l’endroit où était le grabat ; mais les murs massifs du côté du corridor empêchaient la lumière de pénétrer.
— Mon père ! dit Jacopo avec douceur.
Il n’obtint pas de réponse.
— Mon père ! répéta-t-il d’une voix plus forte.
La respiration se releva, et le captif parla.
— La vierge Marie a écouté mes prières, dit-il d’une voix affaiblie ; Dieu t’a envoyé, mon fils, pour me fermer les yeux.
— Vos forces vous abandonnent-elles, mon père ?
— De plus en plus. Mon heure est arrivée ; j’avais espéré voir encore la lumière du jour et bénir ta mère et ta sœur… La volonté de Dieu soit faite !
— Elles prient pour nous deux, mon père ; elles sont au-delà du pouvoir du sénat.
— Jacopo, je ne te comprends pas.
— Ma mère et ma sœur sont mortes ! ce sont des saintes dans le ciel.
Le vieillard gémit, car les liens qui l’attachaient à la terre n’étaient point encore brisés. Jacopo l’entendit murmurer une prière, et il s’agenouilla près du grabat.
— C’est un coup inattendu, murmura le vieillard ; nous quittons ensemble ce monde.
— Il y a longtemps qu’elles sont mortes, mon père !
— Pourquoi, Jacopo, ne me l’as-tu pas dit plus tôt ?…
— N’avais-tu pas assez de chagrin ? Maintenant que tu vas les rejoindre, il te sera doux d’apprendre qu’elles sont depuis longtemps heureuses.
— Et toi ?… tu resteras seul… Donne-moi ta main… Pauvre Jacopo !
Le Bravo s’approcha, et prit la main tremblante de son père ; elle était humide et froide.
— Jacopo, continua le captif dont l’âme soutenait le corps, j’ai prié trois fois depuis une heure : une fois pour le salut de mon âme, une seconde fois pour le repos de ta mère, et une troisième pour toi.
— Que Dieu vous bénisse, mon père ! que Dieu vous bénisse ! j’ai besoin de prières.
— J’ai demandé à Dieu qu’il t’accordât ses faveurs. — Je me suis rappelé — tout ton amour et tes soins, — tout ton dévouement à ma vieillesse et à mes souffrances. Lorsque tu étais un enfant, Jacopo, ma tendresse pour toi me porta à des actes de faiblesse. — Je tremblais que dans ton âge mûr tu ne m’en fisses repentir. — Tu ne peux connaître les craintes qu’un père éprouve pour son enfant ; — mais tu m’as récompensé de mes peines. — Agenouille-toi, Jacopo : — que je demande encore une fois à Dieu — de se souvenir de toi.
— Je suis à tes côtés, mon père.
Le vieillard leva ses faibles bras, et, d’une voix qui semblait recouvrer son ancienne énergie, il prononça une bénédiction solennelle et fervente.
— La bénédiction d’un père mourant, Jacopo, adoucira ton chagrin, ajouta-t-il après une pause, et donnera la paix à tes derniers moments.
— Elle produira surtout ce dernier effet, mon père.
Un coup bruyant frappé à la porte interrompit ces touchants adieux.
— Viens, Jacopo, dit un des gardiens, le Conseil t’attend !
Jacopo sentit son père tressaillir, mais il ne répondit pas.
— Ne te laisseront-ils pas quelques minutes de plus ? murmura le vieillard ; je ne te retiendrai pas longtemps.
La porte s’ouvrit ; un rayon de la lampe pénétra dans le cachot Le gardien eut l’humanité de la fermer encore, et Jacopo se retrouva dans l’obscurité. Le regard que le Bravo obtint, à la faveur de cette lueur fugitive, fut le dernier que son père jeta sur lui. La mort était dans ce regard, qui exprimait en même temps l’affection la plus tendre.
— Cet homme est humain ; il ne veut pas t’arracher de mes bras, murmura le père.
— Ils ne peuvent pas te laisser mourir seul, mon père.
— Mon fils, je suis avec Dieu. — Cependant je serais heureux de t’avoir à mes côtés. — N’as-tu pas dit que ta mère et ta sœur étaient mortes ?
— Mortes !
— Ta jeune sœur aussi ?
— Toutes les deux, mon père ; ce sont des saintes dans le ciel.
Le vieillard respira plus péniblement, et il y eut un moment de silence. Jacopo sentit une main se mouvoir dans les ténèbres, comme si elle l’eût cherché. Il aida ce dernier effort, et posa avec respect la main mourante sur sa tête.
— Que la vierge Marie sans tache et son fils qui est Dieu te bénissent, Jacopo ! murmura une voix qui parut à l’imagination exaltée du Bravo s’élever dans les airs.
Ces paroles solennelles furent suivies d’un soupir péniblement exhalé ; Jacopo cacha sa tête dans la couverture et pria. Un profond silence eut lieu.
— Mon père ! dit Jacopo tressaillant au son de sa propre voix.
Il n’obtint point de réponse, et, avançant la main, il toucha les traits froids d’un cadavre. Avec une fermeté qui tenait du désespoir, il courba de nouveau la tête, et prononça avec ferveur une prière pour le mort.
Lorsque la porte du cachot s’ouvrit, Jacopo partit devant ses gardiens avec cette dignité qui n’appartient qu’aux grands caractères, et qui était augmentée par la scène dans laquelle il venait de jouer un rôle. Il leva les mains et resta immobile lorsque les menottes furent replacées ; alors il suivit ses guides à l’appartement secret. Peu de temps après, il avait repris sa place devant le Conseil des Trois.
— Jacopo Frontoni, dit le secrétaire, tu es accusé d’un autre attentat qui a eu lieu, il y a quelques jours, dans notre ville. Connais-tu un noble de Calabre qui a des droits aux honneurs du sénat et qui demeure depuis longtemps à Venise ?
— Oui, Signore.
— As-tu jamais eu des rapports avec lui ?
— Oui, Signore.
Un mouvement général d’intérêt eut lieu parmi les auditeurs.
— Sais-tu où don Camillo est à présent ?
Jacopo hésita. Il connaissait si bien les intelligences que possédait le Conseil, qu’il doutait s’il serait prudent de nier la connaissance qu’il avait de la fuite des amants ; d’ailleurs son âme était profondément pénétrée, dans ce moment, d’un sentiment de vérité.
— Peux-tu dire pourquoi le jeune duc ne se trouve pas dans son palais ? répéta le secrétaire.
— Illustrissimo, il a quitté Venise pour toujours.
— Comment peux-tu le savoir ? Aurait-il fait son confident d’un spadassin ?
Le sourire qui traversa les traits de Jacopo respirait toute la fierté d’un homme qui se sent au-dessus de celui à qui il l’adresse, et le secrétaire du tribunal secret regarda plus attentivement ses papiers, comme un homme qui reconnaissait le pouvoir de ce sourire.
— Je vous demande encore si vous êtes son confident ?
— Oui, Signore, dans cette occasion. Don Camillo m’a assuré lui-même qu’il ne reviendrait plus.
— C’est impossible, puisqu’il y perdrait toutes ses espérances et une immense fortune.
— Il se consolera, Signore, par l’amour de l’héritière et dans la possession de ses propres richesses.
Il y eut parmi les trois juges un nouveau mouvement que toute leur habitude de contrainte et la dignité de leurs mystérieuses fonctions ne purent empêcher.
— Que les gardiens s’éloignent, dit l’inquisiteur qui portait une robe rouge.
Aussitôt que le prisonnier se trouva seul avec les trois membres et le secrétaire, l’interrogatoire continua. Les sénateurs, se fiant à l’effet produit par leurs masques, parlèrent lorsque l’occasion s’en présenta.
— Tu viens de faire une communication importante, Jacopo, dit le chef du tribunal ; elle pourrait te racheter la vie, si tu voulais entrer dans quelques détails.
— Que puis-je apprendre à Votre Excellence ? Il est sûr que le Conseil connaît la fuite de don Camillo, et je ne puis croire que des yeux qui s’endorment si rarement ne se soient point encore aperçus du départ de la fille de Tiepolo.
— Cela est vrai, Jacopo ; mais tu as quelque chose à dire sur les moyens qui ont été employés. Souviens-toi que le Conseil, en décidant de ton sort, aura égard à ta sincérité.
Le visage du prisonnier laissa voir encore un de ces sourires qui forçaient les interrogateurs à baisser les yeux.
— Les moyens de fuite ne peuvent pas manquer à un amant téméraire, Signore, répondit-il. Don Camillo est riche et aurait pu trouver mille complaisants, s’il en avait eu besoin.
— Tu parles d’une manière équivoque : c’est ce que tu peux faire de plus dangereux pour toi que de te jouer du Conseil. Quels sont les agents qu’il a employés ?
— Il avait des serviteurs fidèles, Excellence, plusieurs gondoliers courageux, enfin des domestiques de toute espèce.
— Nous savons tout cela. — Il s’est échappé par d’autres moyens ; ou même es-tu sûr qu’il se soit échappé ?
— Signore, est-il à Venise ?
— C’est nous qui te le demandons. Voilà une accusation trouvée dans la gueule du lion et qui dit que tu l’as assassiné.
— Et donna Violetta aussi, Excellence ?
— Nous ne savons rien d’elle. Quelle réponse fais-tu à cette accusation ?
— Signore, pourquoi trahirais-je mes propres secrets ?
— Ah ! tu veux nous tromper ! Rappelle-toi que nous avons sous les plombs un prisonnier qui peut tirer de toi la vérité.
Jacopo leva la tête et prit l’attitude d’un homme qui n’a plus rien à craindre. Cependant son regard était triste, en dépit de ses efforts, et il y avait dans sa voix une grande mélancolie.
— Sénateurs, dit-il, votre prisonnier sous les plombs est libre.
— Ton désespoir te donne la hardiesse de te jouer de nous ?
— Je dis la vérité. La liberté, si souvent attendue, est venue à la fin !
— Ton père… ?
— Est mort ! interrompit Jacopo d’une voix solennelle.
Les deux membres les plus âgés du conseil se regardèrent avec surprise, tandis que le plus jeune écoutait avec l’intérêt d’un homme qui entrait dans un noviciat de secrets et de devoirs embarrassants. Les deux premiers se consultèrent ensemble, puis ils communiquèrent au signor Soranzo ce qu’ils jugeaient nécessaire de lui dire dans cette occasion.
— Veux-tu consulter ta propre sûreté, Jacopo, et révéler tout ce que tu sais sur la fuite du Napolitain ? continua l’inquisiteur lorsque la consultation fut terminée.
Jacopo ne trahit aucune faiblesse à cette menace renfermée dans les paroles du sénateur ; mais, après un moment de réflexion, il répondit avec autant de franchise qu’il aurait pu en mettre au confessionnal.
— Vous savez, illustres sénateurs, dit-il, que l’État avait le désir de marier l’héritière de Tiepolo en consultant ses propres avantages, et qu’elle était aimée par le noble Napolitain. Comme cela arrive aux cœurs jeunes et vertueux, elle répondait à son amour, ainsi qu’il convient à une fille de sa haute naissance et d’un âge aussi tendre. Il n’y a rien d’extraordinaire dans cette circonstance : deux personnes si bien faites l’une pour l’autre devaient tout tenter pour se réunir. Signori, la nuit où le vieux Antonio mourut, j’étais seul au milieu des tombes du Lido, rempli de tristes et amères pensées ; la vie était devenue pour moi un fardeau. Si le mauvais génie qui s’était emparé de mes sens eût été vainqueur, j’aurais péri de la mort misérable d’un suicide. Dieu envoya don Camillo Monforte à mon secours. Grâces soient rendues à la vierge Marie et à son adorable fils pour leur miséricorde ! Ce fut là que j’appris les desseins du Napolitain et que je m’engageai à son service. Je lui jurai, sénateurs de Venise, une fidélité à toute épreuve ; je lui jurai de mourir pour lui si cela était nécessaire, et de l’aider à enlever celle qu’il aimait. J’ai accompli mes promesses. Les heureux amants sont maintenant dans les États de l’Église et sous la puissante protection du cardinal secrétaire, le frère de la mère de don Camillo.
— Insensé ! telle a donc été ta conduite ? N’as-tu aucune pensée pour toi-même ?
— J’en ai peu, Excellence. Je songeais plutôt à trouver un cœur humain où je pusse déposer le fardeau de mes souffrances qu’à votre mécontentement. Je n’ai jamais connu dans toute ma vie un moment aussi doux que celui où je vis le duc de Sainte-Agathe presser contre son sein sa belle fiancée tout en larmes.
Les inquisiteurs furent frappés du froid enthousiasme du Bravo, et la surprise les tint encore une fois en suspens. Enfin le plus âgé des trois reprit son interrogatoire.
— Veux-tu nous faire connaître des détails sur la fuite, Jacopo ? Rappelle-toi que tu as encore une vie à racheter.
— Signore, cela n’en vaut guère la peine ; mais pour vous faire plaisir, je ne cacherai rien.
Alors, Jacopo, en termes simples et francs, expliqua les moyens employés par don Camillo pour favoriser sa fuite ; son espoir, son désappointement, et enfin son succès. Dans ce récit, rien ne fut oublié que le lieu où les dames trouvèrent temporairement un asile et le nom de Gelsomina. Il révéla encore l’attentat de Giacomo Gradenigo sur la vie du Napolitain, et la part qu’y prit le juif. Personne n’écouta ces détails plus attentivement que le jeune sénateur. Malgré ses devoirs publics, il sentait son sang précipiter ses pulsations pendant que le prisonnier racontait les dangers des amants ; et, lorsqu’il proclama leur union, il sentit son cœur bondir de joie. Ses collègues, au contraire, vieillis dans la politique vénitienne, écoutèrent les détails du Bravo avec une froideur calculée. Les effets de tout faux système sont de subordonner les sentiments aux circonstances : la fiction prend la place de la passion et de la vérité. Tel est l’effet de la doctrine de la prédestination chez les Musulmans : car celui-là se soumet facilement à une défaite, qui a obtenu un avantage sur la nature et la justice ; sa résignation étant en général aussi parfaite que son arrogance était insupportable. Les deux vieux sénateurs virent tout d’abord que don Camillo et sa belle compagne n’étaient plus en leur pouvoir ; et ils se convainquirent promptement qu’il était sage de se faire un mérite de la nécessité. N’ayant plus rien à apprendre de Jacopo, ils rappelèrent les gardiens et le renvoyèrent à son cachot.
— Il sera convenable décrire des lettres de félicitation au cardinal secrétaire sur l’union de son neveu avec une si riche héritière de notre ville, dit l’inquisiteur des Dix lorsque la porte se ferma sur le prisonnier. L’influence du Napolitain peut nous être favorable.
— Mais s’il parlait de la résistance que le sénat a opposée à son bonheur ? dit le seigneur Soranzo, comme une faible objection à un plan aussi hardi.
— Nous nous excuserons en en rejetant la faute sur un Conseil antérieur au nôtre. Ces malentendus sont les conséquences inévitables des caprices de la liberté, Signore. Le coursier qui parcourt les forêts dans la liberté de la nature ne peut pas être conduit comme le triste animal qui traîne une charrette. Voici la première de nos assemblées, Signore ; mais l’expérience vous prouvera que, toute excellente que soit notre théorie, il se trouve quelquefois des défauts dans la pratique. L’affaire du jeune Gradenigo est fort grave, Signore !
— Je connais depuis longtemps son libertinage, répondit le plus âgé des membres. Il est bien malheureux pour un si noble patricien d’avoir un si indigne fils. Mais ni l’État ni la ville ne peuvent tolérer l’assassinat.
— Plût à Dieu qu’il fût moins fréquent ! s’écria le signor Soranzo avec une parfaite sincérité.
— Ah ! sans doute. Des informations secrètes tendent à confirmer l’accusation de Jacopo ; et d’ailleurs une longue expérience nous a appris à mettre notre confiance dans ses rapports.
— Comment ! — Jacopo est-il un agent de police ?
— Nous parlerons de cela plus à loisir, signor Soranzo. Maintenant, nous devons nous occuper d’un attentat sur la vie d’un personnage protégé par nos lois.
Les trois membres entrèrent alors dans une sérieuse discussion sur l’affaire des deux délinquants. Venise, ainsi que tous les gouvernements despotiques, avait le mérite d’une grande activité dans sa police criminelle lorsqu’elle était disposée à faire justice, comme dans tous les cas où les intérêts du gouvernement n’étaient pas compromis, ou qu’on n’avait pas su corrompre les juges. Quant à ce dernier moyen, grâce à la jalousie de l’État et à la richesse de ceux qui rendaient la justice, il n’était en aucune manière aussi fréquent que dans les autres sociétés où les juges, étant moins riches, sont plus exposés aux tentations. Le seigneur Soranzo eut alors une belle occasion d’exercer ses sentiments généreux. Quoique allié à la maison de Gradenigo, il n’était pas le dernier à blâmer la conduite de l’héritier de cette famille. Son premier mouvement fut de demander un exemple terrible, afin de montrer au monde que le crime, à Venise, ne trouvait de l’impunité dans aucun rang. Il fut détourné de cette sévérité par ses deux compagnons, qui lui rappelèrent que les lois faisaient une distinction entre l’intention et l’exécution d’une offense. Éloigné de son premier dessein par expérience plus calme de ses collègues, le jeune inquisiteur proposa ensuite que l’affaire fût renvoyée devant les tribunaux ordinaires. On ne manquait pas d’exemples pour prouver que l’aristocratie de Venise savait sacrifier au besoin un de ses membres à l’apparence de la justice, car, lorsque de pareilles affaires étaient conduites avec prudence, elles affermissaient plutôt qu’elles n’affaiblissaient son pouvoir. Mais le crime du jeune Gradenigo était trop commun pour permettre que l’aristocratie se relachât de ses privilèges, et les vieux inquisiteurs s’opposèrent au vœu de leur jeune collègue avec une apparence de raison. On convint définitivement qu’ils décideraient eux-mêmes dans cette affaire.
La question qui vint ensuite fut le degré de châtiment. Le chef rusé du Conseil commença par proposer un bannissement de quelques mois ; car Giacomo Gradenigo s’était déjà exposé à la rigueur du sénat dans plus d’une circonstance. Le signor Soranzo s’opposa à cette faible punition avec l’ardeur d’un esprit généreux et juste. Il finit par l’emporter, et ses compagnons prirent soin que leur complaisance eût l’air d’une concession à ses arguments. Le résultat de cette consultation fut que le signor Gradenigo serait condamné à dix ans d’exil dans les provinces, et Osée banni pour la vie. Si le lecteur pensait que la justice n’eût pas la même impartialité envers les deux coupables, il faut qu’il se rappelle que le juif devait être bien aise d’en être quitte à si bon marché.
— Nous ne devons cacher ni ce jugement, ni ce qui l’a motivé, dit l’inquisiteur du Conseil des Dix quand l’affaire fut terminée. L’État ne perd jamais rien à faire connaître sa justice.
— Et la manière dont il la rend, j’espère, dit le signor Soranzo. Nos affaires étant finies pour ce soir, Signori, votre bon plaisir est-il que nous retournions dans nos palais ?
— Nous avons encore cette affaire de Jacopo.
— Cet homme ! Nous pouvons sûrement le livrer aux tribunaux ordinaires.
— Comme vous le jugerez à propos, Signori. Est-ce votre avis ?
Les deux autres firent un signe d’assentiment, et tous trois se disposèrent à partir.
Soranzo sortit le premier ; mais avant de quitter le palais, les
deux autres membres du Conseil eurent ensemble une longue
conférence secrète. Le résultat fut un ordre expédié au juge 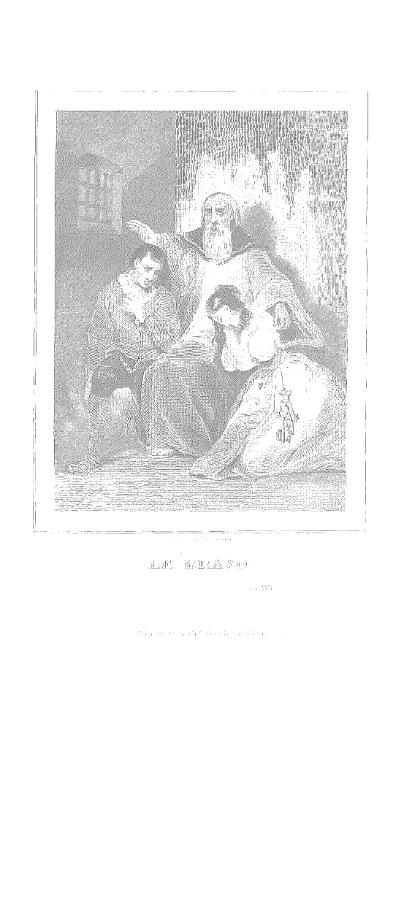 criminel, et alors ils retournèrent chacun chez soi, en hommes ayant
l’approbation de leur conscience.
criminel, et alors ils retournèrent chacun chez soi, en hommes ayant
l’approbation de leur conscience.
De son côté, le signor Soranzo regagna son heureuse et magnifique demeure. Pour la première fois de sa vie, il y rentra avec méfiance de lui-même ; il éprouvait une mélancolie dont il avait peine à se rendre compte, car il avait fait le premier pas dans ce sentier tortueux de la corruption, des sophismes et des fictions de la politique qui mène à l’anéantissement de tous les sentiments nobles et généreux. Il aurait bien voulu se sentir le cœur aussi léger qu’au moment de cette même soirée où il avait donné la main à son épouse à cheveux blonds pour l’aider à entrer dans sa gondole ; mais sa tête pesa longtemps sur son oreiller avant que le sommeil jetât un voile sur le souvenir qui lui revenait sans cesse de la manière dont on avait changé l’accomplissement des devoirs les plus sérieux en une comédie solennelle dans laquelle il venait de jouer son rôle.