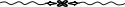Histoire socialiste/La Constituante/La Fuite à Varennes
LA FUITE À VARENNES.
C’est l’attitude de l’Église qui commandera celle du Roi. Or, l’hostilité de l’Église catholique ne tarde pas à éclater. Déjà, chez beaucoup d’évêques et de prêtres, l’exaspération était grande depuis les lois qui mettaient en vente les biens d’Église. Il leur paraissait qu’en perdant son domaine foncier, son prestige de propriété, l’Église perdait les prises temporelles dont elle a besoin pour maintenir sa domination sur les esprits. Mais elle n’osait pas engager directement la lutte sur cette question. Il lui était trop malaisé de persuader au peuple des campagnes, si ignorant ou si fanatique qu’il pût être, que la foi était intéressée à ce que des abbés fainéants, des moines avides détiennent une large part du sol de la France.
Mais à peine la Constituante eût-elle promulgué la constitution civile, que prêtres et évêques saisirent avidement ce prétexte de déclarer que la religion était compromise. Et ils s’appliquèrent à agiter les consciences, soumises depuis des siècles à l’empire du dogme.
Or, il est plus facile d’arracher à l’Église ses titres de propriété foncière que d’arracher des âmes les terreurs et les espérances surnaturelles qu’elle y a longuement enracinées. L’Église le savait et c’est là qu’elle porta son effort, espérant ensuite, par ce détour, retrouver sa propriété.
Peu de jours même avant le vote de la loi, et sous prétexte de mettre les fidèles en garde, l’évêque de Toulon avait, le 1er juillet 1790, engagé la bataille et attaqué l’ensemble de la Révolution :
« Qu’est-ce donc s’écriait-il, que cette régénération qui vous a été solennellement promise ? Au lieu du bonheur dont vous deviez jouir, je ne vois partout que désordre, confusion et anarchie. »
L’évêque de Vienne, Lefranc de Pompignan, un curé de la Flandre maritime se prononcent violemment contre la loi, et l’Assemblée commence à s’émouvoir.
Le 30 octobre la bataille prit soudain de grandes proportions. Les évêques de l’Assemblée déposèrent sur le bureau une Exposition des principes sur la Constitution civile du Clergé. C’était une critique sévère de presque tous les articles. Les évêques protestaient contre la prétention de la puissance civile de toucher à l’organisation de l’Église sans consulter les représentants de l’Église et sans s’inquiéter de leur acquiescement. Et ils disaient « Nous avons proposé la constitution d’un Concile national. Nous avons réclamé, suivant les formes antiques de l’Église gallicane, le recours au chef de l’Église universelle (au pape). »
« Nous avons désigné les objets sur lesquels pouvait s’exercer la compétence des conseils provinciaux. Nous avons déclaré ne pouvoir participer en rien dans l’ordre des objets spirituels à des délibérations émanées d’une puissance purement civile (l’Assemblée Nationale) qui ne peut pas s’étendre sur la juridiction spirituelle de l’Église. »
« Nous avons réclamé, pour les objets purement spirituels, le recours aux formes canoniques et pour les objets mixtes, le concours de la puissance civile et de la puissance ecclésiastiques. Nous avons refusé le serment sur tout ce qui concerne les objets spirituels dépendant de l’autorité de l’Église. Nous avons enfin demandé que l’Assemblée Nationale suspendit l’exécution des décrets dans les départements, jusqu’à ce que l’Église eût manifesté son vœu par la voix de son chef visible (le pape) ou que les formes canoniques eussent été remplies. »
Les archevêques de Rouen, de Reims, d’Aix, d’Arles, d’Albi, de Toulouse, de Bourges, les évêques de Poitiers, de Montauban, de Condom, de Beauvais, du Mans, de Nîmes, de Rodez, de Limoges, de Montpellier, de Perpignan, d’Agen, de Chartres, de Laon, de Saint-Flour, de Châlons-sur-Marne, d’Oléron, de Dijon, de Saintes, de Coutances, de Luçon, de Clermont, d’Uzès, de Couserons, tous membres de l’Assemblée, avaient signé ce document. C’était le signal de la guerre générale.
En Vendée, l’évêque de Luçon, M. de Mercy, s’était appliqué plus particulièrement dès les premiers jours à fomenter l’agitation et le fanatisme. L’Assemblée capitulaire de Luçon adressa en décembre 1790 à l’Assemblée une pétition très habile où elle affectait de se désintéresser des biens d’Église, où elle affectait aussi à l’égard des protestants nombreux dans la région une demi-tolérance, mais où elle combattait la liberté des cultes.
« Le clergé de France, écrivaient les chanoines de Luçon, a été dépouillé de tous les biens qu’il possédait, nous nous sommes interdit la plainte ; nous nous sommes tus… Mais de plus grands intérêts nous forcent aujourd’hui de parler. La Religion, tremblante, éplorée, nous ordonne de mettre sous les yeux de l’Assemblée Nationale ses inquiétudes, ses alarmes… Jamais l’intention des représentants de la Nation n’a pu être de refuser à la religion catholique, à l’unique religion de l’empire français, le tribut d’hommages que depuis quinze siècles lui ont payé avec reconnaissance toutes les Assemblées Nationales qui les ont précédés. La reconnaître pour la seule religion de l’État, interdire tout autre culte public et solennel, était un devoir prescrit par tous les mandats des provinces… »
« Cependant des écrits périodiques répandus avec profusion se sont empressés de publier que la motion faite dans l’Assemblée de reconnaître la religion catholique pour la religion de l’État, et de lui assurer un culte solennel exclusif, avait été repoussée. Les termes du décret rendu sur cet objet ont pu laisser des doutes. Un mot aurait pu fixer toutes les incertitudes et ce mot n’a pas été dit… »
« Habitants d’une province qui fut, pendant plus d’un siècle, le théâtre des querelles et des dissensions religieuses, qui plus que nous a droit d’en redouter les tristes effets ? Quelle province du royaume a eu davantage à gémir sur les suites terribles de la diversité des cultes publics… La paix, la concorde, un jour plus pur ont succédé à ces temps funestes, à ces siècles d’horreur. Puisse cette tranquillité, cette union n’être jamais troublée par une diversité de culte que nos mœurs ne nous permettent pas d’envisager sans terreur ! »
« Ah ! loin que nos désirs appellent la punition sur la tête de nos frères errants, nous volerions, s’ils étaient menacés, nous placer entre eux et les peines qu’on voudrait leur infliger. Nous applaudissons à tout ce qui a été décrété pour assurer leur état civil, leur liberté de croire et de penser. Que les consciences soient libres ; nous détestons toute violence qui aurait la croyance pour objet ; notre religion dédaigne les hommages forcés ; celui d’un cœur libre et persuadé est le seul dont elle s’honore… »
« Mais en demandant que personne ne soit traîné malgré lui aux pieds de nos autels, nous demandons avec non moins d’instance comme citoyens et comme catholiques, qu’il ne soit pas élevé autel contre autel, et qu’en laissant à tout particulier la liberté du culte privé ou domestique, l’Assemblée nationale déclare la religion catholique la seule religion de l’État et défende expressément tout autre culte public et solennel. »
C’est un monument d’intolérance hypocrite et doucereuse. Les Chanoines de Luçon veulent empêcher le retour des guerres de religion entre protestants et catholiques : et comment ? Est-ce en demandant à la loi de protéger efficacement la liberté des uns et des autres ? Non, c’est en supprimant pour les protestants la liberté du culte public.
Mais quel état d’esprit supposent, dans cette province et dans la plupart des provinces, des manifestations pareilles ! Le clergé avait à se défendre, la vente de son domaine était décidée ; les colères contre « les calotins » commençaient à éclater dans quelques grandes villes ; et, à ce moment même, le clergé ne craint pas de demander contre le culte protestant des mesures de rigueur. Et il ose dire, il peut dire que la liberté des cultes provoquera une agitation sanglante !
Vraiment oui, la lutte entre l’esprit de la Révolution et l’esprit de l’Église est inévitable, et on devine combien la Constitution civile du clergé va être exploitée contre la Révolution dans ces provinces de l’ouest dont le sombre fanatisme catholique était chauffé par les prêtres dès les premiers jours. On comprend ainsi que la Constituante, malgré la liberté d’esprit philosophique d’un grand nombre de ses membres, ait cru utile et même nécessaire de s’arrêter au compromis de la Constitution civile.
L’Assemblée, pour arrêter cette agitation croissante voulut frapper un grand coup. Elle avait, à force d’insistance, obtenu du Roi, la sanction du décret sur la Constitution civile et sur le serment des ecclésiastiques. Elle se décida à exiger d’abord de ses membres ecclésiastiques la prestation du serment. Ce sont les évêques de l’Assemblée qui avaient, de l’Assemblée même, dressé le signal le plus haut des protestations.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
C’était à eux de donner, de l’Assemblée même, à tout le clergé de France, l’exemple de la soumission à la loi. Et je m’explique mal les reproches adressés à ce sujet à la Constituante par des hommes comme M. Chassin. Sans doute la résistance des membres de l’Assemblée à prêter le serment accroîtrait la force générale de résistance du clergé. Mais les évêques avaient déjà pris parti. Dans l’Assemblée ou hors de l’Assemblée, ils avaient refusé le serment et donné à leur refus tout l’éclat possible.
Au contraire s’ils s’inclinaient, s’ils n’osaient pas braver l’Assemblée en face, la partie était gagnée. Les évêques refusèrent. Seuls, Talleyrand évêque d’Autun et Gobel, évêque in partibus de Lydda prêtèrent le serment. Hors de l’Assemblée, trois prélats seulement, l’archevêque de Sens, Loménie de Brienne, l’évêque d’Orléans, Jarente et l’évêque de Viviers, Lafont Savine jurèrent sans délai et sans réticence « de veiller sur les fidèles de leur diocèse, d’être fidèles à la Nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée Nationale et acceptée par le Roi. »
L’abbé Grégoire, à la tribune de l’Assemblée, essaya de disculper les préventions des fidèles et des prêtres contre la Constitution civile. « On ne peut se dissimuler, dit-il, que beaucoup de pasteurs très estimables et dont le patriotisme n’est point équivoque éprouvent des anxiétés, parce qu’ils craignent que la Constitution française ne soit incompatible avec les principes du catholicisme.
« Nous sommes aussi inviolablement attachés aux lois de la religion qu’à celles de la Patrie. Revêtus du sacerdoce, nous continuerons de l’honorer par nos mœurs : soumis à cette religion divine, nous en serons constamment les missionnaires, nous en serions s’il le fallait les martyrs : mais après le plus mûr, le plus sérieux examen, nous déclarons ne rien apercevoir dans la Constitution civile du clergé qui puisse blesser les vérités saintes que nous devons croire et enseigner. »
« Ce serait injurier, calomnier l’Assemblée Nationale que de lui supposer le projet de mettre la main à l’encensoir. À la face de la France, de l’univers, elle a manifesté son profond respect pour la religion catholique, apostolique et romaine. Jamais elle n’a voulu priver les fidèles d’aucun moyen de salut ; jamais elle n’a voulu porter la moindre atteinte au dogme, à la hiérarchie, à l’autorité spirituelle du chef de l’Église. Elle reconnaît que ces objets sont hors de son domaine. »
« Dans la nouvelle circonscription des diocèses, elle a voulu simplement déterminer des formes politiques plus avantageuses aux fidèles et à l’État. Le titre seul de Constitution civile du clergé énonce suffisamment l’intention de l’Assemblée Nationale. Nulle considération ne peut donc suspendre l’émission de notre serment ; nous formons les vœux les plus ardents pour que, dans toute l’étendue de l’Empire, nos confrères, calmant leurs inquiétudes, s’empressent de remplir un devoir de patriotisme si propre à porter la paix dans le royaume et à cimenter l’union entre les pasteurs et les ouailles. »
L’effort de Grégoire était sincère : mais il démontre l’étendue de la résistance. De plus, la centralisation catholique était déjà telle, que le janséniste Grégoire est obligé de protester lui-même que l’Assemblée n’a pas touché à la religion romaine, à l’autorité spirituelle du pape. Qu’adviendra-t-il le jour où Rome se prétendra frappée, où le pape proclamera que son autorité spirituelle est méconnue ? Bien menacé sera le compromis imaginé par les jansénistes, accepté par les philosophes et approuvé par les politiques. Soixante-un curés députés prêtent le serment aussitôt après Grégoire. C’était un chiffre important ; mais comme on est loin du mouvement presque unanime qui emporta le bas clergé à se réunir aux Communes et à voter l’abolition des dîmes ! Évidemment un grand trouble a saisi une partie des prêtres. Et à quoi bon méconnaître que plus d’un, assez disposé à faire bon marché des avantages matériels, hésita à la pensée de compromettre la foi dont il était le gardien ?
Le soulèvement religieux eût été plus facile à vaincre s’il n’y avait eu que cupidité et parade. La sincérité passionnée et parfois héroïque d’une partie des prêtres et des fidèles fit la force de la résistance : et comment des âmes habituées aux terreurs du mystère n’imagineraient-elles point que tout ce qui modifie la Constitution même extérieure de l’Église risque au moins d’effleurer le dogme obscur qui réside en elle ?
Précisément parce qu’il est mystérieux on ne sait au juste jusqu’où s’étend sa sphère ; et quel drame pour ces consciences de prêtres se demandant si elles n’empiétaient pas sur le divin ! et ne recueillant, dans l’ombre où elles étaient accoutumées, que des réponses incertaines et de flottantes lueurs ! L’Assemblée s’impatiente, et le 3 janvier 1791, sur la proposition de Barnave et de Lameth, elle décide que si le lendemain les ecclésiastiques ou fonctionnaires publics n’en ont pas fini avec la formalité du serment, ils seront déchus.
Le lendemain, vingt-trois membres de l’Assemblée, tous curés, prêtent le serment. Le 6, Barnave demande que ceux qui n’avaient pas encore juré, soient interpellés nominativement par le Président. L’évêque d’Agen monte à la tribune et déclare qu’il ne jurera pas. Leclère, curé de la Combe, député du bailliage d’Alençon, dit qu’il est enfant de l’Église catholique et qu’il ne peut jurer. Couturier, curé de Senlis, ne veut jurer qu’avec réserve. L’évêque de Poitiers dit : « Je ne veux pas déshonorer ma vieillesse en prêtant le serment. » (Voir Robinet).
L’Assemblée, irritée, décide enfin sur une nouvelle motion de Barnave, que tous ceux, évêques ou curés qui n’ont point juré soient déchus et que leurs sièges soient déclarés vacants.
En fait, c’était appeler du clergé, à demi réfractaire, au pays. La bataille était incertaine encore : ou même l’Assemblée pouvait espérer, à cette date, qu’elle aurait raison du mouvement. Si les élections se faisaient partout ou presque partout paisiblement, si partout il y avait des candidats constitutionnels et assermentés aux fonctions de curé ou d’évêque, la résistance des réfractaires se lasserait sans doute, et la Révolution aurait échappé au plus grand des dangers.
Le mouvement fut d’abord très mêlé et très incertain. Il est difficile, faute de documents authentiques, de savoir quelle fut la proportion exacte des jureurs et des non jureurs, des assermentés et des insermentés. À Paris, il semble bien que la moitié au moins des prêtres ait prêté le serment : et presque partout, surtout dans les campagnes, la proportion fut plus élevée. Et non seulement, un grand nombre de prêtres acceptaient la Constitution civile et assuraient la continuation du culte dans les conditions fixées par l’Assemblée : mais ces prêtres constitutionnels faisaient, à l’exemple de Grégoire, un véhément effort pour ramener à eux les « réfractaires ».
Eux-mêmes tâchaient de donner à leur serment le plus de retentissement et d’éclat.
Après l’avoir prononcé devant l’assemblée électorale, ils désiraient souvent qu’avis en fût donné à l’Assemblée nationale elle-même. Des chanoines du chapitre de Paris ayant attaqué la Constitution civile, beaucoup de leurs confrères adressèrent immédiatement une protestation à la Constituante, le 7 janvier 1791 : « Nous soussignés, prêtres, diacres, sous-diacres, ci-devant bénéficiers de l’Église métropolitaine de Paris, sous les titres de chanoines de Saint-Denis-du-Pas, de Saint-Jean-le-Rond et vicaires de Saint-Aignan, de plus les musiciens clercs de cette église, après avoir pris connaissance d’une protestation des ci-devant chanoines et chapitres, et, en outre, d’une déclaration par eux faite aux officiers municipaux de cette ville, lors de l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de ladite église : désirant autant qu’il est en nous demeurer fidèles au serment civique que nous avons prêté avec tous les Français, montrer de la manière la plus solennelle notre entière soumission aux lois décrétées par l’Assemblée nationale, acceptées par le roi, et spécialement à la constitution civile du clergé, déclarons désavouer authentiquement toutes protestations ou déclarations réelles ou supposées, secrètes ou publiques sous le nom de Chapitre de Paris ; reconnaissons que l’Assemblée nationale a eu le bon droit de décréter, et le roi de sanctionner et faire exécuter comme loi obligatoire pour tout ecclésiastique citoyen, ladite constitution civile du clergé de France ; que nous sommes disposés à prononcer le serment exigé des fonctionnaires ecclésiastiques de la nation sans y être portés par d’autres motifs que ceux de la conscience, de la raison, de la justice et de l’amour de la patrie : en foi de quoi nous avons signé la présente déclaration :
« Feray, prêtre, ci-devant chanoine de Saint-Denis du Pas ; Larsonnier, prêtre, ci-devant premier vicaire de Saint-Aignan ; Damaz, prêtre, ci-devant chanoine de Saint-Jean-le-Rond ; Merlin, diacre, ci-devant chanoine de Saint-Denis-du-Pas ; Bauweur, musicien ; Devillicer, clerc ; Pinard, clerc ; Goutte, sous-diacre, ci-devant chanoine de Saint-Jean-le-Rond ; Messier, clerc de matines ; Duncon, diacre, ci-devant chanoine de Saint-Jean-le-Rond ; Cornu, clerc ; Hurez, clerc ».
J’ai reproduit ce document, cité par Robinet d’après les archives parlementaires, pour montrer l’effervescence extraordinaire du monde ecclésiastique : toute paroisse, toute institution cléricale était divisée contre elle-même : et l’esprit de la Révolution était si puissant, l’appel à la force populaire, même pour instituer les ministres du culte, avait tant de grandeur que même cette Église, la négation vivante de la pensée révolutionnaire, était, en partie au moins entraînée.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
Il y a une vigueur d’accent étonnante et une évidente sincérité dans le discours de l’abbé Thomeret, curé de Noisy-le-Sec : il conduisait à l’Assemblée électorale du département de Paris, une délégation civique du canton de Pantin ; et au nom des délégués, il parla ainsi, le 7 janvier 1791 : « Messieurs, nous venons avec confiance au milieu de vous, persuadés que votre génie accueillera favorablement notre simplicité.
« Nous venons vous offrir l’hommage de nos vœux fraternels, vous applaudir au nom du peuple, sur les juges intègres que vous lui avez donnés ; nous réjouir d’avance des administrateurs que votre sagesse nous prépare, vous exprimer enfin combien nous sommes honorés et attendris de la communication et de la lecture de votre adresse à l’Assemblée nationale.
« Un regret s’est mêlé à notre reconnaissance : nous aurions désiré qu’en dénombrant les bienfaits de votre immortelle constitution, vous eussiez fait une mention expresse de ceux qu’elle a répandus abondamment sur les campagnes. Votre dessein fut peut-être de nous ménager à nous-mêmes une occasion touchante de manifester nos sentiments.
« De toutes les classes sociales, le peuple agriculteur était le peuple le plus outragé par nos anciennes lois : de toutes les classes sociales, le peuple agriculteur est le plus favorisé par les lois nouvelles.
« Nous les bénissons dans nos chaumières qui vont s’embellir ; nous les bénissons dans nos champs qui vont prospérer ; nous les bénissons dans nos temples qui, témoins jusqu’ici de nos calamités, vont l’être enfin de notre bonheur.
« Devenus citoyens libres et armés, la tyrannie a perdu l’espérance de nous reconquérir ; mais elle gardait celle de nous tromper. Elle nous dépeignait nos législateurs sous des traits odieux et la Révolution sous un aspect sinistre. Le bien que nous recueillons efface, anéantit le mal que l’on nous annonce ; nous voyons approcher la moisson et s’éloigner l’orage.
« Ne pouvant plus nous opprimer ni nous séduire, que fait à présent une aristocratie au désespoir ? Elle nous calomnie.
« Oui, Messieurs, elle annonce à la France, elle répète aux étrangers, que les habitants des campagnes ont reçu les bienfaits de la législation mais qu’ils rejettent ses décrets.
« Les insurrections villageoises que ces perturbateurs publics ont suscitées eux-mêmes ont donné à la patrie des moments de terreur et à la haine un horrible triomphe. Il n’a pas duré. Bientôt ont paru à découvert le zèle imposteur qui conduisait des égarés et le zèle véritable qui ramenait des patriotes ; et la nation instruite a séparé les monstres d’avec les imprudents.
« Plus près de la lumière, puisque nous sommes plus voisins de la Capitale, nous n’avons point cédé à des impulsions, perfides ; notre conduite a signalé notre civisme ; invariables dans nos principes, inébranlables dans notre fidélité, en un mot constitutionnels de cœur et de fait, pour ajouter un bon exemple à tant d’exemples solennels, nous déclarons et nous jurons :
« 1o Que nous sommes attachés à l’observation exacte de nos devoirs autant qu’à la conservation entière de nos droits : l’une est la charte primitive et l’autre est le décalogue naturel.
« 2o Que nous ne séparons point dans nos cœurs ce qui est inséparable dans l’empire français, la constitution monarchique de la constitution populaire, et qu’après d’excellentes lois le premier don du Ciel nous semble être un excellent monarque ; Louis XVI n’a pas créé la Constitution, mais il semble avoir été créé pour elle.
« 3o Que nous plaçons au premier rang des vertus chrétiennes cette tolérance charitable. Cette fraternité évangélique, cette subordination religieuse, établie par le fondateur du christianisme, prêchée par les apôtres de la foi, renversée par d’ambitieux pontifes et rétablie enfin par nos législateurs, qui ont retrouvé la religion quand on la croyait perdue ;
« 4o Que nous sommes également résolus à payer et à faire payer les contributions imposées par la loi, et réparties par la justice, comme une dette religieuse, comme un contrat civique, comme un patrimoine national ;
« 5o Que nous favoriserons de toutes nos forces, ainsi que de toute notre docilité, la circulation des blés, non moins indispensable au monde que la circulation des airs et la circulation des fleuves ;
« 6o Que nous respecterons les propriétés jusque dans les débris féodaux ; que nous serons soumis à la magistrature, autant qu’indépendants d’une vaine noblesse, et que désormais nous regarderons l’homme inutile comme le seul être ignoble, et l’homme bienfaisant comme le seul noble réel ;
« 7o Et enfin que nous ne quitterons jamais nos armes, nos instruments de liberté, pas plus que ceux de la culture ; mais que nous ne les tournerons jamais contre la patrie, jamais contre la loi, jamais contre l’ordre public. Nous voulons conserver la liberté des hommes et non pas imiter la liberté des tigres et celle des brigands.
« Nous déposons dans votre sein. Messieurs, le serment de nos cœurs ; nous avons applaudi vos sentiments ; daignez approuver les nôtres ».
Bien suggestives sont ces démarches, ces paroles du clergé révolutionnaire. Les prêtres, dans plusieurs campagnes subissaient évidemment l’entraînement général.
Comment auraient-ils pu persuader à leurs fidèles que la Révolution était diabolique du moment où par l’abolition des dîmes et des plus humiliants des droits féodaux, par l’abolition des impôts odieux comme la gabelle, et du droit exclusif de chasse du noble, elle améliorait et relevait la condition du paysan ?
Le prêtre pouvait-il dire à ces paysans que la Révolution qui était son amie était l’ennemie de Dieu ? Il était ainsi conduit à chercher lui-même la conciliation de son antique foi et du grand mouvement populaire.
Ainsi, bien que la Révolution procédât à la fois d’une croissance économique bourgeoise qui n’avait rien de religieux et d’une philosophie générale qui était la négation même du christianisme, elle obligeait le prêtre, par les bienfaits dont elle comblait les paysans, à chercher et à reconnaître en elle un caractère divin. Elle l’obligeait à se rapprocher, dans son interprétation religieuse du monde, des sentiments naturels et humains, la charte primitive, le décalogue naturel.
Grand sujet de méditation pour nous tous. Et nous aussi, républicains socialistes, nous rencontrons aujourd’hui devant nous l’Église contre laquelle la Révolution bourgeoise eut à lutter il y a plus d’un siècle.
Elle est puissante encore, et dans toutes les classes : elle ralentit nos progrès ; et si soudain l’évolution socialiste s’accélérait en Révolution, si le prolétariat saisissait le pouvoir ou une grande partie du pouvoir, c’est sans doute l’Église qui deviendrait le centre de la résistance ; et peut-être pourrait-elle refouler encore pour un demi-siècle, pour un siècle même, le mouvement ouvrier comme en juin 1848, comme en mai 1871.
Il serait insensé de croire que la seule violence suffise à la déraciner : elle a enfoncé trop profondément sa puissance dans les habitudes, les préjugés, les affections ; et c’est par un long effort que nous diminuerons ses prises sur le monde.
La Révolution bourgeoise eut contre l’Église deux grandes forces, la force de la science et de la philosophie qui ne s’était communiquée qu’aux esprits les plus libres de la bourgeoisie, et la force des bienfaits immédiats assurés par elle aux paysans.
« Nous vous bénissons dans nos chaumières qui vont s’embellir, dans nos champs qui vont prospérer ».
Et nous, nous devons par un effort passionné d’instruction et d’éducation populaire, éveiller la raison, la pensée libre dans le prolétariat des champs et des villes nous devons aussi, dès maintenant, par un plan méthodique de réforme et d’organisation, par la coopération agricole, par l’institution de la grande propriété paysanne, communale ou coopérative, régie par des syndicats d’ouvriers ruraux, préparer les campagnes à recevoir sans étonnement et sans effroi, au jour décisif de la Révolution libératrice, le bienfait du communisme.
S’il n’y était point préparé, le paysan verrait sa ruine peut-être dans ce qui sera son salut ; et il faudrait perdre à acclimater son esprit aux nécessités du régime nouveau, le temps que la Révolution, sous peine de périr, devrait consacrer à l’organisation et à l’action.
Ce qui a sauvé la Révolution bourgeoise c’est que dans beaucoup de paroisses les paysans ont pu dire à la contre-révolution dès les premières semaines : « Des charges pesaient sur moi : j’en suis libéré ».
Pour que la Révolution communiste puisse de même dans les campagnes, neutraliser d’emblée, au moins en partie, l’action funeste du prêtre, il faudra aussi que dès les premières semaines, les travailleurs du sol puissent dire : « Nous étions au service de la bourgeoisie oisive, de la finance des nobles ; maintenant c’est nous qui, sous la forme coopérative, communale et syndicale, possédons le sol ; le communisme nous a délivrés ».

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Mais les paysans ne pourraient parler ainsi et obliger le prêtre au silence, si dès les premiers jours, ils n’avaient pas compris. Donc nous tous socialistes, dans la période peut-être longue encore, d’inévitable préparation qui précède toujours dans l’histoire les grandes transformations révolutionnaires, appliquons-nous dès aujourd’hui à faire pénétrer dans les campagnes des germes, des ébauches du communisme.
La Révolution mûrira soudain ces germes, complétera et amplifiera ces ébauches, sans que le paysan soit, une minute, déconcerté : et les travailleurs des campagnes, même s’ils sont encore chrétiens et superstitieux, pourront opposer un argument immédiat aux manœuvres sournoises et violentes de l’Église, alliée et servante de la propriété bourgeoise. Ce qui subsistera alors de foi ou d’habitude chrétienne pourra s’éteindre ainsi doucement, comme une flamme sans nourriture, et leur libération économique ne coûtera pas aux paysans les terribles et inutiles souffrances des déchirements religieux.
C’est à coup sûr à la reconnaissance passionnée d’une partie des paysans pour ses premiers bienfaits, que la Révolution bourgeoise a dû le concours enthousiaste de quelques prêtres de campagne : l’ardeur révolutionnaire de leurs « fidèles » s’était communiquée à eux. Écoutez le véhément langage du curé de Crosnes, Pierre-Guillaume Berthou, ancien maire de la dite paroisse, puis électeur et administrateur du district de Corbeil. Avant de prêter serment, le 30 janvier 1791, il parle ainsi :
« Si les enfants d’une même patrie, les membres d’une même famille regardent comme un jour de fête celui où ils sont invités à renouveler et à resserrer l’alliance protectrice de leur commune félicité, avec quelle délicieuse ivresse ce sentiment ne doit-il pas se répandre dans l’âme d’un prêtre citoyen ?
« Vous savez, mes frères, et je n’ai pas besoin de vous le dire, vous savez combien je chéris notre admirable Constitution ; vous connaissez mon application à en méditer la doctrine, et mon zèle à en suivre les progrès, et mon courage à venger ses droits et ma persévérance à étendre ses conquêtes ; vous avez été les témoins assidus et de mes déplaisirs, quand elle est menacée, et de ma joie, quand elle triomphe. Vous avez pu vous convaincre qu’elle était pour moi une seconde religion ; parce que le Dieu créateur de la bienfaisante liberté, de la douce égalité, de l’aimable fraternité, de la justice universelle, ne mérite pas moins notre culte que l’auteur et le consommateur de notre foi.
« Aussi dans cette dernière agression d’un sacerdoce inquiet pour ses prérogatives encore plus que pour ses autels, dans ce torrent de déclamations calomnieuses contre la nouvelle organisation que nos représentants ont décrétée, dans cette rébellion des ministres de toutes les classes contre la souveraineté nationale, dans ces divorces fréquents et scandaleux entre les pasteurs et leur troupeau, je suis bien sûr que vous n’avez cessé de me compter au nombre des plus intrépides défenseurs de la chose publique et de l’incorruptible patriotisme. Non, vous n’avez pas craint, un seul instant, que l’aîné de la famille consentît à déserter la maison commune, à trahir la confiance de ses frères, à flétrir les honneurs civiques de maire, d’électeur et d’administrateur qui lui avaient été décernés.
« Le serment solennel que je vais déposer entre vos mains ne saurait donc être autre chose que l’expression sincère, l’expression constante de mes vœux, de mes sentiments, de mes travaux, de ma conscience et de ma conduite.
« Et que prétendent ces lévites abusés ou conspirateurs ? Est-ce à la Constitution qu’ils en veulent ? Elle est invincible. Est-ce après leurs anciennes jouissances qu’ils soupirent et se précipitent ? Leurs efforts sont aussi vains que leurs regrets. Est-ce autour de l’arche sainte qu’ils se réunissent ? Elle n’a pas besoin de leurs boucliers. Est-ce l’économie évangélique qui les éveille et leur met des armes à la main ? Quel délire !… Par quel étrange contraste les disciples d’un Dieu qui a fondé son Église sur la pauvreté, l’humilité, la charité, le renoncement à soi-même, la soumission au souverain et à ses lois, la fuite de ce que le monde préconise, la pratique de ce qu’il dédaigne, affectent-ils aujourd’hui une fastueuse opulence, une ambitieuse domination ?
« Docile aux leçons et aux exemples de mon divin maître, guidé par les pures et vives lumières qui jaillissent des sources apostoliques, pénétré des nobles sentiments et des sublimes vérités qui illustrèrent cet âge justement nommé l’âge d’or du christianisme, pourrais-je être ébranlé, par les raisonnements hypocrites de l’orgueil, de la cupidité, par les arguments subtils de la scholastique ? Pourrais-je écouter des traditions profanes incertaines, ennemies du genre humain ?
« Bien convaincu que le but de la société, même religieuse, est de procurer l’avantage de ceux qui sont gouvernés et non de ceux qui gouvernent, pourrais-je ne pas reconnaître et publier hautement que l’Assemblée nationale a usé de son droit en extirpant l’ivraie qui couvrait le champ du Seigneur, en moissonnant ce monstrueux assemblage d’abus et de prévarications qui le rendaient tout à la fois informe et stérile, en ramenant les pasteurs à l’ordre primitif, en adaptant le régime ecclésiastique à toutes les institutions de l’empire, en faisant concourir au système du bonheur public l’Évangile et la liberté ? »
C’est comme un écho des foudroyants éclats de Luther. Les prêtres, comme on le voit par l’exemple du curé Berthou, étaient pris dans le mouvement révolutionnaire par un curieux engrenage. D’abord, sous l’ancien régime, la communauté de souffrances, de servitude et d’humiliation avait rapproché du peuple, des paysans surtout, le bas clergé. Les curés avaient aidé à la confection et à la rédaction des cahiers dirigés contre les grands seigneurs laïques et les grands seigneurs d’Église. Plusieurs de ces curés, comme le curé Berthou, comme tous ces prêtres dont M. Guillemaut a relevé le nom dans son histoire du Louhannais, furent appelés aux fonctions publiques par le suffrage populaire : maires, administrateurs. Allaient-ils, soudain, quand parut la Constitution civile, rebrousser chemin ? Elle leur apparut, et non sans raison, comme la suite de tout le mouvement où ils étaient engagés, et, soutenus d’ailleurs par des souvenirs du jansénisme, lequel n’avait point dédaigné le cartésianisme, ils se firent une sorte de philosophie religieuse semi-rationaliste.
Le curé Berthou a deux religions, la religion de l’Évangile, la religion de la liberté.
Oui, combinaison fragile : mais qu’on se figure que dans un grand nombre de paroisses retentissaient ces appels des prêtres jureurs en faveur de la Révolution. Qu’on se rappelle qu’au même moment et au plus fort des luttes passionnées soulevées dés le début par la Constitution civile, avaient lieu les ventes des biens d’Église, qu’une prédication unanimement hostile du clergé aurait peut-être empêchées : on comprendra les services que la Constitution civile, divisant l’armée d’Église, rendit à la Révolution en lui permettant de gagner du temps.
Mais l’opposition était déjà formidable. Beaucoup de prêtres refusaient le serment. Ils entraînaient à leurs offices une partie des fidèles. Les prêtres non-jureurs raillaient avec âpreté les cérémonies nouvelles d’élection et d’investiture semi-chrétienne, semi-laïque :
« On avait, dit l’un d’eux, placé dans l’église Notre-Dame, entre les autels de la Sainte Vierge et de Saint Denis, un peu en avant, un autel à l’antique, élevé sur deux ou trois marches, de forme carrée, de trois pieds et demi de hauteur et de trois pieds de largeur et de profondeur.
« Cet autel était orné d’une corniche et décoré de peintures sur les trois faces : à celle de devant, était une couronne de chêne, renfermant en inscription : Dieu, la loi, le roi. A la face droite, qui était du côté de l’autel de la Sainte Vierge, on voyait une couronne civique semblable à la première, qui environnait une massue surmontée du bonnet de la liberté : A la face gauche, un faisceau d’armes était entouré d’une couronne semblable : aux deux côtés étaient deux candélabres !
« Le tout paraît avoir été fourni par les Menus, et tiré de la décoration d’Iphigénie !
« M. Bailly, maire, était accompagné, le 16, de MM. Hourmel et Tassin, banquiers de la religion prétendue réformée.
« Quelle jouissance pour eux de voir cette foule de prêtres et de moines qui les environnaient se rapprocher de cette réforme repoussée avec horreur depuis si longtemps ! Il faut avouer que les Rabaud et les Barnave ont bien mérité de leur secte. Mais nous en verrons bien d’autres, Français. »
Oui, et ils en avaient déjà bien vu d’autres au temps où c’étaient les maîtresses du roi Louis XV qui disposaient, en somme, des bénéfices et des évêchés. Mais ce qui était plus grave que ces railleries, c’est que les prêtres non-jureurs essayaient de démontrer aux croyants que les nouveaux évêques, les nouveaux curés n’étaient pas régulièrement investis, qu’ils n’étaient que des usurpateurs sans autorité, et que les sacrements administrés par eux étaient sans effet ou même étaient une parodie sacrilège. Cela jetait un trouble immense.
En Vendée, comme on le voit dans l’admirable recueil de documents publié par M. Ghassin, la résistance prend dès le début des allures de guerre civile et religieuse.
A Fontenay-le-Comte, le 21 janvier 1791, les prêtres de la ville déposent à la mairie un cahier où leurs déclarations étaient résumées en cette formule : « Je jure d’accepter la Constitution, excepté dans les droits qui dépendent de l’autorité spirituelle. »
L’Assemblée nationale avait exigé le serment « sans préambule, explication, ni restriction ».
La municipalité de Fontenay-le-Comte, quoiqu’assez disposée à transiger, ne put donc accepter la formule restrictive des prêtres : un seul des trois curés, celui de la paroisse de Saint-Nicolas se soumit. Le doyen de Notre-Dame, Bridault, le curé de Saint-Jean, Sabeurand, refusèrent le serment et expliquèrent leur refus devant le peuple en des prédications passionnées. Les autorités civiles timides, hésitantes, ne sévirent point, et l’ébranlement se propagea. D’ailleurs elles n’avaient pas en mains de moyens légaux de répression.
Dès que les nobles de l’ouest virent ce commencement de rébellion cléricale, ils espérèrent en tirer profit pour la contre-révolution. Ils affectèrent soudain des préoccupations religieuses auxquelles la noblesse voltairienne du xviiie siècle avait été jusque là étrangère. Ils essayaient de piquer d’honneur les curés. « On verra maintenant, criaient hobereaux et Demoiselles, si les curés seront assez impies pour renoncer à la cause de Dieu. »
Les nobles se pressaient dans les églises pour manifester impunément sous le couvert de la religion, pour obliger les curés à se compromettre, à s’animer, sous l’influence de l’auditoire contre-révolutionnaire qui les inspirait et les jugeait.
Un observateur contemporain, Mercier du Rocher, écrit dans ses notes : « Les églises presque vides naguère, se remplissaient à tous les offices de ci-devant nobles qui avaient passé leur vie dans la débauche la plus effrénée, s’approchant souvent des sacrements, eux qui avaient dans tous les temps traité ces cérémonies de farces ridicules. »
Comme des incroyants entrent dans une église pour s’abriter d’un orage, soudain les nobles y entraient pour s’abriter de la Révolution.
Les révolutionnaires, les patriotes n’avaient pas d’abord pris parti : ils avaient, au début, tenté de dire, avec un certain dédain : Querelle de prêtres, comme on disait : Querelle de moines : et leurs femmes, menées par l’habitude, les conduisaient aussi bien à la messe du non-jureur qu’à celle du jureur et quelquefois de préférence.
Mais quand ils s’aperçurent que les offices célébrés par les non-jureurs devenaient de véritables rassemblements de guerre civile contre la Révolution, ils se portèrent en masse aux offices des prêtres constitutionnels.
L’évêque de la Rochelle, de Goucy, chapelain de la reine, se jeta passionément dans la lutte.
L’essentiel, pour l’Église réfractaire, était de maintenir en fonction les prêtres insermentés ; et de les aider à vivre, leur traitement supprimé, sans demander aux paysans le moindre sacrifice.
Si la Vendée fut, à quelques égards, un mouvement « populaire », si de simples paysans, de simples artisans y jouèrent un grand rôle, ce fut un mouvement d’égoïsme populaire, d’égoïsme paysan. Prendre de toute main et ne rien donner, sera la véritable politique des masses paysannes vendéennes : aucun haut esprit de sacrifice n’était en elles : et si elles risquaient parfois leur vie, c’était pour des avantages matériels, qui valaient à leurs yeux plus que la vie.
Les grands chefs du mouvement comprirent bien qu’il fallait ménager d’abord et exploiter ensuite ce fond et ce tréfond d’égoïsme. Ils se gardèrent bien de faire appel à la bourse des paysans en faveur des prêtres. C’est l’évêque qui se procura, sous forme d’avance sur les revenus de son évêché, soixante mille livres. Les nobles s’engagèrent à assurer le traitement des réfractaires. Les missionnaires et les sœurs de Saint-Laurent-sur-Sèvres, qui parcouraient sans cesse l’ouest, continuèrent, il est vrai, à quêter : mais ils assuraient aux paysans qu’il fallait organiser des caisses de secours et de propagande pour défendre le pays contre les révolutionnaires. Ils commençaient à leur inoculer l’idée que la Vendée devrait se suffire, vivre de ses ressources et refuser son concours à la nation. Une fermentation aigre et basse de fanatisme et d’égoïsme se propageait.
Mais un nouveau coup retentissant allait être porté par l’Église à la Révolution. Le pape prenait parti. Le 10 mars 1791, il adressait à son Excellence, M. le cardinal de la Rochefoucauld, M. l’archevêque d’Aix et aux autres archevêques et évêques de l’Assemblée nationale de France un bref où il condamnait violemment la constitution civile. Il prétendait que l’Assemblée s’était attribué la compétence et la puissance spirituelle. Il affirmait que la consécration canonique instituée par elle sans l’intervention de la papauté n’avait point de valeur. Il protestait contre la dissolution des ordres religieux. Il protestait aussi violemment contre la saisie des biens d’Église. Et il contestait ainsi, il niait toute la Révolution.
Son bref du 15 avril était une condamnation nouvelle de toute l’œuvre révolutionnaire. Et de plus le pape y déclarait nettement les élections des prêtres constitutionnels illégitimes, leur consécration sacrilège, et suspens de toutes fonctions ecclésiastiques, les consacrés et les consécrateurs. C’était la proclamation officielle du schisme.
On devine le parti que les évêques réfractaires allaient tirer des brefs du pape. Pourtant le pape allait plus loin que les tacticiens de la contre-révolution ne l’auraient désiré.
Dans un consistoire secret du 7 mars il n’avait pas seulement attaqué la Constitution civile. Il avait dénoncé comme impie, la liberté accordée par la Révolution aux non-catholiques.
C’est la tolérance même qu’il condamnait comme diabolique, et ce sentiment perçait dans le bref du 10 mars.
De plus il paraissait imprudent aux évêques réfractaires de condamner ouvertement la vente des biens d’Église et d’animer ainsi contre les réacteurs tous les acquéreurs déjà nombreux de biens nationaux. C’est ce que le rusé évêque de Luçon, de Mercy, indique bien dans sa lettre du 27 mars, à Monsieur Noirot, curé de Sallertaine, par Challans (Bas-Poitou).
« J’ai baigné de mes larmes, mon cher curé, votre lettre et la déclaration qu’elle contenait, j’en ai répandu de joie sur ceux de vos confrères que j’ai vus soussignés, et de douleur sur ceux qui se sont séparés de vous. Espérons que bientôt ils reconnaîtront leur erreur et que nous les verrons revenir à l’unité ».
« Je ne reviens pas de la désertion de tous les prêtres de l’île de Noirmoutier, jamais ma confiance ne fut plus cruellement trompée. Mais il s’en faut que je les regarde comme perdus pour moi et pour l’Église : ils nous reviendront, j’en suis sûr, je le demande avec de trop vives instances au Père des miséricordes ; ils verront et vous verrez avec eux le Bref que le Pape vient d’adresser à Monsieur l’archevêque de Sens, et ils ne douteront plus de la façon de penser du chef de l’Église ; ils se convaincront qu’il est uni de sentiments avec les évêques de France, et que la doctrine que nous avons annoncée et défendue est véritablement celle de l’Église.
« Le Pape a enfin répondu au Roi et aux évêques de l’Assemblée qui ont signé l’exposition des principes, et jamais notre doctrine ne fut plus solennellement canonisée.
« Mais le Bref, extrêmement volumineux renferme des dispositions qui, dans les circonstances pourraient avoir des inconvénients ; d’ailleurs il a été fait dans un moment où les choses étaient bien différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui, et peut-être que par prudence nous ne le publierons pas avant d’avoir proposé au chef de l’Église nos observations et qu’il se soit expliqué sur les circonstances du moment ».
Le Bref du Pape n’eut pas sur l’ensemble du clergé l’effet foudroyant qu’on pourrait imaginer. Le jansénisme avait depuis un siècle habitué le clergé à lutter contre Rome, à ruser avec la papauté, à n’accepter ses décisions et communications qu’avec toute sorte de restrictions, de commentaires et de chicanes.
Les prêtres assermentés contestèrent l’authenticité de la Bulle papale : ils prétendirent en tout cas que le Pape n’avait pas qualité pour toucher au temporel.
Notamment les deux évêques que le Pape avait pris personnellement à partie, le cardinal Loménie, évêque de Sens, ancien contrôleur général des finances, et l’évêque d’Autun, Talleyrand-Périgord ne se soumirent pas.
L’évêque de Sens écrivit au Pape, une lettre assez fière : « Très-Saint-Père, j’ai prié le Nonce de faire parvenir à Votre Sainteté mes premières représentations sur le Bref qu’elle m’a adressé et sur son étonnante publicité ; mais je dois à mon honneur une dernière réponse et je m’en acquitte en remettant à Votre Sainteté la dignité qu’elle avait bien voulu me conférer ; les liens de la reconnaissance ne sont plus supportables pour l’honnête homme injustement outragé.
« Quand Votre Sainteté, a daigné m’admettre dans le Sacré Collège, je ne prévoyais pas que pour conserver cet honneur il fallut être infidèle aux lois de mon pays, et à ce que je crois devoir à l’autorité souveraine ».
« Placé entre ces deux extrémités de manquer à cette autorité ou de renoncer à la dignité de Cardinal, je ne balance pas un moment, et j’espère que Votre Sainteté jugera par cette conduite, mieux que par d’inutiles explications, que je suis loin de ce prétendu sacrilège d’un serment extérieur, que mon cœur n’a jamais désavoué ce que ma bouche prononçait, et que si j’ai pu ne pas approuver tous les articles de la Constitution civile du clergé, je n’en ai pas moins toujours été dans la ferme intention de remplir l’engagement que j’avais contracté d’y être soumis, ne voyant rien dans ce qu’elle m’ordonne de contraire à la foi ou qui répugne à ma conscience ».
« Je devrais peut-être, Très-Saint-Père, répondre aux autres reproches contenus dans le Bref de Votre Sainteté ; car, si je ne lui appartiens plus comme cardinal, je ne cesse pas comme évêque de tenir au chef de l’Église et au père commun des fidèles ; et, sous ce rapport je serai toujours prêt à lui rendre raison de ma conduite ; mais le délai de sa réponse, les expressions dans lesquelles elle est conçue, surtout l’étrange abus de confiance que son ministre s’est permis, m’imposent silence.
« Qu’il me soit seulement loisible de répéter à Votre Sainteté qu’on la trompe sur l’état de la religion dans le royaume et que les voies de condescendance auxquelles je tâchais de l’amener sont impérieusement commandées par les circonstances, que son long silence a peut-être amené les affaires au dernier point de crise, et que les moyens rigoureux auxquels elle paraît déterminée ne peuvent que produire un effet contraire à son intention ».
La fierté du gentilhomme offensé parle ici plus haut que l’esprit d’obéissance du prêtre. Quant à Talleyrand frappé de suspense pour avoir consacré des curés selon le rite de la Constitution civile, il ne répondit que par le plus dédaigneux silence.
Ainsi l’intervention du Pape fut loin d’être décisive et en Vendée même les prêtres constitutionnels ne faiblirent pas. Leurs adversaires multipliaient les basses manœuvres de tromperie et de superstition.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Ils enfermaient un chat noir dans le tabernacle d’un prêtre assermenté, et au moment où celui-ci ouvrait le tabernacle, le diable, sous la forme d’un chat noir, en jaillissait. Les fidèles épouvantés fuyaient en maudissant la Révolution.
Les mulotins, c’est-à-dire les frères quêteurs, au moyen de lanternes magiques, faisaient passer sur les murailles des chapelles des ombres mystérieuses, des apparitions sacrées qui exaltaient ou terrorisaient les paysans. Quand ces moyens grossiers de la plus vile superstition ne suffisaient pas, les nobles, et grands propriétaires intervenaient pour contraindre leurs paysans à suivre les offices des prêtres rebelles ou déserter ceux des prêtres constitutionnels. Ceux-ci, contre tout ce déchaînement, tâchaient de tenir bon.
Ils répondaient aux brochures, aux catéchismes, aux inventions et aux outrages par des manifestes, par d’autres brochures. Un des plus distingués de la Vendée, Coveleau, curé de Péault (canton de Mareuil), publia, sous le titre « Lettre à un bon ami », une lettre curieuse où il y a comme une application de la théorie des climats de Montesquieu à la question religieuse. Magnifique puissance de la pensée du xviiie siècle qui avait électrisé et renouvelé tous les cerveaux, même ceux que semblait figer l’immuable dogme.
Sa lettre est en même temps un acte d’accusation contre la conduite du haut clergé.
« Pour savoir qui de nous deux à tort, discutons un peu les motifs qui m’ont déterminé à faire ce serment, qui donne à votre tendre amitié des alarmes pour mon salut. Vous en trouverez une partie dans la misérable conduite qu’a tenue le clergé à l’Assemblée nationale ».
« Voyez d’abord les efforts qu’il a fait dès l’ouverture des États généraux pour s’opposer à la réunion des Ordres… L’opinion publique était formée depuis longtemps à ce sujet et cette opinion était fondée sur la base immuable de la justice.
« L’orgueil et l’intérêt seuls pouvaient lutter contre elle… Était-ce aux ministres d’un Dieu qui n’a jamais prêché que l’abnégation de soi-même et le mépris des choses de la terre à réclamer la prétention de donner des lois à un empire dont ils ne supportaient pas les charges ? Si, dès le commencement ils eussent fait une démarche que toutes les considérations divines et humaines leur commandaient, la noblesse eut été forcée de suivre aussitôt leur exemple ; la séance royale n’eût point été exécutée ; le blocus de Paris et l’enlèvement du Roi n’eussent point été projetés : le clergé eût sauvé la France des malheurs qui ont été la suite funeste de ces deux époques désastreuses. Il ne l’a pas fait, il a donc été bien aveugle ou bien coupable ».
« S’il a combattu avec tant d’acharnement pour soutenir les prétentions de son amour-propre, on juge bien que ses efforts ne se sont pas relâchés lorsqu’il a été question des intérêts de sa fortune. Aussi quels cris n’a-t-il pas poussés lorsqu’il fut question de détruire ses privilèges pécuniaires ?…
« Vous me direz peut-être que le clergé lui-même avait offert le sacrifice de ses privilèges lorsqu’il était encore séparé en Ordres, et que cette offre avait été devancée par le vœu de tous les ecclésiastiques dans les bailliages !Mais à qui persuaderez-vous que cette offre a été sincère ? »
« Tout le monde ne sait-il pas que si ce vœu a été exprimé dans les cahiers c’est aux curés qu’on le doit et que les évêques s’y sont opposés de toutes leurs forces ? Tout le monde ne les a-t-il pas entendus dans les conversations particulières repousser avec dédain ce vœu de la Nation ? »
« Toute la France n’a-t-elle pas lu avec scandale l’adresse qu’ils ont présentée au Roi dans leur dernière Assemblée pour le maintien de leurs privilèges qu’ils osaient qualifier de propriété sacrée ? Mais ils en ont fait le sacrifice. Oui, comme la noblesse, en enrageant contre la nécessité qui les y forçait, et parce qu’ils espéraient, en jetant ce gâteau dans la gueule du Tiers-État, se ménager d’autres jouissances plus chères à leur vanité…
« La suppression de la dîme leur fit une plaie profonde. Vainement on leur représentait que de tous les impôts établis sur la terre c’était le plus injuste, parce qu’il était le plus inégal ; vainement on leur offrait un remplacement ; les foudres du ciel étaient invoquées pour écraser les impies qui osaient porter une main sacrilège sur l’Arche Sainte…
« Lorsque l’Assemblée nationale osa mettre les fonds ecclésiastiques à la disposition de la Nation, ce fut alors surtout qu’on vit le clergé invoquer, avec les accents de la rage, l’autorité du ciel à l’appui des possessions qu’on lui ravissait. Ce fut alors qu’on vit mêler très scandaleusement la cause de Dieu avec celle de Mammon et crier que la religion était perdue, parce qu’il n’y aurait plus d’évêchés de cent mille livres de rente…
« Mais, me direz-vous, si ce n’est pas une impiété, c’est au moins une injustice d’avoir ravi au clergé la propriété de ses biens. Et sur quels titres fondait-il donc cette étrange propriété ?
« Le possesseur d’un bénéfice en était-il le propriétaire ? Il ne pouvait pas seulement vendre un arbre sans la permission du gouvernement. À sa mort, y avait-il un seul individu dans le corps ecclésiastique qui eût droit à lui succéder et qui pût se plaindre qu’on lui fit une injustice en ne lui donnant pas le bénéfice ?
« Si le clergé n’avait pas la propriété de ses biens ils appartenaient donc à la Nation, qui s’en, servait pour payer le travail qu’il faisait, ou qu’il devait faire à son profit.
« Elle a donc le droit de les lui retirer sans injustice et convertir en argent le salaire qu’elle lui doit… Si le clergé a lancé des anathèmes, lorsqu’on a touché à ses possessions temporelles, on n’a pas dû être surpris de la prescription à laquelle il a voué la nouvelle Constitution qu’on a voulu lui donner.
« Chaque article de cette Constitution choque les prétentions de son amour-propre. Aussi eût-elle été apportée par un ange au Comité ecclésiastique, j’aurais parié d’avance qu’elle eût été regardée comme hérétique ».
« Le premier reproche que l’on fait à la nouvelle Constitution est l’incompétence de l’Assemblée nationale. Celle-ci, toute politique ne doit s’occuper que d’objets temporels… Oui, Monsieur, la religion est toute spirituelle : sous ce rapport, elle est indépendante de l’autorité civile. Tout le monde en convient et l’Assemblée nationale a rendu un hommage solennel à cette vérité. Mais cette religion est enseignée par des hommes, elle est placée au milieu des hommes pour leur bonheur.
« Elle touche par tous les points aux diverses institutions sociales ; elle doit donc être organisée pour le plus grand bien possible de la société : il faut donc qu’elle puisse se prêter à toutes ses institutions sans en déranger aucune… Dans les régions chaudes et fertiles de l’Italie et de l’Espagne, où l’homme consomme peu, où le travail d’une journée suffit pour le nourrir une semaine entière, où, dans l’impuissance physique de soutenir des occupations longues et pénibles, l’oisiveté est pour lui le souverain bien, la religion peut et doit offrir un aliment à son imagination par la pompe de ses cérémonies, les fêtes peuvent être nombreuses sans qu’il en résulte aucun inconvénient.
« Mais, dans un climat froid et stérile, où il ne peut arracher sa subsistance à la terre que par des travaux longs et pénibles, si les fêtes sont trop multipliées, si elles sont placées dans la saison des travaux les plus nécessaires, pour servir Dieu les hommes sont exposés à mourir de faim.
« La nation n’aurait-elle donc pas le droit, malgré le clergé, de réduire le nombre de ces fêtes, ou de les placer à des époques où elles seraient moins nuisibles ?
« Il importe souverainement à la société que toutes les parties de son territoire rendent le plus grand produit possible pour favoriser la population en fournissant abondamment à la subsistance de ses membres.
« Il lui importe que les terres soient divisées dans le plus grand nombre de mains possible, afin d’intéresser un plus grand nombre d’hommes au maintien de l’ordre. Ce double but était mal rempli par la manière dont les possessions du clergé étaient placées et administrées ; l’Assemblée nationale avait donc le droit d’en faire une application différente.
« Il importe à la société que tous ses membres travaillent à son profit, il lui importe que nul n’obtienne une récompense sans avoir bien mérité d’elle : on a donc pu, on a donc dû détruire tous les titres sans fonctions qui offraient un appât séduisant à l’oisiveté puissante, détournaient une foule d’individus d’emplois utiles où ils auraient pu rendre des services réels à la patrie…
« Enfin il importe à la société que tous ceux qui exercent dans son sein quelque fonction publique, fassent respecter et chérir les lois dans lesquelles elle a posé le fondement de son bonheur et de sa prospérité : elle a donc le droit de s’assurer du patriotisme des ministres de la religion.
« Si ces ministres, loin d’être soumis aux lois de leur pays, profitent de l’empire que la religion leur donne sur des consciences faibles, pour semer l’esprit d’insubordination et de révolte, la société doit les repousser de son sein ; elle doit en établir à leur place qui connaissant mieux l’esprit de la religion qu’ils sont chargés d’enseigner, n’en fassent pas un instrument funeste pour anéantir l’autorité légitime et renverser la base sur laquelle Dieu lui-même a planté les fondements de l’ordre social ».
Voilà des prêtres qui auraient pu aller loin avec ce : « il importe à la société », car peut-être lui importe-t-il que des doctrines de salut surnaturel, ne détournent pas vers des joies invisibles et extra-sociales l’activité des hommes.
La société n’est plus faite pour la religion : la religion est faite pour la société entendue dans le sens le plus humain : et si les conditions même économiques, même climatériques de la vie sociale autorisent le pouvoir civil à modifier, à façonner sur sa mesure l’organisation religieuse, pourquoi le dogme échapperait-il à cette prise sociale et ne devrait-il pas s’adapter aux exigences, aux besoins de la société civile ?
Et puis, auraient pu demander des philosophes, d’où vient que le clergé ait été ainsi conduit à une politique d’égoïsme, de paresse, d’orgueil ? et que valent maintenant des principes qui n’ont pu préserver des égarements les plus anti-sociaux ceux-mêmes qui les enseignent ?
Qu’on ne réponde pas que la religion est sujette à se corrompre, mais qu’elle prouve précisément sa vertu interne en se régénérant, Car si, du temps de la Réforme, c’est au nom de l’Évangile et de la Bible, et avec une inspiration religieuse, que Luther dénonçait et transformait l’Église, maintenant, et dans la théorie même de l’abbé Coveleau, c’est du dehors que vient le principe même de régénération : c’est de la philosophie du siècle, c’est de son esprit d’humanité, c’est du caractère social qu’elle imprime à toute vérité que vient la réforme de l’Église.
En fait, la lettre de l’abbé Coveleau pourrait s’appeler la déclaration des Droits de l’homme sur le christianisme même. Oui, admirable puissance de la philosophie du siècle, puisqu’elle pénétre ainsi des esprits d’Église et les induit à ce christianisme naturaliste et social qui n’est plus qu’une forme de l’activité humaine.
Étrange alternative du christianisme, obligé ou de se raidir contre l’esprit du siècle et de contracter, pour se tenir debout, l’immobilité et la rigidité de la mort ; ou s’il garde la fluidité de la vie, de se dissoudre dans la raison humaine et dans l’immense mouvement social !
Cette lettre, qui était comme un mémento de catholicisme constitutionnel et révolutionnaire, fut distribuée en mars et avril à tous les prêtres qui avaient prêté le serment : elle les fournissait d’arguments et aussi de courage contre le fanatisme soulevé : c’est le moment même où paraissaient les Brefs du Pape.
En une brochure plus populaire, le curé de Saint-Vincent-du-Fort-du-Lac, Benjamin Gaule, essaie lui aussi de répondre. Il proteste que le Bref du Pape est supposé : mais il affirme que, fût-il vrai, il constituerait une erreur et que du Pape le clergé constitutionnel appellerait à Jésus-Christ.
Vraiment, on est à la limite de la Réforme. «Si le Souverain Pontife actuel refusait sa communion aux pasteurs de France, qui ont absolument la même foi que l’Église, ce serait lui qui aurait tort ; il se comporterait comme ce père qui, par caprice et parce que de mauvaises langues l’auraient gagné et indisposé contre des enfants dignes de sa tendresse, les en priverait et refuserait de les reconnaître… Alors Jésus-Christ leur tient lieu de père ».
Et après cette sorte de congé hardiment signifié au Pape, le curé Gaule analyse avec force tous les ressorts d’intérêt matériel qui meuvent l’Église réfractaire.
S’il y a des prêtres mécontents, c’est parce qu’on ne leur a pas donné des terres et le jardin attenant à la cure. « L’hésitation cessa, écrit-il, dès qu’un mot malheureux et impolitique fut prononcé par l’Assemblée nationale : Il n’y a pas à délibérer sur le cadeau qu’on demandait pour les curés ! Une partie considérable des curés s’est alors tournée contre la patrie, et la Constitution civile est devenue hérétique et schismatique par le refus de cette borderie… Oui, c’est le refus de cette malheureuse borderie qui a engagé à refuser le serment que l’État exigeait ; nous le savons, nous en donnerions la preuve au moins pour le pays qui nous avoisine : et nous apprenons que partout c’est le même motif qui a conduit les prêtres désobéissants ».
Et si les fidèles en trop grand nombre vont aux prêtres insermentés c’est sous la contrainte des grands propriétaires.
« Demandez à ce domestique, à ce journalier, à ce métayer, à cet artisan, pourquoi ils n’assistent pas à la messe, pourquoi ils ne s’adressent pas pour la confession à leur prêtre qui a fait serment, ils vous répondront sincèrement : « Je n’y avais pas d’éloignement, je n’en ai même pas à présent ; je ne voudrais pas que cela fût redit : si je n’y vais pas, c’est que j’ai besoin de gagner ma vie.
« Celui chez qui je suis, celui dont je fais valoir les domaines, celui qui me fait travailler est ennemi de la Révolution parce qu’il y perd, et je sais de bonne part, il me l’a dit à moi-même, que si j’allais à l’office d’un prêtre insermenté, il me mettrait dehors ou que je ne travaillerais jamais pour lui » ; Il éclatait en invectives contre les prêtres réfractaires, il s’écrie : « Cruels, vous ne vous contentez pas de déchirer le sein de l’Église, vous déchirez celui de votre patrie pour un peu de bien dont vous ne deviez prendre qu’une portion nécessaire à une honnête subsistance que la patrie paye si généreusement !
« Pensez-y : l’avarice a fait plus d’un Judas. Ne dites pas que vous êtes indifférents pour vos biens temporels ; le crime le plus impardonnable à vos yeux est de les avoir achetés.
« Pourquoi prenez-vous tant d’intérêt à ces nobles émigrés ? Pourquoi, comme on l’assure, vous êtes-vous cotisés pour leur envoyer des soldats et de l’argent ? Pourquoi voit-on des évêques, un cardinal (Rohan surtout) à la tête de quelques troupes prêtes à fondre sur leur patrie ? Pourquoi ce vœu pour le succès de leurs armes ? Oseriez-vous en trouver la justice dans votre amour pour la religion ? Non, non vous ne nous tromperez plus. »
« C’est l’assurance que vous avez qu’ils vous rétabliront dans vos biens… Ces nobles vous bercent, il est vrai, de cette illusion et ils sentent le besoin qu’ils ont de vous pour séduire un peuple ignorant auprès duquel vous êtes leur unique appui. Mais si, une fois, leur triomphe était assuré, si une fois ils étaient rentrés dans leurs droits absurdes et dans leurs injustes privilèges, bien loin de vous rendre un seul pouce de terre, ils regretteraient que l’Église ne fût plus assez riche pour lui prendre de quoi s’indemniser des frais de leur campagne.. »
C’est un acte d’accusation terrible. Selon le curé Gaule les prêtres réfractaires sont coupables de trahison envers la patrie : ils font plus que des vœux pour la réussite des meneurs, ils vont jusqu’à soudoyer les envahisseurs. Et cela non par exaltation de fanatisme religieux mais par calcul sordide, pour recevoir des ennemis de la France triomphants les biens ecclésiastiques vendus, les prébendes supprimées. L’acte d’accusation dressé par les prêtres constitutionnels contre les autres aurait suffi à les conduire à l’échafaud si, à cette date, il eût été dressé. En tout cas il prépare les esprits à des rigueurs désespérées. Il n’y a pas dans Marat une seule page plus redoutable.
Quelle était, en ce moment en Vendée, la force respective des deux partis ? Il est impossible de la mesurer : les patriotes des Sables-d’Olonne écrivent en mars aux Jacobins de Paris qu’ils sont débordés, qu’ils ne peuvent tenir tête aux forces de contre-révolution et de fanatisme. Pourtant, ils ne se découragent pas : et stimulés par le péril ils fondent une « Société ambulante des amis de la Constitution » qui supplée à l’insuffisance des centres urbains dans toute la Vendée et qui va de village en village opposer la pensée de la Révolution à la propagande cléricale et aux saints et saintes du paradis descendant sur les fidèles ébahis par la vertu de la très sainte lanterne magique de l’invention du jésuite Guichet.
Les insermentés commencent à recourir à la force. En plusieurs paroisses les habitants s’assemblent pour empêcher la vente des biens attenant à la cure. Les émissaires des nobles donnent des mots d’ordre de ferme en ferme et commencent à organiser des bandes, et les administrateurs du département de la Vendée, sont obligés de demander des renforts au ministre de la guerre en avril et mai. Pourtant à travers toutes ces difficultés, il était procédé en mai aux élections de l’évêque et des prêtres : et l’installation du nouveau clergé se faisait tant bien que mal.
A Paris et dans le peuple révolutionnaire des villes la résistance des prêtres insermentés excitait la plus violente colère ; les brefs du Pape furent reçus avec insulte et raillerie. Que nous veut l’évêque de Rome ? Et quant à la bulle du pape, qu’elle soit brûlée. C’est ce que décident dans les premiers jours de mai les Sociétés fraternelles et patriotiques et le 5 mai au soir devant une foule immense, dans le jardin du Palais-Royal, le feu est mis à un énorme mannequin de huit pieds de haut représentant le Pape Pie VI : il était revêtu de tous les ornements et insignes pontificaux : il tenait d’une main un poignard, de l’autre les brefs du 10 mars et du 15 avril. Mais comme les brûleurs eux-mêmes prenaient garde de ne pas froisser et animer contre la Révolution le sentiment catholique si fort encore dans le peuple !
Bien curieux à cet égard est le réquisitoire lu contre le Pape par un des assistants en une sorte de parodie des jugements ecclésiastiques et des sentences d’inquisition… « Citoyens, il y a longtemps que les projets terribles de vos prêtres réfractaires vous auraient armés les Uns contre les autres ; vous vous égorgeriez aujourd’hui, si vous eussiez écouté leurs insinuations perfides ; une semaine consacrée à la célébration de nos plus saints mystères (la semaine de Pâques) était destinée à l’effusion du sang. C’était sur vos cadavres qu’ils devaient élever un autel au despotisme ! Que dis-je : ils conçurent encore des espérances funestes. Tarissez-en la source ; respectez dans leurs personnes une religion qu’ils nous accusent de violer lorsque ce sont eux-mêmes qui la dégradent ; qu’une effigie représentant les traits hideux du fanatisme tenant un poignard d’une main et le libelle de l’autre, soit jetée dans le bûcher qu’ils voulaient eux-mêmes allumer ?
« Que cette utile exécution leur apprenne que la France du xviiie siècle ne veut plus être l’esclave du despotisme ultramontrain ; qu’elle a arraché pour toujours le bandeau des préjugés et qu’en conservant le respect le plus profond pour la religion catholique, qui a été son berceau, elle peut sans scrupule livrer aux flammes l’image de l’insolent muphti qui se dit le vicaire d’un dieu de paix et qui aiguise les poignards de la fureur.
« Et sur ce nous demandons l’avis et jugement des bons citoyens, nos frères et amis qui ont entendu les motifs du présent réquisitoire. » (Cité par Robinet d’après le journal de Gorsas).
La foule répondit : Oui, oui, soit brûlé ; et le mannequin du pape, et le bref du pape flambèrent non sans un profond respect de tout le peuple assemblé pour la religion catholique.
En somme le mouvement provoqué par la Constitution civile du clergé et par la résistance naissante de l’Église fut profond et vif : mais il n’était point irrésistible. Il était neutralisé par la force de la Révolution et il n’en aurait pas empêché l’installation tranquille et souveraine, il se serait même sans doute arrêté et lassé bientôt sans la trahison du Roi qui déconcertait l’action révolutionnaire et méditait l’appel à l’étranger. Depuis le mois de novembre 1790, il n’était plus entouré des mêmes ministres.
(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
L’Assemblée nationale reprochait leur mollesse à Necker, à la Tour-du-Pin, à la Luzerne, à Saint-Priest. Elle prétendait qu’ils négligeaient de gouverner avec fermeté dans le sens de la Révolution et qu’ils affaiblissaient le pouvoir exécutif pour fournir au Roi des prétextes à modifier la Constitution. « Le pouvoir exécutif fait le mort pour faire croire que vous l’avez détruit », s’écria Lameth. Cazalès, avec sa brillante éloquence méridionale démontra l’impuissance, le néant des ministres : il leur appliqua le vers du Tasse : « Ils allaient encore mais ils étaient morts. » La vérité est que Necker, l’homme le plus considérable du ministère, était devenu inutile depuis que la vente des biens d’Église et la création des assignats avaient substitué de larges ressources révolutionnaires aux pauvres conceptions de finance où il s’épuisait orgueilleusement.
Plus qu’inutile, il était fastidieux par ses avis stériles, par ses remontrances vaines, par les aigres conseils de l’impuissance hautaine à la vivante et agissante Révolution. Il partit, honni de tous les côtés, et retiré dans son domaine de la Suisse, il se lamenta sur un mode ridiculement shakespearien. Dans ses mémoires il se compare au roi Lear, abandonné par ses filles ingrates : sa fille la Révolution le raillait et le chassait presque avec mépris. O vanité humaine ! La Révolution, fille de Necker !
Au bruit mélancolique du vent dans les grands arbres de la montagne, il berçait ses ridicules pensées.
Tous les autres ministres, à l’exception de Montmorin ménagé par la gauche, se retirèrent aussi : Necker avait été remplacé par Lambert, puis par Delessart. Fleurieu succéda à la Luzerne. Duport du Tertre prit les sceaux des mains de l’archevêque de Cicé : et du Portail, ancien officier de la guerre d’Amérique prit, à la guerre, la place de la Tour-du-Pin. Ces choix, vaguement constitutionnels n’avaient pas de signification éclatante et forte : aucun homme, parmi les ministres n’avait assez d’autorité pour diriger le Roi dans la voie de la Révolution ; et le Roi continua sa politique toute personnelle. Sa conscience religieuse timorée et étroite était troublée par toutes les mesures de l’Assemblée contre l’Église : son orgueil de roi souffrait beaucoup plus que ne voulait l’avouer son apparente bonhomie des restrictions apportées à son pouvoir traditionnel.
Enfin la surveillance inquiète du peuple l’irritait. La Reine moins dévote mais plus passionnément orgueilleuse, souffrait cruellement de la vie diminuée et retirée à laquelle elle était réduite : son âme ardente et active, dissipée avant la Révolution dans les fêtes et les intrigues, se contractait amèrement et cherchait une issue, une voie de salut, un moyen de liberté pleine et de revanche.
Quel drame humain profond, si on pouvait suivre au jour le jour, en cette année 1791, le va et vient, les incertitudes et les revirements de ces pensées inquiètes, dans la prison des Tuileries ! De la reine au roi peu de sympathie : elle le trouvait faible et de médiocre conseil. Elle n’osait non plus se confier à la sœur du Roi, Mme Élisabeth : celle-ci tenait pour la tactique ridicule et imprudente des princes, du prince de Condé, du comte d’Artois.
La reine, qui haïssait le frère du Roi et qui redoutait comme la suprême déchéance et le suprême péril d’être sauvé par eux, était pleine d’amertume contre Mme Élisabeth. Et le roi, en toutes ses perplexités n’avait qu’une pensée fixe : éviter de s’engager à fond dans une politique irrévocable. Depuis longtemps, depuis les premiers jours de la Révolution l’idée d’une fuite, d’une évasion le tentait : il lui semblait que, loin de Paris et à la tête de quelques régiments fidèles, il pourrait grouper toutes les forces royalistes et contre-révolutionnaires et faire la loi à l’Assemblée. Mais les risques de l’entreprise étaient grands ; et il retombait en ses rêveries hésitantes.
Le peuple avait l’instinct que le Roi cherchait à fuir : et il redoutait cette fuite comme un péril immense. Il paraît étrange et même contradictoire que les révolutionnaires aient redouté à ce point le départ d’un Roi peu ami de la Révolution. Le peuple pourtant avait raison.
Il n’y avait pas à cette date de parti républicain, d’opinion républicaine : nul ne savait par quelle autorité aurait été remplacée l’autorité royale : et la fuite du roi semblait creuser un vide immense. De plus et surtout le peuple sentait bien qu’il y avait d’innombrables forces de réaction disséminées, encore à demi-latentes qui n’attendaient qu’un signal éclatant pour apparaître, qu’un centre de ralliement pour agir.
Le Roi parlant haut de la frontière, dénonçant la guerre faite à l’Église, effrayant la partie timide de la bourgeoisie, lui faisant peur pour ses propriétés, grossissant son armée de contingents étrangers et les couvrant du pavillon de la monarchie, pouvait être redoutable. Aussi le peuple montait bonne garde autour des maisons royales et même princières. Mesdames tantes de Louis XVI, annoncent en février qu’elles partent pour Rome. Les révolutionnaires voient dans ce voyage le commencement d’un plan de contre-révolution : il fallut une escorte de trente dragons pour que Mesdames pussent continuer leur voyage. Un jour aussi le peuple entoure la voiture de Monsieur et la ramène de force au Luxembourg.
Le 28 février le peuple du faubourg Saint-Antoine croit que des préparatifs militaires se faisaient au donjon de Vincennes ; il y court et le démolit. La Fayette se hâte pour réprimer le soulèvement. Mais il arrive trop tard, et son état-major essuie quelques coups de feu des révolutionnaires du faubourg. En même temps le bruit courait dans Paris que les Tuileries allaient subir un assaut comme le donjon de Vincennes. La Cour elle-même, sérieusement effrayée, ou simulant la terreur, répand l’alarme et appelle ses affiliés. Trois à quatre cents gentilshommes armés s’établirent aux Tuileries.
La Fayette, résolu à frapper à la fois à droite et à gauche, à contenir le mouvement populaire et à réprimer les complots aristocrates, accourt aux Tuileries, somme les gentilshommes de rendre leurs armes et les fait briser dans la cour du Château. Exaspéré, le peuple appelle ces gentilshommes les chevaliers du poignard.
C’étaient plutôt des paniques que des troubles graves. Mais cela indiquait la nervosité croissante de l’opinion. Et Louis XVI, Marie-Antoinette, durent enfin prendre un parti. Quatre voies s’ouvraient à eux. Ou bien il fallait accepter pleinement, irrévocablement, la Révolution et rester à Paris, donner, par la présence même et par toute la conduite, la preuve d’une entière bonne foi, désarmer ainsi les défiances et être vraiment une royauté constitutionnelle et moderne.
C’était le parti le plus sage, mais les préjugés, les croyances, l’orgueil du Roi et de la Reine le leur rendaient inacceptable. Ou bien il fallait accepter sans arrière-pensée la Révolution et quitter Paris, non pour aller à la frontière, non pour se rapprocher de l’étranger, mais pour s’établir en province, à Rouen ou à Fontainebleau, et adresser de là un appel à la nation. J’ai déjà dit les périls de ce plan. Mirabeau y insista encore le 4 février, il essaya d’y rallier avec le Roi, La Fayette. Mais La Fayette affectait de mépriser Mirabeau, et le Roi le méprisait.
Il n’avait jamais compris ce qu’il y avait de grand et de sincère dans son génie ; il acceptait ses services, les dégradait en les payant et s’imaginait que Mirabeau pourrait travailler ainsi à la désorganisation des forces révolutionnaires. Mais l’admettre à créer vraiment et à équilibrer un ordre nouveau eût paru à Louis XVI une imprudence et une indignité.
Ainsi, le grand homme se débattait en vain, séparé toujours par un mur de mépris de ceux que dans l’intérêt de la France nouvelle, il aurait voulu sauver.
Il ne restait donc plus que deux plans, inspirés tous deux de la haine pour la Révolution. Ou bien le Roi se tairait, approuvant passivement, laissant dire et laissant faire, au besoin même encourageant les partis extrêmes dans l’espoir insensé que la Révolution s’userait par ses propres excès et que le pays fatigué rétablirait en sa plénitude la vieille autorité royale et religieuse.
Oui, plan insensé, car d’abord si la Révolution s’était emportée « à des excès », le premier de ces excès eut été de supprimer la puissance souveraine qui aurait attendu ainsi, gîtée au cœur de la Révolution, une défaillance nationale ; et puis, comme c’est la résistance de la Cour et du Roi qui exaspérait les énergies révolutionnaires, la cessation, même hypocrite, des hostilités royales aurait peut-être amené un calme et un équilibre d’esprit dont précisément on avait peur.
Ou bien enfin il fallait fuir, non pas pour se livrer à Mirabeau, c’est-à-dire encore à la Révolution, mais pour prendre le commandement de l’armée de Bouillé et dicter à la France des conditions avec l’appui de l’étranger. C’est entre ces deux derniers systèmes qu’en janvier, février et mars oscilla l’esprit du Roi.
Nous pouvons, quoique d’une façon bien incomplète, suivre ces oscillations dans la correspondance et les notes du comte de Fersen. Ce jeune officier suédois avait été, avant la Révolution, présenté à la Cour et sa beauté avait produit sur Marie-Antoinette une vive impression. Le comte de Creutz écrivit le 10 avril 1779 une dépêche secrète à son maître Gustave III, roi de Suède, où il disait : « Je dois confier à Votre Majesté que le jeune comte de Fersen a été si bien vu de la reine que cela a donné des ombrages à plusieurs personnes. J’avoue que je ne puis m’empêcher de croire qu’elle avait du penchant pour lui ; j’en ai vu des indices trop sûrs pour en douter. Le jeune comte de Fersen a eu dans cette occasion une conduite admirable par sa modestie et par sa réserve, et surtout par le parti qu’il a pris d’aller en Amérique.
« En s’éloignant, il écartait tous les dangers ; mais il fallait évidemment une fermeté au-dessus de son âge pour surmonter cette séduction. La reine ne pouvait pas le quitter des yeux les derniers jours ; en le regardant ils étaient remplis de larmes.
« Je supplie V. M. d’en garder le secret pour elle et pour le sénateur Fersen. Lorsqu’on sut le départ du comte, tous les favoris en furent enchantés. La duchesse de Fitz-James lui dit : Quoi ! Monsieur, vous abandonnez ainsi votre conquête ? — Si j’en avais fait une, je ne l’abandonnerais pas, répondit-il ; je pars libre, et malheureusement sans laisser de regrets. — V. M. avouera que cette réponse était d’une sagesse et d’une prudence au-dessus de son âge. » (Papiers de Gustave III, archives d’Upsal).
De loin en loin Fersen revint en France, comme officier des régiments suédois qui y résidaient. Il était en garnison à Valenciennes à la fin de l’année 1789 quand le roi de Suède Gustave III le chargea d’aller à Paris, d’y rester auprès du roi de France, de lui remettre des lettres et d’établir des communications entre les deux souverains.
Gustave III qui se croyait le paladin de la monarchie absolue en Europe voulait surveiller de près les événements de France. Curieuses sont les nombreuses lettres écrites par de Fersen sur le mouvement de la Révolution ; au 6 octobre, il était dans le cortège du Roi et de la Reine quand ils furent conduits à Paris ; et sans doute la Reine revoyait avec un plaisir extrême l’homme qu’elle avait aimé, qu’elle aimait peut-être encore et qui était mis chevaleresquement à son service par un roi ami.
Le comte de Fersen ne tarda pas à devenir le confident le plus intime du Roi et de la Reine. Il l’annonce à son père, en février 1791, par une lettre très importante, car elle donne une valeur exceptionnelle à tous les renseignements qui nous viennent de Fersen : « Ma position est différente de celle de tout le monde. J’ai toujours été traité avec bonté et distinction dans ce pays-ci par les ministres et par le Roi et la Reine. Votre réputation et vos services ont été mon passeport et ma recommandation ; peut-être une conduite sage, mesurée et discrète, m’a-t-elle valu l’approbation et l’estime de quelques-uns et quelques succès.
« Je suis attaché au Roi et à la Reine, et je le suis par la manière pleine de bonté dont ils m’ont toujours traité, lorsqu’ils le pouvaient, et je serais vil et ingrat si je les abandonnais quand ils ne peuvent plus rien faire pour moi, et que j’ai l’espoir de pouvoir leur être utile. A toutes les bontés dont ils m’ont toujours comblé, ils viennent d’ajouter encore une distinction flatteuse : celle de la confiance ; elle l’est d’autant plus qu’elle est extrêmement bornée et concentrée entre trois ou quatre personnes, dont je suis le plus jeune. (Les autres étaient le baron de Breteuil, le marquis de Bouillé et le comte de Mercy.) Si nous pouvons les servir, quel plaisir n’aurai-je pas à m’acquitter envers eux d’une partie des obligations que je leur ai ; quelle douce jouissance pour mon cœur d’avoir pu contribuer à leur bonheur. Le vôtre le sent, mon cher père, et ne peut que m’approuver. Cette conduite est la seule qui soit digne de votre fils, et, quoi qu’il puisse vous en coûter, vous seriez le premier à me l’ordonner si j’étais capable d’en avoir une autre. Dans le courant de cet été, tous ces événements doivent se développer et se décider ; s’ils étaient malheureux et que tout espoir fut perdu, rien ne m’empêcherait de vous aller voir. »
Il est clair, par le ton de cette lettre, que le comte de Fersen est dès ce moment associé à une entreprise hardie et dangereuse. Le projet de fuite, en effet, était dès lors sérieusement étudié. M. de Fersen écrit à son ami et confident le baron de Taube, ministre du roi de Suède, le 7 février 1791 :
« Le roi de France a été très sensible à la réponse du Roi (de Suède). Si le roi de France sortait de Paris, ce qui arrivera probablement, et que je puisse sortir aussi, le Roi veut-il que je me rende alors près du roi de France et que je fasse usage de mes lettres de créance ou que je reste avec mon régiment ? Mais il pourrait arriver alors que je ne fusse pas à portée convenable s’il y avait quelque chose à traiter. »
Pourtant, à cette date encore, le départ du Roi n’était que probable. Vaguement encore, quoique de moins en moins, le Roi comptait sur la décomposition spontanée de la France, sur la prétendue désaffection du pays envers la Révolution. Surtout, il comprenait qu’il ne lui servirait à rien de fuir de Paris s’il ne trouvait en province une forte armée. Mais cette armée, le Roi n’espérait point que la France suffit à la former, et par une contradiction saisissante, au moment même où la monarchie s’apprêtait à prendre les armes contre la Révolution sous prétexte de répondre au sentiment vrai de la France, elle devait s’avouer à elle-même qu’elle tirerait surtout ses soldats du dehors.
Or les dispositions des souverains étrangers absorbés par d’autres soucis et voyant sans trop de déplaisir ce qu’ils appelaient l’anéantissement politique de la France, étaient incertaines. Le Roi n’était pas encore assuré en mars qu’ils missent une armée à sa disposition. D’ailleurs que ferait cette armée ? et si le Roi était ramené presque exclusivement par des uniformes étrangers n’y aurait-il pas un soulèvement national ? Entre l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse les défiances étaient grandes et ils se surveillaient l’un l’autre, au lieu d’agir. Une lettre du 7 mars du comte de Fersen au roi Gustave de Suède traduisait à merveille cet état incertain et compliqué des esprits aux Tuileries. Il écrit à Taube, en une lettre chiffrée :
« Tout ce que j’ai mandé au roi (de Suède), comme des idées à moi, sur le départ du roi de France et de la reine de France, sur la manière d’opérer des changements ici et sur la nécessité de secours étrangers, est un plan qui existe et auquel je travaille ; tout le monde l’ignore, et il n’y a que quatre Français dans la confidence, dont moi seul hors du pays. Celui qui y est est sûr et n’est pas à Paris (C. de Bouillé).
« Je n’ai rien mandé là-dessus au Roi ; j’ai craint un peu son indiscrétion et cela demande le plus grand secret. Vous sentez combien cela est important et vous n’en ferez usage qu’autant que cela serait nécessaire pour qu’il ne croie pas qu’on veut tout abandonner et ne rien faire. Je laisse cela à votre prudence, vous pourrez lui dire qu’il vous semble par ce que je vous écris qu’il y a quelque plan et qu’on y travaille.
« Méfiez-vous surtout de tous les Français, même de ceux qui sont les mieux intentionnés. Ils sont d’une telle indiscrétion qu’ils gâteraient tout. S’ils savaient quelque chose, ils ne manqueraient pas d’en écrire sur le champ. Je pourrai peut-être dans quelque temps vous en écrire plus en détail. — M. le comte d’Artois et le prince de Condé ne sont pour rien dans ce plan. »
Ainsi, le plan est dessiné dans ses grands traits dès cette époque : c’est vers Bouillé et son armée que le roi ira : il fera appel à l’étranger, mais se livrera le moins possible aux émigrés indiscrets et importuns : et les princes haïs de la Reine ne seraient même pas dans le secret.
Au roi de Suède, le comte de Fersen, sans entrer dans le détail du projet de fuite, expose la situation générale : et c’est ainsi à coup sûr qu’elle apparaissait au Roi, à la Reine surtout. Par là ses lettres ont une haute valeur historique ;
« Sire, Votre Majesté est sans doute trop au courant des opérations de l’Assemblée nationale et de ses décisions, pour qu’il soit nécessaire de l’en entretenir encore. Les quatre partis qui la divisent, c’est-à-dire les aristocrates royalistes, les 89 (révolutionnaires modérés), les monarchistes (groupe de Malouet) et les Jacobins, se détestent tous également, et sont tous également à détester.
« Les premiers, avec de bonnes intentions, ne font que des sottises par leur emportement et un zèle mal entendu, qui ne veut pas se laisser guider ; ce sont eux qui ont commencé cette révolution, et ce n’est que la perte de leurs fortunes et de leur existence qui les a ramenés au roi. Les principes des trois autres sont tous mauvais, et ne diffèrent entre eux que par le plus ou le moins. Les Jacobins l’emportent cependant sur les autres par leur extrême scélératesse ; comme tous les moyens leur sont bons, ils ont pris un grand ascendant, mais ils commencent à perdre beaucoup, et sans le secours de la canaille, qui est soldée par eux, et les velléités des aristocrates, ils seraient déjà perdus. Leur division avec les 89 et les monarchistes achèvera de les perdre.
« Mirabeau est toujours payé par la cour et travaille pour elle ; mais il n’a pas autant de moyens pour faire le bien qu’il en avait pour faire le mal, et il est obligé de se cacher sous les dehors de la démocratie pour ne pas perdre toute son influence. Ses principes sont toujours mauvais, mais ils le sont moins que ceux des autres. Malgré cela il est intéressant de ne pas l’avoir contre soi.
M. de Mont travaille avec lui, soit crainte ou prudence, ou intérêt, ou bien tous les deux, il se dit maintenant attaché au roi. Ils ont acheté plusieurs personnes, comme MM. Talon et Semonville, qui ont beaucoup influé à soulever Paris, et qui doivent travailler à présent dans le sens contraire. Tout cela n’est utile qu’à ramener un peu d’ordre et de tranquillité et à assurer la sûreté de la famille royale, mais jamais on ne pourra se servir d’eux pour autre chose.
« Paris, quoique fort changé, vit encore d’espérance, et les idées d’égalité et de liberté le séduisent encore, les provinces de même. Le mécontentement est grand et augmente, mais il ne peut se manifester tant qu’il n’y aura pas de chefs et de centre, et, tant que le Roi sera enfermé à Paris, il ne peut avoir ni l’un ni l’autre ; et, quoi qu’il arrive, jamais le roi sera roi par eux, et sans des secours étrangers qui en imposent même à ceux de son parti. Il faut qu’il en sorte, mais comment et où aller ?
« Le parti du roi n’est composé que de gens incapables, ou dont l’exaspération et l’emportement sont tels qu’on ne peut ni les guider ni leur rien confier, ce qui nécessite une marche plus lente et de grandes précautions. Le lieu de la retraite en demande encore davantage. Il faut y être bien en sûreté ; il faut avoir trouvé un homme capable et dévoué qui eût de l’influence sur les troupes, qu’il lui faut bien connaître auparavant. Mais tous ces moyens seraient encore insuffisants sans les secours des puissances voisines : l’Espagne, la Suisse et l’Empereur, et sans l’assistance des puissances du Nord (la Russie et la Suède), pour en imposer à l’Angleterre, la Prusse et la Hollande dans le cas très probable où elles voudraient mettre obstacle aux bonnes intentions de ces puissances et, en les attaquant, les empêcher de secourir efficacement le Roi de France.
« Sans cette réunion, je crois impossible que jamais le roi de France fasse aucune tentative pour reprendre son autorité. Tous les ressorts sont rompus, toutes les têtes sont égarées, il n’y a plus aucun ordre, aucune subordination dans les troupes ; personne ne veut obéir, tous veulent commander. Les lois sont sans vigueur ou n’existent pas ; tous les pouvoirs sont confondus et en opposition, tous les crimes restent impunis, excepté celui d’être attaché au roi : le découragement et la peur ont gagné tous les esprits, et celui de révolte est général.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
« La propagande, ce gouffre infernal, a partout des agents cachés ; déjà en Espagne, en Savoie et en Suisse il y a eu de petits mouvements ; en Brabant, ils en excitent d’assez considérables, et on a même essayé de séduire les troupes de l’Empereur en leur vantant la liberté française et en leur offrant jusqu’à un louis par homme. Le juif Ephraïm, émissaire de M. Hertzberg, de Berlin (le ministre des affaires étrangères) leur fournit de l’argent ; il n’y a pas longtemps qu’il a touché encore 600,000 livres. Toutes ces tentatives, souvent répétées, peuvent enfin réussir.
« C’est un exemple dangereux s’il restait impuni, et il est de l’intérêt de tous les souverains de détruire, dans ses principes un mal qui sans cela pourrait, gagner, et dont les progrès sont effrayants par leur rapidité. Sans ordre, il ne peut exister ni société, ni sûreté, ni bonheur ; les rois en sont les dépositaires-nés. Ils doivent conserver leur autorité pour le maintien de cet ordre et pour le bonheur des peuples.
« Voilà, Sire, quelle est ma manière d’envisager la position du Roi de France et du royaume ; elle est effrayante, et peut influer sur le reste de l’Europe. Les remèdes à tant de maux sont difficiles, mais non pas impossibles ; je serais trop flatté si V. M. m’approuve. »
« La constance et le courage du roi, et surtout de la reine, sont au-dessus de tous les éloges ; plus on voit cette princesse, et plus on est forcé de l’admirer. Ses ennemis, même sont obligés de lui rendre justice et, quoi qu’on puisse dire à V. M., je puis avoir l’honneur de l’assurer que le roi de France sent vivement sa position mais tout lui fait, un devoir de la dissimuler ; après toutes les fautes qui ont été faites, et la manière indigne dont il a été servi ou plutôt trahi, il ne lui reste d’autre parti à prendre que ta patience et la dissimulation ; tout autre ne ferait en ce moment qu’exposer inutilement ses véritables serviteurs et lui-même, jusqu’au moment où il pourra agir.
« V. M. sait déjà les détails des scènes scandaleuses ou indécentes qui ont eu lieu au Château le 28 du mois dernier (l’affaire des chevaliers du Poignard). J’ai envoyé hier au baron de Taube deux brochures qui pourront en instruire V. M.
« La conduite de cette garde qui était en insurrection, mais surtout celle de M. de Lafayette, a été indigne ; c’est l’arrêt de sa mort qu’il a signé là, car il me paraît impossible que jamais la noblesse lui pardonne les propos qu’il a tenus, ni l’ordre qu’il a fait afficher le lendemain et qui est rempli de faussetés. Il a répondu au jeune M. de Duras, premier gentilhomme de la Chambre, qui lui demandait si c’était par son ordre qu’il y avait dix ou douze soldats devant sa porte : « Oui, monsieur, et s’il était nécessaire, j’en mettrais un même dans votre lit. »
« Heureusement, je n’étais pas au château, car je ne sais pas jusqu’à quel point j’aurais supporté l’affront que ces messieurs ont essuyé. Ce n’est pas que j’approuve en tout leur conduite. Leur attachement, qui ne veut point se laisser guider, est presque toujours plus nuisible qu’utile ; je les trouve imprudents et irrespectueux d’être chez le roi en frac, et avec des pistolets ; l’arme d’un gentilhomme est son épée, et il n’a pas besoin d’en porter d’autres. Mais ces torts, qui ne sont ceux que d’un zèle peu réfléchi, ne sauraient excuser ceux de M. de Lafayette, ni le surcroît d’infamie et de trahison dont il est couvert. »
Cette lettre est évidemment le reflet des conversations mystérieuses qui se prolongeaient entre le Roi, la Reine et le comte de Fersen. C’est l’exposé le plus complet et le plus décisif de la pensée et de la politique royales en janvier et mars 1791. C’est aussi l’acte d’accusation le plus formidable contre la monarchie. Cette monarchie nationale n’a plus aucune racine en France : elle attend sa force, toute sa force, son salut, tout son salut, de l’étranger. Le Roi et la Reine se méfient également de tous les partis, y compris le leur. Ils ont de la haine pour cette noblesse égoïste et étourdie qui, en refusant le sacrifice d’une partie de ses privilèges pécuniaires quand furent convoqués les notables, a acculé le roi à la convocation des États-Généraux, et ouvert ainsi, selon le mot de Fersen, la Révolution.
Ils ne lui pardonnent pas non plus les calomnies et les accusations qu’elle a colportées contre la Reine, au risque de révolutionner l’opinion. Les partis révolutionnaires, même les plus modérés, les plus sagement constitutionnels, ne leur inspirent aucune confiance : ils en détestent les principes, ils en méprisent les hommes, et ils ne se servent du grand Mirabeau lui-même que comme d’un instrument provisoire, pour amortir un peu le choc des passions et donner à la royauté le temps d’aviser.
Pas plus qu’ils ne peuvent s’appuyer sur les partis organisés, ils n’ont confiance en la France elle-même. Ils se rendent bien compte qu’elle n’est pas dans l’ensemble désenchantée de la Révolution : et ceux mêmes qui se plaignent d’elle n’ont ni assez de ressort, ni assez de foi dans leur propre cause pour se soulever spontanément. Il faudra que le Roi leur donne de haut le signal du mouvement.
Il faudra que l’étranger intervienne : et Fersen, écho du Roi et de la Reine, écrit au roi de Suède cette phrase terrible, qui est pour nous la disqualification définitive de la monarchie : « Jamais le Roi ne sera roi par les Français, et sans des secours étrangers. » Bien mieux, ces secours étrangers, le Roi les invoque, non seulement pour dompter et châtier ses ennemis, mais pour en imposer même à ceux de son parti dont il n’obtiendrait ni une obéissance suffisante, ni la docilité aux mesures nécessaires de réorganisation. Ainsi isolée de toute force française, la monarchie ne semble plus avoir que deux idées : imaginer des moyens de vengeance contre ses ennemis du dedans ; imaginer des moyens pour appeler le plus tôt possible les amis du dehors.
Contre Lafayette qui se compromet pourtant dès cette époque à contenir les mouvements violents du peuple, le Roi, la Reine, toute la cour ont une haine féroce et insensée. « Il a signé son arrêt de mort », écrit Fersen au nom de la Reine ; et dans son journal, à la date du 12 juin 1791, quelques jours seulement avant le départ du Roi, je note ces lignes étranges : « Dimanche 12. — Le voyage est remis au 29 ; la faute en est à une femme de chambre. Procès de Lafayette, renvoyé à une cour martiale. »
Ainsi, jusque dans la fièvre et l’embarras d’un départ clandestin, on se demandait comment le Roi victorieux pourrait frapper Lafayette : et une cour martiale devait l’exécuter pour trahison. O abîme de folie ! En même temps, pour animer contre la France tous les souverains de l’univers, pour mettre un terme aux divisions des empereurs et des rois par un grand intérêt, on leur persuade que déjà le gouffre infernal de la propagande révolutionnaire est ouvert sous leurs pas dans tous les pays.
Hâtez-vous ! hâtez-vous ! Venez arracher de la terre de France la racine du mal qui ira cheminant et se propageant. O rois, venez vous sauver vous-mêmes en nous sauvant contre la France ! Et pour préparer tranquillement cette agression, pour que la Révolution, confiante et trompée, relâche sa surveillance, le roi n’a plus qu’une politique : mentir ! Mentir à tous, mentir à ses ministres, mentir à l’Assemblée nationale, mentir au pays ; simuler la déférence à la Constitution afin de la mieux détruire.
Ainsi, deux moyens de salut : l’étranger, le mensonge. Voilà à quoi la monarchie de France s’est réduite en méconnaissant les nécessités nouvelles de la vie nationale. Égoïsme et sottise la conduisent tout droit à la trahison.
Cette politique de dissimulation et de ruse, le roi la pratiquait depuis la fête de la Fédération : la Constitution civile du clergé lui paraissait une impiété et lui-même s’obstina à ne recourir jamais qu’à des prêtres insermentés : mais il se garda bien d’entrer franchement en lutte avec l’Assemblée, et, il donna même, en décembre 1790, la sanction ou décret qui obligeait les fonctionnaires ecclésiastiques au serment.
Il écrit à l’Assemblée, le 27 décembre, avec le contre-seing de Duport-Dutertre, une lettre très patriote et doucereuse : « Je viens d’accepter le décret du 27 novembre dernier ; en déférant au vœu de l’Assemblée nationale je suis bien aise de m’expliquer sur les motifs qui m’avaient déterminé à retarder cette acceptation et sur ceux qui me déterminent à la donner en ce moment. Je vais le faire ouvertement, franchement, comme il convient à mon caractère ; ce genre de communication entre l’Assemblée nationale et moi, doit resserrer les liens de cette confiance mutuelle si nécessaire au bonheur de la France. »
« J’ai fait plusieurs fois connaître à l’Assemblée nationale, la disposition invariable où je suis d’appuyer par tous les moyens qui sont en moi, la Constitution que j’ai acceptée et juré de maintenir.
« Si j’ai tardé à prononcer l’acceptation sur ce décret, c’est qu’il était dans mon cœur de désirer que les moyens de sévérité puissent être prévenus par ceux de la douceur ; c’est qu’en donnant aux esprits le temps de se calmer, j’ai dû croire que l’exécution de ce décret s’effectuerait avec un accord qui ne serait pas moins agréable à l’Assemblée nationale qu’à moi.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
« J’espérais que ces motifs de prudence seraient généralement sentis ; mais puisqu’il s’est élevé sur mes intentions des doutes que la droiture connue de mon caractère devait éloigner, ma confiance en l’Assemblée nationale m’engage à accepter : je répète encore qu’il n’est pas de moyens plus sûrs, plus propres à calmer les agitations, à vaincre toutes les résistances que la réciprocité de ce sentiment entre l’Assemblée nationale et moi ; elle est nécessaire ; je la mérite ; j’y compte. Signé : Louis, contre-signé : Duport-Dutertre. »
La lettre est du 27 décembre et nous venons de constater qu’un mois après, au commencement de février, et avant même que l’alerte du 28 février puisse fournir au Roi un semblant d’excuse, des négociations sont engagées, des combinaisons sont poussées, pour écraser la Constitution sous le poids des armes étrangères. Perfidie, mensonge, trahison.
Le peuple immuablement se méfiait : et après la journée du 28 février Marat redouble de zèle et de colère à lui prêcher la vigilance, à dénoncer les préparatifs de fuite. Il s’indigne que la municipalité fasse chanter un Te Deum pour le rétablissement du Roi.
« C’est une chose bien étrange, écrit-il le 20 mars, que le zèle fervent de la municipalité parisienne à sacrifier le bien des pauvres pour faire chanter un Te Deum, en actions de grâces de l’heureux retour de l’appétit qu’avait fait perdre au Roi une violente indigestion causée par le déplaisir de voir houspiller sous ses yeux la noire bande des conspireurs : a-t-elle ordonné un Te Deum et des illuminations pour l’heureuse découverte de la conspiration qui devait éclater le 28 février et qui aurait infailliblement plongé la France dans les horreurs de la guerre civile ? »
Il revient à la charge le 28 mars, et comme d’habitude, il mêle à des accusations, à des dénonciations passionnées et fausses des vues étrangement perçantes. Il se trompait à fond quand il accusait Bailly et Lafayette (condamné à mort par la Cour) de préparer l’évasion du Roi ; mais il devinait, tout en lui donnant des proportions qu’elle n’avait pas encore, l’intrigue nouée avec l’étranger :
« La cour, les ministres, les pères conscrits, le général, l’état-major et les municipaux ne cherchent qu’à pousser le peuple à l’insurrection afin d’avoir un prétexte de publier la loi martiale et d’égorger les bons citoyens. Et ce moment n’est pas éloigné.
« Une armée ennemie de 80,000 hommes campe sur nos frontières, presqu’entièrement dégarnies de troupes françaises, et où le peu de régiments étrangers qui s’y trouvent en garnison ont ordre de livrer passage aux Autrichiens.
« Les gardes nationaux des départements, qui pourraient leur disputer l’entrée dans le royaume sont sans armes, sans munitions et soumis à des directoires totalement composés de suppôts de l’ancien régime. »
« A l’instant que la famille royale sera enlevée, l’ennemi s’avancera vers Paris, où l’Assemblée nationale et la municipalité traîtresse proclameront la soumission au monarque. Une partie de la garde nationale, les alguazils à cheval, les chasseurs des barrières, les gardes des ports, et quarante mille brigands cachés sous nos murs se joindront aux conspirateurs pour égorger le peuple ; et les amis de la liberté sans armes, sans argent, seraient forcés de se soumettre à l’esclavage pour échapper à la mort. »
« Ces scènes d’horreur commenceront dès que le Roi, sa femme et son fils auront pris la fuite : ainsi c’en est fait de nous pour toujours si nous les laissons aller à Saint-Cloud. Le traître Berthier à la tête des chasseurs de Lorraine, du régiment de Flandre, des maréchaussées de tous les départements de l’entour, égorgera la garde parisienne et les enlèvera de force ; comme il a enlevé de Bellevue les voitures des béguines (les tantes du roi).
« Citoyens, je vous le répète, c’en est fait de la liberté, c’en est fait de la Patrie, si nous souffrons que la famille royale aille à Saint-Cloud, si elle quitte les Tuileries. »
Dans l’imagination de Marat se mêlaient et s’ajoutaient l’un à l’autre, pour aboutir à un extraordinaire effet d’horreur, le plan de Mirabeau qui excluait le concours de l’étranger et faisait appel à la municipalité parisienne, le plan de la Cour qui excluait la municipalité et Lafayette, et faisait appel à l’étranger. De plus, il s’exagérait la tendance de l’étranger à servir dès ce moment le Roi de France par une intervention armée. Mais malgré tout, ce sont comme des traits de flamme qui percent la nuit de mensonge et de trahison où s’enveloppait la Cour.
Mais ce qu’il y a de plus curieux, c’est un passage peu remarqué, je crois, de son numéro du 26 mars : « Avis de la dernière importance : je suis informé par plusieurs personnes très-sûres, qui approchent journellement le Roi, qu’il n’a pas été indisposé une heure depuis le 28 février ; que sa prétendue maladie est une imposture de ses ministres qu’ont accréditée ses médecins et chirurgiens, tous dans le secret, qu’elle n’a pour objet que d’alarmer les Français sur les jours du prince, de les pousser à des actes d’idolâtrie, et de donner aux conjurés les facilités de tramer de nouvelles conspirations dans son cabinet ; que le jour où les députés de l’Assemblée n’ont pas été reçus, les appartements étaient remplis des membres du club monarchique, et des courtisans les plus dévoués.
« Enfin, que le Roi parait content, que jamais si femme n’a été plus gaie, que l’on parlait il y a huit jours, d’un voyage à Compiègne, sans doute pour faire une fugue à Bruxelles, et qu’aujourd’hui on parle d’aller à Saint-Cloud d’où il sera presque aussi facile de l’exécuter au moyen des manœuvres du fidèle Berthier, commandant de la garde de Versailles. »
Marat ne soupçonne pas le vrai plan de fuite, il s’imagine que le Roi se fera escorter par des troupes presque au sortir de Paris ; il ne se figure pas que Louis XVI s’enfuira incognito jusqu’à la frontière et il ne se doute pas, à ce moment, que c’est avec Bouillé que la combinaison se prépare. Mais il a su que les projets de départ se précisaient à la fin de mars et qu’une animation joyeuse inaccoutumée se marquait au visage du Roi et de la Reine.
Or il résulte d’une lettre du comte de Fersen du 1er avril 1791, et d’un mémoire du même du 27 mars que précisément à la fin de mars le Roi et la Reine venaient enfin de prendre la décision ferme de partir. Et c’est la joie d’une résolution enfin arrêtée qui se lisait sur le visage royal.
Ainsi le grand secret avait percé les murailles des Tuileries et il était allé jusqu’à la cave de Marat se révéler à la Révolution. Il faut citer ce mémoire et cette lettre de Fersen interprète du Roi et de la Reine, car il nous donne la nuance exacte de leur pensée, et il constitue en même temps un nouvel acte d’accusation formidable contre la monarchie.
C’est de peur que la Révolution en se modérant, en s’organisant, ne ralliât peu à peu tous les esprits, et ne devînt irrévocable par l’adhésion presque unanime de la France, que Louis XVI et Marie-Antoinette se décident à brusquer le mouvement.
Le « mémoire du comte de Fersen pour le Roi et la Reine de France », du 27 mars 1791, paraît beaucoup moins destiné à déterminer par des conseils leur résolution qu’à en fixer par écrit les motifs : « Il ne paraît pas douteux, écrit-il, qu’il ne soit nécessaire d’agir, et d’agir vigoureusement, si l’on veut rétablir l’ordre et le bonheur dans le royaume, le sauver d’une ruine totale, empêcher son démembrement, remettre le Roi sur le trône et lui rendre son autorité.
« La marche uniforme et constante des Jacobins dans leur scélératesse, la désunion des démocrates dans l’Assemblée, le mécontentement des provinces qui augmente visiblement, mais ne peut éclater, faute d’avoir un centre et un point de réunion ; la détermination des princes et en particulier du prince de Condé, d’agir, si le Roi n’agit pas, tout cela paraît même être favorable, et plus on tardera, plus il sera difficile.
« Mais comment agir d’après les nouvelles qu’on reçoit de l’empereur, avec les indécisions de l’Espagne, et la difficulté de trouver de l’argent ? Deux partis se présentent : l’un de ne rien entreprendre avant d’avoir formé des alliances et obtenu des différentes puissances les secours nécessaires, tant en hommes qu’en argent ; l’autre de n’attendre pour sortir de Paris, que l’assurance des bonnes dispositions des puissances étrangères, et d’avoir trouvé l’argent nécessaire pour subvenir, pendant deux ou trois mois, à la solde des troupes, époque à laquelle on aurait obtenu un emprunt en Suisse. »
« Le premier de ces partis est sans contredit le plus sûr ; il présente moins de danger pour leurs Majestés, et l’avantage d’un succès moins douteux ou du moins contesté.
« Mais, comme il n’est pas possible d’en prévoir l’époque, n’est-il pas à craindre que les maux de l’État étant considérablement augmentés pendant ce temps, il soit plus difficile de les réparer ?
« L’habitude ou le découragement n’auront-ils pas trop gagné pour qu’il soit alors possible de les vaincre ?
« les esprits exaltés ne se seront-ils point calmés, ne se réuniront-ils pas pour créer un ordre de choses toujours désavantageux au roi, mais où les particuliers trouveront encore leur compte, par la tranquillité dont ils jouiront et qu’ils préféreront alors aux convulsions de la guerre civile ?
« Les princes n’auront-ils pas avant cette époque, fait quelque tentative, et, si elle leur réussit, n’en recueilleront-ils pas seuls tout l’honneur et le fruit, ne rallieront-ils pas à eux toute la noblesse, tous les mécontents au régime actuel et ne seront-ils pas alors les maîtres du Royaume et de Leurs Majestés ?

Hé ! que ne la fondez-vous… vous y gagnerez toujours quelque chose.
(D’après une estampe du musée Carnavalet.)
« Le second parti est plus hasardeux. Le comte de Mercy (ambassadeur d’Autriche, résidant à Bruxelles) et le baron de Breteuil (chargé par le Roi de négocier avec les cours étrangères) semblent l’indiquer tous les deux. La réussite en est fondée sur de grandes probabilités, l’Empereur et l’Espagne sont bien disposés, mais l’Espagne ne sait rien faire sans l’Empereur, et celui-ci, par une politique mal entendue et une prévoyance craintive, voudrait retarder l’époque de manifester sa bonne volonté.
« Les puissances du Nord sont bien intentionnées, mais leur éloigneraient et la guerre des Turcs, les empêchent de seconder les vues de LL. MM., d’une manière active ; on est assuré de la Sardaigne et de la Suisse, et il est plus que probable qu’une démarche de LL. MM. bien prononcée déciderait ces deux puissances qui peut-être ne sont indécises que par le doute où elles sont de la fermeté de la résolution de LL. MM., et la crainte de se compromettre inutilement, si elles changeaient ; M. de Mercy semble l’indiquer dans sa lettre. »
« Une telle démarche aurait quelque chose de grand, de noble, d’imposant et d’audacieux dont l’effet, tant dans le royaume que dans toute l’Europe, serait incalculable ; elle pourrait ramener l’armée et préserver sa décomposition totale, elle ramènerait la Constitution, et empêcherait les factieux d’y faire les changements nécessaires pour la rendre supportable et consolider la révolution ; et, faite en ce moment, elle rendrait utiles au Roi les mouvements des princes qui, s’ils agissaient seuls et qu’ils eussent des revers, ne pourraient dans un autre temps, plus servir la cause du Roi. »
« Quel que soit le parti que LL. MM. adoptent, on croit nécessaire d’attendre les réponses de Vienne et de l’Espagne sur le plan qu’on leur a communiqué, afin de bien connaître leurs dispositions et ce qu’on en pourra espérer.
« Si le premier parti est adopté, il faut arrêter les préparatifs de Bouillé et continuer à négocier.
« Si c’est le second qui est préféré, il faut continuer à tout préparer pour l’exécution, s’occuper à trouver l’argent nécessaire, et choisir une personne bien intentionnée et capable, qu’on enverrait dès à présent en Angleterre, pour sonder habilement et sans se compromettre, les intentions de cette puissance, et qui ne recevrait ses instructions qu’au moment du départ du Roi ; elles seraient de traiter pour obtenir de cette Cour sa neutralité parfaite, soit par des sacrifices raisonnables, soit en l’y forçant par le concours des cours du Nord, dont les dispositions ne sont pas équivoques, mais qui, vu leur éloignement, ne sauraient secourir le Roi d’une manière plus directe.
« D’après la certitude que LL. MM. ont des intentions du roi de Suède et de son désir de leur être utile, trouveraient-elles quelques inconvénients à m’autoriser de lui communiquer de leur part le plan qu’elles ont adopté, et le projet qu’elles ont de profiter des bonnes dispositions qu’il manifeste, en réclamant ses bons offices pour contenir l’Angleterre, dans le cas où cette puissance ne voudrait entendre aucune proposition d’accommodement, et voudrait mettre obstacle à l’exécution de leurs projets.
« Cette marque de confiance la flatterait, et ne pourrait que l’intéresser davantage à leur réussite. Comme cette ouverture passerait par le baron de Taube, dont l’attachement pour son maître et pour LL. MM. m’est connu, je lui manderais de n’en faire que l’usage qu’il croirait nécessaire et le plus avantageux pour LL. MM. »
Ainsi, il est entendu de toute façon que le Roi partira. Toute la question est de savoir s’il attendra pour partir que des traités fermes avec les cours étrangères lui assurent des secours certains en hommes et en argent, ou si au contraire il brusquera, par son départ, les lenteurs diplomatiques, les hésitations et les réserves des puissances étrangères et mettra les souverains de l’Europe en face du fait accompli.
Or, la raison décisive pour laquelle Fersen incline visiblement au départ prochain, c’est que la France s’accoutume à la Révolution et que, si l’on tarde encore, tous les citoyens, tous les particuliers y trouveront des garanties de repos et de paix.
C’est uniquement l’intérêt du Roi, opposé à l’intérêt de la France, qui compte. On se décidera donc à partir, même sans avoir des traités précis avec l’étranger, mais assuré de ses bonnes dispositions.
Et au besoin, pour obtenir la neutralité de l’Angleterre, en faveur du Roi contre la France, ou le gagnera par des sacrifices raisonnables, c’est-à-dire par l’abandon d’une partie du territoire, de tout ce qui reste du domaine colonial.
C’est la trahison flagrante et cynique. Quant au manque d’argent qui parait faire hésiter Fersen, il surprend un peu quand on songe aux vingt-cinq millions de liste civile dont disposait Louis XVI : mais il n’avait pas une forte avance et il avait besoin d’une grosse somme pour solder d’emblée une armée de soldats étrangers.
C’est au second parti, au départ prochain, que s’arrêtèrent le Roi et la Reine, ou plutôt il est visible qu’en le préférant, Fersen se conformait à leur pensée, il s’agissait seulement de donner une forme un peu solennelle à la résolution définitive qu’on allait prendre, et de pouvoir produire au besoin un document authentique où les raisons de LL. MM. seraient exposées. La lettre adressée par le comte de Fersen au baron de Taube le 1er avril 1791 montre qu’à la suite du mémoire de Fersen c’est au départ le plus prochain possible que Louis XVI et Marie-Antoinette avaient conclu : En chiffre : « Le Roi et la Reine de France m’ont chargé de témoigner au roi (de Suède), combien ils sont sensibles aux témoignages d’intérêt que S. M. leur donne : ils aiment à y compter et cette certitude les a déterminés à communiquer à S. M. le plan qu’ils ont adopté.
« La position où se trouve le roi de France devenant tous les jours plus insupportable, LL. MM. se sont déterminées à la faire changer par tous les moyens possibles : ayant en vain employé ceux de la patience, des sacrifices de tout genre et de la douceur, elles se sont résolues à tenter ceux de la force ; mais l’Assemblée ayant, par ses opérations, détruit ou affaibli tous ceux qu’elles auraient pu trouver en France, elles ne les croient pas suffisants, s’ils ne sont pas combinés avec des secours et des bons offices des puissances étrangères.
« LL. MM. sont assurées d’un parti considérable en France, et d’un lieu de retraite à portée de la frontière du Nord. C’est M. Bouillé qui dirige tout cela. Elles sont assurées des dispositions favorables et des secours de l’empereur, de l’Espagne, de la Sardaigne, et de la Suisse, mais ces deux premières puissances craignent l’effet de la réunion de l’Angleterre, de la Hollande et de la Prusse, et que ces trois puissances ne veuillent en les attaquant, les empêcher de secourir le Roi de France d’une manière efficace.
« Elles voudraient donc qu’on différât cette affaire jusqu’à ce qu’on fût assuré de leur parfaite neutralité. C’était aussi le projet du roi (de Louis XVI), mais la marche des factieux est trop rapide, les dangers sont trop pressants et le royaume marche avec trop de rapidité vers sa ruine et sa décomposition totale pour qu’il soit possible au roi de différer plus longtemps. Il est donc décidé de tenter tous les moyens possibles pour mettre fin à tant de maux, et par une démarche prononcée et hardie engager les puissances alliées à se prononcer.
« Le roi est résolu de négocier avec l’Angleterre pour obtenir sa neutralité en lui offrant des avantages ou des sacrifices raisonnables, et, en cas de refus, de demander les bons offices de S. M. Frédéric pour engager la Russie et le Danemarck de se joindre à lui et en imposer de cette manière à l’Angleterre… Le roi de France désire et espère du roi (de Suède) une réponse prompte. Elle doit influer beaucoup sur sa détermination.
« Le roi de France voudrait partir de Paris et agir dans deux mois au plus tard ; mais cela dépend des différentes réponses qu’il attend… D’après le plan, le départ se fera de nuit et clandestinement. Je le ferai savoir au roi par un courrier. Je vous recommande cette affaire. »
Enfin on a trouvé dans le portefeuille des papiers confiés par la reine Marie-Antoinette au comte de Fersen lors du départ pour Varennes, la minute d’une lettre adressée par le comte de Fersen au baron de Breteuil ; la minute est annotée de la main de la reine qui indique quelques corrections, et c’est bien la pensée de la reine qui fut ainsi transmise au baron de Breteuil.
Celui-ci représentait au dehors le roi.
Calonne était l’agent des princes, du comte d’Artois, des émigrés ; de Breteuil était l’agent du roi et de la reine. Entre Calonne et de Breteuil il y avait lutte. Calonne voulait que toute l’œuvre de contre-révolution fût conduite par les princes, c’est-à-dire par lui-même. Il déconseillait donc très vivement le départ de Louis XVI.
Sa présence à la tête des troupes de la contre-révolution aurait relégué les princes dans l’ombre, et les émigrés, toujours infatués, redoutaient que le roi, même à la tête d’une armée de nobles et d’étrangers, transigeât encore avec la Révolution. Que Louis XVI, à ses risques et périls, reste donc aux Tuileries ; s’il est tué par les révolutionnaires, si les premiers mouvements de l’armée d’invasion soulèvent le peuple contre le roi et la reine, ce « forfait » aura un double avantage. Il animera encore contre la France révolutionnaire la colère des souverains, peut-être même l’ignorante pitié des peuples, et il débarrassera la monarchie d’un chef hésitant et faible.
De Breteuil, au contraire, voulait avant tout le salut du roi et de la reine et le rétablissement de l’autorité monarchique par eux et pour eux, non par les princes et pour les princes. La communication faite par le comte de Fersen, au nom de la reine, au baron de Breteuil est donc comme le sceau aux résolutions prises.
… « Le roi pense comme vous sur les conclusions à tirer des différentes lettres de M. de Merciy et il est convaincu que son départ de Paris est au préalable nécessaire, sans lequel aucune personne ne voudra s’engager à se mêler de ses affaires et à le secourir ; mais S. M. n’a pas lieu d’être aussi convaincue que vous paraissez l’être des dispositions actives de l’empereur à son égard ; ce que ce prince a dit à M. de Bombelles et qui est même revenu au roi, qu’il a dû dire à d’autres personnes, ne s’accorde nullement avec ce qu’il a mandé lui-même à la reine.
« Après beaucoup de protestations d’amitié, d’intérêt et de sensibilité sur la position de LL. MM., l’empereur dit clairement que les embarras où il se trouve et ceux que ses voisins pouvaient peut-être encore lui susciter, l’empêcheraient de favoriser en ce moment et d’une manière active les projets du roi pour le rétablissement de son autorité. Il exhorte à la patience et à remettre à une époque plus éloignée l’exécution du plan que le roi lui a communiqué.
« Cette différence de langage ne peut selon moi être attribuée qu’au penchant naturel de l’empereur pour la paix, à la crainte qu’il a d’en compromettre la durée par une démarche un peu prononcée en faveur du roi, à l’indécision de son caractère, et à l’embarras qu’il éprouve de donner une réponse positive de ce genre aux personnes qui lui prouvent combien la position du roi est affreuse et combien la cause de S. M. étant celle de tous les souverains, doit être protégée par eux…
« Le roi est toujours décidé à partir dans les quinze derniers jours de mai ; Sa Majesté en sent la nécessité et espère avoir reçu, vers cette époque, les réponses d’Espagne et avoir rassemblé l’argent nécessaire pour subvenir aux dépenses du premier moment…
« Recommandez à M. de Bombelles la plus grande prudence et une grande circonspection vis-à-vis du comte d’Artois. Le roi craint, et avec raison, qu’il ne revienne quelque chose de ses projets à M. le prince de Condé, et que ce prince, poussé par son ambition et le désir de jouer un rôle principal, ne hâte l’exécution de son entreprise chimérique, et vous sentez assez quelles en seraient les conséquences et les inconvénients pour celle que le roi veut exécuter…
« Le roi est de votre avis de différer les négociations relatives à une confédération à former contre la Prusse, la Hollande et l’Angleterre, jusqu’au moment où les dispositions favorables ou défavorables de ces puissances seront mieux connues, ainsi que sur les avantages ou sacrifices à accorder pour prix des services qu’on aurait rendus. S. M. a toujours répugné, et son projet n’a jamais été de les offrir, mais de les accorder si cela devenait absolument nécessaire. Elle avait même pensé à ne s’y décider qu’en faveur de l’Angleterre. »
La lettre est du 2 avril, mais soumise à correction elle ne fut pas expédiée tout de suite et les derniers paragraphes se réfèrent à des événements un peu ultérieurs : « D’après ce qui s’est passé le 18 (avril) le roi sent encore plus vivement la nécessité d’agir et d’agir promptement ; il est décidé à tout sacrifier à l’exécution des projets qu’il a formés et, pour y parvenir plus, sûrement, Sa Majesté s’est décidée à adopter un autre système de conduite ; et, pour endormir les factieux sur ses véritables intentions, il aura l’air de reconnaître la nécessité de se mettre tout à fait dans la révolution, de se rapprocher d’eux ; il ne se dirigera que sur leurs conseils et préviendra sans cesse le vœu de la canaille, afin de leur ôter tout moyen et tout prétexte d’insurrection, et afin de maintenir la tranquillité et leur inspirer la confiance si nécessaire pour la sortie de Paris. Tous les moyens doivent être bons pour parvenir à ce but. On dit qu’on va demander le renvoi de toute sa maison, il sera accordé, et cette circonstance pourra peut-être fournir un peu d’argent. »
« D’après une lettre très pressante du comte d’Artois, dans laquelle il paraissait disposé à aller joindre le prince de Condé (pour tenter une brusque invasion en France) et où il appuyait beaucoup sur les moyens qu’il avait, on lui a mandé d’envoyer un homme de confiance pour être pleinement instruit de ses moyens et se concerter avec lui sur la possibilité d’agir. On a imaginé ce moyen pour le retenir où il est et gagner du temps. On va aussi envoyer au prince de Condé un nommé Conti, homme de confiance de ce prince, pour lui rendre compte de la position du roi et l’empêcher d’agir, en lui représentant les dangers auxquels la famille royale serait exposée si l’on voulait tenter quelque chose en ce moment. »
Ainsi, à la fin de mars et au commencement d’avril, les résolutions du roi étaient arrêtées : le plan d’évasion et de négociation ultérieure avec l’Europe était tracé. La lettre du comte de Fersen au baron de Breteuil porte, je l’ai dit, la date du 2 avril. Le 2 avril, c’est le jour où meurt Mirabeau. Mais il est très clair que la mort du grand tribun n’est pour rien dans la décision du roi, communiquée au roi de Suède par la lettre du 1er avril. M. Thiers a écrit que la mort de Mirabeau en enlevant au roi le seul révolutionnaire sur lequel il pût s’appuyer, le détermina à partir et à engager ouvertement la lutte. Comme on l’a vu, c’est absolument inexact et le parti du roi était pris irrévocablement quand Mirabeau mourut.
Tragique rencontre ! Au moment même où Mirabeau succombait, épuisé par tous les excès et toutes les agitations de sa vie, la royauté renonçait décidément à cet accord avec la Révolution où Mirabeau voyait le salut de la Révolution et de la monarchie elle-même !
Il mourait donc tout entier, ne laissant pas une pensée qui lui survécût. Sa mort causa une émotion immense dans tout le pays. C’était une grande et ardente lumière qui s’éteignait soudain. Il semblait que dans tous les orages révolutionnaires sa parole avait été l’éclair et la foudre, et on se demanda avec une sorte de stupeur si la Révolution n’avait point perdu, en le perdant, sa force électrique. Il y avait en cet homme un mélange si extraordinaire de pensée et de passion que l’esprit humain paraissait en lui comme une force de la nature. Le peuple et la bourgeoisie révolutionnaire se rappelèrent soudain ses luttes véhémentes contre le despotisme paternel et l’arbitraire d’ancien régime, sa magnifique campagne contre les nobles qui retentit en éclats tumultueux sous le ciel enflammé de Provence, son audacieuse et habile tactique de sagesse et de menace aux premiers jours des États Généraux, son apostrophe à de Brezé et ses appels au calme.
Ils se rappelèrent que, dans tous les actes décisifs de la Révolution, quand il avait fallu saisir les biens d’Église et les mettre à la disposition de la nation, puis, quand il avait fallu créer les assignats, c’est lui qui avait dissipé les obscurités, fixé les incertitudes, donné aux intelligences, en les éclairant, l’impétuosité même de l’instinct.
Et c’est par lui encore que sur les vaisseaux commandés par tant d’officiers nobles et contre-révolutionnaires flottait, au haut des mâts, le drapeau tricolore, le drapeau de la Révolution, illuminant au loin de son triple rayon l’étendue inquiète des mers. Qui donc allait le remplacer ? Et le peuple révolutionnaire pleurait comme si on lui eût arraché un peu de la Révolution elle-même.
Dans l’émotion, dans l’angoisse de cette disparition presque subite, tous ou presque tous oubliaient les bruits de corruption et de trahison qui couraient pourtant depuis des mois. Quand il avait soutenu le droit du roi dans la question de la paix et de la guerre, ce n’étaient pas seulement des pamphlets anonymes, c’était le grave journal de Loustalot qui avait enregistré ces soupçons de vénalité.
Mirabeau avait réussi à cacher ses relations avec la Cour ; il avait pu aller voir la reine à Saint-Cloud, et quand un journal raconta cette entrevue, le public resta sceptique et Mirabeau n’eut même pas besoin de nier. Pourtant une sorte d’instinct avertissait le peuple qu’entre Mirabeau et la Cour il y avait peut-être quelques rapports secrets, mais qui sait si le grand révolutionnaire n’avait pas voulu simplement suivre de près les intrigues de la contre-révolution pour les mieux déjouer ?
Sa parole, aux grands jours de crises, jaillissait toujours si audacieuse, si fière d’elle-même, si foudroyante parfois pour la contre-révolution qu’elle dissipait soudain toutes ces vagues nuées de soupçon. Marat seul garda, même devant la mort, toute sa haine et tout son mépris, et sous le titre : Oraison funèbre de Riquetti, il écrivit le lundi 4 avril :
« Peuple, rends grâce aux dieux, ton plus redoutable ennemi vient de tomber sous la faux de la Parque, Riquetti n’est plus : il meurt victime de ses nombreuses trahisons, victime de ses trop tardifs scrupules, victime de la barbare prévoyance de ses complices atroces, alarmés d’avoir vu flottant le dépositaire de leurs affreux secrets. »
Ainsi, selon Marat, Mirabeau mourait, empoisonné par la Cour, parce qu’il n’avait pas voulu s’associer, jusqu’au bout à ses complots contre la liberté, et la Cour le faisait disparaître pour qu’il ne pût dénoncer ses trames. En accusant Mirabeau de la sorte, Marat le justifiait, car ce que retenait la partie la plus ardente et la plus soupçonneuse du peuple, c’est que Mirabeau avait été empoisonné par la contre-révolution, et qui sait encore une fois s’il n’avait point paru s’associer à certaines intrigues pour en mieux surprendre le secret ?
Une impression de mystère se mêlait, dans l’âme du peuple, à la naturelle émotion de la mort, et tout, même les accusations passionnées de Marat, tournait à la glorification du tribun.
Dans sa conscience révolutionnaire, plus vaste que tous les partis et que toutes les haines, le peuple réconciliait toutes les forces de la Révolution : Mirabeau, Robespierre, Marat. Les sociétés populaires dressaient côte à côte le buste de Robespierre « l’incorruptible » et le buste de Mirabeau accusé de corruption. Et chose curieuse ! c’est à Marat lui-même que des ouvriers demandaient avec une admirable candeur de Révolution le moyen de célébrer la mémoire de Mirabeau. Marat recevait et publiait dans son numéro du 24 mai 1791, la lettre suivante :
- « A l’Ami du Peuple,
« Cher ami du peuple, daignez nous aider par vos conseils : je vous parle au nom de tous les garçons cordonniers de la capitale, qui, pour vous garantir de la plus légère blessure seraient tout prêts à répandre leur sang. Il est bon de vous dire que le 18 de ce mois, nous nous proposions de faire un service à feu Mirabeau. Cela éprouva beaucoup de contestations et il n’y avait de silence dans la salle nue lorsqu’on disait : Messieurs, l’ami du peuple l’a accusé de plusieurs malversations. Cependant le torrent l’emporta et nous fîmes le 16 entre nous une somme de 900 livres. Le 20, la municipalité fit afficher que nous ne pourrions avoir ni tambour ni trompette et nous ordonna de nous rassembler à la sourdine.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
« Nous craignons, cher ami du peuple, que sitôt que nous serons assemblés de cette manière elle ne fasse courir le bruit que nous sommes des séditieux et qu’elle le proclame la loi martiale. Nous attendons là-dessus vos salutaires avis pour disposer de cette somme d’une autre manière, car nous avouons que nous avons cessé de mettre à la Bourse.
« Nous sommes, cher ami du peuple, en attendant votre réponse, vos fidèles amis les garçons cordonniers, assemblés rue Beaurepaire. Signé : « Millau au nom de ses confrères ».
Ainsi, même parmi les lecteurs et amis de Marat, le « torrent » d’admiration pour Mirabeau emportait tout. Mais ce n’est pas seulement la perte d’une grande force révolutionnaire que la nation déplorait. La plupart des hommes de la Révolution cherchaient anxieusement à cette date le moyen de la concilier avec la monarchie, et il leur paraissait que Mirabeau, par l’ampleur et la souplesse de son génie, par le sens monarchique et conservateur qui s’alliait en lui au sens révolutionnaire, saurait réaliser cette conciliation nécessaire. Ils sentaient en lui une puissance mystérieuse et qui n’avait pas dit son dernier mot. L’audace et l’imprévu de ses démarches politiques, la complexité de sa pensée, la soudaineté et si je puis dire, l’étendue de ses coups de foudre qui menaçaient tantôt la conspiration d’ancien régime, tantôt le désordre du mouvement populaire, même les bruits étranges qui couraient sur ses relations avec la cour, si souvent accablée par lui, tout persuadait aux esprits inquiets qu’il portait en lui un secret puissant, et qu’il saurait, en un creuset inconnu, fondre des éléments contradictoires.
Cette sorte d’espérance vague et de pressentiment inquiet hante encore aujourd’hui beaucoup d’historiens. Les uns, conservateurs libéraux comme M. Dareste, se demandent si Mirabeau aurait « sauvé la France », c’est-à-dire s’il aurait su trouver et réaliser l’équilibre de l’ordre monarchique et de la liberté révolutionnaire. D’autres, révolutionnaires bourgeois, intrigants et hardis, comme M. Thiers, se demandent avec éloquence si Mirabeau aurait pu arrêter le cours de la Révolution, sur les pentes de la démocratie et de la République. « Aurait-il pu, s’écrie M. Thiers, dire aux agitateurs qui voulaient à leur tour l’éclat et le pouvoir : Restez dans vos faubourgs obscurs ? »
Ce que j’ai cité du comte de Fersen me permet de répondre avec certitude : Non, à cette date, en avril 1791, Mirabeau ne pouvait plus rien. Il n’aurait pu fixer la Révolution dans la monarchie constitutionnelle et accorder la liberté avec la puissance du pouvoir exécutif royal que si le Roi avait accepté honnêtement la Révolution, s’il avait accepté vraiment les conseils de Mirabeau. Or il est démontré qu’en avril 1791, à l’heure où Mirabeau expirait, le Roi avait décidément adopté un plan de lutte à outrance contre la Révolution, avec le concours de l’étranger. Non seulement le Roi ne l’avait pas écouté, mais il l’avait méprisé et trompé, il ne l’avait pas mis dans la confidence de son projet de fuite. Il n’avait vu en lui qu’un instrument dégradé qu’on paye pour une besogne subalterne et provisoires qu’on rejette ensuite avec dédain. Chose plus terrible encore pour le grand tribun égaré qui, exclu du ministère, rejeté des voies éclatantes du pouvoir, s’était enfoncé dans la politique occulte ! C’est un conseil de Mirabeau que le Roi paraissait suivre, mais en le dénaturant, en le travestissant jusqu’à la trahison. Fuir de Paris et appeler à la nation, c’était le plan de Mirabeau aussi ; mais il voulait que le Roi trouvât la force nécessaire à cet appel dans la Révolution elle-même, loyalement acceptée et invoquée par lui.
Pas de hordes étrangères, pas de despotisme, pas de fuite vers la frontière et vers la tyrannie. Le Roi, libéré de Paris, devait s’installer au cœur même de la France et de la liberté. Or, voilà que, par une abominable parodie, châtiment de ce qu’il y avait d’impur en ces relations secrètes, le Roi fuyait de Paris, mais fuyait aussi de la Révolution. C’est une caricature ignominieuse du plan du grand tribun, mais qui en retenait assez de traits pour le déshonorer et pour le désespérer. Si Mirabeau avait assez vécu pour apprendre la fuite de Varennes, il aurait été frappé d’un coup formidable dans son orgueil et dans sa dignité même. Il aurait dû s’avouer qu’il avait été dupe de la Cour, dupe misérable et méprisée, et l’argent même qu’il avait reçu du Roi et où il affectait de voir le prix d’une sorte de collaboration, le salaire d’une sorte de ministère occulte, lui aurait apparu avec dégoût comme le prix de son aveuglement, comme un salaire de trahison, chute salissante dans l’obscur sentier soudain devenu fangeux ! Et aucun moyen de relèvement, aucune issue hors de ce morne abîme.
Excuser la fuite du Roi, lui donner ou essayer de lui donner une signification nationale, c’était accepter la substitution du plan de trahison au plan de libération. C’était soi-même entrer dans la trahison définitive. Mirabeau ne s’y serait point résigné ; d’un bond, pour échapper à cette contagion de crime et de bassesse, il se serait jeté à l’extrémité révolutionnaire. Plus d’une fois déjà il avait averti la Cour ; si on ne l’écoutait point tout serait perdu, et il ne lui resterait plus alors qu’à se sauver lui-même en se portant de nouveau à l’avant-garde de la Révolution, mais quoi ! après Varennes, l’aurait-il pu ?
Il était si facile au Roi, qui n’avait plus rien alors à ménager, de foudroyer Mirabeau en publiant ses relations avec lui et le compte des sommes qu’il lui avait données. Il était facile au Roi d’attribuer ce revirement du grand révolutionnaire à la suspension des mensualités. Et non seulement il pouvait déshonorer et briser Mirabeau, mais il pouvait par là, frapper au cœur la Révolution elle-même.
Plus tard, quand le peuple révolutionnaire du 10 août trouvera aux Tuileries la preuve des relations de Mirabeau avec la Cour, il ne se sentira pas humilié et dégradé, car la Révolution aura depuis longtemps déployé des forces où Mirabeau n’était point mêlé, et c’est encore une victoire révolutionnaire qui forçait et livrait au grand jour ce triste secret. Mais si, en 1791, le Roi fugitif et prenant contre la France révolutionnaire le commandement des troupes étrangères avait pu se réclamer cyniquement de Mirabeau, il aurait pour ainsi dire porté le désespoir et presque l’infamie en toutes les âmes que la parole du grand révolutionnaire avait soulevées. « Voilà la source de votre enthousiasme ; voilà la nuée d’intrigue et de corruption d’où jaillissaient les grands éclairs. »
Une sorte de nuit morale se serait faite un moment sur la patrie, et c’est du choc en retour des foudres révolutionnaires que l’ironie royale aurait pu foudroyer la Révolution. Non, non, il n’était donné à aucun homme, si grand qu’il fût, de lutter contre le destin et d’arracher la vieille monarchie à ses instincts rétrogrades : il n’était donné à aucun homme de lui communiquer une âme révolutionnaire, et pour l’avoir essayé, pour avoir préparé d’impossibles amalgames comme un alchimiste acharné à ses fourneaux, le grand tribun, devenu presque un conspirateur, s’exposait à la terrible solidarité des trahisons royales. Cette douleur et cette honte lui furent épargnées : la mort souveraine le couvrit de son manteau.
Mirabeau est le seul grand homme de la Révolution qui n’ait point péri sur l’échafaud ; sa mort eut ainsi une grandeur plus intellectuelle. Devant les têtes coupées de Vergniaud, de Madame Roland, de Danton, de Robespierre, un horrible frisson paralyse la pensée. Mirabeau vit approcher la mort, et il la regarda en face, sans faiblesse et sans jactance, en se recueillant dans sa gloire. Matérialiste et athée, il ne se laissait aller à aucun rêve mystique : c’est dans l’éclatante lumière du xviiie siècle que sa pensée s’endormit. Il sentait bien que la combinaison de démocratie et de monarchie qu’il avait voulue avait quelque chose de paradoxal et que son génie seul l’aurait pu fonder ; mais il savait aussi que la nature inépuisable susciterait d’autres formes de vie, d’autres arrangements sociaux et il faisait crédit à l’univers. Peut-être aussi une lassitude secrète de l’œuvre contradictoire et surhumaine où il s’épuisait depuis deux ans, lui rendit la mort plus facile. Il recommanda qu’on publiât un jour sa correspondance avec la Cour : « Ce sera là, dit-il, ma défense et ma gloire. » Et comment pourrait-on accuser de trahison et de bassesse l’homme qui, avant de mourir, lègue à la postérité tout son secret ? Avec quelle émotion, écrivait Camille Desmoulins le lendemain de la mort, j’ai contemplé cette tête puissante « ce superbe magasin d’idées démeublé par la mort ! »
L’Assemblée, Paris, la Révolution elle-même lui firent de splendides funérailles : mais sa mémoire n’entrait pas encore dans le repos, elle sera secouée par tous les orages de la Révolution ; le grand tribun s’était si profondément uni à elle que, même mort, il sera présent en elle, tour à tour exalté et maudit, jamais oublié.
Cependant la Cour continuait ses négociations et ses préparatifs de fuite, et la juste défiance du peuple s’exaspérait. Le 18 avril, le roi voulut aller à Saint-Cloud. Le peuple était très irrité du dessein attribué au Roi de faire ses Pâques avec un prêtre réfractaire, et de plus il pensait que de Saint-Cloud le roi essaierait de fuir. Les sentiments populaires sont admirablement saisis dans le mémoire du comte de Fersen au baron de Taube. « A onze heures et demie, le Roi fut à la messe ; M. Bailly était venu auparavant le prévenir que son départ occasionnerait du mouvement et que le peuple paraissait vouloir s’y opposer. Le Roi lui répondit qu’il avait décrété la liberté pour tout le monde d’aller où il voudrait, et qu’il serait bien extraordinaire qu’il fût le seul homme qui ne pût jouir de celle d’aller à deux lieues prendre l’air, et qu’il était décidé à partir. Il descendit avec la Reine, Madame Élisabeth, les enfants et Madame de Tourzel, et comme les voitures n’avaient pu entrer dans la cour des Princes, il voulut, aller les chercher dans le Carrousel. Sur ce qu’on lui dit qu’il y avait une foule énorme, il s’arrêta dans le milieu de la cour des Princes, et la Reine lui proposa de monter dans la voiture qui était entrée dans la cour, quoiqu’elle ne fût qu’une berline. Ils y montèrent tous six, et lorsque les chevaux furent à la porte, les gardes nationaux refusèrent de l’ouvrir et de laisser partir le Roi.
« En vain, M. de Lafayette leur parla et leur prouva qu’il n’y avait que des ennemis de la Constitution qui pussent se conduire ainsi, qu’en gênant la volonté du Roi, on lui donnait l’air d’un prisonnier et qu’on annulait ainsi tous les décrets qu’il avait sanctionnés. On ne lui répondit que par des invectives et des assurances qu’on ne laisserait pas partir le Roi. On se servit contre le Roi des termes les plus injurieux : qu’il était un foutu aristocrate, un bougre d’aristocrate, un gros cochon ; qu’il était incapable de régner, qu’il fallait le déposer, et y placer le duc d’Orléans, qu’il n’était qu’un fonctionnaire public et qu’il fallait qu’il fît ce qu’on voulait. Les mêmes propos se tenaient parmi le peuple ; qu’il était entouré d’aristocrates, de prêtres réfractaires ; qu’il fallait qu’il les chassât. M. de Lafayette demanda au maire de faire proclamer la loi martiale et déployer le drapeau rouge, il s’y refusa. On lui dit qu’on s’en moquait et qu’il serait la première victime. Il offrit sa démission, on le pria de se dépêcher à la donner. Il ne fut pas mieux reçu du peuple lorsqu’il le harangua.
« Les détachements des grenadiers, à mesure qu’ils arrivaient, juraient que le Roi ne partirait pas ; plusieurs mâchaient des balles en disant qu’ils les mettraient dans leurs fusils pour tirer sur le Roi, s’il faisait le moindre mouvement pour partir. Tous les gens de sa maison qui s’étaient approchés de la voiture, furent insultés par les soldats, ils en arrachèrent M. de Duras, quoique le Roi leur dit qu’il devait y être et qu’il était de son service ; et ce ne fut qu’après leur avoir parlé longtemps, et avoir sommé les grenadiers de le rendre, qu’ils le laissèrent à la portière ; il appela deux grenadiers pour leur dire de protéger le duc de Villequiers, qui y était aussi. M. de Geugenot, maître d’hôtel, s’étant approché de la portière de la Reine, pour prendre ses ordres pour le dîner, en fut arraché et allait être pendu, si les grenadiers ne fussent arrivés, qui tout en le maltraitant et le tiraillant l’entraînèrent en lui disant tout bas : « Du moins, vous pourrez dire au Roi qu’il y a encore de braves gens qui savent sauver ceux qui lui sont attachés. » La Reine s’avança pour leur dire de le laisser rester, qu’il était du service du Roi ; ils lui dirent qu’ils n’avaient pas d’ordre à recevoir d’elle, qu’ils n’en recevraient que de leurs officiers.
« D’autres disaient : voilà une plaisante bougresse pour donner des ordres. Ils insultèrent de propos les gardes suisses qui étaient rangés en haie vis-à-vis, ils insultèrent les ecclésiastiques qui étaient aux fenêtres du château, et il y en eut qui couchèrent en joue le cardinal Montmorency, grand aumônier. M. de Lafayette envoya consulter le département et le pria de publier la loi martiale, il ne fit pas de réponse. Il demanda au Roi s’il voulait qu’on employât la force pour le faire passer et faire respecter la loi. Les soldats lui répondirent qu’il n’avait aucune force pour cela, ils avaient tous ôté leurs baïonnettes, en disant qu’ils ne s’en serviraient pas contre de braves citoyens. Le Roi refusa d’employer la force et dit : « Je ne veux pas qu’on verse du sang pour moi ; quand je serai parti, vous serez les maîtres d’employer tous les moyens que vous voudrez, pour faire respecter la loi. »
« Dans la place du Carrousel, le postillon de la voiture du Roi, qui n’avait pu entrer, fut menacé d’être massacré, s’il faisait le moindre mouvement. Le piqueur manqua d’être pendu : des grenadiers qui étaient près de la voiture pleuraient à chaudes larmes ; il y en eut plusieurs qui s’avancèrent et dirent au Roi : Sire, vous êtes aimé, vous êtes adoré de votre peuple, mais ne partez pas ; votre vie serait en danger, on vous conseille mal, on vous égare, on veut que vous éloigniez les prêtres, on craint de vous perdre. Le Roi leur imposa silence et leur dit que c’étaient eux qui étaient égarés et qu’on ne devait pas douter de ses intentions et de son amour pour son peuple. »
« Enfin, après deux heures et un quart d’attente, et d’efforts inutiles de M. de Lafayette, le roi fit retourner la voiture. En descendant, les soldats se pressèrent en foule autour, il y en eut qui dirent : Oui, nous vous défendrons. La Reine leur répondit, en les regardant fièrement : Oui, nous y comptons, mais vous avouerez à présent que nous ne sommes pas libres. Comme ils serraient beaucoup et entraient en foule dans le vestibule, la Reine prit le Dauphin dans ses bras, madame Élisabeth se chargea de Madame et elles les emmenèrent le plus vite qu’elles purent. Le Roi alors ralentit sa marche et lorsqu’elles furent entrées dans l’appartement de la Reine, le Roi se retourna et dit d’une voix ferme : « Halte-là, grenadiers ! » Tous s’arrêtèrent comme si on leur avait coupé les jambes.
« Il n’y avait dans la cour des Princes que des gardes nationales, le peuple était dans le Carrousel et les portes étaient fermées. On ne dit rien contre la Reine, mais des horreurs contre le Roi. Ils parurent tous deux avec beaucoup de fermeté et de sang-froid et eurent un maintien parfait. Tout fut tranquille dans le château. À huit heures le Roi fut averti que la garde avait décidé d’entrer la nuit dans toutes les chambres, même celle du Roi, sous prétexte de visiter s’il n’y avait pas de prêtres. Cette résolution changea à dix heures. Dans le Carrousel un homme lisait à la lueur d’un flambeau, un papier rempli d’horreurs contre le Roi, où il exhortait le peuple à forcer le château, à jeter tout par les fenêtres, et surtout à ne pas manquer l’occasion qu’ils avaient manquée à Versailles, le 6 octobre. »
Étrange journée qui n’eut aucun effet immédiat sur la marche des événements, mais qui révèle la prodigieuse complexité du sentiment populaire ! Il n’y avait pas dans cette foule immense un seul républicain. Ceux même qui injuriaient brutalement le Roi, le traitant d’aristocrate, d’incapable et de gros cochon, parlaient de le remplacer, non par la République, mais par le duc d’Orléans. En fait, l’immense majorité de ceux qui étaient là voulaient avant tout garder le Roi, mais le séparer de la contre-Révolution. Dans ce soulèvement, le peuple et la bourgeoisie se rencontrent. Les gardes nationaux, citoyens actifs et bourgeois, sont les premiers qui empêchent le départ du Roi ; dès que la Révolution est menacée, les défiances entre le peuple et les bourgeois s’effacent ; tous sont d’accord pour la défendre.
Comme il eût été facile encore à Louis XVI de garder le pouvoir et même de conquérir une autorité immense ! Qu’il soit avec la Révolution, et le cœur du peuple est avec lui. On croit avoir besoin de lui, et s’il dispensait la nation de choisir entre la Révolution et la royauté, Louis XVI exciterait une reconnaissance incroyable. La bourgeoisie redoutait tout à la fois les représailles réactionnaires et les commotions populaires. Jamais Roi n’eut tâche plus facile : apaiser, en l’acceptant, la Révolution. Dès le lendemain du 18 avril, Lafayette, outré de n’avoir pas été obéi par les gardes nationaux, donne sa démission. Il y eut dans presque toute la bourgeoisie parisienne une stupeur immense. Elle multiplia les pétitions, les protestations d’obéissance aveugle pour le retenir, et il resta. Oui, si le Roi avait été loyal, il aurait eu une force légale presque sans précédent. Mais il redouble de ruse. On a noté le mot échappé à la Reine : Vous avouerez maintenant que nous ne sommes pas libres. Dans ces grandes, émotions révolutionnaires qui mêlaient peuple et bourgeoisie, le Roi et la Reine ne voyaient pas un avertissement, mais un prétexte à discréditer la Constitution.
C’était comme un cas de nullité qu’ils invoquaient d’avance contre toutes les sanctions données par le Roi. Mais ce propos imprudent pouvait éveiller les défiances. Il ne fallait pas surtout que la nation et l’Assemblée puissent croire que le Roi, aigri par la journée du 18 avril, songeait à en tirer argument pour désavouer après coup la Constitution, ou pour justifier son départ. Car une surveillance plus active aurait peut-être empêché la fuite. Louis XVI crut bon de se rendre à l’Assemblée pour mentir de nouveau.
« Messieurs, dit-il, je viens au milieu de vous avec la confiance que je vous ai toujours témoignée. Vous êtes instruits de la résistance qu’on a apportée hier à mon départ pour Saint-Cloud, je n’ai pas voulu qu’on la fit cesser par la force, parce que j’ai craint de provoquer des actes de rigueur contre une multitude trompée et qui croit agir en faveur des lois lorsqu’elle les enfreint. Mais il importe à la nation de prouver que je suis libre ; rien n’est si essentiel pour l’autorité des sanctions et des acceptations que j’ai données à vos décrets. Je persiste donc, pour ce puissant motif, dans mon projet de voyage à Saint-Cloud, et l’Assemblée nationale en sentira la nécessité.
« Il semble que pour soulever un peuple fidèle, et dont j’ai mérité l’amour par tout ce que j’ai fait pour lui, on cherche à lui inspirer des doutes sur mes sentiments pour la Constitution. J’ai accepté et j’ai juré de maintenir cette Constitution, dont la Constitution civile fait partie, et, j’en maintiens l’exécution de tout mon pouvoir. Je ne fais que renouveler ici l’expression des sentiments que j’ai souvent manifestés à l’Assemblée nationale et elle sait que mes intentions et mes vœux n’ont d’autre but que le bonheur du peuple, et ce bonheur ne peut résulter que de l’observation des lois et de l’obéissance à toutes les autorités légitimes et constitutionnelles. » Au nom du Roi, le ministre des Affaires étrangères signifiait à toutes les cours étrangères que Louis XVI acceptait librement et aimait la Constitution.
Mais en même temps Louis XVI les faisait avertir que ce n’était là qu’un jeu, et qu’elles ne devaient pas s’y tromper. Le 22 avril, Fersen en envoyant au baron de Taube le discours de Louis XVI, lui écrit : « le roi ne doit plus s’opposer à rien, mais au contraire, céder à tout, tout faire ce qu’on lui demandera, afin de mieux prouver qu’il n’est pas libre et de les endormir sur les véritables projets auxquels il tient plus que jamais et à l’exécution desquels il faut tout sacrifier, quelque pénible que cela puisse être et le roi (de Suède) ne doit pas être surpris de tout ce qu’il pourrait dire ou faire ; c’est toujours une suite de non liberté. Leurs Majestés iront dimanche à la paroisse à la messe, et pour peu qu’on le désire, elles se confesseront et feront leurs pâques de la main d’un prêtre qui aurait fait le serment ».
Les agents du Roi au dehors essayèrent de tirer parti des événements du 18 avril pour émouvoir les souverains de l’Europe, pour les effrayer sur leur propre danger et pour brusquer leur intervention. Le baron de Breteuil fait remettre à l’empereur Léopold, alors à Florence, un mémoire très pressant, le 3 mai : « Les nouveaux attentats auxquels les factieux viennent de se porter, en empêchant le Roi de sortir des Tuileries, ne peuvent qu’ajouter au désir qu’ont Leurs Majestés de se tirer de captivité. L’indignation publique en facilitera les moyens, et l’Europe sera forcée d’applaudir aux efforts de l’Empereur pour sauver les jours de la Reine.
« Les ennemis de toute royauté n’entassent crime sur crime que parce qu’ils croient à leur impunité ; leurs attentats ont marché avec progression ; et bien certainement Leurs Majestés sont plus en danger ici si l’on n’agit pas que si l’intention de les secourir se manifeste. »
« L’Empereur, comme le plus autorisé à punir les insultes faites à la fille des Césars (Marie-Antoinette, qui était une Habsbourg) est le seul souverain qui doive et qui puisse donner l’impulsion à tous les autres. Les troupes de Sa Majesté Impériale sont aux portes de l’Alsace, des évêchés et de la Flandre. Des mouvements propres à consolider le retour de l’ordre dans les Pays-Bas se continueront avec des démonstrations suffisantes pour que les troupes fidèles et les généraux bien pensants forment dans l’intérieur un point vers lequel le roi se portera avec sûreté ; car l’évasion de LL. MM. n’est pas, à beaucoup près, impossible ; mais si on resserrait leurs chaînes, alors on peut assurer que c’est à l’Empereur seul à les faire tomber, en appuyant un manifeste de forces imposantes…

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
« Il faut quinze millions au roi ; quatre portés au plus tôt à Luxembourg, et le reste arrivant peu de semaines après. Un vrai serviteur de l’Empereur prend en ce moment la liberté d’affirmer que de toutes les dépenses du trésor impérial, celle-ci est faite pour passer la première : le salut de la reine de France, celui de la monarchie et la tranquillité du règne de Léopold en dépendent. Si la démocratie n’est pas arrêtée dans ses pas aussi précipités qu’effroyables, aucun trône ne peut plus reposer sur des bases solides… »
C’est l’appel à l’or de l’étranger comme à sa force militaire. Et de plus, de Breteuil esquisse une double combinaison : d’abord la fuite du roi venant prendre le commandement des troupes autrichiennes, croates, sardes ; ou, si l’évasion du roi est impossible, un manifeste menaçant des puissances, suivi d’une intervention armée. Léopold, hésitant encore, se dérobait, et ce qui l’y aidait, c’est la dualité de l’intrigue contre-révolutionnaire. Le 3 mai, M. de Breteuil, par l’intermédiaire de M. de Bombelles, remettait à l’Empereur le mémoire que j’ai cité, concluant avant tout au départ du roi. Le 20 mai, à Mantoue, le comte d’Artois avait avec Léopold une conversation dont les conclusions sont fixées dans la fameuse note reproduite par Bertrand de Molleville.
Or, cette note, qui promettait une intervention de trente-cinq mille hommes à la frontière de Flandre et de quinze mille hommes à la frontière de Dauphiné et qui annonçait pour la fin de juillet une protestation collective de la maison de Bourbon, déconseillait nettement la fuite.
« Quoique l’on ait désiré jusqu’à présent que Leurs Majestés pussent elles-mêmes se procurer leur liberté, la situation présente engage à les supplier très instamment de n’y plus songer. Leur position est bien différente de ce qu’elle était avant le 18 avril, avant que le roi eût été forcé d’aller à l’Assemblée et de faire écrire la lettre aux ambassadeurs.
« L’unique objet dont Leurs Majestés doivent s’occuper est d’employer tous les moyens possibles à augmenter leur popularité, pour en tirer parti quand le moment sera venu, et de manière que le peuple, effrayé à l’approche des armées étrangères, ne voie son salut que dans la médiation du roi et dans sa soumission à l’autorité de Sa Majesté : telle est l’opinion de l’Empereur. Il attache uniquement à ce plan de conduite le succès des mesures qu’il a adoptées, et il demande surtout qu’on éloigne toute autre idée. Ce qui arriverait à Leurs Majestés si, dans leur fuite, elles ne pouvaient échapper à la surveillance barbare les fait frémir d’horreur. Sa Majesté croit que la sauvegarde la plus sûre est dans le mouvement des armées des puissances, précédé par des manifestes menaçants. »
Beaucoup d’historiens ont accordé à cette note bien plus de valeur qu’elle n’en a. Ce n’est point là la pensée ferme et le plan de l’Empereur : il n’avait qu’un plan : gagner du temps. Et voilà pourquoi il paraissait se rallier à l’idée du comte d’Artois qui, en retardant le départ du roi, ajournait par là même le problème. Entre la politique contradictoire du baron de Breteuil et du comte d’Artois, l’Empereur s’échappait.
Le comte d’Artois, qui l’a évidemment inspirée ou même rédigée avec l’approbation plus ou moins vague de l’Empereur, s’applique d’ailleurs à subordonner Louis XVI, à le lier : « Tout étant ainsi combiné avec les puissances, on doit regarder ce plan comme arrêté et prendre garde qu’il ne soit contrarié par des idées disparates ; c’est pourquoi Leurs Majestés doivent éviter avec grand soin de diviser la confiance et de multiplier les entremises, ayant déjà éprouvé que cette manière d’agir ne servait qu’à nuire, retarder et embarrasser. »
Le comte d’Artois voulait être seul à diriger la lutte contre la Révolution : jeu étrange des ambitions et des intrigues autour du roi, vers lequel s’allonge déjà l’ombre d’un destin tragique ! Les raisons données par le comte d’Artois contre le départ du roi sont misérables : car si les événements du 18 avril ont conduit le roi à aggraver son système de mensonge, à assurer la France et le monde de son amour pour une Constitution haïe, en quoi cela peut-il fixer le roi à Paris ?
Est-ce que le comte d’Artois ne conseille pas au roi un mensonge plus odieux encore s’il est possible, une plus vile et plus scélérate hypocrisie ? Appeler les armées étrangères pour écraser la Constitution et la liberté, et en même temps se donner au peuple affolé par l’invasion comme le médiateur et le sauveur nécessaire, quel manège plus répugnant ?
Aussi bien, la note du 20 mai n’eut aucun effet sur Louis XVI, si même elle fut connue de lui autrement que par un message verbal. Dès la fin d’avril, comme il résulte des lettres de Bouillé à Fersen, le départ était si bien décidé que Bouillé et Fersen s’employaient dès lors à déterminer l’itinéraire. Le roi se disait qu’il obligerait bien les souverains de l’Europe à se prononcer pour la monarchie contre la démocratie.
Mais avait-il arrêté un plan de politique intérieure ou, comme on dira plus tard, un plan de Restauration ? Quelle conduite Louis XVI, vainqueur de la France révolutionnaire, tiendrait-il envers la Révolution ? Ses idées étaient très flottantes. Une seule chose est sûre, c’est que tandis que le comte d’Artois cherchait à devenir le grand chef de la Contre-Révolution et à supprimer toute autre influence, le baron de Breteuil, de son côté, aspirait à devenir le ministre dirigeant, le haut conseiller et le haut guide de la monarchie restaurée en son plein pouvoir.
Il écrit le 30 avril : « Comme il est impossible, quelque diligence que je puisse faire, que le roi ne soit pas plusieurs jours avant moi au lieu où il devra se rendre ; je demande qu’excepté les opérations militaires, sur lesquelles il importe de ne gêner ni retarder les vues du général (Bouillé), Sa Majesté veuille bien ne prendre aucune résolution sur les personnes et sur les choses avant que j’aie pu prendre ses ordres. Rien n’est plus essentiel pour le service du roi, que d’éviter les démarches précipitées sur lesquelles il faudrait peut-être revenir.
« J’oserai ajouter qu’il ne l’est pas moins que Sa Majesté fasse connaître jusque dans les moindres détails l’étendue de la confiance dont elle voudrait m’honorer dans la conduite des affaires. Le roi pourrait voir cette demande de mon zèle le plus pur sous le jour de l’ambition ; je serais dès cet instant incapable de devenir de quelque utilité dans la situation difficile où se trouve le royaume. »
C’est le marché en main : ou le roi s’engagera avec précision et jusque dans les moindres détails à assurer au baron de Breteuil le plein pouvoir ministériel, ou le baron de Breteuil, qui détient tous les secrets du roi dans une négociation difficile et redoutable, se considérera brusquement comme inutile et cessera ses services. Les hommes du peuple qui insultaient le roi sur la place du Carrousel lui témoignaient à coup sûr moins de mépris que ce grand seigneur qui lui demandait avec menaces et presque avec chantage un blanc-seing ministériel.
Au demeurant le roi était pris entre des plans de réaction forcenée et des plans de réaction plus modérée.
Le roi de Suède, fanfaron d’absolutisme et fier-à-bras de la royauté, trace à Louis XVI un programme délirant de contre-révolution. La lettre du baron de Taube au comte de Fersen, datée de Stockolm, 6 mai 1791 est un monument de folie furieuse. « Mon cher ami, le roi (de Suède) m’a ordonné de vous dire qu’il vous charge d’assurer le roi et la reine de France qu’il emploiera tous les moyens possibles pour tâcher de les secourir. Son avis — en attendant qu’il puisse faire une réponse aux demandes que lui portera le courrier de Stedingk — est, si leurs Majestés peuvent se sauver de Paris, de faire tout de suite convoquer tous les Parlements et déclarer l’Assemblée nationale illégale, usurpatrice des droits du trône et de la royauté, de déclarer les individus rebelles et traîtres à la patrie ; d’ordonner dans tout le royaume de courir sus ; de rappeler toutes les grandes charges et les chefs de l’armée, qui ont été obligés de se sauver hors de la patrie, ainsi que tous les évêques ; de rétablir tout comme c’était avant la Révolution, et de remettre le clergé dans leur ancien régime et culte ; rétablir les trois ordres de l’État qui ont été confondus, par une usurpation de l’Assemblée nationale, mais déclarer en même temps qu’il n’y aura pas de distinction ni de différence entre les trois ordres pour le payement des impôts ; — de faire arrêter le duc d’Orléans, le faire juger et condamner par un des Parlements et ne point lui faire grâce ; — de faire rentrer surtout l’armée dans la discipline et la subordination la plus absolue et point ménager les exemples les plus rigoureux pour les y contraindre ; — enfin ne point faire de compositions avec qui ce soit, ne faire aucun gouvernement mixte, mais remettre la royauté dans toute sa puissance ; s’éloigner à jamais de paris et faire périr ce repaire d’assassins par un oubli total de son existence ; car tant qu’il y aura un paris en france, il n’y aura jamais de rois. »
Quel fou furieux ! et que sont les massacres de septembre si terribles pourtant et si monstrueusement inutiles, que sont ces violences soudaines du peuple excité par la fureur patriotique et par la peur affolante de l’étranger, à côté de ce rêve d’extermination ? Il faudra organiser dans tout le pays, de sang-froid et au son du cor royal une battue contre les membres de l’Assemblée nationale. Et en même temps, par une merveilleuse ironie de l’histoire, la même lettre nous apprend que ce déséquilibré, forcené d’absolutisme, était mené par ses conseillers comme un enfant. Ils redoutaient ses indiscrétions et ne lui communiquaient que ce qui pouvait être connu de tous. Et ils le trompaient, le dupaient à plaisir.
Taube ayant exposé au nom du roi, ce programme d’absolutisme insensé et sanglant ajoute : « Je n’ai point entrepris d’empêcher le voyage du Roi : ç’aurait été en vain… J’ai pris une autre voie pour exciter encore davantage sa haine contre l’Assemblée nationale, qu’il déteste déjà du fond de son cœur.
« Je lui ai dit que vous m’avez prié de le prévenir, qu’il serait entouré des espions de l’Assemblée nationale qui expliqueront le moindre mot qui lui échapperait ; qu’il doit même se défier des personnes qu’il croit le mieux intentionnées et qui, par leurs indiscrétions causeraient autant de mal que les plus enragés au roi de France. Le roi m’a chargé de vous remercier de cet avis et qu’il ne se confiera à personne et que ses discours en général seront plus républicains que monarchistes, ce dont il vous prie de prévenir leurs Majestés. »
Ce détraqué qui veut qu’on coure sus à tous les députés révolutionnaires et que Paris soit supprimé, ne trouve d’autre moyen de dérouter les prétendus espions imaginés par ses conseillers que de tenir « des discours républicains ».
Et Louis XVI était lié de confiance et amitié avec l’homme qui lui donnait contre la France ces conseils de folie et de meurtre. Qui sait s’il aurait pu contenir les fureurs déchaînées des émigrés et des princes ainsi aiguillonnés encore par des rois ? Mais lui-même était très préoccupé du problème qui avait suscité la Révolution, le problème financier. Comment la monarchie raffermie aurait-elle de l’argent ? La Révolution, en attendant le fonctionnement normal de ses budgets, s’alimentait par la vente des biens nationaux : mais la conscience religieuse et rétrograde du Roi lui ordonnait de restituer à l’Église son domaine. Ainsi une ressource immense échappait. Mais, en outre, qu’allaient devenir les porteurs d’assignats ainsi privés de leurs gages ? N’allaient-ils pas être exaspérés par leur ruine contre le pouvoir royal à peine restauré ? Ah ! comme la Révolution avait vu juste en saisissant les biens de l’Église et en les mettant tout de suite en circulation par les assignats ! Elle avait créé d’emblée de l’irréparable, de l’irrévocable et le roi s’ingéniait en vain à chercher une solution.
Il s’arrêta d’abord à l’idée très simple de faire banqueroute, puis, pour rassurer les porteurs d’assignats, l’Église les rembourserait jusqu’à concurrence d’un milliard, sur les biens qui lui auraient été restitués. À ce propos, le comte de Fersen consulte le baron de Breteuil, le 16 mai.
« Comme il sera intéressant de ne prendre aucune résolution précipitée, sur laquelle il fallût peut-être revenir, et qu’il peut cependant se présenter des circonstances où il faille se décider avant votre arrivée, le roi voudrait que vous missiez par écrit des idées générales et des aperçus qui pourraient servir de bases, et qui guideraient pour conserver une marche constante et uniforme. — Nous avons quatre millions pour les premiers besoins. Il serait, je crois, intéressant de prendre sur-le-champ, un parti sur la banqueroute à faire ou non et sur les assignats. Les biens du clergé, en les rendant, pourraient en répondre. Cela ferait des ennemis de moins et intéresserait tous ceux qui en sont porteurs et tous les banquiers au succès de l’entreprise du roi ; qu’en pensez-vous ? »
Évidemment Fersen traduit ici la pensée de Louis XVI et ses perplexités. Mais voici une lettre plus explicite. Dans les papiers de Fersen publiés par son petit-neveu cette lettre porte, évidemment par erreur, la mention : Du baron de Breteuil au comte de Fersen. Elle est au contraire du comte de Fersen au baron de Breteuil et de la main même du comte. — Paris, le 23 mai 1791. « Le roi veut partir dans les premiers jours de juin : car il doit recevoir à cette époque deux millions de la liste civile qu’on emporterait aussi. Le roi est embarrassé sur la personne à emmener avec lui ; il avait pensé à M. de Saint-Priest, mais il craint qu’ayant été déjà dans le ministère, il ne soit contracté avec lui une sorte d’engagement, et il lui faut cependant en voiture quelqu’un qui puisse parler si cela était nécessaire.
« Quant aux assignats, le roi pense qu’il faudra rendre au clergé leurs biens, en remboursant ceux qui en ont acheté, et à condition qu’il remboursera les assignats qui seront alors en circulation en argent, sur la valeur qu’ils auront au moment de son départ. Ils seront probablement alors à vingt pour cent de perte, ce qui réduirait la valeur de la totalité des assignats à neuf cent millions ; on pourrait demander au clergé un milliard. Quant à la banqueroute, le roi pense qu’il ne faudrait la faire que partielle, on assurerait toutes les rentes viagères, afin de faire moins de mécontents ; c’est aussi l’avis de plusieurs personnes avec qui j’en ai causé. »
Quel chaos d’idées à la fois impraticables et funestes ! Au fond, c’était la banqueroute totale, c’est-à-dire l’arrêt de toute vie économique, de toute croissance de la France : car comment les détenteurs des rentes viagères auraient-ils gardé confiance en voyant supprimer ainsi toutes les autres créances sur l’État ? Et comment d’ailleurs les paierait-on ? Comment rembourserait-on les acheteurs des biens nationaux ? Et pour les porteurs des assignats, comment le roi pourrait-il se flatter que le clergé consentirait à abandonner un milliard sur les biens qu’il aurait ressaisis ? De plus le clergé n’avait pas un milliard en argent : il n’aurait pu le réaliser qu’en vendant pour un milliard de terres ; et qui donc se risquerait à acheter, en plein triomphe de la contre-révolution, des biens du clergé, au moment même où les ventes antérieures seraient cassées ? Vraiment il serait trop facile au clergé de simuler un bon vouloir impuissant, de décourager successivement les acheteurs et de garder toutes ses terres en alléguant qu’il n’a pu les vendre.
Ainsi c’était bien la ruine complète pour tous les créanciers de l’État, dont on se débarrassait par la banqueroute, pour les acheteurs de biens nationaux qu’on dépouillait de leurs biens sans les rembourser, enfin pour les porteurs d’assignats qui, perdant leur gage n’avaient plus en main qu’un papier mort, une feuille sèche tombée de l’arbre de la Révolution, frappé de la foudre.
C’était la ruine de la bourgeoisie active et révolutionnaire, la ruine aussi des paysans, acheteurs des biens d’Église et sur lesquels d’ailleurs la dîme, partie du domaine de l’Église, allait être rétablie. Et c’était pour accomplir, au profit de l’Église et du roi, ce meurtre de la France, que Louis XVI appelait l’or et les armes de l’étranger ! C’est un crime inexpiable même si l’on fait la part très large aux préjugés royaux, même si on juge le roi avec les idées que, comme roi, il pouvait avoir alors.
Il savait bien, par l’exemple de l’Angleterre, qu’une monarchie absolue peut se transformer en monarchie constitutionnelle ou parlementaire sans que la nation périsse ou soit affaiblie. Il savait bien, par sa propre expérience, que la banqueroute était mortelle puisque c’est pour l’écarter qu’il avait couru toutes les chances de la convocation des États-Généraux. Quand il faisait appel aux sabreurs Croates pour imposer à la France un régime d’absolutisme et de banqueroute, il sacrifiait à son monstrueux égoïsme, à sa vanité doucereuse et exaspérée, ce qu’il savait lui-même être le bien de la patrie.
Et ce sont les descendants, plus ou moins directs, de cette trahison royale qui osent aujourd’hui se donner comme les seuls gardiens de l’esprit « national ! » A quel abêtissement serait descendu notre peuple s’il pouvait prendre au sérieux tout ce nationalisme de félonie et de mensonge !
Mais ce n’est point tout cela qui tourmentait à ce moment le baron de Breteuil. Dans la lettre si grave sur la banqueroute et les assignats, un seul mot lui avait fait dresser l’oreille : le nom de M. de Saint-Priest. N’est-ce pas lui qui allait devenir, dans les résolutions de la première heure qui entraîneraient tout, le conseil, le ministre dirigeant ?
« Je ne puis avoir d’avis sur le projet du roi, relativement à M. de Saint-Priest, parce que je ne conçois pas bien ce que se propose Sa Majesté. Il est incontestable, comme vous le remarquez fort bien, que le roi contracterait un bien grand engagement avec lui, en l’emmenant, si c’était pour avoir un conseil à portée pour les premières démarches. » Quant à la banqueroute, il se réserve : « toute détermination relative à cet objet serait anticipée. »
Pendant que se préparait ce grand crime contre la Révolution et la patrie, pendant que la royauté « nationale » machinait avec l’étranger, peu empressé d’ailleurs et rechignant, l’invasion, la banqueroute, l’anéantissement de la France, l’Assemblée nationale s’obstinait à espérer qu’elle concilierait la Révolution avec la royauté. Elle s’appliquait à amortir toutes les causes de trouble. Bien que dans tout le Comtat Venaissin des luttes sanglantes eussent éclaté entre les conservateurs et les patriotes, qui demandaient à être annexés à la France révolutionnaire, la Constituante, pour ménager le pape et aussi pour ne pas inquiéter l’Europe par une première incorporation de territoire, hésitait. Elle ne se décidera qu’à la fin même de la législature, en septembre. Elle essayait d’apaiser le conflit religieux entre les prêtres insermentés et les prêtres assermentés. Elle faisait effort pour permettre aux prêtres non jureurs de continuer à dire leur messe, mais comme simples prêtres, non comme fonctionnaires publics : et comme jureurs et non jureurs se disputaient en plus d’une région les registres des naissances et des décès, elle trancha heureusement le différend en remettant à la nation, aux autorités civiles le soin de tenir les actes de l’état « civil ». Et surtout dans les lois par lesquelles elle restreignait le droit de pétition et l’initiative populaire, elle tâchait de fortifier de nouveau le pouvoir exécutif royal et de rattacher le roi à la Révolution.
Dans le travail de revision auquel elle se livra dans le dernier semestre de 1791, elle manifesta des velléités très conservatrices. Chapelier essaya même de faire rétablir le système des deux Chambres par une division de l’Assemblée unique en deux sections. Cela n’aboutit point : mais la liberté de la presse et le droit de pétition furent réglementés. On aurait dit que la bourgeoisie révolutionnaire s’efforçait par tous les moyens de rendre son œuvre acceptable au roi.
Après un immense effort de rénovation elle éprouvait le besoin passionné de maintenir, de consolider son œuvre. Or, dans son œuvre, le Roi, quoique soumis à la volonté souveraine de la nation, était une pièce essentielle. Comment le remplacer s’il se dérobait ? quel est le Comité de bourgeois qui aurait le prestige nécessaire pour remplacer le séculaire pouvoir royal, pour imposer la Constitution au clergé soulevé, à une partie de la nation méfiante ou réfractaire ? Et si la Révolution était séparée du Roi, comment pourrait-elle lutter contre tous ses ennemis ligués sous le drapeau royal sans recourir à la force brutale ? Or cette force brutale, cette force physique, selon le mot déjà cité de Mirabeau, elle était dans le peuple immense des campagnes et des villes.
Quel salaire demanderait-il à la bourgeoisie si elle l’appelait à l’aide pour sauver la Révolution ? N’allait-il point demander le droit de suffrage pour tous ? Déjà, des voix graves comme celle de Robespierre, des voix passionnées et menaçantes comme celles du Club des Cordeliers réclamaient cette égalité. Comment résister à ce vœu grandissant du peuple quand on le convierait à sauver contre le Roi la Révolution menacée ? De plus, dans ce vaste combat, les groupements spontanés de la force populaire, les clubs, les assemblées de section deviendraient comme un immense pouvoir à la fois législatif et exécutif qui dessaisirait la bourgeoisie dirigeante de sa primauté politique ; et qui sait si, rassemblés pour la défense de la Révolution, les ouvriers, les prolétaires, ne profiteraient point de ce droit de réunion reconquis pour imposer de hauts salaires aux entrepreneurs, pour dominer le patronat, « les ci-devants maîtres », qu’on pourrait toujours accuser de tiédeur envers la Révolution menacée et menaçante ? Garder le roi avec soi, le conquérir peu à peu, désarmer ses défiances, guérir les blessures de sa vanité, c’était faire l’économie de toutes les agitations populaires.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
C’était presque faire l’économie d’une Révolution nouvelle. Il fallait à la bourgeoisie révolutionnaire un point d’appui : comme il lui était plus commode de le trouver dans le pouvoir royal, connu, circonscrit, subordonné et stable, qu’en cette immense force mouvante et nouvelle du peuple inquiet et illimité ! Ainsi songeait la Constituante et Duport ne craignait pas de dire à la tribune de l’Assemblée : « La Révolution est faite ». Oui, elle était faite, et les principes essentiels d’un ordre nouveau étaient en effet réalisés, si le pouvoir royal acceptait de bonne foi l’œuvre accomplie : la Révolution se serait développée ensuite sous l’influence des intérêts variés, des forces diverses qu’elle portait en elle : tantôt dans le sens de l’oligarchie bourgeoise, tantôt dans le sens de la démocratie, jusqu’au jour où la croissance économique et politique de la classe ouvrière romprait l’équilibre et susciterait des formes nouvelles de la propriété, de la société et du droit. Ah ! que le roi accepte donc ! Qu’il soit constitutionnel sincèrement ! Voilà le vœu passionné de la Constituante et de toute la bourgeoisie. Peut-être la Constituante, quand elle décida, à la demande de Robespierre, de déclarer ses membres non rééligibles à la prochaine législature et de disparaître toute entière, céda-t-elle un peu au désir de donner au Roi lui-même un exemple de désintéressement.
Nous avons touché à tout, semblaient dire les députés au Roi, à tout et à votre pouvoir même : mais ce n’est pas dans une pensée égoïste : nous nous en allons, nous laissons à d’autres le soin de maintenir notre œuvre. Vous, vous demeurez, avec des pouvoirs d’autant plus grands que vous aurez confiance en la Révolution et en vous-mêmes. Cessez donc de vous replier sur vous-même, soyez le roi d’un ordre nouveau. Sans doute aussi, une lassitude si bien exprimée par Robespierre : « Nous sommes des athlètes victorieux mais fatigués », et le pressentiment triste de nouveaux labeurs et de nouveaux périls aidèrent-ils la Constituante à prendre cette décision extraordinaire. Enfin, la droite et l’extrême-gauche n’étaient point fâchées, dans des sentiments et des intérêts tout opposés, d’éliminer le personnel révolutionnaire connu et de donner ainsi l’essor à des chances nouvelles. Mais il y avait aussi ce besoin d’apaisement, de détente, que j’ai dit tout à l’heure, et Cazalès emporté un peu malgré lui par la grandeur de l’œuvre révolutionnaire, traduisit ce sentiment avec éloquence aux applaudissements de l’Assemblée.
Celle-ci avait soulevé des haines, froissé des amours-propres, inquiété ou blessé bien des intérêts particuliers contraires à la notion qu’elle s’était faite de l’intérêt général ; qui sait si, en s’effaçant, elle n’emporterait pas toutes ces haines et n’en délivrerait pas la Révolution elle-même ? Dans ce sacrifice de l’ouvrier puissant, lassé et poudreux, qui se retire pour ne pas laisser l’empreinte de ses mains et, pour ainsi dire la poussière même de son travail sur son œuvre, il y a une réelle grandeur ; que cet esprit de désintéressement soit contagieux et que le Roi se retire sans regret de son absolutisme de jadis, puisque la grande Assemblée révolutionnaire se retire elle-même de son pouvoir légal.
Or, tout à coup, sur l’Assemblée ainsi obstinée à réconcilier la Révolution et le roi éclate la foudroyante nouvelle : « Le roi est parti, et sa fuite est sans doute le signal de la lutte ouverte, violente, de la puissance royale contre la Révolution ».
Le roi, en effet, avait quitté les Tuileries dans la nuit du 20 juin, pour se rendre avec sa famille à Montmédy, près de la frontière, où Bouillé devait le rejoindre. C’est à onze heures du soir que la famille royale avait fui. Fersen lui avait procuré un passeport au nom de la baronne de Korff. C’est Mme de Tourzel, gouvernante des enfants, qui figurait la baronne. La reine, voyageant comme gouvernante, devait être Mme Rocher, Mme Élisabeth devenait Rosalie, demoiselle de compagnie et le roi était un valet de chambre du nom de Durand, avec habit gris et perruque. Ils purent sortir sans être reconnus.
Ils montèrent dans une première voiture que Fersen, habillé en cocher, conduisit jusqu’à Bondy. Là, ils prirent une vaste berline, que conduisaient trois jeunes gardes du corps, portant le costume jaune des courriers ; ils devaient gagner Montmédy par Châlons-sur-Marne et Sainte-Ménéhould. Fersen après les avoir quittés, alla tout droit vers la Belgique et de Mons, le 22 juin, à 11 heures du matin, il écrivit au baron de Taube : « Mon cher ami, le roi, la reine, Mme Élisabeth, le Dauphin et Madame (la jeune sœur du Dauphin), sont sortis de Paris à minuit ; je les ai accompagnés jusqu’à Bondy, sans accident. Je pars dans ce moment pour aller les joindre. » Un peu plus tôt, à 8 heures du matin, il avait écrit à son père : « J’arrive ici dans l’instant, mon cher père. Le roi et toute la famille sont sortis de Paris heureusement le 20, à minuit. Je les ai conduits jusqu’à la première poste. Dieu veuille que le reste de leur voyage soit aussi heureux. J’attends ici Monsieur à tout moment. Je continuerai ensuite ma route le long de la frontière, pour joindre le roi à Montmédy, s’il est assez heureux pour y arriver. »
Comment cette fuite du roi et de toute sa famille fut-elle possible ? Ils sortirent par un escalier de service, donnant sur la cour des princes et, confondus avec les nombreuses personnes qui, à cette heure, sortaient du château, ils ne furent point reconnus. Mais comment la surveillance ne fut-elle pas plus exacte ? Les avertissements pourtant, depuis des semaines et des mois, ne faisaient pas défaut. J’ai déjà noté les avis singulièrement précis de Marat à la fin de mars et au commencement d’avril : il n’avait pas cessé depuis. À vrai dire, j’ai beau chercher dans la collection de l’Ami du Peuple, l’article « foudroyant » dont parle Louis Blanc. Je ne parviens pas à le découvrir. En tout cas, il ne pourrait être des dernières semaines, puisque, d’après Louis Blanc, il renferme ces mots : « Parisiens, insensés Parisiens, je suis las de vous le répéter : ramenez le roi et le dauphin dans vos murs. » Or, en mai et juin ils étaient à Paris, et je me demande si ce que Louis Blanc appelle un article de Marat, sans d’ailleurs en donner la date, n’est pas simplement un résumé plus ou moins exact de plusieurs articles différents, et notamment d’un article du 20 avril : « Parisiens, vous seriez les bourreaux de trois millions de vos frères, si vous aviez la folie de lui permettre de s’éloigner de vos murs. »
Mais, ce qu’il est intéressant de noter avec plus de précision que ne l’a fait le grand historien, ce sont les avertissements singuliers, mêlés de calomnies insensées et de vérités saisissantes, que Marat ne cessa de donner en juin. Et d’abord, le lundi 6 juin, voici une communication étrange : « A l’Ami du peuple. Comment se fait-il, cher Marat, que du fond de votre souterrain, vous voyiez cent fois plus clair à toutes les menées des contre-révolutionnaires que nos patriotes qui suivent de si près toutes leurs démarches ? Vous ne cessez de leur répéter que tout est prêt pour la contre-révolution, qu’il n’y a plus qu’à mettre le feu à la bombe, que la guerre civile est allumée dans tout le royaume si la famille royale vient à fuir, et que nous sommes perdus à jamais si nous ne la surveillons jour et nuit. Apprenez donc que notre bonne étoile vient encore une fois de sauver la patrie et que les monstres acharnés à notre perte l’eussent enfin consommée dans la nuit du samedi dernier si le roi n’avait un excellent physique. Sa femme, toujours à l’obséder comme une furie, travaillait depuis huit jours à le décider à la fuite ; elle le conjurait au nom de sa gloire, de l’amour de son fils, de l’intérêt de ses fidèles sujets ; elle lui répondait de tous les événements, et toujours Louis opposait à Antoinette la crainte de perdre la couronne. Irritée de ne pouvoir rien gagner sur lui, elle use de supercherie, elle le provoque à souper le verre en main, dans l’espoir que l’excellent baume fera plus que son éloquence et déjà elle commençait à se livrer à la joie.
« Une nuit orageuse semblait favoriser l’affreuse trame en la couvrant d’un sombre voile. Dès le matin, les principaux conspirateurs avaient le mot, et dans la soirée Motté, leur digne chef, avait fait courir l’ordre aux meneurs de ses coupe jarrets de rassembler leurs bandes infernales. Conjurés et brigands se rendent à minuit, et par petits pelotons aux Champs-Élysées. Ils y sont joints par les satellites en épaulettes et les mouchards à gages de tous les bataillons.
« Réunis en armes et en uniformes au nombre de sept mille, ils attendaient le signal convenu pour enlever la famille royale. Les chefs des conspirateurs étaient rassemblés au château des Tuileries, et les voitures étaient prêtes : il semblait qu’il n’y eut plus qu’à monter dedans et à fouetter les chevaux. Mottié, Virieu, Despremenil, d’André, La Galissonnière, Gouvion, Lagasse, Lacolombe et cent autres qui étaient auprès d’Antoinette n’attendaient plus que l’instant d’emballer le roi pour Bruxelles.
« Les mouvements et les secousses qu’on lui donne en le voulant transporter de son fauteuil dans sa voiture le réveillent ; on le croyait dans les nuages : ils s’étaient heureusement dissipés pendant son somme ; étonné de voir tout ce monde autour de lui dans un temps qu’il se croyait seul, il demande ce qu’on veut faire de lui : on se regarde, on hésite, enfin sa femme lui dévoile le mystère.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
« Les larmes et les supplications sont employées à la fois par tous les complices ; le roi lui-même fond en pleurs et leur demande à chaque instant s’ils ont bien prévu tous les événements, et si les choses ne tournent pas à leur gré, s’ils lui rendront la couronne quand il l’aura perdue !
« La reine fait un dernier effort qui devient infructueux, elle lui amène le dauphin ; l’enfant voyant son père en pleurs, croit que les scélérats qui l’entourent veulent lui faire du mal, il se met à crier. Les cris de l’enfant écartent quelques moments la foule criminelle. Le roi en profite pour se renfermer avec son fils dans son cabinet. La partie était rompue.
« Mottié envoya un aide de camp porter l’ordre aux conjurés sous les armes aux Champs-Élysées de se retirer par petits pelotons comme ils étaient venus, jusqu’à nouvel ordre : et il passa le reste de la nuit avec la reine et les principaux conspirateurs à déplorer ce funeste contre-temps, la faiblesse du monarque et à forger de nouveaux complots. Signé : « Un patriote qui s’est fait aristocrate pour sauver le peuple. »
Évidemment dans ce récit bizarre il y a une part de roman absurde : la complicité de La Fayette avec Marie-Antoinette, le rassemblement nocturne de la garde nationale pour favoriser l’enlèvement du roi, la tentative de la reine d’enivrer Louis XVI pour l’emballer sur Bruxelles, ce sont là des inventions enfantines et presque délirantes. Et pourtant, je suis convaincu qu’il y a dans ce récit un fond de vérité.
De très nombreuses personnes entraient au château des Tuileries : des fournisseurs, des marchandes de modes, des lingères, des blanchisseuses. Il en est qui y revenaient souvent : et une invincible curiosité les possédait de savoir ce que faisait, ce que disait la famille royale. Si le roi et la reine ne se surveillaient pas, si, dans le feu de l’émotion et de la dispute, ils se laissaient aller à parler haut, des propos pouvaient être entendus : et les imaginations excitées, avec quelques fragments, reconstituaient toute une scène. « Le patriote qui s’est fait aristocrate pour sauver le peuple » était ou un de ces fournisseurs du château, ou l’ami, l’amant d’une des femmes qui y fréquentaient ; et il transmettait à Marat ces échos de la vie royale que l’oreille du peuple percevait à travers les murs. Nous-mêmes, d’après toute cette lettre, nous pouvons très bien démêler ce qui s’est passé le samedi soir 28 mai, dans l’intimité de l’appartement du roi.
C’est toujours le départ projeté qui fait le fond des conversations. Le roi est repris d’hésitation : il se demande s’il ne va pas en cette aventure jouer sa couronne et la vie des siens. Sans renoncer à son projet, il exprime ses craintes, essaie de se rassurer en obligeant la reine à répéter ses affirmations confiantes. Celle-ci, de nouveau, l’adjure de ne pas faiblir ; puis, lassée de cet effort toujours renouvelé pour affermir une volonté incertaine elle dit avec quelque impatience : c’est l’heure de souper maintenant ; — et pour la femme, blanchisseuse ou lingère, qui écoute d’un peu loin, attardée dans une dépendance de l’appartement ou dans un couloir obscur, et attendant la sortie de onze heures, ce simple propos devient une manœuvre. La reine n’a pu convaincre le roi : elle va le faire boire.
Après le dîner, la conversation reprend et s’anime ; et dans l’émotion de cette lutte, devant les effroyables périls qui les menacent de tous côtés, la reine et le roi se prennent à pleurer. En. ce moment, on apporte le Dauphin, soit pour qu’il embrasse son père et sa mère avant de se coucher, soit parce que la reine, en une objurgation suprême veut invoquer le droit de son jeune fils à la couronne, à la royauté entière et superbe, et animer ainsi à la bataille contre la Révolution l’âme flottante et faible du roi.
L’enfant surpris et effrayé de toute cette agitation et de ces larmes jette des cris : le roi, d’un pas pesant que perçoit l’invisible écouteuse, l’emmène pour le consoler et la femme repart, en se disant : Ils n’ont pu cette fois en avoir raison.
Mais l’idée de la fuite organisée la hante, l’idée aussi de la violence méditée contre le roi, et quand, descendue à onze heures, avec la foule des gens de service, par l’escalier même que prendront bientôt le roi et la reine, elle croise dans la nuit obscure et couverte les patrouilles de la garde nationale qui vont et viennent autour des Tuileries et dans les Champs-Élysées, elle s’imagine que ces gardes nationaux sont des complices, qu’ils sont là pour l’enlèvement projeté ; à peine rentrée, elle le conte à son amant, qui va, lui, le raconter à Marat le lendemain.
C’est d’une absolue vraisemblance et l’étrange serait que dans cette longue préparation de fuite, les pauvres gens du peuple qui venaient au château n’eussent saisi aucune indiscrétion ou aucun éclat de voix, aucun sanglot. La force de Marat, sa puissance prophétique, c’était de ne point rejeter ces communications populaires, malgré l’enveloppe de fables qui couvrait souvent la vérité. Mais ce qu’il y a de particulièrement curieux, c’est qu’il est possible, par les billets de Fersen, de comprendre ce qui le 28 mai 1791 a passionné la famille royale et exalté la conversation jusqu’aux larmes. Le 26 mai, le comte de Fersen écrit au marquis de Bouillé : « Le roi approuve la route, et elle sera fixée, telle que vous l’avez envoyée ; on s’occupe des gardes du corps. Je vous envoie, par la diligence de demain ou mardi, dans du taffetas blanc et à l’adresse de M. de Contades un million en assignats ; nous en avons quatre, dont un hors du royaume. Le roi veut partir dans les huit premiers jours de juin, car, à cette époque il doit recevoir deux millions de la liste civile » et le 29 mai 1791, c’est-à-dire le lendemain de la soirée où l’écouteuse du peuple avait entendu un orage de querelles et de pleurs, Fersen écrit à Bouillé : « Le départ est fixé au 12 du mois prochain. Tout était prêt, et on serait parti le 6 ou le 7, mais on ne doit recevoir les deux millions que le 7 ou le 8 et il y a d’ailleurs auprès du Dauphin une femme de chambre très démocrate, qui ne quitte que le 11. On prendra la dernière route indiquée. Je n’accompagnerai pas le roi, il n’a pas voulu ».
A ce changement de date, l’inquiétude et l’agitation de Louis XVI durent être très grandes. Quoi ! il suffit du retard d’un jour dans le paiement de la liste civile, il suffit même d’une femme de chambre aux intentions suspectes pour que tous les plans doivent être remaniés. Mais nous sommes à la merci de tous les incidents, de tous les hasards ! Êtes-vous bien sûrs, au moins, que nous ne nous engageons pas dans une voie funeste ?
Et lorsque ces incertitudes furent de nouveau dissipées, le débat sur Fersen ajouta à l’énervement. L’offre chevaleresque du mélancolique officier aimé de la reine et qui jouait sa tête dans l’aventure, le refus du roi qui ne voulait pas l’exposer, l’idée de la séparation pendant le voyage même, c’est-à-dire à l’heure même du péril, ce trouble profond qui descend au cœur de l’homme quand en fixant les détails d’une entreprise émouvante, il donne à sa résolution même quelque chose d’irrévocable, tout contribua en cette soirée du 28 mai, à bouleverser les nerfs, à élever le ton des paroles, à les couper d’irrépressibles sanglots. Et c’est tout cela que le peuple, en la personne de quelque femme inconnue, entendit et interpréta.
La note secrète et chiffrée de l’officier suédois concorde merveilleusement avec l’essentiel du récit fait à Marat. Puissance inouïe des grandes révolutions qui font battre tant de cœurs, ouvrent et passionnent tant d’oreilles et d’yeux, qu’il n’y a point de secret pour elles, et qu’elles semblent douées d’une pénétration surhumaine !
Mais ce qu’il y a de curieux encore et d’assez important dans ce récit, c’est qu’en répandant l’idée de l’enlèvement violent du roi, il prépare à sa manière l’espèce de mensonge public par lequel les modérés de la Révolution, après Varennes, s’empressèrent à sauver le roi.
Il est curieux de voir Marat accoutumer le peuple, sans y penser, à ce qui sera demain la fiction de la bourgeoisie constitutionnelle et de Lafayette lui-même.
Un moment et sous l’impression de ce récit, qu’il accepte tout entier, il se figura décidément que le roi ne voulait pas partir et qu’on le prenait de force : « Oui, s’écrie-t-il, c’est le ciel qui combat pour nous, c’est lui qui répare sans cesse les fautes de notre imprévoyance, de notre incurie, de notre lâcheté ; c’est lui qui nous relève toujours par quelque coup imprévu de l’abîme creusé sous nos pas par nos ennemis implacables. Après tant de miracles, qu’il a fait en notre faveur, il vient encore de nous sauver par la main d’un enfant (le Dauphin). Je ne ferai aucune réflexion sur l’atrocité des trames de la Cour. Qui n’en serait saisi d’horreur !Mais je ne puis m’empêcher d’observer que le monarque, quoi qu’on en dise, est plus clairvoyant et plus judicieux que ces hommes lâches et perfides dont il a formé son conseil. C’est avec raison qu’il redoute que les mesures insensées qu’ils prennent pour rétablir sa couronne et leur dignité, ne renversent sa couronne. Puisse-t-il avoir toujours devant les yeux cette crainte salutaire, seule capable de le maintenir sur le trône, s’il n’a pas le bon esprit de sentir que ce n’est qu’en renonçant à tout projet de contre-révolution et en s’attachant à être juste, qu’il peut s’y affermir. »
Marat avait souvent accusé le roi lui-même. Il l’avait désigné comme le chef du complot : il avait même depuis peu précisé qu’il comptait sur Bouillé pour son projet de fuite. Quand le roi protestait de son amour pour la Constitution, Marat rappelait tous ses attentats contre elle, et il disait : Le cœur d’un roi se retourne-t-il comme un gant ? Pour qu’il renonçât donc à l’accuser, et pour qu’il consentît à ne voir en lui qu’un homme faible, auquel les meneurs essayaient de faire violence, il faut qu’il ait pris tout à fait au sérieux le récit qui lui était fait. N’y avait-il pas là de quoi émouvoir un peu l’attention de Lafayette et de Bailly ?

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
« Citoyens, concluait Marat le 6 juin, jamais nous ne fûmes menacés par des dangers plus alarmants ; redoublez de zèle pour veiller sur le château des Tuileries et empêcher que la famille royale ne prenne la fuite. »
Enfin, par une coïncidence vraiment dramatique et qui dut donner à ce numéro du journal de Marat une puissance extraordinaire sur le peuple, voici ce que disait Marat dans le numéro du 21 juin, c’est-à-dire le matin même où Paris apprenait que les Tuileries étaient vides et que le roi était parti pendant la nuit. — « La fusée prête à se démêler.
« En attendant, l’Ami du peuple, dont le devoir est de réveiller éternellement le peuple de sa fatale léthargie et de lui mettre le feu sous le ventre pour l’empêcher de périr, ne cessera de crier que jamais les dangers n’ont été plus iminents, et que nous touchons au moment d’une explosion terrible. Tout est prêt. L’empereur est à Bruxelles le 26, où doivent se trouver le roi de Suède, plusieurs princes des cercles de l’Empire, et les deux Capet, chefs des conspirateurs fugitifs. On parle aussi de la présence de Louis XVI dans le conciliabule de ces brigands couronnés. La famille royale n’attend pour prendre la fuite, que de voir le peuple endormi. Amis de la patrie, souvenez-vous que vous êtes voués au carnage, comme des moutons à la boucherie ; souvenez-vous qu’ayant affaire à des ennemis implacables, le comble de la démence serait de ne pas les prévenir. Si le roi vous échappe, dès l’instant de sa fuite, main basse immédiatement sur tous les suppôts connus du despotisme, à commencer par les traîtres de l’Assemblée nationale, de l’état-major, de la municipalité, du département, du club monarchique, des sections, jusqu’aux mouchards de l’ancienne police, ils sont tous connus, que la race en soit anéantie à jamais. Le seul principe qui doit alors régler votre conduite, c’est qu’il n’y a rien de sacré sous le soleil que le salut du peuple. »
« Et pour que les membres pourris de la nation soient à la fois retranchés des parties saines, qu’à la nouvelle de la fugue royale, chaque ville ferme ses portes et donne la mort à tous les conjurés antirévolutionnaires. »
Mais ce n’étaient pas seulement les avertissements répétés et terribles de Marat qui auraient dû tenir en éveil la municipalité de Paris et la garde nationale. Un aide de camp de Lafayette, Gouvion, raconta à la Constituante, aussitôt après le départ du roi, que des avis pressants avaient été donnés depuis plusieurs jours sur les préparatifs de fuite de la famille royale. Bailly et Lafayette s’étaient bornés à prendre acte de ces avis, et il ne semble pas qu’ils aient ordonné des précautions exceptionnelles. Pourquoi ?
Il est absurde de supposer avec Marat qu’ils étaient dans le complot. Mais d’abord, des rumeurs de fuite leur étaient si souvent parvenues que, sans doute, ils ne s’en inquiétaient plus suffisamment. Et, surtout, ils craignaient, en répandant l’alarme parmi le peuple par leurs précautions mêmes, de provoquer et de justifier les rassemblements révolutionnaires. Ils redoutaient sans doute un renouvellement des scènes d’avril, et ils gardaient pour eux les avis alarmants qui leur étaient transmis. Ainsi s’explique que la famille royale ait pu quitter les Tuileries à onze heures du soir sans être aperçue. À la nouvelle de la fuite du roi, l’Assemblée retrouva les grandes inspirations à la fois révolutionnaires et bourgeoises de ses premiers jours. Elle domina son émotion et délibéra avec un calme solennel et presque grandiose. Sa préoccupation était double. D’abord, elle voulait rassurer le pays, prévenir tout abattement des révolutionnaires. La confiance même qu’elle témoigna alors dans la Révolution se communiqua rapidement à la nation tout entière. L’Assemblée manda immédiatement les ministres ; elle décréta que tous les arrêtés qu’elle prendrait en l’absence du roi auraient force de loi, sans qu’il fût besoin de sanction. Elle s’empara ainsi de l’autorité souveraine, et l’on peut dire qu’elle remplit l’intérim de la royauté. En même temps la Constituante s’employa à calmer toute effervescence populaire et à maintenir, dans la crise, la primauté de la bourgeoisie. Pour cela, il fallait d’abord couvrir Lafayette, contre lequel les soupçons les plus violents s’élevaient dans le peuple. Il était accusé d’être le complice de la fuite du roi ou par trahison ou par négligence. Un moment, sa situation fut terrible. De tous les chantiers de Paris, où les ouvriers étaient rassemblés, des cris s’élevaient, écho du formidable article de Marat.
Lafayette discrédité ou supprimé, c’était la bourgeoisie révolutionnaire modérée perdant son chef militaire : c’était la rue d’abord, et bientôt peut-être la puissance, livrée aux prolétaires exaspérés. Barnave, qui fut en cette grande crise le vrai chef de la bourgeoisie, comprit le péril, et dès la séance du 21 juin, se hâta, contre les insinuations de Rewbell, de défendre Lafayette :
« J’arrête l’opinant sur les doutes qu’il a paru vouloir répandre. L’objet qui doit nous occuper dans le moment actuel, c’est de sauver la chose publique, de réunir toutes nos forces et d’attacher la confiance populaire à ceux qui la méritent véritablement. Je demande que l’Assemblée ne laisse pas continuer le discours de l’opinant, et qu’il ne soit pas permis d’élever des doutes injurieux contre des hommes qui n’ont pas cessé de donner des preuves de patriotisme. Il est des circonstances dans lesquelles il est facile de jeter des soupçons sur les sentiments des meilleurs citoyens. (Le calme se rétablit.) Il est des hommes sur lesquels ces circonstances malheureuses pourraient appeler des défiances que je crois profondément, que je jurerais à la face de la nation entière qu’ils n’ont pas méritées… (Applaudissements.) M. de Lafayette mérite toute notre confiance ; il importe à la nation qu’il la conserve, nous devons la lui marquer hautement. (Applaudissements dans les tribunes.) »
Barnave avait été longtemps, il était encore la veille l’adversaire de Lafayette. Aussi son plaidoyer parut-il aussi généreux qu’il était habile, et les défiances du peuple tombèrent presque aussitôt. Dans son Introduction à la Révolution française, c’est-à-dire dans ses Mémoires, Barnave a écrit, en parlant de la crise d’impopularité qu’il traversa avant le 21 juin : « Heureusement que quelques semaines ne suffirent pas pour détruire entièrement mon influence, et quelques soins qu’eussent pris mes ennemis pour me priver de cette scandaleuse popularité, au 21 juin, il m’en restait encore assez pour sauver Lafayette… » Et c’est bien tout le régime bourgeois qu’il entendait sauver ainsi à la fois contre la Cour et contre le peuple. Il le déclara dès le 21 juin à la tribune même de l’Assemblée avec une netteté audacieuse
« Je rappelle à tous les bons citoyens que ce qui importe surtout dans les circonstances actuelles, c’est qu’au lieu où la puissance publique peut parler, peut agir, elle puisse le faire librement, qu’elle jouisse du plus grand calme ! de la plus ferme union, et que tous ses mouvements, livrés à la seule prudence des représentants de la nation, ne soient pas influencés par des causes qui, quelque populaires qu’elles puissent paraître, ne seraient que le résultat d’influences étrangères. (C’est bien vrai.)
« Messieurs, il faut de la force dans Paris, mais il y faut de la tranquillité. Il faut de la force, mais il faut que cette force soit mue par une seule volonté, et cette volonté doit être la vôtre. Du moment qu’on croirait pouvoir l’influencer, on mettrait dès lors en péril la chose publique dont vous êtes seuls les dépositaires et de laquelle seuls vous pouvez répondre. Le véritable danger du moment est dans ces circonstances extraordinaires où l’effervescence est excitée par des personnes dont le patriotisme serait loin d’être le sentiment, dont le salut public serait loin d’être l’objet.
« Il importe actuellement que tous les hommes véritablement amis de la patrie, que tous ceux qui ont un intérêt commun avec elle, que ceux qui sont devenus les sauveurs de la France et de Paris dans cette journée du 14 juillet qui a fait la Révolution, se réunissent encore et se tiennent prêts à marcher.
« Vous vous rappellerez qu’alors le premier mouvement fut donné par une classe peu réfléchie, facilement entraînée et que des désordres en furent l’effet. Le lendemain, les hommes pensants, les propriétaires, les citoyens véritablement attachés à la patrie s’armèrent, les désordres cessèrent les actes véritablement civiques leur succédèrent et la France fut sauvée. Telle est la marche que nous devons prendre. Je demande donc que l’Assemblée nationale prenne une résolution par laquelle elle ordonne à tous les citoyens de Paris de se tenir armés et prêts, mais de se tenir dans le plus profond silence dans une attente immobile jusqu’au moment où les représentants de la nation auront besoin de les mettre en mouvement pour le maintien de l’ordre public ou pour la défense de la patrie. »
C’était concentrer aux mains de l’Assemblée toute la direction des événements. C’était jeter le soupçon sur ceux qui tenteraient d’animer le peuple jusqu’au renversement de la monarchie. C’était proclamer que la conduite du monde nouveau appartenait à l’élite propriétaire considérée seule comme pensante. Rewbell essaya en vain de répliquer : il fut interrompu dès le premier mot : et il est à noter que ni Petion, ni Robespierre, ni aucun des démocrates de l’extrême gauche ne tentèrent de protester contre les paroles si bourgeoises de Barnave.
On dirait que la Révolution, menacée d’un péril soudain, se repliait sur son centre, la bourgeoisie modérée. Aussi bien l’action hardie et confiante de la Constituante saisissant tout le pouvoir, envoyant partout l’ordre d’arrêter le Roi et ordonnant à tous les fonctionnaires publics de prêter un nouveau serment à la nation et à la loi ralliait autour d’elle tous les esprits. De toute part, les adresses enthousiastes lui arrivaient. Partout les municipalités, les directoires lui disaient que bien loin d’abattre le courage, le péril les électrisait. Et partout aussi, sans que le mot de République fût prononcé, un sentiment républicain se faisait jour.
J’ai déjà cité le mot admirable de la municipalité nantaise : « Le roi est parti ; la nation reste. » Il faut encore, entre bien d’autres adresses, noter celle de la ville de Givet : « Le roi est parti, se dirent les bons citoyens, hé bien ! cet événement n’a rien qui doive nous décourager. L’Assemblée nationale suppléera à tout, et si la royauté était une récompense, ses travaux immortels lui en ont mérité les droits ».
C’est la royauté de l’Assemblée élue, c’est-à-dire de la nation elle-même qui remplace la royauté défaillante et traîtresse des Capet. Les ouvriers des ateliers publics, dont l’Assemblée, comme nous l’avons vu, venait de prononcer la dissolution se présentaient à la barre, non pas pour récriminer, mais pour assurer l’Assemblée de leur dévouement à la Patrie et à la loi : « Un d’entre eux, dit le procès-verbal, prête en leur nom le serment de fidélité à la nation. Il fait de respectueuses représentations sur le décret qui fixe l’époque de la cessation des ateliers de charité, et demande le rapport de ce décret. Il jure que dans tous les cas ils ne seront jamais infidèles à leur serment. » Ainsi l’adhésion était universelle.
Le roi, en partant, avait laissé à Laporte, intendant de la liste civile, un pli cacheté. Ce pli fut remis au ministre de la justice Duport-Dutertre. C’était une déclaration du Roi à tous les Français. Il s’y plaignait longuement des empiétements de l’Assemblée nationale sur l’autorité royale. Il affirmait n’avoir jamais été libre : et il gémissait sur la médiocrité de la liste civile (fixée à 25 millions), sur l’insuffisance des aménagements du palais des Tuileries. Il terminait cette terne et vulgaire déclaration par l’annonce filandreuse d’un changement constitutionnel : « Français, et vous surtout Parisiens, vous habitants d’une ville que les ancêtres de Sa Majesté se plaisaient à appeler la bonne ville de Paris, méfiez-vous des suggestions et des mensonges de vos faux amis ; revenez à votre Roi ; il sera toujours votre père, votre meilleur ami. Quel plaisir n’aura-t-il pas à oublier toutes les injures personnelles et à se revoir au milieu de vous, lorsqu’une Constitution, qu’il aura acceptée librement, fera que notre sainte religion sera respectée, que le gouvernement sera établi sur un pied stable et utile par son action, que les biens et l’état de chacun ne seront plus troublés, que les lois ne seront plus enfreintes impunément et qu’enfin la liberté sera posée sur des bases fermes et inébranlables. »
C’était la contre-révolution. L’Assemblée écouta ce triste papier dans un silence méprisant. Mais du coup se posa ou se précisa pour elle le problème : Quelle attitude allait elle prendre envers ce Roi qui désertait son poste et qui répudiait en bloc la Constitution dont il avait déjà sanctionné les parties principales ? L’Assemblée comprit qu’elle ne pouvait laisser sans réponse devant le pays la protestation royale : et elle rédigea une adresse aux Français. Dans cette adresse, elle s’appliqua à ne pas créer de l’irréparable et à réfuter vigoureusement les allégations de Louis XVI sans se mettre dans l’obligation de prononcer sa déchéance.
Elle commença à exprimer l’hypothèse que Louis XVI pouvait bien avoir été enlevé. C’est Demeunier qui, à la séance du 22 juin, lut le projet d’adresse aux Français : « Un grand attentat vient de se commettre. L’Assemblée nationale touchait au terme de son long travail ; la Constitution était finie ; les orages de la Révolution allaient cesser ; et les ennemis du bien public ont voulu, par un seul forfait, immoler la nation entière à leur vengeance. Le roi et la famille royale ont été enlevés dans la nuit du 20 au 21 de ce mois » (Murmures.)
Rœderer interrompt avec violence : « C’est faux, il a lâchement déserté son poste… !
Demeunier reprend : « Je prie l’Assemblée d’écouter avec attention jusqu’à la fin. Le Comité de Constitution a rédigé son projet d’adresse dans le sens que les circonstances ont paru lui dicter : peut-être après l’avoir entendu en entier la réclamation qui vient d’avoir lieu n’existera plus. » L’adresse en effet, après cette première réserve savamment calculée pour ménager toutes les chances d’avenir était très rigoureuse et très sévère. « La liberté publique sera maintenue ; les conspirateurs et les esclaves apprendront à connaître l’intrépidité des fondateurs de la liberté française : et nous prenons à la face de la nation, l’engagement solennel de venger la loi ou de mourir. » (Applaudissements.)
« La France veut être libre ; et elle sera libre ; on cherche à faire rétrograder la Révolution ; elle ne rétrogradera pas… »
Et Demeunier rappelant tous les serments de fidélité du roi à la Constitution, s’écrie : « Si un jour le roi ne déclarait pas que les factieux l’ont entraîné, on aurait dénoncé son parjure au monde entier… »
« Des adresses de félicitations et de remerciements sont arrivées de toutes les parties du royaume ; on dit que c’est l’ouvrage des factieux ; oui sans doute, de 24 millions de factieux. (Vifs applaudissements)… « On nous reproche de n’avoir pas soumis la Constitution au refus du roi ; mais la royauté n’est établie que pour le peuple, et si les grandes nations sont obligées de la maintenir, c’est parce qu’elle est la sauvegarde de leur bonheur : La Constitution lui laisse sa prérogative et son véritable caractère. Vos représentants seraient criminels s’ils avaient sacrifié 24 millions de citoyens à l’intérêt d’un seul homme »…
« La capitale peut servir de modèle au reste de la France : le départ du Roi n’a pas causé d’agitation ; et, ce qui fait le désespoir de nos ennemis, elle jouit d’une tranquillité parfaite ». (Vifs applaudissements.)
« Il est, envers les grandes nations, des attentats que la générosité seule peut faire oublier. Le peuple français était fier dans la servitude ; il montrera les vertus et l’héroïsme de la liberté. Que les ennemis de la Constitution le sachent : pour asservir de nouveau le territoire de cet Empire, il faudrait anéantir la nation. Le despotisme formera, s’il le veut, une pareille entreprise ; il sera vaincu ou à la suite de son affreux triomphe, il ne trouvera que des ruines. » (Vifs applaudissements.)
Ce sont déjà presque les accents de la Marseillaise : mais en même temps, avec une extrême prudence politique, l’Assemblée se réservait ou de constater que le Roi avait été contraint, ou de faire appel à la générosité de la nation envers ce grand attentat. Elle rappelait la nécessité de la monarchie pour un grand peuple, jusque dans le document qui accusait la royauté contre-révolutionnaire.
Mais, en cette même séance du 22 juin, une demi-heure après la lecture de l’adresse de Demeunier, des cris du dehors annoncent l’arrivée d’un courier : on entend dire confusément, note le procès-verbal : le roi est pris ! le roi est arrêté ! Les députés rentrent avec précipitation dans la salle ; une grande agitation règne dans l’Assemblée ; deux couriers entrent au milieu des applaudissements et remettent un paquet au président. Le roi était pris en effet : c’étaient des lettres des officiers municipaux de Sainte-Menehould annonçant qu’au passage le roi avait été reconnu ; et que Drouet courait à la poursuite des voitures. « Il est 3 heures du matin et ils ne sont pas encore revenus ». Mais des lettres de Châlon et de Clermont annonçaient qu’à Varenne le roi avait été arrêté.
En vain avait-il essayé d’attendrir la municipalité de Varennes. En vain les détachements de dragons, placés à Varennes, par Bouillé, avaient-ils été invités à enlever le roi ; un gros rassemblement de peuple avait obligé les dragons à se retirer ; et le roi fut ramené vers Paris. L’Assemblée ordonna immédiatement que Bouillé serait mis en état d’arrestation. Elle ordonna que le roi fût reconduit sous la protection des gardes nationales et que toutes les précautions fussent prises pour assurer sa vie. Elle dépêcha trois commissaires, Pétion, Latour-Maubourg et Barnave à la rencontre de la famille royale.
En apprenant l’arrestation du roi, les modérés de l’Assemblée se félicitèrent de n’avoir prononcé aucune parole irrévocable. Ils n’avaient plus à craindre un mouvement contre-révolutionnaire organisé et dirigé par le roi, avec l’appui de l’étranger. Ils songèrent dès lors à terminer la crise en douceur sans bouleverser la Constitution, sans abolir la royauté et même sans remplacer le roi.
Au langage si prudent tenu par Barnave dans la séance même du 21 juin, c’est-à-dire sous le coup immédiat de la nouvelle du départ, il est clair que dès ce moment il inclinait à cette solution. Il se peut, comme le disent ses adversaires, qu’il ait été fasciné par la beauté et ému par la douleur de la reine, pendant le voyage où il l’escortait, mais c’est bien dans une vue politique, c’est bien, comme il avait coutume de le dire, pour « achever la Révolution » qu’il conseille à tous ses amis de mettre le roi hors de cause et de lui restituer son pouvoir.
Il a d’ailleurs lui même, dans ses mémoires, expliqué sa conduite et analysé, de son point de vue, l’état des esprits : « L’assemblée ne se livra point à cette précipitation, à cette affluence de mesures désespérées qui n’annoncent que la faiblesse ; mais elle pourvut à tout et aucune mesure importante ne fut omise, et lorsque, deux jours après sa disparition, on apprit que le roi était arrêté à Varennes, ah ! combien, dans ce moment, le long travail de la calomnie fut promptement effacé, combien la confiance revint rapidement à ceux dont chacun, au fond de son cœur, connaissait la sincérité, le dévouement et l’inflexible courage. Ces moments sont ceux peut-être où il a été le plus facile de distinguer l’esprit des différents partis qui divisaient la gauche de l’assemblée : Tandis que quelques-uns s’abandonnaient à leurs chimères favorites, méditaient, dans des comités obscurs, les moyens de profiter de ces événements pour parvenir à l’accomplissement de leurs funestes décisions tout le reste parut tourner les yeux sur ceux qui s’étaient rendus le plus dignes de leur estime, et ces hommes qui, quelques jours auparavant, étaient en butte aux attaques des factions, se virent subitement environnés d’une confiance presque unanime et investis d’une autorité qui approchait de la dictature. »
« Je fus l’un des trois commissaires nommés pour accompagner le roi à son retour à Paris ; époque à jamais gravée dans ma mémoire, qui a fourni à l’infâme calomnie tant de prétextes, mais qui, en gravant dans mon imagination ce mémorable exemple de l’infortune m’a servi sans doute à supporter facilement les miennes. »
« Pour juger si ce fameux voyage a changé quelque chose à mes dispositions personnelles, il suffit d’examiner dans ma conduite ce qui le précède et si tout est d’accord avec ce qui l’a suivi. »
« Avant le voyage de Varennes comme depuis, je n’ai pas cru un moment que cet événement inattendu dût porter atteinte à la Constitution. Les preuves, les voici : 1o Le jour même du départ du roi, je proposai et je fis adopter à la société des Jacobins une adresse à leurs sociétés affiliées, qui finissait par ces mots : L’assemblée nationale ! voilà notre guide : La Constitution ! voilà notre cri de ralliement. 2o Le lendemain, l’assemblée avait décidé que tous les militaires seraient tenus de lui prêter serment de fidélité. Je concourus dans les comités réunis, à la rédaction du serment qu’ils prescrivirent à l’Assemblée. La formule portait : Fidélité au roi constitutionnel, car si nous eussions été réduits à faire la guerre, nous devions la faire contre un rebelle,

à l’âge de 26 ans.
d’après une miniature peinte à Paris
et appartenant aujourd’hui à Mme la Comtesse
Louise de Gyldehstolpe née de Fersen.
(Document contenu dans « Le Comte de Fersen et la cour de France »,
par le baron de Klinchowström
et reproduit avec l’autorisation de l’auteur).
au nom de tous les pouvoirs nationaux. L’assemblée retrancha cette partie de la formule. 3o J’ai rédigé, dans les mêmes comités, le décret qui réglait les pouvoirs des commissaires envoyés à Varennes et qui leur enjoignaient spécialement de veiller à ce que le respect dû à la dignité royale soit maintenue.
4o Lorsque nous eûmes joint la voiture du roi, sur la route de Dormans à Épernay, et avant d’y être monté, le roi répondit, à la lecture qui lui fut faite du décret de l’Assemblée nationale, qu’il n’avait jamais eu l’intention de sortir de la France. Je me retournai vers M. Dumas, qui était derrière moi, et je lui dis : Voilà un mot qui sauvera le royaume. »
Ce que Barnave n’ajoute pas c’est que dès le retour du Roi, il se fit son conseiller et lui suggéra ou même rédigea pour lui les habiles réponses qu’il fit aux commissaires de l’Assemblée chargés de l’interroger. L’agitation populaire et l’agitation des clubs étaient assez grandes. Mais les modérés de l’Assemblée étaient bien décidés à ne pas rouvrir l’inconnu en mettant le roi en accusation. C’est le 13 juillet que l’ordre du jour de l’Assemblée appela le rapport des comités sur les événements relatifs à l’évasion du roi et de la famille royale. Le Comité de Constitution déclara que le roi était inviolable ; que la Constitution n’avait pas prévu le délit de fuite avec une précision suffisante : que d’ailleurs si le roi pouvait facilement être mis en cause, la stabilité que les législateurs ont voulu donner au pouvoir royal par le maintien de la royauté serait sans cesse à la merci des accusateurs : que toujours les ministres devaient être responsables des actes du roi : ou que lorsque le roi agissait à l’insu de ses ministres c’étaient les conseillers, les inspirateurs de cet acte illégal qui étaient considérés par une fiction nécessaire, comme les principaux coupables.
Et c’est en ce sens que les Comités concluaient à mettre Bouillé en accusation et le roi hors de cause. Barnave fit mieux que de résumer tous ces arguments juridiques. Il fit appel, dans un discours très ample et très habile, à l’instinct conservateur des révolutionnaires de l’Assemblée : Et au fond il posa deux questions : Voulez-vous substituer la République à la monarchie ? Voulez-vous susciter une Révolution nouvelle ? « On a très bien établi les faits : mais je les prends en masse et je dis : tout changement est aujourd’hui fatal ; tout prolongement de la Révolution est aujourd’hui désastreux ; la question, je la place ici et c’est bien là qu’elle est marquée par l’intérêt national. Allons-nous terminer la Révolution ? Allons-nous la recommencer ? (Applaudissements répétés.) Si vous vous défiez une fois de la Constitution, où sera le point où vous vous arrêterez, et où s’arrêteront surtout nos successeurs ?…. »
« On nous fait un grand mal quand on perpétue ce mouvement révolutionnaire qui a détruit tout ce qui était à détruire et qui nous a conduits au point où il fallait nous arrêter….. Songez, messieurs, songez à ce qui se passera après vous. Vous avez fait ce qui était bon pour la liberté, pour l’égalité ; aucun pouvoir arbitraire n’a été épargné, aucune usurpation de l’amour-propre ou des propriétés n’est échappée : vous avez rendu tous les hommes égaux devant la loi civile et devant la loi politique ; vous avez repris, vous avez rendu à l’État tout ce qui lui avait été enlevé. De là résulte cette grande vérité que si la Révolution fait un pas de plus, elle ne peut le faire sans danger ; c’est que dans la ligne de la liberté le premier acte qui pourrait suivre serait l’anéantissement de la royauté ; c’est que dans la ligne de l’égalité, le premier acte qui pourrait suivre serait l’anéantissement de la propriété. (Applaudissements). »
La question était largement posée : et au point de vue de la Révolution bourgeoise Barnave aurait eu raison si l’on avait pu supposer que le roi était maintenant résigné à la Révolution et qu’il ne tenterait pas, lui, de la rouvrir à sa manière. Là était le point décisif : et il semble que c’est sur ce point que les démocrates de l’extrême gauche auraient dû porter leur effort. Ils n’avaient en somme qu’une chose à dire. L’expérience démontre, après tant de serments solennels et violés, que Louis XVI et la Révolution ne peuvent s’accorder.
Il est permis de penser que ni le fils, ni le frère, ni le cousin de Louis XVI n’accepteront avec plus de sincérité les principes révolutionnaires. Il n’y a donc qu’une solution : écarter non seulement le monarque mais la monarchie et installer un véritable gouvernement national. C’est à tort que l’on redouterait des agitations et du trouble : le calme profond de Paris et du pays tout entier pendant l’absence du roi et pendant la royauté de l’assemblée démontre que la nation est préparée à l’exercice direct de la souveraineté toute entière. Au demeurant, les agitations seront bien plus grandes si le roi, humilié par son arrestation, recommence ses entreprises contre la Révolution. Il faudra alors procéder au milieu des orages et des périls à un changement de Constitution que nous pouvons accomplir aujourd’hui dans une tranquillité suffisante. À la thèse monarchique et conservatrice de Barnave, c’est une thèse républicaine et démocratique qu’il fallait opposer. L’extrême gauche n’osa pas. Elle se borna à ergoter sur l’inviolabilité royale. « Si le roi fait violence à votre femme ou à votre fille, le déclarerez-vous inviolable ? » Pétion termina bien son discours en demandant que le roi fût jugé soit devant l’assemblée nationale, soit devant une Convention ad hoc. » Mais sa pensée était très incertaine.
Tout en réclamant les poursuites, il paraissait prévoir et désirer l’acquittement : « Quand il ne serait prononcé en définitive aucune peine, il est très essentiel de déclarer qu’il peut en être prononcé et de consacrer le principe.
« Si la nation, dans sa clémence, veut jeter un voile religieux sur le délit de celui qu’elle a choisi pour son chef, il faut que cette clémence parle et que l’absolution ne paraisse pas dictée par la loi. »
Ce n’est pas ainsi qu’on détermine un grand peuple à mettre en accusation la royauté séculaire : il faut être réellement résolu à aller jusqu’au bout et à frapper la monarchie. Pétion disait avec embarras : « Nous ne sommes pas forcés de recourir à des rigueurs », et il annonçait, sans le formuler à la tribune, un système qui concilierait tout. Ce système, qu’il expliqua par écrit, consistait à « entourer le chef du pouvoir exécutif d’un certain nombre de représentants du peuple électifs et temporaires ». C’était comme un conseil exécutif délégué par l’Assemblée auprès du roi. Et, dans la pensée de Pétion, le Conseil des ministres choisi par le roi subsistait aussi. C’était compliqué et puéril. C’était le maintien de la royauté avec un conseil de tutelle qui aurait été ou ridicule ou souverain. Ah ! que d’efforts, que de tâtonnements, que de transitions maladroites et incertaines pour passer de l’idée de monarchie à l’idée de République ! Robespierre opposa en termes vagues l’inviolabilité de la nation à l’inviolabilité du roi, et sur la République il eut les paroles les plus équivoques : « Qu’on m’accuse, si l’on veut, de républicanisme ; je déclare que j’abhorre toute espèce de gouvernement où les factieux règnent. Il ne suffit pas de secouer le joug d’un despote ; l’Angleterre ne s’affranchit du joug de l’un de ses rois que pour retomber sous le joug plus avilissant encore d’un petit nombre de ses concitoyens. Je ne vois point parmi nous, je l’avoue, le génie puissant qui pourrait jouer le rôle de Cromwell ; je ne vois pas non plus personne disposé à le souffrir ; mais je vois des coalitions plus actives et plus puissantes qu’il ne convient à un peuple libre, mais je vois des citoyens qui réunissent entre leurs mains des moyens trop variés et trop puissants d’influencer l’opinion. »
La question n’était pas là. Il ne s’agissait pas de savoir si la République substituée à la monarchie pourrait être plus ou moins menacée d’oligarchie. Il s’agissait de savoir si, en ouvrant le procès du roi et de sa famille, on était résolu à aller jusqu’à la République, qui était, pour tout homme sensé, l’inévitable conséquence de la mise en jugement et de la condamnation de Louis XVI.
Robespierre se dérobait donc ; il se dérobait aussi lorsqu’il demandait « de quel droit on excepte dans le décret les personnes qui ne sont pas inviolables ; je veux parler de Monsieur, frère du roi, par exemple ». Il n’osait pas nommer la reine. Le langage de l’abbé Grégoire fut plus net : « La défiance est la sauvegarde d’un peuple libre : la confiance ne se commande pas. Hé bien, pouvez-vous jamais réinvestir Louis XVI de la confiance nationale ? S’il promet d’être fidèle à la Constitution, qui osera s’en porter garant ?… Je demande qu’au plus tôt on assemble les collèges électoraux et qu’on nomme une Convention nationale. » C’est la marche que la Révolution suivra une année plus tard, après le 10 août. Mais l’abbé Grégoire lui-même n’ose pas dire : « Et si cette Convention reconnaît qu’il y a incompatibilité non seulement entre Louis XVI et la Révolution, mais entre la Révolution et la monarchie, nous sommes prêts pour la liberté républicaine. » Lui aussi a laissé un voile sur l’avenir prochain de la France. Grande faiblesse pour des politiques !
Le vieux Vadier, auquel M. Tournier a consacré une pénétrante étude très documentée, fut d’une extrême violence contre Louis XVI. L’ancien officier démissionnaire après Rosbach, l’ancien procédurier, juge naguère au présidial de Pamiers, crut le moment venu de sortir de l’ombre par un coup d’éclat. Il prononça devant l’Assemblée, le 14 juillet, un discours où abondaient les réminiscences de Marat : « Le décret que vous allez rendre décidera du salut ou de la subversion de l’Empire. Un grand crime a été commis : il existe de grands coupables ! L’Univers vous contemple et la Postérité vous attend. Vous pouvez en un instant perdre ou consolider vos travaux. Il est, selon moi, une question préliminaire à celle de l’inviolabilité : c’est celle de savoir si un roi parjure qui déserte son poste, qui emmène avec lui l’héritier présomptif de la couronne, qui se jette dans les bras d’un général perfide, qui veut assassiner sa patrie, qui répand un manifeste où il déchire la Constitution ; si, dis-je, un tel homme peut être qualifié du titre de roi des Français ? L’inviolabilité ne réside plus sur sa tête depuis qu’il a abdiqué sa couronne. (Quelques membres de la partie gauche et les tribunes applaudissent.) Aucun de nous a-t-il pu entendre qu’un brigand couronné… (La grande majorité de la partie gauche murmure… Quelques applaudissements se font entendre dans la salle et les tribunes. Plusieurs membres de la partie droite se lèvent avec précipitation et menacent l’opinant.) Aucun de nous a-t-il jamais pu croire qu’un brigand couronné pût impunément massacrer, incendier, appeler dans le royaume des satellites étrangers ? Une telle monstruosité enfanterait bientôt des Néron et des Caligula ! (On entend des applaudissements.)
« Je fais une question à ceux qui proposent de remettre le roi sur le trône : Lorsqu’il s’agira de l’exécution de vos lois contre les traîtres à la patrie, sera-ce au nom d’un transfuge, d’un parjure que vous la réclamerez ? Sera-ce au nom d’un homme qui les a ouvertement violées ? Jamais une nation régénérée, jamais les Français ne s’accoutumeront à un pareil genre d’ignominie. N’est-ce donc pas assez d’avoir acquitté les déprédations de sa faiblesse, d’avoir sauvé son règne d’une infâme banqueroute ? Ses valets, dont le faste contraste tant avec le régime de l’égalité, nous accusent de parcimonie. (Les applaudissements recommencent.) La sueur et le sang de plusieurs millions d’hommes ne peuvent suffire à sa subsistance. Je ne veux pas vous rappeler ici les circonstances de son règne, cette séance royale, ces soldats envoyés pour entourer l’enceinte où vous étiez rassemblés ; en un mot, la guerre et la faim dont on voulait en même temps affliger le royaume.
« Jetons sur tous ces désastres un voile religieux. (L’agitation se manifeste dans les diverses parties de la salle.) On m’accuse de parler comme Marat ; je fréquente peu la tribune. (Plusieurs voix s’élèvent dans la partie droite : « Tant mieux ! monsieur, tant mieux ! ») Je n’ai d’autre éloquence que celle du cœur ; je dois mon opinion à mes commettants ; je la déclarerai au péril de ma vie. La nation vous a revêtus de sa confiance ; vous connaissez son vœu ; ne transigez pas, ou bien empressez-vous de rendre aux corps électoraux l’activité que vous leur avez ôtée. Mais n’allez pas vous charger d’une absolution qui ne peut que flétrir votre gloire. (Nouveaux applaudissements.) Je conclus à ce que les complices, fauteurs ou adhérents de la fuite du roi soient renvoyés à la Cour provisoire séant à Orléans, que l’activité soit rendue aux corps électoraux pour choisir vos successeurs, et qu’il soit nommé une Convention nationale pour prononcer sur la déchéance de la couronne que Louis XVI a encourue. » (Les applaudissements de la gauche et des tribunes recommencent.)
C’est déjà le langage et le ton de la Convention. Vadier envoie à Marat le texte de son discours avec prière de le publier. Qui ne croirait que l’homme qui parle du roi avec cette violence est au moins préparé à l’idée de la République ? Or, le surlendemain 16 juillet, le décret sur l’inviolabilité royale ayant été adopté, Vadier déclara à la tribune : « J’ai développé hier une opinion contraire à l’avis des comités avec toute la liberté qui doit appartenir à un représentant de la nation. Cependant je déclare que je déteste le régime républicain, je le crois subversif et inconciliable avec notre situation politique ; mais aujourd’hui que la loi est rendue et quoique je n’aie pas été d’avis de l’inviolabilité absolue du roi, je déclare qu’autant j’ai mis de zèle à soutenir mon opinion avant le décret, autant j’en emploierai aujourd’hui à en maintenir l’exécution, et s’il faut sacrifier ma vie pour le défendre en bon citoyen, je la sacrifierai de grand cœur ! » (Vifs applaudissements.)
Quel agneau ! Marat, exaspéré, l’accusa d’avoir reçu de l’or de la Cour. La vérité est simplement que Vadier était un homme de peu de consistance, que le courant monarchiste était encore très fort, et que le procédurier finaud, après s’être signalé à l’attention par un coup de réclame, rentrait prudemment dans le rang pour attendre la suite des choses. Plus tard, il se vanta de son discours contre le roi et se garda bien de rappeler son désaveu de la République. « Ce n’est pas sans indignation que j’ai vu ces vampires voraces, au mois de juillet 1791, se prosterner traîtreusement devant ce mannequin couronné, lorsqu’on le ramena de Varennes, prostituer leurs talents à le remonter sur le trône, tandis que leur devoir était de le conduire à l’échafaud ; mais ils avaient besoin de ce monstre pour assouvir leur insatiable cupidité. La minorité incorrompue du corps constituant fut interdite à la vue de cette ignominieuse coalition ; l’énergie qu’elle avait développée dans son adolescence fit place à une espèce de torpeur, déplorable effet de sa caducité. Je fus le seul qui eus la courageuse audace de proposer une Convention nationale pour juger ce roi parjure et fugitif… J’osai demander au nom de la nation outragée la tête de ce scélérat couronné. Je fus donc le seul qui osai, d’une main hardie, porter la cognée sur le colosse de la royauté, et qui osai poser la première pierre de l’édifice républicain. »
On sait ce qu’il faut penser de ces hâbleries ; mais ce qui est vrai, ce qui est à retenir, c’est la « torpeur », le défaut de vigueur de l’extrême gauche démocratique… Comment l’expliquer ? Sans doute, tout en demandant des poursuites contre le roi, elle avait le sentiment qu’il serait difficile d’obtenir contre lui une condamnation. En fait, la tentative du roi n’avait pas abouti : il lui était permis de dire qu’il n’avait pas voulu quitter le royaume ; les étrangers n’avaient pas mis leurs troupes en mouvement ; les négociations de trahison conduites par le roi avec les souverains de l’Europe étaient inconnues ; ainsi, l’énergie du sentiment national, qui, au 10 août 1792, emporta la royauté, complice des premières défaites, n’aurait pas suffi à la fin de 1791, et en pleine paix, à refouler les vieux instincts monarchiques. Dès lors, le procès ne devenait-il pas dangereux et n’aurait-il point pour unique effet de ramener au roi les sympathies ? Cette crainte secrète paralysait à coup sûr les démocrates de l’Assemblée.
De plus, l’idée de la République était toute nouvelle. Tous comprenaient bien qu’il ne pouvait s’agir ni d’une république comme celles de la Grèce et de Rome, fondées sur l’esclavage, ni d’une république aristocratique comme celle de Genève.
L’exemple d’un pays neuf comme l’Amérique ne pouvait non plus être invoqué. C’est donc une République sans précédent qu’il s’agissait de créer : et la plupart des révolutionnaires reculaient devant cette entreprise incertaine et obscure. Voilà pourquoi l’assemblée vota la mise hors de cause de Louis XVI et se prépara tout doucement à lui rendre le pouvoir à la seule condition qu’il voulût bien accepter l’ensemble de la Constitution révisée.
Mais, malgré tout, la secousse fut forte : et on peut dire dès ce jour que le roi et la royauté n’ont plus une seule faute à commettre. La suspension de l’autorité royale est, en fait, un premier essai du régime républicain. L’idée de République est posée. Quelques grands esprits commencent à la formuler nettement : et si le peuple n’est pas encore nettement républicain, du moins, est-il prêt à suivre jusqu’à la République le mouvement de la Révolution. Brissot mêlait à ses idées républicaines trop d’intrigues, trop de combinaisons à échappements multiples. C’est lui qui avait suggéré à Pétion l’idée bizarre du conseil exécutif.
Ce qui est plus remarquable c’est que dès cette époque il s’appliquait à préparer l’opinion à ne pas redouter l’intervention étrangère. Il disait aux Jacobins dans la séance du 10 juillet : « On ne peut mettre, disent les comités, le roi en cause, on ne peut le juger sans s’exposer à la vengeance des puissances étrangères. On fait entrevoir à l’assemblée nationale un tableau effrayant des calamités que leur ligue, leur invasion entraînerait en France. C’est avec ces terreurs imaginaires qu’on espère ranger autour d’un parti honteux ou faible des patriotes sincères, mais timides et peu instruits….. Qui êtes-vous ? un peuple libre : et on vous menace de quelques brigands couronnés et de meutes esclaves ! Athènes et Sparte ont-ils jamais craint les armées innombrables que les despotes de la Perse traînaient à leur suite ? A-t-on dit à Miltiade, à Cimon, à Aristide : Recevez un roi ou vous périrez ? Ils auraient répondu dans un langage digne des Grecs : Nous nous verrons à Marathon, à Salamine. … » Et les Français aussi auront leur Marathon, leur Salamine, s’il est des puissances assez folles pour les attaquer. Ici, messieurs, le nombre est même du côté de la liberté, et nous aurons à envier aux Spartiates la gloire qu’ils ont eue de lutter avec peu de héros contre des nuées ennemies : Nos Thermopyles seront toujours couvertes de légions nombreuses. »
« D’ailleurs, disait-il, les puissances doivent éviter la guerre précisément pour éviter le contact du peuple avec la France révolutionnaire. Est-ce en s’armant contre nous, en inondant la France de leurs troupes, que les rois étrangers préviendront la contagion de la liberté ? Peuvent-ils croire que leurs soldats n’entendront pas ces saints cantiques : qu’il ne seront pas ravis d’une Constitution où toutes les places sont ouvertes à tous ; où l’homme est l’égal de l’homme ? Ne doivent-ils pas craindre que leurs soldats n’imitent la conduite des Allemands en Amérique, ne s’enrôlent sous les drapeaux de la liberté, ne se mêlent dans nos familles, ne viennent cultiver nos champs qui deviendront les leurs ? »
« Ce n’est pas seulement ceux qui resteront avec nous qu’ils auront à redouter, mais ceux qui, lassés d’une guerre impie et infructueuse, retourneront chez eux. Ceux-là feront naturellement des comparaisons de leur sort avec le sort des Français, de la perpétuité de leur esclavage avec l’égalité des autres. Ils trouveront leurs seigneurs plus insolents, leurs ministres plus oppresseurs, les impôts plus pesants et ils se révolteront. La Révolution américaine a enfanté la Révolution française ; celle-ci sera le foyer sacré d’où partira l’étincelle qui embrasera les nations dont les maîtres oseront l’approcher ! »
Ainsi, dans la tête active de Brissot est formé dès maintenant tout le système prochain de la Révolution : la tendance à la République, la Révolution belliqueuse, la guerre de propagande.
En ces chaudes et troubles journées de juillet, bien des idées fermentaient. Mais elles étaient trop confuses et trop contradictoires pour prendre sur les événements.
Par exemple, le procès intenté à Louis XVI pouvait appeler sur la France révolutionnaire la violence des rois : Brissot dit, non sans témérité, que la France était prête à repousser l’agression du monde. Mais que devenait alors le procès même ?
Le roi ne pouvait alors être acquitté sans que cette absolution parût une concession de la peur à la force armée des souverains. C’était donc la condamnation obligatoire non seulement du roi, mais de la monarchie pour les droits de laquelle les rois et les empereurs auraient pris les armes. De l’hypothèse de Brissot la République jaillissait donc nécessairement.
Et pourtant cette République nécessaire, Brissot lui-même la masquait par toute sorte de combinaisons compliquées comme celle du conseil exécutif. Le brusque départ du roi et sa tentative, à demi innocente pour avoir été arrêtée à temps, obligent les démocrates, les républicains, à avouer leur système avant que l’heure soit venue. De là toutes les réticences, toutes les mollesses de ce qu’on pourrait appeler l’opposition démocratique de juillet 1791.

(Document contenu dans « Le Comte de Fersen et la cour de France », par le baron de Klinchowström et reproduit avec l’autorisation de l’auteur.)
Condorcet, avec beaucoup de sérénité et de grandeur, défendit l’idée républicaine. C’est le premier manifeste de philosophie politique où la République soit vraiment affirmée avec force, et non comme un rêve lointain, mais comme l’immédiate nécessité. Il ne manque à la démonstration de Condorcet, pour être décisive, que d’avoir prévu le péril d’une dictature militaire, survenant après de grandes guerres et de grandes victoires.

« Les amis de la royauté nous disent : il faut un roi pour ne pas avoir un tyran : un pouvoir établi et borné par la loi est bien moins redoutable que la puissance usurpée d’un chef qui n’a d’autres limites que celles de son adresse et de son audace. »
« Mais cette puissance d’un usurpateur est-elle à craindre pour nous ? Non, sans doute : la division de l’empire en départements suffirait pour rendre impossible ces projets ambitieux (il s’agit bien entendu de l’organisation administrative de la Révolution où les autorités départementales et locales sont toutes électives) La division des pouvoirs fondée non seulement sur cela, mais sur la différence des fonctions est une autre barrière. … Enfin la liberté de la presse, l’usage presque universel de la lecture, la multitude de papier publié suffisent pour préserver de ce danger. Pour tout homme qui a lu avec attention l’histoire de l’usurpation de Cromwell, il est évident qu’une seule gazette eût suffi pour en arrêter le cours : il est évident que si le peuple d’Angleterre eût su lire d’autres livres que la Bible, l’hypocrite, démasqué dès ses premiers pas, eût bientôt cessé d’être dangereux. »

Les tyrans populaires ne peuvent agir que sous le masque et dès qu’il existe un moyen sûr de le faire tomber avant le succès, de les forcer à marcher le visage découvert, ils ne peuvent plus être à craindre. »
Foi admirable dans la puissance de la liberté et de la lumière. …
« Un roi, dit-on, est nécessaire pour donner de la force au pouvoir exécutif ; mais dans un pays libre il n’existe de force réelle que celle de la nation même, les pouvoirs établis par elle et pour elle ne peuvent avoir que la force qui naît de la confiance du peuple et de son respect pour la loi. Quand l’égalité règne il faut bien peu de force pour forcer les individus à l’obéissance, et l’intérêt de toutes les parties de l’Empire est qu’aucune d’elle ne se soustraie à l’exécution des lois que les autres ont reconnues. »
« On parle toujours comme au temps où des associations puissantes donnaient à leurs membres l’odieux privilège de violer les lois, comme au temps où il était indifférent à la Bretagne que la Picardie payait ou non les impôts. Alors, sans doute, il fallait une grande force aux chefs du pouvoir exécutif, alors nous avons vu que même celle du despotisme armé ne lui suffisait pas. Il a existé des abus, des dangers contre lesquels l’existence d’un roi a été utile, et sans cela y aurait-il eu jamais des rois ? Les institutions humaines les plus vicieuses sont-elles autre chose que des remèdes maladroitement appliqués à des maux imaginaires ou réels ?…. C’est au contraire l’existence d’un chef héréditaire qui ôte au pouvoir exécutif toute sa force utile en armant contre lui la défiance des amis de la liberté, en obligeant à lui donner des entraves qui embarrassent et retardent ses mouvements. La force que l’existence d’un roi donnerait au pouvoir exécutif ne serait, au contraire, que honteuse et nuisible ; elle ne pourrait être que celle de la corruption. »
« Nous ne sommes plus au temps où l’on oserait compter, parmi les moyens d’assurer la puissance des lois, cette superstition impie qui faisait d’un homme une espèce de divinité. Sans doute, nous ne croyons plus qu’il faut pour gouverner les hommes, imposer leur imagination par un faste puéril et que le peuple sera tenté de mépriser les lois si leur suprême exécuteur n’a pas un grand maître de la garde-robe. »
Ainsi, Condorcet, avec une haute philosophie historique, reconnaît que la royauté a été utile. Mais elle a cessé de l’être depuis que la société française, devenue plus homogène par l’effet de la Révolution, favorise par son unité même le jeu du pouvoir exécutif. Et le prestige religieux qui s’attachait à la monarchie s’étant évanoui à la lumière de la raison, l’inutilité présente des rois apparaît sans voile.
Voici maintenant des vues admirables de philosophie historique : « Des hommes qui se souviennent des événements de l’histoire, mais qui ne connaissent pas l’histoire, sont effrayés des tumultes, des injustices, de la corruption de quelques républiques anciennes.
« Mais qu’ils examinent ces Républiques, ils y verront toujours un peuple souverain et des peuples sujets ; ils y verront dès lors de grands moyens pour corrompre ce peuple et un grand intérêt de le séduire. Or, ni cet intérêt ni ces moyens n’existent quand l’égalité est entière non seulement entre les citoyens, mais entre tous les habitants de l’Empire. Que le peuple d’une ville règne sur un grand territoire, que celui d’une province domine par la force sur des provinces voisines, ou qu’enfin des nobles répandus dans un pays y soient les maîtres de ceux qui l’habitent, cet empire d’une multitude sur une autre est la plus odieuse des tyrannies ; cette forme du corps politique est la plus dangereuse pour le peuple qui obéit comme pour le peuple qui commande. Mais est-ce là ce que demandent les vrais amis de la liberté, ceux qui veulent que la raison et le droit soient les seuls maîtres des hommes ? Aux dépens de qui pourrions-nous satisfaire à l’avidité de nos chefs ? Quelles provinces conquises un général français dépouillera-t-il pour acheter nos suffrages ? Un ambitieux nous proposera-t-il, comme aux Athéniens, de lever des tributs sur les alliés pour élever des temples ou donner des fêtes ? Promettre-t-il a nos soldats, comme aux citoyens de Rome, le pillage des Espagnes ou de la Syrie ? Non. sans doute, et c’est parce que nous ne pouvons être un peuple-roi, que nous resterons un peuple libre. »
On ne peut lire ce passage extraordinaire sans une émotion d’enthousiasme et de douleur. Si j’osais emprunter le langage d’un art qui n’était point inventé encore, je dirais que dans les dernières lignes Condorcet nous donne comme une épreuve négative de la monstrueuse tyrannie napoléonienne. Il nous semble voir tout le butin de la Syrie et des Espagnes payant la servitude héroïque des généraux de César. Au fond, bien qu’il n’ait pas pressenti, comme bientôt le pressentira Robespierre, que de la lutte armée de la Révolution contre les rois une dictature militaire sortirait, Condorcet ne se trompait point sur la condition vitale de la liberté républicaine. Elle suppose, de la part de la France, une politique de paix constante et profonde.
Par le plus tragique des contrastes, la grande conception de liberté et de paix de Condorcet s’affirme au moment même où Brissot formule la politique belliqueuse de la Révolution. Comment fut-elle jetée dans la voie d’aventure et de péril qu’ouvrait le parti de Brissot ? La guerre était-elle nécessaire, et pourquoi ? Nous étudierons à fond ce terrible problème quand la Révolution, en avril 1792, jettera ses premiers défis de guerre.
Mais maintenant il nous plaît, en regard de la politique belliqueuse de Brissot, que la force des événements et la faiblesse des hommes imposeront à la Révolution, de dresser le sublime idéal de paix républicaine tracé par Condorcet. Il nous plaît, que dans le premier manifeste grand et noble de l’esprit républicain, dans le premier titre philosophique et politique dont nous puissions nous réclamer, la paix soit liée d’une chaîne d’or à la liberté. C’est bien là notre vrai et noble destin. En un sens idéal, qui ne contrarie pas le déterminisme des faits de l’histoire, la formidable épopée guerrière de Napoléon est une déviation révolutionnaire. En rentrant dans la politique de paix, nous rentrons dans notre vérité à nous ; nous retrouvons notre lumineux chemin marqué dès juillet 1791 par le philosophe en qui le génie du xviiie siècle s’élargissait à la mesure des événements nouveaux.
Pendant que Condorcet agitait ces spéculations sublimes et s’efforçait en vain d’amener la Constituante à la République, le peuple, en bien des points se soulevait. Aux Cordeliers, aux Jacobins, des voix irritées réclamaient la mise en jugement du roi. Les Cordeliers, sous l’inspiration de Danton, allaient plus loin. Ils demandaient qu’on en finît avec tous les rois. Dans la séance des Jacobins du 22 juin, le lendemain même du jour où avait été connue la fuite du roi, un ami de Danton, Robert, porte toute vive la pensée républicaine des Cordeliers : « J’étais à quatre heures au club des Cordeliers, je fus envoyé avec deux autres membres de ce club pour porter à la Société Fraternelle une adresse pour demander la destruction de la monarchie. »
Des cris d’indignation, dit le procès-verbal, s’élevèrent de toutes parts. Les Jacobins ne voulaient pas sortir de la légalité constitutionnelle, et Brissot, qui avait d’abord lancé un mot d’ordre de république, recula et louvoya. Robespierre, craignant d’être entraîné hors du terrain légal qui seul lui paraissait solide, continue ses symétries savantes. Il n’est ni républicain ni monarchiste. Il veut la Constitution et la liberté. Le vif courant populaire des Cordeliers semble se briser sur le roc de la légalité jacobine. Pourtant les Jacobins eux-mêmes commencent à s’ébranler. Les Cordeliers, animés par les événements, venaient plus souvent aux Jacobins, ils envoyaient des délégations, ils assistaient aux séances. Il se faisait ainsi comme un mélange de l’esprit révolutionnaire et spontané des uns, de l’esprit révolutionnaire et légal des autres.
D’ailleurs le peuple ouvrier, remué par la grandeur du drame et par les mystérieuses promesses que renfermait pour lui l’inconnu des événements, affluait dans les clubs où jusque-là la bourgeoisie seule s’était pressée. Barnave signale avec insistance et avec son habituelle netteté de vues cette soudaine pénétration des éléments prolétaires dans la Révolution bourgeoise.
« Paris, dit-il, qui depuis le départ du roi n’avait cessé d’offrir le tableau le plus imposant, fut menacé de quelques troubles à l’approche de la délibération qui devait prononcer sur l’inviolabilité ; ce n’est pas que la presque unanimité des citoyens ne fût fort tranquille, mais les Jacobins, livrés aux différents partis qui espéraient faire triompher leur système sur la condamnation de Louis XVI, étaient violemment agités. On était parvenu à soulever un assez grand nombre d’ouvriers occupés aux différents ateliers près de Paris, gens qui, quoique tous sans propriété, la plupart sans patrie connue, et souvent, à ce qu’on avait cru jusqu’alors, sans lumières politiques, parurent cependant attacher un grand intérêt à la punition du tyran. »
Il est inutile de relever le ton dédaigneux et presque insultant de Barnave. C’est le fait seul qu’il importe de retenir. Barnave ajoute :
« Tandis que Paris applaudissait à ce décret (qui mettait le roi hors de cause), les Jacobins s’en indignèrent ; ils proclamèrent hautement l’insurrection, ils admirent dans leur sein une multitude d’ouvriers, qu’ils appelèrent la nation et les incitèrent à la révolte. »
Ainsi tandis que Barnave et les chefs de la bourgeoisie modérée font appel « aux propriétaires et aux hommes pensants » pour maintenir la Constitution malgré la fuite du roi, et pour raffermir la monarchie, les bourgeois démocrates ouvrent leurs rangs aux ouvriers pour commencer la lutte contre le pouvoir royal. Pendant que l’Assemblée discutait, des pétitions, les unes violentes, d’autres plus mesurées, étaient proposées aux Cordeliers et aux Jacobins. Les Cordeliers, dès le départ du roi, allaient droit à la République. « Nous étions esclaves en 1789, nous nous étions crus libres en 1790, nous le sommes à la fin de 1791. »
« Législateurs, vous aviez distribué les pouvoirs de la nation que vous représentez ; vous aviez investi Louis XVI d’une autorité démesurée ; vous aviez consacré la tyrannie en l’instituant roi inamovible, inviolable et héréditaire ; vous aviez consacré l’esclavage des Français en déclarant que la France était une monarchie.
« Les bons citoyens ont gémi, les opinions se sont choquées avec véhémence, mais la loi existait et nous lui avons obéi, nous attendions notre salut du progrès des lumières et de la philosophie.
« Ce prétendu contrat entre une nation qui donne tout et un individu qui ne fournit rien semblait devoir être maintenu, et jusqu’à ce que Louis XVI eût été traître et ingrat, nous ne pouvions imputer qu’à nous-mêmes d’avoir gâté notre propre ouvrage.
« Mais les temps sont changés. Elle n’existe plus, cette prétendue convention d’un peuple, avec son roi. Désormais Louis XVI n’est plus rien pour nous, à moins qu’il ne devienne notre ennemi.
« Nous voilà donc au même état où nous étions lors de la prise de la Bastille : libres et sans roi. Reste à voir s’il est avantageux d’en nommer un autre.
« La Société des amis des droits de l’homme pense qu’une nation doit tout faire ou par elle ou par des officiers amovibles et de son choix ; elle pense qu’aucun individu, dans l’État, ne doit, raisonnablement, posséder assez de richesses, assez de prérogatives, pour pouvoir corrompre les agents de l’administration politique ; elle pense qu’il ne doit exister aucun emploi dans l’État qui ne soit accessible à tous les membres de l’État ; elle pense enfin que plus un emploi est important, plus sa durée doit être courte, passagère. »
« Pénétrée de la vérité, de la grandeur de ces principes, elle ne peut donc plus se dissimuler que la royauté, que la royauté héréditaire surtout, est incompatible avec la liberté. »
« Telle est son opinion : elle en est comptable à tous les Français. Elle prévoit qu’une telle proposition va faire lever une légion de contradicteurs, mais la Déclaration des Droits elle-même n’a-t-elle pas éprouvé des contradictions ? — Quoi qu’il en soit, cette question est assez importante pour mériter une discussion sérieuse de la part des législateurs. Déjà ils ont manqué une fois la révolution par un reste de condescendance pour le fantôme de la royauté (sans doute après le 14 juillet), il a disparu ce fantôme ; agissons donc sans crainte et sans terreur et tâchons de ne pas le faire revivre. »
« La Société des Droits de l’homme et du Citoyen n’aurait peut-être pas de sitôt demandé la suppression de la royauté si le roi, fidèle à ses serments, s’en fût fait un devoir, si les peuples, toujours dupes de cette institution funeste au genre humain n’eussent enfin ouvert les yeux à la lumière.
« Mais aujourd’hui que le roi, libre de garder la couronne, l’a volontairement abdiquée, aujourd’hui que la voix publique s’est fait entendre, aujourd’hui que tous les citoyens sont désabusés, nous nous faisons un devoir de servir d’organe à leur intention en demandant instamment et à jamais la destruction de ces fléaux de la liberté. »
« Législateurs, vous avez une grande leçon devant les yeux : sachez bien qu’après ce qui vient de se passer, il est impossible que vous parveniez à inspirer au peuple aucun degré de confiance dans le fonctionnaire appelé roi et d’après cela nous vous conjurons, au nom de la patrie, ou de déclarer sur le champ que la France n’est plus une monarchie, qu’elle est une république, ou au moins d’attendre que tous les départements, que toutes les assemblées primaires, aient émis leur vœu sur cette question importante avant de penser à replonger une seconde fois le plus bel empire du monde dans les entraves du monarchisme. »
Voilà qui est net : c’est le premier manifeste populaire et politique de la République dont Condorcet formulait le manifeste philosophique.
Le lendemain 23 juin, Danton de sa voix puissante, proclamait aux Jacobins que le roi était un criminel, ou un imbécile ; or « l’individu royal ne peut plus être roi, dès qu’il est imbécile, et ce n’est pas un régent qu’il faut, c’est un conseil à l’interdiction.
« Le conseil ne peut être pris dans le corps législatif. Il faut que les départements s’assemblent, que chacun d’eux nomme un électeur, que ces électeurs nomment ensuite les dix ou douze membres qui devront composer ce conseil, et qui seront changés, comme les membres de la législature, tous les deux ans. »
En fait, sous la forme sarcastique d’un conseil judiciaire pour la royauté imbécile, c’était l’organisation définitive du pouvoir exécutif républicain que proposait Danton : il était déjà l’homme du 10 août ; et sa clairvoyante et audacieuse pensée allait bien au delà des vagues et prudentes généralités de Robespierre.
L’idée grandissait, aux Cordeliers, aux Jacobins, qu’il faudrait, par voie de pétition, faire appel à l’Assemblée elle-même de la décision de l’assemblée, si elle rétablissait le roi. Le 15 juillet, Laclos propose aux Jacobins une forme de pétition assez modérée et constitutionnelle.

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
Cette pétition fut portée au Champ-de-Mars avec toutes les formes légales le 16 juillet : et elle n’excita qu’un médiocre intérêt. C’était un langage plus véhément et plus net qu’attendait le peuple. Devant cette agitation naissante l’assemblée constituante s’énervait un peu.
Elle sentait bien, malgré tout, ce qu’il y avait de factice dans la solution adoptée par elle. Proclamer que Bouillé était le principal coupable et mettre le roi hors de cause c’était un expédient qui laissait à coup sûr du trouble dans l’esprit du législateur lui-même.
Aussi, comme il arrive toujours aux pouvoirs qui ne sont pas bien contents d’eux-mêmes, l’assemblée voulut imposer le silence et traiter comme des factieux tous les protestataires. Dans la séance du 16 juillet elle manda à sa barre les officiers municipaux, les accusateurs publics, les ministres : et elle leur donna l’ordre de réprimer avec vigueur toute agitation. Le maire Bailly fut spécialement appelé, et plusieurs députés se plaignirent que la veille et le matin même la municipalité eût manqué de fermeté. Funestes reproches qui contribuèrent sans doute beaucoup aux tristes événements du lendemain.
Les Cordeliers avaient décidé en effet de porter au Champ-de-Mars une pétition plus énergique. Les Jacobins, envahis, la veille, au soir, par un flot de manifestants venus du Palais-Royal, s’étaient séparés sans prendre de décision ; mais le peuple, dont l’animation croissait, alla, en assez grande masse, au Champ-de-Mars : toute l’après-midi, la pétition se couvrit de signatures. Elle était ainsi conçue :
« Sur l’autel de la Patrie, le 17 juillet, l’an III (de la Révolution).- « Représentants de la Nation,
« Vous touchiez au terme de vos travaux ; bientôt des successeurs, tous nommés par le peuple, allaient marcher sur vos traces sans rencontrer les obstacles que nous ont présentés les députés de deux ordres privilégiés, ennemis nécessaires de tous les principes de la sainte égalité. Un grand crime se commet : Louis XVI fuit ; il abandonne indignement son poste ; l’Empire est à deux doigts de l’anarchie. Des citoyens l’arrêtent à Varennes ; il est ramené à Paris.
« Le peuple de cette capitale vous demande instamment de ne rien prononcer sur le sort du coupable sans avoir entendu l’expression du vœu des quatre-vingt-trois autres départements.
« Vous différez.
« Une foule d’adresses arrivent à l’Assemblée ; toutes les sections de l’Empire demandent simultanément que Louis soit jugé. Vous, Messieurs, avez préjugé qu’il était innocent et inviolable, en déclarant, par votre décret d’hier, que la Charte constitutionnelle lui sera présentée alors que la Constitution sera achevée.
« Législateurs, ce n’était pas là le vœu du peuple, et nous avions pensé que votre plus grande gloire, que votre devoir même consistait à être les organes de la volonté publique.
« Sans doute, Messieurs, que vous avez été entraînés à cette décision par la foule de ces députés réfractaires qui ont fait d’avance leur protestation contre toute espèce de constitution ; mais, Messieurs, représentants d’un peuple généreux et confiant, rappelez-vous que les deux cent trente protestants (les députés de la droite qui avaient déclaré, après l’arrestation du roi, qu’ils ne prendraient plus part aux délibérations) n’avaient plus de voix à l’Assemblée nationale ; que le décret est donc nul et dans la forme et dans le fond ; nul au fond, parce qu’il est contraire au vœu du souverain ; nul en la forme, parce qu’il est porté par deux cent quatre-vingt-dix individus sans qualité.
« Ces considérations, toutes en vue du bien général, le désir impérieux d’éviter l’anarchie à laquelle nous exposerait le défaut d’harmonie entre les représentants et les représentés, tout nous fait la loi de vous demander, au nom de la France entière, de revenir sur ce décret, de prendre en considération que le délit de Louis XVI est prouvé, que le roi a abdiqué, de recevoir son abdication et de convoquer un nouveau pouvoir constituant pour procéder d’une manière vraiment nationale au jugement du coupable et surtout au remplacement et à l’organisation d’un nouveau pouvoir exécutif. »
Pour la première fois depuis la journée d’octobre 1789, la partie la plus ardente du peuple s’élève contre une décision de l’Assemblée. En octobre, au moment où l’on craignait que l’Assemblée donnât au roi le veto absolu, les démocrates aussi disaient que sa décision serait nulle, parce que les représentants de la noblesse et du clergé, qui formaient la moitié de l’Assemblée, n’avaient pas le droit de décider au nom de la Nation. Cette fois, c’est parce que les députés de la droite, après avoir annoncé qu’ils ne voteraient plus, avaient cependant pris part au scrutin sur l’inviolabilité du roi, que les juristes de la démocratie contestaient la validité du vote.
Pendant que la pétition se couvrait de signatures, sans désordre d’ailleurs et sans cris, la municipalité, réunie à l’Hôtel-de-Ville, était dans le plus grand émoi. Le matin, sous l’autel de la Patrie, deux hommes avaient été trouvés : ils s’étaient cachés là probablement avec une pensée égrillarde, dans l’espoir que des femmes monteraient aux marches de l’autel. Découverts, ils furent tués par le peuple, qui les soupçonna d’avoir voulu pratiquer une mine sous l’autel de la Patrie. La nouvelle de ce meurtre parvint, enflée et déformée, jusqu’à la mairie. Le sang coule ! L’émeute est maîtresse du Gros-Caillou ! La municipalité proclama la loi martiale. Le drapeau rouge, drapeau de la répression bourgeoise, fut arboré aux fenêtres de l’Hôtel-de-Ville. Le maire et La Fayette, en tête de bataillons de gardes nationaux, se mirent en marche vers le Champ-de-Mars. Ils y arrivèrent tard, vers sept heures et demie ou huit heures moins un quart, presque à la tombée du jour. La foule était nombreuse, mais calme. À l’arrivée des gardes nationaux, l’émoi, la colère aussi s’emparent du peuple. Des cris hostiles sont poussés. A bas le drapeau rouge ! A bas les baïonnettes ! Quelques pierres sont jetées ; au témoignage de Bailly, un coup de pistolet est tiré : la balle effleure le maire et va percer la cuisse d’un dragon. Effrayés ou irrités, les gardes nationaux font feu sans prendre le temps d’adresser au peuple les trois sommations légales.
Bailly assure que, cette première fois, ils tirèrent en l’air et que personne ne fut blessé. Il est étrange que des hommes qui avaient assez de sang-froid pour tirer en l’air n’en aient pas eu assez pour attendre les sommations légales. Le peuple, exaspéré par cette décharge, jette de nouveau des projectiles, et la garde nationale fait feu. Au dire des démocrates, plusieurs centaines d’hommes et de femmes tombèrent dans ce que Marat appela le « gouffre infernal du Champ-de-Mars ». Bailly, dans son rapport du 18 juillet à la Constituante, n’avoue que onze à douze morts et une dizaine de blessés. Il y eut, en tout cas, une large effusion de sang. Ce ne fut point là, à proprement parler, une bataille sociale de la bourgeoisie et des prolétaires, car c’est une fraction de la bourgeoisie qui avait rédigé la pétition, et la question de la propriété n’était point posée. Pourtant il est certain que la bourgeoisie possédante était du côté de l’Assemblée nationale et que le peuple ouvrier était sympathique aux pétitionnaires. Il y a donc bien en cette triste journée un commencement de lutte de classes, quoique du sang bourgeois ait coulé pour la République en même temps que le sang ouvrier.
La stupeur de la France et de Paris fut grande, et grande la douleur. Mais on se trompe si l’on croit qu’il y eut une indignation générale contre la municipalité et contre l’Assemblée. Au contraire, c’est contre les pétitionnaires surtout que se souleva, à ce moment, le sentiment public de la France révolutionnaire. L’autorité morale de l’Assemblée était encore immense, même dans le peuple. La vigueur qu’elle avait montrée dans les jours qui suivirent le départ du roi, le rôle souverain qu’elle avait joué, tout avait ranimé sa popularité. Elle apparaissait comme le pouvoir nécessaire jusqu’au jour où la Nation aurait constitué une autre Assemblée. Et combattre ses décrets, une fois rendus, semblait une grave imprudence. Quelle garantie resterait à la Nation si les révolutionnaires eux-mêmes attaquaient la Constitution ? Ne devaient-ils pas la respecter jusque dans ses fautes pour avoir le droit d’en imposer le respect aux nobles, aux prêtres réfractaires, à la cour, aux émigrés, aux tyrans ? Aussi l’avant-garde courageuse et républicaine formée par les Cordeliers fut-elle désavouée, assez piteusement d’ailleurs, même par les démocrates.
Le 18 juillet, dans la séance de l’Assemblée où Bailly vint en personne raconter le drame de la veille et rejeter toute la responsabilité sur le peuple, pas une voix ne s’éleva pour protester : ni celle de Prieur, ni celle de Pétion, ni celle de Robespierre. Bien mieux, le président Charles de Lameth, au nom même de l’Assemblée, félicita la municipalité et la garde nationale : « L’Assemblée nationale a appris avec douleur que des ennemis du bonheur et de la liberté des Français, usurpant le masque, le langage du patriotisme, avaient égaré quelques hommes, les avaient rendus séditieux, rebelles à la loi, et vous avaient forcés de substituer les moyens de rigueur aux moyens de persuasion dont jusqu’ici vous ayez fait usage avec tant de succès.

(D’après une estampe du Musée Carnvalet.)
« L’Assemblée nationale approuve votre conduite et toutes les mesures que vous avez prises ; elle voit avec satisfaction que la garde nationale parisienne, que les soldats de la liberté et de la loi, que les citoyens mêmes à qui leurs occupations ne permettent pas de faire un usage constant et dont on s’était efforcé de calomnier les intentions, ont, dans ces circonstances, donné des preuves éclatantes de leur attachement à la Constitution et à la loi, et ont continué de justifier la haute estime et la reconnaissance de la Nation par leur zèle, leur modération et leur fidélité. » (Vifs applaudissements.)
Robespierre même n’osa pas formuler une réserve, lui qui, plus tard, parlera avec tant de violence du sang qui couvrait La Fayette. Les Jacobins, qui avaient toujours adopté comme règle absolue de ne jamais laisser mettre en discussion un décret de l’Assemblée, ne se pardonnaient pas à eux-mêmes leur attitude incertaine et assez médiocre de ces derniers jours. Ils s’étaient laissé pénétrer et déborder par les Cordeliers. Et ils n’avaient eu le courage ni de les désavouer à temps, ni de les suivre. Maintenant, les éléments modérés les abandonnaient en masse pour aller constituer un club de modérantisme, le Club des Feuillants. Les sociétés de province, affolées, menaçaient d’abandonner la Société mère. Les Jacobins envoyaient des circulaires très humbles où ils assuraient qu’ils s’étaient pour rien dans la pétition du Champ-de-Mars. Non, vraiment, l’heure de la République n’était pas encore venue, puisqu’ici, sous la menace de la bourgeoisie révolutionnaire modérée, les bourgeois démocrates baissaient ainsi la tête. Par leur silence accablé, ils permettaient qu’en leur nom on glorifiât les meurtres du Champ-de-Mars.
Dans la même séance du 18, et aussitôt après le rapport de Bailly, l’Assemblée, comme si la loi martiale appliquée la veille ne suffisait pas, vota une nouvelle loi répressive :
« L’Assemblée nationale, après avoir ouï le Comité de conciliation et de jurisprudence criminelle, décrète ce qui suit :
« Article premier. — Toutes personnes qui auront provoqué formellement le meurtre, le pillage, l’incendie ou la désobéissance à la loi, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits publics ou colportés, soit par des discours tenus dans des lieux ou assemblées publics, seront regardées comme séditieuses ou perturbatrices de la paix publique, et, en conséquence, les officiers de police seront tenus de les faire arrêter sur-le-champ et de les remettre au tribunal pour être jugées suivant la loi.
« Article 2. — Tout homme qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de trois ans de chaîne, si le meurtre ne s’en est pas suivi, et comme complice du meurtre, s’il a eu lieu. Tout citoyen présent est tenu de s’employer ou de prêter main-forte pour l’arrêter.
« Article 3. — Tout cri contre la garde nationale tendant à lui faire baisser ou déposer les armes est un cri de sédition et sera puni d’un emprisonnement qui ne pourra excéder deux années.
« Le présent décret sera imprimé et envoyé dans tous les départements. »
Pétion était monté à la tribune ; mais, à sa vue, une grande agitation s’était produite comme s’il était responsable du sang versé la veille. « Aux voix ! » criait l’Assemblée. Ceux qui ont vu ces sortes de déchaînements savent qu’il faut du courage à un orateur pour affirmer sa pensée contre la violence de l’orage. Pétion parla : « Le moment dans lequel je parle est peu favorable à l’opinion que je vais défendre. Je la défendrai cependant avec la plus intime conviction. Je dis que le premier article du projet des Comités, dans la partie que je vais exposer à l’Assemblée, est très funeste à la liberté de la presse. » (Rires ironiques.)
À gauche : « Oui ! funeste à Marat, Brissot, Laclos, Danton ! »
Pétion reprend : « Il est des expressions dans cet article à l’aide desquelles on pourrait rendre des jugements très arbitraires. (Applaudissements à l’extrême gauche.) Vous n’avez pas cru sans doute que mon dessein était de m’élever contre la totalité de l’article : du moins on n’a pas dû le croire ». (Murmures.)
Ainsi, Pétion, dès les premiers mots, se dérobait à la bataille. Il se borna à demander que le mot formellement fût joint au mot provoqué. Le rapporteur y consentit, et, avec cette addition, Pétion vota la loi nouvelle. Le torrent de réaction bourgeoise emportait tout.
Robespierre, menacé, chercha un abri chez le menuisier Duplay, rue Saint-Honoré. Desmoulins se cacha. Danton, pour plusieurs semaines, passa en Angleterre. Il y eut un moment ce que M. Robinet appelle « une Terreur constitutionnelle », ce que M. Aulard appelle « une petite Terreur bourgeoise ».
L’Assemblée, achevant dans un sens conservateur la révision de la Constitution, réprima, par une loi, les « calomnies » de la presse contre les fonctionnaires publics. Et elle remania, au profit des possédants, la loi du cens électoral. La loi d’éligibilité, qui exigeait quarante marcs d’argent d’impôt des députés, gênait la bourgeoisie ; elle écartait des fonctions publiques un certain nombre de bourgeois instruits et pauvres. Et elle n’offrait aux principes conservateurs qu’une médiocre garantie. Le Comité de Constitution demanda l’abolition du décret du marc d’argent ; toute condition de cens était supprimée pour l’éligibilité. Mais en même temps il élevait de beaucoup le cens électoral : les électeurs, c’est-à-dire ceux qui étaient choisis par les assemblées primaires pour désigner les députés, devaient, dans le nouveau projet, payer, non plus dix journées de travail d’impôt, mais quarante journées. Des députés de campagne, notamment Dauchy, remarquèrent qu’à ce taux il n’y aurait presque plus d’électeurs dans les campagnes. L’Assemblée modifia le système et elle décida enfin que pour faire partie de l’assemblée électorale, il faudrait « être propriétaire ou usufruitier d’un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail dans les villes au-dessus de 6,000 âmes ; de cent cinquante journées dans les villes au-dessous de 6,000 âmes et dans les campagnes ; ou encore être locataire d’une habitation évaluée sur les mêmes rôles à un revenu égal à la valeur soit de cent cinquante, soit de cent journées de travail, selon la population des villes ; ou, enfin, être métayer ou fermier de biens évalués à un revenu de quatre cents journées de travail ». C’était une restriction considérable du nombre de ceux qui pouvaient être choisis comme électeurs. Les assemblées primaires restaient composées de citoyens ne payant que trois journées de travail, mais elles ne pouvaient choisir les électeurs du second degré que dans une catégorie assez restreinte. L’Assemblée constituante s’éloignait de la démocratie ; elle se rapprochait de la politique des classes moyennes.
Ce système électoral ne pouvait être appliqué aux élections de 1791, pour lesquelles les rôles étaient dressés déjà d’après les premières bases constitutionnelles déterminées en 1789 ; et de fait il ne sera jamais appliqué. Mais il caractérise bien l’état d’esprit « bourgeois » qui se développait de plus en plus dans la Constituante. Barnave fut le théoricien des classes moyennes dans tout ce débat. Son grand discours du 11 août 1791 est vraiment le manifeste de la bourgeoisie censitaire, un premier essai du doctrinarisme à la Guizot. En ces journées de pensée féconde, presque toutes les conceptions qui devaient pendant un siècle soutenir la lutte des partis et des classes se faisaient jour. Aux manifestes démocratiques et républicains de Condorcet et des Cordeliers s’opposait la thèse bourgeoise et doctrinaire de Barnave. Il commence par formuler la théorie que reprendra plus tard Royer-Collard : « Le vote n’est pas un droit ; c’est une fonction. »
« La qualité d’électeur, dit Barnave, n’est qu’une fonction publique à laquelle personne n’a droit et que la société dispense ainsi que le prescrit son intérêt….. La fonction d’électeur (du second degré) n’est pas un droit ; c’est encore une fois pour tous que chacun l’exerce ; c’est pour tous que les citoyens actifs nomment les électeurs ; c’est pour la société entière qu’ils existent ; c’est à la société entière qu’il appartient de déterminer les conditions avec lesquelles on peut être électeur ; et ceux qui méconnaissent profondément la nature du gouvernement représentatif, comme ses avantages, viennent sans cesse nous mettre sous les yeux les gouvernements d’Athènes et de Sparte. Indépendamment de la différence de population, d’étendue, ont-ils donc oublié que la démocratie pure n’exista dans ces petites Républiques, qu’elle n’exista dans Rome, au déclin de sa liberté, que par une institution plus vicieuse que celle qu’on peut reprocher au gouvernement représentatif ? Ont-ils donc oublié que les Lacédomoniens n’avaient le droit de voter dans les assemblées publiques que parce que les Lacédomoniens avaient des ilotes, et que c’est en sacrifiant non pas les droits politiques, mais les droits individuels de la plus grande partie de la population du territoire, que les Lacédémoniens, les Romains eux-mêmes, avaient mis la démocratie pure à la place du gouvernement représentatif, encore inconnu dans cet âge du monde ?
« Je demande à ceux qui veulent mettre en comparaison ces gouvernements et le nôtre, s’ils veulent à ce prix acheter la liberté ? » (Applaudissements.)
Étrange thèse et puérile. Comme s’il était nécessaire de rétablir l’esclavage pour donner à tous les citoyens de la France nouvelle le droit de figurer parmi les électeurs du second degré !

(D’après une estampe du Musée Carnavalet).
Un an exactement après ce discours de Barnave, le lendemain du 10 août 1792 la Législative, sous la poussée populaire, instituait le Suffrage universel à deux degrés. Il suffira d’un mouvement du peuple pour renverser les savants systèmes historiques de Barnave, comme il suffira en février 1848 d’un mouvement du peuple pour renverser les savants systèmes historiques de Guizot.
Barnave poursuit : « Les trois moyens de liberté, les trois gages (lumière, intérêt à la chose publique, indépendance de la fortune) que les assemblées électorales pensent donner à la nation, et aux électeurs qui la composent, je ne les cherche pas dans la classe supérieure ; car c’est là sans doute qu’avec l’indépendance de fortune on trouverait trop facilement des motifs individuels, un intérêt particulier d’ambition séparé de l’intérêt public, et des moyens de corruption qui pour être différents de ceux du besoin, n’en sont souvent que plus alarmants pour la liberté.
« Mais s’il est vrai que ce n’est pas dans les classes supérieures que se trouvent le plus généralement les trois garanties, il est également vrai que ce n’est pas dans la classe des citoyens qui, obligés immédiatement et sans cesse, par la nullité absolue de leur fortune, de travailler pour leurs besoins, ne peuvent acquérir aucune des lumières nécessaires pour faire les choix, n’ont pas un intérêt assez puissant à la conservation de l’ordre social existant, étant enfin sans cesse aux prises avec le besoin et étant chaque jour, par l’absence d’un moment de travail, réduits aux dernières extrémités, offriraient par là même à la corruption de la richesse un moyen trop facile de s’emparer des élections. C’est donc dans la classe moyenne qu’il faut chercher des électeurs, et je demande à tous ceux qui m’écoutent, si c’est une contribution de 10 journées de travail qui constitue cette classe moyenne, et qui peut assurer à la société un degré certain de sécurité. »
Barnave, découvrant toute sa pensée, déclare qu’il ne redoute pas précisément les prolétaires. Ceux-ci étaient à ce moment trop faibles, trop peu conscients de leur intérêt de classe pour effrayer directement la bourgeoisie possédante.
Ce que Barnave redoute, ce sont, si l’on peut dire, les nouvelles couches bourgeoises, cette bourgeoisie pauvre, avide et ambitieuse qui pour se créer un rôle prolongera la Révolution, agitera les éléments populaires qui sans elle resteraient passifs.
C’est la haine contre Brissot et sa suite, c’est la peur des libellistes qui anime Barnave. Écoutez-le, comme sa parole est âpre ! « Il se glisse cependant dans les assemblées électorales une espèce d’hommes qui n’ont pas les qualités que vos comités voudraient exiger, mais qui est bien loin d’appartenir à cette classe pure d’artisans et d’agriculteurs que je verrais avec autant de plaisir que tout autre dans les assemblées électorales. Parmi les électeurs qui sont choisis sans payer 30 ou 40 journées de travail, ce n’est pas l’ouvrier sans crédit, ce n’est pas le laboureur, ce n’est pas l’artisan honnête et incessamment adonné aux travaux que ces besoins nécessitent qui va exercer la fonction d’électeur, ce sont quelques hommes animés, poussés par l’intrigue, qui vont colportant dans les assemblées primaires la turbulence et le désir de changement dont-ils sont intérieurement dévorés ; ce sont des hommes qui, par la même raison qu’ils n’ont rien et qu’ils ne savent pas trouver dans un travail honnête la subsistance qui leur manque, cherchent à créer un nouvel ordre de choses, qui puisse mettre l’intrigue à la place de la probité, un peu d’esprit à la place du bon sens, et l’intérêt particulier et toujours actif à la place de l’intérêt général et stable de la société. (Vifs applaudissements.)
« Si je voulais appuyer par des exemples la proposition que je viens d’énoncer, je n’irais certainement pas les chercher fort loin, je demanderais aux membres de cette Assemblée qui ont soutenu l’opinion contraire : Ceux des membres électoraux qui vous sont connus, qui sont tout près de nous, ceux qui ne payent pas 30 ou 40 journées de travail, sont-ils des ouvriers ? Non. Sont-ils des cultivateurs ? Non. Sont-ils des libellistes ? Sont-ils des journalistes ? Oui ! (Vifs applaudissements.)
« Dès que le gouvernement est déterminé, dès que par une Constitution établie, les droits de chacun sont réglés et garantis (c’est le moment auquel j’espère que nous allons toucher) alors il n’y a plus qu’un même intérêt pour les hommes qui vivent de leurs propriétés et pour ceux qui vivent d’un travail honnête : alors il n’y a plus dans la société que deux intérêts opposés, l’intérêt de ceux qui veulent conserver l’état de choses existant parce qu’ils voient le bien être avec la propriété, l’existence avec le travail, et l’intérêt de ceux qui veulent changer l’état de choses existant parce qu’il n’y a de ressources pour eux que dans une alternative de révolution, parce qu’ils sont des êtres qui grossissent et grandissent pour ainsi dire dans les troubles comme les insectes dans la corruption ! » (Vifs applaudissements.)
Ces habiles et violentes paroles flattaient les passions conservatrices de la bourgeoisie révolutionnaire. Elles étaient couvertes d’acclamations, mais quel sophisme ! Est-ce parce que, en ce moment, les artisans, les ouvriers, les laboureurs, ne choisissaient point parmi eux les électeurs du second degré, qu’il fallait leur fermer à jamais l’accès des assemblées électorales ? Et que signifient ces dédains, ces outrages pour la bourgeoisie pauvre, ambitieuse à coup sûr, qui remuait des couches plus profondes de démocratie ? Barnave a-t-il donc oublié que trois ans plus tôt ce n’étaient pas les artisans, les laboureurs, qui rédigeaient eux-mêmes leurs cahiers mais qu’ils empruntaient la plume et les passions mêmes de la petite bourgeoisie de campagne ?
Il y a dans cette colère de l’inquiétude. La bourgeoisie révolutionnaire modérée sait que, malgré tout, son œuvre est instable, que sa combinaison savante des pouvoirs est minée sourdement, d’un côté par le mauvais vouloir du roi, de l’autre par le mouvement démocratique : et elle témoigne une extrême nervosité.
Barnave donnait à ces sentiments de la majorité de la gauche une expression passionnée. Le 15 août, un député, Guillaume, ayant dit que la Constitution revisée présentait des lacunes, Barnave présenta avec véhémence la défense des Comités : « Une autre classe à la vérité, s’est montrée opposée à notre travail, mais quelle était cette classe ?
« Je la divise en deux espèces très-distinctes, l’une est celle des hommes qui dans l’opinion intime de leur conscience donnent la préférence à un autre gouvernement, au gouvernement républicain, qu’ils déguisent plus ou moins dans leurs opinions, mais qui, lors même qu’ils l’abandonnent, reviennent toujours, dans le détail, aux principes de ce gouvernement-là et cherchent à enlever à notre Constitution monarchique tout ce qui pourrait éloigner des résultats qu’ils désirent.
« Je déclare que, quant à ceux-là, je ne les attaque point ; quiconque a une pensée sincère, une opinion politique pure, comme pour la plupart je les en crois parfaitement capables, a le droit de l’énoncer. Chacun a sa façon de voir ; c’est l’opinion de la majorité qui fait la loi. Mais il s’est élevé une autre classe de personnes contre notre travail ; et celle-là, ce n’est pas à raison de ses opinions politiques qu’elle s’est montrée opposante, ce n’est pas parce qu’elle aime mieux la République que la monarchie, la démocratie que l’autocratie, c’est parce qu’elle ne veut aucune espèce de gouvernement ; c’est parce que tout ce qui fixe la machine politique, tout ce qui est l’ordre public, tout ce qui rend à chacun ce qui lui appartient, tout ce qui met à sa place l’homme probe et l’homme honnête, l’homme improbe et le vil calomniateur, lui est odieux et contraire. » (On applaudit à plusieurs reprises dans la très-grande majorité de la partie gauche.)
L’extrême gauche, encore affaiblie et ébranlée par la journée du 17 juillet laissait passer l’orage. Robespierre se bornait à des interventions de détail. Mais peu à peu, aidé par Pétion, il raffermissait les Jacobins, retenait les sociétés affiliées, et il n’attendait qu’une occasion de frapper sur ses adversaires un grand coup en les accusant de faire le jeu de la Cour, en insinuant qu’ils avaient revisé la Constitution pour lui être agréables. Il éclata dans la séance du 1er septembre.
Le vote des lois constitutionnelles était terminé. Il s’agissait de soumettre l’ensemble de la Constitution à l’acceptation du roi. Plusieurs députés exprimaient l’espoir que le roi l’accepterait en effet. Robespierre s’écria avec sarcasme qu’il serait vraiment étrange que le roi n’agréât pas une Constitution où tant de remaniements avaient été faits pour lui plaire. « C’est bien le moins, ajouta-t-il, qu’on nous assure la possession des débris qui nous restent de nos premiers décrets. »
Et haussant le ton jusqu’à la menace révolutionnaire : « Si on peut attaquer encore notre Constitution après qu’elle a été arrêtée deux fois, que nous reste-t-il à faire ? reprendre ou nos fers, ou nos armes. » Cette sorte d’appel à l’insurrection témoigne que Robespierre avait repris confiance en sa force et que la période « de terreur bourgeoise » ou, pour parler plus exactement, de terreur feuillantiste était passée.
L’Assemblée s’indigna comme si Robespierre appelait de nouveau le peuple au Champ-de-Mars, et pour une action plus décisive. Duport, le théoricien, ami de Barnave, s’emporta, dit-on, jusqu’à le menacer.
Ou du moins, Robespierre interpréta son geste comme un outrage. « Je vous prie, Monsieur le Président, de dire à M. Duport de ne pas m’insulter s’il veut rester auprès de moi. » Soutenu par l’extrême gauche, qui se réveillait de son silence effrayé et par les tribunes, Robespierre faisant allusion à une brochure récente de Duport, accable son adversaire d’insinuations terribles. « Je ne présume pas, qu’il existe dans cette assemblée un homme assez lâche pour transiger avec la Cour sur aucun article de notre Code constitutionnel, assez perfide pour faire proposer par elle des changements nouveaux que la pudeur ne lui permettrait pas de proposer lui-même, assez ennemi de la patrie pour chercher à discréditer la Constitution parce qu’elle mettrait quelque borne à son ambition, ou à sa cupidité, assez imprudent pour avouer aux yeux de la nation qu’il n’a cherché dans la Révolution qu’un moyen de s’agrandir et de s’élever ; car je ne veux regarder certain écrit et certain discours qui pourraient présenter ce sens que comme l’explosion passagère du dépit déjà expié par le repentir. »

(D’après un document des Archives nationales.)
Cette fois, c’est Duport et Barnave qui gardèrent le silence. Mirabeau ne serait point resté immobile et muet sous de tels outrages et de si dangereuses accusations. Barnave n’avait-il donc point un suffisant ressort ? ou bien était-il en effet comme interdit par ses relations secrètes avec la Cour ? Sentait-il lui-même le péril que si âprement Robespierre dénonçait ?
La Constitution fut portée au roi le 3 septembre par une députation de soixante membres ; le roi l’accepta le 13 et le lendemain 14, il vint une fois de plus jurer fidélité à la nation et à la loi. Il y eut des fêtes dans Paris. Au même moment continuait la correspondance secrète de la famille royale avec Fersen et les cours étrangères.
Celles-ci, effrayées par les événements de Varennes et commençant à redouter la propagande révolutionnaire, s’engageaient par de mystérieuses conventions sur le chemin de la guerre. Le 27 août, à Pilnitz, l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse signaient une déclaration fameuse qui est le premier acte officiel de la coalition contre-révolutionnaire : « Sa Majesté l’Empereur et Sa Majesté le roi de Prusse ayant entendu les désirs et les représentations de Monsieur et de M. le comte d’Artois, se déclarent conjointement qu’elles regardent la situation où se trouve actuellement le roi de France comme un objet d’un intérêt commun à tous les souverains de l’Europe. Elles espèrent que cet intérêt ne peut manquer d’être reconnu par les puissances dont le secours est réclamé et que, en conséquence, elles ne refuseront pas d’employer, conjointement avec leurs dites Majestés, les moyens les plus efficaces relativement à leurs forces, pour mettre le roi de France en état d’affermir, dans la plus parfaite liberté, les bases d’un gouvernement monarchique également convenable aux droits des souverains et au bien-être de la nation française. Alors et dans ce cas, leurs dites Majestés, l’Empereur et le roi de Prusse, sont résolues d’agir promptement d’un mutuel accord, avec les forces nécessaires, pour obtenir le but proposé en commun.
« En attendant, elles donneront à leurs troupes les ordres convenables pour qu’elles soient en état de se mettre en activité.
« A Pilnitz, le 27 août 1791.
« Sire, notre Seigneur et frère, lorsque l’Assemblée qui vous doit l’existence à l’indignité de vous tenir captif au milieu de votre capitale ajoute la perfidie de vouloir que vous dégradiez votre trône de vos propres mains, nous nous empressons d’apprendre à Votre Majesté que les puissances dont nous avons réclamé pour elle les secours sont déterminées à y employer toutes leurs forces… Dans votre malheur, Sire, vous avez la consolation de voir toutes les puissances coopérer à les faire cesser, et votre fermeté, dans le moment critique où vous êtes, aura pour appui l’Europe entière. Les intentions des souverains qui vous donneront des secours sont aussi droites que le zèle qui nous a fait les solliciter. Le but des puissances confédérées n’est que de soutenir la partie saine de la nation contre la partie délirante, et d’éteindre au sein du royaume le volcan du fanatisme dont les éruptions propagées menacent tous les empires… Tout Paris doit savoir que si une scélératesse fanatique ou soudoyée osait attenter à vos jours ou à ceux de la reine, des armées puissantes chassant devant elles une milice faible viendraient aussitôt fondre sur la ville qui aurait attiré sur elle la vengeance de l’univers… Nous devons cependant vous annoncer que, si des motifs qu’il nous est impossible d’apercevoir forçaient votre main de souscrire une acceptation que votre cœur rejette, nous protesterions pour vous-même, Sire, en protestant pour vos peuples, pour la religion, pour les maximes fondamentales de la monarchie et pour tous les ordres de l’État. Nous obéirons, Sire, à vos véritables volontés en résistant à des défenses extorquées et nous serons sûrs de votre approbation en suivant les lois de l’honneur.
« Au château de Schœnburnstast, près Coblentz, le 10 septembre 1791. »
C’est une lettre insensée. On ne pouvait jouer plus témérairement avec la vie du roi, que ces menaces furibondes pouvaient mettre en péril. Et, pour le roi même, la lettre était offensante. Les princes lui reprochaient en somme comme une lâcheté, l’acceptation éventuelle de la Constitution : ils déclaraient n’en pas apercevoir les motifs. Et ils jetaient sur cette acceptation qui, même hypocrite, ne pouvait servir le roi qu’à condition de paraître sincère, un soupçon public de fraude. Bouillé, après Varennes, avait déjà écrit à l’Assemblée une lettre délirante et sans dignité, où il appelait les Français brigands et anthropophages et les menaçait de la destruction par les armes de l’étranger.
Qu’allait dire Paris cette fois de cette nouvelle menace, lancée par les frères mêmes du roi ? Louis XVI fut pris d’épouvante, et il essaya de détourner le coup en adressant au baron de Breteuil une lettre publique : « Je suis informé, Monsieur le baron de Breteuil, que mon très cher frère, Monsieur, comte de Provence, trompé sur ma véritable situation et me croyant dans les chaînes, a cru devoir établir une autorité centrale destinée à régir mon empire, comme si le trône était vacant ou en minorité. Les choses, avec la permission de Dieu, ne sont point ainsi ; à quelques orages près, je jouis de la liberté nécessaire à un prince, et moi seul dois donner des ordres dans mon État. Vous voudrez donc bien, Monsieur le baron de Breteuil, dès la réception de la présente, vous transporter à Vienne, auprès de notre puissant et cher frère l’Empereur, pour lui communiquer nos intentions. Vous agirez de même auprès de toutes les têtes couronnées pour les supplier de ma part en mon nom de n’admettre ni reconnaître la susdite régence. Les actes de cette autorité contradictoire n’aboutiraient qu’à irriter davantage mon peuple et le porteraient infailliblement aux derniers excès contre moi. »
C’est le cri de la peur : mais la peur, du moins depuis Varennes, avait-elle assagi Louis XVI ? L’avait-elle décidé enfin à accepter sans arrière-pensée de résistance et de trahison la Constitution à laquelle il allait jurer fidélité ? Il continue au contraire ses négociations obscures et son double jeu : toujours redoutant les imprudences des émigrés et des princes, mais toujours sollicitant le secours de l’étranger.
Dès le 27 juin, peu de jours après Varennes, Fersen écrit de Bruxelles à Marie-Antoinette une lettre chiffrée : « Le malheur qui vient d’arriver doit changer entièrement la marche des affaires, et si l’on persiste dans la résolution où l’on était, de faire agir pour soi, ne le pouvant plus soi-même, il est nécessaire de recommencer les négociations et de donner à cet effet un plein pouvoir. Il faut que la masse des puissances qui agira soit assez forte pour en imposer et préserver ainsi des jours précieux. Voici les questions auxquelles on doit répondre :
« 1o Veut-on qu’on agisse malgré toutes les défenses qu’on serait dans le cas de recevoir ?
« 2o Veut-on donner les pleins pouvoirs à Monsieur ou au comte d’Artois ?
« 3o Veut-on qu’il emploie sous lui le baron de Breteuil ou confie-t-on à M. de Calonne, ou veut-on lui en laisser le choix ? »
Et Fersen adresse au roi une « forme des pleins pouvoirs », qui aurait été l’abdication de Louis XVI aux mains de ses frères.
« Étant détenu prisonnier dans Paris, et ne pouvant plus donner des ordres nécessaires pour rétablir l’ordre dans mon royaume, pour rendre à mes sujets le bonheur et la tranquillité, et recouvrer mon autorité légitime, je charge Monsieur et à son défaut le comte d’Artois, de veiller pour moi à mes intérêts et à ceux de ma couronne, donnant à cet effet des pouvoirs illimités ; j’engage ma parole royale de tenir religieusement et sans restriction tous les engagements qui seront stipulés avec lesdites puissances : et je m’engage à ratifier dès que je serai en liberté tous les traités, conventions ou autres pactes qu’il pourrait contracter avec les différentes puissances qui voudront bien prendre ma défense ; de même, toutes les commissions, brevets ou emplois que Monsieur aurait cru nécessaire de donner, ce à quoi je m’engage, foi de roi. Fait à Paris, ce vingt juin mil sept cent quatre-vingt-onze. »

(D’après une estampe du Musée Carnavalet.)
« Ce plein pouvoir sera écrit en encre blanche et remis le plus tôt possible à la personne qui remettra cette lettre. »
C’était l’aliénation de la monarchie et de la France elle-même au profit des princes. Louis XVI ne se résigna point à aller jusque-là : et il adressa à ses frères, le 7 juillet, une lettre de confiance, non pas un blanc-seing absolu : « Je m’en rapporte absolument à la tendresse de mes frères pour moi, à leur amour et à leur attachement pour leur patrie, à l’amitié des princes souverains mes parents et alliés, et à l’honneur et à la générosité des autres souverains pour convenir ensemble de la manière et des moyens à employer dans les négociations dont le but doit tendre au rétablissement de l’ordre et de la tranquillité dans le royaume ; mais je pense que tout emploi de forces… (des mots manquent) ; que, placé en arrière des négociations, je donne tout pouvoir à mes frères de traiter dans ce sens-là avec qui ils voudront et de choisir les personnes à employer dans ces moyens politiques. »
Quelles ambiguités ! quelles incertitudes ! quels appels de trahison réfrénés par la peur ! Et comme il eût été plus simple et plus sage, aussi bien que plus honnête, d’accepter loyalement l’œuvre constitutionnelle de la France ! La reine, commentant cette lettre du roi, écrit à Fersen à la même date du 8 juillet, pourquoi on ne peut donner les pleins pouvoirs absolus : « Le roi pense que la prison resserrée où il est retenu et l’état de dégradation totale où l’Assemblée nationale a porté la royauté, en ne lui laissant plus exercer aucun acte quelconque, est assez connu des puissances étrangères pour qu’il soit besoin de l’expliquer ici. »
« Le roi pense que c’est par la voie des négociations seules que leur secours pourrait être utile à lui et à son royaume ; que la démonstration des forces ne doit être que secondaire, et si l’on se refusait ici à toute voie de négociation. »
« Le roi pense que la force ouverte, même après une première déclaration, serait d’un danger incalculable, non seulement pour lui et sa famille, mais même pour tous les Français qui dans l’intérieur du royaume ne pensent pas dans le sens de la révolution. Il n’y a pas de doute qu’une force étrangère ne parvienne à entrer en France, mais le peuple armé, comme il est, en fuyant les frontières et les troupes du dehors, se servirait dans l’instant de leurs armes contre ceux de leurs concitoyens que depuis deux ans on ne cesse de leur faire regarder comme leurs ennemis.
« Le roi pense qu’un plein pouvoir illimité tel qu’il est composé, même en le datant du 20 de juin, serait dangereux pour lui, dans l’état où il se trouve. Il est impossible qu’il ne fût pas communiqué, et tous les cabinets ne sont pas également secrets. »
« On annonce que d’ici à quinze jours les articles regardés comme constitutionnels seront présentés au roi, qu’alors on le mettra en liberté, le laissant maître d’aller où il voudra, pour qu’il se décide à les accepter, oui ou non, mais en gardant son fils, ce qui rendrait la liberté illusoire. On doit regarder tout ce qui s’est fait depuis deux ans comme nul, quant à la volonté du roi, mais impossible à changer, tant que la grande majorité de la nation sera pour les nouveautés. C’est à faire changer cet esprit qu’il faut tourner toute notre application. »
« Résumé : Il désire que la captivité du roi soit bien constatée et bien connue des puissances étrangères ; il désire que la bonne volonté de ses parents, amis et alliés et des autres souverains, qui voudraient y concourir, se manifestât par une manière de Congrès où on employât la voie des négociations, bien entendu qu’il y eût une force imposante pour les soutenir ; mais toujours assez en arrière pour ne pas provoquer au crime et au massacre.
« Le roi ne croit pas devoir ni pouvoir donner un plein pouvoir illimité, mais il envoie ce papier écrit en blanc pour être remis à son frère. »
Ainsi la force des manifestations révolutionnaires après Varennes fait hésiter le roi et la reine : ils n’osent plus appeler le secours des armes étrangères de peur d’être massacrés par le peuple. Mais ils ne se résignent pas à la Constitution : ils font constater officiellement leur captivité pour pouvoir désavouer ensuite devant le monde le serment prêté à la loi nouvelle.
Ils désirent que les puissances étrangères pèsent sur la France, mais par une intervention prudente et en dissimulant leurs armées derrière un rideau de Congrès et de diplomatie. Mais ils se placent par là dans une situation tout à fait fausse.
En se déclarant prisonniers ils autorisent les princes à dépasser leurs instructions, et la fougue de ceux-ci, leur zèle immodéré ou égoïste les compromettent à tout instant. À vrai dire, même après Pilnitz, les étrangers attendent encore et se réservent. Seul le roi de Suède, ayant recueilli Bouillé à sa Cour, médite des entreprises aventureuses contre la France : il rêve de réunir une flotte dans la Manche, et de débarquer des troupes en Normandie. Mais nul en Europe ne le prend au sérieux : il avait demandé, pour ses projets de rassemblement naval, la bienveillance de l’Angleterre : le roi Georges II, conseillé par ses ministres, se refusa par une lettre catégorique à toute démarche compromettante.
Il écrit le 13 août 1791, au roi de Suède : « Ma conduite par rapport aux troubles qui ont tant agité le royaume de France a été dirigée par les principes d’une neutralité exacte et parfaite, et jamais, dans aucune des occasions qui se sont élevées, je ne me suis départi de ce système.
« Je suis bien éloigné de vouloir m’immiscer dans les affaires intérieures de ce royaume, afin de profiter de ce moment de crise, ou pour en retirer les avantages que les circonstances pourraient m’offrir. Par une suite des mêmes principes, je suis dans l’intention de ne prendre aucune part aux mesures que les autres puissances de l’Europe pourront se trouver dans le cas d’adopter à ce sujet, ni en les secondant, ni en m’y opposant.
« Les vœux que je forme à cet égard tendent uniquement au bonheur de LL. MM. Très-Chrétiennes et de leurs sujets, et à l’établissement de la tranquillité et de l’ordre public dans ce royaume si voisin de mes États et avec lequel mes sujets ont des relations d’amitié et de commerce. Je verrai avec plaisir tout événement qui pourra contribuer à des objets si intéressants ; et si le nouvel ordre de choses paraissait présenter des conséquences qui pourraient influer sur les intérêts de mes sujets, je n’aurais aucune difficulté de m’expliquer ultérieurement là-dessus de la manière la plus franche avec les différentes puissances de l’Europe avec lesquelles j’ai le bonheur de vivre en paix et en bonne intelligence. »
Gustave III avait beau tourner et retourner cette lettre. C’était un refus catégorique. Et l’Angleterre, bien décidément, ne voulait pas à cette date se mêler des choses de France. D’ailleurs Fersen constatait l’irrésolution, les lenteurs de l’empereur Léopold lui-même. Et le 10 octobre, il écrit à la reine : « Je vous plains d’avoir été forcés de sanctionner, mais je sens votre position : elle est affreuse, et il n’y avait pas d’autre parti… L’Empereur est le moins voulant ; il est faible et indiscret ; il promet tout, mais son ministère, qui craint de se compromettre et voudrait éviter de s’en mêler, le retient surtout. »
Ainsi, dans cette période qui suit Varennes, tout est inconstant, incohérent et vague dans les conseils de l’Europe comme dans les conseils du roi. Dans la Révolution même il y a malaise et incertitude. Elle sent très bien que la volonté du roi reste une inconnue redoutable : et elle essaie en vain de se persuader que tout conflit avec la royauté est clos. Mais enfin aucun péril immédiat et précis ne menace l’œuvre révolutionnaire, et elle se dresse, édifice résistant et superbe, sous les grises et changeantes nuées. Sera-ce bientôt l’orage et la foudre ? Ou bien l’éternelle sérénité ?
Au moment où la Constituante se séparait, elle put, au plus profond de sa conscience, se rendre ce témoignage qu’elle avait fait un effort immense et que cet effort n’était pas vain. Les ordres étaient abolis, et l’Assemblée prochaine ne compterait plus que des représentants de la nation. Le système féodal était blessé à mort. L’arbitraire royal était aboli, et la loi, œuvre de la nation, expression de sa volonté, pouvait se transformer avec cette volonté même, se prêter aux nécessités toujours nouvelles des sociétés vivantes. Le conflit social entre la bourgeoisie et le prolétariat s’ébauchait, le conflit politique entre l’oligarchie bourgeoise et la démocratie était déjà aigu, mais toujours, entre bourgeois et prolétaires, l’union se refaisait aux grands jours de crise, quand la Révolution et la nation paraissaient menacées.
Dans les derniers mois de la Constituante, la tendance bourgeoise s’était affirmée avec une force particulière, et Barnave, dans son « Examen critique de la Constitution », en a justement souligné les éléments conservateurs. « J’ai fait les plus grands efforts lors de la révision pour faire augmenter le taux de contribution exigé de la part des électeurs, ainsi je ne dois pas être suspect en disant que le reproche d’avoir donné trop peu d’influence à la propriété a été extrêmement exagéré.
« Sur ce point comme sur beaucoup d’autres on a absolument confondu les effets de l’état révolutionnaire avec ceux de la constitution. Les riches propriétaires étant, pour la plupart, émigrés, ont prononcé contre le nouveau régime ; et ceux mêmes qui étaient demeurés paisibles, étant devenus suspects au milieu de la fermentation générale, un très-petit nombre ont été élus aux places et on en a conclu que la constitution les en excluait, ou, du moins, ne les y appelait pas assez. »
« Cependant une observation plus attentive prouve que dans le petit nombre de citoyens riches et même d’anciens nobles qui ont adopté le nouvel ordre de choses assez clairement pour écarter les soupçons, la plupart ont été élus aux premières places, et l’ont emporté à cet égard sur beaucoup d’autres citoyens qui, avec beaucoup plus de capacités n’avaient pas les mêmes avantages de fortune.
« D’ailleurs le deuxième degré d’électeurs, avec quelques inconvénients, a pleinement réparé le peu que la loi exigeait de propriété dans les électeurs.
2o A l’exception de deux ou trois départements, où la fermentation révolutionnaire a été excessive, et où des villes anarchiques ont donné la loi à la masse du département, les corps électoraux constitués avant le 10 août, quoiqu’ils eussent été composés au milieu des troubles, des soupçons, des haines que la Révolution a enfantés, ont été formés de la partie la plus saine et la plus recommandable de la société : la presque totalité de leurs membres avaient plus de propriété non seulement que la loi n’en exigeait pour conférer les droits électoraux, mais qu’aucune loi raisonnable ne pourrait en exiger.
« Chacun d’eux joignait à la garantie résultant de sa fortune celle de la considération publique que le choix des assemblées primaires suppose. Dans les campagnes surtout, à l’exception de quelques personnes fortement prononcées contre la Révolution, les principaux citoyens ont été choisis pour électeurs. »
Cette vue générale de Barnave confirme ce que nous a montré déjà l’analyse sociale de quelques municipalités : c’est que la moyenne et la grande bourgeoisie avaient en 1791 la direction du mouvement révolutionnaire. Et même quand le peuple renversait la vieille bourgeoisie privilégiée d’ancien régime, c’est à de nouvelles forces bourgeoises qu’il faisait appel. Ainsi Vadier déclare dans son rapport sur les troubles de Pamiers en 1790 : « La révolution ne pouvait donc s’opérer à Pamiers que par la sainte insurrection d’un peuple opprimé. Les choses demeurèrent dans cet état précaire jusques au décret sur l’organisation des municipalités. C’est alors seulement que le peuple se mit à son aise, et qu’il usa de l’intégrité de ses droits. Au lieu de nommer ses sangsues ordinaires, ces vampires et ces frelons rapaces qui dévoraient depuis longtemps sa substance ; au lieu d’élire ceux qu’on appelait si improprement chapeaux noirs et gens comme il faut, il prit ses municipaux dans son propre sein et dans tous les états ; il jeta les yeux sur ceux qui avaient montré le plus d’ardeur pour la Révolution et qui avaient suivi les bannières de la liberté. »
Mais ce n’étaient pas à proprement parler des prolétaires. Vadier lui-même possédait environ trois cent mille livres de biens fonciers, et l’aristocratie exaspérée essaya de prendre la revanche contre les bourgeois de la Révolution en prêchant à Pamiers, dès 1790, une sorte de loi agraire. La prédominance politique et sociale de la bourgeoisie à cette date est donc incontestable.
Mais la Constitution n’était pas rigide : elle pouvait s’assouplir dans le sens de la démocratie. La vie municipale surtout créait quelques foyers populaires ardents, dont le rayonnement pouvait pénétrer peu à peu toute la nation. Les sections de Paris travaillaient à élargir le droit de suffrage, à l’étendre à tous au moment même où la Constituante s’appliquait à le restreindre.
En juin 1791, quand Paris procéda, dans ses assemblées primaires, au choix des électeurs qui devaient nommer les députés, un mouvement très vif se produisit en plusieurs points pour le suffrage universel. Le 8 juin, la section de Sainte-Geneviève prit un arrêté portant qu’il serait nommé deux commissaires chargés de se réunir à ceux des autres sections pour rédiger, en se servant du discours de Robespierre, une pétition contre les distinctions de classes. (Voir Mellié : les sections de Paris.) La section des Gobelins fit une pétition dans le même sens.
La section du Louvre, le 25 juillet 1791, rédige une adresse sur la « nécessité de donner le droit de citoyen actif à tous les citoyens qui paient même la plus légère contribution, attendu leurs justes murmures de n’être comptés pour rien dans l’Empire, tandis qu’ils servent la patrie par leurs bras, par leurs femmes et leurs enfants ; mais de priver de cet avantage tous citoyens connus pour être de mauvaise conduite, accapareurs, agioteurs, de les laisser juger par leurs pairs dans les assemblées mêmes et exclure d’icelles ». Ainsi, dans les sections ardentes, c’étaient les « accapareurs », c’est-à-dire évidemment des bourgeois, qui devenaient les citoyens passifs. Marat dressait et publiait, quartier par quartier, la liste des mauvais patriotes qui devaient être écartés des assemblées.
La section du Théâtre-Français ne se bornait pas à pétitionner pour le suffrage universel. Elle l’instituait elle-même, dans ses limites, par un acte révolutionnaire. Déjà, le 23 juin, elle avait décidé d’ouvrir les assemblées primaires à tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans et domiciliés, et elle avait effacé du serment le mot actif. Elle renouvela solennellement cet arrêté le 27 juillet, et elle abolit dans son sein la distinction de citoyens actifs et de citoyens passifs. À coup sûr, ces décisions révolutionnaires se heurtaient à la loi générale, à la Constitution, et elles ne tardaient pas à être réprimées. Mais je veux marquer la force des poussées démocratiques qui se produisaient et qui, dans une longue période de liberté et de paix, auraient sans doute neutralisé les tendances censitaires de la bourgeoisie. La Constitution, en même temps qu’elle assurait la prédominance bourgeoise, laissait aux forces populaires un assez libre jeu pour que l’avènement graduel de l’entière démocratie ne fût pas chimérique. Des germes de vie populaire abondaient dans la Constitution, malgré son caractère bourgeois, et cette complexité ajoutait singulièrement à sa puissance.
De plus, la vaste opération de finances entreprise par l’Assemblée avait réussi à merveille. Non seulement la vente des biens nationaux avait été rapide ; mais elle s’était faite à de hauts prix. Partout les adjudications avaient sensiblement dépassé les prix d’estimation. Dans sa substantielle et pénétrante étude sur la formation du département du Calvados, M. Le Brethon a donné le tableau des ventes avant le 1er août 1791. On y voit qu’à Caen les estimations avaient été de 6,114,230 livres ; les adjudications s’élevèrent à 8,227,429 livres, un quart en plus. À Bayeux, les estimations avaient été de 2,700,999 livres ; les adjudications s’étaient élevées à 4,945,011 livres. À Lisieux : estimations, 1,869,168 livres ; adjudications, 3,001,828 livres. À Falaise : estimations, 1,032,731 livres ; adjudications, 1,668,923 livres. À Vire : estimations, 865,928 livres ; adjudications, 1,389,735 livres. À Pont-l’Évêque : estimations, 1,703,382 livres ; adjudications, 2,538,991 livres. — Au total, les estimations avaient été, pour les ventes effectuées jusqu’au 1er août 1791, de 15,358,450 livres ; les adjudications avaient été de 21,771,128 livres : un quart en sus, et même un peu plus. C’était pour la Révolution un véritable triomphe. L’élan continua, et, six mois plus tard, d’après le relevé des ventes du premier trimestre de 1792, M. Le Brethon dresse ce tableau :
| En décembre 1791. . | Estimation, | 657,950 l. ; | adjudication, | 982,782 l. |
| En janvier 1792. . . . | — | 730,115 l. ; | — | 1,013,182 l. |
| En février 1792. . . . | — | 337,451 l. ; | — | 515,078 l. |
| En mars 1792. . . . . | — | 454,038 l. ; | — | 644,568 l. |
Ainsi, non seulement la Révolution recueillait d’abondantes ressources et pouvait attendre sans crise que le fonctionnement régulier du nouveau système d’impôts assurât son budget, mais ces ventes attestaient une foi absolue de la nation en la Révolution même. Devant ces résultats, la Constituante était fière de son œuvre, et, malgré la lassitude de travaux immenses, malgré l’âpreté croissante des divisions entre révolutionnaires, elle avait confiance dans le jugement de la postérité. Elle était fière surtout d’avoir pu accomplir cette révolution immense dans un calme presque complet, que même le grand drame de la fuite du roi n’avait pu troubler. Calme si profond, que l’activité économique du pays s’était développée à un degré inconnu jusque-là.
La nation entière tressaillit d’une émotion presque sacrée lorsque Thouret, au nom du Comité de Constitution, termina la lecture de la Constitution par ces belles paroles, acclamées de l’Assemblée : « L’Assemblée nationale constituante remet le dépôt de la Constitution à la fidélité du Corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l’affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français. »
La Constituante peut se séparer : la liberté sainte est vraiment au cœur de la nation.
Mais moi, au moment où nous quittons la grande Assemblée, j’éprouve un trouble et presque un remords. Je me demande si j’ai assez marqué la force de pensée qui était en elle, l’action du grand esprit du xviiie siècle. Pour ne point forcer démesurément le cadre du récit, je n’ai pas commencé par exposer l’œuvre de Voltaire, de Montesquieu, de Jean-Jacques, de Diderot, de Buffon ; j’ai analysé surtout les causes économiques trop peu connues de la Révolution, la croissance des intérêts bourgeois. Je n’ai point rappelé avec une ampleur suffisante tout l’immense travail de pensée du xviiie siècle, et ainsi, je n’ai pas donné assez fortement l’impression qu’en tous les révolutionnaires cette pensée était présente et vivante. Pour bien comprendre ces hommes il aurait fallu, avant d’entrer avec eux dans l’orage des événements, vivre longuement avec eux dans la grande paix ardente de l’étude, dans les horizons silencieux et enflammés que leur ouvrait Jean-Jacques, dans les horizons infinis que leur ouvrait Buffon. Presque aucun des grands écrivains, des grands philosophes du siècle n’est mêlé, de sa personne, à la Révolution. Montesquieu, Voltaire, Diderot, Buffon, Rousseau sont morts depuis des années. Condorcet, le correspondant de Voltaire et de Turgot, le vaste et libre esprit, n’a pas encore la haute gloire que lui donneront son Essai sur le progrès, et sa mort. L’abbé Raynal, vieilli, fatigué, est le seul survivant des générations héroïques de la pensée, et morose, troublé par les désordres inévitables qui se mêlent à tout changement, il écrit à la Constituante une lettre de blâme écoutée dans un silence respectueux et irrité.
Mais si les grands penseurs du siècle ont disparu avant l’heure où leur pensée même va déterminer les événements, leur esprit est présent à tous les Constituants. Mirabeau portait dans son puissant cerveau toute l’œuvre du siècle. Robespierre, aux heures de lutte triste et de lassitude, relisait Jean-Jacques pour se réconforter. Barnave, malgré le tourbillon d’intrigue et de vanité où il se laissa emporter presque aussitôt, faisait retour parfois vers ses longues lectures méditatives de la première jeunesse, vers cette allée du jardin paternel où il lisait Werther pendant que le vent d’automne roulait des feuilles flétries.

(D’après un estampe du Musée Carnavalet.)
La plupart des Constituants étaient arrivés à Versailles avec une sorte d’inexpérience touchante de la vie « pratique » ; beaucoup ne connaissaient pas Paris, et c’est surtout pour s’assister les uns les autres, pour ne pas se perdre de vue dans la grande tourmente, qu’ils fondèrent les premiers clubs, notamment à Versailles, le club breton. Mais presque tous, dans la demi-solitude de leur province, ils avaient lentement accumulé les idées, les émotions, les rêves. C’est avec un accent admirable que Salle, dans une des premières séances de la Constituante, raconte ses longues angoisses : il ne pouvait se promener dans la campagne de France, sans se demander si ces paysans, ces laboureurs sauraient se réveiller enfin de leur torpeur séculaire et comprendre la liberté. Et une vision puissante de démocratie rurale, où les couleurs de Plutarque se fondaient avec les idées de Rousseau, obsédait son esprit. C’est cette force secrète de pensée et de rêve qui soutint toujours la Constituante et qui lui donna, dès les premières heures, une puissance grave, une autorité clairvoyante.
Cette Assemblée, toute neuve aux choses de la politique, sut, à peine réunie, déjouer toutes les manœuvres de la Cour. Pourquoi ? Parce qu’elle portait en elle quelques idées abstraites et grandes, fortement et longuement méditées, qui lui étaient une lumière. L’idée du droit de la nation, de la loi consentie par la volonté générale, l’idée du droit de l’homme supérieur aux prétentions des castes étaient entrées si avant dans les esprits qu’elles leur donnaient, si je puis dire, la sûreté de l’instinct, et que ces novices de l’action trouvaient soudain, dans leur foi profonde, des ressources merveilleuses d’habileté. Et aussi des ressources de courage. Nous ne nous représentons pas assez ce qu’il y eut d’héroïsme tranquille dans le serment du Jeu de Paume, et dans tant d’autres journées. Malgré nous, nous voyons les hommes de la Révolution dans la majesté de leur œuvre, et il nous semble, par une illusion étrange, que dès les premiers jours cette majesté les enveloppait et les protégeait ; mais le 20 juin 1789, les hommes des Communes n’étaient encore que les pauvres représentants contestés et bafoués du Tiers État. Ce n’était pas leur puissance d’action naissante à peine et incertaine encore, c’était la puissance sublime de l’esprit du siècle incorporé à chacun d’eux qui leur donnait cette audace tranquille en face de la Cour menaçante et des privilégiés insultants.
La pensée des Constituants était plus complexe et plus vaste que leur œuvre, car Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, avaient mis en eux des tendances multiples dont quelques-unes seulement purent être réalisées ; parmi tous les germes semés en ces esprits quelques-uns seulement se développèrent d’abord, d’autres, plus profondément enfouis, attendaient une heure plus favorable et une saison plus ardente pour éclore et percer. Que de conflits secrets et douloureux durent se produire dans les consciences ! Quand on discutait la Déclaration des droits de l’homme, fallait-il se livrer tout entier à la logique du droit humain et aller jusqu’à la démocratie républicaine, ou fallait-il transiger avec la royauté, avec les nécessités historiques ? C’est à un compromis entre l’idée et le fait que la Constituante se fixa un moment ; mais qui ne sentait en elle que cet équilibre était instable ?
Plus tard, après Varennes, les esprits, qui se croyaient comme assurés dans une Constitution moyenne, semi-monarchique, semi-populaire, durent entrevoir, comme en un éclair, la possibilité, la nécessité même d’un ordre nouveau, tout démocratique et républicain. Et sans doute Montesquieu et Jean-Jacques se heurtaient dans les intelligences. C’est la solution moyenne et transactionnelle qui l’emporta encore une fois mais la logique inquiète de l’idée réclamait sourdement dans les esprits, et la Constituante, à l’heure même où elle organisait, selon des lois tempérées et un équilibre complexe le monde nouveau pressentait confusément la naissance d’un ordre plus systématique, plus passionné, où la volonté du peuple serait portée à son expression suprême. Les luttes tragiques de la Révolution et de l’Europe feront jaillir ce système de démocratie ; mais il était déjà tout au fond de la pensée des Constituants, et il ne faut pas oublier que beaucoup des hommes de la Constituante n’eurent pas besoin de se transformer pour aller à la Convention : il leur suffit de laisser agir en eux la logique profonde de leurs idées premières que tout d’abord le poids des traditions historiques avait à demi comprimées.
Dans la conscience de la Constituante, on pourrait démêler, en y regardant bien, à côté de la joie grave et forte d’avoir vraiment créé un monde nouveau, je ne sais quelle mélancolie d’avoir retranché beaucoup des hardiesses de l’idée, et déjà on pressent, en ces esprits modérés et sévères le germe encore obscur d’une œuvre plus audacieuse. Sous la majesté mesurée et sereine de la première œuvre révolutionnaire, on démêle, pour emprunter une belle expression de Mlle de Lespinasse « l’âme de douleur et de feu » d’une Révolution nouvelle.
Ainsi apparaissent les limites de ce qu’on a appelé la méthode « marxiste » en histoire. La conception du matérialisme économique qui explique les grands événements par les rapports des classes est un guide excellent à travers la complication et la confusion des faits, mais elle n’épuise pas la réalité de l’histoire.
D’abord, il est à peine besoin de dire qu’elle ne nous donna pas la clef des diversités individuelles. Pourquoi, par exemple, Robespierre fut-il le théoricien fanatique de la démocratie, tandis que Barnave était le théoricien brillant de la bourgeoisie ? Pourquoi Robespierre avait-il une sorte d’adoration pour Jean-Jacques et pourquoi Barnave écrivait-il de lui qu’il avait rendu fous bien des hommes qui, sans lui, n’auraient été que des sots ? Et ce n’est pas seulement l’action, la pensée des hommes éclatants qui ne peut s’expliquer tout entière, à un moment donné de l’histoire, par le seul jeu ou par le seul reflet des intérêts de classe ; il n’y a pas dans l’immense multitude humaine en fermentation, un seul individu dont tout l’être moral, toute l’action puissent ainsi être déterminés par l’influence exclusive des rapports économiques.
Il n’y a pas d’individu humain qui cesse tout entier d’être un homme pour devenir uniquement un individu de classe, et ainsi en d’innombrables consciences, en d’innombrables centres d’énergie, un fond à peu près indéfinissable d’humanité, de traditions lointaines et d’aspirations confuses, se mêle à l’action déterminée des intérêts immédiats. Mais il y a mieux, et les classes elles-mêmes, comme telles, n’ont pas exclusivement une conscience de classe. De même que sous des températures différentes, les mêmes éléments chimiques réalisent des combinaisons très variées, ainsi il y a une température morale, une température humaine qui, des mêmes éléments économiques, forme des combinaisons historiques très diverses. Pourquoi, par exemple, la bourgeoisie révolutionnaire, tout en prenant des précautions contre les citoyens les plus pauvres, a-t-elle admis quatre millions d’électeurs, tandis que sous Louis-Philippe, la bourgeoisie n’en admettra que deux cent mille ? Je sais bien que l’antagonisme de la bourgeoisie et du prolétariat apparaissait moins en 1790 qu’en 1830, et qu’ainsi l’instinct de classe de la bourgeoisie était d’abord moins défiant et moins resserré. Mais, qui pourrait contester l’action toute présente, toute vive, de la philosophie du xviiie siècle qui, en dissolvant par l’analyse toutes les institutions factices, n’avait laissé subsister que « la nature », c’est-à-dire, dans les sociétés humaines, l’humanité ? La raison du siècle était imprégnée de droit humain, et nul ne peut dissocier, dans l’œuvre révolutionnaire, cette grande influence humaine des premiers calculs de l’esprit de classe.
Par Vauban, Racine et Fénelon, qui lui avaient transmis je ne sais quelles tendresses chrétiennes tournées au salut social, par la sensibilité irritée de Voltaire et la sensibilité ardente de Rousseau, le xviiie siècle s’était formé une âme d’humanité infiniment riche, et il n’y a pas un seul événement de la Révolution où cette âme ne palpite. L’ardente éducation donnée aux esprits par Rousseau, bientôt le drame même de la Révolution portèrent si haut la température des esprits, que des combinaisons de démocratie et d’humanité se réalisèrent, que la seule évolution des rapports économiques n’aurait suscitées peut-être qu’un siècle plus tard. Les survivants de la Révolution s’étonnaient eux-mêmes, après bien des années, que de leur cœur, où il ne restait plus que de la cendre, tant de lave enflammée eût jailli. Ce feu intérieur de la Révolution a bouleversé plus d’une fois les rapports économiques des classes, comme le feu intérieur de la terre, quand il éclate, bouleverse et mélange les terrains superposés.