L’amour saphique à travers les âges et les êtres/32
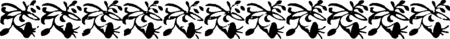
XXXII
La pratique du saphisme est-elle absolument incompatible avec l’amour naturel ? — La lesbienne ne peut-elle être quand même une bonne épouse, et parfois une épouse tendre et passionnée ?
Voici des questions auxquelles on ne peut faire une réponse générale et collective sans commettre de grosses erreurs.
Dans le courant de ces pages, nous avons donné des détails qui éclairent ce sujet ; il nous suffira de les résumer ici, puis de les appuyer par quelques exemples, photographiés, pour ainsi dire, d’après nature.
L’invertie, la femme aux goûts, aux instincts, aux impulsions nettement mâles, fera toujours une détestable épouse, du moins au point de vue des rapports sexuels.
Pour elle, le coït est un acte pénible, humiliant, atroce. Quelque bonne volonté qu’elle y mette, quelque empire qu’elle possède sur elle-même, elle ne parviendra qu’à le supporter et y souffrira toujours.
L’invertie ne prend jamais son parti du rôle qui lui est dévolu aux côtés d’un homme normal ; cela lui est impossible, car, à chaque instant, tout en elle est heurté, froissé, meurtri. Si, avec courage, elle se force à accepter ses devoirs, ses nerfs, son tempérament, en sont profondément affectés, et sa santé peut en être altérée.
Mme D…, présentant toutes les particularités de la femme mâle, s’était mariée, sans se douter naturellement de l’anomalité de son être physiologique et moral. Belle femme, intelligente, pleine de valeur intellectuelle, elle était fougueusement adorée de son mari, un homme sain, très normal et d’une vigoureuse virilité.
L’épreuve conjugale lui fut atroce. Et, loin de s’accoutumer au coït, la jeune femme en arriva à être hantée de l’idée des caresses conjugales ainsi que d’un cauchemar. À part cette question de relations physiques qui lui étaient odieuses, elle estimait son mari, elle avait pour lui une sérieuse affection qui surmontait les rancunes inconscientes qu’elle lui gardait des tortures qu’il lui imposait.
D’ailleurs le mari ne se doutait point des répugnances de sa femme, qui s’efforçait de les lui cacher par bonté, par sentiment du devoir, car, se renseignant discrètement auprès d’amies, elle avait reconnu qu’en réalité elle ne pouvait rien reprocher à son époux, et que c’était elle dont le tempérament était anormal.
Au bout de deux ans de martyre, elle se décida à consulter secrètement un docteur. Celui-ci, spécialiste de maladies nerveuses, la trouva déjà atteinte de symptômes inquiétants, dus à la perpétuelle contrainte qu’elle s’imposait, à l’effort surhumain par lequel elle domptait ses révoltes et ses nausées.
L’ayant habilement et paternellement confessée, ce médecin acquit la certitude qu’il se trouvait devant un type accompli de l’invertie.
Le cas lui parut des plus graves. La jeune femme était à bout de forces : ou elle s’avouerait vaincue, révélerait à son mari ses impulsions, se refuserait désormais au coït, et ce serait la désunion, la ruine d’un ménage qui par ailleurs avait tout pour être florissant ; ou elle lutterait encore et succomberait promptement à la névrose qui la guettait. Déjà, elle avait de légères hallucinations, des aberrations du goût, l’obsession maladive de certaines pensées, de certains mots. Encore quelques mois et elle glisserait rapidement dans la lamentable troupe des détraquées.
Tout dépendait du mari.
Le docteur ordonna un traitement insignifiant à la jeune femme, ne lui révéla rien de ce qu’il avait conclu de son examen moral et matériel ; puis il demanda que M. D… vînt causer avec lui.
Il était décidé à agir suivant la nature d’homme qu’il verrait devant lui.
Le mari dans son cabinet, la conversation engagée, le docteur, qui était un fin psychologue, vit immédiatement à qui il avait affaire.
M. D… était un garçon loyal, peut-être supérieur dans sa profession d’ingénieur industriel, mais il ne possédait aucune culture intellectuelle raffinée, il était incapable de largeur d’idées et profondément ancré dans un cercle étroit de principes de morale banale et de lieux communs universels.
Si on lui révélait l’être bizarre qu’était sa femme, il tomberait des nues, s’esclafferait, traiterait le docteur de loufoque et n’admettrait point que sa femme, une belle femme, pourvue de seins opulents et de hanches larges, eût pourtant des instincts exactement semblables aux siens au point de vue sensuel.
Et si, à force d’arguments probants, le docteur arrivait à le convaincre, ce serait sans doute pis, car alors le mari prendrait sa femme — ce cas pathologique — en aversion et en dégoût.
Le docteur X… se résigna donc, dans l’intérêt du ménage, à mentir.
Il s’appuya sur le fait de la stérilité de Mme D… — stérilité qui pour lui provenait de sa constitution tout entière — pour dire à M. D… que sa femme souffrait d’une affection des organes génitaux qui demandait d’abord le repos sexuel complet durant plusieurs mois, puis la reprise des relations conjugales, mais avec des ménagements extrêmes.
Il savait qu’il fallait que Mme D… se sût momentanément délivrée de la corvée pour que son esprit reprît son équilibre, et ensuite il comptait sur sa force d’âme pour pouvoir accepter sans troubles nerveux une sujétion conjugale modérée et enrayée.
M. D… aimait réellement sa femme. Il se soumit à tout ce que voulait le docteur et Mme D… recouvra la santé. Comme l’avait pressenti le médecin, jamais elle ne put dompter sa répugnance pour le coït, mais celui-ci ne lui étant imposé qu’à des intervalles suffisamment espacés, elle le subit sans que sa santé en fût altérée.
Cependant, il arriva ce qui était immanquable. Auprès d’une jeune femme que le hasard mit dans son intimité, sa véritable nature lui fut révélée ; elle désira follement son amie, lui fit partager son trouble et finit par connaître avec elle toutes les ivresses du saphisme.
Plus heureuse que Mme D…, une autre jeune femme dont le tempérament était tout masculin, se trouva devenir la femme d’un inverti qui, comme elle, ignorait son véritable tempérament.
Les jeunes époux essayèrent gauchement de s’aimer selon les lois de la nature, et se désolaient en secret de leurs répugnances, de leurs défaillances qu’ils s’efforçaient d’éprouver et de se prouver.
Eux aussi, à bout de forces, vinrent trouver le docteur X… Celui-ci se livra à un examen interne de la jeune femme aussi complet que possible. Il se convainquit qu’elle était destinée à être stérile et tout à fait impropre à l’amour normal. De même, sans être impuissant, le mari lui parut incapable de se livrer au coït, sinon de façon tout à fait exceptionnelle, sans que sa santé en fut altérée. Il conseilla donc aux deux époux, après les avoir mis à l’aise l’un vis-à-vis de l’autre par la révélation de leurs doubles confidences, de cesser résolument toute corvée conjugale, puisqu’elle n’apportait de joie ni à l’un ni à l’autre.
Du reste il leur conseillait aussi de ne point se désunir moralement, de s’aimer, et surtout d’être francs et de tout s’avouer sans détour de leur être et de leur âme.
Les jeunes gens suivirent docilement ses avis, et il arriva ce que, en lui-même le docteur avait prévu : ils finirent par comprendre que leurs natures se complétaient parfaitement et qu’ils pouvaient goûter d’exquises ivresses ensemble… pourvu qu’ils changeassent de rôle.
Ces deux exemples que nous venons de donner, nous pourrions les répéter à l’infini ; différant par le détail, leur ensemble prouverait néanmoins que l’invertie est incapable de se plier à l’union sexuelle normale.
Dans la nombreuse liste des crimes commis par des femmes sur leurs époux, quand le mobile du meurtre est la haine qu’elles éprouvent envers celui-ci, la cause profonde de cette haine qui s’affole jusqu’à l’acte suprême, c’est une mésintelligence sexuelle.
Or, celle qui a le pouvoir de mettre dans l’âme de la femme une colère suffisante pour qu’elle ait la pensée de tuer, c’est la mésintelligence qui provient du sexe qui est heurté dans ses tendances instinctives.
Si l’on étudiait physiologiquement les femmes qui ont tué par haine l’homme qui s’imposait à elles, l’on s’apercevrait qu’elles sont toutes des inverties. Ce sont des hommes fourvoyés dans une apparence de sexe féminin, et que révolte et outrage la sujétion sexuelle dont on les écrase.
Pour ce qui concerne la lesbienne compensatrice, c’est-à-dire celle qui cherche dans le saphisme l’illusion de l’amour naturel, la question est tout autre.
C’est en réalité une femme parfaitement normale, qui s’adresse au saphisme pour satisfaire des aspirations que l’amour ordinaire pourrait contenter. C’est la faute du mari ou de l’amant si elle cherche auprès d’une femme ce qu’il ne tient qu’à eux de lui donner.
Dire tout ce qui peut éloigner de l’homme une femme dont pourtant l’esprit aussi bien que le sexe réclament l’amour, c’est faire le procès de cent mille cas divers d’égoïsme, de sottise, de cruauté, de pédanterie, d’impuissance chez l’homme.
Mme N… était jolie, suffisamment ardente, elle aimait son mari et n’éprouvait aucune répugnance pour l’étreinte, bien que celle-ci ne lui apportât pas de grandes joies. Ceci ne dépendait pas d’elle mais de son mari, qui l’avait épousée uniquement pour sa dot et préférait aller exercer chez une maîtresse son habile doigté de l’amour. Mme N… apprit la vérité, souffrit, puis se consola avec une amie, qui se trouva à point pour la convaincre avec une éloquence intéressée que tous les hommes ne valaient pas mieux que cet époux, qu’il était dérisoire de se compromettre pour eux et que l’on pouvait goûter sans danger, sans risques d’aucune sorte, un plaisir infiniment doux en compagnie d’une femme.
Mme… O avait épousé, ayant la dot réglementaire, un officier sans fortune. Celui-ci lui fit trois enfants de suite ; elle manqua mourir et subit toutes les conséquences pénibles pour une femme d’être mère sans posséder l’argent nécessaire pour que les enfants et soi-même aient les gâteries qu’il leur faut.
Elle s’éloigna de ce mari-gigogne et, comme elle avait des sens, elle les contenta avec une saphiste, de qui elle n’avait point à craindre de progéniture supplémentaire.
Mme S… se trouvait, à vingt-six ans, l’épouse d’un homme prématurément vieux, malade et répugnant. Ses goûts la poussaient vers un amant ; mais le souci de sa réputation, la crainte d’ajouter aux tourments de son mari la retenaient. Une femme l’amena adroitement à admettre l’amour saphique et sut la garder.
Tout autre était Edmée H… Petite, noire, maigre, légèrement bossue, elle avait trouvé un mari grâce à sa dot, mais celui-ci n’avait pas tardé à se débarrasser de la corvée conjugale, et bien qu’elle fût des plus ardentes, résolue à tromper son mari avec le premier venu, elle n’avait pas trouvé d’amant.
Une femme s’intéressa à elle, la désira, sinon pour sa beauté, au moins pour la luxure contenue en elle. Elles s’unirent et connurent des joies extrêmes.
Mme T… n’était pas abandonnée de son mari mais son tempérament à elle ne pouvait pas s’accommoder de la règle d’hygiène qui amenait dans son lit tous les samedis un époux qui, le reste de la semaine, n’admettait pas que l’on attentât à sa chasteté.
Le hasard la mit en relation avec une lesbienne qui combla son appétit passionnel. Du reste, Mme T… ne bouda point pour cela l’offrande hebdomadaire de son époux. Certainement cette liaison saphique eut les meilleurs effets du monde. Discrète, sans dangers, elle préservait Mme T… d’amours masculines qui pouvaient lui amener le scandale et le déshonneur.
Une autre jeune femme à peu près dans le même cas que Mme T… reconnaissait volontiers qu’elle acceptait avec un plaisir plus vif, plus reconnaissant les démonstrations un peu rares de l’amour conjugal depuis qu’elle s’adonnait au saphisme.
Pour les adoratrices du coït factice, la question est des plus complexes. Souvent, il est vrai, la femme resterait fidèle à son mari si celui-ci consentait à varier et pimenter leur liaison par des raffinements qui lui sont indispensables ; mais il arrive aussi que cette sorte de femme n’aime pas l’homme, s’irrite de ses façons, ne conçoive aucune sensualité dans ses bras.
Ce qu’il lui faut, ce qui contente ses sens, c’est l’accomplissement par une amie à laquelle elle se révèle sans gêne, d’imaginations parfois morbides, quelquefois saugrenues, toujours singulières.
Il y a entre les femmes une camaraderie naturelle, une tolérance de leurs fantaisies, une compréhension tacite de leurs goûts qui, si elles enlèvent du mystère et du piquant aux amours saphiques, permettent aux adeptes de s’enfoncer sans embarras et sans timidité dans les voies de luxure qu’elles redoutent souvent d’aborder avec un homme.
La femme, naturellement coquette, sachant l’influence que sa grâce, sa relative pudeur, sa préoccupation d’esthétique lui donnent de prestige vis-à-vis de l’homme, ne consent pas volontiers à descendre de son piédestal devant lui.
Elle a raison.
L’homme déteste la femme sensuelle ; il méprise et se détache de celle qu’il trouve trop semblable à lui-même. Son plaisir n’est pas de partager des joies sensuelles égales. Donc la femme qui veut garder sa souveraineté près de l’homme fait bien de se voiler de mystère et de nier ses réelles aspirations.
Mais, par le fait que, dans les conjonctions amoureuses, la femme joue presque toujours un rôle, ne s’abandonne jamais à ses instincts complètement, elle ne saurait goûter près de l’homme toutes les joies qu’il connaît avec elle.
Pour certaines, qui, sensuelles, curieuses, imaginatives, aspirent à la luxure, à des raffinements des « vautrements » si l’on veut, qu’elles n’osent se permettre près de leurs époux ou amants, c’est une joie incomparable de pouvoir se livrer sans entraves à leurs aspirations auprès de femmes, dans une intimité complaisante et clairvoyante sans hostilité.
Je demandais un jour à une saphiste : « En somme, que faites-vous de plus avec votre amie que ce que vous faites avec votre mari ? — Elle me répondit avec vivacité : — Tout ce dont il croit que j’ignore l’existence !… » La vérité, c’est que, pour la femme, l’amante, c’est la réalisation en luxure de tout ce qu’elle n’ose accomplir avec l’homme.
C’est pourquoi, nous l’avons déjà dit, il n’est pas douteux que l’amour saphique ne soit infiniment plus fécond en joies matérielles que l’amour naturel pour la femme, si, d’autre part, il reste inférieur ici, au point de vue cérébral : la femme goûtant auprès de l’homme des satisfactions mentales, émotives, vaniteuses, tendres, etc., qu’elle ne saurait retrouver en compagnie d’une de ses pareilles.
