L’amour saphique à travers les âges et les êtres/07
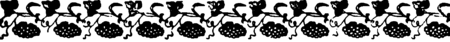
VII
L’amour saphique, lorsqu’il est pratiqué sans que les partenaires de ces jeux soient attirées l’une vers l’autre par un sentiment sincère, ou une illusion exaltée de tendresse, un besoin ardent d’affection, d’appui, n’est qu’une manifestation d’égoïsme et un violent désir de satisfactions sensuelles purement matérielles.
C’est parmi les saphistes que l’on trouve les passions les plus extrêmes, les plus répugnantes et parfois les plus terrifiantes. Jamais auprès d’un homme la femme n’arrive, comme aux côtés d’une autre femme, à outrepasser toutes les limites, à oublier toute pudeur, à se laisser glisser jusqu’à la bestialité, l’animalité la plus ignoble, la plus sinistrement burlesque.
Tombant aux pires excès, ou conservant quelque réserve, ces nouvelles citoyennes de Lesbos sont légion ; nous croyons que leur nombre dépasse de beaucoup celui des sentimentales amoureuses de la femme, c’est pourquoi nous parlerons d’elles les premières, en étudiant avec soin chacun de leurs groupes et les variétés essentielles qu’elles présentent.
Et cette recherche ne nous paraît pas inutile, car c’est avec le document humain vrai et hardiment précis que se constitue une histoire solide d’une race et d’une époque.
Chacun des types de la lesbienne sensuelle n’a qu’une ressemblance toujours retrouvée : la recherche du plaisir sensuel. Mais le mobile qui l’y pousse et la façon de se le procurer sont fréquemment fort différents.
Comment la femme voluptueuse devient-elle lesbienne ? Voilà une question qui souvent se pose, et que nous chercherons à élucider, non pas en nous servant d’une formule vide, élastique, mais en examinant chacun des cas-types qui se présentent.
Et, nous ferons observer que cette recherche n’a pas qu’un intérêt psychologique mais aussi un but moral. Si les mères étaient mieux instruites des vérités physiologiques, elles dirigeraient avec plus de sûreté et d’adresse leurs filles et leurs fils. Elles les garderaient non seulement des périls du dehors, mais de ceux du dedans ; elles sauraient les préserver des passions précoces et anormales par une hygiène morale et physique bien entendue.
Indubitablement, l’onanisme est la pratique qui, le plus souvent, conduit la femme vers le saphisme.
On le comprend aisément ; l’onaniste féminine, c’est-à-dire la femme qui pratique le plaisir solitaire par voie d’attouchements manuels, sera particulièrement prédisposée à chercher ou à accueillir une compagne pour des jeux destinés à faire passer le délicieux frisson dans les nerfs.
L’onaniste a éprouvé toutes les joies énervantes de l’amour ; elle connaît le pouvoir des contacts ; elle aspire souvent à des caresses qu’elle est impuissante à se donner elle-même.
Dès qu’elle sait qu’elle se trouve près d’une compagne des mêmes plaisirs, elle se sent en communion : les confidences sont faciles entre femmes, et elles ne comportent aucun risque, car les unes et les autres ont un égal intérêt à se montrer discrètes.
Or, il est bien rare que les plaisirs solitaires contentent parfaitement celle qui s’y livre. Certaines femmes très orgueilleuses, ne voulant confier à personne leur faiblesse, d’autres pourvues d’une imagination débordante, se suffisent, mais, en général, l’amie partageant les ébats donne une saveur excitante à des jeux qui, à la longue, finissent par perdre de leur valeur.
Comment l’onanisme naît-il chez la femme ?
En général, il est pratiqué par la petite fille encore impubère, ignorante des lois de la nature et ne se doutant pas que ces frottements qui déterminent en elle une sensation si agréable sont du domaine de l’amour.
Bien que la conformation féminine n’expose pas la petite fille à des contacts extérieurs comme ceux qui s’imposent, pour ainsi dire, au petit garçon, beaucoup de causes peuvent amener l’enfant à porter la main à son sexe, ne serait-ce que le besoin d’uriner réprimé pour une cause ou une autre.
Souvent, la jouissance du frottement du clitoris est révélée à la petite fille par un amusement qui lui fait enfourcher une monture quelconque.
Dans les mémoires d’une grande dame du dix-huitième siècle, il nous est fait la hardie confidence que les premières sensations voluptueuses de l’héroïne lui furent causées par une rampe d’escalier, sur laquelle, étourdiment, elle s’était mise à cheval pour se laisser glisser.
Le pantalon n’existant pas à cette époque, les chairs intimes de la fillette se trouvaient en contact direct avec le palissandre lisse de la rampe. D’abord, elle ressentit, dit-elle, une fraîcheur délicieuse qui la pénétra tout entière, puis un énervement, et enfin, il lui sembla qu’un feu exquis entrait en elle. Les mains crispées, elle s’arrêta en route, puis se laissa glisser de nouveau jusqu’à ce qu’un tressaillement la secoua toute et la plongea dans une telle béatitude qu’elle faillit lâcher la rampe et être précipitée du deuxième étage sur les paliers inférieurs.
Un peu effrayée, mais ravie des sensations ignorées et qui venaient de lui être apportées par cet exercice vulgaire et en apparence si innocent, la fillette le recommença en cachette et y apporta peu à peu des raffinements.
Ses meilleures sensations lui étaient procurées, nous apprend-elle, par l’acte de se laisser d’abord glisser, puis, par la force des bras, de se remonter un peu avant de se laisser retomber plus bas.
Et, sa volupté fut portée à son comble à partir du jour où ses parties sexuelles s’humectèrent naturellement et lui permirent de subir le contact un peu brutal du bois sans une exaspération des muqueuses intimes trop prononcée.
Du reste, en pratiquant ce sport, la petite fille, tout en sachant faire quelque chose de peu esthétique et de bon à dissimuler, n’avait pas la moindre idée du genre de vibrations qu’elle déterminait en elle. Elle avait sept ans environ lorsqu’elle commença cette « fricarelle » de genre particulier, et ce fut près de dix ans plus tard qu’elle devina qu’elle avait ainsi préludé aux escarmouches amoureuses et lesbiennes, qui jouèrent par la suite un fort grand rôle dans son existence.
Ce que l’on peut poser en principe à l’usage des mères qui souhaitent préserver leurs enfants des habitudes fâcheuses, c’est que, si la prédisposition à l’onanisme ne dépend pas chez l’enfant d’une faiblesse de santé, d’un système nerveux déjà attaqué par des causes héréditaires auxquelles il est bien difficile de le soustraire, on peut l’en sauver par une habile hygiène intellectuelle et corporelle.
L’enfant très propre, bien nourrie, très occupée, très amusée, très entourée sera préservée tout naturellement de l’onanisme, qui est une joie d’affamée et d’isolée.
Que l’on examine avec soin les faits. Le cerveau de l’enfant tout comme celui de l’adulte a besoin d’occupation et d’amusement, de travail et de sensations agréables. Si on ne sait pas les lui fournir, il se les procurera.
L’enfant que l’on a adroitement obligée à fournir un travail musculaire et intellectuel modéré mais suffisant, à laquelle on a fourni quotidiennement une somme raisonnable de sensations gaies, agréables, meublé l’esprit de joie, s’endort le soir, sous vos yeux, dans une saine et profitable fatigue, sans songer, sans avoir besoin de la secousse nerveuse que procure l’onanisme.
L’onaniste, la petite fille maniaque qui arrive à ne s’endormir qu’après la pratique de son vice, c’est l’enfant qui a dépassé ses forces dans la journée et se trouve dans un état fébrile morbide ou qui, au contraire, n’a pas eu l’emploi de sa vigueur naturelle. C’est encore une enfant que l’on néglige, que l’on laisse s’endormir dans une chambre solitaire où elle se sent abandonnée, où elle a peur, ce qui l’incite à oublier ses terreurs et son abandon dans ses joies factices, qui au moins l’arrachent à ses sentiments pénibles.
Une femme qui vécut sous le règne vertueux et hypocrite de Louis-Philippe et qui eut la vie durant un renom d’austérité éclatant, fut en réalité une onaniste enragée et une furieuse lesbienne.
Mais, avec celle-ci, nous entrons dans le cycle des créatures originellement entachées de névrose et dont le vice ne provient pas du manque de surveillance ou d’une éducation maladroite.
C’est d’un docteur dont la spécialité gynécologique le mettait à même de recevoir bien des confidences féminines curieuses que nous tenons les détails suivants, ainsi que nombre des observations qui seront citées dans tout notre volume.
Elles sont, croyons-nous, nécessaires pour éclairer une question que l’on n’a jamais abordée jusqu’ici par son véritable côté, qui est surtout physiologique et pathologique.
« Armande » avait huit ans. Jamais elle n’avait eu conscience de ce qu’elle possédait au milieu du corps ; les questions sexuelles lui étaient absolument étrangères et jamais aucun prurit ne l’avait incitée à quelque attouchement que ce soit.
Par suite d’un petit dérangement de santé, on lui appliqua le remède si en honneur à cette époque : un lavement.
La fillette, effarée, commença par se refuser énergiquement à l’opération, puis vaincue par les raisonnements, les menaces et les promesses maternelles, elle s’abandonna, étendue sur le ventre, yeux clos, bras voilant sa face congestionnée par les pleurs et l’épouvante.
Or, il arriva que l’introduction de la canule dans l’anus, loin de lui être pénible, lui causa une bizarre sensation d’énervement qui, jointe à l’état général d’excitation où elle se trouvait, finit par lui laisser une impression que, secrètement, elle désira retrouver.
Malheureusement pour ses nouvelles dispositions, ses entrailles capricieuses se refusèrent à provoquer l’administration du remède souhaité.
En vain, suggéra-t-elle timidement à sa mère qu’elle avait des douleurs abdominales, on la surveillait et on déclara que point n’était besoin de nouveau lavement.
Et la petite continuait à rêver de canule…
Enfin, n’y tenant plus, elle déroba le précieux instrument et courut se cacher au plus profond d’un grenier à foin où, étendue, tâchant mentalement d’imaginer une nouvelle scène pareille à la première, qui lui paraissait obligatoire pour amener la sensation que lui causerait la canule, elle procéda à l’introduction de l’objet dans son anus.
Ses sensations furent encore plus aiguës que la première fois.
Elle se résolut à recommencer l’expérience et dissimula l’objet.
Le lendemain, les jours suivants, dès qu’elle était libre de s’esquiver, elle courait demander ses joies favorites à la canule.
Jusqu’alors l’anus lui semblait le seul pertuis à explorer.
Pourtant, à la réflexion, elle imagina que peut-être bien cette autre cavité, qu’elle croyait uniquement destinée à rejeter l’urine, concevrait du bonheur à connaître la caresse de la chère canule.
Elle essaya, et, sans lui faire délaisser entièrement les visites de l’anus, les attouchements au vagin la comblèrent de plaisir.
Un fait remarquable à noter, c’est que, chez cette femme, le clitoris, d’habitude la principale source de volupté féminine, resta toujours frigide : le logis de ses sensations se localisait dans la profondeur du vagin et également dans l’anus.
À force d’user de la canule, il arriva que son diamètre exigu cessa de faire éprouver les ultimes sensations à la fillette — c’est pourtant cet objet qui avait eu les honneurs du pucelage de l’enfant. — Lors donc, elle chercha à remplacer l’auxiliaire de son plaisir par un autre plus volumineux. Ce qui obtint sa faveur fut un objet appartenant à sa mère et qu’elle déroba comme la canule sans que personne la soupçonnât du menu vol. Cet objet était un bâton en buis, arrondi du bout et allant en grossissant vers le haut. Son usage était de recevoir les boucles postiches de Mme X… afin qu’enroulées autour, elles prissent une ondulation élégante avant d’être suspendues dans la coiffure de la dame au milieu des autres boucles naturelles.
On se rappelle la coiffure féminine à cette époque, aux environs de 1845. Un chignon et, de chaque côté du visage, une grappe de grosses boucles, ou vulgairement « tire-bouchons ». Il était rare que l’on possédât assez de cheveux pour fournir à cet étalage, d’où l’habitude d’intercaler adroitement quelques postiches.
Donc, le moule aux boucles fausses de Mme X… disparut du cabinet de toilette et vint procurer d’innombrables et énervantes jouissances à la jeune voleuse.
Et comme l’autre femme dont nous parlions précédemment, l’innocente sensuelle se livrait à l’acte amoureux en toute inconscience, se cachant soigneusement parce qu’elle eut été fort honteuse que l’on sût qu’elle s’amusait avec ce qu’elle considérait comme les organes seulement destinés à expulser du corps le surplus de la nourriture et qui, comme tels, lui paraissaient immondes.
Si nous insistons particulièrement sur l’histoire secrète de cette femme, c’est qu’elle est l’exemple frappant des aberrations pour ainsi dire machinales, où ni le cœur ni l’esprit n’ont de part, où tombent tant d’enfants et dont le devoir des mères vigilantes est de les garder.
Au point de vue médical, le cas d’Armande s’expliquait au début par la constipation extrême et presque perpétuelle dont était affligée cette enfant, par suite d’une nourriture qui ne convenait pas à son tempérament et d’une vie trop sédentaire.
Cette constipation, amenant un afflux sanguin anormal aux environs de l’anus, causait une irritabilité excessive aux nerfs proches qui se fondait en sensations sensuelles. La petite fille eût été soumise à un autre régime que jamais elle n’eût été conduite à cette aberration, qui s’ancra par la suite profondément en elle et modifia sa vie intime du tout au tout.
Elle arriva au mariage sans se douter d’avoir goûté par avance les sensations de l’union sexuelle et de n’apporter à son mari qu’un corps défloré.
Son ignorance la sauva de terribles angoisses concernant ce pucelage absent et que pourtant aucun homme n’avait cueilli.
Elle épousait un homme âgé, dans une belle situation. Aucun attrait ne la poussait vers lui, et à la vérité, son cœur ni ses sens — contentés par ailleurs à son insu — n’avaient parlé pour aucun autre homme. L’acte de l’union sexuelle la plongea dans la stupeur. Elle n’y trouva aucun plaisir parce que le compagnon lui faisait peur et qu’elle trouvait abominablement honteux de se livrer à deux à ce plaisir qu’elle ne concevait que solitairement et en cachette de tous.
Quant au pucelage absent, l’époux très troublé, peu vaillant, n’y vit que du feu.
Cependant, éclairée par le mariage, Armande, bien que sachant que ce qui lui secouait les nerfs si exquisement, c’était l’acte d’amour, Armande n’arrivait pas à souhaiter d’amant. Le coït restait pour elle quelque chose d’inacceptable de la part d’un homme. Elle avoua ses répulsions, ses pudeurs à une amie plus âgée, une lesbienne, qui l’encouragea fort dans ses répugnances et lui fit accepter beaucoup plus aisément ses bons offices.
L’intimité de femme à femme pour les actes indécents de l’amour paraissait beaucoup plus naturelle à Armande que celle avec un être de sexe différent.
D’ailleurs, jamais le désir de la sensation ne se lia en elle avec un élan de tendresse ; ses amies étaient tout juste pour elle ce qu’avaient été pour son enfance et sa première jeunesse la canule et le bâton à friser les boucles.
Et, bien qu’elle arrivât à goûter tous les raffinements de l’amour lesbien, sa préférence resta toujours à l’organe postiche, figuré par des objets divers, manié manuellement par l’amie, et introduit dans le vagin ou l’anus.
Jamais elle ne souffrit que ses amies, s’attachant le classique faux membre, la possédassent avec un simulacre d’élan masculin. Elle détestait l’enlacement, l’étreinte. Sa posture favorite continuait d’être étendue sur le ventre et de subir la pénétration de l’objet sans autre attouchement et surtout sans caresses. Elle détestait les baisers sur la figure et ne supportait pas les baisers sur la bouche. C’était par complaisance qu’elle tolérait que ses amantes l’embrassassent sur les seins et le corps, car elle n’y trouvait aucun plaisir et ces démonstrations l’agaçaient.
Tous ces détails prouvent qu’Armande était bien une victime de la manie contractée dans son enfance, à la suite de ces légers malaises dont une mère attentive l’aurait aisément préservée.
Une autre femme, que nous nommerons Henriette pour la commodité de la narration, parvint à l’onanisme et ensuite à l’amour saphique par suite de circonstances assez curieuses.
Nous en citerons les détails qui prouveront aux éducateurs que, si l’ignorance des vérités sexuelles dans laquelle on tient trop souvent les jeunes filles est un mal, il est par contre fort dangereux de les habituer à des spectacles grossiers ou lubriques.
Henriette était la fille d’un valet de chiens d’une importante meute appartenant à un gros propriétaire foncier. Dès son jeune âge, elle fut spectatrice des amusements et aussi des accouplements des élèves de son père. Et les gens simples et grossiers avec lesquels elle vivait ne se faisaient point faute de répondre à ses questions étonnées :
— Les bêtes, dame, c’est comme le monde, elles font l’amour !…
Elle avait environ treize ans lorsque, désireuse d’expérimenter l’acte d’amour sur elle-même, elle songea, non point à prendre un amant, mais à se fabriquer un engin qui lui apporterait, elle n’en doutait point, les transes visiblement agréables qui secouaient MM. les cabots journellement sous ses yeux.
Naturellement elle n’avait jamais vu d’organe viril ; et elle l’imaginait naïvement pareil à celui du chien, en plus gros, puisque la stature de l’homme était plus élevée.
Après avoir longuement réfléchi, voici comment elle édifia l’objet. Elle prit une carotte fraîche qu’elle pela et amenuisa de l’extrémité et dont elle arrondit soigneusement les contours. Ensuite, laissant dépasser le bout, elle colla une peau de gant fourré en conservant tout à l’extrémité supérieure une petite bande de fourrure.
Ceci exécuté lui donna d’inénarrables transports, rien que par la vue. L’usage ne la déçut point.
Cependant, ayant montré mystérieusement cet objet à une amie, femme de chambre au château, qui, au rebours d’Henriette, était beaucoup plus familiarisée avec les apanages masculins qu’avec ceux du chien, celle-ci éclata de rire et certifia à la fillette mortifiée que cette chose ne ressemblait que de fort loin à la nature.
Pour l’en convaincre, elle lui prêta son amant, l’un des laquais. Mais l’amoureuse des toutous fut déçue.
Devenue par la suite demi-mondaine, Henriette ne trouva jamais une satisfaction complète avec ses amants et goûtait des plaisirs beaucoup plus complets avec des femmes complaisantes et qui consentaient à se servir d’engins qu’elle faisait faire exprès pour son vice particulier.
Ce cas particulier démontre éloquemment le danger de laisser voir aux enfants des spectacles de nature à attirer leur attention sur les choses sensuelles. La grande erreur des parents est d’imaginer que le jeune âge de leur progéniture empêche celle-ci de remarquer des faits qu’elle ne peut comprendre. C’est au contraire durant la toute petite enfance qu’existe le plus grand danger. C’est à ce moment que se prennent les habitudes, que naissent les vices, que s’impriment les germes des aberrations qui entraînent plus tard l’individu en une voie néfaste.
Nous le répétons et nous ne cesserons de le répéter dans tout le cours de cet ouvrage : les excès sensuels, les aberrations, les vices qui affligent l’humanité, sont le résultat de lésions intellectuelles et physiques, qui proviennent soit de tares héréditaires que l’on aurait dû combattre activement, soit d’habitudes fâcheuses prises dès l’enfance, faute de soins, de surveillance et d’intelligence de la part des parents.
Appartenant à un monde tout à fait différent de celui de l’enfant dont nous venons de consigner l’histoire secrète, Mlle Alice M… connut des délices qui la faisaient presque tomber en pamoison lorsqu’elle accomplissait l’acte vulgaire et quotidien de se laver ses parties intimes avec une éponge douce. Au couvent, elle confia ses jouissances faciles à une compagne, et toutes deux s’ingénièrent pour pouvoir se les procurer en commun, ce qui n’était pas chose aisée, vu la surveillance dont elles étaient l’objet.
Prises un jour en flagrant délit de lavage intempestif, les amies furent sévèrement punies, ce qui ne fit qu’exaspérer leur désir de braver les défenses.
Ce fut alors qu’Alice eut l’idée que les lèvres et la langue étaient pour le moins aussi douces qu’une éponge et que, ces dernières leur étant confisquées depuis leur escapade, on pourrait user de la bouche pour retrouver la divine extase de la caresse intime.
Au contraire des femmes que nous avons précédemment étudiées, Alice et son amie ne ressentaient de sensations agréables qu’au clitoris, et par suite d’un frottement très doux et très léger. Jamais l’idée ne leur vint d’explorer leur vagin et elles restèrent pucelles tout aisément.
La nuit, quand tout dormait dans le dortoir, soit Alice, soit sa complice se glissait jusqu’au lit de l’autre, et le baiser intime alternait, donné tantôt par l’une, tantôt par l’autre.
L’amie d’Alice ayant été retirée du couvent, la jeune fille, privée de sa compagne de délices, fut cruellement sevrée. Aucune de ses amies ne lui parut assez discrète pour obtenir ses confidences, et il fallut qu’une pensionnaire beaucoup plus âgée et ayant deviné les relations de ses deux camarades vint lui faire de claires propositions.
Une nouvelle liaison commença. Mais, ce n’était plus cette recherche ingénue d’une sensation dont ni l’une ni l’autre des fillettes ne connaissait la nature, Mlle Denise avait lu en cachette énormément de romans archi-défendus, elle savait ce que c’était que Lesbos et quels rites étaient célébrés par la divine poétesse Sappho et ses élèves. Plus cérébrale que véritablement sensuelle, Denise « faisait de la littérature » en caressant la jeune Alice. Elle s’enflammait pour le bel amour féminin et clamait son mépris et son dégoût de l’homme. Ce qui ne l’empêchait pas de nommer Alice « Henri » durant leurs expansions, et de se désoler que l’impuberté de sa petite amie la privât d’une « moustache » que l’ardente Denise eût aimé à caresser.
Nous profiterons de l’occasion pour nous élever contre la détestable coutume de l’internement des enfants, filles ou garçons.
Si ce déplorable système d’éducation cloîtrée existe encore de nos jours, c’est grâce à la pudeur néfaste qui clôt les bouches, enterre les tristes histoires de ces lieux où fatalement l’enfance se fane, se déflore, glisse au vice, aux aberrations, aux folies qui parfois ruinent à jamais le cerveau et le corps.
L’enfant, comme la plante, a besoin de lumière, d’isolement, d’air pur autour de lui pour se développer sainement et normalement.
Tout, dans le couvent, la pension, le lycée va à l’inverse de ce qu’il lui faut. Les conditions d’existence matérielles sont défectueuses. La nourriture insuffisante, mauvaise, nullement appropriée aux tempéraments divers, prédispose à l’anémie, aux désordres de l’estomac, de l’intestin, fournit mal aux besoins d’un corps qui est en pleine voie de développement.
L’exercice est presque nul, l’air des dortoirs, des salles d’étude mauvais. Enfin, et surtout, le manque de l’affection maternelle, la sujétion, l’ennui d’une existence monotone, enfermée, l’agglomération des individus produisent de fatales perturbations chez les jeunes individus.
Moralement et matériellement, tout concourt pour l’enfant interné à appeler son attention sur des organes qu’il importe pour son avenir d’homme ou de femme de laisser intacts et indifférents le plus longtemps possible.
Plus l’imagination de l’enfant est occupée, plus ses membres se livrent à un sain et naturel exercice, moins la préoccupation sensuelle est à craindre pour lui.
Ensuite, l’enfant dans sa famille, défendu par les siens, n’a pas à redouter le contact d’êtres anormaux, déjà pervertis consciemment ou inconsciemment.
Trop souvent, dans les couvents, l’onanisme et le saphisme sont enseignés, imposés à la petite fille faible et ignorante par l’éducatrice elle-même qui satisfait ses vices. D’autres fois, il suffit d’une fillette vicieuse pour contaminer toute une institution.
Dans tous les cas, l’enfermement produit dans les cerveaux d’enfants un état morbide, propice pour le développement de toutes les manies, de toutes les tares qui affligeront plus ou moins son individu devenu adulte.
Lorsque l’enfant est sauvé du vice, il contracte n’importe quelle autre monomanie, la prédisposition morale à la mélancolie, aux effrois tenaces pour tels ou tels objets, telles ou telles choses. Nous avons connu, entre autres, une femme qui n’avait jamais pu se guérir d’une terreur folle, obsédante, du silence, de l’obscurité et des grandes pièces sombres, contractée durant son enfance passée dans un vieux cloître. Mariée, devenue mère de famille, elle ne se plaisait qu’en de petites pièces, très garnies de meubles, préférait un appartement à une maison isolée et ne se serait pas privée de lumière pendant la nuit pour un empire.
Obligée de passer un hiver à la campagne, dans une maison assez vaste, elle y avait pris une sorte de maladie nerveuse, causée par ses effrois irraisonnés qu’elle arrivait à réprimer à force de volonté, mais qu’elle ne pouvait empêcher de naître en elle et de la bouleverser.
