Amélie, ou Les Écarts de ma jeunesse/03
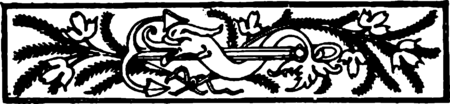
AMÉLIE
OU
LES ÉCARTS DE MA JEUNESSE
 ’avais juré de laisser à jamais étendu
sur ma vie passée le voile que mes mains
y avaient si soigneusement jeté ; et
tranquille au sein de l’abondance, je
devais même appréhender de le soulever.
Pourquoi faut-il qu’un sentiment
que je ne puis vaincre, celui de l’amitié,
m’oblige de publier ce que je voudrais me taire
à moi-même ? N’importe, j’ai promis : si je
manquais à ma parole, ce serait un tort de plus à
ajouter aux faiblesses que je dois me reprocher.
’avais juré de laisser à jamais étendu
sur ma vie passée le voile que mes mains
y avaient si soigneusement jeté ; et
tranquille au sein de l’abondance, je
devais même appréhender de le soulever.
Pourquoi faut-il qu’un sentiment
que je ne puis vaincre, celui de l’amitié,
m’oblige de publier ce que je voudrais me taire
à moi-même ? N’importe, j’ai promis : si je
manquais à ma parole, ce serait un tort de plus à
ajouter aux faiblesses que je dois me reprocher.
Je suis fille unique d’un fermier du Soissonnais : ma mère mourut fort jeune, et j’étais encore au berceau quand je la perdis. Mon père, après s’être ruiné dans un emploi auquel il n’entendait rien, fut forcé d’abandonner son équipage et de se retirer avec moi chez un de ses frères, curé d’un village près Orléans. Soit qu’il craignît d’être à charge à ce bon parent, brave homme qui nous avait appelés et reçus de bien bon cœur, malgré la modicité de son revenu, soit qu’il s’ennuyât de ne rien faire dans un pays où il n’avait ni connaissances, ni habitudes, le chagrin s’empara de lui, et quelques mois après notre arrivée, il fut attaqué d’une maladie violente qui le ravit en peu de jours à la tendresse de mon oncle et aux embrassements de sa fille.
Je n’avais alors que dix ans : mon oncle sentant bien qu’il était temps de commencer mon éducation, mais hors d’état d’en faire les frais, s’il n’augmentait son revenu par quelques accessoires à celui de sa cure, monta une petite maison d’instruction, et prit des pensionnaires, auxquels il enseignait la géographie et la langue latine. Au moyen de cette ressource, il ne se borna pas à mon égard aux leçons qu’il pouvait me donner lui-même, il me procura des maîtres ; et si j’acquis quelques talents agréables, je les dois au sacrifice que mon oncle fit de son repos pour activer cette institution.
De beaucoup d’élèves qu’il avait formés depuis les six années que durait cet établissement, il ne lui restait que les deux fils d’un riche négociant d’Orléans. L’aîné, nommé Georges, était âgé de dix-huit ans ; l’autre, qu’on appelait Joseph, n’en avait que dix-sept, et moi j’achevais ma seizième année.
Élevés ensemble, il régnait entre nous trois une tendre amitié ; je les appelais mes frères, ils me nommaient leur sœur : l’amour ne m’avait point encore appris qu’il est des noms plus doux, et nous coulions nos jours dans les douceurs de la paix et de l’union la plus intime. Nous les partagions entre l’étude, la promenade et les jeux de notre âge. Je ne sais si plus d’égards de la part de Georges me le faisaient préférer à son frère, mais mon cœur éprouvait près de lui de ces émotions douces, de ces sentiments tendres que l’autre ne m’avait point inspirés.
Un jour que Joseph, mandé chez son père pour faire consulter un mal d’yeux qui lui était survenu, avait engagé mon oncle à l’accompagner, nous restâmes seuls, Georges et moi. Une vieille bonne, sous l’inspection de laquelle nous étions depuis longtemps, était la seule gardienne qu’on nous eût donnée. Cette femme nous laissa libres, parce qu’elle ne s’était pas encore aperçu qu’il y eût du danger à le faire, et qu’elle aurait pu craindre que trop de précautions ne nous fît naître des idées toujours très difficiles à étouffer.
Le temps était superbe : Georges, après le dîner, me proposa un tour de promenade ; j’acceptai. Nous étions à peine sortis, qu’il me dit qu’il avait un grand secret à me confier ; qu’il n’avait pu jusqu’alors trouver l’occasion de soulager son cœur ; mais que, puisqu’elle s’offrait, il espérait que je ne dédaignerais pas de l’entendre.
— Non, mon ami, lui dis-je, vous ne devez pas craindre un refus de ma part. Pouvez-vous avoir des chagrins ou des plaisirs que votre sœur n’aime à les partager ? De grâce, calmez promptement mon inquiétude, apprenez-moi ce secret que je brûle de connaître.
Georges me fixe attentivement ; le feu brille dans ses yeux, son teint se colore, je le regarde sans oser dire un mot ; et, pour la première fois, mes yeux craignent de rencontrer les siens. Enfin, il rompt le silence :
— Ô mon amie, me dit-il, pardonne à ma franchise l’aveu que je vais te faire ; il importe à ma tranquillité de connaître tes véritables sentiments pour moi. Les traits divins dont la nature a pris plaisir à t’orner, ont fait sur mon cœur une impression si vive, que je ne suis plus maître d’en contenir les transports. La nature en vain se pare de ses plus beaux ornements pour embellir les lieux que nous habitons : l’étude même, qui faisait autrefois mes délices, et dont je sens la nécessité, n’a plus de charmes pour moi. Toi seule occupes mon âme tout entière. Je t’aime enfin, ma chère Amélie, et rien n’égale ma tendresse pour toi.
— Je t’aime aussi de bien bon cœur, et mon amitié pour toi, mon cher Georges, est un de mes plus grands plaisirs.
— Que parles-tu d’amitié ? est-ce là le seul sentiment qui nous convienne ? Et l’amour ? — Tout en prononçant ce mot, il imprima sur mes lèvres un baiser de feu — : et l’amour ?…
— Il ne peut pas m’obliger de t’aimer davantage.
— Non, je veux le croire ; mais il exige des preuves que l’amitié ne demande pas.
— Que veux-tu dire ? explique-toi. N’es-tu pas sûr d’obtenir tout ce que je peux t’accorder ?
— Oui ; mais l’amour, plus exigeant que l’amitié, ne se contente pas, comme elle, d’un attachement ordinaire ; il veut trouver dans l’union de deux cœurs, l’aliment nécessaire à sa subsistance ; et si tu m’aimes, comme tu me le dis, il faut m’accorder une faveur qui me sera bien chère, et me rendra le plus heureux des hommes.
— Mais je ne sais rien en mon pouvoir qui soit préférable à tout ce que j’ai fait, jusqu’à présent, pour te prouver que tu m’es bien cher.
Il n’osait me dire ce qu’il me demandait, et moi je feignais de ne pas l’entendre.
Tout en discourant sur ce sujet, dont je m’entretenais, pour la première fois, avec tant de plaisir, et que les baisers passionnés de mon cher Georges me rendaient bien intéressant, nous nous étions enfoncés dans un petit bois voisin. La chaleur nous avait un peu fatigués ; mais la conversation surtout y avait beaucoup contribué. Georges m’invite à m’asseoir, je ne me fais point prier, n’ayant aucune crainte sur les résultats de cette nouvelle position.
Nous voilà donc assis tout près l’un de l’autre.
Et les baisers de recommencer ; cependant ce petit jeu nous échauffait prodigieusement ; la sueur coulait de mon front ; ce fut un prétexte pour mon amant de me proposer de me débarrasser de mon mouchoir : il n’avait pas même achevé que ce voile n’était déjà plus sur mon cou. Ma gorge se trouvait alors en liberté ; il la presse contre son cœur, la couvre de baisers ; et, d’une main plus hardie, il parcourt mes autres charmes : je ne m’oppose à rien ; le cœur rempli du sentiment que j’éprouve, je n’ai pas la force de lui résister ; il me renverse, et sa main, sans doute, guidée par l’Amour lui-même, arrive à cet endroit, encore intact, où toutes mes idées vinrent probablement se confondre dès que je la sentis, car mon imagination s’exalta, mes sens se troublèrent, et je ne fus plus maîtresse de ma raison.
Georges allait passer de cet état délicieux, qu’il éprouvait lui-même, au comble de ses désirs : l’autel était orné ; les plaisirs l’environnaient ; nous allions jouir de cette suprême félicité qui, dans ce moment, élève au rang des dieux les êtres fortunés qu’un amour véritable et sincère unit.
Déjà Georges plaçait sur les bords de l’autel… Ô mortelles douleurs ! ô revers inouïs ! pourquoi ne sommes-nous pas morts de frayeur ? notre sort eût été, à jamais, envié des vrais amants, et je n’aurais pas été victime de la brutalité de mes ravisseurs. Trois hommes armés s’élancent sur nous, nous saisissent tous les deux, et garrottent mon pauvre Georges, qui se débattait vainement dans leurs bras. Quant à moi, la honte d’avoir été surprise dans cette position, et la peur que j’eus de ces scélérats, me firent tomber dans un évanouissement dont je ne sortis vraisemblablement que fort longtemps après ; car, en reprenant mes sens, je me trouvai dans une berline fermée avec soin, assise entre deux inconnus, chargés de me contenir dans tous les mouvements que je ferais, soit pour avoir du secours, soit pour m’échapper de leurs mains.
J’ignore combien de temps dura mon évanouissement ; mais lorsque nous arrivâmes dans la cour du château, où l’on me fit descendre, il était soleil couchant, d’où je calculai qu’il pouvait y avoir quatre heures que nous étions en route. Personne ne parut : mes conducteurs m’engagèrent à monter à l’appartement qui m’était destiné ; mais voyant que je refusais avec opiniâtreté de me rendre à leur invitation, ils me portèrent dans une chambre à coucher, assez bien ornée, dont l’un d’eux ferma les croisées, tandis que l’autre fut chercher des bougies.
On m’avait à peine déposée dans cette chambre, qu’une jeune personne, à peu près de mon âge, parut, et me demanda, de l’air le plus tendre, comment je me trouvais, et si j’avais besoin de quelque chose.
— Où suis-je ?… m’écriai-je en pleurant, où suis-je ?… mademoiselle, et quels sont les barbares qui ont pu abuser ainsi de ma faiblesse, pour me traiter aussi indignement ? répondez, de grâce ; oh ! qui que vous soyez, répondez ; vous n’êtes point assez cruelle pour me refuser les éclaircissements que je vous demande dans la malheureuse situation où je me trouve. Ah ! par pitié, mademoiselle !
Voyant qu’elle ne me répond pas, je me jette à ses genoux :
— Eh quoi ! vous vous taisez, quoi ! vous pouvez voir, sans être émue de compassion, l’innocence vous implorer ; et votre cœur, que mon état devrait intéresser, reste froid et sourd à mes prières !
Pendant tout ce temps, cette jeune fille n’avait pas seulement ouvert la bouche. Enfin, des larmes s’échappent de ses yeux en me regardant :
— Mademoiselle, je vous plains bien sincèrement, me dit-elle, mais il m’est défendu, sous peine de la vie, de vous donner des détails sur le lieu où vous êtes maintenant, et sur le sort qu’on vous y destine ; ne m’interrogez donc plus, je vous en supplie, car je suis dans la dure nécessité de vous refuser tout éclaircissement sur ce sujet.
Je me remis de nouveau à pleurer, mais plus amèrement.
— Quel est donc, me dis-je à moi-même, en me jetant dans un fauteuil, quel est donc ce mystère impénétrable ? à quel dessein m’a-t-on arrachée de la maison de mon oncle, et des bras de mon amant ? ô perfidie ! d’où vient cette différence effrayante entre les hommes ? pourquoi les uns sont-ils si cruels et les autres si bons ? Ô mon cher Georges ! qu’es-tu devenu ? toi, la douceur même ! toi, mon souverain bien ! Ces monstres ne t’ont-ils éloigné du bonheur que pour t’arracher la vie ? Ah ! s’il en est ainsi, qu’ils achèvent leur crime, et que je périsse ; je ne pourrai vivre, je le sens bien, séparée de celui qui m’est plus cher que le jour.
Je réfléchissais encore aux suites épouvantables de cet événement, lorsque j’entendis du bruit à la porte de la chambre.
— Ô ciel ! dis-je à ma trop discrète compagne, que vient-on m’annoncer, et que vais-je devenir ?…
Un homme inconnu se présente, et d’un ton ironique, bien cruel, bien molestant dans mon malheur :
— Eh bien ! la belle, me dit-il, en me passant la main sous le menton, êtes-vous un peu remise de vos fatigues ? car, Dieu merci, aujourd’hui vous en avez essuyées de bien des manières ; ce joli garçon, avec lequel nous vous avons surprise, ne vous a pas sans doute épargnée ? Allons, remettez-vous. S’il ne vous a pas entièrement contentée sur ce point, vous trouverez ici des gens tout aussi complaisants que lui, qui ne vous refuseront rien.
Ce discours ne me laissa plus de doutes sur le sort qui m’était réservé dans cette maison, et je vis bien que je n’y avais été amenée que pour satisfaire la passion de mes indignes ravisseurs. Un torrent de larmes inonde mon visage ; mais le barbare se rit de ma douleur, et continue son persiflage :
— Allons, la belle innocente, allons, préparez-vous à jouer à ce jeu charmant, auquel vous preniez tant de plaisir ce matin, et tenez-vous bien sur vos gardes, car vous aurez affaire à forte partie. Je ne crois pas cependant que cela vous inquiète. L’habitude vous a mise dans le cas de ne pas craindre un adversaire, quelque savant qu’il soit.
Je ne soufflais pas un mot ; je n’avais pas la force de lui répondre, tant était grand l’étonnement où j’étais, de me voir ainsi traitée. Puis, s’adressant à la jeune personne qui s’était levée à son arrivée, ce qui me fit présumer qu’elle était à son service :
— Adélaïde, lui dit-il, déshabillez mademoiselle, et disposez-la à nous recevoir ; nous allons entrer dans un moment. Il sortait, je cours après lui :
— Homme vil et méprisable, lui dis-je, avez-vous pu ordonner de sang-froid des apprêts qui font frémir la vertu, et a-t-on à vos yeux cessé d’adorer cette déesse, pour avoir voulu rendre heureux le plus aimé des mortels ?
Il m’écoute en riant, hausse les épaules, et se retire.
Restée seule avec Adélaïde, je veux l’interroger sur l’espèce d’hommes dont je suis la déplorable proie ; mais elle me fait la même réponse qu’auparavant, et m’engage à faire de bonne volonté ce qu’on exigera sans doute.
— Non, lui dis-je, jamais je ne consentirai à ce que cet homme féroce paraît vouloir obtenir. Je ne servirai point les caprices de ces barbares, pour qui rien n’est sacré ; et s’il n’y a que la mort qui puisse m’éviter le déshonneur, je suis prête à la recevoir.
— Hélas ! mademoiselle, me dit Adélaïde, c’est inutilement que vous voudrez résister : ils sont les plus forts ; vous résigner à leurs volontés, et vous soumettre, est le plus court parti qu’il vous reste à prendre.
— Non, jamais ; je n’y consentirai jamais…
Les sanglots m’empêchaient de continuer. Adélaïde, en rougissant, essayait de me persuader. On ouvre, et je vois entrer les monstres qui m’avaient enlevée, suivis de Georges, les mains liées. Parmi ces scélérats, je reconnus le marquis de R…, seigneur du village que nous habitions. Dans les visites intéressées qu’il faisait souvent à mon oncle, à cause de moi, il m’avait fait différentes propositions, que j’avais toujours rejetées, ce qui l’avait déterminé à m’enlever : il est présumable qu’il en guettait depuis longtemps l’occasion, pour avoir si complètement réussi ; mais pour ne pas s’exposer, si l’on faisait des recherches chez lui, il avait jugé plus convenable de me conduire chez un de ses amis, dont la terre était à quelques lieues de la sienne. À peine j’aperçois le malheureux Georges, que je m’élance auprès de lui :
— Ô mon ami ! lui dis-je, en le serrant dans mes bras, et sans faire attention à mes persécuteurs, que la présence de mon amant semble avoir fait disparaître ; ô mon ami ! dans quel abîme de malheur t’a plongé la triste Amélie !
Il me regarde sans proférer un seul mot ; la pâleur a remplacé les roses de son teint ; un froid mortel a passé dans ses veines : l’impuissance où il se trouve de se venger est le premier supplice qu’il lui faut endurer. Je veux délier les nœuds de cette corde fatale, qui tient sa colère captive ; à l’instant un de ces barbares m’arrache d’auprès de mon amant, et les deux autres l’attachent au pied du lit.
Grands dieux ! serait-il donc possible que vous voulussiez que l’homme injuste et cruel, auquel vous donnez la force en partage, ne l’employât que pour écraser le faible ? et n’est-il pas permis à l’innocence persécutée de douter du pouvoir qu’on vous suppose, si le titre de justes, dont vous vous parez, ne vous impose pas la loi d’empêcher ce que vous ne pouvez permettre ?
Quand ils eurent bien garrotté Georges, ils vinrent à moi, et m’ordonnèrent de quitter tous mes vêtements. J’eus beau employer la prière pour toucher ces farouches libertins, je ne pus rien obtenir ; ils s’élancèrent sur moi, et en un instant je me vis dans l’état où la chaste Suzanne fut autrefois surprise par ses vieux adorateurs.
Après m’avoir ainsi tenue exposée pendant quelque temps à leurs regards lascifs, et m’avoir fait l’objet de leurs injurieuses plaisanteries, un de ces monstres, que je supposai être laquais dans la maison, fut chercher une forte table, qu’il plaça au milieu de la chambre. On m’y étendit sur le dos ; l’un d’eux me prit les mains, qu’il appuya contre ma poitrine, pour me retenir sur la table ; deux autres élevèrent mes jambes en l’air ; en sorte que la chute de mes reins se trouvait précisément sur le bord de la table ; et le marquis, qui, pendant ces préparatifs, avait tout disposé pour l’attaque qu’il méditait, vint se placer entre mes jambes, et consomma, en présence même de Georges, le sacrifice sanglant que cet amant infortuné n’avait pas eu le temps d’achever.
Qui ne sait ce qu’on éprouve dans ce moment critique de la vie ? Ah ! si les douleurs qui accompagnent toujours la perte de cette fleur se pardonnent sans peine à l’amant heureux auquel on accorde la faveur de la cueillir, combien ne nous rendent-elles pas odieux le ravisseur méprisable, qui ne la doit qu’aux moyens violents qu’il a mis en usage pour s’en emparer ?
Aussitôt que ce tigre affamé eut mis un terme à sa voracité, son digne compagnon de débauche se jeta sur les restes sanglants de sa proie ; et sans pitié pour l’état affreux où je me trouvais, il eut la cruauté de renouveler des douleurs que la joie féroce et les propos insultants de ces barbares avaient rendues insupportables.
Ah ! sans doute, la maison où se passaient tant d’horreurs était dans le fond d’un désert, puisque aucun être vivant n’accourut aux cris perçants que je fis, chaque fois que j’essayai de me débarrasser de leurs mains.
Est-il une situation pareille à celle du malheureux Georges, et peut-on peindre les tourments affreux qu’il fut obligé de supporter pendant tout le temps que dura cette scène abominable ? Je crois, pour moi, qu’il n’en est pas de plus cruelle, et qu’il n’y a que ceux que j’éprouvai dans cette circonstance, qui puissent soutenir la comparaison.
On me laissa libre enfin, et je descendis de cette table, théâtre infâme des plaisirs horribles de mes bourreaux. On ordonna à Adélaïde de rester avec moi, pour m’aider à me r’habiller, et me tenir compagnie ; et les trois scélérats sortirent, emmenant avec eux l’infortuné Georges, qui jeta sur moi, en s’éloignant, un regard où se peignait son désespoir, et qui fit sur mon âme une impression qui ne s’effacera jamais.
Dès que nous fûmes seules, Adélaïde et moi, nous nous regardâmes, sans avoir la force de nous dire un mot ; les larmes, seule ressource de la faiblesse, soulagèrent un peu mes angoisses ; et la pauvre Adélaïde, qu’on avait obligée d’assister à l’opération qu’on venait de me faire subir, mêla ses pleurs aux miens. Je rompis enfin ce silence de mort.
— Eh quoi ! lui dis-je, il est donc sur la terre une espèce d’hommes qui ne cherche ses jouissances que dans les douleurs des autres, et pour qui les raffinements de cruauté, qui font frémir la nature, ne sont que des jeux qu’elle invente dans ses excès pour augmenter la masse de ses plaisirs ? Les cruels ! avec quelle joie barbare ils comptaient les soupirs de Georges ! comme ils insultaient à ses malheurs !
— Ce n’est rien encore que cela, mademoiselle, me répondit Adélaïde, et si je vous racontais les monstruosités dont j’ai été témoin dans cette abominable maison, mon récit seul vous ferait reculer d’horreur ; mais je dois épargner à votre sensibilité des détails qui ne pourraient qu’ajouter à vos maux.
Je me mis à pleurer de nouveau, et en regardant, avec l’œil du désespoir, la triste compagne de mes malheurs, je m’écriai :
— Ô ciel ! où mon destin m’a-t-il conduite, et qu’allons-nous devenir, mon pauvre Georges ?
Quand cette fille compatissante eut un peu rétabli le désordre de ma toilette, je la questionnai de nouveau ; mais je ne pus rien savoir ce jour-là ; toujours muette sur ce qui m’intéressait, elle me refusa impitoyablement les renseignements que je lui demandais. Je fus donc obligée d’employer cette éternelle soirée, ou à gémir des maux que je venais d’endurer, ou à parler de choses indifférentes.
Enfin, l’heure du souper arriva : le laquais qui avait été un des instruments de mes persécutions servit, et je forçai Adélaïde, qui voulait se retirer, de souper avec moi, pour me tenir compagnie. Après souper elle se jeta à mon cou, les larmes aux yeux, et me dit qu’elle allait s’occuper des moyens de nous servir, et qu’elle espérait réussir dans l’exécution d’un projet qu’elle avait conçu depuis longtemps. Elle m’aida à me déshabiller et je me couchai.
Je dormis peu, parce que je craignais toujours qu’on ne vînt me faire éprouver de nouveaux outrages. Cependant la nuit s’écoula tout entière, sans que j’entendisse parler de qui que ce fût. Le lendemain matin, Adélaïde rentra et m’assura que le soir même elle nous délivrerait, Georges et moi, de la captivité où on nous retenait ; que pour prix de ses soins, elle nous demandait seulement la permission de nous accompagner. Je le lui promis bien volontiers, et je me levai.
Dès qu’Adélaïde eut ouvert les contrevents de la croisée, je m’empressai d’y courir pour voir si je ne reconnaîtrais pas les lieux qui environnaient ma prison ; mais elle donnait sur un bois dans lequel je ne remarquai point de chemin pratiqué ; et la chambre où j’étais me parut être à plus de trente pieds d’élévation de la terre. Il n’était pas possible de s’échapper par là, sans se mettre en danger de périr en tombant ; néanmoins, j’aurais encore préféré ce moyen de fuite, au sort auquel je me voyais condamnée, si Adélaïde ne m’eût assurée qu’elle avait découvert un endroit par où nous pourrions nous évader, sans nous exposer à un aussi grand danger. Je la laissai donc maîtresse absolue de ma destinée, et je fis des vœux ardents pour notre délivrance.
On me laissa parfaitement tranquille toute la journée ; la seule peine que j’éprouvai, fut de la voir s’écouler aussi lentement. Enfin, la nuit arriva. Adélaïde m’avait quittée depuis environ deux heures ; je ne savais ce qu’elle était devenue, quand je la vis rentrer, tenant Georges par la main. Ô moment fortuné ! Je m’élance dans ses bras, nous nous tenons longtemps serrés l’un contre l’autre, nos larmes se confondent, et le plaisir de nous voir réunis nous fait oublier nos souffrances. Adélaïde m’apprend que Georges n’a pas voulu sortir sans moi, quoiqu’elle lui eût promis que nous allions le rejoindre, et tout en lui sachant gré de cette preuve touchante de son amour, je le blâmai de sa délicatesse, qui pouvait empêcher son évasion. Elle nous dit qu’elle avait profité du moment où le baron et son laquais étaient sortis, pour aller à une lieue de là, et que, comme il n’y avait dans la maison que le marquis, alors dans un appartement éloigné du nôtre, elle croyait l’instant favorable pour échapper à nos persécuteurs.
Comme nous nous disposions à la suivre, nous entendîmes marcher dans le corridor ; Adélaïde courut pour savoir qui c’était. Elle revint aussitôt :
— Nous sommes perdus, nous dit-elle, et qu’allons-nous devenir ? le marquis vient ici.
— Je veux l’y attendre, dit Georges, et s’il est seul, nous verrons si le crime triomphera toujours de la vertu.
Il était sans défense, le marquis pouvait être armé ; je ne voulus jamais consentir qu’il courût les risques d’un combat inégal, je le priai, les mains jointes, de se cacher sous le lit ; il m’obéit : pour moi, je pris un livre qui se trouvait sur la cheminée, et j’eus l’air de faire une lecture à Adélaïde ; tout cela fut l’affaire d’un instant, et il n’y avait plus matière au moindre soupçon quand le marquis entra.
— Comment se porte, aujourd’hui, dit-il en m’adressant la parole, la plus complaisante de toutes les beautés ?
Et il voulut m’embrasser ; je le repoussai vigoureusement sans lui répondre.
— Je ne viens point encore, reprit-il, avec cet appareil menaçant d’un chevalier méprisé, qui veut se faire obéir, mais avec la douceur d’un amant qui attend de vous son bonheur. Puis-je espérer que ma tendresse obtiendra le pardon d’un peu de rigueur ? et me laisserez-vous, de bonne grâce, réparer quelques légers torts dont j’ai pu me rendre hier coupable envers vous ?
— Ne l’espérez pas, lui répondis-je avec emportement ; il semblait que la présence de Georges enflammât mon courage, ne l’espérez pas ; jamais vous n’obtiendrez de moi ce que vous exigez ; j’ai bien assez souffert d’être obligée d’endurer vos outrages, sans vous permettre de les renouveler ! Sortez d’ici, barbare ! et ne réduisez pas au désespoir la plus malheureuse de toutes les femmes.
Le cruel se mit à rire, et ordonna à Adélaïde de sortir. Cette fille obéit sans répliquer. Dès qu’elle fut dehors, il mit les verrous, quitta son habit, vint à moi, me prit dans ses bras, et m’étendit sur le lit, malgré les efforts que je fis pour m’opposer à cette violence.
Georges, indigné, était sorti de dessous le lit. Il prend une pincette, seule arme qui soit en sa disposition, et en décharge un coup sur le derrière de la tête du marquis. Ce coup inattendu le fait tomber par terre ; mais bientôt, reprenant ses sens, il se relève et se précipite sur Georges. Celui-ci, qui guette tous ses mouvements, se jette en même temps sur lui ; et les voilà aux prises, se portant, l’un et l’autre, des coups qui font ruisseler le sang sur leurs visages. Ils se débarrassent enfin des mains l’un de l’autre ; le marquis se recule et sort de sa poche un pistolet, dont il ajuste son adversaire. Georges ne lui donne pas le temps de lâcher la détente ; furieux, il se jette sur lui et lui arrache des mains cette arme meurtrière. Le marquis désarmé, en reprend un second, tire sur Georges, qui, heureusement, évite le coup, et a le temps d’ajuster le marquis, qu’une balle, dans la poitrine, renverse au pied du lit.
Pendant ce temps, à genoux sur le lit et les mains levées au ciel, j’attendais, en invoquant les dieux, l’issue de ce combat, et quand je vis tomber l’infâme marquis :
— Je vous demande pardon, grands dieux ! m’écriai-je, d’avoir douté de votre justice. Tôt ou tard vous punissez le coupable, et si l’innocence fut sa victime, vous ne l’avez souffert que pour avoir plus de plaisir à la récompenser.
Adélaïde, que son intérêt pour moi avait fait rester à la porte de la chambre, pour savoir ce qui s’y passerait, épouvantée du bruit qu’elle entendait, frappait en désespérée. Georges, qui reconnaît sa voix, court lui ouvrir et la fait entrer.
Le marquis respirait encore. Elle le voit, et contemple, avec plaisir, ce méchant homme qui nageait dans son sang.
— Meurs donc, barbare, lui dit-elle, en l’entendant se plaindre, meurs. Délivre la terre d’un monstre qui la souillait par ses impuretés, meurs, et que ta mort, si elle est connue, épouvante les scélérats, qui, comme toi, dégradent le nom d’homme, par les crimes dont ils se rendent coupables, meurs.
Un mouvement du marquis nous annonça qu’il approchait du terme fatal, et nous le regardions encore qu’il n’était déjà plus.
— L’instant est favorable, nous dit Adélaïde, suivez-moi.
Nous descendons, et nous étions déjà dans la cour, lorsque nous entendîmes fermer la porte cochère.
— C’est le baron qui rentre, nous dit tout bas Adélaïde. Remontons sans faire de bruit ; nous allons tacher de sortir par l’endroit dont je vous ai déjà parlé.
L’obscurité dans laquelle nous nous trouvions favorisait son projet, et le baron, qui ne nous avait point entendus, regagnait lentement l’escalier. Le cerf que l’on poursuit fuit avec moins de légèreté que nous ; en un instant nous nous trouvons au bout du corridor ; Adélaïde marchait la première ; je la suivais, et Georges venait après nous. Elle ouvre la porte d’un cabinet d’aisance dont elle n’avait pu se procurer la clef que ce jour-là, malgré toutes les recherches qu’elle eût pu faire auparavant ; elle savait bien qu’il était possible de sortir de la maison par cet endroit éloigné, parce qu’un jour la porte de ce cabinet s’étant trouvée ouverte par la négligence d’un laquais, elle y était entrée, et se disposait à fuir, lorsqu’on était venu, sans le savoir, l’empêcher de mettre son projet à exécution.
Quoiqu’il n’y eût point de lumière dans cet endroit, cependant, à la faveur du crépuscule de la nuit, nous distinguions parfaitement qu’il était éclairé par une fenêtre. Adélaïde l’ouvre, pose un pied sur le siège du cabinet, l’autre sur l’appui de la croisée, et descend sur un petit toit qui régnait le long du mur. Elle me donne la main pour monter ; bientôt je la rejoins.
— Nous n’avons pas dix pieds à sauter, me dit-elle, ma chère demoiselle ; un pareil obstacle n’est pas fait pour nous arrêter en si beau chemin.
— Dépêchez-vous, disait Georges, car on nous poursuit.
Adélaïde et moi nous faisons, sans hésiter, puisqu’il n’y avait plus que ce parti, le saut qui devait nous sauver la vie ; heureusement, nous ne nous faisons point de mal. Georges, sur le toit, allait s’élancer près de nous ; un coup de feu part du corridor, l’atteint, et le fait rouler à nos pieds.
Ô fatalité ! destin inexplicable ! Georges et moi nous sommes victimes de la férocité de deux barbares ; l’innocence un moment triomphe ; l’un périt sous les coups de mon amant, et l’autre l’assassiné. Grands dieux ! faites donc briller à mes yeux la lumière céleste ! ou dites-moi ce que c’est que la justice éternelle ?
Je m’élance sur le corps de l’infortuné Georges ; je couvre de baisers sa bouche, qui venait, un instant auparavant, de me jurer une flamme éternelle ; je l’appelle, mais vainement ; il n’existait plus. Cependant Adélaïde a repris ses sens.
— Fuyons, mademoiselle, fuyons ce spectacle déchirant, puisque, hélas ! nos soins ne sont plus nécessaires à votre malheureux amant. Si les traîtres sont sûrs de la mort de Georges, ils vont nous poursuivre, et nous avons le temps de nous éloigner, si vous voulez m’en croire.
Je ne pouvais pas me tenir sur mes jambes.
— Fuyons donc, mademoiselle, je vous le répète, ou la mort la plus cruelle va nous faire expier celle du marquis, si nous retombons dans les mains du baron et de ses gens.
Je me rends à l’avis d’Adélaïde, je lui donne le bras, et nous suivons, dans le bois, le premier sentier qui s’offre à nous.
Nous marchons quelque temps sans nous reposer ; à la fin, la fatigue nous force de nous arrêter : nous nous couchons par terre, et un quart d’heure de repos suffit pour rendre à nos jambes l’activité qui leur était si nécessaire. Nous nous trouvons enfin sur la grande route. Incertaines de savoir de quel côté tourner, nous prenons au hasard sur notre droite, et à une lieue environ, nous trouvons un village. Il n’était point encore jour, personne n’était levé : nous nous décidons à poursuivre notre route, remettant à demander des éclaircissements dans le premier endroit où nous passerons.
Nous n’avions pas fait une demi-lieue, que nous sommes devancées par une petite voiture, qui portait des provisions à la ville voisine.
— Questionnons le conducteur, me dit Adélaïde, et sachons au moins où nous allons.
Et sans attendre ma réponse, elle court après la voiture, et interroge le conducteur qui a la complaisance de s’arrêter ; ce qui me donne le temps de les rejoindre.
— Sommes-nous bien éloignées de la ville, monsieur, lui dit Adélaïde ?
— À trois lieues, mademoiselle, d’Orléans, où je vais ; et si vous voulez prendre chacune une place dans ma voiture, telle qu’elle est, je me ferai un vrai plaisir de vous y conduire.
L’offre était trop généreuse, et nous étions trop fatiguées, pour ne pas l’accepter. Nous voilà donc montées, assises sur la paille, et la voiture reprend son train.
— Il faut que vous ayez de grandes affaires, mesdemoiselles, nous dit notre conducteur, pour être ainsi seules sur un grand chemin, à deux heures du matin. Je suis étonné du courage qui vous fait braver les dangers que l’on court sur les routes.
— Notre voyage était indispensable, lui répondis-je, et comme nous étions à pied, il fallait partir avant le jour, pour trouver les personnes chez lesquelles nous nous rendons.
Mille autres mensonges servirent de réponses aux questions sans fin, que ce bavard ne cessa de nous faire.
Enfin le jour paraissait comme nous entrions dans Orléans. Nous descendîmes de voiture : j’offris au conducteur de payer les places qu’il nous avait fait prendre ; mais il ne voulut rien qu’un baiser de chacune de nous, en nous disant adieu.
Nous avions grand besoin de repos ; aussi nous cherchâmes promptement une auberge, où, après avoir amplement déjeuné dans une petite chambre que nous demandâmes exprès, nous nous mîmes au lit, où le sommeil nous retint jusqu’à l’heure du dîner.
La servante, que j’avais prévenue, vint nous avertir qu’on allait nous servir. Nous nous levâmes sur-le-champ, et notre toilette fut bientôt faite, car nous n’avions, pour tout ajustement, qu’un chapeau de paille sur nos cheveux flottants, et un déshabillé tout uni. Néanmoins ces riens, placés avec un peu d’art, sur deux jeunes personnes de seize ans, assez bien de figure, ne nous rendaient point indifférentes, et nous n’étions pas les moins bien des femmes qui se trouvaient à la table commune.
Cependant, un peu honteuses de nous trouver seules au milieu de tant d’étrangers, nous n’osions lever les yeux sur personne, et si parfois on nous adressait la parole, l’air modeste et décent que nous mettions naturellement dans nos réponses, parlait en notre faveur. Enfin, enhardies par les attentions qu’on voulut bien avoir pour nous, nous nous mêlâmes un peu de la conversation. Un indiscret, qui nous fixait presque toujours, nous demanda si nous allions plus loin qu’Orléans.
— À Paris, monsieur, lui répondis-je sans me déconcerter, où ma sœur et moi sommes mandées pour recueillir la succession d’une tante que nous n’avons jamais vue ; mais qui, meilleure après sa mort, qu’elle ne le fut pendant sa vie, nous laisse jouir de ce qu’elle n’a pu emporter.
On quitte la table enfin, et nous remontons à notre chambre.
À peine avions-nous eu le temps d’en fermer la porte, que la servante vient frapper, et nous dit qu’une personne, qui avait dîné avec nous, désirait nous parler. Nous étions deux ; il n’y avait aucun danger. Nous lui permettons d’entrer. Je présumais que ce pourrait être l’homme qui nous avait questionnées pendant le dîner ; mais c’en était un autre, d’environ quarante ans, que j’y avais remarqué, et qui ne s’était pas beaucoup mêlé de la conversation.
— Mesdemoiselles, nous dit-il en entrant, vous allez me trouver bien importun, et ma démarche vous paraîtra peut-être extraordinaire ; mais je n’ai pu résister à l’impression profonde que vous m’avez faite. Je n’ai pas vu, sans inquiétude pour vous, les dangers du voyage que vous entreprenez, et ceux que vous allez courir dans une ville où vous n’avez personne de connaissance. À votre âge on rencontre bien des écueils, et quelque vertueuse qu’on soit, on a beaucoup de peine à les éviter tous ; si j’avais le bonheur de mériter votre confiance, je vous offrirais de vous conduire à Paris, où j’ai mon établissement, et vous y trouveriez, dans la société de ma femme et de mes enfants, la sûreté et l’aisance que vous pourriez désirer pendant votre séjour dans notre ville. Faites vos réflexions, mesdemoiselles ; ma voiture est grande et commode ; je compte partir demain soir ; et si vous acceptez mes propositions, vous verrez que je sais tenir mes engagements.
En achevant ces mots, il se lève, ne nous donne pas le temps de le remercier, et sort, nous laissant tout étourdies de ce que nous venons d’entendre.
Nous nous regardions, Adélaïde et moi, bien embarrassées de la réponse que nous avions à faire ; retourner chez nos parents, c’était la chose impossible ; on m’aurait demandé compte de ma conduite. Forcée d’avouer la mort violente de Georges, je me livrais indubitablement à la fureur d’un père irrité, auquel je n’aurais pas pu donner des détails suffisants, puisque je ne connaissais point du tout le lieu de la scène ; enfin, ce qui pouvait m’arriver de plus doux, était, au moins, la perte de ma liberté. Adélaïde, par d’autres raisons, ne pouvait, pas plus que moi, se représenter chez sa mère ; nous n’avions, à nous deux, qu’une vingtaine de francs, ou environ ; un homme qui nous paraissait honnête, nous offrait des secours ; ma foi, la nécessité nous fit la loi, et nous convînmes que le lendemain matin nous dirions à notre protecteur qu’il pouvait compter sur nous, et que nous l’accompagnerions jusqu’à Paris. Heureusement que mon amie était plus décidée que moi, et qu’elle avait plus d’expérience ; elle se chargea de lui en porter la nouvelle. Il la reçut avec grand plaisir, et tout s’arrangea pour le mieux.
Nous partîmes donc d’Orléans, Adélaïde et moi, avec notre généreux inconnu, à sept heures du soir ; on courut toute la nuit, et le lendemain dans l’après-midi nous arrivâmes à Paris. Nous nous attendions à trouver chez notre père adoptif la famille qu’il nous avait annoncée ; mais nous ne vîmes en entrant que deux domestiques qui s’empressèrent beaucoup autour de leur maître, sans faire la moindre attention à ses compagnes de voyage.
Cependant, le maître de la maison nous conduisit au salon, sortit, et revint un instant après nous dire qu’il était désespéré que sa femme et ses enfants ne fussent point au logis pour nous tenir compagnie, comme il nous l’avait promis, mais qu’ils ne tarderaient pas à revenir de la campagne où ils étaient allés passer quelques jours, n’espérant pas le revoir si tôt.
Nous le crûmes sans peine, parce que l’air de vérité qu’il mettait ordinairement dans ses discours, nous avait, pour ainsi dire, habituées à le croire sur parole. Il nous fit donner à chacune une chambre, et après avoir, par ses soins, réparé nos forces, nous allâmes goûter, dans les bras du sommeil, un repos nécessaire.
Le lendemain matin on nous fit descendre au salon pour prendre le café ; notre hôte nous combla d’honnêtetés et de caresses ; et nous avions à peine fini de déjeuner, que deux marchandes qu’il avait fait venir, nous présentèrent, de sa part, plusieurs étoffes dans lesquelles il nous pria de choisir celles qui nous flatteraient le plus. Si nous eussions été seules avec lui, nous aurions vraisemblablement hésité à recevoir ce présent ; mais sentant bien que devant ces femmes, la moindre difficulté nous rendrait ridicules, pour ne rien dire de plus, nous nous crûmes obligées de faire ce qu’on exigeait de nous, sans nous permettre la moindre réflexion sur les conséquences de l’engagement tacite que nous prenions avec notre bienfaiteur. Nous choisîmes donc une pièce de ces étoffes, dans laquelle il se trouvait de quoi nous faire à chacune une robe, dont on nous prit à l’instant mesure.
— Je désire, dit notre hôte à ces femmes, que les ajustements de mes filles (c’est ainsi qu’il nous nomma devant elles) soient prêts pour demain ; et comme je leur ai fait laisser dans la maison d’éducation qu’elles habitaient en province, tout ce qui était à leur usage, voilà d’abord vingt-cinq louis que vous voudrez bien employer à leur procurer pour le moment tout ce qui leur est nécessaire, sauf à vous tenir compte de ce qui excédera cette somme, d’après l’état que vous me donnerez.
On promit que tout serait prêt pour le lendemain ; et effectivement, lorsque notre hôte, qui était sorti toute la matinée, revint à l’heure du dîner avec un de ses amis, il nous trouva parées de ses dons, et dans la toilette la plus brillante.
— Bonjour, mes chères filles, nous dit-il en entrant d’un air satisfait, comment vous portez-vous ? Vous voilà belles comme des anges ; allons, venez que je vous embrasse.
L’air de bonhomie du papa, un mouvement de reconnaissance, peut-être aussi la crainte de ne pas paraître devant un étranger ce qu’il disait que nous étions, tout cela nous détermina à nous jeter à son cou toutes les deux en même temps, en lui donnant le nom qui paraissait tant le flatter.
On dîna en partie carrée, et le soir on fut au spectacle. Adélaïde eut pour cavalier l’ami de notre hôte, et moi je pris le bras du papa. C’était nous faire un grand cadeau que de nous mener à la comédie, car je la voyais pour la première fois ; aussi je m’y amusai beaucoup.
De retour au logis, Adélaïde profita d’un moment où on nous laissa seules, pour m’instruire des propositions que lui avait faites l’ami de Richeville (car c’est ainsi que se nommait notre protecteur.) On l’avait informé de tout ce qui nous concernait, et il paraissait vouloir l’entretenir. Cette fille, qui avait reçu assez favorablement les propositions de son galant, m’avoua franchement que, dénuée de tout secours, et craignant de tomber dans la misère, elle allait lui laisser entrevoir qu’elle n’était pas éloignée de prendre ce nouvel engagement. En effet, trois ou quatre jours suffirent pour lier une entière connaissance, et elle me quitta pour aller demeurer avec lui. Peu de temps après ils partirent pour l’île de France, où cet ami avait des possessions, et je ne les revis plus.
Quant à moi, je sentis bien que j’étais destinée à servir aux plaisirs de mon trop généreux protecteur. Jusque là, cependant, il n’avait encore été question de rien entre nous. Mais je me familiarisais de jour en jour avec l’idée qu’un moment viendrait où je serais obligée de payer tout ce que je recevais de sa libéralité. Vainement je cherchais un moyen pour me soustraire à l’acquit de la dette énorme que je contractais envers lui. Que pouvais-je faire dans la position embarrassante où je me trouvais ? rien, que d’attendre avec soumission ce que le sort ordonnerait de moi. Je me livrais, quand j’étais seule, à mille réflexions.
— Il y a donc, me disais-je, des moments dans la vie où il est impossible à la fille la plus sage de rester vertueuse, et où la nécessité la contraint de se plier sous le joug qu’elle lui impose ?
Richeville, depuis la sortie d’Adélaïde, me traitait avec plus d’attentions ; tous ses domestiques, et une femme de chambre qu’il m’avait donnée, avaient ordre de m’obéir comme à lui-même. Tous les jours il me menait au spectacle, et je ne rentrais pas sans avoir reçu de sa générosité un présent de mon choix. Tant de marques d’amitié m’attachaient insensiblement à lui ; mon infortune commençait à moins peser sur mon cœur, et j’y sentis naître un sentiment plus doux que celui de la reconnaissance.
Il y avait déjà quinze jours que nous étions à Paris. Richeville et moi nous rentrions un soir de la comédie. Nous étions seuls. Sans doute qu’ayant conçu un projet qu’il voulait faire réussir, il s’était arrangé pour que nous pussions jouir d’un tête-à-tête. Quand je fus déshabillée, et qu’un simple négligé eut remplacé ma toilette, je passai au salon où il m’attendait. Il vint à moi et m’embrassa plus tendrement qu’à l’ordinaire.
— Asseyons-nous, me dit-il, ma chère petite, et causons tranquillement sur ce qui vous intéresse. Je n’ai point été dupe du petit mensonge que vous m’avez fait à Orléans ; l’état dans lequel je vous ai trouvées, vous et votre amie, m’a fait soupçonner que vous fuyiez la maison paternelle ; je prends trop de part à ce qui vous regarde, et je vous avoue même que je vous aime trop pour ne pas désirer d’être instruit de tout ce qui vous touche. S’il y a de l’indiscrétion à vous demander des détails que je brûle de connaître, vous aurez, j’en suis bien sûr, le bon esprit de me pardonner ma curiosité en faveur du motif.
Cette question me déconcerta un peu, et dès qu’il s’aperçut qu’un vermillon plus vif animait ma figure, il m’embrassa plus tendrement encore, et me pria de me remettre, en m’assurant que, quelque chose que j’eusse à lui apprendre, rien ne pourrait altérer la tendresse qu’il avait pour moi.
Je ne savais que lui dire, et j’étais d’avis de forger une histoire pour me sauver la honte de raconter ce qui m’était arrivé ; mais je craignais qu’à l’air embarrassé que je montrerais sans doute, il ne s’aperçut que je le trompais encore et ne me retirât ses bonnes grâces, dont je sentais tout le besoin ; je me déterminai donc à lui dire la vérité, quoiqu’il dût m’arriver, et je lui fis le récit fidèle de ma malheureuse aventure.
Pendant ce récit, qu’il écoutait avec la plus grande attention, je suivais tous ses mouvements pour y découvrir l’impression qu’il faisait sur lui ; j’eus la satisfaction de m’apercevoir qu’il était vivement affecté, et quand j’eus fini, il me remercia de ma complaisance, avec tant de bonté, que je me sus bon gré de ma franchise.
Il ne put en dire davantage pour le moment, parce qu’on vint annoncer que le souper était servi. Mais aussitôt que nous fûmes seuls, il remit la conversation sur ce qui nous avait d’abord occupés, et en me prenant la main qu’il couvrit de baisers, il me dit, du ton le plus expressif, qu’il n’avait plus qu’un désir, celui de me tenir lieu du trop malheureux Georges. Cet aveu, auquel cependant je m’attendais, me rendit un peu confuse, et je baissai les yeux sans lui répondre. Il se leva, vint à moi, et me prit sur la bouche un baiser que je ne défendis pas. Ce larcin, qui servit d’aiguillon à sa flamme, dérangea mes combinaisons ; ma tête obéit à mon cœur, et j’oubliai Georges et mes serments, pour me livrer tout entière à l’amour de mon bienfaiteur. Sûr du désordre qu’il cause, il me prend par la main, me reconduit au salon, qu’il ferme après lui ; et, comptant sur le moyen qui lui avait déjà si bien réussi, il reprend sur ma bouche les baisers de feu qu’il vient d’y déposer. Pour cette fois, je n’y suis plus ; mon égarement est à son comble : je me laisse tomber sur lui, il me soulève doucement, et me renverse sur un sopha ; déjà mon mouchoir a disparu de dessus mon cou ; déjà ses yeux perçants ont dévoré mes autres charmes ; et bientôt l’Amour me décoche le trait que Richeville est chargé de diriger. Oubli du monde entier ! ô volupté des sens ! avec quelle ardeur je savourai tes délices ! combien de fois je crus expirer dans les bras de l’auteur de mes plaisirs ! Vils assassins, qui osâtes assouvir sur moi votre passion féroce, ah ! l’Amour m’a bien vengée, ce jour-là, de votre brutalité !
Quand je fus revenue de mon extase, j’étais si honteuse que je n’osais pas lever les yeux sur Richeville ; mais il me fit tant de caresses, il me dit tant de belles choses pour justifier ma faiblesse, que je cessai bientôt d’en rougir, pour donner un libre cours aux épanchements d’un cœur tendrement affecté.
Un an s’était écoulé dans les divertissements de toute espèce qu’il m’avait procurés ; j’étais loin de m’attendre que mon bonheur dût bientôt cesser, quand un événement imprévu vint le détruire.
Nous étions, Richeville et moi, à nous promener au Bois de Boulogne ; un jeune homme, auquel je n’avais pas trop pris garde, s’était déjà arrêté plusieurs fois pour nous examiner. Fatiguée de tant d’importunités, je jetai les yeux sur lui pour tâcher de deviner ce qui pouvait attirer son attention ; mais quelle fut ma surprise, quand je reconnus Joseph, le frère de l’infortuné Georges ! Je n’essayerai pas de peindre l’effroi que me causa cette étonnante apparition ; ce qui me surprend, c’est d’avoir pu conserver l’apparence du sang-froid, dans une circonstance aussi embarrassante. J’engageai Richeville à rentrer chez lui, et pour le déterminer à hâter notre retour, je lui dis que j’avais donné rendez-vous à une marchande, qui sûrement m’attendait déjà. Pendant ce temps, j’examinais Joseph, pour savoir ce qu’il allait devenir ; il nous suivit jusqu’à la porte du bois. En montant en voiture, j’ordonnai au laquais de dire au cocher d’aller grand train, parce que nous étions pressés d’arriver. Je voulais, par ce moyen, empêcher Joseph de nous suivre, et lui laisser ignorer, s’il était possible, le lieu que j’habitais. Je ne sais s’il courut aussi vite que la voiture, ou s’il mit sur-le-champ du monde à ma poursuite ; mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’il sut ma demeure.
J’étais à peine rentrée, qu’un tremblement soudain s’empara de tous mes membres ; je fus obligée de me jeter sur un canapé où je restai évanouie. Cet état de faiblesse fut long ; cependant je revins à moi, mais je conservai, pendant quelques heures, un étouffement qui me fit beaucoup souffrir. Dès que Richeville me vit mieux, il voulut savoir la cause de cet accident ; je la lui appris, en lui observant que je ne l’en avais point instruit dans le bois, pour ne pas lui donner d’inquiétude à mon sujet. Nous reconnûmes alors que j’avais commis une grande imprudence en me montrant si souvent en public, et il fut convenu que je ne paraîtrais plus, qu’il n’y eût certitude que je pourrais le faire sans danger.
Je me couchai de bonne heure ; mais il me fut impossible de dormir un seul instant, tant je fus agitée. Je craignais que Joseph ne connût la maison que j’habitais, et qu’il me fût impossible de lui échapper. Hélas ! j’avais bien raison ; car, dès le lendemain, on remit au portier une lettre à mon adresse. Je ne pus pas douter qu’elle fût de lui ; je l’ouvris en tremblant. Elle était ainsi conçue :
« Quoique vous ayez paru méconnaître hier le frère de Georges, il est trop sûr d’avoir été reconnu pour n’être pas piqué de l’insulte qu’il a reçue. Il désire cependant avoir un entretien particulier avec vous sur l’événement qui a mis le deuil dans sa famille et donné la mort à votre oncle.
« P. S. — Le domestique qui vous porte ce billet retournera demain à huit heures du matin chercher votre réponse. »
Quand j’eus achevé la lecture de cette lettre, un torrent de larmes s’échappa de mes yeux.
— Hélas ! me dis-je en soupirant, mon oncle n’est plus ; c’est peut-être à cause de moi qu’il est mort, et je ne puis cependant me reprocher sa perte.
Comme j’allais rêver au parti qui me restait à prendre, Richeville entra, je lui donnai à lire l’écrit de Joseph.
— Il n’y a pas à balancer, me dit-il, ma chère, il faut changer de demeure ; je vais, à l’instant même, vous retenir un appartement le plus près d’ici qu’il me sera possible, et dès ce soir vous vous y installerez.
Je le remerciai bien sincèrement de tant de complaisance, et il me tint parole ; je couchai ce jour-là même dans mon nouveau logement.
On a bien raison de dire que l’imagination fait tout : je l’éprouvai, car je fus à peine dans cet appartement, que m’y croyant plus en sûreté, je n’eus plus la moindre inquiétude.
Richeville, qui m’y avait accompagnée, me dit, en se retirant, qu’il serait deux ou trois jours sans me venir voir, pour que, dans le cas où on l’épierait, on ne pût pas découvrir l’endroit où je m’étais retirée.
J’y restai donc seule avec une femme qu’il me donna pour me servir.
Le lendemain matin on vint frapper à la porte ; j’hésitai quelque temps à faire ouvrir ; cependant, n’ayant pas le moindre soupçon sur Joseph, qui ne pouvait pas encore, selon moi, être parvenu à me retrouver, je fis entrer. Mais, oh ciel ! quel fut mon étonnement, quand je le vis, avec un inconnu, se précipiter dans l’appartement.
— Mademoiselle, me dit-il, il ne s’agit pas de fuir un éclaircissement qui m’est nécessaire ; vous pouvez vous expliquer devant monsieur, qui est homme de loi, et que j’ai amené ici pour recevoir votre déclaration. Il importe à ma famille et à moi de savoir ce qu’est devenu mon frère, et vous seule êtes en état de m’en donner des nouvelles.
Ce début m’intimida d’abord, et je fus un peu déconcertée ; cependant, en me recueillant sur ce que j’avais à répondre, la persuasion de mon innocence me rendit le courage ; d’ailleurs, je me doutai bien qu’il n’était point instruit du sort de son frère, parce qu’il était présumable que ses assassins avaient fait disparaître toutes les traces de sa mort. D’après ce petit raisonnement, je crus pouvoir arranger une fable qui, sans faire grand tort à la mémoire de Georges, me sauva le désagrément de redire de tristes vérités qui auraient pu me compromettre ; et voici comme je m’y pris :
— Il est bien cruel pour moi, messieurs, leur dis-je, d’être obligée de renouveler le souvenir de ma douleur et de n’avoir d’autre moyen de justification devant vous, que d’avouer ma faiblesse pour le plus perfide des hommes ; je sens que je me dois cet aveu, quoiqu’il m’en coûte, et vous allez juger si je ne suis pas moins condamnable qu’à plaindre.
Georges, comme vous avez pu vous en apercevoir, mon cher Joseph, pendant que nous étions chez mon oncle, devint amoureux de moi ; je l’aimai véritablement, et, de bonne foi, je me sentais disposée à lui en donner toutes les preuves qu’il exigerait. Il avait préparé de loin le plan d’évasion qu’il méditait, et nous profitâmes de votre absence et de celle de mon oncle pour venir ici. Il y avait près d’un mois que nous y étions, quand il fit connaissance d’une Anglaise, dont il obtint les faveurs, et, sans s’embarrasser de ce que je deviendrais, il m’abandonna pour passer en Angleterre avec elle. C’est ainsi qu’après m’avoir tout fait quitter pour le suivre, le cruel m’exposa aux tourments de la misère et du désespoir.
Joseph parut touché de mes prétendus malheurs.
— Ma pauvre Amélie, me dit-il, en se jetant à mon cou, que je vous plains ! je n’aurais jamais cru mon frère assez peu délicat, pour se conduire ainsi. Et comment avez-vous vécu ? comment vivez-vous à présent ?
— Réduite à la plus affreuse misère, par l’abandon de cet ingrat, et n’ayant point osé retourner dans mon pays, après la conduite peu sage que j’avais tenue, j’ai, par le plus grand hasard, eu le bonheur de rencontrer un homme honnête et compatissant qui, touché de ma triste situation, a eu la bonté de m’adopter et de me traiter comme sa propre fille. Je ne puis vous donner d’autres éclaircissements, et je vous prie de vous retirer, car je ne suis point chez moi ; je craindrais que votre présence ici ne m’occasionnât des désagréments.
Je m’aperçus que cette histoire avait produit un grand effet sur Joseph ; mais j’étais loin de soupçonner l’étrange changement qui s’opérait en lui.
— Je ne puis plus me séparer de vous, me dit-il, ma chère petite sœur, je veux réparer tous les torts de mon frère : vous êtes libre ; venez demeurer avec moi, nous serons parfaitement heureux.
Je lui observai que tout s’opposait à l’exécution de ce projet ; que mes liaisons avec son frère étaient un obstacle invincible à notre réunion ; que je ne pouvais le suivre sans offenser les mœurs et me rendre criminelle (car je voulais qu’il me crût des principes) : tout fut inutile ; une passion subite enflamma son esprit ; il me déclara que rien ne lui coûterait pour en venir à ses fins ; que c’était à tort que je cherchais des excuses pour ne pas me rendre à ses désirs. J’étais seule alors ; ma domestique venait de sortir, et le confident de Joseph, qu’un signe de ce dernier avait fait disparaître, sans que je me doutasse de ses desseins, m’avait laissée à la merci du frère de mon malheureux amant : il court vers la porte, met les verrous, revient, me prend dans ses bras, et me couvre de baisers enflammés, dont l’ardeur pénètre malgré moi dans mes veines. En vain je veux lui résister ; un bras nerveux, dont il me ceint le corps, suffit pour m’étendre sur le lit, où mon vainqueur s’élance ; et bientôt, plus fortuné que son frère, il jouit d’un bonheur que Georges n’avait fait qu’entrevoir.
Nous en étions là de cet exploit, lorsque nous entendîmes un bruit épouvantable à la porte de mon appartement. Nous sautons en bas du lit, et pendant que Joseph se rajuste de son mieux, je m’avance du côté de la première porte, et je prête l’oreille pour connaître, s’il est possible, la cause de cet esclandre. Qu’entends-je ? oh ciel ! malheureuse Amélie ! Richeville, furieux de ne pouvoir entrer, et ma domestique essayant en vain d’ouvrir la porte, dont le verrou nous répondait.
— Voyez, dis-je à l’imprudent Joseph, à quoi votre aveugle passion vient de m’exposer ? que vais-je devenir ? et vous-même, comment allez-vous vous tirer de ce mauvais pas ?
J’ignorais l’effet que produirait cette aventure sur l’esprit de mon amant ; car je ne voyais nul moyen de lui prouver que je lui fusse restée fidèle. Joseph tremblait de toutes ses forces, et me suppliait de le cacher pour le dérober aux vengeances d’un homme qui, sans doute, ne l’épargnerait pas.
Peu rassurée moi-même, mais obligée de prendre un parti quelconque, je fis entrer mon trembleur dans une armoire pratiquée dans le mur, et j’en mis la clé dans ma poche ; mais trop effrayée sans doute pour prendre les précautions qui étaient indispensables, j’oubliai de réparer le désordre du lit et de ma toilette, témoins muets, mais suffisants, pour attester ma faute. Je fus donc ouvrir les verrous, et Richeville et sa suivante entrèrent, bien étonnés de ne trouver que moi dans l’appartement.
— Pourquoi donc, me dit-il, nous faites-vous attendre si longtemps, et qu’avez-vous à craindre pour vous enfermer avec tant de précaution ?
Et tout en me parlant, il jetait sur moi, et par tout l’appartement, des yeux inquiets, que ma rougeur et mon embarras enflammèrent de courroux. Ce n’est plus un homme, c’est un forcené dont on ne peut maîtriser la rage. En vain je veux faire entendre quelques mots pour ma justification, il ne m’écoute pas, et m’ordonne de lui livrer le traître qui a violé l’asile qu’il m’avait accordé contre une prétendue persécution, que je n’ai imaginée, selon lui, que pour jouir plus tranquillement du fruit de sa complaisance et de son fol amour pour moi. Je me jette à ses pieds, je le conjure de calmer les transports qui l’agitent, et de m’entendre avant de me juger coupable ; ma position suppliante le désarme ; il s’assied et m’écoute :
— Qui peut donc causer le trouble effrayant où je vous vois, lui demandai-je, en m’approchant de lui, pour l’apaiser plus sûrement par des caresses qu’il repousse ? Quel rapport alarmant a-t-on pu vous faire sur mon compte, et ne suis-je plus digne de la tendresse que vous m’avez vouée ?
— Il vous sied bien, ingrate, me répondit-il avec dédain, de me tenir un pareil langage, à vous, qui me payez de mes bienfaits par la plus noire perfidie ! Où est ce prétendu frère de Georges, qui venait, m’aviez-vous dit, la vengeance à la main, vous demander compte des destins de son frère ? Où est-il, que je lui fasse passer l’envie d’aller désormais en bonne fortune ?
Cette menace fut accompagnée d’un geste qui me fit trembler pour les jours de Joseph, s’il était découvert ; car il sortit de sa poche une paire de pistolets dont il me parut disposé à faire usage. Je protestai de mon innocence, et l’assurai que j’étais seule ; que si je m’étais enfermée aux verrous, c’était dans la crainte que Joseph, profitant de l’absence de ma domestique, ne revînt à la charge, et que je croyais que c’était lui qui reparaissait, quand j’avais laissé si longtemps frapper à la porte ; qu’il pouvait, au surplus, visiter mon appartement, pour s’assurer de la vérité de ce que je lui disais.
Il se contentait de cette explication, et j’allais en être quitte pour la peur, quand ma maudite servante entra dans ma chambre à coucher ; elle soutint que j’en imposais par ma fermeté, et que ma défense était un tissu de mensonges ; qu’elle n’était sortie pour avertir M. Richeville que lorsque l’ami de Joseph m’avait laissée seule avec lui, et qu’à la manière dont mon lit et mes cheveux étaient dérangés, il était facile de voir que je n’avais pas été aussi sage que je le prétendais.
Je convins qu’effectivement ce jeune homme avait voulu profiter de l’occasion que l’absence de ma dénonciatrice lui fournissait, pour obtenir quelques faveurs ; mais que ma reconnaissance et mon amour pour Richeville m’avaient prêté assez de force pour les lui refuser.
— À votre place, reprit cette mégère, je ferais la visite la plus stricte de l’appartement, et je suis sûre qu’elle ne serait pas infructueuse.
L’avis est trouvé bon, et voilà mon homme qui se met en devoir de faire la recherche qu’on lui conseille. Il regarde d’abord sous le lit, et passe ensuite avec elle dans un petit salon, qui, heureusement, n’avait qu’une porte sur ma chambre à coucher. Ils y sont à peine entrés, que je ne balance pas sur le parti qui me reste : je les y enferme, et je cours délivrer le trop heureux Joseph des frayeurs dont il avait failli périr dans son étroite prison.
Quand je crus lui avoir donné assez de temps pour être dans la rue, je revins ouvrir la porte du salon, où le couple que j’y avais consigné chantait à ma louange le plus joli duo du monde. Richeville fond sur moi, et me menace de me rendre victime de ma trahison. Loin de m’épouvanter de sa fureur, je Je regarde fièrement, et lui demande de quel droit il prétend m’avoir fait son esclave, s’il ne croit pas ce qu’il appelle des bienfaits assez payés par ma complaisance sans bornes pour lui, et s’il espère m’ôter jusqu’à la liberté d’y renoncer ?
— Non, me dit-il, mademoiselle, je n’ai pas ce pouvoir, et pour vous le prouver, je vous déclare que dès ce moment, il n’y a plus rien de commun entre nous ; vous êtes bien maîtresse de disposer de vous comme vous le jugerez à propos.
Il ne m’en dit pas davantage, et sortit en me laissant seule avec la méchante femme qui m’avait attiré cette scène.
Trop fière pour m’abaisser jusqu’à vouloir connaître les motifs de sa conduite, je ne lui fis pas l’honneur de lui adresser un mot. Mon mépris pour elle fut si profond, qu’il m’aurait été impossible de lui faire le moindre reproche.
Trop sensible pour n’être pas piquée du ton absolu que Richeville avait pris avec moi, je m’interdis toutes réflexions sur ce que j’allais devenir en le quittant. J’étais bien persuadée qu’il m’aimait assez pour me retenir chez lui, si je voulais faire quelques avances pour y rester ; mais je m’occupai sur-le-champ des moyens d’abandonner un homme que son courroux, peut-être légitime, mais molestant pour moi, venait de me rendre odieux.
Je regrettai fort de ne pas savoir où trouver Joseph ; car, d’après ce qui s’était passé entre nous, je me sentais décidée à accepter la proposition qu’il m’avait faite d’aller vivre avec lui ; mais je désespérai de le revoir, par la seule raison que je le savais trop peureux pour revenir dans une maison d’où il était échappé par une espèce de miracle, et où il pouvait croire que j’étais restée.
À peine Richeville fût-il dehors, que je m’empressai de recueillir tout ce que j’avais reçu de sa libéralité, en linge, hardes, bijoux et argent ; j’enfermai le tout bien soigneusement, et je sortis pour louer un petit appartement.
Chemin faisant, il me vint dans l’idée d’aller faire visite à une jeune personne, nommée Victoire, que j’avais eu occasion de voir souvent chez Richeville, parce qu’elle avait été entretenue par un de ses parents qui l’avait quittée depuis quelques mois. Je lui appris l’événement fâcheux qui m’arrivait ; elle y parut sensible, et l’air de vérité que je crus apercevoir en elle, redoubla l’affection que je lui portais ; mais on va voir dans quelle erreur grossière j’étais tombée à son égard, et ce qu’il m’en a coûté pour m’être trop facilement livrée aux mouvements de mon cœur, pour la plus scélérate de toutes les femmes.
Je lui fis part de l’intention où j’étais de me loger dans son quartier, pour être plus à portée de la voir, et de cultiver sa connaissance. J’eus aussi l’indiscrétion de lui parler d’une somme assez considérable que j’avais en ma possession. Elle connaissait une grande partie de ma garde-robe, et n’ignorait pas que j’avais été une des femmes les mieux entretenues de la ville. Il faut croire que ma petite fortune la tenta ; car, pour réussir dans son projet, elle fit usage d’un moyen qui devait d’autant mieux la servir, qu’il augmentait ma confiance, en paraissant m’indiquer le degré d’attachement qu’elle avait pour moi. Elle se jette à mon cou les larmes aux yeux, et me dit qu’elle ne souffrira pas que j’aille m’exposer à périr d’ennui dans la solitude où j’ai dessein de me retirer : elle veut absolument que je dispose d’une partie de son logement, et me promet de me faire trouver l’oubli de mes peines, dans les douceurs de l’amitié la plus tendre.
Je ne puis exprimer le plaisir que me fit l’offre consolante de cette généreuse amie. Trop pleine de ma reconnaissance, je ne pus lui répondre ; mais les pleurs de joie dont je mouillai son visage en l’embrassant, pour la remercier, durent lui faire assez connaître combien j’avais été touchée de l’honnêteté de son procédé.
Dès le lendemain matin, je fis faire mon déménagement, et il n’était pas encore nuit, que j’étais déjà chez elle.
Pendant le premier mois, je n’eus qu’à me louer de la manière dont je fus traitée. Soins, prévenances, elle ne négligea rien pour me captiver ; nous étions d’ailleurs du même âge, nous avions presque les mêmes goûts, et je ne refusais jamais les parties de plaisir qu’elle me proposait ; aussi ce premier mois fut-il employé en divertissements de toute espèce.
Victoire avait depuis quelque temps un nouvel amant que je ne lui connaissais pas ; il pouvait avoir trente ans, grossièrement tourné, mais assez bien de figure, bavard à l’excès, superficiel, parlant de tout, sans avoir jamais rien approfondi, et voulant paraître fort instruit, quoiqu’au fond très ignorant. Il avait été autrefois dans la pratique, puis il s’était fait commis ; mais ses appointements ne suffisant point à la dépense qu’il faisait, il était sur les crochets de cette amie qui, pour prix de son amour et des soins qu’elle lui prodiguait, n’en recevait souvent que dédains et mortifications. Cependant, avec tous ses défauts, elle l’aimait éperdument, et aurait tout sacrifié à l’avantage de le conserver. Je ne pouvais pas concevoir cette aveugle frénésie ; il me semblait extravagant de prodiguer tant d’amour à un être qui s’en montrait si peu digne ; et pour moi, il m’eut été impossible de nourrir dans mon cœur une flamme qui n’aurait pas embrasé celui qui l’y aurait fait naître.
Ce singulier galant était toujours de nos parties, et ne voulait jamais souffrir qu’on y admît d’autres hommes que lui, malgré les propositions que faisait souvent sa maîtresse, de me donner un cavalier, pour faire, à ce qu’elle disait, partie carrée ; mais plutôt de peur que trop d’occasions de se trouver seul, ou presque seul avec moi, ne lui inspirassent le désir de m’en conter à ses dépens. On va voir quels étaient les motifs de l’obstination de l’amant, et si les craintes de Victoire étaient fondées.
Je ne m’étais point encore trouvée en tête-à-tête avec lui ; je ne pouvais donc pas connaître ses véritables intentions à mon égard. Il s’était bien quelquefois, en présence de sa maîtresse, permis avec moi des libertés que j’avais toujours su réprimer ; mais cela n’indiquait pas assez clairement qu’il eût jeté des vues sur moi. Il ne lui était pourtant pas difficile de me rencontrer seule à la maison ; Victoire s’en absentait des heures entières, et j’ai souvent remarqué que ce n’était pas par excès de fidélité ; car ces sorties avaient toujours lieu le matin, quand elle était bien sûr que Lechesne (c’est ainsi qu’on appelait son ami) ne pouvait venir : son emploi le retenait presque toute la matinée, et elle comptait un peu sur cette espèce de servitude, pour se permettre des passades lucratives, que quelques femmes charitables se faisaient un devoir de lui procurer.
Un jour cependant qu’elle était sortie, il vint vers dix heures du matin. Je présume qu’il savait qu’il me trouverait seule ; j’étais encore couchée. Il entra dans ma chambre. J’avoue que ce ne fut pas sans crainte que je l’y souffris ; mais quand j’aurais voulu l’obliger de sortir et de passer dans une autre pièce, pour attendre sa maîtresse, cela eut été inutile, parce que je vis bien qu’il ne m’aurait pas obéi.
Il me fit quelques compliments, vint s’asseoir auprès de mon lit, et sans autre cérémonie, le téméraire glissa sa main sous le drap, me prît la gorge, et s’empara d’une de mes mains, qu’il baisa malgré mes efforts pour l’en empêcher. Je le repoussai brusquement, et m’enveloppai de manière à augmenter les difficultés de l’entreprise, mais ce fut en vain ; car, dès qu’il s’en aperçut, il se leva, et je me trouvai bientôt sans drap ni couverture. Profitant de cet avantage, il s’élance sur le lit pour se saisir de moi ; au mouvement que je lui vois faire, je suis bientôt debout, et dans l’instant où il veut me serrer dans ses bras, furieuse, je lui passe les miens autour du cou ; nous nous tenons quelques instants dans cette posture ; mais enfin, un effort pour me faire tomber sur le lit, un autre de ma part pour lui résister, nous entraînent tous les deux et nous précipitent en bas du lit. Heureusement qu’il eut le dessous dans cette catastrophe ; je ne me fis aucun mal en tombant sur lui, et le malheureux reçut à la tête une blessure qu’à tous égards il avait bien méritée. Cette chute me débarrassa d’un adversaire opiniâtre, qui commençait à se faire redouter.
Je ne voulais cependant pas jouer la prude dans cette circonstance ; je l’aurais même été de bonne foi, qu’on ne voudrait pas me croire ; mais deux fortes raisons m’empêchaient de me rendre à ses désirs ; d’abord, c’est que je ne me sentais aucun goût pour lui ; et, en second lieu, que mon amitié pour Victoire, à laquelle c’eût été manquer trop essentiellement, ne m’aurait jamais fait consentir à lui accorder la moindre faveur.
Au bruit que nous fîmes en tombant, la domestique accourut et me trouva occupée à donner des soins à ce jeune homme qui s’était évanoui. En me voyant aussi lestement vêtue, cette fille s’imagina, sans doute, qu’il avait été l’homme du monde le plus heureux, tandis que la blessure qu’il s’était faite, était tout le fruit, bien amer, qu’il avait recueilli de ses peines. Dans le moment, je m’inquiétai fort peu de ce qu’elle pouvait penser ; je ne songeai qu’à le rappeler à la vie ; mais, par réflexion, je craignis qu’elle ne m’accusât, auprès de sa maîtresse, d’avoir trahi l’amitié ; je fis tout ce qui dépendit de moi pour l’obliger à se taire, et Lechesne parvint à lui persuader qu’il ne s’était rien passé entre nous, en lui racontant l’événement comme il était arrivé.
Pendant le récit de cette scène, j’avais eu soin de me remettre au lit. Je m’attendais à quelques reproches ; il me les fit assez tranquillement, mais d’un air qui ne me laissa que trop apercevoir qu’il était vivement piqué contre moi ; il sortit aussitôt, me laissant livrée à mille réflexions sur les suites de cet accident.
Bientôt après, Victoire rentra ; le calme parfait qui régnait alors dans la maison ne lui fit rien soupçonner de ce qui s’y était passé ; ce ne fut qu’à l’heure du dîner, quand elle ne vit point venir son ami, qu’elle manifesta quelques inquiétudes ; elle envoya chez lui pour savoir ce qui causait ce retard ; il lui fit dire qu’il s’était, en tombant, fait à la tête une légère blessure qui l’obligeait de garder la chambre ; qu’il espérait que deux ou trois jours suffiraient pour sa guérison.
Après dîner, Victoire me témoigna le désir de l’aller voir, et me proposa de l’accompagner ; j’étais fort embarrassée pour lui répondre, je craignais d’éveiller ses soupçons en refusant tout net, et je redoutais de paraître chez celui que j’avais si maltraité sans le vouloir. Cependant, pour ne pas la contrarier, je promis dès qu’elle renouvela ses instances.
Il est aisé de se faire une idée de la manière dont je fus reçue ; son étonnement ne pourrait se rendre : il ignorait que j’eusse cédé aux sollicitations de mon amie, et pouvait croire que je n’étais allée chez lui que pour jouir de mon triomphe, et l’insulter dans sa défaite ; je crois même qu’il n’eut que cette dernière idée, parce que, dès ce moment, il me voua une haine implacable. Je ne conçois pas comment Victoire, qui le voyait ordinairement libre, gai, et aux petits soins avec moi, ne s’aperçut pas de l’air froid qu’il me marquait. La contrainte que j’avais éprouvée dans cette première visite m’en fit craindre une seconde ; le lendemain, je feignis une migraine pour m’en exempter ; le troisième jour on ne m’en parla plus, et je fus insensiblement délivrée de cette gêne, qui était devenue une sorte de tourment pour moi.
Au bout de huit jours, l’amant reparut, bien guéri, bien dispos, et en état de reprendre son plan d’attaque ; mais celui qu’il avait formé était bien loin de ma pensée : c’était à tort que je croyais qu’il pourrait se flatter de me trouver plus sensible, après ce que je lui avais coûté de peine et de souffrance. Il affecta, au contraire, de me regarder avec dédain, de ne jamais m’adresser la parole, et ce mépris fut si marqué, que, cette fois, Victoire ne put douter qu’il y eût quelque chose d’extraordinaire. Elle voulut en savoir les raisons, et le forcer de s’expliquer ; mais ce fut inutilement qu’elle employa prières et caresses ; il persista dans son refus. Quant à moi, je parus en ignorer absolument les motifs, et n’eus point l’air d’être offensée de son procédé.
Il était à peine sorti de l’appartement, que Victoire me conjura de lui expliquer ce mystère. Je m’y refusai d’abord, parce que je sentais bien tout ce qui allait résulter de mon aveu, et que je ne voulais pas me donner l’odieux de les avoir désunis par une indiscrétion ; mais, pour m’arracher mon secret, elle me menaça de me retirer son amitié ; il n’en fallut pas davantage ; je lui fis une confidence dont j’eus bientôt lieu de me repentir.
Cruellement affectée de voir ses soupçons éclaircis, elle dissimula cependant assez bien ses véritables sentiments, pour ne pas trop le paraître ; ce ne fut que le lendemain, quand Lechesne revint, qu’elle ne put se contenir. Ils eurent une explication très vive, à laquelle je n’assistai point, parce que, dès que je vis que la conversation s’échauffait, j’eus l’attention de me retirer dans ma chambre, et de ne reparaître que quand il fut parti.
Victoire me répéta toute leur conversation, et me dit qu’il exigeait que je sortisse de la maison, ou qu’il n’y remettrait plus les pieds ; mais qu’elle lui avait répondu, sur ce dernier point, de manière à lui faire comprendre qu’elle préférait me conserver. Persuadée du contraire, je voulais absolument qu’elle consentît à ce que je m’éloignasse ; mais quelques raisons que je pusse lui donner, il me fut impossible de les lui faire entendre. Je pris toutefois mon parti, parce qu’il n’était pas naturel qu’elle se contraignît au point de paraître, vis-à-vis de moi, brouillée avec un homme qu’elle chérissait au delà de l’imagination. Cependant, à dire vrai, je me trouvais un peu embarrassée dans le choix des moyens que j’employerais pour la forcer de me laisser partir ; car, en entrant chez elle, je l’avais fait dépositaire de tout ce que je possédais, et j’avais de la peine à prendre sur moi de lui en demander la restitution. Il fallait bien en venir là, si je persistais dans mon dessein, et je sentais parfaitement que, par beaucoup de raisons, je ne pouvais pas m’en dispenser. Je laissai néanmoins écouler quelques jours, pour voir comment les choses tourneraient. Lechesne ne reparut point. Victoire me confia qu’elle avait entièrement rompu avec lui : elle me dit même que depuis longtemps elle désirait cette séparation, parce que cet homme commençait à lui devenir à charge, et prenait chez elle un ton d’autorité auquel, à tous égards, il n’avait pas droit de prétendre : que rien ne s’opposant plus à ce que je continuasse de rester avec elle, elle m’engageait, au nom de la plus tendre amitié, de ne pas l’abandonner. J’eus la bonhomie de croire à la sincérité de ses démonstrations, et je me déterminai, de bonne grâce, à faire ce qu’elle paraissait tant désirer.
Cette absence de l’amant, ce sacrifice apparent de la maîtresse en ma faveur, tout cela n’était qu’une feinte, pour pouvoir plus aisément me faire donner dans le piège qu’on me tendait et dont je ne m’aperçus pas.
Depuis que Lechesne ne paraissait point à la maison, Victoire, plus libre, ne s’y conduisait pas de la même manière. Elle ne se bornait plus à ses courses du matin : il lui arrivait souvent de sortir seule le soir, et de rentrer, peu de temps après, avec un homme inconnu, qui la suivait dans sa chambre, où on devine aisément ce qui se passait.
Je ne tardai pas à me dégoûter de ce genre de vie, et je m’en expliquai amicalement avec elle. Ma franchise lui déplut ; elle mit de l’aigreur dans ses observations ; je m’emportai ; nous oubliâmes insensiblement que nous étions amies, pour nous livrer aux transports de la passion qui nous guidait.
Dans un mouvement de colère, je lui dis que je voulais absolument la quitter, et qu’elle eût à me remettre, à l’instant, l’argent, les bijoux et les hardes que j’avais apportés chez elle, offrant de lui payer, comme il était naturel de le faire, les frais que je pouvais lui avoir occasionnés, par mon séjour dans sa maison.
Elle se mit à rire, et parut peu disposée à satisfaire à ma demande. J’insistai cependant ; et, forcée de me répondre, elle eut l’impudence de me dire qu’elle était surprise de mes réclamations, et qu’il fallait sans doute que je fusse devenue folle pour lui en faire de pareilles ; qu’elle n’avait jamais rien eu à moi, et me priait de ne plus lui en reparler.
Je l’avouerai, la foudre tombée à mes pieds m’eut moins atterrée que sa réponse. Je conservai pourtant assez de présence d’esprit pour lui reprocher, de sang-froid, la noirceur de son procédé, et pour lui faire sentir toute son injustice ; mais après m’avoir écoutée patiemment pendant quelque temps, lassée d’entendre des vérités dures, elle me laissa seule et se retira dans sa chambre : je l’y suivis, bien déterminée à ne la laisser en repos que lorsque je l’aurais trouvée plus raisonnable. Elle feignit enfin de se rendre à mes sollicitations ; m’allégua différentes raisons pour m’engager à cesser mes importunités, et me promit que le lendemain ne se passerait pas, sans que tout fût terminé entre nous.
Il fallut bien se résoudre à lui accorder le délai qu’elle exigeait ; j’y consentis, d’ailleurs, d’autant plus volontiers, que je crus qu’il lui était nécessaire pour lui donner le temps de remplacer ce dont elle avait pu faire usage ; car je ne pouvais pas me persuader qu’elle eût réellement l’intention de me voler.
Le lendemain, elle sortit de très bonne heure, et ne rentra point de la journée. J’augurai bien de cette absence, qui semblait me confirmer dans l’idée, que j’avais eue la veille, qu’elle s’occupait de moi. Il était nuit quand, à mon grand étonnement, elle revint avec l’inséparable Lechesne, suivi de deux hommes, dont la tournure sinistre n’annonçait rien de bon.
J’avais attendu son retour avec tant d’impatience, que je lui laissai à peine le temps de se reposer, et je profitai d’un moment où elle passa seule dans une autre pièce, pour lui rappeler la parole qu’elle m’avait donnée. Elle me dit qu’ayant été obligée d’employer, à des besoins pressants, l’argent que je lui avais confié, elle avait fait beaucoup de démarches pour se le procurer ; et qu’enfin elle y était parvenue, par l’entremise des personnes qu’elle venait d’amener avec elle ; mais que l’ami qui lui faisait ce prêt ne pourrait être en état de l’effectuer qu’à huit heures du soir, parce qu’il fallait qu’il fit lui-même quelques recettes pour le compléter ; qu’il avait donné rendez-vous chez lui pour cette heure, et que ne voulant pas s’exposer en sortant si tard, elle me priait de l’y accompagner. L’envie de terminer avec cette femme, et d’avoir mon argent, m’empêcha de faire aucune réflexion sur la singularité de cette proposition. En effet, qu’avais-je besoin de me mêler de ses affaires ? Ne valait-il pas mieux en attendre la réussite tranquillement à la maison ? C’est ce que j’aurais dû faire, et ce que, malheureusement, je ne fis pas.
À sept heures et demie, on fit venir une voiture de place ; Victoire et moi nous y montâmes, avec Lechesne et les deux hommes qui l’avaient accompagnée. L’ordre fut donné au cocher sans que je m’en aperçusse. Il nous conduisit à l’une des extrémités de la ville, dans un quartier qui m’était tout à fait inconnu. La voiture s’arrêta devant une maison à porte cochère ; je crus que c’était là que nous allions entrer, et comme on ouvrit la portière de mon côté, Lechesne en sortit avec précipitation, et me donna la main pour descendre. Nous en étions à peine dehors, que la voiture partit et disparut bientôt à mes yeux.
Restée seule avec ce gredin, dans une rue déserte, où on n’apercevait pas même une lumière, une terreur subite s’empara de tous mes sens ; je voulus parler, mais inutilement, il me fut impossible d’articuler un seul mot ; mais j’entendis très clairement ce qu’il était chargé de me dire de la part de l’infâme Victoire : elle me répétait qu’elle n’avait rien à moi, et me défendait très expressément de remettre les pieds chez elle, à moins que je ne voulusse m’en faire chasser ignominieusement. Il me parlait en fuyant, et je n’avais pas encore retrouvé l’usage de la parole, qu’il était déjà bien loin.
Épouvantée du coup qui venait de m’accabler ; indignée du procédé de l’abominable femme qui avait si cruellement abusé de ma crédulité, et révoltée de la scélératesse du monstre, qui n’avait que trop bien secondé son coupable dessein, mille idées confuses me passaient par la tête, sans que mon esprit incertain pût se fixer sur le parti que j’avais à prendre : mes yeux s’arrêtaient indistinctement sur tous les objets qui les frappaient, sans en distinguer aucun ; enfin, je sentis que je n’étais pas loin du mur, et reprenant, par degrés, mes sens, je parvins à gagner le bout de la rue, en tâtonnant mon chemin.
Quand je fus à cet endroit, j’aperçus quelques boutiques encore ouvertes, et je commençai à me rassurer un peu ; mais il était temps que j’y arrivasse ; car à peine revenue de mon saisissement, mes jambes fléchirent sous moi, et je n’eus que le temps de m’asseoir sur une borne, qui se trouva là fort à propos, pour m’empêcher de tomber.
Ma position terrible me fournissait une ample matière à réfléchir. Il me vint d’abord dans l’idée de prendre un fiacre et de me faire reconduire chez Victoire ; mais en me rappelant les adieux de son émissaire, je n’eus pas de peine à me persuader que je n’en obtiendrais rien, et je craignais qu’en voulant y rentrer de force, on ne me fit arrêter et mener en prison, parce qu’à coup sûr elle aurait feint de ne pas me connaître, et m’aurait fait passer pour une aventurière : je crus donc entrevoir qu’il n’était pas prudent de s’exposer à ce danger ; j’avais bien assez de mon malheur présent, sans courir encore les risques de l’accroître.
Il ne me restait qu’à chercher un abri pour la nuit, et de remettre au lendemain à aviser aux moyens de réparer mes pertes, ou du moins d’adoucir la rigueur du sort dans lequel ma fatale destinée venait de me plonger ; car il est bon de savoir que je n’avais qu’un louis en or et un peu de monnaie ; et qu’avec une somme si modique, on ne va pas ordinairement bien loin.
Je m’adressai donc à la première boutique, et je priai une dame que j’y trouvai, de m’indiquer une maison garnie où je pusse aller coucher. Elle eut l’honnêteté de sortir et de me montrer une rue, où elle me dit que je trouverais ce que je cherchais. Effectivement, je ne m’adressai qu’à une seule personne qui me conduisit à cette maison tant désirée.
Elle était tenue par un tailleur, qui occupait la boutique ; je lui demandai s’il avait vacant un cabinet garni, et s’il voulait me le louer : il me dit que la seule chambre qui lui restât était au second étage, sur le devant ; qu’il ne pouvait la louer moins de dix-huit francs par mois, et que l’usage de sa maison était de payer quinze jours d’avance. Ce n’était pas le cas de marchander ; je lui payai ce qu’il exigeait, et je pris possession de cette chambre.
La scélératesse de Victoire était toujours présente à ma pensée : livrée à moi-même, sans apercevoir le moment qui me rendrait à la société, dont je me croyais séparée pour jamais, cette solitude me fit sentir toute l’horreur de ma situation. Ce fut là, que du fond de l’abîme, où cette indigne amie m’avait précipitée, je m’abandonnai aux plus cruelles réflexions. Incapable de gagner ma vie par aucune espèce de travail, je sentis tout le vice de mon éducation : je reconnus que l’homme, dans quelque rang que la fortune le fasse naître, doit employer ses premières années à se donner un talent qui puisse l’élever au-dessus du besoin, s’il plaît à cette inconstante déesse de lui faire éprouver ses caprices. D’un côté, la misère s’offrait, sous les traits les plus hideux, à mes regards épouvantés ; de l’autre, je ne voyais, pour toute ressource, que l’infamie ; mais quelle cruelle alternative !… Le cœur navré de douleur, l’âme abattue, un froid mortel se répandit sur tout mon corps ; je me crus seule dans l’univers ; je fondis en larmes. Ce délire des esprits faibles, le désespoir, s’empara de moi ; vingt fois je voulus me précipiter par la fenêtre : dans mon égarement, je faisais le tour de ma chambre avec autant de promptitude que si j’eusse été poursuivie. Je ne pouvais longtemps résister à tant d’agitations ; excédée de fatigues, affaiblie par tant de mouvements, je me jetai tout habillée sur le lit, pour y chercher des secours que l’impitoyable Morphée eut la cruauté de me refuser.
Quelle nuit j’y passai, ou plutôt quel supplice il m’y fallut endurer ! Non, je ne crois pas qu’il y ait de tourments qui puissent égaler ce que j’ai souffert. Il faut s’être trouvé dans une pareille circonstance, pour en concevoir l’idée. C’est en vain que je voudrais décrire cette affreuse position, je serais trop loin de mon sujet, et je craindrais d’ailleurs que le tableau, s’il était ressemblant, ne me rendît l’impression qu’elle m’a faite.
Cependant le jour venait de dissiper les ombres de la nuit : tout avait repris une forme nouvelle ; mon cœur seul conservait sa tristesse. Accablée sous le poids de mon infortune, j’essayai de descendre de ce lit de douleur, où la nuit cruelle que j’y avais passée m’avait paru un siècle ; mais je ne pus me soutenir sur mes jambes ; je fus obligée de prendre une chaise, où j’attendis que la fille vînt faire mon lit. Elle me trouva dans cet état affreux, et s’apercevant que je ne m’étais pas couchée, elle me demanda si j’étais incommodée, et si j’avais besoin de quelque chose. Je la remerciai de son attention, mais je profitai de sa bonne volonté pour m’exempter de sortir. Elle m’acheta les choses les plus nécessaires à la vie, m’offrit tous ses soins, et me laissa seule abandonnée à mes chagrins.
Je restai huit jours dans cette chambre, à me creuser la tête pour chercher les moyens d’exister, sans en trouver aucun. Je ne voulais pas m’avilir au point de mendier dans la rue les secours du premier venu, en échange de la jouissance de mes appas ; cet abaissement répugnait à ma fierté ; cependant, que pouvais-je faire pour obvier à cet inconvénient ? Manquant absolument de tout, après avoir payé si chèrement quatre mois d’existence chez Victoire, il ne me restait qu’un parti, celui de me jeter, en détournant les yeux, dans les bras de l’une de ces femmes qui savent faire valoir les appas des autres, sans leur donner le désagrément de les offrir. Je ne me dissimulai pas que le crime est toujours le même ; mais je m’aveuglai sur la honte qu’il imprime à celle qui s’en rend coupable, en croyant trouver une excuse dans la manière de le commettre.
J’imaginai que, pour me faire connaître de cette espèce de femmes, il fallait me montrer au spectacle, et que c’était là la recette infaillible ; heureusement que j’avais fait un peu de toilette, quand j’étais sortie de chez Victoire ; je n’eus besoin que de me faire coiffer, et me rendis de bonne heure aux Italiens.
À peine étais-je placée, que je vis entrer dans la loge où j’étais, une femme attirée, sans doute, par le fumet d’un gibier qu’elle chassait souvent. Je jugeai, à sa tournure, qu’elle était une de celles que je cherchais ; en effet, elle ne tarda pas à lier avec moi une conversation, qui d’abord fut très indifférente, mais qui devint bientôt plus sérieuse. Quand je l’eus assez entendue, pour ne pas me tromper sur son compte, je glissai adroitement quelques mots sur la position où je me trouvais : elle me fit entrevoir la possibilité de la changer promptement, et de me placer chez une femme qui me procurerait les moyens de regagner, en peu de temps, tout ce que j’avais perdu.
— J’ai votre affaire, me dit-elle ; dès demain matin je vous présenterai à une de mes amies, qui n’admet chez elle que des gens comme il faut ; vous y trouverez l’utile et l’agréable.
Elle me tint parole : le lendemain, elle vint me prendre et me conduisit rue de Richelieu, chez madame Dupré, son amie. Cette femme, à laquelle j’eus le bonheur de plaire, me fit l’accueil le plus flatteur, et témoigna à mon introductrice sa reconnaissance, de la préférence qu’elle lui avait donnée sur beaucoup d’autres, qui auraient été bien flattées de me recevoir. Je lui fis quelques compliments pour toute réponse, et nous convînmes de nos faits.
Le lendemain, je fus admise au nombre des sultanes qui composaient son sérail. En me présentant aux deux compagnes qu’elle allait me donner, elle nous dit qu’à présent elle était sûre que l’amour ne déserterait pas sa maison, puisqu’elle était parvenue à y réunir les trois Grâces. En effet, ces deux jeunes filles étaient infiniment jolies ; et la Dupré, pour me faire sa cour, ne cessait de me répéter que j’étais encore plus jolie qu’elles.
Quelques jours suffirent pour me lier étroitement avec ces charmantes filles ; la bonne Dupré, de son côté, fit tout ce qui dépendait d’elle pour me faire oublier Victoire et sa perfidie. Je promis de n’y plus penser, et je m’abandonnai entièrement au nouveau sentiment qu’on venait de m’inspirer. L’amitié, ce besoin du cœur, qu’on éprouve rarement entre femmes qui sont exposées aux préférences des hommes, et d’où naissent ces rivalités, source de mille désagréments, ne tarda pas à nous unir toutes les trois, et nous donna assez de philosophie pour nous rendre insensibles à ce qu’on appelle ailleurs des mortifications, et que là, nous eûmes le bon esprit de trouver naturelles, persuadées que c’est plus souvent le caprice que le bon goût, qui détermine dans ces circonstances.
Cependant, pour adoucir, autant qu’il était possible, l’espèce d’humiliation que doivent ressentir des femmes qui n’ont pas totalement rompu avec les principes, lorsqu’il faut qu’elles passent en revue devant un homme, que le désir de jouir amène dans ces sortes de maisons, la Dupré nous avait fait peindre toutes les trois : nos portraits, parfaitement ressemblants, et point du tout flattés, étaient suspendus dans le salon, où l’amateur introduit pour faire son choix, désignait à la maman celle qui lui plaisait le plus : on la faisait avertir ; elle paraissait seule, et par ce moyen notre amour-propre ne se trouvait jamais compromis. Ce sont là de ces idées heureuses, dont on doit savoir gré aux personnes qui les conçoivent, puisqu’elles servent à entretenir la paix entre gens qui ont tant d’occasions de la voir troubler.
Il n’y avait pas longtemps que la Dupré avait mis ce moyen en pratique ; nous en avions cependant déjà ressenti les heureux effets ; mais plusieurs de ses habitués, absents pendant quelque temps, ignoraient même qu’il existât. Un d’eux, entre autres, jeune homme charmant qui, depuis dix-huit mois, voyageait en Allemagne, venait d’arriver à Paris. Un de ses premiers soins fut de venir visiter notre sérail. On le fit passer dans le salon, où il vit nos portraits. Nous étions toutes les trois entrées chez la Dupré depuis que ce jeune homme n’y avait paru : par conséquent, il n’en connaissait aucune de nous. Il fut surpris, à ce qu’il dit, de la réunion de trois personnes aussi intéressantes, et après nous avoir longtemps examinées en peinture, il avoua qu’il était dans le plus grand embarras, et que jamais, restât-il deux heures à nous contempler, il ne pourrait faire un choix qui lui fît oublier celles qu’il n’aurait pas demandées : qu’il ne voyait qu’un moyen de satisfaire ses désirs, et qu’il espérait que la Dupré, en faveur de leur ancienne connaissance, se priverait, pendant toute la journée, des beautés qu’elle offrait à ses regards, puisqu’il ne pouvait se décider à donner la pomme à l’une d’elles.
La bonne ne promit rien, parce qu’elle voulait auparavant savoir si nous accepterions cette partie ; il s’agissait d’aller dîner à la campagne, trois femmes avec un seul homme ; Sophie n’était pas de cet avis, elle craignait de s’ennuyer ; l’autre ne savait trop que répondre.
— Pourquoi refuserions-nous, leur dis-je, de faire une partie qui, d’abord, j’en conviens, paraîtra bizarre ; mais qui peut aussi nous procurer beaucoup d’agrément ? N’êtes-vous pas curieuses de voir comment se tirera d’affaire, un homme assez imprudent pour faire une pareille proposition à trois femmes comme nous, qui sommes, l’une après l’autre, en état de lui tenir tête ? Pour moi, je vous avoue que je suis prête à partir, bien convaincue que celui qui se propose n’est pas un homme ordinaire ; et qu’en supposant que nous ne trouvions pas en lui toutes les ressources qu’une seule aurait le droit d’exiger de ses forces, il doit les suppléer par un fonds inépuisable d’esprit, qui nous promet au moins les charmes de la société. Allons, il n’y a pas à balancer, le temps est superbe, il faut en profiter.
On céda à mes sollicitations, et la Dupré sortit, pour rendre notre réponse, et ne demander que le temps nécessaire à nous préparer.
Quand nous parûmes au salon, ce jeune homme vint à nous, et nous dit les choses les plus flatteuses, en s’adressant à nous trois en général, sans paraître s’attacher à l’une, de préférence à l’autre : il nous remercia beaucoup de notre bonne volonté, et nous montâmes en voiture. Il semblait tout rayonnant de gloire, entouré de trois femmes, qu’il appelait ses divinités, et dont les charmes allaient être en son pouvoir.
Pendant deux petites heures que dura notre voyage, la conversation fut très gaie, et notre Adonis en fit presque tous les frais ; nous nous regardâmes alors plusieurs fois, mes compagnes et moi, pour nous dire, par signe, que nous n’avions pas regret de nous être embarquées avec lui.
La maison de campagne où il nous conduisit était infiniment jolie ; on y trouvait tout ce que l’on pouvait désirer, et la promenade, surtout, y était charmante. Nous en profitâmes un peu avant le dîner ; mais notre conducteur eut grand soin de ne pas nous faire tout parcourir, pour nous procurer la surprise que devait nous donner la vue d’un bosquet, entouré de murs très élevés, consacré aux plaisirs du maître, et où nul mortel, hors d’état de sacrifier à la beauté, n’avait encore porté ses pas téméraires.
Nous avions déjà eu mille occasions de remarquer que notre hôte était rempli d’esprit ; mais ce fut au dîner, lorsque échauffé par le vin, les liqueurs et le punch, il eut donné un libre cours à son humeur gaillarde ; il n’y a pas de saillies, de bons mots, de plaisanteries qu’il ne fît, pas de fantaisie qu’il ne voulût satisfaire. Qu’on joigne à cela une belle figure, une voix agréable, et le talent de s’accompagner sur plusieurs instruments, on aura une juste idée de notre adorateur ; pour nous, nous fûmes alors obligées de convenir, que si nous n’étions pas chez l’homme le plus honnête, du moins, nous avions rencontré le libertin le plus aimable qu’on puisse trouver.
Quand on eut rendu à Bacchus tous les honneurs qu’on lui devait, on se leva de table ; je m’aperçus, et je sentis bien, pour mon compte, que mes compagnes et moi, n’avions pas juré de ne sacrifier qu’à ce dieu, et que l’amour voulait avoir part à nos hommages : un mouvement involontaire nous précipita toutes vers celui qui, seul, pouvait les lui faire agréer ; et nous le couvrîmes de baisers, qu’il nous rendit avec tant de profusion et d’ardeur, que nous nous livrâmes à des conjectures flatteuses, sur les scènes agréables dont ils n’étaient que le prélude.
On fit mille folies dans le jardin, et insensiblement on se trouva tout près du mur de ce fameux bosquet, qui devait être témoin des plaisirs que chacun se promettait ; car, de bonne foi, nous étions tous bien disposés à nous divertir. À l’instant, le jeune faune s’échappe, et nous voilà toutes à le poursuivre : il arrive à une porte, qui ressemblait à celle d’un souterrain, l’ouvre et y entre ; nous le suivons sans hésiter, il ferme après nous. On fait trente ou quarante pas dans l’obscurité ; enfin nous revoyons la lumière, et les allées épaisses d’un bosquet délicieux.
— Venez, mesdemoiselles, nous dit en riant notre guide, je vais vous conduire où vous désirez d’aller.
Il nous fait prendre un chemin couvert, et nous arrivons à une salle de verdure, entourée de marronniers, qui laissent à peine le jour pénétrer leur feuillage ; une statue en marbre, représentant l’Amour, est au milieu de cette salle.
— C’est ici, nous dit-il, que l’Amour, ou si vous l’aimez mieux, que la Folie a, depuis longtemps, établi son temple ; je vous crois toutes dignes d’être initiées dans les mystères qui me sont révélés ; et vous allez être consacrées par des voies différentes : qu’on se dépouille de tous ces vains ornements du luxe, pour paraître aux yeux de la divinité que nous allons adorer, comme les enfants de la nature, quand ils invoquent le soleil.
Et tout en parlant, il s’était déjà débarrassé de ses vêtements.
Nous nous regardions comme pour nous demander si nous devions en croire le grand-prêtre, qui nous exhortait.
— Eh quoi ! vous balancez, profanes que vous êtes, nous dit-il d’une voix qu’il semblait emprunter du dieu dont il était rempli. Vous balancez, et vous ne craignez pas mon courroux ? Obéissez, obéissez, vous dis-je, ou vous ne méritez plus d’approcher de ces lieux.
Cette plaisanterie nous fit rire aux éclats ; cependant nous étions bien aises d’en venir au dénouement, et il n’y avait pas d’autre moyen que de faire ce qu’on exigeait de nous.
Quand nous eûmes obéi, le grand-prêtre nous fit venir auprès de lui, et nous donna à toutes un baiser sur le front.
— Maintenant, nous dit-il, quelle est celle d’entre vous qui veut sacrifier la première ? Qu’elle paraisse !
Nous aurions bien voulu toutes commencer, parce que nous craignions que la lampe sacrée ne s’éteignît, et que les dernières n’eussent point de part au sacrifice ; mais pour ne pas paraître jalouses l’une de l’autre, nous voulûmes que le sort en décidât, et trois brins d’herbe, d’inégale grandeur, fixèrent irrévocablement nos rangs. Le plus long m’échut ; je ne fus pas fâchée de me trouver la première, quoique j’ignorasse absolument ce qu’il allait faire de moi.
Il me mena à une balançoire, faite de plusieurs cordes réunies, dont les deux bouts étaient attachés à deux marronniers, et au milieu desquels était retenu un banc à deux dossiers. Il s’y plaça le premier, et me fit monter ensuite sur lui, le visage tourné vers le sien, embrassant son corps avec mes cuisses, de manière que nous formions un X parfait. On s’imagine aisément, que dans la crainte que je ne tombasse par terre, il avait eu soin de me retenir par-dessous, avec une des flèches qu’il avait prise dans le carquois de l’Amour. Mes deux compagnes eurent aussi de l’emploi ; l’une fut chargée de nous balancer, en tirant à elle une corde attachée sous le banc ; et l’autre devait le pousser chaque fois qu’il revenait à elle, pour lui donner plus d’élasticité.
Cet arrangement fait, mon vis-à-vis donna le signal, et bientôt nous voguâmes dans les airs. La voiture m’avait paru si solide, que je n’eus pas la moindre frayeur ; de sorte que je m’abandonnai tout entière au plaisir du voyage. À peine avions-nous fait six tours, que je sentis ma tête se troubler, tout mon corps frissonna, je serrai dans mes bras mon compagnon de voyage, et ne le quittai que lorsque, revenue de l’extase où cette course aérienne m’avait jetée, je me sentis en état de retrouver l’équilibre que j’avais perdu pendant quelques instants, dans le tourbillon qui m’environnait.
Je descendis de la balançoire, très satisfaite de mon expérience, et je me promis bien de la recommencer le plutôt que je pourrais.
C’était à Sophie à sacrifier après moi ; mais ce devait être d’une autre manière : cependant le jeu de la balançoire lui avait paru si plaisant, qu’elle désirait que ce fût de cette façon que son hommage fût présenté ; elle le demanda avec instance : on se rendit à ses vœux. Je remarquai, quand elle prit sa place, que tout n’était pas disposé comme il l’avait été pour moi, et je craignis qu’elle ne glissât, n’apercevant rien pour la fixer sur le banc ; mais cela pouvait venir pendant le voyage, et cette espérance me rassurait un peu pour elle. J’avais tort d’y compter ; on s’arrêta comme on était parti, et la pauvre Sophie, bien désolée sans doute de l’accident qui lui arrivait, mais trop bonne pour s’en fâcher devant nous, prit le parti d’en rire aux dépens de son conducteur, qu’elle persifla de la bonne manière.
Pour moi, je riais sous cape, rendant grâce au sort de la faveur qu’il m’avait faite, et Sophie elle-même me félicitait de mon bonheur.
— Souffrirons-nous, dit Antoinette, qui prit un ton sérieux pour tromper l’infortuné galant, souffrirons-nous que cet impudent nous amène ici pour se jouer de nous, et croit-il avoir affaire à des femmes auxquelles on peut manquer sans conséquence ? Vengeons-nous, mesdemoiselles, armons-nous chacune d’une branche d’arbre, et corrigeons-le de sa présomption.
Et dans l’instant, elles furent toutes les deux en état d’effectuer leur menace.
— Eh quoi donc ! poursuivit Antoinette en me voyant sans armes, crois-tu pouvoir te dispenser de nous imiter, parce que tu t’imagines n’avoir pas à te plaindre ? Allons, allons, toute injure doit être commune entre nous ; tu dois, dans ce moment, oublier tes plaisirs pour nous seconder dans nos justes vengeances.
Je présumai bien que c’était une plaisanterie, je m’armai donc comme les autres.
Quand l’objet de notre feinte colère nous vit prêtes à fondre sur lui, il se jeta, en riant, à nos pieds, dans l’espérance de nous attendrir.
— Pardon, mesdemoiselles, nous dit-il, je vous le demande à mains jointes, mille fois pardon. Je n’avais pas trop présumé de mes forces quand j’ai formé le projet de vous fêter toutes les trois ; je suis même encore persuadé que cet effort ne m’est point impossible, et je vous promets de vous le prouver dans un moment plus favorable ; mais aujourd’hui que je suis enivré du plaisir de voir, pour la première fois, des beautés incomparables, dont les attraits célestes ont étonné mes regards et forcé mon admiration, aujourd’hui que Bacchus, jaloux des plaisirs que l’Amour me promettait, a, pour lui jouer un méchant tour, dont je suis la première victime, mêlé dans le nectar qu’il m’a versé, les vapeurs qui ont échauffé mon cerveau et répandu dans mes veines le froid mortel dont vous vous plaignez, je ne puis rendre à vos charmes divins tout l’hommage qui leur est dû. Jouissez de ma confusion et faites grâce au malheureux qui ne peut pas se reprocher l’injure qui vous irrite, puisqu’elle est involontaire.
Toutes ces raisons me paraissaient, à moi, fort bonnes ; mais les autres ne les jugèrent pas de même. Ni les supplications du patient, ni sa posture humiliée, ne purent le sauver de la correction qui l’attendait. Nous tombâmes toutes les trois sur sa peau, et je fus la seule qui l’épargnai, mes compagnes y allèrent bon jeu, bon argent.
Quand il sentit qu’on s’occupait trop sérieusement de lui, il se leva et voulut s’esquiver ; mais nous nous mîmes à sa poursuite, et il reçut encore en courant quelques petits coups, dont il ne se vanta pas. Nous avions déjà parcouru plusieurs allées ; soit que l’air ou les aiguillons des branches qui l’atteignaient lui eussent fait retrouver ce que nous croyons totalement perdu, il s’arrête, et, se tournant fièrement devant nous :
— Serez-vous encore en colère ? nous dit-il ; n’ai-je donc plus le moyen de vous apaiser ?
À l’instant toutes les branches nous tombent des mains, Sophie s’élance sur lui et veut absolument profiter de l’occasion, c’est d’ailleurs son tour ; elle ne croit pas qu’on puisse le lui disputer, mais l’autre, tout aussi pressée de jouir qu’elle, s’oppose à ses desseins, et soutient qu’ayant coopéré comme elle à rendre une nouvelle activité à l’objet de leurs désirs, il ne doit plus être question de la première désignation des tours, et que toutes y ont un droit égal. Grands débats à ce sujet ; j’observe que d’après ce raisonnement on ne peut pas même me priver de mes prétentions ; on est forcé d’en convenir. Cependant, trop généreuse pour rentrer encore en lice, j’abandonne volontiers mes droits et je me charge d’aider le sort à désigner sa favorite. Il tombe sur Sophie, qui s’entend nommer avec satisfaction ; mais, ô revers cruel et mortifiant ! l’oiseau chéri s’est envolé pendant la dispute, et n’a laissé à celle qui lui préparait une cage, que le regret de ne l’avoir pas assez tôt enfermé.
Sophie fut réellement piquée de ce nouvel accident ; et je crois que devant tout autres que nous, elle aurait fait éclater son dépit. Elle se contenta de plaisanter l’oiseleur maladroit qui n’avait pas su retenir dans ses filets l’oiseau de passage qu’il y avait arrêté quelques instants. Celui-ci s’excusa encore une fois de son mieux : tout le tort, en effet, n’était pas de son côté.
— Ce n’est plus à vous de quereller, lui dit-il, c’est à moi de vous corriger, pour avoir fait un si mauvais emploi de votre temps. Que cela vous serve de leçon et vous apprenne que, dans ces sortes de circonstances, il ne faut pas parler, mais agir.
Il avait bien raison. On se persuada de cette vérité ; d’ailleurs, l’espoir qu’on avait de rattraper un jour le petit fripon qui s’était échappé, acheva de calmer les esprits. Nous revînmes prendre nos habillements, et après quelques tours de promenade, nous montâmes en voiture pour revenir à la maison.
Notre jeune fou, en nous quittant, nous promit bien de réparer ses torts, et de temps en temps il nous reçut l’une après l’autre à sa campagne ; mais enfin, pour nous faire voir que ce n’était pas vainement qu’il s’était vanté de nous satisfaire toutes les trois un même jour, il disposa la partie, et quoique ce jour-là je ne fusse que la dernière à donner mon avis, je ne me plaignis pas de mon sort.
Ce sont là de ces folies qu’il est quelquefois bon de se permettre, pour que les plaisirs, qui se succèdent si rapidement, se montrent sous de nouvelles formes et ne cessent pas d’en être pour celles qui sont obligées, par état, de les entretenir. Elles ont bien quelquefois leurs petits désagréments ; mais aussi elles ont toujours un mérite réel, c’est qu’elles ne ressemblent point à celles qui les ont précédées.
Pour diversifier un peu nos amusements, la bonne Dupré nous menait de temps en temps au spectacle : je me rappelle qu’un jour j’étais seule avec elle au Théâtre Français ; on y donnait une pièce où la jalousie, peinte sous les couleurs les plus tragiques, m’avait vivement intéressée ; cependant je ne pouvais pardonner au héros de ce drame, l’excès de sa cruauté envers une femme que je savais innocente, et sa position malheureuse me faisait répandre des larmes bien sincères. J’allais me livrer à quelques réflexions sur les funestes effets de cette misérable passion, quand je vis entrer dans la loge où nous étions un jeune homme d’environ vingt-cinq ans. Après les compliments d’usage, il renouvela connaissance avec la Dupré, chez laquelle il allait fréquemment autrefois. J’observai que pendant qu’il lui parlait, ses yeux étaient presque toujours fixés sur moi. La pièce venait de finir.
— Voulez-vous, mesdames, nous dit-il, me permettre de vous donner la main jusque chez vous ?
La bonne Dupré accepta sans difficulté, et nous montâmes avec lui dans sa voiture. Ma directrice, qui s’était aperçu de l’effet que mes charmes avaient fait sur lui, l’engagea d’entrer : elle lui fit beaucoup de questions sur son état et sur sa fortune, parce qu’elle ignorait ce qu’il était devenu depuis plus de deux ans qu’elle ne l’avait vu.
Il lui donna tous les éclaircissements qu’elle parut désirer et lui apprit qu’il était marié depuis environ un an, mais que ce lien ne l’empêcherait pas de prétendre aux faveurs de mademoiselle (en me montrant), si je voulais consentir à lui accorder quelques instants.
Je répondis assez faiblement, parce que je craignais qu’il ne fût pressé de jouir et qu’il ne voulût, dès le soir même, user des droits qu’on allait lui donner. Cela m’eût beaucoup contrariée, car je ne me sentais point disposée à me livrer au plaisir ; la représentation à laquelle j’avais assisté m’avait singulièrement affectée, et calculant assez bien mes jouissances pour être presque toujours de moitié avec ceux auxquels j’en procurais, je sentais bien qu’un engagement si prompt ne pouvait pas me convenir. Heureusement il indiqua la partie au lendemain soir, chez lui, où nous serions très libres, nous dit-il, parce que sa femme partait le matin pour l’une de ses terres. Quand l’heure à laquelle je devais me rendre chez lui fut arrêtée, et qu’on fut convenu des moyens que j’employerais pour m’introduire dans l’appartement où nous étions attendus par la volupté, il sortit en laissant à la Dupré de bons garants de la parole qu’il me donnait.
Le lendemain, sur la brune, je pris une voiture de place, et je me fis descendre à dix pas de l’hôtel de mon nouvel adorateur. Un laquais que je crus le confident intime de son maître, m’y attendait. Il m’apprit que madame de Verneuil avait différé son voyage de quelques jours ; qu’elle était même alors dans l’hôtel ; mais que monsieur n’entendait pas se priver pour cela du plaisir de me recevoir ; qu’il me priait de le suivre et qu’il allait me faire passer par un escalier dérobé, où je ne serais vue de personne. Je fis d’abord quelques difficultés de suivre ce laquais ; mais comme il m’assura que je pouvais être parfaitement tranquille, je me laissai conduire, sans faire d’autre observation ; je l’avouerai même avec franchise, je mis une sorte d’orgueil à être préférée à madame de Verneuil ; et l’idée de faire faire à son mari une infidélité, pour ainsi dire, sous ses yeux, rendit la scène plus piquante. N’est-ce pas le comble de la dépravation ? N’importe, ce fut là la raison qui me fit braver les dangers que je pouvais courir, si nous étions découverts.
Je suivis donc mon guide : il m’introduisit mystérieusement dans une pièce de l’appartement de son maître, qui vint un instant après m’y rejoindre. C’était une espèce de boudoir dans lequel se trouvait un lit orné de glaces. Plusieurs bougies éclairaient ce petit réduit, fait pour recevoir l’Amour, et où peut-être il ne s’était jamais trouvé, même depuis le mariage de Verneuil.
Aussitôt qu’il fut entré, il ferma au verrou la porte qui communiquait de cette pièce aux autres appartements, et l’on ne tarda pas à s’occuper de l’objet qui m’attirait dans cette maison.
Ce voluptueux jeune homme, qui connaissait tous les raffinements de la jouissance, avait observé que, pour jouir véritablement, il faut ménager le plaisir, et ne s’y livrer que par gradation, en laissant toujours les désirs se succéder les uns aux autres. Pénétré de ces principes, il se serait bien gardé d’exposer à ses regards l’universalité de mes charmes ; il avait soin, au contraire, de voiler ceux qu’il avait déjà parcourus, à mesure qu’il en découvrait d’autres ; de sorte qu’il était possible que les mêmes redevinssent plusieurs fois l’objet de ses désirs. Je ne fus donc point obligée de me déshabiller. Il prit lui-même, bien volontiers, ce soin ; car c’était une nécessité pour lui de le faire, s’il voulait mettre ses leçons en pratique ; enfin, quand il eut épuisé tous les préliminaires que sa sensualité lui inspirait, il me joignit sur le lit, où il m’avait étendue depuis longtemps, et préparée, comme je l’étais, par tout ce qu’il avait mis en usage pour m’enflammer ; je le reçus dans mes bras, où il dut s’apercevoir, aux transports auxquels je me livrai, que sa leçon n’avait pas été infructueuse.
Déjà trois fois, je ne dirai pas l’amour, mais un je ne sais quel être qui lui ressemble fort, m’avait fait sentir son pouvoir redoutable ; déjà l’ardent Verneuil cherchait à retrouver ses forces énervées, dans un de ces moyens que le dieu du plaisir permet à ses favoris : on frappe à la porte du boudoir avec une force incroyable : nous ne répondons point ; on redouble. Verneuil, impatienté, demande avec humeur qui vient ainsi le troubler ?
— Ouvrez, c’est moi, dit sa femme, ouvrez.
Je tremblais qu’il ne commît cette imprudence ; mais heureusement, il ne le fit point. Nous nous rajustâmes du mieux qu’il nous fut possible, et Verneuil descendit par le petit escalier pour appeler le laquais qui devait protéger ma sortie, comme il avait assuré mon entrée. Son absence ne fut pas longue ; il revint, accompagné de ce laquais, auquel il me remit en m’abandonnant à ses soins. Pour lui, il est présumable, d’après ce qu’on va voir, que n’étant resté dans le boudoir que le temps nécessaire à mon évasion, il était immédiatement sorti, pour n’avoir pas d’explication avec sa femme.
Au lieu de me faire descendre l’escalier, ce laquais m’avait fait entrer par une porte qui se trouvait sur le même carré, en face de celle du boudoir. Il m’avait donné pour raison de cette différence, la crainte où il était que madame de Verneuil ne nous fît guetter par cet endroit, qui était la sortie naturelle du boudoir, et il me fit entendre qu’il n’y avait, pour échapper à sa poursuite, que le moyen de gagner le grand escalier.
Je crus bonnement cet imposteur, et je le suivis sans hésiter. Quand il m’eut fait traverser plusieurs pièces, à ce que je présume, car nous n’avions point de lumière, il me fit asseoir et me dit qu’il allait examiner s’il n’y avait personne à la découverte ; jusque là rien n’était plus simple que sa conduite, et mon intention était de lui donner, en sortant, un des louis de Verneuil, pour le remercier de ses bons offices ; mais le drôle, qui avait sur moi des projets que j’étais éloignée de lui soupçonner, s’embarrassait fort peu de mon cadeau, et ne m’avait quittée un moment, que pour, d’un côté, s’assurer que Verneuil n’était plus dans l’hôtel, et de l’autre, tromper sa femme, pour avoir le temps d’en venir à ses fins.
Il n’y avait pas cinq minutes qu’il m’avait quittée, quand je le vis rentrer. Il posa sur la table une bougie qu’il avait apportée, et me dit qu’il lui était impossible de me faire sortir dans ce moment, parce que madame Verneuil avait aposté ses domestiques pour m’arrêter au passage, et qu’il savait qu’il n’était pas prudent de s’exposer aux effets de la jalousie d’une femme, qui employerait toute sorte de moyens pour se venger de ce qu’elle appelait un affront.
— Je vous ai conduite dans ma chambre, me dit-il ensuite, mademoiselle, pour que vous soyez plus en sûreté, parce qu’on ne se doutera pas que vous y êtes, et qu’on vous croira sortie, en ne vous trouvant pas dans l’appartement ; et pour plus de prudence, je vais fermer la porte à double tour, et mettre le verrou.
Il parlait encore, que tout cela était déjà fait.
J’avais eu beau me persuader jusque-là qu’il était dans les meilleures intentions à mon égard, j’avoue que cet excès de précaution me donna quelques inquiétudes sur les suites de cet événement ; et bientôt mes doutes se trouvèrent parfaitement éclaircis.
— Nous sommes seuls, me dit-il, ma chère amie, je viens de m’assurer que personne ne peut troubler nos plaisirs ; ainsi j’espère que tu ne refuseras rien à l’homme du monde qui t’aime le plus.
Et tout en s’exprimant ainsi, d’une main, le drôle fourrageait mes appas ; et de l’autre, il mettait en liberté le terrible argument auquel il me fallait répondre. Indignée de ce procédé, furieuse, je me lève et veux crier au secours, contre un attentat qui compromettait, en quelque sorte, la réputation que pouvait me donner les bonnes grâces de Verneuil.
— Prends garde, me dit-il, à ce que tu vas faire, ce parti violent que tu veux prendre te mène à ta ruine ; car en faisant du bruit, tu fais venir les domestiques de madame, et tu tombes infailliblement dans ses mains ; au lieu qu’en m’accordant, de bonne grâce, ce que je te demande, pour prix de ta complaisance, je te fais esquiver, sans qu’il t’arrive la moindre égratignure. Délibère donc promptement, et fais bien attention que le parti que je te propose est pour toi le plus sage.
Loin de me rendre aux raisons qu’il me donne, et qu’il a la présomption de vouloir me faire trouver excellentes, je me débarrasse de ses bras, et je proteste hautement que je ne consentirai jamais à ce qu’il exige de moi.
— Ah ! ma petite amie, me dit-il, tu veux jouer la vertueuse en sortant du boudoir de Verneuil ! conviens avec moi, de bonne foi, que ce caprice est parfaitement ridicule, et puisqu’il faut employer la force, pour obtenir de toi ce que ta reconnaissance aurait peut-être dû m’offrir, tu vas voir si l’on a beau jeu quand on veut me refuser quelque chose.
Me faire cette douce observation, me prendre dans ses bras, et m’étendre sur le plancher, tout cela fut l’affaire d’un moment : le vigoureux compère, habile à profiter de ma chute, m’avait déjà mise hors d’état d’en détourner les inconvénients, que je n’avais pas encore eu le temps de m’y préparer. Ainsi, malgré mes prières et ma résistance, il fallut livrer une place qu’il n’était plus en mon pouvoir de défendre.
Quand ce perfide eut apaisé l’ardeur de ses feux, il m’offrit de me conduire hors de l’hôtel, pour qu’il ne m’arrivât rien. Il m’était plus permis que jamais de croire à sa parole, d’après ce qui venait de se passer, et je ne me doutais pas qu’une nouvelle trahison serait le prix de mes faveurs. Je le suivis donc, sans la moindre crainte. Il me fit entrer dans un salon dont il ferma, en dedans, la porte par laquelle nous étions entrés. Il courut ensuite à la porte opposée, l’ouvrit ; et, à un signal qu’il donna, trois femmes entrèrent et se précipitèrent sur moi. Deux d’entre elles étaient armées d’une poignée de verges ; la troisième, qui me parut être madame Verneuil, ordonna au traître qui m’avait livrée à leurs fureurs, de me tenir les mains, et elle me les lia avec un ruban. J’eus beau me récrier contre cette violence et faire retentir tout l’hôtel de mes cris, il me fallut endurer le supplice que ces dames avaient préparé pour moi. Le laquais me prit par le milieu du corps pour me contenir ; les deux femmes armées se placèrent à mes côtés ; puis, relevant mes jupons d’une main, de l’autre, elles me fustigèrent sans miséricorde pendant près d’un quart d’heure. Quant à madame Verneuil, qui voulait jouir à son aise du fruit de sa vengeance, elle s’était assise dans un fauteuil, en face de nous, et riait aux éclats en voyant les efforts inutiles que je faisais pour me débarrasser des mains de mes assaillants.
Cependant le sang ruisselait de mes fesses, et les douleurs devenaient si aiguës, que peu s’en fallait que je ne me trouvasse mal. Madame Verneuil vint à moi, et s’apercevant que la pâleur avait remplacé sur mon visage le pourpre qu’un instant auparavant la rage impuissante y avait répandu, ordonna à mes bourreaux de cesser la correction. On obéit : mais, remise en liberté, il me fut impossible de me tenir debout ou de m’asseoir. Je me laissai tomber le plus doucement que je pus sur le plancher, où je demeurai longtemps les yeux cachés par mes mains, trop humiliée de ce qui venait de m’arriver, pour oser les lever sur les objets de mon indignation.
Enfin, madame Verneuil, qui jusque-là s’était contentée de ma punition sans l’avoir rendue plus sévère, en m’accablant de reproches, m’adressa la parole, et du ton le plus méprisant, le plus injurieux :
— Apprenez, me dit-elle, que c’est ainsi que l’on punit les créatures de votre espèce, qui, sans respect pour les mœurs qu’elles outragent à chaque pas, vont semer la discorde et la désolation dans les familles. Je désire bien sincèrement que la leçon, que vous avez prise ici, vous soit utile pour l’avenir, et que vous ne soyez jamais tentée d’en mériter une seconde.
Après cette courte harangue, à laquelle je fus peut-être plus sensible qu’à la correction, elle sortit et me laissa livrée aux propos injurieux d’une valetaille insolente qui ne me ménagea pas.
Pour moi, je dévorais dans le silence la honte dont j’étais couverte, et je n’osais me lever pour m’en aller, parce que j’ignorais si j’étais à la fin du supplice que j’endurais : cependant, une de ces harpies me prit par un bras, et me soulevant de terre :
— Allons donc, me dit-elle, la belle éplorée, voulez-vous passer la nuit dans cette posture ? n’est-il donc pas temps que vous preniez congé de nous ?
Ce mot soulagea l’oppression dans laquelle mes craintes me retenaient, et je ne me le fis pas redire. Je me levai brusquement pour gagner la porte, sans ouvrir la bouche et sans regarder personne, n’espérant trouver que dans ma fuite la possibilité d’éteindre ma confusion. L’infâme laquais dont, pour tant de raisons, j’avais à me plaindre, me fit descendre par le grand escalier, et lorsque je fus dans la rue, il me dit adieu, en m’engageant à me souvenir de lui.
Je n’avais pas besoin de cette recommandation ; la bassesse de sa conduite était suffisamment gravée dans ma mémoire. Mais il ne s’agissait pas de songer à ce qui venait de m’arriver, il fallait m’occuper des moyens d’empêcher la Dupré de s’en apercevoir : mon amour-propre aurait trop souffert si elle ou mes compagnes en eussent été instruites. Je me rajustai donc du mieux que je pus, tout en marchant avec peine, car mes douleurs n’étaient point encore apaisées, et je composai assez bien ma figure pour qu’en entrant mon air de gaieté naturelle ne parut point altéré. Néanmoins, comme il aurait été possible à la longue qu’on fît quelques remarques défavorables, je montai à ma chambre, où je restai jusqu’au souper à bassiner mes plaies avec de l’eau fraîche, et à me mettre dans un négligé qui pût écarter le plus léger soupçon.
On me fit à table quelques questions sur le jeune homme auquel j’avais eu affaire ; tout ce que j’en racontai fut parfaitement à son avantage ; car, au fait, il n’avait eu aucune part aux outrages que j’avais reçus chez lui. La Dupré me demanda s’il m’avait promis de revenir, et quand nous le reverrions ; je répondis qu’à cet égard il ne s’était point expliqué ; et quoique je me sentisse du goût pour lui, je désirai, de bien bon cœur, qu’il ne revînt point. Je ne sais s’il fut instruit de la manière brutale dont on m’avait traitée ; je le présume au moins, car mon amour-propre me dit que je ne dois son éloignement qu’à l’aveu que lui en fit sa femme.
Pendant environ huit jours, je refusai, sous différents prétextes, toutes les parties qui m’étaient offertes. Je voulais attendre ma guérison entière, pour ne pas m’exposer aux plaisanteries que mes singulières blessures auraient pu m’attirer : je me contentai seulement de jouir des plaisirs qui faisaient le charme de notre petite société. Enfin, toutes les traces de ma honte disparurent ; je me trouvai bientôt en état de reprendre les exercices communs.
Dans l’intervalle de mon accident à ma guérison, plusieurs personnes, qui venaient habituellement chez la Dupré, lui avaient mis dans la tête de prendre une petite maison de campagne, pour rendre plus agréables les parties qu’on pourrait faire chez elle, avec nous. Elle y avait consenti, et venait d’en louer une toute meublée, dans les environs de Paris.
Avant de la consacrer à l’usage de ceux qui la lui avaient fait prendre, elle voulut nous y conduire seules avec elle, pour nous distraire, pendant quelques jours, des plaisirs bruyants qui nous obsédaient sans cesse. Rien n’était plus flatteur qu’une proposition qui avait pour but de nous rendre un moment à la tranquillité, et de nous mettre à portée de jouir enfin de nous-mêmes ; car nous étions rarement ensemble, quoique dans la même maison, à cause des occupations distinctes et séparées qui nous écartaient l’une de l’autre.
J’avais déjà remarqué, avec un plaisir infini, que mes compagnes s’exprimaient en bons termes et avec grâce ; qu’elles avaient des talents agréables, qui sont le fruit ordinaire d’une éducation suivie, et qu’elles n’avaient point été élevées pour l’état où je les voyais ; je brûlais d’impatience de les connaître mieux, et de savoir par quelle fatalité elles étaient tombées dans la malheureuse position où nous étions toutes les trois réduites.
L’occasion ne pouvait être plus favorable. Depuis plusieurs jours nous habitions cette maison de campagne où nous ne faisions que folâtrer, comme des enfants qu’on laisse en liberté, après les avoir longtemps occupés. En y rentrant un matin, après une longue promenade au dehors, nous nous assîmes sur un gazon qui entourait un large bassin, où une eau claire et renouvelée par une petite source, qui le traversait, laissait voir une quantité prodigieuse de poissons se jouer dans son sein. Après quelques folies faites en nous roulant sur l’herbe, j’amenai insensiblement la conversation sur le chapitre qui m’intéressait, et je fis part du désir que j’avais de leur entendre raconter leurs histoires. Elles ne se firent pas prier ; la seule restriction qu’elles mirent à leur complaisance, fut que je commencerais par la mienne.
J’avais trop envie de me satisfaire pour différer un instant de leur obéir : je leur fis donc le récit exact de tout ce qui m’était arrivé, jusqu’au moment où je les avais connues.
Quand j’eus fini, on me remercia beaucoup, en m’embrassant ; alors la belle Sophie prit la parole, et commença ainsi :