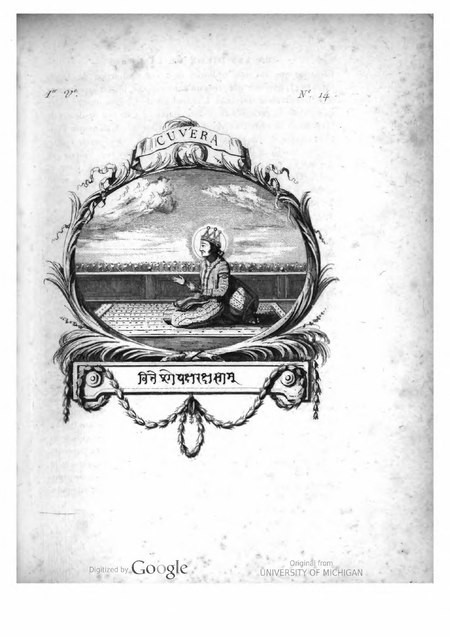Sur les dieux de la Grèce, de l’Italie et de l’Inde
Quand les faits ne viennent pas à l’appui des raisonnemens, il y a de la témérité à prétendre qu’un peuple idolâtre ait emprunté d’un autre peuple ses dieux, ses cérémonies et ses dogmes. L’imagination, cette faculté qui ne reconnoît point de bornes, l’imposture et la folie, peuvent créer des dieux de toutes les formes et de toutes les dimensions, dans des contrées qui n’ont ensemble aucun rapport ; mais lorsque différens systèmes de polythéisme présentent des traits de ressemblance trop marqués pour être l’effet du hasard, sans que la fantaisie ou le préjugé colore le tableau et ajoute à la ressemblance, nous ne pouvons guère nous empêcher de croire qu’il a existé, de temps immémorial, quelque liaison entre les différens peuples qui les ont adoptés. Je me propose d’indiquer dans cet Essai une ressemblance de ce genre entre le culte populaire des anciens habitans de la Grèce et de l’Italie, et celui des Hindous(1). D’un autre côté, il existe beaucoup d’analogie entre leurs étranges religions et celles de l’Égypte, de la Chine, de la Perse, de la Phrygie, de la Phénicie et de la Syrie, auxquelles nous ne risquons rien d’ajouter celles de quelques royaumes méridionaux, et même des îles de l’Amérique, tandis que le système gothique, qui prit le dessus dans les régions septentrionales de l’Europe, non-seulement avoit de l’analogie avec ceux de la Grèce et de l’Italie, mais étoit presque le même sous un autre costume, avec une broderie d’images visiblement asiatiques. Si j’établis ces propositions d’une manière satisfaisante, il nous sera permis d’en conclure une union ou affinité générale entre les habitans les plus distingués du monde primitif, à l’époque trop reculée où ils s’écartèrent de l’adoration raisonnable du seul vrai Dieu.
Il paroît que les sources de toutes les mythologies sont au nombre de quatre, 1.° La vérité historique ou naturelle a été convertie en fable par l’ignorance, l’imagination, la flatterie ou la stupidité. C’est ainsi qu’on imagina qu’un roi de Crète, dont on avoit découvert le tombeau dans cette île, étoit le dieu de l’olympe ; et que Minos, législateur de ce pays, étoit son fils, et rendoit la justice aux âmes des morts. De là naquit également, selon toute apparence, le conte de Cadmus, ainsi que Bochart le prouve savamment(2) ; de là vint que les fanaux ou les volcans furent des géans n’ayant qu’un œil, et des monstres vomissant des flammes, et que l’aspect de deux rochers, dans certaines positions, fit supposer aux navigateurs qu’ils mettoient en pièces tous les navires qui tâchoient de passer dans leur intervalle. L’Odyssée, et les poèmes qui célèbrent l’expédition des Argonautes, pourroient fournir quantité d’autres exemples de ces fictions extravagantes. Moins nous nous étendrons sur les étoiles Juliennes, sur les apothéoses de princes ou de guerriers, sur les autels érigés au plus vil des hommes à côté de ceux d’Apollon, et sur les titres divins décernés à des misérables tels que Caïus Octavianus, moins nous exposerons au grand jour l’infamie dont se couvrirent de graves sénateurs et des poètes élégans, ou le sot délire de la multitude : mais il est certain que l’absurde apothéose de quelques hommes vraiment grands, ou de petits hommes faussement appelés grands, a produit des erreurs grossières dans toutes les parties du monde idolâtre. 2.° Leur seconde source paroît avoir été une admiration excessive des corps célestes, et, au bout d’un certain temps, les systèmes et les calculs des astronomes. De là vint une portion considérable de la mythologie égyptienne et grecque ; le sabéisme(3) en Arabie, les types ou emblèmes persans de Mihr(4) ou du Soleil, l’extension prodigieuse du culte des élémens et des forces de la nature, et peut-être toute la chronologie artificielle des Chinois et des Indiens, avec l’invention des demi-dieux et des héros, pour remplir les lacunes de leurs périodes extravagantes et imaginaires. 3.0 La magie poétique a seule créé des divinités poétiques, sa principale affaire étant de personnifier les notions les plus abstraites, et de placer une nymphe ou un génie dans chaque bosquet, et presque dans chaque fleur. De là vient qu’Hygie et Jason, la santé et le remède, sont les poétiques enfans d’EscuIape, qui fut lui-même ou un médecin distingué ou la science médicale personnifiée : de là vient aussi que Chloris, ou la verdure, est mariée au Zéphyr. 4.° Les métaphores et les allégories des moralistes et des métaphysiciens ont aussi été très-fécondes en divinités. On pourroit en offrir mille exemples tirés de Platon, de Cicéron, et de la foule inventive des commentateurs d’Homère, dans leurs théogonies et dans leurs fabuleuses leçons de morale. La plus riche et la plus noble veine de cette source abondante est le charmant conte philosophique de Psyché, ou l’histoire de l’ame. Jamais, à mon sens, la sagesse ou le génie de l’homme n’a produit une allégorie plus belle, plus sublime, et soutenue avec plus d’art. De là vient aussi que la Maya indienne(5), ou, pour nous servir de l’explication que de savans Hindous donnent de ce mot, « la première disposition de la Divinité à se diversifier (c’est leur expression) en créant des mondes », est supposée la mère de la nature universelle et de tous les dieux inférieurs, ainsi que me l’apprit un Kachmyryen, à qui je demandois pourquoi Cdma [l’Amour ] étoit représenté comme son fils. Mais le mot maya(6) [illusion] a un sens plus subtil et plus caché dans la philosophie Vêdânta(7), où il signifie le système des perceptions, des qualités, soit primitives, soit secondaires, que, dans la croyance d’Épicharme, de Platon, et de plusieurs personnages véritablement pieux, la Divinité fait naître, par son esprit universel, dans les âmes de ses créatures, mais à qui ils n’attribuoient point une existence indépendante de l’ame.
En comparant les dieux des idolâtres de l’Inde et de l’Europe, quelle qu’en ait été la source, je ne perdrai point de vue que rien n’est moins favorable à la recherche de la vérité, qu’un esprit de système ; et je me rappellerai ce que dit un auteur hindou, que lorsqu’on tient obstinément à une série d’opinions, on peut en venir au point de croire que « le bois de sandal le plus récemment coupé est une flamme de feu. » Cette précaution m’empêchera de soutenir que tel dieu de l’Inde fut le Jupiter des Grecs, tel autre leur Apollon, tel autre leur Mercure. Dans le fait, puisque toutes les causes du polythéisme ont largement contribué à l’assemblage des dieux de la Grèce (quoique Bacon les réduise tous à des allégories raffinées, et Newton à l’histoire déguisée par la poésie), nous trouvons plusieurs Jupiters, plusieurs Apollons, plusieurs Mercures, avec des facultés et des attributs distincts ; et tout ce que je veux donner à entendre, c’est qu’avec tel ou tel attribut il existe une ressemblance frappante entre les principaux objets du culte de l’ancienne Grèce et de l’intéressant pays que nous habitons.
Le parallèle que je vais mettre sous vos yeux sera nécessairement très-superficiel, soit à raison du peu de séjour que j’ai fait dans l’Hindoustân(8), soit parce que j’ai rarement le loisir de me livrer tout entier aux amusemens littéraires, mais sur-tout parce que je n’ai d’autre livre européen, pour me rappeler les anciennes fables, que le Panthéon de Pomey(9), ouvrage rempli d’affectation, quoiqu’il ne soit pas dépourvu de savoir ; et je n’en ai même qu’une traduction si pitoyable, qu’il est difficile de la lire sans impatience. Je suis persuadé qu’on saisiroit mille autres traits de ressemblance, en parcourant, dans cette intention, Hésiode, Hygin, Cornutus, et les autres mythologues, ou, ce qui serait un moyen plus court et plus agréable, en se bornant à lire les élégans Syntagmata de Lilio Giraldi(10).
Des recherches sur les mœurs et la conduite de notre espèce dans les temps recules, ou même à toutes les époques, sont toujours, pour le moins, curieuses et amusantes ; mais elles ont le plus grand intérêt pour ceux qui peuvent dire, avec le Chrémès de Térence : « Je suis homme, et je m’intéresse à tout ce qui touche l’humanité. » Elles peuvent même avoir une importance solide dans un siècle où des hommes sensés et vertueux penchent à révoquer en doute l’authenticité des récits de Moïse concernant le monde primitif. En effet, rien de ce qui tend à écarter ces doutes ne sauroit être indifférent, soit la manière de raisonner, soit les faits qui servent de base aux raisonnemens. Ou les onze premiers chapitres de la Genèse sont vrais, en accordant ce qti’on doit au style figuré des Orientaux, ou tout l’édifice de notre religion nationale est empreint de fausseté ; et je pense qu’aucun de nous ne desireroit voir tirer cette conséquence. Pour moi, qui ne puis m’empêcher de croire à la divinité du Messie, d’après l’antiquité incontestable de plusieurs prophéties, et leur accomplissement manifeste, en particulier de celles d’Isaïe, à l’égard du seul personnage historique à qui elles puissent s’appliquer, je suis obligé de croire à la sainteté des livres respectables que cette personne sacrée, cite comme authentiques. Mais ce n’est pas la vérité de notre religion nationale, envisagée comme telle, que j’ai à cœur, c’est la vérité elle-même ; et si un raisonneur de sang-froid et exempt de préjugés réussit à me convaincre clairement que Moïse, à l’aide des Egyptiens, puisa son récit dans les antiques sources de la littérature indienne, je l’estimerai comme un ami qui m’aura délivré d’une erreur capitale, et je promets d’être un des premiers à propager la vérité qu’il aura établie. Après cette déclaration, je me flatte de ne pas déplaire aux lecteurs de bonne foi, si, dans le cours de ce Mémoire, j’use envers les argumens qu’ils ont pu avancer, de la même liberté dont je voudrois réellement qu’ils usassent envers les miens, s’ils étoient disposés à les contredire. N’ayant point à défendre un système qui me soit particulier, je ne m’assujettirai point à une méthode fort régulière ; je parlerai de tous les dieux, à mesure qu’ils s’offriront à moi, en commençant par Janus ou Ganesa(11), à l’exemple des Romains et des Hindous.
Les titres et les attributs de cette ancienne divinité de l’Italie sont rassemblés dans deux vers choriambiques de Sulpitius(12) ; et il serait superflu de chercher à cet egard d’autres renseignemens dansOvide :
Jane pater, Jane tuens, dive biceps, biformis ;
O cate rerurn sator ! ô principium deorum !
« Père Janus, Janus qui vois tout, dieu à deux têtes et à deux formes, auteur intelligent de toutes choses, o principe des dieux ! »
Nous voyons qu’il étoit le dieu de la sagesse. De là vient qu’il Janus, dieu étoit représenté sur les médailles avec deux visages, et avec quatre bras sur l’image étrusque trouvée à Falisque. Ces visages étoient des emblèmes de prudence et de circonspection. C’est ainsi que Ganeśa, Canesa, dieu de la sagesse dans l’Hindoustân, est peint avec une tête d’éléphant, symbole d’un discernement profond, et accompagné d’un rat, animal que les Indiens regardent comme doué de sagesse et de prévoyance. Un autre grand caractère de Janus, source abondante de pratiques superstitieuses, étoit celui qui lui faisoit donner le titre emphatique de père, ou, comme le second vers l’exprime plus amplement, d’origine et d’auteur de toutes choses. Il n’est pas aisé de conjecturer d’où cette opinion prit naissance, à moins que ce n’ait été d’une tradition portant qu’il fut le premier qui bâtit des sanctuaires, érigea des autels et institua des sacrifices. Quoi qu’il en soit, de là vint que son nom étoit invoqué avant celui de tous les autres dieux ; que, dans les anciens rites, on commençoit par lui offrir du blé et du vin, auxquels on ajouta depuis de l’encens ; que les portes ou entrées des maisons particulières étoient appelées Januæ(13), et tous les passages Jani, ou ayant deux commencemens ; qu’on le représentoit tenant une baguette comme gardien des chemins, et une clef comme ouvrant non-seulement les portes, mais encore tous les travaux et toutes les affaires importantes du genre humain ; qu’il passoit pour présider au matin ou au commencement du jour ; que, quoique l’année romaine commençât régulièrement par le mois de mars, le onzième mois, appelé Januarius, étoit considéré comme le premier des douze ; que, par suite de cet usage, on plaçoit l’année entière sous son influence, et quelle s’ouvroit par l’inauguration des consuls, faite dans son temple avec beaucoup de solennité, devant sa statue ornée de lauriers nouvellement cueillis. Par la même raison, lorsqu’il s’agissoit de l’un des actes publics les plus importans, d’une déclaration de guerre, le consul militaire y procédoit en ouvrant les, portes de son temple avec tout l’appareil de sa magistrature. Les douze autels et les douze chapelles de Janus pouvoient dénoter, conformément à l’opinion générale, qu’il dirige et gouverne les douze mois, ou que, comme il le dit de lui-même dans Ovide, c’est par lui qu’on doit arriver aux grands dieux, qui étoient au nombre de douze, ainsi que l’atteste un proverbe. Nous ajouterons que Janus présidoit aussi à la naissance des enfans, ou au commencement de la vie.
La divinité indienne a précisément les mêmes attributs. Les pieux Hindous commencent tous les sacrifices, toutes les cérémonies religieuses, toutes les prières, celles même qu’on adresse aux dieux supérieurs, tous les ouvrages sérieux, toutes les affaires importantes, par une invocation à Ganeśa, mot composé d'iśa, gouverneur ou chef, et de gaha, compagnie de dieux(14), telle qu’il en est compté neuf dans l’Amarkôch(15). Il seroit aisé de multiplier les exemples d’affaires commencées par une invocation au Janus de l’Inde, si les points de ressemblance que j’ai indiqués m’autorisent à lui donner ce nom. Peu de livres commencent sans offrir ces mots, Salut à Gaties ; et c’est lui qu’invoquent le premier les Brahmanes qui dirigent l’épreuve judiciaire(16) et font la cérémonie du hôma ou sacrifice du feu. M. Sonnerat(17) nous apprend qu’il est très-révéré sur la côte de Coromandel. Ils (les Indiens) ont la plus grande vénération pour ce dieu, dont ils placent l’image dans tous les temples, dans les rues, dans les chemins et dans les campagnes, au pied d’un arbre, afin que tout le monde soit à portée de l’invoquer avant de rien entreprendre, et que les voyageurs puissent lui adresser leurs adorations et » leurs offrandes avant de continuer leur route. » J’ajouterai à ce passage, d’après mes propres observations, que dans la ville utile et commode qui s’élève maintenant à Dhermâranya ou Gayâ, sous les les auspices de l’actif et bienfaisant Thomas Law, collecteur de Rhotas(18), le nom de Ganeśa est inscrit sur la porte de chaque maison nouvellement bâtie, conformément à un usage pratiqué de temps immémorial chez les Hindous ; et que, dans la vieille ville, l’image de ce dieu est placée sur les portes des temples.
Passons à Saturne(19), le plus ancien des dieux du paganisme, sur l’emploi et sur les actions duquel on nous a transmis beaucoup de détails. En le disant fis de la Terre et du Ciel, fils lui-même du Firmament et du Jour, on n’a fait qu’avouer l’ignorance où l’on étoit sur ses parens ou ses prédécesseurs ; et il y a plus de sens dans la tradition de laquelle Platon, ce philosophe avide de savoir et bien informé, passe pour avoir fait mention. Suivant cette tradition, Saturne ou le Temps, ainsi que Cybèle ou la Terre son épouse, et leurs serviteurs, étoient nés de l’Océan et de Téthys(20), ou, dans un langage poétique, sortirent des eaux du grand abîme. Cérès, déesse des moissons, paroît être leur fille ; et Virgile représente « la mère et la nourrice » universelle couronnée de tourelles, dans un char traîné par des lions, et glorieuse de ses cent petits-fils, tous dieux, tous habitans des célestes demeures. » Comme dieu du temps, ou plutôt comme le temps lui-même personnifié, les païens avoient coutume de peindre Saturne avec une faux dans une main, et dans l’autre un serpent mordant sa queue, symboles des cycles et des révolutions perpétuelles des âges. Souvent on le représentoit occupé à dévorer les années sous la forme d’enfans, et quelquefois entouré des saisons, représentées comme de jeunes garçons et de jeunes filles. Les Latins le nommoient Saturnus ; et l’étymologie la plus ingénieuse de ce moi est celle qu’en donne Festus le grammairien, qui, par une savante analogie avec d’autres noms du même genre, le fait dériver à satu(21), mot qui signifie planter, parce qu’il introduisit et perfectionna l’agriculture, lorsqu’il régna en Italie. Mais son attribut caractéristique, qui, à vrai dire, explique tous ses autres litres et ses autres fonctions, étoit exprimé allégoriquement par la poupe d’un vaisseau ou d’une galère sur le revers de ses anciennes monnoies. Ovide en donne une raison très-peu satisfaisante : « C’est, dit-il, parce que cet étranger arriva dans un vaisseau sur la côte d’Italie » ; comme si l’on avoit dû s’attendre à le voir arriver à cheval ou à travers les airs !
Si le passage d’Alexandre Polyhistor(22), que cite Pomey(23), est réellement fondé sur une tradition antique, il répand plus de jour sur toute l’histoire de Saturne. Suivant cet auteur, il prédit une abondance de pluie extraordinaire, et fit construire un vaisseau pour mettre à l’abri d’une inondation générale les hommes, les quadrupèdes, les oiseaux et les reptiles.
Il ne paroît pas aisé d’examiner de sang-froid tous ces témoignages concernant la naissance, la famille, la postérité, le caractère, les occupations et la vie entière de Saturne, sans adopter l’opinion de Bochart, à qui cette fable paroît composée d’après l’histoire de Noé(24), ou sans la regarder au moins comme extrêmement probable. Le déluge de Noé fut le commencement d’une nouvelle ère ; et l’on peut dire qu’il a produit une nouvelle suite d’âges. Ce patriarche sortit des eaux comme s’il y avoit reçu une seconde naissance : son épouse fut réellement la mère universelle ; il lui fut promptement accordé une postérité nombreuse et florissante, pour que la terre fût bientôt repeuplée. Par conséquent, si nous offrons un roi indien de naissance divine, illustre par sa piété et sa bienfaisance, dont l’histoire semble être évidemment celle de Noé, déguisée par l’imagination asiatique, nous pouvons conjecturer en toute sûreté qu’il fut aussi le même personnage que Saturne. Ce roi est Menou ou Satyavrata, dont le nom patronymique étoit Vaivasaouata(25), ou fils du Soleil, et que les Indiens croient non-seulement avoir régné sur le monde entier dans les premiers âges de leur chronologie, mais encore avoir fait sa résidence dans le pays de Dravira, sur la côte de la presqu’île orientale de l’Inde. J’ai traduit littéralement du Bhagavat(26) le récit suivant du principal événement de sa vie ; et il forme le sujet du premier Pourâna(27), intitulé Pourâna du Matsya ou du poisson(28).
« Désirant la conservation des troupeaux et des Brahmanes, des génies et des hommes vertueux, des Vêdas(29), de la loi, et des choses précieuses, le seigneur de l’univers prend plusieurs formes corporelles ; mais quoique, comme l’air, il passe à travers une multitude d’êtres, il demeure toujours lui-même, parce qu’il n’a point de qualité sujette au changement. À la fin du dernier calpa(30), il y eut une destruction générale occasionnée par le sommeil de Brâhmah(31). Ses créatures de différens mondes furent noyées dans un vaste océan. Brâhmah ayant envie de dormir, et souhaitant le repos après une longue suite d’âges, le fort démon Hayagrîva s’approcha de lui, et déroba les Vêdas qui avoient coulé de ses lèvres. Lorsque Héri, le conservateur de l’univers(32), découvrit cette action du prince de Dânavas, il prit la forme d’un petit poisson appelé sap’harî. Un saint monarque, nommé Satyavrata, régnoit alors ; c’étoit un serviteur de l’esprit qui marchoit sur les eaux, et si pieux que l’eau étoit sa seule nourriture. Il étoit fils du Soleil ; et dans le calpa actuel, il est investi par Narâyan de l’emploi de Menou, sous le nom de Srâddhadêva, ou dieu des funérailles. Un jour qu’il faisoit une libation dans le fleuve Critamâla, et qu’il tenoit de l’eau dans la paume de sa main, il ay vit remuer un petit poisson. Le roi de Dravira jeta sur-le-champ le poisson et l’eau dans le fleuve où il les avoit pris. Alors le sap’harî adressa d’un ton pathétique ces paroles au bienfaisant monarque : Ô roi, qui montres de la compassion pour les opprimés, comment peux-tu me laisser dans l’eau de ce fleuve, moi trop foible pour résister aux monstres qui l’habitent, et qui me remplissent d’effroi î Le prince, ne sachant pas qui avoit pris la forme d’un poisson, appliqua son esprit à la conservation du sap’harî, tant par bonté naturelle que pour le salut de son ame ; et après avoir entendu sa prière, il le plaça obligeamment sous sa protection, dans un petit vase plein d’eau : mais, dans l’espace d’une seule nuit, il grossit tellement que le vase ne pouvoit plus le contenir. Il tint ce discours à l’illustre prince : Je n’aime point à vivre misérablement dans ce petit vase ; procure-moi une demeure où je puisse habiter avec plaisir. Le roi, l’ôtant du vase, le plaça dans une citerne ; mais il devint grand de cinquante coudées en moins de cinquante minutes, et dit : Ô roi, il ne me plaît point de demeurer inutilement dans cette étroite citerne ; puisque tu m’as accordé un asile, donne-moi une habitation spacieuse. Le roi le changea de place, et le mit dans un étang, où, ayant assez d’espace autour de son corps, il devint d’une grosseur prodigieuse. Ô monarque, dit-il encore, ce séjour n’est pas commode pour moi, qui dois nager au large dans les eaux ; travaille à ma sûreté, et transporte-moi dans un lac profond. À ces mots, le pieux monarque jeta le suppliant dans un lac ; et lorsque sa grosseur égala l’étendue de cette pièce d’eau, il jeta l’énorme poisson dans la mer. Quand il fut au milieu des vagues, il parla ainsi à Satyavrata : Ici les goulus armés de cornes, et d’autres monstres très-forts, me dévoreront. Ô vaillant homme, tu ne me laisseras point dans cet océan. Trompé ainsi, à plusieurs reprises, par le poisson qui lui avoit adressé des paroles flatteuses, le roi dit : Qui es-tu, toi qui m’abuses sous cette forme empruntée ï Jamais, avant toi, je n’ai eu le spectacle ou je n’ai entendu parler d’un aussi prodigieux habitant des eaux, qui, comme toi, ait rempli en un seul jour un lac de cent lieues de circonférence. Sûrement, tu es Bhagavat qui m’apparois, le grand Héri(33), dont la demeure étoit sur les vagues, et qui maintenant, par commisération pour tes serviteurs, prends la forme des habitans de l’abîme. Salut et louange à toi, ô premier mâle, seigneur de la création, de la conservation et de la destruction ! Tu es, ô gouverneur suprême, le plus sublime objet que nous ayons en vue, nous tes adorateurs, qui te cherchons pieusement. Toutes tes descentes illusoires dans ce monde donnent l’existence à diflerens êtres ; mais je suis curieux de savoir pour quel motif tu as emprunté cette forme. Ô toi qui as des yeux de lotus, que je n’approche point en vain des pieds d’un dieu dont la bienfaisance parfaite s’est étendue à tous, quand tu nous as montré, à notre grande surprise, l’apparence d’autres corps, non pas existans en réalité, mais présentés successivement. Le seigneur de l’univers, aimant l’homme pieux qui l’imploroit ainsi, et désirant le préserver de la mer de destruction causée par la perversité du siècle, lui dit en ces termes ce qu’il avoit à faire : Ô toi qui domptes les ennemis, dans sept jours les trois mondes seront plongés dans un océan de mort : mais, au milieu des vagues meurtrières, un grand vaisseau, envoyé par moi pour ton usage, paroîtra devant toi. Tu prendras alors toutes les plantes médicinales, toute la multitude des graines ; et accompagné de sept saints, entouré de couples de tous les animaux, tu entreras dans cette arche spacieuse, et tu y demeureras à l’abri du déluge d’un immense océan, sans autre lumière que la splendeur de tes saints compagnons. Lorsqu’un vent impétueux agitera le vaisseau, tu l’assujettiras à ma corne avec un grand serpent de mer ; car je serai près de toi. Tirant le vaisseau, avec toi et tes compagnons, je demeurerai sur l’océan, ô chef des hommes, jusqu’à ce qu’une nuit de Brâhmah soit complètement écoulée : tu connoîtras pour lors ma véritable grandeur, justement nommée la Divinité suprême. Par ma faveur il sera répondu à toutes tes questions, et ion esprit recevra des instructions en abondance. Héri disparut, après avoir donné ces ordres au monarque ; et Satyavrata attendit avec humilité l’époque assignée par celui qui règle nos sens. Le pieux monarque, ayant répandu vers l’est les tiges pointues de l’herbe darbha, et tourné son visage vers le nord, étoit assis et méditoit sur les pieds do dieu qui avoit pris la forme d’un poisson. La mer, franchissant ses rivages, inonda toute la terre ; et bientôt elle fut accrue par les pluies que versoient des nuages immenses. Le roi, méditant toujours les commandemens de Bhagavat, vit le vaisseau s’approcher, et y entra avec les chefs des Brahmanes, après y avoir porté les plantes médicinales, et s’être conformé aux préceptes de Héri. Les saints lui adressèrent ce discours : Ô roi, médite sur Césava, qui nous délivrera sûrement de ce danger, et nous accordera la prospérité. Le dieu, invoqué par le monarque, apparut encore distinctement sur le vaste océan, sous la forme d’un poisson brillant comme l’or, s’étendant à un million de lieues, avec une corne énorme, à laquelle le roi, comme Héri le lui avoit commandé, attacha le vaisseau avec un câble fait d’un grand serpent, et, heureux de sa conservation, il se tint debout, louant le destructeur de Madhou. Quand le monarque eut achevé son hymne, le premier mâle, Bhagavat, qui veilloit à sa sûreté sur la grande étendue des eaux, parla tout haut à sa propre divine essence, prononçant un Pourâna sacré, qui contenoit les règles de la philosophie Sànk’hya : mais c’étoit un mystère infini qui devoit être caché dans le sein de Satyavrata ; assis dans le vaisseau avec les saints, il entendit le principe de l’ame, l’être éternel, proclamé par le pouvoir suprême. Ensuite Héri, se levant avec Brâhmah du sein du déluge destructeur, qui étoit apaisé, tua le démon Hayagrîva, et recouvra les livres sacrés. Satyavrata, instruit dans toutes les connoissances divines et humaines, fut choisi dans le calpa actuel, par la faveur de Vichnou, pour septième Menou, et surnommé Vaivasaouata : mais l’apparition d’un poisson cornu au religieux monarque, fut Maya [ou illusion] ; et celui qui entendra dévotement ce récit historique et allégorique, sera affranchi de l’esclavage du péché(34). »
Cet abrégé de la première histoire indienne qui subsiste aujourd’hui, me paroît très-curieux et très-important : car l’histoire, quoique bizarrement rédigée en forme d’allégorie, semble prouver qu’il existe dans l’Inde une tradition primitive du déluge universel décrit par Moïse, et fixe par conséquent l’époque où commence réellement la chronologie authentique des Hindous. Nous trouvons, il est vrai, dans le Pourân, d’où ce récit est tiré, un autre déluge, qui eut lieu vers la fin du troisième âge, lorsque Youdhichtir(35) gémissoit des persécutions de Douryôdhan, son ennemi invétéré, et lorsque Crichna, qui s’étoit incarné depuis peu, afin de secourir les hommes religieux et de détruire les pervers, faisoit des prodiges dans le pays de Mat’hourâ(36) : mais ce second déluge fut purement local, et sans autre but que de châtier les habitans de Vradja. Ce peuple, à ce qu’il semble, avoit offensé Indrâ, le dieu du firmament(37), par son culte enthousiaste de l’enfant merveilleux, qui enlevoit le mont Gôverdhana comme si c’eût été une fleur, et convainquit Indrâ de sa suprématie, en abritant de l’orage tous les bergers et toutes les bergères. Un examen attentif des dix avatars ou descentes(38) de la Divinité dans son caractère de conservatrice, prouvera que l’âge satya(39), ou, si nous pouvons hasarder de l’appeler ainsi, l’âge Saturnien, fut réellement celui du déluge général, puisque, sur les quatre qu’on dit avoir eu lieu dans l’youg satya, les trois premiers se rapportent évidemment à quelque terrible convulsion du globe, occasionnée par la mer, et le quatrième montre le châtiment miraculeux de l’orgueil et de l’impiété. En premier lieu, comme nous l’avons fait voir, il y eut, dans l’opinion des Hindous, une intervention de la Providence pour sauver un personnage pieux et sa famille (car tous les Pandits s’accordent à penser que sa femme, quoiqu’il n’en soit pas fait mention, doit être comprise dans sa délivrance) d’une inondation qui détruisit tous les pervers. Secondement, la divinité descend sous la forme d’un verrat(40), symbole de la force, pour tirer et soutenir sur ses défenses toute la terre affaissée sous l’océan. Troisièmement, le même pouvoir est représenté sous la forme d’une tortue qui soutient le globe, bouleversé par les violens assauts des démons, tandis que les dieux battoient la mer avec la montagne Mandar(41), et la forçoient de dégorger les choses sacrées et les animaux, ainsi que l’eau de vie(42), qu’elle avoit avalés. Ces trois histoires, je pense, ont trait au même événement, déguisé sous une triple allégorie, morale, métaphysique et astronomique ; et toutes trois paroissent liées avec les sculptures hiéroglyphiques de l’ancienne Égypte. Le quatrième âvatâr fut un lion sortant d’une colonne de marbre entr’ouverte pour dévorer un monarque blasphémateur, qui, sans cela, auroit tué le prince religieux à qui il avoit donné le jour ; et des six autres, aucun n’a rapport à un déluge. Les trois qui sont assignés au trétâ-youg, époque de l’origine de la tyrannie et de l’irréligion, eurent pour objet la chute des tyrans, ou de leurs emblèmes naturels, des géans à mille bras, formés pour la plus vaste oppression ; et dans le douâpar-youg(43), l’incarnation de Crichna(44) eut en partie le même but, en partie celui de purger le monde des hommes injustes et impies, qui s’étoient multipliés dans cet âge, et commençoient à fourmiller aux approches du kali-youg, ou de l’âge de la dispute et de la bassesse. Quant à Bouddha, il semble avoir été le réformateur des dogmes contenus dans les Vêdas ; et quoique sa bonté le portât à censurer ces anciens livres, parce qu’ils ordonnoient des sacrifices d’animaux, les Brahmanes même de Câsi(45) le regardent comme le neuvième âvatâr(46), et le poëte Djayadêva célèbre ses louanges. Son caractère est, à plusieurs égards, fort extraordinaire : mais comme ce sujet appartient à l’histoire plutôt qu’à la mythologie, je le réserve pour une autre dissertation. Le dixième âvatâr passe pour être encore à venir ; et l’on s’attend à le voir paroître, monté ( comme le vainqueur couronné de l’Apocalypse) sur un cheval blanc, armé d’un cimeterre resplendissant à l’égal d’une comète(47), pour faucher tous les pécheurs incorrigibles et impénitens qui seront alors sur la terre.
Ces quatre yougs(48) ont une affinité si remarquable avec les âges des Grecs et des Romains, qu’on peut naturellement assigner la même origine aux deux systèmes. Dans l’un et dans l’autre, le premier âge est dépeint comme abondant en or, quoique satya signifie bonne foi et probité, deux vertus qui durent exister, ou jamais, dans les temps qui suivirent immédiatement un exercice de la puissance divine aussi terrible que la destruction du genre humain par un déluge universel : le second est caractérisé par l’argent, et le troisième par le cuivre, quoique leurs noms usuels fassent allusion aux proportions imaginées dans chacun entre le vice et la vertu. L’âge actuel, ou âge de terre, semble distingué plus convenablement que par le fer, comme il l’étoit dans l’Europe ancienne, puisque ce métal n’est ni plus vil ni moins utile que le cuivre, bien qu’il soit plus commun de nos jours, et par conséquent moins précieux ; tandis tandis que la terre présente l’idée de l’extrême dégradation. Nous pouvons remarquer ici que la véritable histoire du monde paroît susceptible d’être divisée en quatre âges ou périodes, que l’on peut nommer, 1.° l’âge diluvien, ou l’âge très-pur ; savoir, les temps antérieurs au déluge, et ceux qui lui succédèrent, jusqu’à la folle introduction de l’idolâtrie à Babel ; 2.° l’âge patriarcal, ou pur, dans lequel il y eut sans doute de puissans chasseurs d’hommes et d’animaux, depuis l’origine des patriarches dans la famille de Sem, jusqu’à l’établissement simultanée de plusieurs grands empires par les descendais de son frère Cham ; 3.° l’âge Mosaïque, ou moins pur, depuis la mission de Moïse, et pendant que ses préceptes furent observés et exempts d’altération ; 4.° enfin l’âge prophétique, ou impur, qui a commencé aux sévères avertissemens donnés par les prophètes aux rois apostats et aux nations dégénérées : cet âge subsiste encore, et subsistera jusqu’à l’entier accomplissement de toutes les prophéties authentiques. Il faut nécessairement que la durée des âges historiques soit très-inégale et très-disproportionnée ; tandis que celle des yougs indiens est ménagée avec tant d’art et de régularité, qu’on ne sauroit l’admettre comme naturelle ou probable. Les hommes n’empirent pas dans une progression géométrique, ou à la fin de certaines périodes régulières : cependant les yougs sont si bien proportionnés, que la longueur même de la vie humaine diminue, à mesure qu’ils avancent, de cent mille ans dans une raison sous-décuple ; et de même que le nombre des principaux âvatârs de chacun d’eux décroît arithmétiquement de 4, le nombre de leurs années respectives décroît géométriquement, et forme en total la somme extravagante de 4, 320, 000 ans, qui, multipliée par 71, est la période durant laquelle on croit que chaque Menou régit le monde. Il est permis d’imaginer qu’une période semblable auroit contenté Archytas, qui mesura la terre et la mer, et compta leurs grains de sable, ou Archimède, qui inventa des chiffres capables d’en exprimer le nombre : mais la vaste intelligence d’un chronologiste indien ne connoît point de limites, et les règnes de cinquante Menous ne sont qu’un jour de Brâhmah ; cinquante de ces jours se sont écoulés, suivant les Hindous, depuis la création. J’admets volontiers et je penche même à croire que tout cet enfantillage, tel qu’il paroît être à la première vue, n’est qu’une énigme astronomique, relative à la révolution apparente des étoiles fixes, dont les Brahmanes faisoient un mystère : mais un arrangement aussi technique exclut toute idée d’histoire sérieuse. Je sens combien ces remarques blesseront les ardens défenseurs de l’antiquité indienne ; mais nous ne devons pas sacrifier la vérité à la crainte pusillanime d’offenser. Je ne croirai jamais que les Vêdas aient été composés avant le déluge(49) ; et nous ne sommes pas fondés à conclure de l’histoire précédente, que les savans Hindous le croient ; car le sommeil allégorique de Brâhmah, et le vol des livres sacrés, signifient seulement, dans un langage plus simple, que la race humaine étoit plongée dans la corruption : mais je prends sur moi d’assurer que les Vêdas sont très-anciens, et remontent beaucoup plus haut que toute autre production sanskrite, tant pour les avoir examinés par moi-même, que pour en avoir comparé le style avec celui des Pourânas(50) et du Dherma sâstra(51). Une comparaison semblable m’autorise à prononcer que l’excellent code attribué à Saouâyambhouva Menou, quoiqu’on ne le prétende pas écrit par lui, est plus ancien que le Bhagavat : mais les Brahmanes auroient de la peine à me persuader qu’il fut composé dans le premier âge du monde ; et la date qu’on y a fixée, ne se trouve ni aux deux copies que je possède, ni à aucune de celles qui ont été collationnées pour moi. Dans le fait, la date supposée est comprise dans un vers qui contredit directement l’ouvrage même : car ce n’est pas Menou qui rédigea le code, par le commandement de son père Brâhmah, mais un saint personnage ou demi-dieu, nommé Bhrigou, qui révéla aux hommes ce que Menou avoit enseigné, à sa prière et à celle des autres saints ou patriarches. Pour terminer cette digression, la mesure des vers du Mànava sâstra(52) est si uniforme et si mélodieuse, et le style si parfaitement sanskrit ou châtié, que ce livre est nécessairement plus moderne que les écritures de Moïse, où la simplicité, ou plutôt la nudité du dialecte, du mètre et du style hébraïques, démontre à tout homme exempt de prévention, qu’elles sont d’une date beaucoup plus ancienne(53).
Je laisse aux étymologistes, qui décident de tout, le soin de décider si le mot Menou, ou, au nominatif, Menous, a quelque affinité avec Minos le législateur et le prétendu fils de Jupiter. Les Crétois, selon Diodore de Sicile, feignoient que leur île avoit donné le jour à la plupart des grands hommes qui avoient été déifiés en reconnoissance des services qu’ils avoient rendus au genre humain : ainsi l’on peut douter que Minos fût né dans la Crète. Le législateur indien fut le premier et non le septième Menou, ou Satyavrata, que je suppose être le Saturne de l’Italie. En effet, le caractère de Saturne fut en partie celui de ce grand législateur,
Qui genus indocile ac dispersum montilus altis
Composuit, legesque dedit ;
et nous pouvons supposer que les quatorze Menous se réduisent peut-être à un seul, nommé par les Arabes, et probablement par les Hébreux, Noùhh, dénomination que nous avons défigurée en la prononçant mal. On peut déduire une connexion prochaine entre le septième Menou et le Grec Minos(54), du caractère singulier d’Yama[2], demi-dieu hindou, qui étoit pareillement fils du Soleil, et nommé pour cette raison Vaivasaouata. Il partageoit aussi ce titre avec son frère Srâddhadêva. Un autre de ses titres étoit Dhermarâdja(55), ou roi de justice ; et un troisième, Pitripéti(56), ou seigneur des patriarches : mais il est principalement désigné comme juge des âmes séparées des corps. En effet, les Hindous croient que l’ame, en quittant le corps, se rend aussitôt à Yamapoùr, ou la ville d’Yama(57) ; qu’Yamala juge dans cette ville avec équité, et que de là elle monte au Souerga, c’est-à-dire, le premier ciel, ou qu’elle est jetée dans le Naræ, la région des serpens, ou bien qu’elle prend sur la terre la forme de quelque animal, à moins que, par la nature de ses offenses, elle ne doive être condamnée à une prison végétale, ou même minérale.
Cérès, la même que Lakchmî, nommée aussi Sri.
Un autre de ses noms est très-remarquable ; c’est celui de Câla ou Temps, dont l’idée se confond avec le caractère de Saturne et de Noé : car le mot Cronos a une affinité visible avec celui de Chronos ; et un savant disciple de Zérâtocht(58) m’assure que, dans les livres sacrés des Bouddhistes, il est fait mention d’une inondation universelle, appelée le déluge du Temps.
Comme il a été observé en passant que Cérès étoit la fille poétique de Saturne, je ne puis terminer cet article sans ajouter que les Hindous ont aussi leur déesse de l’abondance, qu’ils appellent ordinairement Lakchmî, et qu’ils regardent comme la fille, non de Menou, mais de Bhrigou, qui promulgua le premier recueil de lois sacrées. Elle porte aussi les noms de Pedmâ et de Camala, noms tirés du saint lotus ou nymphœa ; mais son nom le plus remarquable est Sri, ou, au nominatif, Srîs, qui a de la ressemblance avec son nom latin, et signifie fortune ou prospérité. On peut objecter que, s’il est permis d’appeler figurement Lakchmî la Cérès de l’Hindoustân, il étoit naturel à deux ou plusieurs nations idolâtres qui vivoient de l’agriculture, d’imaginer une divinité qui présidoit à leurs travaux, sans qu’elles eussent ensemble la moindre relation : mais on ne voit pas de raison qui ait pu engager deux nations à faire cette divinité du genre féminin. Il étoit au moins plus vraisemblable que l’une d’elles supposât que la terre étoit une déesse, et que le dieu de l’abondance la rendoit féconde. De plus, on voit, dans de très-anciens temples situés près de Gayâ(59), des images de Lakchmî avec des mamelles remplies de lait, et une corde nouée sous son bras, semblable à une corne d’abondance, qui ressemblent beaucoup aux anciennes figures de Cérès honorées dans la Grèce et à Rome(60).
Après avoir ainsi analysé la fable de Saturne, passons à ses descendais ; et, pour suivre le conseil du poëte, commençons par Jupiter. Les petits garçons apprennent à connoître dans Ovide sa suprématie, ses foudres et son libertinage ; tandis que l’on ne considère pas généralement, dans les systèmes de la mythologie européenne, ses grandes fonctions de créateur, de conservateur et de destructeur.
Les Romains, comme nous l’avons déjà observé, avoient plusieurs Jupiters, dont l’un n’étoit autre chose que le firmament personnifié, ainsi qu’Ennius le dit clairement :
Ce Jupiter, ou Diespiter, est le dieu indien des deux visibles, appelé Indrâ [le roi], et Divespetir [le seigneur du ciel], qui a aussi les attributs du génie des Romains, ou de chef des bons esprits ; mais plusieurs de ses épithètes en sanskrit sont les mêmes que celles du Jupiter d’Ennius. Son épouse est nommée Satchî ; sa ville céleste, Amardvati ; son palais, Vaidjayanta ; son jardin, Nandana ; son principal éléphant, Airdvat ; son cocher, Mât ali ; et son arme, vadjra, ou le foudre. Il gouverne les vents et les pluies ; et quoique l’orient soit particulièrement sous sa direction, son Olympe est Mérou, ou le pôle septentrional, représenté allégoriquement comme une montagne d’or et de pierres précieuses. Malgré toute sa puissance, il est regardé comme une divinité du second ordre, et très-inférieure aux trois personnes de la Trinité indienne, Brâhmah, Vichnou, et Mahâdêva ou Sîva, qui sont trois formes d’une seule et même divinité. Ainsi la principale divinité des Grecs et des Latins, qu’ils appeloient Zeus et Jupiter, mots dont le génitif est irrégulier, et fait Dios et Jovis, n’étoit pas seulement Fulminator [le Tonnant] ; mais, comme le dieu destructeur de l’Inde, il s’appeloit Magnus Divus, Ultor, Genitor ; comme le dieu conservateur, Conservator, Soter, Opitulus, Altor, Ruminus ; et comme le dieu créateur, celui qui donne la vie. Je fais mention de ce dernier, attribut sur la foi de Cornutus, auteur consommé dans la science mythologique. Platon lui-même conseille de chercher les racines des mots grecs sur un sol barbare, c’est-à-dire, étranger ; mais moi, qui regarde les conjectures fondées sur l’étymologie comme une foible base pour les recherches historiques, j’ose à peine indiquer que Zev, Sîv et Jov sont la même syllabe, différemment prononcée. Il faut cependant convenir que les Grecs n’ayant point de sigma palatal semblable à celui des Indiens, ont pu l’exprimer
Jupiter, le même qu’Indrâ, &c. par leur zêta, et que les lettres initiales de zugon et de jugum sont aisément substituées l’une à l’autre, ainsi que cet exemple le prouve(62).
Descendons maintenant de ces observations générales et préliminaires à quelques remarques particulières sur la ressemblance qui existe entre Zeus ou Jupiter et la triple divinité Vichnou, Sîva et Brâhmah : car tel est l’ordre dans lequel ils sont énoncés par les lettres A, U et M, qui s’amalgament ensemble, et forment le mot mystique ÔM(63) ; mot que le pieux Hindou, qui le médite en silence, ne laisse jamais échapper de ses lèvres. Je m’en repose sur d’autres pour déterminer si le on des Égyptiens, qui, dans l’opinion générale, signifie le Soleil, est le monosyllabe sanskrit(64). Il faut toujours se souvenir que, d’après les instructions contenues dans leurs livres sacrés, les savans Indiens ne reconnoissent véritablement qu’un Etre suprême, qu’ils appellent Brahmah(65), ou le Grand, au genre neutre. Ils croient son essence infiniment au-dessus de toute intelligence, excepté de la sienne ; et ils supposent qu’il manifeste sa puissance par l’opération de son esprit divin, qu’ils nomment Vichnou [le Pénétrant], et Nârâyan [Marchant sur les eaux], l’un et l’autre au masculin, d’où il prend souvent le nom de premier mâle : ils croient enfin que ce dieu conserve et soutient l’ordre entier de la nature. Mais les Vêdântis(66), hors d’état de se faire une idée distincte de la matière brute, indépendante de l’esprit, ou de concevoir que l’ouvrage de la suprême bonté ait été laissé un seul moment à lui-même, imaginent que la Divinité s’occupe continuellement de son ouvrage, et soutient sans cesse une série de perceptions que, dans un sens, ils nomment illusoires, quoiqu’ils soient forcés d’avouer la réalité de toutes les formes créées, en tant qu’elles peuvent affecter le bonheur des créatures. Lorsqu’ils envisagent la puissance divine s’exerçant à créer ou à donner l’existence à ce qui n’existoit pas auparavant, ils appellent Dieu Brahmah, aussi au masculin ; et lorsqu’ils le considèrent en qualité de destructeur, ou plutôt de changeur de formes, ils lui donnent mille noms, dont les plus communs sont ceux de Sîva(67), Îśa ou Îśouara(68), Roudra, Hara, Sambhou, et Mahâdèva ou Mahêsa. Les premières opérations de ces trois pouvoirs sont diversement décrites, dans ies différens Pourânas, par une multitude d’allégories ; et nous y trouvons l’origine de la philosophie ionienne sur l’eau primitive, du dogme de l’œuf symbole du monde, et de la vénération qu’on avoit pour le nymphœa ou lotus(69), qui étoit anciennement révéré en Égypte, comme il l’est aujourd’hui dans l’Hindoustân, le Tibet et le Népal(70). On dit que les Tibétains en décorent leurs temples et leurs autels ; et un habitant du Népal se prosterna plusieurs fois devant un lotus, dans mon cabinet, où cette belle plante et ses superbes fleurs étoient offertes à l’examen des curieux. M. Holwell, dans l’explication de sa première planche, suppose que Brâhmah flotte au milieu de l’abîme sur une feuille de bétel(71) ; mais il est évident que c’est une feuille de lotus ou de figuier-d’Inde, mal dessinée. L’espèce de poivre connue au Bengale sous le nom de tâmbôula, et à la côte de Malabar sous celui de bétel, n’est point, ainsi qu’il l’assure, regardée comme sacrée par les Hindous, ou nécessairement cultivée sous l’inspection de quelques Brahmanes. Tout ce qu’il y a de vrai, c’est qu’à raison de la délicatesse de sa tige, on en abrite avec soin les plantations, et qu’elle doit être cultivée par une tribu particulière de Sôudras, qui prennent de là le nom de Tâmbôuli.L’opinion de tous les philosophes indiens est que l’eau fut l’élément primitif et le premier ouvrage de la puissance créatrice : mais comme ils rendent un compte si particulier du déluge universel et de la création, il est impossible d’admettre que la totalité de leur système ait pris sa source dans des traditions relatives au seul déluge ; et il doit paroître indubitable que leur doctrine est en partie empruntée du début du Bérêchyt [de la Genèse], où se trouve ce passage, qui, depuis le premier mot jusqu’au dernier, est le plus sublime qui ait jamais coulé ou coulera jamais d’une plume humaine : « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. — Et la terre étoit stérile et sans habitans ; et les ténèbres (couvraient) la face de l’abime ; et l’esprit de Dieu s’agitoit sur la surface des eaux ; et Dieu dit, Que » la lumière soit ; et la lumière fut. » Menou, fils de Brâhmah, diminue beaucoup la sublimité de ce passage en le paraphrasant ainsi, au commencement de son discours aux sages qui le consultoient sur la formation de l’univers(72) : « Cet univers, leur dit-il, n’existoit que dans l’obscurité ; on n’y distinguoit rien ; il sembloit plongé dans un profond sommeil, jusqu’au moment où le Dieu invisible, existant par lui-même, le rendant manifeste avec cinq élémens et d’autres formes glorieuses, chassa parfaitement les ténèbres. Désirant produire diverses créatures par une émanation de sa gloire, il créa d’abord les eaux, et leur imprima la faculté de se mouvoir. Cette faculté produisit un œuf d’or, resplendissant à l’égal de mille soleils, où naquit Brâhmah, existant par lui-même, père auguste de tous les êtres raisonnables. Les eaux sont appelées nârà, parce qu’elles sont la postérité de Néra ou Isouara ; et Nârâyana en prit son nom, parce que son premier âyana, ou mouvement, fut sur les eaux.
Celui qui est, la cause invisible, éternelle, existante par elle-même, mais inaperçue, (passant du genre neutre) au genre masculin, est célébré parmi toutes les créatures sous le nom de Brâhmah. Ce dieu ayant demeuré dans l’œuf pendant les révolutions des années, méditant sur lui-même, le divisa en deux parties égales, et de ces moitiés forma les deux et la terre, plaçant dans le milieu l’éther subtil, les huit points du monde, et le réceptacle permanent des eaux. »
Je ne puis m’empêcher de joindre à cette description curieuse, qui ouvre le Mânava sâstra, les quatre strophes qui servent de texte au Bhagavat, et que l’on croit avoir été adressées à Brâhmah par l’Etre suprême. La traduction suivante est scrupuleusement littérale[3] :
« J’étois, oui, j’étois dès le commencement, et nulle autre chose, celui qui existe, inaperçu, suprême ; en outre, je suis celui qui est ; et celui qui doit rester, je le suis encore.
Excepté la première cause, sachez que tout ce qui peut paroître et ne pas paroître dans l’esprit, est maya [ou illusion] de l’esprit, comme la lumière, comme les ténèbres.
De même que les grands élémens sont dans les differens corps, y entrant, toutefois n’y entrant pas (c’est-à-dire, les pénétrant sans les détruire), de même je suis dans eux et ne suis pas dans eux. Voilà jusqu’où peuvent aller les recherches de celui qui s’efforce de connoître le principe de l’intelligence, dans l’union et la séparation, qui doivent toujours être par-tout. »
Malgré la bizarrerie et l’obscurité inévitable de ces strophes dans une traduction littérale, plusieurs personnes penseront sans doute que la poésie ou la mythologie de la Grèce et de l’Italie n’offrent pas de conceptions plus augustes et plus magnifiques : cependant elles n’égalent pas la concision et la simplicité du style de Moïse.
À l’égard de la création du monde, dans l’opinion des Romains, Ovide, de qui il étoit naturel d’attendre qu’il la décriroit avec autant de savoir que d’élégance, nous laisse absolument dans les ténèbres sur la question de savoir lequel des dieux y joua le principal rôle. D’autres mythologues sont plus détaillés ; et, sur la foi de Cornutus, nous pouvons croire que les anciens païens de l’Europe regardoient Jupiter (non le fils de Saturne, mais de l’Éther, c’est-à-dire, d’un père inconnu) comme le grand auteur de la vie, et le père des dieux et des hommes. On peut ajouter à ce témoignage la doctrine Orphique, conservée par Proclus, qui enseigne que l’abîme et l’empyrée, la terre et la mer, les dieux et les déesses, furent produits par Zeus ou Jupiter(73). Sous ce point de vue, il répond à Brâhmah, et peut-être à ce dieu des Babyloniens (si nous pouvons compter sur les notices qui nous sont parvenues concernant leur ancienne religion), qui, à l’instar de Brâhmah, soumit l’univers aux lois de l’ordre, et, comme lui, perdit sa tête, dont le sang forma sur-le-champ de nouveaux animaux. Je fais allusion au récit populaire, et inintelligible pour moi, suivant lequel Brâhmah eut cinq têtes, jusqu’à ce que l’une d’elles eût été coupée par Nârâyan(74).
Les épithètes qu’on donnoit anciennement à Jupiter, et ce que dit Cicéron, que son nom ordinaire étoit une contraction de Juvans pater(75), font voir que, sous un autre rapport, il étoit le protecteur et le conservateur universel. L’étymologie de Cicéron montre l’idée qu’on avoit du caractère de ce dieu, quoiqu’il y ait lieu de douter de l’exactitude de cette étymologie. Nous savons que Callimaque l’implore comme le dispensateur de tout bien et de la sécurité contre l’affliction ; et puisque ni la richesse sans vertu, ni la vertu sans richesse, ne donnent un bonheur complet, en poëte sensé il demande l’une et l’autre. Une prière indienne qui auroit la richesse pour objet, seroit adressée à Lakchmî, épouse de Vichnou, parce que l’on croit que les déesses hindoues sont les facultés de leurs époux(76).
Quant à Couvêra(77), le Plutus indien, qui parmi ses noms a celui de Paulastya, il est, à la vérité, honoré comme un dieu libéral, qui réside dans le palais d’Alacâ, ou qui est porté dans le ciel sur un char éclatant nommé Pouchpaca ; mais il est évidemment subordonné, comme les sept autres génies, aux trois dieux principaux, ou plutôt au Dieu suprême, considéré dans ses trois attributs. À l’égard de l’ame du monde, ou de l’intelligence qui pénètre tout, si élégamment décrite par Virgile, plusieurs poètes latins, et entre autres, Lucain, avec beaucoup de sublimité, dans le fameux discours de Caton concernant l’oracle de Hammoji, représentent ainsi Jupiter : « Jupiter » est tout ce que nous voyons ; il est par-tout où nous dirigeons » nos pas. » Telle est précisément l’idée que les Indiens se font de Vichnou, suivant les quatre strophes ci-dessus. Ce n’est pas que les Brahmanes supposent que leur divinité mâle soit la divine essence du grand Dieu, qu’ils déclarent absolument incompréhensible ; mais comme le pouvoir de conserver les choses créées par une providence surveillante appartient éminemment à la Divinité, ils croient que ce pouvoir existe d’une manière transcendante dans le membre conservateur de la Trinité, qu’ils supposent exister continuellement par-tout, non substantiellement, mais en esprit et en énergie. Ici néanmoins je parle des Vaichnavas ; car les Saivas(78) assignent une sorte de prééminence à Sîva, dont je vais, en peu de mots, examiner les attributs.Ce fut comme vengeur et destructeur que Jupiter combattit et renversa les Titans et les Géans, conduits par Typhon, Briarée, Titye et le reste de leurs frères, contre le dieu de l’Olympe, à qui, durant la bataille, un aigle apporta les éclairs et les foudres. Ainsi, dans un combat semblable entre Sîva et les Daityas, ou enfans de Diti, qui se révoltoient souvent contre le ciel, on croit que Brâhmah donna des flèches enflammées au dieu de la destruction. L’un des nombreux poèmes intitulés Râmâyan(79), dont le dernier livre a été traduit en italien, renferme un dialogue extraordinaire entre le corbeau Bhoûchanda et un aigle raisonnable nommé Garoûda, qui est souvent représenté avec la figure d’un beau jeune homme et le corps d’un oiseau chimérique : l’un des dix-huit Pourânas porte son nom, et renferme toute son histoire. M. Sonnerat nous apprend que Vichnou est quelquefois représenté monté sur le garoûda, qu’il suppose être l’aigle de Pondichéri, de Brisson(80), d’autant plus que les Brahmanes de la côte ont une profonde vénération pour cette classe d’oiseaux, et en nourrissent des multitudes à des heures marquées. J’imagine plutôt que le garoûda est un oiseau fabuleux ; mais je pense avec lui que le dieu hindou qui le monte, ressemble au Jupiter de l’antiquité. Dans les anciens temples de Gayâ(81), Vichnou est monté sur cet oiseau poétique, ou accompagné par lui et par un petit page : mais de peur qu’un étymologiste ne trouve Ganymède dans Garoûda, j’observerai que le mot sanskrit se prononce Garoûra. J’admets cependant qu’il paroît y avoir quelque ressemblance entre l’histoire de l’oiseau et du page célestes, telle que la racontent les Grecs et les Indiens. De même que le Jupiter olympien avoit fixé sa cour et tenoit conseil sur une montagne élevée et brillante, ainsi le séjour de Mahâdêva, que les Saivas(82) regardent comme le chef des dieux, étoit le mont Caïlâsa, des rochers duquel chaque éclat étoit une pierre précieuse d’une valeur inestimable. Ses résidences terrestres sont les montagnes neigeuses d’Himâlaya(83), ou la branche de cette chaîne qui est à l’est du Brahmâpoutra (84,), et qui s’appelle Tchandrasic’hara, ou la montagne de la Lune. Lorsqu’après toutes ces circonstances nous apprenons que Sîva passe pour avoir trois yeux, d’où il est aussi nommé Trilôtchan, et lorsque nous savons de Pausanias, non-seulement que Triophthalmos étoit une épithète de Zeus, mais encore qu’on avoit trouvé une de ses statues, dès l’époque de la prise de Troie, avec un troisième œil au front, comme nous le voyons représenté par les Hindous, nous sommes forcés d’en conclure que l’identité de ces dieux est à-peu-près démontrée.
Sous le rapport de destructeur, le dieu indien répond également au Jupiter stygien, ou Pluton ; d’autant mieux que Calï, ou le Temps, au féminin, est un des noms de son épouse, en qui l’on reconnoîtra bientôt Proserpine. Dans le fait, si l’on peut s’en rapporter à une traduction persane du Bhagavat (car l’original n’est pas encore en ma possession), le souverain de Patala, ou des régions infernales, est le roi des serpens, nommé Sêchanâga ; car il y est dit que Crichna (85) descendit, avec son favori Ardjoun (86), dans le séjour de cette divinité formidable, et en obtint sur-le-champ la faveur qu’il sollicitoit ; savoir, que les âmes des six fils de Brâhmah, qui avoient péri dans une bataille, pussent rentrer dans leurs corps respectifs. Voici la description de Séchanâga : « Il avoit un air majestueux avec mille tètes, et sur chacune d’elles une couronne garnie » de pierreries éclatantes, dont une étoit plus grosse et plus brillante que les autres. Ses yeux étinceloient comme des torches enflammées ; mais son cou, ses langues et son corps étoient noirs ; » les franges de son vêtement étoient jaunes ; et un joyau radieux » pendoit à chacune de ses oreilles. Il avoit les bras étendus et ornés » de riches bracelets. Ses mains portoient la sainte coquille, la flèche » radiée, la masse d’armes et le lotus. » C’est ainsi qu’on peignoit souvent Pluton avec un diadème et un sceptre ; mais lui et son attirail étoient du noir le plus sombre.
Mahâdêva est encore distingué par un autre attribut dans les dessins et dans les temples du Bengale. Selon les Vêdântis de l’Inde, les Ssoùfys (87) de la Perse, et plusieurs philosophes de l’école européenne, détruire n’est qu’engendrer et reproduire sous une autre forme. De là vient qu’en ce pays on croit que le dieu de la destruction préside à la génération, en signe de quoi il est monté sur un taureau blanc. Peut-on douter que les amours et les actions de Jupiter Genitor (sans oublier le taureau blanc d’Europe), et son titre extraordinaire de Lapis, dont on ne donne pas une raison satisfaisante, n’aient des rapports avec la philosophie et la mythologie indiennes ? Quant au dieu de Lampsaque, ce n’étoit originairement qu’un épouvantail, et il ne doit avoir place dans aucun système mythologique. À l’égard de Bacchus, dieu des vendanges, dont les actes, comme l’observe Bacon, offrent une ressemblance étonnante avec ceux de Jupiter, ses images ithyphalliques, ses dimensions et ses cérémonies faisoient probablement allusion à l’affinité supposée de l’amour et du vin ; à moins de croire qu’elles appartinrent dans l’origine à Sîva, qui, parmi ses noms, a celui de Wâguîs ou Bâguîs ( 88), et qu’elles furent dans la suite appliquées mal-à-propos. Quoique, dans un Essai sur les dieux de l’Inde, contrée où il est positivement défendu aux Brahmanes de goûter des liqueurs fermentées, nous ayons peu à nous occuper de Bacchus en sa qualité de dieu du vin, lequel n’étoit, suivant toute apparence, que le président imaginaire des vendanges en Italie, dans la Grèce et dans l’Asie mineure, nous ne devons pas passer sous silence Sourâdêvî (89), déesse du vin, qui, au rapport des Hindous, naquit de l’océan, lorsqu’il fut battu avec le mont Mandar (90) : or cette fable semble indiquer que les Indiens venoient d’un pays où l’on faisoit anciennement du vin, et où cette liqueur étoit considérée comme un bienfait des dieux, quoique les dangereux effets de l’intempérance eussent engagé leurs premiers législateurs à prohiber l’usage de toutes les boissons spiritueuses ; et il seroit bien à souhaiter qu’une loi aussi sage n’eût jamais été enfreinte.Nous pouvons ici faire mention du Jupiter marin, ou Neptune, des Romains, comme ressemblant à Mahâdêva (91) dans son caractère générateur ; sur-tout parce que ce dieu est l’époux de Bhavânî, dont le rapport avec les eaux est clairement prouvé par la cérémonie où on leur restitue l’image de cette déesse à la fin de sa grande fête appelée Dourgâtsava (92). On sait aussi qu’elle a des attributs exactement semblables à ceux de Vénus marine, produite par l’écume de la mer : sa naissance, et sa sortie brillante de la conque qui lui avoit servi de berceau, ont fourni une infinité de sujets charmans aux artistes anciens et modernes ; et il est bien remarquable que la Rembhâ, de la suite d’Indrâ, qui semble répondre à la Vénus populaire, ou déesse de la beauté, fut produite, selon les mythologues indiens, de l’écume de l’océan agité. L’identité du trisôula (93) et du trident, l’arme de Sîva et de Neptune, semble établir cette analogie ; et la vénération qu’on a dans toute l’étendue de l’Inde pour le grand buccin, sur-tout lorsqu’on le trouve avec la ligne spirale et la bouche tournée de gauche à droite, nous rappelle sur-le-champ la musique de Triton. Le génie de l’eau est Varouna ; mais, comme les autres génies, il est très inférieur à Mahêsa, et meme à Indra, qui est le prince des génies bienfaisans (94).
Cette manière d’envisager les dieux comme des substances individuelles, mais comme personnes distinctes, avec des caractères distincts, est commune au système européen et au système indien, aussi bien que l’usage de donner le plus de noms aux plus élevés en dignité. De là vint, pour ne pas répéter ce qui a été dit de Jupiter, le triple caractère de Diane, et l’objet de sa demande dans Callimaque, qui consiste à être polyonyme ou décorée de plusieurs titres. L’épouse de Sîva est plus éminemment caractérisée par ces distinctions que celles de Brâhmah ou de Vichnou ; elle ressemble à l’Isis myrionyme, à laquelle est consacré un ancien marbre décrit par Gruter : mais ses noms et ses attributs principaux, sont Parvatî, Dourgâ, Bhaydnî.
Comme déesse née sur une montagne, ou Parvatî (95), elle a plusieurs attributs de Junon olympienne ; sa contenance majestueuse, son humeur altière et ses qualités générales sont les mêmes ; et nous la trouvons accompagnant de même son époux sur le mont Cailâsa et aux banquets des dieux. Leur parallèle offre une particularité extrêmement curieuse. Pârvatî a constamment avec elle son fils Cârtiguêya* (96), qui est monté sur un paon ; et dans quelques dessins, sa robe à elle-même semble jonchée d’yeux ; à quoi il faut ajouter que, dans quelques-uns de ses temples, on voit un paon, sans cavalier, à côté de ses images. Cârtiguêya, avec ses six visages et la multitude de ses yeux, a bien quelque ressemblance avec Argus, que Junon employoit comme son principal garde ; mais comme c’est une divinité du second ordre, et le chef des armées célestes, il paroît être clairement l’Orus d’Égypte et le Mars d’Italie. Je suis persuadé que son nom de Skanda, sous lequel il est célébré dans un des Pourânas, a de l’affinité avec l’ancien Skander de Perse, que les poëtes confondent ridiculement avec Alexandre de Macédoine (97).Les attributs de Dourgâ, ou d’accès difficile (98), ne sont pas moins frappans dans la fête dont il vient d’être fait mention : cette fête porte son nom ; et, sous ce rapport, elle ressemble à Minerve, non pas à la pacifique inventrice des beaux-arts et des arts utiles, mais a Pallas, coiffée d’un casque et armée d’une lance : l’une et l’autre représentent la vertu héroïque, ou la valeur unie à la sagesse ; l’une et l’autre tuèrent de leurs propres mains des géans et des démons ; l’une et l’autre protégeoient les hommes bons et vertueux, qui leur rendoient un culte légitime. De même, dit-on, que Pallas tire son nom de l’action de jeter une lance et paroît d’ordinaire armée de pied en cap, ainsi curis, l’ancien mot latin qui signifioit lance, étoit l’un des titres de Junon (99) ; et si Lilio Gyraldi (100) n’est point dans l’erreur, un autre de ses titres étoit Hoplosmia (101), qui, à ce qu’il semble, désignoit en Élide une femme vêtue en panoplie (102), ou complètement armée. La Minerve non armée des Romains répond visiblement, comme protectrice du savoir et du génie, à Saresouatî, épouse de Brâhmah, et emblème de sa principale faculté créatrice. Ces deux déesses ont donné leur nom à de célèbres ouvrages de grammaire ; mais le Sdresouata de Saroûpâtchârya est infiniment plus concis que la Minerva de Sanctius, en même temps qu’il est plus utile et plus agréable. La Minerve (103) d’Italie inventa la flûte ; et Saresouatî préside à la musique. Ce fut aussi par la même raison que la protectrice d’Athènes eut le surnom de Musicé.
Plusieurs savans mythologues, ayant à leur tête Lilio Gyraldi, voient dans la pacifique Minerve l'Isis égyptienne. Plutarque cite une inscription singulière du temple de cette dernière à Sais (104), qui a de la ressemblance avec les quatre strophes rapportées ci-dessus, comme servant de texte au Bhagavat : « Je suis tout ce qui a été, est » et sera, et jamais mortel n'a soulevé mon voile (105).» Quant à moi, je ne doute nullement que l'Isouara et l'Isî des Hindous ne soient l'Osiris et l'Isis des Égyptiens ; mais il faudrait un Mémoire séparé, à la manière de Plutarque, pour démontrer leur identité. Ils désignent, à ce qu'il me semble, les facultés de la nature considérées comme mâle et femelle ; et Isis, à l'instar des autres déesses, représente la faculté active de son époux, dont les huit formes sous lesquelles il devient visible à l'homme furent décrites en ces termes par Câlidâsa (106), il y a près de deux mille ans : « L'eau fut le premier ouvrage du Créateur ; et le feu reçoit l'oblation de beurre clarifié (107), comme la loi le prescrit ; le sacrifice s'accomplit avec solennité ; les deux luminaires du ciel distinguent le temps ; l'éther subtil, qui est le véhicule du son, pénètre l'univers ; la terre est naturellement la mère de tout accroissement ; et l'air anime toutes les choses qui respirent. Puisse Isa, le pouvoir qui daigne se manifester sous ces huit formes, vous accorder ses bénédictions et son appui (108) ! » Les cinq élémens, aussi-bien que le Soleil et la Lune, sont donc considérés comme Isa, ou celui qui gouverne : or, d'Isa on peut former régulièrement Isî, quoiqu'Îśânî soit le nom usité pour sa faculté active, adorée comme la déesse de la nature. Je n'ai pas encore trouvé dans les livres sanskrits le conte bizarre, mais poétique, d'io ; mais je suis persuadé qu'au moyen des Pourânas nous découvrirons, avec le temps, toute la science des Égyptiens, sans déchiffrer leurs hiéroglyphes. Le taureau d'isouara paraît être Apis, ou Ap, ainsi qu'il est plus correctement nommé dans la véritable leçon d'un passage de Jérémie ; et si la vénération qu'on témoigne dans le Tibet et dans l'Inde pour un quadrupède aussi aimable et aussi utile que la vache, ainsi que la reproduction du Lama Lama lui-même, n’ont pas quelque affinité avec la religion de l’Egypte et l’idolâtrie d’Israël, il faut au moins convenir que les circonstances ont merveilleusement coïncidé.Bhavânî (109) appelle maintenant notre attention ; et, sous ce point de vue, je suppose que la femme de Mahâdêva est aussi-bien la Junon Cinxia ou la Lucine des Romains (qu’ils appeloient aussi Diana SoJvi- 10 tm, et les Grecs, ll’ithyia), que Vénus elle-même : non la Vénus d’idalie, reine de l’Enjouement et des Ris , qui, avec ses Nymphes et ses trois Grâces, fut la belle production de l’imagination des poëtes, et répond à la Rembhâ de l’Inde , avec son céleste cortège d’Apsarâs, ou de filles du paradis ; mais Vénus Uranie , dont Lucrèce a fait un tableau si animé, et qu’il invoque si à propos ; Vénus qui préside à la génération, et que, pour cette raison, on représente quelquefois avec les deux sexes (union très-commune dans les sculptures indiennes ), comme dans sa statue barbue (110) à Rome, dans les images qu’on nommoit peut-être Hermatheua (111), et dans ces figures où elle avoit la forme d’un cône de marbre ; « forme, dit Tacite, dont 011 » nous laisse ignorer le motif. » Ce motif n’est que trop visible dans les temples et dans les peintures de i’Hindoustân. Il semble n’être jamais venu à l’esprit des législateurs de cette contrée qu’une chose naturelle pût blesser la décence par son obscénité (112). Cette singularité se retrouve dans tous leurs ouvrages et dans tous leurs discours ; mais elle ne prouve point la dépravation de leurs mœurs. Platon et Cicéron parlent à’Eros, ou du Cupidon céleste, comme fils de Vénus et de Jupiter ; ce qui prouve l’affinité du monarque de l’Olympe et de la déesse de la fécondité avec Mahâdêva et Bhavânî. En effet, le dieu Câmâ (113) étoit fils de Mâyâ et de Casyapa, ou Uranus, au moins suivant les mythologues de Kachmyr ; mais, à plusieurs égards, il paroît être le jumeau de Cupidon , avec des attributs plus riches et plus animés. Une de ses nombreuses épithètes est Dîpaca [ celui qui enflamme ], mot que l’on écrit , par erreur, Dîpuc ; et je suis maintenant convaincu que l’espèce de ressemblance qui a été observée entre son nom latin et son nom sanskrit, est purement accidentelle (114). Dans tous les noms, les trois premières lettres sont la racine1. Or il n’y a point d’affinité entre elles. Il faut laisser dans l’indécision la question de savoir s’il existoit un rapport mythologique entre l’amaracus, dont les feuilles embaumées ceignoient les tempes d’Hymen, et le toulasî de l’Inde : ces deux plantes ont beaucoup d’affinité sous le point de vue botanique, si marjolaine est la traduction exacte d’amaracus.
L’une des cérémonies les plus remarquables qui ont lieu dans la solennité de la déesse indienne, est celle dont j’ai parlé ci-dessus, où l’on jette son image dans le fleuve. Les Pandits, que j’ai interrogés concernant son origine et sa signification, m’ont répondu qu’elle éioit prescrite par le Vêda, sans qu’ils sussent pourquoi : mais j’imagine que cet usage a rapport à la doctrine suivant laquelle l’eau est une forme d’Isouara, et par conséquent d’Isànî ; on représente même quelquefois Isânî comme la patronne de cet élément, à qui l’on restitue sa figure après qu’elle a reçu tous les honneurs qui lui sont dus sur la terre considérée comme une autre forme du dieu de la nature, mais subséquente au fluide primitif dans l’ordre de la création. Le culte des dieux et déesses des fleuves, l’hommage rendu à leurs eaux, et les idées de purification qui y ctoient annexées, ne sont point une preuve décisive d’un système primitif parmi les nations idolâtres, puisque les Grecs, les Italiens, les Égyptiens et les Hindous, ont pu, sans avoir de communication les uns avec les autres, adorer les divinités des grands fleuves qui leur procuroient le plaisir, la santé et l’abondance. Le docteur Musgrave a pensé que la force et la rapidité des grands fleuves faisoient supposer qu’ils étoient conduits par des dieux, tandis que les ruisseaux n’étoient protégés que par des déesses. Les faits combattent cette idée, comme presque toutes les conjectures des grammairiens fondées sur les genres des noms. La plupart des
a Il seroit aisé de prouver par des exemples, et d’établir par de bonnes raisons, que la racine est le plus souvent la syllabe ou les lettres du milieu des mots. (Labaume.) grands fleuves de l’Inde ont des noms féminins ; et les trois déesses des eaux, pour qui les Hindous ont une vénération particulière, sont Gangâ, qui sortit, comme Pallas, de la tête du Jupiter indien (115), Yamounâ (116), fille du Soleil, et Saresouatî (117). Toutes trois s’assemblent à Prayâga, nommé par cette raison Trivêni, ou les trois boucles tressées ; mais, suivant la croyance populaire, Saresouatî s’enfonce sous la terre, et reparoît à un autre Trivêni, situé près d’Hoùgly, où elle rejoint sa biec-aimée Gangâ. Le Brahmâpoùtra est, à la vérité, un fleuve mâle ; et comme son nom signifie le fils de Brdhmab, j’en ai pris occasion de feindre dans un de mes hymnes qu’il avoit épousé Gangâ, quoique je n’aie pas rencontré dans les livres sanskrits un seul passage où il fût mentionné comme dieu.Il faut parler maintenant de deux divinités incarnées du premier Rama, le rang, Râma et Crichna, et développer clairement leurs divers attri- Bacbuts. Le premier étoit, ce me semble, le Dionysos (118) des Grecs, chus’ qu’ils appeloient Bromius, sans savoir pourquoi, et Bugenes, quand ils le représentaient avec des cornes. Ils le nommoient encore Lyaios et Eleut/ierios [le Libérateur], et Truimbos ou Ditbyrantbos [le Triomphant]. La plupart de ces titres furent adoptés par les Romains, qui le nommoient Bruma, Tauriformis, Liber, Triumphus. Les deux nations avoient des traditions ou des documens suivant lesquels il avoit donné des lois aux hommes et jugé leurs différens, perfectionné la navigation et le commerce, et, ce qui paroîtra encore plus digne de remarque, fait la conquête de l’Inde et de plusieurs autres régions avec une armée de satyres, commandée par un personnage aussi distingué que Pan. Lilio Gyraldi, j’ignore sur quelle autorité, assure que ce dernier résida dans i’Ibérie, « après être retourné, » dit ce savant mythologue , de la guerre de l’Inde, où il avoit « accompagné Bacchus. » II seroit superflu, dans un simple essai, de prolonger ce parallèle entre ce dieu européen et le souverain d’Ayodhyâ (1 19), sous la forme duquel les Hindous croient que le pouvoir conservateur apparut à la terre. Suivant eux, ce fut un conquérant célèbre ; il délivra les nations des tyrans, et Sitâ, son épouse, du géant Râvan, roi de Lankâ, et commanda en chef une race nombreuse et intrépide de ces grands singes que nos naturalistes, ou au moins quelques-uns d’entre eux, ont nommés satyres indiens (120). Son général, le prince des satyres, s’appeloit Hanoumat, ou l’homme aux pommettes élevées ; et, avec des ouvriers aussi agiles, il eut bientôt construit sur la mer un pont de rochers, dont une partie subsiste, encore, au rapport des Hindous. C’est probablement la suite de rochers à laquelle les Musulmans ou les Portugais ont donné le nom bizarre de Pont d’Adam ; il devoit s’appeler Pont de Rama. Ne se pourroit-il pas que cette armée de satyres eût été seulement une race de montagnards civilisés par Râma, si ce monarque a jamais existé ? Quoi qu’il en soit, les Hindous ont aujourd’hui en grande vénération l’immense famille des . singes indiens ; et ces animaux sont pieusement nourris par les Brahmanes, qui paraissent avoir pour leur subsistance des fondations en règle dans deux ou trois endroits situés sur les bords du Gange. Ils vivent par tribus de trois ou quatre cents, sont d’une extrême douceur (j’en parle comme témoin oculaire), et paraissent avoir une espèce d’ordre et de subordination dans leur petite police forestière. Il ne faut point passer sous silence que le père de Hanoumat Pavan,dieu étoit je djeu vent, nommé Pavan, l’un des huit génies ; et de même que Pan perfectionna la flûte en y ajoutant six tuyaux, « et » joua parfaitement du luth quelques instans après sa naissance, » de même l’un des quatre systèmes de la musique indienne porte le nom de Hanoumat, ou Hanouman (121) au nominatif, comme celui de son premier inventeur, et jouit maintenant de l’estime générale.
La guerre de Lankâ est représentée sous une forme dramatique à la fête de Râma, le neuvième jour de la nouvelle lune de Tchaitra (122) ; et, au rapport d’HolwelI, qui y avoit assisté, le au drame se termine par une représentation de l’épreuve du feu moyen de laquelle Sitâ, l’épouse du vainqueur, prouva sa fidélité conjugale. « Le dialogue, ajoute-t-il, est pris des dix-huit livres sacrés. » Je suppose qu’il entend par-là les Pourânas. Mais les Hindous possèdent un grand nombre de drames réguliers, qui ont au moins deux mille ans d’antiquité (123) ; et dans le nombre, il y en a de très-beaux tirés de l’histoire de Râma. Le premier poète des Hindous fut le grand Vâlmik (124) ; son Râmâyan est un poème épique sur le même sujet, très-supérieur pour l’unité d’action, la magnificence des images et l’élégance du style, à l’ouvrage savant et châtié de Nonnus, intitulé les Dionysiaques, dont je lus la moitié ou vingt-quatre livres avec beaucoup d’empressement, lorsque j’étois fort jeune, et que j’aurois lu jusqu’à la fin, si d’autres occupations ne m’eussent captivé. Je n’aurai jamais le loisir de comparer les Dionysiaques et le Râmâyan : mais je suis sûr qu’une comparaison exacte de ces deux poèmes prouveroit l’identité de Dionysos et de Râma ; et je penche à croire que ce dernier fut le Râma, fils de Koùch, qui peut avoir établi le premier gouvernement régulier dans cette partie de l’Asie. J’avois presque oublié que, suivant les Grecs, Méros est une montagne de l’Inde, sur laquelle étoit né leur Dionysos, et quq Mérou, quoique ce mot désigne généralement le pôle septentrional dans la géographie indienne, est aussi une montagne située près de la ville de Naichada ou Nysa (125), que les géographes grecs appellent Diouysopolis, et qui est célébrée dans tous les poèmes sanskrits. On suppose néanmoins que le lieu de la naissance de Râma fut Ayodhyâ ou Aoude (126). Si l’on en croit les Brahmanes, cette ancienne ville s’étendoit sur une ligne de dix yôdjans (127), ou d’environ quarante milles ; et la ville actuelle de Lakhnaù, qui se prononce Laknau, n’étoit que la loge de l’une de ses portes, appelée Lakchmanadouâra, ou la porte de Lakchman, frère de Râma. M. Sonnerat (128) suppose que Ayodhyâ étoit Siam : cette hypothèse erronée et sans fondement auroit été de peu de conséquence, s’il n’avoit pas étayé sur elle un raisonnement pour établir l’identité de Râma et de Bouddha, dont l’apparition date nécessairement de plusieurs siècles après la Conquête de Lankâ ( 129).
Crichna (130), le second des grands dieux, mena, suivant les Crichna, l’Apollon indien. Indiens, la vie la plus extraordinaire et la plus incompréhensible. Il étoit fils de Dêvald et de Vasoudêva ; mais on cacha sa naissance par crainte du tyran Kansa, à qui il avoit été prédit qu’un enfant né à cette époque dans cette famille lui donneroit la mort. Il fut élevé à Mat’hourâ, par un honnête berger, surnommé Ananda [Heureux], et par son aimable femme Yasôdâ, qui, comme une autre Palès, étoit sans cesse occupée de ses pâturages et de sa laiterie. Leur famille étoit composée d’une multitude de jeunes gôpas ou vachers, et de belles gôpîs (131) ou laitières, qui furent les compagnons de son enfance ; et dans sa première jeunesse, il choisit pour ses favorites neuf jeunes filles, avec qui il passoit gaiement les heures à danser, chasser, et jouer de la flûte. Je n’ai d’autre autorité pour le nombre remarquable de ses gôpîs, qu’un tableau bizarre, où neuf filles composent un groupe ayant la forme d’un éléphant, sur lequel il est assis et joue de la flûte. Malheureusement le mot nava signifie tout ensemble neuf (nom de nombre), nouveau, et jeune ; en sorte qu’il peut s’interpréter de deux manières dans la stance suivante :
Tarañidjâpouline nava ballavi
Perisadâ saha, guélicoutoûhalât
Droutavilam witatchârouvihârinam
Herimaham hrĭdayéna sadâ vahê.
« Je porte continuellement dans mon sein ce dieu, qui, dans ses amusemens avec un cortège de neuf (ou jeunes) laitières, danse gracieusement, tantôt vite, tantôt avec lenteur, sur les sables que vient de quitter la fille du Soleil. »
Lui et les trois Râmas sont représentés comme des jeunes gens d’une beauté parfaite ; mais les princesses de l’Hindoustân, aussibien que les jeunes filles de la ferme de Nanda, étoient passionnément éprises de Crichna, qui est encore à présent le dieu favori des femmes indiennes. La secte d’Hindous qui l’adore avec une dévotion enthousiaste et à-peu-près exclusive, a rédigé une doctrine qu’elle soutient avec zèle, et qui paroît généralement répandue dans ces contrées ; savoir, qu'il fut distingué de tous les avatars, qui n'avoient qu'une ansa ou portion de sa divinité, tandis que Crichna étoit la personne même de Vichnou sous une forme humaine (132). De là vient qu'elle regarde le troisième Râma, son frère aîné, comme le huitième avatar (133) investi d'une émanation de sa splendeur divine, et que, dans le principal dictionnaire sanskrit, composé il y a environ deux mille ans, Crichna, Vâsadêva, Gôvinda, et les autres noms du dieu berger, sont entremêlés d'épithètes de Nârâyati [l'Esprit divin]. Tous les avatars sont peints avec des couronnes de pierres précieuses, éthiopiennes ou parthes, la tête ceinte de rayons, des joyaux aux oreilles : ils ont deux colliers, l'un étroit, l'autre tombant sur leur sein, et où pendent des pierres précieuses ; des guirlandes de fleurs diaprées et arrangées avec goût, ou des colliers de perles, qui leur pendent jusqu'à la ceinture : de larges manteaux de tissu d'or ou de soie colorée, bordés de fleurs en broderie, sont élégamment jetés sur leurs épaules, et pliés en sautoir sur leur poitrine ; ils ont aussi des bracelets à un bras et à chaque poignet. Ils sont nus jusqu'à la ceinture, et leur peau est uniformément couleur d'azur foncé, probablement par allusion à la teinte du fluide primitif sur lequel Nârâyan marchoit dans le commencement des temps : mais leurs chemises sont d'un jaune brillant, couleur du péricarpe curieux qui se trouve au centre du lis aquatique, où la nature, comme l'observe le docteur Murray, dévoile ses secrets jusqu'à un certain point, puisque chaque graine, avant de germer, contient quelques feuilles parfaites. Ils sont quelquefois représentés tenant cette fleur à une main, un anneau elliptique et radié dans une autre, la sainte coquille ou le buccin gaucher dans une troisième, et une massue ou hache d'armes dans une quatrième : mais lorsque Crichna figure parmi les âvatârs, comme il arrive quelquefois, il est décoré avec plus de splendeur qu'aucune divinité, et porte une riche guirlande de fleurs champêtres (d'où il prend le nom de Vanamâli), qui lui descend jusqu'à la cheville, qui est ornée de rangs de perles. On croit que la couleur de son teint étoit bleu foncé, presque noir ; ce que signifie le mot Crichna. De là vient que la grande abeille de cette couleur lui est consacrée, et qu’on la peint souvent voltigeant sur sa tête. Cette teinte azurée, approchant du noir, est particulière à Vichnou, comme nous l’avons déjà remarqué ; et c’est pourquoi, dans le grand réservoir ou citerne de Cathmândoit, capitale du Népal (134), on voit une grande statue bien proportionnée, de marbre bleu, couchée et représentant Nârâyan qui flotte sur les eaux. Mais retournons aux actions de Crichna, qui n’étoit pas moins courageux qu’aimable. Dans son enfance, il tua le terrible serpent Kâliya, avec une multitude de géans et de monstres. Dans un âge plus avancé, il mit à mort son cruel ennemi Kansa ; et ayant pris sous sa protection le roi Youdhichthir (135) et les autres Pandous (136) qui avoient été très-opprimés par les Kourous (137) et leur chef tyrannique, il alluma la guerre qui est décrite dans le grand poème épique intitulé le Mahabharat (138) ; et l’ayant terminée avec gloire, il retourna dans son séjour céleste de Vaïcomha, après avoir laissé les instructions comprises dans le Guîtâ (139) à son inconsolable ami Ardjoun, dont le petit-fils parvint à la souveraineté de l’Inde.
Il est impossible de ne pas découvrir dans ce portrait, au premier coup-d’œil, les traits d’Apollon, surnommé, dans la Grèce, Nomios [le Pastoral], et Opifer en Italie, qui fit paître les troupeaux d’Admète et tua le serpent Python ; amoureux, beau et belliqueux. Le mot Gôvinda peut se rendre littéralement par Nomios ; de même que Césava est le même que Crinitus, ou à la belle chevelure : mais c’est aux étymologistes à déterminer si le mot gôpâla [berger] a du rapport avec Apollon. Le colonel Vallancey, dont les savantes recherches sur l’ancienne littérature de l’Irlande, sont du plus grand intérêt, m’assure qu’en irlandois, Crichna (140) signifie le Soleil ; et nous savons que les poètes latins regardoient Apollon et le Soleil comme étant le même dieu. Dans le fait, je penche à croire que les premiers idolâtres désignoient le feu solaire, non-seulement par Crichna ou Vichnou, mais même par par Brâhmah et Sîva, lorsqu’ils étoient unis et exprimés dans le mot mystique Ôm. Mais Phœbus, ou le disque du soleil personnifié, est adoré chez les Indiens sous le nom du dieu Soûrya (141), d’où les sectaires qui lui rendent un culte particulier, sont appelés Sauras. Leurs poëtes et leurs peintres le représentent dans un char traîné par sept coursiers verts, précédé d’Aroun, ou le point du jour, qui lui sert de cocher, et suivi par des milliers de génies qui l’adorent et chantent ses louanges. Il a une multitude de noms, et, parmi eux, douze épithètes ou titres qui indiquent ses facultés distinctes dans chacun des douze mois. Ces facultés sont appelées Adityas, ou enfans d’Aditi et de Casyapa, 1’Uranus indien ; et, suivant quelques autorités, l’une d’elles porte le nom de Vichnou [le Pénétrant]. On croit que Soûrya est fréquemment descendu de son char sous la forme humaine, et qu’il a laissé sur la terre une postérité aussi fameuse dans les histoires indiennes que les Héliades de la Grèce. Il est très-singulier que ses deux fils, nommés Asouitiau, ou Asouinîkoumârau au duel, soient regardés comme jumeaux, et représentés comme Castor et Pollux ; mais tous deux ont, parmi les dieux, les attributs d’Esculape, et on les croit nés d’une Nymphe qui, sous la forme d’une jument, fut fécondée par les rayons du soleil. Je soupçonne toute la fable de Casyapa et de ses enfans, d’être une allégorie astronomique ; et je ne puis m’empêcher de croire que le nom grec de Cassiopée y a rapport (142). Une autre grande famille indienne est appelée Enfans de la Lune ou de Tchandra (143), qui est une divinité mâle, et que par conséquent il ne faut point comparer avec Artémis ou Diane. Je n’ai pas encore trouvé non plus, dans l’Inde, d’analogue à la déesse de la chasse, qui paroît avoir dû le jour à une imagination européenne, et avoir été créée très-naturellement par l’invention des poëtes géorgiques et bucoliques. Cependant, puisque la Lune est une des formes d’isouara, le dieu de la nature, suivant la strophe de Câlidàsa, et puisque nous avons montré qu’lsânî est son épouse ou sa faculté, nous pouvons la considérer comme la Lune, sous un de ses attributs ; d’autant mieux que nous serons bientôt convaincus que, dans les ténèbres souterraines, elle répond à l’Hécate d’Europe.Le culte du feu solaire ou de Vesta (144), comme celui d’Isis et d’Osiris, peut être attribué à la seconde source de la mythologie ; savoir, à une admiration enthousiaste des forces merveilleuses de la nature ; et, autant que je suis en état de comprendre les Vêdas, il paroît être le principal culte qu’ils recommandent. Nous avons vu que Mahâdêva lui-même est désigné par le feu : mais il a au-dessous de lui le dieu Agni (145), souvent appelé Pâvaca [le Purificateur], qui répond au Vulcain d’Égypte (146), où il étoit un dieu du premier rang ; et son épouse, Souâhâ, ressemble à Vesta la jeune, ou Vestia, comme les Eoliens prononçoient le mot grec qui signifie âtre (147). Bhavânî, ou Vénus, est l’épouse du pouvoir suprême, destructeur et générateur ; mais les Grecs et les Romains, dont le système mythologique est moins régulier que celui des Indiens, la marioient à leur artiste divin, qu’ils nommoient aussi Hephaistos et Vulcain, et qui paroît être le dieu indien Visouaharman, l’armurier des dieux, et l’inventeur de l’agnyastra (148) [flèche enflammée], dans la guerre qu’ils eurent avec les Daityas ou Titans. On ne peut guère s’empêcher d’observer ici (et si cette observation déplaît en Angleterre, c’est contre mon intention) que la planète nouvellement découverte devroit incontestablement porter le nom de Vulcain, puisque la confusion de l’analogie dans les noms des planètes est contraire à l’élégance, à l’érudition et à la philosophie. Le nom d’Uranus est approprié au firmament : mais Vulcain, le plus lent des dieux et le plus âgé, suivant les prêtres égyptiens, s’accorde admirablement avec un globe qui doit accomplir sa révolution dans une période très-longue ; et, en lui donnant cette dénomination, nous aurons sept planètes primitives avec les noms d’autant de divinités romaines : Mercure, Vénus, Tellus, Mars, Jupiter, Saturne et Vulcain.
J’ai déjà donné à entendre que les Muses et les Nymphes sont les Gôpîas de Mat’hourâ, et de Gôverdhan, le Parnasse des Hindous ; et les poëmes lyriques de Djayadêva justifient pleinement cette opinion. Mais les Nymphes de la musique sont les trente Rdguinîs, ou Passions femelles, dont les fonctions et propriétés diverses sont si richement exprimées par les peintres indiens, et si élégamment décrites par les poètes. Mais je ne veux pas anticiper sur ce qui demande un mémoire séparé (149). en m’étendant ici sur la belle allégorie des Hindous dans leur système de modes musicaux, qu’ils appellent rdgas [passions] (150), et dont ils font des génies ou des demi-dieux. Un fils très-distingué de Brâhmah, appelé Nâred (151), dont les actions forment le sujet d’un Pourâna, ressemble beaucoup à Hermès ou Mercure. Il fut un sage législateur, grand dans les arts et dans les armes, éloquent messager des dieux auprès de tel ou tel mortel favorisé, et musicien très-habile. On trouve dans le poème intitulé Mâgha, la description suivante du vînâ, ou luth indien, dont il fut l’inventeur : « Nâred étoit assis, observant de temps en temps son grand vînâ, à qui le zéphyr faisoit rendre des sons qui perçoient successivement les régions de son oreille, et procédoient par intervalles musicaux. » Le code, qu’on suppose avoir été révélé par Nâred, est maintenant cité par les Pandits : ainsi nous ne pouvons croire qu’il ait été le patron des voleurs, quoiqu’on impute bizarrement à son père Brâhmah, dans le Bhagavat, le vol innocent du bétail de Crichna, commis en vue de mettre sa divinité à l’épreuve.La dernière des divinités de la Grèce ou de l’Italie pour lesquelles nous trouvons un parallèle dans le Panthéon de l’Inde, est la Diane stygienne ou taurique, autrement appelée Hécate (152), et que l’on confond souvent avec Proserpine. Il n’y a point de doute sur son identité avec Câlî (153), ou l’épouse de Sîva, dans son caractère de Jupiter stygien. On offroit anciennement, ainsi que l’ordonnoient les Vêdas, des sacrifices humains à cette noire déesse, qui portoit un collier de crânes d’hommes, ainsi que nous la voyons représentée dans ses principaux temples ; mais, dans ce siècle, ces sacrifices sont absolument défendus, ainsi que les sacrifices de taureaux et de chevaux. On lui offre encore des agneaux ; et pour pallier la barbarie de l’effusion du sang, qui déplaisoit tant à Bouddha, les Brahmanes font accroire que ces pauvres victimes montent dans le ciel d’Indrâ, où elles deviennent les musiciens de sa bande. Au lieu des sacrifices surannés, et maintenant illégaux, d’un homme, d’un taureau et d’un cheval, appelés Ne’ratnêdha, Gômêdha et Asouamêdha (154), on croit se rendre favorables les facultés de la nature par les cérémonies moins sanglantes de la fin de l’automne, où les fêtes de Câlî et de Lakchmî sont célébrées presque en même temps. Si l’on demande comment la déesse de la mort a pu être associée à l’aimable déesse de l’abondance, je demanderai, à mon tour, comment il s’est fait, dans le système européen, que Proserpine ait été représentée comme fille de Cérès (155). La réponse à ces deux questions se trouve peut-être dans cette proposition des naturalistes, que la destruction apparente d’une substance est sa production sous une autre forme, La musique bizarre des prêtres de Câlî, dans une de leurs fêtes (156), m’a rappelé sur-le-champ les airs scythiques des adorateurs de Diane dans le magnifique opéra d’Iphigénie en Tauride, que Gluck a donné à Paris, avec plus d’art, il est vrai, que de génie, mais avec tous les avantages que pouvoit fournir un orchestre.
Pour ne pas terminer cet assemblage des divinités de l’Europe et de l’Asie par un sujet aussi horrible que les autels d’Hécate et de Câlî, je finirai par deux observations qui, à proprement parler, appartiennent à la philosophie indienne, dont nous ne nous occupons pas en ce moment. 1.° L’élysée, non le lieu du bonheur, mais le bonheur même dont on y jouissoit, acception dans laquelle Milton se sert de ce mot, doit paroître une espèce de jouissance très-fastidieuse et très-insipide, tel qu’il est décrit par les poètes ; il est néanmoins plus sublime que l’élysée temporaire de la cour d’Indrâ, où, comme dans le paradis de Mohhammed, les plaisirs sont purement sensuels : mais le moukti [bonheur élysien] (157) de l’école Vêdânta (158) est d’un ordre beaucoup plus relevé ; elle le représente comme une absorption totale dans la divine essence, qui cependant ne détruit pas le moi. Au reste, par la raison indiquée ci-dessus, je ne m’étends pas davantage sur cette idée de béatitude, et je m’abstiens de toucher à la doctrine de la transmigration, et à la ressemblance de l’école Vêdânta avec les écoles sicilienne, italienne, et l’ancienne académie.
2.° Le caractère mystique et élevé de Pan, comme personnification de l’univers, suivant l’idée de Bacon, établit une sorte de ressemblance entre lui et Crichna considéré comme Nârâyan. Pan joue divinement de la flûte, pour exprimer, nous dit-on, l’harmonie céleste ; il a ses Nymphes des pâturages et de la laiterie ; son visage est radieux comme le ciel, et sa tête illuminée des cornes d’un croissant, tandis que ses extrémités inférieures sont difformes et velues, symbole des végétaux que produit la terre, et des animaux qui en parcourent la surface. Or nous pouvons comparer ce portrait, en partie avec le caractère général de Crichna, le dieu berger, en partie avec la description que fait le Bhagavat de l’Esprit divin manifesté sous la forme de cet univers : à quoi nous pouvons ajouter l’histoire suivante, tirée de ce poème extraordinaire. Les Nymphes s’étoient plaintes à Yasôdâ que le petit Crichna avoit bu leur lait et leur caillé. Sa nourrice l’ayant réprimandé de cette indiscrétion, il la pria d’examiner sa bouche, où, avec une surprise très-légitime, elle vit l’univers entier dans la plénitude de sa magnificence.
On ne doit pas être étonné de trouver, en examinant de près, que les caractères des divinités païennes, tant mâles que femelles, se fondoient les uns dans les autres, et enfin dans un ou deux ; car on est, ce semble, bien fondé à penser que toute la multitude des dieux et des déesses de l’ancienne Rome et de la Vârânès (159) moderne, ne signifie que les forces de la nature, et principalement celles du soleil, exprimées de mille manières et sous mille noms différens.
J’ai essayé d’établir un parallèle suivi entre les dieux adorés par trois différentes nations, les Grecs, les Romains et les Indiens. Je n’ai fait que i’ébaucher, à défaut de matériaux plus amples ; ma confiance s’est néanmoins accrue à mesure que j’avançois : mais je n’ose point décider laquelle de ces mythologies est l’original, laquelle est la copie ; et je crois que nous n’aurons pas de long-temps des bases suffisantes pour la solution de ce problème. La règle fondamentale, que les opérations naturelles et la plupart des opérations humaines procèdent du simple au composé, ne fournira point de secours à cet égard, puisque ni le système européen ni le système asiatique ne présentent aucune simplicité. L’un et l’autre sont tellement compliqués, pour ne pas dire absurdes, quoique entremêlés de beau et de sublime, qu’on ne sauroit attribuer avec quelque certitude à i’un ou à l’autre l’honneur de l’originalité.
Comme l’Egypte paroît avoir été la grande source des connoissances de l’Occident, et l’Inde celle des connoissances de l’Orient, il peut être intéressant de savoir si les Égyptiens communiquèrent leur mythologie et leur philosophie aux Hindous, ou vice versa : mais aucun mortel ne connoît ce que les savans de Memphis ont dit ou écrit au sujet de l’Inde ; et si ceux de Vârânès ont assuré quelque chose concernant l’Égypte, cela est peu satisfaisant. J’offrirai cependant les preuves circonstanciées que j’ai pu me procurer sur cette question, parce que, malgré leur foiblesse, il peut s’y rencontrer quelque chose qui 11e soit pas tout-à-fait indigne de fixer l’attention. Après tout néanmoins, quelques colonies qui aient passé des bords du Nil sur ceux du Gange, nous finirons peut-être par tomber d’accord avec M. Bryant, que les Égyptiens, les Indiens, les Grecs et les Italiens sortirent originairement d’un même lieu central, et que ie peuple dont ils faisoient partie porta sa religion et ses sciences à la Chine et au Japon : ne pourroit-on pas ajouter, au Mexique même et au Pérou ?
Tout le monde sait que le vrai nom de l’Égypte est Afisr (160), épelé avec une palatale sifflante, en hébreu et en arabe. Ce nom, en hébreu, paroît avoir été le nom propre du premier qui s’établit dans cette région ; et quand ies Arabes s’en servent pour exprimer une grande ville, ils entendent probablement une ville comme la capitale de l’Égypte. Le P. Marco, missionnaire catholique, qui n’est pas un savant du premier ordre, mais qui, j’en suis persuadé, est incapable d’une imposture préméditée, m’a prêté le dernier livre d’un Râmâyan, qu’il a traduit dans sa langue à l’aide des Hindous ; il y a joint un petit vocabulaire de noms historiques et mythologiques, que lui ont expliqués les Pandits de Betîyà (161), où il a fait une longue résidence. Un des articles de ce dictionnaire est ainsi conçu : « Tirôut, ville et province où s’établirent des « prêtres venus d’Egypte. » Lorsque je lui ai demandé comment l’Égypte s’appeloit chez les Hindous, il m’a répondu Misr, mais en observant qu’ils la confondoient quelquefois avec l’Abyssinie. J’ai vu qu’il se rappeloit bien ce qu’il avoit écrit ; car Misr étoit un autre article de son index, et il m’a dit que c’étoit « le pays d’où venoient « les prêtres égyptiens qui s’établirent à Tirôut ( 162). » J’ai soupçonné sur-le-champ que ce renseignement lui venoit des Musulmans, qui appellent le sucre candi misry [égyptien] ( 163). Mais, en l’examinant de près, et quand je l’ai prié avec instance de se rappeler de qui il tenoit ces renseignemens, il m’a assuré positivement, et à plusieurs reprises, qu’ils lui avoient été donnés par plusieurs Hindous, et en particulier par un Brahmane, son intime ami, qui avoit la réputation d’être un Pandit important, et qui avoit logé pendant trois ans dans son voisinage. Nous avons pour lors imaginé que le siége de cette colonie égyptienne devoit avoir été Tirô/iit, qu’on prononce ordinairement Tirôut, et qui s’appeloit anciennement Mithilâ, principale ville du Djanacadesa, ou Béhâr septentrional. Mais le Pandit Mahêsa, qui est né dans ce canton même, et qui s’est soumis patiemment à un long examen concernant Misr, a détruit toutes nos inductions. Il a nié que les Brahmanes de son pays fussent généralement surnommés Misr, comme nous l’avions appris. Il nous a dit que l’addition du mot mïsra au nom de Vdtchespeti, et de quelques autres savans auteurs, étoit un titre qui se donnoit anciennement aux écrivains de mélanges, ou aux : compilateurs de traités divers sur la religion ou les sciences, ce mot étant dérivé d'une racine qui signifie mêler(164). Je lui ai demandé où étoit situé le pays de Misr. « Il y a, m'a-t-il répondu, deux contrées de ce nom : l'une est située dans l'occident, et les Musulmans en sont maîtres ; l'autre, dont il est fait mention dans tous les Sâstras et Pourânas, est dans une région montagneuse, au nord d'Ayodhyâ. » Il est évident que, par le premier, il entendoit l'Egypte ; mais il n'est pas aisé de déterminer ce qu'il entendoit par le second. On voit dans les cartes, entre la frontière nord-est d'Aoude et les montagnes du Népal, un pays que nos géographes appellent Tiruhut : mais je ne puis décider si c'est le Tirôut dont parloit au P. Marco son ami de Betîyà. Je sais seulement avec certitude que Misra est une épithète donnée à deux Brahmanes dans le drame de Sacontala(165), composé près d'un siècle avant la naissance de J. C. ; que ce titre est déféré à quelques-uns des plus grands jurisconsultes et à deux des meilleurs poètes dramatiques de l'Inde ; que nous l'entendons fréquemment dans les tribunaux, ajouté au nom des parties ; et qu'aucun des Pandits que j'ai consultés, ne connoît sa véritable signification, en tant que nom propre, ou n'en donne d'autre explication, sinon que c'est un surnom des Brahmanes de l'occident. Je ne puis compter sur ce que le vieux radjah de Crichnanagar a dit un jour au colonel Kyd „ concernant des traditions qui se conservoient parmi les Hindous, et d'après lesquelles des Egyptiens se seraient établis dans cette contrée. Je tiens de quelques parens du radjah, personnes dignes de foi, qu'il n'avoit pas des connoissances solides, bien qu'il possédât des livres curieux, et qu'il eût été attentif à la conversation des savans(166). Je sais d'ailleurs que son fils, et plusieurs de ses parens, ont été des faussaires en fait de littérature indienne ; et je les crois très-sujets à s'abuser eux-mêmes, et à égarer ceux avec qui ils conversent, en confondant les sources d'instruction. Le mot misr, ainsi épelé en sanskrit avec une palatale sifflante, est très-remarquable ; autant que l'étymologie peut venir à notre secours, nous pouvons, en toute sûreté, dériver Nilus du mot sanskrit nîla [bleu], puisque Denys le Périégète nomme expressément ce fleuve un courant d’azur ; et si nous nous en rapportons à la version italienne du Râmâyan par Marco, le nom de Nîla se donne à une montagne haute et sacrée, dont le sommet est d’or pur, et d’où couloit un fleuve d’eau douce, limpide et fraîche. M. Sonnerat(167) renvoie à une dissertation de M. Schmidt, couronnée par l’Académie des inscriptions, sur une colonie égyptienne établie dans l’Inde. Il seroit utile d’examiner les autorités de cet écrivain, et de les renverser ou de les constater au moyen des autorités de plus grand poids auxquelles on a maintenant accès dans ces provinces. Je penche beaucoup à croire qu’il a raison, et que des prêtres égyptiens sont en effet venus des bords du Nil à ceux du Gangâ et de l’Yamounâ, que très-certainement les Brahmanes n’auroient jamais abandonnés. Ils auroient pu y venir sans doute pour chercher ou pour répandre l’instruction ; mais il paroît plus probable qu’ils visitèrent les Sarmans(168) de l’Inde, à l’instar des sages de la Grèce, plutôt pour acquérir des connoissances que pour en communiquer : d’ailleurs il n’est pas vraisemblable que les Brahmanes, qui se suffisent à eux-mêmes, les eussent reçus en qualité de précepteurs.
Quoi qu’il en soit, je suis persuadé qu’il a subsisté des relations entre les anciens peuples idolâtres de l’Égypte, de l’Inde, de la Grèce et de l’Italie, long-temps avant leur migration dans leurs divers établissemens, et par conséquent avant la naissance de Moïse. Mais la preuve de cette proposition n’affectera en aucune manière la vérité et la sainteté de l’histoire Mosaïque, qu’elle tendroit plutôt à confirmer, s’il en étoit besoin. L’envoyé divin, élevé par la fille d’un roi, et éminemment accompli sous tous les rapports, devoit connoître le système mythologique de l’Égypte ; mais il dut condamner les superstitions de ce peuple, et mépriser les absurdités spéculatives de ses prêtres, quoique quelques-unes de leurs traditions concernant la création et le déluge fussent fondées sur la vérité. Qui mieux que Socrate connoissoit la mythologie d’Athènes !
Qui plus que Saint Paul étoit versé dans la doctrine des Rabbins ? Qui eut des idées plus claires que Newton, de tous les anciens systèmes astronomiques, ou que Locke, de la métaphysique de l’école ? En qui l’église romaine auroit-elie trouvé un adversaire plus redoutable que Chillingworth, profondément instruit de ses dogmes, et par là, si en état de les combattre ? En un mot, qui mieux que Moïse lui-même connut les rites abominables et la révoltante idolâtrie de Canaan ? Néanmoins le savoir de ces grands hommes les excita à chercher d’autres sources de vérité, de piété et de vertu, que celles où ils s’étoient abreuvés long-temps. Il n’y a donc pas le moindre motif de penser que Moïse ait emprunté de la littérature des Égyptiens les neuf ou dix premiers chapitres de la Genèse. À plus forte raison, les colonnes de diamant de notre foi chrétienne né sauroient-elles être ébranlées par le résultat d’une discussion quelconque sur l’antiquité comparative des Hindous et des Égyptiens, ou par celui des recherches qu’on pourroit faire sur la théologie indienne. Des Indiens très-respectables m’ont assuré qu’un ou deux missionnaires avoient poussé l’absurdité, dans leur zèle pour la conversion des Gentils, au point de soutenir qu’aujourd’hui même les Hindous étoient presque chrétiens, parce que leur Brâhmah, leur Vichnou et leur Mahêsa, n’étoient autres que la Trinité chrétienne : nous sommes réduits à douter si c’est la folie, l’ignorance ou l’impiété, qui prévaut dans cette assertion. Les trois facultés créatrice, conservatrice et destructive, que les Hindous expriment par le mot trilittéral Ôm, furent grossièrement attribuées, par les premiers idoj lâtres, à l’ardeur, à la lumière et à la flamme du soleil, leur fausse divinité ; et leurs successeurs orientaux, plus sensés, voyant que le soleil n’étoit qu’une créature, appliquèrent ces facultés à son créateur. Mais la Trinité indienne, et celle de Platon, qu’il appelle le Dieu suprême, la raison et lame, sont à une distance infinie de la sainteté et de la sublimité de la doctrine que de pieux Chrétiens ont déduite des textes de l’Évangile, quoique d’autres Chrétiens non moins pieux fassent ouvertement profession de ne pas penser de même. Chaque secte est justifiée par sa croyance et ses bonnes intentions. Je n’ai d’autre but, en m’exprimant ainsi, que de montrer qu’on ne peut, sans profanation, comparer la doctrine de notre église avec celle des Hindous, qui n’a avec elle qu’une ressemblance apparente, et qui en diffère beaucoup pour le sens. Il ne faut pas néanmoins passer sous silence un fait singulier : nous savons avec certitude que le nom de Crichna et le canevas général de son histoire sont fort antérieurs à la naissance de Jésus-Christ, et probablement au temps où vécut Homère. Cependant le poème célèbre intitulé Bhagavat, qui renferme une histoire prolixe de sa vie, est plein de récits d’une nature fort extraordinaire, mais étrangement diversifiés et entremêlés d’ornemens poétiques. Le dieu incarné du roman sanskrit eut, à ce qu’il nous apprend, son berceau parmi des bergers ; mais il ajoute qu’il fut élevé au milieu d’eux, et qu’il passa sa jeunesse à folâtrer avec une troupe de laitières. À l’époque de sa naissance, un tyran ordonna de mettre à mort tous les enfans nouveau-nés ; mais cet enfant merveilleux échappa, en mordant, au lieu de téter, le sein empoisonné d’une nourrice chargée de le faire périr. Il fit des miracles surprenans, mais ridicules, dans son enfance ; et à l’âge de sept ans, il tint une montagne sur le bout de son petit doigt. Il sauva des multitudes d’hommes, en partie par la force de ses armes, en partie par sa puissance miraculeuse. Il ressuscita les morts, en descendant, à cette intention, dans les régions les plus profondes. Il fut le plus doux des êtres, celui qui avoit le meilleur caractère : il lavoit les pieds des Brahmanes, et prêchoit d’une manière noble et très-sublime, mais toujours en leur faveur. Il étoit, au fond, pur et chaste ; mais il affectoit un libertinage excessif, et il avoit une multitude innombrable de femmes et de maîtresses. Enfin, il étoit bienfaisant et sensible ; néanmoins il fomenta et dirigea une guerre terrible. Cette histoire bigarrée donne lieu de soupçonner que les évangiles apocryphes, qui abondoient dans le premier siècle du christianisme, avoient été portés dans l’Inde(169), et que leurs parties les plus bizarres avoient été répétées aux Hindous, qui les greffèrent sur l’antique fable de Césava, l’Apollon des Grecs.
Quant à la propagation générale de notre pure croyance dans l’Inde, plusieurs fâcheux obstacles s’y opposent aujourd’hui. Les Musulmans sont déjà une sorte de Chrétiens hétérodoxes. Ils sont Chrétiens, si Locke raisonne juste, parce qu’ils croient fermement à l’immaculée conception, au caractère divin et aux miracles du Messie ; mais ils sont hétérodoxes, en ce qu’ils nient avec obstination son titre de fils de Dieu, et son égalité, comme Dieu, avec Dieu le père, sur l’unité et les attributs duquel iis ont et expriment les idées les plus augustes : d’ailleurs, ils regardent notre doctrine comme entièrement blasphématoire, et ils soutiennent que les Juifs et les Chrétiens ont altéré les copies que nous possédons de l’Ecriture sainte. Il sera extrêmement difficile de les désabuser, et presque impossible de diminuer leur vénération pour Mohhammed et pour A’iy, qui furent deux hommes très-extraordinaires, et dont le second eut des mœurs irréprochables. Sans doute le Qorân brille d’une lumière empruntée, puisque la plupart de ses beautés sont pillées dans la Bible ; mais il en a de très-grandes, et jamais on ne convaincra les Musulmans qu’elles lui viennent d’ailleurs. D’un autre côté, les Hindous admettraient volontiers la vérité de l’Évangile ; mais ils prétendent qu’il est parfaitement compatible avec leurs Sâstras. « La Divinité, disent-ils, s’est manifestée par des apparitions sans nombre, dans plusieurs parties de ce monde et de tous » les mondes, pour le salut de ses créatures ; et quoique nous l’adorions sous une forme, et les étrangers sous d’autres formes, nous » adorons le même Dieu, qui accueille également nos différens cultes, » s’ils sont sincères, quoiqu’ils diffèrent quant à la forme. » Nous pouvons Être sûrs que ni les Musulmans ni les Hindous ne seront convertis par les missionnaires de l’église romaine ou de toute autre église ; et la seule manière, peut-être, dont les hommes puissent venir à bout d’une aussi grande révolution, sera de traduire en sanskrit et en persan les chapitres des prophètes, en particulier d’Isaïe, qui sont incontestablement évangéliques, en y joignant un des évangiles, et une introduction écrite avec simplicité, qui renferme la preuve complète de la haute antiquité des siècles où furent publiées et les prédictions et l’histoire du personnage divin qui en étoit l’objet. Il faudroit ensuite répandre paisiblement cet ouvrage parmi les Hindous qui ont reçu une bonne éducation ; et si, avec le temps, il ne produisoit pas des effets salutaires par son influence naturelle, nous aurions à déplorer plus que jamais la force du préjugé et la foiblesse de la raison abandonnée à elle-même.
NOTES DU C.en LANGLÈS
(1) Le système religieux des Hindous peut être regardé comme le plus simple et le plus pur qui ait jamais existé, si l’on en juge par cette belle profession de foi tirée littéralement des Vêdas :
Il existe un Dieu Vivant et vrai, éternel, incorporel, impalpable, impassible, tout-puissant, tout-savant, infiniment bon, qui fait et conserve toutes choses. L’esprit grossier du vulgaire, pour qui la crédulité est un besoin, ne pouvoit s’accommoder d’une religion sans miracles, sans dogmes et sans culte. Bientôt cet Être suprême, ou cette essence éternelle, prit le nom de Brahm ou Brehmâ, mot sanskrit du genre neutre. « Cette première cause, ou CE QUI EST, comme le nomme Menou (chap, Ier, v. 11, de ses Institutes), qui ne peut être soumise aux sens, qui existe par-tout en substance, mais qui échappe à notre perception, sans commencement ni fin, produisit le mâle divin, célèbre dans tous les mondes, sous la dénomination de Brâhmah, le créateur ou formateur ; Vichnou, le conservateur ; et Sîva, le destructeur ou plutôt le changeur de formes : » car les Hindous ne croient pas plus à l’anéantissement total des choses qu’à leur création ; la préexistence est un de leurs articles de foi : ils pensent que la création consiste, non à tirer quelque chose de rien, ce qui leur paroît absurde, mais à produire sous une nouvelle forme ; et toutes les formes continueront de changer jusqu’à ce que des purifications progressives les rendent dignes d’être réabsorbées dans l’essence éternelle, qui doit ensuite les reproduire par une série infinie de créations ou de formations. Cette essence nommée Brehmă, et le pouvoir formateur nommé Brâhmah (et plus correctement Brahmâ), n’ont aucun temple particulier, sans doute parce que le besoin et la crainte, ces deux grands mobiles de la superstition parmi les hommes, ne peuvent les appeler à leur secours.
Vichnou et Sîva (ou Chiva) se partagent les hommages des Hindous, qui forment deux sectes fortement divisées d’opinion, et sur-tout d’affection ; car les partisans de Vichnou, qu’on nomme Vichnou âmâdam sur la côte de Coromandel, et Vichnou bakt dans le nord de l’Inde, ou bien encore Vaichnava, détestent très-cordialement les Siva âmâdam, ou Siva bakt, ou Saiva, c’est-à-dire, les partisans de Sîva, lesquels leur rendent la pareille avec usure. Vichnou est adoré dans beaucoup de temples ou pagodes, avec de grandes cérémonies, et sous les différens noms qu’il porta dans ses différentes incarnations ou descentes sur la terre : elles sont au nombre de neuf ; et Ton croit qu’il paroîtra encore une dixième fois, sous la forme d’un cheval. (Voyez, p. 234, ma note 38 sur les avatars.) Sîva n’a pas moins de temples et d’adorateurs que le précédent ; et Ion compte mille huit manifestations de sa présence sur la terre. En conséquence, il est adoré dans ses pagodes sous plusieurs noms ; ce qui a induit en erreur beaucoup d’Européens, qui ont cru que ces noms et ces pagodes appartenoient à des divinités différentes. L’emblème sous lequel Sîva est le plus communément adoré, est le lïngatn, ou la représentation des organes de la génération réunis. Quelques sectateurs de Sîva regardent le lingam comme l’emblème du créateur suprême ; mais il s’en faut de beaucoup que ce soit une opinion universellement accréditée parmi les Hindous. Les sectateurs de Vichnou ont horreur de cette indécente figure emblématique.
Chacune des personnes de cette trimourti ou trinité a une épouse qui jouit des honneurs divins, et qui a des attributs et une puissance analogues, mais subordonnés, au dieu auquel elle est unie. Saresouatî, épouse du créateur ou formateur Brâhmah, possède les facultés de l’imagination et de l’invention, qu’on peut bien nommer créatrices. Lakchmî, épouse de Vichnou, est douée du pouvoir conservateur : c’est la déesse du courage, de la joie, de la valeur, de l’éloquence, du mariage. Moudèvi ( ou Bhoudêvi J, autre femme de Vichnou, est la déesse de la terre, de la patience et de la turpitude : elle ne jouit d’aucun culte. Sîva (ou Chiva) a aussi deux femmes : l’une nommée Pârvatî ou B bavant, la déesse de l’abondance on lui rend de grands hommages dans les temples mêmes de Sîva : l’autre est Gangà, la rivière sacrée que nous nommons le Gange (suivant quelques auteurs, elle est la fille et non l’épouse de ce dieu) ; c’est la déesse de la propreté ; on ne l’adore que sur les bords des rivières ; elle est accompagnée de huit vierges, emblèmes des principales rivières qui se jettent dans le Gange. Ces dieux et ces déesses ont un assez grand nombre de noms ou épithètes, qu’on verra ci-après dans le cours de mes notes ; ils ont aussi des enfans qui ne jouent pas un rôle très-important dans le panthéon indien. La région inférieure du ciel est habitée par les Déva et les Dêvata, espèce d’anges gardiens, de demi-dieux, que l’on invoque pour être préservé des malheurs, et qui ont pour chef Indrâ, le dieu du firmament : ce sont les génies des Arabes, les péry des Persans, et les fées du Nord. Les Hindous ont aussi beaucoup de foi dans l’influence des astres sur les événemens sublunaires. Les astres qu’ils consultent, sont les sept planètes et les deux nœuds du dragon : ils nomment cette réunion nava graha, que les Malabars prononcent nova greggam [les neuf luminaires]. M. Wilkins observe que les poètes hindous ont donné à la tête et à la queue du dragon les noms de rahou et de kétou, et qu’ils feignent que ce sont deux planètes malignes, et que l’on ne peut apercevoir que lorsqu’elles saisissent le soleil et la lune dans les éclipses.
Tel est le précis très-rapide, mais aussi très-fidèle, de la théologie indienne, dans laquelle il est aisé de reconnoître la pureté du culte primitif rendu autrefois k l’Etre suprême. La première cause de la corruption de ce culte, suivant M. Jones, paroît avoir été la distinction qu’on a voulu établir, par le moyen des emblèmes, entre les trois grands actes de la Divinité (ou de la nature), /æ formation, la conservation, et le changement de formes, et non leur destruction, qui produirait un contraste choquant avec le Ungam, le principal attribut de Sîva. Le même savant que nous venons de citer, pense que cette triple divinité des Hindous doit son origine au soleil personnifié, qu’ils nomment encore aujourd’hui Tritcni [à trois corps], d’après la triple puissance qu’a cet astre de produire les corps par sa chaleur vivifiante, de les conserver par sa lumière, et de les détruire ou de les décomposer par la force concentrée de sa nature ignée. Cette hypothèse, et l’idée extraordinaire d’attacher à chacune des personnes de la Trinité indienne une faculté femelle revêtue d’une portion d’autorité analogue à celle de son époux, peuvent donner la clef de tout le polythéisme de l’Inde, de l’Egypte, de la Grèce et de l’Italie. J’observerai pourtant que la théologie indienne est maintenant assez bien connue par les ouvrages des Holwell, des Jones, des Wilkins, des Wilford, et autres savans de la Société de Calcutta, tandis que celle des Grecs et des Latins nous offre des lacunes désespérantes ; de manière qu’il est impossible de concevoir un système bien suivi de rapprochemens entre ces religions : voilà pourquoi M. Jones, malgré toute son érudition, s’est borné à indiquer des rapprochemens partiels entre tel ou tel personnage. Heureux si j’ai pu, avec les lumières nouvellement acquises, et par des recherches ultérieures, ajouter un nouveau degré de probabilité à ses conjectures !
(2) Il s’agit ici des soldats produits par les dents du serpent qui avoit dévoré les compagnons de Cadmus. On sait que ces soldats, sortis subitement armés du sein de la terre, se détruisirent mutuellement et aussi promptement qu’ils avoient été créés ; cinq d’entre eux seulement survécurent aux autres. Le docte Bochart, que M. Jones cite ici, me paraît avoir donné, dans sa Geographia sacra (liv. i.er, chap. 19, col. 447, édit, de Leyde), une explication bien plus savante que satisfaisante de cette fable. Le C.en Dupuis, dans son Origine de tous les cultes (tome II, p. 3 et 28), regarde Cadmus comme le serpentaire fameux dans les allégories phéniciennes et égyptiennes, et paroît ne lui accorder, comme à beaucoup d’autres héros de l’antiquité, qu’une existence astronomique.
(3) Le culte des astres et des étoiles. Le docteur Hyde fait dériver ce mot de l’hébreu צפא tsabâ [armées, troupes] : c’est pourquoi ceux qui adoroient l’armée du ciel ou les étoiles, se nommoient צפאי vox tsabai [Sabéens]. Le mot arabe صبا employé pour désigner que l’on professe le sabéisme, signifie littéralement apostasier. Voici comment un nommé Aboù-Yoùçouf, cité par Hottinger, parle des Sabéens, dans son Traité des dogmes des Kharânéens, connus de notre temps sous le nom de Sabéens, عن ملاهب اىحـــرانيين الـعــروفين فير عـصرنا بالصابة : « C’est un peuple qui tient le milieu entre les Chrétiens et les Mages : on dit que sa religion est fondée sur celle de Noé. Les uns prétendent qu’il adore les anges ; d’autres, les étoiles. Si ce mot est arabe, il doit dériver de ssabâ [il est sorti, il a dévié] ; car il a dévié des autres religions vers la sienne, ou de la vérité vers le mensonge. » فرم نين النصاري و المجــوس و فيل اصل دنبرم ديــن نوح عايه السلام و فيلهم عبافالالانكة و فيل عباق الكواڪن و هو ان كان عربيا فمن صبا اغا خرج و مال لانفــم مالوا عن ساير الاديان الت دينرم او من الحــق الت الباطل . Voyez des détails fort étendus sur le sabéisme dans l’Historia Orientalis de Hottinger, p. 25 5 et suiv. ; dans l’Historia dynastiarum d’Aboùl faradje, p. 9, 13, 96, du texte arabe, et p. 6, 8, 62, de la traduction latine ; et dans mes Notes sur le Voyage de Norden, t. III, p. 24/, 299, 318, 320 et 344, édit, in-4o.
(4) مهر Corruption persane moderne du zend Méthréhé, et du sanskrit Mitra [soleil, ami], mot que les Grecs ont représenté très-fidèlement par celui de Μιθρα. Ainsi le docteur Hyde a eu tort, dans son Hist. relig. veterum Persarum, pag. 105 (2.e edit.), de leur reprocher d’avoir altéré ce mot, comme ils ont fait, à la vérité, pour d’autres mots également étrangers à leur langue. Ce savant paroît ne s’être pas aperçu que, dans le pehlvy et dans le pârsy, qui sont bien moins anciens que le zend et le sanskrit, on substituoit une aspiration au th zend et au t sanskrit. Nous pourrions ajouter beaucoup d’autres exemples à celui qu’on vient de voir : tels sont tchethro en zend, tchatoura en sanskrit, et tchéhâr en pârsy et persan moderne ; ces mots signifient quatre ; pothré en zend, poutra en sanskrit, pour en pehlvy, pucer en persan moderne, c’est-à-dire, fils, &c. &c. Ces observations prouvent une grande affinité entre les deux plus anciennes langues connues de la Perse et de l’Inde ; c’est ce qui me paroît avoir été démontré par le P. Paulin de Saint Barthélemi, dans son excellent Traité de antiquitatc et affinitate Ungucc Zendicœ, Samscrdamicœ et Germanicce. Quant aux honneurs dont a joui le dieu Mithra parmi les Persans, je ne déciderai pas si ce n’étoit qu’un culte, et non une adoration divine : cette distinction du docteur Hyde me paroît trop subtile pour être discutée dans une note. Le P. Paulin (dans sa Grammatica Samscrdamica, p. 28-31) me semble avoir démontré l’identité du Soleil, de Sîva, le même queChiva, et de Mithra, par d’excellens raisonnemens, et par une inscription ancienne ainsi conçue, NAMA. SEBESIO. DEO. SOLI. INVICTO. MITHRÆ. ; laquelle signifie, je crois, Prùre à Bacchus, dieu, soleil, invincible, Mithra. Le C.cn Dupuis ajoute à ces noms celui du Christ, et croit apercevoir de nombreux rapprochemens entre ces deux personnages qu’il regarde comme symboliques, entre les dogmes, la croyance, les cérémonies du culte de Mithra et ceux du christianisme, ôcc. Voyez l’Origine de tous les cultes, tome Ier, page 24 ; tome II, pag. 20y, 260 ; tome III, pag. 40-87 et suiv, , édit. in-4 ! ; et les Ruines par le C.en Volney, pag. 186 et 2021 j.e édit.
(5) Les anciens avoient plusieurs Mdia, parmi lesquelles il s’en trouvoit une que les Latins adoroient comme l’emblème de la terre fertile et l’épouse de Vulcain : c’est pourquoi on la confondoit avec Cybèle ou Tellus, et on lui offroit une truie pleine, victime consacrée à la Terre. Voyez la nouvelle édition du Dictionnaire portatif de la fable, publiée dernièrement, avec des additions considérables, par le C.en Millin. — J’observe ci-après, tome II, pag. 42}, note b, et dans ma notice du Rituel des Tatârs-Mantchoux, que la mère de Bouddha et celle de Mercure se nommoient toutes deux Mdia. Voyez les Notices et Extraits des Mss. de la Bibliothèque nationale, t. VII, ire partie, page 243.
(6) Ce mot, qui a passé de l’ancien persan dans le moderne, a un grand nombre de significations, dont la principale est essence, principe, base, mature. Voici celles que lui assigne le fameux dictionnaire intitulé Ferhang Djihânguyry, فرهنك جهانكيري, dont je donne une notice ci-après, t. II, pag. 86-88, note b : « Mâyéh a trois significations : 1.° une quantité, comme le prouve ce vers de Râzy êd-dyn de Nichâboùr : Que de chagrins j’ai dévorés de la part de mon ami, jusqu’à ce que les larmes de sang que je versai rendirent mon cœur immobile ! 2.° la matière, substance de chaque objet ; 3.° il a le même sens que Mâyoùn, que nous allons indiquer.
Mâyoùn est le nom d’une vache qui allaita Fêrydoùn : on la nomme également Bermâyéh et Bermâyoùn. »
بآب ديلُ خون جكر كرفتر قرارء
Suivant le dictionnaire de Meninski, Bermâyéh et Bermâyoùn est le nom d’un taureau ou d’un bœuf qui appartenoit seulement à Fêrydoùn ; mais je crois que ce savant lexicographe a été dupe du laconisme du Ferhang Cho’oùry فرهنك شعوري, qu’il a pris pour guide, et dont l’autorité n’équivaut pas à celle de Ferhang Djihânguyry.
(7) Voyez, p. 425, ma note 53 sur le Traité de la littérature des Hindous.
(8) Cette dissertation fut composée en 1784, c’est-à-dire, un an après l’arrivée de M. Jones aux Indes. (Voyez, tome II, page 130, la description de l’île d’Hinzoùân.) Notre savant n’avoit alors qu’une légère teinture de la littérature sanskrite, et ne la connoissoit encore que par les versions persanes, qui sont proprement des paraphrases, dans lesquelles les auteurs, ardens Musulmans, sacrifient la fidélité au désir de répandre les principes de leur religion dans les ouvrages qui lui sont le plus étrangers. Dans la suite, M. Jones fit de grands progrès dans la langue sanskrite, comme on en peut juger par ses traductions.
(9) Pantheum mythicum, seu fabulosa Deorum historia, hoc primo epitomes eruditionis volumine breviter dilucideque comprehensa, auctore P. Francisco Pomey, Societatis Jesu, 1 vol. in-12. Cet ouvrage, imprimé à Lyon pour la première fois en 1558, a eu plusieurs éditions, et mérite cet honneur : l’auteur a puisé directement dans les sources.
(10) Historiœ Deorum Gentilium syntagmata XII, apud Lilii Gregorii Gyraldi Ferrariensis Opera omnia ; Lugduni Batav. 1676, in-folio.
(11) Je ne rapporterai ici aucune des étymologies du nom de Janus présentées par Vossius dans son Etymologicon linguœ Latinœ, et par Mathias Martini dans son Lexicon philologicum, parce qu’elles ne me semblent nullement satisfaisantes. Celle que mon estimable collègue le C.en Millin propose dans son Dictionnaire de la fable, d’après M. Visconti, me plaît d’autant plus, qu’elle me paroît coïncider avec l’opinion de notre auteur. Suivant ces deux savans, le Janus des Romains est une dérivation du Phanes des Grecs (dont parle aussi Boulanger, liv. V, chap. ier, de son Antiquité dévoilée). Parmi les premières divinités, Phanes étoit celle qui exprimoit le monde sorti du chaos, c’est-à-dire, le commencement du monde, et conséquemment de toutes choses ; idée très-conforme à celle que les Hindous ont de leur Ganeśa. Ajoutons que les noms de Phanes et Ganeśa ont plus de conformité qu’on ne l’imagineroit. On sait que le g se change souvent en w : c’est ainsi que du Wales anglois nous avons fait Galles ; le v n’est qu’un f ou ph adouci. Quant à l’a final, c’est une terminaison commune à beaucoup de mots sanskrits. La ressemblance entre Janus et Ganeśa est trop sensible pour exiger un commentaire, et se trouve indiquée dans les Ruines, p. 288, 3e édit.
(12) Ces vers sont, non de Sulpitîus, mais de Quintus Septimius, cité dans le Terentianus. Voyez aussi Ovidii Fastorum lib. i, vers. et not. 65, ex edit. Burmannïi. M. Jones avoît sans doute cette édition d’Ovide, ou quelque autre avec des notes, ou le Terentianus même ; car ces vers ne se trouvent pas à l’article de Janus dans l’ouvrage du P. Pomey, le seul traité mythologique dont il dit avoir fait usage. Lilio Gyraldi ne les a pas non plus cités dans ses Syntagmata.
(13) Boulanger a observé que nous avions une fête de Saint Jean à chaque solstice, c’est-à-dire, aux deux époques de l’année où l’on peut raisonnablement en fixer le commencement. La fête de Sainte Geneviève, [Genoveſa], personnage peu connu, mais dont le nom a une étonnante affinité avec celui de Janus et de Januœ, tombe le 3 du mois de janvier [januarius]. Voyez l’Antiquité dévoilée, tome III, liv, iv, chap. 4. Au reste, je donne ces rapprochemens pour ce qu’ils valent, et sans y attacher plus d’importance qu’ils n’en méritent.
(14) Gaña, cœtum, numerum, computum, seu unius rei aggregatum} significat…, Isa vel Isha dominum. Voyez Sidharubam, seu Grammatica Samscrdamica, &c. auctore Paulino a Sancto-Bartholomœo, p. 36 ; et Amarasinha, sectio prima, &c. p. 3 8, note 1. Le même savant observe, dans son Systema Brahmanicum, p. 170, que les Indiens du nord, tels que les Mahrattes, les Bengalis, les Bénârésiens, les Népâliens, nomment ce dieu Ganecha ; les Malabars l’appellent Gœnavadi ou Gœnadbiba ; et les Tamouls, Vinâyaga. Les deux premiers mots signifient maître de l’assemblée, des nombres ; le dernier, grand-maître. Son nom vulgaire est Polleyar : on lui donne encore Pépithète de Vighnarâdja t souverain des obstacles, parce qu’il les surmonte, et qu’il est comme la porte qui conduit à toutes les affaires. Le P. Paulin possède deux figures de ce dieu, où il est représenté tenant à la main deux clefs malabares, destinées à ouvrir les portes ; circonstance qui, selon moi, coïncide parfaitement avec la clef que les anciens, suivant Suidas (au mot Ἰανᴕάριος (Ianouarios), p. 1214, édit. de 1619), plaçoient dans la main droite de Janus, le regardant comme le principe du temps et le portier de l’année. C’est le dieu des sciences, du conseil, du destin, du mariage, des nombres ou du calcul, et des comptes, le chef de toute association honnête. Il s’oppose aux maléfices, aux malheurs, à l’infortune ; il écarte les maux, procure le bonheur, et chasse les mauvais génies. Le rat ou le loir sur lequel ce dieu est assis, est un titan ou démon, ou le mauvais génie Kaymoughâsoura changé en un loir nommé Pirousali, qui voulut mordre le pied de Ganes, et que ce dieu rempli de sagesse a dominé et subjugué. Sa tête d’éléphant indique la sagesse, la prudence, la vigueur et le courage nécessaires pour écarter ou surmonter les malheurs. D’après ces heureux attributs, il n’est pas étonnant que tous les savans Indiens et tous leurs copistes placent une invocation à ce dieu au commencement de leurs écrits. Chez les Malabars, cette invocation est ainsi conçue : Sri fou Chri) Gœnavadayé namâ [Adoration du bienheureux dieu Gænavadi], ou simplement Gœnavadayé namâ [Adoration de Gænavadi ou de Ganesa]. Ce dieu se nomme encore Gourou [Maître, Directeur], parce qu’il prépare la voie des affaires, et’instruit les ignorans ; de là ce protocole usité non-seulement parmi les Indiens, mais aussi chez les Tibétains, Namo Gourou [Adoration du Maître], corruption tibétaine des mots sanskrits Namâ Gourou, ou Sa/ Gourouve namâ [Adoration du vrai Maître]. Cette corruption paroît au P. Paulin de Saint-Barthélemi être une nouvelle preuve que les Tibétains ont reçu leur religion des Indiens, loin que ceux-ci soient redevables de la leur aux Tibétains, comme l’ont rêvé, dit-il, de Paw et Bailly. Au reste, ce savant, qui nous fournit les principaux matériaux de cette note, partage si fortement l’opinion de M. Jones touchant l’identité de Ganeia et de Janus, qu’il lui reproche de l’avoir énoncée avec trop d’obscurité et de timidité. Janus, dit-il, étoit la plus ancienne divinité des Romains ; il est aussi adoré chez les Indiens, et il aura probablement passé de la mythologie des Brahmanes dans celle des Grecs, et de là dans celle des Latins : car Macrobe nous apprend que Janus et Saturne sont deux divinités étrangères ; Juvénal appelle Janus le plus ancien des dieux [antiquissime divùm], Le nombre 365, qu’on lui plaçoit entre les mains, justifie pleinement l’influence que les Indiens lui attribuent sur les nombres et les calculs, À l’épithète de Gœnadhiba [maître des nombres, des comptes, des réunions], on peut encore ajouter celle de Dvaymâdoura [ayant deux mères]. L’une de ces deux mères est Pârvatî, ou la Lune ; et l’autre, Anga, épouse du roi Daçaprayâvadi, dont les amours avec Pârvatî forment une fable astronomique, et purement relative aux effets de la lune. Cette dernière épithète, suivant notre auteur, semble expliquer les deux visages que l’on donnoit au Janus romain. L’auteur de l’Origine de tous les cultes (tome III, page 47, et II.e partie, page 59) regarde Janus muni de sa clef et chef des douze mois de l’année, comme le prototype de Saint Pierre.
(15) Le même dictionnaire sanskrit que le P. Paulin de Saint-Barthélemî appelle Amarasinha, et dont il a publié la i.re partie in-4.° à Rome en 1798. Voyez, pag. 430-432, ma note 61 sur le Traité de la littérature des Hindous.
(16) Voyez, sur ces épreuves judiciaires, très-communes dans l’Inde, le Mémoire ci-après, n.° XXII.
(17) Voyage aux Indes et à la Chine, tom. I.", liv.ll, page 1S1, édit, in-jd Ce voyageur ne désigne ce dieu que sous le nom de Poléar, que j’indique en effet dans ma note 14, p. 221.
(18) Rhotâs, forteresse située à environ cent milles sud-ouest de Dynârpoùr, et à environ trois cent quarante milles nord-ouest de Calcutta, sur les bords de la Sône. Voici la description qu’en donne Àboùl-fâzel dans l’Ayïn Akbery, page 169 verso de mon manuscrit, et tome II, page 32, de la traduction de M. Gladwin, édition de Calcutta. « Rhotâs est un fort sur le sommet dune « montagne élevée jusqu’au ciel et escarpée ; il a quatorze kôss de circonférence : l’intérieur de cet espace est cultivé et habité. Il s’y trouve beaucoup de sources ; et, en creusant à la profondeur de trois ou quatre guèz [coudées], dans quelque endroit que ce soit, on découvre de l’eau. Il y a aussi des étangs. Dans les temps de pluie, il se forme plus de deux cents cascades : l’air (est si vif, qu’il) brûle les yeux et les oreilles. » رهتاس دثي است نر فرازكوه اسمـــان ساي دشوار كذارد در آن چهـــــارده كروه بر آن كشت و كار شود و قراوان چشمر بر چوشد و هر ظ سه چركز بر كنند آب پديد آيد و نس كولاها هنكم بارش افزون چشم و كوش را نر افروزد هواء.
Férichtah, dans son Histoire de l’Inde, traduite par M. Dow, a copié la description qu’on vient de lire, en y ajoutant des détails qui méritent d’autant plus de trouver place ici, que le fort de Rhotâs est peu connu, et se voit sur la carte du major Rennell, vers le 24d 45′ de latitude. Nous allons donc réunir ces détails à quelques autres tirés d’ouvrages cités à la fin de cette note. « Ce a> fort est situé, dit-il, sur une montagne escarpée et d’un très-difficile accès : il 33 n’a qu’une entrée, à laquelle conduit une montée très-rude, longue de deux 3> milles. Les portes, au nombre de trois, l’une au-dessus de l’autre, sont 33 défendues par des canons et des pierres mobiles… D’un côté, au bas, coule la Sône, dans un lit qui forme un immense précipice. Le côté opposé est défendu par une autre rivière, dont le lit forme un précipice semblable au premier ; cette rivière se jette dans la Sône, un peu plus bas. Enfin un troisième côté se trouve défendu par une vallée profonde, remplie de bois impénétrables, qui s’étendent sur les montagnes voisines. Ce rocher a quatorze kôss de circonférence à sa base. Le terrain enclos a dix milles de circonférence, est cultivé, et renferme des villes, des villages et des champs de blé. Dans cet espace jaillissent plusieurs sources, et partout on peut se procurer de l’eau, en creusant à la profondeur de trois ou quatre verges. Il y a plusieurs étangs dans l’intérieur du fort.
En 1542, le râdjah ou prince hindou propriétaire naturel de cette forteresse en étoit encore en jouissance ; mais le célèbre usurpateur du Béhâr, Tchéït Khân, s’en empara par un acte de perfidie extrêmement adroit. Comme il étoit intimement lié avec le râdjah, il le pria de recevoir dans cette forteresse ses femmes et ses trésors en dépôt, sous prétexte d’aller faire une expédition dans le Bengale. Le râdjah, non moins perfide que son ami, accepta cette proposition avec joie, dans l’espérance de s’emparer du dépôt. II reçut donc un nombreux convoi de palanquins couverts, qui contenoient des hommes armés, au lieu des femmes que le râdjah croyoit y être cachées : il permit en outre l’entrée de son château à une multitude de soldats déguisés en porteurs de palanquins ou de caisses supposées renfermer des trésors. Le massacre de la garnisonet l’occupation du fort furent le résultat de cette opération. Le râdjah, suivi d’un très-petit nombre de ses gens, eut beaucoup de peine à échapper. 33 Voyez Dow’s History of Hindoostan, tom. II, pag. 173, 2e édit. ; et Pennant’s View of Hindoostan, t. II, p. 222.
M. Daniell a donné, dans son Oriental Scenery, trois vues magnifiques de Rhotâs. La première représente le Râdje-ghât [passage royal], qui est la principale route qui conduit à Rhotas-ghor [fort de Rhotâs], dans le Béhâr. C’est, dit-il, la forteresse de montagne la plus considérable qui existe dans cette partie de l’Inde ; elle doit prodigieusement à la nature, et l’art a corroboré les parties foibles. Ce fort renferme des ruines de temples hindous, de mosquées musulmanes, d’un palais, et d’autres édifices publics, qui offrent des modèles d’une excellente architecture. La montagne sur le sommet de laquelle il se trouve, passe pour avoir plus de huit cents pieds de haut, et plus de vingt milles de circuit ; la Sône en baigne le pied du côté du sud-est.
L’ancien temple hindou situé dans l’intérieur du fort de Rhotâs forme le n.° XI de la précieuse collection que nous venons de citer. Ce temple, construit construit en granit gris, d’une manière toute particulière, porte le caractère d’une haute antiquité. Les Hindous, qui choisissoient avec une prédilection particulière les lieux élevés pour y bâtir leurs temples, n’ont pu résister au désir de construire dans cet endroit, dont la situation délicieuse leur offroit de l’eau, du bois, et toutes les autres commodités en abondance. Enfin la troisième vue donnée par M. Daniel ! a été prise presque au sommet de la montagne, dans l’intérieur des fortifications. On y distingue le temple hindou dont nous venons de parler, et une suite de degrés qui conduisoient jusqu’au sommet de la montagne. Les Musulmans ont détruit le temple, pour élever sur ses ruines une mosquée, qui est détruite. Cette magnifique forteresse ne contient maintenant aucun habitant.
Deux ghât ou passages conduisent au fort : on les a rendus assez praticables, en y taillant des marches. L’un se nomme Râd)e-ghât, c’est le supérieur ; l’autre, Akbarpoùr-ghât ; il tire son nom du village d’Akbarpoùr, situé presque au pied de la montagne.
(19) Mon savant ami, M. Alexandre Hamilton, ne partage pas l’opinion de M. Jones, touchant l’identité de Menou et de Saturne. Il reconnoît bien celle de Menou et de Noé, qui sont clairement, à son avis, le même personnage ; mais il n’adopte pas la tradition conservée par Ovide, et suivant laquelle Saturne arriva en Italie dans un vaisseau, circonstance à laquelle on attribue le vaisseau qui servit de type aux premières monnoies de Rome. Ce vaisseau, suivant M. Hamilton, n’a rien de relatif à l’arche de Noé. ce Pour trouver, dit ce savant, quelque ressemblance entre Saturne et Menou, il faut d’abord convenir du terme moyen, qui est Noé ; et c’est, à mon avis, une forte objection contre l’hypothèse : car jamais on n’auroit imaginé que Saturne fût le même que Menou, si l’on n’eût pas établi d’abord l’identité de ces deux personnages avec Noé. Mais le Cronos des Grecs, modelé sur celui de Sanchoniaton, n’a rien de relatif à un déluge. Il seroit possible néanmoins que le Saturne des Latins fût le Menou des Hindous, sans être le même que le Cronos des Grecs, comme on a vu Janus correspondre à Ganeia, sans avoir de représentant en Grèce. Mais quel auteur nous apprend que Saturne ait survécu à un déluge ! À la vérité, M. Jones indique une espèce d’identité de surnoms, celui de Chronos [le Temps] pour Saturne, et celui de Cala [le Temps] pour Menou : mais tous les mythologues conviennent que Saturne n’étoit pas originairement adoré comme dieu du temps ; en outre il ne seroit pas impossible que M. Jones se fût trompé en attribuant à Menou le surnom de Câla, que l’on donnoit communément à Sîva. Au reste, la religion des anciens Grecs et Romains nous est trop peu connue, pour établir un parallèle parfait entre elle et la religion des Hindous. » — D’après les grands traits de son histoire, comme père des dieux, fils du Ciel, et autrefois gouverneur de la terre et du monde entier, mais aujourd’hui dépourvu d’adorateurs, Saturne a, selon Al. Hamilton, beaucoup de traits de ressemblance avec Brâhmah, qui forma le monde sans le gouverner, créa les dieux et les hommes, est fils de Brchm [l’Être suprême], et ne reçoit aucune adoration. L’étymologie de Saturnus, qu’on fait dériver de satu, en supprimant deux consonnes essentielles, puisqu’elles ne sont pas finales, est véritablement forcée ; tandis qu’il est bien plus naturel de tirer ce mot de Tchatouranama [quadriformis], épithète particulière à Brâhmah, qu’on représente avec quatre têtes. — Ajoutons enfin que Menou n’a jamais été regardé comme un dieu par les Hindous, tandis que Saturne est le plus remarquable personnage de l’Olympe.
(20) Ce passage m’a paru d’autant plus important, qu’il ne s’accorde pas entièrement avec l’opinion adoptée par tous les mythographes, laquelle donne à Saturne le Ciel pour père et la Terre pour mère. Ainsi, quoique M. Jones n’ait rapporté aucune indication sur celui des ouvrages de Platon qui lui avoit fourni cette curieuse citation, j’ai cru devoir en faire la recherche dans les nombreux écrits du philosophe grec, et j’ai été assez heureux pour la trouver dans le Timée, tome III, page 40, des Opera Platonis, ex editione Serrani, et tome IX, page 324, ex editione Bipontinâ. La voici : Γῆς τε καὶ Οὐρανοῦ παῖδες Ὀκεανος τε καὶ Τηθὺς ἐγενέσθηυ· ἐκ ἀύτων δέ, φόρκυς τε καὶ Κρόνος καὶ Ῥέα, καὶ ὅσοι, μετὰ τούτων· ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ῥέας, Ζεὺς Ἥρα τε, καὶ πάντες ὅσους ἴσμεν ἀδελφους λεγομένους αὐτῶν. « L’Océan et Téthys passent pour être enfans de la Terre et du Ciel. D’eux naquirent Phorcys, Saturne et Rhéa, et leurs autres frères ; de Saturne et Rhéa, Jupiter, Junon, et d’autres que nous entendons chaque jour appeler leurs frères. » Platon, comme on voit, place une génération, l’Océan et Téthys, entre la Terre, le Ciel, et Saturne, qui, suivant ce philosophe, n’étoit que leur petit-fils. Parmi les écrivains modernes, je ne connois que Bochart qui ait observé (dans sa Geographia sacra, page 4, édition in-fol. de Leyde 1712) cette légère différence d’opinion touchant l’origine de Saturne.
(21) L’étymologie attribuée ici à Festus ne se trouve pas dans l’ouvrage de ce grammairien, comme je m’en suis convaincu, mais dans le iv.e livre de Varron, de Linguà Latinâ, pag. 18 du texte, et 30 des notes, de l’édition publiée par Scaliger en 1585. L’explication que ce grammairien et son docte commentateur donnent de cette étymologie, n’est pas tout-à-fait conforme à celle que propose M. Jones, et n’offre aucune relation avec l’agriculture. Le Ciel, dit-il, étant le principe (des choses), Saturne a été nommé ainsi de satu ; et comme le feu est reconnu pour le principe de la génération, on envoyoit à ses supérieurs, pendant les Saturnales, des feux, c’est-à-dire, des bougies allumées. » J’ai fait imprimer en lettres italiques les mots ajoutés par le commentateur. Quelques-uns font dériver le mot Saturne de σάθης (sathês), le membre viril (παρὰ τὴν σάθης (para tên sathên)), parce que c’étoit chez les anciens le symbole de la génération ; d’autres, tels que Cicéron, et après lui Lactance, de satura ri [être assouvi], parce qu’il est rempli d’années. Cette étymologie coïncide assez bien avec le nom de Κρόνος (Kronos), que les Grecs lui donnoient, et qui paroît être une légère altération de Χρόνος (Chronos) [le Temps], parce que, suivant Macrobe (Saturnal. lib. 1, cap. 8), ce dieu est l’auteur des temps, ou, suivant Cicéron (de naturâ Deorum), parce qu’il est le même que le Temps. Tous ces différens noms me paroissent relatifs à la durée du temps, à l’ancienneté du monde ; et il ne falloir pas moins que l’esprit systématique et l’imagination active de Bochart, pour retrouver dans Saturne le même personnage que Noé.
Hospitis adventum testijicata Dei,
(23) Page 144 du Panthéon mythicum. Le P. Pomey, qui a copié ici Bochart, auroit pu ajouter au témoignage d’Alexandre Polyhistor, rapporté par S. Cyrille dans sa diatribe contre Julien, liv. I.er, celui d’Abydène, qui assure que Saturne prédit qu’il tomberont une grande pluie. Κρόνος ϖροσημαίνοι μὲν ἔσεθαι ϖλῆθος ὄμϐρων (Kronos prosêmainoi men esethai plêthos ombrôn). Abydenus, apud Bocharti Geographiam sacram, pag. 4, ex editione Lugduno-Batavâ 1712.
(24) J’ai lu avec la plus grande attention la savante et verbeuse dissertation dans laquelle Bochart tâche d’établir cette opinion ; j’ai lu également l’analyse très-bien faite de cette dissertation, par le P. Pomey ; et je ne puis partager la conviction de M. Jones. Je ne puis non plus me déterminer à reconnoître Cham dans Jupiter, Japhet dans Neptune, et Pluton dans Sem. — Saturne me paroît être simplement le Temps personnifié, comme le prouvent la faux, le serpent qu’il tient à la main, la barque dans laquelle on le place et qui se retrouve dans les anciens monumens égyptiens, son avidité à manger ses enfans, qu’il rend ensuite en détail, &c. Saturne étoit le plus ancien dieu des Arabes, qui l’adoroient sous le nom d’Elah اله ; et l’auteur du Dabistân, دابستان ouvrage dont le premier chapitre a été publié dans le New Asiatick Miscellany, pag. 88-138, et cité dans ma note b, pag. 22-25 du tome II de ces Mémoires, nous apprend que la pierre placée à un des angles de la Ka’bah de la Mekke, est un fragment d’une statue de ce dieu. Il paroît être le Brehm plutôt que le Menou des Indiens, comme on a pu le voir dans la note 19 ci-dessus, page 225.
(25) Voyez, sur ce personnage, le Traité de la chronologie des Hindous, dans le volume suivant, p. 172.
(26) Ouvrage indien canonique, publié en français sous le titre de Bagavadam [ou Doctrine divine], par le C.en d’Obsonville. Voyez ci-après, dans mes notes sur la littérature des Hindous, et page 171 du tome II, les deux notices que j’ai données de cet ouvrage, qui est aussi un Pourâna. L’épisode cité par M. Jones se trouve p. 212 et suiv. de l’édition française.
(27) Les dix-huit Pourânas sont des poèmes sacrés en l’honneur des dieux. Voyez, ci-après, le Mémoire sur la littérature des Hindous.
(28) Ce Pourâna étant le premier des dix-huit poèmes qui portent ce titre, et le plus important, je ne puis résister au désir de communiquer au lecteur la traduction de la Table des chapitres, faite par mon ami M. Alexandre Hamilton, membre de la Société asiatique de Calcutta, dont j’ai déjà eu occasion de citer plusieurs fois le nom avec les éloges dus à sa vaste érudition orientale et à son extrême complaisance. Il a fait cette traduction immédiatement d’après le texte sanskrit, qui se trouve sous le n.° 18 nouveau et ancien des manuscrits indiens de la Bibliothèque nationale.
Souta parle. « i.er vers. Maintenant je vous ai communiqué ce qui a été dit par celui dont l’univers est une des formes : le Pourâna intitulé le Poisson, qui mène à la vertu, à la félicité et au bonheur éternel.
2. Il commence par la conversation entre Menou et Vichnou pisciforme, suivie de l’histoire de l’œuf du monde, et de la création par Brâhmah.
3. Les dieux et les démons sont appelés à l’existence : alors se trouve la naissance des vents, suivie du récit des cérémonies qu’on pratique à la fête du dieu de l’amour, et à celle de l’installation des dieux tutélaires dans leurs fonctions.
4. Un Menou est nommé pour gouverner le monde pendant l’intervalle de temps qui s’appelle Menouantara, La naissance du Menou fils du Soleil ; les amours de la planète Mercure.
5. L’histoire de la race du Soleil, le récit des cérémonies funéraires, le lieu consacré aux dieux mânes, la naissance de la Lune.
6. L’histoire de la race de la Lune, les aventures du roi Yayâti, les vertus de Cartavirya, l’histoire de la race de Vristi.
7. Les imprécations de Bhrigou et de Vichnou contre les démons ; l’histoire des descendans de Pourou, et de la race du feu.
8. L’énumération des Pourânas, le récit des rites des sacrifices, les cérémonies appelées la constellation des hommes, et le sommeil de Martounda.
9. La fête célébrée, le huitième de la lune, en l’honneur de Crichna ; la conjonction de la lune et de l’étoile Rohini ; les rites de Sarâga ; la fête des arbres.
10. Le développement des plaisirs, la naissance d’Àgastya, les fêtes de la déesse Ouma.
11. Les fêtes de cette déesse et de Sîva ; celle de la déesse de la science ; les cérémonies pratiquées pendant les éclipses, et pour empêcher les avortemens.
12. Les rites révélés par Césava k Bhîma, les cérémonies enjointes aux courtisanes, la fête de Gôvinda, et les rites des Sôudras adressés à Angâra.
13. Les cérémonies pratiquées le septième jour de quelques mois, et celle appelée Visoca ; la donation d’une quantité de blé, ayant la forme de la montagne Merou, et les rites dits Sânti, ainsi que la donation d’un taureau d’or le jour consacré à Sîva.
14. Les fêtes de Sîva renouvelées tous les mois, la fête de Brâhmah, les autres fêtes des mois, celles de Vichnou dans ses âvatâras.
15. La cérémonie du sixième jour de la lune, et celles qui sont pratiquées durant l’ablution dans le Gange ; la sainteté de Prayâga, suivie d’une description du monde.
16. La résidence du fils de Ilâ ; une description des Douipa (îles habitées) et des mondes ; les règles des orbes célestes, et la prééminence de l’étoile polaire.
17. Des demeures des dieux, ou les constellations de la destruction de Tripoura : de l’institution des cérémonies pour les mânes ; de la succession des Menouantaras.
18. De la naissance de Vadjrânga, et de celle de Taraca ; de la victoire de ce démon sur les Dêvas, et leur fuite auprès de Brâhmah. 19. De la naissance de Pârvatî, et des mœurs de Sîva ; de la combustion du dieu de l’amour (Càmâ), et les lamentations de la nymphe Retî (son épouse).
20. La retraite de la déesse Pârvatî dans les forêts, ses prières pour la résurrection de Câmâ, sa conversation avec le Cichy, et les noces de Sîva et de Pârvatî.
21. De la naissance de Koumâra, et de sa victoire ; de la mort de Taraca ; de l’âvatàra de Narsingha (en homme-lion).
22. De la création nommée celle du lotus ; de la mort du démon Andhaca ; de la sainteté de Yârânèsi [Bénârès], et de celle de la rivière Narmadâ.
23. Des races des hommes saints, et des sacrifices offerts aux mânes ; de la donation à un Brahmane , d’une vache pleine et d’un taureau noir.
24. Les aventures de Sâvriti ; des devoirs d’un souverain ; de la saison pour commencer la guerre ; des interprétations des songes. 25. De l’âvatâra sous la forme d’un nain, et de celui sous la forme d’un sanglier ; des dieux qui boivent l’ambroisie ; de l’apparition de Calahrit engloutie par Sîva.
26. De la guerre des dieux avec les démons ; de l’art de l’architecture, de la sculpture, et des formes célestes, et des cérémonies de leur installation.
27. De la salle dédiée à la réception des statues des dieux ; de l’autel des sacrifices ; des rois qui existeront dans les siècles futurs ; de l’avantage des donations prescrites.
28. Une récapitulation des trente calpas qui composent un mois de Brâhmah, une table des matières. Voilà ce qui forme le Matsya Pour an a t pur, saint, et qui donne au lecteur la renommée et l’immortalité. (Note communiquée par M. Alexandre Hamilton, membre de la Société de Calcutta.)
(29) Les quatre livres sacrés sortis de la bouche même de Bràhmah. M. Wilkins, dans ses notes sur le Bhaguat-Geeta &c, p. 143, édit. in-4.°, et d’autres savans Indiens, pensent que ces livres n’étoient originairement qu’au nombre de trois. Le mot vêda, qu’on prononce vèd, signifie science. Voyez encore mes notes sur la littérature des Hindous, et p. 164 du second volume. Héri est un des noms de Vichnou, la seconde personne de la Trinité indienne, emblème du pouvoir conservateur. Voye la note 32.
(30) Qu’on prononce calpa, mot sanskrit qui signifie formation ; c’est un jour de Brâhmah, qui équivaut à mille révolutions de yougs. Les Hindous croient qu’à la fin de chaque calpa [création ou formation ], toutes choses sont absorbées dans la Divinité, et que, durant l’intervalle d’une création à une autre, l’Être suprême se repose sur le serpent Sécha [durée], nommé aussi Ananta [sans fin]. Voyez les notes de l’Heetopades of Veeshnoo-Sarma, translated from an ancient manuscript in the sanscreet language, &c. by Wilkins, p. 296, et les notes du même savant sur sa traduction du Bhaguat-Geeta, p. 143. Voyez aussi, dans le tome II, les Mémoires sur l’astronomie et sur la chronologie indiennes.
(31) La première personne de la Trinité indienne, qu’il ne faut pas confondre avec Brehma, nommé Parâbahrahvechtou sur la cote de Coromandel, et qui est la grande cause première, l’auteur de toutes choses. Voyez, dans les Spécimens of Hindoo literature de M. Kindersley, les Introductory Remarks on the mythology, literature, &c. of the Hindoos, p. 2.
(32) Héri, un des titres de Vichnou, le pouvoir conservateur de la Divinité. Presque en face de Suithân-Gondje, ville considérable du Béhàr, se trouve un rocher de granit formant une petite île au milieu du Gange, laquelle est connue des Européens sous le nom de rocher de Djihanguyry ; il mérite de fixer l’attention des voyageurs, à cause de la grande quantité de figures qui y sont sculptées en relief. On remarque surtout Héri, d’une stature gigantesque, assis sur un serpent roulé, dont les nombreuses têtes s’élèvent en s’inclinant de manière à former un dais au-dessus de la tête du dieu endormi ; de chacune des bouches du serpent sort une langue fourchue, qui semble menacer d’une mort inévitable quiconque auroit l’audace de vouloir troubler le repos de Héri ; toute la figure est presque détachée du rocher sur lequel on l’a taillée ; elle est bien conçue, et d’une belle exécution. Voyez Wilkins, Notes on the Heetopades of Veeshnoo-Sarma, &c. p. 295 et 296, et ci-dessus, note 30.
(33) M. Thomas Maurice a rapproché avec le plus grand soin toutes les circonstances de ce récit et celles de la Genèse relatives au déluge, pour démontrer l’identité de ces deux événemens, et pour prouver surtout la réalité d’un déluge universel ; il a même eu soin de calculer l’étendue que pouvoit occuper dans l’arche une couple d’animaux de chaque espèce : le résultat de son travail forme un tableau dont lui seul peut garantir l’exactitude. Enfin ce laborieux auteur n’a omis aucune des circonstances capables de corroborer son hypothèse. Nous laissons à d’autres savans le soin d’apprécier ses preuves ; nous nous bornons donc h les prier de consulter l’History of Hindostan, its arts and its sciences, as connected with the history of the other great empires of Asia, during the most ancient periods of the world, tom. I, pag. 557-561.
(34) Voyez l’histoire de cet avatar, ou incarnation de Vichnou en Crichna, p. 276 et suiv. du Bagavadam [ou Doctrine divine], ouvrage indien canonique sur l’Etre suprême, les dieux, les geans, les hommes, les diverses parties de l’univers, publié par le C.cn d’Obsonville ; et dans YHistory of Hindostan, its arts, sciences, &c. de M. Maurice, t. II, p. 255 et suiv.
(35) Voyez, sur ce personnage, le Traité de la chronologie indienne, p, 185 et suiv. du tome II.
(36) On écrit aussi Madourah. Cette ville, célèbre par ses antiquités, dont M. Daniell nous a donné six vues magnifiques, est située sur la rivière de Vaygarou, environ à soixante milles des côtes orientales de l’Océan indien, vers le 9d 52′ 30″ de latitude. Elle étoit autrefois capitale d’un royaume qui s’étendoit dans l’intérieur des terres vers le nord-est, et formoit la portion méridionale du regnum Pandionis de Ptoléinée, ou Pandi AJandalam des Indiens modernes. Voye^ PennantV View of Hindoostan, tom. II, pag. 7, 9 et 10, et Paulini à Sancto-BartholomæoIndia Orientalis Christianaf pag. xix, 156 et suiv.
(37) Indrâ est le dieu des vents et de l’air, comme l’indiquent ses surnoms de Sorgarâdja [roi du firmament] ; Maroulvàn [aérien], mot dérivé de maroùl [l’air, [l’air, le vent] ; Afêghavan [habitant des nuées] ; Djichnou [vainqueur] ; Pourouhrda [courageux, brave] ; Sahasrâkcha [ayant mille yeux] ; Divaspadi [maître des demi-dieux] ; Indra [qui affecte les sens], parce que c’est la qualité de l’air ; Dyoupeti ou Dyoupetir [dieu du ciel], d’où est probablement dérivé le mot étrusque Ditspiter, ancien nom de Jupiter : en effet, c’est, suivant le P. Paulin de Saint-Barthélemi et M. Jones, le Jupiter conducteur des Grecs et des Latins. Voilà, dit le P. Paulin, un second dieu philosophique, qui prouve que presque toutes les divinités indiennes sont relatives à l’astronomie et à la physique. Parmi les attributs d’Indrâ, nous citerons le vadjiram ou koullcham, c’est-à-dire, la foudre f parce que l’air contribue à former la foudre et lui sert de conducteur ; le vimânam [char], qu’on nomme aussi vyomayanam [voiture du firmament]. L’épouse d’Indrâ se nomme Indràni ; son cocher, Sârathi, &c. Il a en outre plusieurs ministres, et des nymphes pour le servir ; il préside les demi-dieux et les bons génies subalternes, qui dirigent les cieux inférieurs, les portent et les animent. Il examine leurs droits, décide leurs différens, frappe de son foudre les niéchans, chasse du ciel les dieux qui pèchent, les exile dans des corps humains ou dans ceux de différens animaux. Il donne aux dieux bons Yamrda [breuvage de l’immortalité], dirige l’air et les nuages, régit tôut ce qui tient à ce monde sublunaire, répand sur la terre 1 ç gandje céleste, c’est-à-dire, la rosée qui la rafraîchit et la fertilise, la préserve du feu brûlant qui la dessèche. Il a le caractère bouillant et lascif du Jupiter des Grecs. Tout le monde connoît, dans l’Inde, l’histoire de sa métamorphose en coq, à la faveur de laquelle il viola Ahalya, femme d’un mouni nommé Gaudama (c’est une planète), tandis que son mari s’acquittoit de ses prières du matin et se lavoit dans le Gange avant l’aurore. Gaudaina, instruit de cet attentat, maudit Indrâ, dont tout le corps se trouva couvert de mille membres virils ; mais, d’après ses prières instantes et répétées, ces membres furent transformés en mille yeux, qu’il porte encore maintenant. Le P. Paulin de Saint-Barthélemi reproche aux académiciens de Calcutta (c’est-à-dire, à M. Jones, puisqu’il cite la page même de sa dissertation) d’avoir répandu beaucoup d’obscurité sur l’histoire d’Indrâ, en voulant décrire les divinités indiennes plutôt d’après la mythologie grecque que d’après celle des Brahmanes, qu’il n’entendoit pas suffisamment. Il leur reproche aussi d’être peu versés dans la langue sanskrite. Nous ne nous permettrons pas même de discuter jusqu’à quel point ces reproches sont fondés ; mais il nous semble que les immenses travaux de M. Jones, et les excellentes traductions du sanskrit publiées par lui et par M. Wilkins, sont des réfutations satisfaisantes. La gravure représente le dieu Indrâ tenant à la main une branche de lotus, parce que l’éther [l’air] ne contribue pas foiblement à la production des choses.
Nous avons parlé précédemment des cieux inférieurs, parce que les Hindous établissent deux cieux. À la tête du premier est placé le Soleil, le plus grand dieu des Hindous, et le roi du ciel, avec ses conseillers et ses contemplateurs, qui sont les planètes, et sa femme, la Lune. Les planètes sont les mounis [huissiers], qui obéissent au Soleil ; elles ont des disciples qui leur sont soumis, qu’elles éclairent et dirigent. Les anciens Hindous professoient donc le sabéisme, ou adoration des astres, aussi-bien que les Égyptiens, chez qui les Grecs l’ont puisé, pour le dénaturer à leur manière.
Le ciel inférieur, nommé Sorga, est le domaine d’Indrâ, qui gouverne les petits dieux, nommés Dêva (au pluriel, Dêvagael) : le nombre de ceux-ci ne s’élève pas à moins de trois cent trente-deux millions. Ils ne sont ni impeccables ni immortels ; car Indrâ peut les chasser du ciel, et les reléguer sur la terre, pour habiter des corps d’hommes et d’animaux, suivant l’exigence des cas. Le nombre de nativités et de morts est toujours proportionné aux fautes. Ce dieu a des danseurs particuliers nommés Kinnara, et des danseuses nommées Apsara, qui répondent aux پري péry ou fées des anciens Persans, aux حور العين. hhoùr êl-a’yn [belles aux yeux noirs] des Musulmans, connues chez nous sous le nom de Houris. Voyez le Systema Brahmanicum, &c. p. 180-185 ; Hymn to Indra, dans le t. II, p. 1 52, de YAsiatick Miscellany, édit, de Calcutta, et dans le t. VI, p. 337, des Works of sir Wiil. Jones.
(38) Ce mot signifie descente. « Ce dieu (Vichnou), dit le Bagavadam (page 264), ce dieu, qui est invisible et sans corps, tout-puissant et infini, s’incarne et prend ainsi des formes relatives aux circonstances pour lesquelles il se métamorphose. Le motif de ces apparitions est toujours de remettre en vigueur la pratique des vertus relâchées, et de détruire ou de réprimer la méchanceté parvenue à son comble. Celui qui a donné l’être à toutes choses, peut prendre telle figure ou telle forme qu’il lui plaît. » Ce passage est parfaitement conforme au discours même de Vichnou dans le Bhaguat Guîtâ, que l’on trouvera dans la note a p. 173 du tome II de cette collection. Voyez en outre, sur cette partie intéressante de la mythologie indienne, the Bhaguat-Geeta, or Dialogues of Creeshna and Arjoon, &c. translated from the original sanskreet by Wilkins, page 51 de l’édition in 4.°, et page 55 de la traduction française du C.en Parraud ; Paulini à Sancto-Bartholomæo Systema Brahmanicum, pages 83, 284, &c. ; the Institutes of emperor Akber, translated from the persian by Gladwin, tome III, page 232, édition de Calcutta. J’ai tout lieu de croire que M. Maurice a négligé de consulter ce dernier ouvrage pour composer les descriptions, d’ailleurs fort circonstanciées et fort curieuses, qu’il donne des âvatârs, dans son History of Hindostan, its arts and its sciences, &c, tome Ier, pag. 553 et suiv., et tome II, pag, 5 et suiv.
(39) L’âge de pureté, ou plutôt de vérité ; car, suivant M. Holwell, satya signifie vérité : c’est le premier des quatre âges hindous ; il dura trois millions deux cent mille ans ; les hommes vivoient alors cent mille ans, et avoient vingt-une coudées de haut. Voyez Maurice’s History of Hindostan, its arts and its sciences, &c. t. I, p. 86-87.
(40) Voyez la description et la représentation de ce vara âvatâr, ou seconde incarnation de Vichnou sous la forme d’un sanglier, dans l’History of Hindustan, &c. de M. Thomas Maurice, t. II, p, 575, et dans les autres ouvrages cités dans ma note 38, ci-dessus. Je dois pourtant observer que, suivant le P. Paulin de Saint-Barthélemi [Systema Brahmanicum, p. 295), l’incarnation en tortue [kourma avatar] est antérieure à l’incarnation en sanglier [vara avatar], et que Vichnou revêtit la forme d’une tortue, pour soutenir le monde penchant vers sa ruine et dans un imminent danger, à cause de la guerre acharnée que se faisoient les dieux et leurs ennemis les géans [Asour], qui vouloient leur ravir l’ambroisie [amrday. Vichnou prit ensuite la hure d’un sanglier, pour soutenir sur ses défenses la terre, que le géant Irannia vouloit plonger dans les eaux de l’abîme. Cette incarnation, ajoute notre savant, est intimement liée avec les deux précédentes, et toutes trois ont trait au déluge. Les Brahmanes nommoient le sanglier dont il s’agit, Varaha, Kidi, ei Sougara, mots qui désignent un sanglier des montagnes et des bois. Peut-être les étymologistes trouveront-ils quelque analogie entre le mot varaha et notre mot verrat.
(41) Montagne que la plupart des mythologues indiens confondent avec le mont Mérou, quoique ce soit une autre montagne, comme l’observe M. Wilkins dans ses excellentes notes sur le Bhaguat-Geeta, p. 146 et suiv, édit, in-4.° Le Mérou y dont le nom signifie axe ou centre, est le pôle septentrional de la terre, et passe pour la plus haute des montagnes. Dans la mythologie indienne, il est représenté comme le séjour du soleil et le support de la terre.
Dans une rixe qui s’éleva entre les bons et les mauvais génies, au sujet de l’eau de l’immortalité, le Mérou fut précipité dans la mer, et tomba au plus profond de l’abîme. Les bons génies prièrent aussitôt Vichnou, conservateur du monde, de remettre cette montagne sur pied. Vichnou prit la forme d’une tortue, plongea et souleva la montagne, et la soutint sur son dos. Les dieux bons et méchans, voyant la montagne céleste ainsi hors de danger, l’enveloppèrent avec un immense serpent nommé Vasoughi, suivant le P. Paulin de Saint-Barthélemi, et Vasouki, suivant M. Wilkins ; et les démons prenant la tête du serpent, les dieux saisissant sa queue, ils le tirèrent alternativement, et par ce moyen imprimèrent au mont Mérou un mouvement de rotation qui dut en faire sortir l’eau de la vie. Il la rendit en effet, ou plutôt elle sortit de la mer ; et le médecin céleste Danouvandra recueillit cette eau éparse sur la mer, et la remit dans un vase à Vichnou, assis sur le sommet du mont Mérou. Ce dieu la distribua ensuite aux autres dieux bons, à l’exclusion des démons, qui, dès ce moment, leur jurèrent une haine éternelle. Tel est, en abrégé, le sujet d’un dessin du cabinet du savant et vénérable cardinal Borgia, prélat dont le nom est cher à tous les amis des lettres : ce sujet est gravé dans le Systema Brahmanicum du P. Paulin. On y remarque la figure du dieu Vichnou, répétée trois fois : 1.° sous la forme d’une tortue ; il soutient le inont Mérou : 2.° sous celle d’un dieu ou d’un homme ; il tire la queue du serpent : 3.° comme dieu, avec les attributs de la royauté, et assis sur une fleur de lotus, au sommçt du mont Mérou ; il a la face noire, la tête ceinte d’une couronne, et quatre mains, &c. Aussitôt après que ce dieu eut distribué aux autres l’eau de la vie, tirée de la mer, cet élément produisit la déesse Lakchmî, la mère universelle, la Vénus indienne, déesse de la génération et de la fécondité, la Terre, femme de Vichnou, laquelle est assise auprès de lui, avec une fleur de lotus ou nymphcea à la main. Dans le même moment naquit aussi Saresouatî ou Saravatî, déesse de l’harmonie et de l’éloquence, femme de Brâhmah, assise à la gauche de Vichnou. Enfin la même mer produisit Moudêvi (ou mieux Bhoudêvi), déesse de la turpitude et de la discorde. Outre ces trois déesses, on vit encore sortir de cette mer, la vache, symbole de la fécondité, le cheval à sept têtes, l’arbre Kalpavrkcham, et l’éléphant blanc, emblème du courage et de la prudence, qui soutint le monde, sauvé par Vichnou. De là encore la fable accréditée chez les Hindous, que la terre est portée sur une tortue et sur huit éléphans, qui, en se relayant, causent les tremblemens de terre. Les principaux traits de l’histoire mythologique que nous venons de rapporter, se retrouvent chez les Japonois, qui croient à l’incarnation de Dieu en poisson, et conservent dans leurs temples des représentations de cette incarnation. On voit dans quelques-unes la tortue nageant sur la mer, et portant le mont Mérou, ou bien l’arbre du paradis. La même montagne se retrouve dans la mythologie tibétaine ; elle y est divisée en degrés mystiques, où l’on place le soleil, la lune, les laha, ou planètes, qui sont des dieux indiens et tibétains : cette montagne se nomme Rirou, ou Righiel Loumbò, en tibétain. Ces mots, d’après l’étymologie sanskrite indiquée par le P. Paulin, dériveroient de Irouchi, qui fait, par corruption, Rigi, ou Richi Loumbò, montagne des contemplatifs ou des dieux des planètes et des bienheureux, qui contemplent là et adorent le Soleil-dieu et la Lune. Les Tibétains, ainsi que les Indiens, font jaillir du pied du mont Mérou, à travers quatre rochers, et tout près de l’arbre Kalpavrkcham, quatre fleuves, le Gange, l’Indus, et deux autres nommés en tibétain Pahkiou et Si ta, lesquels paroissent correspondre aux quatre fleuves du paradis terrestre. — Terminons cette note par la description du mont Mérou, tirée d’une géographie tamoule intitulée Puwana (lisez Pourâna) Sakkaram, que cite le savant Bayer, et dont le P. Paulin ne paroît pas avoir eu connoissance. « Le mont Mérou a plus de seize mille yosineï de circuit à sa base (l’yosineï ou yodjan est, selon Bayer, égal à plus de deux milles d’Allemagne), et son élévation est de trente-deux mille yosinéï. Sur cette montagne sont dispersées mille huit kodoumoudi ou collines. Le dieu Vichnou et son épouse Lakchmî habitent la partie orientale ; Brâhmah et son épouse Saresouadî, la partie septentrionale ; Tetchana-Mourdi, roi du monde, la méridionale ; et Nandi-Sourer, portier de Chiven (ou Sîva), l’occidentale (lisez occidentalibus, au lieu d’orientalibus). Les Sitter et les Kendou-rouver [ministres ailés des dieux], les Mouni-Sourer [les prophètes], les Devergœl [les demi-dieux], les Kinœrer et les Tombourou-Narader [les musiciens instrumentaux], et les Attama-Sitter [satellites protecteurs des dieux], habitent autour de cette montagne. » Voyez Bayer, Historia regni Grœcorum Bactriani, &c. pag. 9 et 10 ; et le P. Paulin de Saint-Barthélemi, Systema Brahmanicum, &ç. pag. 289-291.
(42) Ce breuvage céleste, qui ressemble beaucoup à l’ambroisie des anciens, se nomme amrda et amrita, c’est-à-dire, immortalité. Ce mot sanskrit est composé de l’a privatif, qui existe en sanskrit comme en grec, et de mrda [mortalité]. On a vu, dans la note précédente, de quelle manière ce précieux breuvage fut retiré de la mer battue avec la montagne Mérou, suivant les uns, et avec la montagne Mandar, suivant d’autres. M. de Paw ( Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois, t. I.er, p. 360-363, édit. 1773), observe, avec beaucoup de raison, que, long-temps avant l’ère chrétienne, les Scythes, les Perses, les Tibétains et les Chinois, cherchoient avec obstination la composition de ce breuvage, auquel ils croyoient que leurs dieux devoient leur immortalité. Plus d’un empereur de la Chine, victime de sa crédulité et de ce breuvage trompeur, est allé chercher parmi ses aïeux une immortalité dont il comptoit jouir sur la terre. Aujourd’hui encore, la plupart des grands et des personnages un peu considérables de la Chine s’occupent de cette recherche, qui a coûté la vie à plusieurs de leurs ancêtres, et qui ne paroît avoir été absolument d’aucune utilité. Chez nous, au moins, plusieurs de ceux qui s’occupoient de la recherche de la pierre philosophale et de la quadrature du cercle, ont fait, en chimie et en géométrie, des découvertes capables de dédommager suffisamment de ses travaux tout autre qu’un visionnaire.
(43) C’est le troisième âge des Hindous, qui, selon eux, a duré huit cent soixante-quatre mille ans (Kindersley’s Specimens of Hindoo literature, pag. 35) ; et un million six cent mille ans, suivant M. Craufurd (Sketches relating to the history… of the Hindoos, t. I, p. 295, seconde édition).
(44) L’incarnation de Vichnou en Crichna, et non en Kistna ou Kistnou, comme l’écrit M. Kindersley, p. 18 de ses Specimens of Hindoo literature, est le neuvième avatar, ou descente de la Divinité sur la terre, pour la conservation du monde, et particulièrement pour le bien des provinces de l’Hindoustân. Voyez ci-après (page 286, note 140), l’article de Crichna, qui paroît être le même que l’Apollon des Grecs et des Latins, et un emblème du soleil.
(45) L’ancien nom de Bénârès.
(46) C’est aussi l’opinion d’Aboùl-fâzel, dans l’Ayïn Akbery ; mais elle n’est partagée ni par le P. Paulin, ni par M. Kindersley et autres savans orientalistes. Au reste, l’histoire des âvatârs, ou incarnations de la Divinité, mériteroit d’être traitée avec détail et critique ; et il s’en faut de beaucoup que M. Thomas Maurice ait épuisé la matière dans son Ancient History of Hindostan et dans ses Indian Antiquities. Quant à Bouddha, dont parle ici M. Jones, j’ai eu occasion de parler si souvent de ce personnage dans les notes que j’ajoute à ces Mémoires, dans celles que j’ai faites sur le Voyage de M. Thunberg, et dans ma Notice du Rituel des Tatârs-Mantchoux, que je me bornerai ici à une seule observation ; c’est que j’ai de fortes raisons pour le croire plus ancien que Brâhmah, législateur des Hindous.
(47) Il me semble que le calighi âvâtar, ou dixième descente de la Divinité, sera sous la forme même d’un cheval blanc, nommé calighi, muni d’ailes, superbement équipé, et conduit par un monarque qui aura une épée nue à la main, afin de corriger et même de percer les pécheurs obstinés.
(48) Ce mot sanskrit signifie proprement jonction, jointure. Les Persans écrivent جُك et prononcent djoug. Il désigne les différens âges des Indiens, lesquels, suivant un astronome anglois, ne sont autres que des périodes astronomiques produites par la coïncidence de certains cycles, dont deux sont formés par la précession des équinoxes et de la lune. Mille révolutions dyougs font un calpa, ou jour de Brâhmah, c’est-à-dire, quatre milliars trois cent vingt millions d’années humaines. Voyez les notes de M. Wilkins sur sa traduction du Bhaguat-Geeta, p. 142 et 143, édit. in-4.° ; et consultez, pour les yougs, le Mémoire sur les calculs astronomiques des Hindous, t. II, p. 268, de cette collection ; le Mémoire de M. Jones sur l’antiquité du zodiaque indien, même volume, p, 332 ; Voyage de Sonnerat aux Indes, t. II, pag, 178 et suiv. ; Beschi Grammatica Tamutica (Tranquebar, 1738), cap, V, pag, 163 ; Waltheri Doctrina temporum Indica, ad calcem Historiée regni Bactriani, p. i 80 ; Paolino da Santo-Bartolomeo, Viaggio aile Indie Orientait, p. 308 ; Drummond’s Grammar of the Malabar language, &c. (Bombay, 1799), p. 1 2 8 ; Craufurd’s Sketches relating to the history… of the Hindoos, t. II, p. 295, seconde édition ; le Gentil, Bailly, &c. &c.
(49) Dans sa préface des Institutes of Hindu laws, or the ordinances of Menu, &c, transiated from the original sanscrit, M. Jones fixe, par des raisonnemens et des calculs, la composition de l’Yadjour Véda vers l’an 1580 avant l’ère vulgaire ; ce qui rend ce livre, dit-il, plus ancien que ceux de Moïse. Or le déluge étant arrivé, suivant les annales d’Ussérius, en l’an 2348 avant J. C., et Moïse étant né l’an 1556 (ou 1611, suivant M. Larcher) avant cette même ère, il faut avouer que la multiplication de l’espèce humaine, et ses progrès dans la civilisation, ne sont pas moins étonnans que cette grande catastrophe, à en juger seulement par les Hindous, tels qu’ils sont représentés dans les Vêdas, et par l’état de l’Égypte, décrit dans les livres de Moïse.
(50) Suivant la préface déjà citée dans ma note précédente, les Pourânas sont postérieurs aux Vêdas de six cents ans, et le code de Menou, de trois cents ans seulement ; ce qui fixe la promulgation de ce code vers l’an 1280 avant J. C., et celle des Pourânas vers l’an 980. Voyeç ci-après, sur ces livres, les notes que j’ai ajoutées au Mémoire sur la littérature des Hindous.
(51) Le Dherma sâstra est un des six grands Sâstras qui sont censés comprendre toute la science divine et humaine : celui-ci est un code de législation sacrée ; son nom signifie, en sanskrit, bonne ordonnance.
(52) Le code, l’ordonnance de Menou.
(53) Il me semble que la simplicité du style, et les autres caractères d’antiquité dont parle ici M. Jones, ne sont applicables qu’aux livres d’une seule et même nation, sur la civilisation de laquelle ils peuvent en effet nous donner quelques renseignemens : mais ce raisonnement manque de justesse, quand il s’agit de décider de l’ancienneté relative de différens peuples chez qui les commencemens de civilisation, à quelque époque que ce soit, ne doivent pas avoir eu les mêmes caractères. Ainsi la simplicité et la nudité du style de la Genèse et du Pentateuque entier, en comparaison de la mélodie et de la perfection du style des Vêdas, ne sont à mes yeux d’aucun poids en faveur de l’antériorité de l’ouvrage de Moïse II est très-possible, et cela est probable, que les Hindous, libres et heureux sur les bords du Gange, s’occupassent de polir leur langage et de châtier leur style, bien avant que les Juifs, asservis dans une terre étrangère, où ils gémissoient dans le plus dur esclavage, eussent seulement le désir d’apprendre à écrire ou à lire.
(54) M. Jones observe ailleurs que Menou, Minos, Mneves et Mnévis sont des terminaisons grecques, et que le nom, dans sa simplicité originaire, est composé des mêmes lettres radicales, tant en grec qu’en sanskrit : ce mot, aussi-bien que menes, mens et mind, dérive de la racine men [comprendre] ; et tous les Pandits conviennent qu’il signifie intelligence, sur-tout dans la doctrine du Vêda. Voyez dans le tome III des Works of sir William Jones, les Institutes of Hindu laws, or the ordinances of Menou, &c. verba/ly translated from the original sanscrit, pag. 56, 57 et 58 ; et, ci-après, mes notes sur la littérature des Hindous.
(55) Dherma radjah signifie le roi ion et vertueux : on suppose qu’il régna dans le cours du troisième âge du monde, qui finit il y a environ cinq mille ans. Voyez Kindersley’s Specimens of Hindoo literature, p. 88, not.
(56) Je crois que ce mot sanskrit signifie pire des pires.
(57) Yama râdjah décerne les peines et les récompenses, juge les bonnes et les mauvaises actions, punit les crimes ; c’est le premier ministre de Chiva, ou Sîva (la divinité destructive) : en un mot, son ministère répond à celui de Minos, juge des enfers chez les anciens. On le désigne sous les titres de Dherma râdjah [roi de la vertu, des bonnes œuvres], Pidroubadi [seigneur des morts], Samavarti [qui établit les compensations, les proportions, c’est-à-dire, qui balance les bonnes et les mauvaises actions], Krdânda [secrétaire de la vie humaine], Chamouna [Styx], Yamounabhrâda [frère du Styx], Chradadêva [dieu qui fait pleurer], &c. Il a pour serviteurs différens démons. Les Indiens le représentent avec une fourche à la main droite et un miroir dans la gauche, pour observer les actions des hommes, &c. Auprès de lui sont des génies qui, avec des cailloux noirs et blancs, calculent les bonnes et les mauvaises actions des humains, afin d’en rendre compte au dieu. Au-dessous, des aines sont torturées dans des chaudières, rôties à la broche, percées et remuées avec des fourches, &c. Le même dieu est connu des Tibétains sous le nom de Chintchetchokiel, Ils croient, comme les Indiens, que toute ame dégagée de son corps doit comparoître devant lui, pour être sévèrement jugée. Quelque ridicules que soient ces idées, 0Il les retrouve encore ailleurs que dans Flnde et au Tibet : on peut au moins en conclure que ces nations, comme l’observe très-bien le P. Paulin de Saint-Barthélemi, croient à l’immortalité de l’ame et à une autre vie. Voyez son Systema Brahmanicum, p. 177-180.
(58) Un Guèbre ou Pârsy, le même, je crois, que Bahman, dont notre savant cite souvent le témoignage dans son Discours sur les Persans, ci-après, t, II, p. 83 et suiv. n.° III.
(59) Lieu de dévotion des Hindous dans le Béhâr. Voyez, dans le tome II, page 56, de ces Mémoires, une notice sur Gayâ, que j’ai extraite de l’Ay’in Akbery آيين اڪبري. Il y avoit à Gayâ un temple consacré à la planète Saturne, suivant le témoignage de Mohhammed Fâny, que je cite dans la note b de la page 21 du même volume. C’est par erreur que j’écris dans cette note Guyâ au lieu de Gayâ : je n’avois pas alors de documens bien positifs sur la vraie prononciation de ce mot ; ce second volume ayant été imprimé avant le premier, par les motifs énoncés dans l’Avertissement.
(60) Nous avons déjà observé que chaque personnage de la Trinité indienne, et même chaque dieu des Hindous, a une ou plusieurs épouses qui ont aussi leurs attributs et leur influence. Les épouses de Vichnou sont au nombre de deux. La première, qui est la puissance conservatrice de la nature, n’a pas moins de douze noms, dont voici les principaux : Sri (ou Chrt), heureuse, fortunée, opulente ; Lakchmî, belle (mot qui dérive de Lakehmya, beauté) ; Padmâ, lotus, nymphæa ; Hiripriya, amante de Vichnou (nommé aussi Héri, et, en cette qualité, représentant la bonté divine), et non pas épouse de Vichnou, comme a traduit M. Jones ; Logadjenani, génératrice du monde ; Ma, grande ; Rama, abondante ; Mangala dêvadâ, déesse de la félicité. Les Pourânas ne s’accordent pas sur l’origine de cette déesse. Quelques-uns la représentent comme fille de Bhrigou fils de Brâhmah. Suivant le Marcandeya Pourâna, l’isis indienne [la Nature] a pris trois formes transcendantes, d’après ses troisgouna [qualités] : sous chacune de ces formes, elle a produit trois divinités, savoir, Brâhmah et Saresouatî, Mahêsa et Câlî, Vichnou et Lakchmî, qui préserva de la destruction l’œuf du monde. Enfin, une troisième opinion veut que Lakchmî ait pris naissance dans la mer de lait que les dieux battirent à la seconde incarnation de Vichnou, pour en tirer l’eau de la vie, comme nous l’avons raconté plus haut, page 236.
Cette déesse est représentée assise, tenant un lotus dans les deux mains. Quelques-unes de ses statues ont une mitre conique ; d’autres ont la tête nue avec les cheveux noués négligemment sur le sommet. Elle porte sur le front le signe sacré du lingam ; elle a la poitrine nue : quelquefois elle tient un enfant, et lui présente la mamelle. On la représente aussi comme une vierge charmante, assise sur le lotus ; alors elle est vêtue, et porte de superbes pendans d’oreilles. Le manglier, nommé maa, lui est dédié, aussi-bien que son feuillage ; et c’est pour cela que les Brahmanes se servent des branches de cet arbre pour faire des aspersions d’eau lustrale, nommée tirtha. Le lotus lui est aussi consacré, comme lui servant de siège et même de demeure. On prétend aussi que cette déesse habite dans la gueule des vaches. Elle passe pour la protectrice du feu nocturne ; c’est pourquoi l’on a soin tous les soirs de conserver du feu en l’honneur de Lakchmî : heureuse la maison où brûle consécutivement une lampe, ou tout autre feu, en l’honneur de Lakchmî ! Quand il s’agit de faire cuire du riz, les femmes indiennes en jettent quelques grains dans le feu, en invoquant la déesse ; les jeunes filles curieuses de devenir belles et fécondes ont une dévotion particulière pour elle. Enfin elle reçoit un culte universel dans toute l’Inde, et les partisans de Vichnou la nomment la grande mire : c’est, comme on sait, un des noms que les anciens donnoient à Cérès. Pour se convaincre de l’étonnante ressemblance qui existe entre ces deux déesses indienne et grecque, il suffit d’examiner avec attention les attributs de celle dont il s’agit, et de les comparer avec ceux de la déesse qui lui correspond dans la mythologie grecque et latine.
Cérès, fille d’Ops, la déesse des moissons, la nourrice Cérès, δημήτηρ, la terre, grande mère, créatrice de tous les végétaux, la grande déesse, que les Arcadiens nommoient δέσποινα [la maîtresse], &c. est évidemment la même que Srî ou Lakchmî, la déesse de l’abondance, la déesse conservatrice, la déesse des richesses, du plaisir, du courage, de la joie [χαρά en grec], &c. qui nourrit les hommes. Les torches que Cérès alluma au feu de l’Etna pour chercher sa fille Proserpine, les flambeaux que les anciens allumoient à sa fête, ressemblent bien aux feux qu’on allume dans l’Inde en l’honneur de Lakchmî. On la nomme belle, parce que Lakchmî, ou la Vénus indienne, est née d’une coquille suivant quelques-uns, et d’un lotus suivant d’autres ; et c’est à cause de cela que les jeunes filles lui offrent des sacrifices. Lakchmî s’assied sur un lotus, parce que cette plante est l’origine de toute génération, suivant les Brahmanes. Ils disent qu’elle-même est un lotus, parce que, sous le point de vue physique, elle est la production du soleil, de la terre et de l’eau, et parce que la terre nourricière est la mère, la matrice et le réceptacle de toute semence, laquelle ensuite enfante et nourrit. On l’appelle la grande mire, la génératrice du monde, parce que, suivant les anciens, tout vit et subsiste par les productions végétales de la terre et de la nature, et est même engendré par elles. En effet, où Cérès ne se trouve pas, quelle végétation peut-il y avoir ! On la nomme douce et lactée, parce qu’elle porte des végétaux doux et remplis d’un suc qui ressemble à du lait. Rappelons-nous aussi que Cérès nourrit Triptolème avec du lait divin, afin de le rendre immortel. En outre, la résidence de Lakchinî dans du lait, et dans la gueule, dans les mamelles ou sur la queue de la vache, annonce que la vache, symbole de la fécondité et de la terre, représente encore cette déesse féconde ; elle aime le lait ; les Brahmanes et les dieux indiens l’aiment de même beaucoup ; aussi ne manque-t-on pas de donner du lait à boire aux serpens sacrés : on le mêle avec du riz pour l’offrir aux autres dieux. Enfin, on pétrit de petits gâteaux de riz et de miel, pour les offrir aux idoles et aux âmes des morts, le jour de leur anniversaire. Les feuilles, les fruits du manglier, et le manglier lui-même, sont consacrés à cette déesse, dont ils offrent un emblème d’autant plus frappant, que c’est l’arbre le plus fécond que l’on connoisse dans toute l’Inde.
Les détails qu’on vient de voir sur Lakchmî, expliquent pourquoi les Indiens allument sept lampes en son honneur ; pourquoi leurs monnoies portent son image, qu’ils ne manquent jamais d’adorer et de poser sur leurs yeux et sur leur bouche avant de passer un contrat ou de changer de l’argent ; pourquoi, le soir, ils saluent avec les mains levées la lumière de la lampe ; pourquoi cette lumière figure dans les solennités du mariage ; pourquoi les veuves sont couvertes de mépris, comme stériles ou comme inutiles ; pourquoi ils ont horreur des prostituées ; pourquoi ils révèrent la vache , et pourquoi leur vœu le plus ardent est de monter au ciel en tenant la queue de cet animal ; pourquoi sa fiente leur sert à faire un enduit pour en couvrir l’intérieur de leurs maisons, &c. &c. Voyez Paulini à Sancto-Bartholomæo Systema Brahmanicum, p. 95-98 ; Kindersley’s Specimens of Hindoo literature, pag. 18 et 19 ; Jones’s Works. t. VI, p. 355 et 356, an hymn to Lakshmee ; et the History of Dooshwanta and Sakoontala, extracted from the Mahabhârat, a poem in the sanskreet language, translated by Charles Wilkins, t. II, p. 433, note (a), de l’Oriental Repertory de M. A. Dalrymple.
Je ne terminerai pourtant pas cette note sans ajouter que l’identité de Srî et Cérès paroît suffisamment prouvée à M. Alex. Hamilton. « Les deux déesses, dit-il, ont les mêmes fonctions, et presque les mêmes noms ; en outre, celui de Camala n’étoit pas inconnu à l’antiquité : on adoroit Cérès sous le nom de Camala, et avec beaucoup de pompe, dans la Cappadoce et en Arménie, suivant Strabon, qui fournit d’amples détails relativement à ce culte. »
(61) Un vers non moins caractéristique est celui que Lucain met dans la bouche de Caton :
Voici en outre un hémistiche, que Virgile a traduit des Phénomènes d’Aratus,
Jupiter désigne dans ces vers famé du monde, qui, suivant le système des Pythagoriciens, adopté ensuite par les Platoniciens et les Stoïciens, étoit répandue dans tout l’univers ; le principe agent qui produisoit les âmes de tout ce qui respire, et qui, après la dissolution du corps, retiroit famé à soi comme dans un réceptacle universel ; enfin le Jupiter dont il s’agit ici ne paroît être autre chose que la matière organisée. Je crois que les philosophes avoient emprunté ce nom de la théologie populaire, pour exprimer les idées qui leur étoient particulières. Voyez Virgil. Eclog. III, 60 ; Georg. IV, 220, t. Ier, p. 81 et 694, de l’édition du savant M. Heyne (Lipsiœ, 1800) ; Lucani Pharsalia, lib. ix, 579, p. 720, ex edit. Oudendorp. ; ci-dessous, p. 250, note 75.
(62) M. Jones auroit encore pu ajouter, à l’appui de son observation, que la plupart des Grecs modernes ne peuvent prononcer le j français, et y substituent le son du z.
(63) Ce mot, emblème mystique de la Divinité, ne doit être proféré que dans le silence : c’est une syllabe formée des lettres dévanâgary a et ou, qui se fondent ensemble dans la composition, et font o, et de la consonne nasale m. La première lettre indique le créateur, la deuxième le conservateur, et la troisième le destructeur ; c’est-à-dire, Brâhmah, Vichnou, et Sîva ou Chîva. Cette explication, donnée par MM. Wilkins et Jones, est condamnée, comme absolument fausse, par le P. Paulin de Saint-Barthélemi ; et voici celle que propose ce savant :
« La particule ÔM sert, dit-il, suivant le dictionnaire intitulé Amarasinha, exprimer le consentement, la volonté, la similitude. Ainsi ÔM ou ÉVAM peut se traduire par entièrement, oui, je le veux, ainsi soit-il. Au lieu d’ÔM, les Malabars écrivent AM, qui a la même signification que ÔM : l’une et l’autre de ces particules sont la réponse de l’interrogative HOUM, que les Malabars prononcent AMÒ. Ainsi, à l’époque de la création du monde, le dieu Ichvara, ou Îśouara [le Seigneur], dit à son épouse Chakti, c’est-à-dire, la Puissance et « la Vertu, car telle est la signification de ce nom : Houm ; c’est-à-dire, voulez-vous, est-ce qu’il ne faut pas créer le Soleil, adorer Vichnou ou l’eau, adorer Sîva ou le feu Chakti, la déesse Puissance ou Vertu, laquelle est aussi la Nature universelle, épouse du Créateur, nommé Ichvara ou Isouara, répondit : ÔM, oui, volontiers, j’y consens, &c., que l’on adore Sîva ou le feu, &c. Le dieu reprit : Houm mani padme [L’enfant ou le lingam n’est-il pas dans le lotus] ! — ÔM, répondit Chakti ; c’est-à-dire, oui, le lingam ou l’enfant est dans le lotus, dans yoni, la matrice de la nature ou la déesse Bhavânî. » Telle est donc la véritable et exacte signification de la particule interrogative HOUM, et de l’affirmative ÔM, qui ont donné lieu à bien des suppositions et des rêveries de la part de plusieurs savans Européens. On peut en voir l’énumération exacte, accompagnée de la réfutation, dans le Sidharubam, seu Grammatica Samscrdamica du P. Paulin de Saint Barthélemi, pag. 53-59. Voyez aussi Wilkins Notes on the Bhaguat-Geeta, p. 142, édit. in-4.°
(64) Si ma note précédente ne me paroissoit pas suffisante pour détruire entièrement cette conjecture, il me seroit aisé d’en ajouter ici une autre bien plus étendue, pour prouver que, d’après Jablonski, le monosyllabe égyptien ΩΝ ôn suivant l’orthographe des Grecs, que nous avons copiée, ou אן ân suivant celle des Hébreux, est une syncope du mot ⲟⲱⲟⲉⲓⲛ voein, ou ⲟⲉⲓⲛ oein, qui, en dialecte ssa’ydyque, désigne la lumière : par une onomatopée fort naturelle, on a donné ce nom au soleil et même à la ville qui lui étoit particulièrement consacrée, comme nous le voyons par ce passage grec et qobthe de la version des Septante, qui ne se trouve pas dans l’hébreu : Καὶ Ὢν, ἥ ἐστιν Ἡλιούπολις ⲛⲉⲙ ⲱⲛ ⲉⲱⲉ ⲩⲃⲁⲕⲓ ⲙⲫⲣⲏⲱⲉ [Et ÔN, qui est la ville du soleil], Exod. lib. i. Nous savons en outre très-positivement que le nom du soleil en égyptien ancien et moderne est ⲣⲏ re, et, avec l’article, ⲡⲣⲏ pre, et ⲡⲓ ⲣⲏ pi-re, que l’on retrouve dans le nom de Putiphar, corruption de l’égyptien ⲡ-ⲝⲟⲛⲧ-ⲙⲫⲣⲏ [p-hont-mphre, grand-prêtre du soleil]. En effet, la Genèse, xli, 45, 50, nous apprend qu’il étoit כֵהַן אֽן Kohen ân, grand-prêtre, à Héliopolis ; et elle le nomme פוֹטִפֶירַע Poùthypherà. Voyez Jablonski, Pantheon Ægyptiorum, in prolegom. XVIII, tom. I, pag. 137-139 ; Lacroze, Thesaurus epistolicus, tom. I, pag. 182 et 183, et ejusdem Lexicon Ægyptiaco-Latinum, pag. 83 et 189.
(65) Il y a ici une faute d’impression dans l’original anglois : il faut lire Brahm ou Brehmā, mot neutre, qui signifie le grand être, et dont le masculin est Brâhmah ou plutôt Brahmâ, le créateur ou le pouvoir créateur. Voyez ci-dessus, ma note première, page 214.
(66) Les partisans des Vêdas.
(67) Qu’on prononce aussi Chiva, Siven, Chiven, Chib, &c. Ses attributs sont décrits, avec autant d’exacthude que de magnificence, dans une prière des Brahmanes, composée originairement en sanskrit, traduite d’abord en persan par Dârâ-chékoùh, le vertueux, savant et malheureux frère de l’hypocrite et sanguinaire Aureng-Zeb, ensuite en anglois par M. Boughton Rouse, et de l’anglois en français par M. Parraud, qui a inséré ce morceau véritablement curieux à la suite du discours préliminaire placé à la tête de sa traduction du Bhaguat-Guita, publiée en 1787.
(68) Îśa ou Îśouara et Îśânî ou Îśî sont incontestablement l’Osiris et l’Isis des Egyptiens, dit ailleurs M. Jones, Hymn to Pracriti, t. VI, p. 318, des Works of sir William Jones.
(69) Cette plante, également sacrée pour les Indiens, les Tibétains, les Japonois et les Égyptiens, se nomme en sanskrit tamara, patmaleya, patmâ ou padma ; les Tibétains ont fait de ce mot pemà. On sait que la fleur du lotus s’ouvre aux premiers rayons du soleil, et se ferme quand cet astre se couche. On la peignoit ordinairement avec un enfant qui sembloit sortir de son calice, pour indiquer, sans doute, que l’eau et le soleil sont les principes de la génération. Cet enfant est désigné sous le nom de Mâni, mot qui signifie aussi un phallus et le fruit du figuier indien nommé bananier. Au reste, un enfant ou le lingam sont également bien placés dans le lotus, puisque c’est toujours le symbole de la nature fécondée par le soleil et par l’eau, par la chaleur et par l’humidité ; enfin cette plante est l’yôni, la matrice ou réceptacle de fécondité, figuré quelquefois par un triangle. Les Japonois la nomment tarate. Elle jouissoit d’une grande vénération chez les anciens Égyptiens, et sa fleur a fourni à leurs artistes des chapiteaux de colonne d’une beauté et d’une variété admirables, comme on peut s’en convaincre en examinant les belles planches 59 et 60 de l’intéressant Voyage dans la basse et haute Égypte, par M. Denon, membre de l’Institut national. Les Qobthes l’appellent ⲕⲉⲛⲛⲁⲣⲓ kennari. نباق nabaq en arabe. Ajoutons ici une observation de M. Jones sur cette plante mystique : « Nymphœa, et non lotus, dit-il, est en Europe le nom générique de la fleur consacrée à Isis. Les Persans connoissent sous le nom de nilufer cette espèce de nymphœa que les botanistes appellent ridiculement nelumbo, et qui est remarquable par la singularité de son péricarpe, où chaque graine renferme en miniature les feuilles d’un végétal parfait. Le lotus d’Homère étoit probablement la canne à sucre, et celui de Linné est une plante papilionacée : mais il donne le même nom à une autre espèce de nymphœa ; et nous sommes tellement accoutumés dans l’Inde à nommer ainsi le nilufer, que toute autre dénomination seroit à peine intelligible. Le lotus bleu croît dans le Kachmyr et dans la Perse, mais non dans le Bengale, où nous ne voyons que le rouge et le blanc. » Hymn to Pracriti, dans le tome VI, p. 320, des Works of sir William Jones.
(70) نيبال Voyez la description de ce royaume dans le tome II, page 348.
(71) Floating on a leaf of beetle, Holwell’s Interesting historical events relative to the provinces of Bengal, &c. &c. t. II, p. 113.
(72) Le passage cité ici se trouve dans les Institutes of Hindu laws, or the ordinances of Menu, &c. verbally translated from the original sanscrit, with a preface, t. III, p. 66, des Works of sir Will. Jones ; mais il y a des différences assez considérables entre les deux traductions de ce passage, faites cependant par le même savant. Je crois pouvoir assigner deux causes à ces différences : 1.° M. Jones, à l’époque où il composa sa dissertation sur les mythologies indienne, grecque et romaine, ne savoit pas encore la langue sanskrite, et étoit obligé de s’en rapporter aux versions plus ou moins infidèles qu’avoient faites les Persans, ou que lui donnoient les Brahmanes : 2.° il n’avoit besoin ici que d’un simple précis ; mais celui-ci manque d’exactitude dans quelques points assez importans, comme on va le voir par la traduction que je vais donner donner ici d’après celle que M. Jones a faite lui-même en anglois sur le texte sanskrit :
« Celui dont la puissance est sans bornes, ayant été ainsi invité par les grands sages, dont les pensées sont profondes, les salua tous avec considération, et leur fit une réponse générale que l’on écouta.
Cet univers n’existoit que dans la première idée divine, non encore développée ; comme si elle étoit plongée dans l’obscurité, imperceptible, indéfinissable, inaccessible à la raison, et non découverte par la révélation ; comme si elle étoit entièrement absorbée dans le sommeil.
Alors le seul pouvoir existant par lui-même, qui ne se laisse pas voir, mais qui fait voir ce monde avec cinq élémens et autres principes de nature, apparut avec une gloire non affaiblie, répandant son idée, ou chassant l’obscurité.
Celui que l’esprit seul peut apercevoir, dont l’essence échappe aux organes extérieurs, qui n’oftre rien de visible, qui existe de toute éternité, enfin lame de tous les êtres, qu’aucun être ne peut comprendre, parut en personne.
Celui-là, ayant voulu produire différens êtres de sa propre substance divine, créa d’abord les eaux avec une pensée, et y plaça une semence productive.
Cette semence devint un œuf brillant comme l’or, éclatant comme le grand luminaire aux mille rayons ; et, dans cet œuf, il naquit lui-même sous la forme de Brâhmah, le grand ancêtre de tous les esprits.
Les eaux sont appelées nârâ, parce qu’elles sont le produit de Nara [l’esprit de Dieu] ; et puisqu’elles furent son premier ayana [place de mouvement], il fut alors nommé nârâyana [qui se meut sur les eaux].
De CE qui EST, la première cause, non l’objet des sens, existant partout en substance, n’existant pas a notre perception, sans commencement ni fin, fut produit le mâle divin, célèbre dans tous les mondes sous la dénomination de Brâhmah.
Dans cet œuf, le grand pouvoir reposa inactif pendant une année entière du Créateur ; à la fin de cette année, par sa seule pensée, il fit que l’œuf se partagea de lui-même.
Et de ses deux divisions, il construisit le ciel d’en-haut, la terre au-dessous ; dans le milieu, il plaça le subtil éther, les huit régions, le réceptacle permanent des eaux, &c. »
(73) Ces différens systèmes, appuyés de toutes les citations imaginables d'auteurs grecs et latins, sont rapportés avec fidélité et clarté par Lilio Gyraldi, dans son Historia Deorum, col. 75-117.
(74) C'est-à-dire, gui se meut ou marche sur les eaux : c'est un des noms de Vichnou, seconde personne de la Trinité indienne ; les deux autres sont, comme on sait, Brâhmah et Sîva ou Chiva. Ces trois personnes ne font qu'un Dieu, qu'ils nomment Brahm ou Brahma. Voyez Wilkins's Notes on the Heetopades of Veeshnoo-Sarma, &c. p. 315.
(75) Jupiter, id est, juvans pater, guem conversis casibus appellamus à juvando Jovem… Cicero, de naturâ Deorum, lib. II, cap. 25, t. IV, parte 1 .*, p. 537, ex editione Emesti. La même assertion se trouve répétée dans le Traité de Varron de Lingua Latinà, lib. tv, pag. 18, ex editione Scalig. tySy, dans les Noctes Atticœ d'Aulu-Gelle, lib. v, cap. 12, p. 323-324, r* edit. Gronovii, 1706. Mais le savant Vossius, dans son Etymologicon linguce Latinœ, pag. 274, tx edit, 1662, rejette cette étymologie : il pense que Jupiter est la contraction de Jovis pater, et fait dériver le mot Jovis de Jova, contraction de Jehova mn* mot ineffable parmi les Hébreux. Cette étymologie ne me paroîtroit pas inadmissible, si l'on pouvoit découvrir quelle route un mot hébraïque doit avoir tenue pour se rendre dans la langue latine. Voyeç, sur le même mot, les Ruines par le C.en Volney, pag. 277, 290, 310, 3.e édit. ; et ma note 61, ci-dessus, page 245.
(76) Les déesses hindoues, dit ailleurs M. Jones, sont régulièrement représentées comme les pouvoirs subordonnés de leurs maîtres respectifs : ainsi Lakchmî, épouse de Vichnou le conservateur, est la déesse de l'abondance et de la prospérité ; Bhavânî, l'épouse de Mahâdêva, est le pouvoir de la fécondité ; et Saresouatî, qui eut pour époux Brâhmah le créateur, possède le pouvoir de l'imagination et de l'invention : on peut donc la regarder comme créatrice. Voye1 l'arguiTient de YHymn to Sereswaty, inséré dans le tome I.er, page 179, de Asiatick Miscellany (Calcutta, 1785), réimprimé dans le tome VI, page 375, des Works of sir Will. Jones ; et ma note première, page 215.
(77) Que M. Dow appelle Cobere ou richesse. Il a quinze surnoms ou épithètes, qu'on peut voir dans le Catalogue of the Cods of the Hindoos, tom. 1, pag. 81, de l'History of Hindoostan, translated from the persian, &c. by Alex. Dow, 2e édit.
(78) C’est-à-dire, les partisans de Vichnou et de Sîva ou Chiva. Voyez ma note première, page 214.
(79) Extrait du Bhoûchanda Râmâyan, traduit du sanskrit en anglois par M. Jones, et de l’anglais en français par le C.tn Labaume.
La belle et majestueuse montagne appelée Neil [ou Azur] a un sommet pointu qui est d’or pur. Les arbres sacrés, peipel, ber et pacr, fleurissent sur sa pente ; et sa cime est couronnée d’un lac d’eau brillante comme les diamans les plus éclatans. Des courans limpides, frais, et d’une saveur exquise, déployant une riche variété de couleurs, en descendent de tous côtés, et des milliers d’oiseaux font retentir des chants joyeux entre les branches sacrées. C’est en ce lieu que la corneille Bhoûchanda avoit fixé son séjour ; Bhoûchanda, qui avoit été ornée de maintes vertus, et déshonorée par plusieurs vices ; qui avoit résidé dans toutes les parties de l’univers, et à qui tous les événemens étoient connus depuis l’origine des temps. Sous le peipel, la Divinité étoit le sujet de ses méditations ; elle formoit des invocations sous le pacr ; à l’ombre du ber, elle chantoit l’histoire de Vichnou. Les habitans ailés des bois et ceux des eaux se rassembloient autour d’elle pour l’entendre ; et Mahâdéo lui-même, sous la forme du grand marâl au plumage d’argent, se perchoit sur une branche, et se plaisoit à écouter les aventures du tout-bon et tout-puissant Râm.
Le sage aigle Guerhoûr[4], essence de toutes les qualités aimables, qui se tient auprès de Vichnou lui-même et lui sert de monture, prit son vol vers cette montagne, et, à son aspect, fut soulagé des ennuis qui l’accabloient. Il baigna ses ailes dans le lac, et rafraîchit son bec en buvant de l’eau sacrée. Au moment où Bhoûchanda commençoit sa divine histoire, le roi de l’air parut en sa présence : le chœur ailé lui rendit un hommage respectueux, le salua avec des expressions solennelles de vénération ; puis, lui adressant des paroles affectueuses, le plaça sur un siége convenable à son éminente dignité.
Monarque des oiseaux, dit Bhoûchanda, ta vue me transporte de joie ; donne-moi tes ordres, et apprends-moi quel motif t’amène dans l’habitation de ta servante.
Ma sœur, répondit Guerhoûr, le premier aspect de ta charmante solitude a presque rempli l’objet de ma visite ; et les doutes que tu pouvois seule bannir de mon cœur, sont presque entièrement dissipés ; mais écoute mon récit :
« Quand le fils de Ràvan, le géant à mille bras, eut lié Ram avec un serpent sorti de son front, Nâred me commanda de mettre en liberté le guerrier céleste ; et je me hâtai d’obéir fidèlement à cet ordre. Mais l’orgueil s’éleva dans mon sein ; et réfléchissant que la dévotion rend les mortels eux-mêmes exempts des fers de la terreur, j’en conclus que, si Râm avoit été véritablement un dieu revêtu d’une puissance infinie, il n’auroit jamais été emprisonné dans les plis d’un reptile. Toute la nuit je fus troublé par ces réflexions embarrassantes ; et l’arrogance que m’inspiroit le titre de libérateur d’un dieu, parvint à un tel degré, que ma raison m’avoit presque abandonné. Cependant je conservai assez de bon sens pour chercher la solution de mes doutes ; et courant à mon sage maître Nâred, je lui découvris mon secret.
Tu es tombé, me dit le fils de Brâhmah d’un air compatissant, tu es tombé dans les piéges de la passion, dont ne peuvent se garantir les êtres les plus vertueux, lorsqu’ils négligent d’exercer leur entendement. L’apparence qui fa trompé n’étoit que le maya [ou l’illusion] de Vichnou, qui m’a souvent abusé moi-même. Il est au-dessus de mon pouvoir de te donner un parfait soulagement : va au palais de mon père, et suis implicitement ses ordres.
Je volai avec toute la vitesse imaginable au ciel de Brâhmah, chantant les louanges de Vichnou, mon seigneur, et j’expliquai au dieu bienfaisant les motifs de ma perplexité. Le créateur garda quelque temps le silence, réfléchissant à la gloire de Râm et à la force de ses illusions. Puis, interrompant sa méditation : Il n’est pas surprenant, dit-il, que tu aies été déçu par une puissance qui m’atteignit moi même à l’époque de la création. Râm t’a éprouvé par une apparence illusoire ; et après avoir déroulé une chaîne vivante qui le tenoit captif, tu as passé toute la nuit, enflé d’orgueil, à admirer ta prouesse. Cours au palais de Mahâdéo, celui de tous les dieux qui connoît le mieux la suprématie de Râm : il dissipera tes soucis.
Je dirigeai aussitôt mon vol vers Cailâs ; mais je rencontrai le dieu destructeur près de l’habitation de Cobayr, l’opulent génie du Nord. Il écouta mon récit avec bonté, et m’instruisit en ces termes : Tu es sous l’influence d’une passion violente, dont mes paroles ne sauroient t’affranchir aussi promptement que la conversation des personnages religieux et une attention sérieuse à l’histoire de Vichnou, harmonieusement racontée par de pieux mounis. À moins de converser avec les hommes religieux, on ne peut connoître les nobles faits du dieu conservateur ; sans cette connoissance, on ne peut triompher des passions ; sans ce triomphe, on ne peut acquérir la vraie piété ; et sans elle, Dieu ne sera jamais vu de l’homme, quelques sacrifices qu’il célèbre, quelques cérémonies qu’il observe. Ô Guerhoûr, vole aux régions de l’Occident, et prête une oreille pieuse, avec les oiseaux d’un : ordre inférieur, aux exploits de Râm racontés par la sage habitante de la montagne d’Azur, la vertueuse Bhoùchanda ; ce récit domptera ta passion et bannira entièrement tes douleurs. N’attends pas de moi ta guérison, puisque tu as nourri des pensées orgueilleuses au sujet de Râm, qui m’a comblé de faveurs. D’ailleurs, un oiseau transmettra plus efficacement des instructions à un autre oiseau dans leur dialecte commun.
Je n’ai pas perdu un moment pour chercher ton délicieux séjour ; et son aspect a détruit presque entièrement mon orgueil, grâce à son fruit amer, mais assuré, l’affliction. Achève ma guérison, ô ma sœur bien-aimée, en me racontant l’histoire sacrée de Râm. »
La pieuse Bhoûchanda obtempéra aussitôt à sa demande ; et ayant prononcé l’éloge du dieu incarné, elle commença par le récit de son avatar [ou descente]. Elle raconta ensuite les aventures de son enfance, les actions de sa jeunesse, et les particularités de son mariage avec Sîta. Elle apprit à l’aigle attentif comment les manœuvres de Bhârt, beau-frère de Râm, et celles de Caycai sa belle-mère, engagèrent le roi Djesr et son père à l’envoyer dans les bois, tandis que toute la nation désolée déploroit sa perte ; comment Letch’hmen, son tendre frère, insista pour l’accompagner dans son exil ; comment ils méditèrent sur la providence dans une grande forêt, et passèrent le Gange afin de prêcher des leçons de piété dans les villes populeuses. Elle dit la mort du vieux rûdjah, la pénitence de Bhârt et son voyage à la poursuite de Râm, qui, après de longues et vives sollicitations, retourna dans Ayodhyâ [Aoude], où il vécut avec la splendeur d’une divinité. Elle dit comment Râm se retira de nouveau parmi les bosquets, et y donna des instructions à des ermites et à de vénérables mounis ; comment Letch’hmen irrité défigura une géante et tua deux géans, sœur et parens de Râvan ; comment cet impérieux démon se saisit par force de l’incomparable Sîta, et transporta sa captive dans l’ile de Lankâ [Ceylan], siége de sa domination tyrannique ; comment Râm, affligé à l’excès, passa toute la saison des pluies sur une montagne, ayant contracté une étroite amitié avec la race des singes, et nommé leur chef Hanouman[5], fils du Vent, pour commander l’armée qu’il venoit de lever ; comment ils découvrirent le berceau d’asocaî[6] où Sîta étoit prisonnière ; comment ils construisirent sur la mer un vaste pont d’où Hanouman sauta dans l’île, consola la fidèle Sîta, et mit le feu aux jardins de Râvan, qui fut défait et tué par Râm dans une bataille furieuse ; enfin, comment le divin conquérant retourna dans sa patrie, rendit la joie à ses habitans désolés, conféra de grands honneurs aux doctes Brahmanes, traita son précepteur Bâsicht avec tant de respect, qu’il but l’eau dans laquelle il avoit lavé les pieds de ce mouni, et instruisit l’humble Bhârt dans la science céleste ; comment les râny[7] et les nobles vierges, après avoir baigné l’aimable Sîta, la parèrent de joyaux inestimables, et lui offrirent de saint caillé dans des bassins d’or, couronnés de branches de toulsy ; comment les princes des singes et d’autres animaux belliqueux prirent les plus belles formes humaines ; comment les hommes de tout Tang, qui accouroient en foule au palais, oubliant leurs foyers, comme les personnages pieux oublient leurs ennemis, se réunirent pour chanter les louanges de leur roi, pendant que du haut du ciel les dieux faisoient pleuvoir des fleurs sur l’assemblée ravie.
Ô monarque de l’air, ajouta la corneille, tu fus témoin des fêtes et des divertissemens qui eurent lieu, lorsqu’il reçut la marque sacrée de vermillon et monta sur le trône avec Sîta, et tu fus transporté d’une pieuse joie ; car Brâhmah, Mahâdéo, Nâred et d’autres divinités les accompagnoient, et tu n’aurois pas voulu être absent dans une occasion aussi signalée. Pendant le règne de Râm, aucune terreur n’alarma ses adorateurs ; aucune affliction ne déchira leur sein : tout fut amour, piété, concorde ; le nom de vice étoit inconnu, ou on ne l’entendoit pas prononcer. Personne n’étoit infirme, ignorant ou malheureux ; des boissons douces et salutaires découloient de chaque arbre, des fleurs qui ne se fanoient point sourioient sur chaque tige, et de beaux fruits sans cesse renouvelés pendoient à chaque branche. Un vent doux et frais souffloit sans interruption ; les oiseaux charmoient toutes les forêts par une mélodie aérienne, et les animaux des espèces les plus opposées vivoient ensemble dans une parfaite amitié, qui alloit jusqu’à la tendresse, comme la vénérable vache et son veau. Tels furent les bienfaits que Râm répandit sur le genre humain ; sa présence rendit l’âge d’argent égal à l’âge d’or en vertu et en bonheur. »
Aussitôt que Bhoûchanda eut terminé son récit : « Ô adorable Râm, s’écria l’aigle, je te révère à cause de ta puissance, et je t’aime à cause de ta bonté. Si tu n’avois pas daigné élever des doutes dans mon esprit, et m’induire au péché d’orgueil par ton divin mâyâ, comment aurois-je été guidé vers cette noble montagne ! comment aurois-je entendu le récit de tes actions glorieuses ! comment se seroit allumé dans mon sein le brûlant amour que je ressens pour toi ! »
« Moi aussi, reprit la corneille, Râm m’a exaltée, en me procurant l’honneur d’être ainsi consultée par le souverain des oiseaux. Son affection s’est hautement manifestée envers toi, et tu peux maintenant cesser d’être surpris que les plus éminens d’entre les dieux et les plus vertueux richis soient tombés sous le joug des passions. Quel être, excepté Dieu, n’a jamais été séduit par l’amour des richesses î Quel est celui que rien n’a excité à la colère ou à la vengeance, que n’ont point attiré les plaisirs de la jeunesse, dont le cœur a été à l’abri des flèches que lance la beauté des femmes, et du pouvoir de deux grands yeux languissans ! Qui peut se vanter d’avoir été toujours exempt de terreurs sans motif et d’inutiles douleurs ! De qui la réputation n’a-t-elle pas été souillée par l’orgueil ! Quel est celui que l’ambition n’a jamais captivé par de fausses idées de grandeur ! Toutes ces tentations, toutes ces amorces, sont les filles de Mâyâ ; et Vichnou emploie leurs illusions, répandues sur l’univers, à décevoir toutes les créatures pour leur avantage ultérieur. Il est l’être des êtres, une substance sous trois formes, sans mode, sans qualité, sans passion ; immense, incompréhensible, infini, indivisible, immuable, incorporel, irrésistible. Nulle intelligence ne peut concevoir ses opérations, et sa volonté fait mouvoir tous les habitans de l’univers, comme des marionnettes sont mises en mouvement par des cordes. L’homme pieux, qu’il aime comme une mère aime son unique enfant, se réjouit sous son empire et triomphe de sa gloire, tandis que les impies, qui sont orgueilleux, ignorans, captieux, et qui imputent follement à Râm les suites de leur propre stupidité, s’affligent vainement et voient tous les objets sous de fausses couleurs, de même que ceux qui ont les yeux enflammés supposent que la lune est rouge. Leur démence leur feroit croire que le soleil se lève à l’occident, et leurs craintes les agitent comme de petites barques battues par les vagues. Quand bien même seize lunes éclaireroient le firmament, on ne verroit point les.étoiles disparoître, si le soleil ne se levoit pas : ainsi le vice et l’erreur ne peuvent être dispersés sans la religion et l’humilité. Ô Guerhour, écoute l’histoire de ma vie, comme une preuve de ces vérités, et remarque les triste* effets de mon péché.
Lorsque Râm fut né à Ayodhyâ, je volai avec empressement au lieu de sa naissance ; je le servis pendant cinq ans avec assiduité, contemplant la beauté de ses traits, et recevant le bonheur de l’éclat de ses yeux. Il avoit coutume de rire quand j’approchois de lui, et de pleurer quand je m’éloignois : quelquefois il tâchoit de me saisir par les pieds, et il versoit des larmes si je m’envolois hors de sa portée. Se peut-il, me dis-je à moi-même, que cet enfant soit le maître de l’univers î Ainsi j’étois déçue par son illusion, et mon esprit étoit embarrassé de doutes : je devins triste et pensive ; mais le divin enfant rioit de mon affliction. Un jour il courut subitement pour me saisir ; mais, voyant son corps noir et ses pieds rougeâtres, je pris la fuite dans les airs avec une agitation inexprimable. Il étendit le bras ; et ît quelque hauteur que je m’élevasse, ce bras me poursuivit en gardant toujours la même distance. Dès que j’eus atteint le ciel de Brâhmah, je regardai eu arrière, et j’aperçus encore derrière moi le bras de Vichnou. Etonnée et stupéfaite, je fermai les yeux, comme ravie en extase ; et, en les ouvrant, je me trouvai près de la ville d’Ayodhyâ.
À mon retour dans le palais de Djesret, je renouvelai mon hommage à Râm : mais il se joua de ma confusion ; elle étoit si grande, que je volai dans sa bouche pendant qu’il rioit. Là je vis des milliers de cieux d’une splendeur infinie, des milliers de Rrâhmahs ef de Mahâdéos, des milliers de soleils, de lunes et d’étoiles, de dieux et de déesses, de râdjahs et de rànys ; et je contemplai avec admiration au-dessous de moi cette vaste terre ceinte de mers nombreuses, veinée de fleuves, couverte de forêts et peuplée d’animaux sans nombre. Je passai cent années complètes dans chaque ciel ; en les traversant tous, je fus éblouie de leurs gloires infinies et inexprimables : mais, par-tout où je dirigeois ma course, je voyois un être unique, Râm, le même enfant aimable dont l’idée étoit gravée dans mon esprit d’une manière indélébile.
Quand j’eus employé une période étonnante de siècles à ce voyage éthéré, je retournai dans mon habitation. Là j’appris que Râm s’étoit fait chair ; et volant au lieu de sa naissance, je jouis du ravissement de le contempler. Cependant mon cœur étoit encore agité par un ouragan de passions, et mille inquiétudes s’élevoient dans mon sein. Ram, connoissant l’anxiété que ses illusions avoient produite, se mit encore à rire, et je sortis de sa bouche. Voyant que j’avois parcouru tant de mondes et vu tant de merveilles en si peu de minutes, et considérant la puissance de l’Esprit divin, je tombai à terre hors d’haleine. Enfin je m’écriai : Aie pitié de moi, toi qui récompenses les dévots ; cesse de décevoir et d’affliger ton adoratrice humiliée. Le dieu remarquant mon angoisse, où il n’entroit point de feinte, suspendit l’influence de son mâyâ, me posa doucement les mains sur la tête, dissipa tout-à-coup ma sollicitude, et, ayant écouté avec bienveillance une prière fervente que je prononçai les yeux en pleurs, m’ordonna de demander ce que je desirois le plus. Je demandai une piété sincère envers lui, et il me l’accorda avec une louange gracieuse, ajoutée aux bénédictions célestes. Adore donc et invoque à jamais cet être invisible, qui, n’ayant point de forme, est décrit dans les Vèdes par une similitude, et comparé à un océan sans fond de vertus innombrables.
« Combien sont salutaires, dit Guerhour, les leçons d’un instituteur spirituel ! Quand bien même cent Brâhmahs et cent Mahâdéos seroient venus à mon aide, je n’aurois pas éprouvé un soulagement aussi efficace.
Après une longue conversation entre Bhoûchanda et son hôte repentant, où ils se racontèrent mutuellement leurs plus intéressantes aventures, la corneille discourut plus en détail sur la grandeur de Râm et sur la félicité de l’âge où il parut sur la terre. « Bien différent, continua-t-il, sera le kaly-youg ou l’âge de l’impureté ! Alors les prêtres, les rois et les sujets seront entièrement adonnés au vice. On négligera les saints rites et la juste distinction des rangs ; on ne regardera point la piété sincère comme le vrai, l’inestimable joyau que tous doivent rechercher. Ceux qui babilleront avec le plus de volubilité, seront honorés du titre de Pandits ; et ceux qui débiteront le plus de mensonges, le seront de l’épithète de vertueux. Ceux qui porteront des colliers de grains de chapelet et le vêtement des Gossaïns, seront respectés comme de zélés observateurs des livres inspirés ; et ceux qui laisseront croître leurs ongles, qui ne couperont point leurs cheveux, ou qui se tiendront le plus long-temps sur une jambe en tenant l’autre dans leur main, seront respectés comme de dévots Sanyâsy. La caste inférieure des Tchoudre aura des Brahmanes pour disciples, et osera porterie même cordon, tandis que les Brahmanes ne seront distingués que par la marque suivante qu’ils porteront à découvert : ils seront illettrés, avides, voluptueux, inobservateurs des rites, et semblables à des taureaux sans queue ; dissipant les biens de leurs pupilles, d> et non l’ignorance ou les chagrins de ces enfans ; et les parens eux-mêmes instruiront leurs enfans dans la gourmandise, et non dans la religion. Alors y » les râdjahs seront inexorables et débauchés, mettant h mort les Brahmanes, et imposant sans cesse des tortures ou des contributions à leurs sujets, dont a plusieurs mourront de besoin, parce que la famine ravagera de temps en a temps des provinces entières ; les nuages ne répandront point de pluie, et a le sol ne rendra rien pour les semences qu’il aura reçues. Néanmoins, dans a cet âge dégradé, la misérable race humaine pourra être sauvée par une dévotion fervente envers Râm, non manifestée par des actes extérieurs, mais brûlante dans les replis du cœur.
Assurément, dit l’aigle, les maux de cet âge seront aussi terribles que le remède en sera délicieux et certain.
Heureux, dit Bhoûchanda, ceux qui l’appliqueront fidèlement ! Mais la domination de l’orgueil est plus ou moins absolue dans le cœur de l’homme. Ce péché abominable causa mes nombreuses métamorphoses et ma condamnation à une vie solitaire parmi ces rochers.
J’étois à invoquer le nom de Mahâdéo dans un de ses temples, lorsque le guide de ma jeunesse, celui qui m’instruisit dans les devoirs religieux, y entra avec une humilité sincère. Cependant telle fut l’arrogance que m’inspiroit une vaine idée de ma piété et de mon savoir, que je ne le a saluai point, et ne lui témoignai aucun respect. Il n’ouvrit point les lèvres ; ma présomption n’excita point sa colère : mais le dieu qu’il adoroit ne la supporta point aussi patiemment, et, d’une voix terrible qui retentit du haut des cieux, il prononça contre moi la sentence foudroyante d’une misère éternelle. Ce redoutable jugement plongea mon instituteur dans une angoisse douloureuse ; ses membres tremblèrent, sa langue balbutia ; et, se jetant sur la terre les mains jointes, il supplia le dieu de mitiger mon arrêt. Tant de bonté et de zèle ne pouvoit qu’apaiser son courroux ; il parla en ces termes, du sommet de Cailâs : La justice demande le châtiment de cet orgueilleux mortel ; mais il est redevable â la piété de la rémission de ses plus grandes peines. Il subira mille transmigrations ; dans toutes, il existera sans plaisir, mais non sans sagesse. Il sera un constant adorateur de Vichnou, et invoquera assidûment mon nom : il jouira aussi de l’avantage d’être aimé de tous. La mort m’ayant fait quitter la forme humaine, je ressuscitai sous celle de serpent ; et dans toutes mes métamorphoses, je continuai d’adorer Mahâdéo, par la grâce duquel j’abandonnois chaque corps, ainsi qu’on dépose un vieux vêtement.
À la suite de plusieurs changemens, je devins un Brahmane ; mais les semences de l’orgueil germèrent de nouveau dans mon cœur. Je dédaignai les instructions de mon père, et, m’étant retiré dans les bois et sur les montagnes, je méditois sans cesse sur les attributs de Dieu. Là, j’entendis les discours d’un vénérable richi, avec qui j’eus la hardiesse d’argumenter, et de soutenir que la dévotion envers la Divinité visible ou incarnée étoit préférable à la dévotion envers la Divinité invisible. Le sage, irrité de ma présomption opiniâtre, cessa un moment d’ètre maître de lui-même, et proféra une imprécation, par l’effet de laquelle j’existe ainsi sous la forme d’un oiseau de la race la plus vile. Mais Mahâdéo ayant calmé le trouble de son esprit, il se repentit de sa colère ; et lorsque je pris ma forme actuelle, il me consola par des expressions affectueuses, me donna le mentre ou formule d’enchantement de Râm, me conseilla de tenir compagnie au dieu pendant son enfance, et de chercher ensuite cette retraite, où j’ai passé des milliers d’années. Il termina en me donnant sa bénédiction, qui fut ratifiée en ces termes par une voix céleste : Que les vœux de l’ame pieuse soient accomplis !
Je me suis convaincue ici de plus en plus que les ignorans qui négligent la vache Camdhen, source de toute félicité véritable, et qui n’aspirent qu’aux voluptés des sens, ressemblent à ceux qui cherchent l’herbe acun f mais ne désirent que son lait ; que les hommes sans religion sont pareils à ceux qui essaient de traverser l’océan sans vaisseau ; et que, quoique l’aine humaine soit une émanation immortelle de la Divinité, ceux » qui sont dominés par leurs passions, deviennent semblables à des perroquets enfermés dans une cage, ou à des singes attachés par une chaîne. II n’en est pas ainsi des hommes religieux qui étudient les Vèdes et pratiquent de bonnes œuvres ; ils ressemblent à des vaches qui pâturent dans des plaines verdoyantes, les mamelles chargées d’un lait pur, dont le berger remplit son vase, qu’il fait bouillir, qu’il laisse ensuite refroidir au grand air, dont il fait du caillé et du beurre délicieux. La piété est le feu qui augmente la bonté du lait ; elle brûle les taches du vice. Le repentir forme le beurre, qui, changé en huile, entretient la lampe de l’entendement, à l’aide de laquelle on parcourt les livres divins et on découvre des vérités lumineuses. Les dieux propices aiment alors à coopérer avec les mortels. Il y a dans chacun de leurs sens plusieurs treillis, où les dieux veillent continuellement ; et si par mégarde Famé les laisse ouverts au vent brûlant et pestiféré de la tentation, l’invocation sincère de ces gardiens célestes préservera la précieuse clarté d’une extinction totale. »
L’aigle transporté écoutoit avec attention les sublimes préceptes de Bhouchanda. Il la pria de compléter ses leçons, en définissant la plus excellente des formes naturelles, le souverain bien, la plus grande douleur et le plus grand plaisir, la plus grande scélératesse et le châtiment le plus rigoureux.
Je vais, répondit la corneille, les décrire avec précision. Dans les trois mondes, empyrée, terrestre et infernal, aucune forme ne l’emporte sur la forme humaine ; la suprême félicité sur la terre consiste dans la vraie piété, et dans le mépris des avantages mondains ; la plus grande des jouissances est la conversation des hommes dévots et vertueux ; la douleur la plus vive est l’effet de l’extrême pauvreté ; le péché le plus odieux est le défaut de charité ; et les hommes dépourvus de charité, qui ne manquent jamais de blasphémer les dieux et de mépriser les Vêdes, seront punis dans les dernières profondeurs de l’enfer, tandis que ceux qui méprisent leurs guides spirituels vivront éternellement sous la forme de grenouilles ; ceux qui méprisent les Brahmanes, sous la forme de corneilles ; ceux qui méprisent les hommes pieux, sous la forme de corbeaux nocturnes ; ceux qui méprisent les autres hommes, sous la forme de chauves-souris : tant les » passions déréglées engendrent d’infortunes !
Comment, continua Bhoûchanda, celui qui chérit tous les hommes, et que tous les hommes chérissent, seroit-il déchiré par l’affliction î Comment celui qui possède la pierre paras, seroit-il dans l’indigence ! Comment ceux qui haïssent leurs voisins, peuvent-ils être exempts de terreur, ou les voluptueux de souffrance ! Comment prospérerait un pays où les Brahmânes sont injurieusement traités ! ou comment subsistera un royaume où l’on ne rend point la justice ! Comment celui qui agit avec circonspection, peut-il manquer de réussir ! Comment ceux qui ne méprisent pas les gens vertueux, seront ils tourmentés d’appréhensions fâcheuses ! Comment le séducteur de la femme d’autrui seroit-il sauvé de la perdition ! ou comment celui qui murmure contre la providence, couleroit-il d’heureux jours ! Qui peut être glorifié sans mérite ! qui peut être déshonoré sans blâme ! Enfin, comment le péché habitera-1-il dans lame de celui qui écoute l’histoire de Râm et chante ses louanges ! Il n’est point de bonheur égal à la pure dévotion de ses adorateurs ! »
Voyez, sur les nombreux poèmes intitulés Ramayan, ma note ci-dessus, pag. 80-82.
(80) Que les Européens appellent miote. Voyez le Voyage aux Indes et à la Chine, &c. par Sonnerat, t. I.er, p, 172, de l’édition in-4.°
(81) Voyez la note 59, page 242.
(82) Voyez la note 78, page 251.
(83) Ou la demeure de la neige. Ce nom est dérivé du mot sanskrit halmas [neigeux] ; de là peut-être le mot latin hiems. On les nomme aussi Himala et Emodi, d’où les anciens ont formé le mot Imaùs, C’est cette chaîne de montagnes couvertes de neige que l’on voit d’une partie du Bengale, et qui sépare l’Inde de la Tatârie. Elle se divise en deux branches, orientale et occidentale, lesquelles s’étendent jusqu’k l’océan : la branche orientale se nomme Tchandrasic’hara [rocher de la Lune] ; l’autre, qui se prolonge vers l’ouest jusqu’aux bouches de l’Indus, étoit connue des anciens sous le nom de Montes Parveti. Les Indiens regardent ces montagnes comme sacrées ; ils supposent qu’elles sont le séjour terrestre du dieu Isouara, une de leurs fictions poétiques personnifiées. Le mont Himâlaya est représenté comme un puissant monarque, qui avoit Mênâ pour épouse. Leur fille se nommoit Pârvati [née de la montagne], et Dourgâ [de difficile accès] : les Hindous croient que, dans une existence antérieure, elle avoit épousé Sîva, et qu’elle portoit alors le nom de Sati. Cette fille du mont Himâlaya eut deux enfans ; savoir, Ganesa, ou le seigneur des esprits, que l’on adore comme le plus sage des dieux, et dont nous avons parlé assez amplement ci-dessus, p. 22i ; et Coumara, nommé aussi Shanda et Cârtigueya, chef des armées célestes. Voyez Wilkins’s Notes on the Bhaguat-Geeta, p. 145, édit. in-4.° ; et Hymn to Pracriti, t. II, p. 319, des Works of sir Will, Jones.
(84) برهمپثر ou Brahmâ-poutre برهماپتر [enfant de Brâhmah]. C’est le nom que les Hindous donnent à un très-grand fleuve dont ils placent la source dans la bouche de Brâhmah ; fable qui prouve que cette source leur est peu connue : et c’est un point, en effet, sur lequel les voyageurs et les géographes ne sont pas d’accord. Ceux qui paroissent les plus dignes de confiance, sont les Lamas qui furent chargés, par l’empereur Kan-hi, de dresser des cartes du Tibet et de la Tatârie orientale. Ces Lamas, qui paroissent avoir examiné les lieux très-soigneuseinent, placent la source du fleuve dont il s’agit sur le côté oriental du mont Kentaisse, à quarante milles environ du lac Mansaroar. M. Turner porte cette source, ainsi que celle du Gange, dans ce lac même qu’il appelle Mansororé, à un mois de distance de la ville de Tichou-Ioumbou, ou Trachi-Ihouinbou, comme le prononçoit un Potya ou Tibétain que M. Jones a consulté. Ce fleuve traverse entièrement le Tibet ; il passe auprès de la forteresse de Rimbou, de file de Palté ou d’Yambro, où réside, dit-on, une prêtresse non moins célèbre que la déesse Bhâvanî chez les Hindous ; il coule ensuite, à quelque distance nord de Tichou-loumbou, dans un vaste canal parsemé d’îles. Un peu au-delà de Tichou-loumbou, notre fleuve reçoit les eaux du Païnomtchieu, rivière assez considérable, qui vient, ainsi que plusieurs autres, perdre son nom et ses eaux avant qu’il passe au sud de Lhassa. De là il fait un circuit autour des montagnes limitrophes du Tibet, pour entrer dans le royaume d’AchAm, où il reçoit les eaux sacrées du Bràhma-kound [fontaine de Brâhmah], pénètre dans le Bengale au-dessous de Rangainati, l’ancien Rhandamarcotta ou Rhangamar, célèbre par son nard ( tome IIt p. 445). Bientôt il se joint au Gange, un peu au-dessous de Dhakka. Ces deux fleuves réunis perdent leur nom primitif, et s’appellent alors Megna ou Poudda ; ils se divisent en nombreux canaux, qui forment un labyrinthe inextricable à l’endroit où ils se jettent dans la mer. Le Brâhma-poutre § comme plusieurs autres rivières du Tibet, charie une si grande quantité de sable d’or, que le râdjah d’Achâm emploie jusqu’à dix mille hommes pour le ramasser.
L’Ayïn Akbery, ouvrage dans lequel je comptois trouver quelques détails curieux sur le Brahma poutre s se borne à nous apprendre que « c’est une » rivière qui coule du Khotâï dans le Kaùtch (portion du Béhûr), et de » là par le canton de Bàzoùhâh jusqu’à la mer. » بَرهم پتربغتح با و سكون را وهاي خغى وميم و ضم باي فارسي و سكون ياي فوقاني و را از ختابكوج آيد و از انجـــا بسر كارنازوها سيران سازد وبشور دريا در شـــود (Ayïn Akbery, p. 150 verso de mon manuscrit.) Les géographes chinois ne sont pas beaucoup plus satisfaisans, si l’on en juge par l’extrait donné par M. Amiot dans son ouvrage intitulé Introduction à l’histoire des peuples tributaires de la Chine, à l’article Ya-lou-tsang-pou-kiang, tome XIV, page 177, des Mémoires concernant les Chinois, ce Cette rivière, disent les géographes de l’empereur, prend sa source à l’ouest du Tsang, au nord-ouest de Tchouo-chou-te-pou-to, à la distance d’environ trois cent quarante lys de la montagne Ta-mou-chou-kodca-pa-chan, Elle reçoit plusieurs ruisseaux avec lesquels elle coule l’espace d’environ deux mille cinq cents lys, » après quoi elle passe au nord de Ka-mou-pa-Ia-ling, entre les terres des Ouei [le Tibet proprement dit, dont la capitale est Lhassa], va au nord-est de la ville de Ge-ka-eulh-koung-ka-eulh-tcheng ; elle se jette dans la rivière de Ka-eulh-tchao-mou-loung-kiang. Ces deux rivières coulent dans un même lit l’espace de douze cents lys vers le sud-est, passent au midi des Ouei [le Tibet], dans le royaume de Lo-ha-pou-tchan [le Boutan], tournent ensuite vers le sud-ouest, entrent dans le royaume de Ngo-no-té [le Bengale], d’où elles se jettent dans la mer du Sud [le golfe du Bengale]. »
Je dois convenir que je n’aurois jamais reconnu le Brahmâ-poutre dans l’article ci-dessus, si je n’eusse appris par M. Rennell que c’étoit la même rivière que celle qui est indiquée dans la Description de la Chine du P. du Halde, sous le nom de Yarou-tsan-pou ou dsan-pou. Ce dernier mot a le même sens que Ganga ڪَنكَ dans l’Hindoustan, et désigne en général toutes les grandes rivières ; mais on l’applique plus particulièrement à celle qui nous occupe. C’est ainsi qu’à la Chine le mot kiang, qui signifie fleuve, désigne spécialement le grand fleuve Yang-tse-kiang, qui partage ce vaste empire. Je n’ai pu découvrir d’après quelle autorité M. Jones a avancé que san-pou signifie bonheur suprême, Le savant missionnaire que nous venons de citer, ignoroit dans quel endioit se décharge le Tsan-pou, et avoit cependant conjecturé que son embouchure devoit être dans le golfe du Bengale. Les Anglois se sont convaincus de la vérité de cette conjecture. Outre les noms que nous venons de citer, le même fleuve porte ordinairement au Tibet celui d’Erechoumbou. Voyez Description de la Chine par du Halde, t. IV, p. 584-585, édit, in-4.° ; Rennell’s Memoir for a map of Hindoostan, p. 275-278 ; Turner’s Embassy to Tibet, p. 297, édit. in-4.°, et t. II, page 67, de la traduction française ; et ci-après, t. II, p. 217, note A ; Jone’s Hymn to Ganga, dans l’Asiatick Miscellany, t. I, p. 257, et t. VI, p. 383, de ses Œuvres.
(85) La huitième incarnation de la Divinité. Voyez, sur les avatars, la note 38, ci-dessus, page 234.
(86) Le troisième fils de Pandou et le favori de Crichna.
(87) صوفي Voyez ma note 2 sur ce mot dans le tome II, page 106.
(88) Ce dernier mot a beaucoup de ressemblance avec le nom de Bacchus, dont on cherche vainement l’origine et la signification dans les langues grecque et latine. On verra en outre, dans une de mes notes suivantes (pag. 277, 281), les nombreuses conformités qui existent entre Sîva et Bacchus, que les anciens regardoient eux-mêmes comme une divinité originaire de l’Inde.
(89) Sourâ, en langues sanskrite et hindoustâne, est un des noms du vin. Voyez Gilchrist’s English and Hindoostanee Dictionary, &c. ; Calcutta, 1787-1801 ; tome II, page 1 82 de l’appendix, édit. in-4.° De ce mot, sans doute, est dérivé le composé سوري مشكخصي soùry mochkhessy [taxe sur les liqueurs spiritueuses] que l’on trouve dans le Dictionary of Mohammedan laws, Bengal revenue terms, shanskrit, hindoo, and other words, &c, &c, by Rousseau ; London, 1802.
(90) Par le mont Mérou, suivant la plupart des mythologistes. Voyez ci-dessus la note 419 page 235.
(91) Mahâdêva [grand dieu] : c’est un des surnoms de SI va, la troisième personne de la Trinité indienne. Il porte, en effet, un trident nommé trisôula, pour indiquer sa puissance dans le ciel, sur la terre et dans l’enfer. Ce trident ressemble beaucoup à celui que les Égyptiens plaçoient sur le front de leur Osiris ou Soleil, le même que Sîva, Mahâdêva et Bacchus. Les Saiva ou Sivaya [les sectateurs de Siva] portent ce signe sur le front ou sur la poitrine. Voyez Viaggio aile Indie Orientait, &c, da Paolino da S. Bartolomeo, pag. 297-298, et page 340 de la traduction angloise.
(92) La grande fête de Bhavânî, qui se célèbre à la fin des pluies en jetant l’image de la déesse dans le Gange ou dans un autre fleuve sacré. Voyez Jones’s Hymn to Pracriti, tom. III, pag. 317 et suiv. de ses Works,
(93) Triśôula, trident que le dieu Sîva, Roudra ou Mahâdêva, porte à la jnain ; ce qui lui a fait donner le surnom de śôuli, ou porte-trident. C'est le signe de sa puissance dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Ce triple gouvernement est exprimé par le mot sanskrit Tripourandaga, c'est-à-dire, Dieu qui gouverne les trois mondes, figurés par trois montagnes appelées Tripoura. Le triśôula ou τρίοδους diffère très-peu, quant à la forme, de celui qu'on remarque sur la tête du dieu égyptien Osiris, et qui doit probablement désigner aussi un triple empire. Suivant le P. Paulin (Viaggio, p. 298 ), dont je partage l'opinion, Osiris ou le Soleil est le même que Sîva ou Mahâdêva, c'est-à-dire, le grand dieu, chez les Égyptiens comme chez les Indiens. Les Saiva, c'est-à-dire, les Hindous qui ont une dévotion particulière pour Sîva (voyez ci-dessus ma note, p. 214), portent ce signe sur le front ou sur la poitrine ; et ils l'appellent quelquefois rounâma [nom saint] : c'est ainsi qu'on lisoit le nom ineffable de יְהוָה Jéhovah sur le front du grand-prêtre des Hébreux ; et les Hébreux eux-mêmes suspendoient le Décalogue sur leur front. Saint Jérôme observe à ce sujet que les Indiens et les Persans portoient de semblables signes. On vient de voir que les Indiens modernes conservent encore aujourd'hui cet usage ; mais je n'en trouve aucune trace sur les anciennes médailles perses, ou dans les monumens rapportés par MM. Hyde, Anquetil et Silvestre de Sacy.
(94) C'est sur-tout pour ce qui regarde Jupiter que les rapprochemens de notre auteur manquent de justesse. Avec un peu d'attention, il est aisé de s'apercevoir que les attributs de ce dieu conviennent à plusieurs divinités indiennes. Pater Deorum conviendroit à Brâhmah, juvans pater à Vichnou, Jupiter ultùr à Mahâdêva ou Sîva, fulminans à Indrâ. Comme planète, c'est le même que Vrihaspati, qui préside aux bons génies. Neptune et Pluton n'ont aucun rapport avec Varouna et Couvèra, qui ne sont que des génies très-insignifians : l'un préside à l'eau, et le second aux richesses. Le rapprochement de Jov ou Zeus avec Sîva est bien hasardé, sur-tout quand on sait que les anciens nommoient Sîva, Bacchus ou Bâguîs, Il valoit mieux convenir que les sectateurs des Pourânas ne connoissent pas de dieu qui ressemble à Jupiter. Ils sont réellement monothéistes, et ne reconnoissent au fond qu'un seul dieu,dont Us personnifient les attributs. (Note communiquée par mon ami Hamilton.)
(95) Ou Pàrvadî, souveraine des montagnes. Voyez Systema Brahmanicum, &c. page 99 ; ma note 109,page 271, et la note*, tome II, page 371. M. Hamilton reconnoît bien la ressemblance qui existe entre les attributs généraux de Pârvadî et de son fils Cârtiguêya et ceux de Junon et de Mars ; mais comme Junon n’a rien de guerrier, M. Jones est obligé de lui associer Pallas, qu’il découpe ensuite pour en former Saresouatî, déesse des arts, de la littérature et de la musique. Ici encore, comme dans bien d’autres circonstances, le parallèle manque de justesse. Des polythéistes peuvent bien avoir une déesse des armes et de la science ; mais, lorsque ces attributs sont divisés par d’autres, il n’y a plus moyen d’établir ces rapprochemens.
(96) Cârtiguêya, Coumara ou Soubramanya, est le troisième fils de Sîva, que le P. Paulin regarde comme l’emblème du soleil. Cârtiguêya est, selon lui, l’Hercule indien, qui naquit de Pârvadî, épouse de Sîva. Elle le conçut en l’absence de son mari, soit par un adultère, soit par la force de ses propres désirs. II eut pour nourrices et pour institutrices six étoiles. Le muséum de M. le cardinal Borgia renferme une figure de ce dieu en bronze : il est assis sur un paon, et a six têtes. Soubramanya est le nom propre du dieu dont il s’agit ; Cârtiguêya, une de ses épithètes, qui indique les services qu’il a reçus de l’étoile Cârtica, l’une des vingt-sept mansions que parcourt la lune chaque mois. Celte étoile se trouve en effet indiquée dans le Voyage de Sonnerat, tome page voy, édit, in-4o, et dans le catalogue donné par les Indiens (ci-après, tome II, p, 338) : nouvelle preuve, dit le P. Paulin de Saint-Barthélemi, que tout le système de la mythologie brahmanique repose sur une base purement astronomique, et que chez les Brahmanes, aussi-bien que chez les Chaldéens et les Persans, le sabéisme originel a dégénéré en idolâtrie. Cette opinion n’est point du tout celle de mon ami M. Alexandre Hamilton. II pense que cette mythologie est purement figurative de la puissance et des attributs divins. Cârtiguêya se nomme encore Gouha [né d’un antre]. Gouhya signifie la matrice de la femme, parce que ce dieu naquit ou vit la lumière dans le même accès voluptueux où Pârvadî sa mère le conçut : de Ik, sans doute, cette ancienne fable grecque qui fait naître Hercule dans un antre de Scythie, et qui place aussi sa mère dans un antre. Enfin un autre surnom de Cârtiguêya, non moins remarquable que les précédens, est Skanda, mot qui indique la célérité de la marche, l’action de précipiter ses pas, parce que ce dieu fait rapidement la revue de son armée céleste ; il est monté sur un paon couvert d’yeux, pour indiquer que la vigilance et la célérité doivent être les qualités essentielles d’un général. Skanda, dit le P. Paulin, est donc une divinité indienne et non pas scythique, et c’est l’origine du nom Scandinavie donné à cette extrémité septentrionale de notre hémisphère, habitée par les Scythes. Ceux-ci, par leurs communications avec les Indo-Scythes, ont reçu le nom de la divinité Skanda, ainsi que Bout, Vodin, Odin ou Teut, qui est le même que Bouddha, Hermès ou Menou, fondateur et roi de la nation indienne. Voilà pourquoi Tacite appelle le premier, Tuiston [ ou Mars], mot que nous retrouvons dans Tuesday [ou Mardi], enfant de la terre, et son fils Afannus, principes et fondateurs de la nation Scandinave. Voyez De moribus Germanor. c. il ; et Scheidius, de Dûs Germants, pag. 194 et 473. Ajoutons, d’après les Annales Boiorum d’Aventinus, lib. i, que Tuiston passe pour l’inventeur des lettres celtes ; ce qui lui donneroit quelque conformité avec Hermès. Le culte religieux que les descendans modernes des Scythes, tels que les Tatârs, les Moghols, les Calmouks, et même les Sibiriens, rendent au grand Lama du Tibet, prouve leur attachement à la religion de leurs pères ; car le lamisme et le brâhmisme ont une source commune, ou l’une de ces religions a donné naissance à l’autre. Enfin ce Skanda ou Cârtiguêya qui nous a entraînés dans une si longue digression, paroît être, comme l’observe très-bien M. Jones, l’Iskander aux deux cornes اسكندر ذو القرنين ou Alexandre Persan, que l’on a mal-à-propos confondu avec Alexandre le Grec اسكندر رومي. Cette distinction est incontestable, et me paroît avoir été démontrée jusqu’à l’évidence par âl-Maqryzy dans un chapitre de sa Description de l’Égypte, intitulé, de la Différence qui se trouve entre les deux Alexandres. Voyez l’extrait de ce chapitre dans mes notes sur le Voyage de Norden, tome III, page 186, édit, in-4o.
(97) Les exploits de Dourgâ, dans son caractère belliqueux, comme protectrice de la vertu, et son combat avec un démon caché sous la forme d’un buffle, sont le sujet de plusieurs épisodes des Pourânas et des Cavyâs, c’est-à-dire, des poèmes sacrés et populaires. Jones’Hymn to Pracriti, tome VI, pag. 317 et suiv. de ses Œuvres.
(98) Voyez ci-dessus mes notes sur Dourgâ, pag, 261 et 265.
(99) Curis signifioit une lance en langue sabine : de là le surnom de Quirinus donné à Romulus, parce qu’il portoit une lance. Junon se nommoit aussi Curis, parce qu’elle portoit la lance ainsi appelée. Voyez Pomponius Festus, de verbor, signifie, p. 45, ex edit. Scalig. Un commentateur d’Ovide observe que Curinus, et par corruption Quirinus, étoit aussi chez les Sabins le surnom de Mars, qui n’avoit originairement chez eux et chez les Romains d’autre statue qu’une simple lance. Voy ! Ovid. Fast. lib. Il, vers. 477 » ex tdit. Burmanni.
(100) Histor. Deorum Syntagma pag. 128.
(101) ὁπλοσμία.
(102) Πανοπλία, armure qui couvre tout le corps, armure entière de la tête aux pieds.
(103) Grammaire sanskrite, dont on trouve la première partie ( celle qui traite des verbes) indiquée dans le Catalogue des manuscrits indiens de M. Jones. Voyez page 1 1, n.° 39, du Catalogue of sanskrit manuscrits presented to the royal Society by sir Will. and lady Jones ; by Charles Wilkins. Nota. C’est par erreur que le renvoi dans le texte a été placé après le mot Minerve ; U est aisé de voir qu’il appartient au mot Sâresouata.
(104 et 105) Saïs, ville célèbre d’Égypte, où les Pharaons ont fait longtemps leur résidence. Elle étoit située entre le canal Canopique, aujourd’hui canal de Mo’êz, خليج معزيه et le canal Saïtique, à deux schoenes [ou un peu plus de deux lieues] de la ville de Naucratis, qui, étant sur le canal Canopique, se trou voit un peu plus à l’ouest. M. Larcher ( Table géogr., tome IX, pag. 477 et 478, de sa traduction de l’Histoire d’Hérodote, 2.° édit.) pense que Sais est la même ville que la Tsôân צואן de l’Écriture, quoique la plupart des interprètes, ainsi que MM. J. R. Forster, Michaëlis et d’Anville, aient prétendu que les Hébreux avoient désigné sous le nom de Tsôân, la ville égyptienne nommée Tanis [Τανις] par les Grecs. Je crois pouvoir reconnoître cette dernière dans les ruines qui portent aujourd’hui le nom de Tennys {ar} et dont un des officiers les plus distingués de la brave armée d’Égypte, le général Andréossy, a donné la description dans son excellent Mémoire sur le lac MenzAleh بركت منزاله Nous devons au même officier la découverte et la description des immenses ruines de ce qui constituoit autrefois la cité royale de Saïs ou Tsôân, laquelle, comme l’observe très-bien M. Larcher, devoit être incomparablement plus vaste et plus magnifique que Tanis, dont Josephe et d’autres anciens auteurs ne patient que comme d’une ville médiocre. Ces ruines portent aujourd’hui le nom de Ssân صان ; le géographe arabe Chéryf Edrycy les nomme Ssâh صاه : j’ignore la cause de cette légère différence dans la dénomination du même lieu. Au reste, le premier de ces mots se rapproche beaucoup du Tsòân hébreu : le second paroît avoir été hellénisé dans le mot Saïs [Σαις] ; et je crois avoir pour appui de mon opinion le savant major Rennell, qui, ne connoissant encore que l’orthographe de l’Edrycy, a dit (dans son Geographical System of Herodotus, p. 529 et 531) : « Sah (lisez Ssâh » صاه) est l’emplacement de l’ancienne Saïs. »
Cette ville, dans laquelle les Pharaons firent long-temps leur séjour, et où naquit celui que les Grecs nomment Amasis, renfermoit de magnifiques monumens, comme on peut en juger par les ruines encore subsistantes à Ssân. Nous savons qu’il y avoit un temple fameux consacré à Néïtha, divinité égyptienne, qui avoit tant de conformité avec la Minerve des Grecs, que Platon (in Timœo) a prétendu que c’étoit la même divinité ; et cette opinion a été adoptée par tous les écrivains grecs et latins qui lui sont postérieurs. Une circonstance qui semble donner un nouveau degré de probabilité à cette opinion des anciens, c’est le nom de Saïs, que l’on soupçonne avec beaucoup de fondement devoir son origine au ϫⲁⲓⲑ djaïth qobthe, qui signifie de l’huile ; זית zeit en hébreu, et زيت en arabe. L’olivier étoit, comme on sait, consacré à Minerve chez les Grecs. Malgré ces rapprochemens, le docte Jablonski persiste, d’après plusieurs motifs savamment déduits dans son Pantheon Ægyptiorum, t. I, p. 63-68, à croire que Néïtha a bien plus de conformité avec Vulcain qu’avec Minerve, 1.° parce que, comme Phtha, ou le Vulcain égyptien, elle réunissoit les deux sexes : voilà pourquoi, suivant Horus Apollo (Hieroglyph. lib. I, cap. 12), Minerve étoit représentée sous l’emblème du scarabée, et Vulcain sous celui du vautour ; c’étoient les seuls dieux qui fussent à-la-fois du sexe masculin et du sexe féminin. 2.° La célèbre inscription du temple de Saïs, rapportée par Plutarque, et dont parle ici M. Jones, est une autre preuve que Jablonski allègue en faveur de son opinion : Ἐγὼ ἔιμι πᾶν τὸ γεγονός, καὶ ὂν, καὶ ἐσίμενον · καὶ τὸν ἐμὸν πέπλον οὐδείς πω ἀπεκάλυψεν. JE SUIS TOUT CE QUI FUT, EST ET SERA ; ET NUL ÊTRE N’A ENCORE LEVÉ MON VOILE. Cette inscription, dit-il, si elle est véritablement authentique, explique pourquoi Néïtha étoît une divinité masculo-féminine ; elle enfermoit en elle toutes les facultés de la nature, ou plutôt c’étoit la nature même personnifiée. Quoique cette version de l’inscription du temple de Saïs soit très-favorable à son système, notre savant en soupçonne l’authenticité par plusieurs raisons que l’on peut voir pag. 65 et 66 du Panthéon ; il préfère la version de Proclus (in Timœum, p. 30) : Τὰ ὄντα καὶ τὰ ἐσόμενα, καὶ τὰ γεγονότα, ἐγώ ἔιμι. Τὸν ἐμόν χτῶνα οὐδεὶς ἀπεκάλυψεν· ὂν ἐγὼ καρπὸν ἔτεκον, ἥλιος ἐγένετο. JE SUIS CE QUI EST, SERA ET FUT. PERSONNE N’A LEVÉ MA ROBE ; LE FRUIT QUE J’AI PRODUIT EST LE SOLEIL. Jablonski trouve cette leçon bien plus conforme au style et à la mythologie des Égyptiens. Au reste, quelle que soit celle que l’on adopte, toutes deux nous représentent Néïtha comme l’emblème de la nature et de la sagesse divine : c’est sans doute à cause de cela que, dans des temps plus modernes, on la fit présider aux beaux-arts et à toutes les productions du génie. Sa haute antiquité paroit, suivant Jablonski, indiquée par son nom même, qui, en qobthe, doit être écrit ainsi : ⲛⲉⲓⲑ néïth ou ⲛⲉⲓⲧ néït [ancien ou ancienne]. C’est le nom que Dieu se donne à lui-même dans Daniel, VII, 9, 13, 22 : עתיק יומין [l’ancien des jours]. Ce rapprochement entre les idées égyptiennes et les idées hébraïques m’en rappelle un autre non moins remarquable ; Dieu, parlant à Moïse dans le buisson ardent, lui dit : אֽהְוֶהֽ אֲשֶׁרֽ אֶֽהְיֶאֽ ; JE SUIS CELUI QUI EST. Exod, III, 14. Voyez aussi les mêmes-expressions employées par Menou, ci-dessus page 249.
(106) Câlidâsa, fameux poète dramatique indien, florissoit dans le premier siècle avant l’ère chrétienne. Il est unanimement reconnu pour le premier des neuf poètes désignés ordinairement sous le nom des neuf Perles, que Vicramaditya (ou Becker-madjit) entretenoit à sa cour. Outre le drame de Sacontala, traduit en anglois par M. Jones, on connoît de lui différentes pièces, entre autres une en cinq actes, intitulée Ourvasî ; un poème épique, ou plutôt une suite de poèmes en un livre, sur les enfans du Soleil ; un autre, dans lequel on trouve une parfaite unité d’action, sur la naissance de Coumara, le dieu de la guerre ; deux ou trois contes d’amour en vers ; et un excellent petit traité de la prosodie sanskrite, précisément dans le genre du Terentianus. Il passe pour avoir revu les ouvrages de Vyâsa et de Vâlmik ; il a corrigé les textes qui ont cours maintenant. Personne ne lui conteste la première place après ces deux anciens poètes. Voyez la préface de Sacontala, or the fatal Ring, translated from the sanscrit and pracrit by W. Jones, et mes notes, page 310, et tome II, pag. 184 et 409.
(107) Le beurre clarifié, que les Indiens nomment ghy ڭهي. Voyez ma note ci-après, page 315.
(108) Ce passage, cité par M. Jones, est la bénédiction que prononce un Brahmane au commencement du prologue de Sacontala.
(109) Bhavânî [qui donne l’existence]. Voyez les différens noms de cette déesse dans ma note a, tome II de ces Recherches, page 371. J’ajouterai ici quelques détails à cette note imprimée antérieurement à celle-ci. Les Indiens représentent Bhavânî comme les anciens représentoient Isis, sous la figure symbolique des parties naturelles de la femme, nommées meddhra en sanskrit, mot qui ressemble beaucoup au grec μήτρα [matrice]. La figure symbolique se nomme Yônî. Cette dignité a passé avec son nom chez les Persans, qui, suivant Hérodote, appeloient la lune Mitra ; elle étoit nommée Alitta (plus correctement Êlat الة chez les Arabes, Militta chez les Assyriens, Diane chez les Grecs. Parmi ses innombrables fonctions, on lui attribue la garde des ports, des fleuves, des étangs et de la mer. Bhagavadî, comme la Diane des Grecs, assiste aux enfantemens, punit les impies par la peste. La fête dont parle M. Jones, se célèbre le 7 de la nouvelle lune de mars, et dure huit, neuf et dix jours ; le dernier jour, on plonge l’image de cette divinité dans le Gange. (Voyez ma note 122, ci-dessous, p. 282.) Un Brahmane la porte sur un éléphant, à l’ombre d’un dais ; il est accompagné d’une multitude d’instrumens de musique, de danseuses, et d’un peuple immense qui se livre à la joie, et qui chante des chansons obscènes relatives à la génération, dont cette déesse est la protectrice et l’origine, ainsi que son époux Siva ou Chixa [le Soleil], Les Brahmanes la lavent et l’aspergent en qualité de maîtresse de l’humidité, laquelle, jointe à la chaleur, favorise la fécondité et la génération. Voyez Viaggio alle Indie orientali, &c. dal P. Paolino da S. Bartolomeo, p. 79-114 ; Holwell’s Interesting historical events &c. iie part. p. 137 ; et ma note 122, ci-dessous, page 282.
(110) Macrobe nous apprend que les habitans de l’île de Cypre repréreprésentoient sentoient Vénus avec un corps couvert de poils, mais avec un vêtement de femme et une taille virile, parce qu’ils croyoient qu’elle réunissoit les deux sexes. Voyez Macrobii Saturnal. lib. iii, cap. 8, p. 28 Londini, 1694. La Vénus syrienne réunissoit aussi les deux sexes. Voyez, sur cette déesse, l’excellente dissertation de M. Larcher et celle de l’abbé de la Chau, publiées toutes deux dans la même année 1776.
(111) Statue double de Mercure et de Minerve : ce mot est composé de Ἑρμῆς [Mercure] et Ἀθηνά [Minerve]. Les Romains avoient coutume de réunir ces deux statues et de les placer dans leurs gymnases, comme Cicéron nous l’apprend dans sa 4e lettre à Atticus, liv. I.er.
(112) Voyez cette figure dans le Voyage de Sonnerat, tome II, pl. 54, page 179, édit. in-4.°
(113) Câmadêva [dieu du désir] est le nom du Cupidon indien, dont les nombreuses épithètes, rapportées dans l’Amarasinha, ne sont pas moins ingénieuses qu’agréables. Voici les plus remarquables : madana, vif, folâtre, enivré ; mannmatha, qui enivre le cœur, l’esprit, la volonté ; mâra, caché, mystérieux ; ananga, sans corps, subtil, léger ; pantcha chara, ayant cinq fleurs (pour arc et pour flèches) ; manasidja, qui naît du cœur, de la volonté, et vainqueur de la volonté et du cœur ; âtmabhou, existence de l’ame, ou existant dans l’ame ; magaradouadja, né (du signe) du capricorne. Cette épithète, tirée de l’astronomie, semble prouver que la mythologie indienne n’est pas étrangère à cette science. D’après les dispositions lascives du capricorne, il n’est pas étonnant qu’on ait choisi sa constellation pour père du dieu de l’amour. Sa mère est Maya, ou la force générale attractive ; et son épouse se nomme Retti, ou affection. Son favori est Vassant, vulgairement Bessent بسنت en hindou, le printemps. On le représente comme un beau jeune homme, quelquefois s’entretenant avec sa mère ou sa femme, au milieu de ses jardins et dans ses temples ; quelquefois monté sur un perroquet et se promenant au clair de la lune avec de jeunes danseuses, dont la plupart portent ses attributs, qui consistent en un poisson sur un fond rouge. Il se plaît particulièrement dans un vaste canton situé autour d’Agrah, et sur-tout dans la plaine de Mathoura, où Crichna, ainsi que les neuf Gopîas, ont aussi coutume de passer la nuit à faire de la musique et à danser. Une canne à sucre ou une tige de fleur forme le bois de son arc, qui a une corde composée d'abeilles : ses cinq flèches, qui correspondent sans doute aux cinq sens, sont armées chacune d'une fleur de l'Inde, qui a la vertu d'échauffer ; une de ces flèches se nomme mellica, C'est le nyctantes de nos botanistes, qui rejettent mal-à-propos les noms indigènes de la plupart des plantes de l'Asie. Le poète dramatique Câlidàsa parie fort élégamment de cette plante et de Câmdéo dans les deux vers suivans :
Mellicamoucoulè bhâti goundjanmattamadhouvratah
Prayanè pantcha oànasya sankhamâpourayanniva.
« L'abeille enivrée brille et bourdonne dans la mellica récemment épanouie, comme celui qui prête un souffle à une conque blanche dans la sj procession du dieu à cinq flèches. »
Les Hindous croient que Câmdéo est réduit à une essence intellectuelle, depuis qu'il osa attaquer Vichnou ou Mahâdéo. Ce dieu puissant, pour le punir de sa témérité, lança sur lui une flamme qui dévora toute sa substance corporelle : Câmdéo exerce maintenant son empire suri'esprit des mortels et sur celui des dieux, qu'il a la permission d'asservir.
Il reçoit particulièrement les hommages des femmes qui désirent des amans fidèles ou de bons maris. Le râdjah de Travancor, prince puissant, sacrifie à ce dieu une fois par an dans le temple de Souclindram, qui lui est consacré sur la côte de Coromandel. Il est à remarquer que dans le culte que les Hindous rendent à Câmdéo, ils excluent les images obscènes, les chansons libres, et tout ce qui pourroit offrir des idées indécentes et lascives. Ils ne se permettent même ces licences qu'aux fêtes de Câlî ou Bhadracâlî, déesse née de Pceil placé au milieu du front de Chiva, et à celles du Lingam. Nous avons déjà observé que Câmdéo fut presque anéanti par le terrible Mahâdéo, ou au moins qu'il perdit toute existence corporelle. Cet accident causa la plus vive douleur à Retti son épouse, dont les lamentations font le sujet d'un poème sanskrit tout entier. La description des noces et des cérémonies du mariage de Câmdéo et de Retti remplit un autre volume, dont il est défendu de donner communication aux profanes. Les Brahmanes ont seuls le droit de lire la description d'une cérémonie où Brâhmah lui-même assista en qualité de père du fiancé. Voyez Paulini à Sancto-Bartholomæo Systema Brahmanicum, &c. pag. 185-1 89, et Jones's Hymn to Camdeo, et Hymn to Pracriti, tome I.er, pag. 18 et 19 de l’Asiatick Miscellany, Calcutta, 1785, et tome VI, pag. 313 et 319, des Works of sir Will. Jones.
(114) Cette observation est de M. Jones lui-même, dans l’argument de son hymne à Càmdéo, cité à la fin de la note précédente ; la voici : « Kâm signifie désir dans l’ancien persan et dans le moderne, et il est possible que les mots dipuc et cupid, dont le sens est le même, aient la même origine. En effet, nous savons que les anciens Étrusques, chez qui les Romains puisèrent la plus grande partie de leur langue et de leur religion, et dont le système avoit une étroite affinité avec celui des Persans et des Indiens, écrivoient par lignes alternatives de droite à gauche et de gauche à droite, comme par sillons ; et quoique les deux dernières lettres de cupido puissent bien être une terminaison grammaticale, comme dans libido et cupido, cependant la racine primitive de cupido est renfermée dans les trois premières lettres du mot. » M. Jones avoit, sans doute, de justes misons pour rejeter, dans un mémoire composé en 1784, mais revu depuis et publié en 1788, une étymologie vraiment ingénieuse, et qu’il avoit déjà consignée dans un recueil de littérature orientale publié à Calcutta en 1785. Quant à son observation sur le mot sanskrit câma, qui est le même que l’ancien mot persan conservé dans le persan moderne ? kâm [désir], c’est une nouvelle preuve en faveur de l’opinion qui donne une origine commune au sanskrit et au persan.
(115) C’est-à-dire, Mahâdêva, suivant l’opinion des Brahmanes, qui ne connoissent pas les sources du Gange. Grâces aux travaux ordonnés par l’empereur Kan-hi, qui, vers l’an 1700, fit lever le plan du Tibet, nous connoissons maintenant la source des deux plus grandes rivières de l’Hindoustân, le Brahmà-poutra, dont nous avons déjà donné une courte description, et le Gange, sur lequel nous allons présenter quelques détails rapides. Nous savons qu’une chaîne de montagnes, presque parallèle à l’Imaiis, et que les Tatârs nomment Kentaisse, située au-delà du Tibet, sert de ligne de séparation entre les sources des deux fleuves dont il s’agit : le premier, comme nous l’avons déjà dit, coule vers l’est ; l’autre est d’abord composé de deux branches qui prennent leur cours vers l’ouest. En inclinant beaucoup vers le nord, après avoir parcouru trois cents milles en ligne droite, ils remontent le que ces deux rivières confondent leurs eaux, et forment ce qu’on appelle le Gange. Cette masse d’eau, après avoir longé pendant à-peu-près un mille le mont Himaléh, se fraye un passage à travers une caverne, et tombe dans un bassin creusé dans le roc, au pied de la montagne. C’est là que des observateurs superficiels ont fixé les sources du Gange ; et le génie de la superstition avoit donné à l’ouverture de la caverne la forme d’une vache, animal non moins révéré chez les Hindous que le bœuf Apis l’étoit chez les Egyptiens.
De cette seconde source, s’il m’est permis de m’exprimer ainsi, le Gange se dirige plus à l’ouest, à travers le pays rocailleux de Sery-nagar ; enfin, à Herdouar, il s’échappe du territoire montagneux sur lequel il a erré pendant plus de huit cents milles anglois. À Herdouar, il s’ouvre un passage à travers la montagne de Seouâleik, au nord de la province de Dehly. Ensuite ce fleuve arrose paisiblement les plaines de l’Inde, et reçoit les eaux du Brahmâpoutre, tout auprès d’une de ses embouchures dans l’Océan.
M. Jones a composé un hymne adressé à Ganga, considéré comme divinité protectrice du fleuve qui porte son nom. Nous regrettons de ne pouvoir en présenter ici la traduction entière ; mais, au moins, une simple notice de cet hymne offrira quelques renseignemens utiles pour la mythologie et la géographie indiennes. Après avoir donné une description générale du Gange, M. Jones raconte la fable qui fait naître la déesse comme Pailas du front de Sîvà ou Chiva, le Jupiter tonans et genitor des Latins. La création de son amant, le Brahmâ-poutre, par un acte de la volonté de Brâhmah, est le sujet d’une autre strophe. La quatrième et la cinquième représentent la déesse du Gange arrêtée dans son passage à l’ouest par les montagnes d’Emodi, ainsi nommées d’uji mot sanskrit qui signifie neige, et d’où dérivent également les mots Irnaüs et Himalaya, Himala et Himaléh. La sixième décrit la marche de cette déesse à travers l’Hindoustân, où elle entre par le détroit de Koûpala, passant près de Sambal, pays qui est le même que le Samba laça de Ptolémée, fameux par la plante du même nom : de là elle passe non loin de Kânyakouvdja, ville jadis opulente et séjour d’un souverain. Les Grecs l’ont mal-à-propos nommée Calinipaxa, et les Asiatiques n’ont pas été plus exacts en l’appelant Kanoùdje. Ici le Gange se joint au Kalinadi, et s’avance vers Prayâga, d’où les habitans du Béhâr furent appelés Prasii, et où PYamounû [ou Djemnah], ayant reçu les eaux du Saresouatî au-dessous d’Indra-prestha ou de Dehly, et ayant arrosé le sol poétique de Madhoura et d’Agrah, mêle ses nobles eaux aux eaux sacrées du Gange, près de la forteresse moderne d’Âllah-âbâd. Ce lieu est regardé comme le confluent de trois fleuves sacrés, et est connu sous le nom de Trivêni, ou des trois boucles de cheveux tressés : une multitude de pèlerins y commencent des cérémonies qu’ils doivent terminer à Gayâ ; ils emportent avec eux des vases remplis d’eau, qu’ils conservent avec une vénération superstitieuse ; à leur retour, ils sont salués respectueusement par tous les Hindous qui les rencontrent.
M. Jones nomme ensuite six des principales rivières qui se jettent dans le Gange, et il les décrit rapidement d’après leurs propriétés spéciales : ainsi le Gandac, connu des Grecs sous une dénomination analogue, abonde, selon le P. Georgi, en crocodiles d’une grandeur extraordinaire ; le Mahanadi traverse la plaine de Gaoura, qui formoit jadis un canton très-peuplé, avec une capitale magnifique, d’où les Bengalis furent probablement appelés Gangaridts, mais qui est aujourd’hui le séjour de la désolation et le repaire des bêtes farouches. De Prayàga, le fleuve se dirige avec rapidité vers l’antique ville de Kâsî, que les Musulmans nomment Bénârès بنارس ; puis il baigne les murs de Pâtalipoutra, aujourd’hui Patnah, qui, pour le site et le nom, répond mieux à l’ancienne Palibothra que Prayâga ou Kànyakouvdja. Si Mégasthène et les ambassadeurs de Séleucus visitèrent la dernière de ces villes, et la nommèrent Palibothra, il est évident qu’ils se trompèrent. On trouve ensuite la belle montagne de Mouctiguiri ou Menguîr, et le merveilleux étang de Sîta, qui doit son nom à l’épouse de Râma, célébré par l’immortel Vâlmîki et d’autres poètes épiques de l’Inde, comme le vainqueur du géant Râvana et le conquérant de l*île de Sinhaldouyp ou Ceylan. Le poète jette en passant un coup-d’œil sur les montagnes de Kâligrâm et de Gangâ-presâd : il profite de cette circonstance pour faire un éloge bien justement mérité de M. Auguste Cleveland, qui parvint k civiliser les habitans sauvages de ces montagnes, qui étoient une île composée de rochers, ou au moins dont le pied étoit arrosé par la mer, sur laquelle on a conquis par la suite des temps la belle et fertile plaine du Bengale. Le zèle philantropique et les succès honorables de M. Cleveland parmi ces montagnards, ont été décrits et justement loués par M. George Forster dans son Voyage du Bengale à Saint-Pétersbourg.
Le bras occidental du Gange est appelé Bhâgarathî, Cette dénomination doit son origine à un demi-dieu ou saint homme nommé Bhâguiratha, qui par sa piété avoit obtenu de Sîva le privilége de conduire à sa suite une grande partie de l’eau du ciel : il l’emmena donc, et en forma deux branches, lesquelles embrassent la belle île qui tire son nom actuel de Qâcembâzâr, et qui depuis quelques années est fameuse par la défaite de Sérâdje èd-doùlah. Ces deux branches se rencontrent près du vénérable séminaire hindou de Nayadouyp ou Nédîyâ, et coulent à grands flots à travers les établissemens européens, pour se jeter dans une baie près d’une île qui porte le nom de Sagiir, soit à cause de la mer voisine, soit à cause d’un ancien râdjah célèbre par sa piété. M. Jones parle épisodiquement des soundarabans ou belles forêts qui méritent bien en effet celte honorable dénomination. Ces forêts sont situées entre le Bhûguirathî et le grand fleuve ou le bras oriental, qui forme plusieurs îles considérables par sa jonction avec le Brahmâ-poutre : une de ces îles, aussi-bien qu’une ville située auprès du confluent, tire son nom de Lakchmî, la déesse de l’abondance. Voyez Jones’s Hymn to Ganga, tome I. Cf, page 257, de l’Asiatick Miscellany, Calcutta, 1785, et tome VI, page 383, des Works of sir William Jones ; Georgi Alphabetum Tibetanum, page 344 ; Voyage du Bengale à Saint-Pétersbourg, tome I.er, pages 24 et 32.
(116) Nommé vulgairement Djemnah. Voyez ma note ci-dessus, page 275.
(117) Saresouatî, épouse de Brâhmah le créateur, préside à l’imagination et à l’invention, de manière qu’on peut à certains égards lui donner le titre de créatrice. Nous avons déjà observé que les trois personnes de la Trinité indienne ont chacune leur épouse ou puissance subordonnée. Saresouatî est adorée comme patronne des beaux-arts, sur-tout de la rhétorique et de la musique, comme l’inventrice de la langue sanskrite et du caractère dêvanagary, ainsi que des sciences dont l’écriture perpétue la connoissance : ainsi ses attributs correspondent à ceux de la Minerva musica des Grecs et des Romains, laquelle inventa la flûte et présidoit à la littérature. Quant à la rivière à laquelle la déesse indienne a donné son nom, elle est, sans doute, plus fameuse par ce nom que par la longueur de son cours ; car elle ne se trouve pas indiquée sur la grande carte de l’Inde de M. le major Rennell, ni dans son excellent Atlas du Bengale, dont les n.os 12 et 14 renferment les environs d’Allah-âbâd, et conséquemment de la jonction du Djemnah avec le Gange.
(118) Le laconisme de M. Jones touchant une divinité grecque célèbre par ses expéditions dans l’Inde, nous paroît un problème. Nous ne nous flattons pas de pouvoir dédommager nos lecteurs, du silence de ce savant ; nous nous bornerons à indiquer quelques rapprochemens qui feront peut-être regretter ceux qu’il lui auroit été si facile d’accumuler. Les principaux faits et gestes de Bacchus sont assez connus, et on les trouve racontés avec beaucoup de détails et d’exactitude dans les deux excellens Dictionnaires mythologiques des C.cns Millin et Noël : ainsi nous nous bornerons à les rapprocher de ceux qu’on attribue aux personnages du panthéon indien, qui nous paroissent leur correspondre.
Quelques mythologues ont cru pouvoir compter jusqu’à cinq Bacchus, qui, selon nous, se réduisent à deux, et même à un seul, qui est l’emblème du soleil. Les deux Bacchus dont nous voulons parler, sont le jeune, qui est le plus connu, et le vieux, que l’on représente avec une barbe et tous les caractères de l’âge mûr. Le premier de ces deux personnages, qui n’en font réellement qu’un, est aisé à reconnoître dans Rama, sixième incarnation de Vichnou, le même qu’Osiris ou le Soleil ; l’autre est Sîva, Chiva ou Chib, &c.
Les opinions des anciens touchant la naissance de Bacchus le Thébain, fils de Jupiter et de Sémélé, sont si peu uniformes, que nous pouvons indiquer celle qui nous paroît la plus probable, c’est-à-dire, celle qui s’accorde le mieux avec la mythologie, où Bacchus semble avoir pris naissance. Suivant Eustathe, ce dieu lut nourri sur le mont Méros en Arabie. Il est aisé de reconnoître dans ce mot le nom hellénisé de la montagne Mérou, si fameuse dans la mythologie indienne. Nous observerons que le mot^^ç en grec signifie cuisse ; et voilà, sans doute, l’origine de cette fable qui fait passer Bacchus du sein de sa mère dans la cuisse de Jupiter, d’où il ne sortit qu’à l’expiration des neuf mois. Enfin, Pline, Arrien, Strabon et d’autres placent le mont Mérou et Bacchus dans l’Inde. En effet, suivant les anciens Brahmanes, le mont Mérou, Himâlaya ou Himala, branche de l’Imaiis ( voyez ci-dessus, pages 261 et 275) est la demeure de Sîva, Chiven, ou Sib, &c. nom de la troisième personne de la Trinité indienne, d’où Bacchus a sans doute tiré le surnom de Sebasïus ouSebadius qu’il portoit parmi les anciens. Le sens de l’allégorie indico-grecque qui place la naissance et le séjour de Chiven, Bacchus, ou le Soleil, sur le mont Mérou, me paroît assez simple : cet astre, relativement à l’Inde, semble sortir de ces montagnes, qui séparent cette contrée du Tibet. On me permettra d’ajouter quelques nouvelles preuves à l’appui de cette conjecture. Les Indiens donnent au mont Mérou l’épithète de Sourâlaya [demeure du soleil], et à Chiven ou Bacchus celle de Dêvanichi ou Dionichi [dieu de Nicha], parce qu’il fut élevé dans cette ville, qui porte aussi l’épithète de Nichadaboura [ville de la nuit], Il est aisé de reconnoître ici la ville de Nysa, où les anciens disent que Bacchus fut élevé, et qu’ils placent mal-à-propos en Arabie. On nous permettra encore d’observer que Dionichi est incontestablement l’origine de Dionysus [Denys], l’un des noms de Bacchus, lequel désigne, comme on voit, le dieu de la nuit : c’est à cause de ce titre, sans doute, que ses orgies se célébroient chez les anciens et se célèbrent encore aujourd’hui dans l’Inde pendant la nuit. Ces fêtes nocturnes se nommoient Chivaratri [orgies du Sîva ou Chiva nocturne], et Chakpoudjâ [fête de la déesse Chakti], c’est-à-dire, du soleil et de la puissance génératrice.
Chakti ou Bhavânî [celle qui fait exister] sont les surnoms de Pûrvadî, la lune, e{ l’épouse de Sîva, Chiva ou Bacchus [le soleil ] : elle naquit et fut élevée sur une montagne voisine du Mérou. Les Indiens la nomment communément la fille du roi des montagnes. Ces peuples, ainsi que les Tibétains, adorent sa partie sexuelle sous l’emblème du lotus. Le lingam, ou les parties naturelles de l’homme, sont un des emblèmes de Sîva ou Chiva, qui est aussi le dieu de la nuit, le maître de la mort, le vengeur des crimes, muni de trois yeux, le juge des morts, le maître des fantômes qui errent dans les ténèbres, et des démons, le contemplateur, le pénitent, le vagabond, l’instituteur de la philosophie et des sectes, et en même temps le soleil qui détruit tout, le soleil de la nuit, caché derrière le Mérou, montagne froide et couverte de neige, habitant la ville de la nuit, parce que le matin il semble sortir d’au-delà des montagnes pour rendre la lumière à l’Inde. C’est, sans doute, à cause de cette circonstance géographique, que les habitans de cette contrée distinguent deux soleils : l’un nocturne ; c’est Sîva ou Chiven [le vieux Bacchus ] dont nous venons de parler : l’autre diurne, celui qui les éclaire pendant le jour ; c’est Râma, le jeune Bacchus ou Apollon, dont il va être question. On sait que les anciens, suivant Macrobe, distinguoient quelquefois le soleil levant par le nom d’Apollon et le soleil couchant par celui de Bacchus.
Râma, ou Sri Râma, naquit de l’étoile Rohini, et passe pour le frère de Vichnou, à-peu-près de la même manière que Brâhmah et Sîva [ou le soleil] sont frères. Parmi la longue série de ses noms, nous ne citerons que Râmaf qui signifie blanc ou beau ; Câma-pâla, luxurieux ; Ramena, gai, jovial, vigoureux : tous ces noms caractérisent parfaitement le jeune Bacchus indien. Son épouse se nomme Sita, c’est-à-dire, terre labourée ou fertile. À sa suite marche Hanouman, le singe du soleil, fils de la lune, c’est-à-dire, l’air qui pénètre par-tout, le même que Pan, dont le nom en grec Πὰν signifie tout, l’inventeur de l’instrument à vent que les Grecs et les Indiens lui mettent à la bouche, un des symboles du soleil parmi les Égyptiens, qui lui avoient élevé un temple dans la ville qui portoit son nom. Il étoit représenté dans ce temple avec un veretrum erectum, ὀρθιαϰὸν ἔχον τὸ αἰδοῖον et frappant la lune avec un fouet. Un sujet à-peu-près semblable a été dessiné dans un temple de la haute Égypte par un des artistes de l’expédition. Ajoutons qu’il y a quelque légère conformité entre le nom égyptien de Pan, ϣⲙⲓⲛ chmin, ou ϣⲙⲟⲩⲛ chmoun, et l’Hanouman des Indiens. Saint Clément d’Alexandrie a donc eu raison de dire que les Brahmanes adoroient Hercule et Pan, c’est-à-dire, le soleil et le vent. Outre Hanouman, on voit à la suite de Râma marcher deux autres singes, nommés Bali et Sougriva, qui ressemblent beaucoup aux Faunes ou Satyres compagnons de Bacchus dans son expédition de l’Inde. On voit encore aujourd’hui, parmi les sculptures qui couvrent les pagodes, Râma accompagné de ses singes ou satyres, et de nombreuses Dêvadasi ou Bacchantes tenant des tambours et des cymbales. Cette sixième incarnation de la Divinité passe pour avoir été un chef ou roi guerrier, qui enseigna l’agriculture aux hommes, donna des lois aux Indiens et fonda des villes : il châtia les rois pervers qui refusoient de rendre hommage à Sîva ou Chiva. Arrien nous apprend que « Bacchus enseigna aux : » Indiens, qui menoient une vie sauvage avant son arrivée chez eux, à cultiver » la vigne, à faire le vin, à ensemencer les terres, à se servir d’armes offensives « et défensives, soit, ajoute-t-il, que Triptolème, envoyé par Cérès, n’ait point » pénétré dans ces contrées, soit que Bacchus lui fût antérieur. >> C’est ce que nous ne nous permettrons pas de décider. Nous observerons seulement que, suivant Pline, depuis Bacchus jusqu’à Alexandre-le-Grand, on comptoit cent cinquante-trois ou cent cinquante-quatre rois, et six mille quatre cent cinquante-un ans et trois mois, ou six mille quatre cent deux ans, suivant quelques manuscrits. Arrien s’accorde assez bien avec Pline, quoiqu’il ne paroisse point l’avoir copié : il dit que « depuis Bacchus jusqu’à Androcottus ou Sandrocottus, qui fût vaincu par Alexandre, on compte cent cinquante-trois règnes, » six mille quatre cent deux ans », δύο ϰαὶ τεσσαράϰοντα ϰαὶ ἐξαϰισχίλια. Le texte de ces deux auteurs me paroît d’autant plus digne de remarque, que nos meilleurs chronologistes s’accordent à placer l’expédition d’Alexandre dans l’Inde en l’année 326 avant J. C., laquelle correspond à l’an 3678 de la création, suivant la chronologie d’Ussérius. La civilisation des Hindous, même suivant les auteurs grecs et latins, remontera donc au moins à deux mille sept cent vingt-quatre ans avant l’époque où les chronologistes chrétiens placent communément la création du monde. Mais revenons à Râma. Ce personnage est célèbre sur-tout par ses guerres avec Râvana, tyran de Lankâ ou Ceylan, qui lui avoit ravi Sita son épouse. Ces guerres sont le sujet d’un poème dont nous avons eu déjà occasion de parler plusieurs fois, et intitulé Râmâyana. Le P. Paulin de Saint-Barthélemi a inséré dans son Systema Brahmanicum la gravure d’un dessin indien représentant un combat entre Râma ou Bacchus le jeune, et Râvana ou Pluton ; car c’est ainsi qu’il les désigne. Râma commande une armée de singes qui ressemblent beaucoup aux Satyres qui accompagnoient Bacchus. Au lieu de léopards, il a des ours, parce que les ours des Ghâttes sont plus cruels que les léopards. Ses singes portent des branches de palmier, parce que les Indiens tirent de cet arbre une liqueur spiritueuse nommée arec ou ta garant, Elle est douce tant qu’elle conserve sa fraîcheur ; et les singes, qui sautent d’arbre en arbre, en boivent jusqu’à s’enivrer dans les vases que l’on place au pied des arbres pour la recevoir. II n’est donc pas étonnant que les suivans du Bacchus indien portent des branches de palmier au lieu des pampres que les Grecs ont placés dans leurs mains.
Si nous en croyons Hérodote, le jeune Bacchus [ou Râma] est le même que l’Osiris des Égyptiens, si célèbre par ses bienfaits, ses conquêtes, et sur-tout par ses guerres avec Typhon : Osiris étoit aussi, comme Bacchus, l’emblème du soleil. Mais Jablonski, en admettant cette identité, pense que les Grecs ont trop multiplié les conformités de leurs dieux avec ceux de l’antique Égypte, d’où la plupart, à la vérité, étoient originaires. Au reste, nous ne nous arrêtons qu’aux traits principaux, et nous croyons en avoir recueilli assez pour prouver, 1.° que le Διόνυσος des Grecs et le Bacchus des Latins tirent leur origine de la mythologie indienne ; 2.° que le grand Bacchus est absolument le même que Sîva, nommé aussi Bâguîs (mot qui peut être l’origine du Bacchus latin), troisième personne de la Trinité indienne, qui fait sa demeure habituelle sur le mont Mérou, au pied duquel est située la ville de Nicha, nommée Nysa par les Grecs ; 3.0 que le jeune Bacchus a beaucoup de ressemblance avec Râma, sixième incarnation de la Divinité, si célèbre par ses guerres avec Râvana, tyran de Ceylan. Cette dernière opinion, qui est celle de M. Jones et du P. Paulin de Saint-Barthélemi, n’est point du tout goûtée par M. Hamilton, qui a eu la complaisance de me faire observer que Râma étoit roi d’Ayodhyâ (aujourd’hui Aoude) : il possédoit par droit de naissance une grande partie de l’Inde, et il ajouta à ses domaines l’île de Ceylan, dont il fit la conquête. Tous les noms que rapporte M. Jones, dit ce savant, conviennent à Bacchus ou à Sîva ; mais aucun d’eux ne convient à Râma et ne lui a jamais appartenu. Le point principal de ressemblance entre Râma et Bacchus consiste dans l’armée de singes qui accompagna Râma dans son expédition contre Ceylan : mais M. Hamilton est persuadé que les Satyres de Bacchus étoient les Rakchasas de Sîva ; et le témoignage de Mégasthène prouve que les Indiens plaçoient le règne de Bacchus bien avant celui du célèbre monarque d’Ayodhyâ. Comme le règne de Râma est au moins à demi fabuleux, que la chronologie n’en est nullement certaine, je laisse à mes lecteurs le soin de décider cette question, et d’apprécier la justesse des rapprochement indiqués entre Bacchus et Râma. Voyez Plin. Hist. Natur. lib. VI, cap. 21 (XVII) ; Solin. Polyhist, cap. J2, p. 78 ; Arrian. Hist. Ind. pag. 528, ex edit. Blancardi ; Clem. Alex. Strom. pag. 194 (539 ex edit. Potter) ; Jablonski Pantheon Ægyptiorum, tom. I, pag. 295 ; Paulini à Sancto-Bartholomæo Systema Brahmanicum, p. 124-144.
(119) Râma, sixième incarnation de Vichnou. Voyez ma note 126, p, 283.
(120) Ourang-outang, اورچ اوتچ en malai [hommes des bois]. On les nomme en sanskrit, Marcada, Kabi, Plavanga : ils composent l’armée de Râma ou du jeune Bacchus, qui les conduisit dans Pile de Ceylan, sur la côte de Malabar, dans le royaume de Kichkinda ou Golconde, et dans le royaume de Népâl, &c. Voyez Musei Borgianï Codices manuscripti &c. pag. 259.
(121) Il est aisé de s’apercevoir que les Grecs ont confondu Pavan et son fils Hanouman en un seul personnage, qu’ils ont nommé Pan. Voyez ma note 118, ci-dessus, page 279.
(122) Vulgairement جيث tchéït, le dernier mois de l’année bengale. Voyez ma notea, tome II, page 372. La fête dont parle ici M. Jones est le Dourgâpoudjâ [adoration de la déesse de difficile accès], nommé aussi Bhesentipoudjâ [adoration finale], parce que c’est la dernière fête de l’année des Hindous, laquelle commence ordinairement le 11 avril. Cette fête précède leur carême. Selon M. Holwell, elle tombe le 7 de la nouvelle lune de mars, et continue le 8 et le 9 ; le dernier jour on jette l’image de la déesse dans le Gange. Cette déesse a une fête beaucoup plus solennelle pendant la nouvelle lune du mois de septembre. Voyez Holwell’s Interesting historical events &c. of Bengal, pag. 118, 137, 139-148, et ma note 109, ci-dessus, page 271.
(123) De ce nombre, ajoute le P. Paulin de Saint-Barthélemi, est le Bàlaga-pourâna, ou Crichna-pourâna, dont le P. Marc à Tumba, savant missionnaire, a fait une traduction italienne, intitulée : Traduction interlinéaire du livre de Crichna [huitième incarnation], ou Lalee-pourâna. Ce poème étoit écrit dans le dialecte de la ville de Patnah. Voyez Musei Borgiani Codices manuscripti Avenses, Ptguani, Siamicij Malabarici, Indostani, &c. pag. 133.
(124) Voyez sur ce poète et sur son principal ouvrage, ma note, pag. 80-82.
(125) Voyez, sur Mérou et sur Naichada ou Nysa, mes notes précédentes, pag. 235 et 277.
(126) Ssoubah صوبه ou gouvernement de l’Inde, sur lequel on peut voir ma noteb ci-après, tome II, pag. 109 et 110. J’ajouterai ici que cette ville se nomme aussi Ayiôdia, Haud, Aud, Avod, Oudc ; mais son véritable nom est Ayodhya, c’est-à-dire, ville des combattans, sans doute à cause des exploits de Rama [Bacchus]. Elle est située au 26d 45′ de latitude nord, et au 82d de longitude, à une lieue de Fayz-âbâd, sur le bord méridional du Gagra ou Sardjou, qui se jette dans le Gange, un peu plus bas, vers le 26d de latitude, auprès de la ville de Tchiapra. Voyez Musci Borgiani Codices manuscripti Avenses, Peguani, Siamici, Malabarici, Indostani, &c. pag. 149.
(127) L’yôdjan est évalué neuf et douze milles anglois par M. Wilkins, ci-dessus, page 99 ; et plus de deux milles allemands, suivant M. Bayer. Voyez ma note 41, ci-dessus, page 237.
(128) Voyage aux Indes, &c. tome I.er, page 163, édit, in-4.°
(129) Cette assertion contredit mon opinion relativement à l’antiquité de Bouddha, que je crois antérieur au brahmanisme : mais ce n’est pas dans une note qu’on peut discuter un pareil point de critique ; j’espère pouvoir y revenir.
(130) Huitième âvatâr ou incarnation de la Divinité. On le regarde comme l’Apollon indien, parce qu’il passa une partie de ses jours à garder des troupeaux, et mena une vie pastorale, pour se soustraire aux poursuites et à la fureur du géant Kansa. Son nom signifie noir, Cette couleur est la plus belle de toutes, suivant l’opinion des Indiens. Pour indiquer combien un homme leur paroît beau, ils disent qu’il est noir ; et ils le comparent à Crichna [ou Apollon] : de là, chez eux, ce proverbe trivial, Pourouckechou Crichna [le plus beau des hommes, Crichna]. Cette idée de beauté attachée à la couleur noire se trouve exprimée dans l’Écriture : « Je suis noire, mais je suis belle, 6 fille de Jérusalem, » dit l’épouse du Cantique. Plusieurs images de la Vierge, entre autres celle que l’on révère à Lorette, et que nous avons vue pendant quelque temps au Cabinet des antiques de la Bibliothèque nationale, sont noires. La seule portion du globe où la couleur noire puisse passer pour un des attributs de la beauté, c’est sans contredit l’Afrique ; et cette prédilection des Indiens pour la couleur noire ne semble-t-elle pas justifier mon opinion touchant l’origine éthiopienne de la civilisation et des religions de l’Égypte, de l’Inde, &c. ! Voyez mes notes et édaircissemens sur le Voyage de Norden, tome III, pag. 348 et suiv. Mais revenons à Crichna. On le nomme aussi Govina et Gopâla, c’est-à-dire, pasteur, qui fait paître les vaches. Il est invoqué sous ce nom au commencement du Sambhâvam (la Genèse indienne). C’est YApol/o Nomius des anciens. Au lieu de la lyre grecque, les Indiens lui mettent à la main une flûte de berger : au son de cette flûte, il fait danser des bergères dans les forêts ; les femmes abandonnent leurs maisons pour venir le trouver et le suivre ; elles courent toutes nues avec lui sous les arbres, au bord des ruisseaux et des étangs, et forment des chœurs qui dansent devant lui. On dit qu’il aima sur-tout huit reines ou femmes d’un haut rang. Son troupeau favori étoit composé de neuf vaches ; ce qui lui valut le surnom de Navagovara [ pasteur des neuf vaches ]. Enfin il étoit éperdument amoureux de neuf belles filles, qu’on peut comparer aux neuf Muses. De même que le laurier étoit consacré à Apollon, le tchauâna, ou sandal, est consacré à Crichna, dont le corps fut changé en cet arbre ; et les Indiens emploient le bois de sandal réduit en cendre ou en poussière, pour se faire sur le front le signe sacré nommé kouri. Cet usage religieux tire son origine de la vertu que l’on attribue à la poudre de jsandal délayée dans l’eau, de calmer les maux de tête, de chasser la fièvre, &c. Les Indiens prétendent que le corps de Crichna fut métamorphosé en un tronc de sandal, parce que ce corps ayant été jeté dans l’Yamounâ [le Djeinnah], fut porté par ce fleuve jusqu’à une embouchure du Gange, et de là aborda sous la forme d’un tronc de sandal à Djagarnath, où on l’adore encore aujourd’hui sous cette forme. Crichna se nomme encore nourricier des hommes, sauveur, médecin, Les femmes à qui le lait tarit dans leurs mamelles, lui adressent cette prière : Om, Kchirà Gopalâya svû/ia [Que cela soit, que le lait soit produit, ô pasteur]. On trouve beaucoup de protocoles de cette espèce dans les livres de médecine indiens.
OIl sait que l’Apollon grec garda les troupeaux du roi Admète auprès du fleuve Amphryse : nous avons déjà vu que Crichna garda les vaches du roi ou chef des pasteurs d’Ayodhyâ, auprès de l’Yamounâ, fleuve qu’on nomme aujourd’hui Djemnah, lequel se jette dans le Gange auprès d’Allah-âbâd, entre le 26 / et le 27.* degré de latitude septentrionale : c’est le Diamouna de Ptolémée, et YJomanes de Pline. L’Apollo Nomius naquit et vécut dans les montagnes de l’Arcadie : Crichna naquit au pied du mont Vindhya, dans l’ancienne ville de Madoura, que Ptolémée appelle la ville des dieux, laquelle est située sur le Djemnah, entre Agrah et Dehly, et renferme encore aujourd’hui d’immenses ruines de temples indiens. Apollon tua le serpent Python, et cette victoire lui valut le surnom de Pythien : Crichna perça de ses flèches le serpent Calenga, qui sortoit du fleuve Yamounâ. Les Grecs célébroient la victoire d’Apollon entre le 7 et le 13 janvier ; les Malabars, celle de Crichna au mois de décembre. Apollon a voit Jupiter pour père : celui de Crichna se nomme Ananda-Vasoudêva, c’est-à-dire, Dieu de Véther, infini, sans bornes. Un tyran nommé Kansa, c’est-à-dire, avide, qui ne peut se rassasier d’années (c’est ici le même que Saturne), poursuit le jeune Crichna ; il envoie, pour le tuer, Asoura, Rakchasa, Dêvada, c’est-à-dire, les géans, les titans et les démons, que le jeune dieu trompe et détruit par différens moyens : c’est à cause d’une semblable victoire qu’Apollon est nommé Tituicida par Orphée ; Crichna reçoit le nom de Kansaràdi et Madhourâdi [destructeur des titans Kansa et Madhou], Tandis qu1 Apollo Nomius et Jupiter Arcadius venaient au monde, les Corybantes frappoient le tambour, afin que l’on n’entendît pas les vagissemens de l’enfant : au moment de la naissance de Crichna, les Brahmanes battoient le tambour et jouoient des instrumens dans la ville de Madoura, afin que les cris du jeune dieu ne parvinssent pas aux oreilles des espions du tyran. Saturne écrasoit les enfans d’Ops contre des pierres, ou les dévoroit : Kansa écrasoit les enfans de Dêvagui sa sceur contre les pierres ; et si Djadjoda, la prétendue mère de Crichna, n’eut substitué à Crichna la déesse de l’imagination et de l’illusion, Mâyâ, qu’elle présenta au roi Kansa, celui-ci eût immanquablement détruit et exterminé Crichna. MâyÀ échappa des mains de Kansa, qui la laissa aller, après avoir reçu d’elle un énorme coup dans le ventre. Voyez Afusei Borgiani Codices manuscripti, p. 142.-147. Nous regrettons de ne pouvoir ajouter aux rapprochemens que nous venons d’indiquer entre Crichna et Apollon, ceux que le révérend docteur M. Thomas Maurice a établis entre Crichna et Jésus-Christ (en réfutant, comme on l’imagine bien, l’opinion du C.5" Volney sur le même objet), dans son History of Hindostan, tome III, pag. 268, 26^, 309, 310, 324 et suiv. jusqu’à la page 479.
(131) Ou Gopîa. Ce mot signifie bergère ; et M. Jones, dans un autre ouvrage cité précédemment, page 273, compare les neuf Gopîas de Crichna aux neuf Muses présidées par Apollon.
(132) C’est ce que Crichna dit lui-même dans le Bhagouat-Guîtà:« Moi et toi nous avons passé par différentes naissances ; les miennes me sont connues, mais tu ne connois pas les tiennes. Quoiqu’il soit peu de mon essence d’être sujet à la naissance et à la mort, et que je sois le maître de toutes les créatures, néanmoins, ayant commandé à ma propre nature, je me suis rendu visible par mon propre pouvoir. » Voyez the Bhaguat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Ardjoon, &c. translated from the original Sanskreet by Charles Wilkins, pag. 51 et 52.
(133) Plutôt la sixième incarnation. Voyez ci-dessus ma note 118, pag. 277.
(134) Voyez la description du Népâl, page 348 du tome JI de cette collection.
(135) Voye, sur cet ancien roi de l’Inde, le Mémoire sur la chronologie indienne, dans le tome II, pag. 183 et 184, de cette collection,
(136) Voyez ci-dessous la note 1 38,
(137) Voyez ci-dessous la note 138.
(138) Le Mahàbhârat contient la généalogie ou l’histoire générale de la maison de Bhârat, ainsi nommée de Bhârt son fondateur, et l’un des plus anciens rois de l’Inde, qui donna son nom à cette contrée; elle le conserve encore parmi les naturels. L’épithète de mahâ [ grand ] est une marque de distinction. Le principal objet de ce poème est le récit des dissensions et des guerres qui eurent lieu entre les deux grandes branches collatérales de cette famille, savoir, les Kourous et les Pandous, qui descendoient directement au second degré de Vitchitravîrya leur ancêtre commun, de qui naquirent les deux pères respectifs de ces deux branches, l’un nommé Dritrarachtra et l’autre Pandou.
Les Kourous (ce nom est quelquefois employé pour désigner toute la famille, mais plus communément c’est le nom patronymique de la branche aînée), les Kourous, dis-je, passent pour avoir été au nombre de cent ; et l’on regarde Douryôdhan comme leur chef et comme le représentant de la famille durant la vie de son père, qui étoit affligé de cécité.
Les enfans de Pandou étoient au nombre de cinq, savoir, Youdhichtir, Bhîma, Ardjoun, Nekoul et Sehûdéo. Douryôdhan, chef de l’autre branche, employa tant de ruses et d’artifices auprès de Dritrarachtra leur oncle et tuteur, qu’il parvint à faire chasser les Pandous de la ville d’Hastenapour, qui étoit alors le siége du gouvernement de l’Hindoustân.
Après une série de nombreuses aventures, racontées dans le Mahâbhârat avec autant de fécondité d’invention que de richesse de style, les Pandous exilés revinrent avec une puissante armée pour venger leur injure et soutenir leurs droits au trône de leur père, l’aîné des deux frères, qui avoit été, comme nous venons de le voir, supplanté par le plus jeune, d’après les moyens artificieux employés par Dritrarachtra auprès de leur oncle. Voyez la Lettre de AI. Hastings à M. Nathaniel Smith, sur le Bhagouat-Guîtâ, page 6 de l’édition angloise in-4.° de cet ouvrage, et pag. 2 et y de la traduction de M. Parraud ; et mes autres notes, pag. 90 de ce volume, et 185 du second.
(139) M. Jones veut ici parler du Guitâ de Bhagavat [le chant de Crichna] ; car Bhagavat ou Bhagouat est un des noms de Crichna. Ce mot sanskrit signifie sainteté, puissance, splendeur. Crichna est, comme nous l’avons déjà observé, la dernière incarnation de la Divinité. Guîtâ signifie chant, modulation. L’ouvrage dont il s’agit a été traduit du sanskrit par M. Charles Wilkins, sous le titre de Bhaguat Geeta, or Dialogues of Kreeskna and Ardjoon &c. ; London, 1785, in-4.° M. Parraud en a fait une traduction française d’après l’édition angloise, en un volume in-8.°, dans lequel il a ajouté beaucoup de morceaux curieux sur la mythologie indienne. M. Wilkins, si justement célèbre par son érudition indienne, n’hésite pas à donner cinq mille ans d’antiquité au Alahâbhârat, dont le Bhagouat-Guîtâ est un épisode, suivant l’opinion unanime de MM. Wilkins, Hastings, Jones, Hamihon, &c. M. Anquetil prétend que « le Bhagouat-Guîtâ n’est pas une portion du Mahâbhârat, et que seulement le sujet de cet ouvrage est pris du sixième Porb, &c. » ? Quoique l’assertion de M. Anquetil ne soit pas rigoureusement vraie, elle ne paroît pas entièrement dépourvue de justesse, quand on sait que le Bhagouat-Guîtâ contenant une doctrine qu’on regarde comme trop sublime pour le vulgaire, on le détache ordinairement des exemplaires du Mahâbhârat, dans lequel il fait partie du vi.e livre intitulé Bichma parva. Nous possédons à la Bibliothèque nationale plusieurs copies du Bhagouat-Guîtâ séparées du Mahâbhârât, en langue sanskrite. Voyez Recherches historiques et géographiques sur l’Inde, par Anquetil, Bernoulli, Tieffenthaler, &c. tome II, p. 566 ; Paulini à Sancto-Bartholomæo Examen historico-criticum codicum Indicorum bibliothecæ sacræ Congregationis de propagandâ fide passim, et a Catalogue of Sanscrit and other Oriental manuscripts presented to the royal Society by sir William and lady Jones, t. VI, p. 443, des Works of sir William Jones.
(140) M. le lieutenant-général Vallancey a depuis consigné cette étymologie, qui me paroît bien hasardée, dans un Mémoire sur l’émigration orientale des Druides d’Hibernie, prouvée par leurs connoissances astronomiques. Cris, Crisean, Criosna, Crisna-ain, le Soleil. Les Brahmanes font dériver leur Crichna [le Soleil], d’un mot qui signifie noir. Ciar en irlandais signifie noir, et cris ou gris, charbon de terre brûlé, noir. Il n’y a pas de doute que le chaldéen כרש Kerès et l’hébreu חרס Hherès [Soleil] ne dérivent de la même racine ; et probablement tout cela vient du syriaque kris, brûler, חרה kharah en chaldéen : de là Bochart fait venir קיר חרס Qyr-Hherès [mur du Soleil], en ancienne langue punique ; kahir-crios en irlandois ; de là vient, ajoute Bochart, כורש Kourech ou Cyrus [le Soleil]. » J’ajouterai qu’en persan moderne خور Khòr et خورشيد Khorchyd signifie le Soleil ; et il n’y a pas de doute que ce mot ne soit en effet l’origine d’un nom de prince que les Hébreux, les Grecs et les Latins ont défiguré chacun à leur manière. Quant aux étymologies indiquées par M. Vallancey dans le passage que je viens de citer, elles ne me paroissent pas toutes également heureuses ; mais on aura une idée plus juste de son système et de sa manière de procéder dans ce genre de travail, en consultant sa dissertation même, intitulée the Oriental Emigration of the Hibernian Druids proved from their knowledge in astronomy, collated with that of the Indians and Chaldeans, from fragments of Irish manuscripts, dans les Oriental Collections de M. Ouseley, t. II, n.° 1, p. 1-20 ; n.° 2, pag. 101-121 ; n.° 3, p. 201-227 ; n.° 4, p. 321-347 ; t. III, n.° 1, p. 1-31, et n.° 2, p. 114-126.
(141) Soûrya, le Phœbus des païens d’Europe, a près de cinquante noms ou épithètes en langue sanskrite. Il est à remarquer que les Tibétains, comme les anciens Egyptiens, donnent au char du Soleil la forme d’un bateau.
(142) M. Hamilton ne partage nullement les idées de M. Jones touchant Apollon et Crichna. Leurs amours pastorales sont le seul point de ressemblance qu’il trouve entre eux ; tandis qu’il existe un dieu du soleil, nommé Soûrya, qui est le Sol ou Apollon indien.
(143) Nommée aussi Soma, Cette divinité est du genre masculin dans le système indien, comme Mona [la Lune] chez les Saxons, et comme chez quelques-uns des peuples qui s’établirent en Italie. On croit que les mansions lunaires sont les filles de Casyopa, première production de la tête de Brâhmah ; et de leurs douze noms sont dérivés ceux des douze mois. Voyez Jones’s Hymn to Surya, t. I.{er, p. 163, de l’Asiatick Miscellany, édit, de Calcutta, et tome VI, page 346, de la collection de ses Œuvres.
(144) Quelques mythologues distinguent deux Vesta : la première, fille de Démogorgon, femme du Ciel, mère de Saturne, et que l’on nommoit aussi Ops, la Terre, Cybile, Rhéa, la grande mère, &c. (voyez Cicero, de naturâ Deorum, lib. II, cap. 27) ; l’autre descendant de la précédente, fille de Saturne et d’Ops sa femme, laquelle portoit aussi le même nom que la mère de ce dieu. La seconde Vesta est regardée comme le feu. Cicéron et Ovide les confondent et n’en font qu’une. Les Troyens paroissent être les premiers qui aient adoré Vesta ; Enée porta ce culte en Italie. Au moins nous ne pouvons douter que cette divinité ne jouît déjà d’une grande vénération parmi les Étrusques, lorsque Numa Pompilius, en l’an 4 de Rome, lui éleva un temple dans l’endroit où fut ensuite le Forum, entre le mont Palatin et le Capitole : il attacha à ce temple un certain nombre de prêtresses, toutes vierges et chargées d’entretenir le feu sacré, sous peine de perdre la vie si elles le laissoient éteindre. Ce temple ne renfermoit aucune image : le feu qu’on y entretenoit perpétuellement représentoit Vesta, comme Procope l’observe très-bien (lib. I, cap. 24) en parlant du feu des Persans. « C’est le même, dit-il, que les Romains appeloient Vesta et qu’ils adoroient anciennement.» Il n’y a pas de doute que le culte de Vesta, qui est le même que celui du feu, ne tire son origine de l’Orient. Le docteur Hyde (Historia religionis veterum Persarum, cap. 7) croit que Numa introduisit le culte du feu ou de Vesta chez les Romains, et ne fit qu’imiter la loi Mosaïque, qu’il ne comprenoit pas bien. Sans nous amuser à combattre une assertion très-hasardée, puisqu’il y a tout lieu de croire que le culte du feu existoit parmi les Étrusques avant Numa, nous conviendrons qu’il y a une grande ressemblance entre ce culte tant chez les Grecs que chez les Romains, et le feu sacré qui brûloit perpétuellement sur l’autel du temple de Jérusalem, où l’on offroit chaque jour le sacrifice éternel. Il est impossible de parler du culte du feu sans se rappeler cette antique et autrefois puissante nation qui posséda si long-temps la Perse, et dont les déplorables restes ne semblent subsister que pour rivaliser avec les Juifs en opprobre et en misère. L’histoire de la religion des Guèbres a fourni à MM. Hyde et Anquetil la matière de deux ouvrages considérables et nourris de la plus vaste érudition : ainsi nous y renvoyons le lecteur, et nous nous bornons à remarquer, d’après le savant Anglois, que le mot latin Vesta est évidemment dérivé du mot grec ἑστία [foyer], lequel est lui-même étranger à la langue grecque. Ce mot dérive du chaldéen אשתא astâ [feu], aussi-bien que l’ancien mot persan استا astâ, qui signifioit originairement du feu.
(145) Ce mot sanskrit signifie proprement du feu, et ne me paroît pas fort éloigné du mot latin ignis, pour lequel Vossius n’a indiqué aucune étymologie plausible. On représente ce dieu avec quatre bras et monté sur un bélier ; on lui donne une femme nommée Aghnay ou Svahâ. On lui offre un sacrifice nommé homa, ou dêvayagna [sacrifice divin ] ; ce qui indique combien le dieu du feu est honoré parmi les Hindous, et toute l’importance qu’ils attachent à ce sacrifice du feu. En effet, ils ne commencent aucune entreprise difficile, importante ou sainte, sans avoir fait préalablement un sacrifice à cet élément. Voyez Kindersley’s Specimens of Hindoo literature &c. pag. 21, et Systema Brahmanicum, pag. 9 et 12, où le P. Paulin de Saint-Barthélemi donne une description fort détaillée de l’homa ou sacrifice du feu.
(146) Les anciens Égyptiens le nommoient Phtas, et les Grecs Ἥφαιστος. Il passoit pour le plus ancien souverain de l’Égypte, et fut, suivant Diodore, l’inventeur du feu. Saint Clément assure que son nom en égyptien signifie le feu. Comme ce mot ne se retrouve pas en qobthe ou égyptien moderne avec cette signification, le savant la Croze et Jablonski ont cru le reconnoître dans ϕψϫϣ [ordonnateur, régulateur] ; titre qui, selon eux, répond parfaitement à l’idée que les prêtres égyptiens avoient de la puissance et des travaux de cet ancien dieu-roi, qui eut le Soleil pour successeur. C’étoit aussi, suivant eux, l’intelligence éternelle, un feu subtil et pur, supérieur à toutes les planètes et aux étoiles, d’où toutes les âmes émanoient pour descendre sur la terre, et vers lequel elles retournoient après un certain temps, &c. Voyez de plus amples détails dans le Pantheon Ægyptiorum de Jablonski, tome Ltr, pag. 44-52.
(147) Voyez ma note 144, p. 289.
(148) Ce mot signifie proprement arme à feu. L’origine mythologique que l’on donne aux armes dont les Dêvatas ou Dieux se servirent contre les Asours ou mauvais génies dans le saty-youg, prouve leur haute antiquité ; et il n’y a pas de doute que les Indiens, les Tibétains et les Chinois ne connussent une composition pyrique très-semblable à la poudre à canon, bien des siècles avant que cette invention infernale parût en Europe. Quant à moi, je suis persuadé que la poudre à canon, aussi-bien que l’imprimerie, la boussole, la papeterie (toutes découvertes dont nous nous sommes trouvés enrichis en moins de trois siècles), nous ont été rapportées de l’Orient, soit par quelques voyageurs, soit par les croisés. J’ai développé cette idée dans mon Mémoire sur l’origine de la poudre à canon, dont un extrait a été imprimé dans la Décade, an VI, … Voyez la description d’un rocket ou espèce de fusil indien, dans Craufurd's Sketches chiefy relating to the religion, history, manners &c. of the Hindoos, tome II, pag. 54-55, et le dessin de la même arme, gravé sur le frontispice du même volume, 2.e édit.
(149) M. Jones veut ici parler de son Mémoire sur les modes musicaux des Indiens. Ce mémoire se trouve dans le tome III de ce recueil, n.° VII.
(150) M. Jones écrit ailleurs ragymala, prononcez raguymala [collier de sons musicaux]. Ce système peut être regardé comme l’invention la plus agréable des anciens Hindous, et la plus belle union de la peinture avec la mythologie poétique et la vraie théorie musicale.
La différente position des deux semi-tons dans l’échelle des sept notes, donne naissance à sept modes primordiaux et connus : la série entière est composée de douze semi-tons, dont chacun peut devenir une note module ou tonique. Il y a dans la nature, quoique cela ne soit pas universel en pratique, soixante-dix-sept autres modes que l’on peut nommer dérivatifs. Les Persans attachent aux quatre-vingt-quatre modes l’idée de localité, les distribuent en trois classes formées de douze salles, vingt-quatre angles et quarante-huit réduits. Mais l’ordre hindou est élégamment établi sur les variations de l’année indienne, et sur l’association des idées, puissant auxiliaire ajouté aux effets ordinaires de la modulation. Les modes sont déifiés dans ce système ; et comme il y a six saisons dans l’Inde, savoir, deux printemps, l’été, l’automne et deux hivers, on croit qu’un Râg, ou dieu du mode, préside à chacune d’elles. Chaque mode principal est accompagné de cinq Râgny ou nymphes de l’harmonie ; chacun a huit fils ou génies également adonnés à cet art divin ; à chaque Râg, avec sa famille, est assignée une saison particulière où l’on ne peut chanter et jouer que sa mélodie. Le mode de Detpuc, ou Cupidon l’inflammateur, passe pour être perdu ; et suivant une tradition encore subsistante dans l’Hindoustân, un musicien qui tenta de le rétablir, fut consumé par le feu du ciel. La distribution naturelle des modes auroit été sept, trente-trois, quarante-quatre, conformément au nombre des tons secondaires majeurs et mineurs ; mais on changea cet ordre en faveur de la charmante fiction dont je viens de parler. Voyez Jones’s Hymn to Sereswati, dans le tome I.er, page 179, de l’Asiatick Miscellany, et tome VI, page 375, des Works of sir Will. Jones.
(151) Un des premiers êtres créés, fils de Brâhmah, et l’Hermès ou Mercure des Hindous. C’étoit un sage législateur, grand dans les arts et dans les armes, un messager éloquent, que les dieux s’envoyoient respectivement, ou qu’ils dépêchoient aux mortels leurs favoris ; enfin c’étoit un musicien d’un talent supérieur. Ses faits et gestes sont le sujet d’un Pourâna. Les Pandits citent encore un traité de lois que l’on suppose avoir été révélé par Nâreda. Il inventa le Anâ, instrument à cordes : on pince ces cordes, et elles sont soutenues par deux grosses gourdes. C’est, sans contredit, le meilleur instrument dont on se serve dans toute l’Asie, suivant l’opinion de M. Jones, Hymn to Sereswati. Voyez le Mémoire sur le bîn ou vinâ, ci-après, n.° XII, pages 319-323. Au reste, comme le parallèle entre Nâreda et Mercure repose entièrement sur l’invention du luth, M. Hamilton n’est pas très-convaincu de sa justesse, et il aimeroit mieux retrouver Mercure dans Bouddha, non comme neuvième âvatâr ou incarnation, mais comme présidant à la planète Bouddha, qui est la même que Mercure, &c. Voyez Craufurd’s Sketches chiefly relating to the religion, manners, learning, of the Hindoos, tome I.er, pag. 201-202, 2.e édit.
(152) Ce nom vient d’ἑκὰς, qui lance au loin ses rayons. Hécate, Diane, la lune et Proserpine, sont un seul et même personnage. Quant à la Diane Taurique, elle tiroit son nom de la Tauride même, où elle avoit un temple révéré, et où on lui sacrifioit tous les étrangers que leur malheureux destin poussoit sur cette plage inhospitalière. On la nommoit aussi Ταυροπολία [Tauropole], propriétaire de taureaux, parce que cette espèce de bestiaux étoit très-abondante dans la Tauride. Voyez Lilio Gyraldi, Historiæ Deorum syntagma duodecimum, p. 357, 358, 369, 372, 546, &c.
(153) Câlî, mot dérivé de Câla [le temps]. C’est le nom de Bhavânî dans sa qualité destructive. On offroit à cette déesse, en cette qualité et sous cette image, des sacrifices humains, pour écarter les malheurs dont on étoit menacé. Voyez Notes to the Heetopades of Veeshnoo-Sarma, &c. p. 325 et 326.
(154) Au risque de faire une digression un peu étrangère à cette dissertation, je ne puis m’empêcher d’observer combien les trois mots sanskrits rapportés ici par M. Jones ont de rapport avec les anciens mots persans conservés dans le persan moderne. Néra est bien certainement le même mot que ner نر qui, en persan moderne, signifie mâle, et sert à distinguer les animaux mâles de ceux du sexe féminin, après le nom desquels on ajoute le mot ماده mâdéh, femelle. Go est évidemment le même mot que ڭاو, taureau, vache, en persan moderne. Asoua répond aussi à séoùâr سوار, ou açoùâr اسوار cheval, cavalier. Mêdha dérive certainement de la même racine que le mot mât مات qui, dans presque toutes les langues de l’Asie, et même en malai, signifie tuer, faire mourir. Je n’indique ces rapprochemens que pour prouver combien il y a de ressemblance entre les langues sanskrite et persane, et pour rassembler quelques preuves à l’appui d’une conjecture que j’avois formée long-temps avant de connoître la trop courte mais excellente dissertation du P. Paulin de Saint-Barthélemi, de affinitate Unguarum Samscrdamiccc, Persicœ et Germanie a, &c.
(155) M. Jones ne fait de Proserpine qu’une divinité simple. D’après ce principe, M. Hamilton ne voit point de difficulté à regarder Câlî comme représentant Hécate ainsi que Proserpine : mais cette réunion des deux déesses en une seule semble contraire à l’opinion généralement adoptée par les anciens mythologues ; et puisque M. Jones convient n’avoir pas trouvé la représentante de Diane dans le Panthéon indien, Hécate, qui n’est qu’une autre forme de cette déesse, n’en aura pas non plus.
(156) M. Jones veut ici parler du Laky poudjâ, qui tombe dans la pleine lune de septembre, et se célèbre pendant une nuit entière, et du Kalleka, Câlkï ou Câli poudjâ : ces trois mots sont synonymes. Cette fête se célèbre le dernier jour de la lune de septembre. Câlî est adorée généralement par tous les Hindous pendant toute la nuit, mais avec une solennité particulière, à Câlighât, environ à trois milles sud de Calcutta. La se voit une ancienne pagode dédiée à cette déesse, et située près d’un ruisseau très-petit, que les Brahmanes regardent comme l’ancien lit du Gange. Différentes portions de la déesse indienne sont adorées dans différens cantons de l’Inde ; on révère ses yeux à Câlighât, sa tête à Bénârès, ses mains à Bindoubend. Nous ne nous rappelons pas où se trouvent les autres parties de son corps. Selon M. Holwell, le nom de Câlî que porte cette déesse, lui vient de la couleur de son vêtement, qui est noir : Câlî, dit-il, signifie de l’encre. On dit qu’elle s’élança, complètement armée, de l’œil de Dourgâ, au moment où cette dernière étoit poussée à outrance par les tyrans de la terre, dont on voit les têtes suspendues au cou de Câlî.
Dans la fête dont il s’agit, on fait des offrandes aux mânes des ancêtres décédés ; mais outre ces cérémonies, qui ont lieu tous les ans à la même époque, chaque Hindou célèbre l’anniversaire de la mort de son père par un jeûne, par un acte d’adoration envers les mânes, que l’on appelle baap ka sourraad [ consacré au père]. M. Holwell remarque en passant que, dans tout le Devonshire, le mot Cah désigne la couleur noire. Nous laissons, dit-il, aux curieux le soin d’expliquer comment il se fait que la même combinaison de lettres présente à deux peuples si éloignés l’un de l’autre, absolument la même idée. Voyez Holwell’s Interesting historical events relative to the provinces of Bengal and the empire of Indoostan, &c. also the mythology and cosmogony, fasts and festivals of the Gentoos followers of the Shastah, 2.d part, pag. 131 et 132.
(157) Le moukti ou moukt est le dernier degré de la félicité. Ce mot signifie proprement absorption dans l’esprit universel, suivant M. Craufurd (Sketches &c, t. I, p. 195), et absorption dans la nature de l’Etre suprême, suivant le vocabulaire de mots sanskrits, placé au commencement du III.e volume de l’Ayïn Akbery, translated by Gladwin.
(158) Des Vêdes. Voyez, ci-après, le Mémoire sur la littérature indienne, n° XVII.
(159) Nommée plus communément Bénârès par les Musulmans. L’ancien nom de cette ville est Kaśi.
(160) Il auroit été à desirer que M. Jones s’expliquât ici avec un peu plus de précision : nous allons faire en sorte d’y suppléer. Les auteurs arabes que j’ai consultés pour composer mes notes et éclaircissemens sur le Voyage de Norden, t. III, p, 242, disent bien que Messr, descendant de Noé, alla s’établir, après le déluge, dans la basse Égypte, à laquelle il donna son nom, &c. Cette assertion n’est appuyée sur aucun monument historique d’une certaine authenticité : nous savons seulement que, dans l’Écriture, l’Égypte est appelée מצור Metsoùr, et מצרים Metsraïm ; et le docte Bochart observe avec quelque raison (Geographia sacra, lib. IV, cap. 25) que ces deux noms, dont le premier signifie resserré, et dont l’autre est le duel du premier, conviennent à l’Égypte prise en total, ou divisée en haute et basse. Quant à la signification de ce nom, je crois qu’il faut, sur ce point, convenir de notre ignorance. Les Hébreux ont-ils voulu puiser dans leur propre idiome une épithète convenable à l’Égypte ! ou bien ont-ils transcrit avec leurs caractères un des noms originaux de cette contrée ! Je l’ignore : mais je doute fort que ce nom ait été bien restitué en caractères qobthes, par J. Reinold Forster, qui, dans l’Epistola ad Michaelem, insérée à la suite du Spicilegium geographiœ Hebrœorum, &c. page 8, croit que מְצרַיִם est le duel de מֶצְרֶה, corruption hébraïque de l’égyptien ⲙⲉϣϣⲏ-ⲣⲏ mechche-re [champ du soleil]. Outre l’inconvenance du changement du צ tsadé en deux ϣ chéi, cette étymologie n’offre aucun rapprochement convenable avec מצור Metsoùr, qui est probablement le singulier de מצורים et dont M. J. R. Forster ne fait nulle mention. Je réserve pour une autre circonstance l’examen de l’étymologie proposée par M. Wilford dans son Mémoire sur l’Égypte et le Nil d’après les livres des Hindous, n.° III du tome III de ces Recherches. Ce savant pense que le mot Messra-stan, qui sert à désigner l’Égypte dans les anciens livres indiens, signifie pays du mélange ou des nations mêlées, à cause des différens peuples qui se sont établis en Égypte. Au reste, il n’y a point de doute que l’un des noms les plus connus et les plus authentiques de l’ancienne Égypte, ne fût ⲭⲁⲙⲉ Khamé, ou ⲕⲁⲙⲉ Kamé [noir].
(161) Bettyah, suivant l’orthographe du major Rennell, est une ville du nord de l’Hindoustân, située dans le Béhâr, vers l’extrémité septentrionale de cette province, non loin de celle d’Aoude, vers le 26d 45′ de latitude, et 84d 50′ de longitude de Greenwich, suivant la grande carte de l’Inde de M. Rennell.
(162) Tyroot ( prononcez Tyrhoùt), suivant la carte rare et vraiment curieuse de M. William Boltz, publiée en 1773, et intitulée the Kingdom of Bengal, Bahar and parts of Orissa which are noiv under the dominion of the honourable company of English merchants trading to the East Indies ; together with the conquered provinces of Illahabad, Owd, Banaras, which by the servants of the said society in iy6y were confered on the Alogul emperor Shah-allum and the nabob Sujah-dowlah ; survey’d by order of the company [c’est-à-dire, le Royaume de Bengale, Béhâr et portions d’Orissah qui sont maintenant sous la domination de l’honorable compagnie de marchands anglais faisant le commerce des Indes orientales, avec les provinces conquises d’Allah-âbâd, d’Aoude, de Bénârès, que les employés de ladite compagnie cédèrent en 1765 au grand Moghol Châha’iein et au nabâb Choudja’ah êd-doùlah ; levée par ordre de la compagnie]. Cette carte et celle du Bengale et du Béhâr, n.° 9 du Bengal Allas du major Rennell, placent le canton de Tyrhoùt entre le 25d 30′ et le 26d 40′ de latitude. Ce canton n’est point indiqué dans la grande carte de l’Inde, et je ne sais à quoi attribuer cette omission importante. Les Brahmanes avoient autrefois une académie dans le Tyrhoùt, comme nous l’apprend le P. Georgi dans son Alphabetum Tibetanum, pag. 429. Son témoignage est justifié par celui d’Aboùl-fâzel, qui écrit Terhyt (ou Tirohyt), au lieu de Tyrhoùt, et donne de ce canton la description suivante, dans l’Ayin Akbery : « Terhyt est depuis long-temps le séjour de la science des Hindous. L’eau et le climat y sont excellens. Les fromages fromages s’y conservent une année entière, sans changer de couleur. Si les marchands de lait y mêlent de l’eau, leur supercherie est bientôt découverte. Les buffles sont tels, qu’ils terrassent les lions. Il y a beaucoup de lacs : l’un de ces lacs est tel, que l’eau n’y diminue jamais, et que l’on n’a pu en découvrir le fond. Des bois d’orangers ont trois koss de longueur [dix lieues]. À l’époque de la saison des pluies, les cerfs, les daims et les lions, se rassemblent dans les cantons habités, et les habitans se donnent le plaisir de la chasse ; ils s’assurent de ces animaux en leur cassant les jambes, les enferment dans une enceinte murée, et les chassent de temps en temps. » ترهيت ازدنربز بنكاه هندي دانش آب و هو انسكزين جغرات تايك سال دكركون ذشود شيرفروش اڪر بآب آيسذ از غيت بدو ڪزندي رسد كاوميش چنان شودكه شيربشكرد كولابها فراوان و تـكي چنان است كه اب او هـركزكم نشــود و ژرفاي او ناپاید و درخت زار نارخ تا سيکروه نشاط افزا بهنکام بارش اهو و کوزن و شیریکجا بآبادي در آید و مردم بجان شکري برخیزند بسادست و پاشکستر بچار دیوار سردهند اهسته بکار برند. Voyez l’Ayïn Akbery, اِين اڪبري ou Institutes du Grand-Moghol Akbar, article du ssoùbah de Béhâr, صوبه بهار, page 169 verso du manuscrit autographe qui est en ma possession, et tome II, page 329 de la traduction angloise de M. Gladwin, édit. de Calcutta. Le P. Marco, cité par le P. Paulin de Saint-Barthélemi (Systema Brahmanicum, &ç, page 303, note 1), pense que le pays dont il s’agit a tiré son nom d’un royaume d’Afrique nommé aussi Tyrout, et qui étoit autrefois habité par des Brahmanes. Cette opinion, et le fait sur lequel elle est fondée, sont de nouvelles preuves en faveur de mon système sur l’origine éthiopienne de la civilisation et de la religion de l’Égypte, de l’Inde et du Tibet. Peut-être me sera-t-il permis un jour de donner quelques développemens à ce système, que je n’ai pu indiquer que très-rapidement dans mes notes et éclaircissemens sur le Voyage de Norden, pag. 348 et suiv.
(163) مصري. On le nomme encore ainsi. Voyez l’Hindostanee Vocabulary de M. Gilchrist ; Calcutta, 1781 ; tome II, pag. 391 et 332, édit. in-4.°
(164) Seroit-ce là l’origine du mot latin miscere ! Ce ne seroit pas le seul mot commun à ces deux langues. Nous avons déjà vu la conformité de Janus avec Ganèś, divinité absolument inconnue aux Grecs.
(165) Ce drame a été traduit par M. Jones sous le titre de Sacontala, or the fatal Ring. Voyez mes notes, tome II, pages 184 et 403.
(166) C’est ce même prince dont parle M. Halhed dans la préface de sa Bengal Grammar. L’assertion de ce râdjah se trouve consignée page v de la préface de la Grammar of the Bengal language de M. Halhed, imprimée à Hougly au Bengale, en 1778, et qui n’est pas un des livres les moins rares de la nombreuse collection que j’ai formée sur l’Inde. « Ce prince prétendoit avoir en sa possession des livres sanskrits qui faisoient mention d’une communication anciennement subsistante entre l’Inde et l’Egypte ; les Égyptiens étoient constamment représentés comme les disciples et non comme les maîtres des Hindous. » Une connoissance plus approfondie des livres sanskrits que ne l’avoit M. Jones à l’époque où il composa cette dissertation, et le Mémoire de M. Wilford sur l’Égypte et sur le Nil, n.° III du tome III de ces Recherches, suffisent maintenant pour justifier l’assertion du râdjah, relativement au contenu de ses livres. Quant au titre de maîtres que réclament les Hindous envers les Égyptiens, nous croyons qu’il est très-possible de le leur disputer, et nous osons nous flatter de démontrer un jour que les uns et les autres ont puisé leurs sciences à une source commune.
(167) M. Sonnerat cite en effet, dans son Voyage aux Indes et à la Chine (t. Ier, p. 192, note a édit. in-4.°), une Dissertation de M. Schmidt sur une colonie égyptienne établie aux Indes ; dissertation couronnée, dit-il, par l’Académie des inscriptions. J’ai examiné avec la plus grande attention les sujets des dix prix remportés par M. Schmidt de Berne à l’Académie des inscriptions et belles-lettres ; je possède même quelques-uns des mémoires couronnés et imprimés depuis ( tous n’ont pas été publiés), et je puis affirmer que le sujet mentionné par M. Sonnerat n’est pas de ce nombre. Je ne relève cette légère inexactitude que pour éviter au lecteur des recherches superflues, et non point pour exercer une censure pédantesque envers un voyageur vraiment estimable par son exactitude pour ce qui concerne l’Inde, traité avec une sévérité au moins rigoureuse par M. Law de Lauriston (Mémoires sur les Chinois, tome IX, pag. xij-xx), relativement à son article de la Chine. Le foible mais sincère témoignage d’estime que je paye ici à M. Sonnerat bien spontanément, et après un mur examen de son ouvrage, ne le dédommage pas sans doute, s’il vit encore, des nombreux désagrémens que lui ont causés ses envieux et les stupides échos de ses envieux. Il est fâcheux, je dirois même honteux pour nous, qu’il ait reçu de nos rivaux un dédommagement plus honorable et plus satisfaisant. Les Anglois, que l’on ne récusera pas sans doute pour juges compétens dans ce qui concerne l’Inde, ont traduit le Voyage de M. Sonnerat : cette traduction a eu plusieurs éditions à Londres, et a été réimprimée avec luxe à Calcutta. C’est ainsi qu’ils font le plus grand cas de notre voyageur Bernier, dont l’existence n’est guère connue chez nous que de nos bibliographes.
(168) Σαμαναῖοι, les Samanéens, ou sectateurs de Bouddha, que je crois antérieurs aux Brahmanes. Voyez ma Notice du Rituel des Mantchoux, tome VII, ire partie, page 241, des Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale.
(169) Le Bhagavat, ou Bhagavadam, dans lequel sont consignées ces fables dont M. Jones vient de donner quelques échantillons, est un des dix-huit Pourânas ; et nous avons vu ci-dessus, dans la note 50, page 240, que, d’après le témoignage même de M. Jones, dans sa préface de la traduction des Lois de Menou (et il connoissoit bien la langue et la littérature sanskrites quand il entreprit cette traduction), les Pourânas ont été composés à-peu-près neuf cent quatre-vingts ans avant la naissance de Jésus-Christ.
- ↑ L’étendue de mes notes a exigé que je les plaçasse à la fin de cette Dissertation, pour ne pas interrompre trop souvent et trop long-temps le lecteur. (L-s.)
- ↑ Yama, dieu des morts, le même que Minos.
- ↑ Voyez le texte original, sur la pl. IV.
- ↑ Que M. Jones nomme Garoûda ou Garoûra, dans sa Dissertation sur les dieux de la Grèce, de l’Italie et de l’Inde, ci-dessus, page i8p, (L-s.)
- ↑ Le même que le dieu Pan. Voyez, ci-après, ma note, page 279. (L-s.)
- ↑ La Jonesia du D.r Roxburgh.
- ↑ Les princesses, les reines : ce mot sanskrit est le féminin de râdjah. (L-s.)