Port-Tarascon/Livre premier/III
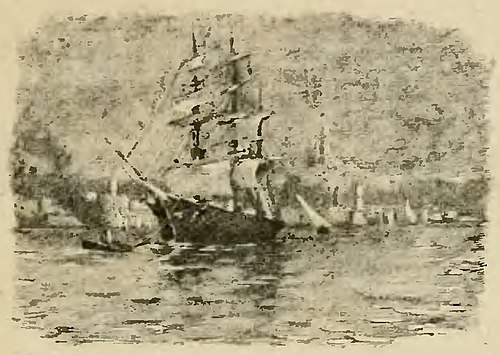
III
Un matin, Tarascon s’éveilla avec cette dépêche à tous les coins de rue :
La « Farandole », grand voilier de douze cents tonneaux, vient de quitter Marseille au point du jour, emportant dans ses flancs, avec les destinées de tout un peuple, des pacotilles pour les sauvages et un chargement d’instruments aratoires. Huit cents émigrants à bord, tous Tarasconnais, parmi lesquels Bompard, gouverneur provisoire de la colonie, Bézuquet, médecin-pharmacien, le Révérend Père Vezole, le notaire Cambalette, cadastreur. Je les ai conduits moi-même au large. Tout va bien. Le duc rayonne, Faites imprimer.
Ce télégramme, affiché dans toute la ville par les soins de Pascalon, à qui il était adressé, la remplit d’allégresse. Les rues avaient pris un air de fête, tout le monde dehors, des groupes arrêtés devant chaque affiche de la bienheureuse dépêche, dont les mots se répétaient de bouche en bouche : « Huit cents émigrants à bord… Le duc rayonne… » Et pas un Tarasconnais qui ne rayonnât comme le duc.
C’était la deuxième fournée d’émigrants qu’un mois après la première emportée par le vapeur Lucifer, Tartarin, investi du beau titre et des importantes fonctions de des groupes arrêtés devant chaque affiche…

Cet accident, qui aurait pu sembler de mauvais augure, ne refroidissait en rien l’enthousiasme colonisateur des Tarasconnais. Il est vrai qu’à bord de ce premier navire ne se trouvait que la rafataille ; vous savez, les gens du commun, ceux qu’on envoie toujours en avant-garde.
Sur la Farandole, de la rafataille encore, mêlée de quelques cerveaux brûlés, tels que le notaire Cambalalette, cadastreur de la colonie.
Le pharmacien Bézuquet, homme paisible malgré ses formidables moustaches, aimant ses aises, craignant le chaud et le froid, peu porté aux aventures lointaines et périlleuses, avait longtemps résisté avant de consentir à s’embarquer.
Il ne fallait rien moins pour le décider que le diplôme de médecin, envié pendant toute sa vie, ce diplôme que le gouverneur de Port-Tarascon lui décernait aujourd’hui de son autorité privée.
Il en décernait bien d’autres, le gouverneur ! des diplômes, des brevets, des commissions, nommant directeurs, sous-directeurs, secrétaires, commissaires, grands de première classe et de deuxième classe, ce qui lui permettait de satisfaire le goût de ses compatriotes pour tout ce qui est titre, honneur, distinction, costume et soutache.
L’embarquement du Père Vezole n’avait rien nécessité de semblable. Une si brave pâte d’homme, toujours prêt à tout, content de tout, disant : « Dieu soit loué ! » à tout ce qui arrivait. Dieu soit loué ! Quand il avait dû quitter le couvent ; Dieu soit loué ! Quand il s’était vu fourrer à bord de ce grand voilier, pêle-mêle avec la rafataille, les destinées de tout un peuple et les pacotilles pour sauvages.
La Farandole partie, il ne restait plus que la noblesse et la bourgeoisie. Pour ceux-ci, rien ne pressait : ils laissaient à l’avant-garde le temps d’envoyer des nouvelles de son arrivée là-bas, afin qu’on sût à quoi s’en tenir.
Tartarin, lui non plus, en sa qualité de gouverneur, d’organisateur, de dépositaire de la pensée du duc de Mons, ne pouvait quitter la France qu’avec le dernier convoi. Mais en attendant ce jour impatiemment désiré, il déployait cette énergie, ce feu au corps que l’on a pu admirer dans toutes ses entreprises.
Sans cesse en route entre Tarascon et Marseille, insaisissable comme un météore qu’emporte une invisible force, il n’apparaissait, ici ou là, que pour repartir aussitôt.
« Vous vous fatiguez trop, Maî…aî… tre !… » bégayait Pascalon, les soirs où le grand homme arrivait à la pharmacie, le front fumant, le dos arrondi.
Mais Tartarin se redressait : « Je me reposerai là-bas. À l’œuvre, Pascalon, à l’œuvre ! »
L’élève chargé de la garde de la pharmacie depuis le départ de Bézuquet, cumulait avec cette responsabilité de bien plus importantes fonctions.
Pour continuer la propagande si bien commencée, Tartarin publiait un journal, la Gazette de Port-Tarascon, que Pascalon rédigeait à lui seul de la première à la dernière ligne, d’après les indications, et sous la direction suprême du gouverneur.
Cette combinaison nuisait bien un peu aux intérêts de la pharmacie ; les articles à écrire, les épreuves à corriger, les courses à l’imprimerie, ne laissaient guère de temps aux travaux d’officine : mais Port-Tarascon, avant tout !
La Gazette donnait chaque jour au public de la métropole les nouvelles de la colonie. Elle contenait des articles sur ses ressources, ses beautés, son magnifique avenir ; on y trouvait aussi des faits divers, des variétés, des récits pour tous les goûts.
Récits de voyages à la découverte des îles, conquêtes, combats contre les sauvages, pour les esprits aventureux. Aux gentilshommes campagnards, des histoires de chasse à travers les forêts, d’étonnantes parties de pêche sur des rivières extraordinairement poissonneuses, avec description des méthodes et des engins de pêche des naturels du pays.
Les gens plus, paisibles, boutiquiers, braves bourgeois sédentaires, se délectaient à la lecture de quelque frais déjeuner sur l’herbe au bord d’un ruisseau à cascade, sous l’ombre de grands arbres exotiques ; ils y croyaient être, et sentaient gicler sous leurs dents le jus des fruits savoureux, mangues, ananas et bananes.
« Et pas de mouches ! » disait le journal, les mouches étant, comme on sait, le trouble-fête de toutes les parties de campagne en terre de Tarascon.
La Gazette publiait même un roman, la Belle Tarasconnaise, une fille de colon enlevée par le fils d’un roi papoua ; et les péripéties de ce drame d’amour ouvraient aux imaginations des jeunes personnes des horizons sans fin. La partie financière donnait le cours des denrées coloniales, les annonces d’émission des bons de terre et des actions de sucrerie ou de distillerie, ainsi que les noms des souscripteurs et les listes de dons en nature qui continuaient à affluer, avec l’éternel « costume pour un sauvage » de Mlle Tournatoire.
Pour suffire à de si fréquents envois, il fallait que la bonne demoiselle eût installé chez elle de véritables ateliers de confection. Du reste elle n’était pas la seule que ce prochain déménagement pour des îles inconnues et si lointaines eût jetée en d’étranges préoccupations.
Un jour Tartarin se reposait tranquillement chez lui, dans sa petite maison, ses babouches aux pieds, douillettement enveloppé de sa robe de chambre, pas inoccupé cependant, car près de lui, sur sa table, s’éparpillaient des livres et des papiers : les relations de voyages de Bougainville, de Dumont-Durville, des ouvrages sur la colonisation, des manuels de cultures diverses. Au milieu de ses flèches empoisonnées, avec l’ombre du baobab qui tremblotait minusculement sur les stores, il étudiait « sa colonie » et se bourrait la mémoire de renseignements puisés dans les livres. Entre temps il signait quelque brevet, nommait un grand de première classe ou créait sur papier à tête un emploi nouveau pour satisfaire, autant que possible, le délire ambitieux de ses concitoyens.
Tandis qu’il travaillait ainsi, ouvrant de gros yeux et soufflant dans ses joues, on lui annonçait qu’une dame voilée de et qui refusait de dire son nom, demandait à lui parler. Elle n’avait même pas voulu entrer, et attendait dans le jardin, où il courut précipitamment, en pantoufles et en robe de chambre.
Le jour finissait, le crépuscule rendait déjà les objets indistincts ; mais, malgré l’ombre tombante et l’épaisse voilette, rien qu’au feu des yeux ardents qui brillaient sous le tulle, Tartarin reconnut sa visiteuse :
« Madame Excourbaniès !
— Monsieur Tartarin, vous voyez une femme bien malheureuse. »
La voix tremblait, lourde de larmes. Le bonhomme en fut tout ému et l’accent paternel :
— Ma pauvre Évelina, qu’avez-vous ?… Dites… »
Tartarin appelait ainsi par leur petit nom à peu près toutes les dames de la ville, qu’il avait connues enfants, qu’il avait mariées comme officier municipal, restant pour elles un confident, un ami, presque un oncle.
Il prit le bras d’Évelina, la fit marcher en rond autour du petit bassin aux poissons rouges, pendant qu’elle lui contait son chagrin, ses inquiétudes conjugales.
Depuis qu’il était question de s’en aller coloniser au loin, Excourbaniès prenait plaisir à lui dire à propos de tout sur un ton de menace gouailleuse :

« Tu verras, tu verras, quand nous serons là-bas, en Polygamille… »
Elle, très jalouse, mais aussi naïve, même un peu bêtasse, prenait au sérieux cette plaisanterie.
« Est-ce vrai, cela, monsieur Tartarin, que dans cet affreux pays les hommes peuvent se marier plusieurs fois ?
Il la rassura doucement.
« Mais non, ma chère Évelina, vous vous trompez. Tous les sauvages de nos îles sont monogames. La correction de leurs mœurs est parfaite, et, sous la direction de nos Pères-Blancs, rien à craindre de ce côté-là.
Pourtant, le nom même du pays ?… Cette Polygamille ?… »
Alors seulement il comprit la drôlerie de ce grand farceur d’Excourbaniès, et partit d’un joyeux éclat de rire.
« Votre mari se moque de vous, ma petite. Ce n’est pas la Polygamie que le pays s’appelle, c’est Polynésie, ce qui signifie : groupe d’îles, et n’a rien pour vous alarmer. »
On en a ri longtemps dans la société tarasconnaise !
Cependant les semaines passaient et toujours pas de lettres des émigrants, rien que des dépêches communiquées de Marseille par le duc. Dépêches laconiques, expédiées à la hâte d’Aden, de Sydney, des différentes escales de la Farandole.
Après tout, on ne devait pas trop s’étonner, étant donné l’indolence de la race.
Pourquoi auraient-ils écrit ? Des télégrammes suffisaient bien ; ceux qu’on recevait, régulièrement publiés par la Gazette n’apportaient d’ailleurs que de bonnes nouvelles :
Traversée délicieuse, mer d’huile, tous bien portants.
Il n’en fallait pas plus pour entretenir l’enthousiasme.
Un jour enfin, en tête du journal, parut la dépêche suivante expédiée toujours via Marseille :
Arrivés Port-Tarascon. – Entrée triomphale – Amitié avec naturels venus au-devant sur la jetée – Pavillon tarasconnais flotte sur maison de ville – Te Deum chanté dans l’église métropolitaine – Tout est prêt, venez vite.
À la suite, un article dithyrambique, dicté par Tartarin, sur l’occupation de la nouvelle patrie, sur la jeune ville fondée, la visible protection de Dieu, le drapeau de la civilisation planté en terre vierge, l’avenir ouvert à tous.
Du coup, les dernières hésitations s’évanouirent. Une nouvelle émission de bons à cent francs l’hectare s’enleva comme des petits pains blancs.
Le tiers, le clergé, la noblesse, tout Tarascon voulait partir ; c’était une fièvre, une folie d’émigration répandue par la ville, et les grincheux, comme Costecalde, les tièdes ou les méfiants se montraient maintenant les plus enragés de colonisation lointaine.
Partout on activait les préparatifs du matin au soir. On clouait les caisses jusque dans les rues jonchées de paille, de foin, au milieu d’un roulement de coups de marteau.
Les hommes travaillaient en bras de chemise, tous de bonne humeur, chantant, sifflant, et l’on s’empruntait les outils de porte à porte en échangeant de gais propos. Les femmes emballaient leurs ajustements, les Pères-Blancs leurs ciboires, les tout petits leurs joujoux.
Le navire nolisé pour emporter tout le haut Tarascon, baptisé le Tutu-panpan, nom populaire du tambourin tarasconnais, était un grand steamer en fer commandé par le capitaine Scrapouchinat, un long-cours toulonnais. L’embarquement devait avoir lieu à Tarascon même.

Les eaux du Rhône étant belles et le navire sans grand tirant d’eau, on avait pu lui faire remonter le fleuve jusqu’à la ville, et l’amener à bord du quai, où le chargement et l’arrimage prirent un grand mois.
Pendant que les matelots rangeaient dans la cale les innombrables caisses, les futurs passagers installaient d’avance leurs cabines ; et avec quel entrain ! Quelle urbanité ! Chacun cherchant à se rendre serviable et agréable aux autres.
« Cette place vous va mieux ? Comment donc !
— Cette cabine vous plaît davantage ? À votre aide ! »
Et ainsi de tout.
La noblesse tarasconnaise, si morgueuse d’ordinaire, les d’Aigueboulide, les d’Escudelle, gens qui d’habitude vous regardaient du haut de leur grand nez, fraternisaient maintenant avec la bourgeoisie.
Au milieu du tohu-bohu de l’embarquement, on reçut un matin une lettre du Père Vezole, le premier courrier daté de Port-Tarascon :
« Dieu soit loué ! Nous sommes arrivés, disait le bon Père. Nous manquons de bien des petites choses, mais Dieu soit loué tout de même !… »
Guère d’enthousiasme dans cette lettre, guère de détails non plus.
Le Révérend se bornait à parler du Roi Négonko, et de Likiriki, la fillette du roi, une charmante enfant à qui il avait donné une résille de perles. Il demandait ensuite qu’on envoyât quelques objets un peu plus pratiques que les dons habituels des souscripteurs. C’était tout.
Du port, de la ville, de l’installation des colons, pas un mot. Le Père Bataillet grondait, furieux :
« Je le trouve mou, votre Père Vezole… Ce que je vais vous le secouer en arrivant ! »
Cette lettre était en effet bien froide, venant d’un homme si bienveillant ; mais le mauvais effet qu’elle aurait pu produire se perdit dans le remue-ménage de l’installation à bord, dans le bruit assourdissant de ce déménagement de toute une ville.
Le gouverneur — on n’appelait plus Tartarin que de ce nom — passait ses journées sur le pont du Tutu-panpan. Les mains derrière le dos, souriant, allant de long en large, au milieu d’un encombrement de tas de choses étrangers, panetières, crédences, bassinoires, qui n’avaient pas encore trouvé place dans l’arrimage de la cale, il donnait des conseils d’un ton patriarcal :
« Vous emportez trop, mes enfants. Vous trouverez tout ce qu’il vous faut là-bas. »
Ainsi lui, ses flèches, son baobab, ses poissons rouges, il laissait tout ça, se contentant d’une carabine américaine à trente-deux coups et d’une cargaison de flanelle.
Et comme il surveillait tout, comme il avait l’œil à tout, non seulement à bord mais aussi à terre, tant aux répétitions de l’orphéon qu’aux exercices de la milice sur le cours !
Cette organisation militaire des Tarasconnais, survivant au siège de Pampérigouste, avait été renforcée, en vue de la défense de la colonie et des conquêtes que l’on comptait faire pour l’agrandir ! Et Tartarin, enchanté de l’attitude martiale des miliciens, leur exprimait souvent sa satisfaction, ainsi qu’à leur chef Bravida, dans des ordres du jour.
Pourtant un pli sillonnait anxieusement parfois le front du Gouverneur.
Deux jours avant l’embarquement, Barafort, un pêcheur du Rhône, trouvait dans les oseraies de la rive une bouteille vide hermétiquement bouchée, dont le verre était encore assez transparent pour laisser distinguer à l’intérieur quelque chose comme un papier roulé.
Pas un pêcheur n’ignore qu’une épave de ce genre doit être remise aux mains de l’autorité, et Barafort apportait au gouverneur Tartarin la mystérieuse bouteille contenant cette lettre étrange :
Cataclysme épouvantable à Port-Tarascon. Île, ville, port, tout englouti, disparu. Bompard admirable comme toujours, et comme toujours mort victime de son dévouement. Ne partez pas, au nom du ciel ! Que personne ne parte !
Cette trouvaille paraissait l’œuvre d’un farceur. Comment cette bouteille, du fond de l’Océanie, serait-elle arrivée de flot en flot directement jusqu’à Tarascon ?
Et puis ce « mort comme toujours » ne trahissait-il pas une mystification ? N’importe, ce présage troublait le triomphe de Tartarin.
