Partenza… vers la beauté !/Texte entier
La fortune de l’Italie
est inséparable du sort |

| Achille ESSEBAC | — Partenza (6e édition). 1 vol. |
| — | — Dédé (10e édition). 1 vol. |
| — | — Luc (5e édition). 1 vol. |
| — | — L’Élu (5e édition). 1 vol. |
| Comte Paul d’ABBES | — Luxuria (6e édition). 1 vol. |
| Nonce CASANOVA | — La Libertine (8e édition). 1 vol. |
| Roger DAVREUSE | — La Proie (6e édition). 1 vol. |
| Delphi FABRICE | — L’Araignée rouge (4e édition). 1 vol. |
| J.-C. HOLL | — Les deux Idoles (4e édition). 1 vol. |
| Victor MAUROY | — Satan-Dieu (4e édition). 1 vol. |
| A. GIRON & A. TOZZA | — L’Augustule (3e édition). 1 vol. |
| * * * | — Chez les Pères (5e édition). 1 vol. |
| Comte Paul d’ABBES | — Les Bateleurs 1 vol. |
| Achille ESSEBAC | — Les Boucs 1 vol. |
| Delphi FABRICE | — L’Acteuse 1 vol. |
pour tous les pays, y compris
la Hollande, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande
S’adresser, pour traiter, à MM. Ambert & Cie,
Éditeurs, 25, rue Lauriston, Paris.La fortune de l’Italie est
inséparable du sort de la Beauté |
| Gabriele d’Annunzio. |

Aux petits cireurs de Marseille ;
Aux petites marchandes de fleurs de la place d’Espagne, à Rome ;
Aux gamins effrontés de Naples ;
À Pio, le petit aveugle florentin ;
À tous ces jolis visages pleins de soleil, de sourires et de beauté, parfois aussi pleins de souffrance et de douce résignation ; à tous ces pauvres petits dont les grands beaux yeux furent la joie et le charme inexprimables des heures trop brèves passées là-bas, dans les villes italiennes, affectueusement, leur frère très humble dédie ce livre.

Partenza…
Au milieu du cercle intime attentif à ses moindres mouvements, je vois encore, spirituelle et fine comme une tête de César sur une médaille antique, la figure de celui qui, Nonce Apostolique, allait être l’Éminentissime di Rende, et préparait ses épaules patriciennes, fières déjà sous le port de son front lumineux, au poids lourd de la pourpre romaine.
Il parlait de sa patrie en un français élégant et raffiné ; un léger accent enveloppait mollement certains mots qu’il retenait comme sous une caresse voulue, pour les pénétrer du charme de cette langue italienne, douce encore des harmonies Virgiliennes et câline comme une chanson d’amour.
Et c’était une chanson, en effet, une amoureuse chanson que murmuraient les lèvres du prélat, tandis que ses yeux regardaient au delà, dans un lointain que nous devinions tous, la patrie si belle dont il célébrait le Midi marqué des vestiges indélébiles de la beauté grecque, tout imprégné encore de son radieux souvenir. Le Nonce déplorait les excursions faites au cœur de l’hiver alors que l’Italie, frileuse elle aussi, replie sous les vents frais qui passent, chargés pourtant de l’odeur capiteuse des orangers, les splendeurs déployées seulement quand les brasillements du soleil d’août font craquer la terre sous le ciel torride, au temps de la moisson des épis dorés, tandis que finissent de mûrir les grappes lourdes des vignes d’où s’écouleront les vins parfumés, après les vendanges.
Avec des mots gracieux, il traçait en maître les plus jolis tableaux des campagnes fatiguées de chaleur, accablées de lassitude dans le jour brûlant, mais ardentes de beauté, riches de pittoresque, et d’allure éveillée par les beaux soirs très calmes où les pastorales cantilènes s’élèvent en douceur des lèvres épanouies ; où la gaieté du ciel et de la terre trouve un écho dans tous les cœurs, délie les membres superbes des garçons vigoureux et fait plus souriantes les grâces juvéniles des filles dansant au retour des pèlerinages leurs danses chastes et naïves, dans l’air moite du parfum des fleurs et de la rude senteur des herbes fauchées, tiède des effluves de la terre incendiée, avec le grésillement précipité des cigales battant leurs élytres accordées aux rustiques pizzicati des mandolines.
Les paroles de l’évêque violet au profil de César, gravées profondément dans les souvenirs de ma seizième année, me revinrent attirantes quelques mois après quand, pour la première fois, tremblant d’émotion, j’allai fouler cette vieille Terre latine vers laquelle les jeunes têtes se tournent et s’inclinent, avides de connaître ses charmes, et de remplir du rayonnement impérissable des grandes choses disparues l’existence qui se prépare, vide peut-être, mesquine et vulgaire…
Malheureusement, ce fut dans un novembre, aux journées très belles et très limpides, mais si courtes ! que se dévoilèrent d’abord à mes regards les séductions puissantes de Rome. Et je me souvins d’elle comme d’une aïeule au visage défait et sévère, rude aussi, mais dont la rudesse se déride parfois en des sourires où passe tant de langueur, dont les traits ruinés gardent encore de si fraîches beautés, qu’à vingt ans je l’aimai du même amour qu’inspirent les frais regards de l’adolescence, de la même affection pieuse et filiale dont on entoure l’aïeule qui, peut-être, va s’éteindre bientôt. Et j’emportai dans mes yeux le splendide épanouissement des midis clairs et le souvenir des froides matinées embrumées de vapeurs mauves, légères et pénétrantes, dans lesquelles tremblaient les ombres augustes des grandes reliques de pierre, et passaient les graves sonorités de l’appel matinal des cloches…
Cette fois encore, je retourne là-bas dans le décembre glacé et le dur janvier. Je reverrai les mêmes choses séculaires, immuables presque, sur qui sept années auront pesé moins que sept jours sur moi… Je reviendrai sans connaître l’Italie tiède et parfumée dont parlait le prélat romain, et je n’aurai pas vu les danses des garçons aux yeux de velours et des filles jolies… Mais peut-être, depuis que ses gars sont allés mourir si loin dans l’Afrique noire, ne danse-t-on plus guère, même dans l’été radieux, sur cette vieille Terre de Beauté, — où le Nord, aujourd’hui, n’envoie pas la lumière…I
On nous affirme que c’est un demi-mistral seulement, ce vent aigre qui balaie tout Marseille et se déchire en hurlant à chaque coin de rue ; dans ce cas nous devons nous estimer très heureux, car un mistral entier n’eût certainement pas laissé pierre sur pierre de toute la cité, revêtue ce matin d’une vilaine teinte grisâtre où le soleil de Provence ne parvient pas à insinuer la plus légère dorure. Les gros nuages, comme de monstrueuses boules d’ouate, passent au galop, durement fouettés par le vent qui les roule l’un sur l’autre en rangs serrés, ne laissant place entre eux à aucun lambeau d’azur.
La rue est gaie cependant : c’est dimanche. Le temps va-t-il bien vouloir se faire beau tout à l’heure et donner congé à cette folle moitié de mistral, qui vraiment gâte la joie que nous avions eue hier de quitter Paris enseveli sous la neige si vite transformée en boue ?
Ici, du moins, tout est sec, et puis voilà le mol balancement des grands bateaux et des milliers de petites barques au repos dans le Vieux-Port, à l’extrémité de la Cannebière.
Les marchandes du cours Saint-Louis sont obligées de laisser le vent, ce grand semeur, emporter la presque totalité du parfum de leurs jolies fleurs ; et cela, mêlé à l’âcre senteur des algues, aux poussières des embruns, est déjà réjouissant au possible. Le long des quais, les marchands de coquillages gris enveloppent si bien de varechs et de mousses marines aux transparences d’émeraudes mouillées leur laide petite marchandise, qu’elle en devient appétissante ; les oursins, qui ardent autour de leur corps étrange les piquants sous lesquels ils ont l’air de grosses châtaignes, deviennent presque aimables, et l’on devine des trésors de perles enfouies sous la nacre rugueuse des huîtres humides, bâillant au soleil et laissant sur les mousses d’émeraudes déborder de fraîches coulées d’eau de mer. C’est qu’il vient de se montrer enfin, le soleil, sans qui toute cette côte méditerranéenne semble en deuil ; et ses clartés jouent de toutes parts, se répandent en mille étincellements sur la crête des vagues menues sous le vent un instant apaisé, rient de la belle joie d’un soleil provençal dans tout le peuple endimanché, pressé de jouir, heureux d’aller par ses quais gercés et noircis sous la brise du large qu’il fait bon respirer, par ses ruelles ténébreuses aux loques sordides, aux misères irrémédiables, soudainement transformées au soleil qui change les unes en oripeaux éclatants et verse sur les autres de longues traînées d’espoir…
Auprès de la Cannebière, devant la mer, une façade d’église, blanche d’un récent badigeon de chaux. Elle me plaît avec son faux air de chapelle espagnole, et, puisque c’est dimanche, nous allons entrer et nous joindre aux gars solides, aux humbles bonnes femmes, aux fillettes embarrassées de robes empesées, coiffées de chapeaux où se heurtent maladroitement toutes les verdures des fruits pas mûrs et tous les incendies des rouges, du coquelicot à la groseille.
Gauches et jolies cependant, les petites cousines de Mireille ; de beaux cheveux noirs et des yeux où passent des reflets tièdes et caressants, et, comique, l’assent que martèle chacune de leurs paroles passant volubiles entre les lèvres saignantes ouvertes sur la blancheur des dents.
L’église, c’est Saint-Ferréol, et j’avais deviné le décor intérieur en voyant la façade : une chapelle de couvent espagnol, un de ces couvents de Franciscains où la pauvreté est de règle absolue : les murs blanchis à la chaux, les ornements sommaires et rarement remplacés, pauvre autel, pauvres tableaux en des cadres piteux, et tout cela un peu humide de je ne sais quelles rosées, comme si les gens qui sont là répandaient en l’air les buées de leurs vêtements mouillés un jour de pluie.
Mais comme ils sont de belle tenue, les gens du port, les pêcheurs de poissons, les marins, les portefaix, les soldats et les pauvres femmes égrenant leur gros chapelet du même geste que leurs voisins les hommes aux rudes et bonnes figures !
Ce n’est pas la paroisse aristocratique, tant mieux ; on vient ici pour prier. Et de tous les fidèles je suis le seul à tourner la tête, distrait, tandis qu’eux, dans leur confiante simplicité, s’agenouillent à même les dalles, comme en Espagne, sur un coin déplié de leur mouchoir blanc des dimanches, devant la Madone et le Sauveur en croix à qui, pour deux sous sévèrement prélevés sur le tabac ou les petites douceurs quotidiennes, ils viennent, tendres et confiants, offrir l’humble cire dont la flamme suspend dans l’air obscur des chapelles une étoile d’or… Je n’ai même pas envie de sourire quand les chantres, gamins des rues bruns et rieurs dans leur robe rouge trop courte et leurs blanches aubes, si drôlement, de toute leur âme, chantent, avec l’ineffable assent, les liturgies sacrées.
Par la porte grande ouverte, après la messe, le vent s’engouffre et chasse devant lui, dans l’église, des flots de clartés blondes. Dehors, le balancement ininterrompu des bateaux me fait souvenir de Marseille, que j’avais presque oubliée, rêveur pendant l’office. Vraiment je ne m’imaginais pas qu’il pût y avoir quelque part une telle intensité de lumière, une telle orgie de grand et de beau jour étincelant ; j’étais, à la minute encore, perdu dans le rêve grisâtre des petites chapelles et des petites gens, et les petits cierges de deux sous me semblaient des étoiles réunies en constellations ; tout cela vient de s’évanouir devant le spectacle du ciel et de la mer.
Le grand air vivifiant accourt du large, donne cette sensation de vie intense, de pleine liberté, fait très lointaine la vie monotone et trop régulière de chaque jour, transforme l’être qui se dépouille et, chrysalide, devient papillon au contact des choses et des horizons nouveaux.
Là-bas, au bout du quai, en tournant à droite vers la Joliette et la cathédrale neuve, quel immense espace d’air pur et de limpidité ! De très loin arrivent, se gonflent, les lignes moutonneuses des vagues creusant derrière elles de profonds sillons où tombent du ciel et germent, spontanément épanouies, des semences de lumières. Et la mer, depuis l’horizon immobile jusqu’aux lourdes vagues brisées sans cesse sur les rocs, devant nous, est une mouvante et féerique coulée de diamants.
Comme s’il m’était nécessaire d’associer au tumulte grandiose de cette mer que j’aime avec passion, quelque autre chose d’infini dont elle ne serait que le reflet blafard, l’image d’une extrême ténuité, mes yeux s’élèvent au-dessus des vieilles pierres des citadelles et des forts, sur la colline où tend ses petites mains l’Enfant infiniment grand, entre les bras de sa Mère… Le soleil illumine les vitraux de Notre-Dame-de-la-Garde, et la statue colossale au sommet de sa haute tour éparpille dans l’espace des rayons dorés.
Marseille est très belle vue ainsi, retranchée derrière ses bassins immenses enclos de forteresses aux créneaux béants par lesquels bâillent, noires, les gueules des canons.
La cathédrale moderne est trop moderne, et ses marbres, et ses mosaïques, et sa splendeur demi-byzantine ne parviennent pas à m’émouvoir, moins, en tout cas, beaucoup moins que ses voisines les murailles banales de l’esplanade, écorchées par la tempête et soutenant avec peine les hauts chemins dominant la Joliette ; elles sont prêtes à crouler sous la poussée des terres, et laissent pendre, secouées par le mistral, les minces chevelures de plantes sauvages dont la délicatesse jette une envolée de poésie sur ces délabrements.
Des ruelles inextricables, enchevêtrées de constructions branlantes, penchées, étayées, forment un côté de ce vieux quartier de Marseille, dont l’autre débouche sur le quai du port en rues étroites, escarpées, étranglées entre de hautes maisons ; c’est un commencement des taudis italiens, où grouille un peuple audacieusement mélangé de toutes les races du monde arrêtées contre cette formidable pierre d’achoppement, Marseille, où viennent échouer tant d’errants et de vagabonds de tous les continents.
Devant nous passe un triste ménage de Levantins, Égyptiens ou Turcs ; ils ont fui, pourquoi ? leurs palmiers et leurs minarets du Caire, de Damas ou de Salonique, et les douces mélopées des muezzins ; ils viennent de débarquer il y a peu d’instants, et traînent, vers quel bouge ? sur un misérable véhicule, leur mobilier navrant. Transis, les fils suivent, à peine vêtus, des fez crasseux posés sur les boucles brunes de leurs cheveux. Ils sont trois, de sept à onze ans ; pauvres gamins ! ils iront se joindre demain au grand troupeau des gavroches marseillais, petits coureurs, petits cireurs qui portent dans leurs clairs regards toutes les mélancolies de l’Orient, tous les embrasements des côtes méditerranéennes ; ces jolis petits cireurs des rues, loqueteux et misérables, dont les voix se font un moment nasillardes et traînantes pour offrir aux passants les menus services de leurs brosses et reprennent ensuite, joyeux comme des violes et des castagnettes, le superbe langage des idiomes barbares.
Ils jouent aux billes, près de la cathédrale, sur le grand parvis délaissé où personne ne vient ; c’est leur dimanche à eux aussi ; et, dédaigneux du sou qui les fait vivre, ils se livrent aux jeux tranquilles des enfants.
Là, devant eux, contre les formidables paquebots endormis, les vagues se heurtent, rageuses et surprises de leur impuissance, et bavent une écume blanche le long des flancs inertes.
Ils sont gigantesques vus de près, ces mondes de ferraille et de charpentes dont la grande mer, au large, ne sent même pas le poids et diminue jusqu’à l’infinitésimale poussière la stature de colosses.
Ils vont frôler les quais de toutes les villes étranges dressées au front des caps, étalées au fond des baies ; ils passent toujours semblables à ce qu’ils sont ici, dans les vents ouatés d’odeurs affolantes, là-bas, à travers les îles océaniennes si lointaines qu’elles semblent d’improbables pays de rêves ; ils glissent sur des mers splendides comme des apothéoses, où s’allument, par des soirs fantastiques, des ciels embrasés de flammes de bengale, sans souffle, lourds de pesants parfums, dans les blêmes phosphorescences de la nuit soudaine, parmi les récifs, les bancs de coraux, les algues géantes et les poissons volants qui sautillent, phosphorescents aussi, comme des feux follets en ballade sur le Grand-Cimetière où les rangées de tombes sont les lignes infinies des vagues…
Ils vont, les paquebots immenses, dans les haleines chaudes et mouillées de l’extrême Orient où sommeillent des fièvres affreuses ; ils vont, écrasés entre les détroits du Sud et du Nord ; ils se balancent mollement sur les flots de la Corne-d’Or, devant les palais et les mosquées de Byzance méchante, découpée toute blanche sur le fond du ciel bleu ; à travers les Cyclades ils songent à Délos, aux mystères d’Apollon ; ils rêvent de Cépros, aux rites de Vénus ; leur proue déchire les lapis de la mer Ionienne ; ils se penchent vers Zante, la fleur du Levant, et vers Corfou, et tressaillent peut-être dans leur âme d’acier en voyant les beautés qui s’enfuient sous leur vent…
Puis ils reviennent ici, s’appesantissent sur les ancres, traînant encore dans leur sillage à peine refermé les ruissellements de tous les soleils — des clartés âpres et glaciales des terres arctiques aux sanglants crépuscules entrevus sur le seuil des déserts terrifiants, quand le jour expire entre les hauts palmiers dont les cimes s’empourprent…
Ils ne pensent pas à tout cela, les gamins ; ils jouent aux billes. Leur petite caisse, dans laquelle sont venues de si loin de belles mandarines rouges comme le soleil couchant dans les palmiers, est auprès d’eux, posée à terre, avec, dedans, des petites brosses très bon marché, pleines de cirage. C’est là tout leur avoir ; il est bien chétif auprès du paquebot aux machines ronflantes prêtes à mâcher les vagues de leurs hélices prodigieuses ! Je voudrais être parmi eux, pourtant, gamin joueur et insouciant, toujours, plutôt que de penser à tant de choses écrasantes et fatigantes comme des cauchemars, en regardant la mer tellement grande et les énormes bateaux du port… et la vie inquiète où je retombe tout de suite, dans le saut douloureux du rêve à la réalité…
Pour aller à Notre-Dame-de-la-Garde, gravi, après midi, les avenues larges et silencieuses, si différentes des pauvres quartiers du port, avec leurs bordures de riches hôtels enfouis sous les branches effeuillées de vieux arbres.
La ville se dévoile peu à peu, à mesure que montent les chemins, et soudain se découvre tout entière. Même devant la mer vivante, elle reste très exacte, cette comparaison faite souvent des villes étendues à nos pieds, mouvantes et houleuses comme des vagues pressées l’une contre l’autre et tout à coup pétrifiées par la magie des fées inconnues. Elle apparaît ainsi l’antique cité phocéenne, estompée sous les transparences d’une brume légère, devant les résilles des mâts et des cordages dessinés nets et noirs sur le fond miroitant des bassins. Les phares tout blancs, comme de grands cierges éteints, ce soir s’allumeront pour guider les marins ; mais il me plaît de croire que leur flamme pieusement vacille au bord de la mer immense pour l’éternelle veillée des morts à qui personne ne songe plus jamais !
Vertigineuse, la montée du funiculaire escaladant à pic les rocs éventrés d’où, superbe, jaillit la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde, souveraine des océans où s’en vont, les yeux humides malgré leur vaillance mâle, les jeunes hommes qui se raidissent devant les regards douloureux de la mère, de la pauvre vieille décidée à les accompagner jusqu’au bout, et qui partirait bien avec eux si les grands bateaux voulaient des mamans ! Ils l’apercevront encore au retour, la Vierge accueillante ; sa couronne d’or pointe d’abord au loin avant même que, très indécise, se tende sur l’horizon cette ligne minuscule, ce rien qui m’arracherait à moi des larmes que je ne saurais contenir : la terre de France !…
Les hou… hou… terribles du vent se brisent sur les murailles épaisses de la basilique dont le calme intérieur paraît presque formidable de silence et de paix, après les secousses acharnées du dehors. La basilique est petite et parée comme une châsse ; l’autel est caparaçonné d’or ; de lourdes orfèvreries retiennent, en des cercles d’émaux, des reflets pâles d’améthystes et de turquoises, de saphirs blêmes et d’opales troubles aux transparences orangées. Des flambeaux massifs écrasent sur les degrés de l’autel leurs larges pieds composés d’hiératiques animaux, écaillés aussi de gemmes et de métaux ciselés où reposent des lueurs bleues de clairs de lune ; et la Vierge, sous un dais fait de larges ornementations d’or épanouies en pierreries, regarde, sereine, la nef sombre où luisent, sur les murs hauts et resserrés, des suintements de mosaïques d’or parmi les marbres des ex-voto.
Si terrible est la poussée du dehors que je m’étonne de voir immobile cette chapelle, fragile en somme ; immobile aussi la veilleuse qui navigue lentement sur l’huile et promène sa flamme paisible autour du gobelet de cristal.
La tempête devient intolérable ; le ciel est couleur d’ardoise ; les montagnes lointaines, éclaboussées de neige par places, sont lugubres ; il faut nous tenir très solidement pour n’être pas renversés ; le vent s’accroche et se déchire à toutes les balustrades, beugle contre tous les obstacles et nous tient haletants, suspendus sur un abîme de vide.
La Notre-Dame d’or paraît extraordinairement puissante, là-haut sur la tour où rien ne bouge, pas même les petites mains de l’Enfant Jésus qui continuent de bénir, étendues sur la mer.
Un soir glacial naît sous les rafales violentes, un soir brutal, gris, bas, maussade, à fleur de mer, tombé sans les timidités rougissantes du crépuscule poudré d’or. La seule poussière des embruns voltige sur la route de la Corniche que nous suivons quand même, malgré le mauvais temps, jusqu’au Prado, dont l’avenue interminable débouche en hémicycle face à la mer.
Le Prado est désert ; des arbres bas, au tronc noueux, se recroquevillent vers la terre comme des vieux las qui tremblent et ramassent sous eux leurs membres fatigués ; cela est très triste ; à la fin, on ne les voit plus guère, mais on les sent tout près et souffrants, — les arbres souffrent peut-être aussi dans le vent lugubre, — et l’on passe vite, vite, car la nuit est épaisse ; aucune lumière ne luit, aucun bruit ne résonne plus, hors les sanglots de l’air agité, les pas du cheval et le roulement sourd de la voiture sur le sable détrempé des avenues. Un verglas très fin se colle aux glaces du coupé et s’arrange en arborescences figées par le gel, semblables à des coraux blancs, illuminés quand paraît au travers la devanture éclatante d’un magasin de la ville où nous rentrons enfin, las et transis dans l’âme et dans le corps, après les visions grises de Notre-Dame-de-la-Garde, de la Corniche et du Prado.II
Comme hier, même temps maussade. Ce vent qui traîne à sa remorque les vilaines loques grises et sales des nuages et bouleverse tout le ciel ; cette bruine, poussière d’eau pénétrante qui tend un voile glacé entre nous et la mer où dansent comme chaque jour, invariablement, les gros bateaux aux coques noires et les barques légères dans le clapotis d’eau couleur d’encre ; toutes ces choses humides, navrées et transies mettent autour de mes yeux et de mon âme une ambiance, une désolation de ville septentrionale, de petite ville des Flandres, froide et vieillotte ; froide avec des canaux qui dorment entre des quais toujours mouillés, entre des maisons irrémédiablement grises et monotones ; je n’ai pas dit silencieuses, car Marseille a vraiment la gaieté chevillée au corps, et, sous la pluie, reste joviale et bon enfant.
Mais si c’est là le soleil et l’azur que nous venions chercher !
En route ! Nous abandonnons le Nord ; c’est de Marseille que je veux parler, dussent ne me le point pardonner les Marseillais de la Cannebière, la Cannebière semblable en ce moment à une Laponie en dégel…
Notre-Dame-de-la-Garde qui, dès le matin, se cachait dans le brouillard, se montre toute bleue maintenant que nous avons fait un grand détour en nous éloignant de Marseille. Même, dans cette silhouette bleuâtre qui va toujours en s’amincissant, ont déjà glissé quelques lueurs pâles d’un vague soleil deviné sous un large halo de nuages argentés ; puis, enfin ! dans leur étoffe sombre, une déchirure se produit, et par cette déchirure un jet de lumière dorée tombe droit sur la verdure qui nous surprend, sur la mer qui resplendit, scintille, se meut dans un ruissellement de clartés. Les brouillards gris, devenus d’opale, puis de saphir, sont vermeils maintenant et fondent leurs vapeurs au soleil, et la terre se découvre… Le ciel lui-même se met tout nu ; et, toute veloutée, toute frémissante de lumières, cette nudité, en un réveil triomphant, étreint la terre tout entière, et de ce baiser joyeux naissent la joie et la beauté…
C’est alors la définitive verdure, le définitif enchantement ; c’est la vraie parure du Midi rayonnant et tiède, et ce ne sont plus les grisailles attristées des Flandres aux clochers d’ardoises, aux toitures pointues en chasse-neige ; ce sont déjà les toits plats en tuiles roses et les terrasses italiennes, ce sont les fleurs et la paisible menace des cactus armés jusqu’aux dents sous les aigrettes mobiles des palmiers…
La mer disparaît ; ce sont maintenant de longs défilés entre les montagnes rousses, dans les limpides vallées, parmi la Virgilienne pâleur des oliviers et le robuste feuillage des orangers. Et quand la mer réapparaît après un effacement de quelques heures qui nous rend plus cher son retour, ce n’est plus le désert immense de désolation et de ténèbres, c’est un champ d’azur, c’est, sous le ciel bleu, un autre ciel plus mouvant, avec des millions d’étoiles en plein jour… C’est la vraie Méditerranée, celle-là, la Grande Bleue ; et tout au bord, ces villas blanches sur une grève minuscule qui, légèrement, en une courbe gracieuse, se dérobe devant un flux sans violence : c’est Cannes. Déjà ?… Déjà !… Combien de fois, allons-nous le répéter ce mot plein de regrets, qui signifie surtout le charme trop tôt rompu, la fin trop tôt venue, la fin de quelque chose d’aimable et de charmeur comme cette route du bord de l’eau, tellement éblouissante et enchanteresse que, même en descendant parmi l’immense gerbe de verdure ensoleillée qui est Cannes, nous ne pouvons retenir ce déjà ! Et nous le redirons, car maintenant tout ce qui va commencer devrait bien ne jamais finir…III
Promenade au mont Chevalier par une jolie matinée ensoleillée, tiède et chaude, même, aux approches de midi. Cannes, la vieille petite ville, est ravissante avec ses ruelles en escalier, grimpant dans le plus pittoresque et le plus inattendu désordre vers l’église antique, souriante comme une aïeule devant les jeunes beautés de la ville neuve, et contente, la chère aimée, de présider à l’éclosion de splendeurs nouvelles dans ce cadre grandiose : les montagnes couvertes du feuillage pâle des oliviers dont les racines vénérables se tordent sur l’argile rose ; la mer, synthèse de toutes les couleurs lumineuses, de toutes les chansons, depuis le murmure des vaguelettes timides jusqu’au crescendo horrifiant de la tempête, ce Dies iræ que soulèvent les âmes des marins de tous les siècles amoncelés.
En bas, non loin du port minuscule, le marché aux fleurs. Sous les toiles écrues auxquelles le soleil fait une transparence ambrée, c’est une folie, un carnaval de petites choses fraîches, une cohue gracieuse de dominos qui dissimulent chacun, non pas un visage, mais l’âme frêle et menue d’un être éphémère dont les couleurs à peine écloses blêmissent et s’effacent : une fleur. Ici, des œillets de toute beauté, du blanc neigeux, et combien parfumés ! au rouge noir sans arome, mais veloutés et caressants et lascifs, presque, dans l’étalage troublant de leur chair ; là, les narcisses et les anémones, les mimosas aux menues prunelles d’or, veloutées aussi…
Le soir, après les féeries de Vallauris et du golfe Juan, les yeux se reposent ; ce ne sont plus des gouffres de lumière implacable, des averses de feu sur les vergers tranquilles ponctués des boules rondes et luisantes des orangers, c’est un abîme de douceur, au bord de la mer, un ronron caressant de vagues mourantes ocellées, sur leurs crêtes blanches, de paillettes aux clartés d’acier. Tout est paisible, calme ; et l’âme éprise se laisse éperdument bercer, rêveuse, au rythme presque silencieux de la belle nuit qui commence. La lune apparaît, blanche entre les feuillages bleus et immobiles des eucalyptus ; elle apparaît comme une souveraine, et l’on dirait qu’à son approche le monde entier s’est tu, s’endort, qu’on l’entend respirer, et que son haleine monte, très doucement, s’étendre comme un voile sur toutes choses…IV
Un labyrinthe de palmiers penchés sur des routes toujours grimpantes. À chaque pas la mer et le paysage se découvrent davantage ; l’Estérel éperonne, là-bas, de sa masse légère comme une buée matinale, la mer à peine mouvante dont les senteurs arrivent jusqu’à nous humides, fraîches, vigoureuses. Il fait bon marcher ; et pour raccourcir les chemins nous les coupons en escaladant des talus ; la terre s’éboule en petites avalanches rouges engloutissant de minuscules travaux de fourmis ; il arrive que nous glissons ; alors, pour nous rattraper, nous empoignons les vertes chevelures de graminées tendres et mouillées de rosée, piquées de fleurs de trèfles, de campanules mauves ou de larges marguerites blanches aux cœurs dorés. Tout est clos de haies d’où s’envolent des roses. Parfois un mur ; rarement, mais sur les pierres blanches tendues ainsi qu’un drap de lin, se détachent des guirlandes de géraniums comme pour un passage de procession en une éternelle Fête-Dieu, et ce sont les aloès géants qui présentent les armes.
Il me plaît qu’un peu de tristesse se mêle à tant de joie : voici, enfouie sous les verdures, comme un nid, la chapelle funéraire du duc d’Albany. Mais la mort même, ici, refuse jusqu’aux apparences du deuil, et tout au plus est-elle mélancolique — si divinement ! — la chapelle élégante, toute de bois clair et luisant égayé de cuivreries, chef-d’œuvre de comfort anglais où l’on a songé d’abord à vêtir la prière de parures légères qui la retiennent à peine et laissent libre son essor vers le ciel. Point de marbres pesants ; seulement un Carrare éclatant de blancheur dans lequel s’est figée la figure du prince, délicate et fragile. La chapelle est déserte, mais j’évoque aisément les cérémonies de ce culte protestant dont la froideur stérile contraste avec la joliesse de tout, ici ; je vois, attentifs sur les stalles de bois vernis, les boys aux vestes courtes, aux chevelures fines, aux yeux clairs dans l’ovale aristocratique du visage ; les misses frêles et dodues aux jolis yeux de babys, aux joues roses à travers les boucles retombantes de soieries blond cendré, avec, dans le sourire de leurs lèvres rouges et mouillées, la double ceinture de leurs dents blanches et ténues. La délicieuse chapelle ! où dort le prince que viennent regarder ses petits frères et ses petites sœurs, dont les voix fraîches et caressantes chantent les psaumes des eucologes qui demeurent là, à chaque place. Un que j’ouvre porte à la première page blanche ces noms seuls : Harold M. Merton, avec ceci exquisement, étrangement mélancolique, et si conforme à mes propres pensées, en ce moment même, dans cette retraite charmante plutôt que dans cette chapelle funéraire, asile en effet de la Jeunesse et de la Mort :
Every earthly whiteness seems
Matched with his obscure and dim ;
He is King of all my dreams,
I am king of love for him.
J’ai pris la peine de copier ces phrases énigmatiques, et souvent en pensant aux clartés radieuses de la chapelle d’Albany aux verrières blanches à travers lesquelles glissent, dans le soleil, les frondaisons souriantes des glycines et des vignes vierges, je me demande quel est ce jeune roi d’amour qui soupire si joliment après le prince de ses rêves, « dont l’éclat surpasse toutes les blancheurs terrestres », et qui, pour confident, a pris ce livre pieux rempli de chants mystiques, ce petit livre à couverture noire dans lequel je viens de lire, sans doute, l’incompréhensible fragment de quelque passionnante et mystérieuse histoire enveloppée toute en des obscurités maladives comme un sonnet de Shakespeare, quelque plainte secrète d’un pauvre cœur meurtri qui cache, sous les vers délicats d’un délicat poète, l’aveu tendre de son amour, peut-être parce que ce livre de prières, tout à l’heure ou demain à l’office, passera dans les mains blanches, sous les yeux aimés, auréolés de boucles courtes et dorées comme le soleil, sous des yeux bleus larges et profonds comme un peu de ciel, et comme lui d’une beauté qui confine à l’angoisse…
Nous redescendons par des sentiers de mimosas aux petites feuilles légères et menues ainsi que des plumes. Dans les jardins, les globes vermeils des oranges se balancent, lourds, parmi les fleurs virginales ; des roses envahissent les parterres ; des fougères arborescentes empanachent les pelouses de leurs splendeurs tropicales ; et partout, sous nos pas, autour de nous dans l’air, s’épanouit en rires sonores la joie de vivre. Les orchestres invisibles, dans le parc des hôtels, chantent les chansons langoureuses des tziganes coupées par le roulement métallique des tambours de basque dont frétillent les disques de cuivre. Le soleil très haut dans le ciel darde sa prodigieuse vitalité sur la terre bénie ; les montagnes exultent de richesses, de verdures ; les jardins distillent, comme des cassolettes orientales, d’invraisemblables aromes ; la mer charrie des pluies d’étoiles. C’est un écrasement d’or, de parfums, d’azur et de musique ; c’est l’énervante mélopée de la matière triomphante, dont chaque note vibre et s’enfonce dans la chair délicieusement pâmée en d’interminables jouissances…
V
Nous quittons Nice de bonne heure pour aller à Menton.
Le soleil fait danser aux flancs des montagnes, dont les crêtes changent continuellement d’aspect, la gamme lumineuse de ses couleurs sans nombre.
Soudain la rade de Villefranche paraît, ronde, éblouissante, miroir incomparable dans ce cadre où tout n’est qu’enchantement et parfums. L’eau de la mer est d’une telle limpidité que le fond se voit, à peine bleuté ; et les varechs s’y jouent, échevelés sous la poussée des vagues, dans le clapotis des mille gouttelettes qui sans cesse jaillissent en lumières contre la muraille du remblai sur lequel nous glissons vers Beaulieu, dans le frémissement de l’atmosphère qui lentement se réchauffe et bientôt aura reconquis tout l’éclat, toute la tiédeur dorée, molle et voluptueuse qu’avait emportés la nuit…
De Menton, une voiture, en descendant de wagon, nous a aussitôt ramenés à Monaco par ces routes exquises du bord de l’eau, par les champs de roses et de violettes, par les vergers de citronniers et les hautes futaies du cap Martin…
Monaco ! Le bloc énorme du rocher majestueusement accroupi sur les flots est ceinturonné de murailles massives d’où retombent les innombrables verdures des jardins suspendus à tous les plans, à tous les étages, séparant entre elles les maisons qui semblent des fruits dorés couchés dans la mousse. Elles paraissent vraiment petites, ainsi posées sur le colosse ; la cathédrale, elle-même, qui hardiment fait face à l’horizon infini, semble un jouet aux lignes pures, blanches et d’une singulière précision sur le fond bleu du ciel ; les deux tours sont deux nonnes pieuses aimablement sévères. Oh ! la jolie cathédrale accueillante et fière ! En face les deux campaniles du Salon des Jeux ressemblent à deux filles maquillées sous des clinquants odieux…
Un chemin de fer grimpe à la Turbie, en des courbes gracieuses ; il s’élève, escaladant les pentes du rocher, sautant les ravins, glissant par des rampes douces au milieu des vignes étagées sur de multiples terrasses maintenues par des contreforts de pierres brutes. Et tandis que se rapprochait de plus en plus la pointe vers laquelle roulait la minuscule locomotive, et que s’affirmait à chaque pas l’intensité de la vie sous un débordement de gaieté, de fraîcheur, la vie riant aux éclats dans le soleil doré, et l’éternelle verdure, sur la mer où se pousse le tumulte des vagues en lignes écumeuses, — un père Franciscain nous entretenait de son monastère qu’il allait rejoindre vers quelque vallée perdue de l’autre côté de la montagne. Son bon et franc visage sortait tout en sourire du lourd capuchon de bure ; ses yeux perçants avaient la mobilité des yeux d’enfant et disaient la sérénité de son être, les joies trouvées par delà nos étroites visions et nos conceptions du bonheur, quand les regards plongent dans un océan de douceur et de bonté et que la foi robuste s’éclaire aux ruissellements infinis d’un Soleil qui ne connaît pas de nuit… Et ses douces paroles de prêtre, et sa robe de bure étaient les bienvenues dans cette veillée de Noël.
Elle est exquise cette Turbie, exquise dans son délabrement et ses haillons, et chaude, colorée même, dans les ombres et le gris uniforme de ses croulantes masures. Et comme on respire déjà l’étrange parfum d’inconnu, comme on sent autour de soi cette atmosphère pénétrante relevée d’un je ne sais quoi de fatalisme, de nonchalance orientale ; cette physionomie nouvelle des villes italiennes indolentes et sales ! Les gamins ont de jolis yeux noirs, ils mendient ; les filles mendient aussi, avec, sur les bras et autour d’elles, une horde insupportable de pauvres marmots dont les petits cris de poussins se joignent aux glapissements geignards de la sœur aînée.
Il faut l’avouer, l’air est frais malgré le soleil répandu joyeusement sur les tables couvertes de nappes blanches, dehors ; et, seule, la satisfaction de se souvenir d’un déjeuner en plein air le 24 décembre, fait braver les souffles, glacés par instant, qui racontent leur passage sur les Alpes neigeuses où l’hiver bat son plein ; c’est aussi le besoin de ne distraire aucun regard de ce merveilleux panorama tendu de la côte ensoleillée à l’infini de cette Méditerranée souveraine et belle, des échancrures fines des baies, aux pointes hardies des caps ivres de soleil, mais non rassasiés, qui s’avancent toujours plus avant dans le sud pour l’aller chercher vivifiant et réjoui. Tout en bas, comme un cailloutis blanc, comme une grève de petits cubes éclatants, les maisonnettes et les villas dégringolent du flanc des montagnes et se répandent sur les bords de la mer. Le rocher de Monaco perdant tout relief s’affaisse sur lui-même ; il ne reste rien de la hardiesse de ses remparts ; le monstre est au repos, et les vagues agressives se détournent de lui stupéfaites de n’avoir pu mordre son granit.
La Condamine, banale entre Monte-Carlo où nous redescendons et Monaco vers qui nous allons, sur une belle route sinueuse le long des rochers. Quel charme à mesure que s’approchent les jardins, que se découvrent les rues claires, nettes, élégantes, coupées de menus carrefours où ne passe personne ! Personne non plus sur les remparts bien moyennâgeux, vrais, tels que l’imagination les évoque aux siècles écoulés, sans replâtrages maniérés et faux ; personne devant la cathédrale dont la blancheur un peu neuve est atténuée par le rose plaqué d’or que lui envoie le soleil couchant. Dans une ruelle qui doucement s’achemine vers la place du Palais, sereines sont les façades claires des maisons aux fenêtres gaiement fleuries de plantes grimpantes étoilées de couleurs vives : rouges incandescents, vermillons sonores des géraniums épanouis aussi en fleurs d’opale et de chairs rosées ; les maisonnettes charmantes s’apprêtent à clore leurs persiennes vertes, tout à l’heure, quand la nuit arrivera tiède et bleue, dans cette atmosphère de calme, d’apaisement infini, dans le silence que vient à peine troubler, s’il n’y ajoute plutôt la mélancolie d’une chanson berceuse, le flot qui heurte avec des plaintes la ligne des rochers qu’en se penchant sur les garde-fous on aperçoit au bas de la place d’où se dégage, très éclairée par les lueurs du crépuscule, l’élégance florentine du palais. Ses tours blanches et ses vitraux flambent de pacifiques incendies dans la tranquillité suprême, dans le recueillement de cette fin du jour. On dirait la féerique demeure d’un Prince charmant, ou mieux, le palais enchanté d’une Belle au bois dormant : dans la cour, de fines gazelles vont sur leurs pattes d’ibis fauves en mouvements de ravissante délicatesse, sautillent sans bruit sur les marches du grand escalier de marbre et, sans bruit, comme des oiseaux, volent sur le gravier blanc répandu sur le sol et puis nous regardent, inquiètes et curieuses, avec leurs yeux jolis et purs comme des yeux d’enfant.
C’est fini, le jour se meurt, et les flancs des rochers se revêtent d’un velouté mauve frotté d’or que fait le soleil avant de disparaître. Sur la place silencieuse un soldat veille ; le fil d’acier d’une baïonnette étincelle par intervalles au-dessus de lui ; à ses pieds, des boulets sont dressés en pyramides sur le derrière des canons ; et ces menaces enfantines sont amusantes et ajoutent encore à la tranquillité de cette invraisemblable principauté détachée comme une île de rêve du reste de la terre.
Monte-Carlo, savamment maquillé, fardé, surchargé de bijoux dorés, lourd de pierres fausses et de clinquant ! Monte-Carlo étonne par l’ordonnance parfaite et l’alignement rigoureux de son ensemble. À Monte-Carlo les poses sont savantes et étudiées, à Monaco elles restent encore à demi sauvages. Ici, les fleurs, petites maîtresses susceptibles, sont recouvertes, la nuit, d’une housse d’étoffe qui préserve leur fragilité des morsures du souffle âpre du large ; là-bas sur le rocher elles ne craignent pas d’être enveloppées dans les baisers du vent de la mer, dût-il laisser sur elles, à peine, l’empreinte de son mâle enlacement, la rougeur des étreintes mystérieuses des soirs…
Noël ! c’est Noël déjà quand s’allument tous les feux de la ville, quand le vieux rocher de Monaco n’est plus, de l’autre côté de l’eau, sur le bleu noir du ciel, qu’une masse énorme aux silhouettes grises et fantastiques piquées çà et là de quelques points de lumière, étoiles qui semblent tombées du ciel où commencent à clignoter leurs yeux d’or pâle… Noël ! Noël !…
Au Casino la cohue se presse. Quels pauvres visages ! dans les salons des jeux, autour des tables vertes, éclairées au milieu de la demi-obscurité qui flotte au-dessus d’elles, quels pauvres visages, neufs ou vieux ! Cette jeune femme promène ses gants blancs sur les numéros, et sème au hasard les pièces d’or d’où va germer la fortune. Chacun de ses gestes a son contrecoup sur son regard qui s’allume de convoitise et d’espérance. Elle gagne. L’or pleut littéralement et déborde sous les râteaux qui le poussent vers elle. Les poignées de louis s’amassent, puis se dispersent aussitôt, glissant de la blancheur de ses gants sur le tapis, en piles minuscules, en tartelettes jaunes. Elle se lève, exubérante, s’agite, allonge son bras, sa main, vers le numéro porte-bonheur, accumule l’or, sème l’or, jette l’or qui disparaît, puis revient en jet lancé avec une adresse surprenante par le croupier ; et, devant elle, en tas, il s’amoncelle, et sa chanson tintinnabule éperdument joyeuse… Autour des tapis les joueurs s’efforcent de rester indifférents aux fantaisies de la fortune, jusqu’à ce qu’un coup formidable, bon ou mauvais, éclaire leurs yeux d’une joie mal contenue, ou crispe, d’un même mouvement douloureux, leur front et leurs lèvres quand, dans la rafle du dernier louis, disparaît en un miroitement d’or la dernière chance.
Noël ! Noël ! la veine a tourné les talons, la dame aux gants blancs a perdu. Les yeux s’arrachent un moment à la fascination de l’or et la suivent machinalement. Tout à l’heure elle était enviée, admirée ; chancelante elle va, maintenant, où ?… Elle va !…
Au 30 et 40 les enjeux sont énormes, les toilettes plus brillantes aussi. Un jeune couple amasse les feuillets bleus et roses des billets de banque fripés, comptés et recomptés ; ils arrivent vers eux avec des battements d’ailes, posés sur le râteau d’ébène. Auprès de ces joueurs heureux, une vieille parcheminée, les yeux lamentables dans un maquillage impuissant qui souligne davantage encore le désastre déjà lointain de sa beauté. Elle joue ; pauvre vieille, avec sa robe de satin pâle mouillée de paillettes d’argent, son corsage qui laisse deviner par l’échancrure la ruine de sa chair, et, sur ses cheveux où la neige maculée se dispute avec les teintures odieuses, un chapeau à larges plumes blanches, larges et défaites comme des panaches de corbillard. Quelle pitié ! Si la chance tournait, et sous ses mains creusées et tremblantes ne laissait que du vide, elle partirait aussi ; et sur quel grabat irait-elle, irrémédiablement écroulée dans l’ironie de sa robe de satin argenté, mourir de faim et de misère ?
Des Anglais impassibles jouent et gagnent ; ils gagnent toujours ceux-là ! Des Allemands, figures épaisses et impénétrables, barbes rougeaudes, marche lourde, circulent autour des tables. Des femmes élégantes, horriblement défaites souvent, parfois jeunes et jolies comme cette belle fille toute vêtue de velours noir, robe et corsage d’une recherche simple et provocante ; une croix de diamants étincelante et d’une extraordinaire pureté de lignes, un bijou superbe, bijou sacrilège, fascine et détourne les regards sur l’insolente richesse de sa poitrine offerte dans les reflets tendres et caressants du velours, sous le poids éclatant du rare joyau. Et continuent les bruissements clairs de l’or convulsivement secoué, et le cliquetis des billes d’ivoire sur la course vertigineuse de la roulette !…
Noël ! Noël !… Minuit s’avance ; le tripot ferme. Dehors la nuit est splendide, les étoiles allumées brillent dans le ciel de décembre. Les vagues viennent se briser et gémir sur les rocs. Nul autre bruit que l’éternel halètement de la mer.
Nous traversons les jardins. Sous le vent du large les feuillages s’agitent, découpés sur le bleu noir et satiné du ciel ; ils gémissent d’une voix blanche et lente ; les branches s’enveloppent, s’étreignent comme des bras qui se cherchent l’un l’autre, frôlent leur chair qui se désire, et, par d’invisibles visages, soupirent les mots d’amour que la brise récolte en légères moissons.
Une ombre glisse contre moi, appelle doucement et s’enfuit ; qu’est-ce ? Le chuchotement était bien délicat, les yeux bien jolis, mais pourquoi cette retraite furtive, honteuse presque ? je n’ai rien vu qu’une taille svelte et fluette et, à peine, l’étrange perversité des regards… Les blêmes rayons de la lune brillent et se jouent dans les taillis, éclairent les haleines tremblotantes des jasmins qui, chaudes, flottent en vapeurs embaumées dans la fraîcheur de la nuit… L’apparition de tout à l’heure m’obsède et j’aurais bien voulu savoir. Cette ombre est-elle la consolation qui donne ou qui vend ses sourires et va, rôdant, au guet des désespérés, pour les toucher au front et leur rappeler que, tout perdu, il reste encore cette magique raison de vivre : l’invincible attirance des lèvres, la griserie des baisers qui chantent les plaisirs d’amour, en cette enivrante soirée, sous les étoiles brillantes et douces, avec leurs prunelles d’or indulgentes sur le velours tranquille du ciel ?
Noël ! Noël !… il est minuit !… Dans une obscurité fraîche comme celle-ci, par les mêmes souffles nocturnes promenant avec eux les senteurs des plantes, dans le même silence émouvant des ténèbres bleutées, au pays de Gâlil, sur la terre plus jeune de vingt siècles, un Enfant naissait d’une Vierge, et les premiers cris issus de ses lèvres frêles tressaillaient dans les airs magnifiés, en suaves cantiques de paix et d’allégresse. Des bergers, dans les graciles ritournelles de leurs fragiles chalumeaux, chantaient la joie des humbles en s’approchant de Bethléem endormie. À genoux ils adoraient ces bras divins plus grands que tous les mondes et dont les tendres menottes venaient de s’abaisser jusqu’à notre misère… Les bergers riaient aux petits yeux rieurs emplis de la splendeur des cieux, et l’homme, sous les haillons des pâtres tremblants et réjouis, inclinait son front pâle vers Dieu, né des flancs immaculés de Celle qu’il avait bénie entre toutes les femmes…
Dans la rapidité d’un éclair, les yeux perdus sur la mer immense, ce fut en moi, à ce souvenir, le recueillement d’une adoration infinie…VI
C’est un Noël tout à fait dépourvu d’allégresse ; même, est-ce bien Noël ? Nous sommes rentrés hier soir à Nice, et je me souviens d’une rêverie très fugitive et très exquise en passant dans les jardins du Casino ; rêverie faite de pensées dont je me reproche l’accouplement profane ; d’abord les chuchotements timides, ingénus allais-je dire, de l’ombre subtile, puis, après, cette minute d’un mysticisme aigu, devant la mer qui roulait jusqu’à moi dans ses volutes, en rythmes enchanteurs, la mélodie des célestes hautbois du Grand Noël de la Judée. Après encore, c’est, dans une gare banale, la longue attente du train, en regardant les affiches qui bégaient l’étincellement du soleil, la verdure fraîche des végétations au long de la côte d’Azur. Puis le retour à Nice après le rude bercement et les chaos des wagons…
Ce matin est triste à pleurer, gris, froid, morne. Oh ! le pauvre Noël, dans cette église cathédrale quelconque et vide malgré la foule indifférente, sans cohésion, sans piété ! Même dans l’enceinte sacrée, Nice me poursuit avec cette obsédante impression de bazar, d’instabilité, d’endroit où l’on passe seulement ; et j’ai toutes les peines du monde à m’isoler quelques instants en la ferveur mal assurée de vagues prières…
Par la belle route qui se déploie sur la mer et sur Nice, blanche et sinueuse parmi les villas, nous allons à Villefranche. Nice peu à peu s’enfonce et disparaît ; seule encore, tel un gros scarabée brun, la Jetée-Promenade flotte sur l’eau, puis s’efface. Au détour de la corniche paraît, merveilleuse, la rade de Villefranche étendue à nos pieds dans un large rayon de soleil ; ses flots limpides sont bordés d’une fine dentelle, d’un ourlet de guipure qui court le long des côtes sombres d’alentour ; et la ville, là-bas, égrène ses maisonnettes du bord extrême du rivage jusqu’aux flancs des rochers ; leurs couvertures de tuiles roses et rouges jouent dans la lumière ; les ruelles irrégulières dégringolent vers la rive, franchissant des jardins d’œillets et de violettes. Comme nous désirons emporter de ces fleurs qui demain seront la joie du marché de Nice, une belle fille s’approche et va nous renseigner ; douce et timide sous la dorure de ses cheveux, sa main enveloppe d’un seul coup tout un coin de vergers à peine enclos de haies fleuries, pour nous montrer les gerbes encore sur pied que demain matin elle portera à la ville.
— Mais ce soir, dit-elle, on ne peut en avoir, personne ne travaille, c’est fête, n’est-ce pas !
Et les cloches des vêpres, juste à ce moment, accouplent aux senteurs qui s’échappent de toutes parts, le heurt mélancolique de leur bronze, et dans l’or du soleil, la brise passe, emportant les chansons du clocher, les regards de la belle et l’haleine des fleurs…VII
Le matin, de bonne heure, l’avenue de la Gare tout éclatante de lumière pure et fraîche ; la place Masséna largement ensoleillée. Plus loin, vers la mer, dans les ruelles étroites, les boutiques s’ouvrent, et sur leurs devantures s’amoncellent les paniers ; entre des feuillages glisse la tentation des oranges d’or et de vermillon, des mandarines savoureuses, et la pâleur acide et fuselée des citrons pareils à d’énormes cocons de soie. Sur les pavés s’étalent les corbeilles fleuries, sans apprêt, sans coquetterie. Les mimosas essaiment leurs feuilles menues de pépites veloutées et caressantes, et l’air s’emplit de leur parfum. Les anémones rustiques s’habillent de rouge ou de mauve. Les iris royaux élancent les pourpres et les violets de leurs pétales ouverts et retombants avec une grâce souveraine. Les résédas allongent leurs petits cônes bronzés si discrètement odorants. Les œillets triomphants priment les marguerites de porcelaine blanche au cœur ensoleillé ; tous exquis de tons et de nuances, ces œillets ; il en est d’épaissement rouges dont la sève se gonfle à fleur de peau comme du sang sous les lèvres voluptueuses ; d’autres sont presque noirs dans leur violet écarlate ; les jaunes pâles font songer aux premières étoiles du soir qui naissent de l’or crépusculaire ; les blancs neigeux répandent des senteurs violentes, suaves et troublantes ; des chairs roses se bercent, sensuels, sur leurs tiges frêles ; des panachés résument dans la frisure de leurs pétales les baisers ardents, la ciselure de l’or fin, les veloutés noirs des pourpres ténébreuses et les ivoires fraîchement travaillés. Les violettes se penchent sur les bords de l’osier tressé, l’imprègnent de leur haleine friande qui volète dans l’air, distincte de toutes les autres, douce et pénétrante et reposante comme le demi-deuil charmant et puéril de leurs corolles qui n’osent s’entr’ouvrir. Et c’est, côte à côte, dans chaque corbeille tressée de jonc et d’osier, une pyramide de gemmes délicates ou, si l’on veut, un rire épanoui de petites créatures vivantes et désirables, vêtues de brocarts précieux, de soies changeantes, de velours épais et lourdement drapé, de lin blanc tissé en réseaux imperceptibles par les fées des tièdes nuitées et des aubes adolescentes…
Dans Nice tapageuse et effrontée ce sont précisément les ruelles modestes, les étalages simplets qui séduisent ; et c’est une joie de partir avec, dans les regards, cette saine vision de plein air du marché aux fleurs.
Et maintenant, en route vers l’Italie, en route ! Nous allons entendre bientôt l’incessant refrain qui, chaque jour presque, va nous pousser toujours plus avant dans le Sud et qui, hélas ! aussi nous suivra à notre retour auquel, déjà, je pense tristement quand je ne devrais songer qu’à me réjouir, puisque, à l’extrémité du ruban de fer qui se déroule du côté de Vintimille, j’entends le gai : Partenza !…
Menton s’efface, et c’est Vintimille, avec déjà je ne sais quoi de rudement parfumé, d’étrange, d’une saveur de bazar oriental. Vintimille, d’ailleurs, est très sale et se rapproche en cela des villes de l’extrême Sud. Mais j’adore ce piment bizarre qui demeure pour moi inséparable des souvenirs trop restreints de mes chères promenades dans Séville, dans Ronda et Tanger, adorables malgré leur malpropreté, sensuelles et plaisantes, quand, une fois compris ces haillons qu’il faut savoir aimer, leurs charmes apparaissent souverainement tendres, captivants et irrésistibles, vous retenant tout entier par le délicieux arome et le ragoût de leurs voluptés…
Nous traversons de jolis villages ; mais le train file, les haltes sont rares ou courtes, et nous perdons de ne point voir les types simples des champs. Quelques beaux visages se sont montrés dont la finesse surprend ici ; des jeunes garçons bruns aux traits réguliers ; des femmes aux cheveux épais et noirs, qui grimacent à cause du soleil et découvrent leurs dents blanches en clignotant leurs yeux perçants ; et les petits enfants, hélas ! naïvement effrontés, apprennent déjà ce métier de mendiant, fléau ravageur de toute l’Italie ; ils tendent leurs mains sales, et leurs parents les imitent, tant la misère est atroce par ici, et invétéré ce besoin de mendier conduit à se développer davantage, à mesure que nous descendrons dans l’Italie méridionale, parfois sous une forme moins gracieuse et différente du joli regard implorant des bambini qui se précipitent vers nous et se feraient écraser entre les roues des wagons pour quelques centimes.
Souvent, à la traversée rapide d’une bourgade, c’est un coin merveilleux et agreste, murailles hâlées supportant avec peine un escalier grimpant en plein air vers quelque grenier, quelque loggia ouverte sous la toiture mal équilibrée par des colonnettes de bois entortillées de plantes grimpantes. Les grappes de fleurs, longues et retombantes, rouges, violettes ou blanches, dans un espace très court, hâtivement, précipitent jusqu’à nous leurs odeurs subtiles. Des vergers s’encadrent d’allées bordées de pilastres reliés entre eux par des poutres à peine dégrossies, mais d’une rusticité légère, car les vignes y courent librement et se tordent avec les feuillages d’or, de bronze et de cuivre oxydé des vignes vierges et des lierres. Et quand ces galeries ajourées se haussent sur un mur en terrasse, l’effet est des plus charmants et d’une idyllique simplicité ; l’œil cherche les mains qui s’enlacent, les regards qui se croisent, les seize ans qui chantent l’éternelle chanson dans l’apaisement et la sérénité du soir, devant la mer infinie, sous l’amoureux enlacement des lianes.
La lune se lève pâle, estompée dans la pâleur presque de même couleur du ciel mêlé de bleu très atténué dans l’or et l’argent d’un crépuscule blanc ; puis cette lune monte silencieusement, plus éclatante à mesure que décroît le jour… Là-bas une lumière brille déjà, puis deux autres aperçues en même temps, puis tout d’un coup des milliers aux approches d’une ville… les lumières diminuent, s’éloignent, s’éteignent et l’ombre seule persiste, étendue sur toutes choses, voilant d’un brouillard léger la surface de la mer phosphorescente sous les reflets lunaires.
Des usines, une gare noire, bruyante, sifflante et hurlante où nous stoppons, nous diraient assez que nous approchons de quelque ville fameuse si nous ne savions exactement que Gênes est là tout proche. Mais cette première vision de choses si enténébrées, malgré les mauvaises lueurs jaunâtres des lampes, nous fait craindre une immense déception, si c’est de la sorte que s’annonce la superbe Gênes, dans les chocs de ferraille et les odeurs huileuses, frappant et empuantant les grands murs couverts de suie de la gare d’embranchement. Un peu de ciel réapparaît, bienvenu après cette vision d’enfer ; un phare resplendit en avant, sur la mer que nous ne voyons pas encore, que nous ne verrons pas, ensevelis entre les maisons très hautes, d’une hauteur qui nous étonne et paraît plus grande encore dans la lumière très vague et très indécise poignardée en tous sens par les lames brillantes des lampes électriques.
Voici Gênes !
Étrange impression ressentie dès les premiers pas, le soir, dans les belles rues dallées ; la ville me paraît remplie de pâtissiers, mais de pâtissiers élégants, aux menus étalages parés de feuillages d’or et de fleurs rouges, bien tranquilles sous les lumières nombreuses. Les gâteaux sont jolis comme un dessert de conte de fée, perlés de sucres richement travaillés et ciselés, rehaussés de couleurs fines et d’anis multicolores avec des irisements de nacre, de perles, qui sont de minces dragées recouvertes d’argent brillant. J’admire l’ingénieux apparat de ces décors, de ces enguirlandements de fruits glacés parmi les succulentes verdures d’angélique enveloppées de beaucoup de papiers dorés qui, sous la rampe d’éclairage, doivent horriblement tenter les robustes petits bambini vite accourus, pour voir, des ruelles étroites, en s’appelant par des noms si jolis ; de ces ruelles plus charmantes encore que les larges voies emplies de monde, ces ruelles aux allures de coupe-gorge, pacifiques maintenant, mais terribles autrefois, sans doute, avec leurs maisons abruptes, aux corniches saillantes qui se rejoignent et laissent entre elles un mince filet de ciel bleuté où se jouent, comme chez les confettieri, ces morceaux de papier doré que sont les étoiles.
Les carrefours sont innombrables, où se rencontrent et se divisent plusieurs de ces hauts et longs couloirs qui grimpent du port vers le sommet de la ville en pentes douces ou raides, en degrés de granit toujours extrêmement propres. Ce soir, des chanteurs occupent les oisifs, et font la joie des gamins trottant pieds nus d’un carrefour à l’autre pour ne perdre aucun refrain de ces concerts en plein vent.
Dans un passage étroit, quelques jeunes gens forment un groupe singulier ; ils sont quatre ou cinq en rond, enlacés étroitement, les bras passés autour du cou, d’une épaule à l’autre, de façon que leurs lèvres se touchent presque et leurs haleines se confondent. Intrigué, je m’avance : une voix s’élève, éclatante, de l’une des bouches réunies, éclatante, exquise, sonore et brève, telle que sa fraîcheur juvénile éveille aussitôt en moi les souvenirs lointains des chantres mutilés de Saint-Jean-de-Latran et des ardentes mélopées de Séville. C’est le soprano aérien ; ses vocalises claires s’épandent au loin, forment un réseau enveloppant de guipures soyeuses dont les mailles s’élargissent et se resserrent, et doucement, mollement, broient l’âme et le cœur petit à petit, mais à coup sûr, en câlines étreintes subies sans résistance, recherchées au contraire et qui laissent un vide immense dès qu’on ne les sent plus. Le soprano s’est tu ; un mezzo-soprano lui répond. La voix la plus étrange et la plus émouvante que je connaisse ! Elle semble s’échapper du corps insexué d’un archange douloureux, et, flottante, caresse également les lèvres pures et ingénues d’un enfant ou les lèvres inquiètes et tremblantes de désirs imprécis de l’adolescent étonné en qui la chair vient de tressaillir. Et bouche contre bouche, en sourdine, s’unissent les lentes psalmodies des jeunes hommes, les couplets mélancoliques et berceurs, mués en marches vives, guillerettes, joliment cadencées sur les paroles italiennes pliées aux caprices des habiles chanteurs ; la cantilène berceuse s’achève en langoureux appels d’amour, raisonnables d’abord, exaspérés ensuite en cris mâles et volontaires diminués, éteints, jusque dans un frémissement de passion qui semble traduire le baiser musical de ces jeunes lèvres, l’étreinte harmonieuse de ces jeunes corps…
Autour d’eux la foule passe indifférente. Ils chantent donc pour le seul plaisir. Leur mise simple et soignée indique assez d’ailleurs qu’ils n’attendent rien des passants. Je les entends encore plusieurs fois, puis ils vont porter plus loin leurs étonnantes vocalises. Je me souviendrai longtemps de la splendeur de ces chants dans le beau soir de Gênes, de ces voix pures de jeunes hommes et d’enfants dont le timbre surpasse encore en fraîcheur le charme de la voix féminine…
Au coin des rues, des Madones adornées en les dentelles pieuses, les dévotes fleurs artificielles et les ors mystiques et les simplettes fanfreluches, brillent sous les glaces qui les protègent, devant les lampes allumées et les cierges dont les flammes plient sous le vent et font couler d’énormes stalactites de cire blanche sans cesse allongées par les gouttelettes chaudes que pleure la flamme contrariée. Toute la ville paraît franchement heureuse et d’une gaieté tout en dehors, un peu puérile, bellement placée sous les regards des Madones saintes qui font en passant se signer les filles aux beaux yeux noirs. Les chapelles ressemblent aux confettieri et les confettieri sont pareils aux chapelles : feuillages dorés, fleurs rouges et naïves verroteries chatoyantes comme d’enfantines sucreries.
L’impression est complète, de l’extraordinaire, de l’imprévu tant recherché. Un charme très grand se dégage de cette foule amusée, jeune, semble-t-il, quelque peu sensuelle et folle, allant et venant entre ces maisons énormes qui, toutes, ont des allures de palais avec leurs portes immenses, leurs voûtes hautes éclairées par de majestueuses lanternes aux dimensions invraisemblables, riches de fers ouvrés et dorés, de bronzes ciselés et savamment patinés, tordus en rinceaux, en volutes sur l’éclat des marbres dont se revêtent à profusion les murs des vestibules amples comme des porches d’églises…
Pendant les premières heures de la nuit, le vent se lève et secoue violemment les fenêtres mal ajustées de ma chambre. Une véritable tempête pleure sous les portes, descend par les cheminées en plaintes déchirantes ; et cependant je sens en moi un grand calme qui n’est pas fait seulement de la joie quelque peu égoïste de me sentir abrité, mais aussi de la sérénité des chansons reprises à nouveau, douces et obsédantes, dans le demi-sommeil qui tombe lourd et clôt mes yeux encore éblouis des lumières de tout à l’heure ; et mon premier rêve s’enveloppe dans les vocalises berceuses des bouches roses et tremblantes mêlées aux orgues frissonnantes du vent…VIII
Par la fenêtre grande ouverte, dans l’air apaisé, la place de l’Annunziata est délicieuse de roses, de vermeils qui se jouent dans la limpidité bleue du matin. Les toits, rapprochés ou éloignés par un lointain très net, sont couleur de bure avec des lisérés de pâles dorures ; les murs sont aussi d’or pâle, et sur les hautes fenêtres, la verdure — les feuillages traversés par la lumière — brille en émeraudes. La ville entière se réveille dans une atmosphère extrêmement pure qu’ont balayée les rafales de la nuit ; elle s’enveloppe dans cette sorte d’auréole ondoyante que font les torrides chaleurs sur le sol embrasé ; mais ce sont des vagues fraîches, dont les remous impalpables apportent des sensations délicieuses et neuves comme si le monde entier venait de se renouveler.
En face de moi l’église de l’Annunziata bombe ses toitures vieillottes, et ses coupoles s’arrondissent et me paraissent faire le gros dos, paresseusement, devant la flambée du soleil.
De la rue montent les cris des marchands, ouatés par le roulement des voitures sur les dalles, le choc métallique des boîtes à lait qu’on promène, les papotages de la clientèle matinale et mille bruits qui, très distincts, se mêlent pourtant et voltigent dans l’admirable pureté de l’air en une rumeur confuse et pleine de fraîcheur. C’est dimanche. Les carillons s’appellent et se répondent d’un campanile à l’autre. Les cloches ont ici comme en Espagne le timbre chevrotant et fêlé d’une voix d’aïeule, leurs sonneries défaillent en sons graves ou aigus, éraillés, usés, rongés de vert-de-gris comme les vieux bronzes qui les clament sous le heurt des lourds battants de fer rouillés ; les charpentes séculaires se plaignent en balançant les ais de leurs membres trapus où s’accrochent et bâillent, dans le demi-jour des beffrois, les bouches édentées des cloches.
Et c’est dans ce carillonnement général dont la chanson se modifie sans cesse, — des voix nouvelles s’élevant quand d’autres se sont tues, — que la rue apparaît très vivante, d’une sorte d’animation recueillie et joyeuse qui revêt, ainsi que les gens, sa parure dominicale. Au jour, la ville a changé complètement d’aspect ; elle n’est plus, comme hier soir aux lumières, un dédale de mystérieux défilés entre les hautes maisons ; chacun des vicoli s’éclaire d’un jour doux et tamisé, encore timide. Le soleil ne pénètre que les grandes voies, mais cela m’est indifférent, au contraire, je préfère les vicoli modestes et propres avec la multitude des seuils entr’ouverts aux regards indiscrets qui pénètrent l’intérieur des maisons, où, par les fenêtres des rez-de-chaussée, se créent des choses formidables derrière le grillage épais de fers losangés qui, scellés dans l’épaisseur des pierres ou des marbres vermiculés, répondaient autrefois de la sécurité des Génois contre les soudains envahissements des pirates et des émeutes. La plupart de ces vicoli sont tellement resserrés et l’air y est si rare qu’ils seraient des foyers de mort, n’était leur méticuleuse propreté. Et l’on dirait, à circuler ainsi au fond de ces couloirs, que l’on parcourt quelque ville étrange creusée à même la terre ; mais en haut la ligne du ciel est d’un bleu frais et tendre qui suffit à égayer jusqu’au fond de ces tranchées, à aviver encore le brillant des dalles luisantes. Il arrive même, quand une de ces ruelles s’oriente vers le soleil, que ses rayons versent entre la découpure des toits des coulées d’ombres et de lumières dont s’amusent avec des ressources surprenantes les corniches, les sculptures et les couleurs vives des palais et des maisons.
Le port, vers lequel se précipitent tous ces chemins étranglés, est au repos. Quelques bandes de marins, tous semblables en quelque pays qu’ils se trouvent, paraissant fils d’une unique patrie : la Mer, se préparent à grimper dans la ville, par étapes, en s’arrêtant aux nombreux comptoirs où l’on boit ; et le soir peut-être, quelques-uns de ces bons et francs visages seront figures de brutes congestionnées et défaites : le gai marsouin se sera bien amusé !
À côté de ces marins montent ensemble aussi, très raisonnables et d’une si belle tenue, des moussaillons de quinze ans, solides et robustes, avec de grands beaux yeux noirs sertis dans l’exquise finesse d’un bronze pompéien. Ces gamins ramassés aux côtes de Sicile hument l’air chaud du large dès leur enfance et plongent dans l’eau salée, tout nus jusqu’à dix ans, leur corps svelte et dégagé emprisonné maintenant dans l’étroit pantalon de drap qui les serre et colle à leurs cuisses rondes. Les filles en passant sourient vers eux déjà. La gracilité des cous souples et de lignes pures dans l’échancrure très large des vareuses attire leurs yeux sur les cols bleus grands ouverts contre les épaules qu’ils découvrent, montrant le poli des nuques hâlées, la vigueur des jeunes poitrines. Le plus joueur a piqué dans ses cheveux bruns, sur l’oreille, une rose naturelle, rouge ; et cette fantaisie jolie, soulignée d’œillades très polissonnes, déconcerte les filles qui ont pour lui des regards étonnés où pointe un peu de jalousie.
Le décor est plein de mélancolie où s’agitent ces petits marins ; il n’a pas dû varier beaucoup, sans doute, depuis des siècles que reviennent ces mêmes dimanches silencieux qui font déserts les vieux quais, silencieuses, inanimées, les maisons hautes, appuyées, chancelantes et comme prêtes à s’écrouler, sur les arcades déjetées bordant un côté de la Strada Vittorio Emanuele. Des magasins boueux se cachent dans leur ombre, dissimulés derrière les piliers aux pierres effritées et rongées à la base ; et aussi des échoppes louches, sales et obscures, dont les entrées étroites sont éculées et huileuses par le frôlement séculaire des mains, des épaules, des vareuses grasses de cambouis et de goudron. Sous le soleil, joyeux coloriste, ces choses restent grises, ternes ; grises de la crasse qui, avec le salpêtre, suinte de partout, et grises aussi des loques innombrables dont le blanc n’est jamais revenu malgré les lavages successifs, des loques informes accrochées aux fenêtres bancales ; le vent les soulève et, lourdes de lessive, elles résistent, s’enflent et retombent inertes.
À terre, c’est un encombrement de toutes les formes de caisses, de fûts, de ballots descendus des voiliers antiques, noirs aussi et tannés ; et tout cela commence à chauffer ; l’air est saturé déjà de sels et de goudron, et des senteurs drôles viennent, intermittentes avec les âcres relents du vieux port, ajouter, à la griserie que promène le vent, l’énigme de leur origine ; odeurs oubliées depuis des années en quelque coin de ce quartier si délabré ; le vent les apporte et les chasse ; quand elles passent, on dirait que pleut la pesanteur des siècles, la vieillesse caduque de quelque chose d’imprécis. Et devant cette ribambelle de jeunes garçons qui montent, si gais en se dandinant, en se jouant, vers la Piazza Nuova, vers la ville, et devant l’effroyable vétusté des constructions de ce quartier, qui eurent aussi leur jeunesse et leur beauté, toutes sortes de pensées tristes et d’un calme poignant me sollicitent en songeant que les rires sonores tôt épanouis, là-haut, devant moi attentif à leurs jeux, dans la bouche frivole des mousses de quinze ans, auprès de cette fleur rouge qui en avive encore la fraîcheur, bientôt seront perles écrasées dans le noir du néant, chansons ensevelies dans le silence irrémédiable…
En face la cathédrale San Lorenzo des gamins font des misères aux bouquinistes dont l’éventaire de livres anciens fait craquer les minces planches des baraques ; et rien n’égale la drôlerie des petits effrontés, mauvais chalands aujourd’hui lâchés par la ville, occupés à feuilleter gravement les énormes in-folio aux textes indéchiffrables pour eux, aux tranches rouges et jaunes, aux plats caparaçonnés de cuirs épais.
D’une profusion de marbre, le Campanile s’élance en un jet formidable vers le ciel, tout de marbre blanc et noir, comme la cathédrale elle-même élevée sur des marches également faites de degrés superposés de marbre blanc et de marbre noir. J’ai peur d’avouer que je ne ressens aucune admiration pour ces alternances de deux couleurs sans éclat ; il me semble que l’architecture de cette cathédrale aurait gagné en puissance l’effet dispersé dans le demi-deuil de ces murs très somptueux et très uniformes, si, par exemple, ce campanile et cette cathédrale eussent été tout de marbre blanc.
La nef, quoique encombrée d’échafaudages comme une partie du dehors, émeut par l’austérité de ses lignes, la décoration étant reléguée dans les chapelles latérales ; par endroits, malheureusement, apparaît encore cette double teinte blanche et noire, plus funérairement théâtrale encore, si j’ose ainsi dire, qu’à l’extérieur.
Les chapelles ont toutes cette patine qui recouvre les vieilles choses et donne une harmonieuse tonalité aux dorures apaisées, aux marbres moins brillants, aux bronzes polis et avivés par l’usure et le frôlement quotidien de l’air et des encens. Les vitraux voilent leur transparence d’une buée qui fait plus tranquilles et mystérieuses leurs clartés figées en rayonnements colorés, en caresses chatoyantes aux creux poussiéreux des boiseries sculptées, sur les dalles de brèches précieuses, les broderies des autels, et jouent, candides et vaporeuses, avec la flamme mobile des lampes suspendues.
Du même côté que la chapelle somptueuse de Saint-Jean-Baptiste, enfouie dans la richesse des porphyres et la splendeur des châsses d’argent ciselé, un orgue déploie des volets immenses, merveilleusement peints qui, fermés, cachent les jeux des tuyaux ; nous sommes si peu habitués à cet arrangement, que ces panneaux ouverts prennent une envergure d’ailes, vivantes presque en leur archaïsme bizarre ; il suffirait du bruissement de l’orgue pour les animer d’un souffle pareil à l’haleine des anges blottis en ce coin de cathédrale, entre leurs ailes d’arc-en-ciel. Aux tintements de la clochette qui grelotte des sons fluets dans les mains de l’enfant de chœur, tandis que l’hostie élève rayonnante sa pure blancheur de neige, très dévotement l’âme suit les fantaisies de l’esprit, et la prière se répand, large comme l’essor de ces ailes étonnantes qui viennent battre jusqu’aux portes du sanctuaire !…
Quel dommage que ces merveilles et d’autres dont s’emplit cette très belle église, soient en partie masquées ou souffrent du voisinage des échafauds élevés là, à perpétuité presque, pour soutenir les écroulements de toutes ces vieilles choses et peut-être aussi parce que cette basilique, conçue autrefois en des plans tellement grandioses, reste toujours inachevée ! À l’entrée de la nef, au beau milieu, un coffre énorme, bardé de fer, sollicite les aumônes des fidèles pour l’achèvement del Duomo, pour l’achèvement de travaux jamais interrompus, et si lentement conduits, depuis huit siècles !
Des églises innombrables s’élève et retombe sans cesse le rythme des sonneries dont vibre l’air comme saturé d’un fluide métallique qui serait fait du bronze volatilisé des cloches mêlé à l’or rose que répand le soleil.
Gênes a vraiment des allures hautaines, vêtue de la splendeur de ses palais aux architectures puissantes, élevant jusque dans le ciel bleu les marbres festonnés des frises et des corniches, étalant encore sur leurs façades, entre les bossuages des pierres, d’étranges fresques aux teintes agonisantes dont, sans intermittence, le temps implacable hâte l’effacement. Dans cette radieuse matinée empreinte de triomphales clartés, il semble qu’on avance au milieu de quelque cité souveraine et que les patriciens vont sortir tout à l’heure de ces hauts vestibules au milieu d’un cortège superbe, dans le déploiement des soieries miroitantes, des velours opulents et des moires raides de broderies d’or et de pierreries que tissaient jadis les maîtres artisans de ces Républiques aux rivalités formidables, aux passés étincelants dont se meurent à peine les suprêmes lueurs : Venise et Gênes, encore merveilleuses, même déchues, ayant flamboyé d’assez glorieuses apothéoses pour qu’il en reste de pâles auréoles, et que jaillissent de toutes parts, ici, sur les marbres des vieux palais armés de leurs blasons, les feux de leurs regards, à ces illustres disparus : les Doria, les Spinola, les Grimaldi, et plus près, dans les tonnerres précurseurs de notre Épopée impériale, Masséna !
Tous ces souvenirs me suivent à chaque pas, de la Strada Carlo Alberto à la Piazza Nuova, dentelée des élégances du palais Ducal, enrichie de cette vieille façade du Gesû fleurie d’incrustations de marbres précieux. Après, ce sont les portiques sévères du Carlo Felice, et plus loin je reconnais le vicolo escarpé affluant sur la Strada Nuovissima, silencieux maintenant, d’où hier dans la nuit s’élevaient, troublantes, les chansons des jeunes garçons enlacés, échangeant la tiédeur de leurs lèvres qui, rafraîchies pourtant du même nombre des baisers du printemps, je ne sais par quelle magie, ou quelles contraintes de leurs gosiers chanteurs, mêlaient dans ce concert improvisé toutes les voix, des sopranos aigus aux ténorinos charmants, lesquels se détachaient souples et effilés sur les pizzicati des basses graves et résonnantes. Ils avaient seize ou dix-huit ans, et l’on aurait dit les voix fluettes des garçonnets, grêles, mais captivantes, et aussi les voix solides et profondes des poitrines d’hommes accomplis. L’ombre bleutée contient seulement, ce matin, quelques poussières d’or dans un faisceau de lumière échappé de la réverbération d’un vitrail ; peut-être, ce sont, douces comme un miel ensoleillé, les haleines d’hier soir qui volètent encore et vont mourir, pâmées et finissantes comme le faible écho vibrant en moi des chansons câlines des petits Génois.
Elle est plaisante et remuante la place de l’Annunziata, avec, en face de notre hôtel tout blanc, les belles colonnes de marbre raides sur le portail de l’église. Le ciel semble immense maintenant dans ce grand cadre auquel nous n’étions plus accoutumés déjà, errants par les ruelles étroites. Des palais toujours, avec leurs portes très hautes ; des grillages ouvragés aux balcons et des herses féroces aux larges baies du rez-de-chaussée. La via Balbi déverse continuellement le flot des gens qui vont, passent et reviennent. Des paysannes arrangent sur les marches de l’église de menus étalages de fruits, de légumes et de fleurs qui se colorent de teintes ravissantes au soleil, et embaument de leurs parfums rustiques le vent un peu frais qui souffle par moments.
Oh ! l’éblouissement de ces plafonds, la profusion de ces dorures aux patines incandescentes ! L’église de l’Annunziata nous réservait cette surprise : un amoncellement extraordinaire, une richesse inouïe de sculptures fouillées et refouillées disparaissant sous une coulée d’or qui évoque des largesses de milliardaires, et restant, sous les feux innombrables allumés dans cette voûte de métal précieux, d’un bon goût parfait et d’une somptuosité presque discrète et légère. Dehors, l’averse de lumière ne parvient pas à dissiper immédiatement les éblouissements de ce que je viens de voir.
Via Balbi, le palais royal s’ouvre dans l’éclatante blancheur des vestibules où se développent de merveilleux escaliers de marbres rares. Au delà de la cour d’honneur s’éploient les jardins disposés en terrasses, d’où l’œil suit, avec quelle complaisante et exquise attention ! le panorama de Gênes appuyée sur les collines, tournée vers la mer sous un chaos de dômes, de campaniles, de terrasses, de toits rouges et plats, de tours blanches, auxquels se mêle la verdure. La mer s’étend toute bleue au-devant de Gênes, toute bleue, un peu houleuse. Dans le port les bateaux se balancent, et je vois d’ici les longues aiguilles des mâts, la pesanteur massive des coques noires parmi le réseau très fin des agrès et des cordages et les mobiles miroitements des vagues. Le palais Balbi continue, de l’autre côté de la rue, la montée des jardins royaux : c’est un enchevêtrement de colonnes et de portiques qui s’ouvrent à la lumière de toutes parts envahissante. Rien de moderne ne peut rendre cette sensation de vieux, de passé somptueux résistant si bien à l’anéantissement des siècles que, de ces escaliers, il semble, comme tout à l’heure au seuil d’autres palais, que vont descendre dans un instant les personnages en pourpoints d’écarlate, en toques de fourrures aux aigrettes de pierreries : les hallebardes vont tomber sur les marbres sonores, annonçant la venue du maître. Et, fascinés, les yeux attendent, perdus dans un rêve, le défilé d’une escorte gravissant ces marches, projetant ses ombres magnifiques sur les murailles peintes qui, familières, ne s’étonneraient pas de leur retour, toutes pleines encore du souvenir de ces grandes figures englouties dans l’au-delà !
Nous devions partir immédiatement, quitter Gênes après en avoir à peine effleuré de nos regards toutes les magnificences, mais on nous supplie de voir encore au moins le Campo Santo. Et nous allons très loin, en dehors de la ville, au fond d’un val que sillonnent les tramways, le chemin de fer, et d’où, par instants, on aperçoit la traînée lumineuse de la mer. Enfin se distinguent les lignes unies et monotones du Campo Santo. Nous arrivons. Des couloirs très profonds, avec un faux air de cryptes très hautes. Sur le sol un éparpillement de couronnes, verroteries poussiéreuses ou chiffons décolorés qui pendent lamentables ou s’égrènent sur les montures rouillées des fils de fer ; fleurs artificielles semblables à de lentes et tristes agonies de fleurs véritables veillées par quelques cierges aux flammes espacées, pâles dans une demi-clarté qui vient on ne sait d’où. Et cela est navrant, ces hauts et longs couloirs où gisent dans les casiers répartis contre des murs étiquetés, les pauvres chères dépouilles tant aimées, où dorment le dernier sommeil les yeux éteints qui ont joui comme nous des splendeurs de Gênes la superbe. Et puis, autour d’un cimetière, véritable celui-là, sur quatre côtés, courent les arcades innombrables de beaux et uniformes portiques. Tandis qu’au milieu sont les tristes croix de bois des miséreux qui n’ont droit qu’à la terre, qui n’ont droit à aucun autre mausolée que les fleurs en touffes, les verdures dans la belle saison, et, dans l’hiver, la neige scintillante avec les sveltes balancements des cyprès, — sous les arcades sont les monuments des riches, les marbres coûteux érigés en apothéoses, en allégoriques enlacements ; fantômes blancs et immobiles sous qui l’on devine de noires et mobiles décompositions !… Et combien tristes ces membres figés dans des gestes sans idéal par le jeu facile d’une virtuosité sans grandeur ! Chaque famille s’est appliquée pieusement à rappeler les traits des chers absents, leurs attitudes coutumières, mais avec quelle recherche puérile de détails et quelle absence de mouvements vrais, quand il faudrait si peu de chose pour réveiller dans le cœur l’affaissement des pensées endormies et faire couler des larmes ! Non, on a voulu surtout des corps et des vêtements : un chapeau est soigneusement creusé jusqu’à la coiffe où l’on cherche la marque de fabrique ; des chaussures portent le long des cuirs assemblés la piqûre des aiguilles qui les ont cousues ; ce sont des pantalons qui tombent, impeccables, sur des talons fort bien tournés et laissent deviner le drap dont ils sont fabriqués ; des coiffures de femme ornées de fleurs et de plumes qui remuent peut-être au souffle du vent ; des mantilles où chaque maille du tissu ouvragé se distingue de l’autre ; puis des châles dont aucun effilé n’est omis et des gants avec leurs boutons et la saillie des bagues sous le chevreau ; des rubans, des chapelets, des volants de dentelle, des mouchoirs dans les mains entr’ouvertes, reproduits à merveille, patiemment brodés, cousus, tricotés et frisés dans le marbre ! Mais c’est trop peu en vérité pour émouvoir, que la science maniérée des ouvriers habiles à copier les étoffes jusqu’à en faire des trompe-l’œil, jusqu’à faire se demander en voyant les cassures des soieries, les raideurs des satins, les plis des larges manteaux, si l’on n’est pas en présence de pétrifications d’objets véritables.
De rares envolées de génie ; à peine, très clairsemées, quelques-unes de ces œuvres qui font passer dans les veines le frisson de vie magnifique dont s’anime le marbre même. Le Campo Santo est un musée, moins encore, une exposition de sculptures vieillottes, à cause des costumes trop modernes, à cause des modes dont l’histoire ne s’est pas encore emparée et ne s’emparera jamais, et que l’on trouve ridicules, et qui feraient sourire presque, si la Mort planant sur les tombeaux n’apportait ici l’écrasante majesté de l’humilité qu’elle suggère !
Et les regards s’arrêtent sur les petits monticules de terre d’où s’élèvent les simples croix de bois ; les fleurs jaillissent des pauvres cendres, leurs parfums viennent envelopper les marbres glacés, et sous les corridors poussiéreux et sans lumière, la brise passe, emportant l’incessant murmure des feuillages clairs qui se frôlent, balancés sur les tiges frêles…
Sur la route nous croisons des voiturées d’ulsters et de casquettes jaunes à carreaux des Cooks’tourists, Bædeker en mains, qui vont à leur tour, tandis que nous rentrons dans Gênes, visiter le Campo Santo. Il y aurait, pour eux, ample moisson de souvenirs sur les monuments du cimetière, toutes choses menues et fragiles, faciles à détacher pour ces iconoclastes grands collectionneurs de futilités, démolisseurs persévérants et tenaces des statues et des monuments. Sans doute, leur admiration va se porter tout entière du côté des tours de force insignifiants ; ils passeront vagues devant les archanges insexués, aux corps fuselés serrés dans les plis de leurs dalmatiques, aux beaux yeux égarés vers des régions sereines que leurs ailes éployées semblent vouloir atteindre ; monuments merveilleux, ceux-ci, qui déjà, dans mon esprit, se classent, effaçant la mesquinerie des gravures de modes, planant de toute la calme beauté de leurs visages adolescents, de toute la perfection de leurs hiératiques attitudes, dans la splendeur des marbres diamantés.
Du sculpteur inspiré songes harmonieux,
Muets à notre oreille et qui chantent aux yeux.
Il est midi ; des clochers, glissent sur les toits aux tuiles roses et tombent dans les rues éclaboussées de lumière, les douze coups lentement chantés, graves, sévères, et fêlés aussi comme les voix de leurs sœurs les cloches du matin. Ils prennent une forme palpable ces coups répétés à l’infini, recommencés par un campanile quand un autre vient d’achever le martèlement de ses heures. On dirait la clameur de quelque chose de vivant qui pleure d’une voix chaque jour plus cassée l’éloignement, chaque jour, chaque heure, plus grand, du temps où la vie s’écoulait aimable et douce dans les palais de marbre peuplés de dames aux vêtements raides et dorés suivies, la main dans la main des chevaliers aux gestes alourdis d’armures, par les pages court-vêtus, emprisonnés, sveltes et élégants, dans les soieries chaudes et les blasons brodés ; figures invraisemblables de vieux missels enluminés de pourpres, de vermeils et de mauves, qui ont existé pourtant et dont les ombres s’agitent aux carrefours, entre les vicoli de Gênes, parmi les buées d’or du midi radieux : pâleur des visages de femmes, force mâle des grands aventuriers, effronterie charmante des pages effilés, grâce mutine de leurs beaux yeux las d’une innocence qui leur pèse.
Gênes étincelle, et puisque nous devons bientôt la quitter, qu’au moins restent dans nos regards ses blancheurs assises au fond du golfe de verdure ; l’enivrante vision de ses palais de marbre, de ses rues belles comme des basiliques, le soir, quand s’allument, pareilles à des chapelles, les vitrines des marchands ; de ses ruelles étranges où chantent des voix berceuses et puériles, où semblent revivre quand même, malgré l’envahissante banalité du présent, les poétiques agitations du passé, tellement que, à chaque pas, la foule disparue semblait me suivre, sur chaque pierre découpait ses ombres grandioses, partout étalait le rutilement de ses splendeurs, les raffinements de sa magnificence et que j’aurai vécu ces heures trop brèves côte à côte avec cette vision doucement obsédante, dans les froissements des soieries, dans les caresses des velours, dans l’invincible enlacement des regards de femmes que je n’ai jamais vues, mais que je devine à travers les siècles, et que j’aime pour ce qui reste de leur beauté irrémédiablement attaché aux murailles, aux verdures, au ciel de leur belle cité !
Et, la quittant, Genova la superba, je salue la grande ombre de Colomb vers qui, sur cette place dell’ Acqua Verde enfouie dans les maisons roses, s’inclinent en ce moment, courbées par le vent qui passe, les palmes flexibles aux mille pointes dorées sous le soleil…
Dans le compartiment du train qui doit nous emporter vers Rome ont déjà pris place deux jeunes gens qui regagnent, les vacances de Noël terminées, leur École navale à Livourne. Ils déjeunent avec un appétit plus réjouissant à voir que leurs physionomies qui ne paraissent pas extraordinairement enchantées de nous voir partager leur société. Le train est presque au complet partout ; nous n’avons pas le choix, et d’ailleurs nous roulons avant d’avoir eu le temps de chercher un milieu plus sympathique. Je me réjouis de retrouver autour de moi les yeux clairs des jeunes gens au nombre desquels je n’ose déjà presque plus me compter, mais je suis forcé de convenir que malgré leur uniforme coquet, les broderies épaisses de leur casquette, la ceinture vernie qui retient une dague très courte et fort jolie avec ses garnitures dorées et sa poignée de nacre, nos petits officiers n’ont pas le type généralement élégant de par ici, ni l’air aimable.
Un arrêt : la Spezia ; nos voisins, qui ne sont pas arrivés cependant, descendent et vont porter ailleurs leurs désobligeantes façons. Mais il était dit que nous aurions, malgré tout, un petit marin auprès de nous. Aussitôt disparus, un de leurs jeunes camarades au guet — sa valise à la main — d’un coin où se caser, veut bien nous donner la préférence, et très gentiment, très gaiement, fait usage de toutes ses connaissances de notre langue, qu’il parle fort bien du reste, pour me remercier du léger service rendu en l’aidant à l’installation de son modeste bagage. Et tandis que défile la rade de la Spezia, avec, sur une nappe magnifique illuminée de soleil, la masse énorme des cuirassés tout noirs, vautrés dans la lumière liquide des vagues, la conversation de notre gracieux compagnon fait oublier ses collègues maussades ; et c’est entre nous un assaut de remarques flatteuses sur chacune de nos belles patries. Nous essayons de nous prouver mutuellement que rien ne nous est étranger dans les arts et dans la littérature française et italienne, et je dois reconnaître que malgré ses seize ans notre petit Italien fait la meilleure figure du monde en abordant ces sujets. Ses yeux s’allument de convoitise au seul nom de Paris et de dépit en même temps de me céder le pas, lui qui ne connaît pas notre capitale, à moi qui vais à Rome pour la seconde fois.
— Mais, dit-il, mon père a vu Paris au moment de votre grande Exposition, et j’irai moi aussi, bientôt, dès que je serai de retour d’une croisière que nous devons faire autour du monde, après les vacances prochaines…
Le soleil va disparaître du ciel illuminé de clartés d’or pâle avec un imperceptible voile de brume, de poussière d’or aussi, jeté sur la surface de toutes choses comme dans les magiques tableaux de Claude Lorrain.
La nuit est venue déjà quand, à Pise vaguement aperçue, notre petit ami rajuste sa dague de nacre et d’or dans sa ceinture brillante et nous quitte pour le train de Livourne, emportant avec une cordiale poignée de main le souhait que je lui exprime de voir un jour les trois étoiles scintiller fièrement sur les parements de ses manches ; il comprend fort bien, s’échappe en riant et se perd dans l’obscurité.
Et nous voilà de nouveau emportés avec une rapidité vertigineuse, livrés à nous-mêmes dans le balancement monotone des voitures, dans le vacarme toujours pareil aussi, le glissement sur les rails, les plaintes des essieux, le bruissement des chaînes et les hurlements de la vapeur qui s’échappe en sifflets assourdissants. Nous côtoyons sans cesse la mer, nous traversons les plaines immenses des Maremmes avec, toujours à notre gauche, la silhouette confuse et éloignée des Apennins, et à droite la mer qui, paisiblement, charrie des reflets chatoyants comme des miroitements d’acier bleui.
À Grosseto, le buffet de la gare avec une grande table qui ressemble aux naïves ornementations d’un mois de Marie dans quelque petite chapelle de religieuses. Sur la nappe très blanche, de grands candélabres d’argent, toutes bougies allumées, éclairent des gâteaux revêtus comme à Gênes de sucreries et de fioritures où l’or se mêle à toutes les couleurs. Entre des vases de faïence peinturlurée qui contiennent des fleurs, les jolies petites bouteilles de Chianti clairet emprisonnent leur forme ronde allongée en un col gracieux dans les tresses d’un osier fin qui s’arrête en chemin et semble vouloir laisser leurs épaules découvertes. L’intérieur de cette station est plutôt fruste et les grands candélabres d’argent viennent, on dirait, d’être sortis des armoires pour quelque grande cérémonie qui va se passer là tout à l’heure quand seront éloignés les indiscrets occupés à défaire les arrangements puérils de toutes ces petites choses si bien en place sur les nappes blanches, entre les fleurs et les bougies qui font jouer à travers les flacons de verre blanc les rubis du Chianti parmi les reflets vermeils des oranges. C’est une joie pour les yeux, après les ténèbres du chemin, que ce tableau d’une physionomie, d’un rococo ravissants, très apprêté et très simple à la fois et si franchement italien.
Le wagon-restaurant me paraît quelconque et sans charme, tellement dépourvu de ce cachet local qui, tout à l’heure, débordait en couleurs éclatantes. Nous retrouvons avec joie cependant les fluettes et joyeuses bouteilles de Chianti, semblables à celles des petits étalages, sur l’autel du mois de Marie, au buffet de Grossetto…
Nous approchons de Rome, une grande lueur est projetée dans le ciel et flotte, pâle des pâles incendies de l’électricité, au-dessus de la Ville Éternelle. Très prosaïquement, sans aucune espèce de recueillement, nous nous engouffrons sous la gare, d’où nous sommes entraînés, par un dédale de rues sombres ou crûment éclairées, jusqu’à l’hôtel, près de la place de Venise, sur le Corso ponctué par des globes électriques suspendus au milieu de la voie, grosses perles lumineuses qui finissent là-bas au loin vers la place du Peuple…
Le vent souffle très froid et glace davantage encore l’entrée si dépourvue d’enthousiasme que nous venons de faire dans cette Rome très aimée où pas une âme ne s’agite à l’heure silencieuse qui nous reçoit…IX
J’avais emporté, des coins, des carrefours et des vicoli tortueux, les visions ensoleillées que je retrouve avec enchantement. Je vais, frôlant des palais sévères et d’une architecture si particulière et si somptueuse, avec les grandes cours aux portiques élégants dont les grisailles s’animent de la blancheur des statues de marbre et d’un jet d’eau sur une vasque élégante encadrée de plantes vertes.
La place d’Espagne incline toujours, depuis les marches de la Trinité-des-Monts jusqu’aux vicoli qui descendent au Corso, son sol de pavés pointus et durs sur lesquels dansent les omnibus légers qui traversent le Corso, le Tibre, et vont jusqu’à Saint-Pierre.
Une jolie lumière baigne les moindres encoignures et fait de la place irrégulière un décor original, un vrai régal d’artiste, et je suis navré de me sentir l’être si peu. Les petites marchandes de fleurs promènent leurs paniers fraîchement garnis de violettes pâles, de giroflées blanches, de narcisses, et de minuscules bouquets où les fleurs d’oranger marient leurs pétales blancs et leurs petits boutons d’opale à l’odeur capiteuse, avec les soucis larges et cuivrés comme l’écorce des oranges. Ces petites marchandes effrontées ont des yeux très beaux et très purs, cachés dans l’ombre des paupières voluptueusement bordées de longs cils noirs ; leur poitrine soulève le linge immaculé de la chemisette, légère malgré la saison, et le corsage toujours curieusement coloré dont les lacets se tendent sur l’effervescence des jeunes chairs ; leur jupe courte aux larges plis est bordée de velours, et sur leur tête gracieuse la traditionnelle coiffure plate, retenue par de grosses épingles dorées, retombe, mêlée aux tresses de leur chevelure, jusque sur leurs épaules graciles. Petites folles, elles partagent leur existence entre les séances de l’atelier du peintre et du sculpteur, qui jouissent dans toute sa splendeur du modelé de ces jeunes corps, — et la course aux passants : gentilles et importunes, elles glissent dans les manches, dans les poches, dans l’échancrure des gilets les petits bouquets de deux sous, bénévolement acceptés pour l’amour des jolis regards qui les offrent et des mains mignonnes qui demandent…
Sur les degrés qui, de la fontaine de pierre, la Barcaccia du Bernin, montent vers l’église française de la Trinité-des-Monts, et même tout près des eaux claires et chuchotantes, se tiennent les groupes superbes des modèles professionnels, filles et garçons ; celles-là, comme les petites vendeuses de fleurs avec qui elles se confondent, prêtes à toutes les gamineries ; ceux-ci, les jeunes hommes, plus graves, se tiennent un peu à l’écart, isolés des groupes féminins et babillards. Les gars vigoureux aux visages réguliers, beaux comme de jeunes dieux, emprisonnent leur noble poitrine dans une veste courte ; leurs jambes élégantes se dessinent tout entières dans la culotte de velours étroitement ajustée et retenue sur leurs reins bien campés, souples et solides, par une large ceinture d’étoffe ; leur chapeau de feutre mou planté avec audace sur leurs cheveux bouclés est serré par un ruban d’où s’élance une plume de coq qui donne un air de crânerie très charmant à toute leur personne débordante de jeunesse, de force et de mâle beauté. Ce sont les ciociari.
Avec la place Navone, la place d’Espagne est un des coins où Rome abdique la gravité, la froideur de ses rues, l’ordonnance sévère de ses places, et se revêt de la parure frivole des maisons aux façades riantes, des fontaines d’une outrancière fantaisie qui laissent échapper leurs eaux en continuelles chansons.
Si je devais jamais rester ici, c’est près de cette place d’Espagne que je voudrais habiter, à deux pas du Pincio dont je ferai mille fois les promenades ornées de plantes délicates, qui conduisent à la terrasse d’où l’on voit Rome dans le tumulte et la richesse de ses dômes, de ses palais, de ses murailles et de ses perspectives ensorcelantes…
Le Panthéon est sur notre chemin, et nous voulons le voir avant d’aller à Saint-Pierre. Les portes de bronze franchies, sous le beau péristyle dont les proportions harmonieuses ne paraissent pas souffrir des barbares et incessantes dégradations qu’il a subies, c’est, tout de suite, le tombeau de Victor-Emmanuel, et sa statue aperçue ou rencontrée déjà dans chaque ville, presque sur chaque place publique.
Elle abrite d’autres cendres, la coupole majestueuse du Panthéon, creusée de caissons énormes ombrés par la lumière qui tombe droit de l’ouverture béante d’en haut, découpée à l’emporte-pièce sur l’azur du ciel : un de ces bambini, petits traîneurs des rues, nous montre sur les marbres d’une chapelle appliquée aux parois circulaires du temple, ce nom : Raphaël Sanzio, et le buste où revivent les traits adolescents du jeune maître d’Urbino, son visage charmant, encore adouci par la chevelure longue et soyeuse qui l’encadre et fait ressortir l’extraordinaire finesse des lèvres tendres, la sveltesse du cou et l’éclat radieux et pur de ses yeux de génie. Désormais son souvenir évoqué devant cette image juvénile va me suivre partout dans Rome étincelante à jamais de l’éclat de son nom, et je sentirai toujours à ses côtés l’exquise beauté de l’heureuse Transtéverine, la Fornarina, qui fut peut-être pour une large part dans le resplendissement des figures admirables de ses madones d’une inspiration et d’une pureté célestes, elle, la glorieuse fille de luxure dont les lèvres se brûlèrent aux baisers de Raphaël !
Sous le pont Saint-Ange que gardent les Chérubins de marbre aux gestes contorsionnés en longues draperies flottantes, roulent les flots jaunâtres du Tibre, encaissé maintenant entre deux quais tout neufs aux très hautes murailles reliées entre elles par un pont de fer d’une silhouette abominable.
Je me rappelle ces berges, en partie dégringolant jusqu’à la surface de l’eau dans un agreste fouillis de baraques et de verdures également sauvages, de maisonnettes bizarres, soutenues on ne sait comme au-dessus de l’eau, appuyées à de longs madriers posant leurs jambes vermoulues sur les bancs de sable amassés aux replis des rives. Les quais sont excusables, puisqu’on ne peut guérir les Piémontais de leur fureur de démolitions, de leur manie d’alignement ; au moins auraient-ils dû avoir le bon sens de ne pas écraser sous le poids de cette ferraille imbécile, la perspective merveilleuse uniquement par le réseau compliqué des vieilles choses, le luxe des éclatantes couleurs, le désordre émouvant et naturel des constructions barbares lentement posées là par les siècles. C’est demander beaucoup aux gens qui rêvent d’une Rome ennuyeuse, régulière et banale comme Turin, où se fabriquent des vermouths, et comme New-York, où se vendent des saindoux.
Bien jolies les boutiques du Borgo Vecchio, remplies jusqu’à en déborder des bibelots très authentiques offerts aux passants : bronzes écorchés et rongés de vert-de-gris ; boiseries patinées au brou de noix ; faïences craquelées et cassées ; enfin, sur le tout, des croûtes extravagantes de pauvres rapins, attribuées sans vergogne aux maîtres des Écoles italiennes. Elles me font souvenir des Murillo rarissimes offerts, à Séville, aux étrangers moyennant des sommes jamais inférieures à un nombre respectable de pesetas ; les affaires se concluent quelquefois, paraît-il, là-bas dans la calle Genova comme ici dans le Borgo Vecchio ou la via Sistina ; et les pesetas et les lires sont comptées… en dollars ou en livres sterling !
Saint-Pierre ! Je croyais échapper, l’ayant subi déjà, au saisissement que produit la vue de cette place monumentale soudain offerte au seuil des vieilles rues tortueuses ; et voilà que je ne puis réprimer un frisson devant cet amoncellement de pierres, devant l’énormité des souvenirs qu’embrassent, comme deux bras gigantesques, les colonnades du Bernin, sous la pesante assemblée des saints aux grands gestes pétrifiés. En face, dans le fond, la coupole triomphante de Michel-Ange se lève, pleine de la souveraine majesté du Siège apostolique rayonnant parmi les splendeurs formidables du génie humain presque divinisé dans la plus sublime peut-être et la plus radieuse expression de sa puissance et de sa beauté…
Dussé-je paraître quelque peu naïvement inflammable, j’avoue que l’enthousiasme m’empoigne facilement et que je ne saurais voir certaines choses dans la complète sérénité de moi-même ; mon émotion, cependant, est calme et recueillie et jamais ne se traduit extérieurement. Je préfère être seul et souffrir du trop-plein de cette émotion, plutôt que de la partager avec une âme qui ne serait pas en parfaite communion de sentiments avec la mienne et, brusquement, me rappellerait de mon rêve fugitif pour me rejeter dans le prosaïsme maussade, tout vibrant de sensations arrêtées dans leur marche ascensionnelle vers l’extase que je désire.
J’ai éprouvé déjà ces mêmes émotions maladives et tant aimées, faites de la plénitude inattendue et oppressante du beau ou du grand, offerts soudainement aux regards, dans certaines circonstances qu’il serait malaisé de définir, tant elles sont complexes et dépendent de l’état d’esprit, du temps et du lieu ; heures bizarres dans lesquelles toutes choses pénètrent l’âme, s’y incrustent profondément et demeurent exquises et douloureuses…
…Ce Vendredi-Saint d’Andalousie au fanatisme enjôleur et demi-païen, rôdant autour des remparts croulants de Séville, après une journée chaude, sous un brouillard de poussière lumineuse et rougeâtre qui demeurait en nappes horizontales à la surface du sol et desséchait la gorge, j’entrai dans la chapelle d’un couvent de capucins, non loin de la Alameda de Hercules. Au milieu de l’obscurité farouche, un Christ en croix saignait sur les degrés, devant l’autel. Sa face écorchée de plaies réalistes paraissait s’allumer sous les feux de deux gros cierges et pleurait des larmes de sang mêlées au ruissellement de ses grands yeux douloureux de clémence et de pardon… Et les voix des moines, lugubres, râlaient les désespérantes Lamentations… Toute l’Espagne de Philippe II se dressait devant moi, tragique : l’Escurial funèbre, l’attrait invincible de la mort ou du néant entraînant les princes vêtus de noir au fond des cloîtres glacés… Et les moines reprenaient des chants que je n’avais plus entendus depuis le collège où, sur les lèvres aimées d’un petit camarade très beau, leur douleur m’était une joie sans égale : Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum… J’étais absolument isolé dans le noir épais où s’agitaient les formes indécises des cagoules pointues, devant la réalisation effarante du Crucifié.
Et, convulsives, se tordaient les clameurs des moines : Sed et cum clamavero et rogavero, exclusit orationem meam… Jerusalem… Jerusalem !… convertere ad Dominum Deum tuum…
Je me souviens des longues heures passées à la Mosquée de Cordoue, seul dans un coin d’ombre, parmi la forêt des colonnes de jaspe, de brèches précieuses et de porphyre ; heures de rêves confiées aux vapeurs flottantes des encens, aux rutilements des mosaïques d’or et de lapis du Mirhab saint orienté vers la Mecque ! Les parfums des orangers portés en la tiédeur de l’air doré du patio de los Naranjeros filtraient sous les portes élégantes aux grands cintres effilés, festonnées d’arabesques délicieuses, où glissaient aussi des éblouissements de murailles roses, atténués par la verdure des palmes lentement balancées sur les hautes tiges des palmiers. C’était le soir de Pâques. L’office terminé, de vagues plaintes d’hymnes religieuses soupiraient dans le silence comme si l’écho survivait du lent appel des muezzins. Des filles aux yeux chauds se traînaient le long des portiques, dehors, au guet, très belles… Sur leurs visages, de larges frôlements de dentelles rappelaient les voiles légers des sultanes d’autrefois. Et par delà les vieux murs, Cordoue, au crépuscule, languide sur le Guadalquivir doré, retombait immobile dans le suaire bleuissant qui, chaque nuit, semble contenir sa mort.
Dans l’ensoleillement d’un ciel d’Orient, sous des averses de lumières, Tanger-la-Blanche descendait à mes pieds, énervante et capiteuse, vers la mer violette. Ses minarets reflétaient dans leurs faïences, qui chaque jour se détachent des murs comme une lèpre brillante, les flambées éblouissantes du soir. Des bruits lointains de sonnailles et de chalumeaux montaient également des ruelles étroites où passent des fantômes muets et de la grande place brûlée du Socco. Ils se répandaient en l’air, pénétrant dans l’âme, avec l’étrange saisissement de cette vie musulmane pareille encore, en son inexprimable délabrement, à ce qu’elle fut il y a mille ans, dans les indicibles féeries du royaume de Grenade !…
Les beaux yeux calmes et profonds de mon petit guide Mohammed rencontrèrent les miens. Je ne sais pourquoi, il me tendit au bout de ses doigts très fins et comme ciselés dans du bronze pâle, avec un peu de sang rose aux extrémités sous l’ovale poli des ongles, une fleur rouge comme sa bouche, cueillie dans la verdure d’un arbuste inconnu penché sur sa jolie tête. Ses épaules s’enveloppaient d’une sorte d’aube très blanche passée sur une élégante veste de drap bleu d’acier, brodée et garnie de passementeries faites d’une multitude de petites boules de soie noire ; une très belle écharpe de soie multicolore retenait une large culotte bouffante à la mode orientale, d’un vieux rose mordoré, qui, sous les genoux, laissait ses jambes nues… Était-ce un reproche ? Ne pensais-je pas à lui, dans cette minute, en prenant de ses mains la fleur rouge qu’il me donnait si gentiment ? Non. J’errais très loin, au delà des champs d’asphodèles, vers Mekinez et Fez, où règne, sur des plaines infiniment mélancoliques, le fils de Moulaï-el-Hassan et de la Circassienne Laëla Rekia, le petit sultan Abdul-Aziz, enfoui en d’hiératiques voiles de mousselines de laine blanche. Adolescent très beau, très saint et très impénétrable, du même âge que Mohammed, pareil à lui, car Mohammed me paraissait assez joli pour avoir aussi, peut-être, une mère Circassienne ?… Et je remarquai davantage l’éclat des deux grands yeux noirs qui sollicitaient je ne sais quoi, et la superbe régularité des lignes brunes de ses sourcils tendus sur l’ombre fauve de ces yeux, par elle démesurément agrandis, et les pâleurs mates et duvetées de la peau ambrée, à travers la fumée continuelle d’une cigarette pressée entre ses lèvres…
Je conserve toujours sa petite fleur desséchée ; elle sent encore les jasmins et les géraniums de la Villa de France. Je garde le souvenir de ses mains délicates comme des mains de fille, de la fixité troublante des jolis yeux noirs fouilleurs de mes yeux, tandis que montaient vers nous, avec la chanson des chalumeaux, l’énervante splendeur de Tanger qui, dans le soir commençant, étendait sur ses terrasses un burnous de vapeurs laiteuses, puis d’opales, puis orangées et blêmes enfin, pendant que dans le ciel, une à une, s’allumaient les constellations, se mouraient les voix tendres des muezzins, prenant leur vol jusqu’au loin sur la mer, et là-haut vers les étoiles…
Maintenant je crois revoir, comme il y a sept ans dans ce même déploiement royal des marbres, des ors et des mosaïques qui tombent de la voûte de Saint-Pierre, passer l’auguste et souveraine blancheur du Pape. Je me souviens qu’en posant mes lèvres très indignes sur la pâleur diaphane de ses doigts je crus voir l’hostie qu’il venait d’élever sur l’autel, modelée en la forme humaine de cette main sur laquelle, dans l’effondrement de tout mon être, je venais de poser mes lèvres. Un lourd anneau d’orfèvrerie serti d’une pierre dont je n’ai pas distingué la couleur — peut-être était-ce un énorme diamant ? — tournait autour de l’annulaire du Pontife, et, comme honteux d’avoir osé frôler sa chair, je me repris en embrassant l’anneau longuement…
La chaise à porteurs qui contenait Léon XIII, enlevée par des serviteurs vêtus de soie rouge, avait disparu déjà sous l’épaisse tenture de la porte communiquant au fond d’une chapelle avec le Vatican, que, seulement revenu à moi-même, je mêlai aux voix perdues en bas des voûtes immenses, exaltant le Vicaire du Christ, la triple acclamation au Pontife Romain.
Puis ce fut dans le Vatican le défilé interminable des choses merveilleuses accumulées depuis des siècles ; la montée des escaliers somptueux débouchant dans la splendeur des salles, des cours, et des jardins immenses…
Puis l’atmosphère, brûlante et sèche comme celle d’un four, qui circulait entre le dôme extérieur et la demi-sphère intérieure de la coupole de Saint-Pierre ; des escaliers sinuant en courbes tourmentées pour maintenir le plan horizontal des marches tangentes à la calotte des moellons énormes qui, sur l’église, brille de mosaïques d’or. J’allais avec une sensation de vide effroyable sous mes pieds. Les lucarnes monstrueuses qui, d’en bas, paraissent des chatières, encadraient des coins ravissants de paysages verts et bleus. Soudain, dans le grand air du campanile haut comme une église entière hissée sur le dôme fantastique de Michel-Ange, la Campagne romaine apparaissait grandiose et mélancolique, empreinte des vapeurs déjà répandues à travers le jour finissant sur les Apennins vêtus d’une brume bleuâtre, sur les monts du Latium et les collines Albaines dorés des suprêmes éclats du soleil. Là-bas, il tombait dans la mer, allongeant en une traînée de feu la ligne d’horizon, lit de pourpre où s’achevait l’ardente agonie du jour. Je montai plus haut, dans la boule de bronze traversée par une tige de fer qui supporte la croix ; et je me souviens que, ainsi détaillée, l’immense basilique prenait des proportions cyclopéennes. Redescendu en bas dans la rue, les maisons me parurent extrêmement misérables de petitesse, et les hommes semblables à de petites choses mesquines et fragiles…
Aujourd’hui nous avons seulement voulu nous agenouiller sur le tombeau de Pierre, devant les balustrades de jaspe et d’onyx où s’accrochent les clignotements perpétuels de cent lampes de vermeil. Las ! ma prière reste glacée sous le froid des marbres, timide devant les pompes de ce temple unique et fastueux, propice aux chants de triomphe, peut-être, mais mortel aux humbles prières comme la mienne qui n’ose prendre son essor dans l’effroi de cette immensité…
Tout à l’heure nous partons à Naples, puis nous reviendrons dans Rome passer quelques heures encore, trop courtes pour ce que j’aurais de souvenirs à réveiller, assoupis déjà sous les poussières lumineuses du printemps qui, pour moi, s’achève. Je suis heureux de les raviver un peu, ces souvenirs, avant qu’ils s’enfouissent dans la poudre épaisse et grise des années de maturité et de défaillance que rien alors ne pourra plus disperser… Et malgré l’éclat si pur de cette matinée très fraîche et très gaie par l’azur doré du ciel, je me sens le cœur oppressé d’angoisse, à la pensée qu’un jour la vieillesse viendra, inexorable. J’en ai peur. J’ai peur du néant dans lequel, bientôt, vont s’effondrer les visions exquises qui charment mes yeux en ce moment, emplissent mon cœur de chansons et me donnent autant l’envie d’être joyeux à la vue de la gaieté débordant de toutes parts, que d’être triste à la pensée qu’un jour très proche ce sera la disparition de tout cela en quelque gouffre noir, sous la cendre finale…
Voilà que Rome s’éloigne, maintenant, et que nous nous enfonçons dans sa campagne âpre et dénudée. Détachées sur le fond resplendissant de verdure des Apennins, les ruines d’un aqueduc, l’Aqua Felice, élèvent leurs nobles arceaux, courant l’un après l’autre sur l’herbe rare et pâle qui recouvre la terre, la terre, morne voûte sur le dédale des catacombes et sur les tombeaux qui la traversent en tout sens. Quelques fûts de colonnes et de vagues débris, ici et là, érigent dans l’air leurs pierres effritées sur lesquelles demeure la majesté des splendeurs de jadis. Des cyprès de loin en loin tachent, piqués comme des fantômes noirs, la clarté du plein midi ; et presque au ras de la terre brûlée flottent les brouillards inquiétants qui charrient la mal’aria…
Et notre locomotive laisse tomber de gros flocons de fumée blanche qui s’attarde sur cette terre sacrée, comme pour la caresser, et atténuer le sacrilège de notre moderne civilisation qui va, roulant sa force brutale sur les souvenirs gigantesques, sur les reliques des vaillants et des grands d’autrefois…
Un arrêt dans une petite gare coquette, égarée parmi les fleurs. Les rares habitants aperçus montrent déjà une certaine indépendance dans leur costume d’une allure plus libre et plus fantaisiste. Je suis surpris pourtant de voir arriver sur moi une sorte de colosse tellement semblable aux légendaires bandits de la Calabre que d’abord je crois à une extravagance ; mais non, mon personnage est très naturel, et gravement s’installe auprès de moi : ses traits sont contractés comme à force de rire, mais n’en gardent dans les lignes que la grimace sans aucun air réjoui, au contraire ; ses cheveux en broussailles se mêlent à la barbe inculte qui remplit les sillons creusés sur sa face jusqu’autour des yeux, desquels elle s’écarte pour laisser échapper l’éclat de deux boules noires susceptibles d’être très douces, mais dans un encadrement plus calme ; mon homme a le visage d’un faune, à tel point que je cherche à l’extrémité de ses cuisses brutales les pattes velues du dieu joueur de flûte. Son costume conserve intactes les traditions très vieilles du pays. C’est, en moins élégant, le costume des jolis modèles de la place d’Espagne : courte veste, culotte bleue s’arrêtant aux jambes enveloppées de linges serrés dans de mauvaises courroies de cuir, qui leur donnent pourtant grand air, et, sur la tête, le feutre armé d’un jet de plumes belliqueuses ; ses épaules sont couvertes d’un manteau de drap épais, rugueux, d’une étoffe comme il ne s’en fait plus nulle part, tissée à la main sur un métier primitif. Tout le personnage tient de la muraille, de l’étable et de la bête à cornes dont il a respectivement la couleur et les aspérités, l’odeur et les bons gros yeux mouillés et tranquilles, et le mufle humide que l’on devine sans l’apercevoir, enfoui sous les crins noirs de la barbe d’où s’écoule le giclement continuel d’une salive qui inonde le tapis et finit par faire, machinalement, lever nos pieds surpris de ce déluge. Il est d’une telle intensité de couleur locale, ce bandit ou ce pasteur, au milieu de nos vestons ridicules, qu’il nous intéresse malgré la chaîne d’or dont une aisance capricieusement manifestée orna son gilet grossier. Le peintre Léopold Robert s’est inspiré d’un type semblable pour son tableau du Louvre, l’Arrivée des Moissonneurs dans les Marais Pontins ; c’est le rude paysan mollement assis sur un des grands bœufs de l’attelage avec son manteau sur l’épaule, ses jambières de cuir et le long aiguillon dont il harcèle les bêtes paisibles… Nous lui pardonnons tout à ce merveilleux bonhomme inconscient de son originalité, — de sa beauté, — tout, même son odeur ; et je le remercierais volontiers pour la joie qu’il vient de me donner, vision agreste d’un fragment du passé, qui disparut, détaché en lumière, parmi les rocs légitimement orgueilleux de Cassino. — Le Mont-Cassin.
Et tant de gloire gît là-haut, sur l’aire très vénérable où le monastère bénédictin déploie ses murailles très saintes et ferme ses cloîtres très savants !…
Nous quittions en effet les Marais Pontins. Nos yeux encore inquiets de la rudesse colorée du paysan de tout à l’heure ne comptaient plus sur aucune vision douce et calme de vivante beauté.
Cependant nous allions vers Naples ! Dès les premiers pas dans ces champs de fécondité qui sont le prélude des immortelles splendeurs de la Grande-Grèce il va nous être donné de contempler la gracieuse antithèse de l’homme fruste et sauvage de Cassino. Et ce ne sera ni par le charme d’une jeune fille, ni par la grâce souriante d’une femme que nous serons initiés aux précieuses sensations qui firent si douces les délices de Capoue toute proche ! Vais-je pas m’en plaindre ?
Un bon gros garçon d’une vingtaine d’années monte et prend la place du bouvier descendu ; un jeune homme, un enfant presque, l’accompagne ; celui-là épais, joufflu, disgracieux, les traits déformés sous l’accroissement immodéré de son corps élargi comme une outre pleine ; celui-ci, le jeune homme, éblouissant d’une étrange et complète beauté. Son délicat visage aux lignes harmonieuses est d’une régularité souveraine ; tout est jeunesse dans la douceur des lèvres, dans les courbes mutines des sourcils ; son cou est fin, le contour de ses épaules est précieux et flexible, son teint pâle donne un air de suprême élégance et de distinction rare à sa personne ; les boucles de sa chevelure ambrée, d’une finesse féminine, caressent doucement le front le plus spirituel du monde ; enfin la sensualité de ses yeux rieurs, aux larges prunelles mobiles d’un brun roux chaud et rayé d’or, éclairent l’obscurité troublante des vers de Virgile, le Virgile amoureux et tendre des Bucoliques :
Et c’est pour nos yeux, à nous, une vision toute de fraîcheur, cet adolescent aimable et plus beau qu’une fille, que la jolie fille en vain souhaitée. Il joue comme un gamin fou ; son corps de jeune dieu inconscient de sa splendeur est secoué d’un rire tout vibrant de jeunesse ; il joue avec son gros voisin, appuie, câline, une délicieuse tête sur son épaule massive, puis il se redresse, enserre la taille énorme de son compagnon, l’agace, se repose, reprend ses jeux, rit encore, plus joyeux, plus fou et toujours plus joli. Et je trouve que le hasard n’a pas été si maladroit en envoyant ici tant de gracieuse espièglerie sur cette tête fragile, tant d’innocente gaieté sur ces lèvres magnifiques et sur tout ce clair visage qui n’est que sourires et beauté.
Le contraste est violent entre l’athlétique charpente du paysan de Cassino aux traits rudes et tailladés, et la mignonne sveltesse de notre joli petit voisin dont l’image semble ciselée dans le marbre, comme les statues antiques des éphèbes autrefois divinisés pour la radieuse perfection de leurs formes…
Nous touchons maintenant aux premiers vergers de la Campagne napolitaine, luxuriante, sous l’épaisse et riche végétation baignée, en cette fin du jour, par la lumière d’un ciel dont le bleu commence à se fondre au-dessus de l’horizon dans un vert pâle dégradé en nuances roses, orangées, puis rouges tout à fait au milieu des incendies où se débat le soleil impuissant à vaincre la force irrésistible qui l’entraîne à chaque minute, lentement, inexorablement, et promène par le monde infini la joie lumineuse des aubes, la splendeur pâmée des midis et les poignantes incertitudes des crépuscules.
Des pins parasols découpent, noires sur les métaux en fusion du couchant, leurs silhouettes étranges qui donnent une telle intensité, une allure si puissante à ce paysage de lumière. Nous ne les avions pas encore vus jusqu’ici en aussi grand nombre et, plus que les palmiers et les cactus hérissés, leur gravité mélancolique annonce un changement radical du climat, le calme et la douceur et les enchantements étendus sous leurs rameaux, la vie facile sur la terre prodigue sans que la charrue ait besoin de la creuser profonde pour en tirer les fruits. Je me rappelle le rocher de Gibraltar, sphinx accroupi, énorme et bleuissant, découvert tout à coup dans le lointain de la mer avec ces mêmes encadrements de pins parasols, et je cherche à distinguer ici, dans l’obscurité croissante qui envahit les campagnes, l’ombre gigantesque du Vésuve sur lequel se balancent les fumées éternelles.
La nuit est venue, complète maintenant. J’éprouve comme une sensation de cauchemar en promenant mes yeux autour de moi dans le compartiment où nous sommes quelques-uns, bien à l’aise pourtant ; on dirait que tout vient d’être diminué, rapetissé et que je ne suis plus moi-même qu’une petite chose, comme dans ces délires de fièvre où les prunelles dilatées, après avoir exagéré jusqu’à la terreur les formes démesurées, ensuite écrasent, diminuent, resserrent l’être entier qui s’anéantit. Je venais de tomber du rêve de mon rocher de Gibraltar contre les banquettes du wagon, et, des vomissements embrasés du Vésuve, mes regards s’arrêtaient à la lampe fumeuse jetant sur chacun de nous sa mauvaise clarté jaunâtre et vacillante qui modifie les visages et creuse en place des yeux, deux trous énormes.
Notre jeune voisin s’était arrêté de jouer ; devant sa grâce les ombres du quinquet blafard ne pouvaient rien, tant il paraissait tenir des dieux la juvénile sérénité de sa figure. Le voyant endormi auprès de son robuste compagnon, tel Bacchus adolescent, les yeux clos, ingénument abandonné sur l’épaule de Silène, l’obsession de cauchemar devint une vision de rêve…
Toujours la même arrivée, le soir, dans les grandes villes qui s’annoncent au loin par la réverbération de mille clartés. Nous devinons Naples, là-bas, parmi le noir enveloppant dont le tissu épais se déchire tout d’un coup sur les lumières éblouissantes de l’électricité.
Oh ! les facchini navrants que nous trouvons ici, avec de pauvres yeux noirs allumés, humbles et suppliants, dans leur brune figure ; des yeux de peine et de misère, convoitant, dès notre sortie de la gare, nos personnes et nos bagages. Leur foule est grouillante dehors. Ils grelottent dans l’extrême fraîcheur du soir, sous leurs mauvaises loques, débris de vêtements anglais coupés par le bon faiseur, mais dans un tel état !… Aucun bourgeron, aucune blouse, aucun vêtement de travail. Ce n’est pas la pauvreté, c’est la déchéance, l’écroulement de ce qui fut ou essaya d’être élégant et qui n’est plus que sordide !
Il fait très froid ; la bise fouette durement l’air d’une incroyable pureté.
Des voitures découvertes filent dans un bruit de grelots au trot rapide des petits chevaux harnachés de clinquant, conduits par des cochers délabrés dont les plus jeunes sont quelquefois des gamins de douze ans ; attelages de lilliputiens très fringants lancés en courses vertigineuses.
Nous nous enfonçons dans des ruelles tortueuses et escarpées où nous allons être écrasés entre les maisons penchées d’un côté et de l’autre jusqu’à nous toucher : c’est le vieux Naples, et le boulevard interminable que nous avons suivi après la sortie de la gare est une percée, un massacre parmi les étranges petites ruelles très encombrées où ce sera très amusant, demain, de venir flâner.
On dirait, maintenant, que nous entrons dans la campagne ou dans quelque faubourg spacieux aux maisons aristocratiques, d’une aristocratie sévère des siècles passés… Naples ne finit pas… Nous roulons depuis une demi-heure à fond de train. Les lumières diminuent de plus en plus. Nous doutons de notre cocher, qui pourrait bien se jouer de nous et nous emmener dans quelque coupe-gorge ; nous voulons retourner sur nos pas, dans la ville, mais nous essayons vainement de le lui faire comprendre. J’ai dû très gauchement m’expliquer, avec un air très embarrassé, car, en passant dans un de ces carrefours où s’atténuent un peu, à la clarté d’un réverbère isolé, les ténèbres épaisses de quatre ou cinq vicoli, des rires sonores issirent d’un groupe de filles arrêtées là, curieuses de voir aboutir mes réclamations embrouillées. Un vigoureux coup de fouet fit partir enfin, au grand trot, sur les dalles, notre attelage que suivit, strident et moqueur, le rire contagieux recueilli par d’autres bouches de belles filles joyeuses. Entrée de bonne augure dans cette Naples désinvolte où nous devions cependant trouver aussi tant de misères !
Installés à l’hôtel de la Riviera, arrive jusqu’à nous la rumeur des vagues qui déferlent en chantant de l’autre côté des feuillages légers d’un jardin dont les arbres s’élèvent, là, devant nous et nous séparent de la mer…
Du balcon de nos chambres, nous découvrons tout le golfe très obscur, et l’on nous indique, au delà de quelques feux rouges et verts qui se meuvent dans le noir, sur l’eau où leurs torsions se répètent et s’allongent en zigzags infinis, un point, une masse indécise qui serait le Vésuve. Notre foi lui prête une lueur de braise, très petite et lointaine. À sa droite, c’est Capri, puis Ischia, en face de nous, devant le Pausilippe. Mais nous ne voyons rien de tout cela, et ces noms flambent dans mes yeux, et je me prépare pour demain une belle série d’admirations… ou de déceptions !X
Non, pas de déceptions, murmurent les rais d’or du soleil qui, jeunes fous, entrent dans ma chambre, se pressent dans les guipures des rideaux, grimpent sur mon lit et, avant même mon réveil, inondent mon demi-sommeil paresseux de lumières et de transparences roses.
Dehors, un azur implacable règne en maître sur tout ; et, la fenêtre ouverte, recommence l’éternelle féerie de chaque jour dans l’immuable décor de bleus pâles, d’ors, dans le frou-frou des vapeurs de topazes et d’émeraudes qui se lèvent sur la mer. Je vois enfin le Vésuve caché sous une fine soierie à travers laquelle s’érigent et pèsent deux cônes énormes affaissés sur leurs larges bases, celui de droite plus haut, avec cette fumée blanche indolente chassée au-dessus de l’eau et tombant aussi du cratère jusqu’à mi-flanc du monstre. Et toute Naples, très tranquille et très ensoleillée suit la courbe gracieuse et molle du Golfe chanté presque autant que les femmes, autant que leurs beaux yeux, autant que leurs lèvres fines où naissent des sourires… Et le tintement clair d’une cloche voisine gazouille et métallise la lumière immense.
Capri enfoncée dans la mer et Ischia, là-bas, semblent deux énormes épaves encore indistinctes parmi les brumes violettes qui flottent sur les vagues berceuses.
Devant moi, à mes pieds, verdoie la promenade très belle aperçue hier soir ; jardin qui ne finit pas et confond ses verdures à droite avec les verdures du Pausilippe. Des statues blanches et polies, blanches et jolies, animent son calme élyséen des mouvements harmonieux de leur chair caressée de jour pâle et satinée d’ombres qui la modèlent en lui donnant la vie.
La Chiaja d’un côté et les quais largement dallés de l’autre encadrent cette promenade, qui est la Villa Reale ; et la Chiaja est le chemin que nous suivons d’abord, dès notre première sortie, pour aller au Vésuve.
Un cocher nous a enlevés d’assaut à vingt de ses collègues et s’efforce de trouver les mots qu’il faut pour désigner les choses que nous reconnaissons sans les avoir jamais vues. Ses petits chevaux trottent à merveille, ils secouent leurs harnais tout brillants de clous polis et grésillants des ritournelles des grelots ; et sur le harnais une main de cuivre lève ses doigts pour conjurer le mauvais sort !… Tous les petits chevaux que nous rencontrons sont aussi gaiement parés de cuivreries avec la petite main levée sur leur dos, du même geste très antique, et impudique, aussi…
Les rayons de soleil avaient raison, pas de déceptions ! Et ce m’est une joie presque maladive, rien que de me savoir dans cette Naples merveilleuse dont les beautés m’entrent par tous les pores, dont les lumières s’inoculent à moi-même, me pénètrent de sensations que je ne saurais exprimer ; mon cœur se revêt des couleurs qui charment mes yeux, il répète la chanson de toutes choses, il se gonfle et se soulève comme la grande mer où se dissolvent des paillons argentés dans les eaux limpides ; et cela est bien sot et bien enfantin, j’ai envie de battre des mains comme les petits enfants, et je sens que si je faisais cela, les larmes arrêtées au bord de mes yeux seraient capables de sauter le long de mes joues ; et l’on n’en saurait pas la cause, et ce serait ridicule en effet…
Mais le décor va changer.
Nous venons de traverser beaucoup de places et de rues. Nous sommes déjà dans les faubourgs de Naples. Des femmes laissent glisser, des étages élevés, de pauvres paniers très sales, pendus à l’extrémité de cordages disparates mal assemblés bout à bout ; le marchand qui passe et crie ses misérables denrées, prend dans le panier la monnaie déposée, il y place en échange les légumes, les petites épiceries ; la femme, là-haut, tire à elle son vieux panier et n’aura pas la peine de descendre faire son marché. Cela est d’une belle indolence ; mais les maisons sont quelquefois si hautes, et nous savons que ce n’est pas à Naples seulement qu’il est doux de ne rien faire !
Ces faubourgs allongés vers la mer, de Naples à Résina, sont horribles. C’est de toutes parts un suintement de crasses, une coulée de misères indéfinissables, tellement profondes et anciennes qu’elles ont pétri, pénétré les couches mêmes du sol, les pierres et les mauvais mortiers des maisons ; et le soleil qui transfigure et fait jolies certaines laideurs, n’éclaire rien ici que la misère et l’horreur.
Des viandes suspectes pendent, noires de mouches malgré la fraîcheur, aux crochets des étals ; des choses abominables grouillent sur des planches graisseuses, en plein air ou sous les vitres sales et cassées de minables boutiques empuantées ; et tout ce pauvre monde qui vit dans la rue et livre aux regards des passants les tristes intimités de son existence, se nourrit de ces détritus ; je ne puis éloigner de moi la pensée des Mangeurs-de-Choses-Immondes, dans la Salammbô de Flaubert ; et comme mon cœur reflète trop fidèlement les impressions reçues des choses extérieures, j’ai hâte de fuir ces cités de souffrance, où de mignonnes petites filles et d’adorables petits garçons jouent dans les fanges. Leurs jolis yeux sont mangés aussi par les mouches ; ils vautrent des petits corps charmants dans les ruisseaux infects où s’écoulent toutes les pourritures où s’égouttent les linges innommables étendus sur de longues cordes qui coupent les rues et les carrefours, tirant sur les maisons lépreuses, foyers épouvantables de souillures, de douleurs et d’angoisses…
De Naples au Vésuve, passant à Portici, à San Vito, c’est le chemin de croix de la misère humaine ; et les mots restent froids et paralysent les expressions qui essaient de définir tout cela !
La route commence à gravir les premières coulées de lave très anciennes déjà, puisque toute une ville est bâtie dessus et déploie, hélas ! sans cesse la même abjection. Et c’est bien une voie douloureuse que nous parcourons là, jusqu’à la dernière maison, jusqu’à la dernière branche d’arbre, tant qu’il reste une poignée de terre entre des laves, où peut prendre pied, naître et s’épanouir, noire sous un tel soleil, le soleil de Naples ! la Misère…
Des gamins effrontés courent, pieds nus, aux côtés de notre voiture ; tous sont jolis ; l’un d’eux a de grands yeux ardents, encore plus beaux que les autres ; des couleurs de pleine santé, par exception, jouent dans le bronze clair de sa petite figure ; ses traits sont assez réguliers, et des cils extrêmement longs et noirs tombent sur ses yeux en vérité merveilleux ; et le petit drôle lance, d’une voix nasillarde, les mots très doux de sa chanson ; il fait des cabrioles, des soleils sur ses petits poignets et ses petits pieds très sales, et comme il veut une récompense à tant de peine, il ne tend pas la main, il lève l’index, le plie et le redresse pour appeler le gros sou attendu avec impatience et qu’il s’évertue à mériter par de nouvelles chansons et des culbutes inédites ; et ses regards se font si gentiment suppliants, ils mentent si gentiment en affirmant qu’il est fatigué, très fatigué, tandis que rient ses lèvres rouges, que nous ne voulons pas l’éprouver davantage ; nous le gâtons de chocolat très fin emporté à tout hasard, et nous y joignons aussi des sous ; il met le chocolat dans sa poche, dédaigneux, et se sauve preste et moqueur avec les sous dans ses mains. Le petit effronté se retourne vers nous en courant et nous envoie des œillades malicieuses et des grimaces jolies, qui signifient clairement que nous venons d’être joués, que nous sommes des sots, et que ses pirouettes ne valaient certainement pas tout ça… Ses pirouettes, mais ses yeux !…
Sur des terrasses contenues par de hautes murailles fleuries de mousses et de fleurs sauvages, les vignes célèbres d’où jaillit le Lacryma-Christi tordent leurs ceps enchevêtrés et courent en berceaux disposés pour être, en été, des ombrages ravissants, avec les sarments pliés sous le poids des grappes lourdes et brillantes comme des topazes brûlées ou comme des pierres violettes presque noires dans l’épaisse verdure.
Des musiciens se groupent autour de notre voiture qui va lentement ; ils nous font une conduite dont l’harmonie n’est pas très savante, mais elle arrive si bien à point qu’elle ne laisse plus, pour un moment très fugitif sans doute, aucun désir à l’âme, aucun regret aux yeux. Rien ne pouvait nous être plus agréable que cette musique naïve sonnée par les guitares, pleurée tendrement par les violes, à ce moment précis où, nous échappant des misères pesantes de Portici et de San Vito, tout le golfe apparaît devant nous, radieux dans la lumière, Naples découvre ses blanches théories de maisons, de palais et d’églises, la Campagna felice déploie ses tapis verdoyants depuis la mer jusqu’au pied des Apennins neigeux, illuminés comme en de claires vapeurs d’aurore. Du Vésuve grandiose se précipite le tumulte des vagues de laves hérissées, figées en des formes fantastiques, en d’effroyables soulèvements qui font ressortir davantage le calme, la douceur et la sérénité d’en bas. Des genêts sèment dans leurs sombres végétations, de petites étoiles d’or…
O dolce Napoli, o suol beato,
Ove sorridere volle il creato !
Tu sei l’impero dell’ armonia,
Santa Lucia ! Santa Lucia !
Les chemins sont coupés, la route disparaît sous une coulée toute récente paraît-il, et nous allons faire un grand détour sur les blocs énormes de laves. Il semble que nous voilà dans un paysage extra-terrestre, dans un commencement ou dans une fin de monde, dans les premiers âges nébuleux des formations et des chaos, ou dans les bouleversements d’un cataclysme apaisé seulement depuis hier, dont on est surpris de voir le soleil éclairer encore les ruines titanesques, les suprêmes achèvements, les irrémédiables désolations.
Les facchini que nous n’attendions guère ici, — mais où ne les rencontrerons-nous pas ? — nous rappellent à la réalité. Ceux-ci sont tout à fait bandits. Par bonheur il fait grand jour, et il y a là, tout près, les casquettes galonnées des employés d’une agence de voyages qui sont pour eux un vague porte-respect, autrement nous serions dépouillés par ces gueux dont nous avons le plus grand besoin cependant, à cause des petits chevaux ou des chaises à porteurs indispensables pour gagner le funiculaire. Par exemple les « chaises à porteurs » ont volé leur nom et ne représentent rien de semblable aux élégantes commodités du grand siècle ; elles sont tellement rudimentaires que la plus déplorable amazone est contrainte de leur préférer les affres d’une équitation forcée, dès qu’elle se sent enlevée sur les épaules de quatre gaillards vigoureux, avec les planches vermoulues, mal assemblées sur deux mauvais rotins, qui constituent ce que ces brigands appellent la chaise à porteurs qu’ils se disputent et s’arrachent au milieu de cris et de vociférations épouvantables, tandis que le patient, ou le plus souvent la patiente, se demande avec angoisse ce qu’il adviendrait si, dans une des phases très mouvementée de la discussion, les facchini lâchaient la chaise hissée au-dessus de leurs têtes, pour en venir aux mains…
Sur un très bon petit cheval je continue l’ascension. Elle commence à devenir vertigineuse malgré la hardiesse et l’extraordinaire sûreté de ma bête docile qui pose ses sabots aux bons endroits et avance sans hésitation dans des hérissements de laves où j’aurais peine à me tenir. Mon petit guide s’appelle Agostino ; il est de Résina, en bas du Vésuve. Il n’est pas joli comme le galopin de San Vito, mais ses grands yeux étonnés sont très doux et tout à fait noirs ; ses regards ont un je ne sais quoi de tiède, de mélancolique et d’interrogateur ; des cils très longs les voilent par intervalles espacés, quand ils tombent lentement sur le cercle bistre violet qui cerne et plonge dans l’ombre le tour de ses yeux de petit faune d’une sauvage élégance, habitués à l’âpre contact de ces laves brûlantes et des genêts d’or dont ils ont les reflets. Il excite son petit cheval avec des cris gutturaux qui m’étaient inconnus : hrrâh… hrrââh, et glissent étranges et impressionnants entre ses lèvres rouges, entre ses dents très blanches d’adolescent toujours libre, hâlé magnifiquement sous le clair soleil, assoupli dans l’étreinte incessante du grand air : hrââh… gémit-il encore, hrââh !… comme s’il avait cueilli dans le vent rapide ou dans le grondement sourd du brasier qui râle sous nos pieds le rythme de sa plainte : hrââh…
Nous marchons sur des crêtes de vagues monstrueuses refroidies tout doucement dans leur marche lente. Par endroits, de petits cratères s’enfoncent, cylindriques, dans la terre ; leur ouverture est jaune, pailletée de cristaux de soufre qu’y déposent en s’échappant des vapeurs suffocantes. Des laves récentes sur lesquelles nous passons échauffent l’air qui frémit au-dessus, et le vent piquant commence à souffler emportant des tiédeurs dans sa course. Auprès d’une de ces cheminées sans cesse en activité, le sol est brûlant, et l’on nous dit que ce serait dangereux de nous attarder sur cette croûte ; elle pourrait craquer et nous entraîner dans les incendies du sous-sol.
Et le panorama s’étend immense, en bas, autour de nous : les bateaux minuscules font briller leurs larges voiles étendues comme des ailes de grands oiseaux sur le clapotis incessant des flots. Naples ressemble à une grève rose semée de coquillages tout blancs ; Sorrente, très discrète, se cache dans les verdures luisantes des orangers, sur le promontoire effilé qui, à notre gauche, s’avance vers Capri haute et translucide comme un gros cabochon bleuté ; à droite se détache Ischia, plus effacée sur l’horizon embrumé d’or. Les nuages légers promènent sur la mer et sur la campagne de longs faisceaux de lumière qui embrasent au ras de terre des villages entiers, plaquent sur la mer des resplendissements fantastiques, tandis que dans l’air ce sont des rayures diaphanes allongées entre le ciel et la terre, comme il en tombe à travers les vitraux des cathédrales, violettes, bleuâtres, rosées et dorées, ajoutant à cette apparence de chaos où nous sommes perdus le vacillement de l’atmosphère, la danse de toutes ses molécules qui se désagrègent, perdent leur équilibre et s’effondrent dans la décomposition de toutes les couleurs…
Après un déjeuner inouï de parfaite tranquillité, au milieu de ces visions d’enfer, le funiculaire nous emmène à la station extrême après laquelle on doit gagner à pied le Cratère. Une fumée intense nous enveloppe, fouettée par le vent qui la rabat sur nous, chargée de vapeurs sulfureuses ; et de petites fleurs de neige tombent, si menues et si frêles qu’il faut s’étonner de les voir survivre à la violence du vent.
Mon guide me suit de loin. La fumée épaisse nous sépare presque constamment l’un de l’autre, et je devine le monde tellement petit et tellement loin au-dessous de moi, que l’isolement me plaît ainsi. Quand, par moments, les rafales suspendent leurs sifflements, il règne un grand silence, — le Silence, — large, large, infini, tel que je ne l’ai compris nulle part ailleurs. Maintenant la tempête chasse, avec des cendres menues et lourdes qui chatouillent la figure, une fumée compacte et tiède sous les picotements froids de la neige qu’elle entraîne. Je monte, bousculé par un vent alterné de glace et de feu, enfonçant jusqu’aux chevilles dans la cendre noire qui se soulève et vous envahit. Encore quelques pas très difficiles, aveuglé et étouffé par le soufre en vapeurs très denses et les poussières. J’arrive au trou béant sur le monde inférieur, où tourbillonnent les bourrasques. Mon guide est redescendu sans m’avertir et pendant quelques secondes je ne vois plus ni le ciel ni même le sol sur lequel je suis à demi enfoncé, rien que l’ouverture large comme un lac desséché, et profonde d’une profondeur stupéfiante que la fumée ne me laisse même pas soupçonner tout entière, où quelque chose a l’air de se débattre dans les râles…
Ce cône qui d’en bas paraît si tranquille, si apaisé dans son panache de fumée, est un monde colossal agité de mouvements dont la grandeur dépasse presque notre compréhension… Je me baisse pour recueillir un peu de cendre au bord extrême du cratère taraudé devant moi, entonnoir formidable à l’issue étranglée vers le brasier dont les flammes, en le temps d’un éclair, ne laisseraient rien du misérable qui, poussé par les rafales, roulerait avec elles dans ce gouffre noir où elles s’effondrent et remontent aussitôt en tournoyant, en hurlant d’épouvante.
Je descends, fuyant la solitude de ce lieu de vertige et d’exaspération où je viens d’avoir la notion exacte du néant que je ne puis imaginer absolu, mais décomposé en ce délire inexprimable, en cette inexprimable dissolution dans un choc effroyable de l’air, de la terre et du feu…
Même un peu plus bas le vent est encore terrible et la fumée toujours envahissante. J’enfonce dans les cendres vierges, unies comme une plage que vient de balayer la mer ; seulement je n’ai plus devant les yeux l’horreur de ce trou sans limites apparentes, et il me semble, comme au réveil après un cauchemar, que je suis délivré d’un grand poids…
Nos petits chevaux nous attendaient en bas, où l’air est reposé ; et les grands yeux noirs d’Agostino regardent, interrogent ; son visage se fait régulier, presque joli dans le sourire de tous ses traits ; il veut être content avec moi, il veut avoir sa part de satisfaction, être bien certain que je n’ai pas été déçu et que le cyclope accroupi sur son village m’a bien donné toutes les joies que j’étais en droit d’attendre. Il me les a données, amplement ; et le petit Agostino emporte, content, de quoi manger macaroni, lui et sa fine petite bête, puisque sur sa demande j’ai dû ne pas oublier le macaroni du cheval !
Il est tard ; Agostino redescend à Résina. Je voudrais le suivre dans l’humilité de sa maison de lave bâtie parmi les genêts d’or, pour voir la femme qui, royalement, met aux yeux de ses petits la flamme superbe de ses yeux, les velours caressants de ses regards, l’empreinte souveraine de la beauté qu’un instant trop court j’aimai dans l’adolescent sauvage du Vésuve…
Le même voile qui ce matin enveloppait le golfe, la mer et les îles, retombe lourdement, chargé d’ors fauves ; et, le soleil à peine englouti dans le couchant, l’air devient rougeâtre, puis s’assombrit et unit ses vapeurs aux fumées opaques du Vésuve ; et tout d’un coup la nuit arrive, parée des scintillantes joailleries des étoiles…
Roulé très longtemps au milieu des pauvres faubourgs de tout à l’heure, quelconques maintenant sous les réverbères allumés dans l’obscurité très épaisse. Il semble que nous n’arriverons jamais et que les faubourgs s’ajoutent aux faubourgs. La misère s’efface, mais on la devine, on la sent poignante derrière ces fenêtres sans carreaux, avec des rideaux en loques inhabiles à dissimuler les taudis affreux, les nichées d’enfants aux larges yeux noirs et les dolentes petites vieilles et les tremblants vieillards qui n’ont jamais, là, derrière, dans ces bouges empuantés de cuisines atroces et de quinquets fumeux, que misère et souffrance, hier, aujourd’hui, demain…
Sur le seuil des maisons, dans de beaux bassins de cuivre, halètent des braises ardentes illuminant soudain les visages penchés sur elles pour les aviver ; les pauvres corps transis par le vent froid vont essayer de se réchauffer à ces foyers qui seraient d’une grâce antique si charmante, s’ils n’étaient aussi tristes et insuffisants.
Les mêmes lumières rouges, blanches et vertes que nous apercevions hier, s’allument de nouveau ; et c’est bien sur la mer que dansent, très nettes au fond de la nuit noire, leurs clartés perçantes d’escarboucles.
Devant les madones aussi, la flamme des lampes s’incline, penchée sous le vent ; et ses lueurs vacillantes se mirent dans les glaces qui protègent les fleurettes de papier doré, les feuillages coloriés et la jolie robe aux teintes fanées, aux passementeries d’or éteint dont s’entourent et se revêtent les naïves saintes vierges.
Après les vicoli abominables dont les maisons se relient par des guirlandes de linges et de défroques secouées au vent qui en décroche quelques-unes et les chasse devant lui, ce sont les illuminations soudaines et violentes de l’électricité sur les grandes places, le heurt des ombres rudement tranchées contre les blancheurs qui partout se répandent. Je préfère à la piazza immense l’étrangeté mystérieuse du vicolo avec, sur des seuils crasseux, les longs regards de filles en cheveux noirs et luisants, porteurs d’invitations à quelque fête, pleins des promesses galantes de plaisirs bizarres offerts par ces corps de gouges au sabbat, ces corps de goules inassouvies… Mais les belles ont des amants, et les amants ont des rasoirs dont ils jouent à merveille, paraît-il ; et les lèvres des téméraires ruissellent de la tiédeur du sang avant d’avoir goûté aux baisers de la femelle…
Le même chemin qu’hier soir, pour regagner notre hôtel. Nous connaissons maintenant les ensoleillements exquis de la Chiaja, et les verdures de la Villa Reale, et la joliesse des statues nues promises aux regards ; la nuit ne réussit pas à effacer complètement les splendeurs de ce matin, les longues pâmoisons de toutes choses sous les caresses savantes de ce soleil qui fait, depuis les lauriers sans cesse renaissants du tombeau de Virgile, là-bas au Pausilippe, jusqu’au Vésuve sur les flancs duquel l’illusion sertit des incandescences de rubis, s’étirer de langueur la rive aux lignes harmonieuses de cette Naples heureuse et souriante…
J’ai eu tort peut-être de croire aux souffrances, à la misère ; n’est-ce pas voulu, n’est-ce pas la monnaie qui paie l’insouciance et les joies du far niente ? Ce peuple déjeune et dîne de la légendaire pastèque à la pulpe fraîche et savoureuse ; il ne demande rien que des jeux, des éclats de rire, des chansons et du soleil ; et pour seule ambition désire ne pas déchoir de sa légère royauté d’amour et de gaieté. Tout crie, sous ce beau ciel, l’antique : Panem et circenses !
Après dîner, rôdé le long des quais déserts battus sans cesse par les flots envoyant contre les pierres humides leur plainte amortie sur les varechs. Je vois arriver de loin les sillons qui grimpent en écume blanche sur les crêtes, puis redescendent sillons, remontent, retombent du même mouvement éternel, soit qu’ils promènent les lames dorées du soleil, qu’ils s’allument sous les incendies du Vésuve, s’engouffrent avec des bruits horribles dans le sol entr’ouvert d’Ischia, ou comme ce soir, très unis, qu’ils apportent d’âcres senteurs marines, le bruit monotone et berceur des vagues frémissantes encore de caresses reçues là-bas, sur les côtes d’Andalousie. Et voilà, dirait-on, qu’elles meurent tout près de moi, dans un frôlement mouillé de lèvres, dans un gazouillis de baisers…
Jamais la nuit ne m’a paru aussi épaisse que sur ces quais de Santa Lucia, et j’ai presque peur, — une peur irraisonnée et très enfantine dans laquelle il me plaît de m’obstiner, — de voir surgir derrière chacun des petits comptoirs où se vendent, le jour, des poissons et des coquillages, des frutti di mare, quelque monstre marin au corps huileux et flasque, au visage squameux de pieuvre, avec des yeux énormes et phosphorescents, avec des clapotis de nageoires trempées, retombant lourdes sur le corps mou en faisant un flac ! qui me donne le frisson ; je n’aurais pas dû m’aventurer par ici où la solitude est lugubre, entre la silhouette menaçante du château de l’Œuf, blafarde sur l’eau, et les hautes murailles de Pizzo Falcone, contreforts immenses grimpant vers je ne sais quelles terrasses qui dominent, écrasent tout par ici. Je m’étonne que cette Naples déjà tant aimée me donne ces sensations également intenses de joies et de lumières, de misères et de ténèbres.
Comme la façade du Carlo Felice à Gênes, auquel ressemble notre Odéon, la façade du San Carlo, ici, est assez morose dans les lignes raides de son architecture classique ; mais je l’aime mieux encore que le portique éclatant des Nouvelles Galeries Umberto, sculpté, clinquant et tout frais sorti du moule vulgaire des décorations modernes. Je fuis les marbres trop blancs et trop neufs, les onyx plaqués, riches et somptueux comme des rastaquouères, les magasins très éclairés où l’on vend toutes sortes de fanfreluches à l’usage des étrangers, souvenirs stupides de cuivre estampé ou de zinc fondu, terres cuites mignardes et minables, tableaux peints avec des confitures, photographies pleines de promesses de celles que l’on ne montre pas, marrons glacés, bonbons fondants et nougats. Seule est drôle cette boutique, à gauche en allant vers la via Roma, où des gamins, le corps vêtu d’une grande robe blanche et le visage enveloppé de grands yeux noirs, rasent des mentons qui sortent tout bleus de leurs doigts agiles de petits Figaros.
Un music-hall : le salone Margherita, perce de ses lumières les dalles de verre qui, au milieu de la rotonde de marbres neufs et d’onyx tapageurs, remplacent les pavés de granit de la Galerie Umberto. Par un escalier de crypte aux murs glacés sous le givre qu’y dépose l’électricité, j’arrive à la porte banale, velours grenat et clous dorés, entre-bâillée sur la salle de ce bizarre concert souterrain ; à travers un brouillard de fumées épaisses, une chanteuse en oripeaux rouges ; les bruits de bocks s’entre-choquent ; les hurlements des cuivres couvrent des paroles qui semblent expirer entre les lèvres maquillées de la dame ; quelque ignoble refrain de beuglant, rauque et voyou, tombant sur les charmes extravasés du corsage écarlate ; une pantomime de chairs trop rouges et trop blanches, lourdes et sans tenue, qui se débattent en des gestes obscènes… La fumée tout d’un coup agite ses remous empâtés sur le tumulte des applaudissements : la dame a fini… non, on la rappelle !…
Dehors, au grand air pur de la nuit, la rue de Rome, già Toledo, est très animée. Une des nefs de la Galerie Umberto s’ouvre sur elle, inondant de ses flots d’électricité des groupes compacts pressés de lire à ses clartés les derniers journaux du soir annoncés par les petits crieurs importuns qui vendent aussi des allumettes et tout ce que l’on veut, au hasard de l’occasion.
Un individu me frôle, profil louche d’homme d’affaires véreuses, visage glabre patiné d’un poli froid et gluant ; il m’envoie dans un murmure inintelligible une haleine qui sent la marée ; ses yeux noirs et perçants clignotent, caressants et tentateurs. J’ai deviné sans hésiter le hullulement de ses lèvres exsangues : des cartes transparentes… signor… signor… una bella ragazza ?… quindici anni !… Et son inflexion de voix veut dire : j’ai mieux dans le cas où vous trouveriez tout cela un peu banal. Je poursuis mon chemin. Un peu plus haut, pour que je comprenne, — et puis il y a beaucoup moins de monde où nous sommes, — signor… signor… bel ragazzo ?… signor, sedici anni… bimbo molto bello, molto birichino ! signor…
Le coquin ! Je m’y attendais. Il paraît qu’un… courtier de ce genre ne reste jamais coi ; — Naples se souvient de Caprée, — il lui reste toujours en dernier ressort un appât merveilleux auquel ne résiste pas la vertu la plus solide, et la mienne ne l’est guère !…
Je regagne l’hôtel, tranquillement, par les quais traversés déjà ; je n’ai plus de frissons dans la solitude des ruelles étroites et des obscurités mystérieuses ; je me suis exagéré le danger. Sans doute les filles aux lèvres rouges sont très paisibles ; sur leurs seuils hospitaliers, elles attendent des amants, ne désirent que des baisers qu’elles voudraient recevoir et rendre avec lenteur ; le sang ne coulera pas par le rasoir, mais le bruit étouffé des soupirs sous les lèvres unies s’en ira tendrement…
J’ai peur maintenant des lumières aveuglantes et des grandes maisons blanches dans les rues trop larges où des faces glabres vendent d’énervantes caresses, postérité infâme de ce Cesonius Priscus, chevalier romain, Intendant des Voluptés de Tibère…
Sur les vieux quais de Santa Lucia, au pied des murs pesants, je m’attarde en flâneries exquises. L’ombre noire et lourde du château de l’Œuf se dresse tout près, paisible comme un souvenir. Tout est silencieux. Rien ne bouge que l’eau et le vent frais et pur. Je me repose comme en la paix et la sérénité d’un cloître, et je pense à ces gens enfermés dans les tabagies du salone Margherita avec, au fond, dans le plâtrage des décors, dans les ors faux qui verdegrisent, la grosse en rouges atours, pauvre chair où coulent les onguents, les fards et les cold-cream, en larmes de misère !
Le drôle !… Molto bello, signor… molto birichino, signor !… sedici anni, signor…
Naples ! Naples !…
Dans l’obscurité de tes ruelles, quelles adolescences se prostituent dont les yeux éclairent les ténèbres de tes bouges et les illuminent de leur beauté, comme les étoiles de là-haut, très pâles, qui font des lueurs dans l’ombre et, roses, bleutées, vert tendre ou dorées, ouvrent doucement leurs grands yeux de lumière dans le ciel qui se penche sur ton golfe voluptueux ?…XI
Dès le matin, nous parcourons des quartiers aux petites ruelles très longues et très resserrées ; les maisons sont hautes, comme à Gênes, mais beaucoup moins propres ; c’est un grouillement continuel de choses et de gens ; les pavés et les trottoirs, s’il y en a, sont noirs de monde ; les petits trams sonnent de la trompe et difficilement trouvent leur passage dans l’envahissement des rues.
Rien de noble ni de sévère : haillons, désordre, fouillis et saletés, remue-ménage pittoresque du haut en bas des étroites fenêtres très rapprochées, l’une touchant l’autre ; laisser aller charmant dans toutes les démarches, et sur tous les visages insouciance et joie de vivre ! De jolis coins ressortent, crûment illuminés de soleil, en resplendissements roses et fauves, roses de soleil perpétuel, fauves des rares averses et des poussières qui dansent dans la lumière et finissent par se coller aux pierres qu’elles revêtent de cette patine chaude et bronzée. Les ombres sont aussi subtiles et nuancées, et comme le soleil n’a pas encore dissous leurs buées matinales, de grosses tours d’églises, dont les murailles seront vermeilles dans le midi, sont bleutées en ce moment, bleutées et mauves de buées fraîches, attirantes comme si l’on éprouvait le besoin d’en respirer l’azur palpable.
Je préfère aux illuminations du soleil ces ombres fines ; elles n’ont pas l’effronterie des choses voyantes et dorées sous l’astre qui les étreint et triomphe d’elles ; elles sont voilées de fraîcheur, timides et tremblantes de pudeur.
Sur des paniers d’osier montent les pyramides de fruits appétissants dont les flancs vont s’ouvrir et dégorger un jus savoureux.
Des fontaines sont envahies par d’adorables petites filles qui se fâchent parce que des garçons, vigoureux et nus sous les loques qui les recouvrent à demi, s’amusent des jets d’eau qu’ils envoient sur elles ; mais, réconciliés bien vite après des moues charmantes, tous ces gamins et ces gamines composent leurs petits bouquets de fleurs d’orangers et de violettes offerts comme à Rome aux étrangers qui passent et qu’ils devinent, et qui cèdent aux câlineries de leurs œillades. Et c’est, dans ce peuple, au milieu de ces maisons hautes qui s’éveillent, ouvrent les grands yeux que sont les fenêtres, le jeu infini de toutes les clartés, de toute la vie qui renaît et, joyeuse déjà, va s’épanouir davantage encore au plein soleil.
Le portail de San Gennaro est enfermé dans un réseau compliqué de boiseries et d’échafaudages que l’on craint à chaque instant de voir s’effondrer dans la via del Duomo, tant ils paraissent fragiles.
La Basilique paraît colossale ; c’est, je crois, l’une de ses rares qualités ; malgré les marbres dont les surfaces tellement polies semblent mouillées et ruisselantes, les hautes voûtes et la coupole ne recouvrent que le vide. Des escaliers prennent naissance aux côtés du maître-autel et descendent dans une crypte très ancienne, dont le sol est couvert de mosaïques précieuses. De vieilles choses d’argent ciselé et repoussé déposent en cet archaïque réduit le charme vieillot de leurs menues intimités. Il semble que le Dieu tout-puissant, mal à l’aise dans la nudité du temple, au-dessus, s’est retiré dans les fraîcheurs de la crypte fleurie de mosaïques épanouies, embaumée de vieilles odeurs d’encens, imprégnée d’un murmure vague et ininterrompu de prières, comme si, depuis des siècles, les oraisons avaient pénétré la voûte et, du maître-autel, étaient chaque jour tombées ici dans ce réduit de pieux silence. Et le gardien indiquant, dans un tabernacle couvert de gemmes et plaqué d’orfèvreries, une relique très sainte, je pliai les genoux, respectueux, sous le poids léger des ferveurs mystiques, qui, de toutes parts, émanent du sanctuaire illustre de saint Janvier…
Le soleil est déjà haut dans le ciel. Les physionomies suivent la progression du jour. On dirait qu’il faut à ces Napolitains rieurs la pleine lumière qui baigne en ce moment toute leur ville, la verdure des campagnes, leur Vésuve monstrueux, et répand de claires traînées de bleus nuancés qui moirent l’azur du ciel et l’azur de la mer.
Toute Naples est dans les rues.
Nous montons, à travers des faubourgs populeux, des pentes raides semées de cailloux pointus qui s’allument sous les pieds des chevaux. Des escaliers s’enchevêtrent dans les ruelles, si bien posés, qu’ils semblent — avec leurs paliers en terrasses, leurs dégagements sur des jardins aperçus très haut sur des murs, ou tout en bas au fond de quelque précipice que surplombe le chemin — de vrais praticables de théâtre ; et les acteurs ne manquent pas, aux tournures extravagantes, et naturelles cependant, sur la scène grandiose dont le décor reste le même dans sa tonalité générale, malgré la transformation plaisante des détails. Des femmes superbes, dans leurs vêtements communs, ont des allures d’impératrices ; leurs cheveux noirs sont relevés sur leur front avec une science instinctive de la beauté ; des filles, en riant, découvrent les rangées de leurs dents blanches comme des amandes nouvelles que l’on voudrait croquer.
Des boutiques de chaudronniers préparent la voie aux boutiques de Pompéi où nous serons tout à l’heure. C’est un resplendissement de ces bassins de cuivre déjà vus hier soir sur le seuil des maisons de Portici ; nobles vases aux formes antiques, larges et plats, élevés sur des trépieds de fer avec, pour oreilles, deux lourds anneaux brillants qui retombent sur leur panse au galbe savant. Ces humbles ustensiles semblent copiés sur des pièces de musée : leur unique destination est d’être utiles ; il arrive que, par une sorte d’atavisme, les modestes artisans qui les façonnent, héritiers des esthétiques passées, leur donnent par surcroît l’élégante simplicité, la pureté de lignes que l’on chercherait parfois en vain dans des profils mieux étudiés. Le soleil de midi mire ses rayons d’or dans les cuivres de ces bassins ; des jeunes filles accroupies tendent leurs nuques flexibles à ses baisers, tandis qu’elles soufflent du feu dans un des braseros. L’air est doré, le soleil est doré, les cuivres sont dorés, les chairs des filles sont belles à voir, tout dans ce cadre à souhait forme un tableau original et vécu de quelque scène antique…
Nous montons vers San Martino. Quel spectacle, et comment oser en parler ! La mer étend sur Naples une draperie somptueuse diamantée de mille reflets qui se jouent dans les facettes des vagues molles brodées des passementeries irisées de l’écume. Elles jettent leurs résilles de perles d’Orient sur le bleu ruisselant de ce voile merveilleux, Zaïmph sacré de Tanit, retenu là-haut sur l’horizon par ces deux îles enluminées de vert tendre et d’or pâli comme deux clous de chrysoprase : Capri, Ischia…
Ischia, de ses fleurs embaumant l’onde heureuse
Dont le bruit, comme un chant de sultane amoureuse,
Semble une voix qui vole au milieu des parfums.
Ces jolis vers des Orientales s’égouttent dans ma mémoire, doucement, très doucement, au pas lent du petit cheval qui nous emmène, tranquille, au-dessus de cette mer, au niveau de ce ciel, flamboyants l’un et l’autre dans une apothéose.
De vieux remparts écroulés avec un chemin de ronde très étroit où l’on peut à peine se tenir tant les pierres sont éculées, creusées et usées ; de la marmaille encore, avec de grands beaux yeux de velours noir, des mains très sales, immobiles dans le même geste qui demande ; et de petites jambes fines, nues, joliment tournées, qui courent à côté de notre voiture ; des facchini maintenant, grands détrousseurs au guet de leur proie.
Par le portail grand ouvert nous entrons dans la cour du cloître de San Martino, noble patio d’Andalousie aux murailles et aux portiques réchampis de couleurs tendres, voilés d’un côté, dans l’ombre, éblouissants de l’autre côté, au soleil qui dévore les bleus et les roses pâles.
Dans le musée, les vieilles reliques alourdissent l’air frais des salles, aux murs épais, de leurs parfums humides de maroquins, d’une odeur de bric-à-brac, un bric-à-brac de bonne tenue qui sent son aristocratie.
De vieux couloirs froids où, semble-t-il, nous allons rencontrer quelque fantôme de moine triste et rêveur devant le viol sacrilège de son cloître. Et nous marchons en essayant d’atténuer le bruit de nos pas, en parlant à mi-voix sous les voûtes dont les échos très brefs contrarient les efforts que nous faisons pour glisser en silence sur les carrelages rouges et mouillés qui grincent, habitués seulement aux frôlements légers et souples des sandales de cuir.
Les choses caduques endormies et pieuses de San Martino ne sont qu’un prétexte à promenades mélancoliques dans les salles capitulaires et dans les réfectoires, où les religieux dépouillés ne viennent plus écouter les saintes lectures pendant leur frugal repas. On goûte d’autant mieux le charme pénétrant et sévère des longs corridors, que l’on sent, du dehors, les rayonnements intenses de la lumière, et que l’on va donner, en sortant, libre essor aux regards momentanément écrasés et ensevelis sous les murs impénétrables du monastère.
La chapelle fleuronnée des roses énormes qui s’épanouissent sur les piliers, taillées dans un marbre rare d’Égypte, est un contraste violent auprès des humilités du cloître ; c’est le déploiement de toutes les richesses resserrées et accumulées avec un goût scrupuleux dans ce vaisseau relativement petit où les moines, non contents de faire grandiose, se sont plu à réaliser l’impossible. Ils ont ciselé les rinceaux et les médaillons, découpé les balustrades, cherché les piliers dans les marbres antiques rares déjà il y a des siècles, dans les porphyres et les lapis travaillés au diamant. Les rarissimes onyx d’Orient, les agates introuvables, de dimensions énormes, en morceaux extraordinaires et sans prix maintenant, rutilent, flamboient, brillent doux et polis comme des chairs roses, veloutés comme des prunelles fauves et brûlées, rouges et saignants comme des anatomies, et caressants, bleutés ou verdoyants comme des mosaïques d’améthystes, de saphirs et d’émeraudes. Au milieu de l’autel, tout en gemmes amoncelées, luit un rubis féerique, quintessence d’incendies et de lumières, qui semblait autrefois, avant la profanation, quand il éclatait au soleil dans les musiques des hymnes sacrées et les vapeurs de l’encens, l’ombre d’un infime reflet du regard de la Divinité cachée derrière la porte d’or du tabernacle.
Les moines aujourd’hui sont disséminés. On en rencontre encore par les vicoli, vieux, à la démarche lente, avec des toisons d’argent qui revêtent de reflets blancs et soyeux leurs traits creusés où sommeillent le calme et l’espoir. Ici le cloître est désert ; mais, ailleurs, des monastères ont été convertis en casernes. L’oratoire est écurie, la bibliothèque manège, et le réfectoire cantine. — Dors-tu content, Homais ?…
Dans cette chapelle, la prière s’échauffe au contact des rutilantes matières, en glissant sur les orfèvreries et les pierreries inestimables ; et les pompes religieuses devaient être, dans ce déploiement inouï de magnificences, un magnifique élan de ferventes oraisons. Mais les moines avaient la subtile compréhension des milieux favorables aux épanchements de l’âme : dans les cellules, c’est le recueillement, l’anéantissement de tout l’être qui, après s’être élevé en un rêve mystique jusqu’à la Divinité, retombe dans la pauvre réalité de soi-même et flagelle son corps du fouet dur des renoncements de chaque jour, de chaque instant ; la volonté, sans cesse aux prises avec les révoltes de la chair insoumise, ici, dompte ses tressaillements par les souffrances du cilice, et les austérités pesantes des cellules glacées comme des tombeaux…
Mais ils ont fait aux splendeurs du ciel napolitain, ces moines, un cadre incomparable dans les jardins de leur cloître. Le soleil paresseux s’attarde sur les marbres éclatants élevés en portiques neigeux, dore les balustrades délicates et légères qui contiennent, dans les parterres, l’effervescence des feuillages : lauriers-roses, jasmins, lavandes, géraniums, dont les parfums se mêlaient d’encens aux grands jours de fête. Les roses des lauriers, avec la grâce charmante d’une vision antique, éclataient lumineuses près des géraniums fleuris de sang dans les touffes de verdures. Mais pour que les yeux ne s’oublient aux langueurs profanes des fleurs délicieuses, parmi les jardins enchanteurs, des crânes flanqués de tibias en croix se détachent comme de blancs ossements ciselés dans les balustres, à même le marbre, entre les ornements, les rinceaux, les capricieuses fantaisies et les riches fioritures ; les bouches sans lèvres grimacent et ricanent, les orbites décharnées s’ouvrent hideuses et méchantes en œillades vides qui font signe à la Mort…
Malgré cela, à cause de cela peut-être, à cause de la joie de vivre auprès de cette perpétuelle menace du néant, ce jardin éveille des impressions exquises, et je ne crois pas qu’il soit possible d’ajouter, à tant de virtuosité, dans le calme, la magnificence et le charme ; cet enlisement qui veut prendre l’âme seule, me paraît, à moi, frôler en même temps et caresser le corps : baiser tiède sans les lèvres tremblantes, étreinte chaude sans le doux enlacement des bras…
Après des couloirs blancs et vieillots dont les plafonds descendent très bas sur les dalles rouges, où flottent des parfums discrets, odeurs de surplis tuyautés fleurant l’iris, odeurs d’encens, odeurs de choses vierges, c’est la demi-obscurité d’une salle très blanche aussi, striée de raies de lumières qui filtrent entre les lamelles des volets clos et se répandent sur les murs. Soudain, par les portes hautes, ouvertes sur une terrasse étroite, s’engouffrent des vagues de clartés, et toute Naples s’étend, baignée de grand jour, au fond d’un abîme de limpidités, incendiée sous les feux de plusieurs soleils. Sa rumeur monte jusqu’à nous en plaintes languissantes et monotones, — la douce Parthénope pleure toujours Ulysse, — comme un chant de grillons dans la profondeur des midis éclatants. Le Zaïmph sacré jette, de l’horizon étincelant, les joailleries de son azur diamanté. Le ciel dilue dans l’or pâle le ruissellement de ses infinis bleutés ; et sous les réverbérations de la mer il tressaille, étonné des splendeurs qu’il recouvre…
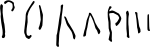 [1]
[1]
Prendre un billet de chemin de fer, aller et retour, pour Pompéi !… Mes illusions sont encore entretenues, heureusement, par la splendeur et la gaieté de cette rive méridionale du golfe de Naples : Portici, Résina, Torre del Greco, Torre d’Annunziata, et les visions riantes de Castellamare et de Sorrente qui, peu à peu, se rapprochent et déposent sur les flots bleus l’offrande rose et blanche de leurs maisons enfouies dans les blêmes oliviers, sous les coupoles élégantes des pins parasols.
Comme si je ne l’avais pas vu hier, le Vésuve me paraît étonnant de puissance et de majesté. Il écrase tout autour de lui ; tandis que de la Chiaja sa masse pesante, harmonieusement estompée dans de légères vapeurs, est un fond très simple et très naturel au tableau merveilleux du golfe. Ici, le géant se soulève dans sa stature gigantesque ; c’est bien le cyclope effrayant qui m’enveloppait hier de l’haleine terrible de son cratère.
Les petites maisons aux toits roses de Résina et de Torre del Greco sont éparpillées sur les coulées de lave qui, dix fois déjà, les ont ensevelies ; elles ressemblent à des jouets d’enfants, insouciants du danger, posés auprès de la fournaise sans cesse surchauffée, par quelque jolie menotte de bébé confiant en la tranquillité de toutes choses, heureux sous le ciel bleu, devant la mer bleue où se promènent de petits bateaux aux voiles légères, gracieux aussi comme des joujoux. Sur les flancs du Vésuve se tordent les ceps plus nombreux autrefois, avant les éruptions, quand le volcan était la colline verdoyante chère à Bacchus, dont parle Martial, admirateur fervent de ses tièdes vergers et des pampres verts de ses treilles fécondes.
De l’autre côté du Vésuve, une gare très petite, insignifiante comme celle d’un village ignoré ; deux ou trois employés, pas plus. Personne ne descend. Mais nous avons bien vu sur le pignon, dans un tableau, en lettres banales : Pompéi. C’est là Pompéi ! Le train repart et nous laisse hésitants sur le quai. Devant la gare, une courte avenue traverse des champs, rejoint sur une route, en pleine campagne, une ou deux maisons, des hôtels-restaurants, presque des guinguettes, où nous attendaient, sous forme de guides… les facchini. Il faudra les subir, et malgré leur exaspérante société essayer de se recueillir ici comme ailleurs, tâcher de s’isoler quand même, malgré ces gens qui vous enlèvent l’unique possibilité de jouir des merveilles dont ils sont les gardes-chiourme : la paix et la solitude.
Un abominable tourniquet tourne, grince, numérote notre passage de pèlerins et nous plonge dans une atroce banalité de concours agricole. Je vais, moi, presque m’agenouiller sur le seuil de cette Tombe immense, dont rien, aucune pierre ne paraît encore, et je pousse du ventre, péniblement, la roue sacrilège qui barre le passage et mutile les illusions.
Rien ne trahit encore la vie antique ressuscitée un peu chaque jour, délicatement et pieusement, il faut le dire. Un couloir sombre resserré entre deux talus de verdures, conduit à l’une des portes de Pompéi qui se découvre soudain dans l’encadrement de voûtes épaisses. Magique effacement de dix-huit siècles devant la splendeur colorée des murailles, des colonnades et des temples de la grande morte. Tout est clair, parmi ces ruines qui n’ont pas des allures de ruines, dans cette cité morte préservée des tristesses de la mort, et seulement figée dans une inexplicable interruption de la vie, prête, semble-t-il, à ressurgir tout à l’heure sur ces blocs de laves bleuâtres très irréguliers qui forment entre deux hauts trottoirs la chaussée de toutes les rues. Les roues des chars vont continuer le sillon des ornières déjà profondes ; les fontaines épancher leurs eaux claires aux carrefours ; les bassins de marbre sont disposés encore à les recevoir, et les tuyaux de plomb qui les apportent vont se couvrir de rosée fraîche. De jolies mains blanches s’appuieront sur les margelles, aux places déjà marquées et moites du dernier frôlement ; mains savantes de belles esclaves qui venaient boire ici, se miraient dans l’eau tranquille et souriaient à leurs yeux tendres en dénouant les nattes touffues de leur chevelure ; mains de jeunes garçons effrontés, altérés par les rires sonores et les jeux fous, qui, nus et trempés de sueur, apaisaient sur les dalles glacées le halètement de leur corps ardent, ivre de joie et de plaisir.
Les marchands arrivent ; ils viennent derrière les comptoirs de marbre puiser, dans les vasques creusées devant eux, les olives, la saumure de poisson, les vins de Sicile cuits et parfumés dont le peuple est friand. Les boulangers ouvrent leurs fours ; les flammes en lèchent la porte, et la fumée noircit le seuil où finissent de cuire les pains dorés semblables à de grosses fleurs jaunes aux pétales gras et ronds ; les amphores sont blanches, sur les bords, de la farine que l’on vient d’y verser, toute fine, échappée des lourdes meules de pierre dont la rotation s’achève à peine sous la poussée d’un esclave.
La foule bruyante se presse dans les ruelles étroites. Les uns courent à leurs affaires, au forum : magistrats, avocats, banquiers, armateurs ou marchands ; d’autres, et les plus nombreux peut-être, sortent des temples où l’on célèbre la luxure, où l’on exalte toutes les voluptés ; ils marchent, frémissants, pâles déjà des plaisirs qu’ils vont prendre. Et dans cette Pompéi où le ciel embrasé chante l’amour que protègent les dieux, l’embarras n’est pas grand ; des portes de Stabiæ aux portes d’Herculanum, les débauchés, les désœuvrés, soldats, courtisans, jeunes efféminés vêtus de la toge blanche aux bordures écarlates, gladiateurs favoris dont les reins s’enveloppent d’un riche lambeau de pourpre de Tyr ou de Capoue qui fait valoir la blancheur des chairs assouplies, trouvent au fond des quartiers louches les bouges aux enseignes monstrueuses qui tendent aux passants le piège de leur engageante promesse : Hic habitat felicitas…
Les riches patriciens passent en litière ; passent en litière aussi les dames nobles dont les cheveux s’enroulent autour des épingles d’or finement ciselées et dont les bras sont lourds de bracelets et de bijoux massifs aux formes impeccables…
Le soir Pompéi s’amuse, et rôde la populace des proxénètes et des entremetteurs. Dans les palais, si petits, mais d’une élégance si raffinée, les jeunes filles servent, en des plateaux d’orfèvrerie, les fruits et les confiseries du dessert ; elles s’avancent en mouvements cadencés, au son des flûtes et des crotales, cependant que des esclaves, choisis parmi les plus beaux des jeunes garçons, versent, juvéniles échansons, les vins fameux de Lesbos ou de Falerne des rhytons ciselés dans les patères d’argent.
C’est le luxe ruineux et la joie souriante de Pompéi que viennent habiter les patriciens de Rome et les marchands de Naples. Des galères croisent d’Alexandrie à Carthagène, de Cyrène au Pont-Euxin, d’Antioche à Syracuse ; et leur proue d’ivoire, sur le bleu de la Méditerranée, conduit aux maîtres heureux la virilité naissante, mais éprouvée déjà des esclaves adolescents. Éprouvée déjà, car les matrones qui leur ont enseigné l’art de plaire au moyen de belles attitudes et de danses efféminées, se sont payées de leurs leçons sur la fougueuse ardeur des garçons de quinze ans. De la sorte, ils sautent des galères, instruits aussi dans les sciences érotiques. Leur beauté naïve encore, bien que savante en les moyens changeants et ingénieux d’aimer, est le charme vivant des atriums où bruissent des jets d’eau claire. Et les chambres où s’émeut la lascivité des fresques voluptueuses connaissent leurs soupirs épuisés et la fraîcheur amoureuse de leur souffle…
Qu’elle soit d’opale aux cheveux d’or, de bronze fin aux poils d’ébène, de rose ivoire au duvet roux, d’ambre aux boucles châtain, de nuit crespelée de ténèbres soyeuses, ou d’aurore vêtue de fauves toisons, leur adolescence parfaite est habillée avec une recherche serve de luxure. La courte tunique de lin qui découvre leurs genoux se relève sur les hanches et mal dissimule une érectile nudité que la licence des hôtes pris de vin sollicite au passage, — contre quoi les défendent à peine leurs beaux bras, complices des étreintes clandestines, que laissent nus les demi-manches de la tunique transparente. Leurs cheveux annelés sont couronnés de fleurs. Les feuillages tressés de bandelettes en rejettent les extrémités sur chaque épaule. Et leur marche s’adorne, aux pieds délicats, de cothurnes dorés où gisent des émaux, en des sertissures d’électrum et d’argent, retenus haut sur leurs jambes sveltes et rondes par des courroies de pourpre.
L’amphitryon richissime prodigue autour des tables ces jeunes esclaves très élégants et très recherchés qui sont les pocillateurs. Tandis que le festin s’achève les convives reçoivent de leurs mains fines aux ongles polis la branche de myrte et la lyre, invitation symbolique à chanter les couplets à la gloire d’Éros, Éros dont ces adolescents d’une rare beauté sont comme l’image multiple en son Unité radieuse : l’Amour…
Et Pompéi, dans la nuit étoilée, ne s’endort pas ; elle commence de vivre au bruit des chansons. Les amants effeuillent sur la tête des amantes les pétales embaumés des roses de Pæstum ; les courtisanes se livrent ; et quand l’aube paraît, les lèvres se cherchent encore, le jour se lève dans un murmure de baisers…
Mes yeux se caressent longuement à ces ruines sans tristesse, calmes et grandioses, d’une extrême pureté de lignes, d’où s’élève encore une haleine de concupiscence qui m’entraîne en des rêves auxquels je n’ose me soustraire. À chaque pas tout est prêt encore, tout invite à la joie ; les restes du festin en font connaître la chère exquise. Sur le seuil des palais minuscules l’atrium s’ouvre comme autrefois aux tiédeurs du ciel, aux étreintes du soleil. Autour des colonnes de marbre, sur les fresques obscènes, et pudiques presque à force de naïveté, passent des effluves de luxure qui envahissent et tenaillent l’esprit, d’autant plus aimables qu’ils s’excusent sous la forme religieuse d’un culte païen, il est vrai, et à jamais aboli, mais qui pendant des siècles a couvert de son indulgence, quand il ne favorisait pas en des rites insensés, l’exaltation des vices infâmes et des plus attirantes débauches.
Les gradins des théâtres conservent l’empreinte des marbres polis dont ils resplendissaient ; et je ne me refuse pas, en me reposant une minute sur l’un d’eux, à respirer l’odeur des huiles parfumées dont les essences se fondaient, molles et sensuelles avec les relents des athlètes nus, oints d’huiles et de sueurs, crispant leurs membres raidis sur la chair offerte de leurs adversaires, au milieu des vociférations de l’amphithéâtre hurlant, bestial et sauvage, ivre de sang, ivre de chair, ivre de souffrances et de râles, ivre de corps tout nus tordus dans les spasmes de l’agonie…
Les bains publics portent sur les dalles usées la trace des pieds charmants des femmes, et les plafonds d’azur ont retenu, dans les étoiles d’or qui scintillent aux voûtes, l’éclat de leurs yeux enchanteurs. Il reste dans le tepidarium des revêtements de stucs ciselés en médaillons, en figurines délicates soutenant de petites niches creusées dans la muraille entre des caryatides de terre cuite, où persistent, flottantes, des senteurs de vêtements soyeux.
Plus loin, dans des flots de lumière, s’élèvent les portiques d’un gymnase rempli encore des cris joyeux de la jeunesse exercée comme en Grèce à tous les jeux corporels. Le gamin fragile venait là et surprenait un jour son corps débile mué en la forte splendeur d’un jeune homme gracieux et robuste, et se plaisait
À voir ses longs cheveux flotter au libre vent
Et sur son col d’ivoire errer plein de mollesse ;
À voir ses reins brillants de force et de souplesse,
Son bras blanc et nerveux, au geste souverain
Qui soutient sans ployer un bouclier d’airain.
Dans la piscine de marbre blanc, encore intacte, les jeunes Pompéiens se plongeaient, s’ébrouaient gaminement et montraient, au sortir de l’eau,
De beaux corps ruisselants du frais baiser des bains
Qui fumaient au soleil comme des urnes pleines
De parfums d’Ionie aux divines haleines
En me répétant ces vers délicieux des Poèmes Antiques, j’ai cueilli, entre les dalles disjointes de la piscine, des feuillages de fine guipure qui jaillissent, sauvages, de la blancheur des marbres. Ils ne sont que délicatesse, et leurs verdures frêles suspendent des lamelles d’émeraudes à des fils de soie noirs ou bronzés. À Pompéi, on les appelle cheveux de Vénus. Pourquoi ? Elles n’ont rien de l’épaisse chevelure d’une femme, ces brindilles spirituelles et fines comme les cheveux de Ménalcas. Ce seraient des boucles viriles, en effet, ces feuillages que nous appelons capillaires ; fils ténus tombés des têtes séduisantes d’adolescents aux fronts ombragés de boucles noires comme leurs grands yeux noyés dans l’ombre des cils, tels que j’en ai vus encore à Portici, à Résina, frères de ceux qui, vainqueurs à la palestre, animaient autrefois ces pavés de marbre des frôlements caresseurs de leur chair…
Les petites choses surtout sont restées immuables. Les menus détails de la vie écoulée sont à la place qu’ils occupaient, où leur propriétaire aimait à les trouver pour son usage ou pour son plaisir. J’ai vu des robinets de bronze cachés dans le sol, sous des grillages de fer ; ils amenaient aux réservoirs de marbre de l’atrium les ondes glacées du Sarnus. Les nôtres sont parfaitement semblables à ceux-ci, vieux peut-être de deux mille ans ; et cette communauté de besoins, cette exécution très simple d’un ustensile banal crée, plus encore que les palais somptueux, une étroite sympathie entre nous et les pauvres disparus de Pompéi.
Des statuettes sont demeurées sur leurs socles, en face de larges bancs de marbre en hémicycle, dans des jardins étroits et délicieux où certainement par des soirs roses et dorés comme celui qui descend aujourd’hui, sont venus s’aimer des jeunes gens, et se souvenir, devant les couples heureux et charmants, ceux qui eurent à leur tour ce charme et ce bonheur et dont la vieillesse se rafraîchit à la joie des baisers et des serments d’amour échangés sous leurs yeux.
Dans le silencieux alignement des rues très droites, tirées au cordeau, nous allons seuls avec notre guide ; et cette solitude me plaît. Je la voudrais plus grande encore. Je voudrais être absolument isolé dans ce milieu étrange où tout est ruine avec des couleurs vives encore, révélées sous les petites pierres ponces que des ouvriers enlèvent dans des corbeilles. On les prend à poignées tant elles sont légères et peu compactes. On dirait qu’en peu de temps, avec beaucoup de monde, Pompéi tout entière serait découverte. Mais il faut des soins minutieux pour ne rien perdre et une surveillance incessante pour que rien ne soit dérobé des choses mises à jour, précieuses dans leur matière parfois, et toujours dans leur valeur artistique.
On achève devant nous le déblaiement d’une fort jolie maison décorée de peintures exquises, très vives de contours et d’une éclatante fraîcheur de coloris ; elles sont nettoyées avec beaucoup de soin, et recouvertes de glaces qui les laissent voir sans que le vent, la pluie… ou les Anglais les puissent détériorer. C’est une cuisine que l’on débarrasse en ce moment des scories légères, mais épaisses de plusieurs mètres, qui n’ont pas endommagé, aussi irrémédiablement que les laves d’Herculanum, les habitations de Pompéi. On tire sous nos yeux trois chaudrons en bronze de formes élégantes et trois trépieds de fer qui leur servaient de support. Les chaudrons, dont la partie inférieure est ovoïde, n’ont pas d’assise et ne pouvaient être de quelque usage qu’avec ces trépieds auprès desquels ils se trouvaient encore. En somme, cela ne diffère pas essentiellement des mêmes pièces employées à nos besoins, mais les anciens avaient su donner aux leurs des contours purs et gracieux, relevés encore par la jolie patine verte et bleue dont le temps et l’humidité les ont revêtues.
Par des rues secondaires et tortueuses, nous traversons la ville alanguie d’abandon et de clarté. Le guide, très discret, me fait entrer dans l’étroite et hospitalière demeure où Vénus accueillante recevait les sacrifices, et me traduit les inscriptions tracées là, au-dessus des lits de pierre très petits. La plupart sont écrites dans la langue d’Ovide ; plusieurs sont tracées en grec, et aucune ne s’écarte, dans ses trop libres confidences, d’une recherche de pensée et d’expression vraiment surprenante en ce lieu et en les circonstances qui produisent ces tendres expansions. Nos murailles modernes ne connaissent plus de tels raffinements.
Nous avons eu la chance rare d’être seuls, cet après-midi, à parcourir les ruelles de Pompéi, seuls avec notre guide, un jeune homme froid, au visage pâle et grave ressemblant d’une façon que je ne puis m’empêcher de noter, à ce portrait de Sculpteur[2], du Bronzino, — oh ! dans les Bronzino, la grâce attirante et voluptueuse des mains ! — suspendu, au Louvre, au-dessus du sourire immobile de la Joconde. À la rigoureuse nomenclature des choses et des chiffres, il a bien voulu ajouter quelques mots personnels en réponse aux questions que je lui adressais ; un contact un peu plus long, je le sentais, l’aurait fait se départir d’une réserve quelque peu délaissée cependant dans la maison de joie. J’aurais eu grand plaisir à lui voir donner libre cours à l’aimable érudition qui, par moments, perçait timide entre les mots.
Les derniers ouvriers occupés aux fouilles passent devant nous et regagnent leurs maisonnettes dans la campagne ; leurs pas résonnent un instant, puis s’effacent, sous la voûte où nous nous enfonçons à leur suite, ne laissant personne après nous dans la ville muette. Il me semble qu’elles vont être affreusement seules cette nuit, sur les dalles irrégulières et larges des hauts trottoirs de lave, les fontaines aux mascarons grimaçants, d’où l’eau fraîche s’écoulait entre les blocs énormes placés là-bas au milieu de la rue, écartés pour le passage des chars et servant aussi de gué aux jolies filles qui, soulevant leurs voiles, sautaient de l’un à l’autre sans mouiller leurs pieds nus. Elles vont être seules les colonnades du forum, peintes de vermillon ; seuls, les autels de marbre des temples, sanctuaires sans dieux et sans prêtres. L’irrémédiable silence plane sur les murailles de granit, sur les écroulements de cette ville qui, la nuit venue, reprend son aspect de nécropole ; plus jamais ne viendront le troubler les frôlements des sandales, les rires joyeux des gamins et les bruits de la foule, les applaudissements des théâtres et des cirques et les appels mystérieux des courtisanes. C’est en vain que sur les seuils déserts doucement persiste le mot de bienvenue :
Dans l’atmosphère antique et pénétrante qui règne ici, le Musée se dresse comme un anachronisme, et ses vitrines désolées succèdent, dans la lumière blafarde tombée des vitraux dépolis, aux ruines presque vivantes, dehors, dans les radieuses clartés du crépuscule. Des cadavres sont immobilisés, sous la couche pierreuse qui les enserre et s’est substituée au poli tiède de l’épiderme, en des attitudes et des gestes tellement humains que les nôtres seraient tout semblables, et que ceux-là paraîtraient arrêtés dans la minute qui vient de s’écouler, n’était cette patine séculaire qui revêt les membres encore jolis, les bras potelés et bien faits, les doigts chargés de bagues, les torses ceinturonnés de courroies de cuir, les jambes rondes, d’une plastique irréprochable et si naturelle que l’on éprouve la sensation de surprendre vilainement ces pauvres corps impuissants à défendre, à couvrir leur nudité.
Dans des vitrines sont rangés les petits objets : épingles, colliers, miroirs, anneaux, boîtes pour les fards, tous usés chaque jour par ces mêmes êtres dont les corps peut-être sont couchés ici ; bijoux aimés dont les ciselures ressortaient sur la blancheur de la chair et qui furent tièdes aussi de sa tiédeur ; parures délicatement choisies, tristes épaves de rouille et de vert-de-gris auxquelles s’attache encore un peu d’argent noirci, une mince plaquette d’or ciselé ; puériles intimités confiées aux coffrets à bijoux où trouvait place, avec les los d’amour, la boucle des cheveux du jeune fiancé, fleuris maintenant de paillettes d’émeraudes dans les bains de marbre des gymnases. Chers petits débris informes qui furent des joyaux très aimés comme les menues orfèvreries dont nous nous plaisons à nous parer, que nous caressons sous nos doigts, offrandes d’amants aux yeux chéris que nous voyons sourire, aux corps très aimés et très beaux que nous voulons faire plus beaux encore pour les aimer davantage.
Personne ici ne vient s’émouvoir ; et dans ce Musée triste comme une Morgue où ne passent que des indifférents ou des sceptiques, je crains de rester insensible aussi, et j’aurais dû ne pas venir troubler la paix et le repos de toutes ces choses fragiles éparpillées là comme des bibelots de famille arrachés, pour les vendre, à l’intimité d’une maison où vient d’entrer la mort.
Rien n’égale la magnificence de cette fin de jour dans le silence absolu des ruines. Elles commencent à se revêtir d’une gaze violette très légère et très pâle à travers laquelle les colonnes safranées, les seuils grands ouverts et les marbres des statues inachevées rêvent, mélancoliques, aux fastes du passé. Le Vésuve, très sage sous un beau nuage blanc qui s’élève silencieusement, regarde l’œuvre de sa colère ; et l’on entend parfois, dit-on, le vieux cyclope dont les grondements arrivent jusqu’ici en sourdes menaces.
De la hauteur d’un amoncellement de pierres ponces j’embrasse la ville impure que le Feu de la terre a peut-être punie, comme autrefois le Feu du ciel en tombant sur Sodome, Gomorrhe, Adama, Seboïm et Ségorrhe. La pensée de la mort passe, éphémère, juste assez de temps pour ajouter un charme étrange de plus à ces écroulements que je persiste à voir tout roses, plongés dans les clartés sereines et tranquilles d’un crépuscule qui succède aux ténèbres de vingt siècles, si calmes dans l’apaisement infini des clameurs éteintes, des luttes achevées, d’une vie tout entière anéantie. Corps charmant et voluptueux de la voluptueuse Pompéi dont il reste seulement les formes desséchées, momifiées, mais assez belles encore, assez ensorcelantes pour que les yeux se plaisent aux vestiges des splendeurs effacées, pour que les lèvres s’agitent et baisent la poussière d’or qui voltige là où tant de sourires ont vécu, où tant de soupirs se sont exhalés des lèvres jolies, dans cette ville qui ne fut pas chaste, mais dont l’impudicité riante et la luxure effrontée se revêtirent des formes radieuses, et pures quand même, de la Beauté…
Sur les chemins où, lentement, roulent des voitures chargées de fruits, sur les champs et sur les vergers, flottent des nappes de poussières bronzées, maintenant, et lourdes, traînant à la surface du sol ; elles sont, plus haut, atténuées de rouges mêlés d’ors et de roses, de roses fondus dans l’or qui s’écoule goutte à goutte sur les turquoises glauques du ciel.
Torre Annunziata, où nous arrivons bientôt au galop vigoureux de notre petit cheval, est noyée et ruisselante comme dans un bain de métal.
Sur la mer Tyrrhénienne le soleil allume les incendies dont flambent Castellamare et Sorrente. Dans les buées du soir, Ischia et Capri ont l’immobilité de deux gros nuages que n’émeut aucun vent ; le couchant épuise sur leurs floconneuses silhouettes les richesses de ses grenats et de ses incarnats, et dépose sur elles des transparences délicieuses, limpides et claires, aux tons de chairs très pâles…
Les roues de massives charrettes grincent sur les routes, et les chevaux rapides, pareils à celui qui nous a conduits si hardiment, tirent du collier, excités par la clameur monotone du voiturier, longue et lugubre comme un râle dans l’agonie du jour : hrââh !
L’air devient très froid. La nuit laisse rôder des ombres qui ne veulent pas s’épandre, et le soleil s’attarde dans les brumes dorées envahies par des vols de nuages lilas entraînés lentement vers l’horizon.
Dans la petite gare de Torre Annunziata l’obscurité est grande, les feux rouges et verts des signaux brillent, tournent et disparaissent ; de pâles quinquets tremblent sous le vent, fument et font paraître la nuit plus profonde encore.
Derrière un rideau d’oliviers et de roseaux la lumière se meurt. Cependant que le soleil fait doucement, dans les opales d’une aurore, son entrée sur l’autre côté du monde, c’est ici la fin d’un beau jour. Et dans le chaos de pourpres et d’obscurités flotte une indéfinissable langueur dont s’empare l’âme encore sous le charme de cette cité païenne débordante de sensualisme, soudainement révélée, facile, riante, et belle de toutes les beautés, et trop tôt disparue au tournant du chemin… Il ajoute aussi, ce beau soir tout doré, à l’angoisse faite des sensations douloureuses et sans causes explicables issues des grandes choses en train de disparaître insensiblement, ou déjà terminées, et que l’on ne doit plus revoir…
Encore de la musique, ce soir à l’hôtel, dans la vaste salle à manger très belle et très haute, que deux ouvertures ovales percées aux extrémités, dans les murs, rendent un peu solennelle en amenant je ne sais quelle réminiscence du salon de l’Œil-de-Bœuf, à Versailles, mais éclairé et blanc. La société, ici, ne ressemble en rien aux cohues mélangées des hôtels : jeunes misses élégamment enfouies dans de vaporeuses soieries, comme au bal ; ladies un peu mûres, mais si joliment rajeunies sous le grand voile de crêpe blanc qui retombe de la coiffure sur les épaules avec la grâce et la noblesse d’une parure de cour. On dirait, ces Anglaises impeccables, une réunion de personnages du grand siècle à qui l’amphitryon somptueux fait donner la comédie.
Peut-être a-t-elle tout de même l’air bien opéra-comique cette troupe de chanteuses et de chanteurs napolitains parés de velours et d’écharpes de satin, de chemisettes légères sur les torses des jeunes hommes et sur la ferme cambrure des femmes dont la beauté est très médiocre ; mais je leur sais gré d’arriver, ce soir, à atténuer la transition trop brusque du rêve de tout à l’heure heurté contre la réalité présente, laquelle il faut, hélas ! toujours subir : de la musique, des chansons et des danses, c’est toujours un peu d’idéal qui passe…XII
Ce n’est pas en curieux, en touriste que, ce matin, je monte lentement, emplissant mes yeux de lumière, parmi la cohue gracieuse de Naples qui s’éveille et descend de chez soi, c’est en pèlerin, c’est un pèlerinage qui m’attire au sanctuaire où je m’étais bien promis de passer quelques heures très exquises.
Je monte vers ce Musée de Naples, navré plus que nulle autre part de manquer des connaissances artistiques qui permettent une admiration solide et raisonnée devant les œuvres des Maîtres, au lieu du seul plaisir vague que procure, même aux moins initiés, ce qui demeure sans conteste la plus pure expression du Beau. Mais je vais, tranquille, sachant bien que mes yeux feront souvent passer en moi les frissons et les jouissances d’Art que je chercherai là-haut, où je voudrais tant comprendre ce que je vais aimer infiniment…
La joie de raviver le souvenir de Pompéi et le désir d’en mieux connaître les vestiges précieux me font dépasser les grandes salles où s’amassent les blancheurs des marbres solennels. Après la provocante et impure vision de cette Vénus Callipyge, femme jusque dans les regards qu’elle traîne sur tout son corps effrontément découvert, c’est tout de suite, — dans la clarté du jour doré qui vient de la rue où je passais tout à l’heure sous les frémissements du matin, un matin de Naples, remuant et joyeux, — l’atmosphère de santé robuste des éphèbes de bronze, le grand calme de la nudité sereine qui succède aux remous voluptueux de l’air amolli dans les voiles levés sur la Vénus impudique dont le marbre fut terni, dit-on, par les embrassements fous de ses adorateurs.
Dans le Mercure au repos comme dans la statuette ravissante de Narcisse, c’est, amoureusement modelée par des maîtres dont la science exalte le rythme cher à l’école Praxitélienne, la plus sublime conception de la vie corporelle ramassée toute en les contours charmants, en la grâce et la force déjà viriles de la jeunesse offrant aux regards sa radieuse et saine nudité.
C’est un ravissement, cette statuette de Narcisse, dont la tête riante et mutine, aux traits spirituels doucement s’incline en avant, retenue sur des épaules robustes par la nuque enveloppée des boucles légères d’une chevelure répandue en ondulations soyeuses autour du beau visage de l’adolescent et sur son front couronné de feuillages. Sa poitrine aux rondeurs masculines descend jusqu’au ventre sans effort, dans le modelé d’un torse impeccable. À la grâce de ses bras et de ses mains fines aux gestes gamins et frivoles, s’unit délicieusement le dessin ferme des cuisses et des jambes aux lignes précieuses. Les pieds impatients qui semblent à peine peser sur la terre, sont à demi cachés dans des cothurnes d’une recherche surprenante : les courroies ornées de ciselures s’écartent et laissent voir la délicatesse des chevilles, l’extrême légèreté des attaches, attestant ainsi l’art du sculpteur jusqu’en les plus infimes détails de cette fragile figurine qui demeure comme un type achevé du plus pur atticisme, et la réalisation parfaite de ce tout harmonieux qu’est un jeune corps.
Sur un roc chargé du faix gracieux de ses formes juvéniles, Mercure repose en une attitude calme et naturelle. On sent, à travers la patine du bronze, la saveur tiède du modelé, le soin et le fini suprêmes du travail. On voit se précipiter à travers la chair le flux de la vie ; et devant ces formes raffinées, l’esprit a peine à concevoir autant l’éblouissante et invraisemblable beauté des modèles, que le génie subtil et la passion des maîtres qui savaient les copier pareillement…
Ils devaient les aimer, ces jeunes hommes, ceux qui, de leurs doigts, ont taillé dans le marbre, pétri dans la glaise et ciselé dans le bronze la gloire de leurs corps empreints d’une élégance telle qu’il ne paraît pas que la nature même ait jamais offert une semblable perfection. Et cependant ils ont vécu, ces adolescents, embellissant par leur seule présence la vie quotidienne de la Grèce antique. Chacun les voyait aller, chastes et nus, sous les portiques des gymnases, luttant de grâce, d’adresse et de force, beaux et fiers, comme le Doryphore de Polyclète, — cet autre chef-d’œuvre, — épanouis en la plénitude des formes qui annoncent à l’enfant assoupli aux jeux de la palestre sa transformation virile et prochaine. Leurs figures reflètent encore, dans les marbres qui nous enchantent, la sérénité de l’esprit, le calme de tout l’être confiant en sa robustesse, heureux de s’offrir sans voiles sous l’azur du ciel, de dorer sa blonde nudité, ou de tremper la floraison brune de sa chair aux rayons ardents du soleil, très pur, ignorant même s’il est nu…
J’aurais aimé voir le Faune dans sa maison de Pompéi, dans le cadre choisi, à la place indiquée par le maître somptueux dont ce bronze seul dit assez la richesse mise par lui au service de la plus noble passion artistique : à travers le métal vivifié, la gaieté circule comme dans une chair véritable, sous la rondeur des muscles libres et reposés. Il rit, ce grand Faune, par tous les membres de son corps effilé. Ses jambes sont heureuses de soutenir tant d’allégresse ; ses cuisses merveilleusement tournées et dansantes portent avec légèreté le torse élégant que soulève le halètement du plaisir. Tout le corps est en harmonieuse communion avec l’ivresse heureuse du visage moqueur sous la couronne de pin, et les bras lancent dans l’air le geste des doigts en un mouvement d’exubérant et ineffable contentement…
Entre toutes les mignonnes statuettes de bronze trouvées à Pompéi, véritables chefs-d’œuvre en qui la ciselure s’ajoute à la souplesse juvénile des formes et fait valoir l’exécution caressée des chairs, je veux distinguer encore la grâce troublante de l’Apollon adolescent, peut-être le pulcher Apollo de Virgile.
Il serait difficile de traduire la mollesse voluptueuse marquée dans son frais visage, dans l’attitude et jusque dans la manière dont est traitée la chevelure flottante et ramenée sur la tête en une touffe de boucles arrangées avec le raffinement que rappelle l’Apollon du Belvédère. La volonté du statuaire, ici, ne saurait être contestée : dans la virilité du garçon de quinze ans, il a mis je ne sais quels mouvements adorablement ambigus indiqués avec une singulière volupté, de la rondeur délicate des épaules jusqu’aux hanches étroites et très belles dont la beauté perverse ne saurait être ignorée des yeux malins qui éclairent le visage gracile et coquet du jeune homme…
Même physionomie encore, la tête colossale d’Antinoüs, figure dolente et fière que couronnent les anneaux des cheveux détaillés avec un art sans égal, un art tout féminin et qui ne surprend pas sur ce front et ces yeux fascinateurs, tendres et mâles, et prêts à défaillir, ces yeux dont l’impérieuse et douce flamme devait s’éteindre dans les eaux transparentes du grand fleuve égyptien :
|
Les flots glacés du Nil ont gardé ta mémoire,
|
Les beaux vers du poète Jean Lorrain accouplent leur rythme hallucinant aux magnificences des Poèmes Antiques, et je ne sais rien de plus délicieux que laisser se dérouler les spirales bleutées des mots harmonieux qui de mes lèvres montent se glacer et mourir sur les lèvres des dieux de marbre ou de bronze vert d’une inexprimable beauté.
Mais les noms dont nous les appelons, ces dieux, ne sont pas les leurs. Ce Narcisse très séduisant, cet Apollon coiffé comme une femme et provocant comme l’une d’elles, cet Antinoüs, ces menues statuettes de bronze, ces camilles et ces pocillateurs, peut-être, sont, les uns et les autres, les images très exactes des esclaves d’Alexandrie d’Égypte, d’Asie, de Grèce ou de Rome même, de Rome jalouse des infamies de l’Orient, de la Rome des Césars, qui, avec un Héliogabale encore adolescent, connut les plus mystérieuses débauches… Et ces visions, ici, passent devant mes yeux, frémissantes et radieuses de la splendeur de la chair. Je voudrais ignorer les turpitudes d’autrefois, ne rien connaître du passé qu’il faut oublier pour les fastes du présent… Mais le passé m’obsède ; le passé rayonne ici tout entier ; la sereine immobilité des marbres et des bronzes n’efface rien de son souvenir… Et, très calmes et très purs, les éphèbes sont là, fleurs éclatantes de jeunesse traînées dans les ruisseaux des bas quartiers, sur le seuil immonde de l’ephebæum ; fleurs marquées à jamais du culte extravagant et de l’adoration fougueuse des peuples, de l’amitié impure des Césars et du contact même des philosophes et des poètes, ces toujours immaculés rêveurs : César aime Antinoüs, Socrate chante l’immortelle beauté de Charmide, Anacréon célèbre les boucles blondes et soyeuses et la splendeur surhumaine de l’esclave Bathylle, le petit danseur.
Bathylle alors s’arrête, et d’un œil inhumain
Fixant les matelots rouges de convoitise,
Il partage à chacun son bouquet de cytise
Et tend à leurs baisers la paume de sa main.
Oh ! le rythme exquis et dangereux de ceci, que je prends encore à Jean Lorrain ! Et tout à l’heure sonnaient à mes oreilles les vers de Virgile, évoquant l’image parfaite de notre joli voisin de lundi dernier, dont le charme délicat et les grâces fragiles égalent certainement la frêle magnificence de tous les jeunes hommes d’ici… Donc il fut, puisqu’il est encore, l’Alexis des Bucoliques, blanc comme les troènes pâles, mignon et fier comme l’Apollon de bronze à la chevelure féminine, celui que Tibulle compare à une vierge qui, pour la première fois, se livre aux caresses de son jeune époux :
Antinoüs, c’est Gygès, c’est Néarque, Ligurinus, Encolpe, Éarinus, c’est l’un de ces jeunes hommes dont l’histoire a recueilli les noms, c’est l’un d’eux ou leur frère. La pâleur de son marbre, l’hallucinante rigidité de son masque, disent-elles la blancheur de l’esclave grec, la ténébreuse science de l’esclave égyptien, l’épiderme duveté d’or et la souplesse des esclaves asiatiques ou le raffinement spirituel et railleur, la monstrueuse perversité, la dépravation joyeuse, la langueur suggestive du jeune Romain ? Qui sait !… J’ai dit que les riches et les puissants d’alors payaient au prix d’une fortune la beauté d’un esclave, la perfection de son corps, de ses lèvres, de ses yeux, surtout de sa chevelure ; les statuaires s’appliquaient ensuite à reproduire leurs images charmantes ; et c’est ce qui nous reste de cette fantaisie prodigue de trésors offerts pour un garçon de seize ans élu entre dix mille… Alors, il fallait aux dieux aussi la sélection radieuse d’une jeunesse éperdument belle ; Jupiter Adolescent et Bacchus Imberbe possédaient des prêtres choisis parmi les plus beaux fils des patriciens. Rome marchait sur les traces de la Grèce, et la Grèce rendait à la beauté physique d’incroyables hommages.
La capitale de l’Élide, Élis, chaque année, réunissait dans un concours les plus beaux parmi les jeunes hommes que contenaient ses gymnases. Les formes parfaites, la distinction et la grâce étaient les conditions indispensables exigées des candidats ; ceux-ci désignaient celui d’entre eux qui l’emportait encore sur eux-mêmes par la perfection totale de son corps.
Le vainqueur superbe était conduit devant le peuple dont les vivats affolés saluaient sa triomphante nudité. L’ami qu’il s’était donné couronnait son front de myrtes et de bandelettes et nouait à ses pieds des sandales de pourpre aux ornements de bronze ciselé. Cette unique parure laissant resplendir l’entière pureté de sa chair encore vierge, il allait, sous des flots d’azur et de soleil, dans la gloire d’une marche triomphale, porté jusque sur les places publiques, dans la pénombre fraîche des portiques, sur le parvis des temples.
À la ville orgueilleuse l’enfant dévoilait la splendeur fière et ravie de sa chair offerte aux regards depuis les brodequins pourprés à ses talons jusqu’aux feuillages pâmés dans les boucles brunes de sa chevelure, avec seulement, ombres très douces dans la jolie clarté du visage, l’éclatante obscurité des grands yeux noirs, les pétales rouges des lèvres entr’ouvertes et, avivant la blancheur de sa peau, sur son corps tiède et rose de contentement juvénile, dans les courbes impeccables et le frisson des hanches, l’affirmation soyeuse de sa jeune puberté… Sur lui, la musique lente des flûtes, dans le bruit des cymbales, passait acharnée et caressante. La fixité avide des yeux, les murmures de la foule frémissante, les baisers des femmes l’enveloppaient au passage dans le cortège étincelant et nu de ses jeunes camarades. Les filles énamourées l’épiaient du haut des terrasses et jetaient vers lui, comme vers une divinité, les roses effeuillées, le voluptueux balancement de leurs bras, l’encens de leur haleine, la clameur de leur bouche criant la gloire de la virile beauté dont enfin se délectaient leurs yeux pâmés de désirs…
Et nous allons, nous, dans les musées, presque indifférents, sans savoir ce qu’a coûté la boucle de cheveux mêlée, sur ces jeunes têtes, aux pampres, aux feuillages et aux fleurs ! sans nous douter des magnificences et des voluptés endormies à jamais dans les marbres aux teintes éburnéennes, dans les bronzes couleur d’émeraudes et de saphirs, les uns épanouis comme des fleurs blêmes aux pétales exsangues, les autres comme des fleurs altérées encore de caresses et de louanges dans une extraordinaire nudité de corolles bleues…
Je pensais à toutes ces choses dans ce musée de Naples, si riche en souvenirs disséminés autrefois sur la terre heureuse de la Campanie, dont le nom seul évoque des mondes de coupables luxures, mais aussi de suaves harmonies.
Pour moi, pas un pli de mes lèvres ne commencera l’ombre d’un sourire de mépris ; je ne retiendrai de ces faiblesses que, seule, la beauté qui subsiste ; je ne vois pas les tares et ne ferai même pas aux mânes des grands disparus l’injure de prétendre excuser des mœurs conformes à l’ordre des choses en un temps où le culte de la chair surpassait tous les autres.
Ils traînent avec eux, ces bronzes et ces marbres, un brasillement de soleil égayé dans la floraison claire des lauriers-roses. Ils sont la vivante incarnation du paganisme si réaliste en ce que la réalité a de séduisant et d’idéal, opposant son Olympe charnel et sensuel à notre Ciel impalpable et pur. Immondes, ils me reviennent à moi tout baignés de rêves, ces siècles jeunes dont le destin est accompli, mais dont les vestiges sacrés subsistent encore quelque peu dans les maisons sans abri, sur les margelles desséchées des fontaines de Pompéi, dans les bains de marbre où verdissent les capillaires d’émeraudes… Tandis que nous espérons un infini mouillé d’azur et de brumes dorées en l’éternelle contemplation du Père, ils avaient, eux, réalisé, sous les portiques éclatants de blancheur et les frises harmonieuses des Parthénons élevés dans les ruissellements du ciel d’Attique, leur vision du ciel et fait sur la terre divine de la Grèce un paradis dont les splendeurs sont ruines maintenant, et pâles reflets les scintillantes et lumineuses gloires. En ce moment, leur seule évocation et leur magique souvenir me font tressaillir au plus profond de moi-même d’une joie infiniment intellectuelle et pure. J’envie les peuples qui firent de mon rêve leur existence accoutumée, ceux dont le puissant génie non seulement sut voir merveilleusement la créature, mais créa ce que la nature même paraît impuissante à produire, tant la beauté, — leur beauté, — reste sous la dépendance de leur volonté et jaillit, comme dans l’immortelle chevauchée Panathénaïque, des œuvres de leurs mains…
Il ne faut plus maintenant l’autorisation du roi de Naples pour visiter le Cabinet secret.
Voici la porte surmontée de l’inscription : Oggetti osceni ; mais je n’entre pas immédiatement, et le garde surpris, qui s’apprêtait à m’ouvrir l’huis, rentre son trousseau de clefs ; je reviendrai dans un instant, non pour prolonger davantage le plaisir d’attendre, cela me paraît bien banal d’avance cette exhibition de pauvres choses que nous connaissons tous et qui, pour moi du moins, n’avive aucune sensation, mais j’ai résolu de finir par là, et je redescends d’abord aux fresques de Pompéi, d’Herculanum et de Stabiæ, pour remonter ensuite à la collection des Monnaies m’arrêter, trop peu de temps ! devant les médailles syracusaines et les belles monnaies de l’antique Taras, — Tarente.
Et c’est un effet merveilleux que chaque regard porté sur chaque objet, ici, prépare à mieux sentir, et mieux aimer l’objet suivant. Sur ma prière, le garde ressort ses clefs, ouvre la porte et daigne même, très empressé, souligner de réflexions amusantes par l’incorrection de son langage qui souvent déforme sa pensée, quelques-unes des peintures, quelques-uns des bronzes ou des marbres pour lesquels peut-être, il a une instinctive prédilection.
Voilà bien réduit par les dimensions de la salle qui lui est affectée, ce que je me nommais le Musée Secret et dont le mot Cabinet secret contient plus exactement l’importance matérielle, sinon l’intérêt archéologique, ethnique ou ethnologique. En bel éclairage devant une haute fenêtre, la merveille de la collection érotique, par son caractère obscène autant que par la magistrale exécution du sujet figé dans un Paros éblouissant, — est le Satyre au Bouc. Il est vrai que les femmes égyptiennes se prostituaient, dans son temple de Mendès, au Bouc Sacré tombé du signe Zodiacal. Mais le statuaire dédaigna cette union quasi rituelle et substitua dans ce groupe, avec une incomparable maîtrise, l’activité ardente d’un satyre à la passivité d’une femme ! Si la loi musulmane autorisait la représentation des figures humaines et qu’un sculpteur capricieux se plût en la licence d’un semblable sujet, aujourd’hui même certaine tribu au nord du Maroc fournirait les éléments naturels qui constituent l’étrangeté odieuse de cet accouplement. Et Virgile n’a pas su taire l’existence en son temps d’une impudicité dont je n’aurais pas voulu charger l’élégance des pâtres latins :
Novimus et qui te… transversa tuentibus hircis,
Et quo, sed faciles nymphæ risere, sacello.
L’occasion est rare de vérifier mieux que dans une œuvre aussi franchement licencieuse la possibilité de faire accepter les pires dérèglements en les plaçant sous l’égide intangible de l’art et de la beauté.
L’homme aux pieds de chèvre, agenouillé dans le travail heureux de ses sens recueillis, s’amuse aussi à voir se détourner vers lui la tête camuse et le menton barbu de son complice aux yeux curieusement nuancés d’un étonnement indécis entre le plaisir et l’indifférence. Le faune sourit à la béatitude animale. Les élans de sa chair transportée se répandent sur son visage très humain traité avec un soin presque aristocratique par l’arrangement délicat des cheveux, la grâce voluptueuse des paupières alourdies et l’expression moqueuse des lèvres très fines. En outre, le torse ondulé, l’attache des cuisses offrent une souplesse telle qu’ils semblent, comme les bras bien cambrés, moulés sur le plus beau modèle vivant.
Le délit constaté et procès-verbal dressé de l’attentat, il est impossible de trouver en ce satyre, égrillard comme il convient, aucune arrière-pensée grossière. On sent plutôt dans l’impudence sans impudeur de son abandon la liberté naïve d’un temps où l’homme, ainsi que les dieux, ignorait la pruderie d’apparences qui mentent outrageusement aux réalités sournoises de l’alcôve.
Je ne sais rien autre de ce chef-d’œuvre que ce qu’en peuvent retenir les yeux. Que représente-t-il exactement ? Quel est son auteur, sa destination ? Peut-être saurons-nous cela quelque jour, quand la vérité pure voudra se dépouiller du voile inutile qui depuis trop longtemps l’étouffe sans parvenir à l’habiller. Alors il sera permis aussi d’avouer la qualité des éphèbes charmants sur la beauté svelte et séduisante desquels les érudits, les guides et les catalogues observent le mot d’ordre d’un silence sans compromission.
Et voilà, sous des vitrines, les mêmes petites mains de cuivre qui lèvent leurs doigts menus sur les harnais des chevaux napolitains ; postérité des mains obscènes dont un des gestes expressifs est encore, du Pausilippe à Pompéi, désigné par ces mots : far le fiche. Vénus n’est pas oubliée. Il est étrange de retrouver dans une population dont le fond est demeuré immuable, à deux mille ans de distance et parmi des croyances empressées à détruire ces manifestations païennes, la petite main et les cornes de corail ou de nacre qui sont la forme modernisée du Phallus, du Fascinum, appelé fica à Naples. La destination n’a pas varié ; le peuple est persuadé que ces symboles érotiques préservent du mauvais œil, éloignent la jettatura.
D’une image atténuée dans le geste espiègle des doigts il faut passer aux images réelles. Ce musée sans doute unique au monde offre le plus curieux assemblage des emblèmes consacrés à la Force Virile par les adorateurs des divinités génératrices. Qu’ils fussent de proportions monumentales et mêlés aux architectures des cités, ou seulement réduits à l’état de bijoux, d’ex-voto, d’amulettes, l’étendue de leur influence paraît avoir atteint les extrêmes limites du monde connu des anciens, des Indes aux Colonnes d’Hercule. On les portait aussi en procession ; les épouses appelaient la fécondité sur leurs œuvres en l’attachant à leur poitrine, et les enfants en gardaient suspendus à leur cou.
Devant moi, un petit buste de femme dont la remarquable beauté est encore mise en valeur par la savante disposition de sa chevelure, a les épaules couvertes d’un collier de ces attributs. Leur nombre, suivant l’usage, représente une égale quantité de victoires consécutives (!) remportées sur la belle créature par son heureux amant… Et je ne sais qui louer de cette heureuse personne ou de l’adolescent robuste qui marquait auprès d’elle, très près, l’anniversaire impétueux de ses dix-sept printemps… Pends-toi, Hercule.
Si je cherchais auprès d’elle la fière image de lui, sans doute la reconnaîtrais-je dans un des trois élégants personnages qui soutiennent le brasero de ce magnifique Trépied de bronze que nul n’ignore dans son ensemble, sinon dans… sa totalité. Voltaire parle d’un trépied d’or né sur l’enclume du divin forgeron et qui se rendait seul aux conseils des dieux ; celui du Cabinet Secret, lui, est prêt à voler aux conseils des déesses… Pends-toi, Vulcain.
Et de quel geste spirituel le bras des trois faunes se tend aussi, portant devant eux le mouvement conjurateur d’une main plus soucieuse d’aider au danger qui les menace que d’en écarter les angoisses voluptueuses. Rien n’égale, dans ce lieu de réprobation, la mutinerie gracile et les adorables contours de ces figurines du Trépied de bronze, au priapisme sans brutalité, candide comme l’effervescence involontaire des jeunes hommes à leur réveil.
Vais-je pas, devant eux, me voiler le visage et, pour je ne sais quelle pudeur à tort alarmée, taire ce dont l’antiquité fit un Objet sacré sur quoi, dans les grandes époques, sinon aux siècles de décadence, rayonnait seul un respect qui, pour aller jusqu’à la Fécondité vénérable, s’attardait un peu trop sans doute — de l’effet à la Cause ?
Non. Je suis entré au Musée Secret ; je veux voir.
Sur des Lampes de terre et de bronze une imagination… méridionale s’est donné libre cours par le soin qu’ont pris les céramistes et les fondeurs d’exagérer un don sans mesure déjà, dit-on, de Naples en Sicile.
Auquel « dit-on » souscrirait volontiers le cynisme naïf des jeunes cochers de Sorrente ou la vergogne éhontée des gamins de Taormine, s’il est vrai que des voyageurs les ont vus précéder par d’avantageux simulacres de bois l’essor prochain d’une masculinité impatiente de surenchérir encore sur les promesses de ces audacieux postiches. Ces petits drôles savent-ils, au moins, choisir les traits noueux du figuier dans lequel, jadis, Isis tailla pour Osiris mutilé un nouveau facteur de sa reproduction ?
Ah ! les petits monstres de Taormine et de Sorrente !
N’est-ce pas ici le temps de rappeler pour leur excuse, à ces polissons, que les cultes priapiques tournés en dérision dès le christianisme naissant furent abandonnés alors aux parodies frondeuses des enfants ? D’où peut-être ce goût, ce besoin, — pour quelles fins ?! — de simulacres virils demeurés dans leurs jeux.
Des Lampes encore, auprès de coupes aux belles formes où des éphèbes se livrent entre eux à des caresses impures et, sous le regard des filles, à des accouplements stériles. Puis, des Vases à boire…
S’il est d’une allusion trop vive ou d’une extravagante fantaisie de faire jaillir la lumière et la flamme de Phallus dont l’énergie démontre assez l’ardeur de celle-ci, que penser de ces vases de verre aux jolis reflets irisés où se posèrent autrefois quelles lèvres altérées de quelles voluptés ? Car ces vaisseaux ingénieusement soufflés sur des galbes précis, servaient à boire ; je me le répète avec la stupéfaction qu’eût empruntée devant eux M. Joseph Prud’homme… Athènes et Corinthe célébraient nuitamment des mystères que l’emploi de semblables récipients permettrait de nommer orgies, s’ils n’eussent fait partie d’un rituel exclusivement consacré à la très pure Cérès honorée aussi dans les temples très saints d’Éleusis.
Des Termes audacieux s’érigent, dont la puissance lapidaire n’approche point cependant l’impertinence réaliste du Faune Mendésien si fort épris du Bouc Zodiacal. Sous le nom d’Hermès, les Grecs dressaient ces Termes aux carrefours d’Athènes, où Rome avide de dieux inédits les alla chercher. Bien que les potins de l’histoire prétendent qu’ils eussent de mauvaises raisons de protéger leur fougue inlassable, Alcibiade et ses compagnons brisèrent ces Hermès dans une nuit de débauche. Et cette mutilation sacrilège, que le beau général ne sut pas limiter à son chien, pesa comme une éternelle calamité sur l’adorable Hellas dont Syracuse allait venger les dieux.
L’antiquité variait à plaisir les dimensions et la destination de ces symboles que nous entachons d’un érotisme outrageant. Voici, suspendus à de courtes chaînettes de bronze, des Phallus de même métal, ornés de deux ailes et de pattes d’oiseau… D’autres sont chargés de clochettes. Ils rappellent probablement, ceux-ci, les coutumes bizarres des prêtres hindous. Nus et tenant à la main des plumes de paon, ces sacerdotes parcouraient les rues, traversaient les palais, faisant accourir au bruit d’une sonnette les femmes dévotes heureuses de baiser, à même ces lévites étranges, l’original ému du Lingam, ce Phallus honoré de la vallée du Gange au golfe de Bengale…
Il est connu aussi que la clochette était consacrée à Priape.
Réduits ou non à la taille de petites amulettes, certains de ces sexes sont doubles ; et quand les phénomènes jumeaux parurent insuffisants, trois membres sur une même souche branchèrent leur Masculinité sans défaillance.
Et ce n’est point une pudeur que je ne ressens pas qui me retient d’énumérer la somme des curiosités jalousement recueillies en l’exiguïté du Cabinet obscène — mais plutôt la crainte d’une inévitable monotonie si l’érudition, qui me manque, ne vient rehausser d’intérêt une froide nomenclature. Et je mesure aussi, pour m’en défendre bien, toute la réserve qu’exige un tel sujet, puisque nous n’osons plus reconnaître ces faiblesses auxquelles notre bégueulerie mondiale continue à devoir son existence actuelle et dont elle attend, je pense, sa pérennité.
J’ai peur de m’attarder entre ces murs étroits du Musée honteux ; mais voilà que, prétendant me rire de ces jouets érotiques, je lis sur les Phallus d’argile, d’airain, d’électrum ou d’argent, d’ivoire ou de corail… l’histoire de notre humanité ! Est-ce ridicule ? Il me paraît que tout gît douloureusement dans le symbole générateur de ces représentations ou grossières ou délicatement achevées : Que sommes-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ?…
Est-ce une numismatique par hasard attrayante qui disperse en moi l’improbable belle humeur de ses jetons d’or et de bronze, ou dois-je cet éclat de bienveillante joie au souvenir des beaux yeux noirs de Naples ? Pour une fois laissons-en le bénéfice rare à la Numismatique avec un N majuscule. Sourires de Naples, offres du soir, les médailles spinthriennes plaisamment s’entretiennent de tout cela. Sous des vitrines, leurs coins fatigués évoquent les débauches fastueuses de Tibère à Caprée. Dans les délices de son île, César offrait aux dieux, qui n’en pouvaient mais, l’image vivante des fétiches phalliques dont les vierges nubiles suscitaient sans effort la vigueur complaisante. Une musique invisible les entraînait, nouées aux bras des jeunes garçons qu’un choix exigeant avait désignés comme devant être particulièrement agréables à Priape. Lors, aux confins de leur énervement, le dieu puissant abandonnait aux vierges les robustes offrandes des adolescents, et celles-là les recevaient de ceux-ci dans l’échange charmé de leur virginité… Et la vie docile issait du plaisir sous les regards heureux de César et des dieux…
Pourquoi tenons-nous emmurés dans la réprobation ces Emblèmes des sèves fécondantes indispensables à la prospérité de notre Terre ! Oublions-nous — et ce Musée le prouve — qu’ils furent publiquement honorés dans un temps où le cagotisme luthérien ne prétendait pas régenter les mœurs aimables dont le golfe de Naples a gardé la licence ? À travers les champs de la Campanie, longtemps même après le paganisme, l’usage subsista de célébrer des fêtes en l’honneur d’il santo Membro. Un char luxueux traîné par des mules pacifiques offrait aux vénérations populaires une image armée du Simulacre belliqueux, si l’on peut dire ainsi ; et les mères de famille elles-mêmes le venaient couronner de fleurs. Par là l’Église catholique pourrait revendiquer sa place auprès des vestiges lascifs des autels abolis. — Et ce n’est pas un reproche.
Il faut se souvenir de ceci en parcourant les vitrines du Cabinet appelé obscène. Mais il nous manquera toujours, pour admettre ou seulement comprendre sans émotions lubriques l’idée de ce culte, la vue quotidienne de la nudité. Sous les beaux climats méditerranéens les vêtements devenaient vite importuns, sinon inutiles. La condition habituelle était la nudité. Les enfants et les jeunes hommes, au moins, allaient nus, sans entraves, soucieux de maintenir et d’accentuer en les formes de leur corps une beauté dont tous pouvaient être des juges avertis. Lycurgue voulut que les vierges allassent sans voiles auprès des éphèbes nus. La Renaissance renouvela ce spectacle ; et des adolescents couraient le Palio, à Vérone, tous vêtements rejetés. Ainsi la foule assemblée se plaisait aux belles attitudes des garçons, et la plastique mâle du vainqueur la charmait. Nous pouvons comparer le reflet magnifique que reçurent les Arts d’une semblable liberté, et chercher aujourd’hui dans le symbolisme contorsionné de nos plus habiles statuaires la parcelle introuvable d’une beauté dont Michel-Ange à lui seul combla tout un siècle. — De sorte que le grotesque de notre anatomie qui défaille même entre les mains de nos sculpteurs, rendrait impossible l’ostension d’une nudité que la sotte hypocrisie des mœurs actuelles laisse d’ailleurs improbable.
Comment ne pas avouer aussi le plaisir éprouvé devant les fresques enlevées aux maisons de Pompéi, aux petites maisons que je voyais, hier, s’effacer dans les lointains cendrés du soir ?
En présence de ces libertinages aimables et jolis l’impression immédiate est une flatterie accordée à la curiosité par la possibilité de voir, d’être témoin de choses qui, relativement, ne sont pas à la portée de tous. Mais cette sensation première, ce contentement très réel dans lequel je retrouve la joie de savourer le fruit défendu, se disperse ; et de cette visite au Cabinet Secret, il reste surtout le souvenir des choses qui sont belles par elles-mêmes et demeurent, dans ce milieu où la clameur immense du rut antique monte si exactement semblable aux désirs contenus dans notre corps, presque chastes et pudiques.
Dans une de ces fresques aux couleurs heureusement atténuées, voici Mars et Vénus sous la figure d’un adolescent robuste et d’une belle fille dont les jeunes chairs, d’un éclat si voilé et si discret, s’épanouissent, suivant l’ordonnance à peu près générale des fresques Pompéiennes, dans un azur limpide où voltigent deux amours : les personnages ne reposent point leurs pieds à terre, ils flottent, aériens ; Mars casqué d’acier, nu avec seulement un manteau de pourpre jeté sur ses épaules, comme il convient à un dieu que la beauté parfaite rend aimable aux regards, étreint de son bras le corps souple de Vénus dont la poitrine découverte est d’une exquise pureté ; les jambes sont dessinées dans la grande draperie rouge qui les recouvre sans laisser rien ignorer de leurs formes ; les bras sont chargés de bracelets d’or, et d’une main coquette elle agite un flabellum. Sera-t-il écouté le petit dieu qui lui conseille de se soustraire aux caresses de son amant ? Non, peut-être, car l’autre Amour qui porte auprès de Mars le baudrier et l’épée, excite le juvénile guerrier à poursuivre ses entreprises, et Vénus ne laissera pas se consumer les beaux yeux amoureux de celui qui la regarde et l’enlace si tendrement.
Hymen ! hyménée ! c’est une scène nuptiale : Bacchus et Ariane sont étendus mollement sur les coussins et les blanches draperies d’un lit ; la jolie fiancée, étonnée et craintive, laisse Bacchus soulever les voiles où tremblante s’est blottie sa jeune pudeur ; ses yeux clairs essaiment leurs frais regards sur le front de l’époux, contenant parmi les boucles de ses cheveux couronnés de lierres, la splendeur et l’éclat d’une charmante jeunesse.
Je pense à cette autre peinture exquise, Mercure et Maïa, que je viens de voir avant d’entrer ici ; elle est plus ravissante encore que la précédente et mériterait autant que celle-ci la relégation du Musée secret, — cet excès d’honneur ou cette indignité. Maïa, gracieuse, s’abandonne généreusement sur l’épaule d’un Mercure adolescent dont la svelte et complète nudité frôle les chairs aux lignes délicates de l’aimée. De ces deux créations merveilleuses, Mercure est encore la plus belle et la plus sereine, et l’on retrouve dans l’exécution de cette figure ravissante le même soin, le même raffinement, le même amour, — il n’y a pas d’autre mot, — qui inspirait plusieurs siècles avant les statuaires grecs épris de l’admirable beauté de leurs modèles.
Une fine mosaïque attire et retient les regards sous le charme des formes parfaites qu’elle reproduit : c’est une hamadryade dont tout le corps, d’une grande beauté, semble se préparer à la danse ; dans un mouvement qui ne laisse échapper aucun des attraits de sa pleine et souple carnation, les bras s’arrondissent languissamment au-dessus de sa tête, et son visage doux et riant a la coquetterie de ne pas laisser apercevoir la joie que lui cause l’arrivée d’un satyre marchant vers elle, bras tendus, prêt à meurtrir de caresses l’objet de sa convoitise.
Moins jolie est la Vénus Marine étendue dans sa coquille couleur de rose comme si, de la surface nacrée du coquillage, venait d’issir sa chair que ne dérobe aucun voile ; l’attitude hiératique de la déesse n’est pas aussi plaisante que la tendre expression des autres peintures ; la raideur des membres ou leur modelé trop sommaire ignore la vie et offre quelque peu cette apparence ridicule d’une figure de cire.
Enfin, je laisse les jeunes esclaves cubiculaires attentifs aux soins qu’ils prennent des ébats très peu discrets de leurs maîtres. Ici les fresques deviennent réellement d’une effronterie indescriptible. En quelques-unes l’exécution, même très naïve, n’arrive pas à atténuer le côté coupable. D’autres, au contraire, sont charmantes d’habileté, mais non moins audacieuses, comme cette scène délicate dont l’inscription dit tout : lente impelle et attire la compassion sur la craintive inexpérience de la jeune femme qui, semble-t-il, pourrait s’en remettre tranquillement à la vigoureuse et ferme assurance du bel adolescent que les dieux propices lui donnèrent pour époux.
Une autre, la plus remarquable peut-être sous le rapport de l’art, représente cette lutte bizarre que les anciens désignaient par le mot clinopale. Elle est d’une facture absolument parfaite et d’une description malheureusement impossible à tenter… car, depuis Horace, nous ne savons plus donner à toute chose son nom propre !
Le brave homme de gardien qui n’a cessé de suivre les moindres mouvements de mes yeux et s’est assuré à plusieurs reprises, en me voyant crayonner ces notes très brèves, que je ne les accompagnais d’aucune figure, paraît enfin rassuré sur ma vertu, et je vois de l’estime plein son visage lorsque je lui glisse dans la main un billet de banque de… une lire.
Ces fresques de Pompéi sont, il est vrai, de charmantes évocatrices du paganisme dont la beauté vient presque toujours excuser la licence, mais je leur préfère la douceur, l’harmonieuse et paisible noblesse, la grâce souveraine des marbres et des bronzes rassemblés en bas dans les grandes salles où je redescends. On les vient contempler à l’aise ; ils emplissent l’âme de leur calme ; les yeux peuvent longuement en caresser, en toucher les formes pures. Et je m’arrête devant eux encore pendant quelques minutes exquises, là, assis sur un banc, seul, comme je le désire. Je me grise du silence parfait, de la quiétude immense qui tombent légers des hautes voûtes. Comme dans une église, l’air volète chargé de je ne sais quelles odeurs, il sent bon, il est frais, de la fraîcheur des marbres ; il enveloppe la souplesse des corps aux polis d’ivoire qui gardent l’intacte et virginale beauté de leur chair comme si aucun autre corps n’avait jamais effleuré ou doucement meurtri cette chair que viennent baigner des aromes inconnus porteurs d’hymnes antiques mystérieux, lointains et enivrants, des hymnes dorés de soleil, couleur de lis pâles et de lauriers-roses épanouis comme des fleurs embaumées de sereines et pénétrantes voluptés…
Dehors, maintenant, dans le gai pullulement de la rue, des soldats passent, aux figures de gamins ; le plus âgé paraît avoir dix-huit ans. J’ai vu en Espagne de petits troupiers, — dont, en passant, je salue avec émotion la lutte héroïque[3] contre la Force et l’Argent également immondes ; — ceux d’ici leur ressemblent ; ils ont aussi leurs figures juvéniles et si gentiment résignées des garnisons de la Linea et d’Algéciras, aux portes de Gibraltar, où les highlanders blonds et roses montrent leurs jambes nues dans des jupes écossaises ; les highlanders aux yeux bleu pâle d’une expression insaisissable. Mais je préférais les beaux yeux noirs et fatigués, et la figure bronzée des Espagnols pauvres et courageux comme les jeunes gens qui défilent en ce moment devant moi, descendant, vers le port, la via Roma. Ils ne sont pas faits pour l’uniforme, les petits Latins de l’extrême Midi. Je vois là, sous les longues plumes aux reflets métalliques capricieusement flottantes sur la coiffure ronde des bersaglieri, des prunelles noires très mélancoliques. De petites lèvres joliment bordées d’un duvet imperceptible sont entr’ouvertes avec des airs de lassitude, tandis que les sourcils se froncent et racontent le labeur de ces fils douloureusement pliés aux rigueurs du militarisme. Leurs officiers sont heureux de vivre, sanglés en des uniformes très avantageux, en des pantalons gris très ajustés dans lesquels ils se cambrent. Les petits soldats peinent. Eux passent triomphants dans cette Naples où tout est spectacle ; leur marche raide sous le balancement des reins ressemble furieusement aux déhanchements des garnisons de Cologne, de Trêves et de Coblentz qu’ils me rappellent sans effort ; ils s’éloignent… Leur présence a jeté une note triste et morne qui disparaît promptement dans la gamme joyeuse des rues…
Sur des places, une jolie marmaille aux chairs veloutées, aux grands yeux qui mangent la moitié du visage et font l’autre moitié si rieuse et si délicate : haillons, jeunesse, misère et gaieté ! Des pieds nus à peine posés à terre, aussitôt levés, prestes, en courses échevelées ; des éclats de rire de petits espiègles grignotant un fruit, une amande, des figues ou des olives entre plusieurs cabrioles, entre des colères minuscules très importantes et très comiques ; des pleurs, des disputes terminées qui recommencent, puériles, exprimées si drôlement en une kyrielle de mots que l’on ne comprend pas et qui donnent envie de sourire quand même ! La jolie marmaille de Naples ! si gracieuse et si pittoresque ; la moue des lèvres fines qui s’avancent et demandent — attirent — la piécette de cuivre par laquelle, davantage encore, sourient en minaudant les jolis yeux du visage futé et si tendrement implorant, et les bouches trop mignonnes qui imposent immédiatement à l’esprit une image de fleur ou de fruit ! Oh ! les jolis petits guenilleux et les polissons napolitains !
La rue de Rome s’élargit tout à coup sur la Piazza Dante où tombe, abondant, le soleil dans un encadrement de vieux murs roussis qui sont des églises, des casernes et un collège. De vieilles grilles patiemment ouvragées, fleuronnées, se tordent et s’enroulent, en accord parfait dans leur rouille, avec les vieilles murailles, rouillées aussi, rouges, ardentes des brûlures du soleil. De grands murs percés de portes immenses ouvertes, d’un côté de la place, sur des profondeurs sombres où clignote l’or des cierges, de l’autre côté, sur des jardins qui ne finissent pas, d’où s’échappent gazouillants et joueurs, les écoliers, la classe du matin enfin terminée.
Quels mots employer pour dire toutes ces choses, ces odeurs d’encens et ces visions de splendeurs mystiques, lancées comme les émanations d’un autre âge par le portail béant d’une vieille basilique aux pierres rongées de soleil, là, devant moi, en pleine rue où le bruit augmente et le grouillement s’exaspère sous la poussée des jeunes garçons grisés de liberté et joyeux au sortir de l’école ? Sur cette cohue, la lumière aveuglante d’un ciel incomparable, tiède, transparent, et vibrant de frissons de beauté, de joie, de bonheur, que l’âme savoure lentement, comme s’ils ne devaient plus jamais exister pour elle, ces instants délicieux, comme s’ils ne pouvaient plus être jamais surpassés ou même atteints par d’autres exquises sensations !
À tout cela se mêle un peu de tristesse ; et cette journée où j’aurai vécu, dans la beauté calme et parfaite de l’antiquité et dans les rayonnements superbes de l’heure présente, des minutes de pur enchantement, pour moi se voile de mélancolie : dans quelques heures cette joie ne sera déjà plus que souvenirs. Je ne verrai plus rien. Naples continuera de s’épanouir au fond de son golfe sans que je sois là pour la voir et l’aimer…
J’ai le cœur serré en traversant les ruelles charmantes auxquelles je m’étais habitué déjà ; j’en connaissais les étalages menus, les boutiques, les coins pittoresques, telle petite marchande de fleurs devant qui je passais plusieurs fois dans le jour, tel joli gosse, rôdeur dont l’empressement inquiète.
Près de la place des Martyrs, dans un renfoncement de vieilles maisons, est une église où j’entrais souvent, où j’entre encore pour revoir les saints vêtus de tuniques raides de dorures, les madones aux accoutrements un peu sauvages, tellement bariolés ! enveloppées de dentelles et coiffées, sur leurs vrais cheveux bruns et bouclés, de lourdes couronnes de perles fausses, derrière les grandes glaces, sur les autels beaucoup trop éclaboussés de clinquant et de métal doré. Devant l’église vont et viennent toujours des mômes vendeuses de fleurs ; une fontaine est là aussi, qui rafraîchit leurs bouquets, inonde les dalles et répand un peu d’humidité dans l’air. J’achète, pour les yeux clairs d’une effrontée marchande belle comme l’amour, un peu de giroflée, fleur commune dont j’aime la robustesse, l’odeur et la robe de bure striée d’or, un peu de violettes de Parme et des fleurs d’oranger ; aussitôt toutes les gamines qui barbotaient à la fontaine se précipitent vers moi, tous les gamins aussi, dont l’éventaire se compose, dans leur main sale et jolie, d’un seul bouquet ramassé je ne sais où. Tous et toutes m’offrent des fleurs avec un pépiement de petits oiseaux. Et je songe, en voyant ce menu peuple si gentil, pieds nus, mains tendues, sur cette place élégante et fruste, que c’est Naples qui me charme en lui : des cris, de la beauté plein les larges yeux noirs, de la gaieté plein les lèvres, des rires, des haillons et des fleurs…
Passé Santa Lucia, sur ma tête, là-haut, c’est San Martino aux portiques éclatants, la chapelle ruisselante d’ors et de jaspes, les grandes salles austères où flottent d’augustes fantômes ; en bas, la Villa Reale, où je flâne lentement, essayant en vain la récapitulation de tout ce qui vient de m’éblouir et de m’enchanter. Elle s’allonge et sinue, la belle promenade, telle un grand reptile d’émeraudes, au flanc de la Chiaja. Là, nous avons acheté, en marchandant beaucoup en mémoire des bazars juifs de Tanger, quelques coraux d’un si beau rouge ! Et là-bas, c’est le Pausilippe, le cap Misène, Ischia et Procida, puis Capri, Sorrente, Castellamare, Pompéi, — Pompéi que j’aime tant, à cause de tout, et surtout à cause des capillaires légers et frissonnants comme des âmes de feuillages ; à cause de ses statuettes fragiles aux formes exquises ; Pompéi cachée de l’autre côté du Vésuve, enfouie dans le grand silence que j’aime aussi, parce que j’y voudrais distinguer les chuchotements imprécis d’autrefois… Je regarde tout cela, dont l’évanouissement est si proche. Je regarde en musant encore un peu au bord de l’eau, sur le quai désert, entre les verdures et la Méditerranée qui jamais ne m’était apparue aussi belle, aussi limpide et attirante ; la Méditerranée roulant dans ses flots les plus caressés de mes rêves les plus chers : la joie de connaître, là-bas dans le Sud, la Sicile, ses filles et ses jeunes hommes aux profils ciselés, ses villes aux noms doux et sonores comme un murmure de mandolines : Syracuse, Taormine, Messine, Palerme ; puis Malte, incandescente dans une mer de lapis ; Tunis, l’Égypte : le Caire, les Pyramides et les Pharaons… la Grèce : Athènes, l’Acropole… Corfou, dont les petits enfants chantent aux gens qui passent : « Puissiez-vous jouir de vos yeux !… » et Tanger si lointaine, avec ses blanches maisons attirantes et que je voudrais revoir ! Gibraltar, où j’ai tant flâné, seul, sur les pentes délicieuses de la Alameda, ou bien à l’extrémité du rocher, à la Pointe d’Europe, avec, derrière moi, les monts violets d’Andalousie, et devant, roses dans la splendeur du midi, les côtes d’Afrique, Ceuta, devinée au poudroiement perlé de ses terrasses… Dans l’air infini passaient les craquements humides des vagues brisées sur les rocs, les marches pointues des fifres aigrelets, les douces ritournelles des cornemuses écossaises, sonnées par de jeunes highlanders blonds aux jambes nues et claires, dont les robes courtes frôlaient les orangers, les jasmins et les haies d’aloès et de géraniums de la Alameda, après le canon du soir, à neuf heures…
Naples sera bientôt pour moi ce que sont toutes ces choses passées, finies : dans un étincellement d’or, un dessin, un tableau d’un coloris doux et clair qui ira s’effaçant davantage à chaque moment, plus net peut-être dans les jours tristes, quand l’esprit se ressaisit et cherche à se consoler du présent laid et méchant en évoquant le passé…
Voici maintenant la dernière minute de notre séjour ici ; à peine ai-je le temps de courir sur les larges dalles de la Chiaja pour aller vers le Pausilippe, un peu loin de notre hôtel, chez un vannier que l’on vient de m’indiquer, faire l’emplette de paniers et commander une caisse qui devront contenir quelques petits achats n’ayant pu trouver place dans notre bagage.
Dehors, l’échoppe est enguirlandée de pailles de maïs aux tresses jaune pâle gracieusement mêlées à de fines corbeilles d’osier ; il faut descendre deux ou trois marches, et tout de suite grimpent jusqu’au plafond bas des entassements légers de paniers rustiques faits de ces copeaux de bois à reflets luisants sous un bariolage vert, rouge et mauve. — Je me souviens que, très jeune, je recevais de ces boîtes remplies de petits jouets de bois sculpté, petites maisonnettes, arbres naïvement frisés, tailladés et peinturlurés, qui se tenaient très bien debout sur une rondelle de bois jaune. Et tout cela sentait bon, comme ici, la colle, le sapin… et se fleurissait d’insouciance.
J’ai toutes les peines du monde à me faire comprendre et je m’amuse de l’étonnement du vannier lorsqu’il me voit prendre quelques planchettes, m’installer à son établi et les lui scier à la mesure que je désire pour qu’il n’ait plus qu’à les ajuster et les clouer ; bon enfant, il rit d’un rire aimable dans sa figure jeune, aux traits délicats, autant de notre embarras commun que de la façon un peu maladroite dont je m’y prends, mes gants prestement enlevés, pour me servir moi-même. Puis j’attends sur le seuil encombré de petites caisses et d’osiers tressés qui ne peuvent guère contenir que des choses très menues, fleurs ou fruits nouveaux ou beaux joujoux très naïfs.
À travers les murs j’entends, venant de l’autre côté, un accord d’instruments à cordes, des éclats de voix. Peut-être des chansons vont s’envoler tout à l’heure.
Mes petits emballages s’avancent, ils embaument le bois fraîchement raboté ; toute l’échoppe d’ailleurs est pleine de l’arome des copeaux, des osiers verts, des joncs et des pailles de maïs, et du grand air du large tamisé par les feuillages de la Villa Reale. Il n’a devant lui, ce vannier, que du bleu, de l’or et des frémissements d’émeraudes, ces richesses qui sont à tous les yeux : le ciel, le soleil et les grandes chevelures des arbres doucement agitées sur la mer…
Comme je regrette de ne pouvoir attendre toujours là, dans le réduit frais et sombre, avec, au fond, la virgule d’or de la petite lampe vacillante devant une Madone !… justement les chansons commencent de l’autre côté du mur, — et mes petits emballages qui sont déjà finis !…
Pour aller à la gare, nous faisons traverser à notre voiture les vieux quartiers où nous n’avons pas encore pénétré ; et voilà que les ruelles affreuses de Santa Lucia nous paraissent non seulement belles de pittoresque, — les autres aussi, si terribles, sont merveilleuses à ce point de vue, — mais belles de propreté, de grand air et d’aisance.
Oh ! les affreuses visions des vicoli empuantés, où notre cheval, à peine, peut se frayer un passage au milieu des cuisines qui achèvent d’empester l’air ; cassolettes immondes d’où s’échappent lourdes et graisseuses, des fumées, des vapeurs de cuissons atroces, les relents âcres et fades des fritures où mijotent, nagent et crèvent on ne sait quelles victuailles abjectes dont se nourrit le pauvre peuple !
Des maisons hautes de huit étages, huit étages enfoncés plutôt qu’élevés dans l’air épais et sombre que ne traverse jamais — jamais dans cette Naples qui partout ailleurs ruisselle de clartés — aucun rayon de soleil.
Dans la rue le sol est gras et luisant. Les ruisseaux canalisent des fanges qui éclaboussent en feux d’artifice boueux et puants et se collent aux flancs de notre cheval. Et, traînants, passent de tristes et pâles visages de femmes épuisées par l’incessante maternité des pauvres marmots innombrables dont les yeux brillent de fièvre et de beauté entre les cernes rouges et violets de leurs paupières, sur leurs petites joues d’une blancheur de cire vierge ombrées des grandes boucles brunes de leur chevelure !
Sur les tables boiteuses roulent, glissent, s’éventrent et coulent des fruits : tomates sanglantes trop mûres, oranges dont l’or disparaît sous des taches de moisissures grises et molles, coquillages, poissons, viandes sanguinolentes, ferrailles, vêtements, loques souillées au contact de ces choses gluantes !… Et ces gens pressés l’un contre l’autre, défaits, misérables, terreux, vivent au milieu de cela, vivent de cela, sordides, pauvres, — oh ! si pauvres et si pitoyables ! — entre ces maisons, remparts élevés contre la lumière, dans ces bouges écœurants où tout est noir, où tout sent l’humidité, la maladie, la peine, tout ce qui est hideux, tout ce qui fait frémir et frissonner… Le long des murs végètent des crasses, et les porosités des pierres suent des larmes !
J’ai entendu rire dans ces ruelles !
Ils sont dix mille dans un seul de ces îlots de maisons, dix mille, depuis les rez-de-chaussée lugubres jusqu’aux gargouilles, en l’air.
À deux pas, le ciel est d’une insolente beauté ; dans l’azur, le soleil trop éclatant laisse perdre sur la mer le trop-plein de ses ruissellements prodigieux, les vivifiantes fantasmagories de sa gaieté, de ses ors et de ses lumières…
Même ces misères n’atteignent pas le prestige de Naples ; elle reste la ville rose et blanche et vermeille, enivrante de beau soleil. Elle est immense et semble cependant ramassée dans la joie de vivre. Elle peine, mais sa peine est voulue presque. C’est une ville de cigales qui se rient du labeur des fourmis. Ses faubourgs promènent sur la courbe du golfe, jusqu’au Vésuve, leurs misères et leurs chansons, le bariolage clair des choses, le brouhaha joyeux des gens ; et quand nous pensons qu’ils souffrent, nous nous trompons : ils marchent dans un rêve ; à peine se réveillent-ils pour « manger macaroni », mordre à belles dents à même les pastèques et les melons sucrés conservés sur chaque fenêtre de chaque maison, à côté des chapelets de piments rouges qui sèchent au soleil. Ils mangent, ne font rien et se rendorment ensuite.
Heureuse ville, fainéante et molle, mais belle vraiment et presque majestueuse d’insouciance : Naples la Fainéante, otiosa Neapolis ! On dit que les îles, Capri, Ischia échappées à notre course trop rapide, sont les portes somptueuses ouvertes sur l’Orient de blancheurs, de rayonnantes lumières, de palmiers roses et souples bercés dans le ciel bleu ; Naples aussi a déjà cette fière indolence et cette beauté des grandes cités orientales assises tranquilles au fond des golfes d’azur, hiératiquement belles dans l’immobilité de leur geste, accroupies, indifférentes devant les civilisations grises qui passent et jettent à travers leur ciel limpide la fumée noire des machines, opposant à leur nonchalance si jolie le heurt des membres tordus sous le travail ; le han !… pénible et dur de l’effort au sourire né sans fatigue des lèvres rouges ouvertes sur les dents éclatantes, tandis que les yeux noirs brillent sans appréhension du lendemain, libres de contrainte, étonnés et rieurs comme des yeux d’enfants.
Elle s’efface en ce moment, cette Naples si jolie. Le fort San Elmo et San Martino ne sont déjà plus. Seul, le Vésuve violet d’or étire paresseusement dans le ciel, très calme aujourd’hui, son panache monstrueux et léger ; et l’horizon, tandis que le train s’enfuit à toute vitesse, se raie de la ligne nette et brillante des vagues interrompues seulement par les îles blanches ainsi qu’un brouillard impalpable.
La Campagne-Heureuse est somnolente sous les tiédeurs de midi. À peine les coupoles des pins parasols daignent-elles, lentement, se bercer au souffle du vent : grandioses et sévères, leurs alignements se renouvellent sans cesse autour des vergers, les uns s’effacent, les autres apparaissent en découpures bizarres avec, toujours visible jusqu’ici entre leurs ramures sombres faites de milliers d’aiguilles enchevêtrées, la pointe de plus en plus pâle du Vésuve, soudainement enfoui dans un repli du terrain. C’est fini ! Naples qui demeurait encore un peu là-bas maintenant me paraît très lointaine comme si des mondes nous en séparaient ; et ses rumeurs, qui semblaient nous suivre un peu tant que le Vésuve piquait sur l’horizon l’endroit précis du rivage où dorment ses toits et ses terrasses, se sont tues tout à fait.
Dans les champs, les vignes enlacent les troncs des arbres, courent de l’un à l’autre, enveloppant les platanes et mêlant aux troènes leurs sarments bruns et noueux, joyeux comme le vin que donnent leurs grappes, répandant l’ivresse de leurs treilles dans l’air ; tels jadis les grains écrasés versaient dans les bouches avides des Faunes la superbe et voluptueuse saoulerie du paganisme.
Avec l’aimable compagnon qu’un heureux hasard nous donne, elles paraissent moins pénibles, les tristesses du vide affreux que laisse Naples disparue. Nous parlons d’Athènes, de l’École française dont il est un élève distingué. Athènes, la Grèce, évocation de la vie antique, au milieu de ces champs qui en restent tout imprégnés, sur cette terre dont chaque labour émeut encore, après vingt siècles, les ineffables souvenirs endormis entre chaque sillon et rejette dans l’atmosphère vibrante les visions exquises des chairs nues et roses sous les chlamydes transparentes, le rythme discret des jambes alertes dans les cnémides d’or…
Le jeune archéologue venait précisément d’arriver d’Athènes à Naples et sautait du paquebot dans le train où nous fîmes aussitôt connaissance. Dès le premier mot, banal toujours, nous nous étions devinés aussi fous l’un que l’autre de toutes les choses pour lesquelles nous avons une commune tendresse… Il m’a conté de jolies histoires empreintes du plus pur atticisme, belles et claires comme des contes de fées, les yeux vagues perdus sur les plaines où s’élevait la paresseuse Capoue… Et nous revoyions tout l’autrefois. À travers les jardins emplis des odeurs enivrantes des myrtes, parmi les fleurs blanches des troènes, passaient les lentes processions, au sortir du Forum dont les portiques résonnaient encore des cris du pontife : Saturnales ! Saturnales !… Et la clameur immense des esclaves libres pour un jour tonnait, pâmée de luxures : Io Saturnales !…
Et c’était, pendant notre causerie, un murmure à peine perceptible, la musique délicieuse ressurgie des flûtes et des cithares, et les perles sonores tombées des syrinx Virgiliennes sous les lèvres des pâtres aux traits allongés et fins, aux belles figures tout à fait grecques, telles qu’on en rencontre souvent sur les chemins de Naples à Sorrente…
Les jolies histoires qu’il m’a contées, tandis que chantaient dans les vignes innombrables le souvenir des belles filles chargées de corbeilles débordantes de fleurs et de fruits nouveaux, les mélopées des phalléphores demi-nus couronnés de lierres et de violettes, le tumulte de la foule ivre des Silènes, des Nymphes et des Satyres, des Bacchantes et des Bacchants, hurlant dans les vallons et les clairières, au milieu des festins et des danses, au bruit lointain des pipeaux et des tambours : Evohe Bacche ! Evohe Sabbæe ! o Iacche ! Io Bacche !…
Il disait les voluptés semblables encore, là-bas en Grèce, dans l’ombre bleue des oliviers argentés et des myrtes efféminés, à ce qu’elles furent jadis ; ses aventures au loin dans les campagnes baignées de lumières, au fond des monastères schismatiques où s’épuisent en des lampes de vermeil et d’argent les huiles parfumées, devant les icônes sacrées peintes sur des fonds burelés d’or, encadrées de lourdes orfèvreries, comme les images byzantines, étrangement enluminées de fleurs et de feuillages barbares… Et, dans la demi-sauvagerie des cloîtres agonisants perdus sur les monts nettement découpés dans l’air si limpide qu’il semble ne pas exister, dans la langueur affolante des soirs où voltigent les caresses des fleurs, dans les défaillances tièdes et moites du jour qui se livre à l’obscurité bleue, — la rencontre soudaine de jeunes drôles très beaux contre qui il fallait se défendre…
La nuit est venue doucement, profonde et transparente, avec des étoiles d’or très éloignées et très scintillantes. Jolie nuit qui revient, après chaque crépuscule, rassurer les anxiétés de l’âme en face des simulacres de la Fin ! Nous la voyons arriver, presque toujours, de l’angle commode du wagon où nous sommes installés pour de longues heures ; et chaque fois je m’intéresse au pacifique bouleversement des choses enfouies lentement dans l’ombre… Nous laissons sur la voie, en plein champ, les incendies éphémères des charbons tombés de la machine, et les bruits de ferraille traversent rudement le grand silence nocturne qui se reprend ensuite, après nous, plus intense et plus immuable…
Les lueurs de Rome, la gare, la fin d’une rêverie charmante. Une poignée de main dans laquelle nous mettons, mon compagnon et moi, tout le regret de nous quitter si tôt, heureux d’avoir pu causer un peu des choses très aimées, dans ces incomparables milieux tout vibrants d’elles : la Campagne de Naples brûlée de soleil, et cette autre sur qui traînaient les premières ombres du soir ajoutant encore à son auguste et suprême mélancolie : la Campagne Romaine…
Ce soir, à neuf heures, Rome est déserte. Erré par les rues, du Palais de Venise au Pincio. Le Palais de Venise, rose dans des flots d’électricité, avec les trous d’ombres noires de ses rares fenêtres sur sa façade sévère. Le Corso est noyé dans les mêmes vagues de lumière, d’une limpidité, d’une transparence inexprimables. De l’autre côté de la place de Venise, tout est noir. Sur le Corso, les vicoli s’ouvrent, noirs aussi dès l’entrée ; mais les yeux s’habituent ensuite aux ténèbres qui paraissent être l’état normal de ces ruelles éclairées de loin en loin par les lueurs jaunes du gaz. Pas une âme. Il fait un peu froid, un froid sec qui passe en courants d’air le long des maisons. Au fond du ciel les étoiles semblent s’agiter ; on les perçoit nettement, larges et scintillantes et très blanches. À terre, de petits pavés irréguliers encadrés de dalles forment trottoir au même niveau que la chaussée. Le moindre bruit de pas résonne sur ces dalles, au loin, s’avance, grossit, puis s’efface : un passant quelconque à qui je dois sembler un être bizarre, si lent à marcher, à glisser contre les murs sombres percés de hautes fenêtres aux grillages ventrus, sous les madones des encoignures, le long des palais aux allures prodigieuses, uniques peut-être, dans ces villes d’Italie, d’où ne sort aucun bruit, aucune clarté. Du noir, du vide et le silence absolu… Rome me plaît ainsi. Quelque chose de fantastique me précède, m’accompagne, me suit, enveloppe délicieusement ma solitude savoureuse de rôdeur paisible… Un chuchotement mouillé, un froufrou liquide, c’est bientôt la Fontaine de Trévi ; je vais ; le chuchotement devient clameur et le froufrou brise sur les murs ses bruissements précipités de cataractes ; voilà la fontaine enfin. L’eau éclate en gerbes sur les rocs artificiels ; les cascades s’illuminent comme des fontaines de palais enchantés ; l’électricité fait merveille, tellement sont magiques ses clartés et limpide l’acqua Vergine, et blanches les nappes de lumière étalées sur les nappes mobiles et scintillantes de l’eau. Les colosses de pierre se dressent, brusquement éclairés au milieu des architectures puissantes dont les corniches, les pilastres et les entablements montent, retombent, escaladent le faîte des maisons… Il y a de la sorcellerie dans la magnificence de ces pierres violemment éclaboussées de lumières liquides qui rejaillissent jusque sur l’église et les murs sombres d’en face, en éclairages étonnants et tellement inutiles ! puisque je suis tout seul, et que la ville entière sommeille insouciante de cette apothéose sans fin…
Par les ruelles noires, plus loin, s’amortissent les plaintes confuses des jets brisés et des déchirures de l’eau, et s’éteignent les pâles incandescences de la Fontaine de Trévi. Je retrouve ma chère place d’Espagne, dépouillée, elle, des rais d’or du soleil, esseulée, sans le va-et-vient des petites marchandes de fleurs aux yeux si jolis dont les étoiles, là-haut, essayent, sans y parvenir, de rendre le doux éclat ; sans les groupes superbes des modèles promenant sur les degrés somptueux de la Trinité-des-Monts, le rythme de leur jeune beauté. Et la Barcaccia du Bernin pleure, silencieuse, ses larmes glacées. La place d’Espagne n’existe plus la nuit.
Par un petit chemin grimpant dont le gravier grince sous mes pas, à travers de grands arbres penchés dont les ombres froides rêvent sur les murs, j’arrive devant la Villa Médicis. Là l’air est plus vif encore. Les arbres immenses enveloppent les flancs du palais qui s’élargit à la base comme écrasé sous le poids énorme de la haute et lourde façade. Des arbres noirs, rien que des arbres, et devant moi, dans une élégante vasque de marbre, jaillit le sanglot d’une colonnette liquide dont le chapiteau se brise, se disperse, tombe et gémit en plaintes ininterrompues. En bas, à travers les feuillages d’hiver, des carrés lumineux qui sont les grandes baies vitrées des ateliers et des hôtels où l’on rit, où l’on s’amuse, où l’on franchit gaiement le seuil de l’an nouveau… Le petit jet d’eau à côté de moi distille des gouttelettes de tristesse infinie qui me pénètrent et me glacent, et répandent en même temps un vague exquis en tout moi-même. Je préfère, — avec quelle énergie ! — je préfère le floconnement froid et blanc de ma fontaine, son petit panache glacial, aux mousses blondes et folles du champagne ; son ronron monotone et berceur, aux hoquets du bouchon qui déchire sa capsule d’or ; et la sérénité de ma nuit bleue, aux extravagantes lumières des lustres ; et le baiser brutal de l’air pur, et les soupirs embaumés des eucalyptus, aux baisers, aux soupirs de là-bas…
L’obscurité est verte et bleue, avec des semis d’étoiles sans nombre. On devine les places aux grandes traînées blêmes immobiles sur Rome, au-dessus des palais et des dômes. Rien ne trouble la quiétude de cette terrasse où je suis, dominant toute la ville assoupie, voyant, au loin, les remous indécis des ondulations tour à tour éclairées et sombres d’où s’élève, au dernier plan, plus grandiose encore dans ses formes indistinctes, la vision dantesque de Saint-Pierre et du Vatican. J’accroche mes regards sur ces deux choses dont les masses confondues me semblent le Pôle de toutes les espérances, l’Axe colossal autour duquel gravite l’existence du Monde, où, géant, est enfoui dans un coin de son palais immense et muet le Vieillard frêle et diaphane dont les épaules se redressent sous ce poids plus formidable encore que la pesanteur matérielle du Globe : le fardeau des âmes et la raison d’être des corps…
Puis il me vient à l’idée que c’est bizarre, cet individu que je suis, accoudé là, seul, sur un mur de pierre très froid au contact des mains, bouleversé de songes écrasants et peut-être ridicules, rêvant en même temps à cette petitesse : les danses de ces gens dont les silhouettes passent l’une après l’autre derrière les baies illuminées, aux accords d’un piano, et songeant aussi que ce n’est pas la peine de faire ainsi les fous, puisque de tous ces bruits de voix et de musique il ne doit rester que du silence, moins encore, le Néant. Et cela bientôt, tout à l’heure…
J’envie ceux qui prétendent que tout doit finir sur terre. Il ferait bon terminer ici la course au but ignoré et inquiétant. Ce serait très bien, dans les verdures froides des arbres, et le froid bleuté du ciel, avec le dernier regard de ses pauvres yeux fixés sur Rome tout entière, près de la petite fontaine élégante dont le sanglot s’augmenterait peut-être en un instant furtif, sous la poussée de l’air secoué par la détonation d’un pistolet ; ensuite, elle continuerait à pleurer seule de vraies larmes presque silencieuses dans sa gracieuse vasque de marbre… et ce serait à jamais fini. Le reste, qu’importe !…
XIII
Tombé le décor de la nuit bleue et transparente, il reste seulement dans l’infini juvénile du ciel de petites traînées d’or, comme si, de ces fleurs lointaines et mystérieuses, les étoiles, la vaporeuse fécondité d’un pollen s’était répandue dans l’azur et sur la terre où tout se dore et s’éveille.
De la place du Peuple, large et paisible, gravi par des rampes très douces les pentes du Pincio enveloppé de bosquets délicieux, des menus feuillages des palmiers, des eucalyptus et des pâles bambous que soulève le moindre vent.
Ma petite fontaine de cette nuit est un cirque de marbre tout résonnant du concert des oiseaux penchés sur ses bords où ils prennent leurs ébats ; les ailes trempées d’eau limpide, ils lancent autour d’eux une mince pluie de gouttelettes en lesquelles s’arrondissent les irisements de menus arcs-en-ciel. On dort dans les ateliers de peintres. Des sonneries courent sur la ville, et ce sont les seuls bruits dont l’exaspération passagère tantôt se déchaîne et tantôt arrive jusqu’à nous dans une caresse lente à s’évanouir. Il m’est impossible de fixer en moi cette idée que nous sommes au premier janvier ; ici tout est reposé, calme, tranquille, bercé d’une inexprimable sérénité ; je ne connaissais que le premier janvier assommant, maussade et menteur de Paris ; ce jour de l’an à Rome est infiniment doux et n’oblige à aucune étreinte fausse, à aucun répulsif serrement de main…
La via Sistina, la rue des marchands de photographies dont la consommation est grande, ici, comme le besoin d’emporter avec soi le souvenir matérialisé de tout ce qui enchante les yeux. À côté des reproductions de monuments quelconques et d’œuvres d’art qui déjà, celles-ci, sont pleines d’intérêt, il y a des photographies charmantes ; ce sont des études de modèles prises sur nature, un peu partout, particulièrement à Rome, à Naples et à Taormine. Les gars de Taormine sont superbes, mais leur nudité a l’aspect un peu rude ; leurs yeux très beaux éclairent des visages réguliers, mais fermés, ne laissant deviner aucun frisson de leur être intérieur ; à part quelques jeunes garçons délicats et d’une joliesse plutôt efféminée, les autres ont des allures solides d’étalons et feront, certes, de beaux enfants comme eux ; j’allais dire de fort jolies bêtes, car il m’a paru que c’est l’animalité jolie qui domine surtout en eux malgré la forme pure des visages où ne s’égare aucune pensée. Mais ceux de Naples et de Rome ! Quelle exquise finesse dans les yeux, dans la bouche dont la lèvre inférieure fuyante vers le menton termine un profil impeccable ; quelle intense harmonie de formes et de lignes ! c’est l’énergique et presque musicale beauté des chairs lumineuses et veloutées.
Éphèbes entièrement nus ou drapés, avec quel art ! dans la blancheur de vêtements antiques soulevés par de jeunes bras aux gestes d’une grâce absolue, chaussés de sandales de cuir ou de cnémides qui soulignent la perfection des jambes, couronnés de feuillages, ou bien les boucles noires des cheveux simplement contenues dans un bandeau de laine blanche, ce sont les types merveilleux d’une race extrêmement élégante, et j’écrirais volontiers divine, tellement, dans tous les purs reliefs de leur corps, s’épanouit l’inépuisable splendeur des marbres grecs. Les jolies épaules des adolescents, dont la superbe nudité tout entière sourit au grand soleil napolitain ! Des sèves glorieuses de jeunesse, chez les uns charrient — des pieds délicats aux poitrines tendues, des hanches assouplies aux nuques annelées de soieries brunes — des tiédeurs visibles de vie palpable sous les ondoiements des membres fatigués. Une lassitude câline étire paresseusement chez les autres des langueurs énervées de jeunes chats ; elle gonfle les membres de pleine et robuste santé, elle joue à fleur de peau, cambre la chair, élève jusqu’aux magnificences immortelles des divinités païennes la virilité plaisante des jeunes hommes.
Ils sont tous ainsi, d’ailleurs, en Sicile, à Naples, ici même. Les rues sont pleines de ces jolis gamins dont la piquante beauté s’affine davantage encore aux approches de l’adolescence et acquiert son complet et parfait épanouissement au moment où l’âge viril va parachever les corps fragiles et muer leur sveltesse en la charpente svelte et solide que je voyais il y a un instant sur la place d’Espagne, dans les loques des ciociari dont la misère, joliment, brave la laideur.
Et je ne me lasse jamais d’admirer, à chaque pas, la grâce espiègle des petits mendiants qui se roulent dans la poussière des rues, les jeunes hommes à la démarche simple et sans pose ; et quand passe l’un de ceux-ci, le visage enveloppé de la belle sévérité des grands yeux calmes et limpides, avec des lèvres aux lignes pures, un cou flexible où tombent, de la nuque souple et solide, de jolies boucles brunes répandues en caresses sur la chair, brune aussi, aux reflets d’ambre pâle, c’est en moi, renouvelé du Musée de Naples, l’envahissement d’un charme intangible et imprécis dont je ne veux pas me défendre…
Et s’il était nécessaire d’ajouter un trait suprême, un argument irréfutable en faveur d’une beauté dont restent émerveillés tous ceux qui ont fait quelques pas sur cette terre d’Italie, il suffirait de rappeler que la légende, confirmée depuis par les travaux de très érudits historiens, veut que Raphaël, — enfant de dix-huit ans, timide ou impuissant à vaincre les scrupules des femmes Ombriennes qui refusaient, même vêtues, de se prêter au jeune peintre comme modèles, — ait simplement reproduit le visage de ceux de ses jeunes camarades, de ses petits amis de jeux et d’étude en qui rayonnait la grâce idéale et candide des vierges immortelles que nous admirons aujourd’hui…
Et je continue, dans la rapide traversée de Rome, la reconnaissance des choses aimées autrefois. Presque toutes me paraissent embellies ; d’autres ramènent à des formes plus simples l’image qui m’était restée d’elles ; et je n’ai pas les désillusions du revoir par l’amoindrissement de mes souvenirs. Mais, ici et là, les larges éclaircies faites à travers les vieux quartiers jettent en moi la mélancolie de ce qui va disparaître pour toujours.
Sainte-Marie-Majeure, une façade de palais, plutôt de théâtre. Dedans, un plafonnement d’or qui baigne ses étincellements dans le liquide, miroitant comme une eau dormante, des dallages en marbres précieux ; au bord de cette eau paisible, les colonnes antiques aux merveilleux chapiteaux se mirent également et se répètent presque entières jusqu’au fond des marbres limpides. La Confession enferme parmi ses cristaux de roche, ses agates et ses onyx, les bois millénaires d’un petit lit de mauvaises planches vermoulues que je vis il y a déjà des années. Je le sais là, derrière les volets de fer, que seuls les cardinaux-chanoines, crosse en main, mitre en tête, ont le droit de soulever dans la clameur frémissante des orgues, dans le déploiement des bannières et des croix, et le vol des encensoirs d’or qui lancent les étoiles de leurs orfèvreries parmi les nuages bleus… Un Nouveau-Né s’est endormi dans ces planches, ses petits poings fermés en boules roses et blanches ; au réveil, ses yeux ont vu le bois du triste petit lit, et peut-être, en pensant à l’Autre, déjà, ont-ils mouillé celui-là de grosses larmes bien chagrines et bien douloureuses… comme les nôtres… J’aurais voulu baiser leur trace ineffable et divine en écrasant devant Elles la misère de mon adoration…
Dans un désert, à l’extrémité de Rome, Saint-Jean-de-Latran. Les hauts parvis dépassés sous les colossales statues des terrasses, les portes de bronze franchies, c’est encore une vertigineuse splendeur : des voûtes sortent les saints, et les saintes, et le Christ, en hauts reliefs d’or ; les caissons contiennent de monstrueux enroulements d’or parmi les rinceaux et les feuillages d’or ; les boules rouges des Médicis sont posées sur le ventre d’or des écussons avec un point de tangence tellement petit qu’elles semblent vouloir rouler du plafond sur nos têtes ; les tiares, les clefs, les mitres sont figées en de fantastiques ciselures dans des creux séparés par des digues de marbres et de porphyres. Et le plafond est une misère parmi toutes les beautés de l’insigne basilique !… D’ailleurs aussi, cela est immobile, inerte, mort… Ce qui vit d’une extravagante vie, c’est, là-bas, au fond, dans le sanctuaire où tout l’or des voûtes, des corniches et des écussons, tout l’or des mosaïques, des rinceaux, des frises, des tiares et des mitres vient se fondre et couler comme un fleuve à travers les grillages forgés, ciselés et recouverts de feuilles et de rosaces d’or, — ce qui vit, ce qui revit, ce qui renaît, c’est la commotion lointaine et ineffaçable, le lointain souvenir des chants dont je tressaille encore… Était-ce de la Sixtine ou de la Julienne, était-ce de l’une de ces chapelles, dont les voix ont conservé des traditions qui ne se retrouvent plus nulle autre part, capables d’exprimer, jusqu’à en meurtrir non seulement l’âme mais la chair, toutes les transes joyeuses dont peut vibrer un être, les transes adoratrices, les splendeurs des triomphes, les transports d’une ivresse mystique, les arrachements supra-terrestres des extases, les lentes et savantes et toutes proches et retardées et venues enfin pâmoisons d’amour ? Je ne sais… Je me souviens seulement d’un après-midi de novembre, tiède ici, dans la basilique ; la lumière allait mourir tôt et griffait, avant la fin suprême, griffait avec ses griffes d’or l’or des orfèvreries, l’or des chapes lourdes sur les épaules de vingt cardinaux, de quarante évêques, l’or de soixante triangles de gemmes sur soixante visages immobiles. Le jour dorait les fils d’argent des barbes soyeuses des Patriarches orientaux et des évêques missionnaires, il chauffait encore un peu la braise des yeux somnolents sous les fronts des prélats écrasés de joailleries. L’autel était un brasier ; l’incendie des cierges se mêlait en une flamme unique aux incendies des murailles et des rétables d’or. Et partout s’élevaient les intenses fumées d’aromates en fusion sur les charbons des cassolettes balancées par les thuriféraires en robes rouges et violettes, les thuriféraires jolis et graves comme un chœur de Chérubins. Les chaînettes d’or bruissaient contre eux, sur la blancheur des aubes de dentelles. Leurs grands yeux brillaient sous les boucles brunes des cheveux répandus sur leurs fronts et leurs tempes ; ils brillaient autant que l’or des cassolettes d’or, autant que les charbons des cassolettes mouillés sans cesse d’une bouillante coulée d’encens aussitôt réduit en vapeurs bleues dans lesquelles s’enveloppaient les ors des chapes, l’or de l’autel, la flamme remuante des cierges et la jeune flamme remuante des jeunes yeux… La magnificence des rites atteignait les splendeurs irréelles d’un rêve…
Soudain, de la chair, — car rien ne fut plus extraordinairement charnel que cette voix, — de la chair s’éleva un murmure doux, une plainte, un gémissement musical, une phrase d’amour faite de cette pauvre chair qui, précisément, ne savait pas les transes de l’amour et les ivresses de ses triomphes ; de cette pauvre chair défaite, morte avant la mort, ensevelie sans cercueil et sans suaire, montait, s’échappait un mystérieux frisson de vie d’une infinie douceur, d’une infinie douleur… Et ce fut dans l’ample basilique de stucs, de marbres et d’or, parmi la multitude des pontifes réfugiés sous la carapace gemmée des chapes et des dalmatiques, ce fut, dans les grands yeux inquiets et ignorants des thuriféraires adolescents, ce fut en moi, en nous tous, je suppose, le tressaillement, la déchirure lente et poignante du cœur crispé, tordu par le charme incommensurable d’une voix, d’une Voix en qui, semblait-il, s’étaient ramassées, cristallisées toutes les sensations d’une chair insensible, toutes les joies d’une chair sans jouissances, toutes les voluptés amoureuses d’une chair pour qui ne sont ni les voluptés, ni l’amour ; une voix étrange faite de caresses, faite d’enlacements, fraîche, sonore, veloutée, savoureuse et dangereuse comme un fruit vénéneux ; étendue et lointaine, avec des mouvements lascifs comme tout un Orient de plaisirs ; avec une harmonie majestueuse et sereine aux rythmes paradisiaques et berceurs ; une voix paresseuse comme la fumée nonchalante des encens ; limpide comme les yeux des enfants de chœur ; chatoyante comme des ailes de bengali ; lumineuse comme les grands vitrails où s’éteignaient les saintes et les saints de rubis et d’émeraudes ; souple, et de lignes pures comme les reins nus du danseur Bathylle ; païenne, oh ! si païenne, que le désespoir me vint avec la foule des pensées mauvaises dans ce temple où je devais adorer le Pur entre les purs, le désespoir d’obsessions odieuses que je ne pouvais chasser… Le chant était adorablement beau ; chaque note, chaque frémissement était une image, un cri sensuels, obscènes presque ; ce chant qui montrait sa nudité souffrante, monstrueusement souffrante et mutilée pour qui, aveugle, ne sont plus les clartés du jour ; glacée, ne sont pas toutes les suavités, les tièdes effluves d’avril, l’immense floraison de toutes choses et la poussée vers la vie, vers le renouvellement, vers la création !…
Tout cela tombait de la bouche du chanteur debout dans la tribune aux balustres alternés de marbre et d’or, sur la tête des vieillards enveloppés d’hiver, sur la tête des jeunes hommes splendides de printemps… Et je me souviens encore que la voix insexuée vint battre de ses ailes blanches contre les rayonnements d’un ostensoir large comme le soleil à son zénith, et vacillant entre les mains affaiblies d’un cardinal de pourpre et d’or devant qui tous les fronts silencieux dans le silence troué de clochettes tintinnabulantes s’inclinèrent doucement…
Quand je me relevai, le vide immense s’était fait autour de moi ; les cierges étaient éteints ; les triangles d’or et de gemmes avaient disparu avec les chapes et les dalmatiques ; il ne restait des fumées bleues qu’un intense parfum toujours endormi dans le sanctuaire ; les enfants de chœur avaient fui, et, dans la nuit fraîche, derrière les vitraux, le ciel étoilé avait recueilli leurs grands yeux… Je n’avais pas vingt ans, — jamais les années ne recouvriront la splendeur de ce souvenir !…
Dans la basilique, une porte de bronze lourdement se replie et découvre le cloître. Ah ! l’enchantement ! — Encore ce ne sont pas les floraisons d’avril où déjà, à Rome, naissent les roses, se cisèlent les aubépines, se modèlent les camélias, où les pivoines orgueilleuses s’éploient ; non ; des feuillages roux seuls aujourd’hui parent d’automne le jardin qu’enserrent les frêles colonnettes. L’hiver — s’il est un hiver ici, dans la tiédeur des architectures incrustées de pierreries — semble reculer ses frigides nudités. Les colonnettes accouplées se frôlent, et le soleil qui mire en les joailleries de leurs torsades ses rayons argentés, réchauffe leurs caresses élégantes.
Près de la sacristie, parmi les boiseries somptueuses d’une salle d’apparat où des trônes aux marquetteries précieuses, sur chaque face, appuient leurs bras refouillés au ciseau, — un clerc esseulé avive de ses lèvres roses de gamin déjà petit homme les braises mourantes d’un encensoir ; ses mains jolies se nouent aux lacs pesants des chaînettes d’or et la douceur de ses yeux s’ouate de pâles fumées bleues. Il sait donc qu’il est très beau, que voilà prête à sourire sa bouche malicieuse, parce qu’il sent mes regards rivés à ses gestes espiègles ? Alors il y a des choses que je voudrais bien connaître, des noms de peintres, d’architectes, des heures d’offices, que sais-je ? Il répond, svelte et rieur dans la mutinerie câline de son visage charmant.
Quelle importante monnaie prise au hasard mis-je dans sa menotte adolescente embarrassée de chaînettes d’or ?… Si Virgile n’avait envoyé, pour nous conduire à Naples, l’Alexis séduisant de ses Bucoliques, je n’aurais jamais aimé des yeux plus beaux que les yeux noirs du petit cardinal de quinze ans, enfant de chœur à Saint-Jean-de-Latran.
…Depuis, j’ai revu les colonnettes orfévrées du cloître basilical, transcrites par Viollet-le-Duc dans ses dessins du Trocadéro. Leurs joailleries m’ont fait souvenir de ce garçon très mignon, parce que le Maître incomparable évoque, là aussi, d’un crayon magistral, les luminosités païennes du Temple de Girgenti qui me fait regretter le catholicisme sévère de Latran.
Dans une autre basilique, jadis, j’eusse baisé ses lèvres ardentes et ses poignets d’opale, à cet adolescent joli tout vêtu d’écarlate, pour rendre hommage à sa beauté et remercier les dieux de leur munificence.
Hélas ! je ne monterai plus comme autrefois, à genoux, l’Escalier saint où demeurent, sous de petites plaques de cristal, des taches de sang qui sont le sang du Christ ; l’Escalier de Pilate ? J’aurais peur de renouveler la Passion !… Mais nous avons voulu quand même aller jusqu’à la Scala Santa, et je laisse ma mère, pieusement, pour nous deux, s’agenouiller sur les degrés où se posèrent les pieds ensanglantés… Et je pleure les ronces qui chaque jour davantage envahissent le jardin de ma foi et recouvrent le sol où, péniblement, par elles, je vois étouffer les roses de l’amour divin !…
Tout en haut de l’Escalier l’image de Jésus enfant peinte par saint Luc et achevée, dit-on, par les anges, sourit parmi les lampes pieuses, comme si la douce figure ne voyait pas Judas, en bas, au pied des marches. Je regarde l’immobile statue de l’apôtre infâme, je regarde en moi la statue grandissante de mes péchés, et je me demande quel est, pour Lui, le Judas le plus douloureux, celui qui Le vendit il y a deux mille ans ou celui qui Le torture encore maintenant ?…
Nous quittons le désert de Latran, les vieux murs de l’enceinte d’Aurélien aux briques croulantes, et nous allons vers cet autre désert, le Forum. Désert prodigieux, Sahara de silence où se dressent les gigantesques ossements des colonnades, les frises chancelantes sur les fiers chapiteaux silhouettés en lumière dans les grisailles du Capitole. Le Passé demeure tout entier dans ce grand trou de lumière, dans cette solitude rayonnante entre le Palatin et le Viminal, entre le Capitole, le roc tarpéien qui n’est plus que souvenir, le beau campanile roux de Sainte-Françoise-Romaine et, tout au fond, le Colisée… Ici encore, ce n’est pas une formule vaine, il n’y a rien à raconter, il faut voir. Et lorsqu’on a vu, l’évocation de ces lieux d’irrésistible enchantement veut la seule admiration muette. Les mots et les paroles s’effondrent sous le poids colossal de tout ceci. L’âme s’abîme dans la majesté, dans la grandeur de ces Ruines qui se débattent contre le Temps vaincu, et mesure, frémissante, tout ce qui tient là de beauté sur cette parcelle étroite de notre Terre…
Après midi, repris notre tournée pieuse en commençant par l’église d’Ara Cœli. Si je ne craignais de commettre une hérésie d’esthétique, j’avouerais très humblement que de tous les fastueux portails de Rome, c’est le dessin fruste, un peu sauvage, mais d’une simplicité poignante, d’Ara Cœli que j’aime par-dessus tous. Point de mosaïques d’or, point de lapis, ni d’opales, ni de rubis enfoncés et cloisonnés dans les marbres ; à peine quelques pierres vermeilles ; des briques, tout simplement, qui sont d’un rose grave dans le soleil. Les lignes inclinées de la muraille austère dont est faite la façade de l’église sont coiffées de tuiles, roses aussi. Cela est d’une rusticité sévère et d’un contraste tout à l’avantage du simple portail, auprès des architectures solennelles du Capitole et de la cavalcade poncive des chevaux de Castor et de Pollux. Et puis toute cette clarté rosée s’offre si joliment en haut du grand escalier de marbre qui monte sans effort entre les feuillages verts des palmiers et des bambous, avec, sur ses marches usées, fatiguées, les guenilles remuantes et chaudement colorées des mendiants, des mendiantes geignardes, — et des petites marchandes de fleurs ! Dans le ciel limpide, une grande traînée de lumière paraît s’élever, venant des profondeurs du Forum, pour envelopper le désordre lumineux, l’irrégularité délicieuse de ces degrés, de ces murailles, de ces verdures pâles ou sombres et de ces personnages misérables, noblement drapés à l’antique dans leurs vieux manteaux rongés d’intempéries. Ils découvrent, pour nous demander l’aumône, des têtes merveilleuses, et tendent des mains que le dolce farniente a faites semblables à des mains de patriciens. Les filles, jolies et fraîches comme l’amour tout nu, nous offrent des fleurs, des chapelets, des images du Santissimo Bambino, et, dans le sourire de leurs lèvres humides, le chapelet de nacre de leurs dents…
Sur le Pont Sixte, passé le Tibre enfoui tout au fond des berges rétrécies par les quais neufs. Le fleuve roule lentement, épais, dédaigneux et froissé de subir, dans la traversée de Rome, les ferrailles odieuses des ponts.
Nous sommes au Janicule.
Que ce soit des terrasses du Pincio, dans l’ombre bleue et diffuse de la nuit, ou d’ici, dans le jour doré, — des différentes parties de la Ville Éternelle s’élève la même rumeur vertigineuse des siècles écoulés. Chaque monument, chaque pierre crie la souffrance et la gloire des êtres qui passèrent là, leur effort vers la Beauté, l’effort de leur génie, de leur pensée, aussi bien que l’effort de leur corps, de leurs mains. Sur les coupoles vieillies, sur les tours carrées et trapues, plane l’âme immortelle d’un Monde. Là-bas, le Colisée, derrière la façade rose d’Ara Cœli, tressaille encore de l’agonie des martyrs, et sous ses voûtes épaisses l’écho n’a pas fini de redire l’enthousiasme effroyable des cent mille hommes, à chaque spectacle, engouffrés dans ses murs… Par la splendeur lumineuse des places et des rues, en l’ombre fraîche des temples, mon esprit fait se dérouler encore les triomphes des Césars, la pompe des cortèges dont le merveilleux souvenir désespère nos désirs de les égaler jamais. J’évoque l’ineffable poésie de tout ce passé, et je voudrais que mon respectueux amour, affranchi de la banalité des mots, que le respect de mes yeux, de mon front, de mon cœur, de ma pauvre intelligence, du moi total qui pense et s’émeut, aillent clamer mon enthousiasme à tous les coins d’horizon, à tous les pavés des rues, et jusqu’aux verdures éparses, issues des verdures d’autrefois, dans les ruines pantelantes, sur les murailles écroulées. J’ai besoin, j’ai soif de dire à tout cela la largeur de mon infime admiration, l’amour de cette grâce antique qui demeure parmi la grâce fastueuse et sévère de la Renaissance dont est faite la Rome d’inégalable beauté que j’ai là sous les yeux…
Séparé de lui par l’abîme de sa grandeur et l’abîme de ma petitesse, volontiers je pleurerais là, devant le spectacle déconcertant des inéluctables disparitions, comme Léon X, dans les magnificences funèbres du Capitole, pleura, sur les mains glacées du divin Raphaël, la perte du génie à jamais rentré dans le néant…
En quittant les hauteurs du Janicule, la voix mourante des eaux limpides de la Fontaine Pauline nous suit, et déjà lui répondent les psalmodies monotones des grandes vasques de la place Saint-Pierre.
Rome, partout, même la nuit, — la nuit surtout dans le silence, — Rome se laisse bercer par le murmure de fraîcheur de ses fontaines jamais taries. Leurs voix n’ont pas changé depuis des siècles, et les tristesses d’autrefois ont dû connaître leurs sanglots et le bruit déchirant des grosses larmes qui viennent l’une contre l’autre se briser encore maintenant. Les joies passées pareilles aux joies présentes ont ri du rire clair des perles jetées dans l’écume blanche que fait blonde la dorure soudaine d’un rayon de soleil. Tour à tour, comme cette nuit sur le Pincio et la place d’Espagne, on entend l’eau rire ou pleurer ; et le cœur, joyeux ou triste, reconnaît en sa voix une voix grave d’aïeule qui se plaint en attendant la mort, ou le gazouillis joyeux d’un nouveau-né qui sourit à la vie…XIV
Hier, avec la nuit tombante, nous avons trouvé closes les portes de Saint-Pierre et nous pûmes seulement pénétrer dans le Vatican par la Porte de Bronze, où la garde suisse, aux vêtements couleur de flammes, veille au pied de l’Escalier Royal. Par la cour Saint-Damase, et par d’autres escaliers encore, nous sommes arrivés à la salle Clémentine. À cette heure, le Vatican désert était figé dans le silence. Les hallebardiers allaient et venaient dans l’ombre croissante à chaque minute, et laissaient tomber leur arme paisible, en s’arrêtant au passage de quelque prélat attardé ; le bruit sec rebondissait sur les dalles, prenait de l’ampleur et se répétait à l’infini sous les voûtes…
Dans la salle Clémentine tendue de fresques jusqu’en haut des murailles immenses, des valets vêtus de soie pourpre avec des ailes de damas rouge qui pendent inertes des épaules, prirent sur un plateau de vermeil quelques chapelets que leur remit ma mère pour les présenter à la bénédiction du Souverain-Pontife, pendant que nous restions seuls dans un coin de ténèbres, avec les fantômes qui semblaient attendre notre départ pour se détacher des fresques et remplir de leurs formes impalpables et décolorées le volume entier de cette salle dont les plafonds se dérobaient et n’étaient déjà plus visibles dans l’obscurité…
Ce matin, pris par le chemin des écoliers pour retourner à Saint-Pierre. Suivi le Corso tout entier, la place du Peuple, la via Ripetta, le palais Borghèse ; erré par toutes ces rues si délicieusement éloignées encore de nos prétendus raffinements modernes, si vieilles, dans les vieux quartiers au bord du Tibre, en face des Prati défigurés maintenant par la stupidité laide et ruineuse de constructions inhabitées d’ailleurs, et par ce bloc sans nom, sans style, sans esthétique, horrible bâtisse qui sera, quand les échafaudages vermoulus seront tombés, le Palais de Justice ! Vu le palais Madama, la place Navone, le palais de la Chancellerie. — Le palais de la Chancellerie… N’avais-je pas raison d’aimer follement cette Renaissance dont la Beauté souveraine, seule, peut faire oublier la décrépitude fauve des grandes ruines du Forum et du Palatin et nous consoler de leur impossible recommencement ! Traversé le Campo dei Fiori, pittoresque, pour gagner le palais Farnèse. — Le palais Farnèse… Allons, vite, le temps presse et meurtrit les joies qui montent de toutes ces choses… Repris le Pont-Sixte, parce que la Farnésine me requiert, où Raphaël a laissé de sa grâce, où G.-A. Bazzi, — dont je veux connaître, quelque jour, la Sainte Catherine, à Sienne, — a créé la force élégante d’Alexandre et donné le souffle aux lèvres amoureuses de Roxane. Les Noces d’Alexandre et de Roxane contiennent mieux que l’expression dernière du talent. Bazzi a inculqué son âme aux molécules dont est faite cette œuvre prestigieuse que n’a point dépassée, en langueur souriante et en séduction voluptueuse, Raphaël même dans son Triomphe de Galathée tout proche.
Puis, parmi les gamins au teint brun d’Orient, aux yeux ardents, aux gestes souples, aux lèvres luxurieuses, et parmi la laideur altière des femmes du Trastevere, je vais. Je m’enfonce dans la vieillerie ravissante de ce qui subsiste encore, je m’imprègne de cette vétusté si pleine de la poésie de ce qui n’est plus, et que dégagent encore mille choses : fontanelles assiégées par de jolies filles aux corsages demi-nus malgré le froid ; humbles églises au chef branlant ; palais aux faces parcheminées ; ruelles dont toutes les masures aux baies armées de grilles massives tremblent et radotent ensemble et se racontent des souvenirs que j’écoute au passage… que j’entends. Chaque pierre, chaque pavé est une anecdote intéressante partout, même dans les coins les plus misérables. Tout ce qui m’environne là me touche, me pénètre, me parle, et je comprends. Je compatis à tout ce que je retrouve, à tout ce que l’on retrouve là où beaucoup de nos frères pendant longtemps ont pensé, ont souffert et sont morts, laissant la trace palpable presque de leur présence comme si c’était un peu de leur âme qui demeure…
On a dit que Rome sent le mort ! De la mort Rome contient seulement, — dans l’atmosphère tout entière où subsiste la vraie Rome, et non pas dans la misère neuve des récentes constructions, — l’émanation des cierges éteints dont la pointe, rouge encore, s’étire en traînantes fumées mêlées à l’odeur très douce des fleurs épuisées qui restent sur les draps blancs.
Dans la tranquillité du matin, parmi le seul va-et-vient des prêtres précédés de leurs servants, figures rieuses et distraites de polissons éveillés et joueurs, dont on sent les mouvements impatients des petites jambes à travers la soutanelle rouge et le rochet de dentelles, des petites jambes alertes que suit péniblement la lenteur exténuée des vieux prêtres, pour dire leur messe aux autels de Saint-Pierre, — je suis revenu dans le but unique de voir encore le Tombeau des Stuarts, me souvenant d’avoir lu dans Stendhal l’admiration du paradoxal écrivain pour ce mausolée très simple, fait d’une pyramide dont la pointe tronquée se termine par un fronton chargé des Armes d’Angleterre et orné de trois bustes parmi des guirlandes funéraires. Ce monument, d’une simplicité de lignes en faveur au commencement de ce siècle avec le Premier Empire, est démodé, mais : «… au-dessous de ces bustes, écrit Stendhal, — sans paradoxe cette fois, — un grand bas-relief représente la porte d’un tombeau, et aux deux côtés deux anges dont, en vérité, il m’est impossible de décrire la beauté. Vis-à-vis est un banc de bois sur lequel en 1817, et en 1828, j’ai passé les heures les plus douces de mon séjour à Rome. — C’est surtout à l’approche de la nuit que la beauté de ces anges paraît céleste. — En arrivant à Rome, c’est auprès du tombeau des Stuarts qu’il faut venir essayer si l’on tient du hasard un cœur fait pour sentir la sculpture. La beauté tendre et naïve de ces jeunes habitants du ciel apparaît au voyageur longtemps avant qu’il puisse comprendre celle de l’Apollon du Belvédère et la sublimité des marbres d’Elgin. »
Je ne sais si l’auteur de Rouge et Noir a fait école, mais pour ma part j’ai tenu, assis sur le même banc de bois où s’écoulèrent ses heures de rêverie, à venir dans le silence doré du matin pour jouir aussi de la fragile délicatesse des jeunes hommes de marbre blanc. J’ignore l’effet que produisent sur eux les clartés agonisantes et mélancoliques du crépuscule, quand le soleil sanglant inonde la gloire de bronze de la Chaire Apostolique ; mais j’ai vu que les fraîches lueurs matutinales osent à peine s’approcher de leur nudité et que, triomphantes partout ailleurs dans la basilique, elles passent auprès d’eux roses et craintives comme des amoureuses ; leurs impalpables poussières se dissolvent et font, à distance, à leurs amants si jolis, une enveloppante auréole de lumières sous les irradiations des vitraux…
Hélas ! Tartufe a passé là ; je ne veux pas dire le clergé à l’esprit éclairé et libéral qui permit à Canova d’ajouter aux richesses artistiques de Saint-Pierre la jeune splendeur de ces formes humaines, mais quelque faux dévot dont l’œil oblique dans la face huileuse dérobe sa prunelle devant le « sein qu’il ne saurait voir ». Tartufe, dis-je, n’a pu contempler ces corps entièrement nus ; et des voiles de bronze, merveilleusement ajustés il est vrai, et confondus avec l’éclatante blancheur du marbre, habillent cette nudité très belle, très naïve et très pure, que ne redoutaient ni le ciseau d’un Phidias, ni l’insondable génie d’un Praxitèle ni, plus près de nous, la puissance d’un Rude ou d’un Canova, continuateurs glorieux des grâces infinies de l’antique Hellade…
Henri Beyle sans doute ne connut pas l’enfantillage de cette transformation, dont il y aurait d’ailleurs mauvaise grâce à se plaindre quand on se rappelle l’obscénité des feuillages en fer-blanc du Musée de Naples !
Les rigoristes qui firent ceci eussent condamné Phryné, en cachant leur face d’iconoclaste devant l’adorable frisson de son corps de femme. Sophocle à quinze ans, — au milieu des adolescents de son âge, rejetant avec eux ses vêtements pour chanter dans la gloire de sa blonde nudité, le Pæan, après la victoire de Salamine, parce que les Grecs ne trouvaient à offrir aux dieux dans les ivresses d’un triomphe et dans l’ardeur d’un enthousiasme sacré que cet hommage immédiat de la beauté toute nue, — eût été puni de je ne sais quelle peine, au nom de la morale de ces gens dont les divinités s’appellent hypocrisie et laideur !
Moi je les regarde bien en face, des épaules jusqu’aux pieds finement rattachés aux chevilles, et je les trouve beaux tous ces marbres, sous la palpitation de l’immobile vie qui fait noblement onduler les torses, se ployer les reins et se tendre les muscles dans le geste superbe des bras, dans la hardiesse vigoureuse des cuisses, dans l’élégant élancement des jambes, dans l’idéale régularité des lignes, la noblesse des poses et du maintien ; je les trouve beaux et je les goûte jusque dans les moindres fossettes qu’a voulu sur leur corps l’exact et impeccable ciseau du sculpteur… J’ai rêvé souvent de me faire un musée minuscule de leurs réductions pour vivre toujours environné de leur aristocratique beauté, pour réjouir mes yeux et les dédommager du spectacle laid de l’habituelle existence…
J’ose penser et écrire ces choses devant le spectacle charmant du Tombeau des Stuarts, et il m’est agréable dans l’indépendance de mon modeste jugement, de constater son accord avec la pensée de l’auteur délicat de la Chartreuse de Parme. Je ne crains pas de faire place, dans l’immensité de la prodigieuse basilique chrétienne, auprès de l’immortelle et pure Religion de Charité, à cette autre religion qui est la parure de notre vie et de nos croyances sacrées ou profanes : la Religion de la Beauté…
Je quitte Saint-Pierre et les portiques resplendissants de la colonnade du Bernin, en passant entre les fontaines dont le vent secoue les panaches et les promène en poudre d’argent à travers la place ensoleillée… J’ai le cœur aussi plein de soleil, et la fraîcheur limpide des fontaines s’abat doucement sur mon front quand je me découvre devant le fragment de la Vraie Croix suspendu dans le bleu pur du ciel, sur l’obélisque des Pharaons…
XV
Voici la dernière étape de notre voyage, j’allais écrire la dernière station de notre pèlerinage. Que va-t-elle être, cette Florence traversée hier soir dans un dédale de rues dont, par endroits, les réverbères heurtaient violemment l’énigmatique obscurité ? Ce matin le jour pâle s’imprègne d’un ton vieux rose en caressant les tuiles des toitures que j’aperçois face à notre hôtel, à travers la fenêtre aux grands rideaux blancs ?
De toute Florence monte vers moi un murmure de clochers, un bruit de carillons qui, lentement, gravement, promènent dans le ciel très pur leurs clameurs dominicales. Et je suis ravi que le hasard — et l’hôtelier — m’aient donné cette chambre haute d’où je domine les faîtes des maisons. Je n’ai pas eu le loisir de compter les étages et je n’en veux ni à l’hôtelier, ni au hasard, de m’avoir fait grimper ici, je leur dois une des joies que j’aime et recherche, bien que l’aveu en puisse être assez puéril : l’amour des toits.
Je ne sais pourquoi cette Italie éveille en moi, comme autrefois l’Espagne, l’affection des toitures de tuiles roses ou couleur de bure, — les simples tuiles demi-cylindriques qui recouvraient déjà les temples de la Grèce et de Rome, — dont aucune laideur de cheminée ne vient contrarier le gracieux enchevêtrement et salir les teintes de vieilles couleurs mortes. Le soleil joue dans leurs graminées légères issues au caprice des semences déposées par les vents qui passent. Ils me rappellent, ici, les toits de Séville aperçus du haut de la Giralda, avec leurs verdoyantes chevelures d’herbes fragiles, jetant par les rues, étroites comme ici et comme ici pleines d’ombre dans le matin, une pluie de petits flocons blancs échappés de leurs minces calices frais éclos dans l’exquis avril d’Andalousie, pendant que, un peu plus bas, sur les terrasses, s’épanouissaient dans de grosses poteries, fleurs de sang, les œillets larges comme des pivoines.
Pourquoi cette association de souvenirs avec Florence si différente de Séville ? Je ne sais. Est-ce leur communauté de splendeur, leur même renommée de beauté, ou, plus simplement, le besoin d’unifier le plaisir que je vais avoir ici, avec le plaisir que j’eus là-bas, au bord du Guadalquivir sinuant en lignes caressantes au long des plaines hérissées de palmiers nains, d’aloès vert pâle comme les oliviers, aussi agressifs avec leurs poignards dressés vers le ciel que sont doux aux regards et sans défense les tendres rameaux de paix des vieux arbres caducs ?
Je descends très matin, impatient de connaître cette ville recouverte de la pourpre vieillotte de ses tuiles sur lesquelles tombe dru le soleil et s’épandent en remous métalliques les tintements joyeux des clochers ; cette Florence dont le passé fantastique chante à mes oreilles, dont les magnificences m’éblouissent et reprennent corps dans la soudaine réalité de la rue où se déroule un décor incomparable surpassant encore ce que j’avais osé rêver de plus séduisant et de plus beau.
Et je vois là cette Florence tout ensemble vigoureuse et pâle comme les fresques immortelles qu’ont semées à pleines mains, à plein génie les ouvriers de la Renaissance. Ses églises et ses palais dessinent leurs dômes et leurs terrasses dans l’air bleu en contours d’une netteté inouïe, dans l’ineffable clarté de ce grand jour qui la caresse, la baigne d’indéfinissables nuances de lumières et sur elle dépose la parure d’or du soleil. Elle est aussi belle que Rome, sévère et rigide, plus enlaçante que Naples aux molles étreintes. On sent que ce n’est pas la chair seulement qui va tressaillir de nobles jouissances, mais que l’esprit vient aussi se féconder aux sources mêmes du Beau et réclame sa part dans la fête des sens.
Sur l’Arno, voilà le Ponte-Vecchio, vieux et croulant, avec ses trois grandes baies au milieu que transperce la lumière ; triptyque improvisé où s’encadrent les montagnes bleutées qui font à Florence une ceinture toujours brillante au midi comme au septentrion.
C’est tout le XVe siècle, ses palais et ses campaniles carrés, trapus et massifs et si élégants ! si belle, cette grande tour du Palazzo-Vecchio : la formidable Seigneurie ! charmantes ses vieilles rues étroites, dont les maisons transformées, sans doute, sont filles des maisons de la Florence du Dante, de Michel-Ange et du Vinci, la Florence dont les murailles chantaient vingt sonnets le même jour quand, des mains géniales de Cellini, magnifique, naquit le bronze immortel du Persée ; la Florence qui fermait ses boutiques, arrêtait ses métiers, accourait haletante et jouisseuse, éprise de beauté, interrompant sa vie pour entendre des vers sur la place publique…
Sur le pont de la Trinité gazouillent les voix claires et s’emplissent des clartés de leurs yeux les beaux visages des petites Florentines et des jolis gamins de Florence, marchands de fleurs ; je ne comprends pas leur parler, mais je sens aux mouvements délicats de leurs lèvres qu’il doit être très pur et que c’est ici, dans cette Florence dont le nom me plaît à répéter, la terre du beau langage. J’achète pour quelques sous des bouquets où se pâment des violettes de Parme, blêmes et embaumées comme jamais je n’en ai vu ailleurs, des roses sensuelles, des œillets, des narcisses et des giroflées, et de frêles lilas, des lilas d’hiver avec de rares feuillages d’un vert tendre et diaphane. La rue est toute fleurie d’éventaires ambulants de la place et du pont de la Trinité jusqu’au palais Strozzi, paré à la base, comme un reposoir d’enfants, d’une suite de petites choses épanouies et colorées.
Ces fleurs font un contraste curieux avec les grosses pierres grises et massives, avec les contorsions énormes des porte-étendards et des porte-flambeaux de fer forgé scellés dans les murailles. Méfiantes et haineuses, belles quand même, elles laissent filtrer par leurs pores invisibles des siècles de splendeur mal dissimulée sous la façade austère.
C’est encore dimanche, aujourd’hui, et puisque je n’ai pas le courage de quitter de suite ce coin délicieux où Florence vient de se révéler si belle, je ferai mes trop peu ferventes dévotions dans l’église dont le portail modeste resplendit au soleil sur la place étroite où s’élève, en l’honneur de Cosme Ier de Médicis, une colonne de granit enlevée à Rome aux thermes d’Antonin. J’ai honte de me joindre gauchement, dans ma tenue de voyage, aux fidèles pressés contre les grilles de fer noir relevé d’or de la chapelle où le prêtre célèbre la messe. Pas de chaises suivant l’heureuse coutume italienne ; les hommes sont debout, les femmes à genoux sur les dalles. Ils valent bien le sacrifice d’une menue commodité, les groupes charmants disséminés sous la voûte grise, d’où tombent, le long des pilastres et sur les murs, les nobles fresques de Domenico Ghirlandajo, le vieux maître de Michel-Ange, sombres et atténuées, vision lointaine des âges écoulés. Des écus d’une rare sobriété de formes, avec des fonds d’or éveillés sous les lumières, en relèvent la couleur ; ce sont les seules dorures ; tout le reste est demi-teintes, rien ne heurte les regards, tout s’assemble et se confond harmonieusement sous une patine sévère.
Cette chapelle où le hasard m’a conduit est la chapelle Sassetti, et sans peine je lis dans les personnages de Ghirlandajo la Vie de François d’Assise, dont j’aime l’immortelle et naïve figure. Dans l’une des compositions, le saint apparaît au milieu d’un nuage : d’un geste de sa main meurtrie il ressuscite une petite fille assise sur la pierre de son tombeau, les mains jointes, candidement étonnée du réveil merveilleux de sa jeune âme rappelée près de son corps, retour d’un long et surprenant voyage dont sa figure enfantine indique encore les exquises et inattendues visions. Cette scène touchante se passe sur la place même de la Trinité, très reconnaissable et tout imprégnée, comme aujourd’hui, d’une atmosphère délicieusement florentine.
Mes regards sont attirés vers une jeune femme accroupie à deux genoux sur les dalles, un peu devant moi ; je devine sans le voir exactement un profil qui doit être très beau. Auprès d’elle, et s’appuyant de la main droite sur son épaule, si confiant et si tendre que je devine bien qu’elle est sa maman, un joli garçonnet de huit à neuf ans se tient debout, et demeure immobile. La jeune mère a vingt-cinq ans peut-être ; vêtue d’un costume sombre d’une rare élégance, un collet d’astrakan tombe des épaules jusque sur le corsage rouge brique soutaché de passementeries noires répétées en bas sur la jupe de même couleur dont les plis se drapent sur le mouvement de son corps. De temps à autre, sans que l’enfant aille au-devant ou se détourne de son côté, elle prend dans sa main la main du bambin, pour l’assurer qu’elle est bien là, de ce geste plein de sollicitude et d’amour que nos mères nous ont appris, mais plus long encore chez elle et plus tendre. Lui, impassible, laisse se dérouler de sa tête mignonne semblable aux têtes d’enfants de Lucca della Robia, ingénues et charmantes, les lourdes boucles d’une chevelure dont la couleur de cuivre enténébré allume de minces lueurs métalliques et soyeuses sur son large col de guipure ; un petit vêtement de velours noir contenu à la taille dans une ceinture de cuir s’arrête au-dessus des genoux, en même temps que la culotte d’étoffe pareille serrée sur des bas de soie noire où s’enferment de petites jambes nerveuses et bien faites, comme celles de ces pages d’autrefois qui, dans les vieilles peintures, maintiennent avec peine de fins lévriers aussi grands qu’eux-mêmes ; sa main droite ne quitte pas un instant l’épaule maternelle ; sa petite figure est inexpressive, fixée sur un même point vers l’autel. On dirait, lui et sa mère, les enfants de Sassetti et de sa femme, donna Néra, agenouillés devant le Miracle de François d’Assise dans les fresques de Ghirlandajo, qui lentement s’effacent sur les murs des chapelles…
La messe est dite. Un mendiant soulève le lourd matelas de cuir appliqué à la porte ; un rayon de soleil se précipite, tranche net l’ombre tranquille de l’église et s’aplatit sur les dalles en rayonnements qui éclairent les visages en dessous, comme au théâtre devant la rampe. La Florentine passe d’abord, vraiment belle, telle que je me l’étais imaginée ; elle mouille d’eau bénite le front de son fils et commence le signe de la Croix qu’il achève lui-même sur sa poitrine et sur ses épaules où pèsent les soieries de sa chevelure. Les yeux bruns de sa maman ont cette langueur adorable des yeux de créoles, exquisement soulignés et élargis d’un cercle bistré. L’enfant paraît hésiter un instant ; il avance avec un air singulier, appuyé contre sa mère, d’un pas saccadé que n’expliquent pas ses petites jambes très solides ; j’ai peur de deviner quelque chose de terrible. Sa mère glisse dans sa main d’enfant une pièce de monnaie, en la guidant vers la main tendue d’un aveugle. Le soleil tombe droit sur son front pâle, faisant un brasier des cheveux échappés de sa toque noire, sans qu’il détourne la tête comme tout le monde. Je me penche, à peine, sans être remarqué… Oh ! la tristesse de ce que je viens de voir, la tristesse de cette aumône sacrée offerte au vieil aveugle misérable et flétri par les mains élégantes de l’enfant, aveugle aussi !… Et tous deux sont là face à face, sans que l’un et l’autre puissent rien savoir de la navrante communauté de leur malheur… Les yeux bleus du joli garçonnet sont tout troubles ; on dirait deux violettes de Parme très pâles fondues dans le globe des yeux, sous les paupières blanches ourlées de cils très longs et si beaux, couleur de cuivre bruni comme les cheveux…
Je les vois passer, tristes dans le radieux soleil, la mère douloureuse dont je comprends maintenant l’implorante oraison face au miracle du Pauvre d’Assise, et le petit garçon pour qui ne sont point faits l’éblouissement de sa Florence pâmée sous une longue coulée d’azur, ni les flots glauques de l’Arno qui chantonne entre ses vieux quais séculaires, ni Fiésole blanche dans l’émeraude des collines prochaines… Et j’ai la vision de ses pauvres dix-huit ans, plus tard, quand sa jolie figure, mâle déjà, sera plus belle encore sous les boucles coupées de ses cheveux, et fera rêver les filles qu’il ne verra pas lui sourire avec des yeux amoureux et compatissants… Quand leurs lèvres verseront leurs parfums dans ses lèvres à lui, il ne saura pas de quelles fleurs vivantes et désirables émanent ces douceurs… Ils ne peuvent que pleurer, ses pauvres yeux, fleurs mal écloses dans ses paupières blanches. Qu’ils pleurent donc, plus que la lumière à jamais inconnue, plus que Florence, plus que les regards tendres des amantes : sa mère toujours à ses côtés, sa maman dont il ignore la tendre, la douce figure veuve de toutes joies !…
Par le lung’ Arno Acciajoli ils s’éloignent, presque sans parler ; j’ai entendu qu’on l’appelait Pio, le petit aveugle… Puis, je suis resté un moment appuyé sur les balustrades du pont, au-dessus du fleuve, entre des corbeilles d’osier pleines de violettes et de roses ; j’ai fait semblant de regarder l’eau en songeant à de petits yeux qui me sont chers, des yeux rieurs sous des boucles blondes, qui auraient pu, eux aussi, ne pas exister et ne pas voir comme on les aime, si Dieu avait permis que, dans les cils fauves, des fleurs troubles fussent écloses, au lieu des étoiles qu’il y laissa tomber…
Ils devaient me séduire, ces quais appelés ici lung’ Arno, moi dont la joie est la rêverie solitaire entre le pont des Arts et le Pont-Royal sur l’une ou l’autre rive de la Seine, devant mon Paris que j’aime, royalement paré des tours de Notre-Dame, massives, derrière l’aiguille piquée d’or de la Sainte-Chapelle ; mon Paris, vêtu des architectures somptueuses du Louvre espaçant dans la verdure des grands arbres dont les racines baignent dans l’eau, ses statues, ses frises, ses balcons dorés et ses colonnades. Ils sont beaux aussi les quais de Florence, beaux et graves ; et je les foule avec respect, songeant aux ombres inquiètes qui reviennent peut-être, à travers la limpidité des nuits tranquilles, traîner, sur les dalles vibrantes encore du bruit de leurs pas, le suaire impuissant à contenir leur génie, leur grandeur ou leur beauté, quand les heures se répandent dans l’air apaisé et meurtrissent le silence de leur voix implacable…
Aussi m’apparaît-il comme dans un rêve, le Ponte-Vecchio, d’une si surprenante vieillesse, avec ses boutiques étroites suspendues de chaque côté, désagrégées et branlantes, au-dessus du fleuve qui les guette et sent sa proie prochaine. Tant pis ! quand ces rustiques débris d’un autre âge iront se dissoudre dans les flots radoteurs du vieil Arno sur lequel ils se penchent, il n’y aura plus là les spirituels artisans de jadis pour faire des choses les plus prosaïques de petits mondes de poésie imprévue et charmante, et l’on jettera sur l’Arno, comme sur le Tibre, à Rome, la toile d’araignée d’une hideuse ferraille.
Les auvents assombrissent la rue qui se prolonge sur le vieux pont et le traverse ; ils laissent passer de jour juste ce qu’il faut pour allumer des feux dans les perles que vendent les marchands d’orfèvrerie. Il y en a plein des sébiles, des vraies et des fausses ; gemmes précieuses et verroteries de Venise. Elles composent de petites mosaïques de vives couleurs, jetées au hasard, toutes jolies : coraux taillés à facettes ou arrondis et polis, rouges baies d’aubépines et d’églantiers ; opales, cornalines, lapis, agates, porphyres, nacres, turquoises aux blêmes nuances bleues et laiteuses ou tirant sur le vert ; mais plus joli que tout cela, si menu, est le décor de ces constructions rousses, aux larges pans de bois garnis de plâtras entre leurs interstices ; elles regardent, depuis tant de siècles, passer les Florentins élégants dont la finesse de race ne se dément pas. C’est ici que nous avons vu, plus agréables et plus pimpantes qu’à Rome et à Naples, des femmes aux visages très purs, des jeunes filles qui semblent emprunter à la démarche d’une virilité toute neuve et inhabile encore des adolescents, tandis que ceux-ci ont pris d’elles l’ovale parfait du visage, la grâce féminine du sourire et des regards, dépourvus cependant de l’éclat incomparable des yeux napolitains qui sont joie et beauté.
Il a vu passer, le Vieux-Pont, dont chaque pierre effritée et chaque poutre vermoulue concourent à l’harmonieuse vétusté, les orfèvres entre les mains de qui le burin, le ciseau, l’ébauchoir, souvent aussi le pinceau, se disputaient la paternité des œuvres géniales qu’il ne me sera pas permis d’apercevoir toutes dans notre course si rapide. Mais, comme je me les répète, ces noms immortels, accoudé au triptyque du pont, dans cette triple percée de lumière par où s’enfuit, devant et derrière moi, l’indescriptible perspective de l’Arno profondément encaissé dans ses quais rudement et merveilleusement encadrés de maisons semblables à des palais, aux couvertures de tuiles plates, aux étages troués de loggias, avec, çà et là, de grosses tours d’église à l’architecture sévère dont la structure massive se rit de la lourdeur et de l’austérité ! Et quelle veillée, si je puis ainsi parler des quelques moments passés en pleine lumière, quelle préparation avant d’entrer aux Uffizi, ce milieu et ces ressouvenirs de Maîtres que je connais trop peu ou trop mal ! Ils me semblent des dieux créateurs de cette force suave et de cette grâce dont nous sommes encore tout imprégnés, tout haletants, comme si leurs chefs-d’œuvre venaient seulement de voir le jour et nous donnaient la toute première et ineffable impression de souveraine beauté qui dut enchanter les yeux et ravir l’esprit de leurs contemporains. Étoiles de cette voie lactée du génie qui traversa du XIIIe au XVIe siècle le ciel de Florence et de l’Italie, ils avaient à vingt ans les larges envolées vers la splendeur, l’exubérance de la création qui fait l’homme s’élancer de son infinie misère pour atteindre presque jusqu’au divin : ce Ghiberti remportant sur son maître — et quel maître, Brunelleschi ! — la victoire avec sa Porte du Baptistère et travaillant quinze années à la réalisation de cette œuvre devant laquelle s’inclinent les plus grands d’entre nous ; ces habiles fondeurs, ces ciseleurs délicats, manieurs de bronze, de métaux précieux ou d’argile, d’ivoire ou de marbre qu’ils façonnaient et jetaient, matières inertes, toutes vibrantes de leur génie dans ce foyer d’où s’échappent à flots les purs rayonnements de tous les arts : Florence, à qui chaque siècle en passant apporte l’hommage de son admiration et de son étonnement…
Le soleil glisse des faisceaux de lumières par les arcades qui mènent du Vieux-Pont aux Uffizi ; et malgré cette clarté, l’ombre très dense est plus épaisse encore et froide dans le long couloir à l’extrémité duquel apparaît, formidable, le Palazzo-Vecchio. Sa grosse tour se dresse, puissamment armée d’un double rang de créneaux, aussi surprenante par la hardiesse de sa masse élevée en porte-à-faux sur la terrasse du Palais, que par l’élégante pesanteur en laquelle se résume et s’épanouit de saisissante façon le plus beau style florentin, comme si Florence pouvait être, d’un seul bloc, personnifiée dans ce colosse rugueux qui est à la fois sa tête et son cœur.
Un dieu me préserve des importuns, car je suis encore à peu près seul à monter le grand escalier de marbre conduisant au Musée. Tout de suite après la salle où l’on admire le fameux Sanglier, le jour clair que j’avais oublié sous les colonnades sombres d’en bas vient frapper les vitrages, éclairant bien en face les bustes, les tapisseries et les peintures réunis dans la triple galerie développée sur les trois faces du palais.
J’admire l’ordonnance parfaite du Musée. De jolis sièges en X satisfont la fantaisie possible de faire une station devant quelque œuvre préférée. Je passe rapidement, mais je suis si bien seul que c’est un incomparable dédommagement à la trop grande brièveté de ma visite ; je vois mieux ainsi, en silence, comme à Naples, les œuvres choisies auxquelles j’ai décidé d’avance de me consacrer. J’entre à la Tribune, petite pièce octogonale, soignée, coquette et recueillie, véritable sanctuaire privilégié ménagé dans un coin du temple spacieux des Uffizi. Cinq marbres font cercle autour de la salle et laissent voir entre leurs incorruptibles nudités le coloris exquis des toiles dans le rutilement de leurs cadres d’or. À terre, d’épais tapis rouges amortissent le bruit des pas, et il me semble que si je parlais ici ce serait à voix très basse, comme en face d’illustres personnages ; mais je suis absolument seul, enfoncé dans un siège de velours et d’or… Ces détails sur des choses sans aucun rapport avec les peintures ou les sculptures mêmes paraissent superflus ; c’est qu’il n’est pas banal le milieu dans lequel on a su grouper des œuvres ravissantes, épanouies dans l’or et la pourpre de ce tranquille salonnet.
Du geste candide de ses mains, la Vénus de Médicis est impuissante à dissimuler les charmes de son corps frémissant de jeune fille, la robustesse de sa jeune poitrine et la grâce de ses cuisses adorablement effarouchées, ployantes et inquiètes sous le regard de quelque heureux indiscret.
Le Faune joyeux danse comme celui de Naples, et sous ses pieds sortent les gaies chansons d’une outre gonflée d’air.
Une riche floraison de chairs entrelacées, de muscles empoignés et fondus dans la rude étreinte des Lutteurs ; la tiédeur de la peau se communique d’un corps à l’autre ; on songe aux jeux barbares du cirque, aux amis tendrement unis parfois, contraints de lutter jusqu’à la tuerie, et l’on se demande ce que pouvait être l’embrassement de ces deux corps, de ces deux âmes broyées dans le suprême enlacement de la mort.
Aussi charmant que l’Apollon de Tibulle, l’Apollon de la Tribune a les seize ans de son frère de Naples ; et si l’ouvrier sublime dont le ciseau tailla dans le marbre cette fraîche adolescence pouvait entendre un reproche, ce serait assurément pour avoir donné trop de grâce troublante à cet éphèbe joli comme une jolie fille. Il en a presque les formes onduleuses et souples et parfaitement unies, les jambes et les hanches rondes et masculines pourtant, le corps si pudique simplement offert aux regards dans l’éclat de sa triomphante nudité, avec, sur les lèvres, le demi-sourire conscient de cette beauté frêle qui l’a fait surnommer l’Apollino.
Le Saint Jean de Raphaël, c’est Ménalcas, le Ménalcas païen de Virgile, avec ses tendres yeux noirs, fougueux dans son fier visage aux traits virils, où le sang à fleur de chair attiédit le pigment bronzé de la peau ; ses cheveux bruns et bouclés donnent à sa physionomie ce je ne sais quoi de mâle vaillance qui manque si voluptueusement à la douce beauté grecque de l’Apollino. Saint Jean, c’est le beau pâtre joueur de syrinx, nu dans la splendeur des champs napolitains ; et l’on ne voit pas dans ce corps de jeune garçon, où vont éclater brutalement tous les désirs de sa chair ardente et magnifique, le futur ascète du désert ; dans la vigueur prometteuse du gamin de quinze ans, le visage émacié et illuminé du Précurseur.
Quelles courtisanes eurent jamais la carnation radieuse des Vénus du Titien, l’une languissamment couchée sur un lit, l’autre étendue, fine et séduisante, sur une draperie de velours rouge ? De la seule palette du maître coloriste pouvaient naître ces créatures d’une sensuelle et voluptueuse perfection, et son pinceau était digne d’honorer la main d’un empereur à l’égal du sceptre le plus glorieux.
Si charmante, la Vierge au chardonneret, d’un si calme visage de jeune fille pleine de grâce et de pureté, auprès des regards souillés de péchés des femmes du Titien ; c’est à ce joli tableau que je m’arrête avant de quitter la Tribune, tandis que flamboient dans les richesses des cadres ces noms qu’il me faut rapidement saluer d’un regard : le Dominiquin, le Guide, le Pérugin, Mantegna, Andrea del Sarto, Véronèse, Rubens, Albert Dürer, tous, dont les œuvres ont réjoui et contenté tant de regards déjà depuis tant de siècles ; les grands, les illustres dont les pensées sont demeurées là, vivantes, écrites comme dans un livre où viennent lire indistinctement tous les peuples, la langue universelle de l’immortelle et reposante Beauté.
Quelle folie de se hâter, quand à chaque pas se dressent dans la splendeur du marbre ou s’épanouissent dans les couleurs doucement éteintes des vieilles toiles ces figures de rêve qui font, des quelques instants passés à leur contact, des minutes exquises arrachées à la réalité ! Et pourtant je me hâte, laissant un peu de mes regards sur chaque chose, j’allais écrire sur chaque être, car ils me parurent vivre, ces marbres, ces bronzes et ces tableaux, de la vie qu’il ferait bon reprendre belle et désirable et si conforme aux aspirations de tous vers l’Idéal.
En courant, j’aime encore les Anges, les Madones aériennes de cette École toscane que j’ai désiré voir ici, représentée par un si grand nombre d’œuvres précieuses, au milieu de Florence qui surtout en a connu la genèse…
Notre Salle des Primitifs au Louvre s’anime des inspirations de ces Maîtres dont le génie a guidé l’art vers les splendeurs du XVe siècle : Cimabue, Giotto, Benozzo Gozzoli, Ghirlandajo, — Ghirlandajo et sa Visitation du Louvre, — peintres de chairs délicates, de fines et angéliques figures de chérubins serties en des auréoles d’or dans les bois des panneaux ciselés et dorés, au milieu des étoffes impalpables et des dalmatiques ocellées de pierreries, sur des fonds de paysages bleuis comme des visions exquises de célestes campagnes candidement gauches et invraisemblables. On ne les regarde guère ces tendres visages de vierges et d’adolescents conçus dans le goût simple et sévère de la belle École florentine amoureuse de la tendresse, de la grâce et de l’ingénuité, on ne les regarde guère, — ils sont trop près des diamants de la Couronne…
J’ai la vision de cette galerie déserte en voyant le Saint Sébastien du Lombard Giovanni-Antonio Bazzi, semblable à notre Saint Sébastien du Pérugin. Ils sont l’un et l’autre d’une exquise harmonie de formes, celui du Pérugin moins frêle et moins féminin, le visage plus calme sur un corps moins tourmenté ; mais tous deux ont la même attitude, le même raccourci de la tête rejetée en arrière sur les épaules tombantes qui ne sont pas des épaules de colosses, mais de jolies épaules d’enfants presque, aux lignes fragiles et élégantes, et si peu faites pour souffrir !
Bazzi, que j’aimai tant à la Farnésine, a mis dans la figure de son martyr une expression de souffrance profonde et résignée concentrée toute en les larmes douloureuses qui baignent les yeux adorablement beaux du jeune saint ; et cette souffrance si doucement supportée n’enlève rien à l’harmonieuse régularité des traits. Des flèches cruelles déchirent et font saigner sa chair délicate ; son corps s’abandonne, parce qu’il n’est déjà plus de ce monde d’où se détournent ses clairs regards confiants en les promesses d’un ange aux ailes d’or déployées sur sa tête, et dont les mains vont poser sur son front glorieux la couronne d’immatérielles orfèvreries.
La chair du jeune martyr ploie dans le frisson d’une indéfinissable langueur douloureuse et paisible, et peut-être est-il pénétré de délicieuses sensations répandues en son être ravi, extasié et recevant déjà le juste dédommagement de sa peine et du sacrifice accepté de sa jeunesse radieuse.
Je ne connaissais pas ce chef-d’œuvre de Bazzi ; il a fallu que sa lointaine ressemblance avec le panneau du Louvre, que je connais très bien, me frappât et me fît arrêter devant lui. Sur le cadre, j’ai bien lu ce nom : le Sodoma… Au surplus, il est plein de gloire, et j’allais m’étonner de son infamie. Il est plein de la gloire que nous saluons tous quand nous passons émerveillés par ces toiles où l’élégant conteur de la dévotion frivole et des raffinements mondains a laissé le meilleur de lui-même. La légende a menti sans doute en ajoutant à ce nom de Bazzi ce qu’elle crut être une flétrissure. Et l’eût-il méritée, elle n’enlèverait pas un fil de lumière à l’immarcescible pureté de son nom et de son œuvre. Il ne la mérita pas. Il faut laisser aux imbéciles le soin de défigurer des pensées ou des préférences que leur pauvre cerveau, incapable de les apprécier, ramène toujours à la vulgarité pitoyable de leurs sens, quand les sens — avec tout ce que le mot renferme de basse matérialité — ne sont pour rien souvent dans l’impression subie devant la Beauté, d’où qu’elle émane. Ce modèle d’ineffable splendeur dont s’est inspiré le Sodoma, je l’aime, parce que mon âme s’émeut au spectacle enchanteur d’une chose ou d’un être parfaits, quand même cet être parfait devrait se présenter à mes yeux sous les traits, sous les lignes impeccables d’un corps dont ma guenille n’a que faire, mais que mon âme réclame éperdument et que mes yeux contemplent dans l’enchantement, comme ils s’arrêtaient avec complaisance sur les beaux yeux des gamins de Naples et sur la démarche fière des petits ciociari de la place d’Espagne.
Et quand cessera cette confusion de Pharisiens intéressés à détourner d’eux l’anathème ? — Le Sodoma ! — L’histoire d’Athènes n’est qu’une longue exaltation de la Beauté dans la Jeunesse. Athènes fut-elle Sodome !
Certes, Bazzi, sensible comme les Grecs de jadis à cette floraison qu’est l’Adolescence virile, connut la joie de chérir des êtres assez heureux pour inspirer ce Saint Sébastien par exemple. Mais de quelle adroite métaphore user pour faire entendre que dans cette affection, chez certains esprits demeurée aussi vive et nécessaire qu’autrefois, le don de s’émouvoir peut ne s’accoupler pas au forfait de salir ?
Je l’entends ainsi.
Et j’admire en G.-A. Bazzi, sous l’opprobre indifférent du sobriquet, l’artiste qui sut entre Raphaël et Vinci exalter dans un rayonnement immortel le charme sans égal des jeunes hommes, — jusqu’à être victime de son éclat original, de son enthousiasme et de son génie !
Je ne puis m’arracher maintenant aux délices de cette salle de l’École toscane où je retrouve avec joie mes amies aux figures délicates. Voici dans un médaillon une Vierge à l’Enfant Jésus, de Botticelli, absolument semblable à son même tableau du Louvre. Il en aurait donc fait une copie, car les couleurs sont aussi tendres, et il a réalisé dans ce tondo des Uffizi, autant que dans celui de notre grand Musée, le type de l’être humain en qui la chair splendide n’est plus qu’un accessoire. Les cinq anges entourant la Vierge (il y en a quatre seulement au Louvre) touchent à cette légèreté inouïe, à cette immatérialité en laquelle réside encore la splendeur — je ne connais pas d’autre mot et je suis contraint de le répéter — la splendeur charnelle dégagée de toute concupiscence, tellement leurs gestes sont exquis ; mais le doux visage de la Mère de Dieu les surpasse tous en pureté ; il atteint jusqu’au sublime l’expression d’amour infini pour son Fils et d’immense adoration pour l’Enfant divin couché dans son giron ; les mains sont au-dessus de toute expression et sont surpassées encore en délicatesse par la main de l’ange contenant en même temps l’écritoire qu’il maintient et le livre grand ouvert où les doigts fuselés de la Vierge chantent, plutôt qu’ils ne l’écrivent, le Magnificat. Les Vénus de la Tribune sont de pauvres choses comparées à la beauté surnaturelle qui s’exhale de ce tableau. Dans les uns, c’est un étalage indécent de matrones effrontées ; dans l’autre, c’est l’apothéose de la femme avec tout l’éclat, toute la grâce qu’un front pétri de notre chair mortelle est capable de supporter.
Et parmi ces bronzes où la Renaissance païenne entreprit de ressusciter — et fut un moment sur le point d’y parvenir — les chefs-d’œuvre de l’antiquité, je veux m’arrêter un instant devant le David de Verrocchio.
Ah ! la délicieuse fantaisie et le caprice charmant dans la sérénité de l’adolescent, le poignet replié sur le flanc à gauche, et la main droite ferme au pommeau du glaive justicier ! Non, ce n’est pas la noblesse d’un être poussé jusqu’à l’effacement de soi et magnifié dans une quasi-divinité. C’est l’être lui-même. C’est le gamin des rues fringant et batailleur, mais dont les épaules infléchies refuseraient encore la cuirasse de Saül ; dont les reins joueurs ne ceindraient point la pesante épée d’Israël, ni la tête élégante le lourd casque d’airain. Je ne me souviens plus où nous fûmes servis un soir, à dîner, par un jeune drôle de dix-sept ans, aux formes amenuisées, qui cheminait alertement de la table au dressoir. Sa marche accentuait la longueur flexible de ses jambes en train de conquérir la robuste maîtrise des muscles ; un pantalon étroit moulait ses hanches et révélait les ondulations fermes où le dos se retire pour prendre l’élan cambré qui tend les épaules masculines et les bras blancs très souples. Pas homme encore, plus enfant déjà, l’ambiguïté de son doux visage ajoutait à l’indécision de sa beauté. Et la virilité de son corps, pourtant, frémissait d’impatience — d’aimer ou d’être désirée ?… Je pus connaître seulement qu’il était le fils de la maison ; ses yeux noirs étaient d’un père Italien tandis que de sa mère Allemande il tenait la fraîcheur du teint, la rougeur appétissante des lèvres et l’or des cheveux ; le tout patiné de cette morbidesse italienne sans égale, je pense.
Or, des mercenaires allemands jadis passèrent ici ; leurs joies charnelles ont dû laisser à Verrocchio, peut-être, la même grâce attendrie de ce garçon très svelte, très réel et très séduisant…
Le bronze élancé du maître Florentin me fait songer à l’inutile beauté de ce jeune homme, et celui-là me plaît dans la neuve image de celui-ci.
Ce soir dont je parle, j’avais été seul à le considérer.
«… Alors le Philistin regarda, et vit David, et le méprisa ; car c’était un jeune homme, blond et beau de visage. » (I Samuel, xvii, 42, 43).
En sortant du Musée, tout de suite, cette merveille : la Loggia de’ Lanzi, aérienne, sévère et légère. Une terrasse repose sur des arceaux à plein cintre dont la hardiesse et la nouveauté étonnèrent Florence, — à peine appuyés sur de frêles colonnes. De l’air tout autour, de l’air qui frisonne dans les fraîcheurs apportées des longues galeries sombres des Uffizi ; qui frisonne et voltige, plein de rayons de soleil, caresse les bronzes et les marbres, continue, achève son travail régulier, l’œuvre entreprise de vêtir d’une chaude caducité les groupes superbement nus, dans la lumière de cette place della Signoria, mêlant leurs corps et leurs haleines presque, aux buées que font les lèvres des gens qui passent dans la claire et fraîche journée de janvier.
En face, le Palais-Vieux, élégant aussi sur ses rudes assises, élégant dans ses murailles fauves à peine interrompues par de rares ouvertures, mais parées, dans la bure qui leur va comme un manteau royal, de larges écussons dorés et enluminés de belles couleurs héraldiques, si simples et si justement serties là dans les échancrures des mâchicoulis, non pas pour en atténuer la sévérité, il n’y a rien à atténuer ici, tout est la perfection même, mais pour ajouter plutôt une coquetterie, un semblant de joyaux et d’orfèvreries sur les grosses pierres irrégulières qui bossèlent la façade. La tour jaillit d’entre les créneaux et jette dans l’azur trois cents pieds de fière et mâle et majestueuse architecture.
Je l’ai déjà dit, c’est toute Florence, ses arts, sa beauté, sa force, la force méchante et formidable de ses luttes municipales, les déchirements de ces deux factions, dont les noms jettent à travers les siècles un bruit de trompettes, un choc d’armures, un cliquetis de dagues : les Gibelins et les Guelfes ; c’est aussi la grâce rayonnante et survivante de ses élégances finies, résumées dans la silhouette de cette chose colossale sur laquelle se joue la lumière éclatante et s’incrustent profondément les ombres sévères : la Tour du Palais-Vieux.
Sur la cour, une lame d’or tombe lugubre comme au fond d’un puits et souligne de cernes noirs les sculptures délicates en les colonnes massives ; elle se répand sur les dalles, glisse avec peine sous les galeries où flottent des voiles grisâtres et les morceaux d’étoffe des fresques dans lesquels devaient très bien s’envelopper autrefois les durs visages et les costumes aux pittoresques arrangements des reîtres et des lansquenets allemands. Et la jolie fontaine avec l’Enfant au Poisson, de Verrocchio, n’arrive pas à dissiper l’austérité froide, et empoignante cependant, de tout cela.
Maintenant, pour gagner les terrasses, ce sont des couloirs bas qu’il faut traverser, des escaliers étroits tout à coup arrêtés net sur des paliers où s’ouvrent trois ou quatre portes grillagées et bardées de fer ; le plus souvent tout est noir derrière les barreaux, c’est quelque horrible in pace ; d’autres fois, au contraire, les murs renvoient les miroitements du soleil qui vient, comme un fou, se jeter sur elles par des ouvertures profondément taraudées dans les murs. On monte et l’on redescend pour remonter encore et traverser des trous de taupes qui tournent, forés dans l’épaisseur de la muraille. Mon guide me remet entre les mains d’un vieil homme occupé, dans un singulier atelier encombré de plâtres et de moulages, à modeler dans la glaise d’énormes feuillages gras et gris qu’il abandonne aussitôt pour m’accompagner. Il va être obligé de gravir avec moi quinze étages ; et ses pauvres jambes tremblent déjà sur les marches raides du campanile. Son bon sourire de vieil artiste à la figure intelligente semble vouloir faire excuser cet accouplement bizarre du sculpteur au gardien de monument.
— Mais la sculpture ne rapporte guère, les arts sont dans le marasme, il faut bien manger, n’est-ce pas, monsieur ?…
Et le vieux bonhomme a, malgré tout, quelque joie, je le sens, à guider les étrangers dans cette ascension. Il escompte, et il a raison, le cri d’étonnement qui se traduira en un menu billet de banque, le cri d’étonnement qui va s’échapper comme un hymne quintessencié à la gloire de Florence superbe et figée dans une auréole de lumière, sous les tuiles rousses, dans l’envolée de ses dômes, de ses tours et de ses campaniles, fièrement assise, la cité glorieuse, au fond des collines bleutées dont les crêtes pâlissent sous de neigeux éblouissements, tandis qu’à leurs pieds se reposent dans la verdure des oliviers, des vignes et des ormeaux, les villes et les villages tributaires de sa gloire, splendides de sa splendeur, rayonnants du tranquille et souverain rayonnement de sa beauté…
Au sommet extrême, la girouette, faite d’un énorme lion de bronze grince sous la poussée du vent. Il a fallu grimper les degrés de fer enroulés autour de l’un des quatre gros piliers du faîte, suspendus dans le vide ; et l’on frissonne, moins encore du vertige vaincu que de l’ineffable grandeur de cette vision, de cette longue théorie de palais pressés sur les rives de l’Arno, dont scintille entre les ponts la suite des plaquettes de cristal déchiquetées çà et là par l’ombre des maisons.
Très près de nous, le Campanile de Giotto revêtu de fine marquetterie de marbres rares, et le dôme immense de Sainte-Marie-des-Fleurs colossalement rebondi sous les pans de tuiles retombant chacun sur un œil-de-bœuf profondément fraisé dans les murs ; autour se groupent d’autres dômes agrafés sur le bariolage des marbres ; et le grand vaisseau de l’église s’avance, le Campanile à son côté, vers le Baptistère Saint-Jean que Dante aimait :
Ce qui est infiniment gracieux, c’est le semis de villas enfouies dans la verdure des collines ; leurs façades blanches et brillantes de soleil, découpées dans le bleu du ciel, sont tachées des ombres des portiques et des loggias. Les longs cyprès noirs sont piqués dans de clairs feuillages qui résistent à l’hiver ; et là, sur la rive gauche de l’Arno, de l’autre côté, dominant les masses puissantes du palais Pitti, une silhouette prodigieuse, une seule, d’un pin parasol géant et roux. Tout cela est d’une tournure, d’un arrangement vraiment italien, vraiment exquis, plus : florentin, c’est-à-dire d’une perfection telle que l’on n’imagine aucune chose plus belle et plus fastueuse, et que les yeux se laissent émerveiller, bercés sans secousse, comme en bas dans le Musée devant les toiles merveilleuses. Le corps est anéanti, supprimé ; l’âme subsiste seule, rêveuse, flottante de l’une à l’autre de cette campagne à cette ville, rassasiée d’idéal et de beauté.
En redescendant, le vieux sculpteur me fait voir un étroit caveau où deux personnes au plus pourraient s’asseoir sur deux banquettes de pierre ; il est vrai qu’il est magnifiquement éclairé, presque au sommet de la tour, à côté d’un petit escalier sur lequel il s’ouvre sans palier, à même les marches :
— Jérôme Savonarole est resté là quelques heures.
Et cela me fait frissonner d’entendre, au-dessus de Florence que je domine tout entière, ce nom auquel je ne songeais pas, jeté presque mystérieusement par le vieil artiste au moment précis où le palais s’ébranle sous les douze coups de midi. Les cloches de la ville semblent leur répondre comme à un appel de tocsin. Les vibrations des bronzes se heurtent aux parois de pierre. La tour monstrueuse en est tremblante de surprise. Pendant un temps encore, des clameurs métalliques descendent et lentement se répercutent dans les rues bleues…
Jérôme Savonarole, le couvent de Saint-Marc, les prédications à Sainte-Marie-des-Fleurs, la révolte, les visages glabres des moines ses frères, Benedetto le Peintre, dominicain batailleur ; Baldo Inghirami, docteur ès lois ; Francesco Davanzati ; la proscription, les tortures ; et celui-là — Borgia — et le supplice final en bas, sur la place où je redescends, le supplice dans une belle journée de mai, sous le beau soleil le même qui brille en ce moment ; les flammes du bûcher tourbillonnant monstrueuses et goulues autour de la frêle enveloppe du grand cerveau qu’elles allaient consumer : Jérôme Savonarole !… des fumées léchant ces murailles où je m’appuie, collant sur elles un peu de son être, des vapeurs de son sang, apportant les derniers râles de ses lèvres éloquentes, criant, angoissées, à travers les braises ardentes : Ah ! Florence, que fais-tu aujourd’hui !… tandis que tombaient, funèbres, les mêmes marteaux sur les mêmes bronzes qui viennent de carillonner tout à l’heure. Carillons de joie, carillons d’effroi, carillons de crime, ils tombent toujours semblables, depuis des siècles, sur Florence qui doucement s’achemine aussi vers la fin commune… Le vieil Arno roule dans son lit presque sec, entre les sables d’or rouge qui rouillent ses eaux vertes, les cendres de Savonarole, comme la Seine, là-bas à Rouen, caresse de son flot royal les virginales poussières de la Pucelle. Et, autant que la survivance d’une poudre inerte puisse être de quelque intérêt quand l’esprit s’en est allé, — quelle revanche du Destin, la dispersion totale de ce qui fut, chez le Borgia bourreau de Savonarole, un corps esclave souillé d’une âme dont l’inconscience n’excuse ni l’abjection ni la cruauté !
En vain on a fouillé les sarcophages ! Nulle trace au monde ne demeure de ce Pontife simoniaque. Alexandre VI Borgia n’est plus. Nulle trace ne subsiste aussi de Lucrèce, fille du tortionnaire obscène, et sœur du fratricide élégant César Borgia, qui lui-même n’a rien laissé d’une dépouille autrefois jetée outrageusement à l’indifférence des vents.
Dans quelles tempêtes se rencontrent à nouveau ces atomes dissociés, — dans quelle existence paisible, en quelle exquise créature, dans quels yeux charmeurs, sur quelles lèvres délicieuses ? — puisque rien ne s’anéantit à jamais et que les Forces de la nature se récupèrent dans les plus abominables corruptions ?…
Avant de descendre, je regarde le couvent de Saint-Marc, de l’autre côté du Dôme, et je vois aussi, dans ce même couvent de moines batailleurs, la simplicité candide de Fra Angelico, peintre de vierges suaves, harmonieux créateur de Mages adorateurs, et d’archanges immatériels annonçant à la Vierge tremblante qu’elle sera la Mère du Sauveur.
Après midi, une paire de bons petits chevaux nous font traverser l’Arno, et par des ruelles et des places charmantes, doucement, au petit trot, nous emmènent vers le palais Pitti. À droite et à gauche, sur notre route, ce sont des restes d’architectures anciennes enchâssés dans des constructions récentes. Très habilement, l’adroite simplicité des façades neuves se marie à l’exacte simplicité de jadis ; rien en tout cela ne jure ; il n’est presque à aucun endroit du chemin aucun accroc fait au bon goût ; on sent que des architectes, des artisans peut-être, que dis-je, des maçons intelligents se sont appliqués à suivre pieusement les traditions des ancêtres glorieux ; ce sont dans les moindres pans de murs, dans les encoignures les plus ignorées, des petits chefs-d’œuvre de sculpture : chapelle minuscule ou tabernacle de pierre où l’on déposait autrefois, en temps de peste, les images saintes et l’Hostie elle-même. Et, quand au soleil se tendent sur les murs, comme des lambeaux de tapisseries, les couleurs attendries d’un fragment de peinture, fresque naïve à demi effacée, dans un éclair passent devant mes yeux les siècles de splendeur…
Le coup est imprévu, que reçoivent les regards à la vue des roches cyclopéennes dans lesquelles on a taillé le palais Pitti. La tête pleine encore des efforts issus des créneaux guelfes et gibelins du Palazzo Vecchio pour se rendre formidables, on est surpris pourtant devant l’ampleur monstrueuse de ce palais-ci. Les assises des deux terrasses qui s’avancent sur la route et la surplombent sont faites de blocs tels qu’ils rivalisent, je pense, avec les matériaux des temples de la Haute-Égypte et ceux de Baal-Beck dans les plaines bibliques de la Palestine, fameux par les dimensions que nous ne concevons plus guère et que nos puissants leviers ne pourraient mouvoir.
Un banquier traficant d’or, de soieries, d’épices et de teintures précieuses, un marchand, Luca Pitti fit commencer ce palais, rêve d’un petit-fils des Pharaons. Et l’on comprend, en face d’un pareil document, ce que pouvait être la puissance de ces marchands dont furent les Médicis qui donnèrent au palais Pitti sa définitive et grandiose allure. Ces Médicis forts, pendant trois siècles, comme une lignée, comme une dynastie royale, tinrent dans leurs mains ce joyau dont l’éclat ne se mésalliait pas aux magnificences de tels maîtres : Florence haletante, assoiffée de grandeurs, bonne, méchante, ingrate, paisible, sanguinaire, se déchirant les flancs, accueillant les proscrits, proscrivant tous les siens, mais belle toujours, du Médicis surnommé le Père de la Patrie, Cosme, jusqu’au Médicis Magnifique ; depuis le Médicis, cardinal adolescent aux frêles épaules ployant sous la pourpre romaine, enfant délicat et raffiné dont le souvenir allait jaillir à travers les siècles et jeter sur l’humanité entière et sur la Papauté le rayonnement superbe de ce nom : Léon X, jusqu’à l’efféminé Lorenzo, Lorenzino, Lorenzaccio !… pâle et rude, languissant et brave, éphèbe vicieux dont l’esprit étrange se berçait déjà en des rêves immenses d’affranchissement et de liberté…
Des hautes fenêtres du palais Pitti, Florence apparaît ; bien plus la Florence d’autrefois, vers laquelle l’esprit rétrograde, — ou plutôt la seule qu’il aperçoit comme s’il n’avait jamais connu que celle-là, — que la Florence moderne, si jolie cependant. Mais c’est un des charmes exquis de cette ville de faire revivre naturellement, sans effort, l’existence radieuse de jadis.
Les regards détachés avec peine des lignes harmonieuses de Florence apaisent les regrets qu’ils éprouvent sur cette autre harmonie et sur ces autres lignes où resplendissent aussi la beauté des siècles qui ne sont plus, les rêves fugitifs des Maîtres et la grâce survivante des modèles fixée à jamais sur les toiles de la galerie Pitti.
Auprès de moi, la lumière se répand et se fige dans les fines ciselures et les ors dont s’auréolent les personnages fluides de Fra Angelico et de Filippo Lippi. Les panneaux de bois ont été approchés sur des chevalets, seuls, près des larges baies d’où tombe le grand jour. Devant toutes les fenêtres, d’ailleurs, dans l’encadrement des murs épais, c’est une sélection des œuvres les plus achevées que l’on a la joie de manier sur leurs montures mobiles et d’offrir, suivant son caprice, au jour cru, au demi-jour, à l’obscurité presque, pour la seule fantaisie de voir rayonner ou s’éteindre les tons délicats des tuniques orfévrées et gemmées, et resplendir dans la lumière ou se pâmer dans le clair-obscur les séduisantes et poétiques figures de Sandro Botticelli.
La Vierge à la Chaise, à gauche de cette grande porte ouverte, comme sur une apothéose calme et sans fin, sur ce qu’il a de plus exquis et de plus beau parmi les créatures, parmi leurs visages affinés, peints, recréés par des mains divinement semblables aux mains de Dieu !
Je pense aux mains de Raphaël, à ses mains de jeune homme, pleines de juvénile enthousiasme ; je pense à ses yeux, à ses beaux yeux d’enfant rêveur, à ses yeux de seize ans, de vingt ans, débordants de la fraîche et neuve éclosion de son génie, tout ensoleillés, mouillés, éblouissants du charme frais éclos de son talent, — et je regarde sourire tendrement la Vierge, sa Vierge, câlinant de ses bras et de ses mains augustes le corps sacré de l’Enfantelet qui, Dieu, ne pouvait demander à l’argile misérable dont il pétrit nos corps, plus de sourire et de beauté, plus de divine humanité… Et contre la bordure du tableau je pose mes doigts, je le fais mouvoir sur les charnières qui le retiennent à la muraille et, lentement, à la pleine lumière, j’offre l’étreinte exquise et simplement maternelle de la Mère et de son Fils…
À peine ai-je un regard pour les autres toiles quand il faudrait une extase pour chacune. Mais le temps s’enfuit, qui vous arrache quand même aux joies immenses d’ici. Et tandis que les rares visiteurs s’écoulent par les belles portes de marbre et de boiseries dorées, j’arrête devant le Saint Jean d’Andrea del Sarto, André le fils du tailleur, les regards que vainement, hélas ! j’aurai promenés si vite dans ces salons merveilleux où il n’est pas, sur la bordure d’or des tableaux, un nom qui ne resplendisse d’immortelle gloire.
Le Saint Jean, adolescent dont le jeune corps posé de si naturelle et charmante façon est le rameau nécessaire, la tige vigoureuse d’où s’élève, épanouie, la tendre floraison du visage d’une si tranquille harmonie ; oh ! les grands yeux noirs et profonds cueillis peut-être dans quelque immonde vicolo napolitain ; les boucles vagabondes de la splendide chevelure ; et la bouche à la fois impérieuse et aimante, et toute cette chair dont le coloris patiné par les siècles est bruni comme les membres d’un rude gars parfaitement beau, robuste et plein de santé. Andrea del Sarto en a noyé les contours dans l’imprécision molle d’une obscurité voulue dont s’empare et se modèle davantage encore jusqu’au plus petit détail de cette figure vraiment jeune, radieuse et belle, de ce corps pareil au torse nu d’un pâtre latin, vigoureux et sensuel.
C’est d’un coin du jardin Boboli que nous venons d’avoir sur Florence la plus exquise vision ; vision classique d’ailleurs, dont l’exactitude me ravit et que je retrouve avec joie comme tant d’autres choses jamais vues autrement qu’en les multiples images qui en ont été faites, ou comme certaines autres devinées à l’avance et contemplées sans étonnement, sinon sans admiration, parce qu’il me semble, en effet, qu’elles ne pouvaient être que conformes au rêve en lequel, dans ma pensée, se dessinaient leurs silhouettes aimées. Du jardin Boboli, c’est une apparition de Florence demi-voilée par les hautes guipures des grands arbres, charmante, avec cette grâce coquette et voluptueuse d’une beauté qui dérobe aux regards une partie de ses attraits et ne laisse voir qu’à travers la diaphanéité d’une étoffe légère, les lignes sveltes, les fins contours qui savent, ensorceleurs, goutte à goutte verser dans l’âme ce philtre d’amour : le malaise du désir.
La merveilleuse promenade du Viale dei Colli, où nous arrivons par la via et la Porta Romana, achève l’impression de splendeur immense qui, partout et de quelque point qu’elle s’offre à la vue, enveloppe Florence. Seulement ce n’est plus ici, apparu au sommet de la tour du Palais-Vieux, un écrasement des coupoles posées sur les toits rouges des maisons, un plan en demi-relief, pourtant si joli avec les sillons des ruelles bleues d’où s’élevait ce matin la rumeur confuse et monotone d’une chanson lointaine, c’est Florence toute en profils, Florence toute en lignes pures, j’allais écrire chastes ; elle me parut ainsi, belle et pudique à ce moment comme une moniale. La volupté de tout à l’heure, au palais Pitti, s’en est allée parmi l’odeur flottante des buis âcres et les aromes balsamiques des cyprès qui balancent leurs quenouilles noires avec la tranquillité mystique et silencieuse des arbres dans les jardins d’un cloître…
Nous approchons de San Miniato par des routes unies bordées de villas somptueuses dont les façades claires luisent entre les verdures des parcs. Autrefois la vue devait être toute semblable sur Florence immobile, telle que nous la voyons en ce moment, non pas sous la houle tumultueuse des villes ordinaires, mais comme une assemblée très sage de vieilles maisons de haut style, de palais anciens, de chapelles et de basiliques réunis avec déférence à l’ombre de ces deux grandes aînées, l’antique Seigneurie et l’église de Sainte-Marie-des-Fleurs : le bouclier et la branche d’olivier.
Il faut passer sans arrêt au pied de San Miniato où j’aurais aimé suivre Dante Alighieri qui venait d’y entrer, me semblait-il, à l’instant, sous mes yeux. Je me plaisais à me donner l’illusion de le rencontrer là, il y a quelques minutes, sur le chemin ; voûté légèrement, il allait avec son visage austère percé d’yeux rêveurs égarés sur Florence ; le vent frais agitait sur sa tête au profil d’aigle les feuillages de sa couronne de lauriers ; et quand il marchait, j’entendais le froufrou de l’étoffe lourde de sa robe aux rudes plis ; il suivait le bord de la route, sans bruit, penché sur le gouffre d’air limpide d’où jaillit Florence dorée, grise et bleue, ainsi qu’une oasis de fraîcheur et de beauté qui s’offrait toute à celui qui revient de l’Enfer…
Et Florence s’étend là, tellement éblouissante ! infiniment belle et harmonieuse, telle que nous ne devons plus la revoir, rigide en ses somptueux vêtements de pierre brodés de souvenirs augustes, avec, élevées en panaches incomparables, les aigrettes massives de ses campaniles. Le soleil rougeoie sur les plaines toscanes, et dore le côté du levant de teintes qui ruissellent sur les coteaux d’émeraudes et d’opales d’où s’écoule l’Arno qui, à nos pieds, roule des eaux mêlées de paillettes incandescentes frétillantes comme une danse d’étoiles. Et, baignée dans cette lumière d’une extraordinaire intensité, Florence reste grise, d’un joli gris roux de bure qui heureusement habille les silhouettes graves ourlées d’or de ses beautés architecturales, ourlées d’or et d’une expression religieuse incomparable, me sembla-t-il, puisqu’il me vint la pensée que ces ourlets lumineux que fait le soleil sont autant d’auréoles, des nimbes d’ostensoirs, des halos de gloire autour de chacune des beautés paisibles et accueillantes de la cité florentine.
Oh ! ce vagabondage par les lung’ Arno Serristori et Torrigiani jusqu’au Ponte Vecchio, dans l’après-midi, sous un ciel de trois heures qui vient de laisser passer la plénitude de son resplendissement et, mélancolique, va se voiler, tout à l’heure, — quand nous arriverons par de vieilles rues charmantes de pittoresque et de remue-ménage, devant Sainte-Marie-des-Fleurs, — de buées fauves et veloutées, comme l’haleine de ces vieux et chers monuments, comme les palpables émanations des blocs aux énormes bossuages, des marbres précieusement travaillés, sur quoi va passer encore, inexorable, la quotidienne étreinte du soir après la fièvre du jour.
Sainte-Marie-des-Fleurs ; la Tour de Giotto ; le Baptistère ; la Loggia del Bigallo, timide, petite et si fière quand même, devant ces trois merveilles.
Cet appareillage est rude et massif, mais en même temps délicieux aussi ; il reste dans la frivolité de ces marbres finement assemblés sur la Campanile toute la jeunesse et la beauté de Giotto le pâtre… Un gamin vient de passer, il avait une jolie tête ronde perdue dans les boucles noires, légères et folles de sa chevelure ; ses grands yeux expressifs étaient remplis d’une grave et tendre sérénité et d’une sorte de recueillement que rendaient plus calme encore, plus étrange sur un si frêle visage, des paupières bordées de longs cils qui, tombant avec lenteur sur les yeux, répandaient sur les lignes pures de ses joues de grandes ombres violettes, fraîches comme les buées de l’aube à peine éveillée ; ses lèvres étaient extrêmement fines, rouges et mouillées ; le menton s’enfuyait sous elles dans un sourire, spirituel comme un trait d’esprit permanent, et pourtant on eût dit qu’il achevait le profil prématurément grave d’un César adolescent… Je l’ai remarqué, ce jeune homme, là, devant le Baptistère ; et le rapprochement s’est fait tout seul en moi, entre Giotto et lui ; et j’ai bien regardé cette jeune figure délicate et pensive, en songeant que, sans doute, sous un front pareil, puisque Giotto avait aussi la beauté surprenante d’un jeune dieu, s’agitait en celui-ci le chaos magnifique des porphyres et des marbres qu’il devait lancer en plein ciel de Florence, en plein azur, dans la vibrante et lumineuse atmosphère qui l’enivrait en montant de la ville jusqu’à lui, quand, sur les montagnes voisines, il allait, paissant ses brebis, ses chèvres et ses boucs, les lèvres pleines des chansons de sa flûte, et son joli front d’enfant couvert d’un manteau de laine, débordant des rêves de splendeur qu’essayaient de fixer déjà ses mains habiles de petit berger…
Sainte-Marie-des-Fleurs est étrange : on franchit le seuil, fermant les yeux d’avance aux éblouissements que fait espérer la splendeur du dehors ; puis, les yeux ouverts, c’est une chute douloureuse dans le noir. L’immense basilique s’étend, plane et vaste, avec des lointains d’obscurité saisissante après le grand jour aveuglant de la rue. Les rares colonnes s’écartent violemment sous la poussée des ogives monstrueuses, dont les sommets se perdent en s’effaçant sous les voûtes teintes d’argile. C’est un délabrement de champ de bataille, toutes luttes terminées, un champ de bataille aux prises avec les premiers envahissements des ténèbres, dont le silence serait aggravé d’un lent essor de râles. C’est vide tellement que les yeux contemplent dilatés, hagards, l’immense solitude, le grand désert de pierres où danse le vertige…
Un pauvre vieux qui, après mille ruses et malgré nos refus, est parvenu à s’emparer de nous, m’offre de me guider et me demande si j’aime les arts. Et j’ai presque envie de rire de l’ironie puissante de cette question, ici, dans ce temple aux murailles de plomb élevé à la gloire du Néant ; ce temple où glisse en tous sens un courant d’air d’outre-tombe, où ne tremble la lueur d’aucune veilleuse, où les vitraux eux-mêmes, en partie, sont faits de lames métalliques impénétrables contre lesquelles vainement se heurte la lumière ; ce temple, cour d’assises effroyable préparée pour un horrifiant Jugement Dernier… Et le vieux bonhomme découvre pour moi, en effet, une Pietà de Michel-Ange enfouie dans l’ombre, derrière le maître-autel : affaissement de chairs agonisantes, meurtries et pâles avec ces patines de vieux marbres enfermés et frôlés sans cesse, qui mettent un semblant de vie à fleur de peau, une matité de cire si bien appropriée aux traits endoloris de la Vierge, au corps exsangue du Crucifié ; et puis c’est encore l’Ascension de Lucca della Robbia, les monuments de Giotto et de Brunelleschi. Et comme je m’étonne de la parcimonieuse distribution des œuvres d’art ensevelies ici, le vieux guide m’entraîne dans une profondeur de chapelle d’où, des groupes éparpillés à la surface du sol, au ras des dalles, filtrent ces rumeurs que j’avais prises, dès l’entrée, pour des râles :
— La façade, signor, dit-il en son mauvais langage, il est splendide, il est le symbole de l’Église triomphante ; ici, le dedans, il est l’Église militante.
Militante !… Comme ce matin au Palais-Vieux, à ce seul mot du guide revit le souvenir du dominicain révolté ; et les gémissantes prières, là-bas, m’arrivent comme un écho très faible de sa voix, de la voix que les murailles frissonnantes ne peuvent s’empêcher de répéter dès qu’elles en ont été fouettées. Dans cette église, dépouillée et farouche comme une forteresse, c’était autrefois l’incessante veillée des armes, en effet ! Quelle figure devait être ce Savonarole enveloppé dans les plis amples de sa robe de laine blanche coupée par le scapulaire noir ! Quelle figure, et de quelle grandeur tragique elle se montrait dans la grisaille nue et froide de ces murs, quand sa bouche ardente sonnait sur les multitudes, comme un tocsin, le glas de la foi agonisante ! Et quel cadre, cette cathédrale, aux anathèmes du moine flagellant la lâcheté de ses frères aveulis par les courtisanes ! Éloquence sacrée à qui Florence, ranimée à ce souffle puissant, dut l’essor revivifié de ses lettres et de ses arts définitivement guidés vers les plus suaves et les plus intenses manifestations de la Beauté unie à la Pureté. Alors Savonarole marche au milieu de cette phalange aux noms glorieux parmi les plus glorieux dont s’enorgueillit l’auguste pléiade italienne : Fra Bartolomeo, les Della Robbia, Lorenzo di Credi, Pollaiuolo, Sandro Botticelli, puis Raphaël qui plus tard devait rappeler, dans sa Dispute du Saint-Sacrement, que son cœur d’enfant s’était enflammé aux ardentes paroles du dominicain ; enfin Michel-Ange dont l’admirable vieillesse garda pieusement le souvenir lointain du grand ami disparu, de ses gestes même et des éclats de voix qui vibrent encore dans le vaisseau colossal et sous la coupole de Brunelleschi !…
J’aime maintenant leur rigidité de cloître, à ces murs tout frémissants ; j’aime leur mâle et robuste beauté, les lignes sobres et rudes des ogives et la teinte lugubre dont elles sont revêtues ainsi qu’en d’éternelles funérailles. Plutôt que les notes joyeuses des hymnes de triomphe, je voudrais entendre là, étouffées sous le poids des voûtes, les psalmodies attristées des Lamentations, avec, entre chaque sanglot, le lent soupir des lettres hébraïques ; je voudrais sentir les douleurs du Miserere se tordre autour des hautes colonnes droites et inflexibles comme des juges ; et le Dies iræ inquiet, fiévreux, magnifique et blême d’effroi, se soulever en vain et traîner ses hoquets sur les dalles glacées comme la Mort, pour rebondir jusqu’au sommet des coupoles dans l’ineffable Pie Jesu, envolée céleste d’espoir qu’arrache à nos cœurs, pour le porter jusqu’à Dieu, la voix réconfortante et pure d’un enfant…
Et voilà que je ressens toute la grandeur et toute la force de cette architecture d’une émouvante et hautaine simplicité, et que j’ai peine à concevoir la volupté sacrilège, la parade inutile des porphyres, des agates, des jaspes et des ors !… Pourtant j’aime bien l’Annunziata de Gênes et l’amoncellement de gemmes de San Martino debout sur le golfe de Naples et, dans la Basilique Vaticane, au milieu de la symphonie formidable des brèches rarissimes, le rococo solennel du Tombeau des Stuarts, grave et touchant avec ses deux génies modelés dans un marbre doux et tiède comme de la chair, et beaux par la religieuse sensualité des dieux nus sous les caresses du ciel d’Ionie.
C’est vrai que j’aime tout cela contre quoi, dans les églises, vient se meurtrir la prière anémiée, la prière pâle et troublée qui ne trouve plus le chemin de Dieu et s’arrête, prise aux filets des sens, aux frôlements sournois, aux charmes païens des statues ; je sais que c’est mal, mais j’aime quand même et ne puis me défendre de cet amour qui, dans Sainte-Marie-des-Fleurs, se glace et meurt au contact de l’austérité et du silence. Rien dans les courbes sereines des voûtes ne cache Dieu à l’âme ; l’oraison s’élève d’un seul jet, pure, svelte comme la tige d’un lis et s’épanouit En-Haut comme les calices immaculés des fleurs étincelantes sous la fine poussière d’or des pollens. Sainte-Marie-des-Fleurs est chaste comme la robe de bure d’une Carmélite ; elle contient la grandeur souveraine des renoncements éternels !…
Et sous l’écrasement des dômes aux tuiles fauves illuminées de l’éclat mourant du jour, c’est la magnificence des marbres qui surprend alors, après les ténèbres mortuaires des nefs brumeuses et infinies ; et la rue semble une résurrection, une reprise étincelante de la vie sur le néant et sur la mort.
Devant le portail où danse la sarabande effrénée des marbres polychromes, le Baptistère encadre modestement, dans une ordinaire teinte grise de pierres simplement appareillées, la Porte de Bronze de Lorenzo Ghiberti. Nous l’avions entrevue tout à l’heure avant d’entrer au Dôme ; nous la revoyons, longuement, repliée sous une grille protectrice qui met hors d’atteinte la menue fragilité de tout son petit peuple de statuettes, le fourmillement des centaines de personnages ciselés sur chacun des panneaux enfouis eux-mêmes dans les bordures de rinceaux, de feuillages et de figures d’une élégance raffinée. La moindre composition, le groupe le plus inaperçu est traité avec une délicatesse invraisemblable d’objet d’art, d’orfèvrerie finie et fouillée, comme s’ils étaient, ces groupes ou ces petits personnages, destinés aux mêmes caresses des doigts et des yeux, aux mêmes attentions incessantes que les bronzes qui décorent et embellissent l’intimité de nos intérieurs, posés sur une console, une table de travail, une cheminée… Seulement, ici, chaque personnage est une statuette incomparable et chacune de ces statuettes concourt à l’ensemble le plus exquis, le plus complet qu’ait jamais offert, avec ses couleurs chatoyantes, le tableau le plus séduisant.
Dessinées avec une extrême recherche, dans un relief imperceptible, les architectures font à ces tableaux de bronze, aux patines d’un poli délicat, des perspectives d’une richesse et d’une précision de détails absolument inouïes. Les attitudes du peuple minuscule pressé contre les parois de bronze de cette porte sont d’une sveltesse toute pleine de radieuse jeunesse ; les vêtements drapés avec une grâce antique découvrent des nus du plus merveilleux dessin, du modelé le plus chaud et le plus serré ; petites créatures charmantes qui font la joie des yeux attentifs aux séductions de leur pure beauté. J’ai peur d’avoir mal parlé de cette œuvre devant laquelle j’étais resté en une muette et religieuse admiration, stupéfait de la puissance géniale du sculpteur qui unit avec une aisance aussi parfaite la conception formidable de ces tableaux de bronze, à l’exécution savante, large, amoureuse et harmonieuse dont se sont tellement éloignées, depuis, les œuvres italiennes modernes aux grâces énervantes et mignardes.
La Loggia del Bigallo, c’est, plus encore que la Loggia de Lanzi, un peu de l’intimité de Florence libéralement offerte au passant. Ce n’est pas le seuil qu’il faut franchir pour aller ailleurs, au fond d’un palais, d’une basilique ; c’est un tout bien entier, bien complet que les yeux embrassent immédiatement sans effort. Est-ce un parloir, une chapelle ? peut-être une chapelle, avec les fresques effacées et les trois niches légères qui abritent des saints, dans l’ombre du large toit, en auvent sur la rue, suspendu par des poutrelles peintes et sculptées d’un bien joli détail dans l’ensemble de la charpente apparue sous les tuiles. Une porte basse s’ouvre sous l’image accueillante d’une Vierge éclairée le soir par une frêle veilleuse.
Je me suis plu à trouver à cela une séduction d’alcôve, d’alcôve parée, comme un tabernacle, de fines orfèvreries ciselées dans la pierre. Il y a, pour fermer les baies au plein cintre d’une aimable et spirituelle renaissance florentine, des grillages d’un ravissant travail, hauts seulement comme un appui de communion. Et je ne dis pas que par les beaux clairs de lune d’un bleu pâle, glissant unis et tranquilles sur les seuils clos des maisons de la ville, je ne viendrais pas me reposer là devant l’un ou l’autre portail de la loggia, sur les degrés de marbre, pour rêver à je ne sais quelles choses impossibles ; pour attendre je ne sais quoi d’insaisissable ; pour me perdre en des pensées indécises comme les ombres accrochées par les clartés lunaires, dessinant de puériles fantasmagories sur les vitraux à facettes cachés entre les solives de la toiture qui se penche ; pour essayer de vivre un peu, avant de mourir, avant de ne plus rien voir de ces choses, pour essayer de vivre un peu d’une autre vie que celle ordinaire de chaque jour ; pour m’imprégner davantage encore, dans une Florence nocturne et silencieuse, de la Beauté des âmes qui furent ici, belles et rayonnantes ; pour aimer, tout seul, d’un amour vague et frissonnant, des êtres qui ne sauront jamais quelles pensées, parfois, vont vers eux et de qui l’on peut s’entretenir là, tout seul, presque à haute voix dans le délicieux oubli de tout le reste, sous le halo d’argent de la lune aux yeux immobiles, dans la paix infinie que doucement ramène chaque nuit…
Je n’ai jamais rien vu de plus lent et de plus paisible que cette fin de jour ; on dirait que la nuit ose à peine effleurer la nappe lumineuse étendue sur Florence. Les rues se laissent envahir par ces fines et flottantes vapeurs devinées déjà tout à l’heure du haut du Viale dei Colli ; et ce n’est pas une image vaine que de dire le silence ému et recueilli, dans ces minutes de transition entre la lumière et les ténèbres, épandu sur elles. Ce n’est rien, ce sont des splendeurs qui vont s’évanouir dans un néant passager, pendant l’éphémère disparition du soleil ; mais on sent que tout frissonne, choses et gens, dans l’appréhension d’un mystérieux événement…
La nuit, maintenant. Même plus un mince lambeau de pourpre qui, oublié par le couchant d’or, s’attarde sur la route mélancolique et d’une tristesse charmante que suit, vers Pise et la Méditerranée, le cours de l’Arno. C’est la nuit. La dernière vision de lumière qui demeure dans mes yeux, un peu obsédante, me vient du jour cru glissant en biais sur les tableaux d’une exposition assez banale que nous avons eu la malchance de rencontrer en route et où nous avons gâché un temps précieux que nous aurions si bien pu consacrer à Santa-Croce, par exemple, ou au couvent de Saint-Marc. Tant pis ; nous laisserons tant de beautés encore inconnues derrière nous que je ne veux pas m’effrayer outre mesure d’avoir passé si près de celles-ci, inutilement.
Après dîner, repris pour la dernière fois, hélas ! mes vagabondages nocturnes et solitaires dans ces villes d’Italie aux rues hautes et étroites, vides dès neuf heures, où bâillent de profondes fenêtres sous des grillages de fer forgé, ventrus et solides, où s’ouvrent des porches béants dans les façades des grands palais. J’examine attentivement le chaos dans lequel nous sommes tombés hier soir ; je dégage très bien maintenant, en me guidant avec les souvenirs de la journée, l’exacte physionomie des rues, des places, des palais, des églises. Je vais partout sans me perdre, étonné de la rapidité de cette assimilation de mes habitudes, avec le milieu où je suis, c’est-à-dire avec Florence où plus rien déjà ne m’étonne, où tout m’enchante, à chaque minute, davantage, éperdument.
En souvenir des soirs enfiévrés de Séville, de Gibraltar et de Tanger, je vais à la recherche d’un bouge honorable, si j’ose ainsi dire, riant moi-même de cette exaltation peut-être un peu puérile dont je me rends bien compte, pour le Beau absolu, tandis que d’un autre côté, ce soir, je n’ai pas le courage de repousser les aspirations qui risquent de m’entraîner vers ce qui, évidemment, ne serait pas d’un absolutisme bien farouche en fait de Beauté. Je vais un peu au hasard par les rues et les ruelles. Tout est clos, tout dort ! Je regrette presque les vilaines figures de Naples et les joies acides qu’elles m’auraient dévoilées. Je regrette tout à fait, en y songeant, les grands châles roses, crème ou bleu pâle aux longs effilés caresseurs desquels sortent les figures provocantes des Sévillanes, — fleurant des odeurs de musc, de poivre, mêlées aux âcres senteurs de fleurs d’oranger, — en maraude dans les calle de Séville où résonnent les rires, le claquement sec des mains battues en cadence, accompagnant les danses et les chants, le dur grésillement des castagnettes, le galop endiablé des guitares aux accords fêlés et, sur ce chahut, le long et enveloppant gazouillis des fritures dont les spirales fumeuses emplissent l’air saturé d’aromes en lesquels se débat la luxure empoignante et chaude des rues… des rues de Séville par un beau soir de printemps brûlant comme un été parisien… Tandis que ce soir Florence est glacée, et que je parcours en vain les lung’ Arno déserts, où s’allonge en un mince filet lumineux sinuant jusqu’aux Cascines la ligne ininterrompue des réverbères.
Alors, machinalement, après avoir erré dans vingt ruelles, je reprends les quais tracés comme un large sillon à travers la ville ; et par une étrange bizarrerie je marche dans Florence en pensant, en voyant Séville, dont le souvenir vraiment m’est importun, tellement différent de là où je suis ; tellement ! Les quais du Guadalquivir, eux, du Paseo de Cristina au pont de Triana, sont emplis de cigarières qui vont, enténébrées comme la nuit, avec ces deux taches sanglantes : l’œillet rouge énorme, planté dans la chevelure épaisse, et la bouche mignonne, petite, et rouge aussi, effrontément rouge, taillée dans le satin bronzé de leur jolie figure ; et de cette fleur exquise, qu’est cette bouche, sort, mâchée, provocante, une tige de grenadier ou d’oranger dont s’effeuillent les pétales roses ou blancs ; de la chair ou de la neige… ô Séville ! Séville, avec ses yeux contre lesquels il ne faut pas lutter, qui s’accrochent aux vôtres et mordent comme des dents cachées sous des lèvres ; Séville avec ses cantilènes aux vieux rythmes arabes, enivrants et berceurs !…
Ici, dans Florence froide et précise, plus magnifiquement belle que doucement jolie, l’extase de la chair se mue en l’extase de l’esprit, et ce n’est pas le corps qui s’émeut et tressaille, c’est l’âme…
J’ai frôlé sans le voir le Palais-Vieux et j’arrive sans m’en rendre compte à ma Loggia del Bigallo. Je n’ai rien rencontré jusqu’à cette place monumentale où se dressent dans la nuit noire les fantômes des grandes architectures ; où tout à l’heure, dans le soleil, je me promettais de revenir me reposer. Je m’appuie seulement contre un pan de mur sous la veilleuse de la porte basse, et finis par m’asseoir comme un voyageur fatigué, comme un pauvre, sur un degré de marbre devant la grille qui ferme la Loggia… Dante Alighieri est venu souvent méditer aux environs de cette place, on dit sur cette place même, sur une pierre conservée pieusement depuis, que j’ai touchée sans doute il n’y a qu’un instant, moi atome dont rien ne sera plus dans quelques années, dans quelques jours, peut-être dans quelques heures… Et tout ce que j’ai vu, aimé, continuera d’être, à peine modifié par le temps en marche vers la Fin… Et longtemps je reste les regards attachés sur cette tour de Giotto que Pétrarque, le tendre poète de Laure, a vu petit à petit s’élever dans les airs où je discerne en ce moment les dessins des marbres obscurs, combinés avec les clartés des marbres aux nuances pâles qui sommeillent dans l’ombre, entre les colonnettes. J’évoque tous les noms, tous les êtres, si lointains dans le passé, qui vinrent là, heurter, contre les murailles fastueuses du Dôme, leurs regards, comme les miens s’y abandonnent à cette heure et vont chercher les statues immobiles dans leurs niches, compagnes élégantes et muettes, pour revoir ensemble, elles sans frissons ni vertiges, moi transi de petitesse, chétif dans ce coin de nuit, — oublieux du présent, — tout le passé qui recommence, dans un rêve enfin venu…XVI
Le bonjour matinal que je donne à ma chère Florence est un adieu attristé, un adieu qui va se prolonger jusqu’au départ, puisque pendant quelques heures encore je serai près d’elle, en elle.
Je m’aperçois que dans chaque ville j’aurai souffert, dès l’arrivée, du mal de la séparation parce que pour moi la séparation commence au moment où je vois ce que j’aime avec cette arrière-pensée que bientôt, tout de suite, il va falloir me séparer de ces choses affectionnées, puisque nous traversons à une allure si rapide ces jolies villes italiennes. Cela a préludé à Gênes surtout, s’est aggravé à Rome, fut douleur à Naples et sera ici triste comme un arrachement de quelque chose de moi-même. Alors je vais, plus fiévreux, par les rues étroites dont la gaieté contraste avec les bordures de grands palais presque noirs et de belles maisons sévères. Je me hâte de fixer en moi les multiples aspects de Florence. J’entre partout, hélas ! hélas ! presque sans voir. Je ne détaille plus chaque église et chaque palais ; je détaille Florence. Chacune des beautés que je puis saisir encore hâtivement est un fragment d’une beauté d’ensemble, d’un tout qui est la beauté générale de la grande cité ; je ne vois rien, je vois Florence…
Le ciel est bleu, le soleil est doré, et, par couches horizontales, comme de minces feuilles d’ouate très blanche, lentement évoluent les nuages légers. Ailleurs, cela passerait inaperçu ; ici, les teintes grises, rousses et rudes des monuments se détachent splendides sur les colorations fragiles et les flocons argentés du ciel et sur les frêles buées du matin, qui s’enfuient. Des rives de l’Arno on dirait, comme hier où cette image a passé déjà devant mes yeux, un paysage des tableaux des Primitifs avec les verdures bleues, la ville bleutée, le fleuve limpide qui l’enserre au pied des murailles toutes proches, et les enluminures que dessine le soleil sur les façades des maisons. Le cadre est d’un charme exquis et rare, aussi j’essaye en vain de m’éloigner, je reviens toujours, fasciné, dans le cercle où sont le Dôme, le Baptistère, le Palais-Vieux, les Uffizi et, depuis la place de la Trinité, le lung’ Arno Acciajoli où débouche le Ponte-Vecchio.
Entre la Signoria et les Uffizi, dans la voie étroite que traverse une grande voûte jetée d’un palais à l’autre, je viens de rencontrer Pio et sa mère. Les boutiques étaient ouvertes déjà presque toutes. Je me souviens que, des boulangeries, sortait par tièdes bouffées la bonne odeur des pains chauds que l’on apportait aux étalages de la rue dès leur sortie du four ; ils étaient de formes inusitées chez nous, et leur belle croûte blonde et lisse, brusquement refroidie, se craquelait avec un murmure sec et ininterrompu comme une confuse chanson de cricris. Il y avait d’autres boutiques encore où se précipitaient et caquetaient les femmes, faisant, en même temps que des vivres journaliers, provisions de commérages. Et le soleil, en intrus, se glissait partout, dans les boutiques et dans la foule, se répétait dans les larges carreaux des devantures, semait d’autres petits soleils dans les vitres étroites des fenêtres moyennâgeuses, s’arrêtait complaisamment sur des corbeilles de fleurs, et mêlait ses écheveaux d’or aux fines chevelures des femmes qui passaient.
En suivant très discrètement, sans aucune pensée mauvaise, grand Dieu ! la maman de Pio, j’ai vu plus encore qu’hier de quelle exquise et touchante résignation sont faites les lignes délicates de son jeune visage, de quelle tranquillité sereine sont emplis ses jolis yeux. On dirait qu’ayant subi les plus atroces tourments, ses traits et ses regards, désormais inaccessibles à une pire douleur que la nuit répandue sur les yeux de son fils, ont pris cette rigidité sévère et attristée des vierges transpercées de glaives ; ses yeux, ses beaux yeux de créole dont l’éclat et la pureté sombrèrent mystérieusement en son enfant dans le travail sublime de la maternité, ont reconquis la pureté des yeux vierges de baisers, à peine voilés d’une interrogation curieuse et candide, et tremblants un peu d’effroi dans l’attente de ce qui doit venir… Et je m’imagine, — oh ! je sens la naïveté de ce que je vais dire, — je m’imagine qu’elle doit les craindre horriblement, ces baisers, délicieuses floraisons de lèvres réunies, dont le fruit fut pour elle la pauvre chair à jamais sans clartés que ses mains mignonnes de jeune femme guident à travers le soleil, dans Florence belle en ce moment d’une inoubliable beauté…
Tous les trois nous avons couru par la ville ; eux faisant probablement comme chaque jour leur promenade ou leurs petites courses matinales dans ces rues, qui, dès l’aurore, s’emplissent du parfum des fleurs, des fruits et du pain quotidien ; moi, machinalement, presque sans but en somme, sachant très bien que tout cela ne mène à rien, puisque je vais partir, mais éprouvant une sorte de joie confuse faite peut-être de curiosité satisfaite parce que j’ai, hier et aujourd’hui, pénétré un peu l’existence de ces deux jolis êtres que le hasard a jetés sous mes yeux, ces deux êtres auxquels je vais penser, que je suis capable d’aimer sans qu’ils puissent jamais le savoir. Leurs silhouettes pures, détachées sur le fond d’une rue de Florence à la perspective fuyante en des vapeurs bleuâtres, s’ajouteront, s’ajoutent déjà, au souvenir de ces amours inavouées perdues au milieu des villes jadis traversées à la hâte et même aux amours trop platoniques qui, régulièrement, s’éveillent, dans ce grand Paris, au frôlement de chers yeux inconnus vers qui vont se caresser les miens, sans qu’ils devinent et sentent, ces beaux yeux, que discrètement on les regarde, on les aime… et que l’on aurait tant de joie à le leur dire…
Je ne sais plus par quels détours nous sommes revenus à notre point de départ, au Palazzo Vecchio, pour reprendre ensuite la via Calzaioli ; mais là, nous avons rencontré, dès les premières maisons de cette grande rue qui va jusqu’au Dôme et au Baptistère, une troupe de gamins, une émeute minuscule de petits bonshommes pâmés, délirants de joie, arrêtés comme un essaim de jolies abeilles bourdonnantes à la devanture d’un confiseur, devant une montagne, des vallées et des arbres de sucreries dorées, fleuries et fondantes sous les yeux, parmi lesquelles, ingénieusement, le sculpteur en verve avait fait s’avancer vers un Bambino blond et rose, couché sur un lit de pailles blondes tressées en filaments de caramel, une procession si douce et si chatoyante de Rois Mages qui traînaient, en des parterres d’angélique bordés de gros rochers de chocolat en mousse pétrifiée, de longues robes à la rose, à la violette, à la pistache ; et même, une qui avait des reflets de feu devait être à l’abricot. L’un des rois montrait, sous une tiare lourde de cabochons de sucre cristallisé, une belle figure au café qui, d’un seul coup, fit éclater en grelots joyeux, en roulements sonores de lèvres épanouies, mille rires d’enfants, mille exclamations folles dans vingt bouches roses et fraîches comme les belles robes à la rose des Rois adorateurs, dans vingt petites figures malicieuses, brunes et blondes comme celles du roi au café et du divin Bambino couché sur sa paille étincelante d’or… Oh ! les beaux yeux mouillés de grosses larmes par les rires interminables ; et ces jolis cris entre-croisés, et toute cette joie exubérante, mutine et gracieuse, jaillie du matin sur toute la journée des petits écoliers émus de la splendeur inouïe et puérile de cette Épiphanie que chantaient leurs minces petites voix : O Dio, com’ è bello !… com’ è bello !
La maman de Pio eut un frissonnement de tout son corps, en passant là ; et le petit Pio qui avait déjà quitté sa main, essaya de rire en tournant du côté d’où venait tout le bruit, vers la Crèche, ses pauvres yeux inutiles qui auraient tant voulu voir aussi.
Alors nous étions devant Or San Michele ; j’y entrai rapidement par une ruelle qu’il faut contourner pour passer dans une autre traversée d’une voûte imitée d’un sotto-portico napolitain ; je poussai la porte et je n’étais pas plus tôt dans l’obscurité douce du sanctuaire, qu’à mon tour un frisson m’enveloppa tout entier ; je fermai un instant les yeux comme pour me recueillir, mais en réalité ce fut pour refouler une sotte humidité que je sentais affluer contre mes paupières, quoique je ne voulusse pas m’avouer à moi-même les larmes que m’arrachait l’inconsciente, mais si intense douleur de ces grands yeux bleus d’enfant qui ne pouvaient pas voir… Ou bien, peut-être, était-ce à cause de ce clair visage de femme qui m’échappait sans retour, à l’instant même où Florence aussi allait disparaître ?…
J’avais besoin de rencontrer sur mon chemin l’obscurité douce de cette église où je venais de me réfugier si soudainement pour échapper à la fois à ces deux souffrances, l’une faite de la douleur même de Pio et de sa mère, l’autre, à laquelle en vérité je ne pouvais pas me soustraire, mais pour quoi je trouvais dans l’église un dérivatif immédiat et salutaire, et qui était la rupture inexorable avec cette frêle vision de femme que je m’étais accoutumé déjà à suivre dans les rues de Florence, et qui, sans moi, en ce moment continuait son chemin, vers sa maison sans doute, vers les siens très aimés.
Je m’étais réfugié de suite dans l’angle noir où scintille à grand’peine le Tabernacle d’Andrea Orcagna, splendeur de matières précieuses, de richesse, d’art patiemment plié, guidé à travers les milliers de petits fragments de pierres fines dressées en menues rosaces, en portails lilliputiens, en ogives de dentelles et de joailleries au milieu desquels lentement s’éteignent, en les coloris exquis et pâles, en les ors exténués de vieillesse, les regards candides de la Madone d’Ugolino de Sienne et de huit chérubins aux profils nimbés d’or. Et je pensai à combien de tempêtes la Vierge miraculeuse avait opposé le calme de son doux visage immobile, là, dans le crépuscule permanent de l’antique église, ou mieux, dans l’aube dont Elle, la Vierge, était l’éternel Soleil Levant ! Il y a dans la chapelle des catéchismes de Saint-Germain-l’Auxerrois ces mêmes hésitations de la lumière à percer les lamelles épaisses des vitraux sertis dans les réseaux compliqués des vieux plombs, les mêmes topazes de boutons d’or, les rouges des pivoines ardentes, les émeraudes des myrtes et les turquoises et les saphirs d’un azur improbable, assemblés en d’hiératiques figures de saints, de guerriers, de vierges et de fleurs, qui jettent les lueurs pâles et vaporeuses de toutes ces nuances, les bleus et les rouges surtout, contre les pierres grises des fumées de l’encens et des cierges. Or San Michele aussi retient dans la vétusté vermeille des fresques éparses le long des pilastres, comme dans les vieilles boiseries d’or vermillonné et poussiéreux de Saint-Germain, le même mysticisme dangereusement sensuel contre lequel, décidément, je ne puis me défendre et qui m’étreint là, atténuant de son charme singulier la tristesse mortelle et pourtant si douce qui fait, jusqu’à mes yeux, monter la faiblesse honteuse des pleurs…
Dans l’encoignure où je me suis retiré, caché entre les murailles des hauts portiques, autrefois grands ouverts sur la rue, quand Or San Michele était une halle aux grains, je vois les mosaïques ténues et tourmentées du Tabernacle, élevées en frêles colonnettes qui s’enfuient vers l’ombre d’en haut en spirales d’or, de porphyres et de lapis-lazuli. On distingue mal le Tabernacle d’Orcagna, mais justement ce clair-obscur enveloppant ajoute aux mièvreries charmantes de ce temple minuscule et très grand à la fois, digne des splendeurs de Byzance, perdu ici dans une lumière vague qui en estompe les contours et donne des allures d’imprécision infinie au dais resplendissant dont la coupole dresse — au-dessus des frontons triangulaires étoilés du sceau de Salomon, vers une voûte faite d’obscurités bleuies, roses, mauves et dorées — la grâce légère d’un archange aux ailes déployées.
Et tandis que je cherchais à recueillir l’impression tendre de ces choses et que les pensées indécises pressaient l’essor mal assuré des mots, je ne trouvais rien autre dans la confusion du moment que le rythme autrefois retenu de ces vers :
|
Vierge, vous rayonnez comme une aube irrorée,
|
Oh ! ces minutes, ces secondes de rêveries délicieuses et inexplicables où viennent, en soi, se caresser — car tout cela est très doux et très paisible — tant de pensées et de sentiments opposés, tant de sensualisme aigu uni à tant de foi ; et cette douleur, cette tranquillité sereine, ce désespoir mal défini, et par contre cette joie de vivre si nette et si intense !… Mais tout cela ne dure pas ; c’est un spasme moral tôt rentré, étouffé par le fonctionnement normal du corps, de la peau, de la guenille, intolérante pour ces fantaisies qui l’usent comme les autres, quoique moins directement faites de sa vie purement animale. Aussi voilà le prosaïsme de la rue, et je me livre à lui.
Or San Michele m’a retardé ; il faut courir maintenant pour ne pas manquer l’heure du départ. Et déjà sont loin de moi les fresques et les grisailles et les demi-lumières et les folies de marbres de l’antique église et, sur les façades, dehors, le Saint Jean de Ghiberti, le Saint Georges de Donatello, son Saint Marc et les œuvres de Michelozzo Michelozzi, de Jean de Bologne, de Verrocchio… qui ont pris à tâche, par leur élégance suprême, de donner un peu de vie et de légèreté au carré trapu que forme extérieurement le vieux sanctuaire.
C’est un peu, cette sortie précipitée d’Or San Michele, l’image de la fin de chaque chose très douce, et surtout, oh ! surtout, l’image trop réelle de ce voyage plaisant qui s’achève, dont voici la fin arrivée plus rapidement que je n’osais le croire, quoique je l’aie vue déjà, dès les premiers jours, venir, menaçant de gâter, si c’eût été possible, les sensations attrayantes de ces heures trop brèves ! trop brèves !… Chères heures qui vont épandre sur tout le reste de ma vie, si longue ou si courte qu’en puisse être la durée, la pluie fine et rafraîchissante des souvenirs…
Nous allons encore dans un magasin de marbres du Borgo Ognissanti, ma mère et moi, pour acheter une de ces petites sculptures, œuvres mignardes et insignifiantes des habiles ouvriers italiens ; et ma mère a bien voulu me laisser libre de choisir un buste très élégant du Narcisse de Pompéi que nous avons distingué chez le statuaire parmi tout un Olympe composé de dieux et de déesses en albâtre que le marchand étiquette marbre de je ne sais plus quel pays au nom sonore, et de marbre vrai Carrare aux jolies paillettes de mica, scintillantes dans la chair neigeuse des épaules, des jambes et des poitrines… Et Narcisse est chez moi maintenant, devant mes yeux. Pendant que j’écris ceci, sa jolie tête aux boucles de cheveux ciselés parsemés de feuillages chargés de petites baies rondes comme des perles, sa jolie tête frivole se penche vers moi, sa bouche esquisse un fin et malicieux sourire, et ses grands yeux sans prunelles le font ressembler à un masque de comédie antique infiniment gracieux et coquet… J’aime que des fleurs soient devant lui, toujours, et qu’elles montent d’un vase bleu cendré, aux formes très simples, jusqu’à ses épaules rondes, jusqu’à ses lèvres où persiste, après deux mille ans de ténèbres, la radieuse clarté de sa voluptueuse Pompéi ; jusqu’à son front où rayonnent la jeunesse éternelle, la splendeur pâle des encens sacrilèges échappés en volutes légères des grands trépieds de bronze, et les étincellements du golfe napolitain… et, pour moi, le souvenir ému de Florence !…
Exprès, j’ai voulu, en écrivant les pages ultimes de ce journal sans prétention, que revive un instant entre ses lignes inhabiles la silhouette de cette précieuse figurine. Et peut-être trouvera-t-on que vraiment j’ai bien dédaigné les autels des Vénus innombrables, pour déposer trop fidèlement sur les parvis des temples d’Antinoüs et d’Apollon, la branche de myrte nouée de bandelettes. C’est que j’aime les sanctuaires silencieux et délaissés !
Seul, le silence est grand, tout le reste est faiblesse.
Et ce vers du chaste Vigny me console de n’aimer ni la foule, ni la cohue tumultueuse, ni les temples où bruyamment on sacrifie. Et si j’ai rencontré vers Naples, où palpite encore doucement l’âme du Paganisme, les statuettes frêles des dieux dont on ne parle plus, je les ai aimées pour le silence qui se fait autour d’elles ; pour la splendeur de leur paisible nudité ; parce qu’elles restent, — devant les misères lancinantes qui, de notre chair, montent jusqu’à notre âme et l’enserrent, l’étouffent, — la vision sans apprêt, sans fards, sans gestes étudiés, de ce qui nous console de vivre encore après que sont venues les souffrances, rides au visage, et les désillusions, rides au cœur : la Jeunesse, dont le nom seul corrige l’horreur de ce mot : vieillir.
Mes frères qui, jusqu’ici, auront eu la patience de me suivre et l’indulgence d’accueillir quelques-unes des pensées éparses dans ce récit forcément tracé avec très peu de cohésion, mes frères me comprendront, soit qu’ils partagent un sentiment, ou qu’ils veuillent bien me pardonner une faiblesse, — si faiblesse il y a.
Pour les autres, le sourire entendu que je devine — et que je brave — sera l’ivraie perdue en la moisson blonde de mes joies intérieures… Les gerbes passées sur l’aire, seuls demeurent le chaume doré et les grains d’ambre du pur froment… Le reste !…
Et voilà que Florence s’efface… Et la grâce du paysage toscan avec, sur les hauteurs bleues, les villas et les terrasses blanches et le grave balancement des noirs cyprès, et les grands yeux de braise éteinte d’une jolie petite voisine, qui va nous suivre jusqu’à Empoli seulement, tout cela ne m’arrache pas à la mélancolie de ce départ. Sans nous y arrêter, nous allons voir Pise endormie pour jamais sur la plaine où lentement s’étire l’Arno paresseux, sinuant au pied du Dôme et de la Tour penchée, près de ce Campo Santo où les corps reposent en terre sainte, où les âmes reviennent pour voir, au clair de lune, les fresques immortelles de Benozzo Gozzoli et d’Orcagna… ce Campo Santo où la Mort, dit-on, se fait si calme qu’on la voit venir sans crainte si l’on a la certitude qu’elle vous couche là, pieusement, dans le Champ sacré, au bord de la ville où, si doucement, tout sommeille ou va s’endormir ; où tout est mort ou agonise paisiblement… Mais, ni les grands yeux noirs, ni les paysages bleus, ni le repos attirant de Pise ne me feront oublier Florence. Inutilement, demain, nous irons sur les crêtes des montagnes, devant les Alpes casquées d’argent sous la chevauchée caressante des nuages, de Menton à Nice. Monaco et les vapeurs mauves de l’Estérel en vain diront leurs chansons de sirènes au bord des vagues molles qui viennent sur les troncs des palmiers, parmi les roses, briser leurs lames d’émeraudes limpides en accrochant aux cactus épineux des dentelles d’écume. Tout reste ici. Tout le charme demeure jusqu’à cette extrême limite où la Tour du Palais-Vieux apparaît encore, pâle fantôme de bure à demi effacé, dans le bleu qui s’accumule entre elle et nous, et devient de plus en plus dense, de plus en plus compact, comme un voile léger dont la trame, sans cesse, s’accroît d’invisibles fils… C’est fini, Florence n’est plus pour nous !…
Depuis, les semaines et les mois se sont ajoutés aux semaines et aux mois, et j’entends encore, se jouant parmi mes souvenirs, les notes frémissantes d’un cantique d’Amour, de Foi et de Beauté. Peut-être sont-ce trois voix inséparables qui, de Naples, de Rome et de Florence, se rejoignent et viennent charmer mes heures tristes ?… car je les entends souvent…