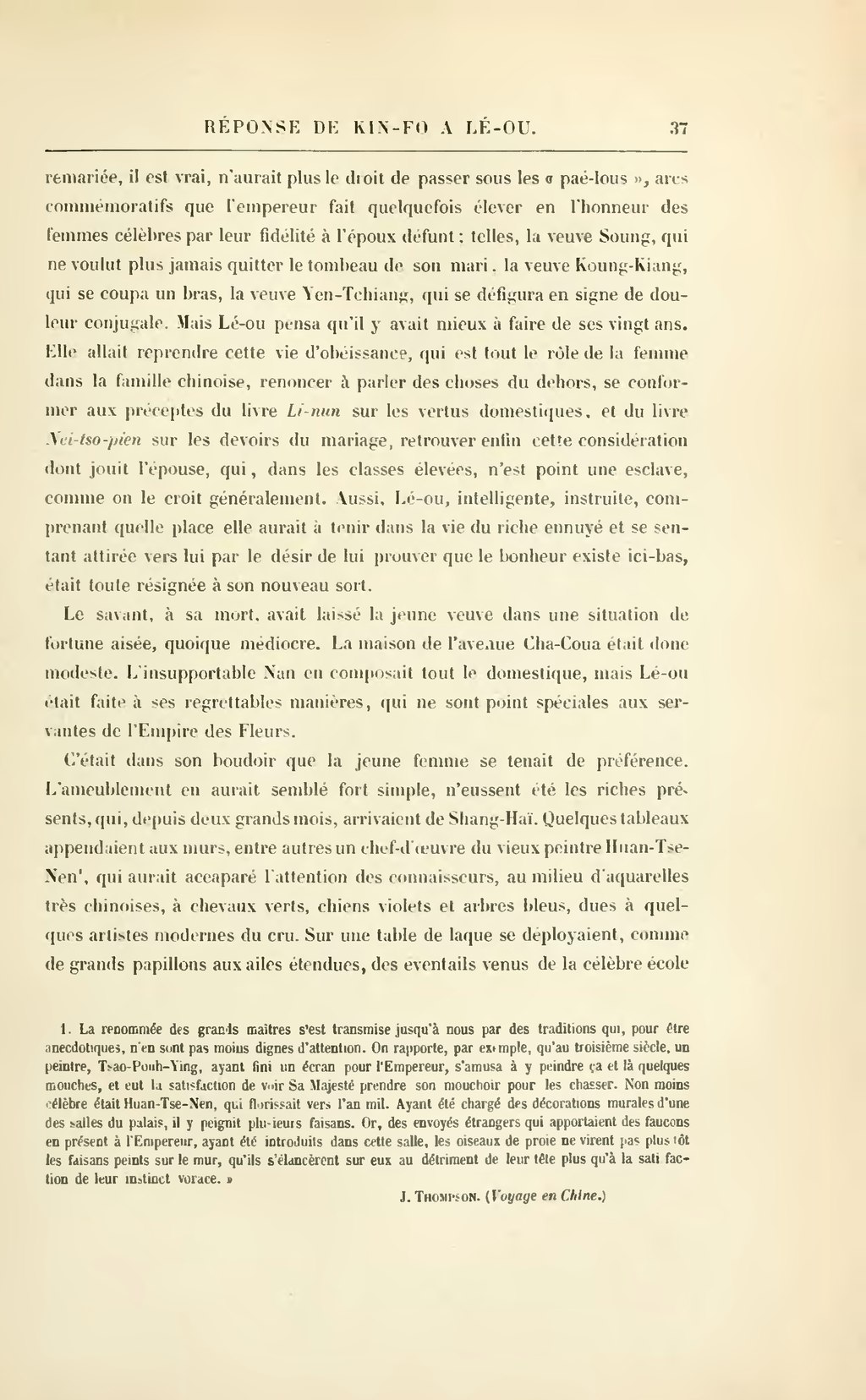remariée, il est vrai, n’aurait plus le droit de passer sous les « paé-lous », arcs commémoratifs que l’empereur fait quelquefois élever en l’honneur des femmes célèbres par leur fidélité à l’époux défunt ; telles, la veuve Soung, qui ne voulut plus jamais quitter le tombeau de son mari, la veuve Koung-Kiang, qui se coupa un bras, la veuve Yen-Tchiang, qui se défigura en signe de douleur conjugale. Mais Lé-ou pensa qu’il y avait mieux à faire de ses vingt ans. Elle allait reprendre cette vie d’obéissance, qui est tout le rôle de la femme dans la famille chinoise, renoncer à parler des choses du dehors, se conformer aux préceptes du livre Li-nun sur les vertus domestiques, et du livre Nei-tso-pien sur les devoirs du mariage, retrouver enfin cette considération dont jouit l’épouse, qui, dans les classes élevées, n’est point une esclave, comme on le croit généralement. Aussi, Lé-ou, intelligente, instruite, comprenant quelle place elle aurait à tenir dans la vie du riche ennuyé et se sentant attirée vers lui par le désir de lui prouver que le bonheur existe ici-bas, était toute résignée à son nouveau sort.
Le savant, à sa mort, avait laissé la jeune veuve dans une situation de fortune aisée, quoique médiocre. La maison de l’avenue Cha-Coua était donc modeste. L’insupportable Nan en composait tout le domestique, mais Lé-ou était faite à ses regrettables manières, qui ne sont point spéciales aux servantes de l’Empire des Fleurs.
C’était dans son boudoir que la jeune femme se tenait de préférence. L’ameublement en aurait semblé fort simple, n’eussent été les riches présents, qui, depuis deux grands mois, arrivaient de Shang-Haï. Quelques tableaux appendaient aux murs, entre autres un chef-d’œuvre du vieux peintre Huan-Tse-Nen[1], qui aurait accaparé l’attention des connaisseurs, au milieu d’aquarelles très chinoises, à chevaux verts, chiens violets et arbres bleus, dues à quelques artistes modernes du cru. Sur une table de laque se déployaient, comme de grands papillons aux ailes étendues, des éventails venus de la célèbre école
- ↑ La renommée des grands maîtres s’est transmise jusqu’à nous par des traditions qui, pour être anecdotiques, n’en sont pas moins dignes d’attention. On rapporte par exemple qu’au troisième siècle, un peintre, Tsao-Pouh-Ying, ayant fini un écran pour l’Empereur, s’amusa à peindre çà et là quelques mouches, et eut la satisfaction de voir Sa Majesté prendre son mouchoir pour les chasser. Non moins célèbre était Huan-Tse-Nen, qui florissait vers l’an mil. Ayant été chargé des décorations murales d’une des salles du palais, il y peignit plusieurs faisans. Or, des envoyés étrangers qui apportaient des faucons en présent à l’Empereur, ayant été introduits dans cette salle, les oiseaux de proie ne virent pas plus tôt les faisans peints sur le mur, qu’ils s’élancèrent sur eux au détriment de leur tête plus qu’à la satisfaction de leur instinct vorace. »
J. Thompson. (Voyage en Chine.)