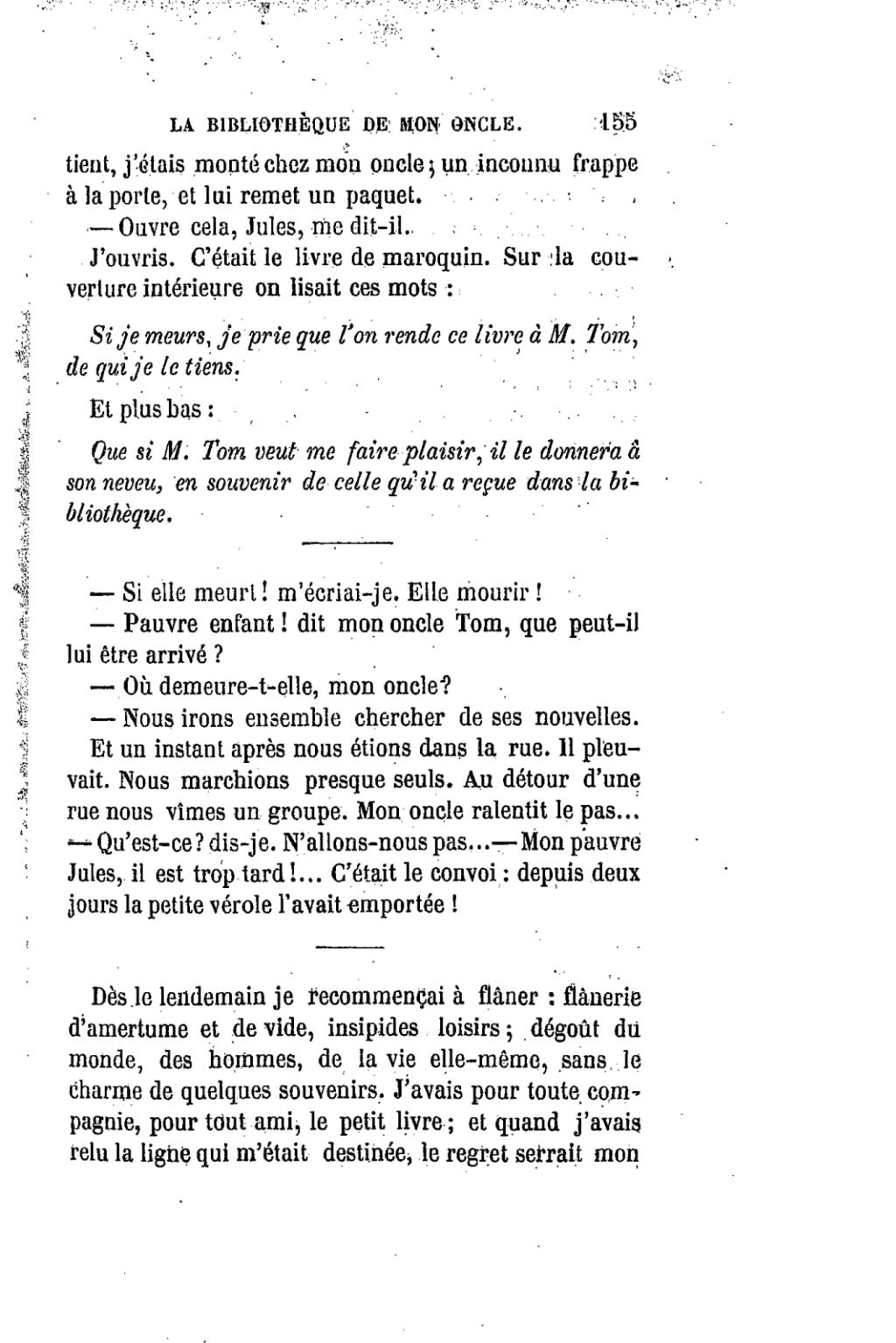tient, j’étais monté chez mon oncle ; un inconnu frappe à la porte, et lui remet un paquet.
— Ouvre cela, Jules, me dit-il.
J’ouvris. C’était le livre de maroquin. Sur la couverture intérieure on lisait ces mots :
Si je meurs, je prie que l’on rende ce livre à M. Tom, de qui je le tiens.
Et plus bas :
Que si M. Tom veut me faire plaisir, il le donnera à son neveu, en souvenir de celle qu’il a reçue dans la bibliothèque.
— Si elle meurt ! m’écriai-je. Elle mourir !
— Pauvre enfant ! dit mon oncle Tom, que peut-il lui être arrivé ?
— Où demeure-t-elle, mon oncle ?
— Nous irons ensemble chercher de ses nouvelles.
Et un instant après nous étions dans la rue. Il pleuvait. Nous marchions presque seuls. Au détour d’une rue nous vîmes un groupe. Mon oncle ralentit le pas… — Qu’est-ce ? dis-je. N’allons-nous pas… — Mon pauvre Jules, il est trop tard !… C’était le convoi : depuis deux jours la petite vérole l’avait emportée !
Dès le lendemain je recommençai à flâner : flânerie d’amertume et de vide, insipides loisirs ; dégoût du monde, des hommes, de la vie elle-même, sans le charme de quelques souvenirs. J’avais pour toute compagnie, pour tout ami, le petit livre ; et quand j’avais relu la ligne qui m’était destinée, le regret serrait mon