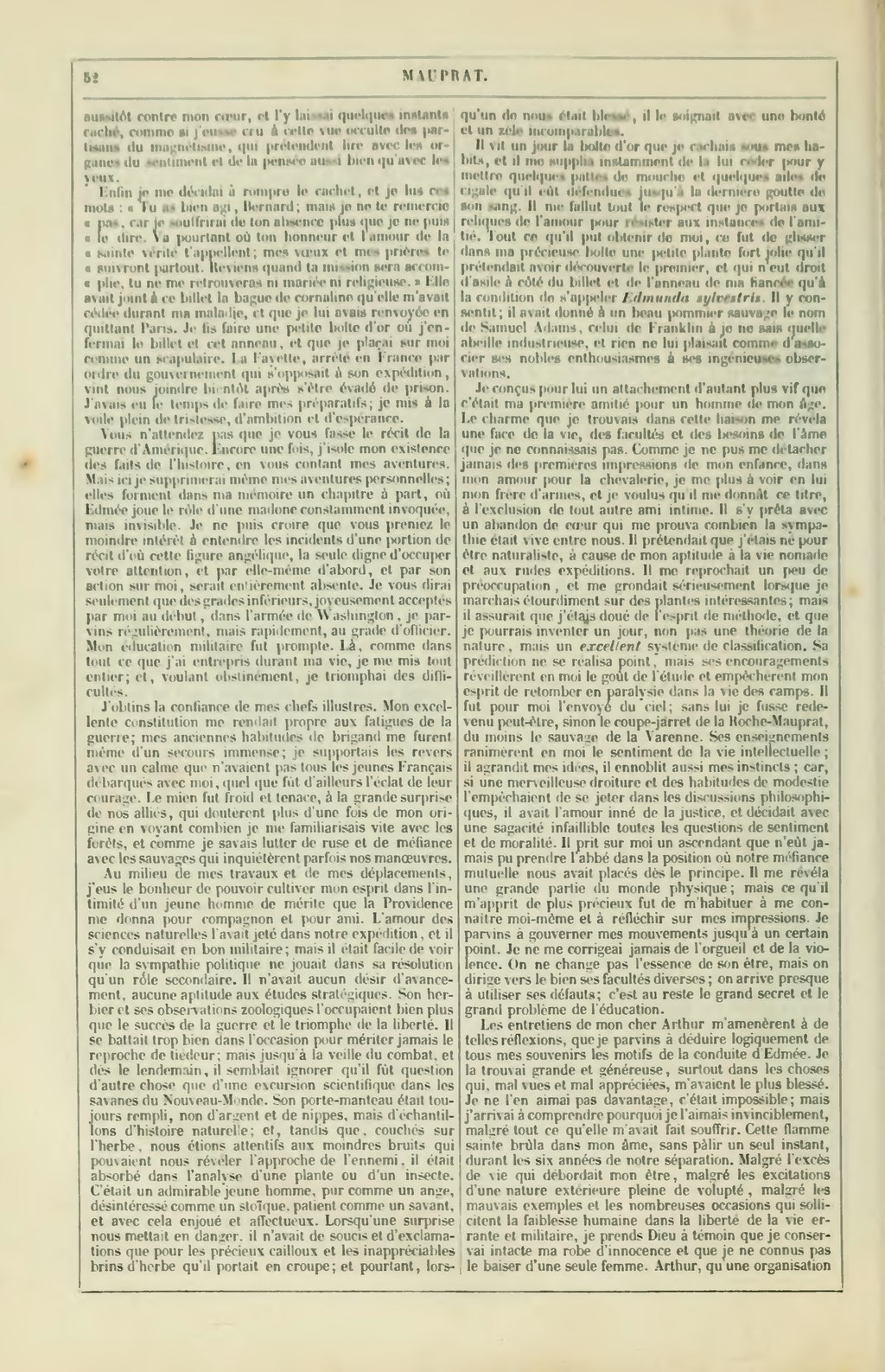aussitôt contre mon cœur, et l’y laissai quelques instants caché, comme si j’eusse cru à cette vue occulte des partisans du magnétisme qui prétendent lire avec les organes du sentiment et de la pensée aussi bien qu’avec les yeux.
Enfin je me décidai à rompre le cachet, et je lus ces mots : « Tu as bien agi, Bernard ; mais je ne te remercie pas, car je souffrirai de ton absence plus que je ne puis le dire. Va pourtant où ton honneur et l’amour de la sainte vérité t’appellent ; mes vœux et mes prières te suivront partout. Reviens quand ta mission sera accomplie, tu ne me retrouveras ni mariée ni religieuse. » Elle avait joint à ce billet la bague de cornaline qu’elle m’avait cédée durant ma maladie, et que je lui avais renvoyée en quittant Paris. Je fis faire une petite boîte d’or où j’enfermai le billet et cet anneau, et que je plaçai sur moi comme un scapulaire. La Fayette, arrêté en France par ordre du gouvernement qui s’opposait à son expédition, vint nous joindre bientôt après s’être évadé de prison. J’avais eu le temps de faire mes préparatifs ; je mis à la voile plein de tristesse, d’ambition et d’espérance.
Vous n’attendez pas que je vous fasse le récit de la guerre d’Amérique. Encore une fois, j’isole mon existence des faits de l’histoire, en vous contant mes aventures. Mais ici je supprimerai même mes aventures personnelles ; elles forment dans ma mémoire un chapitre à part, où Edmée joue le rôle d’une madone constamment invoquée, mais invisible. Je ne puis croire que vous preniez le moindre intérêt à entendre les incidents d’une portion de récit d’où cette figure angélique, la seule digne d’occuper votre attention, et par elle-même d’abord, et par son action sur moi, serait entièrement absente. Je vous dirai seulement que des grades inférieurs, joyeusement acceptés par moi au début, dans l’armée de Washington, je parvins régulièrement, mais rapidement, au grade d’officier. Mon éducation militaire fut prompte. Là, comme dans tout ce que j’ai entrepris durant ma vie, je me mis tout entier ; et, voulant obstinément, je triomphai des difficultés.
J’obtins la confiance de mes chefs illustres. Mon excellente constitution me rendait propre aux fatigues de la guerre ; mes anciennes habitudes de brigand me furent même d’un secours immense ; je supportais les revers avec un calme que n’avaient pas tous les jeunes Français débarqués avec moi, quel que fût d’ailleurs l’éclat de leur courage. Le mien fut froid et tenace, à la grande surprise de nos alliés, qui doutèrent plus d’une fois de mon origine en voyant combien je me familiarisais vite avec les forêts, et comme je savais lutter de ruse et de méfiance avec les sauvages qui inquiétèrent parfois nos manœuvres.
Au milieu de mes travaux et de mes déplacements, j’eus le bonheur de pouvoir cultiver mon esprit dans l’intimité d’un jeune homme de mérite que la Providence me donna pour compagnon et pour ami. L’amour des sciences naturelles l’avait jeté dans notre expédition, et il s’y conduisait en bon militaire ; mais il était facile de voir que la sympathie politique ne jouait dans sa résolution qu’un rôle secondaire. Il n’avait aucun désir d’avancement, aucune aptitude aux études stratégiques. Son herbier et ses observations zoologiques l’occupaient bien plus que le succès de la guerre et le triomphe de la liberté. Il se battait trop bien dans l’occasion pour mériter jamais le reproche de tiédeur ; mais jusqu’à la veille du combat, et dès le lendemain, il semblait ignorer qu’il fût question d’autre chose que d’une excursion scientifique dans les savanes du Nouveau-Monde. Son porte-manteau était toujours rempli, non d’argent et de nippes, mais d’échantillons d’histoire naturelle ; et, tandis que, couchés sur l’herbe, nous étions attentifs aux moindres bruits qui pouvaient nous révéler l’approche de l’ennemi, il était absorbé dans l’analyse d’une plante ou d’un insecte. C’était un admirable jeune homme, pur comme un ange, désintéressé comme un stoïque, patient comme un savant, et avec cela enjoué et affectueux. Lorsqu’une surprise nous mettait en danger, il n’avait de soucis et d’exclamations que pour les précieux cailloux et les inappréciables brins d’herbe qu’il portait en croupe : et pourtant, lorsqu’un de nous était blessé, il le soignait avec une bonté et un zèle incomparable.
Il vit un jour la boîte d’or que je cachais sous mes habits, et il me supplia instamment de la lui céder pour y mettre quelques pattes de mouche et quelques ailes de cigale qu’il eût défendues jusqu’à la dernière goutte de son sang. Il me fallut tout le respect que je portais aux reliques de l’amour pour résister aux instances de l’amitié. Tout ce qu’il put obtenir de moi, ce fut de glisser dans ma précieuse boîte une petite plante fort jolie qu’il prétendait avoir découverte le premier, et qui n’eut droit d’asile à côté du billet et de l’anneau de ma fiancée qu’à la condition de s’appeler Edmunda sylvestris. Il y consentit ; il avait donné à un beau pommier sauvage le nom de Samuel Adams, celui de Franklin à je ne sais quelle abeille industrieuse et rien ne lui plaisait comme d’associer ses nobles enthousiasmes à ses ingénieuses observations.
Je conçus pour lui un attachement d’autant plus vif que c’était ma première amitié pour un homme de mon âge. Le charme que je trouvais dans cette liaison me révéla une face de la vie, des facultés et des besoins de l’âme que je ne connaissais pas. Comme je ne pus me détacher jamais des premières impressions de mon enfance, dans mon amour pour la chevalerie, je me plus à voir en lui mon frère d’armes, et je voulus qu’il me donnât ce titre, à l’exclusion de tout autre ami intime. Il s’y prêta avec un abandon de cœur qui me prouva combien la sympathie était vive entre nous. Il prétendait que j’étais né pour être naturaliste, à cause de mon aptitude à la vie nomade et aux rudes expéditions. Il me reprochait un peu de préoccupation, et me grondait sérieusement lorsque je marchais étourdiment sur des plantes intéressantes ; mais il assurait que j’étais doué de l’esprit de méthode, et que je pourrais inventer un jour, non pas une théorie de la nature, mais un excellent système de classification. Sa prédiction ne se réalisa point, mais ses encouragements réveillèrent en moi le goût de l’étude et empêchèrent mon esprit de retomber en paralysie dans la vie des camps. Il fut pour moi l’envoyé du ciel ; sans lui je fusse redevenu peut-être, sinon le coupe-jarret de la Roche-Mauprat, du moins le sauvage de la Varenne. Ses enseignements ranimèrent en moi le sentiment de la vie intellectuelle ; il agrandit mes idées, il ennoblit aussi mes instincts ; car, si une meneilleuse droiture et des habitudes de modestie l’empêchaient de se jeter dans les discussions philosophiques, il avait l’amour inné de la justice, et décidait avec une sagacité infaillible toutes les questions de sentiment et de moralité. Il prit sur moi un ascendant que n’eût jamais pu prendre l’abbé dans la position où notre méfiance mutuelle nous avait placés dès le principe. Il me révéla une grande partie du monde physique ; mais ce qu’il m’apprit de plus précieux fut de m’habituer à me connaître moi-même et à réfléchir sur mes impressions. Je parvins à gouverner mes mouvements jusqu’à un certain point. Je ne me corrigeai jamais de l’orgueil et de la violence. On ne change pas l’essence de son être, mais on dirige vers le bien ses facultés diverses ; on arrive presque à utiliser ses défauts ; c’est au reste le grand secret et le grand problème de l’éducation.
Les entretiens de mon cher Arthur m’amenèrent à de telles réflexions, que je parvins à déduire logiquement de tous mes souvenirs les motifs de la conduite d’Edmée. Je la trouvai grande et généreuse, surtout dans les choses qui, mal vues et mal appréciées, m’avaient le plus blessé. Je ne l’en aimai pas davantage, c’était impossible ; mais j’arrivai à comprendre pourquoi je l’aimais invinciblement, malgré tout ce qu’elle m’avait fait souffrir. Cette flamme sainte brûla dans mon âme, sans pâlir un seul instant, durant les six années de notre séparation. Malgré l’excès de vie qui débordait mon être, malgré les excitations d’une nature extérieure pleine de volupté, malgré les mauvais exemples et les nombreuses occasions qui sollicitent la faiblesse humaine dans la liberté de la vie errante et militaire, je prends Dieu à témoin que je conservai intacte ma robe d’innocence et que je ne connus pas le baiser d’une seule femme. Arthur, qu’une organisation