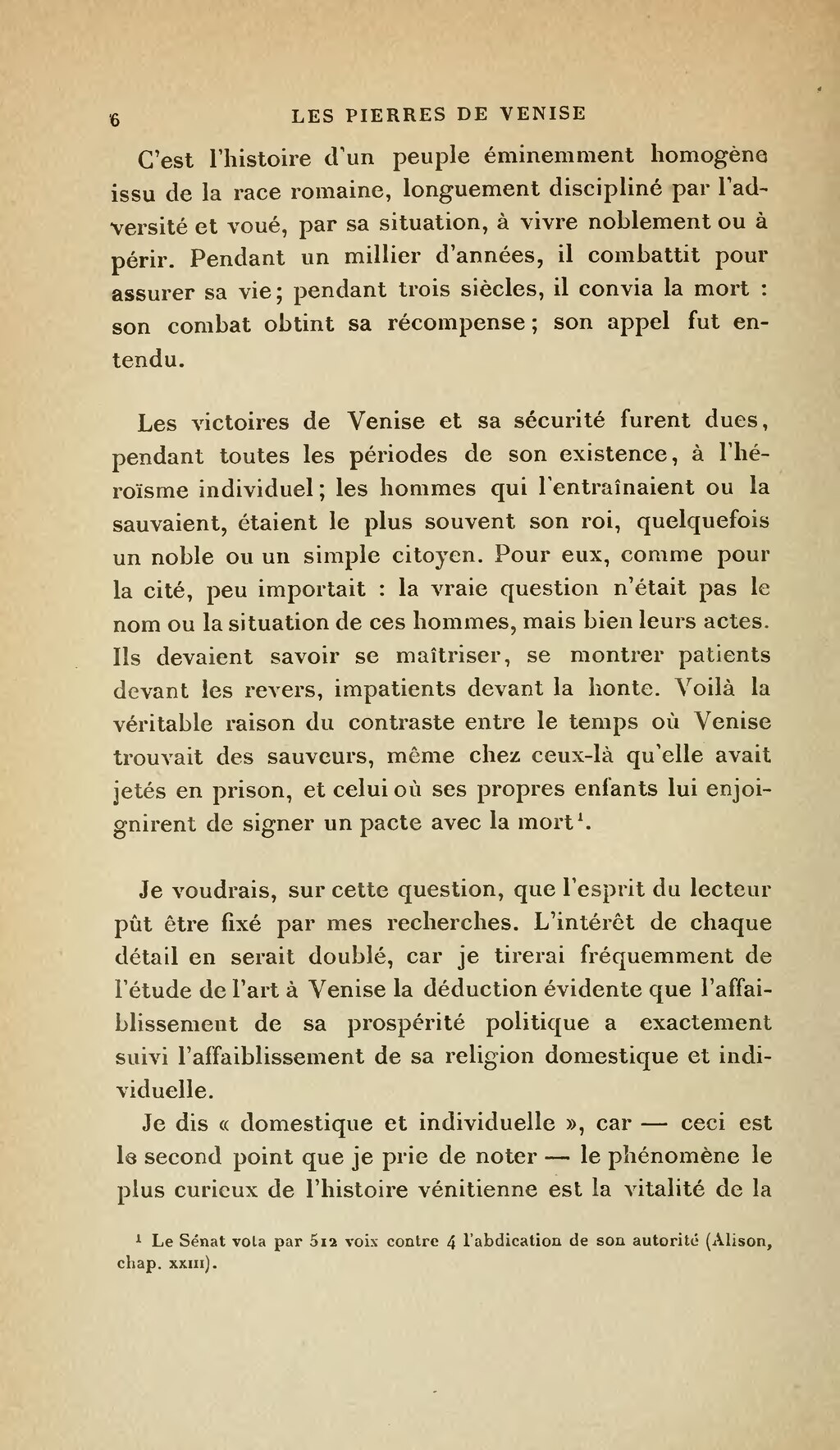C’est l’histoire d’un peuple éminemment homogène issu de la race romaine, longuement discipliné par l’adversité et voué, par sa situation, à vivre noblement ou à périr. Pendant un millier d’années, il combattit pour assurer sa vie ; pendant trois siècles, il convia la mort : son combat obtint sa récompense ; son appel fut entendu.
Les victoires de Venise et sa sécurité furent dues, pendant toutes les périodes de son existence, à l’héroïsme individuel ; les hommes qui l’entraînaient ou la sauvaient, étaient le plus souvent son roi, quelquefois un noble ou un simple citoyen. Pour eux, comme pour la cité, peu importait : la vraie question n’était pas le nom ou la situation de ces hommes, mais bien leurs actes. Ils devaient savoir se maîtriser, se montrer patients devant les revers, impatients devant la honte. Voilà la véritable raison du contraste entre le temps où Venise trouvait des sauveurs, même chez ceux-là qu’elle avait jetés en prison, et celui où ses propres enfants lui enjoignirent de signer un pacte avec la mort[1].
Je voudrais, sur cette question, que l’esprit du lecteur pût être fixé par mes recherches. L’intérêt de chaque détail en serait doublé, car je tirerai fréquemment de l’étude de l’art à Venise la déduction évidente que l’affaiblissement de sa prospérité politique a exactement suivi l’affaiblissement de sa religion domestique et individuelle.
Je dis « domestique et individuelle », car — ceci est le second point que je prie de noter — le phénomène le plus curieux de l’histoire vénitienne est la vitalité de la
- ↑ Le Sénat vola par 512 voix contre 4 l’abdication de son autorité (Alison, chap. xxiii).