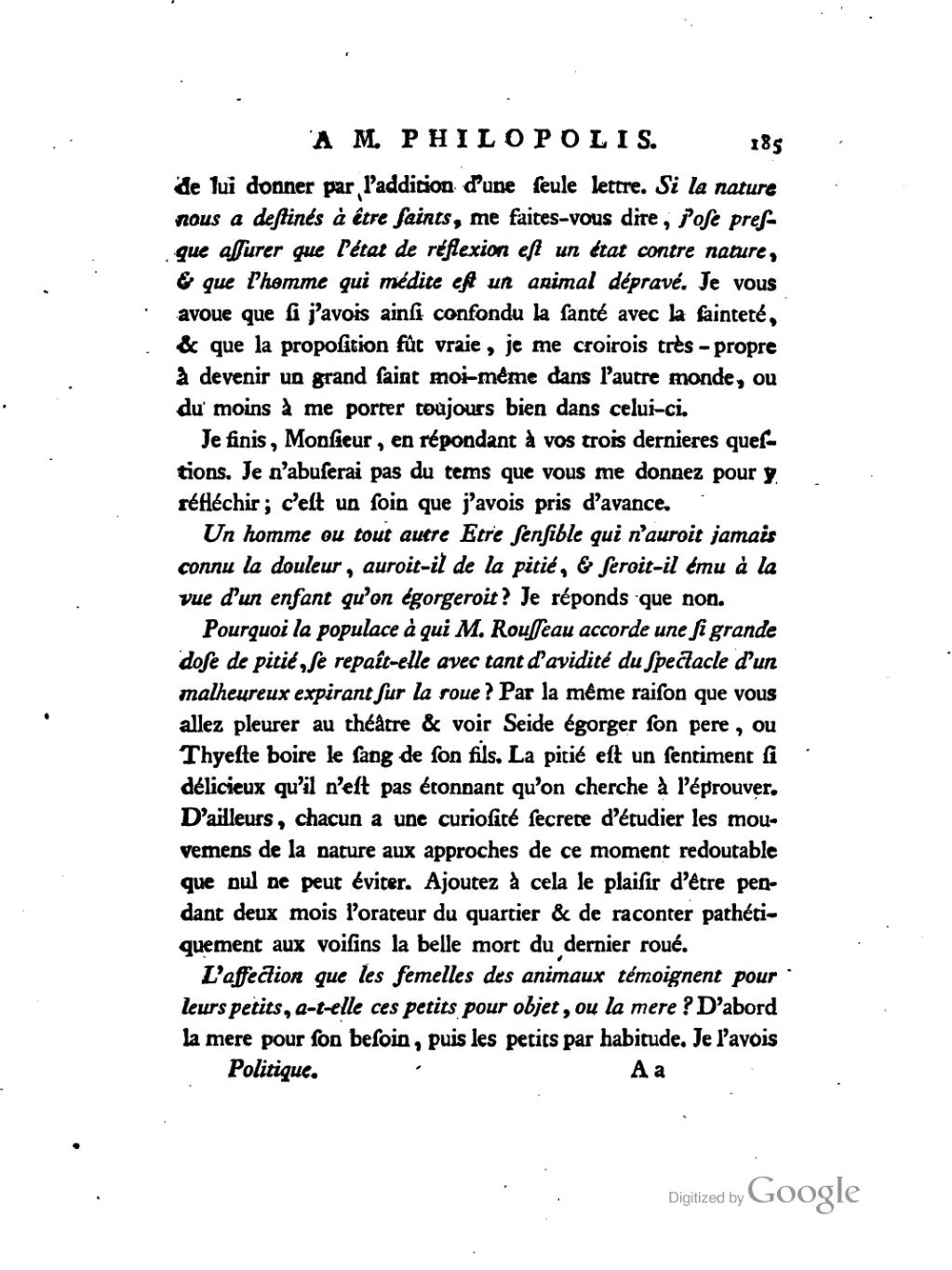de lui donner par l’addition d’une seule lettre. Si la nature nous a destinés à être saints, me faites-vous dire, j’ose presque assurer que l’état de réflexion est un état contre nature, & que l’homme qui médite est un animal dépravé. Je vous avoue que si j’avais ainsi confondu la santé avec la sainteté, & que la proposition fût vraie, je me croirois très-propre à devenir un grand saint moi-même dans l’autre monde, ou du moins à me porter toujours, bien dans celui-ci.
Je finis, Monsieur, en répondant à vos trois dernieres questions. Je n’abuserai pas du tems que vous me donnez pour y réfléchir ; c’est un soin que j’avois pris d’avance.
Un homme ou tout autre Etre sensible qui n’auroit jamais connu la douleur, auroit-il de la pitié, & seroit-il ému à la vue d’un enfant qu’on égorgeroit ? Je réponds que non.
Pourquoi la populace à qui M. Rousseau accorde une si grande dose de pitié, se repaît-elle avec tant d’avidité du spectacle d’un malheureux expirant sur la roue ? Par la même raison que vous allez pleurer au théâtre & voir Seide égorger son père, ou Thyeste boire le sang de son fils. La pitié est un sentiment si délicieux qu’il n’est pas étonnant qu’on cherche à l’éprouver. D’ailleurs, chacun a une curiosité secrete d’étudier les mouvemens de la nature aux approches de ce moment redoutable que nul ne peut éviter. Ajoutez à cela le plaisir d’être pendant deux mois l’orateur du quartier & de raconter pathétiquement aux voisins la belle mort du dernier roué.
L’affection que les femelles des animaux témoignent pour petits, a-t-elle ces petits pour objet, ou la mere ? D’abord la mere pour son besoin, puis les petits par habitude. Je l’avois