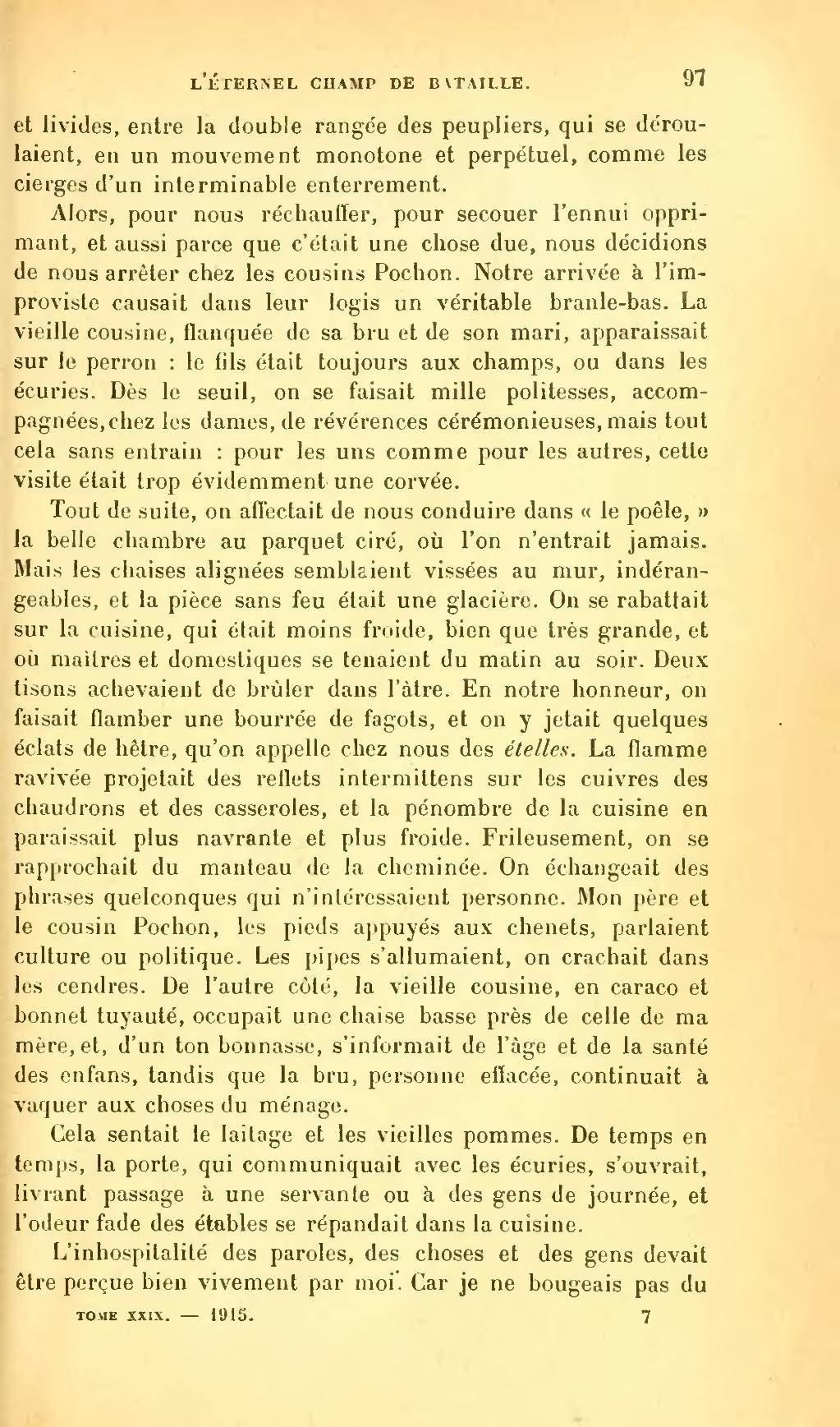et livides, entre la double rangée des peupliers, qui se déroulaient, en un mouvement monotone et perpétuel, comme les cierges d’un interminable enterrement.
Alors, pour nous réchauffer, pour secouer l’ennui opprimant, et aussi parce que c’était une chose due, nous décidions de nous arrêter chez les cousins Pochon. Notre arrivée à l’improviste causait dans leur logis un véritable branle-bas. La vieille cousine, flanquée de sa bru et de son mari, apparaissait sur le perron : le fils était toujours aux champs, ou dans les écuries. Dès le seuil, on se faisait mille politesses, accompagnées, chez les dames de révérences cérémonieuses, mais tout cela sans entrain : pour les uns comme pour les autres, cette visite était trop évidemment une corvée.
Tout de suite, on affectait de nous conduire dans « le poêle, » la belle chambre au parquet ciré, où l’on n’entrait jamais. Mais les chaises alignées semblaient vissées au mur, indérangeables, et la pièce sans feu était une glacière. On se rabattait sur la cuisine, qui était moins froide, bien que très grande, et où maîtres et domestiques se tenaient du matin au soir. Deux tisons achevaient de brûler dans l’âtre. En notre honneur, on faisait flamber une bourrée de fagots, et on y jetait quelques éclats de hêtre, qu’on appelle chez nous des ételles. La flamme ravivée projetait des reflets intermittens sur les cuivres des chaudrons et des casseroles, et la pénombre de la cuisine en paraissait plus navrante et plus froide. Frileusement, on se rapprochait du manteau de la cheminée. On échangeait des phrases quelconques qui n’intéressaient personne. Mon père et le cousin Pochon, les pieds appuyés aux chenets, parlaient culture ou politique. Les pipes s’allumaient, on crachait dans les cendres. De l’autre côté, la vieille cousine, en caraco et bonnet tuyauté, occupait une chaise basse près de celle de ma mère, et, d’un ton bonnasse, s’informait de l’âge et de la santé des enfans, tandis que la bru, personne effacée, continuait à vaquer aux choses du ménage.
Cela sentait le laitage et les vieilles pommes. De temps en temps, la porte, qui communiquait avec les écuries, s’ouvrait, livrant passage à une servante ou à des gens de journée, et l’odeur fade des étables se répandait dans la cuisine.
L’inhospitalité des paroles, des choses et des gens devait être perçue bien vivement par moi. Car je ne bougeais pas du