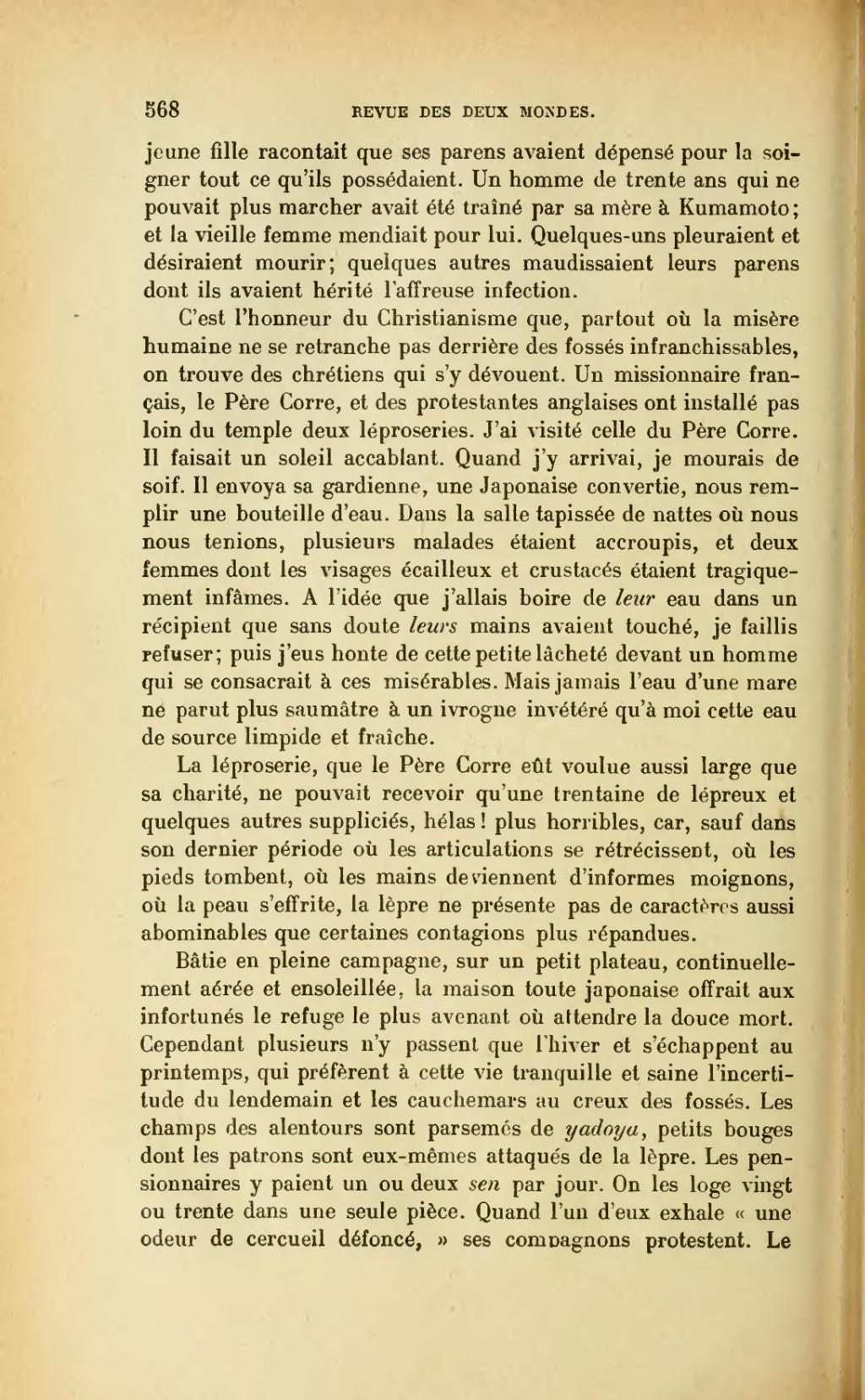jeune fille racontait que ses parens avaient dépensé pour la soigner tout ce qu’ils possédaient. Un homme de trente ans qui ne pouvait plus marcher avait été traîné par sa mère à Kumamoto ; et la vieille femme mendiait pour lui. Quelques-uns pleuraient et désiraient mourir ; quelques autres maudissaient leurs parens dont ils avaient hérité l’affreuse infection.
C’est l’honneur du Christianisme que, partout où la misère humaine ne se retranche pas derrière des fossés infranchissables, on trouve des chrétiens qui s’y dévouent. Un missionnaire français, le Père Corre, et des protestantes anglaises ont installé pas loin du temple deux léproseries. J’ai visité celle du Père Corre. Il faisait un soleil accablant. Quand j’y arrivai, je mourais de soif. Il envoya sa gardienne, une Japonaise convertie, nous remplir une bouteille d’eau. Dans la salle tapissée de nattes où nous nous tenions, plusieurs malades étaient accroupis, et deux femmes dont les visages écailleux et crustacés étaient tragiquement infâmes. A l’idée que j’allais boire de leur eau dans un récipient que sans doute leurs mains avaient touché, je faillis refuser ; puis j’eus honte de cette petite lâcheté devant un homme qui se consacrait à ces misérables. Mais jamais l’eau d’une mare ne parut plus saumâtre à un ivrogne invétéré qu’à moi cette eau de source limpide et fraîche.
La léproserie, que le Père Corre eût voulue aussi large que sa charité, ne pouvait recevoir qu’une trentaine de lépreux et quelques autres suppliciés, hélas ! plus horribles, car, sauf dans son dernier période où les articulations se rétrécissent, où les pieds tombent, où les mains deviennent d’informes moignons, où la peau s’effrite, la lèpre ne présente pas de caractères aussi abominables que certaines contagions plus répandues.
Bâtie en pleine campagne, sur un petit plateau, continuellement aérée et ensoleillée, la maison toute japonaise offrait aux infortunés le refuge le plus avenant où attendre la douce mort. Cependant plusieurs n’y passent que l’hiver et s’échappent au printemps, qui préfèrent à cette vie tranquille et saine l’incertitude du lendemain et les cauchemars au creux des fossés. Les champs des alentours sont parsemés de yadoya, petits bouges dont les patrons sont eux-mêmes attaqués de la lèpre. Les pensionnaires y paient un ou deux sen par jour. On les loge vingt ou trente dans une seule pièce. Quand l’un d’eux exhale « une odeur de cercueil défoncé, » ses compagnons protestent. Le