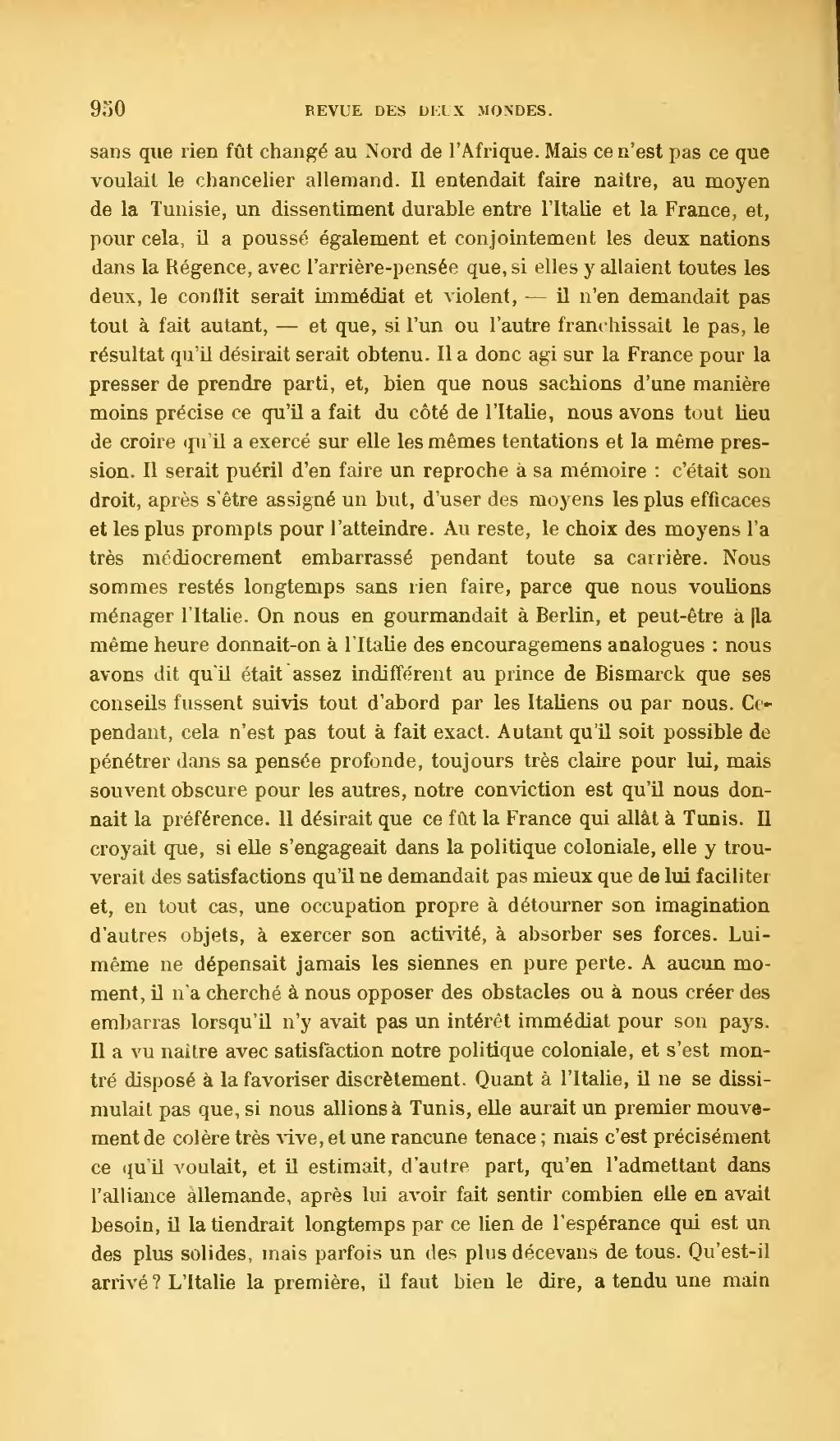sans que rien fût changé au Nord de l’Afrique. Mais ce n’est pas ce que voulait le chancelier allemand. Il entendait faire naître, au moyen de la Tunisie, un dissentiment durable entre l’Italie et la France, et, pour cela, il a poussé également et conjointement les deux nations dans la Régence, avec l’arrière-pensée que, si elles y allaient toutes les deux, le conflit serait immédiat et violent, — il n’en demandait pas tout à fait autant, — et que, si l’un ou l’autre franchissait le pas, le résultat qu’il désirait serait obtenu. Il a donc agi sur la France pour la presser de prendre parti, et, bien que nous sachions d’une manière moins précise ce qu’il a fait du côté de l’Italie, nous avons tout lieu de croire qu’il a exercé sur elle les mêmes tentations et la même pression. Il serait puéril d’en faire un reproche à sa mémoire : c’était son droit, après s’être assigné un but, d’user des moyens les plus efficaces et les plus prompts pour l’atteindre. Au reste, le choix des moyens l’a très médiocrement embarrassé pendant toute sa carrière. Nous sommes restés longtemps sans rien faire, parce que nous voulions ménager l’Italie. On nous en gourmandait à Berlin, et peut-être à la même heure donnait-on à l’Italie des encouragemens analogues : nous avons dit qu’il était assez indifférent au prince de Bismarck que ses conseils fussent suivis tout d’abord par les Italiens ou par nous. Cependant, cela n’est pas tout à fait exact. Autant qu’il soit possible de pénétrer dans sa pensée profonde, toujours très claire pour lui, mais souvent obscure pour les autres, notre conviction est qu’il nous donnait la préférence. Il désirait que ce fût la France qui allât à Tunis. Il croyait que, si elle s’engageait dans la politique coloniale, elle y trouverait des satisfactions qu’il ne demandait pas mieux que de lui faciliter et, en tout cas, une occupation propre à détourner son imagination d’autres objets, à exercer son activité, à absorber ses forces. Lui-même ne dépensait jamais les siennes en pure perte. A aucun moment, il n’a cherché à nous opposer des obstacles ou à nous créer des embarras lorsqu’il n’y avait pas un intérêt immédiat pour son pays. Il a vu naître avec satisfaction notre politique coloniale, et s’est montré disposé à la favoriser discrètement. Quant à l’Italie, il ne se dissimulait pas que, si nous allions à Tunis, elle aurait un premier mouvement de colère très vive, et une rancune tenace ; mais c’est précisément ce qu’il voulait, et il estimait, d’autre part, qu’en l’admettant dans l’alliance allemande, après lui avoir fait sentir combien elle en avait besoin, il la tiendrait longtemps par ce lien de l’espérance qui est un des plus solides, mais parfois un des plus décevans de tous. Qu’est-il arrivé ? L’Italie la première, il faut bien le dire, a tendu une main
Page:Revue des Deux Mondes - 1903 - tome 17.djvu/954
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.