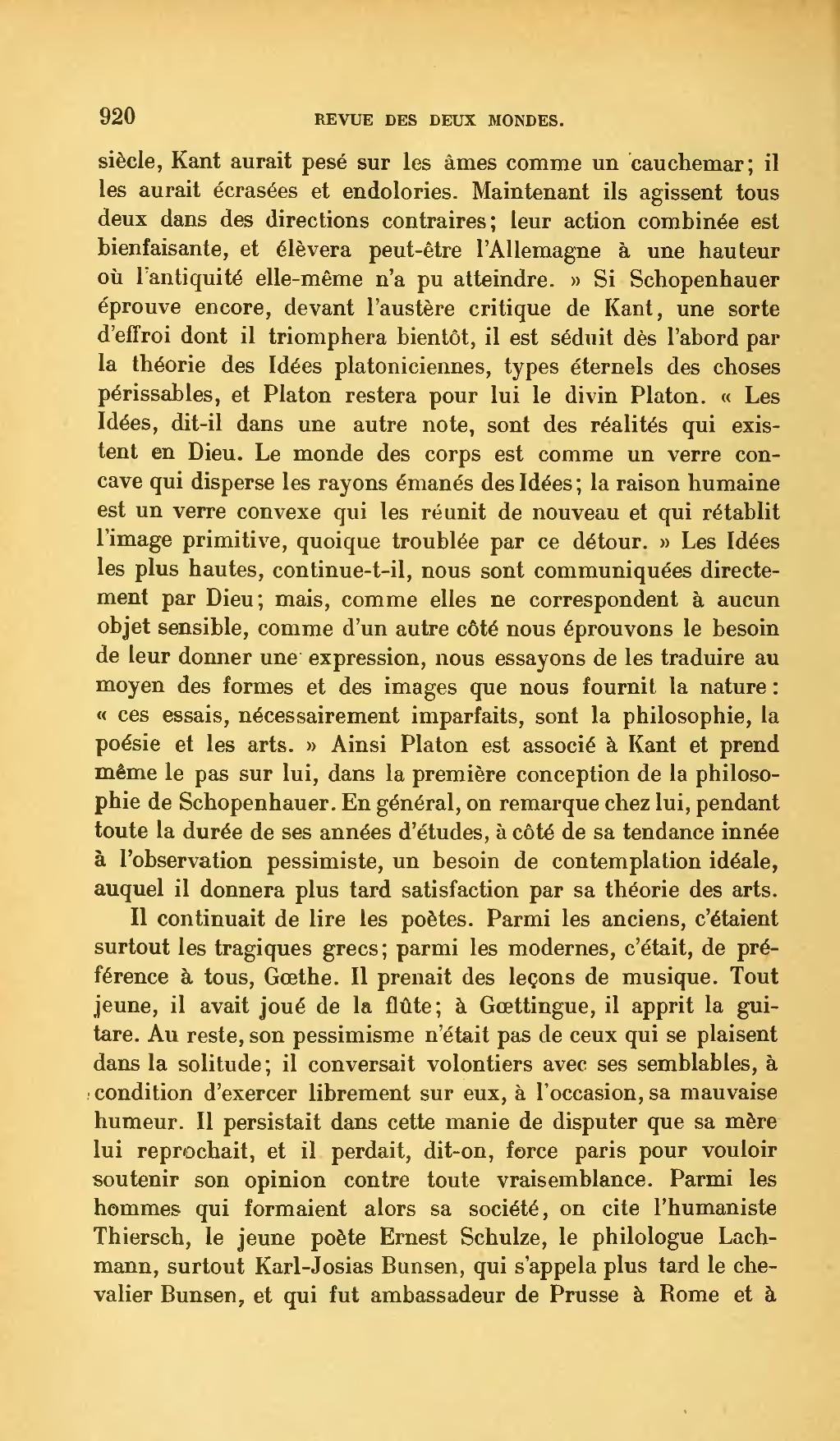siècle, Kant aurait pesé sur les âmes comme un cauchemar ; il les aurait écrasées et endolories. Maintenant ils agissent tous deux dans des directions contraires ; leur action combinée est bienfaisante, et élèvera peut-être l’Allemagne à une hauteur où l’antiquité elle-même n’a pu atteindre. » Si Schopenhauer éprouve encore, devant l’austère critique de Kant, une sorte d’effroi dont il triomphera bientôt, il est séduit dès l’abord par la théorie des Idées platoniciennes, types éternels des choses périssables, et Platon restera pour lui le divin Platon. « Les Idées, dit-il dans une autre note, sont des réalités qui existent en Dieu. Le monde des corps est comme un verre concave qui disperse les rayons émanés des Idées ; la raison humaine est un verre convexe qui les réunit de nouveau et qui rétablit l’image primitive, quoique troublée par ce détour. » Les Idées les plus hautes, continue-t-il, nous sont communiquées directement par Dieu ; mais, comme elles ne correspondent à aucun objet sensible, comme d’un autre côté nous éprouvons le besoin de leur donner une expression, nous essayons de les traduire au moyen des formes et des images que nous fournit la nature : « ces essais, nécessairement imparfaits, sont la philosophie, la poésie et les arts. » Ainsi Platon est associé à Kant et prend même le pas sur lui, dans la première conception de la philosophie de Schopenhauer. En général, on remarque chez lui, pendant toute la durée de ses années d’études, à côté de sa tendance innée à l’observation pessimiste, un besoin de contemplation idéale, auquel il donnera plus tard satisfaction par sa théorie des arts.
Il continuait de lire les poètes. Parmi les anciens, c’étaient surtout les tragiques grecs ; parmi les modernes, c’était, de préférence à tous, Gœthe. Il prenait des leçons de musique. Tout jeune, il avait joué de la flûte ; à Gœttingue, il apprit la guitare. Au reste, son pessimisme n’était pas de ceux qui se plaisent dans la solitude ; il conversait volontiers avec ses semblables, à condition d’exercer librement sur eux, à l’occasion, sa mauvaise humeur. Il persistait dans cette manie de disputer que sa mère lui reprochait, et il perdait, dit-on, force paris pour vouloir soutenir son opinion contre toute vraisemblance. Parmi les hommes qui formaient alors sa société, on cite l’humaniste Thiersch, le jeune poète Ernest Schulze, le philologue Lachmann, surtout Karl-Josias Bunsen, qui s’appela plus tard le chevalier Bunsen, et qui fut ambassadeur de Prusse à Rome et à