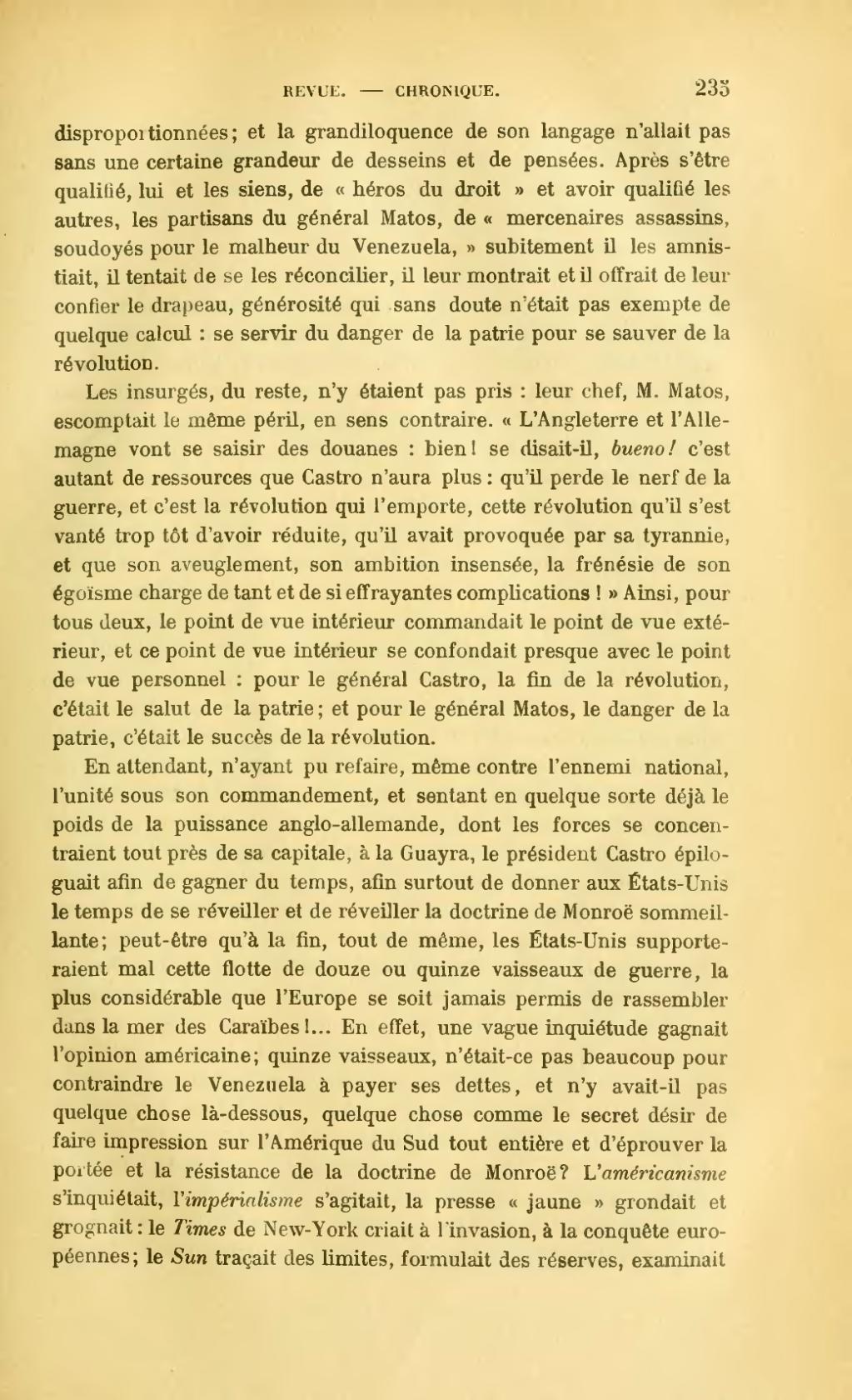disproportionnées ; et la grandiloquence de son langage n’allait pas sans une certaine grandeur de desseins et de pensées. Après s’être qualifié, lui et les siens, de « héros du droit » et avoir qualifié les autres, les partisans du général Matos, de « mercenaires assassins, soudoyés pour le malheur du Venezuela, » subitement il les amnistiait, il tentait de se les réconcilier, il leur montrait et il offrait de leur confier le drapeau, générosité qui sans doute n’était pas exempte de quelque calcul : se servir du danger de la patrie pour se sauver de la révolution.
Les insurgés, du reste, n’y étaient pas pris : leur chef, M. Matos, escomptait le même péril, en sens contraire. « L’Angleterre et l’Allemagne vont se saisir des douanes : bien ! se disait-il, bueno ! c’est autant de ressources que Castro n’aura plus ; qu’il perde le nerf de la guerre, et c’est la révolution qui l’emporte, cette révolution qu’il s’est vanté trop tôt d’avoir réduite, qu’il avait provoquée par sa tyrannie, et que son aveuglement, son ambition insensée, la frénésie de son égoïsme charge de tant et de si effrayantes complications ! » Ainsi, pour tous deux, le point de vue intérieur commandait le point de vue extérieur, et ce point de vue intérieur se confondait presque avec le point de vue personnel : pour le général Castro, la fin de la révolution, c’était le salut de la patrie ; et pour le général Matos, le danger de la patrie, c’était le succès de la révolution.
En attendant, n’ayant pu refaire, même contre l’ennemi national, l’unité sous son commandement, et sentant en quelque sorte déjà le poids de la puissance anglo-allemande, dont les forces se concentraient tout près de sa capitale, à la Guayra, le président Castro épiloguait afin de gagner du temps, afin surtout de donner aux États-Unis le temps de se réveiller et de réveiller la doctrine de Monroë sommeillante ; peut-être qu’à la fin, tout de même, les États-Unis supporteraient mal cette flotte de douze ou quinze vaisseaux de guerre, la plus considérable que l’Europe se soit jamais permis de rassembler dans la mer des Caraïbes !... En effet, une vague inquiétude gagnait l’opinion américaine ; quinze vaisseaux, n’était-ce pas beaucoup pour contraindre le Venezuela à payer ses dettes, et n’y avait-il pas quelque chose là-dessous, quelque chose comme le secret désir de faire impression sur l’Amérique du Sud tout entière et d’éprouver la portée et la résistance de la doctrine de Monroë ? L’américanisme s’inquiétait, l’impérialisme s’agitait, la presse « jaune » grondait et grognait : le Times de New-York criait à l’invasion, à la conquête européennes ; le Sun traçait des limites, formulait des réserves, examinait