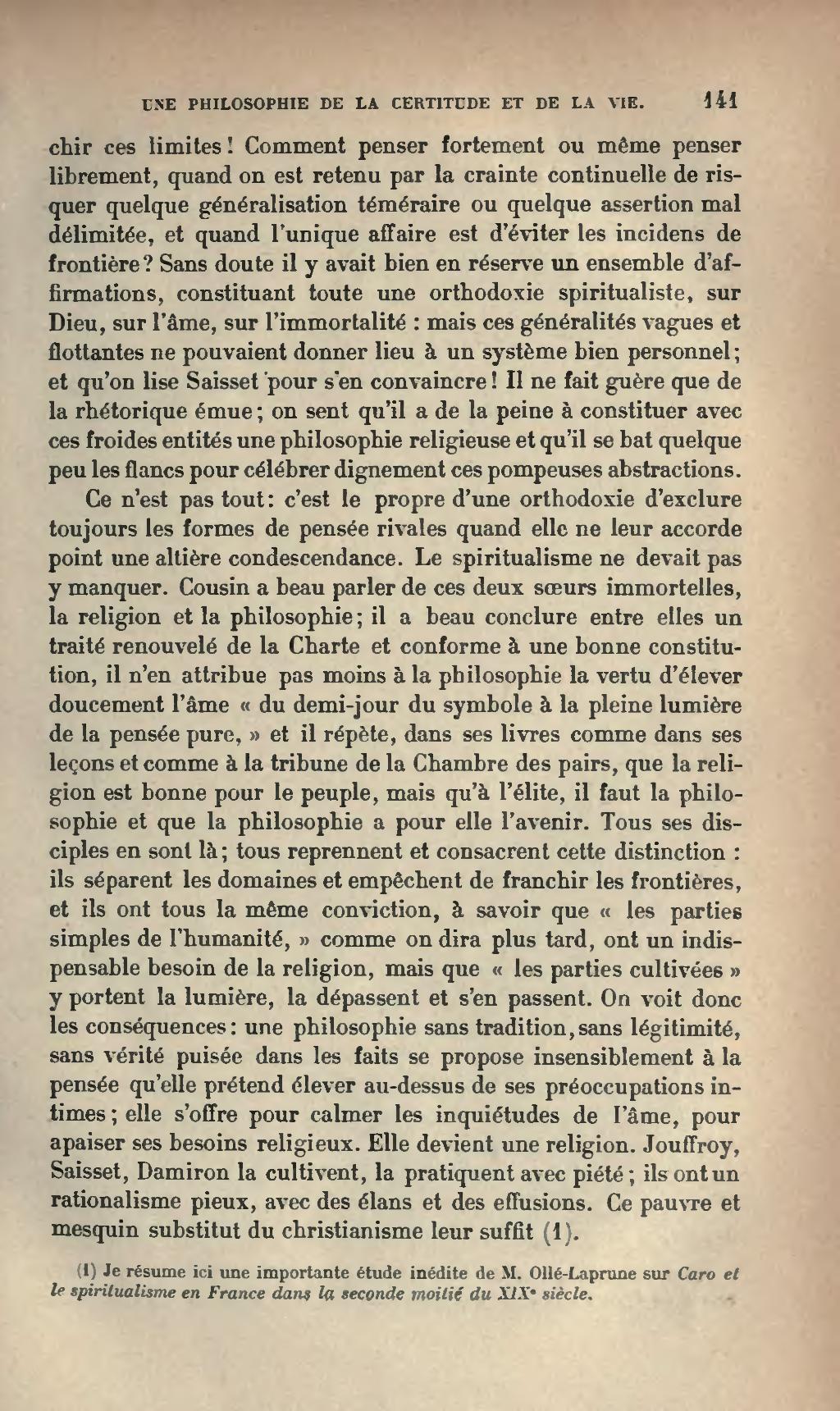franchir ces limites ! Comment penser fortement ou même penser librement, quand on est retenu par la crainte continuelle de risquer quelque généralisation téméraire ou quelque assertion mal délimitée, et quand l’unique affaire est d’éviter les incidens de frontière ? Sans doute il y avait bien en réserve un ensemble d’affirmations, constituant toute une orthodoxie spiritualiste, sur Dieu, sur l’âme, sur l’immortalité : mais ces généralités vagues et flottantes ne pouvaient donner lieu à un système bien personnel ; et qu’on lise Saisset pour s’en convaincre ! Il ne fait guère que de la rhétorique émue ; on sent qu’il a de la peine à constituer avec ces froides entités une philosophie religieuse et qu’il se bat quelque peu les flancs pour célébrer dignement ces pompeuses abstractions.
Ce n’est pas tout : c’est le propre d’une orthodoxie d’exclure toujours les formes de pensée rivales quand elle ne leur accorde point une altière condescendance. Le spiritualisme ne devait pas y manquer. Cousin a beau parler de ces deux sœurs immortelles, la religion et la philosophie ; il a beau conclure entre elles un traité renouvelé de la Charte et conforme à une bonne constitution, il n’en attribue pas moins à la philosophie la vertu d’élever doucement l’âme « du demi-jour du symbole à la pleine lumière de la pensée pure, » et il répète, dans ses livres comme dans ses leçons et comme à la tribune de la Chambre des pairs, que la religion est bonne pour le peuple, mais qu’à l’élite, il faut la philosophie et que la philosophie a pour elle l’avenir. Tous ses disciples en sont là ; tous reprennent et consacrent cette distinction : ils séparent les domaines et empêchent de franchir les frontières, et ils ont tous la même conviction, à savoir que « les parties simples de l’humanité, » comme on dira plus tard, ont un indispensable besoin de la religion, mais que « les parties cultivées » y portent la lumière, la dépassent et s’en passent. On voit donc les conséquences : une philosophie sans tradition, sans légitimité, sans vérité puisée dans les faits se propose insensiblement à la pensée qu’elle prétend élever au-dessus de ses préoccupations intimes ; elle s’offre pour calmer les inquiétudes de l’âme, pour apaiser ses besoins religieux. Elle devient une religion. Jouffroy, Saisset, Damiron la cultivent, la pratiquent avec piété ; ils ont un rationalisme pieux, avec des élans et des effusions. Ce pauvre et mesquin substitut du christianisme leur suffit[1].
- ↑ Je résume ici une importante étude inédite de M. Ollé-Laprune sur Caro et le spiritualisme en France dans la seconde moitié du XIXe siècle.