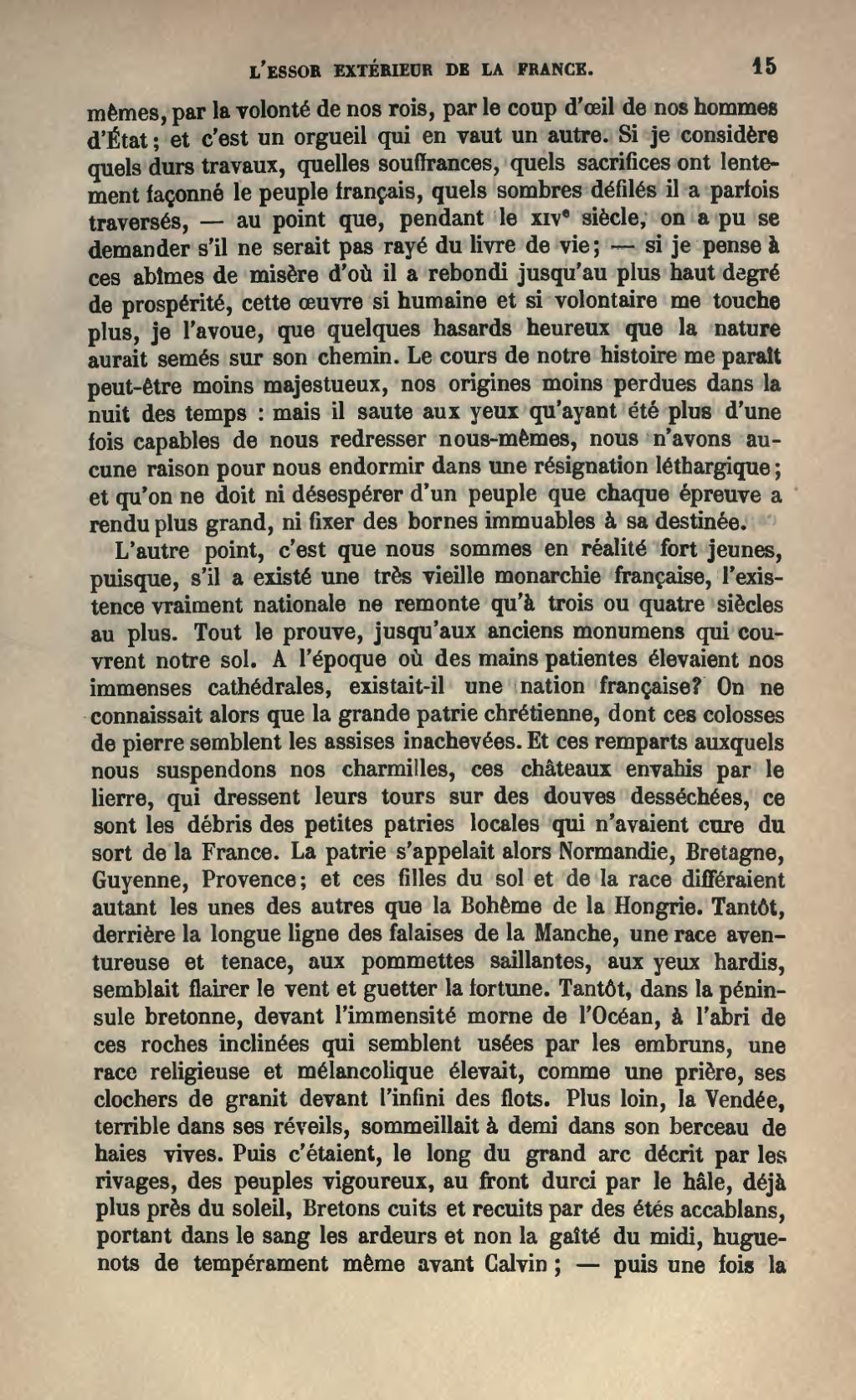nous-mêmes, par la volonté de nos rois, par le coup d’œil de nos hommes d’État ; et c’est un orgueil qui en vaut un autre. Si je considère quels durs travaux, quelles souffrances, quels sacrifices ont lentement façonné le peuple français, quels sombres défilés il a parfois traversés, — au point que, pendant le XIVe siècle, on a pu se demander s’il ne serait pas rayé du livre de vie ; — si je pense à ces abîmes de misère d’où il a rebondi jusqu’au plus haut degré de prospérité, cette œuvre si humaine et si volontaire me touche plus, je l’avoue, que quelques hasards heureux que la nature aurait semés sur son chemin. Le cours de notre histoire me parait peut-être moins majestueux, nos origines moins perdues dans la nuit des temps : mais il saute aux yeux qu’ayant été plus d’une fois capables de nous redresser nous-mêmes, nous n’avons aucune raison pour nous endormir dans une résignation léthargique ; et qu’on ne doit ni désespérer d’un peuple que chaque épreuve a rendu plus grand, ni fixer des bornes immuables à sa destinée.
L’autre point, c’est que nous sommes en réalité fort jeunes, puisque, s’il a existé une très vieille monarchie française, l’existence vraiment nationale ne remonte qu’à trois ou quatre siècles au plus. Tout le prouve, jusqu’aux anciens monumens qui couvrent notre sol. À l’époque où des mains patientes élevaient nos immenses cathédrales, existait-il une nation française ? On ne connaissait alors que la grande patrie chrétienne, dont ces colosses de pierre semblent les assises inachevées. Et ces remparts auxquels nous suspendons nos charmilles, ces châteaux envahis par le lierre, qui dressent leurs tours sur des douves desséchées, ce sont les débris des petites patries locales qui n’avaient cure du sort de la France. La patrie s’appelait alors Normandie, Bretagne, Guyenne, Provence ; et ces filles du sol et de la race différaient autant les unes des autres que la Bohème de la Hongrie. Tantôt, derrière la longue ligne des falaises de la Manche, une race aventureuse et tenace, aux pommettes saillantes, aux yeux hardis, semblait flairer le vent et guetter la fortune. Tantôt, dans la péninsule bretonne, devant l’immensité morne de l’Océan, à l’abri de ces roches inclinées qui semblent usées par les embruns, une race religieuse et mélancolique élevait, comme une prière, ses clochers de granit devant l’infini des flots. Plus loin, la Vendée, terrible dans ses réveils, sommeillait à demi dans son berceau de haies vives. Puis c’étaient, le long du grand arc décrit par les rivages, des peuples vigoureux, au front durci par le hâle, déjà plus près du soleil, Bretons cuits et recuits par des étés accablans, portant dans le sang les ardeurs et non la gaîté du midi, huguenots de tempérament même avant Calvin ; — puis une fois la