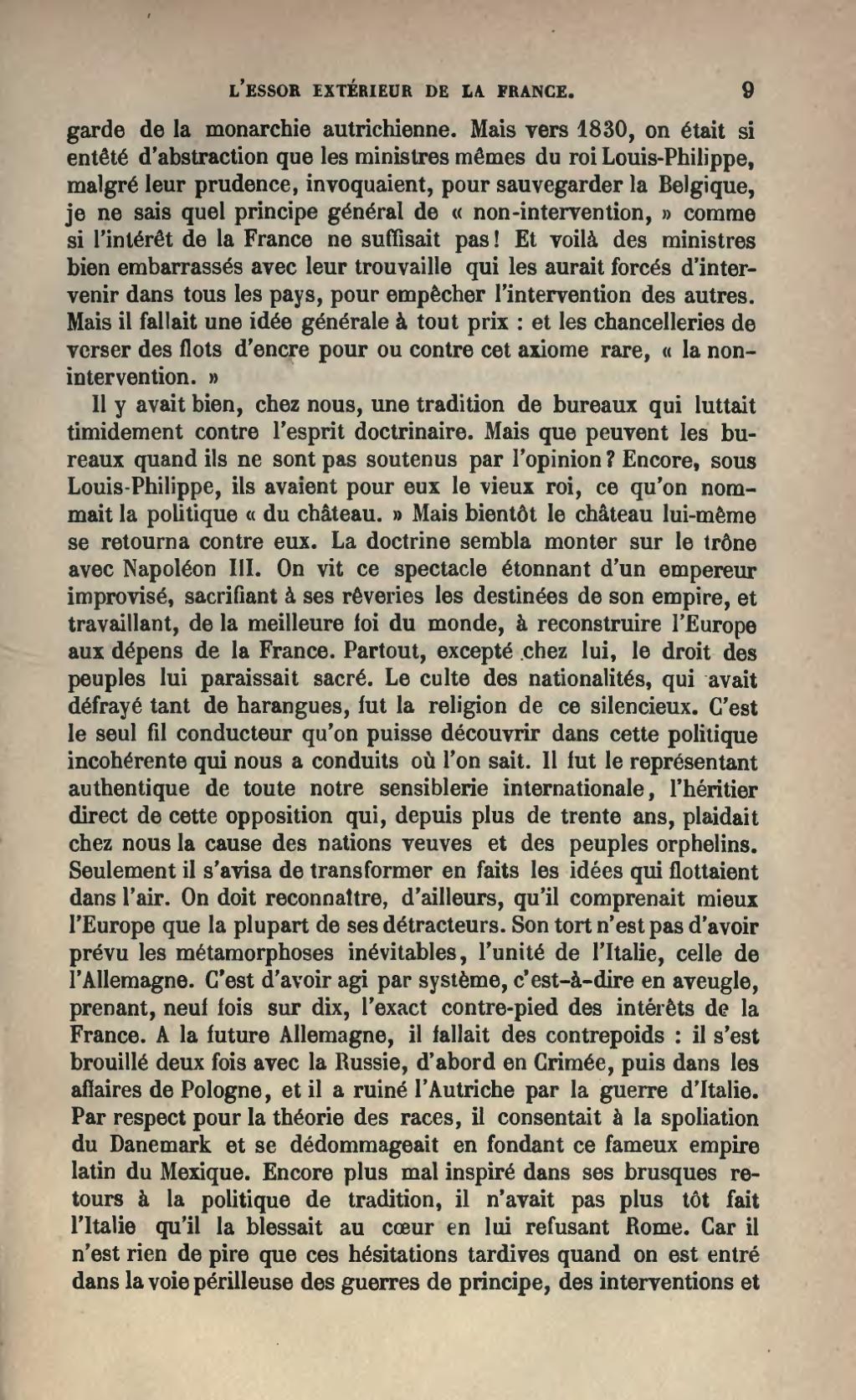sauvegarde de la monarchie autrichienne. Mais vers 1830, on était si entêté d’abstraction que les ministres mêmes du roi Louis-Philippe, malgré leur prudence, invoquaient, pour sauvegarder la Belgique, je ne sais quel principe général de « non-intervention, » comme si l’intérêt de la France ne suffisait pas ! Et voilà des ministres bien embarrassés avec leur trouvaille qui les aurait forcés d’intervenir dans tous les pays, pour empêcher l’intervention des autres. Mais il fallait une idée générale à tout prix : et les chancelleries de verser des flots d’encre pour ou contre cet axiome rare, « la non-intervention. »
Il y avait bien, chez nous, une tradition de bureaux qui luttait timidement contre l’esprit doctrinaire. Mais que peuvent les bureaux quand ils ne sont pas soutenus par l’opinion ? Encore, sous Louis-Philippe, ils avaient pour eux le vieux roi, ce qu’on nommait la politique « du château. » Mais bientôt le château lui-même se retourna contre eux. La doctrine sembla monter sur le trône avec Napoléon III. On vit ce spectacle étonnant d’un empereur improvisé, sacrifiant à ses rêveries les destinées de son empire, et travaillant, de la meilleure foi du monde, à reconstruire l’Europe aux dépens de la France. Partout, excepté chez lui, le droit des peuples lui paraissait sacré. Le culte des nationalités, qui avait défrayé tant de harangues, fut la religion de ce silencieux. C’est le seul fil conducteur qu’on puisse découvrir dans cette politique incohérente qui nous a conduits où l’on sait. Il fut le représentant authentique de toute notre sensiblerie internationale, l’héritier direct de cette opposition qui, depuis plus de trente ans, plaidait chez nous la cause des nations veuves et des peuples orphelins. Seulement il s’avisa de transformer en faits les idées qui flottaient dans l’air. On doit reconnaître, d’ailleurs, qu’il comprenait mieux l’Europe que la plupart de ses détracteurs. Son tort n’est pas d’avoir prévu les métamorphoses inévitables, l’unité de l’Italie, celle de l’Allemagne. C’est d’avoir agi par système, c’est-à-dire en aveugle, prenant, neuf fois sur dix, l’exact contre-pied des intérêts de la France. À la future Allemagne, il fallait des contrepoids : il s’est brouillé deux fois avec la Russie, d’abord en Crimée, puis dans les affaires de Pologne, et il a ruiné l’Autriche par la guerre d’Italie. Par respect pour la théorie des races, il consentait à la spoliation du Danemark et se dédommageait en fondant ce fameux empire latin du Mexique. Encore plus mal inspiré dans ses brusques retours à la politique de tradition, il n’avait pas plus tôt fait l’Italie qu’il la blessait au cœur en lui refusant Rome. Car il n’est rien de pire que ces hésitations tardives quand on est entré dans la voie périlleuse des guerres de principe, des interventions et