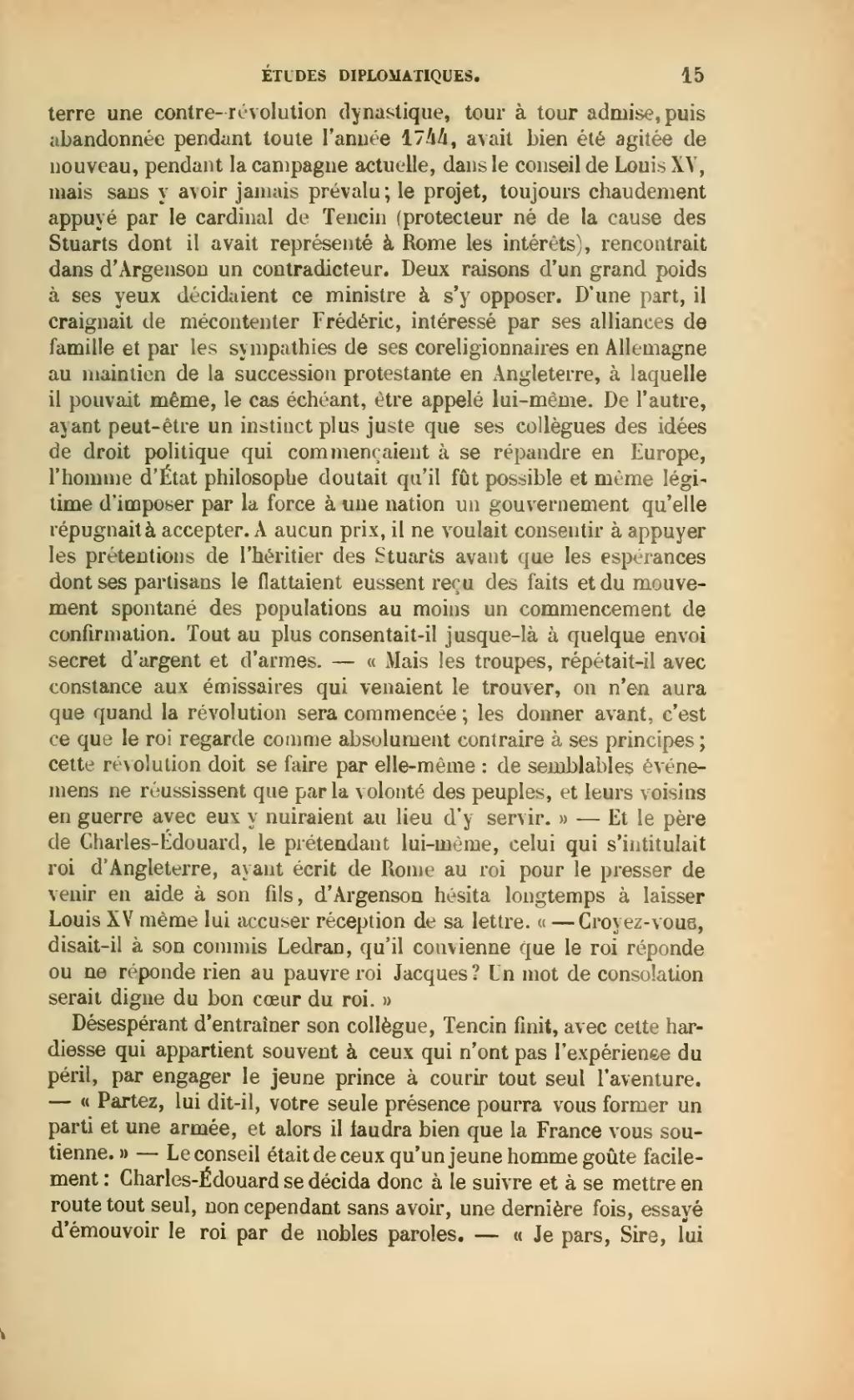Angleterre une contre-révolution dynastique, tour à tour admise, puis abandonnée pendant toute l’année 1744, avait bien été agitée de nouveau, pendant la campagne actuelle, dans le conseil de Louis XV, mais sans y avoir jamais prévalu ; le projet, toujours chaudement appuyé par le cardinal de Tencin (protecteur né de la cause des Stuarts dont il avait représenté à Rome les intérêts), rencontrait dans d’Argenson un contradicteur. Deux raisons d’un grand poids à ses yeux décidaient ce ministre à s’y opposer. D’une part, il craignait de mécontenter Frédéric, intéressé par ses alliances de famille et par les sympathies de ses coreligionnaires en Allemagne au maintien de la succession protestante en Angleterre, à laquelle il pouvait même, le cas échéant, être appelé lui-même. De l’autre, ayant peut-être un instinct plus juste que ses collègues des idées de droit politique qui commençaient à se répandre en Europe, l’homme d’État philosophe doutait qu’il fût possible et même légitime d’imposer par la force à une nation un gouvernement qu’elle répugnait à accepter. A aucun prix, il ne voulait consentir à appuyer les prétentions de l’héritier des Stuarts avant que les espérances dont ses partisans le flattaient eussent reçu des faits et du mouvement spontané des populations au moins un commencement de confirmation. Tout au plus consentait-il jusque-là à quelque envoi secret d’argent et d’armes. — « Mais les troupes, répétait-il avec constance aux émissaires qui venaient le trouver, on n’en aura que quand la révolution sera commencée ; les donner avant, c’est ce que le roi regarde comme absolument contraire à ses principes ; cette révolution doit se faire par elle-même : de semblables événemens ne réussissent que par la volonté des peuples, et leurs voisins en guerre avec eux y nuiraient au lieu d’y servir. » — Et le père de Charles-Edouard, le prétendant lui-même, celui qui s’intitulait roi d’Angleterre, ayant écrit de Rome au roi pour le presser de venir en aide à son fils, d’Argenson hésita longtemps à laisser Louis XV même lui accuser réception de sa lettre. « — Croyez-vous, disait-il à son commis Ledran, qu’il convienne que le roi réponde ou ne réponde rien au pauvre roi Jacques ? Un mot de consolation serait digne du bon cœur du roi. »
Désespérant d’entraîner son collègue, Tencin finit, avec cette hardiesse qui appartient souvent à ceux qui n’ont pas l’expérience du péril, par engager le jeune prince à courir tout seul l’aventure. — « Partez, lui dit-il, votre seule présence pourra vous former un parti et une armée, et alors il faudra bien que la France vous soutienne. » — Le conseil était de ceux qu’un jeune homme goûte facilement : Charles-Edouard se décida donc à le suivre et à se mettre en route tout seul, non cependant sans avoir, une dernière fois, essayé d’émouvoir le roi par de nobles paroles. — « Je pars, Sire, lui