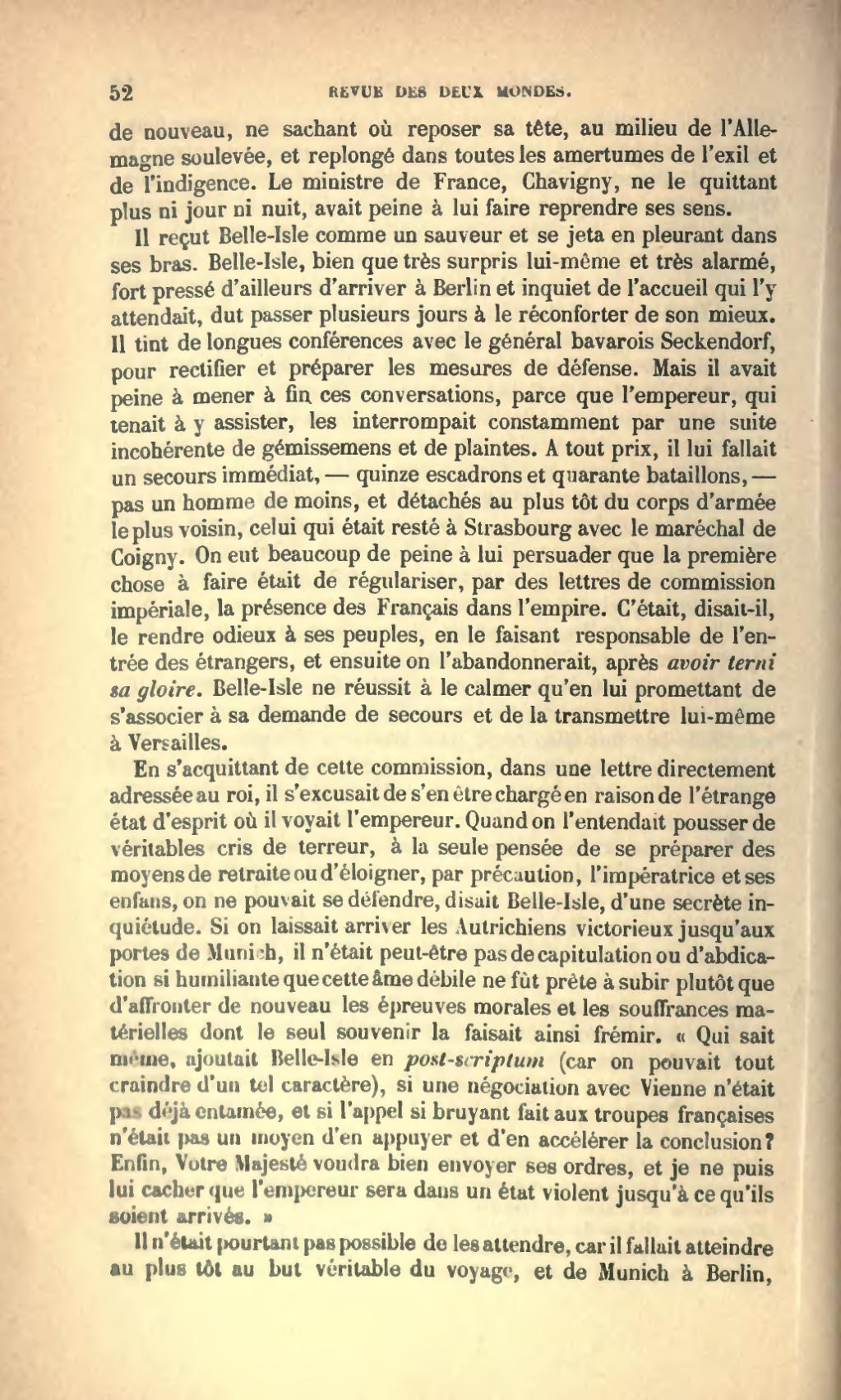de nouveau, ne sachant où reposer sa tête, au milieu de l’Allemagne soulevée, et replongé dans toutes les amertumes de l’exil et de l’indigence. Le ministre de France, Chavigny, ne le quittant plus ni jour ni nuit, avait peine à lui faire reprendre ses sens.
Il reçut Belle-Isle comme un sauveur et se jeta en pleurant dans ses bras. Belle-Isle, bien que très surpris lui-même et très alarmé, fort pressé d’ailleurs d’arriver à Berlin et inquiet de l’accueil qui l’y attendait, dut passer plusieurs jours à le réconforter de son mieux. Il tint de longues conférences avec le général bavarois Seckendorf, pour rectifier et préparer les mesures de défense. Mais il avait peine à mener à fin ces conversations, parce que l’empereur, qui tenait à y assister, les interrompait constamment par une suite incohérente de gémissemens et de plaintes. A tout prix, il lui fallait un secours immédiat, — quinze escadrons et quarante bataillons, — pas un homme de moins, et détachés au plus tôt du corps d’armée le plus voisin, celui qui était resté à Strasbourg avec le maréchal de Coigny. On eut beaucoup de peine à lui persuader que la première chose à faire était de régulariser, par des lettres de commission impériale, la présence des Français dans l’empire. C’était, disait-il, le rendre odieux à ses peuples, en le faisant responsable de l’entrée des étrangers, et ensuite on l’abandonnerait, après avoir terni sa gloire. Belle-Isle ne réussit à le calmer qu’en lui promettant de s’associer à sa demande de secours et de la transmettre lui-même à Versailles.
En s’acquittant de cette commission, dans une lettre directement adressée au roi, il s’excusait de s’en être chargé en raison de l’étrange état d’esprit où il voyait l’empereur. Quand on l’entendait pousser de véritables cris de terreur, à la seule pensée de se préparer des moyens de retraite ou d’éloigner, par précaution, l’impératrice et ses enfans, on ne pouvait se défendre, disait Belle-Isle, d’une secrète inquiétude. Si on laissait arriver les Autrichiens victorieux jusqu’aux portes de Munich, il n’était peut-être pas de capitulation ou d’abdication si humiliante que cette âme débile ne fût prête à subir plutôt que d’affronter de nouveau les épreuves morales et les souffrances matérielles dont le seul souvenir la faisait ainsi frémir. « Qui sait même, ajoutait Belle-Isle en post-scriptum (car on pouvait tout craindre d’un tel caractère), si une négociation avec Vienne n’était pas déjà entamée, et si l’appel si bruyant fait aux troupes françaises n’était pas un moyen d’en appuyer et d’en accélérer la conclusion ? Enfin, Votre Majesté voudra bien envoyer ses ordres, et je ne puis lui cacher que l’empereur sera dans un état violent jusqu’à ce qu’ils soient arrivés. »
Il n’était pourtant pas possible de les attendre, car il fallait atteindre au plus tôt au but véritable du voyage, et de Munich à Berlin,