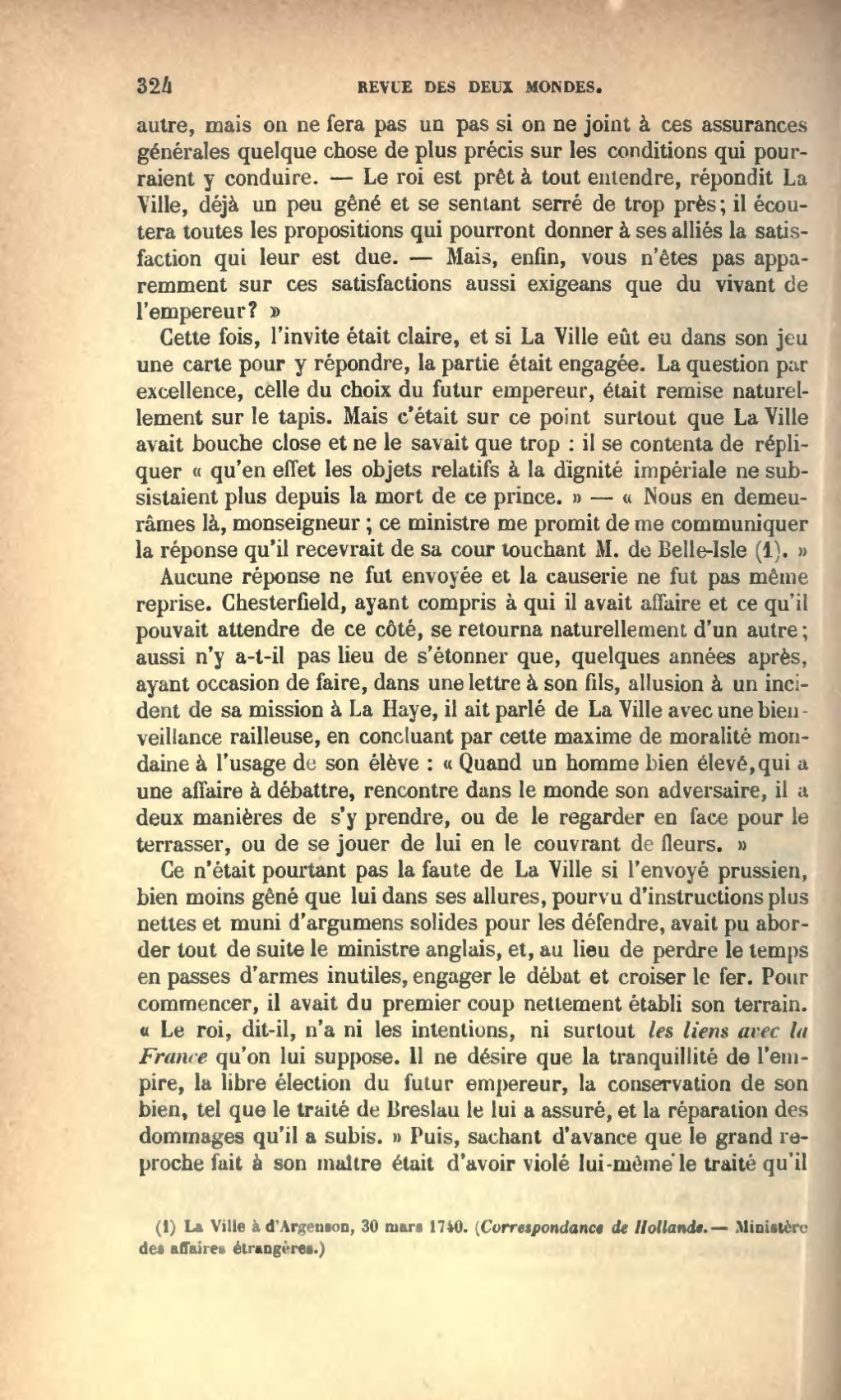autre, mais on ne fera pas un pas si on ne joint à ces assurances générales quelque chose de plus précis sur les conditions qui pourraient y conduire. — Le roi est prêt à tout entendre, répondit La Ville, déjà un peu gêné et se sentant serré de trop près ; il écoutera toutes les propositions qui pourront donner à ses alliés la satisfaction qui leur est due. — Mais, enfin, vous n’êtes pas apparemment sur ces satisfactions aussi exigeans que du vivant de l’empereur ? »
Cette fois, l’invite était claire, et si La Ville eût eu dans son jeu une carte pour y répondre, la partie était engagée. La question par excellence, celle du choix du futur empereur, était remise naturellement sur le tapis. Mais c’était sur ce point surtout que La Ville avait bouche close et ne le savait que trop : il se contenta de répliquer « qu’en effet les objets relatifs à la dignité impériale ne subsistaient plus depuis la mort de ce prince. » — « Nous en demeurâmes là, monseigneur ; ce ministre me promit de me communiquer la réponse qu’il recevrait de sa cour touchant M. de Belle-Isle[1]. »
Aucune réponse ne fut envoyée et la causerie ne fut pas même reprise. Chesterfield, ayant compris à qui il avait affaire et ce qu’il pouvait attendre de ce côté, se retourna naturellement d’un autre ; aussi n’y a-t-il pas lieu de s’étonner que, quelques années après, ayant occasion de faire, dans une lettre à son fils, allusion à un incident de sa mission à La Haye, il ait parlé de La Ville avec une bienveillance railleuse, en concluant par cette maxime de moralité mondaine à l’usage de son élève : « Quand un homme bien élevé, qui a une affaire à débattre, rencontre dans le monde son adversaire, il a deux manières de s’y prendre, ou de le regarder en face pour le terrasser, ou de se jouer de lui en le couvrant de fleurs. »
Ce n’était pourtant pas la faute de La Ville si l’envoyé prussien, bien moins gêné que lui dans ses allures, pourvu d’instructions plus nettes et muni d’argumens solides pour les défendre, avait pu aborder tout de suite le ministre anglais, et, au lieu de perdre le temps en passes d’armes inutiles, engager le débat et croiser le fer. Pour commencer, il avait du premier coup nettement établi son terrain. « Le roi, dit-il, n’a ni les intentions, ni surtout les liens avec la France qu’on lui suppose. Il ne désire que la tranquillité de l’empire, la libre élection du futur empereur, la conservation de son bien, tel que le traité de Breslau le lui a assuré, et la réparation des dommages qu’il a subis. » Puis, sachant d’avance que le grand reproche fait à son maître était d’avoir violé lui-même le traité qu’il
- ↑ La Ville à d’Argenson, 30 mars 1745. (Correspondance de Hollande. — Ministère des affaires étrangères.)