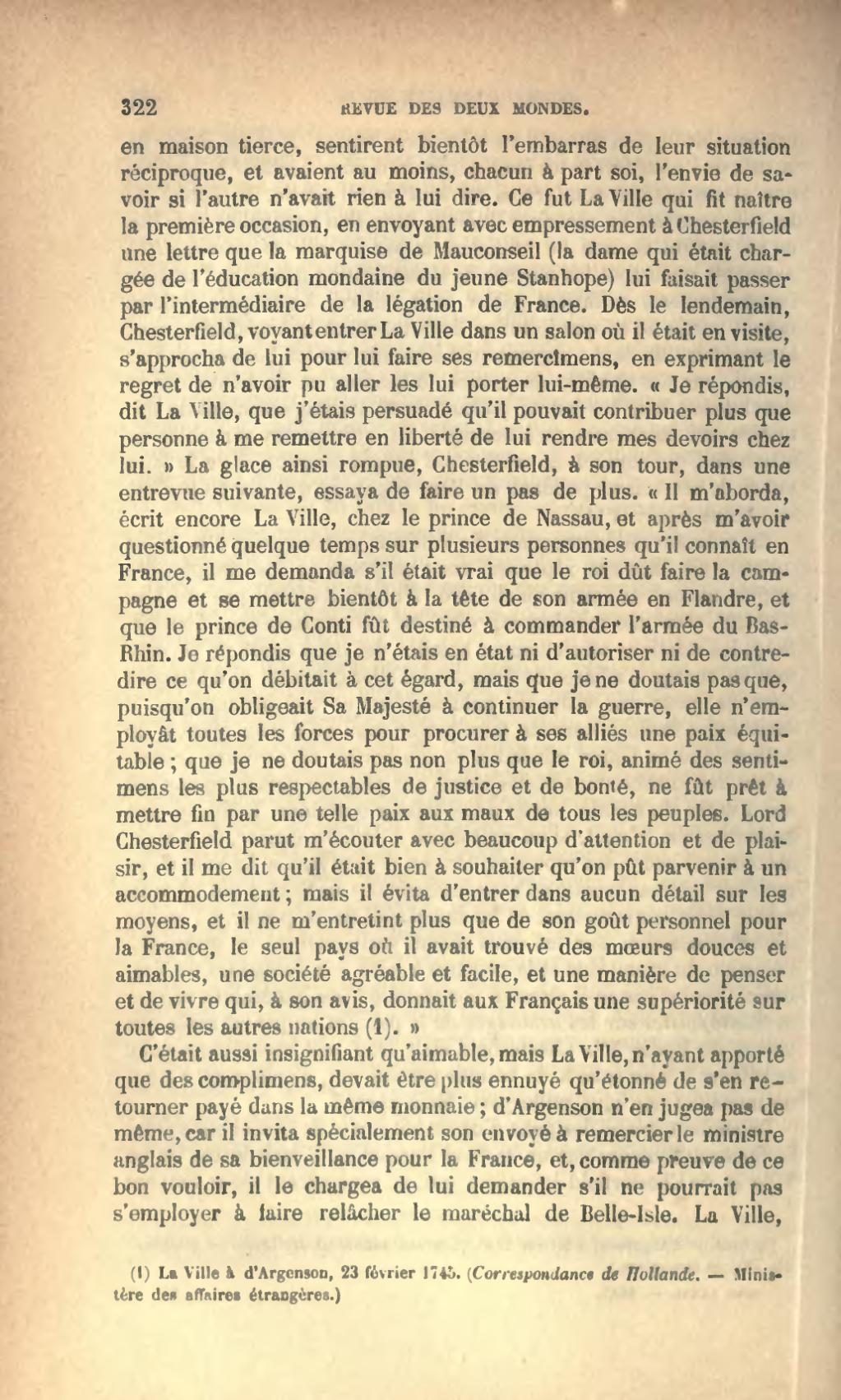en maison tierce, sentirent bientôt l’embarras de leur situation réciproque, et avaient au moins, chacun à part soi, l’envie de savoir si l’autre n’avait rien à lui dire. Ce fut La Ville qui fit naître la première occasion, en envoyant avec empressement à Chesterfield une lettre que la marquise de Mauconseil (la dame qui était chargée de l’éducation mondaine du jeune Stanhope) lui faisait passer par l’intermédiaire de la légation de France. Dès le lendemain, Chesterfield, voyant entrer La Ville dans un salon où il était en visite, s’approcha de lui pour lui faire ses remercîmens, en exprimant le regret de n’avoir pu aller les lui porter lui-même. « Je répondis, dit La Ville, que j’étais persuadé qu’il pouvait contribuer plus que personne à me remettre en liberté de lui rendre mes devoirs chez lui. » La glace ainsi rompue, Chesterfield, à son tour, dans une entrevue suivante, essaya de faire un pas de plus. « Il m’aborda, écrit encore La Ville, chez le prince de Nassau, et après m’avoir questionné quelque temps sur plusieurs personnes qu’il connaît en France, il me demanda s’il était vrai que le roi dût faire la campagne et se mettre bientôt à la tête de son armée en Flandre, et que le prince de Conti fût destiné à commander l’armée du Bas-Rhin. Je répondis que je n’étais en état ni d’autoriser ni de contre-dire ce qu’on débitait à cet égard, mais que je ne doutais pas que, puisqu’on obligeait Sa Majesté à continuer la guerre, elle n’employât toutes les forces pour procurer à ses alliés une paix équitable ; que je ne doutais pas non plus que le roi, animé des sentimens les plus respectables de justice et de bonté, ne fût prêt à mettre fin par une telle paix aux maux de tous les peuples. Lord Chesterfield parut m’ écouter avec beaucoup d’attention et de plaisir, et il me dit qu’il était bien à souhaiter qu’on pût parvenir à un accommodement ; mais il évita d’entrer dans aucun détail sur les moyens, et il ne m’entretint plus que de son goût personnel pour la France, le seul pays où il avait trouvé des mœurs douces et aimables, une société agréable et facile, et une manière de penser et de vivre qui, à son avis, donnait aux Français une supériorité sur toutes les autres nations[1]. »
C’était aussi insignifiant qu’aimable, mais La Ville, n’ayant apporté que des complimens, devait être plus ennuyé qu’étonné de s’en retourner payé dans la même monnaie ; d’Argenson n’en jugea pas de même, car il invita spécialement son envoyé à remercier le ministre anglais de sa bienveillance pour la France, et, comme preuve de ce bon vouloir, il le chargea de lui demander s’il ne pourrait pas s’employer à faire relâcher le maréchal de Belle-Isle. La Ville,
- ↑ La Ville à d’Argenson, 23 février 1745. (Correspondance de Hollande. — Ministère des affaires étrangères.)