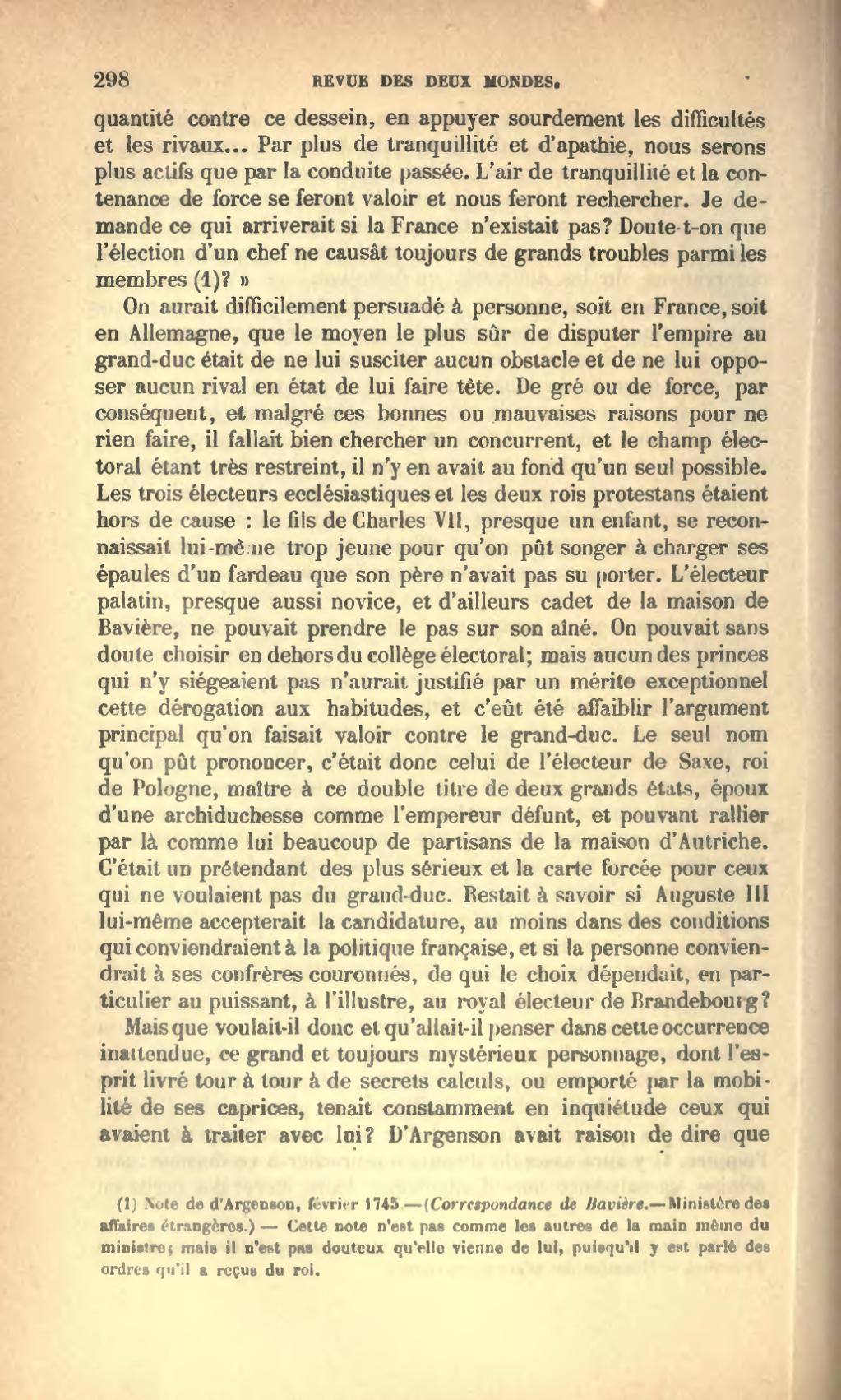quantité contre ce dessein, en appuyer sourdement les difficultés et les rivaux… Par plus de tranquillité et d’apathie, nous serons plus actifs que par la conduite passée. L’air de tranquillité et la contenance de force se feront valoir et nous feront rechercher. Je demande ce qui arriverait si la France n’existait pas ? Doute-t-on que l’élection d’un chef ne causât toujours de grands troubles parmi les membres[1] ? »
On aurait difficilement persuadé à personne, soit en France, soit en Allemagne, que le moyen le plus sûr de disputer l’empire au grand-duc était de ne lui susciter aucun obstacle et de ne lui opposer aucun rival en état de lui faire tête. De gré ou de force, par conséquent, et malgré ces bonnes ou mauvaises raisons pour ne rien faire, il fallait bien chercher un concurrent, et le champ électoral étant très restreint, il n’y en avait au fond qu’un seul possible. Les trois électeurs ecclésiastiques et les deux rois protestans étaient hors de cause : le fils de Charles VII, presque un enfant, se reconnaissait lui-même trop jeune pour qu’on pût songer à charger ses épaules d’un fardeau que son père n’avait pas su porter. L’électeur palatin, presque aussi novice, et d’ailleurs cadet de la maison de Bavière, ne pouvait prendre le pas sur son aîné. On pouvait sans doute choisir en dehors du collège électoral ; mais aucun des princes qui n’y siégeaient pas n’aurait justifié par un mérite exceptionnel cette dérogation aux habitudes, et c’eût été affaiblir l’argument principal qu’on faisait valoir contre le grand-duc. Le seul nom qu’on pût prononcer, c’était donc celui de l’électeur de Saxe, roi de Pologne, maître à ce double titre de deux grands états, époux d’une archiduchesse comme l’empereur défunt, et pouvant rallier par là comme lui beaucoup de partisans de la maison d’Autriche. C’était un prétendant des plus sérieux et la carte forcée pour ceux qui ne voulaient pas du grand-duc. Restait à savoir si Auguste III lui-même accepterait la candidature, au moins dans des conditions qui conviendraient à la politique française, et si la personne conviendrait à ses confrères couronnés, de qui le choix dépendait, en particulier au puissant, à l’illustre, au royal électeur de Brandebourg ?
Mais que voulait-il donc et qu’allait-il penser dans cette occurrence inattendue, ce grand et toujours mystérieux personnage, dont l’esprit livré tour à tour à de secrets calculs, ou emporté par la mobilité de ses caprices, tenait constamment en inquiétude ceux qui avaient à traiter avec lui ? D’Argenson avait raison de dire que
- ↑ Note de d’Argenson, février 1745. — (Correspondance de Bavière. — Ministère des affaires étrangères.) — Cette note n’est pas comme les autres de la main même du ministre : mais il n’est pas douteux qu’elle vienne de lui, puisqu’il y est parlé des ordres qu’il a reçus du roi.