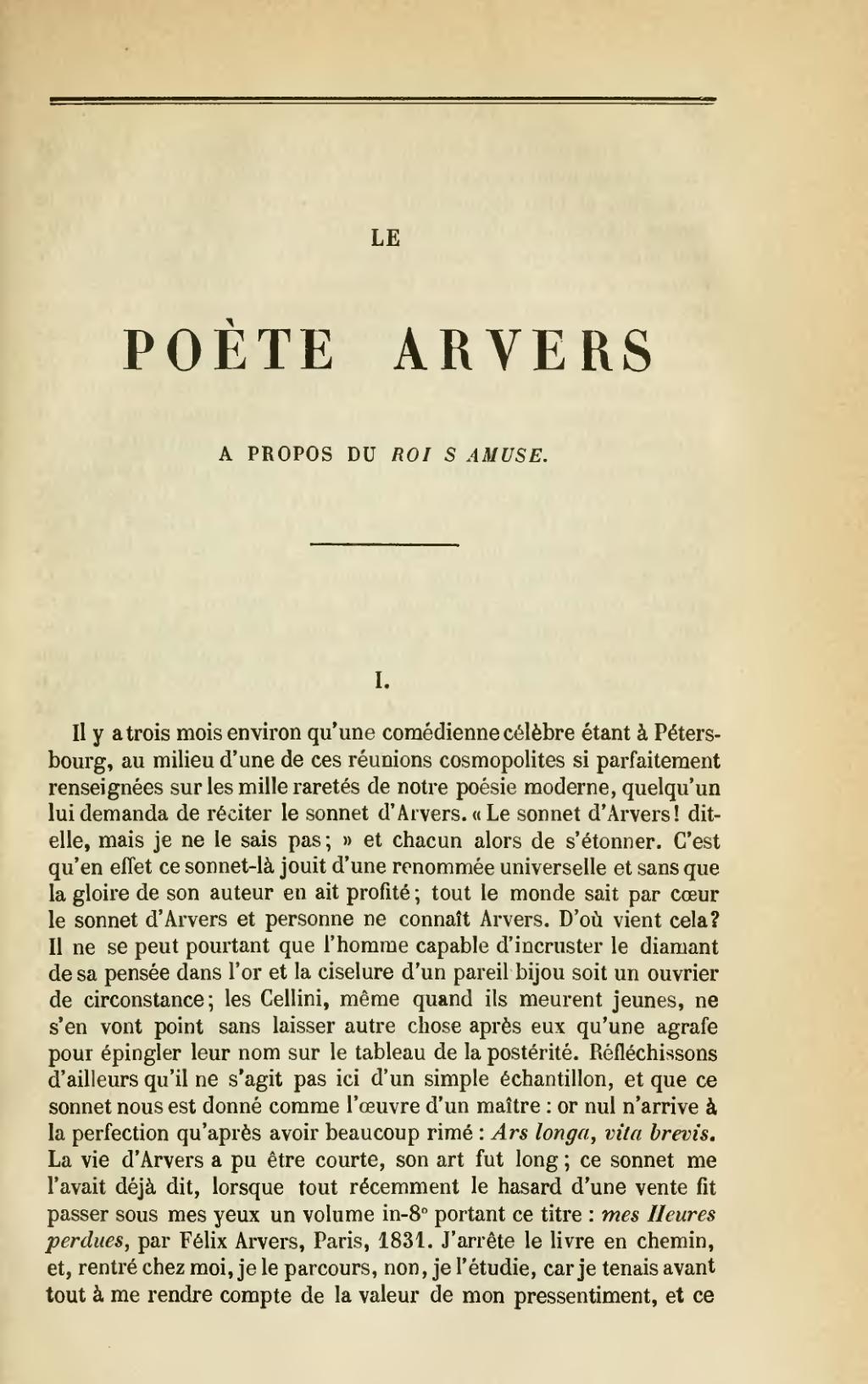Il y a trois mois environ qu’une comédienne célèbre étant à Pétersbourg, au milieu d’une de ces réunions cosmopolites si parfaitement renseignées sur les mille raretés de notre poésie moderne, quelqu’un lui demanda de réciter le sonnet d’Arvers. « Le sonnet d’Arvers ! dit-elle, mais je ne le sais pas ; » et chacun alors de s’étonner. C’est qu’en effet ce sonnet-là jouit d’une renommée universelle et sans que la gloire de son auteur en ait profité ; tout le monde sait par cœur le sonnet d’Arvers et personne ne connaît Arvers. D’où vient cela ? Il ne se peut pourtant que l’homme capable d’incruster le diamant de sa pensée dans l’or et la ciselure d’un pareil bijou soit un ouvrier de circonstance ; les Cellini, même quand ils meurent jeunes, ne s’en vont point sans laisser autre chose après eux qu’une agrafe pour épingler leur nom sur le tableau de la postérité. Réfléchissons d’ailleurs qu’il ne s’agit pas ici d’un simple échantillon, et que ce sonnet nous est donné comme l’œuvre d’un maître : or nul n’arrive à la perfection qu’après avoir beaucoup rimé : Ars longa, vita brevis. La vie d’Arvers a pu être courte, son art fut long ; ce sonnet me l’avait déjà dit, lorsque tout récemment le hasard d’une vente fit passer sous, mes yeux un volume in-8o portant ce titre : mes Heures perdues, par Félix Arvers, Paris, 1831. J’arrête le livre en chemin, et, rentré chez moi, je le parcours, non, je l’étudie, car je tenais avant tout à me rendre compte de la valeur de mon pressentiment, et ce