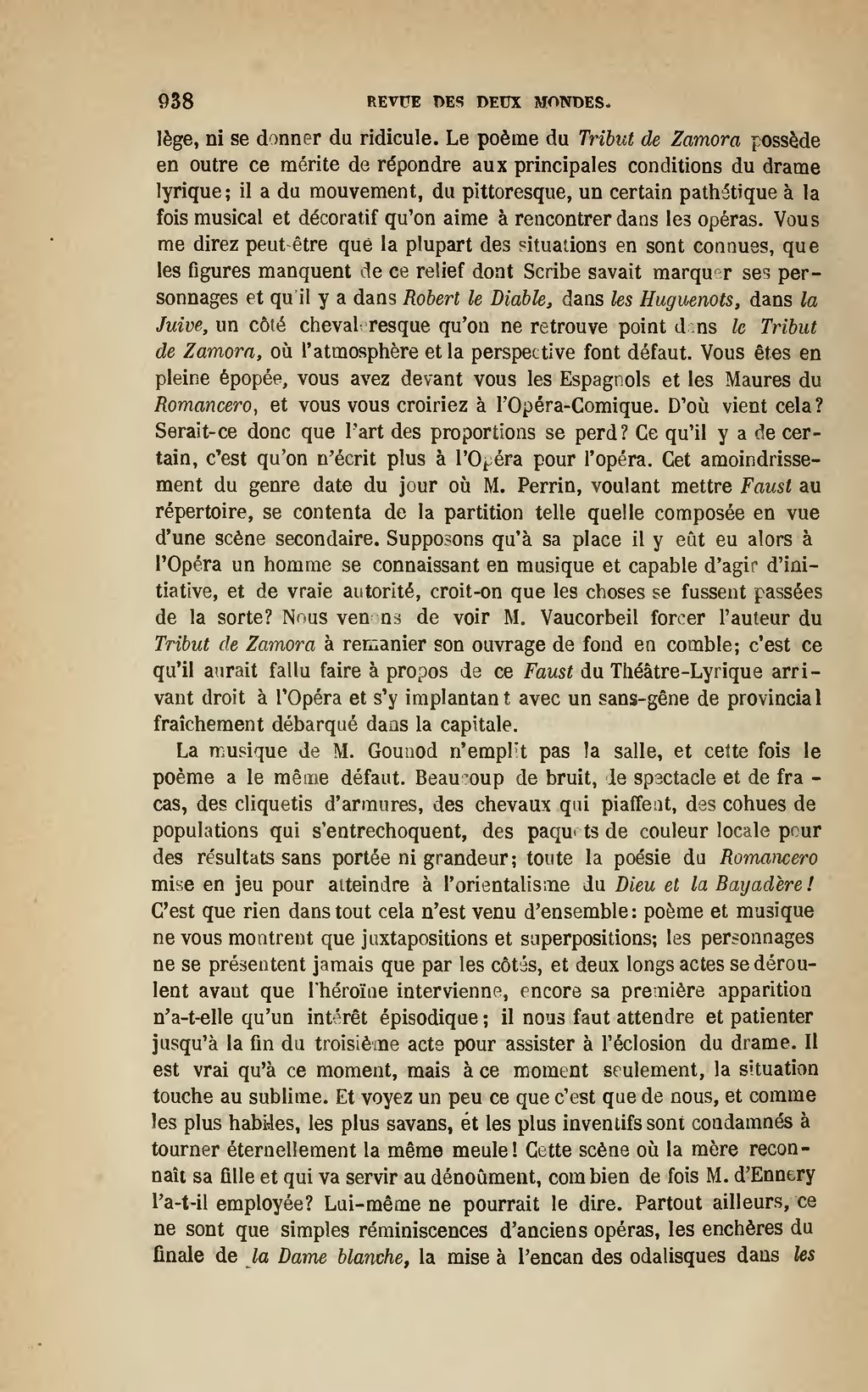ni se donner du ridicule. Le poème du Tribut de Zamora possède en outre ce mérite de répondre aux principales conditions du drame lyrique; il a du mouvement, du pittoresque, un certain pathétique à la fois musical et décoratif qu’on aime à rencontrer dans les opéras. Vous me direz peut-être que la plupart des situations en sont connues, que les figures manquent de ce relief dont Scribe savait marquer ses personnages et qu’il y a dans Robert le Diable, dans les Huguenots, dans la Juive, un côté chevaleresque qu’on ne retrouve point dans le Tribut de Zamora, où l’atmosphère et la perspective font défaut. Vous êtes en pleine épopée, vous avez devant vous les Espagnols et les Maures du Romancero, et vous vous croiriez à l’Opéra-Comique. D’où vient cela? Serait-ce donc que l’art des proportions se perd? Ce qu’il y a de certain, c’est qu’on n’écrit plus à l’Opéra pour l’opéra. Cet amoindrissement du genre date du jour où M. Perrin, voulant mettre Faust au répertoire, se contenta de la partition telle quelle composée en vue d’une scène secondaire. Supposons qu’à sa place il y eût eu alors à l’Opéra un homme se connaissant en musique et capable d’agir d’initiative, et de vraie autorité, croit-on que les choses se fussent passées de la sorte? Nous venons de voir M. Vaucorbeil forcer l’auteur du Tribut de Zamora à remanier son ouvrage de fond en comble; c’est ce qu’il aurait fallu faire à propos de ce Faust du Théâtre-Lyrique arrivant droit à l’Opéra et s’y implantant avec un sans-gêne de provincial fraîchement débarqué dans la capitale.
La musique de M. Gounod n’emplit pas la salle, et cette fois le poème a le même défaut. Beaucoup de bruit, de spectacle et de fracas, des cliquetis d’armures, des chevaux qui piaffent, des cohues de populations qui s’entrechoquent, des paquets de couleur locale pour des résultats sans portée ni grandeur; toute la poésie du Romancero mise en jeu pour atteindre à l’orientalisme du Dieu et la Bayadère ! C’est que rien dans tout cela n’est venu d’ensemble: poème et musique ne vous montrent que juxtapositions et superpositions; les personnages ne se présentent jamais que par les côtés, et deux longs actes se déroulent avant que l’héroïne intervienne, encore sa première apparition n’a-t-elle qu’un intérêt épisodique ; il nous faut attendre et patienter jusqu’à la fin du troisième acte pour assister à l’éclosion du drame. Il est vrai qu’à ce moment, mais à ce moment seulement, la situation touche au sublime. Et voyez un peu ce que c’est que de nous, et comme les plus habilles, les plus savans, et les plus inventifs sont condamnés à tourner éternellement la même meule! Cette scène où la mère reconnaît sa fille et qui va servir au dénoûment, combien de fois M. d’Ennery l’a-t-il employée? Lui-même ne pourrait le dire. Partout ailleurs, ce ne sont que simples réminiscences d’anciens opéras, les enchères du finale de la Dame blanche, la mise à l’encan des odalisques dans les