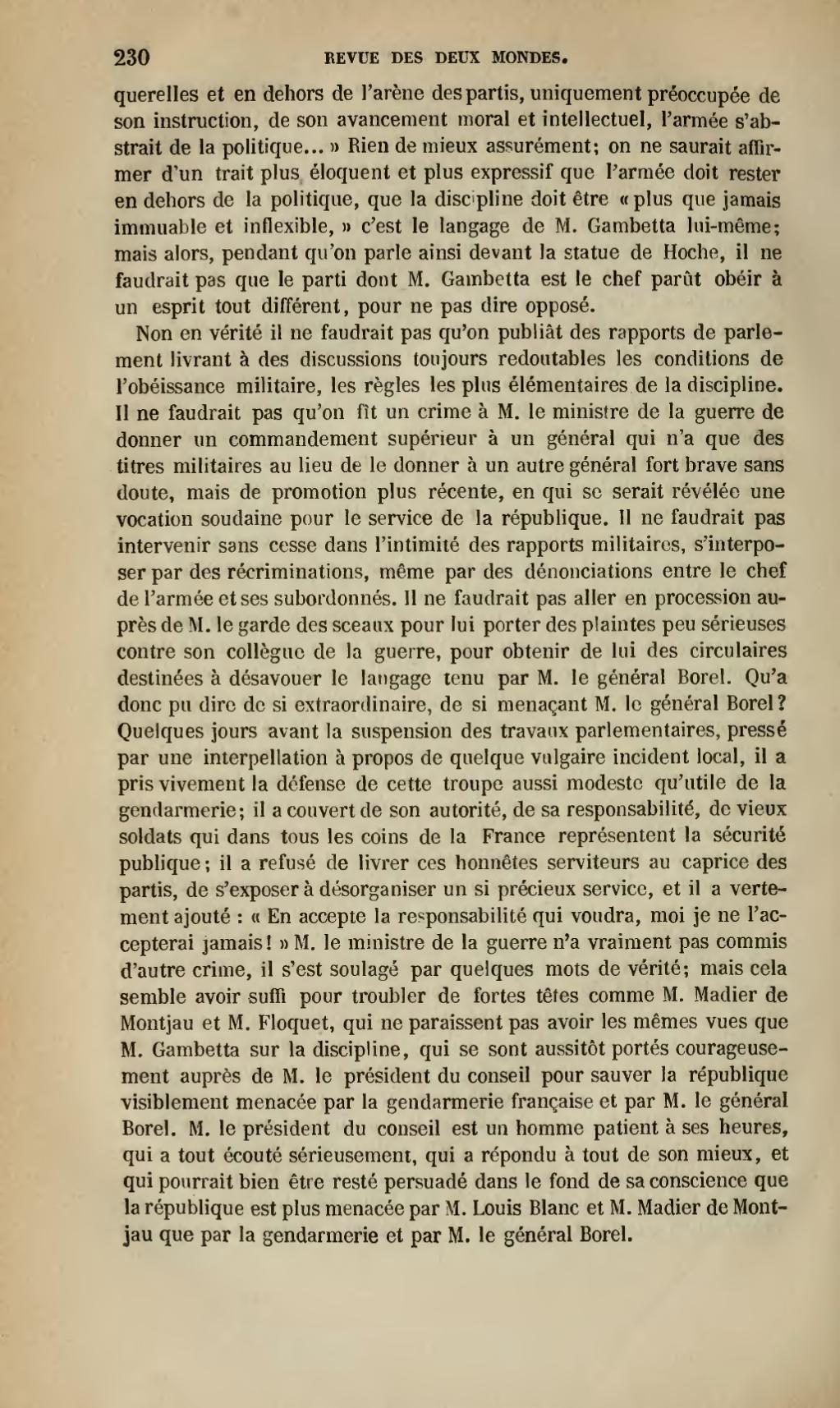querelles et en dehors de l’arène des partis, uniquement préoccupée de son instruction, de son avancement moral et intellectuel, l’armée s’abstrait de la politique… » Rien de mieux assurément ; on ne saurait affirmer d’un trait plus éloquent et plus expressif que l’armée doit rester en dehors de la politique, que la discipline doit être a plus que jamais immuable et inflexible, » c’est le langage de M. Gambetta lui-même ; mais alors, pendant qu’on parle ainsi devant la statue de Hoche, il ne faudrait pas que le parti dont M. Gambetta est le chef parût obéir à un esprit tout différent, pour ne pas dire opposé.
Non en vérité il ne faudrait pas qu’on publiât des rapports de parlement livrant à des discussions toujours redoutables les conditions de l’obéissance militaire, les règles les plus élémentaires de la discipline. Il ne faudrait pas qu’on fit un crime à M. le ministre de la guerre de donner un commandement supérieur à un général qui n’a que des titres militaires au lieu de le donner à un autre général fort brave sans doute, mais de promotion plus récente, en qui se serait révélée une vocation soudaine pour le service de la république. Il ne faudrait pas intervenir sans cesse dans l’intimité des rapports militaires, s’interposer par des récriminations, même par des dénonciations entre le chef de l’armée et ses subordonnés. Il ne faudrait pas aller en procession auprès de M. le garde des sceaux pour lui porter des plaintes peu sérieuses contre son collègue de la guerre, pour obtenir de lui des circulaires destinées à désavouer le langage tenu par M. le général Borel. Qu’a donc pu dire de si extraordinaire, de si menaçant M. le général Borel ? Quelques jours avant la suspension des travaux parlementaires, pressé par une interpellation à propos de quelque vulgaire incident local, il a pria vivement la défense de cette troupe aussi modeste qu’utile de la gendarmerie ; il a couvert de son autorité, de sa responsabilité, de vieux soldats qui dans tous les coins de la France représentent la sécurité publique ; il a refusé de livrer ces honnêtes serviteurs au caprice des partis, de s’exposer à désorganiser un si précieux service, et il a vertement ajouté : « En accepte la responsabilité qui voudra, moi je ne l’accepterai jamais ! » M. le ministre de la guerre n’a vraiment pas commis d’autre crime, il s’est soulagé par quelques mots de vérité ; mais cela semble avoir suffi pour troubler de fortes têtes comme M. Madier de Montjau et M. Floquet, qui ne paraissent pas avoir les mêmes vues que M. Gambetta sur la discipline, qui se sont aussitôt portés courageusement auprès de M. le président du conseil pour sauver la république visiblement menacée par la gendarmerie française et par M. le général Borel. M. le président du conseil est un homme patient à ses heures, qui a tout écouté sérieusement, qui a répondu à tout de son mieux, et qui pourrait bien être resté persuadé dans le fond de sa conscience que la république est plus menacée par M. Louis Blanc et M. Madier de Montjau que par la gendarmerie et par M. le général Borel.