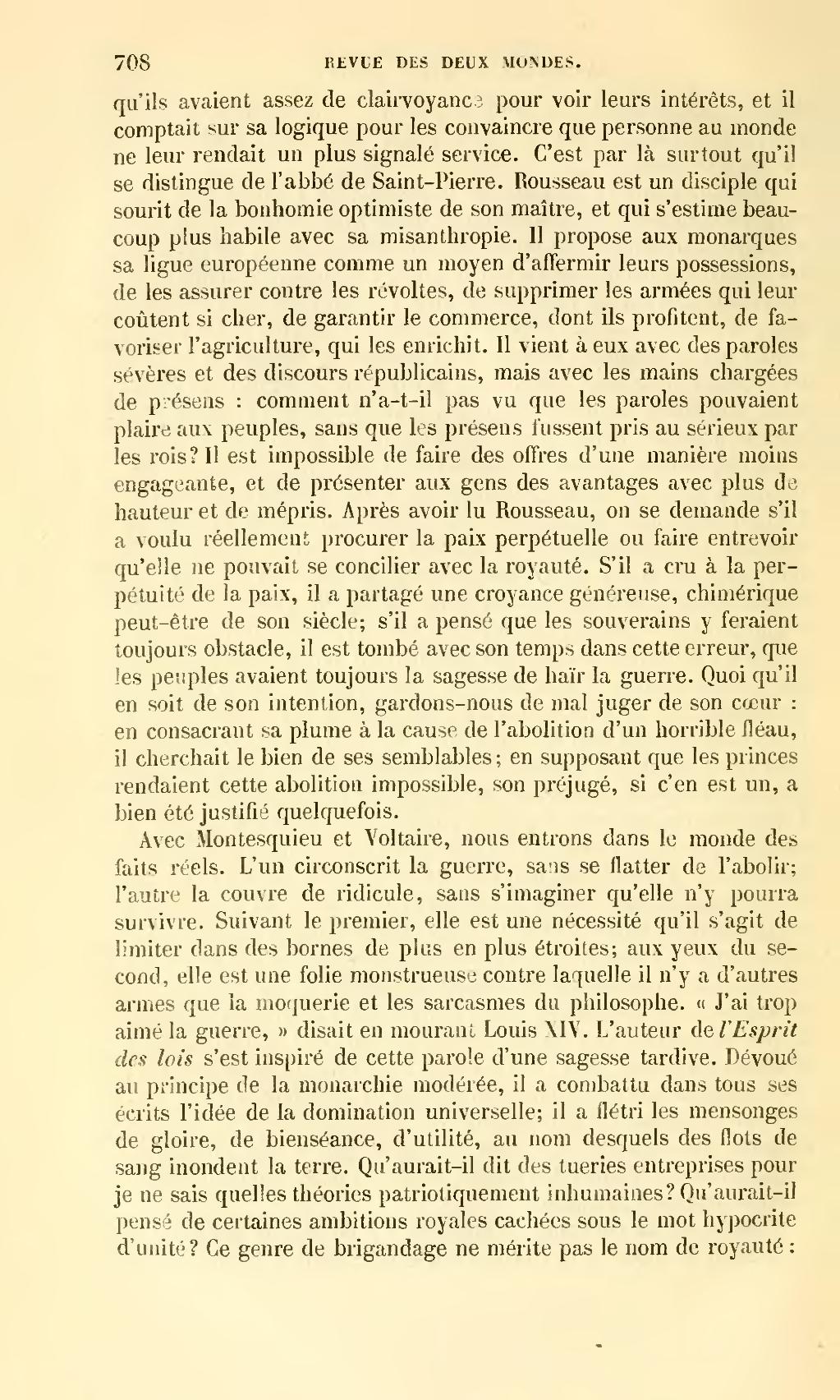qu’ils avaient assez de clairvoyance pour voir leurs intérêts, et il comptait sur sa logique pour les convaincre que personne au monde ne leur rendait un plus signalé service. C’est par là surtout qu’il se distingue de l’abbé de Saint-Pierre. Rousseau est un disciple qui sourit de la bonhomie optimiste de son maître, et qui s’estime beaucoup plus habile avec sa misanthropie. Il propose aux monarques sa ligue européenne comme un moyen d’affermir leurs possessions, de les assurer contre les révoltes, de supprimer les armées qui leur coûtent si cher, de garantir le commerce, dont ils profitent, de favoriser l’agriculture, qui les enrichit. Il vient à eux avec des paroles sévères et des discours républicains, mais avec les mains chargées de présens : comment n’a-t-il pas vu que les paroles pouvaient plaire aux peuples, sans que les présens fussent pris au sérieux par les rois ? Il est impossible de faire des offres d’une manière moins engageante, et de présenter aux gens des avantages avec plus de hauteur et de mépris. Après avoir lu Rousseau, on se demande s’il a voulu réellement procurer la paix perpétuelle ou faire entrevoir qu’elle ne pouvait se concilier avec la royauté. S’il a cru à la perpétuité de la paix, il a partagé une croyance généreuse, chimérique peut-être de son siècle ; s’il a pensé que les souverains y feraient toujours obstacle, il est tombé avec son temps dans cette erreur, que les peuples avaient toujours la sagesse de haïr la guerre. Quoi qu’il en soit de son intention, gardons-nous de mal juger de son cœur : en consacrant sa plume à la cause de l’abolition d’un horrible fléau, il cherchait le bien de ses semblables ; en supposant que les princes rendaient cette abolition impossible, son préjugé, si c’en est un, a bien été justifié quelquefois.
Avec Montesquieu et Voltaire, nous entrons dans le monde des faits réels. L’un circonscrit la guerre, sans se flatter de l’abolir ; l’autre la couvre de ridicule, sans s’imaginer qu’elle n’y pourra survivre. Suivant le premier, elle est une nécessité qu’il s’agit de limiter dans des bornes de plus en plus étroites ; aux yeux du second, elle est une folie monstrueuse contre laquelle il n’y a d’autres armes que la moquerie et les sarcasmes du philosophe. « J’ai trop aimé la guerre, » disait en mourant Louis XIV. L’auteur de l’Esprit des lois s’est inspiré de cette parole d’une sagesse tardive. Dévoué au principe de la monarchie modérée, il a combattu dans tous ses écrits l’idée de la domination universelle ; il a flétri les mensonges de gloire, de bienséance, d’utilité, au nom desquels des flots de sang inondent la terre. Qu’aurait-il dit des tueries entreprises pour je ne sais quelles théories patriotiquement inhumaines ? Qu’aurait-il pensé de certaines ambitions royales cachées sous le mot hypocrite d’unité ? Ce genre de brigandage ne mérite pas le nom de royauté :