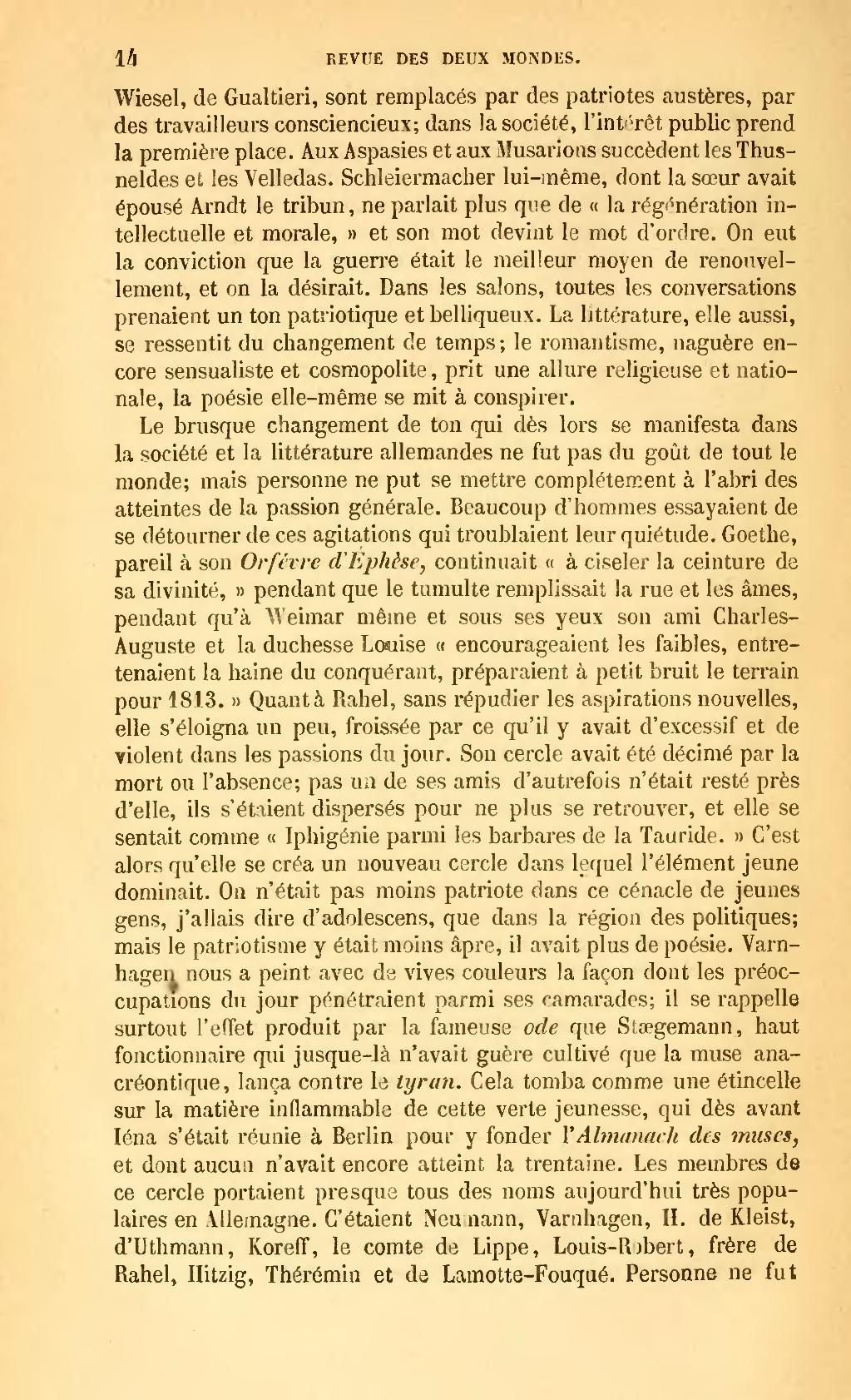Wiesel, de Gualtieri, sont remplacés par des patriotes austères, par des travailleurs consciencieux ; dans la société, l’intérêt public prend la première place. Aux Aspasies et aux Musarions succèdent les Thusneldes et les Velledas. Schleiermacher lui-même, dont la sœur avait épousé Arndt le tribun, ne parlait plus que de « la régénération intellectuelle et morale, » et son mot devint le mot d’ordre. On eut la conviction que la guerre était le meilleur moyen de renouvellement, et on la désirait. Dans les salons, toutes les conversations prenaient un ton patriotique et belliqueux. La littérature, elle aussi, se ressentit du changement de temps ; le romantisme, naguère encore sensualiste et cosmopolite, prit une allure religieuse et nationale, la poésie elle-même se mit à conspirer.
Le brusque changement de ton qui dès lors se manifesta dans la société et la littérature allemandes ne fut pas du goût de tout le monde ; mais personne ne put se mettre complètement à l’abri des atteintes de la passion générale. Beaucoup d’hommes essayaient de se détourner de ces agitations qui troublaient leur quiétude. Goethe, pareil à son Orfèvre d’Ephèse, continuait « à ciseler la ceinture de sa divinité, » pendant que le tumulte remplissait la rue et les âmes, pendant qu’à Weimar même et sous ses yeux son ami Charles-Auguste et la duchesse Louise « encourageaient les faibles, entretenaient la haine du conquérant, préparaient à petit bruit le terrain pour 1813. » Quant à Rahel, sans répudier les aspirations nouvelles, elle s’éloigna un peu, froissée par ce qu’il y avait d’excessif et de violent dans les passions du jour. Son cercle avait été décimé par la mort ou l’absence ; pas un de ses amis d’autrefois n’était resté près d’elle, ils s’étaient dispersés pour ne plus se retrouver, et elle se sentait comme « Iphigénie parmi les barbares de la Tauride. » C’est alors qu’elle se créa un nouveau cercle dans lequel l’élément jeune dominait. On n’était pas moins patriote dans ce cénacle de jeunes gens, j’allais dire d’adolescens, que dans la région des politiques, mais le patriotisme y était moins âpre, il avait plus de poésie. Varnhagen nous a peint avec de vives couleurs la façon dont les préoccupations du jour pénétraient parmi ses camarades ; il se rappelle surtout l’effet produit par la fameuse ode que Stægemann, haut fonctionnaire qui jusque-là n’avait guère cultivé que la muse anacréontique, lança contre le tyran. Cela tomba comme une étincelle ; sur la matière inflammable de cette verte jeunesse, qui dès avant Iéna s’était réunie à Berlin pour y fonder l’Almanach des muses et dont aucun n’avait encore atteint la trentaine. Les membres de ce cercle portaient presque tous des noms aujourd’hui très populaires en Allemagne. C’étaient Neumann, Varnhagen, H. de Kleist, d’Uthmann, Koreff, le comte de Lippe, Louis-Robert, frère de Rahel, Hitzig, Thérémin et de Lamotte-Fouqué. Personne ne fut