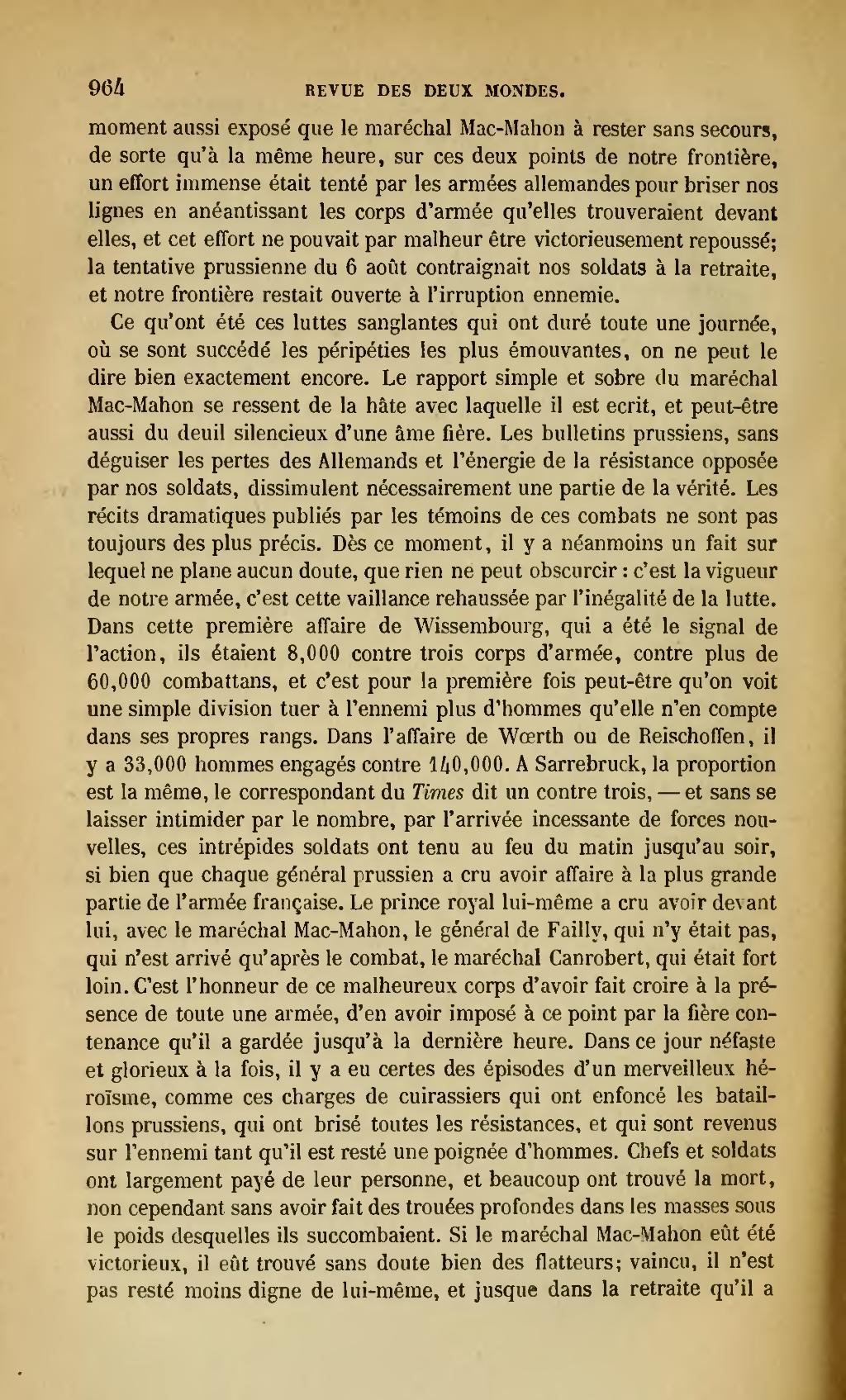moment aussi exposé que le maréchal Mac-Mahon à rester sans secours, de sorte qu’à la même heure, sur ces deux points de notre frontière, un effort immense était tenté par les armées allemandes pour briser nos lignes en anéantissant les corps d’armée qu’elles trouveraient devant elles, et cet effort ne pouvait par malheur être victorieusement repoussé ; la tentative prussienne du 6 août contraignait nos soldats à la retraite, et notre frontière restait ouverte à l’irruption ennemie.
Ce qu’ont été ces luttes sanglantes qui ont duré toute une journée, où se sont succédé les péripéties les plus émouvantes, on ne peut le dire bien exactement encore. Le rapport simple et sobre du maréchal Mac-Mahon se ressent de la hâte avec laquelle il est écrit, et peut-être aussi du deuil silencieux d’une âme fière. Les bulletins prussiens, sans déguiser les pertes des Allemands et l’énergie de la résistance opposée par nos soldats, dissimulent nécessairement une partie de la vérité. Les récits dramatiques publiés par les témoins de ces combats ne sont pas toujours des plus précis. Dès ce moment, il y a néanmoins un fait sur lequel ne plane aucun doute, que rien ne peut obscurcir : c’est la vigueur de notre armée, c’est cette vaillance rehaussée par l’inégalité de la lutte. Dans cette première affaire de Wissembourg, qui a été le signal de l’action, ils étaient 8,000 contre trois corps d’armée, contre plus de 60,000 combattans, et c’est pour la première fois peut-être qu’on voit une simple division tuer à l’ennemi plus d’hommes qu’elle n’en compte dans ses propres rangs. Dans l’affaire de Wœrth ou de Reischoffen, il y a 33,000 hommes engagés contre 140,000. À Sarrebruck, la proportion est la même, le correspondant du Times dit un contre trois, — et sans se laisser intimider par le nombre, par l’arrivée incessante de forces nouvelles, ces intrépides soldats ont tenu au feu du matin jusqu’au soir, si bien que chaque général prussien a cru avoir affaire à la plus grande partie de l’armée française. Le prince royal lui-même a cru avoir devant lui, avec le maréchal Mac-Mahon, le général de Failly, qui n’y était pas, qui n’est arrivé qu’après le combat, le maréchal Canrobert, qui était fort loin. C’est l’honneur de ce malheureux corps d’avoir fait croire à la présence de toute une armée, d’en avoir imposé à ce point par la fière contenance qu’il a gardée jusqu’à la dernière heure. Dans ce jour néfaste et glorieux à la fois, il y a eu certes des épisodes d’un merveilleux héroïsme, comme ces charges de cuirassiers qui ont enfoncé les bataillons prussiens, qui ont brisé toutes les résistances, et qui sont revenus sur l’ennemi tant qu’il est resté une poignée d’hommes. Chefs et soldats ont largement payé de leur personne, et beaucoup ont trouvé la mort, non cependant sans avoir fait des trouées profondes dans les masses sous le poids desquelles ils succombaient. Si le maréchal Mac-Mahon eût été victorieux, il eût trouvé sans doute bien des flatteurs ; vaincu, il n’est pas resté moins digne de lui-même, et jusque dans la retraite qu’il a